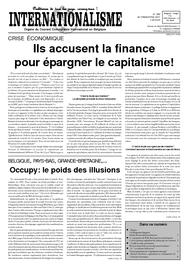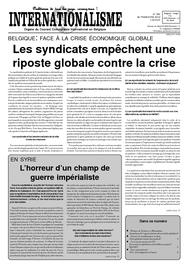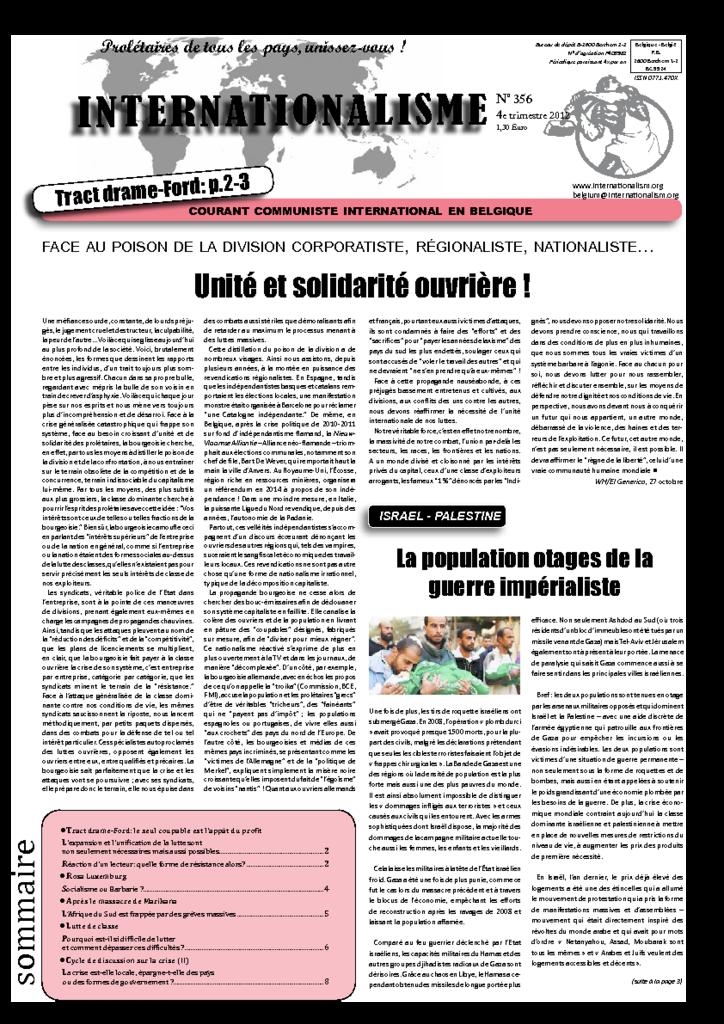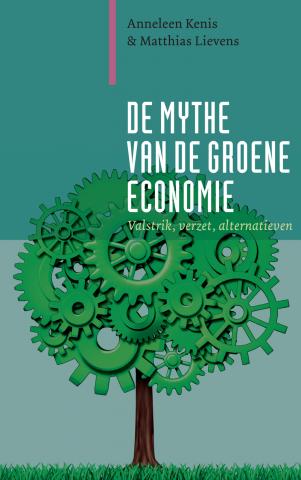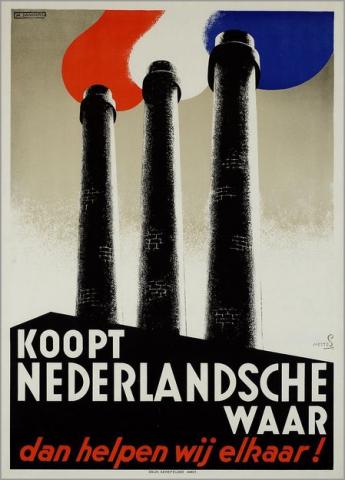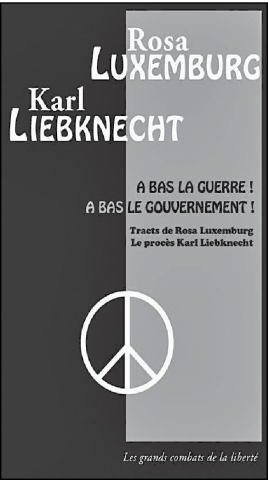Internationalisme - les années 2010
- 2580 lectures
Structure du Site:
Internationalisme - 2010
- 1768 lectures
Internationalisme no. 345
- 1536 lectures
Sommet de Copenhague: pour sauver la planète, il faut détruire le capitalisme!
“A Copenhague, la douche froide” [1], “Le pire accord de l’histoire” [2], “Copenhague s’achève sur un échec” [3], “Déception à Copenhague” [4]…, la presse est unanime, ce sommet annoncé comme “historique” a été un véritable fiasco !
Il n’y avait rien à attendre de ce sommet
Durant plusieurs semaines, les médias et les politiques ont enchaîné les déclarations grandiloquentes qui toutes affirmaient en substance : “l’avenir de l’humanité et de la planète se joue à Copenhague”. La fondation Nicolas Hulot avait ainsi lancé un ultimatum : “l’avenir de la planète et avec lui, le sort d’un milliard d’affamés […] se jouera à Copenhague. Choisir la solidarité ou subir le chaos, l’humanité a rendez-vous avec elle-même”. Il y avait ici une moitié de vérité. Les documentaires télévisés, les films (comme Home de Yann Arthus Bertrand), les résultats des recherches scientifiques montrent que la planète est en train d’être ravagée. Le réchauffement climatique s’aggrave et, avec lui, la désertification, les incendies, les cyclones… La pollution et l’exploitation intensive des ressources entraînent la disparition massive d’espèces. 15 à 37 % de la biodiversité devrait disparaître d’ici à 2050. Aujourd’hui, un mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, un tiers des amphibiens et 70 % des plantes sont en danger d’extinction [5]. Selon le Forum humanitaire mondial, le “changement climatique” entraînerait la mort de 300 000 personnes par an (dont la moitié de malnutrition) ! En 2050, il devrait y avoir “250 millions de réfugiés climatiques” [6]. Alors, oui, il y a urgence. Oui, l’humanité est confrontée à un enjeu historique et vital !
Mais il n’y avait aucune illusion à se faire, rien de bon ne pouvait sortir de ce sommet de Copenhague où 193 États étaient représentés. Le capitalisme détruit l’environnement depuis toujours. Déjà, au xixe siècle, Londres était une immense usine crachant sa fumée et déversant ses déchets dans la Tamise. Ce système produit dans l’unique but de faire du profit et accumuler du capital, par tous les moyens. Peut importe si, pour ce faire, il doit raser des forêts, piller les océans, polluer les fleuves, dérégler le climat… Capitalisme et écologie sont forcément antagoniques.
Toutes les réunions internationales, les comités, les sommets (tel celui de Rio de Janeiro en 1992 ou celui de Kyoto en 1997) n’ont toujours été que des cache-sexes, des cérémonies théâtralisées pour faire croire que les “grands de ce monde” se soucient de l’avenir de la planète. Les Hulot, Yann Arthus Bertrand, et autres Al Gore ont voulu nous faire croire qu’il en serait cette fois-ci autrement, que face à l’urgence de la situation, les hauts-dirigeants allaient se “ressaisir”. Mieux, ils devaient même comprendre qu’il s’agissait là d’une opportunité historique de changer en profondeur le capitalisme, en s’orientant vers une green economy capable de sortir le monde de la récession par une croissance durable et écologique ! Pendant que tous ces idéologues brassaient de l’air, ces mêmes “hauts-dirigeants” affûtaient leurs armes éco… nomiques ! Car là est la réalité : le capitalisme est divisé en nations, toutes concurrentes les unes des autres, se livrant sans répit une guerre commerciale et, s’il le faut, parfois militaire. Un seul exemple : le pôle Nord est en train de fondre. Les scientifiques y voient une véritable catastrophe écologique. Les États y voient, eux, une opportunité d’exploiter des ressources jusqu’ici inaccessibles et d’ouvrir de nouvelles voies maritimes libérées des glaces. La Russie, le Canada, les États-Unis, le Danemark (via le Groenland) se livrent actuellement une guerre diplomatique sans pitié. Le Canada a même commencé à poster des armes à sa frontière dirigées dans cette direction ! Capitalisme et écologie sont bel et bien antagoniques.
Et ils voulaient nous faire croire que, dans ce contexte, les États-Unis et la Chine allaient accepter de “réduire leur émission de CO2”, c’est-à-dire limiter leur production ? D’ailleurs, cette notion de “limitation des émissions de CO2” est en elle-même révélatrice de ce qu’est le réchauffement climatique pour le capitalisme, une arme idéologique pour mener la concurrence. Chaque pays veut fixer les objectifs qui l’arrangent : les pays d’Afrique veulent des chiffres très bas, qui correspondent à leur production, pour mettre des bâtons dans les roues aux autres nations, les pays d’Amérique du Sud souhaitent des chiffres un peu plus élevés, et ainsi de suite pour l’Inde, les États européens, eux-mêmes divisés entre eux, la Chine, les Etats-Unis…
La bourgeoisie ne parvient même plus à sauver les apparences
Le seul élément peut-être surprenant de ce fiasco de Copenhague est que tous ces chefs d’État n’ont même pas réussi à sauver les apparences. D’habitude, un accord final signé en grande pompe fixe quelques vagues objectifs à atteindre un jour et tout le monde s’en félicite. Cette fois, il s’agit officiellement d’un “échec historique”. Les tensions et les marchandages sont sortis des coulisses et ont été portés au devant de la scène. Même la traditionnelle photo des chefs d’États s’auto-congratulant bras-dessus, bras-dessous, et affichant de larges sourires d’acteurs de cinéma, n’a pu être réalisée. C’est tout dire !
En fait, la récession ne contraint pas les chefs d’État à saisir la “formidable opportunité” d’une green economy mondiale mais ne peut au contraire qu’attiser les tensions et la concurrence internationale. Le sommet de Copenhague a fait la démonstration de la guerre acharnée que sont en train de se livrer les grandes puissances. Il n’est plus l’heure pour eux de faire semblant de bien s’entendre et de proclamer des accords (même bidons). Ils sortent les couteaux, tant pis pour la photo !
Jamais le capitalisme ne sera “vert”. Demain, la crise économique va frapper encore plus fort. Le sort de la planète sera alors le dernier des soucis de la bourgeoisie. Elle ne cherchera qu’une seule chose : soutenir son économie nationale, en s’affrontant toujours plus durement aux autres nations, en fermant les usines pas assez rentables, quitte à les laisser pourrir sur place, en réduisant les coûts de production, en coupant dans les budgets de la prévention l’entretien, ce qui signifiera aussi plus de pollution et d’accidents industriels. C’est exactement ce qui s’est déjà passé en Russie dans les années 1990, avec ses sous-marins nucléaires laissés à l’abandon et la Sibérie polluée au point d’en faire mourir une large proportion de ses habitants.
Enfin, une partie de plus en plus grande de l’humanité va se retrouver dans la misère, démunie, sans nourriture ni logement. Elle sera donc plus vulnérable encore aux effets du changement climatique, aux cyclones, à la désertification.
Il est temps de détruire le capitalisme avant qu’il ne détruise la planète et ne décime l’humanité !
Pawel (19 décembre)
1. Sur le site de Libération le 19 décembre.
2. Idem.
3. Sur le site du Figaro le 19 décembre.
4. Sur le site du Monde le 19 décembre.
5. https://www.planetoscope.com/biodiversite
6. www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-vers-30000-morts-an-chine-2-c-19468
"Capitalism : a love story", un aperçu
- 1755 lectures
Le nouveau film de Michael Moore, “Capitalism: Love Story” est sorti fin septembre, élevé au rang de polémique «anti-capitaliste». Le film contient quelques descriptions très émouvantes d'ouvriers confrontés à des saisies d'hypothèques et à des fermetures d'usines. Il y a des séquences sur l'occupation d'usine de Chicago en décembre dernier. Quand les ouvriers parlent, ils confirment ce que nous écrivions dans Internationalism à ce moment-là, que les ouvriers ne veulent pas perdre leurs emplois, qu'ils veulent se battre pour leurs emplois. C’était les syndicats et les politiciens qui soulignaient que les travailleurs devraient obtenir ce à quoi ils avaient «légalement» droit, qui se montait à 6000$ comme indemnités de congé et de licenciement.
L'évêque de Chicago est venu voir les ouvriers et leur a dit qu'il était lui-même fils de métallurgiste, et qu'il comprenait que leur lutte était juste. Il les a bénis et leur a donnés la communion. Beaucoup de séquences du film montrent d'autres ouvriers, venus individuellement ou en famille apporter de la nourriture aux travailleurs en lutte, en signe de solidarité.
On y voit également un groupe de 20 ou 30 personnes de la communauté de Miami déclarant nulle une expulsion et ramenant la famille expulsée dans sa maison. Un représentant de la banque arrive, leur dit qu'ils enfreignent la loi, et ensuite neuf véhicules de police arrivent. Il y a beaucoup de cris et de discussions, le banquier et les policiers finalement s'en vont et la famille reste dans la maison. (A la fin du film, dans le défilement du texte, nous lisons que la famille a été autorisée à rester définitivement dans sa maison).
Le film est bourré des singeries de Michael-Moore-au-centre-de-l'histoire. Ces singeries incluent Michael Moore essayant de rencontrer le président du conseil d'administration de GM, ou essayant de mettre le conseil entier d'AIG ou tout le monde à la bourse des valeurs de NY sous arrestation citoyenne, ou plaçant une bande jaune de scène de crime autour de la Bourse, ou conduisant un camion blindé jusqu'à la Banque d'Amérique et annonçant qu'il est là pour récupérer les 10 milliards de dollars de renflouement.
Le grand problème, c'est la politique de Moore. Son attaque du capitalisme est largement provocatrice, mais pas réelle. C'est comme s'il avait décidé de renverser toutes les accusations hystériques de la droite à propos du «socialisme» d'Obama. La crise dévastatrice globale de 2008 est attribuée aux politiques de dérégulation de Reagan commencées dans les années 1980 et poursuivies dans les années Bush I, Clinton et Bush II, et par la reprise de facto du gouvernement US par Goldman Sachs, qui a favorisé les politiques bénéfiques à sa compagnie, au détriment des contribuables et de ses concurrents. En d'autres termes, le réel problème ne serait pas une crise économique généralisée du capitalisme, mais plutôt la cupidité de quelques personnalités de l'élite politique et financière. C'est vrai, Moore dit que le capitalisme est mauvais, et interroge même trois ou quatre catholiques qui déclarent que Jésus aurait été contre le capitalisme, mais dans les faits, son opposition au capitalisme n'est qu'une opposition au capitalisme dérégulé. Il inclut des scènes de manifestations de quelques douzaines de personnes en provenance de groupes gauchistes comme « Answer Coalition » contre les renflouements d'entreprises ou les saisies, les décrivant comme le début d'un mouvement de masse anti-capitaliste aux USA.
Il semble dubitatif quant à l’appréciation d’Obama, qu'il voit comme quelqu'un qui, avec ses appels au changement, fait trembler ceux de Wall Street ayant répondu à sa campagne, précise t’il, par leur contribution. Il dénonce tous les conseillers économiques d'Obama comme partisans de Goldman Sachs, mais lui est encore amouraché d'Obama.
Dans la vision de Moore, l'alternative contre le capitalisme, c'est la démocratie. Il interroge le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, qui se prétend avocat du socialisme démocratique, défini comme le gouvernement au service des classes moyenne et ouvrière, pour protéger leurs droits. Moore a trouvé une scène perdue du discours de 1944 de Franklin Delano Roosevelt (FDR) sur l'état de l'Union un mois avant sa mort, dans lequel FDR appelait à une seconde déclaration sur les droits des Américains après la guerre, qui appelait non au socialisme ou à la destruction du capitalisme, mais à un capitalisme d'Etat du genre Etat-Providence:
-le droit à un travail utile et rémunérateur dans les industries, les magasins, les fermes ou les mines de la nation;
-le droit de gagner assez pour accéder à l'alimentation, à l'habillement et aux loisirs;
-le droit pour chaque fermier d'élever et de vendre sa production contre une rémunération qui lui permette de faire accéder sa famille à une vie décente;
-le droit pour chaque homme d'affaires, grand ou petit, de commercer dans une atmosphère de liberté, à l'abri de la concurrence déloyale et de la domination des monopoles, que ce soit sur le sol américain ou à l'étranger;
-le droit de chaque famille à un logement décent;
-le droit à des soins appropriés et la possibilité d'atteindre une bonne santé et d'en jouir;
-le droit à une protection efficace contre les craintes économiques de la vieillesse, de la maladie, de l'accident et du chômage;
-le droit à une bonne éducation.
Moore se lamente sur le fait que FDR est décédé avant d'avoir pu créer cette société merveilleuse aux USA, mais il dit que dans la période d'après-guerre, les USA ont envoyé des hommes de FDR en Europe et au Japon, où pendant la reconstruction de l'Italie, de l'Allemagne et du Japon, aussi bien que d'autres pays d'Europe, cette vision de la société a été mise en application. Exactement comme il l'avait fait dans Sicko, il idéalise le salaire social du capitalisme d'Etat européen comme un but glorieux pour les Américains. En aucun cas, l'anti-capitalisme de Moore ne pourrait détruire l'Etat capitaliste ou mettre en œuvre le contrôle de la classe ouvrière sur les moyens de production. Au lieu de cela, il transformerait l'Amérique en une sorte de France, Allemagne, Japon ou Norvège qui sont des sociétés capitalistes où la classe ouvrière doit lutter pour se défendre contre l'exploitation. Moore termine le film en appelant chacun à le rejoindre dans le combat pour cette société avec une version vulgarisée de l'Internationale, qui avait plus l'air de Bobby Darin chantant Mack the Knife que d'un chant révolutionnaire.
Jerry Grevin/20.09.09
En Belgique, chez Opel et chez AB InBev, le même combat, le même sabotage syndical
- 2063 lectures
Jeudi 21 janvier, deux infos sociales sont à la une des journaux: «Opel Anvers : coup de massue pour l’emploi. La direction de GM Europe a annoncé son intention de fermer Opel Anvers et de procéder au licenciement collectif des 2.600 personnes qui y travaillent. Quelque 5.000 emplois au total sont menacés.» (Le Soir, 21/01) et d’autre part «Un accord sauve AB InBev de la procédure Renault. Les médiateurs sociaux et la direction d’AB InBev sont finalement parvenus jeudi, après une troisième réunion de conciliation, à un cadre de négociation, mettant ainsi un terme à la procédure Renault, à la grande satisfaction des syndicats.»
Apparemment, voilà deux situations contradictoires: l’entreprise brassicole Anheuser-Busch InBev suspend à l’appel des syndicats la procédure de licenciements annoncés (près de 300 en Belgique et 800 en Europe sur les 8.000 employés) et assure le paiement menacé des travailleurs, alors que l’usine automobile Opel Anvers, elle, ferme! L’action syndicale aurait-elle été mieux menée à AB InBev qu’à Opel Anvers? Ou est-ce que le retrait des mesures chez AB InBev n’est qu’une tactique consciente de la bourgeoisie afin de ne pas accumuler au même moment des plans de restructurations risquant de développer une colère et une combativité des ouvriers dépassant l’emprise des syndicats? En réalité, les deux conflits constituent des indices complémentaires d’une même réalité sociale : autant pour la classe ouvrière, pour qui il est capital de saisir comment mener la lutte dans cette période de crise ouverte, que pour la bourgeoisie, qui veut veiller à ce que son bras droit, les syndicats, arme de maintien de l’ordre social reste le plus longtemps crédible au sein de la classe exploitée. Imposer l’application des mesures de restructurations à AB InBev en même temps que la fermeture d’Opel aurait fortement amoindri l’image et la confiance envers les syndicats qui dans les deux cas ont été à l’avant-plan des actions menées pour soi-disant «sauver» l’entreprise. La «victoire» syndicale chez AB inBev permet de contrebalancer l’idée d’une «défaite» syndicale chez Opel Anvers et renforce l’illusion que c’est derrière les syndicats que la classe ouvrière doit lutter. La manifestation nationale de 30.000 affiliés syndicaux à Bruxelles du 29 janvier 2010 pour la défense de l’emploi, organisée par les syndicats en front commun, n’avait d’autre but que d’enfoncer dans la tête des travailleurs que les syndicats sont les véritables défenseurs des intérêts de la classe ouvrière et que sans eux, rien n’est possible.
Les enjeux de la situation sociale
Les emplois d’AB InBev seront-ils maintenus? Rien n’est moins sûr! Tout fait penser que la suspension temporaire des mesures de licenciements s’applique à la règle: «reculer pour mieux sauter». Déjà, au début du conflit, cette idée de suspension du plan avait été émise par la direction: «..la direction …avait aussi proposé de suspendre temporairement le plan afin de pouvoir discuter de façon approfondie de sa raison d’être durant le week-end avec les syndicats…» ( Le Soir 15/01/10). Des illusions similaires sur une solution positive pour les travailleurs avaient été répandues chez Opel. La vente annoncée d’Opel par GM à un consortium d’entreprises, soutenu par divers gouvernements européens devait assurer un nouvel avenir à Opel Anvers et à ses travailleurs. On sait depuis ce qu’il est advenu de ce mirage!
Fondamentalement, AB InBev n’a pas d’autre choix que de répondre aux exigences des lois implacables du marché capitaliste: diminuer et rationaliser les frais de production au moyen de plans de restructuration pour faire face à la baisse de sa vente (en Belgique, sur les 9 premiers mois de 2009, les volumes vendus par AB InBev ont baissé de 1.7%) et pour faire front à la concurrence des autres grands producteurs de bière. Le lancement de la «procédure Renault» par InBev en dit déjà long sur l’avenir de l’usine. Cette loi, promulguée un an après le désastre social de la fermeture en février 1997 de l'usine Renault de Vilvorde, «doit rendre plus contraignante l'obligation de tenir un dialogue social consistant avant toute décision de licenciement collectif». Mais en réalité, «Dans la pratique, l'obligation de consultation sociale est plutôt formelle alors que tout est déjà ficelé… ", explique Pieter De Koster, avocat associé chez Allen & Overy…." (Mis en ligne le 20/11/2006 . Le Soir). Bref, tout comme à Opel Anvers, les dés sont jetés pour l’avenir d’AB InBev. A plus ou moins long terme, ce sont de nouvelles restructurations qui s’annonceront avec des licenciements à la clé. Et de nouveau, les syndicats seront sollicités pour étouffer dans l’œuf la colère et la combativité qui s’exprimeront dans les rangs ouvriers. De nouveau, de par leurs manœuvres, ils contribueront à asséner un nouveau coup de massue sur la tête des ouvriers, qui renforcera le découragement et la résignation comme le montrent les réactions des ouvriers d’Opel aujourd’hui.
Les mêmes tactiques syndicales chez Opel et à AB InBev
Des stratégies syndicales différentes? Quelle a été l’orientation de la politique syndicale lors de l’annonce de la faillite de GM?: «Quand GM est déclaré en faillite et qu’une restructuration drastique s’annonce pour Opel Europe, les syndicats prennent le devant de la lutte en déclarant vouloir lutter jusqu’au bout pour le maintien de l’usine. Leur action consiste en fait en du lobbying avec les patrons, la région flamande et l’Etat fédéral auprès de GM et l’Etat allemand pour démontrer que l’usine anversoise est «au moins aussi performante que ses concurrentes allemandes», pour faire respecter les «règles de la concurrence européenne». Ils n’hésitent pas à opposer la qualité de leur combat aux mouvements «incontrôlés» chez Ford l’année passée: «on est respectable et avec une vision à long terme», «en Belgique, on n’en est pas à séquestrer les patrons comme en France» écrivions-nous dans notre presse en novembre 2009 (Internationalisme n°344: «Faut-il soutenir les actions de protestations syndicales?»)
En quoi cette stratégie diffère-t-elle de celle menée par les syndicats à AB InBev? En rien, sinon que cette fois-ci, les syndicats ont bel et bien séquestré la direction locale de l’entreprise sur le site liégeois pendant quelques heures, à l’exemple cette fois-ci des tactiques de leurs confrères français. Tout comme à Opel, ils ont pris les devants pour appeler, main dans la main avec les gouvernements régionaux et l’Etat fédéral, au sens des responsabilités de l’entreprise, mettant en avant les critères de rentabilité performants du groupe brassicole mondial n°1 AB InBev : «le groupe se porte bien. Il fait des plantureux bénéfices. Et en plus, nos parts de marché sont en croissance en Belgique. Quelle est la nécessité de restructurer?», déclare Marc Sparmont, syndicaliste Setca (socialiste) (Le Soir.be 8/01/2010). Déclaration suivie quelques jours plus tard par celle de la ministre de l’emploi, Joelle Milquet, offusquée de voir cette entreprise «envisager de licencier aussi facilement un nombre de personnes alors qu’elle réalise des bénéfices… l’annonce des licenciements n’a pas du tout été faite pour des raisons liées à la crise mais bien pour diminuer le coût du travail») (Le Soir.be 15/01/2010) et renforcée par le discours du ministre wallon de l’Economie, Jean-Claude Marcourt (PS): «InBev remet le couvert et réduit l’emploi de 10% au niveau européen…la multinationale, elle, a gagné des parts de marché et ce, au plan local, grâce aux bonnes performances de Jupiler» (Le Soir.be 15/01/2010).
L’idée d’un capitalisme éthique qui s’opposerait au capitalisme prédateur est une dangereuse illusion visant à faire croire aux travailleurs qu’il existerait un capitalisme équitable. Or, le propre de toute entreprise capitaliste est de garantir son profit, d’accroître sa productivité en baissant les salaires, en augmentant la flexibilité, en fermant les divisions les moins rentables, en licenciant des travailleurs. Cette politique est pleinement soutenue par l’Etat et ses fractions politiques. En tentant de lier les travailleurs aux gouvernements nationaux ou régionaux, aux actionnaires ou aux directions ‘locales’, les syndicats les jettent consciemment dans la gueule du loup.
Quant à leurs actions sur le terrain, elles visent avant tout à désamorcer la colère des travailleurs, à enfermer leur riposte dans des actions inoffensives et démoralisantes. En effet, tout comme à Opel, les actions syndicales se sont concentrées sur :
-la prise en main totale et le dévoiement de la colère justifiée des ouvriers vers des voies de garage comme la prise en otage de la direction sur le site liégeois, les barrages filtrants, le blocage des trois brasseries concernés par les mesures (Jupille, Louvain, Hoegaarden);
-l’enfermement de la lutte dans l’usine et dans le secteur: des actions au sein des sites et l’extension au niveau des dépôts et de la distribution;
-la mise en place d’une fausse solidarité sans lendemain sous forme d’actions symboliques appelant à la sympathie du public: distribution gratuite de bière devant les grilles de l’entreprise, aux étudiants à Liège et aux passants, appel au boycott de la Jupiler, distribution de tracts d’appel à la solidarité et d’un acte de soutien des supporters des deux camps lors d’un match qui opposait le Standard à Anderlecht à Liège. On peut se demander dans quel état d’ébriété ces supporters, étudiants et autres ont pu offrir leur soutien!
- non pas le rejet des licenciements mais sur la revendication d’associer les syndicats au marchandage sur l’emploi.
Et lorsque le combat local est dans l’impasse, les syndicats font croire aux travailleurs déboussolés qu’ils doivent mettre tous leurs espoirs dans l’action du ‘front commun des syndicats européens de l’entreprise’, aussi bien chez Opel qu’à InBev. Ils instillent ainsi dans les esprits que la solidarité internationale des travailleurs se réduit à un marchandage entre délégations nationales pour trouver un équilibre ‘équitable’ dans les sacrifices sur le plan européen.
Nous concluions dans notre article d’Internationalisme n°344 concernant Opel: «En réalité, ce combat «exemplaire» n’est qu’un enfermement dans une voie sans issue corporatiste: «Wir sind Opel». Il n’est rien d’autre qu’un méprisable marchandage pour répartir équitablement les sacrifices, les victimes, les licenciements, tout en acceptant la logique de la rationalisation capitaliste». Nous pouvons aujourd’hui en dire autant pour le combat à InBev. La prétendue «victoire» à InBev tout comme le combat à Opel Anvers sont en réalité une défaite pour la classe ouvrière. Le retrait du plan de restructuration à InBev n’est pas le résultat d’une lutte réelle des ouvriers. C’est une stratégie menée de consorts entre le patronat et les syndicats pour contrecarrer ce qui représente un plus grand danger pour eux: voir la classe ouvrière, classe ennemie, prendre en mains sa lutte, organiser ses propres assemblées générales pour prendre des décisions sur le déroulement de sa lutte, organiser une véritable extension de sa lutte vers d’autres usines, d’autres secteurs en expliquant la nécessité d’une action commune, et ainsi développer une solidarité de classe capable d’établir un réel rapport de forces qui peut contraindre les patrons et l’Etat à reculer.
Pour le moment, la classe ouvrière est encore désemparée (voir article dans ce journal: Pourquoi autant d’attaques et si peu de luttes?) et s’en remet aux mains des syndicats lorsque sa colère explose. Mais l'aggravation de la crise économique contraindra la classe dominante à repasser à l'offensive et à mener des attaques simultanées encore plus désespérées contre les conditions de vie et de travail. Cela demande à la classe ouvrière, dès à présent, de tirer toutes les leçons du rôle des syndicats 1 et se réapproprier ses moyens de lutte pour transformer sa colère en une combativité qui paie et qui fera peur à sa classe ennemie: la bourgeoisie. Les révolutionnaires et les minorités combatives sont à ses côtés pour l’aider dans ce lent et difficile développement de la lutte.
H/29.01.2010
1 Lire dans notre presse: "Dans quel camp sont les syndicats ?" (Internationalisme n° 340).
Situations territoriales:
Récent et en cours:
Hommage au camarade Anton Brenders (1922-2010)
- 1668 lectures
Nous évoquons Anton comme un combattant intransigeant de la classe, qui s'est opposé à l'exploitation dans la société qu’il a lui-même subie en usine et qui a contribué à la transmission de ses expériences à une nouvelle génération de révolutionnaires après 1968.
Il ne l'a pas fait tout seul: à côté de lui et avec lui, il y en avait beaucoup d'autres qui ont vécu des expériences similaires, pendant et après la deuxième guerre mondiale. Autour de cette communauté s'est développé un cercle de discussion vivant dans les années qui ont suivi la guerre. Il y a eu de nombreuses discussions politiques et philosophiques immédiatement après la guerre au sein de l'Institut Emile Vandervelde avec le professeur Flam, issu de la résistance au sein des camps de l'holocauste. Les heurts, également, avec la bureaucratie social-démocrate de Hoboken (une banlieue 'rouge' d'Anvers) et l'intégration des groupes de la résistance du PCB (Parti Communiste de Belgique) au gouvernement, ont constitué l'arrière-plan de la rupture politique définitive avec le stalinisme. Au début des années 1950, celle-ci a mené à des contacts avec le groupe de la Gauche communiste Spartacusbond aux Pays-Bas. Celui-ci a alors organisé d'intenses débats communs à Anvers. Il s'en est suivi une collaboration avec le Spartacusbond. Anton devint un fidèle collaborateur de leur journal, au travers des traductions qu'il faisait d'articles de la presse internationale de la Gauche communiste et d'anarchistes (parmi lesquels 'Révolution Internationale' après 1973).
Dans le conflit entre le Spartacusbond et le groupe conseilliste déchiré Daad & Gedachte, autour de 1964, il prit très consciemment le parti de Spartacusbond. Il trouvait en effet que les positions de D&G ne mèneraient qu'à la négation de toute activité politique en tant que groupe prolétarien, ce que la réalité a confirmé. Les tendances conseillistes de D&G ont en effet souvent eu une influence négative sur la survie des groupes prolétariens aux Pays-Bas et en Belgique. Y compris au sein de nos prédécesseurs directs: les Revolutionaire Raden Socialisten (Anvers), les Vrije Raden Socialisten (Gand) en Belgique, et Radencommunisme aux Pays-Bas se sont développés au travers d'une critique de l'attitude conseilliste de Daad & Gedachte au profit de la défense d'une intervention active de l'organisation révolutionnaire dans la lutte de classe.
Dans ce sens, c'est Anton qui a mis en contact notre groupe de jeunes Revolutionaire Raden Socialisten, issu du bilan politique de mai 68, avec Révolution Internationale en 1972-73. Il a alors apporté une contribution essentielle à notre orientation politique de 1972 à 1975, en attirant notre attention sur l'importance des analyses politiques de Révolution Internationale, (un des groupes fondateurs du CCI), ce qui a conduit en 1975 à notre adhésion au CCI en cours de formation. Très tôt, il attirait notre attention sur l'importance d'approfondir la question de l'écologie d'un point de vue marxiste. Depuis lors, il est toujours resté un véritable sympathisant de notre organisation.
Chez lui, on rencontrait régulièrement des visiteurs qui discutaient des sujets les plus divers. Ces dernières années, il vivait plus retiré en compagnie des dessins et des peintures rudes de Rik Schevernels (†1972), son meilleur ami et artiste prolétarien (qui fustigeait l'église, le stalinisme et les syndicats) et de ses livres et publications philosophiques et politiques. Nous lui sommes toujours reconnaissants de sa contribution à notre évolution politique.
Internationalisme no. 346
- 1455 lectures
Le capitalisme n'offre qu'une seule perspective à la classe ouvrière : la misère
Gouvernement et médias le proclament haut et fort: la Belgique aurait traversé la crise sans trop de dégâts grâce à sa Sécurité sociale. Et déjà, l’horizon économique s’éclaircirait de sorte que l’austérité et les restrictions ne seraient plus bientôt qu’un mauvais rêve pour notre "petit pays prospère". L’hiver dernier, les associations caritatives tiraient la sonnette d’alarme: à cause d’une pauvreté croissante, beaucoup de gens étaient victimes du froid rigoureux. Depuis lors, la neige et le gel ont disparu mais les sans-logis, les SDF, la misère croissante dans des parties de plus en plus larges de la population sont plus que jamais bien présents. L’hiver glacial n’a d’ailleurs dévoilé que la partie visible de l’iceberg car la pauvreté se développe au niveau planétaire. La période où la pauvreté était associée à l’Afrique, l’Asie ou l’Amérique latine est révolue. Aujourd’hui, c’est en Europe même que des millions de gens y sont confrontés. Un Européen sur cinq risque de tomber dans la pauvreté, d’après les derniers chiffres d’Eurostat et de EU-SILC (Union européenne/ Study on Income and Living Conditions). Selon la définition utilisée, quiconque gagne moins de 60% du revenu d’une famille moyenne court le risque de connaître la pauvreté. En Espagne et en Grèce, 20% de la population est déjà en dessous de ce seuil de pauvreté relatif et 4,5% de la population vit dans une misère extrême. Au Royaume-Uni, un tiers des enfants grandit dans la pauvreté. En Belgique, la pauvreté touche déjà 15% des personnes (une famille sur sept, soit plus de 1.500.000 personnes), un chiffre plus élevé que dans les autres pays "riches" d’Europe occidentale.
L’insécurité sociale devient plus que jamais la règle pour une grande partie de la classe ouvrière. Le développement de cette insécurité a également un impact sur les conditions de vie que les travailleurs peuvent assurer pour eux-mêmes et pour leurs enfants dans ce système social. La pauvreté n’est pas seulement un drame financier mais elle inclut tous les domaines de la vie sociale: le logement, les soins de santé, l’enseignement et mène à l’exclusion sociale, à l’isolement, à l’absence de perspective, à une pression extrême pour une partie croissante de la population. C’est un cercle vicieux qui entraîne des familles entières de plus en plus profondément dans la misère. Des drames individuels et des révoltes sans perspectives découlant de cette situation terrible sont d’ailleurs devenus une rubrique récurrente à la une des médias.
Des emplois moins nombreux et mal payés …
Les revenus générés par le travail sont bien sûr la pierre angulaire du système capitaliste. Or, les marchés qui se contractent posent à la bourgeoisie un problème de capitaux disponibles et de baisse des profits et la pousse à attaquer les salaires et les conditions de travail. Les profits et le capital sont de fait du travail non rémunéré. Dès lors, soit la productivité du travail augmente, soit la part des salaires diminue: moins de travailleurs par unité produite ou moins de salaire.
- La crise économique actuelle accentue lourdement la contraction du marché du travail: l’année dernière, la "clientèle" de l’ONEM a augmenté de 10% pour atteindre 1,3 million de personnes et la situation se détériore encore en 2010 (déjà 1,4 millions en mars). Jamais dans l’histoire de l’ONEM, ce chiffre n’a été atteint (et ceci malgré une politique agressive de "contrôle" des chômeurs qui a abouti en 2009 à la suspension (temporaire) de 90.000 personnes (Agence Belga, 10.03.2010)). Rien qu’en Flandre le nombre a augmenté sur base annuelle de 23,8%. Dans des pays comme l’Irlande ou le Danemark, on a observé un doublement du nombre de chômeurs. Au Pays-Bas, la hausse était de 50% et en France de 25%. Le résultat relativement bas de la Belgique s’explique par l’existence d’un système généralisé de chômage partiel, qui permet aux entreprises de "parquer" leurs travailleurs – et depuis peu aussi (sous conditions) leurs employés – en surnombre auprès de l’ONEM, sans pour autant devoir les licencier. En mars et avril 2009, 25% de la population ouvrière totale se retrouvait dans ce système de chômage économique temporaire!
- Par ailleurs, un nombre de plus en plus important de travailleurs court également le risque de tomber dans la pauvreté. A cause de situations de travail précaires ou de salaires insuffisants, les familles monoparentales (de 32% en 2005 à 40% en 2008, selon le rapport EU-SILC), des familles avec plusieurs enfants et des personnes qui ne sont pas de nationalité d’un pays de l’UE sont les premières à sombrer dans la pauvreté. Les nombreux contrats partiels ou temporaires, les emplois précaires induisent aussi un risque accru de pauvreté. En 2006, 14% de ceux qui se trouvaient sous le seuil de pauvreté avaient cependant un travail.
Trouver un emploi devient de plus en plus difficile et le fait d’avoir un emploi n’est pas en soi une garantie d’échapper à la spirale de la pauvreté. La paupérisation absolue de larges parties de la population – et essentiellement de travailleurs – se traduit clairement dans la baisse de la quote-part des salaires dans le revenu national du pays: elle est descendue en quelques années de 60% à 50% d’après les chiffres de la Banque nationale.
et les allocations en chute libre...
Nos démocraties se targuent pourtant d’avoir mis en place une sécurité sociale solide qui empêche la chute dans la pauvreté en soutenant les plus vulnérables par des allocations sociales. Les instituts universitaires qui observent la situation sociale pour le compte de la bourgeoisie dégonflent la baudruche: «Les minima sociaux sont largement insuffisants. Même si les familles avec un revenu faible n’ont pas de problèmes de santé et gèrent leurs revenus de manière exemplaire, ils ne pourront pas réaliser les conditions matérielles pour une bonne santé et une autonomie (...). Celui qui vit uniquement d’une allocation se situe presque automatiquement dans notre pays autour ou en dessous du seuil de pauvreté» (B. Cantillon, Centre pour la Gestion Sociale, U. Anvers, De Standaard, 16.05.09 et 24.03.10). Le Pacte des Générations (2005) et la Loi Programme (2006), avaient permis aux autorités de proposer en grande pompe un mécanisme structurel d’adaptation des allocations sociales au bien-être. Sur papier cela semblait nickel mais dans la réalité, malgré les belles promesses des gouvernements successifs, rien n’a été mis en application. La ministre flamande de la lutte contre la pauvreté, Ingrid Lieten (Socialiste flamande) soulignait encore dernièrement que les allocations de base (fédérales), telles que le salaire de survie et l’allocation minimale en cas de maladie chronique n’étaient plus "décentes". Elle veut les augmenter de 150 euros par mois, tout en ajoutant cyniquement: «Evidemment, une telle augmentation est difficile à réaliser en pleine période de crise. Nous le savons parfaitement». Le recul des allocations sociales est implacablement illustré par les données suivantes:
- Les allocations minimales – le salaire de survie, les retraites de base, les allocations d’invalidité, etc. - se situent 100 euros en dessous du seuil de pauvreté européen!
- En Belgique, le rapport entre les allocations de chômage minimales et les salaires moyens a baissé de 40% par rapport au milieu des années 1970;
- En comparaison avec l’évolution des salaires les plus bas, les allocations d’assistance ont reculé proportionnellement durant les années 1990 de 10% (Belgique) à 20% (Suède) et plus (Pays-Bas).
D’une part, la bourgeoisie veut réduire les frais improductifs: tous les frais qui ne sont pas directement liés au processus de production doivent être réduits au minimum. D’autre part, elle veut maintenir ce que les sociologues appellent la fonction de "stimulation" de ces allocations: les allocations sociales doivent rester nettement inférieures aux revenus du travail car, pour faire baisser les salaires, il ne faut pas que ces derniers s’approchent trop du niveau de ces allocations, soi-disant pour ne pas "démotiver le travail"(sic). Sous le prétexte d’ "inclusion sociale", on organise ainsi l’exclusion de quiconque ne peut pas être "activé".
Le système des pensions est déjà depuis un certain temps à la traîne et est totalement insuffisant. Les interventions forfaitaires des soins de santé sont bien trop limitées pour ceux qui ont une petite retraite et cette dernière ne suffit plus dans la plupart des cas à payer la maison de repos. La pension moyenne brut par salarié comporte 925 euros (Assuralia, 10.02.2010). De fait, la Belgique a environ les retraites les plus basses d’Europe de l’Ouest. Les systèmes de pension complémentaires deviennent de plus en plus incontournables, mais ceux-ci accentuent non seulement l’inégalité mais sont aussi des mécanismes d’exclusion structurels. Des centaines de milliers de personnes non actives n’ont pas accès à ces systèmes complémentaires, tout comme les chômeurs, plus de 200.000 invalides, les handicapés et ceux qui bénéficient du salaire de survie, car, pour en bénéficier, il faut travailler. Et ne parlons pas des travailleurs intérimaires ou de ceux mis au travail dans le cadre du système des chèques-services.
Presque tous les pays européens ont revu durant ces dernières années à plusieurs reprises leur système de retraite. Dans les années 1990, ils ont rétabli "l’équilibre financier" des caisses de retraite et supprimé les retraites anticipées. Les réformes de la dernière décennie ont pour but soi-disant de prendre en considération l’augmentation de l’espérance de vie et le fait qu’il y a trop peu de "jeunes" qui cotisent et trop de "vieux" qui touchent ces allocations. Nous avons déjà montré qu’une partie croissante de la classe ouvrière est exclue du système et la bourgeoisie arrive sur le plan mondial de moins en moins à intégrer les jeunes générations dans le circuit du travail. Les revenus provenant des salaires sont donc en baisse et en conséquence, les caisses de retraite sont de plus en plus en difficulté. L’augmentation de l’âge de la retraite n’est qu’une nouvelle diminution de fait de l’allocation et annonce donc une accentuation de la paupérisation!
... mènent à une détérioration des conditions de vie
La combinaison du chômage, d’emplois précaires et mal payés et d’allocations de plus en plus maigres aboutit à un cumul de problèmes qui affectent de plus en plus durement les conditions de vie de la classe ouvrière:
- L’endettement des ménages augmente. De plus en plus de Belges vivent à crédit et ont des difficultés à repayer à temps leurs dettes. La centrale des crédits de la Banque nationale de Belgique relève qu’à la fin 2009, 4,5 millions de personnes (sur une population de +/- 10,5 millions) ont au moins un crédit à repayer. 356.611 de ceux –ci ont un retard de remboursement, une augmentation de 3,6%. Le total de la somme impayée a augmenté en 2009 de 16,1% (2,16 milliards d’euros). En 2007, 338.933 personnes étaient fichées comme surendettées. Et ce chiffre ne concerne que les crédits de consommation et les prêts hypothécaires. Les dettes concernant la location, les soins de santé, les télécommunications, l’énergie, ... ne sont pas reprises dans ces statistiques;
- La qualité de l’habitat se dégrade. Les revenus en baisse poussent une part croissante de la population ouvrière à rechercher des logements meilleur marchés, donc à louer dans les segments les plus bas du marché immobilier privé (le nombre d’habitations sociales étant totalement insuffisant). Ces familles modestes occupent dès lors de petites maisons humides et insalubres, avec des installations sanitaires insuffisantes, ou alors, elles deviennent des sans-logis. Dans la spirale infernale de la paupérisation et de l’exclusion sociale, l’accès à un logement abordable et décent est effectivement une donnée cruciale. Près de 3 millions d’Européens sont sans logis, dont 20.000 en Belgique (Ministère fédéral de l’intégration sociale). Selon une estimation des centres de recherche des Universités d’Anvers et de Liège, il y aurait en Flandre 12 sans-logis pour 10.000 habitants (7.000 au total), en Wallonie 25 pour 10.000 (8.000 au total) et à Bruxelles 30 pour 10.000 (3.000 au total).
Par ailleurs, un certain nombre de groupes ne sont sans doute pas repris dans les statistiques. Il y a les sans-abris temporaires ou chroniques, d’autres encore ne veulent pas être identifiés, souvent parce qu’ils sont illégaux. Le groupe des sans-abris augmente et devient de plus en plus jeune et féminin. Parmi eux aussi de plus en plus de locataires expulsés de leur habitation. La moitié des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sont encore propriétaires d’une maison, héritée ou acquise au moment où ils en avaient encore les moyens. Mais 1 sur 6 n’arrive plus à l’entretenir ou à la chauffer (étude EU-SILC). Voilà encore une confirmation du processus de paupérisation en cours ;
- L’augmentation des coupures partielles ou totales de gaz ou d’électricité est une autre indication de la détérioration des conditions de vie de la population ouvrière. Le prix du gaz naturel a augmenté de 50 à 70% entre début 2003 et la fin 2009 pour la grande majorité des familles belges, selon une étude du régulateur officiel du marché belge. Pour une famille qui a une consommation moyenne de gaz naturel, le prix à payer en décembre 2009 est de 35% à 40% plus cher qu’il y a 6 ans. En octobre 2009, Eandis, le gestionnaire de réseau le plus important en Flandre, avait plus de 88.000 points de raccordement (électricité et gaz) en tant que pourvoyeur social sur son réseau de distribution, c’est-à-dire des personnes qui avaient été rejetées par les fournisseurs commerciaux parce qu’elles n’arrivaient pas à payer leurs factures énergétiques. En région wallonne, 37.991 utilisateurs bénéficient du tarif social pour le gaz et 81.677 pour l’électricité (Commission Wallonne pour l’Energie – CwaPE, 2009);
- Les soins de santé reculent également. Logements insalubres, conditions de travail stressantes et une nourriture bon marché et déséquilibrée mènent souvent à des problèmes de santé. Pour des raisons financières, ces soins de santé sont souvent postposés. La santé se détériore et rend les conditions de travail encore plus difficiles. Les données confirment que la baisse des revenus mène à une détérioration de la santé, à un accès plus difficile aux soins de santé et à une mortalité anticipée. L’espérance de vie des Belges augmente et la mortalité enfantine baisse, mais les indicateurs de santé soulignent les inégalités significatives en ce qui concerne l’état de santé et l’accès aux soins de santé, par exemple quant à l’appréciation subjective de la santé, les limitations dans l’exercice des activités quotidiennes dues à la maladie, les dépressions, le surpoids, la consommation d’alcool et de cigarettes, les campagnes de prévention des cancers de l’utérus et des seins.
Pour la bourgeoisie, la première préoccupation est toujours "qui paie les soins de santé?" et pas "comment faire pour que tout le monde en bénéficie au mieux?". Et lorsqu’il faut réduire de manière drastique les dépenses de l’Etat pour la sécurité sociale, la bourgeoisie n’hésitera pas à faire payer une fois de plus les travailleurs. Et ceci alors que dans 8% des familles en 2009, quelqu’un a arrêté un traitement médical à cause de problèmes d’argent, que dans 26% des cas, un traitement a été reporté et que dans 9% des cas l’idée d’un traitement a simplement été abandonnée pour des raisons financières ((enquête de Test–Santé/Test–Achat).
En ce qui concerne la distribution de nourriture bon marché, il faut constater que la clientèle des banques alimentaires augmente pour la 14ième année consécutive. En 1994, 59.461 personnes s’adressaient aux neuf banques alimentaires qui font partie de la Fédération belge, et ce chiffre est passé à 108.100 personnes en 2007. On y retrouve de plus en plus des personnes provenant de milieux divers: chômeurs, bénéficiaires du salaire de survie, des gens qui ont fait faillite, des travailleurs et des employés avec un salaire bas, ce qui confirme une fois de plus que la paupérisation touche des secteurs de plus en plus larges de la population en général et de la classe ouvrière en particulier.
La bourgeoisie tente de mettre le capitalisme hors du coup
Même la bourgeoisie et ses gouvernements ne peuvent plus ignorer une réalité aussi criante. Sa stratégie consiste alors à maquiller pour l’ensemble de la classe ouvrière les raisons fondamentales du développement de la paupérisation. D’une part, elle veut faire croire que les gouvernements démocratiques mettent tout en œuvre pour engager le combat contre l’extension de la pauvreté: l’Europe a par exemple proclamé en grande pompe que 2010 serait l’année européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’objectif était de créer l’illusion parmi les travailleurs que les gouvernements démocratiques s’occupaient du problème afin de détourner leur attention des vraies causes de leur misère. Lors du traditionnel sommet du printemps, les premiers ministres et présidents de l’Union Européenne ont cependant déjà clairement montré que leurs plans pour réduire de 20 millions le nombre de personnes tombées dans la pauvreté étaient purement du bluff. Cette intention a carrément été retirée de la déclaration finale. Différents états membres ne trouvaient pas que la réduction de la pauvreté était un but en soi mais devait être une conséquence de la croissance économique (sic!). Pour quand les poules auront des dents donc!
D’autre part, la bourgeoisie et ses média essaient de faire croire à la population en général et à la classe ouvrière en particulier que si les pauvres se retrouvent dans cette situation, c’est de leur propre faute, parce qu’ils ne travaillent pas assez dur, ce qui implique qu’ils sont paresseux et irresponsables. C’est une manière d’instiller parmi un nombre croissant de travailleurs un sentiment de culpabilité et de rejeter sur eux la pleine responsabilité pour leur situation de détresse. C’est aussi une manière de mettre hors de cause la société capitaliste et d’insinuer qu’il ne faut rien changer aux rapports sociaux. Les conséquences inévitables de la pauvreté dans la société capitaliste sont traitées de manière isolée et individualisée de sorte que les causes fondamentales de cette situation ne sont pas abordées. «Les problèmes sociaux (chômage, pauvreté, etc.) sont vus comme des problèmes individuels qui doivent être traités au moyen d’une politique plus répressive. Ceci conduit à des mesures simplistes, qui sont essentiellement orientées vers les symptômes : les sans-abris sont chassés hors des stations de métro, les jeunes qui font l’école buissonnière (et leurs parents) sont plus strictement contrôlés. Et la société reste bien hors d’atteinte» remarquaient déjà Nadia Fadil (U.Louvain), Sarah Bracke (U.Louvain), Pascal Debruyne (UGand) en Ico Maly (association KifKif) lors d’un débat à l’occasion des émeutes à Anderlecht en début d’année. Ces chercheurs "oublient" un peu trop facilement que cette société qui reste hors d’atteinte a un nom: le capitalisme, un système qui depuis des décennies a atteint les limites de son développement et qui s’enfonce dans sa décadence historique.
Pour exterminer la pauvreté, il faut s’attaquer à ses racines, qui sont enchevêtrées dans la logique de profit des lois du marché capitaliste, elle-même asséchée par la crise historique dans laquelle le système s’est enfoncé. Les campagnes montées par la bourgeoisie ont effectivement pour but de d’éviter que la question des responsabilités mène à la mise en cause des rapports sociaux. La réalité qui apparaît clairement derrière les données avancées et la dynamique qu’elles révèlent démontrent le caractère irréversible de la spirale de la paupérisation dans les limites du système actuel. L’approfondissement de la crise économique frappe la classe ouvrière de plus en plus durement et rejette une partie de plus en plus importante de celle-ci dans la pauvreté.
Dans la pauvreté, il y a plus que la pauvreté
Tenter de cacher la compréhension des véritables rapports sociaux et des oppositions de classe équivaut à entraver le processus de prise de conscience de la classe ouvrière et à lui enlever la seule perspective qui puisse lui fournir une sortie de la pauvreté. Dans les années 1930, les révolutionnaires appelaient déjà les travailleurs à ne pas se laisser berner par des chimères: «Un capitalisme qui est contraint de nourrir les travailleurs au lieu d’être nourri par eux n‘a pas de futur (...). Si le capital avait du travail à offrir, soyons-en sûr, il nous en donnerait à ne plus savoir où donner de la tête. (...) Ne demandez pas du travail ; battez vous simplement pour de la nourriture, des habits, un toit ! Joignez votre voix à celle des autres! Allez aux bureaux de pointage, allez dans la rue, allez aux portes des usines!” (Living Marxism, USA).
La bourgeoisie essaie bien sûr de se servir de ce "malaise social" pour démoraliser la classe ouvrière: elle veut nous faire croire que le désespoir et la concurrence font partie de la "nature humaine" et que la classe ouvrière ne peut qu'accepter cette situation comme une fatalité. Les révolutionnaires, quant à eux, doivent mettre en avant que c'est la barbarie du capitalisme qui est responsable de la misère et la spirale suicidaire. Les conditions d'exploitation et la concurrence que connaît aujourd'hui le prolétariat dans le monde n'ont pas comme seule perspective le désespoir individuel, les suicides ou les dépressions. Car la dégradation vertigineuse des conditions de vie des prolétaires porte avec elle la révolte collective et le développement de la solidarité au sein de la classe exploitée. L'avenir n'est pas à la concurrence entre les travailleurs mais à leur union grandissante contre la misère et l'exploitation. L'avenir est à des luttes ouvrières de plus en plus ouvertes, massives et solidaires.
Aussi, dans le sillage de Marx, il faut rappeler que la réalité de la crise capitaliste et de la spirale de paupérisation révèle plus que la paupérisation elle-même: «Tout comme les économistes sont les représentants scientifiques de la classe bourgeoise, les socialistes et les communistes sont les théoriciens de la classe ouvrière. Aussi longtemps que la classe ouvrière n’est pas assez développée pour constituer réellement une classe et que donc le combat avec la bourgeoisie ne prend pas encore une forme politique, aussi longtemps que les forces productives au sein de la bourgeoisie elle-même ne sont pas suffisamment développées pour rendre globalement visibles les conditions matérielles qui sont nécessaires pour la libération du prolétariat et pour la constitution d’une nouvelle société, ces théoriciens ne seront que des utopistes qui, pour répondre aux besoins de la classe opprimée, imaginent des systèmes et vont à la recherche d’une science régénératrice.
Mais au fur et à mesure que l’histoire avance et que la lutte du prolétariat prend une forme plus précise, ils ne sont plus forcés de chercher la science dans leur propre tête. Ils doivent simplement prendre conscience de ce qui se passe devant leurs propres yeux pour en devenir l’expression. Aussi longtemps qu’ils cherchent la science et se limitent à créer des systèmes, aussi longtemps qu’ils se trouvent au début de la lutte, ils ne voient dans la misère que la misère, sans déceler en son sein l’aspect révolutionnaire, menant à un bouleversement, qui mènera au renversement de l’ancienne société. A partir de ce moment, la science devient un produit conscient du mouvement historique et a cessé d’être doctrinaire. Elle est devenue révolutionnaire» (Karl Marx, La misère de la philosophie, chapitre II: La métaphysique de l’économie politique).
Lac / 24.04.2010
La recherche du profit et ses victimes
- 1512 lectures
Aux chemins de fer
Le 15 février 2010 en Belgique, 19 personnes ont perdu la vie (parmi lesquelles un conducteur de train) et 170 voyageurs ont été blessés lorsque deux trains de passagers sont entrés en collision frontale. D'un seul coup, les manquements à la sécurité des chemins de fer étaient remis en lumière. Bien que dans le passé, plusieurs accidents meurtriers avaient eu lieu dans un contexte similaire, les chemins de fer belges, qui sont sous la pression de l'UE depuis 2005 pour mettre en place des normes de sécurité plus modernes, devaient reconnaître à l'occasion de la catastrophe que seulement un tiers des trains locaux étaient équipés de systèmes de sécurité conformes. Alors que les chemins de fer belges sont parmi les plus anciens du continent européen, depuis que la première ligne a été ouverte en 1835, et que ce vieux pays industrialisé dispose encore du réseau ferré le plus dense du monde, 175 ans plus tard, tous les trains ne sont pas encore équipés selon les normes de sécurité les plus modernes, qui arrêtent le convoi lorsqu'un feu rouge est grillé.
Le gouffre révoltant qui sépare les possibilités techniques actuelles de la réalité quotidienne n'est pas le fait d'un pays du tiers-monde, mais d'un des pays les plus anciennement industrialisés, qui abrite le siège de l'UE. En Allemagne, également, le pays industrialisé le plus puissant d'Europe, qui a longtemps été reconnu mondialement comme le pays exportateur par excellence grâce à ses produits de haute technologie, la pression de la crise et la recherche du profit à tout prix mènent aussi de plus en plus à des atteintes à la sécurité. Après le déraillement d'un train ICE-3 en été 2008, les chemins de fer allemands ont du procéder au remplacement des axes de roues sur la plupart des 250 trains ICE-3 utilisés, pour un montant estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Entretemps, les berlinois vivent depuis des mois avec les dangers des politiques d'austérité et de la soif de profits aux chemins de fer allemands. La rupture d'une roue, qui a mené en mai 2009 au déraillement d'un train S-Bahn (une sorte de train de banlieue), a contraint la DB à un réexamen de tout le parc de S-Bahn à Berlin. (…) Ici aussi, il s'agit d'une facture d'au moins 350 millions d'euros. Et le déraillement ces dernières semaines de plusieurs trains de marchandises démontre l'ampleur du danger d'autres accidents. (…)
Les conducteurs de train belges ont montré à ce propos la seule réaction juste en cessant le travail dans de grandes parties du pays, dès le lendemain de l'accident, en réaction aux conditions de travail et de sécurité.
Dans la construction du métro de Cologne
Après qu'en mars 2009 à Cologne, le bâtiment des archives historiques et les immeubles d'habitation voisins se soient effondrés, les premières constatations ont mis à nu des pratiques qui jusqu'à présent avaient principalement cours dans les pays du tiers-monde. Il est maintenant établi que seulement 17% des fixations métalliques indispensables ont été installées, ce qui signifie que 83% ne l'ont pas été. Une partie de ces équipements a été revendue par les ouvriers à un ferrailleur. Cela montre certainement que les salaires sont peu élevés, et les conditions de travail et les cadences misérables. Mais s'il semble vrai que des équipements de sécurité n'ont pas été installés par les ouvriers, et au lieu de cela, ont été massivement bazardés, ce comportement porte atteinte aux principes éthiques de la classe ouvrière. Il s'oppose à l'attitude des cheminots en Belgique.
Jusqu'à présent, le respect de certaines normes de sécurité était admis dans les pays hautement industrialisés, parce qu'il était indispensable au fonctionnement un tant soi peu uniforme du processus de production. Ce qui est maintenant mis en lumière, comme dans les enquêtes les plus récentes à propos de la construction du métro de Cologne, signifie qu'un seuil a été franchi. «Une foule de rapports falsifiés, des équipements de sécurité volés et pas installés, des sources illégales, de l'eau de source pompée en excès, fissures récurrentes dans les parois latérales, surtout par manque de contrôle» ont été mis à jour, en bref, «maladresse, occultations, affaires systématiquement étouffées et falsifiées» (Kölner Stadtanzeiger, 19.2.2010). (…) A partir de maintenant, le danger menace que de tels comportements se généralisent aussi dans les pays hautement développés, dont les structures n'avaient jusqu'à présent pas été sérieusement touchées par une corruption omniprésente.
Dans le transport aérien
L'écrasement d'un Airbus en juin 2009 (avec 228 personnes à bord) aurait mis en lumière, selon les informations de Der Spiegel, une grave lacune dans les systèmes de sécurité de tous les appareils qui avaient été approuvés à l'époque: les capteurs de vitesse se basent sur des spécifications de 1947, c'est-à-dire d'avant la période des avions à réaction. Les capteurs soupçonnés, dont la congélation est à l'origine de l'écrasement du Airbus A330, ne sont supposés fonctionner que jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Mais les avions actuels volent presque toujours à des altitudes où règnent des températures bien inférieures. Une autre technique peut être commandée depuis quelques années pour les appareils Airbus. Mais Air France refuse toujours de se procurer ces systèmes, appelés «Buss», dont le coût s'élève à 300.000 euros (https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,679180,html) n
EB / 26.2.10.
version résumée d'un article publié in extenso sur notre site en allemand : https://de.internationalism.org/
Récent et en cours:
Été 2010: Journée de rencontre et de discussions avec le CCI en Belgique
- 1460 lectures
Pour la quatrième fois, le CCI organise le samedi 28 août une journée de discussions et de rencontre en Belgique. C’est une occasion pour certains d’approfondir sur un certain nombre de questions et pour d’autres de tout simplement faire connaissance. Un thème de discussion, choisi avec le concours de nos lecteurs est mis à l’ordre du jour le matin et l’après midi. Libre à chacun de participer à l’entièreté de la journée ou seulement à une partie. Il y a pleinement la possibilité de poser à souhait des questions ou tout simplement d’écouter, de découvrir, de discuter ou d’approfondir des arguments sur des sujets variés.
Pour plus d'informations et de détails, merci de prendre contact avec nous à l'adresse :
Vie du CCI:
Géographique:
Internationalisme no. 347
- 1838 lectures
Belge, Flamande, Wallonne, Bruxelloise: la bourgeoisie est toujours unie pour faire payer la crise aux travailleurs
Quiconque a suivi les médias bourgeois de juin à septembre doit croire que la Belgique est décidément le seul endroit au monde qui ne subit pas les contrecoups de la crise mondiale. Depuis les élections fédérales de juin, soit depuis plus de 90 jours, les projecteurs de la presse ont été centrés sur les rebondissements de l’interminable feuilleton communautaire: négociations, compromis, ruptures, trahisons; le « citoyen » est amené à osciller constamment entre l’espoir d’un compromis national et le désespoir de l’éclatement du pays.
La Belgique, le seul Etat au monde qui peut se permettre de ne pas se préoccuper de l’instabilité du système bancaire, du recul du PNB, de la crédibilité de l’Etat? Evidemment non et les données économiques récentes le confirment: ses banques (Fortis, KBC, Dexia) ont fortement subi la crise bancaire et sont encore déstabilisées par des créances douteuses, en particulier envers certains pays de l’Europe de l’Est et du Sud; le PIB belge a reculé de 4,3% en 2008-2009, la dette dépasse maintenant les 100% du PIB et le déficit budgétaire 2010 est de 5,2%, au lieu des 4,8% prévus il y a un an (+1,3 milliard d’euros). Par ailleurs, après les PIIGS (Portugal, Irlande, Italie, Grèce, Espagne), la Belgique, avec la Grande-Bretagne est en deuxième ligne des Etats présentant une vulnérabilité économique et dès lors menacés de faillite.
De manière générale donc, des attaques générales sont aussi incontournables en Belgique que dans le reste des pays européens. Pourquoi alors cette focalisation sur les tensions communautaires et linguistiques? Certes, la bourgeoisie belge est loin d’être homogène: des tensions existent depuis longtemps en son sein, en particulier entre fractions régionales, et ces tensions, exacerbées par la crise depuis 2008, se sont matérialisées par la montée en puissance lors des dernières élections d’un parti autonomiste flamand, la NVA (Nieuwe Vlaamse Alliantie). Toutefois, il serait naïf de croire que, pour la défense de leurs intérêts communs fondamentaux - le maintien de leurs profits, de leurs parts de marché menacées par la concurrence exacerbée - ces fractions bourgeoises ne se coalisent pas pour imposer leur loi aux exploités. L’histoire de ces 50 dernières années nous apprend qu’elles utilisent habilement à cet effet leurs divisions internes dans un double objectif: d’une part pour freiner la prise de conscience des attaques et du rôle central de l’Etat dans celles-ci, d’autre part pour entraver toute réaction unitaire des travailleurs et toute extension de leurs luttes.
Freiner la prise de conscience des attaques et du rôle central de l’Etat dans celles-ci
Face au risque de défaut de paiement, tous les Etats européens ont lancé de gigantesques plans d’austérité pour tenter d’assainir leurs finances publiques et leur système bancaire: Allemagne, 82 milliards d’euros; Grande-Bretagne, 7,2 milliards d’euros en 2010; Italie, 13 milliards d’euros en 2011; Espagne, 15 milliards d’euros supplémentaires. Ces attaques impres-sionnantes impliquent des suppressions massives d’emplois dans le secteur public, la réduction des salaires (par exemple -5% pour les fonctionnaires en Espagne), le recul de l’âge de la retraite et la baisse des pensions (baisse des allocations de certains fonds de pension aux Pays-Bas par exemple) ou des allocations de soins de santé. Bref, elles vont signifier une baisse conséquente du niveau de vie de la classe ouvrière, comparable à celle qu’elle a connue dans les années 1930. D’autre part toutefois, elles dévoilent par la même occasion de plus en plus le rôle de l’Etat, ce pseudo ‘Etat social’, dans l’imposition de l’austérité capitaliste, ce qui risque d’orienter la colère ouvrière contre celui-ci. Effectivement, loin d’être un arbitre au dessus de la mêlée, garant de la justice sociale, « l’Etat démocratique » se manifeste de plus en plus pour ce qu’il est en réalité: l’instrument de la classe exploiteuse pour imposer des conditions de plus en plus impitoyables à la classe ouvrière.
Cependant, les diverses bourgeoisies nationales utilisent tous les moyens de mystification à leur disposition pour occulter le plus longtemps possible cette réalité aux yeux de la classe ouvrière et pour, au contraire, l’embobiner dans les illusions démocratiques. Dans ce contexte, la bourgeoisie belge et ses diverses fractions attisent précisément les oppositions entre régions et communautés, afin de noyer les attaques et le rôle central qu’y occupe « l’Etat démocratique » dans un imbroglio institutionnel.
De manière révélatrice, les années 1970, les années de la première manifestation de la crise actuelle du capitalisme, ont aussi été en Belgique le début d’une vaste série de mesures de restructuration institutionnelle, visant à régionaliser l’Etat et à diluer les responsabilités à divers niveaux de pouvoir communautaire, régional ou communal. Une flopée de gouver-nements fédéral, communautaires et régionaux (sept au total) ont vu le jour, des regroupements de communes et de régions urbaines ont été mis en place, en plus de la privatisation partielle ou totale de certaines entreprises publiques (Poste, chemin de fer, téléphone, gaz et électricité, secteur des soins de santé, ...). Ceci a entraîné un partage ubuesque des compétences, une redistribution des fonctionnaires du secteur public sur les différents niveaux de pouvoir et la création de toutes sortes de statuts mixtes. Dans le concret, ces « réformes de l’Etat » ont abouti aux résultats suivants :
- accroître l’efficacité de l’exploitation : la « responsa-bilisation » des entités autonomes organise de fait la concurrence interne entre régions. Les travailleurs flamands sont appelés à être plus « performants » que leurs collègues wallons et vice versa, les régions, les communes, sont en concurrence pour gérer plus rationnellement les budgets sociaux ou mieux mettre en œuvre la flexibilité de leurs fonctionnaires, etc.;
- accélérer les restructurations et les attaques contre les statuts du personnel, les salaires et les conditions de travail des fonctionnaires sous couvert de réorganisation des structures de l’Etat;
- diluer l’ampleur des attaques, en les fragmentant sur divers niveaux de pouvoir ou en responsabilisant divers niveaux de pouvoir pour divers types de mesures.
L’actuel battage communautaire (dont la « victoire » de la NVA fait partie) et la « grande réforme de l’Etat », annoncée comme inévitable, ne visent pas d’autre but. Car dans les coulisses en effet, les « think tanks » économiques de la bourgeoisie ont déjà esquissé les grandes lignes d’un redoutable plan d’austérité 2010-2015, basé sur une double orientation:
- la réduction drastique des dépenses budgétaires pour infléchir l’évolution de la dette (25 milliards d’euros en 5 ans selon certains, 42 milliards d’euros en 4 ans selon le Bureau du Plan (cf. De Morgen, 20.05 et 28.07));
- la réduction importante des salaires (évaluée globalement à 10% (De Standaard, 03.09)) pour restaurer la position concurrentielle de la Belgique vis-à-vis de l’Allemagne (salaires +23,4% en 10 ans en Belgique, contre +8,8% en Allemagne), pour reconquérir des parts de marché et contrer la chute des investissements étrangers (-70%, faisant passer la Belgique de la 2e à la 10e place des pays attirant des investissements étrangers (De Morgen, 23.07.10)).
La « réforme de l’Etat » devrait une fois de plus permettre de masquer en partie l’ampleur des attaques et le rôle fondamental de « l’Etat démocratique » dans l’imposition de l’austérité. L’effort sera réparti sur les différents niveaux de pouvoir: gouvernement fédéral mais aussi entités fédérées (par exemple 17 milliards de réductions budgétaires à supporter par les régions et communautés), et ceci sera justifié par le fait que les nouvelles « autonomies régionales », obtenues grâce à la réforme de l’Etat, doivent nécessairement aller de pair avec une « responsabilisa-tion » accrue. De cette manière, la bourgeoisie espère une fois de plus diluer la responsabilité étatique dans l’imposition de l’austérité et détourner le mécontentement vers des boucs émissaires: « la région de Bruxelles et le trou sans fond de ses finances publiques », « les Wallons qui ne veulent pas travailler et engloutissent les milliards des budgets sociaux », « les Flamands égoïstes qui refusent la solidarité et poussent à la concurrence entre régions ».
Paralyser la capacité de réaction et d’extension des luttes de la classe ouvrière
Et lorsque les travailleurs s’insurgent contre les attaques dont ils sont victimes, la bourgeoisie - en particulier à travers ses syndicats - se sert une fois de plus de l’intensification de l’immonde battage (sous-)nationaliste et régionaliste pour entraver toute réaction unitaire des travailleurs et toute extension de leurs luttes face à l’agression subie contre leur niveau de vie. Cela aussi est une constante du rapport de force entre les classes en Belgique.
Depuis les années 1960 en particulier, la bourgeoisie utilise la mystification régionaliste pour freiner la prise de conscience au sein de la classe ouvrière de la nécessité d’une réaction unitaire et de l’extension de ses luttes face aux attaques. Déjà lors de la grève générale de 1960, le syndicalisme radical, avec à sa tête André Renard, détourne la combativité des ouvriers des grands bassins industriels de Liège et du Hainaut vers le sous-nationalisme wallon, faisant croire qu’un sous-Etat wallon sous la direction du PS pourrait s’opposer au capital national et sauver du déclin les industries de la région. Les travailleurs paieront cher cette mystification, car ce sont ces autorités régionales qui liquideront progressivement l’industrie minière et sidérurgique wallonne dans les années 1970 et 1980. Depuis la fin des années 1980, la Flandre est confrontée aux mêmes problèmes avec le bassin minier limbourgeois, les chantiers navals (Boel Tamise) et l’automobile (Renault et dernièrement Opel). Une fois de plus, c’est la même mystification qui est utilisée: « Ce que nous faisons nous-mêmes, nous le faisons mieux » est le slogan des sous-nationalistes flamands. De fait, la liquidation des mines et des chantiers navals a été rondement menée, et récemment ce sont les travailleurs d’Opel qui se sont fait rouler dans la farine par les promesses du gouvernement flamand et les campagnes sur le « combat de la Flandre pour sauver Opel ».
Une fois de plus aujourd’hui, alors que les travailleurs commencent à engager la riposte face aux attaques, la régionalisation des différents niveaux de pouvoir et le battage (sous-)nationaliste sont exploités par la bourgeoisie et ses organisations syndicales, d’abord pour diviser, isoler et enfermer les mouvements de lutte dans des carcans qui n’offrent aucune perspective d’avancée pour la classe ouvrière. Ainsi, lorsque les fonctionnaires subiront des attaques contre leur salaire et les conditions de travail, ils seront amenés à manifester, chaque groupe devant son pouvoir de tutelle (fédéral, communautaire, régional, provincial, communal, ...). Dans le passé, on a même vu des manifs ne sachant pas exactement devant quel ministère manifester ! D’autre part, les syndicats n’hésitent pas à entraîner la lutte ouvrière vers le terrain pourri de la division régionale, voire des intérêts nationalistes. Ainsi, les enseignants néerlandophones et francophones sont appelés à lutter pour des revendications différentes dans chacune des régions. Et récemment encore, les organisations syndicales appelaient les travailleurs à manifester pour une sécurité sociale belge unitaire, contre les velléités des nationalistes flamands de la régionaliser. De cette manière, ils essaient de les entraîner sur le terrain du nationalisme belge, flamand ou wallon.
Le régionalisme et le (sous-)nationalisme sont donc des armes fondamentales de la bourgeoisie dans son combat contre les travailleurs, et celle-ci est particulièrement experte dans leur utilisation. Déjà, lors de réactions aux plans drastiques d’austérité pendant les années 1980, la division entre ouvriers wallons « extrémistes » et flamands « modérés » fut son arme centrale pour s’opposer aux mouvements massifs de grèves en 1983 et 1986. Aujourd’hui, le battage communautaire intense de la bourgeoisie, qui se développe en réalité de manière quasi ininterrompue depuis l’été 2008, crée pour la classe ouvrière effectivement des conditions difficiles pour la mobilisation, pour la lutte et surtout pour l’extension de celle-ci. Ceci explique pourquoi les réactions ouvrières sont jusqu’à présent moins marquées que dans les pays voisins comme la France ou l’Allemagne. En même temps, l’intensité du battage et la prudence de Sioux avec laquelle la bourgeoisie avance ses mesures sont aussi révélatrices de la peur de la bourgeoisie face à une classe ouvrière qui a montré dans les années 1970 et 80 sa combativité. Plus que jamais, dans ce contexte de campagnes, les révolutionnaires doivent souligner que les ouvriers, d’où qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, se battent contre les mêmes attaques, pour la défense des mêmes intérêts. Ils doivent réaffirmer avec force que la classe ouvrière n’a pas de patrie, ni flamande, ni wallonne, ni belge.1
Jos / 15.09.10
1 Voir également la série: "Le prolétariat face à l’Etat belge." (Internationalisme n° 319/321/322)
Internationalisme no. 348
- 1277 lectures
Nationalisme flamand ou sentiments anti-flamands des francophones : le nationalisme est une arme pour briser la lutte unitaire contre l'austérité
Alors qu’une résistance croissante contre le tsunami de mesures d’austérité se développe en France et dans d’autres pays d’Europe (l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, ...) et que les luttes deviennent de plus en plus massives, les réactions des ouvriers en Belgique restent relativement limitées. Certes, de timides manifestations de combativité surgissent par ci et par là (Duferco à La Louvière et Charleroi, personnel de la SNCB, chauffeurs de bus en Wallonie (TEC) et en Flandre (De Lijn), transporteurs de fonds de la compagnie Brinks), mais le développement des luttes en Belgique est lourdement entravé par l’ampleur d’un constant battage nationaliste.
Alors que l’impasse politique perdure depuis 150 jours, les médias bourgeois rabâchent les revendications et les griefs des néerlandophones et des francophones. D’un côté, le discours nationaliste flamand instille avec plus ou moins de nuances les idées suivantes: «les francophones, qui nous ont toujours exploités et méprisés, sont un fardeau pour la Flandre. Au lieu de travailler et de payer des impôts pour couvrir la dette des régions francophones et payer leurs chômeurs, une Flandre indépendante pourra utiliser ces moyens pour garantir sa propre prospérité». Une variante plus policée en quelque sorte du «eigen volk eerst» («notre propre peuple d’abord») du parti d’extrême-droite Flamand Vlaams Belang. D’autre part, une campagne parallèle prend de l’ampleur du côté francophone, visant à attiser une animosité anti-flamande parmi les francophones: «ces Flamands ingrats et peu dignes de confiance, ont profité dans le passé de la solidarité wallonne pour développer leur région et maintenant, ils nous laissent tomber. Qu’ils s’en aillent : préparons un plan B pour une Belgique francophone sans ces traîtres de Flamands».
Que peuvent attendre les travailleurs belges, flamands et wallons, de telles perspectives nationalistes, de revendications d’autonomie nationale basée sur une spécificité linguistique? S’agit-il - comme l’affirment certains intellectuels «de gauche» - de revendications démocratiques qui concernent aussi la classe ouvrière?
A partir du milieu du 19e siècle, les revendications nationales occupent le devant de la scène (elles sont au cœur de la révolution de 1848 à travers l'Europe). Elles font alors partie intégrante des «revendications démocratiques» dans la mesure, notamment, où il existe une convergence entre les anciens empires (l'empire russe et l'empire autrichien) et la domination de l'aristocratie. L'appui du mouvement ouvrier à certaines de ces revendications nationales affaiblissait dès lors ces empires et donc la réaction féodale tout en ouvrant la voie à la constitution d'États-nations viables, au développement de l’économie capitaliste et à la constitution d’un prolétariat moderne. Même alors, le soutien à ces revendications nationales n’était cependant jamais automatique. Ainsi, si le mouvement ouvrier s’est fortement mobilisé pour soutenir l'indépendance de la Pologne, ce soutien ne s'est jamais appliqué à toutes les revendications nationales. Ainsi, Marx et Engels condamnent les revendications nationales des petits peuple slaves (Serbes, Croates, Slovènes, Tchèques, Moraves, Slovaques...) car elles ne peuvent conduire à la constitution d'un État national viable et qu'elles sont un obstacle aux progrès du capitalisme moderne en faisant le jeu de l'Empire russe et en entravant le développement de la bourgeoisie allemande. De même, ils ont soutenu la politique du président américain Lincoln contre la tentative de sécession des États du Sud (dans ce cas, Marx et Engels se sont donc opposés, et avec la plus grande vigueur, à une revendication d'indépendance nationale!). Quant à la Belgique, ils la considéraient comme un Etat artificiel voulu par l’Angleterre pour contrer l’essor industriel de la France (autant donc ne pas évoquer l’apport de la «nation flamande» au développement du capitalisme...).
L'attitude de soutien du mouvement ouvrier aux revendications démocratiques à cette époque-là se fondait donc essentiellement sur une situation historique où le capitalisme était encore progressif. Dans cette situation, certains secteurs de la bourgeoisie pouvaient encore agir de façon «révolutionnaire» ou «progressiste». Mais la situation change radicalement au début du 20e siècle et particulièrement avec la Première Guerre mondiale. Désormais, tous les secteurs de la bourgeoisie sont devenus réactionnaires puisque le capitalisme a achevé sa tâche historique fondamentale en soumettant l'ensemble de la planète à ses lois économiques et en développant à une échelle sans précédent les forces productives de la société (à commencer par la principale d'entre elles, la classe ouvrière). Ce système n'est plus une condition du progrès de l'humanité mais au contraire un obstacle à celui-ci. Nous sommes entrés, comme l'a dit l'Internationale communiste en 1919, dans "l'Ère des guerres et des révolutions". Dès ce moment, les revendications nationales, fondées sur la langue, la religion, la race ou toute autre spécificité, n’ont absolument plus rien de progressif et n’ont pas à être soutenues par la classe ouvrière. Au contraire, ils deviennent un moment dans la lutte impérialiste entre puissances, comme l’illustrent tragiquement les deux guerres mondiales et les nombreux conflits locaux sanglants (du Moyen-Orient jusqu’aux Balkans par exemple) et constituent une entrave au développement international des luttes de la classe ouvrière contre ses exploiteurs. Dans ce sens, le nationalisme flamand a été exploité dès la première guerre mondiale par l’impérialisme allemand et, après la seconde guerre mondiale, il a été systématiquement utilisé pour diviser la classe ouvrière (pendant la grève générale de 1960-61, par exemple).
Mais ces revendications sous-nationalistes n’affaiblissent-elles pas la bourgeoisie? Elles peuvent certes jouer un rôle dans la modification du rapport de force entre factions de la bourgeoisie, mais elles n’affaiblissent nullement la bourgeoisie en tant que totalité, bien au contraire. Celle-ci n’a aucun état d’âme à adapter une structure étatique, si cela permet de renforcer la crédibilité de son Etat et d’imposer plus efficacement son exploitation. L’exemple de l’évolution de la situation politique récente en Belgique est particulièrement instructif sur ce point.
Selon l’image répandue par les médias, les forces politiques belges vont d’échec en échec: informateurs, pré-formateurs, médiateurs, clarificateurs, réconciliateurs se sont succédé depuis 5 mois sans le moindre résultat. En examinant de plus près le jeu politique sophistiqué, on constate néanmoins l’élaboration par touches successives d’une réorganisation de l’Etat qui permettrait à l’ensemble des fractions de la bourgeoisie de s’y retrouver. Ainsi, le «pré-formateur», le socialiste francophone Di Rupo, a fait approuver les principes au sein desquels la réforme de l’Etat devrait s’inscrire. Un groupe d’experts sous la direction des médiateurs a ensuite formulé des propositions en ce qui concerne la répartition des moyens financiers entre Etat fédéral et régions, indiquant dans quel sens les partis francophones étaient prêts à faire des concessions. Le conciliateur De Wever, chef du parti nationaliste flamand, a de son côté proposé un projet d’accord révélant les concessions que les nationalistes flamands envisageaient. Enfin, pour le moment, les différents partis ont accepté l’arbitrage de la Banque Nationale et du Bureau du Plan pour chiffrer et évaluer l’impact des différents modèles de réorganisation de l’Etat mis sur la table. Ainsi, par thèses à antithèses successives, la bourgeoisie, derrière un nuage de fumée mystificateur de disputes et de querelles, recherche bien la meilleure synthèse possible pouvant répondre aux intérêts de l’ensemble de ses fractions.
Et là où toutes les fractions bourgeoises se retrouvent, c’est bien dans la volonté de faire payer la crise aux travailleurs. Dans ce sens, le maître mot de la réforme de l’Etat sera la «responsabilisation» des divers niveaux de pouvoir. L’Etat fédéral, mais aussi les diverses régions et communautés seront plus que jamais responsables pour leurs entrées et leurs dépenses, et donc aussi pour l’équilibre de leurs budgets. Plus encore que dans les régionalisations du passé, cela pourrait impliquer des impôts et des salaires différents d’une région à une autre, des variations dans les systèmes et les allocations de chômage, des statuts différents pour les fonctionnaires, etc. Les restrictions budgétaires et les attaques contre les salaires et les conditions de vie seront ainsi camouflées sous des mesures de régionalisation des budgets et de responsabilisation des régions. D’une certaine manière, l’Etat belge opère comme une multinationale qui filialise un certain nombre de ses activités au sein du groupe industriel, ce qui permet d’imposer des conditions de travail et de salaire différentes et d’opposer les travailleurs entre eux comme des concurrents.
La classe ouvrière n’a donc absolument rien à gagner dans la mise en avant de revendications nationalistes, dans la création de nouvelles entités nationales. Dans le temps, la Belgique était dominée par la bourgeoisie francophone et les ouvriers flamands avaient souvent affaire à un patron qui parlait français. Cela pouvait nourrir l’illusion qu'en refusant de parler français, ils résistaient à leur patron et à la bourgeoisie. Aujourd’hui les ouvriers flamands parlent flamand avec les cadres supérieurs et les PDG et cela n’a absolument rien changé à leurs conditions d’exploitation. Aujourd’hui, ils peuvent s’adresser à un gouvernement flamand, qui, comme l’exemple d’Opel Anvers l’a bien démontré, les défend aussi peu que le gouvernement belge. Aujourd’hui, ouvriers flamands comme francophones doivent défendre leurs conditions de vie face à des patrons francophones, flamands mais aussi américains, allemands, chinois, ... , et les campagnes nationalistes constituent une entrave majeure au développement d’une riposte large et unie:
- dans la mesure où elles appellent à l’union des travailleurs et des patrons de même nationalité, parlant la même langue, etc. contre les travailleurs d’autres nationalités, parlant d’autres langues, vus comme des concurrents, voire des ennemis;
- dans la mesure où elles multipient les divisions entre travailleurs et stimulent même les ouvriers à s’opposer les uns aux autres.
Le «divorce belge» est actuellement en plein sous la lumière des projecteurs des médias, mais l’exploitation du sous-nationalisme et du régionalisme n’est nullement un phénomène purement belge, loin s’en faut. De telles tendances centrifuges parcourent de nombreux pays et la crise et le pourrissement du système exacerbent encore plus ces tendances: on les retrouve de la Turquie au Canada, de la Bolivie à la Chine, et l’Europe de l’Ouest ne fait sûrement pas exception: développement des nationalismes catalan, basque, galicien, en Espagne, tendances autonomistes du Nord de l’Italie, velléités autonomistes en Ecosse, en Suisse ... L’expression de revendications nationalistes particulières – avec l’exacerbation générale du nationalisme et d’attitudes xénophobes dans tous les Etats - n’est qu’une des expressions de la montée du chacun pour soi qui découle de la décomposition sociale d’un système capitaliste totalement dans l’impasse.
Aujourd’hui, la faillite du capitalisme peut être constatée chaque jour et les diverses expressions de lutte seront de plus en plus amenées à se poser des questions fondamentales concernant la perspective que le capitalisme peut encore nous offrir. La bourgeoisie s’en rend parfaitement compte et sait que la politique d’austérité peut déclencher une réaction radicale de la part de la classe ouvrière. Ceci explique l’intensité des campagnes en vue de mystifier les ouvriers et les monter les uns contre les autres.
Les travailleurs ne peuvent donc sous-estimer le poison instillé par l’extension de ces revendications (sous-)nationalistes, dans le sens où, non seulement, elles véhiculent des attaque très importantes contre les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière, mais, de plus limitent la capacité de cette dernière à s’unir contre les mesures et à développer une alternative. La classe ouvrière est en effet la seule classe dans la société dans cette période de décomposition à pouvoir développer une dynamique qui va à l’encontre de l’effritement des Etats et de la dispersion des rapports de production capitalistes, une dynamique qui vise à réaliser une unité internationale à travers une «forme de gouvernement» qui correspond et répond au développement planétaire des forces productives.
Jos / 17.11.10
Journée de rencontre et de discussion 2010 : une réunion de contacts réussie, discussion dans une atmosphère ouverte
- 1593 lectures
Fin août, a eu lieu la 4ème journée de rencontre et de discussion organisée par le CCI. Nous publions ci-dessous une présentation rédigée par un collectif de présents traitant des deux sujets discutés l’un le matin et l’autre l’après-midi. Nous saluons cette contribution, point de départ pour poursuivre le débat et appelons à ce que d’autres s’y joignent en y apportant leurs réactions et commentaires.
Une salle, décorée d'affiches à propos de l'histoire du mouvement ouvrier, et avec des tables garnies de lectures politiques de plusieurs tendances: un environnement propice à la curiosité, c'est là que des contacts se sont une nouvelle fois retrouvés cette année pour une journée de discussion.
La journée organisée par un groupe de travail composé de sympathisants et de camarades du CCI, s'est déroulée fin août à Anvers, pour la quatrième fois déjà. “Au travers de réunions préparatoires, le CCI, avec les sympathisants, a pu mettre en place cette journée et a pu en approfondir son but et ses moyens”, selon le sympathisant F.
Cette fois-ci aussi, nombreux ont été les participants: surtout en provenance de Belgique, mais aussi de France et des Pays-Bas. Bien que la plupart étaient jeunes, il y avait des gens de tout âge, y compris un camarade de plus de 80 ans.
Le but était d’offrir aux sympathisants l’occasion de se rencontrer dans une ambiance détendue, de se parler, d'échanger leurs idées, de partager un repas, etc. “Avec l'impression de passer un moment entre semblables, l'isolement individuel s'envole et le sentiments d'impuissance fait place à une perspective positive”, avançait le sympathisant R.
De par l’importante participation, il apparaît qu'entre ceux qui défendent des points de vue internationalistes, anticapitalistes ou anti-réformistes, existe le besoin de se rencontrer, d'échanger des idées, de se retrouver dans une réunion générale dans laquelle un sujet est discuté.
Le soir, un barbecue était prévu. La journée était destinée à échanger des idées, à présenter du matériel, en particulier sur deux sujets qui avaient été décidés en collaboration avec les sympathisants et le groupe de travail: la crise économique et la question des réfugiés.
Les discussions qui ont animé la journée avaient pour but, en plus de la clarification politique, de donner vie à la culture du débat: faire connaître aux contacts l'atmosphère ouverte et l'ambiance fraternelle qui règnent dans les discussions que mène le CCI.
D'après le sympathisant R: «l'actuelle culture du débat du CCI, à l'intérieur et à l'extérieur, lors des journées de discussion, lors des interventions et pendant les discussions privées se caractérise par un esprit ouvert, un caractère amical, stimule et pour certains rafraîchit, en comparaison avec les chamailleries souvent dogmatiques des autres partis de gauche». Cela est confirmé par le sympathisant F: “Ces discussions m'ont enrichi non seulement du point de vue de leur contenu, mais aussi de leur forme. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'honnêteté et la loyauté des participants à la discussion”.
La discussion sur la crise économique
Dans la discussion sur la crise économique, le besoin s'est fait ressentir de développer une plus grande compréhension sur son contexte. L'introduction faite par un sympathisant a tenté d'expliquer l'actualité et a été fortement appréciée par les présents: le poids accru hors de toute proportion de la dette des États, comme la Grèce, les médias qui présentent la crise comme quelque chose de totalement nouveau, les gens qui ne croient plus que les syndicats défendent leurs intérêts, l'hésitation à prendre ses propres luttes en main, résultant dans une certaine passivité, et peu de mobilisations.
La discussion qui a suivi a principalement porté sur:
-la nature du fonctionnement du système actuel, sur l'accumulation de capital comme moteur de la recherche permanente de profit par le capitalisme. Ce profit se réalise en exploitant la force de travail, qui ne peut donc acheter la totalité de sa production. Parce qu'il y a un manque sur le plan du pouvoir d'achat, et que tous les biens produits ne peuvent plus être vendus, l'accumulation stagne. L'argent ne peut alors plus être transformé en argent, et donc ne peut plus être transformé en capital.
-les différentes formes de politique économique mises en place par la bourgeoisie pour tenir tête à la crise: le keynésianisme, le néo-libéralisme accompagné de la spéculation croissante sur les marchés financiers, la politique économique stalinienne (= capitalisme d'État), qui ont toutes trois failli.
D'autres mesures alternatives immédiates sont-elles possibles? Il n'y avait pas unanimité là-dessus. Certains pensaient que cela ne pouvait que renforcer les illusions au sein de la classe ouvrière; d'autres pensaient plutôt qu'en attendant la révolution, ce serait possible. Concernant la différence entre les pays riches et ceux du tiers-monde: un partage différent, honnête de l'abondance n'est pas possible dans le capitalisme, car tous les pays du monde sont soumis à la même dynamique!
Lorsque la bourgeoisie tente de diviser les ouvriers entre ceux des pays riches et ceux des pays pauvres, entre ceux qui vivent pour consommer et ceux qui vivent pour l'environnement, elle essaye d'imposer à la classe ouvrière sa vision de «diviser pour régner». A l'encontre de celle-ci, il n'existe qu'une seule vision, la vision totale de la classe ouvrière comme unité internationale.
La question des réfugiés et des immigrés
L'introduction sur la question des réfugiés a été préparée par un contact, membre de l'AAGU (1). Il a parlé du travail, des motivations et du contexte du groupe.
Le CCI part de l'optique et des positions de la classe ouvrière. L'AAGU dirige ses activités vers tous les réfugiés, parmi lesquels des ouvriers réfugiés. Que veut l'AAGU et comment pensent-ils atteindre leur but?
Selon la Convention de Genève de 1951, un réfugié est “une personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays”.
Les réfugiés fuient souvent la misère et la guerre, ce sont les premières victimes du capitalisme. Il n'y a pas de distinction entre réfugiés légaux et réfugiés illégaux.
Du fait de leur situation semi-illégale, ils ne sont jamais reconnus comme semblables et ne reçoivent aucun statut légal. L'État conduit la répression contre les réfugiés en envoyant régulièrement sa police militaire ou sa gendarmerie pour traquer les réfugiés illégaux ou pour les enfermer dans des camps de réfugiés ou centres de détention.
Frontex, une organisation européenne paramilitaire, tente de s'opposer à l'accès à la forteresse européenne. Les réfugiés sont emprisonnés sans aucune forme de procès, parfois pendant plus d'un an.
Le capitalisme, c'est l'individualisme, et chacun peut donc facilement être isolé et mis sous pression. Par une forme de nationalisme moderne, les réfugiés sont tenus à l'écart de la “richesse”.
Dans le capitalisme, le problème des réfugiés ne pourra jamais se résoudre. Comment le combat en faveur des réfugiés peut-il contribuer à la lutte de classe? Qu'est-ce qui s'approche le plus de la révolution: la lutte ouvrière ou le combat en faveur des réfugiés?
AAGU est pour “l'action directe”; pour la vraie lutte. Ils ont un point de vue internationaliste et ne font aucune distinction entre les différentes nationalités, ni sur la possession ou non d'un passeport. Ils sont convaincus qu'une lutte antinationale, combinée à la solidarité internationale, mène à un assaut contre le capitalisme.
AAGU pense que le combat en faveur des réfugiés est donc aussi une sorte de lutte de classe. La question des réfugiés est une des questions centrales pour la lutte de la classe ouvrière. Partout dans le monde, ce sont les ouvriers qui sont touchés, et se retrouvent dans une misère sans perspective, traités comme des parias.
Discussion vivante sur la question des réfugiés
L'introduction a été saluée et suivie d'une discussion vivante qui a abordé différents aspects de la questions des réfugiés. C'est une des questions centrales pour la classe ouvrière dans le monde entier. L'exposé a soulevé toute une série de questions, et le sujet a vivement intéressé tous les participants.
Trois approches sont possibles: raciste, humanitaire-bourgeoise et radicale de gauche, mais aucune des trois ne résout le problème des réfugiés. En fait, les deux premières se complètent mutuellement. Les organisations humanitaires bourgeoises ne sont pas en soi contre les expulsions de réfugiés illégaux. La troisième approche est fondamentalement incapable d'offrir une solution. Exactement comme la classe ouvrière qui n'a aucune solution immédiate actuellement.
Certains ont plaidé pour des frontières ouvertes, pour l'accès libre et la suppression de toute limitation au sein du système capitaliste, mais le capitalisme est incapable de gérer le flux des réfugiés. Le capitalisme en phase ascendante a aussi généré des flux de réfugiés. Mais maintenant qu'il est en pleine décadence, ils ne sont plus considérés comme une force de travail potentielle, mais comme des réfugiés dont on ne sait que faire, et qui ne peuvent occasionner que des problèmes.
La solution est la destruction du capitalisme, mais que faire en attendant? Tout ce qu'on fait n'est jamais que du replâtrage. Exiger l'ouverture des frontières? Cela ne résout rien. Cela aboutirait à l'arrivée massive de réfugiés, alors qu'il existe déjà une paupérisation totale et qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde.
Quelle attitude envers les réfugiés?
Les minorités servent de bouc émissaire. Elles sont accusées d'être à l'origine de la misère aux Pays-Bas et ailleurs dans le monde. Le capitalisme est hypocrite: il les met au travail dans différents secteurs pour un salaire de misère, mais dès qu'il n'y a plus de profit à faire, ils sont reconduits à la frontière comme étrangers indésirables.
Les réfugiés doivent-ils conserver et alimenter leur propre culture ou tendre vers une culture unitaire? Aussi bien la gauche que la droite de la bourgeoisie tentent de souligner les différences culturelles. La gauche dit que les réfugiés devraient pouvoir conserver leur identité culturelle, et selon la droite, ces différences culturelles sont tellement importantes qu'elles ne peuvent pas subsister.
La classe ouvrière aspire à lever tous les obstacles qui se dressent devant elle. Elle tend vers une culture unitaire des ouvriers en lutte. La révolution d'octobre 1917 en Russie a concerné des ouvriers et des ouvrières de plus de dix “nationalités”. Toutes et tous ont pris part à des assemblées générales et à des rassemblements massifs, et déjà là, des femmes révolutionnaires portaient des foulards ou des bonnets de leurs régions respectives.
Faut-il être solidaires avec tous les réfugiés? Impossible. Certainement avec les ouvriers réfugiés! Mais tous les réfugiés ne font pas partie de la classe ouvrière. Nous ne pouvons pas être solidaires de réfugiés bourgeois qui ont commis des crimes contre leur population dans leur pays. Les réfugiés, à cause de leur statut semi-illégal, tombent relativement vite dans la criminalité. Ce ne sont pas des criminels, mais la criminalité les utilise.
La convention de Genève, une arme aux mains de la «démocratie»
L'intervention du sympathisant M a donné à la discussion une nouvelle dimension. Il a posé le fait que cette convention «portait à première vue sur les réfugiés, mais qu'en réalité elle avait un but de propagande (…) La convention a été adoptée comme un des instruments de la guerre politique et idéologique du bloc occidental contre le bloc de l'Est (…) Les réfugiés en provenance de l'Est étaient par définition intéressants. Ils étaient systématiquement traités comme victimes innocentes du totalitarisme de l'Est et intégrés comme héros des idéaux occidentaux». On ne faisait pas de différence entre réfugiés économiques ou politiques. Selon M, il n'y avait parmi les réfugiés “pas un ouvrier qui fuyait vers l'Ouest en signe de protestation contre le maintien du travail salarié, l'érosion du pouvoir des conseils ouvriers, la décomposition du mouvement internationaliste ou en raison des relations politico-économiques avec des régimes réactionnaires”.
Les réfugiés sont utilisés par les grandes puissances dans la guerre impérialiste. Très souvent, ils servent de «tampon» dans la guerre d'un impérialisme contre un autre.
Réfugiés d'alors et d'aujourd'hui
Il y a une différence essentielle entre les réfugiés actuels et les immigrés d'avant. Entre 1750 et 1914, on émigrait surtout à cause de la faim et de la misère. Avant, il y avait nécessité et besoin d'une «armée de réserve» de main-d’œuvre pour le capitalisme. Le marché mondial n'était pas encore saturé, et de nouvelles forces de travail étaient sans cesse absorbées par l'industrie. Maintenant que le marché mondial est saturé, la surproduction est généralisée, y compris en ce qui concerne l'offre réelle de force de travail. Aujourd'hui, les gens ne fuient plus seulement la faim et la misère, mais aussi la guerre et les destructions. Et puisque le capitalisme est un système en pleine décadence, ces gens ne peuvent plus être réellement intégrés au processus du travail.
Aide-t-on les réfugiés en présentant ceux-ci comme les plus vulnérables et les ouvriers d'Europe occidentale comme ceux qui se vendent au capital? Il y a un grand danger pour les réfugiés de tomber dans le lumpenprolétariat. Seule la lutte ouvrière peut leur offrir une perspective lorsque celle-ci atteint un certain niveau. Dans ce sens, la question des réfugiés et des immigrés est une question de la classe ouvrière. Seule la classe ouvrière peut offrir une perspective aux réfugiés. Et les réfugiés ne peuvent développer une perspective que s'ils prennent part à la lutte ouvrière.
La classe ouvrière est une classe d'immigrés
L'unité de la classe ouvrière est centrale comme classe internationale: la classe ouvrière mondiale. La bourgeoisie tente en permanence de nous imposer de fausses contradictions pour individualiser les gens et canaliser leur colère. La classe ouvrière doit tout mettre en œuvre pour défendre son unité contre la bourgeoisie. Organiser une partie de la classe ouvrière (sous-classe, les précaires...) contre d'autre parties de la classe va précisément à l'encontre de la perspective que nous défendons actuellement: l'unité de la classe ouvrière mondiale, qui n'a pas de patrie.
Conclusion: c'était une discussion très vivante, avec un espace énorme pour différentes réflexions.
Collectif-28 / 31.10.2010
(1) AAGU, Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht. www.aaguwww.aagu.nl.
Vie du CCI:
Nationalisme flamand ou sentiments antiflamands des francophones : le nationalisme est une arme pour briser la lutte unitaire contre l'austérité
- 1838 lectures
Alors qu’une résistance croissante contre le tsunami de mesures d’austérité se développe en France et dans d’autres pays d’Europe (l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, ...) et que les luttes deviennent de plus en plus massives, les réactions des ouvriers en Belgique restent relativement limitées. Certes, de timides manifestations de combativité surgissent par ci et par là (Duferco à La Louvière et Charleroi, personnel de la SNCB, chauffeurs de bus en Wallonie (TEC) et en Flandre (De Lijn), transporteurs de fonds de la compagnie Brinks), mais le développement des luttes en Belgique est lourdement entravé par l’ampleur d’un constant battage nationaliste.
Alors que l’impasse politique perdure depuis 150 jours, les médias bourgeois rabâchent les revendications et les griefs des néerlandophones et des francophones. D’un côté, le discours nationaliste flamand instille avec plus ou moins de nuances les idées suivantes: «les francophones, qui nous ont toujours exploités et méprisés, sont un fardeau pour la Flandre. Au lieu de travailler et de payer des impôts pour couvrir la dette des régions francophones et payer leurs chômeurs, une Flandre indépendante pourra utiliser ces moyens pour garantir sa propre prospérité». Une variante plus policée en quelque sorte du «eigen volk eerst» («notre propre peuple d’abord») du parti d’extrême-droite Flamand Vlaams Belang. D’autre part, une campagne parallèle prend de l’ampleur du côté francophone, visant à attiser une animosité anti-flamande parmi les francophones: «ces Flamands ingrats et peu dignes de confiance, ont profité dans le passé de la solidarité wallonne pour développer leur région et maintenant, ils nous laissent tomber. Qu’ils s’en aillent : préparons un plan B pour une Belgique francophone sans ces traîtres de Flamands».
Que peuvent attendre les travailleurs belges, flamands et wallons, de telles perspectives nationalistes, de revendications d’autonomie nationale basée sur une spécificité linguistique? S’agit-il - comme l’affirment certains intellectuels «de gauche» - de revendications démocratiques qui concernent aussi la classe ouvrière?
A partir du milieu du 19e siècle, les revendications nationales occupent le devant de la scène (elles sont au cœur de la révolution de 1848 à travers l'Europe). Elles font alors partie intégrante des «revendications démocratiques» dans la mesure, notamment, où il existe une convergence entre les anciens empires (l'empire russe et l'empire autrichien) et la domination de l'aristocratie. L'appui du mouvement ouvrier à certaines de ces revendications nationales affaiblissait dès lors ces empires et donc la réaction féodale tout en ouvrant la voie à la constitution d'États-nations viables, au développement de l’économie capitaliste et à la constitution d’un prolétariat moderne. Même alors, le soutien à ces revendications nationales n’était cependant jamais automatique. Ainsi, si le mouvement ouvrier s’est fortement mobilisé pour soutenir l'indépendance de la Pologne, ce soutien ne s'est jamais appliqué à toutes les revendications nationales. Ainsi, Marx et Engels condamnent les revendications nationales des petits peuple slaves (Serbes, Croates, Slovènes, Tchèques, Moraves, Slovaques...) car elles ne peuvent conduire à la constitution d'un État national viable et qu'elles sont un obstacle aux progrès du capitalisme moderne en faisant le jeu de l'Empire russe et en entravant le développement de la bourgeoisie allemande. De même, ils ont soutenu la politique du président américain Lincoln contre la tentative de sécession des États du Sud (dans ce cas, Marx et Engels se sont donc opposés, et avec la plus grande vigueur, à une revendication d'indépendance nationale!). Quant à la Belgique, ils la considéraient comme un Etat artificiel voulu par l’Angleterre pour contrer l’essor industriel de la France (autant donc ne pas évoquer l’apport de la «nation flamande» au développement du capitalisme...).
L'attitude de soutien du mouvement ouvrier aux revendications démocratiques à cette époque-là se fondait donc essentiellement sur une situation historique où le capitalisme était encore progressif. Dans cette situation, certains secteurs de la bourgeoisie pouvaient encore agir de façon «révolutionnaire» ou «progressiste». Mais la situation change radicalement au début du 20e siècle et particulièrement avec la Première Guerre mondiale. Désormais, tous les secteurs de la bourgeoisie sont devenus réactionnaires puisque le capitalisme a achevé sa tâche historique fondamentale en soumettant l'ensemble de la planète à ses lois économiques et en développant à une échelle sans précédent les forces productives de la société (à commencer par la principale d'entre elles, la classe ouvrière). Ce système n'est plus une condition du progrès de l'humanité mais au contraire un obstacle à celui-ci. Nous sommes entrés, comme l'a dit l'Internationale communiste en 1919, dans "l'Ère des guerres et des révolutions". Dès ce moment, les revendications nationales, fondées sur la langue, la religion, la race ou toute autre spécificité, n’ont absolument plus rien de progressif et n’ont pas à être soutenues par la classe ouvrière. Au contraire, ils deviennent un moment dans la lutte impérialiste entre puissances, comme l’illustrent tragiquement les deux guerres mondiales et les nombreux conflits locaux sanglants (du Moyen-Orient jusqu’aux Balkans par exemple) et constituent une entrave au développement international des luttes de la classe ouvrière contre ses exploiteurs. Dans ce sens, le nationalisme flamand a été exploité dès la première guerre mondiale par l’impérialisme allemand et, après la seconde guerre mondiale, il a été systématiquement utilisé pour diviser la classe ouvrière (pendant la grève générale de 1960-61, par exemple).
Mais ces revendications sous-nationalistes n’affaiblissent-elles pas la bourgeoisie? Elles peuvent certes jouer un rôle dans la modification du rapport de force entre factions de la bourgeoisie, mais elles n’affaiblissent nullement la bourgeoisie en tant que totalité, bien au contraire. Celle-ci n’a aucun état d’âme à adapter une structure étatique, si cela permet de renforcer la crédibilité de son Etat et d’imposer plus efficacement son exploitation. L’exemple de l’évolution de la situation politique récente en Belgique est particulièrement instructif sur ce point.
Selon l’image répandue par les médias, les forces politiques belges vont d’échec en échec: informateurs, pré-formateurs, médiateurs, clarificateurs, réconciliateurs se sont succédé depuis 5 mois sans le moindre résultat. En examinant de plus près le jeu politique sophistiqué, on constate néanmoins l’élaboration par touches successives d’une réorganisation de l’Etat qui permettrait à l’ensemble des fractions de la bourgeoisie de s’y retrouver. Ainsi, le «pré-formateur», le socialiste francophone Di Rupo, a fait approuver les principes au sein desquels la réforme de l’Etat devrait s’inscrire. Un groupe d’experts sous la direction des médiateurs a ensuite formulé des propositions en ce qui concerne la répartition des moyens financiers entre Etat fédéral et régions, indiquant dans quel sens les partis francophones étaient prêts à faire des concessions. Le conciliateur De Wever, chef du parti nationaliste flamand, a de son côté proposé un projet d’accord révélant les concessions que les nationalistes flamands envisageaient. Enfin, pour le moment, les différents partis ont accepté l’arbitrage de la Banque Nationale et du Bureau du Plan pour chiffrer et évaluer l’impact des différents modèles de réorganisation de l’Etat mis sur la table. Ainsi, par thèses à antithèses successives, la bourgeoisie, derrière un nuage de fumée mystificateur de disputes et de querelles, recherche bien la meilleure synthèse possible pouvant répondre aux intérêts de l’ensemble de ses fractions.
Et là où toutes les fractions bourgeoises se retrouvent, c’est bien dans la volonté de faire payer la crise aux travailleurs. Dans ce sens, le maître mot de la réforme de l’Etat sera la «responsabilisation» des divers niveaux de pouvoir. L’Etat fédéral, mais aussi les diverses régions et communautés seront plus que jamais responsables pour leurs entrées et leurs dépenses, et donc aussi pour l’équilibre de leurs budgets. Plus encore que dans les régionalisations du passé, cela pourrait impliquer des impôts et des salaires différents d’une région à une autre, des variations dans les systèmes et les allocations de chômage, des statuts différents pour les fonctionnaires, etc. Les restrictions budgétaires et les attaques contre les salaires et les conditions de vie seront ainsi camouflées sous des mesures de régionalisation des budgets et de responsabilisation des régions. D’une certaine manière, l’Etat belge opère comme une multinationale qui filialise un certain nombre de ses activités au sein du groupe industriel, ce qui permet d’imposer des conditions de travail et de salaire différentes et d’opposer les travailleurs entre eux comme des concurrents.
La classe ouvrière n’a donc absolument rien à gagner dans la mise en avant de revendications nationalistes, dans la création de nouvelles entités nationales. Dans le temps, la Belgique était dominée par la bourgeoisie francophone et les ouvriers flamands avaient souvent affaire à un patron qui parlait français. Cela pouvait nourrir l’illusion qu'en refusant de parler français, ils résistaient à leur patron et à la bourgeoisie. Aujourd’hui les ouvriers flamands parlent flamand avec les cadres supérieurs et les PDG et cela n’a absolument rien changé à leurs conditions d’exploitation. Aujourd’hui, ils peuvent s’adresser à un gouvernement flamand, qui, comme l’exemple d’Opel Anvers l’a bien démontré, les défend aussi peu que le gouvernement belge. Aujourd’hui, ouvriers flamands comme francophones doivent défendre leurs conditions de vie face à des patrons francophones, flamands mais aussi américains, allemands, chinois, ... , et les campagnes nationalistes constituent une entrave majeure au développement d’une riposte large et unie:
- dans la mesure où elles appellent à l’union des travailleurs et des patrons de même nationalité, parlant la même langue, etc. contre les travailleurs d’autres nationalités, parlant d’autres langues, vus comme des concurrents, voire des ennemis;
- dans la mesure où elles multipient les divisions entre travailleurs et stimulent même les ouvriers à s’opposer les uns aux autres.
Le «divorce belge» est actuellement en plein sous la lumière des projecteurs des médias, mais l’exploitation du sous-nationalisme et du régionalisme n’est nullement un phénomène purement belge, loin s’en faut. De telles tendances centrifuges parcourent de nombreux pays et la crise et le pourrissement du système exacerbent encore plus ces tendances: on les retrouve de la Turquie au Canada, de la Bolivie à la Chine, et l’Europe de l’Ouest ne fait sûrement pas exception: développement des nationalismes catalan, basque, galicien, en Espagne, tendances autonomistes du Nord de l’Italie, velléités autonomistes en Ecosse, en Suisse ... L’expression de revendications nationalistes particulières – avec l’exacerbation générale du nationalisme et d’attitudes xénophobes dans tous les Etats - n’est qu’une des expressions de la montée du chacun pour soi qui découle de la décomposition sociale d’un système capitaliste totalement dans l’impasse.
Aujourd’hui, la faillite du capitalisme peut être constatée chaque jour et les diverses expressions de lutte seront de plus en plus amenées à se poser des questions fondamentales concernant la perspective que le capitalisme peut encore nous offrir. La bourgeoisie s’en rend parfaitement compte et sait que la politique d’austérité peut déclencher une réaction radicale de la part de la classe ouvrière. Ceci explique l’intensité des campagnes en vue de mystifier les ouvriers et les monter les uns contre les autres.
Les travailleurs ne peuvent donc sous-estimer le poison instillé par l’extension de ces revendications (sous-)nationalistes, dans le sens où, non seulement, elles véhiculent des attaque très importantes contre les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière, mais, de plus limitent la capacité de cette dernière à s’unir contre les mesures et à développer une alternative. La classe ouvrière est en effet la seule classe dans la société dans cette période de décomposition à pouvoir développer une dynamique qui va à l’encontre de l’effritement des Etats et de la dispersion des rapports de production capitalistes, une dynamique qui vise à réaliser une unité internationale à travers une «forme de gouvernement» qui correspond et répond au développement planétaire des forces productives.
Jos / 17.11.10
Géographique:
Situations territoriales:
Internationalisme - 2011
- 1464 lectures
Internationalisme no 349 - 1er trimestre 2011
- 1350 lectures
Le problème n’est pas la crise de gouvernement, mais la crise du système capitaliste
Dimanche 23 janvier, plus de trente mille citoyens, défilent dans les rues de Bruxelles sous le slogan « shame ! » pour exprimer leur exaspération face au blocage politique en Belgique et pour réclamer un gouvernement. Quelle signification donner à cette marche lancée à l’appel de cinq étudiants, ainsi qu’à d’autres actions comme celle du jeudi 17 février qui se sont répandues comme un feu de paille? Elles expriment d’abord un ras-le-bol au sein de la population et surtout parmi les jeunes. Ras-le-bol de toutes ces querelles mesquines entre les différents partis politiques qui font la Une des journaux, alors que la situation de crise économique se fait de plus en plus pressante et interpelle plus d’un sur l’avenir! Mais elles en appelaient aussi à la prise de responsabilité des forces politiques démocratiques, dix mois après le verdict électoral : «Je suis sidéré de constater qu’après tout ce temps, ce pays n’a toujours pas de gouvernement alors que les problèmes s’amoncellent: 365.000 belges en défaut de paiement, ce n’est pas une raison majeure de trouver rapidement un compromis, ça?», «Qu’y a-t-il de superficiel à demander qu’un gouvernement assure rapidement la qualité de vie de tous les belges et le futur socio-économique de tous les jeunes?» (déclarations des jeunes organisateurs, Le soir, 24.01.2011). Au-delà de l’inquiétude et de l’exaspération, deux idées maîtresses ressortent des déclarations des initiateurs du mouvement: la première, c’est qu’il faut que le pays soit gouverné pour faire face à la crise; la seconde, c’est la nécessité de solidarité pour mettre en œuvre une politique au service de l’ensemble de la population du pays!
L’Etat Belge est-il réellement paralysé sans nouveau gouvernement et n’est-il plus capable de prendre des décisions? Qu’on ne s’y méprenne pas! Certes, la bourgeoisie belge est divisée en diverses fractions nationales et régionales qui s’entre-déchirent comme une bande de loups enragés pour s’accaparer les plus beaux morceaux. Mais lorsque leurs intérêts vitaux sont menacés, celles-ci, repoussant ces conflits au second plan, s’unissent afin de défendre leurs intérêts communs: leur part de marché menacée par la pression de la crise et l’austérité à imposer pour maintenir le caractère concurrentiel de leur économie. Comme aujourd’hui, quand les instances internationales mettent sous pression la crédibilité économique et politique de l’Etat Belge, aussi bien le Fonds monétaire international que l’agence de notation Standards and Poors, au même titre qu’ils l’ont fait pour la Grèce et l’Espagne: «Si la Belgique échoue à former bientôt un gouvernement, une dégradation (de sa note de solvabilité financière) pourrait intervenir, potentiellement dans les six mois». (S1P, Le soir, 14.12.2010). Alors, face au péril, quels que soient les blocages institutionnels et les querelles communautaires, la bourgeoisie, tous partis confondus, a montré qu’elle peut parfaitement décider de se passer d’un gouvernement constitué dans les formes. Elle n’a pas hésité à mandater le gouvernement démissionnaire, en théorie limité constitutionnellement à gérer les «affaires courantes», à prendre les mesures qui s’imposent pour garantir la position concurrentielle du capital Belge: «Reste que – et là tous les constitutionnalistes sont unanimes – si le gouvernement (d’affaires courantes) argue que les mesures budgétaires, voire le budget dans son ensemble, répondent à une urgence ou sont la réponse à une menace pour le pays, il ne se trouvera personne pour le contester» (Le Soir, 2.02.11). Et en surplus, elle arrive à exploiter machiavéliquement ses propres divisions régionales, ses chamailleries sous-nationalistes pour mobiliser la population dans un appel à être gouverné, à ce que des mesures soient prises.
Et sur ce plan, qu’en est-il de cette solidarité pour mettre en œuvre une politique au service de l’ensemble de la population du pays: «nous avons prouvé aujourd’hui que cinq jeunes citoyens ont réussi là où les politiciens ont échoué: se rassembler! se rassembler sans tenir compte des barrières politiques, culturelles et sociales qui sont censées nous différencier. Se rassembler dans la solidarité, la confiance et le respect».(déclarations de jeunes, Le soir, 24.01.2011). Se rassembler certes, mais pour quoi faire, pour mener quelle politique? Pour le gouvernement et les partis «démocratiques», les objectifs de cette solidarité sont bien résumés dans le mandat que le roi a donné au gouvernement «d’affaires courantes» de Leterme: «que le gouvernement en affaires courantes prépare le budget 2011 «avec comme objectif que le solde de ce budget soit meilleur que celui convenu avec les autorités européennes» ». (Le soir 2.02.2011). Et dans un élan unanime, tous ces partis qui se disputent et s’invectivent sur les questions communautaires et linguis-tiques n’hésitent pas à s’inscrire dans ce «pacte de solidarité» pour défendre le capital national: tracer au plus vite le budget 2011, dégager 20 à 22 milliards d’euros pour ramener le déficit public à zéro d’ici 2015, contre 6 % du PIB l’année dernière, empêcher la dette de repasser l’an prochain au-dessus du seuil psychologique de 100 % du PIB, imposer l’accord interprofessionnel négocié par les «partenaires sociaux» (syndicats et patronat), afin d’imposer l’austérité sur le dos des travailleurs et de sauvegarder la position concurrentielle du capital Belge sur les marchés internationaux. Même le nationaliste Flamand radical De Wever tend la main au premier ministre démissionnaire Leterme: «Nous sommes prêts, au Parlement, à collaborer de manière constructive à l’élaboration du budget 2011 afin de lancer un message rassurant aux marchés internationaux.» (Le Soir, 24.01.2011). Et précisément, ces mesures apparaissent comme d’autant plus légitimes qu’elles ne portent pas la couleur d’un parti et apparaissent plus que jamais comme «l’émanation de l’intérêt collectif». Se ranger derrière une telle «solidarité», la solidarité pour la défense du capital national et de l’Etat démocratique, c’est accepter de se soumettre à ses exploiteurs, c’est accepter une fois de plus que les exploités soient les dindons de la farce et acceptent de payer pour un capitalisme en déliquescence.
Non, le problème, ce n’est pas que le gouvernement belge soit en crise! C’est que le système capitaliste plonge dans une crise économique mondiale effroyable. Et tout comme les gouvernements de tous les pays, l’ensemble des partis belges, unitaires ou régionalistes appellent les travailleurs à être «solidaires», c’est-à-dire à se serrer la ceinture, à accepter des sacrifices pour garantir le niveau concurrentiel du capital national. Et ils le font avec beaucoup de machiavélisme, exploitant le battage communautaire, nationaliste, (sous)-nationaliste, les chamailleries entre partis pour diviser les ouvriers, dévier leur attention, obstruer la conscience qu’ils font partie de la classe qu’on exploite au niveau international, afin de sauver un système en crise mortelle. Comme seule classe n’ayant aucun intérêt à défendre ce système en perdition, elle seule peut le renverser en se mettant en lutte internationalement pour instituer un système au service des besoins humains. « se rassembler sans tenir compte des barrières politiques, culturelles et sociales qui sont censées nous différencier. Se rassembler dans la solidarité, la confiance et le respect» Oui! Mais pas derrière les bannières nationales ou derrière la défense de la démocratie bourgeoise car la classe ouvrière n’a pas de patrie à défendre, ni d’intérêts en commun avec ses exploiteurs!
H & J /13.02.2011
Belgique : le problème n'est pas la crise du gouvernement, mais la crise du capitalisme
- 1836 lectures
Dimanche 23 janvier, plus de trente mille citoyens, défilent dans les rues de Bruxelles sous le slogan « shame ! » pour exprimer leur exaspération face au blocage politique en Belgique et pour réclamer un gouvernement. Quelle signification donner à cette marche lancée à l’appel de cinq étudiants, ainsi qu’à d’autres actions comme celle du jeudi 17 février qui se sont répandues comme un feu de paille? Elles expriment d’abord un ras-le-bol au sein de la population et surtout parmi les jeunes. Ras-le-bol de toutes ces querelles mesquines entre les différents partis politiques qui font la Une des journaux, alors que la situation de crise économique se fait de plus en plus pressante et interpelle plus d’un sur l’avenir! Mais elles en appelaient aussi à la prise de responsabilité des forces politiques démocratiques, dix mois après le verdict électoral : «Je suis sidéré de constater qu’après tout ce temps, ce pays n’a toujours pas de gouvernement alors que les problèmes s’amoncellent: 365.000 belges en défaut de paiement, ce n’est pas une raison majeure de trouver rapidement un compromis, ça?», «Qu’y a-t-il de superficiel à demander qu’un gouvernement assure rapidement la qualité de vie de tous les belges et le futur socio-économique de tous les jeunes?» (déclarations des jeunes organisateurs, Le soir, 24.01.2011). Au-delà de l’inquiétude et de l’exaspération, deux idées maîtresses ressortent des déclarations des initiateurs du mouvement: la première, c’est qu’il faut que le pays soit gouverné pour faire face à la crise; la seconde, c’est la nécessité de solidarité pour mettre en œuvre une politique au service de l’ensemble de la population du pays!
L’Etat Belge est-il réellement paralysé sans nouveau gouvernement et n’est-il plus capable de prendre des décisions? Qu’on ne s’y méprenne pas! Certes, la bourgeoisie belge est divisée en diverses fractions nationales et régionales qui s’entre-déchirent comme une bande de loups enragés pour s’accaparer les plus beaux morceaux. Mais lorsque leurs intérêts vitaux sont menacés, celles-ci, repoussant ces conflits au second plan, s’unissent afin de défendre leurs intérêts communs: leur part de marché menacée par la pression de la crise et l’austérité à imposer pour maintenir le caractère concurrentiel de leur économie. Comme aujourd’hui, quand les instances internationales mettent sous pression la crédibilité économique et politique de l’Etat Belge, aussi bien le Fonds monétaire international que l’agence de notation Standards and Poors, au même titre qu’ils l’ont fait pour la Grèce et l’Espagne: «Si la Belgique échoue à former bientôt un gouvernement, une dégradation (de sa note de solvabilité financière) pourrait intervenir, potentiellement dans les six mois». (S1P, Le soir, 14.12.2010). Alors, face au péril, quels que soient les blocages institutionnels et les querelles communautaires, la bourgeoisie, tous partis confondus, a montré qu’elle peut parfaitement décider de se passer d’un gouvernement constitué dans les formes. Elle n’a pas hésité à mandater le gouvernement démissionnaire, en théorie limité constitutionnellement à gérer les «affaires courantes», à prendre les mesures qui s’imposent pour garantir la position concurrentielle du capital Belge: «Reste que – et là tous les constitutionnalistes sont unanimes – si le gouvernement (d’affaires courantes) argue que les mesures budgétaires, voire le budget dans son ensemble, répondent à une urgence ou sont la réponse à une menace pour le pays, il ne se trouvera personne pour le contester» (Le Soir, 2.02.11). Et en surplus, elle arrive à exploiter machiavéliquement ses propres divisions régionales, ses chamailleries sous-nationalistes pour mobiliser la population dans un appel à être gouverné, à ce que des mesures soient prises.
Et sur ce plan, qu’en est-il de cette solidarité pour mettre en œuvre une politique au service de l’ensemble de la population du pays: «nous avons prouvé aujourd’hui que cinq jeunes citoyens ont réussi là où les politiciens ont échoué: se rassembler! se rassembler sans tenir compte des barrières politiques, culturelles et sociales qui sont censées nous différencier. Se rassembler dans la solidarité, la confiance et le respect».(déclarations de jeunes, Le soir, 24.01.2011). Se rassembler certes, mais pour quoi faire, pour mener quelle politique? Pour le gouvernement et les partis «démocratiques», les objectifs de cette solidarité sont bien résumés dans le mandat que le roi a donné au gouvernement «d’affaires courantes» de Leterme: «que le gouvernement en affaires courantes prépare le budget 2011 «avec comme objectif que le solde de ce budget soit meilleur que celui convenu avec les autorités européennes» ». (Le soir 2.02.2011). Et dans un élan unanime, tous ces partis qui se disputent et s’invectivent sur les questions communautaires et linguis-tiques n’hésitent pas à s’inscrire dans ce «pacte de solidarité» pour défendre le capital national: tracer au plus vite le budget 2011, dégager 20 à 22 milliards d’euros pour ramener le déficit public à zéro d’ici 2015, contre 6 % du PIB l’année dernière, empêcher la dette de repasser l’an prochain au-dessus du seuil psychologique de 100 % du PIB, imposer l’accord interprofessionnel négocié par les «partenaires sociaux» (syndicats et patronat), afin d’imposer l’austérité sur le dos des travailleurs et de sauvegarder la position concurrentielle du capital Belge sur les marchés internationaux. Même le nationaliste Flamand radical De Wever tend la main au premier ministre démissionnaire Leterme: «Nous sommes prêts, au Parlement, à collaborer de manière constructive à l’élaboration du budget 2011 afin de lancer un message rassurant aux marchés internationaux.» (Le Soir, 24.01.2011). Et précisément, ces mesures apparaissent comme d’autant plus légitimes qu’elles ne portent pas la couleur d’un parti et apparaissent plus que jamais comme «l’émanation de l’intérêt collectif». Se ranger derrière une telle «solidarité», la solidarité pour la défense du capital national et de l’Etat démocratique, c’est accepter de se soumettre à ses exploiteurs, c’est accepter une fois de plus que les exploités soient les dindons de la farce et acceptent de payer pour un capitalisme en déliquescence.
Non, le problème, ce n’est pas que le gouvernement belge soit en crise! C’est que le système capitaliste plonge dans une crise économique mondiale effroyable. Et tout comme les gouvernements de tous les pays, l’ensemble des partis belges, unitaires ou régionalistes appellent les travailleurs à être «solidaires», c’est-à-dire à se serrer la ceinture, à accepter des sacrifices pour garantir le niveau concurrentiel du capital national. Et ils le font avec beaucoup de machiavélisme, exploitant le battage communautaire, nationaliste, (sous)-nationaliste, les chamailleries entre partis pour diviser les ouvriers, dévier leur attention, obstruer la conscience qu’ils font partie de la classe qu’on exploite au niveau international, afin de sauver un système en crise mortelle. Comme seule classe n’ayant aucun intérêt à défendre ce système en perdition, elle seule peut le renverser en se mettant en lutte internationalement pour instituer un système au service des besoins humains. « se rassembler sans tenir compte des barrières politiques, culturelles et sociales qui sont censées nous différencier. Se rassembler dans la solidarité, la confiance et le respect» Oui! Mais pas derrière les bannières nationales ou derrière la défense de la démocratie bourgeoise car la classe ouvrière n’a pas de patrie à défendre, ni d’intérêts en commun avec ses exploiteurs!
H & J /13.02.2011
Géographique:
Situations territoriales:
Internationalisme no 350 - 2e trimestre 2011
- 1415 lectures
Une guerre humanitaire ? Non, une guerre impérialiste !
“Le Conseil de sécurité [de l’ONU],
- Se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l’escalade de la violence et les lourdes pertes civiles, […]
- Condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l’homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions sommaires, […]
- Considérant que les attaques généralisées et systématiques actuellement commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent constituer des crimes contre l’humanité, […]
- Se déclarant résolu à assurer la protection des civils, […]
- Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une notification à cet effet […] à prendre toutes mesures nécessaires, […] pour protéger les populations […]” (Résolution ONU 1973 – Libye, 17.03.2011).
Une nouvelle fois, les hauts dirigeants de ce monde usent de belles formules humanitaires, font des discours, la voix vibrante, sur la “démocratie”, la “paix” et la “sécurité des populations”, pour mieux justifier leurs aventures impérialistes.
Ainsi, depuis le 20 mars, une “coalition internationale” (1) mène en Libye une opération militaire d’envergure, nommée poétiquement “Aube de l’Odyssée” par les États-Unis. Chaque jour, des dizaines d’avions décollent des deux puissants porte-avions français et américain pour larguer des tapis de bombes sur toutes les régions abritant des forces armées fidèles au régime de Kadhafi (2).
En langage clair, c’est la guerre!
Tous ces Etats ne font que défendre leurs propres intérêts… à coup de bombes.
Évidemment, Kadhafi est un dictateur fou et sanguinaire. Après des semaines de recul face à la rébellion, l’autoproclamé “Guide libyen” a su réorganiser ses troupes d’élite pour contre-attaquer. Jour après jour, il a réussi à regagner du terrain, écrasant tout sur son passage, les “rebelles” comme la population. Et il s’apprêtait sans aucun doute à noyer dans leur propre sang les habitants de Benghazi quand l’opération Aube de l’Odyssée a été déclenchée.
Les frappes aériennes de la coalition ont mis à mal les forces de répression du régime et ont donc effectivement évité le massacre annoncé.
Mais qui peut croire un seul instant que ce déploiement de forces armées a réellement eu pour but le bien-être de la population libyenne?
Où était cette même coalition quand Kadhafi a fait massacrer 1000 détenus dans la prison Abu Salim de Tripoli en 1996? En réalité, c’est depuis quarante ans que ce régime enferme, torture, terrorise, fait disparaître, exécute… en toute impunité.
Où était hier cette même coalition quand Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte ou Bouteflika en Algérie faisaient tirer sur la foule lors des soulèvements de janvier et février?
Et que fait aujourd’hui cette même coalition face aux massacres qui ont lieu au Yémen, en Syrie ou à Bahreïn? Oh pardon… ici nous ne pouvons pas dire qu’elle est tout à fait absente: un de ses membres, l’Arabie Saoudite, intervient effectivement pour soutenir l’État du Bahreïn… à réprimer les manifestants! Et ses complices de fermer les yeux.
Les Sarkozy, Cameron, Obama et consorts peuvent bien se présenter fièrement comme des sauveurs, des défenseurs de la veuve et de l’orphelin, la souffrance des “civils” de Benghazi n’a été pour eux qu’un alibi pour intervenir militairement sur place et défendre leurs sordides intérêts impérialistes respectifs. Tous ces gangsters ont une raison, qui n’a rien à voir avec l’altruisme, de se lancer dans cette croisade impérialiste.
Cette fois-ci, contrairement aux dernières guerres, les États-Unis ne sont pas le fer de lance de l’opération militaire. Pourquoi? En Libye, la bourgeoisie américaine est contrainte de jouer à l’équilibriste.
D’un côté, elle ne peut pas se permettre d’intervenir massivement par voie terrestre sur le sol libyen. Cela serait perçu par l’ensemble du monde arabe comme une agression et une nouvelle invasion. Les guerres d’Irak et d’Afghanistan ont en effet encore renforcé l’aversion généralisée pour “l’impérialisme américain, allié d’Israël”. Et le changement de régime en Égypte, traditionnel allié de l’Oncle Sam, est venu affaiblir un peu plus sa position dans la région (3).
Mais de l’autre, ils ne peuvent rester en dehors du jeu sans risquer de décrédibiliser totalement leur statut de “combattant pour la démocratie dans le monde”. Et il est évidemment hors de question pour eux de laisser le terrain libre au tandem France/Grande-Bretagne.
La participation de la Grande-Bretagne a un double objectif. Elle aussi tente, auprès des pays arabes, de redorer son blason terni par ses interventions en Irak et en Afghanistan. Mais elle essaye aussi d’habituer sa propre population à des interventions militaires extérieures qui ne manqueront pas de se multiplier à l’avenir. “Sauver le peuple libyen de Kadhafi” est l’occasion parfaite pour cela (4).
Le cas de la France est un peu différent. Il s’agit du seul grand pays occidental à jouir d’une certaine popularité dans le monde arabe, acquise sous De Gaulle et amplifiée par son refus de participer à l’invasion de l’Irak en 2003.
En intervenant en faveur du “peuple libyen”, le président Sarkozy savait parfaitement qu’il serait accueilli les bras grands ouverts par la population et que les pays voisins verraient d’un bon œil cette intervention contre un Kadhafi beaucoup trop incontrôlable et imprévisible à leur goût. Et effectivement, à Benghazi, ont retenti des “Vive Sarkozy”, “Vive la France” (5). Une fois n’est pas coutume, l’État français est parvenu ici à profiter ponctuellement de la mauvaise posture américaine.
Le président de la République française en a aussi profité pour se rattraper suite aux bourdes successives de son gouvernement en Tunisie et en Égypte (soutiens aux dictateurs finalement chassés par les révoltes sociales, accointances notoires pendant ces luttes entre ses ministres et les régimes locaux, proposition d’envoyer ses forces de police pour épauler la répression en Tunisie…).
Nous ne pouvons pas ici détailler les intérêts particuliers de chaque Etat de la coalition qui frappe aujourd’hui la Libye mais une chose est sûre, il ne s’agit en rien d’humanisme ou de philanthropie! Et il en est exactement de même pour ceux qui, réticents, se sont abstenus de voter la résolution de l’ONU ou alors du bout des doigts:
La Chine, la Russie et le Brésil sont très hostiles à cette intervention tout simplement parce qu’ils n’ont rien à gagner au départ de Kadhafi.
L’Italie, elle, a même tout à perdre. Le régime actuel assurait, jusqu’à maintenant, un accès facile au pétrole et un contrôle draconien des frontières. La déstabilisation du pays peut remettre tout cela en cause.
L’Allemagne d’Angela Merkel est encore aujourd’hui un nain militaire. Toutes ses forces sont engagées en Afghanistan. Participer à ces opérations aurait révélé un peu plus au grand jour cette faiblesse. Comme l’écrit le journal espagnol El País, “Nous assistons à une réédition du rééquilibrage constant de la relation entre le gigantisme économique allemand, qui s’est manifesté pendant la crise de l’euro, et la capacité politique française, qui s’exerce aussi à travers la puissance militaire”(6).
Finalement, la Libye, comme l’ensemble du Moyen-Orient, ressemble aujourd’hui à un immense échiquier où les grandes puissances tentent d’avancer leurs pions.
Pourquoi les grandes puissances interviennent-elles maintenant?
Cela fait des semaines que les troupes de Kadhafi avancent vers Benghazi, le fief des rebelles, massacrant tout ce qui bouge sur leur passage. Pourquoi les pays de la coalition, s’ils avaient de tels intérêts à intervenir militairement dans la région, ont-ils tant attendu?
Dans les premiers jours, le vent de révolte qui a soufflé en Libye venait de Tunisie et d’Égypte. La même colère contre l’oppression et la misère embrasait toutes les couches de la société. Il était donc hors de question pour les “Grandes démocraties de ce monde” de soutenir réellement ce mouvement social, malgré leurs beaux discours condamnant la répression. Leur diplomatie refusait hypocritement toute ingérence et vantait le “droit des peuples à faire leur propre histoire”. L’expérience enseigne qu’à chaque lutte sociale, il en est ainsi: la bourgeoisie de tous les pays ferme les yeux sur les plus horribles répressions, quand elle ne leur prête pas directement main forte!
Mais en Libye, ce qui semblait avoir commencé comme une véritable révolte de “ceux d’en bas”, avec des civils sans armes, partant courageusement à l’assaut des casernes des militaires et incendiant les QG des prétendus “Comités du Peuple” s’est rapidement transformé en une sanglante “guerre civile” entre fractions de la bourgeoisie. Autrement dit, le mouvement a échappé des mains des couches non-exploiteuses. La preuve en est que l’un des chefs de la rébellion et du CNT (Conseil National de Transition) est Al Jeleil, l’ancien ministre de la Justice de Kadhafi! Cet homme a évidemment autant les mains couvertes de sang que son ancien “Guide” devenu son rival. Autre indice, alors que “les prolétaires n’ont pas de patrie”, ce gouvernement provisoire s’est donné pour drapeau les couleurs de l’ancien royaume de Libye. Et enfin, Sarkozy a reconnu les membres du CNT comme les “représentants légitimes du peuple Libyen”.
La révolte en Libye a donc pris une tournure diamétralement opposée à celle de ses grandes sœurs tunisienne et égyptienne. Ceci est principalement dû à la faiblesse de la classe ouvrière de ce pays. La principale industrie, le pétrole, embauche presque exclusivement des travailleurs venus d’Europe, du reste du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique. Ceux-là, dès le début, n’ont pas pris part au mouvement de contestation sociale. Résultat, c’est la petite-bourgeoisie locale qui a donné sa coloration à la lutte, d’où la mise en avant du drapeau national par exemple. Pire! Les travailleurs “étrangers”, ne pouvant alors se reconnaître dans ces combats, ont fui. Il y a même eu des persécutions de travailleurs noirs entre les mains des forces “rebelles”, car il y avait de nombreuses rumeurs selon lesquelles certains mercenaires d’Afrique noire avaient été recrutés par le régime pour écraser les manifestations, ce qui jetait la suspicion sur tous les immigrants venant de là.
Luttes ouvrières versus guerres impérialistes
Ce retournement de situation en Libye a des conséquences dépassant largement ses frontières. La répression de Kadhafi d’abord et l’intervention de la coalition internationale ensuite, constituent un coup de frein à tous les mouvements sociaux de la région. Cela permet même aux autres régimes dictatoriaux contestés de se livrer sans retenue à une répression sanglante: c’est le cas à Bahreïn où l’armée saoudienne a prêté main forte au régime en place pour réprimer violemment les manifestations (7); au Yémen où le 18 mars les forces gouvernementales n’ont pas hésité à tirer sur la foule, faisant 51 morts supplémentaires; et plus récemment en Syrie.
Cela dit, il n’est pas du tout sûr qu’il s’agisse là d’un coup fatal. La situation libyenne pèse, tel un boulet attaché aux pieds du prolétariat mondial, mais la colère est si profonde face au développement de la misère qu’elle ne la paralyse pas totalement. Au moment où nous écrivons ces lignes, il faut s’attendre à des manifestations à Riyad, alors même que le régime saoudien a déjà décrété que toutes les manifestations sont contraires à la charia. En Égypte et en Tunisie, où la “révolution” est censée avoir déjà triomphé, il y a des affrontements permanents entre les manifestants et l’État, maintenant “démocratique”, qui est administré par des forces qui sont plus ou moins les mêmes que celles qui ont mené la danse avant le départ des “dictateurs”. De même, des manifestations perdurent au Maroc, malgré l’annonce par le roi Mohammed VI de l’avènement d’une monarchie constitutionnelle.
Quoi qu’il en soit, pour toutes ces populations prises sous le joug de terribles répressions, et parfois sous les bombes démocratiques des différentes coalitions internationales, le ciel ne s’éclaircira vraiment que lorsque le prolétariat des pays centraux, en particulier d’Europe occidentale, développera à son tour des luttes massives et déterminées. Alors, armé de son expérience, rompu notamment aux pièges du syndicalisme et de la démocratie bourgeoise, il pourra montrer ses capacités à s’auto-organiser et ouvrir la voie d’une véritable perspective révolutionnaire, seul avenir pour toute l’humanité.
Être solidaire de tous ceux qui tombent aujourd’hui sous les balles, ce n’est pas soutenir le régime de Kadhafi, ni les “rebelles”, ni la coalition onusienne! Il faut au contraire dénoncer tous ceux-là comme des chiens impérialistes!
Être solidaire, c’est choisir le camp de l’internationalisme prolétarien, lutter contre nos propres exploiteurs et massacreurs dans tous les pays, participer au développement des luttes ouvrières et de la conscience de classe partout dans le monde!
Pawel /25.03.2011
1) Royaume-Uni, France, États-Unis en particulier, mais aussi Italie, Espagne, Belgique, Danemark, Grèce, Norvège, Pays-Bas, Émirats, Arabe Unis et Qatar.
2) A en croire les médias occidentaux, seuls les hommes de main de Kadhafi meurent sous ces bombes. Mais souvenons-nous qu’au moment de la Guerre du Golfe, ces mêmes médias avaient aussi fait croire à une “guerre propre”. En réalité, en 1991, au nom de la protection du “petit Koweït” envahi par l’armée du “boucher” Saddam Hussein, la guerre avait fait plusieurs centaines de milliers de victimes.
3) Même si la bourgeoisie américaine a réussi à limiter les dégâts en soutenant l’armée pour remplacer le régime honni par la population
4) Il faut se souvenir ici qu’en 2007, à Tripoli, l’ex-Premier ministre britannique Tony Blair embrassait chaleureusement le colonel Kadhafi, en le remerciant de la signature d’un contrat avec BP. Les dénonciations actuelles du “dictateur fou” ne sont que purs cynisme et hypocrisie
et un contrôle draconien des frontières.
5) Rappelons que la bourgeoisie française ne fait là, elle aussi, que retourner une nouvelle fois sa veste, elle qui a reçu en grande pompe Kadhafi en 2007. Les images de sa tente plantée au beau milieu de Paris ont d’ailleurs fait le tour du monde et ridiculisé encore un peu plus Sarkozy et sa clique. Mais aujourd’hui, c’est un nouveau film qui nous est joué : “OTAN en emporte l’auvent”
6) https://www.elpais.com/articulo/ internacional/guerra/europea/ elpepuint/20110321elpepiint_6/Tes
7) Ici aussi d’ailleurs, la faiblesse de la classe ouvrière favorise ces répressions. Le mouvement y est en effet dominé par la majorité chiite, soutenue par l’Iran
Séismes, tsunami et accidents nucléaires au Japon : le capitalisme est une horreur
- 1501 lectures
“Le pire est à craindre!” Telle est la tonalité qui s’étale maintenant sur toutes les manchettes de journaux, dans tous les médias comme dans la bouche des dirigeants de la planète eux-mêmes. Mais le pire est déjà là! Parce que du tremblement de terre au tsunami puis aux accidents nucléaires qui n’en finissent pas, la population japonaise se trouve dans une situation effroyable. Et parce que ce sont aussi des millions de gens sur la planète qui vivent dès aujourd’hui sous l’épée de Damoclès du nuage nucléaire dégagé des réacteurs de Fukushima. Cette fois, il ne s’agit pas d’un pays pauvre comme Haïti ou l’Indonésie qui est frappé de plein fouet mais le cœur d’un des États les plus industrialisés du monde, particulièrement spécialisé dans les technologies de pointe.
Un pays qui connaît les effets dévastateurs de l’énergie nucléaire, qui a été le premier à subir les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945.
C’est le capitalisme qui rend l’humanité plus vulnérable aux catastrophes naturelles
Une fois de plus, la folie du capitalisme et l’irresponsabilité de la bourgeoisie explosent au grand jour. Le monde prend conscience seulement aujourd’hui que des millions de personnes ont été entassées dans des maisons de bois le long de rivages côtiers, menacés en permanence par le risque de séismes et de vagues géantes qui engloutissent tout. Et cela sur les terres de la troisième puissance économique mondiale!
Comme si cela ne suffisait pas, des centrales nucléaires, qui constituent partout de véritables bombes à retardement, ont été construites elles aussi à la merci des tremblements de terre et des tsunamis. La plupart des centrales nucléaires du Japon ont été construites il y a 40 ans, non seulement dans des zones très peuplées mais aussi près des côtes. Elles sont donc particulièrement exposées aux inondations. Ainsi, sur les 55 réacteurs japonais répartis sur 17 sites, 11 ont été touchés par le sinistre. Résultat immédiat, la population est déjà exposée à des taux de radiations allant officiellement (1) jusqu’à plus de 40 fois la normale jusqu’à Tokyo, située à 250 km de Fukushima, radiations pourtant déclarées “sans risque” par le gouvernement japonais! Et il n’y a pas que les centrales qui ont été frappées, mais aussi les complexes pétrochimiques construits au bord de la mer et dont un certain nombre ont été incendiés, ce qui vient ajouter au désastre et à la catastrophe écologique en cours.
La bourgeoisie tente encore de nous faire croire que c’est la faute à la nature, que l’on ne peut prévoir la force des séismes et l’amplitude des tsunamis. Ce qui est vrai. Mais ce qui est surtout frappant, c’est comment le capitalisme, tout en ayant développé depuis deux siècles et de façon phénoménale les connaissances scientifiques et les moyens techniques qui pourraient être mis à profit pour prévenir ce genre de catastrophe, fait courir en permanence des dangers monstrueux à l’humanité. Le monde capitaliste actuel a d’énormes moyens technologiques mais est incapable de les utiliser pour le bien être de l’humanité, seul compte à ses yeux le profit du capital… au détriment de nos vies. Depuis la catastrophe de Kobe en 1995, l’État japonais avait par exemple développé une politique de construction de bâtiments antisismiques qui ont tenu, mais qui sont restés destinés aux plus riches ou aux immeubles de bureaux des métropoles.
Les gros mensonges de la bourgeoisie
Aujourd’hui, les comparaisons abondent avec de précédents accidents nucléaires majeurs, en particulier avec la fusion sans explosion du réacteur de Three Mile Island aux États-Unis en 1979. Celle-ci n’avait causé officiellement aucun décès. Par contre, tous les responsables politiques affirment que, “pour l’heure”, il ne s’agit pas d’un événement aussi grave que celui de l’explosion de la centrale de Tchernobyl en 1986. Doit-on donc être rassuré par ces propos outrageusement optimistes? Comment évaluer le danger réel pour la population vivant au Japon, en Asie, en Russie, aux Amériques… et dans le monde? La réponse ne fait aucun doute?: les conséquences vont de toute façon être dramatiques. Il y a d’ores et déjà une pollution nucléaire majeure au Japon et les responsables de Tepco qui exploitent les centrales japonaises ne peuvent faire face au risque d’explosion qu’en bidouillant au jour le jour et en exposant sans vergogne la vie de centaines d’employés et de pompiers à des taux de radiations fatals. Ici d’ailleurs se révèle une différence fondamentale entre la bourgeoisie et le prolétariat. D’un côté, une classe dominante n’hésitant pas à envoyer à la mort “son” personnel et, plus largement encore, à mettre en danger la vie de dizaines de milliers de personnes au nom de son sacro-saint profit. De l’autre, des ouvriers prêts à se sacrifier, à subir l’agonie lente et insoutenable des irradiés, pour l’humanité.
Aujourd’hui, l’impuissance de la bourgeoisie est telle qu’après une semaine de tentatives désespérées pour refroidir les réacteurs endommagés, ses spécialistes en sont réduits à jouer aux apprentis sorciers en tentant de rebrancher sur le réseau électrique les différents systèmes de refroidissement des cœurs des centrales. Personne ne sait ce que cela peut donner: soit les pompes fonctionnent correctement et la chaleur baissera effectivement, soit les dégâts causés sur les câbles et appareils engendrent des courts-circuits, des incendies et des… explosions! La seule solution sera alors de recouvrir la centrale de sable et de béton, comme… à Tchernobyl (2). Face à de telles atrocités présentes et à venir, le discours de nos exploiteurs est toujours le même: le mensonge!
En 1979, Washington avait menti sur les conséquences radioactives de la fusion du cœur de la centrale, tout en évacuant malgré tout 140.000 personnes; si aucun mort direct n’a été à déplorer, les cancers s’étaient ensuite multipliés dans leurs rangs (entre 2 et 10 fois), ce que le gouvernement américain n’a jamais voulu reconnaître.
Concernant la centrale de Tchernobyl, atteinte de graves déficiences de sa structure et de son entretien, le gouvernement russe avait caché durant des semaines l’urgence de la situation. Ce n’est qu’après l’explosion du réacteur et le dégagement d’un immense nuage nucléaire se dispersant à des kilomètres de hauteur et à des milliers de kilomètres alentour que le monde entier a perçu l’ampleur de la catastrophe. Mais il ne s’agit pas là d’une spécificité stalinienne. Les responsables occidentaux ont fait exactement de même. A l’époque, l’État français s’était d’ailleurs même particulièrement distingué dans la menterie XXL en nous racontant que le nuage se serait arrêté pile poil aux frontières orientales de la France! Autre fait édifiant, aujourd’hui encore, l’OMS (Organisation mondiale pour la santé), indéniablement liée à l’AIEA (Agence internationale pour l’énergie atomique), dresse un bilan dérisoire et même ridicule de l’explosion de Tchernobyl : 50 morts, 9 décès d’enfants de cancers et 4.000 cancers potentiellement mortels! En réalité, selon une étude de l’Académie des sciences de New York, 985.000 personnes ont péri à cause de cet accident nucléaire (3). Et ce sont aujourd’hui ces mêmes organismes qui sont chargés de dresser le bilan de Fukushima et de nous informer sur les risques! Comment, dès lors, leur accorder le moindre crédit? Par exemple, que vont devenir ceux qu’on nomme “les liquidateurs” (ceux qui interviennent aujourd’hui en urgence) de Fukushima quand on sait qu’à Tchernobyl, “des 830.000 “liquidateurs” intervenus sur le site après les faits, 112.000 à 125.000 sont morts” (4). Encore aujourd’hui, la bourgeoisie s’efforce de cacher que le noyau de cette centrale est toujours hautement à risque puisqu’il est aujourd’hui nécessaire et urgent de confiner le cœur du réacteur sous une énième couche de béton comme elle a caché que les centrales de Fukushima ont connu pas moins de 200 incidents au cours de ces dix dernières années!
Tous les pays mentent sur la réalité du danger nucléaire! L’ État français ne cesse de déclarer avec aplomb que les 58 réacteurs nucléaires de l’Hexagone sont parfaitement sous contrôle, alors que la plupart des centrales sont soit sur des zones sismiques, soit en zone maritime ou fluviale inondable. Durant la tempête de 1999, durant laquelle un vent violent avait causé d’importants dégâts sur tout le territoire national et fait 88 morts en Europe, l’inondation de la centrale du Blayais, proche de Bordeaux, avait déjà failli provoquer la fusion d’un réacteur. Peu de gens l’ont su. Parlons encore de la centrale de Fessenheim dont la vétusté est telle qu’elle doit fermer depuis des années. Mais à coups de pièces de rechange (non homologuées pour bon nombre d’entre elles), elle continue tant bien que mal à fonctionner, avec des taux d’irradiation sans doute catastrophiques pour les personnels de maintenance. C’est cela, “avoir le contrôle” et prétendre à la “transparence”.
Dès le début du tremblement de terre au Japon, vendredi 11 mars, les médias aux ordres nous avaient asséné avec l’aplomb qui les caractérise que les centrales nucléaires japonaises étaient parmi les plus “sûres” au monde. Pour nous dire le contraire deux jours après et rappeler que l’entreprise Tepco, qui gère les centrales japonaises, avait déjà caché par le passé certains incidents nucléaires irradiants. En quoi les centrales en France où “en l’espace de dix ans, le nombre d’incidents mineurs et d’anomalies sur les installations nucléaires a doublé” (5), comme ailleurs dans le monde, sont elles “plus sûres”? En rien. “Environ 20 % des 440 réacteurs civils en activité dans le monde sont situés dans des zones “d’importante activité sismique”, selon l’Association mondiale du nucléaire (World Nuclear Association, WNA), un groupement d’industriels. Certains des 62 réacteurs en construction sont également dans des zones à risque sismique, tout comme nombre des 500 autres projets en particulier dans les pays à économie émergente. De nombreuses centrales – y compris les quatre réacteurs de Fukushima endommagés par le tsunami du 11 mars – se trouvent sur ou près du “cercle de feu”, un arc de 40 000 km de failles tectoniques qui entoure le Pacifique” (6).
Ainsi, des informations sérieuses “laissent entendre que les éléments radioactifs circulent de plus en plus. Par exemple, alors que le plutonium n’existait pas dans la nature avant 1945, on en trouve désormais dans les dents de lait des enfants britanniques” (7), et bien que la Grande-Bretagne ait cessé son programme nucléaire civil.
Le capitalisme pousse l’humanité vers de plus en plus de désastres
Et au Japon, il n’y a pas que la catastrophe nucléaire en marche, mais aussi une autre catastrophe humanitaire. Ainsi, la troisième puissance économique mondiale s’est trouvée plongée en quelques heures dans une situation de crise sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Les mêmes ingrédients terrifiants y sont présents: destructions massives, morts par dizaines de milliers et pour finir, irradiations, comme à l’issue des bombardements atomiques de Nagasaki et d’Hiroshima.
Des millions de gens au Nord-est du Japon survivent sans électricité, sans eau potable, avec des vivres en diminution constante, quand elles ne sont pas contaminées. 600.000 personnes ont été déplacées, à cause du tsunami qui a dévasté des villes entières face au Pacifique et à cause du risque nucléaire, dans le plus grand dénuement, subissant le froid et la neige. Contrairement à ce qu’annonce le gouvernement nippon, qui n’a cessé de minimiser la gravité de la situation, et de sous-évaluer le nombre de victimes, ne livrant l’augmentation du nombre de morts qu’au compte-gouttes, jour après jour, on peut déjà, et sans aucun doute, compter les morts par dizaines de milliers dans tout le pays. La mer ne cesse de rejeter des cadavres sur les côtes. Le tout sur fond de destructions gigantesques d’habitations, de bâtiments, d’infrastructures hospitalières, d’écoles…
Ce sont des villages, des immeubles, des trains, voire des villes entières, qui ont été emportés par la vague du tsunami qui a frappé la côte nord-est du Japon. Dans certaines villes, encastrées dans des vallées généralement étroites comme à Minamisanriku, c’est jusqu’à plus de la moitié des 17.000 habitants qui ont été emportés et ont péri. Avec le temps d’alerte de 30 minutes annoncé par le gouvernement, les routes ont été rapidement embouteillées, mettant les “retardataires” à la merci des vagues.
La population a été saluée par tous les médias occidentaux pour son “exemplaire courage” et sa “discipline”, population que le premier ministre japonais appelle à “reconstruire le pays à partir de zéro”, autrement dit, en langage clair, la classe ouvrière vivant dans ce pays doit maintenant s’attendre à de nouvelles privations, à une exploitation accrue et à une aggravation de la misère. Certes, cela fait joli pour entretenir les images d’Épinal qu’on nous déverse depuis des décennies, celle d’une population servile qui fait du sport avec son patron le matin, qui se tait et se fait exploiter en silence, et qui reste gentiment stoïque et aux ordres pendant que les bâtiments s’écroulent sur sa tête. Bien sûr, la population japonaise est d’un courage extraordinaire, mais la réalité de son “stoïcisme” décrite dans les journaux est totalement différente. En-dehors des centaines de milliers qui s’entassent dans des gymnases ou autres locaux collectifs et parmi lesquels la colère monte inexorablement à juste titre, des centaines de milliers d’autres cherchent à s’enfuir, dont un nombre grandissant des quelque 38 millions d’habitants de Tokyo et sa banlieue. Et ceux qui restent ne le font pas pour “braver le danger et la fatalité”, mais parce qu’ils n’ont pas d’autre choix. Par manque de moyens financiers et pour aller où ? Et pour être “accueilli” où? De toute façon, être un “réfugié environnemental” constitue une indécence aux yeux de la bourgeoisie. Environ 50 millions de gens seront contraints dans les années à venir de migrer pour des raisons environnementales mais ne connaissent pas de “statut” au regard de la Convention des Nations Unies, même s’ils sont victimes d’une catastrophe, fût-elle “nucléaire”. En clair, les Japonais sans le sou qui vont chercher à échapper à la catastrophe nucléaire, ou simplement à se reloger quelque part, se verront refuser le “droit d’asile”, partout dans le monde.
Ce système d’exploitation forcenée est moribond et chaque jour plus inhumain. Alors que d’immenses connaissances et de gigantesques forces technologiques ont été accumulées par l’Homme, la bourgeoisie est incapable d’en faire une force allant dans le sens des bienfaits de l’humanité, qui devrait permettre de nous prémunir contre les catastrophes naturelles. Elle œuvre au contraire avec vigueur à sa destruction, pas seulement ici ou là, mais partout dans le monde.
“Nous n’avons pas d’autre choix face à cet enfer capitaliste?: socialisme ou barbarie. Lutter contre lui ou mourir” (8)
Mulan/ 19.03.2011
1) Et l’expérience montre quel crédit nous pouvons accorder aux chiffres officiels en général et à ceux concernant le nucléaire en particulier?: le mensonge, la manipulation et la sous-estimation des dangers est ici la règle d’or des dirigeants de tous les pays!
2) La catastrophe actuelle était même attendue; comme le rapporte le Canard enchaîné du 16.03.2011: “Pas fous, les huit ingénieurs allemands d’Areva qui bossaient sur le site de la centrale de Fukushima 1 (...) surpris par le tremblement de terre “en pleine opération d’une tranche” du réacteur numéro 4 dès vendredi soir (11 mars) avaient été mis à l’abri à une quarantaine de kilomètres de la centrale” puis “acheminés à Francfort dès le dimanche 13 mars”.
3) Source: “Troublante discrétion de l’Organisation mondiale de la santé”, le Monde du 19.03.2011.
4) https://www.monde-diplomatique.fr/2010/12/KATZ/19944
5) www.europe1.fr/societe/En-France-les-incidents-nucleaires-en-hausse-497336
7) https://blog.mondediplo.net/2011-03-12-Au-Japon-le-seisme-declenche-l-alerte-nucleaire
8) Propos tenu par un intervenant sur notre forum en français au cours de la discussion sur cette catastrophe: http:/ :fr.internationalism.org/forum/312/tibo/4593/seisme-au-japon.
Géographique:
Récent et en cours:
Face à la politique anti-immigrés, solidarité de classe !
- 1557 lectures
Des étudiants et des travailleurs grecs vivant à Lyon, en France, nous ont récemment interpellés sur la situation dramatique des travailleurs immigrés implantés sur le sol grec.
Comme dans tous les pays, les travailleurs immigrés sont là-bas actuellement la cible d’une politique totalement inhumaine. Leurs conditions de vie effroyables sont tout simplement en train de les pousser vers la mort.
C’est pourquoi du 25 janvier au 9 mars, environ 300 travailleurs immigrés ont mené une grève de la faim, à Athènes et à Thessalonique. Ils réclamaient les mêmes droits politiques et sociaux que les travailleurs et travailleuses en Grèce, leur régularisation et surtout une vie plus digne. Après plus d’un mois de refus total de s’alimenter, la plupart d’entre eux présentent aujourd’hui des troubles de santé graves.
Leur Appel des immigrés, grévistes de la faim, appelé aussi l’Appel des 300, est un témoignage bouleversant. Il révèle quelle cruauté se cache derrière tous les discours policés sur la “nécessaire maîtrise des flux migratoires”. Tous ces dirigeants politiques en costard-cravate ou en tailleur de haute couture ne sont rien d’autre que des assassins (et en Grèce, les dirigeants actuels sont “socialistes”!). La réalité sur ces hommes et femmes qui vivent dans la clandestinité et qui sont dénoncés aujourd’hui par tous les ministres de l’immigration du monde comme des “profiteurs” et même des “parasites”, la voici : “Nous sommes des immigrés et des immigrées venus de toute la Grèce. Nous y sommes venus, chassés par la pauvreté, le chômage, les guerres et les dictatures.”
Cet “Appel” souligne aussi avec force que la seule façon pour nous, travailleurs immigrés ou non, de résister aux assauts du capital, c’est la solidarité de classe dans la lutte!
D’ailleurs, si le gouvernement grec a en partie cédé aux revendications des 300, en leur accordant ponctuellement quelques miettes (tel que l’allégement de taxes), ce n’est certainement pas par charité ou bonté d’âme. La classe dirigeante n’a que faire de voir 300 travailleurs crever la bouche ouverte à la suite d’une grève de la faim! Non, ce qui les a contraint à réagir, c’est l’élan d’indignation et de solidarité qui a commencé à se développer dans le pays. Comme l’ont écrit les étudiants grecs qui nous ont interpellés dans leur invitation à une réunion de solidarité avec les 300 sur Lyon: “De nombreuses actions de solidarité ont eu lieu partout dans le pays (rassemblements, manifestations, déploiements de bannières, occupations des bâtiments publics, interventions sur les chaînes de télé, de radio, pendant des événements culturels, etc.), ainsi qu’à l’étranger. Les pressions créées par tous ces mouvements de solidarité peuvent amener la victoire!”
Appel des immigrés, grévistes de la faim (Grèce)
Si nous voulons faire entendre notre voix, nous n’avons pas d’autre choix. Le 25 janvier, trois cents (300) d’entre nous commencent une grève de la faim. Nos points de lutte seront à Athènes et à Thessalonique.
Nous sommes des immigrés et des immigrées venus de toute la Grèce. Nous y sommes venus, chassés par la pauvreté, le chômage, les guerres et les dictatures. Les multinationales du monde occidental et leurs serviteurs politiques dans nos pays ne nous laissent pas d’autres choix que de risquer nos vies des dizaines de fois pour arriver jusqu’à la porte de l’Europe. L’Occident, qui pille nos pays, et où le niveau de vie est infiniment mieux (comparé au notre), est notre seul espoir de vivre comme des êtres humains. Nous sommes venus (par la voie légale ou pas) en Grèce et nous travaillons pour notre survie et pour la survie de nos enfants. Nous vivons dans la galère, et à l’ombre de l’illégalité, au profit des patrons et des organismes étatiques qui à leur tour exploitent brutalement notre travail. Nous gagnons notre pain à la sueur de notre front en rêvant d’obtenir un jour des droits égaux.
Ces derniers temps, nos conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Au fur et à mesure que les salaires et les retraites se voient rongés et que tous les prix augmentent, l’immigré est présenté comme le fautif, le coupable de la détérioration et de l’exploitation sauvage des salariés grecs et des petits commerçants. La propagande fasciste et raciste est déjà devenue la langue officielle des appareils étatiques. La terminologie fasciste est reproduite par les médias quand ils parlent de nous. Leurs “propositions” sont déjà consacrées comme politiques gouvernementales: le mur à Évros, les camps flottants et l’armée européenne dans la mer Égée, la répression brutale dans les villes, les déportations massives. Ils veulent faire croire aux travailleurs grecs que nous sommes, tout à coup, une menace pour eux, et que nous sommes les seuls coupables de la nouvelle attaque lancée par leurs propres gouvernements. La réponse à leurs mensonges et à leur incessante barbarie doit être immédiate. Et c’est à nous, aux immigrés, de la donner. Nous faisons face, avec nos propres vies comme arme, pour mettre fin à l’injustice qui nous est faite. Nous demandons la régularisation de tous les immigrés et de toutes les immigrées. Nous demandons les mêmes droits politiques et sociaux et les mêmes obligations que les salariés grecs.
Nous demandons à nos collègues travailleurs grecs et à chaque être humain qui souffre aujourd’hui de l’exploitation de sa propre sueur, de se tenir à nos côtés. Nous demandons de soutenir notre lutte, pour ne pas laisser triompher leurs mensonges, l’injustice, le fascisme et le totalitarisme des élites politiques et économiques. C’est à dire de ne pas permettre ce qui a prédominé dans nos pays et qui nous a forcés à nous expatrier afin de revendiquer une vie digne pour nous et pour nos enfants.
Nous n’avons pas d’autre moyen pour faire entendre notre voix, et pour faire entendre la voix de nos droits.
Le 25 janvier, trois cents d’entre nous ont commencé une grève de la faim, à l’échelle nationale, à Athènes et à Thessalonique. Nous mettons en danger notre vie, car de toute manière nous ne vivons pas dans la dignité. Nous préférons mourir ici, plutôt que de laisser nos enfants hériter de ce que nous avons vécu .
Janvier 2011
L’assemblée des immigrés, grévistes de la faim
Récent et en cours:
Qu'est-ce qu'une révolution ?
- 1790 lectures
Aujourd’hui, tout le monde ne parle plus que de "révolution" . Les soulèvements récents en Afrique du Nord ont été décrits comme des "révolutions" . En Irlande, le leader du Fine Gael, Enda Kenny a proclamé "une révolution démocratique" parce que maintenant, c’est à son tour d’imposer les mesures d’austérité auparavant menées par ses prédécesseurs, le Fianna Fail et le Green Party. Aux Etats-Unis, le célèbre chef Jamie Oliver combat pour une "révolution de l’alimentation" contre l’obésité. Dans les médias, nous ne nous attendons pas à voir quelque effort sérieux d’examen de l’idée de révolution telle que l’entendent les marxistes dans le mouvement ouvrier. Ce serait comme attendre de magazines de mode qu’ils se réfèrent à des "images créées pour être des objets de vénération religieuse" ou de "petites images sur un écran d’ordinateur" quand ils parlent des "icônes" .
La Commune est une publication qui se réclame de l’héritage marxiste. Sur son site Web, à la mi-février, a été publié un article "Sur l’Egypte et la révolution" . Il commence ainsi:
"Les révolutions sont en fait très communes. On est seulement en février, et il y a déjà eu deux révolutions cette année en Tunisie et en Egypte. D’autres révolutions récentes concernent la Serbie (2000), la Géorgie (2003), le Kirghizistan (2005) et l’Ukraine (2005). Il y a eu des échecs récents qui comprennent la Thaïlande (2009), le Myanmar (2007) et l’Iran 2009). Toutes ces révolutions ont été, pour utiliser le terme marxiste, des révolutions politiques plus que sociales. C'est-à-dire qu’elles ont renversé la faction qui tenait l’Etat et l’ont remplacée par une autre." La distinction que fait l’auteur entre révolution politique et révolution sociale est qu’ "une révolution sociale est celle qui ne change pas que la clique au pouvoir mais la façon dont la société est organisée" .
La vision de Trotsky, dans une période de défaite
Cette démarche, de la part de quelqu’un qui affirme être marxiste, n’est pas un cas unique. Dans La Révolution trahie, Trotsky considère l’Etat de la Russie et donne une perspective à la classe ouvrière. Prévoyant un régime plus démocratique, il écrit "… en ce qui concerne les rapports de propriété, le nouveau pouvoir n’aura pas à recourir à des mesures révolutionnaires. Il maintiendra et développera l’expérience de l’économie planifiée. Après la révolution politique – c'est-à-dire la destitution de la bureaucratie – le prolétariat devra introduire une série très importante de réformes dans l’économie, mais pas une autre révolution sociale" . Dans ce passage, la "révolution politique" veut dire ne pas avoir à "recourir à des mesures révolutionnaires" - ce n’est pas une "révolution sociale" .
Ailleurs, dans le même ouvrage, Trotsky dit: " le renversement de la caste bonapartiste aura, naturellement, des conséquences sociales sérieuses, mais en lui même, il se confinera aux limites de la révolution politique" . Ce concept de "limites de la révolution politique" se trouve aussi dans En défense du Marxisme de Trotsky, un ouvrage qui est un recueil de travaux écrits en 1939 et 1940. Dans cet ouvrage, il voit l’Etat russe "comme un complexe d’institutions sociales qui continuent à persister malgré le fait que les idées de la bureaucratie soient maintenant presque à l’opposé des idées de la Révolution d’Octobre. C’est pourquoi nous n’avons pas renoncé à la possibilité de régénérer l’Etat soviétique par une révolution politique" . En dépit du fait que l’Etat en Russie ait été l’instrument du maintien écrasant de l’exploitation et de la répression de la classe ouvrière, Trotsky pensait qu’il pouvait être régénéré par le processus de "révolution politique".
Les principes fondateurs du marxisme sur la question
Pour trouver les bases de la compréhension marxiste de ce qu’est une révolution, il faut partir de Marx.
Dans son article de 1844 ‘Notes critiques relatives à l'article " Le roi de Prusse et la Réforme sociale" par un Prussien’, Marx analyse la phrase: "Une révolution sociale avec une âme politique" et conclut que "chaque révolution dissout l’ancienne société; en ce sens, elle est sociale. Toute révolution renverse l’ancien pouvoir; en ce sens, elle est politique" .
Il continue: Mais autant une ‘révolution sociale avec une âme politique’ est paraphrase ou absurdité, autant est raisonnable une révolution politique avec une âme sociale. La révolution en tant que telle – le renversement du pouvoir établi et la dissolution des conditions anciennes- est un acte politique. Or sans révolution, le socialisme ne peut devenir réalité. Cet acte politique lui est nécessaire dans la mesure où il a besoin de détruire et de dissoudre. Mais là où commence son activité organisatrice, là où se manifeste son propre but, son âme, le socialisme rejette son enveloppe politique." (Œuvres III, La Pléïade, p. 417-418)
Il est clair que tout en se situant toujours dans le même cadre, Marx a pris en compte les développements historiques tout au long de sa vie. La préface à l’édition allemande du Manifeste Communiste dit que les événements font que quelques détails de son programme politique sont "datés". En particulier, l’expérience de la Commune de Paris (en citant La Guerre Civile en France) a démontré que "la classe ouvrière ne peut simplement s’emparer de la machinerie d’Etat existante et la faire fonctionner pour ses objectifs". L’Etat doit être détruit par la classe ouvrière pour qu’elle accomplisse la transformation de la société au niveau le plus élevé. La Commune de Paris "était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail … La domination politique du producteur ne peut coexister avec la pérennisation de son esclavage social. La Commune devait donc servir de levier pour renverser les bases économiques sur lesquelles se fonde l'existence des classes, donc, la domination de classe." (La Guerre Civile en France, Marxism.org).
Il y a eu par la suite d’autres développements dans la vision marxiste du processus révolutionnaire, en particulier L’Etat et la révolution de Lénine. Ce qu’ils ont de plus clair en commun, c’est la compréhension qu’une révolution de la classe ouvrière est "politique" en ce sens qu’elle détruit l’Etat de ses exploiteurs et "sociale" en ce sens que son but est la transformation de la société. Le "politique" et le "social" ne sont pas deux phénomènes séparés mais les deux faces d’une même lutte. Quand une faction capitaliste en remplace une autre à la suite d’élections parlementaires, quand une faction capitaliste s’empare du pouvoir grâce à un coup d’Etat militaire, ou quand la réalité force la bourgeoisie à réorganiser sa façon de fonctionner comme classe dominante, rien de tout cela n’est une "révolution" . En un mot : l’Etat capitaliste reste intact.
Les "révolutions" évoquées dans la liste de la publication La Commune ne sont pas des révolutions sociales pas plus qu’elles ne sont des révolutions politiques. Le remplacement d’une faction par une autre, du point de vue de la classe ouvrière, n’est en aucune façon une révolution. Pour la classe ouvrière, la destruction de l’Etat capitaliste est un moment politique essentiel dans la révolution sociale, une partie du processus qui peut mener à la libération de toute l’humanité.
Barrow/04.03.2011
Heritage de la Gauche Communiste:
90 ans après, l'écrasement de Cronstadt reste une tragédie toujours en débat au sein du camp révolutionnaire
- 1500 lectures
Ces dernières semaines, les discussions sur le forum du CCI ont été particulièrement animées et passionnées autour d’un événement tragique: l’écrasement, dans le sang, des insurgés de Cronstadt.
Il y a 90 ans, en 1921, des ouvriers se sont dressés face au Parti bolchevique, réclamant, entre autre, la restitution du pouvoir réel aux soviets et sans le Parti bolchevique. Le Parti communiste a alors pris la terrible décision de les réprimer.
Une participante à ce débat, prénommée Youhou, nous a envoyé la lettre que nous publions ci-dessous et que nous saluons chaleureusement. Elle y fait à la fois l’effort d’essayer de synthétiser les différents points de vue qui se sont faits jour au fil des interventions et de prendre clairement position.
Il ne s’agit pas là, en aucune manière, d‘une conclusion à la discussion. Au contraire, il nous semble que dans l’esprit de la camarade, son texte se veut être seulement une étape.
Enfin, nous nous joignons à elle quand, dans ses dernières lignes, elle lance: “Venez nous rejoindre dans ce débat passionnant! Le débat fraternel est notre meilleure arme face à l’idéologie bourgeoise” (1).
Sur le forum du CCI se déroule actuellement, à l’occasion du 90e anniversaire de la répression de Cronstadt, une discussion très animée qui mérite d’être commentée. Elle est très intéressante car finalement très représentative des positions qui traversent la classe ouvrière sur ce sujet. L’écrasement de la classe ouvrière révoltée du soviet de Cronstadt, par l’armée révolutionnaire, sur ordre du parti bolchevique en 1921 est posé sans tabou et sans langue de bois sur le forum. La volonté de tirer les leçons de ce massacre, si importantes pour la révolution future, rassemble tous les camarades sur ce forum et confirme ce que Rosa Luxemburg écrivait sur la Révolution russe: “il est clair que seule une critique approfondie, et non pas une apologie superficielle, peut tirer de tous ces événements les trésors d’enseignement qu’ils comportent.” Ce débat est marqué depuis des décennies par deux tendances diamétralement opposées: les trotskistes qui pensent que l’écrasement était une “tragique nécessité” et les anarchistes qui pensent que le Parti bolchevique en tant que parti contenait en lui les germes de cette dégénérescence et remettent en cause la nécessité même de l’existence d’un parti de la classe ouvrière.
Alors, est-ce une “erreur” ou “une nécessité” tragique?
Voici une des idées avancées par Jeannotrouge: “Le prolétariat ne peut se constituer en classe et donc ensuite, après la révolution, en classe dominante qu’à l’issu d’une lutte politique tenace en son sein, contre les influences bourgeoises portées par différentes institutions, organisations et partis prétendument “ouvriers”, lutte qui ne peut pas ne pas comporter d’épisode d’affrontement et de violence.”
Mouhamed, un peu plus nuancé, explique que les bolcheviques ne pouvaient pas faire autrement.
Mais sur ce point, je rejoins pleinement Tibo et Underthegun: l’écrasement de Cronstadt n’allait pas dans le sens de la révolution. Ce massacre n’était absolument pas nécessaire et a précipité la défaite de la révolution russe. Pourquoi? Ce sont des ouvriers qui ont été éliminés et massacrés et non des contre-révolutionnaires en col blanc comme Trotski le concédera lui-même: “Nous avons attendu aussi longtemps que possible pour que les matelots, nos camarades aveuglés, ouvrent les yeux et voient où la mutinerie les conduisait”. La société communiste ne peut pas naître de luttes fratricides: un tel massacre ne peut faire partie des armes des révolutionnaires. Tibo écrit avec raison: “Oui, nous avons un monde “enfin humain” à bâtir. Et celui-ci ne peut avoir pour fondation des cadavres des ouvriers tués par d’autres ouvriers”. Je rajouterai: et surtout de cette manière, en prenant leur famille en otage, en condamnant les soldats de l’armée de rouge s’ils refusaient de tirer... La violence de classe est nécessaire, certes, mais pour la classe ouvrière elle est déterminée par le but final qui est la libération de l’humanité du joug de l’exploitation. Les camarades, en désaccord sur ce point, ont rappelé, à juste titre, les apports des bolcheviques pour la classe ouvrière. Le Parti bolchevique sous l’impulsion de Lénine n’a jamais trahi les intérêts du prolétariat et en refusant toute politique d’alliance pour former un parti de masse, il a fait le choix de rester minoritaire parmi les ouvriers et de répéter inlassablement la nécessité de ne plus faire confiance au sociaux-démocrates. Ce parti a défendu l’internationalisme jusque dans sa chair. Les bolcheviques ont soutenu les ouvriers dans leur lutte en restant à leur côté même quand ils savaient qu’ils commettaient une erreur.
Alors comment ce parti qui avait pleinement conscience du fait que le socialisme ne s’impose pas par la force sur la classe ouvrière, et que le devoir du parti est de combattre au côté de la classe, s’est-il retrouvé armé face à elle?
Comment le parti bolchevique en est-il arrivé à commettre un tel crime ?
Le camarade Mouhamed écrit: “Pour moi, s’il y avait eu la révolution mondiale, il n'y aurait ni Cronstadt, ni rien du tout”. Il est vrai que l’enfermement de la Russie est une cause fondamentale de la débâcle de la révolution. Beaucoup d’ouvriers sont morts dans la guerre civile, les soviets se trouvent partiellement dépeuplés et se limitent pour beaucoup à des comités militaires de quelques membres qui décident des stratégies à adopter. Quand le président du Bund (parti communiste juif) demanda ce que faisait le comité central, lors du VIIe congrès des soviets, Trotsky répondit: “le CEC est sur le front!”. S’ajoute à cela des rationnements alimentaires draconiens du fait de l’Ukraine, grenier à blé de la Russie, qui l’affame. L’entrée du prolétariat allemand en contaminant les autres prolétariats d’Europe puis du monde aurait apporté un second souffle à la révolution russe. Le CCI écrit dans sa brochure sur la période de transition: “Mais le pire danger de la contre-révolution n’est venu ni des “koulaks”, ni des ouvriers lamentablement massacrés de Cronstadt, ni des “complots des blancs” que les bolcheviques voyaient derrière cette révolte. C’est sur les cadavres des ouvriers allemands massacrés en 1919 que la contre-révolution a gagné et c’est à travers l’appareil bureaucratique de ce qui était supposé être le “semi-Etat” du prolétariat qu’elle s’est le plus puissamment exprimée.” En épuisant les soviets, fondement de la dictature du prolétariat, en restant enfermé dans les frontières nationales de Russie, le Parti bolchevique s’est retrouvé face à des choix très lourds de conséquence et a commis le pire: éliminer physiquement leur frère de classe.
L’isolement de la Russie dans le processus de la révolution mondiale explique en partie l’attitude des bolcheviques mais n’explique pas pourquoi les soviets se sont retournés contre le parti: s’ils ne s’étaient pas révoltés, la question ne se serait même pas posée. Comme je le défends, ainsi qu’Underthegun, on voit très nettement, que ce soit dans les revendications du soviet de Cronstadt (“tout le pouvoir au soviet”), mais aussi dans les vagues de grèves qui avaient gagné Moscou ou Petrograd (3 régions à l’avant-garde de l’insurrection d’Octobre, soit dit en passant), qu’un fossé s’est creusé entre le parti et la classe ouvrière. Voici un message radio destiné “aux ouvriers du monde entier” enregistré le 6.03.1921: “Nous sommes partisans du pouvoir des soviets, non des partis. Nous sommes pour l’élection libre de représentants des masses travailleuses. Les soviets fantoches manipulés par le Parti communiste ont toujours été sourds à nos besoins et à nos revendications; nous n’avons reçu qu’une réponse: la mitraille [...]. Camarades! Non seulement ils vous trompent, mais ils travestissent délibérément la vérité et nous diffament de la façon la plus méprisable [...]. À Cronstadt, tout le pouvoir est exclusivement entre les mains des marins, soldats et ouvriers révolutionnaires [...]. Vive le prolétariat et la paysannerie révolutionnaire! Vive le pouvoir des soviets librement élus!”. Que l’on soit d’accord ou pas avec ces revendications, il est incontestable que les soviets s’opposent directement au parti qu’il voit désormais comme un ennemi. Pour ma part, je pense que l’assimilation du parti dans l’Etat, organe par nature réactionnaire et conservateur, a entraîné les bolcheviques à s’éloigner de la classe. Finalement, c’est l’isolement dans l’isolement. Le parti fut à la fois juge et parti et ne pouvait donc comprendre la révolte de leur camarade des soviets. Underthegun écrit très justement: “le “gouvernement bolchevique” mais c’est bien là le problème de cette révolution isolée, assiégée de toutes parts. L’urgence de la situation, les dangers multiples, ont amené les bolcheviks dès 1918 avec Brestlitovsk à assurer l’exercice du pouvoir. Or […] la dictature du prolétariat n’est pas la dictature du parti.”. Si le parti ne représente pas les intérêts d’un soviet ou d’une partie de la classe ouvrière, il doit défendre les intérêts du prolétariat mondial, et c’est justement parce que le parti était confondu dans l’Etat qu’il a manqué de clairvoyance pour donner des orientations issues du mouvement ouvrier mondial. Pris au piège de perspective immédiate liée à l’organisation de la révolution il a perdu de vue le but final: la libération de l’humanité. C’est pourquoi il ne s’agit pas d’une erreur de parcours mais bien de comprendre que la dictature du prolétariat doit être exercée par les soviets et ce au sein d’une révolution mondiale. Voici ici présentées les causes matérielles et objectives de ce crime fratricide mais il est clair que contrairement à ce que pensent Prodigy, Jeannotrouge et Mouhamed, les conditions matérielles ainsi évoquées ne sont pas complètes si elles n’intègrent pas la dimension éthique.
La question: “a-t-on le droit de dresser un bilan moral de ce drame?” a été longuement débattue
Underthegun insiste beaucoup sur le fait qu’il n’y a pas de déterminisme et que parmi les révolutionnaires au sein du parti, certains, dans des conditions identiques d’urgence, ont fait le choix de défendre leur frère à Cronstadt. Les Lénine et Trotski avaient le choix et ils ont fait celui de massacrer leurs camarades. A mon sens, la question mérite d’être posée mais les camarades Mouhamed et Prodigy objecteront dans leurs interventions: qu’“une analyse marxiste ne consiste pas à faire un bilan moral ; mais faire un bilan objectif et matérialiste. Il ne s’agit pas de condamner, de dire que c’est immoral ou pas. Il s’agit de tirer les enseignements sans sentiments humanistes.”. Bilan moral et analyse contextuelle ne s’opposent pas mais se complètent. La morale n’est pas la morale manichéenne bourgeoise, c’est le fruit d’une longue évolution tout droit issu du fait que l’homme a sélectionné la civilisation et s’exprime dans la préservation de l’espèce par la solidarité: elle est, donc, inhérente aux conditions matérielles. Le Parti bolchevique a dégénéré et s’est trouvé dans des situations inédites pour lesquelles il n’y a pas de recette. Alors, oui, il a choisi la voie qui le mènera à sa perte et, non, l’écrasement de Cronstadt n’allait pas dans le sens de la révolution. Pouvait-il faire autrement? Peut-être. Aurait-il dû le faire? C’est une certitude! Pourquoi certains ont ordonné ce massacre et d’autres s’y sont opposés? Simplement parce que face à une même situation la conscience n’est pas homogène, le lien entre conscience et conditions matérielles n’est pas mécanique. C’est pourquoi nous ne devons pas jeter sur la répression de Cronstadt le regard d’une morale sans faille forgée durant 9 décennies de luttes prolétariennes. Les révolutionnaires seront face à des choix tout aussi essentiels dans les luttes futures et Cronstadt est un “sombre trésor d’enseignements” car elle apporte avec son lot de malheur une leçon essentielle: “pas de violence au sein de la classe ouvrière!”. Si la fin ne justifie pas les moyens, elle les détermine!
Nous n’avons pu débattre de cette question sans clarifier nos positions sur le marxisme mais aussi sur le trotskisme et l’anarchisme. Venez nous rejoindre dans ce débat passionnant! Le débat fraternel est notre meilleure arme face à l’idéologie bourgeoise.
Fraternellement, Youhou
1) C'est pourquoi nous ne répondons pas ici à la camarade Youhou. Non seulement nous partageons l'essentiel de son analyse mais le débat peut et doit se poursuivre. Pour connaître néanmoins la position du CCI sur cet événement tragique, nous renvoyons nos lecteurs à deux de nos articles:
a) "La répression de Cronstadt en mars 1921: une erreur tragique du mouvement ouvrier"
b) "1921: comprendre Cronstadt", Revue internationale n° 104.
Vie du CCI:
Heritage de la Gauche Communiste:
Internationalisme no 351 - 3e trimestre 2011
- 1171 lectures
Face aux conséquences de la crise mondiale, une seule classe, un même combat !
L’Organisation des Nations Unies vient de tirer la sonnette d’alarme. Son département des Affaires économiques et sociales a intitulé son dernier rapport publié fin juin “La crise sociale globale”! Les médias ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, tous y ont vu un clair avertissement pour les bourgeoisies du monde entier: face aux différents plans d’austérité et aux effets dévastateurs de la crise économique mondiale, le risque grandit de voir partout apparaître une montée de la combativité ouvrière.
Dans tous les pays, la classe ouvrière retrouve le chemin de la lutte
Ces derniers mois ont été marqués par une actualité sociale internationale brûlante. En fait, les luttes sociales donnent l’impression de se répondre les unes aux autres, de se faire écho d’un pays à l’autre.
Durant l’automne 2010, le prolétariat vivant en France s’est mobilisé par centaines de milliers à de multiples reprises, dans d’immenses manifestations, pour protester contre une énième attaque du régime de retraite. Le fait le plus significatif de ce mouvement fut sans nul doute l’apparition, certes très minoritaire, d’assemblées spontanées et autonomes, hors de tout contrôle syndical. Qu’elles se nomment assemblées “interprofes-sionnelles”, “autonomes” ou “populaires”, elles ont chaque fois permis à quelques dizaines de travailleurs, chômeurs, étudiants, précaires et retraités de se regrouper et discuter pour se battre ensemble, collectivement. Ils ont ainsi tenté de prendre l’organisation de la lutte entre leurs propres mains. L’un des slogans les plus forts de ce mouvement et initié par la CNT-AIT à Toulouse a été?: “Libérons la parole!”.
A peine quelques semaines plus tard, c’est au tour de la jeunesse vivant en Angleterre de faire parler d’elle. Refusant une nouvelle augmentation du coût des inscriptions aux universités, ces jeunes – qui sont largement précarisés et très souvent endettés pour plusieurs années – ont rompu l’atonie sociale qui prévalait depuis les années de plomb de l’ère Thatcher. Dans les années 1980, cette “Dame de fer” de la bourgeoisie anglaise avait réussi, en effet, à briser moralement le prolétariat alors le plus combatif d’Europe, avec la défaite de la grève des mineurs. Le début du retour à la lutte de classe dans ce pays est donc un signe particu-lièrement prometteur pour le futur.
Et depuis le début de l’année 2011, les exploités ont encore fait un pas supplémentaire sur le chemin de la lutte contre le développement de la misère.
En Tunisie et en Égypte, face aux conditions de vie insupportables liées à la dégradation de la situation économique, mais aussi contre la répression et l’absence de toute liberté d’expression, de larges couches de la population se sont dressées contre les pouvoirs en place. En quelques semaines, le “Printemps arabe” et la “place Trahir” sont devenus les symboles du courage des masses face aux puissants et à la répression sanglante. Évidemment, ces “révoltes” ont été aussi marquées par d’importantes faiblesses. La lutte ne s’est pas réellement organisée collectivement au sein de ces immenses rassemble-ments sur les grandes places des villes; par exemple, à notre connaissance, il n’y a eu que très peu de réels débats collectifs en assemblées. Mais surtout, la colère s’est chaque fois focalisée sur un gouvernant, le dictateur en place (ou sur sa famille et son clan). “Ben Ali dégage!” et “Moubarak dégage!” étaient les slogans les plus populaires: il y avait là, indiscutablement, le faux espoir d’établir un nouveau régime plus humain car plus “démocratique”. Enfin, allant de pair avec cette illusion démocratique, le nationalisme a lui aussi marqué de son empreinte le “Printemps arabe”; les drapeaux nationaux ont envahi tous les lieux de rassemblement. L’ensemble de ces faiblesses est lié à la faiblesse du prolétariat dans cette région du monde; celui-ci est très combatif et courageux mais aussi très peu expérimenté. Il n’a pas été confronté, comme les travailleurs d’Europe occidentale, à des décennies de mensonges “démocratiques”, de réformes “démocratiques”, de sabotages syndicaux “démocratiques”…
Cela dit, bien plus que “la pression populaire” en général, ce sont surtout les grèves ouvrières qui ont réellement fait trembler les pouvoirs tunisien et égyptien, mais aussi américain et européen, et qui ont poussé la bourgeoisie à mettre hors circuit Moubarak et Ben Ali. Toutes les grandes bourgeoisies ont senti qu’il leur fallait éviter qu’une grève générale n’embrase totalement les grands centres industriels.
C’est d’ailleurs ce rôle, secondaire numériquement mais déterminant politiquement, que n’a pas pu jouer le prolétariat en Libye, au Yémen et en Syrie. Ici, sa quasi-inexistence n’a pu lui permettre d’empêcher le poison nationaliste de couler à flots dans les veines des “opposants” et de se répandre dans l’ensemble du mouvement, pour finalement tuer toute possibilité d’une lutte des exploités sur leur terrain de classe. Dans ces trois pays, les populations ont été enrôlées dans une guerre de cliques bourgeoises; elles n’ont là rien à y gagner et n’ont que la vie à y perdre! (1). Le “Printemps arabe” lègue donc à la classe ouvrière internationale trois leçons fondamentales:
– face au développement de la misère et à la répression sanglante, il n’y a pas d’autre choix que de relever la tête pour se battre dans la dignité. Comme le scandaient les manifestants sur la place Trahir “Maintenant, nous n’avons plus peur!”;
– la rue appartient aux exploités!;
– la force d’un mouvement de lutte contre la misère et la barbarie capitalistes dépend de la capacité de la classe ouvrière à s’organiser, à ne pas se laisser diluer dans la contestation interclassiste et à entraîner derrière ses propres mots d’ordre les autres exploités (et non le contraire).
C’est justement sur ces trois enseignements que s’est développé le “mouvement des Indignés” en Espagne.
Depuis trois ans, la crise économique frappe de plein fouet la péninsule Ibérique. Les plans d’austérité s’y succèdent les uns aux autres, engendrant une misère sans nom, et comme partout ailleurs les syndicats ne font qu’organiser des “manifestations-balades”, simulacre de lutte, pour encadrer et endiguer la colère. Mois après mois se rejoue depuis 2008 cette même scène sinistre d’un cortège de manifestants se rendant d’un point A à un point B, mobilisés pour une “journée d’action syndicale”, et rentrants chez eux démoralisés, avec un profond sentiment d’impuissance. Mais le courage et la combativité des exploités qui ont bravé la plus terrible des répressions en Tunisie et en Égypte ont allumé une flamme dans les yeux des jeunes travailleurs, chômeurs et précaires d’Espagne. Ceux que l’on appelle la “génération 600 euros” se sont inspirés des combats de leurs frères exploités de l’autre côté de la Méditerranée. Ils se sont, à leur tour, regroupés massivement sur les grandes places de plus de 70 villes du pays, notamment à Madrid et à Barcelone, pour prendre à leur tour l’organisation de la lutte entre leurs mains. “De la place Trahir à la Puerta del Sol” ou “Nous non plus, nous n’avons plus peur!”, sont autant de slogans qui témoignent de l’impact du “Printemps arabe”. Mais ces jeunes Indignés ont porté beaucoup plus loin le flambeau de la lutte.
Ils ont su organiser de grands débats collectifs à travers une multitude d’assemblées (assemblées générales ou populaires, assemblées de commissions et de quartiers…). Ils ont rejeté explicitement tous les grands partis bourgeois, de droite comme de gauche, ainsi que les centrales syndicales. Il faut dire que la présence à la tête de ce pays d’un gouvernement “socialiste” qui attaque sans relâche et férocement les conditions de vie, et la “trahison” quotidienne des syndicats pour accompagner ces attaques, ont permis une très large et profonde réflexion dans les rangs des exploités sur la véritable nature de ces officines.
Évidemment, ce mouvement a lui aussi présenté des faiblesses. En particulier, l’idéologie “alter-mondialiste”, préconisée par ATTAC et Democracia Real Ya, a désarmé en partie ce mouvement en transformant le slogan “Ni partis ni syndicats” en rejet de la “politique”. Cet “apolitisme” a permis en fait à toutes les fractions classiques de la gauche (socialistes, trotskistes, alter-mondialistes…) d’infiltrer le mouvement, de noyauter les AG et les commissions pour mieux empêcher toute possibilité d’extension massive du mouvement à l’ensemble de la classe ouvrière. Ils ont ainsi pu imposer à tous, à nouveau, leur idéologie démocratiste et réformiste (2).
Néanmoins, ce mouvement des Indignés est riche de promesses pour les luttes futures. Il est par exemple parvenu à gagner la sympathie et la solidarité des travailleurs: dans de nombreuses entreprises d’Espagne ont éclaté des grèves, des assemblées générales avec débat ont été organisées sur les places occupées par les jeunes Indignés. Et cet élan a largement dépassé les frontières. En France, en Belgique, au Mexique, au Portugal, en Chine, en Allemagne, aux États-Unis et surtout en Grèce (3), il y a eu aussi et il y a encore des assemblées régulières, bien plus minoritaires, où s’affirment la solidarité avec les Indignés et la volonté d’organiser la lutte. Au Portugal, on a pu lire des pancartes telles que “Espagne, Grèce, Irlande, Portugal?: notre lutte est internationale” (4). Mais c’est encore une fois en Espagne que la maturation de la conscience de classe a été la plus évidente. A Valence, on a pu entendre le slogan: “Ce mouvement n’a pas de frontières!”. Dans plusieurs campements ont été organisées des manifestations “pour la Révolution européenne”. Le 15 juin, il y a eu des démonstrations de soutien aux luttes en Grèce. Le 19 juin sont apparus, minoritaires, des slogans internationalistes comme “Joyeuse union mondiale” ou, en anglais, “World Revolution” (révolution mondiale). Sur la place de Catalogne à Barcelone, on a pu lire sur une pancarte le slogan: “Capitalisme, dégage!” ou encore?: “Dictature et démocratie sont les deux faces de la même médaille. Tous les États sont des assassins!”, etc. A Tarrasa (ville ouvrière de la banlieue de Barcelone), des jeunes ont affirmé, dans une assemblée générale des commissions: “Nous ne luttons pas pour la victoire immédiate, mais pour préparer le futur”.
Il s’agit là d’une avancée très importante. Évidemment, cette prise de conscience que les exploités du monde entier rament en fait dans la même galère, qu’ils sont tous marqués au fer rouge de la même exploitation capitaliste, que sans une lutte mondiale du prolétariat, nul salut… tout cela n’est pas encore partagé par tous les prolétaires et dans tous les pays. En Grèce par exemple, le mouvement est sur ce point largement en retard par rapport au mouvement des Indignés d’Espagne: les drapeaux nationaux grecs, les slogans nationalistes et anti-allemands qui jalonnent les manifestations à Athènes en témoignent. Mais de manière générale, le sentiment internationaliste avance lentement, mais sûrement, dans les têtes des exploités. Pendant des années, ce qu’on a appelé la “mondialisation de l’économie” servait à la bourgeoisie de gauche à susciter des réflexes nationalistes, ses discours consistant à revendiquer, face aux “marchés apatrides”, la “souveraineté nationale”. Autrement dit, il était proposé aux ouvriers d’être encore plus nationalistes que les bourgeois eux-mêmes! Avec le développement de la crise, mais aussi grâce à la popularisation d’Internet, des réseaux sociaux, etc., la jeunesse prolétarienne commence à renverser les choses. Il émerge un sentiment selon lequel, face à la globalisation de l’économie, il faut répondre par la “globalisation” internationale des luttes. Face à une crise économique et à une misère mondiales, la seule riposte possible est la lutte mondiale!
La responsabilité du prolétariat des pays d’Europe occidentale (5)
Jusqu’à présent, c’est donc le prolétariat d’Espagne qui a porté le plus loin les méthodes et les revendications qui vont nous permettre à l’avenir de nous unir dans la lutte en tant que classe, de nous organiser collectivement et de construire peu à peu un rapport de force en notre faveur. Et ce n’est pas là un hasard. L’Espagne est un pays touché brutalement par la crise économique mais, surtout, il est un pays démocratique d’Europe occidentale. Les prolétaires d’Espagne font partie des bataillons les plus expérimentés par des décennies de luttes, de victoires, de défaites et d’amères expériences. C’est dans les pays centraux d’Europe occidentale que la classe ouvrière est confrontée aux pièges démocratiques les plus sophistiqués. C’est dans cette région du monde (et notamment dans l’espace Schengen), composée d’une mosaïque d’États nationaux, que la question de l’internationalisme se pose de façon plus évidente. C’est sur le vieux continent européen, là où le capitalisme est né et où la bourgeoisie est la plus forte et la plus expérimentée sur le plan idéologique, que la classe exploitée pourra ouvrir une perspective et donner le signal de la révolution prolétarienne mondiale.
Cela ne veut pas dire que les combats prolétariens dans les autres parties du monde ne peuvent à leur tour rien apporter aux prolétaires d’Europe occidentale, loin de là! La classe ouvrière est une classe internationale, la lutte de classe existe partout où se font face prolétaires et capital. Les enseignements de toutes les luttes sont valables pour l’ensemble du prolétariat mondial quel que soit le lieu où elles éclatent. En particulier, l’expérience des luttes dans les pays de la périphérie influencera de plus en plus la lutte des pays centraux, comme on l’a vu en Tunisie et en Égypte. La détermination, le courage exemplaire et la massivité de la révolte des exploités de Tunisie et d’Égypte ont constitué un encouragement pour les luttes des exploités en Espagne comme dans tous les pays (par exemple en Grande-Bretagne).
Mais le prolétariat vivant en Europe occidentale a une responsabilité particulière. Ses 200 ans d’expérience doivent lui permettre de tracer le chemin vers la révolution pour tous les exploités du monde. Il doit parvenir, comme il commence timidement à le faire, à mettre en avant les méthodes de luttes qui, seules, peuvent permettre à toute la classe ouvrière de s’organiser collectivement, de prendre en main sa propre destinée. Et il doit surtout dévoiler à ses frères de classe des pays périphériques le vrai visage de la démocratie bourgeoise en déjouant ses pièges les plus dangereux et sophistiqués: les illusions démocratiques, réformistes, électoralistes, syndicales…
Ce n’est nullement là une vision “euro-centriste”. Le monde bourgeois s’est développé à partir de l’Europe, il y a développé le plus vieux prolétariat, qui de ce fait a été doté de l’expérience la plus grande. C’est le monde bourgeois qui a concentré sur un petit espace de terre autant de nations avancées, ce qui facilite d’autant l’épanouissement d’un internationalisme pratique, la jonction des luttes prolétariennes de différents pays…
Le cœur du monde capitaliste, l’histoire l’a situé depuis des siècles en Europe occidentale. C’est là où le capitalisme a fait ses premiers pas et c’est là que la révolution mondiale prolétarienne fera les siens.
Ces derniers mois de lutte, de l’Afrique du Nord à l’Europe occidentale, en passant par la Chine et les États-Unis, ont confirmé une nouvelle fois que le prolétariat est une seule et même classe sur toute la planète, qu’il mène le même combat pour l’émancipation de toute l’humanité dans tous les pays, sans distinction de race, de nationalité ou de religion. Comme l’écrivait déjà Engels en 1847 dans ses Principes du communisme: “La grande industrie, en créant le marché mondial, a déjà rapproché si étroitement les uns des autres les peuples de la terre, et notamment les plus civilisés, que chaque peuple dépend de ce qui se passe chez les autres. Elle a, en outre, uniformisé dans tous les pays civilisés le développement social à tel point que, dans tous ces pays, la bourgeoisie et le prolétariat sont devenus les deux classes décisives de la société, et que la lutte entre ces deux classes est devenue la principale lutte de notre époque. La révolution communiste, par conséquent, ne sera pas une révolution purement nationale; elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés, c’est à dire tout au moins en Angleterre, en Amérique, en France et en Allemagne. (...) Elle exercera également sur tous les autres pays du globe une répercussion considérable et elle transformera complètement et accélérera le cours de leur développement. Elle est une révolution universelle; elle aura par conséquent, un terrain universel.”
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!
Pawel /1.07.2011
(1) Lire notre article sur la Syrie au sein de ce même journal,
(2) Lire notre article concernant le piège de l’apolitisme, publié au sein de ce même journal,
(3) De nombreux articles au sein de ce journal ou sur notre site Internet détaillent les différentes luttes qui ont animé les exploités de ces différents pays ces derniers mois.
(4) Éléments repris du site espagnol https://www.kaosenlared.net/
(5) De très larges extraits de cette partie sont repris de notre article “Le prolétariat d’Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe” qui date de 1982. Celui-ci, à notre sens, n’a rien perdu de sa force et de son actualité et nous en conseillons évidemment vivement sa lecture (article disponible sur notre site Internet).
Avec les mêmes mesures d'austérité qu'ailleurs, la Belgique n'a jamais été une exception
- 1923 lectures
Enfin …… la Belgique aura son gouvernement. Huit différents partis ont pris leur responsabilité. Les "séparatistes" sont temporairement mis de côté pour pouvoir exécuter "dans l’union" un plan d’austérité solide. Après le record mondial en exercice comme premier d’un "gouvernement d’affaires courantes", Leterme pourra largement profiter d’un petit job bien payé par une institution internationale. Est-ce un retour vers une situation normale dans une Europe où les cours de la bourse oscillent? Qui peut maintenant pousser un soupir de soulagement: les politiciens ou la classe ouvrière?
Selon les nouvelles économiques, l’économie belge a connu une relative bonne période: maintenant cela ne peut que davantage s’améliorer. La situation économique était relativement stable. Au niveau social, c’était tranquille. La population s’est conduite calmement. Seuls les politiciens ont longtemps adopté une attitude irresponsable. Maintenant qu’eux aussi en sont arrivés à l’idée qu’une telle situation ne peut plus durer, la situation ne peut qu’aller mieux.
Est-ce effectivement ainsi? Ou veulent-ils simplement nous le faire croire? Bien qu’ un certain nombre d’affirmations mentionnées ci-dessus sont correctes, la situation économique belge jusqu’ici ne s’est pas détériorée seulement par le fait qu’elle pouvait parasiter l’économie d’un certain nombre de ses pays voisins.
Depuis des mois (en réalité depuis 2008 déjà), la Belgique a nouveau été confrontée à tout un "battage communautaire, nationaliste, (sous)-nationaliste, les chamailleries entre partis pour diviser les ouvriers, dévier leur attention, obstruer la conscience qu’ils font partie de la classe qu’on exploite au niveau international… " (….) "Et tout comme les gouvernements de tous les pays, l’ensemble des partis
Belges, unitaires ou régionalistes appellent les travailleurs à être "solidaires", c’est-à-dire à se serrer la ceinture, à accepter des sacrifices pour garantir le niveau concurrentiel du capital national." (Le problème n’est pas la crise de gouvernement, mais la crise du système capitaliste ; Internationalisme 349).
Mais, tandis que le système capitaliste plonge dans une crise économique mondiale de plus en plus effroyable, la Belgique a été toujours présentée comme une exception en Europe:
- un Etat relativement épargné par la crise et l’austérité;
- un Etat où le problème essentiel n’était pas la question sociale, les luttes contre les licenciements et l’austérité, "l’indignation" des jeunes générations contre le manque de perspectives, mais la question de la scission d’un arrondissement électoral et les tensions communautaires entre Wallons "profiteurs’ et flamands "arrogants".
Mais contrairement à ce que prétendent les groupes gauchistes, ces "spécificités nationales", auxquelles font parfois aussi référence les gauchistes, sont un leurre. Plus spécifiquement en ce qui concerne la Belgique, c’est de point de vue de la classe ouvrière important á
a) dénoncer l’incroyable mystification à propos de la "spécificité belge" que la bourgeoisie a diffusée et diffuse dans la population en général et au sein de la classe ouvrière en particulier;
b) expliquer comment cette mystification a été rendue crédible ;
c) mettre en garde les travailleurs, les chômeurs et les jeunes contre la nouvelle vague d’austérité qui se prépare à court terme.
1. La mystification sur la bonne santé de l’économie Belge a été entretenue par l’ensemble des partis politiques qui affirment que "la Belgique résiste mieux à la crise", mais aussi par le gouvernement "démissionnaire" Leterme qui affirme que "le gouvernement a tout sous contrôle" et qu’il gère le pays "en bon père de famille". Cette mystification a largement pris eau cet été: la crise de la dette souveraine des Etats et la pression sur les obligations d’Etat en Europe, la crise de l’euro, la pression sur les banques et la bourse touchent tous les Etats d’Europe, y compris la Belgique.
- La pression devient de plus en plus importante sur les banques et sociétés d’assurance Belges et sur celles liées aux banques Françaises (Dexia, Kredietbank, Ethias, BNP Paribas Fortis, ...).
- La pression croît également sur la dette de la Belgique (ampleur de la dette et coût de l’argent emprunté).
- De nouveaux soubresauts économiques menacent, avec le ralentissement de la production en Allemagne, le premier partenaire économique de la Belgique et la crise bancaire aiguë qui touche la France.
- Enfin, l’instabilité de la gouvernance en Belgique est un facteur important de déstabilisation à l’époque actuelle.
La brouillard nationaliste et sous-nationaliste est particulièrement intense en Belgique pour cacher la réalité de la crise et les enjeux qu’elle pose et ce serait une illusion de penser que la bourgeoisie s’attachera à le dissiper dans la période actuelle. D’ailleurs, ici aussi, il est erroné de voir un tel battage (sous-)nationaliste comme une "exception Belge". Avec l’approfondissement de la crise, en particulier en Europe, ce type de campagne s’accentue partout: en Allemagne, il y a la campagne contre "les Grecs menteurs et voleurs", en Hollande, c’est un sentiment anti-Européen qui est exacerbé sous la poussée du populiste Wilders, en Italie ou en Espagne, les régions riches (l’Italie du Nord, la Catalogne) veulent larguer les parties plus pauvres, ces "gouffres à subsides".
Ainsi, au-delà de ses spécificités, l’exacerbation des campagnes (sous-)nationalistes en Belgique, elle aussi, s’inscrit dans un cadre général marqué par l’enrayement croissant des mécanismes du capitalisme mondial. En effet, l’exacerbation des tensions au sein de la bourgeoisie américaine, au début d’août, sur les mesures budgétaires à prendre (réduire les dépenses ou stimuler la consommation) souligne bien que, sans nier les spécificités de l’Etat et de la bourgeoisie Belge, cette exacerbation des tensions entre fractions bourgeoises est une réalité internationale. Et elle exprime (de manière variable bien sûr selon les pays) avant tout la pression croissante de la crise historique du capitalisme sur la cohésion de l’ensemble des bourgeoisies de la planète.
2. Qu’est-ce qui a permis cette illusion d’une "Belgique qui échappe à la crise", qu’est-ce qui a pu lui donner un semblant de vérité ? En réalité, trois facteurs l’ont favorisé:
- la forte reprise de l’économie allemande après 2008 lui a attribué pour un temps le rôle de locomotive de l’économie mondiale. Or, ce pays est le premier partenaire économique de la Belgique, et, en conséquence, cette dernière en a aussi bénéficié. Entre 2008 et 2011 l’économie Belge était pour 65% dépendante de deux pays voisins (1): La France et l’Allemagne. Elle a donc pu "parasiter’ pendant quelques années sur les mesures de ces deux pays, en profitant du plan de relance de la France et de la croissance Allemande.
- la gestion des affaires s’est poursuivie. D’une part, le gouvernement fédéral étant en "affaires courantes’ depuis en gros 2008, la bourgeoisie a pu éviter la pression sur le budget des dépenses "partisanes’ classiques imposées par les partis gouvernementaux pour satisfaire leur électorat classique. D’autre part, les gouvernements régionaux, non démissionnaires, sont responsables de larges domaines de la gestion étatique, comme l’enseignement, la santé publique, l’écologie et la culture, et ont donc pu pleinement prendre les mesures d’austérité qui s’imposent dans ces domaines.
- mais le plus important, c’est que toute une série de mesures cadres pour imposer l’austérité ont été prises en douce, d’abord un premier plan d’austérité, concocté par Van Rompuy en 2009 et engagé depuis déjà deux ans: passer d’un déficit budgétaire de 6% en 2009 à 0% en 2015, soit 22 milliards d’euros d’économies en 2011. Mais ensuite aussi d’autres mesures, telles l’imposition d’un blocage des salaires strict pour 2011 et 2012 - comme en ont fait l’expérience les travailleurs du secteur des cimenteries- ou le non remplacement des fonctionnaires par gouvernement "d’affaires courantes" de Leterme.
3. Aujourd’hui, des attaques sans merci contre les conditions de vie de la classe ouvrière se préparent, à l’instar de ce qui se fait dans les autres pays d’Europe. Les mesures prises dans des pays comme la Hollande, la France, l’Italie ou l’Espagne donnent le cadre général et annoncent les mesures supplémentaires qui seront prises en Belgique. Les attaques prendront une double forme :
a. des mesures d’attaques globales contre l’ensemble de la classe ouvrière, en dessus des mesures déjà prises dans le cadre du plan "pluriannuel" 2010-2015 de Van Rompuy, justifiées à partir de la défense de l’Europe et de l’euro contre la crise mondiale (cf. les différentes mesures proposées par le formateur E. Di Rupo):
- réduction budgétaires dans les soins de santé, menaçant la qualité des soins aux patients;
- réduction et même suppression des allocations pour les chômeurs de longue durée, y compris chefs de famille et sans cohabitant + sanctions renforcées contre les chômeurs, suppression de l’allocation d’attente pour les jeunes;
- limitation du droit au crédit d’heures et à la pause carrière;
- suppression de la prise en compte des périodes de chômage, de retraite anticipée et de crédit d’heures pour la retraite;
- la limitation de l’accès à la retraite anticipée, sans même attendre l’évaluation des résultats du Pacte des générations par les partenaires sociaux;
- la limitation du départ à la retraite à 60 ans;
-une attaque contre les retraites des fonctionnaires.?
L’accroissement de la pression sur les banques (cfr Dexia) et sur la dette de l’Etat imposera des mesures supplémentaires (impôts nouveaux et/ ou restrictions budgétaires plus drastiques) pour renflouer les banques ou pour supporter le coût de la dette.
b. l’exacerbation de la concurrence entre les régions, au nom d’une régionalisation plus poussée.
Cette dernière dynamique mènera à l’exploitation des tensions communautaires sur le plan économique à travers l’organisation d’une concurrence interne entre régions: fiscalité différenciée entre régions pour "attirer les entreprises", financement des régions partiellement lié à l’atteinte de critères de rentabilité et d’efficacité (exemple le budget pour les allocations chômage sera lié à l’efficacité de la politique de "mise au travail" des chômeurs). La concurrence et la course à la performance entre les régions impliqueront une pression accrue sur les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière.
4. Pour la classe ouvrière en Belgique, la situation ces dernières années a été difficile et cela va encore rester difficile pendant une certaine période: les campagnes et les divisions qu’on fait avaler restent intenses. La classe ouvrière ne sera pas seulement confrontée à une perduration des campagnes de division mais aussi dans un premier temps, par la mise en place du nouveau gouvernement, à son propre soulagement du fait que les affaires au niveau de la gestion de l’Etat belge sont enfin réglées.
Toutefois, les éléments avancés dans cet article démontrent bien que le décalage avec la situation sociale dans les autres pays d’Europe est plus une question de perception et de prise de conscience qu’une réalité objective: la réalité économique et sociale en Belgique est complètement similaire à celles de pays comme la France ou les Pays-Bas.
Aussi, la situation sociale peut évoluer très vite, comme l’ont illustré le "printemps arabe’ et les événements en Espagne ou en Angleterre. Bien qu´une hésitation dans le premier temps est plus que probable; très vite la classe ouvrière en Belgique peut retrouver le chemin de la lutte. Et une fois en mouvement, elle peut très bien réagir avec encore beaucoup plus de combativité et de détermination qu’ailleurs. Sur ce plan-là aussi, contrairement aux campagnes de la bourgeoisie, la Belgique n’est pas une exception n
Ricardo / 29.09.2011
(1) www.ing.be/xpedio/groups/internet/@public/@bbl/@publications/documents/portalcontent/502395_nl.pdf.
Situations territoriales:
Rubrique:
Débat ouvert entre internationalistes sur la nature de classe de la Révolution russe
- 1679 lectures
"Ces dernières années, les communistes de gauche du Courant Communiste International (CCI) ont beaucoup écrit sur l’anarchisme. Nous nous concentrons ici sur le courant dont fait partie aussi De Vrije Communist: l’anarchisme internationaliste.
"Il apparaît clairement que l’anarchisme constitue un lieu où s’affrontent des positions ouvertement bourgeoises et nationalistes et des positions prolétariennes internationalistes." (Les anarchistes et la guerre (4e partie), L’internationalisme, une question cruciale).
Le CCI a écrit deux séries d’articles sur l’anarchisme. La première série traitait de l’anarchisme et la guerre. La deuxième série portait sur la Gauche Communiste et l’anarchisme internationaliste. Le CCI fait une distinction entre les différents courants anarchistes.
A juste titre, le CCI pointe les convergences avec l’anarchisme internationaliste. Il s’agit essentiellement de deux terrains de convergence: le rejet des élections et celui de la guerre. En effet, les anarchistes internationalistes ne prennent pas position en faveur de l’un ou l’autre camp de la classe dominante.
Le CCI énumère aussi les différences les plus importantes entre le CCI et l’anarchisme internationaliste: le CCI est centraliste, matérialiste, pour une période de transition de l’Etat et pour la prise de pouvoir de Lénine en Russie en octobre 1917. L’anarchisme internationaliste est fédéraliste (pour une organisation partant de la base), idéaliste, pour une suppression immédiate de l’Etat et contre la prise de pouvoir de Lénine en Russie en octobre 1917.
Les anarchistes internationalistes ont une tout autre forme d’organisation que les communistes de gauche. Et les anarchistes internationalistes rejettent toute survie "momentanée" de la dictature pendant une soi-disant période de transition. Cela ne pourrait pas mener vers une autre société. On ne se défait plus d’une telle dictature "momentanée". Les nombreuses dictatures marxistes du vingtième siècle l’ont amplement démontré.
Une autre différence entre les communistes de gauche et les anarchistes internationalistes est peut-être aussi que les anarchistes internationalistes ont un terrain d’intérêt plus large et se consacrent plus souvent à des sujets qui ne sont pas complètement réductibles à la lutte de classe.
Les communistes de gauche veulent engager la discussion avec les anarchistes internationalistes et collaborer avec eux. Entre temps, aux Pays-Bas, on a vu un début d’une telle collaboration. Les Kritische Studenten Utrecht (KSU)[Etudiants critiques d’Utrecht], le Anarcho-Syndicalistische Bond (ASB)[La ligue Anarcho-Syndicaliste] et le Courant Communiste International (CCI) ont fait une déclaration commune sur les actions contre les coupes salariales chez le Viva ! Zorggroep [Groupe de soignants Viva]."
De Vrije Communist
(1)De Vrije Communist, à commander chez "Woorden van Rebellen", Amsterdam, n° du compte 87.12.25.115.
Nous saluons la publication de l’article ci-dessus dans le Vrije Communist. Il constitue une contribution sérieuse au développement du débat entre organisations qui se situent sur le caractère internationaliste de la lutte et qui réfutent la voie parlementaire de réforme durable, fondamentale à l’intérieur du capitalisme comme une illusion. Car au-delà de nos divergences, parfois importantes, nous partageons en effet des positions révolutionnaires essentielles: l’internationalisme, le rejet de toute collaboration et de tout compromis avec des forces politiques bourgeoises, la défense de “la prise en main des luttes par les ouvriers eux-mêmes”. Mais comme nous l’avons exprimé dans la série d’articles dans la presse, il existe aujourd’hui encore, de part et d’autre certaines craintes à débattre et à collaborer. Pour dépasser ces difficultés, il faut être persuadé d’appartenir bel et bien au même camp, celui de la révolution et du prolétariat, malgré les divergences. Mais cela ne peut suffire. Nous devons aussi faire un effort conscient pour cultiver la qualité de nos débats. Et l’article dans le Vrije Communist en est un bon exemple. (2)
L’article pose effectivement de façon claire, et selon nous c’est aujourd’hui de loin le plus important, que la Gauche communiste et l’anarchisme internationaliste aient une base commune. L’article développe également quelques points de divergence. Nous espérons que notre réaction peut contribuer au prolongement d’une discussion fructueuse entre anarchistes internationalistes et communistes de gauche où que ce soit. Ceci malgré le fait, et nous en sommes pleinement conscients, que les premiers ont une toute autre conception de l’Etat de transition, de la révolution Russe et sur d’autres points.
Avec cette courte réaction nous aimerions déjà aborder quelques points concernant les divergences mentionnées.
Est-ce que la Gauche communiste est, comme le dit le texte ci-dessus: " pour la prise de pouvoir de Lénine en Russie en octobre 1917" ? ou encore "Et les anarchistes internationalistes rejettent toute survie "momentanée" de la dictature pendant une soi-disant période de transition. Cela ne pourrait pas mener vers une autre société. On ne se défait plus d’une telle dictature "momentanée ". Les nombreuses dictatures marxistes du vingtième siècle l’ont amplement démontré."
Nous comprenons très bien que c’est le point de divergence qui est développé en premier lieu dans le texte. Si nous relisons le " jeune " Marx d’avant la Commune de Paris, le social-démocrate Kautsky ou même divers écrits de Lénine ou Trotski, alors il y a matière à douter de la validité de certaines positions marxistes. En vue d’approfondissements complémentaires de ces questions, il est justement important de savoir de quel type d’expérience il s’agit. La Révolution russe a t’elle été une révolution ouvrière? Ou bien a t’elle été un coup d’Etat, fomenté par un parti bourgeois particulièrement habile dans la manipulation des masses? Le stalinisme a t’il été le produit "naturel" de cette révolution ou bien en a t’il été le bourreau? Suivant la réponse que l’on donne à ces questions élémentaires, les enseignements que l’on tirera seront évidemment radicalement opposés.
"Les idéologies staliniennes "reconnaissent" une nature prolétarienne (ils préfèrent en général parler de "populaire"), à la révolution d’Octobre. Mais la version totalement défigurée qu’ils en donnent n’a d’autre objectif que de faire oublier l’effroyable répression à laquelle le stalinisme s’est livré contre les ouvriers et les bolcheviks qui en avaient été les protagonistes; de tenter de justifier ce qui restera comme un des plus grands mensonges de l’histoire: l’assimilation du capitalisme d’Etat comme synonyme de "commu-nisme".(…) D’autres se contentent de parler de mouvement nationaliste en vue de moderniser le capitalisme russe. (…) En somme une révolution bourgeoise (…). D’autres parlent de "révolution ouvrière" pour Octobre 1917 et s’accordent avec les staliniens pour considérer l’Union Soviétique comme un pays " communiste ", mais ce n’est que pour mieux décrire les horreurs du stalinisme en en déduisant: "c’est à cela, et seulement à cela que peuvent conduire des mouvements révolutionnaires à notre époque".
"C’est lorsque le prolétariat mondial se trouvera devant la tâche d’organiser collectivement une insurrection armée qu’ils ressentiront massivement le besoin de posséder les leçons d’octobre 1917. C’est lorsqu’ils seront confrontés à des questions telles que: savoir qui exerce le pouvoir; ou bien: quels rapports doit il y avoir entre le prolétariat en armes et l’institution étatique qui surgira au lendemain des premières insurrections victorieuses; ou bien encore: comment réagir face aux divergences entre secteurs importants du prolétariat; qu’ils comprendront les véritables erreurs commises par les bolcheviks (en particulier dans la tragédie de Kronstadt en 1921)." (De l’introduction de la brochure sur la Révolution Russe)
Finalement un passage d’un texte ultérieur qui traite également un des aspects que le Vrije Communist soulève: "C’est en fait de l’intérieur, (…), que surgit la contre-révolution et que se reconstitua le pouvoir de la bourgeoisie du fait du processus d’absorption du parti bolchévik par l’Etat. Gangrené (…), le parti bolchevik tendit de plus en plus à substituer la défense des intérêts de l’Etat soviétique au détriment des principes de l’internationalisme prolétarien. Après la mort de Lénine en 1924, Staline, principal représentant de cette tendance vers l’abandon de l’internationalisme, aida la contre-révolution à s’installer (…). Le bastion prolétarien russe s’effondra de l’intérieur et la chasse aux révolutionnaires internationalistes fut ouverte dans le parti. (…).. L’URSS devenait un pays capitaliste à part entière où le prolétariat était soumis, le fusil dans le dos, aux intérêts du capital national, au nom de la défense de la “patrie socialiste”. (Internationalisme n° 234, octobre 1997) n
Wereldrevolutie/Internationalisme / 27.09.2011
(2)Notons aussi l’initiative prise par le AKG (Collectif Anarchiste Gand) à organiser ensemble avec le CCI, les " Lege Portemonnees " et le Catholic Workers des débats sur la perspective de la lute contre le capitalisme et sur comment unir nos forces.
Histoire du mouvement ouvrier:
S'indigner, oui ! contre l'exploitation capitaliste ! (à propos des livres de Stéphane Hessel "Indignez-vous !" et "Engagez vous !")
- 1542 lectures
Indignez-vous! et Engagez-vous! de l’écrivain, poète et diplomate français Stéphane Hessel, sont de véritables “best-sellers”. Ils constituent déjà une référence pour tous ceux qui réfléchissent sur l’injustice de ce monde. Le mouvement de grogne sociale qui vient de parcourir l’Espagne (et dans une bien moindre mesure d’autres États d’Europe) s’est même donné pour nom los Indignados en référence explicite à son premier livre (1)
Indignez-vous! est un fascicule d’une trentaine de pages. Il a été traduit en plusieurs langues, vendu à des millions d’exemplaires sur l’ensemble de la planète, à un prix dérisoire pour qu’il soit le plus largement diffusé. Cette publication a rencontré immédiatement un immense succès. Et pour cause, son titre est à lui seul un cri de révolte contre la barbarie de ce monde. Il correspond parfaitement au sentiment général qui grandit dans les rangs des opprimés : les horreurs qui ravagent la planète, de la misère à la guerre, sont ressenties comme de plus en plus insoutenables et révoltantes. Le “Printemps arabe”, en Tunisie et en Égypte, et le mouvement des Indignés en sont une claire manifestation.
De quelle société rêve Stéphane Hessel? (2)
Stéphane Hessel est un homme de 93 ans qui a encore la force de clamer son indignation face à ce monde inique. En tant que tel, cela ne peut que forcer l’admiration et provoquer la sympathie. Mais au final, pour quel monde nous propose-t-il de nous battre ?
Dès le début de son livre, Stéphane Hessel fait l’apologie des principes et des valeurs qui ont amené le Conseil national de la Résistance (CNR) (3) à élaborer un programme économique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. A la question “est ce que ces mesures sont toujours d’actualité?”, Hessel répond “Bien entendu, les choses ont changé en soixante-cinq ans. Les défis ne sont pas les mêmes que ceux que nous avons connus à l’époque de la Résistance. Le programme que nous proposions à l’époque ne peut donc plus s’appliquer intégralement aujourd’hui, et il ne faut pas faire de suivisme aveugle. Par contre, les valeurs que nous affirmions sont constantes, et il faut s’y attacher. Ce sont les valeurs de la République et de la démocratie. Je pense que l’on peut juger les gouvernements successifs à l’aune de ces valeurs. Il y avait dans le programme du Conseil de la Résistance l’affirmation d’une vision, et cette vision est toujours valable aujourd’hui. Refuser le diktat du profit et de l’argent, s’indigner contre la coexistence d’une extrême pauvreté et d’une richesse arrogante, refuser les féodalités économiques, réaffirmer le besoin d’une presse vraiment indépendante, assurer la sécurité sociale sous toutes ses formes… nombre de ces valeurs et acquis que nous défendions hier sont aujourd’hui en difficulté ou même en danger. Beaucoup des mesures qui ont été récemment adoptées choquent mes camarades résistants – car elles vont à l’encontre de ces valeurs fondamentales. Je pense qu’il faut s’en indigner, notamment chez les jeunes. Et résister!” (4). Mais alors qui est responsable de cette situation? “…le pouvoir de l’argent, tellement combattu par la Résistance, n’a jamais été aussi grand, insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de l’État. Les banques, désormais privatisées se montrent d’abord soucieuses de leurs dividendes, et des très hauts salaires de leurs dirigeants, pas de l’intérêt général. L’écart entre les plus pauvres et les plus riches n’a jamais été aussi important; et la course à l’argent, la compétition autant encouragée” (). Pour Hessel, la démocratie doit guider l’action des dirigeants, cette démocratie plus soucieuse de l’intérêt général en opposition à l’égoïsme des financiers et autres banquiers: “les responsables politiques, économiques, intellectuels et l’ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l’actuelle dictature des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie” (). Voici donc le sacro-saint intérêt général qui réunit les politiciens, les patrons de l’industrie côte à côte avec les travailleurs, les chômeurs, les étudiants, les retraités, les précaires... Autrement dit, la démocratie de Stéphane Hessel, c’est ce mythe, cette escroquerie, où exploiteurs et exploités sont mis comme par magie sur un pied d’égalité, où ils sont censés avoir les mêmes “droits et devoirs”, et les mêmes intérêts démocratiques en tant que citoyens contre la dictature des financiers. Et pour aboutir à quoi? “Aujourd’hui, c’est en réfléchissant, en écrivant, en participant démocratiquement à l’élection des gouvernants que l’on peut espérer faire évoluer intelligemment les choses… bref, par une action de très long terme” (). Et quel camp Hessel nous propose-t-il de défendre? “Je me considère toujours comme socialiste – c’est-à-dire selon le sens que je donne à ce terme, conscient de l’injustice sociale. Mais les socialistes doivent être stimulés. J’ai l’espoir de voir émerger une gauche courageuse, impertinente s’il le faut, qui puisse peser et défendre une vision et une conception des libertés des citoyens. De plus, il me semble important qu’il y ait des Verts dans les institutions, pour que la notion de préservation de la planète progresse” (). Finalement, pour Hessel, notre indignation doit déboucher sur un slogan que nous connaissons déjà, le fameux “il faut aller voter”… pour un nouveau programme alternatif (qui fera l’objet d’une nouvelle publication), inspiré du CNR, regroupant toutes sortes d’éléments, de la gauche radicale aux altermondialistes, en passant par des syndicalistes, en fait des partis et des organisations qui ont le sens de l’intérêt général… capitaliste. Heureusement que ces millions de jeunes, à qui Hessel s’adresse tout particulièrement, au Portugal et en Espagne, n’ont pas écouté tous ces discours citoyens de gauche et ont boudé les urnes. Il faut dire qu’ils ont eu l’occasion de voir les gouvernements socialistes de leur pays respectif à l’œuvre ; ils ont vu quelles mesures d’austérité draconiennes les partis socialistes étaient capables d’adopter de façon toute démocratique (ce qui est aussi vrai pour la Grèce d’ailleurs); ils ont tâté de la matraque de la très démocratique police du très démocratique gouvernement socialiste de Zapatero!
Malgré tout, Hessel persiste dans son soutien à ces partis en déclarant: “Qu’est-ce que cela impose comme tâche aux membres de la jeune génération? C’est de prendre au sérieux les valeurs sur lesquelles ils fondent leur confiance ou méfiance dans ceux qui les gouvernent – c’est le principe de la démocratie, par lequel on peut avoir de l’influence sur ceux qui prennent des décisions” (9). Quelle influence cette jeune génération peut-elle avoir sur ces États démocratiques qui lui imposent tant de misère? Peut être, remplacer un ministre devenu impopulaire… et alors? Quel véritable changement? Aucun! Dans tous les pays, que les gouvernants soient de droite ou de gauche (ou d’extrême-gauche comme en Amérique latine), le fossé devient de plus en plus profond entre l’immense majorité de la population en proie à une dégradation généralisée de ses conditions de vie et un pouvoir étatique démocratique bourgeois prônant une politique d’austérité afin d’éviter la banqueroute économique. Il ne peut en être autrement! Derrière le masque démocratique de l’État se cache toujours la dictature du Capital.
Pas touche au capitalisme!
“Ma génération a contracté une véritable allergie à l’idée de révolution mondiale. Un peu parce que nous sommes nés avec elle. Moi qui suis né en 1917, année de la Révolution russe, c’est une caractéristique de ma personnalité. J’ai acquis le sentiment, peut être injuste, que ce n’est pas par des actions violentes, révolutionnaires, renversant les institutions existantes, que l’on peut faire progresser l’histoire”(10). Et plus loin Hessel continue encore: “Dans toutes les sociétés existe une violence latente qui est capable de s’exprimer sans retenue. Nous avons connu cela avec les luttes de libération coloniale. Il faut avoir conscience que des révoltes, ouvrières par exemple, sont encore possibles. Mais c’est peu probable étant donné la façon dont l’économie s’est développée et globalisée. Le genre Germinal, c’est un peu dépassé” (). Voilà l’appel que lance Hessel à la jeune génération: ôtez-vous de la tête toute idée de révolution mondiale, toute idée de lutte de classe! C’est du passé! Essayez plutôt d’améliorer le fonctionnement de ce système. Comment? C’est là que Hessel a une idée “géniale et innovante”… avancée mille fois par toute la gauche depuis un siècle: la création d’un Conseil de sécurité économique et social, réunissant les États les plus puissants de la planète, une sorte de gouvernance mondiale. Cet organisme mondial aurait comme objectif de réguler l’économie, ce qui éviterait les crises en exerçant un contrôle efficace sur toutes ces grandes institutions financières, avides de profits et de pouvoir. Rappelons simplement que la Société des Nations (SDN), qui est devenue ensuite l’Organisation des Nations Unies (ONU), a été créée à la suite de la Première Guerre mondiale en suivant officiellement un raisonnement presque identique: empêcher le retour de la guerre par un organisme international conciliant l’intérêt des nations. Résultat? La Seconde Guerre mondiale et… 14 jours de paix dans le monde depuis 1950! En fait, ce monde est divisé en nations capitalistes concurrentes les unes des autres: elles se livrent une guerre économique sans merci et, quand nécessaire, l’arme au poing. Toutes les “gouvernances mondiales” qui existent (OMC, FMI, ONU, OTAN…) ne sont que des repères de brigands où les États poursuivent leur lutte impitoyable. Mais avouer cela, ce serait reconnaître ce que veut absolument évacuer à tout prix Stéphane Hessel: la nécessité d’un nouveau système mondial et donc d’une révolution internationale!
Il préfère envoyer les jeunes dans des impasses plutôt que de leur indiquer un chemin qui les mènerait vers une remise en cause trop radicale à ses yeux de ce système d’exploitation. Il les encourage donc à faire pression sur leurs États pour que ceux-ci mènent une nouvelle politique au sein de son nouveau Conseil de sécurité économique et social. Pour lui, il suffirait d’une intervention massive de la société civile, d’une mobilisation citoyenne d’ampleur, pour influer sur les décisions des États. Cet engagement devrait aussi se conjuguer avec une implication plus grande dans les ONG et autres réseaux associatifs car les défis, et donc les combats, sont multiples: écologiques, sociaux, antiracistes, pacifiques, pour une économie solidaire...
En fait, fondamentalement, Hessel nous ressert la vieille soupe réformiste: avec quelques ingrédients bien choisis (une implication citoyenne de la population, un vote intelligent..), le capitalisme pourrait cesser d’être ce qu’il est, un système d’exploitation, et pourrait devenir plus humain, plus social.
Réforme ou révolution?
“L’histoire est faite de chocs successifs, c’est la prise en compte de défis. L’histoire des sociétés progresse, et au bout, l’homme ayant atteint sa liberté complète, nous avons l’État démocratique dans sa forme idéale” nous dit Hessel dans Indignez-vous!. C’est vrai, l’humanité est face à un défi: trouver la solution à tous ses maux ou disparaître. Au cœur de cet enjeu: la nécessité de transformer la société. Mais quelle transformation? Peut-on réformer le capitalisme ou doit-on le détruire pour construire une autre société?
Réformer le capitalisme est un leurre, c’est se soumettre à ses lois, à ses contradictions qui mènent l’humanité à la misère, à la guerre, au chaos, à la barbarie. Le système capitaliste est un système d’exploitation, peut-on rendre humaine une exploitation? Peut-on rendre humain un système dont le seul objectif est de permettre à une classe d’accumuler des richesses en faisant du profit sur le dos de millions de travailleurs? Et quand la concurrence entre capitalistes devient plus aiguë, que la crise économique mondiale fait rage, alors c’est la classe ouvrière qui en paie durement le prix: chômage de masse, précarité généralisée, surexploitation sur les lieux de travail, baisse des salaires… Pourtant, tout est là pour que les être humains puissent subvenir à leurs besoins élémentaires et construire une société sans classes, donc sans injustices, sans barbarie guerrière, en abolissant les frontières. Seule la classe ouvrière peut porter la perspective d’un tel monde. C’est d’ailleurs ce qui est déjà en germe dans le mouvement des Indignés: l’entraide, le partage, la solidarité, le dévouement, la joie d’être ensemble… Ce formidable mouvement social que nous avons vécu en Espagne n’est pas un feu de paille, il annonce les futures luttes qui vont se développer un peu partout dans le monde, des luttes qui verront la classe ouvrière se mobiliser de plus en plus massivement, entraînant derrière elle toutes les couches opprimées par ce système; des luttes qui vont de plus en plus s’affirmer contre l’inhumanité du capitalisme, et d’où émergera une conscience plus aiguë d’un nécessaire changement de société pour construire une nouvelle humanité n
Antoine/02.07.2011
(1) Stéphane Hessel est très connu en Espagne, au moins autant qu’en France. Il y vit et a pour ami Jose Luis Sampedro, écrivain et économiste espagnol et, surtout, initiateur de Democracia Real Ya. Jose Luis Sampedro a d’ailleurs publié un pamphlet inspiré de son alter ego et a écrit la préface d’Indignez-vous ! pour l’édition de son pays.
(2) Le CNR est pour Stéphane Hessel la référence historique, l’exemple à suivre. Nous reviendrons prochainement de façon plus détaillée sur cette question précise.
(3) Indignez-Vous!, p. 15.
(4) Idem, p. 11.
(5) Idem, p. 12.
(6) Engagez-vous!, p. 16.
(7) Idem, p. 43 et 44.
(8) Engagez vous !, p. 22.
(9) Idem, p. 20.
(10) Idem, p. 21.
(11) Idem, p. 21.
Personnages:
Avec la terreur, le risque d'une aggravation du chaos en Syrie
- 1361 lectures
Dans la lignée des révoltes du printemps dans les pays arabes, la population syrienne a commencé à la mi-mars à manifester pour réclamer le départ de son dirigeant suprême et un régime “démocratique”. Devant ce mouvement populaire exprimant le ras-le-bol des conditions de vie de plus en plus intolérables imposées par la junte de la clique issue du régime d’Hafez-al-Assad, le “renard du désert” et père de l’actuel dictateur, c’est une violente répression qui s’est abattue et n’a cessé de s’accentuer: 1.600 morts, on ne sait combien de blessés, et 12.000 réfugiés, principalement en Turquie mais aussi au Liban où plusieurs centaines de personnes ont fui. Cette répression s’abat tous azimuts pour semer la terreur et brandir à la face du monde la volonté de Bachar al-Assad de rester en place, contre vents et marées. Des villages, des bourgs, sont privés d’eau, d’électricité, d’approvisionnement, “pour l’exemple”, c’est-à-dire pour rien, tandis que les habitants sont abattus pendant leur fuite devant les exactions de la soldatesque syrienne aux ordres. Les villes “rebelles” sont bombardées. Le recours à la torture, déjà quotidienne auparavant connaît des sommets d’horreur. Souvenons-nous que c’est celle infligée à cinq enfants qui avait été un des éléments déclencheurs de la révolte populaire, à la mi-mars. Les forces de l’ordre ouvrent systématiquement le feu dans les manifestations et les faubourgs de Damas sont livrés avec une intensité grandissante à la vindicte de l’armée ou aux tirs de snipers recrutés pour l’occasion. La situation est même devenue tellement odieuse que des désertions de militaires sont apparues, désertions réprimées dans le sang, comme celle de Jisr Al-Chouhour le 5 juin où il semblerait que 120 soldats déserteurs aient été abattus par l’armée elle-même. Le gouvernement s’est bien sûr empressé de mettre ces meurtres sur le compte des “terroristes armés qui sèment le chaos”. C’est d’ailleurs le prétexte mis en avant par le régime syrien dans sa fuite en avant dans la répression, qui n’est pas sans rappeler celui des États-Unis et de ses alliés pour justifier la guerre en Irak et en Afghanistan, ou celui de la Russie en Tchétchénie, etc.
Pour l’heure, l’État syrien joue la carte de la confusion. Ainsi, tout en élargissant inexorablement la répression à tout le pays, Bachar al-Assad promet un programme de réformes pour le 10 juillet, programme dont aucune ligne n’a encore été officiellement tracée. Avec une situation économique catastrophique, on se demande ce qu’il va bien pouvoir tenir sinon davantage de balles pour les manifestants. De plus, pour essayer de mieux clouer le bec à toute opposition, il s’efforce d’organiser des manifestations en sa faveur, dont on ne sait pas trop si les participants y sont vraiment volontaires, comme à l’époque des manifestations massives à la “gloire” du stalinisme et le fusil dans le dos, stalinisme avec lequel son père avait connu une longue lune de miel durant la “Guerre Froide” opposant les États-Unis et l’URSS. Un simulacre de réunion “d’opposants” au régime a même été organisé à Damas le 26 juin, sous l’œil complaisant de forces de l’ordre qui n’en ont pas moins continué de tabasser et assassiner toute une population “opposante”. Tout cela ne leurre personne, mais permet de gagner du temps.
Et c’est aussi et surtout la carte de l’extension du chaos à toute la région que brandit la Syrie. L’installation massive de l’armée à la frontière turque, ses incursions militaires brutales dans des villages de plus en plus proches de la frontière avec la Turquie, alors que cette zone est loin d’être l’épicentre de la révolte, sont un message clair d’al-Assad à toute la “communauté internationale": pas touche où je sème le désordre. Alors que la Turquie a déjà fort à faire avec ses régions limitrophes du Kurdistan irakien et iranien, alors que le chef d’État turc, Erdogan, s’inquiète d’un embrasement de ses frontières avec la Syrie et de la survenue d’une réelle catastrophe humanitaire qui en serait la conséquence, Damas menace de mettre le feu aux poudres et d’ouvrir un nouveau front de tensions militaires. Dans ce jeu de “je te tiens, tu me tiens, par la barbichette”, la Syrie est en position de force car il est hors de question pour l’État turc de se permettre le moindre dérapage, obligé pour assurer la défense de ses propres intérêts, de maintenir l’ordre impérialiste au nord du Moyen-Orient. C’est dans le même sens que la pression est mise sur le Liban, à travers les attaques sur Kseir, limitrophe de la Syrie avec le Golan, que Damas revendique historiquement, et qui a été la cause depuis les années 1970 de dizaines d’années de guerre et de massacres. Cependant, derrière le Liban, il y a un énorme problème, c’est celui d’Israël, qui a tout récemment durci sa position sur les questions palestinienne et du Liban. En venant exciter les tensions au sud de son territoire, la Syrie vient là aussi agiter la menace d’une aggravation des tensions guerrières, avec des résultats certainement plus risqués, ne serait-ce que du fait que le chef d’État israélien, Netanyahou, mène résolument une politique anti-arabe et anti-palestinienne provocatrice.
Les pays développés, dont certains au sein de l’ONU ont produit un “projet” de résolution il y a déjà un mois (Allemagne, Grande-Bretagne, France et Portugal), ont bien compris qu’il fallait prendre la situation avec des pincettes, car au-delà du chaos potentiel que représente un changement de régime en Syrie, c’est toute la région qui peut connaître en effet un basculement brutal dans une barbarie aggravée et incontrôlable. Il ne s’agit évidemment pas pour eux de penser aux populations ni à leur bien-être, mais de s’efforcer de contenir une situation pleine de dangers… pour leurs différents intérêts impérialistes dans la région. C’est pour cela que tous ces “humanitaires” patentés roulent des mécaniques dans les salons (1) mais sans aller trop loin car ils savent qu’une intervention militaire en Syrie signifierait l’ouverture d’une boîte de Pandore dont l’issue serait plus qu’incertaine, avec face à eux une armée syrienne solide et entraînée.
Nul ne peut prévoir la perspective qui attend la population de Syrie, et si les États occidentaux, comme l’Amérique qui soutient “l’opposition” depuis des années, vont intervenir. Il est cependant évident que l’évolution actuelle de la situation dans ce pays, qu’elle soit ou non directement le produit de l’action des États-Unis comme certains commentateurs l’avancent, va être le centre d’une foire d’empoigne entre grands et petits impérialistes dont la population ne pourra que faire les frais. L’opposition formelle à toute intervention de la part de la Russie et de la Chine au sein de l’ONU en est une préfiguration. Et, quel que soit le camp que défendent les uns et les autres, ce n’est que pour avancer leurs pions et préserver leurs propres intérêts, pas pour améliorer le sort de tous ceux qui subissent la misère et la violence de la répression étatique n
Wilma/28.06.2011
(1) On peut ici signaler la lettre au Conseil de Sécurité de l’ONU signée entre autres par Woody Allen, Umberto Eco, David Grossman, Bernard-Henry Levy, Amos Oz, Orhan Pamuk, Salman Rushdie et Wole Soyinka. De tous ces signataires, dont on ne peut pas douter de la volonté de bien faire, il faut mettre en valeur celle de Bernard-Henry Levy, dont le travail “philosophique” consiste depuis bientôt 20 ans à exhorter (sur les plateaux télé) l’occident à faire rendre gorge aux méchants de tous poils?: Serbes, Albanais, Irakiens, Afghans (al-qaïdistes et talibans), etc., et maintenant Syriens.
Géographique:
Misère et colère explosent en Grèce
- 1385 lectures
En Grèce, la misère et l’injustice sont en passe de devenir tout simplement insupportables aux yeux des exploités. Les plans d’austérité, tous d’une incroyable brutalité, se succèdent les uns aux autres à un rythme infernal. Chaque nouvelle mesure prise par le gouvernement pour écarter temporairement le pays de la faillite se traduit par de nouveaux sacrifices pour toute la population. Et malgré tout, l’économie nationale n’en finit pas de plonger. Résultat, la misère et la colère explosent!
Un pays symbole de la faillite historique du capitalisme
Le pays croule sous les dettes. L’Etat, les banques et les entreprises sont au bord de l’asphyxie. Et toutes les mesures prises par le gouvernement socialiste de Papandréou pour éviter le défaut de paiement ne font qu’empirer la situation et préparer des lendemains encore plus douloureux. Pour obtenir de l’argent frais de l’Union européenne, sans lequel l’Etat ne pourrait tout simplement plus fonctionner, les conditions de travail et de vie de la population sont littéralement sacrifiées. Le nombre de fonctionnaires ne cesse de se réduire, tout comme les salaires. Les pensions de retraite, les allocations chômage et sociales, les aides pour les soins sont en train de disparaître. Mais cette explosion de la misère ne fait que plonger le pays un peu plus profondément dans la récession, ce qui aggrave… l’endettement! Il s’agit d’un cercle vicieux duquel la Grèce ne pourra pas sortir.
La bourgeoisie grecque pointe d’un doigt accusateur le FMI, l’Union européenne, les agences de notation, l’Allemagne… Elle veut faire croire que ce sont eux et eux seuls les responsables de cette situation économique désastreuse. Dans le reste du monde, le discours tenu est l’exact opposé: la Grèce serait dans une situation “exceptionnelle” et “particulière” du fait du laxisme de ses dirigeants, de la corruption généralisée de la société hellénique (la triche fiscale est présentée comme un sport national) et de la fainéantise des salariés grecs (selon les propos à la mi-juin de la chancelière allemande Angela Merkel). Cette propagande mensongère et nauséabonde a un certain succès puisque dans les manifestations à Athènes, le nationalisme est souvent exacerbé (les drapeaux grecs flottent sur les cortèges, des slogans comme “FMI go home!” ou “Allemagne go home!” sont scandés…), et dans certains pays comme l’Allemagne l’idée “nous ne voyons pas pourquoi nous paierions pour les Grecs” se répand dans la population. Autrement dit, la classe dominante dresse les exploités les uns contre les autres!
En réalité, la Grèce est le symbole de la faillite historique du capitalisme; d’un point de vue économique, elle indique la direction que vont prendre une à une toutes les autres économies nationales. L’Espagne ne va d’ailleurs pas tarder à suivre.
La lutte s’inspire du mouvement des “Indignés” d’Espagne
Si le nationalisme est un poison qui touche aujourd’hui de façon assez importante les ouvriers en Grèce, il y a aussi des lignes de force qui apparaissent peu à peu dans le mouvement de contestation.
En particulier, la jeunesse précarisée a su regarder au-delà des frontières nationales pour s’inspirer du mouvement des Indignés d’Espagne. Dès la fin du mois de mai, sur la place Syntagma d’Athènes, des milliers d’Aganaktismeni (ce mot grec signifie autant l’indignation que la colère (1)) ont commencé à se réunir pour discuter et construire collectivement la lutte. Comme en Espagne, la marque de ce mouvement est, là aussi, l’immense méfiance envers les partis (en particulier le Parti socialiste qui est au pouvoir) et les syndicats (le GSEE, principal syndicat national, est même dénoncé par beaucoup comme un agent de la bourgeoisie). La similitude de la réflexion qui traverse la jeunesse précarisée vivant en Espagne et en Grèce est frappante. Le 25 mai, sur la place Syntagma, par exemple, il y a eu trois bonnes heures de discussion où 83 personnes se sont exprimées. Certains intervenants ont mis en avant l’importance de l’auto-organisation de la classe ouvrière et la nécessité d’une lutte révolutionnaire. Cette réflexion, même si elle est encore exprimée par une toute petite minorité, est très significative. Le simple fait que certains osent tenir ainsi publiquement des propos en faveur de la révolution révèle que le climat est en train de changer. Ils trouvent le courage d’exprimer tout haut, certainement de façon diffuse, ce que bon nombre pensent. D’ailleurs, dans toutes les assemblées des Indignés d’Europe, en Grèce comme en Espagne, en France ou en Angleterre, ces interventions pour l’auto-organisation des masses et pour l’abolition du capitalisme sont souvent parmi les plus applaudies.
Alors, non, la Grèce n’est pas un cas à part! La crise qui y fait rage est celle qui secoue tout le système capitaliste mondial. Et la lutte qui est en train de se développer est l’un des multiples maillons de la chaîne du combat de la classe ouvrière à l’échelle internationale n
Laurence /1.07.2011
(1) Et la colère est d’autant plus grande qu’à la pauvreté s’ajoute une répression féroce et meurtrière.
Géographique:
La Commune de Paris, premier assaut révolutionnaire du prolétariat
- 3040 lectures
Il y a 140 ans, avec le massacre de plus de 20.000 ouvriers lors de la Semaine sanglante, la bourgeoisie mettait fin à la première grande expérience révolutionnaire du prolétariat. Avec la Commune de Paris, c’était la première fois que la classe ouvrière se manifestait avec une telle force sur la scène de l’histoire. Pour la première fois, elle avait montré sa capacité à s’affirmer, comme étant désormais la seule classe révolutionnaire de la société. Cette formidable expérience de la Commune de Paris est là pour témoigner que, malgré l’immaturité des conditions historiques de la révolution mondiale, le prolétariat se montrait déjà en 1871 comme la seule force capable de remettre en cause l’ordre capitaliste. Aujourd’hui, la bourgeoisie cherche encore à convaincre les prolétaires (et notamment les jeunes générations) qu’on peut construire un avenir meilleur pour l’humanité sans renverser l’État capitaliste. Face à la misère et à la barbarie du monde actuel, il importe que la classe ouvrière se penche sur son propre passé, pour en tirer les leçons, reprendre confiance en elle-même et en l’avenir que portent ses combats.
La Commune de Paris a constitué, pour de nombreuses générations de prolétaires, un point de référence dans l’histoire du mouvement ouvrier. En particulier, les révolutionnaires russes de 1905 et d’Octobre 1917 étaient fortement imprégnées de son exemple et de ses enseignements avant que cette dernière ne vienne prendre le relais comme phare pour la lutte du prolétariat mondial.
Aujourd’hui, les campagnes de la bourgeoisie essaient d’enterrer définitivement aux yeux des prolétaires du monde entier l’expérience révolutionnaire d’Octobre 1917, de les détourner de leur propre perspective en continuant à identifier le communisme avec le stalinisme. Ne pouvant utiliser la Commune de Paris pour inoculer ce même mensonge, la classe dominante a toujours essayé de récupérer cette expérience pour en masquer la véritable signification, pour la dénaturer en l’assimilant soit à un mouvement patriotique, soit à une lutte pour les libertés républicaines.
Un combat contre le capital et non une lutte patriotique
C’est suite à la guerre de 1870 entre la Prusse et la France que se constitue la Commune de Paris, sept mois après la défaite de Louis Napoléon Bonaparte à Sedan. Le 4 septembre 1870, le prolétariat parisien se soulève contre les conditions de misère qui lui sont imposées par l’aventure militaire de Bonaparte. La République est proclamée alors même que les troupes de Bismarck sont aux portes de Paris. La Garde nationale, à l’origine composée de troupes petite-bourgeoises, va désormais assurer la défense de la capitale contre l’ennemi prussien. Les ouvriers, qui commencent à souffrir de la famine, s’y engagent en masse et vont bientôt constituer l’essentiel de ses troupes. Mais, contrairement aux mensonges de la bourgeoisie qui veut ne nous faire voir dans cet épisode que la résistance du “peuple” de Paris contre l’envahisseur prussien, très vite, cette lutte pour la défense de Paris assiégé va céder la place à l’explosion des antagonismes irréconciliables entre les deux classes fondamentales de la société, le prolétariat et la bourgeoisie. En effet, après 131 jours de siège de la capitale, le gouvernement capitule et signe un armistice avec l’armée prussienne. Dès la fin des hostilités avec Bismarck, Thiers, nouveau chef du gouvernement républicain, comprend qu’il faut immédiatement désarmer le prolétariat parisien car celui-ci constitue une menace pour la classe dominante. Le 18 mars 1871, Thiers va essayer d’utiliser la ruse pour parvenir à ses fins: prétextant que les armes sont la propriété de l’État, il envoie des troupes dérober l’artillerie de la Garde nationale, composée de plus de 200 canons, que les ouvriers avaient cachée à Montmartre et Belleville (1). Mais cette tentative échoue grâce à la résistance farouche des ouvriers, et au mouvement de fraternisation entre les soldats et la population parisienne. C’est l’échec de cette tentative de désarmement de la capitale qui va mettre le feu aux poudres et déchaîner la guerre civile entre les ouvriers parisiens et le gouvernement bourgeois réfugié à Versailles. Le 18 mars, le Comité central de la Garde nationale, qui assurait provisoirement le pouvoir, déclare: “Les prolétaires de la capitale, au milieu des défaillances et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris que l’heure est arrivée pour eux de sauver la situation en prenant en main la direction des affaires publiques. (...) Le prolétariat a compris qu’il était de son devoir impérieux et de son droit absolu de prendre en main ses destinées, et d’en assurer le triomphe en s’emparant du pouvoir.” Le même jour, il annonce la tenue immédiate d’élections au suffrage universel. La Commune, élue le 26 mars et composée de délégués des différents arrondissements, sera proclamée deux jours plus tard. Plusieurs tendances seront représentées en son sein: la majorité, où dominent les blanquistes, et la minorité, dont les membres seront surtout des socialistes proudhoniens rattachés à l’Association Internationale des Travailleurs (la Première Internationale).
Immédiatement, le gouvernement de Versailles va riposter pour reprendre Paris tombé aux mains de la classe ouvrière, cette “vile canaille”, selon les termes de Thiers: les bombardements de la capitale que dénonçait la bourgeoisie française lorsqu’ils étaient l’œuvre de l’armée prussienne ne cesseront pas pendant les deux mois que durera la Commune.
Ainsi, loin d’avoir été un mouvement pour la défense de la patrie contre l’ennemi extérieur, c’est bien pour se défendre contre l’ennemi intérieur, contre “sa” propre bourgeoisie représentée par le gouvernement de Versailles, que le prolétariat parisien refusa de remettre les armes à ses exploiteurs et instaura la Commune.
Un combat pour la destruction de l’état bourgeois et non pour les libertés républicaines
La bourgeoisie a toujours eu besoin, en travestissant l’histoire, de s’appuyer sur les apparences pour distiller les pires mensonges. Ainsi, c’est en se fondant sur le fait que la Commune se revendiquait effectivement des principes de la révolution bourgeoise de 1789 qu’elle a toujours cherché à rabaisser cette première expérience révolutionnaire du prolétariat au niveau d’une vulgaire lutte pour les libertés républicaines, pour la démocratie bourgeoise contre les troupes monarchistes derrière lesquelles s’était ralliée la bourgeoisie française. Mais ce n’était pas dans les habits que le jeune prolétariat de 1871 avait revêtus que se trouvait l’esprit véritable de la Commune. C’est ce qu’il portait déjà comme perspective d’avenir qui fait de ce mouvement une étape de première importance dans la lutte du prolétariat mondial pour son émancipation. C’était la première fois dans l’histoire que, dans une capitale, le pouvoir officiel de la bourgeoisie avait été renversé. Et ce gigantesque combat était bien l’œuvre du prolétariat, d’un prolétariat certes encore très peu développé, à peine sorti de l’artisanat, traînant encore derrière lui le poids de la petite-bourgeoisie et de multiples illusions issues de la révolution bourgeoise de 1789. Mais c’était bien cette classe, et aucune autre, qui avait constitué le moteur et l’élément dynamique de la Commune. Ainsi, alors que la révolution prolétarienne mondiale n’ était pas encore à l’ordre du jour (tant du fait de l’immaturité de la classe ouvrière que d’une situation où le capitalisme n’avait pas encore épuisé toutes ses capacités à développer les forces productives à l’échelle de la planète), la Commune annonçait déjà avec fracas la direction dans laquelle allaient s’engager les futurs combats prolétariens.
Et si la Commune a pu reprendre à son propre compte les principes de la révolution bourgeoise de 1789, ce n’est certainement pas pour leur donner le même contenu. Pour la bourgeoisie, la “liberté” veut dire liberté du commerce et d’exploiter le travail salarié; l’“égalité” n’est rien d’autre que l’égalité juridique entre capitalistes et contre les privilèges de la noblesse; la “fraternité” est interprétée comme l’harmonie entre le capital et le travail, c’est-à-dire la soumission des exploités aux exploiteurs. Pour les ouvriers de la Commune, “Liberté, Égalité, Fraternité” signifiait l’abolition de l’esclavage salarié, de l’exploitation de l’homme par l’homme, de la société divisée en classes. Cette perspective d’un autre monde qu’annonçait déjà la Commune, on la retrouve justement dans le mode d’organisation de la vie sociale que la classe ouvrière a été capable d’instaurer pendant deux mois. Car ce sont bien les mesures économiques et politiques impulsées par le prolétariat parisien qui confèrent à ce mouvement sa véritable nature de classe, et non les mots d’ordre du passé dont il se réclamait.
Ainsi, deux jours après sa proclamation, la Commune affirme son pouvoir en s’attaquant immédiatement à l’appareil d’État à travers l’adoption de toute une série de mesures politiques: suppression de la police des mœurs, de l’armée permanente et de la conscription (la seule force armée reconnue étant la Garde nationale), suppression de toutes les administrations d’État, confiscation des biens du clergé, déclarés propriété publique, destruction de la guillotine, école gratuite et obligatoire, etc., sans compter les différentes mesures symboliques telle la démolition de la colonne Vendôme, emblème du chauvinisme de la classe dominante érigé par Napoléon premier. Le même jour, la Commune affirme encore son caractère prolétarien en déclarant que “le drapeau de la Commune (2) est celui de la République universelle”. Ce principe de l’interna-tionalisme prolétarien est notamment affiché clairement par le fait que les étrangers élus à la Commune (tels le polonais Dombrowski, responsable de la Défense, et le hongrois Frankel, chargé du Travail) seront confirmés dans leurs fonctions.
Et parmi toutes ces mesures politiques, il en est une qui vient particulièrement démentir l’idée selon laquelle le prolétariat parisien se serait insurgé pour la défense de la République démocratique: la révocabilité permanente des membres de la Commune, responsables devant l’ensemble de ceux qui les avaient élus. Ainsi, bien avant que ne surgissent, avec la Révolution russe de 1905, les conseils ouvriers, cette “forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat”, comme le disait Lénine, ce principe de la révocabilité des charges que se donnait le prolétariat pour la prise du pouvoir vient encore confirmer la nature prolétarienne de la Commune. En effet, alors que la dictature bourgeoise, dont le gouvernement “démocratique” n’est que la variante la plus pernicieuse, concentre tout le pouvoir d’État de la classe exploiteuse entre les mains d’une minorité pour opprimer et exploiter l’immense majorité des producteurs, le principe de la révocabilité permanente est la condition pour qu’aucune instance de pouvoir ne s’impose au-dessus de la société. Seule une classe qui vise à l’abolition de toute domination d’une minorité d’oppresseurs sur l’ensemble de la société peut prendre en charge cette forme d’exercice du pouvoir.
Et c’est justement parce que les mesures politiques prises par la Commune traduisaient clairement le caractère prolétarien de ce mouvement que les mesures économiques, bien que limitées, ne pouvaient aller que dans le sens de la défense des intérêts de la classe ouvrière: gratuité des loyers, suppression du travail de nuit pour certaines corporations telle celle des boulangers, abolition des amendes patronales et retraits sur salaires, réouverture et gestion par les ouvriers eux-mêmes des ateliers fermés, rétribution des membres de la Commune équivalant au salaire ouvrier, etc.
Ainsi, il est clair que ce mode d’organisation de la vie sociale allait dans le sens non de la “démocratisation” de l’État bourgeois, mais de sa destruction. Et c’est bien cet enseignement fondamental que légua l’expérience de la Commune pour tout le mouvement ouvrier futur. C’est cette leçon que le prolétariat en Russie allait, sous l’impulsion de Lénine et des bolcheviks, mettre en pratique de façon beaucoup plus claire en octobre 1917. Comme Marx le signalait déjà en 1852 dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte: “Toutes les révolutions politiques jusqu’à présent n’ont fait que perfectionner la machine d’État au lieu de la briser.” Bien que les conditions du renversement du capitalisme ne fussent pas encore réunies, cette dernière révolution du xixe siècle que fut la Commune de Paris, annonçait déjà les mouvements révolutionnaires du xxe siècle: elle montrait dans la pratique que “la classe ouvrière ne peut se contenter de prendre telle quelle la machine d’État et la faire fonctionner pour son propre compte. Car l’instrument politique de son asservissement ne peut servir d’instrument politique de son émancipation.” (Marx, La Guerre civile en France.)
Face à la menace prolétarienne, la bourgeoisie déchaîne sa furie sanguinaire
La classe dominante ne pouvait accepter que le prolétariat ait osé se dresser contre son ordre. C’est pour cela qu’en reprenant Paris par les armes, la bourgeoisie s’était donné comme objectif non seulement de rétablir son pouvoir dans la capitale, mais surtout d’infliger une saignée mémorable dans les rangs ouvriers afin de donner au prolétariat une leçon définitive. Et la fureur qu’elle déchaîna dans la répression de la Commune était à la mesure de la peur que lui inspirait déjà la classe ouvrière. Dès les premiers jours d’avril s’organise, pour écraser la Commune, la sainte alliance entre Thiers et Bismarck, dont les troupes occupaient les forts du nord et de l’est de Paris. Ainsi, déjà à cette époque, la bourgeoisie montrait sa capacité à reléguer au second plan ses antagonismes nationaux pour affronter son ennemi de classe. Cette collaboration étroite entre les armées française et prussienne a permis d’abord la mise en place d’un double cordon sanitaire autour de la capitale. Le 7 avril, les Versaillais s’emparent des forts de l’ouest de Paris. Devant la résistance acharnée de la Garde nationale, Thiers obtient de Bismarck la libération de 60.000 soldats français faits prisonniers à Sedan, ce qui va donner au gouvernement de Versailles une supériorité décisive à partir du début mai. Dans la première quinzaine de mai, c’est le front sud qui est enfoncé. Le 21, les Versaillais, dirigés par le général Galliffet, entrent dans Paris par le nord et l’est grâce à une brèche ouverte par l’armée prussienne. C’est alors que va se déchaîner toute la furie sanguinaire de la bourgeoisie. Pendant huit jours, les combats font rage dans les quartiers ouvriers; les derniers combattants de la Commune vont tomber comme des mouches sur les hauteurs de Belleville et de Ménilmontant. Mais la répression sanglante des communards ne pouvait s’arrêter là. Il fallait encore que la classe dominante puisse savourer son triomphe en débridant sa haine vengeresse contre un prolétariat désarmé et battu, contre cette “vile canaille” qui avait eu l’audace de se rebeller contre sa domination de classe: tandis que les troupes de Bismarck recevaient l’ordre de ne laisser passer aucun fugitif, les hordes de Galliffet perpétraient des massacres massifs d’hommes, de femmes et d’enfants sans défense: c’est par centaines qu’ils furent froidement assassinés à la mitrailleuse et même à bout portant.
La Semaine sanglante se termina ainsi sur une innommable boucherie qui fit plus de 20.000 morts. Puis sont venues les arrestations en masse, les exécutions de prisonniers “pour l’exemple”, les déportations au bagne et les placements de plusieurs centaines d’enfants dans des maisons de correction.
Voilà comment la bourgeoisie a pu rétablir son ordre. Voilà comment elle réagit lorsque sa dictature de classe est menacée. Et ceux qui ont noyé la Commune dans un bain de sang, ce ne sont pas les seuls secteurs les plus réactionnaires de la classe dominante. C’est sa fraction républicaine et “démocratique”, avec son Assemblée nationale et ses parlementaires libéraux, qui, en confiant cette sale besogne aux troupes monarchistes, porte l’entière responsabilité du massacre et de la terreur. Ce premier haut fait de la démocratie bourgeoise, le prolétariat ne doit jamais l’oublier.
Avec l’écrasement de la Commune, qui a conduit à la disparition de la Première Internationale après 1872, la bourgeoisie est parvenue à infliger une défaite aux ouvriers du monde entier. Et cette défaite fut particulièrement cuisante pour la classe ouvrière en France, puisqu’elle a cessé, après cette tragédie, d’être aux avant-postes de la lutte du prolétariat mondial comme cela avait été le cas depuis 1830. Cette position d’avant-garde, le prolétariat de France ne la retrouvera que lors de la grève massive de mai 1968, qui ouvrira une nouvelle perspective en signant la reprise historique des combats de classe après quarante ans de contre-révolution. Et ce n’est pas le fait du hasard: en reprenant, même de façon momentanée, son rôle de phare qu’il avait abandonné depuis près d’un siècle, il annonçait toute la vitalité, la force et la profondeur de cette nouvelle étape de la lutte historique de la classe ouvrière mondiale vers le renversement du capitalisme.
Mais cette nouvelle période historique ouverte par mai 1968 se situe, contrairement à la Commune, à un moment où la révolution prolétarienne est devenue non seulement une possibilité mais aussi une nécessité. C’est justement cette vitalité et cette force du prolétariat, ainsi que les enjeux de ses combats actuels, que la bourgeoisie cherche à tout prix à lui masquer à travers toutes ses campagnes mensongères, ses falsifications et tentatives de dénaturer les expériences révolutionnaires du passé n
Avril/15.05.91, d’après RI n°202, juin 1991
(1) fait, ces canons avaient été achetés avec l’argent des membres de la Garde nationale.
(2) fait que dès sa proclamation, la Commune fit flotter sur Paris le drapeau rouge au détriment du drapeau tricolore, emblème de l’idéologie nationaliste de la bourgeoisie, révèle encore le caractère prolétarien et non patriotique de ce mouvement. Il faudra attendre les années 1930 pour que, avec la trahison des partis communistes, les staliniens (et notamment le PCF) avilissent le drapeau de l’internationalisme prolétarien en le croisant avec le drapeau national de la bourgeoisie.
Histoire du mouvement ouvrier:
Internationalisme no 352 - 4e trimestre 2011
- 1228 lectures
Ils accusent la finance pour épargner le capitalisme!
- 1441 lectures
“Il va y avoir un krach et la chute sera violente”. “Absolument personne ne croit aux plans de sauvetage, ils savent que le marché est cuit et que la bourse est finie”. “Les traders se foutent de comment on va redresser l’économie”. “Cette crise économique est comme un cancer”. “Préparez-vous! Ce n’est pas le moment d’espérer que les gouvernements règlent les problèmes. Les gouvernements ne dirigent pas le monde, c’est Goldman Sachs qui dirige le monde. Cette banque se fiche des plans de sauvetage”. “Dans moins de 12 mois je prédis que les économies de millions de gens vont disparaître, et ce ne sera que le début...”. Ces propos ont été tenus lundi 26 septembre sur la BBC par le trader londonien Alesio Rastani. 1
Nous partageons évidemment la noirceur de la perspective tracée par cet économiste. Le capitalisme va continuer de plonger, la crise va s’aggraver et être de plus en plus ravageuse, et les mille souffrances de la misère vont s’abattre sur une frange toujours plus large de l’humanité. Cette déclaration d’Alesio Rastani vient surtout alimenter l’un des plus gros mensonges de ces dernières années: la planète serait en faillite à cause de la finance… et seulement à cause de la finance. “C’est Goldman Sachs qui dirige le monde”. Et toutes les voix altermondialistes, de gauche et d’extrême-gauche de s’écrier alors en chœur: “Quelle horreur! Voilà la cause de tous nos maux. Nous devons reprendre le contrôle de l’économie. Nous devons mettre au pas les banques et la spéculation. Nous devons lutter pour un Etat plus fort et plus humain!”.
Ce n’est pas une nuance ou une simple affaire de terminologie. Accuser le libéralisme ou accuser le capitalisme est fondamentalement différent. D’un côté, il y a l’illusion que ce système d’exploitation peut être réformé. De l’autre, il y a la compréhension que le capitalisme n’a pas d’avenir, qu’il doit être détruit de fond en comble et remplacé par une nouvelle société. Nous comprenons donc pourquoi la classe dominante, ses médias et ses experts déploient autant d’énergie à pointer du doigt l’irresponsabilité de la finance en l’accusant de tous les déboires économiques actuels.
“C’est la faute aux traders!” : le pitoyable procédé du bouc-émissaire
Depuis quatre ans, à chaque krach boursier éclate une affaire de trader véreux. En janvier 2008, le “scandale Jérôme Kirviel” fait la Une des journaux. Il est jugé responsable de la déroute de la Société générale (banque française) pour avoir perdu 4,82 milliards d’euros. La vraie raison, l’éclatement de la bulle immobilière aux Etats-Unis, est reléguée au second plan. En décembre 2008, l’investisseur Bernard Madoff est mis en examen pour une arnaque de 65 milliards de dollars et fait ponctuellement oublier la faillite du géant bancaire américain Lehman Brothers. En septembre 2011, le trader Kweku Adoboli est accusé d’une fraude de 2,3 milliards de dollars à la banque suisse UBS. Cette affaire tombe, par le “plus grand des hasards”, en pleine nouvelle déconfiture économique mondiale.
La ficelle tirée ici par les banques pour justifier leurs déboires est un peu trop grosse pour ne pas être vue. Mais cette propagande médiatique intense permet de focaliser toutes les attentions sur le monde pourri de la finance. L’image de ces requins de spéculateurs, sans foi ni loi, est en train de s’incruster dans nos esprits jusqu’à devenir obsédante et embrumer notre réflexion.
Alors, prenons un instant de recul et réfléchissons: comment ces faits-divers peuvent-ils expliquer en quoi que ce soit les menaces de faillite qui planent sur l’économie mondiale? Aussi révoltantes que puissent être ces magouilles de plusieurs milliards de dollars quand des millions de personnes meurent de faim à travers le monde, aussi cyniques et honteux puissent être les propos tenus par Alesio Rastani, il n’y a là rien qui justifie en profondeur l’ampleur de la crise économique mondiale qui touche actuellement tous les secteurs et tous les pays. Il n’y a là rien de nouveau. Le capitalisme est un système d’exploitation inhumain depuis sa naissance. Le pillage barbare et sanguinaire des populations d’Afrique et d’Asie au XVIII et au XIX ème siècles en constitue une preuve tragique. La voyoucratie des traders et des banques n’explique donc rien de la crise actuelle. Si les escroqueries financières entraînent aujourd’hui des pertes colossales et mettent parfois en péril l’équilibre des banques, c’est en réalité à cause de leur fragilité induite par la crise et non l’inverse. Si, par exemple, Lehman Brothers a fait faillite en 2008, ce n’est pas à cause de l’irresponsabilité de sa politique d’investissement mais parce que le marché de l’immobilier américain s’est effondré lors de l’été 2007 et que cette banque s’est retrouvée avec des monceaux de créances sans aucune valeur.
“C’est la faute aux agences de notation” : comment accuser le thermomètre en cas de fièvre
Les agences de notation sont, elles aussi, sous le feu croisé des critiques. Fin 2007, elles étaient taxées d’incompétence pour avoir négligé le poids des dettes souveraines des Etats. Aujourd’hui, elles sont accusées au contraire de trop pointer du doigt ces mêmes dettes souveraines de la zone euro (pour Moody’s) et des Etats-Unis (pour Standard & Poor’s).
Il est vrai que ces agences ont des intérêts particuliers, que leur jugement n’est pas neutre. Les agences de notation chinoises ont ainsi été les premières à dégrader la note de l’Etat américain, et les agences de notation américaines sont plus sévères envers l’Europe qu’envers leur propre pays. Et il est aussi vrai qu’à chaque dégradation, les financiers en profitent pour spéculer, ce qui accélère la dégradation des conditions économiques.
Mais la réalité, c’est que ces toutes agences sous-estiment volontairement la gravité de la situation; les notes qu’elles attribuent sont bien trop élevées au regard de la capacité réelle des banques, des entreprises et de certains Etats à pouvoir un jour rembourser leurs dettes. L’intérêt de ces agences est indéniablement de ne pas trop critiquer les fondamentaux économiques pour ne pas créer d’affolement. Quand elles décôtent, c’est qu’elles y sont contraintes pour conserver un minimum de crédibilité. Nier totalement la gravité de la situation de l’économie mondiale serait grotesque et personne n’y croirait; il est plus intelligent, du point de vue de la classe dominante, de reconnaître certaines faiblesses pour mieux amoindrir les problèmes de fond de son système. Tous ceux qui accusent les agences de notation aujourd’hui savent tout cela parfaitement. S’ils dénigrent la qualité du thermomètre, c’est pour éviter toute réflexion sur l’étrange maladie qui touche le capitalisme mondial, de peur que l’on ne s’aperçoive qu’il s’agit là d’une maladie dégénérescente et incurable!
“C’est la faute à la finance” : la confusion de la maladie et du symptôme
Ces critiques des traders et des agences de notation appartiennent à une entreprise de propagande beaucoup plus vaste sur la folie et l’hypertrophie de la finance. Comme toujours, cette idéologie mensongère s’appuie sur une parcelle de vérité. Car il faut bien l’avouer, le monde de la finance est effectivement devenu ces dernières décennies un monstre gigantesque, presque obèse, qui est peu à peu gagné par l’irrationalité.
Les preuves sont légions. En 2008, le total des transactions financières mondiales s’élevait à 2200000 milliards de dollars, contre un PIB mondial de 55000 milliards. 2 L’économie spéculative est donc environ 40 fois plus importante que l’économie dite “réelle”! Et ces milliards ont été au fil des ans investis de manière de plus en plus folle et auto-destructrice. Un exemple est à lui seul édifiant: la VAD (vente à découvert). De quoi s’agit-il? “Dans le mécanisme de vente à découvert, nous commençons par vendre une valeur que nous ne possédons pas pour la racheter plus tard. Le but du jeu est bien évidemment de vendre une valeur à un certain prix et de la racheter à un prix inférieur pour encaisser la différence. Comme nous le voyons, le mécanisme est complètement opposé à celui d’un achat suivi d’une vente”. 3 Concrètement, la VAD entraîne d’immenses flux financiers spéculatifs sur certaines valeurs en pariant sur leur baisse, ce qui parfois peut entraîner la faillite de la cible. C’est aujourd’hui ce qui fait scandale. De nombreux économistes et politiciens nous expliquent qu’il s’agit même là du principal problème, de LA cause de la faillite de la Grèce ou de la chute de l’euro. Leur solution est donc simple: interdire les VAD et tout ira de nouveau pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il est vrai que ces ventes à découvert sont une pure folie et qu’elles accélèrent la destruction de pans entiers de l’économie. Mais justement, elles ne font que “l’accélérer”, elles n’en sont pas la cause! Il faut que la crise économique fasse déjà rage pour que ces ventes soient avantageuses à une si grande échelle. Les capitalistes parient de manière croissante sur la baisse et non plus sur la hausse des marchés. Les investisseurs font “des coups” sur le très court terme, sans aucun souci de la pérennité des entreprises et des usines car, de toute façon, il n’y a presque plus de secteurs industriels sûrs et rentables sur le long terme. Et c’est là, qu’enfin, nous commençons à toucher du doigt le vrai cœur du problème: l’économie dite “réelle” ou “traditionnelle” est plongée dans un profond marasme depuis des décennies. Les capitaux fuient cette sphère qui est de moins en moins rentable. Le commerce mondial étant saturé de marchandises invendables, les usines ne tournent plus suffisamment et n’accumulent plus assez. Résultat, les capitalistes investissent leur argent dans la spéculation, le “virtuel”. D’où l’hypertrophie de la finance qui n’est qu’un symptôme de la maladie incurable du capitalisme: la surproduction.
“C’est la faute au néolibéralisme” : comment enchaîner les exploités à l’Etat
Ceux qui luttent contre le néolibéralisme partagent ce constat d’état de délabrement de l’économie réelle. Pour eux, “c’est Goldman Sachs qui dirige le monde”. Ils luttent donc pour plus d’Etat, plus d’encadrement, plus de politique sociale. “Avec plus d’Etat pour encadrer la finance, nous pourrons construire une nouvelle économie, plus sociale et prospère.”
Le “plus d’Etat” ne permet en rien de régler les problèmes économiques du capitalisme. Répétons-le, ce qui mine fondamentalement ce système, c’est sa tendance naturelle à produire plus de marchandises que ses marchés ne peuvent en absorber. Depuis des décennies, il parvient à éviter la paralysie de son économie en écoulant sa surproduction dans un marché créé artificiellement par l’endettement. En d’autres termes, le capitalisme survit à crédit depuis les années 1960. C’est pourquoi aujourd’hui, les particuliers, les entreprises, les banques, les Etats, croulent tous sous une gigantesque montagne de créances et que la récession actuelle est nommée “la crise de la dette”. Or, depuis 2008 et la faillite de Lehman Brothers, que font les Etats, à travers leurs banques centrales, Fed et BCE en tête? Ils injectent des milliards de dollars pour éviter les faillites. Et d’où viennent ces milliards? De nouvelles dettes! Ils ne font donc que déplacer l’endettement privé vers la sphère publique et ainsi préparer de futures faillites d’Etat, comme nous le voyons avec la Grèce dès aujourd’hui.. 4
“Mais s’il ne règle pas la crise, l’Etat pourrait tout de même nous protéger, être plus social”, nous disent tous les chœurs de la gauche.
C’est oublier un peu vite que l’Etat est et a toujours été le pire des patrons. Ainsi, les nationalisations n’ont jamais été une bonne nouvelle pour les travailleurs. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’importante vague de nationalisations avait pour objectif de remettre sur pied l’appareil productif détruit en augmentant les cadences de travail. A l’époque, Thorez, secrétaire général du Parti communiste français et alors vice-président du gouvernement dirigé par De Gaulle, lança à la face de la classe ouvrière: “Si des mineurs doivent mourir à la tâche, leurs femmes les remplaceront”, ou encore: “Retroussez vos manches pour la reconstruction nationale!”.
Les révolutionnaires communistes ont toujours mis en évidence, depuis l’expérience de la Commune de Paris de 1871, le rôle viscéralement anti-prolétarien de l’État. “L’État moderne, quelle qu’en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste: l’État des capitalistes, le capitaliste collectif idéal. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n’est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble.” Friedrich Engels a écrit ces lignes en 1878, ce qui montre que, déjà à l’époque, l’Etat commençait à étendre ses tentacules sur l’ensemble de la société. Depuis lors, le capitalisme d’Etat n’a fait que se renforcer; chaque bourgeoisie nationale est en rang et au garde-à-vous derrière son Etat pour mener à bien la guerre commerciale internationale sans merci.
“Les Brics vont nous sauver” : les miracles économiques n’existent pas
Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (ou Brics) ont connu ces dernières années un succès économique retentissant. La Chine en particulier est considérée aujourd’hui comme la deuxième puissance économique mondiale, et nombreux sont ceux qui pensent qu’elle ne tardera pas à détrôner les Etats-Unis. Cette réussite flamboyante fait espérer aux économistes que ce groupe de pays pourrait devenir la nouvelle locomotive de l’économie mondiale. Les altermondialistes voient là une raison de se réjouir: la suprématie américaine de l’ultra-libéralisme étant vécue comme l’un des pires fléaux de ces dernières décennies, la montée en puissance des Brics permettrait l’avènement futur d’un monde plus équilibré et juste. Cet espoir commun de voir les Brics se développer, qu’expriment tous les grands bourgeois et les alter-mondialistes, n’est pas seulement comique, il révèle aussi qu’ils sont tous également profondément attachés au monde capitaliste.
Cet espoir va vite être déçu car il y a dans toute cette affaire de “miracle économique” un air de déjà-vu. L’Argentine et les tigres asiatiques dans les années 1980-1990 ou, plus récemment, l’Irlande, l’Espagne et l’Islande, ont été eux aussi mis en avant, en leur temps, comme des “miracles économiques”. Et comme tout miracle, cela s’est révélé être une supercherie. Tous ces pays devaient leur rapide croissance à un endettement totalement débridé. Ils ont donc connu le même sort: récession et faillite. Il en sera de même pour les Brics. Le président du fonds souverain China Investment Corp, Gao Xiping, vient d’ailleurs de déclarer: “Nous ne sommes pas des sauveteurs, nous devons nous sauver nous-mêmes”. Nous ne saurions être plus clairs !
La vérité, c’est que le capitalisme n’a ni solution, ni avenir
Le capitalisme ne peut plus être réformé. Etre réaliste, c’est admettre que seule la révolution peut éviter la catastrophe. Le capitalisme, comme l’esclavagisme et le servage avant lui, est un système d’exploitation condamné à disparaître. Après s’être développé et épanoui durant deux siècle, aux xviiie et xixe siècles, après avoir conquis la planète, le capitalisme est entré en décadence avec fracas en déclenchant la Première Guerre mondiale. La Grande dépression des années 1930 puis l’effroyable boucherie de la Seconde Guerre mondiale sont venues confirmer l’obsolescence de ce système. Mais depuis les années 1950, aucune crise aussi violente que celle de 1929 n’a éclaté. La bourgeoisie a appris à limiter les dégâts et à relancer l’économie; ce qui laisse croire aujourd’hui à certains que la nouvelle crise que nous traversons n’est qu’un énième et nouvel épisode de ces multiples tremblements et que la croissance ne tardera pas à revenir, comme elle le fait depuis 60 ans et plus.
En effet, chaque fois, la bourgeoisie n’est parvenue à relancer l’économie mondiale qu’en ouvrant toujours plus grandes les vannes du crédit. Elle n’est jamais parvenue à régler le problème de fond, la surproduction chronique ; elle n’a donc fait que repousser les échéances à coup de dettes et aujourd’hui, le système entier est étouffé sous les créances: tous les secteurs, tous les pays sont surendettés. Cette fuite en avant touche donc à sa fin. Est-ce à dire que l’économie va se bloquer, que tout va s’arrêter? Evidemment non. La bourgeoisie va continuer à se débattre. Concrètement, aujourd’hui, la classe dominante n’a le choix qu’entre deux politiques qui sont comme la peste et le choléra: austérité draconienne ou relance monétaire. La première mène à la récession violente, la seconde à l’explosion d’une inflation incontrôlable.
Dorénavant, l’alternance de courtes phases récessives et de longues périodes de reprise financées à coups de crédits est une époque définitivement révolue: le chômage va exploser et la misère comme la barbarie vont se répandre de façon dramatique. S’il y aura, de temps à autres, des phases de relance, ce ne seront que des “bouffées d’oxygène” de très courte durée auxquelles succéderont de nouveaux cataclysmes économiques. Tous ceux qui prétendent le contraire sont comme ce suicidaire qui, après avoir sauté du haut de l’Empire State Building, disait à chaque étage que “jusqu’ici, tout va bien”. La seule véritable incertitude est de savoir comment va s’en sortir l’humanité. Va-t-elle sombrer avec le capitalisme? Ou va-t-elle être capable de construire un nouveau monde de solidarité et d’entraide, sans classes ni Etat, sans exploitation ni profit? Comme l’a écrit Friedrich Engels il y a déjà plus d’un siècle: “La société bourgeoise est placée devant un dilemme: ou bien passage au socialisme ou rechute dans la barbarie”! Les clés de ce futur sont entre les mains de toute la classe ouvrière, de ses luttes unissant travailleurs, chômeurs, retraités et jeunes précaires.
D’après Pawel/29.09.2011 5
1 Source?: http ://www.dailymotion.com/video/xlcg84_alessio-rastani-c-est-goldman-sachs-qui...
2 Source?: http?://www.jacquesbgelinas.com/index_files/Page3236.htm
3 Source?: http?://www.abcbourse.com/apprendre/1_vad.html
4 Le “plus d’Europe” ou le “plus de gouvernance mondiale” est évidemment tout autant une impasse?: qu’ils soient seuls ou à plusieurs, les Etats n’ont aucune solution réelle et durable. Tout juste leur union permet-elle de ralentir un peu l’avancée de la crise alors que leurs divisions l’accélèrent.
5 pour lire l’article en entier, voir https://fr.internationalism.org
Rubrique:
Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne : Occupy, le poids des illusions
- 1499 lectures
"Le mouvement Occupy a lieu partout dans le monde. Nous sommes les 99%. Nous sommes un forum pacifique et non-hiérarchique. Nous convenons tous que le système actuel est antidémocratique et injuste. Nous avons besoin d’alternatives, vous êtes invités à nous rejoindre dans le débat et de les développer, à créer un avenir meilleur pour tous“. Ceci est la déclaration qui vous accueille sur le site Web de Occupy Londres. 1
Indéniablement, les appels, les rencontres et occupations d’espaces public partout dans le monde trouvent leur source d’inspiration dans le mouvement Occupy Wall Street, qui s’étend dans plus d’une centaines de villes aux Etats-Unis 2, ainsi que dans d’autres villes à travers l’Europe, et également à des villes en Asie et en Amérique-Latine. Nous avons aussi vu cette vague d’Occupy traverser la Belgique et les Pays-Bas. Le format général de ce mouvement a été l’occupation (pour une courte ou longue durée) d’une place public centrale, suivie par des discussions ouvertes, discours, témoignages, appelant à des manifestations et autres actions.
Que les gens prenant part aux mouvements Occupy aient des préoccupations sincères sur la santé du monde actuel, l’état de son économie et de sa politique, est incontestable. Les nombreux sites Web, pages Facebook et Twitter, les discussions ouvertes et les déclarations en témoignent. Des camarades du CCI ont visité différents sites du mouvement dans plusieurs pays et ils ont activement pris part aux discussions qui se déroulaient. Parmi les participants aux manifestations, on retrouvait aussi bien des gens qui travaillaient, que des chômeurs, retraités et étudiants. De nombreux orateurs exprimaient leurs frustrations, leur mécontentement, d’autres tentaient de développer des analyses. Des témoignages suivaient des "discours" classiques et un nombre croissant de participants voulait vraiment lancer une discussion collective entre eux. Les occupations fournissent en effet, quelque chose qui n’est pas disponible en grand nombre dans le monde - un espace public où les gens sont libres de venir et de discuter en assemblées générales (AG) dans un effort d’essayer de comprendre la situation actuelle du monde.
Comme les événements récents en Espagne et la Grèce l’ont démontré, les assemblées sont l’élément vital de l’auto-organisation des travailleurs. Elles sont le lieu où la confrontation politique, la clarification et la réflexion peuvent avoir lieu. Mais au stade actuel il ne faut surtout pas confondre le point de départ et la forme avec le stade final. La route est encore longue. L’exemple le plus clair en est les discussions intenses en Espagne entre ceux qui plaident pour la "démocratie réelle», c’est à dire une meilleure démocratie gouvernementale réformée et ceux mettant en avant une perspective prolétarienne: "Il y a eu quelques moments très émouvants où les orateurs étaient très excités et presque tous parlaient de révolution, de dénoncer le système, d’être radical (dans le sens d’ "aller à la racine du problème» comme l’un d’eux l’a dit).“3
Beaucoup de discussions autour des protestations Occupy s’articulent encore autour de deux thèmes principaux: comment "améliorer» la démocratie parlementaire, la reconquérir pour le peuple contre les riches, les banquiers, les élites et, deuxièmement comment amener la justice sociale c’est à dire une répartition plus équitable sous le capitalisme. Comme un de nos camarades en Grande-Bretagne rapporta: "J’ai finalement trouvé la réunion où il y avait une discussion sur la démocratie et où j’ai appris qu’ils n’ont pas vraiment la démocratie en Espagne ... Dans cette réunion, les politiciens étaient à blâmer presque pour tout. Il y a eu quelques voix dissidentes qui ont tenté de soulever la question de l’économie, de souligner que la démocratie au Royaume-Uni n’est pas meilleure. Et il y avait quelques contributions bizarres à la discussion, y compris l’idée que nous devrions faire participer le public dans la fonction publique dans le même sens qu’il soit appelé à faire partie d’un jury public ...ou nous devrions obtenir de meilleurs gestionnaires dans le gouvernement comme en Chine ..."
Lors des discussions et discours, il y a eu des tentatives à certains endroits d’envoyer des délégations, entre autre à des manifestations ouvrières (électriciens en Grande-Bretagne, d’autres conflits ouvriers en Espagne, les métallurgistes en Belgique). Ceci à un moment où, aussi bien en Grande-Bretagne, en Belgique qu’aux Pays-Bas, malgré la peur et la colère engendrées par l’austérité, il n’y avait pas réellement de riposte ouvrière.
Il devient de plus en plus clair que l’énergie spontanée initiale du mouvement est en reflux un peu partout, comme le montrent les assemblées générales, de plus en plus transformées en chambres d’écho passives des “groupes de travail" et des “comités", dont beaucoup semblent être dominés par des militants professionnels, des militants gauchistes, etc.
En Belgique et en Hollande, le CCI a également apporté des contributions limitées aux discussions. Parmi celles-ci: (a) que la façon dont les politiciens se comportent n’est pas causée par le système électoral, que ce soit en Espagne, ou en Belgique ou aux Pays-Bas, mais par le fait qu’ils défendent le capitalisme; (b) sur le rôle de la crise, qui n’est pas seulement provoquée par les banquiers; (c) sur l’importance des assemblées générales et la référence aux principales expériences historiques.
Le mouvement Occupy en Belgique et aux Pays-Bas n’est pas seulement beaucoup plus limité en taille que les mouvements en Espagne et aux Etats-Unis, mais il a surtout beaucoup plus de peine à parvenir à un véritable débat collectif et à obtenir la profondeur dans sa quête d’analyses et de réponses aux questions actuelles.
Un bon nombre de groupes gauchistes en Belgique, aux Pays-Bas, comme en Angleterre, ont souvent essayé de surfer sur les vagues du mouvement afin de faire passer leur propre agenda à travers de nombreux discours et des groupes de travail. Ce ne fut pas très difficile, parce que les réunions avaient la forme d’une réunion ouverte à tous sans beaucoup de structure. En outre, le mouvement n’était pas assez mature pour contrer les tentatives de ces groupes de monopoliser le mouvement. Aussi par une aversion aveugle de la politique, il y avait une réticence à annoncer la couleur politique, un nombre se cachant derrière "une idéologie a-politique" engendrant rapidement le nivellement de nombreuses discussions vers des slogans, vers la désignation de "coupables» et une série de protestations sans perspectives. Cela signifiait que la teneur des débats a été la plupart du temps, à part quelques cas positifs, limitée à un mélange de contributions réformistes, a-historiques et mystiques.
Les mouvements Occupy ici, mais aussi dans de nombreux autres pays, ont été très sensibles à leur image dans les médias. En effet, l’absence d’une claire conscience qu’ils devaient prendre en main et organiser eux-même l’extension et la solidarité les ont placé dans une position de faiblesse. La réaction des médias a été assez prévisible: de titres dans le genre "le choc! l’horreur!" aux articles dans la presse plus libérale ou de gauche qui mettaient en avant que ces occupations stimulaient ou constituaient un coup de pouce pour un système démocratique pondéré. Dans l’ensemble, la plupart de la presse a essayé de mettre en évidence que les politiciens devraient "répondre» aux "préoccupations" de cette protestation légitime. Mais par l’absence d’une perspective d’élargissement du mouvement vers la classe ouvrière, le mécontentement et la colère, alimentés par les médias et comment ils présentaient l’occupation, devenaient un point de fixation.
Aussi la menace d’expulsion et comment se défendre contre la violence et la répression consécutives, sont évidemment une préoccupation importante dans les lieux où il y avait une occupation permanente. Dans de nombreux endroits, tels qu’à travers les Etats-Unis, la "réponse" des politiciens a pris la forme d’une répression sévère. Cependant, quand ils ont discuté dans les assemblées générales sur la façon de réagir aux menaces d’expulsion, la préoccupation majeure était de savoir comment les médias dépeignaient leur réactions. Une proposition d’aller aux travailleurs, soutenue par nos camarades sur place, ainsi qu’ un rappel par un autre participant que leurs objectifs vont au-delà d’un maintien indéfiniment de l’occupation, ne sont pas repris. En fait les deux propositions ont été considérées comme une distraction.
Nous craignons que le plus grand danger aujourd’hui est que les mouvements Occupy se trouvent piégés dans une dynamique de recherche désespérée introspective et laissent ainsi les gauchistes et les médias décider de l’avenir du mouvement.
Lac & Ward / 20.11.2011
2 https://en.internationalism.org/node/4571
3 https://en.internationalism.org/icconline/2011/september/indignados
Récent et en cours:
Rubrique:
En Egypte, les dirigeants changent, la lutte des travailleurs demeure
- 1065 lectures
Le “mouvement de la Place Tahrir” du Caire, en Egypte, qui a fait chuter le régime de Moubarak, a inspiré les exploités du monde entier, en Espagne, en Grèce, en Israël et même aux Etats-Unis. Le courage et la détermination des manifestants ainsi que l’ampleur des rassemblements ont impressionné et donné confiance en la capacité des masses à se dresser ensemble, comme un seul homme, face aux puissants. Mais la force la plus importante dans ce mouvement a été la classe ouvrière. Les grèves dans tout le pays les 8, 9 et 10 février ont en effet constitué le facteur décisif dans la destitution du président Moubarak.
Cela dit, il faut aussi avoir conscience des limites objectives de cette lutte. Contrairement à ce que nous ont raconté la bourgeoisie et tous ses médias aux ordres, ce mouvement n’a jamais été une “révolution”. Qui est aujourd’hui au pouvoir? L’armée! Et à la tête de l’Etat, ses décisions sont tout ce qu’il y a de plus réactionnaire, répressives et anti-ouvrières. Elle a ainsi adopté presque immédiatement une nouvelle loi interdisant les grèves. Les travailleurs vivant en Egypte l’ont d’ailleurs instantanément compris. Ils ne sont pas laissés berner par ce changement de masque du régime, ils ont poursuivi la lutte pour défendre leurs conditions de vie. Depuis le début de septembre, il y a même une nouvelle vague de mécontentement et de contestation.
Des dizaines de milliers d’ouvriers du textile ont fait grève un peu partout dans le pays ainsi qu’une grande partie des 100.000 médecins, la moitié des 200.000 techniciens de la santé des hôpitaux, 4.000 dockers de l’un des ports du canal de Suez, plus de 50 % des 1,7 million d’enseignants du pays. Cette grève des enseignants est très significative de la colère immense qui traverse le pays puisqu’il s’agit de leur première grève nationale depuis 1951 et qu’ils sont allés jusqu’à occuper un certain nombre de bâtiments gouvernementaux. Au Caire, 45.000 chauffeurs d’autobus, mécaniciens et contrôleurs de billets ont aussi été en grève. Certains ont rejoint les manifestations des enseignants au siège du gouvernement.
La vague de luttes spectaculaire qui avait fait trembler tout le pays début 2011 s’était presque totalement éteinte quelques semaines après le départ de Moubarak et l’annonce des nouvelles mesures envisagées par les nouveaux maîtres militaires. Mais toutes les promesses n’ayant évidemment jamais été tenues, la colère explose aujourd’hui de nouveau. Al-Masry Al-Youm a ainsi écrit le 15 septembre: “Les revendications économiques et politiques non satisfaites ont maintenu la fureur des ouvriers d’Egypte” et “Selon les analystes, la récente réapparition de grèves très étendues, reflète une désillusion profonde par rapport au processus de transition démocratique, avec des travailleurs qui sentent de plus en plus que l’amélioration de leurs conditions économiques et politiques ont été de vaines promesses de la révolution.” En guise “d’amélioration de leurs conditions économiques”, les masses ont vu l’inflation exploser, avec, par exemple, une hausse des prix des produits alimentaires de 80 % depuis janvier!
Un des principaux pièges qui attend la classe ouvrière en Egypte, c’est l’illusion de pouvoir être défendue par de nouveaux syndicats autonomes. Depuis le départ de Moubarak, il y a eu au moins 130 créations de syndicats. Ce n’est pas inattendu puisque les syndicats officiels étaient partie intégrante de la machine d’Etat. Mais vieux ou jeunes, les syndicats seront toujours contre les luttes ouvrières. Ces nouveaux syndicats “indépendants” se sont déjà révélés les dignes successeurs des anciens en arrêtant prématurément les grèves et en sapant le développement du mouvement avec une propagande pour “un capitalisme plus démocratique”. Il y a eu récemment de grandes manifestations pour “réclamer la Révolution”. L’acteur Sean Penn, notamment, était sur la place Tahrir. Ces manifestations, tout en s’opposant à l’actuel gouvernement, réclament… un calendrier pour des élections! Le danger pour la classe ouvrière, c’est qu’elle soit prise dans ce type de bataille entre factions militaire et démocratique.
La dernière vague de grèves montre une force qui pourrait se développer, pour autant qu’elle ne soit pas détournée vers l’impasse démocratique.
Car/01.10.2011
Récent et en cours:
Rubrique:
L'occupation de Wall Street par les manifestants : c'est le système capitaliste lui-même qui est l'ennemi
- 1484 lectures
Les lecteurs ont sans doute suivi les événements autour du mouvement Occupation de Wall Street (OWS). Depuis la mi-septembre, des milliers de manifestants occupent Zuccotti Park à Manhattan, à quelques blocs de Wall Street. Les manifestations se sont maintenant étendues à des centaines de villes à travers l’Amérique du Nord. Des dizaines de milliers de personnes ont pris part à des occupations, à des manifestations et à des assemblées générales qui ont montré une capacité d’auto-organisation et de participation directe à des activités politiques jamais vues aux Etats-Unis depuis de nombreuses décennies. Les exploités et la population en colère ont fait entendre leur voix, montré leur indignation contre les maux du capitalisme. L’impact international de l’OWS à travers le monde ne doit pas non plus être sous-estimée: des manifestations ont eu lieu dans les centres les plus importants du capitalisme mondial, brandissant des slogans et des expressions de ras-le-bol qui font écho à ceux jaillis à travers l’Europe et l’Afrique du Nord. (…).
Le CCI a pu participer à ces événements à New York, où plusieurs militants et sympathisants proches ont fait un certain nombre de voyages pour aller à Zuccotti Park parler avec les occupants et participer aux assemblées générales. Par ailleurs, des sympathisants du CCI nous ont envoyé des comptes-rendus sur leurs expériences dans ces mouvements dans leurs villes. Une discussion animée a également commencé sur le forum de discussion de notre site. 1 Cet article est une contribution à ce débat, et nous encourageons nos lecteurs à se joindre à la discussion.
Comment répondre aux attaques du capitalisme? Le combat pour trouver un terrain de classe
D’abord, nous devons reconnaître que le mouvement actuel d’occupation provient de la même source que toutes les révoltes sociales massives auxquelles nous avons assisté au cours de l’année 2011. Des mouvements en Tunisie et en Egypte à l’apparition des Indignés en Espagne, aux occupations en Israël et aux mobilisations contre l’austérité et l’anti-syndicalisme dans le Wisconsin et dans d’autres Etats, la frustration et le désespoir de la classe ouvrière, en particulier des jeunes générations durement frappées par le chômage. 2
Ainsi, nous voyons une continuité directe entre OWS et la volonté croissante de la classe ouvrière de se battre contre les attaques du capitalisme, à l’échelle internationale. Il est clair qu’OWS n’est pas une campagne bourgeoise pour faire dérailler et récupérer la lutte de classe. (…). Néanmoins, nous devons aussi reconnaître qu’il existe des tendances différentes dans le mouvement et qu’une lutte se déroule en leur sein. Les tendances dominantes ont une attitude très réformiste et les tendances les plus prolétariennes ont de grandes difficultés à trouver le terrain de classe de leur lutte.
En défense de la souveraineté des assemblées générales
Peut-être l’aspect le plus positif de la revendication de OWS a-t-il été l’émergence des assemblées générales (AG) comme des organes souverains du mouvement qui représente une avancée par rapport aux mobilisations dans le Wisconsin, qui, malgré leur spontanéité initiale, ont été rapidement prises en charge par les appareils syndicaux et par la gauche du Parti Démocrate. 3 L’émergence des AG dans OWS représente une continuité avec les mouvements en Espagne, en France et ailleurs, et est la preuve de la capacité de la classe ouvrière de prendre le contrôle de ses luttes et d’apprendre des événements dans d’autres parties du globe. En effet, l’internationalisation des AG, comme forme de lutte, est l’une des caractéristiques les plus impressionnantes de la phase actuelle de la lutte des classes. Les AG sont, par-dessus tout, une tentative de la classe ouvrière pour défendre son autonomie en impliquant l’ensemble du mouvement dans les décisions prises et en veillant à ce que les discussions soient les plus larges possibles.
Cependant, malgré leur importance dans ce mouvement, il est clair que ces AG n’ont pas été en mesure de fonctionner sans de considérables distorsions et sans les manipulations des activistes professionnels et des gauchistes qui ont largement contrôlé les différents groupes de travail et comités qui étaient censés être nominalement responsables des AG. Ce poids a constitué une difficulté grave pour le mouvement dans le maintien d’une discussion ouverte et il a travaillé à empêcher que les discussions ne s’ouvrent à ceux qui n’occupaient pas, pour atteindre l’ensemble de la classe ouvrière. Le mouvement du 15 Mai en Espagne a également rencontré des problèmes similaires. 4
Au début de l’occupation, en réponse aux demandes persistantes des médias pour que le mouvement identifie ses objectifs et ses exigences, un comité de presse a été formé dans le but de publier un Occupy Wall Street journal. Un de nos camarades était présent à l’AG quand le premier numéro de ce journal, qui avait déjà été rédigé et diffusé auprès des médias par le comité de presse, a été critiqué. Le sentiment dominant de l’AG a été l’indignation devant le fait que ce journal ait été produit et diffusé auprès des médias, alors que son contenu ne reflétait pas le consensus du mouvement, mais semblait refléter un point de vue politique particulier. La décision a été prise de retirer la personne responsable de la production et de la diffusion du journal du comité de presse. Cette action a montré la capacité de l’AG d’affirmer sa souveraineté sur les comités et sur les groupes de travail. Il s’agit d’une expression embryonnaire du “droit de révocation immédiate”, à l’encontre d’un membre fautif du comité de presse, qui a été rapidement révoqué pour avoir outrepassé les limites de son mandat.
Cependant, une semaine plus tard, lors d’une AG (…), des occupants du parc Zuccotti, notre camarade a trouvé une atmosphère totalement différente. (…). L’AG n’a pratiquement pas eu de discussion constructive.(…). Cette AG n’a jamais abordé la question de l’avenir du mouvement. Elle n’a même pas envisagé la question de savoir comment développer une stratégie et formuler des tactiques pour étendre le mouvement au-delà de ses limites actuelles et comment s’opposer à sa disparition presque certaine de Zuccotti Park.
Lors de cette AG, l’un de nos camarades a tenté de proposer que les occupants envisagent l’avenir en s’adressant, au-delà des limites du parc, à la classe ouvrière de la ville, auprès de qui ils étaient susceptibles de recevoir un accueil chaleureux. Il a été répondu à notre camarade que son intervention était hors sujet (…). Comment, alors, expliquer la tendance des groupes de travail, des comités et des animateurs à assurer progressivement leur contrôle sur le mouvement, au fur et à mesure que le temps passe?
Le danger de l’anti-politique
Dès le début, le mouvement OWS s’est caractérisé par un certain esprit “anti-politique” qui a servi à étouffer la discussion, empêcher la polarisation des idées contradictoires et le développement des revendications de classe. Cela a été rendu possible par les gauchistes, les célébrités politiques et les politiciens de tous bords qui ont pu intervenir et parler au nom du mouvement, et ont permis aux médias de présenter le mouvement comme la première étape d’une “aile gauche” du Tea Party. 5
Le refus de presque tous les manifestants d’OWS d’aborder la question des objectifs et des exigences, ce qui représente à notre avis une réticence générale à examiner la question du pouvoir, se présente un peu comme une énigme pour les révolutionnaires. Comment pouvons-nous comprendre ce phénomène, qui a également été présent dans d’autres mouvements des indignés et Occupy à l’échelle mondiale? Nous pensons que cela découle, dans une large mesure, des facteurs suivants:
Le poids, encore présent, des campagnes idéologiques autour de la mort du communisme
S’il est vrai que la principale force sociale derrière ces mouvements semble être la jeune génération de travailleurs, dont beaucoup sont nés après l’effondrement du stalinisme en 1989, il reste une crainte réelle de la part de la classe ouvrière de se réapproprier la question du communisme. Alors que Marx a souvent été intégré dans un processus de réhabilitation pour sa critique du capitalisme, il y a toujours une grande peur d’être associé à un système que beaucoup continuent à croire qu’il a “déjà été essayé et qu’il a échoué” et qui va à l’encontre de l’objectif d’établir “une véritable démocratie”. (…).
La prédominance de la jeune génération
En général, ces mouvements sont animés par la jeune génération des travailleurs. Bien que les travailleurs plus âgés, touchés par la destruction massive d’emplois qui s’est produite aux Etats-Unis depuis 2008 soient également présents dans les mouvements, sociologiquement, la force motrice de ces manifestations est constituée de prolétaires qui ont entre vingt et trente ans. La plupart sont instruits, mais beaucoup n’ont jamais connu dans leur vie un emploi stable. Ils sont parmi les plus profondément touchés par le chômage massif de longue durée qui hante désormais l’économie américaine. Peu d’entre eux ont une expérience du travail associé, si ce n’est d’une manière précaire. Leur identité n’est pas enracinée dans leur lieu de travail ou dans leur catégorie d’emploi. Bien que ces qualités sociologiques soient susceptibles de les rendre plus ouverts à une large solidarité abstraite, elles signifient également que la plupart d’entre eux n’ont pas l’expérience des luttes de défense des conditions de vie et de travail avec des exigences et des objectifs propres. Ayant été en grande partie exclus du processus de production, ils connaissent trop peu la réalité concrète pour défendre autre chose que leur dignité d’êtres humains! La nécessité de développer des exigences spécifiques et des objectifs n’est donc pas si évidente.(…). Un autre aspect qui ne peut être ignoré est le poids du discours politique post-moderniste, en particulier sur ceux qui sont passés par le cursus du système universitaire américain, qui instille la méfiance “traditionnelle” envers une politique de classe et son rejet.
Cela dit, nous ne pouvons pas “demander à l’enfant de se comporter en homme”. La simple existence d’assemblées générales est une victoire en soi, et ces AG constituent d’excellentes écoles où les jeunes peuvent développer leur expérience et apprendre à combattre les forces de la gauche de la bourgeoisie. Tout cela est vital pour les luttes à venir.
Le contexte spécifiquement américain
OWS reste obstinément coincé dans le contexte de la politique et de l’histoire des Etats-Unis. Les racines de la crise internationale et les mouvements sociaux dans d’autres pays sont rarement mentionnés. La croyance dominante du mouvement continue d’être que les immenses problèmes auxquels le monde est confronté sont tous, sous une forme ou une autre, la conséquence des comportements contraires à l’éthique des banquiers de Wall Street, aidés et encouragés par les partis politiques américains. (…). Enfin, il faut identifier le problème principal qui est que “le capital financier non réglementé” a servi à maintenir des illusions sur la nature finalement altruiste de l’Etat bourgeois américain.
De toute évidence, l’éthique anti-politique du mouvement OWS a servi à l’empêcher d’aller au-delà du niveau du mouvement lui-même et a finalement seulement servi à reproduire le genre de domination politique qu’il craignait à juste titre. Cela devrait servir de leçon pour les mouvements futurs. Alors que le mouvement a le droit d’être sceptique par rapport à tous ceux qui cherchent à parler pour lui, la classe ouvrière ne peut se dérober devant la discussion ouverte et la confrontation des idées. Le processus de polarisation, de travailler sur des objectifs et des exigences concrets, aussi difficile soit-il, ne peut être évité si le mouvement va de l’avant.(…). Il y a un fort risque que les principales fractions de la bourgeoisie puissent orienter ce mouvement dans une direction qui serve leurs propres intérêts contre la renaissance de la droite dans leur lutte de cliques. Cependant, en dernière analyse, l’incapacité totale de la bourgeoisie à résoudre sa crise mortelle signe la fin des illusions sur le “rêve américain”, remplacé par le cauchemar de l’existence, sous le capitalisme.
Seule la classe ouvrière offre un avenir à l’humanité
Avec toutes ses faiblesses, nous devons reconnaître les leçons profondes que les protestations d’OWS contiennent pour la poursuite du développement de la lutte des classes. L’apparition des AG, probablement pour la première fois depuis des décennies sur le sol de l’Amérique du Nord, représente une avancée majeure pour la classe ouvrière car elle cherche à développer son combat au-delà des limites tracées par la gauche bourgeoise et par les syndicats. Cependant, nous devons affirmer qu’un mouvement qui se replie sur lui-même plutôt que de chercher l’extension en direction de l’ensemble de la classe est voué à l’échec, que cet échec soit le résultat de la répression, de la démoralisation ou d’un encadrement derrière les campagnes de la bourgeoisie de gauche. (…).
Par ailleurs, aux Etats-Unis, les campagnes persistantes de l’aile droite pour écraser les syndicats ont effectivement eu pour effet de revitaliser dans une certaine mesure le carcan syndical aux yeux des travailleurs et elles ont encore plus désorienté ce secteur de la classe ouvrière. 6 En fait, dans la mesure où ce secteur de la classe ouvrière a participé au mouvement d’OWS, celle-ci s’est largement faite sous la bannière syndicale, mais avec des syndicats qui ont systématiquement œuvré à isoler leurs membres des occupants. Il était clair que, sous l’influence des syndicats, les ouvriers étaient là pour soutenir les occupants, mais non pour les rejoindre! C’est dans le mouvement de la lutte de la classe ouvrière pour défendre ses conditions de vie et de travail que les organes qui peuvent réellement mettre en œuvre la transition vers une société de producteurs associés – les conseils ouvriers – peuvent émerger.(…).
Dans une première étape, nous pensons que le mouvement d’OWS s’est laissé piéger sur le terrain idéologique bourgeois, cependant, celui-ci a déjà un immense mérite, car il donne un aperçu de la façon avec laquelle la classe ouvrière peut prendre le contrôle de sa propre lutte.
D'après Internationalism/19.10.2011
1 https://en.internationalism.org/forum/1056/beltov/4515/occupy-wall-stree... # comment-3866.
2 Voir tous nos articles sur le mouvement indignado https://en.internationalism.org/icconline/2011/september/indignados
3 Bien que contrairement au Wisconsin, où, pour l’instant la menace d’une grève générale a été brandie, OWS représente une mobilisation beaucoup moins “massive”, car, à part pour un petit groupe de manifestants, la mobilisation n’est pas régulière.
4 https://en.internationalism.org/iccon. Voir “Real Democracy Now !’?: A dictatorship against the mass assemblies , article line/2011/special-report-15M-spain/real-democracy-now.
5 Voir Pierre Beinhart, “Occupy Protests” Seismic Effects” pour une déclaration sur la façon avec laquelle la gauche bourgeoise pense qu’OWS pourrait être utilisée pour faire les choux gras d’Obama. https://news.yahoo.com/occupy-protests-seismic-effect-062600703.htm.
6 Voir notre article sur la récente grève de Verizon.
Géographique:
Récent et en cours:
Ni un Etat, ni deux, un monde sans frontières !
- 1809 lectures
Les manifestations de rue massives en Israël semblent, pour l’instant en tout cas, être en net recul. La question sociale, qui a été bruyamment soulevée autour des questions du logement, de l’inflation et du chômage, est une fois de plus mise sur la touche pour mettre en avant la question nationale.
Dans la Cisjordanie occupée, il y a eu des affrontements entre les soldats israéliens et des Palestiniens qui manifestaient leur soutien à la candidature de l’Autorité de la libération de la Palestine pour qu’elle soit acceptée à l’ONU en tant qu’Etat membre.
A Qalandia, un check-point israélien majeur entre la Cisjordanie et Jérusalem, les troupes israéliennes ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les lanceurs de pierres palestiniens. Les affrontements ont duré plusieurs heures et environ 70 Palestiniens ont été blessés par des granulés de caoutchouc et d’acier ou ont souffert d’inhalation de gaz lacrymogène. Ce scénario s’est joué dans de nombreux endroits. D’après des témoins et un rapport militaire, des soldats israéliens ont abattu un Palestinien, près du village d’Ousra, en Cisjordanie, lors d’un incident entre les villageois et les colons israéliens.
Un peu plus tôt, en septembre, un assaut violent contre l’ambassade d’Israël en Egypte a déclenché des raids aériens israéliens sur Gaza, qui ont causé la mort d’un certain nombre de gardes-frontières égyptiens.
Par contre, les tentatives du gouvernement pour détourner l’attention des manifestants de leurs revendications économiques et politiques en brandissant la “question palestinienne” et le sentiment anti-Israël ont rencontré peu de succès. D’après un article de Nadim Shehadi dans le New York Times (25 septembre), “même la récente attaque contre l’ambassade israélienne au Caire a été vue par beaucoup comme une diversion contre la poursuite des manifestations de la place Tahrir”. Il y avait des indices laissant soupçonner une collusion entre le gouvernement et la police dans l’attaque, qui a également coïncidé avec une visite au Caire du Premier ministre turc Erdogan, avide de promouvoir un nouvel axe anti-Israël au Moyen-Orient entre la Turquie et l’Egypte. En tout cas, le pillage de l’ambassade a certainement contribué à détourner l’attention d’une nouvelle vague de mécontentement populaire contre le régime, qui a de nouveau conduit à une vague de grèves ouvrières.
Un ou deux Etats?
Parmi ceux qui affirment être opposés au système capitaliste actuel, beaucoup soutiennent que, tant que la question nationale ne sera pas réglée en Israël et Palestine, il ne pourra jamais y avoir de lutte de classe “normale” dans la région, réunissant les travailleurs et les opprimés, indépendamment de la nationalité et de la religion, contre les capitalistes de tous les pays.
Il existe différentes approches sur la façon dont la question israélo-palestinienne pourrait être résolue: une partie de la gauche s’est montrée plus que disposée à appuyer une action militaire contre Israël (par des groupes palestiniens nationalistes, laïques et islamiques, et, logiquement, par les Etats qui leur ont fourni des armes et des ressources, comme l’Iran, la Syrie, la Libye de Kadhafi ou l’Irak de Saddam Hussein). Le fait qu’une telle politique soit combinée avec la rhétorique de la “révolution arabe” et celle d’une future “Fédération socialiste du Moyen-Orient” ne modifie pas fondamentalement son caractère militariste. Une telle vision a été mise en avant par George Galloway, du SWP et par d’autres. Cette approche a souvent été liée à l’idée d’une “solution à un Etat”: une Palestine démocratique laïque avec des droits pour tous. Comment un tel régime idyllique pourrait-il émerger d’un massacre impérialiste est une question à laquelle seuls pourraient répondre ceux qui sont formés à la sophistique trotskiste.
D’autres, à gauche, et une foule de libéraux, privilégient la “solution à deux Etats”, avec les nations israélienne et palestinienne qui se “déterminent toutes deux” et respectent mutuellement leurs droits nationaux. Dans cette vision, il y a beaucoup de nuances différentes: officiellement, les Etats-Unis sont en faveur d’une solution à deux Etats, sur la base de négociations, qu’ils supervisent avec l’ONU, l’UE et la Russie. Mais Washington met actuellement son veto à la candidature de la Palestine à l’ONU parce qu’elle dit qu’elle n’est pas basée sur des conditions mutuellement convenues. Le fait que les Etats-Unis soient de plus en plus incapables de faire plier l’intransigeance du gouvernement de droite d’Israël avec ses propositions, en particulier avec leur appel à un gel de la colonisation dans les territoires occupés, joue également un rôle majeur dans la position actuelle de l’Amérique.
En attendant, Mohamed Abbas, le président de l’autorité palestinienne, soulignant que les négociations n’existent simplement pas, va de l’avant avec la proposition que la Palestine devienne un Etat parce que cela va lui donner un certain nombre d’avantages tactiques, comme la possibilité de traduire Israël devant la Cour pénale internationale. Mais l’opposition à cette stratégie vient d’un certain nombre de partisans du nationalisme palestinien, à la fois laïques et islamiques, qui soulignent à juste titre qu’un Etat fondé sur quelques morceaux de terrains divisés et dominés par les militaires israéliens et le Mur ”anti-terroriste” n’est rien de plus qu’un Etat symbolique. Les islamistes, dont la plupart ne reconnaissent même pas l’existence d’Israël, veulent poursuivre la lutte armée pour un Etat islamique dans l’ensemble de la Palestine historique (bien qu’en pratique, ils soient prêts à examiner diverses étapes intermédiaires). A ce niveau, l’Islam militariste et le trotskisme militariste préconisent les mêmes méthodes pour la réalisation de leurs différents plans pour un système à un seul Etat. 1
Les communistes sont contre l’Etat-nation
A notre avis, ce sont toutes de fausses solutions. Le conflit Israël- Palestine, qui a traîné en longueur pendant 80 ans, est un exemple concret qui montre pourquoi le capitalisme ne peut pas résoudre les différentes “questions nationales” dont il a hérité en partie des anciens systèmes sociaux, mais qu’il a en grande partie lui-même créées.
En s’opposant au slogan du “droit de tous les peuples à l’autodétermination nationale” durant la Première Guerre mondiale, Rosa Luxemburg a fait valoir que, dans un monde désormais dépecé par les puissances impérialistes, aucune nation ne peut défendre ses intérêts sans s’aligner sur les plus grands Etats impérialistes, tout en cherchant, dans le même temps, à satisfaire ses propres appétits impérialistes. Le nationalisme n’est pas, comme Lénine et d’autres l’ont soutenu, une force potentielle qui pourrait affaiblir l’impérialisme, mais fait partie intégrante de ce dernier. Cette analyse a certainement été confirmée par l’histoire du conflit au Moyen-Orient. Il est bien connu que, depuis sa création, le sionisme ne pouvait faire la moindre conquête sans le soutien de l’impérialisme britannique et, plus tard seulement, il s’est tourné contre l’Angleterre pour se mettre au service des Etats-Unis plus puissants. Mais le mouvement national palestinien n’a pas été moins obligé de chercher le soutien des puissances impérialistes: l’Allemagne et l’Italie fascistes avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, la Russie stalinienne et ses satellites arabes pendant la guerre froide, la Syrie, l’Irak, l’Iran et d’autres depuis l’effondrement de l’ancien système des blocs. Les alliances ont changé au fil des années, mais la constante est que les nationalismes juif et arabe ont agi comme des agents locaux de rivalités impérialistes plus larges et mondiales. Ceux qui préconisent la défaite militaire d’Israël ou des solutions plus pacifiques, présidées par l’ONU, sont toujours enfermés dans cette logique.
Dans le même temps, un soutien à des solutions nationales, dans une période de l’histoire où la classe ouvrière et ses exploiteurs n’ont pas d’intérêts communs, même pas celui de la nécessité de s’opposer aux précédentes classes dominantes réactionnaires, est directement nocive pour la lutte de la classe exploitée. En Israël, la lutte des travailleurs pour défendre leur niveau de vie est constamment accueillie avec l’argument que le pays est en guerre, qu’ils doivent accepter les sacrifices et que les grèves ne peuvent que saper les besoins de la défense nationale. En Egypte et dans d’autres pays arabes, les travailleurs qui résistent à leur exploitation s’entendent dire, en permanence, que leur véritable ennemi est le sionisme et l’impérialisme américain. Les luttes ouvrières massives de 1972 en sont une illustration très claire: à la suite de la répression des grèves à Helwan par le gouvernement de Sadate, “les gauchistes (maoïstes, militants palestiniens, etc.) ont réussi à détourner toute la question vers des fins nationalistes. Ainsi, les demandes de libérer les travailleurs emprisonnés ont été combinées avec des déclarations de soutien à la guérilla palestinienne, avec des demandes pour la mise en place d’une économie de guerre (y compris un gel des salaires) et pour la formation d’une “milice populaire” pour défendre la “patrie” contre l’agression sioniste. Ainsi, le grief principal était que le gouvernement n’avait pas été assez décisif dans ses préparatifs de guerre; quant aux travailleurs, ils ont été exhortés à ne pas mener la lutte contre leurs exploiteurs, mais à former les hommes de troupe d’un impérialisme “populaire” égyptien contre son rival israélien” (“Lutte de classe au Moyen-Orient”, World Revolution no 3, avril 1975).
D’autre part, les récents mouvements de protestation montrent que lorsque la question sociale se pose dans la lutte ouverte, les arguments des nationalistes peuvent être remis en question. Le refus des manifestants de la place Tahrir, en Egypte, de subordonner leur lutte contre le régime de Moubarak à la lutte contre le sionisme, les avertissements prémonitoires par des manifestants israéliens que le gouvernement Netanyahou utiliserait un conflit militaire pour faire dérailler leur mouvement, et surtout leur détermination à poursuivre leurs revendications, même quand les affrontements militaire eurent lieu sur les frontières, montrent que la lutte des classes n’est pas quelque chose qui peut être reporté en attendant qu’une solution idéale au problème national ait été mise en œuvre. Au contraire, c’est dans le cadre de la lutte de classes elle-même que les divisions nationales peuvent être mises à jour et affrontées. En Israël, des slogans inspirés des mouvements dans le monde arabe, bruyamment clamés, comme “Moubarak, Assad, Netanyahu”, des appels à l’unité de lutte entre arabes et juifs, ont été des exemples concrets et positifs de cette possibilité, même si le mouvement est resté hésitant par rapport à l’éventualité de prendre directement en charge la question de l’occupation.
Il serait naïf de s’attendre à ce que ces mouvements récents naissent libres de toute idée nationaliste car, pour la majorité de ceux qui y ont pris part, l’internationalisme signifie plutôt une sorte de trêve ou de fête d’amour entre nations. Ceux qui luttent n’ont par encore pris pleinement conscience de ce que le combat internationaliste implique réellement: la guerre de classe à travers les divisions nationales, la lutte pour un monde sans Etats-nations.
C’est à peine nécessaire de mentionner le terrible engrenage de vengeance, de méfiance et de haine que le conflit israélo-arabe a créé et renforce chaque jour. Mais, dans le même temps, le capitalisme fournit d’amples preuves, non seulement de sa faillite économique, mais aussi de son incapacité à concilier les intérêts nationaux. Dans la prison de l’Etat-nation, que soit préféré l’idéal d’une solution à un ou à deux Etats, il n’y a tout simplement aucune possibilité de délivrer les millions de Palestiniens de la misère des camps de réfugiés ou de rendre la masse des Israéliens capables de vivre sans la peur constante de la guerre et des attaques terroristes. La vision d’une communauté humaine sans frontières, qui est la seule réponse à la crise mondiale du capitalisme, va aussi apparaître comme la seule solution réaliste au conflit israélo-arabe. Et cette vision ne peut prendre corps que dans le cadre de mouvements sociaux massifs qui évoluent vers une authentique révolution des exploités et des opprimés. Tous les Etats bourgeois, réels ou potentiels, seront l’ennemi d’une telle révolution: ils seront le premier mur à devoir être démantelé sur le chemin de la liberté.
Amos/01.10.201
1 Il est important de souligner que certains sionistes de droite ont également conclu qu’un Etat serait préférable, mais que ce serait bien sûr un Etat juif dans lequel la minorité arabe serait soit expulsée, soit y resterait pour toujours comme des citoyens de seconde classe.
Géographique:
Rubrique:
Energie nucléaire, capitalisme et communisme: l'homme et la nature (I)
- 1657 lectures
L’ampleur de la catastrophe en cours à Fukushima révèle une fois de plus l’exploitation prédatrice de la nature par le capitalisme. L’espèce humaine a toujours été amenée pour vivre à transformer la nature. Mais le Capital pose aujourd’hui un nouveau problème: ce système ne produit pas pour satisfaire les besoins de l’humanité mais pour le profit. Il est prêt à tout pour cela. Laissé à sa seule logique, ce système finira donc par détruire la planète.
Au sein de cette nouvelle série, nous allons donc retracer brièvement l’histoire des rapports entretenus par l’Homme à la nature pour mieux comprendre les dangers actuels mais aussi les nouvelles possibilités énergétiques qui pourraient s’ouvrir à l’Homme dans la société future, le communisme.
Le désastre du réacteur nucléaire de Fukushima au Japon au mois de mars dernier a réouvert le débat sur le rôle de la puissance nucléaire dans les besoins que connaît l’énergie mondiale. Beaucoup de pays, y compris la Chine, ont annoncé qu’ils allaient revoir ou temporairement arrêter leur programme de constructions de centrales tandis que la Suisse et l’Allemagne sont allées plus loin et prévoient de remplacer leur capacité nucléaire. Dans le cas de ce dernier pays, 8 des 17 centrales du pays seront fermées cette année avec un arrêt de toutes en 2022 et seront remplacées par des sources d’énergie renouvelables. Ce changement a provoqué de puissants avertissements de la part de l’industrie nucléaire et certains grands utilisateurs d’énergie de problèmes de réserves et de grosses augmentations des prix. Depuis ces dernières années, on avait vu des rapports sur la renaissance de l’industrie nucléaire avec 60 centrales en construction et une 493e planifiée selon le groupe industriel World Nuclear Association . 1 En Grande-Bretagne, il y a eu un débat sur les risques et les bénéfices du nucléaire comparé à celui des plus profitables énergies vertes. George Monbiot, par exemple, a annoncé non seulement sa conversion au nucléaire comme la seule voie réaliste pour éviter le réchauffement global de la planète 2 mais allant jusqu’à attaquer ses anciens collègues du mouvement anti-nucléaire d’ignorer la question scientifique du risque réel de la puissance nucléaire. 3
En réalité, le problème du nucléaire ne peut être compris comme une question purement technique ou comme une équation déterminée par les différents coûts ou bénéfices du nucléaire, de l’énergie fossile ou des énergies renouvelables. Il est nécessaire de s’arrêter et de regarder l’ensemble de la question de l’utilisation de l’énergie dans la perspective historique de l’évolution de la société humaine et des différents modes de production qui ont existé. Ce qui suit se veut être une esquisse nécessairement brève d’une telle approche.
L’utilisation de l’énergie et le développement humain
L’histoire de l’humanité et des différents modes de production est aussi l’histoire de l’énergie. Les premières sociétés de chasseurs-cueilleurs vivaient principalement de l’énergie humaine comme de celle des animaux et des plantes produites par la nature avec une intervention plutôt modérée, même si certains usages impliquaient l’utilisation du feu pour la déforestation en vue de cultures ou pour abattre les arbres. Le développement de l’agriculture au néolithique marqua un changement fondamental dans l’utilisation de l’énergie par l’humanité et dans ses relations avec la nature. Le travail humain fut organisé sur une base systématique pour transformer la terre, avec des forêts nettoyées et des murs érigés pour élever les animaux domestiques. Les animaux commencèrent à être utilisés pour l’agriculture et donc dans certains processus productifs comme les moulins à grains. Le feu servait à réchauffer et faire la cuisine et pour des processus industriels comme la fabrication de poteries et la fonte des métaux. Le commerce se développa également, reposant à la fois sur la puissance du muscle et de l’animal mais aussi exploitant la force du vent pour traverser les océans.
La révolution néolithique transforma la société humaine. L’augmentation des sources de nourriture qui en résulta conduisirent à une augmentation significative de la population et à une plus grande complexité de la société, avec une partie de la population allant graduellement de la production directe de nourriture vers des rôles plus spécialisés liés aux nouvelles techniques de production. Certains groupes furent aussi libérés de la production pour prendre des rôles militaires ou religieux. Ainsi, le communisme primitif des sociétés de chasseurs-cueilleurs se transforma en sociétés de classe, les élites militaires et religieuses soutenues par le travail des autres.
Les accomplissements des sociétés dans l’agriculture, l’architecture et la religion requéraient tous l’utilisation concentrée et organisée du travail humain. Dans les premières civilisations, ils furent le résultat de la cœrcition massive du travail humain, qui trouva sa forme typique dans l’esclavage. L’utilisation par la force de l’énergie d’une classe assujettie permit à une minorité d’être libérée du travail et de vivre une vie qui exigeait la mobilisation d’un niveau de ressources bien supérieur à celui qu’un individu aurait pu réaliser pour lui-même. Pour donner un exemple: une des gloires de la civilisation romaine était les systèmes de chauffage des villas qui faisaient circuler de l’air chaud sous les sols et dans les murs; rien de comparable n’a été vu par la suite durant des siècles où même les rois vivaient dans des bâtiments qui étaient si froids qu’on raconte que le vin et l’eau gelaient sur les tables l’hiver. 4 Ces systèmes étaient le plus souvent construits et entretenus par des esclaves et consommaient de grandes quantités de bois et de charbon. La chaleur dont profitait la classe dominante venait de l’appropriation de l’énergie humaine et naturelle.
La relation entre l’humanité et la nature
Le développement des forces productives et des sociétés de classe qui était à la fois la conséquence et l’aiguillon de ces dernières changea la relation entre l’homme et la nature comme il avait changé la relation entre les gens. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient immergées dans la nature et dominées par elle. La révolution de l’agriculture poussa à contrôler la nature avec les cultures et la domestication des animaux, le défrichement des forêts, l’amendement des sols par l’utilisation de fertilisants naturels et le contrôle des apports d’eau.
Le travail humain et celui du monde naturel devinrent des ressources à exploiter mais aussi des menaces devant être dominées. Il en résulta que les Hommes – exploités et exploiteurs – se détachèrent de la nature et les uns des autres. Vers le milieu du 19e siècle, Marx montra l’intime inter-relation entre l’humanité et la nature qu’il vit comme la “vie des espèces”: “Physiquement, l’homme ne vit que de ces produits naturels, qu’ils apparaissent sous forme de nourriture, de chauffage, de vêtements, d’habitation, etc. L’universalité de l’homme apparaît en pratique précisément dans l’universalité qui fait de la nature entière son corps non-organique, aussi bien dans la mesu re où, premièrement, elle est un moyen de subsistance immédiat que dans celle où, [deuxième ment], elle est la matière, l’objet et l’outil de son activité vitale. La nature, c’est-à-dire la natu re qui n’est pas elle-même le corps humain, est le corps non-organique de l’homme. L’homme vit de la nature signifie: la nature est son corps avec lequel il doit main te nir un processus cons tant pour ne pas mourir. Dire que la vie physique et intellectuelle de l’homme est indis so lu blement liée à la nature ne signifie pas autre chose sinon que la nature est indissoluble ment liée avec elle-même, car l’homme est une partie de la nature.”.5 Le capitalisme, le travail salarié et la propriété privée déchire tout cela, détournant la production du travail ouvrier en “une puissance autonome vis-à-vis de lui” et transformant la nature qui “s’oppose à lui, hostile et étrangère.”.6
L’aliénation, que Marx voyait comme une caractéristique du capitalisme dont la classe ouvrière faisait l’expérience de façon très aiguë, avait émergé en fait avec l’apparition des sociétés de classe mais s’accélérait avec la transition vers le capitalisme. Tandis que l’humanité toute entière est affectée par l’aliénation, son impact et son rôle n’est pas le même qu’il s’agisse de la classe exploitante ou de la classe exploitée. La première, en tant que classe qui domine la société, pousse vers l’avant le processus d’aliénation tout comme elle anime le processus d’exploitation et ressent rarement ce que cela provoque, même si elle ne peut échapper aux conséquences. La seconde ressent l’impact de l’aliénation dans sa vie quotidienne comme un manque de contrôle sur ce qu’elle fait et ce qu’elle est mais absorbe en même temps la forme idéologique que prend l’aliénation et le répète en partie dans ses relations humaines et dans sa relation avec le monde naturel.
Le processus a continué depuis que Marx l’a décrit. Au siècle dernier, l’humanité aliénée s’est entredévorée dans deux guerres mondiales et a vu l’effort systématique effectué pour anéantir des parties d’elle-même dans l’holocauste de la Seconde Guerre mondiale et lors des “nettoyages ethniques” des vingt dernières années. Elle a également exploité et détruit la nature brutalement au point que le monde naturel et toute vie menacent de s’éteindre. Cependant, ce n’est pas une humanité vue comme une abstraction qui a fait cela mais la forme particulière de société de classe qui est arrivée à dominer et menacer la planète: le capitalisme. Ce ne sont pas non plus tous ceux qui vivent dans cette société qui en portent la responsabilité: entre les exploiteurs et les exploités, entre la bourgeoisie et le prolétariat, il n’y a pas d’égalité de pouvoir. C’est le capitalisme et la classe bourgeoise qui ont créé ce monde et qui en portent la responsabilité. Cela peut déranger ceux qui veulent nous mettre tous ensemble dans le même sac pour le “bien commun”, mais l’histoire a montré que notre conclusion est correcte..
North/19.06.201
1 Financial Times du 6 juin 2011, “Nuclear power : atomised approach”.
2 Guardian du 22 juin 2011, “Why Fukushima made me stop worrying and love nuclear power”.
3 Guardian du 5 avril 2011, “The unpalatable truth is that the anti-nuclear lobby has misled us all”.
4 Fernand Braudel, Civilisation and Capitalism 15th – 18th Century, Volume one?: The Structures of Everyday Life, p.299. William Collins Sons and Co. Ltd, London.
5 Marx, manuscrits philosophiques et économiques de 1844, “Le travail aliéné” (www.marxists.org)
6 Ibid.
Récent et en cours:
Rubrique:
Internationalisme - 2012
- 1391 lectures
Internationalisme no 353 - 1er trimestre 2012
- 1136 lectures
La crise, l'austérité et des actions syndicales stériles
- 1301 lectures
Si récemment encore, la bourgeoisie présentait la situation économique belge comme une exception en Europe, plus personne aujourd'hui ne nie l'impact de la crise mondiale sur le pays. Rapports chiffrés et déclarations des "responsables" s'accumulent pour appeler la population à prendre conscience de la situation catastrophique et à se serrer la ceinture au nom d'une solidarité avec le système en place.
En Belgique aussi, l'avenir que nous promettent nos dirigeants s'annonce de plus en plus sombre.
Un système économique sans perspective
A la mi-février, 114 banques étaient menacées d'une dégradation de leur note par les agences de notation et la plupart des grandes banques belges ne répondent pas aux nouvelles normes de solvabilité, imposées par l'Europe d'ici à 2019. D'autre part, partout en Europe et dans le monde, des pays voient leur note de solvabilité dégradée par ces mêmes agences. La bourgeoisie dans tous les pays se rend compte de l'impasse, mais les recettes qu'elle avance ne présentent point de soulagement, comme en témoigne le récent sommet à Davos.
Faire marcher la planche à billets crée encore plus d'argent et provoque une flambée d'inflation. Stimuler de nouveaux emprunts et des déficits pour créer ainsi des débouchés artificiels n'offre pas plus d'issue dans un monde surendetté. Depuis des décennies le capitalisme vit, ou plutôt survit, à crédit. Augmenter les revenus de l'Etat par une augmentation des impôts, ce qui implique une restriction du pouvoir d'achat et une augmentation des coûts de production, ne fait qu'accentuer encore l'enfoncement dans la récession. Reste à réduire les dépenses des Etats et des entreprises. Pour l'Etat, cela passe par des coupes budgétaires afin de réduire le poids de l'endettement et élargir la marge de manSuvre pour les opérations de sauvetage des banques et des industries en difficulté. Pour les entreprises, le mot d'ordre est de baisser le coût de production des marchandises en espérant être moins chères que les concurrents et de garder suffisamment de profit sur leurs ventes. Dans la pratique, cela veut dire délocaliser davantage la production vers des régions aux coûts moindres, augmenter la productivité, supprimer la partie excédentaire de l'appareil productif, diminuer la charge salariale (directe et indirecte). Dans tous les cas, les salariés, ceux qui produisent les biens dans le monde entier, paient la note. Même si les économistes, tels P. De Grauwe, avertissent que cette politique entraîne à son tour un rétrécissement consécutif du pouvoir d'achat et donc du marché réel.
La bourgeoisie belge et son gouvernement, enfin sorti de couveuse, sont confrontés exactement aux mêmes dilemmes :
- elle doit gérer une dette de l'Etat dépassant en 2012 les 100% du PIB, plaçant la Belgique dans le même panier que la Grèce, le Portugal ou l'Italie ;
- elle fait face à une inflation croissante de 2,7% par rapport à 2011 ;
- il lui faut diminuer la vulnérabilité du financement public, fort exposé au secteur financier en difficulté, une situation comparable à l'Irlande. Après l'effondrement de la banque Fortis, c'est Dexia qui annonçait récemment une perte de 12 milliards d'euro en 2011. En outre, son incapacité à rembourser les garanties d'Etat cause un trou de centaines de millions d'euro dans le budget fédéral;
- elle veut mener une politique de relance, mais est dans le peloton de tête des 9 pays à croissance négative au sein de l'Union européenne, tandis que la récession entraine de plus en plus de restructurations d'entreprises ;
- elle est obligée de réduire un trou budgétaire qui s'accroît constamment, ce qui nécessite toujours plus de mesures d'austérité supplémentaires.
Et ses réponses ne sont pas différentes de ce qui se passe partout en Europe : réduction du nombre de fonctionnaires, allongement des carrières et réduction des allocations de retraite, augmentation de la flexibilité (emplois précaires, contrats limités) et de la productivité (moins d'absentéisme, d'interruptions de carrière payées, plus de maladies, de dépression, de stress&), pression accrue sur les chômeurs et réduction des allocations, recul des salaires, augmentation des taxes indirectes. En même temps, restructurations, délocalisations et licenciements se multiplient dans tous les secteurs : dans le port d'Anvers, la sidérurgie wallonne, Beckaert, Van Hool, Procter&Gamble, Crown-Cork, Nokia-Siemens, Alcatel-Lucent, ...
Voilà l'image d'un système sans autre perspective que l'imposition d'une misère et d'une violence toujours plus brutale et inhumaine.
Eviter la remise en cause du système
Dès l'annonce des mesures du gouvernement Di Rupo sur les pensions, le front uni des organisations syndicales a décrété "un programme ambitieux de manifestations et de grèves", culminant dans une journée de grève générale en janvier. Le président du parti socialiste flamand Tobback taxait immédiatement cette journée de grève générale de "bombe atomique" face à des mesures finalement fort modérées par rapport à ce qui était imposé dans d'autres pays européens. Dès ce moment, toute la campagne autour de cette grève générale a été orientée sur la division des travailleurs: débats autour du pour ou contre cette grève, sur la manière de mener la grève (qui mènerait à prendre en otage ceux qui ne veulent pas faire la grève et notre économie en difficulté). La classe est divisée par secteur et par usine face aux effets de la crise: secteurs publics opposés aux privés, secteur des transports en grève bloquant les secteurs non en grève, grandes entreprises opposées aux petites entreprises. Division entre générations : la grève générale est la grève des vieux qui veulent garder leurs avantages sur le plan du chômage et des retraites aux dépens des jeunes.
Derrière une unité de façade et des actions apparemment radicales, les syndicats organisent ainsi la division tous azimuts et évitent soigneusement toutes possibilités de mobilisation réelle et de discussions de fond sur la situation, brisant ainsi toute perspective de développement des luttes. Les mesures et les attaques sont vues comme des faits ponctuels, séparés. Aucun lien ou signe de solidarité n'apparaît entre conflits sociaux (entre Van Hool, Beckaert, Crown Cork ou les fonctionnaires par exemple). De fait, cette campagne enfermait la classe ouvrière dans une alternative pourrie: ou bien adhérer aux actions impuissantes syndicales, c.-à-d. la manifestation nationale en décembre et puis la grève générale d'un jour fin janvier, ou bien subir les mesures dans l'inertie : il y a le problème des sans-abris, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Les licenciements c'est grave, mais que faire? La vision par secteur et par usine amène à penser que certains secteurs ne sont plus assez performants, que leurs produits ne sont plus vendables et qu'il faut effectivement les rationaliser.
Mais l'effet le plus pervers de "l'échec" de la "bombe atomique" de la grève générale d'un jour, c'est l'avantage que la bourgeoisie belge en tire pour éviter toute réflexion sur une alternative au système en crise. Si la "bombe atomique" n'a pu arrêter les mesures, "arrêtons de rêver et essayons ensemble de gérer au mieux la crise du système": voilà en résumé le message que la bourgeoisie, avec l'aide de ses syndicats, veut faire passer. Son plus grand souci est d'écarter à tout prix une remise en cause du système en tant que tel et l'envisagement de son remplacement par un autre. L'indignation et la colère des exploités ne cesseront de croître face aux plans d'austérité successifs, en Belgique comme ailleurs et il faut éviter que cela aboutisse à la remise en cause du système. Les discours mystificateurs des gérants du système font dès lors appel au sens de responsabilité collectif et à la solidarité nationale pour "gérer ensemble" les problèmes. La lutte contre la fraude fiscale est mise en avant, comme si c'était une solution miracle, une punition pour les capitalistes (qui récupéreront évidemment les sommes transférées à l'Etat sur le dos des ouvriers et des consommateurs), cela permettra aussi de réprimer encore plus fort les "fraudeurs" sociaux, exclus de toute allocation et jetés dans la misère. On souligne le besoin écologique et démographique de consommer moins, pour mieux masquer derrière un voile idéologique l'austérité « librement » consentie. On tape sur les méchants banquiers qu'il faut soumettre à une régulation étatique. On répand des illusions sur une «Europe sociale» contre une "Europe des banquiers". On appelle aux bienfaits de la démocratie - "réelle", avec une participation plus grande de la population aux décisions de l'Etat capitaliste, pour imposer des mesures répartissant l'effort de façon "équitable". Faisons confiance à la démocratie bourgeoise, luttons pour une démocratisation du capitalisme, dans le cadre de la logique et des marges que nous offre le système actuel, donnons un visage humain aux mesures inhumaines innées à ce système économique. Comme si gérer "démocratiquement" une société d'exploitation signifie supprimer cette exploitation, comme si gérer "équitablement" la misère signifie la rendre supportable !
Que faire ?
Des changements de gouvernants ne changent rien aux attaques. Malgré ses divisions la bourgeoisie est unanime quant aux besoins des plans d'austérité drastiques. Seule la voie de la lutte, essentiellement dans la rue, classe contre classe, peut s'opposer effectivement aux attaques sur nos conditions de vie. Nous, prolétaires en activité ou au chômage, à la retraite ou en formation/études devons défendre partout les mêmes intérêts. Pour y parvenir nous devons prendre en main nous-mêmes nos luttes sous le contrôle des assemblés et surtout ne pas laisser la libre voie aux syndicats pour diviser la lutte et la dévoyer vers des voies sans issues, ne pas nous laisser démoraliser et réduire à l'impuissance. La bourgeoisie s'entredéchire face à sa crise, poussée par la concurrence et la recherche de profits. Cette situation par contre nous pousse, nous les exploités, à riposter de manière de plus en plus massive, unie et réellement solidaire !
Lac / 27.02.2012
Géographique:
Rubrique:
De l'Iran à la Syrie, les manoeuvres impérialistes passent la vitesse supérieure
- 1222 lectures
L’article suivant, a été écrit par un sympathisant de notre organisation, avant la récente attaque contre l’ambassade britannique en Iran.
Le 29 novembre, des étudiants ont fait irruption dans le bâtiment, causant des dommages aux bureaux de l’ambassade et à des véhicules. Dominick Chilcott, l’ambassadeur britannique, dans une interview à la BBC, a accusé le régime iranien d’être derrière ces attaques “spontanées”. En représailles, le Royaume-Uni a expulsé l’ambassade iranienne de Londres. Ces événements sont un nouvel épisode de la montée des tensions au Moyen-Orient entre l’Occident et l’Iran, autour de la question des armes nucléaires et de la Syrie. Le récent rapport de l’AIEA sur le nucléaire iranien a déclaré que l’Iran avait développé un programme nucléaire militaire. En réponse, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis ont introduit de nouvelles sanctions. Ces derniers jours, l’Iran a affirmé qu’il a abattu un drone américain qui tentait de recueillir des renseignements militaires. Par rapport à la Syrie, l’article mentionne la collaboration entre le régime d’Assad et la Garde Révolutionnaire Iranienne dans le massacre de la population syrienne. Dans le sac de l’ambassade britannique, on a également vu un coup de main de la part de la section jeunesse du Basij, téléguidé par El-Assad. De même que les rivalités inter-impérialistes, nous ne devons pas oublier les rivalités internes au sein des bourgeoisies nationales elles-mêmes. L’été dernier, il est devenu clair qu’un fossé croissant se creusait entre le président iranien Mahmoud Ahmadinejad et l’ayatollah Ali Khamenei. Malgré ses diatribes antisémites et sa rhétorique pleine de rodomontades, Ahmadinejad représente une fraction de la bourgeoisie iranienne qui veut maintenir quelques liens avec l’Occident. Khamenei avait arrêté quelques-uns des proches alliés d’Ahmadinejad au sein du gouvernement limogé. En réponse, Ahmadinejad a “fait grève” pendant 11 jours, refusant de s’acquitter de ses fonctions à la tête du gouverne-ment. Les récents événements autour de la mise à sac de l’ambassade britannique sont considérés par certains analystes des médias dans le cadre de cette querelle. Khamenei et ses partisans conservateurs sont considérés comme étant derrière les attaques pour saper la politique plus conciliante de M. Ahmadinejad et lui nuire en vue des prochaines élections de 2012.
Avec l’aggravation des tensions entre l’Iran et l’Occident, certains pronostiquent le déclenchement d’une troisième guerre mondiale. La question qui se pose dans la réalité est tout autre: est-ce que les ouvriers du Moyen-Orient et de l’Occident sont prêts à être mobilisés pour soutenir une autre guerre majeure ? Les travailleurs du monde entier supportent le fardeau de la crise sur leurs épaules et commencent à riposter. La guerre signifiera encore plus d’austérité, plus de violence contre les travailleurs, plus de désespoir. Les travailleurs n’ont aucun intérêt dans ces massacres impérialistes sanglants et ne sont pas prêts à y être embrigadés de façon massive.
CCI/28.01.2012
Courrier de lecteur
Après huit mois de manifestations, à l’origine parties d’un mouvement régional et international contre l’oppression, le chômage et la misère, impliquant Druzes, Sunnites, Chrétiens, Kurdes, hommes, femmes et enfants, les événements en Syrie continuent à prendre une sinistre allure. Si, par rapport à la défense de leurs propres intérêts et de leur stratégie, les États-Unis , la Grande-Bretagne et la France se méfient d’une attaque directe contre l’Iran, en revanche, ils peuvent contribuer à une agression sur son plus proche allié, le régime d’Assad en Syrie, dans la logique des rivalités inter impérialistes.
Les brutales forces de sécurité d’Assad, avec le soutien logistique de “300 à 400 Gardiens de la Révolution” d’Iran (The Guardian du 17 novembre 2011), ont massacré des milliers de personnes et donné naissance à la mensongère et hypocrite “préoccupation pour les civils” de la part des trois principales puissances du front anti-iranien nommées ci-dessus. Comme pour la Libye, les États-Unis sont le “leader par l’arrière”, cette fois en poussant la Ligue arabe (tout en l’amenant à se détacher des alliés algériens, irakiens et libanais d’Assad), dont la Syrie était une puissance majeure, à suspendre son adhésion et en la soumettant à des échéances ultérieures humiliantes. Au premier plan de cette préoccupation-bidon pour la vie et l’intégrité physique de la population se trouve le régime meurtrier d’Arabie Saoudite qui, il y a quelque temps, avait envoyé environ deux mille soldats de ses troupes d’élite, formées par la Grande-Bretagne, pour écraser les manifestations à Bahreïn ainsi que pour protéger les intérêts et les bases américaines et britanniques. Comble de l’hypocrisie, la confirmation de la suspension de la Syrie pour son “bain de sang” a été faite par la réunion de la Ligue Arabe dans la capitale marocaine, Rabat, le 16 novembre, alors même que les forces de sécurité de ce pays étaient en train d’attaquer et de réprimer des milliers de ses propres manifestants. Il y a des ramifications impérialistes plus larges par rapport à l’action de la Ligue Arabe, en ce sens que ses décisions ont été condamnées par la Russie, mais soutenues par la Chine.
Ce n’est pas seulement la Ligue Arabe que la Grande-Bretagne et les États-Unis poussent en avant dans cette voie, mais aussi la puissance régionale qu’est la Turquie, qui a également participé aux réunions à Rabat. Après avoir apparemment dissuadé l’État turc de mettre en place une sorte de zone tampon ou une “zone de non-survol” sur la frontière entre la Turquie et la Syrie, l’administration américaine a désormais changé d’avis. Ainsi, Ben Rhodes, conseiller d’Obama à la sécurité nationale, a dit la semaine dernière: “Nous saluons fortement l’attitude ferme que la Turquie a prise...” Le chef en exil des Frères Musulmans en Syrie a également déclaré aux journalistes la semaine dernière que l’action militaire turque (“pour protéger les civils”, bien sûr !) serait acceptable (The Guardian du 18 novembre 2011). La possibilité d’une zone tampon le long de la désormais fortement militarisée frontière turco-syrienne verrait la mystérieuse “Armée Syrienne Libre”, largement basée en Turquie (ainsi qu’au Liban) et, pour le moment, largement inférieure en nombre à l’armée syrienne, capable de se déplacer avec un armement beaucoup plus lourd. Au sein de cette convergence d’intérêts impérialistes se trouvent les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la majorité de la Ligue arabe, des gauchistes divers, les Frères musulmans et les djihadistes salafistes de Syrie qui ont également pris un plus grand rôle dans l’opposition à Assad. En outre, la déstabilisation de la région et la perspective d’une aggravation des problèmes sont bien visibles tant dans l’avertissement du président turc Gül adressé à la Syrie et précisant qu’elle aurait à payer pour semer le trouble dans le Sud-Est kurde de la Turquie que dans “la volonté renouvelée de Washington de fermer les yeux sur des incursions militaires turques contre les bases de guérilla kurdes dans le nord l’Irak.” (The Guardian du 18 novembre 2011). Toute cette instabilité, alimentée par ces puissances et ces intérêts, rend une intervention militaire de la Turquie dans le territoire syrien d’autant plus probable.
“L’Armée syrienne libre” a elle-même été impliquée dans des meurtres sectaires et des assassinats de civils en Syrie (Newsnight du 17 novembre 2011) et, comme elle opère à partir de ses refuges en dehors du pays, pour combattre et tuer les forces gouvernementales et la police, les représailles s’abattent sur la population civile. Le Conseil National Syrien, qui a fait son apparition le mois dernier, a également appelé à une intervention militaire contre les forces d'Assad, tandis qu’une autre force d’opposition, le Comité National de Coordination, a dénoncé cette position. Le ministre français des Affaires Étrangères, Alain Juppé, a déjà rencontré les forces d’opposition à Paris et, le secrétaire au Foreign Office, Hague, les a rencontrées à Londres le 21 novembre. Il n’a pas été précisé qui étaient ces “forces d’opposition”, ni si elles incluent l’Armée Syrienne Libre, le Conseil National Syrien, le Comité de Coordination Nationale, l’opposition kurde, les Frères Musulmans et les djihadistes salafistes. En outre, les coalitions de l’opposition incluent des staliniens, onze organisations kurdes, des structures tribales et claniques, plus un nombre ahurissant d’amorces d’intérêts contradictoires. En tout cas, Hague a appelé à un “front uni” et a nommé un “ambassadeur désigné” pour eux (BBC News du 21 novembre) !
Téhéran, l’objectif ultime
Depuis maintenant plusieurs années, les États-Unis , la Grande-Bretagne, Israël et l’Arabie Saoudite ont fait monter l’hystérie anti-iranienne et c’est ce qui se cache derrière leur soutien à l’opposition syrienne et leur “préoccupation pour les civils”. Cette campagne a été considérablement renforcée par un récent rapport de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) qui laissait entrevoir une “possible” dimension militaire aux ambitions nucléaires de l’Iran. Mais les États-Unis encerclent l’Iran depuis un certain temps. Sur la frontière orientale de l’Iran, il y a plus d’une centaine de milliers de soldats américains en Afghanistan, au Nord-Est, il y a le Turkménistan avec ses bases militaires américaines. Dans le sud de Bahreïn, ce sont des bases navales américaines et britanniques. De même au Qatar, il y a le siège du comman-dement avancé des forces américaines et la marionnette anti-iranienne, l’Arabie Saoudite. Le seul espace où l’Iran peut respirer se situe maintenant autour de sa frontière occidentale avec l’Irak et même ici, les forces spéciales américaines et britanniques ont fait un certain nombre d’incursions directes ou indirectes: en 2007, Bush a obtenu l’approbation du Congrès pour un programme de 400 millions de dollars afin de soutenir les groupes “ethniques”, tandis que, plus récemment, Seymour Hersch dans le Daily Telegraph et Brian Ross de la chaîne ABC ont eu des renseignements sur le groupe de gangsters terroristes iranien Joundallah. Le chef de ce groupe, Abdolmalek Rigi, capturé par les services secrets iraniens alors qu’il allait à Doha, affirme qu’il a rencontré la CIA à la base aérienne américaine de Manas au Kirghizistan pour apporter son aide dans des attaques terroristes en Iran. Au large des côtes de l’Iran, il y a une accumulation massive de navires de guerre américains dans le Golfe Persique et dans l’ensemble de la région du Golfe, les États-Unis vont renforcer leurs atouts au Koweït, au Bahreïn et dans les Émirats Arabes Unis. Des révélations récentes (The Guardian du 11 mars 2011) ont montré que le Royaume-Uni préparait des plans d’urgence pour la liaison avec les forces américaines en vue d’une possible attaque navale et aérienne contre des cibles en Iran. A seulement environ 1500 km de là se trouve Israël, qui possède l’arme nucléaire, qui a été impliqué dans l’attaque au virus Stuxnet qui a réussi à arrêter définitivement environ un cinquième des centres nucléaires d’Iran, et dans la mort de scientifiques iraniens, dont un expert nucléaire de premier plan, le major général Moghaddam, tué avec 16 autres dans une énorme explosion dans une base des Gardiens de la Révolution, près de Téhéran, il y a dix jours. Encore une fois, l’hypocrisie de la démocratie est presque incroyable: au mépris de leur rhétorique sur le désarmement, le British American Security Information Conseil affirme que les États-Unis dépenseront 700 milliards de dollars pour la modernisation de leur installations d’armes nucléaires au cours de la prochaine décennie et “d’autres pays, y compris la Chine, l’Inde, Israël, la France et le Pakistan devraient consacrer des sommes énormes pour les systèmes de missiles tactiques et stratégiques” (The Guardian du 31 octobre 2011). Le rapport poursuit en disant que “les armes nucléaires se voient assigner des rôles qui vont bien au-delà de la dissuasion... de rôles d’armes de guerre dans la planification militaire”. En ce qui concerne Israël, le rapport déclare: “... la dimension des têtes nucléaires des missiles de croisière de sa flotte sous-marine est augmentée et le pays semble être sur la bonne voie, grâce à son programme de lancement de fusée satellite, pour le développement futur d’un missile balistique intercontinental (ICBM)”.
La Grande-Bretagne, qui a contribué à fournir à Israël des armes nucléaires, n’est pas mentionnée dans ce rapport commandé par ce pays. Tout le monde sait qu’une attaque sur l’Iran serait de la folie, même le Mossad et le Shin Bet, les forces secrètes de sécurité externes et internes d’Israël. Utilisant leur canal habituel de fuite contre leurs politiciens, le journal koweïtien Al-Jarida, les deux agences ont exprimé leurs sérieux doutes et le patron du Mossad, qui a récemment pris sa retraite, Meir Dagan, a appelé la perspective d’une attaque sur l’Iran “la plus stupide des idées” dont il n’avait jamais entendu parler. Mais le fait qu’elles soient stupides ou irrationnelles ne les rend pas improbables: il suffit de regarder les guerres en Irak et l’interminable cauchemar, complètement irrationnel, en Afghanistan/Pakistan. La Syrie devient une autre étape manifeste dans la transformation de la guerre secrète contre l’Iran. Cela n’a rien à voir avec “la protection des civils”, mais s’identifie entièrement à l’avancée des objectifs de plus en plus irrationnels imposés par un système capitaliste en pleine décomposition.
Baboon /21.11.2012
Rubrique:
En Egypte et dans le Maghreb, quel avenir pour les luttes ?
- 1326 lectures
La misère croissante, les morsures brutales de la crise économique, le besoin de liberté face au règne de la terreur, l’indignation face à la corruption, continuent d’agiter un peu partout les populations révoltées, notamment en Égypte (1).
Après les grandes mobilisations des mois de janvier et février dernier, les occupations devenues permanentes et quotidiennes sur la place Trahir du Caire se sont transformées en nouvelles démonstrations massives depuis le 18 novembre. Cette fois, c’est en grande partie l’armée et ses chefs qui sont dans le collimateur. Ces événements démontrent que si la colère demeure, c’est parce que, contrairement à ce que prétendaient la bourgeoisie et ses médias, il n’y a pas eu de “révolution” début 2011 mais un mouvement massif de contestation. Face à ce mouvement, la bourgeoisie est parvenue à imposer un simple changement de maître du pays : l’armée agit exactement comme Moubarak et rien n’a changé quant aux conditions d’exploitation et de répression pour la majorité de la population.
La bourgeoisie réprime dans le sang et calomnie les manifestants
Toutes les grandes villes égyptiennes ont de nouveau été touchées par la contagion du ras-le-bol vis-à-vis de la dégradation des conditions de vie et face à l’omniprésence de l’armée pour assurer le maintien de l’ordre. Le climat de confrontation est aussi présent à Alexandrie et Port-Saïd dans le Nord qu’au Caire ; des affrontements importants se sont produits au centre, à Suez et Qena, mais aussi dans le Sud à Assiout, Assouan, de même que vers l’Ouest à Marsa Matrouh. La répression a été brutale : 42 morts et environ 2.000 blessés ont été officiellement recensés ! L’armée n’hésite pas à violenter les foules avec ses forces antiémeutes. Elle multiplie ses tirs et lance des gaz lacrymogènes particulièrement nocifs. Certaines victimes décèdent après inhalation et suffocation. Une partie du sale travail de répression est “sous-traitée” : des tireurs spécialisés embauchés et embusqués utilisent ainsi en toute impunité des balles réelles. De jeunes manifestants s’effondrent dans la rue suite aux tirs meurtriers de ce genre de mercenaires. La police, pour compenser les limites imposées par l’usage de balles en caoutchouc, n’hésite pas à tirer systématiquement en plein visage. Une vidéo accablante circule et provoque la colère des manifestants qui peuvent entendre les propos d’un flic “arracheur d’yeux” félicitant son collègue : “Dans son œil ! C’est dans son œil ! Bravo, mon ami !” (L’express.fr) Les manifestants qui se retrouvent avec un œil en moins sont devenus légion! A cela, il faut ajouter les arrestations sauvages et les tortures. Bien souvent, les militaires sont accompagnés de miliciens, “les baltaguis”, utilisés en sous-main par le régime pour semer le désordre. Armés de barres de fer ou de gourdins, ils se chargent de mater plus ou moins discrètement les manifestants en essayant de les isoler. Ce sont eux par exemple qui, l’hiver dernier, avaient arraché et brûlé les tentes des opposants et qui avaient prêté main-forte pour de nombreuses arrestations (LeMonde.fr).
Contrairement à ce que les médias laissent entendre, les femmes, plus nombreuses aujourd’hui dans la foule des mécontents, sont souvent agressées sexuellement par les “forces de sécurité” et par exemple sont fréquemment contraintes à se soumettre à d’horribles humiliations comme les “examens de virginité”. Elles sont généralement considérées et davantage respectées par les manifestants, bien que l’agression de quelques journalistes occidentales ait été instrumentalisée (comme celle de Caroline Sinz, journaliste de France 3, où de jeunes “civils” seraient impliqués). Ainsi, “les débordements de Tahrir ne doivent pas faire oublier que, sur la place, un nouveau rapport s’établit entre hommes et femmes. Le simple fait que les deux sexes puissent dormir à proximité en plein air constitue une véritable nouveauté. Et les femmes se sont aussi saisies de cette liberté née sur la place. Elles sont parties prenantes de la lutte...” (Lepoint.fr).
On laisse aussi entendre insidieusement que les occupants de Tahrir sont des “voyous” parce qu’ils se “moquent des élections” et risquent de “mettre en péril la transition démocratique”. Ce sont ces mêmes médias qui, après avoir longtemps soutenu Moubarak et sa clique, ont soutenu et salué il y a quelques mois à peine le régime militaire qualifié de “libérateur”, aujourd’hui décrié, en profitant des illusions sur l’armée dans la population !
Le rôle clé de l’armée pour la bourgeoisie égyptienne
Même si, à l’heure actuelle, l’armée s’est fortement discréditée, c’est surtout le CSFA (Conseil suprême des forces armées) et son chef Hussein Tantaoui qui sont visés. Ce dernier, ministre de la Défense pendant dix ans sous Moubarak, perçu comme un clone du dictateur, génère un vœu unanime des foules qui se résume ainsi : “Dégage !”. Mais l’armée, soutien historique de Moubarak, est un solide rempart et continue de tenir l’ensemble des leviers de l’Etat. Elle n’a cessé de manœuvrer pour assurer sa position avec le soutien de toutes les grandes puissances, et en particulier des Etats-Unis, car l’Egypte est une pièce maîtresse de contrôle de la situation au Moyen-Orient et un facteur de stabilité essentiel dans la stratégie impérialiste dans la région, notamment dans le conflit israélo-palestinien. En vantant un “retour de l’armée dans les casernes”, la bourgeoisie parvient pour l’instant à mystifier sur l’essentiel. Non sans raisons, le quotidien Al Akhbar mettait en garde : “La plus dangereuse chose qui puisse arriver est la détérioration de la relation entre le peuple et l’armée.” En effet, l’armée n’a pas seulement un rôle politique majeur depuis l’arrivée au pouvoir de Nasser en 1954, constituant depuis un pilier essentiel et constant du pouvoir, elle détient aussi un rôle économique de premier plan, gérant directement nombre d’entreprises. En effet, depuis la défaite de la “guerre des 6 jours” contre Israël et surtout depuis les accords de Camp David en 1979, lorsque des dizaines de milliers de militaires ont été démobilisés, la bourgeoisie a encouragé et largement favorisé une partie de l’armée à se reconvertir en entrepreneurs, de crainte qu’elle ne représente une lourde charge supplémentaire sur le marché du travail où régnait déjà un chômage massif endémique. “Elle a commencé par la production de matériel pour ses propres besoins : armement, accessoires et habillement puis, avec le temps, s’est lancée dans différentes industries civiles et a investi dans des exploitations agricoles, exemptées de taxes et d’impôts” (Libération du 28.11.2011), investissant 30 % de la production et irriguant tous les rouages de la bourgeoisie égyptienne. Ainsi, “le CSFA peut être considéré comme le conseil d’administration d’un groupe industriel composé des sociétés possédées par l’institution [militaire] et gérées par des généraux à la retraite. Ces derniers sont aussi ultra-présents dans la haute administration : 21 des 29 gouvernorats du pays sont dirigés par d’anciens officiers de l’armée et de la sécurité”, selon Ibrahim al-Sahari, représentant du Centre des études socialistes du Caire, qui ajoute : “… on peut comprendre l’angoisse de l’armée face à l’insécurité et aux troubles sociaux qui se sont développés ces derniers mois. Il y a la crainte de la contagion des grèves à ses entreprises, où ses employés sont privés de tous droits sociaux et syndicaux tandis que toute protestation est considérée comme un crime de trahison” (cité par Libération du 28.11). La poigne de fer avec laquelle elle dirige le pays révèle donc son vrai visage répressif.
Une détermination courageuse dont les limites interpellent le prolétariat des pays centraux
Si la poursuite de la répression et la protestation des “comités de familles de blessés” ont précipité la cristallisation et la colère contre l’armée, ce n’est pas seulement pour réclamer l’abandon du pouvoir par les militaires, plus de démocratie et des élections, mais face à l’aggravation de la situation économique et la misère noire qui poussent les manifestants dans la rue aujourd’hui. Avec le chômage massif, nourrir sa famille devient simplement de plus en plus difficile. Et c’est cette dimension sociale qu’occul-tent précisément les médias. On ne peut que saluer le courage et la détermination des manifestants qui font face avec leurs mains nues aux violences de l’Etat. Seuls les trottoirs éventrés servent de munitions, les pavés et débris étant utilisés comme projectiles pour se défendre contre des flics armés jusqu’aux dents. Les manifestants témoignent d’une grande volonté de s’organiser dans un élan collectif et spontané pour les besoins de la lutte. Ils sont obligés de s’organiser et de développer avec ingéniosité une véritable logistique face à la répression. Ainsi, des hôpitaux de fortune s’improvisent un peu partout sur la grande place, des chaînes humaines laissent passer les ambulances. Des scooters servent à transporter les blessés vers les premiers soins ou les centres de secours. Mais la situation n’est plus la même qu’au moment de la chute de Moubarak où le prolétariat avait joué un rôle déterminant, où l’extension rapide de grèves massives et le rejet de l’encadrement syndical avaient largement contribué à pousser les chefs militaires, sous la pression des États-Unis, à chasser l’ancien président égyptien du pouvoir. La situation est bien différente pour la classe ouvrière aujourd’hui. Ainsi, dès le mois d’avril, une des premières mesures prises par l’armée a été de durcir la législation “contre les mouvements de grève susceptibles de perturber la production pour tout groupe ou secteur nuisant à l’économie nationale” et poussé les syndicats à les encadrer plus étroitement. Cette loi prévoit un an de prison ferme et une amende de 80.000 dollars (dans un pays où le salaire minimum est de 50 euros !) pour les grévistes ou pour ceux qui inciteraient à la grève.
Ainsi, le recours à la grève est resté ces derniers jours très localisé, se limitant à des mouvements purement économiques face à des fermetures d’usines ou face à des salaires impayés. La mobilisation ouvrière n’a plus été en mesure de rejouer un rôle important comme force autonome dans le mouvement.
Si la poursuite du mouvement rejette le pouvoir de l’armée, il n’en demeure pas moins affaibli et perméable à beaucoup d’illusions. D’abord, parce qu’il en appelle à un gouvernement “civil démocratique”, même si les Frères musulmans, voire les salafistes (les deux partis donnés en tête des législatives à travers le processus électoral), qui se savent aux portes d’un “gouvernement civil” de façade et sans réel pouvoir (dans la mesure où l’armée continuera d’assurer le réel pouvoir politique), se sont démarqués du mouvement de contestation et n’ont pas appelé aux rassemblements et aux manifestations pour négocier déjà leur avenir politique avec les militaires. Le mirage “d’élections libres”, les premières depuis plus de 60 ans, semble en mesure de saper momentanément la colère. Cependant, même si elles sont réelles, ces illusions démocra-tiques ne sont pas aussi fortes que ce que la bourgeoisie voudrait nous le faire croire : en Tunisie, où on nous a vanté 86 % de votants, il n’y a eu que 50 % des électeurs potentiels inscrits sur les listes électorale. Il en est de même au Maroc où le taux de participation aux élections était de 45 % et, en Egypte, où les chiffres sont restés plus flous (62 % des inscrits mais 17 millions de votants sur 40).
Aujourd’hui les fractions gauchistes de tous les pays crient : “Tahrir nous montre le chemin !” comme s’il s’agissait de recopier ce modèle de lutte en tout point, partout, de l’Europe aux Amériques. Il s’agit là d’un piège tendu aux travailleurs. Car tout n’est pas à reprendre de ces luttes. Le courage, la détermination, le slogan désormais célèbre “Nous n’avons plus peur !”, la volonté de se regrouper massivement sur les places pour vivre et lutter ensemble… constituent effectivement une source d’inspiration et d’espoirs inestimable. Mais il faut aussi, et peut être surtout, avoir conscience des limites de ce mouvement : les illusions démocratiques, nationalistes et religieuses, la faiblesse relative des travailleurs… Ces entraves sont liées au manque d’expérience révolutionnaire et historique de la classe ouvrière de cette région du monde. Les mouvements sociaux d’Egypte et de Tunisie ont apporté à la lutte interna-tionale des exploités le maximum de ce qui leur était possible pour l’heure. Ils atteignent aujourd’hui leurs limites objectives. C’est aujourd’hui au prolétariat le plus expérimenté, vivant sur les terres du cœur historique du capitalisme, en particulier d’Europe, de porter plus loin le glaive du combat contre ce système inhumain. La mobilisation des Indignés en Espagne appartient à cette dynamique internationale indispensable. Elle a commencé à ouvrir de nouvelles perspectives avec ces assemblées générales ouvertes et autonomes, avec ces débats dont ont parfois émergé des interventions clairement internationalistes et dénonçant la mascarade de la démocratie bourgeoise. Seul un tel développement de la lutte contre la misère et les plans d’austérités draconiens dans les pays du cœur du capitalisme peut ouvrir de nouvelles perspectives aux exploités, non seulement d’Egypte mais aussi dans le reste du monde. C’est la condition indispensable pour offrir un avenir à l’humanité !
WH / 01.12.2011
1) C’est évidemment le cas aussi en Syrie où le régime a tué plus de 4.000 personnes (dont plus de 300 enfants) en réprimant dans le sang les manifestations depuis le mois de mars. Mais nous reviendrons sur la situation dans ce pays dans un autre article à paraître ultérieurement.
Géographique:
Récent et en cours:
Rubrique:
Rapport sur la situation en Belgique
- 1287 lectures
Depuis les élections fédérales de juin 2010, soit pendant près de 540 jours, les projecteurs des médias bourgeois ont été centrés sur les rebondissements de l’interminable feuilleton communautaire: négociations, compromis, ruptures, trahisons; le «citoyen» a été amené à osciller constamment entre l’espoir d’un compromis national et le désespoir de l’éclatement du pays. Aujourd’hui, après un accord péniblement conclu sur une réforme communautaire et un plan budgétaire pluriannuel, un nouveau gouvernement se met en place. Dans ce contexte, pour comprendre la situation à laquelle la classe ouvrière devra faire face dans les mois à venir, le rapport veut répondre aux questions suivantes:
-Où en est la Belgique sur le plan économique face à la dépression mondiale?
-Comment comprendre ces 18 mois de crise politique communautaire?
-quelles en sont les conséquences pour la population et plus spécifiquement pour la classe ouvrière?
-quelles sont les perspectives pour la lutte de classe?
1.La Belgique dans l’œil du cyclone de la crise
Depuis 2008, la bourgeoisie n’arrive pas à endiguer la tendance à la récession mondiale. Plus précisément depuis l’été 2011, on a vu s’accélérer la spirale infernale de la crise de la dette souveraine des États et la pression sur les obligations d’État en Europe, la crise de l’Euro, la pression sur les banques et la bourse, une économie mondiale glissant de plus en plus clairement vers une profonde récession mondiale, de nouvelles faillites d’établissements financiers, etc.
La Belgique est une des économies les plus ouvertes au monde mesurée en termes de la part du commerce extérieur au PIB. La Belgique est très dépendante de la situation qui prévaut chez ses principaux partenaires économiques, en particulier l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Le secteur manufacturier (21% du PIB), spécialisé dans les biens intermédiaires et semi-finis (produits métalliques et chimiques) et fortement exportateur, expose fortement le pays aux fluctuations de l’économie internationale.
1.1.Dans la première phase de la crise ouverte (en particulier de 2008 à 2010), la bourgeoisie a présenté la situation économique en Belgique comme une exception en Europe:
-Un État relativement épargné par la crise et l’austérité;
-Un État où le problème essentiel n’était pas la question économique ou sociale, mais les tensions communautaires entre Wallons «profiteurs» et flamands «arrogants».
Cette mystification sur la bonne santé de l’économie belge a été entretenue par l’ensemble des partis politiques et par le gouvernement «démissionnaire» Leterme qui affirme que «le gouvernement avait tout sous contrôle». Qu’est-ce qui a donné un semblant de crédibilité à cette illusion d’une «Belgique qui échappe à la crise» ? En réalité, trois facteurs l’ont favorisé:
-entre 2008 et 2011, l’économie belge a pu «parasiter» pendant quelques années sur la croissance allemande et sur les plans de relance de la France, dont elle est dépendante pour 65%;
-le gouvernement fédéral a continué à gérer les «affaires courantes», évitant la pression sur le budget des dépenses «partisanes» classiques imposées par les partis gouvernementaux pour satisfaire leur électorat traditionnel. D’autre part, les gouvernements régionaux, non démissionnaires, responsables de larges domaines de la gestion étatique, comme l’enseignement, la santé publique, l’écologie et la culture, ont donc pu pleinement prendre les mesures d’austérité qui s’imposent dans ces domaines;
-toute une série de mesures cadres pluriannuelles pour imposer l’austérité avaient déjà été prises dès 2009 par le gouvernement Van Rompuy dans le but de passer d’un déficit budgétaire de 6% en 2009 à 0% en 2015, soit 22 milliards d’Euros d’économies en 2011. Celles-ci ont continué à être appliquées.
1.2.Depuis l’automne 2011, le réveil est particulièrement dur et met en évidence une situation économique précaire, bien plus difficile que celle de ses voisins immédiats:
-les banques belges (Fortis, KBC, Dexia) ont fortement subi la crise bancaire et sont encore déstabilisées par des créances douteuses, en particulier envers certains pays de l’Europe de l’Est et du Sud, ce qui a mené récemment à la faillite de la banque franco-belge Dexia;
-si le PIB belge recule pour le moment moins que celui de ses principaux voisins, le déficit budgétaire 2010 est de 5,2%, au lieu des 4,8% prévu il y a un an (+1,3 milliards d’euros) et le soutien massif aux banques a fait regrimper la dette qui atteint actuellement les 96% du PIB;
-la Belgique subit de plus en plus la pression des marchés et les taux d’intérêts payés par l’État belge sur les marchés internationaux tendent à se rapprocher des niveaux des pays du groupe des PIIGS;
-l’agence de notation Standard en Poor’s (S&P) a dégradé le 25 novembre soir la note de la Belgique de AA+ à AA, avec une perspective négative.
Malgré la formation d’un nouveau gouvernement qui devrait faire disparaître «l’incertitude politique» tant décriée par les institutions bourgeoises internationales, la bourgeoisie belge sous-évalue encore la situation catastrophique dans laquelle ses contradictions internes l’ont placée. Ainsi, dans l’appréciation relative du poids de l’austérité imposée, les mesures prises depuis 2008 et celles inscrites dans le nouvel accord gouvernemental restent globalement au niveau de l’effort d’austérité imposé au début des années 1980 (dévaluation du franc) ou de celui pour intégrer l’euro à la fin des années 1990. Or, le tourbillon de la dette souveraine et de la dépression mondiale accentueront la pression pour imposer des attaques encore plus larges et globales sur les systèmes de calcul des salaires, des allocations de chômage et des retraites: «La Belgique est décrite comme le premier exemple de l’État-providence bismarckien congelé. La plupart des sources considère que la réforme en Belgique (s’il y en a) reste progressive et insuffisante pour faire face efficacement aux défis de la restructuration et au vieillissement de la population » (8ième Conférence ESPAnet 2010, « Politique sociale et la crise mondiale: conséquences et réponses»).
2.La pression de la décomposition met en évidence les faiblesses de la bourgeoisie belge
Pourquoi alors cette focalisation pendant près de 18 mois sur les tensions communautaires et linguistiques? La division au sein des diverses fractions nationales exprime avant tout la pression croissante de la crise historique du capitalisme sur la cohésion de l’ensemble des bourgeoisies de la planète. De l’opposition entre Républicains et démocrates aux USA sur la politique à mener pour faire face à la dépression jusqu’aux oppositions entre les régions riches d’Italie du Nord ou d’Espagne (la Catalogne) et les régions pauvres de ces pays, ou encore le surgissement dans des pays comme les Pays-Bas de fractions ouvertement anti-européennes, on peut constater que ces tensions s’exacerbent un peu partout. Dans ce cadre il est erroné de voir les tensions (sous-)nationalistes comme une «exception Belge»,
Ceci étant dit, il est également incontestable que la bourgeoisie belge est caractérisée par un manque évident d’homogénéité: depuis la création artificielle de l’État belge en 1830, des tensions existaient en son sein. Ces tensions entre fractions régionales se sont particulièrement développées depuis la première guerre mondiale et se sont exacerbées depuis l’ouverture de la crise historique à la fin des années 1960. Le dernier avatar de ces tensions a été la montée en puissance lors des dernières élections du parti autonomiste flamand NVA (Nieuwe Vlaamse Alliantie) qui a mené au blocage de la vie politique de la bourgeoisie pendant 18 mois. Pendant des mois, les diverses fractions se sont déchirées comme des loups enragés afin de se positionner le mieux possible pour assurer leur survie dans la lutte sans merci qui est engagée sur le marché mondial, perdant même de vue à certains moments que cette lutte fratricide risquait de les mener tous à leur perte.
Si la bourgeoisie belge est effectivement divisée en diverses fractions nationales et régionales qui s’entre-déchirent, lorsque leurs intérêts vitaux sont menacés, celles-ci, repoussent ces conflits au second plan et s’unissent afin de défendre leurs intérêts communs. Il serait naïf de croire que, pour la défense de leurs intérêts communs fondamentaux - le maintien de leurs profits, de leurs parts de marché menacées par la concurrence exacerbée - ces fractions bourgeoises ne se coalisent pas pour imposer leur loi aux exploités.
3.La bourgeoisie exploite ses faiblesses dans un battage nationaliste intense contre la classe ouvrière
L’histoire de ces 50 dernières années nous apprend que la bourgeoisie belge utilise habilement ses divisions internes contre la classe ouvrière dans un double objectif:
3.1.Freiner la prise de conscience des attaques et du rôle central de l’état dans celles-ci.
Face au risque de défaut de paiement, tous les états européens lancé de gigantesques plans d’austérité pour tenter d’assainir leurs finances publiques et leur système bancaire. Ces plans dévoilent toutefois de plus en plus le rôle de l’État, ce pseudo ‘État social’, dans l’imposition de l’austérité capitaliste, ce qui risque d’orienter la colère ouvrière contre celui-ci. Loin d’être un arbitre au-dessus de la mêlée, garant de la justice sociale, «l’État démocratique» se manifeste ici pour ce qu’il est en réalité: l’instrument de la classe exploiteuse pour imposer des conditions de plus en plus impitoyables à la classe ouvrière.
Cependant, les diverses bourgeoisies nationales utilisent tous les moyens de mystification à leur disposition pour occulter le plus longtemps possible cette réalité aux yeux de la classe ouvrière et pour aux contraire embobiner cette dernière dans les illusions démocratiques. Dans ce contexte, la bourgeoisie belge et ses diverses fractions, attisent précisément les oppositions entre régions et communautés afin de noyer les attaques et le rôle central qu’y occupe «l’État démocratique» dans un imbroglio institutionnel.
De manière révélatrice, les années 1970, les années de la première manifestation de la crise historique du capitalisme, ont aussi été en Belgique le début d’une vaste série de mesures de restructuration institutionnelle, visant à régionaliser l’État et à diluer les responsabilités à divers niveaux de pouvoir communautaire, régional ou communal. Une flopée de gouvernements fédéral, communautaires et régionaux (sept au total) ont vu le jour, des regroupements de communes et de régions urbaines ont été mis en place, en plus de la privatisation partielle ou totale de certaines entreprises publiques (Poste, chemin de fer, téléphones, gaz et électricité, secteur des soins de santé, ...). Ceci a entraîné un partage ubuesque des compétences, une redistribution des fonctionnaires du secteur public sur les différents niveaux de pouvoir et la création de toutes sortes de statuts mixtes. Dans le concret, ces «réformes de l’État» ont abouti aux résultats suivants:
-accroître l’efficacité de l’exploitation: la «responsabilisation» des entités autonomes organise de fait la concurrence interne entre régions. Les travailleurs flamands sont appelés à être plus «performants» que leurs collègues wallons et vice versa, les régions, les communes, sont en concurrence pour gérer plus rationnellement les budgets sociaux ou mieux implémenter la flexibilité de leurs fonctionnaires, etc.
-accélérer les restructurations et les attaques contre les statuts du personnel, les salaires et les conditions de travail des fonctionnaires sous le couvert de réorganisation des structures de l’État;
-diluer l’ampleur des attaques, en les fragmentant sur divers niveaux de pouvoir ou en responsabilisant divers niveaux de pouvoir pour divers types de mesures.
3.2.Paralyser la capacité de réaction et d’extension des luttes de la classe ouvrière.
Lorsque les travailleurs s’insurgent contre les attaques dont ils sont victimes, la bourgeoisie -à travers en particulier de ses syndicats- se sert de l’intensification du battage (sous-)nationaliste et régionaliste pour entraver toute réaction unitaire des travailleurs et toute extension de leurs luttes face à l’agression subie. Cela aussi c’est une constante du rapport de force entre les classes en Belgique.
Depuis les années 1960 en particulier, la bourgeoisie utilise la mystification régionaliste pour freiner la prise de conscience au sein de la classe ouvrière de la nécessité d’une réaction unitaire et de l’extension de ses luttes face aux attaques. Lors de la grève générale de 1960, le syndicalisme radical, avec à sa tête André Renard, détourne la combativité des ouvriers des grands bassins industriels de Liège et du Hainaut vers le sous-nationalisme wallon, faisant croire qu’un sous-état wallon sous la direction du PS pourrait s’opposer au capital national et sauver du déclin les industries de la région. Les travailleurs paieront cher cette mystification, car ce sont ces autorités régionales qui liquideront progressivement l’industrie minière et sidérurgique wallonne dans les années 1970 et 1980. Depuis la fin des années ’80, la Flandre est confrontée aux mêmes problèmes avec le bassin minier limbourgeois, les chantiers navals (Boel Tamise) et l’automobile (Renault et dernièrement Opel). Une fois de plus, c’est la même mystification qui est utilisée: «Ce que nous faisons-nous mêmes, nous le faisons mieux» est le slogan des sous-nationalistes flamands. De fait, la liquidation des mines et des chantiers navals a été rondement menée et récemment, ce sont les travailleurs d’Opel qui se sont fait rouler dans la farine par les promesses du gouvernement flamand et les campagnes sur le «combat de la Flandre pour sauver Opel».
Une fois de plus aujourd’hui, alors que les travailleurs commencent à engager la riposte face aux attaques, la régionalisation des différents niveaux de pouvoir et le battage (sous-)nationaliste sont exploités par la bourgeoisie et ses organisations syndicales, d’abord pour diviser, isoler et enfermer les mouvements de lutte dans des carcans qui n’offrent aucune perspective d’avancée pour la classe ouvrière. Ainsi, lorsque les fonctionnaires subiront des attaques contre leurs salaires et les conditions de travail, ils seront amenés à manifester, chaque groupe devant son pouvoir de tutelle (fédéral, communautaire, régional, provincial, communal, ...). D’autre part, les syndicats n’hésitent pas à entraîner la lutte ouvrière vers le terrain pourri de la division régionale, voire des intérêts nationalistes. Ainsi, les enseignants flamands et francophones sont appelés à lutter pour des revendications différentes dans chacune des régions. Et récemment encore, les organisations syndicales appelaient les travailleurs à manifester pour une sécurité sociale belge unitaire, contre les velléités des nationalistes flamands de la régionaliser.
4.Au-delà du programme d’austérité du nouveau gouvernement, des attaques d’ampleur se préparent
4.1.Le programme du nouveau gouvernement Di Ruppo contient des attaques contre la classe ouvrière sur deux plans.
Les mesures budgétaires pluriannuelles impliquent des mesures d’attaques globales contre l’ensemble de la classe ouvrière, en sus des mesures déjà prises dans le cadre du plan pluriannuel 2010-2015 de Van Rompuy, justifiées à partir de la défense de la crédibilité de l’État belge face aux marchés:
-réduction des allocations pour les chômeurs de longue durée, y compris chefs de famille, à partir de la 2ième année de chômage;
-la limitation de l’accès à la retraite anticipée, qui passe progressivement de 60 à 62 ans;
-suppression de la prise en compte des périodes de chômage, de retraite anticipée et de crédit d’heures pour la retraite;
-limitation du droit au crédit d’heures et à la pause carrière;
-réduction budgétaires dans les soins de santé, menaçant la qualité des soins aux patients. “
Les mesures de réforme de l’État impliquent une exacerbation de la concurrence entre les régions. Elles mèneront à l’exploitation des tensions communautaires sur le plan économique à travers de l’organisation d’une concurrence interne entre régions: fiscalité différenciée entre régions pour «attirer les entreprises», financement des régions partiellement lié à l’atteinte de critères de rentabilité et d’efficacité (exemple le budget pour les allocations chômage sera lié à l’efficacité de la politique de «mise au travail» des chômeurs). La concurrence et la course à la performance entre les régions impliqueront une pression accrue sur les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière.
4.2.Quelles sont les mesures prises dans les autres pays d’Europe? Allemagne, 82 milliards d’euros; Grande-Bretagne, 7,2 milliards d’euro en 2010; Italie, 13 milliards d’euro en 2011 et depuis lors, deux autres plans d’austérité; Espagne, 15 milliards d’euro extra. Ces attaques impressionnantes impliquent des suppressions massives d’emplois dans le secteur public, la réduction des salaires (par exemple -5% pour les fonctionnaires en Espagne), le recul de l’âge de la retraite et la baisse des pensions (baisse des allocations de certains fonds de pension en Hollande par exemple) ou des allocations de soins de santé. Bref, elles signifient une baisse conséquente du niveau de vie de la classe ouvrière, comparable à celle qu’elle a connue dans les années 1930.
Dans ce contexte Européen et dans le contexte de l’accroissement de la pression sur les banques et sur la dette de l’État, des mesures supplémentaires s’imposeront pour «restaurer la crédibilité de la Belgique». Dans les coulisses, les «think tanks économiques» de la bourgeoisie esquissent déjà les grandes lignes d’un redoutable plan d’austérité, basé sur une double orientation: une éduction drastique des dépenses budgétaires de l’État pour infléchir l’évolution de la detteet une éduction importante des salaires (évaluée globalement à 10% pour restaurer la position concurrentielle de la Belgique vis-à-vis de l’Allemagne (salaires +23,4% en 10 ans en Belgique, contre +8,8% en Allemagne) et pour reconquérir des parts de marché ou contrer la chute des investissements étrangers (-70%, faisant passer la Belgique de la 2e à la 10e place des pays attirant des investissements étrangers (De Morgen, 23.07.10).
5.Contexte et perspectives pour les luttes ouvrières
Le battage communautaire intense de la bourgeoisie, qui se développe en réalité de manière quasi ininterrompue depuis l’été 2008, a caché aux travailleurs la réalité de la crise et des enjeux et a créé des conditions difficiles pour leur mobilisation, pour leur lutte et surtout pour l’extension de celles-ci. Ceci explique pourquoi les réactions ouvrières sont jusqu’à présent moins marquées que dans les pays voisins comme la France ou l’Allemagne. Il serait par ailleurs illusoire de penser que la bourgeoisie s’attachera à dissiper le brouillard dans la période actuelle. Bien au contraire, elle tend à exploiter un certain soulagement au sein de la classe ouvrière du fait que les tensions au niveau de la gestion de l’État belge semblent réglées pour jouer à présent la carte de la nécessaire «unité nationale» face aux marchés en appelant à une «solidarité nationale» pour «défendre notre pays» contre les attaques d’un «monde extérieur agressif» et pour «corriger les erreurs du passé». Pour la classe ouvrière en Belgique, la situation a été difficile ces dernières années et cela va encore rester difficile pendant une certaine période.
En même temps, l’intensité du battage et la prudence de Sioux avec laquelle la bourgeoisie avance ses mesures est aussi révélateur de la peur de la bourgeoisie face à une classe ouvrière qui a montré dans les années ’70 et ’80 sa combativité. Mais la pression de la crise la contraint de plus en plus à rendre ses attaques plus directes. Par ailleurs, dès l’annonce des mesures du nouveau gouvernement, le front uni des organisations syndicales annoncent un programme impressionnant de mobilisations, de manifestations et de grèves afin d’occuper solidement le terrain social. Tous les éléments avancés dans ce rapport démontrent bien que le décalage avec la situation sociale dans les autres pays d’Europe est plus une question de perception et de prise de conscience qu’une réalité objective: la réalité économique et sociale en Belgique est tout à fait parallèle à celles de pays comme la France ou les Pays-Bas.
Aussi, la situation sociale peut évoluer très vite, comme l’ont illustré le «printemps arabe» et les événements en Espagne ou en Angleterre. Même si une période d’hésitations et de désamorçage de la combativité dans une multitude d’actions syndicales semble probable dans un premier temps, une dynamique de mûrissement de la combativité et de la réflexion dans des minorités est dès à présent perceptible:
-multiplications de débrayages: sidérurgistes à Liège; infirmières à Anvers et Bruxelles; grève dans les ateliers SNCB à Bruxelles; arrêts de travail dans les transports publics;
-apparition de minorités discutant de la situation et des perspectives à mettre en avant, dans différentes manifs ou assemblées dans le cadre des mouvements des «Indignés» ou «Occupy» à plusieurs endroits.
Ces derniers mouvements qui se développent depuis des mois révèlent une sincère volonté de vivre et de lutter ensemble, collectivement, de tourner le dos à l’individualisme du capitalisme pour occuper ensemble un lieu et y discuter; ces mouvements, aussi limités qu’ils soient encore, révèlent la volonté de débattre collectivement et de réfléchir collectivement. Le fait que ces mouvements se développent au niveau international leur donne leur importance décisive. Ils indiquent que la classe ouvrière en Belgique peut très vite retrouver le chemin de la lutte. Et une fois en mouvement, elle peut très bien réagir avec encore beaucoup plus de combativité et de détermination qu’ailleurs. Sur ce plan là aussi, contrairement aux campagnes de la bourgeoisie, la Belgique n’est pas une exception.
Internationalisme/11.2011
Vie du CCI:
Géographique:
Rubrique:
Cycle de discussions : le capitalisme a fait faillite, pourquoi? Et alors, quoi d'autre?
- 1295 lectures
À l’heure actuelle, dans toute la société, la crise économique est au cœur des préoccupations. Tout le monde se fait des soucis sur son avenir, celui de ses enfants, ses parents âgés, ses voisins, amis, collègues, ... existe t’il encore un avenir décent pour nous tous ou allons-nous tout droit dans la plus grande pauvreté et la précarité? Pour ne pas parler de la répression croissante par l’État et de la tendance toujours montante dans la société du chacun pour soi, du sentiment d’insécurité.
Comme le formulait jadis Marx : “il ne faut pas voir dans la misère que la misère”. La crise économique n’est pas une fatalité. Elle n’est pas une loi naturelle. Ce n’est pas une destinée qui nous est réservée. Elle est le résultat d’un système qui est empêtré dans ses propres contradictions, comme celles entre les forces productives et les rapports de production, en d’autres termes entre le caractère social du processus de production et la réappropriation privée de la production et de ses produits par les propriétaires capitalistes.
La crise économique reste encore toujours l’"alliée" de la classe ouvrière. Partout, elle pousse à s’engager dans la lutte contre les mesures d’austérité et ouvre de nouvelles perspectives pour le renforcement de la lutte pour une autre société. Elle pousse la lutte de classe à un tel point que la question d’une autre forme de société est posée. Elle pousse les contradictions à une telle extrême que la société actuelle devient porteuse d’une nouvelle société qui correspond et est en concordance avec le caractère essentiellement social du processus de production: un système qui existe pour le respect des besoins humains et pas pour l’appât du gain.
Nous organisons dans les prochains mois un CYCLE DE DISCUSSION
où nous voulons approfondir ce thème sous différents angles.
Qui désire y participer ou y prendre part, peut nous CONTACTER
via notre adresse e-mail ou l’adresse de la boîte postale.
Vie du CCI:
Rubrique:
Internationalisme no 354 - 2e trimestre 2012
- 1151 lectures
Face à la crise économique globale, les syndicats empêchent une riposte globale contre la crise
- 1633 lectures
La manifestation syndicale du 31 janvier dernier a déclenché une discussion intense dans les médias, les entreprises et un large milieu politique sur l'utilité de la grève générale syndicale d'un jour et de manière plus globale sur l'efficacité des actions syndicales, voire le rôle des syndicats dans la période actuelle.
Cette discussion est une question importante et pose des enjeux cruciaux. Depuis maintenant près de 5 ans, crises immobilières, crises boursières, crises monétaires, crises bancaires et crises de la dette souveraine des États se succèdent et se conjuguent, attestant de l'impasse dans laquelle se trouve le système capitaliste mondial. Pour les conditions de vie des travailleurs, les conséquences ne se sont pas fait attendre: attaques générales sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail, les retraites, ... En Belgique plus particulièrement, licenciements (Beckaert, Arcelor-Mittal), blocage des salaires, allongement des carrières, suppression des pauses carrières constituent l'avant-goût d'attaques plus pénibles encore qui s'annoncent. D'Espagne aux États-Unis, de l'Égypte à la Grèce, se pose la question comment faire face à de telles agressions, comment organiser la lutte, quelle perspective avancer. C'était déjà une des questions centrales débattue dans les mouvements des «Indignés» ou de «Occupy Wall Street». Il est donc pleinement légitime que cette question soit posée en Belgique également.
Les syndicats et les besoins actuels de la lutte contre les mesures
Face aux mesures générales et internationales, ces mouvements qui se sont développés pendant toute l'année 2011 ont mis en avant trois besoins impérieux pour la lutte: le besoin d'extension et d'unification des mouvements, l'importance du développement de la solidarité entre salariés, chômeurs, jeunes et la nécessité d'engager au sein du mouvement une ample discussion sur une alternative au système actuel en faillite. Les syndicats répondent-ils à ces besoins pour la lutte?
a) Les syndicats favorisent-ils l'extension et l'unifica-tion des luttes?
La spécialité des syndicats, ce sont les actions par usine, par secteur; lorsque la tension sociale monte, ils prônent des actions «symboliques» visant surtout à «lâcher de la vapeur» et à désamorcer la colère et la combativité. Lorsqu'ils organisent une grève générale, ils prennent bien soin de la limiter à un jour, ou à organiser des actions « tournantes» par région ou secteur. Ainsi, lors de la dernière grève générale du 31.1, toute la campagne autour de cette grève générale a été orientée sur la division des travailleurs: débats autour du pour ou contre cette grève, sur la manière de mener la grève (qui mènerait à prendre en otage ceux qui ne veulent pas faire la grève et notre économie en difficulté). La classe est divisée par secteur et par usine face aux effets de la crise: secteurs publics opposés aux privés, secteur des transports en grève bloquant les secteurs non en grève, grandes entreprises opposées aux petites entreprises. Division entre générations: la grève générale est la grève des vieux qui veulent garder leurs avantages sur le plan du chômage et des retraites aux dépens des jeunes.
Et ne parlons pas de perspectives sérieuses au niveau européen ou mondial, alors que la crise et les attaques le sont de manière évidente. Tout dans leurs actions est fait pour isoler et diviser tous azimuts les travailleurs, pour instiller un sentiment d'impuissance face au tsunami d'attaques qui leur tombe dessus.
b) Les syndicats favorisent-ils l'expression de la soli-darité entre retraités, salariés, chômeurs et jeunes?
Bien au contraire, les actions autour de la grève générale sur le recul de l'âge de la retraite a montré combien leurs actions stimulaient les rivalités entre «jeunes» et «vieux», qui se reprochaient mutuellement un «manque de solidarité». D'ailleurs, dans la logique syndicale, la solidarité se réduit aux sacrifices que les «secteurs mieux nantis «doivent faire pour les «secteurs plus faible», en d'autre mots une répartition plus équitable de la misère parmi les travailleurs.
c) Les syndicats favorisent-ils la discussion sur une alternative au système en faillite?
Les syndicats raisonnent uniquement dans le cadre de la «concertation» au sein du système capitaliste. Et lorsque le «gâteau se réduit», la discussion ne peut porter que sur une manière «équitable» de répartir l'austérité, ce qui signifie aussi «favorable» aux intérêts nationaux. Ils font tout pour éviter la remise en cause du système: en février, les syndicats exultaient: le gouvernement accepte de négocier et finit par assouplir certaines mesures secondaires: victoire sur toute la ligne pour la bourgeoisie grâce à ses syndicats: l'essentiel des mesures passe et l'impression est donnée que la lutte syndicale paie, ce qui permet d'éviter de contrer la réflexion sur la remise en cause du système. Si la «bombe atomique» n'a pu arrêter les mesures, «arrêtons de rêver et essayons ensemble de gérer au mieux la crise du système»: voilà en résumé le message que la bourgeoisie, avec l'aide de ses syndicats, veut faire passer. Comme si gérer «démocratiquement» une société d'exploitation signifie supprimer cette exploitation, comme si gérer «équitablement» la misère signifie la rendre supportable!
Les syndicats ne répondent donc aucunement aux besoins de la lutte, en Belgique comme ailleurs d'ailleurs. Bien au contraire. Leur action vise à neutraliser la colère et à désamorcer la combativité. La division et la démoralisation sont un objectif des syndicats pour dissuader à tout prix les ouvriers d'entrer massivement en lutte. Dans la réalité, la méfiance des travailleurs envers eux, leurs promesses creuses et leurs magouilles continuelles, s'accroît d'ailleurs fortement, comme l'a encore montré dernièrement la grève spontanée du personnel des transports publics bruxellois suite à une agression mortelle contre un de leurs collègues de celui-ci. Au delà de cette simple indignation face au sabotage des luttes par les syndicats, beaucoup de prolétaires se posent les mêmes questions plus fondamentales: est-ce que tout cela n'est qu'un malheureux hasard?
Existe-t-il de «bons«et de «mauvais« syndicats?
NON! Tous les syndicats, y compris les plus «radicaux» et «combatifs», ne défendent pas les intérêts des travailleurs mais ceux de la bourgeoisie. Leur fonction consiste à saboter les luttes en faisant semblant d'être du côté des exploités. Toutes les mobilisations derrière les syndicats ne mènent qu'à la défaite et à la démoralisation. L'apparente division entre les syndicats «mous» et les syndicats plus à gauche, «plus radicaux», ne sert qu'à diviser la classe ouvrière, à mieux couvrir tout le terrain de la lutte.
S'il n'y a pas de «bons» et de «mauvais» syndicats, c'est parce que le syndicalisme n'est plus adapté aux besoins de la lutte de classe aujourd'hui. Le syndicalisme est devenu une arme de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. Les syndicats sont devenus (depuis que le capitalisme a sonné la fin de sa période d'ascendance internationale avec l’éclat de la Première Guerre mondiale) des organes de l'État capitaliste dans les rangs ouvriers. Depuis près d'un siècle, leur fonction consiste à diriger les luttes pour empêcher la classe ouvrière de prendre elle-même la direction de ses combats, pour l'empêcher de développer sa solidarité et son unité lui permettant de se battre efficacement contre le capitalisme. Croire qu'il existe de «bons» syndicats est une pure illusion. La preuve: l'agitation des syndicats les plus «radicaux» n'a pas empêché la bourgeoisie de renforcer ses attaques et de faire passer tous ses plans d'austérité. Au contraire! La division entre les syndicats ne leur sert qu'à oeuvrer pour diviser la classe ouvrière et la conduire à la défaite.
Tous les syndicats sont complices du gouvernement et du patronat. Lorsqu'ils «négocient» (toujours dans le dos des travailleurs), c'est pour discuter avec les représentants du gouvernement et du patronat de la façon de faire passer les attaques. Tous les syndicats ont pour fonction d'encadrer les luttes pour maintenir l'ordre social du capital! Pour cela, ils se partagent le travail entre eux et en étroite collaboration avec les représentants de la classe dominante.
Peut-on «réformer» les syndicats?
NON! Dans la mesure où les syndicats sont devenus des organes d'encadrement de la classe ouvrière et ont été définitivement intégrés à l'appareil de l'État bourgeois, on ne peut pas les «réformer».
Beaucoup de prolétaires pensent que ce sont les bureaucraties syndicales qui sont pourries et qu'il suffirait de changer la direction des syndicats pour que ces derniers deviennent de vrais organes de défense des travailleurs. C'est une illusion! Si les syndicats ne sont pas «efficaces», ce n'est pas à cause de leurs «mauvais» leaders qui trahissent la «base». C'est la forme syndicale elle-même qui est devenue inefficace et totalement inadaptée aux besoins de la lutte.
Le syndicalisme est une idéologie réformiste basée sur la division de la classe ouvrière en corporations, en corps de métiers.
Le syndicalisme est une idéologie qui sème l'illusion que l'on peut se battre aujourd'hui pour obtenir des réformes durables afin d'améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière au sein-même du capitalisme (comme c'était le cas au 19e siècle). Aujourd'hui, avec l'enfoncement du capitalisme dans une crise économique sans issue et qui ne peut que continuer à s'aggraver, les seules «réformes» durables sont celles qui nous sont imposées par la bourgeoisie, telle la «réforme» du système de retraite. Ces «réformes», au lieu d'améliorer les conditions d'existence des salariés, ne peuvent que les plonger dans une pauvreté et une misère croissantes.
Le syndicalisme sème l'illusion qu'en se battant chacun dans son coin, derrière des revendications spécifiques à sa boîte, son secteur, sa corporation, on peut obtenir gain de cause. C'est FAUX! Seule une lutte massive englobant tous les secteurs de la classe ouvrière, derrière des mots d'ordre unitaires peut faire reculer le gouvernement et le patronat. Pour cela, il faut briser toutes les divisions corporatistes, sectorielles que les syndicats nous imposent.
Il ne sert à rien de chercher à «réformer» les syndicats ou créer de nouveaux syndicats. La preuve: lors des luttes des ouvriers de Pologne en 1980, par exemple, ces derniers avaient l'illusion qu'en créant un nouveau syndicat «libre» et «démocratique» (le syndicat Solidarnosc dirigé par Lech Walesa), ils allaient pouvoir renforcer leurs luttes et obtenir des réformes durables. On a vu ce que cela a donné: c'est grâce à la création du syndicat «indépendant» Solidarnosc (mis en place avec le soutien des syndicats occidentaux et de toute la bourgeoisie des États «démocratiques») que le général Jaruzelski a pu décréter l'état de guerre et réprimer férocement la classe ouvrière en Pologne (voir notre brochure sur les luttes en Pologne de 1980). Par la suite, on a vu le parcours du leader du syndicat Solidarnosc: Lech Walesa est devenu chef de l'État polonais et c'est lui qui a eu la responsabilité de gérer le capital national polonais et de porter des attaques directes contre la classe ouvrière!
Peut-on lutter efficacement sans les syndicats dans les pays «démocratiques»?
OUI! Pour cela, il faut que la classe ouvrière prenne confiance en elle-même et en ses propres forces. Il faut qu'elle puisse surmonter les hésitations et surtout la peur de la répression des grèves «sauvages» et «illégales». Cette peur de la répression (sous forme de sanctions disciplinaires) ne pourra être dépassée que si les travailleurs sont capables de développer la solidarité entre eux, s'ils refusent de se laisser diviser et intimider. Cette peur ne pourra être dépassée que lorsque les exploités prendront conscience qu'ils n'ont plus rien à perdre que leurs chaînes.
Les travailleurs, salariés ou au chômage, en retraite ou étudiants ne pourront prendre en mains leur propre destinée que lorsqu'ils auront compris que toutes les actions «radicales», les actions commandos préconisées par les syndicats (séquestration des patrons, sabotage de la production, blocage des voies ferrées, etc.) ou les actes de désespoir (telles les menaces de faire sauter l'usine) sont totalement stériles et ne peuvent conduire qu'à la démoralisation et à la défaite. Toutes ces actions pseudo-radicales derrière lesquelles les syndicats cherchent à entraîner les travailleurs les plus combatifs ne servent qu'à défouler leur colère et ne sont que des feux de paille.
Dans les pays «démocratiques», les syndicats sont les représentants de la «démocratie» bourgeoise au sein de la classe ouvrière, c'est-à-dire de la forme la plus sournoise et hypocrite de la dictature du capital.
Comment lutter efficacement ?
Pour pouvoir se battre efficacement en se dégageant de l'emprise totalitaire des syndicats, il faut faire vivre la vraie «démocratie» de la classe ouvrière. Cela veut dire développer la discussion collective au sein des assemblées générales massives et souveraines. Ces AG doivent être des lieux de débats où chacun peut intervenir librement, faire des propositions d'actions soumises au vote. Ces AG doivent élire des délégués révocables à tout moment, qu'ils soient syndiqués ou non. Si les délégués élus ne remplissent pas correctement le mandat confié par l'AG, l'AG suivante doit les remplacer. Contrairement aux méthodes de sabotage syndicales, il faut que ces AG soient ouvertes à TOUS les travailleurs (et pas seulement à ceux de la boîte, de l'entreprise ou de la corporation, ou les membres du syndicat). Les chômeurs doivent également être invités à y participer activement car ce sont des prolétaires exclus du monde du travail. Ceci est un des points forts que les mouvements en Espagne des Indignés et aux EU de Occupy nous ont montré. Avec un % toujours croissant d’exclus du marché régulier du travail (précaires, chômeurs) l’AG est devenu par excellence le lieu où toutes les parties de la classe exploitée peuvent s’unir et développer leur solidarité. Les AG souveraines doivent être des lieux de discussions public, (comme l'ont montré les travailleurs de Vigo en Espagne en 2006). Ce n'est qu'à travers la discussion et la réflexion collective dans ces AG ouvertes à tous que peut se construire l'unité et la solidarité de la classe exploitée. Ce n'est que dans ces Assemblées que peuvent se décider des actions unitaires, être mises en avant des revendications communes à tous et que pourront être démasquées les magouilles des syndicats.
Pour se battre efficacement en se débarrassant des entraves et du carcan des syndicats, les travailleurs doivent immédiatement poser la question de l'extension de leur lutte et de la solidarité avec tous leurs camarades des autres secteurs et entreprises frappés par les mêmes attaques de la bourgeoisie. Lorsque les travailleurs d'une entreprise engagent la lutte, ils doivent envoyer des délégations massives vers les autres entreprises voisines pour entraîner dans la lutte tous les travailleurs de la même zone géographique et élargir leur mouvement de proche en proche.
Aujourd'hui, si la classe ouvrière a beaucoup de difficulté à engager la lutte sans attendre les directives des syndicats, c'est parce qu'elle manque encore de confiance en elle-même et dans ses propres forces. C'est aussi parce que l'idéologie «démocratique» inoculée dans ses rangs par les syndicats (et le syndicalisme) pèse encore sur sa conscience.
L'idée qu'on a besoin des syndicats pour se battre est véhiculée par la bourgeoisie. La classe dominante veut nous faire croire que seuls les syndicats peuvent nous «représenter» parce que ce sont des professionnels de la «négociation», alors que ce sont des professionnels du sabotage, de la magouille et de la collaboration avec l'ennemi de classe.
Face aux plans d’austérité dont nous sommes tous victimes, il est possible de lutter efficacement. Mais pour construire un véritable rapport de force capable de faire reculer la bourgeoisie, les travailleurs doivent déjouer les manœuvres de sabotage des syndicats et comprendre qu’ils ne peuvent plus compter sur ces faux amis. Cette discussion est d’une grande importance si nous «voulons faire comprendre à toute la classe, à tous les collègues-ouvriers qu’à l 'intérieur du capitalisme pour eux il n'y a pas d’avenir et que seulement par la lutte, non comme syndicat mais comme classe-unie, nous pouvons remporter la victoire» (Sur les syndicats, A. Pannekoek, 1936). Nous appelons toutes les forces combattives d’engager la discussion là-dessus.
Les organisations syndicales n'ont pas d'autre fonction que de préserver l'ordre social capitaliste et faire passer les attaques du gouvernement et du patronat. Malgré leurs discours «radicaux», elles ne peuvent que continuer à nous diviser, à nous affaiblir pour empêcher tout «débordement» et nous faire voter la reprise du travail sans n'avoir rien obtenu. C'est bien grâce aux syndicats que la classe dominante peut continuer à cogner toujours plus fort et à faire payer aux travailleurs les frais de la crise insurmontable du capitalisme.
Jos & Sofiane /15.04.2012
Géographique:
Situations territoriales:
Rubrique:
En Syrie, l'horreur d'un champ de guerre impérialiste
- 1467 lectures
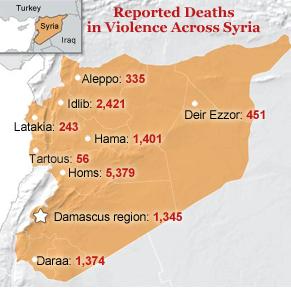 Samedi 4 février, un après-midi comme un autre à Homs. Une foule immense enterre ses morts et manifeste contre le régime de Bachar Al-Assad. Depuis le début des événements en avril 2011, il ne se passe pas un jour en Syrie sans qu’une manifestation ne soit réprimée. En moins d’un an, il y aurait eu largement plus de 2.500 morts et des milliers de blessés.
Samedi 4 février, un après-midi comme un autre à Homs. Une foule immense enterre ses morts et manifeste contre le régime de Bachar Al-Assad. Depuis le début des événements en avril 2011, il ne se passe pas un jour en Syrie sans qu’une manifestation ne soit réprimée. En moins d’un an, il y aurait eu largement plus de 2.500 morts et des milliers de blessés.
Mais dans la nuit du 4 au 5 février, la pratique de l’assassinat en masse s’est encore élevée d’un cran. Pendant des heures, dans l’obscurité, seuls s’entendent les canons de l’armée d’Assad qui tonnent et les cris des hommes qui meurent. Au petit-matin apparaît toute l’horreur de ce qui est aujourd’hui nommée «la nuit rouge d’Homs»: à la lumière du jour, les rues se révèlent jonchées de cadavres. Le bilan de la tuerie serait de 250 morts, sans compter tous ceux qui ont succombé à leurs blessures depuis lors ou qui ont été achevés froidement, après coup, par les militaires à la solde du pouvoir. Car ce massacre n’a pas pris fin à la levée du jour; les blessés ont été pourchassés jusque dans leur lit d’hôpital pour y être exécutés, des médecins surpris en train de soigner des «rebelles» ont été abattus, certains habitants d’Homs sont morts d’une balle dans la tête simplement pour avoir commis le crime de transporter des médicaments dans leurs poches. Ni les femmes ni les enfants n’échappent à ce carnage. La même nuit, la chaîne de télévision Al Jazeera a annoncé que de fortes explosions avaient été entendues dans la région de Harasta, dans la province de Rif Damas. Dans cette ville, située à une quinzaine de kilomètres au Nord de Damas, de violents combats opposent l’armée syrienne libre (ASL) et les forces du régime. Là-aussi, les massacres sont abominables.
Comment tout cela est-il possible? Comment un mouvement de protestation qui a débuté contre la misère, la faim et le chômage a pu en quelques mois se transformer en un tel bain de sang?
Qui est responsable de cette horreur? Qui commande la main meurtrière des militaires et des mercenaires?
La barbarie du régime syrien n’est plus à démontrer. La clique au pouvoir ne reculera devant aucune exaction, aucun massacre pour se maintenir à la tête de l’État et ainsi conserver ses privilèges. Mais qui est cette «armée syrienne libre» qui s’est mise au commandement de la «protestation du peuple»? Une autre clique d’assassins! L’ASL prétend se battre pour libérer le peuple, elle n’est que le bras armé d’une fraction bourgeoise concurrente à celle de Bachar Al-Assad. Et c’est bien là tout le drame des manifestants. Ceux qui veulent lutter contre leurs conditions de vie insoutenables, contre la misère, contre l’exploitation, ceux-là sont pris entre le marteau et l’enclume et ils s’y font écraser, torturer, massacrer...
En Syrie, les exploités sont trop faibles pour développer une lutte autonome; leur colère a ainsi été immédiatement détournée et instrumentalisée par les différentes cliques bourgeoises du pays, les manifestants sont devenus de la chair à canon, enrôlés dans une guerre qui n’est pas la leur pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, comme cela avait été le cas en Libye quelques mois plus tôt.
Ainsi, l’ASL n’a rien à envier à la nature sanguinaire du régime syrien au pouvoir. Début février, elle a, entre autres exemples, menacé de bombarder Damas et tous les postes de commandement du régime et ses fiefs. L’ASL demandant à la population de Damas de s’éloigner de ces cibles, ce qu’elle sait impossible. Les habitants de Damas n’ont en fait pas d’autres choix que de se terrer, terrorisés, dans les caves ou les souterrains tels des taupes ou des rats, à l’image de leurs frères exploités d’Homs.
Mais la bourgeoisie syrienne n’est pas seule responsable de ces massacres. Les complicités internationales sont aussi nombreuses qu’il y a de sièges à l’ONU. Ammar AL-Wawi, l’un des commandants de l’ASL, accuse ainsi directement la Russie et certains pays voisins, tels que le Liban et l’Iran par leur implication, et indirectement la Ligue arabe et la communauté internationale par leur inaction, d’avoir donné le feu vert à Assad pour massacrer le peuple. Quelle découverte!
- La Chine et la Russie défendent publiquement et politiquement le régime syrien. Avec l’Iran, la Russie approvisionne en armes ce régime. Et il est probable que des forces armées de ces pays interviennent directement sur le terrain sous une appellation ou une autre. Pour les puissances capitalistes, les morts ne comptent pas ni la souffrance humaine qu’inflige la défense de leurs sordides intérêts impérialistes.
- L’Iran joue en Syrie une grande partie de sa domination sur le Proche et le Moyen-Orient. C’est pourquoi cet État soutient de toutes ses forces, en s’impliquant même directement militairement, le régime syrien en place. Et les «grandes nations démocratiques» qui aujourd’hui proclament la main sur le cœur et des larmes de crocodile à l’œil que la répression des manifestants par l’armée de Bachar Al-Assad est insoutenable, n’ont aucune réelle compassion pour les familles en deuil, seul l’affaiblissement de l’Iran en mettant sous leur coupe la Syrie les intéresse. Mais il s’agit là d’un bras de fer dangereux car l’Iran n’est pas l’Irak. L’Iran est un pays de plus de 70 millions d’habitants, avec une armée nombreuse et bien équipée. Et surtout avec un pouvoir de nuisance autrement plus important que celui de la Syrie. Si on obligeait l’Iran à empêcher le passage du pétrole par le détroit d’Ormuz, quelle catastrophe économique ce serait! Toute attaque directe de l’Iran provoquerait un chaos incontrôlable. Des nuits rouges comme à Homs se généraliseraient à toute la région.
La Syrie au bord de la guerre impérialiste généralisée
 Chaque jour, les tensions montent entre l’Iran et bon nombre de puissances impérialistes dans le monde : États-Unis, Angleterre, France (1), Arabie Saoudite, Israël, etc. La guerre menace mais pour le moment n’éclate pas (2). En attendant et presque mécaniquement, les bruits de bottes se font de plus en plus entendre en direction de la Syrie, amplifiés encore par le veto de la Chine et de la Russie au sein de l’ONU concernant une proposition de résolution condamnant la répression par le régime de Bachar Al-Assad. Tous ces charognards impérialistes prennent le prétexte de l’infamie et de l’inhumanité du régime syrien pour préparer l’entrée en guerre totale dans ce pays. C’est en premier lieu par l’entremise du média russe La Voix de Russie, relayant la chaîne de télévision publique iranienne Pess TV, que des informations ont été avancées selon lesquelles la Turquie s’apprêterait avec le soutien américain à attaquer la Syrie. A cet effet, l’État turc masserait troupes et matériels à sa frontière syrienne. Depuis lors, cette information a été reprise par l’ensemble des médias occidentaux. En face, en Syrie, des missiles balistiques sol-sol de fabrication soviétique ont été déployés dans les régions de Kamechi et de Deir Ezzor, à la frontière avec l’Irak et la Turquie. Tout cela fait suite à une réunion tenue en novembre à Ankara qui a donné lieu à une série de rendez-vous. L’émissaire du Qatar a offert à Erdogan, premier ministre turc, de financer toute opération militaire depuis le territoire turc contre le président Al Assad (3). Réunions auxquelles ont participé aussi les oppositions libanaises et syriennes. Ces préparatifs ont amené les alliés de la Syrie, en premier lieu l’Iran et la Russie, à hausser le ton et à proférer des menaces à peines voilées contre la Turquie. Pour le moment, le Conseil National Syrien (CNS), qui regrouperait selon la presse bourgeoise la majorité de l’opposition dans ce pays, a fait savoir qu’il ne demandait aucune intervention militaire extérieure sur le sol syrien. C’est sans aucun doute ce refus qui paralyse encore les bras armés de la Turquie et éventuellement de l’État israélien. Le CNS se moque, comme toutes les autres fractions bourgeoises impliquées, des souffrances humaines qu’entraînerait une guerre totale sur le sol syrien Ce qu’il craint, c’est tout simplement de perdre totalement le peu de pouvoir qu’il possède actuellement en cas de conflit majeur.
Chaque jour, les tensions montent entre l’Iran et bon nombre de puissances impérialistes dans le monde : États-Unis, Angleterre, France (1), Arabie Saoudite, Israël, etc. La guerre menace mais pour le moment n’éclate pas (2). En attendant et presque mécaniquement, les bruits de bottes se font de plus en plus entendre en direction de la Syrie, amplifiés encore par le veto de la Chine et de la Russie au sein de l’ONU concernant une proposition de résolution condamnant la répression par le régime de Bachar Al-Assad. Tous ces charognards impérialistes prennent le prétexte de l’infamie et de l’inhumanité du régime syrien pour préparer l’entrée en guerre totale dans ce pays. C’est en premier lieu par l’entremise du média russe La Voix de Russie, relayant la chaîne de télévision publique iranienne Pess TV, que des informations ont été avancées selon lesquelles la Turquie s’apprêterait avec le soutien américain à attaquer la Syrie. A cet effet, l’État turc masserait troupes et matériels à sa frontière syrienne. Depuis lors, cette information a été reprise par l’ensemble des médias occidentaux. En face, en Syrie, des missiles balistiques sol-sol de fabrication soviétique ont été déployés dans les régions de Kamechi et de Deir Ezzor, à la frontière avec l’Irak et la Turquie. Tout cela fait suite à une réunion tenue en novembre à Ankara qui a donné lieu à une série de rendez-vous. L’émissaire du Qatar a offert à Erdogan, premier ministre turc, de financer toute opération militaire depuis le territoire turc contre le président Al Assad (3). Réunions auxquelles ont participé aussi les oppositions libanaises et syriennes. Ces préparatifs ont amené les alliés de la Syrie, en premier lieu l’Iran et la Russie, à hausser le ton et à proférer des menaces à peines voilées contre la Turquie. Pour le moment, le Conseil National Syrien (CNS), qui regrouperait selon la presse bourgeoise la majorité de l’opposition dans ce pays, a fait savoir qu’il ne demandait aucune intervention militaire extérieure sur le sol syrien. C’est sans aucun doute ce refus qui paralyse encore les bras armés de la Turquie et éventuellement de l’État israélien. Le CNS se moque, comme toutes les autres fractions bourgeoises impliquées, des souffrances humaines qu’entraînerait une guerre totale sur le sol syrien Ce qu’il craint, c’est tout simplement de perdre totalement le peu de pouvoir qu’il possède actuellement en cas de conflit majeur.
Les horreurs que nous voyons chaque jour à la télévision ou à la Une de la presse bourgeoise sont dramatiquement vraies. Si la classe dominante nous montre tout cela à longueur de temps, ce n’est ni par compassion, ni par humanité. C’est pour nous préparer idéologiquement à des interventions militaires toujours plus sanglantes et massives. Dans ce génocide en cours, Bachar Al-Assad et sa clique ne sont pas les seuls bourreaux. Le bourreau de l’humanité, c’est ce système capitaliste agonisant qui sécrète la barbarie de ces massacres inter-impérialistes comme la nuée porte l’orage.
Tino/16.02,2012
Notes du 16,04
(1) Début mars, la télévision officielle syrienne confirmait que l’armée avait emprisonné 18 agents français à Homs et un 19ième à Azouz. Ce message signifiait que les –prudentes- négociations entre Paris et Damas avaient échoué et que la Syrie décidait d’augmenter la pression sur la France en rendant l’affaire publique.
(2) Les États-Unis, au cours du mois de mars, ont mené des «entretiens intensifs» avec l’Inde, la Chine et la Turquie pour « inciter» ces pays d’arrêter l’exportation de pétrole d’Iran. Mais cela ne va pas de soi car ces pays sont réticents à abandonner leurs propres aspirations régionales impérialistes. Prenons par exemple la Turquie.
Un spécialiste dans le domaine des relations internationales, Sol Ozel, de l’Université Kadir Has, déclarait le 9 février que «la Turquie a clairement fait savoir qu’elle n’est pas d’accord avec les sanctions contre l’Iran.»
Une raison importante est que non seulement les entreprises turques profitent du commerce du pétrole provenant de l’Iran, mais aussi les banques turques. Elle transfère près d’un milliard de dollars par mois à Téhéran. La Banque Hall, qui est contrôlée par l’État turc, rend possible le paiement de l’exportation du pétrole iranien, en particulier vers l’Inde.
(3) la Russie et la Chine n’ont toujours pas accepté la résolution du Conseil de sécurité condamnant le comportement du régime syrien de Bachar al-Assad. Entre temps, bien qu’à contrecœur, ils sont d’accord avec «une déclaration de l’ONU » soutenant l’initiative de paix de Kofi Annan.
Géographique:
Rubrique:
Les drames de Toulouse et Montauban sont des symptômes de l'agonie barbare de la société capitaliste
- 1398 lectures
 Les assassinats commis les 11, 15 et 19 mars à Toulouse et Montauban ainsi que leurs répercussions constituent une illustration saisissante de la barbarie dans laquelle s’enfonce le monde actuel.
Les assassinats commis les 11, 15 et 19 mars à Toulouse et Montauban ainsi que leurs répercussions constituent une illustration saisissante de la barbarie dans laquelle s’enfonce le monde actuel.
D’après le Président Sarkozy, Mohamed Merah, le jeune toulousain qui a commis ces crimes et qui a été exécuté par le RAID, était un «monstre». Cette affirmation soulève au moins deux questions:
C’est quoi un «monstre» ?
Comment la société a-t-elle pu fabriquer un tel «monstre»?
Les «bons monstres» et les «mauvais monstres»
Si le fait de tuer de sang-froid des personnes parfaitement innocentes, et par surcroît inconnues, fait d’un être humain un «monstre», alors la planète est gouvernée par des «monstres» puisqu’un grand nombre des chefs d’État de ce monde ont commis de tels crimes. Et ce ne sont pas seulement quelques «dictateurs sanguinaires» qui sont concernés comme Staline ou Hitler dans le passé, Kadhafi ou Assad dans la période actuelle. Que penser de Winston Churchill, le «Grand homme» de la Seconde Guerre mondiale qui a ordonné les bombardements des villes allemandes de Hambourg durant l’été 1943 et Dresde du 13 au 15 février 1945, bombardements qui firent des dizaines, voire des centaines de milliers de morts civils dont 50 % de femmes et 12 % d’enfants? Que penser de Harry Truman, président de la «grande démocratie» américaine, qui ordonna les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki au Japon en août 1945, lesquels firent plusieurs centaines de milliers de victimes civiles, en majorité des femmes et des enfants? Ces tués n’étaient pas des victimes «collatérales» d’opérations visant des objectifs militaires. Les bombardements visaient expressément les civils et notamment, dans le cas de l’Allemagne, ceux habitant les quartiers populaires. Aujourd’hui, les dirigeants des pays «démocratiques» «couvrent» en permanence tous les bombardements des populations civiles, qu’ils aient lieu en Irak, en Afghanistan, à Gaza ou en bien d’autres lieux.
Pour exonérer les dirigeants politiques et militaires, on entend que tous ces crimes sont le prix à payer pour gagner la guerre contre les «forces du mal». Même les opérations de représailles contre des populations civiles sont ainsi justifiées: ces actes de vengeance ont pour but de «démoraliser» et de «dissuader» l’ennemi. C’est exactement ce qu’a affirmé Mohamed Merah, si on en croit les policiers qui ont discuté avec lui avant son exécution: en s’attaquant aux militaires, il voulait «venger ses frères d’Afghanistan», en s’attaquant aux enfants d’une école juive, il voulait «venger les enfants de Gaza» victimes des bombardements israéliens.
Mais peut être que ce qui fait de Mohamed Merah un «monstre», c’est qu’il ait lui-même appuyé sur la gâchette de l’arme qui allait donner la mort. C’est vrai que les dirigeants qui ordonnent des massacres ne sont pas en contact direct avec leurs victimes: Churchill n’a pas actionné les lancers de bombes sur les villes allemandes et il n’a pas eu l’occasion de voir mourir ou agoniser les femmes et les enfants qu’elles ont tués. Mais n’est-ce pas aussi le cas de Hitler et de Staline qui eux sont considérés, à juste titre, comme de sinistres criminels? De plus, les soldats qui, sur le terrain, assassinent des civils désarmés, que ce soit sur ordre ou mus par la haine qu’on a mis dans leur tête, sont rarement traités de «monstres». Bien souvent, ils reçoivent même des médailles et ils sont parfois considérés comme des «héros».
Qu’il s’agisse des dirigeants des États ou de simples citoyens ordinaires enrôlés dans une guerre, les «monstres» sont pléthore dans le monde actuel et ils sont avant tout le produit d’une société qui elle, effectivement, est «monstrueuse».
L’itinéraire tragique de Mohamed Merah l’illustre de façon saisissante.
Comment on devient un «monstre»
Mohamed Merah était un très jeune homme issu de l’immigration maghrébine, élevé par une mère seule, qui s’est retrouvé en échec scolaire et a commis un certain nombre de délits de droit commun avec violence lorsqu’il était mineur, ce qui l’a conduit en prison. Il a connu le chômage à plusieurs reprises et a tenté de s’engager dans l’armée, ce qui lui a été refusé du fait de ses antécédents judiciaires. C’est à cette même période qu’il a commencé à s’approcher de l’islamisme radical, apparemment sous l’influence de son frère aîné.
Nous avons là un parcours extrêmement classique emprunté par beaucoup de jeunes d’aujourd’hui. C’est vrai que tous ces jeunes ne finissent pas dans la peau d’un assassin. Mohamed Merah avait une fragilité particulière comme l’attestent sa tentative de suicide lorsqu’il était en prison et le séjour qu’il a fait en établissement psychiatrique. Mais il est significatif – comme le montrent les tentatives de créer sur Internet des forums à sa gloire – que Mohamed Merah soit dès à présent considéré comme un «héros» parmi de nombreux jeunes des banlieues, tout comme le sont ces terroristes qui se font sauter avec leur bombe dans les lieux publics en Israël, en Irak ou à Londres. La dérive vers un Islam extrémiste et violent affecte principalement certains pays à population musulmane où elle peut même constituer un caractère de masse comme en témoigne, par exemple, le succès du Hamas à Gaza. Quand elle concerne des jeunes nés en France (ou dans d’autres pays d’Europe) elle résulte, en partie, des mêmes causes: la révolte contre l’injustice, le désespoir et le sentiment d’exclusion. Les «terroristes» de Gaza sont recrutés parmi les jeunes d’une population qui, depuis des décennies, vit dans la misère et le chômage, qui a subi la colonisation de l’État d’Israël et continue de recevoir régulièrement des bombes de cet État, et cela sans que se présente la moindre perspective d’amélioration. «La religion, comme l’écrivait Marx au 19e siècle, est le soupir de la créature accablée par le malheur. Elle est le cœur d’un monde sans cœur comme elle est l’esprit d’une époque sans esprit. Elle est l’opium du peuple.» Confrontées à un présent intolérable et à une absence de futur, les populations ne trouvent d’autre consolation et espoir que dans une fuite dans la religion qui leur promet le Paradis pour après la mort. Jouant sur l’irrationnel (puisqu’elles sont basées sur la foi et non sur la pensée rationnelle), les religions constituent un terrain propice au fanatisme, c’est-à-dire au rejet radical de la raison. Quand elles comportent l’ingrédient de la «guerre sainte» contre les «infidèles» comme moyen de gagner le Paradis (comme c’est le cas de l’islam mais aussi du christia-nisme) et qu’outre la misère et le désespoir, l’humiliation est quotidienne, elles sont prêtes à se convertir en justification céleste de la violence, du terrorisme et des massacres.
A l’automne 2005, la flambée de violence qui a embrasé les banlieues françaises était un symptôme du mal-être et du désespoir qui touche une jeunesse de plus en plus massivement victime du chômage et de l’absence de futur, et particulièrement la jeunesse issue de l’immigration maghrébine ou subsaharienne. Celle-ci subit la «double peine»: en plus de l’exclusion que constitue le chômage lui-même s’ajoute l’exclusion liée à la couleur de peau ou au nom; à compétences égales, Joseph ou Marie auront plus de chances de trouver un emploi que Youssef ou Mariam, surtout si cette dernière porte le voile comme l’exige sa famille.
Dans ce contexte, le "repli identitaire" ou le "communau-tarisme", comme le qualifient les sociologues, ne peut que s’aggraver, un repli qui trouve dans la religion son principal ciment. Et un tel communautarisme, notamment ses formes les plus xénophobes et violentes, est encore alimenté par la situation internationale où l’État d’Israël (et donc le juif), constitue "l’Ennemi" par excellence.
Les racines de l’antijudaïsme
Suivant les informations fournies par la police, c’est parce qu’il n’a pas trouvé de militaire à abattre le 19 mars que Mohamed Merah s’est «replié» sur une école juive, tuant trois enfants et un enseignant. Cet acte barbare n’est que la pointe extrême d’un très fort sentiment anti-juif qui habite aujourd’hui un grand nombre de musulmans.
Pourtant, l’antijudaïsme n’est pas une «spécialité» historique de l’Islam, bien au contraire. Au Moyen-Âge, la situation des juifs était bien plus enviable dans les pays dominés par l’Islam que dans les pays dominés par le Christianisme. Dans l’Occident chrétien, les persécutions prenant les juifs (accusés d’être les «assassins de Jésus») comme boucs émissaires dans les périodes de famine, d’épidémie ou de difficultés politiques étaient contemporaines des bonnes relations et de la coopération entre juifs et musulmans dans les pays de l’Empire arabo-musulman. A Cordoue, capitale de l’Al-Andalus (l’Andalousie musulmane), des juifs occupent des postes de diplomate ou de professeur d’université. En Espagne, les premières persécutions massives de juifs seront le fait des «rois catholiques» qui les chassent en même temps que les musulmans au moment de la «reconquête» en 1492. Par la suite, la situation des juifs sera bien meilleure au sud de la Méditerranée que dans les pays chrétiens, qu’ils soient catholiques ou orthodoxes. Le mot «ghetto» est d’origine italienne (16e siècle), le mot «pogrom» d’origine russe (19e siècle). C’est en Europe, face aux pogroms à l’Est et à la vague d’antisémitisme liée à «l’affaire Dreyfus» en France, et non au Maghreb ou au Proche-Orient, que se développe le sionisme, cette idéologie nationaliste née à la fin du 19e siècle qui prône le retour des juifs et la création d’un État confessionnel sur les terres de la Palestine biblique désormais peuplée essentiellement de musulmans. C’est la création après la Première Guerre mondiale d’un «Foyer national juif» en Palestine sous mandat britannique où émigrent dans les années 1930 de nombreuses victimes des persécutions nazies qui marque le début de l’antagonisme entre juifs et musulmans. Mais c’est surtout la création en 1948 de l’État d’Israël, destiné à accueillir des centaines de milliers de survivants de la «Shoah» qui ont tout perdu, qui va alimenter et aggraver l’hostilité de nombreux musulmans envers les juifs, notamment avec le départ vers des camps de réfugiés de 750.000 arabes. Les différentes guerres entre Israël et les pays arabes, de même que l’implantation de colonies dans les territoires occupés par Israël, ne vont évidem-ment pas arranger les choses ni non plus la propagande des gouvernements de la région qui ont trouvé dans la politique coloniale d’Israël un excellent exutoire pour défouler la colère des populations qu’ils maintiennent dans la misère et l’oppression. Et il en est de même des «croisades» rhétoriques ou armées des dirigeants américains et de leurs alliés occidentaux et israélien contre (ou dans) des pays musulmans (Irak, Iran, Afghanistan) au nom de la lutte contre le «terrorisme islamique».
Né de l’histoire barbare du 20e siècle, de plus au cœur d’une région cruciale du point de vue stratégique et économique, l’État d’Israël et sa politique sont condamnés à alimenter indéfiniment les tensions au Moyen-Orient et la haine du juif parmi les musulmans.
Quelles perspectives?
Mohamed Merah est mort, le corps criblé de balles, mais les causes qui sont à l’origine de son itinéraire tragique ne sont pas prêtes de disparaître. Avec l’aggravation de la crise d’un système capitaliste à l’agonie, avec la croissance inéluctable du chômage, de la précarité et de l’exclusion, particulièrement parmi les jeunes, le désespoir et la haine de même que le fanatisme religieux ont de beaux jours devant eux, ouvrant aux petits caïds de la drogue ou du «djihad» de belles perspectives de recrutement. Le seul contrepoison à cette dérive barbare réside dans le développement massif et conscient des luttes prolétariennes qui offrira aux jeunes une véritable identité, l’identité de classe, une véritable communauté, celle des exploités et non celle des «croyants», une véritable solidarité, celle qui se développe dans la lutte contre l’exploitation entre travailleurs et chômeurs de toutes races, nationalités et religions, un véritable ennemi à combattre et terrasser, non pas le juif, mais le capitalisme. Et ce sont ces mêmes luttes ouvrières qui seules permettront de sortir le Moyen-Orient de l’état de guerre permanent, ouvert ou larvé, dans lequel il se trouve, lorsque les prolétaires juifs et musulmans, de chaque côté du «Mur de la Honte» ou à l’intérieur de ce mur, comprendront qu’ils ont les mêmes intérêts et qu’ils doivent être solidaires contre l’exploitation. Des luttes ouvrières qui, en se développant dans tous les pays, devront de plus en plus comprendre et prendre en charge la seule perspective qui puisse sauver l’humanité de la barbarie: le renversement du capitalisme et l’instauration de la société communiste.
Fabienne/29.03.2012
Géographique:
Rubrique:
Journée de manifestation en Inde : grève générale ou pare-feu syndical ?
- 1304 lectures
 En Inde, une journée de grève, lancée à l’appel des onze centrales syndicales nationales (c’était la première fois qu’elles agissaient ensemble depuis l’indépendance du pays en 1947) et de 50.000 syndicats plus petits, représentant 100 millions de travailleurs à travers tout le pays, a eu lieu le 28 février 2012. Elle a touché de nombreux secteurs, notamment les employés de banque, les travailleurs de la poste et des transports publics, les enseignants, les dockers… Cette mobilisation a été saluée comme étant une des grèves les plus massives du monde à ce jour.
En Inde, une journée de grève, lancée à l’appel des onze centrales syndicales nationales (c’était la première fois qu’elles agissaient ensemble depuis l’indépendance du pays en 1947) et de 50.000 syndicats plus petits, représentant 100 millions de travailleurs à travers tout le pays, a eu lieu le 28 février 2012. Elle a touché de nombreux secteurs, notamment les employés de banque, les travailleurs de la poste et des transports publics, les enseignants, les dockers… Cette mobilisation a été saluée comme étant une des grèves les plus massives du monde à ce jour.
Le fait que des millions de travailleurs se soient mobilisés montre que, malgré tous les discours sur le «boom» économique indien, il n’est pas ressenti comme tel par la classe ouvrière. Par exemple, les centres d’appels téléphoniques et l’industrie liée à la l’informatique en Inde, dépendant à 70 % de compagnies américaines, subissent lourdement le poids de la crise économique. C’est également le cas dans tout un tas de secteurs. L’économie indienne n’est pas à l’écart du reste de l’économie mondiale et de sa crise.
En Inde aussi donc la colère ouvrière gronde. C’est pourquoi les syndicats se sont tous mis d’accord sur l’appel commun à la grève… pour faire face, unis, à… la classe ouvrière! Quel autre sens donner à cette subite entente des organisations syndicales, elles qui dans le passé ont au contraire savamment entretenu la division, systématiquement, à chacune des précédentes mobilisations contre les mesures gouvernementales.
Loin de montrer que la bourgeoisie attaque aujourd’hui sans répit les travailleurs à cause de la crise d’un système malade et pourrissant, au contraire, les efforts des syndicats visent à faire croire qu’il faudrait faire confiance à ce système et que la bourgeoisie pourrait accorder n’importe quoi si elle souhaitait le faire. La preuve en est le cocktail de revendications avancées portant notamment sur l’obtention d’un salaire minimum national, réclamant aussi des emplois permanents pour 50 millions de travailleurs précaires, des mesures gouvernementales pour juguler l’inflation (qui a dépassé les 9 % pendant la majeure partie de ces deux dernières années), des améliorations sur la protection sociale comme sur les retraites pour tous les travailleurs, un renforcement du droit du travail comme des droits syndicaux et la fin de la privatisation des entreprises d’État. Ces revendications mises en avant par les syndicats reposent toutes sur l’hypothèse que le gouvernement est capable de répondre aux besoins des classes exploitées. Il répand aussi l’idée mensongère qu’il pourrait réduire l’inflation ou que, derrière l’appel à la défense des services publics, l’arrêt de la revente au privé de pans entiers de l’activité du secteur public bénéficierait d’une manière quelconque à la classe ouvrière.
Une «grève unitaire» très sélective
Les syndicats n’ont pas toujours demandé à leurs membres de se joindre à la grève. Ainsi, plus d’un million et demi de cheminots, et beaucoup d’autres ouvriers, la plupart d’entre eux membres de ces syndicats, n’étaient même pas appelés à faire grève. Dans la plupart des zones industrielles, dans des centaines de villes petites ou grandes, dans toute l’Inde, alors que les travailleurs du secteur public se mettaient en grève, des millions d’ouvriers du secteur privé continuaient à travailler et leurs syndicats n’ont pas appelé à la grève. Tout en appelant à une «grève générale», les syndicats ne se sont pas gênés pour que des millions de leurs membres aillent au travail comme d’habitude ce jour-là.
Même dans les secteurs où les syndicats ont appelé à la grève, leur attitude était plus celle d’appeler à une «grève absentéiste». Beaucoup de travailleurs ont fait grève tout en restant à la maison. Les syndicats n’ont pas fait de grands efforts pour les amener dans la rue tous ensemble et pour organiser des manifestations. Ni pour impliquer dans la grève les millions de travailleurs du secteur privé membres de syndicats nationaux en grève. Il faut rapprocher cette manœuvre au fait que récemment et pendant pas mal de temps, les ouvriers du secteur privé ont été beaucoup plus combatifs et moins respectueux des lois de la bourgeoisie. Même des zones industrielles comme Gurgaon et les industries automobiles près de Chennai, les usines comme Maruti à Gurgaon et Hyundai près de Chennai qui avaient récemment connu de grandes luttes, n’ont pas rejoint cette grève.
Pourquoi les syndicats ont-ils appelé à la grève?
Il est clair que les syndicats n’ont pas utilisé la grève pour mobiliser les ouvriers, pour les faire descendre dans la rue et s’unir. Ils l’ont utilisée comme un rituel, comme un moyen de lâcher un peu de vapeur, pour séparer les ouvriers, les inciter à la passivité et les démobiliser. Être assis à la maison, à regarder la télé, ne renforce pas l’unité et la conscience des travailleurs. Cela ne fait qu’accroître le sentiment d’isolement, la passivité et la sensation d’avoir perdu une occasion. Étant donnée cette attitude, pourquoi les syndicats ont-ils alors appelé à la grève? Et qu’est ce qui a pu tous les amener à s’unir, y compris le BMS (1) et ses plus de 6 millions d’adhérents? Pour comprendre cela, nous devons regarder quelle est la situation réelle au niveau économique et sociale comme ce qui se passe au sein de la classe ouvrière en Inde.
La dégradation des conditions de vie des travailleurs
Malgré les grands discours sur le boom économique, la situation économique a empiré ces dernières années. Comme partout, l’économie est en crise. Selon les statistiques gouvernementales, le taux de croissance annuelle est tombé de 9 % à 6 % environ. Beaucoup d’industries ont été sévèrement touchées dans les secteurs de l’informatique, du textile, de l’usinage des diamants, des biens de consommation, d’infrastructure, des compagnies privées d’électricité, des transports aériens. Cela a conduit à intensifier les attaques contre la classe ouvrière. L’inflation générale plane autour de 10 % depuis plus de deux ans. L’inflation au niveau des produits alimentaires et des objets de première nécessité est beaucoup plus élevée, allant quelques fois jusqu’à 16 %. La classe ouvrière s’enfonce dans la misère.
Le développement de la lutte de classe
Dans cette ambiance de conditions de vie et de travail dégradées, la classe ouvrière a repris le chemin de la lutte de classe. Depuis 2005, on a vu une accélération progressive de la lutte de classe dans l’Inde toute entière, démontrant qu’elle s’inscrit clairement dans le développement actuel de la lutte de classe internationale. Les années 2010 et 2011 en particulier ont connu de nombreuses grèves dans beaucoup de secteurs et des milliers de travailleurs ont pris part à des occupations d’usine, à des grèves sauvages et à des rassemblements de protestation. Quelques-unes de ces grèves ont été très importantes, notamment dans le secteur de l’automobile comme par exemple celles des ouvriers de Honda Motor Cycle en 2010 ou de Gurgaon et de Hyundai Motors à Chennai en 2011, dans lesquelles les travailleurs ont arrêté le travail à plusieurs reprises contre la précarisation et les autres attaques des patrons et ont exprimé une grande combativité et une forte détermination dans l’affrontement avec l’appareil de sécurité des patrons. Récemment, entre juin et octobre 2011, toujours dans les usines de production d’automobiles, les travailleurs ont agi de leur propre initiative et n’ont pas attendu les consignes syndicales pour se mobiliser avec de fortes tendances à la solidarité et une volonté d’extension de la lutte à d’autres usines. Ils ont aussi exprimé des tendances à l’auto-organisation et à la mise en place d’assemblées générales, comme lors des grèves à Maruti-Suzuki à Manesar, une ville nouvelle liée au boom industriel dans la région de Delhi, durant laquelle les ouvriers ont occupé l’usine contre l’avis de «leur» syndicat. Après une négociation signée par les syndicats début octobre, 1.200 travailleurs sous contrat n’ont pas été réembauchés et 3.500 ouvriers sont donc repartis en grève et ont occupé, pour montrer leur solidarité, l’usine d’assemblage des voitures. Cela a entraîné 8.000 ouvriers dans d’autres actions de solidarité dans une douzaine d’autres usines de la région. Cela a aussi conduit à des rassemblements et à la formation d’assemblées générales pour éviter le sabotage par les syndicats.
La redécouverte de l’assemblée générale en tant que forme la plus appropriée pour étendre la lutte et assurer l’échange d’idées le plus large possible représente une formidable avancée pour la lutte de classe. Les assemblées générales de Maruti-Suzuki à Manesar étaient ouvertes à tous et encourageaient chacun à participer à la réflexion sur la direction et les buts de la lutte.,
En plus de cette vague de lutte de classe qui monte lentement, les luttes qui se sont déroulées au Moyen Orient, en Grèce, en Grande-Bretagne, et l’ensemble du «mouvement Occupy» a eu un écho dans la classe ouvrière indienne.
La peur de la contagion de la lutte de classe au sein de la bourgeoisie
Au moment de la confrontation violente à l’usine de motos Honda et face aux grèves répétées à Maruti-Suzuki, on a pu voir clairement s’exprimer une certaine crainte de la part de la bourgeoisie. Chaque fois, les médias ont mis en avant le fait que les grèves pourraient s’étendre et impliquer d’autres compagnies automobiles à Gurgaon et paralyser toute la région. Ce n’était pas de la spéculation. Alors que les principales grèves ne touchaient que peu d’usines, d’autres ouvriers sont venus aux portes des usines en grève. Il y a eu des manifestations communes d’ouvriers et même une grève dans toute la cité industrielle de Gurgaon. Le gouvernement provincial était lui-même sérieusement inquiet de la propagation de la grève. Le Premier ministre et le ministre du travail du Haryana, à l’instigation du Premier ministre et du ministre du Travail de l’Union, ont réuni les patrons des entreprises et des syndicats pour étouffer la grève.
Comme le reste de la bourgeoisie, les syndicats ont été encore plus inquiets de perdre le contrôle sur les ouvriers si la combativité continuait à croître. Là aussi, ce fut évident dans les grèves à Maruti en 2011, quand les ouvriers ont accompli beaucoup d’actions contraires à ce que voulaient les directions syndicales. Cette peur a poussé les syndicats à vouloir apparaître comme faisant quelque chose. Ils ont appelé à un certain nombre de grèves rituelles, y compris une grève des employés de banque en novembre 2011. La grève actuelle, tout en étant, sans aucun doute, une expression de la montée de la colère et de la combativité au sein de la classe ouvrière, est aussi un des derniers efforts en date des syndicats pour la contenir et la canaliser.
Prendre nos luttes en main
Les travailleurs doivent comprendre que faire une journée de grève rituelle et rester à la maison ne nous mène nulle part. Pas plus que de se rassembler dans un parc pour écouter les discours des patrons syndicaux et des membres des partis parlementaires. Les patrons et leur gouvernement nous attaquent parce que le capitalisme est en crise et qu’ils n’ont pas d’autre choix. Nous devons comprendre que tous les travailleurs sont attaqués. Rester passifs et isolés les uns des autres ne décourage pas les patrons d’intensifier leurs attaques contre les travailleurs. Les ouvriers doivent utiliser ces occasions de se mobiliser pour prendre la rue, se rassembler et discuter avec d’autres travailleurs. Ils doivent prendre leurs luttes en main. Cela ne résoudra pas immédiatement les problèmes des travailleurs mais cela rendra possible le développement authentique de la lutte. Cela nous aidera à développer notre combat contre le système capitaliste et d’œuvrer à sa destruction. Comme le disaient ceux qui ont occupé la faculté de droit en Grèce en février 2012, «Pour nous libérer de la crise actuelle, nous devons détruire l’économie capitaliste!».
D’après deux articles de Communist Internationalist, organe du CCI en Inde/mars 2012
1) Le Bharatiya Mazdoor Sangh qui est le plus grand syndicat du pays, est lié au BJP, le parti religieux hindouiste fondamentaliste.
Géographique:
Rubrique:
le capitalisme a fait faillite, pourquoi? que faire ?
- 1217 lectures
À l’heure actuelle, dans toute la société, la crise économique est au cœur des préoccupations. Tout le monde se fait des soucis sur son avenir, celui de ses enfants, ses parents retraités, ses voisins, amis, collègues, ... existe t’il encore un avenir décent pour nous tous ou allons-nous tout droit dans la plus grande pauvreté et la précarité? Cette situation est-elle dûe à des banquiers cupides et corrompus, des agences de notation? Est-ce le résultat de gouvernements irresponsables et de leurs banques centrales? Si oui! le système d'exploitation pourrait être réformé. Sinon, il est clair que le capitalisme n'a pas d'avenir et qu'il doit être totalement détruit pour être remplacé par une autre société. C'est pourquoi, cette discussion est importante pour déterminer les perspectives et les buts des effets de la crise.
1ère soirée : vendredi 27 avril – 19h30 à 22h30
La crise est-elle temporaire, donc le produit d’un dérapage, d’un déséquilibre dans le fonctionnement économique?
A quelle sorte de crise sommes-nous confrontés? Une crise de la dette, des banques, une crise immobilière, une crise de l’euro ou encore une crise historique du mode de production capitaliste?
La crise immobilière a débouché sur une crise ouverte de dimension mondiale, sur une chute de l’activité économique que la société n’a plus connue depuis 1929. En Grèce, en Espagne, en Italie ou au Portugal une austérité inouïe est mise en place. Dans de nombreux autres pays européens, de nouvelles attaques sont planifiées. Est-ce que cette situation est la faute de banquiers cupides et corrompus, des agences de notation? Est-ce le résultat de gouvernements irresponsables et de leurs banques centrales? Ou d’une Europe trop faible?
Marx soulignait: "ne voyons pas dans la misère que la misère". La crise économique n’est pas une fatalité. Ce n’est pas une loi naturelle. Il ne s’agit pas d’un destin qui s’impose à nous. C’est la conséquence d’un système qui s’est empêtré dans ses propres contradictions: comme celles entre les forces productives et les rapports de production, ou, en d’autres mots, entre le caractère social du processus de production et l’appropriation privée des produits de celui-ci par les propriétaires capitalistes.
2 ième soirée: Vendredi 11 mai – 19h30 à 22h30
La crise est-elle locale et y-a-t ‘il des pays ou des politiques qui y échappent?
(la Chine, la Corée, le Cuba "socialiste", ou les fameux pays BRICS?)
Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (les BRICS) ont montré ces dernières années une remarquable réussite économique.
La Chine, en particulier, est désormais considérée comme la deuxième puissance économique dans le monde et beaucoup pense qu’elle va bientôt détrôner les États-Unis. Cette performance flamboyante a amené des économistes à placer leurs espoirs dans ce groupe de pays comme la nouvelle locomotive pour l’économie mondiale. L’émergence des BRICS conduirait à un monde plus juste et plus équitable.
Il y a un soupçon de déjà vu au sujet de ce «miracle économique». L’Argentine et les tigres asiatiques dans les années 1980 et 1990 ou plus récemment l’Irlande, l’Espagne, l’Islande ont tous été, à différents moments, présentés comme des «miracles économiques».
Tous ces pays devaient cette croissance rapide à une augmentation effrénée de la dette. Ils ont tous connu une même fin fâcheuse: la récession et la faillite.
3 ième soirée: Vendredi 25 mai – 19h30 à 22h30
La crise est-elle structurelle et peut-elle être contenue par une série de réformes et d’ajustements?
Bon nombre reconnaissent que l'économie connaît de grandes difficultés. Mais, prétendent ils «avec plus de contrôle de l’État sur les finances, nous pouvons construire une nouvelle économie, plus sociale et plus prospère». Est-ce qu’une plus grande ingérence de l’État peut résoudre les problèmes économiques? Les ménages, les entreprises, les banques et Etats, tous sont endettés. Qu’est-ce qu’on fait les États? Ils ont injecté des milliards de dollars dans l’économie afin d’éviter de nouvelles faillites en faisant des nouvelles dettes! Comment une réforme du système financier peut-elle ici apporter une réponse? Et les nationalisations alors? Depuis l’expérience de la Commune de Paris le rôle de l’État contre les ouvriers nous est connue. «L’Etat moderne, quel qu’en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l’Etat des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n’est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble». Depuis lors, chaque bourgeoisie nationale se range derrière son État pour mener la guerre commerciale internationale impitoyable.
Vie du CCI:
Rubrique:
Internationalisme no 355 - 3e trimestre 2012
- 1524 lectures
Elections communales : rien que du bluff et des illusions
- 1239 lectures
L'avenir ne se décide plus dans le bulletin de vote, mais dans la lutte sociale : classe contre classe
Avec l’automne, voici le retour du carnaval électoral, cette fois-ci sur le plan communal ; et avec lui, le cortège inépuisable de bluff, de magouilles politiciennes, de mensonges, d’illusions. Une fois de plus on nous appellera à remplir notre "devoir de citoyen", à participer par notre vote au choix d’une bonne gestion du système, d’un meilleur fonctionnement des services publics, cette fois-ci sur le plan communal, à nous mobiliser pour la "défense de la démocratie". En réalité, les dés sont pipés d’avance : c’est toujours la bourgeoisie qui gagne les élections. Que la gauche ou la droite l’emporte, Janssens ou De Wever, Reynders ou Di Rupo, tel candidat ou tel autre, pour les travailleurs, les chômeurs, les jeunes, cela signifie de toute façon la même politique d’attaques incessantes sur leurs conditions de vie.
C’est pourquoi, aujourd’hui le CCI souligne plus que jamais que la classe ouvrière n’a rien à attendre du terrain électoral. Cette attitude des révolutionnaires n’est pas liée aux spécificités des élections communales qui se dérouleront en octobre en Belgique, mais découle, comme le texte ci-dessous le rappelle, des caractéristiques générales du développement du capitalisme depuis le début du siècle précédent.
Face à l’angoisse de l’avenir, à la peur du chômage, au ras-le-bol de l’austérité et de la précarité, la bourgeoisie utilise les élections afin de pourrir la réflexion des ouvriers, en exploitant les illusions encore très fortes au sein du prolétariat.
Le refus de participer au cirque électoral ne s’impose pas de manière évidente au prolétariat du fait que cette mystification est étroitement liée à ce qui constitue le cœur de l’idéologie de la classe dominante, la démocratie. Toute la vie sociale dans le capitalisme est organisée par la bourgeoisie autour du mythe de l’Etat “démocratique”. Ce mythe est fondé sur l’idée mensongère suivant laquelle tous les citoyens sont “égaux” et “libres” de “choisir”, par le vote, leurs représentants politiques et le parlement est présenté comme le reflet de la “volonté populaire”. Cette escroquerie idéologique est difficile à déjouer pour la classe ouvrière du fait que la mystification électorale s’appuie en partie sur certaines vérités. La bourgeoisie utilise, en la falsifiant, l’histoire du mouvement ouvrier en rappelant les luttes héroïques du prolétariat pour conquérir le droit de vote. Face aux grossiers mensonges propagandistes, il est nécessaire de revenir aux véritables positions défendues par le mouvement ouvrier et ses organisations révolutionnaires. Et cela, non pas en soi, mais en fonction des différentes périodes de l’évolution du capitalisme et des besoins de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
La question des élections au 19e siècle dans la phase ascendante du capitalisme
Le 19e siècle est la période du plein développement du capitalisme pendant laquelle la bourgeoisie utilise le suffrage universel et le Parlement pour lutter contre la noblesse et ses fractions rétrogrades. Comme le souligne Rosa Luxemburg, en 1904, dans son texte Social-démocratie et parlementarisme : “Le parlementarisme, loin d’être un produit absolu du développement démocratique, du progrès de l’humanité et d’autres belles choses de ce genre, est au contraire une forme historique déterminée de la domination de classe de la bourgeoisie et ceci n’est que le revers de cette domination, de sa lutte contre le féodalisme. Le parlementarisme bourgeois n’est une forme vivante qu’aussi longtemps que dure le conflit entre la bourgeoisie et le féodalisme”. Avec le développement du mode de production capitaliste, la bourgeoisie abolit le servage et étend le salariat pour les besoins de son économie. Le Parlement est l’arène où les différents partis bourgeois s’affrontent pour décider de la composition et des orientations du gouvernement en charge de l’exécutif. Le Parlement est le centre de la vie politique bourgeoise mais, dans ce système démocratique parlementaire, seuls les notables sont électeurs. Les prolétaires n’ont pas le droit à la parole, ni le droit de s’organiser.
Sous l’impulsion de la 1ère puis de la 2e Internationale, les ouvriers vont engager des luttes sociales d’envergure, souvent au prix de leur vie, pour obtenir des améliorations de leurs conditions de vie (réduction du temps de travail de 14 à 10 heures, interdiction du travail des enfants et des travaux pénibles pour les femmes…). Dans la mesure où le capitalisme était alors un système en pleine expansion, son renversement par la révolution prolétarienne n’était pas encore à l’ordre du jour. C’est la raison pour laquelle la lutte revendicative sur le terrain économique au moyen des syndicats et la lutte de ses partis politiques sur le terrain parlementaire permettaient au prolétariat d’arracher des réformes à son avantage. “Une telle participation lui permettait à la fois de faire pression en faveur de ces réformes, d’utiliser les campagnes électorales comme moyen de propagande et d’agitation autour du programme prolétarien et d’employer le Parlement comme tribune de dénonciation de l’ignominie de la politique bourgeoise. C’est pour cela que la lutte pour le suffrage universel a constitué, tout au long du 19e siècle, dans un grand nombre de pays, une des occasions majeures de mobilisation du prolétariat”. (1) Ce sont ces positions que Marx et Engels vont défendre tout au long de cette période d’ascendance du capitalisme pour expliquer leur soutien à la participation du prolétariat aux élections.
La question des élections au 20e siècle, dans la phase de décadence du capitalisme
A l’aube du 20e siècle, le capitalisme a conquis le monde. En se heurtant aux limites de son expansion géographique, il rencontre la limitation objective des marchés : les débouchés à sa production deviennent de plus en plus insuffisants. Les rapports de production capitalistes se transforment dès lors en entraves au développement des forces productives. Le capitalisme, comme un tout, entre dans une période de crises et de guerres de dimension mondiale.
Un tel bouleversement va entraîner une modification profonde du mode d’existence politique de la bourgeoisie, du fonctionnement de son appareil d’Etat et, a fortiori, des conditions et des moyens de la lutte du prolétariat. Le rôle de l’Etat devient prépondérant car il est le seul à même d’assurer “l’ordre”, le maintien de la cohésion d’une société capitaliste déchirée par ses contradictions. Les partis bourgeois deviennent, de façon de plus en plus évidente, des instruments de l’Etat chargés de faire accepter la politique de celui-ci.
Le pouvoir politique tend alors à se déplacer du législatif vers l’exécutif et le Parlement bourgeois devient une coquille vide qui ne possède plus aucun rôle décisionnel. C’est cette réalité qu’en 1920, lors de son 2e congrès, l’Internationale communiste va clairement caractériser : “L’attitude de la 3ème Internationale envers le parlementarisme n’est pas déterminée par une nouvelle doctrine, mais par la modification du rôle du Parlement même. A l’époque précédente, le Parlement en tant qu’instrument du capitalisme en voie de développement a, dans un certain sens, travaillé au progrès historique. Mais dans les conditions actuelles, à l’époque du déchaînement impérialiste, le Parlement est devenu tout à la fois un instrument de mensonge, de tromperie, de violence, et un exaspérant moulin à paroles... A l’heure actuelle, le Parlement ne peut être en aucun cas, pour les communistes, le théâtre d’une lutte pour des réformes et pour l’amélioration du sort de la classe ouvrière, comme ce fut le cas dans le passé. Le centre de gravité de la vie politique s’est déplacé en dehors du Parlement, et d’une manière définitive”.
Désormais, il est hors de question pour la bourgeoisie d’accorder des réformes réelles et durables des conditions de vie de la classe ouvrière. C’est l’inverse qu’elle impose au prolétariat : toujours plus de sacrifices, de misère et d’exploitation. Les révolutionnaires sont alors unanimes pour reconnaître que le capitalisme a atteint des limites historiques et qu’il est entré dans sa période de déclin, comme en a témoigné le déchaînement de la Première Guerre mondiale. L’alternative était désormais : socialisme ou barbarie. L’ère des réformes était définitivement close et les ouvriers n’avaient plus rien à conquérir sur le terrain des élections.
Néanmoins un débat central va se développer au cours des années 1920 au sein de l’Internationale communiste sur la possibilité, défendue par Lénine et le parti bolchevique, d’utiliser la “tactique” du “parlementarisme révolutionnaire”. Face à d’innombrables questions suscitées par l’entrée du capitalisme dans sa période de décadence, le poids du passé continuait à peser sur la classe ouvrière et ses organisations. La guerre impérialiste, la révolution prolétarienne en Russie, puis le reflux de la vague de luttes prolétariennes au niveau mondial dès 1920 ont conduit Lénine et ses camarades à penser que l’on peut détruire de l’intérieur le Parlement ou utiliser la tribune parlementaire de façon révolutionnaire. En fait cette “tactique” erronée va conduire la 3e Internationale vers toujours plus de compromis avec l’idéologie de la classe dominante. Par ailleurs, l’isolement de la révolution russe, l’impossibilité de son extension vers le reste de l’Europe avec l’écrasement de la révolution en Allemagne, vont entraîner les bolcheviks et l’Internationale, puis les partis communistes, vers un opportunisme débridé. C’est cet opportunisme qui allait les conduire à remettre en question les positions révolutionnaires des 1er et 2e Congrès de l’Internationale communiste pour s’enfoncer vers la dégénérescence lors des congrès suivants, jusqu’à la trahison et l’avènement du stalinisme qui fut le fer de lance de la contre-révolution triomphante.
C’est contre cet abandon des principes prolétariens que réagirent les fractions les plus à gauche dans les partis communistes (2). A commencer par la Gauche italienne avec Bordiga à sa tête qui, déjà avant 1918, préconisait le rejet de l’action électorale. Connue d’abord comme “Fraction communiste abstentionniste”, celle-ci s’est constituée formellement après le Congrès de Bologne en octobre 1919 et, dans une lettre envoyée de Naples à Moscou, elle affirmait qu’un véritable parti, qui devait adhérer à l’Internationale communiste, ne pouvait se créer que sur des bases antiparlementaristes. Les gauches allemande et hollandaise vont à leur tour développer la critique du parlementarisme. Anton Pannekoek dénonce clairement la possibilité d’utiliser le Parlement pour les révolutionnaires, car une telle tactique ne pouvait que les conduire à faire des compromis, des concessions à l’idéologie dominante. Elle ne visait qu’à insuffler un semblant de vie à ces institutions moribondes, à encourager la passivité des travailleurs alors que la révolution nécessite la participation active et consciente de l’ensemble du prolétariat.
Dans les années 1930, la Gauche italienne, à travers sa revue Bilan, montrera de façon concrète comment les luttes des prolétaires français et espagnols avaient été détournées vers le terrain électoral. Bilan affirmait à juste raison que c’est la “tactique” des fronts populaires en 1936 qui avait permis d’embrigader le prolétariat comme chair à canon dans la 2ème boucherie impérialiste mondiale. A la fin de cet effroyable holocauste, c’est la Gauche communiste de France qui publiait la revue Internationalisme (dont est issu le CCI) qui fera la dénonciation la plus claire de la “tactique” du parlementarisme révolutionnaire : “La politique du parlementarisme révolutionnaire a largement contribué à corrompre les partis de la 3ème Internationale et les fractions parlementaires ont servi de forteresses de l’opportunisme (…). La vérité est que le prolétariat ne peut utiliser pour sa lutte émancipatrice “le moyen de lutte politique” propre à la bourgeoisie et destiné à son asservissement. Le parlementarisme révolutionnaire en tant qu’activité réelle n’a, en fait, jamais existé pour la simple raison que l’action révolutionnaire du prolétariat quand elle se présente à lui, suppose sa mobilisation de classe sur un plan extra-capitaliste, et non la prise des positions à l’intérieur de la société capitaliste.” (3) Désormais, la non participation aux élections, est une frontière de classe entre organisations prolétariennes et organisations bourgeoises. Dans ces conditions, depuis plus de 80 ans, les élections sont utilisées, à l’échelle mondiale, par tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, pour dévoyer le mécontentement ouvrier sur un terrain stérile et crédibiliser le mythe de la “démocratie”. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si aujourd’hui, contrairement au 19e siècle, les Etats “démocratiques” mènent une lutte acharnée contre l’abstentionnisme et la désaffection des partis, car la participation des ouvriers aux élections est essentielle à la perpétuation de l’illusion démocratique.
Les élections ne sont qu’une mystification
Contrairement à la propagande indigeste voulant nous persuader que ce sont les urnes qui gouvernent, il faut réaffirmer que les élections sont une pure mascarade.
Certes, il peut y avoir des divergences au sein des différentes fractions qui composent l’Etat bourgeois sur la façon de défendre au mieux les intérêts du capital national mais, fondamentalement, la bourgeoisie organise et contrôle le carnaval électoral pour que le résultat soit conforme à ses besoins en tant que classe dominante. C’est pour cela que l’Etat capitaliste organise, manipule, utilise ses médias aux ordres. Ainsi, depuis la fin des années 1920 et jusqu’à aujourd’hui, quel que soit le résultat des élections, que ce soit la droite ou la gauche qui sorte victorieuse des urnes, c’est finalement toujours la même politique anti-ouvrière qui est menée.
Ces derniers mois, la focalisation orchestrée par la bourgeoisie autour des élections présidentielles de mai 2007 a réussi momentanément à capter l’attention des ouvriers et à les persuader qu’elles étaient un enjeu pour leur avenir et celui de leurs enfants. Non seulement la bourgeoisie plonge le prolétariat dans la paupérisation absolue, mais en plus elle l’humilie en lui donnant “des jeux et du cirque électoral”. Aujourd’hui, le prolétariat n’a pas le choix. Ou bien il se laisse entraîner sur le terrain électoral, sur le terrain des Etats bourgeois qui organisent son exploitation et son oppression, terrain où il ne peut être qu’atomisé et sans force pour résister aux attaques du capitalisme en crise. Ou bien, il développe ses luttes collectives, de façon solidaire et unie, pour défendre ses conditions de vie. Ce n’est que de cette façon qu’il pourra retrouver ce qui fait sa force en tant que classe révolutionnaire : son unité et sa capacité à lutter en dehors et contre les institutions bourgeoises (parlement et élections) en vue du renversement du capitalisme. D’ailleurs, face à l’aggravation des attaques et malgré ce bourrage de crane électoraliste, le prolétariat est en train de développer une réflexion en profondeur sur la signification du chômage massif, sur les attaques à répétition, sur le démantèlement des systèmes de retraite et de protection sociale. A terme, la politique anti-ouvrière de la bourgeoisie et la riposte prolétarienne ne peuvent que déboucher sur une prise de conscience croissante, au sein de la classe ouvrière, de la faillite historique du capitalisme. Le prolétariat n’a pas à participer à la fabrication de ses propres chaînes, mais à les briser ! Au renforcement de l’Etat capitaliste, les ouvriers doivent répondre par la volonté de sa destruction !
L’alternative qui se pose aujourd’hui est donc la même que celle dégagée par les gauches marxistes dans les années 1920 : électoralisme et mystification de la classe ouvrière ou développement de la conscience de classe et extension des luttes vers la révolution ! n
D. (d'après Internationalisme n° 331, avril 2007)
(1) Plate-forme du CCI.
(2) Le CCI est l’héritier de cette Gauche communiste et nos positions en sont le prolongement.
(3) Lire cet article d’Internationalisme n°36 de juillet 1948, reproduit dans la Revue Internationale n°36.
Rubrique:
La pire des attaques à nos conditions de vie (pour le moment), jusqu'où ? comment riposter ? (tract)
- 1077 lectures
Voici un tract avec lequel notre section en Espagne dénonce la pire attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière, une attaque qui paraîtra pourtant “légère” en comparaison à celles qui vont venir. C’est aussi une analyse de la situation, qui essaie d’apporter des solutions aux dernières luttes.

En 1984, le gouvernement du PSOE (Parti socialiste, de gauche) imposa la première Réforme du travail ; il y a tout juste trois mois, le gouvernement actuel du PP (Parti populaire, de droite) a mis en place la plus grave des Réformes du travail connue jusqu’ici. En 1985, le gouvernement du PSOE fit la première Réforme des retraites ; en 2011, un autre gouvernement de ce même PSOE en imposa une autre. Pour quand la prochaine ? Depuis plus de 30 ans, les conditions de vie des travailleurs ont empiré graduellement, mais depuis 2010 cette dégradation a pris un rythme frénétique et, avec les nouvelles mesures gouvernementales du PP, elle a atteint des niveaux qui, malheureusement, sembleront bien bas lors des futures attaques. Il y a, par-dessus le marché, un acharnement répressif de la part de la police : violence contre les étudiants à Valence en février dernier, matraquage en règle des mineurs, usage de balles en caoutchouc utilisées, entre autres, contre des enfants. Par ailleurs, le Congrès est carrément protégé par la police face aux manifestations spontanées qui s’y déroulent depuis mercredi dernier et qui s’y sont renouvelées dimanche 15 juillet...
Nous, l’immense majorité, exploitée et opprimée, mais aussi indignée ; nous, travailleurs du public et du privé, chômeurs, étudiants, retraités, émigrés..., nous posons beaucoup de questions sur tout ce qui se passe. Nous devons tous, collectivement, partager ces questionnements dans les rues, sur les places, sur les lieux de travail, pour que nous commencions tous ensemble à trouver des réponses, à donner une riposte massive, forte et soutenue.
L’effondrement du capitalisme
Les gouvernements changent, mais la crise ne fait qu’empirer et les coupes sont de plus en plus féroces. On nous présente chaque sommet de l’UE, du G20, etc.., comme la “solution définitive”... qui, le jour suivant, apparaît comme un échec retentissant ! On nous dit que les coupes vont faire baisser la prime de risque, et ce qui arrive est tout le contraire. Après tant et tant de saignées contre nos conditions de vie, le FMI reconnaît qu’il faudra attendre… 2025 (!) pour retrouver les niveaux économiques de 2007. La crise suit un cours implacable et inexorable, faisant échouer sur son passage des millions de vies brisées.
Certes, il y a des pays qui vont mieux que d’autres, mais il faut regarder le monde dans son ensemble. Le problème ne se limite pas à l’Espagne, la Grèce ou l’Italie, et ne peut même pas se réduire à la “crise de l’euro”. L’Allemagne est au bord de la récession et déjà, il s’y trouve 7 millions de mini-jobs (avec des salaires de 400 €) ; aux Etats-Unis, le chômage part en flèche à la même vitesse que les expulsions de domicile. En Chine, l’économie souffre d’une décélération depuis 7 mois, malgré une bulle immobilière insensée qui fait que, dans la seule ville de Pékin, il y a 2 millions d’appartements vides. Nous sommes en train de souffrir dans notre chair la crise mondiale et historique du système capitaliste dont font partie tous les Etats, quelle que soit l’idéologie officielle qu’ils professent –“communiste” en Chine ou à Cuba, “socialiste du 21ème siècle” en Équateur ou au Venezuela, “socialiste” en France, “démocrate” aux Etats-Unis, “libérale” en Espagne ou en Allemagne. Le capitalisme, après avoir créé le marché mondial, est devenu depuis presque un siècle un système réactionnaire, qui a plongé l’humanité dans la pire des barbaries (deux guerres mondiales, des guerres régionales innombrables, la destruction de l’environnement...) ; aujourd’hui, depuis 2007, après avoir bénéficié de moments de croissance économique artificielle à base de spéculation et de bulles financières en tout genre, il est en train de se crasher contre la pire des crises de son histoire, plongeant les États, les entreprises et les banques dans une insolvabilité sans issue. Le résultat d’une telle débâcle, c’est une catastrophe humanitaire gigantesque. Tandis que la famine et la misère ne font qu’augmenter en Afrique, en Asie et en Amérique latine, dans les pays “riches”, des millions de personnes perdent leur emploi, des centaines de milliers sont expulsées de leur domicile, la grande majorité n’arrive plus à boucler les fins de mois ; le renchérissement de services sociaux ultra-réduits rend l’existence très précaire, ainsi que la charge écrasante des impôts, directs et indirects.
L’Etat démocratique c’est la dictature de la classe capitaliste
Le capitalisme divise la société en deux pôles : le pôle minoritaire de la classe capitaliste qui possède tout et ne produit rien ; et le pôle majoritaire des classes exploitées, qui produit tout et reçoit de moins en moins. La classe capitaliste, ce 1 % de la population comme le disait le mouvement Occupy aux États-Unis, apparaît de plus en plus corrompue, arrogante et insultante. Elle cumule les richesses avec un culot indécent, se montre insensible face aux souffrances de la majorité et son personnel politique impose partout des coupes et de l’austérité... Pourquoi, malgré les grands mouvements d’indignation sociale qui se sont déroulés en 2011 (Espagne, Grèce, Etats-Unis, Egypte, Chili etc..), continue-t-elle avec acharnement à appliquer des politiques contre les intérêts de la majorité ? Pourquoi notre lutte, malgré les précieuses expériences vécues, est si en dessous de ce qui serait nécessaire ?
Une première réponse se trouve dans la tromperie que représente l’Etat démocratique. Celui-ci se présente comme étant “l’émanation de tous les citoyens” mais, en vérité, il est l’organe exclusif et excluant de la classe capitaliste, il est à son service, et pour cela il possède deux mains : la main droite composée de la police, des prisons, des tribunaux, des lois, de la bureaucratie avec laquelle elle nous réprime et écrase toutes nos tentatives de révolte ; et la main gauche, avec son éventail de partis de toutes idéologies, avec ses syndicats apparemment indépendants, avec ses services de cohésion sociale qui prétendent nous protéger..., qui ne sont que des illusions pour nous tromper, nous diviser et nous démoraliser.
A quoi ont-ils servi, tous ces bulletins de vote émis tous les quatre ans ? Les gouvernements issus des urnes ont-ils réalisé une seule de leurs promesses ? Quelle que soit leur idéologie, qui ont-ils protégé ? Les électeurs ou le capital ?
À quoi ont servi les réformes et les changements innombrables qu’ils ont faits dans l’éducation, la sécurité sociale, l’économie, la politique, etc.. ? N’ont-t-ils pas été en vérité l’expression du “tout doit changer pour que tout continue pareil” ? Comme on le disait lors du mouvement du 15-Mai : “On l’appelle démocratie et ça ne l’est pas, c’est une dictature mais on ne le voit pas.”
Face à la misère mondiale, révolution mondiale contre la misère !
Le capitalisme mène à la misère généralisée. Mais ne voyons pas dans la misère que la misère ! Dans ses entrailles se trouve la principale classe exploitée, le prolétariat qui, par son travail associé – travail qui ne se limite pas à l’industrie et à l’agriculture mais qui comprend aussi l’éducation, la santé, les services, etc.. –, assure le fonctionnement de toute la société et qui, par là même, a la capacité tant de paralyser la machine capitaliste que d’ouvrir la voie à une société où la vie ne sera pas sacrifiée sur l’autel des profits capitalistes, où l’économie de la concurrence sera remplacée par la production solidaire pour la pleine satisfaction des besoins humains. En somme, une société qui dépasse le nœud de contradictions dans lesquelles le capitalisme tient l’humanité prisonnière.
Cette perspective, qui n’est pas un idéal mais le fruit de l’expérience historique et mondiale de plus de deux siècles de luttes du mouvement ouvrier, paraît cependant aujourd’hui difficile et lointaine. Nous en avons déjà mentionné une des causes : on nous berce avec l’illusion de l’Etat démocratique. Mais il y a d’autres causes plus profondes : la plupart des prolétaires ne se reconnaissent pas comme tels. Nous n’avons pas confiance en nous-mêmes en tant que force sociale autonome. Par ailleurs, et surtout, le mode de vie de cette société, basé sur la concurrence, sur la lutte de tous contre tous, nous plonge dans l’atomisation, dans le chacun pour soi, dans la division et l’affrontement entre nous.
La conscience de ces problèmes, le débat ouvert et fraternel sur ceux-ci, la récupération critique des expériences de plus de deux siècles de lutte, tout cela nous donne les moyens pour dépasser cette situation et nous rend capables de riposter. C’est le jour même (11 juillet) où Rajoy a annoncé les nouvelles mesures que quelques ripostes ont immédiatement commencé à poindre. Beaucoup de monde est allé à Madrid manifester sa solidarité avec les mineurs. Cette expérience d’unité et de solidarité s’est concrétisée les jours suivants dans des manifestations spontanées, appelées à travers les réseaux sociaux. C’était une initiative, hors syndicats, propre aux travailleurs du public ; comment la poursuivre en sachant qu’il s’agit d’une lutte longue et difficile ? Voici quelques propositions :
La lutte unitaire
Chômeurs, travailleurs du secteur public et du privé, intérimaires et fonctionnaires, retraités, étudiants, immigrés, ensemble, nous pouvons. Aucun secteur ne peut rester isolé et enfermé dans son coin. Face à une société de division et d’atomisation nous devons faire valoir la force de la solidarité.
Les assemblées générales et ouvertes
Le capital est fort si on laisse tout entre les mains des professionnels de la politique et de la représentation syndicale qui nous trahissent toujours. Il nous faut des assemblées pour réfléchir, discuter et décider ensemble. Pour que nous soyons tous responsables de ce que nous décidons ensemble, pour vivre et ressentir la satisfaction d’être unis, pour briser les barreaux de la solitude et de l’isolement et cultiver la confiance et l’empathie.
Chercher la solidarité internationale :
Défendre la nation fait de nous la chair à canon des guerres, de la xénophobie, du racisme ; défendre la nation nous divise, nous oppose aux ouvriers du monde entier, les seuls pourtant sur lesquels nous pouvons compter pour créer la force capable de faire reculer les attaques du capital.
Nous regrouper
Nous regrouper dans les lieux de travail, dans les quartiers, par Internet, dans des collectifs pour réfléchir à tout ce qui se passe, pour organiser des réunions et des débats qui impulsent et préparent les luttes. Il ne suffit pas de lutter ! Il faut lutter avec la conscience la plus claire de ce qui arrive, de quelles sont nos armes, de qui sont nos amis et nos ennemis !
Tout changement social est indissociable d’un changement individuel
Notre lutte ne peut pas se limiter à un simple changement de structures politiques et économiques, c’est un changement de système social et, par conséquent, de notre propre vie, de notre manière de voir les choses, de nos aspirations. Ce n’est qu’ainsi que nous développerons la force de déjouer les pièges innombrables que nous tend la classe dominante, de résister aux coups physiques et moraux qu’elle nous donne sans trêve. Nous devons développer un changement de mentalité qui nous ouvre à la solidarité, à la conscience collective, lesquelles sont plus que le ciment de notre union, mais aussi le pilier d’une société future libérée de ce monde de concurrence féroce et de mercantilisme extrême qui caractérise le capitalisme. n
CCI / 16.07.2012
Rubrique:
La situation en Syrie et au Mali révèle l'avenir dans le capitalisme
- 1311 lectures
 Depuis plus d’un an et demi en Syrie, le pouvoir d’Assad bombarde, massacre, viole et torture, sous les yeux d’une “communauté internationale” qui se répand en lamentations hypocrites sur le sort d’une population syrienne soumise quotidiennement à toutes ces horreurs. De part et d’autre, les réunions internationales se multiplient, dénonçant les 16.000 morts de la répression syrienne, tout comme les appels à la paix assortis de menaces plus stériles les unes que les autres. Bernard Henry Lévi, ce “philosophe” représentant sans faille des intérêts impérialistes de la bourgeoisie française et insatiable samouraï des plateaux télés et des salons parisiens depuis la guerre en ex-Yougoslavie, n’en peut plus d’appeler à l’intervention militaire en Syrie, à l’instar des États-Unis dont le doigt est sur la gâchette pour régler son compte au potentat syrien.
Depuis plus d’un an et demi en Syrie, le pouvoir d’Assad bombarde, massacre, viole et torture, sous les yeux d’une “communauté internationale” qui se répand en lamentations hypocrites sur le sort d’une population syrienne soumise quotidiennement à toutes ces horreurs. De part et d’autre, les réunions internationales se multiplient, dénonçant les 16.000 morts de la répression syrienne, tout comme les appels à la paix assortis de menaces plus stériles les unes que les autres. Bernard Henry Lévi, ce “philosophe” représentant sans faille des intérêts impérialistes de la bourgeoisie française et insatiable samouraï des plateaux télés et des salons parisiens depuis la guerre en ex-Yougoslavie, n’en peut plus d’appeler à l’intervention militaire en Syrie, à l’instar des États-Unis dont le doigt est sur la gâchette pour régler son compte au potentat syrien.
Et, depuis six mois, le Mali est entré dans une situation de guerre qui n’offre elle aussi aucune perspective d’apaisement avant longtemps. Là encore, les dignes représentants de la bourgeoisie démocratique occidentale n’ont de cesse de s’offusquer et de s’inquiéter de l’enfer qui attend les habitants de cette région où les bandes armées peu ou prou islamistes sévissent sans vergogne. Mais qu’en est-il de ces velléités et de tout ce battage médiatique censé nous interpeller sur le sort de ces deux pays en particulier ? Rien ! Du vent et encore du vent !
Non seulement les grandes puissances ne se préoccupent au fond aucunement de la barbarie que vivent les populations vivant en Syrie ou au Mali, comme partout ailleurs, mais elles n’ont pour réelle problématique que de calculer les bénéfices possibles à tirer d’une intervention militaire et les risques qui en découleraient.
Ces deux situations sont une expression critique de l’impasse dans laquelle se trouve le monde capitaliste et de l’impuissance dans laquelle sont plongées les puissances occidentales.
Au Mali, une population prise au piège…
Au Mali, il s’agit d’un imbroglio qui est directement issu à la fois de la pourriture sociale qu’a laissé derrière lui le colonialisme français et de son incapacité à faire vivre un État malien suffisamment stable. L’explosion des différentes fractions qui sont apparues ces derniers mois en dit assez long sur l’état de déliquescence de toute cette région, bien au-delà du Mali proprement dit. De l’Aqmi au Mnla en passant par les divers groupes dissidents et opposants au régime de Bamako, tous plus “vrais croyants” les uns que les autres, il s’agit de cliques de bandits armés qui ne sont pas apparues hier par enchantement. On nous dit que le facteur déclenchant de cette nouvelle zone de chaos sahélienne a été le retour des touaregs anciennement enrôlés par Khadafi, c’est-à-dire de centaines d’hommes entraînés, aguerris, et traînant avec eux des armes lourdes.
Comme s’il ne fallait pas s’y attendre ! Comble de “surprise”, la Libye n’ayant pas de frontières communes avec le Mali, les touaregs ont dû franchir deux frontières : Libye-Algérie et Algérie-Mali. Et ils n’ont même pas été désarmés (!), venant grossir de façon significative les rangs et les forces d’une rébellion touarègue chronique, excitant de ce fait les appétits des petits truands locaux et régionaux.
Car le ver était depuis longtemps dans le fruit. Le Mali, avec l’ensemble du Sahel, fait en effet partie de ces endroits historiquement difficilement contrôlables du fait de l’existence d’une myriade de populations aux cultures différentes et parmi lesquelles les ex-puissances coloniales, en l’occurrence la France, ont pendant plus de 150 ans excité et entretenu les dissensions, selon l’adage : “diviser pour mieux régner”. Et si la situation actuelle est le produit de ce qu’on appelait la “Françafrique”, elle ne peut qu’être aggravée par la guerre larvée qui se mène entre les États-Unis et la France depuis vingt ans pour le contrôle du marché des matières premières africaines.
Après le Soudan, il n’est donc pas impossible que le Mali connaisse une partition en deux États. En attendant, une épidémie de choléra se développe à Goa, que les islamistes forcenés ont de surcroît miné aux alentours, prenant toute la population en otage. Mais, soyons rassurés, le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à des sanctions contre les rebelles du nord du Mali dans une résolution adoptée à l’unanimité jeudi, tandis que la Cedeao refuse toute ingérence militaire occidentale dans le pays !
… comme en Syrie
Ville après ville, le pays est soumis à un bombardement d’artillerie intense et la population est piégée dans les maisons ou les caves, privée de nourriture et d’électricité durant des jours, voire des semaines. Les snipers de l’armée s’installent sur les toits, cueillant ceux qui sont assez fous pour tenter de trouver à manger pour leurs familles. Et lorsque la ville tombe au bout du compte, toutes les familles sont frappées de façon directe et personnelle, soit par les soldats de l’armée régulière, ou plus fréquemment – du fait des désertions massives des soldats dégoûtés de ce qu’ils ont été contraints de faire – par des bandes de vagues criminels nommés “Shabiha”, c’est-à-dire des “fantômes”. Les deux massacres les plus connus ont eu lieu à Houla et Mazraat al-Qubair, mais ils sont loin d’être les seuls exemples.
Avec l’arrogance la plus éhontée, les porte-parole du régime justifient ces bains de sang par l’existence de “groupes terroristes armés” qui auraient pris place dans les villes en question. Très souvent, ils accusent même les massacres les plus médiatisés de femmes et d’hommes comme étant du fait de ces groupes, agissant prétendument pour jeter le discrédit sur le gouvernement.
Devant les larges protestations qui ont surgi contre sa domination lors d’autres mouvements massifs à travers l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Bashar el-Assad a essayé de suivre les traces de son père : en 1982, Hafez el-Assad avait dû faire face à un autre soulèvement, conduit par les Frères musulmans et concentré sur Hama. Le régime avait envoyé l’armée et provoqué une atroce boucherie : le nombre de morts a été estimé entre 17.000 et 40.000. La révolte fut écrasée et la dynastie Assad a pu maintenir un contrôle plus ou moins contesté sur le pays pendant presque 30 ans.
Ce qui a débuté l’an dernier comme une révolte populaire non-armée contre le régime d’Assad s’est transformé en guerre locale entre les puissances impérialistes régionales et mondiales. L’Iran, allié principal de la Syrie dans la région, se tient fermement aux côtés d’Assad, et on sait que des Gardiens de la Révolution ou autres agents de la République islamique travaillent sur le terrain et sont complices de la campagne de terreur d’Assad. Ce dernier continue également de profiter de la protection de la Russie et de la Chine, qui s’activent au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour bloquer les résolutions condamnant son gouvernement et appelant à des sanctions. Même si la Russie a été contrainte, devant les atrocités commises, de modérer sa position, faisant ses premières critiques timides des massacres d’Assad, son soutien à une politique de “non-intervention” revient à renforcer son aide massive en armes envers la Syrie. Hillary Clinton a récemment accusé la Russie d’alimenter la Syrie en hélicoptères d’attaques – ce à quoi le ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a répondu que les hélicoptères n’avaient qu’une destination “défensive” et que, de toute façon, l’Ouest armait les rebelles. Ce qui est également vrai.
Car dès que l’opposition s’est coalisée en force bourgeoise politique sérieuse autour de l’Armée libre de Syrie et du Conseil national syrien, il y a eu des acheminements d’armes depuis l’Arabie Saoudite et le Qatar.
Quant à la Turquie, alors qu'elle a longtemps manifest de bonnes relations avec le régime d'Assad, ces derniers mois ont vu son discours radicalement changer avec une condamnation de son inhumanité, offrant sa protection aux militaires dissidents et aux réfugiés fuyant le massacre.
Au niveau militaire, elle a amassé des forces considérables sur sa frontière syrienne et, dans le même discours accusant Moscou de soutenir la Syrie, Hillary Clinton a suggéré que l'arrivée massive de troupes syriennes autour d'Aleppo, proche de la frontière turque, "pourrait bien être une ligne rouge pour les Turcs en termes de défense de leurs intérêts nationaux stratégiques." De la part de l'Etat turc, il s'agit d'une politique de provocation évidente (1) destinée à lui assurer aux yeux des puissances occidentales un statut renforcé de puissance majeure au niveau régional.
La politique de terreur, loin de renforcer la main de fer d’Assad sur le pays, a fait bouillir le tout dans une perspective de conflit impérialiste imprévisible. Les divisions ethniques et religieuses à l’intérieur du pays ne cessent de s’accroître. Les Iraniens soutiennent la minorité Alawite, c’est-à-dire les Saoudiens, et sans aucun doute tout un tas de djihadistes hors de contrôle attirés par le conflit, afin d’imposer une sorte de régime sunnite. Les tensions montent aussi entre chrétiens et musulmans, et entre Kurdes et Arabes. Le tout dans un contexte où Israël fait pression sur les États-Unis pour attaquer l’Iran et menace de faire le boulot lui-même. Aussi, une escalade de la guerre en Syrie aurait pour effet de mettre encore plus en lumière la question de l’Iran, avec les conséquences encore plus dévastatrices qui s’ensuivraient.
Les répercussions sociales et politiques d’un nouveau théâtre de guerre s’ouvrant aux grandes puissances dans cette région syrienne ravagée seraient incalculables. Il en est de même au Mali où le risque d’embrasement de tout le Sahel est réel avec la création d’un immense foyer de conflits traversant l’Afrique d’Ouest en Est.
Nous ne pouvons donc pas prédire si les puissances occidentales interviendront dans la période à venir, que ce soit en Syrie ou au Mali, car la situation ne serait alors probablement pas contrôlable. Mais qu’elles le fassent ou non, les morts s’entassent et leurs grands discours “humanitaires” montrent ce qu’ils valent : mensonges, mépris des populations et calculs d’intérêts.
Wilma/7.07.2012
(1) La destruction d'un avion turc dans l'espace aérien libyen en est une preuve.
Géographique:
Rubrique:
C'est quoi en fait l'impérialisme ? Dans quel contexte surgit-il ? quelle est son origine ?
- 20956 lectures
Le texte que nous publions ci-dessous faisait figure d’introduction à une discussion du cercle de discussion Spartacus le 11 mars à Anvers.
Le cercle Spartacus se définit comme suit : " Spartacus est l’initiative de quelques jeunes qui veulent consciemment créer des moments de clarification politique en confrontant différents points de vue et visions. Nous voulons créer un endroit où l’on peut mener un débat libre sur des sujets engagés. Spartacus doit devenir selon nous un groupe engagé et militant et pas un ‘club de baratineurs’ académiste ou lieu de ‘formation’ scolaire. Car pour un meilleur monde, il faut lutter. Cependant, la question qui se pose est " Comment ? ". Le sens d’un groupe de discussion se reflète dans cette question, où la théorie et la pratique se joignent. En discutant, nous espérons développer notre propre conscience et celles des autres sur nos actes.(…) "
Le texte introductif développe très bien la question de l’impérialisme au cours de l’histoire, dès les sociétés antiques jusqu’à la société capitaliste, ce que nous avons souligné lors de cette soirée.
(https://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2012/03/10/inleiding-imperialisme/#more-1234)
Ce qui selon notre point de vue manquait était l’insistance qui doit être mis sur le rôle que l’impérialisme va jouer dès que le capitalisme dépasse son sommet de développement. C’est surtout Rosa Luxemburg qui au début du 20ième siècle va lier la question de la crise de surproduction avec la tendance générale de la politique impérialiste appliquée par tous les États et pose ainsi les bases pour la combattre efficacement.
Comme l’écrivait Rosa Luxembourg, “L'impérialisme actuel est (…) la dernière étape de son processus historique d'expansion : la période de la concurrence mondiale accentuée et généralisée des états capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe. Dans cette phase finale, la catastrophe économique et politique constitue l'élément vital, le mode normal d'existence du capital, autant qu'elle l'avait été dans sa phase initiale, celle de l' " accumulation primitive ". (…) De même, dans la phase finale de l'impérialisme, l'expansion économique du capital est indissolublement liée à la série de conquêtes coloniales et de guerres mondiales que nous connaissons. (…) Ainsi l'impérialisme ramène la catastrophe, comme mode d'existence, de la périphérie de son champ d'action à son point de départ. (…)l'expansion capitaliste précipite aujourd'hui les peuples civilisés de l'Europe elle-même dans une suite de catastrophes dont le résultat final ne peut être que la ruine de la civilisation ou l'avènement de la production socialiste. A la lumière de cette conception, l'attitude du prolétariat à l'égard de l'impérialisme est celle d'une lutte générale contre la domination du capital..”( R. Luxemburg,Critique des critiques).
(Voir aussi : https://fr.internationalism.org/ri372/imperialisme.html#sdfootnote1sym)
Une grande partie de ce travail n'est pas sur l'impérialisme même parce que le terme impérialisme est souvent utilisé en vase clos et souvent à propos d’appareils d’États ou de politique étrangère de certains États. Toutefois, il est important de voir l'impérialisme comme un développement historique associé à d'autres développements qui font partie d’une certaine logique. Ce texte ne vise donc pas tellement à chercher à définir bêtement l'impérialisme mais surtout à mettre à nu cette "logique". De cette expérience, il m'est apparu clairement que chercher à définir l'impérialisme est un exercice qui porte peu de fruits pour une meilleure compréhension politique. Or, c'est bien cela que nous recherchons ?
Une quête de l'impérialisme.
Nous recherchons une définition de l'impérialisme qui nous donne une compréhension de quelque chose dont nous pouvons pointer ce qui en fait partie (par ex. Les guerres), mais pas quels sont les critères qui font en sorte que certains phénomènes historiques en font partie. Nous voulons avant tout que ces critères nous offrent une compréhension de ce qui est typique des conflits entre les États, à notre époque.
Une première tentative.
A première vue, définir ce qu'est l'impérialisme ne semble pas être si difficile. Nous pouvons faire référence à l'élément central dans impérialisme: "Imperium". Imperium renvoie à la possibilité de commander (en latin : imperare). Mais toutefois, le mot "Imperium" nous fait plutôt penser à un type spécifique d'État et l'exemple typique en Europe Occidentale est l'Empire romain (Latin : Imperium Romanum).
Mais un (ou plusieurs) Empire(s) ne semble pas suffire pour parler d'impérialisme. En effet, un "isme" se réfère à une propagation plus large, une tendance générale, une idéologie, une ère ou quelque chose de similaire (1).
Une seconde tentative : États et lutte.
Nous devons donc chercher une tendance générale qui est censée se trouver dans une période historique. Supposons un instant que l'impérialisme est une période où les États essayent de construire un empire mondial. Les États entrent alors en conflit. Dans une telle définition, l'impérialisme est de tous les temps. Des périodes historiques dans lesquelles de tels conflits permanents pour des territoires existaient sont nombreux. Nous pensons par exemple aux guerres entre l'Empire romain et les Sassanides (250-550 après JC), les Mayas et leurs peuples voisins (250-900 après JC), les Grecs et les Perses (400 av. J.-C. – 60 après JC), les Turcs et les arabes (av. 1000-1200 après JC) etc.
L’avidité de conquête semble fondamentale pour l'impérialisme. Pourtant, je dirais que ce ne sont pas des exemples d’impérialisme. Nous devons affiner pour en avoir une meilleure compréhension. Un exemple pour démontrer que de tels conflits ne relèvent pas de l’impérialisme: la guerre de Cent Ans (1337-1453) entre la maison de Valois (France) et la maison de Plantagenet (Angleterre) pour le trône du royaume Occidental des Francs tel qu'il a surgi après la division de l'empire carolingien (888 après JC). Ce combat impliquait deux appareils d’État développés qui convoitaient les mêmes zones. Les deux maisons possédaient déjà des territoires et si l’une obtenait la victoire sur l’autre, cela lui garantissait la domination sur l’Europe occidentale.
Mais je pense qu'une telle définition de l'impérialisme rend trop peu en évidence les développements des 300 dernières années qui ont donné naissance au terme impérialisme même. La base : l'impérialisme est une période historique dans laquelle les États entrent en conflit entre eux parce qu'ils tentent de conquérir des territoires les uns des autres. Mais nous devons ajouter deux autres hypothèses: 1) les États concernés ne sont pas en premier lieu intéressés dans un territoire aussi vaste que possible et 2) les zones pour lesquelles les États se battent ne font pas parties des territoires des États impérialistes, mais de territoires d’autres États, moins puissants (à condition que des États existent sur ce territoire). La Guerre de Cent ans dans ce sens n'est pas une guerre impérialiste : il s'agissait de territoires appartenant aux deux États qui étaient intéressés par un territoire aussi grand que possible. La raison pour cela réside dans l'utilité spécifique de ces territoires au cours de la guerre de Cent ans : plus de territoire signifiait plus de seigneurs tributaires qui à leur tour saignaient la pyramide de soumis. Il importait peu quel territoire l'on capturait: toutes les régions d'Europe connaissaient la même structure et leur conquête donnait tout simplement au roi plus de revenus. Peu importait si l'on pouvait acquérir le comté de Hollande, le Royaume de Bohême ou le comté de Navarre. Au Moyen Age, tous les territoires étaient similaires. L'impérialisme implique donc une troisième chose: 3) que les États aient un intérêt réel dans des caractéristiques économiques très spécifiques de la zone concernée. Il est de plus en plus évident que l'impérialisme est enraciné dans le capitalisme.
L'impérialisme et ses prédécesseurs.
Nous commençons avec l’État-Cité, comme il existait par exemple dans la Grèce classique, à la fin du Moyen-Âge Européen et le Moyen-Âge islamique. L’État-Cité s'est formé comme un lieu de rassemblement de commerçants dans un endroit sûr souvent créé par la présence militaire. Le commerce se faisait avec d'autres (proto-)villes et la campagne environnante. Les commerçants de la ville avaient souvent une relation symbiotique avec les militaires : ils leur offraient les biens et services dont ils avaient besoin et les militaires donnaient les biens et l'argent dont les commerçants à leur tour avaient besoin. Souvent on était militaire et marchand en même temps, ou encore les habitants de la ville étaient censés contribuer à la puissance militaire comme réservistes. L’État-Cité, puissance économique et militaire, était en mesure de soumettre tant militairement qu'économiquement la campagne environnante. L'utilité de cette domination réside dans les relations économiques inégales qui en résultent. Une campagne indépendante permettait à l'agriculteur de décider ce qu'il produisait et éventuellement avec qui il échangeait contre son prix. La soumission à une ville signifiait, dans le cas le moins grave, que l'agriculteur ne pouvait écouler son produit qu’uniquement dans la ville dominante. Cependant, existait également la situation où l'agriculteur était obligé de céder une partie de sa production (p. ex. en Mésopotamie antique) ou encore où il récupérait une partie de ses biens en devises de la ville (p. ex. Le Levant médiéval), ou encore où il devait céder la totalité de son produit et où sa famille devenait esclave de la ville (p. ex. en Grèce Antique).
Un exemple : la ville de Rome, dans les premiers siècles avant J.C. Elle était impliquée dans une guerre éternelle avec Carthage. Après une longue guerre, les Romains ont détruit Carthage mais ont conquis la campagne environnante (!) pour s’approprier l’abondante production de grain. Carthage ne pouvait plus appliquer des prix élevés sur le troc, la campagne répondait maintenant directement à Rome. Il en va de même pour beaucoup d'États-Cités, sous une forme ou une autre: l'assujettissement d'autres territoires plus faibles afin d’acquérir de ces territoires un plus grand bénéfice.
Comme dans l'impérialisme moderne il y avait souvent des alliances entre les États-Cités afin de défendre conjointement les intérêts individuels.
Dans le haut moyen-âge européen, la campagne était dominante et les villes soumises aux seigneurs ruraux qui les dominaient par leur importance économique et supériorité numérique. Les rois et les empereurs, qui étaient supérieurs aux seigneurs ruraux mais fortement dépendant d'eux, ont vu des opportunités dans les villes émergentes. Parce que les seigneurs organisaient eux-mêmes ce qui allait dans les caisses du roi, celui-ci commence bientôt à comprendre que les nouvelles villes offraient une occasion de consolider son propre pouvoir. Les villes émergentes et en expansion étaient exemptées des revendications des seigneurs locaux, étaient des refuges où les serfs en fuite pouvaient s'établir et étaient directement soumises et tributaires du roi ou de l'empereur. Un exemple d'un roi qui maîtrisait bien ce processus était, par exemple. Frédéric I, ou Barberousse. Ces villes devenaient ce que l'on appelait " villes Royales " ou " Villes de la Couronne ". Au travers des siècles, les villes et ses citoyens dépassaient par une croissance proto-capitaliste les seigneurs "appauvris". Nous utilisons ici des parenthèses parce que les seigneurs locaux ne produisent pas substantiellement plus ou moins (ils ont toujours été "pauvres"). La ville, mais surtout la campagne qui tombait sous l'influence de la ville, connaissaient une croissance beaucoup plus rapide. En Europe occidentale, par exemple en Hollande, la campagne fut capitalisée au XVe siècle (au lieu d’être féodalisée). La terre pouvait être vendue (chose inconcevable auparavant), et les agriculteurs incorporés comme travailleurs libres sur ces mêmes terres. Les propriétaires de la terre, vous l'aurez bien sûr deviné étaient: les citoyens des villes. Les États modernes, comme nous venons de le décrire avec des villes dominantes et un roi central ou une structure républicaine, ont connu la prospérité. La force et la portée des pays riches se sont accrues parce qu'il y avait croissance économique. C'est l'endroit où s'est créé ce que nous appelons "l'impérialisme".
Impérialisme
L'impérialisme est le processus par lequel des États nationaux ou pré-nationaux, par des moyens de soumission économique et militaire, rendent des régions économiquement plus faibles dépendantes d’un État dominant. Cela crée nécessairement un conflit entre ces États nationaux, car les régions économiquement plus faibles sont rares. Ce processus a commencé à se produire à partir du début du 16ème siècle dans les États européens, par exemple avec la Compagnie des Indes orientales dans la République des Sept Provinces des Pays-Bas-Unis. Toutefois, cela ne signifie pas que seuls les États européens sont impérialistes : c'est un processus, une logique de conflit entre États dans le cadre du capitalisme. Le but de conquérir ces régions économiquement plus faibles est double et les accents varient selon les circonstances: 1) réduire les coûts de production par des moyens de production moins chers ou 2) dominer le marché local pour écouler ses propres produits. On voit déjà surgir ces deux processus dans les relations entre la ville et la campagne, mais dans l'impérialisme, ils ont une nouvelle dimension. L'origine des deux se situe donc dans un (proto)-capitalisme. Qu’est-ce que j’entends par économiquement plus faible ? Je veux dire par là, essentiellement un manque de capital propre dans les limites d'une certaine région déterminée, où il devient impossible de développer soi-même une certaine puissance économique.
D'une part, cette zone reste militairement arriérée. La région se rend surtout intéressante par sa main d’œuvre moins coûteuse pour la production de produits à forte intensité de main-d'œuvre, surtout les matières premières rares. D’autre part, il y a aussi le potentiel d’écoulement des marchés que le capitalisme recherche dans les limites d'un territoire soumis. Par exemple, au XVII siècle, le Pendjab avait développé une proto-industrie où le lin était transformé en toutes sortes de produits. Par la conquête des anglais, avec un développement supérieur de leurs moyens de production, se développèrent rapidement des produits à base de lin meilleur marché à l’intérieur et pour le marché anglais. Quand celui-ci s’est avéré saturé et que le coût minimum du lin atteignait le fond, le lin a également été écoulé sur le marché du Pendjab (où là encore, un prix fort était demandé). Le résultat fut une famine dans le Pendjab, puisque pour le Pendjab, en raison de leurs produits coûteux, le marché en Grande-Bretagne était déjà devenu caduc. La destruction du marché local a été le coup de massue pour l'industrie des tisserands de lin. L'exemple provient d’Eric Hobsbawm.
Les marxistes à leur tour ont mis l’accent sur diverses composantes du processus, mais il existe une logique symbiotique entre les deux parties du processus. Une école récente de
Marxistes en sociologie/histoire, a essayé de réunir les deux en une seule description. Le sociologue Immanuel Wallerstein affirme qu’historiquement, les territoires étaient divisés en trois parties: le centre, les États semi-périphériques et les États périphériques. Les États centraux produisaient des biens et des services à forte valeur ajoutée, dont la production nécessitait un degré élevé de capital. Les États centraux essayaient activement de garder la compétitivité de leur capital sur leurs concurrents et la périphérie. Les États centraux ont une relation générale dominante sur les États périphériques. Les États périphériques vendent bon marché les matières premières nécessaires aux États centraux et importent de ces derniers les produits plus chers de haute qualité. Il en résulte un système de commerce mondial où l'impérialisme, la conquête d'autres États en vue d’importer et d’exporter forment une substance nécessaire dans la lutte concurrentielle de la bourgeoisie des centres.
Je pense avoir défini dans une certaine mesure l’impérialisme. Il y a encore suffisamment de place ici pour en discuter.
Pratique politique
Nous voulons nous positionner face à l'impérialisme. Mais à partir de quelles positions pouvons-nous choisir? Le court texte qui suit présente des idéologies qui ne sont pas élaborées mais plus une collection d'idées qui sont souvent combinées.
L'approche des conservateurs et libéraux. ans celle-ci, on suppose que la conquête des États n'a rien à voir avec une base matérielle de l'augmentation des profits, mais est considérée comme une partie nécessaire de la condition humaine. La guerre a été de tous les temps, les batailles entre les empires aussi. Un affaiblissement, une perte de volonté de se battre, une décadence, comme le conservateur historien Edward Gibbon l’appelle dans le cas de l'Empire romain, feront en sorte que les empires périssent. Il vaut mieux donc s’armer contre les autres groupes et territoires. Cela fait complètement abstraction de la nature historique de l'impérialisme !
Une forme particulière de cette approche conservatrice, est l'idée du "choc des civilisations" (Huntington). C'est l'idée que les empires se composent réellement de groupes culturellement homogènes qui devront combattre ensemble pour la vie et la mort. Mais ici aussi une base matérielle est niée. Le monde serait composé d’idéologies, de religions et de cultures qui pour des raisons encore obscures mais évidentes ne s’accordent pas les unes les autres une place au soleil.
L'approche sociale-démocrate . Ici, on préfère ne pas parler d’'impérialisme et on ne voit que les cas concrets d’exploitation dans les pays qui se trouvent à la périphérie. On essaie de remédier à ces cas d'exploitation par des accords internationaux ou par des interdits moraux. On part du fait qu’une entreprise (Nike) ou "un pays" (les mines de l'État chinois) exploite ses ouvriers, mais on ne tient pas compte du contexte plus large qui se trouve derrière. Au mieux, cela a à voir ou bien avec l'avarice des entreprises (sociaux-démocrates), la consommation excessive des Occidentaux (verts/consommation éthique), ou le fait que nos gouvernements nationaux interviennent peu dans la condamnation des violations du droit international (Chrétiens-démocrates). En aucun cas n’est vu le lien matériel.
L’approche socialiste nationale (trotskistes/staliniens) . Il est reconnu qu'il existe une base matérielle sous-jacente à l'impérialisme et la solution qui est proposée est un appel à soutenir activement les pays supposés " plus faibles " ou ayant une auréole " prolétarienne ". Par exemple : l’Anti-OTAN, Pour Chavez contre les États-Unis, etc.… Le problème ici est qu'à la base il est supposé que dans les conflits entre États, il y a quelque chose de "prolétarien". Cela n’est tout simplement pas le cas, et même si la classe ouvrière est activement impliquée dans un conflit (par exemple dans le cas où un fort sentiment anti-américanisme, qui est un nationalisme déguisé, est présent), il est naïf de croire que sa participation sert les intérêts de la classe ouvrière. Selon moi, un tas d’arguments contredisent l’idée que la classe ouvrière aurait un intérêt commun avec l’État qui la domine. Car, tous les États sont pris dans les mêmes restrictions bourgeoises. D’ailleurs, en se focalisant activement sur par exemple l’Anti-OTAN, on peut aussi devenir l’instrument de la bourgeoisie du Vénézuéla, Chine, Iran, etc.. En outre, dans certains conflits, il est difficile de savoir quel est le pays "le plus faible" parce que les nations sous-développées entre elles essaient aussi de grimper sur l’échelle du capitalisme. L'idée du " moindre impérialisme " que nous, socialistes, devrions prendre comme position lors d’un conflit me semble donc extrêmement dangereuse et insensée.
Une approche socialiste internationaliste. Dans cette approche, il est clair que tous les États fonctionnent à partir d'une logique qui leur est indiquée par les règles du capitalisme, et qui est inhérente à leur positionnement sur le terrain. Le remplacement d’un impérialisme par un autre, est dénué de sens parce que cela ne change en rien les règles du capitalisme international. La seule chose qu'on puisse faire, est de radicaliser la classe ouvrière et de lui expliquer la futilité du nationalisme dans ce jeu.
SP.L./11.03.2012
(1)Une comparaison pour clarifier cela. Ce n'est pas parce que nous pouvons découvrir quelqu'un au Moyen-Âge qui passe toute sa journée à accumuler l'argent acquis précédemment qu’on peut déjà parler de capitalisme. Pour parler de capitalisme, ce phénomène doit être généralisé et occuper une position dominante dans la société.
Vie du CCI:
Rubrique:
De quelle crise parlons-nous ? (cycle de discussion sur la crise, 1)
- 1422 lectures
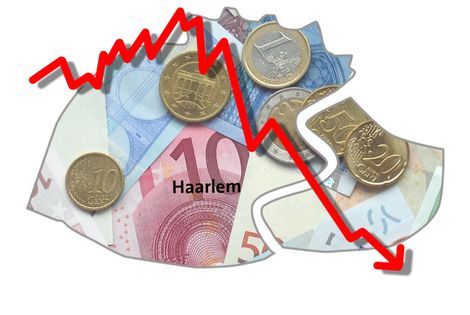
En avril et mai 2012, le CCI, ensemble avec ses sympathisants et autres intéressés venant d’horizons divers, a organisé un cycle de trois discussions sur la crise.
Dans la discussion l’accent a été mis sur la culture du débat et tous étaient invités à prendre part au débat. Nous soulignions que ce n’était pas une affaire d'experts car mêmes les plus grands experts économiques bourgeois n’avaient pas vu venir la crise. Et pourtant, ils dominent maintenant le débat dans les médias. A été posé le fait que pour nous il était grand temps que nous allions vers des arguments solides sur les causes des symptômes récurrents toujours plus graves de la crise et pourquoi cela ressemble de plus en plus à une crise du capitalisme en tant que système, aussi bien économiquement, socialement que politiquement. La question se pose : réforme ou renversement révolutionnaire?
Dans la contribution suivante, nous proposons la première introduction de ce cycle. La discussion qui a suivi a été très animée et traversée d’une participation enthousiaste de tous les participants.
Cette première discussion s’est centrée autour de quatre axes : la recherche d’une meilleure compréhension des définitions et concepts utilisés (argent et crédit, dette, marché, échange et valeurs d’usage, etc..); la crise historique du capitalisme (sa décadence) et la question de la surproduction ; le lien entre crise-guerre-reconstruction et le rôle de l'impérialisme, thèmes qui lançaient déjà les deux prochains tours de discussion.
Un recueil de textes a été créé au service des participants. Il peut aussi être envoyé sur simple demande.
Indéniablement, la crise se manifeste, et de manière particulièrement spectaculaire même, sur le plan financier : depuis la fin des années 1980, les banques ont reçu toute la latitude pour étendre leur politique de financement et de commercialisation de toutes sortes de produits financiers, de sorte qu’elles constituent aujourd’hui – même si c’est de manière virtuelle à travers les systèmes informatiques – un marché plus important que tous les secteurs non financiers réunis. En 2008, la totalité des transactions financières mondiales avait atteint la somme de 2.200.000 milliards de dollars, face à un Produit National Brut sur le plan mondial de 55.000 milliards. L’économie spéculative est en conséquence 40 fois plus importante que l’économie ‘réelle’. Or, durant ces dernières années, ces milliards ont été investis de manière croissante dans des placements totalement aberrants et autodestructeurs.
Durant ces 25 dernières années en effet, les transactions financières ne sont plus basées sur des valeurs réelles et intrinsèques, mais sont devenues un processus fonctionnant pleinement selon une logique propre. Le secteur financier a perdu tout contact avec la réalité économique, il n’est plus depuis longtemps au service de l’économie réelle, mais est basé sur de la plus-value irréelle, sur du vent. C’est bien là que se situe l’origine de l’accumulation hallucinante des dettes des gouvernements, des institutions financières, des entreprises et des particuliers.
Cette crise, est-elle à la base une crise hypothécaire ?
A la fin du 20e siècle, la bourgeoisie a donné le feu vert aux banques pour conclure des prêts hypothécaires plus importants que d’habitude à des taux de départ très bas. L’explosion du crédit hypothécaire a mené dans un grand nombre de pays à une hausse des prix immobiliers et des habitations. En offrant des prêts de plus en plus importants pour des prix fortement surévalués sur le marché immobilier, les banques sont arrivées à engranger sous la forme d’intérêts une partie de plus en plus importante du salaires des travailleurs.
A un moment donné, les taux ont toutefois été relevés pour contrer une inflation menaçante (la hausse du prix des habitations menait à une surchauffe sur le marché immobilier). Et soudain, une masse de familles ouvrières n’arrivaient plus à repayer leur crédit hypothécaire. Le phénomène des familles ouvrières liées pieds et poings à une hypothèque n’est cependant pas nouveau dans le capitalisme. Il l’a toujours accompagné et ne peut expliquer l’ampleur de la crise actuelle. Aujourd’hui, ces familles sont liées pieds et poings aux banques, avant, elles l’étaient au patron, comme on le sait à travers les rapports de Friedrich Engels : " ‘L’enchaînement du travailleur à sa propre maison’ existait déjà dans les années ’80 du 19e siècle. (Le fabriquant) Dolfuss et ses collègues essayaient de vendre aux travailleurs de petites maisons qu’ils devaient repayer en traites annuelles (...). De cette manière, les travailleurs avaient de lourdes charges hypothécaires sur le dos (...) et devenaient ensuite vraiment les esclaves de leurs patrons : ils étaient liés à leurs maisons, ils ne pouvaient pas s’en aller et ils devaient accepter sans rechigner n’importe quelles conditions de travail. " (Friederich Engels, 1887).
Mais aujourd’hui, le blocage ne touche pas le marché immobilier en soi, mais l’ensemble du mécanisme de marché, avec son caractère spéculatif exacerbé.
La crise s’explique-t-elle alors par une crise du crédit, une crise bancaire ?
Les prêts bancaires extravagants aux ménages et aux entreprises, qui ont déclenché la crise, n’avaient aucun caractère productif. Aucune valeur réelle n’était créée. Seuls les frais des marchandises et de services déjà existants ont augmenté à cause de cette politique des banques. D’une manière encore plus vulgaire, les assureurs ont vendu des polices avec de gigantesques frais cachés, ce qu’on appelle adéquatement des polices usuraires. D’une manière imagée, on pourrait dire que les banques et les assureurs ont gagné de l’argent en disposant des points de péage intermédiaires, pas en construisant de nouvelles routes.
Si ces banques ont réalisé des bénéfices, elles ont comme toutes les institutions partout dans le monde (fonds de pension, banques, sociétés immobilières) profité des bénéfices réalisés au moyen de prêts hypothécaires pourris, en particulier au niveau du marcher immobilier américain. Ces prêts hypothécaires pourris, ces investissements à hauts risques, ont été mélangé avec des investissements moins dangereux et proposés comme des produits boursiers par ces banques.
Et de par le fait que ces actions et obligations de ces banques et des compagnies d’assurance continuaient à monter, d’autres, qui voulaient également leur part du butin, commencèrent également à prendre plus de risques. Afin de participer à ce jeu de hasard, les banques (en tant que véritables entreprises d’utilité publique) reçurent l’autorisation de leurs Etats respectifs de réduire leurs réserves liquides au minimum. Les rentrées augmentaient en effet fortement. Ainsi, les fonds de pension aux Pays-Bas y gagnaient tellement que l’Etat a puisé deux fois dans leurs caisses dans les années ’90, parce qu’ils disposaient de tellement de réserves. La croissance exponentielle des bénéfices ne démontrait-elle pas que tout cela ne pouvait causer aucun souci.
Mais lorsqu’aux USA, la survaleur (virtuelle) disparut brusquement en fumée, les différentes institutions dans le reste du monde se réveillèrent avec la gueule de bois : Leurs placements dans des hypothèques pourries ne valaient du jour au lendemain pratiquement plus rien. Une fois de plus toutefois, ce phénomène n ‘est pas nouveau, nous l’avons déjà vu dans l’histoire, et il ne nous apprend rien sur les causes de l’actuelle crise. Un des phénomènes principaux de la Grande Dépression des années 1930 était la faillite d’un grand nombre de banques. A ce moment-là aussi, la confiance entre les banques descendit sous zéro (on se demandait avec angoisse : quelle banque a des crédits pourris et combien ?), ce qui fit que l’instillation de liquidités dans l’économie, la graisse indispensable au fonctionnement des mécanismes, s’arrêta presque complètement.
La cause de la crise doit-elle alors être trouvée auprès des spéculateurs, des fraudeurs ?
Ces dernières années, chaque effondrement boursier est effectivement allé de pair avec des cas de fraude. Et cela ne posait pas seulement la question des fraudeurs ! Ainsi, les magouilles de Madoff ont bien été contrôlées huit fois ces dernières seize années par toutes sortes d’organismes de contrôle, comme la Securities and Exchange Commission. Et malgré le fait que les contrôleurs avaient été informés sur des pratiques frauduleuses, ils n’ont jamais rien trouvé. Mais en décembre 2008, Bernard Madoff était brusquement un fraudeur. L’entreprise bancaire géante Lehman Brothers voyait s’évaporer 65 milliards de dollars. La même chose se passa en septembre 2011 avec Kweku Adoboli avec une " fraude " de 2,3 milliards de dollars auprès de la banque suisse UBS. En janvier 2008, Jérôme Kerviel provoqua une " fraude " de 4,82 milliards d’euros auprès de la banque française Société Générale.
Mais ici encore, la spéculation n’est pas un phénomène nouveau : " Un certain Sullivan se voit attribué au moment de son départ – pour une mission gouvernementale – vers une région d’Inde qui est éloignée des régions où l’on cultive l’opium, un contrat concernant l’opium. Sullivan vend son contrat pour £40.000 à un certain Binn. Binn vend ce contrat le même jour encore pour £60.000 et l’acheteur ultime et exécuteur du contrat déclara qu’il en tira encore malgré tout de substantiels bénéfices ". Et ce phénomène n’est par ailleurs pas non plus caractéristique pour la crise actuelle. Il existe depuis très longtemps dans le cadre du capitalisme. Marx a décrit à son époque l’activité destructrice du secteur financier et des spéculateurs comme " des chevaliers pillards du crédit ", une " classe parasitaire " : " le capital usuraire utilise le mode d’exploitation capitaliste, sans mettre en oeuvre le mode de production capitaliste ".
Bref, la spéculation accompagne toute l’histoire du capitalisme et ne peut donc fournir les fondements pour expliquer la crise actuelle.
S’agit-il enfin d’une crise de la dette souveraine des Etats ?
Lorsque les Etats ont décidé de sauver les banques du naufrage, on a vu la dette des Etats exploser. Suivant l’exemple " brillant " d’autres Etats de l’UE, le gouvernement grec a également injecté des capitaux importants dans les banques afin de les sauver de la faillite. Jusqu’à présent, les banques grecques ont reçu plus de 110 milliards de soutien financier sous diverses formes. Elles n’ont bien sûr jamais utilisé cet argent pour stimuler l’économie réelle. La dette de l’Etat grec avait bien augmenté jusqu’à des proportions inconsidérées. Sa dette correspondait déjà en 2008 à 125% du PIB et, à cause d’un déficit annuel de 12%, elle continuait à augmenter par bonds.
Mais à nouveau, la dette étatique n’est pas plus un phénomène nouveau au sein du capitalisme. Marx (Le Capital) en son temps expliquait déjà parfaitement en quoi consistait la dette d’Etat : " La dette de l’Etat implique que l’aliénation de l’Etat imprime sa marque sur l’ère capitaliste. La seule partie de la soi-disant richesse nationale qui est véritablement la propriété collective des peuples modernes, est leur dette d’Etat (...). Les emprunts (par l’Etat) permettent aux gouvernements d’effectuer des dépenses extraordinaires sans que ceux qui paient des impôts le sentent immédiatement, mais ils rendent une augmentation des impôts dans le futur indispensable. D’autre part, ces augmentations d’impôts, causées par une accumulation de dettes successives, poussent les gouvernements dans le cas de nouvelles dépenses extraordinaires à souscrire continuellement de nouveaux emprunts ". Il s’agit là d’un cycle infernal de dettes, dont l’Etat ne peut d’aucune manière se dégager, une fois qu’il a été engagé. C’est comme toute dépendance, on s’enfonce de plus en plus. Plus la période de dépendance de l’Etat est longue, plus ce dernier a besoin de sa drogue pour se maintenir dans la concurrence économique internationale. Le phénomène n’est donc pas nouveau, mais existe déjà depuis les premiers agissements financiers au sein du mode de production capitaliste.
S’agit-il plus précisément d’une crise de la monnaie unique européenne, d’une crise de l’euro ?
Il existe sans doute un gouffre entre les économies de pays du Sud et des pays du Nord comme les Pays-Bas et l’Allemagne, mais ceci était évident en 2000 déjà. Un pays comme la Grèce n’est pas en état de supporter la concurrence avec des pays plus au Nord. Depuis le début, il était évident que la situation était intenable et que cela devait miner les fondements même de la monnaie unique européenne.
C’est en parfaite harmonie avec leurs intérêts économiques que les différentes bourgeoisies du Nord ont agi dans le passé en intégrant dans la zone euro des pays de la périphérie européenne, qui trichaient de manière évidente avec leurs statistiques budgétaires. Des règles fiscales contraignantes ont été mises de côté face à la promesse de nouveaux marchés protégés pour les entreprises de ces pays du Nord.
Et aujourd’hui encore, les politiciens noient le poisson en attaquant celui par qui le scandale arrive. Mais cela correspond bien sûr au rôle pour lequel ils sont élus et payés : mettre en place un rideau de fumée sur le fondement des événements qui provoquent la pression sur certains pays européens et exacerbent les tensions au sein de la zone euro, cacher qu’ils révèlent fondamentalement les contradictions fondamentales qui caractérisent le capitalisme et qui sont insolubles au sein du système.
Quels sont donc les fondements de la crise actuelle ?
Le capitalisme est la première forme de société dans l’histoire dont la crise n’est pas la conséquence d’une sous-production, d’une production de la pénurie, mais d’une surproduction, d’une abondance de marchandises. Avec les crises éclate une épidémie sociale qui aurait semblé absurde dans toutes les périodes précédentes, une épidémie de surproduction. C’est une crise du mode de production capitaliste basé sur le salariat.
Le capitalisme est marqué depuis sa naissance par une tare congénitale : il produit en abondance un poison que son organisme ne peut contrôler, la surproduction. Il produit plus de marchandises que son marché peut absorber. Pourquoi ? Prenons un exemple pour l’expliquer. Un travailleur travaille à la chaine ou derrière son ordinateur et reçoit à la fin du mois un salaire de 800 euro. En réalité, il ne produit pas l’équivalent de ces 800 euro, mais une valeur de, disons, 1600 euro. Il a donc produit une valeur qui ne lui est pas ristournée sous forme de salaire, en d’autres mots, il a produit de la plus-value. Que fait le capitaliste avec cette plus-value qu’il a volé des travailleurs (à condition bien sûr qu’il la réalise en vendant les marchandises sur le marché !) ? Il utilise une partie (peut-être 150 euro) pour sa consommation personnelle. Mais l’essentiel, les 650 euro restants, il les réinvestit dans le capital de son entreprise, généralement pour l’achat d’un équipement plus moderne. Pourquoi le capitaliste agit-il de la sorte ? Parce qu’il y est contraint du point de vue économique. Le capitalisme est un système de concurrence, les produits doivent être vendus meilleur marché que ceux du voisin, du concurrent qui produit les mêmes produits. En conséquence, chaque patron doit non seulement réduire ses frais de production (les salaires) mais surtout et d’abord réinvestir la majeure partie du travail non payé des travailleurs dans des machines plus modernes pour accroître la productivité. S’il ne le fait pas, il ne peut pas moderniser sa production et il perdra des parts de marché à un concurrent qui, lui, a réussi à proposer des produits meilleur marché.
Le système capitaliste est caractérisé par un phénomène contradictoire : en ne rétribuant pas complètement les travailleurs pour le travail effectivement réalisé et en imposant aux patrons de ne pas consommer eux-mêmes une grande partie des bénéfices qu’ils ont arrachés aux travailleurs, le système produit plus de valeur qu’il ne peut traiter en son sein. Les travailleurs et les capitalistes ne peuvent jamais ensemble consommer l’intégralité des marchandises produites. Le capitalisme doit donc vendre le surplus de marchandises en dehors de sa propre sphère de production, sur des marchés qui n’ont pas encore été conquis par les rapports de production capitalistes, et que nous appelons des marchés extra-capitalistes. S’il n’arrive plus à le faire, nous sommes alors confrontés à une crise de surproduction.
Voilà donc dans de grandes lignes les conclusions de Karl Marx dans ‘Le Capital’ et de Rosa Luxembourg dans ‘L’Accumulation du Capital’. Pour le formuler de manière encore plus concise, nous résumerons la théorie de la surproduction en quelques points :
- Le capital exploite ses ouvriers (ou autrement dit : leurs salaires ne recouvrent pas la valeur réelle qu’ils réalisent par leur travail).
- De cette manière, le capital peut vendre ses marchandises avec un profit, pour un prix qui comprend, outre le salaire des ouvriers et la plus-value, également le remboursement des moyens de productions. Mais à qui vend-il ?
- Bien sûr, les ouvriers achètent des marchandises... Pour un montant permis par leur salaire. Une bonne partie des marchandises restera donc à vendre autre part. La valeur de celles-ci est égale à la partie non payée du travail des ouvriers. Ce n’est que cette partie qui possède la caractéristique magique de réaliser du profit pour le capital.
- Les capitalistes ne consomment eux-mêmes qu’une partie des marchandises qui sont porteuses de la plus-value. S’il veut réaliser du profit, le capital ne peut acheter la totalité des marchandises pour lui-même. ce serait absurde, comme s’il sortait l’argent de sa poche de droite pour le fourrer dans sa poche de gauche. Ce n’est pas une manière de générer du profit.
- Pour accumuler, pour se développer, le capital doit donc trouver impérativement des acheteurs en dehors de la sphère des ouvriers et des capitalistes. Autrement dit, il doit trouver des marchés en dehors de son système, c’est une question cruciale s’il ne veut pas rester avec des marchandises invendues sur les bras qui étouffent le marché, s’il ne veut pas tomber dans une ‘crise de surproduction’ !
DS
Récent et en cours:
Rubrique:
Internationalisme no 356 - 4e trimestre 2012
- 1139 lectures
Face au poison de la division corporatiste, régionaliste, nationaliste: unité et solidarité ouvrière!
- 1079 lectures
Une méfiance sourde, constante, de lourds préjugés, le jugement cruel et destructeur, la culpabilité, la peur de l’autre... Voilà ce qui se glisse aujourd’hui au plus profond de la société. Voici, brutalement énoncées, les formes que dessinent les rapports entre les individus, d’un trait toujours plus sombre et plus agressif. Chacun dans sa propre bulle, regardant avec mépris la bulle de son voisin en train de crever d’asphyxie. Voilà ce qui chaque jour pèse sur nos esprits et nous mène vers toujours plus d’incompréhension et de désarroi. Face à la crise généralisée catastrophique qui frappe son système, face au besoin croissant d’unité et de solidarité des prolétaires, la bourgeoisie cherche, en effet, par tous les moyens à distiller le poison de la division et de la confrontation, à nous entraîner sur le terrain obsolète de la compétition et de la concurrence, terrain indissociable du capitalisme lui-même. Par tous les moyens, des plus subtils aux plus grossiers, la classe dominante cherche à pourrir l’esprit des prolétaires avec cette idée : “Vos intérêts sont ceux de telles ou telles fractions de la bourgeoisie.” Bien sûr, la bourgeoisie camoufle ceci en parlant des “intérêts supérieurs” de l’entreprise ou de la nation en général, comme si l’entreprise ou la nation étaient des formes sociales au-dessus de la lutte des classes, qu’elles n’existaient pas pour servir précisément les seuls intérêts de classe de nos exploiteurs.
Les syndicats, véritable police de l’Etat dans l’entreprise, sont à la pointe de ces manœuvres de divisions, prenant également eux-mêmes en charge les campagnes de propagandes chauvines. Ainsi, tandis que les attaques pleuvent au nom de la “réduction des déficits” et de la “compétitivité”, que les plans de licenciements se multiplient, en clair, que la bourgeoisie fait payer à la classe ouvrière la crise de son système, c’est entreprise par entreprise, catégorie par catégorie, que les syndicats minent le terrain de la “résistance.” Face à l’attaque généralisée de la classe dominante contre nos conditions de vie, les mêmes syndicats saucissonnent la riposte, nous lancent méthodiquement, par petits paquets dispersés, dans des combats pour la défense de tel ou tel intérêt particulier. Ces spécialistes autoproclamés des luttes ouvrières, opposent également les ouvriers entre eux, entre qualifiés et précaires. La bourgeoisie sait parfaitement que la crise et les attaques vont se poursuivre ; avec ses syndicats, elle prépare donc le terrain, elle nous épuise dans des combats aussi stériles que démoralisants afin de retarder au maximum le processus menant à des luttes massives.
Cette distillation du poison de la division a de nombreux visages. Ainsi nous assistons, depuis plusieurs années, à la montée en puissance des revendications régionalistes. En Espagne, tandis que les indépendantistes basques et catalans remportaient les élections locales, une manifestation monstre était organisée à Barcelone pour réclamer “une Catalogne indépendante.” De même, en Belgique, après la crise politique de 2010-2011 sur fond d’indépendantisme flamand, la Nieuw-Vlaamse Alliantie – Alliance néo-flamande – triomphait aux élections communales, notamment son chef de file, Bart De Wever, qui remportait haut la main la ville d’Anvers. Au Royaume-Uni, l’Écosse, région riche en ressources minières, organisera un référendum en 2014 à propos de son indépendance ! Dans une moindre mesure, en Italie, la puissante Ligue du Nord revendique, depuis des années, l’autonomie de la Padanie.
Partout, ces velléités indépendantistes s’accompagnent d’un discours écœurant dénonçant les ouvriers des autres régions qui, tels des vampires, suceraient le sang fiscal et économique des travailleurs locaux. Ces revendications ne sont pas autre chose qu’une forme de nationalisme irrationnel, typique de la décomposition capitaliste.
La propagande bourgeoise ne cesse alors de chercher des bouc-émissaires afin de dédouaner son système capitaliste en faillite. Elle canalise la colère des ouvriers et de la population en livrant en pâture des “coupables” désignés, fabriqués sur mesure, afin de “diviser pour mieux régner”. Ce nationalisme réactivé s’exprime de plus en plus ouvertement à la TV et dans les journaux, de manière “décomplexée”. D’un côté, par exemple, la bourgeoisie allemande, avec en échos les propos de ce qu’on appelle la “troika” (Commission, BCE, FMI), accuse la population et les prolétaires “grecs” d’être de véritables “tricheurs”, des “fainéants” qui ne “payent pas d’impôt” ; les populations espagnoles ou portugaises, de vivre elles aussi “aux crochets” des pays du nord de l’Europe. De l’autre côté, les bourgeoisies et médias de ces mêmes pays incriminés, se présentant comme les “victimes de l’Allemagne” et de la “politique de Merkel”, expliquent simplement la misère noire croissante qu’elles imposent du fait de “l’égoïsme” de voisins “nantis” ! Quant aux ouvriers allemands et français, pourtant eux aussi victimes d’attaques, ils sont condamnés à faire des “efforts” et des “sacrifices” pour “payer les années de laxisme” des pays du sud les plus endettés, soulager ceux qui sont accusés de “voler le travail des autres” et qui ne devraient “ne s’en prendre qu’à eux-mêmes” !
Face à cette propagande nauséabonde, à ces préjugés bassement entretenus et cultivés, aux divisions, aux conflits des uns contre les autres, nous devons réaffirmer la nécessité de l’unité internationale de nos luttes.
Notre véritable force, c’est en effet notre nombre, la massivité de notre combat, l’union par-delà les secteurs, les races, les frontières et les nations. A un monde divisé et cloisonné par les intérêts privés du capital, ceux d’une classe d’exploiteurs arrogants, les fameux “1 %” dénoncés par les “Indignés”, nous devons opposer notre solidarité. Nous devons prendre conscience, nous qui travaillons dans des conditions de plus en plus inhumaines, que nous sommes tous les vraies victimes d’un système barbare à l’agonie. Face au chacun pour soi, nous devons lutter pour nous rassembler, réfléchir et discuter ensemble, sur les moyens de défendre notre dignité et nos conditions de vie. En perspective, nous avons devant nous à conquérir un futur qui nous appartient, un autre monde, débarrassé de la violence, des haines et des terreurs de l’exploitation. Ce futur, cet autre monde, n’est pas seulement nécessaire, il est possible. Il devra affirmer le “règne de la liberté”, celui d’une vraie communauté humaine mondiale.
WH/El Generico, 27 octobre
Géographique:
Rubrique:
Tract drame-Ford: le seul coupable est l'appât du profit
- 1399 lectures

Ford Genk, récemment encore une usine de plus de 10.000 employés, ferme définitivement. Depuis les années 90, l'emploi y a été systématiquement réduit, la productivité augmentée, les salaires réduits de 12%. Malgré cela, le rideau tombe sur les 4.300 emplois directs et des milliers d’autres travailleurs sont touchés chez les différents fournisseurs. Après Renault-Vilvoorde (1997), VW Forest (2006) et Opel Anvers (2010), c’est la quatrième usine d’assemblage automobile qui ferme en Belgique. Cela touche durement la région limbourgeoise qui a vu disparaître, il y a 20 ans, plus de 17.000 jobs lors de la fermeture des mines de charbon.
Une crise du secteur automobile ? Et le Limbourg est-il particulièrement visé ?
Licenciements chez Belfius Banque, Arcelor Mittal acier, Beckaert Zwevegem, Volvo, Duferco, Alcatel, etc. A l’évidence, le nouveau drame social n'est pas spécifique à un secteur ou une province. La crise touche tous les secteurs et régions. C’est précisément ce qui rend la situation si dramatique et désespérée.
Au nom de la «compétitivité» et «de la réduction des pertes», les licenciements se succèdent. Encore avant l'annonce de la fermeture de Ford, plus de 3.000 emplois ont disparu de septembre à mi-octobre dans tous les secteurs, toutes les régions, des petites entreprises familiales jusqu’aux grandes multinationales, dans des entreprises nationales comme étrangères. D’autres assainissent drastiquement « sans licenciements secs», comme KBC, Brussels Airlines et Delhaize. Les contrats fixes sont remplacés par des contrats temporaires, des emplois à temps plein par des emplois à temps partiel, des contrats d’employés par des contrats d’indépendants. Le chômage temporaire est généralisé. Le travail saisonnier est de plus en plus la norme tout au long de l'année. Les fameuses « créations d’emplois » dont les médias ont la bouche pleine, se limitent en grande partie à des emplois de qualité inférieure, des emplois par « chèques services ». Afin d'échapper à la pauvreté, de nombreux travailleurs doivent chercher un 2ème ou un 3ème emploi. L’obtention d’un emploi n’équivaut plus nécessairement à un revenu décent!
L'État lui aussi est mal en point. Comme le montre la discussion sur la suspension temporaire (le saut d’index) ou la réforme de l'index, le pouvoir d'achat n'est pas une préoccupation centrale. Toujours au nom de la défense de la «compétitivité de l'économie nationale", tous les partis bourgeois, de la NVA au PS, sont d’accord pour dire qu’il faut constamment faire des économies pour réduire les coûts de main d’œuvre et améliorer le climat économique. On passe d’un «pacte social», à un autre « pacte des générations ». Car l'État est là pour appliquer les lois du capitalisme: favoriser la recherche du profit, la force concurrentielle et l’exploitation au moyen de mesures coercitives. Les milliards que les gouvernements cherchent pour permettre leurs plans de relance, leur équilibre budgétaire et la réduction de la dette d’État, seront en fin de compte soutirés aux mêmes familles ouvrières. Les allocataires sociaux, les retraités, les fonctionnaires, les enseignants, tous paieront les pots cassés. Selon le nouvel indicateur européen de la pauvreté, 21% de la population en Belgique est déjà menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale. L'inquiétude et l'indignation d'un nombre croissant de familles ouvrières ne se comprend donc que trop bien.
Ford Genk est aujourd'hui une illustration douloureuse de la nature impitoyable de cette attaque générale contre la classe ouvrière: licenciements nombreux, blocage et/ou réduction des salaires (chez Ford, on a accepté précédemment une réduction de 12%, chez VW-Audi 20%), prolongement du temps de travail. Sans riposte ouvrière, Ford Genk annonce des attaques encore plus douloureuses dans le futur pour l’ensemble de la classe ouvrière. La situation actuelle nécessite donc une résistance contre la dégradation des conditions de travail et de vie de la plupart d'entre nous. Elle contient aussi les germes d'une riposte commune de toute la classe ouvrière. Ce n’est pas que le personnel de Ford, mais tout le monde qui est visé, c’est pourquoi aussi tout le monde doit s’indigner, être solidaire, se mobiliser classe contre classe!
A qui la faute? Y a-t-il un bouc émissaire?
Depuis des décennies, on nous promet une sortie de la crise et de la misère. Le bout du tunnel était en vue, nous disait-on, encore quelques ultimes mesures exceptionnelles et des solutions durables s’imposeraient, les rationalisations ne surviendraient plus que dans «les vieilles industries», dans «des sociétés mère ou des filiales malades » ; plus tard, tout était cette fois-ci la faute « du vieillissement de la population» ou «des réfugiés», de «l’émigration incontrôlée » (la conséquence d’une misère et d’un désespoir pires encore ailleurs dans le monde!) ; plus tard encore les coupables du moment étaient les « bad banks », les fraudeurs, etc. Aujourd'hui, c’est de la faute du PDG de Ford que ce bain de sang social a lieu. Auparavant, lors de la fermeture des mines, les boucs émissaires étaient le ministre flamand socialiste De Batselier et le PDG de la société minière Gijselinck. Derrière toutes ces pseudo vérités et ces discours populistes creux se cache la propagande bourgeoise qui cherche constamment à trouver des boucs émissaires de telle sorte que la question de la faillite du système capitaliste ne soit pas posée. Ainsi, la colère est canalisée et est orientée vers la désignation de « coupables», faits sur mesure, pour mieux «diviser et régner».
Ce même scénario décrit ci-dessus est appliqué dans presque tous les pays du monde, les médias en témoignent quotidiennement. Évidemment, il y a des variantes, tout comme il y en a selon le secteur ou la région en Belgique même. Cependant, partout dans le monde, la question est posée : qui est le responsable de la crise ? Cette question a également été au cœur des débats dans les mouvements du «printemps arabe» en Tunisie et en Égypte, dans ceux des «Indignés» ou de «Occupy Wall Street».
Depuis plusieurs années se sont succédé, au niveau mondial, les crises de l'immobilier, de la bourse, du commerce et de l'industrie, des banques et de toutes les dettes souveraines des Etats. Ainsi, le total des dettes souveraines dans la zone euro s’élève à 8.517 milliards d'euros. Soit une moyenne de 90 % du produit intérieur brut de la zone euro. Une grande partie de celle-ci ne sera jamais remboursée. Quelqu'un doit financer ces dettes, mais financer des dettes impayables signifie finalement qu’on devient insolvable soi-même (un risque qui menace par exemple l'Allemagne). Comment le système peut-il alors financer la relance indispensable pour arrêter le bain de sang au sein de son économie ? En continuant à le faire essentiellement au moyen de mesures d’austérité et de rationalisation, il réduit encore le pouvoir d’achat dont il a besoin pour écouler ses produits, ce qui produira encore plus de rationalisations, de fermetures, de réductions des salaires. S’il écume le marché de l’épargne en imposant des taux d’intérêt dérisoires sous les 1%, tandis que l’inflation atteint les 2,76%, les réserves que de nombreuses familles ouvrières avaient mises de côté pour affronter des contretemps, l’accumulation de dettes ou le chômage, fonderont comme neige au soleil. Quelle que soit la méthode, elle ne peut donc mener à terme qu’à une nouvelle forte baisse du pouvoir d’achat. Devra-t-il se résoudre à faire marcher la planche à papier pour imprimer des billets supplémentaires, comme l’ont fait les USA, le Japon ou la Grande-Bretagne, afin de les mettre sur le marché à des taux de prêt extrêmement bas ? De cette manière, le système capitaliste accentue l’abîme des dettes et en revient au point de départ : en fin de compte, il faut toujours que de la valeur nouvelle soit produite en contrepartie de cet argent imprimé pour repayer les dettes. De l’argent fictif ne peut faire l’affaire, tel notre épargne que les banques remettent en circulation sous la forme d’un emprunt, tandis qu’elles nous font croire qu’il se trouve toujours sur notre compte. De la valeur nouvelle n’est obtenue qu’à partir du travail effectué en lui ajoutant une plus-value : les frais de production d’un produit ne peuvent constituer qu’une fraction de leur valeur de vente totale. Mais pour ce faire, il faut un marché solvable. S’il n’existe pas ou à peine (comme c’est le cas depuis des années), nous entrons dans une crise de surproduction permanente. C’est pourquoi des usines ferment, baissent leurs coûts de production (les salaires), augmentent la productivité, c’est pourquoi aussi les frais improductifs (sécurité sociale, allocations de chômage, retraites) sont constamment comprimés.
Tout ceci constitue la loi générale de la manière capitaliste de produire, qui ne peut être contournée par aucun patron individuel ou par aucun gouvernement particulier ! Si aujourd’hui les usines s’arrêtent, ce n’est pas parce que les travailleurs ne veulent plus travailler ou parce qu’il n’y a plus de besoins à assouvir, mais simplement parce que les capitalistes n’y voient plus de profit à réaliser. Le système capitaliste mondial est gravement malade : les marchés solvables se réduisent comme peau de chagrin et le profit ne peut être maintenu qu’à travers une spoliation sociale et une exploitation toujours plus intenses.
Se mobiliser massivement, forger l’unité, rechercher la solidarité, avoir confiance en sa propre force
Durant ces six derniers mois, protestations, grèves, manifestations massives ont éclaté sur tous les continents : de l’Argentine au Portugal, de l’Inde à la Turquie, de l’Egypte à la Chine. Ainsi, en septembre, des centaines de milliers ont occupé la rue au Portugal, des dizaines de milliers ont manifesté en Espagne en Grèce et en Italie. Au Japon, des manifestations contre la baisse des conditions de vie d’une telle ampleur n’avaient plus eu lieu depuis 1970 (170.000 manifestants à Tokyo). Partout, les mêmes questions sont posées : comment faire face à de telles attaques, comment organiser la lutte, quelles perspectives avancer ? Ce sont les mêmes questions que se posaient déjà les jeunes et les chômeurs du mouvement massif des Indignés ou de Occupy en 2011, e.a. en Espagne, en Grèce, aux USA ou au Canada.
A ce propos, trois besoins centraux pour la lutte ont été mis en avant : la nécessité de l’extension et de l’unification de la lutte, l’importance du développement d’une solidarité active parmi les salariés, les chômeurs et les jeunes et enfin le besoin d’une large discussion à propos de l’alternative pour le système actuel en faillite.
Notre vraie force est notre nombre, l’ampleur de notre lutte, notre destin commun, notre unité au delà des frontières des secteurs, des races, des régions, des pays. Face à un monde divisé et cloisonné par les intérêts personnels étroits d’exploiteurs arrogants, face au « chacun pour soi », à leur « compétitivité », nous devons opposer notre unité et notre solidarité. Nous devons refuser de nous laisser diviser, de réduire nos problèmes à des questions spécifiques et séparées, propres à l’entreprise, au secteur ou à la région. Non à la rivalité entre « jeunes » et « vieux », entre « fixes » et « temporaires », entre employés et ouvriers, entre travailleurs de la maison-mère et des filiales, entre travailleurs d’ici et d’autre part, ...
Cette unité est non seulement indispensable, elle est aussi possible aujourd’hui !
- L’extension de la lutte et de la solidarité avec d’autres secteurs et entreprises, qui sont fondamentalement touchés par les mêmes attaques et qui luttent souvent de manière isolée dans leur coin, pourra le mieux être engagée en envoyant des délégations massives vers les autres usines, c’est ce que nous apprennent les expériences de luttes précédentes ici comme ailleurs. Nos actions doivent renforcer notre lutte, l’étendre et lui donner des perspectives. Aller dans la rue pour « se défouler », mener un long combat isolé, chacun dans son usine ou sa région, ne permettront jamais de développer une lutte générale et massive.
- L’expérience nous apprend aussi que des actions comme la prise en otage de patrons, le sabotage de la production, le blocage de lignes de chemin de fer ou des actions désespérées, comme la menace de faire sauter l’usine, ne favorisent nullement l’union et l’extension de la lutte. Elles mènent au contraire à la démoralisation et à la défaite.
- Les leçons des luttes passées mettent en évidence que travailleurs et chômeurs doivent prendre en mains leurs propres luttes. Pour développer une véritable discussion collective, pour réfléchir et décider collectivement, il faut appeler à des assemblées générales massives, au sein desquelles chacun peut intervenir librement et avancer des propositions d’action, soumises au vote de l’assemblée. Pour forger l’unité du mouvement, ces assemblées doivent être ouvertes à tous les travailleurs et les chômeurs.
Et attention à la supercherie ! L’autre classe – la bourgeoisie – parle aussi de « solidarité » et « d’unité ». Elle appelle aux sacrifices des « secteurs forts » en « solidarité » avec les « secteurs faibles », pour répartir équitablement la misère. Quand son « gâteau devient plus petit », la discussion ne peut porter selon elle que sur une répartition « équivalente» de l’austérité qu’elle nous impose, sur ce qui est profitable à la compétitivité et à l’intérêt national . Elle appelle donc à « l’unité » avec les intérêts du capital. Comme si la répartition équivalente de la misère la rendait supportable ! Comme si la gestion commune de l’exploitation supprimait cette dernière. Ce discours ne sert qu’à entraver la mise en question du système et la recherche de perspectives dans le cadre d’une autre société basée sur l’assouvissement des besoins de tous et non pas des intérêts particuliers de certains !
unité et solidarité – extension et généralisation – confiance en ses propres forces – classe contre classe
Notre force, c’est notre solidarité, pas leur compétitivité.
Internationalisme / 02.11.12
Lettre d’un lecteur
Bonjour
Je vous écris à propos du tract publié récemment sur la crise «du secteur automobile».
Tout d'abord, sur l’analyse qui y est faite de la situation dans la branche de l’automobile, il n’y a rien à redire. Encore une fois, bon travail !
Cependant, la fin du tract reste (volontairement?) vague sur le plan de la prise en main.
Si les prises d’otage, le sabotage, les blocages, etc, ne constituent pas des formes de résistance anticapitaliste, quoi alors?
La mobilisation, la solidarité et l'unité de la classe ouvrière sont sûrement la première étape vers une base révolutionnaire - l'association de jeunes, de vieux, de chômeurs, de prolétaires, de précaires, etc. Cela devra se passer en premier lieu sur le plan économique (à l'intérieur des usines et sur les lieux de travail). L'ensemble de ce processus (comme décrit correctement dans le tract) prendra la forme d’assemblées générales (probablement clandestines), à la rigueur appelées conseils ou comités. Ces assemblées devront s’unir massivement (mutuellement par le biais de conseils / comités à l’échelle d’une «zone», «région» et «ville»).
C’est-à-dire, la démocratie prolétarienne à la base, à partir de l'économique (lieu de travail), vers le haut. Alors finalement, en théorie, l'organisation de masse surgit.
Mais quelle est alors l'arme de la classe ouvrière?
Jusqu’à présent, à côté des options plus radicales comme le sabotage, les occupations des lieux de travail et les blocages envers l’économie capitaliste et les traitres de la classe ouvrière (options qui certainement doivent être appliquées( !)), seule la grève semble être une arme légitime de la classe ouvrière.
Une grève entraîne la mobilisation de la classe ouvrière avec elle, et élimine pendant la période de la grève la division au sein de la classe.
En bref, la grève générale de masse est l'action directe contre l'économie capitaliste. Sur cette base, les exigences politiques envers l’État, le système, la social-démocratie et les syndicats peuvent être exprimées.*
Voilà ainsi une courte et simplifiée vision d'un lecteur. Mais quelle est alors l'alternative pour une révolution socialiste / communiste pour le CCI ?**
Sincèrement
KW/11.2012
.
* afin de ne pas compliquer ma lettre, j’ai ôté toute référence à la résistance ou à la participation des autorités et le militarisme.
** en tenant compte des conséquences juridiques. Ce qui peut expliquer l’imprécision de la conclusion du tract.
Réponse du CCI
Cher lecteur,
Merci pour ta contribution….Nous saluons chaque tentative d’approfondissement et de clarification de la discussion, même si cela implique une critique (fondamentale) des textes que nous avons publiés.
Nous souscrivons en grande partie avec ta contribution. Mais si tu n’y vois pas d’inconvénient, nous voulons aussi faire ici et là des remarques sur tes commentaires.
A la fin de ta lettre, tu écris «Cependant, la fin du tract reste (volontairement? vague sur le plan de la prise en main» et « cela (la mobilisation, la solidarité et l'unité de la classe ouvrière) devra se passer en premier lieu sur le plan économique. »
La question porte sur le fait que tu peux distinguer la lutte économique de la lutte politique mais elles ne sont pas totalement séparables l’une de l’autre.
« il n'existe pas deux espèces de luttes distinctes de la classe ouvrière, l'une de caractère politique, et l'autre de caractère économique(…) dans une action révolutionnaire de masse, la lutte politique et la lutte économique ne font plus qu'un ». Toute tentative de « distinction entre la lutte politique et la lutte économique, l'autonomie de ces deux formes de combat ne sont qu'un produit artificiel, quoique historiquement explicable, de la période parlementaire. (…)» (Rosa Luxembourg : grève de masse, parti et syndicat)
Dans la période de décadence du capitalisme, il n’est plus possible d’obtenir des réformes permanentes et durables. Cela signifie que toutes les luttes des travailleurs constituent indirectement une attaque à la nature du système. Toute opposition de la part de la classe peut ébranler les bases du capitalisme car le système a peu ou pas de marge de manœuvres pour neutraliser l’attaque des ouvriers.
La lutte de classe dans la période de décadence « vise à la fois à limiter les effets de l'exploitation capitaliste et à supprimer cette exploitation en même temps que la société bourgeoise.». En d’autres termes : « (toute) période de luttes de classe (a) un caractère à la fois politique et économique. ». (Idem)
Il est vrai que le point de départ de la lutte des ouvriers –en tout cas jusqu’à la période de l’insurrection révolutionnaire- sera toujours une résistance aux attaques sur les conditions de vie. Par conséquent, dans un sens, il est vrai que dans la lutte il ne s’agit pas de ce que les ouvriers attendent de leurs propres actions, mais de ce que la classe ouvrière est et de ce qu’elle est forcée de faire sur ce plan. Mais si la classe ouvrière est obligée de faire certaines choses, elle ne le fait pas sans une certaine conscience (surtout pas d’une manière mécanique, comme par exemple le chien de Pavlov). C’est pourquoi, le développement de la conscience dans la classe ouvrière est aussi, selon nous, une condition essentielle pour le développement d’un contre-pouvoir : une prise de conscience sur l’existence du salariat, la façon associée et collective dans laquelle les ouvriers sont dans la production et le fait que les travailleurs de cette façon, comme classe, sont les producteurs de toutes les richesses dans le monde.
Pour une minorité grande ou petite de la classe, il existe toujours l’idée et la perspective d’une autre société communiste. C’est parce qu’elle a une mémoire historique, un souvenir des périodes passées (que ce soit transmis ou non par une autre génération) et une capacité à apprendre de ses expériences de lutte. Ce qui fait qu’elle peut pousser l’enjeu de la lutte, à chaque fois qu’elle l’engage, à une échelle toujours plus générale. «Reculer pour mieux sauter» c’est-à-dire faire quelques pas en arrière pour mieux sauter en avant, c’est à peu près de cela qu’il s’agit pour la lutte ouvrière. Les travailleurs ont la capacité, chaque fois qu’ils engagent la lutte, de mettre de plus en plus de côté leurs propres intérêts immédiats et de la poser sur une échelle de plus en plus générale (et donc plus large et finalement aussi politique). Cette dynamique conduit à ce que le combat ne portera plus de façon prédominante sur un niveau direct économique mais sur un niveau politique : la lutte pour le pouvoir dans la société.
Salutations fraternelles
Au nom du CCI
A/11.2012
Géographique:
Situations territoriales:
Rubrique:
Rosa Luxemburg: socialisme ou barbarie?
- 1330 lectures
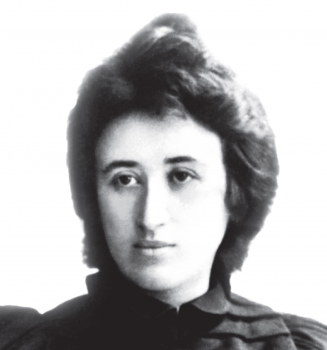 Nous publions ci-dessous de larges extraits du premier chapitre (1) de la brochure de Rosa Luxemburg "la Crise de la social-démocratie" (2).
Nous publions ci-dessous de larges extraits du premier chapitre (1) de la brochure de Rosa Luxemburg "la Crise de la social-démocratie" (2).
Ce texte magistral de 1915 doit être une source d’inspiration face aux difficultés actuelles du prolétariat. Alors confrontée à la pire boucherie de l’histoire de l’humanité, la Première Guerre mondiale (3) , et à la trahison de la social-démocratie qui a contribué à embrigader dans ce carnage impérialiste les ouvriers de tous les pays, Rosa Luxemburg ne cède pas au découragement. Au contraire ! Elle plaide pour un marxisme vivant, non dogmatique, empreint de la méthode scientifique, qui regarde les erreurs et les défaites en face pour en tirer les leçons et mieux préparer l’avenir. Car cette révolutionnaire a une confiance inébranlable en l’avenir et dans la capacité du prolétariat mondial à accomplir sa mission historique : lutter consciemment pour l’émancipation de toute l’humanité.
CCI
[…] Finie l’ivresse. […] L’allégresse bruyante des jeunes filles courant le long des convois ne fait plus d’escorte aux trains de réservistes et ces derniers ne saluent plus la foule en se penchant depuis les fenêtres de leur wagon, un sourire joyeux aux lèvres […]. Dans l’atmosphère dégrisée de ces journées blêmes, c’est un tout autre chœur que l’on entend : le cri rauque des vautours et des hyènes sur le champ de bataille. […] La chair à canon, embarquée en août et septembre toute gorgée de patriotisme, pourrit maintenant en Belgique, dans les Vosges, en Masurie, dans des cimetières où l’on voit les bénéfices de guerre pousser dru. […] Les affaires fructifient sur des ruines. Des villes se métamorphosent en monceaux de décombres, des villages en cimetières, des régions entières en déserts, des populations entières en troupes de mendiants, des églises en écuries. […]123
Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment.
Et au cœur de ce sabbat de sorcière s’est produit une catastrophe de portée mondiale : la capitulation de la social-démocratie internationale. Ce serait pour le prolétariat le comble de la folie que de se bercer d’illusions à ce sujet ou de voiler cette catastrophe : c’est le pire qui pourrait lui arriver. “Le démocrate” (c’est-à-dire le petit-bourgeois révolutionnaire) dit Marx, “sort de la défaite la plus honteuse aussi pur et innocent que lorsqu’il a commencé la lutte : avec la conviction toute récente qu’il doit vaincre, non pas qu’il s’apprête, lui et son parti, à réviser ses positions anciennes, mais au contraire parce qu’il attend des circonstances qu’elles évoluent en sa faveur.” Le prolétariat moderne, lui, se comporte tout autrement au sortir des grandes épreuves de l’histoire. Ses erreurs sont aussi gigantesques que ses tâches. Il n’y a pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer le chemin à parcourir. Il n’a d’autre maître que l’expérience historique. Le chemin pénible de sa libération n’est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d’erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l’atteindra s’il sait s’instruire de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l’autocritique, une autocritique sans merci, cruelle, allant jusqu’au fond des choses, c’est l’air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre. Dans la guerre mondiale actuelle, le prolétariat est tombé plus bas que jamais. C’est là un malheur pour toute l’humanité. Mais c’en serait seulement fini du socialisme au cas où le prolétariat international se refuserait à mesurer la profondeur de sa chute et à en tirer les enseignements qu’elle comporte.
Ce qui est en cause actuellement, c’est tout le dernier chapitre de l’évolution du mouvement ouvrier moderne au cours de ces vingt-cinq dernières années. Ce à quoi nous assistons, c’est à la critique et au bilan de l’œuvre accomplie depuis près d’un demi-siècle. La chute de la Commune de Paris avait scellé la première phase du mouvement ouvrier européen et la fin de la I Internationale. A partir de là commença une phase nouvelle. Aux révolutions spontanées, aux soulèvements, aux combats sur les barricades, après lesquels le prolétariat retombait chaque fois dans son Etat passif, se substitua alors la lutte quotidienne systématique, l’utilisation du parlementarisme bourgeois, l’organisation des masses, le mariage de la lutte économique et de la lutte politique, le mariage de l’idéal socialiste avec la défense opiniâtre des intérêts quotidiens immédiats. Pour la première fois, la cause du prolétariat et de son émancipation voyait briller devant elle une étoile pour la guider : une doctrine scientifique rigoureuse. A la place des sectes, des écoles, des utopies, des expériences que chacun faisait pour soi dans son propre pays, on avait un fondement théorique international, base commune qui faisait converger les différents pays en un faisceau unique. La théorie marxiste mit entre les mains de la classe ouvrière du monde entier une boussole qui lui permettait de trouver sa route dans le tourbillon des événements de chaque jour et d’orienter sa tactique de combat à chaque heure en direction du but final, immuable.
C’est le parti social-démocrate allemand qui se fit le représentant, le champion et le gardien de cette nouvelle méthode. […] Au prix de sacrifices innombrables, par un travail minutieux et infatigable, elle a édifié une organisation exemplaire, la plus forte de toutes ; elle a créé la presse la plus nombreuse, donné naissance aux moyens de formation et d’éducation les plus efficaces, rassemblé autour d’elle les masses d’électeurs les plus considérables et obtenu le plus grand nombre de sièges de députés. La social-démocratie allemande passait pour l’incarnation la plus pure du socialisme marxiste. Le parti social-démocrate occupait et revendiquait une place d’exception en tant que maître et guide de la IIree Internationale. […] La social-démocratie française, italienne et belge, les mouvements ouvriers de Hollande, de Scandinavie, de Suisse et des Etats-Unis marchaient sur ses traces avec un zèle toujours croissant. Quant aux Slaves, les Russes et les sociaux-démocrates des Balkans, ils la regardaient avec une admiration sans bornes, pour ainsi dire inconditionnelle. […] Pendant les congrès, au cours des sessions du bureau de l’Internationale socialiste, tout était suspendu à l’opinion des Allemands. […] “Pour nous autres Allemands, ceci est inacceptable” suffisait régulièrement à décider de l’orientation de l’Internationale. Avec une confiance aveugle, celle-ci s’en remettait à la direction de la puissante social-démocratie allemande tant admirée : elle était l’orgueil de chaque socialiste et la terreur des classes dirigeantes dans tous les pays.
Et à quoi avons-nous assisté en Allemagne au moment de la grande épreuve historique ? A la chute la plus catastrophique, à l’effondrement le plus formidable. […] Aussi faut-il commencer par elle, par l’analyse de sa chute […]. La classe ouvrière, elle, ose hardiment regarder la vérité en face, même si cette vérité constitue pour elle l’accusation la plus dure, car sa faiblesse n’est qu’un errement et la loi impérieuse de l’histoire lui redonne la force, lui garantit sa victoire finale.
L’autocritique impitoyable n’est pas seulement pour la classe ouvrière un droit vital, c’est aussi pour elle le devoir suprême. Sur notre navire, nous transportions les trésors les plus précieux de l’humanité confiés à la garde du prolétariat, et tandis que la société bourgeoise, flétrie et déshonorée par l’orgie sanglante de la guerre, continue de se précipiter vers sa perte, il faut que le prolétariat international se reprenne, et il le fera, pour ramasser les trésors que, dans un moment de confusion et de faiblesse au milieu du tourbillon déchaîné de la guerre mondiale, il a laissé couler dans l’abîme.
Une chose est certaine, la guerre mondiale représente un tournant pour le monde. […] La guerre mondiale a changé les conditions de notre lutte et nous a changés nous-mêmes radicalement. Non que les lois fondamentales de l’évolution capitaliste, le combat de vie et de mort entre le capital et le travail, doivent connaître une déviation ou un adoucissement. […] Mais à la suite de l’éruption du volcan impérialiste, le rythme de l’évolution a reçu une impulsion si violente qu’à côté des conflits qui vont surgir au sein de la société et à côté de l’immensité des tâches qui attendent le prolétariat socialiste dans l’immédiat toute l’histoire du mouvement ouvrier semble n’avoir été jusqu’ici qu’une époque paradisiaque. […] Rappelons-nous comment naguère encore nous décrivions l’avenir :
[…] Le tract officiel du parti, Impérialisme ou socialisme, qui a été diffusé il y a quelques années à des centaines de milliers d’exemplaires, s’achevait sur ces mots “Ainsi la lutte contre le capitalisme se transforme de plus en plus en un combat décisif entre le Capital et le Travail. Danger de guerre, disette et capitalisme - ou paix, prospérité pour tous, socialisme ; voilà les termes de l’alternative. L’histoire va au-devant de grandes décisions. Le prolétariat doit inlassablement œuvrer à sa tâche historique, renforcer la puissance de son organisation, la clarté de sa connaissance. Dès lors, quoi qu’il puisse arriver, soit que, par la force qu’il représente, il réussisse à épargner à l’humanité le cauchemar abominable d’une guerre mondiale, soit que le monde capitaliste ne puisse périr et s’abîmer dans le gouffre de l’histoire que comme il en est né, c’est-à-dire dans le sang et la violence, à l’heure historique la classe ouvrière sera prête et le tout est d’être prêt.” […] Une semaine encore avant que la guerre n’éclate, le 26 juillet 1914, les journaux du parti allemand écrivaient “Nous ne sommes pas des marionnettes, nous combattons avec toute notre énergie un système qui fait des hommes des instruments passifs de circonstances qui agissent aveuglément, de ce capitalisme qui se prépare à transformer une Europe qui aspire à la paix en une boucherie fumante. Si ce processus de dégradation suit son cours, si la volonté de paix résolue du prolétariat allemand et international qui apparaîtra au cours des prochains jours dans de puissantes manifestations ne devait pas être en mesure de détourner la guerre mondiale, alors, qu’elle soit au moins la dernière guerre, qu’elle devienne le crépuscule des dieux du capitalisme” (Frankfurter Volksstimme) […] Et c’est alors que survint cet événement inouï, sans précédent : le 4 août 1914.
Cela devait-il arriver ainsi ? […] Le socialisme scientifique nous a appris à comprendre les lois objectives du développement historique. Les hommes ne font pas leur histoire de toutes pièces. Mais ils la font eux-mêmes. Le prolétariat dépend dans son action du degré de développement social de l’époque, mais l’évolution sociale ne se fait pas non plus en dehors du prolétariat, celui-ci est son impulsion et sa cause, tout autant que son produit et sa conséquence. Son action fait partie de l’histoire tout en contribuant à la déterminer. Et si nous pouvons aussi peu nous détacher de l’évolution historique que l’homme de son ombre, nous pouvons cependant bien l’accélérer ou la retarder. Dans l’histoire, le socialisme est le premier mouvement populaire qui se fixe comme but, et qui soit chargé par l’histoire, de donner à l’action sociale des hommes un sens conscient, d’introduire dans l’histoire une pensée méthodique et, par là, une volonté libre. Voilà pourquoi Friedrich Engels dit que la victoire définitive du prolétariat socialiste constitue un bond qui fait passer l’humanité du règne animal au règne de la liberté. Mais ce “bond” lui-même n’est pas étranger aux lois d’airain de l’histoire, il est lié aux milliers d’échelons précédents de l’évolution, une évolution douloureuse et bien trop lente. Et ce bond ne saurait être accompli si, de l’ensemble des prémisses matérielles accumulées par l’évolution, ne jaillit pas l’étincelle de la volonté consciente de la grande masse populaire. La victoire du socialisme ne tombera pas du ciel comme fatum, cette victoire ne peut être remportée que grâce à une longue série d’affrontements entre les forces anciennes et les forces nouvelles […]. Friedrich Engels a dit un jour : “La société bourgeoise est placée devant un dilemme : ou bien passage au socialisme ou rechute dans la barbarie.” Mais que signifie donc une “rechute dans la barbarie” au degré de civilisation que nous connaissons en Europe aujourd’hui ? Jusqu’ici nous avons lu ces paroles sans y réfléchir et nous les avons répétées sans en pressentir la terrible gravité. Jetons un coup d’œil autour de nous en ce moment même, et nous comprendrons ce que signifie une rechute de la société bourgeoise dans la barbarie. Le triomphe de l’impérialisme aboutit à l’anéantissement de la civilisation – sporadiquement pendant la durée d’une guerre moderne et définitivement si la période des guerres mondiales qui débute maintenant devait se poursuivre sans entraves jusque dans ses dernières conséquences. C’est exactement ce que Friedrich Engels avait prédit, une génération avant nous, voici quarante ans. Nous sommes placés aujourd’hui devant ce choix : ou bien triomphe de l’impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquences, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien victoire du socialisme, c’est-à-dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l’impérialisme et contre sa méthode d’action : la guerre. C’est là un dilemme de l’histoire du monde, un ou bien – ou bien encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire : l’avenir de la civilisation et de l’humanité en dépendent. Au cours de cette guerre, l’impérialisme a remporté la victoire. En faisant peser de tout son poids le glaive sanglant de l’assassinat des peuples, il a fait pencher la balance du côté de l’abîme, de la désolation et de la honte. Tout ce fardeau de honte et de désolation ne sera contrebalancé que si, au milieu de la guerre, nous savons retirer de la guerre la leçon qu’elle contient, si le prolétariat parvient à se ressaisir et s’il cesse de jouer le rôle d’un esclave manipulé par les classes dirigeantes pour devenir le maître de son propre destin.
La classe ouvrière paie cher toute nouvelle prise de conscience de sa vocation historique. Le Golgotha de sa libération est pavé de terribles sacrifices. Les combattants des journées de Juin, les victimes de la Commune, les martyrs de la Révolution russe – quelle ronde sans fin de spectres sanglants ! Mais ces hommes-là sont tombés au champ d’honneur, ils sont, comme Marx l’écrivit à propos des héros de la Commune, “ensevelis à jamais dans le grand cœur de la classe ouvrière”. Maintenant, au contraire, des millions de prolétaires de tous les pays tombent au champ de la honte, du fratricide, de l’automutilation, avec aux lèvres leurs chants d’esclaves. Il a fallu que cela aussi ne nous soit pas épargné. Vraiment nous sommes pareils à ces Juifs que Moïse a conduits à travers le désert. Mais nous ne sommes pas perdus et nous vaincrons pourvu que nous n’ayons pas désappris d’apprendre. Et si jamais le guide actuel du prolétariat, la social-démocratie, ne savait plus apprendre, alors elle périrait “pour faire place aux hommes qui soient à la hauteur d’un monde nouveau”.
Junius (1915)
1 ) Dont le titre est Socialisme ou barbarie.
2 ) Aussi connue sous le nom de La brochure de Junius, pseudonyme utilisé par Rosa pour le signer, ce texte est intégralement disponible sur le site marxists.org.
3 ) De pires atrocités viendront ensuite, comme la Seconde Guerre mondiale.
Rubrique:
Après le massacre de Marikana, l'Afrique du Sud est frappée par des grèves massives
- 1217 lectures
 En septembre (voir site web: RI no 435), nous analysions le contexte dans lequel s’est déroulé le massacre des mineurs en grève à Marikana par la police sud-africaine, le 16 août dernier. Nous montrions de quelle manière les syndicats et le gouvernement avaient en fait tendu un piège meurtrier aux ouvriers afin d’étrangler la dynamique de lutte qui touche depuis plusieurs mois “la plus grande démocratie africaine”. Tandis que ses flics brutalisaient et assassinaient les travailleurs en toute impunité, la bourgeoisie brandissait le thème de l’apartheid pour les entraîner sur le terrain stérile de la prétendue lutte des races dont les travailleurs noirs seraient les victimes. Si les grèves semblaient s’étendre à d’autres mines, il nous était toutefois impossible de déterminer avec certitude si elles glisseraient effectivement sur le terrain du conflit inter-racial ou continueraient à s’étendre.
En septembre (voir site web: RI no 435), nous analysions le contexte dans lequel s’est déroulé le massacre des mineurs en grève à Marikana par la police sud-africaine, le 16 août dernier. Nous montrions de quelle manière les syndicats et le gouvernement avaient en fait tendu un piège meurtrier aux ouvriers afin d’étrangler la dynamique de lutte qui touche depuis plusieurs mois “la plus grande démocratie africaine”. Tandis que ses flics brutalisaient et assassinaient les travailleurs en toute impunité, la bourgeoisie brandissait le thème de l’apartheid pour les entraîner sur le terrain stérile de la prétendue lutte des races dont les travailleurs noirs seraient les victimes. Si les grèves semblaient s’étendre à d’autres mines, il nous était toutefois impossible de déterminer avec certitude si elles glisseraient effectivement sur le terrain du conflit inter-racial ou continueraient à s’étendre.
Depuis la publication de notre article, nous avons assisté au plus important mouvement de grève en Afrique du Sud depuis la fin de l’apartheid en 1994. Ces grèves sont doublement significatives car, non seulement elles démontrent – si cela était encore nécessaire – que derrière le prétendu miracle économique des “pays émergents” se cache, comme partout, une misère croissante, mais elles mettent également en évidence que les travailleurs du monde entier, loin d’avoir des intérêts divergents, se battent partout contre les conditions de vie indignes qu’impose le capitalisme. A ce titre, malgré les faiblesses sur lesquelles nous reviendrons, les grèves qui secouent l’Afrique du Sud s’inscrivent dans le sillage des luttes ouvrières de par le monde.
Face aux mineurs, l’Etat divise, épuise et terrorise
Suite au massacre du 16 août, la lutte semblait devoir s’essouffler, écrasée par le poids des manœuvres de la bourgeoisie. En effet, tandis que la grève s’étendait à plusieurs autres mines avec des revendications identiques, une concertation de requins était organisée entre les seuls syndicats de Marikana, la direction et l’Etat, le tout sous la très sainte médiation de dignitaires religieux. La manœuvre visait à étouffer l’extension des grèves en divisant les ouvriers entre ceux, d’une part, qui bénéficiaient de négociations et de toute l’attention médiatique et ceux, d’autre part, qui se lançaient dans la grève dans l’indifférence générale, à l’exception de l’attention des flics (blancs et noirs) qui poursuivaient leur campagne de terreur, leurs provocations et leurs descentes nocturnes.
Sur le terrain, l’AMCU, syndicat qui avait profité du déclenchement de la grève sauvage à Marikana le 10 août pour lancer ses gros bras dans une guerre de territoire meurtrière contre son concurrent du MUN, incitait les ouvriers à s’en prendre physiquement aux mineurs qui avaient repris le travail : “La police ne pourra pas les protéger tout le temps, la police ne dort pas avec eux dans leurs baraquements. Si tu vas travailler, tu dois savoir que tu vas en subir les conséquences.” A cause du blackout médiatique qui s’est brutalement abattu sur cette lutte, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si les ouvriers ont effectivement cédé à la violence ou si les syndicats ont poursuivi leur règlement de comptes sous couvert des grèves ; toujours est-il que plusieurs assassinats et agressions ont été perpétuées tout au long du mouvement.
Bien que la propagande autour du “retour de l’apartheid” n’ait jamais réellement été prise au sérieux par les ouvriers, dans un tel contexte, la lutte refluait bel et bien. Pourtant, à ce stade, le mouvement connaissait un nouveau souffle.
La grève s’étend
Le 30 août, la population apprenait, par l’intermédiaire du journal de Johannesburg, The Star, qu’en affirmant avoir tiré sur les mineurs de Marikana “en Etat de légitime défense”, la police avait menti éhontément puisque les rapports d’autopsie montraient que les mineurs avaient en fait été abattus dans le dos, en essayant de fuir leurs bourreaux. Selon plusieurs témoignages de journalistes présents sur place, les flics pourchassaient même les grévistes pour les assassiner de sang froid. Or, presque au même moment, le tribunal de Pretoria annonçait son intention d’inculper les deux cent soixante-dix mineurs arrêtés le 16 août lors de la fusillade policière... pour le meurtre de leurs camarades ( !), en vertu d’une loi anti-émeute prévoyant l’inculpation pour meurtre de toutes les personnes arrêtées sur le site d’une fusillade impliquant la police. C’est que, dans “la plus grande démocratie africaine”, on ne fait pas dans la dentelle ; tandis qu’aucun des policiers qui ont abattu les mineurs de Marikana n’a été inquiété, l’Etat inculpe les survivants de la fusillade. Avec un peu d’imagination, le tribunal de Pretoria aurait presque pu exécuter une seconde fois les morts pour leur propre assassinat !
La consternation fût telle que, le 2 septembre, le tribunal était contraint de reculer en annonçant l’annulation des inculpations et la libération de l’ensemble des prisonniers. Surtout, l’Etat se rendait rapidement compte de son erreur puisque, sur la base des mêmes revendications, les grèves se sont aussitôt multipliées dans la plupart des mines du pays. En effet, le 31 août, quinze mille employés d’une mine d’or exploitée par le groupe Gold Fields, près de Johannesburg, lançaient une grève sauvage. Le 3 septembre, les mineurs de Modder East, employés par Gold One, entraient à leur tour dans la lutte. Le 5 septembre, presque tous les mineurs de Marikana manifestaient sous les acclamations de la population et refusaient, le lendemain, de s’associer à l’accord minable signé entre les syndicats et la direction de Lomin. Dès le 14 septembre, les compagnies Amplats, Aquarius et Xstrata, qui exploitent chacune plusieurs sites, annonçaient la suspension de leur activité, tandis que la production de presque l’ensemble des mines du pays semblait à l’arrêt. La vague de grève devait même s’étendre à d’autres secteurs, en particulier celui des transporteurs routiers.
Cette dynamique était, en partie, alimentée par l’indignation suscitée par les témoignages des grévistes emprisonnés : “Ils [les policiers] nous ont frappés et nous ont giflés, nous ont marchés sur les doigts avec leurs bottes”, “Je n’arrive toujours pas à comprendre ce qui m’est arrivé, c’est ma première fois en prison ! Nous réclamions une hausse de salaire et ils se sont mis à nous tirer dessus, et en prison les policiers nous ont battus, ils ont même volé les 200 rands [20 euros] que j’avais sur moi !”
Lent reflux de la lutte
La terreur policière s’abattait également sur les grévistes en liberté par le biais d’interventions très violentes, occasionnant des arrestations pour des motifs incongrus, de nombreux blessés et plusieurs morts (1). Ainsi, le 14 septembre, le porte-parole du gouvernement déclarait : “Il est nécessaire d’intervenir car nous sommes arrivés à un point où il faut faire des choix importants.” Après ce bel exemple de phrase creuse dont seuls les politiciens ont le secret, le porte-parole ajoutait, beaucoup moins laconiquement : “Si nous laissons cette situation se développer, l’économie va en souffrir gravement.” Le lendemain, une descente extrêmement brutale était organisée, vers deux heures du matin, dans les dortoirs abritant les ouvriers de Marikana et leur famille. La police, appuyée par l’armée, blessait de nombreuses personnes, dont plusieurs femmes. Au matin, des émeutes éclataient, des barricades étaient dressées sur les routes. Il n’en fallait pas moins à la police pour déchaîner sa violence sur les ouvriers de tout le pays au nom de la “sécurité des personnes”.
Tandis que ses flics terrorisaient la population, l’Etat, avec la complicité des syndicats, portait un coup important à la lutte, le 18 septembre, en accordant aux seuls mineurs de Marikana des augmentations de 11 à 22 %. Cette victoire en trompe-l’œil visait clairement à diviser les ouvriers et à priver le mouvement des travailleurs qui étaient jusque-là au cœur de la lutte. En clair, la bourgeoisie sacrifiait 22 % aux mineurs de Marikana pour étouffer la combativité des autres grévistes, stopper l’extension de la lutte et priver la plupart des ouvriers des augmentations de salaire revendiquées.
Pourtant, le 25 septembre, les neuf mille employés de la mine Beatrix entraient à leur tour en grève, ceux de Atlatsa se lançaient dans la lutte le 1er octobre. La violence de la police s’éleva à nouveau d’un cran avec son lot d’interpellations brutales, de matraquages et d’assassinats. Le 5 octobre, la compagnie Amplats sortait la grosse artillerie en annonçant le licenciement de douze mille mineurs. Dans la foulée, plusieurs compagnies, appuyées par les tribunaux, menacèrent de licencier massivement à travers un chantage écœurant : soit les ouvriers acceptaient les misérables augmentations de salaire proposées par les directions, soit ils étaient mis à la porte. Gold One devait finalement licencier mille quatre cents personnes, Gold Field mille cinq cents autres, etc.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les dernières poches de grévistes retournent peu à peu au travail. Mais cette lutte, et malgré les faiblesses qui l’ont caractérisée, exprime une certaine élévation de la conscience de classe. Les ouvriers sud-africains ont ressenti la nécessité de lutter collectivement, ont formulé des revendications précises et unitaires, ont constamment cherché à étendre leur combat. Dans un contexte où la crise et la misère vont inexorablement s’approfondir, ce mouvement est une expérience inaltérable dans le développement de la conscience de tous les prolétaires de la région et une leçon pour les prolétaires du monde entier.
El Generico, 22 octobre
1 ) Il est encore impossible de déterminer le nombre de grévistes abattus par la police sud-africaine, mais la presse a rapporté sept morts à Rustenburg et au moins un mort dans les rangs des chauffeurs de camion.
Géographique:
Rubrique:
Pourquoi est-il si difficile de lutter et comment dépasser ces difficultés?
- 1246 lectures
Tout semble a priori favorable à une explosion sans précédent de la colère ouvrière. La crise est manifeste, elle n’échappe à personne, et personne n’y échappe. Peu croient encore à la “sortie de crise” dont on nous rebat les oreilles quotidiennement. La planète nous déroule tout aussi quotidiennement son spectacle de désolation : guerres et barbarie, famines insupportables, épidémies, sans parler des manipulations irresponsables d’apprentis-sorciers délirants auxquels les capitalistes se livrent avec la nature, la vie et notre santé, au seul nom du profit.
Face à tout cela, il est difficile d’imaginer qu’un autre sentiment que la révolte et l’indignation puisse occuper les esprits. Il est difficile de penser qu’une majorité de prolétaires croient encore à un avenir sous le capitalisme. Et pourtant, les masses n’ont pas encore pleinement pris le chemin de la lutte. Faut-il alors penser que les jeux sont faits, que le rouleau compresseur de la crise est trop puissant, que la démoralisation qu’il engendre est indépassable ?
De grandes difficultés…
On ne peut nier que la classe ouvrière connaît actuellement des difficultés importantes. Il y a au moins quatre raisons essentielles à cela :
• La première, de loin la plus centrale, c’est tout simplement le fait que le prolétariat n’a pas conscience de lui-même, qu’il a perdu sa propre identité de classe. Suite à la chute du mur de Berlin, toute une propagande s’était en effet déchainée dans les années 1990 pour tenter de nous convaincre de la faillite historique du communisme. Les plus audacieux – et les plus stupides – annonçaient même “la fin de l’histoire”, le triomphe de la paix et de la “démocratie”… En amalgamant le communisme à la carcasse du monstre stalinien putréfié, la classe dominante a cherché à discréditer par avance toute perspective de classe visant à renverser le système capitaliste. Non contente de chercher à détruire toute idée de perspective révolutionnaire, elle s’est aussi efforcée de faire du combat prolétarien une sorte d’archaïsme bon à préserver comme “mémoire culturelle” au musée de l’Histoire, à l’instar des fossiles de dinosaures ou de la grotte de Lascaux.
Surtout, la bourgeoisie n’a cessé d’insister sur le fait que la classe ouvrière sous sa forme classique avait disparu de la scène politique. Tous les sociologues, journalistes, politiciens et philosophes du dimanche rabâchent l’idée que les classes sociales ont disparu, fondues dans le magma informe des “classes moyennes”. C’est le rêve permanent de la bourgeoisie d’une société où les prolétaires ne se verraient qu’en simples “citoyens”, divisés en catégories socioprofessionnelles plus ou moins bien discernées et surtout bien divisées – en cols blancs, cols bleus, employés, précaires, chômeurs, etc. – avec des intérêts divergents et qui ne “s’unissent” que momentanément, isolés et passifs, dans les urnes. Et il est vrai que le battage sur la disparition de la classe ouvrière, répété et asséné à grands renforts de reportages, de livres, d’émissions télévisés… a eu pour résultat que nombre d’ouvriers ne parviennent pour l’instant plus à se concevoir comme partie intégrante de la classe ouvrière et encore moins comme classe sociale indépendante.
• De cette perte de l’identité de classe découle, en second lieu, les difficultés du prolétariat à affirmer son combat et sa perspective historique. Dans un contexte où la bourgeoisie elle-même n’a aucune perspective à offrir autre que l’austérité, le chacun pour soi, l’isolement et le sauve-qui-peut dominent. La classe dominante exploite ses sentiments pour monter les exploités les uns contre les autres, les diviser pour empêcher toute riposte unie, pour les pousser au désespoir.
• Le troisième facteur, comme conséquence des deux premiers, c’est que la brutalité de la crise tend à paralyser de nombreux prolétaires, à cause de la peur de tomber dans la misère absolue, de ne pouvoir nourrir sa famille et de se retrouver à la rue, isolé et exposé à la répression. Même si certains, mis au pied du mur, sont poussés à manifester leur colère, à l’image des “Indignés”, ils ne se conçoivent pas comme une réelle classe en lutte. Ceci, malgré les efforts et le caractère parfois relativement massif des mouvements, limite la capacité à résister aux mystifications et aux pièges tendus par la classe dominante, à se réapproprier les expériences de l’histoire, à tirer des leçons avec le recul et la profondeur nécessaires.
• Il y a enfin un quatrième élément important pour expliquer les difficultés actuelles de la classe ouvrière à développer sa lutte contre le système : c’est l’arsenal d’encadrement de la bourgeoisie, ouvertement répressif, comme les forces de police, ou surtout plus insidieux et bien plus efficaces, comme les forces syndicales. Sur ce dernier aspect, notamment, la classe ouvrière n’est pas encore parvenue à dépasser ses craintes de lutter en dehors de leur encadrement, même si ceux qui ont encore des illusions sur la capacité des syndicats à défendre nos intérêts sont de moins en moins nombreux. Et cet encadrement physique se double d’un encadrement idéologique plus ou moins maîtrisé par les syndicats, les médias, les intellectuels, les partis de gauche, etc. Ce que la bourgeoisie réussit aujourd’hui le plus à développer est sans conteste l’idéologie démocratique. Tout événement est exploité pour vanter les bienfaits de la démocratie. La démocratie est présentée comme le cadre où toutes les libertés se développent, où toutes les opinions s’expriment, où le pouvoir est légitimé par le peuple, où les initiatives sont favorisées, où tout le monde peut accéder à la connaissance, à la culture, aux soins et, pourquoi pas, au pouvoir. En réalité, la démocratie n’offre qu’un cadre national au développement du pouvoir des élites, du pouvoir de la bourgeoisie, et le reste n’est qu’illusion, l’illusion qu’en passant par l’isoloir on exerce un quelconque pouvoir, que dans l’hémicycle s’expriment les opinions de la population au travers du vote de “représentants”. Il ne faut pas sous-estimer le poids de cette idéologie sur les consciences ouvrières, tout comme il ne faut pas oublier le choc extrême qu’aura provoqué l’effondrement du stalinisme à la charnière des années 1980 et 1990. A tout cet arsenal idéologique vient s’ajouter l’idéologie religieuse. Elle n’est pas nouvelle si l’on considère qu’elle a accompagné l’humanité depuis ses premiers pas dans le besoin de comprendre son environnement. Elle n’est pas nouvelle non plus si on se rappelle à quel point elle est venue légitimer toutes sortes de pouvoirs à travers l’histoire. Mais aujourd’hui, ce qu’elle présente d’original est qu’elle vient se greffer aux réflexions d’une partie de la classe ouvrière face au capitalisme destructeur et en faillite. Elle vient dévoyer cette réflexion en expliquant la “décadence” du monde occidental dans son éloignement des valeurs portées depuis des millénaires par la religion, en particulier les religions monothéistes. L’idéologie religieuse a cette force qu’elle réduit à néant la complexité extrême de la situation. Elle n’apporte que des réponses simples, faciles à mettre en œuvre. Dans ses formes intégristes, elle ne convainc qu’une petite minorité d’ouvriers, mais de façon plus générale, elle contribue à parasiter la réflexion de la classe ouvrière.
… et un formidable potentiel
Ce tableau est un peu désespérant : face à une bourgeoisie qui maîtrise ses armes idéologiques, à un système qui menace de misère la plus grande partie de la population, quand elle ne l’y plonge pas directement, y a-t-il encore une place pour développer une pensée positive, pour dégager un espoir ? Y a-t-il vraiment encore une force sociale capable de mener à bien une œuvre aussi immense que la transformation radicale de la société, rien de moins ? A cette question, il faut répondre sans hésitation : oui ! Cent fois oui ! Il ne s’agit pas d’avoir une confiance aveugle dans la classe ouvrière, une foi quasi-religieuse dans les écrits de Marx ou un élan désespéré dans une révolution perdue d’avance. Il s’agit de prendre du recul, d’avoir une analyse sereine de la situation, au delà des enjeux immédiats, tenter de comprendre ce que signifient réellement les luttes de la classe ouvrière sur la scène sociale et étudier en profondeur le rôle historique du prolétariat.
Dans notre presse, nous avons déjà analysé que, depuis 2003, la classe ouvrière est dans une dynamique positive par rapport au recul qu’elle a subi avec l’effondrement des pays de l’Est. De nombreuses manifestations de cette analyse se retrouvent dans des luttes plus ou moins importantes mais qui ont toutes pour caractéristique de montrer la réappropriation progressive par la classe de ses réflexes historiques comme la solidarité, la réflexion collective, et plus simplement, l’enthousiasme face à l’adversité.
Nous avons pu voir ces éléments à l’œuvre dans les luttes contre les réformes des retraites en France en 2003 et en 2010-2011, dans la lutte contre le CPE, toujours en France, en 2006, mais aussi de façon moins étendue en Grande-Bretagne (aéroport d’Heathrow, raffineries de Lindsay), aux Etats-Unis (Métro de New York), en Espagne (Vigo), en Egypte, à Dubaï, en Chine, etc. Les mouvements des Indignés et Occupy, surtout, reflètent une expression beaucoup plus générale et ambitieuse que des luttes se développant au sein d’une entreprise, par exemple. Qu’avons-nous vu, notamment, dans les mouvements des Indignés ? Des ouvriers de tous horizons, du précaire au cadre, simplement venus pour vivre une expérience collective et attendre d’elle une meilleure compréhension des enjeux de la période. Nous avons vu des personnes s’enthousiasmer à la seule idée de pouvoir à nouveau discuter librement avec d’autres. Nous avons vu des personnes discuter d’expériences alternatives et d’en poser les atouts et les limites. Nous avons vu des personnes refuser d’être les victimes impassibles d’une crise qu’ils n’ont pas provoquée et qu’ils refusent de payer. Nous avons vu des personnes mettre en place des assemblées spontanées, y adopter des formes d’expression favorisant la réflexion et la confrontation, limitant la perturbation et le sabotage des discussions. Enfin et surtout, le mouvement des Indignés a permis l’éclosion d’un sentiment internationaliste, la compréhension que, partout dans le monde, nous subissons la même crise et que nous devons lutter contre elle par-delà les frontières.
Certes, nous n’avons pas, ou peu, entendu parler explicitement de communisme, de révolution prolétarienne, de classe ouvrière et de bourgeoisie, de guerre civile, etc. Mais ce que ces mouvements ont montré, c’est avant tout l’exceptionnelle créativité de la classe ouvrière, sa capacité à s’organiser, issues de son caractère inaliénable de force sociale indépendante. La réappropriation consciente de ces caractéristiques est encore au bout d’un chemin long et tortueux, mais elle est indéniablement à l’œuvre. Elle s’accompagne forcément d’un processus de décantation, de reflux, de découragement partiel. Elle alimente cependant la réflexion des minorités qui se situent à l’avant-garde du combat de la classe ouvrière au niveau mondial, et dont le développement est visible, quantifiable, depuis plusieurs années.
C’est un processus sain qui contribue à la clarification des enjeux auxquels la classe ouvrière est confrontée aujourd’hui.
Finalement, même si les difficultés posées à la classe ouvrière sont énormes, rien ne permet dans la situation d’affirmer que les jeux sont faits, que la classe ouvrière n’aura pas la force de développer des luttes massives puis révolutionnaires. Bien au contraire, les expressions vivantes de la classe se multiplient et en étudiant ce qu’elles ont vraiment, non en apparence, où seule leur fragilité est évidente, mais en profondeur, alors apparaît le potentiel, la promesse d’avenir qu’elles contiennent. Leur caractère minoritaire, épars et sporadique n’est là que pour nous rappeler que les principales qualités des révolutionnaires sont la patience et la confiance en la classe ouvrière1 ! Cette patience et cette confiance s’appuie sur la compréhension de ce qu’est historiquement, la classe ouvrière : la première classe à la fois exploitée et révolutionnaire qui a pour mission d’émanciper toute l’humanité du joug de l’exploitation. Il s’agit là d’une vision matérialiste, historique, à long terme ; c’est cette vision qui nous a permis d’écrire en 2003, lorsque nous dressions le bilan de notre XVe congrès international : “Comme le disent Marx et Engels, il ne s’agit pas de considérer “ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier imagine momentanément comme but. Seul importe ce qu’il est et ce qu’il sera historiquement contraint de faire conformément à cet être” (la Sainte famille). Une telle vision nous montre notamment que, face aux coups très forts de la crise du capitalisme, qui se traduisent par des attaques de plus en plus féroces, la classe réagit et réagira nécessairement en développant son combat. Ce combat, à ses débuts, sera fait d’une série d’escarmouches, lesquelles annonceront un effort pour aller vers des luttes de plus en plus massives. C’est dans ce processus que la classe se comprendra à nouveau comme une classe distincte, ayant ses propres intérêts et tendra à retrouver son identité, aspect essentiel qui en retour stimulera sa lutte.”
GD / 25.10.2012
1) Lénine aurait ajouté l‘humour !
Rubrique:
La crise est-elle locale, épargne-t-elle des pays ou des formes de gouvernement? (cycle de discussion sur la crise II)
- 1189 lectures
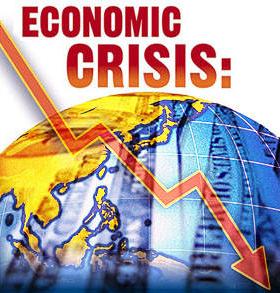 En avril et mai 2012, le CCI, avec une partie de ses sympathisants et autres intéressés venant d’horizons divers, a organisé un cycle de trois discussions sur la crise.
En avril et mai 2012, le CCI, avec une partie de ses sympathisants et autres intéressés venant d’horizons divers, a organisé un cycle de trois discussions sur la crise.
Dans la discussion l’accent a été mis sur la culture du débat et tous étaient invités à prendre part au débat. Nous soulignions que ce n’était pas une affaire d'experts car mêmes les plus grands experts économiques bourgeois n’avaient pas vu venir la crise. Et pourtant, ils dominent maintenant le débat dans les médias. A été posé le fait que pour nous il était grand temps que nous allions vers des arguments solides sur les causes des symptômes récurrents toujours plus graves de la crise et pourquoi cela ressemble de plus en plus à une crise du capitalisme en tant que système, aussi bien économiquement, socialement que politiquement.
La question se pose : réforme ou renversement révolutionnaire? Dans la contribution suivante, nous proposons la deuxième introduction de ce cycle. La discussion qui a suivi a été très animée et traversée d’une participation enthousiaste de tous les participants.
Un recueil de textes a été créé au service des participants. Il peut aussi être envoyé sur simple demande.
Qu’en est-il des pays “socialistes”, tels la Chine, la Corée du Nord ou Cuba ou les fameux pays BRICS
Tandis que les économies de l’ouest sont entraînés depuis la fin des années 1960 dan une spirale sans fin de secousses économiques, la bourgeoisie de droite comme de gauche nous assène régulièrement que ce n’est pas son système qui est en crise, puisqu’il y a des endroits dans le monde qui y échappent.
Ses représentants de gauche renvoient régulièrement dans la direction des pays “socialistes”, comme la Chine, Cuba, voire la Russie ... Ses représentants plus libéraux pointent plutôt du doigt vers les “miracles économiques” comme l’Argentine, les “Tigres asiatiques” dans les années 1980/ 90, mais plus récemment aussi vers l’Irlande, l’Islande, l’Espagne, et surtout aujourd’hui vers les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine) pour mettre en valeur le dynamisme du système.
Les pays “socialistes” vers lesquels on renvoyait il y a 25 ans étaient l’Union Soviétique et son bloc qui ont depuis lors disparu en 1989, après qu’ils se sont effondrés sous la pression de la crise économique et de la pression de la concurrence impérialiste du bloc américain (vu le poids des gigantesques « frais improductifs » dans le secteur militaire). La Corée du Nord ne tient que grâce au soutien chinois et sa population est régulièrement confrontée à la famine. Cuba enfin a déclaré récemment qu’elle voulait aussi ouvrir son économie aux capitaux étrangers sous un contrôle strict de l’Etat, comme d’autres pays (La Chine, le Vietnam) l’ont fait.
Les « données objectives »
Certaines « données objectives » sont indispensables pour donner une certaine crédibilité aux mensonges. Quelles sont celles que la propagande bourgeoise avance pour donner foi à son histoire ? Relevons les données concernant la Chine, dans la mesure où elles illustrent de la manière la plus marquée les faits également relevés dans le cas d’autres pays.
1. Durant les trente années de crise et de mondialisation (1980-2008), tandis que l’Europe voyait son Produit Intérieur Brut(1) augmenter de 1,7 fois, celui des USA de 2,2 fois, celui de l’ensemble de l’économie mondiale de 2,5 fois, l’Inde a vu le sien augmenter de 4 fois, les pays en développement d’Asie de 6 fois et la Chine de 10 fois.
2. La Chine est aujourd’hui l’atelier du monde et le secteur des services y a connu une croissance énorme. Le nombre d’emplois dans le secteur industriel, qui est de 170 millions, est de 40% supérieur à celui de l’ensemble des pays de l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques) qui en comptent 123 millions, alors qu’en 1952, la Chine était encore pour l’essentiel (84% de la population) un pays agraire.
3. La croissance économique annuelle est de 8 à 10% et la Chine ne produit plus seulement des produits de base pour l ‘exportation ou des produits d’assemblage dans ses ateliers à salaires base ; elle produit et exporte de plus en plus de produits à haute valeur ajoutée, comme de l’électronique et des matériaux de transport.
Par ailleurs, les salaires bas et les conditions de travail extrêmes sont utilisés par la bourgeoisie comme moyen de chantage à l’Ouest par rapport à l’emploi (menaces de délocalisation) ou aux salaires et aux conditions de travail.
Les données aujourd’hui
L’enthousiasme s’est quelque peu refroidi et les chiffres spectaculaires de croissance du PIB appartiennent tout doucement au passé. La deuxième économie mondiale connaît aujourd’hui deux contretemps inquiétants :
- La récession qui sévit dans les économies occidentales, le principal marché pour ses exploitations, a eu un impact direct sur ses chiffres de croissance, qui sont en baisse.
- Elle connait une forte inflation de plus de 10%, malgré l’intervention monétaire de l’Etat chinois depuis 2008, qui va de pair avec une énorme bulle financière spéculative (plus de 1700 milliards de dollars), qu’elle n’arrive pas à contrôler.
En réalité, la croissance de la Chine et d’autres pays constituant un « miracle économique » n’a été possible qu’à cause de la crise mondiale de l’économie capitaliste. En cas de stagnation ou de recul du taux de profit réel sur le plan mondial, le capital va à la recherche d’un environnement adéquat pour contrer cette tendance. Ces conditions, c’est des salaires bas et un contexte politique favorable. Cela explique aussi pourquoi la Chine s’est développée grâce aux exportations, mais dépend aussi de manière cruciale de celles-ci, malgré un développement relatif de son marché intérieur.
Mais c’est la même crise qui coince aujourd’hui la Chine entre le marteau et l’enclume, entre le marteau du marché extérieur qui se réduit et l’enclume du marché intérieur qu’elle doit soutenir, entre une inflation menaçante et des bulles spéculatives qui risquent d’exploser.
La situation n’est pas différente pour les autres « pays émergents », comme l’Inde et le Brésil par exemple. Pour eux aussi, la baisse des activités économiques à cause d’un marché mondial qui se réduit est une réalité actuelle (baisse de la croissance pour l’Inde de 9,3% à 7,2%, pour le Brésil de 7,5% à 3,7% de 2010 à 2011). DE même, ils sont confrontés à l’inflation et à des problèmes monétaires. Ainsi, une des premières décisions de la nouvelle présidente brésilienne D. Rousseff après sa victoire électorale a été d’imposer un ensemble de mesures d’austérité pour 30 milliards de dollars et d’augmenter le taux d’intérêt pour l’emprunt d’argent auprès de la banque centrale du Brésil à 12%.
Bref,
Aucun pays ne peut échapper aux lois du capitalisme mondial et à leurs conséquences. La crise économique qui continue à affaiblir le système capitaliste n’est pas une histoire sans fin, elle annonce la fin d’un système , mais aussi la nécessité de la lutte contre sa barbarie et pour un monde nouveau : le communisme.
(1) Le Prodit Intérieur Brut (PIB) peut être défini (cf. Wikipedia) comme l’ensemble de la valeur monétaire de tous les biens et services produits dans un pays donné (par l’Etat et le privé) pendant une période donnée (généralement un an). Généralement le PIB est fourni sur la base des prix du marché.
Rubrique:
En Israël et en Palestine, la population est otage de la guerre impérialiste
- 1683 lectures
 Une fois de plus, les tirs de roquette israéliens ont submergé Gaza. En 2008, l’opération « plomb durci » avait provoqué presque 1500 morts, pour la plupart des civils, malgré les déclarations prétendant que seules les cibles terroristes faisaient l’objet de « frappes chirurgicales » . La Bande de Gaza est une des régions où la densité de population est la plus forte mais aussi une des plus pauvres du monde. Il est ainsi absolument impossible de distinguer les « dommages infligés aux terroristes » et ceux causés aux civils qui les entourent. Avec les armes sophistiquées dont Israël dispose, la majorité des dommages de la campagne militaire actuelle touche aussi les femmes, les enfants et les vieillards.
Une fois de plus, les tirs de roquette israéliens ont submergé Gaza. En 2008, l’opération « plomb durci » avait provoqué presque 1500 morts, pour la plupart des civils, malgré les déclarations prétendant que seules les cibles terroristes faisaient l’objet de « frappes chirurgicales » . La Bande de Gaza est une des régions où la densité de population est la plus forte mais aussi une des plus pauvres du monde. Il est ainsi absolument impossible de distinguer les « dommages infligés aux terroristes » et ceux causés aux civils qui les entourent. Avec les armes sophistiquées dont Israël dispose, la majorité des dommages de la campagne militaire actuelle touche aussi les femmes, les enfants et les vieillards.
Cela laisse les militaires à la tête de l’État israélien froid. Gaza a été une fois de plus punie, comme ce fut le cas lors du massacre précédent et à travers le blocus de l'économie, empêchant les efforts de reconstruction après les ravages de 2008 et laissant la population affamée.
Comparé au feu guerrier déclenché par l’Etat israéliens, les capacités militaires du Hamas et des autres groupes djihadistes radicaux de Gaza sont dérisoires. Grâce au chaos en Libye, le Hamas a cependant obtenu des missiles de longue portée plus efficace. Non seulement Ashdod au Sud (où trois résidents d’un bloc d’immeubles ont été tués par un missile venant de Gaza) mais Tel-Aviv et Jérusalem également sont à présent à leur portée. La menace de paralysie qui saisit Gaza commence aussi à se faire sentir dans les principales villes israéliennes.
Bref : les deux populations sont tenues en otage par les arsenaux militaires opposés et qui dominent Israël et la Palestine – avec une aide discrète de l’armée égyptienne qui patrouille aux frontières de Gaza pour empêcher les incursions ou les évasions indésirables. Les deux populations sont victimes d’une situation de guerre permanente – non seulement sous la forme de roquettes et de bombes, mais aussi en étant appelées à soutenir le poids grandissant d’une économie plombée par les besoins de la guerre. De plus, la crise économique mondiale contraint aujourd’hui la classe dominante israélienne et palestinienne à mettre en place de nouvelles mesures de restrictions du niveau de vie, à augmenter les prix des produits de première nécessité.
En Israël, l’an dernier, le prix déjà élevé des logements a été une des étincelles qui a allumé le mouvement de protestation qui a pris la forme de manifestations massives et d’assemblées – mouvement qui était directement inspiré des révoltes du monde arabe et qui avait pour mots d’ordre « Netanyahou, Assad, Moubarak sont tous les mêmes » et « Arabes et Juifs veulent des logements accessibles et décents».
Au cours de cette période courte mais stimulante, tout dans la société israélienne était ouvert à la critique et au débat – y compris le « problème palestinien », l’avenir des colonies et des territoires occupés. Une des plus grandes peurs des protestataires était que le gouvernement réponde à ce défi naissant à « l’unité » nationale en se lançant dans une nouvelle aventure militaire.
De même, l'été dernier, dans la région des territoires occupés de la Bande de Gaza, les augmentations du carburant et des prix de la nourriture ont provoqué une série de manifestations de colère, avec des blocages de route et des grèves. Les ouvriers du transport, de la santé et de l’éducation, des étudiants des universités et des écoles ainsi que des chômeurs, se sont retrouvés dans la rue face à la police de l’Autorité palestinienne en exigeant des hausses de salaires, du travail, des baisses de prix et la fin de la corruption. Il y a également eu des manifestations contre le coût de la vie dans le royaume de Jordanie.
Malgré les différences de niveau de vie entre les populations israélienne et palestinienne, en dépit du fait que cette dernière subit en plus l’oppression et l’humiliation militaire, les racines de ces deux révoltes sociales sont exactement les mêmes : l’impossibilité grandissante de vivre dans un système capitaliste profondément en crise .
Il y a eu beaucoup de spéculations sur les motifs de la dernière escalade militaire. Netanyahou essaie-t-il de faire monter le nationalisme pour améliorer ses chances de réélection ? Le Hamas a-t-il provoqué ses attaques à la roquette pour prouver son crédit militaire devant le défi que posent les bandes islamistes plus radicales ? Quel rôle sera appelé à jouer dans le conflit le nouveau régime en Égypte ? Comment ces événements vont-ils affecter la guerre civile en Syrie ?
Toutes ces questions, pertinentes en elles-mêmes, ne permettent pas de répondre au problème de fond qui les relie. La réalité, c'est qu'il s'agit d'une escalade guerrière de nature impérialiste, aux antipodes des intérêts et des besoins des populations israéliennes, palestiniennes et plus largement du Moyen-Orient.
Alors que les révoltes sociales des deux côtés permettent aux exploités de se battre pour leurs intérêts matériels contre les capitalistes et l’État qui les exploite, la guerre impérialiste crée une fausse unité entre les exploités et leurs exploiteurs, renforce les divisions des exploités des deux côtés. Lorsque les avions d’Israël bombardent Gaza, cela fait des nouvelles recrues pour le Hamas et les djihadistes pour lesquels tous les Israéliens sont l’ennemi. Lorsque les djihadistes tirent à coups de roquettes sur Ashdod ou Tel-Aviv, encore plus d’Israéliens se tournent vers la protection et les appels à la vengeance de « leur » État contre les « Arabes ». Les problèmes sociaux pressants qui existent derrière les révoltes sont écrasés sous une avalanche de haine et d’hystérie nationalistes.
Petites ou grandes, toutes les nations sont impérialistes ; petites ou grandes, toutes les fractions bourgeoises n’ont jamais aucun scrupule à utiliser la population comme chair à canon au nom des intérêts de la patrie. D’ailleurs, devant l’escalade actuelle de la violence à Gaza, quand les gouvernements « responsables » et démocratiques comme ceux des États-Unis et de la Grande-Bretagne appellent à « l’apaisement », au retour vers « le processus de paix », l’hypocrisie atteint des sommets. Car ce sont ces mêmes gouvernements qui font la guerre en Afghanistan, au Pakistan, en Irak. Les États-Unis sont aussi le principal soutien financier et militaire d’Israël. Les grandes puissances impérialistes n’ont aucune solution « pacifiques » pas plus que les États comme l’Iran qui arme le Hamas et le Hezbollah. Le réel espoir d’une paix mondiale ne se trouve pas chez « nos » dirigeants, mais dans la résistance des exploités, dans leur compréhension grandissante qu’ils ont les mêmes intérêts dans tous les pays, le même besoin de lutter et de s’unir contre un système qui ne peut rien offrir d’autre que la crise, la guerre et la destruction.
Amos (20 novembre 2012)
Géographique:
Rubrique:
Internationalisme - 2013
- 1218 lectures
Internationalisme no 357 - 1er trimestre 2013
- 1010 lectures
Après Ford-Genk, Arcelor Mittal, Caterpillar... encore plus d'austérité, de licenciements, de précarité... l'unification et la solidarité sont nécessaires!
- 1560 lectures
Mais comment?
Après la fermeture de Ford-Genk, c’est 1.400 des 4.000 jobs qui sont supprimés chez Caterpillar. ArcelorMittal pour sa part arrête 7 de ses 12 lignes de production de l’acier à froid à Liège: 1.300 licenciements sont annoncés. Depuis 2011, 800 emplois avaient déjà disparu par la fermeture de la production à chaud.. À Bruxelles, à Gand, à Schoten et à Overpelt aussi, des licenciements ont été annoncés les deux dernières années. Ils font partie des 9.000 jobs qui disparaissent mondialement, selon ce que ArcelorMittal avait déjà annoncé en 2008 (1): la bourgeoisie belge «oublie» en effet souvent de mentionner les pertes d'emplois en France, en Espagne, au Luxembourg .... Et n’oublions pas d’autres drames dans des entreprises diverses, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger: Beckaert, Belfius, Carsid, Dow Chemical, Duferco, ING, NLMK, Philips, Siemens… Dans tous ces cas, il s’agit de licenciements, de fermetures d’unités de production ou d'autres mesures d'économie. Les services publics n'échappent pas à la vague des rationalisations: les réformes du secrétaire d'État Bogaert prévoient un nouveau système d'évaluation qui apportera entre autres une charge de travail plus lourde, des promotions plus compliquées, une réduction des primes pour le travail de nuit et le week-end (2). Dans les CPAS aussi, on taille drastiquement dans les budgets: A Beringen, Malines, Rochefort, Zelzate…, il y a des licenciements et des suppressions de postes. Les contrats des temporaires ne sont pas prolongés, les gens qui partent à la retraite ne sont pas remplacés.
La Belgique n’échappe donc clairement pas à la crise: en 2012, près de 1.7000 emplois ont disparu (3), le nombre des faillites pour 2012 dépasse les 10.000 unités et le chômage augmente clairement, surtout parmi les jeunes (4). La fermeture de sites de production ici ne mène guère en outre à la réouverture d'autres à l’étranger. Il ne s’agit donc pas de simples «délocalisations», mais d’un rétrécissement effectif de la production mondiale. Et si de nouvelles unités de production ouvrent malgré tout, c’est pour presser encore plus le citron: ainsi Ford a déménagé une partie de la production de Genk vers Valence, où les salaires sont jusqu’à 42 % plus bas! Le malheur de l’un fait donc ... aussi le malheur de l’autre!
Qui est responsable de ce carnage? Est-ce Ford qui a trahi son «engagement» pour Genk? Est-ce Lakshmi Mittal qui s’est révélé un manager «non fiable»? Est-ce les gouvernements parce qu’ils ont avalé leurs promesses de protéger l'emploi? Non! La vraie cause pour ces catastrophes sociales n’est pas à chercher auprès d’entreprises spécifiques «non éthiques» de capitalistes «non fiables» ou de gouvernements «lâches». La généralité des attaques que la classe ouvrière subit en Belgique comme sur un plan mondial est la conséquence directe de la crise du capitalisme. De toute évidence, le capitalisme n’en peut plus!
Le capitalisme n'offre pas d'avenir
Depuis quelques années, les crises de l'immobilier, de la bourse, du commerce et de l'industrie, des banques et des dettes souveraines des États se succèdent sur le plan mondial. Entre-temps, la dette des États de la zone euro s’élève à 8.517 s'élève milliards d'euros, soit 95 pour-cent du produit intérieur brut de la zone (5). Quel Etat prendra le risque de financer ces dettes? Financer des dettes qui ne pourront jamais être repayées signifie en effet à terme devenir soi-même insolvable. C'est un risque qui menace par exemple l'Allemagne. Comment le système va-t-il alors financer cette relance absolument nécessaire, qui devrait arrêter le carnage dans l'économie? Toujours plus d'économies et de rationalisations diminueront encore plus fortement le pouvoir d'achat, avec pour conséquence que les produits seront encore moins vendus et donc qu’il y aura encore des rationalisations, des fermetures, des baisses des salaires…. Ou le système va-t-il écumer maintenant le marché de l'épargne en imposant des taux d’épargne faibles, comme en Belgique avec des taux d'intérêt qui plongent en dessous des 1%, alors que l'inflation s'élève à 2,76%? Dans ce cas, la réserve financière que beaucoup de familles ouvrières ont établie pour faire face aux contretemps potentiels, aux dettes courantes (emprunts) et à la pauvreté fondra comme neige au soleil. Quelle que soit la méthode choisie, à terme le pouvoir d'achat diminuera une fois de plus fortement.
Faire marcher la planche à billet alors, comme le font les EU, le Japon et le Royaume Uni en mettant sur le marché des emprunts à faible taux d'intérêt? Mais ainsi, on accroît le puits sans fond de la dette et on en revient au début du problème, car en fin de compte, pour chaque somme d’argent, une contrepartie en valeur réelle est nécessaire. Donc pas de l’argent fictif, comme c’est le cas de notre épargne que la banque fait circuler sous la forme d'un emprunt, tandis qu’on nous fait croire qu'il se trouve toujours sur notre compte. Pour rembourser les dettes il faut donc créer et vendre une nouvelle valeur effective (sous la forme de marchandises).
Comment surgit la nouvelle valeur? «La valeur d'une marchandise est déterminée par la quantité de travail totale contenue dans la marchandise. Une partie de cette quantité de travail est réalisée dans une valeur pour laquelle un équivalent est payé sous forme du salaire; une autre partie toutefois est réalisée dans une valeur pour laquelle aucun équivalent n'a été payé (la plus-value). Une partie du travail que comprend la marchandise est du travail payé; une partie est du travail non rémunéré» (6). Si les capitalistes de ce monde réussissent à vendre suffisamment leurs marchandises, ils empochent la plus-value et font du profit. «Évidemment, les ouvriers achètent ces marchandises… à la hauteur de leurs salaires. Il en reste donc une bonne partie encore à vendre. Sa valeur est équivalente à celle du travail des ouvriers qui ne leur a pas été payée. Elle seule a ce pouvoir magique pour le Capital de générer du profit. Les capitalistes eux aussi consomment… et ils ne sont d’ailleurs en général pas trop malheureux. Mais ils ne peuvent pas à eux seuls acheter toutes les marchandises porteuses de plus-value. Cela n’aurait d’ailleurs aucun sens. Le Capital ne peut s’acheter à lui-même, pour faire du profit, ses propres marchandises; ce serait comme s’il prenait l’argent de sa poche gauche pour le mettre dans sa poche droite. Personne ne s’enrichit ainsi, les pauvres vous le diront. Pour accumuler, se développer, le Capital doit donc trouver des acheteurs autres que les ouvriers et les capitalistes. Autrement dit, il doit impérativement trouver des débouchés en-dehors de son système, sous peine de se retrouver avec des marchandises invendables sur les bras et qui viennent engorger le marché: c’est alors la “crise de surproduction”!» (7)
Si les entreprises arrêtent de tourner aujourd’hui, ce n'est donc pas parce que les ouvriers ne veulent pas travailler ou parce qu’il n’y a plus de besoins, mais parce que les capitalistes n’y ont plus rien à gagner. Les débouchés solvables sont soit insuffisants soit inexistants et les profits ne peuvent donc être obtenus que par une exploitation sociale encore plus grande. Voilà pourquoi les entreprises ferment leurs portes, baissent les frais de production, augmentent la productivité, voilà pourquoi les frais improductifs (sécurité sociale, allocations de chômage, retraites) sont réduits de manière drastique. Le système capitaliste mondial est dans l’impasse!
Que pouvons-nous faire contre la dégradation de nos conditions de vie et de travail? Comment pouvons-nous faire face aux attaques? Dans son histoire, le capitalisme n'a jamais été pacifique, raisonnable, moral ou durable. Il n'a jamais concédé de son plein gré des améliorations aux ouvriers ou à d'autres exploités. Le mouvement ouvrier a toujours été un mouvement de lutte. Sans résistance, les exploiteurs gardent l’initiative. Ces dernières années, on constate à nouveau une combativité ascendante au sein de la classe ouvrière mondiale. En Belgique aussi, les ouvriers montrent des signes de combativité. Cela s’est vu à Ford-Genk et surtout auprès des sous-traitants, à ArcelorMittal Liège, dans les manifestations des fonctionnaires en 2012 et 2013… Mais le ras-le-bol et la combativité seuls ne sont pas suffisants pour développer une résistance efficace. L'indignation ne réussit pas véritablement à se transformer en un mouvement de résistance vigoureux. Pourquoi pas?
Le corporatisme = une voie sans issue
Pour construire un rapport de force, l'unité est nécessaire. Et pour y arriver, la solidarité est exigée. Mais la bourgeoisie en appelle aussi par le biais de ses différents organes, comme les syndicats, le gouvernement (national, ou régional ou local), les partis bourgeois, les mass media… à la «solidarité», mais de quelle sorte!
«La solidarité, bien sûr», avance le bourgeoisie, mais alors au sein de l’entreprise, du secteur et de la région. La solidarité «bourgeoise» enferme les ouvriers dans le corporatisme et le régionalisme.
Pourquoi les ouvriers de Liège et de Genk ne se sont-ils pas retrouvés, alors qu’ils ne sont séparés que par 50 km et que leurs problèmes sont les mêmes? Pourquoi les manifestations se tiennent-elles à différents endroits et à différents moments et en plus de manière aussi locales que possible? Ainsi la «marche pour l'avenir» s’est tenue le 11 novembre à Genk, alors que le 14 novembre avait lieu à Bruxelles une manifestation européenne. Le 26 janvier, il y avait une manifestation à Seraing, tandis que le 7 février, une manifestation de fonctionnaires était prévue à Bruxelles. Et une autre manifestation devait encore avoir lieu le 21 février à Bruxelles.
Ce fractionnement des ouvriers est orchestré par les syndicats en personne pour exterminer dans l’oeuf tout germe d’unification de la lutte et de discussion. Que les syndicats sabotent chaque forme de solidarité et d'unité, est bien ressenti par des parties du prolétariat: des ouvriers des sous-traitants de Ford-Genk se sont détachés des syndicats et se sont organisés dans un comité de grève indépendant. Mais est-ce bien suffisant? Malgré le mécontentement de ces ouvriers vis-à-vis des syndicats, ils n'ont pas rompu avec la logique corporatiste. Le comité exigeait en effet des primes de licenciement aussi élevées que celles des ouvriers de l'usine de Ford elle-même. Ils veulent être aussi «Ford» que ceux de «Ford». Est-ce suffisant d’être furieux au sujet d'une mauvaise répartition de la pauvreté? Ne faut-il donc pas exprimer un ras-le-bol de la pauvreté elle-même? Ne devons-nous pas être solidaires contre la pauvreté? La «solidarité» des syndicats correspond à l'acceptation de la misère au nom de l'économie nationale! Et c'est parfaitement compréhensible, car les syndicats sont depuis des dizaines d'années une partie intégrale de l'état capitaliste. Ils sont les chiens de garde des intérêts de l’Etat au sein des usines.
Pas de solidarité avec l'économie nationale!
«La solidarité, bien sûr», renchérit la bourgeoisie, mais alors avec les forces sociales et politiques au sein du système démocratique. La «solidarité» bourgeoise enferme les ouvriers dans la logique du capitalisme national.
Beaucoup d'ouvriers, dont ceux de Ford et d’ArcelorMittal, placent tout leur espoir dans l’intervention des autorités. Ils ont même plus souvent confiance dans les pouvoirs régionaux ou locaux que dans les autorités nationales. Aucun gouvernement ne peut toutefois offrir une réponse à leurs problèmes, étant donné que la tâche du gouvernement est la gestion et la défense des intérêts de l'économie nationale. Que l'Etat soit belge, flamand, wallon, catalan, écossais ou palestinien, aucun ne peut échapper à la faillite du capitalisme. Les gouvernements ne peuvent pas réaliser leurs promesses, par exemple pour assurer le maintien en activité des haut fourneaux à Liège (sous le contrôle direct de l'Etat ou par un repreneur privé). Ils racontent des bobards aux ouvriers. Rappelons-nous l’interminable et épuisante procédure avant la fermeture définitive d'Opel Anvers. Les intérêts nationaux demandent toujours plus de sacrifices et d'exploitation et sont donc antagoniques aux intérêts de la classe ouvrière. «Les ouvriers n'ont pas de patrie.» (8)
La démocratie n'est-elle pas un appareil politique du peuple et pour le peuple? Non! La démocratie capitaliste se distingue de la dictature ouverte par le fait qu’en apparence elle accorde un droit de décision à ses ressortissants. Ainsi elle lie la classe ouvrière à ses intérêts qui ne sont rien d'autre que les intérêts du capital national et donc du capitalisme. Ou comme le mouvement de l'Indignados en Espagne l’a affirmé: «c'est une dictature, mais tu ne le vois pas ». Rechercher la solidarité avec l'Etat démocratique mène au suicide pour la classe ouvrière.
L'élargissement, l'unification, la solidarité de classe!
En 2011 et en 2012 il y a eu de manière massive sur tous les continents des protestations, des grèves et des manifestations: de la Norvège jusqu'au Portugal, de l'Inde jusqu'à la Turquie, de l'Égypte jusqu'à la Chine. En septembre, des centaines de milliers de personnes ont manifesté au Portugal, des dizaines de milliers en Espagne, en Grèce et en Italie. Au Japon, depuis 1970, il n’y avait plus eu des manifestations contre les conditions de vie d’une telle ampleur (170.000 manifestants à Tokyo). Les mouvements les plus frappants ont été ceux des Indignés et d'Occupy en 2011, qui ont surtout été portés par les jeunes et les chômeurs en Espagne, en Grèce et aux EU. Partout la question était posée de comment faire face à de telles attaques, comment organiser la lutte, quelle perspective mettre en avant. Trois besoins centraux pour la lutte ont constamment été avancés: (a) l'élargissement et l'unification de la lutte, (b) le développement de la solidarité active parmi les travailleurs salariés, les chômeurs et les jeunes et (c) une large discussion au sujet de l'alternative pour le système actuel en faillite. Ces différents aspects dépendent l’un de l’autre et se nourrissent mutuellement.
Pour construire un rapport de force effectif contre le capitalisme, la classe ouvrière doit s’unifier au delà des frontières des entreprises, des secteurs, des régions et des nations. Un tel mouvement d’unification exige de la solidarité. Toute prime de licenciement, toute concession apparente du capital n’est qu’une aumône et ne remet pas en question les fondements de la misère. Une attitude défensive ne suffit pas. La solidarité mutuelle contre le système et sa logique est plus que jamais nécessaire. Les ouvriers en Pologne en 1980 l’ont bien compris, tout comme les ouvriers en Belgique en 1986. Des délégations massives ont été envoyées vers d’autres régions, villes, secteurs, lieux de travail… pour persuader les ouvriers de participer à une lutte commune. En Pologne, le mouvement s’est développé jusqu’à devenir le mouvement de lutte le plus important depuis 1968 et à faire vaciller le régime stalinien. En Belgique, le mouvement a connu son apogée au cours des mois avril et mai, quand les mineurs, les ouvriers de l'automobile, les métallurgistes, les enseignants, les lycéens, les éboueurs, les dockers, les ouvriers des transports en commun ont été impliqués… dans un tourbillon des grèves spontanées et de manifestations (pendant lequel les trains ont continué à rouler en fonction du mouvement de lutte!). Ceci a été le résultat d'une recherche active de la solidarité qui a nourri l'élargissement et l'unification de la lutte.
Comment développer cette solidarité? En ne faisant pas confiance aux syndicats ou à d'autres «spécialistes», mais bien à notre propre force en tant que classe. La force de la classe ouvrière ne se situe pas seulement dans sa capacité à arrêter une partie ou même la totalité de la production. La grève est une arme importante, mais doit être utilisée en fonction du renforcement de la solidarité de classe. La force du prolétariat se trouve surtout dans sa capacité à construire une nouvelle société. Elle est en effet le cœur de l'appareil de production: elle est constituée de l’ensemble des producteurs qui doivent chaque jour collaborer. Elle a la capacité de transformer la production: d'un système où la production est placée sous le signe du profit, vers un système où la production vise la satisfaction des nécessités et des besoins. Le fait que le prolétariat est la seule classe qui produit collectivement, fait qu’elle est aussi la seule classe qui peut développer une véritable solidarité. Cette solidarité et cette unité sont non seulement nécessaires, mais elles sont aussi possibles.
Alex/ 06.03.2013
(1) The New York Times, 2008, https://www.nytimes.com/2008/11/27/business/worldbusiness/27iht-steel.4....
(2) De Wereld Morgen, 2013, https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/07/federale-ambtenaren-be...
(3) Le Soir, 2012, le https://archives.lesoir.be/l-annee-2012-a-co%FBte-17.000-jobs-en-chiffre...…
(4) De standard, 2012, https://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121203_00390...
(5) Reuters, 2013, https://graphics.thomsonreuters.com/F/09/EUROZONE_REPORT2.html
(6) Marx, 1865,Salaire, prix et profit.
(7) Internationalisme n 353, «la crise de la dette, pourquoi?», 1ier trimestre 2012, https://fr.internationalism.org/isme353/la_crise_de_la_dette_pourquoi.html
(8) Marx, 1848, manifeste communiste
Géographique:
Situations territoriales:
Rubrique:
Intervention au Mali: encore une guerre au nom de la paix et de la libération des populations!
- 1101 lectures
« Ce que nous avons fait était pour libérer... » : voici ce que le président Hollande pouvait déclarer devant les caméras lors de sa visite du 2 février dernier à Tombouctou. Difficile de ne pas se laisser prendre au jeu des apparences! En effet, c’est bien une foule en liesse, agitant des drapeaux tricolores et maliens, chantant et vantant les mérites du Président français, qui a accueilli le «héros national du Mali». Hollande, le «grand libérateur», ne s’est probablement pas trompé en y voyant «la journée la plus importante de sa vie politique». La communication est une arme stratégique et, comme Mitterrand l’avait fait à Sarajevo en son temps, Hollande a voulu marquer les esprits d’un sentiment de légitime victoire au nom d’un prétendu combat «pour la paix». Par contre, pas une image du conflit n’a filtré, pas l’ombre d’un cadavre, aucune trace des bombardements massifs de l’armée française au Nord du Mali, à peine quelques mots chuchotés des exactions des troupes maliennes. Circulez, il n’y a rien à voir! Tout cela ne porte pas à critique, tant le travail de propagande a été facilité par la terreur même des fondamentalistes et hordes mafieuses d’un côté et la liesse d’une population exsangue soulagée, pouvant enfin «se mettre à chanter» de l’autre! La cruauté des bandes armées qui régnaient au Nord du Mali ne fait aucun doute. Ces seigneurs de guerre sèment la mort et la terreur partout où ils passent. Mais, contrairement à ce que nous racontent en chœur politiciens et journalistes, les motifs de l’intervention française n’ont évidemment rien à voir avec les souffrances des populations locales. L’Etat français ne vise qu’à défendre ses sordides intérêts impérialistes. En réalité, l’allégresse des populations sera de courte durée. Quand une «grande démocratie» passe avec ses chars, l’herbe n’est jamais plus verte après! Au contraire, la désolation, le chaos, la misère, sont les preuves de leur intervention. La carte ci-dessous détaille les principaux conflits qui ont ravagé l’Afrique dans les années 1990 et les famines qui l’ont frappé. Le résultat est spectaculaire: chaque guerre – souvent opérée sous la bannière du droit à l’ingérence humanitaire, comme en Somalie en 1992 ou au Rwanda en 1994 – a entraîné de graves pénuries alimentaires. Il ne va pas en être autrement au Mali. Cette nouvelle guerre, paradoxalement, va déstabiliser la région entière et accroître considérablement le chaos.
Une guerre impérialiste
«Avec moi Président, c’est la fin de la ‘Françafrique’». Ce mensonge grossier de François Hollande pourrait prêter à rire s’il n’impliquait pas une logistique militaire imposante et de nouvelles victimes. Il y a autant de soldats mobilisés qu’en Afghanistan, 4000 hommes! Selon le ministre de la défense français : « Nous avons acheminé 10.000 tonnes de matériel en quinze jours. C’est autant que ce que nous avons transporté en un an lors du retrait d’Afghanistan. » L’utilisation du matériel aérien est particulièrement intensive, notamment avec les frappes aériennes au nord de Kidal.
La gauche n’a de cesse de mettre en avant son humanisme mais, depuis près d’un siècle, les valeurs dont elle se drape ne servent qu’à dissimuler sa réelle nature: une fraction bourgeoise qui comme les autres est prête à tout, à tous les crimes, pour défendre l’intérêt national. Car c’est bien de cela qu’il s’agit au Mali: défendre les intérêts stratégiques de la France. Comme François Mitterrand qui avait décidé d’intervenir militairement au Tchad, en Irak, en ex-Yougoslavie, en Somalie et au Rwanda, François Hollande prouve que les «socialistes» n’hésitent jamais à protéger leurs «valeurs» (entendre les intérêts bourgeois de la nation française) à la pointe de la baïonnette.
Depuis le début de l’occupation du Nord du pays par les islamistes, les grandes puissances, en particulier la France et les Etats-Unis, poussaient en coulisses les pays de la zone à s’impliquer militairement en leur promettant financements et moyens logistiques. Mais à ce petit jeu d’alliances et de manipulations, l’État américain semblait plus doué et gagner peu à peu en influence. Se faire ainsi damer le pion au cœur de son «pré-carré» était tout simplement inacceptable pour la France, elle se devait de réagir et de taper un grand coup: «A l’heure des décisions, la France a réagi en usant de son ‘droit-devoir’ d’ancienne puissance coloniale. Le Mali se rapprochait certes un peu trop des Etats-Unis, au point d’apparaître comme le siège officieux de l’Africom, le commandement militaire unifié pour l’Afrique, instauré en 2007 par George Bush et consolidé depuis par Barack Obama» (Courrier international du 17 janvier 2013).
En réalité, dans cette région du globe, les alliances impérialistes sont d’une infinie complexité et très instables. Les amis d’aujourd’hui peuvent devenir les ennemis de demain quand ils ne sont pas les deux en même temps! Ainsi, tout le monde sait que l’Arabie Saoudite et le Qatar, ces «Grands alliés» déclarés de la France et des Etats-Unis, sont aussi les principaux bailleurs de fonds des groupes islamiques agissants au Sahel. Il n’y a donc aucune surprise à lire dans les colonnes du Monde du 18 janvier, le Premier ministre du Qatar se prononcer contre la guerre que la France a engagée au Mali en mettant en doute la pertinence de l’opération «Serval». Et que dire des superpuissances que sont les Etats-Unis et la Chine qui soutiennent officiellement la France pour mieux agir en coulisses et continuer d’avancer leurs pions?
Selon Hollande, «le combat n'est pas terminé»
Conscient des difficultés, le président français n’a pas hésité à déclarer: «Le terrorisme a été repoussé, chassé, mais il n’a pas encore été vaincu. » Si Gao, centre névralgique de la lutte contre les islamistes radicaux a été reprise comme tout le nord du Mali, les zones montagneuses restent un ultime refuge pour des groupes terroristes bien armés et fanatisés, conditions qui rappellent la situation et le terrain difficiles de l’Afghanistan. On ne peut, en outre, s’empêcher aussi de faire un rapprochement avec la Somalie. «La violence dans le pays, à la suite des tragiques événements de Mogadiscio au début des années 1990, s’est propagée dans toute la Corne de l’Afrique qui, vingt ans après, n’a toujours pas retrouvé sa stabilité.» (A. Bourgi, Le Monde du 15 janvier 2013). Cette dernière idée doit être soulignée: la guerre en Somalie a déstabilisé toute la Corne de l’Afrique qui, «vingt ans après, n’a toujours pas retrouvé sa stabilité». Voilà ce que sont ces guerres prétendument «humanitaires» ou «antiterroristes». Quand les «grandes démocraties» brandissent le drapeau de l’intervention guerrière pour défendre le «bien-être des peuples», la «morale» et la «paix», elles laissent toujours derrière elles des champs de ruines où règne l’odeur de la mort.
De la Libye au Mali, de la Côte d’Ivoire à l’Algérie, le chaos se généralise
«Impossible (…) de ne pas noter que le récent coup d’Etat (au Mali) est un effet collatéral des rébellions du Nord, qui sont elles-mêmes la conséquence de la déstabilisation de la Libye par une coalition occidentale qui n’éprouve étrangement ni remords ni sentiments de responsabilité. Difficile aussi de ne pas noter cet harmattan kaki qui souffle sur le Mali, après être passé par ses voisins ivoirien, guinéen, nigérien et mauritanien » (Courrier international du 11 avril 2012). En effet, nombreux ont été les groupes armés qui se battaient aux côtés de Kadhafi qui se trouvent aujourd’hui au nord du Mali, et ailleurs, avec leurs armements après avoir vidé les caches d’armes libyens. Pourtant, en Libye aussi, la «coalition occidentale» intervenait prétendument pour faire régner l’ordre et la justice, pour le bien être du peuple libyen… Aujourd’hui, la même barbarie est subie par les opprimés de cette région du monde et le chaos ne cesse de s’étendre. Ainsi, avec cette guerre au Mali, l’Algérie elle même se trouve aujourd’hui déstabilisée. Depuis le début de la crise malienne, le pouvoir algérien menait un double jeu, comme l'ont montré deux faits significatifs: d’un côté la «négociation» ouverte avec certains groupes islamistes, laissant même certains s’approvisionner sur son sol en grosses quantités de carburant lors de leur offensive pour la conquête de la ville de Konna en direction de Bamako; d’un autre côté, Alger a autorisé le survol de son espace aérien aux avions français pour bombarder les groupes djihadistes au Nord du Mali. Ce positionnement contradictoire et la facilité avec laquelle les éléments d’AQMI ont pu accéder au site industriel le plus «sécurisé» du pays, tout cela a montré le caractère décomposé des rouages de l’Etat comme de la société. A l’instar des autres Etats du Sahel, l’implication croissante de l’Algérie ne peut qu’accélérer le processus de décomposition en cours.
Toutes ces guerres indiquent que le capitalisme est plongé dans une spirale extrêmement dangereuse et qui met en péril la survie même de l’humanité. Progressivement, des zones entières du globe plongent dans le chaos et la barbarie. S’entremêlent la sauvagerie des tortionnaires locaux (seigneurs de guerre, chefs de clans, bandes terroristes…), la cruauté des seconds couteaux impérialistes (petits et moyens Etats) et la puissance dévastatrice des grandes nations, chacun étant prêt à tout, à toutes les intrigues, à tous les coups bas, à toutes les manipulations, à tous les crimes, à toutes les atrocités… pour défendre ses minables et pathétiques intérêts. Les incessants changements d’alliances donnant à l’ensemble des allures de danse macabre.
Ce système moribond ne va cesser de s’enfoncer, ces conflits guerriers ne vont faire que s’étendre, embrasant des régions du globe toujours plus vastes. Choisir un camp, au nom du moindre mal, c’est participer à cette dynamique qui n’aura d’autre issue que la mort de l’humanité. Il n’y a qu’une seule alternative réaliste, qu’une seule façon de sortir de cet engrenage infernal: la lutte massive et internationale des exploités pour un autre monde, sans classe ni exploitation, sans misère ni guerre.
Amina/15.02.2013
Rubrique:
Tunisie, Egypte: l'impasse des "révolutions arabes"
- 1139 lectures
Alors que les prétendues «révolutions arabes» fêtaient leur deuxième anniversaire, les émeutes et les manifestations massives qui se produisent ces derniers mois et ces dernières semaines en Égypte et en Tunisie sont venues rappeler à la face du monde que le départ des dictateurs Ben Ali et Moubarak n’avait rien réglé. Bien au contraire, la situation économique avec son cortège de chômage grandissant, de misère et d’attaques anti-ouvrières s’est aggravée. Et l’autoritarisme régnant comme la violence de la répression qui s’abattent aujourd’hui sur les manifestants n’ont rien à envier à ce qui prévalait auparavant.
Une colère et un courage immenses…
La Tunisie, où l’immolation par le feu du jeune Mohammed Bouazizi avait été le déclencheur du «Printemps arabe», traverse une grave crise sociale, économique et politique. Le taux de chômage officiel est de 17% et les grèves se multiplient dans de nombreux secteurs depuis des mois. La colère qui s’est exprimée si ouvertement et massivement dans de nombreuses villes du pays n’a donc pas explosé dans un ciel serein. En décembre déjà, de jeunes chômeurs s’étaient violemment opposés à la police dans la ville de Siliana, en protestation contre le programme d’austérité annoncé par le président Moncel Marzouki, provoquant des manifestations de solidarité contre la répression et ses 300 blessés, dont certains par chevrotines, dans plusieurs grandes villes et dans la capitale. Le président tunisien avait alors déclaré devant la tension sociale grandissante: «Nous n’avons pas une seule Siliana. J’ai peur que cela se reproduise dans plusieurs régions.» Et c’est l’assassinat de l’opposant laïc Chokri Belaïd qui a tout dernièrement poussé une nouvelle fois la population dans la rue, tandis que son enterrement était l’occasion pour les 50.000 personnes présentes dans le cortège funéraire d’appeler à «une nouvelle révolution» et de réclamer «Du pain, la liberté et la justice sociale», slogan principal de 2011. Dans une douzaine de villes, outre des postes de police, comme un commissariat du centre de Tunis, des locaux du parti islamiste Ennahda au pouvoir étaient attaqués, et l’armée déployée pour contenir les manifestations de masse à Sidi Bouzid d’où était partie la «révolution de jasmin» il y a deux ans.
Pour calmer la situation et récupérer le mouvement, le syndicat UGTT (Union générale de Tunisie) a appelé à une grève générale, une première depuis 35 ans en Tunisie, tandis que le gouvernement organisait un simulacre de changement parmi des dirigeants de l’État en attendant les élections législatives de juin. A l’heure actuelle, la tension semble être retombée mais il est clair que la colère va continuer à gronder d’autant que la promesse d’un prêt à venir du Fonds monétaire international va impliquer de nouvelles mesures d’austérité drastiques.
En Égypte, la situation n’est pas meilleure. Le pays est en cessation de paiement. En octobre dernier, la Banque mondiale a publié un rapport qui exprimait son «inquiétude» devant la multiplication des grèves, avec un record de 300 pour la seule première moitié de septembre. La fin de l’année avait vu se dérouler de nombreuses manifestations anti-gouvernementales, en particulier autour du referendum organisé par les Frères musulmans pour légitimer leur pouvoir, mais c’est depuis le 25 janvier, jour du deuxième anniversaire du déclenchement de la «révolution égyptienne», que la contestation s’est amplifiée. Jour après jour, des milliers de manifestants ont dénoncé les conditions de vie imposées par le nouveau gouvernement et réclamé le départ de Morsi.
Mais c’est encore la colère face à la répression qui a mis le feu aux poudres. En effet, l’annonce le 26 janvier de la condamnation à mort de 21 supporters du club al-Masry de Port-Saïd impliqués dans le drame de fin de match du 1er février 2012 (1) où 77 personnes avaient trouvé la mort, a été le prétexte à cette flambée de violence. Les manifestations pacifiques auxquelles avait appelé le Front du Salut National, la principale force d’opposition, ont donné lieu à des scènes de guérilla urbaine. Le soir du 1er février, place Tahrir et devant le palais présidentiel, des milliers de manifestants se sont livrés à une bataille rangée avec les forces de l’ordre. Le 2 février encore, ils étaient plusieurs milliers à jeter des pierres et des cocktails-Molotov contre l’enceinte du bâtiment. En une semaine, les émeutes violemment réprimées se sont soldées par plus de 60 morts, dont 40 à Port-Saïd. Une vidéo montrant un homme nu, battu par des policiers, n’a fait qu’aviver la colère déjà grande des manifestants.
Malgré le couvre-feu instauré par le régime, des manifestations avaient lieu dans trois villes situées sur le canal de Suez. Un manifestant déclarait: "Nous sommes dans les rues maintenant, car personne ne peut nous imposer sa parole (...) nous ne nous soumettrons pas au gouvernement."
Dans la ville d'Ismaïlia, outre les manifestations, des matches de football ont été organisés par les habitants pour défier le couvre-feu comme le durcissement du régime, et le siège des Frères musulmans était incendié.
Devant l’ampleur et la rage exprimée dans le mouvement, les policiers, craignant pour eux-mêmes, ont manifesté dans dix provinces le 12 février pour demander au gouvernement de ne pas les utiliser comme instruments de répression dans les troubles qui ébranlent le pays! Déjà, en décembre, nombre d’entre eux avaient refusé de s’affronter contre les manifestants au Caire et s’étaient déclarés opportunément «solidaires» de ces derniers.
… mais sans espoir…
Les leitmotivs qui peuvent s’entendre dans toutes ces manifestations sont: «Ennahda, dégage!» et «Morsi, dégage!», comme, il y a deux ans, on entendait «Ben Ali, dégage!» et «Moubarak, dégage!». Mais si, début 2011, l’heure était à l’espoir de changement, à l’ouverture d’une voie royale vers la liberté «démocratique», en 2013, l’heure est au désenchantement et à la colère. Cependant, au fond, s’exprime toujours la même illusion démocratique qui subsiste, ancrée fortement dans les esprits.. Celle-ci est entretenue par tout le battage idéologique actuel montrant du doigt le fanatisme religieux, présenté comme le grand responsable de la répression et des assassinats, ce qui masque en fait la continuité de l’appareil répressif de la bourgeoisie. C’est ce qu’on a vu de façon frappante en Égypte comme en Tunisie, où le pouvoir a réprimé sans vergogne, alors qu’il était impuissant jusqu’alors face aux grèves ouvrières parce que les illusions se paient et se paieront toujours plus dans des bains de sang. Après le départ des dictateurs «laïcs» sont venus les dirigeants religieux, qui tentent d’imposer «démocratiquement» une autre dictature, celle de la charia, sur laquelle tout est focalisé, mais il s’agit de la même: la dictature de la bourgeoisie et de son État sur la population, celle de l’exploitation forcenée de la classe ouvrière(2).
La même question se pose concernant la croyance en la possibilité de «changer la vie» en choisissant telle ou telle clique de la bourgeoisie. Car, comme on l’a encore vu récemment, ce sont aussi ces illusions-là qui ont fait le lit de la répression et de l’explosion de la violence étatique. Cela est particulièrement vrai dans ces pays conduits depuis des décennies par des fractions bourgeoises arriérées, maintenues à bout de bras par les pays développés, et dans lesquels aucune équipe de rechange avec une perspective viable, sinon les massacres de population, n’est possible. Il n’y a qu’à voir l’état de déliquescence des coalitions au pouvoir dans les deux pays, passant leur temps à se faire et se défaire, sans être en mesure de dessiner un programme économique à peu près crédible, la vitesse avec laquelle la situation de pauvreté s’est généralisée et accélérée, avec une crise agraire, donc d’alimentation, sans précédent. Ce n’est pas la question que les dirigeants seraient plus stupides qu’ailleurs, mais cela manifeste l’impasse complète dans laquelle se trouve la bourgeoisie de ces pays, qui n’a pas de marge de manœuvre, reflets de toute la bourgeoisie mondiale et du système capitaliste en entier qui n’ont aucune solution à offrir à l’humanité.
«Le peuple veut une autre révolution» criaient les jeunes chômeurs de Siliana. Mais si «révolution» veut dire changement de gouvernement ou de régime, en attendant d’être mangé tout cru par les nouveaux caciques au pouvoir, ou encore si cela signifie focalisation et combats de rue et affrontements contre telle ou telle fraction de la bourgeoisie, désorganisés face à des tueurs professionnels armés par les grandes puissances, ce n’est plus un leurre mais du suicide.
Il est significatif que si les populations égyptiennes et tunisiennes ont à nouveau relevé la tête c’est parce qu’en leur sein il existe une forte composante ouvrière, qu’on avait vu clairement s’exprimer en 2011 par une multitude de grèves. Mais c’est justement à elle qu’il revient de ne pas se laisser happer par toutes les illusions drainées par les anti-islamistes et/ou les pro- ou anti-libéraux de tout poil. La poursuite des grèves démontre en effet la force potentielle du prolétariat pour défendre ses conditions de vie et de travail et il faut saluer son immense courage.
… tant que la lutte ne se développera pas dans les pays centraux
Mais ses luttes ne pourront offrir une réelle perspective tant qu’elles resteront isolées. On avait assisté en 1979, en Iran, à une série de révoltes et de grèves ouvrières qui avaient aussi démontré la force des réactions prolétariennes mais qui, enfermées dans un cadre national faute de perspectives et d´une maturation insuffisante des luttes ouvrières au niveau mondial, avaient été étouffées par les illusions démocratiques et prises dans le carcan des affrontements entre cliques bourgeoises. C’est le prolétariat occidental, par son expérience et sa concentration, qui porte la responsabilité de donner une véritable perspective révolutionnaire. Les mouvements des Indignés en Espagne et des Occupy aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne se sont explicitement référés à la continuité des soulèvements en Tunisie et en Égypte, à leur immense courage et leur incroyable détermination. Le cri poussé lors du «printemps arabe», «Nous n’avons plus peur», doit effectivement être source d’inspiration pour tout le prolétariat mondial. Mais c’est seulement le phare de l’affirmation des assemblées ouvrières, au cœur du capitalisme, dressées contre les attaques du capitalisme en crise qui peut offrir une alternative permettant réellement le renversement de ce monde d’exploitation qui nous plonge toujours plus profondément dans la misère et la barbarie.
Il ne faut pas que la classe ouvrière minimise le poids réel dont elle dispose dans la société, de par sa place dans la production mais aussi et surtout dans ce qu’elle représente comme perspective pour toute la société et pour l’avenir du monde. En ce sens, si les ouvriers d'Égypte et de Tunisie ne doivent pas se laisser berner par les mirages de l’idéologie bourgeoise démocratique, il est de la responsabilité de ceux des pays centraux de leur montrer le chemin. C’est en Europe particulièrement que les prolétaires ont la plus longue expérience de confrontation à la démocratie bourgeoise et aux pièges les plus sophistiqués dont elle est capable. Il se doivent donc de cueillir les fruits de cette expérience historique et d’élever bien plus haut qu’aujourd’hui leur conscience. En développant leurs propres luttes, en tant que classe révolutionnaire, ils briseront l’isolement actuel des luttes désespérées qui secouent nombre de régions à travers la planète et redonneront ainsi l’espoir de la possibilité d’un nouveau monde à toute l’humanité.
Wilma/15.01.2013
1)Lire notre article sur notre site web : fr.internationalism.org/./drame_a_port_said_en_egypte_une_provocation_ policiere_pour_baillonner_la_revolte_populaire.html
2) Lire notre article sur notre site web : fr.internationalism.org/./egypte_un_changement_de_regime_n_est_pas_une _revolution
Rubrique:
L'internationalisme comme réponse à la problématique kurde: le nationalisme ne peut jamais être à la base d'une société sans classes
- 1636 lectures
Début août 2012, une Rencontre internationale anarchiste s’est tenue dans la commune de St Imier (Jura suisse). Un des conférenciers était le porte-parole de Fekar (1). L'initiative de lui donner la parole a été prise par le groupe suisse du Forum des anarchistes germanophones, qui s'efforce de réunir les anarchistes turcs/kurdes dans une seule fédération.
Selon le conférencier, le PKK (Parti ouvrier kurde, un parti avec des origines maoïstes et staliniennes, en kurde: Partiya Karkerên Kurdistan) «serait arrivé à la conclusion, fin des années quatre-vingt-dix, que même si les Kurdes n'ont pas encore leur propre État, des problèmes avec l'autorité dans leur propre mouvement se posaient déjà, problèmes qui correspondent à ceux au sein d'un État. Le PKK s'est dès lors éloigné d'une «orientation prolétarienne» et d'un modèle d'un État national indépendant avec son propre gouvernement, et donc d'une forme d'État autoritaire. Il serait maintenant un modèle pour des formes de vie sociale «communalistes», dans lequel la liberté de la femme, mais également des «transsexuels» et fondamentalement de chaque individu est primordiale, dans lequel règne le respect des différences et où on vise à atteindre un bon équilibre écologique dans la nature.» Dixit le rapport synthétique d’un des participants (2). Jan Bervoets, un membre du comité de rédaction de la revue anarchiste aux Pays-Bas «Buiten de Orde» (en dehors de l'ordre), exprime ses réserves quant à la déclaration du porte-parole de Fekar. Il se demande si «Öcalan a été illuminé, ou si c'est plutôt l'adage «quand le renard prêche, prenez garde à vos poules» qui s'applique ici ». Mais en même temps, il laisse entendre que ce n'est pas totalement impossible que le PKK se développe réellement dans la direction d'une organisation avec des principes antiautoritaires et communalistes, dans lesquels l'individu est primordial: «Avons-nous tous ensemble vécu un moment historique, ou un tour d'illusionniste? L'histoire elle-même nous le dira. » Malgré les réserves exprimées ici, c'est une fois de plus le comble de la naïveté politique si souvent caractéristique de l'anarchisme, qui surgit. Le désir parmi les anarchistes de voir quelque part des expressions de principes anarchistes est si grand, qu'un spectre d'un principe anarchiste (antiautoritaire, communaliste, fédéraliste, la primauté de l'individu) est suffisant pour créer une ambiance de liesse chez beaucoup d'entre eux (ibid.).
À l'occasion de cette discussion dans le milieu anarchiste, un participant à la «journée d'été 2012» du CCI en Belgique nous a demandé quelle est la position du CCI par rapport aux développements récents au sein du PKK. Il ressort de la contribution ci-dessous que le PKK, quel que soit l'image positive qu'en trace le conférencier, n'a toujours rien à voir avec la lutte pour l'émancipation de l'humanité et sa libération du joug de la société de classes (3).
Les origines du P.K.K.
Le PKK a été fondé le 27 novembre 1978 au village Fis (Diyarbakir) par entre autre Abdullah Öcalan, Mazlum Dogan et 21 disciples. Son but était de mettre fin au «colonialisme» turc dans l'Est et le Sud-Est de la Turquie et la réalisation d'un État kurde indépendant et uni (4). Depuis sa création, Öcalan (apo) est le leader incontesté du PKK.
Au niveau idéologique, le PKK s'inspirait du maoïsme basé sur le stalinisme (ce que le conférencier invité à St Imier appelle «l'orientation prolétarienne»). D'une part, le pouvoir pouvait être conquis par le biais d'une armée de paysans et d'autre part, des alliés devaient être recherchés sur l'échiquier impérialiste du bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. Pour atteindre cet objectif, le PKK s'est déclaré prêt à utiliser tous les moyens, aussi terribles que certains actes puissent être. Le PKK a lancé une lutte armée, avec de nombreux attentats, également contre d'autres fractions kurdes. Certains insistent pourtant sur le fait que le PKK a rendu aux Kurdes turcs leur respect de soi et les a rendus conscients de leur identité kurde. De son côté, la Turquie, où la plus grande partie des Kurdes habite, s'est toujours opposée, malgré les promesses après la seconde guerre mondiale, contre toute forme d'autonomie et a joué la carte de l’assimilation. L'importance stratégique de la région, beaucoup plus encore que son importance économique, y a été déterminante. Les Kurdes étaient officiellement dénommés «Turcs des montagnes» et leur langue était classée comme un dialecte turc. Ils étaient tenus dans la pauvreté et devaient marcher au pas.

La guerre civile: champ de bataille de l'impérialisme mondial
Le 15 août 1984, des paysans kurdes, entraînés par le PKK, attaquaient des postes de police dans les villages Eruh (Siirt) et Şemdinli (Hakkâri), actions dans lesquelles deux agents turcs ont été tués. Ce fut le début de toute une série d'actions paramilitaires. Comme contre-attaque, les autorités turques ont décidé de recruter des milliers de Kurdes qui, en échange d'argent et d'armes, étaient postés comme gardes villageois contre le PKK.
En plus de leurs attentats contre les propriétaires fonciers, le PKK agissait sans pitié contre ces gardes villageois et contre tous les Kurdes qui montraient une quelconque sympathie avec l'autorité centrale turque. Le PKK a ainsi perdu la sympathie d'une partie de la population kurde, y compris celle d'autres fractions kurdes telle que celle de Massoud Barzani au Nord de l'Irak. La population du Kurdistan était donc prise en tenaille entre la guérilla du PKK d'une part et l'armée turque d’autre part. Dans ce conflit, le parti nationaliste, organisé sur des bases staliniennes, était également soutenu de façon stratégique par d'autres forces impérialistes dans la région qui l'utilisaient comme moyen de pression contre la Turquie.
Tout comme les autres partis bourgeois de gauche, le PKK se présentait à l’époque comme le défenseur du «socialisme». Grâce à la lutte armée contre le cruel gouvernement turque de l'époque, le PKK pouvait s'attirer une partie des ouvriers et des masses de pauvres qui étaient désespérés ou qui avaient des illusions, pour les entraîner dans une lutte nationaliste et impérialiste. En mars 1990, lors du Nouvel An kurde, des funérailles de membres du PKK abattus ont abouti à des manifestations massives.
Mais après l'effondrement du bloc russe en 1989 et l'effritement du bloc occidental rival, les cartes sur l'échiquier impérialiste étaient fortement secouées et le PKK perdait des anciens alliés. La Guerre du Golfe en 1991 en Irak avait ouvert la porte vers un «nouvel (dés) ordre mondial», dans lequel le nationalisme kurde était utilisé pour la énième fois comme appât pour recruter de la chair à canon. Dans le chaos croissant, avec le développement du «chacun pour soi», où toutes les puissances impérialistes, petites et grandes, veulent accroître leur influence dans l’importante région économique et stratégique du Moyen-Orient, le PKK continue à jouer sur les contradictions impérialistes dans la région, recevant le soutien de gouvernements tels que ceux de la Syrie, l'Iran, l'Irak, l'Arménie, la Grèce et d'autres pays impérialistes, y compris la Russie.
Pour survivre, le PKK devait changer son fusil d'épaule; il ne pouvait plus se présenter comme une formation purement maoïste-stalinienne. Et alors qu'au début des années 90, quelques trois mille guérilleros du PKK avaient conquis encore de fait le pouvoir dans l'Est de la Turquie, Öcalan devait chercher en même temps d'autres opportunités politiques afin de pouvoir se maintenir. À partir de ce moment, les confrontations militaires alternent avec des périodes de cessez-le-feu et de négociations. Un premier tournant est advenu au début des années 90, lorsque le président Turgut Özal a accepté de négocier. À part Özal, lui-même à moitié kurde, peu de politiciens turcs s'y intéressaient, pas plus qu'une partie du PKK lui-même, et après la mort du président, le 17 avril 1993, dans des circonstances suspectes, l'espoir d'une conciliation s'est évaporé. En juin 1993, Öcalan appelait de nouveau à la «guerre totale». D'autres épisodes ont suivi en 1995 et 1998 qui se sont soldés chaque fois par des échecs. Quand la lutte armée a pris des formes de plus en plus intenses, la Turquie a contraint la Syrie (pays dans lequel il s’était réfugié) à expulser Öcalan. Celui-ci a pris la fuite, mais a été finalement arrêté par des agents turcs le 15 février 1999. Il a été condamné à mort pour haute trahison, mais cette sentence, sous pression de l'Union Européenne (UE), a été commuée en réclusion perpétuelle. La Turquie avait en effet posé sa candidature à l'adhésion à l'UE et devait ainsi promettre d'améliorer la situation des Kurdes turcs au niveau des droits humanitaires. Depuis, Öcalan essaie de diriger son parti de la prison, à travers ses avocats. À partir d'août 1999, les guérilleros du PKK se retirent de la région et une série d'initiatives sont prises visant à élaborer le soi-disant «processus de paix et de démocratie».
Des manœuvres politiques pour cacher leur vraie nature
La stratégie pour conquérir leur place au sein de la bourgeoise dominante devait être modifiée, et après beaucoup de luttes (sanglantes) entre fractions au sein du mouvement, la carte de l'autonomie et du fédéralisme fut jouée afin de sortir de l'impasse politique. Le huitième Congrès du Parti PKK a approuvé le 16 avril 2002 cette soi-disant transformation «démocratique». Dès lors, il s’efforcerait d’obtenir la «libération» à travers des droits politiques pour les Kurdes en Turquie et renoncerait à la violence, bien que le leader de fait du PKK, Murat Karayilan déclarait encore en 2007 qu’un État indépendant reste toujours l'objectif principal de l'organisation. Lors de ce congrès, le PKK s'est transformé et une nouvelle branche politique a été créée, même si cela n'était qu'un acte purement tactique: le Congrès du Kurdistan pour la démocratie et la liberté (KADEK). Le PKK signalait à ce moment-là qu'il ne voulait poursuivre la lutte qu'avec des moyens démocratiques. Un porte-parole du PKK/KADEK déclarait cependant qu'il ne dissolverait pas sa branche armée, les Forces de défense du peuple (HPG), ni rendre ses armes pour des raisons de «légitime défense». L'organisation voulait maintenir sa capacité à effectuer des opérations armées afin de s'imposer comme partenaire à part entière dans les négociations. En avril, le KADEK élit sa direction mais les membres furent presque les mêmes que ceux du Conseil présidentiel du PKK. Le 15 novembre 2003, le KADEK est à son tour transformé dans une fraction encore plus «modérée», le Congrès du peuple du Kurdistan (KONGRA-GEL), dans une tentative de se rendre plus acceptable à la table des négociations et pour un mandat parlementaire.
Les négociations avec le gouvernement turc ne donnent pourtant pas les résultats escomptés, et Öcalan appelle en juin 2004 par le biais de ses avocats à reprendre les armes. Pour maintenir l'image démocratique, il s'empresse d'y ajouter qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre mais de «légitime défense». Entre 2004 et 2009, le PKK perpétra régulièrement des attentats et l'armée turque attaqua à plusieurs reprises les combattants du PKK dans le Nord de l'Irak. Ainsi, les deux parties ont maintenu la pression sur la chaudière.
En 2005, les nationalistes essaient dès à présent d'obtenir par voie légale une place au parlement turc. À cette fin, un parti pro-kurde soi-disant indépendant et large fut fondé, le Parti de la société démocratique (DTP), une organisation politique affiliée au PKK qui a envoyé plusieurs élus au parlement. Ce parti a cependant à son tour été interdit par les autorités turques en raison de ses liens étroits avec le PKK et a été remplacé en 2008 par le Parti pour la paix et la démocratie (BDP) pro-kurde (turc :Barış ve Demokrasi Partisi, kurde :Partiya Aştî û Demokrasiyê). Ce dernier est maintenant officiellement reconnu comme un parti social-démocrate. En 2009, il a participé pour la première fois aux élections municipales et il a remporté une large majorité dans le Sud-Est de la Turquie; depuis la dernière élection, 36 délégués siègent en tant qu'indépendants au parlement turc. Beaucoup de prisonniers du KCK (5) sont membres de ce parti.
Afin de couper l'herbe sous les pieds du PKK, le gouvernement turc entame en juillet 2009 une nouvelle contre-offensive, cette fois-ci présentée comme «démocratique»: le plan de réforme kurde. Les Kurdes recevraient leur propre radio-télévision publique, de nouveaux droits comme le droit à l’enseignement de la langue kurde, le droit aux noms de villages kurdes et les partis politiques kurdes pourraient participer à des voyages à l'étranger. Plus récemment, on essaie encore de gagner la sympathie des masses kurdes par des distributions charitables de nourriture, de frigos, de fours, etc…
Le chef du PKK, Öcalan, y répond de sa prison avec une nouvelle version de sa «feuille de route vers la paix» de 2003 (dont la publication ne sera pas autorisée par les autorités turques) (6). Le PKK annonce qu'il abandonnera la lutte armée et qu'il va envoyer des «brigades de la paix» à travers la frontière afin de soutenir la solution «démocratique» du conflit que le gouvernement turc a entamée. La première brigade, composée de 8 combattants du PKK et de 26 citoyens kurdes turcs qui avaient fui dans les années 90 en Irak, passe la frontière le 19 octobre à partir de l'Irak et est accueillie avec des drapeaux kurdes par des milliers de Kurdes turcs.
Désormais, les deux camps cachent leurs véritables intentions. Leurs intérêts capitalistes, nationalistes et impérialistes sont déguisés par un discours pacifiste et démocratique qui s'intègre mieux dans la nouvelle vision du monde. Les deux camps cherchent également à présenter des motifs religieux et à répondre ainsi à l'islamisme politique émergent, tel que l'appel d'Öcalan à former une alliance avec le mouvement islamiste turc autour de Gülen.
Mais c'est dans le contexte des nombreuses tensions dans la région du Moyen-Orient et des ravages de la crise économique mondiale que nous devons comprendre les efforts de la bourgeoisie turque et kurde, qui utilisent la «liberté» des Kurdes comme carte de négociation.
Que représentent l'autonomie kurde et le fédéralisme?
Alors que la stratégie du gouvernement de l'AKP (Parti de la justice et du développement) restait fondamentalement la même que celle des gouvernements précédents, sa tactique était nettement différente. Les représentants du mouvement kurde dans la politique turque furent ouvertement comblés d'intrigues et de faux gestes et en arrière-plan se sont tenues pendant trois ans des négociations avec des représentants du PKK en Europe dans la capitale norvégienne Oslo, tandis que le gouvernement poursuivait sa répression. Pendant ce processus, des milliers furent arrêtés dans les procès contre le KCK, des centaines de guérilleros kurdes furent tués alors qu'ils se retiraient pendant les «cessez-le-feu». Des manifestations furent sévèrement réprimées avec de nombreux blessés et plusieurs morts. La répression sociale fut encouragée dans les villes turques contre les Kurdes qui y habitaient, avec des tentatives de lynchage comme conséquence.
Les nationalistes du PKK ont répondu à la tactique du gouvernement AKP avec leur plan pour une autonomie démocratique pour la région. Au quatrième congrès du DTK (7) en août 2010 à Diyarbakir, la capitale officieuse du Kurdistan, le co-président Ahmet Turk a présenté le projet d'un Kurdistan libre et autonome par la création et la définition d'une autonomie au niveau juridique au sein de la constitution turque. Donc pas de séparatisme. En ce qui concerne la question historique de l'utilisation de la langue kurde, celle-ci doit être apprise à tous les groupes d'âge, de l'école primaire à l'université, localement et dans toutes les villes kurdes. Dans un Kurdistan libre et autonome, le kurde doit être la langue officielle, à côté du turc et des dialectes locaux. L'exploitation des ressources économiques dans les régions kurdes doit être entre les mains des dirigeants kurdes du Kurdistan libre et autonome. Il y aura également des représentants du Kurdistan libre et autonome dans le parlement turc afin de discuter de questions d'égalité de droits et de discussions connexes. Enfin, le Kurdistan libre et autonome doit avoir un drapeau qui diffère du drapeau de la République turque, à savoir un drapeau kurde avec ses propres logos et symboles qui sont basés sur l'histoire des Kurdes et du Kurdistan. Le débat évoluait dans la direction d'une Confédération des différentes régions kurdes dans la région. Selon le congrès, les peuples et les régions kurdes dans des pays tels que la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran appartiennent indéniablement au tissu du Kurdistan.
«Le modèle de l'autonomie démo-cratique est la solution la plus raisonnable, parce qu'il correspond le mieux à l'histoire et aux circonstances politiques dans lesquelles la Turquie se trouve. En effet, les Kurdes jouissaient d'un statut d'autonomie dans les frontières de l'Empire ottoman. D'où cette proposition qui ne se base pas sur le séparatisme. Au lieu de cela, nos peuples détermineront leur relation réciproque sur base de la libre volonté et l'union volontaire dans une patrie commune. Le modèle ne vise pas l'abolition de l'État, ni le changement des frontières. La Turquie démocratique et le Kurdistan autonome démocratique sont la formule concrète pour nos peuples pour se gouverner soi-même avec leur propre culture et identité, ainsi que leur droit de vivre librement. » (Déclaration de presse du PKK, 13.08.2010) (8).
Mais face à la répression incessante, il fallait encore renchérir et le 14 juillet 2011, le 5ème congrès kurde du DTK approuve une déclaration dans laquelle il déclare audacieusement et unilatéralement «l’autonomie démocratique» pour les Kurdes de Turquie, et appelle à ce qu'elle soit reconnue internationalement. La pression d'Ankara est intensifiée et le 24 juillet, le DTK annonce unilatéralement des élections dans 43 provinces. Le maire de Diyarbakir considéra ces élections comme un pas important vers l'autonomie. Bengi Yildiz, député parlementaire et délégué du BDP dans le DTK, a déclaré que la région autonome ne devait plus payer des impôts à Ankara.
Le récent sixième congrès du DTK, le 15 et 16 septembre 2012 à Diyarbakir, s'est tenu sous le slogan «de l'autonomie démocratique vers l'Unité nationale». La tâche principale était de renforcer les bases du PKK contre les tentatives des autorités turques de l'isoler et de l'affaiblir.
Le DTK devait devenir le parlement de tous ceux qui vivent au Kurdistan, Kurdes ou pas Kurdes. La situation en Syrie était également un point important à l’ordre du jour. Il ne faut pas oublier en effet que le PKK fait partie de l’Union des communautés du Kurdistan KCK, le proto-État du mouvement nationaliste kurde. Elle a quatre organisations militaires sœurs fortes dans la région: le PKK dans le Kurdistan turc, le Parti pour une vie libre du Kurdistan (PJAK) en Iran, le Parti pour de la solution démocratique du Kurdistan (PÇDK) en Irak et le Parti de l'union démocratique (PYD) en Syrie, qui récemment, avec l'accord tacite d'El Assad, a pris le contrôle de quatre villes (9).
Il ne ressort nulle part, ni des dix principes de la feuille de route du PKK en 2003 ou en 2009, ni de la déclaration du PKK en 2010, ni de la pratique du Kurdistan «autonome et libre» jusqu'à présent, que «le PKK se développe réellement en direction d'une organisation avec des principes antiautoritaires et communalistes, où l'individu est primordial». Pas d'illusions, camarades, la stratégie de la bourgeoisie kurde, dont le PKK en est un représentant majeur, consiste à s’intégrer dans l'État turc et à gouverner le Kurdistan turc en tant qu’appareil local de l'tat turc. Cette stratégie l’a contrainte à suivre au coup par coup les nombreuses sales manœuvres de son rival, ne serait-ce que pour pouvoir rester à la table des négociations. Les négociations de paix que le gouvernement turque AKP a entamées en janvier 2013, directement avec Öcalan ne sont qu'un pas de plus, logique dans ce processus. Ce qui n'empêche pas la poursuite des affrontements militaires entre les deux parties.
En effet, «Le PKK, même s'il n'a pas réussi à devenir un véritable État, agit comme l'appareil principal de la bourgeoisie nationaliste kurde en Turquie; il essaie de réaliser ses intérêts dans son domaine d'activité comme s'il était un véritable État et est tenu dans ses tentatives à compter sur le soutien direct ou indirect de tel ou tel État impérialiste dont les intérêts rivalisent avec ceux de l'impérialisme turc sur différents points. Alors que ses forces sont plus faibles que celles de l'État impérialiste turc, et ses intérêts plus limités, le PKK est dans ce cadre tout autant une partie intégrante de l'impérialisme mondial que l'État turc.» (Point 1 de la résolution adoptée par notre section en Turquie à propos des développements au Kurdistan, 02.2012, cf. note 3).
La bourgeoisie kurde veut survivre et pour cela, du capital doit être attiré vers la région. Sur ce terrain, la bourgeoisie kurde et la bourgeoisie turque ont des intérêts mutuels. Cela inclut également la transformation de la Turquie en un paradis de main d'œuvre à bon marché. Inutile de mentionner qu'une bonne partie sera composée de forces de travail kurdes qui travaillent déjà pour des salaires très bas dans de nombreux secteurs. La mise en œuvre de cette politique est déjà en pleine préparation au Kurdistan avec la nouvelle politique régionale des salaires minimaux. Les deux bourgeoisies ont donc intérêt dans une normalisation de la situation pour assurer la stabilité, notamment pour ne pas mettre en danger l'important projet stratégico-économique Nabucco (10). Mais le jeu pour répartir ces intérêts entre eux est joué très durement, à l'image du capitalisme impitoyable.
Y a-t-il une raison pour jubiler sur «la liberté de la femme qui serait primordiale» au sein du PKK?
Le PKK affirme qu'au sein de l'organisation, femmes et hommes sont traités de manière égale et que les femmes adhèrent au PKK sur une base volontaire. La question est de savoir si c'est un principe souhaitable, hérité de son «orientation prolétarienne», ou bien d'une illusion trompeuse.
Limitons-nous pour cet aperçu aux références des nombreux témoignages dans le livre 'PKK'da Semboller, Aktörler, Kadınlar' (Symboles, acteurs et femmes dans le PKK) (11) de Necati Alkan. Dans son livre, elle parle avec des centaines de femmes qui étaient dans les milices du PKK dans les montagnes du Sud-Est de la Turquie, à la frontière avec l'Irak, la Syrie et l'Iran. Selon le livre, la plupart d'entre elles ont fui l'oppression familiale et plus particulièrement le risque de mariage forcé ou de crime d'honneur dans les territoires kurdes traditionnels et dans la société turque. Elles se sont crues en sécurité. Mais contrairement à ce que notre conférencier Fekar affirmait, ces femmes témoignent aussi que dans les camps du PKK, elles ont été victimes de la violence masculine. Elles ont été enrôlées comme chair à canon dans les milices, endoctrinées idéologiquement, sans égard pour leur propre personnalité. Ensuite, quand elles ont voulu quitter le PKK, elles en étaient empêchées et contraintes à continuer à se battre dans ses rangs.
Nationalisme contre internationalisme
Ce texte vise à exposer l'hypocrisie et la pratique bourgeoise et nationaliste du PKK. Et il est illusoire de penser qu'une telle qu'organisation, qui, depuis sa fondation, ne s'est posée que des questions stratégiques et tactiques afin de conquérir sa place parmi les autres États-nations, et qui pour atteindre cette place a utilisé une terreur impitoyable envers tous et chacun (y compris contre les Kurdes eux-mêmes dans leur propre pays et dans les pays voisins), pourrait se transformer en une organisation internationaliste.
Dans l'ère actuelle du capitalisme, tous les mouvements ethniques qui luttent pour l'autodétermination ou la libération nationale, sont des mouvements réactionnaires. La participation ou le soutien à de tels mouvements reviennent à approuver les actions et les objectifs du capitalisme, parfois en collaboration ouverte avec les différentes forces impérialistes, sinon de façon déguisée. Comme le disait clairement Rosa Luxemburg au début du 20ème siècle, l'idée d'un «droit» abstrait à l'autodétermination nationale n'a rien à voir avec le marxisme, parce qu'elle occulte la réalité que chaque nation est divisée en classes sociales antagoniques. Si la formation de certains États-nations indépendants pouvait être soutenue par le mouvement ouvrier à une période où le capitalisme avait encore un rôle progressif à jouer, cette période a pris fin définitivement – comme Luxemburg a également montré – avec la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, la classe ouvrière n'a plus de tâches «démocratiques» ou «nationales» à remplir. Son unique avenir réside dans la lutte de classe internationale, non seulement contre les États nationaux existants, mais pour leur destruction révolutionnaire.
«Dans un monde désormais divisé et partagé en blocs impérialistes, toute lutte de «libération nationale», loin de constituer un quelconque mouvement progressif, se résume en fait à un moment de l'affrontement constant entre blocs rivaux dans lequel les prolétaires et paysans enrôlés, volontairement ou de force, ne participent que comme chair à canon.» (Plateforme du CCI, Le mythe contre-révolutionnaire de la libération nationale)
«Cela a encore une fois démontré, à la suite de toutes ces réformes et négociations, que la paix de la bourgeoisie ne peut qu'engendrer la guerre, que la solution de la problématique kurde ne saurait être le résultat d'un compromis avec l'État impérialiste turc, et que le PKK est en aucun cas une structure, loin de là, qui serait en mesure d'offrir quelque solution que ce soit. La question kurde ne peut pas être résolue dans la seule Turquie. La solution kurde ne peut être résolue par une guerre entre nations. La question kurde ne peut être résolue avec la démocratie. La seule solution de cette question réside dans la lutte unie des ouvriers kurdes et turcs avec les ouvriers du Moyen-Orient et du monde entier. La seule solution de la question kurde est la solution internationaliste. Seule la classe ouvrière peut porter haut la bannière de l'internationalisme contre la barbarie de la guerre nationaliste en refusant de mourir pour la bourgeoisie.» (Point 8 de la résolution adoptée par notre section en Turquie à propos des développements au Kurdistan, 0..2012 – voir note 3).
Rosa & Felix & Lac / 03.01.2013
1)Fekar: Fédération des associations kurdes en Suisse, www.fekar.ch/
2)https://www.vrijebond.nl/internationale-anarchistische-bijeenkomst-st-im...
3)Voir aussi la résolution que la section du CCI en Turquie a adoptée à sa dernière conférence à propos des développements au Kurdistan: l'Internationalisme est la seule solution pour la question kurde! https://en.internationalism.org/icconline/201202/4676/internationalism-o...
Voir pour d’autres sources de cet article également:
-Le Monde Diplomatique, 1 novembre 2007 archive cache PKK
-https://www.lenziran.com/2011/08/pkk-leader-murat-karayilan-exclusive-in...
-https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10707935
-https://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=dtk-declares...
4)Au cours des derniers siècles, les descendants du peuple kurde historique se sont dispersés sur différents États de la région: Iran, Irak, Turquie, Syrie, Arménie et Azerbaïdjan. Beaucoup d'entre eux ont en plus émigré vers des dizaines de pays à travers le monde.
5)KCK, l’Union des communautés du Kurdistans (Koma Civakên Kurdistan), le proto-État du mouvement nationaliste kurde. Techniquement parlant, il sert comme organe qui chapeaute tous les organes du PKK, tels que la formation politico-parlementaire Kongra-Gel (Congrès du peuple) et l'aile militaire HPG (Forces de défense du peuple, Hêzên Parastina Gel), le Parti pour une vie libre au Kurdistan (PJAK) en Iran, le Parti pour une solution démocratique du Kurdistan (PÇDK) en Irak et le Parti de l'union démocratique (PYD) en Syrie; en plus de nombreux autres organes et organisations qui remplissent une fonction étatique.
6)La proposition de feuille de route (Road Map to Peace) est un document qui fait des propositions détaillées sur différents domaines du nouvel État qui doit être créé:
https://www.fekar.ch/index.php/en/english/88-abdullah-ocalans-three-phas...
7)Pour compléter l'enchevêtrement d'organisations clandestines, semi-légales, licites et chapeautantes, liées ou sous le contrôle direct des idéologues nationalistes du PKK, il faut ici encore mentionner que le DTK, le Congrès populaire démocratique (en turc Demokratik Toplum Kongresi), une organisation chapeautant pro-kurde avec environ 850 délégués du monde politique, religieux, culturel, social et des ONG, jouera un rôle important dans les initiatives du PKK.
8)Déclaration de presse du PKK :
https://www.pkkonline.com/en/index.php?sys=article&artID=60
9)L'aile syrienne du parti a récemment, selon un accord non-officiel avec le gouvernement de Bashar ElAssad, conquis quatre villes au nord de la Syrie (des photos d'Öcalan et Bashar Assad ont été suspendues à divers endroits), alors que d'autres fractions de Kurdes en Syrie sont bien intentionnées envers l'opposition. Les Kurdes irakiens «indépendants» de Barzani essaient également de rompre le pouvoir du PKK-PYD. «Au début du conflit syrien, le PKK aurait conseillé à son allié syrien, le parti kurde PYD, de veiller à ce que les droits des Kurdes soient si possible étendus sous un nouveau gouvernement. Maintenant cependant, il semble que le gouvernement Assad qui se retrouve coincé, aurait retiré ses troupes des régions kurdes. «Le PYD contrôle depuis lors la région et garantit un minimum d'ordre public». Simultanément, le PKK a déplacé 1.500 combattants du Nord de l'Irak vers la région kurde en Syrie.» (https://ejbron.wordpress.com/2012/08/16/koerden-starten-groot-offensief-...)
«Le PYD tient cependant un double langage. Le parti doit son pouvoir actuel à Basjar al-Assad, qui a cédé des positions militaires aux combattants du PYD. Il est généralement admis qu'Assad a décidé de coopérer à cause de l'ennemi commun, la Turquie. Il pouvait être sûr que le PYD défendrait la frontière turque, et passait ainsi également le signal à Ankara de ne pas s'aventurer dans une intervention en Syrie. La chose la plus importante était que la coopération lui donnait la possibilité de se concentrer militairement sur les villes les plus importantes. (…) La montée en puissance de la sœur du PKK en Syrie, le PYD, est suivie avec méfiance, à la fois en Turquie et au Kurdistan irakien. Ankara craint que le Kurdistan syrien ne devienne le tremplin pour le PKK, qui opère actuellement surtout à partir du Kurdistan irakien, et a déjà menacé avec une intervention militaire. Le président irako-kurde Barzani a fait en sorte que le PYD ait été contraint de coopérer avec les autres partis kurdes, entre autres par l'entrainement militaire de jeunes kurdes syriens en Irak. Pour garder la pression, quelques six-cents de ceux-ci ont ensuite été cantonnés à la rivière frontalière entre les deux régions kurdes, et les parlementaires irako-kurdes ont déjà suggéré que les peshmergas, l'armée irako-kurde, pourrait intervenir en Syrie si cela s'avère nécessaire. Pour contrer le pouvoir du PYD, Barzani a organisé une rencontre entre les blocs kurdes et l'opposition syrienne organisée par la Turquie. La rencontre a pour but d'unifier l'opposition syrienne dans un seul front pour l'avenir de la Syrie. » (https://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3321328/2012/0...)
Voir aussi à propos de la Syrie : https://blogs.mediapart.fr/blog/maxime-azadi/190712/syrie-les-kurdes-ont...
10)https://fr.wikipedia.org/wiki/Nabucco_gazoduc
11)PKK’da Semboller, Aktörler, Kadinlar (Acteurs, Symboles et Femmes au sein du PKK) de Necati Alkan; https://www.kitapsarayi.nl/PKKda-Semboller-Aktoerler-Kadnlar-Necati-Alka...)
Rubrique:
La crise est-elle structurelle et peut-elle être contenue par une série de réformes et d'ajustements? (cycle de discussion sur la crise III)
- 1367 lectures
«Karl Marx le disait déjà : L'État est de retour. Même les néo-libéraux purs et durs préconisent aujourd'hui la nationalisation.» Ainsi écrivait De Standaard au milieu de la crise, le 1er mars 2009. Des économistes et professeurs éminents, des dirigeants mondiaux veulent « moraliser » et réglementer l'économie depuis la nouvelle crise ouverte de 2009. L'ingérence de l'État et les nationalisations sont devenues presque monnaie courante dans tous les pays du monde : une vague de nationalisations a commencé en 2009 dans le secteur bancaire et l'industrie automobile aux États-Unis et la Grande-Bretagne. En Bolivie, Morales nationalise l'industrie du gaz, et au Venezuela Chavez fait de même avec le pétrole. La Russie nationalise en 2003 Yukos (exploitation pétrolière), la Hongrie est critiquée par l'UE en raison du contrôle excessif de l'État de l'industrie, des médias, des fonds des pensions, de la banque centrale, etc. Le Japon nationalise Tepco (distribution d'électricité), l'Argentine nationalise pour la deuxième fois en quelques années l'exploitation du pétrole. Les Pays-Bas nationalisent la banque ABN-Amro et pensent à re-nationaliser les chemins de fer, la Belgique et la France nationalisent la banque Dexia, l'Espagne de même,...
Thatcher, Reagan, Milton Friedman, l'école de Chicago, en bref le néo-libéralisme était l'épouvantail qui avait réduit la croissance économique en miettes. Mais il semblait que l'époque du néo-libéralisme était au bord de l'épuisement, écrivait Joseph Stiglitz dans Freefall. C'est ce qui donnait le ton pour ce qui est avancé depuis 2008 en chœur par tous les partis, mais surtout par la gauche et l'extrême-gauche : plus d'ingérence de l'État, plus de réglementation, plus de contrôle, plus de nationalisations.
Une poignée de déclarations : « Une banque étatique est un premier pas possible pour contrer la crise à court terme. » (De Bruyn, président Sp.a Rood, De Standaard 1/03/09) ; « … qu’une nationalisation complète du secteur financier est nécessaire. » (PSL, Alternative Socialiste, avril 2009) ; « Le PTB veut une banque publique » (PTB, Solidaire, 26/03/2009). « Le secteur bancaire dans son ensemble doit devenir propriété publique » (l'ultragauche aux Pays-Bas).
Ici se posent plusieurs questions :
- est-ce que la crise peut être contrée par l'ingérence de l'État (nationalisations) et un nouveau développement des forces productives mis en marche ?
- est-ce qu'une forte ingérence de l'État (nationalisations) peut garantir que la classe ouvrière soit épargnée ou au moins protégée ?
- Les expropriations (nationalisations) signifient quand même un affaiblissement de la propriété privée capitaliste. Par conséquent, « plus d'État » est progressif, une revendication que toute la classe ouvrière doit soutenir. Est-ce vrai ?
Est-ce que l'État à travers des nationalisations a jamais sorti le capitalisme du marasme?
Engels écrivait en 1878 :
« La période industrielle de haute pression, avec son gonflement illimité du crédit, aussi bien que le krach lui-même, par l'effondrement de grands établissements capitalistes, poussent à cette forme de socialisation de masses considérables de moyens de production qui se présente à nous dans les différents genres de sociétés par actions. Beaucoup de ces moyens de production et de communication sont, d'emblée, si colossaux qu'ils excluent, comme les chemins de fer, toute autre forme d'exploitation capitaliste. Mais, à un certain degré́ de développement, cette forme elle-même ne suffit plus; […] il faut finalement que le représentant officiel de la société́ capitaliste, l'État, en prenne la direction. La nécessité́ de la transformation en propriété́ d’État apparaît d'abord dans les grands organismes de communication : postes, télégraphes, chemins de fer. »
Mais il y ajoute :
« Car ce n’est que dans le cas où les moyens de production et de communication sont réellement trop grands pour être dirigés par les sociétés par actions, où donc l'étatisation est devenue une nécessité́ économique, c'est seulement en ce cas qu'elle signifie un progrès économique, même si c'est l'État actuel qui l'accomplit; qu'elle signifie qu'on atteint à un nouveau stade, préalable à la prise de possession de toutes les forces productives par la société́ elle-même. Mais on a vu récemment, depuis que Bismarck s'est lancé dans les étatisations, apparaître certain faux socialisme qui même, çà et là, a dégénéré en quelque servilité́, et qui proclame socialiste sans autre forme de procès, toute étatisation, même celle de Bismarck. Évidemment, si l'étatisation du tabac était socialiste, Napoléon et Metternich compteraient parmi les fondateurs du socialisme. Si l'État belge, pour des raisons politiques et financières très terre à terre, a construit lui-même ses chemins de fer principaux; si Bismarck, sans aucune nécessité́ économique, a étatisé́ les principales lignes de chemins de fer de la Prusse, simplement pour pouvoir mieux les organiser et les utiliser en temps de guerre, pour faire des employés de chemins de fer un bétail électoral au service du gouvernement et surtout pour se donner une nouvelle source de revenus indépendante des décisions du Parlement, - ce n'était nullement là des mesures socialistes, directes ou indirectes, conscientes ou inconscientes. Autrement ce seraient des institutions socialistes que la Société́ royale de commerce maritime [...], la Manufacture royale de porcelaine et même, dans la troupe, le tailleur de compagnie […]. » (F. Engels, L’Anti-Dühring, Ch. II : Notions Théoriques, pp. 140-141)
Engels démontre que dans la période d'épanouissement du capitalisme, des nationalisations pouvaient avoir un caractère progressif (c'est-à-dire promouvoir le développement du capitalisme).
Mais il ajoute que beaucoup de nationalisations ne correspondaient pas à ce critère. Cette question est bien sûr parallèle avec le rôle progressif que l'État national jouait dans cette période de développement du jeune capitalisme.
Nous pouvons y revenir dans la discussion.
La transformation de la propriété des sociétés anonymes – qui de ce temps-là ne dépassaient pas les frontières de l'État-nation – en propriété de l'État était donc progressive. Le développement du capitalisme dans cette période de progrès était caractérisé par un transfert de propriété des capitalistes individuels à des sociétés à actions, et ensuite, selon les conditions, à la propriété de l'État. La concentration des forces productives dans les mains de groupes de capitalistes (ou de l'État) était alors un important pas en avant. Les signes de l'expansion de la production et de la concentration de la propriété étaient alors, en principe, l'État-nation unifié, dont la formation signifiait une amélioration en comparaison aux entités féodales fragmentées.
L'échelle de concentration de capital nécessaire pour le développement était dont un facteur crucial (le capital accumulé qui ne pouvait être accordé uniquement par l'attribution de crédit énorme). Et aussi l'intérêt général de la bourgeoisie nationale, sans laps dans une concurrence stérile.
Mais, rapidement, l'expansion de la production et la concentration de la propriété débordèrent les limites des Etats nationaux. Les grandes compagnies anonymes prirent de plus en plus un caractère international, créant à leur manière une division internationale du travail, et cela, en dépit de son caractère contradictoire, constituant une des contributions les plus importantes du capitalisme au progrès de l'humanité. Le caractère de plus en plus international de la production, commence alors à se heurter avec la division du monde en Etats nationaux. « L’État national », affirme le 1er Congrès de l'Internationale Communiste en 1919, « après avoir donné un élan vigoureux au développement capitaliste est amené à être trop étroit pour l’expansion des forces productives ».
Mais aujourd'hui, la situation est totalement différente :
Personne ne prétendra que la nationalisation de l'industrie pétrolière au Mexique 1938, ou celle de l'Argentine ou de la banque Dexia en Belgique aujourd'hui sont advenues parce qu'économiquement parlant, leur gestion dépassait les limitations de la société (multinationale). Et personne ne verra un progrès économique dans la transformation de la propriété de ces multinationales déjà étendues, organisées mille fois mieux et bien plus puissantes que l'État mexicain, argentin, hongrois ou vénézuélien qui en acquiert la propriété. Une telle nationalisation, dit Engels, ne représente aucun progrès pour le capitalisme ou pour un développement des forces productives.
Les nationalisations commencèrent à changer de signification : dirigées chaque fois davantage contre la division internationale du travail croissante, elles constituèrent par conséquent, au lieu d'un progrès, une régression. Tandis que les nationalisations dans le passé étaient l'expression de la croissance et de l'expansion du capitalisme, actuellement, elles sont, au contraire, l'expression de la régression et de la décomposition chaque fois plus violente du système capitaliste.
Des nationalisations à caractère progressif ne sont donc plus possibles dans l’actuelle phase de décomposition du capitalisme.
La question de savoir si une forte ingérence de l'État (nationalisation) peut faire en sorte que la classe ouvrière soit épargnée, ou du moins protégé, ne saurait être répondue que par la négative.
Il ne s'agit plus de l'expansion des forces productives, mais de leur rétrécissement... avec une exception notable : celle de l'industrie de guerre. Depuis cette période, les nationalisations s'orientent sur la destruction des forces productives et des biens de consommation. Avant de disparaître de la scène historique, le capitalisme détruit une grande part de ce qu'il a créé lui-même : son magnifique appareil de production, le prolétariat moderne et la division internationale du travail, enchaînant chaque fois davantage les forces de production dans les limites des Etats nationaux.
Et nous constatons que depuis cette période qui a donné lieu à la première guerre mondiale, depuis que la survie de chaque nation dépend de sa capacité d'assurer sa position par la force et la violence (et à défendre sa place dans l'arène impérialiste) sur un marché mondial devenu trop étroit, l'économie capitaliste est devenu continuellement plus dépendante de son État. Dans le capitalisme en décadence, la tendance au capitalisme d'État est d'ailleurs devenue une tendance générale, universelle.
Ce que nous vivons aujourd'hui, depuis 2008, n'est donc point un changement radical dans la vision du rôle de l'État, mais au contraire la confirmation du rôle central que l'État joue pour éviter des catastrophes économiques. Ce rôle consiste à se réfugier derrière l'État afin de faire fonctionner une machine économique qui, spontanément, livrée à elle-même, s'est paralysée, coincée entre ses contradictions internes. C'est seulement en analysant les nationalisations et la tendance à « plus d’État » depuis 1914 comme faisant partie du processus de décomposition du capitalisme que nous pouvons comprendre leur véritable signification historique :
- la nationalisation de l'industrie de guerre dans tous les pays impliqués dans la Première Guerre mondiale;
- Avec le développement de la crise dans les années 1920, tous les régimes, le stalinisme, le fascisme, les démocraties se retrouvent dans une politique de nationalisations et d'ingérence accrue de l'État, comme le New Deal aux États-Unis en 1933, celui du Front populaire en France ou le Plan De Man en Belgique;
- Ensuite sont venus la nationalisation générale ou le contrôle étatique sur l'industrie de guerre dans les années de guerre 1940;
- Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, la politique de reconstruction est directement prise en charge par les États dans de nombreux pays, également à travers des nationalisations importantes de secteurs-clé de l'économie, y inclus dans l'Angleterre « libérale » et tout le bloc de l'Est nouvellement formé;
- Suit maintenant une période de guerre froide avec une course aux zones d'influence et la réorganisation de l'économie post-guerre. Cette période est également celle des décolonisations et est accompagnée d'une nouvelle série de nationalisations dans de nombreux pays;
- La nouvelle crise à partir des années 1970 est déjà mieux connue. Nous pouvons y revenir dans la discussion, et surtout sur la période du néo-libéralisme avec ses fausses contradictions.
Est-ce que les expropriations (nationalisations) signifient un affaiblissement du capitalisme ?
Il s’agit ici de la question de la propriété privée et de la propriété collective des moyens de production. L’affaiblissement de la propriété privée signifierait par conséquent un pas vers le « socialisme » et pour cette raison une revendication que la classe ouvrière doit soutenir.
Nationalisation ne signifie en aucune manière « propriété de la 'nation' », mais uniquement, exclusivement propriété de l'État. En d'autres termes : avec la « nationalisation », la propriété passe simplement des capitalistes individuels ou des compagnies capitalistes au « capitalisme collectif » (pour employer la formule d'Engels), c'est-à-dire l'État des capitalistes.
L'État bourgeois n'est « autre chose qu’une machine d’oppression d’une classe par une autre classe et cela autant dans la république démocratique que dans la monarchie » (Engels, préface à ‘La Guerre civile’ de Marx).
L'Etat est une institution née de la division de la société en classes ayant des intérêts irréconciliables, et sa fonction est de perpétuer cette division et avec elle «le droit de la classe possédante d’exploiter celle qui ne possède rien, et la domination de la première sur la seconde» (Engels). «L’État moderne n’est à son tour que l’organisation que cette société bourgeoise se donne pour défendre les conditions collectives extérieures du mode de production capitaliste, tant par les ouvriers que par les capitalistes individuels. L’État moderne, sous n’importe quelle forme, est en essence un outil capitaliste, l’État capitaliste, le capitaliste universel idéel.» (Friedrich Engels)
Les nationalisations ne sont pas du socialisme
En proclamant la possession privée des moyens de production comme la nature du capitalisme, on proclame en même temps qu'en dehors de cette possession privée, le capitalisme ne peut subsister. Le concept marxiste de la propriété privée des moyens de production, comme étant le fondement de la production capitaliste, semblait contenir l'autre formule : la disparition de la possession privée des moyens de production équivaudrait à la disparition de la société capitaliste, et donc est vue comme synonyme du socialisme. Or, le développement du capitalisme, ou plus exactement, le capitalisme dans sa phase décadente, nous présente une tendance plus ou moins accentuée mais également généralisée à tous les secteurs, vers la limitation de la possession privée des moyens de production, vers leur nationalisation.
La nature du capitalisme n’est pas donnée par la possession privée des moyens de production, qui n’est qu’une forme, propre à une période donnée du capitalisme, à la période du capitalisme libéral, mais dans la séparation entre les moyens de production et le producteur.
Ce qui donne un caractère capitaliste à la production, ce n'est pas la possession privée des moyens de production. La propriété privée et celle des moyens de production existaient aussi dans la société esclavagiste ainsi que dans la société féodale. Ce qui fait de la production une production capitaliste, c'est la séparation des moyens de production d'avec les producteurs, leur transformation en moyens d'acheter et de commander le travail vivant dans le but de lui faire produire de l'excédent, de la plus-value, c'est-à-dire la transformation des moyens de production perdant leur caractère de simple outil dans le processus de production, pour devenir et exister en tant que capital.
Le capitalisme c'est la séparation entre le travail passé, accumulé, entre les mains d'une classe, dictant et exploitant le travail vivant d'une autre classe. Peu importe comment la classe possédante répartit entre ses membres la part de chacun. Dans le régime capitaliste, cette répartition se modifie constamment par la lutte économique ou par la violence militaire.
A l'époque du capitalisme libéral, la forme sous laquelle existait le capital était essentiellement celle du capitalisme privé individuel.
« Possession privée des moyens de production = capitalisme » et « atteinte à la possession privée = socialisme » étaient des formules frappantes, mais n'étaient que partiellement vraies.
L'inconvénient ne surgit que lorsque la forme tend à se modifier. L'habitude prise de représenter le contenu par sa forme, parce que correspondant pleinement à un moment donné, se transforme en une identification qui n'existe pas, et conduit à l'erreur de substituer le contenu par la forme.
L'expropriation la plus poussée peut tout au plus faire disparaître les capitalistes en tant qu'individus jouissant de la plus-value, mais ne fait pas encore disparaître la production de la plus-value, c'est-à-dire le capitalisme.
« La grande différence entre le principe capitaliste et le principe socialiste de la production est celle-ci : les ouvriers trouvent-ils en face d’eux les moyens de production en tant que capital, et ne peuvent-ils en disposer que pour augmenter le surproduit et la plus-value au compte de leurs exploiteurs, ou bien, au lieu d’être occupés par ces moyens de production, les emploient-ils pour produire la richesse à leur propre compte. » (Marx)
Lac / mai 2012
Récent et en cours:
Rubrique:
Internationalisme no 358 - 2e trimestre 2013
- 1009 lectures
Ecologie: piège, mystification et alternatives
- 1472 lectures
Le livre « Le mythe de l'économie verte » (1), se présente comme une critique impitoyable de « l'économie verte », car il remet en cause bon nombre de solutions vedettes (le fracking par exemple) de cette soi-disant approche « alternative » : soit parce que celles-ci ne résolvent qu’un problème restreint, sans tenir compte de l’impact écologique destructif à long terme, soit parce que le remède se révèle plus terrible que le mal de par l'utilisation dans le cadre de « l’économie verte » de moyens qui mettent en marche des processus qui sont au moins autant, sinon encore plus polluant à moyen et à long terme.
Une critique apparemment dure de « l'économie verte » …
Dans le premier et le deuxième chapitre, la situation désastreuse est expliquée par le fait qu’on ne peut attendre aucune solution de la part du capitalisme parce que ce système considère la nature comme « un don gratuit » (2), qu’on peut utiliser à son gré.
Les auteurs essaient aussi de rechercher les racines de cette crise écologique et argumentent que celles-ci se trouvent dans l'expropriation du commons, les biens sociaux communautaires. Ils démontrent très minutieusement comment le capitalisme agit dans la dégradation de la nature et n’y porte un certain intérêt que quand elle peut être transformée en valeurs marchandes. Il en découle que tout ce à quoi le capitalisme touche en ce qui concerne la nature est voué à être saccagé ou détruit. Ils montrent enfin que « l'économie verte » elle aussi ne réussit pas à stopper les méfaits de la marchandisation de la nature, bien au contraire.
Avec des faits et des arguments à l’appui, ils décrivent comment toutes les solutions proposées déplacent seulement l'hypothèque qui pèse sur la société et essayent de rejeter la faute sur la population et « les citoyens ». Selon les auteurs, un des objectifs prioritaires est de réduire la consommation de pétrole et d’autres combustibles fossiles en tant que cause de pollution la plus importante qui doit être prise en main avec la plus grande urgence.
Ensuite, le livre porte essentiellement sur l'alternative écologique des commons - qui sont attaqués constamment par la libéralisation de l’économie - et sur l'échec évident du néolibéralisme en matière écologique. Quand il est question d'une nécessaire alternative, une critique est effectivement formulée par rapport au « socialisme réel » de l'USSR et des pays qui s’en inspirent, où la catastrophe écologique est flagrante à beaucoup d'endroits. (3) Mais dès qu›il est fait référence à Cuba, cette critique n’est soudainement plus valable. Cuba serait maintenant un exemple, le pays avec la plus petite empreinte écologique au monde, grâce sans doute à l'arrêt soudain des livraisons de pétrole après l'écroulement de l'USSR. Que Cuba a décimé l’essentiel de sa forêt subtropicale pour la culture de la canne à sucre au début des années 1960 et d'autres catastrophes écologiques, les auteurs apparemment n’en ont jamais entendu parler. Mais ce mythe-là a aussi depuis longtemps été dévoilé par des activistes cubains. (4)
… pour promouvoir la mystification « de la démocratie verte »
D'abord et avant tout, il faut dire que la science peut être une alliée de la classe ouvrière et plus largement de l'humanité. En outre, les études scientifiques qui peuvent se dégager aujourd’hui de la mainmise matérielle ou idéologique du capitalisme et de son sponsoring inévitable, sont plus que bienvenues. Pourtant la question se pose ici : Le livre explore-t-il effectivement jusqu’au fond la contradiction du système capitaliste en ce qui concerne « l'économie verte »? Une lecture attentive de l’ouvrage permet immédiatement de relever un certain nombre de contradictions dans l’argumentation.
D'une part, il est affirmé, de façon juste, que les solutions qui sont proposées par « l'économie verte », restent strictement dans le cadre de la possibilité de réaliser des profits. D'autre part, il est dit que les commons feraient exactement le contraire. Mais pour rendre aux biens sociaux communautaires tous leurs droits, l’aide d’une régulation par l’Etat (ou par des organes qui sont contrôlés ou promus par l'Etat, comme les syndicats) est pourtant invoquée. Etant donné que la suppression de l'exploitation capitaliste n'est en rien évoquée mais uniquement une autre régulation de la consommation, il s’agit en fait de demander le soutien à l'état bourgeois qui doit être réformé « écologiquement » pour mieux servir « les intérêts du peuple ». La présentation des régimes de Morales et de Chavez et du modèle par excellence Cuba comme des exemples d’une alternative, confirment cette logique d’une régulation de l'Etat, typique du « milieu gauchiste». Le fait que ces régimes soient non seulement totalitaires, mais aussi qu’ils aient réprimé plus d'une fois la protestation ouvrière avec violence- où des troupes ont été engagées à plusieurs reprises contre les usines en grève et les ouvriers agricoles- n'est pas mentionné.
Sur le plan des revendications, le livre est très ambigu : vanter les commons comme une action écologique créative alternative et en même temps quémander l'aide de l'Etat et des syndicats qui sont entièrement imbriqués dans la société capitaliste, c’est essayer de réconcilier l'eau et le feu. Ces derniers ne sont pas des acteurs neutres dans le contexte capitaliste: l'Etat garantit « l'ordre social global » et veille à ce que le système capitaliste puisse survivre, si nécessaire aux moyens d’élections démocratiques ou sinon par les armes. La structure syndicale s›occupe déjà depuis la première guerre mondiale de la discipline dans l'usine et ne vient jamais avec des exigences qui peuvent menacer l'intérêt national et le système. Les seuls qu’ils menacent sont les ouvriers, quand ils s’engagent dans une grève « sauvage » (comme récemment les ouvriers des sous-traitants de Ford-Genk en ont fait l’expérience).
Dans l’alternative des auteurs, ils avancent sans beaucoup de profondeur « une solution démocratique ». Mais qu›est-ce qu’une solution démocratique? Parfois elle semble se situer - selon les auteurs –à l’extérieur du capitalisme, à d’autres moments, elle semble devoir passer via des lois rapides car « le temps presse ». Pourtant ils ont eux-mêmes constaté auparavant que toutes les mesures « de l'économie verte » vont dans le sens du système et sont destructrices pour la nature. Il n'est pas clair avec quelles mesures ils vont renverser la tendance. D’un côté ils avancent quelques « succès », comme les cas d'autogestion en Argentine, au Mexique et en Grande-Bretagne, mais plus tard il apparait que ceux-ci ne sont que temporaires… Cela ressemble plutôt à des emplâtres sur une jambe de bois !
Les arguments avancés dans le livre ressemblent parfois à ceux de la partie « réformiste » du mouvement Occupy » et « Indignados » - (Democracia Real Ya - « une véritable démocratie maintenant» - en Espagne), qui par tous les moyens a essayé d’orienter le mouvement de protestation vers des objectifs concrets au sein du capitalisme, tandis qu’au sein de ces mouvements beaucoup de tendances prolétariennes se sont manifestées qui remettaient en question le système capitaliste.
D’autres alternatives sont énumérés: « l’ensemble des pays du Sud», le prolétariat écologique, « les citoyens » conscients, mais qui sont-ils, ces 99%? Ce qui frappe, c’est qu’aucun mot n’est soufflé à propos de la classe ouvrière. Existe-t’elle encore? Apparemment, pour les auteurs, elle ne compte pas. A la page192, ils affirment qu’un capitalisme vert fabrique des consommateurs à la place de « citoyens » ! « Aux citoyens conscients », il reviendrait dès lors la tâche d’empêcher la catastrophe écologique. La place centrale de la classe ouvrière dans le processus de production capitaliste a disparu. Seule reste l'indignation morale « du consommateur conscient », « du citoyen ». Toute protestation est de cette façon canalisée vers la sphère de la consommation, elle est retirée de celle de la production. Il devient ainsi impossible d’avoir une compréhension fine des rapports de production capitaliste et du rôle central de la classe ouvrière dans le renversement de ceux-ci.
Finalement, la critique radicale de l'économie verte apparaît n’être qu’un rideau de fumée pour faire avaler les recettes classiques de l’extrême-gauche: l'Etat, la « démocratie populaire», la réforme de la consommation comme une alternative au sein de la logique du /profit capitaliste.
Le marxisme propose-t-il une alternative ?
A la recherche d’alternatives en dehors du capitalisme où il sera mis fin à la production pour le profit (la valeur d'échange des marchandises) et où l’usage (la valeur d’usage) sera posée comme but, nous aboutissons nécessairement chez Marx et Engels.
Deux chercheurs académiques récents en particulier - John Bellamy Foster et Paul Burkett (4) - ont fourni une importante contribution sur la vision que Marx et Engels défendaient réellement concernant le rapport entre l’Homme et la Nature. Le résultat surprend agréablement au profit du marxisme. J. Bellamy Foster avait constaté que les Verts étaient fortement sous l’emprise du philosophe anglais Francis Bacon, un penseur matérialiste, qui était à la base de la fondation de la Royal Society of London (créée en 1660). Il a trouvé cela tellement remarquable qu’il a voulu investiguer plus loin. Par Bacon et sa vision matérialiste sur la nature, exprimée dans son travail « Novum Organum », il a abouti auprès des philosophes matérialistes et Epicure, en Grèce antique, et chez Lucrèce, dans la culture romaine antique. Via ce détour, il a « redécouvert » Marx (dont la thèse traitait d’Epicure). A partir de là, il a mis en évidence que « la critique verte » était au fond « idéaliste » et qu’elle attaquait de manière totalement infondée le marxisme pour son soi-disant « productivisme », sur la base d’une critique des positions de Staline et de beaucoup de partis et de groupes d’extrême-gauches. Son collègue P. Burkett menait une recherche complémentaire et apporta encore plus de données, venant surtout du Capital partie III, Théories au sujet de la plus-value, de Marx et de la Dialectique de la nature, de Engels. Mais par manque de place dans cet article, nous ne pouvons malheureusement pas développer ce point.
Le stalinisme a trahi à peu près tous les principes marxistes possibles : l'internationalisme prolétarien au profit de la patrie « socialiste », la violation de l'art et de la culture subordonnées à l'Etat tout-puissant, l’abandon du matérialisme historique en faveur du matérialisme vulgaire, la croissance monstrueuse de l’Etat au lieu de sa suppression, la mise de côté de l'analyse des rapports de production au profit de celle du mode de production. Cela leur a permis de promouvoir comme du « socialisme » leur système de production de plus-value - et donc d'exploitation. En fait, il s’agissait d’une forme de capitalisme d'état, étant donné que les rapports de production capitalistes continuaient à exister du fait même que la plus-value était réalisée globalement par l'Etat (la conception d’un « socialisme d'Etat » avait déjà été rejetée par Engels).
Dans les années du début de la révolution russe, on s'est basé minutieusement sur les avis de Marx & Engels au sujet de la nature. Lors du développement des nouveaux complexes industriels, il a été calculé quels dommages seraient causés à l’environnement et comment ceux-ci seraient compensés, e.a. par la création de parcs naturels, les zapovedniki (entre 1919 et 1929, 61 parcs naturels ont été créés avec une superficie totale de pas moins de 4 millions d’ha), dans lesquels les régions naturelles étaient protégées comme etaloni (modèles) pour pouvoir les comparer avec les terres cultivées (5). Lors de l'industrialisation forcée sous le stalinisme, les défenseurs de cette politique ont été liquidés au propre comme au figuré, avec toutes les conséquences qui s’en sont suivies pour l'environnement (6).
Au sein de la tradition marxiste, cela a signifié un sérieux coup pour la réflexion créative concernant la nature et l'équilibre écologique. À part Christopher Caudwell (7) et Amadeo Bordiga (8) (dans Le Fil du Temps), la réflexion sur le lien indissociable entre homme et nature s’est presque totalement arrêtée jusque dans les années 1980. Les communistes de gauche autour de Bordiga se basaient sur les idées de Engels concernant la suppression dans le socialisme de l'opposition entre la ville et la campagne: « La suppression de l'opposition entre la ville et la campagne n'est pas plus une utopie que la suppression de l'antagonisme entre capitalistes et salariés. Elle devient chaque jour davantage une exigence pratique autant du point de vue de la production industrielle que de la production agricole. Personne ne l'a défendue avec plus de force que Liebig dans ses ouvrages sur la chimie agricole, dans lesquels il demande que l'homme rende à la terre ce qu'il a reçu d'elle… … » (9). Ils posent aussi : « Nous nous trouvons là en plein dans le cadre des atroces contradictions que le marxisme révolutionnaire dénonce comme propre à la société bourgeoise aujourd’hui. Ces contradictions ne concernent pas seulement la répartition des produits du travail et les rapports qui en découlent entre les producteurs, mais elles s’étendent de manière indissociable à la répartition territoriale et géographique des instruments et des équipements de production et de transport, et donc des hommes eux-mêmes ; à aucune autre époque historique, peut-être, cette répartition n’a présenté des caractères aussi désastreux, aussi épouvantables…la lutte révolutionnaire pour la destruction des épouvantables agglomérations tentaculaires peut être ainsi définie : oxygène communiste contre cloaque capitaliste. Espace contre ciment » (Bordiga, p.124 et p. 155).
Pour l'humanité, il s’agit d’arrêter le Molloch du capitalisme par la révolution prolétaire, la seule qui peut et doit renverser ce système de production. Ce n’est qu’après qu’une autre logique peut se mettre en route qui rompe radicalement avec le principe du profit, qui exploite l'homme et la nature et menace de les détruire. Comme Caudwell l’a formulé : « D'ici le temps qu'une situation révolutionnaire mûrisse, il y aura une toute nouvelle superstructurequi existera de façon latente au sein de la classe exploitée, découlant de tout ce qu’elle a appris du développement des forces productives… C'est le rôle créatif des révolutions… La révolution prolétarienne est une conséquence de l'antagonisme croissant entre la superstructure bourgeoise et le travail prolétarien». Pour suivre ce chemin, nous avons besoin d’une analyse beaucoup plus radicale que celle qui nous est avancée par les auteurs du « mythe de l'économie verte ». Avec leurs arguments, on continue à rester prisonnier de la spirale descendante de la réflexion au sein des limites d’un système d'exploitation qui détruit tout.
JZ/6.12.12
(1) Anneleen Kennis & Matthias Lievens, « le mythe de l'économie verte », EPO, Anvers, 2012.
(2) Selon Adam Smith, économiste et père de la pensée économique capitaliste.
(3) 20% du territoire immense de l’ex-URSS est gravement pollué d’un point de vue écologique pour des générations entières.
(4) voir les contributions très intéressantes de l’activiste écologique cubain, Gilberto Romero, 'Cuba's environmental Crisis', Contacto, Magazine. (c) 1994-96 (c) 1994-96 et deux contributions critiques provenant du milieu anarchiste : Frank Fernández, 'Cuban Anarchism, the history of a movement', See Sharp Press Arizona 2001 en Sam Dolgoff 'The Cuban revolution, a critical perspective', Blackrose Books, Montreal 1976.
(5) John Bellamy Foster, 'Marx's Ecology', materialism and nature, Monthly Review Press, Nex York, 2000. Paul Burkett, 'Marx and Nature', a red and green perspective, St. Martins' press, New York, 1999.)
L'unique limite des deux chercheurs est que, même s’ils partent de points de vue matérialistes basés sur Marx & Engels, ils ne se sont pas référés dans la recherche de perspectives aux expériences effectives du mouvement ouvrier révolutionnaire, entre autre à l'héritage des communistes de gauche. Ceci ne réduit en rien la valeur d’une contribution qui permet la « réhabilitation » de l'analyse marxiste de l'homme & de la nature face aux falsifications staliniennes.
D’autres sources intéressantes à ce sujet sont : J. Grevin, Myth ou the Green Economy, in Revue Internationale 138, 2009 et le scientifique qui a imaginé le concept de la biosphère et qui a aussi souffert des poursuites staliniennes: Vladimir I. Vernadsky ; « The Biosphere », Moscow, 1926, reprint Copernicus-Springer Verlag, New York, 1997.
(6) Arran Gare dans 'Soviet Environmentalism', The Path not taken' in 'The Greening of Marxism', edited by Ted Benton, Guilford Press, New York London, 1996.
(7) Christopher Caudwell, Studies and further studies in a dying culture, Monthly Review Press, 1971, Men and Nature, pp151-2. Un marxiste critique qui est mort jeune pendant le guerre civile en Espagne.
(8) Amedeo Bordiga, in Espèce humaine et croûte terrestre, 341, Petite bibliothèque Payot, Paris 1978.
(9) Friedrich Engels, le problème du logement, SUN, Nijmegen.
Rubrique:
Face au poison de la division régionaliste et nationaliste: unité et solidarité ouvrière
- 1436 lectures
Face à la crise généralisée catastrophique qui frappe son système, face au besoin croissant d’unité et de solidarité des prolétaires, la bourgeoisie cherche, par tous les moyens à distiller le poison de la division et de la confrontation, à nous entraîner sur le terrain obsolète de la compétition et de la concurrence, terrain indissociable du capitalisme lui-même. Par tous les moyens, la classe dominante cherche à pourrir l’esprit des prolétaires avec cette idée : “Vos intérêts sont ceux de telles ou telles fractions de la bourgeoisie.” Bien sûr, la bourgeoisie camoufle ceci en parlant des “intérêts supérieurs” de l’entreprise ou de la nation en général, comme si l’entreprise ou la nation n’existaient pas pour servir précisément les seuls intérêts de classe de nos exploiteurs.
Cette distillation du poison de la division a de nombreux visages. Ainsi nous assistons, depuis plusieurs années, à la montée en puissance des revendications régionalistes. En Espagne, tandis que les indépendantistes basques et catalans remportaient les élections locales, une manifestation monstre était organisée à Barcelone pour réclamer “une Catalogne indépendante (voir article).” De même, en Belgique, après la crise politique de 2010-2011 sur fond d’indépendantisme flamand, la Nieuw-Vlaamse Alliantie – Alliance néo-flamande – triomphait aux élections communales, notamment son chef de file, Bart De Wever, qui remportait haut la main un tas de communes dont la ville d’Anvers (voir article). Au Royaume-Uni, l’Écosse, région riche en ressources minières, organisera un référendum en 2014 à propos de son indépendance ! Dans une moindre mesure, en Italie, la puissante Ligue du Nord revendique, depuis des années, l’autonomie de la Padanie.
Partout, ces velléités indépendantistes s’accompagnent d’un discours écœurant dénonçant les ouvriers des autres régions qui, tels des vampires, suceraient le sang fiscal et économique des travailleurs locaux.
 La propagande bourgeoise ne cesse alors de chercher des bouc-émissaires afin de dédouaner son système capitaliste en faillite. Elle canalise la colère des ouvriers et de la population en livrant en pâture des “coupables” désignés, fabriqués sur mesure, afin de “diviser pour mieux régner”. Ce nationalisme réactivé s’exprime de plus en plus ouvertement dans les médias de manière “décomplexée”. D’un côté, par exemple, la bourgeoisie allemande, avec en échos les propos de ce qu’on appelle la “troika” (Commission, BCE, FMI), accuse la population et les prolétaires “grecs et cypriotes” d’être de véritables “tricheurs”, des “fainéants” qui ne “payent pas d’impôt” ; les populations espagnoles ou portugaises, de vivre elles aussi “aux crochets” des pays du nord de l’Europe. De l’autre côté, les bourgeoisies et médias de ces mêmes pays incriminés, se présentant comme les “victimes de l’Allemagne” et de la “politique de Merkel”, expliquent simplement la misère noire croissante qu’elles imposent du fait de “l’égoïsme” de voisins “nantis” !
La propagande bourgeoise ne cesse alors de chercher des bouc-émissaires afin de dédouaner son système capitaliste en faillite. Elle canalise la colère des ouvriers et de la population en livrant en pâture des “coupables” désignés, fabriqués sur mesure, afin de “diviser pour mieux régner”. Ce nationalisme réactivé s’exprime de plus en plus ouvertement dans les médias de manière “décomplexée”. D’un côté, par exemple, la bourgeoisie allemande, avec en échos les propos de ce qu’on appelle la “troika” (Commission, BCE, FMI), accuse la population et les prolétaires “grecs et cypriotes” d’être de véritables “tricheurs”, des “fainéants” qui ne “payent pas d’impôt” ; les populations espagnoles ou portugaises, de vivre elles aussi “aux crochets” des pays du nord de l’Europe. De l’autre côté, les bourgeoisies et médias de ces mêmes pays incriminés, se présentant comme les “victimes de l’Allemagne” et de la “politique de Merkel”, expliquent simplement la misère noire croissante qu’elles imposent du fait de “l’égoïsme” de voisins “nantis” !
Face à cette propagande nauséabonde, à ces préjugés bassement entretenus et cultivés, aux divisions, aux conflits des uns contre les autres, nous devons réaffirmer la nécessité de l’unité internationale de nos luttes.
Notre véritable force, c’est en effet la massivité de notre combat, l’union par-delà les secteurs, les races, les frontières et les nations. À un monde divisé et cloisonné par les intérêts privés du capital, ceux d’une classe d’exploiteurs arrogants, les fameux “1 %” dénoncés par les “Indignés”, nous devons opposer notre solidarité. Nous devons prendre conscience, nous qui travaillons dans des conditions de plus en plus inhumaines, que nous sommes tous les vraies victimes d’un système barbare à l’agonie. Face au chacun pour soi, nous devons nous rassembler, réfléchir et discuter ensemble, sur les moyens de défendre notre dignité et nos conditions de vie.
Internationalisme / 10 avril 2013
Rubrique:
Le lavage de cerveau nationaliste empêche une réaction unie
- 1438 lectures
[1….]
2. La pression de la décomposition met en évidence les faiblesses de la bourgeoisie belge
(…) La division au sein des diverses fractions nationales exprime avant tout la pression croissante de la crise historique du capitalisme sur la cohésion de l’ensemble des bourgeoisies de la planète. De l’opposition entre Républicains et démocrates aux USA sur la politique à mener pour faire face à la dépression jusqu’aux oppositions entre les régions riches d’Italie du Nord ou d’Espagne (la Catalogne) (voir article) et les régions pauvres de ces pays, ou encore le surgissement dans des pays comme les Pays-Bas de fractions ouvertement anti-européennes, on peut constater que ces tensions s’exacerbent un peu partout. Dans ce cadre il est erroné de voir les tensions (sous-)nationalistes comme une «exception Belge»,
Ceci étant dit, il est également incontestable que la bourgeoisie belge est caractérisée par un manque évident d’homogénéité: depuis la création artificielle de l’État belge en 1830, des tensions existaient en son sein. Ces tensions entre fractions régionales se sont particulièrement développées depuis la première guerre mondiale et se sont exacerbées depuis l’ouverture de la crise historique à la fin des années 1960. Le dernier avatar de ces tensions a été la montée en puissance lors des dernières élections du parti autonomiste flamand NVA (Nieuwe Vlaamse Alliantie). Pendant les 18 mois de négociations interminables, suivant les élections fédérales de juin 2010, les diverses fractions se sont déchirées comme des loups enragés afin de se positionner le mieux possible pour assurer leur survie dans la lutte sans merci qui est engagée sur le marché mondial, perdant même de vue à certains moments que cette lutte fratricide risquait de les mener tous à leur perte.
Si la bourgeoisie belge est effectivement divisée en diverses fractions nationales et régionales qui s’entre-déchirent, lorsque leurs intérêts vitaux sont menacés, celles-ci, repoussent ces conflits au second plan et s’unissent afin de défendre leurs intérêts communs. Il serait naïf de croire que, pour la défense de leurs intérêts communs fondamentaux - le maintien de leurs profits, de leurs parts de marché menacées par la concurrence exacerbée - ces fractions bourgeoises ne se coalisent pas pour imposer leur loi aux exploités.
3. La bourgeoisie exploite ses faiblesses dans un battage nationaliste intense contre la classe ouvrière
L’histoire de ces 50 dernières années nous apprend que la bourgeoisie belge utilise habilement ses divisions internes contre la classe ouvrière dans un double objectif:
3.1. Freiner la prise de conscience des attaques et du rôle central de l’État dans celles-ci.
Face au risque de défaut de paiement, tous les états européens ont lancé de gigantesques plans d’austérité pour tenter d’assainir leurs finances publiques et leur système bancaire. Ces plans dévoilent toutefois de plus en plus le rôle de l’État, ce pseudo ‘État social’, dans l’imposition de l’austérité capitaliste, ce qui risque d’orienter la colère ouvrière contre celui-ci. Loin d’être un arbitre au-dessus de la mêlée, garant de la justice sociale, «l’État démocratique» se manifeste ici pour ce qu’il est en réalité: l’instrument de la classe exploiteuse pour imposer des conditions de plus en plus impitoyables à la classe ouvrière.
Cependant, les diverses bourgeoisies nationales utilisent tous les moyens de mystification à leur disposition pour occulter le plus longtemps possible cette réalité aux yeux de la classe ouvrière et pour au contraire embobiner cette dernière dans les illusions démocratiques. Dans ce contexte, la bourgeoisie belge et ses diverses fractions attisent précisément les oppositions entre régions et communautés afin de noyer les attaques et le rôle central qu’y occupe «l’État démocratique» dans un imbroglio institutionnel.
De manière révélatrice, les années 1970, les années de la première manifestation de la crise historique du capitalisme, ont aussi été en Belgique le début d’une vaste série de mesures de restructuration institutionnelle, visant à régionaliser l’État et à diluer les responsabilités à divers niveaux de pouvoir communautaire, régional ou communal. Une flopée de gouvernements fédéral, communautaires et régionaux (sept au total) ont vu le jour, des regroupements de communes et de régions urbaines ont été mis en place, en plus de la privatisation partielle ou totale de certaines entreprises publiques (Poste, chemin de fer, téléphones, gaz et électricité, secteur des soins de santé, ...). Ceci a entraîné un partage ubuesque des compétences, une redistribution des fonctionnaires du secteur public sur les différents niveaux de pouvoir et la création de toutes sortes de statuts mixtes. Dans le concret, ces «réformes de l’État» ont abouti aux résultats suivants:
-accroître l’efficacité de l’exploitation: la «responsabilisation» des entités autonomes organise de fait la concurrence interne entre régions. Les travailleurs flamands sont appelés à être plus «performants» que leurs collègues wallons et vice versa, les régions, les communes, sont en concurrence pour gérer plus rationnellement les budgets sociaux ou mieux implémenter la flexibilité de leurs fonctionnaires, etc.
-accélérer les restructurations et les attaques contre les statuts du personnel, les salaires et les conditions de travail des fonctionnaires sous le couvert de réorganisation des structures de l’État;
-diluer l’ampleur des attaques, en les fragmentant sur divers niveaux de pouvoir ou en responsabilisant divers niveaux de pouvoir pour divers types de mesures.
3.2. Paralyser la capacité de réaction et d’extension des luttes de la classe ouvrière.
Lorsque les travailleurs s’insurgent contre les attaques dont ils sont victimes, la bourgeoisie -à travers en particulier de ses syndicats- se sert de l’intensification du battage (sous-)nationaliste et régionaliste pour entraver toute réaction unitaire des travailleurs et toute extension de leurs luttes face à l’agression subie. Cela aussi c’est une constante du rapport de force entre les classes en Belgique.
Depuis les années 1960 en particulier, la bourgeoisie utilise la mystification régionaliste pour freiner la prise de conscience au sein de la classe ouvrière de la nécessité d’une réaction unitaire et de l’extension de ses luttes face aux attaques. Lors de la grève générale de 1960, le syndicalisme radical, avec à sa tête André Renard, détourne la combativité des ouvriers des grands bassins industriels de Liège et du Hainaut vers le sous-nationalisme wallon, faisant croire qu’un sous-état wallon sous la direction du PS pourrait s’opposer au capital national et sauver du déclin les industries de la région. Les travailleurs paieront cher cette mystification, car ce sont ces autorités régionales qui liquideront progressivement l’industrie minière et sidérurgique wallonne dans les années 1970 et 1980. Depuis la fin des années ’80, la Flandre est confrontée aux mêmes problèmes avec le bassin minier limbourgeois, les chantiers navals (Boel Tamise) et l’automobile (Renault et dernièrement Opel et Ford). Une fois de plus, c’est la même mystification qui est utilisée: «Ce que nous faisons-nous mêmes, nous le faisons mieux» est le slogan des sous-nationalistes flamands. De fait, la liquidation des mines et des chantiers navals a été rondement menée et récemment, ce sont les travailleurs d’Opel et de Ford qui se sont fait rouler dans la farine par les promesses du gouvernement flamand et les campagnes sur le «combat de la Flandre pour les sauver».
Une fois de plus aujourd’hui, alors que les travailleurs commencent à engager la riposte face aux attaques, la régionalisation des différents niveaux de pouvoir et le battage (sous-)nationaliste sont exploités par la bourgeoisie et ses organisations syndicales, d’abord pour diviser, isoler et enfermer les mouvements de lutte dans des carcans qui n’offrent aucune perspective d’avancée pour la classe ouvrière. Ainsi, lorsque les fonctionnaires subiront des attaques contre leurs salaires et les conditions de travail, ils seront amenés à manifester, chaque groupe devant son pouvoir de tutelle (fédéral, communautaire, régional, provincial, communal, ...). D’autre part, les syndicats n’hésitent pas à entraîner la lutte ouvrière vers le terrain pourri de la division régionale, voire des intérêts nationalistes. Ainsi, les enseignants flamands et francophones sont appelés à lutter pour des revendications différentes dans chacune des régions. Et récemment encore, les organisations syndicales appelaient les travailleurs à manifester pour une sécurité sociale belge unitaire, contre les velléités des nationalistes flamands de la régionaliser.
[4….]
5. Contexte et perspectives pour les luttes ouvrières
Le battage communautaire intense de la bourgeoisie, qui se développe en réalité de manière quasi ininterrompu depuis l’été 2008, a caché aux travailleurs la réalité de la crise et des enjeux et a créé des conditions difficiles pour leur mobilisation, pour leur lutte et surtout pour l’extension de celle-ci. Ceci explique pourquoi les réactions ouvrières sont jusqu’à présent moins marquées que dans les pays voisins comme la France ou l’Allemagne. Il serait par ailleurs illusoire de penser que la bourgeoisie s’attachera à dissiper le brouillard dans la période actuelle. Bien au contraire, elle tend à exploiter un certain soulagement au sein de la classe ouvrière du fait que les tensions au niveau de la gestion de l’État belge semblent réglées pour jouer à présent la carte de la nécessaire «unité nationale» face aux marchés en appelant à une «solidarité nationale» pour «défendre notre pays» contre les attaques d’un «monde extérieur agressif» et pour «corriger les erreurs du passé». Pour la classe ouvrière en Belgique, la situation a été difficile ces dernières années et cela va encore rester difficile pendant une certaine période.
(…) Tous les éléments avancés dans ce rapport démontrent bien que le décalage avec la situation sociale dans les autres pays d’Europe est plus une question de perception et de prise de conscience qu’une réalité objective: la réalité économique et sociale en Belgique est tout à fait parallèle à celles de pays comme la France ou les Pays-Bas.
Aussi, la situation sociale peut évoluer très vite, comme l’ont illustré le «printemps arabe» (…) en Tunisie et en Égypte et les mouvements des «Indignés» en Espagne ou «Occupy» aux États-Unis.
Ces mouvements depuis 2011, aussi limités qu’ils soient encore, révèlent une sincère volonté de débattre collectivement, de réfléchir collectivement et de lutter ensemble, de tourner le dos à l’individualisme du capitalisme. Le fait que ces mouvements se développent au niveau international leur donne leur importance décisive. Ils indiquent que la classe ouvrière en Belgique peut très vite retrouver le chemin de la lutte. Et une fois en mouvement, elle peut très bien réagir avec encore beaucoup plus de combativité et de détermination qu’ailleurs. Sur ce plan là aussi, contrairement aux campagnes de la bourgeoisie, la Belgique n’est pas une exception.
Internationalisme/novembre 2011
Rubrique:
Internationalisme n° 359 - 3e trimestre 2013
- 996 lectures
Syrie: guerre impérialiste ou solidarité de classe
- 921 lectures
Irak, Afghanistan, Liban, Egypte, Syrie, les massacres ne cessent de s’étendre. L’horreur et la barbarie capitalistes se répandent, les morts s’amoncellent. Véritable génocide en marche que rien ne semble pouvoir arrêter, la guerre impérialiste gagne encore et toujours du terrain. Le capitalisme en pleine décadence et décomposition entraîne le monde dans un chaos et une barbarie généralisés(1). L’utilisation des armes chimiques comme en Syrie actuellement n’est malheureusement qu’un des instruments de morts parmi bien d’autres. Mais cette perspective de destruction de l’humanité n’a rien d’irrémédiable. Le prolétariat mondial ne doit pas rester indifférent devant autant de massacres et de guerres, produits d’un système en pleine putréfaction. Seul le prolétariat en tant que classe révolutionnaire peut mettre définitivement fin à cette généralisation de la barbarie capitaliste. Communisme ou barbarie, plus que jamais l’humanité est confrontée à cette seule alternative.
La population syrienne sacrifiée sur l’autel des intérêts impérialistes
Le lundi 21 août, une attaque à l’arme chimique a fait des centaines de morts près de Damas, la capitale syrienne. Sur toutes les chaînes de télévision, dans tous les journaux s’étalaient des images insupportables d’enfants, de femmes et d’hommes agonisants. La bourgeoisie, sans aucun scrupule, se saisissait de cette tragédie humaine pour défendre toujours et encore ses sordides intérêts. Le régime de Bachar el Assad, boucher parmi les bouchers, venait de franchir la ligne rouge. Car officiellement, pour la classe bourgeoise, on peut massacrer à tour de bras mais pas avec des armes chimiques. Ce qu’elle appelle dans son jargon des armes sales, qui seraient bien différentes selon elle des armes propres, tels des bombes et obus en tout genre ou encore comme des bombes atomiques lancées en 1945 par les américains sur Hiroshima et Nagasaki. Mais l’hypocrisie de la bourgeoisie ne connaît pas de bornes. Depuis la Première Guerre mondiale de 1914-1918 où les gaz toxiques ont été employés massivement pour la première fois, faisant plusieurs centaines de milliers de morts, cette arme chimique n’a jamais cessé depuis d’être produite, « perfectionnée » et employée. Les accords de façade quant à sa non utilisation, notamment après les deux guerres mondiales et dans les années 1980 n’étant que déclarations de principes, ne visant aucunement à être appliquées. Et tel fut le cas ! Bien des théâtres de guerre depuis cette époque ont connu l’utilisation de ce type d’armes. Au Nord Yémen de 1962 à 1967, l’Egypte employa sans vergogne le gaz moutarde. Dans la guerre Iran-Irak en 1988, des villes telle Halabja ont été bombardées à l’arme chimique faisant plus de 5.000 morts, sous l’œil bienveillant et complice de la ‘communauté internationale’, des Etats-Unis à la France, en passant par l’ensemble des membres de l’ONU ! Mais l’utilisation de ce type d’armes n’est pas l’apanage des petits pays impérialistes, ou des dictatures à la Bachar el Assad, comme voudrait nous le faire croire la bourgeoisie. L’utilisation la plus massive de l’arme chimique à ce jour, à côté des bombardements au napalm, fut l’œuvre des Etats-Unis pendant la guerre du Vietnam. Il s’agissait de déverser massivement de l’herbicide contaminé à la dioxine afin de détruire les rizières et les forêts. Il fallait tout raser et réduire la population vietnamienne et le Vietcong à la famine. Terres brûlées et désertifiées, population grillée et asphyxiée... voilà l’œuvre de l’action du capitalisme américain au Vietnam, qui aujourd’hui avec d’autres grandes puissances occidentales, telle la France, s’apprêtent à intervenir en Syrie pour y défendre prétendument la population. Depuis le début de cette guerre en Syrie, il y a eu plus de 100.000 morts et au moins un million de réfugiés dans les pays limitrophes. Au-delà des discours déversés à longueur de temps par l’ensemble des médias bourgeois, la classe ouvrière doit savoir quelles sont les véritables causes du déchaînement de la guerre impérialiste en Syrie.
En Syrie, c’est la société capitaliste décadente qui est responsable
La Syrie est actuellement au cœur du développement des tensions inter-impérialistes et du chaos qui s’étend depuis l’Afrique du Nord jusqu’au Pakistan. Si la bourgeoisie syrienne s’affronte dans la guerre au sein d’un pays maintenant en ruines, elle peut s’appuyer pour continuer son jeu de massacre sur l’appétit insatiable de bon nombre d’impérialismes de tout acabit. Dans la région, l’Iran, le Hezbollah libanais, l’Arabie saoudite, Israël, la Turquie..., tous sont impliqués plus ou moins directement dans ce conflit sanglant. Les plus puissants impérialismes du monde y défendent également leurs plus sordides intérêts. La Russie, la Chine, la France, l’Angleterre et les Etats-Unis participent eux aussi à la propagation de cette guerre et à son extension dans l’ensemble de la région. Devant leur impuissance croissante à contrôler un tant soit peu la situation, ils y sèment encore plus le chaos et la destruction, suivant parfois cette vieille stratégie de la terre brûlée (« si je ne peux dominer cette région, qu’elle brûle »).
Durant la guerre froide, cette période qui va officiellement de 1947 à 1991 et la chute de l’URSS, deux blocs s’opposaient, l’Est et l’Ouest, avec à leur tête respectivement la Russie et les Etats-Unis. Ces deux super-puissances dirigeaient d’une main de fer leurs « alliés » ou « satellites », contraints à l’obéissance face à l’ogre ennemi. Le terme qualifiant cet ordre mondial s’appelait la discipline de bloc. Cette période historique fut lourde de danger pour l’humanité, puisque si la classe ouvrière n’avait pas été en mesure de résister, même passivement, à l’embrigadement idéologique guerrier, une troisième conflagration mondiale aurait été possible. Depuis l’effondrement de l’URSS, il n’y a plus de blocs, plus de risque d’une troisième guerre mondiale généralisée. Seulement, la discipline de bloc aussi a volé en éclats. Chaque nation joue depuis sa propre carte, les alliances impérialistes sont de plus en plus éphémères et de circonstance... ainsi, les conflits se multiplient sans qu’aucune bourgeoisie ne puisse finalement rien contrôler. C’est le chaos, la décomposition grandissante de la société.
Ainsi, l’affaiblissement accéléré de la première puissance impérialiste mondiale, les Etats-Unis, participe activement de l’enfoncement de tout le Moyen et Proche-Orient dans la barbarie. Au lendemain de l’attaque chimique aux alentours de Damas, les bourgeoisies française et anglaise, suivies beaucoup plus timidement par la bourgeoisie américaine, ont déclaré de manière tonitruante qu’un tel forfait ne pouvait rester impuni. La réponse militaire était imminente et serait proportionnelle au crime qui venait de se produire. Seulement voilà, la bourgeoisie américaine et certaines bourgeoisies occidentales dans son sillage, viennent de connaître deux revers retentissants dans les guerres d’Afghanistan et d’Irak, pays en totale décomposition. Comment intervenir en Syrie sans se retrouver dans la même situation ? Mais plus encore, ces bourgeoisies ont à faire avec ce qu’elles appellent l’opinion publique, au moment même où la Russie envoie de nouveaux bateaux de guerres dans la région. La population ne veut pas de cette intervention ! Elle ne croit plus majoritairement aux mensonges de sa propre bourgeoisie. L’opinion publique défavorable à cette intervention, y compris sous la forme de bombardements limités dans le temps, pose un problème aux bourgeoisies occidentales.
Voici ce qui a finalement contraint la bourgeoisie anglaise à renoncer à intervenir militairement en Syrie, au prix de désavouer elle-même ses premières déclarations va-t-en-guerre ! C’est aussi la preuve que la bourgeoisie occidentale n’a pas de « bonne solution », que des mauvaises : soit elle n’intervient pas (comme vient de le choisir la Grande-Bretagne) et alors c’est un immense aveu de faiblesse ; soit elle intervient (comme cela semble se dessiner vraisemblablement pour les Etats-Unis et la France) et alors elle n’en retirera rien d’autre que toujours plus de chaos, d’instabilité et de tensions impérialistes incontrôlables.
Seul le prolétariat peut, en détruisant le capitalisme, venir à bout de la barbarie
Le prolétariat ne peut pas rester indifférent à toute cette barbarie. Ce sont des exploités, des familles entières qui se font massacrer, pourchasser par toutes les cliques impérialistes. Chiites ou sunnites, laïcs ou druzes... il n’y a de ce point de vue aucune différence. La réaction humaine et saine est de vouloir faire quelque chose, « tout de suite », d’arrêter ces crimes abominables. C’est ce sentiment qu’exploitent les grandes démocraties pour chaque fois mener et justifier leurs offensives guerrières au nom de « l’humanitaire ». Et chaque fois, la situation mondiale empire. Il s’agit donc d’un piège.
La seule façon pour l’humanité d’exprimer sa véritable solidarité envers toutes ces victimes du capitalisme pourrissant, c’est de mettre à bas ce système qui produit toutes ces horreurs. Un tel bouleversement ne se fera effectivement pas en un jour. Mais si ce chemin est long, c’est le seul à mener réellement à un monde sans guerre ni patrie, sans misère ni exploitation. Car la classe ouvrière n’a pas de drapeaux nationaux à défendre. Le pays où elle vit est le lieu de son exploitation et pour certains dans le monde, le lieu de leur mort, broyés par les armes de la classe capitaliste. Il est de la responsabilité de la classe ouvrière d’opposer au nationalisme guerrier bourgeois son internationalisme. Aussi difficile que soit ce chemin, il est nécessaire et... possible ! La classe ouvrière d’aujourd’hui doit se rappeler que la Première Guerre mondiale n’a pas pris fin de par la bonne volonté des belligérants, pas plus que par la défaite de l’Allemagne. C’est la révolution prolétarienne qui y a mis fin et elle seule.
Tino/31.08.2013
1)Lire p.4 la partie de la résolution du XX° congrès du CCI sur les tensions impérialiste
Rubrique:
L'Egypte nous montre l'alternative: socialisme ou barbarie
- 1212 lectures
Face à l'agitation sociale en Égypte, l'armée a prouvé qu'elle reste la fraction la plus à même d'assurer le pouvoir et la défense des intérêts globaux de la bourgeoisie nationale.
Partout dans le monde, le sentiment que l'ordre actuel des choses ne peut plus continuer comme avant grandit. Suite aux révoltes du "Printemps arabe", au mouvement des Indignados en Espagne et celui des Occupy aux Etats-Unis, en 2011, l'été 2013 a vu des foules énormes descendre dans la rue en Turquie et au Brésil.
Des centaines de milliers de personne, voire des millions, ont protesté contre toute sorte de maux: en Turquie c'était la destruction de l'environnement par un "développement" urbain insensé, l'intrusion autoritaire de la religion dans la vie privée et la corruption des politiciens ; au Brésil, c'était l'augmentation des tarifs des transports en commun, le détournement de la richesse vers les dépenses sportives de prestige alors que la santé, les transports, l'éducation et le logement périclitent – et encore une fois, la corruption des politiciens. Dans les deux cas, les premières manifestations ont rencontré une répression policière brutale qui n'a fait qu'élargir et approfondir la révolte. Et dans les deux cas, le fer de lance du mouvement n'était pas les "classes moyennes" (c'est-à-dire, en langage médiatique, n'importe quelle personne qui possède encore un emploi), mais la nouvelle génération de la classe ouvrière qui, bien qu'éduquée, n'a qu'une maigre perspective de trouver un emploi stable et pour qui vivre au sein d'une économie "émergente" signifie surtout observer le développement de l'inégalité sociale et la richesse répugnante d'une minuscule élite d'exploiteurs.
En juin et juillet, c'était encore au tour des Égyptiens de descendre par millions dans les rues, revenant à la Place Tahrir qui fut l'épicentre de la révolte de 2011 contre le régime Moubarak. Eux aussi étaient poussés par de vrais besoins matériels, dans une économie qui n'est pas tant "émergente" que plutôt stagnante ou en régression. En mai, un ancien ministre des finances, un des principaux économistes égyptiens, soulignait dans un entretien au Guardian, que "L'Egypte souffre de sa plus grave crise économique depuis la Grande Dépression. Dans ses effets sur les plus démunis, la situation économique du pays est la pire depuis les années 1930". Et l'article de continuer : "Depuis la chute de Hosni Moubarak en 2011, l'Egypte a connu une chute dramatique des revenus à la fois de l'investissement étranger et du tourisme, suivie par une chute de 60% dans les réserves de devises, un déclin de 3% de la croissance, et une dévaluation rapide de la livre égyptienne. Tout cela a causé une augmentation vertigineuse des prix de la nourriture et du chômage, et une pénurie de carburant et de gaz pour la cuisine (...) Actuellement, selon les chiffres du gouvernement égyptien, 25,2% des Égyptiens vivent en dessous du seuil de pauvreté et 23,7% ne sont que guère au-dessus".
Le gouvernement islamiste "modéré" dirigé par Morsi et les Frères musulmans (avec le soutien des islamistes "radicaux") s'est rapidement révélé tout aussi corrompu que l'ancien régime, alors que ses tentatives d'imposer une "moralité" islamique étouffante a provoqué, comme en Turquie, un ressentiment énorme parmi la jeunesse urbaine.
Mais alors que les mouvements en Turquie et au Brésil, qui en pratique sont dirigés contre le pouvoir en place, ont généré un véritable sentiment de solidarité et d'unité parmi tous ceux qui participaient à la lutte, la perspective en Égypte est bien plus sombre : celle de la division de la population derrière différentes fractions de la classe dominante, voire la descente dans une guerre civile sanglante. La barbarie qui a englouti la Syrie ne nous montre que trop clairement ce que cela pourrait être.
Le piège de la démocratie
On a affublé les événements de 2011 en Égypte et en Tunisie du nom de "révolution". Mais une révolution est autre chose que des manifestations des masses dans les rues – même si cela est un point de départ nécessaire. Nous vivons une époque où la seule révolution possible est mondiale, prolétarienne et communiste : une révolution non pas pour changer de régime mais pour démanteler l'Etat ; non pas pour une gestion plus "juste" du capitalisme, mais pour le renversement du rapport social capitaliste tout entier ; non pas pour la gloire de la nation mais pour l'abolition des nations et la création d'une communauté humaine planétaire.
Les mouvements sociaux que nous voyons aujourd'hui sont encore loin de la conscience d'eux-mêmes et de l'auto-organisation nécessaires pour créer une telle révolution. Certes, ce sont des pas dans cette direction, qui expriment un effort profond du prolétariat de se trouver, de retrouver son passé et son avenir. Mais ce sont des pas hésitants, qui pourront être facilement dévoyés par la bourgeoisie, dont l'idéologie est profondément enracinée et constitue un énorme obstacle dans les esprits des exploités eux-mêmes. La religion est certes un de ces obstacles idéologiques, un "opium" qui prêche la soumission envers l'ordre dominant. Mais encore plus dangereuse est l'idéologie démocratique.
En 2011, les masses dans la Place Tahrir exigeaient la démission de Moubarak et la "fin du régime". Et on a effectivement poussé Moubarak dehors – surtout après le surgissement d'une vague puissante de grèves à travers le pays, ajoutant une dimension de plus à la révolte sociale. Mais le régime capitaliste est plus que le simple gouvernement en place : au niveau social, c'est tout le rapport basé sur le travail salarié et la production pour le profit. Au niveau politique, c'est la bureaucratie, la police, et l'armée. Et c'est aussi la façade de la démocratie parlementaire, où régulièrement au bout de quelques années, on offre aux masses le choix d'une nouvelle bande d'escrocs pour les plumer. En 2011, l'armée – que beaucoup de manifestants croyaient "unie" au peuple – est intervenue pour virer Moubarak et organiser les élections. Les Frères musulmans, qui tiraient leur grande force des régions rurales les plus arriérées mais qui étaient également le parti le mieux organisé dans les centres urbains, ont gagné les élections et, depuis, ont fait la plus claire des démonstrations possibles que changer de gouvernement par les élections ne change rien. Et pendant ce temps, le véritable pouvoir est resté en place comme dans tant d'autres pays : celui détenu au sein de l'armée, la seule force réellement capable d'assurer l'ordre capitaliste sur le plan national.
Lorsque les masses se sont déplacées de nouveau vers la Place Tahrir en juin, elles étaient pleines d'indignation contre le gouvernement Morsi et contre la réalité quotidienne de leurs conditions de vie face à une crise économique qui n'est pas simplement "égyptienne" mais mondiale et historique. Malgré le fait que beaucoup d'entre eux ont pu voir le vrai visage répressif de l'armée en 2011, l'idée que "le peuple et l'armée ne font qu'un" était très répandue, et a trouvé une nouvelle vie lorsque l'armée a commencé à prévenir Morsi qu'il devrait écouter le peuple ou faire face aux conséquences. Quand Morsi a été renversé par un coup d'Etat militaire quasiment sans effusion de sang, les scènes de célébrations ont été importantes sur la Place Tahrir. Est-ce que cela veut dire que le mythe démocratique ne tient plus les masses ? Non : l'armée prétend agir au nom de la "vraie démocratie" trahie par Morsi, et promet d'organiser de nouvelles élections.
Ainsi le garant de l'Etat, l'armée, intervient de nouveau, afin d'empêcher que la colère des masses ne se retourne contre l'Etat lui-même. Mais elle le fait cette fois-ci au prix de divisions profondes qu’elle a semées au sein de la population. Que ce soit au nom de l'Islam ou de la légitimité démocratique du gouvernement Morsi, un nouveau mouvement de protestation est né, qui exige le retour du régime Morsi et qui refuse de travailler avec ceux qui l'ont démis. La réponse de l'armée fut rapide : un massacre impitoyable des manifestants devant le QG de la Garde républicaine. Il y a eu aussi des accrochages, dont certains mortels, entre des groupes rivaux de manifestants.
Le danger de guerre civile et la force capable de l'empêcher
Les guerres en Libye et en Syrie ont démarré avec des manifestations populaires contre les régimes en place. Mais dans les deux cas, la faiblesse de la classe ouvrière et la force des divisions tribales et sectaires ont fait que ces révoltes furent rapidement englouties par des conflits armés entre factions bourgeoises. Et dans les deux cas, ces conflits locaux ont immédiatement acquis une dimension internationale: en Libye, la Grande- Bretagne et la France, discrètement soutenues par les États-Unis, sont intervenues pour armer et "guider" les forces rebelles ; en Syrie, le régime Assad a survécu grâce au soutien de la Russie, de la Chine, de l'Iran, du Hezbollah et autres vautours du même acabit, alors que l'Arabie saoudite et le Qatar ont armé les rebelles avec le soutien plus ou moins ouvert de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Dans les deux cas, l'élargissement du conflit a accéléré la chute dans le chaos et l'horreur.
Le même danger existe en Egypte aujourd'hui. L'armée n'est absolument pas prête à lâcher le pouvoir. Pour l'instant, les Frères musulmans ont promis de réagir pacifiquement au coup d'Etat militaire, mais à côté de l'islamisme "pragmatique" d'un Morsi, il y a des factions plus extrêmes qui sont déjà adossées au terrorisme. La situation ressemble de manière sinistre à celle de l'Algérie après 1991, quand l'armée a renversé un gouvernement islamiste "porté par les urnes", provoquant ainsi une guerre civile sanglante entre l'armée et des groupes islamistes armés comme le FIS. Comme d'habitude, la population civile en avait été la principale victime: on a estimé le nombre de morts entre 50.000 et 200 000.
La dimension impérialiste est également présente en Egypte. Les États-Unis ont exprimé leur regret à propos du coup d'État militaire, mais leurs liens avec l'armée sont anciens et profonds, et ils n'aiment pas le moins du monde le type d'islamisme prôné par Morsi ou par Erdogan en Turquie. Les conflits qui s'étendent aujourd'hui depuis la Syrie vers l'Irak et le Liban pourraient également atteindre une Égypte déstabilisée.
Mais la classe ouvrière en Égypte est une force bien plus formidable qu'en Syrie ou en Libye. Elle a une longue tradition de luttes combatives contre l'État et ses syndicats officiels qui remonte au moins jusqu'aux années 1970. En 2006 et en 2007, des grèves massives se sont étendues à partir des usines textiles hautement concentrées, et cette expérience de défiance ouverte envers le régime a alimenté le mouvement de 2011, fortement marqué par l'empreinte de la classe ouvrière à la fois dans ses tendances à l'auto-organisation qui sont apparues sur la Place Tahrir et dans les quartiers, comme dans la vague de grèves qui ont finalement convaincu la classe dominante de se débarrasser de Moubarak. La classe ouvrière en Égypte n'est pas immunisée contre les illusions démocratistes qui imprègnent tout le mouvement social, mais il ne sera pas facile non plus pour les cliques bourgeoises de la convaincre d'abandonner ses intérêts de classe et de l'attirer dans le cloaque de la guerre impérialiste.
La capacité potentielle de la classe ouvrière de barrer le chemin à la barbarie se voit non seulement dans son histoire de grèves autonomes et d'assemblées générales, mais aussi dans les expressions explicites de conscience qui sont apparues dans les manifestations de rue : dans des pancartes qui proclament "Ni Morsi, ni les militaires !", ou "La révolution, pas un coup d'État !", ainsi que dans des prises de position plus directement politiques comme la déclaration des "camarades du Caire" publiée récemment sur le site libcom: "Nous voulons un avenir qui ne soit gouverné ni par l'autoritarisme minable et le capitalisme de copinage des Frères musulmans, ni par l'appareil militaire qui maintient sa poigne de fer sur la vie politique et économique, ni par un retour aux anciennes structures de l'ère Moubarak. Même si les rangs des manifestants qui descendront dans la rue le 30 juin ne sont pas unis autour de cet appel, il doit être le nôtre – cela doit être notre position parce que nous n'accepterons pas un retour aux périodes sanglantes du passé".(1)
Cependant, tout comme « le printemps arabe » a trouvé son véritable sens avec le soulèvement de la jeunesse prolétarienne en Espagne, qui a donné lieu à un questionnement bien plus profond de la société bourgeoise, la capacité de la classe ouvrière en Égypte de barrer la route à de nouveaux massacres ne pourra être réalisée qu'à travers la solidarité active et la mobilisation massive des prolétaires dans les vieux centres du capitalisme mondial.
Il y a cent ans, face à la Première Guerre mondiale, Rosa Luxembourg rappelait solennellement à la classe ouvrière que le choix offert par un ordre capitaliste sur le déclin était entre le socialisme ou la barbarie. L'incapacité de la classe ouvrière de mener à bien les révolutions qui ont répondu à la guerre de 1914-18 a eu comme conséquence un siècle de véritable barbarie capitaliste. Aujourd'hui, les enjeux sont plus élevés encore, parce que le capitalisme s'est donné les moyens de détruire toute vie sur la terre entière. L'effondrement de la vie sociale et le règne des bandes armées meurtrières – c'est ça, le chemin de la barbarie qui est illustré par ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. La révolte des exploités et des opprimés, la lutte massive pour défendre la dignité humaine et un véritable avenir – c'est ça, la promesse des révoltes sociales en Turquie et au Brésil. L'Égypte se tient à la croisée des chemins de ces deux choix radicalement opposés, et dans ce sens il est symbolique du dilemme auquel est confrontée toute l'espèce humaine.
Amos/10.07.2013
1 https://libcom.org/forums/news/we-can-smell-tear-gas-rio-taksim-tahrir-29062013
Rubrique:
Manifestations au Brésil: la répression policière provoque la colère de la jeunesse
- 1159 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article de Revolução Internacional, organe de presse du CCI au Brésil.
Une vague de protestations contre l’augmentation du prix des transports collectifs se déroule actuellement dans les grandes villes du Brésil, particulièrement dans la ville de São Paulo mais aussi à Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Aracaju et Natal. Cette mobilisation rassemble des jeunes, étudiants et lycéens et dans une moindre mesure, cependant non négligeable, des travailleurs salariés et autonomes (prestataires de services individuels).
La bourgeoisie brésilienne, avec à sa tête le PT (Parti du Travail) et ses alliés, a insisté pour réaffirmer que tout allait bien. Et cela alors que la réalité perceptible montre qu’il existe de grosses difficultés pour contenir l’inflation au moment où sont adoptées des mesures de soutien à la consommation des ménages afin d’éviter que l’économie n’entre en récession. Sans aucune marge de manœuvre, la seule alternative sur laquelle elle peut s’appuyer pour contenir l’inflation consiste d’une part à augmenter les taux d’intérêt et de l’autre à réduire les dépenses des services publics (éducation, santé et aide sociale).
Ces dernières années, beaucoup de grèves ont éclaté contre la baisse des salaires et la précarisation des conditions de travail, de l’éducation et du système de soins. Cependant, dans la majorité des cas, les grèves ont été isolées par le cordon sanitaire des syndicats liés au gouvernement "pétiste" (dominé par le PT) et le mécontentement a été contenu afin qu’il ne remette pas en question la "paix sociale" au bénéfice de l’économie nationale. C’est dans ce contexte qu’intervient l’augmentation du prix des transports à São Paulo et dans le reste du Brésil : toujours plus de sacrifices pour les travailleurs afin de soutenir l’économie nationale, c’est-à-dire le capital national.
Sans aucun doute, les exemples de mouvements qui ont explosé de par le monde ces dernières années, avec la participation de la jeunesse, mettent en évidence que le capitalisme n’a pas d’autre alternative à offrir pour le futur de l’humanité que l’inhumanité. C’est pour cela que la récente mobilisation en Turquie a eu un écho aussi fort dans les protestations contre le coût des transports au Brésil. La jeunesse brésilienne a montré qu’elle ne veut pas accepter la logique des sacrifices imposée par la bourgeoisie et s’inscrit dans les luttes qui ont secoué le monde ces dernières années comme la lutte des enfants de la classe ouvrière en France (lutte contre le CPE en 2006), de la jeunesse et des travailleurs en Grèce, Egypte et Afrique du Nord, des Indignés en Espagne, des "Occupy" aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
Une semaine de protestations et la réaction brutale de la bourgeoisie
Encouragées par le succès des manifestations dans les villes de Porto Alegre et de Goiânia, qui ont dû faire face à une forte répression et qui, malgré celle-ci, ont réussi à obtenir la suspension de l’augmentation du prix des transports, les manifestations à São Paulo ont commencé le 6 juin. Elles furent appelées par le Mouvement pour le libre accès aux transports (MPL, Movimento Passe Livre), groupe constitué majoritairement par des jeunes étudiants influencés par les positions de gauche, et aussi anarchistes, qui a vu une augmentation surprenante de ses adhérents pour atteindre entre 2.000 à 5.000 personnes. D’autres mobilisations intervinrent ensuite les 7, 11 et 13 juin. Dès le début, la répression fut brutale et s’est soldée par de nombreuses arrestations et de nombreux jeunes blessés. Il faut ici souligner le courage et la combativité des manifestants et la sympathie qu’ils ont suscitée rapidement dans la population, dès le début, à un point tel que cela a surpris les organisateurs.
Face aux manifestations, la bourgeoisie a déchaîné un niveau de violence peu commun dans l’histoire de mouvements de ce type, parfaitement pris en charge par les médias qui se sont empressés de qualifier les manifestants de vandales et d’irresponsables. Une personne haut placée dans la hiérarchie étatique, le procureur de justice Rogério Zagallo, s’est illustré publiquement en conseillant à la police de bastonner et tuer : "Cela fait deux heures que j’essaie de regagner mon domicile mais il y a une bande de singes révoltés qui bloquent les stations Faria Lima et Marginal Pinheiros. Quelqu’un pourrait-il informer la Troupe de Choc (Tropa de Choque : unité d’élite de la police militaire) que cette zone fait partie de ma juridiction et que s’ils tuent, ces fils de putes, c’est moi qui instruirai l’enquête policière (…). Comment ne pas avoir la nostalgie de l’époque où ce genre de choses se résolvait avec une balle en caoutchouc dans le dos de ces merdes".
En plus de cela, on a vu une succession de discours d’hommes politiques appartenant à des partis adversaires entre eux, comme le gouverneur d’État Geraldo Alckmin, du PSDB (parti de la social-démocratie brésilienne) et le maire de São Paulo, du PT, tous deux vociférant en défense de la répression policière et condamnant le mouvement. Une telle syntonie n’est pas commune, vu que le jeu politique de la bourgeoisie consiste typiquement à attribuer la responsabilité des problèmes qui se posent à la fraction de la bourgeoisie qui se trouve momentanément au pouvoir.
En réponse à la répression croissante et au rideau de fumée des principaux journaux, chaînes de télévision et radio, davantage de participants se sont réunis à chaque mobilisation, jusqu’à 20.000 personnes jeudi dernier, le 13 juin. La répression fut encore plus féroce et cela se traduisit par 232 arrestations et de nombreux blessés.
Il vaut la peine de souligner l’apparition d’une nouvelle génération de journalistes. Quoiqu’encore minoritaires, à travers une claire manifestation de solidarité, ils ont rendu compte des violences policières et, en même temps, en ont été les victimes. Conscients des manipulations toujours présentes dans les éditoriaux des grands médias, ces journalistes sont parvenus, d’une certaine manière, à faire percevoir que les actes de violence des jeunes sont une réaction d’autodéfense et que, certaines fois, les déprédations effectuées essentiellement contre des cabinets gouvernementaux et de la justice sont des manifestations non contenues d’indignation contre l’État. En plus de cela, des actes émanant de provocateurs, ceux que la police utilise habituellement dans les manifestations, ont également été rapportés.
La mise en évidence d’une série de manipulations qui constituait un démenti aux versions de source étatique officielle, des médias et de la police tentant de falsifier les faits, de démoraliser et criminaliser un mouvement légitime, eut pour effet de multiplier la participation des manifestants et d’augmenter le soutien de la population. En ce sens, il est important de souligner la grande contribution qu’a eue l’action sur les réseaux sociaux d’éléments actifs dans le mouvement ou sympathisant avec lui. Par peur que la situation devienne incontrôlable, certains secteurs de la bourgeoisie commencent à changer de discours. Les grandes entreprises de communication, dans leurs journaux et télévisions, après une semaine de silence sur la répression policière ont finalement fait état des "excès" de l’action policière. Certains hommes politiques, de la même manière, ont critiqué les "excès" sur lesquels ils promettent d’enquêter.
La violence de la bourgeoisie à travers son État, quel que soit son visage, démocratique ou "radical", a comme fondement la terreur totalitaire contre les classes qu’elle exploite ou opprime. Si avec l’État démocratique, cette violence n’est pas aussi ouverte que dans les dictatures et est plus cachée, de manière à ce que les exploités acceptent leurs conditions d’exploités et s’identifient à elles, cela ne signifie pas que l’État renonce aux méthodes de répression physique les plus variées et modernes lorsque la situation l’exige. Ce n’est donc pas une surprise si la police déchaîne une telle violence contre le mouvement. Cependant, comme dans l’histoire de l’arroseur arrosé, on a vu que l’accroissement de la répression n’a fait que provoquer une solidarité croissante au Brésil et même dans le monde, encore que de façon très minoritaire. Des mobilisations en solidarité sont déjà prévues en dehors du Brésil, principalement à l’initiative de Brésiliens vivant à l’étranger. Il faut dire clairement que la violence policière est dans la propre nature de l’État et que ce n'est pas un cas isolé ou un "excès" de démonstration de force par la police comme voudraient le faire croire les médias bourgeois et les autorités liées au système. En ce sens, il ne s’agit pas d’un échec des "dirigeants" et cela n’avance à rien de "demander justice" ou encore demander un comportement plus courtois de la police car, pour faire face à la répression et imposer un rapport de force, il n’existe pas d’autre moyen que l’extension du mouvement vers de larges couches de travailleurs. Pour cela, nous ne pouvons pas nous adresser à l’État et lui demander l’aumône. La dénonciation de la répression et de l’augmentation du prix des transports doit être prise en charge par l’ensemble de la classe ouvrière, en l’appelant à venir grossir les actions de protestation dans une lutte commune contre la précarisation et la répression.
Les manifestations, qui sont loin d’être terminées, se sont étendues à tout le Brésil et les protestations ont été présentes au début de la Coupe des Confédérations de football de 2013 qui fut marquée par les huées adressées à la présidente Dilma Rousseff, ainsi qu’au président de la FIFA, Joseph Blatter, avant le match d’ouverture du tournoi entre le Brésil et le Japon(1). Tous deux n’ont pu dissimuler à quel point ils furent incommodés par ces marques d’hostilité et ont abrégé leur discours afin de limiter la confusion. Autour du stade s’est aussi déroulée une grande manifestation à laquelle participèrent environ 1.200 personnes en solidarité avec le mouvement contre l’augmentation du coût des transports. Elles aussi furent fortement réprimés par la police qui blessa 27 personnes et en mit 16 en détention. Afin de renforcer encore la répression, l’État déclara que toute manifestation à proximité des stades durant la coupe des Confédérations serait interdite, sous le prétexte de ne pas porter préjudice à cet événement, à la circulation des personnes et véhicules, ainsi qu’au fonctionnement des services publics.
Les limites du mouvement pour la gratuité des transports et quelques propositions
Comme on le sait, ce mouvement s’est développé à l’échelle nationale grâce à sa propre dynamique et à la capacité de mobilisation des jeunes étudiants et lycéens contre l’augmentation des prix des transports. Cependant, il est important de prendre en compte qu’il a comme objectif, à moyen et long terme, de négocier l’existence d’un transport public gratuit pour toute la population et mis à disposition par l’État.
Et c’est exactement là que se situe la limite de sa principale revendication, vu qu’un transport universel et gratuit, cela ne peut exister dans la société capitaliste. Pour arriver à cela, la bourgeoisie et son État devraient accentuer plus encore le degré d’exploitation de la classe ouvrière et autres travailleurs, à travers une augmentation des impôts sur les salaires. Ainsi, il faut prendre en compte que la lutte ne doit pas être placée dans la perspective d’une réforme impossible, mais toujours dans celle de faire que l’État révoque ses décrets.
Actuellement, les perspectives du mouvement semblent dépasser les simples revendications contre l’augmentation des tarifs des transports. Déjà des manifestations sont prévues la semaine prochaine dans des dizaines de villes grandes et moyennes.
Le mouvement doit être vigilant vis-à-vis de la gauche du capital, spécialisée dans la récupération des manifestations pour les diriger vers des impasses, comme par exemple demander que les tribunaux de justice résolvent les problèmes et que les manifestants rentrent à la maison.
Pour que ce mouvement se développe, il est nécessaire de créer des lieux pour écouter et discuter collectivement les différents points de vue à propos de la lutte. Et cela n’est possible qu’au moyen d’assemblées générales avec la participation de tous, où est garanti indistinctement le droit de parole à tout manifestant. En plus de cela, il faut appeler les travailleurs salariés, les convier à des assemblées et à des actions de protestation car eux et leurs familles sont concernés par l’augmentation du prix des transports.
Le mouvement de protestation qui s’est développé au Brésil constitue un démenti cinglant à la campagne de la bourgeoisie brésilienne, soutenue en cela par la bourgeoisie mondiale, selon laquelle le Brésil est un "pays émergent" en voie de dépasser la pauvreté et de mettre en route son propre développement. Une telle campagne a été particulièrement promue par Lula qui est mondialement connu pour avoir prétendument tiré de la misère des millions de Brésiliens alors qu’en réalité sa grande réalisation pour le capital est d’avoir réparti des miettes parmi les masses les plus pauvres afin de les maintenir dans l’illusion et accentuer la précarité du prolétariat brésilien en général.
Face à l’aggravation de la crise mondiale et de ses attaques contre les conditions de vie du prolétariat, il n’y a pas d’autre issue que la lutte contre le capitalisme.
Revolução Internacional /16.06.2013
1)Les dépenses somptuaires de l’État et du gouvernement entreprises pour la préparation de la Coupe du Monde de football en 2014 et les JO de 2016 prévus au Brésil alimentent aussi la colère d’une grande partie de la population ainsi davantage pressurée (NdT).
Rubrique:
Les tensions impérialistes dans la phase de décomposition (extraits de la résolution sur la situation internationale, XXe congrès du CCI)
- 1091 lectures
Nous publions ci-dessous la partie consacrée aux tensions impérialistes de la résolution sur la situation internationale adoptée lors du dernier congrès international du CCI. Cette résolution sera bientôt disponible dans son intégralité (1) comme le bilan de ce XX° congrès, sur notre site Internet internationalism.org.
1
Depuis un siècle, le mode de production capitaliste est entré dans sa période de déclin historique, de décadence. C’est l’éclatement de la Première Guerre mondiale, en août 1914, qui a signé le passage entre la “Belle Époque”, celle de l’apogée de la société bourgeoise, et “l’Ère des guerres et des révolutions”, comme l’a qualifiée l’Internationale communiste lors de son premier congrès, en 1919. Depuis, le capitalisme n’a fait que s’enfoncer dans la barbarie avec à son actif, notamment, une Seconde Guerre mondiale qui a fait plus de 50 millions de morts. Et si la période de “prospérité” qui a suivi cette horrible boucherie a pu semer l’illusion que ce système avait pu enfin surmonter ses contradictions, la crise ouverte de l’économie mondiale, à la fin des années 60, est venue confirmer le verdict que les révolutionnaires avaient déjà énoncé un demi-siècle auparavant: le mode de production capitaliste n’échappait pas au destin des modes de production qui l’avaient précédé. Lui aussi, après avoir constitué une étape progressive dans l’histoire humaine, était devenu un obstacle au développement des forces productives et au progrès de l’humanité. L’heure de son renversement et de son remplacement par une autre société était venue.
2
En même temps qu’elle signait l’impasse historique dans laquelle se trouve le système capitaliste, cette crise ouverte, au même titre que celle des années 1930, plaçait une nouvelle fois la société devant l’alternative: guerre impérialiste généralisée ou développement de combats décisifs du prolétariat avec, en perspective, le renversement révolutionnaire du capitalisme. Face à la crise des années 1930, le prolétariat mondial, écrasé idéologiquement par la bourgeoisie suite à la défaite de la vague révolutionnaire des années 1917-23, n’avait pu apporter sa propre réponse, laissant la classe dominante imposer la sienne: une nouvelle guerre mondiale. En revanche, dès les premières atteintes de la crise ouverte, à la fin des années 1960, le prolétariat a engagé des combats de grande ampleur: Mai 1968 en France, le “Mai rampant” italien de 1969, les grèves massives des ouvriers polonais de la Baltique en 1970 et beaucoup d’autres combats moins spectaculaires mais tout aussi significatifs d’un changement fondamental dans la société: la contre-révolution avait pris fin. Dans cette situation nouvelle, la bourgeoisie n’avait pas les mains libres pour prendre le chemin d’une nouvelle guerre mondiale. Il s’en est suivi plus de quatre décennies de marasme croissant de l’économie mondiale, accompagné d’attaques de plus en plus violentes contre le niveau et les conditions de vie des exploités. Au cours de ces décennies, la classe ouvrière a mené de multiples combats de résistance. Cependant, même si elle n’a pas subi de défaite décisive qui aurait pu inverser le cours historique, elle n’a pas été en mesure de développer ses luttes et sa conscience au point de présenter à la société, ne serait-ce qu’une ébauche de perspective révolutionnaire. “Dans une telle situation où les deux classes fondamentales et antagoniques de la société s’affrontent sans parvenir à imposer leur propre réponse décisive, l’histoire ne saurait pourtant s’arrêter. Encore moins que pour les autres modes de production qui l’ont précédé, il ne peut exister pour le capitalisme de “gel”, de “stagnation” de la vie sociale. Alors que les contradictions du capitalisme en crise ne font que s’aggraver, l’incapacité de la bourgeoisie à offrir la moindre perspective pour l’ensemble de la société et l’incapacité du prolétariat à affirmer ouvertement la sienne dans l’immédiat ne peuvent que déboucher sur un phénomène de décomposition généralisée, de pourrissement sur pied de la société” (“La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste”, Revue internationale no 62). C’est donc une nouvelle phase de la décadence du capitalisme qui s’est ouverte depuis un quart de siècle. Celle où le phénomène de la décomposition sociale est devenu une composante déterminante de la vie de toute la société.
3
Le terrain où se manifeste de façon la plus spectaculaire la décomposition de la société capitaliste est celui des affrontements guerriers et plus généralement des relations internationales. Ce qui avait conduit le CCI à élaborer son analyse sur la décomposition, dans la seconde moitié des années 1980, c’était la succession d’attentats meurtriers qui avaient frappé de grandes villes européennes, notamment Paris, au milieu de la décennie, des attentats qui n’étaient pas le fait de simple groupes isolés mais d’États constitués. C’était le début d’une forme d’affrontements impérialistes, qualifiés par la suite de “guerres asymétriques”, qui traduisait un changement en profondeur dans les relations entre États et, plus généralement, dans l’ensemble de la société. La première grande manifestation historique de cette nouvelle, et ultime, étape dans la décadence du capitalisme a été constituée par l’effondrement des régimes staliniens d’Europe et du bloc de l’Est en 1989. Immédiatement, le CCI avait mis en avant la signification que cet événement revêtait du point de vue des conflits impérialistes : “La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux “partenaires” d’hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l’heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (...). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d’être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible” (Revue internationale no 61, “Après l’effondrement du bloc de l’Est, déstabilisation et chaos”) Depuis, la situation internationale n’a fait que confirmer cette analyse :
– 1re guerre du Golfe en 1991;
– guerre dans l’ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001;
– deux guerres en Tchétchénie (en 1994-1995 et en 1999-2000);
– guerre en Afghanistan à partir de 2001 qui se poursuit encore, 12 ans après;
– la guerre en Irak de 2003 dont les conséquences continuent de peser de façon dramatique sur ce pays, mais aussi sur l’initiateur de cette guerre, la puissance américaine;
– les nombreuses guerres qui n’ont cessé de ravager le continent africain (Rwanda, Somalie, Congo, Soudan, Côte d’Ivoire, Mali, etc.);
– les nombreuses opérations militaires d’Israël contre le Liban ou la Bande de Gaza répliquant aux tirs de roquettes depuis les positions du Hezbollah ou du Hamas.
4
En fait, ces différents conflits illustrent de façon dramatique combien la guerre a acquis un caractère totalement irrationnel dans le capitalisme décadent. Les guerres du XIXe siècle, aussi meurtrières qu’elles aient pu être, avaient une rationalité du point de vue du développement du capitalisme. Les guerres coloniales permettaient aux États européens de se constituer un Empire où puiser des matières premières ou écouler leurs marchandises. La Guerre de Sécession de 1861-65 en Amérique, remportée par le Nord, a ouvert les portes à un plein développement industriel de ce qui allait devenir la première puissance mondiale. La guerre franco-prussienne de 1870 a été un élément décisif de l’unité allemande et donc de la création du cadre politique de la future première puissance économique d’Europe. En revanche, la Première Guerre mondiale a laissé exsangues les pays européens, “vainqueurs” aussi bien que “vaincus”, et notamment ceux qui avaient eu la position la plus “belliciste” (Autriche, Russie et Allemagne). Quant à la Seconde Guerre mondiale, elle a confirmé et amplifié le déclin du continent européen où elle avait débuté, avec une mention spéciale pour l’Allemagne qui était en 1945 un champ de ruines, à l’image aussi du Japon, autre puissance “agressive”. En fait, le seul pays qui ait bénéficié de cette guerre fut celui qui y était entré le plus tardivement et qui a pu éviter, du fait de sa position géographique, qu’elle ne se déroule sur son territoire, les États-Unis. D’ailleurs, la guerre la plus importante qu’ait menée ce pays après la seconde mondiale, celle du Vietnam, a bien montré son caractère irrationnel puisqu’elle n’a rien rapporté à la puissance américaine malgré un coût considérable du point de vue économique et surtout humain et politique.
5
Cela dit, le caractère irrationnel de la guerre s’est hissé à un niveau supérieur dans la période de décomposition. C’est bien ce qui s’est illustré, par exemple, avec les aventures militaires des États-Unis en Irak et en Afghanistan. Ces guerres, elles aussi, ont eu un coût considérable, notamment du point de vue économique. Mais leur bénéfice est des plus réduits, sinon négatif. Dans ces guerres, la puissance américaine a pu faire étalage de son immense supériorité militaire, mais cela n’a pas permis qu’elle atteigne les objectifs qu’elle recherchait; stabiliser l’Irak et l’Afghanistan et obliger ses anciens alliés du bloc occidental à resserrer les rangs autour d’elle. Aujourd’hui, le retrait programmé des troupes américaines et de l’OTAN d’Irak et d’Afghanistan laisse une instabilité sans précédent dans ces pays avec le risque qu’elle ne participe à l’aggravation de l’instabilité de toute la région. En même temps, c’est en ordre dispersé que les autres participants à ces aventures militaires ont quitté ou quittent le navire. Pour la puissance impérialiste américaine, la situation n’a cessé de s’aggraver: si, dans les années 1990, elle réussissait à tenir son rôle de “gendarme du monde”, aujourd’hui, son premier problème est d’essayer de masquer son impuissance face à la montée du chaos mondial comme le manifeste, par exemple, la situation en Syrie.
6
Au cours de la dernière période, le caractère chaotique et incontrôlable des tensions et conflits impérialistes s’est illustré une nouvelle fois avec la situation en Extrême-Orient et, évidemment, avec la situation en Syrie. Dans les deux cas, nous sommes confrontés à des conflits qui portent avec eux la menace d’un embrasement et d’une déstabilisation bien plus considérables.
En Extrême-Orient on assiste à une montée des tensions entre États de la région. C’est ainsi qu’on a vu au cours des derniers mois se développer des tensions impliquant de nombreux pays, des Philippines au Japon. Par exemple, la Chine et le Japon se disputent les îles Senkaku/Diyao, le Japon et la Corée du Sud l’île Take-shima- Dokdo, alors que d’autres tensions se font jour impliquant aussi Taiwan, le Vietnam ou la Birmanie. Mais le conflit le plus spectaculaire concerne évidemment celui opposant la Corée du Nord d’un côté et, de l’autre, la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Prise à la gorge par une crise économique dramatique, la Corée du Nord s’est lancée dans une surenchère militaire qui, évidemment, vise à faire du chantage, notamment auprès des États-Unis, pour obtenir de cette puissance un certain nombre d’avantages économiques. Mais cette politique aventuriste contient deux facteurs de gravité. D’une part, le fait qu’elle implique, même si c’est de façon indirecte, le géant chinois, qui reste un des seuls alliés de la Corée du Nord, alors que cette puissance tend de plus en plus à faire valoir ses intérêts impérialistes partout où elle le peut, en Extrême-Orient, évidemment, mais aussi au Moyen-Orient, grâce notamment à son alliance avec l’Iran (qui est par ailleurs son principal fournisseur d’hydrocarbures) et aussi en Afrique où une présence économique croissante vise à préparer une future présence militaire quand elle en aura les moyens. D’autre part, cette politique aventuriste de l’État nord-coréen, un État dont la domination policière barbare témoigne de la fragilité fondamentale, contient le risque d’un dérapage, de l’entrée dans un processus incontrôlé engendrant un nouveau foyer de conflits militaires directs avec des conséquences difficilement prévisibles mais dont on peut déjà penser qu’elles constitueront un autre épisode tragique venant s’ajouter à toutes les manifestations de la barbarie guerrière qui accablent la planète aujourd’hui.
7
La guerre civile en Syrie fait suite au “printemps arabe” qui, en affaiblissant le régime d’Assad, a ouvert la boîte de Pandore d’une multitude de contradictions et de conflits que la main de fer de ce régime avait maintenue sous le boisseau pendant des décennies. Les pays occidentaux se sont prononcés en faveur du départ d’Assad mais ils sont bien incapables de disposer d’une solution de rechange sur place alors que l’opposition à celui-ci est totalement divisée et que le secteur prépondérant de celle-ci est constitué par les islamistes. En même temps, la Russie apporte un soutien militaire sans faille au régime d’Assad qui, avec le port de Tartous, lui garantit la présence de sa flotte de guerre en Méditerranée. Et ce n’est pas le seul État puisque l’Iran n’est pas en reste de même que la Chine: la Syrie est devenue un nouvel enjeu sanglant des multiples rivalités entre puissances impérialistes de premier ou de deuxième ordre dont les populations du Moyen-Orient n’ont cessé de faire les frais depuis des décennies. Le fait que les manifestations du “Printemps arabe” en Syrie aient abouti non sur la moindre conquête pour les masses exploitées et opprimées mais sur une guerre qui a fait plus de 100.000 morts constitue une sinistre illustration de la faiblesse dans ce pays de la classe ouvrière, la seule force qui puisse mettre un frein à la barbarie guerrière. Et c’est une situation qui vaut aussi, même si sous des formes moins tragiques, pour les autres pays arabes où la chute des anciens dictateurs a abouti à la prise du pouvoir par les secteurs les plus rétrogrades de la bourgeoisie représentés par les islamistes, comme en Égypte ou en Tunisie, ou par un chaos sans nom comme en Libye.
Ainsi, la Syrie nous offre aujourd’hui un nouvel exemple de la barbarie que le capitalisme en décomposition déchaîne sur la planète, une barbarie qui prend la forme d’affrontements militaires sanglants mais qui affecte également des zones qui ont pu éviter la guerre mais dont la société s’enfonce dans un chaos croissant comme par exemple en Amérique latine où les narcotrafiquants, avec la complicité de secteurs de l’État, font régner la terreur.
CCI
1) La question de l’impérialisme est le premier point traité par cette résolution. Viennent ensuite la destruction de l’environnement, la crise économique et enfin la lutte de classe.
Rubrique:
Mouvement social en Turquie: le remède à la terreur d’État n’est pas la démocratie
- 954 lectures
Nous publions ci-dessous des extraits de la traduction d’un article réalisé par notre section en Turquie – une jeune section, à la fois dans l’histoire du CCI et du fait de l’âge de ses membres. En tant que révolutionnaires et partie de la génération qui a conduit la révolte, ces camarades se sont activement impliqués dans le mouvement. Nous encourageons nos lecteurs à se rendre sur notre site pour une lecture complète de cet article qui est à la fois un premier rapport “sur le vif” fourmillant de détails concrets sur la vie de ce mouvement et une première tentative d’analyse de sa signification. C’est ici ce dernier aspect que nous avons choisi de mettre particulièrement en lumière à travers notre choix d’extraits. Quelle est la nature de ce mouvement ? A quelle dynamique internationale participe-t-il ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Quelles perspectives laisse-t-il entrevoir ?... Voici autant de questions qui sont en effet au cœur des enjeux de la période actuelle et à venir.
Le mouvement a commencé contre l’abattage des arbres effectué en vue de détruire le parc Gezi de la place Taksim à Istanbul, et il a pris une ampleur inconnue dans l’histoire de la Turquie jusqu’à ce jour. (...) On ne peut comprendre le véritable caractère de ce mouvement qu’en le remplaçant dans son contexte international. Et vu sous cet angle, il devient clair que le mouvement en Turquie est en continuité directe non seulement avec les révoltes du Moyen Orient de 2011 – les plus importants d’entre eux (Tunisie, Égypte, Israël) eurent une empreinte très forte de la classe ouvrière – mais en particulier du mouvement des Indignés en Espagne et Occupy aux États-Unis, là où la classe ouvrière représentait non seulement la majorité de la population dans son ensemble mais aussi des participants au mouvement. Il en est de même de la révolte actuelle au Brésil et également du mouvement en Turquie, dont l’immense majorité des composantes appartient à la classe ouvrière, et particulièrement la jeunesse prolétarienne.
(…) Le secteur qui a participé le plus largement était celui nommé :“la génération des années 1990”. L’apolitisme était l’étiquette apposée sur les manifestants de cette génération, dont beaucoup ne pouvaient se souvenir de l’époque précédent le gouvernement AKP (1) Le Parti pour la justice et le développement, islamiste “modéré”, est au pouvoir depuis 2002 en Turquie. Cette génération, dont on disait qu’elle n’était pas investie dans les événements et dont les membres ne cherchaient qu’à se sauver eux-mêmes, a compris qu’il n’y avait pas de salut en restant seul et en avait assez des discours du gouvernement lui disant ce qu’elle devait être et comment elle devait vivre. Les étudiants, et particulièrement les lycéens, ont participé aux manifestations de façon massive. Les jeunes ouvriers et les jeunes chômeurs étaient largement présents dans le mouvement. Les ouvriers et les chômeurs éduqués étaient également présents.
Dans certains secteurs de l’économie où travaillent principalement des jeunes dans des conditions précaires et où il est habituellement difficile de lutter – particulièrement dans le secteur des services – les salariés se sont organisés sur la base des lieux de travail mais d’une façon qui transcendait chaque lieu de travail particulier et ils ont participé ensemble aux manifestations. On trouve des exemples d’une telle participation parmi les livreurs des boutiques de kebab, le personnel des bars, les travailleurs des centres d’appel et des bureaux. En même temps, le fait que ce genre de participation ne l’a pas emporté sur la tendance des ouvriers à aller aux manifestations individuellement a constitué une des faiblesses les plus significatives du mouvement. Mais cela a été typique aussi des mouvements dans d’autres pays, où la primauté de la révolte dans la rue a été une expression pratique du besoin de dépasser la dispersion sociale créée par les conditions existant dans la production et la crise capitalistes – en particulier, le poids du chômage et de l’emploi précaire.
Mais ces mêmes conditions, couplées aux immenses assauts idéologiques de la classe dominante, ont rendu difficile à la classe ouvrière de se voir en tant que classe et a contribué à renforcer l’idée chez les manifestants qu’ils étaient essentiellement une masse de citoyens individuels, des membres légitimes de la communauté “nationale”. Tel est le chemin contradictoire vers la reconstitution du prolétariat en classe, mais il ne fait pas de doute que ces mouvements sont un pas dans cette voie.
Une des principales raisons pour laquelle une masse significative de prolétaires mécontents de leurs conditions de vie ont organisé des manifestations avec une telle détermination se trouve aussi dans l’indignation et le sentiment de solidarité contre la violence policière et la terreur de l’État. Malgré cela, différentes tendances politiques bourgeoises ont été actives, essayant d’influencer le mouvement de l’intérieur pour le maintenir dans les frontières de l’ordre existant, pour éviter qu’il ne se radicalise et pour empêcher les masses prolétariennes qui avaient pris les rues contre la terreur étatique de développer des revendications de classe sur leurs propres conditions de vie. Ainsi, alors qu’on ne peut évoquer de revendication ayant emporté l’unanimité dans le mouvement, ce qui a généralement dominé celui-ci étaient les revendications démocratiques. La ligne appelant à “plus de démocratie” qui s’est formée autour d’une position anti AKP et, en fait, anti-Erdogan n’exprimait par essence rien d’autre qu’une réorganisation de l’appareil d’Etat turc sur un mode plus démocratique.
L’impact des revendications démocratiques sur le mouvement a constitué sa plus grande faiblesse idéologique. Car Erdogan lui-même a construit toutes ses attaques idéologiques contre le mouvement autour de cet axe de la démocratie et des élections ; les autorités gouvernementales bien qu’avec des monceaux de mensonges et de manipulations, ont répété à satiété l’argument selon lequel, même dans les pays considérés plus démocratiques, la police utilise la violence contre les manifestations illégales – ce en quoi elles n’avaient pas tort. De plus, la ligne visant à obtenir des droits démocratiques liait les mains des masses devant les attaques de la police et la terreur étatique, et pacifiait leur résistance.
(…) Cela dit, l’élément le plus actif dans cette tendance démocratique qui semble avoir pris le contrôle de la Plate-forme de Solidarité de Taksim se trouve dans les confédérations syndicales de gauche comme le KSEK et le DISK. (…) La Plate-forme de Solidarité de Taksim et donc la tendance démocratique, du fait qu’elle était constituée de représentants de toutes sortes d’associations et d’organisations, a tiré sa force non pas d’un lien organique avec les manifestants mais de la légitimité bourgeoise, des ressources mobilisées et du soutien de ses composantes.
(…) La gauche bourgeoise est une autre tendance qu’il faut mentionner. La base des partis de gauche, qu’on peut aussi définir comme la gauche légale bourgeoise, a été pour une large part coupée des masses. De façon générale, elle a été à la queue de la tendance démocratique. Les cercles staliniens et trotskistes, ou la gauche radicale bourgeoise, étaient aussi pour une grande part coupés des masses. Ils étaient influents dans les quartiers où ils ont traditionnellement une certaine force. Bien que s’opposant à la tendance démocratique au moment où cette dernière essayait de disperser le mouvement, ils l’ont généralement soutenue. Les analyses de la gauche bourgeoise étaient, pour la plus grande part, limitées à se réjouir du “soulèvement populaire” et à essayer de présenter ses porte-paroles comme les leaders du mouvement. Même les appels à une grève générale, une ligne traditionnellement mise en avant par la gauche, n’a pas vraiment eu d’écho au sein de celle-ci à cause de l’atmosphère de joie aveugle. Son slogan le plus largement accepté parmi les masses était “épaule contre épaule contre le fascisme”.
(…) En plus des tendances mentionnées ci-dessus, on peut parler d’une tendance prolétarienne ou de plusieurs tendances prolétariennes au sein du mouvement.
(…) De façon générale, une partie significative des manifestants défendait l’idée que le mouvement devait créer une auto-organisation qui devait lui permettre de déterminer son propre futur. La partie des manifestants qui voulait que le mouvement s’unisse avec la classe ouvrière était composée d’éléments qui étaient conscients de l’importance et de la force de la classe, qui étaient contre le nationalisme même s’il leur manquait une claire vision politique. (…) [Cependant], la faiblesse commune des manifestations dans toute la Turquie est la difficulté à créer des discussions de masse et à gagner le contrôle du mouvement grâce à des formes d’auto-organisation sur la base de ces discussions. Les discussions de masse semblables à celles qui se sont développées dans les mouvements à travers le monde ont été notablement absentes dans les premiers jours. Une expérience limitée de la discussion de masse, des réunions, des assemblées générales, etc., et la faiblesse de la culture du débat en Turquie ont sans aucun doute joué sur cette faiblesse. En même temps, le mouvement a senti la nécessité de la discussion et les moyens pour l’organiser ont commencé à émerger. La première expression de la conscience du besoin de discuter a été la formation d’une tribune ouverte dans le Parc Gezi. Celle-ci n’a pas attiré beaucoup l’attention ni duré bien longtemps, mais elle a eu néanmoins un certain impact.
(…) Si on regarde ce mouvement à l’échelle du pays, l’expérience la plus cruciale est fournie par les manifestants d’Eskişehir. Dans une assemblée générale sur la place de la Résistance d’Eskişehir, des comités ont été créés afin d’organiser et de coordonner les manifestations. (…) Enfin, à partir du 17 juin, dans les parcs de différents quartiers d’Istanbul, des masses de gens inspirées par les forums du parc Gezi ont mis en place des assemblées de masse également intitulées : “forums”. Parmi ces quartiers où se sont organisés des forums, il y a Beşiktaş, Elmadağ, Harbiye, Nişantaşı, Kadıköy, Cihangir, Ümraniye, Okmeydanı, Göztepe, Rumelihisarüstü, Etiler, Akatlar, Maslak, Bakırköy, Fatih, Bahçelievler, Sarıyer, Yeniköy, Sarıgazi, Ataköy et Alibeyköy. Les jours suivants, d’autres se sont tenus à Ankara et dans d’autres villes. Du coup, de peur de perdre le contrôle sur ces initiatives, la Plateforme de Solidarité de Taksim a commencé elle-même à faire des appels en faveur de ces forums.
(…) Bien que, par bien des aspects, la résistance du parc Gezi soit en continuité avec le mouvement des Occupy aux États-Unis, des Indignés en Espagne et des mouvements de protestation qui ont renversé Moubarak en Égypte et Ben Ali en Tunisie, elle a aussi ses particularités : comme dans tous ces mouvements, en Turquie, il y a un poids vital du jeune prolétariat. L’Égypte, la Tunisie et la résistance du parc Gezi ont en commun la volonté de se débarrasser d’un régime qui est perçu comme étant une “dictature”. (…) Mais, contrairement au mouvement en Tunisie qui a organisé des comités locaux, et en Espagne ou aux États-Unis où les masses ont généralement assumé la responsabilité du mouvement à travers des assemblées générales, en Turquie cette dynamique est restée au début très limitée.
(…) [De même] Les questions les plus débattues portaient sur les problèmes pratiques et techniques des affrontements avec la police. (…) La similitude avec Occupy aux États-Unis était qu’une occupation effective [de la rue] a eu lieu ; même si en Turquie, les occupations surpassaient en nombre, par une participation massive, celles des États-Unis. De même, en Turquie comme aux États-Unis, il y a une tendance parmi les manifestants à comprendre l’importance de l’implication dans la lutte de la partie du prolétariat au travail.
(…) Bien que le mouvement en Turquie n’ait pas réussi à établir un lien sérieux avec l’ensemble de la classe ouvrière, les appels à la grève via les réseaux sociaux ont rencontré un certain écho qui s’est manifesté à travers plus d’arrêts de travail qu’aux États Unis. En dépit de ses particularités, il ne fait pas de doute que le mouvement de cette “canaille” est une partie intégrante de la chaîne des mouvements sociaux internationaux.
(…) Un des meilleurs indicateurs qui montrent que ce mouvement fait partie de la vague internationale se trouve dans son inspiration des manifestants brésiliens. Les manifestants turcs ont salué la réponse venue de l’autre rive du monde avec les mots d’ordre : “Nous sommes ensemble, Brésil + Turquie !” et “Brésil, résiste !” (en turc). Et puisque le mouvement a inspiré des manifestations au Brésil contenant des revendications de classe, il peut à l’avenir favoriser la naissance de revendications de classe en Turquie. (…) Malgré toutes les faiblesses et les dangers qui menacent ce mouvement, si les masses en Turquie n’avaient pas réussi à devenir un maillon de la chaîne des révoltes sociales qui secouent le monde capitaliste, le résultat serait un bien plus grand sentiment d’impuissance. Le surgissement d’un mouvement social d’une ampleur jamais vue depuis 1908 dans ce pays est donc d’une importance historique. (…).
Dünya Devrimi/21.06.2013
1)Le Parti pour la justice et le développement, islamiste « modéré » est au pouvoir depuis 2002 en Turquie.
Rubrique:
Cycle de discussion du printemps 2013: lutte anticapitaliste et organisation
- 1269 lectures
Dans la période actuelle, il existe une nécessité de réflexion et d’approfondissement concernant les leçons à tirer des mouvements de lutte qui ont eu lieu les années passées, comme le « printemps arabe », le combat des « Indignés » ou le mouvement « Occupy ». En outre, toute rencontre de gens engagés pour discuter et apprendre à se connaître est essentielle pour dépasser l’éparpillement du mouvement internationaliste. Voilà pourquoi le CCI, incité aussi à le faire par quelques courriers dans ce sens (1), avait décidé de tenir un cycle de discussion au printemps 2013 sur le thème « lutte et organisation ». Il s’agissait de deux soirées de discussion pendant lesquelles les participants pouvaient engager entre eux et avec le CCI des échanges sur leurs questionnements, leurs expériences et leurs interprétations des mouvements.
En introduction aux deux soirées, le CCI avait prévu un exposé qui fournissait une base solide pour les discussions (2). Les participants ont en général fort apprécié ces introductions, même s’ils trouvaient celle de la deuxième soirée assez abstraite et ardue à comprendre. Le débat a cependant permis de donner plus de chair aux axes de l’introduction. Le premier exposé a introduit le thème de la lutte comme moteur de l’histoire et a fourni un cadre historique pour commenter et analyser les mouvements de lutte récents. Le deuxième exposé a mis l’accent sur le développement de la conscience de classe dans et par les mouvements de lutte, la conscience de classe stimulant à son tour l’expansion des luttes. Les deux soirées ont fait surgir de nombreux points de discussion communs. Aussi, cet article traitera les deux sessions de discussion comme un ensemble.
Est-ce que la classe ouvrière est une classe révolutionnaire ?
Une des questions principales portait sur la nature même de la classe ouvrière. Les participants reconnaissaient certes l’existence de cette classe, mais doutaient du caractère révolutionnaire du prolétariat. Pourquoi est-ce elle et pas d’autres couches exploitées et opprimées de la société, telles les femmes, les immigrés, les homosexuels, les pauvres, etc., qui peut être à la base du développement d’une autre société ? Ne devons-nous pas nous battre contre bien d’autres injustices que l’exploitation des travailleurs ? Qu’en est-il par exemple de l’exploitation de la nature, des femmes, etc.
Dans la discussion, une distinction a été opérée entre le prolétariat comme entité sociologique et comme entité politico-culturelle. Les travailleurs ont été caractérisés comme ce groupe de gens qui vendent leur force de travail pour un salaire et qui créent de la plus-value par leur travail commun (3). Face à eux, il y a évidemment la bourgeoisie, la classe qui contrôle les outils de production, le processus de production et les produits du travail, parce qu’elle possède et gère les moyens de production. Ces définitions ne sont pas strictement sociologiques, elles ne sont pas fondamentalement fondées sur une répartition d’un groupe de gens selon leur sexe, la couleur de leur peau, leurs revenus ou leur profession. Elles rendent compte du rôle que joue un groupe d’êtres humains dans le processus productif social global. Dans ce rapport social, la classe ouvrière est la classe qui ne dispose d’aucun contrôle sur ce processus.
Comme la force de travail fournit aussi aux hommes la capacité d’exprimer leur force vitale, leurs sentiments et leurs pensées et que les travailleurs sont précisément obligés de vendre celle-ci et de la soumettre aux besoins du capitalisme, la classe ouvrière est aussi la classe la plus aliénée. « Le travail, seul lien qui les unisse encore aux forces productives et à leur propre existence, a perdu chez eux toute apparence de manifestation de soi, et ne maintient leur vie qu'en l'étiolant » (4). Marx et Engels formulent précisément des appréciations élogieuses envers les formes de société précapitalistes, dans lesquelles le travail fournissait encore souvent une certaine satisfaction aux producteurs, même s’ils étaient exploités et s’ils devaient céder une partie des produits de leur travail. Dans le capitalisme toutefois, toute activité humaine est réduite à être une marchandise abstraite et « froide » et ainsi, la force de travail elle-même est réduite à n’être qu’une marchandise, l’être humain plein de qualités potentielles est réduit à n’être qu’un numéro, une « masse grise ». Cette « déshumanisation » du prolétariat en fait « une classe avec des chaînes radicales, (…), une sphère qui ait un caractère universel par ses souffrances universelles et ne revendique pas de droit particulier, parce qu'on ne lui a pas fait de tort particulier, mais un tort en soi, une sphère qui ne puisse plus s'en rapporter à un titre historique, mais simplement au titre humain, (…), une sphère enfin qui ne puisse s'émanciper, sans s'émanciper de toutes les autres sphères de la société et sans, par conséquent, les émanciper toutes, qui soit, en un mot, la perte complète de l'homme, et ne puisse donc se reconquérir elle-même que par le regain complet de l'homme » (5). Pour se libérer en tant que classe exploitée et opprimée, le prolétariat doit créer une nouvelle sorte de société, « où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous » (6).
Différents intervenants ont affirmé qu’à côté de la lutte ouvrière, il fallait encore tenir compte d’autres luttes spécifiques, telles la lutte pour les droits des femmes et des immigrés et contre le racisme. Selon eux, le prolétariat peut supprimer l’exploitation capitaliste, avec toutes les conséquences directes de celle-ci, mais cela n’entraînera pas automatiquement la disparition de toute forme d’oppression. La discussion a mis en évidence que l’accentuation d’une autre identité n’implique ni la même dynamique unitaire, ni surtout la même perspective que l’identité de classe, bien au contraire. Ainsi la dynamique du mouvement « Occupy » aux USA s’est souvent bloquée parce qu’on mettait trop souvent l’accent sur ces « catégories » spécifiques d’oppression. La question de la discrimination des noirs a mené par exemple à des tensions et des divisions au sein des assemblées avant qu’une véritable discussion puisse s’ouvrir sur les problèmes mondiaux. L’antiracisme était dans ce cas plus un frein qu’un stimulant pour la lutte. Sur la côte ouest des USA par contre, où les protestataires d’Occupy se reconnaissaient beaucoup plus dans le combat de la classe ouvrière, le mouvement s’est développé de manière plus radicale (7).
La classe ouvrière peut-elle s’unir ?
Une deuxième série de questions exprimait des doutes concernant la capacité de la classe ouvrière à développer des forces suffisantes pour renverser le capitalisme. Même si elle a une nature révolutionnaire, n’est-elle pas trop divisée ? Est-elle capable de placer cette identité spécifique avant toutes sortes d’autres identités (de sexe, de couleur de peau, d’origine, d’âge, …) ? Peut-elle s’unir dans un monde capitaliste où les entreprises se délocalisent vers des régions où la force de travail est la moins chère et aiguisent ainsi la concurrence entre travailleurs ?
Une intervention a souligné qu’il ne fallait pas voir les choses de manière empirique. En 1914, peu de gens soutenaient que le prolétariat engagerait dans quelques années une vague révolutionnaire internationale. Il en allait de même dans les années avant 1968, lorsque aussi bien la bourgeoisie que certains révolutionnaires prolétariens pensaient que la classe ouvrière était « morte » (8).
Aujourd’hui, la classe ouvrière est effectivement divisée. Cela s’exprime e.a. par le fait que beaucoup de prolétaires individuels s’attribuent en premier lieu toutes sortes d’autres identités. Ces identités se fondent souvent sur une base réelle. Ainsi, un homme n’est pas une femme et on ne peut changer son lieu de naissance. Mais est-ce que chaque identité offre une perspective pour le futur ? Est-ce que chacune d’elle peut mettre en marche un processus et mener à la fin de l’exploitation capitaliste et de l’Etat ? Il suffit de penser aux conséquences dramatiques de l’identité nationale qui a été mise en avant par de nombreux travailleurs en Egypte.
La classe ouvrière est donc divisée, parce qu’elle est encore faible. Par conséquent, elle n’est pas faible parce qu’elle est divisée (9). La concurrence économique « … isole les individus les uns des autres (…) malgré le fait qu’elle les réunit. C’est pourquoi cela dure longtemps avant que ces individus arrivent à s’unir … » (10). Le prolétariat tire sa force de sa solidarité et de sa conscience de soi en tant que force révolutionnaire. Ces deux éléments se développent de concert dans la lutte contre l’Etat et le capital, lorsque la concurrence disparaît. A ce moment, la classe ouvrière, constituée d’une mosaïque d’êtres différents, percevra de manière de plus en plus claire son existence en tant que classe séparée. Les participants à la discussion étaient d’accord pour affirmer que cela n’avait aucun sens de tenter de convaincre les prolétaires un à un qu’ils appartenaient à la même classe internationale. Une telle approche est la conception des missionnaires.
Quelle forme de lutte ?
Comment surmonter la division au sein de la classe ouvrière ? Comment peut-elle développer une force suffisante pour faire vaciller le capitalisme ? Quelles formes de lutte favorisent le développement de la solidarité et de la conscience et lesquelles l’entravent par contre ?
Différents participants ont aussitôt établi un lien avec la question des syndicats, étant donné que ces derniers sont présentés comme les symboles du mouvement ouvrier historique. Ils sont généralement identifiés comme la forme « classique » et même reconnue par l’Etat de la « lutte ouvrière ». Plusieurs présents ont souligné de façon fort correcte que les syndicats n’étaient pas aux avant-postes lors des mouvements de lutte discutés dans le cycle. Bien au contraire, ils ont freiné et divisé les mouvements. Un participant a toutefois voulu nuancer l’analyse en constatant qu’il ne fallait pas mettre tous les syndicats sur le même plan : ainsi, certains syndicats anarcho-syndicalistes auraient soutenu en 2012 la grève sauvage des mineurs dans les Asturies (Espagne). Mais dans quelle mesure une grève, où les mineurs se sont retranchés dans les mines, permet-elle une dynamique de développement de la solidarité et de la conscience ?
Beaucoup d’autres mouvements de lutte ont cependant endossé de manière spontanée une autre forme : l’occupation de rues et de plaines pour les transformer en lieux de débat public. Ces assemblées générales (AG) permettaient la clarification politique, qui favorisaient à leur tour le développement de la solidarité (les présents ont établi des comparaisons avec les soviets dans la Russie du début du 20ième siècle). Ces AG étaient des lieux de débat vivants, où la lutte était organisée par l’ensemble des travailleurs qui y participaient, indépendamment de leur profession ou de leur entreprise. Bien que les revendications et les slogans de ces mouvements de luttes planétaires révélaient souvent des illusions dans l’Etat démocratique et ne manifestaient pas toujours un internationalisme des plus intransigeants, la forme de lutte manifestait l’empreinte de la classe ouvrière. Ce n’est pas un hasard si le mouvement en Espagne est allé le plus loin, car c’est là aussi que la classe ouvrière a acquis d’un point de vue historique des expériences de lutte importantes. D’innombrables AG ont surgi des plus petites places jusqu’à la Puerta del Sol. Dans les AG, de nombreux sujets étaient discutés, aussi bien sur le plan économique (chômage, logement, austérité, …) que politique (la démocratie, l’Etat, …) et que culturel (l’art, les sciences, …).
Une discussion réussie ?
Différents sujet ont à peine été abordés et méritent plus de temps et une approche plus en profondeur. Nous songeons par exemple à la lutte de différentes minorités, la question syndicale et le rôle des minorités révolutionnaires. Pour beaucoup, cette discussion venait de s’ouvrir et ils sont partis avec plus de questions qu’ils n’en avaient au début. Ce n’est pas mauvais en soi, car toutes les questions et les divergences ne pouvaient être résolues en deux soirées. Au moins, les participants ne sont pas partis avec une aversion d’une confrontation constructive de positions. Nous voulons encourager cette approche pour continuer à approfondir les discussions politiques. Ceci aussi fait partie de la lutte pour une autre société qu’il faut mener avec une vision à long terme.
Alex, 21-09-2013
(1) Cf. « Réaction d’un lecteur », Internationalisme n°356, 2012
(2) Intro 1 (en néerlandais): https://nl.internationalism.org/node/1029 et intro 2 (en néerlandais) : https://nl.internationalism.org/node/1030
(3) La plus-value est la nouvelle valeur que les travailleurs créent durant le processus productif et ajoutent à la matière première ou à la marchandise et qui dépasse les frais nécessaires à leur entretien et leur reproduction. C’est pourquoi elle est disponible pour être confisquée par les capitalistes. C’est la base du profit capitaliste.
(4) K. Marx et F. Engels (1845) L’idéologie allemande,
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1845/00/kmfe18450000d.htm
(5) K. Marx (1843) Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, https://www.marxists.org/francais/marx/works/1843/00/km18430000.htm
(6) K. Marx et F. Engels (1848) Le manifeste du parti communiste,
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000b.htm
(7) IKS/Occupy (2011), Oakland: Occupy movement seeks link with the working class, https://en.internationalism.org/icconline/201111/4578/oakland-occupy-movement-seeks-links-working-class
(8) En 1964, l’intellectuel petit-bourgeois Marcuse écrivit son livre « l’homme unidimensionnel » dans lequel il analysait comment la classe ouvrière avait été absorbée par la société capitaliste et dès lors n’était plus porteuse de la révolution contre le capitalisme. Le mouvement international de mai ’68 a contredit totalement cette thèse.
(9) quelqu’un a utilisé cette formulation dans la discussion. Elle a été empruntée à Anton Pannekoek, astronome et marxiste, dans son article « Parti et classe ouvrière », écrit en 1936.
(10) K. Marx et F. Engels (1845) L’idéologie allemande
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1845/00/kmfe18450000d.ht
Rubrique:
Grèce: soigner l'économie tue le malade
- 1003 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d'un article rédigé par notre section en Grande-Bretagne, World Revolution, sur l'effondrement du système de soins en Grèce.
En décembre 2012, le quotidien allemand Frank-furter Allgemeine Zeitung rendait compte d’une visite en Grèce: "En octobre 2012, le traumatologue Georg Pier rapportait les observations suivantes sur la Grèce : des femmes sur le point d’accoucher se hâtaient désespérément d’un hôpital à l’autre; mais comme elles n’avaient pas d’assurance-maladie ou suffisamment d’argent, personne ne voulait les aider à mettre leur enfant au monde.
Des gens, qui jusqu’à présent faisaient partie des classes moyennes, cherchaient des restes de fruits et de légumes dans les poubelles. (…) Un vieil homme disait à un journaliste qu’il n’avait plus les moyens d’acheter les médicaments nécessaires pour soigner son problème cardiaque: sa pension avait été diminuée de 50% comme celle de beaucoup d’autres retraités. Il a travaillé pendant plus de quarante ans, pensant avoir fait les choses correctement; maintenant, il ne comprend plus le monde. Lorsque tu es admis dans un hôpital, tu dois apporter tes propres draps et ta propre nourriture. Comme le personnel d’entretien a été mis à la porte, les médecins et les infirmiers, qui n’ont pas reçu de salaire depuis des mois, ont commencé à nettoyer les toilettes. Il y a une pénurie de gants et de cathéters jetables. Devant les conditions hygiéniques déplorables dans plusieurs établissements, l’Union Européenne avertit du danger de propagation de virus infectieux."
Les mêmes conclusions étaient tirées par Marc Sprenger, chef du Centre Européen pour la Prévention et le Contrôle des Maladies (ECDC). Le 6 décembre, il alerta [les autorités] sur l’effondrement du système de santé et des mesures d’hygiène en Grèce, ajoutant que cela pouvait aboutir à une pandémie dans toute l’Europe. Il y a une pénurie de gants à usage unique, de blouses et de serviettes de désinfection, de boules de coton, de cathéters, de rouleaux de papier pour couvrir les tables d’examen médical. Les patients ayant des maladies infectieuses, comme la tuberculose, ne reçoivent pas le traitement nécessaire, ce qui entraîne l’augmentation du risque de propagation de virus résistants en Europe.
Un contraste frappant entre ce qui est techniquement possible et la réalité du capitalisme
Au 19e siècle, beaucoup de patients (jusqu’à un tiers parfois) mouraient à cause d’un manque d’hygiène à l’hôpital, en particulier les femmes pendant l’accouchement. Ces drames pouvaient s’expliquer en grande partie par l’ignorance, parce que beaucoup de docteurs ne se lavaient pas les mains avant un traitement ou une opération et, souvent, ils allaient avec des blouses sales d’un patient à l’autre.
Les découvertes en hygiène, de Semmelweis ou Lister par exemple, permirent une réelle amélioration. Les nouvelles mesures d’hygiène et les découvertes sur la transmission des germes permirent une forte réduction des maladies nosocomiales.
Aujourd’hui, l’utilisation des gants et des instruments chirurgicaux à usage unique est une pratique courante dans la médecine moderne. Mais, tandis que l’ignorance du 19e siècle est une explication plausible de la mortalité importante dans les hôpitaux, les dangers qui deviennent évidents dans les hôpitaux en Grèce ne sont pas une manifestation de l’ignorance mais une expression de la menace qui pèse sur l’humanité; cette menace provient de la faillite d’un système de production totalement obsolète.
Si, aujourd’hui, la santé des habitants du cœur de la civilisation antique est menacée par le manque de fonds des hôpitaux ou par leur insolvabilité (ils ne peuvent plus acheter de gants à usage unique), si les femmes enceintes qui cherchent une prise en charge dans les hôpitaux sont renvoyées parce qu’elles n’ont pas d’argent ou pas d’assurance médicale, si les gens qui ont des maladies de cœur ne peuvent plus payer leurs médicaments…, cela devient une attaque contre la vie-même. Si, dans un hôpital, le personnel d’entretien, qui est indispensable dans la chaîne de l’hygiène, est licencié, si les docteurs et les infirmiers, qui n’ont pas reçu leur salaire depuis longtemps, doivent prendre en charge les tâches de nettoyage, cela apporte une lumière crue sur la "régénération" de l’économie. C’est le terme utilisé par la classe dominante pour justifier ses attaques brutales contre nous: la "régénération" se retourne en menace sur nos vies.
Après 1989, en Russie, l’espérance de vie a baissé de cinq ans à cause de l’effondrement du système de santé d’une part, mais aussi à cause de l’augmentation de la consommation d’alcool et de drogue. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement en Grèce que le système de santé est démantelé petit à petit pour s’effondrer simplement. Dans un autre pays en faillite, l’Espagne, le système de santé est également en train d’être démoli. Dans le vieux centre industriel qu’est Barcelone, de même que dans d’autres grandes villes, les services des urgences ne sont parfois ouverts que quelques heures, pour faire des économies budgétaires. En Espagne, au Portugal et en Grèce, beaucoup de pharmacies ne reçoivent plus de médicaments vitaux. Le laboratoire pharmaceutique allemand Merck ne fournit plus le médicament anti-cancéreux Erbitux aux hôpitaux grecs; Biotest, un laboratoire qui vend du plasma sanguin pour le traitement de l’hémophilie et du tétanos, a arrêté de fournir ses produits à cause du non-paiement des factures depuis juin dernier.
Jusqu’à présent, ces conditions médicales désastreuses étaient connues principalement dans les pays africains ou dans les régions dévastées par la guerre; mais maintenant, la crise dans les pays anciennement industrialisés a conduit à une situation telle que des domaines vitaux comme les soins de santé sont de plus en plus sacrifiés sur l’autel du profit. Ainsi, l’obtention d’un traitement médical n’est plus basé sur ce qui est techniquement possible: on ne reçoit le traitement que si on est solvable.(1)
Cette évolution montre que l’écart entre ce qui est techniquement possible et la réalité de ce système s’agrandit. Plus l’hygiène est menacée et plus nous risquons de voir apparaître des épidémies incontrôlables. Nous devons rappeler l’épidémie de grippe espagnole, qui s’est répandue à travers l’Europe après la fin de la Première Guerre mondiale, entraînant la mort de plus de vingt millions de personnes. La guerre, avec son cortège de famines et de privations, avait préparé les conditions de cette épidémie. La crise économique joue le même rôle dans l’Europe d’aujourd’hui. En Grèce, le taux de chômage frôlait les 25% au dernier trimestre de 2012; le chômage des jeunes de moins de 25 ans atteignait 57%, 65% des jeunes femmes sont sans emploi. Les prévisions indiquent toutes une augmentation plus rapide, jusqu’à 40% en 2015. La paupérisation accompagnant le chômage a déjà conduit à ce que "des zones résidentielles et des immeubles d’appartements ont été privés de fourniture de fuel pour défaut de paiement. Pour éviter d’avoir trop froid l'hiver chez eux, beaucoup de gens ont commencé à utiliser des poêles à bois; les gens coupent le bois illégalement dans les forêts proches. Au printemps 2012, un vieil homme s’est donné la mort devant le parlement d’Athènes; juste avant de mourir, il aurait crié: je ne veux pas laisser de dettes à mes enfants. Le taux de suicide a doublé en Grèce depuis ces trois dernières années."(2)
Après l’Espagne avec le détroit de Gibraltar, l’Italie avec Lampedusa et la Sicile, la Grèce est le point principal d’entrée pour les réfugiés qui fuient les zones dévastées par la guerre et les espaces paupérisés d’Afrique et du Moyen Orient. Le gouvernement a installé une gigantesque clôture le long de la frontière turque. Il a monté d’immenses camps de réfugiés dans lesquels plus de 55.000 clandestins étaient internés en 2011. Les partis politiques de l’aile droite essayent de susciter une atmosphère de pogrom contre ces réfugiés, leur reprochant d’importer des "maladies de l’étranger" et de s’emparer des ressources qui reviennent de droit aux "Grecs d’origine". Mais la misère qui conduit ces millions de gens à fuir leur pays natal et qui se répand inexorablement dans les hôpitaux et les rues de l’Europe provient de la même source: un système social qui est devenu un obstacle à tout progrès humain.
Dionis/04.01.2013
1) Dans les pays "émergents" comme l’Inde, de nouveaux hôpitaux privés voient sans arrêt le jour. Ils sont accessibles uniquement aux riches patients et encore plus aux patients solvables qui viennent de l’étranger. Ils offrent des traitements qui sont beaucoup trop chers pour la majorité des Indiens et beaucoup de patients étrangers qui viennent en tant que "touristes médicaux" dans les cliniques privées indiennes n’ont pas les moyens de s’offrir leur traitement médical chez eux.
2) Frankfurter Allgemeine Zeitung, décembre 2012
Internationalisme - 2014
- 942 lectures
Internationalisme n° 360 - 1er trimestre 2014
- 765 lectures
Nelson Mandela: l’image trompeuse d’un capitalisme à visage humain
- 1030 lectures
Le 5 décembre dernier, le président de l’Afrique du sud Jacob Zuma annonçait la mort de Nelson Mandela (1918-2013). L'information était aussitôt relayée en boucle dans les médias du monde entier, suivie quelques jours après de funérailles grandioses. Une première cérémonie, au grand stade Soccer City de Soweto (lieu symbolique des émeutes contre l'apartheid en 1976) accueillait mardi 10 décembre tout le gratin international, les chefs d'Etats et de gouvernements venus du monde entier. Cela, avant un hommage et une inhumation prévus le 15 décembre dans son village de Qunu au Sud. La plupart des grands dignitaires (officiellement 53) étaient donc présents dans ce grand stade: les Obama, Hollande, Joakim Gauk (Allemagne), Dilma Roussef (Brésil), de même que de nombreuses personnalités, comme le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki moon. Cette grande union sacrée constitue ainsi la meilleure preuve que Mandela, encensé auparavant plutôt par tous les gauchistes et les staliniens, est bien reconnu aujourd'hui comme un des dignes représentants historiques de sa classe: la bourgeoisie! Cette reconnaissance unanime de toute la classe dominante, sincèrement endeuillée, tranche nettement avec la conduite qu'elle pouvait tenir lors de la disparition des authentiques révolutionnaires. Non seulement les mêmes dignitaires ont fait assassiner bien souvent les grandes figures du mouvement ouvrier, comme ce fut le cas pour Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et Trotski, mais loin de venir se recueillir ensuite, ils ont toujours déversé des tombereaux de calomnies à leur encontre. Ce fut notamment le cas lors de la mort de Lénine, où la haine accumulée redoublait dans tous les journaux de l'époque. Et que dire de Marx qui, aux yeux de tous les bourgeois, incarnait le " diable " en personne?
Aujourd'hui, la reconnaissance des valeurs nationalistes et d'agent du capital vaut à Mandela tous les honneurs posthumes. Une véritable aubaine pour le business qui a transformé momentanément les abords du stade de Soweto à Johannesburg en un véritable supermarché à ciel ouvert: tee-shirts à l’effigie du grand leader et autres produits dérivés à l'image du monde capitaliste que Mandela défendait avec zèle. Le prolétariat ne perd rien. Il ne pleurera pas cette figure qui, comme le montre l'article ci-dessous, incarnait bel et bien l'exploitation capitaliste.
Dans la dernière partie de sa vie, Nelson Mandela était considéré comme une sorte de "Saint" moderne, un apôtre de la réconciliation nationale et internationale sous l'égide bienveillante de la démocratie et de la non-violence. Les intellectuels bourgeois de tous bords, la presse, les politiciens et toute la clique des "faiseurs d'opinion" brossaient du "Père de la nation sud-africaine", un portrait d'homme illustre, le faisant apparaître tantôt sous les traits d'un modèle d’humilité, d’intégrité et d’honnêteté, tantôt sous ceux d'un "héros" doté d'une remarquable propension au pardon.
Mais ce portrait élogieux dissimule en fait la vie bien réelle d'un politicien bourgeois qui n'a jamais hésité à porter les coups les plus rudes et à user des pires manœuvres contre les classes exploitées.
Le "bilan" de Mandela à la tête du gouvernement est à ce titre éloquent: selon un récent rapport d’Oxfam, l’Afrique du Sud est "le pays le plus inégalitaire du monde et significativement plus inégalitaire qu’à la fin de l’Apartheid." L’ANC (1) a en effet gouverné pendant presque vingt ans une société où les classes exploitées, et spécialement la population noire de celles-ci, sont plongées dans la pire des misères. Pourtant, bien que Mandela ait été le représentant incontournable de l’ANC depuis les années 1940, les "faiseurs d'opinion" le présentent encore comme un politicien sensiblement différent des autres dirigeants africains et du reste du monde.
L'homme du pardon?
Après le décès de Mandela, les bulletins spéciaux de la presse bourgeoise l'ont radoté de toutes les manières possibles: Mandela a pardonné ses geôliers! Quelle générosité! Quel désintéressement pour le bonheur de tous!
Le mythe de "l'homme du pardon," qui n'existe que pour magnifier les illusions démocratiques véhiculées par la figure de Mandela, est d'ailleurs confirmé par l'intéressé lui-même dans son autobiographie, rédigée en 1994, La longue route vers la liberté, (LWF): "En prison, ma colère contre les blancs faiblit, mais ma haine du système grandit. Je voulais que l’Afrique du Sud voit que j’aimais même mes ennemis alors que je haïssais le système qui nous montait les uns contre les autres." (LWF, p. 680)
En dépit des reconstructions historiques complètement irrationnelles qui circulent depuis son décès, Mandela n'est pas sorti de prison grâce à la tempérance de son caractère, pas plus qu'à la "force de ses convictions" ou par la bonté d'âme de son co-prix Nobel de la Paix, F.W. de Klerk, alors chef du gouvernement sud-africain. Comme toujours avec la bourgeoise, la réalité est beaucoup plus sordide. Si Mandela a pu quitter sa geôle, c'est sous la pression d'une partie de l'appareil politique sud-africain et de plusieurs grandes puissances, notamment les États-Unis, qui ont su déceler dans ce vieil allié de l'URSS, tout juste démantelée, l'occasion d’assurer la pérennité de l'approvisionnement minier malgré les nuisances d'une société d’Apartheid à bout de souffle et menacée à chaque instant de déflagration sociale. Ainsi, quand Mandela eut quitté la prison, l’ANC s'employa aussitôt à rassurer les investisseurs sur l'aptitude du futur gouvernement à assurer la protection des intérêts économiques. Dans le Message de Mandela à USA Big Business (19/06/1990), on peut lire ce qu’il a d'ailleurs répété à maintes occasions: "Le secteur privé, à la fois intérieur et international, recevra une contribution vitale afin de réaliser la reconstruction économique et sociale après l’Apartheid (…) Nous sommes sensibles au fait qu’en tant qu’investisseurs dans une Afrique post-Apartheid, vous aurez besoin d’avoir confiance dans la sécurité de vos investissements, un retour suffisant et équitable de votre capital et un bon climat général de paix et de stabilité." (3). Assurer au Capital la paix sociale au moyen de la mystification démocratique: voilà le sens véritable de la libération "miraculeuse" de Mandela et de la soudaine conversion de ce fomentateur d'attentats meurtriers à la non-violence et au pardon!
Un défenseur convaincu des intérêts du Capital national!
D'abord allié du régime stalinien, qui a longuement assuré la formation militaire de ses partisans, Mandela, vers la fin des années 1980, c'est-à-dire au moment-même où il négociait sa libération, s'est employé à démolir son image de "socialiste" au profit d'une stature de défenseur sérieux des intérêts nationaux sud-africains.
Mandela a souvent fait référence à la Charte de la Liberté de l’ANC, adoptée en 1955: "En juin 1956, dans le mensuel Libération, j’ai noté que la Charte visait l’entreprise privée et permettait au capitalisme de se développer pour la première fois chez les africains." (LWF, p. 205. En 1988, quand il négociait en secret avec le gouvernement, il fit référence au même article "dans lequel je disais que la Charte pour la Liberté n’était pas une recette pour le socialisme, mais pour le capitalisme appliqué en Afrique. Je leur ai dit que je n’avais pas changé d’avis depuis." (LWF, p. 642). De même, lorsque Mandela reçut la visite, en 1986, d’une délégation d’importantes personnalités, "je leur ai dit que j’étais un nationaliste sud-africain, pas un communiste, que les nationalistes deviennent de plus en plus en vue." (LWF, p. 629).
Ce nationalisme immuable et son rôle dans la "pacification" de la société au profit de la bourgeoisie, Mandela en était parfaitement conscient, lui qui écrivait à propos du massacre de Sharpeville, en 1960: "la bourse de Johannesburg s’effondra et les capitaux commencèrent à fuir le pays." (LWF, p. 281). De fait, la fin de l’Apartheid ouvrit une période d’accroissement des investissements étrangers en Afrique du Sud.
Mais "l'émergence" économique du pays se fit bien entendu par la sueur de la classe ouvrière, largement composée de travailleurs noirs, sans que celle-ci ne puisse au moins s'extraire de la grande misère dans laquelle elle est plongée depuis de nombreuses décennies. Pourtant, pendant les années 1950, Mandela disait que "l’objectif caché du gouvernement était de créer une classe moyenne africaine afin d’étouffer l’appel de l’ANC et la lutte pour la libération." (LWF, p. 223). En pratique, la "libération" politique des travailleurs noirs et près de trois décennies de gouvernement ANC n’ont pas significativement grossi les rangs de cette "classe moyenne" africaine.
L'accroissement de l'exploitation a également signifié la répression, la remilitarisation de la police, l’interdiction de manifester et les attaques physiques contre les ouvriers, comme on l’a vu, par exemple, avec la grève des mineurs de Marikana, au cours de laquelle quarante-quatre ouvriers furent tués et des dizaines gravement blessés.(4)
Dans son autobiographie, Mandela a hypocritement écrit que "tous les hommes, même ceux qui ont le sang le plus froid, ont un souci de décence et si leur cœur est touché, ils sont capables de changer" (LWF, p. 549). Ce qui peut être vrai pour les individus ne l’est aucunement pour le capitalisme: il n’a aucun souci de décence et ne peut être changé. Les apparences du gouvernement noir de l’ANC sont différentes de celles de leurs prédécesseurs blancs mais l’exploitation et la répression demeurent.
La fable de la non-violence
La classe dominante utilise l'idéologie de la non-violence afin de pousser le prolétariat à renoncer à sa violence de classe, massive et organisée, pour la remplacer par celle de l'impuissance politique. Et pour ce faire, il lui faut construire de toute pièce des modèles et des histoires attestant l'efficacité de la lutte non-violente.
Le mythe d'un Mandela "non-violent" est à ce titre un grossier et ridicule mensonge. L’ANC, dans sa lutte de "libération", utilisa sans vergogne une forme particulièrement crapuleuse de violence, typique des classes sans avenir: le terrorisme. Quand la tactique non-violente eut démontré son inefficacité, l’ANC créa une branche militaire, dans laquelle Mandela joua un rôle central. "Nous considérions qu’il existait quatre types d’activités violentes: le sabotage, la guérilla, le terrorisme et la révolution ouverte." Il espérait, écrivait-il, que le sabotage "amènerait le gouvernement à la table des négociations". Bien que des instructions strictes furent données "pour que nous ne supportions aucune perte en vies humaines (…), si le sabotage ne produisait pas les résultats escomptés, nous étions préparés à passer à l’étape suivante: la guérilla et le terrorisme." (LWF, p. 336).
Ainsi, le 16 décembre 1961, "des engins explosifs artisanaux explosèrent dans les centrales électriques et les bureaux du gouvernement à Johannesburg, Port-Elizabeth et Durban." (LWF, p. 338). En 1983, lorsque l’ANC organisa la première attaque à la bombe, dans laquelle dix-neuf personnes furent tuées et plus de deux cents blessées, Mandela écrivit: "La mort violente de civils était un tragique accident et j’ai ressenti une profonde horreur à l’annonce du nombre de victimes. Mais, autant j’ai été perturbé par ces victimes, autant je savais que de tels accidents sont l’inévitable conséquence de la décision de s’embarquer dans un conflit militaire" (LWF, p. 618). Aujourd’hui, on fait allusion à de tels "accidents" en utilisant le doux euphémisme de: "dommages collatéraux."
Dans sa déposition au tribunal, en 1964, Mandela se définissait lui-même comme un "admirateur" de la démocratie: "J’ai un grand respect pour les institutions politiques britanniques et pour le système judiciaire de ce pays. Je considère le parlement anglais comme l’institution la plus démocratique du monde et l’indépendance et l’impartialité de sa magistrature ont toujours suscité mon admiration. Le Congrès américain, la doctrine de ce pays garantissant la séparation des pouvoirs, ainsi que l’indépendance de sa magistrature, éveillent en moi de semblables sentiments" (LWF, p. 436). En champion de la démocratie, Mandela sert encore aujourd'hui les sordides intérêts de sa classe en étant clairement destiné à incarner, vivant comme mort, la figure de proue de l’idéologie démocratique moderne et d'un capitalisme prétendu à visage humain.
KS et El Genericor /10.12.2013
(1) African National Congress, parti de Nelson Mandela au pouvoir depuis la fin de l'Apartheid en 1994.
(2) La pagination est celle de l'ouvrage en langue anglaise.
(3)Souligné par nous.
(4) Vous pouvez lire, à ce sujet nos articles sur le mouvement social de 2012 en Afrique du Sud: En Afrique du Sud, la bourgeoisie lance ses chiens de garde policiers et syndicaux sur la classe ouvrière, et : Après le massacre de Marikana, l’Afrique du Sud est frappée par des grèves massives.
Personnages:
Où en est la lutte de classe ? (extrait de la résolution sur la situation internationale du XXe congrès du CCI)
- 923 lectures
Nous publions ci-dessous la partie consacrée à la lutte de classe de la résolution sur la situation internationale adoptée lors du dernier congrès international du CCI. La première partie de cette résolution (Internationalisme n°359), montre comment l’impérialisme menace l’humanité de la plus effroyable des barbaries. Viennent ensuite le danger de destruction de l’environnement et les ravages de la crise économique. C’est dans ce contexte de faillite historique du capitalisme qu’est ensuite abordée la question de la lutte actuelle et à venir. En particulier, cette résolution souligne le lien entre le niveau des attaques de la bourgeoisie et les capacités de résistances du prolétariat: “Pour le mode de production capitaliste, la situation est sans issue. Ce sont ses propres lois qui l’ont conduit dans l’impasse où il se trouve et il ne pourrait sortir de cette impasse qu’en abolissant ces lois, c’est-à-dire en s’abolissant lui-même. […] La crise des “subprimes” de 2007, la grande panique financière de 2008 et la récession de 2009 ont marqué le franchissement d’une nouvelle étape très importante et significative de l’enfoncement du capitalisme dans sa crise irréversible. […] Cela ne veut pas dire cependant que nous allons revenir à une situation similaire à celle de 1929 et des années 1930. Il y a 70 ans, la bourgeoisie mondiale avait été prise complètement au dépourvu face à l’effondrement de son économie et les politiques qu’elle avait mises en œuvre, notamment le repliement sur soi de chaque pays, n’avaient réussi qu’à exacerber les conséquences de la crise. L’évolution de la situation économique depuis les quatre dernières décennies a fait la preuve que, même si elle était évidemment incapable d’empêcher le capitalisme de s’enfoncer toujours plus dans la crise, la classe dominante avait la capacité de ralentir le rythme de cet enfoncement […]. Il existe une autre raison pour laquelle nous n’allons pas revivre une situation similaire à celle des années 1930. A cette époque, l’onde de choc de la crise, partie de la première puissance économique du monde, les États-Unis, s’était propagée principalement vers la seconde puissance mondiale, l’Allemagne. C’est dans ces deux pays qu’on avait vu les conséquences les plus dramatiques de la crise, comme ce chômage de masse touchant plus de 30% de la population active, ces queues interminables devant les bureaux d’embauche ou les soupes populaires […]. A l’heure actuelle, […] les pays les plus développés de l’Europe du Nord, les États-Unis ou le Japon sont encore très loin d’une telle situation et il est plus qu’improbable qu’ils y parviennent un jour, d’une part, du fait de la plus grande résistance de leur économie nationale face à la crise, d’autre part, et surtout, du fait qu’aujourd’hui le prolétariat de ces pays, et particulièrement ceux d’Europe, n’est pas prêt à accepter un tel niveau d’attaques contre ses conditions d’existence. Ainsi, une des composantes majeures de l’évolution de la crise échappe au strict déterminisme économique et débouche sur le plan social, sur le rapport de forces entre les deux principales classes de la société, bourgeoisie et prolétariat.”
Où en est la lutte de classe?
(Points 15 à 19 de la résolution)
15
. Alors que la classe dominante voudrait nous faire passer ses abcès purulents pour des grains de beauté, l’humanité commence à se réveiller d’un rêve devenu cauchemar et qui montre la faillite historique totale de sa société. Mais alors que l’intuition de la nécessité d’un ordre de choses différent gagne du terrain face à la brutale réalité d’un monde en décomposition, cette conscience vague ne signifie pas que le prolétariat est convaincu de la nécessité d’abolir ce monde, encore moins de celle de développer la perspective d’en construire un nouveau. Ainsi, l’aggravation inédite de la crise capitaliste dans le contexte de la décomposition est le cadre dans lequel s’exprime la lutte de classes actuellement, bien que d’une manière encore incertaine dans la mesure où cette lutte ne se développe pas sous la forme de confrontations ouvertes entre les deux classes. A ce sujet, nous devons souligner le cadre inédit des luttes actuelles puisqu’elles ont lieu dans le contexte d’une crise qui dure depuis presque 40 ans et dont les effets graduels dans le temps – en dehors des moments de convulsion – ont “habitué” le prolétariat à voir ses conditions de vie se dégrader lentement, pernicieusement, ce qui rend plus difficile de percevoir la gravité des attaques et de répondre en conséquence. Plus encore, c’est une crise dont le rythme rend difficile la compréhension de ce qui se trouve derrière de telles attaques rendues “naturelles” de par leur lenteur et leur échelonnement. C’est là un cadre très différent de celui de convulsions et de bouleversements évidents, immédiats, de l’ensemble de la vie sociale que l’on connaît dans une situation de guerre. Ainsi, il y a des différences entre le développement de la lutte de classe – au niveau des ripostes possibles, de leur ampleur, de leur profondeur, de leur extension et de leur contenu – dans un contexte de guerre qui rend le besoin de lutter dramatiquement urgent et vital (comme ce fut le cas lors de la Première Guerre mondiale au début du XXème siècle même s’il n’y eut pas immédiatement de réponse à la guerre) et dans un contexte de crise ayant un rythme lent.
Ainsi, le point de départ des luttes d’aujourd’hui est précisément l’absence d’identité de classe d’un prolétariat qui, depuis l’entrée du capitalisme dans sa phase de décomposition, a connu de grandes difficultés non seulement pour développer sa perspective historique mais même pour se reconnaître comme une classe sociale. La prétendue “mort du communisme” qu’aurait sonné la chute du bloc de l’Est en 1989, déchaînant une campagne idéologique qui avait pour but de nier l’existence même du prolétariat, a porté un coup très dur à la conscience et à la combativité de la classe ouvrière. La violence de l’attaque de cette campagne a pesé sur le cours de ses luttes depuis lors. Mais malgré cela, comme nous le constations dès 2003, la tendance vers des affrontements de classe a été confirmée par le développement de divers mouvements dans lesquels la classe ouvrière a “démontré son existence” à une bourgeoisie qui avait voulu “l’enterrer vivante”. Ainsi, la classe ouvrière dans le monde entier n’a pas cessé de se battre, même si ses luttes n’ont pas atteint l’ampleur ni la profondeur espérées dans la situation critique où elle se trouve. Toutefois, penser la lutte de classes en partant de “ce qui devrait être”, comme si la situation actuelle “était tombée du ciel”, n’est pas permis aux révolutionnaires. Comprendre les difficultés et les potentialités de la lutte de classes a toujours été une tâche exigeant une démarche matérialiste et historique patiente afin de trouver un “sens” au chaos apparent, de comprendre ce qui est nouveau et difficile, ce qui est prometteur.
16
. C’est dans ce contexte de crise, de décomposition et de fragilisation de l’état du prolétariat sur le plan subjectif que prennent leur sens les faiblesses, les insuffisances et les erreurs, tout comme les potentialités et les forces de sa lutte, en nous confirmant dans la conviction que la perspective communiste ne dérive pas de façon automatique ni mécanique de circonstances déterminées. Ainsi, pendant les deux années passées, nous avons assisté au développement de mouvements que nous avons caractérisés par la métaphore des 5 cours:
1. des mouvements sociaux de la jeunesse précaire, au chômage ou encore étudiante, qui commencent avec la lutte contre le CPE en France en 2006, se poursuivent par les révoltes de la jeunesse en Grèce en 2008 et qui culminent dans les mouvements des Indignés et d’Occupy en 2011;
2. des mouvements massifs mais très bien encadrés par la bourgeoisie qui avait préparé le terrain à l’avance, comme en France en 2007, en France et en Grande-Bretagne en 2010, en Grèce en 2010-2012, etc.;
3. des mouvements subissant le poids de l’interclassisme comme en Tunisie et en Égypte en 2011 ;
4. des germes de grèves massives en Égypte en 2007, Vigo (Espagne) en 2006, Chine en 2009;
5. la poursuite de mouvements dans des usines ou des secteurs industriels localisés mais contenant des germes prometteurs comme Lindsay en 2009, Tekel en 2010, les électriciens en Grande-Bretagne en 2011.
Ces 5 cours appartiennent à la classe ouvrière parce que malgré leurs différences, ils expriment chacun à son niveau l’effort du prolétariat pour se retrouver lui-même malgré les difficultés et les obstacles que sème la bourgeoisie; chacun à son niveau a porté une dynamique de recherche, de clarification, de préparation du terrain social. A différents niveaux, ils s’inscrivent dans la recherche “du mot qui nous emmènera jusqu’au socialisme” (comme l’écrit Rosa Luxemburg en parlant des conseils ouvriers) au moyen des assemblées générales. Les expressions les plus avancées de cette tendance ont été les mouvements des Indignés et d’Occupy – principalement en Espagne – parce que ce sont ceux qui ont le plus clairement posé les tensions, les contradictions et les potentialités de la lutte de classes aujourd’hui. Malgré la présence de couches en provenance de la petite bourgeoisie appauvrie, l’empreinte prolétarienne de ces mouvements s’est manifestée par la recherche de la solidarité, les assemblées, l’ébauche d’une culture du débat, la capacité d’éviter les pièges de la répression, les germes d’internationalisme, une sensibilité aiguë à l’égard des éléments subjectifs et culturels. Et c’est à travers cette dimension, celle de la préparation du terrain subjectif, que ces mouvements montrent toute leur importance pour le futur.
17
. La bourgeoisie, pour sa part, a montré des signes d’inquiétude face à cette “résurrection” de son fossoyeur mondial réagissant aux horreurs qui lui sont imposées au quotidien pour maintenir en vie le système. Le capitalisme a donc amplifié son offensive en renforçant son encadrement syndical, en semant des illusions démocratiques et en allumant les feux d’artifice du nationalisme. Ce n’est pas un hasard si sa contre-offensive s’est centrée sur ces questions: l’aggravation de la crise et ses effets sur les conditions de vie du prolétariat provoquent une résistance que les syndicats tentent d’encadrer par des actions qui fragmentent l’unité des luttes et prolongent la perte de confiance du prolétariat en ses propres forces.
Comme le développement de la lutte de classe auquel nous assistons aujourd’hui se réalise dans un cadre de crise ouverte du capitalisme depuis près de 40 ans – ce qui est dans une certaine mesure une situation sans précédent par rapport aux expériences passées du mouvement ouvrier, la bourgeoisie tente d’empêcher le prolétariat de prendre conscience du caractère mondial et historique de la crise en en cachant la nature. Ainsi, l’idée de solutions “nationales” et la montée des discours nationalistes empêchent la compréhension du véritable caractère de la crise, indispensable pour que la lutte du prolétariat prenne une direction radicale. Puisque le prolétariat ne se reconnaît pas lui-même comme classe, sa résistance tend à démarrer comme une expression générale d’indignation contre ce qui a lieu dans l’ensemble de la société. Cette absence d’identité de classe et donc de perspective de classe permet à la bourgeoisie de développer des mystifications sur la “citoyenneté” et les luttes pour une “vraie démocratie”. Et il y a d’autres sources à cette perte d’identité de classe qui prennent racine dans la structure même de la société capitaliste et dans la forme que prend actuellement l’aggravation de la crise. La décomposition, qui entraîne une aggravation brutale des conditions minimales de survie humaine, s’accompagne d’une insidieuse dévastation du terrain personnel, mental et social. Cela se traduit par une “crise de confiance” de l’humanité. De plus, l’aggravation de la crise, à travers l’extension du chômage et de la précarité, vient affaiblir la socialisation de la jeunesse et faciliter la fuite vers un monde d’abstraction et d’atomisation.
18
. Ainsi, les mouvements de ces deux dernières années, et en particulier les “mouvements sociaux”, sont marqués par de multiples contradictions. En particulier, la rareté des revendications spécifiques ne correspond apparemment pas à la trajectoire “classique” qui va du particulier au général que nous attendions de la lutte de classe. Mais nous devons aussi prendre en compte les aspects positifs de cette démarche générale qui dérive du fait que les effets de la décomposition se ressentent sur un plan général et à partir de la nature universelle des attaques économiques menées par la classe dirigeante. Aujourd’hui, le chemin qu’a pris le prolétariat a son point de départ dans “le général”, ce qui tend à poser la question de la politisation d’une façon bien plus directe. Confrontée à l’évidente faillite du système et aux effets délétères de sa décomposition, la masse exploitée se révolte et ne pourra aller de l’avant que quand elle comprendra ces problèmes comme des produits de la décadence du système et de la nécessité de le dépasser. C’est à ce niveau que prennent toute leur importance les méthodes de lutte proprement prolétariennes que nous voyons (assemblées générales, débats fraternels et ouverts, solidarité, développement d’une perspective de plus en plus politique) car ce sont ces méthodes qui permettent de mener une réflexion critique et d’arriver à la conclusion que le prolétariat peut non seulement détruire le capitalisme mais construire un monde nouveau. Un moment déterminant de ce processus sera l’entrée en lutte des lieux de travail et leur conjonction avec les mobilisations plus générales, une perspective qui commence à se développer malgré les difficultés que nous devrons affronter dans les années qui viennent. C’est là le contenu de la perspective de la convergence des “cinq cours” dont nous parlions plus haut en cet “océan de phénomènes”, comme Rosa Luxemburg décrit la grève de masse.
19
. Pour comprendre cette perspective de convergence, le rapport entre l’identité de classe et la conscience de classe est d’une importance capitale et une question se pose: la conscience peut-elle se développer sans identité de classe ou cette dernière surgira-t-elle du développement de la conscience? Le développement de la conscience et d’une perspective historique est à juste raison associé à la récupération de l’identité de classe mais nous ne pouvons pas envisager ce processus se développant petit à petit selon une séquence rigide: d’abord forger son identité, ensuite lutter, ensuite développer sa conscience et développer une perspective, ou n’importe quel autre ordonnancement de ces éléments. La classe ouvrière n’apparaît pas aujourd’hui comme un pôle d’opposition de plus en plus massif; aussi le développement d’une posture critique par un prolétariat qui ne se reconnaît pas encore lui-même est le plus probable. La situation est complexe, mais il y a plus de chances que nous voyions une réponse en forme de questionnement général, potentiellement positif en termes politiques, partant non d’une identité de classe distincte et tranchante mais à partir de mouvements tendant à trouver leur perspective propre au travers de leur propre lutte. Comme nous le disions en 2009, “Pour que la conscience de la possibilité de la révolution communiste puisse gagner un terrain significatif au sein de la classe ouvrière, il est nécessaire que celle-ci puisse prendre confiance en ses propres forces et cela passe par le développement de ses luttes massives” (Résolution sur la situation internationale, point 11, 18e Congrès du CCI). La formulation “développer ses luttes pour retrouver confiance en soi et en sa perspective” est tout à fait adéquate car elle veut dire reconnaître un “soi” et une perspective, mais le développement de ces éléments ne peut dériver que des luttes elles-mêmes. Le prolétariat ne “crée” pas sa conscience, mais “prend” conscience de ce qu’il est réellement.
Dans ce processus, le débat est la clef pour critiquer les insuffisances des points de vue partiels, pour démonter les pièges, rejeter la chasse à des boucs-émissaires, comprendre la nature de la crise, etc. A ce niveau, les tendances au débat ouvert et fraternel de ces dernières années sont très prometteuses pour ce processus de politisation que la classe devra faire avancer. Transformer le monde en nous transformant nous-mêmes commence à prendre corps dans l’évolution des initiatives de débats et dans le développement de préoccupations qui se basent sur la critique des puissantes chaînes qui paralysent le prolétariat. Le processus de politisation et de radicalisation a besoin du débat pour critiquer l’ordre actuel et apporter une explication historique aux problèmes. A ce niveau reste valable que “La responsabilité des organisations révolutionnaires, et du CCI en particulier, est d’être partie prenante de la réflexion qui se mène d’ores et déjà au sein de la classe, non seulement en intervenant activement dans les luttes qu’elle commence à développer mais également en stimulant la démarche des groupes et éléments qui se proposent de rejoindre son combat” (Résolution sur la situation internationale du 17e Congrès du CCI, 2007). Nous devons être fermement convaincus que la responsabilité des révolutionnaires dans la phase qui s’ouvre est de contribuer, catalyser le développement naissant de la conscience qui s’exprime dans les doutes et les critiques qui commencent déjà à se poser dans le prolétariat. Poursuivre et approfondir l’effort théorique doit être le centre de notre contribution, non seulement contre les effets de la décomposition mais aussi comme moyen de fertiliser patiemment le champ social, comme antidote à l’immédiatisme dans nos activités, car sans la radicalité et l’approfondissement de la théorie par les minorités, la théorie ne pourra jamais s’emparer des masses.
CCI
Vie du CCI:
De la "malbouffe" aux famines:le capitalisme empoisonne et affame (I)
- 883 lectures
Notre quotidien est imprégné par ces images insupportables d’enfants et de familles entières qui crèvent de faim au milieu de détritus. La violence de cette misère absurde ne semble pas avoir de limite. En a-t-elle seulement? A regarder la situation à travers le monde, on pourrait se le demander! La manière dont la situation évolue montre bien la tendance dans laquelle s’engouffre la société actuelle toute entière (1). A des degrés divers, la misère ne cesse de progresser à travers le monde et amène même une part de la population des pays "riches", quand elle n’est jetée elle-même dans la misère, à se sentir coupable des maux des pays du "tiers-monde".
Les fausses explications bourgeoises
De la bouche de prétendus "spécialistes" on entend invoquer les raisons les plus invraisemblables: nous serions "trop d’êtres humains", notre régime alimentaire ne serait "pas adapté aux ressources" de notre planète, notre attitude même à l’égard de ces ressources ne serait "pas respectueuse"… En bref, tous les motifs les plus culpabilisants sont évoqués, sans que jamais les véritables responsables ne soient dénoncés. Est-ce de leur faute si des familles "modestes" des "pays du Nord", ne trouvent rien d’autre pour se nourrir que les "modestes" produits que l’on trouve dans les grandes surfaces et des marques à bas prix? Faut-il effectivement rejeter la faute sur les "consommateurs" qui achètent des produits fabriqués dans des conditions plus que douteuses? Certains se plaisent à le répéter. Ceux-là mêmes qui n’hésitent pas à dire que l’on peut "consommer autrement", que si l’on s’en donnait les moyens, on pourrait tous vivre mieux, y compris dans les pays pauvres. En gros, nous n’aurions pas une attitude responsable! Nous mangerions trop, trop mal! Pour ce qui est de mal manger, cela ne fait pas de doute avec tous ces produits bourrés de conservateurs, de colorants, de sucres, de pesticides… Nous y reviendrons plus tard. Nous mangerions trop de viande, trop de ceci ou de cela. Dans certains pays on meurt de faim pendant que dans d’autres, on mange des produits de mauvaise qualité mais finalement, tout cela serait un peu de notre faute. Comment comprendre cette situation? Notre terre est une planète très fertile, dotée d’un écosystème extrêmement riche et diversifié qui offre un immense potentiel. Avec près de 10 GHa (10. 000. 000 000 Ha) de terres potentiellement cultivables, ce sont des terrains fertiles à perte de vue qui se présentent. A tel point, qu’il devrait apparaître comme inconcevable que des individus qui possèdent le niveau de développement technologique actuel puissent connaitre la faim sur une planète aussi riche. Et pourtant! Que voyons-nous aujourd’hui? Si l’on fait le bilan des ressources disponibles sur la planète et que l’on met ce dernier en rapport avec la manière effective dont nous les exploitons aujourd’hui, d’un point de vue purement scientifique, il y a là des contradictions immenses. Aujourd’hui, ces contradictions menacent même l’existence de notre espèce!
Regardons un peu plus en détails quelles sont ces contradictions. Comme nous l'évoquions plus haut, notre planète dispose de près de 10 GHa de terres cultivables. D’après un rapport publié par l’Institution of Mechanical Ingeneers (2) en Angleterre, l’ensemble des terres actuellement exploitées représente une surface de 4,9 GHa, soit environ la moitié des ressources totales exploitables pour la production de denrées alimentaires. Ce même rapport indique que la capacité moyenne de production d’un champ d’un hectare de blé ou de maïs, permet de nourrir, avec les moyens actuels, entre 19 et 22 personnes pendant toute une année quand l’exploitation d’un hectare destiné à l’élevage de bœuf ou de mouton pour la consommation humaine, permet de nourrir environ 1,5 personnes par an.
La productivité actuelle dans le domaine agro-alimentaire permet donc de nourrir très largement toute la population mondiale. Si des millions d’êtres humains meurent chaque jour de faim, la cause est ce système immonde qui ne produit pas pour satisfaire les besoins de l’humanité mais pour vendre et faire du profit. Voici une grande différence avec les famines du Moyen-âge: celles-ci étaient le résultat du faible développement des outils, des techniques, de l’organisation du travail et des terres qui créait des manques réels. Les hommes ne cessaient jamais de défricher, d’exploiter chaque parcelle de terre afin de combler ce manque de productivité. Aujourd’hui, sous le capitalisme, l’humanité possède d’incroyables capacités dont elle ne bénéficie pas. Pire! La course au profit induit un immense gâchis permanent: "Dans les pays d’Asie du Sud-est par exemple, les pertes en riz s’étendent de 37% à 80% de la production totale, en fonction du niveau de développement, et représentent annuellement 180 millions de tonnes (...)[Au niveau mondial] la possibilité de fournir 60 à 100% de nourriture en plus, simplement en éliminant les pertes et simultanément en libérant des ressources en terres, en énergie et en eau pour d’autres utilisations est une opportunité qui ne devraient pas être ignorée." (3)! En Europe, 50% des aliments produits finissent à la poubelle, soit 240.000 tonnes chaque jour.
Face aux famines, l'exploitation des terres arables laissées en friche, la lutte contre le gaspillage, contre la destruction des invendus… apparaissent comme des mesures immédiates à prendre mais largement insuffisantes. D'ailleurs, même ces mesures de première urgence, jamais le capitalisme ne pourra les mettre en place car le bien-être et la satisfaction des besoins humains, même les plus élémentaires, ne sont absolument pas le but de la production (4). Ses usines, ses machines, ses capitaux n'existent que pour accumuler plus de capital et faire des profits. Ces mesures qui paraissent simples et immédiates ne pourront être adoptées que par le prolétariat dans une situation révolutionnaire et politique très avancée.
Cela dit, sur le long terme, un changement bien plus radical devra s’imposer pour une société future libérée des classes sociales et du capital. Le mode de production capitaliste ravage la nature, appauvrit les sols, empoisonne la vie. D’ailleurs, la plupart des espèces animales est en danger et menacée de disparition si un terme n’est pas mis à la folie destructrice de ce système.
Le réflexe de nombres de ceux qui ont conscience de cette situation et s’en indignent, est de prôner une réduction de la consommation, une "décroissance". En réalité, la solution n’est ni "productiviste" (produire toujours plus sans se soucier de la finalité de la production), ni "décroissante" (produire moins pour que chaque être humain vive à peine au-dessus du seuil de la pénurie, ce qui dans le capitalisme est impossible); elle doit être bien plus radicale et profonde que cela. Si la production n’est plus aiguillonnée par la recherche du profit mais par la satisfaction des besoins humains, alors les conditions de la production changeront intégralement. En l’occurrence, dans le domaine agro-alimentaire, toute la recherche, l’organisation du travail et des sols, la répartition,… tout sera guidé par le respect de l’homme et de la nature. Mais cela implique d’abattre le capitalisme.
De la pénurie à la surproduction
De ce que l’on sait actuellement, l’agriculture a fait son apparition il y a près de 10.000 ans, quelque part vers le Sud Est de la Turquie actuelle. Depuis lors, les techniques n’ont cessé de se développer, voyant les rendements faire parfois des bonds considérables. L’utilisation de la force animale ne tarda pas à se généraliser (utilisation de l’araire dès l’antiquité) et au moyen-âge, l’apparition de la charrue et de la rotation triennale (vers le Xe siècle en Europe), permirent de nettes améliorations de la production. Ce système, basé sur la culture attelée, dura de nombreux siècles. Toutefois, il est important de rappeler que malgré les avancées qui marquèrent cette longue période (5), les connaissances et la technique de l’époque ne permettaient pas de garantir des récoltes stables d’une année sur l’autre. Nombreux sont les exemples de grandes famines qui décimèrent les populations: en 1315 par exemple, du fait d’une année particulièrement froide et pluvieuse les récoltes en France sont inférieures de 50% à celles des autres années, entrainant la mort de 5 à 10% de la population. Dans une moindre mesure, le même phénomène est constaté en 1348, cette fois suivi de la peste Noire qui s’abat sur la population affaiblie. Pour faire simple, au cours des XIVe et XVe siècles où le climat se montre moins favorable que dans la période précédente, c’est pratiquement tous les 20 à 30 ans que survient une terrible famine! Finalement, il faudra attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour que la production agricole cesse de subir aussi durement des coups du climat. Les progrès du machinisme et l’utilisation des énergies fossiles (charbon, pétrole), les avancées de la chimie inorganique et l’introduction des engrais minéraux, permettent une augmentation formidable des rendements. Avec le développement du capitalisme, l’agriculture devient une industrie, à l’instar de l’industrie du textile ou des transports. Les tâches sont rigoureusement planifiées et la vision de "processus de fabrication" (avec l’organisation scientifique du travail) permet une augmentation inédite de la productivité. Tout cela pouvait laisser croire que les périodes de crises et de famines dont nous parlions plus haut allaient laisser place à des siècles d’abondance. La plupart des scientifiques de l’époque ne jurait que par le progrès scientifique et voyait dans le développement de la société capitaliste, le remède de tous les maux de la société. La plupart, mais pas tous! En 1845 par exemple, alors même que le capitalisme était en plein développement, une terrible famine s’abat sur l’Irlande. Le mildiou (6) et l’humidité du climat provoquent une chute de la production de pommes de terre de près de 40%. Les conséquences pour la population furent dramatiques. (7) Même si les moyens de l’époque sont encore assez rudimentaires, il serait faux de considérer ce parasite comme seul responsable de ce qui fut une véritable catastrophe: contrairement à ce qui s’est passé pendant la famine de 1780, les ports irlandais restèrent ouverts sous la pression des négociants protestants et l’Irlande continua à exporter de la nourriture. Alors que dans des régions de l’île, des familles entières mourraient de faim, des convois de nourriture appartenant aux landlords, escortés par l’armée, partaient vers l’Angleterre. On peut aussi rappeler qu’à cette époque l’armée britannique possédait les plus grandes réserves alimentaires d’Europe. C’est ainsi que l’Angleterre soutint son expansion capitaliste. La cruauté sans bornes du système capitaliste, dont les exemples foisonnent, amène notamment Engels à écrire en 1882 (8): "Dans les pays industriels les plus avancés, nous avons dompté les forces de la nature et les avons contraintes au service des hommes; nous avons ainsi multiplié la production à l’infini si bien qu’actuellement, un enfant produit plus qu’autrefois cent adultes. Et quelle en est la conséquence? Surtravail toujours croissant et misère de plus en plus grande des masses, avec, tous les dix ans, une grande débâcle."
(Dans le prochain article de cette série, nous aborderons le sujet à l'aune de la décadence du capitalisme).
Enkidu/ 20.10.2013
(1)100. 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde, un enfant de moins de 10 ans meurt toutes les 5 secondes, 842 millions de personnes souffrent de malnutrition chronique aggravée, réduites à l’état d’invalides.
(2) "Global Food, waste not, want not"
(3) Global food report, traduit par nous
(4) La bourgeoisie est seulement intéressée à suffisamment nourrir les ouvriers pour qu’ils aient la force d’aller au travail.
(5) On pourrait citer les travaux d’Olivier de Serres (1539-1619) pour structurer les pratiques agricoles.
(6) Principal parasite de la pomme de terre
(7) On estime à un million, le nombre total de victimes entre 1846 et 1851.
(8) Dans La dialectique de la nature, imprimée la première fois en 1925 d’après des notes datant de 1882, éditions sociales P. 42
Mali, Centrafrique: derrière l'alibi démocratique, la guerre impérialiste
- 839 lectures
La "paix" ne règne pas au Mali! Bien au contraire, l’impérialisme français s’enfonce de plus en plus dans le chaos malien. Pourtant, au même moment, la France a décidé de faire le coup de feu en Centrafrique, un autre pays du Sahel, pour soi-disant "protéger" les populations et "rétablir l’ordre et permettre une amélioration de la situation humanitaire". En effet, les médias exposent en ce moment des images en provenance de la Centrafrique sur les massacres et le Département d’Etat américain évoque une situation "pré-génocidaire". Bref, l’horreur est omniprésente au cœur du continent africain. Mais aucune presse ne mentionne la responsabilité de la France dans l’explosion de cette barbarie alors que l’Etat français est l’acteur ou le témoin principal des crimes, passés et présents, commis dans son ex-pré carré colonial.
En ce qui concerne le Mali, contrairement aux allégations mensongères de François Hollande, sa fameuse "victoire sur les groupes terroristes" ne se confirme toujours pas! Le pouvoir français a beau obliger les cliques maliennes à organiser des "élections libres" et "démocratiques" (présidentielles en août et législatives en ce mois de novembre) en vue de "restaurer l’Etat malien et assurer la paix", cette propagande mensongère est en totale contradiction avec les faits eux-mêmes.
Silence radio sur la nouvelle guerre du Mali
"…pourquoi avoir engagé 1. 500 militaires dans cette "nouvelle reconquête" du Nord Mali? Avec, comme supplétifs, quelques éléments de l’armée malienne et de la force africaine de l’ONU dont les officiers français déplorent " le manque de combativité et leurs équipements médiocres". Enfin, quelle bizarre idée d’avoir baptisé "opération Hydre" ce nouvel engagement français, en référence à ce serpent dont les sept têtes repoussent après avoir été tranchées… En réalité, des avions de combat interviennent régulièrement, et, parfois les combats sont rudes, près de Gao et de la frontière du Niger. (…) A Bamako, l’amiral Guillaud (patron des armées françaises) a parlé métier. Au général Marc Fourcaud, commandant du corps expéditionnaire français, et, à ses officiers, il s’est bien gardé de fixer une date pour la fin de leur intervention: ‘Il faut redoubler d’adaptation, d’imagination et de vigilance face à un adversaire qui se montre jusqu’au-boutiste‘. Façon de dire qu’il ne s’agit pas d’"une simple action de contre-terroriste" comme le prétend Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense." (Le Canard enchaîné du 30/10/13).
"Malgré la présence de milliers de soldats français et africains dans le septentrion malien pour les traquer, les éléments de ces groupes terroristes ont pu perpétrer, depuis septembre 2013, trois attaques meurtrières. Particulièrement élaboré, le raid mené le 23 octobre dernier à Tessalit, dans le nord-est du Mali, contre des soldats tchadiens de la Mission intégrée des Nations-unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) nous apprend beaucoup sur la capacité de résistance d’Aqmi et du Mujao". (Courrier international 7-13/11/13).
A cela s’ajoute une série d’accrochages meurtriers entre l’armée malienne et les forces nationalistes du NMLA en vue de contrôler la ville de Kidal, sans compter les sanglantes prises d’otages et autres explosions de kamikazes dont les civils font régulièrement les frais.
Tout ceci confirme qu’au Mali la guerre est toujours aussi sanglante entre barbares islamistes et gangs agissant au nom de la défense de l’ordre et de la démocratie, tous également avides de sang et de gains économiques, tous semant la mort et la désolation parmi les populations sahéliennes sans le moindre état d’âme.
L'impérialisme français plonge dans le chaos centrafricain
Depuis mars 2013, la Centrafrique est plongée dans un chaos sanglant, suite à un coup d’Etat militaire piloté par une coalition de rebelles se nommant la "Séléka" qui a chassé du pouvoir l’ex-président (putschiste) François Bozizé en mettant à sa tête un élément de la rébellion Michel Djotodia. Une fois au pouvoir, les groupes armés se livrent quotidiennement aux assassinats, au pillage des ressources (or, diamant, etc.), au racket, à la rafle des jeunes dans les quartiers, aux viols... Pour échapper à ce monstrueux carnage, des centaines de milliers d’habitants ont dû quitter leur domicile en allant se réfugier tantôt dans la forêt tantôt dans les pays voisins. Mais, de fait, il n’y a pas que les ex-rebelles au pouvoir qui sèment la terreur, il y a aussi leurs opposants. Par exemple, les partisans de l’ancien président renversé se comportent eux aussi en bourreaux, tout cela sous les yeux indifférents des centaines de soldats français qui se contentent odieusement de "compter les points" et les morts. Sans doute hanté par "l’expérience rwandaise" où il fut accusé de complicité dans le génocide, l’impérialisme français se lance dans une nouvelle intervention en Centrafrique.
" Ce n’est plus qu’une question de jours, la France va lancer une opération militaire en République centrafricaine (RCA). ‘Une opération coup de poing, limitée dans le temps, pour rétablir l’ordre et permette une amélioration de la situation humanitaire, indique une source au ministère de la défense’". (Le Monde, 23/11/13).
Au moment où nous rédigeons ces lignes, le gouvernement français annonce l’envoi en Centrafrique d’un millier de soldats allant renforcer les 400 sur place en permanence.
Les responsabilités criminelles de la France en Centrafrique
" Pour le meilleur comme pour le pire, c’est un pays que Paris connaît bien. Ce fut même une caricature de ce que l’on appelait jadis la "Françafrique". Un Etat où la France faisait et défaisait les régimes. Remplaçant des dictateurs en cours d’émancipation par d’autres qui lui étaient redevables. On a bien noté les visites mystérieuses ces derniers mois à Bangui de Claude Guéant et de Jean-Christophe Mitterrand, deux figures d’une "Françafrique" moribonde". (Le Monde, 28/11/13).
En effet, le gendarme français retrouve le chemin de Bangui pour y rétablir son ordre néocolonial, mais contrairement au gros mensonge du gouvernement Hollande, ce n’est pas pour "permettre une amélioration de la situation humanitaire" ou à cause des "exactions extraordinaires" qui s’y déroulent. Car cela fait bientôt un an que les autorités françaises ferment les yeux sur les "actes abominables" se déroulant en Centrafrique et pire encore le silence était de mise jusqu’aujourd’hui à tous les étages du pouvoir français, grands médias compris. Et pour cause. Le gouvernement français se sentait bien mal à l'aise pour dénoncer les massacres et mutilations que subissent les populations centrafricaines. D’abord, rappelons que le général François Bozizé (arrivé au pouvoir en 2003 par un coup d’Etat téléguidé par Paris) a été renversé fin mars 2012 par une coalition de groupes armés (la "Séléka") soutenue en sous-main par la France. En réalité, l’impérialisme français s’est servi de ces bandes armées pour se débarrasser de l’ancien "dictateur" qui échappait à son contrôle: " Jacob Zuma n’a pas hésité une seconde à voler au secours du président centrafricain François Bozizé lors que ce dernier, menacé par une rébellion armée, a fait appel à lui en décembre 2012. Le fait que Bozizé ait été lâché par la France et soutenu de façon quelque peu ambiguë par ses voisins francophones -considérés à Pretoria comme autant des néo-colonies- a encore accru la détermination sud-africaine à intervenir. En une semaine, 400 soldats de la force de défense nationale d’Afrique du Sud (SANDF) ont été transportés à Bangui. Installés dans les locaux de l’école de la police du kilomètre 9, mais aussi à Bossembélé et à Bossangoa à l’intérieur du pays, ils n’ont aucun contact, ni avec les forces africaines multinationales présentes sur place, ni avec l’ONU, ni bien sûr avec le contingent français. Jakob Zuma n’a de comptes à rendre à personne. Et ce ne sont pas les sociétés chinoises qui, dans le plus grand secret, opèrent depuis 3 ans dans le nord-est de la Centrafrique, où des gisements de pétrole sont désormais avérés, qui s’en plaindront. Elles n’attendent qu’une protection sud-africaine pour démarrer les premiers forages". (Jeune Afrique, 10/03/13).
On voit là la vraie raison du "lâchage" de l’ex-président Bozizé: la "trahison" de son maître français en allant "coucher" avec l’Afrique du Sud, rivale déclarée de la France derrière laquelle se cache à peine la Chine, l’autre redoutable concurrent en train de s’emparer des ressources pétrolières de ce pays. Pourtant, en fonction des "accords de défense" existant entre les deux pays (permettant, entre autres, la présence militaire française permanente en Centrafrique), Hollande aurait dû soutenir Bozizé qui avait fait appel à lui. Au lieu de cela, le président français a décidé de "punir" son "ex- ami dictateur" par tous les moyens y compris en facilitant l’avancée des bandes sanguinaires de la Seléka jusqu’au palais présidentiel entouré par ailleurs de centaines de militaires français.
Cela permet de comprendre la dose de cynisme de la part de François Hollande quand on l’entend déclarer aujourd’hui: " Il se produit en Centrafrique des actes abominables. Un chaos, des exactions extraordinairement graves. Nous devons agir. (sic !)".
Voilà une hypocrisie de langage qui tente de camoufler et de justifier les abominables crimes que l’ex-puissance coloniale s’apprête à commettre en Centrafrique comme elle cherche à masquer sa complicité avec les diverses cliques sanguinaires concurrentes en présence et sa part majeure de responsabilité dans les horribles massacres en cours dans ces pays.
En clair, le gouvernement Hollande se fiche totalement du sort des populations centrafricaines, maliennes et autres, de leurs souffrances multiples. Il s’agit pour lui, de façon inavouée, simplement de défendre les intérêts du capital national par tous les moyens, dans un des derniers bastions de l’impérialisme français, le Sahel, région hautement stratégique et bourrée de matières premières, face aux autres requins impérialistes qui lui disputent son influence.
Amina/29.10.2013
Tragédie à Lampudesa: le capital et ses politiciens responsables de la catastrophe!
- 865 lectures
Début octobre, une embarcation surchargée faisait naufrage à Lampedusa. Plus de 350 immigrés sont morts lors de cette tragédie. Quelques jours après, un autre navire de fortune sombrait et faisait une dizaine de victimes près des côtes maltaises. Chaque année en Méditerranée, avant même d'atteindre la forteresse-Europe tant convoitée, près de 20.000 êtres humains perdent ainsi la vie! Depuis les années 1990, les cadavres se sont accumulés aux frontières, le long des côtes, comme dans la plupart des points sensibles du monde où se concentrent des flux croissants d'affamés et de miséreux qui tentent de forcer le blindage des Etats.
L'hypocrisie de la classe dominante
Si aujourd'hui la bourgeoisie fait mine de s'offusquer et verse ses larmes de crocodiles alors que des milliers de personnes meurent en se fracassant sur ses côtes depuis longtemps, c'est simplement que l'ampleur du phénomène, le caractère désespéré et surtout le nombre élevé des victimes en un seul jour est bien trop visible. Cela risque de favoriser la colère et surtout la réflexion des populations.
La polémique ignoble autour de la "non- assistance" des marins-pêcheurs italiens est d'ailleurs venue à point nommé pour détourner l'attention, cherchant immédiatement des boucs-émissaires, alors même que les lois en vigueur ne cessent de criminaliser ceux qui tentent d'aider les immigrés!(1) C'est en grande partie tout cela qui explique la couverture médiatique de l'événement pour pourrir les cerveaux, dresser un rideau de fumée devant un arsenal répressif mis en place de façon coordonnée par les Etats. Le piège idéologique classique qui l'accompagne est composé des mêmes propos ouvertement xénophobes d'un côté, et de l'autre, des discours "humanitaires" bourgeois pour la "défense des droits", divisant, isolant ainsi de facto les immigrés des autres prolétaires.
Une chose doit être claire, le capitalisme en crise et ses politiciens sont bel et bien les responsables de cette nouvelle tragédie, eux qui obligent des centaines de milliers d'affamés à se jeter dans des aventures toujours plus suicidaires afin de contourner les obstacles qu'ils leurs imposent! Il n'est donc pas surprenant que ces mêmes politiciens, qui se sont présentés à Lampedusa faussement endeuillés, aient été hués à l'aéroport par une population locale écœurée et choquée.(2)
Le prolétariat est une classe d'immigrés
A l'image de ces immigrés, tous les prolétaires sont en réalité des "déracinés". Dès les origines du capitalisme, ils ont été arrachés de force au monde de la terre et de l'artisanat. Alors que durant le Moyen-Âge la main d’œuvre exploitée restait fixée au sol, elle subit un violent exode rural par les forces naissantes du capital. "La création du prolétariat sans feu ni lieu – licenciés des grands seigneurs féodaux et cultivateurs victimes d'expropriations violentes et répétées – allait nécessairement plus vite que son absorption par les manufactures naissantes (…). La législation les traita en criminels volontaires ; elle supposa qu'il dépendait de leur libre arbitre de continuer à travailler comme par le passé et comme s'il n'était survenu aucun changement dans leur condition".(3). Historiquement, le développement du capitalisme dépend du libre accès à la force de travail. Il génère donc des déplacements multiples et des courants migratoires sans précédent pour extraire la plus-value. C'est d’ailleurs en grande partie par l'unité de cette nouvelle condition des exploités que le mouvement ouvrier a toujours considéré que "les prolétaires n'ont pas de patrie" !
Sans la traite négrière des XVIIe et XVIIIe siècles en Afrique, le développement du capitalisme n'aurait pu prospérer aussi rapidement à partir des centres industriels et surtout de l'essor des grands ports négriers que furent Liverpool, Londres, Bristol, Zélande, Nantes ou Bordeaux. Au cours du XIXe siècle et suite aux "bienfaits" d'une main-d’œuvre noire "libérée" par le salariat, accompagnant l'accumulation capitaliste, d'autres facteurs économiques ont accéléré par la suite des exodes ruraux et favorisé des migrations massives d'une autre ampleur, notamment vers le nouveau continent. Rien que pour la période allant du XIXe siècle à 1914, 50 à 60 millions d'Européens se sont dirigés vers les États-Unis pour trouver du travail. Au début du XXe siècle, près d'un million de migrants se rendent chaque année aux Etats-Unis. Rien que pour la seule Italie, entre 1901 et 1913, près de 8 millions de personnes ont été des migrants. Les pressions économiques qui ont été à l’œuvre, lors de sa phase ascendante, permettaient alors au système capitaliste d'absorber les travailleurs toujours plus nombreux dont il avait besoin pour son expansion vigoureuse.
Avec le capitalisme décadent, 'État transformé en bunker
Avec le déclin historique du système, les déplacements des populations et les migrations n'ont jamais cessé. Bien au contraire! Les guerres impérialistes, notamment les deux conflits mondiaux, la crise économique, engendrant la paupérisation et les catastrophes liées aux changements climatiques, poussent toujours davantage aux migrations. En 2010, les immigrés dans le monde étaient estimés à 214 millions (3,1% de la population mondiale(4)). Du seul fait des changements climatiques, certaines projections estiment pour 2050 entre 25 millions et 1 milliard le nombre d'immigrés supplémentaires !(5)
En raison de la crise permanente du capital et de la surproduction de marchandises, les immigrés se heurtent désormais aux limites du marché et aux forces brutales toujours plus réglementées des Etats. Le capital ne peut plus intégrer la force de travail et ne peut en grande partie que la refouler! Ainsi, après la période d'ouverture des Etats-Unis avant la Première Guerre mondiale, la mise en place d'un système de "quotas" a verrouillé et filtré drastiquement les entrées sur le territoire pour finir par la construction d'une véritable muraille à la frontière mexicaine, dont les chicanos, après l'ère tragique des boat-people venus d'Asie, font maintenant eux aussi les frais. La crise économique ouverte à partir des années 1960-70 a conduit tous les gouvernements, notamment d’Europe, à élaborer un quadrillage plus musclé au sud de la Méditerranée, utilisant une armada de navires et des patrouilles pour repousser les migrants. L’objectif non avoué de la classe dominante est clair: "que les migrants crèvent chez eux!". Pour cela, les démocrates zélés d'Europe, notamment en France, n'ont pas hésité jusqu’à ces dernières années à recourir aux services musclés de feu Kadhafi en Libye, ou des autorités marocaines sur le continent, laissant par exemple crever dans le désert ceux qui voulaient s'échapper de l'enfer.
Ces politiques de "contrôles" aux frontières, qui n'ont cessé de se durcir, sont bien des produits de la décadence et du capitalisme d'Etat. Elles ne sont pas nouvelles. En France, par exemple: "la création d'une carte d'identité est en 1917 un véritable bouleversement des habitudes administratives et policières. Nos mentalités d'aujourd'hui ont intégré cet estampillage individuel dont les origines policières ne sont plus perçues comme telles. Il n’est pourtant pas neutre que l'institution de la carte d'identité ait d'abord concerné les étrangers dans un but de surveillance, et ce en plein état de guerre."(6)
Aujourd’hui, la paranoïa des Etats atteint des sommets face aux étrangers qui ont toujours été suspectés de "troubler l'ordre public". Les murs gigantesques de béton et de métal aux frontières(7), ornés de barbelés ou électrifiés, ne sont pas sans rappeler les périmètres grillagés des sinistres camps de la mort de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les Etats européens avaient fêté la chute du "mur de la honte" à Berlin, au nom de la "liberté", s'offusquant à bon compte de ce symbole barbare matérialisant "le rideau de fer", ils se doivent maintenant de masquer, plus que jamais, qu'ils sont eux mêmes d'hypocrites bâtisseurs de murs!
Le sort tragique des immigrés
La décadence du capitalisme est devenue la période des grands déplacements qu'il faut "maîtriser", l'ère des déportés, des camps de concentration et aussi de réfugiés (le nombre de réfugiés palestiniens est passé de 700.000 en 1950 à 4,8 millions en 2005!). Le génocide des Arméniens en 1915 a conduit à un des premiers grands mouvements de masse de réfugiés au XXe siècle. Entre 1944 et 1951, près de 20 millions de personnes ont été déplacées ou évacuées en Europe. La partition d'Etats et les divisions ont poussé à des déplacements massifs de populations. Si le "rideau de fer" allait mettre un frein à l'exode des pays de l'Est, une main-d’œuvre à bas prix disponible conduisait les pays européens à puiser vers le sud de la Méditerranée et l'Afrique. Les prétendues "luttes de libération nationales", issues de la crise et de l'impérialisme durant et après la guerre froide, allaient contribuer à alimenter la détresse et les déplacements de paysans ruinés, venant grossir des mégalopoles hypertrophiées, notamment des pays périphériques, multipliant ainsi les bidonvilles, faisant exploser les trafics en tout genre aux mains des mafias, de la drogue à la prostitution, en passant par la vente des armes. Partout, avec les fléaux du XXe et XXIe siècles, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, les camps de réfugiés permanents ont poussé comme des champignons, parquant des masses toujours plus nombreuses (Palestiniens, Africains...) dans des conditions d'extrême précarité, voire de simple survie, en proie aux maladies, à la famine et aux mafias.
L'explosion du travail "illégal"
Depuis la chute du mur de Berlin et l’effondrement du bloc de l'Est, deux événements majeurs sont intervenus, en plus des conflits croissants, pour peser sur le marché mondial du travail et jouer sur les flux migratoires:
-l'approfondissement de la crise économique, notamment dans les pays centraux;
-l'émergence de la Chine.
Dans un premier temps, les travailleurs des pays de l'Est sont venus vers l'Ouest, notamment en Allemagne, ce qui s'est accompagné en même temps des premières délocalisations et d'une forte pression sur les salaires. Puis, les régimes qui jusqu'ici étaient restés plus en marge du marché mondial, comme l'Inde et la Chine, ont ouvert la possibilité de déraciner des millions de travailleurs venus des campagnes, amplifiant de façon pléthorique une armée de réserve constituée de chômeurs corvéables à merci. La faiblesse extrême de leurs salaires, dans un marché saturé, permettait de nouvelles pressions sur les coûts de la force de travail, entraînant de nouvelles délocalisations. C'est ce qui explique que dans les pays centraux, depuis les années 1990, le nombre de travailleurs illégaux et clandestins a explosé dans certains secteurs, en dépit du renforcement des contrôles, afin de permettre une baisse des coûts de la production et de la force de travail. En 2000, il y avait environ 5 millions de clandestins en Europe, 12 millions au États-Unis et 20 millions en Inde! La plupart des Etats centraux qui pillent les "cerveaux", filtrent par ailleurs une main-d’œuvre fragilisée, sans papiers ni qualification, prête à tout pour se vendre et survivre. Désormais, dans de nombreux secteurs, sous l'impulsion bienveillante de l'Etat, s'organise ainsi tout un marché parallèle et clandestin du travail, provoquant un afflux de migrants et de réfugiés, soumis au chantage, dont on subtilise les papiers et qu'on isole dans des abris de fortune. Il en résulte que l'essentiel des récoltes de l'agriculture sont maintenant le fait de travailleurs étrangers souvent dans l'illégalité. En Italie, 65 % de la main-d’œuvre agricole est illégale! Après la chute du mur de Berlin, 2 millions de Roumains ont émigré dans les régions du sud de l'Europe pour les travaux agricoles. En Espagne, le "boom" d'avant la faillite dans le secteur immobilier s'est en grande partie édifié avec la sueur de clandestins sous-payés, notamment venus d'Amérique latine (Équateur, Pérou, Bolivie, etc.). A cela, il faut ajouter les zones "grises" de l'activité, comme la prostitution. En 2003, dans un pays comme la Moldavie, 30% des femmes âgées de 18 à 25 ans ont disparu! La même année, 500.000 prostituées venues des pays de l'Est étaient au travail en Europe de l'Ouest. En Asie et dans les monarchies du Golfe, on observe les mêmes phénomènes pour des emplois de domestiques ou pour des travaux dans le bâtiment. Dans un pays comme le Qatar, les immigrés représentent 86 % de la population! De jeunes chinoises ou philippines sont formées pour se rendre à Hong-Kong ou en Arabie Saoudite, dans des conditions proches de l'esclavage.
Aujourd'hui, avec le développement des tensions guerrières, il faudra s’attendre à un afflux majeur de population et de ce type de travailleurs, notamment venant d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient.
Le combat du prolétariat
Face à la barbarie qui se déchaîne, au flicage contre les immigrés et face aux campagnes xénophobes qu'une partie de la bourgeoise cherche à diffuser par ses messages populistes, le prolétariat ne peut qu'opposer sa propre indignation et sa solidarité de classe internationale. Pour cela, il convient bien entendu de rejeter le discours officiel qui cherche à générer des réflexes anxiogènes, à faire des immigrés et de "l'étranger" les responsables de la crise et du chômage.
Après avoir polarisé l'attention sur le "péril jaune", les dangers de "l'invasion", les médias et politiciens de tout poil jouent sur les peurs évoquant toujours en arrière-plan les questions de "la délinquance" et des "troubles à l'ordre public". Ils ne cessent de nous bourrer le crâne en stigmatisant "les étrangers", les "illégaux" qui exercent une "concurrence déloyale" et "plombent les droits sociaux"... Cela, alors qu’en réalité, ils sont les premières et principales victimes du système! Une telle tactique grossière et nauséabonde, ignoble, a toujours été utilisée pour diviser les prolétaires entre eux. Mais le piège le plus sournois à éviter est surtout celui du "bon sens" et de la pseudo-générosité des organisations gauchistes ou "humanitaires" qui font des immigrés un "fait de société" l’objet d’une "politique particulière", qu'il faudrait traiter "à part", comme telle au regard du droit bourgeois.
Aujourd'hui, alors que les usines ferment à tour de bras, alors que les carnets de commandes sont en berne malgré l'annonce de la "reprise", il devient évident que tous les prolétaires sont frappés par la crise et la pauvreté croissante, immigrés ou pas. Quel sens peut avoir l'idée d'une concurrence des travailleurs clandestins alors que l’activité disparaît?
Face à toutes les offensives idéologiques et à la politique de répression, le prolétariat se doit de réaffirmer sa perspective historique. Il doit commencer, pour cela, par exprimer sa solidarité, reconnaître la force révolutionnaire qu'il représente dans la société. Lui seul en effet sera capable de réaffirmer, par la lutte, que "les prolétaires n'ont pas de patrie!"
WH /21.10.2013
(1)Plus durement encore que ceux qui ont cherché à assister les migrants à Sangatte, du fait des lois Bossi-Fini, des capitaines de pêche qui ont déjà porté secours à des boat-people ont été poursuivis pour "aide à l'entrée irrégulière sur le territoire" !
(2)Aux côtés du Premier ministre italien A. Alfano, on notait la présence de M. Barroso président de la Commission européenne et de C. Malmström chargée des affaires intérieures, venus surtout pour souligner qu'ils soutiennent, au nom de "l'humanitaire", un durcissement supplémentaire de la surveillance des frontières par le dispositif "frontex".
(3)K. Marx, Le capital, livre I, chap. XXVIII.
(4)Source : INED
(5)133 catastrophes naturelles ont été enregistrées en 1980. Le nombre est passé à plus de 350 par an ces dernières années. Voir le site : https://www.unhcr.org
(6)P-J Deschott, F. Huguenin, La république xénophobe ; JC Lattès, 2001.
(7)Au sud de l'Europe (Ceuta, Melilla), à la frontière mexicaine au sud des Etats-Unis, en Israël face aux Palestiniens, en Afrique du Sud face au reste du continent où les autorités de Gaborone sont en train de construire un mur électrifié de 2,40 m de haut sur 500 km de longueur.
Journée de discussion été 2013: la perspective est-elle similaire à celle des années 1930?
- 1061 lectures
Fin Août 2013, le CCI a organisé une journée de rencontre et de discussion sur la question de savoir si nous sommes confrontés à un retour dans les années 1930. Qu’est-ce qu’il y a de commun entre les deux périodes, qu’est-ce qui les distingue précisément et surtout, pourquoi?
L’initiative fut motivée par les nombreuses discussions qui ont eu lieu sur ce sujet depuis la dépression économique de 2008. En effet, il y a des raisons de penser que nous sommes de retour dans les années 1930 car il est indéniable que nous sommes confrontés actuellement avec :
la crise la plus profonde de l’histoire du capitalisme depuis les années 1930;
une attaque généralisée sans précédent sur les salaires, l’emploi, les retraites et autres allocations, attaque surtout visible en Grèce, Espagne et Portugal;
des difficultés, voire la faillite des banques, dans le contexte de la menace constante d’un effondrement imminent de l’ensemble du système financier;
le développement de guerres barbares telles celles en Afrique Centrale, Mali, Libye, Syrie, … et de tensions impérialistes dans de nombreuses régions du monde ;
un raffermissement des campagnes idéologiques telles que celles de l’extrême droite et du populisme principalement basées sur le nationalisme, le régionalisme et la haine raciste;
un niveau de lutte dans les pays centraux y compris les Pays-Bas et la Belgique, mais surtout en Grande-Bretagne et en Allemagne, qui connait un sérieux déclin après l’éteinte des mouvements des Indignés et Occupy.
Mais est-ce que cela signifie que nous devons suivre les campagnes de défense de la démocratie bourgeoise, de toutes sortes de groupes gauchistes comme le PSL ou les Socialistes Internationaux (Pays-Bas) qui, lors de leurs "festivals" en 2013, ont mis centralement en avant la "lutte contre la dangereuse montée de l'extrême-droite et du nationalisme en Europe et la lutte antifasciste"?
Un certain nombre de groupes et d'individus qui se situent dans leur recherche entre les perspectives bourgeoises et prolétariennes, pensent également que nous sommes face à une situation qui est comparable à celle des années 1930:
"Je vois de grandes similitudes avec la crise des années trente du siècle dernier (....) Il ne s'agit pas de dérives du capitalisme, mais des caractéristiques propres au système d’une politique économique et de l’idéologie d’un type de société. Avec l'effondrement des pays de l’ex bloc soviétique stalinien, le capitalisme a pu prolonger quelque peu sa crédibilité idéologique " (De As169/170, 2010)
"L'éternel retour du fascisme en temps de crise. Pourquoi le fascisme réapparait chaque fois en temps de crise? Débat sur "Le fascisme ne se mange pas" (Basta!, KSU, 10/10/2013).
"Depuis 2008, la population d'Europe se trouve dans une crise sans précédent. Dans de nombreux pays européens, la population s’appauvrit rapidement. Aussi, dans notre pays, la crise a frappé: licenciements massifs entre autre dans les secteurs du bâtiment et des soins, listes d'attente pour les restaurants du cœur, chômage élevé surtout chez les jeunes, personnes âgées qui ne reçoivent plus d'aide à domicile, expulsions à cause des loyers trop chers, études qui ne seront bientôt réservées qu’aux riches, fonctionnaires dont les salaires depuis des années sont gelés. Pour toute cette misère, un bouc émissaire doit être trouvé. (...) L'histoire nous apprend que le racisme progresse avec l’augmentation de la pauvreté (....) Une comparaison avec les années ‘30 du siècle passé s’impose. La haine des Juifs était à l’époque aussi alimentée par la crise. "(Plate-forme Stop Racisme et l'exclusion, Septembre 2013)
"Tout cela au sein d’un climat politique et économique de chômage de masse qui, entre-temps, a dépassé le niveau des années trente et représente la forme " suprême et la plus barbare " d’une réduction du temps de travail imposée par le capital". (Une réduction du temps de travail au profit du capital; études marxiste n ° 101)
Certains participants du cercle de discussion Spartacus (Anvers) et du AAUG (Utrecht) qui ont participé à la journée de discussion, partageaient aussi certaines de ces visions.
Bien que la situation actuelle, en effet, montre certaines analogies avec celles des années 1930, elle n'est toutefois pas la même. Pour en comprendre la différence, le CCI a mis en avant le concept du cours historique, concept hérité d’un de ses plus importants prédécesseurs : Bilan (1). Selon le CCI, c’est le meilleur instrument pour trouver une réponse adéquate à la question de savoir si nous sommes confrontés à un retour dans les années 1930 et pour cette raison, il a été central dans l'introduction.
Dans la discussion, l’accent a été fortement mis sur la fonction du fascisme dans les années ’30 et aujourd'hui et s’il existe bien un lien mécanique entre l’approfondissement de la crise économique et la venue au pouvoir de l’extrême-droite. Ceci a été examiné en relation avec une classe ouvrière qui aujourd’hui, contrairement aux années 1930, n’est mondialement pas battue, ni physiquement, ni politiquement.
L’introduction: le concept du cours historique
L’approche du CCI de la question du cours historique est basée sur la méthode de Bilan, dont les activités politiques dans les années 1930 ont été engagées à la suite d'une reconnaissance du fait que la défaite de la vague révolutionnaire de 1917 à 1923 et le début de la crise de 1929 avaient ouvert un cours vers la guerre impérialiste. Tout comme Bilan, le CCI défend la tâche cruciale et fondamentale des révolutionnaires qui est de donner des orientations générales au développement social pour une période déterminée. Le capitalisme n’est pas "une fatalité économique objective" mais un rapport social. Ce rapport détermine globalement la politique de la bourgeoisie. Précisément, parce que les facteurs subjectifs (la conscience) ne sont pas immédiatement et mécaniquement déterminés par les conditions objectives (entre autre la situation économique) qu’il est tellement important d’analyser la situation à partir de ce concept.
Est-ce que nous revivons les années 1930, est-ce qu’une guerre généralisée s’annonce ou est-ce qu’une perspective révolutionnaire est devant nous? Ce sont des questions de grande importance. La pensée révolutionnaire dynamique n'est pas satisfaite avec "un peu de ceci et un peu de cela" tout mélangé dans une sauce sociologique qui ne donne aucune orientation à la lutte de classe. Si le marxisme nous livre simplement une analyse du passé et s’il faut se contenter du "ok, on verra bien…", il est alors de peu d’utilité. L'action sociale, la lutte des classes, nécessitent une compréhension approfondie des forces élémentaires qui sont impliquées et appellent à une compréhension de la perspective. L’action du prolétariat varie en fonction de sa conscience de la réalité sociale et du rapport de force du moment entre le prolétariat et la bourgeoisie. Ceci s’applique aussi aux possibilités d’intervention des révolutionnaires dans la classe de façon organisée. Le développement de la conscience de classe est différent, non pas sur le plan de son contenu fondamental mais bien dans son expression en fonction de la réponse à la question : est-ce que nous allons vers la guerre ou vers une confrontation révolutionnaire ?
Cet instrument du cours historique est pour les révolutionnaires d’un intérêt essentiel parce qu’il leur permet, contre toutes les autres interprétations, d’affirmer qu’actuellement en aucun cas on se retrouve dans les années 1930.
La discussion: sur les ressemblances et les différences avec les années trente
Cette année également, il y avait un noyau enthousiaste prêt à engager le débat. La plupart d’entre eux venait de l’expérience du mouvement Occupy ou d’un groupe de discussion, désireux d’échanger leurs points de vue et de les confronter à la vision du CCI.
Dans un premier tour, ont été principalement soulevées les nombreuses caractéristiques les plus frappantes de la période en cours, indiquant que chez un bon nombre, il existe bel et bien une sorte de crainte d’une répétition des années 30. Ont été citées: la gravité de la crise économique -dont plusieurs participants en demandaient la cause profonde- les conséquences désastreuses sur un plan écologique et la course massive à l’armement entre autre en Chine, Pakistan, Inde et Russie. En même temps, de nouveaux foyers de tension éclatent à répétition comme au Mali et en Syrie. La question a également été posée de savoir si l'Europe est de plus en plus centralisée et prend un tournant vers la droite. Comment comprendre la montée de Aube Dorée (Grèce) et de Le Pen (France)? Faut-il appeler aujourd'hui à la lutte contre le danger fasciste? Enfin, ont été soulevées la faiblesse et les divisions des réactions. Comment devons-nous comprendre ces faits?
D'autres questions ont été:
Est-ce important de réfléchir sur l'évaluation de la période historique?
Les questions que nous posons sont-elles utiles pour nos activités actuelles? Nous fournissent-elles une perspective?
Peut-on faire un appel aujourd'hui à développer un nouveau mouvement des Indignés ou Occupy?
Était-il sage de faire un appel à la révolution dans les années 1930 et à la création d'une 4ème internationale, comme Trotski l'a fait (2)?
Par manque de temps, plusieurs questions n'ont pas pu être creusées dans cette discussion.
Trois thèmes ont été au centre des réponses:
a. la dynamique de l’économie et la crise historique du capitalisme;
Dans de la discussion, il était clair pour la plupart des participants que la nécessité pour le capitalisme d'accumuler et de croître se fait au détriment des besoins sociaux et de l'environnement. Il a été dit "cette croissance doit cesser!". À cela, a été répondu que la production n’est pas vue pour répondre aux besoins de l'humanité mais pour engendrer du profit. Les marchandises ne constituent seulement qu'une étape intermédiaire entre un capital initial et un capital final supérieur. C'est l'essence même du capitalisme. Cela ne prendra fin que lorsque la classe ouvrière ne voudra plus rester le sujet de l'exploitation et de l'oppression, mais prendra en charge son rôle de porteuse d'une société future qui sera basée sur une production pour la satisfaction des besoins humains.
b. Le cours historique et le rôle de l'extrême-droite:
Dans le deuxième volet de la discussion, on est revenu encore une fois sur l'introduction et le CCI a appelé à prendre un certain recul. Pour comparer deux périodes historiques, on ne peut pas se limiter à prendre quelques éléments de l'une ou de l'autre période, aussi importantes qu'elles soient - comme la crise, la montée de l'extrême droite, un certain succès des thèmes xénophobes et racistes etc. Nous devons replacer ces éléments dans le contexte de la dynamique de la société et donc aussi du rapport de force entre la bourgeoisie et le prolétariat.
Dans les années 1930, l'accession au pouvoir des régimes fascistes a été soutenue par de larges fractions nationales de la classe dominante, en particulier par les grands groupes industriels. En Allemagne, ce furent Krupp, Siemens, Thyssen, Messerschmitt, IG Farben. Ils se sont regroupés en cartels (Konzerns), des fusions de capital financier et industriel, qui contrôlèrent les secteurs clés de l‘économie de guerre. En Italie, les fascistes ont aussi été subventionnés par les grands patrons italiens comme Fiat, Ansaldo, Edison, très vite suivis par l‘ensemble des milieux industriels et financiers centralisés au sein de la Confinindustria ou de l‘Association bancaire. Si besoin était, le programme fasciste était adapté aux besoins du capital national et les fractions indésirables éliminées. L‘émergence des régimes fascistes a correspondu aux besoins du capitalisme: il fallait concentrer tous les pouvoirs au sein de l‘État, accélérer la mise en place de l'économie de guerre et de la militarisation du travail, en particulier dans les pays contraints pour survivre de se lancer dans la préparation d’une nouvelle guerre mondiale pour redistribuer les parts du gâteau impérialiste.
Aujourd'hui, au contraire, les "programmes économiques" des partis d’extrême-droite ou populistes sont soit inexistants, soit inapplicables du point de vue des intérêts de la bourgeoisie. En termes impérialistes aussi, ils n'offrent aucune alternative. Et surtout, l'autre condition majeure et essentielle pour la mise en place du fascisme n’est pas remplie: la défaite physique et politique préalable du prolétariat. Malgré ses difficultés à s'affirmer sur un terrain de classe, le prolétariat n'est pas battu et n'a pas connu de défaite décisive. Nous ne vivons pas dans un cours contre-révolutionnaire.
Pour ces raisons, le danger du retour imminent des régimes fascistes, agité comme un épouvantail, est inexistant. C'est pourquoi, La bourgeoisie actuelle utilise le soi-disant danger fasciste pour mobiliser la classe ouvrière sur un faux terrain derrière la défense de la démocratie bourgeoise, derrière l'Etat bourgeois.
c. Qui détient l’initiative? Qui détermine le cours? Quelle alternative?
Nous sommes donc arrivés à la question: la classe ouvrière reste-t-elle toujours un sujet révolutionnaire? Le CCI soutient que c’est précisément parce que beaucoup ne reconnaissent plus ou pas encore que la classe ouvrière est le sujet révolutionnaire, la force qui donnera une direction au soulèvement révolutionnaire contre le capitalisme, qu’il y a une sous-estimation ou une méconnaissance du concept du cours historique pour analyser la situation mondiale.
La "panique" est une mauvaise conseillère, car s'il est vrai que la classe ouvrière est un tant soit peu déboussolée et divisée, la cause n'est pas tant le fait qu'elle serait hétérogène, mais qu'elle a reçu un coup de massue par les campagnes répétitives pendant des dizaines d’années sur la "mort du communisme".
Le mensonge que le stalinisme est égal au communisme a eu un effet dévastateur tant sur la combativité que sur la perspective de la lutte prolétarienne. Le CCI a soutenu qu’il est de la plus haute importance de définir la classe ouvrière non seulement en terme sociologique, mais aussi politiquement et historiquement. Construire un rapport de force vis-à-vis de la classe dirigeante est une question hautement politique. La responsabilité des minorités politiques dans la classe est alors d’aider à développer la conscience de classe, le levier pour la construction d'une véritable alternative. Un accord général s’est dessiné sur le fait qu’il est de notre devoir de briser le mythe qu’il n’y aurait pas "d’alternative". Plusieurs participants ont déjà vu cette quête d'alternatives lors des mouvements des Indignés et d’Occupy. Ils en voient également la preuve dans l'émergence de cercles de discussion et de groupes d'étude autour du "Capital" de Marx, mais aussi dans le fait de l’émergence ici et là" d’idées utopiques" en réponse à la " realpolitik ".(3)
Le concept théorique du cours historique est un outil indispensable pour analyser la période actuelle. À une époque de prise de conscience que la lutte sera longue, une telle réflexion et un approfondissement théorique constituent une dimension qui préparera la lutte future. Cela nous renforce à mieux résister à l’activisme aveugle et à court terme, qui d’un sentiment euphorique nous plonge immédiatement dans le découragement et le désespoir dès que les mouvements de protestation reculent temporairement.
Le développement de cette compréhension nous donne plus de force et de détermination lors de notre participation dans la lutte. De pair avec le développement de la solidarité dans la lutte, c’est un facteur important dans la reconquête de l’identité de classe et donc d’un développement de la lutte sur un terrain de classe. Et à partir de là, peut se développer une confiance en soi d’une classe qui porte le projet historique pour toute l’humanité.
Le fait qu’un débat enthousiaste a pu se développer sur tous ces sujets avec les participants, essentiellement des jeunes, même si aujourd'hui ils sont encore une petite minorité, nous permet de définir cette initiative comme réussie.
Une table de lecture extensive sur le sujet et aussi autour des positions du CCI en général a fourni suffisamment de matières aux participants pour poursuivre la discussion.
Zyart / Lac, 09.02.2014
(1) "Bilan" est la revue de la fraction de gauche du Parti communiste d'Italie, qui est apparue entre 1933 et 1938. Elle est apparue après qu’au cours des années 1920, plusieurs camarades ont fui le fascisme italien et que le parti de Bordiga (et ses camarades) comme l'un des derniers a été expulsé de l'Internationale communiste en 1926.
(2) Toutes les analyses de la situation internationale qu'a faites Bilan - que ce soient celles des luttes nationales de la périphérie, du développement de la puissance allemande en Europe, du Front populaire en France, de l'intégration de l'URSS sur l'échiquier impérialiste ou de la soi disant révolution espagnole - se fondaient sur la reconnaissance du fait que le rapport de forces avait nettement évolué en défaveur du prolétariat et que la bourgeoisie dégageait la voie pour un autre massacre impérialiste. A l’encontre de la vision de Trotski, volontariste et idéaliste, qui voyait le moment propice pour créer une 4ième internationale. Les efforts pour réunir une organisation de masse dans une telle période ne pouvaient qu’aboutir à l’opportunisme.
(3) Lire l'article dans ce journal qui développe la question.
Rubrique:
L'utopie ne mène pas à la lutte: la recherche de la vérité offre une perspective
- 940 lectures
Ces dernières années, de plus en plus nombreuses sont les voix qui s’élèvent pour mettre en avant des revendications encore plus radicales et rechercher une solution pour une transformation plus fondamentale de la société. Les mouvements de lutte de ces dernières années (Occupy, Indignés, etc.) ont mis en évidence que des revendications partielles en tant que telles, des revendications sur des terrains particuliers de la société, bien qu’elles peuvent constituer un point de départ pour la lutte, sans suite et sans extension dans et par la lutte, se brisent tôt ou tard. Un texte signé Sander du KSU (1), tente de formuler une réponse à cette question.
“Viser les réformes semble, à première vue, plus réaliste, mais il vaut la peine de lutter pour une société qui est entièrement comme tu l’imagines. En revendiquant des réformes, on risque d’affaiblir la lutte une fois que les revendications ont été satisfaites. (…) Des causes sous-jacentes (…) sont faciles à reprendre à leur compte par des parties modérées qui ensuite récupèrent la résistance. Quand par contre, on lutte pour une toute autre société (…) alors il est possible sur cette base de davantage développer, parce que le but final dès le début est une société totalement différente et ainsi on peut continuer vers ce qu’on vise véritablement”. (Sander van Lanen; KSU)
Et Sander n’est pas le seul qui constate que poser des "revendications réalistes" ne favorise pas le combat. D’autres voix également font un plaidoyer pour radicaliser les revendications :
“Celui qui soumet l’art aux lois du marché, après tout, abolit la promesse sur l'avenir. Car du véritable art est hors normes, un sens du possible et de l’imagination et c’est là que le changement commence. Aussi l’artiste et les amoureux de la culture doivent, en ce qui concerne la gestion de la culture, oser réfléchir sur un changement radical." (L'imagination au pouvoir! Egalement dans le domaine de la gestion de la culture; 20-09-2013; DeWereldMorgen)
“Les dernières années m’ont appris que beaucoup de gens entre temps savent qu’un changement radical est inévitable. Les crises sociales, écologiques et économiques ne peuvent pas être résolues par un ‘business as usual’. Les conceptions existantes ont mené vers les crises et ne peuvent être employées pour les résoudre. ” (Martijn Jeroen van der Linden, économe d’entreprise, Hoogeveen)
Mais comment mettre en avant des revendications encore plus radicales si on a déjà lutté pour l'abolition du capitalisme? Quelque part désorientés, mais non découragés et battus, les camarades combattifs du KSU se retirent pour soigner leurs blessures et tirer les leçons, à la recherche d'une autre façon d’enfoncer une plus grande brèche dans le mur de l’état capitaliste. Plusieurs articles sont parus sur le site web du KSU, qui essayent de donner un élan à un nouveau concept stratégique pour la lutte à venir.
Toutes sortes de groupes, surtout anarchistes, ont depuis des années pris ces mêmes chemins battus. Le KSU est un des rares groupes dans le milieu politique qui montre encore une vraie vie et garde la capacité de prendre un autre chemin, dans une tentative de sortir de l’impasse dans laquelle il est arrivé, en partie suite à son propre activisme. C’est un regroupement qui existe depuis plusieurs années mais qui n’est pas un groupe d’action classique. Même si rien n'indique que de nombreuses discussions ont lieu au sein du groupe, les participants sont néanmoins intéressés par la théorie. Régulièrement des textes sont publiés, surtout des reprises, qui approfondissent l’un ou l’autre thème.
Le groupe est assez hétérogène, n’a pas de concept idéologique fixe (anarchiste, situationniste, moderniste, etc.)et développe surtout des activités dans le cadre de l’enseignement supérieur et de la science. Même si le noyau est resté pratiquement le même depuis plusieurs années, le groupe attire encore régulièrement des nouveaux, jeunes gens qui, avec des nouvelles idées, ravivent le groupe. Récemment encore par la publication de quelques contributions sur une stratégie utopique, qui pourrait éventuellement redonner une perspective à la lutte anticapitaliste :
Prenons par exemple l’article titré: "Ecotopia ", dans lequel on tend à présenter une alternative utopique d'une société où la nature est au centre, face à la dérive d’une croissance continue et de la consommation infinie, produits logiques du mode de production capitaliste ;
Un deuxième article sur le site, intitulé : " réalité au-dessus des rêves et de l’imagination ? " écrit : " les rêves sur un meilleur monde. Irréaliste! pas pratique! gaspillage de temps! dangereux ! Nous avons oublié la valeur de l’idéalisme. " ;
Dans un troisième article sur le site du KSU, nommé : " la pensée non pratique comme solution pratique ? " on lit : " …des autres font immédiatement le choix du but ultime et avancent des revendications utopiques " (…) " en élargissant le but, plus nombreux seront ceux qui peuvent s’y retrouver (…) cela parait utopique, mais c’est peut-être le façon la plus pratique de s’y prendre ".
Que ces trois articles cités expriment non seulement les besoins d’un groupe quelconque mais répondent aussi à un besoin plus large parmi les couches non exploiteuses, est confirmé par le fait qu’au cours de l’année passée, plusieurs livres sont parus sur le thème de l’utopie :
La nouvelle coopération entre la réalité et l’utopie (Walter Lotens) ;
De la crise vers l’utopie réalisable (Jan Bossuy) ;
La nouvelle démocratie et autres formes de politique (Willem Schinkel).
S’y ajoute d’autres initiatives:
Konfrontatie a consacré un numéro de sa revue pour une grande partie à la question de l’utopie ;
Une série de trois émissions de radio, il y a un an, traitait de l’idée utopiste ;
Dernièrement, a eu lieu une discussion de forum à Leiden sur le même sujet.
L’anticapitalisme donc, ne suffit pas. Cela entretemps, les camarades du KSU l’ont probablement également bien compris. Cela avait, en passant, déjà été souligné lors d’une contribution précédente sur le site du KSU (2). Il doit y avoir également une perspective, une perspective réelle d’une autre société. Celle-ci représente un autre avenir, constitue une attirance qui peut donner une orientation et une inspiration à la lutte actuelle. Selon Willem Schinkel, on aurait justement besoin de plus d’imagination utopique, car cela constitue un moyen de dépasser la "politique d’une simple gestion des problèmes".
Afin de dépasser la nature purement anticapitaliste de la lutte, certains soulignent l'importance des rêves. Parce que la pensée utopique est l'art de rêver d'une alternative. Pour transcender notre réalité, nous devons en effet apprendre à regarder au-delà de l'horizon du capitalisme et donner un contenu à une vision d'un monde alternatif et meilleur. Pour donner une forme dans nos têtes à un tel avenir, nous avons besoin de nous inscrire à un certain idéal, même s’il reste fondé sur une base matérielle. Libéré de la nécessité de rechercher une solution pratique à la misère quotidienne du capitalisme, un espace est libéré pour créer dans nos pensées une représentation idéale.
“L’imagination au pouvoir!”, a été le célèbre slogan de la révolte de mai 1968. Non pas que l'imagination suffise pour réaliser une autre société. Mais l'imagination peut avoir une fonction importante. "Nous devons à nouveau oser rêver. Parce que les rêves d'un monde meilleur, signifie une réflexion critique sur le monde actuel. Car si on réfléchit à des choses qui semblent impossibles, on est en mesure de penser en dehors du cadre, peu importe que notre idée soit oui ou non "réaliste" ("Réalité au-delà des rêves et de l'imagination?")
Le volet culturel de la lutte contre le capitalisme
La lutte contre le capitalisme se compose de trois éléments:
la lutte contre les attaques sur nos conditions matérielles de vie: notre revenu et sur l'éducation, sur la santé, .... ;
la lutte pour le pouvoir politique: le remplacement du système de la propriété privée par la propriété collective ;
la lutte contre l'aliénation, contre le rétrécissement de la conscience, contre l’abrutissement par un mode de vie comme une machine, comme des aspects importants du volet culturel de la lutte.
Ce troisième volet culturel de la lutte se caractérise par des caractéristiques fondamentales de l’homme, telles que l'engagement moral (la voix de l'intérieur) et les sentiments artistiques (le sens de la beauté), mais aussi par des aspects tels que l'imagination, la créativité, l'intuition. "L'imagination a tout;. Elle décide de la beauté, de la justice et du bonheur, qui signifient tout dans le monde" (Blaise Pacal) La lutte "pour le socialisme n'est pas seulement une question de pain et de beurre, mais un mouvement culturel ... ". (Rosa Luxemburg)
Dans les yeux de Henriette Roland Holst la lutte obtient toute son importance seulement quand la raison et l'intuition coulent conjointement. Il s’agissait pour elle d '"écouter la voix intérieure", où "la véracité et l’empathie sont les deux principales puissances psychiques “. Selon Henriette Roland Holst, le monde n’est pas connu dans son intégralité que par la raison. L’intuition, le sentiment, la perception et leur synthèse dans l’imagination sont les autres composants indispensables. (“Le communisme et la Morale")
"En élargissant l’objectif, plus de gens se reconnaîtront dans le but (....) Cela parait utopique ...” . En fait, dans la période actuelle, l’établissement d'une utopie dans le cadre de la lutte revendicative n'a jamais conduit à une forme de mobilisation générale des travailleurs, des étudiants, des chômeurs. La revendication "utopique": un revenu de base pour tous, qui depuis plusieurs décennies est mis en avant par les gauchistes, mène à l'opposé de l'unification dans la lutte. La revendication comparable de "gratuité de l’enseignement", qu’entre autre le KSU récemment avait mis en avant comme une revendication "utopique", n’a pas fonctionné. C’est parce que l’"utopie" ne se définit pas au niveau de la lutte matérielle, mais est une expression typique de la lutte "spirituelle".
Bien sûr, la lutte pour la défense des conditions matérielles de vie est et reste dans les circonstances actuelles, la première préoccupation dans la lutte de la classe. Parce que sans un minimum vital, la vie de toute façon n’est pas digne d’être vécue. Cependant la lutte contre le capitalisme et son idéologie étroite ne s’arrête pas là. Car la poursuite d’une véritable conscience, de la vérité, est motivée non seulement par des intérêts matériels, comme un revenu décent pour tous, mais aussi par l’idée d’une sorte d’ "idéal".
"Nous avons oublié la valeur de l'idéalisme." Non ! Mais sans nous considérer comme des idéalistes, la valeur la plus élevée de la lutte pour une autre société finalement ne se trouve pas sur le plan matériel, mais sur le plan de la conscience, de la lutte spirituelle. Et nous ne pouvons l'utiliser que si nous comprenons que l'idée créative en constitue un élément indispensable. Dépasser dans la tête – la représentation idéale donc - des limites du système actuel n'est pas possible sans faire appel à l'inspiration de l'imagination. Des structures idéales dans nos esprits sont capables de faire monter à la surface une force intérieure profonde, qui peut fournir un stimulus majeur à la lutte.
Il doit être clair qu’il serait myope de nous limiter aux sources d’inspiration, développées par les utopistes socialistes ci-dessus et Kropotkine. Nous devons considérer dans un contexte plus large la valeur de l’imagination, la pensée créative qui tout au long de l’histoire de l’humanité a toujours été une force majeure dans son progrès. En effet, les gens vivent également dans un monde d’idées et d’idéaux, dont la poursuite à certains moments peut être plus puissante que l’instinct de préserver le niveau des conditions matérielles immédiates. Ainsi, les révolutionnaires sociaux-démocrates en 1905, lors de la montée révolutionnaire en Russie, par exemple, ont été "surpris, rattrapés et dépassés par la turbulence du mouvement, ses nouvelles formes d’apparence, son imagination créatrice ....".
Un exemple d'un effort, conduit par l'imagination et l'inspiration, est la vie de Léon Tolstoï. La source de sa force venait des profondeurs de sa grande personnalité qui lui a donné le courage de rechercher sans préjudice la vérité. Comme a écrit Rosa Luxembourg dans le Leipziger Volkszeitung (1908) "tout au long de sa vie et de son œuvre, c’était en même temps une contemplation agitée de la vérité dans la vie humaine.” Il était un chercheur et un combattant, mais était loin d’être un socialiste révolutionnaire. "Avec son art, il a embrassé toute la passion humaine, toutes les faiblesses et les humeurs" qui lui ont permis, jusqu'à son dernier souffle, de lutter pour faire face aux problèmes sociaux les yeux ouverts.
Zyart / 15.01.2014
(1)KSU : Kritische Studenten Utrecht (Etudiants Critiques d’Utrecht)
(2)“Purement anticapitaliste? Peut-être nous ne le sommes pas tous”
Rubrique:
Internationalisme - 2015
- 947 lectures
Internationalisme n° 362 - 1er trimestre 2015
- 1186 lectures
Manifestations et grèves en Belgique: les actions syndicales ne mènent qu’au découragement et au désespoir
- 1715 lectures
De la gare du Nord au Midi, les rues étaient remplies de couleurs rouge, verte et bleue. Une masse hétéroclite d’environ 120.000 personnes provenant de toutes les régions, dépassant les clivages linguistiques, marchait derrière les banderoles du « front commun » des syndicats socialistes, chrétiens et libéraux. C’était comme si ce jeudi 6 novembre 2014, Bruxelles, le centre de l’Europe capitaliste, s’était transformée en une ville des « syndicats ouvriers ». Et ce n’était que le début d’une longue série d’actions, 3 journées de grèves « provinciales » et une journée de « grève nationale », échelonnées de la mi-novembre jusqu’à la mi-décembre, toutes orientées contre les mesures d’austérité de la coalition « suédoise » des partis de droite (le bleu des partis libéraux flamand et francophone, le jaune des sociaux-chrétiens et des nationalistes flamands).
Le manifestation syndicale massive du 6 novembre est particulièrement révélatrice des objectifs que se donnaient les syndicats. D’une part, elle se termina par des incidents relativement violents entre quelques centaines de « casseurs » et les forces de l’ordre, qui furent largement étalés et dénoncés dans les médias. Mais d’autre part, ces mêmes médias bourgeois caractérisaient explicitement le rassemblement comme la réunion de masse la plus impressionnante depuis la manifestation ouvrière massive du 31 mai 1986 qui avait réuni près de 200.000 travailleurs. Comment interpréter cette double campagne médiatique sur la «guerre dans les rues de Bruxelles» mais aussi sur la «plus importante mobilisation ouvrière depuis 1986»? Quels objectifs réels étaient visés par ces actions syndicales? Voilà les questions auxquelles cet article veut tenter de répondre.
Un contexte comparable à 1986?
La comparaison de la manif du 6 novembre avec celle de 1986 est bancale autant sur le plan des caractéristiques du mouvement que du contexte dans lequel elle a lieu:
- la combativité et la détermination des travailleurs ne sont en rien comparables dans les deux événements.
La manifestation du 31 mai 1986 était le produit de luttes acharnées, déclenchées et souvent organisées par les travailleurs mêmes. Car, ce n’était pas les syndicats ou les gauchistes, mais «les ouvriers mêmes qui ont envoyé des délégations massives vers d'autres entreprises (mineurs, cheminots, STIB...). On a vu aussi des tentatives importantes de disputer aux syndicats le contrôle de la lutte et de le garder entre les mains des grévistes, comme par exemple avec la coordination d'enseignants en grève du "Malibran" à Bruxelles» (Internationalisme N° 117). La recherche de l’unité était aussi fort présente parmi les travailleurs en lutte: «Ainsi se concrétise la volonté d'utiliser la rue comme lieu propice où peut se souder l'unité dans la lutte, actifs et chômeurs réunis. Hormis la manifestation du 31/5, pendant des semaines on a vu toute une série de rassemblements massifs dans les grandes villes industrielles, et ce malgré le travail incessant des syndicats pour maintenir les ouvriers isolés.» (Internationalisme N° 111). Ce n’est que progressivement et avec difficulté que les syndicats réussiront à reprendre le contrôle de la lutte et, en exploitant la faiblesse du mouvement quant à sa perspective historique, la dimension politique et culturelle du combat et aussi en profitant de la démobilisation due aux vacances d’été, à l’entrainer vers la démobilisation.
Contrairement à la manifestation massive en 1986, la combativité dans la manifestation récente à Bruxelles, était pour ainsi dire absente. Aucune contestation des consignes syndicales. Les participants portaient des banderoles qui exprimaient plus souvent une question ou une suggestion qu’une revendication: «Pourquoi travailler plus longtemps? Trois employés sur quatre sont (quand même) malades avant leurs 65 ans!… », «L’union fait la modération», «l'éducation, un droit?» et maintes autres calicots dans ce genre. Certains slogans officiels appelaient même à ne pas faire payer la «communauté» pour les restructurations des patrons: «Aucun licenciement, surtout pas avec l'argent public ». Bref, la marée des manifestants marchaient docilement derrière les syndicats et leurs mots d’ordre.
- la dynamique générale de la lutte de classe est fort différente aussi dans les deux situations.
La manifestation du 31 mai 1986 était le point d’orgue de semaines de luttes dans les entreprises et les secteurs, aussi bien dans le secteur public que privé. Le mouvement a débuté par «des grèves qui démarraient spontanément et qui ont mis le feu aux poudres ... la dynamique d'extension et d'unification a été poussée par les assemblées générales et les comités d'action qui ont surgi au cours de la grève. Ce sont les ouvriers eux-mêmes qui ont lancé l'idée d'une marche sur Bruxelles comme tentative d'unification» (Internationalisme N° 117). Les syndicats ont été submergés dans un premier temps par la combativité et ont sauté sur le train en marche. Par ailleurs, les mouvements de 1986 se situaient dans le contexte d’une vague de luttes internationale. Juste avant «En Norvège, 120.000 travailleurs entrent en grève; en Finlande, ce sont 250.000 grévistes qui, ensemble, se sont opposés à l'État » (Internationalisme 111). Après le déclin du mouvement en Belgique, divers autres mouvements de grève ont encore suivi dans plusieurs autres pays d'Europe occidentale.
La situation actuelle n’est en rien comparable sur ce point aussi. Depuis la fin des années 1980, l’évidence que ni la classe ouvrière, ni la bourgeoisie n’a pu imposer sa perspective historique a causé un blocage du rapport de force entre les classes, ce qui engendre un pourrissement sur pied du capitalisme. L'effondrement des régimes staliniens, qui «a provoqué un recul important du prolétariat, tant au niveau de sa conscience que de sa combativité » (Revue Internationale n°130, 3e trimestre 2007), accentue encore l’impact de la décomposition, du «chacun pour soi» qui devient de plus en plus l’élément prépondérant du capitalisme décadent. Cela a entraîné des difficultés conséquentes pour la lutte ouvrière:
« (…) la décomposition a posé à la classe ouvrière des difficultés importantes à la fois matérielles et idéologiques pour le développement de la lutte de la classe ouvrière:
-au niveau économique et social, les processus matériels de décomposition ont eu tendance à saper pour le prolétariat la conscience de son identité. De plus en plus les concentrations traditionnelles de la classe ouvrière ont été détruites; la vie sociale est devenue de plus en plus atomisée (...); le chômage de longue durée, spécialement parmi les jeunes, renforce cette atomisation et défait encore plus le lien avec les traditions de combat collectif;
-les campagnes idéologiques incessantes de la classe dominante, vendant le nihilisme, l'individualisme, le racisme, l'occultisme, et le fondamentalisme religieux, tout ceci aidant à obscurcir la réalité de la société dont la division fondamentale reste la division en classes;
-la classe ouvrière est donc confrontée aujourd'hui à un grave manque de confiance - pas seulement en sa capacité à changer la société, mais même en sa capacité à se défendre elle-même au jour le jour. Ceci (,,,) a accrue la capacité du capitalisme à dévoyer les efforts des ouvriers pour défendre leurs propres intérêts vers tout un patchwork de mouvements "populaires" et "citoyens" pour plus de "démocratie". (Revue Internationale N° 106, 3e trimestre 2001)
Les conséquences de cette décomposition engendrent régulièrement la confusion et même la démoralisation. Elles marquent toute une génération de prolétaires. En Europe, elles suscitent un grand désarroi parmi les travailleurs à propos des objectifs de la lutte et des alternatives à avancer face au système pourrissant. Même la confiance en soi, le sentiment d’appartenir à une seule classe avec ses propres désirs et revendications sont ébranlés.
Aussi, à l'heure actuelle, les attaques que subit la classe ouvrière en Belgique, qu’elles soient assénées par un gouvernement de gauche (le gouvernement précédent du socialiste Di Rupo) ou par l’actuel gouvernement de droite, rencontrent une résistance pratiquement nulle malgré un réel mécontentement social. C'est d'ailleurs le cas dans pratiquement tous les pays. Ainsi, la bourgeoisie a réussi à faire passer de lourdes restructurations, telles que la fermeture de Ford Genk et la réduction de la sidérurgie à Liège (Mittal) sans que cela n’entraine de résistances ouvrières significatives. Pour le moment, la bourgeoisie réussit à conserver un certain contrôle à la fois sur son appareil économique et sur la situation sociale grâce à la reprise en main des syndicats qui parviennent encore à enfermer les ouvriers dans des simulacres de lutte, insignifiantes et hyper corporatistes (et même très impopulaires pour monter les prolétaires les uns contre les autres, comme les grèves des cheminots de la SNCB à l’automne). Et l’annonce par les gouvernements fédéral et régionaux de mesures d’austérité drastiques touchant les salaires, les retraites, les allocations sociales et de chômage et les services publics, si elles ont engendré un sentiment d’injustice et d’indignation, n’ont pas non plus déclenché des réactions combatives parmi les travailleurs. Il faudra une dégradation encore plus importante des conditions générales d’existence et d’exploitation de la classe ouvrière pour que celle-ci puisse surmonter sa paralysie.
Ce qui est comparable c’est le rôle des syndicats
Si une chose est toutefois comparable dans les deux cas, c’est le rôle de fossoyeur de la lutte de classe que les syndicats jouent dans les deux cas, même si la tactique peut varier.
En 1986, les syndicats ont sauté sur le train en marche non pas pour soutenir la lutte mais, au contraire, pour mettre des bâtons dans les roues de la dynamique du mouvement, le détourner et l’entraîner vers une impasse. Avec l’aide du syndicalisme de base plus «radical», ils y ont finalement réussi: «Ainsi, en reprenant les perspectives issues de la lutte (extension vers d'autres secteurs, auto-organisation, marche sur Bruxelles …), ils les ont peu à peu vidées de tout leur contenu de classe» (Internationalisme N° 111). De fait, la manifestation nationale du 31 mai 1986 était pour les syndicats la meilleure occasion pour reprendre la direction du mouvement qu’ils avaient à moitié perdue.
Aujourd’hui, la stratégie est différente, mais le rôle est identique. Les syndicats prennent l’initiative, alors que les travailleurs sont en plein désarroi, pour accentuer encore plus la confusion dans la tête des ouvriers et surtout pour les convaincre que le cadre de la concertation syndicale est le seul cadre au sein duquel une résistance contre l’austérité peut s’inscrire. Tout en criant haut et fort qu’ils «déclaraient la guerre à ce gouvernement au service des patrons», que «les travailleurs ne se laisseraient pas plumer», la délégation du front syndical a exigé, dès le début des actions, une entrevue avec les principaux ministres du gouvernement pour revendiquer le droit de débattre avec eux des «mesures antisociales qui font mal aux familles et aux travailleurs», pour démontrer que, plutôt que de «forcer à avaler un saut d’index», il était possible de «prendre l’argent là où il y en a» et «d’aller le chercher là où il est !» (discours du dirigeant syndical FGTB De Leeuw).
Dès le début, le vrai objectif des actions syndicales était patent: l’inscription de la manif sous le «patronage» de celle de 1986, un puissant mouvement de lutte ouvrière, visait à troubler encore plus la conscience des travailleurs. Il s’agissait de bien leur faire entrer dans la tête que la lutte des ouvriers ne peut être qu’une lutte pour que les syndicats soient «associés à la concertation», «associés à la concrétisation des plans d’austérité», afin qu’ils puissent infléchir les plans dans le sens de mesures équilibrées qui «demandent un effort à tous selon les possibilités de chacun». Plutôt que de désamorcer une combativité ouvrière persistante comme en 1986, les syndicats visent par leurs actions actuelles à pourrir à la base la volonté de combativité et de prise de conscience des travailleurs en enfermant toute résistance et toute recherche d’alternative dans le carcan de la concertation sociale pour sauvegarder l’intérêt national, et donc de l’unité avec leurs exploiteurs au sein de la démocratie bourgeoise.
Assimiler la lutte de classe à de la violence gratuite
Un autre volet de la campagne était le battage médiatique sur la «guerre dans les rues de Bruxelles». Mené en parallèle au précédent, il répondait à un autre objectif, parfaitement complémentaire. Car si, malgré leurs déclarations ronflantes, les syndicats n’ont jamais «engagé la guerre» contre le gouvernement et ses mesures (et n’ont jamais eu l’intention de l’engager d’ailleurs), la bourgeoisie a largement médiatisé les émeutes qui ont émaillé la fin de la manifestation du 6 novembre pour associer toute idée de lutte radicale avec des visions de terreur urbaine et de violence gratuite.
Ces émeutes ont été une provocation savamment préparée par la police, le service d’ordre syndical et des éléments louches infiltrés. En route vers la manif, les participants à la manif syndicale ont largement été incités à consommer, gratuitement ou non, des boissons, en particulier des bières. Pendant leur promenade de la gare du Nord à la gare du Midi, ils ont été assommés par la musique assourdissante, les haut-parleurs vociférant des slogans et les éclats des pétards. A aucun moment, ils n’ont eu l’occasion d’engager la discussion sur le pourquoi et le comment lutter et sur le quoi faire après la manif, s’ils en avaient l’intention. Dans ces conditions, il n’était pas difficile d’exploiter les frustrations exacerbées par l’alcool de certains groupes de participants, infiltrés par des provocateurs et des éléments troubles, pour les entraîner dans des bagarres avec les forces de l’ordre et les pousser à la destruction gratuite de voitures, de vitrines et de mobilier public.
Cela a permis à la bourgeoisie de déclencher une campagne intensive contre la «violence gratuite» et la «terreur publique» qu’entraîne avec elle toute lutte de classe, assimilée pour l’occasion à ces émeutes provoquées. L’idée instillée dans la presse était que toute opposition «spontanée» et «radicale» contre les mesures d’austérité ne pouvait déboucher que sur de la violence, des destructions gratuites et aveugles qui touchaient sans discernement le citoyen moyen, à l’image de ce pauvre ouvrier d’origine maghrébine qui avait vu son véhicule, indispensable pour son travail, incendié par les casseurs. Heureusement, une collecte sur les réseaux sociaux avait permis de réunir en quelques heures une somme suffisante pour lui en acheter une nouvelle! Ainsi, par la négative, la bourgeoisie veut instiller:
- que la lutte ouvrière radicale ne mène qu’à la violence, un moyen où une minorité impose sa volonté à la majorité de la population et qu’elle est dépassée (« On doit bien se rendre compte peu à peu que la lutte de classe est révolue», lettre ouverte du parlementaire Jean-Marie Dedecker à Rudy de Leeuw);
- qu’elle est de plus anti-démocratique, car elle n’a aucun respect de la volonté de la majorité de la population qui a élu ce gouvernement;
Par la même occasion était démontré une fois de plus que seule la «lutte raisonnable» et «démocratique» des syndicats représentait une alternative «civilisée».
Lutter derrière les syndicats, c’est accepter la logique capitaliste
La suite du scénario des actions syndicales n’a servi qu’à approfondir la campagne et accentuer le message que la bourgeoisie veut faire passer. La série de grèves tournantes provinciales et la journée de grève nationale ont débouché sur une grande «victoire»: les syndicats étaient conviés à la concertation sociale avec le patronat et le gouvernement qui se disait même prêt à «lâcher du lest» sur certains aspects mineurs des mesures annoncées. Après un mois de «dures négociations», un accord social était signé début février avec les syndicats chrétien et libéral, tandis que le syndicat socialiste jugeait l’accord insuffisant, en particulier sur le fétiche du «saut d’index» imposé par le gouvernement (qui en réalité est une pure question de principe puisque l’inflation est quasi nulle pour le moment). Toutefois, le syndicat attend pour voir si le gouvernement se décide à faire d’autres concessions et envisage d’autres types d’actions car «la volonté de faire grève n’est pas élevée parmi nos militants».
Ainsi la boucle est bouclée. En novembre 2014, les syndicats avaient entonné des refrains radicaux: «maintenant c'est tout ou rien: la vérité doit être mise sur la table». Cette vérité, c’est qu’ils tentent d’assimiler la résistance radicale contre l’austérité à de la violence terroriste et qu’ils présentent la soumission devant les impératifs de l’intérêt national de l’Etat démocratique bourgeois comme la seule alternative. Cette vérité sur les syndicats n’est pas nouvelle. Les syndicats depuis le début de la première guerre mondiale, donc depuis plus de cent ans, jouent hypocritement le jeu du système capitaliste.
Cette fois-ci encore, à travers une série de grèves fragmentées, de manifestations muettes et bien d'autres actions menant à l’impuissance (telles que les manifestations les unes à part des autres des travailleurs sociaux, des étudiants et des conducteurs de train du11 Décembre), ils ont précipité la classe ouvrière dans l'abîme du désarroi et de la confusion. Leur seul but était d’ancrer encore plus profondément dans l’esprit des travailleurs actifs, des chômeurs et des employés, des étudiants, des jeunes et des retraités, que la lutte ne mène nulle part, que les mesures d'austérité sont inévitables et donc ne peuvent qu’être avalées. Les syndicats, sont donc de véritables loups en peau du mouton dont les actions ne visent qu’à faire accepter la logique d’un capitalisme inhumaine, tombé dans la décomposition.
Comme tous les communistes de gauche le savent depuis la publication du programme de 1920 des révolutionnaires du KAPD, les syndicats «sont ainsi, à côté des fondements bourgeois, l'un des principaux piliers de l'Etat capitaliste» (Programme du "Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne" (KAPD) Mai 1920). Depuis 100 ans déjà, les syndicats ne sont plus du côté de la classe ouvrière. Depuis un siècle déjà, ils ne sont plus une organisation de combat des travailleurs. Si les syndicats momentanément haussent le ton, ce n’est pas pour défendre les intérêts des travailleurs, mais ceux de l'Etat, du capital et de l'économie nationale. C’est pour paralyser la résistance avant même qu’elle devienne mûre et qu’elle prenne la forme d’un véritable combat contre les causes de toute cette misère.
Jos & Zyart/15.02.2015
Géographique:
Rubrique:
Internationalisme n° 363 - 3e et 4e trimestres 2015
- 975 lectures
Sommaire du n° 363 d'Internationalisme - 3e et 4e trimestres 2015
- 888 lectures
Sommaire du n° 363 d'Internationalisme - 3e et 4e trimestres 2015
Editorial : propagande bourgeoise ou solidarité prolétarienne ? >x<
Situation en Grèce : une attaque contre toute la classe ouvrière >x<
Défense de la Gauche communiste : communiqué de solidarité avec la TCI >x<
Militarisme et décomposition au Moyen-Orient >x<
Naufrages en Méditerranée : le "crime contre l'humanité", c'est le capitalisme >x<
Attentats à Paris : à qui profite le crime ? >x<
Internationalisme - 2016
- 918 lectures
Internationalisme n° 364 - 1e et 2e trimestres 2016
- 1174 lectures
Internationalisme n° 364 - Sommaire
- 740 lectures
La conférence climatique à Paris: COP21
Seule une révolution mondiale peut empêcher le capitalisme de détruire la planète
Le terrorisme: une arme de la guerre impérialiste et contre la lutte de classe !
Résolution: Terreur, Terrorisme et violence de classe
La migration économique et les réfugiés de guerre dans l’histoire du capitalisme
La Ligue Communiste de Tampa et la question du Parti
A propos du débat à une réunion publique
Sommes-nous à la veille d’une nouvelle guerre mondiale ? Et si ce n’est pas le cas, quel type de menace représentent les guerres au Moyen Orient ?
- 2141 lectures
Fin octobre 2015, le CCI en Belgique/Hollande organisa une réunion publique à Anvers sur le thème de la crise des réfugiés intitulée: “la crise des réfugiés montre la faillite du capitalisme”.
Le CCI attache une grande importance aux réunions publiques qui sont des lieux de débat, de confrontation politique ouverte et directe de différents points de vues qui ouvrent la voie vers la réflexion et la clarification sur des sujets brûlants touchant la classe ouvrière et sa perspective pour l’humanité. C’est une de ses diverses activités menées pour remplir sa tâche comme organisation politique de la classe ouvrière: pousser l’approfondissement et la clarification des positions politiques du mouvement ouvrier, situer les nouveaux événements dans une période donnée de l’évolution du capitalisme aujourd’hui dans sa phase finale de décomposition, développer des pistes de réflexion, des nouvelles orientations pour armer et renforcer la lutte du prolétariat vers sa perspective finale: la lutte pour la révolution communiste.
Nous tenons à remercier tous les camarades présents à cette rencontre pour leurs contributions écrites et orales. Avec le texte d’invitation à la RP ainsi que le texte introductif à la discussion (qui se trouvent sur le site-web), elles ont permis une discussion démarrant d’emblée sur des questionnements de fond.
Un thème a particulièrement focalisé l’attention: “allons-nous aujourd’hui vers une troisième guerre mondiale?”, questionnement qui mérite certainement une poursuite de la réflexion entamée à la RP, réflexion à laquelle nous voulons contribuer par l’article publié ci-dessous. Pour qu’un débat ne reste pas une discussion d’un après-midi, nous encourageons tous les participants et les lecteurs, comme certains sympathisants l’ont déjà fait, à le poursuivre en nous envoyant vos questionnements et réflexions.
Un des sujets les plus débattus lors de la réunion publique (RP) d’Anvers de fin octobre 2015 [1] a été la question de savoir si « la troisième guerre mondiale avait débuté ou était sur le point de débuter ? » (tiré d’une contribution d’un participant à la RP). Dans les médias des rumeurs circulent que la troisième guerre mondiale se développerait en Syrie et, selon certains, elle y aurait déjà débuté : « La guerre régionale commence de plus en plus à ressembler à une guerre mondiale. (…). La troisième guerre mondiale est en préparation ». Qui plus est, « le camp russe est en train de submerger tout et tout le monde en Syrie et bientôt, il y aura une invasion à partir de l’Iran. A ce moment, la troisième guerre mondiale commencera vraiment ». Dernièrement, un quotidien titrait à la une : « Le premier ministre russe, Dmitri Medvedev a dénoncé le danger d’une troisième guerre mondiale » (De Standaard, 15.02.2016). Dans la contribution que le participant à notre RP, cité ci-dessus, nous a envoyée, il insiste sur le danger d’une confrontation planétaire entre les grandes puissances : « Je continue à croire que des accidents entre la Russie et les USA peuvent avoir lieu dans l’espace aérien au dessus de la Syrie. La Russie dispose également de missiles de croisière et d’armes atomiques. Cela pourrait donc dégénérer de manière non intentionnelle ».
Dans la même contribution, le camarade relève une série de symptômes bien connus et pertinents pour caractériser la situation mondiale actuelle. Et ceux-ci peuvent effectivement nous choquer. Effectivement, il se passe en ce moment des « choses terribles dans le monde », comme un autre participant à la RP le formulait : un nombre croissant de régions de la planète s’enfoncent dans un chaos sans issue et deviennent même inhabitables à cause de la guerre, de la destruction économique, de la terreur, des flux massifs de réfugiés qui atteignent des sommets historiques, des attentats terroristes sanglants, etc. La question centrale posée dans le débat lors de la RP était donc : comment devons-nous appréhender ces événements ? Devons-nous nous limiter à une énumération empirique des symptômes ou est-il possible de discerner un fil rouge qui permette de cadrer l’ensemble ? Et lequel alors ? Qu’est-ce qui a fondamentalement changé en comparaison de la situation de la « guerre froide » des années 1970-1980 ? Dans quel contexte historique la lutte ouvrière doit-elle se développer aujourd’hui ? Quel est le degré de vérité des extraits de presse cités ci-dessus et pouvons-nous effectivement parler d’une tendance vers une menace de guerre mondiale ?
Une série de données empiriques semblent incontestablement confirmer l’imminence d’une guerre mondiale :
• les deux guerres mondiales précédentes avaient également été précédées de conflits locaux limités (la guerre au Maroc avant la 1ère guerre mondiale, la guerre civile en Espagne avant la seconde) ;
• il est évident qu’avec l’accumulation d’armes sophistiquées, un conflit local peut rapidement embraser toute une région, voire un continent entier ;
• à la veille des guerres mondiales précédentes, les blocs impérialistes n’étaient pas encore complètement délimités et formés ;
• la barbarie à laquelle les populations des régions touchées actuellement par la guerre sont confrontées n’est en rien inférieure à celle d’une guerre mondiale (comme c’est le cas par exemple aujourd’hui en Syrie).
Malgré ces données, le CCI a argumenté lors de la RP que ces « terribles événements » étaient l’expression d’un enfoncement de la société capitaliste dans une période de décomposition et non pas l’annonce ou même le début d’une troisième guerre mondiale.
Le capitalisme décadent et la tendance vers la guerre mondiale
Certes, les raisons pour déclencher une guerre mondiale sont largement présentes. Elles sont fondamentalement ancrées dans le constat qu’avec la répartition du marché mondial entre un certain nombre de puissances dominantes, le développement du capitalisme a atteint ses limites historiques. Dès lors, le militarisme et la guerre sont devenus des expressions centrales d’un système économique en déclin depuis 100 ans [2]. A partir de ce moment, les grands Etats nationaux ne pouvaient qu’entrer en conflit l’un avec l’autre dans leur conquête du monde. Depuis lors, la guerre n’ouvre plus des frontières économiques ou politiques pour permettre la poursuite du développement du capitalisme. Les guerres du 19e siècle, aussi meurtrières qu’elles aient été, avaient une rationalité du point de vue du développement du capitalisme. Maintenant que le gâteau a été réparti, chacun ne peut accroître sa part de celui-ci qu’en réduisant la part des autres. De plus en plus, la guerre devient une activité irrationnelle d’un point de vue économique global et qui menace de surcroit la survie de l’humanité, alors que les raisons d’en déclencher une se multiplient du fait des conflits d’intérêt entre tous les Etats capitalistes, impérialistes.
« La politique impérialiste n'est pas l'oeuvre d'un pays ou d'un groupe de pays. Elle est le produit de l'évolution mondiale du capitalisme à un moment donné de sa maturation. C'est un phénomène international par nature, un tout inséparable qu'on ne peut comprendre que dans ses rapports réciproques et auquel aucun État ne saurait se soustraire. » (Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie, Chapitre VII)
Toute l’histoire depuis la première guerre mondiale jusqu’à la guerre froide nous apprend qu’en préparation d’une telle guerre mondiale, tous les Etats sont contraints de prendre position pour l’un ou l’autre bloc en présence, jusqu’au moment où en fin de compte, deux grands blocs militaires se trouvent face à face. La nécessité pour les Etats de rejoindre un des deux blocs est la seule manière pour eux d’arriver à défendre leurs intérêts nationaux dans la jungle des tensions internationales. « La tendance générale de la politique capitaliste actuelle domine la politique des États particuliers comme une loi aveugle et toute-puissante, tout comme les lois de la concurrence économique déterminent rigoureusement les conditions de production pour chaque entrepreneur particulier. » (Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie, Chapitre VII)
Pendant la réunion publique, la discussion centrale ne s’est pas vraiment centrée sur les raisons pour déclencher une guerre, ni sur l’orientation inhérente au capitalisme décadent vers la guerre mondiale, mais sur la question de savoir si les conditions pour une telle guerre mondiale étaient aujourd’hui présentes. Deux conditions essentielles pour pouvoir parler d’un cours vers la guerre mondiale ont été avancées :
• en premier lieu l’existence de blocs militaires stables ;
• en second lieu une classe ouvrière, en particulier dans les pays centraux du capitalisme (l’Europe de l’Ouest, les USA), qui est disposée à servir de chair à canon dans une telle guerre généralisée et à se soumettre à la main de fer de l’industrie de guerre.
Ces deux conditions ne sont nullement remplies à l’heure actuelle.
Pourquoi n’y a-t-il pas aujourd’hui des blocs militaires stables ?
Dans la discussion, divers arguments ont été avancés pour répondre à la question : comment se fait-il que la bourgeoisie n’arrive pas à développer une dynamique vers la constitution de nouveaux blocs militaires, alors que les contradictions du capitalisme se renforcent et qu’une telle « solution » s’impose chaque jour plus clairement ? L’objection a été avancée que « ce n’est pas parce que les alliances au sein des blocs fluctuent qu’il n’existe pas de blocs : la Russie et l’Iran sont partenaires, l’Iran envoie des troupes au sol et la Russie bombarde » (un commentaire d’un participant à la RP). Par ailleurs, l’absence de blocs signifie-t-elle que le danger de guerre reste limité ?
• Une caractéristique d’une guerre mondiale est qu’elle se développe surtout dans les pays centraux du capitalisme. Car le but ultime d’un tel conflit mondial est qu’un des deux pays, qui assume la direction des blocs impérialistes antagoniques, est mis à genoux par des moyens militaires. Et cela n’est possible que si le bloc impérialiste vainqueur s’introduit jusqu’au cœur du leader du bloc perdant. Le leader du bloc adverse doit en effet être totalement vaincu, de sorte qu’il ne puisse préparer sa revanche (ce qui fut le cas de l’Allemagne, qui avait été la perdante de la première guerre mondiale). Cela signifie que chaque composition de bloc en vue d’une guerre mondiale doit être suffisamment puissante au niveau des forces économiques et militaires tout comme sur le plan de la coordination stratégique. Ceci n’est aujourd’hui nullement le cas dans un contexte de domination des forces centrifuges et du « chacun pour soi ».
• Par ailleurs, dans le cas d’un conflit planétaire, tous les pays, dans le monde entier, sont forcés de prendre parti pour l’un ou l’autre bloc. Il est nécessaire d’imposer la même discipline aux différentes bourgeoisies nationales au sein d’un bloc stable, afin de limiter les contradictions internes et de les unifier pour la confrontation militaire entre les deux camps. Les alliances ne se limitent alors pas entre quelques pays ou à un pacte entre deux pays, comme c’est souvent le cas aujourd’hui. Les alliances actuelles, fluctuantes et sans cesse changeantes, ne répondent absolument pas aux conditions de stabilité et de fiabilité indispensables dans le cas de la constitution de blocs en vue d’une préparation à une guerre planétaire sans merci. On ne peut se permettre que les alliés d’aujourd’hui deviennent les adversaires de demain et vice-versa [3]: « […] la tendance au “ chacun pour soi ” et l’instabilité des alliances militaires [qui en découlent] allaient constituer une entrave à la formation de nouveaux blocs impérialistes. » [4] qui constituent la condition pour l’éclatement de la prochaine boucherie planétaire. De plus, au sein des partenariats actuels, les chefs de bloc ou les candidats chefs de bloc sont constamment contrecarrés. Ainsi, au Moyen Orient, tous les Etats ont un double agenda : Israël, l’Iran, l’Arabie Saoudite, la Turquie, la France, l’Angleterre, l’Allemagne, la Chine.
• Une dernière condition importante pour ouvrir la voie à la boucherie mondiale est que la bourgeoisie dispose de thèmes suffisamment mobilisateurs pour déchaîner un ouragan guerrier sur toute la planète; un thème qui suscite suffisamment d’enthousiasme pour mobiliser les parties essentielles de la population derrières les bannières nationalistes. Au lieu de l’antifascisme, la bourgeoisie voudrait mettre en avant l’antiterrorisme, mais il n’y a aucun pays disposant d’un poids économique et militaire suffisant pour jouer le rôle d’ « Etat voyou » par excellence et pour regrouper autour de lui d’autres Etats « terroristes ».
Comment la classe ouvrière a empêché la bourgeoisie de déclencher une guerre mondiale ?
Dans la période de reconstruction et lors du bref boom économique entre 1950 et 1970 qui ont suivi la seconde guerre mondiale, une confrontation directe entre le bloc de l’ouest (autour des USA) et le bloc de l’Est (autour de l’URSS) a pu être évitée en déplaçant les conflits impérialistes vers des pays non centraux du système capitaliste. Durant cette période, la classe ouvrière ne s’était pas encore rétablie de sa défaite historique à la fin des années 1920 et n’était donc pas un facteur décisif dans le blocage de la tendance vers une guerre mondiale. Avec le resurgissement de la crise historique du capitalisme, la perspective d’une troisième guerre mondiale a refait surface. Les tensions impérialistes et les conflits entre les deux blocs devenaient plus aigus ce qui accroissait le danger d’une confrontation directe entre eux.
Cette orientation a été fondamentalement remise en question depuis la fin des années 1960 par la reprise des luttes à un niveau mondial par une nouvelle génération d’ouvriers qui n’avait pas connu la défaite, et ceci en réponse aux premiers signes du retour de la crise historique ouverte. La classe dominante des deux constellations impérialistes ne pouvait être sure qu’elle réussirait à faire abandonner aux travailleurs la lutte de classe pour leurs propres intérêts matériels et qu’ils abandonneraient tout pour s’engager dans une nouvelle guerre mondiale dont les ravages risquaient d’être apocalyptiques. Elle ne pouvait absolument plus compter sur la classe ouvrière, comme ce fut le cas lors de la première et de la seconde guerre mondiale. Ceci fut confirmé avec force lors de la grève de masse de 1980 en Pologne. Malgré la défaite subie par les ouvriers, ce puissant mouvement de grève a démontré à la classe dominante qu’elle ne réussirait jamais à gagner le prolétariat pour son projet de boucherie planétaire.
Dans la période entre 1968 et 1989, la lutte de classe a empêché le déclenchement de la troisième guerre mondiale. Une défaite idéologique et même physique était absolument nécessaire pour briser la résistance et pour mobiliser la classe ouvrière en vue d’un nouvel Holocauste qui risquait même de signifier la fin de l’espèce humaine.
L’incapacité de la bourgeoisie à mobiliser la classe ouvrière pour une guerre impérialiste planétaire d’un côté, et d’un autre côté aussi la difficulté du prolétariat à aller plus loin qu’une simple résistance aux attaques économiques contre ses conditions de vie et à la mobilisation guerrière, a mené à une « impasse » de l’évolution sociale, impliquant le développement d’une phase de décomposition, une phase ultime et inédite de la décadence du capitalisme.
« Dans une telle situation où les deux classes fondamentales et antagoniques de la société s'affrontent sans parvenir à imposer leur propre réponse décisive, l'histoire ne saurait pourtant s'arrêter. Encore moins que pour les autres modes de production qui l'ont précédé, il ne peut exister pour le capitalisme de «gel», de «stagnation» de la vie sociale. Alors que les contradictions du capitalisme en crise ne font que s'aggraver, l'incapacité de la bourgeoisie à offrir la moindre perspective pour l'ensemble de la société et l'incapacité du prolétariat à affirmer ouvertement la sienne dans l'immédiat ne peuvent que déboucher sur un phénomène de décomposition généralisée, de pourrissement sur pied de la société. » [5]
Avec la décomposition du capitalisme, la menace guerrière prend une forme plus sournoise
Cette situation de blocage a été un élément déterminant, à la fin des années 1980, dans la dissolution des deux blocs impérialistes et dans le report de la menace d’une troisième guerre mondiale classique entre l’Est et l’Ouest.
Cela ne faisait pas disparaître pour autant la question de la guerre comme seule « solution » pour la bourgeoisie aux contradictions internes qui pèsent sur son système. Au contraire, le débat à la RP a mis en évidence que la menace de guerre prend aujourd’hui une forme différente, plus sournoise. Au lieu d’une guerre mondiale, c’est à un feu d’artifice de guerres locales que nous assistons. L’effondrement du bloc de l’Est en 1989 a ouvert la boîte de Pandore. La disparition des deux blocs impérialistes « ouvre la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. [Mais]Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l'heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial […]. En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible. » (6)
Ce développement de la décomposition du capitalisme est déjà fort avancé dans des pays comme la Libye, l’Irak ou la Syrie. Dans les guerres actuelles au Moyen Orient, aucune rationalité ou logique n’apparaît, en dehors d’une tendance exacerbée au chacun pour soi. La rationalité économique est absente : rien que dans les guerres en Irak et en Afghanistan, des millions de dollars se sont envolés en fumée. Le nouvel « Etat », le califat d’Isis, avec ses conquêtes sanglantes, sa brutalité, l’irrationalité de ses discours et son idéologie de « lutte finale » est avant tout l’expression de la décomposition capitaliste et le produit des manœuvres des grandes puissances qui l’ont toutes, d’une manière ou d’une autre, engendré.
Cette situation illustre comment le chacun pour soi et le pourrissement du système dégénèrent en un enchaînement de nombreux conflits locaux et régionaux, impliquant de plus en plus de puissances locales, régionales et mondiales et détruisant des parties de plus en plus importantes de la planète.
« Avec l'entrée du capitalisme dans sa décadence, la guerre devient une […] machine aveugle de destruction et d'anéantissement [qui]entraîne le monde entier dans l'abîme.[ …] nous étions à une croisée des chemins historique (où nous nous trouvons toujours), qui menace pour la première fois de devenir une lutte pour la survie de l'espèce entière. » (1)
Qu’est-ce que cela signifie pour la perspective de la classe ouvrière ?
Ceci nous ramène au thème central de la RP : la signification des flux massifs actuels de réfugiés du point de vue de la classe ouvrière. Car en plus de la guerre, de grandes parties de la population mondiale sont confrontées avec d’autres « choses terribles », par rapport auxquelles elles cherchent à fuir. Le problème est nettement plus différencié et va de la destruction planétaire de l’environnement naturel ou des structures de la vie sociale jusqu’à l’influence croissante de l’irrationnel et de l’obscurantisme dans la société. Comme nous le dénoncions déjà dans l’introduction de ce texte, toutes ces « choses horribles» sont les symptômes de la décadence et plus particulièrement de la phase de décomposition du capitalisme. « la phase de décomposition apparaît comme celle résultant de l'accumulation de toute ces caractéristiques d'un système moribond[...] Ainsi, la phase de décomposition se présente comme l'aboutissement, la synthèse, de toutes les contradictions et manifestations successives de la décadence capitaliste». [6].
La « crise des réfugiés » en Europe indique déjà que la guerre devient de plus en plus un souci journalier pour les travailleurs dans les pays centraux. De plus en plus, ils doivent se poser la question de quel futur ils souhaitent. Veulent-ils s’enfermer dans leur Etat « bunkerisé » dans un état de siège permanent ? S’agit-il de continuer à défendre les intérêts du capital et de sa nation ? Ou au contraire s’engager sur le chemin d’une communauté mondiale solidaire, basée sur la satisfaction des besoins humains, dans laquelle la réalité matérielle de l’ « internationalisme » prend la forme d’une unité et d’une solidarité consciente ?
En Allemagne et dans d’autres pays, nous avons vu des milliers de jeunes travailleurs, mais aussi des pensionnés se mobiliser pour exprimer leur solidarité spontanée avec les réfugiés. Dans le prolongement de la vague d’indignation morale qui était apparue précédemment lors du mouvement des Indignés, ceci est signe qu’une maturation souterraine est en route. Aujourd’hui, « l’internationalisme » tend souvent à se manifester sous une forme apparemment négative et abstraite : à travers une critique radicale du cadre inadapté de l’Etat nation bourgeois pour faire face au problème de la guerre, du terrorisme et des réfugiés ; à travers la reconnaissance de la nécessité de dépasser le cadre de la concurrence entre Etats nations pour vaincre la crise économique et écologique. Par le fait que ces protestations ne s’identifient pas avec la lutte historique de la classe ouvrière pour ses intérêts et par conséquent ne débouchent pas sur une perspective politique positive, la bourgeoisie réussit toujours à neutraliser temporairement cette indignation et ces remises en question, à les détourner au moyen de discours « humanitaires » et démocratiques.
Aussi longtemps que les membres de la classe ouvrière sont coincés entre leur position de classe objective et leur perception d’une « citoyenneté » individuelle, ils sont déchirés dans la mesure où ils sont obligés à faire des choix individuels qui ne sont pas les leurs et cela mène à un sentiment d’impuissance. Ce n’est que dans le mouvement comme classe collective, comme communauté d’intérêt autonome face au capital, qu’ils arriveront à développer une vision politique plus large avec une conscience plus élevée et une plus grande unité grâce au sentiment croissant d’appartenir à une classe.
Vers la fin de la discussion, le CCI a clairement mis en avant, et nous voulons le souligner ici à nouveau, que, pour contrer l’extension de ce niveau de barbarie vers les centres du capitalisme, la classe ouvrière a besoin de plus qu’une résistance passive contre les excès du système et contre la rhétorique guerrière, de plus qu’une résistance économique. Le temps presse car nous risquons de nous retrouver dans une descente irréversible dans la barbarie, qui rendra caduque toute possibilité d’amener la société humaine vers un niveau plus élevé.
La classe ouvrière est toujours la seule classe qui dispose du potentiel pour prendre conscience des causes sous-jacentes de toutes ces « choses horribles », de ces guerres et qui peut les relier à la crise historique et générale du capitalisme. De par son caractère mondial et associé en tant que productrice de tous les biens et les services, elle peut comme seule classe offrir une perspective politique positive à chacun. Pour ce faire, elle doit confirmer la nécessité actuelle d’une nouvelle société, d’un communisme authentique, tel qu’il a été préconisé par Marx et par tous les révolutionnaires après lui n
Lac/20.02.2016
[1] Voir l’article « 100 années de décadence du capitalisme », https://fr.internationalism.org/revue-internationale/201402/8882/100-ans-decadence-du-capitalisme et le texte d’orientation « Militarisme et décomposition ».
[2] voir aussi « Sur l’impérialisme » https://fr.internationalism.org/rinte19/impe.htm
[3] Ceci est même reconnu par les scientifiques bourgeois : « Nowhere in the world has much opportunity to start World War III. A World War requires two (or more) power blocs with a global capacity to wage military, economic, social and political warfare. There does not exist two such blocs. (Is Syria a potential place where WWIII can start from? » (Kevin Flint, political scientist);
[4] « 20e congrès de Révolution Internationale : renforcer les acquis du CCI pour les transmettre à la nouvelle génération de militants », https://fr.internationalism.org/node/5688
[5] « Thèses : la décomposition comme stade ultime de la décadence du capitalisme » , https://fr.internationalism.org/french/rint/107_decomposition.htm
[6] Revue Internationale, n° 61 : « Après l’effondrement du bloc de l’Est, déstabilisation et chaos », https://fr.internationalism.org/rinte61/est.htm
Vie du CCI:
Géographique:
Rubrique:
Internationalisme - 2017
- 26 lectures
Internationalisme - 2018
- 68 lectures
Internationalisme n° 369 - 3e & 4e trimestre 2018
- 57 lectures
11 novembre 1918: "Jamais plus de guerre"? - Un armistice pour sauver le capitalisme et préparer de nouvelles guerres
- 167 lectures
Le 11 novembre 2018, cela fait exactement cent ans que la Grande Guerre s’est arrêtée. Les médias y consacrent une large attention, comme par exemple la télé belge néerlandophone, la VRT, qui se penchera lors d’une émission marathon sur cent ans d’armistice en mettant l’accent sur l’importance de la promesse formulée jadis : « plus jamais de guerre ». Ensuite, 220 villes et communes de Belgique planteront un arbre de paix et le roi se rendra à Ypres pour entendre une version spéciale du « Last Post ». Bref, un grand nombre de festivités et une large couverture médiatique sont prévus pour commémorer et célébrer les cent ans de cet armistice.
Faut-il effectivement saluer l’armistice du 11 novembre 1918 ? Avait-il pour but de déposer définitivement les armes et de bannir à jamais tout acte de guerre dans le futur ? Eliminait-il les causes réelles qui avaient mené à l’éclatement de la première guerre mondiale ? A-t-il effectivement ouvert pour les Etats européens une période de « jamais plus de guerre » ?
1. L’armistice : une pause pour préparer de nouvelles guerres
En novembre 1918, l’Europe était plongée dans un énorme chaos et des millions de personnes avaient été chassées de leurs maisons et de leurs régions et étaient à la recherche d’un eandroit où poursuivre et reconstruire leur vie. Ainsi, un million de Belges s’étaient réfugiés en Hollande, et plus de 100.000 devaient toujours rentrer après l’armistice ; 300.000 réfugiés belges résidaient en France et devaient rentrer en 1918. De plus, il y avait les centaines de milliers de militaires blessés, mutilés, invalides qui parcouraient les régions d’Europe à la recherche de leur ville ou village. A cause du chaos de la guerre mondiale, des migrations massives qui l’accompagnaient et de l’épuisement des populations, la grippe espagnole a pu faire de terribles ravages et causer en fin de compte plus de morts que la guerre mondiale elle-même.
Les idéologues bourgeois s’accordent sur le fait que les conditions, imposées par les alliés à l’Allemagne par le Traité de Versailles, ont posé les germes d’une nouvelle guerre vingt ans plus tard. Le « traité de paix » a suscité le développement de sentiments de vengeance et de rétorsion qui se sont répandus dans de larges couches de la population allemande dans le courant des années 1920. Le commentaire du quotidien du SDAP (social-démocrate) en Hollande en 1919 en donne un avant-goût : « Cette paix pour tous est vue comme une amère désillusion, une déception ressentie comme une catastrophe. (…) Le traité de paix fixe le statut d’une Europe en décadence, de son recul à un niveau inférieur de civilisation. Le plus grand peuple du continent est enchaîné et condamné aux travaux forcés (…) à l’humiliation et à l’amertume. La rancœur ici, la suffisance, la soif de puissance, la témérité là-bas, sont les nouveaux « traits de civilisation » générés par le traité de paix » (Het Volk, 21.06.1919).
Les bourgeoisies de divers pays étaient pleinement conscientes que cette paix était condamnée à l’échec. Il n’y avait pas seulement la politique envers l’Allemagne qui exacerbait les rancœurs, mais aussi, « la création de nouveaux états comme la Pologne, l’Autriche, la Hongrie et la Yougoslavie a mené à des conflits incessants à propos des nouvelles frontières de ces pays. Cela concernait en particulier la Hongrie qui perdait les deux tiers des territoires qu’elle occupait avant la guerre, (…). Bref, la paix était un échec » (Jay Winter, interview dans Le Monde, 12.11.2014).
L’armistice du 11 novembre 1918 était au fond une paix qui mettait fin à toute forme de paix ! La première guerre mondiale marquait l’entrée du capitalisme en décadence et la période qui s’ouvre alors menait à un état quasi permanent de guerre. Quelques exemples des deux décennies suivantes le démontrent.
Après la fin de la première guerre mondiale, la Grèce se voit attribuée une zone d’occupation en Turquie. Pendant l’été de 1920, les Grecs veulent étendre leur zone d’occupation. Ils se heurtent alors à une résistance exacerbée des Turcs. Ceci est le début de la guerre gréco-turque qui a duré jusqu’en 1922. Cette guerre a mené à des atrocités des deux côtés, comme par exemple le massacre de dizaines de milliers de Grecs et d’Arméniens par les Turcs. En 1920, les tribus du Riff au Nord du Maroc s’unissent et déclenchent une guerre contre la domination espagnole. Lors de l’été de 1921, environ 19.000 soldats espagnols périssent. Cette guerre contre l’Espagne, plus tard épaulée par la France, durera jusqu’en 1926. Les Espagnols et les Français utiliseront pendant cette guerre e.a. des gaz asphyxiants, causant des milliers de morts.
En 1929, les Chinois occupent le chemin de fer de Mandchourie. Cela a mené à un conflit ouvert avec l’Union Soviétique. Lorsque les troupes soviétiques franchissent la frontière chinoise le 15 novembre, cela débouche sur des combats féroces, causant du côté chinois plus de 2.000 morts et 10.000 blessés. L’incident de Mandchourie en 1931, un attentat à la bombe visant une voie ferrée, est exploité par le Japon pour déclencher la guerre et occuper la province chinoise. En 1937, la guerre est étendue par l’attaque de tout le subcontinent chinois, dont la plus grande partie est aussi occupée par le Japon. Pendant cette guerre, des centaines de milliers de Chinois seront tués, pour l’essentiel des civils et les troupes japonaises se rendront coupables de nombreux massacres.
Le 3 octobre 1935, l’Italie déclenche une guerre contre l’Ethiopie. Après 7 mois d’intenses combats, elle réussit à conquérir le pays. Dans leurs attaques contre la population civile, les Italiens ont utilisé à grande échelle le gaz moutarde. En plus des 25.000 militaires tués dans les combats, le conflit a coûté la vie à 250.000 civils. En 1936, un certain nombre de généraux commencent une guerre contre la république espagnole, avec le soutien de l’Italie, l’Allemagne et le Portugal. De son côté, la république est soutenue par l’Union soviétique et le Mexique. Cette guerre, qui durera trois ans et qui se terminera par la victoire des généraux, se solde au total par plus d‘un demi-million de morts. Le 12 mars 1938, les Allemands rentrent en Autriche et le 15 mars 1939, ils occupent la Tchéquie, tandis que des troupes hongroises occupent la Slovaquie. Ces conquêtes militaires constituaient les premières actions guerrières qui déboucheront sur l’éclatement de la seconde guerre mondiale.
L’armistice du 11 novembre 1918 n’a donc nullement ouvert une période de paix mais a conduit à une succession ininterrompue de conflits qui ont finalement débouché sur la seconde guerre mondiale.
2. L’armistice : une attaque contre la révolution prolétarienne en réaction à la guerre
L’armistice a permis à la bourgeoisie de déclarer la guerre au prolétariat (a) en divisant les ouvriers entre ceux des pays “vainqueurs” et ceux des pays “vaincus” et (b) en retournant les armes contre la révolution. En Russie, la contre-révolution s’était développée avec force (cf. « La bourgeoisie mondiale contre la révolution d’Octobre » ; Revue Internationale n° 160). En Allemagne aussi, la bourgeoisie était prête à déclencher sa terreur contre-révolutionnaire. Nourrie d’une haine farouche contre la classe ouvrière, elle se préparait à écraser par la force et à exterminer les foyers de la révolution communiste.
a) Diviser la classe ouvrière
La bourgeoisie était consciente du danger : « toute l’Europe est pétrie de l’esprit de la révolution. Il n’y a pas seulement un sentiment profond de mécontentement, mais également de colère et de révolte parmi les travailleurs (…). L’ensemble de l’ordre existant, aussi bien dans ses aspects politiques, sociaux et économiques est remis en question par les masses populaires d’un bout de l’Europe à l’autre » (Lloyd George, premier ministre britannique dans un mémorandum secret adressé au premier ministre français Georges Clemenceau, mars 1919). De par la signature de l’armistice, la classe ouvrière en Europe était divisée en deux parties : d’un côté les ouvriers qui se trouvaient dans le camp des états-nations vaincus et de l’autre côté ceux qui vivaient dans les états capitalistes vainqueurs et qui étaient submergés par une vague de national-chauvinisme (surtout en France, en Grande-Bretagne, en Belgique et aux USA). De cette manière, la bourgeoisie réussit à limiter les mouvements révolutionnaires au premier groupe d’états (plus l’Italie).
La situation particulière qui a surgi à Bruxelles quelques jours avant le 11 novembre illustre parfaitement les conséquences de cette division. Les soldats allemands qui y étaient casernés, renforcés par des détachements de marins de la Kriegsmarine provenant d’Ostende, se révoltent et élisent un conseil révolutionnaire de soldats. Ils manifestent dans les rues de Bruxelles avec des drapeaux allemands, belges et rouges et appellent à la solidarité des travailleurs belges et de leurs organisations. Face à quelques fraternisations avec des membres des Jeunes Gardes Socialistes, les organisations syndicales ont rapidement appelé à ne pas bouger et, sous l’influence de la propagande chauvine, les ouvriers bruxellois ne se mobilisent pas mais attendent passivement l’entrée triomphale de l’armée belge victorieuse dans Bruxelles quelques jours plus tard.
b) diriger les armes contre la révolution
« Les différentes bourgeoisies nationales avaient d’abord essayé de s’arracher mutuellement des territoires sur les champs de bataille de la guerre impérialiste au prix de 20 millions de morts et d’un nombre incalculable de blessés. Mais, confrontées à une classe ouvrière qui lutte sur son terrain de classe, elles sont d’emblée disposées à resserrer les rangs. Une fois de plus, ceci confirme que la classe dominante, de nature divisée, peut s’unir dans une situation révolutionnaire pour affronter la classe ouvrière » (« 1918-1919 : Il y a 70 ans - la révolution allemande », Revue Internationale n° 56)
Lorsque les soviets prirent le pouvoir en octobre 1917, la réaction des forces impérialistes ne s’est pas fait attendre. Une bourgeoisie, unie sur le plan international, a affronté la jeune république soviétique avec des armées provenant de 21 pays. L’attaque contre-révolutionnaire a commencé en 1917 et a duré jusqu’en 1922. Les « armées blanches » ont déclenché une terrible guerre civile. Les armées des états capitalistes d’Europe, des USA et du Japon ont causé par leurs attaques contre la classe ouvrière en Russie un nombre incalculable de victimes. Parmi les victimes de la guerre civile, il y avait environ un million de soldats de l’armée rouge et plusieurs millions de personnes sont par ailleurs décédées à cause de conséquences indirectes de la guerre, comme la famine ou les épidémies. Le nombre de décès causés par la terreur des armées blanches se situe entre 300.000 et 1 million de personnes. (https://www.quora.com/How-many-people-died-during-the-Russian-Civil-War)
Le déclenchement de la révolution en Europe centrale – l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, etc. – a nécessité de ne pas désarmer complètement l’armée allemande. « On partait de l’idée que l’armée allemande devait être suffisamment forte pour maintenir l’ordre intérieur et pour empêcher une éventuelle prise du pouvoir par les Bolcheviks » (Lloyd George at War, George H. Cassar). C’est ainsi qu’on permit à l’état-major allemand, qui en demandait 30.000, de garder 5.000 mitrailleuses.
En Allemagne également, l’insurrection éclata à la fin de 1918. Le 10 novembre 1918, le général Groener, le successeur de Ludendorf à la tête du quartier général de l’armée allemande, propose par téléphone un pacte au chef du gouvernement, le social-démocrate Friedrich Ebert. Le général propose une collaboration loyale pour mettre fin aussi vite que possible au « bolchevisme » et pour assurer une restauration « de la loi et de l’ordre ». « C’était un pacte contre la révolution. « Ebert accepta ma proposition d’alliance », écrit Groener. « A partir de ce moment, nous discutions chaque soir au moyen d’une connexion secrète entre la chancellerie et l’état-major les indispensables mesures à prendre. L’alliance a bien fonctionné » » (Sebastian Haffner, La révolution trahie).
À cause de l’influence de la révolution, la bourgeoisie ne pouvait plus se fier à de larges parties de l’armée de terre et de la marine. Dans la perspective de la guerre de classes, le social-démocrate Gustav Noske, qui avait rejoint en décembre 1918 le gouvernement de Ebert, avait reçu la mission de constituer des Corps-francs. Ceux-ci regroupaient des soldats de métiers fidèles, conservateurs et ultranationalistes, qui voulaient défendre leur patrie contre le bolchevisme et qui se retrouvaient de par la fin de la guerre en marge de la société. Ainsi, l’État allemand pouvait à nouveau disposer en janvier 1919 d’unités militaires loyales de quelques centaines de milliers de soldats, parmi lesquelles 38 Corps-francs. Dans la lutte contre la révolution, Le SPD n’a pas hésité à utiliser sans la moindre pudeur ces forces armées les plus réactionnaires. En affirmant que « quelqu’un doit être le chien sanglant » et en dénonçant les ouvriers et soldats révoltés comme « les hyènes de la révolution », Noske envoie les corps-francs contre les ouvriers : la guerre contre la classe ouvrière allemande avait commencé. À partir de la mi-janvier, l’attaque militaire contre les insurgés et les organisations révolutionnaires (partis, groupe, la presse, etc.). Des quartiers ouvriers entiers des grandes villes étaient attaqués les uns après les autres et partout étaient perpétrés de terribles massacres (lire les articles sur la révolution allemande dans ce journal).
La guerre contre la classe ouvrière n’était pas seulement menée en Allemagne mais aussi dans d’autres pays. Un de ces pays était la Hongrie, où la révolte ouvrière avait aussi mené au pouvoir une direction révolutionnaire. La révolte y fut également écrasée dans le sang après quelques mois au moyen d’une invasion militaire des forces capitalistes. Le 1er août 1919, la Roumanie envahit la Hongrie et renversa le gouvernement révolutionnaire, ce qui mit fin à l’expérience communiste. Soutenue par la France, l’Angleterre et l’armée blanche, les troupes roumaines entrent le 1er août dans Budapest et installent un gouvernement syndical qui liquide les conseils ouvriers. Lorsque les syndicats ont terminé leur basse besogne, ils transmettent le pouvoir à l’Amiral Horty (plus tard un collaborateur des nazis) qui met en place un régime de terreur contre les travailleurs (8.000 exécutions, 100.000 déportations).
3. La paix n’existe pas au sein du capitalisme
Le capitalisme, c’est la violence, et la paix au sein du capitalisme est une illusion complète. L’histoire du 20e siècle démontre qu’un « armistice » est seulement conclu pour commencer une nouvelle guerre. Tandis que les armes ne se sont jamais tues entre la première et la deuxième guerre mondiale, cette tendance à la guerre permanente est devenue encore plus évidente après la seconde guerre mondiale. Ainsi la période de « guerre froide » n’était pas, contrairement à ce qui est souvent suggéré, une période de « simple » paix armée, mais bien de dizaines de confrontations (Corée, Vietnam, Moyen Orient, …) sur l’ensemble de la planète avec des millions de victimes.
Un vœux pieu de paix n’empêche pas la guerre, même s’il est soutenu par des manifestations massives. Ainsi, le 25 juillet 1914, le SPD appela à une manifestation de masse contre la guerre. L’appel fut massivement suivi : les 29 et 30 juillet, 750.000 personnes participent aux protestations dans toute l’Allemagne. Cela n’a pas amené la bourgeoisie à arrêter sa course vers la guerre. Bien au contraire, ce même SPD social-démocrate décida quelques jours plus tard de trahir les masses ouvrières et de soutenir la bourgeoisie dans sa ferveur guerrière.
Une manifestation de masse peut être un moment dans la résistance contre la guerre mais elle doit alors avoir lieu, dans le cadre d’une révolte ouvrière généralisée, dans une dynamique d’attaque contre l’Etat bourgeois, comme cela a eu lieu en 1917 en Russie. Et même en Allemagne en 1918, la révolte visait seulement en première instance la fin de la guerre. Et la guerre fut effectivement arrêtée parce qu’il existait une menace réelle que les travailleurs prennent le pouvoir. De fait, seuls un renversement révolutionnaire et la prise du pouvoir par la classe révolutionnaire peuvent mettre fin à toute forme de guerre n
« Ou bien le gouvernement bourgeois fait la paix, comme il a fait la guerre, et alors l’impérialisme continuera, comme après chaque guerre, à dominer et la guerre sera suivie d’un nouvel réarmement, de nouvelles guerres, de destruction, de réaction et de barbarie. Ou bien, vous devez réunir vos forces pour une insurrection révolutionnaire, vous battre pour acquérir le pouvoir politique qui vous permettra d’imposer la paix, à l’intérieur du pays comme autre part » (Rosa Luxemburg, Spartakusbriefe no. 4, avril 1917).
Dennis / 2018.10.11
Evènements historiques:
Récent et en cours:
Rubrique:
Internationalisme - 2019
- 96 lectures
Internationalisme n° 371 - 3e & 4e trimestre 2019
- 96 lectures
Sommaire:
- Face à la destruction de l'environnement: L'idéologie "verte" au service du capital
- Tensions Iran - Etats-Unis: Le capitalisme c'est le chaos et la barbarie !
- Le "droit" d'asile: Une arme pour dresser de smures contre les immigrés
- Ecolos/Groen et Vlaams Belang, les vainqueurs des élections: Les illusions dangereuses de l'idéologie verte et du populisme
Ecolo/Groen et Vlaams Belang, les vainqueurs des élections: Les illusions dangereuses de l'idéologie verte et du populisme
- 152 lectures
Les illusions dangereuses de l'idéologie verte et du populisme
Les élections du 26 mai ont eu lieu depuis un certain temps déjà mais le résultat continue à alimenter les discussions politiques. La distribution des cartes politiques en vue de la formation des gouvernements fédéral et régionaux révèle une situation compliquée pour la bourgeoisie mais la campagne électorale et les résultats lui fournissent aussi matière à déclencher des campagnes mystificatrices intenses dans la période à venir. En effet, malgré leurs positions apparemment radicalement opposées, les vainqueurs des élections, Ecolo/Groen en Wallonie et à Bruxelles et Vlaams Belang en Flandre, mettront plus que jamais en avant leurs chevaux de bataille: les efforts pour mettre en œuvre la transition écologique pour Ecolo/Groen et l’orientation "notre propre peuple d'abord" dans le cas du Vlaams Belang.
Ainsi, les deux courants fournissent au capitalisme précisément des cadres de référence qui permettent de tromper les travailleurs en leur présentant de fausses formes de solidarité, comme par exemple la solidarité avec sa propre région, son propre peuple ou encore avec ses propres exploiteurs afin de sauver la planète. Cet article veut dénoncer les dangereuses illusions propagées par les partis concernés, Ecolo/Groen et Vlaams Belang, et expliquer comment les travailleurs peuvent s'armer contre celles-ci et y répondre en développant une véritable solidarité qui transcende toutes les frontières de race, de religion ou de nationalité: la solidarité de classe prolétarienne.
Ecolo/Groen: Des sacrifices inévitables pour la transition écologique
L'un des grands gagnants des élections est en effet Ecolo/Groen. Pour ce parti, la protection de l'environnement est primordiale et l’axe politique prioritaire est la transition écologique. Mais comment entend-il y parvenir? Vise-t-il un véritable «changement de système», comme cela a été constamment scandé au printemps dernier lors des manifestations massives des jeunes contre le réchauffement climatique?
C'est une illusion de croire que des politiciens au sein d’institutions de l’État bourgeois puissent prendre des mesures fondamentales en faveur de la protection de la terre. «Cette sorte d’approche pour faire «pression» sur les gouvernements afin «qu’ils fassent quelque chose» est comme demander à un hacker de prendre soin de la sécurité informatique ou à un renard de prendre soin des poules» (Le capitalisme menace la planète et l’humanité. Seule la lutte internationale du prolétariat peut y mettre fin, Internationalisme 370).
A la «pression» des jeunes, la bourgeoisie a répondu - cynique comme elle est - par une enquête en ligne dans laquelle on demande à chaque citoyen comment il pense pouvoir contribuer à la réduction des émissions de CO2. Ainsi, chacun peut réfléchir par lui-même à comment il pense pouvoir réduire son empreinte écologique. De cette façon, le problème écologique devient celui du citoyen individuel et celui-ci est invité à supporter des coûts supplémentaires pour l'environnement. En outre, la classe dirigeante profite du sentiment de culpabilité instillé pour intensifier encore les attaques économiques au nom de la protection de l'environnement (via la fiscalité «verte»).
L'un des plans d'Ecolo/Groen est d’instituer une taxe générale sur le carbone. L'industrie lourde et les producteurs d'énergie sont déjà assujettis à un système européen obligatoire d'échange de quotas d'émission (SCEQE), en vertu duquel ils doivent acheter des quotas afin d'émettre du carbone. Si tous les autres secteurs qui émettent du CO2, comme les transports et l'agriculture, étaient également taxés avec une taxe carbone, cela représenterait plus de 2 milliards d'euros par an. Avec ces revenus, Ecolo/Groen pense pouvoir réaliser une partie de ses projets sans imposer des coûts supplémentaires aux citoyens. Comme si ces coûts pour les transporteurs ou les agriculteurs ne seraient pas payés directement (prix) ou indirectement (subventions publiques) par la population et donc principalement par les travailleurs!
Dans un rapport récent, le Bureau fédéral du Plan en Belgique a estimé les surcoûts pour la protection de l'environnement à 15 milliards d'euros jusqu'en 2030, et à 17 milliards d'euros pour la période 2030-2050. En outre, la Belgique est confrontée à la nécessité urgente de fermer ses centrales nucléaires et il est de notoriété publique qu'il y a un prix à payer pour cela: «Il sera déjà très difficile de compenser la fermeture des centrales nucléaires par des alternatives» (Thomas Wyns, expert climatique de la VUB). Si l’abandon du nucléaire est maintenu, des investissements substantiels seront également nécessaires pour mettre en place une production énergétique alternative à grande échelle.
Selon le gouvernement belge, des réductions de la consommation d'énergie ne peuvent aboutir à des économies de manière efficace. «Quoi qu'il en soit, le défi climatique exigera des efforts importants dans les décennies à venir, et cela coûtera de l'argent. Il n'y a pas de solution magique que personne ne sentira. (...) La transition énergétique coûtera de l'argent aux consommateurs», a déclaré la ministre de l'Énergie, Marie Christine Marghem à la Chambre des représentants, en réponse aux questions de la députée socialiste Karin Temmerman (SPa). Selon elle, la hausse actuelle des prix de l'électricité n'est qu'un avant-goût de ce qui se passera dans quelques années, lorsque les centrales nucléaires seront définitivement fermées.
Pour présenter la transition écologique comme une intervention presque indolore, les économistes progressistes en arrivent à recourir aux solutions les plus ridicules, comme l’idée d’imprimer plus de monnaie. Ecolo/Groen est bien conscient que les plans pour la protection de l'environnement naturel sont difficiles à faire avaler s'ils sont coûteux pour la population. Et les écologistes n’hésitent donc pas à saisir des deux mains l’issue qui leur est suggérée: «Pour sauver le climat, on doit juste imprimer de l'argent. C'est possible pour les banques, donc c'est certainement possible pour le climat» (Bart Staes, eurodéputé vert). Évidemment, ce que notre député vert cache pudiquement, c’est que le sauvetage des banques en 2008 a coûté dix années d’austérité supplémentaire et beaucoup de sacrifices pour la classe ouvrière.
C’est le capitalisme qui détruit la nature
La pollution de l'environnement et le réchauffement climatique ne sont pas fondamentalement causés par certains secteurs de l'industrie, par l'agriculture ou par les transports. Ils ne sont pas non plus occasionnés par le citoyen individuel, mais par le système existant: le capitalisme. C'est bien le mode de production dominant qui est à la base de la détérioration dramatique actuelle de notre cadre de vie. Le capitalisme, surtout dans la période de décadence, est devenu un véritable désastre pour l'humanité et pour tout ce que celle-ci a édifié au cours de l'histoire.
C'est parce que «le processus de la production capitaliste est dominé par le profit. Pour chaque capitaliste, la production n’a de sens et de but que si elle lui permet d’empocher tous les ans un «bénéfice net»… Mais la loi fondamentale de la production capitaliste…n’est pas simplement la poursuite d’un profit tangible, mais d’un profit toujours croissant….La plus grande partie du profit obtenu devient du capital nouveau et sert à élargir la production. Le capital s’amoncelle ainsi… et –condition première aussi bien que conséquence de l’exploitation- la production capitaliste s’élargit indéfiniment». ( Ce que les épigones de la théorie de Marx ont fait ; Critique des Critiques ; Chapitre I, Rosa Luxembourg). L'expansion et l'accumulation du capital, l'accumulation pour l'accumulation, sont les forces motrices du développement capitaliste. Pour ce besoin continu d'expansion et de production accrue, tout doit faire face et cela mène à une surexploitation sans précédent de la nature. Pour démarrer la production, il faut mobiliser la main-d'œuvre et les matières premières. Pour réaliser la production, le résidu doit être éliminé dans le sol, la mer ou l’air. Ce cycle sans fin ne peut être brisé que par la révolution mondiale de la classe ouvrière et l’édification d'une société dans laquelle seules des valeurs d'usage sont produites pour les besoins sociaux de l’humanité.
Quelle est la position d’Ecolo/Groen sur cette question? Le discours est radical, évoquant la nécessité d'une «rupture avec le modèle productiviste, consumériste et capitaliste» («Autrement, ensemble, pour tous!» 27-01-2015). Un représentant au parlement de la région bruxelloise voit même en Ecolo un parti qui «remet fondamentalement en cause le système capitaliste» («Je suis absolument anticapitaliste», Kalvin Soiresse Njall, 29-04-2019). Mais le capitalisme en tant que mode de production est-il ici vraiment remis en question? Ne s'agit-il pas plutôt d’un radicalisme verbal visant à nous endormir avec de belles paroles? Quand Ecolo/Verts place le productivisme, le consumérisme et le capitalisme sur le même pied, il réduit au fond le capitalisme à rien de plus qu'une des manifestations du système existant, qui, lui, n’est pas remis en question. De cette façon, il est facile de lancer des déclarations ronflantes, mais qui sont en fait totalement creuses.
L'utilisation d'un tel langage radical permet à Ecolo/Groen de camoufler la dangereuse mystification qui vise à lier les travailleurs au système: dans le combat contre la crise climatique, le capitalisme pourrait apporter une solution à condition que des sacrifices communs soient réalisés. Il suffirait en effet de transformer l'économie capitaliste en économie verte. Mais l'économie capitaliste «verte» d’Ecolo/Groen est un leurre, qui n'arrêtera ni ne réduira la pollution mondiale croissante de la nature et le réchauffement climatique (1). Et quelles que soient les mesures prises - efficaces, moins efficaces ou totalement inutiles - la classe ouvrière paiera toujours la note. Affirmer que la transition écologique peut se faire sans sacrifices supplémentaires est pure affabulation.
Le PVDA/PTB (Parti des Travailleurs Belges) serait probablement pleinement d'accord avec cela. En effet, ce parti bourgeois de gauche soutient aussi que le capitalisme est la cause de l'attaque systématique contre la nature: «Le problème du climat est un problème du système, le système capitaliste (...) qui ne reconnaît que la loi du marché». (Mathilde El Bakri, députée de la PVDA/PTB de la Région bruxelloise ; 12-11-2018). Mais à lire la solution proposée par cette députée, cela ne semble soudain plus si radical: il suffirait que «l’actuel mode de pensée capitaliste soit remplacé par un mode de réflexion planifié» (Id.). Pas un mot sur une révolution mondiale, pas de destruction de l'État capitaliste, pas de dictature du prolétariat, mais simplement un changement dans le mode de pensée des planificateurs politiques, et qui sont-ils autres que le patronat et l'État capitaliste?
Le Vlaams Belang fait des émigrés les boucs émissaires pour la barbarie capitaliste
Un autre grand vainqueur des élections est le Vlaams Belang. La montée du Vlaams Belang à partir de 2014 sous la présidence de Tom van Grieken repose sur les mêmes piliers que ceux qui ont rendu possible la montée des différents partis populistes ailleurs en Europe: un repli sur le terrain nationaliste, voire régionaliste, à travers une campagne enragée contre les étrangers, le rejet des élites politiques corrompues et la prétendue défense du «propre peuple».
Cette orientation confirme ce qu'avançait Teun Pauwels en 2011, à savoir que le Vlaams Belang était devenu entre-temps quasiment «un prototype de parti populiste. Outre le nationalisme ethnique, la xénophobie, les valeurs éthiques conservatrices et l’approche «law and order», la rhétorique populiste antipolitique est également devenue l'une des composantes de son idéologie. Le parti prétend maintenant être le porte-parole de l'homme de la rue qui n'est plus écouté par la Rue de la Loi » (« Populisme en Flandre », Teun Pauwels, Société & Politique, septembre 2011).
Comme d'autres partis populistes, le Vlaams Belang n'est pas seulement radicalement contre les migrants mais il est aussi catégoriquement en faveur des «gens de chez nous ». Selon Tom van Grieken, nous devons fermer nos frontières, non pas en premier lieu «par haine pour les gens de l'extérieur de nos frontières, mais par amour pour les gens à l'intérieur de nos frontières». La migration constituerait une menace pour la prospérité de la Belgique, qui est le fruit du travail acharné des générations précédentes. Et cette prospérité doit être préservée. Car «nulle part ailleurs en Europe, un peuple ne permet que sa prospérité soit pillée à une telle échelle». (Wouter Vermeersch, tête de liste en Flandre occidentale).
Le Vlaams Belang prétend s’engager énergiquement pour défendre activement les intérêts matériels (économiques) des «gens de chez nous». «Ce gouvernement dépense 7 milliards par an pour de nouveaux arrivants des quatre coins du monde, mais laisse crever ceux à qui nous devons notre système de sécurité sociale» (Tom van Grieken). Le programme électoral du Vlaams Belang prévoit désormais une pension minimale de 1.500 euros, une réduction de la TVA sur l'électricité de 21 à 6% et une augmentation du revenu mensuel de 125 euros net par personne. En outre, il souhaite ramener l'âge de la retraite à 65 ans et accorder une pension après une carrière complète de 40 ans.
L’impact financier des plans du Vlaams Belang a également été calculé par le bureau du Plan. Au total, ces plans coûteraient plus de 10 milliards d'euros, avec pour résultat que la dette publique (états fédéraux et régionaux réunis) augmenterait de 8,7 %. La dette publique représente actuellement déjà 104% du produit intérieur brut (PIB), ce qui fait de la Belgique l'un des rares pays d'Europe occidentale à avoir une dette publique supérieure à 100% (seulement 53% du PIB aux Pays-Bas). Il semble donc que le Vlaams Belang promet des châteaux en Espagne car les plans proposés, tout comme ceux du gouvernement populiste italien (2), sont largement trop coûteux et donc irréalisables.
Selon le Vlaams Belang, «l'ouverture des frontières et la sécurité sociale ne vont pas de pair » (Tom van Grieken). Et comme, pour le Vlaams Belang, la sécurité sociale des «gens de chez nous» est une exigence fondamentale, c’est aux émigrés d’en payer le prix. Les nouveaux émigrés ne pourront plus accéder automatiquement à la sécurité sociale. Le Vlaams Belang propose de créer une caisse de sécurité sociale distincte pour la «sous-classe» des migrants. Ces personnes devraient alors verser leurs cotisations de sécurité sociale dans un fonds distinct et ne recevoir après un certain temps leurs allocations que de ce fonds. S'il y a moins de cotisations sociales qui rentrent dans la caisse, tout le monde recevra automatiquement une allocation inférieure.
Afin de pouvoir réaliser son programme socio-économique pour «les gens de chez nous», les étrangers «illégaux» et les nouveaux arrivants doivent en fait se voir refuser l'accès à la «sécurité sociale». Après que la N-VA a présenté un projet visant à déplacer la décision concernant les migrants du niveau fédéral vers le niveau des régions («La Flandre doit pouvoir choisir pour elle-même à qui et à combien de personnes nous accordons le droit de séjour»), le Vlaams Belang propose d’arrêter totalement l’immigration en Flandre pendant au moins dix ans. Selon le parti, cette mesure offrirait un «répit» (sic) pour édifier la Flandre de demain.
Le populisme flamand affiche la primauté de «son propre peuple»
Le précurseur du Vlaams Belang, le Vlaams Blok, a déjà été condamné par les tribunaux bourgeois en raison de ses déclarations xénophobes. En 2004, la Cour d'appel de Gand a statué que le Vlaams Blok est une association qui «incite sans cesse à la haine et à la discrimination». En effet, «les publications du Vlaams Blok montrent clairement qu'il utilise systématiquement le mécanisme du bouc émissaire pour attiser les sentiments de haine et de discrimination parmi la population» («Le Vlaams Blok incite à la xénophobie», Inge Ghijs, 22 avril 2004). Afin de ne pas se discréditer, les autres partis avaient déjà mis en place un «cordon sanitaire», ce qui ne les a pas empêchés d’œuvrer activement à la construction de la «Forteresse Europe» contre les réfugiés.
Or, l'immigration est aussi ancienne que l'humanité. Lors de la préhistoire, les gens étaient obligés de faire de grands voyages à la recherche de régions où ils pourraient subvenir à leurs besoins. L'immigration est également inextricablement liée aux temps modernes, ainsi qu'au capitalisme. Depuis l'introduction du système capitaliste au XVIe siècle, les gens des pays centraux d'Europe ont erré dans le monde entier, la période la plus importante étant celle des cent ans entre 1814 et 1914, où un total de 50 millions de personnes ont émigré vers le Nouveau Monde pour «tenter leur chance là-bas».
L'immigration est également une caractéristique de la classe ouvrière. L’ouvrier au sein du capitalisme est «obligé de se déplacer sans cesse, toujours à la recherche d’une occasion, d’un endroit pour vendre sa force de travail. Être un salarié implique d’être obligé de se déplacer sur de longues et de courtes distances, et même de se déplacer dans d’autres pays ou continents, partout où un ouvrier peut vendre sa force de travail… En d’autres termes: la classe ouvrière, de par la nature des conditions du capitalisme, est une classe de migrants» (CCI online- décembre 20: La migration économique et les réfugiés de guerre dans l’histoire du capitalisme).
Le projet du Vlaams Belang de fermer complètement la Flandre à l'afflux de migrants pendant dix ans est farfelu et tout aussi irréaliste que la suppression des frontières dans le cadre du capitalisme. Pour les gens en détresse (mortelle), aucune mer n'est trop haute et aucun désert trop large. Ils fuient vers une Europe sûre parce que leur terre natale est le théâtre d'une guerre sans merci entre les différentes puissances régionales et mondiales. Ils fuient vers le Nord parce que leur milieu de vie est devenu inhabitable en raison de l'avancée de la désertification, en grande partie causée par les émissions massives de CO2 dans les pays industrialisés.
La politique ségrégative du Vlaams Belang, la politique d'exclusion de tous ceux qui sont différents, vise également les «holebis » et les transsexuels parmi les «gens de chez nous». Mais au sommet de sa liste se trouvent les musulmans extrémistes, les «fruits pourris qui rendent Molenbeek misérable, qui ne sont là que pour profiter de la sécurité sociale et qui tentent d'imposer une forme extrême d'islam» (Tom van Grieken). Pour reprendre les termes du Vlaams Belang, il faut les «éliminer». L'exclusion des personnes dans le besoin, la politique du «chacun pour soi», stimulent la division et ne font qu'accroître la barbarie du capitalisme en déclin.
Cinquante ans après l'abolition de la ségrégation raciale dans les États du sud des États-Unis, trente ans après l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud, le Vlaams Belang envisage d'introduire une nouvelle ségrégation: celle entre autochtones et allochtones. Et comment en Flandre distinguer les étrangers des «gens de chez nous»? Pas en fonction de la couleur de la peau, puisqu'il n'y a pas que des flamands blancs mais aussi des flamands «colorés», sans parler de la «racaille» d'Europe de l'Est si méprisée par le Vlaams Belang? En obligeant les «vrais flamands» à arborer un Lion flamand sur leur col? Ou en démontrant des «racines flamandes pures» jusqu’à la troisième génération?
L'idéologie de l'exclusion, la recherche de boucs émissaires, la xénophobie sont les piliers de l'idéologie du Vlaams Belang. En réaction, les gauchistes (LSP, PVDA/PTB), se référant à la lutte antifasciste des années 1930 (3), tentent de nous mobiliser derrière des campagnes anti-populistes. Mais ces mouvements de protestation contre le Vlaams Belang n'ont qu'un seul but: dévier les travailleurs de leur propre terrain de classe pour mieux les lier à la défense de la démocratie, l'autre visage du même système d'exploitation de la nature, d'exclusion des «nouveaux venus» et d’attaques contre nos revenus qui ne cessent de diminuer.
L'impuissance de la bourgeoisie à apporter une solution
Immédiatement après les résultats des élections, divers partis ont souligné qu'il sera très difficile de démêler le nœud fédéral et que la formation du nouveau gouvernement sera ardue. «Après ce débat, j'ai le sentiment que la formation d'un gouvernement sera encore plus difficile qu'elle ne l'était déjà» (Carl Devos, Professeur de sciences politiques). «Celui qui arrive avec ce résultat à constituer un gouvernement belge qui correspond logiquement à ce qui a été voté en Flandre et en Wallonie, mérite le prix Nobel. C’est tout simplement impossible» (Bart de Wever N-VA). Dans la semaine qui a suivi les élections, des voix s’élevèrent pour réclamer de nouvelles élections.
Ces difficultés de la bourgeoisie ne profitent-elles pas à la classe ouvrière? Non! Dans la période actuelle de décomposition, les revers de la bourgeoisie ne signifient généralement rien de bon pour la classe ouvrière. Pour la seule raison que la bourgeoisie peut retourner les conséquences de cette décomposition, comme le chacun pour soi (4), contre les travailleurs. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il est important que la classe ouvrière suive de près les développements politiques de la classe dirigeante. De fait, elle doit contrer les efforts de la bourgeoisie pour la mobiliser derrière sa politique à travers les mystifications comme «les efforts nécessaires pour protéger le climat» (Ecolo/Groen) ou «la défense de la sécurité sociale pour les citoyens flamands» (Vlaams Belang).
En exacerbant les divergences de positions en son sein, la bourgeoisie cherche constamment à appâter la classe ouvrière pour l’inciter à choisir l’un ou l’autre camp bourgeois. Pour cette dernière, il est donc de la plus haute importance de démasquer les belles paroles et d'éviter ainsi de tomber dans le piège de la bourgeoisie. Il n'y a qu'une seule règle pour les travailleurs: ne pas se laisser entraîner sur un terrain bourgeois ou petit-bourgeois, mais rester sur leur propre terrain par la défense commune de leurs intérêts matériels et de leurs propres objectifs comme classe indépendante contre le capital. Ce n'est qu'ainsi que la classe ouvrière peut exprimer une véritable solidarité de classe contre toute forme de fausse solidarité des fractions bourgeoises.
Les vainqueurs des élections ne nous présentent pas seulement des plans qui ne peuvent pas être réalisés, ils essaient aussi d'entraîner les travailleurs dans de fausses formes de solidarité. Ecolo/Groen utilise la crise climatique pour pousser les travailleurs à exprimer, en tant que citoyen, leur solidarité avec leurs exploiteurs afin d'essayer «d'écologiser» l'économie. De même, le Vlaams Belang utilise la question de la «sécurité sociale» pour appeler tous les Flamands à exprimer leur solidarité avec les «gens de chez nous» contre les «étrangers» qui mettraient en danger ce système. Face à cela, il existe une solidarité inclusive totale, qui ne fait pas de distinction selon la race, la couleur, l'origine, etc., et ne connaît pas de frontières. Cette solidarité est exprimée par la classe ouvrière, la classe qui, sur la base de sa solidarité globale et internationale, met fin à toutes les classes.
Ces «solutions» alternatives se situent parfaitement dans la ligne de celles des partis traditionnels qui ont constitué les derniers gouvernements: les socialistes, les libéraux et les démocrates-chrétiens avec comme Premiers ministres du premier, le socialiste Di Rupo et du second, le libéral Michel, auquel participait aussi la N-VA. Ces derniers ont également encouragé la solidarité avec l'État national et réduit les dispositions sociales en excluant de plus en plus de catégories. En définitive, cela démontre fondamentalement l'incapacité de la bourgeoisie à résoudre les problèmes essentiels posés par le capitalisme.
Une grand partie des électeurs ont émis un vote rejet: «Tout est mieux que les partis qui ont gouverné précédemment», ont-ils pensé. Lors des prochaines années, ces mêmes personnes arriveront à la conclusion que le Vlaams Belang et Ecolo/Groen aussi ne peuvent pas changer la donne. Les élections ne modifient pas les problèmes fondamentaux du capitalisme (5). Pire: la voix des partis radicaux ne fonctionne que comme un exutoire. Cela souligne une fois de plus combien l'électeur atomisé, prisonnier de la logique démocratique (6), ne peut qu'exprimer le désespoir et l'impuissance.
Dennis /15.07.2019
Notes
(1) Écologie: piège, mystification et alternatives ( Internationalisme nr. 358 - 2e trimestre 2013).
(2) Le gouvernement italien veut injecter plus d'argent dans l'économie, par exemple par des réductions d'impôts, comme le suggère Salvini de Lega Nord, ou un revenu de base pour lequel Luigi Di Maio s’active. Mais aux yeux de Bruxelles, le gouvernement italien dépense beaucoup trop d'argent emprunté. Et comme il ne respecte pas les règles budgétaires et le plafond de la dette, la Commission européenne souhaite que des sanctions soient prononcées.
(3)Voir: «Existe-t-il un danger fasciste?» (Révolution Internationale –nr 429). Et aussi : "Journée de discussion été 2013: la perspective est-elle similaire à celle des années 1930? (Internationalisme n° 360 - 1er trimestre 2014).
(4) Dans la phase de décomposition, à la suite du blocage de la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat, la société capitaliste transpire de tous ses pores : «la marginalisation, l'atomisation des individus, la destruction des rapports familiaux, l'exclusion des personnes âgées, l'anéantissement de l'affectivité et son remplacement par la pornographie…. En bref : l'anéantissement de tout principe de vie collective au sein d'une société qui se trouve privée du moindre projet, de la moindre perspective ».Voir : «thèses: la décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste» (CCI :online)
(5) Lire “Les élections sont un piège pour la classe ouvrière ” (Révolution Internationale nr. 433 - juni 2012).
Aussi: “ L'avenir n'est pas dans le bulletin de vote mais dans la lutte de classe” (Internationalisme nr. 331, april- juni 2007).
Ainsi que: “Élections et démocratie: l’avenir de l’humanité ne passe pas par les urnes” (Révolution Internationale nr. 463, mars-avril 2017).
(6) Tout seul dans l'isoloir, le citoyen est confronté au choix de quelque chose de totalement abstrait, de tout à fait en dehors de sa vie quotidienne. " les exploités n’ont rien à gagner en participant au grand cirque électoral où chacun d’entre nous se retrouve atomisé, impuissant, isolé... précisément dans l’isoloir." ("Élections présidentielles: Quelles leçons pour les travailleurs?" Révolution Internationale n ° 432, mai 2012)