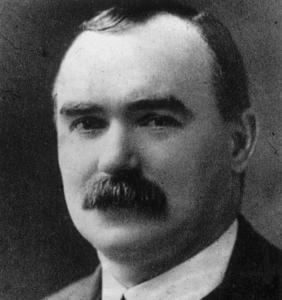Revue Internationale n°157
- 2022 lectures
L'été 2016 a été marqué par des signes d’instabilité croissante et imprévisible à l'échelle mondiale, ce qui confirme que la classe capitaliste rencontre des difficultés croissantes pour se présenter comme le garant de l'ordre et du contrôle politique. Le coup d'État manqué en Turquie et la vague de répression qui s’est ensuivie, une place stratégique vital dans l'arène impérialiste mondiale ; le contrecoup du chaos au Moyen-Orient sous la forme d'attentats terroristes en Allemagne et en France ; les secousses politiques intenses provoquées par le résultat du référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne et les perspectives épouvantables qui se dessinent avec la candidature présidentielle de Trump aux États-Unis : tous ces phénomènes, pleins de dangers pour la classe dominante, ne sont pas moins menaçants pour la classe ouvrière et ils constituent un défi majeur pour les minorités révolutionnaires dans notre classe afin de développer une analyse cohérente capable de balayer le brouillard idéologique obscurcissant ces événements.
Il n’est pas possible, dans ce numéro de la Revue internationale, de couvrir tous les éléments de la situation mondiale. En ce qui concerne le coup d'État en Turquie, en particulier, nous voulons prendre le temps de discuter de ses implications et de travailler sur un cadre d’analyse clair. Pour le moment, nous avons l'intention de nous concentrer sur une série de questions qui nous semblent être encore plus urgentes à clarifier : les implications du "Brexit" et de la candidature Trump ; la situation nationale en Allemagne, en particulier les problèmes créés par la crise européenne des réfugiés; et le phénomène social commun à tous ces développements : la montée du populisme.
Nous avons-nous-même pris du retard à reconnaître la signification du mouvement populiste. C'est pourquoi le texte sur le populisme présenté dans ce numéro est une contribution individuelle, écrite pour stimuler la réflexion et la discussion dans le CCI (et au-delà nous espérons). Il fait valoir que le populisme est le produit d'une impasse qui se trouve au cœur de la société ; même si l'État bourgeois produit des fractions et des partis qui tentent de chevaucher ce tigre, le résultat du référendum sur l'Union Européenne au Royaume-Uni et l'ascension de Trump dans le Parti républicain aux États-Unis démontrent que ce n'est pas une mince affaire et que cela peut même aggraver les difficultés politiques de la classe dirigeante 1.
Le but de cet article sur le Brexit et les élections présidentielles aux États-Unis est d'appliquer les idées du texte sur le populisme à une situation concrète. Il veut aussi corriger une idée présente dans plusieurs articles publiés sur notre site que le référendum sur le Brexit constituerait quelque chose comme un succès pour la démocratie français 2 ou que la montée du populisme aujourd'hui "renforce la démocratie" 3.
Nous publions également un article historique sur la question nationale, en se concentrant sur le cas de l'Irlande 4. Nous les avons choisis non seulement à cause du centenaire de l’insurrection de Dublin en 1916, mais parce que cet événement (et l'histoire ultérieure de l'Armée Républicaine Irlandaise) a été l'un des premiers signes clairs que la classe ouvrière ne pouvait plus faire alliance avec des mouvements nationalistes ou intégrer des revendications "nationales" dans son programme ; et parce qu'aujourd'hui, face à une nouvelle vague de nationalisme dans les centres du système capitaliste, la nécessité pour les révolutionnaires d'affirmer que la classe ouvrière n'a pas de patrie est plus urgente que jamais. Comme le pose le rapport sur la situation nationale allemande, surmonter les limites de la nation est le défi impressionnant posé au prolétariat face au capitalisme mondialisé et aux fausses alternatives du populisme : "Aujourd’hui, avec la mondialisation contemporaine, une tendance historique objective du capitalisme décadent atteint son plein développement : chaque grève, chaque acte de résistance économique des ouvriers quelque part dans le monde, se trouvent immédiatement confrontés à l’ensemble du capital mondial, toujours prêt à retirer la production et l'investissement et à produire ailleurs. Pour le moment, le prolétariat international a été tout à fait incapable de trouver une réponse adéquate, ou même d'entrevoir à quoi pourrait ressembler une telle réponse. Nous ne savons pas s’il réussira à le faire finalement. Mais il parait clair que le développement dans cette direction prendrait beaucoup plus de temps que la transition des syndicats à la grève de masse. D’un côté, la situation du prolétariat dans les vieux pays centraux du capitalisme – ceux, comme l’Allemagne, au "sommet" de la hiérarchie économique – devrait devenir beaucoup plus dramatique qu'elle ne l'est aujourd’hui. D’un autre côté, le pas requis par la réalité objective - lutte de classe internationale consciente, la "grève de masse internationale" - est beaucoup plus exigeant que le pas des syndicats à la grève de masse dans un pays. Car il oblige la classe ouvrière à remettre en question, non seulement le corporatisme et le localisme, mais aussi les principales divisions de la société de classes, souvent vieilles de plusieurs siècles voire même de plusieurs millénaires, comme la nationalité, la culture ethnique, la race, la religion, le sexe, etc. C'est un pas beaucoup plus profond et plus politique".
CCI, août 2016
1 Maîtriser l'analyse du populisme est un objectif que se donne le CCI, et non pas quelque chose que nous aurions déjà pleinement réalisé. À titre d'exemple, nous pouvons citer quelques-unes des formulations dans l'article de titre actuel sur notre site Web, "UE, Brexit, populisme: contre le nationalisme sous toutes ses formes". Bien que l'article dénonce correctement le poison idéologique propagé par les partis populistes et démagogues, certains passages donnent l'impression que le phénomène du populisme est identique à ses expressions politiques les plus évidentes, et est donc quelque chose de totalement contrôlé par l'État capitaliste dans ses attaques idéologiques contre la classe ouvrière.
4 Un second article n'a pu, faute de place, être publié dans cette revue. Il peut néanmoins être lu dans la Revue internationale sur notre site.
Des revers pour la bourgeoisie qui ne présagent rien de bon pour le prolétariat
- 2943 lectures
Il y a plus de trente ans, dans les "Thèses sur la décomposition" (THESES : la décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste [4]) 1, nous avions dit que la bourgeoisie aurait de plus en plus de mal à contrôler les tendances centrifuges de son appareil politique. Le référendum sur le "Brexit" en Grande-Bretagne et la candidature de Donald Trump à la présidence des États-Unis en constituent une illustration. Dans les deux cas, des aventuriers politiques sans scrupules de la classe dominante se servent de la "révolte" populiste de ceux qui ont souffert le plus des bouleversements économiques des trente dernières années pour leur propre auto-glorification.
Le CCI n’a tenu compte que tardivement de la montée du populisme et de ses conséquences. C’est pourquoi nous publions maintenant un texte général sur le populisme 2 qui est toujours en cours de discussion au sein de l’organisation. L’article qui suit tente d’appliquer les principales idées de ce texte de discussion aux situations spécifiques de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Dans une situation mondiale en pleine évolution, il n’a aucune prétention à être exhaustif, mais nous espérons qu’il apportera matière à réflexion et à discussion ultérieure.
Le référendum qui devint incontrôlable
La perte de contrôle par la classe dominante n’a jamais été plus évidente que dans le spectacle de désordre chaotique que nous a offert le référendum sur l’Union européenne en Grande-Bretagne et ses suites. Jamais auparavant, la classe capitaliste britannique n’avait à ce point perdu le contrôle du processus démocratique, jamais auparavant ses intérêts vitaux n’ont été autant à la merci d’aventuriers comme Boris Johnson 3 ou Nigel Farage. 4
Le manque général de préparation aux conséquences d’un Brexit éventuel est une indication de la confusion au sein de la classe dominante britannique. Quelques heures seulement après l'annonce du résultat, les principaux porte-paroles du Leave devaient expliquer à leurs supporters que les 350 millions de livres sterling qu’ils avaient promis d’allouer au NHS 5 si le vote Brexit l’emportait –un chiffre placardé sur tous les autobus de leur campagne– n’étaient en fait qu’une sorte de "faute de frappe". Quelques jours plus tard, Farage a démissionné de son poste de dirigeant de UKIP, laissant tout le pétrin du Brexit entre les mains des autres Leavers ("Sortants") ; Guto Harri, ancien chef de la communication de Boris Johnson, déclarait qu’en fait, "le cœur (de Johnson) n’y était pas" (dans la campagne pour le Brexit), et il y a fort à croire que le soutien de Johnson au Brexit n’était qu’une manœuvre opportuniste et intéressée dans le but de booster sa tentative de s’emparer de la direction du Parti conservateur contre David Cameron ; Michael Gove 6, qui a géré la campagne de Johnson pendant le référendum et devait gérer ensuite sa campagne pour le poste de Premier Ministre (et par ailleurs avait plusieurs fois fait connaître son propre manque d’intérêt pour ce travail), a poignardé Johnson dans le dos, deux heures seulement avant l’échéance de dépôt des candidatures, en se présentant lui-même au prétexte que son ami de toujours, Johnson, n’avait pas les capacités pour remplir la fonction ; Andrea Leadsom 7 s’est lancée dans la course à la direction du Parti conservateur en tant que Leaver convaincue –alors qu’elle avait déclaré trois ans auparavant qu’une sortie de l’UE serait "un désastre" pour la Grande-Bretagne. Le mensonge, l’hypocrisie, la fourberie– rien de tout cela n’est nouveau dans l’appareil politique de la classe dominante, bien sûr. Mais ce qui frappe, au sein de la classe dominante la plus expérimentée du monde, est la perte de tout sens de l’État, de l’intérêt national historique qui prime sur l’ambition personnelle ou les petites rivalités de cliques. Pour trouver un épisode comparable dans la vie des classes dominantes anglaises, il faudrait remonter à la Guerre des Deux-Roses 8 (comme Shakespeare l’a dépeinte dans sa vie de Henry VI), le dernier souffle d’un ordre féodal décadent.
Le manque de préparation de la part du patronat financier et industriel aux conséquences d’une victoire du Leave est tout aussi frappant, surtout étant donné le nombre d'indications selon lesquelles le résultat serait "la chose la plus incertaine qu’on aurait jamais vu de sa vie" (si on peut se permettre de citer le Duc de Wellington après la bataille de Waterloo) 9. L’effondrement de 20 %, puis de 30 %, de la livre sterling par rapport au dollar montre que le résultat "Brexit" n’était pas attendu –et n'avait pas affecté le cours de la livre avant le référendum. On nous a servi le spectacle peu édifiant d’une ruée vers la sortie de la part de banques et d’entreprises cherchant à s’installer, ou carrément déménager, à Dublin ou Paris. La décision rapide de George Osborne 10 de réduire la taxe sur les entreprises à 15 % est clairement une mesure d’urgence pour retenir les entreprises en Grande-Bretagne, dont l’économie est l’une des plus dépendantes du monde des investissements étrangers.
L'Empire contre-attaque
Tout cela étant dit, la classe dominante britannique n’est pas KO. Le remplacement immédiat de Cameron au poste de Premier Ministre (ce qui n’était pas, à l’origine, prévu avant septembre) par Theresa May –une politicienne solide et compétente qui avait fait campagne discrètement pour le Remain ("Rester")– et la démolition par la presse et par les députés conservateurs de ses rivaux, Gove et Leadsom, démontre une capacité réelle de réagir rapidement et de manière cohérente de la part de fractions étatiques dominantes de la bourgeoisie.
Fondamentalement, cette situation est déterminée par l’évolution du capitalisme mondial et par le rapport de forces entre les classes. Elle est le produit d'une dynamique plus générale vers la déstabilisation des politiques bourgeoises cohérentes dans la phase actuelle du capitalisme décadent. Les forces motrices derrière cette tendance vers le populisme ne font pas l'objet de cet article : elles sont analysées dans la "Contribution sur la question du populisme" mentionnée plus haut. Mais ces phénomènes généraux prennent une forme concrète sous l’influence d’une histoire et de caractéristiques nationales spécifiques. De fait, le Parti conservateur a toujours eu une aile "eurosceptique" qui n’a jamais vraiment accepté l’appartenance de la Grande-Bretagne à l’UE et dont les origines peuvent se définir comme suit :
La position géographique de la Grande-Bretagne (et de l’Angleterre avant elle) au large des côtes européennes a toujours fait que la Grande-Bretagne a pu se tenir à distance des rivalités européennes d’une façon qui n’était pas possible pour les États continentaux ; sa taille relativement petite, son inexistence en tant que puissance militaire terrestre, ont fait qu’elle n’a jamais pu espérer dominer l’Europe, comme l’a fait la France jusqu’au XIXe siècle ou l’Allemagne depuis 1870, mais ne pouvait défendre ses intérêts vitaux qu’en jouant les principales puissances les unes contre les autres et en évitant tout engagement auprès d'aucune d’entre elles.
La situation géographique de l'île et son statut de première nation industrielle du monde ont déterminé la montée de la Grande-Bretagne comme impérialisme mondial maritime. Depuis le XVIIe siècle au moins, les classes dominantes britanniques ont développé une vision mondiale qui, encore une fois, leur permet de garder une certaine distance par rapport à la politique purement européenne.
Cette situation changea radicalement suite à la Seconde Guerre mondiale, d’abord parce que la Grande-Bretagne ne pouvait plus maintenir son statut de puissance mondiale dominante, ensuite parce que la technologie militaire (forces aériennes, missiles à longue portée, armes nucléaires) faisait que l’isolement vis-à-vis de la politique européenne n’était plus possible. L’un des premiers à reconnaître ce changement de situation fut Winston Churchill qui, en 1946, appela à la formation des "États-Unis d’Europe", mais sa position n’a jamais été réellement acceptée au sein du Parti conservateur. L’opposition à l’appartenance à l’UE 11 est allée en grandissant au fur et à mesure que l’Allemagne s’est renforcée, surtout depuis que l’effondrement de l’URSS et la réunification allemande en 1990 ont augmenté de façon considérable le poids de l’Allemagne en Europe. Pendant la campagne du référendum, Boris Johnson a fait scandale en comparant la domination allemande au projet hitlérien, mais cela n’avait rien d’original. Les mêmes sentiments, pratiquement avec les mêmes mots, furent exprimés en 1990 par Nicholas Ridley, alors ministre du gouvernement Thatcher. C’est un signe de la perte d’autorité et de discipline dans l’appareil politique d’après-guerre : alors que Ridley fut contraint de quitter immédiatement le gouvernement, Johnson, lui, est devenu membre du nouveau cabinet.
L’ancien statut de première puissance mondiale de la Grande-Bretagne –et la perte de celui-ci– a un impact psychologique et culturel profondément ancré dans la population britannique (y compris dans la classe ouvrière). L’obsession nationale vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale –la dernière fois que la Grande-Bretagne a pu donner l’impression d’agir comme puissance mondiale indépendante– l’illustre à la perfection. Une partie de la bourgeoisie britannique et, encore plus, de la petite-bourgeoisie, n’a toujours pas compris que le pays n’est aujourd’hui qu’une puissance de deuxième, voire de troisième ordre. Beaucoup de ceux qui ont fait campagne pour le Leave semblaient croire que, si la Grande-Bretagne était libérée des "chaînes" de l’UE, le monde entier accourrait acheter des marchandises et des services britanniques –un fantasme qui risque de coûter fort cher à l’économie du pays.
Ce ressentiment et cette colère contre le monde extérieur du fait de la perte de ce statut de puissance impériale sont comparables au sentiment d’une partie de la population américaine face à ce qu’elle perçoit aussi comme la perte de statut des États-Unis (un thème constant des appels de Donald Trump à "faire en sorte que l’Amérique soit de nouveau grande") et leur incapacité à imposer leur domination comme ils ont pu le faire pendant la Guerre froide.
Le référendum : une concession au populisme
Boris Johnson et ses bouffonneries populistes ont été plus spectaculaires, et plus médiatisées, que le personnage de David Cameron, "vieille école", issu de la haute société et "responsable". Mais, en réalité, Cameron est une meilleure indication du degré auquel la désagrégation affecte la classe dominante. Johnson a pu être le principal acteur, mais c’est Cameron qui a fait la mise en scène en utilisant la promesse d’un référendum au profit de son parti, pour gagner les dernières élections parlementaires de 2015. De par sa nature, un référendum est plus difficile à contrôler qu’une élection parlementaire : de ce fait il constitue toujours un pari. 12 Comme un joueur pathologique de casino, Cameron s’est montré parieur récidiviste, d’abord avec le référendum sur l’indépendance écossaise (qu’il a gagné de justesse en 2014), ensuite avec celui sur le Brexit. Son parti, le Parti conservateur, qui s’est toujours présenté comme le meilleur défenseur de l’économie, de l’Union 13 et de la défense nationale, a fini par mettre les trois éléments en péril.
Étant donné la difficulté à manipuler les résultats, les plébiscites sur des questions qui concernent des intérêts nationaux importants représentent en général un risque inacceptable pour la classe dominante. Selon la conception et l’idéologie classiques de la démocratie parlementaire, même sous sa forme décadente de faux-semblant, de telles décisions sont censées être prises par des "représentants élus", conseillés (et mis sous pression) par des experts et des groupes d’intérêts –et non pas par la population dans son ensemble. Du point de vue de la bourgeoisie, c’est une pure aberration de demander à des millions de personnes de décider de questions complexes, telles le Traité constitutionnel de l’UE de 2004, alors que la masse des électeurs ne voulait, voire ne pouvait, ni lire ni comprendre le texte du traité. Pas étonnant alors que la classe dominante ait si souvent obtenu le "mauvais" résultat dans les référendums à propos de tels traités (en France et aux Pays-Bas en 2005, en Irlande au premier referendum sur le Traité de Lisbonne en 2008). 14
Au sein de la bourgeoisie britannique, il y a ceux qui semblent espérer que le gouvernement May réussira le même coup que les gouvernements français et irlandais après leur référendum raté à propos des traités constitutionnels, et qu’il pourra tout simplement ignorer ou contourner le résultat du référendum. Cela nous semble improbable, du moins à court terme, non pas que la bourgeoisie britannique soit plus ardente "démocrate" que ses comparses mais, justement, parce qu’elle a compris que le fait d’ignorer l’expression "démocratique" de la "volonté du peuple" ne fait qu’accréditer les thèses populistes et les rend plus dangereuses.
La stratégie de Theresa May jusqu'ici a donc été de faire contre mauvaise fortune bon cœur en empruntant le chemin du Brexit et en attribuant à trois des Leavers les plus connus la responsabilité de ministères en charge de la tâche complexe du désengagement de la Grande-Bretagne de l'UE. Même la nomination du clown Johnson comme Ministre des Affaires étrangères –accueillie à l’étranger avec un mélange d’horreur, d’hilarité et d’incrédulité– fait sans doute partie de cette stratégie plus vaste. En mettant Johnson sur la sellette des négociations pour quitter l’UE, May s’assure que la "grande gueule" des Leavers soit discréditée par les conditions probablement très défavorables, et qu’il ne puisse jouer le franc-tireur depuis la ligne de touche.
La perception, en particulier de la part de ceux qui votent pour les mouvements populistes en Europe ou aux États-Unis, selon laquelle tout le processus démocratique est une "arnaque" parce que l’élite ne tient pas compte des résultats inopportuns, constitue une vraie menace pour l’efficacité de la démocratie elle-même comme système de domination de classe. Dans la conception populiste de la politique, "la prise de décision directement par le peuple lui-même" est censée contourner la corruption des représentants élus par les élites politiques établies. C’est pourquoi en Allemagne de tels référendums sont exclus par la constitution d’après-guerre, suite à l’expérience négative de la République de Weimar et à leur utilisation dans l’Allemagne nazie. 15
L’élection sortie de piste
Si le Brexit a été un référendum hors de contrôle, la sélection de Trump comme candidat aux présidentielles américaines de 2016 est une élection "sortie de piste". Au départ, personne n’avait pris sa candidature au sérieux : le favori était Jeb Bush, membre de la dynastie Bush, choix préféré des notables républicains et, en tant que tel, capable d’attirer des soutiens financiers importants (ce qui est toujours une considération cruciale dans les élections américaines). Mais, contre toute attente, Trump a triomphé dans les premières primaires et a gagné État après État. Bush s’est éteint comme un pétard mouillé, les autres candidats n’ont jamais été plus que des outsiders et les chefs du Parti républicain se sont trouvés confrontés à la réalité désagréable que le seul candidat ayant une chance de battre Trump était Ted Cruz, un homme considéré par ses collègues au Sénat comme aucunement digne de confiance, uniquement un peu moins égoïste et intéressé que Trump lui-même.
La possibilité que Trump batte Clinton est en soi un signe du degré auquel la situation politique est devenue insensée. Mais déjà sa candidature a répandu une onde de choc à travers tout le système d’alliances impérialistes. Depuis 70 ans, les États-Unis ont été les garants de l’alliance de l’OTAN dont l’efficacité dépend de l’inviolabilité du principe de défense réciproque : une attaque contre l’un est une attaque contre tous. Quand un président américain en puissance met en question l’Alliance nord-atlantique ainsi que la volonté des États-Unis d’honorer ses obligations d’allié –comme Trump l’a fait en déclarant qu’une réponse américaine à une attaque russe contre les États baltes dépendrait, à son avis, du fait que ces derniers aient "payé leur ticket d’entrée"– cela donne froid dans le dos à toutes les bourgeoisies est-européennes directement confrontées à l’État mafieux de Poutine, sans parler des pays asiatiques (le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, les Philippines) qui font confiance aux États-Unis pour les défendre contre le dragon chinois. Presque aussi alarmant est la forte possibilité que Trump ne sache tout simplement pas ce qui se passe, comme l’a suggéré son affirmation selon laquelle il n’y aurait pas de troupes russes en Ukraine (apparemment il ne sait pas que la Crimée est toujours officiellement considérée par tout le monde, sauf par les Russes, comme faisant partie de l’Ukraine).
Mieux encore, Trump a salué le fait que les services russes aient piraté les systèmes informatiques du Parti démocrate et a plus ou moins invité Poutine à faire pire. Il est difficile de dire si cela nuira à Trump, mais cela vaut la peine de rappeler que, depuis 1945, le Parti républicain est farouchement antirusse, est favorable à des forces armées puissantes et à une présence militaire massive à travers le monde, peu importe le coût (c’est l’augmentation colossale des dépenses militaires sous Reagan qui avait vraiment fait exploser le déficit budgétaire).
Ce n’est pas la première fois que le Parti républicain présente un candidat que sa direction considère comme dangereusement extrémiste. En 1964, Barry Goldwater gagna les primaires grâce au soutien de la droite religieuse et de la "coalition conservatrice" -précurseur du Tea Party actuel. À tout le moins son programme était cohérent : réduction drastique du champ d’action du gouvernement fédéral, en particulier de la sécurité sociale, puissance militaire et préparation si nécessaire à l’utilisation d’armes nucléaires contre l’URSS. C’était un programme classique très à droite mais qui ne correspondait pas du tout aux besoins du capitalisme d’État américain, et Goldwater finit par subir une défaite cuisante aux élections, en partie du fait que la hiérarchie du Parti républicain ne l’avait pas soutenu.Trump n’est-il qu’un Goldwater bis ? Pas du tout, et les différences sont instructives. La candidature de Goldwater représentait une prise en main du Parti républicain par le "Tea Party" de l‘époque ; celui-ci fut marginalisé pendant des années à la suite de la défaite électorale écrasante de Goldwater. Ce n’est un secret pour personne qu’au cours des deux dernières décennies, cette tendance a fait son retour et a fait une tentative plus ou moins réussie de prendre le contrôle du GOP 16. Cependant, ceux qui soutenaient Goldwater étaient, dans le sens le plus vrai du terme, "une coalition conservatrice" ; ils représentaient une véritable tendance conservatrice aux États-Unis, dans une Amérique en train de connaître de profonds changements sociaux (le féminisme, le Mouvement pour les Droits civiques, le début d’une opposition à la guerre au Vietnam et l’effondrement des valeurs traditionnelles). Bien que beaucoup de "causes" du Tea Party soient les mêmes que celles de Goldwater, le contexte ne l’est pas : les changements sociaux auxquels Goldwater s’opposait ont eu lieu, et le Tea Party n’est pas tant une coalition de conservateurs qu’une alliance réactionnaire hystérique.
Ceci créé des difficultés croissantes pour la grande-bourgeoisie qui n’a cure de ces questions sociales et "culturelles" et, fondamentalement, a des intérêts dans la force militaire américaine et le libre commerce dont elle tire ses profits. C’est devenu un truisme de dire que quiconque se présente aux primaires républicaines doit s’avérer "irréprochable" sur toute une série de questions : l’avortement (il faut être "pour la vie"), le contrôle des armes (il faut être contre), le conservatisme fiscal et des impôts plus bas, contre l’Obamacare (c’est du socialisme, il doit être aboli : en fait, Ted Cruz avait justifié en partie sa candidature par le battage fait autour de son obstruction à l’Obamacare au Sénat), le mariage (une institution sacrée), contre le Parti démocrate (si Satan avait un parti, ce serait lui). Aujourd’hui, en l’espace de quelques mois, Trump a éviscéré le Parti républicain. C’est un candidat sur qui "on ne peut pas compter" concernant l’avortement, le contrôle des armes, le mariage (lui-même marié trois fois) et qui, dans le passé, a donné de l’argent au diable lui-même, Hillary Clinton. De plus, il propose d’augmenter le salaire minimum, veut maintenir au moins en partie l’Obamacare, veut revenir à une politique étrangère isolationniste, laisser le déficit budgétaire s’envoler et expulser 11 millions d’immigrants illégaux dont le travail bon marché est vital pour les affaires.
Comme les conservateurs en Grande-Bretagne avec le Brexit, le Parti républicain –et potentiellement toute la classe dominante américaine– s’est retrouvé avec un programme complètement irrationnel du point de vue des intérêts de classe impérialistes et économiques.
Les implications
La seule chose que nous pouvons affirmer avec certitude, c’est que le Brexit et la candidature de Trump ouvrent une période d’instabilité croissante à tous les niveaux : économique, politique et impérialiste. Sur le plan économique, les pays européens –qui représentent, ne l’oublions pas, une partie importante de l’économie mondiale et le plus grand marché unique– connaissent déjà une fragilité : ils ont résisté à la crise financière de 2007-08 et à la menace d’une sortie de la Grèce de la zone Euro, mais ils n’ont pas surmonté ces situations. La Grande-Bretagne reste l’une des principales économies européennes et le long processus pour se défaire de ses liens avec l’Union européenne contiendra beaucoup d’imprédictibilité, ne serait-ce que sur le plan financier : personne ne sait, par exemple, quel effet aura la Brexit sur la City de Londres, centre européen majeur pour les banques, les assurances et les actions boursières. Politiquement, le succès du Brexit ne peut qu’encourager et apporter plus de crédit aux partis populistes du continent européen : l’an prochain ont lieu les élections présidentielles en France où le Front national de Marine Le Pen, parti populiste et anti-européen, est maintenant le plus grand parti politique en termes de voix. Les gouvernements des principales puissances d’Europe sont partagés entre le désir que la séparation de la Grande-Bretagne se fasse en douceur et aussi facilement que possible, et la peur que toute concession à celle-ci (comme par exemple l’accès au marché unique en même temps que des restrictions sur le mouvement des populations) donne des idées à d’autres, notamment à la Pologne et à la Hongrie. Il est pratiquement certain que la tentative de stabiliser la frontière sud-est de l’Europe en intégrant des pays de l’ex-Yougoslavie va être stoppée. Ce sera plus difficile pour l’Union européenne de trouver une réponse unifiée au "coup d’État démocratique" d’Erdogan en Turquie et à son utilisation des réfugiés syriens comme pions dans un vil jeu de chantage.
Bien que l’Union européenne n’ait jamais été elle-même une alliance impérialiste, la plupart de ses membres sont également membres de l’OTAN. Tout affaiblissement de la cohésion européenne rend donc probable un effet destructeur sur la capacité de l’OTAN à contrer la pression russe sur son flanc oriental, déstabilisant encore plus l’Ukraine et les États baltes. Ce n’est un secret pour personne que la Russie finance depuis un certain temps le Front national en France et qu’elle utilise, sinon finance, le mouvement PEGIDA en Allemagne. Le seul qui sorte gagnant du Brexit est en fait Vladimir Poutine.
Comme on l’a dit plus haut, la candidature de Trump a déjà affaibli la crédibilité des États-Unis. L’idée de Trump comme président ayant le doigt posé sur le bouton nucléaire est, il faut le dire, une perspective effrayante 17. Mais comme nous l’avons dit de nombreuses fois, l’un des principaux éléments de la guerre et de l'instabilité aujourd’hui est la détermination des États-Unis à maintenir leur position impérialiste dominante contre tout nouveau venu, et cette situation restera inchangée quel que soit le président.
“Rage against the machine”18
Boris Johnson et Donald Trump ont plus en commun qu’une "grande gueule". Ce sont tous deux des aventuriers politiques, dénués de tout principe et de tout sens de l’intérêt national. Tous deux sont prêts à toutes les contorsions pour adapter leur message à ce que leur audience veut entendre. Leurs bouffonneries sont enflées par les médias jusqu’à ce qu’elles semblent plus vraies que nature mais, en réalité, ce sont des non-entités, rien que les porte-paroles au moyen desquels les perdants de la mondialisation hurlent leur rage, leur désespoir et leur haine des riches élites et des immigrants qu’ils tiennent pour les responsables de leur misère. C’est ainsi que Trump s’en tire avec les arguments les plus outrageux et contradictoires : ses supporters s’en fichent tout simplement, il dit ce qu’ils veulent entendre.
Cela ne veut pas dire que Johnson et Trump sont pareils, mais ce qui les distingue a moins à voir avec leur caractère personnel qu’avec les différences entre les classes dominantes auxquelles ils appartiennent : la bourgeoisie britannique a joué un rôle majeur sur la scène mondiale depuis des siècles tandis que la phase de "flibustier" égocentrique et effrontée de l’Amérique n’a véritablement pris fin qu’avec la défaite que Roosevelt a imposée aux isolationnistes et l’entrée dans la Seconde Guerre mondiale. Des fractions importantes de la classe dominante américaine restent profondément ignorantes du monde extérieur, sont dans un état, on est presque tenté de dire, d'adolescence attardée.
Les résultats électoraux ne seront jamais une expression de la conscience de classe, néanmoins ils peuvent nous donner des indications quant à l’état du prolétariat. Que ce soit le référendum sur le Brexit, le soutien à Trump aux États-Unis, au Front national de Marine Le Pen en France, ou aux populistes allemands de PEGIDA et d'Alternative für Deutschland, tous les chiffres concordent pour suggérer que là où ces partis et mouvements gagnent le soutien des ouvriers, c’est parmi ceux qui ont souffert le plus des changements opérés dans l’économie capitaliste au cours des quarante dernières années, et qui ont fini par conclure –de façon pas tout à fait déraisonnable après des années de défaites et d’attaques sans fin contre leurs conditions d’existence par des gouvernements de gauche comme de droite– que le seul moyen de faire peur à l’élite dirigeante est de voter pour des partis qui sont de toute évidence irresponsables, et dont la politique est un anathème pour cette même élite. La tragédie, c’est que ce sont précisément ces ouvriers qui ont été parmi les plus massivement engagés dans les luttes des années 1970.
Un thème commun aux campagnes du Brexit et de Trump est que "nous" pouvons "reprendre le contrôle". Peu importe que ce "nous" n’ait jamais eu de contrôle réel sur sa vie ; comme un habitant de Boston en Grande-Bretagne le disait : "nous voulons simplement que les choses redeviennent ce qu’elles étaient". Quand il y avait des emplois, et des emplois avec des salaires décents, quand la solidarité sociale dans les quartiers ouvriers n’avait pas été brisée par le chômage et l’abandon, quand le changement apparaissait comme quelque chose de positif et avait lieu à une vitesse raisonnable.
Sans aucun doute, il est vrai que le vote Brexit a provoqué une atmosphère nouvelle et déplaisante en Grande-Bretagne, dans laquelle les gens ouvertement racistes se sentent plus libres de sortir du bois. Mais beaucoup –probablement la grande majorité– de ceux qui ont voté Brexit ou Trump pour arrêter l’immigration ne sont pas franchement racistes, ils souffrent plutôt de xénophobie : peur de l'étranger, peur de l’inconnu. Et cet inconnu, c’est fondamentalement l’économie capitaliste elle-même, qui est mystérieuse et incompréhensible parce qu’elle présente les rapports sociaux dans le processus de production comme s’ils étaient des forces naturelles, aussi élémentaires et incontrôlables que le temps qu’il fait mais dont les effets sur la vie des ouvriers sont encore plus dévastateurs. C’est une ironie terrible, dans cette époque de découvertes scientifiques où plus personne ne pense que le mauvais temps est causé par des sorcières, que des gens soient prêts à croire que leurs malheurs économiques proviennent de leurs compagnons d'infortune que sont les immigrants.
Le danger qui est devant nous
Au début de cet article, nous nous sommes référés à nos "Thèses sur la décomposition", rédigées il y a pratiquement trente ans, en 1990. Nous conclurons en les citant :
"(…) il importe d'être particulièrement lucide sur le danger que représente la décomposition pour la capacité du prolétariat à se hisser à la hauteur de sa tâche historique (…)
Les différents éléments qui constituent la force du prolétariat se heurtent directement aux diverses facettes de cette décomposition idéologique :
l'action collective, la solidarité, trouvent en face d'elles l'atomisation, le "chacun pour soi", la "débrouille individuelle";
le besoin d'organisation se confronte à la décomposition sociale, à la déstructuration des rapports qui fondent toute vie en société;
la confiance dans l'avenir et en ses propres forces est en permanence sapée par le désespoir général qui envahit la société, par le nihilisme, par le "no future";
la conscience, la lucidité, la cohérence et l'unité de la pensée, le goût pour la théorie, doivent se frayer un chemin difficile au milieu de la fuite dans les chimères, la drogue, les sectes, le mysticisme, le rejet de la réflexion, la destruction de la pensée qui caractérisent notre époque."
Nous sommes concrètement face à ce danger aujourd’hui.
La montée du populisme est dangereuse pour la classe dominante parce qu’elle menace sa capacité à contrôler son appareil politique et à maintenir la mystification démocratique, qui est l’un des piliers de sa domination sociale. Mais elle n’offre rien au prolétariat. Au contraire, c’est précisément la faiblesse du prolétariat, son incapacité à offrir une autre perspective au chaos menaçant le capitalisme, qui a rendu possible la montée du populisme. Seul le prolétariat peut offrir une voie de sortie à l’impasse dans laquelle la société se trouve aujourd’hui et il ne sera pas capable de le faire si les ouvriers se laissent prendre par les chants de sirènes de démagogues populistes qui promettent un impossible retour à un passé qui, de toutes façons, n’a jamais existé.
Jens, août 2016.
1 Republiées en 2001 dans la Revue internationale n° 107
2Voir ce numéro de la Revue internationale.
3Boris Johnson, membre du Parti conservateur et ancien maire de Londres. Un des principaux porte-paroles du "Leave" (c’est-à-dire "quitter", dénomination de la campagne pour sortir de l’UE).
4Nigel Farage, dirigeant du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (United Kingdom Independence Party – UKIP). UKIP est un parti populiste fondé en 1991 et qui fait campagne principalement sur les thèmes de la sortie de l’UE et l’immigration. Paradoxalement, il a 22 membres au Parlement européen ce qui en fait le principal parti britannique représenté au Parlement.
5NHS : National Health Service – la sécurité sociale britannique.
6Membre du Parti conservateur et Ministre de la Justice dans le gouvernement Cameron.
7Membre du Parti conservateur et Ministre de l’Énergie dans le gouvernement Cameron. Aujourd’hui Secrétaire d’État à l’Environnement.
8Guerre civile entre clans aristocratiques de York et Lancastre pendant le XVe siècle en Angleterre.
9Il est vrai que le Trésor britannique et les instances de l’UE ont fait quelques efforts pour préparer un "Plan B” en cas de victoire du Brexit. Néanmoins, il est clair que ces préparatifs furent inadéquats et, surtout, que personne ne s’attendait à ce que le Leave gagne au référendum. Ceci était même vrai pour le camp du Leave lui-même. Il semblerait que Farage ait concédé la victoire au Remain à une heure la nuit du référendum, pour découvrir à son grand étonnement le matin suivant que le Remain avait perdu.
10Membre du Parti conservateur et Ministre des Finances dans le gouvernement Cameron.
11La Grande-Bretagne est entrée dans la Communauté économique européenne (CEE) sous un gouvernement conservateur en 1973. L’adhésion fut confirmée par un référendum appelé en 1975 par un gouvernement travailliste.
12Cela vaut la peine de rappeler que Margaret Thatcher est restée plus de dix ans au pouvoir sans avoir jamais gagné plus de 40 % des voix lors des élections parlementaires.
13C’est à dire l’Union, au sein du Royaume-Uni, de l’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord.
14 À la suite de résultats contraires à leur volonté, les gouvernements européens ont laissé tomber le Traité constitutionnel, tout en en gardant l’essentiel, en modifiant tout simplement les accords existants via le Traité de Lisbonne de 2007.
15Il faut ici faire une distinction concernant les référendums : dans des États comme la Suisse ou la Californie, ils font partie d’un processus historiquement établi.
16Grand Old Party (le "Grand Vieux Parti"), nom familier pour désigner le Parti républicain, remontant au XIXe siècle.
17 L’une des raisons de la défaite de Goldwater est qu’il avait déclaré être prêt à utiliser l’arme nucléaire. La campagne de Johnson en réponse au slogan de Goldwater : "In your heart, you know he’s right" ("Dans ton cœur, tu sais qu’il a raison") avait pour slogan : "In your guts, you know he’s nuts" ("Par instinct, tu sais qu’il est fou").
18 Groupe de rap américain connu pour ses prises de position anarchisantes et anti-capitaliste. Le titre est ironique.
Géographique:
- Grande-Bretagne [5]
Personnages:
- Donald Trump [6]
- Theresa May [7]
- Boris Johnson [8]
- Hillary Clinton [9]
- Michael Gove [10]
Récent et en cours:
- Brexit [11]
- Candidature Trump [12]
Questions théoriques:
- Populisme [13]
Rubrique:
Contribution sur le problème du populisme, juin 2016
- 1921 lectures
L'article qui suit est un document en cours de discussion dans le CCI, écrit en Juin de cette année, quelques semaines avant le référendum "Brexit" au Royaume-Uni. L'article Des revers pour la bourgeoisie qui ne présagent rien de bon pour le prolétariat [14] de ce numéro de la Revue est une tentative d'appliquer les idées présentées dans cet article aux situations concrètes posées par le résultat du référendum et par la candidature de Trump aux États-Unis.
Nous sommes actuellement les témoins d'une vague de populisme politique dans les vieux pays centraux du capitalisme. Dans des États où ce phénomène s’est développé depuis plus longtemps, comme en France ou en Suisse, les populistes de droite sont devenus le plus important parti politique au niveau électoral. Mais ce qui est plus frappant aujourd’hui est l'ancrage du populisme dans des pays qui, jusqu'à présent, étaient connus pour leur stabilité politique et l'efficacité de la classe dominante : les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Dans ces pays, ce n'est que très récemment que le populisme a réussi à avoir un impact direct et sérieux.
Le surgissement actuel du populisme
Aux États Unis, l'appareil politique a initialement fortement sous-estimé la candidature de Donald Trump aux élections présidentielles pour le Parti républicain. Sa candidature a, au départ, rencontré une opposition plus ou moins ouverte de la part de la hiérarchie de l'appareil du parti et de la droite religieuse. Tous ont été pris de court par le soutien populaire qu'il a reçu à la fois dans la Bible Belt (zones des États-Unis et du Canada dans lesquelles le fondamentalisme protestant est largement répandu) et dans les vieux centres industriels urbains, en particulier de la part de parties de la classe ouvrière "blanche". La campagne médiatique qui s’est ensuivie, menée entre autres par le Wall Street Journal et les oligarchies médiatiques et financières de la côte Est, et qui avait pour dessein de réduire le succès de Trump, n'a fait qu'augmenter sa popularité. La ruine partielle de couches importantes des classes moyennes et aussi ouvrière, dont beaucoup ont perdu leurs économies et même leurs maisons lors des crashs financiers et immobiliers de 2007-2008, a provoqué l'indignation contre le vieil appareil politique qui était intervenu rapidement pour sauver le secteur bancaire, abandonnant à leur destin les petits épargnants qui avaient essayé de devenir propriétaires de leur logement.
Les promesses faites par Trump de soutenir les petits épargnants, de maintenir les services de santé, de taxer la bourse et les grandes entreprises financières et d’empêcher l’immigration que des parties de la population pauvre redoutent, voyant dans les immigrés des concurrents potentiels, ont trouvé un écho à la fois chez les fondamentalistes religieux chrétiens et, plus à gauche, chez des électeurs traditionnellement démocrates qui, il y a quelques années à peine, n'auraient jamais imaginé voter pour un tel homme politique.
Presque un demi-siècle de "réformisme" politique bourgeois, au cours duquel les candidats de gauche - au niveau national, municipal ou local, dans les partis ou dans les syndicats - ont été élus sur leurs prétentions de défendre les intérêts des travailleurs et ont à la place toujours défendu ceux du capital, a préparé le terrain pour que "l'homme de la rue", comme on dit en Amérique, envisage de soutenir un multimillionnaire comme Trump, avec le sentiment que lui, au moins, ne peut pas être "acheté" par la classe dominante.
En Grande Bretagne, la principale expression du populisme pour le moment ne semble s’incarner ni dans un candidat particulier, ni dans un parti politique (bien que le UKIP de Nigel Farage soit devenu un acteur majeur sur la scène politique), mais dans la popularité de la proposition de quitter l'Union Européenne et de le décider par referendum. Le fait que la plus grande partie du courant dominant du monde des finances (City of London) et de l'industrie britannique s’y oppose, a, dans ce cas aussi, tendu à accroître la popularité du "Brexit" dans des parties importantes de la population. L’un des moteurs de ce courant d'opposition, en plus du fait qu’il représente les intérêts particuliers de certaines parties de la classe dominante plus étroitement liées aux anciennes colonies (le Commonwealth) qu'à l'Europe continentale, semble être qu’il marche sur les plates-bandes des nouveaux mouvements populistes de droite. Peut-être que des gens comme Boris Johnson et autres défenseurs du "Brexit" dans le Parti conservateur seront, dans le cas d’un "exit", ceux qui auront à sauver ce qui peut être sauvé en tentant de négocier une sorte de statut d'association étroite avec l'Union Européenne, probablement sur le type de celui de la Suisse (qui adopte en général la réglementation de l'UE sans avoir son mot à dire dans sa formulation).
En Allemagne où, après la Deuxième Guerre mondiale, la bourgeoisie a toujours réussi jusqu'à présent à empêcher l'établissement de partis parlementaires à la droite de la Démocratie Chrétienne, un nouveau mouvement populiste est apparu sur la scène, à la fois dans la rue (Pegida) et au niveau électoral (Alternative für Deutschland) non pas en réponse à la crise "financière" de 2007/08 (dont l'Allemagne est sortie relativement indemne) mais à la suite de la "crise de l'Euro" qu’une partie de la population a appréhendée comme une menace directe envers la stabilité de la monnaie européenne commune et donc pour l’épargne de millions de gens.
Mais à peine cette crise était-elle désamorcée, au moins pour le moment, qu’a eu lieu une arrivée massive de réfugiés, provoquée en particulier par la guerre civile et impérialiste en Syrie et par le conflit avec l'État Islamique au nord de l'Irak. Cette situation a redonné de l’élan à un mouvement populiste qui commençait à faiblir. Bien qu'une majorité importante de la population soutienne encore la Wilkommenskultur ("culture de l'accueil") de la chancelière Merkel et de beaucoup de leaders de l'économie allemande, les attaques contre les asiles pour réfugiés se sont multipliées dans beaucoup d'endroits en Allemagne, tandis que dans des parties de l'ancienne RDA, un véritable esprit de pogrom s'est développé.
Le point atteint par la montée du populisme, en lien avec le discrédit du système politique des partis établis est illustré par les dernières élections présidentielles en Autriche, dont le deuxième tour a mis en présence un candidat des Verts et un de la droite populiste, tandis que les principaux partis, les sociaux-démocrates et les démocrates-chrétiens, qui ont régné sur le pays depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont subi tous deux une débâcle électorale sans précédent.
A la suite des élections en Autriche, les observateurs politiques en Allemagne ont conclu que poursuivre la coalition actuelle entre démocrates-chrétiens et sociaux-démocrates à Berlin après les prochaines élections générales favoriserait probablement encore plus la montée du populisme. De toute façon, que ce soit à travers la Grande Coalition entre droite et gauche (ou la "cohabitation" comme en France), ou à travers l'alternance entre gouvernements de gauche et de droite, après presqu'un demi-siècle de crise économique chronique et environ 30 ans de décomposition du capitalisme, de grandes parties de la population ne croient plus qu'il y ait une différence significative entre les partis établis de gauche et de droite. Au contraire, ces partis sont vus comme une sorte de cartel qui défend ses propres intérêts, et ceux des très riches, aux dépens de ceux de l’ensemble de la population et de ceux de l'État. Comme la classe ouvrière, après 1968, n'a pas réussi à politiser ses luttes et à effectuer des avancées significatives dans le développement de sa propre perspective révolutionnaire, aujourd’hui cette désillusion attise surtout les flammes du populisme.
Dans les pays industrialisés occidentaux, en particulier après le 11 septembre aux États-Unis, le terrorisme islamiste est devenu un autre facteur d’accélération du populisme. À l’heure actuelle, cela pose un problème à la bourgeoisie, en particulier en France qui est une nouvelle fois devenue la cible de ce type d’attaques. L’un des motifs de l’État d’urgence et du langage guerrier tenu par François Hollande est la nécessité de contrer la montée continue du Front national après les récentes attaques terroristes ; le président français a cherché à se présenter comme le leader d’une coalition internationale présumée contre l’État islamique. La perte de confiance de la population dans la détermination et la capacité de la classe dominante à protéger ses citoyens sur le plan sécuritaire (et pas seulement économique) est l’une des causes de la vague actuelle de populisme.
Les racines du populisme de droite contemporain sont donc multiples et varient d’un pays à l’autre. Dans les anciens pays staliniens d’Europe de l’Est, il semble lié à l’arriération et à l’esprit de clocher de la vie politique et économique sous les régimes précédents, ainsi qu’à la brutalité traumatisante du passage à un style de vie capitaliste occidental plus efficace après 1989.
Dans un pays aussi important que la Pologne, la droite populiste est déjà au gouvernement, tandis qu’en Hongrie (un des centres de la première vague révolutionnaire du prolétariat en 1917-23), le régime de Viktor Orbán pousse plus ou moins à des attaques pogromistes et les protège.
Plus généralement, les réactions contre la "mondialisation" constituent un facteur majeur de la montée du populisme. En Europe occidentale, la mauvaise humeur "contre Bruxelles" et l’Union européenne constitue depuis longtemps l’aliment de base de ces mouvements. Mais aujourd’hui, la même atmosphère s’exprime aux États-Unis où Trump n’est pas le seul politicien qui menace d’abandonner les accords commerciaux de libre échange TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) en cours de négociation entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Il ne faut pas confondre cette réaction à la "mondialisation" avec ce que proposent des représentants de gauche comme ATTAC qui demandent une sorte de correctif néo-keynésien aux excès (réels) du néo-libéralisme. Alors que ces derniers avancent une politique économique alternative cohérente et responsable pour le capital national, la critique des populistes représente plus une sorte de vandalisme politique et économique du type de ce qui s’était déjà en partie manifesté lors du rejet du Traité de Maastricht lors des référendums en France, aux Pays-Bas et en Irlande.
La possibilité de participation au gouvernement du populisme contemporain et le rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat
Les partis populistes sont des fractions bourgeoises, des parties de l'appareil capitaliste d'État totalitaire. Ce qu'ils répandent, c'est l'idéologie et le comportement bourgeois et petit-bourgeois, le nationalisme, le racisme, la xénophobie, l'autoritarisme, le conservatisme culturel. Comme tels, ils représentent un renforcement de la domination de la classe dominante et de son État sur la société. Ils élargissent le champ du système des partis de la démocratie et augmentent sa puissance de feu idéologique. Ils revitalisent les mystifications électorales et l'attrait pour le vote, à la fois à travers les électeurs qu'ils mobilisent et ceux qui se mobilisent pour voter contre eux. Bien qu'ils soient en partie le produit de la désillusion croissante envers les partis traditionnels, ils peuvent aussi contribuer à renforcer l'image de ces derniers qui, à la différence des populistes, peuvent se présenter comme étant plus humanitaires et plus démocratiques. Dans la mesure où leur discours ressemble à celui des fascistes des années 30, leur surgissement tend à donner une nouvelle vie à l'antifascisme. C'est particulièrement le cas en Allemagne où l'arrivée au pouvoir du parti "fasciste" a conduit à la plus grande catastrophe dans l'histoire de la nation, avec la perte de presque la moitié de son territoire et de son statut comme puissance militaire majeure, la destruction de ses villes et les dommages quasiment irréparables pour son prestige international par la perpétration de crimes qui sont les pires de l'histoire de l'humanité.
Néanmoins, et comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant, surtout dans les vieux pays du cœur du capitalisme, les fractions dirigeantes de la bourgeoisie ont fait de leur mieux pour limiter la montée du populisme et, en particulier, pour empêcher sa participation au gouvernement. Après des années de luttes défensives sur son terrain de classe pour la plupart sans succès, il semble que certains secteurs de la classe ouvrière aujourd'hui peuvent avoir le sentiment qu’ils peuvent exercer plus de pression et faire plus peur à la classe dominante en votant pour le populisme de droite qu'avec les luttes ouvrières. La base de cette impression est que "l'establishment" réagit réellement de façon alarmée au succès électoral des populistes. Pourquoi cette réticence face à "l'un des leurs" ?
Jusqu'à maintenant, nous avons eu tendance à supposer que c'est surtout le cas à cause du cours historique (c’est-à-dire le fait que la présente génération du prolétariat n’a pas subi de défaite). Aujourd'hui, il est nécessaire de réexaminer ce cadre de façon critique face au développement de la réalité sociale.
Il est vrai que la mise en place de gouvernements populistes en Pologne et en Hongrie est relativement insignifiante si on la compare à ce qui se passe dans les vieux pays occidentaux du cœur du capitalisme. Plus significatif, cependant, est que ce développement n'a pas mené pour le moment à un conflit majeur entre la Pologne et la Hongrie d’une part, et l'OTAN et l'UE de l’autre. Au contraire, l'Autriche, avec un chancelier social-démocrate, après avoir imité au début la Wilkommenskultur d'Angela Merkel au cours de l'été 2015, a bientôt suivi l'exemple de la Hongrie en érigeant des barrières à ses frontières. Et le premier ministre hongrois est devenu un partenaire de discussion favori de la CSU bavaroise qui fait partie du gouvernement Merkel. Nous pouvons parler d'un processus d'adaptation mutuelle entre des gouvernements populistes et de grandes institutions intra-étatiques. Malgré leur démagogie anti-européenne, il n'y a pas de signe, pour le moment, que ces gouvernements populistes veuillent faire sortir la Pologne ou la Hongrie de l'UE. Au contraire, ce qu’ils propagent actuellement, c'est la diffusion du populisme au sein de l'UE. Ce que cela signifie, en termes d'intérêts concrets, c'est que "Bruxelles" devrait moins interférer dans les affaires nationales, tout en continuant à transférer les mêmes subventions, ou même plus, à Varsovie et Budapest. Pour sa part, l'UE s'adapte à ces gouvernements populistes qui sont quelquefois loués pour leur "contribution constructive" au cours de sommets complexes tenus par l'UE. Et, tout en insistant sur le maintien d'un certain minimum de "conditions démocratiques", Bruxelles s'est abstenue pour le moment d'appliquer à ces pays quelque sanction que ce soit dont elle les avait menacés.
En ce qui concerne l'Europe de l'Ouest, l'Autriche, on doit le rappeler, était déjà pionnière, ayant inclus une fois dans un gouvernement de coalition le parti de Jörg Haider comme partenaire minoritaire. Le but poursuivi – celui de discréditer le parti populiste en lui faisant assumer la responsabilité d’assurer le fonctionnement de l'État – avait été en partie atteint. Temporairement. Aujourd’hui au niveau électoral, le FPÖ est plus fort que jamais et a presque remporté les dernières élections présidentielles. Bien sûr en Autriche, le président joue un rôle principalement symbolique. Mais ce n’est pas le cas en France, la seconde puissance économique et la seconde concentration du prolétariat en Europe de l’Ouest continentale. La bourgeoisie mondiale attend avec anxiété la prochaine élection présidentielle dans ce pays où le FN est le parti dominant électoralement.
Beaucoup d’experts de la bourgeoisie ont déjà conclu de ce qui paraît être un échec du Parti républicain aux États-Unis à empêcher la candidature de Trump que, tôt ou tard, la participation des populistes aux gouvernements occidentaux deviendra inévitable et qu’il vaudrait mieux commencer à se préparer à une telle éventualité. Ce débat est une première réaction à la reconnaissance du fait que les tentatives faites jusqu’à maintenant pour exclure ou limiter le populisme ont non seulement atteint leurs limites mais ont même commencé à produire l’effet contraire.
La démocratie est l’idéologie qui convient le mieux aux sociétés capitalistes développées et l’arme la plus importante contre la conscience de classe du prolétariat. Mais aujourd’hui, la bourgeoisie est confrontée au paradoxe selon lequel, en continuant à garder à distance des partis qui ne respectent pas ses règles démocratiques du "politiquement correct", elle risque sérieusement de porter atteinte à sa propre image démocratique. Comment justifier de maintenir indéfiniment dans l’opposition des partis pour qui vote une partie significative de la population, même la majorité finalement, sans se discréditer et s’empêtrer dans des contradictions d’arguments inextricables ? De plus, la démocratie n’est pas qu’une idéologie mais aussi un moyen très efficace de la domination de classe –notamment parce qu’elle est capable de reconnaître les nouveaux élans qui viennent de la société dans son ensemble et de s’y adapter.
C’est dans ce cadre que la classe dominante aujourd’hui pose la perspective de la possibilité d’une participation populiste dans le gouvernement, en lien avec le rapport de force actuel entre la bourgeoisie et le prolétariat. Les tendances actuelles indiquent que la grande bourgeoisie elle-même ne pense pas qu’une telle option soit exclue du fait que la classe ouvrière n’est pas défaite.
Pour commencer, une telle éventualité ne signifierait pas l’abolition de la démocratie parlementaire bourgeoise comme ce fut le cas en Italie, en Allemagne ou en Espagne dans les années 1920-30 après la défaite du prolétariat. Même en Europe de l’Est aujourd’hui, les gouvernements populistes de droite existants n’ont pas tenté de mettre les autres partis hors la loi, ni d’établir un système de camps de concentration. De telles mesures ne seraient d’ailleurs pas acceptées par la génération actuelle de travailleurs, en particulier dans les pays de l’Ouest, et peut être en Pologne ou en Hongrie non plus.
De plus, cependant et par ailleurs, la classe ouvrière, bien que non défaite définitivement et historiquement, est affaiblie à l’heure actuelle au niveau de sa conscience de classe, de sa combativité et de son identité de classe. Le contexte historique de cette situation est avant tout la défaite de la première vague révolutionnaire à la fin de la Première Guerre mondiale, et la profondeur et la longueur de la contre-révolution qui l’a suivie.
Dans ce contexte, la première cause de cet affaiblissement est l’incapacité de la classe, pour le moment, de trouver une réponse adéquate, dans ses luttes défensives, à la phase actuelle de gestion capitaliste d’État, celui de la "mondialisation". Dans leurs luttes défensives, les ouvriers ressentent à juste titre qu’ils sont immédiatement confrontés à l’ensemble du capitalisme mondial parce qu’aujourd’hui, ce ne sont pas seulement le commerce et les affaires mais, aussi et pour la première fois, la production qui est mondialisée, et que la bourgeoisie peut répondre rapidement à toute résistance prolétarienne à l’échelle nationale ou locale en transférant la production ailleurs. Cet instrument apparemment tout-puissant pour discipliner le travail ne peut être effectivement combattu que par la lutte de classe internationale, un niveau de combat que la classe est encore incapable d’atteindre dans un futur prévisible.
La deuxième cause de cet affaiblissement est l’incapacité de la classe de continuer à politiser ses luttes après l’élan initial de 1968/69.Ce qui en a résulté, c’est l’absence de développement de toute perspective de vie meilleure ou de société meilleure : la phase actuelle de décomposition. Et l’effondrement des régimes staliniens en Europe de l’Est en particulier a paru confirmer l’impossibilité d’une alternative au capitalisme.
Pendant une courte période, peut être de 2003 à 2008, il y a eu de premiers signes, ténus, à peine visibles, d’un début de processus nécessairement long et difficile de récupération par le prolétariat des coups qu’il avait subis. En particulier, la question de la solidarité de classe, notamment entre générations, a commencé à être mise en avant. Le mouvement anti-CPE de 2006 a été le point culminant de cette phase, parce qu’il a réussi à faire reculer la bourgeoisie française, et parce que l’exemple de ce mouvement et de ses succès a inspiré des secteurs de la jeunesse dans d’autres pays européens, y compris en Allemagne et en Grande-Bretagne. Cependant ces premiers germes fragiles d’une reprise prolétarienne possible se sont aussitôt figés du fait d’une troisième série d’événements négatifs d’importance historique dans la période d’après 1968, et qui ont représenté un troisième revers majeur pour le prolétariat : la calamité économique de 2007/2008, suivie par la vague actuelle de réfugiés de guerre et d’autres migrants –la plus grande depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
La spécificité de la crise de 2007/08 est qu’elle a commencé comme une crise financière aux proportions énormes. Le résultat est que pour des millions d’ouvriers, l’un de ses pires effets, dans certains cas même le principal, n’a pas été la diminution de salaires, les hausses d’impôts, ni les licenciements massifs imposés par les employeurs ou par l’État, mais la perte de leurs maisons, de leurs économies, de leurs assurances, etc. Ces pertes, au niveau financier, se présentent comme celles de citoyens de la société bourgeoise, elles ne sont pas spécifiques à la classe ouvrière. Leurs causes restent peu claires, favorisant la personnalisation et la théorie du complot.
La spécificité de la crise des réfugiés est qu’elle a lieu dans le contexte de la "Forteresse Europe" (et de la Forteresse nord-américaine). À la différence des années 1930, depuis 1968 la crise mondiale du capitalisme a été accompagnée par une gestion capitaliste d’État internationale sous la direction de la bourgeoisie des vieux pays capitalistes. En conséquence, après presqu’un demi-siècle de crise chronique, l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord apparaissent toujours comme des havres de paix, de prospérité et de stabilité, au moins en comparaison avec "le monde extérieur". Dans un tel contexte, ce n’est pas seulement la peur de la concurrence des immigrants qui alarme des parties de la population mais, aussi, la peur que le chaos et l’anarchie, perçus comme venant de l’extérieur, gagnent via les réfugiés le monde " civilisé ". Au niveau actuel d’extension de la conscience de classe, il est trop difficile pour la plupart des travailleurs de comprendre que tout à la fois la barbarie chaotique à la périphérie du capitalisme et son intrusion, de façon toujours plus proche, dans les pays centraux, sont eux-mêmes le produit du capitalisme mondial et des politiques des pays capitalistes dirigeants.
Ce contexte de crise "financière", de "crise de l’Euro", puis de crise des réfugiés a, pour le moment, étouffé dans l’œuf les premiers pas embryonnaires vers un renouveau de solidarité de classe. C’est pourquoi peut-être, au moins en partie, la lutte des Indignados, bien qu’elle ait duré plus longtemps et ait semblé, sous certains aspects, se développer plus en profondeur que le mouvement anti-CPE, n’a pas réussi à stopper les attaques en Espagne, et a pu être aussi facilement exploitée par la bourgeoisie pour créer un nouveau parti politique de gauche : Podemos.
Le principal résultat, au niveau politique, de cette nouvelle poussée de désolidarisation, depuis 2008 jusqu’à maintenant, a été le renforcement du populisme. Ce dernier n’est pas seulement un symptôme d’un affaiblissement supplémentaire de la conscience de classe et de la combativité prolétariennes, mais constitue lui-même un facteur actif de cet affaiblissement. Pas seulement parce que le populisme fait du chemin dans les rangs du prolétariat. En fait, les secteurs centraux de la classe résistent encore fortement à cette influence, comme l’illustre l’exemple allemand. Mais aussi parce que la bourgeoisie profite de cette hétérogénéité de la classe pour diviser encore plus le prolétariat et semer la confusion en son sein. Aujourd’hui, on semble se rapprocher d’une situation qui, à première vue, présente certaines similitudes avec les années 1930. Bien sûr, le prolétariat n’a pas été défait politiquement et physiquement dans un pays central, comme cela avait eu lieu en Allemagne à l’époque. En conséquence, l’anti-populisme ne peut pas jouer exactement le même rôle que celui de l’antifascisme dans les années 1930. Il semble aussi que ce soit une caractéristique de la période de décomposition que de telles fausses alternatives elles-mêmes apparaissent avec des contours moins fortement dessinés qu’auparavant. Néanmoins, dans un pays comme l’Allemagne, où il y a huit ans, les premiers pas dans la politisation d’une petite minorité de la jeunesse en recherche s’étaient faits sous l’influence du mot d’ordre "À bas le capitalisme, la nation et l’État", aujourd’hui cette politisation se fait à la lumière de la défense des réfugiés et de la Wilkommenskultur contre les néo-nazis et la droite populiste.
Dans l’ensemble de la période post-1968, le poids de l’antifascisme était au moins atténué par le fait que, concrètement, le danger fasciste résidait dans le passé ou était représenté par des extrémistes de droite plus ou moins marginalisés. Aujourd’hui, la montée du populisme de droite en tant que phénomène potentiellement de masse, donne à l’idéologie de la défense de la démocratie une cible nouvelle, beaucoup plus tangible et importante, contre laquelle elle peut mobiliser.
Nous conclurons cette partie en disant que la croissance actuelle du populisme et de son influence sur l’ensemble de la politique bourgeoise, est aussi rendue possible par la faiblesse actuelle du prolétariat.
Le débat actuel au sein de la bourgeoisie sur la montée du populisme
Bien que le débat au sein de la bourgeoisie sur la façon de traiter le populisme qui ressurgit, ne fasse que commencer, nous pouvons déjà mentionner certains des paramètres mis en avant. Si nous regardons le débat en Allemagne –le pays où la bourgeoisie est peut-être la plus sensibilisée et la plus vigilante sur de telles questions– nous pouvons identifier trois aspects.
Premièrement : que c’est une erreur pour les "démocrates" d’essayer de combattre le populisme en adoptant son langage et ses propositions. Selon cette argumentation, c’est cette "copie" des populistes qui explique en partie le fiasco du parti au gouvernement aux dernières élections en Autriche, et qui permet d’expliquer l’incapacité des partis traditionnels en France à stopper l’avancée du FN. Les électeurs populistes, disent les tenants de ce point de vue, préfèrent l’original à la copie. Au lieu de faire des concessions, disent-ils, il est nécessaire de mettre l’accent sur les antagonismes entre "le patriotisme constitutionnel" et le "nationalisme chauvin", entre l’ouverture cosmopolite et la xénophobie, entre la tolérance et l’autoritarisme, entre la modernité et le conservatisme, entre l’humanisme et la barbarie. Selon cette ligne d’argumentation, les démocraties occidentales aujourd’hui sont assez "mûres" pour s’arranger avec le populisme moderne en maintenant une majorité pour la "démocratie", si elles mettent en avant leurs positions de manière "offensive". C’est par exemple la position de l’actuelle chancelière allemande Angela Merkel.
Deuxièmement, on insiste sur le fait que l’électorat doit pouvoir de nouveau faire la différence entre la droite et la gauche, et qu’il faut corriger l’impression d’un cartel de partis établis. Nous supposons que cette idée est déjà le motif de la préparation, au cours des deux dernières années, par la coalition CDU-SPD, d’une future coalition possible entre la Démocratie chrétienne et les Verts après les nouvelles élections générales. L’abandon du nucléaire après la catastrophe de Fukushima, annoncée non au Japon mais en Allemagne, et le récent soutien euphorique des Verts à la Wilkommenskultur vis-à-vis des réfugiés, associée non pas au SPD mais à Angela Merkel, ont été jusqu’à présent les principaux pas de cette stratégie. Cependant, l’ascension électorale rapide et inattendue de l’AfD menace aujourd’hui la réalisation d’une telle stratégie (la tentative récente de faire revenir le FDP libéral au parlement pourrait être une réponse à ce problème, puisque ce parti pourrait à l’occasion rejoindre une coalition "Noir-Vert"). Dans l’opposition, le SPD, le parti qui a dirigé en Allemagne "la révolution néolibérale" avec son agenda 2010 sous Shröder, pourrait alors adopter une posture plus à "gauche". A l’opposé des pays anglo-saxons, où c’est la droite conservatrice de Thatcher et Reagan qui a imposé les mesures "néolibérales", dans beaucoup de pays européens du continent, c’est la gauche (en tant que partis les plus politiques, responsables et disciplinés) qui a dû participer ou même assumer leur mise en œuvre.
Aujourd’hui, cependant, il est devenu évident que la nécessaire étape de mondialisation néolibérale s’est accompagnée d’excès qui devront être corrigés tôt ou tard. Ça a été le cas en particulier après 1989, quand l’effondrement des régimes staliniens a paru confirmer de manière écrasante toutes les thèses ordo-libérales sur l’inadaptation de la bureaucratie capitaliste d’État pour faire tourner l’économie. Certains représentants sérieux de la classe bourgeoise soulignent de plus en plus certains de ces excès. Par exemple, il n’est absolument pas indispensable pour la survie du capitalisme qu’une minuscule fraction de la société possède presque toute la richesse. Cela peut faire des dégâts non seulement socialement et politiquement mais, aussi, économiquement, puisque les très riches, au lieu de partager la part du lion de leurs richesses, sont avant tout concernés par la préservation de leurs valeurs, augmentant donc la spéculation et freinant le pouvoir d’achat solvable. Il n’est pas non plus absolument nécessaire pour le capitalisme que la concurrence entre États capitalistes prenne une forme si drastique qu’aujourd’hui de réduction des impôts et des budgets étatiques, au point que l’État ne puisse plus assurer les investissements nécessaires. En d’autres termes, l’idée est que, grâce à un retour possible à une sorte de correction néo-keynésienne, la gauche, soit sous sa forme traditionnelle ou via de nouveaux partis comme Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne, pourrait regagner une certaine base matérielle pour se présenter comme alternative à la droite ordo-libérale conservatrice.
Il est important de noter cependant que les réflexions d’aujourd’hui dans la classe dominante sur un rôle possible futur de la gauche ne sont pas en premier lieu inspirées par la peur (dans l’immédiat) de la classe ouvrière. Au contraire, beaucoup d’éléments de la situation actuelle dans les principaux centres capitalistes indiquent que le premier aspect qui détermine la politique de la classe dominante est à présent le problème du populisme.
Le troisième aspect est que, tout comme les Tories britanniques autour de Boris Johnson, la CSU, le parti "frère" de la CDU de Merkel, pense que des parties de l’appareil traditionnel du parti devraient elles-mêmes appliquer des éléments de la politique populiste. Nous devons noter que la CSU n’est plus l’expression de l’arriération bavaroise traditionnelle, petite-bourgeoise. Au contraire, à côté de la province contiguë du sud, le Bade-Würtemberg, aujourd’hui la Bavière est économiquement la partie la plus moderne de l’Allemagne, la colonne vertébrale de ses industries high-tech et d’exportation, la base productive de compagnies telles que Siemens, BMW ou Audi.
Cette troisième option dont Munich fait la propagande entre bien sûr en contradiction avec la première dont nous avons parlé, proposée par Angela Merkel, et le cœur actuel des confrontations entre les deux partis n’est pas qu’une manœuvre électorale ni le produit des différences (réelles) entre des intérêts économiques particuliers mais, aussi, des différences de démarche. Au vu de la détermination actuelle de la chancelière à ne pas changer d’esprit, certains représentants de la CSU ont même commencé à "penser tout haut" à présenter leurs propres candidats dans d’autres parties de l’Allemagne contre la CDU aux nouvelles élections générales.
L’idée de la CSU, comme celle de parties des conservateurs anglais, est que, s’il est devenu inévitable, d’une certaine manière, que soient prises des mesures populistes, c’est mieux qu’elles soient appliquées par un parti expérimenté et responsable. De cette façon, de telles mesures souvent irresponsables pourraient d’une part au moins être limitées et, d’autre part, être compensées par des mesures auxiliaires.
Malgré les frictions réelles entre Merkel et Seehofer, comme entre Cameron et Johnson, nous ne devons pas négliger l’élément de division du travail entre eux (une partie, défendant les valeurs démocratiques "de façon offensive", l’autre reconnaissant la validité de "l’expression démocratique de citoyens en colère").
De toute façon, dans son ensemble, ce que ce discours illustre, c’est que les fractions dirigeantes de la bourgeoisie commencent à se réconcilier avec l’idée de politiques gouvernementales populistes d’un certain type et dans une certaine mesure, comme les conservateurs Brexit ou la CSU les mettent déjà partiellement en pratique.
Populisme et décomposition
Comme nous l’avons vu, il y a eu et il subsiste une très grande réticence vis-à-vis du populisme de la part des principales fractions de la bourgeoisie en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Quelles en sont les causes ? Après tout, ces mouvements ne remettent en question, en aucune manière, le capitalisme. Rien de ce dont ils font la propagande n’est étranger au monde bourgeois. À la différence du stalinisme, le populisme ne remet même pas en question les formes actuelles de propriété capitaliste. C’est un mouvement "oppositionnel" bien sûr. Mais dans un certain sens, le stalinisme et la social-démocratie l’ont aussi été, sans que cela ne les empêche pour autant d’être des membres responsables de gouvernements des États capitalistes dirigeants.
Pour comprendre cette réticence, il est nécessaire de reconnaître la différence fondamentale entre le populisme actuel et la gauche du capital. La gauche, même quand elle ne vient pas d’anciennes organisations du mouvement ouvrier (les Verts, par exemple), bien qu’elle puisse être le meilleur représentant du nationalisme et celle qui peut le mieux mobiliser le prolétariat pour la guerre, fonde son pouvoir d’attraction sur la propagande des anciens idéaux du mouvement ouvrier ou sur leur contrefaçon ou, au moins, sur ceux de la révolution bourgeoise. En d’autres termes, aussi chauvine et même antisémite qu’elle puisse être, elle ne renie pas en principe la "fraternité de l’humanité" ni la possibilité d’améliorer l’état du monde dans son ensemble. En fait, même les radicaux néo-libéraux les plus ouvertement réactionnaires affirment poursuivre ce but. C’est nécessairement le cas. Dès l’origine, la prétention de la bourgeoisie à être la digne représentante de la société dans son ensemble a toujours été fondée sur cette perspective. Cela ne signifie en rien que la gauche du capital, en tant que partie de cette société pourrissante, ne diffuse pas également un poison raciste, antisémite tout à fait analogue à celui des populistes de droite !
En revanche, le populisme personnifie la renonciation à un tel "idéal". Ce qu’il propage, c’est la survie de certains aux dépens des autres. Toute son arrogance tourne autour de ce "réalisme" dont il est si fier. En tant que tel, c’est le produit du monde bourgeois et de sa vision du monde –mais avant tout de sa décomposition.
En second lieu, la gauche du capital propose un programme économique, politique et social plus ou moins cohérent et réaliste pour le capital national. En revanche, le problème avec le populisme politique n’est pas qu’il ne fasse pas de propositions concrètes, mais qu’il propose une chose et son contraire, une politique aujourd’hui, une autre demain. Au lieu d’être une alternative politique, il représente la décomposition de la politique bourgeoise.
C’est pourquoi, au moins au sens où le terme est utilisé ici, cela a peu de sens de parler de l’existence d’un populisme de gauche, comme une sorte de pendant au populisme de droite.
Malgré des similitudes et des parallèles, l’histoire ne se répète jamais. Le populisme d’aujourd’hui n’est pas la même chose que le fascisme des années 1920 et 1930. Cependant, le fascisme d’alors et le populisme d’aujourd’hui ont, d’une certaine manière, des causes similaires. En particulier, ils sont tous les deux l’expression de la décomposition du monde bourgeois. Avec l’expérience historique du fascisme et, surtout, du national-socialisme derrière lui, la bourgeoisie des vieux pays capitalistes centraux a une conscience aiguë de ces similitudes et du danger potentiel qu’elles représentent pour la stabilité de l’ordre capitaliste.
Parallèles avec la montée du national-socialisme en Allemagne
Le fascisme en Italie et en Allemagne avait en commun le triomphe de la contre-révolution et le délire de la dissolution des classes dans une communauté mystique après la défaite préalable (surtout grâce aux armes de la démocratie et de la gauche du capital) de la vague révolutionnaire. En commun aussi, leur contestation ouverte du découpage impérialiste et l’irrationalité de beaucoup de leurs buts de guerre. Mais malgré ces similitudes (sur la base desquelles Bilan a été capable de reconnaître la défaite de la vague révolutionnaire et le changement de cours historique, ouvrant la possibilité pour la bourgeoisie de mobiliser le prolétariat dans la guerre mondiale), il est utile –de façon à mieux comprendre le populisme contemporain– d’étudier de plus près certaines des spécificités des développements historiques en Allemagne à l’époque, y compris là où elles différaient du fascisme italien beaucoup moins irrationnel.
Premièrement, l’ébranlement de l’autorité établie des classes dominantes, et la perte de confiance de la population dans sa direction politique, économique, militaire, idéologique et morale traditionnelle, étaient beaucoup plus profonds que partout ailleurs (excepté en Russie), puisque l’Allemagne était la grande perdante de la Première Guerre mondiale et en est sortie dans un état d’épuisement économique, financier et même physique.
Deuxièmement, en Allemagne, beaucoup plus qu’en Italie, une réelle situation révolutionnaire avait eu lieu. La façon dont la bourgeoisie a été capable d’étouffer dans l’œuf, à un stade précoce, ce potentiel, ne doit pas nous faire sous-estimer la profondeur de ce processus révolutionnaire, ni l’intensité des espérances et des attentes qu’il avait éveillées et qui l’avaient accompagné. Il a fallu presque six ans, jusqu’en 1923, à la bourgeoisie allemande et mondiale pour liquider toutes les traces de cette effervescence. Aujourd’hui, il nous est difficile d’imaginer le degré de déception causé par cette défaite et l’amertume qu’elle a laissée dans son sillage. La perte de confiance de la population dans sa propre classe dominante fut ainsi rapidement suivie par la désillusion encore plus cruelle de la classe ouvrière à l’égard de ses (anciennes) organisations (social-démocratie et syndicats), et par la déception vis-à-vis du jeune KPD et de l’Internationale communiste.
Troisièmement, les calamités économiques ont joué un rôle beaucoup plus central dans la montée du national-socialisme que ça n’a été le cas pour le fascisme en Italie. L’hyperinflation de 1923 en Allemagne (et ailleurs en Europe centrale) a sapé la confiance dans la monnaie en tant qu’équivalent universel. La Grande Dépression qui a commencé en 1929 n’a donc eu lieu que 6 ans après le traumatisme de l’hyperinflation. Non seulement la Grande Dépression a frappé en Allemagne une classe ouvrière dont la conscience de classe et la combativité avaient déjà été écrasées, mais la façon dont les masses, intellectuellement et émotionnellement, ont fait l’expérience de ce nouvel épisode de crise économique, était dans une certaine mesure modifiée, pré-formatée pourrait-on dire, par les événements de 1923.
Les crises, celles du capitalisme décadent en particulier, affectent tous les aspects de la vie économique (et sociale). Ce sont des crises de (sur)production –de capital, de marchandises, de force de travail– et d’appropriation et de "distribution" -spéculations financière et monétaire et crash inclus. Mais, à la différence des manifestations de la crise plus centrées sur le lieu de la production, telles que les licenciements et les réductions de salaire, les effets négatifs sur la population au niveau financier et monétaire sont beaucoup plus abstraits et obscurs. Cependant, leurs effets peuvent être tout aussi dévastateurs pour des parties de la population, tout comme leurs répercussions peuvent même être plus mondiales et se répandre encore plus vite que celles qui ont lieu plus directement sur le lieu de production. En d’autres termes, alors que ces dernières manifestations de la crise tendent à favoriser le développement de la conscience de classe, celles qui proviennent plutôt des sphères financières et monétaires tendent à faire le contraire. Sans l’aide du marxisme, il n’est pas facile de saisir les liens réels entre, par exemple, un crash financier à Manhattan et le défaut de paiement d’une assurance ou même d’un État sur un autre continent. De tels systèmes d’interdépendance spectaculaires, créés aveuglément entre pays, populations, classes sociales, qui fonctionnent dans le dos des protagonistes, mènent facilement à la personnalisation et à la paranoïa sociale. Le fait que l’accentuation récente de la crise ait aussi été une crise financière et des banques, liée à des bulles spéculatives et à leur explosion, n’est pas que de la propagande bourgeoise. Le fait qu’une fausse manœuvre spéculative à Tokyo ou à New York puisse déclencher la faillite d’une banque en Islande, ou ébranler le marché de l’immobilier en Irlande, n’est pas de la fiction mais une réalité. Seul le capitalisme crée une telle interdépendance de vie et de mort entre des gens qui sont complètement étrangers les uns aux autres, entre des protagonistes qui ne sont même pas conscients de l’existence des uns ni des autres. Il est extrêmement difficile pour les êtres humains de supporter de tels niveaux d’abstraction, que ce soit intellectuellement ou émotionnellement. Une façon d’y faire face est la personnalisation, ignorant le mécanisme réel du capitalisme : ce sont les forces du mal qui planifient délibérément de nous nuire. Il est d’autant plus important de comprendre aujourd’hui cette distinction entre les différentes sortes d’attaques, que ce ne sont plus principalement la petite bourgeoisie ou ce qu’on appelle les classes moyennes qui perdent leurs économies comme en 1923, mais des millions de travailleurs qui possèdent ou essaient de posséder leur propre logement, d’avoir des économies, des assurances, etc..
En 1923, la bourgeoisie allemande, qui planifiait déjà de mener la guerre contre la Russie, s’est trouvée confrontée à un national-socialisme qui était devenu un véritable mouvement de masse. Dans une certaine mesure, la bourgeoisie était piégée, prisonnière d’une situation qu’elle avait grandement contribué à créer. Elle aurait pu opter pour s’engager dans la guerre sous un gouvernement social-démocrate, avec le soutien des syndicats, dans une coalition possible avec la France ou même la Grande Bretagne, même en tant que partenaire secondaire au début. Mais cela aurait entraîné une confrontation ou, au moins, la neutralisation du mouvement NS, qui non seulement était devenu trop grand à manipuler mais regroupait aussi cette partie de la population qui voulait la guerre. Dans cette situation, la bourgeoisie allemande a commis l’erreur de croire qu’elle pouvait instrumentaliser le mouvement NS à son gré.
Le national-socialisme n’était pas simplement un régime de terreur de masse exercée par une petite minorité sur le reste de la population. Il avait sa propre base de masse. Ce n’était pas qu’un instrument du capital qui s’imposait sur la population. C’était aussi son contraire : un instrument aveugle des masses atomisées, écrasées et paranoïaques qui voulaient s’imposer au capital. Le national-socialisme fut donc préparé, dans une grande mesure, par la perte profonde de confiance de grandes parties de la population dans l’autorité de la classe dominante et dans sa capacité à faire fonctionner efficacement la société et à fournir un minimum de sécurité physique et économique à ses citoyens. Cet ébranlement de la société jusqu’à ses fondations avait été inauguré par la Première Guerre mondiale et avait été exacerbé par les catastrophes économiques qui suivirent : l’hyperinflation qui était le résultat de la guerre mondiale (du côté des perdants), et la Grande Dépression des années 1930. L’épicentre de cette crise était constitué par les trois empires – l’allemand, l’austro-hongrois, le russe –, les trois s’étant effondrés sous les coups de la guerre (perdue) et de la vague révolutionnaire.
À la différence de la Russie où au début la révolution fut victorieuse, en Allemagne et dans l’ancien empire austro-hongrois, la révolution a échoué. En l’absence d’une alternative prolétarienne à la crise de la société bourgeoise, un grand vide s’ouvrit, dont le centre était l’Allemagne et, disons, l’Europe continentale au nord du bassin méditerranéen, mais avec des ramifications à l’échelle mondiale, engendrant un paroxysme de violence et de pogromisation, centré sur les thèmes de l’antisémitisme et de l’antibolchevisme, culminant dans "l’holocauste" et le début d’une liquidation massive de populations entières, en particulier dans les territoires de l’URSS occupés par les forces allemandes.
La forme prise par la contre-révolution en Union Soviétique a joué un rôle important dans le développement de cette situation. Bien qu’il n’y ait plus rien eu de prolétarien dans la Russie stalinienne, l’expropriation violente de la paysannerie en particulier (la "collectivisation de l’agriculture" et la "liquidation des koulaks") n’a pas seulement terrifié les petits propriétaires et les petits épargnants dans le reste du monde, mais aussi beaucoup de grands propriétaires. Cela a été le cas notamment en Europe continentale où ces propriétaires (qui pouvaient inclure les modestes propriétaires de leur propre logement), laissés sans protection contre le "bolchevisme" dont ils n’étaient pas séparés par la mer ou l’océan (à la différence de leur homologues anglais ou américains), avaient peu de confiance dans les régimes "démocratiques" ou "autoritaires" européens instables qui existaient au début des années 1930, pour les protéger contre l’expropriation par la crise ou par le "bolchevisme juif".
Nous pouvons conclure de cette expérience historique que, si le prolétariat est incapable de mettre en avant son alternative révolutionnaire au capitalisme, la perte de confiance dans la capacité de la classe dominante de "faire son boulot" conduit finalement à une révolte, une protestation, une explosion d’une toute autre sorte, une protestation qui n’est pas consciente mais aveugle, orientée non pas vers le futur mais vers le passé, qui n’est pas basée sur la confiance mais sur la peur, non sur la créativité mais sur la destruction et la haine.
Une seconde crise de confiance dans la classe dominante aujourd’hui
Le processus que nous venons de décrire était déjà la décomposition du capitalisme. Et c’est plus que compréhensible que beaucoup de marxistes et d’autres observateurs ingénieux de la société dans les années 1930 se soient attendus à ce que cette tendance submerge rapidement le monde entier. Mais comme cela s’est avéré, ce n’était que la première phase de cette décomposition, pas encore sa phase terminale.
Avant tout, trois facteurs d’importance historique mondiale ont fait reculer cette tendance à la décomposition.
Premièrement, la victoire de la coalition anti-Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale, qui a considérablement rehaussé le prestige de la démocratie "occidentale" et, en particulier, celui du modèle américain d’une part, et celui du modèle du "socialisme en un seul pays" de l’autre.
Deuxièmement, le "miracle économique" d’après la Deuxième Guerre mondiale, surtout dans le bloc de l’Ouest.
Ces deux facteurs étaient du fait de la bourgeoisie. Le troisième a été du fait de la classe ouvrière : la fin de la contre-révolution, le retour de la lutte de classe au centre de la scène de l’histoire, et avec lui, la réapparition (cependant confuse et éphémère) d’une perspective révolutionnaire. La bourgeoisie, pour sa part, a répondu à ce changement de situation non seulement avec l’idéologie du réformisme mais, aussi, par des concessions et des améliorations matérielles réelles (temporaires bien sûr). Tout cela a renforcé, chez les travailleurs, l’illusion que la vie pouvait s’améliorer.
Comme nous le savons, ce qui a mené à la phase actuelle de décomposition a été essentiellement le blocage entre les deux classes principales, l’une incapable de déclencher une guerre généralisée, l’autre incapable de se diriger vers une solution révolutionnaire. Avec l’échec de la génération de 1968 à politiser plus ses luttes, les événements de 1989 ont inauguré alors, à l’échelle mondiale, la phase actuelle de décomposition. Mais il est très important de comprendre cette phase non comme quelque chose de stagnant mais comme un processus. 1989 a avant tout marqué l’échec de la première tentative du prolétariat de redévelopper sa propre alternative révolutionnaire. Après 20 ans de crise chronique et de détérioration des conditions de vie de la classe ouvrière et de la population mondiale dans son ensemble, le prestige et l’autorité de la classe dominante se sont aussi érodés, mais pas au même degré. Au tournant du millénaire, il y avait encore d’importantes contre-tendances qui rehaussaient la réputation des élites bourgeoises dirigeantes. Nous en mentionnerons trois ici.
Premièrement, l’effondrement du bloc de l’Est stalinien n’a pas du tout endommagé l’image de la bourgeoisie de ce qui était auparavant le bloc de l’Ouest. Au contraire, ce qui a semblé réfuté, c’était la possibilité d’une alternative au "capitalisme démocratique occidental". Bien sûr, une partie de l’euphorie de 1989 s’est bien vite dissipée sous l’effet de la réalité, comme l’illusion d’un monde plus pacifique. Mais il est vrai que 1989 a au moins écarté l’épée de Damoclès d’une menace permanente d’annihilation mutuelle dans une troisième guerre mondiale. Également, après 1989, à la fois la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide qui a suivi entre l’Est et l’Ouest ont pu rétrospectivement être présentées de façon crédible comme ayant été le produit de l’"idéologie" et du "totalitarisme" (donc la faute du fascisme et du "communisme"). Au niveau idéologique, c’est une très bonne fortune pour la bourgeoisie occidentale que le nouveau rival impérialiste -plus ou moins ouvert- des États-Unis aujourd’hui ne soit plus l’Allemagne (désormais elle-même "démocratique") mais la Chine "totalitaire" et que beaucoup des guerres régionales contemporaines et d’attaques terroristes puissent être attribuées au "fondamentalisme religieux".
Deuxièmement, l’étape actuelle de "mondialisation" du capitalisme d’État, déjà introduite au préalable, a rendu possible, dans le contexte post 1989, un développement réel des forces productives dans ce qui avait été jusqu’à maintenant des pays périphériques du capitalisme. Bien sûr, les États des BRIC, par exemple, ne constituent en rien un modèle de mode de vie pour les ouvriers dans les vieux pays capitalistes. Mais d’un autre côté, ils créent l’impression d’un capitalisme mondial dynamique. Il faut noter, au vu de l’importance de la question de l’immigration pour le populisme aujourd’hui, que ces pays sont vus à ce niveau comme apportant une contribution à la stabilisation de la situation, puisqu’ils absorbent des millions de migrants qui se seraient autrement déplacés vers l’Europe et l’Amérique du Nord.
Troisièmement, le développement réellement époustouflant au niveau technologique, qui a "révolutionné" la communication, l’éducation, la médecine, la vie quotidienne dans son ensemble, a de nouveau créé l’impression d’une société pleine d’énergie (justifiant, en passant, notre compréhension que la décadence du capitalisme ne signifie pas l’arrêt des forces productives, ni une stagnation technologique).
Ces facteurs (et il y en a probablement d’autres), bien qu’incapables d’empêcher la phase actuelle de décomposition (et avec elle déjà, un premier développement du populisme), ont encore réussi à atténuer certains de ses effets. En revanche, le renforcement de ce populisme aujourd’hui indique que nous pourrions nous approcher de certaines limites de ces effets modérateurs, peut-être même en ouvrant ce que nous pourrions appeler une seconde étape dans la phase de décomposition. Cette deuxième étape, dirions-nous, est caractérisée chez de plus en plus grandes parties de la population par une perte grandissante de confiance dans la volonté ou dans la capacité de la classe dominante de les protéger. Un processus de désillusion qui, au moins pour le moment, n’est pas prolétarien, mais profondément antiprolétarien. Derrière les crises de la finance, de l’Euro et des réfugiés, qui sont plus des facteurs déclenchant que les causes profondes, cette nouvelle étape est bien sûr le résultat des effets cumulés, sur des décennies, de facteurs plus profonds. D’abord et avant tout, l’absence de perspective révolutionnaire prolétarienne. De l’autre côté (celui du capital), il y a une crise économique chronique mais, aussi, les effets du caractère de plus en plus abstrait du mode de fonctionnement de la société bourgeoise. Ce processus, inhérent au capitalisme, a connu une grave accélération au cours des trois dernières décennies, avec la réduction brutale, dans les vieux pays capitalistes, de la force de travail industrielle et manuelle, et de l’activité physique en général, du fait de la mécanisation et des nouveaux media tels que les ordinateurs personnels et Internet. Parallèlement à cela, le moyen d’échange universel a été largement transformé de métal et papier en monnaie électronique.
Populisme et violence
À la base du mode de production capitaliste, il y a une combinaison très spécifique de deux facteurs : les mécanismes économiques ou "lois" (le marché) et la violence. D’un côté : la condition de l’échange d’équivalents est le renoncement à la violence -l’échange à la place du vol. De plus, le travail salarié est la première forme d’exploitation où l’obligation de travailler, et la motivation dans le processus du travail lui-même, constituent essentiellement une force économique plutôt que directement physique. De l’autre côté : dans le capitalisme, tout le système d’échange d’équivalent est basé sur un échange "originel" non équivalent –la séparation violente des producteurs des moyens de production (l’"accumulation primitive") qui est la condition du système salarié et qui est un processus permanent dans le capitalisme puisque l’accumulation elle-même est un processus plus ou moins violent (voir L’Accumulation du Capital, Rosa Luxembourg). Cette permanence de la présence des deux pôles de cette contradiction (violence et renoncement à la violence), de même que l’ambivalence que cela crée, imprègne l’ensemble de la vie de la société bourgeoise. Elle accompagne tout acte d’échange, dans lequel l’option alternative du vol est toujours présente. D’ailleurs, une société fondée radicalement sur l’échange, et donc sur le renoncement à la violence, doit renforcer ce renoncement par la menace de la violence, et pas seulement la menace –ses lois, son appareil de justice, sa police, ses prisons, etc. Cette ambiguïté est toujours présente en particulier dans l’échange entre le travail salarié et le capital, dans lequel la coercition économique est complétée par la force physique. Elle est spécifiquement présente partout où l’instrument par excellence de la violence dans la société est directement impliqué : l’État. Dans ses relations avec ses propres citoyens (coercition et extorsion) et avec les autres États (guerre), l’instrument de la classe dominante pour supprimer le vol et la violence chaotique est lui-même, en même temps, le voleur généralisé, sanctifié.
Un des points de focalisation de cette contradiction et de cette ambigüité entre la violence et son renoncement dans la société bourgeoise réside dans chacun de ses sujets individuels. Vivre une vie normale, fonctionnelle, dans le monde actuel, exige le renoncement à une pléthore de besoins corporels, émotionnels, intellectuels, moraux, artistiques et créatifs, à tout un monde. Dès que le capitalisme mûri est passé de l’étape de la domination formelle à la domination réelle, ce renoncement n’a plus été imposé principalement par la violence externe. D’ailleurs, chaque individu est plus ou moins consciemment confronté à un choix, soit celui de s’adapter au fonctionnement abstrait de cette société, soit celui d’être un "loser", un perdant, qui peut finir dans le caniveau. La discipline devient l’autodiscipline, mais de telle façon que chaque individu devient celui-là même qui réprime ses propres besoins vitaux. Bien sûr, ce processus d’autodiscipline contient aussi un potentiel pour l’émancipation, pour l’individu et surtout pour le prolétariat dans son ensemble (en tant que classe autodisciplinée par excellence) de devenir le maître de son propre destin. Mais pour le moment, dans le fonctionnement "normal" de la société bourgeoise, cette autodiscipline est essentiellement l’internalisation de la violence capitaliste. Parce que c’est le cas, en plus de l’option prolétarienne de transformation de cette autodiscipline en moyen de la réalisation, de revitalisation des besoins humains et de créativité, il y a aussi, en veille, une autre option, celle de la redirection aveugle de la violence internalisée vers l’extérieur. La société bourgeoise a toujours besoin d’offrir un "outsider" afin de maintenir l’(auto)-discipline de ceux qui soi-disant lui appartiennent. C’est pourquoi la ré-externalisation de la violence par les sujets de la société bourgeoise s’oriente "spontanément" (c’est-à-dire est prédisposée ou "formatée" dans ce sens) contre de tels outsiders (pogromisation).
Quand la crise ouverte de la société capitaliste atteint une certaine intensité, quand l’autorité de la classe dominante s’est détériorée, quand les sujets de la société bourgeoise commencent à douter de la capacité et de la détermination des autorités à faire leur travail et, en particulier, à les protéger contre un monde de dangers, et quand une alternative –qui ne peut être que celle du prolétariat– manque, des parties de la population commencent à protester et même à se révolter contre l’élite dominante, mais non dans le but de mettre ses règles en cause, mais pour la forcer à protéger ses propres citoyens "respectueux des lois" contre les "outsiders". Ces couches de la société subissent la crise du capitalisme comme un conflit entre ses deux principes sous-jacents : entre le marché et la violence. Le populisme est l’option de la violence pour résoudre les problèmes que le marché ne peut résoudre, et même pour résoudre les problèmes du marché lui-même. Par exemple, si le marché mondial de la force de travail menace d’engloutir le marché du travail des vieux pays capitalistes de la vague de ceux qui n’ont rien, la solution est d’ériger des barrières et de poster aux frontières une police qui puisse tirer sur quiconque essaie de les franchir sans permission.
Derrière la politique populiste d’aujourd’hui, se cache la soif de meurtre. Le pogrom est le secret de son existence.
Steinklopfer, 8 juin 2016
Personnages:
- Donald Trump [6]
- Angela Merkel [15]
Récent et en cours:
- réfugiés [16]
- Brexit [11]
- Indignados [17]
- Wilkommenskultur [18]
Questions théoriques:
- Populisme [13]
Rubrique:
Rapport sur la situation en Allemagne
- 1064 lectures
La conférence commune des sections du CCI en Allemagne et en Suisse et du noyau en Suède qui s'est tenue en mars 2016 a adopté, entre autres documents, un rapport sur la situation nationale en Allemagne que nous publions ici. Le rapport ne prétend pas être complet. Il se concentre sur un minimum de points sur lesquels nous pensons qu’il est particulièrement important de réfléchir et de discuter à l’heure actuelle. Puisque ces aspects en général ont pour point de départ les événements dramatiques de la situation actuelle, nous ajoutons au rapport la présentation faite à la conférence et qui est en partie consacrée à une actualisation du rapport. Les commentaires critiques envers le rapport et la présentation faits au cours du débat qui s'est ensuivi sont ajoutés à la présentation en tant que notes de bas de page. Au vu de l'importance des développements dans ce qui est aujourd'hui le pays le plus central du capitalisme européen, nous espérons que ces textes pourront être une contribution positive à la nécessaire réflexion, du point de vue du prolétariat, sur la situation mondiale présente.
La compétitivité du capital allemand aujourd'hui
Comme l’État-nation allemand ne s’est pas constitué avant 1870, et a pris du retard pour se joindre au partage impérialiste du monde, il ne s’est jamais établi lui-même comme une puissance coloniale ou financière dominante. La base principale de sa puissance économique était et reste son industrie et sa force de travail hautement performantes. Alors que l'Allemagne de l'Est (la vieille République démocratique allemande, RDA) a pris du retard du point de vue économique en devenant une partie du bloc de l’Est, l’Allemagne de l’Ouest de l'après Seconde Guerre mondiale a été capable de construire sur cette base et même de la renforcer. En 1989, l’Allemagne de l’Ouest était devenue la principale nation exportatrice du monde, avec le déficit d’État le plus bas de toutes les puissances dominantes. Malgré des hauts niveaux de salaire comparativement aux autres nations, son économie était extrêmement compétitive. Elle a aussi bénéficié, économiquement, des possibilités du marché mondial ouvertes par son appartenance au bloc de l’Ouest, et pour avoir un budget militaire réduit en tant que principale perdante des deux guerres mondiales.
Aux niveaux politique et territorial, l’Allemagne a ensuite beaucoup profité de la chute du bloc de l’Est en 1989, en absorbant l’ex-RDA. Mais économiquement, l’absorption rapide de cette zone, qui était désespérément en retard par rapport aux standards internationaux, a aussi représenté un fardeau considérable, surtout financièrement. Un fardeau qui menaçait la compétitivité de la nouvelle et plus grande Allemagne. Pendant les années 1990, elle a perdu du terrain sur les marchés mondiaux, alors que les niveaux de déficit du budget de l’État commençaient à se rapprocher de ceux des autres puissances dominantes.
Aujourd’hui, un quart de siècle plus tard, l’Allemagne a plus que regagné le terrain perdu. C’est le deuxième exportateur mondial, juste derrière la Chine. L’année dernière, le budget d’État affichait un surplus de 26 milliards d’Euros. La croissance, à 1,7%, a été modérée, mais c'est malgré tout une réussite pour un pays hautement développé. Le chômage officiel a chuté à son plus bas niveau depuis la réunification. La politique visant à conserver une production industrielle hautement développée basée en Allemagne-même a, jusqu’à maintenant, été un succès.
Bien sûr, en tant que vieux pays industriel, le socle de ce succès est une composition organique élevée du capital, le produit d'au moins deux siècles d'accumulation. Mais, dans ce contexte, les qualifications et compétences élevées de sa population sont décisives pour son avantage concurrentiel. Avant la Première Guerre mondiale, l’Allemagne était devenue le principal centre du développement scientifique et de ses applications à la production. Avec la catastrophe du national-socialisme et de la Seconde Guerre mondiale, elle a perdu cet avantage et n’a montré aucun signe de récupération depuis. Ce qui reste néanmoins est son savoir-faire dans le processus de production lui-même. Depuis la disparition de la Hanse 1, l’Allemagne n’a jamais été une puissance maritime durable et dominante. Quoique longtemps une économie essentiellement paysanne, son sol, en général, est moins fertile que celui de la France, par exemple. Ses avantages naturels reposent sur sa situation géographique au cœur de l’Europe et ses métaux précieux exploités déjà durant le Moyen Âge. De tout cela ont surgi une grande aptitude au travail et à la coopération entre artisans et industriels, et un savoir-faire développé et transmis de génération en génération. Bien que sa révolution industrielle ait largement bénéficié de grandes ressources en charbon, la disparition d’industries lourdes depuis les années 1970 jusqu’à nos jours a montré que ce n'est pas là que résidait le cœur de l’ascendant économique de l'Allemagne, mais dans son efficacité dans la production de moyens de production et, plus généralement, dans la transformation de travail vivant en travail mort. Aujourd’hui, l’Allemagne est le principal producteur dans le monde de machines complexes. Ce secteur est la colonne vertébrale de son économie, plus que le secteur automobile. En arrière-plan de cette force, il y a aussi le savoir-faire de la bourgeoisie qui, déjà pendant l’ascendance du capitalisme, s’est essentiellement concentrée sur ses activités économiques et industrielles, puisqu’elle était plus ou moins exclue des positions de pouvoir politique et militaire par la caste des propriétaires terriens prussiens (les Junkers). La passion pour l’ingénierie que cette bourgeoisie a développé continue à s’exprimer non seulement dans l'industrie des machines-outils, encore souvent basée sur des unités de taille moyenne gérées par des familles, mais aussi dans la capacité particulière de la classe dominante dans son ensemble à faire tourner l’industrie allemande entière comme si c’était une seule machine. L’interconnexion complexe et hautement efficace de toutes les différentes unités de production et de distribution est un des principaux avantages du capital national allemand.
Face au poids mort de l’économie de la RDA en faillite, le tournant dans la récupération de son avantage concurrentiel a été atteint dans la première décennie du siècle présent. Deux facteurs ont été décisifs. Au niveau organisationnel, toutes les compagnies les plus importantes, mais aussi les fabriques moyennes de machines (Maschinenbau), ont commencé à produire et à œuvrer à une échelle mondiale, créant des réseaux de production tous centrés sur l’Allemagne elle-même. Au niveau politique, sous la direction du SPD (social-démocrate), les attaques contre les salaires et les prestations sociales (dénommées "Agenda 2010") ont été si radicales que le gouvernement français a même accusé l’Allemagne de dumping salarial.
Ce tournant a été favorisé par trois éléments majeurs du contexte économique global, qui se sont avérés être particulièrement favorables pour l’Allemagne.
D’abord, la transition du modèle keynésien au modèle communément appelé "néo-libéral" de capitalisme d'État, favorisant davantage les économies orientées vers l’exportation. Tout en participant fortement à l’ordre économique keynésien dominant le bloc de l'Ouest après 1945, le "modèle" ouest-allemand a été dès le début influencé par les idées "ordolibérales" 2 (Ludwig Erhard, l'école de Fribourg), et n’a jamais développé le type d'"Étatisme" qui continue à handicaper la compétitivité de la France aujourd’hui.
Deuxièmement, la consolidation de la coopération économique européenne après la chute du mur de Berlin (création de l'Union européenne, de l'union monétaire Euro). Bien qu’impulsée en partie pour des motifs politiques, essentiellement impérialistes (le désir de ses voisins de garder le "contrôle" de l’Allemagne), au niveau économique, l'Allemagne, en tant que concurrent le plus fort, a été le principal bénéficiaire de l'UE et de l'union monétaire. La crise financière et la crise de l’Euro après 2008 ont confirmé que les principaux pays capitalistes avaient toujours la capacité de repousser les pires effets de la crise sur leurs rivaux plus faibles. Les différents plans internationaux et européens de sauvetage, comme ceux de la Grèce par exemple, ont essentiellement servi au soutien des banques allemandes (et françaises) aux dépens des économies "secourues".
Troisièmement, la proximité géographique et historique de l’Europe de l’Est a contribué à faire de l’Allemagne le principal bénéficiaire de la transformation de celle-ci par la conquête de marchés auparavant hors de portée, y compris les vestiges extra-capitalistes. 3
Le rapport entre puissance économique et militaire de l'impérialisme allemand
Pour illustrer l’importance des conséquences de cette force compétitive à d’autres niveaux, nous voulons examiner maintenant le lien avec la dimension impérialiste. Après 1989, l’Allemagne a pu mettre en avant ses intérêts impérialistes avec une plus grande détermination et une plus grande indépendance. Des exemples en sont ses initiatives, sous Helmut Kohl, pour encourager l’éclatement de la Yougoslavie (commencées avec la reconnaissance diplomatique de l'indépendance des États de Croatie et de Slovénie), et le refus, sous Gerhard Schröder, de soutenir la seconde guerre d’Irak. Au cours des 25 dernières années, il y a certes eu des avancées au niveau impérialiste. Par-dessus tout, tant la "communauté internationale" que la population en Allemagne se sont accoutumées aux interventions militaires allemandes à l’étranger. La transition d’une armée de conscrits à une armée de métier a été faite. L’industrie d’armement allemande a accru sa part du marché mondial. Néanmoins, au plan impérialiste, elle n'a pas été capable de regagner autant de terrain qu'au plan économique. La difficulté à trouver suffisamment de volontaires pour l’armée reste sans solution. Par-dessus tout, l’objectif de modernisation technique des forces armées et d’accroissement, significatif de leur mobilité et de leur puissance de feu, n’a pas du tout été atteint.
En fait, pendant toute cette période après 1989, l’objectif de la bourgeoisie allemande n’a jamais été d’essayer, à court ou moyen terme, de "poser sa candidature" au leadership d'une tête de bloc potentielle opposée aux États-Unis. Au niveau militaire, cela aurait été impossible, étant donnés la puissance militaire écrasante des États-Unis et le statut actuel de l’Allemagne en tant que "géant économique mais nain militaire". Toute tentative de le faire aurait aussi conduit ses principaux rivaux européens à se liguer contre elle. Au niveau économique, supporter le poids de ce qui aurait été un programme énorme de réarmement aurait ruiné la compétitivité d’une économie qui luttait déjà contre le fardeau financier de la réunification - et aurait également fait courir le risque de confrontations avec la classe ouvrière.
Mais cela ne signifie en rien que Berlin ait renoncé à ses ambitions de regagner son statut, au moins de puissance militaire européenne dominante. Au contraire, depuis les années 1990, l’Allemagne suit une stratégie à long terme visant à augmenter son pouvoir économique comme base pour une renaissance militaire ultérieure. Alors que l’ex-URSS a fourni l'illustration qu’une puissance militaire ne peut se maintenir sur le long terme sans une base économique équivalente, plus récemment la Chine confirme l’autre face de la même pièce : une ascension économique peut préparer une ascension militaire ultérieure.
Une des clefs d’une telle stratégie à long terme est la Russie, mais aussi l’Ukraine. Au niveau militaire, ce sont les États-Unis, et pas l’Allemagne, qui ont le plus profité de l’extension de l’OTAN vers l’Est (en fait l’Allemagne a essayé d’empêcher certaines étapes de ce recul de la Russie). Par contre, c’est surtout au niveau économique que l’Allemagne espère profiter de toute cette zone. À la différence de la Chine, la Russie est incapable, pour des raisons historiques, d’organiser sa propre modernisation économique. Avant que le conflit ukrainien n’ait commencé, le Kremlin avait déjà décidé de tenter cette modernisation en coopération avec l’industrie allemande. En fait, un des principaux avantages de ce conflit pour les États-Unis est qu’il bloque (via l’embargo contre la Russie) cette coopération économique. Là réside aussi une des principales motivations de la chancelière allemande Merkel (et du président français Hollande, son partenaire subalterne dans cette affaire) pour prendre en charge la médiation entre Moscou et Kiev. En dépit de l’état actuellement de désolation de l’économie russe, la bourgeoisie allemande est toujours convaincue que la Russie serait capable de financer elle-même une telle modernisation. Le prix du pétrole ne restera pas toujours aussi bas qu’aujourd'hui, et la Russie recèle aussi beaucoup de métaux précieux à vendre. De plus, l’agriculture russe doit toujours être remaniée sur une base capitaliste moderne (c’est encore plus vrai pour l’Ukraine qui – malgré le désastre de Tchernobyl – a toujours certaines des terres les plus fertiles de la planète). Dans la perspective à moyen terme de disettes et de prix croissants des produits agricoles, de telles zones agricoles peuvent gagner une importance économique et même stratégique considérable. La crainte des États-Unis, que l’Allemagne puisse profiter de l’Est de l’Europe pour accroître encore son poids politique et économique relatif dans le monde et réduire quelque peu celui de l'Amérique en Europe, n'est donc pas infondée.
Un exemple de comment l’Allemagne utilise déjà avec succès sa force économique à des fins impérialistes est celui des réfugiés syriens. Même si elle le voulait, ce serait très difficile pour l’Allemagne de participer directement aux bombardements actuels en Syrie, du fait de sa faiblesse militaire. Mais comme, en raison de son chômage relativement bas, elle peut absorber une partie de la population syrienne sous la forme de l'afflux actuel de réfugiés, elle a gagné un moyen alternatif d'influencer la situation sur place, surtout après la guerre.
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les États-Unis, en particulier, cherchent actuellement à utiliser des moyens juridiques pour refréner la puissance économique de leur concurrent allemand, par exemple en traînant Volkswagen ou la Deutsche Bank devant les tribunaux et en les menaçant de milliards de dollars d'amendes.
Les difficultés de la classe ouvrière
L’année 2015 a été le témoin d’une séries de grèves, surtout dans les transports (DB - chemins de fer allemands, Lufthansa) et chez les employés des crèches. Il y a eu aussi des mouvements plus locaux mais significatifs comme celui de l’hôpital de la Charité à Berlin, où infirmiers et patients ont été solidaires. Tous ces mouvements ont été très sectoriels et très isolés, se focalisant parfois en partie sur la fausse alternative entre grands syndicats et petits syndicats corporatistes, brouillant la nécessité d'une auto-organisation autonome des ouvriers. Bien que tous les syndicats aient organisé les grèves de façon à causer le maximum de tracas au public, la tentative d’éroder la solidarité, au moins sous la forme de la sympathie du public envers les grévistes, n’a réussi qu’en partie. L’argument qui accompagnait les revendications dans le secteur des jardins d’enfants, par exemple, et selon lequel le régime de salaires particulièrement bas dans des professions traditionnellement féminines devait prendre fin, tout en contribuant à l’isolement de cette grève, a été populaire au sein de la classe dans son ensemble, qui a semblé reconnaître que cette "discrimination" était surtout un moyen de diviser les ouvriers.
C’est assurément un phénomène inhabituel que partout dans l’Allemagne contemporaine, les grèves aient joué un rôle si important dans les médias en 2015. Ces grèves, tout en donnant la preuve d’une combativité et d’une solidarité toujours existante, ne sont cependant pas les signes d’une vague ou d’une phase de lutte prolétarienne qui se poursuivrait. Elles doivent être comprises, en partie au moins, comme une manifestation de la situation économique particulière de l’Allemagne telle que nous l’avons décrite plus haut. Dans ce contexte de chômage relativement bas et de manque de main d’œuvre qualifiée, la bourgeoisie elle-même met en avant l’idée que, après des années de salaires en baisse inaugurées sous Schröder (ils ont baissé plus radicalement que presque partout ailleurs en Europe occidentale), les employés devraient être enfin "récompensés" pour leur "sens du réalisme". Le nouveau gouvernement de Grande coalition des chrétiens-démocrates et des sociaux-démocrates a lui-même donné le ton, en introduisant finalement (en tant qu'un des derniers pays en Europe à le faire) une loi sur le salaire minimum de base et en augmentant quelques prestations sociales. Dans l’industrie automobile, par exemple, les grandes entreprises, en 2015, ont payé des primes (qu’ils ont appelées "participation aux bénéfices") allant jusqu’à 9.000 Euros par ouvrier. C’était d’autant plus possible que la modernisation de l’appareil productif a été si efficace que – au moins pour le moment – l'avantage concurrentiel allemand repose beaucoup moins sur des salaires bas qu’il y a une décennie.
En 2003, le CCI a analysé la lutte de classe internationale, débutant avec les protestations envers les attaques contre les retraites en France et en Autriche, comme un tournant (non spectaculaire, presque imperceptible) vers un mieux pour la lutte de classe, essentiellement à cause d’un début de reconnaissance par la génération actuellement au travail (pour la première fois depuis la dernière guerre mondiale) que ses enfants n’auront pas de meilleures, mais de pires conditions de vie qu'elle-même. Cela a conduit aux premières expressions significatives de solidarité entre générations dans les luttes ouvrières. Cette évolution s’est exprimée sur le "lieu de production" plus au niveau de la conscience que de la combativité dans la mesure où la crainte du chômage et la précarité croissante du travail constituent des facteurs d'intimidation pour entrer en grève. En Allemagne même, la réponse initiale des chômeurs à l’Agenda 2010 (les "manifestations du lundi") s’est aussi bien vite essoufflée. Mais par ailleurs, une nouvelle génération, qui ne subit pas encore directement le joug du travail salarié, a commencé à descendre dans la rue (étant souvent rejointe par les employés précaires), pour exprimer non seulement sa propre colère et sa préoccupation pour l'avenir, mais aussi (plus ou moins consciemment) en rapport avec la classe dans son ensemble. Ces manifestations, s’étendant à des pays comme la Turquie, Israël et le Brésil, mais atteignant leur point culminant dans le mouvement anti-CPE en France et les Indignados en Espagne, ont même trouvé un écho, petit, faible mais cependant significatif, dans le mouvement des étudiants et des élèves en Allemagne. Celles-ci n'ont pas encore été accompagnées par la cristallisation d’une nouvelle génération de révolutionnaires mais par ses précurseurs potentiels.
En Allemagne, cela s’est exprimé dans un mouvement modeste mais combatif des Occupy, plus ouvert qu’avant aux idées internationalistes. Le mot d’ordre des premières manifestations Occupy était : "À bas le capital, l’État et la nation". Pour la première fois depuis des décennies en Allemagne, une politisation débutait donc, qui ne semblait pas être dominée par l’idéologie antifasciste et de libération nationale. Cela avait lieu en réponse à la crise financière de 2008 suivie par la crise de l’Euro. Certaines de ces petites minorités commençaient à penser que le capitalisme était au bord de l'effondrement. L’idée a commencé à se développer que s’il s’avérait que Marx avait raison sur la crise du capitalisme, il pourrait bien avoir raison aussi sur la nature révolutionnaire du prolétariat. Un espoir grandissait, celui que les attaques massives à l’échelle internationale se confrontent rapidement à une vague également massive de lutte de classe internationale. "Athènes aujourd’hui – Berlin demain - solidarité internationale contre le capital" est devenu le nouveau slogan.
La bourgeoisie, en réussissant à mettre fin à cette phase de la lutte de classe, n'a pas infligé une défaite historique au prolétariat, mais a réussi à briser, pour le moment, l’ouverture politique entamée en 2003. Ce qui a commencé comme crise américaine des subprimes a constitué une menace bien réelle pour la stabilité de l’architecture financière internationale. Le danger était pressant. Il n’y avait pas le temps pour d'interminables négociations entre gouvernements sur comment y faire face. La banqueroute de Lehman Brothers a eu l’avantage d’obliger les gouvernements dans tous les pays industrialisés à prendre des mesures immédiates et radicales pour sauver la situation (comme l’a écrit plus tard le Herald Tribune : "s'il n’était pas arrivé, l'effondrement de Lehman aurait dû être inventé"). Mais elle a aussi eu des avantages à un autre niveau : contre la classe ouvrière. Pour la première fois peut-être, la bourgeoisie mondiale a répondu à une crise majeure, aiguë, de son système, non pas en minimisant mais en exagérant son importance. On a raconté aux ouvriers du monde qu’à moins qu’ils n’acceptent immédiatement les attaques massives, les États, et avec eux les organismes de retraite et les fonds d’assurance, feraient faillite, les économies privées fondraient comme neige au soleil. Cette offensive de terreur idéologique ressemblait à la stratégie militaire de "choc et stupeur" employée par les États-Unis dans la seconde guerre d'Irak, visant à paralyser, traumatiser et désarmer l’adversaire. Et cela a fonctionné. En même temps, la base objective était présente pour ne pas attaquer tous les secteurs centraux du prolétariat mondial simultanément, puisque de larges secteurs de la classe ouvrière aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Irlande et en Europe du Sud ont beaucoup plus souffert qu’en Allemagne, en France et ailleurs en Europe du nord-ouest.
Le second chapitre de cette offensive de terreur et de division a été la crise de l’Euro, quand le prolétariat européen a été divisé avec succès entre nord et sud, entre les "fainéants de grecs" et les "allemands nazis et arrogants". Dans ce contexte, la bourgeoisie avait un autre atout dans la manche : le succès économique de l’Allemagne. Mêmes les grèves de 2015, et plus généralement les augmentations récentes de salaires et de prestations sociales dans ce pays, ont toutes été utilisées pour marteler le message, sur place comme auprès du prolétariat européen tout entier, que faire des sacrifices face à la crise finit par payer.
Ce message, selon lequel la lutte ne paye pas, a été en plus souligné par le fait que, dans les pays où la stabilité politique et économique est particulièrement fragile et la classe ouvrière plus faible, les mouvements de protestation de la jeune génération ("le Printemps arabe") n’ont réussi qu’à susciter de nouvelles vagues de répression ou des guerres intestines civiles et impérialistes. Tout cela a renforcé le sentiment d’impuissance et de manque de perspective dans la classe dans son ensemble.
Le non-effondrement du capitalisme et l’échec du prolétariat européen à s’opposer aux attaques massives ont aussi pesé sur les précurseurs d’une nouvelle génération de minorités révolutionnaires. L’augmentation de réunions publiques et de manifestations qui a caractérisé cette phase en Allemagne a fait place à une réelle phase de démoralisation. Depuis lors, d’autres manifestations ont eu lieu – contre "PEGIDA" 4, le TTIP 5, la technologie génétique ou la surveillance d’Internet – mais dénuées de toute critique plus fondamentale du capitalisme en tant que tel.
Et depuis l’été 2015, après les offensives autour des crises financière et de l’Euro, une autre offensive idéologique a eu lieu autour de la crise actuelle des réfugiés. Celle-ci est aussi utilisée au maximum par la classe dominante contre tout développement de la réflexion au sein du prolétariat. Mais plus que la propagande bourgeoise, la vague de réfugiés elle-même porte un coup supplémentaire aux premiers germes d'une récupération de la conscience de classe depuis le choc de 1989 ("la mort du communisme"). Le fait que des millions de gens de la "périphérie" du capitalisme risquent leur vie pour pouvoir entrer en Europe, en Amérique du Nord, et dans d’autres "forteresses" ne peut que, pour le moment, renforcer l’impression que c’est un privilège de vivre dans les parties développées du monde et que la classe ouvrière au centre du système, en l’absence de toute alternative au capitalisme, pourrait, après tout, avoir quelque chose à défendre au sein du capitalisme. De plus, la classe dans son ensemble, dépouillée pour le moment de son propre héritage politique, théorique et culturel, tend à voir les causes de cette migration désespérée non au sein du capitalisme, non en lien avec les contradictions centrées sur les pays démocratiques, mais dans une absence ou un manque de capitalisme et de démocratie dans les zones de conflit.
Tout ceci a conduit à un retrait accru tant de la combativité que de la conscience au sein de la classe.
Le problème du populisme politique
Bien que le phénomène de terreur de droite envers les étrangers et les réfugiés ne soit pas nouveau en Allemagne, en particulier depuis la réunification et surtout (quoique pas seulement) dans ses nouvelles provinces de l’Est, jusqu’à maintenant l'essor d’un mouvement politique populiste stable en Allemagne avait été empêché par la classe dominante elle-même avec succès. Mais dans le contexte de la crise de l’Euro, dont la phase aiguë a duré jusqu’à l’été 2015, et de la "crise des réfugiés" qui l'a suivie, un nouveau regain de populisme politique a eu lieu. Cela s’est manifesté principalement sur trois plans : la poussée électorale de "l'Alternative pour l’Allemagne" (Alternative für Deutschland, AfD), qui s’est originellement constituée en opposition aux plans de sauvetage grecs, et sur la base d’une vague opposition à la monnaie commune européenne ; un mouvement de protestation populiste de droite centré sur les "manifestations du lundi" à Dresde ("PEGIDA") ; une nouvelle recrudescence du terrorisme de droite envers les réfugiés et les étrangers, comme "l'Organisation clandestine nationale-socialiste" (Nationalsozialistischer Untergrund, NSU).
De tels phénomènes ne sont pas nouveaux sur la scène politique allemande. Mais jusqu’à maintenant, la bourgeoisie avait toujours réussi à les empêcher d'aboutir à toute espèce de présence stable et parlementaire. Durant l’été 2015, il semblait que les secteurs dominants allaient y parvenir encore une fois. L’AfD avait été privée de son thème (la crise "grecque") et de certaines de ses ressources financières, et avait subi sa première scission. Mais ensuite, le populisme a fait son retour – encore plus fort qu’avant – grâce à la nouvelle vague d’immigration. Et puisque cette question de l’immigration risque de jouer un rôle plus ou moins dominant dans un avenir proche, la possibilité augmente pour que l’AfD s’établisse comme composante nouvelle et plus durable du paysage politique.
La classe dominante est capable d’utiliser tout cela pour rendre son jeu électoral plus intéressant, pour stimuler les idéologies démocratique et antifasciste, et aussi pour répandre la division et la xénophobie. Néanmoins, tout ce processus ne correspond pas directement à ses intérêts de classe, ni n’est en mesure d’être complètement contrôlé.
La crise de l’Euro et ses effets sur la scène politique allemande illustrent qu’il existe un lien étroit entre l’accentuation de la crise globale du capitalisme et l’avancée du populisme. La crise économique ne fait pas qu’augmenter l’insécurité et la peur, en intensifiant la lutte pour la survie. Elle attise aussi les flammes de l’irrationalité. L’Allemagne, économiquement parlant, aurait le plus à perdre de tout affaiblissement de la cohésion de l’UE et de l’Euro. Des millions d’emplois sont directement ou indirectement dépendants des exportations et du rôle que joue l’UE pour l’Allemagne dans ce contexte. Dans un tel pays, c’est d'autant plus irrationnel de mettre en question l’UE, l’Euro, l’orientation du marché mondial dans son ensemble. À ce niveau, ce n’est par hasard si l’apparition récente de tels mouvements xénophobes a été suscitée par des inquiétudes sur la stabilité de la nouvelle monnaie européenne.
La rationalité est d'une importance vitale, bien qu'elle ne soit pas la seule, pour l'entendement humain. La rationalité se centre sur l’élément de calcul dans la pensée. Comme cela inclut la capacité de calculer ses propres intérêts objectifs, c’est un élément indispensable, non seulement de la société bourgeoise, mais aussi de la lutte prolétarienne de libération. Historiquement, elle est apparue et s’est développée dans une large mesure sous l’impulsion de l’échange d’équivalents. Comme, sous le capitalisme, l’argent développe pleinement son rôle en tant qu’équivalent universel, la monnaie et la confiance qu’elle inspire jouent un rôle majeur dans le "formatage" de la rationalité dans la société bourgeoise. La perte de confiance dans l’équivalent universel est par conséquent une des principales sources d’irrationalité dans la société bourgeoise. C’est pourquoi les crises monétaires et les périodes d’hyperinflation sont particulièrement dangereuses pour la stabilité de cette société. L’inflation de 1923 en Allemagne a ainsi été l’un des facteurs les plus importants préparant le triomphe du national-socialisme dix ans plus tard.
La vague actuelle de réfugiés et d'immigrants, par ailleurs, fait ressortir et illustre un autre aspect du populisme : l’accentuation de la concurrence entre les victimes du capitalisme et la tendance à l’exclusion, la xénophobie, la bouc-émissarisation. La misère sous le règne du capitalisme engendre une triade de destructions : premièrement, l’accumulation d'agressivité, de haine, de méchanceté, et une envie de destruction et d’autodestruction ; deuxièmement, la projection de ces pulsions antisociales sur d’autres (hypocrisie morale) ; troisièmement, le fait de diriger ces pulsions non contre la classe dominante, qui apparaît comme trop puissante pour être défiée, mais contre les classes et les couches sociales apparemment plus faibles. Ce "complexe" à trois facettes fleurit par conséquent surtout en l’absence de lutte collective du prolétariat, quand les sujets individuels se sentent impuissants face au capital. Le point culminant de cette triade aux racines du populisme est le pogrome. Bien que l'agressivité populiste s’exprime aussi contre la classe dominante, ce qu’elle lui demande, haut et fort, c’est protection et faveurs. Ce qu’elle souhaite est que la bourgeoisie, soit élimine ce qu’elle voit comme ses rivaux menaçants, soit tolère qu’elle commence à le faire elle-même. Cette "révolte conformiste", une caractéristique permanente du capitalisme, devient aiguë face à la crise, la guerre, le chaos, l’instabilité. Dans les années 1930, le cadre de son développement était la défaite mondiale historique du prolétariat. Aujourd’hui, le cadre est l’absence de toute perspective : la phase de décomposition.
Comme cela a déjà été développé par le CCI dans ses Thèses sur la décomposition, une des bases sociales et matérielles du populisme est le processus de déclassement, la perte de toute identité de classe. Malgré la robustesse économique du capital national allemand et sa pénurie de main d’œuvre qualifiée, il existe une partie importante de la population allemande aujourd’hui qui, bien qu’au chômage, n’est pas réellement un facteur actif de l’armée industrielle de réserve (prête à prendre les emplois des autres et par conséquent exerçant une pression à la baisse sur les salaires), mais qui appartient plutôt à ce que Marx appelait la couche des Lazare de la classe ouvrière. Du fait de problèmes de santé, ou de l'incapacité à supporter le stress du travail capitaliste moderne et de la lutte pour l’existence, ou du manque de qualifications appropriées, ce secteur est "inemployable" du point de vue capitaliste. Au lieu de faire pression sur les niveaux de salaire, ces couches font augmenter la facture totale des salaires pour le capital national à cause des prestations dont ils vivent. C’est aussi ce secteur qui ressent le plus les réfugiés comme des rivaux potentiels aujourd’hui.
Au sein de ce secteur, il existe deux groupes importants de la jeunesse prolétarienne, dont certaines parties peuvent être enclines à la mobilisation en tant que chair à canon pour les cliques bourgeoises mais aussi en tant que protagonistes actifs de pogroms. Le premier est composé d’enfants de la première ou deuxième génération d'ouvriers immigrés (Gastarbeiter). L’idée originelle était que ces ouvriers immigrés ne resteraient pas quand on n'aurait plus besoin d’eux et, surtout, qu’ils n’amèneraient pas leur famille avec eux ou ne fonderaient pas de famille en Allemagne. Le contraire a eu lieu et la bourgeoisie n’a pas fait d’effort particulier pour éduquer les enfants de ces familles. Le résultat aujourd’hui est que, parce que les emplois non qualifiés ont été dans une grande mesure "exportés" vers ce qu'il était d'usage d'appeler les "pays du tiers-monde", une partie de cette jeunesse prolétarienne est condamnée à vivre des allocations de l’État, à n’être jamais intégrée dans le travail associé. L’autre groupe est composé d’enfants des licenciements massifs et traumatisants en Allemagne de l’Est après la réunification. Une partie d'entre eux, des Allemands plus que des immigrants, qui n’a pas été élevée pour être au niveau du standard "occidental" hautement compétitif de capitalisme, et qui n’a pas osé aller en Allemagne de l’Ouest pour trouver un travail après 1989 comme l'ont fait les plus intrépides, a rejoint cette armée de gens qui vivent d’allocations. Ces secteurs en particulier sont vulnérables à la lumpenisation, la criminalisation et aux formes décadentes, xénophobes de politisation.
Quoique le populisme soit le produit de son système, la bourgeoisie ne peut ni produire, ni faire disparaître ce phénomène à volonté. Mais elle peut le manipuler à ses propres fins, et encourager ou décourager son développement à un degré plus ou moins grand. En général, elle fait les deux. Mais cela aussi n’est pas facile à maîtriser. Même dans le contexte du capitalisme d’État totalitaire, il est difficile pour la classe dominante d’arriver à maintenir une cohérence dans une telle situation. Le populisme lui-même est profondément enraciné dans les contradictions du capitalisme. L'accueil des réfugiés aujourd’hui, par exemple, repose sur les intérêts objectifs d'importants secteurs du capitalisme allemand. Les avantages économiques sont mêmes plus apparents que les avantages impérialistes. C’est pourquoi les dirigeants de l’industrie et le monde des affaires sont les partisans les plus enthousiastes de la "culture de l’accueil" en ce moment. Ils estiment que l’Allemagne aurait besoin d’un afflux d’environ un million de personnes chaque année dans la période à venir, au vu de la pénurie prévue de main d’œuvre qualifiée et surtout de la crise démographique causée par le taux de natalité invariablement bas du pays. Et les réfugiés des guerres et d’autres catastrophes s’avèrent souvent être des ouvriers particulièrement assidus et disciplinés, prêts non seulement à travailler pour des bas salaires, mais aussi à prendre des initiatives et des risques. De plus, l’intégration de nouveaux venus de "l'extérieur", et l’ouverture culturelle que cela demande, est en elle-même une force productive (et aussi une force potentielle pour le prolétariat, bien sûr). Un succès ultérieur de l’Allemagne à ce niveau pourrait être un avantage de plus sur ses concurrents européens.
Cependant, l’exclusion est, en même temps, le revers de la médaille de la politique d’inclusion de Merkel. L’immigration requise aujourd’hui n’est plus celle d’une main d’œuvre non qualifiée des générations Gastarbeiter, maintenant que les emplois sans qualification ont été concentrés à la périphérie du capitalisme. Les nouveaux migrants doivent arriver avec de hautes qualifications, ou au moins la volonté de les acquérir. La situation actuelle demande une sélection beaucoup plus organisée et impitoyable que par le passé. Du fait de ces besoins contradictoires d’inclusion et d’exclusion, la bourgeoisie encourage simultanément l’ouverture et la xénophobie. Elle répond aujourd’hui à ce besoin par une division du travail entre droite et gauche, y compris au sein du parti chrétien-démocrate de Merkel et de son gouvernement de coalition avec le SPD. Mais derrière les dissonances actuelles entre les différents groupes politiques à propos de la question des réfugiés, il n’y a pas seulement une division du travail mais aussi des soucis et des intérêts différents. La bourgeoisie n’est pas un bloc homogène. Alors que ces parties de la classe dominante et de l’appareil d’État les plus proches de l’économie poussent à l’intégration, l'ensemble de l’appareil de sécurité est horrifié par l’ouverture des frontières par Merkel à l'été 2015 et par le nombre de personnes qui arrivent depuis lors, à cause de la perte de contrôle sur ceux qui pénètrent sur le territoire de l’État à laquelle cela a temporairement mené. De plus, au sein de l’appareil répressif et judiciaire, il y a inévitablement ceux qui sympathisent avec l’extrême droite et la protègent du fait d’une obsession partagée de la loi et de l’ordre, du nationalisme, etc.
En ce qui concerne la caste politique elle-même, il n’y a pas seulement ceux qui (selon l’humeur dans leur circonscription électorale) flirtent avec le populisme par opportunisme. Il y en a aussi beaucoup qui partagent cette mentalité. À tout cela, nous pouvons ajouter les contradictions du nationalisme lui-même. Comme tous les États bourgeois modernes, l’Allemagne a été fondée sur la base de mythes à propos d'une histoire, d'une culture et même d'un sang partagés. Dans ce contexte, même la plus puissante bourgeoisie ne peut pas inventer et réinventer à volonté des définitions différentes de la nation pour les adapter à ses intérêts changeants. Pas plus qu'elle n'aurait nécessairement un intérêt objectif à le faire, puisque les vieux mythes nationalistes sont toujours essentiels et sont un levier puissant du "diviser pour régner" à l’intérieur, et de mobilisation pour soutenir les agressions impérialistes à l’extérieur. Ainsi, il ne va pas encore de soi aujourd’hui qu’un noir ou un musulman puissent être "Allemand".
La classe dominante allemande face à la "crise des réfugiés"
Dans le contexte de décomposition et de crise économique, le principal moteur du populisme en Europe ces dernières décennies a été le problème de l’immigration. Aujourd’hui, ce problème est devenu plus aigu du fait de l'exode le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi cet afflux est-il apparemment bien plus un problème politique en Europe que dans des pays comme la Turquie, la Jordanie ou même le Liban qui reçoivent des contingents beaucoup plus grands ? Dans les vieux pays capitalistes, les coutumes précapitalistes d’hospitalité et les structures sociales et économiques de subsistance qui les accompagnent se sont beaucoup plus radicalement atrophiées. Il y a aussi le fait que ces migrants viennent d'une culture différente. Bien sûr, ce n’est pas un problème en soi, au contraire. Mais le capitalisme moderne en fait un problème. En Europe occidentale en particulier, l’État-providence est l’organisateur principal de l’aide et de la cohésion sociales. C’est cet État qui est supposé accueillir les réfugiés. Cela place déjà ces derniers en concurrence avec les pauvres "indigènes" pour les emplois, le logement et les prestations sociales.
Jusqu’à maintenant, du fait de sa relative stabilité économique, politique et sociale, l’immigration, et avec elle le populisme, ont causé moins de problème en Allemagne que dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest. Mais dans la situation actuelle, la bourgeoisie allemande est de plus en plus confrontée à ce problème, non seulement chez elle mais aussi dans le contexte de l’Union européenne.
En Allemagne-même, la montée du populisme de droite dérange ses projets d’intégrer une partie des immigrants. C'est un problème réel puisque, jusqu’à maintenant, toutes les tentatives de relever le taux de natalité "à domicile" ont échoué. La terreur de droite altère aussi la réputation du pays à l’étranger – un point très sensible au vu des crimes de la bourgeoisie allemande pendant la première moitié du XXème siècle. L’établissement de l’AfD en tant que force parlementaire stable pourrait compliquer la formation de futurs gouvernements. Au niveau électoral, c’est actuellement surtout un problème pour la CDU/CSU, le parti gouvernemental dominant, qui jusqu’à maintenant, sous Merkel, a été capable d’attirer à la fois les électeurs sociaux-démocrates et conservateurs, consolidant ainsi sa position dominante vis-à-vis du SPD.
Mais c’est par-dessus tout au niveau de l’Europe que le populisme menace aujourd’hui les intérêts de l’Allemagne. Le statut de l’Allemagne, en tant qu’acteur mondial économique et, à un moindre degré, politique, dépend dans une large mesure de l’existence et de la cohérence de l’UE. L’arrivée au gouvernement de partis populistes, plus ou moins anti-européens, en Europe de l’Est (c’est déjà le cas en Hongrie et en Pologne) et surtout en Europe de l’Ouest, tendrait à gêner cette cohésion. C’est en particulier pourquoi Merkel a déclaré que la question des réfugiés était celle qui "décidera du destin de l’Allemagne". La stratégie de la bourgeoisie allemande vis-à-vis de cette question est une tentative de transformer, au niveau européen, la migration plus ou moins chaotique de la période de l'après-guerre et de la décolonisation en une immigration au mérite, hautement sélective, plus sur le modèle canadien ou australien. La fermeture plus efficace des frontières externes de l’UE est une des préconditions pour la transformation proposée d’une immigration illégale en une immigration légale. Cela impliquerait aussi l’établissement de quotas annuels d’immigration. Au lieu de payer des sommes abominables pour passer clandestinement dans l’Union Européenne, les migrants seraient encouragés à "investir" dans leur propre qualification de façon à accroître leurs chances d’accès légal. Au lieu de partir pour l’Europe de leur propre initiative, ces réfugiés acceptés seraient transportés vers des lieux d’accueil et d’emploi déjà prévus pour eux. L’autre face de cette pièce est que les immigrants non désirés seraient arrêtés aux frontières, ou brutalement et rapidement expulsés s’ils ont déjà réussi à y accéder. Cette conversion des frontières de l’UE en sas de sélection (un processus déjà en cours) est présentée comme un projet humanitaire visant à réduire le nombre de noyades en Méditerranée qui, en dépit de toutes les manipulations des médias, est devenu une source de déshonneur moral pour la bourgeoisie européenne. À travers son insistance sur une solution européenne plutôt que nationale, l’Allemagne assume ses responsabilités vis-à-vis de l’Europe capitaliste, soulignant en même temps sa revendication de leadership politique du vieux continent. Son objectif n’est rien de moins que de désamorcer la bombe à retardement de l’immigration, et avec elle du populisme politique, dans l’UE.
Ce fut dans ce contexte que le gouvernement Merkel, durant l’été 2015, a ouvert les frontières allemandes aux réfugiés. À ce moment-là, les réfugiés syriens, qui jusqu’alors étaient prêts à rester en Turquie orientale, ont commencé à perdre l’espoir de retourner chez eux et sont ainsi partis, en masse, vers l’Europe. En même temps, le gouvernement turc décidait, pour faire du chantage à l’UE qui bloquait la candidature d’Ankara à l'entrée en Europe, de ne pas empêcher leur départ. Dans cette situation, la fermeture des frontières allemandes aurait créé un entassement de centaines de milliers de réfugiés dans les Balkans, une situation chaotique et presque incontrôlable. Mais en levant temporairement le contrôle de ses frontières, Berlin a suscité un nouveau flux de migration de gens désespérés qui ont soudainement (mal) compris qu’ils étaient invités en Allemagne. Tout cela montre la réalité d’un moment de perte potentielle de contrôle de la situation.
Du fait de la manière radicale avec laquelle elle s’est identifiée à "son" projet, les chances de succès de la "solution européenne" proposée par Merkel se détérioreraient considérablement si elle échouait à être réélue en 2017. Un des principaux points de la campagne de réélection de Merkel semble être économique. Confrontée au ralentissement actuel de la croissance en Chine et en Amérique, l’économie allemande orientée vers les exportations se dirigerait normalement vers la récession. Un accroissement des dépenses d’État et de l’activité de construction "pour les réfugiés" pourrait éviter une telle éventualité jusqu'aux élections.
À la différence des années 1970 (quand dans nombre des principaux pays occidentaux les partis capitalistes de gauche sont venus au gouvernement : "la gauche au pouvoir") ou des années 1980 ("la gauche dans l’opposition"), la stratégie gouvernementale et le "jeu" électoral actuels en Allemagne sont déterminés à un degré bien moindre par la menace plus immédiate de la lutte de classe et beaucoup plus que par le passé par les problèmes d’immigration et de populisme.
Les réfugiés et la classe ouvrière
La solidarité avec les réfugiés exprimée par une partie importante de la population en Allemagne, bien qu’exploitée au maximum par l’État pour promouvoir l'image d’un nationalisme allemand humain, ouvert sur le monde, a été spontanée et, au début, "auto-organisée". Encore aujourd’hui, plus de six mois après le début de la crise actuelle, la gestion étatique de l’afflux s'effondrerait sans les initiatives de la population. Il n’y a rien de prolétarien dans ces activités en elles-mêmes. Au contraire, ces gens font en partie le travail que l’État est incapable de faire ou ne veut pas faire, souvent encore sans aucune rétribution. Pour la classe ouvrière, le problème central est que cette solidarité ne peut avoir lieu actuellement sur un terrain de classe. Pour le moment, elle revêt un caractère très apolitique, déconnecté de toute opposition explicite à la guerre impérialiste en Syrie par exemple. Tout comme les "ONG" et toutes les différentes organisations "critiques" de la société civile (inexistante en réalité), ces structures ont plus ou moins été immédiatement transformées en appendices de l’État totalitaire.
Mais en même temps, ce serait une erreur de ne prendre simplement cette solidarité que pour de la charité. D’autant plus que cette solidarité s’est exprimée vis-à-vis d’un afflux de rivaux potentiels sur le marché du travail et autres aspects. En l’absence de traditions précapitalistes d’hospitalité dans les vieux pays capitalistes, le travail associé et la solidarité du prolétariat sont la principale base sociale, matérielle, d'une telle solidarité plus généralement ressentie. Son esprit dans l'ensemble n’a pas été celui "d’aider les pauvres et les faibles", mais celui de coopération et de créativité collective. Sur le long terme, si la classe commence à retrouver son identité, sa conscience et son héritage, cette expérience actuelle de solidarité peut être intégrée dans l’expérience de la classe et sa recherche de perspective révolutionnaire. Parmi les ouvriers en Allemagne aujourd’hui, au moins potentiellement, les pulsions de solidarité expriment une certaine lueur de mémoire et de conscience de classe, rappelant qu’en Europe aussi, l'expérience de la guerre et des déplacements massifs de population n'est pas très ancienne, et que le manque de solidarité face à cette expérience pendant la période de contre-révolution (avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale) ne devrait pas se répéter aujourd’hui.
Le pôle opposé au populisme dans le capitalisme n’est pas la démocratie et l’humanisme mais le travail associé – le principal contrepoids à la xénophobie et au pogromisme. La résistance à l’exclusion et à la bouc-émissarisation a toujours été un moment permanent et essentiel de la lutte prolétarienne de tous les jours. Il peut y avoir aujourd'hui les prémices d’un très obscur tâtonnement vers une reconnaissance que les guerres et autres catastrophes qui obligent les gens à fuir font partie des séparations violentes au travers desquelles, dans un processus permanent, est constitué le prolétariat. Et que le refus de ceux qui ont tout perdu de rester docilement là où la classe dominante veut qu’ils restent, leur refus de renoncer à la recherche d’une vie meilleure, sont des moments constitutifs de la combativité prolétarienne. La lutte pour sa mobilité, contre le régime de discipline capitaliste, est un des plus vieux moments de la vie du travail salarié "libre".
La mondialisation et la nécessité d’une lutte internationale
Dans la partie sur le bilan de la lutte de classe, nous avons dit que les grèves de 2015 en Allemagne étaient plus une expression d’une situation économique nationale temporaire et favorable qu’une indication d’une combativité plus généralisée à l’échelle européenne ou internationale. Il reste donc vrai qu’il est devenu de plus en plus difficile pour la classe ouvrière de défendre ses intérêts immédiats par des actions de grèves ou d’autres moyens de lutte. Cela ne signifie pas que les luttes économiques ne soient plus possibles ou aient perdu de leur pertinence (comme la dénommée tendance d’Essen du KAPD l’avait erronément conclu dans les années 1920). Au contraire, cela signifie que la dimension économique de la lutte de classe renferme une dimension politique beaucoup plus directe que dans le passé – une dimension qu’il est extrêmement difficile d’assumer.
Les récentes résolutions de congrès du CCI ont à juste titre identifié un des facteurs objectifs qui inhibe le développement de luttes de défense des intérêts économiques immédiats : le poids intimidant du chômage de masse. Mais ce n’est pas le seul, et même pas la principale cause économique de cette inhibition. Un facteur plus fondamental réside dans ce qu’on appelle la mondialisation - la phase actuelle du capitalisme d’État totalitaire - et le cadre qu’il donne à l’économie mondiale.
La mondialisation du capitalisme global n’est pas, en elle-même, un phénomène nouveau. Nous le trouvons déjà à la base du premier secteur hautement mécanisé de la production capitaliste : l’industrie textile en Grande-Bretagne, centre d’un triangle lié à l'enlèvement d'esclaves en Afrique et à leur travail dans des plantations de coton aux États-Unis. En termes de marché global, le niveau de mondialisation atteint avant la Première Guerre mondiale n’a plus été rejoint avant la fin du XXème siècle. Néanmoins, au cours des trois dernières décennies, cette mondialisation a acquis une nouvelle qualité surtout à deux niveaux : dans la production et dans la finance. Le schéma de la périphérie du capitalisme fournissant de la main d’œuvre bon marché, des produits de plantations agricoles et des matières premières pour les pays industriels de l’hémisphère nord a été, sinon entièrement remplacé, du moins en grande partie modifié par des réseaux globaux de production, toujours centrés sur des pays plus dominants, mais où les activités industrielle et de service prennent place dans le monde entier. Dans ce corset "ordolibéral", la tendance est à ce qu'aucun capital national, aucune industrie, aucun secteur ou aucune affaire ne puisse plus être en mesure de s’exempter de la concurrence internationale directe. Il n’y a presque rien qui soit produit n’importe où dans le monde qui ne puisse être produit ailleurs. Chaque État-nation, chaque région, chaque ville, chaque quartier, chaque secteur de l’économie sont condamnés à se concurrencer pour attirer des investissements globaux. Le monde entier est envoûté, comme s’il était condamné à attendre le salut de l’arrivée de capital sous la forme d’investissements. Cette phase du capitalisme n’est en aucune façon un produit spontané, mais un ordre étatique introduit et imposé surtout par les vieux États-nations bourgeois dominants. Un des buts de cette politique économique est d’emprisonner la classe ouvrière du monde entier dans un monstrueux système disciplinaire.
À ce niveau, nous pouvons peut-être diviser l’histoire des conditions objectives de la lutte de classe, très schématiquement, en trois phases. Durant l’ascendance du capitalisme, les ouvriers étaient confrontés d'abord et avant tout à des capitalistes individuels, et pouvaient donc s’organiser plus ou moins efficacement dans des syndicats. Avec la concentration du capital dans les mains de grandes entreprises et de l’État, ces moyens de lutte établis ont perdu de leur efficacité. Chaque grève était maintenant directement confrontée à l’ensemble de la bourgeoisie, centralisée dans l’État. Il a fallu du temps au prolétariat pour trouver une réponse efficace à cette nouvelle situation : la grève de masse de l’ensemble du prolétariat à l'échelle d’un pays tout entier (Russie, 1905), qui contient déjà en son sein la potentialité de la prise de pouvoir et de l’extension à d'autres pays (première vague révolutionnaire déclenchée par l’Octobre rouge). Aujourd’hui, avec la mondialisation contemporaine, une tendance historique objective du capitalisme décadent atteint son plein développement : chaque grève, chaque acte de résistance économique des ouvriers quelque part dans le monde, se trouvent immédiatement confrontés à l’ensemble du capital mondial, toujours prêt à retirer la production et l'investissement et à produire ailleurs. Pour le moment, le prolétariat international a été tout à fait incapable de trouver une réponse adéquate, ou même d'entrevoir à quoi pourrait ressembler une telle réponse. Nous ne savons pas s’il réussira à le faire finalement. Mais il parait clair que le développement dans cette direction prendrait beaucoup plus de temps que la transition des syndicats à la grève de masse. D’un côté, la situation du prolétariat dans les vieux pays centraux du capitalisme – ceux, comme l’Allemagne, au "sommet" de la hiérarchie économique – devrait devenir beaucoup plus dramatique qu'elle ne l'est aujourd’hui. D’un autre côté, le pas requis par la réalité objective - lutte de classe internationale consciente, la "grève de masse internationale" - est beaucoup plus exigeant que le pas des syndicats à la grève de masse dans un pays. Car il oblige la classe ouvrière à remettre en question, non seulement le corporatisme et le localisme, mais aussi les principales divisions de la société de classes, souvent vieilles de plusieurs siècles voire même de plusieurs millénaires, comme la nationalité, la culture ethnique, la race, la religion, le sexe, etc. C'est un pas beaucoup plus profond et plus politique.
En réfléchissant à cette question, nous devrions prendre en considération que les facteurs qui empêchent le développement par le prolétariat de sa propre perspective révolutionnaire ne résident pas seulement dans le passé, mais aussi dans le présent ; qu'ils n’ont pas seulement des causes politiques mais aussi économiques (plus exactement : économico-politiques).
Présentation du rapport (mars 2016)
Au moment de la crise financière de 2008, il y avait au sein du CCI une tendance à une sorte de "catastrophisme" économique, dont une des expressions était l'idée, mise en avant par certains camarades, que l'effondrement de pays capitalistes centraux comme l'Allemagne aurait pu être alors à l'ordre du jour. Une des raisons pour faire de la force économique et de la compétitivité relatives de l'Allemagne un axe de ce rapport est le souhait de contribuer à surmonter de telles faiblesses. Mais nous voulons également imposer l'esprit de nuance contre la pensée schématique. Parce que le capitalisme lui-même a un mode abstrait de fonctionnement (basé sur l'échange d'équivalents), il existe une tendance compréhensible mais malsaine à voir les questions économiques de manière trop abstraite, par exemple en jugeant de la force économique relative des capitaux nationaux uniquement en termes très généraux (tels que le taux de composition organique du capital, l'abondance de main-d’œuvre nécessaire à la production, la mécanisation, comme mentionnés dans le rapport), en oubliant que le capitalisme est une relation sociale entre êtres humains, et par-dessus tout entre classes sociales.
Nous devrions clarifier un point : quand le rapport dit que la bourgeoisie américaine use de moyens juridiques (les amendes contre Volkswagen et d'autres) pour contrer la concurrence allemande, l'intention n'était pas de donner l'impression que les États-Unis n'ont pas de forces économiques propres à jeter dans la balance. Par exemple, les États-Unis devancent actuellement l'Allemagne dans le développement des voitures électriques et sans conducteur, et une des hypothèses qui circule sur les médias sociaux sur le soi-disant scandale Volkswagen (que l'information sur la manipulation des mesures d'émission par cette entreprise pourrait avoir fuité de l'intérieur de la bourgeoisie allemande vers les autorités américaines pour obliger l'industrie automobile allemande à rattraper son retard sur ce plan) n'est pas totalement invraisemblable.
Sur la façon dont la crise des réfugiés est utilisée à des fins impérialistes, il est nécessaire d'actualiser le rapport. Actuellement, tant la Turquie que la Russie font un usage massif de la situation critique des réfugiés pour faire chanter le capital allemand et affaiblir ce qui reste de cohésion européenne. La façon dont Ankara laisse les réfugiés aller vers l'ouest est déjà mentionnée dans le rapport. Le prix de la coopération turque sur cette question ne se limitera pas à plusieurs milliards d'Euros. Quant à la Russie, elle a récemment été accusée par une série d'ONG et d'organisations d'aide aux réfugiés de bombarder délibérément des hôpitaux et des zones résidentielles dans des villes syriennes dans le but de déclencher de nouveaux départs de réfugiés. Plus généralement, la propagande russe utilise systématiquement la question des réfugiés pour attiser les flammes du populisme politique en Europe.
En ce qui concerne la Turquie, elle exige non seulement de l'argent mais aussi l'accélération de l'accès sans visa de ses citoyens en Europe et des négociations en vue de l'admission dans l'UE. De l'Allemagne, elle exige également la cessation de l'aide militaire aux unités kurdes en Irak et en Syrie.
Pour la chancelière Merkel, la plus éminente partisane d'une plus étroite collaboration avec Ankara sur la question des réfugiés, et qui est une atlantiste plus ou moins fervente (pour elle, la proximité avec les États-Unis est un moindre mal comparé à la proximité avec Moscou), ceci est un problème moins important qu'il ne l'est pour d'autres membres de son propre parti. Comme le rapport l'a déjà mentionné, Poutine avait planifié la modernisation de l'économie russe en étroite collaboration avec l'industrie allemande, en particulier avec son secteur de l'ingénierie qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, est principalement localisé dans le sud de l'Allemagne (y compris Siemens, autrefois basé à Berlin et maintenant à Munich, qui semble avoir été désigné pour jouer un rôle central dans cette "opération russe"). C'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre le lien entre la critique persistante de la "solution européenne" (et "turque") soutenue par Merkel à la crise des réfugiés de la part du parti compagnon de la CDU, la CSU bavaroise, et la spectaculaire visite semi-officielle des dirigeants du parti bavarois à Moscou au point culminant de cette controverse 6. Cette fraction préférerait collaborer avec Moscou plutôt qu'avec Ankara. Paradoxalement, les plus forts soutiens de la chancelière sur cette question aujourd'hui ne se trouvent pas à l'intérieur de son propre parti, la CDU, mais chez son partenaire de coalition, le SPD, et dans l'opposition parlementaire. Nous pouvons l'expliquer en partie par une division du travail au sein de la démocratie chrétienne au pouvoir, son aile droite essayant (pour le moment sans grand succès) d'empêcher ses électeurs conservateurs de passer chez les populistes (AfD). Mais il y a aussi des tensions régionales (depuis la Seconde Guerre mondiale, bien que le gouvernement ait été à Bonn et la capitale financière à Francfort, la vie culturelle de la bourgeoisie allemande était principalement concentrée à Munich. C'est seulement récemment que celle-ci a commencé à être de nouveau attirée par Berlin, suivant le déménagement du gouvernement dans cette ville).
En lien avec les vagues actuelles d'immigration, il n'y a pas seulement un antagonisme au sein de l'Europe, bien sûr, mais aussi une collaboration et une division du travail, par exemple entre les bourgeoisies allemande et autrichienne. En initiant la "fermeture de la route des Balkans", l'Autriche a rendu Berlin moins unilatéralement dépendant de la Turquie pour la rétention des réfugiés, renforçant ainsi en partie la position de Berlin dans les négociations avec Ankara 7.
Alors qu'une partie importante du monde des affaires a soutenu la "politique de l'accueil" de Merkel envers les réfugiés l'été dernier, c'était loin d'être le cas parmi les organes de sécurité de l'État, qui étaient absolument horrifiés par cet afflux plus ou moins contrôlé et déclaré dans le pays. Ils ne lui ont toujours pas pardonné pour cela. Le gouvernement français et les autres gouvernements européens n'étaient pas moins sceptiques. Ils sont tous convaincus que des rivaux impérialistes du monde islamique utilisent la crise des réfugiés pour faire entrer clandestinement des djihadistes en Allemagne, d'où ils peuvent partir rejoindre la France, la Belgique, etc. En fait, les agressions criminelles de la nuit du Nouvel An à Cologne ont déjà confirmé que même les bandes criminelles exploitent les procédures d'asile pour placer leurs membres dans les grandes villes européennes. Nul besoin d'être prophète pour prévoir qu'une nouvelle montée en puissance de la police et des services secrets en Europe sera l'un des principaux résultats des développements actuels 8.
Le rapport établit une relation entre crise économique, immigration et populisme politique. Si nous ajoutons le rôle grandissant de l'antisémitisme, le parallèle avec les années 1930 devient particulièrement frappant. Mais il est intéressant, dans cette relation, d'examiner comment la situation en Allemagne aujourd'hui illustre aussi les différences historiques. Le fait qu'il n'y ait pas de preuve formelle, pour le moment, que les sections centrales du prolétariat soient défaites, désorientées et démoralisées comme elles l'étaient il y a 80 ans est la différence la plus importante, mais pas la seule. La politique économique favorisée par la grande bourgeoisie aujourd'hui est la mondialisation, pas l'autarcie, ni le protectionnisme prôné par les populistes "modérés". Ceci évoque un aspect du populisme contemporain encore peu développé dans le rapport : l'opposition à l'Union Européenne. Cette dernière est, sur le plan économique, un des instruments de la mondialisation actuelle. En Europe, elle est même devenue son principal emblème. Par exemple, les négociations sur l'accord commercial TTIP entre l'Amérique du Nord et l'Europe, qui_ profite à la grande industrie et à l'agro-industrie aux dépens des petits fermiers et producteurs dans des régions comme les États du "groupe de Visegrad" (Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie), font partie du contexte de la formation, récemment, de gouvernements populistes en Europe du centre-est.
En ce qui concerne la situation du prolétariat, le souci exprimé à la fin du rapport est que nous ne devrions pas seulement regarder les causes résidant essentiellement dans le passé (telles que la contre-révolution qui a suivi la défaite de la Révolution russe et mondiale à la fin de la Première Guerre mondiale) pour expliquer les difficultés de la classe ouvrière à développer politiquement sa lutte dans une direction révolutionnaire après 1968. Tous ces facteurs issus du passé, et qui sont tous des explications profondément justes, n'ont néanmoins empêché ni Mai 68 en France ni l'Automne chaud 1969 en Italie. Nous ne devrions pas non plus partir du principe que le potentiel révolutionnaire exprimé à cette époque, de manière embryonnaire, était voué à l'échec dès le début. Les explications basées unilatéralement sur le passé mènent à une sorte de fatalisme déterministe. Sur le plan économique, ce qu'on appelle communément la mondialisation est un instrument capitaliste d'État, économique et politique, que la bourgeoisie a trouvé pour stabiliser son système et pour contrer la menace prolétarienne, un instrument face auquel le prolétariat, à son tour, devra trouver une réponse. C'est pourquoi les difficultés de la classe ouvrière ces 30 dernières années à développer une alternative révolutionnaire sont intimement liées à la stratégie politico-économique de la bourgeoisie, incluant sa capacité à différer dans le temps une catastrophe (Kladderadatsch) économique pour la classe ouvrière - et ainsi la menace de guerre de classe - dans les vieux centres du capitalisme mondial.
1 La Ligue hanséatique était une alliance commerciale et industrielle en Allemagne du nord qui domina le commerce baltique durant le Moyen Âge et le début de la période moderne.
2 L'ordolibéralisme est une variante allemande de libéralisme politico-économique qui met l'accent sur le besoin pour l'État d'intervenir en faisant en sorte que le marché libre produise à un niveau proche de ses potentialités économiques.
3 Selon Rosa Luxemburg, les zones extra-capitalistes sont centrées sur une production non encore directement basée sur l'exploitation du travail salarié par le capital, que ce soit une économie de subsistance ou une production pour le marché par des producteurs individuels. Le pouvoir d'achat de tels producteurs contribue à rendre possible le déroulement de l'accumulation du capital. Le capitalisme mobilise et exploite aussi la force de travail et les "matières premières" (c'est-à-dire les richesses naturelles) en provenance de ces zones.
4 Les Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident.
5 TTIP : en français, "Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement". C'est la proposition d'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis.
6 Lors de la conférence, la discussion a aussi fait justement remarquer que la formulation du rapport selon laquelle le monde des affaires en Allemagne soutient, comme un seul homme, la politique de Merkel concernant les réfugiés, est très schématique et comme telle incorrecte. Même le besoin de ressources fraîches en main-d’œuvre par les employeurs varie beaucoup d'un secteur à l'autre.
7 Bien que cette convergence d'intérêts entre Vienne et Berlin, comme souligné dans la discussion, soit temporaire et fragile.
8 L'infiltration djihadiste et la probabilité croissante d'attaques terroristes sont une réalité. Mais cette situation et d'autres sont ainsi utilisées par la classe dominante comme moyen pour créer une atmosphère de peur, de panique et de suspicion permanentes, antidotes à la réflexion critique et à la solidarité au sein de la population ouvrière.
Géographique:
- Allemagne [19]
Personnages:
- Angela Merkel [15]
- Pegida [20]
Récent et en cours:
Rubrique:
L’insurrection de Dublin en 1916 et la question nationale
- 3302 lectures
Il y a cent ans, à Pâques 1916, une poignée de nationalistes irlandais s'emparait de positions stratégiques dans le centre de Dublin et déclarait l'indépendance de l'Irlande vis-à-vis de l'empire britannique et la création d'une République d'Irlande. Ils réussirent à tenir quelques jours avant d'être écrasés par les forces armées britanniques, qui n'ont pas hésité à bombarder la ville en utilisant les canons de la marine. Parmi ceux qui furent exécutés sommairement après la défaite de l'Insurrection de Pâques, il y avait le grand révolutionnaire James Connolly, l'un des leaders les plus connus de la classe ouvrière en Irlande qui avait fait participer sa milice ouvrière dans la révolte aux côtés des volontaires irlandais nationalistes.
Tout au long de la seconde moitié du 19ème siècle, le soutien à la cause de l'indépendance nationale irlandaise et polonaise avait été une donnée du mouvement ouvrier européen. La tragédie de l'Irlande et la croyance de Marx dans la nécessité de l'indépendance irlandaise ont été utilisées maintes et maintes fois pour justifier le soutien à un certain nombre de mouvements de "libération nationale" contre les puissances impérialistes aussi bien anciennes que nouvelles. Mais le déclenchement de la guerre mondiale en 1914 devait consacrer la prise en compte de changements de la situation mondiale invalidant les anciennes positions. Comme nos prédécesseurs de la Gauche communiste de France le posent : "Seule l'action basée sur les données les plus récentes, en continuel enrichissement, est révolutionnaire. Par contre, l'action faite sur la base d'une vérité d'hier, mais déjà, périmée aujourd'hui, est stérile, nuisible et réactionnaire" 1
Lorsque James Connolly fut exécuté, Sean O’Casey 2 déclara que le mouvement ouvrier avait perdu un dirigeant et que le nationalisme irlandais avait gagné un martyr.
Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment un internationaliste convaincu et inébranlable comme Connolly a-t-il pu remettre son sort entre les mains du patriotisme ? Nous n’examinerons pas ici l’évolution de son attitude en 1914 : ce sujet est traité dans un article publié dans World Revolution en 1976 3 , qui est toujours valable. Nous ne chercherons pas non plus à démontrer sa profonde hostilité envers le nationalisme interclassiste : les paroles mêmes de Connolly, reproduites dans un article de notre s site,4 sont suffisamment claires. Ici notre objectif est plutôt d’examiner la pensée de Connolly dans le contexte du socialisme international de son époque et la manière dont a évolué l’attitude du mouvement ouvrier sur "la question nationale" entre la vague de soulèvements qui a balayé l’Europe en 1848 et l’éclatement de la Première Guerre mondiale en 1914.
Les événements de 1848 – comme Marx allait le montrer plus tard - avaient une double nature. D’une part, c’était des mouvements nationaux démocratiques ayant pour objectif d’unifier des "nations" morcelée en une multitude de petits fiefs et royaumes à demi féodaux : c’était le cas en particulier de l’Allemagne et de l’Italie. D’autre part, ces événements virent, à Paris en particulier, la naissance du prolétariat industriel qui apparaissait pour la première fois sur la scène de l’histoire en tant que force politique indépendante 5. Il n’est donc pas surprenant que 1848 ait posé la question de l’attitude que la classe ouvrière devait adopter sur la question nationale.
C’est en 1848 que parut Le Manifeste communiste où était exposé clairement et sans équivoque le principe internationaliste comme fondement du mouvement ouvrier : "Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut leur ravir ce qu'ils n'ont pas. (…) Les prolétaires n'ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! "
Tel est donc le principe général : les ouvriers ne peuvent être divisés par des intérêts nationaux, ils doivent s’unir au-delà des frontières : "[L’] action commune [du prolétariat], dans les pays civilisés tout au moins, est une des premières conditions de son émancipation" (Ibid.) Mais comment mettre en pratique ce principe ? Dans l’Europe du milieu du 19e siècle, il était clair pour Marx et Engels que pour être à même de prendre le pouvoir, le prolétariat devait d’abord devenir une force politique et sociale majeure et que cela dépendait du développement des rapports sociaux capitalistes. Ce développement requérait le renversement de l’aristocratie féodale, la destruction des particularismes féodaux et l’unification de "grandes nations historiques" (cette expression est d'Engels) en vue de créer le vaste marché intérieur dont le capitalisme avait besoin pour se développer et, ce faisant, de développer le nombre, la force et l’organisation de la classe ouvrière.
Pour Marx et Engels, et en général pour le mouvement ouvrier à l'époque, l’unité nationale, la suppression des privilèges féodaux et le développement de l’industrie ne pouvaient avoir lieu qu'à travers un mouvement démocratique : la liberté de la presse, l’accès à l’éducation, le droit d’association – ce sont des revendications démocratiques, dans le cadre de l’État-nation et qui sont impossibles en dehors de lui. Dans quelle mesure ces conditions étaient nécessaires, cela est discutable. Après tout, le développement industriel du 19ème siècle ne se limite pas aux démocraties comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Les régimes autocratiques comme la Russie tsariste ou le Japon sous la Restauration Meiji ont également connu un progrès industriel surprenant au cours de la même époque. Cela dit, le développement de la Russie et du Japon est demeuré essentiellement dépendant de celui des pays démocratiques les plus avancés, et il est significatif que le régime réactionnaire autocratique prussien Junker qui dominait l'Allemagne ait été contraint de respecter un certain nombre de libertés démocratiques.
Ces revendications démocratiques servaient également l'intérêt de la classe ouvrière et étaient importantes pour elle. Comme le dit Engels, elles donnent à la classe ouvrière "un espace" pour respirer et se développer. La liberté d'association a facilité l'organisation contre l'exploitation capitaliste. La liberté de la presse a facilité la possibilité pour les travailleurs de s'informer, de se préparer politiquement et culturellement pour la prise du pouvoir. Parce qu’il n’était pas encore prêt à faire sa propre révolution, le mouvement ouvrier partageait alors les buts immédiats d’autres classes et il existait une forte tendance à identifier la cause du prolétariat, à celle du progrès, de l’unité nationale et du combat pour la démocratie. Voici un extrait d’une intervention de Marx en 1848 lors d’un meeting à Bruxelles qui célébrait le deuxième anniversaire du soulèvement de Cracovie (Pologne) : "La révolution de Cracovie a donné un exemple glorieux à toute l’Europe en identifiant la cause de la nationalité à la cause de la démocratie et à l’affranchissement de la classe opprimée (…) Elle trouve la confirmation de ses principes en Irlande où le parti étroitement national est descendu dans la tombe avec O’Connell et où le nouveau parti national est avant tout réformateur et démocratique" 6
Cependant, la lutte pour l’unité et l’indépendance nationales n’était aucunement considérée comme un principe universel. Ainsi Engels écrivait en 1860 dans The Commonwealth : "Ce droit à l’indépendance politique des grandes subdivisions nationales d’Europe, reconnu par la démocratie européenne, ne pouvait qu’être également reconnu par la classe ouvrière en particulier. En fait, ce n’était rien de plus que reconnaître dans d’autres grandes communautés nationales ayant une grande vitalité le même droit à une existence nationale distincte que les travailleurs de chaque pays réclamaient pour eux-mêmes. Mais cette reconnaissance, et la sympathie vis-à-vis de ces aspirations nationales, se restreignaient aux grandes nations d’Europe, historiquement bien définies ; il y avait l’Italie, la Pologne, l’Allemagne, la Hongrie" 7. Engels continue : "Il n’y a pas de pays d’Europe où il n’y ait pas différentes nationalités sous le même gouvernement. Les Celtes des Highlands et les Gallois se différencient sans aucun doute par la nationalité des Anglais, mais il n’est venu à l’idée de personne de désigner comme nations ces restes de peuples disparus depuis longtemps, pas plus que les habitants celtiques de la Bretagne en France". Engels établit clairement une différence entre "le droit à l’existence nationale des peuples historiques d’Europe" et celle des "nombreux petits vestiges de peuples qui, après avoir joué un rôle sur la scène de l'histoire pendant une période plus ou moins longue, ont finalement été absorbés par les nations puissantes dont la plus grande vitalité leur a permis de surmonter les plus grands obstacles."
L'Irlande était-elle un cas particulier ?
Le rejet d'un principe national s'appliquant à toutes les nationalités amène naturellement à se poser la question suivante : en quoi l'Irlande est-elle est un cas particulier ? Pourquoi Marx et Engels n'ont-ils pas défendu l'idée que l'Irlande soit simplement absorbée par la Grande-Bretagne comme condition de son développement industriel ?
Car il ne fait pas de doute que, à leurs yeux, l'Irlande constituait un "cas particulier" d'une signification particulière. À un moment donné, Marx alla jusqu'à défendre que l'Irlande fût la clé de la révolution en Angleterre tout comme l'Angleterre était la clé de la révolution en Europe.
Il existait deux raisons à cela. D'abord, Marx était convaincu que la spoliation brutale de la paysannerie irlandaise par les propriétaires terriens anglais "absents" 8 constituait l'un des principaux facteurs qui maintenaient en place la classe aristocratique réactionnaire et barrait la voie du progrès démocratique et économique.
L'autre raison, et sans doute la plus importante, était le facteur moral. La domination par l'Angleterre d'une Irlande réticente et le traitement des Irlandais, en particulier des ouvriers irlandais, comme une sous-classe esclave, n'étaient pas seulement injustes et offensants, cela corrompait moralement les ouvriers anglais eux-mêmes. Comment la classe ouvrière anglaise pourrait-elle se soulever contre l'ordre existant si elle restait complice de sa propre classe dominante dans l'oppression nationale des Irlandais ? Tel était le raisonnement de Marx. De plus, tant que les Irlandais étaient privés de leur dignité nationale, il ne manquerait jamais de prolétaires irlandais prêts à s'engager au service de l'armée anglaise et à participer à l'écrasement des révoltes des ouvriers anglais – comme Connolly allait le montrer plus tard.
Cette insistance sur l'indépendance irlandaise s'étendit à la Première Internationale – comme Engels le défendit en 1872 : "Lorsque les membres de l'Internationale appartenant à une nation conquérante demandent à ceux appartenant à une nation opprimée, non seulement dans le passé, mais encore dans le présent, d'oublier leur situation et leur nationalité spécifiques, d' "effacer toutes les oppositions nationales", etc., ils ne font pas preuve d'internationalisme. Ils défendent tout simplement l'assujettissement des opprimés en tentant de justifier et de perpétuer la domination du conquérant sous le voile de l'internationalisme. En l'occurrence, cela ne ferait que renforcer l'opinion, déjà trop largement répandue parmi les ouvriers anglais, selon laquelle, par rapport aux Irlandais, ils sont des êtres supérieurs et représentent une sorte d'aristocratie, comme les blancs des États esclavagistes américains se figuraient l'être par rapport aux noirs.
Dans un cas comme celui des Irlandais, le véritable internationalisme doit nécessairement se fonder sur une organisation nationale autonome : les Irlandais, tout comme les autres nationalités opprimées, ne peuvent entrer dans l'Association ouvrière internationale qu'à égalité avec les membres de la nation conquérante et en protestant contre cette oppression. En conséquence, les sections irlandaises n'ont pas seulement le droit mais encore le devoir de déclarer dans les préambules à leurs statuts que leur première et plus urgente tâche, en tant qu'Irlandais, est de conquérir leur propre indépendance nationale." 9
Pour l'essentiel, c'est la même logique qui amena Lénine à insister pour que le programme du Parti bolchevique inclue le droit des nations à l'auto-détermination : c'était la seule voie, de son point de vue, pour que le rejet par le Parti du "chauvinisme grand-russe" soit rendu explicite et sans équivoque – l'équivalent parmi les ouvriers de Russie des sentiments de supériorité des ouvriers anglais envers les Irlandais.
L'unité nationale au sein de frontières nationales définies, la démocratie, le progrès et les intérêts de la classe ouvrière : tout cela était considéré alors comme évoluant dans la même direction. Même Marx – qu'on ne peut pas soupçonner de fantasmes sentimentaux – a envisagé, peut-être dans des moments d'optimisme imprudent, la possibilité que les ouvriers prennent le pouvoir par la voie électorale dans des pays comme la Grande-Bretagne, la Hollande ou les États-Unis. Mais à aucun moment l'unité nationale ni, en fait, la démocratie n'ont été considérées comme le but final elles étaient des principes simplement contingents sur le chemin du but : "Les ouvriers n'ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !"
Le problème de tels principes contingents est qu'ils peuvent être figés en principes abstraits et invariants tels qu'ils n'expriment plus la dynamique d'avancée d'un réel développement historique mais, au contraire, tirent en arrière ou pire, se transforment activement en obstacles. Ceci, comme nous allons le voir, est ce qui est arrivé à la perspective du mouvement socialiste sur la question nationale à la fin du 19e siècle. Mais d'abord, arrêtons-nous brièvement sur la façon dont Connolly exprimait concrètement les idées dominantes de la Deuxième Internationale.
Bien qu'il ait passé quelques années aux États-Unis où il avait rejoint les IWW 10, Connolly est resté avant tout un socialiste irlandais. Il épousa les méthodes du syndicalisme industriel, contre le syndicalisme étroit des corporations, se joignit à Jim Larkin pour construire le Irish Transport & General Workers Union (ITGWU) et joua un rôle clé dans la grande grève et le lock-out de Dublin en 1913. Mais même à cette époque, aux États-Unis, Connolly fut successivement membre du Socialist Labor Party de Daniel De Leon et du Socialist Party of America et il est juste de dire qu'il consacra sa vie à construire une organisation politique socialiste en Irlande. Il aurait probablement envisagé cette organisation comme étant marxiste si mettre une étiquette théorique sur une organisation l'avait intéressé. Il est certain que son Irish Socialist Republican Party 11 était reconnu en tant que délégation irlandaise de plein droit lors du Congrès de 1900 de la Deuxième Internationale. Mais on n'a quasiment aucune information à partir des écrits de Connolly sur le fait qu'il ait connu ou pris part aux débats de l'Internationale, sur la question nationale en particulier : c'est d'autant plus étonnant qu'il s'était appliqué à apprendre à lire l'allemand assez couramment.
Connolly croyait que le socialisme ne pourrait pour ainsi dire que grandir sur un terrain national. En fait, sa grande étude Labour in Irish History est partiellement dédiée à montrer que le socialisme émerge naturellement des conditions irlandaises ; il souligne en particulier les écrits de William Thompson dans les années 1820 qu'il considère, à juste titre dans une certaine mesure, comme l'un des précurseurs de Marx dans l'identification du travail comme étant la source du capital et du profit.12
Il n'est donc pas surprenant de voir Connolly défendre dans un article de 1909 dans The Irish Nation intitulé "Sinn Fein, socialism and the nation" le rapprochement entre "les membres du Sinn Fein qui sympathisent avec le socialisme" et "les socialistes qui réalisent que le mouvement socialiste doit s'appuyer sur les conditions historiques et actuelles du pays dans lequel ils agissent et en tirer son inspiration, et ne se perdent pas simplement dans un 'internationalisme' abstrait (qui n'a aucun rapport avec le véritable internationalisme du mouvement socialiste)." Dans le même article, Connolly s'oppose aux socialistes qui "observant que ceux qui parlent le plus fort sur "l'Irlande comme nation" sont souvent ceux qui broient sans pitié les pauvres, s'emportent le plus fort contre le nationalisme et, tout en s'opposant à l'oppression en tous temps, s'opposent aussi aux révoltes nationales pour l'indépendance nationale" ainsi qu'à ceux qui "principalement recrutés parmi les ouvriers des villes du Nord-Est en Ulster, ont été sevré de la domination des capitalistes et des propriétaires terriens Tory et de l'Ordre d'Orange, par les idées socialistes et la lutte des classes, mais à qui le nationalisme irlandais ne leur offre rien d'autre qu'un drapeau vert alors que le English Independent Labour Party a offert des mesures pratiques pour les soulager de l'oppression capitaliste… et qui donc vont naturellement là où ils imaginent qu'ils connaîtront un soulagement." (traduit par nous)
Identifier la classe ouvrière avec la nation pouvait, de façon plausible, prétendre se revendiquer de Marx et Engels. Après tout, on peut lire dans Le Manifeste que : "Comme le prolétariat de chaque pays doit en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s'ériger en classe dirigeante de la nation, devenir lui-même la nation, il est encore par-là national, quoique nullement au sens bourgeois du mot." Et on trouve la même idée dans les écrits de Kautsky de 1887 : "Comme pour les libertés bourgeoises, les prolétaires doivent prendre fait et cause pour l'unité et l'indépendance de leur nation face aux éléments réactionnaires, particularistes, comme face aux éventuelles attaques de l'extérieur. (…) Dans l'Empire romain décadent, les antagonismes sociaux s'étaient tant accrus et le processus de décomposition de la nation romaine, si l'on peut la désigner comme telle, était devenu si intolérable que nombreux étaient ceux à qui l'ennemi du pays, le barbare germanique, apparaissait comme un sauveur. On n'en est pas encore là à présent, du moins dans les États nationaux. Et nous ne croyons pas non plus qu'on en arrive là du côté du prolétariat. Certes, l'antagonisme entre bourgeoisie et prolétariat ne cesse de croître mais simultanément le prolétariat est de plus en plus le noyau de la nation, par le nombre, l'intelligence, et les intérêts du prolétariat et ceux de la nation ne cessent de converger davantage. Une politique hostile à la nation serait donc pur suicide de la part du prolétariat."13
Rétrospectivement, il est facile de voir la trahison de 1914 – la défense de la "culture" allemande contre la barbarie tsariste – derrière cette identification de la nation et du prolétariat. Mais la rétrospective ne peut être d'aucun secours dans le moment présent et le fait est que le mouvement marxiste à la fin du 19e siècle a en grande partie échoué dans la réévaluation de son point de vue sur la question nationale face à la réalité changeante.
Pendant quarante ans, le mouvement socialiste n'a pas vraiment mis en question l'hypothèse optimiste du Manifeste selon laquelle "Déjà les démarcations nationales et les antagonismes entre les peuples disparaissent de plus en plus avec le développement de la bourgeoisie, la liberté du commerce, le marché mondial, l'uniformité de la production industrielle et les conditions d'existence qu'ils entraînent". À un certain niveau cela était vrai - nous allons y revenir - puisque dans les années 1890 la "question nationale" allait se trouver au premier plan de la scène politique comme jamais auparavant, précisément en raison de l'expansion phénoménale des rapports sociaux capitalistes et de la production industrielle. Avec le développement des conditions modernes de production, de nouvelles bourgeoisies nationales avec les aspirations nationales modernes apparaissaient en Europe centrale et orientale. Le débat qui en résultait sur la question nationale a pris une nouvelle importance, surtout pour la social-démocratie russe à l'égard de la Pologne et de l'Empire austro-hongrois, à l'égard des aspirations nationales des Tchèques et une multitude de peuples slaves plus petits.
La critique de l'État-nation par Luxemburg
Au cours des trente dernières années du 19e siècle, la façon dont se posait la question nationale devait donc changer.
D'abord, comme Luxemburg l'a démontré dans La question nationale et l'autonomie 14, une fois que la classe bourgeoise a conquis son marché intérieur, elle doit nécessairement devenir un État impérialiste conquérant. Plus encore, dans la phase impérialiste du capitalisme, tous les États sont contraints de chercher par des moyens impérialistes à se faire une place sur le marché mondial. Répondant au postulat de Kautsky d'un capitalisme évoluant vers un "super-État" unique, Luxemburg écrit : "Le 'meilleur' État national n'est qu'une abstraction qu'on peut facilement décrire et définir théoriquement mais qui ne correspond pas à la réalité (…). Le développement du grand État qui constitue la caractéristique saillante de l'époque moderne et qui s'impose par les progrès du capitalisme condamne d'emblée toute la masse des mini et micro nationalités à la faiblesse politique". 15 "Affirmer qu'un État-nation indépendant est, après tout, la meilleur garantie de l'existence et du développement nationaux suppose de manier une conception de l'État-nation comme s'il s'agissait d'un concept parfaitement abstrait. Considéré uniquement du point de vue national, comme manifestation et incarnation de la liberté et de l'indépendance, l'État-nation n'est qu'un résidu de l'idéologie décadente de la petite bourgeoisie d'Allemagne, d'Italie, de Hongrie – de tout l'Europe centrale dans la première moitié du 19e siècle. C'est un slogan appartenant à la panoplie du libéralisme bourgeois décati " 16 (…) "Les États-nations, même sous la forme de républiques ne sont pas le produit ou l'expression de la "volonté du peuple" comme l'affirme la phraséologie de la théorie libérale et le répète celle de l'anarchisme. Les États-nations sont aujourd'hui les mêmes outils et formes de pouvoir de classe que l'étaient les États précédent, non nationaux et, comme eux, ils aspirent à la conquête. Les États-nations ont les mêmes tendances à la conquête, belliqueuses, oppressives – en d'autres termes des tendances à devenir "non-nationaux". C'est pourquoi se développent constamment parmi les États nationaux des querelles et des conflits d'intérêt et même si aujourd'hui, par miracle, tous les États devenaient nationaux ils offriraient dès le lendemain la même image de guerre, de conquête et d'oppression" 17
Pour les petites nationalités, cela voulait inévitablement dire que la seule "indépendance" nationale possible était de se détacher de l'orbite d'un État impérialiste plus puissant et s'attacher à un autre. Nulle part ceci ne s'est plus clairement illustré que dans les négociations que les Irish Volunteers (précurseurs de l'IRA) ont mené avec l'impérialisme allemand par l'intermédiaire de l'organisation irlandaise aux États-Unis, Clan na Gael, avec Roger Casement qui agit comme ambassadeur auprès de l'Allemagne18. Casement semblait penser que 50 000 troupes allemandes étaient nécessaires pour un soulèvement victorieux, mais c'était évidemment hors de question sans une victoire allemande décisive sur mer. La tentative de débarquer une cargaison de fusils en provenance d'Allemagne à temps pour le soulèvement de 1916 se termina en fiasco mais elle est restée une accusation accablante de la préparation du nationalisme irlandais pour participer à la guerre impérialiste.
Abandonnant l'analyse marxiste de classe sur la guerre impérialiste comme produit du capitalisme quelles que soient les nations, Connolly abandonna également la position de l'indépendance de la classe ouvrière vis-à-vis des capitalistes. On peut voir jusqu'où il est allé dans cette direction à travers la naïveté coupable de sa description idyllique d'une "Allemagne pacifique" combinée avec une attaque à moitié raciste contre les ouvriers anglais "à moitié éduqués" : "Basant ses efforts industriels sur une classe ouvrière éduquée, [la nation allemande] est parvenue dans les ateliers à des résultats auxquels la classe ouvrière d'Angleterre à demi éduquée ne pourrait qu'aspirer. Cette classe ouvrière anglaise entraînée à une servilité d'esclave envers les méthodes empiriques et sous des directeurs mariés à des processus traditionnels se voyant graduellement surclassés par un nouveau rival au service duquel ont été enrôlés les scientifiques les plus instruits coopérant avec les ouvriers les plus éduqués (…). Il était déterminé que, puisque l'Allemagne ne pouvait pas être battue économiquement dans une juste concurrence, elle devait l'être injustement en organisant contre elle une conspiration militaire et navale (…) Cela voulait dire en appeler aux forces des puissances barbares afin d'écraser et d'entraver le développement des puissances industrielles pacifiques." 19 On se demande ce que les dizaines de milliers d'Africains massacrés lors du soulèvement de Herero en 190420, ou encore les habitants de Tsingtao annexé l'arme au poing par l'Allemagne en 1898 auraient pensé des "puissances pacifiques" de l'industrie allemande.
Non seulement les "États nationaux" tendent inévitablement à devenir des États impérialistes et conquérants comme le démontre Luxemburg, ils deviennent également moins "nationaux" comme résultat du développement industriel et de l'émigration de la force de travail de la campagne dans les nouvelles villes industrielles. Dans le cas de la Pologne, en 1900, non seulement le "Royaume de Pologne" (c'est-à-dire la partie de la Pologne qui avait été incorporée au 18e siècle dans l'Empire russe) s'industrialisait rapidement, mais également les régions ethniquement polonaises sous domination allemande21 (la Haute Silésie) et austro-hongroise (Silésie de Cieszyn). De plus, les régions industrielles étaient moins polonaises du point de vue ethnique : les ouvriers de la grande ville d'industrie textile de Lodz étaient principalement d'origine polonaise, allemande et juive avec quelques autres nationalités incluant l'Angleterre et la France. En Haute Silésie, les ouvriers étaient allemands, polonais, danois, ukrainiens, etc. Lorsque Marx appelait à l'indépendance nationale de la Pologne comme rempart contre l'absolutisme tsariste, il n'existait quasiment pas de classe ouvrière polonaise ; désormais, l'attitude des socialistes polonais envers la nation polonaise était devenue une question aigüe et mena à une scission entre le Parti socialiste polonais (Polska Partia Socjalistyczna ou PPS) à droite et la Social-Démocratie du Royaume de Pologne et de Lituanie (SDKPiL) à gauche.
Pour le PPS, l'indépendance polonaise signifiait la séparation de la Pologne d'avec la Russie mais, aussi, l'unification des parties de la Pologne historique alors sous domination allemande ou autrichienne, où les ouvriers polonais travaillaient côte à côte avec les allemands (et d'autres nationalités). En effet, le PPS considérait que la révolution prolétarienne dépendait de la "solution" de la "question nationale" – ce qui ne pouvait, comme le disait Luxemburg, que mener à la division au sein de la classe ouvrière organisée en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Au mieux, ce serait un dévoiement, au pire une destruction de l'unité ouvrière.
Pour Luxemburg et pour le SDKPiL, au contraire, toute résolution de la question nationale dépendait de la prise du pouvoir par la classe ouvrière internationale.22 Le seul moyen pour les ouvriers de s'opposer à l'oppression nationale était de rejoindre les rangs de la social-démocratie internationale :en mettant fin à toute oppression, la social-démocratie mettrait également fin à l'oppression nationale : "Non seulement [le Congrès de Londres de 1896] a clairement posé la question polonaise sur le même plan que la situation de tous les peuples opprimés, il a en même temps appelé les ouvriers de tous ces peuples à rejoindre les rangs du socialisme international comme seul remède à l'oppression nationale, plutôt que de tenter ici et là la restauration d'États capitalistes indépendants dans plusieurs pays : c'est la seule façon d'accélérer l'introduction d'un système socialiste qui, en abolissant les oppressions de classe, supprimera toutes les formes d'oppression une fois pour toutes, y compris sous leurs formes nationales."
Quand Luxemburg a entrepris de s'opposer au nationalisme polonais du PPS au sein de la Deuxième Internationale, elle était tout à fait consciente de s'en prendre à une "vache sacrée" du mouvement socialiste et démocratique : "Le socialisme polonais occupe – ou, en tous cas, a occupé – une place unique dans ses rapports avec le socialisme international, une position qui remonte directement à la question nationale polonaise."23 Mais comme elle l'a dit et démontré très clairement, défendre à la lettre en 1890 le soutien apporté par Marx) l'indépendance de la Pologne en 1848, ce n'était pas seulement refuser de reconnaître que la réalité sociale a changé mais c'est aussi transformer le marxisme lui-même, faire d'une méthode vivante d'investigation de la réalité un dogme quasi- religieux desséché.
En fait, Luxemburg est allée plus loin que cela et considérait que Marx et Engels avaient traité la question polonaise essentiellement comme un problème de "politique étrangère" pour la démocratie révolutionnaire et le mouvement ouvrier : "Même au premier coup d'œil, ce point de vue [c’est-à-dire la position de Marx sur la Pologne] révèle un manque éblouissant de relation interne avec la théorie sociale du marxisme. En ne réussissant pas à analyser la Pologne et la Russie comme des sociétés de classe avec leurs contradictions économiques et politiques en leur sein, en les regardant non du point de vue du développement historique mais comme si elles connaissaient des conditions fixes, absolues en tant qu'unités indifférenciées et homogènes, ce point de vue va à l'encontre de l'essence même du marxisme." C'est comme si la Pologne - et bien sûr la Russie aussi - pouvait en quelque sorte être considérée comme “externe” au capitalisme.
Le développement des rapports sociaux capitalistes a eu essentiellement le même effet en Irlande qu'en Pologne. Bien que l’Irlande ait été avant tout un pays d'émigration, la classe ouvrière irlandaise n'était aucunement homogène : au contraire, la région ayant l'industrie la plus développée était Belfast (l'industrie textile et les chantiers navals Harland and Wolff) où les ouvriers étaient issus de la population celte catholique, qui parlait parfois le gaëlique, et des descendants des Protestants, des Ecossais et des Anglais qui avaient été "établis" en Irlande (grâce à la déportation violente de la population d'origine) par Oliver Cromwell et ses successeurs. Et cette classe ouvrière avait déjà commencé à montrer la voie de la seule solution possible à la "question nationale" en Irlande, en unifiant ses rangs dans les grèves massives à Belfast en 1907. Les ouvriers irlandais étaient présents dans toutes les régions industrielles majeures de Grande-Bretagne, en particulier autour de Glasgow et de Liverpool.
La question morale que Marx avait posée – le problème du sentiment de supériorité des ouvriers anglais envers les Irlandais – ne se limitait plus à l'Irlande et aux Irlandais : le besoin constant du capital d'absorber plus de force de travail entrainait des migrations massives des économies agricoles vers les régions nouvellement industrialisées, tandis que l'expansion de la colonisation européenne amenait les ouvriers européens à entrer en contact avec les Asiatiques, les Africains, les Indiens… sur toute la planète. Nulle part l'immigration n'était plus importante que dans la puissance capitaliste constituée par les États-Unis qui connaissaient non seulement un énorme afflux d'ouvriers en provenance de toute l'Europe, mais aussi de la force de travail bon marché en provenance du Japon et de la Chine et, évidemment, la migration des ouvriers noirs des champs de coton du Sud arriéré vers les nouveaux centres industriels du Nord : le legs de l'esclavage et des préjugés racistes constituent encore "une plaie ouvert" (pour utiliser une expression de Luxemburg) en Amérique aujourd'hui. Inévitablement, ces vagues de migration apportèrent avec elles les préjugés, les incompréhensions, le rejet… toute la dégradation morale que Marx et Engels avaient notée dans la classe ouvrière anglaise se reproduisit encore et encore. Plus la migration mélange les populations d'origine différente, inévitablement l'idée "d'indépendance nationale" comme solution au préjugé devenait de plus en plus absurde. D'autant plus que parmi les facteurs qui sous-tendent tous ces préjugés, il en existe un, universel et bien plus ancien que tout préjugé national, qui traverse le cœur de la classe ouvrière : la supposition irréfléchie de la supériorité des hommes sur les femmes. Marx et Engels avaient identifié là un problème réel, un problème crucial même. S'il devait ne pas être résolu, il affaiblirait mortellement la lutte d'une classe dont les seules armes sont son organisation et sa solidarité de classe. Mais il pourrait et ne pourra être résolu qu'à travers l'expérience du travail et de la vie ensemble, à travers la solidarité mutuelle imposée par les exigences de la lutte de classe.
Qu'est-ce qui a amené James Connolly à finir sa vie en se trouvant dans une contradiction aussi flagrante avec l'internationalisme qu'il avait toujours défendu ? Mis à part les faiblesses inhérentes à sa vision de la question nationale qu'il partageait avec la majorité de la Deuxième Internationale, il est aussi possible – bien qu'il s'agisse de pure spéculation de notre part – que sa confiance dans la classe ouvrière ait été brisée par deux défaites majeures : celle de la grève de Dublin de 1913 et l'échec abject des syndicats britanniques à donner à l'ITGWU le soutien adéquat et, par-dessus tout, actif ; et la désintégration de l'Internationale elle-même face au test de la Première Guerre mondiale. Si tel a été le cas, nous pouvons seulement dire que Connolly a tiré des conclusions fausses. L'échec de la grève de Dublin, produit de l'isolement des ouvriers irlandais, a montré non pas que les ouvriers irlandais devaient chercher le salut dans la nation irlandaise mais, au contraire, que les limites de la petite Irlande ne pouvaient plus contenir la bataille entre le capital et le travail qui se menait maintenant sur une scène bien plus vaste ; et la révolution russe, un an seulement après l'écrasement du soulèvement de Pâques, devait montrer que la révolution ouvrière, non l'insurrection nationale, était le seul espoir de mettre fin à la guerre impérialiste et à la misère de la domination capitaliste.
Jens, avril 2016
1Lire à ce sujet l'article Problèmes actuels du mouvement ouvrier - Extraits d'Internationalisme n°25 (août-1947) - La conception du chef génial [24] Revue Internationale n° 33.
2 Sean O’Casey était écrivain et un des plus grands dramaturges de la langue anglaise au 20e siècle. Né dans une famille pauvre protestante de Dublin, il rejoint d’abord la Ligue Gaélique en 1906 avant d’adhérer au mouvement ouvrier. Il est un des fondateurs de l'Irish Citizen Army mais rompt avec Connolly en refusant tout soutien au nationalisme irlandais. Cf. notre article Sean O’Casey et le soulèvement nationaliste irlandais de Pâques en 1916 [25]
3 Republié dans World Revolution 373 et sur notre site en anglais [26].
5Tout du moins en Europe continentale. En fait, le prolétariat était déjà apparu en tant que tel en Grande-Bretagne d’abord avec le mouvement Luddite, puis le mouvement chartiste.
6 https://library.fes.de/pdf-files/bibliothek/bestand/kmh-bak-2291.pdf [28]. Traduit par nous.
7 https://www.marxists.org/history/etol/newspape/ni/vol10/no07/engels.htm [29]. Traduit par nous.
8 Un des facteurs de l’arriération de la société irlandaise était le fait qu’une grande partie du territoire appartenait à des seigneurs rentiers anglais qui n’avaient cure d'entretenir les exploitations agricoles et encore moins d'investir dans celles-ci, mais se préoccupaient uniquement d'empocher la rente la plus élevée possible.
10 Industrial Workers of the World, syndicaliste révolutionnaire.
11 Connolly est l'un des fondateurs de l'ISRP en 1896. Bien qu'il n'ait probablement jamais compté plus de 80 membres, il eut de l'influence dans la politique socialiste irlandaise par la suite, défendant le principe d'une république d'Irlande avec le Sinn Fein. Le parti vécut jusqu'en 1904 et publia la Workers'Republic.
12 "Si nous devions tenter d'évaluer ce qu'ont apporté Thompson et Marx, nous ne leur ferions pas justice en les opposant, ni en faisant l'apologie de Thompson en vue de rabaisser Marx, comme certains Critiques de Marx sur le continent ont cherché à la faire. Au contraire, nous devons dire que les positions respectives de ce génie irlandais et de Marx peuvent être comparées aux relations historiques entre les évolutionnistes pré-darwiniens et Darwin ; de même que Darwin a systématisé toutes les théories de ses prédécesseurs et a passé sa vie à accumuler les faits pour établir son point de vue et le leur, de même Marx a découvert la véritable ligne de la pensée économique déjà indiquée et a utilisé son génie, sa connaissance et sa recherche encyclopédiques pour l'établir sur des fondements inébranlables. Thompson a balayé les fictions économiques maintenues par les économistes orthodoxes et acceptées par les Utopistes selon lesquelles le profit venait de l'échange et a déclaré qu'il venait de la soumission du travail et de l'appropriation qui en résultait, par les capitalistes et les propriétaires terriens, des fruits du travail des autres. (…) Toute la théorie de la guerre de classe n'est qu'une déduction de ce principe. Mais, bien que Thompson ait reconnu cette guerre de classe comme un fait, il ne l'a pas considérée comme un facteur, comme le facteur de l'évolution de la société vers la liberté. C'est ce qu'a fait Marx et, à notre avis, là réside sa gloire principale et suprême." Labour in Irish History, traduit de l'anglais par nous.
Marx citait toujours scrupuleusement ses sources et accordait du crédit aux penseurs l’ayant précédé. Il cite en effet le travail de Thompson dans le premier tome du Capital, dans le chapitre sur "La division du travail et la manufacture".
13 Die moderne Nationalität, Neue Zeit V, 1887, traduit in Les marxistes et la question nationale, Ed. L'Harmattan, p.125
14 Edition Le temps des cerises
15 La question nationale et l'autonomie. Chapitre "Le droit des nations à l'autodéterminaton". P 40.
16 La question nationale et l'autonomie. Chapitre l'Etat-Nation et le prolétariat. P. 75
17 Idem. P. 77.
18 Voir Ireland since the Famine par FSL Lyons, Fontana Press, pp 340,350
19 Extrait d'un article intitulé "La guerre à la nation allemande [31]" paru dans le journal The Irish Worker. Traduit par nous.
20 Aujourd'hui en Namibie, alors appelé le Damaraland. Un témoin oculaire a rapporté une défaite des Hereros : "J'étais présent quand les Hereros furent battus lors d'une bataille près de Waterberg. Après la bataille, tous les hommes, les femmes et les enfants qui sont tombés entre les mains des Allemands, blessés ou non, ont été mis à morts sans merci. Puis les Allemands ont poursuivi ceux qui restaient et tous ceux qu'ils ont rencontrés sur leur chemin ou dans les prés ont été abattus. La masse des hommes Hereros n'avait pas d'armes et était incapable d'offrir une résistance quelconque. Ils tentaient seulement de partir avec leur bétail." Le haut commandement allemand était tout-à-fait conscient des atrocités et les approuvait.
21 Luxemburg était elle-même très demandée par le SPD allemand comme l'un de ses rares, et certainement meilleurs, orateurs et agitateurs en langue polonaise.
22 Il faudrait peut-être souligner - même si cela dépasse le cadre de cette courte étude - qu'il y avait beaucoup de désaccords et d'incertitudes sur ce qui est identifié sous le terme "nation". Était-ce la langue (comme Kautsky le soutenait), ou était-ce une "identité culturelle" plus vaguement définie comme le pensait Otto Bauer? La question reste valable - et ouverte - à ce jour.
23 Cette citation et celles qui suivent sont tirées de la Préface écrite par Luxembourg à La question polonaise et le mouvement socialiste : celle-ci était un recueil de documents du Congrès de Londres de la 2e Internationale de 1896, où Luxembourg s’opposa avec succès à la tentative du PPS de faire de l’indépendance et de l’unification polonaise, une revendication concrète et immédiate de l’Internationale.
Conscience et organisation:
Personnages:
- James Connolly [33]
Evènements historiques:
- Dublin 1916 [34]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
IRA: Soldats de l'impérialisme
- 1492 lectures
L'article que nous republions ici est d'abord paru dans World Revolution n° 21 en 1978. Dans le premier paragraphe, il établit le cadre dans lequel les luttes "libération nationale" doivent être considérées : "Les "petites nations" comme l'Irlande, qui voulaient arracher quelque chose pour elles-mêmes, devaient essayer d'exploiter pour leurs propres intérêts le conflit entre les grandes puissances impérialistes". Cette réalité a été identifiée par les révolutionnaires à l'époque de l'insurrection de Pâques, en 1916. Trotsky (dans Nashe Slovo du 4 Juillet 1916) a souligné l'importance militaire de l'Irlande par rapport à l'impérialisme britannique :"une Irlande "indépendante" ne pouvait exister que comme avant-poste d'un État impérialiste hostile à la Grande-Bretagne".
Une telle dépendance est reconnue dans la Proclamation lue au début de l'insurrection lorsqu'il est dit que les nationalistes irlandais ont été "pris en charge par leurs enfants exilés en Amérique et par les alliés courageux en Europe". Ceci est une référence aux fonds reçus de partisans aux États-Unis et les livraisons d'armes en provenance d'Allemagne. La "lutte nationale" avait besoin de soutiens impérialistes.
Pour en savoir plus sur le fond des événements de 1916 voir l'article précédant de cette Revue, L’insurrection de Dublin en 1916 et la question nationale [36].
L'article de 1978 retrace l'évolution de la situation nationale et plus particulièrement le rôle de l'IRA jusqu'au début des années 1970. Si, après presque 40 ans, nous pouvons voir que certaines formulations n'ont pas résisté à l'épreuve du temps, le cadre général est toujours valide. Et ces formulations posent encore des questions importantes.
Par exemple, le texte parle de "la chute de l'unionisme". Il est vrai que le Parlement unioniste dominé par l'Irlande du Nord a été aboli au début des années 1970, les unionistes pro-britanniques ont néanmoins continué à exister comme force politique jusqu'à aujourd'hui. Mais l'essentiel de leurs positions a changé, surtout après l'accord du Vendredi Saint de 1998.
Le texte dit que "l'IRA ne va pas disparaître". Ceci apparaît contradictoire avec la déclaration de l'IRA de 2005 où elle annonce mettre fin à la lutte armée et selon laquelle ses objectifs seraient poursuivis par des moyens politiques. Cependant, l'aile politique de l'IRA, le Sinn Féin, joue maintenant un rôle de premier plan dans la direction de l'Irlande du Nord, partageant le pouvoir avec les unionistes et constituant ainsi un pilier fondamental de l'appareil politique de l'État capitaliste. Que l'article identifie à tort le républicanisme stalinien comme une force pour l'avenir ne fait qu'illustrer ce fait que l'issue des conflits au sein de la bourgeoisie ne peut être prévue dans les moindres détails. Nous pouvons aussi ajouter que la branche armée du républicanisme n’a pas disparu, même si elle a pris la forme d’une rupture dissidente de l’IRA.
Un autre aspect problématique de l'analyse (qui ne se limite pas à l'Irlande) peut être vu dans l'idée que les difficultés de l'économie irlandaise sont dues au "fait que le marché mondial est déjà divisé entre les grandes puissances capitalistes, et surtout parce que le système capitaliste lui-même empêche un développement mondial des forces productives." La division du marché mondial entre les différents capitaux nationaux n’est pas figée. Au cours des 20 dernières années, par exemple, nous avons constaté un recul de la position relative de l'économie japonaise et des avancées du capitalisme chinois. Cela ne veut pas dire que la décennie de croissance du tigre celtique aurait pu être maintenue, mais que, dans la compétition entre les différents capitaux, la possibilité d'avancées et de reculs de ceux-ci n'est pas exclue. En outre, il y a dans le passage cité l'idée implicite qu'il ne reste pas de possibilités pour l'expansion du capitalisme. Ceci est quelque chose qui a marqué d'autres textes au cours de l'histoire du CCI.
Par-dessus tout, l'article tape juste lorsqu'il se termine avec l’affirmation que seule la guerre de classe est en mesure de s'opposer aux attaques du capitalisme et de ses mobilisations pour la guerre impérialiste.
L'Insurrection de Pâques 1916, typiquement petite bourgeoise dans son désespoir - son héroïsme étant un produit de pur désespoir - a ouvert une nouvelle période de crise sociale et politique en Irlande. Du fait de la brutalité avec laquelle la bourgeoisie britannique a écrasé le soulèvement de Pâques, et également de l'attitude relativement désintéressée et même hostile des travailleurs irlandais (à l'époque, leurs oreilles résonnent encore du son de la défaite de la vague de grèves en 1913) vis-à-vis des objectifs des classes dirigeantes en Irlande, l'histoire avait montré à la bourgeoisie irlandaise qu'était terminée l'ère où la révolution bourgeoise en Irlande était encore possible. La réalité de la Grande Guerre fut la nouvelle partition violente du monde entre les puissances impérialistes en crise. Les "petites nations" comme l'Irlande, qui voulaient arracher quelque chose pour elles-mêmes, devaient essayer d'exploiter pour leurs propres intérêts les conflits entre les grandes puissances impérialistes. Ainsi, après 1916, la politique du Sinn Fein 1 a tourné autour de la lutte pour obtenir l'admission à la conférence de paix d'après-guerre entre grandes puissances, dans l'espoir d'obtenir le soutien américain pour l'indépendance irlandaise contre la Grande-Bretagne. De même, le soi-disant "Mouvement travailliste irlandais" a envoyé des délégués à la misérable conférence de réconciliation social-démocrate à Berne 2, afin de gagner le soutien à la cause irlandaise de la part des bouchers qui en sont les meilleurs avocats en Europe.
Si la Grande-Bretagne avait perdu la guerre, cela aurait pu être une autre histoire mais, étant donnée la situation d'alors, les nationalistes irlandais ont été incapables de persuader quiconque. Leurs fractions les plus radicales étaient soit restées à l'écart de la guerre, soit avaient tenté d'obtenir l'appui de l'impérialisme allemand. Elles se retrouvèrent les mains vides.
Les développements intervenus dans le monde pendant et immédiatement après la guerre avaient ébranlé l'économie irlandaise. La concentration massive du capital et sa centralisation sous la direction de l'État en temps de guerre en Grande-Bretagne et en Europe, la crise économique grave qui a suivi la guerre et le démantèlement de l'économie de guerre, menaçaient de ruine et d'éliminer la petite bourgeoisie liée à la manufacture dans le sud de l'Irlande. Ce fut la lutte désespérée pour la survie de ces couches usées confrontées avec les convulsions d'un capitalisme mondial lui-même agonisant, qui a donné naissance à cet avorton impérialiste remarquable - l'État libre d'Irlande. Dans cette atmosphère, la bourgeoisie du Sud a pu mobiliser la petite bourgeoisie urbaine et rurale pour une guérilla contre les forces britanniques. Cela est devenu ce qui est connu comme étant la guerre d'Indépendance (1919 à 1921).
Pendant cette période, les nationalistes ont façonné le noyau d'un État séparé, basé sur les critères les plus modernes : doté d'un parlement, d'une force de police, de tribunaux, de prisons, et - bien sûr – d'une armée. L'Armée Républicaine Irlandaise (Irish Republican Army)) était basée sur les Brigades Volontaires de 1916, mais était bien disciplinée et fermement attachée au cadre du nouvel État, lui-même constituant un rempart de l'ordre capitaliste. L'IRA est entrée dans le monde avec le sang du prolétariat ruisselant sur ses mains. Dans le Sud et le Sud-Ouest, elle n'a pas hésité à intervenir contre les travailleurs en grève (voir l'article "James Connolly and Irish nationalism [26]" – "James Connolly et le nationalisme irlandais"). Dans les villes, elle brutalisait la population civile, à l'image de ce qu'infligeaient les Black and Tans britanniques 3.
La partition
Au bord de la défaite, les nationalistes furent contraints de signer un traité avec la Grande-Bretagne en 1921 à travers lequel l'indépendance formelle de l'Irlande était accordée. Cependant, le pays devait être partagé, les comtés industriels du Nord-Est ayant leur propre parlement régional et conservant des liens privilégiés avec la Grande-Bretagne.
L'acceptation du traité faillit provoquer un coup d'État militaire. Cela n'a pas eu lieu mais il en est résulté, au sein du gouvernement et de l'armée dans le Sud, une scission avec les extrémistes républicains qui étaient désireux d'obtenir plus de la Grande-Bretagne 4. Et bien que des tentatives aient été faites pour réunifier l'IRA dans le but de lancer une attaque contre l'Irlande du Nord, face à l'impossibilité évidente d'une telle entreprise, l'État libre a glissé dans un combat de factions bourgeoises encore plus sauvage que la "guerre d'indépendance". Ce conflit prit fin avec la victoire, dans le Sud, des forces en faveur du traité (soutenues par la Grande-Bretagne).
Ces événements nous montrent non seulement le caractère absolument antiprolétarien de "l'indépendance et l'unité irlandaises" dans l'époque actuelle, de même que son impossibilité objective. Avant 1916, les unionistes d'Ulster et les nationalistes irlandais du Sud ont été enrôlés dans des groupements armés rivaux et la constitution d'armées paramilitaires. Dans le Nord, Craig - le leader unioniste - avait généreusement envoyé les travailleurs d'Ulster à la boucherie impérialiste afin de montrer son amour du roi et du pays. Mais les unionistes étaient préparés, même si cela en est resté au niveau de parades militaires, pour résister à toute tentative de Londres de subordonner, de quelque manière que soit, leurs intérêts au contrôle de la bourgeoisie irlandaise du Sud. L'industrie de l'Ulster vivait et produisait pour le marché britannique et mondial. Elle n'avait aucun intérêt à soutenir l'économie agricole irlandaise stagnante, ou à devenir la victime des politiques protectionnistes du Sud.
Le développement économique de l'Irlande
En Irlande, seule l'Ulster a participé à la révolution industrielle britannique. Sur le plan politique et économique, seule la bourgeoisie britannique qui avait le contrôle de l'ensemble de l'île aurait pu être capable d'industrialiser le sud de l'Irlande. Mais, dans le Royaume-Uni, l'Irlande a assumé le rôle de fournisseur à bas coûts de produits agricoles et de force de travail. Si la République d'Irlande se trouve exactement dans la même situation aujourd'hui, alors ceci est le résultat non pas de "700 ans de trahisons" - mais du fait que le marché mondial est déjà divisé entre les grandes puissances capitalistes, et surtout parce que le système capitaliste lui-même constitue une entrave au développement mondial des forces productives. Il ne s'agit donc pas d'une simple question irlandaise : nous vivons dans un monde qui s'enfonce dans la faim et la misère, qui nous entraine vers l'autodestruction nucléaire si la résolution de la crise actuelle du capitalisme est laissée à l'initiative de la bourgeoisie.
L'hostilité entre le Nord et le Sud
L'hostilité dramatique entre le Nord et le Sud de l'Irlande reflète les objectifs impérialistes antagonistes entre la bourgeoisie en Ulster et celle du Sud. Face à un marché mondial qui se rétrécit, ces visées politiques ne pouvaient pas être conciliées. Mais ce conflit avait un aspect "positif" pour le capitalisme en Irlande. Les maîtres des ateliers de misère de Belfast, et l'Armée républicaine des propriétaires de Dublin, ont l'assurance que les travailleurs sont pris dans le feu croisé entre eux. Dans les centres industriels du Nord, les ghettos protestants et catholiques sont destinés à entrer en concurrence les uns contre les autres pour quelque emplois, les salaires et le logement misérables. Intimidée ou mobilisée ou derrière l'orange et le vert 5, la solidarité de classe des travailleurs a trouvé face à elle la tyrannie des pogromes. À Belfast, la vague de grèves prolétarienne de 1919 fut rapidement suivie par orgies sanglantes, motivées par le meurtre par l'IRA de travailleurs protestants, et prises en charge par les Volontaires de Carson en Ulster. Plus de soixante morts dans cette vague de barbarie. Dans les années 1930, les gangs républicains et unionistes firent montre de la même suspicion et hostilité face à la lutte unie des travailleurs sans emploi à Belfast.
L'Irlande du Sud sous De Valera
Grâce à la guerre civile, l'aile de l'IRA qui était en faveur du traité s'était imposée comme l'armée officielle de l'État dans le Sud. Peu de temps après, De Valera et ses partisans se sont éloignés de l'IRA extrémiste et ont fondé un parti politique, le Fianna Fail, pour représenter les républicains radicaux au Parlement. Face à l'effondrement économique mondial de 1929, De Valera est arrivé au pouvoir à travers les élections de 1932, armé d'un protectionnisme de fortune et d'un programme capitaliste d'État. Sa victoire électorale devait beaucoup à l'appui que lui avait donné l'IRA. Cependant, bien que les républicains aient pris des mesures radicales pour consolider le capital national en Irlande du Sud, ils ont été incapables de stimuler la croissance industrielle. Leur "guerre économique" avec la Grande-Bretagne n'a fait que conduire au chaos dans le secteur agricole vital orienté vers l'exportation. Mais, malgré le fiasco de cette politique, nous pouvons voir comment les républicains se sont imposés au cours de cette période comme les dirigeants naturels du capital irlandais. Dans les années 1930, De Valera a été en mesure d'utiliser toute la force de l'État – et celle de l'IRA - pour écraser les Fascistes de Blueshirts de O'Duffy essentiellement pro-britanniques. C'est le moment où les rebelles de l'IRA affluèrent dans les rangs des forces de sécurité officielles de l'État et de la police secrète pour lutter contre la menace fasciste. Et quand les Blueshirts ont entrainé les agriculteurs à ne pas verser la rente au gouvernement en vue d'amener De Valera à appeler à cesser la "guerre économique" avec la Grande-Bretagne, ce sont les hommes armés républicains qui ont confisqué le bétail de ces agriculteurs pour le vendre aux enchères.
La "guerre économique" était une réponse désespérée au rétrécissement du marché mondial, après la Grande Crise. Elle ne constituait, ni ne prétendait constituer, une menace pour le contrôle économique de la Grande-Bretagne sur l'Irlande. Et cela, en dépit de la nostalgie actuelle qu'ont les gauchistes irlandais de cette période. Entre 1926 et 1938, le taux de croissance économique en Irlande du Sud avait été d'environ 1% par an. Dans les années de guerre, il avait été nul. Par nécessité, cette politique a dû être abandonnée avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En effet, Londres était prête à faire des concessions dans la période immédiate d'avant-guerre. Chamberlain, quand ce fut nécessaire, évacua les bases navales en Irlande. Plus tard, Churchill allait offrir l'unification de l'Irlande à la bourgeoisie du Sud en échange d'un soutien plus ouvert que la neutralité de la République pendant la Première Guerre. L'idée de placer les industries de guerre de l'Ulster dans le cocon de la neutralité irlandaise semblait tentant pour la bourgeoisie du Sud. Mais comme toujours, l'intransigeance des unionistes d'Ulster - qui tiraient profit de l'économie de guerre britannique - barrait la route à cette solution.
L'héritage de 1916
"La haine de la Grande-Bretagne" a pu être la force qui animait les "hommes de 1916". Mais pour l'IRA, et pour le républicanisme de De Valera, cet héritage a davantage été utilisé comme thème de propagande pour leur régime et comme un moyen de recrutement pour gagner du soutien. Leur but, après tout, n'a jamais été de briser l'impérialisme britannique, ce qui (en dehors du fait que cela était impossible à cette époque) serait revenu à tuer la poule aux œufs d'or pour ce qui les concernait. Le réel but historique mondial des forces bourgeoises derrière la prétendue Révolution irlandaise était soit de cajoler soit de forcer le gouvernement britannique afin qu'il donne aux patrons Unionistes de l'Ulster le coup de pied dans les dents qu'ils avaient mérité. Et la Grande-Bretagne était la seule dans la région qui soit assez forte pour le faire 6. Les républicains ont estimé que s'ils pouvaient réunir le Nord industriel avec le Sud agricole, ils auraient des tracteurs pour labourer leurs champs. Ils pourraient alors espérer se remplumer en envahissant le marché britannique. Le plan était de concilier les intérêts impérialistes de l'Irlande du sud et de la Grande-Bretagne aux dépens de l'Ulster. Cette grande stratégie expansionniste des républicains a été appelée "l'unification de l'Irlande".
Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a semblé modifier cette situation. Il a fait miroiter aux républicains la possibilité de vraiment renverser les unionistes eux-mêmes, et de chasser les Britanniques hors de l'Irlande dans le sillage de l'impérialisme allemand. La campagne 1939 de bombardement de l'Angleterre (qui a impliqué l'assassinat des travailleurs britanniques) a été suivie par les plans d'action farfelus élaborés par les antifascistes de l'IRA et le gouvernement nazi en Allemagne 7. Cependant, la bourgeoisie allemande n'a jamais sérieusement envisagé une campagne irlandaise, si bien que l'IRA n'a réussi qu'à provoquer de nouvelles vagues de répression de la part du Fianna Fail contre elle-même. S'en prenant à un ami politique indésirable, le gouvernement démocratique de Dublin n'a jamais hésité à utiliser les camps de concentration et l'assassinat ouvert dans ses mesures répressives contre l'IRA pendant les années 1930 et 1940. Tout comme aujourd'hui, le gouvernement démocratique en Irlande organise une terreur systématique au service de la défense des libertés bourgeoises et civiles même si elle se répand en des flots de larmes pour les victimes des campagnes de terreur à plus petite échelle de l'IRA.
La pulvérisation de l'IRA
Dans les années 1960, l'IRA a été militairement pulvérisée dans le Nord et dans le Sud. Elle avait perdu tout soutien parmi les travailleurs "catholiques", qui précédemment avaient constitué une source importante de chair à canon. Elle a ensuite défendu un programme capitaliste d'État radical pour regagner du soutien et, de ce fait, a commencé à se pencher vers le bloc impérialiste russe. L'économie de l'Irlande du Sud, attardée, avait dû lever ses barrières protectionnistes afin de bénéficier du boom d'après-guerre. Mais avec la fin de la période de reconstruction après 1965, la République d'Irlande s'est trouvée de plus en plus dépendante de ses voisins plus puissants. Si son économie voulait éviter l'effondrement face à la crise économique mondiale, elle devait alors s'intégrer plus étroitement dans le bloc occidental dans son ensemble. Peu après, l'Irlande est entrée dans la CEE.
L'IRA, sauveurs potentiel de la nation, a répondu à la crise - et à la combativité alarmante de la classe ouvrière dans le Sud - en se tournant vers le stalinisme. Mais ce basculement en douceur à gauche s'est trouvé brutalement interrompu par les événements d'Irlande du Nord après 1969. La caste industrielle de l'Ulster, la perdante dans la lutte pour la survie économique, étaient devenue un obstacle réel à la gestion politique et économique de la crise politique par la Grande-Bretagne. La bourgeoisie était consciente qu'elle devait transformer le tas d'ordures unioniste. Mais quand elle a essayé d'y toucher, elle l'a trouvé grouillant de rats en colère. À ce stade, avec les unionistes qui résistaient à toutes les réformes, le gouvernement de Dublin est intervenu, d'abord par son soutien au mouvement des droits civiques dans le Nord et, d'autre part, en proposant de soutenir l'IRA du Nord dans une nouvelle campagne. Mais ce soutien n'a été donné que conditionnellement. L'IRA du Nord devait accepter de se séparer de la direction de l'IRA de l'Irlande du Sud.
Ces mesures ont conduit rapidement à une scission au sein de l'IRA. D'une part Les Provisoires, des gangs meurtriers de droite nationaliste basés dans les ghettos d'Ulster, et d'autre part les staliniens "non-sectaires" du Commandement du Sud, qui comprenaient les officiels. À la suite de son habile manœuvre, le gouvernement de Dublin espérait atteindre deux choses :
1. La préparation de la poussée militaire nécessaire pour renverser les unionistes, le principal obstacle à "l'unification irlandaise".
2. L'affaiblissement de ses adversaires staliniens de l'IRA dans le Sud.
Mais même sans entrer dans le cours des événements récents en Ulster, il est clair que la partie antiprolétarienne jouée par l'IRA dans cet holocauste sanglant marque la continuation de ses traditions bourgeoises. Elle a joué son rôle, sans aucun doute, dans la chute de l'unionisme. En même temps, elle a elle-même reçu une sévère raclée. Malgré la poursuite des attentats à la bombe et des fusillades sauvages, ce sont les forces de sécurité britanniques et Irlandaises - les maîtres des rues et des camps de concentration, les anti-terroristes armés - qui seront les principales forces essayant de contenir le mouvement révolutionnaire du prolétariat sur les îles. Mais, même battue, il est possible que l'IRA ne disparaisse pas, qu'elle reste le symbole vivant d'un impérialisme irlandais frustré. Et en particulier, dans sa forme stalinienne, elle aura un rôle important à jouer dans la lutte à venir contre les travailleurs.
Divisé et démoralisé par plus de cinquante ans de contrerévolution, le prolétariat d'Ulster s'est lui-même trouvé entraîné, dans les ghettos en 1969, à la recherche de la sécurité là où il n'était pas possible de la trouver. Il doit maintenant émerger pour répondre aux attaques incessantes du capitalisme que la crise économique aggrave. Et aussi gigantesque que soit cette tâche, il n'y a pas d'autre issue. Comme militants de la classe ouvrière, nous dénonçons les mensonges cyniques de la bourgeoisie irlandaise et britannique sur les réconciliations et sur un "règlement démocratique". Et nous appelons le prolétariat – du nord et du sud - à reprendre la guerre de classe.
Krespel (décembre 1978)
1 Sinn Fein (nous seuls) : parti politique républicain irlandais. Fondé en 1902 par Arthur Griffith, il est passé sous la direction de De Valera en 1917. Après la "guerre d'indépendance" de 1919 à 1921, une scission a eu lieu en 1922, Griffith et Michael Collins acceptant la partition et la création de l'État irlandais libre, De Valera en opposition avec eux formant un autre parti, le Fianna Fail.
2 La Conférence de Berne en 1920 regroupait tous les partis "socialistes", comme le Parti travailliste indépendant de Grande-Bretagne qui avait rompu avec la 2ème Internationale quand elle capitula face l'effort de guerre, mais qui refusa de se joindre à l'Internationale communiste. L'Internationale communiste avait dénoncé cette initiative comme étant une tentative de ressusciter la 2ème Internationale dans l'esprit sinon dans le nom.
3 "Black and Tans" (ainsi nommés pour la couleur de leurs uniformes). Combattants engagés par le gouvernement britannique dès 1920 afin d'aider la police royale irlandaise et l'armée britannique à lutter contre les indépendantistes.
4 Afin d'obtenir mieux, De Valera agissant pour les extrémistes avait même suggéré que la Grande-Bretagne devait déclarer une "doctrine Monroe" concernant l'Irlande, en garantissant que le peuple d'Irlande serait le seul à avoir le droit de décider de son propre destin.
5 Les couleurs respectives de l'Ordre d'Orange et des républicains.
6 Il y avait essentiellement deux tendances politiques impliquées ici, représentées par le Fianna Fail espérant manœuvrer, et l'IRA espérant forcer la bourgeoisie britannique à restituer l'Ulster.
7 A un moment - en 1942 - l'IRA a demandé "Que comme un prélude à une coopération entre Óglaigh noh-Eireann et le gouvernement allemand, le gouvernement allemand déclare explicitement son intention de reconnaître le Gouvernement provisoire de la République d'Irlande (ie. IRA) comme étant le gouvernement de l'Irlande dans toutes les négociations d'après-guerre concernant l'Irlande".
Géographique:
- Irlande [37]
Personnages:
- Eamonn de Valera [38]
- Sinn Fein [39]