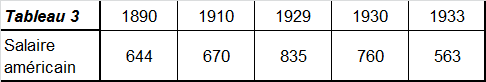Revue Internationale n° 148 - 1er trimestre 2012
- 1463 lectures
La crise économique n'est pas une histoire sans fin, elle annonce la fin d'un système et la lutte pour un autre monde
- 2172 lectures
Depuis 2008, il ne se passe pas une semaine sans qu’un pays n'annonce un nouveau plan d’austérité draconien. Baisse des pensions de retraite, hausse des impôts et des taxes, gel des salaires… rien ni personne ne peut y échapper. L’ensemble de la classe ouvrière mondiale est en train de plonger dans la précarité et la misère. Le capitalisme est frappé par la crise économique la plus aiguë de toute son histoire. Le processus actuel, laissé à sa seule logique, mènera inexorablement à l’effondrement de toute la société capitaliste. C’est ce que montre dès aujourd’hui l’impasse totale dans laquelle se trouve la bourgeoisie. Toutes ses mesures se révèlent vaines et stériles. Pire ! De manière immédiate, elles aggravent même la situation. Cette classe d'exploiteurs n’a plus la moindre solution pérenne, même à moyen terme. La crise n'est pas "arrêtée" à son niveau de 2008, elle continue de s'aggraver. Face à cela, l'impuissance de la bourgeoisie entraîne aujourd'hui des tensions, voire des déchirements, en son sein. D'économique, la crise tend à devenir aussi politique.
Ces derniers mois, en Grèce, en Italie, en Espagne, aux États-Unis… les gouvernements sont devenus de plus en plus instables ou incapables d'imposer leur politique alors que des divisions de plus en plus fortes se développent entre les différentes fractions de la bourgeoisie nationale. Les différentes fractions nationales de la bourgeoisie mondiale sont également souvent divisées entre elles quant aux politiques anti-crises à mettre en place. Il en résulte parfois que c'est avec retard que sont prises des mesures qui auraient dû l'être des mois auparavant, comme on l'a vu dans la zone euro avec le "plan de sauvetage de la Grèce". Quant aux politiques anti-crises actuelles, de même que celles les ayant précédées, elles ne peuvent que refléter l'irrationalité croissante du système capitaliste. Crise économique et crise politique frappent dorénavant simultanément à la porte de l’histoire.
Cependant, cette crise politique majeure de la bourgeoisie ne saurait réjouir les exploités. Face au danger de la lutte de classe, c’est une unité de fer que rencontrera le prolétariat en lutte, l’union sacrée de la bourgeoisie mondiale. Aussi difficile que soit la tâche qui attend le prolétariat, celui-ci possède en lui la force de détruire ce monde agonisant et de construire une société nouvelle. C’est ce but à atteindre que tous les exploités du monde doivent, par la généralisation de leurs luttes, s’approprier collectivement.
Pourquoi la bourgeoisie ne trouve-t-elle aucune solution à la crise ?
En 2008 et 2009, malgré la gravité de la situation économique mondiale, la bourgeoisie a poussé un "ouf !" de soulagement dès que la situation a paru cesser de se dégrader. En effet, à l'en croire, la crise n'était que passagère. La classe dominante et ses spécialistes serviles clamaient dans toutes les langues qu’ils avaient la situation bien en main, que tout était "sous contrôle". Le monde n'était confronté qu'à un ajustement de l’économie, une petite purge chargée d’éliminer les excès des dernières années. Mais la réalité se moque totalement des discours mensongers de la bourgeoisie. Le dernier trimestre 2011 a été rythmé par des sommets internationaux qualifiés, les uns après les autres, de "réunion de la dernière chance" pour tenter de sauver la zone euro de l’éclatement. Les médias conscients de ce danger vital ne parlent plus que de ça, de la "crise de la dette". Tous les jours les journaux et toutes les télévisions y vont de leurs analyses, toutes aussi contradictoires les unes que les autres. La panique est là qui affleure sous tous les discours. On en oublierait presque que la crise continue à se développer en dehors de la zone euro : États-Unis, Grande-Bretagne, Chine etc. Le capitalisme mondial est confronté à un problème qu’il ne peut ni dépasser ni résoudre. Celui-ci peut se représenter sous l’image d’un mur devenu infranchissable : le "mur de la dette".
Pour le capitalisme, ce qui lui est fatal aujourd’hui, c’est sa dette brute. Il est vrai qu’une dette à un endroit du monde correspond à une créance ailleurs d’un même montant, si bien que certains affirment que l'endettement mondial est nul. Il s'agit là d'une pure illusion, une entourloupe comptable, d'un jeu d’écriture sur un morceau de papier. Dans le monde réel, toutes les banques sont par exemple en situation quasi permanente de faillite. Pourtant leur bilan est "équilibré", comme elles aiment à le dire. Mais que valent réellement leurs actifs de dettes grecque, italienne ou ceux représentant des prêts immobiliers espagnols ou américains ? La réponse est claire et nette : presque plus rien ! Leurs tiroirs sont vides, restent alors… les dettes et rien que les dettes.
Mais pourquoi en ce début 2012, le capitalisme est-il confronté à un tel problème ? D’où vient cet océan d’argent emprunté et qui, depuis longtemps déjà, est totalement déconnecté de la richesse réelle de la société ? La dette puise sa source dans le crédit. Ce sont des prêts consentis par les banques centrales ou les banques privées aux États et à tous les agents économiques de la société. Ces prêts deviennent des entraves pour le capital lorsqu’ils ne peuvent plus être remboursés, lorsqu’il est nécessaire de créer de nouvelles dettes pour payer les intérêts en cours sur les dettes anciennes ou tenter d’en rembourser ne serait-ce qu’une partie.
Quel que soit l’organisme qui émet de la monnaie, banques centrales ou banques privées, il est vital, du point de vue du capital global, que soient produites suffisamment de marchandises vendues avec profit sur le marché mondial. C’est la condition même de la survie du capital. Depuis maintenant plus de quarante ans, tel n’est plus le cas. Pour que soit vendu l’ensemble des marchandises produites, c'est de l'argent qui doit être emprunté pour, à la fois, payer les marchandises en question sur le marché, rembourser les dettes déjà contractées et payer les intérêts existants qui s’accumulent au cours du temps. Pour cela, il n'y a pas d'autre solution que de contracter de nouvelles dettes. Il arrive alors un moment où la dette globale des particuliers, banques et États ne peut plus être honorée, ni même, dans plus en plus de cas, le seul service de la dette. Sonne alors l’heure de la crise générale de la dette. C'est le moment où l’endettement et la création toujours plus importante d’argent fictif par le capitalisme sont devenus le poison par lequel tout l’organisme du capital se contamine mortellement.
Quelle est la réelle gravité de la situation économique mondiale ?
Ce début d’année 2012 voit l’économie mondiale retomber en récession. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, en plus graves, en plus dramatiques. Au début de l’année 2008, le système financier a manqué s’effondrer. Les nouveaux crédits octroyés par les banques à l’économie se sont raréfiés et l’économie est entrée en récession. Depuis lors, les banques centrales américaines, britanniques et japonaises, entre autres, ont injecté des milliers de milliards de dollars. Le capitalisme a pu ainsi acheter du temps et relancer un minimum l’économie tout en empêchant les banques et les assurances de s’effondrer. Comment a-t-il procédé ? La réponse est maintenant connue. Les États se sont surendettés auprès des banques centrales et des marchés en reprenant à leur compte une petite partie des dettes des banques. Mais rien n’y a fait !
En ce début d’année 2012, l’impasse dans laquelle se trouve le capital global s'illustre, entre autres, par les 485 milliards d'euros que vient d’octroyer la BCE afin de sauver les banques de la zone d’une faillite immédiate. La BCE a prêté de l’argent, par l’entremise des banques centrales des pays de la zone, en échange d’actifs pourris. Actifs qui sont des morceaux de dettes des États de cette zone. Les banques doivent alors à leur tour acheter de nouvelles dettes d’État pour que ceux-ci ne s’effondrent pas. Chacun soutient l'autre, chacun achète la dette de l’autre avec de l’argent créé de toutes pièces à cet effet. Si bien que si l’un tombe, l’autre tombe.
Tout comme en 2008, mais de manière encore plus drastique, le crédit ne va plus à l’économie réelle. Chacun se protège et garde ou sécurise son argent pour tenter de ne pas tomber. En ce début d’année, au niveau de l’économie privée, les investissements des entreprises se font rares. La population paupérisée se serre la ceinture. La dépression économique est de nouveau là. La zone euro, comme les États-Unis, sont sur un rythme de croissance qui s’approche de zéro. Le fait que les États-Unis aient connu, en cette fin 2011, une activité en léger mieux par rapport au reste de l’année ne saurait changer durablement cette tendance générale qui, à terme, finira par s’imposer. A plus court terme, selon le FMI, la croissance pourrait se situer en 2012 pour ce pays, entre 1,8% et 2,4%. Là encore, "si tout va bien", c'est-à-dire en l'absence d'évènement économique majeur, ce qui correspond aujourd’hui à un pari que personne ne voudrait prendre !
Les pays émergents, tels l’Inde et le Brésil, voient leurs propres activités se réduire rapidement. Même la Chine, présentée depuis 2008 comme la nouvelle locomotive de l'économie mondiale, va officiellement de plus en plus mal. Un article paru sur le site du China Daily, le 26 décembre, affirme ainsi que deux provinces (dont le Guangdong qui est certainement l’une des plus riches car abritant une grande part du secteur manufacturier pour les produits de grande consommation) ont notifié à Pékin qu’elles allaient retarder le paiement des intérêts de leur dette. Autrement dit, la faillite menace aussi en Chine.
L’année 2012 se présente comme une période de contraction de l’activité mondiale dont personne n’est en mesure d’évaluer l’ampleur. La croissance mondiale est évaluée comme pouvant se situer au mieux autour de 3,5%. Au cours du mois de décembre, le FMI, l’OCDE et tous les organismes de prévisions économiques ont revu leurs chiffres de croissance à la baisse. Un constat s’impose alors à nous : des injections colossales de nouveaux crédits ont eu pour effet d'ériger, en 2008, ce qui est appelé le mur de la dette. Depuis, de nouvelles dettes n'ont plus alors comme conséquence que d'élever encore plus ce mur, avec un impact de plus en plus limité pour relancer l'économie. Ce faisant, le capitalisme se retrouve au bord du gouffre : pour l’année 2011, le financement de la dette, c'est-à-dire l’argent qui aura été nécessaire au paiement des dettes arrivant à échéance, et des intérêts de la dette globale, s'est élevé à 10 000 milliards de dollars. En 2012, il est prévu que ce poste atteigne 10 500 milliards alors que, dans le même temps, l’épargne mondiale est évaluée à 5000 milliards. Où le capitalisme va-t-il trouver ce financement ?
La fin de l’année 2011 aura vu apparaître, au premier plan, la crise de la dette au niveau des banques et des assurances, laquelle est venue ainsi s’ajouter aux dettes souveraines des États et s'imbriquer de plus en plus avec celles-ci. Il est légitime de se demander aujourd’hui qui va s’effondrer en premier ? Une grande banque privée et, donc, tout le secteur bancaire mondial ? Un nouvel État comme l'Italie ou la France ? La Chine ? La zone euro ? Le dollar ?
De la crise économique à la crise politique
Nous avions mis en évidence, dans le numéro précédent de la Revue internationale, l'ampleur des désaccords qui avaient surgi entre les principaux pays de la zone Euro pour faire face au problème du financement des cessations de paiement de certains pays, avérées (la Grèce) ou menaçantes (l'Italie, etc.), et les différences qu'il existait entre l'Europe et les États-Unis pour appréhender le problème de la dette mondiale. 1
Depuis 2008, toutes les politiques menant à une impasse croissante, des désaccords au sein des différentes bourgeoisies nationales sur la dette et la croissance donnent lieu à des crispations et se transforment peu à peu en conflits et en affrontements ouverts. Avec l’inévitable évolution de la crise, ce "débat" ne fait que commencer.
Il y a ceux qui veulent tenter de réduire le montant de la dette par une violente austérité budgétaire. Pour eux, un seul mot d’ordre s’impose alors : couper drastiquement dans toutes les dépenses de l’État. Dans ce domaine, la Grèce est un modèle qui montre le chemin à tous. L’économie réelle y connaît une récession de 5%. Les commerces ferment, le pays et la population s’enfoncent dans la ruine et la misère. Pourtant cette politique désastreuse se généralise un peu partout : Portugal, Espagne, Italie, Irlande, Grande-Bretagne, etc. La bourgeoisie s’illusionne encore, à l’image des médecins du XVIIème siècle qui croyaient aux vertus d'une saignée appliquée au malade atteint d'anémie. L’activité économique ne peut supporter un tel remède sans périr.
Une autre partie de la bourgeoisie veut monétiser la dette, c'est-à-dire transformer celle-ci en émissions de monnaie. C’est ce que font, à une échelle inconnue jusque-là, les bourgeoisies américaine et japonaise, par exemple. C’est ce que fait, en tout petit, la Banque Centrale Européenne. Cette politique a le mérite de donner un peu de temps au temps. Elle permet de faire face, à court terme, aux échéances du roulement de la dette. Elle permet de freiner la vitesse de développement de la récession. Mais elle comporte un revers catastrophique pour le capitalisme, c’est celui de provoquer à terme un effondrement global de la valeur de la monnaie. Or, le capitalisme ne peut pas fonctionner sans une monnaie, pas plus que l’homme ne peut vivre sans respirer. Ajouter de la dette à la dette quand celle-ci, comme aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Japon, ne permet plus une relance durable de l’activité conduit, là encore, à terme, à l’effondrement de l’économie.
Enfin, il y a ceux qui souhaitent combiner les deux démarches précédentes. En termes clairs, ils veulent de l’austérité couplée à de la relance par la création monétaire. L’impasse totale de la bourgeoisie ne peut sans doute pas s'exprimer mieux que dans cette orientation. C’est pourtant celle-ci qu’applique depuis au moins deux ans la Grande-Bretagne et que réclame Monti, le nouveau chef du gouvernement italien. Cette partie de la bourgeoisie qui, comme lui, est en faveur d'une telle politique tient le raisonnement suivant : "Si nous faisons des efforts pour réduire nos dépenses drastiquement, les marchés reprendront confiance dans la capacité des États de rembourser. Ils nous prêteront alors à des taux supportables et nous pourrons à nouveau nous endetter." La boucle est bouclée. Une partie de la bourgeoisie pense encore pouvoir revenir en arrière, à la situation d’avant 2007-2008.
Aucune de ces alternatives n’est viable, même à moyen terme. Toutes conduisent le capital dans une impasse. Si la création monétaire expansive effectuée par les banques centrales semble constituer la voie qui va octroyer un peu de répit, le bout de la route est identique, c’est celui de l’effondrement historique du capitalisme.
Les gouvernements seront de plus en plus instables
L’impasse économique du capitalisme engendre inévitablement la tendance historique à la crise politique au sein de la bourgeoisie. Depuis le printemps dernier, en l’espace de quelques mois, nous avons vu des crises politiques s’ouvrir spectaculairement, successivement au Portugal, aux États-Unis, en Grèce et en Italie. De manière plus sournoise, la même crise avance cachée, pour le moment, dans d’autre pays centraux comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France.
Malgré toutes ses illusions, une partie croissante de la bourgeoisie mondiale commence à percevoir, du moins en partie, l’état catastrophique de son économie. Des déclarations de plus en plus alarmistes se font jour. En réponse à cette montée de l’inquiétude, de l’angoisse et de la panique au sein de la bourgeoisie, grandissent des certitudes toujours plus rigides au sein des différents secteurs de la classe dominante y compris au niveau national. Chacun se raccroche à ce qu’il considère être la meilleure façon de défendre l’intérêt de la nation, selon le secteur économique ou politique auquel il appartient. La classe dominante s’affronte autour des options caduques que nous avons citées précédemment. En conséquence, toute orientation politique proposée par l’équipe gouvernementale en place provoque l’opposition violente des autres secteurs de la bourgeoisie.
En Italie, c’est la perte de crédibilité totale de Berlusconi pour faire appliquer les plans d’austérités supposés réduire la dette publique qui a poussé, sous la pression des marchés et avec l’aval des principaux dirigeants de la zone euro, l’ancien président du Conseil italien vers la sortie. Au Portugal, en Espagne, en Grèce, au-delà des particularités nationales, se sont ces mêmes raisons qui ont provoqué des départs précipités des équipes gouvernementales en place.
L’exemple des États-Unis est le plus significatif historiquement. Il s’agit de la plus importante puissance mondiale. Cet été, la bourgeoisie américaine s’est déchirée autour de la question du relèvement du plafond de sa dette. Ce relèvement a été opéré bien des fois depuis la fin des années 1960 sans que cela ne pose apparemment de problème majeur. Alors pourquoi cette fois la crise a-t-elle pris une ampleur telle que l’économie américaine est passée à deux doigts de la paralysie totale ? Il est vrai qu'une fraction de la bourgeoisie qui acquiert un poids croissant dans la vie politique de bourgeoisie américaine, le Tea Party, est totalement décalée et irresponsable du point de vue même de la défense des intérêts du capital national. Cependant, contrairement à ce que l’on a voulu nous faire croire, ce n’était pas le Tea Party qui était la cause première de la paralysie de l’administration centrale américaine mais l’affrontement ouvert entre les démocrates et les républicains au Sénat et à la chambre des représentants, chacun pensant que la solution apportée par l’autre était catastrophique, inadaptée, suicidaire pour le pays. Il en a résulté un compromis douteux, fragile et très probablement de courte durée. Celui-ci sera mis à l'épreuve au moment des prochaines élections américaines dans quelques mois. La poursuite de l’affaiblissement économique des États-Unis ne pourra qu'alimenter le développement de la crise politique dans ce pays.
Mais l'impasse grandissante des politiques économiques actuelles se perçoit également dans les exigences contradictoires des marchés financiers à l’égard des gouvernements. Ces fameux marchés exigent eux aussi des gouvernements à la fois des plans de rigueur draconiens et, de plus en plus, une relance de l’activité. Lorsqu'il leur arrive de perdre confiance dans la capacité d’un État à rembourser une partie significative de sa dette, ils font monter rapidement les taux d’intérêts de leurs prêts. Le résultat à terme est garanti : ces États ne peuvent plus emprunter sur les marchés. Ils deviennent totalement dépendants des banques centrales. Après la Grèce, c’est ce qui est en train de se passer actuellement pour l’Espagne et l’Italie. L’impasse économique se resserre encore plus sur ces pays et la crise politique y puise de nouvelles ressources.
L’attitude de Cameron lors du dernier sommet de l’Union européenne, refusant d’entériner une discipline budgétaire et financière pour tous, sonne, là aussi, le glas de cette union. L’économie britannique survit de fait grâce aux bénéfices de son secteur financier. Le simple fait d’envisager un début hypothétique de contrôle de celui-ci est impensable pour une bonne partie des conservateurs britanniques. Cette prise de position de Cameron a entraîné un affrontement, dans ce pays, entre libéraux démocrates et conservateurs, fragilisant encore plus la coalition au pouvoir. De même qu'elle a entraîné des dissensions au Pays de Galles et en Écosse autour de la question de l’appartenance ou non à l’Union européenne.
Enfin, un nouveau facteur favorisant le développement de la crise politique de la bourgeoisie commence à s’inviter au sein de ses débats. L’impasse dans laquelle se trouve le capital fait resurgir un vieux démon, depuis longtemps contenu, que l’on peut qualifier de néoprotectionnisme. Aux États-Unis, dans la zone euro, une grande partie des conservateurs et des partis populistes, de gauche comme de droite, entonne le chant de la mise en place de nouvelles barrières douanières. Pour cette partie de la bourgeoisie, rejointe par certains secteurs démocrates ou socialistes, il faut réindustrialiser le pays, produire et consommer "national". Sur ce terrain, la Chine se dresse violemment contre les mesures de rétorsion déjà prises par les États-Unis à son égard. Pourtant, à Washington, les tensions sur ce sujet sont loin de se calmer. Le très fameux Tea Party mais, aussi, une part significative du parti conservateur poussent ces exigences jusqu'à la caricature, obligeant les démocrates et Obama (comme sur la question du plafond de la dette) à monter au créneau pour qualifier ces secteurs de la bourgeoisie américaine de passéistes et d’irresponsables. Ce phénomène n’en est qu’à ses débuts. Pour le moment, personne n’est en mesure de prévoir sous quelle forme et à quelle vitesse cela va se développer. Mais ce qui est certain, c’est que cela aura un impact important sur la cohérence d’ensemble de la vie de la bourgeoisie, sur sa capacité à maintenir des partis et des équipes gouvernementales stables.
Quel que soit l’angle sous lequel on aborde cette réalité de crise au sein de la classe dominante, nos regards sont attirés vers une seule direction, celle de l’instabilité croissante des équipes dirigeantes et gouvernementales, y compris au niveau des principales puissances de la planète.
La bourgeoisie divisée face à la crise mais unie face à la lutte de classe
Le prolétariat ne doit pas se réjouir en soi de cette crise politique dans laquelle entre la bourgeoisie. Les divisions, les déchirements au sein de cette classe ne sont pas une garantie de succès pour sa lutte .Tous les prolétaires et les jeunes générations d’exploités doivent comprendre que, quel que soit le niveau de crise existant au sein de la classe bourgeoise, ses divisions, ses querelles et autres guerres intestines, celle-ci se présentera unie devant la menace de la lutte de classe. Cela s’appelle l’union sacrée. Tel fut le cas pendant la Commune de Paris en 1871. Rappelons-nous comment les bourgeoisies prussienne et française s’affrontaient alors dans la guerre. Mais, face à l’insurrection des Communards à Paris, tous ces exploiteurs se sont retrouvés unis, le temps d’écraser dans le sang le premier grand surgissement prolétarien de l’histoire. Tous les grands mouvements de lutte du prolétariat se sont trouvés face à cette union sacrée. Il n’y a aucune exception envisageable à cette règle.
Le prolétariat ne peut pas miser sur les faiblesses de la bourgeoisie. Pour vaincre, il ne doit pas compter sur les crises politiques internes de la classe ennemie. C’est sur ses propres forces, et elles seules, que la classe ouvrière doit compter. Depuis maintenant quelque temps, nous voyons cette force apparaître et se manifester dans de nombreux pays.
En Chine pays où se concentre aujourd’hui une partie importante de la classe ouvrière mondiale – et particulièrement la classe ouvrière industrielle -, les luttes sont pratiquement quotidiennes. On peut parler, dans ce pays, de véritables explosions de colère qui impliquent non seulement les salariés mais plus généralement la population pauvre et démunie comme la paysannerie. Salaires de misère, conditions de travail insoutenables, répression féroce…, les conflits sociaux se multiplient notamment dans les usines où la production est touchée par le ralentissement de la demande européenne et américaine. Ici dans une usine de fabrications de chaussures, là dans une usine à Sichuan, ou encore à HIP, sous-traitant de Apple, à Honda, à Tesco etc. "Il y a presque une grève par jour résume Liu Kalming." (militant du droit du travail) 2. Même si ces luttes restent, pour le moment, isolées et sans perspectives, elles démontrent cependant que les ouvriers d’Asie, comme leurs frères de classe en Occident, ne sont pas près d'accepter sans réagir les conséquences de la crise économique du capital. En Égypte, après les grandes mobilisations des mois de janvier et février 2011, le sentiment de révolte est toujours présent dans la population. Corruption généralisée, misère totale, impasse politique et économique poussent des milliers de gens dans les rues et sur les places. Le gouvernement, actuellement dirigé par les militaires, y répond par la mitraille et la calomnie, répression d’autant facilitée du fait que, contrairement aux mouvements de l’année dernière, la classe ouvrière n’est pas capable de se remobiliser massivement. Car, pour la bourgeoisie le danger est là : "on peut comprendre l’angoisse de l’armée face à l’insécurité et aux troubles sociaux qui se sont développés ces derniers mois. Il y a la crainte de la contagion des grèves à ses entreprises, où ses employés sont privés de tous droits sociaux et syndicaux tandis que toute protestation est considérée comme un crime de trahison." (Ibrahim al Sahari, Représentant du Centre des études socialistes au Caire) 3
Voilà qui est clairement dit : la peur de la bourgeoisie, c’est le mouvement ouvrier qui pourrait se développer sur son propre terrain de lutte. Dans ce pays, les illusions démocratiques sont fortes après tant d’années de dictature, mais la crise économique est là qui resserre son étreinte. La bourgeoisie égyptienne, quelle que soit la fraction qui sera au gouvernement après les récentes élections, ne pourra pas empêcher la situation de se dégrader et l'impopularité du gouvernement de grandir. Toutes ces luttes ouvrières et sociales, malgré leurs faiblesses et leurs limites, expriment un début de refus, de la part de la classe ouvrière et d’une partie croissante de la population exploitée, d’accepter passivement le sort que leur réserve le capitalisme.
Les ouvriers des pays centraux du capitalisme aussi ne sont pas restés inertes ces derniers mois. Le 30 novembre dernier en Grande-Bretagne, deux millions de personnes se sont rassemblées dans la rue pour refuser la dégradation permanente de leurs conditions de vie. Cette grève fut la plus massive depuis plusieurs dizaines d’années sur ces terres où la classe ouvrière (la plus combative d’Europe dans les années 1970) avait été écrasée sous la botte de fer du thatchérisme dans les années 1980. C’est pourquoi, voir ainsi deux millions de manifestants dans les rues anglaises, même lors d’une journée syndicale stérile et sans lendemain, est très significatif du retour de la combativité ouvrière à l’échelle internationale. Le mouvement des Indignés, notamment en Espagne, nous a montré de manière embryonnaire de quoi la classe ouvrière pourra être capable. Les prémisses de sa propre force sont apparues clairement : assemblées générales ouvertes à tous, débats libres et fraternels, prise en main de l’ensemble de la lutte par le mouvement lui-même, solidarité et confiance en soi (Voir notre dossier spécial sur le mouvement des Indignés et des Occupy sur notre site Internet 4). La capacité qu'aura la classe ouvrière de s’organiser comme force autonome, en tant que corps collectif uni, sera un enjeu vital du développement des futures luttes massives du prolétariat. Les ouvriers des pays centraux du capitalisme, plus à même de déjouer les mystifications démocratiques et syndicales auxquelles ils sont confrontés depuis des décennies, montreront ainsi aux yeux du prolétariat mondial que c’est à la fois possible et nécessaire.
Le capitalisme mondial est en train de s’effondrer économiquement, la classe bourgeoise est secouée de manière croissante par des crises politiques. Ce système montre chaque jour un peu plus qu’il n’est pas viable.
Compter sur nos propres forces, c’est aussi savoir ce qui nous manque. Partout commence à naitre un mouvement de résistance contre les attaques du capitalisme. En Espagne, en Grèce, aux États-Unis des critiques émanant des ailes prolétariennes des mouvements de contestation fusent contre ce système économique pourri. On voit même apparaître un début de rejet du capitalisme. Mais alors, la question fondamentale qui taraude la classe ouvrière vient taper aux portes de la conscience ouvrière. Détruire ce monde est une nécessité que l’on peut percevoir mais pour mettre quoi à la place ? Ce dont nous avons besoin, c’est d’une société sans exploitation, sans misère et sans guerre. Une société où l’humanité sera enfin unie à l’échelle mondiale et non divisée en nations, en classes, ni triée par couleur ou par religion. Une société où chacun aura ce dont il a besoin pour se réaliser pleinement. Cet autre monde, qui doit être le but de la lutte de classe lorsque celle-ci s’attaque au renversement du capitalisme, est possible : c'est à la classe ouvrière (actifs, chômeurs, employés, futurs prolétaires encore scolarisés, travaillant derrière une machine ou un ordinateur, manœuvre, technicien ou scientifique, etc.) qu'il échoit de prendre en charge la transformation révolutionnaire qui y conduit et il porte un nom : le communisme qui n'a évidemment rien à voir avec le monstre hideux du stalinisme qui a usurpé ce nom ! Il ne s’agit pas là d’un rêve ou d’une utopie. Le capitalisme, pour se développer et exister, a aussi développé en son sein les moyens techniques, scientifiques et de production qui permettront à la société humaine mondiale et unifiée d’exister. Pour la première fois de son histoire, la société pourra sortir du règne de la pénurie pour établir celui de l’abondance et du respect de la vie. Les luttes qui se déroulent actuellement dans le monde, même si elles sont encore très embryonnaires, ont commencé sous les coups de boutoir de ce monde en faillite, à se réapproprier ce but à atteindre. La classe ouvrière mondiale porte, en elle-même, les capacités historiques de le réaliser.
Tino (10 janvier 2012)
1 "La catastrophe économique mondiale est inévitable [2]".
2 Dans le journal Cette semaine. cettesemaine.free.fr/spip/article.php3?id_article=4602
3 Cité dans l'article "En Égypte et dans le Maghreb, quel avenir pour les luttes ? [3]", Révolution Internationale n° 428.
4 fr.internationalism.org/icconline/2011/dossier_special_indignes.html [4]
Récent et en cours:
- Crise économique [5]
L'État dans la période de transition au communisme (I) (débat dans le milieu révolutionnaire)
- 2876 lectures
Nous publions ci-après une contribution d'un groupe politique du camp prolétarien, OPOP 1, à propos de l'État dans la période de transition et de ses rapports avec l'organisation de la classe ouvrière pendant cette période.
Bien que cette question ne soit pas "d'actualité immédiate", c'est une des responsabilités fondamentales des organisations révolutionnaires de développer la théorie qui permettra au prolétariat de mener à bien sa révolution. En ce sens, nous saluons l'effort d'OPOP pour clarifier une question qui sera de la première importance lors de la future révolution, si elle est victorieuse, afin de pouvoir mettre en œuvre à l'échelle mondiale la transformation de la société léguée par le capitalisme vers une société sans classes et sans exploitation.
L'expérience de la classe ouvrière a déjà apporté sa contribution à la clarification pratique et à l'élaboration théorique de cette question. La brève expérience de la Commune de Paris, où le prolétariat a pris le pouvoir pendant deux mois, a clarifié la nécessité de détruire l'État bourgeois (et non de le conquérir comme le pensaient les révolutionnaires auparavant) et de la révocabilité permanente des délégués élus par les prolétaires. La révolution russe de 1905 a fait surgir des organes spécifiques, les conseils ouvriers, organes du pouvoir de la classe ouvrière. Après l'éclatement de la révolution russe en 1917, Lénine allait condenser dans son ouvrage L'État et la révolution les acquis du mouvement prolétarien sur cette question à cette époque. C'est de la conception résumée par Lénine d'un État prolétarien, l'État des Conseils, que se réclame le texte d'OPOP ci-après.
Pour OPOP, l'échec de la révolution russe (du fait de son isolement international) ne permet pas de tirer des leçons nouvelles par rapport au point de vue de Lénine. C'est sur cette base qu'elle rejette la conception du CCI qui remet en cause la notion d' "État prolétarien". Tout en développant sa critique, la contribution d'OPOP prend soin de délimiter le champ des désaccords entre nos organisations, ce que nous saluons, en soulignant que nous avons en commun la conception selon laquelle "les conseils ouvriers doivent détenir un pouvoir illimité (…) et constituer l'âme de la dictature révolutionnaire du prolétariat".
Le point de vue du CCI sur la question de l'État ne fait que poursuivre l'effort de réflexion théorique mené par les fractions de gauche (italienne en particulier) surgies en réaction à la dégénérescence des partis de l'Internationale communiste. S'il est parfaitement juste de rechercher la cause fondamentale de la dégénérescence de la révolution russe dans l'isolement international de celle-ci, ce n'est pas pour autant que cette expérience ne peut pas apporter d'enseignements quant au rôle de l'État, permettant ainsi d'enrichir la base théorique que constitue L'État et la révolution de Lénine. Contrairement à la Commune de Paris, qui a été clairement et ouvertement battue par la répression sauvage de la bourgeoisie, en Russie, c'est en quelque sorte "de l'intérieur", de la dégénérescence de l'État lui-même, qu'est venue la contre-révolution (en l'absence de l'extension de la révolution). Comment comprendre ce phénomène ? Comment et pourquoi la contre-révolution a-t-elle pu prendre cette forme ? C'est justement en nous basant sur les apports théoriques élaborés à partir de cette expérience que nous critiquons la position de "l'État prolétarien" défendue dans l'ouvrage de Lénine, de même que certaines formulations de Marx et Engels allant dans le même sens.
Évidemment, contrairement aux apports "en positif" de la Commune, ces leçons que nous tirons sur le rôle de l'État sont "en négatif" et, en ce sens, elles font l'objet d'une question ouverte, qui n'est pas tranchée par l'histoire. Mais, comme nous l'avons dit plus haut, il est de la responsabilité des révolutionnaires de préparer l'avenir. Nous publierons, dans un prochain numéro de la Revue internationale, une réponse aux thèses développées par OPOP. On peut ici évoquer, de façon très résumée, les idées essentielles autour desquelles elle s'articulera 2 :
-
Il est impropre de parler de l'État comme pouvant être le produit d'une classe en particulier. Comme Engels l'a mis en évidence, l'État est le produit de l'ensemble de la société divisée en classes antagoniques. S'identifiant aux rapports production dominants (et donc à la classe qui les incarne), sa fonction est celle de préservation de l'ordre économique instauré ;
-
Après la révolution victorieuse, il persiste des classes sociales différentes, même après la défaite de la bourgeoisie au niveau international ;
-
Si la révolution prolétarienne est l'acte par lequel la classe ouvrière se constitue en classe politiquement dominante, cette classe n'en devient pas pour autant la classe économiquement dominante. Elle demeure, jusqu'à l'intégration de l'ensemble des membres de la société dans le travail associé, la classe exploitée de la société et la seule classe révolutionnaire, c'est-à-dire porteuse du projet communiste. À ce titre, elle doit en permanence maintenir son autonomie de classe afin de défendre ses intérêts immédiats de classe exploitée et son projet historique de société communiste.
CCI
Conseils ouvriers, État prolétarien, dictature du prolétariat dans la phase socialiste de transition vers la société sans classes (OPOP)
1. Introduction
Les gauches sont en retard dans la discussion très urgente à mener concernant les questions de stratégie, tactique, organisation et également de la transition [au communisme]. Parmi les nombreux sujets qui nécessitent des réponses, l'un d'entre eux se détache particulièrement, celui de l'État, qui mérite un débat systématique.
Sur cette question, certaines forces de gauche ont une conception différente de la nôtre, en ce qui concerne essentiellement les conseils, véritables structures de la classe ouvrière, qui surgissent en tant qu'organes d'un pré-État-Commune et, par extension, de l'État-Commune lui-même. Pour ces organisations, l'État est une chose et les conseils en sont une autre, totalement différente. Pour nous, les conseils sont la forme au moyen de laquelle la classe ouvrière se constitue sur le plan organisationnel en État, en tant que dictature du prolétariat, vu que l'État signifie le pouvoir institué d'une classe sur une autre.
La conception marxiste de l'État prolétarien contient, pour le court terme, l'idée de la nécessité d'un instrument de domination de classe mais, pour le moyen terme, elle indique la nécessité de la fin de l'État lui-même. Ce qu'elle propose et qui devra prévaloir dans le communisme c'est une société sans classes et l'absence de nécessité de l'oppression de l'homme ou de la femme, étant donné qu'il n'existera plus d'antagonisme social entre différents groupes sociaux, comme c'est le cas aujourd'hui à cause de l'appropriation privée des moyens de production et de la séparation entre les producteurs directs et les moyens – et les conditions - de travail et donc de production.
La société, qui sera alors hautement évoluée, passera par une étape d'auto-gouvernement et d'administration des choses, où il n'y aura besoin d'aucune des organisations sociales transitoires expérimentées depuis qu'existe Homo sapiens, à l'exception de la forme conseils qui est la forme la plus évoluée de l'État (son caractère simplifié, sa dynamique d'auto-extinction délibérée et consciente et sa force sociale ne sont autres que des manifestations de sa supériorité sur toutes les autres formes passées de l'État), que la classe ouvrière utilisera pour passer de la première phase du communisme (le socialisme) à une phase supérieure de la société, la société sans classes. Mais pour atteindre ce stade, la classe ouvrière devra construire, bien avant, le moyen de la transition que sont les conseils à l'échelle planétaire.
Il reviendra alors aux organisations marxistes la tâche, non pas de contrôler l'État, moins encore de l'extérieur que de l'intérieur, mais bien de lutter en permanence au sein de l'État-Commune édifié par la classe ouvrière et l'ensemble du prolétariat au moyen des conseils, afin que celui-ci se hisse à la hauteur de son combat le plus révolutionnaire. Les conseils, à leur tour, devront effectivement assumer la lutte pour le nouvel État, avec la compréhension que ce sont eux-mêmes qui constituent l'État, lequel n'a pas sans raison été qualifié d'État-Commune par Lénine.
L'État des Conseils est révolutionnaire tant dans sa forme que dans son contenu. Il diffère, par essence, de l'État bourgeois de la société capitaliste ainsi que des autres sociétés qui l'ont précédée. L'État des Conseils découle de la constitution de la classe ouvrière en classe dominante comme le pose le Manifeste du Parti communiste de 1848, écrit par Marx et Engels. En ce sens, les fonctions qui lui reviennent diffèrent radicalement de celles de l'État bourgeois capitaliste, dans la mesure où s'opère un changement, une transformation quantitative et qualitative au moment même de la rupture entre l'ancien pouvoir et la nouvelle forme d'organisation sociale : l'État des Conseils.
L'État des Conseils est, en même temps et dialectiquement, la négation politique et sociale de l'ordre antérieur ; c'est pour cela qu'il est, également dialectiquement, l'affirmation et la négation de la forme de l'État : négation en ce sens qu'il entreprend sa propre extinction et en même temps celle de toute forme d'État ; affirmation en tant qu'expression extrême de sa force, condition de sa propre négation, dans la mesure où un État post-révolutionnaire faible serait impuissant à résoudre sa propre existence ambigüe : mener à bien la tâche de répression de la bourgeoisie comme prémices de son pas décisif, l'acte de sa disparition. Dans l'État bourgeois, la relation dictature - démocratie se réalise à travers une relation combinée d'unité contradictoire (dialectique) dans laquelle la grande majorité est soumise au moyen de la domination politique et militaire de la bourgeoisie. Dans l'État des Conseils, au contraire, ces pôles sont inversés. Le prolétariat, qui avait auparavant une participation politique nulle en raison du processus de manipulation et d'exclusion des décisions auquel il était soumis, vient jouer le rôle dominant dans le processus de lutte des classes. Il y établit la plus large démocratie politique connue de l'histoire, laquelle sera associée, comme il se doit, à la dictature de la majorité exploitée sur une minorité dépouillée et expropriée, qui fera tout pour organiser la contre-révolution.
C'est cela l'État des Conseils, l'expression ultime de la dictature du prolétariat qui utilise ce pouvoir, non seulement pour assurer une plus grande démocratie pour les travailleurs en général et la classe ouvrière en particulier, mais avant tout et par-dessus tout, pour réprimer de façon organisée à l'extrême les forces de la contre-révolution.
L'État des Conseils condense en lui, comme cela a déjà été dit, l'unité entre le contenu et la forme. C'est durant la période de situation révolutionnaire, alors que les bolcheviks organisaient l'insurrection en Russie en Octobre 1917, que cette question est devenue la plus claire. A ce moment-là, il était impossible de faire une distinction entre le projet de pouvoir par la classe ouvrière, le socialisme, le contenu et la forme d'organisation, le nouveau type d'État qu'on voulait construire en le basant sur les soviets. Le socialisme, le pouvoir des travailleurs et les soviets, tout cela était la même chose, si bien qu'on ne pouvait parler de l'un sans comprendre qu'on parlait automatiquement de l'autre. Ainsi, ce n'est pas parce que, par la suite, il s'est édifié une organisation étatique toujours plus éloignée de la classe ouvrière en Russie que nous devons laisser de côté la tentative révolutionnaire de mettre en place l'État des Soviets.
Les soviets (conseils), à travers tous les mécanismes et les éléments hérités de la bureaucratie ont, en URSS, été privés de leur contenu révolutionnaire pour se constituer, dans le moule d'un État bourgeois, comme organe institutionnalisé. Mais ce n'est pas pour autant que nous devrions abandonner la tentative de construire un État d'un type nouveau, avec un fonctionnement dont les principes de base seraient nécessairement en adéquation avec ce que la classe ouvrière a créé de plus important à travers le processus historique de sa lutte, à savoir une forme d'organisation nécessitant seulement d'être améliorée sur certains aspects en vue de mener à bien la transition, mais qui, fondamentalement, depuis la Commune de Paris de 1871, a fait l'objet de répétitions générales, à travers une série de tentatives et d'erreurs, pour réaliser l'État des Conseils.
Aujourd'hui, la tâche consistant à établir les conseils comme une forme d'organisation de l'État ne se situe pas seulement dans la perspective d'un seul pays mais à l'échelle internationale et c'est bien là le défi principal qui est posé à la classe ouvrière. Par conséquent, nous nous proposons à travers ce bref essai, de réaliser une tentative pour comprendre ce qu'est l'État des Conseils ou, autrement dit, une élaboration théorique sur une question que la classe ouvrière a déjà expérimentée pratiquement, à travers son expérience historique et dans sa confrontation aux forces du capital. Passons à l'analyse.
2. Préambule
Pour éviter les répétitions et les redondances, nous considérons comme établi que, dans ce texte, nous assumons à la lettre toutes les définitions théoriques et politiques principielles qui définissent le corps de doctrine de L'État et la révolution de Lénine.3 De plus, nous avertissons le lecteur que nous ne rappellerons les prémisses léninistes que dans la seule mesure où elles sont indispensables pour fonder théoriquement quelques postulats qui sont nécessaires au besoin réellement urgent d'une actualisation de ce sujet. De plus, nous ne le ferons que si les prémisses en question sont nécessaires pour clarifier et fonder l'objectif théorique - politique qui nous préoccupe, à savoir les relations entre le système des conseils et l'État prolétarien (= dictature du prolétariat) avec sa forme préalable, le pré-État.
D'un autre point de vue, l'œuvre de Lénine mentionnée précédemment se révèle de façon tout autant nécessaire et irremplaçable, car elle inclut l'aperçu le plus complet des passages de Marx et d'Engels relatifs à l'État de la phase de transition, mettant ainsi à portée de main une quantité plus que suffisante de positions existantes et autorisées produites sur L'État et la révolution dans toute la littérature politique.
3. Quelques prémisses du pouvoir ouvrier
Commentant Engels, Lénine fait, dans deux passages de son texte, les affirmations suivantes: "L'État est le produit et la manifestation de ce fait que les contradictions de classes sont inconciliables (...) Selon Marx, l'État ne pourrait ni surgir, ni se maintenir, si la conciliation des classes était possible" et "... l'État est un organisme de domination de classe, un organisme d'oppression d'une classe par une autre" 4 (l'accentué est de l'auteur). Conciliation et domination sont deux concepts très précis dans la doctrine sur l'État de Marx, Engels et Lénine. Conciliation signifie la négation de toute contradiction quelle qu'elle soit entre les termes d'une relation donnée. Dans la sphère sociale, en l'absence de contradictions dans la constitution ontologique des classes sociales fondamentales d'une formation sociale, parler d'État n'a pas de sens. Il est prouvé historiquement que, dans les sociétés primitives, il n'existe pas d'État tout simplement parce qu'il n'y a pas de classes sociales, d'exploitation, d'oppression et de domination d'une classe sur une autre. D'autre part, lorsqu'on parle de la constitution ontologique même des classes sociales, la domination est une notion qui exclut l'hégémonie, vu que l'hégémonie suppose le partage – même inégal – de positions au sein du même contexte structurel. Le résultat est que, dans le domaine de la socialité bourgeoise, qui s'étend jusqu'à celui de la révolution, au sein duquel la bourgeoisie et le prolétariat sont situés et se battent à partir de positions diamétralement antagoniques, parler de l'hégémonie de la bourgeoisie sur le prolétariat n'a pas de sens, alors qu'il y en a un de parler d'hégémonie entre les fractions de la bourgeoisie qui se partagent le même pouvoir d'État ; cela a un sens également de parler de l'hégémonie du prolétariat sur les classes avec lesquelles il partage l'objectif commun de prendre le pouvoir par le renversement de l'ennemi stratégique commun 5.
Ailleurs, citant Engels, Lénine parle de la force publique, ce pilier caractéristique de l'État bourgeois - l'autre étant la bureaucratie - constitué de tout un appareil répressif militaire et spécialisé, qui est séparé de la société et au-dessus d'elle et "... qui ne coïncide plus directement avec la population s'organisant elle-même en force armée" 6. La mise en évidence de cette composante de base de l'ordre bourgeois a ici un clair objectif : montrer comment, en contrepartie, est également incontournable la mise en place d'une force armée, beaucoup plus forte et cohérente, celle du prolétariat en armes pour réprimer, avec une détermination encore plus résolue, l'ennemi de classe battu, mais pas abattu, la bourgeoisie. Dans quelle instance de la dictature du prolétariat doit se trouver cette force répressive ? C'est une question à traiter dans un chapitre spécifique du présent texte.
L'autre pilier sur lequel repose le pouvoir bourgeois est la bureaucratie, comprenant des fonctionnaires de l'État, qui jouissent de privilèges cumulatifs, parmi lesquels des honoraires différenciés, des postes de tout repos attribués à vie, qui accumulent tous les avantages des pratiques inhérentes à une corruption de grande ampleur et récurrente. De même que pour les milices populaires qui redoublent de force à mesure qu'elles sont structurellement simplifiées, les tâches exécutives, législatives et judiciaires sont plus efficaces dans la mesure même où elles sont également simplifiées ; et exactement pour la même raison, les tâches exécutives des tribunaux et les fonctions législatives gagnent en force dans la mesure même où elles sont prises en charge directement par les travailleurs dans des conditions où la révocabilité des charges est établie afin d'enrayer, dès le début, la tendance à la résurgence des castes, mal dont souffrent toutes les sociétés qui ont été accouchées par des révolutions "socialistes" durant tout le vingtième siècle.
La bureaucratie et la force publique professionnelles, les deux poutres maîtresses sur lesquelles repose le pouvoir politique de la bourgeoisie, les deux piliers dont les fonctions devraient être remplacées par les travailleurs dans des structures simplifiées (au cours de leur extinction) mais alors beaucoup plus efficaces et fortes ; simplification et force qui s'opposent et s'attirent dans le mouvement qui accompagne tout le processus de transition jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de la précédente société de classe. Le problème qui nous est maintenant posé est le suivant : quelle est l'instance qui, pour Marx, Engels et Lénine, doit assumer la dictature du prolétariat ?
4. La dictature du prolétariat chez Marx, Engels et Lénine
Notre trio ne laisse aucun doute à ce sujet :
"Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante, et pour augmenter au plus vite la quantité des forces productives" 7.
Ou encore, État prolétarien (sic) = "prolétariat organisé en classe dominante." "L'État, c'est-à-dire le prolétariat organisé en classe dominante." (sic). Jusqu'ici, le sens du raisonnement de Lénine, Engels et Marx est le suivant : le prolétariat renverse la bourgeoisie par la révolution ; en renversant la machine étatique bourgeoise, il détruira la machine d'État en question pour, immédiatement, ériger son État, simplifié et en voie d'extinction, lequel est plus fort car il est dirigé par la classe révolutionnaire et assume deux types de tâches : réprimer la bourgeoisie et construire le socialisme (comme phase de transition au communisme).
Mais d'où Marx tire-t-il cette conviction que la dictature du prolétariat est l'État prolétarien ? De la Commune de Paris ... tout simplement ! En effet, "La Commune fut composée des conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. La majorité de ses membres étaient naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière." 8 (souligné par l'auteur). La question va beaucoup plus loin : les membres de l'État prolétarien (sic), l'État-Commune, sont élus dans les conseils d'arrondissement, ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas de conseils de travailleurs qui se mettent à la tête de tels conseils, comme en Russie, dans les soviets. La question de l'hégémonie de la direction ouvrière est garantie par l'existence d'une majorité d'ouvriers dans ces conseils et, bien sûr, par l'action de direction que le parti doit exercer dans de telles instances.
Il ne manque qu'un seul ingrédient pour articuler la position État prolétarien, État des Conseils, État-Commune, État socialiste ou dictature du prolétariat : la méthode de prise des décisions et c'est là que se formule et se comprend ce principe universel que beaucoup de marxistes ne parviennent pas à comprendre, il s'agit du centralisme démocratique. "Mais ce centralisme démocratique, Engels ne l'entend nullement au sens bureaucratique que lui donnent les idéologues bourgeois et petit-bourgeois, dont, parmi ces derniers, les anarchistes. Le centralisme, pour Engels, n'exclut pas du tout une large autonomie administrative locale qui, à condition que les "communes" et les régions défendent de leur plein gré l'unité de l'État, supprime incontestablement tout bureaucratisme et tout "commandement" par en haut." 9. Il est clair que le terme et le concept de centralisme démocratique ne sont pas la création du stalinisme, comme le veulent certains - qui tentent de dénaturer cette méthode essentiellement prolétarienne - mais celle d'Engels lui-même. Par conséquent, il ne peut leur être donnée la connotation péjorative qui vient du centralisme bureaucratique utilisé par la nouvelle bourgeoisie d'État de l'URSS.
5. Système des conseils et dictature du prolétariat
La séparation antinomique entre le système des conseils et l'État post-révolutionnaire est une erreur, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elle réside dans une position qui s'éloigne de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État. Séparer l'État prolétarien du système des conseils revient à briser l'unité qui doit exister et persister dans le cadre de la dictature du prolétariat. Une telle séparation place, d'un côté, l'État comme une structure administrative complexe, devant être gérée par un corps de fonctionnaires - une aberration dans la conception de l'État simplifié de Marx, Engels et Lénine – et, de l'autre, une structure politique, dans le cadre des conseils, devant exercer une pression sur la première (l'État en tant que tel). Cette conception résulte d'une accommodation à une vision influencée par l'anarchisme qui identifie l'État-Commune avec l'État bureaucratique (bourgeois). Elle est le produit des ambiguïtés de la Révolution russe et place le prolétariat hors de l'État post-révolutionnaire, créant ainsi une dichotomie qui, elle, constitue le germe d'une nouvelle caste se reproduisant dans le corpus administratif organiquement séparé des conseils.
Une autre cause de cette même erreur, qui est liée à la précédente, réside dans l'établissement d'un lien étrange identifiant de façon acritique l'État surgi dans l'URSS post-révolutionnaire - un État nécessairement bureaucratique - avec la conception de l'État-Commune de Marx, Engels et de Lénine lui-même. C'est une erreur qui découle d'une incompréhension des ambiguïtés ayant résulté de circonstances historiques et sociales spécifiques, qui ont bloqué non seulement la transition mais même le début de la dictature du prolétariat en URSS. Ici, on cesse de comprendre que la dynamique prise par la révolution russe - à moins d'opter pour l'interprétation facile mais peu consistante selon laquelle les déviations du processus révolutionnaire ont été le fruit de la politique de Staline et de son entourage – n'obéissait pas à la conception de la révolution, de l'État et du socialisme qu'en avait Lénine, mais aux restrictions qui émanaient du terrain social et politique d'où émergea le pouvoir en URSS caractérisé, entre autres et pour rappel, par l'impossibilité de la révolution en Europe, par la guerre civile et la contre-révolution à l'intérieur de l'URSS. La dynamique qui en résulta était étrangère à la volonté de Lénine. Lui-même se pencha sur celle-ci, la marquant de façon réitérée par des formulations ambiguës présentes dans sa pensée ultérieure et ce jusqu'à sa mort. De telles ambiguïtés, qui se reflétaient dans la pensée qui tentait de les comprendre, se situaient plus dans les avancées et les reculs de la révolution que dans la conception théorique politique de Lénine et des chefs bolcheviques qui continuaient à être d'accord avec lui.
Une troisième cause à cette erreur est la non prise en compte du fait que les tâches organisationnelles et administratives mises à l'ordre du jour par la révolution sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux. Ainsi, des questions brûlantes comme la planification centralisée - dont la forme bureaucratique dans le système Gosplan (Comité étatique pour la planification) a longtemps été confondue avec la "centralisation socialiste" – rien que pour parler de cet aspect digne d'attention, ne sont pas des questions purement "techniques" mais hautement politiques et, comme telles, ne peuvent être déléguées, même si elles sont "vérifiés" de l'extérieur par les conseils, au moyen d'un corps d'employés situés en dehors du système des conseils où se trouvent les travailleurs les plus conscients. Aujourd'hui, on sait que la planification ultra centralisée "socialiste" n'était qu'un aspect de la centralisation bureaucratique du capitalisme d'État "soviétique" qui maintenait le prolétariat éloigné et étranger à tout le système de définition des objectifs, des décisions concernant ce qui doit être produit et comment cela doit être réparti, l'allocation des ressources, etc. S'il s'était agi d'une véritable planification socialiste, tout ceci aurait dû faire l'objet d'une large discussion au sein des conseils, ou de l'État-Commune, vu que l'État prolétarien se confond avec le système des conseils, l'État socialiste étant "une "machine" très simple, presque sans "machine", sans appareil spécial, par la simple organisation des masses armées (comme, dirons-nous par anticipation, les Soviets des députés ouvriers et soldats)." 10
Une autre incompréhension réside dans la non perception que la véritable simplification de l'État-Commune, telle qu'elle est décrite par Lénine à travers les paroles rapportées précédemment, implique un minimum de structure administrative et que cette structure est si minime et en voie de simplification / extinction, qu'elle peut être assumée directement par le système des conseils. Par conséquent, cela n'a pas de sens de prendre comme référence l'État "soviétique" de l'URSS pour mettre en question l'État socialiste que Marx et Engels ont vu naître de la Commune de Paris. En fait, établir un trait d'union entre l'État des Conseils et l'État bureaucratique issu de la Révolution russe revient à donner à l'État prolétarien une structure bureaucratique, qu'un véritable État post-révolutionnaire, simplifié et en voie de simplification / extinction, non seulement ne possède pas mais encore rejette précisément.
En fait, le caractère et l'étendue de l'État des Conseils (État prolétarien = État socialiste = dictature du prolétariat = État-Commune = État de transition) sont magnifiquement résumés dans ce passage écrit par Lénine lui-même : "l' "État" est encore nécessaire, mais c'est déjà un État transitoire, ce n'est plus l'État proprement dit". 11 Mais, direz-vous, si c'était cela la véritable conception de l'État socialiste de Lénine, pourquoi ne l'a-t-il pas "appliquée" en URSS après la révolution d'Octobre, vu que ce qui est alors apparu est l'exact opposé de tout cela, des distorsions allant de l'extrême centralisation bureaucratique (depuis l'armée à la bureaucratie étatique et aux unités de production) jusqu'à la répression la plus brutale des marins de Cronstadt ? Eh bien, tout cela ne fait que révéler que des révolutionnaires de l'envergure de Lénine peuvent éventuellement être traversés par des contradictions et des ambiguïtés d'une telle importance – et cela a été le contexte exact national et international de la Révolution d'Octobre - qui peuvent les conduire, dans la pratique, à des actions et des décisions souvent diamétralement opposées à leurs convictions les plus profondes. Dans le cas de Lénine et du Parti bolchevique, une seule des impossibilités [à la révolution, NDT] (et elles étaient nombreuses) était suffisante pour orienter la révolution dans une direction non souhaitée. Une de ces impossibilités était plus que suffisante : la situation d'isolement d'une révolution qui ne pouvait pas reculer, mais qui s'est trouvée isolée et n'avait pas d'autre choix que d'essayer d'ouvrir la voie à la construction du socialisme dans un seul pays, la Russie soviétique - tentative contradictoire qui fut initiée déjà à l'époque de Lénine et Trotsky. Que furent le communisme de guerre, la NEP, et autres entreprises, sinon cela ?
Et alors, que devons-nous faire ? Devons-nous rester fermes sur les conceptions de Lénine, Marx et Engels sur l'État, le programme, la révolution et le parti pour, dans le futur, lorsque les problèmes concrets comme celui de l'internationalisation de la lutte de classe, entre autres, montreront les réelles possibilités pour la révolution et la construction du socialisme dans plusieurs pays, mettre en avant et donner corps aux conceptions de Marx, Engels et Lénine ? Ou bien, inversement, devons-nous, face aux premières difficultés, renoncer aux positions de principe, en les échangeant contre des figurations politiques au rabais qui ne pourront que conduire à l'abandon de la perspective de la révolution et de l'édification socialiste ?
6. Pour une conclusion : Conseils, État (socialiste) et pré- État (socialiste)
a) L' État-Conseil
Après avoir analysé les prémisses économiques de l'abolition des classes sociales, c'est-à-dire, les prémisses "pour que 'tous' puissent réellement participer à la gestion de l'État", Lénine, toujours en référence aux formulations de Marx et d'Engels, dit qu' "on peut fort bien, après avoir renversé les capitalistes et les fonctionnaires, les remplacer aussitôt, du jour au lendemain, pour le contrôle de la production et de la répartition, pour l'enregistrement du travail et des produits, par les ouvriers armés, par le peuple armé tout entier". "Enregistrement et contrôle, tel est l'essentiel, et pour la 'mise en route' et pour le fonctionnement régulier de la société communiste dans sa première phase. Ici, tous les citoyens se transforment en employés salariés de l'État constitué par les ouvriers armés. Tous les citoyens deviennent les employés et les ouvriers d'un seul 'cartel' du peuple entier, de l'État" 12. De plus, "En régime socialiste, tout le monde gouvernera à tour de rôle et s'habituera vite à ce que personne ne gouverne." L'étape du socialisme "placera la majeure partie de la population dans des conditions permettant à tous, sans exception, de remplir les 'fonctions publiques'." 13
Tous les citoyens, rappelons-le, organisés dans le système des conseils, ou un autre, dans l'État ouvrier, vu que pour Marx, Engels et Lénine, la simplification des tâches atteindra un point tel que les tâches "administratives" de base, réduites à l'extrême, non seulement pourront être assumées par le prolétariat et les gens en général, comme pourront être prises en charge par le système des conseils qui, après tout, n'est que l'État lui-même.
Ainsi, l'État prolétarien, l'État socialiste, la dictature du prolétariat n'est pas autre chose que le système des conseils, lequel assurera l'hégémonie de la classe ouvrière dans son ensemble, assumera directement, sans qu'il y ait la nécessité d'aucun organe administratif spécifique, à la fois la défense du socialisme et les fonctions de gestion de l'État et des unités de production. Enfin, cette unité de la dictature du prolétariat, sera garantie par l'unité administrative / politique simplifiée, dans une même totalité appelée l'État des Conseils.
b) Le pré-État des Conseils
Le système des conseils qui, dans la situation post-insurrectionnelle, devra assumer la transition structurelle (mise en place de nouveaux rapports de production, élimination de toute hiérarchie dans la production, refus de toute forme mercantile, etc.) et superstructurelle (élimination de toute hiérarchie héritée de l'État bourgeois, de toute la bureaucratie, refus de toute idéologie héritée de la formation sociale antérieure, etc.) est le même système des Conseils que celui qui, avant la révolution, était l'organisation révolutionnaire qui a renversé la bourgeoisie et son État. Il s'agit donc d'un même corpus dont les tâches ont évolué avec les deux étapes du même processus de révolution sociale : une fois réalisée la tâche de l'insurrection, il faut initier la mise en œuvre d'une nouvelle tâche qui devra mener à son terme la véritable révolution sociale – la rupture avec une formation sociale qui a expiré et l'inauguration d'une nouvelle, le socialisme, lui-même aussitôt en marche pour la transition communiste, la seconde société sans classes de l'histoire (la première ayant été, bien sûr, la société primitive).
Eh bien c'est ce système des conseils que nous appelons pré-État (prolétarien). On voit que ce nom n'a, par son contenu, rien d'original, car il était, est et sera toujours une évidence du processus révolutionnaire ouvert par la Commune de Paris. Là, les Communards qui ont pris le pouvoir à partir des arrondissements étaient les mêmes qui ont assumé le pouvoir d'État - dictature du prolétariat - et qui ont inauguré, bien qu'avec des erreurs évidentes de jeunesse, l'édification d'un ordre socialiste. Un processus similaire s'est produit de nouveau en Octobre 1917. La première expérience ne pouvait pas, dans les circonstances où elle s'est produite, aller à son terme et a été frappée par la force contre-révolutionnaire de la bourgeoisie, après plus de deux mois à peine d'une vie mémorable. La seconde, comme on le sait, ne pouvait pas non plus aller à son terme en raison de l'absence de conditions, externes et internes, parmi lesquelles l'impossibilité de mener à terme la construction du socialisme dans un seul pays.
Dans les deux cas, il y eut un pré-État mais, dans les deux cas, un pré-État qui, si d'un côté il put conduire à terme l'insurrection, de l'autre ne put être préparé suffisamment tôt pour la tâche de construction du socialisme. Dans le cas de 1917, ce n'est qu'à la veille d'Octobre que le seul parti (le Parti bolchevique) qui était doté des prérequis théoriques pour préparer l'avant-garde de la classe organisée dans les soviets, surtout à Saint-Pétersbourg, put seulement enseigner à la classe les tâches les plus urgentes de l'insurrection. Pour nous, il semble que, malgré la conscience, surtout chez Lénine, de l'importance fondamentale des soviets depuis 1905, ce n'est seulement qu'après février 1917 que, dans le cas de Lénine, cette conscience devint conviction. C'est pourquoi le parti de Lénine (dont le retour en Russie était facilement prévisible, vu qu'il était déjà revenu en 1905) ne s'est pas soucié de mobiliser à fond le militantisme de ses cadres ouvriers dans les soviets (les mencheviks étaient arrivés plus tôt), y inclus dans la préparation préalable des travailleurs à un resurgissement des soviets, plus tôt et au moyen d'une formation plus efficace. Une telle formation, y compris pour l'avant-garde la plus résolue de la classe organisée dans les soviets, devait inclure, sous le feu d'un débat incessant entre ces travailleurs, les questions de la prise insurrectionnelle du pouvoir et des notions de toute la théorie marxiste concernant l'établissement de leur État et la construction du socialisme. Ce débat a fait défaut, soit par l'incapacité à percevoir plus tôt l'importance des soviets, soit par manque de temps pour porter le débat parmi les ouvriers du soviet deux mois seulement avant l'insurrection. Quoi qu'il en soit, l'impréparation de l'avant-garde à la prise du pouvoir et à l'exercice de celui-ci, à son intervention et son rôle dirigeant, en vue de la construction du socialisme, a constitué un des facteurs défavorables pour une véritable dictature du prolétariat (en tant que base représentée dans les conseils) en URSS. Une telle lacune, provoquée en grande partie par l'absence d'un pré-État approprié, c'est-à-dire un pré-État qui constitue une école de la révolution, a constitué une difficulté supplémentaire dans le naufrage de la révolution russe de 1917.
Comme Lénine lui-même l'a toujours signalé, les révolutionnaires communistes sont des hommes et des femmes qui doivent avoir une formation marxiste très solide. Une solide formation marxiste requiert des connaissances relatives à la dialectique, l'économie politique, le matérialisme historique et dialectique qui permettront aux militants d'un parti de cadres non seulement d'analyser et comprendre les conjonctures passées et présentes, mais également de capter l'essentiel des processus prévisibles, au moins en ce qui concerne leurs grandes lignes (de tels niveaux de prédiction peuvent être identifiés dans beaucoup des analyses présentes dans les Cahiers philosophiques de Lénine). D'où le fait qu'une véritable formation marxiste peut assurer aux cadres militants d'un authentique parti communiste la faculté de prévoir, en les anticipant, les scénarios possibles du développement d'une crise comme la crise actuelle. De même que prévoir un large processus de situations révolutionnaires ne constitue en rien une "Bête à sept têtes" 14.
De plus, il est parfaitement faisable de prévoir la chose la plus évidente de ce monde, le surgissement de formes embryonnaires des conseils - parce que, ici et là, elles commencent à faire surface de façon embryonnaire – et qui devront être analysées, en toute franchise, sans préjugé, afin que, une fois interprétées théoriquement, les travailleurs puissent corriger les erreurs et les lacunes de telles expériences, pour qu'ils les multiplient et en renforcent le contenu, jusqu'à ce qu'elles deviennent, dans un futur proche - cette garantie est donnée par le stade avancé de la crise structurelle du capitalisme - dans le contexte de situations révolutionnaires concrètes, le système des conseils, issus de l'interaction dialectique de petits cercles (dans les lieux de travail, d'éducation et de logement), de commissions (d'usines) et de conseils (de quartiers, de régions, de zones industrielles, nationales, etc.) qui devront se constituer, dans le même temps, en tant qu'épine dorsale de l'insurrection et, dans le futur, organe de la dictature révolutionnaire du prolétariat.
7. En conclusion : le CCI et la question de l'État post-révolutionnaire
Pour nous, les conseils ouvriers doivent détenir un pouvoir illimité et, comme tels, doivent se constituer dans les organes de base du pouvoir ouvrier, en plus du fait qu'ils doivent constituer l'âme de la dictature révolutionnaire du prolétariat. Mais c'est à partir de là que nous nous différencions de certains exégètes du marxisme qui établissent une rupture entre les conseils et l'État-Commune, comme si cet État-Commune et les conseils étaient deux choses qualitativement distinctes. C'est la position, par exemple, du CCI (Courant communiste international). Après avoir opéré cette séparation, de tels exégètes établissent un trait d'union au moyen duquel les conseils devraient exercer une pression et leur contrôle sur le "demi-État de la période de transition", pour que ce même État (= Commune) – qui dans la vision du CCI, "n'est ni le porteur ni l'agent actif du communisme" - ne remplisse pas son rôle immanent de conservateur du statu quo (sic) et "d'obstacle" à la transition.
Pour le CCI, "L'État tend toujours à s'accroître démesurément", devenant ainsi "terrain de prédilection à toute la fange d'arrivistes et autres parasites et recrute facilement ses cadres parmi les éléments résidus et vestiges de l'ancienne classe dominante en décomposition." 15 Et il termine sa vision de l'État socialiste en affirmant que Lénine "a pu constater [cette fonction de l'État] quand il parle de l'État comme la reconstitution de l'ancien appareil d'État tsariste" et quand il dit que l'État accouché par la Révolution d'Octobre avait tendance "à échapper à notre contrôle et tourne dans le sens contraire à ce que nous voulons". Pour le CCI, "l'État prolétarien est un mythe" et "Lénine le rejetait, rappelant que c'était 'un gouvernement des ouvriers et des paysans avec une déformation bureaucratique'". Par ailleurs, pour le CCI :
"La grande expérience de la révolution russe est là pour en témoigner. Chaque fatigue, chaque défaillance, chaque erreur du prolétariat a immédiatement pour conséquence le renforcement de l'État, et inversement, chaque victoire, chaque renforcement de l'État se fait en évinçant un peu plus le prolétariat. L'État se nourrit de l'affaiblissement du prolétariat et de sa dictature de classe. La victoire de l'un est la défaite de l'autre." 16
Il dit aussi, dans d'autres passages [NDLR: du même article], que "Le prolétariat garde sa pleine et entière liberté par rapport à l'État. Sous aucun prétexte, le prolétariat ne saurait reconnaître la primauté de décision des organes de l'État sur celle de son organisation de classe : les conseils ouvriers, et devrait imposer le contraire", que le prolétariat "ne saurait tolérer l'immixtion et la pression d'aucune sorte de l'État dans la vie et l'activité de la classe organisée excluant tout droit et possibilité de répression de l'État à l'égard de la classe ouvrière" et que "Le prolétariat conserve son armement en dehors de tout contrôle de l'État". "La condition première en est la non-identification de la classe avec l'État"
Qu'en est-il de la vision des camarades du CCI sur l'État-Commune ? En premier lieu que ni Marx ni Engels, ni Lénine, comme on l'a vu dans les observations faites plus avant et empruntées à L'État et la révolution, ne défendent la conception de l'État développée par le CCI. Comme nous l'avons vu, l'État-Commune était, pour eux, l'État des Conseils, l'expression de la puissance du prolétariat et de sa dictature de classe. Pour Lénine, l'État post-révolutionnaire non seulement n'était pas un mythe, comme le pense le CCI, mais bien l'État prolétarien. En vertu de quoi cet État peut-il être ainsi qualifié par le CCI alors qu'il le conçoit par ailleurs comme un État-Commune ?
Deuxièmement, comme nous l'avons déjà analysé précédemment, la séparation antinomique entre les conseils et l'État post-révolutionnaire, posée par le CCI, s'éloigne de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État. Il nous faut ici réitérer ce que nous avons déjà dit précédemment, à savoir que séparer l'État prolétarien du système des conseils revient à briser l'unité qui doit exister et existe sous la dictature du prolétariat et qu'une telle séparation place, d'un côté, l'État en tant que structure administrative complexe et gérée par un corps de fonctionnaires - un non-sens dans la conception simplifiée de l'État selon Marx, Engels et Lénine – et, de l'autre, une structure politique au sein des conseils exerçant sa pression sur l'État en tant que tel.
Troisièmement, nous le répétons : cette conception, qui résulte d'une accommodation à une vision influencée par l'anarchisme et identifie l'État-Commune avec l'État bureaucratique (bourgeois) issu des ambiguïtés de la Révolution russe, place le prolétariat hors de l'État post-révolutionnaire en créant alors effectivement une dichotomie qui, elle-même, constitue le germe d'une nouvelle caste se reproduisant dans le corpus administratif séparé organiquement des conseils ouvriers. Le CCI confond le concept de l'État de Lénine avec l'État produit des ambiguïtés de la Révolution d'Octobre 1917. Lorsque Lénine se plaint des atrocités de l'État tel qu'il s'est développé en URSS, ce n'est pas pour autant sa conception de l'État-Commune qu'il rejette, mais bien les déviations de l'État-Commune russe depuis Octobre.
Quatrièmement, les camarades du CCI semblent ne pas se rendre compte, comme nous en avons également traité, du fait que les tâches organisationnelles et administratives que la révolution met à l'ordre du jour, dès le début, sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux.
Cinquièmement, les camarades du CCI ne semblent pas réaliser, également comme indiqué ci-dessus, la simplification véritable de l'État-Commune, dans le sens où Lénine l'exprime, avec un minimum de structure administrative, tellement minime – c'est un processus de simplification / extinction – qu'elle peut être prise en charge directement par le système des conseils.
Sixième et dernier point. C'est seulement en assumant, directement et de l'intérieur, les tâches simplifiées relevant de l'État des Conseils, de défense et de transition / construction socialiste, que la classe ouvrière sera en condition d'éviter que ne se produise un schisme étatique étranger à l'État des conseils et qu'elle pourra exercer son contrôle, non seulement sur ce qui se passe au sein de l'État, mais également sur la société dans son ensemble. Pour cela, il vaut la peine de rappeler que l'État prolétarien, l'État-Commune, l'État socialiste, la dictature du prolétariat ne sont autre chose que le système des conseils qui a pris en charge les tâches élémentaires d'organisation des milices, de la durée quotidienne du travail, des brigades de travail et autres types de tâches également révolutionnaires (révocabilité des postes, égalité des salaires, etc.), des tâches également simplifiées concernant la lutte et l'organisation d'une société en transition. Pour cela, il ne sera pas nécessaire de créer un monstre administratif, encore moins bureaucratique, ni une quelconque autre forme héritée de l'État bourgeois abattu ou lui ressemblant ou encore de l'État bureaucratique du capitalisme d'État de l'ex-URSS.
Ce serait formidable que le CCI se penche sur les passages que nous avons mis en évidence dans ce texte relatif à L'État et la révolution de Lénine, où celui-ci justifie, en s'appuyant sur Engels et Marx, la nécessité de l'État-Commune comme celle de l'État des Conseils, de l'État prolétarien, de la dictature du prolétariat.
OPOP
(Septembre 2008, révisé en décembre 2010).
1 OPOP, OPosição OPerária (Opposition ouvrière), qui existe au Brésil. Voir sa publication sur revistagerminal.com. Le CCI entretient avec OPOP depuis des années une relation fraternelle et de coopération s'étant déjà traduite par des discussions systématiques entre nos deux organisations, des tracts ou déclarations signés en commun ("Brésil : des réactions ouvrières au sabotage syndical", https://fr.internationalism.org/ri373/bresil.html [6]) ou des interventions publiques communes ("Deux réunions publiques communes au Brésil, OPOP-CCI : à propos des luttes des futures générations de prolétaires", https://fr.internationalism.org/ri371/opop.html [7]) et la participation réciproque de délégations aux congrès de nos deux organisations.
2 Celles-ci sont développées dans les articles suivants : "Période de transition – Projet de résolution" de la Revue internationale n° 11 (https://fr.internationalism.org/rint11/periode_de_transition.htm [8]) et "L'État dans la période de transition" de la Revue internationale n° 15 (https://fr.internationalism.org/rinte15/pdt.htm [9]).
3 NDLR : https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/08/er00t.htm [10]
4 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre I, "L'État, produit de contradictions de classes inconciliables".
5 Ceci est un exemple des confusions et des ambiguïtés de l'accumulation de catégories théoriques et politiques, les unes à côté des autres, introduites par Antonio Gramsci dans la doctrine marxiste, portées à leurs limites logiques et politiques par ses épigones et dont les difficultés logiques (apories) ont été brillamment investiguées par Perry Anderson dans son classique, Sur Gramsci.
6 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre I, "Détachements spéciaux d'hommes armés, prisons, etc."
7 NDLR. Extrait du Manifeste communiste, cité par Lénine dans l'État et la révolution ; Chapitre II, "La veille de la révolution".
8 NDLR. Extrait de La guerre civile en France, cité par Lénine dans l'État et la révolution ; Chapitre III, "Par quoi remplacer la machine d'État démolie ?"
9 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre IV, "Critique du projet de programme d'Erfurt".
10 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre V, "La transition du capitalisme au communisme".
11 NDLR. L'État et la révolution, Ibid.
12 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre V, "Phase supérieure de la société communiste".
13 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre VI, "Polémique de Kautsky avec Pannekoek".
14 NDLR. "La Bête à sept têtes est un type de monstre de légende qui se retrouve, sous des formes différentes (souvent un dragon ou un serpent à sept têtes) dans de nombreuses religions, mythologies et traditions à travers le monde. Dans plusieurs traditions, lorsqu'une tête est tranchée, elle repousse en un ou plusieurs exemplaires" (Wikipédia).
15. NDLR. "L'État dans la période de transition", Revue internationale n° 15.
16. NDLR. Idem.
Vie du CCI:
Questions théoriques:
Rubrique:
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique (IV) : de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la veille de Mai 1968
- 2887 lectures
Il est bien connu que l’impérialisme français puisa généreusement de la chair à canon parmi la jeunesse de ses colonies africaines, comme l'exigeait son implication de premier plan dans la seconde boucherie mondiale. En effet, des centaines de milliers de "tirailleurs", dont une écrasante majorité de jeunes, travailleurs et sans travail, furent embrigadés et sacrifiés dans les sanglantes tueries impérialistes. Le conflit terminé, s'ouvrit une période de reconstruction de l’économie française ; ses répercussions dans la colonie se firent sentir à travers une exploitation insoutenable, contre laquelle les ouvriers se mirent courageusement à lutter.
Mutinerie de soldats réprimée dans le sang et mouvements de grève
Il y eut d’abord la révolte menée par des soldats rescapés de la grande boucherie mondiale qui se soulevèrent contre le non-paiement de leur solde. En effet, immobilisés dans le camp de Thiaroye (banlieue de Dakar) après leur retour au pays, des centaines de soldats qui, en décembre 1944, réclamaient leur pension en s’adressant au "Gouvernement provisoire" présidé par de Gaulle, ne reçurent comme seule réponse que la mitraille de la part de leur commandement. La répression fit, officiellement, 35 morts, 33 blessés et 50 arrestations. Voilà comment les ouvriers et les anciens combattants, qui avaient épaulé les "libérateurs" de la France, furent remerciés par ces derniers, lesquels comptaient d’ailleurs dans leurs rangs des "socialistes" et des "communistes", membres du gouvernement d’alors présidé par le général de Gaulle. C'est là une belle leçon d’"humanisme" et de "fraternité" de la part de la célèbre "Résistance française" vis-à-vis de ses "tirailleurs indigènes" en révolte contre le non versement de leur maigre pension.
Cependant, cette réponse sanglante de la bourgeoisie française aux revendications des mutins ne put empêcher durablement l’éclatement d’autres luttes. En fait une certaine ébullition allait se développer :
"D’abord, les enseignants, du 1er au 7 décembre 1945, les ouvriers de l’industrie, du 3 au 10 décembre, avaient lancé le mouvement. La grève reprit en janvier, toucha de nouveau les métallurgistes, mais aussi les employés de commerce et le personnel auxiliaire du Gouverneur général. Les mesures de réquisition prises par le Gouverneur provoquèrent le 14 janvier 1946, une grève générale décrétée par 27 syndicats. Le travail ne reprit que le 24 janvier pour les fonctionnaires, le 4 février pour les employés de commerce, le 8 février pour les métallurgistes".( El hadj Ibrahima Ndao, Sénégal, histoire des conquêtes démocratiques, les Nouvelles Édit. Africaines, 2003.) En dépit des terribles souffrances subies pendant la guerre, la classe ouvrière recommençait à relever la tête, exprimant ainsi sa révolte contre la misère et l’exploitation.
Mais la reprise de la combativité se faisait dans un nouvel environnement peu favorable à l’autonomie de la classe ouvrière. En effet, le prolétariat de l’AOF de l’après-guerre ne put éviter d’être pris en tenaille entre les tenants de l’idéologie panafricaniste (indépendantistes) et les forces de gauche du capital colonial (SFIO, PCF et syndicats). Mais, malgré cela, la classe ouvrière poursuivit son combat avec beaucoup de pugnacité face aux attaques du capitalisme.
Grève héroïque et victorieuse des cheminots entre octobre 1947 et mars 1948
Au cours de cette période, les cheminots de l’ensemble de l’AOF se mirent en grève pour satisfaire nombre de revendications, dont celle de l'établissement d'une catégorie unique pour l’emploi des Africains et des Européens, et contre le licenciement de 3000 employés.
"Ces travailleurs du chemin de fer étaient initialement organisés au sein de la CGT. Quelque 17 500 cheminots l’ont quittée en 1948 à la suite d’une grève très dure. Au cours de ce mouvement, un certain nombre d’employés français s’étaient opposés violemment à une amélioration de la situation du personnel africain." (Mar Fall, L’Etat et la question syndicale au Sénégal, L’Harmattan, 1989)
Cette grève des cheminots se termina victorieusement grâce à la solidarité active des autres secteurs salariés (dockers et autres employés de l’industrie) qui entrèrent en grève générale pendant 10 jours, contraignant ainsi le pouvoir colonial à satisfaire l’essentiel des revendications des grévistes. Tout se décida au cours d’un grand meeting à Dakar convoqué par le gouverneur général. Dans l’espoir de briser le mouvement, la parole fut donnée aux notables politiques et aux chefs religieux qui avaient pour mission d’endormir et d’intimider les grévistes. Et, coutume oblige, les plus zélés furent les religieux.
"Une campagne de démoralisation des grévistes et surtout de leurs femmes avait été entreprise par les "guides spirituels", les imams et les prêtres des différentes sectes. (…) Les imams, furieux de la résistance des ouvriers à leurs injonctions, se déchaînaient contre les délégués, les chargeant de tous les péchés : l’athéisme, l’alcoolisme, la prostitution, la mortalité infantile ; ils prédisaient même que ces mécréants amèneraient la fin du monde". (Ousmane Sembene, Les bouts de bois de Dieu, Pocket, 1960)
Mais rien n’y fit. Même accablés de tous les "péchés", les cheminots persistèrent et leur combativité demeura intacte. Elle se renforça même lorsqu’au cours d'une assemblée générale leur appel à la solidarité reçut un écho grandissant chez les ouvriers des autres secteurs présents qui scandèrent : "Nous, les maçons, nous sommes pour la grève !...Nous, les ouvriers du port, nous sommes pour la grève !... Nous, les métallos...Nous les…". (Ousmane Sembene, ibid)
Et effectivement, dès le lendemain, ce fut la grève générale dans pratiquement tous les secteurs. Pourtant, avant d’en arriver là, les ouvriers du rail eurent à subir non seulement la pression des notables politiques et des religieux, mais aussi, la terrible répression militaire. Des sources (O. Sembene, ibid.) indiquent qu’il y eut des morts, et la "marche des femmes" (épouses et proches des cheminots) sur Dakar, en soutien aux grévistes, fut réprimée dans le sang par les "tirailleurs" et l’encadrement colonial.
La classe ouvrière ne dut compter que sur elle-même. La CGT collecta symboliquement quelques souscriptions financières venant de Paris alors que, sur place, elle stigmatisait "ceux qui voulaient leur autonomie" en se lançant dans une "grève politique". En fait, la CGT se retranchait derrière "l'opinion" de ceux de ses adhérents européens de la colonie qui s’opposaient aux revendications des "indigènes". Aussi ce comportement de la CGT poussa les cheminots indigènes à déserter massivement la centrale stalinienne suite à ce magnifique combat de classe.
SFIO, PCF, syndicats et nationalistes africains détournent la lutte de la classe ouvrière
La grève des cheminots terminée en mars 1948 s'était déroulée dans une atmosphère de grande agitation politique au lendemain du référendum ayant donné naissance à l’"Union française".1 De ce fait, le mouvement des cheminots acquit une dimension éminemment politique, en obligeant toutes les forces politiques coloniales et les éléments indépendantistes à se positionner tactiquement pour ou contre les revendications des grévistes. On vit ainsi le PCF se cacher derrière la CGT pour saboter le mouvement de grève, alors que la SFIO au pouvoir tenta de réprimer le mouvement par tous les moyens. De leur côté, Léopold Sédar Senghor et Ahmed Sékou Touré, deux rivaux panafricanistes qui allaient devenir respectivement présidents du Sénégal et de la Guinée, se déclarèrent ouvertement pour les revendications des cheminots.
Mais dès le lendemain de la victoire des grévistes, les forces de gauche et les nationalistes africains s’affrontèrent, les uns et les autres se revendiquant de la classe ouvrière. En instrumentalisant chacun les luttes de la classe ouvrière au service de leur chapelle, ils parvinrent à détourner la lutte autonome du prolétariat de ses véritables objectifs de classe.
Ainsi, les syndicats s’emparèrent de la question du Code du travail pour empoisonner les relations entre ouvriers. En effet, à travers ce "code", la législation sociale française avait instauré dans les colonies une véritable discrimination géographique et ethnique : d’une part, entre travailleurs d’origine européenne et travailleurs d’origine africaine ; d’autre part, entre ressortissants de différentes colonies, voire même entre citoyens d’un même pays 2. Il se trouve que la SFIO (ancêtre de l'actuel Parti Socialiste), qui avait promis en 1947 l’abolition de cet inique Code du travail, tergiversa jusqu’en 1952, donnant ainsi l’occasion aux syndicats, notamment indépendantistes africains, de focaliser exclusivement les revendications des travailleurs sur cette question à travers la mise en avant systématique du slogan "égalité de droits entre blancs et noirs". Cette idée d’égalité de droits et de traitement avec les Africains suscitait l'opposition ouverte des plus rétrogrades des syndiqués d'origine européenne de la CGT ; et il faut dire que, dans cette situation, la CGT joua un rôle particulièrement ignoble dans la mesure où elle eut tendance à profiter de cette opposition pour justifier son positionnement.
D’ailleurs, en écho, des militants de la CGT d’origine africaine 3 décidèrent alors de créer leur propre syndicat en vue de défendre les "droits spécifiques" des travailleurs africains. Tout cela donna lieu à la formulation de revendications de plus en plus nationalistes et interclassistes, comme l'illustre ce passage de la doctrine de cette organisation :
"Les conceptions importées [celles du syndicalisme français métropolitain- NDLR] éclairent insuffisamment l’évolution et les tâches de progrès économique et social en Afrique, d’autant plus que, malgré les contradictions existantes entre les diverses couches sociales locales, la domination coloniale rend inopportune toute référence à la lutte des classes et permet d’éviter la dispersion des forces dans les compétitions doctrinales". (Cité par Mar Fall, ibid)
De ce fait, les syndicats purent passer à l’acte avec efficacité car, malgré la persistance d'une combativité incessante de la classe ouvrière entre 1947 et 1958, tous les mouvements de lutte pour des revendications d’ordre salarial ou d’amélioration des conditions de travail furent détournés vers la contestation de l’ordre colonial, en faveur de l’avènement de "l’indépendance". En clair, si, lors du mouvement des cheminots de 1947-48, la classe ouvrière de la colonie de l’AOF eut encore la force de diriger sa lutte sur un terrain de classe avec succès, en revanche, par la suite, les grèves furent systématiquement contrôlées et orientées vers les objectifs des forces de la bourgeoisie, syndicats et partis politiques. Ce fut précisément cette situation qui servit de tremplin à Léopold Sédar Senghor et à Ahmed Sékou Touré pour enrôler les populations et la classe ouvrière derrière leur propre lutte pour la succession de l’autorité coloniale. Et dès la proclamation de "l’indépendance" des pays de l’AOF, les dirigeants africains décidèrent aussitôt d’intégrer les syndicats dans le giron de l'État en assignant à ceux-ci un rôle de police auprès des ouvriers. Bref, un rôle de chien de garde des intérêts de la nouvelle bourgeoisie noire aux commandes. Cela est manifeste à travers ce propos du président Senghor :
"Malgré ses services, à cause de ses services, le syndicalisme doit aujourd’hui se convertir en se faisant une idée plus précise de son rôle propre et de ses tâches. Parce qu’il y a aujourd’hui des partis politiques bien organisés et qui représentent sur le plan de la politique générale l’ensemble de la Nation, le syndicalisme doit revenir à son rôle naturel qui est, avant tout, de défendre le pouvoir d’achat de ses membres (…) La conclusion de cette réflexion est que les syndicats feront leur le programme de politique générale du parti majoritaire et des gouvernements". (Fall, ibid.)
En un mot, les syndicats et les partis politiques doivent partager le même programme en vue de la défense des intérêts de la nouvelle classe dominante. Un dirigeant syndical, David Soumah, fait écho aux propos de Senghor :
"Notre mot d’ordre durant cette lutte (anticoloniale) était que les syndicats n’avaient pas de responsabilités dans la production, qu’ils n’avaient pas à se préoccuper des répercussions de leurs revendications sur la marche d’une économie conçue dans le seul intérêt de la puissance coloniale et organisée par elle en vue de l’expansion de son économe nationale. Cette position devient sans objet au fur et à mesure de l’accession des pays africains à l’indépendance nationale et une reconversion syndicale s’impose". (Fall, ibid.)
Par conséquent, durant la première décennie de "l’indépendance", le prolétariat de l'ancienne AOF resta sans véritable réaction de classe, complètement ligoté par la nouvelle classe dirigeante assistée par les syndicats dans sa politique antiouvrière. Il fallut attendre 1968 pour la voir ressurgir sur son terrain de classe prolétarien contre sa propre bourgeoisie.
Lassou (A suivre)
1. Une "fédération" entre la France et ses colonies dont le but était d’encadrer les "indépendances" en vue.
2. Par exemple, les Sénégalais résidents des communes de Gorée, Rufisque, Dakar et Saint-Louis étaient considérés comme "citoyens français", ce qui n’était pas le cas des autres Sénégalais du pays.
3. Cela aboutit à la création de l’UGTAN (Union générale des travailleurs d’Afrique noire), syndicat par ailleurs dominé par la corporation des cheminots.
Géographique:
- Afrique [13]
Critique du livre "Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme" (introduction)
- 2531 lectures
Au moment où l'humanité connaît une accélération tragique de la crise économique mondiale, nous avons décidé de revenir à travers cet article sur des questions fondamentales se posant à quiconque est désireux de comprendre la dynamique de la société capitaliste pour mieux combattre un système condamné à périr soit de ses propres contradictions, soit par son renversement en vue de l'instauration d'une nouvelle société. Ces questions ont déjà été largement traitées dans de nombreuses publications du CCI mais si, aujourd'hui, nous jugeons nécessaire de les aborder à nouveau, c'est en critique à la vision développée dans le livre Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme 1. Ce livre se réclame explicitement, citations à l'appui, des analyses de Marx concernant la caractérisation des contradictions et de la dynamique du capitalisme, notamment le fait que ce système, à l'instar des autres sociétés de classe qui l'ont précédé, est nécessairement appelé à connaître successivement une phase ascendante et une phase de déclin. Mais la manière dont ce cadre théorique d'analyse est parfois interprété et appliqué à la réalité n'est pas sans ouvrir la porte à l'idée que des réformes seraient possibles au sein du capitalisme qui permettraient d'atténuer la crise. Par opposition à cette démarche que nous critiquons, l'article qui suit se veut une défense argumentée du caractère insurmontable des contradictions du capitalisme.
Dans la première partie de cet article ("Le capitalisme freine-t-il la croissance des forces productives depuis la Première Guerre mondiale ? [14]"), nous examinons si, depuis la Première Guerre mondiale, le capitalisme ayant cessé d'être un système progressiste, il est devenu, selon les propres paroles de Marx, "un obstacle pour l'expansion des forces productives du travail" 2. En d'autres termes, les rapports de production propres à ce système, après avoir été un formidable facteur de développement des forces productives, ont-ils constitué, depuis 1914, un frein au développement de ces mêmes forces productives ? Dans une seconde partie ("Existe-t-il une solution à la crise au sein du capitalisme ? [15]"), nous analysons l'origine des crises de surproduction, insurmontables au sein du capitalisme, et démasquons la mystification réformiste d'une possible atténuation de la crise du capitalisme au moyen de "politiques sociales".
1 Marcel Roelandts. Éditions Contradictions. Bruxelles, 2010.
2 Principes d'une critique de l'économie politique – p. 272. Éd. La Pléiade Économie II.
Questions théoriques:
- L'économie [16]
Critique du livre "Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme" : le capitalisme est-il un mode de production décadent et pourquoi ? (I)
- 3255 lectures
Le capitalisme freine-t-il la croissance des forces productives depuis la Première Guerre mondiale ?
En déchaînant la Première Guerre mondiale, les forces aveugles du capitalisme avaient été la cause d'une destruction considérable de forces productives, sans commune mesure avec les crises économiques qui avaient émaillé la croissance du capitalisme depuis sa naissance. Elles avaient plongé le monde, en particulier l'Europe, dans une barbarie menaçant d'engloutir la civilisation. Cette situation provoqua, en réaction, une vague révolutionnaire mondiale se donnant pour objectif d'en finir avec la domination d'un système dont les contradictions constituaient désormais une menace pour l'humanité. La position défendue à l'époque par l'avant-garde du prolétariat mondial s'inscrivait dans la vision de Marx pour qui "C'est par des conflits aigus, des crises, des convulsions que se traduit l'incompatibilité croissante entre le développement créateur de la société et les rapports de production établis"[1]. La Lettre d'invitation (fin janvier 1919) au Congrès de fondation de l'Internationale communiste déclare : "La période actuelle est celle de la décomposition et de l'effondrement de tout le système capitaliste mondial, et sera celle de l'effondrement de la civilisation européenne en général, si le capitalisme, avec ses contradictions insurmontables, n'est pas abattu."[2]. Sa plate-forme souligne : "Une nouvelle époque est née : l'époque de la désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. L'époque de la révolution communiste du prolétariat."[3]
L'auteur du livre (Marcel Roelandts, identifié MR dans la suite de l'article) rejoint cette caractérisation quant à la signification de la Première Guerre mondiale et de la vague révolutionnaire internationale qui l'a suivie, souvent d'ailleurs avec les mêmes termes. Son analyse recoupe en partie les éléments suivants relatifs à l'évolution du capitalisme depuis 1914 et qui, pour nous, viennent confirmer ce diagnostic de décadence du capitalisme :
- La Première Guerre mondiale (20 millions de morts) eut pour conséquence une baisse de plus d'un tiers de la production des puissances européennes impliquées dans le conflit, phénomène d'une ampleur alors sans égale dans toute l'histoire du capitalisme ;
- Elle fut suivie par une phase de faible croissance économique débouchant sur la crise de 1929 et la dépression des années 1930. Cette dernière a entraîné une chute de la production supérieure à celle causée par la Première Guerre mondiale ;
- La Seconde Guerre mondiale, encore plus destructrice et barbare que la première (plus de 50 millions de morts), a provoqué un désastre sans comparaison possible avec la crise de 1929. Elle est venue confirmer tragiquement l'alternative posée par les révolutionnaires lors de la Première Guerre mondiale : socialisme ou barbarie.
- Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu un seul instant de paix dans le monde et des centaines de guerres se sont soldées, depuis lors, par des dizaines de millions de tués, sans compter les catastrophes humanitaires (famines) qui en ont résulté. La guerre, omniprésente dans de nombreuses régions du monde, avait néanmoins épargné pendant un demi-siècle l'Europe, le principal théâtre des deux guerres mondiales. Elle y fit un retour sanglant avec le conflit en Yougoslavie à partir de1991 ;
- Durant cette période, à l'exception de la phase de prospérité des années 1950 / 60, le capitalisme, tout en maintenant une certaine croissance, n'a pu s'éviter des récessions nécessitant, pour être surmontées, l'injection dans l'économie de doses de plus en plus massives de crédit ; ce qui signifie que le maintien de cette croissance n'a pu être obtenu qu'en hypothéquant le futur au moyen d'une dette finalement impossible à rembourser ;
- L'accumulation d'une dette colossale est devenue à partir de 2007 / 2008 un obstacle incontournable au maintien de la croissance durable, même la plus faible, et a fragilisé considérablement ou menacé de faillite, non plus seulement des entreprises, des banques mais également des États, mettant à l'ordre du jour de l'histoire une récession désormais sans fin.
Nous nous sommes volontairement limités, dans cet aperçu, aux éléments les plus saillants relatifs à la crise et à la guerre et qui confèrent au 20ème siècle sa qualité de siècle le plus barbare que l'humanité ait jamais connu. Même s'ils n'en sont pas le produit mécanique, on ne peut dissocier ces éléments de la dynamique économique même du capitalisme durant cette période.
Avec quelle méthode évaluer la production capitaliste et sa croissance ?
Pour MR, ce tableau de la vie de la société depuis la Première Guerre mondiale ne suffit pas pour confirmer le diagnostic de décadence. Pour lui, "si certains arguments fondant ce diagnostic d'obsolescence du capitalisme peuvent encore se défendre, force est de reconnaître qu'il en existe d'autres [depuis la fin des années 1950] venant infirmer ses fondements les plus essentiels". Il s'appuie sur Marx pour qui il ne peut y avoir décadence du capitalisme que si "le système capitaliste devient un obstacle pour l'expansion des forces productives du travail". Ainsi, selon MR, l'examen des données quantitatives ne permet raisonnablement pas de "soutenir que le système capitaliste freine les forces productives" ni "qu'il démontre son obsolescence aux yeux de l'humanité". De même, dit-il, "en comparant avec la période de plus forte croissance du capitalisme avant la Première Guerre mondiale, le développement depuis lors (1914-2008) est encore nettement supérieur" (Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, noté Dyn dans la suite de l'article ; pp. 56 et 57).
Les données empiriques doivent nécessairement être prises en compte. Mais cela ne saurait évidemment suffire. Il faut une méthode pour les analyser. En effet, face à elles, nous ne pouvons nous contenter d'un regard comptable, mais devons aller au-delà des chiffres bruts de la production et examiner attentivement de quoi la production et la croissance sont faites, de manière à identifier l'existence éventuelle de freins au développement des forces productives. Ce n'est pas le point de vue de MR pour qui "ceux qui ont maintenu le diagnostic d'obsolescence n'ont pu le faire qu'en évitant de se confronter à la réalité ou en usant d'expédients pour tenter de l'expliquer : recours au crédit, dépenses militaires et frais improductifs, existence d'un supposé marché de la décolonisation, recours à l'argument de soi-disant trucages statistiques ou de mystérieuses manipulations de la loi de la valeur, etc. En effet, rares sont les marxistes qui ont apporté une explication claire et cohérente à la croissance des Trente Glorieuses et qui sont parvenus à discuter sans a priori de certaines réalités en contradiction flagrante avec le diagnostic d'obsolescence du capitalisme". (Dyn p. 63). Nous imaginons que MR est de l'avis que lui-même appartient à la catégorie des "rares marxistes [parvenant] à discuter sans a priori" et que, de ce fait, c'est avec le plus grand empressement qu'il se saisira de la question suivante que nous lui posons, puisqu'elle ne trouve nulle trace de réponse dans son livre : en quoi le fait d'invoquer les "frais improductifs" constitue-t-il un "expédient" pour tenter d'expliquer la nature de la croissance en phase de décadence ?
En fait, comprendre de quoi est faite la production capitaliste correspond tout à fait aux nécessités de la méthode marxiste dans sa critique du capitalisme. Celle-ci a su voir en quoi ce système, grâce à l'organisation sociale de la production qui lui est propre, a été capable de faire faire un bond énorme à l'humanité en développant les forces productives à un niveau tel qu'une société basée sur la libre satisfaction des besoin humains devient une possibilité, une fois le capitalisme renversé. Peut-on dire que le développement des forces productives depuis la Première Guerre mondiale, et le prix à payer pour celui-ci par la société et la planète, ont constitué une condition nécessaire de l'éclosion de la révolution victorieuse ? En d'autres termes, le capitalisme a-t-il continué à constituer, depuis 1914, un système progressiste, favorisant les conditions matérielles de la révolution et du communisme ?
Les données quantitatives de la croissance
Le Graphique 1[4] représente (en traits continus horizontaux), sur différentes périodes depuis 1820 jusqu'à 1999, le taux moyen annuel de croissance. Il fait apparaître également les écarts significatifs du taux de croissance, au-dessus et au-dessous de ces chiffres moyens.
Les taux moyens annuels de croissance du Graphique 1 sont repris sous forme du Tableau 1 concernant la période 1820-1999. Pour compléter ce tableau, nous avons nous-mêmes estimé le taux moyen annuel de croissance sur la période 1999-2009 en utilisant une série statistique relative à cette période[5] et en nous basant sur une croissance négative mondiale de 0,5% en 2009[6].
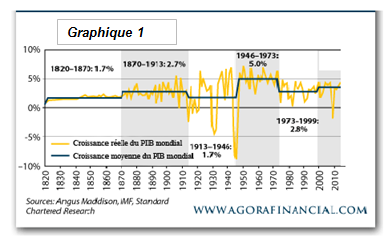
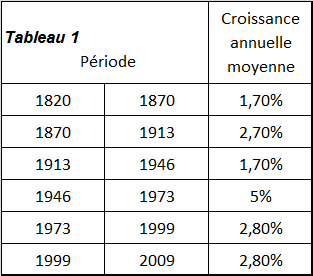
À partir des données présentées ci-dessus, un certain nombre de constats élémentaires peuvent être faits et commentés brièvement :
- Les quatre creux les plus importants de l'activité économique interviennent tous depuis 1914 et correspondent aux deux guerres mondiales, à la crise de 1929 et à la récession de 2009.
- La période la plus faste de la vie du capitalisme avant la Première Guerre mondiale est celle qui va de 1870 à 1913. Cela tient au fait qu'elle est la plus représentative d'un mode de production complètement dégagé des rapports de production hérités de la féodalité et disposant, suite à la poussée impérialiste des conquêtes coloniales[7], d'un marché mondial dont les limites ne se faisaient pas encore sentir. De surcroît, et comme conséquence de cette situation, la vente d'une quantité importante de marchandises pouvait compenser la tendance à la baisse du taux de profit et permettre de dégager une masse de profit largement suffisante à la poursuite de l'accumulation. C'est aussi cette période qui clôt la phase d'ascendance, l'entrée en décadence survenant au faîte de la prospérité capitaliste lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale.
- La période qui fait suite à la Première Guerre mondiale et s'étend jusqu'à la fin des années 1940 vient pleinement confirmer le diagnostic de décadence. En ce sens, nous partageons l'appréciation de MR selon laquelle les caractéristiques de la période 1914 – 1945, et même au-delà, jusqu'à la fin des années 1940, correspondent en tout point à la description que le mouvement révolutionnaire en 1919, dans la continuité de Marx, avait faite de la phase de décadence du capitalisme ouverte avec fracas par la guerre mondiale.
- La période des Trente Glorieuses, qui approximativement recouvre celle allant de 1946 à 1973, avec des taux de croissance bien supérieurs à ceux de 1870 - 1913, contraste énormément avec la période précédente.
- La période suivante, jusqu'à 2009, présente des taux de croissance légèrement supérieurs à la phase la plus faste de l'ascendance du capitalisme.
Les Trente Glorieuses remettent-elles en cause le diagnostic de décadence ? La période suivante confirme-t-elle qu'elles n'auraient pas constitué une exception ?
Le niveau de l'activité économique de chacune de ces deux périodes trouve des explications dans les modifications qualitatives de la production intervenues depuis 1914, en particulier avec le gonflement des dépenses improductives, dans la manière dont le crédit a été utilisé depuis les années 1950 et, également, avec la création de valeur fictive à travers ce qui est appelé la financiarisation de l'économie.
Les dépenses improductives
Qu'entend-on par dépenses improductives ?
Nous rangeons dans la catégorie des dépenses improductives le coût de cette partie de la production dont la valeur d'usage ne permet pas qu'elle puisse être employée, de quelque manière que ce soit, dans la reproduction simple ou élargie du capital. L'exemple le plus parlant de dépense improductive est celui relatif à la production d'armements. Les armes peuvent servir à faire la guerre mais pas à produire quoi que ce soit, pas même d'autres armes. Les dépenses de luxe destinées essentiellement à agrémenter la vie de la bourgeoisie entrent également dans cette catégorie. Marx en parlait en ces termes péjoratifs : "Une grande partie du produit annuel est consommée comme revenu et ne retourne pas à la production comme moyen de production ; il s'agit de produits (valeurs d'usage) extrêmement nuisibles, qui ne font qu'assouvir les passions, lubies, etc. les plus misérables"[8].
Le renforcement de l'appareil étatique
Entrent également dans cette catégorie toutes les dépenses prises en charge par l'État et qui sont destinées à faire face aux contradictions croissantes qu'affronte le capitalisme sur les plans économique, impérialiste et social. Ainsi, à côté des dépenses d'armements on trouve également le coût de l'entretien de l'appareil répressif et judiciaire, de même que celui de l'encadrement de la classe ouvrière (syndicats). Il est difficile d'estimer la part des dépenses de l'État qui appartiennent à la catégorie des dépenses improductives. En effet, un poste comme l'éducation qui, a priori, est nécessaire au maintien et au développement de la productivité du travail (laquelle nécessite une main d'œuvre éduquée) comporte aussi une dimension improductive notamment comme moyen de masquer et rendre plus supportable le chômage à la jeunesse. D'une manière générale, comme le met d'ailleurs fort bien en évidence MR, "Le renforcement de l'appareil étatique, ainsi que son intervention croissante au sein de la société ont constitué l'une des manifestations les plus évidentes d'une phase d'obsolescence d'un mode de production (…) Oscillant autour de 10 % tout au long de la phase ascendante du capitalisme, la part de l'État dans les pays de l'OCDE grimpe progressivement depuis la Première Guerre mondiale pour avoisiner les 50% en 1995, avec une fourchette basse autour de 35% pour les États-Unis et le Japon, et une haute de 60 à 70% pour les pays nordiques" (Dyn pp. 48 et 49).
Parmi ces dépenses, le coût du militarisme surpasse largement les 10% du budget militaire atteint en certaines circonstances par certains des pays les plus industrialisés, puisqu'à la fabrication de l'armement il faut ajouter le coût des différentes guerres. Le poids croissant du militarisme[9] depuis la Première Guerre mondiale n'est évidemment pas un phénomène indépendant de la vie de la société mais constitue bien l'expression du haut niveau des contradictions économiques qui contraignent chaque puissance à s'engager toujours davantage dans la fuite en avant dans les préparatifs guerriers, en tant que condition de sa survie dans l'arène mondiale.
Le poids des dépenses improductives dans l'économie
Le pourcentage des dépenses improductives, qui dépasse très certainement les 20% du PIB, ne correspond, dans la réalité, qu'à la stérilisation d'une partie importante de la richesse créée qui ne peut ainsi être employée à la création d'une plus grande richesse, ce qui est fondamentalement contraire à l'essence du capitalisme. Nous avons ici la claire manifestation d'un freinage au développement des forces productives qui trouve son origine dans les rapports de production eux-mêmes.
A ces dépenses improductives, il convient d'en ajouter un autre type, celui des trafics en tous genres, la drogue en particulier, qui constitue une consommation improductive mais qui, cependant, est comptabilisée en partie dans le PIB. Ainsi, le blanchiment des revenus du commerce de cette activité illicite représente quelques pourcents du PIB mondial :"Les trafiquants de drogue auraient blanchi environ 1600 milliards de dollars, soit 2,7% du PIB mondial, en 2009, (…) selon un nouveau rapport publié mardi par l’Office de l’ONU contre la drogue et le crime (ONUDC) (…) Le rapport de l’ONUDC indique que tous les bénéfices de la criminalité, à l’exclusion d’évasions fiscales, s’élèveraient à environ 2100 milliards de dollars, ou 3,6% du PIB en 2009"[10].
Pour rétablir la vérité concernant la croissance réelle, ce sont environ 3,5% supplémentaires du montant du PIB qui devraient lui être amputés du fait du blanchiment de l'argent des différents trafics.
Le rôle des dépenses improductives dans le miracle des Trente Glorieuses
Les mesures keynésiennes, visant à stimuler la demande finale et ayant ainsi permis que les problèmes de surproduction ne se manifestent pas ouvertement durant toute une partie de la période des Trente Glorieuses, sont en grande partie des dépenses improductives dont le coût a été pris en charge par l'État. Parmi celles-ci figurent les hausses de salaires, au-delà de ce qui est socialement nécessaire à la reproduction de la force de travail. Le secret de la prospérité de la période des Trente Glorieuses se résume à un énorme gaspillage de plus-value qui a pu alors être supporté par l'économie grâce aux gains importants de productivité enregistrés durant cette période.
Le miracle des Trente Glorieuses a donc, dans des conditions favorables, été permis par une politique de la bourgeoisie qui, instruite par la crise de 1929 et la dépression des années 1930, s'est appliquée à retarder le retour ouvert de la crise de surproduction. En ce sens, cet épisode de la vie du capitalisme correspond bien à ce qu'en dit MR : "La période exceptionnelle de prospérité d'après-guerre apparaît en tous points analogue aux parenthèses de reprise durant les périodes d'obsolescence antique et féodale. Nous faisons donc nôtre l'hypothèse que les Trente Glorieuses ne constituent qu'une parenthèse dans le cours d'un mode de production qui a épuisé sa mission historique." (Dyn p. 65).
Des mesures keynésiennes seraient-elles à nouveau envisageables ? On ne peut exclure que des avancées scientifiques et technologiques viennent à nouveau permettre des gains de productivité importants et la réduction des coûts de production des marchandises. Il continuerait néanmoins de se poser la question d'un acquéreur pour celles-ci vu qu'il n'existe plus de marché extra-capitaliste et guère plus de possibilité d'augmenter la demande au moyen d'un endettement supplémentaire. Dans ces conditions la répétition du boom des Trente Glorieuses apparaît totalement irréaliste.
La financiarisation de l'économie
Nous reproduisons ici le sens le plus communément admis de ce terme : "La financiarisation est au sens strict le recours au financement et en particulier à l'endettement, de la part des agents économiques. On appelle par ailleurs financiarisation de l'économie la part croissante des activités financières (services de banque, d'assurance et de placements) dans le PIB des pays développés notamment. Elle provient d'une multiplication exponentielle des types d'actifs financiers et du développement de la pratique des opérations financières, tant par les entreprises et autres institutions que par les particuliers. On peut parler par ailleurs d'un essor du capital financier à distinguer de la notion plus étroite de capital centrée sur les équipements de production"[11]. Nous nous distinguons nettement des altermondialistes, et de la gauche du capital en général, pour qui la financiarisation de l'économie serait à l'origine de la crise que traverse actuellement le capitalisme. Nous avons largement développé dans notre presse en quoi c'est exactement l'inverse dont il s'agit[12]. En effet, c'est parce que l'économie "réelle" est plongée depuis des décennies dans un profond marasme que les capitaux tendent à se détourner de cette sphère qui est de moins en moins rentable. MR semble partager notre point de vue. Ceci étant dit, il ne semble pas intéressé à prendre en compte les implications significatives de ce phénomène pour la composition des PIB.
Les États-Unis sont certainement le pays où l'activité financière a connu le développement le plus important. Ainsi, en 2007, 40% des profits du secteur privé aux États-Unis ont été réalisés par les banques, qui n'emploient que 5% des salariés[13]. Le Tableau 2 détaille, pour les États-Unis et l'Europe, le poids pris par les activités financières[14] (l'évolution parallèle de la production industrielle aux États-Unis sur la même période n'a été donnée qu'à titre indicatif) :
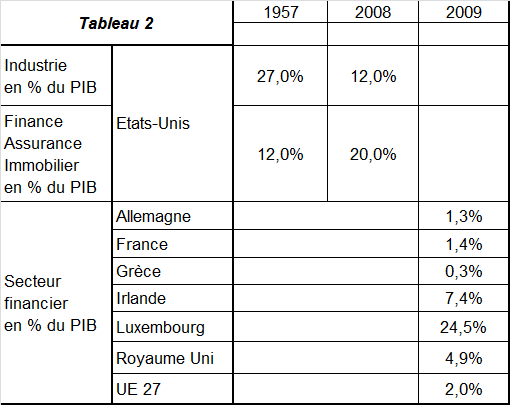
Contrairement aux dépenses improductives, nous n'avons pas ici affaire à une stérilisation de capital, mais dans le même sens que celles-ci, le développement de la finance induit un gonflement artificiel de l'estimation de la richesse annuelle de certains pays, dans une fourchette qui va de 2% pour l'Union Européenne à 27% pour les États-Unis. En effet, la création de produits financiers ne s'accompagne pas de la création d'une richesse réelle, si bien que, en toute objectivité, sa contribution à la richesse nationale est nulle.
Si l'on expurgeait du PIB l'activité correspondant à la financiarisation de l'économie, l'ensemble des principaux pays industrialisés verrait leur PIB diminué d'un pourcentage variant entre 2% et 20%. Une moyenne de 10% parait acceptable compte-tenu du poids respectif de l'UE et des États-Unis.
Le recours croissant à l'endettement depuis les années 1950
De notre point de vue, se priver de prendre en compte l'endettement croissant qui accompagne le développement du capitalisme depuis les années 1950 relève des mêmes préjugés qui consistent à écarter l'analyse qualitative de la croissance.
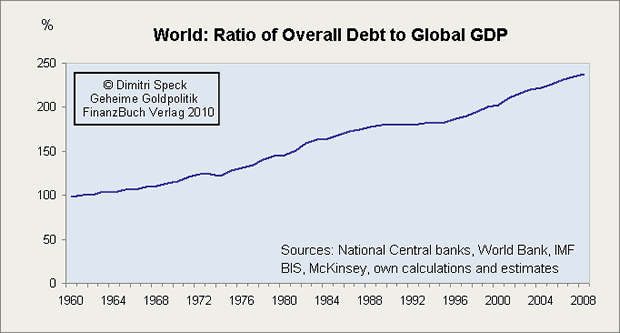
Peut-on nier sa réalité ? Le Graphique 2 illustre la progression de l'endettement total mondial (relativement à celle du PIB) depuis les années 1960. Durant cette période, l'endettement augmente plus rapidement que la croissance économique.
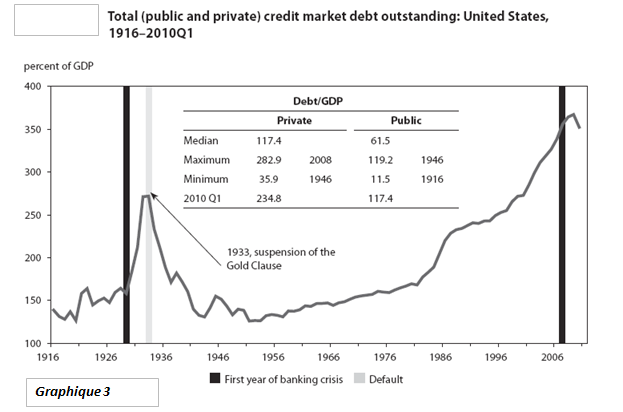 Aux États-Unis (Graphique 3[15]), l'endettement repart à la hausse au début des années 1950. Il passe d'une valeur inférieure à 1,5 fois le PIB à cette époque pour être aujourd'hui supérieur à 3,5 fois le PIB. Avant 1950, il avait connu, du fait de l'endettement privé, un pic en 1933 pour décroître ensuite. A noter que le pic de 1946 de l'endettement public (à un moment où l'endettement privé est faible) est l'aboutissement d'une montée d'abord relativement faible des dépenses publiques pour financer le New Deal, lesquelles se sont accrues très fortement à partir de 1940 pour financer l'effort de guerre.
Aux États-Unis (Graphique 3[15]), l'endettement repart à la hausse au début des années 1950. Il passe d'une valeur inférieure à 1,5 fois le PIB à cette époque pour être aujourd'hui supérieur à 3,5 fois le PIB. Avant 1950, il avait connu, du fait de l'endettement privé, un pic en 1933 pour décroître ensuite. A noter que le pic de 1946 de l'endettement public (à un moment où l'endettement privé est faible) est l'aboutissement d'une montée d'abord relativement faible des dépenses publiques pour financer le New Deal, lesquelles se sont accrues très fortement à partir de 1940 pour financer l'effort de guerre.
Depuis les années 1950-60, l'endettement a constitué la "demande solvable" qui a permis à l'économie de croître. Il s'agit d'un endettement croissant qui, pour l'essentiel, était condamné à ne pouvoir être remboursé, comme en témoigne la situation actuelle de surendettement de tous les acteurs économiques dans tous les pays. Une telle situation, en mettant à l'ordre du jour la faillite d'acteurs économiques majeurs, dont des États, signe la fin de la croissance au moyen d'un accroissement de la dette. Autant dire que cela signifie la fin de la croissance tout court, en dehors de phases limitées dans le temps au sein d'un cours général à la dépression. Il est indispensable de prendre en compte, dans nos analyses, le fait que la réalité va infliger une correction brutale à la baisse des taux de croissance depuis les années 1960. Ce ne sera que le retour de bâton d'une énorme tricherie avec la loi de la valeur. MR rejette l'expression "tricherie avec la loi de la valeur" pour qualifier cette pratique au sein du capitalisme mondial. Elle est pourtant de la même nature que les mesures de protectionnisme qui avaient été prises en URSS afin de maintenir artificiellement en vie une économie très peu performante par rapport à celle des principaux pays du bloc occidental. L'effondrement du bloc de l'Est vint rétablir la vérité. MR devra-t-il attendre l'effondrement de l'économie mondiale pour se rendre compte des conséquences de l'existence d'une masse de dettes non remboursables ?
En toute rigueur, afin de pouvoir juger objectivement de la croissance réelle depuis les années 1960, il faudrait amputer l'augmentation officielle du PIB entre 1960 et 2010 du montant de l'accroissement de la dette durant la même période. En fait, comme le montre le Graphique 2, l'augmentation du PIB mondial a été moins importante que l'accroissement de la dette mondiale sur la période concernée. Si bien que cette période importante des Trente Glorieuses, non seulement n'a pas été génératrice de richesse, mais a participé de créer un déficit mondial qui réduit à néant le miracle des Trente Glorieuses.
L'évolution des conditions de vie de la classe ouvrière
Durant toute la période d'ascendance du capitalisme, la classe ouvrière avait pu arracher des réformes durables sur le plan économique concernant la réduction du temps de travail et l'augmentation des salaires. Celles-ci résultaient à la fois de la lutte revendicative et de la capacité du système de les accorder, en particulier grâce à des gains de productivité importants. Cette situation change avec l'entrée du capitalisme en décadence où, sauf en ce qui concerne la période des Trente Glorieuses, les gains de productivité se trouvent de plus en plus mis au service de la mobilisation de chaque bourgeoisie nationale contre les contradictions qui se manifestent sur tous les plans (économique, militaire et social) et se traduisent, comme on l'a vu, par le renforcement de l'appareil étatique.
Les augmentations de salaires depuis la Première Guerre mondiale ne sont plus, en général, que des rattrapages de la hausse constante du niveau des prix. Les augmentations accordées en France en juin 1936 (accords de Matignon : 12% en moyenne) étaient annulées en six mois puisque, rien que de septembre 1936 à janvier 1937, les prix avaient monté en moyenne de 11%. On sait également ce qui resta un an plus tard des augmentations obtenues en mai 1968 avec les accords de Grenelle.
Sur cette question, MR s'exprime en ces termes : "De même, le mouvement communiste a défendu l'idée que des réformes réelles et durables sur le plan social étaient désormais impossibles à obtenir après la Première Guerre mondiale. Or, si l'on examine l'évolution séculaire des salaires réels et du temps de travail, non seulement rien ne vient attester une telle conclusion, mais les données indiquent le contraire. Ainsi, si les salaires réels dans les pays développés ont, au grand maximum, doublé ou triplé avant 1914, ils ont été multipliés par six à sept ensuite : soit trois à quatre fois mieux durant la période de 'décadence' du capitalisme que durant son ascendance" (Dyn p. 57).
Il est assez difficile de discuter de cette analyse, vu que ce sont des ordres de grandeur très approximatifs qui sont fournis. On peut très bien comprendre qu'il soit difficile de faire mieux compte tenu du matériel disponible sur cette question, mais le minimum de la rigueur scientifique était de citer les sources à partir desquelles des extrapolations éventuelles ont été effectuées. De plus, on nous parle des augmentations de salaires en ascendance et en décadence du capitalisme sans indiquer les périodes auxquelles elles s’appliquent. Il est aisé de comprendre qu'une augmentation sur 30 ans ne peut être comparée à une augmentation sur 100 ans (sauf si celles-ci sont données sous la forme d'augmentations moyennes annuelles, ce qui n'est manifestement pas le cas). Mais, de plus, la connaissance de la période est importante pour que la comparaison puisse intégrer d'autres données de la vie de la société, primordiales à notre sens pour relativiser la réalité des hausses de salaires. Il en est ainsi en particulier de l'évolution du chômage. Une augmentation du salaire concomitante à celle du chômage peut très bien avoir pour conséquence une baisse du niveau de vie des ouvriers.
Dans le livre, à la suite du passage que nous venons de commenter, est publié un graphique dont le titre annonce qu'il concerne à la fois l'augmentation des salaires réels en Grande-Bretagne de 1750 à 1910 et celle d'un manœuvre en France de 1840 à 1974. Mais, manque de chance, les données relatives au manœuvre français sont absentes pour la période s'étendant entre 1840 et 1900 et illisibles concernant la période 1950 - 1980. Plus exploitables sont les informations relatives à la Grande-Bretagne. De 1860 à 1900, il semblerait que le salaire réel y ait augmenté de 60 à 100, ce qui correspond à une augmentation annuelle de 1,29% sur la période. Nous retenons ce dernier chiffre comme pouvant être indicatif de l'augmentation des salaires en période d'ascendance.
Pour l'examen des salaires en décadence, nous procéderons à la division de cette période en deux sous périodes :
- de 1914 à 1950, période pour laquelle nous ne disposons pas de séries statistiques mais de chiffres épars et hétérogènes, significatifs toutefois d'un niveau de vie affecté par les deux guerres mondiales et la crise de 29 ;
- la période suivante, qui court jusqu'à nos jours, pour laquelle nous disposons de davantage de données fiables et homogènes.
1) 1914-1950[16]:
Pour les pays européens, la Première Guerre mondiale est synonyme d'inflation et de pénurie de marchandises. Après celle-ci, les deux camps se trouvent face à la nécessité de rembourser une dette colossale (trois fois supérieure au revenu national d'avant-guerre dans le cas de l'Allemagne) ayant servi à financer l'effort de guerre. La bourgeoisie la fera payer à la classe ouvrière et à la petite bourgeoisie à travers l'inflation qui, en même temps qu'elle réduit la valeur de la dette, opère une diminution drastique des revenus et a pour effet que l'épargne s'envole en fumée. En Allemagne en particulier, de 1919 à 1923, l'ouvrier voit son revenu diminuer sans arrêt, avec des salaires très inférieurs à ceux d'avant-guerre. C'est le cas aussi en France, et dans une moindre mesure en Angleterre. Cependant, toute la période de l'entre-deux-guerres se caractérisera pour ce pays par un chômage permanent immobilisant des millions de travailleurs, phénomène inconnu jusque-là dans l'histoire du capitalisme tant anglais que mondial. En Allemagne, y compris lorsque se termine la période de forte inflation, vers 1924, et jusqu'à la crise de 1929, le nombre des chômeurs reste toujours largement supérieur à 1 million (2 millions en 1926).
Contrairement à l'Allemagne, mais comme la France, la Grande-Bretagne n'avait pas encore retrouvé en 1929 sa position de 1913.
Tout autre est la dynamique des États-Unis. Avant la guerre, le développement de l'industrie américaine suivait un rythme plus rapide que celui de l'Europe. Cette tendance allait se renforcer pendant toute la période qui va de la fin de la guerre jusqu'au commencement de la crise économique mondiale. Ainsi, les États-Unis traversent la Première Guerre mondiale et la période qui s'ensuit dans la prospérité, jusqu'à la crise ouverte de 1929. Mais cette dernière a pour effet de ramener le salaire réel de l'ouvrier américain à un niveau inférieur à celui de 1890 (il ne représente plus alors que 87% de celui-ci), l'évolution pour cette période étant celle présentée dans le Tableau 3[17] :
2) de 1951 à nos jours (en comparaison à 1880 – 1910)
Nous disposons des statistiques du Tableau 4 concernant l'évolution des salaires de l'ouvrier français :
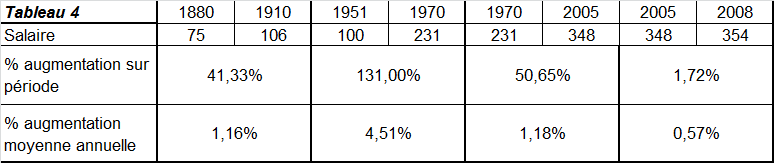
- exprimée en francs sur la période 1880 - 1910[18]
- exprimée sur une base 100 en 1951 sur la période 1951 – 2008[19]
Le Tableau 4 fait apparaître les réalités suivantes :
- La période 1951 – 1970, au cœur des Trente Glorieuses, connaît les taux d'augmentation de salaires les plus importants de l'histoire du capitalisme, ce qui est cohérent avec la phase de croissance économique qui lui correspond et ses particularités, à savoir les mesures keynésiennes de soutien de la demande finale au moyen, entre autres, de l'augmentation des salaires.
De tels taux de croissance des salaires s'expliquent aussi par d'autres facteurs loin d'être secondaires :
- le niveau de vie en France en 1950 était très bas, ce qui va de pair avec le fait que c'est seulement en 1949 que fut aboli le système des cartes et tickets de rationnement mis en place en 1941 pour faire face à la pénurie relative à la période de guerre.
- Depuis les années 1950, le coût de la reproduction de la force de travail doit inclure un certain nombre de frais qui n'existaient pas auparavant de façon aussi importante : les exigences de technicité accrue d'un nombre important d'emplois impliquent que les enfants de la classe ouvrière sont scolarisés jusqu'à un âge plus élevé, en restant à la charge de leurs parents ; les conditions "modernes" de travail dans les grandes villes ont également un coût. Si des objets ménagers entourent le prolétaire moderne alors que ce n'était pas le cas au 19e siècle, ce n'est pas le signe d'un meilleur niveau de vie de ce premier, son exploitation relative n'ayant fait que croître. Beaucoup de ces "objets ménagers" n'existaient pas auparavant : chez les bourgeois, c'étaient les domestiques qui faisaient tout à la main. Ils sont devenus indispensables dans les foyers ouvriers, pour gagner du temps, alors que souvent ce sont l'homme et la femme qui doivent travailler pour faire vivre la famille. De même, l'automobile, lorsqu'elle est apparue, était un luxe réservé aux riches. Celle-ci est devenue un objet incontournable pour beaucoup de prolétaires, afin de pouvoir se rendre sur le lieu de travail autrement qu'en passant des heures dans des transports publics insuffisants. C'est l'élévation de la productivité du travail qui a permis de produire de tels objets, qui ont cessé d'être de luxe, à un coût compatible avec le niveau des salaires ouvriers.
- b) La période suivante, 1970 – 2005, connaît des taux d'augmentation de salaires sensiblement égaux à ceux de l'ascendance du capitalisme (1,18% contre 1,16% - pour mémoire l'augmentation est de 1,29% en Grande-Bretagne sur la période 1860 - 1900). Ceci dit, un certain nombre de facteurs sont à prendre en compte qui fait apparaître qu'en réalité les conditions de vie de la classe ouvrière ne se sont pas améliorées dans les mêmes proportions, et se sont même dégradées par rapport à la période précédente :
- Cette période correspond à une montée importante du chômage qui affecte lourdement le niveau de vie des foyers ouvriers. Pour la France, nous disposons des chiffres du chômage présentés dans le Tableau 5[20]:
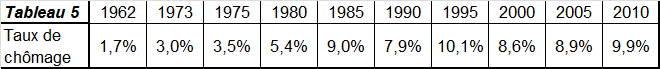
- A partir des années 1980, des directives visant à faire diminuer les chiffres officiels du chômage ont nécessité la modification de la méthode de décompte des chômeurs (par exemple, en ne comptabilisant pas le chômage partiel) et ont aussi abouti à la radiation de chômeurs sur des critères de plus en plus sévères. C'est fondamentalement ce qui explique la moindre envolée du chômage par la suite.
- La période postérieure à 1985 voit se développer la précarisation du travail avec des contrats à durée déterminée et le travail à temps partiel, qui n'est autre qu'un chômage déguisé.
- L'évaluation du salaire réel, ajustée au moyen de l'estimation officielle du coût de la vie, est largement surestimée par les données officielles. C'est à un point tel que l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) en France ne peut faire autrement que d'admettre une différence entre l'inflation officielle et l'inflation "perçue", cette dernière étant basée sur le constat des ménages d'une augmentation des produits de base indispensables (les postes dits incompressibles) bien supérieure à celle de l'inflation officielle[21].
- c) La période 2005 – 2008, bien que plus courte que la précédente, avec ses taux officiels d'augmentation de salaires voisins de 0,5%, est néanmoins plus significative car elle annonce l'avenir. En effet, cette augmentation de seulement 0,5% correspond à une détérioration encore plus importante, en ce sens que tous les facteurs invoqués pour la période précédente sont encore à prendre en compte mais dans des proportions plus grandes. En fait, c'est la disponibilité des statistiques sur les salaires qui nous faire clore en 2008 la période qui commence en 2005. Depuis 2008, la situation de la classe ouvrière a connu une détérioration très importante qui ne peut être ignorée dans notre étude, comme en témoigne l'évolution des chiffres de la pauvreté. En 2009, la proportion de pauvres en France métropolitaine a non seulement augmenté, mais leur pauvreté s’est accrue. Elle concerne désormais 13,5% de la population soit 8,2 millions de personnes, 400 000 de plus qu'en 2008.
Que retenir de presqu'un siècle de développement du capitalisme ?
Nous avons vu que la prise en compte, dans les PIB, de l'ensemble des dépenses improductives, des activités purement financières ou mafieuses contribuait grandement à une surestimation de la richesse créée annuellement.
Nous avons vu également que les contradictions mêmes du capitalisme stérilisent un pourcentage significatif de la production capitaliste (en particulier à travers la production "improductive"). Quant aux conditions de vie de la classe ouvrière, elles sont loin d'être aussi brillantes que les statistiques officielles essaient de le faire croire.
En plus de cela, il est un aspect que ne met pas en évidence l'examen de la production ou de la condition ouvrière que nous avons effectuée, c'est le coût qu'a impliqué la domination des rapports de production capitalistes depuis la Première Guerre mondiale, tant en terme de destruction du milieu ambiant que d'épuisement des ressources de la Terre en matières premières. C'est difficilement chiffrable mais terriblement crucial pour le devenir de l'humanité. C'est une raison supplémentaire, et pas des moindres, pour exclure de façon décisive que le capitalisme ait pu depuis près d'un siècle constituer, du point de vue du devenir de la classe ouvrière et du devenir de l'humanité, un système progressiste.
MR fait le constat que le développement capitaliste a été accompagné durant cette période, de guerres, de barbarie et de dommages à l'environnement. Par ailleurs, et de façon tout-à-fait surprenante, il conclut sa plaidoirie visant à démontrer que les rapports de production n'ont pas constitué, depuis les années 1950, un frein croissant au développement des forces productives, en affirmant que le système est bien en décadence : "Pour notre part, il n'y a donc aucune contradiction à reconnaître, d'un côté, l'indéniable prospérité de la période d'après-guerre avec toutes ses conséquences et à néanmoins maintenir, de l'autre côté, le diagnostic d'obsolescence historique du capitalisme depuis le début du XXème siècle. Il en découle que, pour l'immense majorité de la population laborieuse, le capitalisme ne lui est pas encore apparu comme un outil obsolète dont elle devrait se débarrasser : il a toujours pu faire espérer que 'demain sera meilleur qu'hier'. Si cette configuration tend aujourd'hui à s'inverser dans les vieux pays industrialisés, c'est loin d'être le cas pour les pays émergents" (Dyn p. 67). Si donc le critère marxiste d'un freinage des forces productives ne peut plus être retenu pour caractériser la décadence d'un mode de production, sur quoi donc fonder celle-ci ? Réponse de MR, la "domination du salariat à l'échelle d'un marché mondial désormais unifié", ce qu'il explique en ces termes : "La fin de la conquête coloniale au début du XXème siècle, et la domination du salariat à l'échelle d'un marché mondial désormais unifié vont marquer un tournant historique et inaugurer une nouvelle phase du capitalisme " (Dyn p. 41). Et en quoi cette caractéristique de la nouvelle phase du capitalisme permet-elle d'expliquer la Première Guerre mondiale et la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 ? Comment permet-elle de faire le lien avec les nécessaires luttes de résistance du prolétariat face aux manifestations des contradictions du capitalisme ? Nous n'avons pas trouvé de réponse à ces questions dans le livre.
Nous reviendrons en partie sur celles-ci dans la deuxième partie de l'article, au sein de laquelle nous examinerons également en quoi MR met la théorie marxiste, adaptée par ses soins, au service du réformisme.
Silvio (décembre 2011)
[1] Principes d'une critique de l'économie politique – p. 273. Éd. La Pléiade Économie II.
[2] Plate-forme de l'Internationale communiste, P. Broué, EDI, 1974.
[3] Idem.
[4] Ce graphique est une adaptation d'un graphique reproduit au lien suivant : www.regards-citoyens.com/article-quelques-nouvelles-du-pib-mondial-par-a... [17]. Nous avons supprimé de celui-ci la partie estimation sur la période 2000 – 2030.
[5] equity-analyst.com/world-gdp-us-in-absolute-term-from-1960-2008.html
[6] Conforme aux statistiques du FMI : Perspectives de l'économie mondiale, p. 2, https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-flagship-issues/external/french/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/_textfpdf.ashx [18]
[7] "de 1850 à 1914, le commerce mondial est multiplié par 7, celui de la Grande-Bretagne par 5 pour les importations et par 8 pour les exportations. De 1875 à 1913, le commerce global de l’Allemagne est multiplié par 3,5, celui de la Grande-Bretagne par 2 et celui des États-Unis par 4,7. Enfin, le revenu national en Allemagne est multiplié par près de 4 entre 1871 et 1910, celui des États-Unis de près de 5." (thucydide.over-blog.net/article-6729346.html)
[8] Matériaux pour l'"Économie" – p. 394. Éd. La Pléiade Économie II.
[9] Lire à ce sujet nos deux articles des Revue internationale n° 52 et 53, "Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme"
[10] Drogues Blog. droguesblog.wordpress.com/2011/10/27/la-presse-ca-trafic-de-drogue-chiffres-astronomiques-saisies-minimes-selon-lonu
[12] Lire en particulier "Crise économique : ils accusent la finance pour épargner le capitalisme ! [20]".
[13] lexinter.net/JF/financiarisation_de_l'economie.htm
[14] socio13.wordpress.com/2011/06/06/la-financiarisation-de-l’accumulation-par-john-bellamy-foster-version-complete
[15] A decade of debt, Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff. https://www.piie.com/publications/chapters_preview/6222/01iie6222.pdf [21]. Légend :Debt / GDP:Dette / PIB
[16] Les données chiffrées ou qualitatives contenues dans l'étude de cette période, dont la source ne figure pas explicitement, sont extraites du livre Le conflit du siècle, de Fritz Sternberg. Éditions du Seuil.
[17] Stanley Lebergott, Journal of the American Statistical Association.
[20] Pour 1962 et 1973, source : "La rupture : les décennies 1960-1980, des Trente Glorieuses aux Trente Piteuses".
Guy Caire. www.ihs.cgt.fr/IMG/pdf_Guy_Caire_-_La_rupture-_les_decennies_1960-198O_d... [24]. Pour 1975 à 2005, source : INSEE. www.insee.fr/fr/statistiques [23]. Pour 2010, source Google. https://www.google.fr/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&met_y=unemployment_rate&idim=country:fr&fdim_y=seasonality:sa&dl=fr&hl=fr&q=taux+de+chômage+en+france [25] :
[21] En fait l'inflation officielle est basée également sur l'évolution du coût de produits que les consommateurs achètent rarement ou qui ne sont pas indispensables. https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20100813trib000538586/comment-reconcilier-les-menages-francais-avec-l-insee.html [26]
Questions théoriques:
- L'économie [16]
Décadence du capitalisme (XII) : 40 années de crise ouverte montrent que le capitalisme en déclin est incurable
- 2959 lectures
Le boom d'après-guerre en a conduit beaucoup à conclure que le marxisme était obsolète, que le capitalisme avait découvert le secret de l'éternelle jeunesse 1 et que désormais la classe ouvrière ne constituait plus l'instrument du changement révolutionnaire. Mais une petite minorité de révolutionnaires, travaillant très souvent dans un isolement quasi total, maintenait ses convictions envers les principes fondamentaux du marxisme. L'un des plus importants d'entre eux était Paul Mattick aux États-Unis. Mattick répondit à Marcuse, qui cherchait à découvrir un nouvel acteur révolutionnaire, en publiant Les limites de l’intégration : l'homme unidimensionnel dans la société de classe (1972) 2, où il réaffirmait le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière pour le renversement du capitalisme. Mais sa contribution la plus durable a probablement été son livre Marx et Keynes, les limites de l'économie mixte, publié pour la première fois en 1969 (en français en 1972) mais basé sur des études et des essais réalisés dès les années 1950.
Bien qu'à la fin des années 1960 les premiers signes d'une nouvelle phase de crise économique ouverte aient commencé à apparaître (avec, par exemple, la dévaluation de la livre sterling en 1967), défendre l'idée que le capitalisme était toujours un système miné par une crise structurelle profonde était vraiment aller à contre le courant. Mais Mattick était là, plus de 30 ans après avoir résumé et développé la théorie de Henryk Grossman sur l'effondrement du capitalisme dans son travail majeur, "La crise permanente" (1934) 3, et il maintenait que le capitalisme était toujours un système social en régression, que les contradictions sous-jacentes au processus d'accumulation n'avaient pas été exorcisées et étaient vouées à ressurgir. Se centrant sur l'utilisation de l'État par la bourgeoisie afin de réguler le processus d'accumulation, sous la forme keynésienne d' "économie mixte" en faveur en Occident, ou dans sa version stalinienne à l'Est, il montra que l'obligation d'interférer dans l'opération de la loi de la valeur ne constituait pas le signe d'un dépassement des contradictions du système (comme Paul Cardan / Cornelius Castoriadis, par exemple, l'a notamment défendu dans Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne, 1979) mais était précisément une expression de son déclin :
- "Malgré la longue durée de la conjoncture dite de prospérité, que les pays industriels avancés ont connue, rien ne permet de supposer que la production de capital a pu venir à bout des contradictions qui lui sont inhérentes par le biais d'interventions étatiques. Au contraire, la multiplication de ces dernières dénote la persistance de la crise subie par la production de capital, tandis que la croissance du secteur déterminé par l'État rend manifeste le déclin toujours plus accentué du système de l'entreprise privée." (page 188) 4 "On s'apercevra alors que les solutions keynésiennes étaient factices, aptes à différer, mais non à faire disparaître définitivement les effets contradictoires de l'accumulation du capital, tels que Marx les avait prédits." (idem, page 200)
Ainsi, Mattick maintenait que "… le capitalisme – en dépit de tout ce qui en apparence pourrait donner à penser le contraire – est devenu aujourd'hui un système régressif et destructeur" (page 315) 5. Ainsi, au début du chapitre 19, "L'impératif impérialiste", Mattick affirme que le capitalisme ne peut pas échapper à la tendance à la guerre car elle est le résultat logique du blocage du processus d'accumulation. Mais tout en écrivant que : "… on peut supposer que, par le biais de la guerre, [la production pour le gaspillage] amènera des transformations structurelles de l'économie mondiale et du rapport de forces politiques permettant aux puissances victorieuses de bénéficier d'une nouvelle phase d'expansion" (page 329), il ajoute aussitôt que cela ne doit pas rassurer la bourgeoisie pour autant : "Mais ce genre d'optimisme a cessé de prévaloir en raison des capacités de destruction propres aux armes modernes, dont les engins atomiques." (page 330, idem). De plus, pour le capitalisme, "savoir que la guerre peut conduire à un suicide général (...) n'affaiblit en rien la tendance à une nouvelle guerre mondiale." (idem). La perspective qu'il annonce dans la dernière phrase de son livre reste donc celle que les révolutionnaires avaient annoncée à l'époque de la Première Guerre mondiale : "socialisme ou barbarie".
Cependant, il y a certains défauts dans l'analyse que fait Mattick de la décadence du capitalisme dans Marx et Keynes. D'un côté, il voit la tendance à la distorsion de la loi de la valeur comme une expression du déclin ; mais, de l'autre, il prétend que les pays entièrement étatisés du bloc de l'Est ne sont plus assujettis à la loi de la valeur et donc à la tendance aux crises. Il défend même que, du point de vue du capital privé, ces régimes peuvent être "définis comme un socialisme d'État, du seul fait que le capital y est centralisé par l'État" (page 383) 6, même si du point de vue de la classe ouvrière, il faut les décrire comme du capitalisme d'État. En tous cas, "le capitalisme d'État ignore la contradiction entre production rentable et production non rentable dont souffre le système rival (....) le capitalisme d'État peut produire de manière rentable ou non sans tomber dans la stagnation."(page 350) 7. Il développe l'idée selon laquelle les États staliniens constituent, en un sens, un système différent, profondément antagoniste aux formes occidentales de capitalisme – et c'est dans cet antagonisme qu'il semble situer la force motrice derrière la Guerre froide, puisqu'il écrit à propos de l'impérialisme contemporain que "contrairement à l'impérialisme et au colonialisme du temps du laisser-faire, il s'agit cette fois non seulement d'une lutte pour des sources de matières premières, des marchés privilégiés et des champs d'exportation du capital, mais aussi d'une lutte contre de nouvelles formes de production de capital échappant aux rapports de valeur et aux mécanismes concurrentiels du marché et donc, en ce sens ,d'une lutte pour la survie du système de la propriété privé." (page 318) 8. Cette interprétation va de pair avec son argument selon lequel les pays du bloc de l'Est n'ont pas, strictement parlant, de dynamique impérialiste propre.
Le groupe Internationalism aux États-Unis - qui allait devenir plus tard une section du CCI - releva cette faiblesse dans l'article qu'il publia dans le n° 2 de sa revue au début des années 1970, "Capitalisme d'État et loi de la valeur, une réponse à Marx et Keynes". L'article montre que l'analyse par Mattick des régimes staliniens sape le concept de décadence qu'il défend par ailleurs : car si le capitalisme d'État n'est pas sujet aux crises ; s'il est en fait, comme le défend Mattick, plus favorable à la cybernétisation et au développement des forces productives ; si le système stalinien n'est pas poussé à suivre ses tendances impérialistes ; alors les fondements matériels de la révolution communiste tendent à disparaître et l'alternative historique posée par l'époque de déclin devient également inintelligible :
- "L'utilisation par Mattick du terme capitalisme d'État est donc une appellation impropre. Le capitalisme d'État ou "socialisme d'État", que Mattick décrit comme un mode de production exploiteur mais non capitaliste, ressemble beaucoup à la description par Bruno Rizzi et Max Shachtman du "collectivisme bureaucratique", développée dans les années d'avant-guerre. L'effondrement économique du capitalisme, du mode de production basé sur la loi de la valeur dont Mattick prédit l'inévitabilité, ne pose pas l'alternative historique socialisme ou barbarie, mais l'alternative socialisme ou barbarie ou "socialisme d'État" ".
La réalité a donné raison à l'article d'Internationalism. De façon générale, il est vrai que la crise à l'Est n'a pas pris la même forme qu'à l'Ouest. Elle s'est plutôt manifestée par une sous-production plutôt qu'une surproduction, en tout cas en ce qui concerne les biens de consommation. Mais l'inflation qui a ravagé ces économies pendant des décennies, et a souvent été l'étincelle mettant le feu aux poudres de luttes de classe majeures, était le signe que la bureaucratie n'avait aucunement conjuré les effets de la loi de la valeur. Par dessus tout, avec l'effondrement du bloc de l'Est - qui illustrait aussi son impasse militaire et sociale - la loi de la valeur a pris sa "revanche" sur des régimes qui avaient cherché à la circonvenir. En ce sens, tout comme le keynésianisme, le stalinisme s'est révélé une "solution factice", "apte à différer, mais non à faire disparaître définitivement les effets contradictoires de l'accumulation du capital, tels que Marx les avait prédits." (idem, page 200) 9
Le courage de Mattick avait été nourri par l'expérience directe de la révolution allemande et la défense des positions de classe contre la contre-révolution triomphante des années 1930 et 1940. Un autre "survivant" de la Gauche communiste, Marc Chirik, a aussi continué de militer pendant la période de réaction et de guerre impérialiste. Il a été un membre fondamental de la Gauche communiste de France dont nous avons examiné la contribution dans le précédent article. Au cours des années 1950, il était au Vénézuéla et fut temporairement coupé de toute activité organisée. Mais au début des années 1960, il a cherché à regrouper un cercle de jeunes camarades qui ont formé le groupe Internacionalismo, fondé sur les mêmes principes que la GCF, y compris bien sûr sur la notion de décadence du capitalisme. Mais alors que la GCF avait lutté pour tenir dans une période sombre du mouvement ouvrier, le groupe vénézuélien exprimait quelque chose qui pointait dans la conscience de la classe ouvrière mondiale. Il reconnut avec une clarté surprenante que les difficultés financières qui commençaient à ronger l'organisme apparemment sain du capitalisme signifiaient en réalité un nouveau plongeon dans la crise et qu'il serait confronté à une génération non défaite de la classe ouvrière. Comme il l'écrivit en janvier 1968 : "Nous ne sommes pas des prophètes et nous ne prétendons pas non plus prédire quand et comment se dérouleront les événements dans le futur. Mais ce qui est conscient et certain : le processus dans lequel plonge le capitalisme aujourd'hui ne peut être arrêté et mène directement à la crise. Et nous sommes aussi certains que le processus inverse de développement de la combativité de classe dont nous sommes témoins aujourd'hui amènera le prolétariat à une lutte sanglante et directe pour la destruction de l'État bourgeois." Ce groupe fut l'un des plus lucides dans l'interprétation des mouvements sociaux massifs en France en mai de cette année-là, en Italie et ailleurs l'année suivante, comme marquant la fin de la contre-révolution.
Pour Internacionalismo, ces mouvements de classe constituaient une réponse du prolétariat aux premiers effets de la crise économique mondiale qui avait déjà produit une montée du chômage et des tentatives de contrôler les augmentations de salaire. Pour d'autres, ceci n'était qu'une application mécanique d'un marxisme dépassé : ce que Mai 1968 exprimait avant tout, c'était la révolte directe du prolétariat contre l'aliénation d'une société capitaliste fonctionnant à plein. Tel était le point de vue des situationnistes qui écartaient toute tentative de relier la crise et la lutte de classe comme l'expression de sectes de l'époque des dinosaures : "Quant aux débris du vieil ultra-gauchisme non trotskyste, ils avaient besoin au moins d'une crise économique majeure. Ils subordonnaient tout mouvement révolutionnaire au retour de cette dernière et ne voyaient rien venir. Maintenant qu'ils ont reconnu une crise révolutionnaire en Mai, ils doivent prouver que cette crise économique "invisible" était là au printemps 1968. Sans peur du ridicule, c'est à cela qu'ils travaillent aujourd'hui, produisant des schémas sur la montée du chômage et de l'inflation. Ainsi pour eux, la crise économique n'est plus cette réalité objective terriblement visible qui a été si durement vécue en 1929, mais le fils de la présence eucharistique qui soutient leur religion." (L'Internationale situationniste n° 12) En réalité, comme nous l'avons vu, le point de vue d'Internacionalismo sur les rapports entre la crise et la lutte de classe n'a pas été modifié rétrospectivement : au contraire, sa fidélité à la méthode marxiste lui a permis d'envisager, sur la base de quelques signes avant-coureurs non spectaculaires, l'éclatement de mouvements tels que Mai 1968. L'approfondissement plus visible de la crise à partir de 1973 clarifia rapidement le fait que c'était l'IS – qui avait plus ou moins adopté la théorie de Cardan d'un capitalisme ayant surmonté ses contradictions économiques – qui était liée à une période de la vie du capitalisme désormais définitivement terminée.
L'hypothèse selon laquelle Mai 1968 exprimait une réapparition significative de la classe ouvrière fut confirmée par la prolifération internationale de groupes et de cercles cherchant à développer une critique authentiquement révolutionnaire du capitalisme. Naturellement, après une si longue période de reflux, ce nouveau mouvement politique prolétarien était extrêmement hétérogène et inexpérimenté. Réagissant aux horreurs du stalinisme, il était souvent méfiant envers la notion même d'organisation politique, avait une réaction viscérale envers tout ce qui sentait le "léninisme" ou envers ce qui était considéré comme la rigidité du marxisme. Certains de ces groupes se perdirent dans un activisme frénétique et, en l'absence d'analyse à long terme, ne survécurent pas à la fin de la première vague internationale de luttes commencée en 1968. D'autres ne rejetaient pas le lien entre les luttes ouvrières et la crise, mais le considéraient d'un point de vue totalement différent : c'est fondamentalement la combativité ouvrière qui avait produit la crise en mettant en avant des revendications d'augmentations de salaires sans restrictions et en refusant de se soumettre aux plans de restructuration capitalistes. Ce point de vue était défendu en France par le Groupe de Liaison pour l'Action des Travailleurs (l'un des nombreux héritiers de Socialisme ou Barbarie) et en Italie par le courant autonomiste des ouvriers, qui considérait le marxisme "traditionnel" comme désespérément "objectiviste" (nous y reviendrons dans un autre article) dans sa compréhension des rapports entre la crise et la lutte de classe.
Cependant, cette nouvelle génération découvrait également les travaux de la Gauche communiste et la défense de la théorie de la décadence faisait partie de ce processus. Marc Chirik et quelques jeunes camarades du groupe Internacionalismo étaient venus en France et, dans le feu des événements de 1968, participèrent à la formation d'un premier noyau du groupe Révolution internationale. Dès le début, Révolution internationale plaça la notion de décadence au cœur de sa démarche politique et réussit à convaincre un certain nombre de groupes et d'individus conseillistes ou libertaires du fait que leur opposition aux syndicats, aux libérations nationales et à la démocratie capitaliste ne pouvait être comprise et défendue correctement sans un cadre historique cohérent. Dans les premiers numéros de Révolution internationale, il y a une série d'articles sur "La décadence du capitalisme" qui allait être publiée ensuite comme brochure du Courant communiste international. Ce texte est disponible en ligne 10 et contient toujours les principaux fondements de la méthode politique du CCI, surtout dans son large survol historique qui va du communisme primitif via les différentes sociétés de classes précédant le capitalisme, jusqu'à l'examen de la montée et du déclin du capitalisme lui-même. Comme les articles actuels de cette série, il se base sur la notion de Marx des "époques de révolutions sociales", il met en évidence des éléments-clés et des caractéristiques communes à toutes les sociétés de classes dans les périodes où elles sont devenues des entraves au développement des forces productives de l'humanité : l'intensification des luttes entre les fractions de la classe dominante, le rôle croissant de l'État, la décomposition des justifications idéologiques, les luttes croissantes des classes opprimées et exploitées. Appliquant cette démarche générale aux spécificités de la société capitaliste, il tente de montrer comment le capitalisme, depuis le début du 20e siècle, de "forme de développement" qu'il était, s'est transformé en une "entrave" aux forces productives, mettant en évidence les guerres mondiales et les nombreux autres conflits impérialistes, les luttes révolutionnaires qui ont éclaté en 1917, l'énorme augmentation du rôle de l'État et l'incroyable gaspillage de travail humain dans le développement de l'économie de guerre et d'autres formes de dépenses improductives.
Cette vision générale, présentée à une époque où les premiers signes d'une nouvelle crise économique devenaient plus que visibles, convainquit un certain nombre de groupes d'autres pays que la théorie de la décadence constituait un point de départ fondamental pour les positions communistes de gauche. Elle n'était pas seulement au centre de la plateforme du CCI mais fut également adoptée par d'autres tendances comme Revolutionary Perspectives et, par la suite, la Communist Workers Organisation en Grande-Bretagne. Il y eut d'importants désaccords sur les causes de la décadence du capitalisme : la brochure du CCI adoptait, en gros, l'analyse de Rosa Luxemburg, bien que l'analyse du boom d'après-guerre (qui voyait la reconstruction des économies détruites par la guerre comme une sorte de nouveau marché) fût par la suite l'objet de discussions dans le CCI, et il y eut toujours, au sein du CCI, d'autres points de vue sur la question, en particulier de la part de camarades défendant la théorie de Grossman - Mattick qui était également partagée par la CWO et d'autres. Mais dans cette période de réémergence du mouvement révolutionnaire, "la théorie de la décadence" semblait faire des acquis significatifs.
Bilan d'un système moribond
Dans notre survol des efforts successifs des révolutionnaires pour comprendre la période de déclin du capitalisme, nous arrivons maintenant aux années 1970 et 1980. Mais avant d'examiner l'évolution – et les nombreuses régressions – qui ont eu lieu au niveau théorique depuis ces décennies jusqu'à aujourd'hui, il nous paraît utile de rappeler et de mettre à jour le bilan que nous avions tiré dans le premier article de cette série 11, puisque des événements spectaculaires, sur le plan économique en particulier, se sont déroulés depuis le début 2008, date à laquelle nous avons publié ce premier article.
1. Sur le plan économique
Dans les années 1970 et 1980, la vague de lutte de classe internationale a connu une série d'avancées et de reculs, mais la crise économique, elle, avançait inexorablement et infirmait la thèse des autonomistes pour qui c'étaient les luttes ouvrières qui étaient la cause des difficultés économiques. La dépression des années 1930, qui coïncidait avec une défaite historique majeure de la classe ouvrière, avait déjà largement démenti cette idée, et l'évolution visible de la faillite économique telle qu'elle est apparue, de façon intermittente, au milieu des années 1970 et au début des années 1980, même dans des moments où la classe ouvrière était en retrait et, de façon plus soutenue, au cours des années 1990, a clairement montré qu'un processus "objectif" était à l'œuvre et qu'il n'était pas fondamentalement déterminé par le degré de résistance de la classe ouvrière. Il n'était pas non plus soumis à un contrôle efficace par la bourgeoisie. Abandonnant les politiques keynésiennes qui avaient accompagné les années du boom d'après-guerre mais étaient devenues la source d'une inflation galopante, la bourgeoisie dans les années 1980 cherchait désormais à "équilibrer les comptes" par des politiques qui suscitèrent une marée de chômage massif et de désindustrialisation dans la plupart des pays-clés du capitalisme. Au cours des années suivantes, il y eut de nouvelles tentatives pour stimuler la croissance par un recours massif à l'endettement, ce qui permit l'existence de booms économiques de courte durée mais provoqua aussi une accumulation sous-jacente de profondes tensions qui allaient exploser à la surface avec les krachs de 2007-08. Un aperçu général de l'économie capitaliste mondiale depuis 1914 ne nous fournit donc pas le scénario d'un mode de production ascendant mais celui d'un système incapable d'échapper à l'impasse, quelles que soient les techniques qu'il ait tenté d'utiliser :
- 1914 - 1923 : Première Guerre mondiale et première vague internationale de révolutions prolétariennes ; l'Internationale communiste annonce l'aube d'une "époque de guerres et de révolutions" ;
- 1924 – 1929 : brève reprise qui ne dissipe pas la stagnation d'après-guerre des "vieilles" économies et des "vieux" empires ; le "boom" est restreint aux États-Unis ;
- 1929 : l'expansion exubérante du capital américain se termine dans un krach spectaculaire, précipitant le capitalisme dans la dépression la plus profonde et la plus étendue de son histoire. Il n'y a pas de revitalisation spontanée de la production comme c'était le cas lors des crises cycliques du 19e siècle. On utilise des mesures capitalistes d'État pour relancer l'économie mais elles font partie d'une poussée vers la Seconde Guerre mondiale ;
- 1945-1967 : Un développement très important des dépenses de l'État (mesures keynésiennes) financées essentiellement au moyen de l'endettement et s'appuyant sur des gains de productivité inédits crée les conditions d'une période de croissance et de prospérité sans précédent, bien qu'une grande partie du "Tiers-Monde" en soit exclue ;
- 1967-2008 : 40 années de crise ouverte, que démontrent en particulier l'inflation galopante des années 1970 et le chômage massif des années 1980. Cependant, au cours des années 1990 et au début des années 2000, c'est à certains moments seulement que la crise apparaît plus "ouvertement" et plus clairement, plus dans certaines parties du globe que dans d'autres. L'élimination des restrictions vis-à-vis du mouvement du capital et de la spéculation financière ; toute une série de délocalisations industrielles vers des régions où la main d'œuvre est bon marché ; le développement de nouvelles technologies ; et, surtout, le recours quasi illimité au crédit par les États, les entreprises et les ménages : tout ceci crée une bulle de "croissance" dans laquelle de petites élites font de très grands profits, des pays comme la Chine connaissent une croissance industrielle frénétique et le crédit à la consommation atteint des hauteurs sans précédent dans les pays capitalistes centraux. Mais les signaux d'alarme sont discernables tout au long de cette période : des récessions succèdent aux booms (par exemple celles de 1974-75, 1980-82, 1990-93, 2001-2002, le krach boursier de 1987, etc.) et, à chaque récession, les options ouvertes pour le capital se rétrécissent, contrairement aux "effondrements" de la période ascendante quand existait toujours la possibilité d'une expansion extérieure vers des régions géographiques et économiques jusqu'alors en dehors du circuit capitaliste. Ne disposant quasiment plus de ce débouché, la classe capitaliste est de plus en plus contrainte de "tricher" avec la loi de la valeur qui condamne son système à l'effondrement. Ceci s'applique tout autant aux politiques ouvertement capitalistes d'État du keynésianisme et du stalinisme qui ne font pas mystère de leur volonté de freiner les effets du marché en finançant les déficits et en maintenant des secteurs économiques non rentables afin de soutenir la production, qu'aux politiques dites "néo-libérales" qui semblaient tout balayer devant elles après les "révolutions" personnifiées par Thatcher et Reagan. En réalité, ces politiques sont elles-mêmes des émanations de l'État capitaliste et, par leur incitation au recours au crédit illimité et à la spéculation, elles ne sont pas du tout ancrées dans un respect des lois classiques de la production capitaliste de valeur. En ce sens, l'un des événements les plus significatifs ayant précédé la débâcle économique actuelle est l'effondrement en 1997 des "Tigres" et des "Dragons" en Extrême-Orient, où une phase de croissance frénétique alimentée par de la (mauvaise) dette s'est soudainement heurtée à un mur – la nécessité de commencer à tout rembourser. C'était un signe avant-coureur de l'avenir, même si la Chine et l'Inde ont pris la suite en s'attribuant le rôle de "locomotive" qui avait été réservé à d'autres économies d'Extrême-Orient. "La révolution technologique", dans la sphère informatique en particulier, dont on a fait un grand battage dans les années 1990 et au tout début des années 2000, n'a pas non plus sauvé le capitalisme de ses contradictions internes : elle a augmenté la composition organique du capital et donc abaissé le taux de profit, et cela n'a pu être compensé par une extension véritable du marché mondial. En fait, elle a tendu à aggraver le problème de la surproduction en déversant de plus en plus de marchandises tout en jetant de plus en plus d'ouvriers au chômage ;
- 2008 -... : la crise du capitalisme mondial atteint une situation qualitativement nouvelle dans laquelle les "solutions" appliquées par l'État capitaliste au cours des quatre décennies précédentes et, par dessus tout, le recours au crédit, explosent à la face du monde politique, financier et bureaucratique qui les avaient pratiquées si assidûment avec une confiance mal placée au cours de la période précédente. Maintenant la crise rebondit vers les pays centraux du capitalisme mondial – aux États-Unis et dans la zone Euro – et toutes les recettes utilisées pour maintenir la confiance dans les possibilités d'une expansion économique constante se révèlent sans effet. La création d'un marché artificiel via le crédit montre désormais ses limites historiques et menace de détruire la valeur de la monnaie et de générer une inflation galopante ; en même temps, le contrôle du crédit et les tentatives des États de réduire leurs dépenses afin de commencer à rembourser leurs dettes ne font que restreindre encore plus le marché. Le résultat net, c'est que le capitalisme entre maintenant dans une dépression qui est fondamentalement plus profonde et plus insoluble que celle des années 1930. Et tandis que la dépression s'étend en Occident, le grand espoir qu'un pays comme la Chine porte l'ensemble de l'économie sur ses épaules s'avère aussi une illusion complète ; la croissance industrielle de la Chine est basée sur sa capacité à vendre des marchandises bon marché à l'Ouest, et si ce marché se contracte, la Chine est confrontée à un krach économique.
Conclusion : tandis que dans sa phase ascendante, le capitalisme a traversé un cycle de crises qui étaient à la fois l'expression de ses contradictions internes et un moment indispensable de son expansion globale, aux 20e et 21e siècles, la crise du capitalisme, comme Paul Mattick l'avait défendu dès les années 1930, est permanente. Le capitalisme a désormais atteint un stade où les palliatifs qu'il a utilisés pour se maintenir en vie sont devenus un facteur supplémentaire de sa maladie mortelle.
2. Sur le plan militaire
La poussée vers la guerre impérialiste exprime aussi l'impasse historique de l'économie capitaliste mondiale :
- "Plus se rétrécit le marché, plus devient âpre la lutte pour la possession des sources de matières premières et la maîtrise du marché mondial. La lutte économique entre divers groupes capitalistes se concentre de plus en plus, prenant la forme la plus achevée des luttes entre États. La lutte économique exaspérée entre États ne peut finalement se résoudre que par la force militaire. La guerre devient le seul moyen non pas de solution à la crise internationale, mais le seul moyen par lequel chaque impérialisme national tend à se dégager des difficultés avec lesquelles il est aux prises, aux dépens des États impérialistes rivaux.
Les solutions momentanées des impérialismes isolés, par des victoires militaires et économiques, ont pour conséquence non seulement l'aggravation des situations des pays impérialistes adverses, mais encore une aggravation de la crise mondiale et la destruction des masses de valeurs accumulées par des dizaines et des centaines d'années de travail social. La société capitaliste à l'époque impérialiste ressemble à un bâtiment dont les matériaux nécessaires pour la construction des étages supérieurs sont extraits de la bâtisse des étages inférieurs et des fondations. Plus frénétique est la construction en hauteur, plus fragile est rendue la base soutenant tout l'édifice. Plus est imposante en apparence, la puissance au sommet, plus l'édifice est, en réalité, branlant et chancelant. Le capitalisme, forcé qu'il est de creuser sous ses propres fondations, travaille avec rage à l'effondrement de l'économie mondiale, précipitant la société humaine vers la catastrophe et l'abîme." ("Rapport sur la situation internationale", juillet 1945, GCF 12)
Les guerres impérialistes, qu'elles soient locales ou mondiales, sont l'expression la plus pure de la tendance du capitalisme à s'autodétruire, qu'il s'agisse de la destruction physique de capital, du massacre de populations entières ou de l'immense stérilisation de valeurs que représente la production militaire qui ne se réduit plus aux phases de guerre ouverte. La compréhension par la GCF de la nature essentiellement irrationnelle de la guerre dans la période de décadence a été en quelque sorte obscurcie par la réorganisation et la reconstruction globale de l'économie qui a suivi la Seconde Guerre mondiale ; mais le boom d'après-guerre était un phénomène exceptionnel qui ne pourra jamais se répéter. Et quel que soit le mode d'organisation internationale adopté par le système capitaliste à cette époque, la guerre a également été permanente. Après 1945, quand le monde a été divisé en deux énormes blocs impérialistes, le conflit militaire a généralement pris la forme de guerres de "libération nationale" sans fin à travers lesquelles les deux super-puissances rivalisaient pour la domination stratégique ; après 1989, l'effondrement du bloc russe, plus faible, loin d'atténuer la tendance à la guerre, a rendu l'implication directe de la super-puissance restante, les États-Unis, plus fréquente, comme nous l'avons vu pendant la Guerre du Golfe de 1991, dans les guerres des Balkans à la fin des années 1990, et en Afghanistan et en Irak après 2001. Ces interventions des États-Unis avaient en grande partie pour but – et de façon tout à fait vaine - d'enrayer les tendances centrifuges auxquelles la dissolution de l'ancien système de blocs avait ouvert la voie, ce qui s'est vu dans l'aggravation et la prolifération des rivalités locales, concrétisées dans les conflits atroces qui ont ravagé l'Afrique, du Rwanda au Congo, de l'Éthiopie à la Somalie, dans les tensions exacerbées autour du problème israélo-palestinien, jusqu'à la menace d'un face-à-face nucléaire entre l'Inde et le Pakistan
Les Première et Seconde Guerres mondiales ont apporté un changement majeur dans le rapport de forces entre les principaux pays capitalistes, essentiellement au bénéfice des États-Unis. En fait la domination écrasante des États-Unis à partir de 1945 a constitué un facteur-clé de la prospérité d'après-guerre. Mais contrairement à l'un des slogans des années 1960, la guerre n'était pas "la santé de l'État". De la même façon que le gonflement extrême de son secteur militaire a provoqué l'effondrement du bloc de l'Est, l'engagement des États-Unis pour se maintenir comme gendarme du monde est aussi devenu le facteur de leur propre déclin en tant qu'empire. Les énormes sommes englouties dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak n'ont pas été compensées par les profits rapides d'Halliburton ou autres de ses acolytes capitalistes ; au contraire, cela a contribué à transformer les États-Unis de créditeurs du monde en l'un de ses principaux débiteurs.
Certaines organisations révolutionnaires, comme la Tendance communiste internationaliste, défendent l'idée que la guerre, et surtout la guerre mondiale, est éminemment rationnelle du point de vue du capitalisme. Elles défendent l'idée qu'en détruisant la masse hypertrophiée de capital constant qui est à la source de la baisse du taux de profit, la guerre dans la décadence du capitalisme a pour effet la restauration de ce dernier et le lancement d'un nouveau cycle d'accumulation. Nous n'entrerons pas ici dans cette discussion mais, même si une telle analyse était juste, cela ne pourrait plus être une solution pour le capital. D'abord, parce que rien ne permet de dire que les conditions d'une troisième guerre mondiale – qui requiert, entre autres, la formation de blocs impérialistes stables - soient réunies dans un monde où la règle est de plus en plus celle du "chacun pour soi". Et même si une troisième guerre mondiale était à l'ordre du jour, elle n'initierait certainement pas un nouveau cycle d'accumulation, mais aboutirait quasi certainement à la disparition du capitalisme et, probablement, de l'humanité. 13 Ce serait la démonstration finale de l'irrationalité du capitalisme, mais il n'y aurait plus personne pour dire "je vous l'avais bien dit".
3. sur le plan écologique
Depuis les années 1970, les révolutionnaires ont été obligés de prendre en compte une nouvelle dimension du diagnostic selon lequel le capitalisme n'apportait plus rien de positif et était devenu un système tourné vers la destruction : la dévastation croissante de l'environnement naturel qui menace maintenant de désastre à l'échelle planétaire. La pollution et la destruction du monde naturel sont inhérentes à la production capitaliste depuis le début mais, au cours du siècle dernier et, en particulier, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles se sont étendues et amplifiées du fait que le capitalisme a occupé sans répit tous les recoins de la planète jusqu'au dernier. En même temps, et comme conséquence de l'impasse historique du capitalisme, l'altération de l'atmosphère, le pillage et la pollution de la terre, des mers, des rivières et des forêts ont été exacerbés par l'accroissement d'une concurrence nationale féroce pour les ressources naturelles, la main d'œuvre à bas prix et de nouveaux marchés. La catastrophe écologique, notamment sous la forme du réchauffement climatique, est devenue un nouveau chevalier de l'apocalypse capitaliste, et les sommets internationaux qui se sont succédé ont montré l'incapacité de la bourgeoisie à prendre les mesures les plus élémentaires pour l'éviter.
Une illustration récente : le dernier rapport de l'Agence Internationale de l'Énergie, organisme qui ne s'était jamais distingué auparavant pour ses prédictions alarmistes, assure que les gouvernements du monde ont cinq ans pour renverser le cours du changement climatique avant qu'il ne soit trop tard. Selon l'AIE et un certain nombre d'institutions scientifiques, il est vital d'assurer que la hausse des températures ne dépasse pas 2 degrés. "Pour maintenir les émissions en dessous de cet objectif, la civilisation ne pourrait continuer, comme c'était le cas jusqu'ici, que pendant cinq ans, avant d'avoir "dépensé" le montant total des émissions permises. Dans ce cas, si on veut atteindre les objectifs de réchauffement, toutes les nouvelles infrastructures construites à partir de 2017 ne devraient plus produire aucune émission." 14 Un mois après la parution de ce rapport en novembre 2011, le sommet de Durban était présenté comme un pas en avant car, pour la première fois de toutes ces réunions internationales entre États, on se mit d'accord sur la nécessité de limiter légalement les émissions de gaz carbonique. Mais ce n'est qu'en 2015 que les niveaux devraient être fixés et en 2020 être effectifs – bien trop tard selon les prévisions de l'AIE et de beaucoup d'organismes environnementaux associés à la Conférence. Keith Allot, responsable "changement climatique" au WWF-Royaume-Uni (World Wide Fund for nature / Fonds mondial pour la nature), a déclaré : "Les gouvernements ont préservé une voie aux négociations, mais nous ne devons nous faire aucune illusion – l'issue de Durban nous présente la perspective de limites légales de 4° de réchauffement. Ce serait une catastrophe pour les populations et la nature. Les gouvernements ont passé leur temps, dans ce moment crucial, à négocier autour de quelques mots dans un texte, et ont porté peu d'attention aux avertissements répétés de la communauté scientifique disant qu'une action bien plus urgente et bien plus vigoureuse était nécessaire pour réduire les émissions". 15
Le problème avec les conceptions réformistes des écologistes, c'est que le capitalisme est étranglé par ses propres contradictions et par ses luttes toujours plus désespérées pour survivre. Pris dans une crise, le capitalisme ne peut pas devenir moins compétitif, plus coopératif, plus rationnel ; à tous les niveaux, il est entraîné dans la concurrence la plus extrême, surtout au niveau de la concurrence entre États nationaux qui ressemblent à des gladiateurs se battant dans une arène barbare pour la moindre chance de survie immédiate. Il est forcé de chercher des profits à court terme, de tout sacrifier à l'idole de "la croissance économique" – c'est-à-dire à l'accumulation du capital, même si c'est une croissance fictive basée sur une dette pourrie comme dans les dernières décennies. Aucune économie nationale ne peut se permettre le plus petit moment de sentimentalisme quand il s'agit d'exploiter sa "propriété" nationale naturelle jusqu'à sa limite absolue. Il ne peut pas exister non plus, dans l'économie capitaliste mondiale, de structure légale ni de gouvernance internationales qui soit capable de subordonner les intérêts nationaux étroits aux intérêts globaux de la planète. Quelle que soit la véritable échéance posée par le réchauffement climatique, la question écologique dans son ensemble constitue une nouvelle preuve que la perpétuation de la domination de la bourgeoisie, du mode de production capitaliste, est devenue un danger pour la survie de l'humanité.
Examinons une illustration édifiante de tout cela – une illustration qui montre également en quoi le danger écologique, tout comme la crise économique, ne peut être séparé de la menace de conflit militaire.
- "Au cours des derniers mois, les compagnies pétrolières ont commencé à faire la queue pour obtenir des droits d'exploration de la mer de Baffin, région de la côte occidentale du Groenland riche en hydrocarbures qui, jusqu'ici, était trop obstruée par les glaces pour qu'on puisse forer. Des diplomates américains et canadiens ont rouvert une polémique à propos des droits de navigation sur une route maritime traversant le Canada arctique et qui permettrait de réduire le temps de transport et les coûts des pétroliers.
Même la propriété du pôle Nord est devenue l'objet de discorde, la Russie et le Danemark prétendant chacun détenir la propriété des fonds océaniques dans l'espoir de se réserver l'accès à toutes ses ressources, des pêcheries aux gisements de gaz naturel.
L'intense rivalité autour du développement de l'Arctique a été révélée dans les dépêches diplomatiques publiées la semaine dernière par le site web "anti-secret" Wikileaks. Des messages entre des diplomates américains montrent comment les nations du nord, y compris les États-Unis et la Russie, ont manœuvré afin d'assurer l'accès aux voies maritimes et aux gisements sous-marins de pétrole et de gaz qui sont évalués à 25 pour cent des réserves inexploitées mondiales.
Dans leurs câbles, les officiels américains redoutent que les chamailleries autour des ressources puissent amener à un armement de l'Arctique. "Bien que la paix et la stabilité règnent en Arctique, on ne peut exclure qu'une redistribution du pouvoir ait lieu dans le futur et même une intervention armée", dit un câble du Département d'État en 2009, citant un ambassadeur russe." 16
Ainsi, l'une des manifestations les plus graves du réchauffement climatique, la fonte des glaces aux pôles, qui contient la possibilité d'inondations cataclysmiques et d'un cercle vicieux de réchauffement une fois que les glaces polaires ne seront plus là pour refléter la chaleur du soleil en dehors de l'atmosphère terrestre, est immédiatement considérée comme une immense occasion économique pour laquelle les États nationaux font la queue – avec la conséquence ultime de consommer plus d'énergies fossiles, venant s'ajouter à l'effet de serre. Et en même temps, la lutte pour les ressources qui s'amenuisent – ici le pétrole et le gaz mais, ailleurs, ça peut être l'eau et les terres fertiles – produit un mini-conflit impérialiste à quatre ou cinq (la Grande-Bretagne est elle aussi impliquée dans cette dispute). C'est le cercle vicieux de la folie croissante du capitalisme.
Le même article (du Washington Post) se poursuit par "la bonne nouvelle" d'un modeste traité signé entre certains des protagonistes lors du sommet du Conseil arctique à Nuuk au Groenland. Et nous savons à quel point on peut compter sur les traités diplomatiques quand il s'agit de prévenir la tendance inhérente du capitalisme vers le conflit impérialiste.
Le désastre global que le capitalisme prépare ne peut être évité que par une révolution globale.
4. Sur le plan social
Quel est le bilan du déclin du capitalisme sur le plan social et, en particulier, pour la principale classe productrice de richesses pour le capitalisme, la classe ouvrière ? Quand, en 1919, l'Internationale communiste proclama que le capitalisme était entré dans l'époque de sa désintégration interne, elle traçait également un trait sur la période de la social-démocratie au cours de laquelle la lutte pour des réformes durables avait été possible et nécessaire. La révolution était devenue nécessaire parce que, désormais, le capitalisme ne pourrait qu'augmenter ses attaques contre le niveau de vie de la classe ouvrière. Comme nous l'avons montré dans les précédents articles de cette série, cette analyse fut plusieurs fois confirmée au cours des deux décennies suivantes qui virent la plus grande dépression de l'histoire du capitalisme et les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle fut mise en question, même chez les révolutionnaires, pendant le boom des années 1950 et 1960, quand la classe ouvrière des pays capitalistes centraux connut des augmentations de salaires sans précédent, une réduction importante du chômage et une série d'avantages sociaux financés par l'État : les allocations maladie, les congés payés, l'accès à l'éducation, les services de santé, etc.
Mais ces avancées invalident-elles l'idée, maintenue par les révolutionnaires qui défendaient la thèse selon laquelle le capitalisme était globalement en déclin, que des réformes durables n'étaient plus possibles ?
La question posée ici n'est pas de savoir si ces améliorations ont été "réelles" ou significatives. Elles l'ont été et cela doit être expliqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles le CCI, par exemple, a ouvert un débat sur les causes de la prospérité d'après-guerre, en son sein puis publiquement. Mais ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est le contexte historique dans lequel ces acquis eurent lieu, car on peut alors montrer qu'ils ont peu en commun avec l'amélioration régulière du niveau de vie de la classe ouvrière au 19e siècle qui avait été permise, pour sa plus grande part, grâce à la bonne santé du capitalisme ainsi qu'à l'organisation et à la lutte du mouvement ouvrier :
- s'il est vrai que bien des "réformes" d'après-guerre furent mises en œuvre pour assurer que la guerre ne donne pas lieu à une vague de luttes prolétariennes sur le modèle de 1917-23, l'initiative de mesures comme l'assurance maladie ou pour le plein emploi est directement venue de l'appareil d'État capitaliste, de son aile gauche en particulier. Elles eurent pour effet d'augmenter la confiance de la classe ouvrière dans l'État et de diminuer sa confiance dans ses luttes propres ;
- même pendant les années du boom, la prospérité économique avait d'importantes limites. De grandes parties de la classe ouvrière, en particulier dans le Tiers-Monde mais, également, dans des poches importantes des pays centraux (par exemple, les ouvriers noirs et les blancs pauvres aux États-Unis) étaient exclus de ces avantages. Dans tout le "Tiers-Monde", l'incapacité du capital à intégrer les millions de paysans et de personnes d'autres couches, ruinés, dans le travail productif, a créé les prémices des bidonvilles hypertrophiés actuels, de la malnutrition et de la pauvreté mondiales. Et ces masses furent aussi les premières victimes des rivalités entre les blocs impérialistes, qui eurent pour conséquences des batailles sanglantes par procuration dans une série de pays sous-développés, de la Corée au Vietnam, du Moyen-Orient à l'Afrique du Sud et de l'Ouest ;
- une autre preuve de l'incapacité du capitalisme à véritablement améliorer la qualité de vie de la classe ouvrière réside dans la journée de travail. L'un des signes de "progrès" au 19e siècle fut la diminution continue de la journée de travail, de plus de 18 heures au tout début du siècle à la journée de 8 heures qui constituait l'une des principales revendications du mouvement ouvrier à la fin du siècle et qui a été formellement accordée dans les années 1900 et les années 1930. Mais depuis lors – et cela inclut également le boom d'après-guerre - la durée de la journée de travail est restée plus ou moins la même alors que le développement technologique, loin de libérer les ouvriers du labeur, a mené à la déqualification, au développement du chômage et à une exploitation plus intensive de ceux qui travaillent, à des temps de transport de plus en plus longs pour aller au travail et au développement du travail continu même en dehors du lieu de travail grâce aux téléphones mobiles, aux ordinateurs portables et à internet ;
- quels que soient les acquis apportés pendant le boom d'après-guerre, ils ont été grignotés de façon plus ou moins continue au cours des 40 dernières années et, avec la dépression imminente, ils sont maintenant l'objet d'attaques bien plus massives et sans perspective de répit. Au cours des quatre dernières décennies de crise, le capitalisme a été relativement prudent dans sa façon de baisser les salaires, d'imposer un chômage massif et de démanteler les allocations sociales de l'État-providence. Les violentes mesures d'austérité qui sont imposées aujourd'hui dans un pays comme la Grèce constituent un avant-goût de ce qui attend les ouvriers partout ailleurs.
Au niveau social plus large, le fait que le capitalisme ait été en déclin pendant une période aussi longue contient une énorme menace pour la capacité de la classe ouvrière à devenir "classe pour soi". Quand la classe ouvrière a repris ses luttes à la fin des années 1960, sa capacité à développer une conscience révolutionnaire était grandement entravée par le traumatisme de la contre-révolution qu'elle avait traversée – une contre-révolution qui s'était présentée elle-même dans une grande mesure dans un habit "prolétarien", celui du stalinisme, et avait rendu des générations d'ouvriers extrêmement méfiants vis-à-vis de leurs propres traditions et de leurs organisations. L'identification frauduleuse entre stalinisme et communisme fut même poussée à son extrême quand les régimes staliniens s'effondrèrent à la fin des années 1980, sapant encore plus la confiance de la classe ouvrière en elle-même et en sa capacité à apporter une alternative politique au capitalisme. Ainsi, un produit de la décadence capitaliste – le capitalisme d'État stalinien - a été utilisé par toutes les fractions de la bourgeoisie pour altérer la conscience de classe du prolétariat.
Au cours des années 1980 et 1990, l'évolution de la crise économique a fait que les concentrations industrielles et les communautés de la classe ouvrière dans les pays centraux ont été détruites, et une grande partie de l'industrie a été transférée dans des régions du monde où les traditions politiques de la classe ouvrière ne sont pas très développées. La création de vastes no man's land urbains dans beaucoup de pays développés amena avec elle un affaiblissement de l'identité de classe et, plus généralement, l'émoussement des liens sociaux ayant pour contrepartie la recherche de fausses communautés qui ne sont pas neutres mais ont des effets terriblement destructeurs. Par exemple, des secteurs de la jeunesse blanche exclus de la société subissent l'attraction de bandes d'extrême-droite comme la English Defence League en Grande Bretagne ; d'autres de la jeunesse musulmane qui se trouvent dans la même situation matérielle sont attirés par les politiques fondamentalistes islamistes et jihadistes. De façon plus générale, on peut voir les effets corrosifs de la culture des bandes dans quasiment tous les centres urbains des pays industrialisés, même si ses manifestations connaissent l'impact le plus spectaculaire dans les pays de la périphérie comme au Mexique où le pays est aux prises avec une guerre civile quasi permanente et incroyablement meurtrière entre des gangs de la drogue, dont certains sont directement liés à des fractions de l'État central non moins corrompu.
Ces phénomènes –la perte effrayante de toute perspective d'avenir, la montée d'une violence nihiliste– constituent un poison idéologique qui pénètre lentement dans les veines des exploités du monde entier et entravent énormément leur capacité à se considérer comme une seule classe, une classe dont l'essence est la solidarité internationale.
A la fin des années 1980, il y eut des tendances dans le CCI à considérer les vagues de luttes des années 1970 et 1980 comme avançant d'une façon plus ou moins linéaire vers une conscience révolutionnaire. Cette tendance fut vivement critiquée par Marc Chirik qui, sur la base d'une analyse des attentats terroristes en France et de l'implosion soudaine du bloc de l'Est, fut le premier à développer l'idée que nous entrions dans une nouvelle phase de la décadence du capitalisme qui fut décrite comme une phase de décomposition. Cette nouvelle phase était fondamentalement déterminée par une sorte d'impasse globale, une situation où ni la classe dominante, ni la classe exploitée n'étaient capables de mettre en avant leur alternative propre pour l'avenir de la société : la guerre mondiale pour la bourgeoisie, la révolution mondiale pour la classe ouvrière. Mais comme le capitalisme ne peut jamais être immobile et que sa crise économique prolongée était condamnée à toucher de nouveaux fonds, en l'absence de toute perspective, la société était condamnée à pourrir sur pied, apportant à son tour de nouveaux obstacles au développement de la conscience de classe du prolétariat.
Que l'on soit ou non d'accord avec les paramètres du concept de décomposition défendu par le CCI, ce qui est essentiel, dans cette analyse, c'est que nous sommes dans la phase terminale du déclin du capitalisme. La preuve que nous assistons aux dernières étapes du déclin du système, à son agonie mortelle, n'a fait qu'augmenter au cours des dernières décennies au point qu'un sentiment général d' "apocalypse" – une reconnaissance du fait que nous sommes au bord de l'abîme - se répand de plus en plus. 17 Et pourtant, au sein du mouvement politique prolétarien, la théorie de la décadence est loin de faire l'unanimité. Nous examinerons certains des arguments à l'encontre de cette notion dans le prochain article.
Gerrard
1 Lire le précédent article dans la Revue internationale n° 147, "Décadence du capitalisme : le boom d'après-guerre n'a pas renversé le cours du déclin du capitalisme [27]".
2 En réponse à l'essai de Marcuse L'homme unidimensionnel – Essai sur l'idéologie de la société avancée, 1964 (en français en 1968).
3 Voir dans la Revue internationale n° 146, "Décadence du capitalisme : pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme [28]".
4 Marx et Keynes, les limites de l'économie mixte, Éditions Gallimard 1972, chapitre XIV "L'économie mixte".
5 Ibid., chapitre XIX, "L'impératif impérialiste".
6 Ibid., chapitre XXII, "Valeur et socialisme".
7 Ibid., chapitre XX, "Capitalisme d'État et économie mixte".
8 Ibid., chapitre XIX, "L'impératif impérialiste".
9 Une autre faiblesse dans Marx et Keynes est l'attitude méprisante de Mattick envers Rosa Luxemburg et le problème qu'elle avait soulevé concernant la réalisation de la plus-value. Il ne fait qu'une seule référence directe à Luxemburg dans son livre : "Et, au début du siècle actuel, la marxiste Rosa Luxemburg voyait dans ce même problème [la réalisation de la plus-value] la raison objective des crises et des guerres ainsi que de la disparition finale du capitalisme. Tout cela n'a pas grand-chose à voir avec Marx qui, tout en estimant, il va de soi, que le monde capitaliste réel était en même temps processus de production et processus de circulation, soutenait néanmoins que rien ne peut circuler qui n'a été produit au préalable, et accordait pour ce motif la priorité aux problèmes de la production. Dès lors que seule la création de plus-value permet une expansion accélérée du capital, quel besoin a-t-on de supposer que le capitalisme se trouvera ébranlé dans la sphère de la circulation ?" (page 116, chapitre IX, "La crise du capitalisme")
A partir de la tautologie "rien ne peut circuler qui n'a été produit au préalable" et de l'idée marxiste "qu'une création adéquate de plus-value permet une expansion accélérée du capital", Mattick effectue une déduction abusive en prétendant que la plus-value en question pourra nécessairement être réalisée sur le marché. Le même type de raisonnement est encore présent dans un passage précédent : "La production marchande crée son propre marché dans la mesure où elle est capable de convertir la plus-value en capital additionnel. La demande du marché concerne tant les biens de consommation que les biens capitaux. Mais seuls ces derniers sont accumulables, le produit consommé étant par définition appelé à disparaître. Et seule la croissance du capital sous sa forme matérielle permet de réaliser la plus-value en dehors des rapports d'échange capital-travail. Tant qu'il existe une demande convenable et continue de biens capitaux, rien ne s'oppose à ce que soient vendues les marchandises offertes au marché." (page 97, chapitre VIII, "La réalisation du la plus-value"). Ceci est contradictoire avec le point de vue de Marx selon lequel "le capital constant n'est jamais produit pour lui-même, mais pour l'emploi accru dans les sphères de production dont les objets entrent dans la consommation individuelle" (Le Capital, Livre III, Éd. La Pléiade Économie II. p 1075). En d'autres termes, c'est la demande de moyens de consommation qui tire la demande en moyens de production, et non l'inverse. Mattick lui-même reconnaît (dans Crises et théories des crises) cette contradiction entre sa propre conception et certaines formulations de Marx, comme celle qui précède.
Mais nous ne voulons pas entrer une fois de plus dans ce débat ici. Le problème principal, c'est que bien que Mattick ait bien sûr considéré Rosa Luxemburg comme une marxiste et une révolutionnaire authentiques, il s'est joint au courant de pensée qui rejette le problème qu'elle posait à propos du processus d'accumulation comme un non-sens extérieur au cadre de base du marxisme. Comme nous l'avons montré, ça n'a pas été le cas de tous les critiques de Luxemburg, de Roman Rosdolsky par exemple (voir notre article dans la Revue internationale n° 142 : "Rosa Luxemburg et les limites de l'expansion du capitalisme [29]".)
Cette démarche en grande partie sectaire a toujours énormément entravé le débat entre les marxistes sur ce problème depuis.
10 fr.internationalism.org/brochures/decadence [30]
11 Lire Revue internationale n° 132, "Décadence du capitalisme : la révolution est nécessaire et possible depuis un siècle [31]" (2008).
Pour plus de détails et de statistiques concernant l'évolution globale de la crise historique, son impact sur l'activité productive, le niveau de vie des travailleurs, etc., lire l'article dans ce n° : "Le capitalisme est-il un mode de production décadent et pourquoi ?"
12 Republié en partie dans la Revue internationale n° 59 [32] (1989).
13 Ceci ne veut évidemment pas dire que l'humanité est plus en sécurité dans un système impérialiste qui devient de plus en plus chaotique. Au contraire, sans la discipline imposée par l'ancien système de blocs, des guerres locales et régionales encore plus dévastatrices sont de plus en plus probables et leur potentiel destructeur s'est considérablement accru avec la prolifération des armes nucléaires. En même temps, comme elles pourraient très bien éclater dans des zones éloignées des centres capitalistes, elles sont moins dépendantes d'un autre élément qui a retenu la poussée vers la guerre mondiale depuis le début de la crise à la fin des années 1960 : la difficulté à mobiliser la classe ouvrière des pays centraux du capitalisme dans une confrontation impérialiste directe.
14 www.nationalgeographic.com/science/article/111109-world-energy-outlook-2011 [33]
15 www.theguardian.com/environment/2011/dec/11/global-climate-change-treaty-durban [34]
16 https://www.washingtonpost.com/national/environment/warming-arctic-opens-way-to-competition-for-resources/2011/05/15/AF2W2Q4G_story.html [35]
17 Voir par exemple The Guardian, "The news is terrible. Is the world really doomed? [36]", A. Beckett, 18/12/2011.
Questions théoriques:
- Décadence [37]