ICConline - 2012
- 2391 lectures
ICConline - janvier 2012
- 1363 lectures
En Grèce, les plans d’austérité se heurtent à la résistance de la classe ouvrière
- 1508 lectures
Nous publions ci-dessous un article de World Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne. Ce texte a été écrit juste après la proposition puis l'immédiat renoncement de Papandréou d'organiser un référendum et avant la formation d’une nouvelle l’équipe gouvernementale autour de Lukas Papademos pour imposer un énième plan antiouvrier et de nouvelles manifestations.
Après que le Premier ministre Georges Papandreou a proposé puis renoncé à l’idée d’un referendum, le prix des actions s’est globalement stabilisé. Après avoir obtenu un vote de confiance, mais qui signifiait que ce dernier devait quitter le pouvoir, les marchés financiers s’attendaient à la possibilité que ce soit Evangelos Venizelos qui conduise l’équipe qui devait rencontrer la troïka UE, FMI, BCE, pour négocier les conditions du prochain renflouement. La réalité économique, c’est beaucoup plus qu’une simple visite au gérant de la banque. Les enjeux sont énormes pour la Grèce, pour la zone Euro et l’économie mondiale.
Si la Grèce ne peut pas rembourser les prêts, cela aura un impact bien au delà de ses frontières. De fait, la Grèce a déjà été exemptée de milliards de dettes. Les créanciers de la Grèce ont été d’accord pour annuler 50 % de ce qu’elle leur doit, détruisant de fait 106 milliards d’Euros d’un coup. Cela a été présenté comme une perte substantielle. Le capitalisme n’a aucune solution à sa crise historique, sinon accroître l’austérité. Aucune des mesures alternatives proposées par les différentes factions de la bourgeoisie n’offre de perspective de reprise de l’économie. Cela vaut tout autant pour la fabrication de monnaie, le recours à l’endettement et au « quantitative easing », que pour les coupes budgétaires brutales répétées, comme cela se fait vicieusement, sans aucune préoccupation pour l’impact que cela va avoir sur toute possibilité de croissance.
La seule perspective est l’austérité
En mai 2010, après le premier renflouement massif de 110 milliards de l’économie grecque, il y a eu une diminution de 10 % des salaires dans le secteur public avec toute une série de mesures. Cela s’est ajouté à un plan d’austérité qui était déjà en cours. Ce « plan de sauvetage » s’est avéré complètement inefficace et un second train de mesures d’austérité a été négocié en juillet dernier, entraînant encore plus de restrictions.
Comme prévisible, ça n’a pas eu non plus d’effet positif sur l’économie. Aussi, en octobre, il y a eu une nouvelle table ronde de négociations. Les banques peuvent bien avoir subi une « perte substantielle », mais 30 000 travailleurs du secteur public de plus ont perdu leur emploi et des diminutions de salaires et de pensions ont été proposées. Les leaders européens ont dit qu’il n’y aurait plus d’argent si la Grèce n’est pas intégrée dans l’Euro. Il n’y a pas réellement de choix, pour la Grèce ou l’Europe, puisque toutes les voies prises tendent à exacerber plutôt qu’à ralentir la crise. L’opposition conservatrice Nouvelle Démocratie en Grèce a été très sévère dans ses discours contre le gouvernement PASOK de Papandreou, mais ne fait en réalité qu’ergoter sur des détails. Elle acceptera en définitive le dernier plan d’austérité. Après tout, avant que le PASOK ne vienne au pouvoir en mai 2009, le gouvernement de droite précédent avait déjà commencé à mener les attaques contre les conditions de vie qui allaient s’intensifier sous Papandreou.
La résistance ouvrière aux attaques
C’est sous le précédent gouvernement Nouvelle Démocratie, en décembre 2008 et début 2009, qu’il y a eu une vague de protestation combative contre le meurtre par la police d’un étudiant de 15 ans. Dans les occupations et les assemblées qui ont eu lieu pendant ce mouvement, les potentialités de lutte se révélaient clairement.
L’ampleur et la combativité de la plupart des grèves générales en Grèce en 2010 montraient que la classe ouvrière dans ce pays n’était pas prête à baisser la tête face à une attaque frontale de ses conditions de vie. Néanmoins, le degré de contrôle exercé par les syndicats a finalement limité l’impact de ces actions ouvrières.
En Grèce, en 2011, à côté des grèves appelées par les syndicats en réponse à la véritable colère ressentie dans toute la classe ouvrière, il y a eu aussi un écho du mouvement des « Indignados » en Espagne, avec des réunions d’assemblées dans de nombreuses villes. Entre autres préoccupations, y était envisagée les perspectives du développement de la lutte.
Quand de nouvelles mesures du gouvernement ont été annoncées, proposées, ou ont été l’objet de rumeurs, il y a eu de nouvelles grèves et de nouvelles manifestations. Celles-ci ont concerné des secteurs particuliers d’ouvriers ou, comme la grève générale du 5 octobre, tout le secteur public. La grève générale de 48 heures des 19-20 octobre a provoqué les manifestations les plus larges depuis des décennies. Il y a eu plus d’occupations, plus d’initiatives au-delà des actions proposées par les directions syndicales, et tous les niveaux de protestations et l’éventail des participants à ces manifestations massives ont été cyniquement rapportées, par exemple, par la presse internationale. Les bureaux, les édifices gouvernementaux, les banques, les écoles et les tribunaux étaient fermés. Seules les urgences étaient assurées dans les hôpitaux . Les transports publics étaient paralysés.
Dans une très grande manifestation devant le parlement grec, le KKE stalinien et le syndicat PAME stalinien ont voulu défendre le parlement. Ce n’était pas simplement une garde de cérémonie, mais cela a signifié aussi taper sur les manifestants et les intimider Non contents d’attaquer ceux qui étaient venus manifester, ils les donnaient à la police. Cela a inévitablement conduit à des bagarres avec ceux qui voulaient investir le parlement. Ce n’était pas une explosion de violence isolée puisque les staliniens ont attaqué des manifestants dans bien d’autres endroits.
Le nationalisme est toujours l’ennemi
Chaque année, le 28 octobre, il y a des défilés en Grèce à la date anniversaire du jour de 1940 où le dictateur Metaxas a refusé l’ultimatum de Mussolini. Cela a entraîné une invasion de la Grèce par l’Italie et le début de la participation de ce pays dans la Seconde Guerre mondiale. D’habitude, cette fête du nationalisme grec est marquée par une inflation de drapeaux grecs et de discours rituels, mais cette année, il y a eu des manifestations contre le régime d’austérité. Partout en Grèce, des projectiles ont été jetés, des défilés ont été bloqués, les députés des principaux partis étaient conspués, et en quelques occasions, les défilés ont été annulés.
A Thessalonique, deuxième ville de Grèce, le Président grec a été accueilli par 30 000 manifestants. La police a été incapable de les disperser, le défilé a été annulé et les manifestants ont occupé le podium. Ces manifestations n’étaient pas organisées par les syndicats et semblent avoir été, par bien des côtés, spontanées. Le Président a dit que le choix était entre participer aux manifestations ou aux élections. Papandreou a dénoncé « l’insulte » aux « luttes nationales et aux institutions » et le leader de Nouvelle Démocratie s’est plaint de ce que les manifestations « avaient gâché notre jour férié national ».
Cependant, alors que c’est vrai que bouleverser la commémoration du 28 octobre est plus ou moins du jamais vu, les manifestations n’étaient pas complètement dépourvues de nationalisme. Il y avait, en particulier, un certain niveau de ressentiment anti-allemand qui s’est exprimé, en partie sur la base du rôle de l’Allemagne dans l’Union Européenne. Une banderole en Crète disait « Non au quatrième Reich !». Papandreou a aussi été dénoncé comme « traître » d’une manière qui ne peut être interprétée que comme nationaliste. Mais, globalement, les manifestations les plus récentes confirment que, plutôt que de courber l’échine respectueusement devant ses maîtres, la classe ouvrière ne plie pas devant les attaques.
La bourgeoisie ne peut s’attendre à ce que la classe ouvrière reste passive
La bourgeoisie n’a pas de solution à ses problèmes économiques. En plus, elle fait face à une situation sociale difficile, dans laquelle les travailleurs, à certains endroits, résistent aux tentatives de leur faire payer la crise du capitalisme. Les mesures d’austérité brutales n’entraînent pas inévitablement des luttes ouvrières. Par exemple, en Irlande, jusqu’à maintenant les réactions à la dégradation des conditions de vie ont été très discrètes.
La bourgeoisie s’attend donc tôt ou tard à des réactions à ses mesures car elle n’a rien d’autre à offrir. En Espagne, par exemple, le Parti Socialiste au pouvoir a déjà augmenté les impôts, réduit les salaires et diminué radicalement les investissements. S’il perd le pouvoir lors des élections du 20 novembre, le nouveau gouvernement a promis d’accroître encore les restrictions de budget. Cela ne va pas contribuer à une relance économique et augmentera encore plus le cours à la récession globale. En retour, comme un rapport de l’Organisation Internationale du Travail le souligne, cela va contribuer à généraliser les troubles sociaux.
Les manœuvres de Papandreou autour du referendum sont aussi une démonstration du fait que la classe dominante grecque sait qu’elle ne peut pas simplement enfoncer les ouvriers jusqu ‘au cou dans l’austérité, quelles que soient les exigences de l’UE et du FMI. Mais les leaders eux-mêmes de ces derniers vont aussi voir, « dans leurs propres pays », les travailleurs se comporter de façon aussi « violente et inacceptable » dans le futur proche.
Car (octobre 2011)
Géographique:
- Grèce [1]
Récent et en cours:
- Crise économique [2]
- Luttes de classe [3]
Rubrique:
Les conditions de vie de la classe ouvrière: des décennies de déclin
- 1990 lectures
Nous publions ci-dessous un article de World Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne.
« Ce n'est certainement pas une bonne chose pour le niveau de vie qu'il chute comme il le fait aujourd'hui. Bien sûr que non, mais le niveau relativement élevé qu'il avait atteint à la veille de la crise était insoutenable, et le présent ajustement, bien qu'il soit sans doute douloureux pour beaucoup de ménages, est à la fois inévitable et nécessaire, car il contribue, une fois de plus, à rendre au Royaume-Uni son économie compétitive »1
Un des thèmes persistants de la classe dirigeante est l'idée que la crise actuelle est le résultat d'un consumérisme alimenté par le crédit. Les travailleurs sont censés avoir abusé de leur carte de crédit pendant le boom, et maintenant nous le paierions en devant nous serrer la ceinture.
Un 'boom' qui n'a jamais existé
Comme tous les meilleurs gros mensonges, celui-ci contient des éléments de vérité. Le crédit s'est certainement développé à un rythme insoutenable à tous les niveaux de l'économie et le dernier crach est arrivé parce que cette énorme accumulation de capital fictif ne pouvait plus être valorisée. La propagation folle de crédit était en réalité une politique consciente de la bourgeoisie et la dernière d'une longue lignée de tentatives pour surmonter la stagnation chronique qui a dominé le paysage économique depuis les années 1970.
Mais un mensonge particulièrement insidieux est que la classe ouvrière a joui d'une sorte de renaissance au cours du 'boom'. En fait, la croissance moyenne annuelle au Royaume-Uni pendant la période allant de 1992 à 2008 était de 2,68%, avec une croissance de pointe beaucoup plus faible que dans les décennies précédentes. Ceci est légèrement en dessous de la moyenne de 2,9% ,atteinte lors du boom d'après-guerre, où la Grande-Bretagne était nettement en retard sur ses rivaux. L'idée d'un boom « insoutenable » est donc en contradiction avec l'évidence d'une expansion plus modérée. Le prétendu 'boom du crédit' n'est donc rien de plus qu'un boom dans l'expansion du crédit, et, en dépit de cette énorme injection de crédit, l'économie réelle elle-même n'a progressé que modestement.
Un 'boom de la consommation' sans prospérité
Si la croissance économique réelle ne correspondait pas exactement à l'idée d'un boom, qu'en est-il de la situation de la classe ouvrière? En l'an 2000, 4,5 millions de travailleurs âgés de plus de 22 ans subsistaient avec moins de 7 £ de l'heure2, soit environ 40% des travailleurs de cette tranche d'âge. En 2010, leur nombre était de 3,5 millions, soit 32% de la population active. Donc, le nombre de travailleurs avec de bas salaires payés sur une base horaire a baissé assez fortement, bien que 32% de la population active vivant avec des salaires très bas soit toujours une statistique surprenante pour un supposé boom.
La montée du travail à temps partiel obscurcit partiellement la réalité derrière les chiffres bruts de salaires légèrement en baisse. Le nombre de travailleurs à temps partiel et de travailleurs temporaires qui n'ont pas choisi ces conditions de travail parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de travail à temps plein ou d'emploi permanent a culminé en 1994 avec, respectivement, environ 846 000 et 650 000 travailleurs. Le temps partiel non choisi avait atteint son plus faible niveau (environ 550 000) en 2004 avant de recommencer à augmenter. Le travail temporaire involontaire s'est porté un peu mieux, en restant juste en dessous de 400 000, avant de recommencer à augmenter en 2009. Dès le début de l'année 2010, le temps partiel non choisi a atteint un nouveau pic de plus d'un million. Le travail partiel involontaire n'a pas encore atteint le sommet précédent, mais la tendance est à la hausse3.
Les chiffres ci-dessus suggèrent peut-être de légères améliorations, du moins pour ceux qui travaillent, au moins jusqu'à ce que la récession ne frappe. Mais les indicateurs couvrant l'impact plus large de la pauvreté brossent un tableau plus déprimant. En 1992, le nombre de personnes à faible revenu (égal ou inférieur à 60% du salaire moyen, c'est à dire le point dans l'échelle des revenus où la moitié de la population obtient plus et l'autre moitié reçoit moins) a culminé à environ 14,5 millions. Cela a légèrement baissé l'année suivante et une lente tendance à la baisse a suivi, pour finalement atteindre son plus bas niveau en 2004-2005, juste au-dessous de 12 millions. Depuis, ce chiffre est en hausse. Toutefois, ceux qui reçoivent moins de 40% du salaire moyen ne sont jamais descendus en dessous des 4 millions et leur nombre a lentement mais régulièrement augmenté4.
Pire encore, « Le salaire moyen au Royaume-Uni a stagné de 2003 à 2008, malgré une croissance du PIB de 11% au cours de cette période. Des tendances similaires sont évidentes dans d'autres économies avancées, des Etats-Unis à l'Allemagne. Depuis quelque temps, le salaire de ceux de la moitié inférieure dans la répartition des gains n'a pas réussi à suivre le chemin de la croissance économique globale. »5
La part de la valeur générée dans l'économie qui revient aux travailleurs a considérablement baissé au cours des dernières décennies: « En 1977, sur 100 livres de valeur générée par l'économie britannique, 16 £ sont allées aux salaires des travailleurs qui sont dans la moitié inférieure ; en 2010 ce chiffre est tombé à 12 livres, soit une baisse de 26%. De façon contrastée, 39 £ sont allée aux salaires des travailleurs qui sont dans la moitié supérieure ... et 39 £ sont allées aux entreprises et aux propriétaires, sous forme de profits»6.
La situation actuelle
Le chômage a (selon les chiffres officiels) atteint un sommet, après 17 années de hausse, avec 2,57 millions de chômeurs représentant 8,1% de la population en âge de travailler. Le nombre de ceux recevant des prestations est de 1,6 millions. En 2008-2009 (les données les plus récentes), 13,5 millions vivaient en dessous du seuil de pauvreté, avec une prévision d'augmentation de ce chiffre, selon ce que l'IFS appelle «la plus grande chute du revenu moyen en trois ans, depuis 1974-19777».
Le taux d'inflation a atteint 5,2%, d'après l'indicateur de mesure CPI, ou 5,6%, selon l'indicateur RPI. Mais ces chiffres globaux n’évaluent pas l'impact de l'inflation sur les plus pauvres, pour lesquels la hausse du coût réel de la vie est considérablement plus élevée. Un rapport a démontré que, en 2008-2009, l'inflation subie en réalité par 20% de la population la plus pauvre est de 4,3%, au lieu du chiffre global de l’indicateur RPI qui est de 2,4%8.
La classe ouvrière a connu une récession permanente
En conclusion, le prétendu 'boom' a eu un impact minime sur les conditions de vie réelles de la classe ouvrière. Les chiffres de la pauvreté globale ont légèrement baissé et ceux concernant les plus pauvres ont vraiment augmenté. Alors que le nombre de personnes ayant de bas salaires a légèrement baissé, le revenu moyen a stagné à nouveau, ce qui montre la pression salariale globale à la baisse du niveau de vie exercée sur la majorité de la classe ouvrière. Et ce peu d'amélioration qui a été constaté est destiné à être balayé par la nouvelle plongée dans la crise.
Si la dernière décennie a semblé être un boom pour la classe dirigeante et ses médias, c'est parce que sa part de la richesse sociale a augmenté énormément. L'augmentation « insoutenable » du niveau de vie, tellement déplorée par la classe dirigeante, a consisté en une légère réduction de l’extrême pauvreté. Le plus petit nombre de gens réduits à la pauvreté depuis 1990 a été le chiffre de 12 millions en 2004-2005. Pour relativiser ce ’bon résultat’, il convient de rappeler qu'en 1982, à la fin d'une récession brutale, le nombre de personnes dans la pauvreté, avec la même mesure, était seulement de 8 millions. Pour la classe ouvrière et en particulier ses membres les plus pauvres, la période du prétendu 'boom' a été pire en termes de conditions de vie que les récessions des périodes précédentes !
Ce 'boom qui n'a jamais existé', avec lason prétenduesoi-disant «insoutenable» élévation du niveau de vie qu'il aurait apporté, est une illusion totale. Il devrait plutôt être considéré comme le faible grésillement du feu mourant du capitalisme, payé par l'exploitation massive et la perte de dignité pour des millions de personnes au sein de la classe ouvrière.
Ishamael (5 novembre)
1 Pourquoi la réduction du niveau de vie est très souhaitable, Telegraph, 10 novembre 2011.
2 The Poverty Site - www.poverty.org.uk/51/index.shtml?2 [4].
3 Sources : Les Tendances dans le Temps Partiel et dans le Travail Temporaire, Institute of Publc Policy Research.
4 Sources : Suivi de la pauvreté et de l'exclusion sociale 2010, Joseph Rowntree Foundation.
5 Pourquoi les travailleurs ordinaires connaissent une croissance sans gain, The Resolution Foundation, juillet 2011. Epuisé.
6 Ibid.
7Au Royaume-Uni,, une forte hausse de la pauvreté, déclaration d'IFS, BBC New Online, 10 novembre 2011, https://www.bbc.co.uk/news/education-15242103 [5]
8 L'inflation est 'plus élevée pour les pauvres que pour les riches', BBC News Online.
Récent et en cours:
- Crise économique [2]
Rubrique:
ICConline - février 2012
- 1438 lectures
La plongée dans la misère de la Grèce : c’est ce qui nous attend tous
- 1817 lectures
Face au énième plan d’austérité imposé à la population grecque, la colère a fait irruption dans la rue. Entre 80 000 et 200 000 personnes se sont rassemblées devant le parlement, place Syntagma, lors du vote d’adoption des mesures par les députés dans la nuit du 12 au 13 février et se sont affrontées à la police anti-émeutes. Le bilan brut de ce que les médias ont appelé cette « nuit de guérilla urbaine » fait ressortir que 48 bâtiments ont été brûlés et que 150 magasins ont été pillés. On dénombre aussi une centaine de blessés et 130 arrestations. Les images de ces scènes de violence et d’Athènes en flammes ainsi que les décombres fumants, filmés au petit matin, évoquant des ravages de guerre ont été complaisamment passés en boucle par les médias pour impressionner et effrayer le reste du monde. Mais selon de nombreux témoignages sur le web, près de 300 000 personnes n’ont pu accéder à la place où se situe le parlement, bloquées par la police dans les rues adjacentes ou à la sortie du métro. Et c’est la police qui a commencé dès 17 heures à jeter des gaz lacrymogènes sur la place pour disperser et pourchasser la foule par petits groupes dans tout le centre ville. On a parlé de jeunes casseurs alors qu’on a vu beaucoup de femmes et d’hommes d’âge mûr et âgés participer aux violences ou les encourager. Que les incendies ou les déprédations aient été l’œuvre de provocateurs ou le produit d’actes désespérés, la rage de la population était indéniable comme en témoignaient les images de ceux qui lançaient des pierres ou des cocktails Molotov contre les forces de répression.
Des mesures d’austérité sans précédent dans une situation d’impasse pour la bourgeoisie
Le dernier train de mesures imposées par la « troïka » (le Fonds Monétaire International, l’Union Européenne et la Banque Centrale Européenne) est particulièrement intolérable. Tous les manifestants poussaient le même cri : on ne peut plus nourrir sa famille ni faire soigner ses enfants, on ne veut plus continuer à se faire étrangler de la sorte. Qu’on en juge :
- abaissement du SMIC de 22% (ramené de 750 à 480 euros) et de 32% pour les emplois de jeunes de moins de 25 ans, ce qui donne une idée de l’ampleur de l’amputation des salaires ;
- pour la plupart des prolétaires, les salaires ont été divisés par 2 en moyenne depuis un an.
S’y ajoutent :
-la suppression immédiate ou à terme de 15 000 fonctionnaires payés un ou deux ans avant leur licenciement à 60% de leur salaire de base ;
- la réduction du montant des pensions de retraite ;
- la limitation à un an du versement d’une allocation de chômage ;
- la suppression des hausses automatiques de salaires, y compris celles basées sur l’ancienneté ;
- la réduction du budget de la sécurité sociale, privant une large couche de la population de tout remboursement de soins ;
- la limitation à trois ans des accords collectifs concernant les conventions salariales.
Et cette liste n’est pas exhaustive ! Ainsi, le taux de chômage officiel en novembre 2011 était de 20,9 % (en hausse de 48,7% en un an). Le taux de chômage des jeunes entre 18 et 25 ans avoisine 50%.
En deux ans, le nombre de sans-domicile fixe a augmenté de 25% et la famine menace : la faim est devenue une préoccupation quotidienne pour beaucoup, comme au temps de l’occupation qu’a connue le pays lors de la Seconde Guerre mondiale.
Le témoignage d’un médecin d’une ONG est rapporté dans le quotidien Libération daté du 30 janvier 2012 : « J’ai commencé à m’inquiéter lorsqu’en consultation j’ai vu un, puis deux, puis dix enfants qui venaient se faire soigner le ventre vide, sans avoir pris aucun repas la veille. »
Le nombre de suicides a doublé en deux ans, notamment chez les jeunes, une personne sur deux souffre de dépression, le surendettement des ménages explose.
Le rejet quasi-unanime du dernier plan d’austérité a été tel qu’au moment de son vote, une centaine de députés s’en sont retirés ou s’y sont opposés, y compris une quarantaine appartenant aux deux grandes formations majoritaires de droite comme de gauche, se désolidarisant ainsi de la discipline de vote de leur parti. La situation est de plus en plus chaotique : alors que les deux grands partis traditionnels sont totalement discrédités, ceux qui forment la Nouvelle Démocratie (conservateurs) comme le Pasok, après 3 ans de pouvoir « social-démocrate », rassemblent à eux tous autour de 25% des intentions de vote. Dans ce climat général, la bourgeoisie va avoir les pires difficultés pour organiser les prochaines élections législatives annoncées pour le mois d’avril. D’autant que la décision de débloquer les 130 milliards d’euros prévus par le plan d’aide, qui devait accompagner le vote des mesures d’austérité par le parlement grec, a été reportée par les ministres des finances de l’UE à la semaine suivante. Car les pressions et les réticences des 3 pays de l’UE encore dotés du triple A, en particulier l’Allemagne, qui préféreraient voir la Grèce se déclarer en faillite et quitter l’UE plutôt que de la traîner comme un boulet se font de plus en plus fortes.
Et la Grèce n’est qu’un maillon de cette chaîne d’austérité brutale qui enserre déjà nombre de pays européens. Il n’y a aucune illusion à se faire ! Après la Grèce, la « troïka » s’est déplacée au Portugal pour adresser la même mise en demeure. L’Irlande sera mise sur la sellette dans la foulée. Puis ce sera le tour de l’Espagne et de l’Italie ; même le nouveau président du Conseil italien Mario Monti installé au pouvoir pour faire avaler la même potion amère s’inquiète pour l’avenir réservé à son pays quand il conteste la « dureté avec laquelle la Grèce est traitée. » La France, dont l’économie vacille de plus en plus, se trouvera prochainement sur la liste. En Allemagne même, dont on nous vante la santé et la solidité économiques, on voit une partie grandissante de sa population, et particulièrement les étudiants, s’enfoncer dans la précarité. L’Europe n’est pas et ne sera pas la seule zone touchée et aucun pays dans le monde ne sera épargné. Il n’ya a pas de solution à une crise mondiale qui révèle ouvertement la faillite totale du système capitaliste.
Comment se battre contre les attaques ?
Une enseignante désespérée déclarait : « Avant la crise, je touchais 1200 euros, désormais j’en touche 760. A chaque jour de grève, ils me ponctionnent 80 euros et les mesures sont rétroactives : ce mois-ci j’ai perçu que 280 euros. Ca ne vaut plus le coup de travailler, autant manifester et tout casser pour qu’ils comprennent qu’on ne va pas se laisser faire. »
Cette exaspération et cette colère dont elle témoigne se généralisent et se sont vues encore renforcées par la stérilité avérée et l’impuissance à faire reculer les plans de rigueur successifs des journées de grèves générales de 24 ou 48 heures à répétition depuis 2 ans appelées par les deux principaux syndicats, l’ADEDY (fonction publique) et le GSEE (secteur privé) liés au Pasok) qui se partagent le travail avec le PAME, courroie de transmission du parti communiste pour diviser les travailleurs comme pour encadrer et défouler le ras-le-bol.
Dans cette situation, l’agitation sociale en Grèce est intense et la solidarité tente de s’organiser. Des assemblées sont organisées dans les quartiers, dans les villes et les villages, des cantines ou des distributions de nourriture se sont mis en place, l’occupation de l’université de Novicki se donnait pour but de servir de lieu d’échange et de débats. Il y a eu des occupations de ministères (Travail, Economie, Santé), de conseils régionaux (dans les îles Ioniennes ou en Thessalie), de la centrale électrique de Megalopolis, de la mairie de Holargos, tandis que les producteurs ont distribué du lait ou des pommes de terre à la population. Une action d'auto-organisation des travailleurs s’est déroulée au journal Eleftherotypia qui emploie 800 personnes.
Mais la réaction la plus significative qui montre la détermination du mouvement en Grèce illustre aussi de façon concentrée toutes ses faiblesses et ses illusions. Elle a eu lieu à l’hôpital de Kilkis en Macédoine centrale au Nord du pays, où le personnel hospitalier réuni en assemblée générale a décidé de se mettre en grève et d’occuper l’hôpital pour réclamer la part de leur salaire impayé tout en prenant l’initiative de continuer à faire fonctionner les urgences et à prodiguer des soins gratuits aux plus démunis. Ces travailleurs ont lancé un appel en direction des autres travailleurs qui proclame que « la seule autorité légitime pour prendre les décisions administratives sera l'Assemblée générale des travailleurs ». Nous reproduisons sur notre site une traduction de cet appel [6] (Source https://nantes.indymedia.org/posts/34858/article-2-laurent-berger-a-vendu-le-morceau/ [7]) qui manifeste une claire volonté de ne pas rester isolés en appelant non seulement les autres hôpitaux mais tous les travailleurs de tous les secteurs à les rejoindre dans la lutte. Cependant, cet appel traduit aussi beaucoup d’illusions démocratiques, en voulant s’appuyer sur « une réaction citoyenne » et sur une indistincte « union populaire », « avec la collaboration de tous les syndicats et organisations politiques progressistes et les médias de bonne volonté ». Il est également lourdement imprégné de patriotisme et de nationalisme : « Nous sommes déterminés à continuer jusqu'à ce que les traîtres qui ont vendu notre pays s’en aillent », qui sont de véritables poisons pour l’avenir de la lutte. C’est en effet le principal facteur de pourrissement de ce mouvement « populaire » en Grèce qui reste enlisé et englué dans ce piège du nationalisme et des divisions nationales que tendent les politiciens et les syndicats et qu’ils ne manquent pas d’entretenir par tous les moyens. Au cœur des manifestations flottaient partout des drapeaux grecs. Tous les partis et les syndicats poussent à exacerber un sentiment de « fierté nationale bafouée ». En pointe de cette démagogie populiste, le parti communiste grec (le KKE), qui joue le même rôle que Le Pen père et fille en France, ne cesse de diffuser cette propagande chauvine largement attisée par les principaux partis poussant vers l’impasse de la défense des intérêts du pays : le gouvernement est accusé de vendre et même de brader le pays à l’étranger, d’être un traître à la défense de la nation. On inocule l’idée que le responsable de la situation n’est pas le système capitaliste lui-même mais que ce serait la faute de l’Europe de l’Allemagne ou encore des Etats-Unis. Ce véritable poison qui dévoie le combat de classe sur le terrain pourri de divisions nationales où s’exerce précisément la concurrence capitaliste représente non seulement une impasse mais il constitue un obstacle majeur au développement nécessaire de l’internationalisme prolétarien. Nous n’avons pas d’intérêt national à défendre. Notre lutte doit se développer et s’unifier au-delà des frontières. C’est pourquoi il est vital que les prolétaires des autres pays rentrent en lutte et montrent par là que la réponse des exploités du monde entier face aux attaques du capitalisme n’est pas et ne peut pas être sur le terrain national.
W. (18 février))
Géographique:
- Grèce [1]
Récent et en cours:
- Crise économique [2]
L’hôpital de Kilkis en Grèce sous le contrôle des travailleurs
- 1776 lectures
|
|
| |
Les travailleurs ont rendu publique la déclaration suivante le 4 février dernier : 1. Nous reconnaissons que les problèmes actuels et durables du Système national de santé et des organisations apparentées ne peuvent pas être résolus par des revendications spécifiques et isolées ou pour nos intérêts particuliers, car ces problèmes sont le résultat d'une lutte plus générale contre la politique antipopulaire du gouvernement et du néolibéralisme globalisé. 2. Nous reconnaissons également qu'en insistant sur la mise en avant de ce type de revendications, nous participerions au jeu implacable du pouvoir, qui, afin de répondre à son ennemi – c’est-à-dire le peuple fragilisé et divisé -, essaye d'éviter la création d’un Front populaire universel au niveau national et mondial, avec des intérêts communs et des revendications contre l'appauvrissement social provoqué par la politique du pouvoir. 3. Pour cette raison, nous plaçons nos intérêts particuliers dans le cadre des revendications politiques et économiques exprimées par une grande partie du peuple grec souffrant aujourd'hui de l'attaque brutale du capitalisme ; ces revendications, pour connaître le succès, doivent être portées jusqu’au bout, en coordination avec les classes moyennes et inférieures de notre société. 4. Le seul moyen d’y parvenir est la remise en cause, par l'action, non seulement de la légitimité politique, mais aussi la légalité de l’arbitraire autoritaire et antipopulaire d'une hiérarchie qui se dirige à grande vitesse vers le totalitarisme.
Hôpital général de Kilkis
5. Nous travailleurs de l'Hôpital général de Kilkis, nous répondons à ce totalitarisme par la démocratie. Nous occupons l'hôpital public et le mettons sous notre contrôle direct et total. Dorénavant l’Hôpital général de Kilkis aura un gouvernement autonome et la seule autorité légitime pour prendre les décisions administratives sera l'Assemblée générale des travailleurs. 6. Le gouvernement n'est pas dégagé de ses obligations financières en ce qui concerne la dotation et l’approvisionnement de l'hôpital, mais s’il continue à ignorer ces obligations, nous devrons informer le public à ce sujet et nous nous tournerons vers l'administration locale et, surtout, vers la société tout entière pour qu’elles nous soutiennent de toutes les manières possibles en vue de: (a) la survie de notre hôpital, (b) un soutien général au droit aux soins de santé publics et gratuits, (c) le renversement, par une lutte populaire commune, du gouvernement actuel et la cessation de tout autre politique néolibérale, quelle que soit sa source et (d) une démocratisation profonde et substantielle, à savoir que ce soit la société, et non des tiers, qui soit responsable des décisions sur son avenir. 7. À partir du 6 février, le comité des travailleurs de l'hôpital de Kilkis limitera le travail aux seules urgences jusqu'au paiement intégral des heures travaillées et le retour aux niveaux de salaires antérieurs à l'arrivée de la Troïka ( CE, BCE et FMI). Entre-temps, bien conscients que nous sommes de notre mission sociale et de nos obligations morales, nous veillerons à la santé des citoyens qui viennent à l'hôpital en fournissant des soins gratuits et un hébergement aux nécessiteux et nous continuerons à exiger que le gouvernement prenne ses responsabilités et mette fin à sa politique cruelle, excessive et antisociale.
8. Nous avons convenu de tenir une nouvelle assemblée générale le lundi 13 Février dans l'auditorium du nouveau bâtiment de l’hôpital à 11 heures, où nous déciderons des procédures nécessaires pour mettre en œuvre efficacement l'occupation des services administratifs et mener à bien l’autogestion de l’hôpital, qui commencera ce jour-là. Nous tiendrons chaque jour une assemblée générale, qui sera l'instrument fondamental de prise de décisions sur les employés et fonctionnement de l'hôpital. Nous appelons à la solidarité du peuple et des travailleurs de tous les secteurs, avec la collaboration de tous les syndicats et organisations progressistes et le soutien de tous les médias qui choisissent de dire la vérité. Nous sommes déterminés à continuer jusqu'à ce que les traîtres qui ont vendu notre pays s’en aillent. C'est eux ou nous ! Les décisions ci-dessus seront rendues publiques lors d'une conférence de presse à laquelle sont invités tous les médias (locaux et nationaux), le mercredi 15/2/2012 à 12h 30. Nos AG quotidiennes débuteront le 13 février. Nous informerons les citoyens de tous les événements importants qui se déroulent dans notre hôpital par des communiqués et des conférences de presse. En outre, nous utiliserons tous les moyens disponibles pour faire connaître ces faits afin que cette mobilisation réussisse. Nous appelons : a) nos concitoyens à manifester leur solidarité avec notre effort, b) tous les citoyens qui reçoivent un traitement injuste de notre pays à la contestation, à s'opposer à leurs oppresseurs, c) nos camarades travailleurs d'autres hôpitaux à prendre des décisions similaires, d) les salariés dans d'autres branches des secteurs public et privé et les adhérents des organisations de travailleurs et progressistes, à agir dans le même sens, afin que notre mobilisation devienne une résistance ouvrière et populaire universelle et une insurrection, jusqu’à notre victoire finale sur l'élite économique et politique qui aujourd'hui opprime notre pays et le monde. |
ICConline - mars 2012
- 1644 lectures
Face à l’escalade répressive à Valence (Espagne)
- 1660 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d'un article réalisé par nos camarades d'Accion Proletaria, organe de presse du CCI en Espagne.
Mercredi 15 février, la police a réprimé les lycéens et les étudiants qui avaient arrêté la circulation dans la rue de Xativa à Valence lors de leur manifestation contre les coupes budgétaires. Un jeune mineur a été arrêté. Depuis, les manifestations et les rassemblements se succèdent, l’État répondant par une véritable escalade dans la répression : 17 personnes arrêtées et, traitées de façon humiliante, en particulier les jeunes filles, insultées grossièrement, traînées par terre… Ceux qui se sont rassemblés face au bâtiment de police de Zapadores ont été victimes d’un piège et fichés un par un.
Face à de tels actes, nous voulons exprimer notre solidarité avec tous les emprisonnés, notre soutien à toutes les manifestations de solidarité qui ont eu lieu ainsi qu’à l’attitude des habitants du quartier de Zapadores qui « ont montré leur soutien à ceux qui s’étaient rassemblées en laissant glisser depuis leurs balcons des bouteilles d’eau et autres rafraîchissements, ce qui a provoqué les applaudissements des manifestants »1.
Pourquoi utiliser une répression si brutale contre des jeunes lycéens ?
Une première piste est que ces méthodes ont été employées de façon réitérée dans d’autres pays pour affronter les protestations sociales massives : on peut donc dire que les gouvernants espagnols suivent l’exemple. En France, lors des manifestations contre la réforme des retraites, la police a tendu un piège à 600 jeunes à Lyon, en les fichant un par un, comme aujourd’hui à Valence. Et c’est la même chose que le gouvernement de Cameron a faite à Trafalgar Square, à Londres, lors des mobilisations contre l’augmentation des droits d’inscription à l’université. Le but poursuivi est de prendre les jeunes comme tête de turc pour lancer un avertissement aux nombreux manifestants qui occupent les rues. Voilà ce qu’ils cherchent à faire aussi à Valence. Ils ne peuvent pas se permettre d’affronter des milliers de manifestants, ils choisissent donc quelques centaines de jeunes.
Une deuxième réponse - qui vient compléter la première - est celle de vouloir nous entraîner dans une espèce de spirale d’actions-réactions, avec des arrestations permanentes, des mobilisations, encore d’autres arrestations, de sorte que le mouvement finisse par s’épuiser, et que les buts centraux, la lutte contre les coupes et la réforme du travail, passent au second plan. En Grèce, le gouvernement "socialiste" de Papandreou a employé à foison ces méthodes, n’hésitant pas à utiliser des flics provocateurs pour mettre en place des actes de vandalisme qui, à leur tour, servaient à « justifier » les charges policières et les arrestations massives.
Un autre objectif est celui de créer un climat de tension qui nous pousse à des répliques improvisées et inconscientes. Et c’est ainsi, grâce à l’ambiance provoquée par le pouvoir et sa police, que l’occupation ouverte à tous les travailleurs, aux lycéens et aux étudiants, de TOUS LES SECTEURS, qui était prévue pour lundi 20 février, a dû être annulée.
Finalement, un des objectifs de la répression est en lien avec les traditions de la droite espagnole. Celle-ci s’est distinguée historiquement par son arrogance provocatrice et sa brutalité répressive. Le gouvernement actuel de droite se vautre sans le moindre scrupule dans cette attitude et on pourrait dire qu’il s’en délecte. Tout cela convient parfaitement à l’État et au capital espagnol pris dans leur ensemble pour nous faire dévier vers la défense de la démocratie - prétendument menacée par cette droite-là - et vers une lutte pour des alternatives « moins répressives et plus sociales », alors que la seule solution est celle de lutter contre le capitalisme sous toutes ses formes et toutes ses couleurs politiques.
Les pièges politiques qu’il faut éviter
Un jeune, devant le déchaînement répressif de Valence, criait : « C’est la Syrie ici ! ».
Et il avait raison sur un point : l’État – qu’il soit démocratique ou ouvertement dictatorial comme celui de la clique d’Al-Assad - n’hésite pas une seconde à appliquer une répression brutale quand les intérêts de la classe capitaliste sont en jeu. Cependant, il existe une différence entre l’Etat démocratique et l’État dictatorial. Le premier est capable d’employer la répression avec intelligence politique, en assenant des coups mais accompagnés de manœuvres politiques pour dévoyer, diviser et démobiliser. Ceci le rend plus cynique et dangereux, parce qu’une répression accompagnée de manœuvres de division et de pièges, politiques et idéologiques, fait beaucoup plus de mal qu’une répression pure et dure.
Le piège de montrer la répression comme si c’était une spécialité exclusive de la droite a le grand avantage de rendre présentable l’Etat et ce qui est derrière lui, le Capital et la bourgeoisie. N’y a-t-il pas une continuité entre ce que le gouvernement du PSOE a réalisé (comme coupes sociales autant qu’en répression) et ce qu’accomplit le gouvernement actuel ? En regardant le reste du monde, ne constate-t-on pas que, quel que soit le type de gouvernement, les choses ne font qu’empirer ?
Le piège qui consiste à s’acharner sur des jeunes, ce qui montre déjà une abjecte pleutrerie, a comme objectif de créer une fracture entre les générations, de les diviser, ce à quoi se sont prêtés quelques représentants politiques et syndicaux en disant sur un ton paternaliste que les jeunes « se sont laissés entraîner par la passion » ou « qu’ils n’en ont fait qu’à leur tête dans les protestations ».
Le piège se referme avec les « alternatives » de la si « loyale » opposition (le PSOE, Izquierda Unida, etc.) qui déplorent cette « répression disproportionnée », autrement dit ces messieurs proposent une répression « proportionnée », « contrôlée », une façon de bien légitimer la répression. En plus, ils ont demandé la démission de la Déléguée du Gouvernement [central] en faisant croire ainsi qu’en mettant un autre politicien à ce poste bureaucratique, il n’y aurait plus de répression ou qu’elle serait plus « douce ».
Il faut rejeter ces pièges !
On ne peut pas répondre à la répression avec des « demandes de démission » de tel ou tel représentant, ni en réclamant « plus de démocratie ». Et non plus en « modérant » les revendications pour faire des concessions. Tout cela ne fait que rendre l’Etat encore plus déterminé et plus fort.
Face à la répression, on doit répondre en rendant encore plus massives les manifestations, les rassemblements et les assemblées. Il faut aller vers une assemblée générale de travailleurs, étudiants, chômeurs, qui demande le soutien aux travailleurs du reste de l’Espagne, des autres pays, qui revendique le retrait de la Réforme du code du travail et l’annulation des coupes tout en rejetant les agissements de la police et en demandant la libération sans suite de tous les détenus.
Nous devons tous nous mobiliser, les jeunes et les moins jeunes, les chômeurs et les actifs, les employés publics et ceux du privé, toutes les générations ensemble. La seule possibilité que nous ayons de les faire reculer est celle d’une action conjointe, massive et solidaire. On sait très bien, cependant, que tout recul que nous réussirons à imposer ne sera que temporaire parce que le pouvoir reviendra à la charge avec de nouvelles têtes et de nouvelles méthodes. On a vu ainsi qu’on a changé le PSOE pour le PP qui a continué à frapper encore et encore, comme on l’a vu en Grèce où le Parti dit socialiste a été remplacé par un gouvernement d’Union nationale, qui comprend des néofascistes. Face à tout cela, nous ne pourrons avancer vers une solution des très graves problèmes qui nous assaillent que si notre lutte prend le chemin de la transformation révolutionnaire de cette société.
Accion Proletaria (19 février)
1 Source : www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/02/17/seis-arrestados-nueve-heridos-dia-13003388.html [8]
Géographique:
- Espagne [9]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [3]
Rubrique:
La bourgeoisie accuse le poignard pour épargner l’assassin
- 1298 lectures
Au début du mois de février, l’Europe a subi une vague de froid de 13 jours particulièrement meurtrière. Le bilan de la catastrophe s’élève, officiellement, à plus de 600 morts. Bien que personne n’ignore que les chiffres officiels sont largement sous-evalués, une nouvelle fois, la classe dominante a fait en la circonstance la démonstration de son cynisme le plus répugnant.
Évidemment, les personnes sans-logis sont les principales « victimes du froid ». Quand les foyers d’accueils existent, les places sont bien souvent insuffisantes et à ce point répugnantes ou insécures que de nombreux sans-abris préfèrent encore dormir dehors. Dans tous les pays, les actions telles que «l es maraudes »1 sont invariablement dérisoires au vu des besoins. En France, par exemple, des mesures conséquentes étaient enfin adoptées alors que les thermomètres indiquaient déjà -20°C dans de nombreuses régions. Mais la bassesse de la classe dominante n’a pas de fond ; le défunt président Pompidou face aux manifestations de mai 1968 avait déclaré : « passé les bornes, il n’y a plus de limites ». Mais la bourgeoisie, elle, sait toujours dépasser celles de l’indécence et nous surprendre par son ignominie illimitée. Tandis que ceux qui sont rejetés à la rue par le capitalisme crevaient, dans l’indifférence des puissants bien au chaud dans le confort de leurs riches demeures, les « pouvoirs publics » déployaient des trésors d’ingéniosité pour tenter de déneiger les routes. En Italie, où le froid a fait 45 victimes, la seule ville de Rome a distribué 10 000 pelles, et déployé 700 camions chasse-neige. Plusieurs centaines de morts dans les rangs des ouvriers « improductifs » ne préoccuperont jamais nos bourgeois, mais il fallait que les salariés soient en mesure de se déplacer jusqu’à leurs lieux de travail pour s’y faire exploiter.
Les prolétaires savent que la barrière qui les sépare de la rue est chaque jour plus mince. Il fallait donc en profiter pour souffler le froid et le chaud dans la population en « rassurant » par des « exemples » de pays comme l’Ukraine, où le froid a été le plus meurtrier. « Regardez, c’est bien pire ailleurs ! »
En même temps,, le problème des victimes était noyé au milieu des témoignages de ménagères effrayées par le verglas, des reportages sur la qualité des opérations de déneigement et de tout le battage sur les prétendues consommations « records » d’électricité, histoire de faire rentrer dans les têtes la nécessité du nucléaire. Surtout, il fallait expliquer, de mille et une façons possibles, que c’est le froid qui tue, pas le capitalisme : « Le bilan du froid s'alourdit avec plus de 600 victimes en Europe2 », « La vague de froid, qui doit se poursuivre dans les prochains jours, a fait au moins 12 morts en France3 », « La vague de froid tue encore en Europe de l'Est4 », etc.
Mais depuis quand le froid est responsable du nombre croissant d’ouvriers jeté à la rue ? Le système capitaliste agonisant n’est simplement plus en mesure d’apporter des solutions au chômage, à l’exclusion et à la misère qui se développent à un rythme infernal. Le caractère massif de la catastrophe a fait sensation, mais chaque jour, de très nombreux ouvriers sans-abris meurent de froid, de malnutrition ou de l’absence de soins médicaux au cœur des pays les plus développés, où de plus en plus de prolétaires sont plongés dans une misère et un dénuement croissants c’est-à-dire rien qui s’apparente de près ou de loin à une malheureuse fatalité..
V (16 février)
1 En France, une maraude est un passage en véhicule Croix-Rouge dans les rues où vivent des personnes défavorisées, dans le but de leur distribuer une soupe chaude, un petit sac de denrées alimentaire ou simplement un peu de réconfort.
2 LeMonde.fr, le 13/02/2012.
3 Reuters, le 10/02/2012.
4 L’express, le 12/02/2012
Rubrique:
La lutte des électriciens en Grande-Bretagne : les illusions sur les syndicats mènent à la défaite
- 1859 lectures
Nous publions ci-dessous la traduction d'un article réalisé par nos camarades de World Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne.
Depuis cinq mois, les électriciens manifestent, font des piquets pour élargir la résistance aux nouvelles conditions crées par l’accord de la Building Engineering Services National Agreement (BESNA), accord qui implique une déqualification et une réduction des salaires d’environ 30%. Des réunions de protestation, des piquets forts de plusieurs centaines d’ouvriers, se sont tenus à l’extérieur des sites de construction gérés par les 7 firmes BESNA, chaque semaine, dans tout le pays, à la recherche du soutien d’électriciens – quel que soit l’endroit où ils travaillent et pour quelle compagnie, qu’ils soient syndiqués ou non – et d'étudiants quand ils manifestaient aussi à Londres le 9 novembre, d’Occupy London devant la cathédrale Saint Paul. Là où ils ont cherché la solidarité, ils l’ont trouvée, au moins de la part d’une minorité. Le 7 décembre, ils s’attendaient à être en grève générale après que celle-ci ait été votée à 81 %, sauf que ce résultat a été contesté par les employeurs et qu’il n’y a finalement pas eu d’appel officiel à la grève. Beaucoup d’entre eux ont pris part à une grève sauvage, accompagnée de piquets composés de plusieurs centaines d’ouvriers allant de site en site.
Cependant, malgré ces efforts, les électriciens sont de plus en plus frustrés par le fait que leur lutte ne se développe pas, sachant que le niveau actuel de l’action n’est pas suffisant pour défendre leurs salaires et leurs conditions de travail actuelles – qui ne sont dans certains cas pas toujours respectées, en particulier par les agences. L’action de grève, en particulier, est toujours retardée. Pour rendre les choses pires encore, après des mois pendant lesquels le syndicalisme de base a appelé les ouvriers à ne pas signer le nouvel accord, à ne pas céder au chantage des employeurs qui menacent de supprimer leurs jobs s’ils ne le font pas, le syndicat Unite1 a maintenu son conseille de signer les accords de façon à garder leur travail. « J’ai reçu ma lettre d’Unite qui nous dit de signer le BESNA… Nous sommes vendus par le syndicat et le vote n’a même pas encore eu lieu », « Je peux comprendre ce qu’ils pensent d’un point de vue légal, mais le moment ne pouvait être pire. » (posts sur www.electriciansforums.uk [10])
Pourquoi est-il si dur de lutter aujourd’hui ?
C’est de toute évidence une période difficile, la classe ouvrière dans son ensemble voit ses salaires diminuer et même ceux qui ne subissent pas de réduction de salaire nominal gagnent moins à cause de l’inflation. Le chômage est élevé, les boulots sont rares. La lutte dans l’industrie du bâtiment, avec l’obligation de se déplacer d’un site à l’autre, la mise sur liste noire des militants, demande un réel courage.
Mais il y a plus. Les électriciens combatifs ont passé tous ces mois à faire pression sur Unite pour qu’il organise un vote et des actions de grève, et maintenant, ils attendent que cela conduise à une grève en février – après que beaucoup ont été forcés de signer le nouvel accord sous peine de perdre leur travail. Une fois que la grève aura commencé à Balfour Beatty, ils espèrent qu’elle s’étendra à d’autres sites. Les porte-paroles du syndicalisme de base aux piquets à Londres étaient très contents que Len McCluskey (secrétaire général de Unite) leur ait promis son soutien au début de l’année, y compris un budget illimité pour la lutte, et qu’il y ait un représentant élu des syndicalistes de base à toutes les réunions en vue d’empêcher toute trahison.
La frustration vis-à-vis des tactiques d’Unite pour tout retarder a engendré toutes sortes d’idées sur le forum des électriciens :
-
Il y a eu des concessions et des petits arrangements entre syndicats et patrons avant. Evidemment, c’est vrai, mais çà n’explique pas pourquoi.
-
Les bureaucrates syndicaux s’occupent de leurs petites affaires, « les permanents paresseux se servent du syndicat pour avoir un salaire et une bonne pension. » Beaucoup d’ouvriers combatifs auparavant sont devenus des officiels à plein temps du syndicat, alors qu’y a-t-il dans les syndicats qui les corrompent ? Le salaire et la pension ou la façon dont le syndicat agit en tant qu’organe de négociation ?
-
Unite est trop gros, « si seulement nous avions notre propre syndicat et n’étions pas regroupés avec la moitié du pays », « tout ce qui les intéresse, ce sont ‘les malheurs’ des employés du secteur public. » En fait, les syndicats traitent les travailleurs du secteur public aussi mal que ceux du privé. Par exemple, lors de la grève d’Unison en 2006, les syndicats ont demandé aux enseignants de traverser le piquet du personnel de l'éducation non enseignant et, par la suite, ils ont préconisé la même manœuvre mais en sens inverse (les non-enseignants traversant le piquet des enseignants). Il a pu y avoir de la publicité pour les grèves d’un jour, les manifestations organisées pour les travailleurs du secteur public, mais cela n’a pas fait avancer la lutte du tout.
-
« La plupart des gars sont à blâmer eux-mêmes » pour ne pas vouloir lutter. De façon assez étrange, ce qui rend difficile l’entrée dans la lutte aussi bien que sa dynamique elle-même (pour les ouvriers combatifs faire des piquets de grève tôt le matin autant que pour ceux qui attendent que Unite les appellent à l’action ou même que ceux qui ne croient pas qu’on puisse vraiment faire quelque chose), c’est la vision commune que même si « passer par le syndicat Unite n’est pas une proposition très enthousiasmante et n’a que très peu de crédibilité auprès de l’électricien moyen », même si «beaucoup d’électriciens n’y adhérent plus », ils sentent aussi « que la triste réalité est que c’est tout ce que nous avons sous la main et nous devons l’utiliser du mieux que nous pouvons. »
Le syndicat n’est pas "tout ce que nous avons sous la main"
Ce que les électriciens ont déjà fait montre qu’il y a une alternative aux méthodes syndicales de lutte. Comme il a été dit lors d’un des rassemblements à Blackfriars en janvier, c’était tout un symbole que le 9 novembre Unite ait voulu que la manifestation se dirige vers le Parlement pour faire pression sur les députés, alors que les travailleurs voulaient aller rejoindre le rassemblement étudiant. Le syndicat et la base voulaient aller dans des directions totalement différentes.
Pour les travailleurs, « nous ne pouvons réussir qu’avec d’autres secteurs et d’autres professions venant renforcer nos rangs et se tenir à nos côtés, en solidarité avec la classe ouvrière industrielle, dans un syndicat ou pas, pour une cause et un but communs » (Siteworker), complètement à l’opposé de la « lutte » syndicale limitée à ses membres, et ensuite avec ceux dont l’employeur est celui avec qui le syndicat négocie. Les ouvriers doivent lutter avec toute leur solidarité, avec des piquets de grève forts, pour empêcher les attaques contre leurs salaires, leurs conditions de vie et leur qualification. Pour les syndicats, la lutte n’est qu’un moyen pour aller négocier, et ils acceptent chaque fois l’austérité et les licenciements tant qu’ils peuvent se mettre autour de la table avec les employeurs et souvent le gouvernement.
Les électriciens ont manifesté, ils ont fait des délégations, ils sont partis en grève sauvage, ils ont essayé de construire une lutte – ce qui est la seule voie qui puisse donner confiance à ceux qui peuvent hésiter à lutter. Le syndicat a freiné en usant de toutes sortes d’excuses sur le fait qu’il fallait recruter, voter, tout faire légalement… Il ne faut pas s’étonner du fait que les organisateurs à temps plein aient été en grande partie absents – qu’est-ce que les revendications ouvrières ont à voir avec cela ?
Si nous regardons un peu plus loin, nous voyons que souvent la lutte, et quelquefois des luttes payantes, se déroulent sans les syndicats : les ouvriers du textile au Bengladesh il y a quelques années, les ouvriers de Honda en Chine (qui ont été physiquement attaqués par les syndicats sponsorisés par l’Etat) ; et, bien sûr, les mouvements des Occupy, des Indignés, à travers toute l’Europe et les Etats-Unis, montrent aussi que les gens peuvent se rassembler et organiser une lutte même sans les syndicats.
Les syndicats ne sont pas tout ce que nous avons sous la main ; en fait, ils ne plus du tout de notre côté. Tout ce que nous avons, c’est ce que nous-mêmes, la classe ouvrière, nous faisons.
La lutte est sur le fil du rasoir
Malgré des discours optimistes lors des manifestations en janvier, il y a un sentiment général que la dynamique de résistance des électriciens aux attaques de le BESNA s’épuise. Le résultat du nouveau vote demandé par Unite pour les travailleurs de Balfour Beatty sera annoncé début février – le dernier donnait 81 % en faveur de l’action – avec l’attente d’une grève une semaine plus tard. Mais ce vote intervient dans un moment critique – après qu’Unite ait ordonné à ses membres de signer l’accord, quand les patrons de BESNA pensent qu’ils ont gagné et que beaucoup d’électriciens craignent qu’ils n’aient raison. Les syndicats appellent de nouveau à une grève ou une grande manifestation juste quand la volonté de lutter a été contrariée et s’est épuisée, quand on s’achemine vers la défaite, laissant les ouvriers impuissants et démoralisés. Si c’est ce qu’on laisse arriver, la leçon négative ne va pas que frapper les électriciens mais tous les employés de la construction, donnant aux employeurs du BTP un air (non mérité) d’invincibilité. La défaite d’une section combative de la classe ouvrière aura aussi des conséquences négatives pour la lutte en général.
Les électriciens combatifs sont déterminés à continuer à résister au BESNA organisant « des bus pour faciliter la mobilité des piquets » et déclarent faire passer la grève à un niveau supérieur « sans aucun doute, d’autres sites vont soutenir la grève BBES » (Balfour Beatty Engineering Services)2. Mais cela sera insuffisant si les travailleurs ne peuvent pas prendre en main tout le contrôle de leur lutte pour élargir le mouvement. Prendre le contrôle ne veut pas dire élire des syndicalistes de base pour « contrôler » le syndicat Unite, aussi combatifs soient-il ; cela veut dire organiser des meetings massifs pour discuter de la lutte, prendre des décisions et les appliquer collectivement. Elargir le combat ne veut pas dire en appeler simplement aux électriciens des autres firmes ; cela veut dire aller chercher les ouvriers des autres entreprises de construction et des autres industries, qu’elles soient publiques ou privées. C’est la seule façon de gagner.
Alex (27 janvier)
1 Unite est désormais le premier syndicat du Royaume-Uni, né en mai 2007 d'une fusion entre le deuxième et le troisième syndicat du pays à l'époque, Amicus et T&G. Il accueille 1 557 900 membres (janvier 2009), qui travaillent dans pratiquement tous les secteurs, dont la construction automobile, l'imprimerie, la finance, les transports routiers et les services de santé. Il est plus implanté dans le secteur privé que dans le secteur public, où il compte tout de même 200 000 affiliés.
2 Source : https://siteworkers.wordpress.com/ [11]
Géographique:
- Grande-Bretagne [12]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [3]
Rubrique:
Réflexions sur les émeutes d'août 2011 au Royaume-Uni (1ère partie)
- 1424 lectures
A la suite des émeutes, une discussion s'est développée au sein du mouvement révolutionnaire sur la nature de classe et la dynamique des émeutes. Des organisations de la Gauche communiste et des groupes anarchistes, comme Solfed, ont vu les émeutes comme résultant de la nature et des contradictions de la société capitaliste, mais elles ont critiqué les attaques contre d'autres ouvriers, qu'il s'agisse d'attaques directes ou de mettre le feu à des magasins au-dessus desquels des ouvriers vivent. D'autres ont vu les émeutes comme une attaque contre la marchandise et contre les rapports de production capitalistes. Certains ont établi une distinction entre ces émeutes et celles des années 1980, faisant valoir que celles-ci sont plus clairement dirigées contre les forces qui oppriment et attaquent la classe ouvrière, en particulier la police.
Cet article tente de contribuer à ce débat en examinant le rapport entre les émeutes et la lutte des classes. La première partie, publiée ici, considère la question dans le contexte de l'histoire du mouvement ouvrier et de la nature générale de la lutte. La seconde partie se penchera plus spécifiquement sur les émeutes de cet été au Royaume-Uni.
Le rapport entre les émeutes et la lutte des classes
Ceux qui sont du côté de la classe ouvrière ne peuvent pas accepter le langage et le cadre donnés par la bourgeoisie. La confrontation entre le prolétariat et la bourgeoisie implique inévitablement que la classe ouvrière s'approprie les biens et la propriété de la bourgeoisie et qu’elle se confronte à ses forces de contrôle, dans des périodes de violence, comme on a pu le voir lors des émeutes de la faim du 18ème siècle, dans les luttes pour organiser et obtenir des augmentations de salaire au 19ème siècle, ou pour renverser le capitalisme au début du 20ème siècle. Pour la bourgeoisie, tout ce qui menace sa domination et qui s'oppose à l'inviolabilité de la propriété est émeute, pillage, acte criminel et immoral, et suscite de ce fait un désir de vengeance qui conduit à la répression, à l'incarcération et souvent à des massacres. Ainsi, toutes les fois que la classe dirigeante parle « d'émeutes », nous ne devons pas la croire sur parole.
De même, il ne faut pas être trop hâtif à rejeter toute action comme étant celle du « lumpen prolétariat ». Sur cette question, le Manifeste Communiste de 1848 écrit : « Le lumpenprolétariat, ce produit passif de la pourriture des couches inférieures de la vieille société, peut se trouver, çà et là, entraîné dans le mouvement par une révolution prolétarienne » et que ses conditions de vie « disposeront plutôt à se vendre à la réaction ». Est ici décrit un processus qui a existé tout au long du capitalisme et qui peut s'accroître dans les circonstances actuelles, mais il est également clair qu'il ne représente pas une catégorie immuable.
Ceux qui sont du côté de la classe ouvrière doivent juger tout événement en fonction du fait qu'il accélère ou retarde la lutte de la classe ouvrière pour mettre fin à son exploitation. C'est avant tout une perspective historique ; des gains immédiats ne vont pas nécessairement se traduire par des acquis à long terme. Ainsi évaluer un événement particulier, c'est comprendre son impact sur les armes de la lutte de la classe ouvrière : son organisation et sa conscience.
Marx et Engels soulignent l'unité et la dynamique de ces deux aspects dans le Manifeste du Parti Communiste. D'un côté, ils décrivent le développement des syndicats (la forme que les organisations de masse de la classe ouvrière ont pris à cette époque) et les luttes dans lesquelles les ouvriers se sont engagés et ils commentent : « Parfois, les ouvriers triomphent ; mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leurs luttes est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs. » De l'autre, ils décrivent comment « la bourgeoisie fournit aux prolétaires les éléments de sa propre éducation, c'est-à-dire des armes contre elle-même », avant de faire valoir que les communistes sont « pratiquement,... la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui stimule toutes les autres ; théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat l'avantage d'une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien. »
Organisation et conscience, conscience et organisation, telles sont les qualités de la classe ouvrière qui se renforcent mutuellement, le fruit de son être et de sa lutte au niveau historique et international. Elles ne sont pas identiques et se présentent et se manifestent sous des rythmes différents, mais connexes. Des éléments des autres classes peuvent rejoindre le prolétariat et contribuer à son développement, mais l'origine, la dynamique et la force de ce développement viennent du sein de la classe ouvrière.
Quand on examine la question générale de savoir comment la classe ouvrière lutte et la question spécifique de la place que les émeutes ont dans cette lutte, le mouvement ouvrier en fait une analyse critique à la fois théorique et pratique.
L'analyse théorique
Dans La Situation de la Classe Laborieuse en Angleterre, publié en allemand en 1845, Engels expose la position dans laquelle le capitalisme met chaque travailleur (sans distinction de sexe, malgré le langage des citations suivantes) : « le travailleur est fait pour sentir à chaque instant que la bourgeoisie le traite comme un bien mobilier, comme sa propriété, et pour cette raison, si ce n'est pour d'autres, il doit se présenter comme son ennemi ... dans notre société actuelle, il ne peut sauver sa virilité que dans la haine et la rébellion contre la bourgeoisie. » Il a ensuite esquissé les grandes lignes du développement de la révolte de la classe ouvrière : « La première forme, la plus brutale et la plus stérile, que revêtit cette révolte fut le crime. L'ouvrier vivait dans la misère et l'indigence et il voyait que d'autres jouissaient d'un meilleur sort. Sa raison ne parvenait pas à comprendre pourquoi, précisément lui, devait souffrir dans ces conditions, alors qu'il faisait bien davantage pour la société que le riche oisif. Le besoin vainquit en outre le respect inné de la propriété - il se mit à voler... Mais les ouvriers eurent tôt fait de constater l'inanité de cette méthode. Les délinquants ne pouvaient par leurs vols, protester contre la société qu'isolément, qu'individuellement ; toute la puissance de la société s'abattait sur chaque individu et l'écrasait de son énorme supériorité. » La classe ouvrière s'est mobilisée pour s'opposer aux machines qui excluaient les uns et dominaient les autres puis, pour développer les syndicats, d'abord de façon secrète, puis ouvertement, pour défendre leurs intérêts en maintenant les salaires les plus élevés possibles et pour empêcher la bourgeoisie de diviser la classe avec des taux de rémunérations différents pour le même travail.
Dans cette analyse, Engels avance clairement que la classe ouvrière devait à la fois contester la bourgeoisie de façon légale et être prête à utiliser la force, si nécessaire. Il donne l'exemple d'une grève dans une usine de tuiles à Manchester en 1843, lorsque la dimension des tuiles produites avait été agrandie, sans augmentation des salaires. Lorsque les propriétaires eurent posté des gardes armés, « une bande d'ouvriers tuiliers assaillit la cour, un soir à dix heures, avançant en ordre de combat, les premiers rangs armés de fusils... » et les travailleurs réussirent dans leur objectif à détruire les tuiles nouvellement produites. Plus généralement, il remarque que « les ouvriers ne respectent pas la loi, se contentant au contraire de laisser s'exercer sa force quand eux-mêmes n'ont pas le pouvoir de la changer » et il donne l'exemple des attaques contre la police, chaque semaine à Manchester.
Cependant, ni Marx, ni Engels n'ont vu la violence et l'infraction à la loi comme révolutionnaire en soi et ils étaient prêts à critiquer les actions qui vont contre le développement de la lutte de la classe ouvrière, même quand elles apparaissaient comme spectaculaires et provocatrices. Ainsi en 1886, Engels a vivement attaqué l'activité de la Fédération social-démocrate par rapport à son organisation d'une manifestation de chômeurs qui, tout en passant par Pall Mall et d'autres quartiers riches de Londres sur le chemin de Hyde Park, a attaqué des magasins et pillé des boutiques de vin. Engels a fait valoir que peu de travailleurs y avaient pris part, que la plupart des personnes impliquées « étaient sorties pour rigoler et dans certains cas, étaient déjà à moitié bourrées » et que les chômeurs qui y avaient participé « étaient pour la plupart de ce genre qui ne souhaitent pas travailler – des marchands de quatre saisons, des oisifs, des espions de la police et des voyous. » L'absence de la police était « tellement visible que ce n'était pas seulement nous qui croyions qu'elle était intentionnelle ». Quoi qu'on puisse penser de certaines expressions d'Engels, sa critique essentielle suivant laquelle « ces messieurs socialistes [c'est-à-dire les dirigeants de la FSD] sont déterminés à faire apparaître de façon immédiate un mouvement qui, ici comme ailleurs, réclame nécessairement des années de travail » est valable. La révolution n'est pas le produit du spectacle, de la manipulation ou du pillage.
La pratique de la classe ouvrière
Pour l'ensemble de la critique théorique développée par les grandes figures du mouvement ouvrier, la critique la plus éloquente est celle qui découle de la pratique réelle de la classe ouvrière. Dans l'histoire de la lutte des classes, la question par rapport à la classe ouvrière n'était pas simplement de savoir si un moment particulier avait été violent et « séditieux » ou non, mais dans quelle mesure il aurait eu lieu sur le terrain de la classe ouvrière et contrôlé par celle-ci. Parmi les nombreux cas de troubles, d'émeutes et d'insurrections qui ont eu lieu dans les dernières décennies du 18ème siècle et dans la première du 19ème, il est possible de distinguer entre ceux où la « foule » a été manipulée par la bourgeoisie et ceux où la classe ouvrière naissante a lutté pour se défendre et pour survivre.
Parmi les premiers, il y a eu divers incidents pour attiser l'antipathie religieuse, que ce soit contre les catholiques ou contre des dissidents et aussi des mouvements politiques « populaires », comme ceux menée par Wilkes, à la fin du 18ème siècle. Un exemple est donné par les émeutes de Gordon en 1780 qui ont commencé avec une marche sur la Chambre des Communes pour protester contre les concessions données aux catholiques et dirigées pour attaquer les églises catholiques et la propriété des riches catholiques, et ne fut arrêtée que lorsque la foule a tourné son attention vers la Banque d'Angleterre. Cette perte de contrôle met en évidence l'un des dangers qui menacent la bourgeoisie dans ses efforts visant à utiliser la foule : le mouvement peut glisser hors de son contrôle. Ceci est illustré par le mouvement dirigé par Wilkes, qui était essentiellement une lutte entre différentes factions de la classe dirigeante, alors que le mouvement créé pour soutenir sa campagne a commencé à fusionner avec un mouvement social, et que des slogans révolutionnaires ont été lancés.
Parmi les derniers, on peut voir les émeutes de la faim qui ont eu lieu dans de nombreuses parties de la Grande-Bretagne, qui se sont souvent caractérisées par des saisies de nourriture auprès des commerçants et sa vente forcée à un prix inférieur. Ces mouvements pouvaient être très organisés, durant plusieurs jours sans violence, avec les marchands à qui ont donnait l'argent que les gens estimaient être le « juste prix ». Ces derniers ont également inclus le mouvement Luddiste qui a eu lieu à différents moments dans les Midlands et le Nord de l'Angleterre et qui a cherché à protéger les salaires et les conditions de travail de la classe ouvrière, face à l'industrialisation rapide et à la réorganisation des modes de vie et de travail. Le mouvement s'est caractérisé tant par son organisation et le soutien populaire que par le sabotage de machines qui lui est souvent associé. La bourgeoisie a réagi en alternant usage de la force et concessions. À son apogée, en 1812, plus de 12 000 soldats ont été déployés entre Leicester et York, et la valeur totale des biens détruits a été estimée à 100 000 £ d’aujourd’hui.
Dans La Situation de la Classe Ouvrière en Angleterre, Engels a retracé le développement des syndicats et surtout du chartisme qui découlait de ces premiers efforts de la classe ouvrière. Pour Engels, le chartisme était « la forme condensée de l'opposition à la bourgeoisie », « Dans les unions et les grèves, cette opposition restait toujours isolée, c'étaient des ouvriers ou des sections ouvrières qui, isolément, luttaient contre des bourgeois isolés ; si le combat devenait général, ce n'était guère l'intention des ouvriers... Mais dans le chartisme, c'est toute la classe ouvrière qui se dresse contre la bourgeoisie. » Le chartisme peut se prévaloir d’avoir été la première organisation politique de la classe ouvrière et il peut aussi se targuer d’avoir lutté pour des objectifs tels que le suffrage universel qui ont ensuite été concédés à titre de réformes destinées à contenir la lutte, mais en son temps cette lutte était révolutionnaire et les ouvriers étaient prêts à recourir à la violence si nécessaire. La grève générale et l'insurrection armée y ont été discutées et elles ont trouvé leur expression dans le soulèvement de Newport en 1839 et dans la grève générale de 1842.
Tout au long de leur histoire, les luttes de la classe ouvrière ont été confrontées à la nécessité de recourir à la violence à certains moments. Les libéraux et les pacifistes qui dénoncent la violence ne voient jamais que la vie « ordinaire », « pacifique », sous le capitalisme, est un acte de violence continuel contre les exploités. Il ne s'agit pas de faire l'éloge de la violence en soi, mais de reconnaître qu'elle est une partie inévitable de la lutte des classes. Dans son histoire de la lutte des classes aux Etats-Unis, Louis Adamic montre comment l'exploitation particulièrement brutale et la répression infligée par les patrons aux Etats-Unis ont parfois suscité une réaction tout aussi vigoureuse.
Nous pouvons revenir à la Grande-Bretagne pour examiner l'exemple particulier de l'émeute de Tonypandy, en novembre 1910. Celle-ci a fait partie du conflit plus large de Cambrien Combine, après que les mineurs ont été victimes d’un lock-out par les propriétaires des mines qui déclaraient qu'ils travaillaient de façon délibérément lente. D'autres mines ont apporté leur soutien et 12 000 mineurs ont pris part à la fermeture de presque toutes les mines de la région. La bourgeoisie a réagi en envoyant la police et la troupe, ce qui a provoqué des affrontements violents entre la police et les travailleurs. Les émeutes ont éclaté lorsque des travailleurs ont tenté d'arrêter des briseurs de grève qui entraient dans une des mines pour maintenir les pompes en fonctionnement, ce qui a conduit à un combat au corps à corps entre les ouvriers et la police. Vers minuit, après des assauts répétés à la matraque de la part de la police, les travailleurs ont dû retourner dans le centre de Tonypandy où ils ont affronté d'autres attaques de la police. Au cours des premières heures de la matinée, les magasins ont été brisés et certains pillés. La police n'était pas présente pendant le pillage et celui-ci a été utilisé par la bourgeoisie comme prétexte pour appeler à une intervention militaire. Beaucoup de travailleurs ont été blessés et un d’entre eux a été tué à la suite des affrontements. Cette grande confrontation a suscité une réflexion dans la Fédération des Mineurs du Sud du Pays de Galles et a contribué à l'élaboration d'un courant qui a contesté la direction de la Fédération et avancé des idées syndicalistes dans la brochure La Prochaine Etape des Mineurs, publiée à Tonypandy en 1912.
Encore une fois, la question essentielle n'est pas celle de la violence d'une lutte qui serait le baromètre de nature prolétarienne ou non prolétarienne de celle-ci, le contexte dans lequel elle a eu lieu et sa dynamique. Ainsi, à côté de l'histoire des luttes qui ont fait avancer les intérêts de la classe ouvrière, il existe un autre volet d'actions qui ont fait le contraire et ont poussé la classe ouvrière hors de son terrain de classe. Pour donner quelques exemples :
- Au cours de l'été de 1919, des « émeutes raciales » ont éclaté à Liverpool et à Cardiff après le débarquement de marins noirs et blancs. Les syndicats, qui sont plus tard devenus l'Union Nationale des Marins, se sont plaints que des marins noirs se voyaient attribuer un emploi, alors que des blancs étaient au chômage et, en mai 1919, cinq mille chômeurs blancs, anciens militaires, se sont plaints auprès du maire de Liverpool sur le fait que les travailleurs noirs étaient en concurrence avec les blancs pour les emplois. En juin, des anciens militaires noirs et leurs familles furent attaqués à leur domicile. A Liverpool, une foule de deux à dix mille personnes a attaqué les Noirs dans les rues et, à Cardiff, les quartiers arabes et noirs ont été pris pour cibles. Au cours de ces affrontements, trois personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées.
- En mai 1974, l'Ulster Workers Council organise une grève générale des travailleurs protestants en opposition aux concessions supposées aux travailleurs catholiques. La grève était contrôlée par des organisations politiques et loyalistes paramilitaires et, bien qu'il y ait des preuves que les travailleurs aient été réticents à y participer, elles avaient cependant réussi à diviser la classe ouvrière.
A l'assaut du ciel
La condamnation du système faite par la classe ouvrière est à son apogée quand elle remet en question le pouvoir de la bourgeoisie et commence à affirmer qu'elle porte en elle l'avenir de la société humaine contre le régime inhumain de la bourgeoisie, comme dans la Commune de Paris en 1871, dans le révolution de 1905 en Russie et dans la vague révolutionnaire lancée en Russie.
La question fondamentale de ces mouvements n'était pas tant l'appropriation directe de la propriété, mais la question du pouvoir, exprimée dans la lutte contre la bourgeoisie et pour la réorganisation de la société.
Cela se trouve au cœur de l'analyse de la Commune de Paris faite par Marx dans La Guerre Civile en France, publiée par l'Association Internationale des Travailleurs en 1871. Elle met l'accent sur l'opposition de la Commune à l'organisation de l'Etat, exprimée dans ses premières mesures qui suppriment l'armée permanente et la remplacent par la Garde Nationale. Dans les conditions de siège dans lesquelles elle vivait, la Commune ne pouvait qu'indiquer la direction de la reconstruction sociale à laquelle elle aspirait : « La grande mesure sociale de la Commune, ce fut sa propre existence et son action. Ses mesures particulières ne pouvaient qu'indiquer la tendance d'un gouvernement du peuple par le peuple. Telles furent l'abolition du travail de nuit pour les compagnons boulangers ; l'interdiction, sous peine d'amende, de la pratique en usage chez les employeurs, qui consistait à réduire les salaires en prélevant des amendes sur leurs ouvriers sous de multiples prétextes ... Une autre mesure de cet ordre fut la remise aux associations d'ouvriers ...de tous les ateliers et fabriques qui avaient fermé. » Les membres élus de la Commune, dont la majorité était des travailleurs, et de ses administrateurs ont tous reçu un salaire équivalent à celui d'un simple ouvrier. L'église a été dissoute et l'éducation rendue accessible à tous : «Les prêtres furent renvoyés à la calme retraite de leur église... La totalité des établissements d'instruction furent ouverts au peuple gratuitement, et, en même temps, débarrassés de toute ingérence de l'Église et de l'État. Ainsi, non seulement l'instruction était rendue accessible à tous, mais la science elle-même était libérée des fers dont les préjugés de classe et le pouvoir gouvernemental l'avaient chargée. » Les tentatives faites par le gouvernement français pour affamer la Commune échouèrent et un approvisionnement régulier en nourriture fut maintenu.
La révolution de 1905 a vu l'apparition de comités de grève, dans de larges parties de la Russie, pour contrôler la lutte dans les usines et leur développement ; ceux-ci se réunissaient et ils sont devenus des organes élus et révocables en permanence : les Soviets. Bref, c’était une dynamique constante allant et venant de la lutte économique immédiate à la lutte plus générale fusionnant avec la lutte politique pour le pouvoir. Des questions de survie immédiate ont été abordées dans ce contexte plus large : ainsi, pour les travailleurs licenciés pour fait de grève à l'usine Poutilov, « des mesures de secours furent prises, parmi lesquelles se trouvaient quatre soupes populaires. » Le coeur de la révolution, le Soviet de Saint-Pétersbourg, s'est impliqué dans l'organisation de la vie quotidienne, y compris dans la prévention de la censure de la presse par l'Etat et pour donner des instructions aux chemins de fer et à la poste. A Moscou, le Soviet émit des directives « réglementant la fourniture en eau, pour maintenir ouverts les magasins essentiels [et] pour le report des paiements de loyer pour les travailleurs...»
En 1917, cette situation s'est répétée puis est allée plus loin, la classe ouvrière ayant pris le pouvoir à la bourgeoisie : « … dans de nombreux cas, l'effondrement du gouvernement central et des bureaucraties locales ont fait de ces instruments de la révolution des instances gouvernementales qui sont intervenues et se sont arrogées des fonctions administratives. » Lorsque la perturbation de la révolution a conduit à des pénuries alimentaires dans les zones urbaines, « les soviets locaux ont indépendamment adopté des mesures strictes de lutte contre celles-ci. A Nijni-Novgorod, par exemple, l'exportation de pain a été réduite ; à Krasnoïarsk, le soviet a introduit des cartes de rationnement ; dans d'autres lieux 'bourgeois' , des maisons ont été fouillées et des biens confisqués » Dans l'Histoire de la Révolution Russe, Trotsky écrit : « Dans l'Oural , où le bolchevisme prévalait depuis 1905, les soviets ont fréquemment administré le droits civil et pénal; créé leur propre milice dans de nombreuses usines, en les payant au moyen de fonds d'usine, organisé le contrôle par les ouvriers de matières premières et du carburant pour les usines, supervisé la distribution, et déterminé les échelles de salaires. Dans certaines régions de l'Oural, les soviets ont exproprié des terres pour la culture commune. »
Même dans des luttes moins spectaculaires que celles déjà mentionnées, les méthodes de la classe ouvrière viennent au premier plan. Ainsi, durant les premiers jours de la grève de masse en Pologne, en 1980, des représentants des usines en grève se sont réunis pour former le Comité Inter-Usines (MKS en polonais), qui «contrôlait toute la région et résolvait les problèmes de distribution et de transport de la nourriture. »
Ainsi, nous pouvons tirer un certain nombre de conclusions des luttes qui se déroulent sur un terrain de classe, qu'il s'agisse d'une simple grève ou d'un mouvement révolutionnaire. Tout d'abord, la violence n'est pas une fin en soi, ni une simple expression de la frustration, mais un moyen par lequel la classe ouvrière prend et défend le pouvoir pour changer le monde. Deuxièmement, lorsqu'il y a appropriation des marchandises, cela se fait avant tout comme un moyen de maintenir la lutte collective et c'est la valeur d'usage de la marchandise qui domine plutôt que sa valeur d'échange. Troisièmement, elles sont marquées par l'action collective et la solidarité et elles les renforcent. De telles luttes sont toujours orientées vers l'avenir, vers la transformation de la société.
North (25 janvier)
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Réflexions sur les émeutes d'août 2011 au Royaume-Uni (2ème partie)
- 1902 lectures
Cet article est une contribution à la discussion au sein du mouvement révolutionnaire sur la nature des émeutes qui ont eu lieu en août dernier Grande-Bretagne. Dans la première partie [14] de cet article, nous avons replacé la question des « émeutes » dans le contexte de la lutte historique de la classe ouvrière et développé l’idée que la réponse des révolutionnaires à des événements particuliers n’est pas déterminée par ce qu’en raconte la classe dominante ou par l’analyse qu’elle en fait, mais par la portée qu’ils ont sur la défense des intérêts de la classe ouvrière, en faisant avancer ou reculer celle-ci. Ce ne peut être essentiellement déterminé que par l’impact que ces événements ont sur l’organisation et la conscience de la classe ouvrière. Nous avons brièvement analysé comment ceci a été élaboré en théorie et en pratique dans l’histoire de la classe ouvrière. Dans cette seconde partie, nous revenons sur les événements de l’été dernier et essayons de leur appliquer le cadre développé dans la première partie.
Les émeutes de l’été dernier ne peuvent se comprendre en dehors du contexte historique de l’approfondissement de la crise économique qui est en train de détruire à la fois le monde naturel et celui des hommes et qui prive d’espoir pour le futur tous les travailleurs, en particulier chez la plupart des jeunes, et va même jusqu’à occulter la connaissance de ce qui leur est enlevé. Internationalement et nationalement, la classe ouvrière est confrontée à une misère croissante et au chômage, allant de pair avec le harcèlement des différentes forces de l’ordre telles la police, les organismes sociaux et les contrôles à la frontière. Les travailleurs vivent dans un climat de surveillance et de contrôle social croissant d’un côté, et de l’autre dans l’exclusion de toute possibilité de vie meilleure, quand les conditions d’existence se détériorent à un point tel que, pour beaucoup, c’est même leur survie qui devient incertaine. Les travailleurs sont précipités dans une lutte immédiate pour leur survie, où l’espoir dans l’avenir est étouffé par la vie quotidienne. Beaucoup de jeunes, en particulier, se retrouvent exclus d’emplois décents, sont dans l'impossibilité de participer à la ruée sur les biens de consommation qu'ils croient être un des fondements de la société, ne peuvent réaliser leurs espérances et leurs aspirations, et font face à un avenir sur lequel ils n’ont aucun contrôle. La survie immédiate domine et beaucoup prennent ce qu’ils peuvent, quand ils le peuvent, d’un monde dont ils ne font pas réellement partie.
Cela fait écho à l’analyse faite par Engels en 1840 de la réponse à sa situation de la classe ouvrière qui était en train d’apparaître : « Somme toute, les défauts des ouvriers se ramènent tous au dérèglement dans la recherche du plaisir, au manque de prévoyance et au refus de se soumettre à l'ordre social, et d'une façon générale, à l'incapacité de sacrifier le plaisir du moment à un avantage plus lointain. Mais qu'y a-t-il là de surprenant ? Une classe qui par son labeur acharné, ne peut se procurer que peu de chose et que les plaisirs les plus matériels, ne doit-elle pas se précipiter aveuglément, à corps perdu sur ces plaisirs ? Une classe que personne ne se soucie de former, soumise à tous les hasards, qui ignore toute sécurité de l'existence, quelles raisons, quel intérêt a-t-elle d'être prévoyante, de mener une vie sérieuse et au lieu de profiter de la faveur de l'instant, de songer à un plaisir éloigné qui est encore très incertain, surtout pour elle, dans sa situation dont la stabilité est toujours précaire et qui peut changer du tout au tout ? On exige d'une classe qui doit supporter tous les inconvénients de l'ordre social, sans pouvoir profiter de ses avantages, d'une classe à qui cet ordre social ne peut apparaître qu'hostile, on exige d'elle qu'elle le respecte ? C'est vraiment trop demander. Mais la classe ouvrière ne saurait échapper à cet ordre social tant qu'il existera et si l'ouvrier isolé se dresse contre lui, c'est lui qui subit le plus grand dommage. »
Aujourd’hui, la partie de la classe ouvrière que la bourgeoisie décrit sous des vocables variés : « sous-classe » ; « les éléments criminels », ou quand elle est vraiment déchaînée, « profiteurs », « vermine » et « la jeunesse barbare », vit d’une façon qui renvoie aux premières décennies de la classe ouvrière. La société bourgeoise, dans sa sénilité, retombe donc dans les faiblesses de son enfance.
La nature limitée des émeutes
Les émeutes elles-mêmes ont été de courte durée, éparpillées dans de nombreuses grandes villes d’Angleterre1 et, à quelques notables exceptions près, n’ont relativement causé que peu de dégâts durables. 2 En tout, on a rapporté qu’environ 15 000 personnes y ont pris part, mais quelques incidents particuliers semblent en avoir impliqué un très grand nombre. L’ensemble des personnes arrêtées donne une image de ceux qui étaient impliqués comme étant en majorité de jeunes hommes, venant des zones les plus défavorisées des villes concernées, et souvent ayant déjà eu des histoires avec la police3. Cependant, comme le fait remarquer Aufheben, avec sa manière habituelle d’examiner les choses de façon empirique, cela reflète en partie le fait qu’il est plus facile d’arrêter ceux qui sont déjà connus par la police quand ils laissent leurs visages à découvert.4
Le but premier semble avoir été de s’emparer de marchandises, en général en cassant les vitrines, principalement celles des chaînes de grands magasins, mais aussi, de petites boutiques « de quartier ». La destruction de maisons particulières semble avoir été le produit d’une insouciance et d’une indifférence plutôt qu’un but délibéré. La police et les autres symboles de l’Etat étaient aussi des cibles, ce sur quoi les émeutiers interviewés ont largement insisté. Dans une moindre mesure « les riches » ont aussi été visés, bien qu’on ne sache pas clairement si c’était réellement intentionnel ou si c’était une conséquence de la ruée vers les marchandises les plus coûteuses dans de telles zones5.
Les interviews de jeunes gens impliqués, soit dans les émeutes, soit vivant dans les zones où se sont déroulées celles-ci, donnaient tout un mélange d’explications, mais il y a une insistance sur le manque d’espérance dans le futur et la colère que cela provoque : « Les gens sont en colère, quelques uns voulaient que le gouvernement nous écoute, d’autres sont en colère mais ne savent pas vraiment pourquoi…de toutes façons, les plus jeunes vont être dans la même merde que nous, nulle part où aller et ce sera encore pire quand ils auront 17-18 ans ».6 « Je ne dis pas que je sais pourquoi les gens ont commencé mais je pense que la plupart des gens… et les jeunes sont en colère, en colère pour le travail, pas de maison, pas d’éducation…justement parce qu’il n’y a aucune aide, aucun moyen de faire mieux »7. « (le pillage) était une occasion de faire un bras d’honneur à la police… Les gens ne respectent pas (la police) parce que la police n’a aucun respect… elle abuse de son badge »8. Cela fait écho à la recherche entreprise par le gouvernement : « le document dit qu’ils (les participants aux émeutes) étaient motivés par ‘le plaisir d’avoir des trucs gratuits – des choses qu’ils n’auraient pas été en mesure d’avoir autrement’ – et par l’antipathie à l’égard de la police ». La mort de Mark Duggan, dont l’assassinat par balle avait déclenché au début des protestations à Tottenham le 6 août qui furent suivies par les émeutes, ont conduit certains à Londres à ‘prendre leur revanche’ sur la police, dit le rapport. Celui-ci ajoute « en dehors de Londres, les émeutes n’étaient en général pas attribuées au cas de Mark Duggan. Cependant, l’attitude et le comportement de la police localement était très souvent cités comme déclencheurs, que ce soit à Londres ou en dehors ».9
Ce n’est pas pour déprécier les dommages physiques subis par ceux qui ont été innocemment pris dans les événements ou qui ont été la cible de ceux qui étaient impliqués dedans, ni la détresse de ceux qui ont perdu leur maison et leurs moyens d’existence. Pour certains de ces individus, l’impact a été dévastateur, et se fera ressentir tout le reste de leur vie. Cependant, chaque jour maintenant, des travailleurs perdent leurs moyens d’existence et leurs maisons, du fait des attaques de la classe dominante, et beaucoup ne les récupèreront jamais. La bourgeoisie ne dit pas un mot de tout çà, ou simplement que c’est le prix que « nous » avons à payer pour les extravagances d’hier et les promesses pour demain.
Les émeutes font du mal à la classe ouvrière pas au capitalisme
Comment s’inscrivent les émeutes de cet été dans le cadre que nous avons établi ?
En premier, les émeutes reflétaient la domination de la culture marchande plutôt qu’être un défi à celle-ci. Le pillage qui a eu lieu était une fin en lui-même, une répétition sous une forme altérée du message de la bourgeoisie selon lequel ce qui définit un individu, c’est une accumulation de marchandises. Voler une télévision sans avoir les moyens de s’en servir – pour prendre l’exemple donné par les situationnistes en 1965 et repris par un des commentaires sur les émeutes10- ne remet pas en question le spectacle marchand du capitalisme mais y succombe (quoique la véritable explication soit probablement beaucoup plus prosaïque, la télé étant vendue pour acquérir les moyens d’acheter des marchandises que ‘l’appropriateur’ puisse utiliser – ce qu’on peut comprendre mais ne représente guère une menace pour « la marchandise spectaculaire »). La notion de ‘shopping prolétarien », élaborée par certains peut sembler opposée aux lois et à la morale bourgeoises, mais est étrangère au cadre prolétarien de l’action collective pour défendre des intérêts communs ; l’acquisition individuelle de marchandises n’échappe jamais réellement aux prémisses les plus basiques de la propriété capitaliste Au mieux, une telle appropriation individuelle peut permettre à l’individu et à ses proches de survivre un peu mieux qu’avant. C’est compréhensible, on l’a déjà dit, mais pas une menace pour la culture de la marchandise.11
En second lieu, et beaucoup plus destructeur, les émeutes ont divisé la classe ouvrière et ont donné à la bourgeoisie une opportunité de saper les tentatives d’exprimer la combativité et l’unité au sein de la classe ouvrière qui s’étaient vues dans des luttes éparpillées ces dernières années et qui font part du développement international de la lutte de classe et de la prise de conscience que c’est une possibilité aujourd’hui. La réponse d’un très grand nombre de gens, y compris des membres de la classe ouvrière, qui a été de chercher à défendre leurs familles et leurs maisons contre les émeutes, bien que tout à fait compréhensible, n’était pas sur un terrain prolétarien, comme quelques anarchistes semblent le suggérer12, mais sur celui de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie. On pouvait le voir clairement dans la participation à la campagne de nettoyage qui a vu les émules de Boris Johnson, la maire de Londres, agitant un balai de façon ostentatoire devant les caméras.
Les émeutes ont renvoyé sa propre idéologie à la figure de la bourgeoisie. Ceux qui étaient dedans ne sont pas plus immoraux que la bourgeoisie « responsable » dont la morale maintient cette société d’exploitation et de désespoir. Cependant, la principale victime a été la classe ouvrière, en partie physiquement, mais surtout au niveau idéologique. La bourgeoisie n’en est pas seulement sortie indemne, mais plus forte et a poursuivi une campagne idéologique incessante depuis lors. La classe ouvrière n’a rien gagné en expérience d’auto organisation, tout au contraire, et sa conscience a été attaquée par le renforcement du chacun pour soi qui en a résulté et le réflexe de s’en remettre à l’Etat pour la sécurité. La façon dont les émeutes ont été utilisées par la bourgeoisie pour renforcer ses armes idéologiques et matérielles de contrôle est beaucoup plus significative que les émeutes elles mêmes.
Nous devons donc nous demander dans quelle mesure la bourgeoisie a permis aux émeutes de se produire ? La réponse de la police à la protestation de la famille Duggan était une provocation, mais probablement pas plus que celle dont sont souvent l’objet ceux qui ont été victimes de violence policière. On a beaucoup parlé des défaillances de la police au début, du manque de policiers, de leur abandon de la rue, et de leur incapacité à protéger les maisons et les boutiques. Est-ce que la police a simplement été prise par surprise ? C’est possible. Mais il est aussi possible qu’une fois la flamme allumée, ils aient battu en retraite. Dans ce scénario, « le scandale » qu’ont fait la presse et les politiciens à propos de la police qui abandonne la rue et les commentaires des familles et des « communautés » laissées à elles-mêmes pour se défendre, tout cela allait dans le même sens de monter une partie de la classe ouvrière contre une autre et de noyer toute reconnaissance de ses intérêts de classe communs dans un bourbier de peur et de colère.
La lutte de la classe ouvrière doit aller au-delà des limites imposées par la bourgeoisie, que ce soit la passivité ou les émeutes. Toutes deux expriment la domination de l’idéologie bourgeoise que la lutte de classe doit défier avec la solidarité, l’action collective et en lui opposant sa perspective de libération de l’humanité de la domination de la marchandise et de toute la société de classe qui englobe celle de la bourgeoisie. Au 19e siècle, elle le faisait avec ses syndicats comme organes de masses, et avec les organisations politiques de la classe ouvrière. Dans la période actuelle, face au changement historique de situation dans laquelle le capitalisme est incapable de sortir de façon décisive de sa crise, et aux trahisons des syndicats et de beaucoup d’organisations qui avaient été avant ouvrières mais ont entraîné les travailleurs dans la guerre et les ont marchandés dans les négociations avec les patrons, la forme, mais pas le contenu, de ces luttes, doit changer. Aujourd’hui, les organisations de masse de la classe ouvrière tendent à se former et à disparaître au rythme des luttes, leur expression étant les assemblées de masse ouvertes, alors que les organisations politiques sont réduites à de petites minorités, très isolées de la classe ouvrière, et bien souvent hostiles les unes aux autres. Néanmoins, elles expriment la dynamique historique de la classe ouvrière, et à l’avenir, les confrontations à plus grande échelle et plus décisives avec la classe dominante ; le potentiel existe pour que la clase ouvrière passe des assemblées de masse aux conseils ouvriers qui unissent et organisent le pouvoir collectif de la classe ouvrière internationalement13 et au sein desquels les organisations politiques qui défendent les intérêts de la classe ouvrière ont l’obligation de travailler ensemble pour développer la dynamique de classe en fournissant une analyse basée sur les expériences historiques de la classe ouvrière et en développant une intervention construite sur cette analyse qui permette à la classe ouvrière de faire son chemin contre la bourgeoisie jusqu’à la victoire.
North (25 janvier)
1 Un tableau réalisé par The Guardian liste tous les lieux identifiés. En incluant des faubourgs de Londres séparément, le total serait de 42 lieux et 245 incidents. Certains d’entre eux, comme un incendie de poubelle à Oxford, sont difficilement qualifiables comme un acte « émeutier ». La plupart des émeutes ont eu lieu à Londres, Birmingham, Bristol, Coventry, Liverpool et Manchester.
2 Il a été estimé que le coût total des émeutes pour l’Etat serait de 133 millions de Livres, (The Guardian, 06/09/11) : « Les émeutes coûtent au moins 133 millions de Livres à ceux qui paient des impôts, disent les membres du parlement ». Les pertes individuelles et des magasins ne sont pas inclues dans ce total.
3 Des données émanant du ministère de la Justice en octobre montrent que parmi les 1400 personnes arrêtées et attendant la décision finale, plus de la moitié étaient âgés de 18 à 24 ans, et seulement 64 avaient plus de 40 ans. Voir aussi The Guardian, du 18 août, « Les émeutiers anglais : jeunes , pauvres et chômeurs ».
4Source : Communities, commodities and class in the august 2011 riots
5La catégorisation générale des cibles des émeutes est tirée des informations collectées par la recherche sponsorisée par le Guardian et de l’analyse faite par Aufheben.
6 Guardian du 5 septembre : « Derrière les émeutes à Salford : les jeunes sont en colère ».
7 Ibid.
8 Guardian : « Derrière les émeutes à Wood Green : une opportunité de faire avec les doigts le signe V (aussi injurieux dans certains pays anglo-saxons) en direction de la police
9 Guardian du 3 novembre : « Opportunism and dissatisfaction with police drove study finds”
10 « Lettre ouverte à ceux qui condamnent le pillage » par Socialisme et/ou Barbarie
11 Ce n’est pas une idée nouvelle. Dans une lettre à August Bebel (15 février 1886), Engels commente la casse de vitrines et le pillage de magasins de vin : « c’est le mieux pour installer un club impromptu de consommateurs dans la rue ».Cependant, Engels, peut-être, ne voyait pas cela comme une menace à l’ordre bourgeois.
12 Voir « Alarm on the riots », 13/08/11
13 Ici, l’intelligence et l’énergie déployées par quelques uns des émeutiers dans l’utilisation des media sociaux pour organiser et répondre aux événements et pour déjouer les forces de l’ordre et de la loi trouverons un débouché créatif.
Rubrique:
ICConline - avril 2012
- 1460 lectures
Nous avons besoin d'une véritable lutte ! (tract diffusé en Espagne lors de la manifestation du 29 mars)
- 1834 lectures
Le texte ci-dessous est la traduction du tract distribué lors des manifestations du 29 mars par nos camarades du CCI en Espagne.
Contre les coupes, contre la réforme du travail, contre tout ce qui nous tombe dessus : nous avons besoin d'une véritable lutte !
Cinq ans après le début de cette crise, les conditions de vie des travailleurs vont de mal en pis. Après les plans d’austérité de Zapatero-Rubalcaba1 et du PSOE2, c’est le tour, en plus brutaux, de ceux de Rajoy3 et du PP4 :
augmentation générale des impôts (sur le revenu, taxe d’habitation, et autres taxes en tout genre qui vont renchérir de façon insupportable les factures de l’électricité, de l’eau, le prix du combustible, etc.) ;
énième reforme du Code du travail pour rendre plus simples et meilleur marché les licenciements ce qui fera monter le chômage –selon les prévisions du gouvernement lui-même– jusqu’à 6 millions de chômeurs ;
chantage sur ceux qui « conservent » leur emploi pour qu’ils acceptent des réductions de salaires, des augmentations de la journée de travail, des déménagements et toute sorte d’injonctions arbitraires de la part du patron ou de l’administration publique elle-même ;
nouveaux décrets qui ne sont rien d’autres que des coup de hache sur les salaires des employés publics et qui vont entraîner des licenciements de milliers d’intérimaires, de nouvelles charges comme le payement par l’assuré d’une partie des services sanitaires et, en général, la dégradation des services publics essentiels comme l’éducation ou la santé.
Et tout cela, comme l’a souligné la vice-présidente du gouvernement elle-même : “ n’est que le début du début ”. Il n’y a qu’à regarder ce qui se passe en Grèce où l’on a foudroyé le tiers des employés publics et où le salaire minimum a été réduit à des niveaux vraiment invraisemblables, ou au Portugal où là aussi les dites « reformes du Travail » se succèdent, la suppression du treizième mois, les augmentations des frais de santé,… Mais rappelons-nous aussi ce qui se passe en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne : recule de l’âge de la retraite, coupe les pensions (ce qui en France avait provoqué un mouvement massif de lutte en 2010), précarisation (les “mini-jobs” bien connus et en général le temps partiel), salaires de misère qui se répandent comme la gale. C’est ainsi que dans « l’opulente » Allemagne, presque le quart de la population travailleuse gagne moins de mille euros par mois. Aux Etats-Unis le taux de pauvreté est en train de battre tous les records historiques (plus de 15% de la population) et le nombre de personnes privées d’assurance médicale, malgré la prétendue « réforme de la Santé » d’Obama, a augmenté l’année dernière de presque un million,…
Parce qu’il ne s’agit pas de l’incompétence de tel ou tel gouvernement, ni de la rapacité de telle ou telle nation capitaliste, ni de l’abjection de tel ou tel patron ou politicien. Il s’agit d’une authentique banqueroute, d’une véritable crise systémique du capitalisme, qui ne peut plus offrir à l’humanité que des attaques de plus en plus brutales contre le prolétariat mondial et les autres couches travailleuses de la population, en s’engageant dans une dynamique absurde et irrationnelle, puisque le marché mondial solvable ne fait que se réduire de plus en plus, en enfonçant de plus en plus la société capitaliste dans son propre marécage. C’est ainsi depuis plus de 40 ans, mais ces dernières cinq années ont entraîné un enfoncement qualitatif poussé par la crise irrésoluble de surproduction et aggravé par l’éclatement de l’endettement généralisé des États, des entreprises et des ménages.
C’est pour cela que les illusions comme quoi il y aurait « un autre capitalisme possible » sont dangeureuses. Il s’agit là d’un conte de fées que l’idéologie dominante répète « mille fois jusqu’à ce qu’elle devienne vérité », selon lequel l’État démocratique ne serait pas la dictature d’une minorité privilégiée sur la majorité exploitée mais que nous serions tous des « citoyens égaux devant la loi » et que les « citoyens travailleurs » auraient des partis de gauche et des syndicats qui les défendraient contre les excès et les abus des patrons spéculateurs, des pouvoirs de la finance, des usurpateurs de la « souveraineté » nationale. Au contraire des contes, la dure réalité vécue par les travailleurs dans tous les pays c’est que leur « fée marraine », la gauche du capital, lorsqu’elle est au gouvernement, se comporte comme la marâtre, la droite, en mettant en œuvre les mêmes plans d’austérité. C’est pour cela que l’alternative ne consiste pas à faire des changements dans le système, mais à changer de système, en abolissant l’exploitation et les classes sociales. Oui, mais comment y parvenir ?
Nous avons bien vu et vérifié que nous ne pouvons pas avoir confiance en ceux qui nous disent : « Votez pour nous ! », et aussitôt profitent de notre confiance pour nous attaquer de façon impitoyable. On ne peut pas non plus faire confiance aux syndicats, autoproclamés « représentants des travailleurs », alors qu’en vérité c’est la véritable « cinquième colonne » de la bourgeoisie infiltrée dans les rangs ouvriers. Ils ont toujours mobilisé pour démobiliser et tromper. N’oublions pas que quelques semaines avant la promulgation par Rajoy de sa Reforme du Travail (et que lui-même ait annoncé…la Grève Générale5), UGT et CCOO étaient arrivés à un accord avec le patronat pour rendre flexibles les salaires et accepter des « clauses de suspension » des conventions collectives, toujours favorables aux exploiteurs. Il y a bien longtemps que les syndicats, et ceci partout dans le monde !, sont devenus des gestionnaires du système capitaliste, des défenseurs de l'économie nationale et de la viabilité des entreprises, mais surtout pas des exploités.
Et cela est prouvé dans les « luttes » qu’ils organisent où règne la division et où la passivité des travailleurs est organisée, tel qu’on a pu le voir lors des récentes mobilisations des employés publics à Murcie, Madrid, en Catalogne ou à Valence,… chacun concentré dans son coin ou son centre de travail, chaque jour dans un lieu différent pour ainsi inoculer l’idée que chaque lutte est différente, ne se rassemblant chacun avec ses frères de classe des autres secteurs qu’au coup de clairon des rassemblements syndicaux où, qui plus est, ils nous présentent comme des « citoyens » préoccupés par la propriété étatique de la santé ou de l’éducation et non pas par la défense de nos besoins légitimes en tant que travailleurs. En détournant l’indignation vers la dénonciation de la corruption ou du gaspillage de tel ou tel dirigeant, pour ainsi occulter qu’en dernière instance, tous les gouvernements dans ce système capitaliste ne peuvent se baser que sur une énorme escroquerie, celle qui consiste à dire qu’ils vont agir pour le progrès et le bien-être de la population alors que leur seul guide ce sont les lois capitalistes de la compétitivité, du profit et de l’accumulation de capital.
C’est pour cela que de plus en plus de travailleurs « sentent qu’il y a quelque chose de pourri dans les syndicats », en voyant ceux-ci comme des acteurs d’une comédie où ils jouent, avec le gouvernement, le patronat et d’autres, un rôle inoffensif face à l’avalanche d’attaques que la survie du capitalisme impose. À l’instar du mouvement du 15-Mai qui forgea l’expression « nos revendications ne rentrent pas dans vos urnes », de plus en plus de travailleurs au sein des mouvements des exploités contre les ravages de la crise commencent à pressentir que « notre revendication d’arrêter les attaques capitalistes, notre volonté d’imposer nos besoins face aux exigences de ce système d’exploitation ne rentrent pas dans vos ‘grèves générales’ ».
La forme elle-même de la « Grève générale » est un terrain piégé. En premier lieu parce que l’arme qui consiste à arrêter la production pour faire pression sur les capitalistes a de moins en moins de sens, étant donné qu’aujourd’hui c’est le capitalisme lui-même qui « arrête » la production à cause de la crise économique. Deuxièmement, parce que les propres exigences légales de ces grèves-là (exclusivité des syndicats pour leur appel, décompte de salaire pour ceux qui y participent, convention d’un service minimum abusif pour lesquels les gouvernements du PSOE et du PP sont, encore une fois, d’accord, etc.) fomentent l’atomisation et la passivité des travailleurs. Et la couverture médiatique des grèves générales où l’on mesure leur « efficacité » en pourcentage d’un suivi toujours discutaillé, qui polarise l’attention autour des habituels incidents provoqués par les piquets, qui centre ses caméras sur les têtes des manifs syndicales,…, voilà une panoplie d’instruments pour enlever toute initiative aux travailleurs et fomenter, par contre, leur discipline obéissante devant les ordres des hiérarques syndicaux. La Grève générale – ni celle-ci ni les précédentes - ni celles de l’année dernière au Portugal, ni les plus d’une dizaine qu’il y a eu en Grèce, ne sert à réactiver la combativité, mais elle sert de digue pour la contenir, pour la remettre dans la voie qui l’amène vers le marécage de la résignation et de l’impuissance. La question face à laquelle nous nous trouvons est celle-ci : nous avons besoin de lutter vraiment, unis et sur notre terrain de classe, nous ne pouvons pas déléguer notre responsabilité entre les mains des prétendus représentants « démocratiques » qu’ils soient des syndicalistes ou des députés qui, et la réalité s’est chargée de nous le démontrer jusqu’à plus soif, nous roulent tout le temps, nous trahissent toujours.
Face à une telle situation, il y a beaucoup de camarades qui se méfient et préfèrent rester à la maison. Et c’est cela le « dégât collatéral » principal que les pantomimes syndicales entraînent : démoraliser et isoler ceux qui veulent lutter pour de vrai. Il est vrai aussi qu’il y a beaucoup de travailleurs qui se rendent à ces appels non pas parce qu’ils croient aux syndicats mais poussés par la nécessité d’exprimer tous ensemble notre indignation, de sentir la chaleur de l’unité et de la solidarité des autres camarades de tous les secteurs, de tous les endroits… C’est justement pour tout cela que nous ne pouvons pas laisser les syndicats dilapider notre combativité avec leurs démonstrations stériles.
Les luttes des dernières années (le mouvement en France, en 2010 contre la réforme des retraites, les étudiants en Angleterre contre les augmentations des droits d’inscription aux universités, le printemps arabe, la Grèce, les mouvement des Indignés en Espagne mais aussi en Israël et aux États-Unis, etc.), ont fait apparaître non pas l’épuisement de la combativité des travailleurs mais, au contraire, les forces renouvelées qui ravivent la flamme de la lutte contre l’exploitation et la barbarie capitalistes. Et il n’y a pas que ça. Certes, les difficultés du prolétariat sont multiples et importantes mais, malgré tout, commencent à poindre des tendances porteuses de grands espoirs telles que :
La défense des assemblées comme moyen d’assurer l’organisation et la direction par les travailleurs en lutte eux-mêmes, l’ouverture de ces assemblées à des travailleurs d’autres secteurs, à des chômeurs et des retraités, à tous ceux qui voudront se joindre à la lutte contre les attaques capitalistes.
Le fait de chercher à faire des manifestations un instrument actif pour accumuler de l’unité et de la solidarité. Au lieu des processions syndicales où nous sommes tout juste un numéro, il faut faire de la rue un lieu de rencontre, d’échange d’expériences et de débat sur d’autres nouvelles initiatives (sans attendre le prochain coup de clairon syndical) pour impulser le combat.
Les efforts pour développer une prise de conscience sur la situation actuelle et la perspective que nous affrontons. La détermination pour la lutte sera de moins en moins due à ce que nous pourrons arracher au capitalisme qui aura une marge de manœuvre de plus en plus restreinte. Cette détermination sera de plus en plus due à notre conviction du fait que la seule issue est d’éradiquer ce système de la planète, et cela ne pourra être réalisé que par l’union de tous les exploités du monde.
On a pu le voir avec les luttes et les assemblées du 15-Mai : tout cela n’est point une utopie, mais c’est le début de la véritable lutte qui nous conduira à d’autres défis plus élevés pour essayer de défendre nos conditions de vie et de travail en tant que vrais êtres humains semant ainsi les graines de la société future où il n’y ait ni exploités ni exploiteurs, où l’on puisse enfin réaliser le principe communiste : « De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ».
Courant Communiste International, 24 mars 2012.
1 Dirigeants socialistes au pouvoir en espagne de 2004 à 2011.
2 Parti socialiste ouvrier espagnol.
3 Président du gouvernement depuis 2011 et le retour de la droite au pouvoir.
4 Parti populaire.
5 Ce tract de nos camarades espagnols fait humoristiquement référence aux déclarations de Rajoy lors de sa première réunion à Bruxelles avec le reste des gros bonnets de l’UE, fin janvier. Il avait susurré à l’oreille du finlandais, mezza-voce, sans soi-disant « être conscient d’être filmé » mais tout en le faisant savoir, que « ce vendredi nous avons fait la loi de Stabilité, vendredi prochain ce sera le tour de la reforme financière. Plus tard, la reforme du Travail va me coûter une grève générale », autrement dit, Rajoy faisait là tout le programme en y incluant la nécessaire Grève Générale qui doit servir pour encadrer et défouler le prolétariat espagnol face à ces mesures. Ceci n’empêche, bien au contraire, que le CCI ait tenu, dans la mesure de ses moyens, à distribuer ce tract dans ces rassemblements et à y participer pour justement essayer de contrecarrer les mystifications en montrant d'autres perspectives.
Vie du CCI:
Géographique:
- Espagne [9]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [3]
Rubrique:
Solidarité avec les ouvriers du pétrole du Kazakhstan réprimés par l’état capitaliste !
- 1669 lectures
 Le 16 décembre dernier au Kazakhstan, à Janaozen (ville de 90 000 habitants à environ 150 km de la mer Caspienne, région d'Aktau, Ouest du pays), c’est à un véritable massacre auquel les forces de l’ordre se sont livrées en ouvrant le feu à l’arme automatique contre le rassemblement de 16 000 ouvriers du secteur du pétrole (et des habitants de la ville qui étaient solidaires) protestant contre des licenciements et le non paiement de leurs arriérés de salaire. On dénombre au moins une dizaine de morts, (selon le bilan officiel) mais sans doute en réalité plusieurs dizaines de victimes (70 travailleurs) et de nombreux blessés (entre 700 à 800 personnes) !
Le 16 décembre dernier au Kazakhstan, à Janaozen (ville de 90 000 habitants à environ 150 km de la mer Caspienne, région d'Aktau, Ouest du pays), c’est à un véritable massacre auquel les forces de l’ordre se sont livrées en ouvrant le feu à l’arme automatique contre le rassemblement de 16 000 ouvriers du secteur du pétrole (et des habitants de la ville qui étaient solidaires) protestant contre des licenciements et le non paiement de leurs arriérés de salaire. On dénombre au moins une dizaine de morts, (selon le bilan officiel) mais sans doute en réalité plusieurs dizaines de victimes (70 travailleurs) et de nombreux blessés (entre 700 à 800 personnes) !
Le mouvement de luttes dans le secteur du pétrole remonte à la grève de début mai 2011 des ouvriers de la société Karajanbas Mounai, où il est devenu massif en s'étendant mi-mai aux principales autres entreprises d'extraction ou de transformation du pétrole de la région : Ersaï Kaspian Kontraktor, KazMounaiGaz, Jondeou, Krouz, Bourgylaou et encore AktobeMounaïGaz, dans la région voisine d'Aktioubinsk réclamant des hausses de salaires et plus de sécurité (en raison de la fréquence des accidents du travail). L'usine UzenMunaiGaz a été touchée par une grève de trois mois cette année. En décembre, la décision d’organiser les festivités à la gloire du vingtième anniversaire de l'indépendance sur la place centrale de la ville de Janaozen occupée depuis juillet par les grévistes mis à pied relevait de la provocation et a été prise comme tel. Pour sa part l’opposition démocratique au régime a clairement tenté de manipuler ce mouvement de la classe ouvrière à ses propres fins : “ Le 14 décembre, deux jours avant la fête de l'Indépendance, le journal Respublika a publié un appel à manifester à Janaozen, signé par un groupe anonyme, “un groupe de résidents de la province de Mangistau”. Pour la première fois, l'appel de Janaozen présentait des revendications politiques et l'article était titré A bas Nazarbaev ! Les tracts distribués en ville demandaient aux manifestants de se rassembler sur la place centrale le 16 décembre, jour de la fête de l'Indépendance. ” Des policiers et des soldats armés postés sur les toits environnants et des véhicules blindés attendaient le signal de l’émeute. Des manifestants sur la place (des agents provocateurs selon le témoignage des grévistes) ont renversé les décorations de la fête. Des véhicules de police arrivés sur les lieux ont foncé dans la foule, suscitant la colère des manifestants qui ont renversé puis incendié l'un de ces véhicules. Les manifestants ont ensuite incendié l’hôtel de ville, ainsi que le siège de la compagnie pétrolière UzenMunaiGaz, ce qui a servi de prétexte à l’usage de ses armes et des arrestations en masse (130 personnes) par la police. Les ouvriers ont visiblement été pris au piège d’un traquenard mortel monté de toutes pièces par les autorités étatiques et destiné à briser leur mouvement qui perdurait depuis plusieurs mois.
L’état d’urgence et le couvre-feu ont été instaurés immédiatement jusqu’au 5 janvier. Malgré la coupure des communications (Internet et téléphone mobile) et le black out de la télévision d'Etat, cette violente répression a provoqué des mouvements de solidarité dans toute la région productrice de pétrole du Mangistau, sur la rive orientale de la mer Caspienne. Le 17 décembre, tous les gisements sont à l'arrêt. Alors que Janaozen est encerclée par des blindés et que des soldats du ministère de l'Intérieur y ont été déployés, des heurts violents entre les grévistes et les forces de police appuyée par des avions et des blindés se poursuivaient. Dans la localité voisine de Chetpe, des centaines de manifestants bloquent et font dérailler un train transportant du matériel de répression. Un millier de personnes manifestent à Aktau (la principale ville de 160 000 habitants et chef lieu de la région), défiant des forces de sécurité présentes en grand nombre, pour exprimer leur solidarité et protester contre les violences en portant des banderoles : “ Ne tirez pas sur le peuple ! Retirez l'armée ! ” Le lundi 19 décembre, pour le troisième jour consécutif, plusieurs milliers de travailleurs de l'industrie pétrolière manifestent et s’affrontent à la police sur la grande place d’Aktau pour exiger des autorités la fin des violences, le retrait des troupes de la ville de Janaozen, (en scandant des slogans “ Nous voulons que les soldats partent. Ils ont tué des gens d'ici ”), de “ trouver les coupables de la mort des manifestants ” et la démission du président Nazarbaev.
Une répression menée avec la complicité et l’approbation tacites des grandes puissances
La bourgeoisie kazakhe a tout mis en œuvre pour contraindre les ouvriers à la passivité, maniant tour à tour contre eux la calomnie (en les qualifiant de “ voyous ” et “ d’agents de l’étranger ”), la carotte (ou plutôt le mensonge !), telles la promesse du Premier ministre Masimov de réemployer tous les travailleurs du pétrole mis à pied, ou celle du président Nazarbaev d’accorder des aides aux 1 800 grévistes de Janaozen licenciés) et la répression sauvage (les arrestations arbitraires continues des individus de sexe masculin et la torture des détenus). La présidence a même utilisé les règlements de compte qui font rage au sein de la classe dominante, annonçant le 22 décembre le limogeage du gouverneur régional, des patrons du géant des hydrocarbures de l'Etat kazakh KazMounaiGaz - dont son gendre, T. Koulibaïev - et de plusieurs de ses filiales qui employaient les grévistes, pour les faire passer pour des concessions faites aux ouvriers. La bourgeoisie kazakhe semble être arrivée à briser la combativité de la classe ouvrière, pour le moment incapable d’action collective publique.
Comme toujours en ce qui concerne la lutte de classe du prolétariat, les grands médias occidentaux ont, le plus souvent, passé sous silence cet épisode. Ils sont encore d’autant plus silencieux qu’il s’agit de masquer la complicité des bourgeoisies occidentales dans les crimes perpétrés contre les exploités. En effet, la clique Nazarbaev n’est parvenue à ses fins que grâce à la complaisance et au soutien tacite de la bourgeoisie d’autres grandes puissances (telles la France, l’Allemagne, la Russie, la Chine…) avec lesquelles elle entretient les meilleures relations. Plusieurs Etats occidentaux sont fortement engagés dans plusieurs secteurs-clés de l’économie nationale (dont justement le secteur où les grèves ont eu lieu, celui de l’extraction, la transformation et le transport du gaz et du pétrole regroupés depuis 2002 dans un trust étatique, KazMounaiGaz, chapeautant de nombreuses filiales en joint-ventures avec les grandes compagnies pétrolières mondiales. Ces grands Etats sont donc attachés pour des raisons stratégiques à la stabilité sociale du pays et du régime et ne peuvent que trouver un intérêt direct à la répression opérée par le régime. La Russie, dans l’obsession de sa propre déstabilisation, est hystériquement sur la défensive concernant la stabilité sociale et impérialiste de son “ très cher voisin ”. Les entreprises chinoises (telles AO KarajanbasMounai, joint-venture entre KazMounaiGaz et CITIC Group) ont été directement concernées par les revendications ouvrières d’égalité de traitement entre personnel chinois et autochtone. Pour ce qui est de la France, depuis l'élection de N. Sarkozy, les relations se sont intensifiées avec le Kazakhstan par la signature en juin 2008 d’un traité de partenariat stratégique entre les deux pays et la création en 2010 d’une Commission présidentielle franco-kazakhe. Le régime de Nazarbaev a même été qualifié à cette occasion d’“ îlot de stabilité et de tolérance ”[sic] par C. Guéant. Enfin, la réception de Nazarbaev en Allemagne début février pour signer une importante série d’accords commerciaux destinée à “ améliorer la sécurité de l'industrie allemande en matière (d'approvisionnement) en matières premières ”, n’a même pas donné lieu à l’hypocrite couplet habituel sur le sort de la population laborieuse de la part de la ‘démocratie’ allemande, A. Merkel soulignant le “ grand intérêt des entreprises allemandes à investir encore davantage au Kazakhstan. ” Bref tout exemple d’une classe ouvrière se battant pour défendre ses intérêts et toute révélation des exactions barbares de la bourgeoisie susceptibles de soulever l’indignation des exploités doivent être cachés !
Une expression de la remontée mondiale de la lutte des classes
Pour autant que nous puissions nous faire une idée aussi précise que possible des événements au Kazakhstan compte tenu du manque d’informations et du black out bourgeois, la longue série de luttes qui s’y est déroulée constitue indubitablement une expression de la reprise internationale de la lutte de classe du prolétariat sous l’effet de l’aggravation de la crise économique. Ayant impliqué plus de 15 000 travailleurs, c’est la plus grande grève qu'ait connue ce pays mis en coupe réglée par la clique bourgeoise mafieuse de Nazarbaev qui fonde son pouvoir sur le pillage de l’économie et l’exploitation sans frein de la force de travail. Les salaires ouvriers stagnent (en 2009 le salaire ouvrier mensuel moyen était de 550 euros) alors que le coût de la vie a augmenté de 70 % au cours de la même période tandis que le tenga, la monnaie locale, a perdu 25 % de sa valeur. La lutte des ouvriers du Kazakhstan exprime les mêmes caractéristiques que la lutte ouvrière internationale. Les ouvriers de l’époque soviétique ont fait place à une nouvelle génération de jeunes plus combatifs, venus surtout des provinces, qui n’accepte plus la cruauté de son exploitation et de ses conditions de travail épouvantables. Les femmes ont aussi pris une place plus importante dans le mouvement au Kazakhstan. Enfin, le mouvement des ouvriers du pétrole témoigne du même changement d’état d’esprit au sein de la classe ouvrière qu’ailleurs dans le monde, qui s’est concrétisé par la recherche et l’expression de la solidarité contre la terreur et la répression capitalistes.
La lutte des ouvriers du pétrole au Kazakhstan occidental sur la question des salaires remontre à plusieurs années. Les travailleurs de Janaozen s’étaient déjà mis en grève pour réclamer leurs primes en octobre 2009. Ceux de KarajanbasMounai JSC ont démarré une grève en décembre 2010 pour une augmentation de salaire équivalente à celle obtenue après avoir fait grève par les ouvriers d’UzenMunaiGaz, une autre filiale de KazMounaiGaz. Du 4 au 19 mars 2011, dix mille travailleurs pétroliers de KazMounaiGaz ont fait grève en organisant des assemblées générales pour l’annulation de la nouvelle méthode de calcul de leurs salaires (que la direction voulait leur imposer en les obligeant à signer à travers un chantage aux licenciements) et l’obtention d’une prime pour les travaux dangereux. La ville a alors été encerclée par un cordon de forces de police. La grève a été déclarée illégale et les membres du comité de grève traînés devant les tribunaux. Le 9 mai, une immense grève de la faim a commencé. 1 400 personnes ont refusé de prendre leur repas du midi et du soir en signe de protestation. 4 500 travailleurs sont partis en grève le 17 mai et ont tenu une assemblée générale et décidé de lancer la grève, élisant une représentation de six membres en vue des négociations. La direction de KazMounaiGaz et les autorités locales déclarent la grève illégale et annoncent le licenciement de tous les grévistes, espérant ainsi affamer les grévistes et briser leur détermination. Ce recours à des licenciements massifs touchera au total 2 600 grévistes. Les femmes en grève de la faim ont été particulièrement brutalisées. Le 26 mai, 22 ouvriers de UzenMunaiGaz se sont à leur tour mis en grève de la faim par solidarité avec leurs collègues de KarajanbasMounai et sont rejoints le lendemain par 8 000 ouvriers des diverses filiales de KazMounaiGaz qui rejoignent le mouvement pour des hausses de salaires. Certains des grévistes de la faim poursuivent leur action, entourés d'un piquet immense de 2 000 travailleurs qui les protègent de la police. Dès le début, le mouvement s’affronte à la terreur policière et à la répression. Des tracts sont diffusés à la population par les autorités pour déclarer la grève illégale ; des nervis et des policiers en civil organisent des provocations ; des centaines d’arrestations ont lieu. Le 12 juin, la police agresse les femmes des grévistes, les battant et les accusant de participer à une réunion illégale. Dans la nuit du 8 au 9 juillet la police tente de prendre d’assaut le village de tentes des grévistes sur le terrain de la compagnie UzenMunaiGaz – une quarantaine de grévistes s’aspergent d’essence et menacent de s’immoler collectivement par le feu. Cela ne fait que retarder l’évacuation au lendemain. C’est alors que les grévistes transfèrent le village de tentes sur la place centrale de la ville de Janaozen occupée en permanence et, par moments, jusqu’à entre 5 000 à 8 000 personnes. Des bandes armées multiplient les agressions contre de nombreux ouvriers combatifs et syndicalistes indépendants et se livrent à l’assassinat de plusieurs d’entre eux ou de membres de leur famille au cours des mois de juillet et d’août.
L’impasse de la revendication du syndicat indépendant
Ce qui a clairement fait la force des ouvriers du pétrole dès le départ, c’est leur mobilisation massive et la vitalité de leurs assemblées générales où ils ont pu discuter des moyens de la lutte et prendre collectivement les décisions pour s’organiser et développer leur combat. Mais la principale faiblesse du mouvement réside dans le fait qu’il est resté cantonné au secteur et à la région de production du pétrole. La revendication d’un syndicat indépendant (défendue par les organisations trotskistes) qui a été constamment soutenue par les ouvriers à chaque étape du mouvement, n’est pas pour rien dans l’issue fatale de la lutte.
Le régime kazakh, à la structure et aux mœurs politiques fossilisées directement héritées du stalinisme, incapable de tolérer aucune sorte d’opposition, s'appuie en temps normal sur des syndicats complètement inféodés et ouvertement complices des autorités pour s'assurer la paix sociale. La Fédération syndicale officielle a ainsi dénoncé la grève comme “ illégale. ” De fait, ils sont complètement discrédités auprès de la classe ouvrière. La revendication d’une “ véritable ” représentation syndicale a été, à côté des revendications salariales, l’une des raisons de la mobilisation massive de début mai des ouvriers de KazMounaiGaz. Mais celle-ci, loin d’avoir été une aide au développement de la lutte, en a été un frein.
Pour être forte et offrir le front le plus large possible contre l’Etat capitaliste, la lutte a besoin de s’élargir et de s’étendre à l’ensemble du prolétariat, en dépassant toutes les divisions que lui impose le capitalisme, y compris, à terme, les frontières nationales, justement parce qu’il n’y a pas de solution à la situation de la classe ouvrière dans le cadre national. A notre époque, celle de la décadence du système capitaliste, il n’est plus possible où que ce soit d’obtenir de réforme et d’amélioration durable pour la condition ouvrière. Le prolétariat ne peut vraiment résoudre l’insécurité et la précarité de sa condition que par la suppression de l’exploitation capitaliste par le travail salarié, tâche qu’il ne peut envisager qu’à l’échelle internationale.
Il ne s’agit bien sûr pas de remettre en cause la probité et l’honnêteté des ouvriers combatifs qui s’engagent et militent dans les syndicats indépendants (et qui sont souvent victimes de la répression et poursuivis par la justice bourgeoise pour “ incitation à la haine sociale ”, “ organisation de rassemblements, de marches et de manifestations illégaux ”), mais la méthode de combat que ces organisations proposent à la classe ouvrière. En focalisant les ouvriers sur leur appartenance à une branche de l’économie capitaliste (celle du pétrole), la forme syndicale de lutte les y enferme par ses revendications sectorielles spécifiques. Ce faisant, elle émiette la force potentielle du prolétariat, empêche la construction de son unité en le morcelant et le divisant secteur par secteur. En agissant dans le cadre national, le syndicalisme n’a en vue que l’aménagement des conditions d’exploitation de la classe ouvrière au sein des rapports de production capitalistes existants. C’est pourquoi toute forme de syndicalisme est condamnée à faire obstacle aux besoins réels de la lutte de classe, à finalement soumettre les ouvriers aux impératifs de l’exploitation, à pactiser avec la classe dominante et à s’intégrer à la défense de son système pour participer au maintien de l’ordre établi.
Les ouvriers ne doivent pas accepter de laisser borner leur horizon par ces revendications qui les enferment sur leur secteur et dans le cadre de la défense du capital national. Le prolétariat est une classe internationale, sa lutte de classe est internationale et solidaire : la lutte de chacune de ses parties est un exemple et un encouragement à la lutte pour l’ensemble du prolétariat. Pour renforcer son combat d’ensemble, les différentes fractions du prolétariat doivent enrichir leur pratique de la lutte des leçons que sa longue histoire lui a léguées, des expériences accomplies par ses fractions les plus expérimentées dans la lutte.
Svetlana (28 février 2012)
Géographique:
Rubrique:
Un plaidoyer littéraire pour l'humanité (à propos du livre "extrêmement fort et incroyablement près")
- 1896 lectures
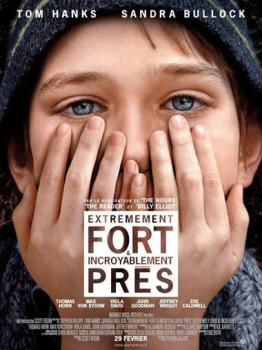 Le film Extrêmement fort et Incroyablement près, sorti en salle début mars, transpose à l’écran un livre sur lequel nos camarades de Welt Revolution, organe du CCI en Allemagne, avaient écrit une courte critique en 2006. Ce livre relate l’histoire d’un petit garçon dont le père a été tué lors de l’attentat du 11 septembre 2001 contre les Tours Jumelles et qui sera amené en cherchant à relier le passé de sa famille au fil de l’Histoire à surmonter son traumatisme et à s’ouvrir à la compréhension profonde que les horreurs de la guerre sont injustifiables.
Le film Extrêmement fort et Incroyablement près, sorti en salle début mars, transpose à l’écran un livre sur lequel nos camarades de Welt Revolution, organe du CCI en Allemagne, avaient écrit une courte critique en 2006. Ce livre relate l’histoire d’un petit garçon dont le père a été tué lors de l’attentat du 11 septembre 2001 contre les Tours Jumelles et qui sera amené en cherchant à relier le passé de sa famille au fil de l’Histoire à surmonter son traumatisme et à s’ouvrir à la compréhension profonde que les horreurs de la guerre sont injustifiables.
Il y a onze ans, le monde a connu un terrible tournant, représentant à la fois un changement et une continuité : les attaques contre le World Trade Center dans la métropole mondiale, New York. Ces attaques qui ont tué des milliers de personnes innocentes ont marqué une nouvelle étape dans la capacité de tuerie du capitalisme.
Avec la chute du bloc de l’Est en 1989, avec les hommes d’Etat proclamant une nouvelle ère de paix, il fallait remplacer le vieux concept occidental de l’ennemi communiste. Depuis le 11 septembre 2001, la classe dominante a réussi à créer le concept d’un ennemi qui semble correspondre à la réalité de la guerre capitaliste depuis 1989 : la guerre contre le terrorisme. C’est un terme très flou qui a l’avantage de pouvoir être utilisé en théorie contre n’importe quel ennemi impérialiste. Cette idéologie fait écho au fait qu’aujourd’hui, tous les impérialismes jouent seuls, qu’ils soient grands ou petits.
Un acte de violence terroriste comme celui du 11 septembre doit-il être justifié ? Peut-on justifier la guerre contre le terrorisme ? Est-ce qu’une guerre juste existe ?
Depuis un certain temps, l’humanité cherche des réponses. Chercher à comprendre est vital pour que la classe ouvrière puisse changer consciemment le monde et forger le futur. En cherchant des réponses, nous pouvons aussi nous aider de l’intuition de l’art et de la littérature.
Les attaques du 11 septembre ont également secoué le jeune auteur new-yorkais Jonathan Safran Foer. Son roman Extrêmement fort et Incroyablement près cherche à assimiler l’incompréhensible en termes artistiques – et il fait bien plus.
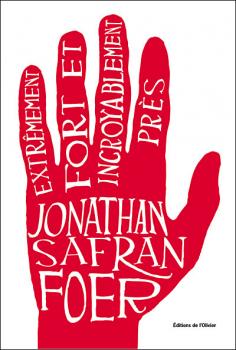 Le roman nous emmène dans le monde d’Oskar Schell, un New-yorkais de 9 ans. Pour lui, le 11 septembre est « le pire jour». C’est celui où son père est mort dans l’une des Tours jumelles. Au début, il est dans un état de stupeur. Cette expérience traumatique l’empêche de communiquer ses sentiments avec les vivants. Tous ses sens sont fixés sur le monde des morts, le monde qui est maintenant celui de son père. Le jour où Oskar trouve une clé dans un vaste appartenant à son père, avec le mot « Black » dessus, marque le point de départ d’une odyssée de 8 mois à travers New York pour résoudre le mystère de la clé. La clé est la métaphore de sa confrontation maintenant permanente avec son traumatisme de guerre. Chercher le mystère de la clé, c’est en fait chercher le chemin du retour à la vie. Ses investigations à travers New York mettent Oskar en contact avec des tas de gens et il commence à réaliser combien il y a d’êtres humains qui sont seuls. Il développe un sentiment de responsabilité et de solidarité envers eux. Les conversations avec ces étrangers en quelque sorte familiers créent peu à peu un pont qui le ramène vers les vivants. Mais pas lui seulement. Il est alors capable de faire face à sa terrible perte. A la fin, sa mère et lui se rapprochent à nouveau.
Le roman nous emmène dans le monde d’Oskar Schell, un New-yorkais de 9 ans. Pour lui, le 11 septembre est « le pire jour». C’est celui où son père est mort dans l’une des Tours jumelles. Au début, il est dans un état de stupeur. Cette expérience traumatique l’empêche de communiquer ses sentiments avec les vivants. Tous ses sens sont fixés sur le monde des morts, le monde qui est maintenant celui de son père. Le jour où Oskar trouve une clé dans un vaste appartenant à son père, avec le mot « Black » dessus, marque le point de départ d’une odyssée de 8 mois à travers New York pour résoudre le mystère de la clé. La clé est la métaphore de sa confrontation maintenant permanente avec son traumatisme de guerre. Chercher le mystère de la clé, c’est en fait chercher le chemin du retour à la vie. Ses investigations à travers New York mettent Oskar en contact avec des tas de gens et il commence à réaliser combien il y a d’êtres humains qui sont seuls. Il développe un sentiment de responsabilité et de solidarité envers eux. Les conversations avec ces étrangers en quelque sorte familiers créent peu à peu un pont qui le ramène vers les vivants. Mais pas lui seulement. Il est alors capable de faire face à sa terrible perte. A la fin, sa mère et lui se rapprochent à nouveau.
L’histoire a de nombreux parallèles aucunement accidentels. Ce n’est pas seulement une histoire à propos du 11 septembre mais aussi de la nuit où la ville allemande de Dresde a été transformée en un tas de décombres par les bombardements. Les grands-parents d’Oskar qui étaient encore des adolescents en 1945, sont des victimes de Dresde. Cette nuit-là, ils ont tout perdu : l’amour, leurs familles, leurs maisons et même leur attachement à la vie. Ils appartiennent à la génération perdue de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu’à la fin, ils seront incapables de surmonter leur expérience traumatique de la guerre. Tandis que la grand-mère continue de penser qu’elle est aveugle, le grand-père devient muet. Les cendres s’accumulent sur eux et ils ne parviennent pas à retrouver le chemin de la vie et du futur.
Il est intéressant de noter que l’auteur, Foer, qui est juif, parle de la famille allemande Schell comme d’une victime de guerre (le père de la grand-mère cacha un Juif des Nazis à Dresde). Ce fait nous transmet un message important. L’histoire dit clairement que toutes ces guerres sont horribles et injustifiables et que les gens normaux sont toujours ceux qui souffrent le plus. Comme le dit le grand-père : « La fin de la souffrance ne justifie pas la souffrance. » En se plaçant de façon inconditionnelle aux côtés des victimes de la guerre impérialiste, le roman met incontestablement en question toutes les histoires sur les guerres « justes » et « bienveillantes » que les puissances capitalistes mettent sans cesse en avant. En particulier, la justification de la Seconde Guerre mondiale par les alliés antifascistes est mise en question. Dans une interview à la télévision, Foer a parlé de son indignation envers la façon dont le terrorisme islamique justifiait le massacre de milliers de civils innocents dans le World Trade Center en se référant aux crimes de l’Etat américain. Mais, en réfléchissant à cette question, il réalisa soudain que l’Etat américain avait utilisé exactement la même logique inhumaine pour justifier la boucherie de la population civile de Dresde et d’Hiroshima. En prenant parti pour la cause de l’humanité, Foer, qui n’est pas politique, entre en contradiction avec la logique du capitalisme et de son idéologie antifasciste. Dans un article dédié à son roman, le célèbre New York Review of Books l’a accusé de mettre les victimes du fascisme sur le même plan que les victimes de l’antifascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme si ici la solidarité inconditionnelle avec les victimes était un crime et pas les massacres commis par toutes les puissances capitalistes ! Ce roman ne porte pas sur la culpabilité ou la non-culpabilité. A la place, il est un fervent plaidoyer pour la dignité humaine foulée aux pieds dans toutes les guerres impérialistes.
Tandis qu’Oskar continue à chercher l’explication de l’inexplicable, il montre à ses camarades de classe et à son professeur choqués une interview d’un survivant de la bombe atomique lancée par l’armée américaine en 1945 sur Hiroshima. Le survivant se rappelle comment sa fille était morte dans ses bras en criant : « Je ne veux pas mourir. » Son père : « Voilà comment est la mort. L’uniforme que portent les soldats n’a pas d’importance. La qualité des armes n’a pas d’importance. J’ai pensé que si n’importe qui pouvait voir ce que j’ai vu, nous n’aurions plus jamais de guerre. »
Bien que le roman fasse à juste raison différents parallèles entre les générations, il fait aussi une distinction significative entre elles. Alors que la génération des grands-parents ressent qu’elle est une génération perdue, le petit Oskar est un représentant d’une nouvelle génération, non défaite. Ses grands-parents qui ont grandi après l’écrasement de la révolution – comme en Allemagne – ouvrant donc la voie à la guerre mondiale et au fascisme, sont incapables de se libérer du traumatisme de guerre du passé. La nouvelle génération d’aujourd’hui, contrairement au passé, est d’abord non défaite et, deuxièmement, prête à apprendre des anciennes générations. Il est significatif qu’Oskar ne parvienne à surmonter son chagrin qu’avec l’aide de ses grands-parents et d’un voisin plus âgé. Il est capable d’assumer son rôle de fils et de reprendre à son compte les choses positives que son père représentait. Oskar parvient à les aborder et à parler de ses sentiments et de ses peurs les plus intimes. Là nous rencontrons sur le plan littéraire une capacité que nous avons récemment connue à son sommet au niveau social durant les manifestations des étudiants en France : la compréhension et la capacité d’apprendre de l’expérience des générations précédentes – ce qui n’était pas le cas en 1968.
Ainsi Oskar a résolu le mystère de la clé. Même si celle-ci n’a pas directement à voir avec son père, cette recherche révèle qu’on ne peut développer assez d’énergie et de joie de vivre que d’une façon collective et embrassant toutes les générations. Ce n’est que par l’amour de la vie, la solidarité et l’humanité que le prolétariat pourra développer une perspective communiste pour toute l’humanité – une société sans crimes terribles comme ceux du 11 septembre ou les bombardements de Dresde ! Le livre de Foer, Extrêmement fort et Incroyablement près, est un plaidoyer pour l’humanité qui ne peut être défendue contre la logique du capitalisme que par le prolétariat révolutionnaire.
Lizzy (9 novembre 2006)
Rubrique:
ICConline - mai2012
- 1522 lectures
Chine : l’intensification des luttes ouvrières
- 2038 lectures
Au cours de la dernière décennie, le prolétariat en Chine et dans le reste de l’Asie du Sud-Est – Birmanie, Cambodge, Philippines, Indonésie, Thaïlande et Vietnam – s’est engagé dans une vague de grèves et de protestation contre l’exploitation capitaliste. Nous voulons nous concentrer ici sur la Chine et, pour ce faire, nous utiliserons largement les informations données par le China Labour Bulletin (CLB), la publication d’une organisation non-gouvernementale basée à Hong-Kong et en lien avec les groupes Human Rights et Radio Free Asia. Le Bulletin veut promouvoir l’idée d’un Etat chinois plus « équitable», et plaide, dans ce cadre, pour l’adoption par celui-ci de « syndicats libres ».
Dans une partie suivante, nous analyserons les récents éléments qui concernent la « République Populaire », y compris les tensions impérialistes, la décomposition et les intrigues autour du tout-puissant bureau politique du PCC.
La lutte de classe
Tout au long des dix dernières années, la classe ouvrière en Chine a été impliquée dans une vague de grèves et de protestations, où les ouvriers se comptaient par milliers, car la colère et la combativité s’accroissent sous le poids de l’exploitation capitaliste. Les grèves spontanées, à l’initiative des travailleurs eux-mêmes, portaient sur tous les tableaux : non-paiement des heures supplémentaires, non-compensation pour les déplacements, corruption des officiels, réduction des salaires et des pensions, dégradation des conditions de travail, augmentation des heures de travail, revendications sur l'éducation et la santé. En somme, toute la gamme des conditions de vie et de travail touchées par l’intensité de l’exploitation de l’Etat chinois. Bien que fortement séparées les unes des autres, ces grèves ont été l’expression d’une réelle dynamique et d’une force grandissante à tel point que le China Briefing du 29 novembre 2011 prévient les investisseurs qu’ils devront s’habituer aux conflits de travail.
Il y a quelques jours seulement, dans la ville de Chongqoing, l’ex-fief du patron du Parti en disgrâce, Bo Xilai, il y a eu des grèves – qui cette fois n’étaient pas liées à des manœuvres du bureau politique – contre les réductions de salaire et des retraites. Cette ville de 30 millions d’habitants du Sud de la Chine, comme beaucoup d’autres, est au bord de la banqueroute, un problème qui s’accroît (les faillites locales sont un gros problème pour le capitalisme, touchant aussi plusieurs Etats comme on le voit dans le monde entier -Etats-Unis ou Espagne par exemple). Contre la lutte à Chongqoing, les autorités, comme partout, ont stoppé les blogs qu’utilisaient les ouvriers pour communiquer entre eux et informer du black-out de l’Etat.
Le CLB du 5 mars 2012 écrit que les grèves et les manifestations se sont poursuivies à travers tout le pays au cours du mois de février 2012, la majorité d’entre elles ayant lieu dans les secteurs industriels, les manufactures et les transports, avec des revendications en grande partie pour des augmentations de salaires et contre la réduction des primes. Cinq mille ouvriers de Hanzhong Steel Co, à Shaanxi, au nord du pays, ont fait grève contre les bas salaires et la durée trop longue du travail. Plusieurs milliers de travailleurs ont quitté l’usine et sont partis dans les rues de la ville pour manifester. Le rapport indique que les ouvriers élisaient leur propres représentants. Le numéro de mars du Bulletin enregistre le plus grand nombre total de grèves depuis qu’il a commencé à tenir des comptes il y a quinze mois, et note l’accroissement du nombre de grèves pour réclamer des hausses de salaires et contre les délocalisations. Les escadrons anti-émeutes et les milices sont présentes de manière active dans beaucoup de ces luttes et , à côté de ceux qui ont été licenciés, nombre de militants ouvriers ont été « détenus » - mais le bureau de la Défense des Droits de l’Homme en Occident n'en souffle pas le moindre mot. En Chine, la répression et la surveillance sont évidemment la spécialité d’un Etat stalinien et, comme dans les régimes arabes, cet Etat utilise aussi des bandes de voyous armés qui sont payés et envoyés dans tout le pays pour être utilisés contre les travailleurs. Les dépenses pour la police « intérieure » assurant le maintien de l'ordre en Chine pour 2010 et celles prévues pour 2011 dépassent le budget de la défense « extérieure » – pourtant loin d'être négligeable.1
La force de travail des travailleurs migrants n’est plus docile
Au début du 21 siècle, des millions de jeunes travailleurs ruraux pauvres ont envahi les villes-usines du Sud de la Chine à la recherche de travail. Ces jeunes gens et ces jeunes femmes faisaient beaucoup d’heures pour un salaire vraiment très bas, dans des lieux souvent très dangereux et insalubres. En majeure partie, ils étaient comme des moutons envoyés à l’abattoir. C’est sur cette base que s’est édifié le « Miracle Economique Chinois ». Mais ce consentement forcé n’a pas duré très longtemps. Passée au feu de la lutte de classe, à la fin de la dernière décennie, la période de la force de travail bon marché et docile était vraiment finie. Un nombre significatif de travailleurs, encore jeunes mais plus avisés, mieux éduqués, plus confiants et combatifs, organisaient et menaient des grèves et des protestations. L’été 2010 a connu un sommet avec la vague de grèves dans le secteur manufacturier.e
Au milieu de la décennie, le ministre chinois des Ressources Humaines et de la Sécurité Sociale évaluait le nombre d’ouvriers migrants à 240 millions, y compris 150 millions qui travaillaient hors de chez eux, et à 70 % dans le secteur manufacturier. Même avec ces nombres, il y a eu une pénurie de main d’œuvre autour de 2005 et cette période a vu les luttes ouvrières faire un pas vers des luttes offensives et des revendications, avec des moments spécifiques très forts, encourageant matériellement d’autres à se battre pour leurs propres revendications. L’Etat chinois a enregistré 8000 « incidents de masse » (autrement dit, conflits de travail) en 2007 – la dernière fois que l’Etat a produit des données officielles2. Le CLB estime que ce phénomène s'est considérablement accru au cours des années et que les grèves ont pris une intensité différente. Par exemple, en août 2011, des milliers de travailleurs licenciés, victimes de restructuration de la National Petroleum Corporation de Chine, ont rejoint une manifestation de milliers d’ouvriers du pétrole en grève pour leurs propres revendications. C’était le signe que les occupations de rue, les blocages de route, les manifestations et les sit-in sur les places se développaient. Un autre aspect du développement des blogs sur la toile mentionné plus haut a été son utilisation dans la grève de Nanhai Honda en 2010, où des communications ont été établies et un petit regroupement d’ouvriers a été créé, appelé « L’unité, c’est la victoire ». Les autorités chinoises ont essayé de mettre fin à cette forme de communication sous le prétexte d’empêcher « les rumeurs non fondées ».3 Un des leaders de la grève à Honda a déclaré au New York Times qu’une minorité d’ouvriers, environ 40 en tout, avaient communiqué entre eux et s’étaient rencontrés avant la grève, pour décider de l’action et des revendications mises en avant. Lors de la grève à Pepsi Co en novembre2011, les ouvriers ont élu leurs propres délégués dans leurs assemblées générales. Malgré des augmentations de salaire offertes par la direction, ils ont étendu et fait durer leur action.4
Beaucoup de grèves se sont terminées par des augmentations de salaire et quelques revendications satisfaites, mais beaucoup n’ont pas abouti. Dans tous les cas, des ouvriers ont été licenciés et arrêtés. Et quand des augmentations de salaire étaient accordées, elles étaient souvent rapidement avalées par l’inflation qui est devenue un fléau majeur de l’économie chinoise. Les revendications salariales n’augmentent pas que dans la zone côtière, mais depuis 2010, dans l’arrière-pays, là où les travailleurs impliqués dans les actions ont leur famille, leurs amis, etc., créant la possibilité de nouvelles actions de grève en même temps que des mouvements sociaux, ce qui élargit donc le front du combat. Par ailleurs, très souvent, les travailleurs migrants installés dans d’autres villes ne reçoivent pas d’éducation de base et de prestations de santé, ni pour eux ni pour leurs enfants – que les employeurs devraient payer d'après la loi mais ne le font pas. Cela a ouvert un autre terrain de confrontation. On est bien loin de la situation d’il y a dix ans quand ces jeunes travailleurs venus des campagnes étaient utilisés et payés uniquement en fonction du bon vouloir de l’Etat chinois. Le chômage apparaît largement, la Fédération industrielle de Hong-Kong annonçant qu’un « tiers des industries possédées par Hong-Kong vont réduire les effectifs ou fermer », ce qui va toucher au minimum des dizaines de milliers d’ouvriers. Le CLB affirme que les travailleurs « n’avaient aucune confiance dans la Fédération des Syndicats de toute la Chine »5 et dans sa « capacité à négocier des augmentations de salaire décentes ». En conséquence, ils « ont pris leurs affaires en main et ont organisé tout un éventail d’actions collectives qui sont de plus en plus efficaces ». AFCTU (la Fédération syndicale) est clairement liée au Parti et constituée de ses membres et de ses cadres ; le CLB attire l’attention sur un grand problème auquel se confronte la classe dominante chinoise : le manque de syndicats efficaces pour contrôler et discipliner les travailleurs. L'encadrement syndical a une fonction répressive et peut mettre de l’huile sur le feu. Comme le remarque l’article du CLB sur la grève à Honda mentionnée plus haut : « Toute organisation ouvrière qui se développe pendant une lutte pour des revendications se dissout habituellement après que les revendications qui les avaient fait naître aient été satisfaites. » Le CLB, en bon défenseur de l'Etat, aimerait rendre ces organisations permanentes et les enfermer dans une structure de syndicats libres ayant des relations paisibles avec l’Etat. Les branches de l’ACFTU, telles qu’elles existent, sont quelquefois constituées exclusivement de managers , comme à l’usine Ohms Electronic à Shenzhen, où les douze managers sont tous des fonctionnaires syndicaux ! Dans un effort désespéré pathétique, qui montre aussi les limites de l’Etat stalinien, la Fédération syndicale de Shanxi a ordonné aux 100 000 responsables syndicaux de la province de rendre public leur numéro de téléphone de façon à ce que les ouvriers puissent les contacter !! Dans tout le pays, les branches de l’ACFTU ont renvoyé des travailleurs, enrôlé des briseurs de grève et appelé la police et la milice contre les travailleurs. Le syndicat fait complètement partie de l’appareil du Parti discrédité. La bourgeoisie, pas seulement en Chine mais internationalement, a besoin d’une structure syndicale renouvelée, crédible et souple et c’est là qu’interviennent le CLB et sa propagande pour des Syndicats libres. Nous pouvons le voir dans son appel à « une plus grande participation (des ouvriers) à des comités et à d’autres structures syndicales » et « à donner aux nouveaux employés des informations sur les activités du syndicat », comme après les luttes récentes à Foxcomm.
Les syndicats en Chine – à la différence de leurs frères sophistiqués à l’Ouest – ne voient même pas, en général, venir les grèves, les laissent de côté, ne les désamorcent pas ni ne les divisent. Cela a été le cas à l’usine automobile Honda à Foshan, dans le sud-ouest de la Chine, l’été dernier. Il a fallu deux semaines et une forte augmentation de salaire pour faire rentrer les ouvriers au travail. Kong Xianghong, un ex-travailleur, membre vétéran du Parti Communiste, et maintenant membre de l’ACFTU, a dit après la grève (et l'éruption ultérieure d'autres grèves qu’elle avait permis de déclencher) : « Nous avons réalisé le danger que notre syndicat se sépare des masses. » Kong a ajouté que la Chine avait besoin « de digérer les leçons des mouvements dans les pays arabes ».6
Pour la classe ouvrière en Chine, les luttes s’intensifient et pour la bourgeoisie, les problèmes s’accumulent. En ce qui concerne cette dernière, s’il y en avait la possibilité, et c’est douteux, de créer des syndicats libres, cela lui donnerait un plus grand moyen de contrôle. Pour les travailleurs, les leçons du syndicat libre, Solidarnosc en Pologne, sont que ces institutions peuvent être, de façon insidieuse, plus destructives pour la cause ouvrière que les relations subordonnées des syndicats au Parti et à l'Etat – qui au moins désignent clairement les syndicats pour ce qu’ils sont, des formations anti-ouvrières.
Baboon (15 avril)
1 Bloomberg News, 6.3.11
e There were an estimated 180,000 incidents in 2010, Financial Times, 2.3.11
2 CASS, Social Trends Analysis and Projection Topic Group, 2008-2009.
3 BBC News, 16.3.12.
4 World Socialist Web: Signs of a new strike wave in China.
5 A Decade of Change: The Workers' Movement in China 2000-2010.
6 Washington Post, 29.4.11
Géographique:
- Chine [17]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [3]
Rubrique:
La folie meurtrière du soldat Bales en Afghanistan reflète la folie du monde capitaliste
- 1689 lectures
Ces dernières semaines d’abominables actes de violence barbare ont choqué le monde. Début mars, le sergent américain Robert Bales s’est livré à des tirs frénétiques dans la province afghane du Kandahar. Il s'est rendu de maison en maison, tirant méthodiquement sur des civils afghans. En tout, il a tué 16 personnes, la plupart des femmes et des enfants. Mi-mars, il y a eu les meurtres commis par Mohammed Merah (voir RI 431). Ce dernier a déclaré vouloir se venger de l’interdiction de la burqa en France, de l’envoi de l’armée française en Afghanistan et de l’oppression des Palestiniens par l’État d’Israël.
La raison du délire meurtrier de Robert Bales est encore inconnue. Toutefois, il a perdu tout contrôle et, dans sa soif aveugle de destruction, il voulait lui aussi tuer le plus de gens possible.
Nous ne voulons pas dans cet article sembler nous apitoyer sur la trajectoire particulière de ce GI qui est sorti des clous du meurtre « légalisé » par les ordres de ses chefs. Pas plus que notre propos serait de balayer d’un revers de main les souffrances infinies que connaissent les populations victimes des multiples guerres dans le monde. Ce n’est pas une nouveauté que la guerre ouvre la porte grande ouverte aux pires exactions, collectives et individuelles. Toute l’histoire des sociétés de classe et au plus haut point celle de la bourgeoisie et du capitalisme débordent de témoignages en ce sens. Les deux guerres mondiales du 20e siècle, mais aussi toutes les autres horreurs et abominations qui ont jalonné la barbarie des massacres et qui se sont multipliés depuis 60 ans ont prouvé que cette tendance ne fait que s’accélérer. Nous voulons surtout illustrer à travers le soldat Bates (à l’instar de Mohamed Merah) jusqu’à quel point de décervelage les individus sont amenés dans un contexte de nationalisme exacerbé et soumis pieds et poings liés à la logique du meurtre planifié et justifié par et pour une idéologie de haine alimentée quotidiennement par tous les camps de la bourgeoisie.
« Je vais aider mon pays… »
Le New York Times a rapporté le 17 mars que Bales s’était engagé dans l’armée tout de suite après le 11 septembre. « Je vais aider mon pays » était sa justification. Cependant, quand il a été envoyé sur les champs de bataille, il est devenu conscient que la vie des soldats américains (comme celle de toutes les troupes de la FISA) était en danger 24 heures sur 24. Chaque jour, ils devaient s’attendre à une attaque à tout moment, la plupart par surprise, hideuses et criminelles. La veille de la tuerie, il avait été témoin d’une scène d’horreur au cours de laquelle un de ses collègues avait perdu une jambe sur une mine terrestre. Nous ne savons pas combien il avait vu de victimes civiles ou parmi les combattants ennemis, ni à combien de fusillades il avait participé. Le cas de Robert Bales n’est pas une exception.
C’est un fait avéré que la guerre crée des dommages psychologiques terribles. « Plus de 200 000 personnes (c'est-à-dire un cinquième de tous les vétérans de la guerre en Irak et en Afghanistan) depuis le début de la guerre dans ces pays, ont reçu des traitements dans les hôpitaux militaires – tous étant traités pour des troubles de stress post-traumatiques (SSPT). ‘USA Today’ a publié des données en novembre 2011 se référant à des archives de l’Association des Vétérans. Le nombre estimé de cas non répertoriés d’anciens combattants malades est probablement beaucoup plus élevé. (…) L’armée ne reconnaît que 50 000 cas de PTSD (Post Traumatic Syndrom Disorder»1.
Un tiers environ des soldats de la guerre du Vietnam sont revenus chez eux avec des troubles psychologiques très importants. Bien qu’il n’y ait eu que 1 % de la population qui ait servi dans l’armée américaine, les suicides des soldats représentent 20 % de tous les suicides. Presque 1000 vétérans font des tentatives de suicide chaque mois. Comme ils le disent: « C’est une horreur. La guerre change votre cerveau. Entre la guerre et la vie à la maison, il y un abîme. Vous changez, que vous le vouliez ou non. Une fois retourné chez vous, vous ne pouvez plus trouver un équilibre.»2
Le cas de Robert Bales en est une illustration : si on met le doigt dans le patriotisme et le nationalisme, on est happé par une machinerie de destruction, qui ne fait pas qu’endommager ou détruire la vie de l’ennemi et de sa population civile, mais les soldats eux-mêmes sont démembrés, mutilés mentalement et émotionnellement déstabilisés et profondément blessés. Alors que la classe dominante et ses idéologues embellissent les guerres, en parlant de « mission humanitaire », de « missions de stabilisation », la réalité sur le théâtre de la guerre est complètement différente. Sur le terrain de la guerre, les soldats sont précipités dans les abysses, dans lesquels leur méfiance initiale inévitable évolue en haine et paranoïa. S’ils n’étaient pas déjà enclins à l’usage facile de la violence avant leur engagement, ou s’ils n’étaient pas déjà psychologiquement instables, beaucoup d’entre eux reviennent chez eux profondément déstabilisés psychologiquement. Ce qui est dépeint comme une intervention « humanitaire » s’avère en réalité être l’exercice de la terreur sur la population, avec des humiliations et des tortures. Les soldats développent un sentiment de satisfaction/compensation s’ils peuvent abîmer ou détruire des symboles que la population locale a en haute estime, ou s’ils peuvent humilier des êtres humains directement et ouvertement. La population locale qui a été poussée dans une impasse ne ressent souvent rien d'autre que du mépris pour les « libérateurs » et, parmi elle, beaucoup peuvent être facilement mobilisés pour des attaques suicides. Bref, la machine à tuer tourne à plein régime.
Après tant d’expériences traumatisantes, le soldat Bales ne pouvait plus se dire « je veux aider mon pays » parce qu’il était particulièrement outré qu’après 4 campagnes, il ait été encore renvoyé en Afghanistan. Selon sa femme, les troupes auraient préféré être stationnées dans des pays plus paisibles, Allemagne, Italie ou Hawaï. Le corps et l’esprit de tant de soldats sont mutilés. La brutalité se développe. Une fois revenus à la maison, la plupart d’entre eux doivent faire face au chômage et au sentiment de n’être chez eux nulle part. L’exemple de la ville de Los Angeles est révélateur : « A Los Angeles, il y a beaucoup de vétérans sans domicile. Ils ont tout perdu : leur travail, leur partenaire, leur maison. Tout cela à cause de leurs troubles psychologiques et parce qu’ils ne reçoivent aucune aide. A peu près un tiers de tous les sans abris de Los Angeles sont des vétérans. » 3
NAPO, l'Association Nationale Britannique des Agents de Probation « estimait que 12 000 (engagés précédemment) sont en liberté surveillée et 8500 de plus derrière les barreaux en Angleterre et au Pays de Galles. Ce total de plus de 20 000 est plus du double du nombre d'engagés actuellement en service en Afghanistan. »4.
Aux Etats-Unis, le soldat Bales peut maintenant être condamné à la peine de mort. Au lieu de chercher et d’expliquer pourquoi le patriotisme et le nationalisme conduisent nécessairement à des orgies de violence et à la destruction de victimes, le système judiciaire américain qui en est l’instigateur, agit maintenant comme procureur et « juge ». Il veut se laver les mains de sa responsabilité, après que la guerre et l’armée ont tellement molesté les soldats que ceux-ci finissent par perdre leur contrôle et « s’effondrent ». Le « bien-être » des psychologues de l’armée n’a qu’un seul but : les soldats doivent être aptes au combat. Le psychologue et metteur en scène Jan Haaken a montré dans son documentaire « Mind Zone » quel rôle jouent les psychologues : « Nous ne sommes pas ici pour réduire le nombre de soldats. En cas de doute, les soldats sont déclarés aptes au combat, aussi longtemps qu’ils peuvent faire le travail.»5
Alors que la plupart des soldats (qui se voyaient au début comme participant à la « libération » du pays du joug des talibans) tout autant que la population locale subissent de grandes souffrances (physiques et psychologiques), le système lui-même est asphyxié par le fardeau économique de la guerre. Les Etats-Unis, qui ont déclenché la plus longue guerre de leur histoire, ont accumulé une dépense gigantesque pour celle-ci. « La facture finale s’élèvera au moins à 3,7 milliards de dollars, selon le projet de recherche « Costs of War » (Coûts de la guerre) de l’Institut Watson des Etudes Internationales de l’Université Brown. »6
La guerre, en tant que mécanisme de « survie » du système requiert sans cesse un prix plus élevé. La survie de ce mode de production décadent devient une affaire totalement irrationnelle.
Combattre la barbarie avec des moyens barbares ?
La spirale de la violence, la machinerie de destruction, qui éliminent tout ce qui est humain, ne peuvent être brisées avec les moyens du système capitaliste. Pour renverser ce système inhumain, le but et les moyens doivent être en harmonie l’un avec l’autre.
« La révolution prolétarienne n'a nul besoin de la terreur pour réaliser ses objectifs. Elle hait et abhorre l'assassinat. Elle n'a pas besoin de recourir à ces moyens de lutte parce qu'elle ne combat pas des individus, mais des institutions, parce qu'elle n'entre pas dans l'arène avec des illusions naïves qui, déçues, entraîneraient une vengeance sanglante. Ce n'est pas la tentative désespérée d'une minorité pour modeler par la force le monde selon son idéal, c'est l'action de la grande masse des millions d'hommes qui composent le peuple, appelés à remplir leur mission historique et à faire de la nécessité historique une réalité. » (Rosa Luxembourg, Que veut la Ligue Spartakus ? )
Dv (25 mars)
1 www.spiegel.de/politik/ausland/amoklaeufer-bales-litt-offenbar-unter-posttraumatischem-stress-a-822232.html [18]
2 www.tagesschau.de/thema/usa [19].
3 www.tagesschau.de/thema/usa [19].
4 https://www.dailymail.co.uk/news/article-1216015/More-British-soldiers-prison-serving-Afghanistan-shock-study-finds.html#ixzz1qEGoRWsa [20]
Géographique:
- Afghanistan [23]
Rubrique:
Prise de position sur les récentes grèves au sein de la Police Militaire au Brésil
- 2584 lectures
La grève de la Police Militaire 1 (PM) qui s’est déroulé dans plusieurs Etats du Brésil début 2012, même si ce n’est pas de manière simultanée, a eu des répercussions importantes : elle a touché les Etats de Maranhão, Ceará, Bahia, et s’est étendue à Rio de Janeiro. Le mouvement a atteint sa plus grande ampleur et force dans l’Etat de Bahia où plus de 3000 agents de la Force Nationale de Sécurité, de la Police Fédérale et principalement de l’armée ont dû être mobilisés pour y faire face. C'est essentiellement dans la capitale, Salvador, que la mobilisation a été la plus forte, les policiers en grève et nombre de leurs proches y ayant occupé l’Assemblée Législative.
Le gouvernement de Dilma Rousseff, suivant la ligne de son mentor Lula, a condamné le mouvement de grève en tant qu’atteinte à la démocratie et a ordonné la mobilisation de l’armée et de la Police Fédérale à Salvador, Rio et d’autres villes dans le but très clair de réprimer les manifestants. Jaques Wagner, gouverneur du Parti des travailleurs (PT) à Bahia, a été chargé de diriger les actions contre le mouvement de grève dans cet Etat.
Pour leur part, de hauts représentant du PT, du PCdoB, des gauchistes PSTU et du PSOL 2, ainsi que d’autres organisations de gauche et de droite se virent dans l’obligation de se prononcer "pour ou contre" le mouvement. Les deux premiers partis, progouvernementaux, prirent position contre le mouvement, le qualifiant de grave atteinte à l’État de droit et à la démocratie. De leur coté, les gauchistes du PSTU et du PSOL apportèrent leur soutien sans restriction aux policiers, les considérant comme des "travailleurs de la sécurité publique". La population, étant donnée la grande couverture médiatique donnée au conflit et face aux craintes d’une augmentation de la violence et des homicides, se trouva également confrontée au problème de décider si elle soutenait ou non le mouvement de la PM.
Cette grève de la PM qui n’est ni la première, ni certainement pas la dernière du secteur, exprime les difficultés de l’État brésilien pour préserver l’ordre et la cohésion au sein de ses corps de répression, affectés par la crise économique tant dans les conditions de vie de ses membres que dans son fonctionnement.
Le prolétariat et ses organisations de classe doivent être le plus clair possible sur cette grève de la PM et ce qu’elle représente pour les prochaines luttes qu’entamera le prolétariat brésilien, face aux attaques que la bourgeoisie assène, et qui s’accentueront avec l’approfondissement de la crise mondiale du capitalisme.
La crise capitaliste : cause principale du mouvement
La bourgeoisie brésilienne se glorifie de faire partie de l’élite des "pays émergents", positionnement atteint principalement durant les périodes du gouvernement de Lula ; de fait elle fait partie des pays du groupe appelé "les BRICs" 3. Tout comme ses partenaires, le Brésil est parvenu à occuper cette place grâce à l’exploitation et à la précarisation des conditions de vie du prolétariat, favorisées par un climat de "paix sociale" principalement obtenu grâce au contrôle exercé sur les masses prolétarienne par la gauche du capital, avec à sa tête le PT.
Les policiers, tout comme le reste de la population salariée, n’échappent pas à la pression constante qu’exerce le capital contre leurs conditions de vie : bas salaires, précarisation qui s’exprime à travers une détérioration accrue du salaire direct et social et des conditions de travail, etc. Cependant, les militaires, quel que soit leur grade dans la hiérarchie, en tant que membres de l’appareil de répression de l’État et donc rémunérés par celui-ci, en se mettant en grève, mettent en lumière les conflits et les contradictions au sein de la classe dominante. En effet, d’une part, celle-ci a besoin de pouvoir compter sur un corps répressif toujours apte à exercer la coercition et la violence contre le prolétariat quand celui-ci lutte pour ses revendications, même les plus basiques comme un salaire permettant de satisfaire les besoins élémentaires. Mais, d’autre part, ce sont pour la plupart des personnes recrutées au sein de familles du prolétariat qui, tout en constituant les éléments de première ligne dans la défense de la classe dominante, sont aussi ceux qui perçoivent les plus basses rémunérations parmi les personnel exerçant les fonctions quotidiennes liées à l’appareil répressif étatique (police, juges, tribunaux). Tout ceci provoque un énorme mécontentement propice à la grève.
Le récent conflit de la PM, en tant que mouvement revendicatif du secteur ayant eu la plus grande ampleur jusqu’à ce jour, a posé des problèmes certains à l’État brésilien. Les mesures répressives prisent par le gouvernement fédéral contre plusieurs dirigeants du mouvement, loin de calmer la situation, ont entrainé une plus grande radicalisation. Par ailleurs, les revendications de salaire accordées sont loin de correspondre aux aspirations initiales du mouvement. Ce qui était demandé : réintégration des policiers expulsés de la PM suite à la grève "historique" de 2001, incorporation des primes, paiement d’une prime de risque, rattrapage linéaire de 17.28% rétroactif depuis avril 2007 et révision du secours d’alimentation. Ce qui a été obtenu : proposition d’une augmentation de salaire de 6.5% et une nouvelle prime pour le travail en tant que policier destinée à augmenter progressivement jusqu’en 2014. Les policiers emprisonnés n’ont pas été amnistiés.
Le mouvement de grève de la PM est partie prenante de l’affaiblissement croissant de la capacité de la bourgeoisie à imposer son ordre, alors que certaines forces de répression vont devenir moins fiables au fur et à mesure de l’accentuation des contradictions de son système. L’approfondissement de la crise capitaliste et avec lui la mise en place des mesures d’austérité nécessaires, vont jouer un rôle de premier plan.
Les corps de police : au service de la bourgeoisie contre le prolétariat
C’est un fait que la grande majorité des éléments des corps de police, tout comme la majorité des salariés, ne possèdent pas de moyens de production et ne disposent que de leur force de travail pour survivre. Ils appartiennent aux couches les plus pauvres de la société et se mettent au service de l’État pour recevoir un salaire qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. On pourrait être amené penser que, du fait de cette similitude d’origine sociale et de condition salariée, les intérêts et revendications des policiers coïncident avec ceux du prolétariat qui se voit dans l’obligation de lutter et de se mobiliser contre les attaques du capital. Mais ce n’est pas le cas ; ce sont des mouvements qui se situent dans des camps ennemis.
L’origine sociale des policiers ne doit pas nous faire oublier qu’ils sont au service du maintien de l’ordre dominant avec comme fonction de réprimer et terroriser la population comme l’illustre ce qui suit : "Ces derniers mois abondent des nouvelles d’abus policiers, d’agressions gratuites envers la population, de viols, de répression violente de la PM lors de manifestations, en plus des traditionnels assassinats et tortures. La police brésilienne est celle qui assassine le plus au monde et ses crimes quotidiens ne font jamais l’objet d’enquêtes ni de poursuites… La PM est à l’Université de Sao Paulo (USP) pour réprimer les étudiants, tout comme elle le fit contre les manifestations à Piaui, Recife, Espirito Santo, etc." 4. On peut aussi voir cette même attitude dans la récente évacuation de Pinheirinho 5 et la menace d’évacuation de la communauté de quilombos (communautés descendant d’esclaves) de Rio do Macaco à Bahia, où la Police Militaire qui avait été en grève récemment, était en train de remplir sa fonction répressive conjointement avec la Marine.
C’est pourquoi il est nécessaire et fondamental pour la classe ouvrière et ses minorités révolutionnaires d’être le plus clair possible par rapport au caractère de classe des membres des corps de police et des corps répressifs en général. La position de classe des policiers n’est pas définie par le fait d’être des salariés mais parce qu'ils constituent la première force répressive utilisée par l’État, et de ce fait par le capital, pour affronter le prolétariat.
Cette distinction provient du fait que le prolétariat n’est pas constitué par la somme de tous les salariés, ni même par la somme de tous les exploités. Le prolétariat est une classe sociale dont les intérêts sont antagoniques à la classe des capitalistes, et ses luttes revendicatives sont un maillon dans la chaine des luttes en vue de son émancipation, ce qui les mène à une confrontation avec la bourgeoisie et son État. Quand un secteur du prolétariat lutte, ce n’est pas seulement le travailleur exploité qui est en train de lutter, c’est tout un secteur de la classe révolutionnaire qui est capable de développer sa conscience à travers son expérience de la force sociale qu’il représente dans le capitalisme.
Le policier, en décidant de vendre sa "force de travail" à l’État pour intégrer les organes de répression, met ses capacités au service de la bourgeoisie avec la mission spécifique de préserver le système capitaliste à travers la répression du prolétariat. En ce sens, il cesse d’appartenir à la classe des prolétaires. Quand un chômeur ou une personne qui cherche un emploi décide d’entrer dans la police, il accepte le "contrat" suivant : être fidèle au mandat de faire appliquer la loi et de maintenir l’ordre établi. Ceci le place contre tout mouvement social ou de classe qui affronte les intérêts du capital et son État. Ainsi, le fonctionnaire de police devient un serviteur de la classe dominante et, en tant que tel, se situe hors du camp du prolétariat. On sait bien que les membres des corps répressifs ne répriment pas seulement les travailleurs, mais aussi leurs propres voisins dans les quartiers où ils habitent.
Le récent conflit entre les corps de police et leurs directions est un conflit sur le terrain du capital. En effet, les membres des corps de polices demandent de meilleures conditions de salaire et de travail pour pouvoir mener à bien leur tâche et même pour le faire avec plus d’efficacité, c'est à dire, pour mener à bien leur tâche répressive dans le cadre de "paix sociale".
Dans ce sens, c’est une erreur d’appeler à la solidarité les différents secteurs de travailleurs salariés avec une grève de policiers de ce genre ; essentiellement parce que la fonction de la police réside dans la défense de l’État capitaliste. Le fait que les policiers soient recrutés au sein de la population pauvre ne modifie pas cette fonction, bien que cela puisse influencer d’autres aspects.
L’État, avec hypocrisie, s’affronte aux grévistes en les rendant responsables de l’augmentation de la criminalité et les accusant de laisser la population à la merci des criminels. Ainsi l’État s’organise pour attribuer aux corps de polices un rôle "social", "utile", comme par exemple la lutte contre la criminalité ; c’est la justification sociale de la nécessité de ces forces au service de l’État. Nous voyons ainsi comment les prolétaires et l’ensemble de la population sont conduits à apporter leur soutien pour renforcer les corps répressifs, justifiant le recrutement de plus de policiers ou le fait que ceux-ci puissent bénéficier de meilleurs équipements. La criminalité et la violence sociale sont en augmentation partout dans le monde du fait des propres contradictions du capitalisme et de la décomposition sociale qui n’affectent pas seulement les corps de police, mais aussi les hauts fonctionnaires de l’Etat et ses forces militaires 6.
Seul le développement de la lutte prolétarienne peut dissoudre les corps répressifs
Il existe des circonstances dans lesquelles les forces de l’ordre, principalement l’armée, peuvent être amenées à ne pas agir dans le cadre de la défense de l’État capitaliste. Ceci peut arriver au moment de luttes massives du prolétariat quand de larges secteurs de la population sont mobilisés, et que des secteurs des forces militaires refusent de réprimer les luttes ou mouvements sociaux, pouvant même aller jusqu’à s’unir aux secteurs en lutte et à s’affronter militairement aux troupes qui restent fidèle à la bourgeoisie. Dans ces cas-là, il existe la possibilité et la nécessité de soutenir et même de protéger ces membres des corps répressifs qui s’opposent ainsi aux ordres de répression de l’État.
L’accélération de la crise du capitalisme depuis 2007 qui est à l’origine de l’émergence des mouvements sociaux en Afrique du Nord et dans les pays arabes, ainsi que des mouvements comme celui des "indignés" en Europe essentiellement, ou "Occupy Wall Street" aux Etats-Unis, peut générer des situations où seront possibles des tentatives de fraternisation entre les soldats et les masses en mouvement. Cependant, de telles situations doivent être analysées avec beaucoup de précision politique pour éviter les comportements trop confiants comme nous l’avons vu lors des mouvements en Egypte, quand l’armée, simulant la sympathie avec le mouvement, a laissé faire le sale travail de répression brutale par la police. En fait, dans ce pays, comme nous le savons – et c’est beaucoup plus clair aujourd’hui -, le pilier du système c’est l’armée.
Les illusions démocratiques de ces mouvements et le fait que le prolétariat n’a pas été la classe qui en a pris la direction, les a rendus victimes des fausses sympathies des forces de l’ordre et des institutions bourgeoises et les a conduit à chercher des solutions qui aboutissent au renforcement du camp de la bourgeoisie. Ce n’est que dans des situations révolutionnaires très avancées, quand le rapport de force entre bourgeoisie et prolétariat sera favorable à ce dernier, que nous pourrons nous attendre à une situation de fraternisation avec les forces militaires, comme on l’a déjà vu dans le mouvement ouvrier.
Il y a eu des épisodes importants de fraternisation au cours de la Révolution russe d’Octobre 1917. Trotsky en rend compte de manière brillante dans son œuvre Histoire de la Révolution Russe qui décrit et approuve l’attitude des ouvriers russes en févier 1917 envers les cosaques dont il affirme "qu’ils étaient fort pénétrés d'esprit conservateur" et qu’ils étaient "de perpétuels fauteurs de répression et d'expéditions punitives" ; et plus loin : "les cosaques attaquaient la foule, quoi que sans brutalité (…) les manifestants se jetaient de côté et d'autre, puis reformaient des groupes serrés. Point de peur dans la multitude. Un bruit courait de bouche en bouche : "Les Cosaques ont promis de ne pas tirer." De toute évidence, les ouvriers avaient réussi à s'entendre avec un certain nombre de Cosaques. (…) Les Cosaques se mirent à répondre individuellement aux questions des ouvriers et même eurent avec eux de brefs entretiens. (…) Un des authentiques meneurs en ces journées, l'ouvrier bolchevik Kaïourov, raconte que les manifestants s'étaient tous enfuis, en certain point, sous les coups de nagaïka de la police à cheval, en présence d'un peloton de Cosaques ; alors lui, Kaïourov, et quelques autres ouvriers qui n'avaient pas suivi les fuyards se décoiffèrent, s'approchèrent des Cosaques, le bonnet à la main : "Frères Cosaques, venez au secours des ouvriers dans leur lutte pour de pacifiques revendications ! Vous voyez comment nous traitent, nous, ouvriers affamés, ces pharaons. Aidez-nous !" Ce ton consciemment obséquieux, ces bonnets que l'on tient à la main, quel juste calcul psychologique, quel geste inimitable ! Toute l'histoire des combats de rues et des victoires révolutionnaires fourmille de pareilles improvisations." 7
Le prolétariat et ses minorités révolutionnaires devons garder à l’esprit que, à plus long terme, il ne peut y avoir de victoires militaires sur la bourgeoisie sans désagrégation des forces répressives. La désagrégation sera le produit de plusieurs facteurs :
- La crise économique ;
- La pression de la lutte de classe, la perspective du pouvoir prolétarien s’imposant à la société comme une alternative à la bourgeoisie ;
- Dans ce contexte, le fait que les forces répressives soient essentiellement constituées d’éléments des couches exploitées ou pauvres de la société, les rend réceptives aux appels à la fraternisation de la part du prolétariat.
Il se peut que nombre de prolétaires, d’éléments et groupes politiques appartenant au camp du prolétariat au Brésil sympathisent ou se solidarisent avec la grève de la PM, étant donné que, d’une certaine manière, ils partagent avec la classe des travailleurs la situation de pénurie à laquelle nous soumet le capital. Il se peut même que certains appellent les travailleurs à prendre la grève des policiers comme exemple de lutte. Toutefois, une telle approche ne sert qu'à nuire à la conscience de la classe ouvrière et à affaiblir sa capacité à affronter la classe ennemie, étant donné que non seulement elle assimile la grève des policiers à un évènement qui appartient aux luttes du prolétariat, mais aussi elle alimente un manque de confiance dans les capacité du prolétariat brésilien à développer ses luttes sur son propre terrain de classe après des décennies de léthargie dues à l’action du PT, des autres partis de droite et de gauche du capital, et leurs syndicats.
Lorsque cette "vieille taupe" dont nous parlait Marx commence à secouer les fondations du capital brésilien, moment où, sans doute, il s’affrontera avec force aux corps répressif de l’Etat, sa lutte persévérante et tenace sur son terrain de classe pourra ouvrir le chemin à un affaiblissement de ces mêmes corps répressifs.
Le CCI (14/03/2012)
1 - Au Brésil la police est divisée entre la sphère fédérale et la sphère étatique (c'est-à-dire propre à chacun des différents États de ce pays). Dans la sphère fédérale, se trouvent la Police Fédérale, la Police Fédérale des Autoroutes (ou voies rapides) et la Police Fédérale Ferroviaire. Dans la sphère étatique se trouvent la Police Civile et la Police Militaire. La Police Civile est responsable des investigations et la Police Militaire est l’institution responsable de la sécurité publique et du maintien de l’ordre bourgeois. En plus de ces organisations policières, il y a la Garde Nationale qui est utilisée en cas d’urgence de "sécurité publique" ; elle est formée d’éléments entrainés et détachés de diverses organisations étatiques.
2 - PCdoB : Partido Comunista do Brasil, scission du Partido Comunista Brasileiro.
PSTU : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (Parti Socialiste des Travailleurs Unifié), de tendance trotskiste.
PSOL : Partido Socialismo e Liberdade (Parti Socialisme et Liberté) qui regroupe plusieurs tendances trotskistes.
3 - En économie, on utilise le sigle BRIC pour désigner l’ensemble : Brésil, Russie, Inde et Chine, qui se détache sur la scène mondiale en tant que "pays émergents". Source : es.wikipedia.org/wiki/BRICS [24]
4 - PCO. Grève de la PM : le gouvernement veut que la police réprime la population. Source : www.pco.org.br/conoticias/ler_materia.php?mat=34993 [25]
5 - OPOP. Nous sommes Pinheirinho : Soutien total et solidarité avec les habitants de Pinheirinho. Source : revistagerminal.com/2012/01/24/nos-somos-o-pinheirinho-todo-apoio-e-solidariedade-aos-moradores-do-pinheirinho
6 - Voir l’article de Revolución Mundial, notre section au Mexique, "L’insécurité sociale … Un motif supplémentaire pour lutter contre le capitalisme [26]". Revolución Mundial n° 125, noviembre-diciembre 2011.
7 Histoire de la Révolution russe. Ch. VII. "Cinq journées : du 23 au 27 février 1917". https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/hrrusse/hrr07.htm [27]
Géographique:
Rubrique:
ICConline - juillet 2012
- 1337 lectures
Hommage à Il Jae Lee
- 1226 lectures
Nous avons récemment été attristés par la nouvelle du décès à l’hôpital du camarade Il Jae Lee, militant du Groupe de la Gauche Communiste en Corée ; il avait 89 ans.
Il Jae est né en 1923 dans la ville de Daegu, dans ce qui est maintenant la Corée du Sud mais qui était alors connue sous le nom de Choseon. A cette époque, l’ensemble de la Corée était une colonie japonaise, très prisée pour ses matières premières et sa production agricole, destinées à soutenir l’effort de guerre de l’impérialisme japonais. La police officielle japonaise tentait de réduire la culture coréenne en curiosité folklorique. A l’école, les enfants devaient apprendre le japonais que Il Jae parlait couramment. Pendant la guerre, alors qu’il n’avait pas encore 20 ans, Il Jae prenait déjà part aux luttes ouvrières. Avec le départ des forces d’occupation japonaises en août 1945, le pays fut livré au chaos et, dans beaucoup d’endroits, les travailleurs prenaient le contrôle de la production dans ce que Il Jae appelait des conseils ouvriers (le Changpyong, ou Conseil Ouvrier National de Choseon), bien que dans les conditions d’un pays dévasté par la guerre ces conseils n’étaient pas en mesure de faire plus que produire le strict minimum pour la vie quotidienne. Il Jae rejoignit le Parti Communiste en septembre 1946, et fut un membre dirigeant de la grève générale qui éclata à Daegu, la même année. Avec l’interdiction des grèves ouvrières par les autorités d’occupation américaine, Il Jae rejoignit les partisans qui combattaient dans le sud du pays, et fut blessé à la jambe en 1953. En 1968, sous la dictature de Park Chung Hee, il fut arrêté et condamné à l’emprisonnement à vie à cause de ses activités politiques. Pendant son séjour en prison, sa santé était constamment mise en danger et son visage a toujours conservé les traces des tortures subies. En 1988, il fut relâché, en liberté surveillée, ce qui ne l’empêcha nullement d'aussitôt s’impliquer dans une activité politique à Daegu. Il devint un membre dirigeant des Syndicats Coréens en 1997. C’était tout à fait naturel pour un jeune travailleur entré au Parti Communiste en 1946. Mais, indépendamment de la sincérité et du courage de beaucoup de ses membres, ce Parti n’était en fait rien de plus que l’instrument des impérialismes chinois et russes, et, à la fin de la guerre de Corée, une caricature particulièrement grotesque et barbare du stalinisme : la dictature de la famille Kim.
Si sa vie n’avait été que cela, nous n’aurions alors pas écrit cet hommage : l’histoire est pleine d’héroïsme au service de mauvaises causes. Mais Il Jae était vraiment remarquable par sa capacité, à près de 80 ans, de remettre en question le combat mené tout au long de sa vie. En 2002, il a participé aux activités de l’Alliance Politique Socialiste (SPA), un nouveau groupe qui introduit les idées de la Gauche Communiste en Corée. C'est à l'occasion de la Conférence Internationale Marxiste, organisée par le SPA en octobre 2006, qu'une délégation du CCI, venue en Corée, rencontra le camarade Il Jae. Pendant les débats, bien que nous ayons eu des désaccords avec lui sur de nombreuses questions – en particulier sur la possibilité de faire revivre les syndicats comme formes organisationnelles des luttes ouvrières – nous étions convaincu d'être en présence d’un authentique internationaliste, en particulier sur la question brûlante de la Corée du Nord. Il Jae rejetait tout soutien à ce régime odieux.
Dans nos discussions avec lui ces dernières années, le camarade Il Jae était surtout préoccupé par deux questions : l’unité internationale de la classe ouvrière et, en Corée, la destruction des barrières entre les travailleurs à contrat permanent, ceux à contrat précaire et les ouvriers immigrés du Bengladesh et des Philippines qui commencent à être nombreux en Corée. C’est sur cette dernière question qu’il a rompu avec les syndicats officiels bien qu’il n’ait pas perdu l’espoir d’utiliser le syndicat comme forme d’organisation. Il a participé au 17e Congrès du CCI en 2007 et espérait accompagner la délégation du CCI au Japon en 2008 : malheureusement sa santé déclinante ne lui a pas permis de faire le voyage.
Le camarade Il Jae Lee fut un combattant inébranlable de la cause prolétarienne dont le courage n’a pu être brisé ni par les épreuves et ni par la prison. Il est resté un internationaliste jusqu’à la fin de sa vie. Surtout, il avait le courage moral de constamment chercher la vérité, même si cela signifiait remettre en question les idées pour lesquelles il avait combattu et souffert dans le passé. La classe ouvrière a subi une perte mais elle s’est enrichie de son exemple.
CCI
Vie du CCI:
Géographique:
- Corée du Sud [29]
Rubrique:
Jeux Olympiques de Londres : ruse impériale, austérité et répression
- 2199 lectures
Alors que déferlent sur nos écrans l’intense propagande nationaliste des Jeux Olympiques, nous publions ci-dessous deux véritables œuvres d’art du célèbre « street artist » Banksy et la traduction d’un article de World Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne.
Ces deux images sont des photos de pochoirs réalisés récemment, malgré les interdictions et les menaces d’amende, quelque part sur les murs de Londres. Disponible sur le blog de l’artiste (www.banksy.co.uk [30]), elles représentent un perchiste sautant au dessus de barbelés et s’apprêtant à retomber sur un matelas usé et un lanceur de javelot armé d’un missile. Elles révèlent puissamment la véritable « âme » de ces jeux.
Quant à l’article de nos camarades vivant outre-manche, il revient sur l’histoire des Jeux à Londres, puisque cette ville les « accueille » pour la troisième fois. Et comme vous le lirez, les jeux et le sport sont à l’image de la société qui les organise : ignobles.


Article de World Revolution
Cette année, c'est la troisième fois que Londres accueille les Jeux Olympiques. A chaque occasion, cela révèle une étape dans l’évolution de la société capitaliste.
JO de 1908 : la domination d’une puissance mondiale
Les Jeux Olympiques (JO) de 1908 devaient initialement se dérouler à Rome ; cependant, l’éruption du Mont Vésuve en avril 1906 impliqua que les ressources furent employées pour la reconstruction de Naples. En tant que puissance mondiale, avec un empire recouvrant alors près d’un quart de la surface terrestre et un cinquième de la population mondiale, le Royaume-Uni avait alors la capacité de prendre en charge les jeux à la dernière minute.
En dix mois, il fut possible d’organiser le financement, de trouver un site et de construire un stade digne des métiers d’art. Les dépenses s’élevèrent à près de 15 000 Livres et les recettes furent de 21 377 livres. Les premiers JO de Londres firent donc du profit et dans ce sens furent un succès. Ce que déplorait le journal The Times (du 27 juillet 1908), c’était que « La parfaite harmonie que chacun souhaitait ait été gâchée par certains conflits regrettables et des protestations et objections aux décisions des arbitres. Dans bien des journaux, tout autour de la planète, le sentiment national s’est déchaîné, et l’on a fait librement circuler accusation et contre-accusation. » En gardant à l’esprit les conflits grandissants entre les différentes nations, alors que l’impérialisme devenait le seul mode de fonctionnement du capitalisme, depuis la guerre hispano-américaine de 1889, la guerre russo-japonaise de 1905 et tous les antagonismes qui ont mené jusqu'à la Première guerre mondiale, ceci n'est pas surprenant.
En 1908, les juges étaient tous britanniques et il y avait en moyenne une plainte de l'équipe américaine par jour. Cela a commencé avec le refus d’incliner le drapeau américain devant le roi lors de la cérémonie d’ouverture et s’est poursuivi durant tous les jeux. Lors de l’épreuve de tir à la corde, les américains se sont plaints des lourdes bottines de l'équipe de la police de Liverpool. Quand leur protestation fut rejetée, les États-Unis se sont retirés de l’épreuve. De même, au 400 mètres, les juges anglais décidèrent que la finale serait à recourir parce qu’un coureur américain avait donné un coup de coude à un adversaire anglais. Les américains ont alors boycotté la course. Finalement, les anglais ont gagné plus de médailles d’or, d’argent et de bronze que tous les autres pays. Contre les équipes de 22 pays, comportant au total 2000 coureurs, les athlètes du Royaume-Unis ont gagné 146 médailles ! Un record encore inégalé pour les Jeux Olympiques modernes. Comme le prévoyait The Times (du 13/07/1908) : « Cette année on peut espérer que nous ferons le compliment à nos concurrents étrangers de leur montrer que nous n'avons pas perdu notre ruse. »
JO de 1948 : les Jeux de l’austérité
Durant les quarante années qui précédèrent les jeux de Londres de 1948, l’impérialisme anglais a connu bien des changements. Les puissances impérialistes alliées de l’Angleterre, la Russie et les États-Unis, gagnèrent la Seconde Guerre mondiale. Mais les États-Unis étaient désormais la puissance dominante de l’Ouest, bien loin devant l’Angleterre, reléguée en deuxième position.
L’Angleterre fut ainsi bien hésitante à l’idée d’accueillir les jeux olympiques. Avec une économie dévastée, un rationnement (de la nourriture, du pétrole et des vêtements) qui devenait plus sévère que pendant la guerre, et un fort taux de chômage, de nombreux sans abri et des grèves ouvrières, elle attendait désespérément les fonds américains qu’elle devait recevoir du plan Marshall et n’était pas sûre de l’impact qu’allaient avoir les jeux.
Seulement un mois avant le début des jeux, il y eu une grève « illicite » des dockers de Londres durant laquelle de nouvelles troupes de circonscrits furent envoyées sur les docks. Pour la première fois, un gouvernement utilisait les pouvoirs que lui conférait la « loi de pouvoirs d’urgence » de 1920 pour faire face à la grève. Il ne s’agissait pas là de la seule fois où les travailleurs s'étaient soulevés contre le régime d’austérité du gouvernement travailliste d’après-guerre.
Il y avait eu au moins deux ans de préparation pour ces jeux. Bien qu'aucun nouveau site n'ait été construit, le travail forcé de prisonniers allemands ou bien de guerre a été utilisé sur plusieurs projets de construction, y compris la route menant au Stade de Wembley. Ce n’est pas pour rien que les jeux olympiques de 1948 ont été reconnus comme les jeux de l’austérité. Les visiteurs des autres pays furent encouragés à apporter leur propre nourriture, bien que l’on autorisa l’augmentation des rations pour les athlètes au niveau de celle des mineurs. Les athlètes masculin furent logés dans les camps de la RAF, les femmes dans les universités de Londres. Les athlètes anglais devaient même s’acheter ou se fabriquer leur propre matériel.
Avec 4000 coureurs venant de 59 pays, les jeux de 1948 ont coûté 732 268 livres et donnèrent des recettes à hauteur de 761 688 Livres. Ils permirent un profit modeste, mais le Royaume-Uni ne finit que 12è au tableau des médailles, et tout le monde savait que les États-Unis allaient remporter la première place avant même que les jeux commencent.
JO de 2012 : dette et répression
Bien que quelques pays aient revendiqué avoir atteint l'équilibre, ou avoir fait un bénéfice (voir les déclarations douteuses de Beijing en 2008), les Jeux olympiques ont été un désastre financier pour les pays qui les ont accueilli plus récemment. La dette de Montréal était si grande qu’elle ne fut finalement réglée qu’environ 30 ans plus tard. Le budget originel pour les jeux d’Athènes en 2004 était de 1,6 milliard : la dépense publique finale est plutôt estimée autour de 16 milliards de dollars avec la plupart des sites désormais abandonnés ou bien peu utilisés et un besoin pour l’entretien et la sécurité qui se chiffre en millions. Il est clair que les jeux olympiques furent un des facteurs aggravant dans la crise de l’économie grecque.
Pour Londres 2012, le budget initial était estimé à 2,37 milliards de Livres, mais en sept ans, depuis que la décision fut prise, des prévisions sur le chiffre final se sont élevées à 4, voire 10 fois ce coût prévisionnel. Et il ne s’agit pas de la faute des organisateurs qui n’auraient pas tout fait pour limiter les dépenses ! Les prix pour les entrées, la nourriture, les boissons et tout ce qui touche les jeux olympiques sont la plupart du temps scandaleux, même pour une capitale aussi chère que Londres. Les intérêts des sponsors officiels sont férocement défendus. Il y a des règles très strictes sur "la publicité d'embuscade", c'est-à-dire sur l'affichage de quoi que ce soit (incluant les marques de vêtements personnels) qui inclut également le nom d'une société qui ne serait pas un sponsor officiel.
Toutefois, le domaine dans lequel Londres 2012 semble être le champion toutes catégories, c’est celui de la répression. Durant les jours les plus intenses, il y aura 12 000 policiers en service. Il y aura encore 13 500 militaires disponibles, soit plus que les troupes anglaises en Afghanistan qui représentent 9 500 soldats. Il est aussi prévu la présence de 13 300 agents de sécurité privés. Ces derniers passeront quelques jours à s’entraîner avec les troupes. Un porte-parole de la compagnie de sécurité disait : « Une partie des entraînements sur site avait pour but d’ajuster les effectifs des deux groupes, les spectateurs des jeux auront donc la même expérience avec l’armée qu’avec les gardes privés » (Financial Times du 24 mai).
Et comme si tout cela n’y suffisait pas, une large publicité a été faite au projet d’installation d’un dispositif ultra rapide de missiles sol-air, sur un immeuble près du principal site olympique. Vraisemblablement, celui-ci est destiné à chasser les avions du ciel au-dessus d’une zone résidentielle densément peuplée.
En collaboration avec l’État anglais, les organisateurs des jeux de Londres semblent avoir pensé à tout. Bien qu'ils ne puissent pas pouvoir s’en charger, le Ministère de l'Intérieur a l'intention de faire des contrôles de sécurité sur chacun des 380 000 athlètes, officiels, employés et personnel des médias liés de près ou de loin aux jeux. Il y aura des voies « spécial jeux » sur les routes et elles seront réservées aux véhicules officiels. Et si vous déviez dans une de ces voies, c’est 135 Livres d’amende (170 euros). En entrant sur les sites, vous serez fouillé, sans avoir le droit d’emporter de l’eau de l’autre côté des contrôles de sécurité. Il sera illégal de Tweeter, de partager sur Facebook, ou bien de partager des photos de l’événement de quelque manière que ce soit.
Il y aura plus de 200 pays représentés à ces Jeux et les organisateurs feront tout leur possible pour fournir tout le matériel nécessaire pour l’habituelle orgie de nationalisme, ainsi qu’une belle opportunité de publicité pour Coca Cola, McDonalds, Panasonic, Samsung, Visa, General Electric, Procter and Gamble, BMW, EDF, UPS et le reste de la bande.
Voici le nouveau menu pour les jeux olympiques modernes : nationalisme et commerce. En attendant, durant les préparatifs pour Londres 2012, le conseil local de Newham, le quartier dans lequel le Stade Olympique est placé, a essayé de 'délocaliser' 500 familles à Stoke-on-Trent, à 150 miles de là. Les locataires locaux sont expulsés pour que des propriétaires privés puissent céder les propriétés une fois les loyers massivement gonflés. Les jeux olympiques sont supposés être une inspiration pour les jeunes. Newham a la population la plus jeune d’Angleterre et du Pays de galles, avec la plus haute proportion d'enfants de moins d'un an. Il présente aussi, en moyenne, la plus large taille de ménage, les taux les plus hauts de bénéficiaires d’allocations à Londres, aussi bien que de hauts taux en termes de mauvaise santé et de morts prématurées. Pour les enfants qui vivent dans l’ombre de cette année olympique, il est clair que leur futur ne sera pas amélioré par le spectacle de la guerre pour les médailles.
Car (5 juin)
ICConline - août 2012
- 1311 lectures
La pire des attaques à nos conditions de vie (pour le moment) : jusqu’où ? Comment pouvons nous riposter ?
- 1527 lectures
Voici un tract avec lequel notre section en Espagne dénonce la pire attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière, une attaque qui paraîtra pourtant « légère » en comparaison avec celles qui vont venir. C’est aussi une analyse de la situation, qui essaie d’apporter des propositions aux dernières luttes.
La pire des attaques à nos conditions de vie (pour le moment) : Jusqu’où ? Comment pouvons nous riposter ?
En 1984, le gouvernement du PSOE [Parti socialiste] d’alors imposa la première Réforme du Travail ; il y a tout juste trois mois, le gouvernement actuel du PP [Parti Populaire, droite] a mis en place la plus grave des Réformes du Travail connue jusqu’ici. En 1985 le gouvernement du PSOE fit la première Réforme de la Retraite ; en 2011, un autre gouvernement de ce même PSOE en a imposé une autre. Pour quand est la prochaine ? Depuis plus de 30 ans, les conditions de vie des travailleurs ont empiré graduellement, mais depuis 2010 la dégradation a pris un rythme vertigineux et, avec les nouvelles mesures gouvernementales du PP, elle a atteint des niveaux qui, malheureusement, seront bien bas face aux attaques futures. Il y a, par-dessus le marché, un acharnement répressif de la part de la police : violence contre les étudiants à Valence en février dernier, matraquage en règle des mineurs, utilisation de balles en caoutchouc qui blessent, entre autres, des enfants. Par ailleurs, le Congrès est carrément protégé par la police face aux manifestations spontanées qui s’y déroulent depuis mercredi dernier et qui s’y sont renouvelées dimanche 15 juillet...
Nous, L’INMENSE MAJORITÉ, exploitée et opprimée, mais aussi indignée, nous travailleurs du public et du privé, chômeurs, étudiants, retraités, émigrés..., nous nous posons beaucoup de questions sur tout ce qui se passe. Nous devons tous, collectivement, partager ces questionnements dans les rues, sur les places, sur les lieux de travail, pour que tous ensemble commençions à trouver des réponses, à donner une riposte massive, forte et soutenue.
L’effondrement du capitalisme
Les gouvernements changent, mais la crise ne fait qu’empirer et les coupes sont de plus en plus féroces. On nous présente chaque sommet de l’UE, du G20 etc., comme la « solution définitive »..., qui, le jour suivant, apparaît comme un échec retentissant ! On nous dit que les coupes vont faire baisser la prime de risque, et ce qui arrive c’est TOUT LE CONTRAIRE. Après tant et tant de saignées contre nos conditions de vie, le FMI reconnaît qu’il faudra attendre… 2025 (!) pour retrouver les niveaux économiques de 2007. La crise suit un cours implacable et inexorable en laissant sur son passage des millions de vies brisées.
Certes, il y a des pays qui vont mieux que d’autres, mais il faut regarder le monde dans son ensemble. Le problème ne se limite pas à l’Espagne, la Grèce ou l’Italie, ni ne peut se réduire à la « crise de l’euro ». L’Allemagne est au bord de la récession et il s’y trouve 7 millions de mini-jobs (avec des salaires de 400 €) ; aux Etats-Unis, le chômage part en flèche à la même vitesse que les expulsions de domicile. En Chine, l’économie souffre une décélération depuis 7 mois, malgré une bulle immobilière insensée qui fait que, seulement à Pékin, il y a 2 millions d’appartements vides. Nous sommes en train de vivre dans notre chair la crise mondiale et historique du système capitaliste dont font partie tous les Etats, quelle que soit l’idéologie officielle qu’ils professent –« communiste » en Chine ou à Cuba, « socialiste du 21ème siècle » en Équateur ou au Venezuela, « socialiste » en France, « démocrate » aux Etats-unis, « libérale » en Espagne ou en Allemagne. Le capitalisme, après avoir créé le marché mondial, est devenu depuis presque un siècle un système réactionnaire, qui a plongé l’humanité dans la pire des barbaries : deux guerres mondiales, des guerres régionales innombrables, la destruction de l’environnement... et, après avoir bénéficié des moments de croissance économique artificielle, à base de spéculation et bulles financières en tout genre, aujourd’hui, depuis 2007, est en train de se crasher contre la pire des crises de son histoire avec des États, des entreprises et des banques plongés dans une insolvabilité sans issue. Le résultat d’une telle débâcle, c’est une catastrophe humanitaire gigantesque. Tandis que la famine et la misère ne font qu’augmenter en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, dans les pays « riches », des millions de personnes perdent leur emploi, des centaines de milliers sont expulsées de leur domicile, la grande majorité n’arrive plus à la fin du mois, le sur paiement de services sociaux ultra-réduits rend l’existence très précaire, et, en plus, la charge des impôts, directs et indirects, les écrase.
L’Etat démocratique c’est la dictature de la classe capitaliste
Le capitalisme divise la société en deux pôles : le pôle minoritaire de la classe capitaliste qui possède tout et ne produit rien ; et le pôle majoritaire des classes exploitées, qui produit tout et reçoit de moins en moins. La classe capitaliste, ce 1% de la population comme on le disait dans le mouvement Occupy aux États-Unis, apparaît de plus en plus corrompue, arrogante et insultante. Elle cumule les richesses avec un culot indécent, se montre insensible devant les souffrances de la majorité et son personnel politique impose partout des coupes et de l’austérité... Pourquoi, malgré les grands mouvements d’indignation sociale qui se sont déroulé en 2011 (Espagne, Grèce, Etats-Unis, Egypte, Chili etc.) elle continue, avec acharnement, à appliquer, des politiques contre les intérêts de la majorité ? Pourquoi notre lutte, malgré les précieuses expériences vécues, est si en dessous de ce qui serait nécessaire ?
Une première réponse se trouve dans la tromperie que représente l’Etat démocratique. Celui-ci se présente comme étant « l’émanation de tous les citoyens », mais, en vérité, il est l’organe exclusif et excluant de la classe capitaliste, il est à son service, et pour cela il possède deux mains : la main droite composée de la police, des prisons, des tribunaux, des lois, de la bureaucratie, avec laquelle elle nous réprime et écrase toute tentative de révolte. Et une main gauche avec un éventail des partis de toute idéologie, avec des syndicats apparemment indépendants, avec des services de cohésion sociale prétendument pour nous protéger..., des illusions pour nous tromper, nous diviser et nous démoraliser.
Ils ont servi à quoi tous ces votes qu’on a émis tous les quatre ans ? Est-ce que les gouvernements sortis des urnes ont réalisé une seule de leurs promesses ? Quelle que soit leur idéologie, avec qui ont-ils été ? Avec leurs électeurs ou avec le Capital ? À quoi ont servi les réformes et les changements innombrables qu’ils ont faits dans l’éducation, la sécurité sociale, l’économie, la politique, etc. ? N’ont-t-ils pas été en vérité l’expression du « tout doit changer pour que tout continue pareil » ? Comme on le disait lors du mouvement du 15-Mai : « On l’appelle démocratie et ce n’est pas le cas, c’est une dictature mais on ne le voit pas ».
Face à la misère mondiale, révolution mondiale contre la misère !
Le capitalisme mène à la misère généralisée. Mais ne voyons pas dans la misère que la misère ! Dans ses entrailles se trouve la principal classe exploitée, le prolétariat qui, avec son travail associé – travail qui ne se limite pas à l’industrie et à l’agriculture mais qui comprend l’éducation, la santé, les services, etc.- assure le fonctionnement de toute la société et qui, par là même, a la capacité de paralyser la machine capitaliste et d’ouvrir la voie pour créer une société où la vie ne soit pas sacrifiée sur l’autel des profits capitalistes, où l’économie de la concurrence soit remplacée par la production solidaire pour la satisfaction pleine des besoins humains. En somme, une société qui dépasse le nœud de contradictions dans lesquelles le capitalisme tient l’humanité emmêlée.
Cela, qui n’est pas un idéal mais l’expérience historique et mondiale de plus de deux siècles de lutte du mouvement ouvrier, parait aujourd’hui difficile et lointain. Nous en avons déjà mentionné une des causes : on nous berce avec l’illusion de l’Etat démocratique. Mais il y a d’autres causes plus profondes : la plupart des travailleurs ne se reconnaissent pas comme tels. Nous n’avons pas confiance en nous-mêmes en tant que force sociale autonome. Par ailleurs, et surtout, le mode de vie de cette société, basé sur la concurrence, sur la lutte de tous contre tous nous amène à l’atomisation, au chacun pour soi, à la division et à l’affrontement entre nous.
La conscience de ces problèmes, le débat ouvert et fraternel sur ceux-ci, la récupération critique des expériences de plus de deux siècles de lutte, tout cela nous donne les moyens pour dépasser cette situation et nous rend capables de riposter. C’est le jour même [11 juillet] où Rajoy a annoncé les nouvelles mesures que quelques ripostes ont commencé à poindre. Il y a eu beaucoup de monde qui est allé à Madrid à la manifestation solidaire avec les mineurs. Cette expérience d’unité et de solidarité s’est concrétisée les jours suivants dans des manifestations spontanées appelées depuis les réseaux sociaux. C’était une initiative, hors syndicats, propre aux travailleurs du public, comment la poursuivre en sachant qu’il s’agit d’une lutte longue et difficile ? Voici quelques propositions :
La lutte unitaire. Chômeurs, travailleurs du secteur public et du privé, intérimaires et fonctionnaires, retraités, étudiants, immigrés, ENSEMBLE, NOUS POUVONS. Aucun secteur ne peut rester isolé et enfermé dans son coin. Face à une société de division et d’atomisation nous devons faire valoir la force de la solidarité.
Les assemblées générales et ouvertes. Le Capital est fort si on laisse tout entre les mains des professionnels de la politique et de la représentation syndicale qui nous trahissent toujours. Des assemblés pour réfléchir, discuter et décider ensemble. Pour que tous deviennent responsables de ce qui a été accordé, pour vivre et ressentir la satisfaction d’être unis, pour briser la barrière de la solitude et de l’isolement et cultiver la confiance et l’empathie.
Chercher la solidarité internationale. Défendre la nation fait de nous la chair à canon des guerres, de la xénophobie, du racisme, nous sépare, nous oppose aux ouvriers du monde entier, les seuls sur lesquels nous pouvons avoir confiance pour créer la force capable de faire reculer les attaques du Capital.
Nous regrouper dans les lieux de travail, dans les quartiers, par Internet, dans des collectifs pour réfléchir sur tout ce qui se passe, pour organiser des réunions et des débats, qui impulsent et préparent les luttes. Il ne suffit pas de lutter ! Il faut lutter avec la conscience la plus claire de ce qui arrive, de quelles sont nos armes, de qui sont nos amis et nos ennemis !
Tout changement social est indissociable d’un changement individuel. Notre lutte ne peut pas se limiter à un simple changement de structures politiques et économiques, c’est un changement de système social et par conséquent de notre propre vie, de notre manière de voir les choses, de nos aspirations. Seulement ainsi, nous développerons la force pour résister aux pièges innombrables qu’on nous met sur le chemin, aux coups physiques et moraux qu’on risque de recevoir. Un changement de mentalité qui aille vers la solidarité, vers la conscience collective, lesquelles sont plus que le ciment de notre union, mais aussi le pilier d’une société future libérée de ce monde de concurrence féroce et de mercantilisme extrême qui caractérise le capitalisme.
Courant Communiste International (16 juillet 2012)
[Si tu veux prendre contact avec nous, collaborer, discuter, agir ensemble, tu peux nous retrouver sur [email protected] [31] ou sur es.internationalism.org.
Ce tract est à ta disposition en version PDF pour le reproduire et le diffuser].
Géographique:
- Espagne [9]
Rubrique:
ICConline - septembre 2012
- 1241 lectures
Sahel : le Mali sombre dans le chaos et la barbarie
- 1782 lectures
 Depuis le coup d’État militaire du 22 mars qui a mis le pays en lambeaux, le Mali baigne dans un chaos sanglant. Il est la proie de nombreux gangs et puissances impérialistes qui se disputent son cadavre. Tandis que des centaines de milliers d’habitants quittent leurs demeures pour tenter d’échapper aux massacres, d’autres, sur place, sont bastonnés systématiquement, abattues froidement, voire lapidés. Les habitants des villes et des campagnes vivent ainsi dans une misère et une insécurité effroyable que les forces armées sanguinaires se préparent encore à aggraver en généralisant les tueries au nom de la « libération » de la région Nord, entre les mains des groupes islamistes.
Depuis le coup d’État militaire du 22 mars qui a mis le pays en lambeaux, le Mali baigne dans un chaos sanglant. Il est la proie de nombreux gangs et puissances impérialistes qui se disputent son cadavre. Tandis que des centaines de milliers d’habitants quittent leurs demeures pour tenter d’échapper aux massacres, d’autres, sur place, sont bastonnés systématiquement, abattues froidement, voire lapidés. Les habitants des villes et des campagnes vivent ainsi dans une misère et une insécurité effroyable que les forces armées sanguinaires se préparent encore à aggraver en généralisant les tueries au nom de la « libération » de la région Nord, entre les mains des groupes islamistes.
« Voilà une situation on ne peut plus claire : un coup d’État dans le Sud, une rébellion qui ne vise désormais qu’à installer un État théocratique d’un autre âge dans le Nord, AQMI et consorts qui narguent le monde entier, leurs chefs, parmi les plus recherchés de la planète, qui se baladent tranquillement à Tombouctou ou à Gao et dont les crimes en série les enverraient aussi sûrement à la CPI [Cour Pénale Internationale] que tous ceux qui attendent leur procès dans les geôles de Scheveninge, à La Haye.
A Bamako, le président de la transition, qui n’a pas grand-chose à se reprocher dans l’épreuve que traverse son pays, s’est fait lyncher pendant près d’une heure, devant des bidasses passifs, voire hilares, par des jeunes désœuvrés dont des politiciens, qui n’avaient aucune chance d’exister en dehors du chaos actuel, avaient savamment lavé le cerveau pour les inciter à commettre ce crime impardonnable. Le « sauveur de la nation », Amadou Haya Sango, chef d’une junte qui a arraché le pouvoir des mains d’un président sur le départ, ne sauve rien du tout. (…) Et ses troupes ne se privent pas de torturer, bastonner et emprisonner arbitrairement tous ceux qui n’adhèrent pas à la « cause ».
[Face au] Mali qui sombre chaque jour un peu plus, on nous explique que tous les ingrédients d’une véritable bombe à retardement sont réunis. Qu’une nouvelle Somalie, plus proche et plus inquiétante, est en gestation. Tout le monde clame sa détermination à ne pas laisser AQMI s’installer et son indignation face à une telle descente aux enfers ».1
Voilà la parfaite description d’un État à terre et de sa population prise en otage par les gangsters civils, militaires et islamiques. Fidèles à leur réputation barbare, ces derniers n’ont pas tardé à mettre en branle leur machine à mutiler, à lapider, à expédier dans « l’enfer islamique » tous ceux qui ne se conforment pas à leur « charia ».
Voici une illustration caractéristique de la mentalité et des méthodes de cette « tribu » d’un autre âge qui règne sur Gao : « Gao n’est plus très loin. Le drapeau noir des salafistes flotte sur le barrage dressé au bord de la route. Le jeune qui nous arrête, mon chauffeur et moi, n’a pas plus de 14 ans. Il s’énerve en entendant la musique que crachote le vieil autoradio de notre véhicule. « C’est quoi, ça ? hurle-t-il en arabe.
- Bob Marley.
- Nous sommes en terre d’Islam et vous écoutez Bob Marley ?! Nous sommes des djihadistes, nous ! Descendez de la voiture, nous allons régler ça avec la charia. »
Un chapelet dans une main, un kalachnikov dans l’autre, il me rappelle ces enfants-soldats croisés vingt ans plus tôt en Sierra Leone… Les enfants sont souvent plus féroces que les adultes. Nous nous empressions de l’assurer de notre fidélité à l’Islam, avant d’être autorisés à reprendre la route. (…) Venus d’Algérie ou d’ailleurs, tous se retrouvent au commissariat de police, rebaptisé siège de la « police islamique » : Abdou est ivoirien ; Amadou, nigérien ; Abdoul, somalien ; El Hadj, sénégalais ; Omer, béninois ; Aly, guinéen ; Babo, gambien… Il y a là toute l’internationale djihadiste ! Lunettes noires sur le nez, le bas du visage mangé par une barbe abondante, un Nigérian explique qu’il est un membre de la secte islamique Boko Haram, responsable de nombreux attentats dans le Nord de son pays. Il parle du Mali comme la « terre promise », fustige l’Occident et les « mécréants », et jure qu’il est ‘prêt à mourir’, si c’est la volonté de Dieu ».2
Ce que vivent les populations sous le « gouvernement » des diverses cliques maliennes, qui rivalisent en barbarie, est abominable. Mais, surtout, le monde bourgeois se fiche des souffrances des victimes en laissant pourrir sordidement la situation et en attendant cyniquement les monstrueux déchaînements qui se préparent.
La décomposition du Mali s’installe pour de bon
Après six mois de gesticulations et de marchandages entre brigands, une coalition hétéroclite de cliques maliennes vient de solliciter officiellement l’aide de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), cela « dans le cadre du recouvrement des territoires occupés du Nord et la lutte contre le terrorisme ». Selon Le Monde du 8 septembre 2012, Paris, qui préside le Conseil de Sécurité de l’ONU, a aussitôt annoncé l’organisation d’une conférence internationale sur le Sahel, le 26 septembre à New York en marge de l’Assemblée Générale de l’ONU, dont l’appui est nécessaire pour une intervention militaire au Mali. Et de fait, les pays de la Cédéao n’attendent que le « feu vert » du Conseil de sécurité pour envoyer au front quelques 3300 soldats. On sait aussi que depuis le début de l’occupation du Nord du pays par les islamistes, les grandes puissances, en particulier la France et les Etats-Unis, poussent en coulisse les pays de la zone à s’impliquer militairement au Mali en leur promettant financements et moyens logistiques.
En clair, après avoir embraser le Mali en soutenant ou armant directement les bandes qui assassinent, Français et Américains, avec leurs rivaux, s’apprêtent à se lancer dans une nouvelle aventure guerrière sous prétexte d’aider le Mali à retrouver son « intégrité territoriale » et au nom de la lutte contre le « terrorisme islamiste ».
Malheureusement pour la classe ouvrière et les opprimés de cette région, toutes les forces bourgeoises autour de l’ONU et de l’UA/Cédéao, qui clament hypocritement leur « détermination » et leur « indignation » pour mieux justifier une intervention armée, ne vont certainement pas lancer la soldatesque dans le but de leur épargner la descente aux « enfers ». En effet, qui peut croire que les impérialismes français ou américain s’indignent sincèrement face à la misère que subissent les masses prolétariennes de cette région ? Qui peut penser que ces chefs de gangs s’activent sérieusement contre AQMI et consorts dans le seul but d’établir la « paix » et la « sécurité » des « peuples » de cette zone ?
A l’évidence, la réponse est : personne ! En vérité, nos grands barbares « démocrates » s’apprêtent à brûler toute la région simplement parce que leurs intérêts stratégiques et économiques y sont menacés directement par des groupes armés, empêchant de fait le « bon fonctionnement » des circuits économiques. D’ailleurs, c’est ce qu’il faut comprendre quand les autorités américaines et françaises parlent de « guerre contre les groupes terroristes » et pour la « sécurisation des zones d’approvisionnement des matières premières ». De même certains organes de la presse bourgeoise préparent les « opinions publiques » dans ce sens pour mieux justifier les massacres de masse : « Ce n’est plus une hypothèse, c’est une certitude : plus les jours passent, plus s’accentue la décomposition de cet État désormais éclaté, et plus le cauchemar stratégique, humanitaire et politique d’une somalisation du Mali hante l’Afrique de l’Ouest, le Maghreb et bientôt l’Europe. Même ceux qui, il y a deux mois, accordaient à la sécession du Nord quelques circonstances atténuantes par sympathie pour les revendications socio-économiques trop longtemps négligées des Touaregs, sont effarés par la mainmise brutale des groupes islamiques les plus intransigeants sur ce qui reste des populations de l’Alzawad. Comment accepter que le terrorisme et les trafics en tous genres trouvent un sanctuaire en plein Sahel, sous le couvert de la charia et la bannière d’un djihadisme dévoyé ? »3
En effet, de l’Algérie au Nigeria, de la Libye au Niger, du Soudan au Mali, du Tchad au Gabon en passant par la Côte d’Ivoire, toute cette partie de l’Afrique est bourrée des matières premières les plus recherchées dont le contrôle constitue un enjeu hautement stratégique. Donc, même s’ils savent parfaitement qu’ils vont y laisser des plumes, les divers charognards vont cyniquement entretenir le sanglant chaos. On sait que la France n’a jamais cessé d’intervenir militairement dans cette zone, notamment en Mauritanie et au Niger, en compagnie de troupes de ces pays pour protéger ses sociétés, comme AREVA qui exploite l’uranium nigérien. Les États-Unis ne sont également pas en reste comme le remarque à nouveau la revue Jeune Afrique : « Leur rôle [des États-Unis] est devenu encore plus vital depuis que le Nord du Mali est tombé entre les mains des islamistes et du Mouvement national pour la libération de l’Azawad. (…) La tension qui règne dans le nord malien incite aussi le Pentagone à renforcer sa présence en Mauritanie. (…) Actuellement, affirme le ‘Washington Post’, les Américains auraient débloqué plus de 8 millions de dollars pour rénover une base proche de la frontière malienne et mener des opérations de surveillance conjointes avec les forces mauritaniennes. Les deux autres points chauds qui incitent les États-Unis à mettre en branle leur dispositif sont le Nigeria, avec la montée en puissance de Bako Haram, et la Somalie (…). Devant le Congrès en mars dernier, le général Carter Ham (qui dirige l’Africom) a souligné : ‘Si nous ne disposons pas de bases sur le continent, nos moyens en RSR (renseignement, surveillance et reconnaissance) seraient limités et cela contribuerait à fragiliser la sécurité des États-Unis. (...) Lors de son passage devant les parlementaires, le général Carter Hom a aussi déclaré qu’il souhaitait pouvoir établir une nouvelle base de surveillance à Nzara, au Soudan du Sud. Là encore, ce projet s’explique par le contexte local. Les tensions entre le Soudan et son voisin méridional riche en hydrocarbures ne laissent pas indifférent Washington, qui doit assurer la sécurité des compagnies pétrolières présentes dans la région’ ».
On ne peut être plus clair : le grand gang américain et ses concurrents vont pulvériser toute la région du Sahel, à commencer par le Mali, dans le seul but de sécuriser (entre autres) les zones « riches en hydrocarbures ».
Le Mali n’est pas seulement un « Afghanistan africain » mais le visage du capitalisme moribond
Voilà un pays en décomposition totale qui ne peut offrir aucune perspective vivable à sa population et à ses enfants livrés à eux-mêmes, dont nombreux sont ceux qui, pour survivre, se laissent manipuler ou se font recruter de force par divers mafieux et autres trafiquants qui les transforment en soldats ou en mercenaires. Voilà comment de simples hommes victimes de la misère du capitalisme peuvent devenir, du jour au lendemain, des tueurs, des « apprentis bourreaux » d’une grande cruauté. Tous ces jeunes, chômeurs et éternels sans travail, tous ces « sans rien » se trouvent à la merci de tous les brigands criminels assoiffés de profits et de sang : « démocrates » civils ou militaires, putschistes, nationalistes indépendantistes, « djihadistes » et autres vrais « fous de Dieu ».
Amina (9 septembre)
1 Jeune Afrique du 14 juillet 2012.
2 Récit d’un journaliste de Jeune Afrique, 4 août 2012.
3 Jeune Afrique, 16 juin 2012.
Géographique:
- Afrique [32]
Rubrique:
ICConline - octobre 2012
- 1730 lectures
L’Espagne et la Catalogne : deux patries pour imposer la même misère
- 2257 lectures
Le nationalisme est un poison idéologique que la bourgeoisie utilise, soit pour embrigader la classe ouvrière dans ses conflits guerriers, soit pour émousser la lutte des classes sur un terrain corrompu et stérile. Les récentes manifestations nationalistes en Catalogne illustrent parfaitement ce piège tendu par la bourgeoisie au prolétariat. C’est pourquoi nous publions la traduction d’un article de notre section en Espagne qui tire les leçons essentielles de ces événements.
Un million et demi de personnes ont manifesté le 11 septembre dernier à Barcelone pour que la Catalogne « ait son propre État à l’intérieur de l’Europe ».
Cet événement a été analysé selon plusieurs grilles de lectures : L’indépendance de la Catalogne est-elle viable ? Pourquoi la Catalogne veut-elle « divorcer » de l’Espagne ? Est-ce que les catalans vivront mieux après l’indépendance ? Est-il vrai que la Catalogne apporte plus à l’Espagne que ce qu’elle reçoit de celle-ci ? Faudrait-il créer un État fédéral ?
Cependant, une autre lecture manque : celle du prolétariat, la classe sociale qui, par sa lutte historique, représente l’avenir de l’humanité. Voici donc une lecture faite du point de vue de la lutte des classes, que nous pourrions synthétiser en opposant deux termes : nation ou classe ?
Lutter pour la nation, c’est lutter pour les intérêts du Capital
Le 11 septembre nous avons pu voir Felip Puig (ministre de l’Intérieur de la Généralité catalane, responsable et animateur de la violente répression contre les manifestations massives de l’an dernier, organisateur de provocations policières tordues contre les manifestants1) défiler, amicalement entouré de ses victimes, de jeunes chômeurs ou de précaires. On a pu voir neuf des onze ministres d’un gouvernement régional, qui fut en première ligne dans la mise en oeuvre des coupes impitoyables dans les secteurs de la santé et l’éducation, marcher coude à coude avec leurs victimes : les infirmières et les médecins qui ont perdu plus de 30% de leurs salaires, les usagers qui doivent payer un euro chaque fois qu’ils vont en consultation ou payer une partie de leurs médicaments en pharmacie. Nous avons vu des patrons, des policiers, des curés, des leaders syndicaux, partager la rue avec leurs victimes : des chômeurs, des ouvriers, des retraités, des immigrants … Une atmosphère d’UNION NATIONALE a présidé le rassemblement. Le Capital s’est fait accompagner par ses exploités en les transformant en idiots utiles pour ses objectifs égoïstes.
Il est fort possible qu’une partie importante des manifestants ne partageait pas l’objectif de l’indépendance. Peut-être étaient-ils là parce qu’ils ne supportent plus les coupes, le chômage, l’absence d’avenir ; mais ce qui est certain, c’est que leur malaise a été canalisé par le Capital vers son terrain, celui de la défense de la Patrie. La rage des travailleurs ne s’est pas exprimée pour leurs propres intérêts, encore moins vers l’intérêt de la libération de l’humanité, mais uniquement et exclusivement au bénéfice du Capital !
Et qu’on ne vienne pas nous raconter que la lutte pour l’indépendance de la Catalogne affaiblit le Capital espagnol ! Qu’on ne nous serve pas la baliverne selon laquelle le soutien à la Catalogne ravive les « contradictions » du Capital, entre ses fractions « espagnole » et « catalane » !
Si le prolétariat lutte derrière des drapeaux qui ne sont pas les siens – et le drapeau national est le plus opposé à ses intérêts – alors il RENFORCE le Capital, toutes et chacune de ses fractions. Il est possible que cela ravive les contradictions entre eux, mais celles-ci sont canalisées dans leurs crises, leurs guerres, leurs conflits de gangsters, leurs bagarres de famille. Autrement dit, elles finissent par faire partie de l’engrenage de barbarie et de destruction avec lequel le système capitaliste bride l’humanité.
La nation n’est pas la communauté de tous ceux qui sont nés sur la même terre, mais la propriété privée de l’ensemble des capitalistes grâce à laquelle ils organisent l’exploitation et l’oppression de leurs « concitoyens bien-aimés »2. Ce n’est pas un hasard si le slogan de la manifestation était que « la Catalogne ait son propre État ». La nation, ce mot « si affectionné », est inséparable de ce monstre – pas du tout affectionné, froid et impersonnel – qu’est l’État avec ses prisons, ses tribunaux, ses armées, sa police et sa bureaucratie.
Le président Mas3 a promis un referendum, on ne sait pas quelle question sera posée, mais on peut être certain de ce que veulent autant lui que ses collègues « espagnols » : nous faire choisir entre trois options, pires l'une autant que les autres : Voulez-vous que les réajustements et les coupes vous soient imposés par l’état espagnol ? Voulez-vous qu’ils vous soient imposés dans le cadre de la « construction nationale de la Catalogne »? Ou bien voulez-vous que ce soient l’État espagnol et l’aspirant catalan qui vous assomment conjointement ? Le Capital en Espagne possède deux patries pour imposer la misère : « l’espagnole » et la « catalane ».
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Quels sont les mécanismes qui font que les travailleurs défilent avec leurs bourreaux, qui, comme le disait un chef de police espagnol (collègue quelque part du susnommé Puig), les voient comme « l’ennemi »4?
Il y en a plusieurs, mais, à notre avis, trois sont les plus importants :
La décomposition du capitalisme. Si depuis les premières décennies du 20 siècle, le capitalisme est entré dans l’ère de sa décadence, depuis presque 30 ans ce processus s’est aggravé amenant à une situation que nous avons identifié comme celle de la décomposition du capitalismeme. Sur le plan politique, cette décomposition aiguë se concrétise par la tendance à une irresponsabilité croissante des différentes fractions de la bourgeoisie de plus en plus embourbées dans le « chacun pour soi » qui, avec l’exacerbation de la crise, amène à un « sauve qui peut ». Lorsque Mas est allé à Madrid le 13 septembre pour ramasser les dividendes de la manifestation du 11, il a dit que l’Espagne et la Catalogne étaient comme deux conjoints qui ne se supportent plus. Il avait raison, les nations sont des « mariages de convenance » entre fractions différentes de la bourgeoisie ; au vu de la crise et de la décomposition du capitalisme, il est de plus en plus difficile en son sein de forger un projet un minimum sérieux qui agglutine les différentes fractions. Ceci pousse à ce que chacun mène son propre jeu, même en sachant que ce jeu ne va pas lui donner non plus la moindre perspective. Beaucoup de nations sont de plus en plus prises d’assaut par un tourbillon de tendances centrifuges : au Canada, le Québec ne veut plus faire partie de la Fédération, en Grande-Bretagne l’indépendantisme fleurit en Écosse, pour ne pas parler de la Belgique, de l’Italie…
Mais le drame c’est que ces tendances affectent et contaminent le prolétariat entouré comme il l’est de la petite bourgeoisie – bouillon de culture de la décomposition sociale – et soumis à la pression exercée par les comportements cyniques et corrompus de la classe dominante et à la propagande qu’elle diffuse. Le prolétariat doit combattre les effets de cette décomposition sociale, développant les anticorps nécessaires : face à un monde de concurrence effrénée, il doit opposer une lutte solidaire ; face à un monde qui se désagrège en morceaux avec des gouvernants aspirant à devenir les roitelets de leurs taïfas, il doit opposer son unité internationale ; face à un monde d’exclusion et de xénophobie, il doit opposer sa lutte d’inclusion et intégratrice …
Les difficultés de la classe ouvrière. Actuellement, le prolétariat n’a pas confiance en ses propres forces, la plupart des ouvriers ne se reconnaissent pas en tant que tels. Ce fut le talon d’Achille des mouvements des Indignés en Espagne, aux États-Unis etc., où, malgré les éléments positifs et pleins d’avenir, la majorité des participants (précaires, chômeurs, travailleurs individuels…) ne se voyaient pas comme membres de leur classe mais comme « citoyens », ce qui les rendait vulnérables face aux mystifications démocratiques et nationalistes du capital5. Ceci explique que des jeunes chômeurs ou des précaires qui, il y a un an, ont occupé la place de Catalogne, à Barcelone, qui y ont lancé des appels à la solidarité internationale, allant jusqu’à rebaptiser cette place : « Place Tahrir », se soient aujourd’hui mobilisés derrière le drapeau national de leurs exploiteurs.
L’intoxication nationaliste. La bourgeoisie, bien consciente des faiblesses du prolétariat, joue à fond l’atout nationaliste. Le nationalisme n’est pas le patrimoine exclusif de la droite et de l’extrême-droite, il est le terrain commun partagé par un éventail politique qui va de l’extrême-droite à l’extrême-gauche et aussi par ce qu’on appelle les « organisations sociales » (Patronat et Syndicats).
Le nationalisme de droite, attaché à des symboles rances et à une repoussante agressivité vis-à-vis de ce qui est étranger (xénophobie), n’est pas très convaincant pour la plupart des travailleurs (sauf les secteurs les plus arriérés). Le nationalisme de gauche et des syndicats accroche davantage parce qu’il apparaît comme plus « ouvert », plus en phase avec le quotidien. C’est ainsi que le discours nationaliste de la gauche nous propose une « issue nationale » à la crise, et pour ce faire il demande un « partage juste » des sacrifices. Cela, en plus de justifier les sacrifices avec le leurre de « faire payer les riches », inocule la vision nationale car cela présente une « communauté nationale » faite de travailleurs et de patrons, d’exploiteurs et d’exploités, tous unis pour la « marque Espagne ». Quelle différence avec ce que disait Primo de Rivera, leader du fascisme espagnol : « patrons et ouvriers, nous sommes dans le même bateau » ?
Un autre des discours préférés de la gauche et des syndicats, c’est de dire que « Rajoy impose les coupes parce qu’il ne défend pas l’Espagne, c’est un larbin de Merkel ». Le message est évident : la lutte contre les coupes serait un mouvement national contre l’oppression allemande et non pas ce qu’elle est : un mouvement pour nos besoins humains contre l’exploitation capitaliste. En fait, Rajoy est aussi « espagnoliste » que l’était Zapatero ou que le serait un hypothétique gouvernement de Cayo Lara6. Ils défendent l’Espagne en imposant « du sang, de la sueur et des larmes » aux travailleurs et à la grande majorité de la population.
Les mobilisations syndicales du 15 septembre ont été appelées parce qu’ « ils [le pouvoir] veulent démolir le pays », ce qui veut dire que nous, les travailleurs, devrons lutter non pas pour nos intérêts, mais pour « sauver le pays », ce qui nous place sur le terrain du Capital, le même que Rajoy qui prétend sauver l’Espagne avec le sacrifice des travailleurs.
Les groupes qui ont gardé « le label 15-M »7 défendent des choses « plus radicales », mais pas moins nationalistes. Ils disent qu’il faut lutter pour garder la « souveraineté alimentaire », ce qui veut dire qu’on doit produire « espagnol » et consommer « espagnol ». Ils parlent aussi de faire des « audits à la dette » pour rejeter les dettes qui « auraient été imposées illégitimement à l’Espagne ». Une fois encore : une position nationaliste pure et dure ! La gauche, les syndicats et les restes frauduleux du 15-M réalisent un « remarquable » travail de « formation de l’esprit national ». C’est ainsi que se nommait du temps du dictateur Franco une matière scolaire obligatoire ; aujourd’hui, depuis toutes les tribunes on nous donne, démocratiquement, ce genre de leçon à avaler de gré ou de force !
Il ne faut surtout pas s’imaginer que toute cette plaie nationaliste ne sévit qu’en Espagne ! On la sert à toutes les sauces dans le reste des pays. En France, Melenchon, leader d’un supposé radical Front de Gauche, proclame que « la bataille contre le traité [de Stabilité que va signer la gauche « molle » de Hollande] est un nouvel épisode révolutionnaire pour la souveraineté et l’indépendance »8., Rien que ça ! On se croirait aux temps de Jeanne d’Arc !
Le matraquage nationaliste n’a d’autre finalité que de faire s’affronter les travailleurs entre eux. Aux travailleurs allemands, qui doivent subir des salaires de 400 € et des retraites de 800 €, on insinue que les causes de leurs sacrifices sont les travailleurs de l’Europe du Sud, des vauriens qui ont vécu au dessus de leurs moyens. Aux travailleurs de Grèce, on fait comprendre que leur misère est le produit des privilèges et du luxe dont jouissent les travailleurs allemands. À Paris, on leur dit qu’il vaut mieux que les licenciements se fassent à Madrid plutôt qu'en France.
Comme on le voit, on nous attache avec un nœud gordien des mensonges qu’il faudra briser en comprenant que la crise est mondiale, que les coupes sévissent dans tous les pays. Le matraquage autours du problème national fait qu’on ne voit que les 700 000 chômeurs en Catalogne ou, à la limite, les 5 millions en Espagne, et on ne voit pas ceux du monde entier qui sont plus de 200 millions. Quand on ne voit que la pluie des coups de ciseaux qu’il y a eu en Catalogne et en Espagne, on ne voit pas les coups de ciseaux monstres qui ont été imposés, par exemple aux travailleurs « privilégiés » des Pays-Bas. Quand on ne regarde que « notre propre misère », en tant qu’espagnols ou catalans, on ne voit pas la misère du monde du point de vue prolétarien. Quand on regarde avec l’optique nationale, étroite, mesquine et excluante, on a le cerveau prêt à croire, comme « Perrette et son pot au lait », aux histoires à dormir debout que raconte l’honorable monsieur Mas tel que « si on payait à la Catalogne les 10 milliards qu’on lui doit, les coupes seraient superflues », version régionale du « si l’Espagne n’était pas aussi ligotée par l’Allemagne il y aurait de l’argent pour la santé et l’éducation ».
Contre la division du monde en États-nation, lutte pour la communauté humaine mondiale
Le capitalisme a créé un marché mondial, il a généralisé à toute la planète le règne de la marchandise et le travail salarié. Mais celui-ci ne peut fonctionner que par le travail associé de l’ensemble des travailleurs du monde. Une automobile n’est pas l’œuvre d’un ouvrier individuel, elle ne l’est pas non plus des ouvriers d’une usine, même pas du pays où elle a été fabriquée. Elle est le produit de la coopération de beaucoup d’ouvriers de différents pays et de différents secteurs aussi : pas seulement de l’automobile mais de la métallurgie, des transports, de l’éducation, la santé…
Le prolétariat possède une force fondamentale face au capitalisme : être le producteur associé de la plupart des produits et des services. Mais il a également une force pour donner un avenir à l’humanité : le travail associé qui, libéré des chaînes capitalistes – de l’État, de la marchandise et du salariat – permettra à l’humanité de vivre d’une façon solidaire et collective, dédiée à la pleine satisfaction de ses besoins et celles du progrès de l’ensemble de la nature.
Pour évoluer dans cette direction, le prolétariat doit s’orienter vers la solidarité internationale de tous les prolétaires. Enchaîné à la nation, le prolétariat sera toujours enchaîné à la misère et à toutes sortes de barbaries ; enchaîné à la nation, il sera toujours empoisonné par des falsifications anti-solidaires, xénophobes, d’exclusion, patriotiques… Enchaîné à la nation, il acceptera la division et l’affrontement dans ses rangs.
Aucune solidarité avec nos exploiteurs ! Notre solidarité doit se porter vers les ouvriers d’Afrique du Sud écrasés par leurs soi-disant « libérateurs noirs »9, notre solidarité doit se porter vers les jeunes et les travailleurs palestiniens qui manifestent aujourd’hui contre leurs exploiteurs du « presque-Etat » palestinien. Notre solidarité l’est avec les ouvriers de tous les pays.
L’unité et la solidarité ne sont pas avec « nos concitoyens » capitalistes de l’Espagne ou de la Catalogne, mais avec les ouvriers exploités du monde entier !
Les prolétaires n’ont pas de Patrie !
Acción Proletaria (CCI, Espagne), 16 septembre 2012
1 Pour bien saisir le niveau moral et les prouesses répressives de ce sinistre sire F. Puig, voir : Qu’y a-t-il derrière la campagne contre les « violents » autour des incidents de Barcelone ?, (fr.internationalism.org/icconline/2011/dossier_special_indignes/quyatil_derriere_la_campagne_contre_les_violents_autour_des_incidents_de_barcelone.html [33]) et : Solidarité avec les indignés de Barcelone matraqués par la démocratie bourgeoise : A BAS L’ÉTAT POLICIER !, (fr.internationalism.org/icconline/2011/dossier_special_indignes/solidarite_avec_les_indignes_de_barcelone_matraques_par_la_democratie_bourgeoise.html [34])
2 Voir notre brochure Nation ou Classe (fr.internationalism.org/brochure/nation)
3 Président de la Généralité de Catalogne
4 Voir : Pourquoi nous considèrent-ils comme leurs ennemis ? (fr.internationalism.org/ri430/pourquoi_nous_considerent_ils_comme_leurs_ennemis.html)
me Voir nos THESES : la décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste, publiées en 1990, (fr.internationalism.org/french/rint/107_decomposition.htm )
5 Pour un bilan critique des mouvements de 2011, voir : "2011 : de l'indignation à l'espoir [35]", et : "Mouvement des indignés en Espagne, Grèce et Israël : de l’indignation à la préparation des combats de classe [36]" dans la Revue Internationale nº 147.
6 Rajoy est l’actuel chef de gouvernement (droite), Zapatero, le précédent (socialiste) et Cayo Lara est le dirigeant du PC et de la coalition Gauche Unie. [NdT]
7 « 15-M », abréviation du 15 mai 2011, date de la manif qui a déclenché le mouvement des Indignés en Espagne. [NdT]
8 Ces déclarations de Mélenchon ont été traduites en français à partir de celles reproduites par le journal espagnol El País, 16/09/2012. [NdT]
9 Lire La bourgeoisie lance ses chiens de garde policiers et syndicaux sur la classe ouvrière (Révolution internationale, septembre 2012), (fr.internationalism.org/node/5158) et, en espagnol, une prise de position d’un lecteur chilien : Masacre de Marikana, lecciones de la experiencia sudafricana (https://es.internationalism.org/node/3468 [37])
Géographique:
- Espagne [9]
Rubrique:
Quelques leçons sur un an de lutte de classe en Espagne
- 2049 lectures
Nous présentons ici trois textes de réflexion sur les dernières expériences de mobilisation survenues récemment en Espagne : l’anniversaire du 15-M (le mouvement des Indignés a été marqué par une mobilisation très forte le 15 mai 2011 qui a donné ce nom) et la grève des mineurs. Ce qui ressort de cet ensemble de textes, c’est son caractère international.
En premier, nous publions un article de notre section en Grande-Bretagne qui prend position sur ces deux mobilisations en réponse à des débats qu’il y a eu sur le forum de langue anglaise libcom.
Ensuite, il y a un camarade qui collabore régulièrement avec nous et qui nous fait part ici de ses propres réflexions sur la grève des mineurs.
Enfin, nous publions un bref commentaire de notre part sur ces réflexions.
Ce caractère international correspond à celui de la lutte du prolétariat, qui est une classe dont les intérêts sont communs dans tous les pays. Ce caractère mondial a l’avantage d’une vision plus large, une vision qui donne une perspective aux événements face à l'étroitesse du prisme national qui, par définition, et frappé de myopie.
1. Espagne : comment pouvons-nous répondre aux attaques dans une économie aux abois ?1
La classe ouvrière en Espagne subit des mesures d’austérité particulièrement dures dans un contexte de crise économique profonde, ce qui fait augmenter la tension sociale. Les luttes qu’il y a eu en 2011 comme réponse à la crise ont servi d’inspiration pour bien d’autres mouvements. Dans le cas du mouvement du 15-M, il a été influencé par le printemps arabe et, à son tour, il a inspiré des luttes en Grèce et aux États-Unis, par exemple. L’anniversaire du 15-M a coïncidé dans le temps avec le début de la grève des 8000 mineurs au nord de l’Espagne contre un important retrait des aides publiques au secteur minier, ce qui, en plus d’en finir avec l’activité minière, menacerait quelque 40 000 emplois indirects dépendants de celle-là, dans un pays comptant 24 % de chômeurs, dont la moitié des jeunes de moins de 25 ans. Cet article veut contribuer au débat sur les leçons qu’on peut tirer de l’anniversaire du 15-M et de la grève dans les mines.
Les difficultés pour lutter avec l’épée de Damoclès du licenciement sur nos têtes
Les mineurs d’Espagne, surtout ceux de la région des Asturies, ont une longue tradition de lutte, avec des épisodes remarquables tels que l’insurrection de 1934 ou les grèves de 1962 ; ce n’est donc pas une surprise que leur détermination à riposter à l’attaque en se mettant en grève le 31 mai. Leur courage dans la lutte est remarquable : l’installation des barricades sur les routes, l’utilisation d’armes improvisées pour repousser les attaques de la Garde Civile qui faisait tout pour lever les blocages, des ripostes aux arrestations, aux charges et aux tabassages. Tout cela a soulevé des sympathies de la part de plein de gens, comme cela a été le cas des participants au forum libcom2 et au site Web de la Tendance Communiste Internationaliste3.
Cette situation rappelle celle de la grève des mineurs au Royaume-Uni des années 1984 et 85, lorsque ce secteur si combatif, profondément respecté et dans un certain sens porteur d’espoir pour l’ensemble de la classe ouvrière, s’est lancé dans une grève courageuse et dure, avec d'innombrables affrontements contre la police pour se défendre d’une répression qui avait atteint des sommets de brutalité. De la même manière que les mineurs espagnols maintenant, ils firent face aux plans de fermeture de beaucoup de mines à une époque de fort chômage. La lutte s’est achevée par une défaite qui a pesé énormément sur la classe ouvrière de Grande Bretagne pendant les deux décennies suivantes.
Dans le débat sur le site libcom, “Fingers Malone” signale les difficultés de la situation à laquelle font face les mineurs espagnols à cause des caractéristiques d’une attaque qui signifie ni plus ni moins la fermeture de cette industrie : « la grève en elle-même ne les mène nulle part », ce qui expliquerait les autres moyens mis en place par les mineurs tels que les barrages de routes et les occupations des mines. Mais, est-ce que ces actions font avancer la lutte de manière efficace ? À notre avis, le problème n’est pas le fait que la grève par elle-même ne soit pas suffisante, mais le fait de se lancer dans la grève seuls, isolés des autres secteurs de la classe ouvrière, ce qui met les mineurs dans une position de faiblesse face au pouvoir (médiatique, économique, politique, répressif) de l’État, les amenant probablement à la défaite. La grève générale dans les contrées minières le 18 juin dernier, organisée par les syndicats (CO et SOMA-UGT) et soutenue par la gauche, n’a pas du tout servi à briser l’isolement des mineurs, cantonnés dans les régions touchées par les réductions des subventions. Et leur revendication d’un « plan charbon » en Espagne, ressemblant à celle des mineurs britanniques de l’époque « coal not dole » (“charbon oui, chômage non ”), ne va déboucher que sur un isolement accru de la grève.
Dans ce sens, le slogan « On n’est pas indignés, on en a plein le cul »4 ne fait réellement qu’exprimer les limites de leur lutte, basée sur l’illusion seln laquelle leur force seule, en tant que mineurs, serait suffisante pour faire face à l’État. D’une certaine manière, les mineurs se voient eux-mêmes comme l’expression d’une position plus radicale que celle des “Indignés”, qui a été une des luttes les plus importantes de l’an dernier, non pas seulement en Espagne, mais au niveau international. Donc, malgré leur grande combativité et leur longue tradition de lutte au sein de la classe ouvrière, l’isolement des mineurs est une faiblesse qui pourrait entraîner un revers important pour la lutte de classe dans son ensemble.
Un an après, que reste-t-il du 15-M ?
Malgré les énormes difficultés qu’affronte la bourgeoisie pour gérer la situation économique, on ne doit jamais sous-estimer l’expérience qu’elle possède dans sa lutte contre la classe ouvrière, tel qu’on a pu le voir clairement lors des manœuvres comme celle de l’isolement des mineurs ou la dernière grève syndicale du 29 mars5, suivie tout de suite par l’annonce des coupes budgétaires allant jusqu’à 2 milliards d’euros.
La “célébration” de l’anniversaire du 15-M en est un autre exemple : une parodie des événements d’il y a un an écrite pour effacer ou du moins caricaturer les mobilisations de 2011, justement au moment où nous avons besoin de réfléchir, de débattre et de digérer les enseignements de cette expérience. Cette année-ci les mobilisations ont été appelées par toute sorte d’organisations gauchistes et syndicales et non pas par des assemblées qui n’existent plus, qui ont mis en avant des positions démocratiques et réformistes “citoyennes”, loin de toute vision de classe.
Les fausses alternatives offertes par la droite gouvernementale et la gauche se complètent à la perfection. Au PP la menace de répression contre le mouvement, l’accusant d’être un sous-marin du PSOE. De son côté, le PSOE, qu’il y a un an essayait de déformer la signification du mouvement en le traitant de petit-bourgeois, marginal et sans perspectives, maintenant l’encense comme étant une grande réussite, avec un grand avenir dans la société. La bourgeoisie dénigre toujours le mouvement réel, pour après le glorifier lorsqu’elle a réussi à le transformer en coquille vide et en souvenirs inoffensifs.
Il y a eu foule lors des manifestations de l’anniversaire du 15-M, mais pas autant que lors des moments les plus chauds du mouvement en juin, juillet ou octobre de l’an dernier. Des assemblées sont réapparues à Madrid, Barcelone, Séville, Valence, Alicante et ailleurs. Mais, malgré le fait que les assemblées ont été reçues avec intérêt et curiosité le samedi soir, elles ont été peu à peu abandonnées sans que le mouvement ait la moindre force pour résister au contrôle des organisations gauchistes ; les gens ont préféré partir. Il y a eu, cependant, quelques signes de caractère prolétarien : la participation massive des jeunes, une ambiance solidaire et ouverte, et quelques contribuions intéressantes au débat. À Madrid a eu lieu un débat très intéressant sur la santé ; on y a entendu des expressions dans le sens de ce que nous avons appelé « l’aile prolétarienne du mouvement », même si c’était bien moins important que l’an dernier. Le mouvement, en général, n’a pas pu briser les chaînes imposées par la bourgeoisie, et s’est maintenu comme une caricature du mouvement originel du 15-M, rappelant d’avantage une joyeuse randonnée de week-end qu’autre chose.
Perspectives pour la classe ouvrière
Les mouvements sociaux qui se sont produits en 2011 ont été une expérience très importante pour la classe ouvrière par leur dimension internationale, par l’occupation des rues, par l’existence des assemblées comme cœur du mouvement6. En Espagne, il y a eu des mobilisations massives dans le secteur éducatif à Madrid et Barcelone, dans la santé à Barcelone, chez les étudiants à Valence. La grève syndicale du 29 mars et celles des mineurs sont aussi des expériences sur lesquelles nous devons tous réfléchir.
À la suite de toutes ces expériences, nos camarades en Espagne disent qu’on a la sensation que le mouvement est en train de réfléchir sur lui même, de revenir sur ses faiblesses et les difficultés pour développer une lutte capable de riposter à la gravité de la situation et au niveau des attaques. Ce processus de réflexion est absolument essentiel dans la préparation du terrain pour le développement d’un mouvement plus large et plus profond capable de mettre en question le système capitaliste lui-même.
Voilà des idées qui se rependent de plus en plus : le capitalisme est un système en faillite, sans avenir ; après cinq années de crise, la classe dominante n’a pas la moindre réponse pour y remédier, il faut changer ce système. Lors d’une assemblée à Valence, par exemple, une femme a mis en avant des idées que par ailleurs le CCI a défendues concernant le mouvement du 15-M : celui-ci a un versant révolutionnaire et un autre réformiste, et c’est le premier qu’il faut renforcer. Mais il y a aussi une recherche de la riposte et de l’action immédiates, qui peut déboucher sur des propositions stériles pour ne pas dire ridicules parfois, comme l’idée selon laquelle si tous les clients de la banque nationalisée Bankia retiraient leur argent « cela ferait du mal au capitalisme ».
Ainsi, en même temps que l’on met en avant l’idée de remplacer le capitalisme, il y a la difficulté pour trouver comment le faire, et aussi l’espoir que la faillite du système pourrait être réversible. C’est ici que la gauche et l’extrême-gauche interviennent pour mettre en avant toutes sortes de “solutions” pour reformer le capitalisme, telles que plus d’impôts pour les riches, l’élimination de la corruption, les nationalisations, etc. En fait, la plupart de ces propositions sont aussi défendues par le centre et la droite.
Il est crucial de ne pas tomber dans ce piège des prétendues alternatives réformistes. Il est tout aussi important que le mépris vis-à-vis des politiciens en général, et vis-à-vis des mensonges de la gauche en particulier, ne nous amène pas à une espèce d’enfermement dans des groupes locaux isolés, méfiants vis-à-vis de tout ce qui dépasse leurs limites géographiques. Ce ne sera qu’en dépassant ces pièges que nous pourrons faire avancer la réflexion sur la crise du capitalisme, sur la nécessité de le détruire et sur comment la classe prolétarienne peut avancer dans sa lutte. Tout cela est essentiel pour préparer les luttes futures.
Alex (30 juin 2012 )
2. Quelques réflexions rapides sur le conflit des mineurs et la situation actuelle
La lutte des mineurs n’est pas, comme certains secteurs ont voulu la faire passer, une lutte décisive ou exemplaire pour le reste du prolétariat, dont la défaite signifierait un pas en arrière important pour l’ensemble du mouvement ouvrier. Les caractéristiques des mineurs sont aujourd’hui très spécifiques et minoritaires : c’est un secteur avec une très grande tradition de lutte et capacité de mobilisation, conscient de ses intérêts sectoriels, avec une forte présence et contrôle syndicaux, et très identifié aux zones géographiques où cette activité se déroule. D’un autre côté ce qui prédomine autant en Espagne qu’internationalement c’est tout le contraire : destruction des liens sociaux au travail et dans les quartiers, très peu de mémoire ou de tradition des méthodes prolétariennes de lutte (assemblées, solidarité, auto-organisation), manque croissant de protection sociale face aux objectifs du capital et de son État, contrats temporaires, précarité, chômage massif.
L’idée selon laquelle la combativité d’un seul secteur (aussi combatif soit-il, tel que le secteur minier) peut faire reculer la bourgeoisie dans l’état actuel de la crise capitaliste est un piège. Seule la lutte massive de larges secteurs du prolétariat peut y arriver.
La présentation de la part de la gauche et des syndicats des mineurs comme “des héros solitaires de la classe ouvrière” est encore un autre piège qui ne fait qu’approfondir encore plus l’isolement de ceux-ci par rapport aux autres secteurs. Les syndicats et la gauche (avec leurs appendices “radicaux” derrière) font tout leur possible pour isoler les mineurs pour qu’ils s’usent dans des actions stériles (“la marche noire”) médiatisées et bien contrôlées.
Discuter sur la rentabilité ou les aides au secteur minier n’est pas une question qui doive occuper les prolétaires. L’économie capitaliste a toujours été peu ou prou orientée par l’État, pour différentes raisons. Ce qui doit nous préoccuper c’est le fait que nous sommes tous soumis au même joug, que nous avons tous le même ennemi : le système capitaliste. L’avenir des mineurs est le même que celui de la majorité : précarité, chômage, misère, émigration. Pour lutter contre tout cela, les mineurs ne doivent plus le faire en tant que mineurs, mais en tant que prolétaires avec le reste de la classe ouvrière.
Quel développement, quel résultat prévisible, quels enseignements tirer du conflit mineur ? Il y a un forum sur Internet qui résume tout cela très bien : « Toujours plus de la même chose. CO et UGT proposent une marche sur Madrid, où les mineurs seront reçus comme des héros, convenablement isolés de la lutte de classes... avec ça, oui, mille anecdotes de voyage dont on tirera des reportages, des chroniques, des vidéos sur youtube, etc., etc. Dispersion syndicale et démocratique bien organisée, usure... et l’État toujours droit dans ses bottes.
Les mineurs, isolés et démocratiquement bien orientés, ceci dit toujours bien en rogne, seront (une fois encore) défaits.
Avec la revendication sectorielle des fonds pour les mines, il y a peu de probabilités pour que d’autres ouvrier(e)s se sentent impliqué(e)s et partie prenante.
Et c’est pareil que cet isolement s’exprime pacifiquement ou avec de la violence. Si là où on dit mineurs, on met une autre catégorie d’ouvriers, on se rendra compte que la défaite s’est produite une fois après l’autre. Le capital et son État se renforcent, deviennent de plus en plus durs. Ils laissent les énergies s’épuiser journée après journée d’action inefficace, contrôlées de près ou de loin par les syndicats démocratiques TOUT LE TEMPS QU’IL FAUDRA..., et, à la fin, spectacle à Madrid, et des "nous avons fait tout ce qu’on a pu", "nous sommes à bout", "épuisement et accablement généraux chez les travailleurs".... et, enfin, tous en car pour rentrer à la maison, et CO et UGT des héros incompris dont "les propositions logiques et sensées" n’ont pas été écoutées par le Ministre et l’administration...»7, « Avec des pétards et ce genre d’affrontement on n’établit pas un nouveau rapport de forces avec le capital. SEULEMENT EN ÉTENDANT les conflits avec des méthodes et des revendications de classe anticapitalistes, EN Y INTÉGRANT le plus grand nombre possible de prolétaires actifs ou au chômage, de retraités, on pourra établir ce rapport de forces favorable.
Pour cela l’indépendance organisationnelle et politique de la classe ouvrière est nécessaire, et non pas ce suivisme des projets bourgeois démocratiques. "Sauver le charbon", "sauver les mines", "défendre les Asturies" et d’autres mot d’ordre de ce genre ce n’est ni plus ni moins que défendre les intérêts patronaux, de sorte que ceux-ci pourront continuer à se développer et à se maintenir en licenciant et en exploitant les ouvriers, avec ou sans aides, avec ou sans petits drapeaux asturiens ou léonais, etc.
La Garde Civile et la Police nationale sont là pour faire leur affaire, elles ont un grand effectif bien entraîné et bien équipé. Elles ne craignent pas ce genre d’affrontement, ce que la bourgeoisie craint c’est l’extension, la généralisation des luttes et que celles-ci se déroulent en dehors du moule du syndicalisme et de la gauche démocratique.
Les activismes gauchistes ce sont des ripostes sans lendemain, ne font que satisfaire la soif activiste ponctuelle de ceux qui les pratiquent et leur entourage. Tout ça ne va nulle part. Ce ne sont pas là des opinions, ce sont des FAITS VÉRIFIÉS À RÉPÉTITION. »8
Bref : l’isolement et les méthodes syndicales de lutte nous amènent à la défaite, chez les mineurs comme ailleurs. La prévisible défaite (au-delà de quelque manigance possible entre les syndicats et le gouvernement pour calmer les esprits) pourra sans doute être utilisée par le gouvernement pour se donner une image de fermeté, du genre même les mineurs ne peuvent pas arrêter les mesures prises contre les conditions de vie et de travail que le capital exige. Cependant, le cours vers des luttes prolétariennes importantes est toujours ouvert : une économie capitaliste qui tombe en lambeaux avec ce nouvel épisode de crise après des années où elle s’est maintenue grâce à une demande fictive de la dette des États, des banques, des entreprises et des particuliers ; une usure de l’appareil politique et syndical de la bourgeoisie ; et la dégradation brutale des conditions de vie et de travail de larges secteurs de la classe travailleuse, une classe qui a de moins en moins à perdre face à un présent et un futur de chômage, de précarité et de déshumanisation.
Le mouvement du 15-M, du moins tant qu’il a eu quelque chose d'un vrai mouvement, a eu beaucoup de faiblesses et d’illusions, a été très hétérogène et pour cela médiatisé. Mais son importance ne réside pas tant dans son existence même (un mouvement condamné à disparaître depuis le début) mais dans deux phénomènes qui ont surgi avec lui : le premier, c’est la concrétisation physique dans la rue de l’explosion du ras-le-bol, “d’indignation” et de la volonté de lutter, ce qui jusqu’alors était diffus ou ruminé chacun dans son coin, et qui a rendu visible le fait que “lutter c’est possible” ; et, en deuxième lieu, la réapparition historique des assemblées massives comme outil de rassemblement, de solidarité, de discussion et de décision face à l’atomisation et la dispersion, au chacun pour soi, à la précarité et au chômage. Lors des luttes futures, ces éléments, améliorés et dépassés, seront de la plus grande importance.
Compañero, juillet 2012
3. Bref commentaire du CCI
Nous partageons pleinement les réflexions du camarade. Nous voudrions faire tout simplement une incise qui, à notre avis, n’invalide pas du tout son analyse, mais qui est une donnée importante dont il faudra tenir compte pour le futur. Tout laissait penser que la manifestation du 11 juillet à Madrid9 avait été pensée comme un genre d’enterrement de la lutte, comme une exhibition du “splendide isolement” des mineurs, qui devraient se contenter de la “solidarité” de quelques personnages de “la culture” et pas grand-chose de plus. Mais, au contraire, l’inquiétude existante a fait que bien plus de monde que prévu est venu à la manifestation en soutien aux mineurs. Un autre facteur a joué. Le même jour où les mineurs étaient à Madrid, Rajoy10, pensant que tout était bien ficelé, a annoncé les dernières violentes mesures d’attaques aux conditions de tous les travailleurs. Ceci a enflammé les esprits et a fait que beaucoup de travailleurs -des fonctionnaires spécialement- se soient présentés spontanément à la manifestation des mineurs et que certains bus de ceux-ci aient retardé leur départ pour rester avec les fonctionnaires et d’autres groupes d’ouvriers à la gare d’Atocha et d’autres lieux de la manifestation. Globalement, les syndicats sont arrivés à contrôler la situation et les mineurs sont rentrés chez eux. Mais c’est un signe fort de jusqu’à quel point la situation est tendue.
CCI
1Pour le texte original en anglais : https://en.internationalism.org/content/5024/spain-how-can-workers-respond-economy-dire-straits [38] [NDLR]
4 Références anatomiques mises à part ça correspond plus ou moins à « No estamos indignados, estamos hasta los cojones » [NdR]
5 En français : https://fr.internationalism.org/ri433/apres_l_escroquerie_de_la_greve_ge... [41]
6 Lire le tract international du CCI « 2011 : de l’indignation à l’espoir », https://fr.internationalism.org/ri431/2011_de_l_indignation_a_l_espoir.html [35]
7 https://interrev.foroactivo.com/t1677-mineria-del-carbon-manifestaciones-hg-y-marchas-convocadas-por-soma-ugt-y-ccoo-aislamiento-es-derrota [42]
8 https://interrev.foroactivo.com/t1677-mineria-del-carbon-manifestaciones-hg-y-marchas-convocadas-por-soma-ugt-y-ccoo-aislamiento-es-derrota [43]
9 Jour de l’arrivée dans la capitale espagnole de la « marche noire » des mineurs venant à pied des contrées minières du Nord de l’Espagne. [NdT]
10 Chef du gouvernement espagnol (droite) [NdT]
Rubrique:
Sur les manifestations en Cisjordanie
- 2506 lectures
Nous publions ci-dessous un article rédigé par un proche sympathisant du CCI en Espagne qui fait un récit et tire des leçons des mobilisations réalisées par les travailleurs et les masses opprimées de Palestine. Nous voulons saluer cette initiative. Dans une région où il y a un affrontement impérialiste brutal avec les énormes souffrances que cela entraîne pour la population, des mots tel que classe, prolétariat, lutte sociale, autonomie du prolétariat…, sont enterrés par les mots guerre, nationalisme, rivalités ethniques, conflits religieux, etc. C’est pour cela que ces mobilisations ont beaucoup d’importance et doivent être connues et prises en compte par les prolétaires de tous les pays. On nous propose des solidarités avec des nations, des peuples, des gouvernants, des organisations de « libération »…, on doit rejeter une telle solidarité ! Notre solidarité ne peut aller que vers les travailleurs et les opprimés de Palestine, d’Israël, d’Égypte, de Tunisie et du reste du monde. SOLIDARITÉ DE CLASSE CONTRE « SOLIDARITÉ » NATIONALE.
CCI
Courrier de lecteur
Manifestations massives en Cisjordanie contre le coût de la vie, le chômage et l’Autorité Palestinienne
Dans cette partie du monde, le Moyen-Orient, si souvent en première page pour cause de massacres et de barbarie militariste, de rivalités entre les différents gangsters impérialistes qui prennent en otage la population civile, et par toutes sortes de haines et de mouvements nationalistes, ethniques et religieux (que les puissances « démocratiques » occidentales fomentent et entretiennent au gré de leurs intérêts), alors que les titres de la presse bourgeoise étaient occupés ces derniers jours par les troubles dans les pays musulmans à la suite des caricatures sur Mahomet, on y a pratiquement rien écrit sur les grandes manifestations et les grèves qui ont eu lieu pendant le mois de septembre contre les effets de la crise capitaliste internationale sur les vies des prolétaires et des couches opprimées des territoires palestiniens de Cisjordanie, pourtant les plus grandes manifestations depuis des années.1
Dans une situation souvent désespérée, le prolétariat et la population exploitée des territoires palestiniens, soumis à l’occupation militaire, au blocage et au mépris total de leur vies et de leurs souffrances par l’État israélien, à d’énormes difficultés pour échapper aux influences autant nationalistes qu’islamistes, et à la tendance à se laisser embrigader par des organisations diverses à la « résistance militaire » contre Israël, autrement dit à aller à l’abattoir sacrificiel face à une énorme supériorité militaire. C’est justement la lutte contre les effets de la profonde crise économique du capitalisme international qui ouvre la possibilité de voir réapparaître des luttes prolétariennes massives au niveau mondial et au dépassement des divisions sectorielles, nationales, ethniques ou d’un autre genre au sein de la classe ouvrière, ainsi qu’au dépassement des illusions et des mystifications de toutes sortes (les illusions « démocratiques » au sein du capitalisme, de la « libération nationale », etc.).
Grèves et manifestations
Le déclencheur de la vague de manifestations et de grèves a été l’annonce faite par le gouvernement du Premier ministre Fayyad2 de l’augmentation des prix des produits de base (alimentation…) et de l’essence. Cela a été l’étincelle qui a fait déborder la défiance de plus en plus forte de la population de Cisjordanie vis-à-vis de l’Autorité Palestinienne. Celle-ci est regardée de plus en plus comme une tanière d’arrivistes et de corrompus, dans laquelle se protège pour ses agissements toute une caste de capitalistes palestiniens et dont Fayyad est d’ailleurs la personnification3 : elle n’a même pas un semblant de légitimité, sans cirque électoral depuis 2006 et en conflit avec le Hamas ; elle est incapable de régler le moindre problème d’une économie palestinienne aux abois et totalement dépendante des dons extérieurs4, étouffée autant par l’occupation militaire que par le contrôle exhaustif sur les importations et les exportations, sur les prix, la perception des impôts ou les ressources naturelles qu’Israël exerce (accords de Paris, le pendant économique des accords d’Oslo).
Déjà durant l’été, le malaise s’est exprimé lors de protestations diverses. Par exemple, fin juin, une manifestation à Ramallah à la suite de l’annonce d’une réunion entre le président Abbas et le vice-premier ministre israélien, Shauz Mofaz, s’est terminée en répression brutale de la part de la police palestinienne5.
Avec un chômage massif (57 % selon l’ONU, insupportable surtout chez les jeunes), et un coût de la vie qui fait que la majorité des gens ait tout juste à manger, et avec une grande partie des secteurs populaires mécontents (par exemple, on doit des salaires aux 150 000 employés publiques du gouvernement), l’annonce de l’augmentation des prix le 1er septembre a été le détonateur.
Depuis le 4 septembre des manifestations massives se succèdent jour après jour pour l’amélioration des conditions de vie partout en Cisjordanie (Hébron, Bethléem, Ramallah, Jenin, etc.). Les manifestations sont aussi dirigées contre le contrôle israélien de l’économie des territoires (accords de Paris), mais il apparaît évident que le mécontentement ne se limite pas à un sentiment anti-israélien ou nationaliste, l’axe central des manifestations ce sont les conditions de vie et de travail. À Ramallah des jeunes scandaient : « Avant nous luttions pour la Palestine, maintenant nous luttons pour un sac de farine ».6
Au début des protestations, Abbas, dans une lutte évidente au sein du pouvoir contre son rival Fayaad, a montré ses sympathies pour le « printemps palestinien ». Mais au fur et à mesure que les manifestations se développaient, où l’expression du malaise ne se limitait pas au gouvernement de Fayaad ou aux accords de Paris, mais s’étendait contre l’Autorité Palestinienne elle-même, cela a amené le Fatah, qui au début a peut-être joué un certain rôle pour canaliser et même organiser des manifestations, à tout faire pour en finir progressivement avec leur radicalisation et leur extension7.
On peut dire la même chose du Hamas, qui a sans doute tiré profit des mobilisations pour essayer de déstabiliser le gouvernement actuel de l’Autorité Palestinienne, mais face à l’ampleur de celles-là et le danger de contagion à la bande de Gaza, a évidemment reculé.
À Naplouse, une manifestante déclarait : « Nous sommes là pour dire au gouvernement que ça suffit… nous voulons un gouvernement qui vive comme son peuple vit et mange ce que son peuple mange »8. « Nous sommes fatigués d’entendre parler de reformes... un gouvernement après l’autre... un ministre après l’autre... et la corruption est toujours là » comme le dit une pancarte dans la ville de Beit Jala9.
À Jenin, les manifestants ont demandé qu’on impose un salaire minimum, la création de postes de travail pour tous les chômeurs et la réduction des droits d’inscription à l’université10. Le premier ministre Fayyad déclare qu’il est « disposé à démissionner ».
Les manifestations massives continuent, avec des barrages sur les routes et des affrontements avec la police de l’Autorité Palestinienne. Le 10 septembre une grève générale dans les transports a commencé à l’appel des syndicats. Des chauffeurs de taxi, des routiers, des chauffeurs de bus y participent massivement. Beaucoup de secteurs, comme celui des employés de garderie, rejoignent la grève. Le mouvement s’élargit. Le 11 ce sont les étudiants et les lycéens qui font un arrêt de travail de 24 heures en solidarité avec la grève générale11.
Des travailleurs de toutes les universités palestiniennes, ensemble avec les étudiants, convoquent une grève de 24 heures pour le 13 septembre12.
Face à une telle situation et à la suite d’une réunion avec les syndicats, le gouvernement annonce qu’il fait machine arrière en ce qui concerne la montée des prix annoncée, qu’il va payer la moitié des salaires dus aux fonctionnaires du mois d’août, et qu’il va faire des coupes dans les salaires et les privilèges des politiciens et des hauts fonctionnaires de l’AP.
Le 14, le syndicat de transports annule l’appel à la grève parce que des « négociations constructives » ont été entamées avec l’AP.
Aussi, les protestations massives paraissent s’être calmées du moins temporairement, mais le malaise social est loin d’avoir disparu. Les syndicats des fonctionnaires et des instituteurs annoncent des mobilisations avec des arrêts de travail partiels à partir du 17.13 Les syndicats de la santé annoncent le 18 septembre qu’ils commenceront des mouvements si leurs revendications (augmentations des effectifs, amélioration de la mobilité et la promotion des travailleurs) ne sont toujours pas entendues par le gouvernement14.
Les mouvements semblent être limités à la zone contrôlée par l’Autorité Palestinienne, la Cisjordanie.
L’importance de ce mouvement
Au-delà des éléments concrets ou particuliers de ce mouvement, il prend toute son importance à cause de la région si sensible où ils se déroulent. C’est une région aux interminables conflits impérialistes sanglants, que ce soit directement entre des États, que ce soit par pions interposés15, avec une population civile qui en subit les conséquences16 et qui est devenue le terrain propice au développement des mouvements réactionnaires d’influences nationaliste ou religieuse. Mais, surtout, il faut souligner que ces mouvements ont clairement lieu dans un contexte de luttes similaires autant dans la région qu’au niveau international. N’oublions pas les grandes mobilisations en Israël ces derniers mois contre la vie chère, qui, malgré ses faiblesses et ses illusions « démocratiques », peuvent signifier un important premier pas vers la rupture de « l’unité nationale » dans un État aussi militarisé que l’État israélien. N’oublions pas que ce furent les grandes grèves ouvrières partout en Égypte qui donnèrent l’élan décisif qui déboucha sur la chute de Moubarak, le protégé des États-Unis.
Il faut que le prolétariat et les couches opprimées de Palestine, et de partout ailleurs, comprennent que le seul espoir pour avoir des conditions de vie et de travail dignes et une existence en paix, ce qui est le vrai souhait de l’immense majorité de la population palestinienne, passe par le développement de luttes massives avec tous les exploités de la région, par-dessus les divisions nationales ou religieuses. Briser « l’unité nationale » palestinienne, unifier ses luttes, en premier lieu avec les exploités et les opprimés d’Israël, et de toute la région, voilà l’arme la plus puissante pour affaiblir et paralyser le bras assassin de l’État israélien et des autres gangsters impérialistes. La « résistance armée », c'est-à-dire la soumission à des intérêts des différents groupes nationalistes ou religieux n’amènent qu’au massacre et à la souffrance sans fin, et au renforcement des exploiteurs et autres corrompus palestiniens.
Il faut que les exploités palestiniens comme ceux du reste du monde n’aient pas à avoir le moindre doute : s’ils ne luttent pas pour leurs propres intérêts de classe contre le capitalisme, s’ils se laissent entraîner dans des luttes de « libération nationale », raciale ou d’autres du même acabit, s’ils se soumettent aux « intérêts généraux du pays », autrement dit aux intérêts généraux de la bourgeoisie et de son État, le présent et le futur qui les attend sous le système capitaliste est le même que l’ANC de Mandela réserve à ses « frères » et « compatriotes » mineurs : la misère, l’exploitation et la mort.17
Draba (23 septembre)
1 Le peu d’information qu’il y a eu était centré, évidemment, sur l’occupation israélienne et sur « l’anti-impérialisme » (autrement dit, pour eux, « l’anti-américanisme » et leurs alliés) telle l’agence cubaine Prensa latina ou la TV iranienne d’État Press TV, des média toujours si diserts pour tout ce qui concerne les mouvements nationalistes. Les forums, en Espagne en tout cas, de la gauche et d’extrême-gauche du capital (tel lahaine.org, kaosenlared.net, ou rebelion.org) n’ont pas montré non plus un grand intérêt pour ces événements. Si l’on comprend bien, la « solidarité avec le peuple palestinien » est limitée aux moments où celle-ci sert à soutenir les différents intérêts sur l’échiquier impérialiste mondial ou à faire la publicité d’une quelconque cause patriotarde. Lorsqu’on lutte contre « son » propre gouvernement et qu’on brise « l’unité nationale » pour défendre ses conditions de vie, alors cette lutte ne paraît pas mériter qu’on en parle.
2 Homme du FMI, nommé par Abbas en 2007 dans le contexte de la guerre avec le Hamas, sous la pression des États-Unis.
3 www.aljazeera.com/opinions/2012/9/13/economic-exploitation-of-palestinians-flourishes-under-occupation [44]
5 https://altahrir.wordpress.com/2012/07/01/ramallah-protesters-attacked-by-palestinian-authority-police/ [46]
11 https://www.latimes.com/archives/blogs/world-now/story/2012-09-10/palestinians-protest-in-west-bank-cities-over-economy [51]
15 Les liens entre l’Iran et la Syrie avec le Hamas son bien connus, ainsi que les liens de la Syrie d’Assad avec la Russie, son principal allié parmi les grandes puissances impérialistes, et avec l’Iran, son principal allié régional.
16 N’oublions pas que la guerre entre le Hamas et le Fatah pour le contrôle de la bande de Gaza en 2007 a fait de nombreuses victimes et des souffrances au sein de la population civile ; voilà des « dommages collatéraux » de la « libération nationale »... "Human Rights Watch Condemns Hamas, Fatah for War Crimes [55]", et https://libcom.org/article/palestinian-union-hit-all-sides [56]
Vie du CCI:
Géographique:
- Palestine [59]
Rubrique:
ICConline - novembre 2012
- 1191 lectures
L'expansion et l'unification de la lutte sont non seulement nécessaires mais aussi possibles (tract)
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 101.94 Ko |
- 1849 lectures
Ford Genk, récemment encore une usine de plus de 10.000 employés, ferme définitivement. Depuis les années 90, l'emploi y a été systématiquement réduit, la productivité augmentée, les salaires réduits de 12%. Malgré cela, le rideau tombe sur les 4.300 emplois directs et des milliers d’autres travailleurs sont touchés chez les différents fournisseurs. Après Renault-Vilvoorde (1997), VW Forest (2006) et Opel Anvers (2010), c’est la quatrième usine d’assemblage automobile qui ferme en Belgique. Cela touche durement la région limbourgeoise qui a vu disparaître, il y a 20 ans, plus de 17.000 jobs lors de la fermeture des mines de charbon.
Une crise du secteur automobile ? Et le Limbourg est-il particulièrement visé ?
Licenciements chez Belfius Banque, Arcelor Mittal acier, Beckaert Zwevegem, Volvo, Duferco, Alcatel, etc. A l’évidence, le nouveau drame social n'est pas spécifique à un secteur ou une province. La crise touche tous les secteurs et régions. C’est précisément ce qui rend la situation si dramatique et désespérée.
Au nom de la «compétitivité» et «de la réduction des pertes», les licenciements se succèdent. Encore avant l'annonce de la fermeture de Ford, plus de 3.000 emplois ont disparu de septembre à mi-octobre dans tous les secteurs, toutes les régions, des petites entreprises familiales jusqu’aux grandes multinationales, dans des entreprises nationales comme étrangères. D’autres assainissent drastiquement « sans licenciements secs», comme KBC, Brussels Airlines et Delhaize. Les contrats fixes sont remplacés par des contrats temporaires, des emplois à temps plein par des emplois à temps partiel, des contrats d’employés par des contrats d’indépendants. Le chômage temporaire est généralisé. Le travail saisonnier est de plus en plus la norme tout au long de l'année. Les fameuses « créations d’emplois » dont les médias ont la bouche pleine, se limitent en grande partie à des emplois de qualité inférieure, des emplois par « chèques services ». Afin d'échapper à la pauvreté, de nombreux travailleurs doivent chercher un 2ème ou un 3ème emploi. L’obtention d’un emploi n’équivaut plus nécessairement à un revenu décent!
L'État lui aussi est mal en point. Comme le montre la discussion sur la suspension temporaire (le saut d’index) ou la réforme de l'index, le pouvoir d'achat n'est pas une préoccupation centrale. Toujours au nom de la défense de la «compétitivité de l'économie nationale", tous les partis bourgeois, de la NVA au PS, sont d’accord pour dire qu’il faut constamment faire des économies pour réduire les coûts de main d’œuvre et améliorer le climat économique. On passe d’un «pacte social», à un autre « pacte des générations ». Car l'État est là pour appliquer les lois du capitalisme: favoriser la recherche du profit, la force concurrentielle et l’exploitation au moyen de mesures coercitives. Les milliards que les gouvernements cherchent pour permettre leurs plans de relance, leur équilibre budgétaire et la réduction de la dette d’État, seront en fin de compte soutirés aux mêmes familles ouvrières. Les allocataires sociaux, les retraités, les fonctionnaires, les enseignants, tous paieront les pots cassés. Selon le nouvel indicateur européen de la pauvreté, 21% de la population en Belgique est déjà menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale. L'inquiétude et l'indignation d'un nombre croissant de familles ouvrières ne se comprend donc que trop bien.
Ford Genk est aujourd'hui une illustration douloureuse de la nature impitoyable de cette attaque générale contre la classe ouvrière: licenciements nombreux, blocage et/ou réduction des salaires (chez Ford, on a accepté précédemment une réduction de 12%, chez VW-Audi 20%), prolongement du temps de travail. Sans riposte ouvrière, Ford Genk annonce des attaques encore plus douloureuses dans le futur pour l’ensemble de la classe ouvrière. La situation actuelle nécessite donc une résistance contre la dégradation des conditions de travail et de vie de la plupart d'entre nous. Elle contient aussi les germes d'une riposte commune de toute la classe ouvrière. Ce n’est pas que le personnel de Ford, mais tout le monde qui est visé, c’est pourquoi aussi tout le monde doit s’indigner, être solidaire, se mobiliser classe contre classe!
A qui la faute? Y a-t-il un bouc émissaire?
Depuis des décennies, on nous promet une sortie de la crise et de la misère. Le bout du tunnel était en vue, nous disait-on, encore quelques ultimes mesures exceptionnelles et des solutions durables s’imposeraient, les rationalisations ne surviendraient plus que dans «les vieilles industries», dans «des sociétés mère ou des filiales malades » ; plus tard, tout était cette fois-ci la faute « du vieillissement de la population» ou «des réfugiés», de «l’émigration incontrôlée » (la conséquence d’une misère et d’un désespoir pires encore ailleurs dans le monde!) ; plus tard encore les coupables du moment étaient les « bad banks », les fraudeurs, etc. Aujourd'hui, c’est de la faute du PDG de Ford que ce bain de sang social a lieu. Auparavant, lors de la fermeture des mines, les boucs émissaires étaient le ministre flamand socialiste De Batselier et le PDG de la société minière Gijselinck. Derrière toutes ces pseudo vérités et ces discours populistes creux se cache la propagande bourgeoise qui cherche constamment à trouver des boucs émissaires de telle sorte que la question de la faillite du système capitaliste ne soit pas posée. Ainsi, la colère est canalisée et est orientée vers la désignation de « coupables», faits sur mesure, pour mieux «diviser et régner».
Ce même scénario décrit ci-dessus est appliqué dans presque tous les pays du monde, les médias en témoignent quotidiennement. Évidemment, il y a des variantes, tout comme il y en a selon le secteur ou la région en Belgique même. Cependant, partout dans le monde, la question est posée : qui est le responsable de la crise ? Cette question a également été au cœur des débats dans les mouvements du «printemps arabe» en Tunisie et en Égypte, dans ceux des «Indignés» ou de «Occupy Wall Street».
Depuis plusieurs années se sont succédé, au niveau mondial, les crises de l'immobilier, de la bourse, du commerce et de l'industrie, des banques et de toutes les dettes souveraines des Etats. Ainsi, le total des dettes souveraines dans la zone euro s’élève à 8.517 milliards d'euros. Soit une moyenne de 90 % du produit intérieur brut de la zone euro. Une grande partie de celle-ci ne sera jamais remboursée. Quelqu'un doit financer ces dettes, mais financer des dettes impayables signifie finalement qu’on devient insolvable soi-même (un risque qui menace par exemple l'Allemagne). Comment le système peut-il alors financer la relance indispensable pour arrêter le bain de sang au sein de son économie ? En continuant à le faire essentiellement au moyen de mesures d’austérité et de rationalisation, il réduit encore le pouvoir d’achat dont il a besoin pour écouler ses produits, ce qui produira encore plus de rationalisations, de fermetures, de réductions des salaires. S’il écume le marché de l’épargne en imposant des taux d’intérêt dérisoires sous les 1%, tandis que l’inflation atteint les 2,76%, les réserves que de nombreuses familles ouvrières avaient mises de côté pour affronter des contretemps, l’accumulation de dettes ou le chômage, fonderont comme neige au soleil. Quelle que soit la méthode, elle ne peut donc mener à terme qu’à une nouvelle forte baisse du pouvoir d’achat. Devra-t-il se résoudre à faire marcher la planche à papier pour imprimer des billets supplémentaires, comme l’ont fait les USA, le Japon ou la Grande-Bretagne, afin de les mettre sur le marché à des taux de prêt extrêmement bas ? De cette manière, le système capitaliste accentue l’abîme des dettes et en revient au point de départ : en fin de compte, il faut toujours que de la valeur nouvelle soit produite en contrepartie de cet argent imprimé pour repayer les dettes. De l’argent fictif ne peut faire l’affaire, tel notre épargne que les banques remettent en circulation sous la forme d’un emprunt, tandis qu’elles nous font croire qu’il se trouve toujours sur notre compte. De la valeur nouvelle n’est obtenue qu’à partir du travail effectué en lui ajoutant une plus-value : les frais de production d’un produit ne peuvent constituer qu’une fraction de leur valeur de vente totale. Mais pour ce faire, il faut un marché solvable. S’il n’existe pas ou à peine (comme c’est le cas depuis des années), nous entrons dans une crise de surproduction permanente. C’est pourquoi des usines ferment, baissent leurs coûts de production (les salaires), augmentent la productivité, c’est pourquoi aussi les frais improductifs (sécurité sociale, allocations de chômage, retraites) sont constamment comprimés.
Tout ceci constitue la loi générale de la manière capitaliste de produire, qui ne peut être contournée par aucun patron individuel ou par aucun gouvernement particulier ! Si aujourd’hui les usines s’arrêtent, ce n’est pas parce que les travailleurs ne veulent plus travailler ou parce qu’il n’y a plus de besoins à assouvir, mais simplement parce que les capitalistes n’y voient plus de profit à réaliser. Le système capitaliste mondial est gravement malade : les marchés solvables se réduisent comme peau de chagrin et le profit ne peut être maintenu qu’à travers une spoliation sociale et une exploitation toujours plus intenses.
Se mobiliser massivement, forger l’unité, rechercher la solidarité, avoir confiance en sa propre force
Durant ces six derniers mois, protestations, grèves, manifestations massives ont éclaté sur tous les continents : de l’Argentine au Portugal, de l’Inde à la Turquie, de l’Egypte à la Chine. Ainsi, en septembre, des centaines de milliers ont occupé la rue au Portugal, des dizaines de milliers ont manifesté en Espagne en Grèce et en Italie. Au Japon, des manifestations contre la baisse des conditions de vie d’une telle ampleur n’avaient plus eu lieu depuis 1970 (170.000 manifestants à Tokyo). Partout, les mêmes questions sont posées : comment faire face à de telles attaques, comment organiser la lutte, quelles perspectives avancer ? Ce sont les mêmes questions que se posaient déjà les jeunes et les chômeurs du mouvement massif des Indignés ou de Occupy en 2011, e.a. en Espagne, en Grèce, aux USA ou au Canada.
A ce propos, trois besoins centraux pour la lutte ont été mis en avant : la nécessité de l’extension et de l’unification de la lutte, l’importance du développement d’une solidarité active parmi les salariés, les chômeurs et les jeunes et enfin le besoin d’une large discussion à propos de l’alternative pour le système actuel en faillite.
Notre vraie force est notre nombre, l’ampleur de notre lutte, notre destin commun, notre unité au delà des frontières des secteurs, des races, des régions, des pays. Face à un monde divisé et cloisonné par les intérêts personnels étroits d’exploiteurs arrogants, face au « chacun pour soi », à leur « compétitivité », nous devons opposer notre unité et notre solidarité. Nous devons refuser de nous laisser diviser, de réduire nos problèmes à des questions spécifiques et séparées, propres à l’entreprise, au secteur ou à la région. Non à la rivalité entre « jeunes » et « vieux », entre « fixes » et « temporaires », entre employés et ouvriers, entre travailleurs de la maison-mère et des filiales, entre travailleurs d’ici et d’autre part, ...
Cette unité est non seulement indispensable, elle est aussi possible aujourd’hui !
- L’extension de la lutte et de la solidarité avec d’autres secteurs et entreprises, qui sont fondamentalement touchés par les mêmes attaques et qui luttent souvent de manière isolée dans leur coin, pourra le mieux être engagée en envoyant des délégations massives vers les autres usines, c’est ce que nous apprennent les expériences de luttes précédentes ici comme ailleurs. Nos actions doivent renforcer notre lutte, l’étendre et lui donner des perspectives. Aller dans la rue pour « se défouler », mener un long combat isolé, chacun dans son usine ou sa région, ne permettront jamais de développer une lutte générale et massive.
- L’expérience nous apprend aussi que des actions comme la prise en otage de patrons, le sabotage de la production, le blocage de lignes de chemin de fer ou des actions désespérées, comme la menace de faire sauter l’usine, ne favorisent nullement l’union et l’extension de la lutte. Elles mènent au contraire à la démoralisation et à la défaite.
- Les leçons des luttes passées mettent en évidence que travailleurs et chômeurs doivent prendre en mains leurs propres luttes. Pour développer une véritable discussion collective, pour réfléchir et décider collectivement, il faut appeler à des assemblées générales massives, au sein desquelles chacun peut intervenir librement et avancer des propositions d’action, soumises au vote de l’assemblée. Pour forger l’unité du mouvement, ces assemblées doivent être ouvertes à tous les travailleurs et les chômeurs.
Et attention à la supercherie ! L’autre classe – la bourgeoisie – parle aussi de « solidarité » et « d’unité ». Elle appelle aux sacrifices des « secteurs forts » en « solidarité » avec les « secteurs faibles », pour répartir équitablement la misère. Quand son « gâteau devient plus petit », la discussion ne peut porter selon elle que sur une répartition « équivalente» de l’austérité qu’elle nous impose, sur ce qui est profitable à la compétitivité et à l’intérêt national . Elle appelle donc à « l’unité » avec les intérêts du capital. Comme si la répartition équivalente de la misère la rendait supportable ! Comme si la gestion commune de l’exploitation supprimait cette dernière. Ce discours ne sert qu’à entraver la mise en question du système et la recherche de perspectives dans le cadre d’une autre société basée sur l’assouvissement des besoins de tous et non pas des intérêts particuliers de certains !
unité – solidarité – extension et généralisation – confiance en ses propres forces – classe contre classe
Notre force, c’est notre solidarité, pas leur compétitivité
Géographique:
- Belgique [61]
Récent et en cours:
- Crise économique [2]
Rubrique:
ICConline - décembre 2012
- 1221 lectures



