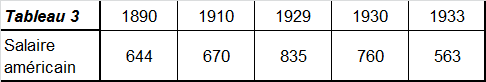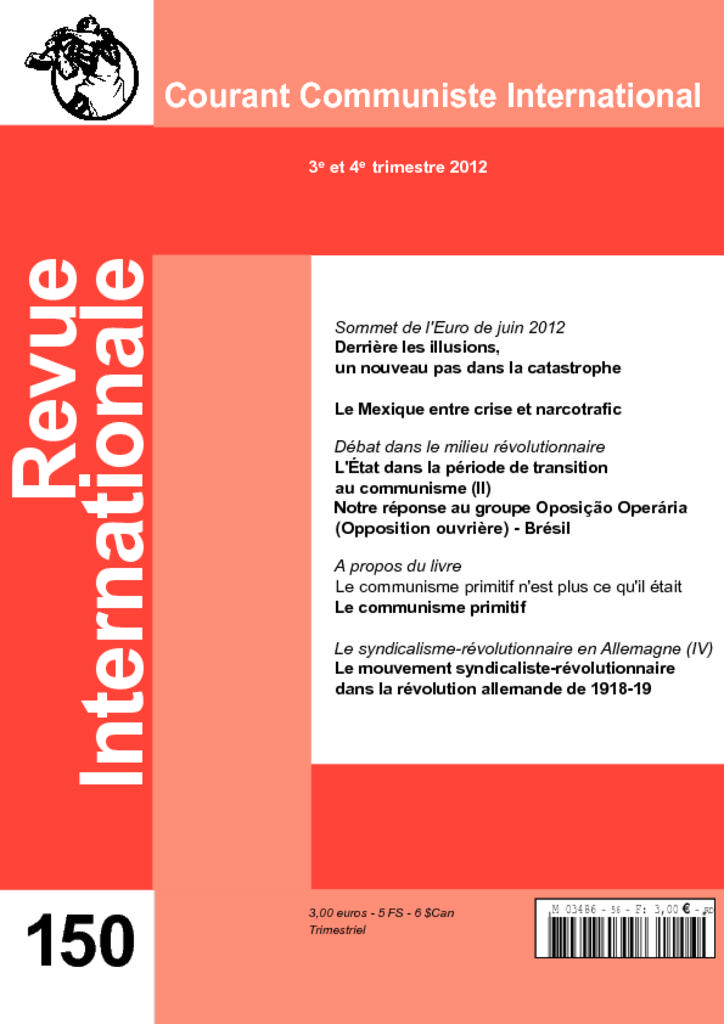Revue Internationale 2012 - n° 148 - 150
- 2051 reads
Revue Internationale n° 148 - 1er trimestre 2012
- 1463 reads
La crise économique n'est pas une histoire sans fin, elle annonce la fin d'un système et la lutte pour un autre monde
- 2172 reads
Depuis 2008, il ne se passe pas une semaine sans qu’un pays n'annonce un nouveau plan d’austérité draconien. Baisse des pensions de retraite, hausse des impôts et des taxes, gel des salaires… rien ni personne ne peut y échapper. L’ensemble de la classe ouvrière mondiale est en train de plonger dans la précarité et la misère. Le capitalisme est frappé par la crise économique la plus aiguë de toute son histoire. Le processus actuel, laissé à sa seule logique, mènera inexorablement à l’effondrement de toute la société capitaliste. C’est ce que montre dès aujourd’hui l’impasse totale dans laquelle se trouve la bourgeoisie. Toutes ses mesures se révèlent vaines et stériles. Pire ! De manière immédiate, elles aggravent même la situation. Cette classe d'exploiteurs n’a plus la moindre solution pérenne, même à moyen terme. La crise n'est pas "arrêtée" à son niveau de 2008, elle continue de s'aggraver. Face à cela, l'impuissance de la bourgeoisie entraîne aujourd'hui des tensions, voire des déchirements, en son sein. D'économique, la crise tend à devenir aussi politique.
Ces derniers mois, en Grèce, en Italie, en Espagne, aux États-Unis… les gouvernements sont devenus de plus en plus instables ou incapables d'imposer leur politique alors que des divisions de plus en plus fortes se développent entre les différentes fractions de la bourgeoisie nationale. Les différentes fractions nationales de la bourgeoisie mondiale sont également souvent divisées entre elles quant aux politiques anti-crises à mettre en place. Il en résulte parfois que c'est avec retard que sont prises des mesures qui auraient dû l'être des mois auparavant, comme on l'a vu dans la zone euro avec le "plan de sauvetage de la Grèce". Quant aux politiques anti-crises actuelles, de même que celles les ayant précédées, elles ne peuvent que refléter l'irrationalité croissante du système capitaliste. Crise économique et crise politique frappent dorénavant simultanément à la porte de l’histoire.
Cependant, cette crise politique majeure de la bourgeoisie ne saurait réjouir les exploités. Face au danger de la lutte de classe, c’est une unité de fer que rencontrera le prolétariat en lutte, l’union sacrée de la bourgeoisie mondiale. Aussi difficile que soit la tâche qui attend le prolétariat, celui-ci possède en lui la force de détruire ce monde agonisant et de construire une société nouvelle. C’est ce but à atteindre que tous les exploités du monde doivent, par la généralisation de leurs luttes, s’approprier collectivement.
Pourquoi la bourgeoisie ne trouve-t-elle aucune solution à la crise ?
En 2008 et 2009, malgré la gravité de la situation économique mondiale, la bourgeoisie a poussé un "ouf !" de soulagement dès que la situation a paru cesser de se dégrader. En effet, à l'en croire, la crise n'était que passagère. La classe dominante et ses spécialistes serviles clamaient dans toutes les langues qu’ils avaient la situation bien en main, que tout était "sous contrôle". Le monde n'était confronté qu'à un ajustement de l’économie, une petite purge chargée d’éliminer les excès des dernières années. Mais la réalité se moque totalement des discours mensongers de la bourgeoisie. Le dernier trimestre 2011 a été rythmé par des sommets internationaux qualifiés, les uns après les autres, de "réunion de la dernière chance" pour tenter de sauver la zone euro de l’éclatement. Les médias conscients de ce danger vital ne parlent plus que de ça, de la "crise de la dette". Tous les jours les journaux et toutes les télévisions y vont de leurs analyses, toutes aussi contradictoires les unes que les autres. La panique est là qui affleure sous tous les discours. On en oublierait presque que la crise continue à se développer en dehors de la zone euro : États-Unis, Grande-Bretagne, Chine etc. Le capitalisme mondial est confronté à un problème qu’il ne peut ni dépasser ni résoudre. Celui-ci peut se représenter sous l’image d’un mur devenu infranchissable : le "mur de la dette".
Pour le capitalisme, ce qui lui est fatal aujourd’hui, c’est sa dette brute. Il est vrai qu’une dette à un endroit du monde correspond à une créance ailleurs d’un même montant, si bien que certains affirment que l'endettement mondial est nul. Il s'agit là d'une pure illusion, une entourloupe comptable, d'un jeu d’écriture sur un morceau de papier. Dans le monde réel, toutes les banques sont par exemple en situation quasi permanente de faillite. Pourtant leur bilan est "équilibré", comme elles aiment à le dire. Mais que valent réellement leurs actifs de dettes grecque, italienne ou ceux représentant des prêts immobiliers espagnols ou américains ? La réponse est claire et nette : presque plus rien ! Leurs tiroirs sont vides, restent alors… les dettes et rien que les dettes.
Mais pourquoi en ce début 2012, le capitalisme est-il confronté à un tel problème ? D’où vient cet océan d’argent emprunté et qui, depuis longtemps déjà, est totalement déconnecté de la richesse réelle de la société ? La dette puise sa source dans le crédit. Ce sont des prêts consentis par les banques centrales ou les banques privées aux États et à tous les agents économiques de la société. Ces prêts deviennent des entraves pour le capital lorsqu’ils ne peuvent plus être remboursés, lorsqu’il est nécessaire de créer de nouvelles dettes pour payer les intérêts en cours sur les dettes anciennes ou tenter d’en rembourser ne serait-ce qu’une partie.
Quel que soit l’organisme qui émet de la monnaie, banques centrales ou banques privées, il est vital, du point de vue du capital global, que soient produites suffisamment de marchandises vendues avec profit sur le marché mondial. C’est la condition même de la survie du capital. Depuis maintenant plus de quarante ans, tel n’est plus le cas. Pour que soit vendu l’ensemble des marchandises produites, c'est de l'argent qui doit être emprunté pour, à la fois, payer les marchandises en question sur le marché, rembourser les dettes déjà contractées et payer les intérêts existants qui s’accumulent au cours du temps. Pour cela, il n'y a pas d'autre solution que de contracter de nouvelles dettes. Il arrive alors un moment où la dette globale des particuliers, banques et États ne peut plus être honorée, ni même, dans plus en plus de cas, le seul service de la dette. Sonne alors l’heure de la crise générale de la dette. C'est le moment où l’endettement et la création toujours plus importante d’argent fictif par le capitalisme sont devenus le poison par lequel tout l’organisme du capital se contamine mortellement.
Quelle est la réelle gravité de la situation économique mondiale ?
Ce début d’année 2012 voit l’économie mondiale retomber en récession. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, en plus graves, en plus dramatiques. Au début de l’année 2008, le système financier a manqué s’effondrer. Les nouveaux crédits octroyés par les banques à l’économie se sont raréfiés et l’économie est entrée en récession. Depuis lors, les banques centrales américaines, britanniques et japonaises, entre autres, ont injecté des milliers de milliards de dollars. Le capitalisme a pu ainsi acheter du temps et relancer un minimum l’économie tout en empêchant les banques et les assurances de s’effondrer. Comment a-t-il procédé ? La réponse est maintenant connue. Les États se sont surendettés auprès des banques centrales et des marchés en reprenant à leur compte une petite partie des dettes des banques. Mais rien n’y a fait !
En ce début d’année 2012, l’impasse dans laquelle se trouve le capital global s'illustre, entre autres, par les 485 milliards d'euros que vient d’octroyer la BCE afin de sauver les banques de la zone d’une faillite immédiate. La BCE a prêté de l’argent, par l’entremise des banques centrales des pays de la zone, en échange d’actifs pourris. Actifs qui sont des morceaux de dettes des États de cette zone. Les banques doivent alors à leur tour acheter de nouvelles dettes d’État pour que ceux-ci ne s’effondrent pas. Chacun soutient l'autre, chacun achète la dette de l’autre avec de l’argent créé de toutes pièces à cet effet. Si bien que si l’un tombe, l’autre tombe.
Tout comme en 2008, mais de manière encore plus drastique, le crédit ne va plus à l’économie réelle. Chacun se protège et garde ou sécurise son argent pour tenter de ne pas tomber. En ce début d’année, au niveau de l’économie privée, les investissements des entreprises se font rares. La population paupérisée se serre la ceinture. La dépression économique est de nouveau là. La zone euro, comme les États-Unis, sont sur un rythme de croissance qui s’approche de zéro. Le fait que les États-Unis aient connu, en cette fin 2011, une activité en léger mieux par rapport au reste de l’année ne saurait changer durablement cette tendance générale qui, à terme, finira par s’imposer. A plus court terme, selon le FMI, la croissance pourrait se situer en 2012 pour ce pays, entre 1,8% et 2,4%. Là encore, "si tout va bien", c'est-à-dire en l'absence d'évènement économique majeur, ce qui correspond aujourd’hui à un pari que personne ne voudrait prendre !
Les pays émergents, tels l’Inde et le Brésil, voient leurs propres activités se réduire rapidement. Même la Chine, présentée depuis 2008 comme la nouvelle locomotive de l'économie mondiale, va officiellement de plus en plus mal. Un article paru sur le site du China Daily, le 26 décembre, affirme ainsi que deux provinces (dont le Guangdong qui est certainement l’une des plus riches car abritant une grande part du secteur manufacturier pour les produits de grande consommation) ont notifié à Pékin qu’elles allaient retarder le paiement des intérêts de leur dette. Autrement dit, la faillite menace aussi en Chine.
L’année 2012 se présente comme une période de contraction de l’activité mondiale dont personne n’est en mesure d’évaluer l’ampleur. La croissance mondiale est évaluée comme pouvant se situer au mieux autour de 3,5%. Au cours du mois de décembre, le FMI, l’OCDE et tous les organismes de prévisions économiques ont revu leurs chiffres de croissance à la baisse. Un constat s’impose alors à nous : des injections colossales de nouveaux crédits ont eu pour effet d'ériger, en 2008, ce qui est appelé le mur de la dette. Depuis, de nouvelles dettes n'ont plus alors comme conséquence que d'élever encore plus ce mur, avec un impact de plus en plus limité pour relancer l'économie. Ce faisant, le capitalisme se retrouve au bord du gouffre : pour l’année 2011, le financement de la dette, c'est-à-dire l’argent qui aura été nécessaire au paiement des dettes arrivant à échéance, et des intérêts de la dette globale, s'est élevé à 10 000 milliards de dollars. En 2012, il est prévu que ce poste atteigne 10 500 milliards alors que, dans le même temps, l’épargne mondiale est évaluée à 5000 milliards. Où le capitalisme va-t-il trouver ce financement ?
La fin de l’année 2011 aura vu apparaître, au premier plan, la crise de la dette au niveau des banques et des assurances, laquelle est venue ainsi s’ajouter aux dettes souveraines des États et s'imbriquer de plus en plus avec celles-ci. Il est légitime de se demander aujourd’hui qui va s’effondrer en premier ? Une grande banque privée et, donc, tout le secteur bancaire mondial ? Un nouvel État comme l'Italie ou la France ? La Chine ? La zone euro ? Le dollar ?
De la crise économique à la crise politique
Nous avions mis en évidence, dans le numéro précédent de la Revue internationale, l'ampleur des désaccords qui avaient surgi entre les principaux pays de la zone Euro pour faire face au problème du financement des cessations de paiement de certains pays, avérées (la Grèce) ou menaçantes (l'Italie, etc.), et les différences qu'il existait entre l'Europe et les États-Unis pour appréhender le problème de la dette mondiale. 1
Depuis 2008, toutes les politiques menant à une impasse croissante, des désaccords au sein des différentes bourgeoisies nationales sur la dette et la croissance donnent lieu à des crispations et se transforment peu à peu en conflits et en affrontements ouverts. Avec l’inévitable évolution de la crise, ce "débat" ne fait que commencer.
Il y a ceux qui veulent tenter de réduire le montant de la dette par une violente austérité budgétaire. Pour eux, un seul mot d’ordre s’impose alors : couper drastiquement dans toutes les dépenses de l’État. Dans ce domaine, la Grèce est un modèle qui montre le chemin à tous. L’économie réelle y connaît une récession de 5%. Les commerces ferment, le pays et la population s’enfoncent dans la ruine et la misère. Pourtant cette politique désastreuse se généralise un peu partout : Portugal, Espagne, Italie, Irlande, Grande-Bretagne, etc. La bourgeoisie s’illusionne encore, à l’image des médecins du XVIIème siècle qui croyaient aux vertus d'une saignée appliquée au malade atteint d'anémie. L’activité économique ne peut supporter un tel remède sans périr.
Une autre partie de la bourgeoisie veut monétiser la dette, c'est-à-dire transformer celle-ci en émissions de monnaie. C’est ce que font, à une échelle inconnue jusque-là, les bourgeoisies américaine et japonaise, par exemple. C’est ce que fait, en tout petit, la Banque Centrale Européenne. Cette politique a le mérite de donner un peu de temps au temps. Elle permet de faire face, à court terme, aux échéances du roulement de la dette. Elle permet de freiner la vitesse de développement de la récession. Mais elle comporte un revers catastrophique pour le capitalisme, c’est celui de provoquer à terme un effondrement global de la valeur de la monnaie. Or, le capitalisme ne peut pas fonctionner sans une monnaie, pas plus que l’homme ne peut vivre sans respirer. Ajouter de la dette à la dette quand celle-ci, comme aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Japon, ne permet plus une relance durable de l’activité conduit, là encore, à terme, à l’effondrement de l’économie.
Enfin, il y a ceux qui souhaitent combiner les deux démarches précédentes. En termes clairs, ils veulent de l’austérité couplée à de la relance par la création monétaire. L’impasse totale de la bourgeoisie ne peut sans doute pas s'exprimer mieux que dans cette orientation. C’est pourtant celle-ci qu’applique depuis au moins deux ans la Grande-Bretagne et que réclame Monti, le nouveau chef du gouvernement italien. Cette partie de la bourgeoisie qui, comme lui, est en faveur d'une telle politique tient le raisonnement suivant : "Si nous faisons des efforts pour réduire nos dépenses drastiquement, les marchés reprendront confiance dans la capacité des États de rembourser. Ils nous prêteront alors à des taux supportables et nous pourrons à nouveau nous endetter." La boucle est bouclée. Une partie de la bourgeoisie pense encore pouvoir revenir en arrière, à la situation d’avant 2007-2008.
Aucune de ces alternatives n’est viable, même à moyen terme. Toutes conduisent le capital dans une impasse. Si la création monétaire expansive effectuée par les banques centrales semble constituer la voie qui va octroyer un peu de répit, le bout de la route est identique, c’est celui de l’effondrement historique du capitalisme.
Les gouvernements seront de plus en plus instables
L’impasse économique du capitalisme engendre inévitablement la tendance historique à la crise politique au sein de la bourgeoisie. Depuis le printemps dernier, en l’espace de quelques mois, nous avons vu des crises politiques s’ouvrir spectaculairement, successivement au Portugal, aux États-Unis, en Grèce et en Italie. De manière plus sournoise, la même crise avance cachée, pour le moment, dans d’autre pays centraux comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France.
Malgré toutes ses illusions, une partie croissante de la bourgeoisie mondiale commence à percevoir, du moins en partie, l’état catastrophique de son économie. Des déclarations de plus en plus alarmistes se font jour. En réponse à cette montée de l’inquiétude, de l’angoisse et de la panique au sein de la bourgeoisie, grandissent des certitudes toujours plus rigides au sein des différents secteurs de la classe dominante y compris au niveau national. Chacun se raccroche à ce qu’il considère être la meilleure façon de défendre l’intérêt de la nation, selon le secteur économique ou politique auquel il appartient. La classe dominante s’affronte autour des options caduques que nous avons citées précédemment. En conséquence, toute orientation politique proposée par l’équipe gouvernementale en place provoque l’opposition violente des autres secteurs de la bourgeoisie.
En Italie, c’est la perte de crédibilité totale de Berlusconi pour faire appliquer les plans d’austérités supposés réduire la dette publique qui a poussé, sous la pression des marchés et avec l’aval des principaux dirigeants de la zone euro, l’ancien président du Conseil italien vers la sortie. Au Portugal, en Espagne, en Grèce, au-delà des particularités nationales, se sont ces mêmes raisons qui ont provoqué des départs précipités des équipes gouvernementales en place.
L’exemple des États-Unis est le plus significatif historiquement. Il s’agit de la plus importante puissance mondiale. Cet été, la bourgeoisie américaine s’est déchirée autour de la question du relèvement du plafond de sa dette. Ce relèvement a été opéré bien des fois depuis la fin des années 1960 sans que cela ne pose apparemment de problème majeur. Alors pourquoi cette fois la crise a-t-elle pris une ampleur telle que l’économie américaine est passée à deux doigts de la paralysie totale ? Il est vrai qu'une fraction de la bourgeoisie qui acquiert un poids croissant dans la vie politique de bourgeoisie américaine, le Tea Party, est totalement décalée et irresponsable du point de vue même de la défense des intérêts du capital national. Cependant, contrairement à ce que l’on a voulu nous faire croire, ce n’était pas le Tea Party qui était la cause première de la paralysie de l’administration centrale américaine mais l’affrontement ouvert entre les démocrates et les républicains au Sénat et à la chambre des représentants, chacun pensant que la solution apportée par l’autre était catastrophique, inadaptée, suicidaire pour le pays. Il en a résulté un compromis douteux, fragile et très probablement de courte durée. Celui-ci sera mis à l'épreuve au moment des prochaines élections américaines dans quelques mois. La poursuite de l’affaiblissement économique des États-Unis ne pourra qu'alimenter le développement de la crise politique dans ce pays.
Mais l'impasse grandissante des politiques économiques actuelles se perçoit également dans les exigences contradictoires des marchés financiers à l’égard des gouvernements. Ces fameux marchés exigent eux aussi des gouvernements à la fois des plans de rigueur draconiens et, de plus en plus, une relance de l’activité. Lorsqu'il leur arrive de perdre confiance dans la capacité d’un État à rembourser une partie significative de sa dette, ils font monter rapidement les taux d’intérêts de leurs prêts. Le résultat à terme est garanti : ces États ne peuvent plus emprunter sur les marchés. Ils deviennent totalement dépendants des banques centrales. Après la Grèce, c’est ce qui est en train de se passer actuellement pour l’Espagne et l’Italie. L’impasse économique se resserre encore plus sur ces pays et la crise politique y puise de nouvelles ressources.
L’attitude de Cameron lors du dernier sommet de l’Union européenne, refusant d’entériner une discipline budgétaire et financière pour tous, sonne, là aussi, le glas de cette union. L’économie britannique survit de fait grâce aux bénéfices de son secteur financier. Le simple fait d’envisager un début hypothétique de contrôle de celui-ci est impensable pour une bonne partie des conservateurs britanniques. Cette prise de position de Cameron a entraîné un affrontement, dans ce pays, entre libéraux démocrates et conservateurs, fragilisant encore plus la coalition au pouvoir. De même qu'elle a entraîné des dissensions au Pays de Galles et en Écosse autour de la question de l’appartenance ou non à l’Union européenne.
Enfin, un nouveau facteur favorisant le développement de la crise politique de la bourgeoisie commence à s’inviter au sein de ses débats. L’impasse dans laquelle se trouve le capital fait resurgir un vieux démon, depuis longtemps contenu, que l’on peut qualifier de néoprotectionnisme. Aux États-Unis, dans la zone euro, une grande partie des conservateurs et des partis populistes, de gauche comme de droite, entonne le chant de la mise en place de nouvelles barrières douanières. Pour cette partie de la bourgeoisie, rejointe par certains secteurs démocrates ou socialistes, il faut réindustrialiser le pays, produire et consommer "national". Sur ce terrain, la Chine se dresse violemment contre les mesures de rétorsion déjà prises par les États-Unis à son égard. Pourtant, à Washington, les tensions sur ce sujet sont loin de se calmer. Le très fameux Tea Party mais, aussi, une part significative du parti conservateur poussent ces exigences jusqu'à la caricature, obligeant les démocrates et Obama (comme sur la question du plafond de la dette) à monter au créneau pour qualifier ces secteurs de la bourgeoisie américaine de passéistes et d’irresponsables. Ce phénomène n’en est qu’à ses débuts. Pour le moment, personne n’est en mesure de prévoir sous quelle forme et à quelle vitesse cela va se développer. Mais ce qui est certain, c’est que cela aura un impact important sur la cohérence d’ensemble de la vie de la bourgeoisie, sur sa capacité à maintenir des partis et des équipes gouvernementales stables.
Quel que soit l’angle sous lequel on aborde cette réalité de crise au sein de la classe dominante, nos regards sont attirés vers une seule direction, celle de l’instabilité croissante des équipes dirigeantes et gouvernementales, y compris au niveau des principales puissances de la planète.
La bourgeoisie divisée face à la crise mais unie face à la lutte de classe
Le prolétariat ne doit pas se réjouir en soi de cette crise politique dans laquelle entre la bourgeoisie. Les divisions, les déchirements au sein de cette classe ne sont pas une garantie de succès pour sa lutte .Tous les prolétaires et les jeunes générations d’exploités doivent comprendre que, quel que soit le niveau de crise existant au sein de la classe bourgeoise, ses divisions, ses querelles et autres guerres intestines, celle-ci se présentera unie devant la menace de la lutte de classe. Cela s’appelle l’union sacrée. Tel fut le cas pendant la Commune de Paris en 1871. Rappelons-nous comment les bourgeoisies prussienne et française s’affrontaient alors dans la guerre. Mais, face à l’insurrection des Communards à Paris, tous ces exploiteurs se sont retrouvés unis, le temps d’écraser dans le sang le premier grand surgissement prolétarien de l’histoire. Tous les grands mouvements de lutte du prolétariat se sont trouvés face à cette union sacrée. Il n’y a aucune exception envisageable à cette règle.
Le prolétariat ne peut pas miser sur les faiblesses de la bourgeoisie. Pour vaincre, il ne doit pas compter sur les crises politiques internes de la classe ennemie. C’est sur ses propres forces, et elles seules, que la classe ouvrière doit compter. Depuis maintenant quelque temps, nous voyons cette force apparaître et se manifester dans de nombreux pays.
En Chine pays où se concentre aujourd’hui une partie importante de la classe ouvrière mondiale – et particulièrement la classe ouvrière industrielle -, les luttes sont pratiquement quotidiennes. On peut parler, dans ce pays, de véritables explosions de colère qui impliquent non seulement les salariés mais plus généralement la population pauvre et démunie comme la paysannerie. Salaires de misère, conditions de travail insoutenables, répression féroce…, les conflits sociaux se multiplient notamment dans les usines où la production est touchée par le ralentissement de la demande européenne et américaine. Ici dans une usine de fabrications de chaussures, là dans une usine à Sichuan, ou encore à HIP, sous-traitant de Apple, à Honda, à Tesco etc. "Il y a presque une grève par jour résume Liu Kalming." (militant du droit du travail) 2. Même si ces luttes restent, pour le moment, isolées et sans perspectives, elles démontrent cependant que les ouvriers d’Asie, comme leurs frères de classe en Occident, ne sont pas près d'accepter sans réagir les conséquences de la crise économique du capital. En Égypte, après les grandes mobilisations des mois de janvier et février 2011, le sentiment de révolte est toujours présent dans la population. Corruption généralisée, misère totale, impasse politique et économique poussent des milliers de gens dans les rues et sur les places. Le gouvernement, actuellement dirigé par les militaires, y répond par la mitraille et la calomnie, répression d’autant facilitée du fait que, contrairement aux mouvements de l’année dernière, la classe ouvrière n’est pas capable de se remobiliser massivement. Car, pour la bourgeoisie le danger est là : "on peut comprendre l’angoisse de l’armée face à l’insécurité et aux troubles sociaux qui se sont développés ces derniers mois. Il y a la crainte de la contagion des grèves à ses entreprises, où ses employés sont privés de tous droits sociaux et syndicaux tandis que toute protestation est considérée comme un crime de trahison." (Ibrahim al Sahari, Représentant du Centre des études socialistes au Caire) 3
Voilà qui est clairement dit : la peur de la bourgeoisie, c’est le mouvement ouvrier qui pourrait se développer sur son propre terrain de lutte. Dans ce pays, les illusions démocratiques sont fortes après tant d’années de dictature, mais la crise économique est là qui resserre son étreinte. La bourgeoisie égyptienne, quelle que soit la fraction qui sera au gouvernement après les récentes élections, ne pourra pas empêcher la situation de se dégrader et l'impopularité du gouvernement de grandir. Toutes ces luttes ouvrières et sociales, malgré leurs faiblesses et leurs limites, expriment un début de refus, de la part de la classe ouvrière et d’une partie croissante de la population exploitée, d’accepter passivement le sort que leur réserve le capitalisme.
Les ouvriers des pays centraux du capitalisme aussi ne sont pas restés inertes ces derniers mois. Le 30 novembre dernier en Grande-Bretagne, deux millions de personnes se sont rassemblées dans la rue pour refuser la dégradation permanente de leurs conditions de vie. Cette grève fut la plus massive depuis plusieurs dizaines d’années sur ces terres où la classe ouvrière (la plus combative d’Europe dans les années 1970) avait été écrasée sous la botte de fer du thatchérisme dans les années 1980. C’est pourquoi, voir ainsi deux millions de manifestants dans les rues anglaises, même lors d’une journée syndicale stérile et sans lendemain, est très significatif du retour de la combativité ouvrière à l’échelle internationale. Le mouvement des Indignés, notamment en Espagne, nous a montré de manière embryonnaire de quoi la classe ouvrière pourra être capable. Les prémisses de sa propre force sont apparues clairement : assemblées générales ouvertes à tous, débats libres et fraternels, prise en main de l’ensemble de la lutte par le mouvement lui-même, solidarité et confiance en soi (Voir notre dossier spécial sur le mouvement des Indignés et des Occupy sur notre site Internet 4). La capacité qu'aura la classe ouvrière de s’organiser comme force autonome, en tant que corps collectif uni, sera un enjeu vital du développement des futures luttes massives du prolétariat. Les ouvriers des pays centraux du capitalisme, plus à même de déjouer les mystifications démocratiques et syndicales auxquelles ils sont confrontés depuis des décennies, montreront ainsi aux yeux du prolétariat mondial que c’est à la fois possible et nécessaire.
Le capitalisme mondial est en train de s’effondrer économiquement, la classe bourgeoise est secouée de manière croissante par des crises politiques. Ce système montre chaque jour un peu plus qu’il n’est pas viable.
Compter sur nos propres forces, c’est aussi savoir ce qui nous manque. Partout commence à naitre un mouvement de résistance contre les attaques du capitalisme. En Espagne, en Grèce, aux États-Unis des critiques émanant des ailes prolétariennes des mouvements de contestation fusent contre ce système économique pourri. On voit même apparaître un début de rejet du capitalisme. Mais alors, la question fondamentale qui taraude la classe ouvrière vient taper aux portes de la conscience ouvrière. Détruire ce monde est une nécessité que l’on peut percevoir mais pour mettre quoi à la place ? Ce dont nous avons besoin, c’est d’une société sans exploitation, sans misère et sans guerre. Une société où l’humanité sera enfin unie à l’échelle mondiale et non divisée en nations, en classes, ni triée par couleur ou par religion. Une société où chacun aura ce dont il a besoin pour se réaliser pleinement. Cet autre monde, qui doit être le but de la lutte de classe lorsque celle-ci s’attaque au renversement du capitalisme, est possible : c'est à la classe ouvrière (actifs, chômeurs, employés, futurs prolétaires encore scolarisés, travaillant derrière une machine ou un ordinateur, manœuvre, technicien ou scientifique, etc.) qu'il échoit de prendre en charge la transformation révolutionnaire qui y conduit et il porte un nom : le communisme qui n'a évidemment rien à voir avec le monstre hideux du stalinisme qui a usurpé ce nom ! Il ne s’agit pas là d’un rêve ou d’une utopie. Le capitalisme, pour se développer et exister, a aussi développé en son sein les moyens techniques, scientifiques et de production qui permettront à la société humaine mondiale et unifiée d’exister. Pour la première fois de son histoire, la société pourra sortir du règne de la pénurie pour établir celui de l’abondance et du respect de la vie. Les luttes qui se déroulent actuellement dans le monde, même si elles sont encore très embryonnaires, ont commencé sous les coups de boutoir de ce monde en faillite, à se réapproprier ce but à atteindre. La classe ouvrière mondiale porte, en elle-même, les capacités historiques de le réaliser.
Tino (10 janvier 2012)
1 "La catastrophe économique mondiale est inévitable [2]".
2 Dans le journal Cette semaine. cettesemaine.free.fr/spip/article.php3?id_article=4602
3 Cité dans l'article "En Égypte et dans le Maghreb, quel avenir pour les luttes ? [3]", Révolution Internationale n° 428.
4 fr.internationalism.org/icconline/2011/dossier_special_indignes.html [4]
Récent et en cours:
- Crise économique [5]
L'État dans la période de transition au communisme (I) (débat dans le milieu révolutionnaire)
- 2877 reads
Nous publions ci-après une contribution d'un groupe politique du camp prolétarien, OPOP 1, à propos de l'État dans la période de transition et de ses rapports avec l'organisation de la classe ouvrière pendant cette période.
Bien que cette question ne soit pas "d'actualité immédiate", c'est une des responsabilités fondamentales des organisations révolutionnaires de développer la théorie qui permettra au prolétariat de mener à bien sa révolution. En ce sens, nous saluons l'effort d'OPOP pour clarifier une question qui sera de la première importance lors de la future révolution, si elle est victorieuse, afin de pouvoir mettre en œuvre à l'échelle mondiale la transformation de la société léguée par le capitalisme vers une société sans classes et sans exploitation.
L'expérience de la classe ouvrière a déjà apporté sa contribution à la clarification pratique et à l'élaboration théorique de cette question. La brève expérience de la Commune de Paris, où le prolétariat a pris le pouvoir pendant deux mois, a clarifié la nécessité de détruire l'État bourgeois (et non de le conquérir comme le pensaient les révolutionnaires auparavant) et de la révocabilité permanente des délégués élus par les prolétaires. La révolution russe de 1905 a fait surgir des organes spécifiques, les conseils ouvriers, organes du pouvoir de la classe ouvrière. Après l'éclatement de la révolution russe en 1917, Lénine allait condenser dans son ouvrage L'État et la révolution les acquis du mouvement prolétarien sur cette question à cette époque. C'est de la conception résumée par Lénine d'un État prolétarien, l'État des Conseils, que se réclame le texte d'OPOP ci-après.
Pour OPOP, l'échec de la révolution russe (du fait de son isolement international) ne permet pas de tirer des leçons nouvelles par rapport au point de vue de Lénine. C'est sur cette base qu'elle rejette la conception du CCI qui remet en cause la notion d' "État prolétarien". Tout en développant sa critique, la contribution d'OPOP prend soin de délimiter le champ des désaccords entre nos organisations, ce que nous saluons, en soulignant que nous avons en commun la conception selon laquelle "les conseils ouvriers doivent détenir un pouvoir illimité (…) et constituer l'âme de la dictature révolutionnaire du prolétariat".
Le point de vue du CCI sur la question de l'État ne fait que poursuivre l'effort de réflexion théorique mené par les fractions de gauche (italienne en particulier) surgies en réaction à la dégénérescence des partis de l'Internationale communiste. S'il est parfaitement juste de rechercher la cause fondamentale de la dégénérescence de la révolution russe dans l'isolement international de celle-ci, ce n'est pas pour autant que cette expérience ne peut pas apporter d'enseignements quant au rôle de l'État, permettant ainsi d'enrichir la base théorique que constitue L'État et la révolution de Lénine. Contrairement à la Commune de Paris, qui a été clairement et ouvertement battue par la répression sauvage de la bourgeoisie, en Russie, c'est en quelque sorte "de l'intérieur", de la dégénérescence de l'État lui-même, qu'est venue la contre-révolution (en l'absence de l'extension de la révolution). Comment comprendre ce phénomène ? Comment et pourquoi la contre-révolution a-t-elle pu prendre cette forme ? C'est justement en nous basant sur les apports théoriques élaborés à partir de cette expérience que nous critiquons la position de "l'État prolétarien" défendue dans l'ouvrage de Lénine, de même que certaines formulations de Marx et Engels allant dans le même sens.
Évidemment, contrairement aux apports "en positif" de la Commune, ces leçons que nous tirons sur le rôle de l'État sont "en négatif" et, en ce sens, elles font l'objet d'une question ouverte, qui n'est pas tranchée par l'histoire. Mais, comme nous l'avons dit plus haut, il est de la responsabilité des révolutionnaires de préparer l'avenir. Nous publierons, dans un prochain numéro de la Revue internationale, une réponse aux thèses développées par OPOP. On peut ici évoquer, de façon très résumée, les idées essentielles autour desquelles elle s'articulera 2 :
-
Il est impropre de parler de l'État comme pouvant être le produit d'une classe en particulier. Comme Engels l'a mis en évidence, l'État est le produit de l'ensemble de la société divisée en classes antagoniques. S'identifiant aux rapports production dominants (et donc à la classe qui les incarne), sa fonction est celle de préservation de l'ordre économique instauré ;
-
Après la révolution victorieuse, il persiste des classes sociales différentes, même après la défaite de la bourgeoisie au niveau international ;
-
Si la révolution prolétarienne est l'acte par lequel la classe ouvrière se constitue en classe politiquement dominante, cette classe n'en devient pas pour autant la classe économiquement dominante. Elle demeure, jusqu'à l'intégration de l'ensemble des membres de la société dans le travail associé, la classe exploitée de la société et la seule classe révolutionnaire, c'est-à-dire porteuse du projet communiste. À ce titre, elle doit en permanence maintenir son autonomie de classe afin de défendre ses intérêts immédiats de classe exploitée et son projet historique de société communiste.
CCI
Conseils ouvriers, État prolétarien, dictature du prolétariat dans la phase socialiste de transition vers la société sans classes (OPOP)
1. Introduction
Les gauches sont en retard dans la discussion très urgente à mener concernant les questions de stratégie, tactique, organisation et également de la transition [au communisme]. Parmi les nombreux sujets qui nécessitent des réponses, l'un d'entre eux se détache particulièrement, celui de l'État, qui mérite un débat systématique.
Sur cette question, certaines forces de gauche ont une conception différente de la nôtre, en ce qui concerne essentiellement les conseils, véritables structures de la classe ouvrière, qui surgissent en tant qu'organes d'un pré-État-Commune et, par extension, de l'État-Commune lui-même. Pour ces organisations, l'État est une chose et les conseils en sont une autre, totalement différente. Pour nous, les conseils sont la forme au moyen de laquelle la classe ouvrière se constitue sur le plan organisationnel en État, en tant que dictature du prolétariat, vu que l'État signifie le pouvoir institué d'une classe sur une autre.
La conception marxiste de l'État prolétarien contient, pour le court terme, l'idée de la nécessité d'un instrument de domination de classe mais, pour le moyen terme, elle indique la nécessité de la fin de l'État lui-même. Ce qu'elle propose et qui devra prévaloir dans le communisme c'est une société sans classes et l'absence de nécessité de l'oppression de l'homme ou de la femme, étant donné qu'il n'existera plus d'antagonisme social entre différents groupes sociaux, comme c'est le cas aujourd'hui à cause de l'appropriation privée des moyens de production et de la séparation entre les producteurs directs et les moyens – et les conditions - de travail et donc de production.
La société, qui sera alors hautement évoluée, passera par une étape d'auto-gouvernement et d'administration des choses, où il n'y aura besoin d'aucune des organisations sociales transitoires expérimentées depuis qu'existe Homo sapiens, à l'exception de la forme conseils qui est la forme la plus évoluée de l'État (son caractère simplifié, sa dynamique d'auto-extinction délibérée et consciente et sa force sociale ne sont autres que des manifestations de sa supériorité sur toutes les autres formes passées de l'État), que la classe ouvrière utilisera pour passer de la première phase du communisme (le socialisme) à une phase supérieure de la société, la société sans classes. Mais pour atteindre ce stade, la classe ouvrière devra construire, bien avant, le moyen de la transition que sont les conseils à l'échelle planétaire.
Il reviendra alors aux organisations marxistes la tâche, non pas de contrôler l'État, moins encore de l'extérieur que de l'intérieur, mais bien de lutter en permanence au sein de l'État-Commune édifié par la classe ouvrière et l'ensemble du prolétariat au moyen des conseils, afin que celui-ci se hisse à la hauteur de son combat le plus révolutionnaire. Les conseils, à leur tour, devront effectivement assumer la lutte pour le nouvel État, avec la compréhension que ce sont eux-mêmes qui constituent l'État, lequel n'a pas sans raison été qualifié d'État-Commune par Lénine.
L'État des Conseils est révolutionnaire tant dans sa forme que dans son contenu. Il diffère, par essence, de l'État bourgeois de la société capitaliste ainsi que des autres sociétés qui l'ont précédée. L'État des Conseils découle de la constitution de la classe ouvrière en classe dominante comme le pose le Manifeste du Parti communiste de 1848, écrit par Marx et Engels. En ce sens, les fonctions qui lui reviennent diffèrent radicalement de celles de l'État bourgeois capitaliste, dans la mesure où s'opère un changement, une transformation quantitative et qualitative au moment même de la rupture entre l'ancien pouvoir et la nouvelle forme d'organisation sociale : l'État des Conseils.
L'État des Conseils est, en même temps et dialectiquement, la négation politique et sociale de l'ordre antérieur ; c'est pour cela qu'il est, également dialectiquement, l'affirmation et la négation de la forme de l'État : négation en ce sens qu'il entreprend sa propre extinction et en même temps celle de toute forme d'État ; affirmation en tant qu'expression extrême de sa force, condition de sa propre négation, dans la mesure où un État post-révolutionnaire faible serait impuissant à résoudre sa propre existence ambigüe : mener à bien la tâche de répression de la bourgeoisie comme prémices de son pas décisif, l'acte de sa disparition. Dans l'État bourgeois, la relation dictature - démocratie se réalise à travers une relation combinée d'unité contradictoire (dialectique) dans laquelle la grande majorité est soumise au moyen de la domination politique et militaire de la bourgeoisie. Dans l'État des Conseils, au contraire, ces pôles sont inversés. Le prolétariat, qui avait auparavant une participation politique nulle en raison du processus de manipulation et d'exclusion des décisions auquel il était soumis, vient jouer le rôle dominant dans le processus de lutte des classes. Il y établit la plus large démocratie politique connue de l'histoire, laquelle sera associée, comme il se doit, à la dictature de la majorité exploitée sur une minorité dépouillée et expropriée, qui fera tout pour organiser la contre-révolution.
C'est cela l'État des Conseils, l'expression ultime de la dictature du prolétariat qui utilise ce pouvoir, non seulement pour assurer une plus grande démocratie pour les travailleurs en général et la classe ouvrière en particulier, mais avant tout et par-dessus tout, pour réprimer de façon organisée à l'extrême les forces de la contre-révolution.
L'État des Conseils condense en lui, comme cela a déjà été dit, l'unité entre le contenu et la forme. C'est durant la période de situation révolutionnaire, alors que les bolcheviks organisaient l'insurrection en Russie en Octobre 1917, que cette question est devenue la plus claire. A ce moment-là, il était impossible de faire une distinction entre le projet de pouvoir par la classe ouvrière, le socialisme, le contenu et la forme d'organisation, le nouveau type d'État qu'on voulait construire en le basant sur les soviets. Le socialisme, le pouvoir des travailleurs et les soviets, tout cela était la même chose, si bien qu'on ne pouvait parler de l'un sans comprendre qu'on parlait automatiquement de l'autre. Ainsi, ce n'est pas parce que, par la suite, il s'est édifié une organisation étatique toujours plus éloignée de la classe ouvrière en Russie que nous devons laisser de côté la tentative révolutionnaire de mettre en place l'État des Soviets.
Les soviets (conseils), à travers tous les mécanismes et les éléments hérités de la bureaucratie ont, en URSS, été privés de leur contenu révolutionnaire pour se constituer, dans le moule d'un État bourgeois, comme organe institutionnalisé. Mais ce n'est pas pour autant que nous devrions abandonner la tentative de construire un État d'un type nouveau, avec un fonctionnement dont les principes de base seraient nécessairement en adéquation avec ce que la classe ouvrière a créé de plus important à travers le processus historique de sa lutte, à savoir une forme d'organisation nécessitant seulement d'être améliorée sur certains aspects en vue de mener à bien la transition, mais qui, fondamentalement, depuis la Commune de Paris de 1871, a fait l'objet de répétitions générales, à travers une série de tentatives et d'erreurs, pour réaliser l'État des Conseils.
Aujourd'hui, la tâche consistant à établir les conseils comme une forme d'organisation de l'État ne se situe pas seulement dans la perspective d'un seul pays mais à l'échelle internationale et c'est bien là le défi principal qui est posé à la classe ouvrière. Par conséquent, nous nous proposons à travers ce bref essai, de réaliser une tentative pour comprendre ce qu'est l'État des Conseils ou, autrement dit, une élaboration théorique sur une question que la classe ouvrière a déjà expérimentée pratiquement, à travers son expérience historique et dans sa confrontation aux forces du capital. Passons à l'analyse.
2. Préambule
Pour éviter les répétitions et les redondances, nous considérons comme établi que, dans ce texte, nous assumons à la lettre toutes les définitions théoriques et politiques principielles qui définissent le corps de doctrine de L'État et la révolution de Lénine.3 De plus, nous avertissons le lecteur que nous ne rappellerons les prémisses léninistes que dans la seule mesure où elles sont indispensables pour fonder théoriquement quelques postulats qui sont nécessaires au besoin réellement urgent d'une actualisation de ce sujet. De plus, nous ne le ferons que si les prémisses en question sont nécessaires pour clarifier et fonder l'objectif théorique - politique qui nous préoccupe, à savoir les relations entre le système des conseils et l'État prolétarien (= dictature du prolétariat) avec sa forme préalable, le pré-État.
D'un autre point de vue, l'œuvre de Lénine mentionnée précédemment se révèle de façon tout autant nécessaire et irremplaçable, car elle inclut l'aperçu le plus complet des passages de Marx et d'Engels relatifs à l'État de la phase de transition, mettant ainsi à portée de main une quantité plus que suffisante de positions existantes et autorisées produites sur L'État et la révolution dans toute la littérature politique.
3. Quelques prémisses du pouvoir ouvrier
Commentant Engels, Lénine fait, dans deux passages de son texte, les affirmations suivantes: "L'État est le produit et la manifestation de ce fait que les contradictions de classes sont inconciliables (...) Selon Marx, l'État ne pourrait ni surgir, ni se maintenir, si la conciliation des classes était possible" et "... l'État est un organisme de domination de classe, un organisme d'oppression d'une classe par une autre" 4 (l'accentué est de l'auteur). Conciliation et domination sont deux concepts très précis dans la doctrine sur l'État de Marx, Engels et Lénine. Conciliation signifie la négation de toute contradiction quelle qu'elle soit entre les termes d'une relation donnée. Dans la sphère sociale, en l'absence de contradictions dans la constitution ontologique des classes sociales fondamentales d'une formation sociale, parler d'État n'a pas de sens. Il est prouvé historiquement que, dans les sociétés primitives, il n'existe pas d'État tout simplement parce qu'il n'y a pas de classes sociales, d'exploitation, d'oppression et de domination d'une classe sur une autre. D'autre part, lorsqu'on parle de la constitution ontologique même des classes sociales, la domination est une notion qui exclut l'hégémonie, vu que l'hégémonie suppose le partage – même inégal – de positions au sein du même contexte structurel. Le résultat est que, dans le domaine de la socialité bourgeoise, qui s'étend jusqu'à celui de la révolution, au sein duquel la bourgeoisie et le prolétariat sont situés et se battent à partir de positions diamétralement antagoniques, parler de l'hégémonie de la bourgeoisie sur le prolétariat n'a pas de sens, alors qu'il y en a un de parler d'hégémonie entre les fractions de la bourgeoisie qui se partagent le même pouvoir d'État ; cela a un sens également de parler de l'hégémonie du prolétariat sur les classes avec lesquelles il partage l'objectif commun de prendre le pouvoir par le renversement de l'ennemi stratégique commun 5.
Ailleurs, citant Engels, Lénine parle de la force publique, ce pilier caractéristique de l'État bourgeois - l'autre étant la bureaucratie - constitué de tout un appareil répressif militaire et spécialisé, qui est séparé de la société et au-dessus d'elle et "... qui ne coïncide plus directement avec la population s'organisant elle-même en force armée" 6. La mise en évidence de cette composante de base de l'ordre bourgeois a ici un clair objectif : montrer comment, en contrepartie, est également incontournable la mise en place d'une force armée, beaucoup plus forte et cohérente, celle du prolétariat en armes pour réprimer, avec une détermination encore plus résolue, l'ennemi de classe battu, mais pas abattu, la bourgeoisie. Dans quelle instance de la dictature du prolétariat doit se trouver cette force répressive ? C'est une question à traiter dans un chapitre spécifique du présent texte.
L'autre pilier sur lequel repose le pouvoir bourgeois est la bureaucratie, comprenant des fonctionnaires de l'État, qui jouissent de privilèges cumulatifs, parmi lesquels des honoraires différenciés, des postes de tout repos attribués à vie, qui accumulent tous les avantages des pratiques inhérentes à une corruption de grande ampleur et récurrente. De même que pour les milices populaires qui redoublent de force à mesure qu'elles sont structurellement simplifiées, les tâches exécutives, législatives et judiciaires sont plus efficaces dans la mesure même où elles sont également simplifiées ; et exactement pour la même raison, les tâches exécutives des tribunaux et les fonctions législatives gagnent en force dans la mesure même où elles sont prises en charge directement par les travailleurs dans des conditions où la révocabilité des charges est établie afin d'enrayer, dès le début, la tendance à la résurgence des castes, mal dont souffrent toutes les sociétés qui ont été accouchées par des révolutions "socialistes" durant tout le vingtième siècle.
La bureaucratie et la force publique professionnelles, les deux poutres maîtresses sur lesquelles repose le pouvoir politique de la bourgeoisie, les deux piliers dont les fonctions devraient être remplacées par les travailleurs dans des structures simplifiées (au cours de leur extinction) mais alors beaucoup plus efficaces et fortes ; simplification et force qui s'opposent et s'attirent dans le mouvement qui accompagne tout le processus de transition jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de la précédente société de classe. Le problème qui nous est maintenant posé est le suivant : quelle est l'instance qui, pour Marx, Engels et Lénine, doit assumer la dictature du prolétariat ?
4. La dictature du prolétariat chez Marx, Engels et Lénine
Notre trio ne laisse aucun doute à ce sujet :
"Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante, et pour augmenter au plus vite la quantité des forces productives" 7.
Ou encore, État prolétarien (sic) = "prolétariat organisé en classe dominante." "L'État, c'est-à-dire le prolétariat organisé en classe dominante." (sic). Jusqu'ici, le sens du raisonnement de Lénine, Engels et Marx est le suivant : le prolétariat renverse la bourgeoisie par la révolution ; en renversant la machine étatique bourgeoise, il détruira la machine d'État en question pour, immédiatement, ériger son État, simplifié et en voie d'extinction, lequel est plus fort car il est dirigé par la classe révolutionnaire et assume deux types de tâches : réprimer la bourgeoisie et construire le socialisme (comme phase de transition au communisme).
Mais d'où Marx tire-t-il cette conviction que la dictature du prolétariat est l'État prolétarien ? De la Commune de Paris ... tout simplement ! En effet, "La Commune fut composée des conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. La majorité de ses membres étaient naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière." 8 (souligné par l'auteur). La question va beaucoup plus loin : les membres de l'État prolétarien (sic), l'État-Commune, sont élus dans les conseils d'arrondissement, ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas de conseils de travailleurs qui se mettent à la tête de tels conseils, comme en Russie, dans les soviets. La question de l'hégémonie de la direction ouvrière est garantie par l'existence d'une majorité d'ouvriers dans ces conseils et, bien sûr, par l'action de direction que le parti doit exercer dans de telles instances.
Il ne manque qu'un seul ingrédient pour articuler la position État prolétarien, État des Conseils, État-Commune, État socialiste ou dictature du prolétariat : la méthode de prise des décisions et c'est là que se formule et se comprend ce principe universel que beaucoup de marxistes ne parviennent pas à comprendre, il s'agit du centralisme démocratique. "Mais ce centralisme démocratique, Engels ne l'entend nullement au sens bureaucratique que lui donnent les idéologues bourgeois et petit-bourgeois, dont, parmi ces derniers, les anarchistes. Le centralisme, pour Engels, n'exclut pas du tout une large autonomie administrative locale qui, à condition que les "communes" et les régions défendent de leur plein gré l'unité de l'État, supprime incontestablement tout bureaucratisme et tout "commandement" par en haut." 9. Il est clair que le terme et le concept de centralisme démocratique ne sont pas la création du stalinisme, comme le veulent certains - qui tentent de dénaturer cette méthode essentiellement prolétarienne - mais celle d'Engels lui-même. Par conséquent, il ne peut leur être donnée la connotation péjorative qui vient du centralisme bureaucratique utilisé par la nouvelle bourgeoisie d'État de l'URSS.
5. Système des conseils et dictature du prolétariat
La séparation antinomique entre le système des conseils et l'État post-révolutionnaire est une erreur, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elle réside dans une position qui s'éloigne de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État. Séparer l'État prolétarien du système des conseils revient à briser l'unité qui doit exister et persister dans le cadre de la dictature du prolétariat. Une telle séparation place, d'un côté, l'État comme une structure administrative complexe, devant être gérée par un corps de fonctionnaires - une aberration dans la conception de l'État simplifié de Marx, Engels et Lénine – et, de l'autre, une structure politique, dans le cadre des conseils, devant exercer une pression sur la première (l'État en tant que tel). Cette conception résulte d'une accommodation à une vision influencée par l'anarchisme qui identifie l'État-Commune avec l'État bureaucratique (bourgeois). Elle est le produit des ambiguïtés de la Révolution russe et place le prolétariat hors de l'État post-révolutionnaire, créant ainsi une dichotomie qui, elle, constitue le germe d'une nouvelle caste se reproduisant dans le corpus administratif organiquement séparé des conseils.
Une autre cause de cette même erreur, qui est liée à la précédente, réside dans l'établissement d'un lien étrange identifiant de façon acritique l'État surgi dans l'URSS post-révolutionnaire - un État nécessairement bureaucratique - avec la conception de l'État-Commune de Marx, Engels et de Lénine lui-même. C'est une erreur qui découle d'une incompréhension des ambiguïtés ayant résulté de circonstances historiques et sociales spécifiques, qui ont bloqué non seulement la transition mais même le début de la dictature du prolétariat en URSS. Ici, on cesse de comprendre que la dynamique prise par la révolution russe - à moins d'opter pour l'interprétation facile mais peu consistante selon laquelle les déviations du processus révolutionnaire ont été le fruit de la politique de Staline et de son entourage – n'obéissait pas à la conception de la révolution, de l'État et du socialisme qu'en avait Lénine, mais aux restrictions qui émanaient du terrain social et politique d'où émergea le pouvoir en URSS caractérisé, entre autres et pour rappel, par l'impossibilité de la révolution en Europe, par la guerre civile et la contre-révolution à l'intérieur de l'URSS. La dynamique qui en résulta était étrangère à la volonté de Lénine. Lui-même se pencha sur celle-ci, la marquant de façon réitérée par des formulations ambiguës présentes dans sa pensée ultérieure et ce jusqu'à sa mort. De telles ambiguïtés, qui se reflétaient dans la pensée qui tentait de les comprendre, se situaient plus dans les avancées et les reculs de la révolution que dans la conception théorique politique de Lénine et des chefs bolcheviques qui continuaient à être d'accord avec lui.
Une troisième cause à cette erreur est la non prise en compte du fait que les tâches organisationnelles et administratives mises à l'ordre du jour par la révolution sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux. Ainsi, des questions brûlantes comme la planification centralisée - dont la forme bureaucratique dans le système Gosplan (Comité étatique pour la planification) a longtemps été confondue avec la "centralisation socialiste" – rien que pour parler de cet aspect digne d'attention, ne sont pas des questions purement "techniques" mais hautement politiques et, comme telles, ne peuvent être déléguées, même si elles sont "vérifiés" de l'extérieur par les conseils, au moyen d'un corps d'employés situés en dehors du système des conseils où se trouvent les travailleurs les plus conscients. Aujourd'hui, on sait que la planification ultra centralisée "socialiste" n'était qu'un aspect de la centralisation bureaucratique du capitalisme d'État "soviétique" qui maintenait le prolétariat éloigné et étranger à tout le système de définition des objectifs, des décisions concernant ce qui doit être produit et comment cela doit être réparti, l'allocation des ressources, etc. S'il s'était agi d'une véritable planification socialiste, tout ceci aurait dû faire l'objet d'une large discussion au sein des conseils, ou de l'État-Commune, vu que l'État prolétarien se confond avec le système des conseils, l'État socialiste étant "une "machine" très simple, presque sans "machine", sans appareil spécial, par la simple organisation des masses armées (comme, dirons-nous par anticipation, les Soviets des députés ouvriers et soldats)." 10
Une autre incompréhension réside dans la non perception que la véritable simplification de l'État-Commune, telle qu'elle est décrite par Lénine à travers les paroles rapportées précédemment, implique un minimum de structure administrative et que cette structure est si minime et en voie de simplification / extinction, qu'elle peut être assumée directement par le système des conseils. Par conséquent, cela n'a pas de sens de prendre comme référence l'État "soviétique" de l'URSS pour mettre en question l'État socialiste que Marx et Engels ont vu naître de la Commune de Paris. En fait, établir un trait d'union entre l'État des Conseils et l'État bureaucratique issu de la Révolution russe revient à donner à l'État prolétarien une structure bureaucratique, qu'un véritable État post-révolutionnaire, simplifié et en voie de simplification / extinction, non seulement ne possède pas mais encore rejette précisément.
En fait, le caractère et l'étendue de l'État des Conseils (État prolétarien = État socialiste = dictature du prolétariat = État-Commune = État de transition) sont magnifiquement résumés dans ce passage écrit par Lénine lui-même : "l' "État" est encore nécessaire, mais c'est déjà un État transitoire, ce n'est plus l'État proprement dit". 11 Mais, direz-vous, si c'était cela la véritable conception de l'État socialiste de Lénine, pourquoi ne l'a-t-il pas "appliquée" en URSS après la révolution d'Octobre, vu que ce qui est alors apparu est l'exact opposé de tout cela, des distorsions allant de l'extrême centralisation bureaucratique (depuis l'armée à la bureaucratie étatique et aux unités de production) jusqu'à la répression la plus brutale des marins de Cronstadt ? Eh bien, tout cela ne fait que révéler que des révolutionnaires de l'envergure de Lénine peuvent éventuellement être traversés par des contradictions et des ambiguïtés d'une telle importance – et cela a été le contexte exact national et international de la Révolution d'Octobre - qui peuvent les conduire, dans la pratique, à des actions et des décisions souvent diamétralement opposées à leurs convictions les plus profondes. Dans le cas de Lénine et du Parti bolchevique, une seule des impossibilités [à la révolution, NDT] (et elles étaient nombreuses) était suffisante pour orienter la révolution dans une direction non souhaitée. Une de ces impossibilités était plus que suffisante : la situation d'isolement d'une révolution qui ne pouvait pas reculer, mais qui s'est trouvée isolée et n'avait pas d'autre choix que d'essayer d'ouvrir la voie à la construction du socialisme dans un seul pays, la Russie soviétique - tentative contradictoire qui fut initiée déjà à l'époque de Lénine et Trotsky. Que furent le communisme de guerre, la NEP, et autres entreprises, sinon cela ?
Et alors, que devons-nous faire ? Devons-nous rester fermes sur les conceptions de Lénine, Marx et Engels sur l'État, le programme, la révolution et le parti pour, dans le futur, lorsque les problèmes concrets comme celui de l'internationalisation de la lutte de classe, entre autres, montreront les réelles possibilités pour la révolution et la construction du socialisme dans plusieurs pays, mettre en avant et donner corps aux conceptions de Marx, Engels et Lénine ? Ou bien, inversement, devons-nous, face aux premières difficultés, renoncer aux positions de principe, en les échangeant contre des figurations politiques au rabais qui ne pourront que conduire à l'abandon de la perspective de la révolution et de l'édification socialiste ?
6. Pour une conclusion : Conseils, État (socialiste) et pré- État (socialiste)
a) L' État-Conseil
Après avoir analysé les prémisses économiques de l'abolition des classes sociales, c'est-à-dire, les prémisses "pour que 'tous' puissent réellement participer à la gestion de l'État", Lénine, toujours en référence aux formulations de Marx et d'Engels, dit qu' "on peut fort bien, après avoir renversé les capitalistes et les fonctionnaires, les remplacer aussitôt, du jour au lendemain, pour le contrôle de la production et de la répartition, pour l'enregistrement du travail et des produits, par les ouvriers armés, par le peuple armé tout entier". "Enregistrement et contrôle, tel est l'essentiel, et pour la 'mise en route' et pour le fonctionnement régulier de la société communiste dans sa première phase. Ici, tous les citoyens se transforment en employés salariés de l'État constitué par les ouvriers armés. Tous les citoyens deviennent les employés et les ouvriers d'un seul 'cartel' du peuple entier, de l'État" 12. De plus, "En régime socialiste, tout le monde gouvernera à tour de rôle et s'habituera vite à ce que personne ne gouverne." L'étape du socialisme "placera la majeure partie de la population dans des conditions permettant à tous, sans exception, de remplir les 'fonctions publiques'." 13
Tous les citoyens, rappelons-le, organisés dans le système des conseils, ou un autre, dans l'État ouvrier, vu que pour Marx, Engels et Lénine, la simplification des tâches atteindra un point tel que les tâches "administratives" de base, réduites à l'extrême, non seulement pourront être assumées par le prolétariat et les gens en général, comme pourront être prises en charge par le système des conseils qui, après tout, n'est que l'État lui-même.
Ainsi, l'État prolétarien, l'État socialiste, la dictature du prolétariat n'est pas autre chose que le système des conseils, lequel assurera l'hégémonie de la classe ouvrière dans son ensemble, assumera directement, sans qu'il y ait la nécessité d'aucun organe administratif spécifique, à la fois la défense du socialisme et les fonctions de gestion de l'État et des unités de production. Enfin, cette unité de la dictature du prolétariat, sera garantie par l'unité administrative / politique simplifiée, dans une même totalité appelée l'État des Conseils.
b) Le pré-État des Conseils
Le système des conseils qui, dans la situation post-insurrectionnelle, devra assumer la transition structurelle (mise en place de nouveaux rapports de production, élimination de toute hiérarchie dans la production, refus de toute forme mercantile, etc.) et superstructurelle (élimination de toute hiérarchie héritée de l'État bourgeois, de toute la bureaucratie, refus de toute idéologie héritée de la formation sociale antérieure, etc.) est le même système des Conseils que celui qui, avant la révolution, était l'organisation révolutionnaire qui a renversé la bourgeoisie et son État. Il s'agit donc d'un même corpus dont les tâches ont évolué avec les deux étapes du même processus de révolution sociale : une fois réalisée la tâche de l'insurrection, il faut initier la mise en œuvre d'une nouvelle tâche qui devra mener à son terme la véritable révolution sociale – la rupture avec une formation sociale qui a expiré et l'inauguration d'une nouvelle, le socialisme, lui-même aussitôt en marche pour la transition communiste, la seconde société sans classes de l'histoire (la première ayant été, bien sûr, la société primitive).
Eh bien c'est ce système des conseils que nous appelons pré-État (prolétarien). On voit que ce nom n'a, par son contenu, rien d'original, car il était, est et sera toujours une évidence du processus révolutionnaire ouvert par la Commune de Paris. Là, les Communards qui ont pris le pouvoir à partir des arrondissements étaient les mêmes qui ont assumé le pouvoir d'État - dictature du prolétariat - et qui ont inauguré, bien qu'avec des erreurs évidentes de jeunesse, l'édification d'un ordre socialiste. Un processus similaire s'est produit de nouveau en Octobre 1917. La première expérience ne pouvait pas, dans les circonstances où elle s'est produite, aller à son terme et a été frappée par la force contre-révolutionnaire de la bourgeoisie, après plus de deux mois à peine d'une vie mémorable. La seconde, comme on le sait, ne pouvait pas non plus aller à son terme en raison de l'absence de conditions, externes et internes, parmi lesquelles l'impossibilité de mener à terme la construction du socialisme dans un seul pays.
Dans les deux cas, il y eut un pré-État mais, dans les deux cas, un pré-État qui, si d'un côté il put conduire à terme l'insurrection, de l'autre ne put être préparé suffisamment tôt pour la tâche de construction du socialisme. Dans le cas de 1917, ce n'est qu'à la veille d'Octobre que le seul parti (le Parti bolchevique) qui était doté des prérequis théoriques pour préparer l'avant-garde de la classe organisée dans les soviets, surtout à Saint-Pétersbourg, put seulement enseigner à la classe les tâches les plus urgentes de l'insurrection. Pour nous, il semble que, malgré la conscience, surtout chez Lénine, de l'importance fondamentale des soviets depuis 1905, ce n'est seulement qu'après février 1917 que, dans le cas de Lénine, cette conscience devint conviction. C'est pourquoi le parti de Lénine (dont le retour en Russie était facilement prévisible, vu qu'il était déjà revenu en 1905) ne s'est pas soucié de mobiliser à fond le militantisme de ses cadres ouvriers dans les soviets (les mencheviks étaient arrivés plus tôt), y inclus dans la préparation préalable des travailleurs à un resurgissement des soviets, plus tôt et au moyen d'une formation plus efficace. Une telle formation, y compris pour l'avant-garde la plus résolue de la classe organisée dans les soviets, devait inclure, sous le feu d'un débat incessant entre ces travailleurs, les questions de la prise insurrectionnelle du pouvoir et des notions de toute la théorie marxiste concernant l'établissement de leur État et la construction du socialisme. Ce débat a fait défaut, soit par l'incapacité à percevoir plus tôt l'importance des soviets, soit par manque de temps pour porter le débat parmi les ouvriers du soviet deux mois seulement avant l'insurrection. Quoi qu'il en soit, l'impréparation de l'avant-garde à la prise du pouvoir et à l'exercice de celui-ci, à son intervention et son rôle dirigeant, en vue de la construction du socialisme, a constitué un des facteurs défavorables pour une véritable dictature du prolétariat (en tant que base représentée dans les conseils) en URSS. Une telle lacune, provoquée en grande partie par l'absence d'un pré-État approprié, c'est-à-dire un pré-État qui constitue une école de la révolution, a constitué une difficulté supplémentaire dans le naufrage de la révolution russe de 1917.
Comme Lénine lui-même l'a toujours signalé, les révolutionnaires communistes sont des hommes et des femmes qui doivent avoir une formation marxiste très solide. Une solide formation marxiste requiert des connaissances relatives à la dialectique, l'économie politique, le matérialisme historique et dialectique qui permettront aux militants d'un parti de cadres non seulement d'analyser et comprendre les conjonctures passées et présentes, mais également de capter l'essentiel des processus prévisibles, au moins en ce qui concerne leurs grandes lignes (de tels niveaux de prédiction peuvent être identifiés dans beaucoup des analyses présentes dans les Cahiers philosophiques de Lénine). D'où le fait qu'une véritable formation marxiste peut assurer aux cadres militants d'un authentique parti communiste la faculté de prévoir, en les anticipant, les scénarios possibles du développement d'une crise comme la crise actuelle. De même que prévoir un large processus de situations révolutionnaires ne constitue en rien une "Bête à sept têtes" 14.
De plus, il est parfaitement faisable de prévoir la chose la plus évidente de ce monde, le surgissement de formes embryonnaires des conseils - parce que, ici et là, elles commencent à faire surface de façon embryonnaire – et qui devront être analysées, en toute franchise, sans préjugé, afin que, une fois interprétées théoriquement, les travailleurs puissent corriger les erreurs et les lacunes de telles expériences, pour qu'ils les multiplient et en renforcent le contenu, jusqu'à ce qu'elles deviennent, dans un futur proche - cette garantie est donnée par le stade avancé de la crise structurelle du capitalisme - dans le contexte de situations révolutionnaires concrètes, le système des conseils, issus de l'interaction dialectique de petits cercles (dans les lieux de travail, d'éducation et de logement), de commissions (d'usines) et de conseils (de quartiers, de régions, de zones industrielles, nationales, etc.) qui devront se constituer, dans le même temps, en tant qu'épine dorsale de l'insurrection et, dans le futur, organe de la dictature révolutionnaire du prolétariat.
7. En conclusion : le CCI et la question de l'État post-révolutionnaire
Pour nous, les conseils ouvriers doivent détenir un pouvoir illimité et, comme tels, doivent se constituer dans les organes de base du pouvoir ouvrier, en plus du fait qu'ils doivent constituer l'âme de la dictature révolutionnaire du prolétariat. Mais c'est à partir de là que nous nous différencions de certains exégètes du marxisme qui établissent une rupture entre les conseils et l'État-Commune, comme si cet État-Commune et les conseils étaient deux choses qualitativement distinctes. C'est la position, par exemple, du CCI (Courant communiste international). Après avoir opéré cette séparation, de tels exégètes établissent un trait d'union au moyen duquel les conseils devraient exercer une pression et leur contrôle sur le "demi-État de la période de transition", pour que ce même État (= Commune) – qui dans la vision du CCI, "n'est ni le porteur ni l'agent actif du communisme" - ne remplisse pas son rôle immanent de conservateur du statu quo (sic) et "d'obstacle" à la transition.
Pour le CCI, "L'État tend toujours à s'accroître démesurément", devenant ainsi "terrain de prédilection à toute la fange d'arrivistes et autres parasites et recrute facilement ses cadres parmi les éléments résidus et vestiges de l'ancienne classe dominante en décomposition." 15 Et il termine sa vision de l'État socialiste en affirmant que Lénine "a pu constater [cette fonction de l'État] quand il parle de l'État comme la reconstitution de l'ancien appareil d'État tsariste" et quand il dit que l'État accouché par la Révolution d'Octobre avait tendance "à échapper à notre contrôle et tourne dans le sens contraire à ce que nous voulons". Pour le CCI, "l'État prolétarien est un mythe" et "Lénine le rejetait, rappelant que c'était 'un gouvernement des ouvriers et des paysans avec une déformation bureaucratique'". Par ailleurs, pour le CCI :
"La grande expérience de la révolution russe est là pour en témoigner. Chaque fatigue, chaque défaillance, chaque erreur du prolétariat a immédiatement pour conséquence le renforcement de l'État, et inversement, chaque victoire, chaque renforcement de l'État se fait en évinçant un peu plus le prolétariat. L'État se nourrit de l'affaiblissement du prolétariat et de sa dictature de classe. La victoire de l'un est la défaite de l'autre." 16
Il dit aussi, dans d'autres passages [NDLR: du même article], que "Le prolétariat garde sa pleine et entière liberté par rapport à l'État. Sous aucun prétexte, le prolétariat ne saurait reconnaître la primauté de décision des organes de l'État sur celle de son organisation de classe : les conseils ouvriers, et devrait imposer le contraire", que le prolétariat "ne saurait tolérer l'immixtion et la pression d'aucune sorte de l'État dans la vie et l'activité de la classe organisée excluant tout droit et possibilité de répression de l'État à l'égard de la classe ouvrière" et que "Le prolétariat conserve son armement en dehors de tout contrôle de l'État". "La condition première en est la non-identification de la classe avec l'État"
Qu'en est-il de la vision des camarades du CCI sur l'État-Commune ? En premier lieu que ni Marx ni Engels, ni Lénine, comme on l'a vu dans les observations faites plus avant et empruntées à L'État et la révolution, ne défendent la conception de l'État développée par le CCI. Comme nous l'avons vu, l'État-Commune était, pour eux, l'État des Conseils, l'expression de la puissance du prolétariat et de sa dictature de classe. Pour Lénine, l'État post-révolutionnaire non seulement n'était pas un mythe, comme le pense le CCI, mais bien l'État prolétarien. En vertu de quoi cet État peut-il être ainsi qualifié par le CCI alors qu'il le conçoit par ailleurs comme un État-Commune ?
Deuxièmement, comme nous l'avons déjà analysé précédemment, la séparation antinomique entre les conseils et l'État post-révolutionnaire, posée par le CCI, s'éloigne de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État. Il nous faut ici réitérer ce que nous avons déjà dit précédemment, à savoir que séparer l'État prolétarien du système des conseils revient à briser l'unité qui doit exister et existe sous la dictature du prolétariat et qu'une telle séparation place, d'un côté, l'État en tant que structure administrative complexe et gérée par un corps de fonctionnaires - un non-sens dans la conception simplifiée de l'État selon Marx, Engels et Lénine – et, de l'autre, une structure politique au sein des conseils exerçant sa pression sur l'État en tant que tel.
Troisièmement, nous le répétons : cette conception, qui résulte d'une accommodation à une vision influencée par l'anarchisme et identifie l'État-Commune avec l'État bureaucratique (bourgeois) issu des ambiguïtés de la Révolution russe, place le prolétariat hors de l'État post-révolutionnaire en créant alors effectivement une dichotomie qui, elle-même, constitue le germe d'une nouvelle caste se reproduisant dans le corpus administratif séparé organiquement des conseils ouvriers. Le CCI confond le concept de l'État de Lénine avec l'État produit des ambiguïtés de la Révolution d'Octobre 1917. Lorsque Lénine se plaint des atrocités de l'État tel qu'il s'est développé en URSS, ce n'est pas pour autant sa conception de l'État-Commune qu'il rejette, mais bien les déviations de l'État-Commune russe depuis Octobre.
Quatrièmement, les camarades du CCI semblent ne pas se rendre compte, comme nous en avons également traité, du fait que les tâches organisationnelles et administratives que la révolution met à l'ordre du jour, dès le début, sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux.
Cinquièmement, les camarades du CCI ne semblent pas réaliser, également comme indiqué ci-dessus, la simplification véritable de l'État-Commune, dans le sens où Lénine l'exprime, avec un minimum de structure administrative, tellement minime – c'est un processus de simplification / extinction – qu'elle peut être prise en charge directement par le système des conseils.
Sixième et dernier point. C'est seulement en assumant, directement et de l'intérieur, les tâches simplifiées relevant de l'État des Conseils, de défense et de transition / construction socialiste, que la classe ouvrière sera en condition d'éviter que ne se produise un schisme étatique étranger à l'État des conseils et qu'elle pourra exercer son contrôle, non seulement sur ce qui se passe au sein de l'État, mais également sur la société dans son ensemble. Pour cela, il vaut la peine de rappeler que l'État prolétarien, l'État-Commune, l'État socialiste, la dictature du prolétariat ne sont autre chose que le système des conseils qui a pris en charge les tâches élémentaires d'organisation des milices, de la durée quotidienne du travail, des brigades de travail et autres types de tâches également révolutionnaires (révocabilité des postes, égalité des salaires, etc.), des tâches également simplifiées concernant la lutte et l'organisation d'une société en transition. Pour cela, il ne sera pas nécessaire de créer un monstre administratif, encore moins bureaucratique, ni une quelconque autre forme héritée de l'État bourgeois abattu ou lui ressemblant ou encore de l'État bureaucratique du capitalisme d'État de l'ex-URSS.
Ce serait formidable que le CCI se penche sur les passages que nous avons mis en évidence dans ce texte relatif à L'État et la révolution de Lénine, où celui-ci justifie, en s'appuyant sur Engels et Marx, la nécessité de l'État-Commune comme celle de l'État des Conseils, de l'État prolétarien, de la dictature du prolétariat.
OPOP
(Septembre 2008, révisé en décembre 2010).
1 OPOP, OPosição OPerária (Opposition ouvrière), qui existe au Brésil. Voir sa publication sur revistagerminal.com. Le CCI entretient avec OPOP depuis des années une relation fraternelle et de coopération s'étant déjà traduite par des discussions systématiques entre nos deux organisations, des tracts ou déclarations signés en commun ("Brésil : des réactions ouvrières au sabotage syndical", https://fr.internationalism.org/ri373/bresil.html [6]) ou des interventions publiques communes ("Deux réunions publiques communes au Brésil, OPOP-CCI : à propos des luttes des futures générations de prolétaires", https://fr.internationalism.org/ri371/opop.html [7]) et la participation réciproque de délégations aux congrès de nos deux organisations.
2 Celles-ci sont développées dans les articles suivants : "Période de transition – Projet de résolution" de la Revue internationale n° 11 (https://fr.internationalism.org/rint11/periode_de_transition.htm [8]) et "L'État dans la période de transition" de la Revue internationale n° 15 (https://fr.internationalism.org/rinte15/pdt.htm [9]).
3 NDLR : https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/08/er00t.htm [10]
4 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre I, "L'État, produit de contradictions de classes inconciliables".
5 Ceci est un exemple des confusions et des ambiguïtés de l'accumulation de catégories théoriques et politiques, les unes à côté des autres, introduites par Antonio Gramsci dans la doctrine marxiste, portées à leurs limites logiques et politiques par ses épigones et dont les difficultés logiques (apories) ont été brillamment investiguées par Perry Anderson dans son classique, Sur Gramsci.
6 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre I, "Détachements spéciaux d'hommes armés, prisons, etc."
7 NDLR. Extrait du Manifeste communiste, cité par Lénine dans l'État et la révolution ; Chapitre II, "La veille de la révolution".
8 NDLR. Extrait de La guerre civile en France, cité par Lénine dans l'État et la révolution ; Chapitre III, "Par quoi remplacer la machine d'État démolie ?"
9 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre IV, "Critique du projet de programme d'Erfurt".
10 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre V, "La transition du capitalisme au communisme".
11 NDLR. L'État et la révolution, Ibid.
12 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre V, "Phase supérieure de la société communiste".
13 NDLR. L'État et la révolution ; Chapitre VI, "Polémique de Kautsky avec Pannekoek".
14 NDLR. "La Bête à sept têtes est un type de monstre de légende qui se retrouve, sous des formes différentes (souvent un dragon ou un serpent à sept têtes) dans de nombreuses religions, mythologies et traditions à travers le monde. Dans plusieurs traditions, lorsqu'une tête est tranchée, elle repousse en un ou plusieurs exemplaires" (Wikipédia).
15. NDLR. "L'État dans la période de transition", Revue internationale n° 15.
16. NDLR. Idem.
Vie du CCI:
Questions théoriques:
Rubrique:
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique (IV) : de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la veille de Mai 1968
- 2887 reads
Il est bien connu que l’impérialisme français puisa généreusement de la chair à canon parmi la jeunesse de ses colonies africaines, comme l'exigeait son implication de premier plan dans la seconde boucherie mondiale. En effet, des centaines de milliers de "tirailleurs", dont une écrasante majorité de jeunes, travailleurs et sans travail, furent embrigadés et sacrifiés dans les sanglantes tueries impérialistes. Le conflit terminé, s'ouvrit une période de reconstruction de l’économie française ; ses répercussions dans la colonie se firent sentir à travers une exploitation insoutenable, contre laquelle les ouvriers se mirent courageusement à lutter.
Mutinerie de soldats réprimée dans le sang et mouvements de grève
Il y eut d’abord la révolte menée par des soldats rescapés de la grande boucherie mondiale qui se soulevèrent contre le non-paiement de leur solde. En effet, immobilisés dans le camp de Thiaroye (banlieue de Dakar) après leur retour au pays, des centaines de soldats qui, en décembre 1944, réclamaient leur pension en s’adressant au "Gouvernement provisoire" présidé par de Gaulle, ne reçurent comme seule réponse que la mitraille de la part de leur commandement. La répression fit, officiellement, 35 morts, 33 blessés et 50 arrestations. Voilà comment les ouvriers et les anciens combattants, qui avaient épaulé les "libérateurs" de la France, furent remerciés par ces derniers, lesquels comptaient d’ailleurs dans leurs rangs des "socialistes" et des "communistes", membres du gouvernement d’alors présidé par le général de Gaulle. C'est là une belle leçon d’"humanisme" et de "fraternité" de la part de la célèbre "Résistance française" vis-à-vis de ses "tirailleurs indigènes" en révolte contre le non versement de leur maigre pension.
Cependant, cette réponse sanglante de la bourgeoisie française aux revendications des mutins ne put empêcher durablement l’éclatement d’autres luttes. En fait une certaine ébullition allait se développer :
"D’abord, les enseignants, du 1er au 7 décembre 1945, les ouvriers de l’industrie, du 3 au 10 décembre, avaient lancé le mouvement. La grève reprit en janvier, toucha de nouveau les métallurgistes, mais aussi les employés de commerce et le personnel auxiliaire du Gouverneur général. Les mesures de réquisition prises par le Gouverneur provoquèrent le 14 janvier 1946, une grève générale décrétée par 27 syndicats. Le travail ne reprit que le 24 janvier pour les fonctionnaires, le 4 février pour les employés de commerce, le 8 février pour les métallurgistes".( El hadj Ibrahima Ndao, Sénégal, histoire des conquêtes démocratiques, les Nouvelles Édit. Africaines, 2003.) En dépit des terribles souffrances subies pendant la guerre, la classe ouvrière recommençait à relever la tête, exprimant ainsi sa révolte contre la misère et l’exploitation.
Mais la reprise de la combativité se faisait dans un nouvel environnement peu favorable à l’autonomie de la classe ouvrière. En effet, le prolétariat de l’AOF de l’après-guerre ne put éviter d’être pris en tenaille entre les tenants de l’idéologie panafricaniste (indépendantistes) et les forces de gauche du capital colonial (SFIO, PCF et syndicats). Mais, malgré cela, la classe ouvrière poursuivit son combat avec beaucoup de pugnacité face aux attaques du capitalisme.
Grève héroïque et victorieuse des cheminots entre octobre 1947 et mars 1948
Au cours de cette période, les cheminots de l’ensemble de l’AOF se mirent en grève pour satisfaire nombre de revendications, dont celle de l'établissement d'une catégorie unique pour l’emploi des Africains et des Européens, et contre le licenciement de 3000 employés.
"Ces travailleurs du chemin de fer étaient initialement organisés au sein de la CGT. Quelque 17 500 cheminots l’ont quittée en 1948 à la suite d’une grève très dure. Au cours de ce mouvement, un certain nombre d’employés français s’étaient opposés violemment à une amélioration de la situation du personnel africain." (Mar Fall, L’Etat et la question syndicale au Sénégal, L’Harmattan, 1989)
Cette grève des cheminots se termina victorieusement grâce à la solidarité active des autres secteurs salariés (dockers et autres employés de l’industrie) qui entrèrent en grève générale pendant 10 jours, contraignant ainsi le pouvoir colonial à satisfaire l’essentiel des revendications des grévistes. Tout se décida au cours d’un grand meeting à Dakar convoqué par le gouverneur général. Dans l’espoir de briser le mouvement, la parole fut donnée aux notables politiques et aux chefs religieux qui avaient pour mission d’endormir et d’intimider les grévistes. Et, coutume oblige, les plus zélés furent les religieux.
"Une campagne de démoralisation des grévistes et surtout de leurs femmes avait été entreprise par les "guides spirituels", les imams et les prêtres des différentes sectes. (…) Les imams, furieux de la résistance des ouvriers à leurs injonctions, se déchaînaient contre les délégués, les chargeant de tous les péchés : l’athéisme, l’alcoolisme, la prostitution, la mortalité infantile ; ils prédisaient même que ces mécréants amèneraient la fin du monde". (Ousmane Sembene, Les bouts de bois de Dieu, Pocket, 1960)
Mais rien n’y fit. Même accablés de tous les "péchés", les cheminots persistèrent et leur combativité demeura intacte. Elle se renforça même lorsqu’au cours d'une assemblée générale leur appel à la solidarité reçut un écho grandissant chez les ouvriers des autres secteurs présents qui scandèrent : "Nous, les maçons, nous sommes pour la grève !...Nous, les ouvriers du port, nous sommes pour la grève !... Nous, les métallos...Nous les…". (Ousmane Sembene, ibid)
Et effectivement, dès le lendemain, ce fut la grève générale dans pratiquement tous les secteurs. Pourtant, avant d’en arriver là, les ouvriers du rail eurent à subir non seulement la pression des notables politiques et des religieux, mais aussi, la terrible répression militaire. Des sources (O. Sembene, ibid.) indiquent qu’il y eut des morts, et la "marche des femmes" (épouses et proches des cheminots) sur Dakar, en soutien aux grévistes, fut réprimée dans le sang par les "tirailleurs" et l’encadrement colonial.
La classe ouvrière ne dut compter que sur elle-même. La CGT collecta symboliquement quelques souscriptions financières venant de Paris alors que, sur place, elle stigmatisait "ceux qui voulaient leur autonomie" en se lançant dans une "grève politique". En fait, la CGT se retranchait derrière "l'opinion" de ceux de ses adhérents européens de la colonie qui s’opposaient aux revendications des "indigènes". Aussi ce comportement de la CGT poussa les cheminots indigènes à déserter massivement la centrale stalinienne suite à ce magnifique combat de classe.
SFIO, PCF, syndicats et nationalistes africains détournent la lutte de la classe ouvrière
La grève des cheminots terminée en mars 1948 s'était déroulée dans une atmosphère de grande agitation politique au lendemain du référendum ayant donné naissance à l’"Union française".1 De ce fait, le mouvement des cheminots acquit une dimension éminemment politique, en obligeant toutes les forces politiques coloniales et les éléments indépendantistes à se positionner tactiquement pour ou contre les revendications des grévistes. On vit ainsi le PCF se cacher derrière la CGT pour saboter le mouvement de grève, alors que la SFIO au pouvoir tenta de réprimer le mouvement par tous les moyens. De leur côté, Léopold Sédar Senghor et Ahmed Sékou Touré, deux rivaux panafricanistes qui allaient devenir respectivement présidents du Sénégal et de la Guinée, se déclarèrent ouvertement pour les revendications des cheminots.
Mais dès le lendemain de la victoire des grévistes, les forces de gauche et les nationalistes africains s’affrontèrent, les uns et les autres se revendiquant de la classe ouvrière. En instrumentalisant chacun les luttes de la classe ouvrière au service de leur chapelle, ils parvinrent à détourner la lutte autonome du prolétariat de ses véritables objectifs de classe.
Ainsi, les syndicats s’emparèrent de la question du Code du travail pour empoisonner les relations entre ouvriers. En effet, à travers ce "code", la législation sociale française avait instauré dans les colonies une véritable discrimination géographique et ethnique : d’une part, entre travailleurs d’origine européenne et travailleurs d’origine africaine ; d’autre part, entre ressortissants de différentes colonies, voire même entre citoyens d’un même pays 2. Il se trouve que la SFIO (ancêtre de l'actuel Parti Socialiste), qui avait promis en 1947 l’abolition de cet inique Code du travail, tergiversa jusqu’en 1952, donnant ainsi l’occasion aux syndicats, notamment indépendantistes africains, de focaliser exclusivement les revendications des travailleurs sur cette question à travers la mise en avant systématique du slogan "égalité de droits entre blancs et noirs". Cette idée d’égalité de droits et de traitement avec les Africains suscitait l'opposition ouverte des plus rétrogrades des syndiqués d'origine européenne de la CGT ; et il faut dire que, dans cette situation, la CGT joua un rôle particulièrement ignoble dans la mesure où elle eut tendance à profiter de cette opposition pour justifier son positionnement.
D’ailleurs, en écho, des militants de la CGT d’origine africaine 3 décidèrent alors de créer leur propre syndicat en vue de défendre les "droits spécifiques" des travailleurs africains. Tout cela donna lieu à la formulation de revendications de plus en plus nationalistes et interclassistes, comme l'illustre ce passage de la doctrine de cette organisation :
"Les conceptions importées [celles du syndicalisme français métropolitain- NDLR] éclairent insuffisamment l’évolution et les tâches de progrès économique et social en Afrique, d’autant plus que, malgré les contradictions existantes entre les diverses couches sociales locales, la domination coloniale rend inopportune toute référence à la lutte des classes et permet d’éviter la dispersion des forces dans les compétitions doctrinales". (Cité par Mar Fall, ibid)
De ce fait, les syndicats purent passer à l’acte avec efficacité car, malgré la persistance d'une combativité incessante de la classe ouvrière entre 1947 et 1958, tous les mouvements de lutte pour des revendications d’ordre salarial ou d’amélioration des conditions de travail furent détournés vers la contestation de l’ordre colonial, en faveur de l’avènement de "l’indépendance". En clair, si, lors du mouvement des cheminots de 1947-48, la classe ouvrière de la colonie de l’AOF eut encore la force de diriger sa lutte sur un terrain de classe avec succès, en revanche, par la suite, les grèves furent systématiquement contrôlées et orientées vers les objectifs des forces de la bourgeoisie, syndicats et partis politiques. Ce fut précisément cette situation qui servit de tremplin à Léopold Sédar Senghor et à Ahmed Sékou Touré pour enrôler les populations et la classe ouvrière derrière leur propre lutte pour la succession de l’autorité coloniale. Et dès la proclamation de "l’indépendance" des pays de l’AOF, les dirigeants africains décidèrent aussitôt d’intégrer les syndicats dans le giron de l'État en assignant à ceux-ci un rôle de police auprès des ouvriers. Bref, un rôle de chien de garde des intérêts de la nouvelle bourgeoisie noire aux commandes. Cela est manifeste à travers ce propos du président Senghor :
"Malgré ses services, à cause de ses services, le syndicalisme doit aujourd’hui se convertir en se faisant une idée plus précise de son rôle propre et de ses tâches. Parce qu’il y a aujourd’hui des partis politiques bien organisés et qui représentent sur le plan de la politique générale l’ensemble de la Nation, le syndicalisme doit revenir à son rôle naturel qui est, avant tout, de défendre le pouvoir d’achat de ses membres (…) La conclusion de cette réflexion est que les syndicats feront leur le programme de politique générale du parti majoritaire et des gouvernements". (Fall, ibid.)
En un mot, les syndicats et les partis politiques doivent partager le même programme en vue de la défense des intérêts de la nouvelle classe dominante. Un dirigeant syndical, David Soumah, fait écho aux propos de Senghor :
"Notre mot d’ordre durant cette lutte (anticoloniale) était que les syndicats n’avaient pas de responsabilités dans la production, qu’ils n’avaient pas à se préoccuper des répercussions de leurs revendications sur la marche d’une économie conçue dans le seul intérêt de la puissance coloniale et organisée par elle en vue de l’expansion de son économe nationale. Cette position devient sans objet au fur et à mesure de l’accession des pays africains à l’indépendance nationale et une reconversion syndicale s’impose". (Fall, ibid.)
Par conséquent, durant la première décennie de "l’indépendance", le prolétariat de l'ancienne AOF resta sans véritable réaction de classe, complètement ligoté par la nouvelle classe dirigeante assistée par les syndicats dans sa politique antiouvrière. Il fallut attendre 1968 pour la voir ressurgir sur son terrain de classe prolétarien contre sa propre bourgeoisie.
Lassou (A suivre)
1. Une "fédération" entre la France et ses colonies dont le but était d’encadrer les "indépendances" en vue.
2. Par exemple, les Sénégalais résidents des communes de Gorée, Rufisque, Dakar et Saint-Louis étaient considérés comme "citoyens français", ce qui n’était pas le cas des autres Sénégalais du pays.
3. Cela aboutit à la création de l’UGTAN (Union générale des travailleurs d’Afrique noire), syndicat par ailleurs dominé par la corporation des cheminots.
Géographique:
- Afrique [13]
Critique du livre "Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme" (introduction)
- 2531 reads
Au moment où l'humanité connaît une accélération tragique de la crise économique mondiale, nous avons décidé de revenir à travers cet article sur des questions fondamentales se posant à quiconque est désireux de comprendre la dynamique de la société capitaliste pour mieux combattre un système condamné à périr soit de ses propres contradictions, soit par son renversement en vue de l'instauration d'une nouvelle société. Ces questions ont déjà été largement traitées dans de nombreuses publications du CCI mais si, aujourd'hui, nous jugeons nécessaire de les aborder à nouveau, c'est en critique à la vision développée dans le livre Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme 1. Ce livre se réclame explicitement, citations à l'appui, des analyses de Marx concernant la caractérisation des contradictions et de la dynamique du capitalisme, notamment le fait que ce système, à l'instar des autres sociétés de classe qui l'ont précédé, est nécessairement appelé à connaître successivement une phase ascendante et une phase de déclin. Mais la manière dont ce cadre théorique d'analyse est parfois interprété et appliqué à la réalité n'est pas sans ouvrir la porte à l'idée que des réformes seraient possibles au sein du capitalisme qui permettraient d'atténuer la crise. Par opposition à cette démarche que nous critiquons, l'article qui suit se veut une défense argumentée du caractère insurmontable des contradictions du capitalisme.
Dans la première partie de cet article ("Le capitalisme freine-t-il la croissance des forces productives depuis la Première Guerre mondiale ? [14]"), nous examinons si, depuis la Première Guerre mondiale, le capitalisme ayant cessé d'être un système progressiste, il est devenu, selon les propres paroles de Marx, "un obstacle pour l'expansion des forces productives du travail" 2. En d'autres termes, les rapports de production propres à ce système, après avoir été un formidable facteur de développement des forces productives, ont-ils constitué, depuis 1914, un frein au développement de ces mêmes forces productives ? Dans une seconde partie ("Existe-t-il une solution à la crise au sein du capitalisme ? [15]"), nous analysons l'origine des crises de surproduction, insurmontables au sein du capitalisme, et démasquons la mystification réformiste d'une possible atténuation de la crise du capitalisme au moyen de "politiques sociales".
1 Marcel Roelandts. Éditions Contradictions. Bruxelles, 2010.
2 Principes d'une critique de l'économie politique – p. 272. Éd. La Pléiade Économie II.
Questions théoriques:
- L'économie [16]
Critique du livre "Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme" : le capitalisme est-il un mode de production décadent et pourquoi ? (I)
- 3255 reads
Le capitalisme freine-t-il la croissance des forces productives depuis la Première Guerre mondiale ?
En déchaînant la Première Guerre mondiale, les forces aveugles du capitalisme avaient été la cause d'une destruction considérable de forces productives, sans commune mesure avec les crises économiques qui avaient émaillé la croissance du capitalisme depuis sa naissance. Elles avaient plongé le monde, en particulier l'Europe, dans une barbarie menaçant d'engloutir la civilisation. Cette situation provoqua, en réaction, une vague révolutionnaire mondiale se donnant pour objectif d'en finir avec la domination d'un système dont les contradictions constituaient désormais une menace pour l'humanité. La position défendue à l'époque par l'avant-garde du prolétariat mondial s'inscrivait dans la vision de Marx pour qui "C'est par des conflits aigus, des crises, des convulsions que se traduit l'incompatibilité croissante entre le développement créateur de la société et les rapports de production établis"[1]. La Lettre d'invitation (fin janvier 1919) au Congrès de fondation de l'Internationale communiste déclare : "La période actuelle est celle de la décomposition et de l'effondrement de tout le système capitaliste mondial, et sera celle de l'effondrement de la civilisation européenne en général, si le capitalisme, avec ses contradictions insurmontables, n'est pas abattu."[2]. Sa plate-forme souligne : "Une nouvelle époque est née : l'époque de la désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. L'époque de la révolution communiste du prolétariat."[3]
L'auteur du livre (Marcel Roelandts, identifié MR dans la suite de l'article) rejoint cette caractérisation quant à la signification de la Première Guerre mondiale et de la vague révolutionnaire internationale qui l'a suivie, souvent d'ailleurs avec les mêmes termes. Son analyse recoupe en partie les éléments suivants relatifs à l'évolution du capitalisme depuis 1914 et qui, pour nous, viennent confirmer ce diagnostic de décadence du capitalisme :
- La Première Guerre mondiale (20 millions de morts) eut pour conséquence une baisse de plus d'un tiers de la production des puissances européennes impliquées dans le conflit, phénomène d'une ampleur alors sans égale dans toute l'histoire du capitalisme ;
- Elle fut suivie par une phase de faible croissance économique débouchant sur la crise de 1929 et la dépression des années 1930. Cette dernière a entraîné une chute de la production supérieure à celle causée par la Première Guerre mondiale ;
- La Seconde Guerre mondiale, encore plus destructrice et barbare que la première (plus de 50 millions de morts), a provoqué un désastre sans comparaison possible avec la crise de 1929. Elle est venue confirmer tragiquement l'alternative posée par les révolutionnaires lors de la Première Guerre mondiale : socialisme ou barbarie.
- Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu un seul instant de paix dans le monde et des centaines de guerres se sont soldées, depuis lors, par des dizaines de millions de tués, sans compter les catastrophes humanitaires (famines) qui en ont résulté. La guerre, omniprésente dans de nombreuses régions du monde, avait néanmoins épargné pendant un demi-siècle l'Europe, le principal théâtre des deux guerres mondiales. Elle y fit un retour sanglant avec le conflit en Yougoslavie à partir de1991 ;
- Durant cette période, à l'exception de la phase de prospérité des années 1950 / 60, le capitalisme, tout en maintenant une certaine croissance, n'a pu s'éviter des récessions nécessitant, pour être surmontées, l'injection dans l'économie de doses de plus en plus massives de crédit ; ce qui signifie que le maintien de cette croissance n'a pu être obtenu qu'en hypothéquant le futur au moyen d'une dette finalement impossible à rembourser ;
- L'accumulation d'une dette colossale est devenue à partir de 2007 / 2008 un obstacle incontournable au maintien de la croissance durable, même la plus faible, et a fragilisé considérablement ou menacé de faillite, non plus seulement des entreprises, des banques mais également des États, mettant à l'ordre du jour de l'histoire une récession désormais sans fin.
Nous nous sommes volontairement limités, dans cet aperçu, aux éléments les plus saillants relatifs à la crise et à la guerre et qui confèrent au 20ème siècle sa qualité de siècle le plus barbare que l'humanité ait jamais connu. Même s'ils n'en sont pas le produit mécanique, on ne peut dissocier ces éléments de la dynamique économique même du capitalisme durant cette période.
Avec quelle méthode évaluer la production capitaliste et sa croissance ?
Pour MR, ce tableau de la vie de la société depuis la Première Guerre mondiale ne suffit pas pour confirmer le diagnostic de décadence. Pour lui, "si certains arguments fondant ce diagnostic d'obsolescence du capitalisme peuvent encore se défendre, force est de reconnaître qu'il en existe d'autres [depuis la fin des années 1950] venant infirmer ses fondements les plus essentiels". Il s'appuie sur Marx pour qui il ne peut y avoir décadence du capitalisme que si "le système capitaliste devient un obstacle pour l'expansion des forces productives du travail". Ainsi, selon MR, l'examen des données quantitatives ne permet raisonnablement pas de "soutenir que le système capitaliste freine les forces productives" ni "qu'il démontre son obsolescence aux yeux de l'humanité". De même, dit-il, "en comparant avec la période de plus forte croissance du capitalisme avant la Première Guerre mondiale, le développement depuis lors (1914-2008) est encore nettement supérieur" (Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, noté Dyn dans la suite de l'article ; pp. 56 et 57).
Les données empiriques doivent nécessairement être prises en compte. Mais cela ne saurait évidemment suffire. Il faut une méthode pour les analyser. En effet, face à elles, nous ne pouvons nous contenter d'un regard comptable, mais devons aller au-delà des chiffres bruts de la production et examiner attentivement de quoi la production et la croissance sont faites, de manière à identifier l'existence éventuelle de freins au développement des forces productives. Ce n'est pas le point de vue de MR pour qui "ceux qui ont maintenu le diagnostic d'obsolescence n'ont pu le faire qu'en évitant de se confronter à la réalité ou en usant d'expédients pour tenter de l'expliquer : recours au crédit, dépenses militaires et frais improductifs, existence d'un supposé marché de la décolonisation, recours à l'argument de soi-disant trucages statistiques ou de mystérieuses manipulations de la loi de la valeur, etc. En effet, rares sont les marxistes qui ont apporté une explication claire et cohérente à la croissance des Trente Glorieuses et qui sont parvenus à discuter sans a priori de certaines réalités en contradiction flagrante avec le diagnostic d'obsolescence du capitalisme". (Dyn p. 63). Nous imaginons que MR est de l'avis que lui-même appartient à la catégorie des "rares marxistes [parvenant] à discuter sans a priori" et que, de ce fait, c'est avec le plus grand empressement qu'il se saisira de la question suivante que nous lui posons, puisqu'elle ne trouve nulle trace de réponse dans son livre : en quoi le fait d'invoquer les "frais improductifs" constitue-t-il un "expédient" pour tenter d'expliquer la nature de la croissance en phase de décadence ?
En fait, comprendre de quoi est faite la production capitaliste correspond tout à fait aux nécessités de la méthode marxiste dans sa critique du capitalisme. Celle-ci a su voir en quoi ce système, grâce à l'organisation sociale de la production qui lui est propre, a été capable de faire faire un bond énorme à l'humanité en développant les forces productives à un niveau tel qu'une société basée sur la libre satisfaction des besoin humains devient une possibilité, une fois le capitalisme renversé. Peut-on dire que le développement des forces productives depuis la Première Guerre mondiale, et le prix à payer pour celui-ci par la société et la planète, ont constitué une condition nécessaire de l'éclosion de la révolution victorieuse ? En d'autres termes, le capitalisme a-t-il continué à constituer, depuis 1914, un système progressiste, favorisant les conditions matérielles de la révolution et du communisme ?
Les données quantitatives de la croissance
Le Graphique 1[4] représente (en traits continus horizontaux), sur différentes périodes depuis 1820 jusqu'à 1999, le taux moyen annuel de croissance. Il fait apparaître également les écarts significatifs du taux de croissance, au-dessus et au-dessous de ces chiffres moyens.
Les taux moyens annuels de croissance du Graphique 1 sont repris sous forme du Tableau 1 concernant la période 1820-1999. Pour compléter ce tableau, nous avons nous-mêmes estimé le taux moyen annuel de croissance sur la période 1999-2009 en utilisant une série statistique relative à cette période[5] et en nous basant sur une croissance négative mondiale de 0,5% en 2009[6].
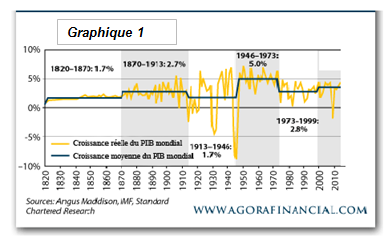
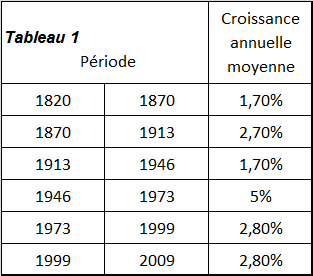
À partir des données présentées ci-dessus, un certain nombre de constats élémentaires peuvent être faits et commentés brièvement :
- Les quatre creux les plus importants de l'activité économique interviennent tous depuis 1914 et correspondent aux deux guerres mondiales, à la crise de 1929 et à la récession de 2009.
- La période la plus faste de la vie du capitalisme avant la Première Guerre mondiale est celle qui va de 1870 à 1913. Cela tient au fait qu'elle est la plus représentative d'un mode de production complètement dégagé des rapports de production hérités de la féodalité et disposant, suite à la poussée impérialiste des conquêtes coloniales[7], d'un marché mondial dont les limites ne se faisaient pas encore sentir. De surcroît, et comme conséquence de cette situation, la vente d'une quantité importante de marchandises pouvait compenser la tendance à la baisse du taux de profit et permettre de dégager une masse de profit largement suffisante à la poursuite de l'accumulation. C'est aussi cette période qui clôt la phase d'ascendance, l'entrée en décadence survenant au faîte de la prospérité capitaliste lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale.
- La période qui fait suite à la Première Guerre mondiale et s'étend jusqu'à la fin des années 1940 vient pleinement confirmer le diagnostic de décadence. En ce sens, nous partageons l'appréciation de MR selon laquelle les caractéristiques de la période 1914 – 1945, et même au-delà, jusqu'à la fin des années 1940, correspondent en tout point à la description que le mouvement révolutionnaire en 1919, dans la continuité de Marx, avait faite de la phase de décadence du capitalisme ouverte avec fracas par la guerre mondiale.
- La période des Trente Glorieuses, qui approximativement recouvre celle allant de 1946 à 1973, avec des taux de croissance bien supérieurs à ceux de 1870 - 1913, contraste énormément avec la période précédente.
- La période suivante, jusqu'à 2009, présente des taux de croissance légèrement supérieurs à la phase la plus faste de l'ascendance du capitalisme.
Les Trente Glorieuses remettent-elles en cause le diagnostic de décadence ? La période suivante confirme-t-elle qu'elles n'auraient pas constitué une exception ?
Le niveau de l'activité économique de chacune de ces deux périodes trouve des explications dans les modifications qualitatives de la production intervenues depuis 1914, en particulier avec le gonflement des dépenses improductives, dans la manière dont le crédit a été utilisé depuis les années 1950 et, également, avec la création de valeur fictive à travers ce qui est appelé la financiarisation de l'économie.
Les dépenses improductives
Qu'entend-on par dépenses improductives ?
Nous rangeons dans la catégorie des dépenses improductives le coût de cette partie de la production dont la valeur d'usage ne permet pas qu'elle puisse être employée, de quelque manière que ce soit, dans la reproduction simple ou élargie du capital. L'exemple le plus parlant de dépense improductive est celui relatif à la production d'armements. Les armes peuvent servir à faire la guerre mais pas à produire quoi que ce soit, pas même d'autres armes. Les dépenses de luxe destinées essentiellement à agrémenter la vie de la bourgeoisie entrent également dans cette catégorie. Marx en parlait en ces termes péjoratifs : "Une grande partie du produit annuel est consommée comme revenu et ne retourne pas à la production comme moyen de production ; il s'agit de produits (valeurs d'usage) extrêmement nuisibles, qui ne font qu'assouvir les passions, lubies, etc. les plus misérables"[8].
Le renforcement de l'appareil étatique
Entrent également dans cette catégorie toutes les dépenses prises en charge par l'État et qui sont destinées à faire face aux contradictions croissantes qu'affronte le capitalisme sur les plans économique, impérialiste et social. Ainsi, à côté des dépenses d'armements on trouve également le coût de l'entretien de l'appareil répressif et judiciaire, de même que celui de l'encadrement de la classe ouvrière (syndicats). Il est difficile d'estimer la part des dépenses de l'État qui appartiennent à la catégorie des dépenses improductives. En effet, un poste comme l'éducation qui, a priori, est nécessaire au maintien et au développement de la productivité du travail (laquelle nécessite une main d'œuvre éduquée) comporte aussi une dimension improductive notamment comme moyen de masquer et rendre plus supportable le chômage à la jeunesse. D'une manière générale, comme le met d'ailleurs fort bien en évidence MR, "Le renforcement de l'appareil étatique, ainsi que son intervention croissante au sein de la société ont constitué l'une des manifestations les plus évidentes d'une phase d'obsolescence d'un mode de production (…) Oscillant autour de 10 % tout au long de la phase ascendante du capitalisme, la part de l'État dans les pays de l'OCDE grimpe progressivement depuis la Première Guerre mondiale pour avoisiner les 50% en 1995, avec une fourchette basse autour de 35% pour les États-Unis et le Japon, et une haute de 60 à 70% pour les pays nordiques" (Dyn pp. 48 et 49).
Parmi ces dépenses, le coût du militarisme surpasse largement les 10% du budget militaire atteint en certaines circonstances par certains des pays les plus industrialisés, puisqu'à la fabrication de l'armement il faut ajouter le coût des différentes guerres. Le poids croissant du militarisme[9] depuis la Première Guerre mondiale n'est évidemment pas un phénomène indépendant de la vie de la société mais constitue bien l'expression du haut niveau des contradictions économiques qui contraignent chaque puissance à s'engager toujours davantage dans la fuite en avant dans les préparatifs guerriers, en tant que condition de sa survie dans l'arène mondiale.
Le poids des dépenses improductives dans l'économie
Le pourcentage des dépenses improductives, qui dépasse très certainement les 20% du PIB, ne correspond, dans la réalité, qu'à la stérilisation d'une partie importante de la richesse créée qui ne peut ainsi être employée à la création d'une plus grande richesse, ce qui est fondamentalement contraire à l'essence du capitalisme. Nous avons ici la claire manifestation d'un freinage au développement des forces productives qui trouve son origine dans les rapports de production eux-mêmes.
A ces dépenses improductives, il convient d'en ajouter un autre type, celui des trafics en tous genres, la drogue en particulier, qui constitue une consommation improductive mais qui, cependant, est comptabilisée en partie dans le PIB. Ainsi, le blanchiment des revenus du commerce de cette activité illicite représente quelques pourcents du PIB mondial :"Les trafiquants de drogue auraient blanchi environ 1600 milliards de dollars, soit 2,7% du PIB mondial, en 2009, (…) selon un nouveau rapport publié mardi par l’Office de l’ONU contre la drogue et le crime (ONUDC) (…) Le rapport de l’ONUDC indique que tous les bénéfices de la criminalité, à l’exclusion d’évasions fiscales, s’élèveraient à environ 2100 milliards de dollars, ou 3,6% du PIB en 2009"[10].
Pour rétablir la vérité concernant la croissance réelle, ce sont environ 3,5% supplémentaires du montant du PIB qui devraient lui être amputés du fait du blanchiment de l'argent des différents trafics.
Le rôle des dépenses improductives dans le miracle des Trente Glorieuses
Les mesures keynésiennes, visant à stimuler la demande finale et ayant ainsi permis que les problèmes de surproduction ne se manifestent pas ouvertement durant toute une partie de la période des Trente Glorieuses, sont en grande partie des dépenses improductives dont le coût a été pris en charge par l'État. Parmi celles-ci figurent les hausses de salaires, au-delà de ce qui est socialement nécessaire à la reproduction de la force de travail. Le secret de la prospérité de la période des Trente Glorieuses se résume à un énorme gaspillage de plus-value qui a pu alors être supporté par l'économie grâce aux gains importants de productivité enregistrés durant cette période.
Le miracle des Trente Glorieuses a donc, dans des conditions favorables, été permis par une politique de la bourgeoisie qui, instruite par la crise de 1929 et la dépression des années 1930, s'est appliquée à retarder le retour ouvert de la crise de surproduction. En ce sens, cet épisode de la vie du capitalisme correspond bien à ce qu'en dit MR : "La période exceptionnelle de prospérité d'après-guerre apparaît en tous points analogue aux parenthèses de reprise durant les périodes d'obsolescence antique et féodale. Nous faisons donc nôtre l'hypothèse que les Trente Glorieuses ne constituent qu'une parenthèse dans le cours d'un mode de production qui a épuisé sa mission historique." (Dyn p. 65).
Des mesures keynésiennes seraient-elles à nouveau envisageables ? On ne peut exclure que des avancées scientifiques et technologiques viennent à nouveau permettre des gains de productivité importants et la réduction des coûts de production des marchandises. Il continuerait néanmoins de se poser la question d'un acquéreur pour celles-ci vu qu'il n'existe plus de marché extra-capitaliste et guère plus de possibilité d'augmenter la demande au moyen d'un endettement supplémentaire. Dans ces conditions la répétition du boom des Trente Glorieuses apparaît totalement irréaliste.
La financiarisation de l'économie
Nous reproduisons ici le sens le plus communément admis de ce terme : "La financiarisation est au sens strict le recours au financement et en particulier à l'endettement, de la part des agents économiques. On appelle par ailleurs financiarisation de l'économie la part croissante des activités financières (services de banque, d'assurance et de placements) dans le PIB des pays développés notamment. Elle provient d'une multiplication exponentielle des types d'actifs financiers et du développement de la pratique des opérations financières, tant par les entreprises et autres institutions que par les particuliers. On peut parler par ailleurs d'un essor du capital financier à distinguer de la notion plus étroite de capital centrée sur les équipements de production"[11]. Nous nous distinguons nettement des altermondialistes, et de la gauche du capital en général, pour qui la financiarisation de l'économie serait à l'origine de la crise que traverse actuellement le capitalisme. Nous avons largement développé dans notre presse en quoi c'est exactement l'inverse dont il s'agit[12]. En effet, c'est parce que l'économie "réelle" est plongée depuis des décennies dans un profond marasme que les capitaux tendent à se détourner de cette sphère qui est de moins en moins rentable. MR semble partager notre point de vue. Ceci étant dit, il ne semble pas intéressé à prendre en compte les implications significatives de ce phénomène pour la composition des PIB.
Les États-Unis sont certainement le pays où l'activité financière a connu le développement le plus important. Ainsi, en 2007, 40% des profits du secteur privé aux États-Unis ont été réalisés par les banques, qui n'emploient que 5% des salariés[13]. Le Tableau 2 détaille, pour les États-Unis et l'Europe, le poids pris par les activités financières[14] (l'évolution parallèle de la production industrielle aux États-Unis sur la même période n'a été donnée qu'à titre indicatif) :
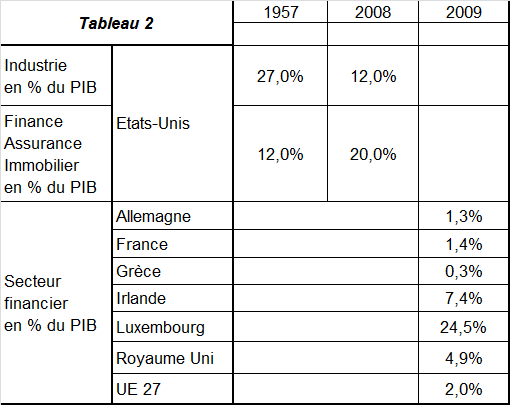
Contrairement aux dépenses improductives, nous n'avons pas ici affaire à une stérilisation de capital, mais dans le même sens que celles-ci, le développement de la finance induit un gonflement artificiel de l'estimation de la richesse annuelle de certains pays, dans une fourchette qui va de 2% pour l'Union Européenne à 27% pour les États-Unis. En effet, la création de produits financiers ne s'accompagne pas de la création d'une richesse réelle, si bien que, en toute objectivité, sa contribution à la richesse nationale est nulle.
Si l'on expurgeait du PIB l'activité correspondant à la financiarisation de l'économie, l'ensemble des principaux pays industrialisés verrait leur PIB diminué d'un pourcentage variant entre 2% et 20%. Une moyenne de 10% parait acceptable compte-tenu du poids respectif de l'UE et des États-Unis.
Le recours croissant à l'endettement depuis les années 1950
De notre point de vue, se priver de prendre en compte l'endettement croissant qui accompagne le développement du capitalisme depuis les années 1950 relève des mêmes préjugés qui consistent à écarter l'analyse qualitative de la croissance.
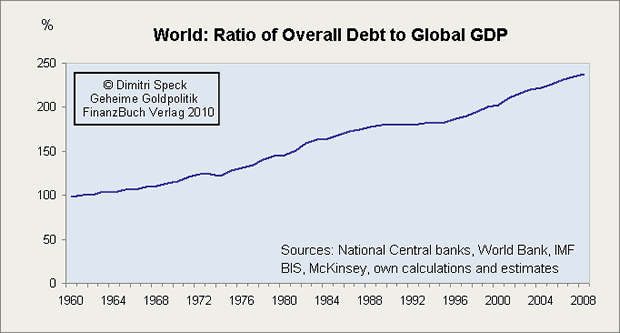
Peut-on nier sa réalité ? Le Graphique 2 illustre la progression de l'endettement total mondial (relativement à celle du PIB) depuis les années 1960. Durant cette période, l'endettement augmente plus rapidement que la croissance économique.
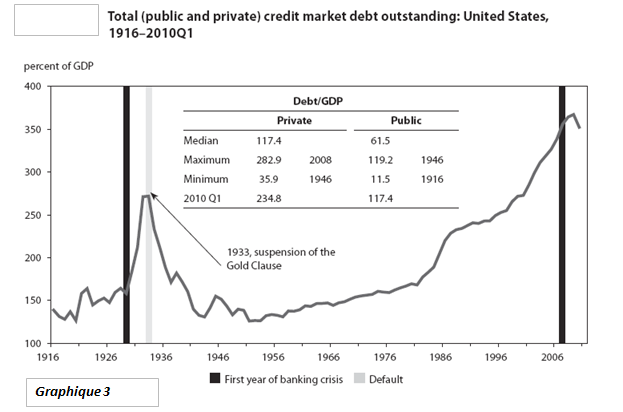 Aux États-Unis (Graphique 3[15]), l'endettement repart à la hausse au début des années 1950. Il passe d'une valeur inférieure à 1,5 fois le PIB à cette époque pour être aujourd'hui supérieur à 3,5 fois le PIB. Avant 1950, il avait connu, du fait de l'endettement privé, un pic en 1933 pour décroître ensuite. A noter que le pic de 1946 de l'endettement public (à un moment où l'endettement privé est faible) est l'aboutissement d'une montée d'abord relativement faible des dépenses publiques pour financer le New Deal, lesquelles se sont accrues très fortement à partir de 1940 pour financer l'effort de guerre.
Aux États-Unis (Graphique 3[15]), l'endettement repart à la hausse au début des années 1950. Il passe d'une valeur inférieure à 1,5 fois le PIB à cette époque pour être aujourd'hui supérieur à 3,5 fois le PIB. Avant 1950, il avait connu, du fait de l'endettement privé, un pic en 1933 pour décroître ensuite. A noter que le pic de 1946 de l'endettement public (à un moment où l'endettement privé est faible) est l'aboutissement d'une montée d'abord relativement faible des dépenses publiques pour financer le New Deal, lesquelles se sont accrues très fortement à partir de 1940 pour financer l'effort de guerre.
Depuis les années 1950-60, l'endettement a constitué la "demande solvable" qui a permis à l'économie de croître. Il s'agit d'un endettement croissant qui, pour l'essentiel, était condamné à ne pouvoir être remboursé, comme en témoigne la situation actuelle de surendettement de tous les acteurs économiques dans tous les pays. Une telle situation, en mettant à l'ordre du jour la faillite d'acteurs économiques majeurs, dont des États, signe la fin de la croissance au moyen d'un accroissement de la dette. Autant dire que cela signifie la fin de la croissance tout court, en dehors de phases limitées dans le temps au sein d'un cours général à la dépression. Il est indispensable de prendre en compte, dans nos analyses, le fait que la réalité va infliger une correction brutale à la baisse des taux de croissance depuis les années 1960. Ce ne sera que le retour de bâton d'une énorme tricherie avec la loi de la valeur. MR rejette l'expression "tricherie avec la loi de la valeur" pour qualifier cette pratique au sein du capitalisme mondial. Elle est pourtant de la même nature que les mesures de protectionnisme qui avaient été prises en URSS afin de maintenir artificiellement en vie une économie très peu performante par rapport à celle des principaux pays du bloc occidental. L'effondrement du bloc de l'Est vint rétablir la vérité. MR devra-t-il attendre l'effondrement de l'économie mondiale pour se rendre compte des conséquences de l'existence d'une masse de dettes non remboursables ?
En toute rigueur, afin de pouvoir juger objectivement de la croissance réelle depuis les années 1960, il faudrait amputer l'augmentation officielle du PIB entre 1960 et 2010 du montant de l'accroissement de la dette durant la même période. En fait, comme le montre le Graphique 2, l'augmentation du PIB mondial a été moins importante que l'accroissement de la dette mondiale sur la période concernée. Si bien que cette période importante des Trente Glorieuses, non seulement n'a pas été génératrice de richesse, mais a participé de créer un déficit mondial qui réduit à néant le miracle des Trente Glorieuses.
L'évolution des conditions de vie de la classe ouvrière
Durant toute la période d'ascendance du capitalisme, la classe ouvrière avait pu arracher des réformes durables sur le plan économique concernant la réduction du temps de travail et l'augmentation des salaires. Celles-ci résultaient à la fois de la lutte revendicative et de la capacité du système de les accorder, en particulier grâce à des gains de productivité importants. Cette situation change avec l'entrée du capitalisme en décadence où, sauf en ce qui concerne la période des Trente Glorieuses, les gains de productivité se trouvent de plus en plus mis au service de la mobilisation de chaque bourgeoisie nationale contre les contradictions qui se manifestent sur tous les plans (économique, militaire et social) et se traduisent, comme on l'a vu, par le renforcement de l'appareil étatique.
Les augmentations de salaires depuis la Première Guerre mondiale ne sont plus, en général, que des rattrapages de la hausse constante du niveau des prix. Les augmentations accordées en France en juin 1936 (accords de Matignon : 12% en moyenne) étaient annulées en six mois puisque, rien que de septembre 1936 à janvier 1937, les prix avaient monté en moyenne de 11%. On sait également ce qui resta un an plus tard des augmentations obtenues en mai 1968 avec les accords de Grenelle.
Sur cette question, MR s'exprime en ces termes : "De même, le mouvement communiste a défendu l'idée que des réformes réelles et durables sur le plan social étaient désormais impossibles à obtenir après la Première Guerre mondiale. Or, si l'on examine l'évolution séculaire des salaires réels et du temps de travail, non seulement rien ne vient attester une telle conclusion, mais les données indiquent le contraire. Ainsi, si les salaires réels dans les pays développés ont, au grand maximum, doublé ou triplé avant 1914, ils ont été multipliés par six à sept ensuite : soit trois à quatre fois mieux durant la période de 'décadence' du capitalisme que durant son ascendance" (Dyn p. 57).
Il est assez difficile de discuter de cette analyse, vu que ce sont des ordres de grandeur très approximatifs qui sont fournis. On peut très bien comprendre qu'il soit difficile de faire mieux compte tenu du matériel disponible sur cette question, mais le minimum de la rigueur scientifique était de citer les sources à partir desquelles des extrapolations éventuelles ont été effectuées. De plus, on nous parle des augmentations de salaires en ascendance et en décadence du capitalisme sans indiquer les périodes auxquelles elles s’appliquent. Il est aisé de comprendre qu'une augmentation sur 30 ans ne peut être comparée à une augmentation sur 100 ans (sauf si celles-ci sont données sous la forme d'augmentations moyennes annuelles, ce qui n'est manifestement pas le cas). Mais, de plus, la connaissance de la période est importante pour que la comparaison puisse intégrer d'autres données de la vie de la société, primordiales à notre sens pour relativiser la réalité des hausses de salaires. Il en est ainsi en particulier de l'évolution du chômage. Une augmentation du salaire concomitante à celle du chômage peut très bien avoir pour conséquence une baisse du niveau de vie des ouvriers.
Dans le livre, à la suite du passage que nous venons de commenter, est publié un graphique dont le titre annonce qu'il concerne à la fois l'augmentation des salaires réels en Grande-Bretagne de 1750 à 1910 et celle d'un manœuvre en France de 1840 à 1974. Mais, manque de chance, les données relatives au manœuvre français sont absentes pour la période s'étendant entre 1840 et 1900 et illisibles concernant la période 1950 - 1980. Plus exploitables sont les informations relatives à la Grande-Bretagne. De 1860 à 1900, il semblerait que le salaire réel y ait augmenté de 60 à 100, ce qui correspond à une augmentation annuelle de 1,29% sur la période. Nous retenons ce dernier chiffre comme pouvant être indicatif de l'augmentation des salaires en période d'ascendance.
Pour l'examen des salaires en décadence, nous procéderons à la division de cette période en deux sous périodes :
- de 1914 à 1950, période pour laquelle nous ne disposons pas de séries statistiques mais de chiffres épars et hétérogènes, significatifs toutefois d'un niveau de vie affecté par les deux guerres mondiales et la crise de 29 ;
- la période suivante, qui court jusqu'à nos jours, pour laquelle nous disposons de davantage de données fiables et homogènes.
1) 1914-1950[16]:
Pour les pays européens, la Première Guerre mondiale est synonyme d'inflation et de pénurie de marchandises. Après celle-ci, les deux camps se trouvent face à la nécessité de rembourser une dette colossale (trois fois supérieure au revenu national d'avant-guerre dans le cas de l'Allemagne) ayant servi à financer l'effort de guerre. La bourgeoisie la fera payer à la classe ouvrière et à la petite bourgeoisie à travers l'inflation qui, en même temps qu'elle réduit la valeur de la dette, opère une diminution drastique des revenus et a pour effet que l'épargne s'envole en fumée. En Allemagne en particulier, de 1919 à 1923, l'ouvrier voit son revenu diminuer sans arrêt, avec des salaires très inférieurs à ceux d'avant-guerre. C'est le cas aussi en France, et dans une moindre mesure en Angleterre. Cependant, toute la période de l'entre-deux-guerres se caractérisera pour ce pays par un chômage permanent immobilisant des millions de travailleurs, phénomène inconnu jusque-là dans l'histoire du capitalisme tant anglais que mondial. En Allemagne, y compris lorsque se termine la période de forte inflation, vers 1924, et jusqu'à la crise de 1929, le nombre des chômeurs reste toujours largement supérieur à 1 million (2 millions en 1926).
Contrairement à l'Allemagne, mais comme la France, la Grande-Bretagne n'avait pas encore retrouvé en 1929 sa position de 1913.
Tout autre est la dynamique des États-Unis. Avant la guerre, le développement de l'industrie américaine suivait un rythme plus rapide que celui de l'Europe. Cette tendance allait se renforcer pendant toute la période qui va de la fin de la guerre jusqu'au commencement de la crise économique mondiale. Ainsi, les États-Unis traversent la Première Guerre mondiale et la période qui s'ensuit dans la prospérité, jusqu'à la crise ouverte de 1929. Mais cette dernière a pour effet de ramener le salaire réel de l'ouvrier américain à un niveau inférieur à celui de 1890 (il ne représente plus alors que 87% de celui-ci), l'évolution pour cette période étant celle présentée dans le Tableau 3[17] :
2) de 1951 à nos jours (en comparaison à 1880 – 1910)
Nous disposons des statistiques du Tableau 4 concernant l'évolution des salaires de l'ouvrier français :
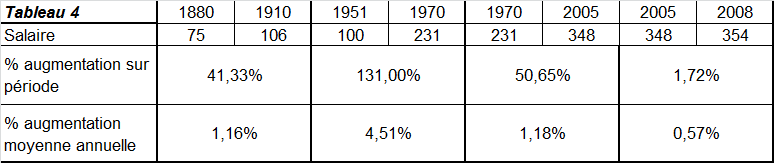
- exprimée en francs sur la période 1880 - 1910[18]
- exprimée sur une base 100 en 1951 sur la période 1951 – 2008[19]
Le Tableau 4 fait apparaître les réalités suivantes :
- La période 1951 – 1970, au cœur des Trente Glorieuses, connaît les taux d'augmentation de salaires les plus importants de l'histoire du capitalisme, ce qui est cohérent avec la phase de croissance économique qui lui correspond et ses particularités, à savoir les mesures keynésiennes de soutien de la demande finale au moyen, entre autres, de l'augmentation des salaires.
De tels taux de croissance des salaires s'expliquent aussi par d'autres facteurs loin d'être secondaires :
- le niveau de vie en France en 1950 était très bas, ce qui va de pair avec le fait que c'est seulement en 1949 que fut aboli le système des cartes et tickets de rationnement mis en place en 1941 pour faire face à la pénurie relative à la période de guerre.
- Depuis les années 1950, le coût de la reproduction de la force de travail doit inclure un certain nombre de frais qui n'existaient pas auparavant de façon aussi importante : les exigences de technicité accrue d'un nombre important d'emplois impliquent que les enfants de la classe ouvrière sont scolarisés jusqu'à un âge plus élevé, en restant à la charge de leurs parents ; les conditions "modernes" de travail dans les grandes villes ont également un coût. Si des objets ménagers entourent le prolétaire moderne alors que ce n'était pas le cas au 19e siècle, ce n'est pas le signe d'un meilleur niveau de vie de ce premier, son exploitation relative n'ayant fait que croître. Beaucoup de ces "objets ménagers" n'existaient pas auparavant : chez les bourgeois, c'étaient les domestiques qui faisaient tout à la main. Ils sont devenus indispensables dans les foyers ouvriers, pour gagner du temps, alors que souvent ce sont l'homme et la femme qui doivent travailler pour faire vivre la famille. De même, l'automobile, lorsqu'elle est apparue, était un luxe réservé aux riches. Celle-ci est devenue un objet incontournable pour beaucoup de prolétaires, afin de pouvoir se rendre sur le lieu de travail autrement qu'en passant des heures dans des transports publics insuffisants. C'est l'élévation de la productivité du travail qui a permis de produire de tels objets, qui ont cessé d'être de luxe, à un coût compatible avec le niveau des salaires ouvriers.
- b) La période suivante, 1970 – 2005, connaît des taux d'augmentation de salaires sensiblement égaux à ceux de l'ascendance du capitalisme (1,18% contre 1,16% - pour mémoire l'augmentation est de 1,29% en Grande-Bretagne sur la période 1860 - 1900). Ceci dit, un certain nombre de facteurs sont à prendre en compte qui fait apparaître qu'en réalité les conditions de vie de la classe ouvrière ne se sont pas améliorées dans les mêmes proportions, et se sont même dégradées par rapport à la période précédente :
- Cette période correspond à une montée importante du chômage qui affecte lourdement le niveau de vie des foyers ouvriers. Pour la France, nous disposons des chiffres du chômage présentés dans le Tableau 5[20]:
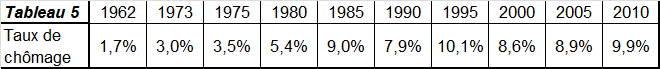
- A partir des années 1980, des directives visant à faire diminuer les chiffres officiels du chômage ont nécessité la modification de la méthode de décompte des chômeurs (par exemple, en ne comptabilisant pas le chômage partiel) et ont aussi abouti à la radiation de chômeurs sur des critères de plus en plus sévères. C'est fondamentalement ce qui explique la moindre envolée du chômage par la suite.
- La période postérieure à 1985 voit se développer la précarisation du travail avec des contrats à durée déterminée et le travail à temps partiel, qui n'est autre qu'un chômage déguisé.
- L'évaluation du salaire réel, ajustée au moyen de l'estimation officielle du coût de la vie, est largement surestimée par les données officielles. C'est à un point tel que l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) en France ne peut faire autrement que d'admettre une différence entre l'inflation officielle et l'inflation "perçue", cette dernière étant basée sur le constat des ménages d'une augmentation des produits de base indispensables (les postes dits incompressibles) bien supérieure à celle de l'inflation officielle[21].
- c) La période 2005 – 2008, bien que plus courte que la précédente, avec ses taux officiels d'augmentation de salaires voisins de 0,5%, est néanmoins plus significative car elle annonce l'avenir. En effet, cette augmentation de seulement 0,5% correspond à une détérioration encore plus importante, en ce sens que tous les facteurs invoqués pour la période précédente sont encore à prendre en compte mais dans des proportions plus grandes. En fait, c'est la disponibilité des statistiques sur les salaires qui nous faire clore en 2008 la période qui commence en 2005. Depuis 2008, la situation de la classe ouvrière a connu une détérioration très importante qui ne peut être ignorée dans notre étude, comme en témoigne l'évolution des chiffres de la pauvreté. En 2009, la proportion de pauvres en France métropolitaine a non seulement augmenté, mais leur pauvreté s’est accrue. Elle concerne désormais 13,5% de la population soit 8,2 millions de personnes, 400 000 de plus qu'en 2008.
Que retenir de presqu'un siècle de développement du capitalisme ?
Nous avons vu que la prise en compte, dans les PIB, de l'ensemble des dépenses improductives, des activités purement financières ou mafieuses contribuait grandement à une surestimation de la richesse créée annuellement.
Nous avons vu également que les contradictions mêmes du capitalisme stérilisent un pourcentage significatif de la production capitaliste (en particulier à travers la production "improductive"). Quant aux conditions de vie de la classe ouvrière, elles sont loin d'être aussi brillantes que les statistiques officielles essaient de le faire croire.
En plus de cela, il est un aspect que ne met pas en évidence l'examen de la production ou de la condition ouvrière que nous avons effectuée, c'est le coût qu'a impliqué la domination des rapports de production capitalistes depuis la Première Guerre mondiale, tant en terme de destruction du milieu ambiant que d'épuisement des ressources de la Terre en matières premières. C'est difficilement chiffrable mais terriblement crucial pour le devenir de l'humanité. C'est une raison supplémentaire, et pas des moindres, pour exclure de façon décisive que le capitalisme ait pu depuis près d'un siècle constituer, du point de vue du devenir de la classe ouvrière et du devenir de l'humanité, un système progressiste.
MR fait le constat que le développement capitaliste a été accompagné durant cette période, de guerres, de barbarie et de dommages à l'environnement. Par ailleurs, et de façon tout-à-fait surprenante, il conclut sa plaidoirie visant à démontrer que les rapports de production n'ont pas constitué, depuis les années 1950, un frein croissant au développement des forces productives, en affirmant que le système est bien en décadence : "Pour notre part, il n'y a donc aucune contradiction à reconnaître, d'un côté, l'indéniable prospérité de la période d'après-guerre avec toutes ses conséquences et à néanmoins maintenir, de l'autre côté, le diagnostic d'obsolescence historique du capitalisme depuis le début du XXème siècle. Il en découle que, pour l'immense majorité de la population laborieuse, le capitalisme ne lui est pas encore apparu comme un outil obsolète dont elle devrait se débarrasser : il a toujours pu faire espérer que 'demain sera meilleur qu'hier'. Si cette configuration tend aujourd'hui à s'inverser dans les vieux pays industrialisés, c'est loin d'être le cas pour les pays émergents" (Dyn p. 67). Si donc le critère marxiste d'un freinage des forces productives ne peut plus être retenu pour caractériser la décadence d'un mode de production, sur quoi donc fonder celle-ci ? Réponse de MR, la "domination du salariat à l'échelle d'un marché mondial désormais unifié", ce qu'il explique en ces termes : "La fin de la conquête coloniale au début du XXème siècle, et la domination du salariat à l'échelle d'un marché mondial désormais unifié vont marquer un tournant historique et inaugurer une nouvelle phase du capitalisme " (Dyn p. 41). Et en quoi cette caractéristique de la nouvelle phase du capitalisme permet-elle d'expliquer la Première Guerre mondiale et la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 ? Comment permet-elle de faire le lien avec les nécessaires luttes de résistance du prolétariat face aux manifestations des contradictions du capitalisme ? Nous n'avons pas trouvé de réponse à ces questions dans le livre.
Nous reviendrons en partie sur celles-ci dans la deuxième partie de l'article, au sein de laquelle nous examinerons également en quoi MR met la théorie marxiste, adaptée par ses soins, au service du réformisme.
Silvio (décembre 2011)
[1] Principes d'une critique de l'économie politique – p. 273. Éd. La Pléiade Économie II.
[2] Plate-forme de l'Internationale communiste, P. Broué, EDI, 1974.
[3] Idem.
[4] Ce graphique est une adaptation d'un graphique reproduit au lien suivant : www.regards-citoyens.com/article-quelques-nouvelles-du-pib-mondial-par-a... [17]. Nous avons supprimé de celui-ci la partie estimation sur la période 2000 – 2030.
[5] equity-analyst.com/world-gdp-us-in-absolute-term-from-1960-2008.html
[6] Conforme aux statistiques du FMI : Perspectives de l'économie mondiale, p. 2, https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-flagship-issues/external/french/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/_textfpdf.ashx [18]
[7] "de 1850 à 1914, le commerce mondial est multiplié par 7, celui de la Grande-Bretagne par 5 pour les importations et par 8 pour les exportations. De 1875 à 1913, le commerce global de l’Allemagne est multiplié par 3,5, celui de la Grande-Bretagne par 2 et celui des États-Unis par 4,7. Enfin, le revenu national en Allemagne est multiplié par près de 4 entre 1871 et 1910, celui des États-Unis de près de 5." (thucydide.over-blog.net/article-6729346.html)
[8] Matériaux pour l'"Économie" – p. 394. Éd. La Pléiade Économie II.
[9] Lire à ce sujet nos deux articles des Revue internationale n° 52 et 53, "Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme"
[10] Drogues Blog. droguesblog.wordpress.com/2011/10/27/la-presse-ca-trafic-de-drogue-chiffres-astronomiques-saisies-minimes-selon-lonu
[12] Lire en particulier "Crise économique : ils accusent la finance pour épargner le capitalisme ! [20]".
[13] lexinter.net/JF/financiarisation_de_l'economie.htm
[14] socio13.wordpress.com/2011/06/06/la-financiarisation-de-l’accumulation-par-john-bellamy-foster-version-complete
[15] A decade of debt, Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff. https://www.piie.com/publications/chapters_preview/6222/01iie6222.pdf [21]. Légend :Debt / GDP:Dette / PIB
[16] Les données chiffrées ou qualitatives contenues dans l'étude de cette période, dont la source ne figure pas explicitement, sont extraites du livre Le conflit du siècle, de Fritz Sternberg. Éditions du Seuil.
[17] Stanley Lebergott, Journal of the American Statistical Association.
[20] Pour 1962 et 1973, source : "La rupture : les décennies 1960-1980, des Trente Glorieuses aux Trente Piteuses".
Guy Caire. www.ihs.cgt.fr/IMG/pdf_Guy_Caire_-_La_rupture-_les_decennies_1960-198O_d... [24]. Pour 1975 à 2005, source : INSEE. www.insee.fr/fr/statistiques [23]. Pour 2010, source Google. https://www.google.fr/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&met_y=unemployment_rate&idim=country:fr&fdim_y=seasonality:sa&dl=fr&hl=fr&q=taux+de+chômage+en+france [25] :
[21] En fait l'inflation officielle est basée également sur l'évolution du coût de produits que les consommateurs achètent rarement ou qui ne sont pas indispensables. https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20100813trib000538586/comment-reconcilier-les-menages-francais-avec-l-insee.html [26]
Questions théoriques:
- L'économie [16]
Décadence du capitalisme (XII) : 40 années de crise ouverte montrent que le capitalisme en déclin est incurable
- 2959 reads
Le boom d'après-guerre en a conduit beaucoup à conclure que le marxisme était obsolète, que le capitalisme avait découvert le secret de l'éternelle jeunesse 1 et que désormais la classe ouvrière ne constituait plus l'instrument du changement révolutionnaire. Mais une petite minorité de révolutionnaires, travaillant très souvent dans un isolement quasi total, maintenait ses convictions envers les principes fondamentaux du marxisme. L'un des plus importants d'entre eux était Paul Mattick aux États-Unis. Mattick répondit à Marcuse, qui cherchait à découvrir un nouvel acteur révolutionnaire, en publiant Les limites de l’intégration : l'homme unidimensionnel dans la société de classe (1972) 2, où il réaffirmait le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière pour le renversement du capitalisme. Mais sa contribution la plus durable a probablement été son livre Marx et Keynes, les limites de l'économie mixte, publié pour la première fois en 1969 (en français en 1972) mais basé sur des études et des essais réalisés dès les années 1950.
Bien qu'à la fin des années 1960 les premiers signes d'une nouvelle phase de crise économique ouverte aient commencé à apparaître (avec, par exemple, la dévaluation de la livre sterling en 1967), défendre l'idée que le capitalisme était toujours un système miné par une crise structurelle profonde était vraiment aller à contre le courant. Mais Mattick était là, plus de 30 ans après avoir résumé et développé la théorie de Henryk Grossman sur l'effondrement du capitalisme dans son travail majeur, "La crise permanente" (1934) 3, et il maintenait que le capitalisme était toujours un système social en régression, que les contradictions sous-jacentes au processus d'accumulation n'avaient pas été exorcisées et étaient vouées à ressurgir. Se centrant sur l'utilisation de l'État par la bourgeoisie afin de réguler le processus d'accumulation, sous la forme keynésienne d' "économie mixte" en faveur en Occident, ou dans sa version stalinienne à l'Est, il montra que l'obligation d'interférer dans l'opération de la loi de la valeur ne constituait pas le signe d'un dépassement des contradictions du système (comme Paul Cardan / Cornelius Castoriadis, par exemple, l'a notamment défendu dans Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne, 1979) mais était précisément une expression de son déclin :
- "Malgré la longue durée de la conjoncture dite de prospérité, que les pays industriels avancés ont connue, rien ne permet de supposer que la production de capital a pu venir à bout des contradictions qui lui sont inhérentes par le biais d'interventions étatiques. Au contraire, la multiplication de ces dernières dénote la persistance de la crise subie par la production de capital, tandis que la croissance du secteur déterminé par l'État rend manifeste le déclin toujours plus accentué du système de l'entreprise privée." (page 188) 4 "On s'apercevra alors que les solutions keynésiennes étaient factices, aptes à différer, mais non à faire disparaître définitivement les effets contradictoires de l'accumulation du capital, tels que Marx les avait prédits." (idem, page 200)
Ainsi, Mattick maintenait que "… le capitalisme – en dépit de tout ce qui en apparence pourrait donner à penser le contraire – est devenu aujourd'hui un système régressif et destructeur" (page 315) 5. Ainsi, au début du chapitre 19, "L'impératif impérialiste", Mattick affirme que le capitalisme ne peut pas échapper à la tendance à la guerre car elle est le résultat logique du blocage du processus d'accumulation. Mais tout en écrivant que : "… on peut supposer que, par le biais de la guerre, [la production pour le gaspillage] amènera des transformations structurelles de l'économie mondiale et du rapport de forces politiques permettant aux puissances victorieuses de bénéficier d'une nouvelle phase d'expansion" (page 329), il ajoute aussitôt que cela ne doit pas rassurer la bourgeoisie pour autant : "Mais ce genre d'optimisme a cessé de prévaloir en raison des capacités de destruction propres aux armes modernes, dont les engins atomiques." (page 330, idem). De plus, pour le capitalisme, "savoir que la guerre peut conduire à un suicide général (...) n'affaiblit en rien la tendance à une nouvelle guerre mondiale." (idem). La perspective qu'il annonce dans la dernière phrase de son livre reste donc celle que les révolutionnaires avaient annoncée à l'époque de la Première Guerre mondiale : "socialisme ou barbarie".
Cependant, il y a certains défauts dans l'analyse que fait Mattick de la décadence du capitalisme dans Marx et Keynes. D'un côté, il voit la tendance à la distorsion de la loi de la valeur comme une expression du déclin ; mais, de l'autre, il prétend que les pays entièrement étatisés du bloc de l'Est ne sont plus assujettis à la loi de la valeur et donc à la tendance aux crises. Il défend même que, du point de vue du capital privé, ces régimes peuvent être "définis comme un socialisme d'État, du seul fait que le capital y est centralisé par l'État" (page 383) 6, même si du point de vue de la classe ouvrière, il faut les décrire comme du capitalisme d'État. En tous cas, "le capitalisme d'État ignore la contradiction entre production rentable et production non rentable dont souffre le système rival (....) le capitalisme d'État peut produire de manière rentable ou non sans tomber dans la stagnation."(page 350) 7. Il développe l'idée selon laquelle les États staliniens constituent, en un sens, un système différent, profondément antagoniste aux formes occidentales de capitalisme – et c'est dans cet antagonisme qu'il semble situer la force motrice derrière la Guerre froide, puisqu'il écrit à propos de l'impérialisme contemporain que "contrairement à l'impérialisme et au colonialisme du temps du laisser-faire, il s'agit cette fois non seulement d'une lutte pour des sources de matières premières, des marchés privilégiés et des champs d'exportation du capital, mais aussi d'une lutte contre de nouvelles formes de production de capital échappant aux rapports de valeur et aux mécanismes concurrentiels du marché et donc, en ce sens ,d'une lutte pour la survie du système de la propriété privé." (page 318) 8. Cette interprétation va de pair avec son argument selon lequel les pays du bloc de l'Est n'ont pas, strictement parlant, de dynamique impérialiste propre.
Le groupe Internationalism aux États-Unis - qui allait devenir plus tard une section du CCI - releva cette faiblesse dans l'article qu'il publia dans le n° 2 de sa revue au début des années 1970, "Capitalisme d'État et loi de la valeur, une réponse à Marx et Keynes". L'article montre que l'analyse par Mattick des régimes staliniens sape le concept de décadence qu'il défend par ailleurs : car si le capitalisme d'État n'est pas sujet aux crises ; s'il est en fait, comme le défend Mattick, plus favorable à la cybernétisation et au développement des forces productives ; si le système stalinien n'est pas poussé à suivre ses tendances impérialistes ; alors les fondements matériels de la révolution communiste tendent à disparaître et l'alternative historique posée par l'époque de déclin devient également inintelligible :
- "L'utilisation par Mattick du terme capitalisme d'État est donc une appellation impropre. Le capitalisme d'État ou "socialisme d'État", que Mattick décrit comme un mode de production exploiteur mais non capitaliste, ressemble beaucoup à la description par Bruno Rizzi et Max Shachtman du "collectivisme bureaucratique", développée dans les années d'avant-guerre. L'effondrement économique du capitalisme, du mode de production basé sur la loi de la valeur dont Mattick prédit l'inévitabilité, ne pose pas l'alternative historique socialisme ou barbarie, mais l'alternative socialisme ou barbarie ou "socialisme d'État" ".
La réalité a donné raison à l'article d'Internationalism. De façon générale, il est vrai que la crise à l'Est n'a pas pris la même forme qu'à l'Ouest. Elle s'est plutôt manifestée par une sous-production plutôt qu'une surproduction, en tout cas en ce qui concerne les biens de consommation. Mais l'inflation qui a ravagé ces économies pendant des décennies, et a souvent été l'étincelle mettant le feu aux poudres de luttes de classe majeures, était le signe que la bureaucratie n'avait aucunement conjuré les effets de la loi de la valeur. Par dessus tout, avec l'effondrement du bloc de l'Est - qui illustrait aussi son impasse militaire et sociale - la loi de la valeur a pris sa "revanche" sur des régimes qui avaient cherché à la circonvenir. En ce sens, tout comme le keynésianisme, le stalinisme s'est révélé une "solution factice", "apte à différer, mais non à faire disparaître définitivement les effets contradictoires de l'accumulation du capital, tels que Marx les avait prédits." (idem, page 200) 9
Le courage de Mattick avait été nourri par l'expérience directe de la révolution allemande et la défense des positions de classe contre la contre-révolution triomphante des années 1930 et 1940. Un autre "survivant" de la Gauche communiste, Marc Chirik, a aussi continué de militer pendant la période de réaction et de guerre impérialiste. Il a été un membre fondamental de la Gauche communiste de France dont nous avons examiné la contribution dans le précédent article. Au cours des années 1950, il était au Vénézuéla et fut temporairement coupé de toute activité organisée. Mais au début des années 1960, il a cherché à regrouper un cercle de jeunes camarades qui ont formé le groupe Internacionalismo, fondé sur les mêmes principes que la GCF, y compris bien sûr sur la notion de décadence du capitalisme. Mais alors que la GCF avait lutté pour tenir dans une période sombre du mouvement ouvrier, le groupe vénézuélien exprimait quelque chose qui pointait dans la conscience de la classe ouvrière mondiale. Il reconnut avec une clarté surprenante que les difficultés financières qui commençaient à ronger l'organisme apparemment sain du capitalisme signifiaient en réalité un nouveau plongeon dans la crise et qu'il serait confronté à une génération non défaite de la classe ouvrière. Comme il l'écrivit en janvier 1968 : "Nous ne sommes pas des prophètes et nous ne prétendons pas non plus prédire quand et comment se dérouleront les événements dans le futur. Mais ce qui est conscient et certain : le processus dans lequel plonge le capitalisme aujourd'hui ne peut être arrêté et mène directement à la crise. Et nous sommes aussi certains que le processus inverse de développement de la combativité de classe dont nous sommes témoins aujourd'hui amènera le prolétariat à une lutte sanglante et directe pour la destruction de l'État bourgeois." Ce groupe fut l'un des plus lucides dans l'interprétation des mouvements sociaux massifs en France en mai de cette année-là, en Italie et ailleurs l'année suivante, comme marquant la fin de la contre-révolution.
Pour Internacionalismo, ces mouvements de classe constituaient une réponse du prolétariat aux premiers effets de la crise économique mondiale qui avait déjà produit une montée du chômage et des tentatives de contrôler les augmentations de salaire. Pour d'autres, ceci n'était qu'une application mécanique d'un marxisme dépassé : ce que Mai 1968 exprimait avant tout, c'était la révolte directe du prolétariat contre l'aliénation d'une société capitaliste fonctionnant à plein. Tel était le point de vue des situationnistes qui écartaient toute tentative de relier la crise et la lutte de classe comme l'expression de sectes de l'époque des dinosaures : "Quant aux débris du vieil ultra-gauchisme non trotskyste, ils avaient besoin au moins d'une crise économique majeure. Ils subordonnaient tout mouvement révolutionnaire au retour de cette dernière et ne voyaient rien venir. Maintenant qu'ils ont reconnu une crise révolutionnaire en Mai, ils doivent prouver que cette crise économique "invisible" était là au printemps 1968. Sans peur du ridicule, c'est à cela qu'ils travaillent aujourd'hui, produisant des schémas sur la montée du chômage et de l'inflation. Ainsi pour eux, la crise économique n'est plus cette réalité objective terriblement visible qui a été si durement vécue en 1929, mais le fils de la présence eucharistique qui soutient leur religion." (L'Internationale situationniste n° 12) En réalité, comme nous l'avons vu, le point de vue d'Internacionalismo sur les rapports entre la crise et la lutte de classe n'a pas été modifié rétrospectivement : au contraire, sa fidélité à la méthode marxiste lui a permis d'envisager, sur la base de quelques signes avant-coureurs non spectaculaires, l'éclatement de mouvements tels que Mai 1968. L'approfondissement plus visible de la crise à partir de 1973 clarifia rapidement le fait que c'était l'IS – qui avait plus ou moins adopté la théorie de Cardan d'un capitalisme ayant surmonté ses contradictions économiques – qui était liée à une période de la vie du capitalisme désormais définitivement terminée.
L'hypothèse selon laquelle Mai 1968 exprimait une réapparition significative de la classe ouvrière fut confirmée par la prolifération internationale de groupes et de cercles cherchant à développer une critique authentiquement révolutionnaire du capitalisme. Naturellement, après une si longue période de reflux, ce nouveau mouvement politique prolétarien était extrêmement hétérogène et inexpérimenté. Réagissant aux horreurs du stalinisme, il était souvent méfiant envers la notion même d'organisation politique, avait une réaction viscérale envers tout ce qui sentait le "léninisme" ou envers ce qui était considéré comme la rigidité du marxisme. Certains de ces groupes se perdirent dans un activisme frénétique et, en l'absence d'analyse à long terme, ne survécurent pas à la fin de la première vague internationale de luttes commencée en 1968. D'autres ne rejetaient pas le lien entre les luttes ouvrières et la crise, mais le considéraient d'un point de vue totalement différent : c'est fondamentalement la combativité ouvrière qui avait produit la crise en mettant en avant des revendications d'augmentations de salaires sans restrictions et en refusant de se soumettre aux plans de restructuration capitalistes. Ce point de vue était défendu en France par le Groupe de Liaison pour l'Action des Travailleurs (l'un des nombreux héritiers de Socialisme ou Barbarie) et en Italie par le courant autonomiste des ouvriers, qui considérait le marxisme "traditionnel" comme désespérément "objectiviste" (nous y reviendrons dans un autre article) dans sa compréhension des rapports entre la crise et la lutte de classe.
Cependant, cette nouvelle génération découvrait également les travaux de la Gauche communiste et la défense de la théorie de la décadence faisait partie de ce processus. Marc Chirik et quelques jeunes camarades du groupe Internacionalismo étaient venus en France et, dans le feu des événements de 1968, participèrent à la formation d'un premier noyau du groupe Révolution internationale. Dès le début, Révolution internationale plaça la notion de décadence au cœur de sa démarche politique et réussit à convaincre un certain nombre de groupes et d'individus conseillistes ou libertaires du fait que leur opposition aux syndicats, aux libérations nationales et à la démocratie capitaliste ne pouvait être comprise et défendue correctement sans un cadre historique cohérent. Dans les premiers numéros de Révolution internationale, il y a une série d'articles sur "La décadence du capitalisme" qui allait être publiée ensuite comme brochure du Courant communiste international. Ce texte est disponible en ligne 10 et contient toujours les principaux fondements de la méthode politique du CCI, surtout dans son large survol historique qui va du communisme primitif via les différentes sociétés de classes précédant le capitalisme, jusqu'à l'examen de la montée et du déclin du capitalisme lui-même. Comme les articles actuels de cette série, il se base sur la notion de Marx des "époques de révolutions sociales", il met en évidence des éléments-clés et des caractéristiques communes à toutes les sociétés de classes dans les périodes où elles sont devenues des entraves au développement des forces productives de l'humanité : l'intensification des luttes entre les fractions de la classe dominante, le rôle croissant de l'État, la décomposition des justifications idéologiques, les luttes croissantes des classes opprimées et exploitées. Appliquant cette démarche générale aux spécificités de la société capitaliste, il tente de montrer comment le capitalisme, depuis le début du 20e siècle, de "forme de développement" qu'il était, s'est transformé en une "entrave" aux forces productives, mettant en évidence les guerres mondiales et les nombreux autres conflits impérialistes, les luttes révolutionnaires qui ont éclaté en 1917, l'énorme augmentation du rôle de l'État et l'incroyable gaspillage de travail humain dans le développement de l'économie de guerre et d'autres formes de dépenses improductives.
Cette vision générale, présentée à une époque où les premiers signes d'une nouvelle crise économique devenaient plus que visibles, convainquit un certain nombre de groupes d'autres pays que la théorie de la décadence constituait un point de départ fondamental pour les positions communistes de gauche. Elle n'était pas seulement au centre de la plateforme du CCI mais fut également adoptée par d'autres tendances comme Revolutionary Perspectives et, par la suite, la Communist Workers Organisation en Grande-Bretagne. Il y eut d'importants désaccords sur les causes de la décadence du capitalisme : la brochure du CCI adoptait, en gros, l'analyse de Rosa Luxemburg, bien que l'analyse du boom d'après-guerre (qui voyait la reconstruction des économies détruites par la guerre comme une sorte de nouveau marché) fût par la suite l'objet de discussions dans le CCI, et il y eut toujours, au sein du CCI, d'autres points de vue sur la question, en particulier de la part de camarades défendant la théorie de Grossman - Mattick qui était également partagée par la CWO et d'autres. Mais dans cette période de réémergence du mouvement révolutionnaire, "la théorie de la décadence" semblait faire des acquis significatifs.
Bilan d'un système moribond
Dans notre survol des efforts successifs des révolutionnaires pour comprendre la période de déclin du capitalisme, nous arrivons maintenant aux années 1970 et 1980. Mais avant d'examiner l'évolution – et les nombreuses régressions – qui ont eu lieu au niveau théorique depuis ces décennies jusqu'à aujourd'hui, il nous paraît utile de rappeler et de mettre à jour le bilan que nous avions tiré dans le premier article de cette série 11, puisque des événements spectaculaires, sur le plan économique en particulier, se sont déroulés depuis le début 2008, date à laquelle nous avons publié ce premier article.
1. Sur le plan économique
Dans les années 1970 et 1980, la vague de lutte de classe internationale a connu une série d'avancées et de reculs, mais la crise économique, elle, avançait inexorablement et infirmait la thèse des autonomistes pour qui c'étaient les luttes ouvrières qui étaient la cause des difficultés économiques. La dépression des années 1930, qui coïncidait avec une défaite historique majeure de la classe ouvrière, avait déjà largement démenti cette idée, et l'évolution visible de la faillite économique telle qu'elle est apparue, de façon intermittente, au milieu des années 1970 et au début des années 1980, même dans des moments où la classe ouvrière était en retrait et, de façon plus soutenue, au cours des années 1990, a clairement montré qu'un processus "objectif" était à l'œuvre et qu'il n'était pas fondamentalement déterminé par le degré de résistance de la classe ouvrière. Il n'était pas non plus soumis à un contrôle efficace par la bourgeoisie. Abandonnant les politiques keynésiennes qui avaient accompagné les années du boom d'après-guerre mais étaient devenues la source d'une inflation galopante, la bourgeoisie dans les années 1980 cherchait désormais à "équilibrer les comptes" par des politiques qui suscitèrent une marée de chômage massif et de désindustrialisation dans la plupart des pays-clés du capitalisme. Au cours des années suivantes, il y eut de nouvelles tentatives pour stimuler la croissance par un recours massif à l'endettement, ce qui permit l'existence de booms économiques de courte durée mais provoqua aussi une accumulation sous-jacente de profondes tensions qui allaient exploser à la surface avec les krachs de 2007-08. Un aperçu général de l'économie capitaliste mondiale depuis 1914 ne nous fournit donc pas le scénario d'un mode de production ascendant mais celui d'un système incapable d'échapper à l'impasse, quelles que soient les techniques qu'il ait tenté d'utiliser :
- 1914 - 1923 : Première Guerre mondiale et première vague internationale de révolutions prolétariennes ; l'Internationale communiste annonce l'aube d'une "époque de guerres et de révolutions" ;
- 1924 – 1929 : brève reprise qui ne dissipe pas la stagnation d'après-guerre des "vieilles" économies et des "vieux" empires ; le "boom" est restreint aux États-Unis ;
- 1929 : l'expansion exubérante du capital américain se termine dans un krach spectaculaire, précipitant le capitalisme dans la dépression la plus profonde et la plus étendue de son histoire. Il n'y a pas de revitalisation spontanée de la production comme c'était le cas lors des crises cycliques du 19e siècle. On utilise des mesures capitalistes d'État pour relancer l'économie mais elles font partie d'une poussée vers la Seconde Guerre mondiale ;
- 1945-1967 : Un développement très important des dépenses de l'État (mesures keynésiennes) financées essentiellement au moyen de l'endettement et s'appuyant sur des gains de productivité inédits crée les conditions d'une période de croissance et de prospérité sans précédent, bien qu'une grande partie du "Tiers-Monde" en soit exclue ;
- 1967-2008 : 40 années de crise ouverte, que démontrent en particulier l'inflation galopante des années 1970 et le chômage massif des années 1980. Cependant, au cours des années 1990 et au début des années 2000, c'est à certains moments seulement que la crise apparaît plus "ouvertement" et plus clairement, plus dans certaines parties du globe que dans d'autres. L'élimination des restrictions vis-à-vis du mouvement du capital et de la spéculation financière ; toute une série de délocalisations industrielles vers des régions où la main d'œuvre est bon marché ; le développement de nouvelles technologies ; et, surtout, le recours quasi illimité au crédit par les États, les entreprises et les ménages : tout ceci crée une bulle de "croissance" dans laquelle de petites élites font de très grands profits, des pays comme la Chine connaissent une croissance industrielle frénétique et le crédit à la consommation atteint des hauteurs sans précédent dans les pays capitalistes centraux. Mais les signaux d'alarme sont discernables tout au long de cette période : des récessions succèdent aux booms (par exemple celles de 1974-75, 1980-82, 1990-93, 2001-2002, le krach boursier de 1987, etc.) et, à chaque récession, les options ouvertes pour le capital se rétrécissent, contrairement aux "effondrements" de la période ascendante quand existait toujours la possibilité d'une expansion extérieure vers des régions géographiques et économiques jusqu'alors en dehors du circuit capitaliste. Ne disposant quasiment plus de ce débouché, la classe capitaliste est de plus en plus contrainte de "tricher" avec la loi de la valeur qui condamne son système à l'effondrement. Ceci s'applique tout autant aux politiques ouvertement capitalistes d'État du keynésianisme et du stalinisme qui ne font pas mystère de leur volonté de freiner les effets du marché en finançant les déficits et en maintenant des secteurs économiques non rentables afin de soutenir la production, qu'aux politiques dites "néo-libérales" qui semblaient tout balayer devant elles après les "révolutions" personnifiées par Thatcher et Reagan. En réalité, ces politiques sont elles-mêmes des émanations de l'État capitaliste et, par leur incitation au recours au crédit illimité et à la spéculation, elles ne sont pas du tout ancrées dans un respect des lois classiques de la production capitaliste de valeur. En ce sens, l'un des événements les plus significatifs ayant précédé la débâcle économique actuelle est l'effondrement en 1997 des "Tigres" et des "Dragons" en Extrême-Orient, où une phase de croissance frénétique alimentée par de la (mauvaise) dette s'est soudainement heurtée à un mur – la nécessité de commencer à tout rembourser. C'était un signe avant-coureur de l'avenir, même si la Chine et l'Inde ont pris la suite en s'attribuant le rôle de "locomotive" qui avait été réservé à d'autres économies d'Extrême-Orient. "La révolution technologique", dans la sphère informatique en particulier, dont on a fait un grand battage dans les années 1990 et au tout début des années 2000, n'a pas non plus sauvé le capitalisme de ses contradictions internes : elle a augmenté la composition organique du capital et donc abaissé le taux de profit, et cela n'a pu être compensé par une extension véritable du marché mondial. En fait, elle a tendu à aggraver le problème de la surproduction en déversant de plus en plus de marchandises tout en jetant de plus en plus d'ouvriers au chômage ;
- 2008 -... : la crise du capitalisme mondial atteint une situation qualitativement nouvelle dans laquelle les "solutions" appliquées par l'État capitaliste au cours des quatre décennies précédentes et, par dessus tout, le recours au crédit, explosent à la face du monde politique, financier et bureaucratique qui les avaient pratiquées si assidûment avec une confiance mal placée au cours de la période précédente. Maintenant la crise rebondit vers les pays centraux du capitalisme mondial – aux États-Unis et dans la zone Euro – et toutes les recettes utilisées pour maintenir la confiance dans les possibilités d'une expansion économique constante se révèlent sans effet. La création d'un marché artificiel via le crédit montre désormais ses limites historiques et menace de détruire la valeur de la monnaie et de générer une inflation galopante ; en même temps, le contrôle du crédit et les tentatives des États de réduire leurs dépenses afin de commencer à rembourser leurs dettes ne font que restreindre encore plus le marché. Le résultat net, c'est que le capitalisme entre maintenant dans une dépression qui est fondamentalement plus profonde et plus insoluble que celle des années 1930. Et tandis que la dépression s'étend en Occident, le grand espoir qu'un pays comme la Chine porte l'ensemble de l'économie sur ses épaules s'avère aussi une illusion complète ; la croissance industrielle de la Chine est basée sur sa capacité à vendre des marchandises bon marché à l'Ouest, et si ce marché se contracte, la Chine est confrontée à un krach économique.
Conclusion : tandis que dans sa phase ascendante, le capitalisme a traversé un cycle de crises qui étaient à la fois l'expression de ses contradictions internes et un moment indispensable de son expansion globale, aux 20e et 21e siècles, la crise du capitalisme, comme Paul Mattick l'avait défendu dès les années 1930, est permanente. Le capitalisme a désormais atteint un stade où les palliatifs qu'il a utilisés pour se maintenir en vie sont devenus un facteur supplémentaire de sa maladie mortelle.
2. Sur le plan militaire
La poussée vers la guerre impérialiste exprime aussi l'impasse historique de l'économie capitaliste mondiale :
- "Plus se rétrécit le marché, plus devient âpre la lutte pour la possession des sources de matières premières et la maîtrise du marché mondial. La lutte économique entre divers groupes capitalistes se concentre de plus en plus, prenant la forme la plus achevée des luttes entre États. La lutte économique exaspérée entre États ne peut finalement se résoudre que par la force militaire. La guerre devient le seul moyen non pas de solution à la crise internationale, mais le seul moyen par lequel chaque impérialisme national tend à se dégager des difficultés avec lesquelles il est aux prises, aux dépens des États impérialistes rivaux.
Les solutions momentanées des impérialismes isolés, par des victoires militaires et économiques, ont pour conséquence non seulement l'aggravation des situations des pays impérialistes adverses, mais encore une aggravation de la crise mondiale et la destruction des masses de valeurs accumulées par des dizaines et des centaines d'années de travail social. La société capitaliste à l'époque impérialiste ressemble à un bâtiment dont les matériaux nécessaires pour la construction des étages supérieurs sont extraits de la bâtisse des étages inférieurs et des fondations. Plus frénétique est la construction en hauteur, plus fragile est rendue la base soutenant tout l'édifice. Plus est imposante en apparence, la puissance au sommet, plus l'édifice est, en réalité, branlant et chancelant. Le capitalisme, forcé qu'il est de creuser sous ses propres fondations, travaille avec rage à l'effondrement de l'économie mondiale, précipitant la société humaine vers la catastrophe et l'abîme." ("Rapport sur la situation internationale", juillet 1945, GCF 12)
Les guerres impérialistes, qu'elles soient locales ou mondiales, sont l'expression la plus pure de la tendance du capitalisme à s'autodétruire, qu'il s'agisse de la destruction physique de capital, du massacre de populations entières ou de l'immense stérilisation de valeurs que représente la production militaire qui ne se réduit plus aux phases de guerre ouverte. La compréhension par la GCF de la nature essentiellement irrationnelle de la guerre dans la période de décadence a été en quelque sorte obscurcie par la réorganisation et la reconstruction globale de l'économie qui a suivi la Seconde Guerre mondiale ; mais le boom d'après-guerre était un phénomène exceptionnel qui ne pourra jamais se répéter. Et quel que soit le mode d'organisation internationale adopté par le système capitaliste à cette époque, la guerre a également été permanente. Après 1945, quand le monde a été divisé en deux énormes blocs impérialistes, le conflit militaire a généralement pris la forme de guerres de "libération nationale" sans fin à travers lesquelles les deux super-puissances rivalisaient pour la domination stratégique ; après 1989, l'effondrement du bloc russe, plus faible, loin d'atténuer la tendance à la guerre, a rendu l'implication directe de la super-puissance restante, les États-Unis, plus fréquente, comme nous l'avons vu pendant la Guerre du Golfe de 1991, dans les guerres des Balkans à la fin des années 1990, et en Afghanistan et en Irak après 2001. Ces interventions des États-Unis avaient en grande partie pour but – et de façon tout à fait vaine - d'enrayer les tendances centrifuges auxquelles la dissolution de l'ancien système de blocs avait ouvert la voie, ce qui s'est vu dans l'aggravation et la prolifération des rivalités locales, concrétisées dans les conflits atroces qui ont ravagé l'Afrique, du Rwanda au Congo, de l'Éthiopie à la Somalie, dans les tensions exacerbées autour du problème israélo-palestinien, jusqu'à la menace d'un face-à-face nucléaire entre l'Inde et le Pakistan
Les Première et Seconde Guerres mondiales ont apporté un changement majeur dans le rapport de forces entre les principaux pays capitalistes, essentiellement au bénéfice des États-Unis. En fait la domination écrasante des États-Unis à partir de 1945 a constitué un facteur-clé de la prospérité d'après-guerre. Mais contrairement à l'un des slogans des années 1960, la guerre n'était pas "la santé de l'État". De la même façon que le gonflement extrême de son secteur militaire a provoqué l'effondrement du bloc de l'Est, l'engagement des États-Unis pour se maintenir comme gendarme du monde est aussi devenu le facteur de leur propre déclin en tant qu'empire. Les énormes sommes englouties dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak n'ont pas été compensées par les profits rapides d'Halliburton ou autres de ses acolytes capitalistes ; au contraire, cela a contribué à transformer les États-Unis de créditeurs du monde en l'un de ses principaux débiteurs.
Certaines organisations révolutionnaires, comme la Tendance communiste internationaliste, défendent l'idée que la guerre, et surtout la guerre mondiale, est éminemment rationnelle du point de vue du capitalisme. Elles défendent l'idée qu'en détruisant la masse hypertrophiée de capital constant qui est à la source de la baisse du taux de profit, la guerre dans la décadence du capitalisme a pour effet la restauration de ce dernier et le lancement d'un nouveau cycle d'accumulation. Nous n'entrerons pas ici dans cette discussion mais, même si une telle analyse était juste, cela ne pourrait plus être une solution pour le capital. D'abord, parce que rien ne permet de dire que les conditions d'une troisième guerre mondiale – qui requiert, entre autres, la formation de blocs impérialistes stables - soient réunies dans un monde où la règle est de plus en plus celle du "chacun pour soi". Et même si une troisième guerre mondiale était à l'ordre du jour, elle n'initierait certainement pas un nouveau cycle d'accumulation, mais aboutirait quasi certainement à la disparition du capitalisme et, probablement, de l'humanité. 13 Ce serait la démonstration finale de l'irrationalité du capitalisme, mais il n'y aurait plus personne pour dire "je vous l'avais bien dit".
3. sur le plan écologique
Depuis les années 1970, les révolutionnaires ont été obligés de prendre en compte une nouvelle dimension du diagnostic selon lequel le capitalisme n'apportait plus rien de positif et était devenu un système tourné vers la destruction : la dévastation croissante de l'environnement naturel qui menace maintenant de désastre à l'échelle planétaire. La pollution et la destruction du monde naturel sont inhérentes à la production capitaliste depuis le début mais, au cours du siècle dernier et, en particulier, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles se sont étendues et amplifiées du fait que le capitalisme a occupé sans répit tous les recoins de la planète jusqu'au dernier. En même temps, et comme conséquence de l'impasse historique du capitalisme, l'altération de l'atmosphère, le pillage et la pollution de la terre, des mers, des rivières et des forêts ont été exacerbés par l'accroissement d'une concurrence nationale féroce pour les ressources naturelles, la main d'œuvre à bas prix et de nouveaux marchés. La catastrophe écologique, notamment sous la forme du réchauffement climatique, est devenue un nouveau chevalier de l'apocalypse capitaliste, et les sommets internationaux qui se sont succédé ont montré l'incapacité de la bourgeoisie à prendre les mesures les plus élémentaires pour l'éviter.
Une illustration récente : le dernier rapport de l'Agence Internationale de l'Énergie, organisme qui ne s'était jamais distingué auparavant pour ses prédictions alarmistes, assure que les gouvernements du monde ont cinq ans pour renverser le cours du changement climatique avant qu'il ne soit trop tard. Selon l'AIE et un certain nombre d'institutions scientifiques, il est vital d'assurer que la hausse des températures ne dépasse pas 2 degrés. "Pour maintenir les émissions en dessous de cet objectif, la civilisation ne pourrait continuer, comme c'était le cas jusqu'ici, que pendant cinq ans, avant d'avoir "dépensé" le montant total des émissions permises. Dans ce cas, si on veut atteindre les objectifs de réchauffement, toutes les nouvelles infrastructures construites à partir de 2017 ne devraient plus produire aucune émission." 14 Un mois après la parution de ce rapport en novembre 2011, le sommet de Durban était présenté comme un pas en avant car, pour la première fois de toutes ces réunions internationales entre États, on se mit d'accord sur la nécessité de limiter légalement les émissions de gaz carbonique. Mais ce n'est qu'en 2015 que les niveaux devraient être fixés et en 2020 être effectifs – bien trop tard selon les prévisions de l'AIE et de beaucoup d'organismes environnementaux associés à la Conférence. Keith Allot, responsable "changement climatique" au WWF-Royaume-Uni (World Wide Fund for nature / Fonds mondial pour la nature), a déclaré : "Les gouvernements ont préservé une voie aux négociations, mais nous ne devons nous faire aucune illusion – l'issue de Durban nous présente la perspective de limites légales de 4° de réchauffement. Ce serait une catastrophe pour les populations et la nature. Les gouvernements ont passé leur temps, dans ce moment crucial, à négocier autour de quelques mots dans un texte, et ont porté peu d'attention aux avertissements répétés de la communauté scientifique disant qu'une action bien plus urgente et bien plus vigoureuse était nécessaire pour réduire les émissions". 15
Le problème avec les conceptions réformistes des écologistes, c'est que le capitalisme est étranglé par ses propres contradictions et par ses luttes toujours plus désespérées pour survivre. Pris dans une crise, le capitalisme ne peut pas devenir moins compétitif, plus coopératif, plus rationnel ; à tous les niveaux, il est entraîné dans la concurrence la plus extrême, surtout au niveau de la concurrence entre États nationaux qui ressemblent à des gladiateurs se battant dans une arène barbare pour la moindre chance de survie immédiate. Il est forcé de chercher des profits à court terme, de tout sacrifier à l'idole de "la croissance économique" – c'est-à-dire à l'accumulation du capital, même si c'est une croissance fictive basée sur une dette pourrie comme dans les dernières décennies. Aucune économie nationale ne peut se permettre le plus petit moment de sentimentalisme quand il s'agit d'exploiter sa "propriété" nationale naturelle jusqu'à sa limite absolue. Il ne peut pas exister non plus, dans l'économie capitaliste mondiale, de structure légale ni de gouvernance internationales qui soit capable de subordonner les intérêts nationaux étroits aux intérêts globaux de la planète. Quelle que soit la véritable échéance posée par le réchauffement climatique, la question écologique dans son ensemble constitue une nouvelle preuve que la perpétuation de la domination de la bourgeoisie, du mode de production capitaliste, est devenue un danger pour la survie de l'humanité.
Examinons une illustration édifiante de tout cela – une illustration qui montre également en quoi le danger écologique, tout comme la crise économique, ne peut être séparé de la menace de conflit militaire.
- "Au cours des derniers mois, les compagnies pétrolières ont commencé à faire la queue pour obtenir des droits d'exploration de la mer de Baffin, région de la côte occidentale du Groenland riche en hydrocarbures qui, jusqu'ici, était trop obstruée par les glaces pour qu'on puisse forer. Des diplomates américains et canadiens ont rouvert une polémique à propos des droits de navigation sur une route maritime traversant le Canada arctique et qui permettrait de réduire le temps de transport et les coûts des pétroliers.
Même la propriété du pôle Nord est devenue l'objet de discorde, la Russie et le Danemark prétendant chacun détenir la propriété des fonds océaniques dans l'espoir de se réserver l'accès à toutes ses ressources, des pêcheries aux gisements de gaz naturel.
L'intense rivalité autour du développement de l'Arctique a été révélée dans les dépêches diplomatiques publiées la semaine dernière par le site web "anti-secret" Wikileaks. Des messages entre des diplomates américains montrent comment les nations du nord, y compris les États-Unis et la Russie, ont manœuvré afin d'assurer l'accès aux voies maritimes et aux gisements sous-marins de pétrole et de gaz qui sont évalués à 25 pour cent des réserves inexploitées mondiales.
Dans leurs câbles, les officiels américains redoutent que les chamailleries autour des ressources puissent amener à un armement de l'Arctique. "Bien que la paix et la stabilité règnent en Arctique, on ne peut exclure qu'une redistribution du pouvoir ait lieu dans le futur et même une intervention armée", dit un câble du Département d'État en 2009, citant un ambassadeur russe." 16
Ainsi, l'une des manifestations les plus graves du réchauffement climatique, la fonte des glaces aux pôles, qui contient la possibilité d'inondations cataclysmiques et d'un cercle vicieux de réchauffement une fois que les glaces polaires ne seront plus là pour refléter la chaleur du soleil en dehors de l'atmosphère terrestre, est immédiatement considérée comme une immense occasion économique pour laquelle les États nationaux font la queue – avec la conséquence ultime de consommer plus d'énergies fossiles, venant s'ajouter à l'effet de serre. Et en même temps, la lutte pour les ressources qui s'amenuisent – ici le pétrole et le gaz mais, ailleurs, ça peut être l'eau et les terres fertiles – produit un mini-conflit impérialiste à quatre ou cinq (la Grande-Bretagne est elle aussi impliquée dans cette dispute). C'est le cercle vicieux de la folie croissante du capitalisme.
Le même article (du Washington Post) se poursuit par "la bonne nouvelle" d'un modeste traité signé entre certains des protagonistes lors du sommet du Conseil arctique à Nuuk au Groenland. Et nous savons à quel point on peut compter sur les traités diplomatiques quand il s'agit de prévenir la tendance inhérente du capitalisme vers le conflit impérialiste.
Le désastre global que le capitalisme prépare ne peut être évité que par une révolution globale.
4. Sur le plan social
Quel est le bilan du déclin du capitalisme sur le plan social et, en particulier, pour la principale classe productrice de richesses pour le capitalisme, la classe ouvrière ? Quand, en 1919, l'Internationale communiste proclama que le capitalisme était entré dans l'époque de sa désintégration interne, elle traçait également un trait sur la période de la social-démocratie au cours de laquelle la lutte pour des réformes durables avait été possible et nécessaire. La révolution était devenue nécessaire parce que, désormais, le capitalisme ne pourrait qu'augmenter ses attaques contre le niveau de vie de la classe ouvrière. Comme nous l'avons montré dans les précédents articles de cette série, cette analyse fut plusieurs fois confirmée au cours des deux décennies suivantes qui virent la plus grande dépression de l'histoire du capitalisme et les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle fut mise en question, même chez les révolutionnaires, pendant le boom des années 1950 et 1960, quand la classe ouvrière des pays capitalistes centraux connut des augmentations de salaires sans précédent, une réduction importante du chômage et une série d'avantages sociaux financés par l'État : les allocations maladie, les congés payés, l'accès à l'éducation, les services de santé, etc.
Mais ces avancées invalident-elles l'idée, maintenue par les révolutionnaires qui défendaient la thèse selon laquelle le capitalisme était globalement en déclin, que des réformes durables n'étaient plus possibles ?
La question posée ici n'est pas de savoir si ces améliorations ont été "réelles" ou significatives. Elles l'ont été et cela doit être expliqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles le CCI, par exemple, a ouvert un débat sur les causes de la prospérité d'après-guerre, en son sein puis publiquement. Mais ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est le contexte historique dans lequel ces acquis eurent lieu, car on peut alors montrer qu'ils ont peu en commun avec l'amélioration régulière du niveau de vie de la classe ouvrière au 19e siècle qui avait été permise, pour sa plus grande part, grâce à la bonne santé du capitalisme ainsi qu'à l'organisation et à la lutte du mouvement ouvrier :
- s'il est vrai que bien des "réformes" d'après-guerre furent mises en œuvre pour assurer que la guerre ne donne pas lieu à une vague de luttes prolétariennes sur le modèle de 1917-23, l'initiative de mesures comme l'assurance maladie ou pour le plein emploi est directement venue de l'appareil d'État capitaliste, de son aile gauche en particulier. Elles eurent pour effet d'augmenter la confiance de la classe ouvrière dans l'État et de diminuer sa confiance dans ses luttes propres ;
- même pendant les années du boom, la prospérité économique avait d'importantes limites. De grandes parties de la classe ouvrière, en particulier dans le Tiers-Monde mais, également, dans des poches importantes des pays centraux (par exemple, les ouvriers noirs et les blancs pauvres aux États-Unis) étaient exclus de ces avantages. Dans tout le "Tiers-Monde", l'incapacité du capital à intégrer les millions de paysans et de personnes d'autres couches, ruinés, dans le travail productif, a créé les prémices des bidonvilles hypertrophiés actuels, de la malnutrition et de la pauvreté mondiales. Et ces masses furent aussi les premières victimes des rivalités entre les blocs impérialistes, qui eurent pour conséquences des batailles sanglantes par procuration dans une série de pays sous-développés, de la Corée au Vietnam, du Moyen-Orient à l'Afrique du Sud et de l'Ouest ;
- une autre preuve de l'incapacité du capitalisme à véritablement améliorer la qualité de vie de la classe ouvrière réside dans la journée de travail. L'un des signes de "progrès" au 19e siècle fut la diminution continue de la journée de travail, de plus de 18 heures au tout début du siècle à la journée de 8 heures qui constituait l'une des principales revendications du mouvement ouvrier à la fin du siècle et qui a été formellement accordée dans les années 1900 et les années 1930. Mais depuis lors – et cela inclut également le boom d'après-guerre - la durée de la journée de travail est restée plus ou moins la même alors que le développement technologique, loin de libérer les ouvriers du labeur, a mené à la déqualification, au développement du chômage et à une exploitation plus intensive de ceux qui travaillent, à des temps de transport de plus en plus longs pour aller au travail et au développement du travail continu même en dehors du lieu de travail grâce aux téléphones mobiles, aux ordinateurs portables et à internet ;
- quels que soient les acquis apportés pendant le boom d'après-guerre, ils ont été grignotés de façon plus ou moins continue au cours des 40 dernières années et, avec la dépression imminente, ils sont maintenant l'objet d'attaques bien plus massives et sans perspective de répit. Au cours des quatre dernières décennies de crise, le capitalisme a été relativement prudent dans sa façon de baisser les salaires, d'imposer un chômage massif et de démanteler les allocations sociales de l'État-providence. Les violentes mesures d'austérité qui sont imposées aujourd'hui dans un pays comme la Grèce constituent un avant-goût de ce qui attend les ouvriers partout ailleurs.
Au niveau social plus large, le fait que le capitalisme ait été en déclin pendant une période aussi longue contient une énorme menace pour la capacité de la classe ouvrière à devenir "classe pour soi". Quand la classe ouvrière a repris ses luttes à la fin des années 1960, sa capacité à développer une conscience révolutionnaire était grandement entravée par le traumatisme de la contre-révolution qu'elle avait traversée – une contre-révolution qui s'était présentée elle-même dans une grande mesure dans un habit "prolétarien", celui du stalinisme, et avait rendu des générations d'ouvriers extrêmement méfiants vis-à-vis de leurs propres traditions et de leurs organisations. L'identification frauduleuse entre stalinisme et communisme fut même poussée à son extrême quand les régimes staliniens s'effondrèrent à la fin des années 1980, sapant encore plus la confiance de la classe ouvrière en elle-même et en sa capacité à apporter une alternative politique au capitalisme. Ainsi, un produit de la décadence capitaliste – le capitalisme d'État stalinien - a été utilisé par toutes les fractions de la bourgeoisie pour altérer la conscience de classe du prolétariat.
Au cours des années 1980 et 1990, l'évolution de la crise économique a fait que les concentrations industrielles et les communautés de la classe ouvrière dans les pays centraux ont été détruites, et une grande partie de l'industrie a été transférée dans des régions du monde où les traditions politiques de la classe ouvrière ne sont pas très développées. La création de vastes no man's land urbains dans beaucoup de pays développés amena avec elle un affaiblissement de l'identité de classe et, plus généralement, l'émoussement des liens sociaux ayant pour contrepartie la recherche de fausses communautés qui ne sont pas neutres mais ont des effets terriblement destructeurs. Par exemple, des secteurs de la jeunesse blanche exclus de la société subissent l'attraction de bandes d'extrême-droite comme la English Defence League en Grande Bretagne ; d'autres de la jeunesse musulmane qui se trouvent dans la même situation matérielle sont attirés par les politiques fondamentalistes islamistes et jihadistes. De façon plus générale, on peut voir les effets corrosifs de la culture des bandes dans quasiment tous les centres urbains des pays industrialisés, même si ses manifestations connaissent l'impact le plus spectaculaire dans les pays de la périphérie comme au Mexique où le pays est aux prises avec une guerre civile quasi permanente et incroyablement meurtrière entre des gangs de la drogue, dont certains sont directement liés à des fractions de l'État central non moins corrompu.
Ces phénomènes –la perte effrayante de toute perspective d'avenir, la montée d'une violence nihiliste– constituent un poison idéologique qui pénètre lentement dans les veines des exploités du monde entier et entravent énormément leur capacité à se considérer comme une seule classe, une classe dont l'essence est la solidarité internationale.
A la fin des années 1980, il y eut des tendances dans le CCI à considérer les vagues de luttes des années 1970 et 1980 comme avançant d'une façon plus ou moins linéaire vers une conscience révolutionnaire. Cette tendance fut vivement critiquée par Marc Chirik qui, sur la base d'une analyse des attentats terroristes en France et de l'implosion soudaine du bloc de l'Est, fut le premier à développer l'idée que nous entrions dans une nouvelle phase de la décadence du capitalisme qui fut décrite comme une phase de décomposition. Cette nouvelle phase était fondamentalement déterminée par une sorte d'impasse globale, une situation où ni la classe dominante, ni la classe exploitée n'étaient capables de mettre en avant leur alternative propre pour l'avenir de la société : la guerre mondiale pour la bourgeoisie, la révolution mondiale pour la classe ouvrière. Mais comme le capitalisme ne peut jamais être immobile et que sa crise économique prolongée était condamnée à toucher de nouveaux fonds, en l'absence de toute perspective, la société était condamnée à pourrir sur pied, apportant à son tour de nouveaux obstacles au développement de la conscience de classe du prolétariat.
Que l'on soit ou non d'accord avec les paramètres du concept de décomposition défendu par le CCI, ce qui est essentiel, dans cette analyse, c'est que nous sommes dans la phase terminale du déclin du capitalisme. La preuve que nous assistons aux dernières étapes du déclin du système, à son agonie mortelle, n'a fait qu'augmenter au cours des dernières décennies au point qu'un sentiment général d' "apocalypse" – une reconnaissance du fait que nous sommes au bord de l'abîme - se répand de plus en plus. 17 Et pourtant, au sein du mouvement politique prolétarien, la théorie de la décadence est loin de faire l'unanimité. Nous examinerons certains des arguments à l'encontre de cette notion dans le prochain article.
Gerrard
1 Lire le précédent article dans la Revue internationale n° 147, "Décadence du capitalisme : le boom d'après-guerre n'a pas renversé le cours du déclin du capitalisme [27]".
2 En réponse à l'essai de Marcuse L'homme unidimensionnel – Essai sur l'idéologie de la société avancée, 1964 (en français en 1968).
3 Voir dans la Revue internationale n° 146, "Décadence du capitalisme : pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme [28]".
4 Marx et Keynes, les limites de l'économie mixte, Éditions Gallimard 1972, chapitre XIV "L'économie mixte".
5 Ibid., chapitre XIX, "L'impératif impérialiste".
6 Ibid., chapitre XXII, "Valeur et socialisme".
7 Ibid., chapitre XX, "Capitalisme d'État et économie mixte".
8 Ibid., chapitre XIX, "L'impératif impérialiste".
9 Une autre faiblesse dans Marx et Keynes est l'attitude méprisante de Mattick envers Rosa Luxemburg et le problème qu'elle avait soulevé concernant la réalisation de la plus-value. Il ne fait qu'une seule référence directe à Luxemburg dans son livre : "Et, au début du siècle actuel, la marxiste Rosa Luxemburg voyait dans ce même problème [la réalisation de la plus-value] la raison objective des crises et des guerres ainsi que de la disparition finale du capitalisme. Tout cela n'a pas grand-chose à voir avec Marx qui, tout en estimant, il va de soi, que le monde capitaliste réel était en même temps processus de production et processus de circulation, soutenait néanmoins que rien ne peut circuler qui n'a été produit au préalable, et accordait pour ce motif la priorité aux problèmes de la production. Dès lors que seule la création de plus-value permet une expansion accélérée du capital, quel besoin a-t-on de supposer que le capitalisme se trouvera ébranlé dans la sphère de la circulation ?" (page 116, chapitre IX, "La crise du capitalisme")
A partir de la tautologie "rien ne peut circuler qui n'a été produit au préalable" et de l'idée marxiste "qu'une création adéquate de plus-value permet une expansion accélérée du capital", Mattick effectue une déduction abusive en prétendant que la plus-value en question pourra nécessairement être réalisée sur le marché. Le même type de raisonnement est encore présent dans un passage précédent : "La production marchande crée son propre marché dans la mesure où elle est capable de convertir la plus-value en capital additionnel. La demande du marché concerne tant les biens de consommation que les biens capitaux. Mais seuls ces derniers sont accumulables, le produit consommé étant par définition appelé à disparaître. Et seule la croissance du capital sous sa forme matérielle permet de réaliser la plus-value en dehors des rapports d'échange capital-travail. Tant qu'il existe une demande convenable et continue de biens capitaux, rien ne s'oppose à ce que soient vendues les marchandises offertes au marché." (page 97, chapitre VIII, "La réalisation du la plus-value"). Ceci est contradictoire avec le point de vue de Marx selon lequel "le capital constant n'est jamais produit pour lui-même, mais pour l'emploi accru dans les sphères de production dont les objets entrent dans la consommation individuelle" (Le Capital, Livre III, Éd. La Pléiade Économie II. p 1075). En d'autres termes, c'est la demande de moyens de consommation qui tire la demande en moyens de production, et non l'inverse. Mattick lui-même reconnaît (dans Crises et théories des crises) cette contradiction entre sa propre conception et certaines formulations de Marx, comme celle qui précède.
Mais nous ne voulons pas entrer une fois de plus dans ce débat ici. Le problème principal, c'est que bien que Mattick ait bien sûr considéré Rosa Luxemburg comme une marxiste et une révolutionnaire authentiques, il s'est joint au courant de pensée qui rejette le problème qu'elle posait à propos du processus d'accumulation comme un non-sens extérieur au cadre de base du marxisme. Comme nous l'avons montré, ça n'a pas été le cas de tous les critiques de Luxemburg, de Roman Rosdolsky par exemple (voir notre article dans la Revue internationale n° 142 : "Rosa Luxemburg et les limites de l'expansion du capitalisme [29]".)
Cette démarche en grande partie sectaire a toujours énormément entravé le débat entre les marxistes sur ce problème depuis.
10 fr.internationalism.org/brochures/decadence [30]
11 Lire Revue internationale n° 132, "Décadence du capitalisme : la révolution est nécessaire et possible depuis un siècle [31]" (2008).
Pour plus de détails et de statistiques concernant l'évolution globale de la crise historique, son impact sur l'activité productive, le niveau de vie des travailleurs, etc., lire l'article dans ce n° : "Le capitalisme est-il un mode de production décadent et pourquoi ?"
12 Republié en partie dans la Revue internationale n° 59 [32] (1989).
13 Ceci ne veut évidemment pas dire que l'humanité est plus en sécurité dans un système impérialiste qui devient de plus en plus chaotique. Au contraire, sans la discipline imposée par l'ancien système de blocs, des guerres locales et régionales encore plus dévastatrices sont de plus en plus probables et leur potentiel destructeur s'est considérablement accru avec la prolifération des armes nucléaires. En même temps, comme elles pourraient très bien éclater dans des zones éloignées des centres capitalistes, elles sont moins dépendantes d'un autre élément qui a retenu la poussée vers la guerre mondiale depuis le début de la crise à la fin des années 1960 : la difficulté à mobiliser la classe ouvrière des pays centraux du capitalisme dans une confrontation impérialiste directe.
14 www.nationalgeographic.com/science/article/111109-world-energy-outlook-2011 [33]
15 www.theguardian.com/environment/2011/dec/11/global-climate-change-treaty-durban [34]
16 https://www.washingtonpost.com/national/environment/warming-arctic-opens-way-to-competition-for-resources/2011/05/15/AF2W2Q4G_story.html [35]
17 Voir par exemple The Guardian, "The news is terrible. Is the world really doomed? [36]", A. Beckett, 18/12/2011.
Questions théoriques:
- Décadence [37]
Rubrique:
Revue Internationale n° 149 - 2e trimestre 2012
- 1419 reads
Massacres en Syrie, crise iranienne, .... La menace d'un cataclysme impérialiste au Moyen-Orient
- 1456 reads
En Syrie, chaque jour qui passe apporte son nouveau lot de massacres. Ce pays a rejoint les terrains des guerres impérialistes au Moyen-Orient. Après la Palestine, l’Irak, l’Afghanistan et la Libye, voici maintenant venu le temps de la Syrie. Malheureusement, cette situation pose immédiatement une question particulièrement inquiétante. Que va-t-il se passer dans la période à venir? En effet, le Proche et le Moyen-Orient dans leur ensemble paraissent au bord d'un embrasement dont on voit difficilement l'aboutissement. Derrière la guerre en Syrie, c’est l’Iran qui attise aujourd’hui toutes les peurs et les appétits impérialistes, mais tous les principaux brigands impérialistes sont également préparés à défendre leurs intérêts dans la région. Celle-ci est sur le pied de guerre, une guerre dont les conséquences dramatiques seraient irrationnelles et destructrices pour le système capitaliste lui-même.
Destruction de masse et chaos en Syrie. Qui est responsable?
Pour le mouvement ouvrier international, comme pour tous les exploités de la terre, la réponse à cette question ne peut être que la suivante: le responsable et le seul, c’est le capital. C'était déjà le cas pour les boucheries des Première et Seconde Guerres mondiales. Mais aussi des guerres incessantes qui, depuis celles-ci, ont fait à elles seules plus de morts que ces deux guerres mondiales réunies. Il y a un peu plus de 20 ans, George Bush, alors président des Etats-Unis, et ceci bien avant que son propre fils n’accède à la Maison Blanche, déclarait d’un air triomphant "que le monde entrait dans un nouvel ordre mondial". Le bloc soviétique s’était littéralement écroulé. L’URSS disparaissait et, avec elle, devaient disparaître également toutes les guerres et les massacres. Grâce au capitalisme enfin triomphant et sous le regard bienveillant et protecteur des États-Unis, la paix allait désormais régner dans le monde. Que de mensonges encore une fois démentis immédiatement par la réalité. N’est-ce pas ce même président qui allait, peu après ce discours cynique et hypocrite, déclencher la première guerre d’Irak?
En 1982 l'armée syrienne avait réprimé dans le sang la population révoltée de la ville de Hama. Le nombre de victimes n'a jamais pu être déterminé avec certitude: les estimations varient entre 10.000 et 40.000.[1] Personne à l'époque n'avait parlé d'intervention pour secourir la population, personne n'avait exigé le départ de Hafez El-Assad, père de l'actuel président syrien. Le contraste avec la situation actuelle n'est pas mince! La raison en est qu'en 1982, la scène mondiale était encore dominée par la rivalité entre les deux grands blocs impérialistes. Malgré le renversement du Shah d'Iran par le régime des Ayatollahs au début 1979 et l'invasion russe de l'Afghanistan un an après, la domination américaine sur la région n'avait pas été contestée par les autres grandes puissances impérialistes et elle était à même de garantir une relative stabilité.
Depuis lors les choses ont bien changé: l'effondrement du système des blocs et l'affaiblissement du "leadership" américain donnent libre cours aux appétits impérialistes des puissances régionales que sont l'Iran, la Turquie, l'Égypte, la Syrie, Israël... L'approfondissement de la crise réduit les populations à la misère et attise leur sentiment d'exaspération et de révolte face aux régimes en place.
Si aujourd'hui aucun continent n’échappe à la montée des tensions inter-impérialistes, c’est au Moyen-Orient que se concentrent tous les dangers. Et, au centre de ceux-ci, nous trouvons en premier lieu la Syrie, après plusieurs mois de manifestations contre le chômage et la misère et qui impliquaient des exploités de toutes origines: Druzes, Sunnites, Chrétiens, Kurdes, hommes, femmes et enfants tous unis dans leurs protestations pour une vie meilleure. Mais la situation dans ce pays a pris une sinistre tournure. La contestation sociale y a été entraînée, récupérée, sur un terrain qui n’a plus rien à voir avec ses raisons d’origine. Dans ce pays, où la classe ouvrière est très faible et les appétits impérialistes très forts, cette triste perspective était, en l’état actuel des luttes ouvrières dans le monde, pratiquement inévitable.
Au sein de la bourgeoisie syrienne, tous se sont jetés tels des charognards sur le dos de cette population révoltée et en détresse. Pour le gouvernement en place et les forces armées pro Bachar Al-Assad, l’enjeu est clair. Il s’agit de garder le pouvoir à tout prix. Pour l’opposition, dont les différents secteurs sont prêts à s’entretuer et que rien ne réunit si ce n’est la nécessité de renverser Bachar el-Assad, il s’agit de prendre ce même pouvoir. Lors des réunions de ces forces d’opposition à Londres et à Paris, il y a peu de temps, aucun ministre ou service diplomatique n’a voulu préciser leur composition. Que représente le Conseil national syrien ou le Comité national de coordination ou encore l’Armée syrienne libre? Quel pouvoir ont en leur sein les Kurdes, les Frères musulmans ou les djihadistes salafistes? Ce n’est qu’un ramassis de cliques bourgeoises, chacune rivalisant avec les autres. Une des raisons pour lesquelles le régime d'Assad n'a pas encore été renversé, c'est qu'il a pu jouer sur les rivalités internes à la société syrienne. Ainsi, les chrétiens voient d'un mauvais œil la montée des islamistes et craignent de subir le même sort que les coptes en Égypte ; une partie des Kurdes essaie de négocier avec le régime; et ce dernier garde le soutien de la minorité religieuse alaouite dont fait partie la clique présidentielle.
De toute façon, le Conseil national n’existerait pas militairement et politiquement de manière significative s'il n’était pas soutenu par des forces extérieures, chacune essayant de tirer ses marrons du feu. Au nombre d’entre elles, il faut citer les pays de la Ligue arabe, Arabie Saoudite en tête, la Turquie, mais également la France, la Grande-Bretagne, Israël et les États-Unis.
Tous ces requins impérialistes prennent le prétexte de l’inhumanité du régime syrien pour préparer la guerre totale dans ce pays. Par l’intermédiaire du média russe La voix de Russie, relayant la chaîne de télévision publique iranienne Press TV, des informations ont été avancées selon lesquelles la Turquie s’apprêterait, avec le soutien américain, à attaquer la Syrie. A cet effet, l’État turc masserait troupes et matériels à sa frontière syrienne. Depuis lors, cette information a été reprise par l’ensemble des médias occidentaux. En face, en Syrie, des missiles balistiques sol-sol de fabrication russe ont été déployés dans les régions de Kamechi et de Deir ez-Zor, à la frontière de l’Irak. Car le régime de Bachar Al-Assad est lui-même soutenu par des puissances étrangères, notamment la Chine, la Russie et l’Iran.
Cette bataille féroce des plus puissants vautours impérialistes de la planète à propos de la Syrie se mène également au sein de cette assemblée de brigands qui est dénommée ONU. En son sein, la Russie et la Chine avaient à deux reprises mis leur veto à des projets de résolution sur la Syrie, dont le dernier appuyait le plan de sortie de crise de la Ligue arabe prévoyant ni plus ni moins que la mise à l’écart de Bachar Al-Assad. Après plusieurs jours de tractations sordides, l’hypocrisie de tous s’est encore étalée au grand jour. Le Conseil de sécurité des Nations unies, avec l'accord de la Russie et de la Chine, a adopté le 21 mars dernier une déclaration qui vise à obtenir un arrêt des violences, grâce à l’arrivée dans ce pays d’un envoyé spécial de renom, monsieur Kofi Annan, tout cela n’ayant par ailleurs bien entendu aucune valeur contraignante. Ce qui veut dire en clair que cela n’engage en réalité que ceux qui y croient. Tout cela est sordide.
La question que nous pouvons nous poser est alors bien différente. Comment se fait-il que, pour le moment, aucune puissance impérialiste étrangère impliquée dans cet affrontement n'ait encore frappé directement – évidemment en défense de ses intérêts nationaux - comme ce fut par exemple le cas en Libye, il y a seulement quelques mois? Principalement parce les fractions de la bourgeoisie syrienne s’opposant à Bachar Al-Assad le refusent officiellement. Elles ne veulent pas d’une intervention militaire massive étrangère et elles le font savoir. Chacune de ces fractions a très certainement la crainte légitime de perdre dans ce cas-là toute possibilité de diriger elle-même le pouvoir. Mais ce fait ne constitue pas une garantie que la menace de la guerre impérialiste totale, qui est aux portes de la Syrie, ne fasse pas irruption dans ce pays dans la période qui vient. En fait, la clé de la situation réside certainement ailleurs.
On ne peut que se demander pourquoi ce pays attise aujourd’hui autant d’appétits impérialistes de par le monde. La réponse à cette question se trouve à quelques kilomètres de là. Il faut tourner les yeux vers la frontière orientale de la Syrie pour découvrir l’enjeu fondamental de cette empoignade impérialiste et du drame humain qui en découle. Celui-ci a pour nom Iran.
L’Iran au cœur de la tourmente impérialiste mondiale
Le 7 février dernier le New York Times déclarait: "La Syrie c’est déjà le début de la guerre avec l’Iran". Une guerre qui n’est pas encore déclenchée directement, mais qui est là, tapie dans l’ombre du conflit syrien.
En effet le régime de Bachar Al-Assad est le principal allié régional de Téhéran et la Syrie constitue une zone stratégique essentielle à l’Iran. L'alliance avec ce pays permet en effet à Téhéran de disposer d'une ouverture directe sur l’espace stratégique méditerranéen et israélien, avec des moyens militaires directement au contact de l’État hébreu. Mais cette guerre potentielle, qui avance cachée, trouve ses racines profondes dans l’enjeu vital que représente le Moyen-Orient au moment où se déchaînent de nouveau toutes les tensions guerrières contenues dans ce système pourrissant.
Cette région du monde est un grand carrefour qui se situe à la croisée de l’Orient et de l’Occident. L’Europe et l’Asie s’y rencontrent à Istanbul. La Russie et les pays du Nord regardent par-dessus la Méditerranée le continent africain et les vastes océans. Mais, plus encore, alors que l’économie mondiale a commencé à vaciller sur ses bases, l’or noir devient une arme économique et militaire vitale. Chacun doit tenter de contrôler son écoulement. Sans pétrole n’importe qu’elle usine se retrouve à l’arrêt, tout avion de chasse reste cloué au sol. Cette réalité fait partie intégrante des raisons pour lesquelles tous ces impérialismes s’impliquent dans cette région du monde. Pourtant, toutes ces considérations ne constituent pas les motifs les plus opérants et pernicieux qui poussent cette région dans la guerre.
Depuis maintenant plusieurs années, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et l’Arabie Saoudite ont été les chefs d’orchestre d’une campagne idéologique anti-iranienne. Cette campagne vient de connaître un violent coup d’accélérateur. En effet, le tout récent rapport de l’Agence Internationale de l’Energie atomique (AIEA) laisse entendre une possible dimension militaire aux ambitions nucléaires de l’Iran. Et un Iran possédant l’arme atomique est insupportable pour bon nombre de pays impérialistes de par le monde. La montée en puissance d’un Iran nucléarisé, s’imposant dans toute la région, est totalement insupportable pour tous ces requins impérialistes, d'autant plus que le conflit israélo-palestinien y maintient une instabilité permanente. L'Iran est totalement encerclé militairement. L’armée américaine est installée à proximité de toutes ses frontières. Quant au Golfe Persique, il regorge d’une telle quantité de bâtiments de guerre de tous ordres que l’on pourrait le traverser sans se mouiller les pieds! L’État israélien ne cesse de proclamer qu’il ne laissera jamais l’Iran posséder la bombe atomique et, selon ses dires, l'Iran devrait en être doté dans un délai maximum d’un an. L’affirmation proclamée haut et fort à la figure du monde est effrayante car ce bras de fer est très dangereux: l’Iran n’est pas l’Irak, ni même l’Afghanistan. C'est un pays de plus de 70 millions d’habitants avec une armée "respectable".
Des conséquences catastrophiques majeures
Économiques
Mais l'utilisation de l'arme atomique par l'Iran n'est pas le seul danger, ni le plus important: ces derniers temps, les dirigeants politiques et religieux iraniens ont affirmé qu’ils riposteraient par tous les moyens à leur disposition si leur pays était attaqué. Celui-ci dispose d'un moyen de nuisance dont personne n’est en mesure d’évaluer la portée. En effet, si l’Iran était conduit à empêcher, y compris en coulant ses propres bateaux, toute navigation dans le détroit d’Ormuz, la catastrophe serait mondiale.
Une partie considérable de la production mondiale de pétrole ne pourrait plus parvenir à ses destinataires. L’économie capitaliste en pleine crise de sénilité serait alors automatiquement entraînée dans une tempête de force maximale. Les dégâts seraient incommensurables sur une économie déjà particulièrement malade.
Écologiques
Les conséquences écologiques peuvent être irréversibles. Attaquer des sites atomiques iraniens, qui sont enterrés sous des milliers de tonnes de béton et de mètres cubes de terre, nécessiterait une attaque aérienne tactique aux moyens de frappes atomiques ciblées. C'est ce qu’expliquent les experts militaires de toutes ces puissances impérialistes. Si tel était le cas, que deviendrait l’ensemble de la région du Moyen-Orient? Quelles seraient les retombées sur les populations et l'écosystème, y compris à l’échelle planétaire? Tout ceci n’est pas le produit d’une imagination morbide sortie du cerveau d'un Docteur Folamour totalement fou. Ce n’est pas non plus un scénario pour un nouveau film catastrophe. Ce plan d’attaque fait partie intégrante de la stratégie étudiée et mise en place par l’État israélien et, avec plus de recul pour le moment, par les États-Unis. L’État-major de l’armée israélienne étudie, dans ses préparatifs, la possibilité, en cas d’échec d’une attaque aérienne plus classique, de passer à ce stade de destruction. La folie gagne un capital en pleine décadence.
Humanitaires
Depuis le déclenchement des guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye au cours des années précédentes, le chaos le plus total règne dans ces pays. La guerre s’y poursuit interminablement. Les attentats sont quotidiens et meurtriers. Les populations tentent désespérément de survivre au jour le jour. La presse bourgeoise l’affirme: "L’Afghanistan est sujet à une lassitude générale. A la fatigue des Afghans répond la fatigue des occidentaux". (Le Monde du 21-03-2012) Si, pour la presse bourgeoise, tout le monde semble fatigué de la poursuite sans fin de la guerre en Afghanistan, pour la population ce n’est pas de fatigue qu’il s’agit mais d’exaspération et d’abattement. Comment survivre dans une telle situation de guerre et de décomposition permanente? Et en cas de déclenchement de la guerre en Iran, la catastrophe humaine serait d'une ampleur encore plus considérable. La concentration de la population, les moyens de destruction qui seraient employés laissent entrevoir le pire. Le pire, c’est un Iran à feu et à sang, un Moyen-Orient plongé dans un chaos total. Aucun de ces assassins de masse à la tête des instances dirigeantes civiles et militaires n’est capable de dire où la guerre en Iran s’arrêterait. Que se passerait-il dans les populations arabes de toutes ces régions? Que feraient les populations chiites? Cette perspective est tout simplement humainement effroyable.
Des bourgeoisies nationales divisées, des alliances impérialistes au bord d’une crise majeure
Le fait même d’entrevoir seulement une petite partie de ces conséquences effraie les secteurs de la bourgeoisie qui tentent de garder un minimum de lucidité. Le journal koweïtien Al-Jarida vient de laisser filtrer une information, relayant ainsi comme à son habitude les messages que les services secrets israéliens veulent faire connaître publiquement. Son dernier directeur Meir Dagan vient en effet d’affirmer "que la perspective d’une attaque contre l’Iran est la plus stupide idée dont il ait jamais entendu parler." Tel est l’avis qui semble également exister au sein de l’autre officine des forces secrètes de sécurité externe israélienne: le Shin Bet.
Il est de notoriété publique que toute une partie de l’état-major israélien ne souhaite pas cette guerre. Mais il est également connu qu'une partie de la classe politique israélienne, rassemblée derrière Netanyahou, veut son déclenchement au moment jugé le plus propice pour l’État hébreu. En Israël, pour des raisons de choix de politique impérialiste, la crise politique couve sous les braises d’une guerre possible. En Iran, le chef religieux Ali Khamenei s’affronte également sur cette question avec le président de ce pays, Mahmoud Ahmadinejad. Mais ce qui est le plus spectaculaire, c’est le bras de fer que se livrent les États-Unis et Israël sur cette question. L’administration américaine ne veut pas, pour le moment, d’une guerre ouverte avec l’Iran. Il faut dire que l'expérience américaine en Irak et en Afghanistan n'est guère probante, et que l'administration Obama a préféré jusqu'ici se fier aux sanctions de plus en plus lourdes. La pression des États-Unis sur Israël, pour que cet État patiente, est énorme. Mais l’affaiblissement historique du leadership américain se fait même sentir sur son allié traditionnel au Moyen-Orient. Israël affirme haut et fort que, de toute manière, il ne laissera pas l’Iran posséder l’arme atomique, quel que soit l’avis de ses plus proches alliés. La main de fer de la surpuissance américaine continue à s’affaiblir et même Israël conteste maintenant ouvertement son autorité. Pour certains commentateurs bourgeois, il pourrait s’agir là potentiellement d’une première rupture du lien États-Unis/ Israël, jusqu’ici indéfectible.
Le joueur majeur de la région immédiate est la Turquie, avec les forces armées les plus importantes du Moyen-Orient (plus de 600 000 en service actif). Alors que ce pays était autrefois un allié indéfectible des États-Unis et un des rares amis d'Israël, avec la montée du régime Erdogan la fraction plus "islamiste" de la bourgeoisie turque est tentée de jouer sa propre carte d'islamisme "démocratique" et "modéré". De ce fait, elle essaie de profiter des soulèvements en Égypte et en Tunisie. Et cela explique aussi le revirement de ses relations avec la Syrie. Il fut un temps où Erdogan prenait ses vacances avec Assad mais, à partir du moment où le leader syrien a refusé d'obtempérer aux exigences d'Ankara et de traiter avec l'opposition, l'alliance a été rompue. Les efforts de la Turquie d'exporter son propre "modèle" d'islam "modéré" sont d'ailleurs en opposition directe avec les tentatives de l'Arabie Saoudite d'accroître sa propre influence dans la région en s'appuyant sur le wahhabisme ultra-conservateur.
La possibilité du déclenchement d’une guerre en Syrie, et peut être ensuite en Iran, est à ce point présente que les alliés de ces deux pays que sont la Chine et la Russie réagissent de plus en plus fortement. Pour la Chine, l'Iran est d'une grande importance puisqu'elle lui fournit 11% de ses besoins énergétiques [2]. Depuis sa percée industrielle, la Chine est devenue un nouveau joueur de taille dans la région. Au mois de décembre dernier, elle mettait en garde contre le danger de conflit mondial autour de la Syrie et de l'Iran. Ainsi elle déclarait par la voix du Global Times [3]: "L’Occident souffre de récession économique, mais ses efforts pour renverser des gouvernements non occidentaux en raisons d’intérêts politiques et militaires est à son point culminant. La Chine, tout comme son voisin géant la Russie, doit rester en alerte au plus haut niveau et adopter les contre-mesures qui s’imposent" [4]. Même si une confrontation directe entre les grandes puissances impérialistes du monde n'est pas envisageable dans le contexte mondial actuel, de telles déclarations mettent en évidence le sérieux de la situation.
Le capitalisme marche tout droit vers l’abîme
Le Moyen-Orient est une poudrière et certains sont tout près d’y mettre le feu. Certaines puissances impérialistes envisagent et organisent froidement l’utilisation de certaines catégories d’armes atomiques dans une prochaine guerre éventuelle contre l’Iran.
Des moyens militaires sont déjà prêts et disposés stratégiquement à cet effet. Comme, dans le capitalisme agonisant, le pire est toujours le plus probable, nous ne pouvons pas écarter totalement cette éventualité. Dans tous les cas, la fuite en avant du capitalisme devenu entièrement sénile et obsolète conduit l’irrationalité de ce système toujours plus loin. La guerre impérialiste, portée à un tel niveau, s’apparente à une réelle autodestruction du capitalisme. Que le capitalisme, maintenant condamné par l’histoire, disparaisse n’est pas un problème pour le prolétariat et pour l’humanité. Malheureusement cette destruction du système par lui-même va de pair avec la menace d'une destruction totale de l’humanité. Cette constatation de l’enfoncement du capitalisme dans un processus de destruction de la civilisation ne doit pas nous conduire à l’abattement, au désespoir ou à la passivité. Dans cette même revue, au premier trimestre de cette année, nous écrivions ceci: "La crise économique n’est pas une histoire sans fin. Elle annonce la fin d’un système et la lutte pour un autre monde." Cette affirmation s'appuie sur l’évolution de la réalité de la lutte de classe internationale. Cette lutte mondiale pour un autre monde vient de commencer. Certes difficilement et à un rythme encore lent, mais elle est maintenant bien présente et en marche vers son développement. C’est cette force à nouveau en mouvement, dont la lutte des Indignés en Espagne au printemps dernier en est, pour le moment, l’expression la plus marquante, qui nous permet d’affirmer qu’existent potentiellement les capacités de faire disparaître toute cette barbarie capitaliste de la surface de notre planète.
Tino (11 avril 2012)
[3] Journal d’actualité internationale appartenant à l’officiel Quotidien du Peuple.
[4] Rapporté par www.solidariteetprogres.org/Iran-La-Chine-ne-doit-pas-reculer-devant-une... [41].
Géographique:
- Moyen Orient [42]
Mobilisations massives en Espagne, Mexique, Italie, Inde, ... Le barrage syndical contre l'auto-organisation et l'unification des luttes
- 2178 reads
Alors même que les gouvernements de tous les pays s’acharnent à imposer des plans d’austérité de plus en plus violents, les mobilisations de 2011 - le mouvement des Indignés en Espagne, en Grèce, etc., et les occupations aux États-Unis et autres pays - se sont poursuivies durant le premier trimestre 2012. Les luttes se heurtent cependant à une puissante mobilisation syndicale qui parvient à entraver sérieusement le processus d’auto-organisation et d’unification commencé en 2011.
Comment s’affranchir de la tutelle syndicale? Comment retrouver et vivifier les tendances apparues en 2011? Quelles sont les perspectives? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter d’apporter quelques éléments de réponse.
Les manifestations massives
Nous commencerons par rappeler brièvement les luttes (cf. notre presse territoriale pour une chronique plus détaillée de chacune d’entre elles).
En Espagne, les coupes sociales brutales (dans l’éducation, la santé et les services de base) et l’adoption d’une "Réforme du travail", qui simplifie les procédures de licenciement et permet aux entreprises des baisses immédiates de salaire, ont provoqué de grandes manifestations, particulièrement à Valence, mais aussi à Madrid, Barcelone et Bilbao.
En février, la tentative de créer un climat de terreur policière dans la rue, en prenant comme têtes de Turcs les élèves de l’enseignement secondaire à Valence, a provoqué une série de manifestations massives où des étudiants et des travailleurs de toutes les générations sont descendus dans la rue pour lutter au coude à coude avec les lycéens. La vague de protestations s’est étendue dans tout le pays, générant des manifestations à Madrid, Barcelone, Saragosse, Séville, qui étaient bien souvent spontanées ou décidées au cours d’assemblées improvisées([1]).
En Grèce, une nouvelle grève générale en février a favorisé des manifestations massives dans tout le pays. Y ont participé les employés des secteurs public et privé, des jeunes et des vieux, des chômeurs; même des flics s’y sont joints. Les travailleurs de l’hôpital de Kilki ont occupé les locaux, appelé à la solidarité et à la participation de l’ensemble de la population, lançant un appel à la solidarité internationale([2]).
Au Mexique, le gouvernement a concentré le gros de ses attaques contre les travailleurs de l’enseignement, en attendant de les généraliser vers d’autres secteurs, dans un contexte de dégradation générale des conditions de vie dans un pays dont on dit par ailleurs qu’il est "blindé contre la crise". Malgré l’encadrement syndical extrêmement fort, les enseignants ont massivement manifesté dans le centre de Mexico([3]).
En Italie ont éclaté en janvier plusieurs luttes contre l’avalanche de licenciements et les mesures adoptées par le nouveau gouvernement: chez les cheminots, dans des entreprises comme Jabil ex-Nokia, Esselunga di Pioltello à Milan; FIAT à Termini Imerese, Cerámica Ricchetti à Mordado/Bologna; à la raffinerie de Trapani; chez les chercheurs précaires de l’hôpital Gasliani de Gênes, etc.; et, aussi, parmi des secteurs proches du prolétariat comme les camionneurs, les conducteurs de taxis, les bergers, pêcheurs, paysans… Cela dit, ces mouvements ont été très dispersés. Une tentative de coordination dans la région milanaise a échoué, restée prisonnière de sa vision syndicaliste([4]).
En Inde, que l’on considère communément avec la Chine comme "l’avenir du capitalisme", a éclaté une grève générale le 28 février, convoquée par plus de cent syndicats représentant 100 millions de travailleurs à travers tout le pays (mais qui n'ont pas tous été appelés à faire grève par leur syndicat, loin de là). Cette mobilisation a été saluée comme étant l’une des grèves les plus massives du monde à ce jour. Cependant elle a surtout été une journée de démobilisation, une façon de "lâcher la vapeur", en réponse à une vague croissante de luttes depuis 2010, dont le fer de lance a été celle des travailleurs de l’automobile (Honda, Maruti-Suzuki, Hyundai Motors). Ainsi, récemment, entre juin et octobre 2011, toujours dans les usines de production d’automobiles, les travailleurs avaient agi de leur propre initiative et n’avaient pas attendu les consignes syndicales pour se mobiliser, manifestant de fortes tendances à la solidarité et une volonté d’extension de la lutte à d’autres usines. Ils avaient aussi exprimé des tendances à l’auto-organisation et à la mise en place d’assemblées générales, comme lors des grèves à Maruti-Suzuki à Manesar, une ville nouvelle dont le développement est lié au boom industriel dans la région de Delhi. Au cours de cette lutte, les ouvriers ont occupé l’usine contre l’avis de “leur” syndicat. La colère ouvrière gronde, c’est pourquoi les syndicats se sont tous mis d’accord sur l’appel commun à la grève… pour faire face, unis, à… la classe ouvrière!([5]).
2011 et 2012: une seule et même lutte
Les jeunes, chômeurs et précaires ont été la force motrice des actions des Indignés et des Occupy en 2011, même si celles-ci ont mobilisé des travailleurs de tous âges. La lutte tendait alors à s’organiser autour d’assemblées générales, ce qui s’accompagnait d’une critique des syndicats, et n’avançait pas de revendications concrètes, se centrant sur l’expression de l’indignation et la recherche d’explications sur la situation.
En 2012, les premières luttes de riposte aux attaques des États se présentent sous une forme différente: leur fer de lance est constitué à présent par les travailleurs "installés" de 40-50 ans du secteur public, fortement soutenus par les "usagers" (pères de famille, parents des malades, etc.) et auxquels se joignent les chômeurs et la jeunesse. Les luttes se polarisent sur des revendications concrètes et la tutelle syndicale y est très présente.
Il semblerait alors qu’il s’agit de luttes "différentes" sinon "opposées", comme s’efforcent de nous le faire croire les différents medias. Les premières seraient "radicales", "politiques", animées par des "idéalistes n’ayant rien à perdre"; les secondes, par contre, seraient le fait de pères de familles imprégnés de conscience syndicaliste et qui ne veulent pas perdre "les privilèges acquis".
Une telle caractérisation de ces "deux types de luttes", qui occulte leurs tendances sociales communes profondes, a comme objectif politique de diviser et d’opposer deux ripostes nées du prolétariat, fruits de la maturation de sa conscience et exprimant un début de réponse à la crise, et qui doivent s’unir dans la perspective des luttes massives. Il s’agit réellement de deux pièces d’un puzzle qui doivent s’emboîter.
Cela ne sera cependant pas facile. La lutte où les travailleurs prennent une part de plus en plus active et consciente, en particulier dans les secteurs les plus avancés du prolétariat, devient une nécessité et sa première condition est un regard lucide sur toutes les faiblesses qui touchent le mouvement ouvrier.
Les mystifications
L’une d’elles est le nationalisme, qui affecte particulièrement la Grèce. Là, la colère provoquée par l’austérité insupportable est canalisée "contre le peuple allemand", dont la prétendue "opulence"([6]) serait à l’origine des malheurs du "peuple grec". Ce nationalisme est utilisé pour proposer des "solutions" à la crise basées sur "la récupération de la souveraineté économique nationale", vision autarcique que se partagent les staliniens et les néofascistes([7]).
La prétendue rivalité entre Droite et Gauche est une autre des mystifications avec lesquelles l’État essaie d’affaiblir la classe ouvrière. Nous pouvons particulièrement le voir en Italie et en Espagne. En Italie, l’éviction de Berlusconi, personnage particulièrement répugnant, a permis à la Gauche de créer une "euphorie artificielle" - "Nous sommes enfin libérés!" - qui a fortement joué dans la dispersion des ripostes ouvrières que nous avions pu voir au début des plans d’austérité imposés par le Gouvernement "technique" de Monti([8]). En Espagne, l’autoritarisme et la brutalité de la répression qui caractérisent traditionnellement la Droite ont permis aux syndicats et aux partis de gauche d’attribuer la responsabilité des attaques à la "méchanceté" et à la vénalité de la droite et de détourner le mécontentement vers la "défense de l’État social et démocratique". En ce sens, il existe une convergence des mystifications de ces forces traditionnelles de l'encadrement de la classe ouvrière que sont les syndicats et les partis de gauche et avec celles plus récemment déployées par la bourgeoisie pour faire face au mouvement des indignés, en particulier DRY ("Democracia Real Ya !" - "La démocratie réelle, tout de suite"). Comme nous l'avons mis en évidence, "la stratégie de la DRY, au service de l’État démocratique de la bourgeoisie, consiste dans le fait de mettre en avant un mouvement citoyen de réformes démocratiques, pour essayer d’éviter que ne surgisse un mouvement social de lutte contre l’État démocratique, contre le capitalisme".[9]
Le barrage syndical
En 2011, la bourgeoisie en Espagne a été surprise par le mouvement des Indignés, qui est parvenu, paradoxalement, à développer assez librement les méthodes classiques de la lutte ouvrière: les assemblées massives, les manifestations non encadrées, les débats de masse, etc.([10]) du fait même qu’il s’est mobilisé non sur le terrain des entreprises mais dans la rue et que les jeunes et les précaires qui en constituaient la force motrice étaient fondamentalement méfiants envers toute institution "reconnue" telle que les syndicats.
Aujourd’hui, la mise en place de plans d’austérité est à l’ordre du jour de tous les États, particulièrement en Europe, provoquant un fort mécontentement et une combativité croissante. Ces États ne veulent pas se laisser surprendre et, à cette fin, ils accompagnent les attaques de tout un dispositif politique qui rend plus difficile l’émergence de cette lutte unie, auto-organisée et massive des travailleurs qui pousserait plus loin les tendances apparues en 2011.
Les syndicats sont le fer de lance de ce dispositif. Leur rôle est d’occuper tout le terrain social en proposant des mobilisations qui créent un labyrinthe où toutes les initiatives, l’effort, la combativité et l’indignation de masses croissantes de travailleurs ne peuvent s’exprimer ou pataugent dans un terrain miné par la division.
Nous voyons clairement cela dans l’une des armes de prédilection des syndicats: la grève générale. Dans les mains des syndicats, de telles mobilisations sans lendemain, qui rassemblent souvent un nombre important d'ouvriers, coupent la classe ouvrière de toute possibilité de prendre en charge sa lutte en vue d'en faire un instrument d'une riposte massive aux attaques de la bourgeoisie. En Grèce ont été convoquées pas moins de seize grèves générales en trois ans! Il y en a déjà eu trois au Portugal, une autre se prépare en Italie, une grève – limitée au secteur de l'enseignement! - est annoncée en Grande-Bretagne, nous avons déjà parlé de la grève en Inde fin février et, en Espagne, suite à la grève générale de septembre 2010, une autre est annoncée pour le 29 mars.
La multitude de grèves générales convoquées par les syndicats est bien sûr un indice de la pression exercée par les travailleurs, de leur mécontentement et de leur combativité. Mais, pour autant, la grève générale n’est pas un pas en avant sinon une façon de "lâcher la vapeur" face au mécontentement social([11]).
Le Manifeste communiste rappelle que "Le résultat véritable de leurs luttes est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs"; le principal acquis d’une grève se trouve dans l’unité, la conscience, la capacité d’initiative et d’organisation, la solidarité qui s'y manifestent, les liens actifs qu’elle permet de nouer.
Et ce sont ces acquis que précisément les convocations à la grève générale et les méthodes syndicales de lutte affaiblissent et dénaturent.
Les leaders syndicaux annoncent la grève générale et, dans un grand barouf médiatique de presse et de télévision, lancent de grandes proclamations invoquant "l’unité" mais, sur les lieux de travail, la "préparation" de la grève générale constitue en fait une immense manœuvre de division, d’affrontement et d’atomisation.
La participation à la grève générale est présentée comme relevant de la décision personnelle de chaque travailleur. Dans beaucoup d’entreprises, ce sont même les cadres de l’entreprise ou de l’administration publique qui les interrogent individuellement sur leur participation éventuelle, avec tout ce que cela suppose de chantage et d’intimidation. Voilà ce qu’il en est du droit de grève, "citoyen" et "constitutionnel"!
Cette manœuvre reproduit fidèlement le schéma mensonger de l’idéologie dominante selon laquelle chaque individu est autonome et indépendant, devant décider "en son âme et conscience" ce qu’il doit faire. La grève serait un autre de ces mille dilemmes angoissants que la vie nous impose dans cette société et auxquels nous devons répondre seuls dans le plus grand des désarrois: dois-je accepter ce travail? Dois-je profiter de telle occasion? Dois-je acheter tel objet? Pour qui vais-je voter? Est-ce que je vais faire grève? De ces dilemmes, nous sortons avec le sentiment d’être encore plus aliénés; c’est le monde de la concurrence, de la lutte de tous contre tous, du chacun pour soi, c'est-à-dire la quintessence de cette société.
Les jours qui précèdent la grève générale voient proliférer les scènes de conflits et de tensions entre travailleurs. Chacun s’affronte à d’angoissantes questions: vais-je faire grève sachant qu’elle ne donnera rien? Est-ce que je laisse tomber mes camarades qui font grève? Puis-je me payer le luxe de perdre un jour de salaire? De perdre mon emploi? Chacun se voit pris entre deux feux: d’un côté les syndicalistes qui culpabilisent celui qui n’y participe pas, de l’autre les chefaillons qui profèrent toutes sortes de menaces. C’est un véritable cauchemar d’affrontements, de divisions et de tensions entre travailleurs, exacerbé par la question du "service minimum" qui est une nouvelle source de conflits([12]).
Le monde capitaliste fonctionne comme une addition de millions de "libres décisions individuelles". En réalité, aucune de ces décisions n’est libre mais est esclave d’un complexe réseau de rapports aliénants: de l’infrastructure des rapports de production - la marchandise et le travail salarié - jusqu’à l’immense structure des rapports juridiques, militaires, idéologiques, religieux, politiques, policiers…
Marx disait que "la véritable richesse intellectuelle de l'individu dépend entièrement de la richesse de ses rapports réels"[13], ces derniers étant le pilier de la lutte prolétarienne et de la force sociale qui, seule, pourra détruire le capitalisme, alors que les convocations syndicales dissolvent les rapports sociaux et enferment les prolétaires dans l’isolement, l’enfermement corporatif, suppriment les conditions qui leur permettent de décider consciemment, le corps collectif des travailleurs en lutte.
C’est la capacité des travailleurs à discuter collectivement du pour et du contre d’une action qui leur donne leur force, car c’est dans ce cadre qu’ils peuvent examiner les arguments, les initiatives, les éclaircissements, prendre en compte les doutes, les désaccords, les sentiments, les réserves de chacun, dans ce cadre qu’ils peuvent prendre des décisions communes. C’est là la façon de réaliser une lutte où s’intègre le maximum de prolétaires avec leurs responsabilités et leurs convictions.
C’est précisément tout cela qui est jeté à la poubelle par les pratiques syndicales qui poussent à "oublier les parlottes" et les "sentimentalismes" au nom de la prétendue "force que donne le blocage de la production ou des services dans lesquels on travaille". La classe ouvrière tire sa force de la place centrale qu’elle occupe dans la production, du fait qu'elle produit la quasi-totalité des richesses que la bourgeoisie s’approprie. Ainsi, par la grève, les ouvriers sont potentiellement capables de bloquer toute la production et de paralyser l’économie. Mais, dans la réalité, l'arme du "blocage tout de suite" est souvent utilisée par les syndicats comme un moyen pour détourner les ouvriers de leur première priorité, développer la lutte à travers sa prise en charge et son extension[14]. Par ailleurs, dans la période de décadence du capitalisme, et de surcroît dans les périodes de crise comme celle que nous vivons, c’est le système capitaliste lui-même, avec son fonctionnement chaotique et contradictoire, qui se charge de paralyser la production et les services sociaux. Un blocage de la production - et d’autant plus de 24 heures! - est mis à profit par les capitalistes pour éliminer des stocks. En ce qui concerne les services, comme l’enseignement par exemple, la santé ou les transports publics, ce blocage est mis à profit par l’État pour faire s’affronter les travailleurs "usagers" à leurs camarades en grève!
Le combat pour une lutte unitaire et massive
Pendant les mouvements de 2011, des masses d’exploités avaient pu agir selon leurs propres initiatives et leurs aspirations les plus profondes, s’exprimer selon les méthodes classiques de la lutte ouvrière, héritées des révolutions russes de 1905 et de 1917, de Mai 68, etc. L’imposition actuelle de la tutelle syndicale rend plus difficile cette "expression libre" mais, cependant, celle-ci suit son cours. Contre la tutelle syndicale, commencent à surgir des initiatives ouvrières: en Espagne par exemple, nous en avons vu plusieurs expressions. Lors de la manifestation du 29 mars, à Barcelone, Castellón, Alicante, Valence, Madrid, des grévistes portaient leurs propres banderoles, formaient des piquets pour expliquer leur mobilisation, réclamaient le droit à la parole lors des meetings syndicaux, tenaient des assemblées alternatives… Il est significatif que ces initiatives s’inscrivent dans le même sens que celles qui se sont développées lors des événements en France en 2010 contre la réforme des retraites([15]).
Il s’agit de livrer le combat sur ce terrain piégé qui nous est imposé pour ouvrir la voie à l’authentique lutte prolétarienne. La tutelle des syndicats semble insurmontable mais les conditions murissent dans le sens de son usure croissante et, en conséquence, dans le sens du renforcement de la capacité d’autonomie du prolétariat.
La crise, qui dure depuis déjà cinq ans et menace de nouvelles convulsions, dissipe peu à peu les illusions sur une possible "sortie du tunnel", et révèle à son tour une préoccupation profonde quant au futur. La faillite croissante du système social devient de plus en plus évidente, avec tout ce que cela implique quant au mode de vie, aux rapports humains, à la pensée, à la culture… Alors que pendant la période où la crise n'était pas aussi aigüe, les travailleurs semblaient pouvoir suivre un chemin tout tracé à leur intention, malgré les souffrances souvent terribles qui accompagnent l’exploitation salariée, cette voie disparaît progressivement. Et cette dynamique est aujourd’hui mondiale.
La tendance qui s’est déjà exprimée en 2011 avec le mouvement des Indignés et des Occupy([16]) à prendre massivement la rue et les places est un autre puissant levier du mouvement. Dans la vie courante du capitalisme, la rue est un espace d’aliénation: embouteillages, foules solitaires qui achètent, vendent, gèrent, font des affaires… Que les masses s’emparent de la rue pour en faire "un autre usage" - des assemblées, des discussions massives, des manifestations - peut faire de celle-ci un espace de libération. Ceci permet aux travailleurs de commencer à entrevoir la force sociale qu’ils sont capables de constituer s’ils apprennent à agir de façon collective et autonome. Ils sèment pour l’avenir les premières graines de ce qui pourrait être le "gouvernement direct des masses" à travers lequel celles-ci s’éduqueront, se libèreront de tous les haillons que la société leur a collés au corps et trouveront la force pour détruire la domination capitaliste et construire une autre société.
Une autre des forces qui pousse le mouvement vers le futur se trouve dans la convergence de toutes les générations ouvrières dans la lutte. Ce phénomène s’est déjà vu il y a peu dans des luttes comme celle contre le CPE en France (2006)([17]) ou dans les révoltes de la jeunesse en Grèce (2008)([18]). La capacité de converger en une action commune de toutes les générations ouvrières est une condition indispensable pour mener à bien une lutte révolutionnaire. Lors de la Révolution russe de 1917, se côtoyaient dans le mouvement les prolétaires de tous âges, des enfants hissés sur les épaules des frères ou des pères jusqu’aux vieillards chenus.
Il s’agit d’un ensemble de facteurs qui ne va développer sa puissance ni immédiatement, ni facilement. De durs combats, animés par l’intervention persévérante des organisations révolutionnaires, ponctués de défaites souvent amères et de moments difficiles de confusion et de paralysie temporaire, seront encore nécessaires pour permettre la pleine éclosion de cette puissance. L’arme de la critique, une critique ferme des erreurs et des insuffisances, sera fondamentale pour aller de l’avant.
"Les révolutions prolétariennes, par contre, comme celles du XIXe siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà être accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et de se redresser à nouveau formidable en face d'elles, reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soit créée enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière, et que les circonstances elles-mêmes crient: Hic Rhodus, hic salta ! C'est ici qu'est la rose, c'est ici qu'il faut danser!"([19]).
C.Mir (27-3-12)
[1] Cf. en espagnol Por un movimiento unitario contra recortes y reforma laboral (voir https://es.internationalism.org/node/3323 [43]); Ante la escalada represiva en Valencia (voir https://es.internationalism.org/node/3324 [44]).
[3] Cf. en espagnol "Nuestra intervención en las movilizaciones del magisterio en México [46]".
[4] Cf. en italien https://it.internationalism.org/node/1147 [47]
[5] Cf. Journée de manifestation en Inde: grève générale ou pare-feu syndical; https://fr.internationalism.org/ri431/journee_de_manifestation_en_inde_g... [48]
[6] Oubliant délibérément les 7 millions de “mini-jobs” (rémunérés à 400 euros mensuels) que supporte la classe ouvrière en Allemagne.
[7] Une minorité de travailleurs en Grèce prend conscience de ce danger, c’est ainsi que les travailleurs de l’hôpital occupé de Kilkis lancent un appel à la solidarité internationale, tout comme les étudiants et professeurs de la faculté de droit occupée d’Athènes.
[8] Qui n’est même pas passé par la mascarade électorale!
[9] Lire notre article, "Le mouvement citoyen "Democracia Real Ya!": une dictature sur les assemblées massives"; /content/4693/mouvement-citoyen-democracia-real-ya-dictature-assemblees-massives [49].
[10] La bourgeoisie n’avait pas réellement laissé le champ libre au mouvement, elle avait utilisé contre lui des forces "nouvelles" mais inexpérimentées, comme DRY. Cf. "Le mouvement citoyen "Democracia Real Ya!": une dictature sur les assemblées massives".
[11] Si l’on en croit “l’inquiétude” ou “la colère” des grands chefs d’entreprise ou des dirigeants politiques, la grève générale semble grandement les inquiéter et évoquerait quelque chose comme une "révolution". Mais l’histoire a largement démontré que tout ce battage n’est que pure comédie, au-delà de ce que tel ou tel personnage de la classe dominante croit réellement.
[12] Rappelons ce que nous disions dans l’article "Rapport sur la lutte de classe" publié dans la Revue internationale no 117 (2004): "En 1921, pendant l'Action de mars en Allemagne, les scènes tragiques des chômeurs essayant d'empêcher les ouvriers de rentrer dans les usines étaient une expression de désespoir face au reflux de la vague révolutionnaire. Les récents appels des gauchistes français à empêcher les élèves de passer leurs examens [pendant le mouvement du printemps 2003 en France], le spectacle des syndicalistes ouest-allemands voulant empêcher les métallos est-allemands -qui ne voulaient plus faire une grève longue pour les 35 heures- de reprendre le travail [pendant la grève des métallos en Allemagne en 2003] sont des attaques dangereuses contre l'idée même de classe ouvrière et de solidarité. Elles sont d'autant plus dangereuses qu'elles alimentent l'impatience, l'immédiatisme et l'activisme décervelé que produit la décomposition. Nous sommes avertis: si les luttes à venir sont potentiellement un creuset pour la conscience, la bourgeoisie fait tout pour les transformer en tombeau de la réflexion prolétarienne" (https://fr.internationalism.org/rinte117/ldc.htm [50]).
[13] L’idéologie allemande, I "Feuerbach".
[14] Lire à ce propos notre article en deux parties, "Bilan du blocage des raffineries", écrit à propos du blocage des raffineries dans la lutte contre la réforme des retraites en France en 2010: https://fr.internationalism.org/ri418/bilan_du_blocage_des_raffineries_1ere_partie.html [51] et https://fr.internationalism.org/ri420/bilan_du_blocage_des_raffineries.html [52].
[15] Cf. Revue internationale no 144, “Mobilisation sur les retraites en France, riposte étudiante en Grande-Bretagne, révolte ouvrière en Tunisie”, https://fr.internationalism.org/node/4524 [53]. De fait, ces luttes de 2010 ont préparé politiquement et dans la pratique le terrain pour l’évolution de la conscience de classe en 2011.
[16] Pour un bilan de ces mouvements, voir “De l’indignation à l’espoir", https://fr.internationalism.org/icconlinz/2012/2011_de_l_indignation_a_l... [54]
[17] Cf. “Thèses sur le mouvement des étudiants”, Revue internationale no 125, https://fr.internationalism.org/rint125/france-etudiants [55]
[18] Cf. “Les révoltes de la jeunesse en Grèce confirment le développement de la lutte de classe", Revue internationale no 136, https://fr.internationalism.org/rint136/les_revoltes_de_la_jeunesse_en_g... [56]
[19] Marx, Le 18 de Brumaire de Louis Bonaparte, https://www.marxists.org/francais/marx/works/1851/12/brum3.htm [57].
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique (V)
- 1587 reads
Mai 1968
Nous publions la dernière partie de notre série de 5 articles sur la lutte de classe en Afrique française, centrée en particulier sur le Sénégal. Cette série couvre la période allant de la fin du 18e siècle jusqu'à 1968. Elle a commencé à être pubiée dans le n°145 de la Revue Internationale.
Mai 1968 en Afrique, expression de la reprise de la lutte de classe internationale
Il s’est effectivement produit un "Mai 68" en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, avec des caractéristiques très proches du "Mai français" (agitation étudiante en prélude à l’entrée en scène du mouvement ouvrier), ce qui n'est pas étonnant étant donnés les liens historiques entre la classe ouvrière de France et celle de l’ancienne colonie africaine.
Si le caractère mondial de "Mai 68" est admis par tous, en revanche son expression dans certaines zones du monde n’est que partiellement connue, voire tout bonnement ignorée:
"Cela s’explique en grande partie par le fait que ces événements se sont déroulés en même temps que d’autres de même nature un peu partout à travers le monde. Cette situation a facilité la tâche des analystes et propagandistes qui s’attachaient à brouiller la signification du Mai 68 sénégalais. En optant pour une lecture sélective insistant sur l'aspect étudiant et scolaire de la crise au détriment de ses autres dimensions." (Abdoulaye Bathily, Mai 1968 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie, Édit. Chaka, Paris 1992)
En fait le "Mai sénégalais" est plus connu en milieu étudiant: du monde entier, des étudiants envoyèrent des messages de protestation au gouvernement de Senghor qui réprimait leurs camarades africains. Signalons aussi que l’université de Dakar fut l’unique université existant dans les colonies de l’AOF, et ce jusqu’au lendemain de "l'indépendance", ce qui explique la présence en son sein d'un nombre important d'étudiants africains étrangers.
Les organes de presse bourgeois ont à l'époque des interprétations variées des causes du déclenchement du mouvement de Mai à Dakar. Pour certains, comme Afrique Nouvelle (catholique), c’est la crise de l’enseignement qui fut à l’origine du mouvement. Marchés Tropicaux et Méditerranéens (milieux d’affaires) considère qu'il est le prolongement du mouvement déclenché en France. Pour sa part, Jeune Afrique, avance la conjonction du mécontentement politique des étudiants et du mécontentement social des salariés.
Il existe un autre point de vue, consistant à faire le lien entre ce mouvement et la crise économique: c'est celui d'Abdoulaye Bathily, un des anciens acteurs de la célèbre révolte, alors qu'il était étudiant à l’époque; plus tard, en sa qualité de chercheur, il fera le bilan global de "Mai à Dakar". Nous lui donnons largement la parole dans cet article pour apporter son témoignage de l’intérieur.
Déroulement des événements
"Le mois de mai 1968 est resté dans l’histoire pour avoir été marqué, à travers le monde, par des bouleversements de grande ampleur dont les étudiants et lycéens ont servi de fer de lance. En Afrique, le Sénégal a été le théâtre très remarqué de la contestation universitaire et scolaire. De nombreux observateurs de l’époque en ont conclu que les événements de Dakar n’étaient rien d’autre que le prolongement de Mai 68 français. (…) Ayant participé directement, et à partir du niveau le plus élevé, à la lutte des étudiants de Dakar, en mai 68, cette thèse m’a toujours paru erronée. (…) L’explosion de Mai 68 a été sans aucun doute, préparée par un climat social particulièrement tendu. Elle fut l’aboutissement d’une agitation sans précédent des salariés des villes, des opérateurs économiques nationaux mécontents du maintien de la prépondérance française, des membres de la bureaucratie face au contrôle des rouages de l'État par l’assistance technique. La crise agricole contribua elle aussi à l’aggravation de la tension dans les villes et à Dakar, notamment en intensifiant l’exode rural (…). Le mémorandum de l’UNTS [Union Nationale des Travailleurs du Sénégal, NDLR] du 8 mai estimait la dégradation du pouvoir d’achat depuis 1961 à 92,4 %." (Bathily, ibid.)
C’est donc dans ce contexte que Dakar connut elle aussi un "Mai 68", entre le 18 mai et le 12 juin, qui faillit ébranler définitivement le régime pro-français de Senghor, avec grèves générales illimitées du monde étudiant puis du monde du travail, avant que le pouvoir en place n’arrive à bout du mouvement au moyen d'une féroce répression policière et militaire, tout en bénéficiant de l’appui décisif de l’impérialisme français.
Le "Mai sénégalais" fut précédé par plusieurs heurts avec le gouvernement Senghor, notamment entre 1966 et 1968, alors que les étudiants organisaient des manifestations de soutien aux luttes de "libération nationale" et contre le "néo-colonialisme" et "l’impérialisme".
De même, il y eut en milieu scolaire des "grèves d’avertissement". Une grève des cours fut déclenchée le 26 mars 1968 par les élèves du lycée de Rufisque (banlieue de Dakar) suite aux sanctions disciplinaires infligées à un lycéen. Le mouvement dura 3 semaines, installant les établissements scolaires de la région dans un climat d’agitation et de contestation du gouvernement.
Le détonateur du mouvement
Le déclenchement du mouvement de mai 1968 eut pour origine immédiate la décision du gouvernement du président Senghor de réduire le nombre de mensualités des bourses d’études de 12 à 10 par an, tout en diminuant fortement le montant alloué, en invoquant "la situation économique difficile que traverse le pays".
"La nouvelle de la décision du gouvernement se répandit comme une traînée de poudre à la cité universitaire, causant partout l’inquiétude et suscitant un sentiment général de révolte. C’était le seul objet de conversations partout sur le campus. Dès son élection, le nouveau comité exécutif de l’UDES [Union Démocratique des Étudiants Sénégalais, NDLR] s’employa à développer l’agitation autour de la question des bourses en milieu étudiant, parmi les élèves des lycées et auprès des syndicats." (Bathily, ibid.)[1]
En effet, dès cette annonce gouvernementale, l’agitation s’installe et la contestation du gouvernement s’intensifie, notamment à la veille des élections que les étudiants dénoncent, comme le montre le titre d’un de leurs tracts: "De la situation économique et sociale du Sénégal à la veille de la mascarade électorale du 25 février…". L’agitation continue et, le 18 mai, les étudiants décident d’une "grève générale d’avertissement" suite à l’échec des négociations avec le gouvernement sur les conditions d’études, grève massivement suivie dans toutes les facultés.
Galvanisés par le franc succès de la grève et gonflés à bloc par le refus du gouvernement de satisfaire leurs revendications, les étudiants lancent un mot d’ordre de grève générale illimitée des cours et de boycott des examens à partir du 27 mai. Déjà, à la veille de cette date, les meetings se succèdent dans le campus et en milieu scolaire en général; bref, c’est l’épreuve de force avec le pouvoir. De son côté, le gouvernement s’empare de tous les médias officiels pour annoncer une série de mesures répressives contre les grévistes, tout en visant à opposer les étudiants, qualifiés de "privilégiés", aux travailleurs et aux paysans. Et l’Union Progressiste Sénégalaise (le parti de Senghor) de dénoncer la "position antinationale" du mouvement des étudiants, mais sans aucun écho cependant; bien au contraire, les campagnes du gouvernement ne font qu’aggraver la colère des étudiants et susciter la solidarité des salariés et de la population.
"Les meetings de l’UED (Union des étudiants de Dakar) constituaient des temps forts de l’agitation dans le campus. Ils enregistraient une influence considérable d’étudiants, d’élèves, d’enseignants, de jeunes chômeurs, d’opposants et, bien entendu, de nombreux agents de renseignement. Au fil du temps, ils constituaient le baromètre qui indiquait les mouvements de la contestation politique et sociale. Chaque meeting était une sorte de messe de l’opposition sénégalaise et de celles des autres pays présents dans le campus. Les interventions étaient ponctuées des morceaux de musique révolutionnaire du monde entier." (Bathily, ibid.)
Effectivement, on assiste là à une véritable veillée d’armes. De fait, le 27 mai à minuit, les étudiants en éveil entendent le bruit des bottes et voient l’arrivée massive d’un cordon policier autour de la cité universitaire. Dès lors une foule d’étudiants et d’élèves s'attroupe et converge vers les résidences en vue de monter des piquets de grève.
En fait, le pouvoir, en faisant encercler le campus universitaire par les forces de l’ordre, cherche à empêcher tout mouvement de l’extérieur vers l’intérieur et inversement.
"Ainsi, des camarades se virent privés de leurs repas et d’autres de leur lit car, comme l’UED a eu souvent à le dire, les conditions sociales sont telles que nombre de camarades mangent en ville (non boursiers) ou y dorment faute de logement à la cité universitaire. Même les étudiants en médecine qui soignaient leurs malades à l’hôpital restaient bloqués à la Cité en même temps que d’autres étudiants en urgence médicale. C’était l’exemple type de violation des franchises universitaires." (Bathily, ibid.)
Le 28 mai, lors d’une entrevue avec le Recteur et les doyens de l’université, l’UED demande la levée du cordon policier, tandis que les autorités universitaires exigent que les étudiants fassent une déclaration sous 24 heures "certifiant que la grève n’a pas pour but de renverser le gouvernement Senghor". Les organisations étudiantes répondent qu’elles n’étaient pas liées à un régime donné et que le temps qui leur est imparti ne permet pas de consulter leur base. Dès lors, le président du gouvernement ordonne la fermeture totale des établissements universitaires.
"Le groupe mobile d’intervention, renforcé par la police, sonna une nouvelle charge et investit les pavillons les uns après les autres. Il avait reçu l’ordre de dégager les étudiants par tous les moyens. Ainsi à coups de matraque, de crosse de fusil, baïonnettes, de grenades lacrymogènes et quelquefois offensives, défonçant portes et fenêtres, les sbires allèrent chercher les étudiants jusque dans leur chambre. Les gardes et les policiers se comportèrent en véritables pillards. Ils volèrent tout et brisèrent ce qui leur paraissait encombrant, déchirèrent les vêtements, les livres et les cahiers. Des femmes enceintes furent maltraitées et des travailleurs malmenés. Au pavillon des mariés, femmes et enfants furent frappés. Il y eut sur le champ un mort et beaucoup de blessés (une centaine) selon les chiffres officiels." (Bathily, ibid.)
L’explosion
La brutalité de la réaction du pouvoir provoque un élan de solidarité et renforce la sympathie envers le mouvement des étudiants. Dans tous les milieux de la capitale s’exprime une forte réprobation du comportement brutal du régime, contre les sévices policiers et l’internement d’un grand nombre d’étudiants. Au soir du 29 mai, tous les ingrédients sont réunis pour un embrasement social car l’effervescence est à son comble parmi les élèves et les salariés.
Ce sont les lycéens, déjà massivement présents lors des "grèves d’avertissement" du 26 mars et du 18 mai, qui se mettent les premiers en grève illimitée. Dès lors la jonction est réalisée entre le mouvement universitaire et le mouvement scolaire. Les uns après les autres, tous les établissements de l’enseignement secondaire se déclarent en grève totale et illimitée tout en formant des comités de lutte et en appelant à manifester avec les étudiants.
Inquiet de l’ampleur de la mobilisation de la jeunesse, ce même 29 mai, le président Senghor fait diffuser un communiqué dans les médias annonçant la fermeture sine die de tous les établissements scolaires (facultés, lycées, collèges) de la région de Dakar et de Saint-Louis, et appelant les parents d’élèves à retenir leurs enfants à la maison. Mais sans le succès escompté.
"La fermeture de l’université et des écoles ne fit qu’augmenter la tension sociale. Les étudiants qui avaient échappé aux mesures d’internement, les élèves et les jeunes se mirent à ériger des barricades dans les quartiers populaires comme la Médina, Grand Dakar, Nimzat, Baay Gainde, Kip Koko, Usine Ben Talli, Usine Nyari Talli, etc. Dans la journée des 29 et 30 notamment, des cortèges imposants composés de jeunes occupaient les principales artères de la ville de Dakar. Les véhicules de l’administration et des personnalités du régime étaient particulièrement recherchés. Selon la rumeur, de nombreux ministres furent ainsi contraints de renoncer à utiliser leurs voitures de fonction, les fameuses voitures de marque Citroën appelées DS 21. En effet, ce type de véhicule officiel symbolisait, aux yeux de la population et des étudiants et élèves en particulier, le "train de vie insolent de la bourgeoisie politico-bureaucratique et compradore". " (Bathily, ibid.)
Face à la combativité montante et à la dynamique du mouvement, le gouvernement décide de renforcer ses mesures répressives en les étendant à toute la population. Ainsi dès le 30 mai, un décret gouvernemental indique d’une part, que jusqu’à nouvel ordre, tous les établissements recevant du public (cinémas, théâtres, cabarets, restaurants, bars) sont appelés à fermer nuit et jour; d’autre part, les réunions, manifestations et attroupements de plus de 5 personnes interdits.
Grève générale des travailleurs
Face à ces mesures martiales et à la poursuite des brutalités policières contre la jeunesse en lutte, tout le pays s’agite et la révolte s’intensifie partout, cette fois-ci plus amplement chez les salariés. C’est alors que les appareils syndicaux traditionnels, notamment l’Union Nationale des Travailleurs du Sénégal, regroupant plusieurs syndicats, décident d’entrer en scène pour ne pas se faire déborder par la base.
"La base des syndicats pressait les directions à l’action. Le 30 mai, à 18 heures, l’union régionale UNTS du Cap-Vert (région de Dakar), à la suite d’une réunion conjointe avec le bureau national de l’UNTS, lança un mot d’ordre de grève illimitée à partir du 30 mai à minuit." (Bathily, ibid.)
Face à la situation explosive pour son régime, le président Senghor décide de s’adresser au pays et tient un discours menaçant envers les travailleurs, les exhortant à désobéir au mot d’ordre de grève générale, tout en accusant les étudiants d’être "téléguidés" de "l’étranger". Mais en dépit des menaces réelles du pouvoir allant jusqu’à donner des ordres de réquisition de certaines catégories de travailleurs, le mouvement de grève s’avère très suivi dans le public comme dans le privé.
Le 31 mai à 10 heures, des assemblées générales sont organisées à la bourse du travail auxquelles sont invitées les délégations des secteurs en grève afin de décider de la suite à donner au mouvement.
"Mais les forces de l’ordre avaient déjà bouclé le quartier. À 10 heures, l’ordre fut donné de charger les travailleurs à l’intérieur de la Bourse. Les portes et fenêtres furent défoncées, les armoires éventrées, les archives détruites. Les bombes lacrymogènes et les coups de matraque eurent raison des travailleurs les plus téméraires. En réponse aux brutalités policières, les travailleurs auxquels se mêlèrent les élèves et le lumpen proletariat, s’attaquèrent aux véhicules et magasins dont plusieurs furent incendiés. Le lendemain Abdoulaye Diack, secrétaire d'État à l’information, révélait devant la presse que 900 personnes avaient été interpellées dans la Bourse du Travail et ses environs. Parmi celles-ci, on comptait 36 responsables syndicaux dont 5 femmes. En réalité, au cours de la semaine de crise, pas moins de 3000 personnes avaient été interpellées. Certains dirigeants syndicaux furent déportés (…). Ces actes ne firent qu’accentuer l’indignation des populations et la mobilisation des travailleurs." (Bathily, ibid.)
En effet, aussitôt après cette conférence de presse au cours de laquelle le porte-parole du gouvernement donne ses chiffres sur les victimes, grèves, manifestations et émeutes ne font que s’intensifier jusqu’à ce que la bourgeoisie décide d’arrêter les frais.
"Les syndicats alliés du gouvernement et le patronat sentaient la nécessité de lâcher du lest pour éviter un durcissement au sein des travailleurs qui, au cours des manifestations, avaient pu prendre conscience de leur poids." (Bathily, ibid.)
Dès lors, après une série de réunions entre le gouvernement et les syndicats, le 12 juin, le président Senghor annonce un accord de fin de grève basé sur 18 points comprenant 15% d’augmentation de salaire. En conséquence, le mouvement prend fin officiellement à cette date-là, ce qui n’empêche pas la poursuite du mécontentement et le resurgissement d’autres mouvements sociaux, car la méfiance est de mise chez les grévistes vis-à-vis des promesses du pouvoir de Senghor. Et, de fait, quelques semaines après la signature de l’accord de fin de grève, des mouvements sociaux repartent de plus belle, avec des moments vigoureux, jusqu’au début des années 1970.
En fin de compte, il convient de souligner l’état de désarroi dans lequel s’est trouvé le pouvoir sénégalais au plus fort de sa confrontation au "mouvement de mai à Dakar":
"Du 1er au 3 juin, on avait l’impression que le pouvoir était vacant. L’isolement du gouvernement était démontré par l’inaction du parti au pouvoir. Devant l’ampleur de l’explosion sociale, les structures de l’UPS (parti de Senghor) n’ont pas réagi. La fédération des étudiants UPS s’est contentée de la distribution furtive de quelques tracts contre l’UDES au début des événements. Cette situation était d’autant plus frappante que l’UPS s’était vantée, trois mois plus tôt, d’avoir été plébiscitée à Dakar lors des élections législatives et présidentielles du 25 février 1968. Or, voilà qu’elle était incapable de trouver une riposte populaire face à ce qui se passait.
Selon la rumeur, les ministres avaient été consignés au building administratif, siège du gouvernement, et de hauts responsables du parti et de l'État s’étaient cachés dans leur maison. C’était là un bien curieux comportement pour des dirigeants d’un parti qui se disait majoritaire dans le pays. En un moment, le bruit avait couru que le président Senghor se serait réfugié à la base militaire française de Ouakam. Ces rumeurs étaient d’autant plus vraisemblables que les informations concernant la "fuite" du général de Gaulle en Allemagne, le 29 mai, étaient connues à Dakar." (Bathily, ibid.)
En effet, le pouvoir sénégalais a vraiment tangué et, en ce sens, il est tout à fait symptomatique de voir la quasi-simultanéité entre les moments où de Gaulle et Senghor cherchaient soutien ou refuge auprès de leur armée respective.
Par ailleurs, à l’époque, d’autres "rumeurs" plus persistantes indiquaient clairement que ce fut l’armée française, sur place, qui arrêta brutalement les manifestants qui marchaient sur le palais présidentiel en causant plusieurs morts et blessés.
Rappelons aussi que, pour venir à bout du mouvement, le pouvoir sénégalais n’utilisa pas seulement ses chiens de garde habituels, à savoir ses forces policières, mais il eut aussi recours aux forces les plus rétrogrades que sont les chefs religieux et les paysans des campagnes reculées. Au plus fort du mouvement, le 30 et le 31 mai, les chefs de cliques religieuses furent invités par Senghor à occuper les médias nuit et jour pour faire des déclarations condamnant la grève et exhortant les travailleurs à reprendre le travail.
Quant aux paysans, le gouvernement essaya de les dresser, sans succès, contre les grévistes, en les faisant venir en ville en soutien aux manifestations pro-gouvernementales.
"Les recruteurs avaient fait croire à ces paysans que le Sénégal avait été envahi à partir de Dakar par une nation appelée "Tudian" (étudiant) et qu’on faisant appel à eux pour défendre le pays. Par groupes, ces paysans furent déposés aux allées du Centenaire (actuel boulevard du général de Gaulle) avec leurs armes blanches (haches, coupe-coupes, lances, arcs et flèches).
Mais ils se rendirent bien vite compte qu’ils avaient été menés en bateau. (…) Les jeunes les dispersèrent à coups de pierres et se partagèrent les victuailles. (…) D’autres furent lapidés lors de leur passage à Rufisque. En tout état de cause, l’émeute révéla la fragilité des bases politiques de l’UPS et du régime en milieu urbain, à Dakar en particulier." (Bathily, ibid.)
Décidément, le pouvoir de Senghor aura utilisé tous les moyens y compris les plus obscurs pour venir à bout du soulèvement social contre son régime. Cependant, pour éteindre définitivement le feu, l’arme la plus efficace pour le pouvoir fut sans doute le rôle joué par Doudou Ngome, le chef du principal syndicat de l’époque, l’UNTS. Ce fut lui qui "négocia" les conditions de l’étouffement de la grève générale. D’ailleurs, en guise de remerciement, le président Senghor le nomma ministre quelques années plus tard. Voilà encore une illustration du rôle de briseur de grèves des syndicats qui, en compagnie de l’ex-puissance coloniale, sauvèrent définitivement la tête de Senghor.
Le rôle précurseur des lycéens dans le mouvement
"Les lycées de la région du Cap-Vert, déjà "chauffés" par la grève du lycée de Rufisque au mois d’avril, furent les premiers à entrer en action. Les élèves étaient d’autant plus prompts à investir la rue qu’ils se considéraient, à l’instar des étudiants, comme les victimes de la politique éducative du gouvernement et concernés en particulier par la politique de fractionnement des bourses. En tant que futurs étudiants, ils se disaient partie prenante de la lutte engagée par l’UDES. De Dakar, le mouvement de grève se répandit très rapidement dans les autres établissements secondaires du pays à partir du 27 mai. (…) La direction du mouvement des élèves était très instable, d’une réunion à l’autre les délégués, très nombreux, changeaient. (…) Un important noyau de grévistes très actifs se faisait également remarquer à l’école normale des jeunes filles de Thiès. Quelques dirigeants élèves s’installèrent même à la Cité et, à partir de là, coordonnaient la grève. Par la suite, un comité national des lycées et collèges d’enseignement général du Sénégal se constitua, devenant ainsi une sorte d’état-major du mouvement élève." (Bathily, ibid.)
L’auteur décrit là le rôle actif des lycéens dans le mouvement massif du Mai 68 local, en particulier la prise en main de la lutte à travers des assemblées générales et coordinations. En effet, dans chaque lycée, il y avait un comité de lutte et des assemblées générales se dotant de directions changeantes, élues et révocables.
Le magnifique engagement des lycéens et des lycéennes fut d’autant plus significatif que c’était la première fois dans l’histoire du pays que cette partie de la jeunesse se mobilisait avec ampleur en tant que mouvement social revendicatif devant la nouvelle bourgeoisie au pouvoir. Si le point de départ du mouvement fut une réaction de solidarité avec un camarade victime d’une "punition administrative", les lycéens, comme les étudiants et les salariés, prenaient aussi conscience de la nécessité de lutter contre les effets de la crise du capitalisme que le pouvoir de Senghor voulait leur faire payer.
L’impérialisme occidental au secours de Senghor
Au plan impérialiste, la France suivait de très près la crise provoquée par les événements de 1968 et pour cause, elle était vraiment chez elle au Sénégal. En effet, outre ses bases militaires (navales, aériennes et terrestres) implantées dans la zone de Dakar, dans chaque ministère et à la présidence, il y avait un "conseiller technique" désigné par Paris dans le but évident d’orienter la politique du pouvoir sénégalais, bien entendu dans le sens de ses intérêts.
On se rappelle à cet égard qu’avant d’être un des meilleurs "élèves" du bloc occidental, le Sénégal fut longtemps le principal bastion historique du colonialisme français en Afrique (de 1659 à 1960), et c’est bien à ce titre que le Sénégal participa, avec ses "tirailleurs", à toutes les guerres que la France dut mener dans le monde depuis la conquête de Madagascar au 19e siècle, en passant par les deux Guerres mondiales et par les guerres d’Indochine et d’Algérie. C’est donc en toute logique que la France mit naturellement à profit son rôle de "gendarme délégué" en Afrique pour le compte du bloc impérialiste occidental pour protéger, en utilisant tous les moyens à sa disposition, le régime de Senghor:
"Dès le lendemain des événements de 68, la France intervint auprès de ses partenaires de la CEE pour voler au secours du régime sénégalais. L'État n’avait pas les moyens pour faire face à l’ardoise découlant des négociations du 12 juin. Dans un discours du 13 juin, le président Senghor a expliqué que les accords avec les syndicats se chiffraient à 2 milliards CFA. Une semaine après ces négociations, le FED [Fonds européen de développement, NDLR] consentit à la Caisse de stabilisation des prix de l’arachide une avance de 2 milliards et 150 millions CFA "destinée à pallier les conséquences des fluctuations des cours mondiaux au cours de la campagne 1967/68". (…) Mais même les USA, qui avaient été pris à partie par le président Senghor pendant les événements, participèrent, avec les autres pays occidentaux, au rétablissement du climat de paix sociale au Sénégal. En effet, les USA et le Sénégal signèrent des accords portant sur la construction de 800 logements pour revenus moyens, pour un total de 5 millions de dollars." (Bathily, ibid.)
Ce faisant, il est clair que l’enjeu principal pour le bloc occidental fut d’éviter la chute du régime sénégalais et son basculement dans le camp des ennemis (la Chine et le bloc de l’Est).
De fait, après avoir repris le contrôle de la situation, le président Senghor prit aussitôt le chemin des "pays amis"; parmi eux l’Allemagne l’accueillit à Francfort, alors qu’il venait de réprimer dans le sang les grévistes sénégalais. Cet accueil de Francfort est d’ailleurs riche d’enseignements car Senghor y allait pour recevoir de l’aide et se faire "décorer" par un pays membre éminent de l’OTAN. De l’autre côté, cette visite fut l’occasion pour les étudiants allemands, à la tête desquels se trouvait "Dany le rouge", de manifester dans la rue leur soutien à leurs camarades sénégalais, comme le relate le journal Le Monde daté du 25/09/1968:
"Monsieur Daniel Cohn-Bendit arrêté dimanche à Francfort au cours de manifestations hostiles à Monsieur Léopold Senghor, Président du Sénégal, a été inculpé (en compagnie de 25 camarades) lundi après-midi par un magistrat allemand de la ville d’incitation à l’émeute et de rassemblement interdit (…)."
Dans leur lutte, les étudiants sénégalais purent recevoir également le soutien de leurs camarades à l’étranger qui occupaient souvent les ambassades et consulats du Sénégal. Le mouvement au Sénégal eut un écho en Afrique même:
"En Afrique, les événements de Dakar connurent leurs prolongements, grâce à l’action des unions nationales (syndicats étudiants). De retour dans leur pays, les étudiants africains expulsés de l’Université de Dakar poursuivirent leur campagne d’information. (…) Les gouvernements africains d’alors considéraient avec méfiance les étudiants venus de Dakar. Autant la plupart d’entre eux montrèrent une certaine irritation face à la manière dont leurs ressortissants avaient été expulsés, autant ils redoutaient la contagion de leurs pays par "la subversion venue de Dakar et de Paris"." (Bathily, ibid.)
A vrai dire, ce fut la quasi-totalité des régimes africains qui craignaient la "contagion" et la "subversion" de Mai 68. À commencer par Senghor lui-même qui dut recourir à de violents moyens répressifs contre la jeunesse scolarisée. Ainsi beaucoup de grévistes connurent la prison ou le service militaire forcé ressemblant fort à des déportations dans des camps militaires. De même de nombreux étudiants africains étrangers furent massivement expulsés, dont certains furent maltraités de retour chez eux.
Quelques enseignements des événements de Mai 68 à Dakar
Incontestablement, le "Mai à Dakar" est un des maillons de la chaîne du Mai 68 mondial. L’importance des moyens déployés par le bloc impérialiste occidental pour sauver le régime sénégalais se mesure à l'aune de la puissance du mouvement de lutte des ouvriers, étudiants et jeunes scolarisés.
Mais au-delà de la radicalité de l’action des étudiants, le mouvement de Mai 68 au Sénégal, avec sa composante ouvrière, venait de renouer avec l’esprit et la forme de lutte prolétarienne qu'avait pratiquée la classe ouvrière de la colonie de l’AOF dès le début du 20e siècle, mais que la bourgeoisie africaine au pouvoir avait réussi à étouffer, notamment durant les premières années de "l’indépendance nationale".
Mai 68 a été finalement plus qu’une ouverture sur un nouveau monde rompant avec la période contre-révolutionnaire, il a été un moment d’éveil pour beaucoup de protagonistes, en particulier chez les jeunes. De par leur engagement dans la lutte contre les forces du capital national, ils ont mis à nu nombre de mythes et d’illusions, notamment sur la "fin de la lutte des classes" sous prétexte de l’absence d’antagonismes entre la classe ouvrière (africaine) et la bourgeoisie (africaine).
Aussi, il convient de remarquer que, pour parvenir à vaincre le mouvement social, la répression policière et l’emprisonnement de milliers de grévistes furent insuffisants; à cela durent s’ajouter le piège syndical et l’appui décisif de la France et du bloc de l’Ouest à leur "poulain protégé". Mais il fallut aussi satisfaire une bonne partie des revendications des étudiants et des travailleurs par une forte augmentation des salaires.
Reste l’essentiel: les grévistes ne furent pas "endormis" très longtemps par l’accord qui mit fin à la grève car, dès l’année suivante, la classe ouvrière reprenait le combat de plus belle en s'inscrivant pleinement dans la vague internationale de luttes initiée par Mai 68.
Enfin, on aura noté dans ce mouvement le recours aux modes d’organisation véritablement prolétariens que sont les comités de grève et assemblées générales, haute expression d’auto-organisation; bref une claire volonté de prise en main des luttes par les grévistes eux-mêmes. Voilà un aspect particulier qui caractérise la lutte d’une fraction de la classe ouvrière mondiale, pleinement partie prenante du combat à venir pour la révolution communiste.
Lassou (fin)
[1] Il vaut ici la peine de rappeler ce que nous avons déjà signalé à l'occasion de la publication de la première partie de cet article dans la Revue Internationale n° 145. "Si nous reconnaissons largement le sérieux des chercheurs qui transmettent les sources de référence, en revanche nous ne partageons pas forcément certaines de leurs interprétations des évènements historiques. Il en est de même sur certaines notions, par exemple quand les mêmes parlent de "conscience syndicale" à la place de "conscience de classe" (ouvrière), ou encore "mouvement syndical" (au lieu de mouvement ouvrier). Reste que, jusqu’à nouvel ordre, nous avons confiance en leur rigueur scientifique tant que leurs thèses ne se heurtent pas aux faits historiques ou n’empêchent pas d’autres interprétations."
Critique du livre "Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme" : le capitalisme est-il un mode de production décadent et pourquoi ? (II)
- 3318 reads
La surproduction, contradiction de base du capitalisme, est liée à l'existence du salariat. Ses déterminations seront mises à nu dans cette seconde partie de l'article afin de pouvoir répondre aux grandes questions qui font l'objet de désaccords importants avec le livre de Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme[1] (identifiés MR et Dyn dans la suite de l'article): pourquoi augmenter les salaires des ouvriers ne résout pas le problème de la surproduction? D'où émane la demande extérieure à celle des ouvriers et quelles en sont le rôle et les limites? Existe-t-il une solution à la surproduction au sein du capitalisme? Comment caractériser les courants qui prônent la résolution des crises du capitalisme au moyen de l'augmentation des salaires? Le capitalisme est-il condamné à un effondrement catastrophique?
Existe-t-il une solution à la crise au sein du capitalisme ?
Les déterminations de la surproduction
La surproduction est la caractéristique des crises du capitalisme, par opposition aux crises des modes de production qui l'ont précédé et qui étaient, elles, caractérisées par la pénurie.
Elle résulte, en premier lieu, de la nature même de l'exploitation de la force de travail propre à ce mode de production, le salariat, qui fait que les ouvriers doivent toujours produire au-delà de leurs besoins. C'est cette caractéristique qu'exprime de la façon la plus fondamentale le passage suivant de Marx:
"Le simple rapport salarié-capitaliste implique que (…) la majorité des producteurs (les ouvriers) (…) Pour pouvoir consommer ou acheter dans les limites de leurs besoins, (…) doivent toujours être surproducteurs, toujours produire au-delà de leurs besoins."[2]
Cela suppose donc l'existence d'une demande extérieure à celle des ouvriers, cette dernière ne pouvant par essence jamais suffire à absorber la production capitaliste:
"On oublie que, selon Malthus, "l'existence même d'un profit sur n'importe quelle marchandise présuppose une demande extérieure à celle de l'ouvrier qui l'a produite", et que, par conséquent "la demande de l'ouvrier lui-même ne peut jamais être une demande adéquate" (Malthus, Principles … p.405)."[3]
C'est justement lorsque la demande extérieure à celle des ouvriers est insuffisante, que la surproduction se manifeste:
"si la "demande extérieure à celle des ouvriers eux-mêmes" disparaît ou s'amenuise, la crise éclate."[4]
La contradiction est d'autant plus violente que, d'un côté, le salaire des ouvriers est contraint au minimum social nécessaire pour reproduire leur force de travail et, de l'autre, les forces productives du capitalisme tendent à être développées au maximum:
"La raison ultime de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolu de la société"[5]
Pourquoi augmenter les salaires des ouvriers ne résout pas le problème de la surproduction?
Il existe différents procédés permettant à la bourgeoisie de masquer la surproduction:
1) Détruire la production en excédent, de manière à éviter que sa mise sur le marché ne tire vers le bas les prix de vente. C'est en particulier ce qui s'est passé dans les années 1970 et 80 avec la production agricole dans les pays de la Communauté économique européenne. Ce procédé présente pour la bourgeoisie l'inconvénient de révéler au grand jour les contradictions du système et de susciter l'indignation alors que les produits ainsi détruits font défaut, de façon vitale, à une partie importante de la population mondiale.
2) Réduire l'utilisation des capacités productives ou même détruire une partie de celles-ci. Une illustration de ce type de réduction drastique de la production avait été le plan Davignon mis en place dès 1977 par la Commission européenne pour réaliser la restructuration industrielle (avec des dizaines de milliers de licenciements à la clé) du secteur sidérurgique, face à la surproduction mondiale d'acier. Il s'était traduit par la destruction d'une grande partie du parc des hauts-fourneaux dans plusieurs pays européens et la mise à la rue de dizaines de milliers de sidérurgistes conduisant à des mouvements de lutte importants, notamment en France en 1978 et 1979.
3) Augmenter artificiellement la demande, c'est-à-dire générer une demande non pas tirée par des besoins en investissements devant être rentabilisés ultérieurement mais directement motivée par le besoin de faire tourner l'appareil productif. C'est typiquement le cas des mesures keynésiennes qui ont un coût assumé par l'État et qui, de ce fait, se répercutent nécessairement sur la compétitivité de l'économie nationale où elles sont appliquées. C'est la raison pour laquelle elles ne peuvent être mises en œuvre que dans des conditions permettant de compenser, grâce à des gains importants de productivité, la perte de compétitivité. De telles mesures peuvent tout aussi bien concerner l'augmentation des salaires que des programmes de travaux publics n'ayant pas une rentabilité immédiate.
Ces trois procédés, quoique différents dans la forme, ont exactement la même signification quant au développement du capitalisme et, dans le fond, ils peuvent se ramener au premier d'entre eux, le plus parlant, la destruction volontaire de la production. Cela peut paraître choquant, du point de vue ouvrier, d'entendre dire qu'une augmentation de salaire non justifiée par les besoins de la reproduction de la force de travail, revient à du gaspillage. Il s'agit bien évidemment de gaspillage du point de vue de la logique capitaliste (laquelle n'a que faire du bien-être de l'ouvrier), pour laquelle payer plus cher l'ouvrier n'augmentera en rien sa productivité.
MR, qui pense que le mécanisme à l'œuvre durant les Trente Glorieuses a été compris par peu de marxistes[6], n'a lui-même pas compris de Marx, ou pas voulu comprendre, que "le but de la production est la mise en valeur du capital et non sa consommation"[7] (Cité explicitement dans la suite de l'article), que cette consommation soit le fait de la classe ouvrière ou des bourgeois.
On peut appeler ce gaspillage "régulation", comme le fait MR sans reconnaître qu'il s'agit de gaspillage; cela lui permettra peut-être de rendre sa thèse plus présentable. Mais cela ne change en rien le fait que, dans une grande mesure, la prospérité des Trente Glorieuses est le gaspillage d'une partie des gains de productivité utilisés à produire pour produire.
D'où émane la demande extérieure à celle des ouvriers?
Pour MR, et contrairement à Rosa Luxemburg dont il critique la théorie de l'accumulation, la demande autre que celle de l'ouvrier peut parfaitement émaner du capitalisme lui-même, et non pas nécessairement de sociétés basées sur des rapports de production non encore capitalistes et qui ont longtemps coexisté avec le capitalisme.
Cette demande, selon Marx, n'émane ni des ouvriers ni des capitalistes eux-mêmes mais des marchés n'ayant pas encore accédé au mode de production capitaliste.
Dans son livre, MR mentionne l'opinion de Malthus à ce sujet: "Il est à noter que cette "demande autre que celle émanant du travailleur qui l'a produite" recouvre, sous la plume de Malthus, une demande interne au capitalisme pur puisqu'elle se réfère aux couches sociales dont le pouvoir d'achat est dérivé de la plus-value et non pas une demande extra-capitaliste selon la théorie luxemburgiste de l'accumulation" (Dyn p.27). Marx, soutenant en cela Malthus, est catégorique sur le fait que cette demande ne peut pas provenir de l'ouvrier: "La demande provoquée par le travailleur productif en personne ne peut jamais être une demande adéquate, puisqu'elle ne concerne pas la totalité de ce qu'il produit. Si tel était le cas, il n'y aurait pas de profit et par conséquent nul motif pour le capitaliste d'employer le travail de l'ouvrier."[8] Il est aussi explicite sur le fait que, pour Malthus, cette demande émane de "couches sociales dont le pouvoir d'achat est dérivé de la plus-value" mais, dans le même temps, il dénonce la motivation de Malthus qui est relative à la défense des intérêts du "clergé d'Église et d'État": "Malthus n’a pas intérêt à masquer les contradictions de la production bourgeoise; au contraire: il est de son intérêt de les souligner, d’une part pour prouver le caractère nécessaire des classes laborieuses (il l’est pour ce mode de production) et, d’autre part, pour démontrer aux capitalistes la nécessité d’un clergé d’Église et d’État bien gras, afin de créer une demande adéquate. […] Il souligne donc, contre les ricardiens, la possibilité d’une surproduction généralisée".[9] Ainsi, ce n'est pas parce que Malthus pense que la demande adéquate peut provenir des "couches sociales dont le pouvoir d'achat est dérivé de la plus-value" qu'il en est de même pour Marx. Au contraire, ce dernier est très explicite quant au fait que cette demande adéquate ne peut provenir ni des ouvriers ni des capitalistes: "La demande des ouvriers ne saurait suffire, puisque le profit provient justement du fait que la demande des ouvriers est inférieure à la valeur de leur produit et qu'il est d'autant plus grand que cette demande est relativement moindre. La demande des capitalistes entre eux ne saurait pas suffire davantage".[10]
A ce propos, on ne peut que relever une mauvaise volonté évidente de MR pour fournir à ses lecteurs les moyens d'élargir le champ de leur réflexion lorsqu'il s'agit de rapporter le point de vue de Marx sur la nécessité d'une demande autre que celle émanant des ouvriers et des capitalistes. Sinon, comment expliquer qu'il n'ait pas évoqué le passage suivant où Marx explicite la nécessité de "commandes au loin", de "marchés étrangers" pour vendre les marchandises produites:
"Comment est-il possible que parfois des objets manquant incontestablement à la masse du peuple ne fassent l'objet d'aucune demande du marché, et comment se fait-il qu'il faille en même temps chercher des commandes au loin, s'adresser aux marchés étrangers pour pouvoir payer aux ouvriers du pays la moyenne des moyens d'existence indispensables? Uniquement parce qu'en régime capitaliste le produit en excès revêt une forme telle que celui qui le possède ne peut le mettre à la disposition du consommateur que lorsqu'il se reconvertit pour lui en capital. Enfin, lorsque l'on dit que les capitalistes n'ont qu'à échanger entre eux et consommer eux-mêmes leurs marchandises, on perd de vue le caractère essentiel de la production capitaliste, dont le but est la mise en valeur du capital et non la consommation."[11] (Souligné par nous)
Il est vrai que la citation ne nous donne pas plus de précisions permettant de mieux caractériser la nature de ces "marchés étrangers", de ces "commandes" qui sont passées "au loin". Ceci dit, celle-ci étant explicite quant au fait que la demande en question ne peut pas émaner des capitalistes eux-mêmes, car le but de la production est la mise en valeur du capital et non pas sa consommation, à partir de là il n'est pas interdit de réfléchir. La demande en question ne peut pas, non plus, émaner de quelque autre agent économique au sein du capitalisme qui vit de la plus-value extraite et redistribuée par la bourgeoisie. Qui reste-t-il en fin de compte dans la société capitaliste? Personne et c'est pourquoi il faut s'adresser aux "marchés au loin", c'est-à-dire non encore conquis par les rapports de production capitalistes.
C'est exactement ce que nous dit le Manifeste communiste lorsqu'il décrit la conquête de la planète par la bourgeoisie, poussée par le besoin de débouchés toujours plus importants:
"Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe. Partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir, partout elle établit des relations. (…) Par suite du perfectionnement rapide de tous les instruments de production et grâce à l'amélioration incessante des communications, la bourgeoisie précipite dans la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bas prix de ses marchandises est la grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares les plus opiniâtrement xénophobes. Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, à adopter le mode de production bourgeois; elle les contraint d'importer chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit: elle en fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image."[12]
Marx nous fournit une description plus détaillée concernant la manière dont s'effectue l'échange avec des sociétés marchandes non capitalistes, aussi variées soient-elles, grâce auquel le capital bénéficie à la fois d'un débouché et d'une source d'approvisionnement nécessaires à son développement: "dans le processus de circulation où le capital industriel fonctionne soit comme argent, soit comme marchandise, son circuit s'entrecroise – comme capital-argent ou comme capital-marchandise – avec la circulation marchande des modes sociaux de production les plus divers, dans la mesure où celle-ci est en même temps production marchande. Il importe peu que les marchandises soient le fruit d'une production fondée sur l'esclavage, ou le produit de paysans (Chinois, ryots des Indes), de communes rurales (Indes hollandaises), d'entreprises d'État (comme on les rencontre aux époques anciennes de l'histoire russe, sur la base du servage), ou de peuples chasseurs demi-sauvages, etc.: comme marchandises et argent, elles affrontent l'argent et les marchandises qui représentent le capital industriel; elles entrent dans le circuit du capital industriel tout autant que dans le circuit de la plus-value véhiculée par le capital-marchandise et dépensée comme revenu; elles entrent donc dans les deux phases de circulation du capital-marchandise. Ce qui caractérise par conséquent le processus de circulation du capital industriel, c'est l'origine universelle des marchandises, l'existence du marché comme marché mondial."[13]
La fin de la phase d'accumulation primitive a-t-elle modifié les relations du capital avec sa sphère extérieure?
MR reproduit également la deuxième partie de la citation ci-dessus du Manifeste communiste, mais en prenant soin de souligner que "tous les ressorts et limites du capitalisme dégagés par Marx dans Le Capital ne l'ont été qu'en faisant abstraction des rapports avec sa sphère extérieure (non capitaliste). Plus précisément, Marx analyse ces derniers uniquement dans le cadre de l'accumulation primitive, car il se réservait de traiter les autres aspects de "l'extension du champ extérieur de la production" dans deux volumes spécifiques consacrés, pour l'un, au commerce international et, pour l'autre, au marché mondial". (Dyn p.36. Souligné par nous)
Il poursuit en affirmant que, pour lui, les "marchés étrangers" n'ont plus continué à jouer un rôle important pour le développement du capitalisme, une fois achevée la phase d'accumulation primitive: "Cependant, une fois ses fondements cimentés par trois siècles d'accumulation primitive, c'est essentiellement sur ses propres bases que le capitalisme s'est déployé. En regard de l'importance et du dynamisme pris par la production capitaliste, la contribution de son environnement extérieur est devenue relativement marginale pour son développement." (Dyn p.38)
Le raisonnement de Marx démontre, nous l'avons vu, la nécessité d'un marché extérieur. La description qu'il fait de cette sphère extérieure dans le Manifeste communiste montre qu'elle est constituée de sociétés marchandes n'ayant pas encore accédé aux relations de production capitalistes. Marx n'explique évidemment pas dans le détail pourquoi cette sphère doit être extérieure aux relations de production capitalistes, cependant il fait clairement découler sa nécessité des caractéristiques mêmes de la production capitaliste. Si, comme MR, Marx ou Engels avaient pensé que, depuis la première publication du Manifeste, des modifications importantes étaient intervenues concernant les relations du capital avec sa sphère extérieure, les "marchés au loin" ayant de cessé de jouer le rôle qu'ils avaient eu jusque-là durant l'accumulation primitive, on peut penser qu'ils auraient ressenti la nécessité d'en rendre compte dans les préfaces des éditions successives du Manifeste[14], alors que l'un et l'autre ont été témoin, sur des périodes différentes, de la marche triomphante du capitalisme après la phase d'accumulation primitive. Or, non seulement cela n'a pas été le cas mais encore le livre III est commencé en 1864 et "terminé" en 1875. On peut penser qu'à cette date-là Marx avait acquis déjà suffisamment de recul par rapport à la phase d'accumulation primitive (de la fin du Moyen-Âge jusqu'au milieu du 19e siècle) et, pourtant, il poursuit dans cet ouvrage l'idée du Manifeste communiste en invoquant, "les commandes au loin", "les marchés étrangers".
MR persiste dans sa thèse, en prétendant qu'elle correspond à la vision qu'avait Marx: "C'est pourquoi, nous pensons comme Marx que "la tendance à la surproduction" ne provient pas d'une insuffisance de marchés extra-capitalistes, mais bien du "rapport immédiat du capital" au sein du capitalisme pur: "Il va de soi que nous n'avons pas l'intention d'analyser ici en détail la nature de la surproduction; nous dégageons simplement la tendance à la surproduction qui existe dans le rapport immédiat du capital. Nous pouvons donc laisser de côté ici tout ce qui a trait aux autres classes possédantes et consommatrices, etc., qui ne produisent pas, mais vivent de leurs revenus, c'est-à-dire procèdent à un échange avec le capital et constituent autant de centres d'échange pour lui. Nous n'en parlerons que là où elles ont une importance véritable, c'est-à-dire dans la genèse du capital" (Grundrisse, chapitre sur le capital, Éditions 10/18. p.226)." (Dyn p.38)
Ce que dit la citation de Marx, c'est que, pour l'examen de la surproduction, on peut laisser de côté le rôle joué par les classes possédantes dans leurs échanges avec le capitalisme car, de ce point de vue, elles n'ont plus qu'un rôle marginal. Or, les classes possédantes ici nommées sont celles qui subsistent de l'ancien ordre féodal. Ce que la citation ne dit pas, en revanche, c'est ce que MR veut lui faire dire, à savoir que les "marchés étrangers", des "commandes" qui sont passées "au loin" n'ont plus qu'un rôle marginal face à la surproduction. Or c'est bien cela qui est au cœur de la polémique.
La théorie de l'accumulation de Rosa Luxemburg à l'épreuve
Il revient à Rosa Luxemburg d'avoir mis en évidence que l'enrichissement du capitalisme, comme un tout, dépendait des marchandises produites en son sein et échangées avec des économies précapitalistes, c'est-à-dire pratiquant l'échange marchand mais n'ayant pas encore adopté le mode de production capitaliste. Rosa Luxemburg n'a pas fait que développer l'analyse de Marx, elle en a également fait la critique dans L'Accumulation du capital lorsque c'était nécessaire, en ce qui concerne notamment les schémas de l'accumulation dont certaines erreurs résultaient, selon elle, du fait que ceux-ci ne font pas intervenir les marchés extra-capitalistes, pourtant indispensables à l'accomplissement de la reproduction élargie. Elle attribue cette erreur au fait que, Le Capital étant une œuvre inachevée, Marx réservait à des travaux ultérieurs l'étude du capital en lien avec son environnement.[15]
MR critique la théorie de l'accumulation de Rosa Luxemburg. Pour lui, en effet, c'est de façon délibérée et justifiée d'un point de vue théorique que Marx écarte, dans sa description de l'accumulation au moyen de schémas, la sphère des relations extra-capitalistes: "Appréhender la place que Marx attribue à cette sphère dans le développement historique du capitalisme permet de comprendre pourquoi il l'élimine de son analyse dans Le Capital: non pas seulement par hypothèse méthodologique comme le pense Luxemburg, mais parce qu'elle représente une entrave dont le capitalisme a dû se débarrasser. Ignorant cette analyse, Luxemburg n'a pas compris les raisons profondes pour lesquelles Marx écarte cette sphère dans Le Capital". (Dyn p.36) Sur quoi MR appuie-t-il une telle affirmation? Sur l'argument que nous avons réfuté précédemment, selon lequel pour lui et Marx, les "marchés lointains" n'auraient plus joué qu'un rôle marginal dans le développement du capitalisme après sa phase d'accumulation primitive.
MR avance trois autres arguments venant, selon lui, étayer sa critique de la théorie de l'accumulation de Rosa Luxemburg.
1) "Pour Rosa Luxemburg, la force du capital dépend de l'importance de la sphère précapitaliste et l'épuisement de celle-ci annonce sa mort. Marx soutient une compréhension opposée: "Tant que le capital est faible, il cherche à s'appuyer sur les béquilles d'un mode de production disparu ou en voie de disparition; sitôt qu'il se sent fort, il se débarrasse de ses béquilles et se meut conformément à ses propres lois" (Le Capital, p.295. Éd. La Pléiade Économie II). Cette sphère ne constitue donc pas un milieu dont le capitalisme devrait se nourrir pour pouvoir s'élargir, mais une béquille qui l'affaiblit et dont il doit se débarrasser pour être fort et se mouvoir conformément à ses propres lois." (Dyn p.36) Cette conclusion est pour le moins hâtive et tirée par les cheveux.[16] Le Manifeste contient d'ailleurs une idée très proche de celle de la citation de Marx ci-dessus empruntée au Capital, mais exprimée de manière telle que, contrairement à ce que pense MR, elle permet d'affirmer que le milieu précapitaliste a constitué un terreau nourricier pour le capitalisme:
"La grande industrie a fait naître le marché mondial, que la découverte de l'Amérique avait préparé. Le marché mondial a donné une impulsion énorme au commerce, à la navigation, aux voies de communication. En retour, ce développement a entraîné l'essor de l'industrie. À mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer prirent de l'extension, la bourgeoisie s'épanouissait, multipliant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan toutes les classes léguées par le Moyen Âge."[17] (souligné par nous)
On voit ici que, alors qu'il crée le marché mondial et qu'il se développe, ce n'est pas le marché mondial que le capitalisme rejette mais bien les classes léguées par le Moyen Âge qu'il refoule à l'arrière-plan.
2) "Les meilleures estimations des ventes à destination du tiers-monde montrent que la reproduction élargie du capitalisme ne dépendait pas des marchés extra-capitalistes en dehors des pays développés: "En dépit d'une opinion très répandue, il n'y a jamais eu, dans l'histoire du monde occidental développé, de période au cours de laquelle les débouchés offerts par les colonies, ou même l'ensemble du tiers-monde, aient joué un grand rôle dans le développement de ses industries. Le tiers-monde dans son ensemble ne représentait même pas un débouché très important [...] on peut estimer que le tiers-monde n'absorbait que 1,3% à 1,7% du volume total de la production des pays développés, dont seulement 0,6 à 0,9% pour les colonies" (Paul Bairoch, Mythes et paradoxes de l'histoire économique, p.104-105). Déjà très faible, ce pourcentage l'est en réalité bien plus puisque ce n'est qu'une partie des ventes au tiers-monde qui est destinée à la sphère extra-capitaliste". (Dyn p.39)
Nous traiterons de cette objection plus globalement en prenant en compte également la suivante: "Ce sont les pays disposant d'un vaste empire colonial qui connaissent les taux de croissance les plus faibles, alors que ceux vendant sur les marchés capitalistes ont des taux bien supérieurs! Ceci se vérifie tout au long de l'histoire du capitalisme, et en particulier aux moments où les colonies jouent, ou devraient jouer, leur plus grand rôle! Ainsi, au XIXème siècle, au moment où les marchés coloniaux interviennent le plus, tous les pays capitalistes non coloniaux ont connu des croissances nettement plus rapides que les puissances coloniales (71% plus rapides en moyenne – moyenne arithmétique des taux de croissance non pondérée par les populations respectives des pays). Il suffit de prendre les taux de croissance du PIB par habitant durant les 25 années d'impérialisme (1880-I913), que Rosa Luxemburg définissait comme la période la plus prospère et dynamique du capitalisme:
1) Puissances coloniales: Grande-Bretagne (1,06%), France (1,52%), Hollande (0,87%), Espagne (0,68%), Portugal (0,84%);
2) Pays très peu ou non coloniaux: USA (1,56%), Allemagne (1,85%), Suède (1,58%), Suisse (1,69%), Danemark (1,79%) (Taux de croissance annuel moyen; source: www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison [58])." (Dyn p.39 et 40)
Notre réponse à ce qui précède tient en quelques mots. Il est faux d'identifier marchés extra-capitalistes et colonies car les marchés extra-capitalistes incluent aussi bien les marchés intérieurs que les colonies non encore assujetties aux relations de production capitalistes. Pendant la période 1880-1913, tous les pays cités ci-dessus bénéficient au minimum de l'accès à leur propre marché extra-capitaliste intérieur, voire à celui d'autres pays industrialisés. De plus, du fait de la division internationale du travail, le commerce avec la sphère extra-capitaliste peut également bénéficier, indirectement, aux pays ne possédant pas directement de colonies.
Quant aux États-Unis, ils sont l'illustration type du rôle que jouent les marchés extra-capitalistes dans le développement économique et industriel. Après la destruction de l’économie esclavagiste des États du Sud par la Guerre civile (1861-1865), le capitalisme s’est étendu au cours des 30 années suivantes vers l’Ouest américain selon un processus continu qu’on peut résumer ainsi: massacre et nettoyage ethnique de la population indigène; établissement d’une économie extra-capitaliste à travers la vente et la concession de territoires nouvellement annexés par le gouvernement à des colons et de petits éleveurs; destruction de cette économie extra-capitaliste au moyen de la dette, la fraude et la violence, et extension de l’économie capitaliste. En 1898, un document du Département d’État américain expliquait: "Il semble à peu près certain que tous les ans nous aurons à faire face à une surproduction croissante de biens qui devront être placés sur les marchés étrangers si nous voulons que les travailleurs américains travaillent toute l'année. L'augmentation de la consommation étrangère des biens produits dans nos manufactures et nos ateliers est, d'ores et déjà, devenue une question cruciale pour les autorités de ce pays comme pour le commerce en général."[18]. Suivit alors une rapide expansion impérialiste: Cuba (1898), Hawaï (1898 également), Philippines (1899), la zone du canal de Panama (1903). En 1900, Albert Beveridge (un des principaux partisans de la politique impérialiste américaine) déclarait au Sénat: "Les Philippines sont à nous pour toujours (...). Et derrière les Philippines, il y a les marchés illimités de Chine (...). Le Pacifique est notre océan (...) Où trouver des consommateurs pour nos surplus? La géographie apporte la réponse. La Chine est notre client naturel." Il n'est nul besoin des "meilleures statistiques" pour prouver qu'un atout ayant permis aux États-Unis de devenir la première puissance mondiale avant la fin du 19e siècle consiste dans le fait qu'ils ont pu disposer d'un accès privilégié à de vastes marchés extra-capitalistes.
3) Voici un dernier argument présent dans le livre nécessitant un court commentaire: "La réalité est donc pleinement conforme à la vision de Marx, et exactement à l'opposé de la théorie de Rosa Luxemburg. Ceci s'explique aisément pour plusieurs raisons sur lesquelles nous ne pouvons nous étendre ici. Signalons rapidement qu'en règle générale, toute vente de marchandise sur un marché extra-capitaliste sort du circuit de l'accumulation et tend donc à freiner cette dernière. La vente de marchandises à l'extérieur du capitalisme pur permet bien aux capitalistes individuels de réaliser leurs marchandises, mais elle freine l'accumulation globale du capitalisme, car cette vente correspond à une sortie de moyens matériels du circuit de l'accumulation au sein du capitalisme pur." (Dyn p.40)
Loin de constituer une entrave à l'accumulation, la vente aux secteurs extra-capitalistes est un facteur qui la favorise. Non seulement ce qui est vendu à la sphère extra-capitaliste ne fait pas défaut à l'accumulation, grâce au dynamisme de ce mode de production qui, par nature, tend toujours à produire de façon excédentaire mais, de plus, elle permet à la sphère des relations de production capitaliste de recevoir des moyens de paiement (le produit de la vente) qui pourront, d'une manière ou d'une autre, accroître le capital accumulé.
L'examen des "arguments" de MR selon lesquels l'existence d'un important secteur extra-capitaliste n'avait pas constitué la condition de l'important développement du capitalisme, montre que ceux-ci ne sont pas consistants. Mais nous sommes évidemment disposés à prendre en compte toute critique concernant la méthode que nous avons employée dans notre propre critique.
Les limites du marché extérieur au capitalisme
L'existence en abondance de marchés extra-capitalistes dans les colonies a permis que, jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'excédent de la production des principaux pays industrialisés ait pu être écoulé. Mais au sein de ces pays, il subsistait aussi à cette époque, en quantité plus ou moins importante, des marchés extra-capitalistes (la Grande-Bretagne a été la première puissance industrielle à les avoir épuisés) servant également de déversoir à la production capitaliste. C'est pendant cette phase de la vie du capitalisme que les crises furent les moins violentes. "Si différentes qu'elles fussent à maints égards, toutes ces crises cependant présentent un point commun: elles font figure d'interruptions relativement brèves d'un gigantesque mouvement ascendant qu'une vue d'ensemble pourrait considérer comme continu".[19]
Mais les marchés extra-capitalistes n'étaient pas illimités, comme le soulignait Marx: "Du point de vue géographique, le marché est limité: le marché intérieur est restreint par rapport à un marché intérieur et extérieur, qui l’est par rapport au marché mondial, lequel - bien que susceptible d’extension - est lui-même limité dans le temps."[20]. C'est à l'Allemagne que s'imposa en premier cette réalité.
La phase du développement industriel le plus rapide de ce pays se situe à une époque où le partage des richesses du monde était à peu près achevé et où les possibilités de nouvelles poussées impérialistes se faisaient de plus en plus rares. En effet, cet État arrivait sur le marché mondial à un moment où les territoires naguère libres de toute domination européenne étaient presque tous répartis et réduits au rang de colonies ou semi-colonies de ces mêmes États industriels plus anciens et qui formaient, précisément, ses concurrents les plus redoutables. La surproduction et la nécessité d'exporter à tout prix constituent des facteurs qui orientent la politique extérieure de l'Allemagne dès le début du 20e siècle (voir à ce propos les développements du Conflit du siècle, pp.51, 53 et 151). Les restrictions d'accès aux marchés extra-capitalistes furent la conséquence de la transformation de ceux-ci, par les plus grandes puissances coloniales, en véritables chasses gardées. Si bien que le seuil du 20e siècle est marqué par le renforcement des tensions internationales nées de l'expansion impérialiste qui aboutiront à la conflagration mondiale de 1914, lorsque l'Allemagne prit l'initiative d'une guerre en vue d'un repartage du monde et de ses marchés.
MR signale à ce propos la grande disparité des analyses au sein de l'avant-garde révolutionnaire pour expliquer l'entrée en décadence que marque l'éclatement du premier conflit mondial: "Si cette sentence historique [le capitalisme entraîné dans une spirale de crises et de guerres] était communément partagée au sein du mouvement communiste, les facteurs qui étaient censés l'expliquer, l'étaient beaucoup moins". (Dyn p.47) Il omet cependant de relever la grande convergence de Rosa Luxemburg et Lénine autour de l'analyse d'une guerre pour le repartage du monde, Lénine s'exprimant sur ce sujet de la manière suivante: "… le trait caractéristique de la période envisagée, c'est le partage définitif du globe, définitif non en ce sens qu'un nouveau partage est impossible - de nouveaux partages étant au contraire possibles et inévitables - mais en ce sens que la politique coloniale des pays capitalistes en a terminé avec la conquête des territoires inoccupés de notre planète. Pour la première fois, le monde se trouve entièrement partagé, si bien qu'à l'avenir il pourra uniquement être question de nouveaux partages, c'est-à-dire du passage d'un "possesseur" à un autre, et non de la "prise de possession" de territoires sans maître."[21]
Qui dit nécessité de repartage du monde pour les pays les plus mal lotis en colonies, ne dit pas insuffisance des marchés extra-capitalistes relativement aux besoins de la production. C'est une identification qui a trop souvent été faite. En effet, il existe encore, au début du 20e siècle, des marchés extra-capitalistes en abondance (dans les colonies et au sein même des pays industrialisés) dont l'exploitation est encore capable de faire faire des bonds en avant très importants au développement du capitalisme. C'est ce que met en avant Rosa Luxemburg en 1907 dans son Introduction à l'économie politique: "À chaque pas de son propre développement, la production capitaliste s'approche irrésistiblement de l'époque où elle ne pourra se développer que de plus en plus lentement et difficilement. Le développement capitaliste en soi a devant lui un long chemin, car la production capitaliste en tant que telle ne représente qu'une infime fraction de la production mondiale. Même dans les plus vieux pays industriels d'Europe, il y a encore, à côté des grandes entreprises industrielles, beaucoup de petites entreprises artisanales arriérées, la plus grande partie de la production agricole, la production paysanne, n'est pas capitaliste. À côté de cela, il y a en Europe des pays entiers où la grande industrie est à peine développée, où la production locale a un caractère paysan et artisanal. Dans les autres continents, à l'exception de l'Amérique du Nord, les entreprises capitalistes ne constituent que de petits îlots dispersés tandis que d'immenses régions ne sont pas passées à la production marchande simple. (…) Le mode de production capitaliste pourrait avoir une puissante extension s'il devait refouler partout les formes arriérées de production. L'évolution va dans ce sens."[22]
C'est la crise de 1929 qui viendra signaler l'insuffisance des marchés extra-capitalistes subsistants, non pas de façon absolue mais au regard de la nécessité du capitalisme d'exporter des marchandises en quantités toujours plus importantes. Ces marchés n'étaient pas pour autant épuisés. Les progrès de l'industrialisation et des moyens de transport réalisés dans les métropoles capitalistes rendirent possible une meilleure exploitation des marchés existants, si bien qu'ils purent encore jouer un rôle au début des années 1950, en tant que facteur de la prospérité des Trente Glorieuses.
Cependant, à ce stade, était posée, selon Rosa Luxemburg, la question de l'impossibilité même du capitalisme: "Cependant, cette évolution enferme le capitalisme dans la contradiction fondamentale: plus la production capitaliste remplace les modes de production plus arriérés, plus deviennent étroites les limites du marché créé par la recherche du profit, par rapport au besoin d'expansion des entreprises capitalistes existantes. La chose devient tout à fait claire si nous nous imaginons pour un instant que le développement du capitalisme est si avancé que sur toute la surface du globe tout est produit de façon capitaliste, c'est-à-dire uniquement par des entrepreneurs capitalistes privés, dans des grandes entreprises, avec des ouvriers salariés modernes. L'impossibilité du capitalisme apparaît alors clairement."[23] Comment cette impossibilité allait-elle être surmontée? Nous y reviendrons plus avant en examinant la question de l'effondrement catastrophique du capitalisme.
Il n'existe pas de solution à la surproduction au sein du capitalisme
Du fait même qu'il n'est pas possible, sous le capitalisme, de résoudre les crises de surproduction en augmentant le salaire des ouvriers, ni d'augmenter indéfiniment la demande solvable extérieure à celle des ouvriers, la surproduction ne peut pas être dépassée au sein du capitalisme. En fait, elle ne peut réellement l'être que par l'abolition du salariat et donc le remplacement du capitalisme par la société des producteurs librement associés.
MR ne peut se résoudre à cette logique implacable et sans appel pour le capitalisme et ses réformateurs. En fait, il a beau citer Marx de différentes façons autour du thème "l'ouvrier ne peut constituer une demande adéquate", il a vite fait de l'oublier et d'entrer en contradiction avec cette idée de base selon laquelle "si la "demande extérieure à celle des ouvriers eux-mêmes" disparaît ou s'amenuise, la crise éclate". C'est ainsi qu'il en vient à faire résulter la crise de surproduction de la diminution de la masse salariale, ce qui n'est autre qu'une resucée des thèmes malthusianistes combattus par Marx: "la masse salariale dans les pays développés s'élève aujourd'hui en moyenne aux deux tiers du revenu total et a toujours représenté une composante majeure de la demande finale. Sa diminution restreint les marchés et aboutit à une mévente qui est à la base des crises de surproduction. Cette réduction de la consommation touche directement les salariés, mais indirectement aussi les entreprises puisque la demande se restreint. En effet, l'augmentation correspondante de la part des profits et de la consommation des capitalistes ne parvient que très partiellement à compenser la réduction relative de la demande salariale. C'est d'autant moins le cas que le réinvestissement des profits est limité par la contraction générale des marchés." (Dyn p.14)
Il est indéniable que la diminution des salaires, au même titre que le développement du chômage, ont un impact négatif sur l'activité économique des entreprises du secteur de la production des biens de consommation, en premier lieu celles qui produisent ce qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail. Mais ce n'est pas la compression salariale qui constitue la cause de la crise. C'est justement l'inverse qui est vrai. C'est parce qu'il y a crise que l'État ou les patrons sont amenés à licencier et diminuer les salaires.
MR a complètement renversé la réalité. Sa problématique devient "si la demande des ouvriers eux-mêmes s'amenuise, la crise éclate". C'est ainsi que, pour lui, la cause ultime du krach boursier immédiatement antérieur au moment où le livre a été écrit (4e trimestre 2010) réside dans la compression de la demande salariale: "La meilleure preuve en est la configuration qui a mené au dernier krach boursier: comme la demande salariale était drastiquement comprimée, la croissance n'a été obtenue qu'en boostant la consommation (graphique 6.6) par une envolée de l'endettement (qui débute justement en 1982: graphique 6.5), une diminution du taux d'épargne (qui débute en 1982 également: graphique 6.4) et une montée des revenus patrimoniaux." (Dyn p.106). Cela revient ni plus ni moins à mettre sur le compte de la compression de la demande salariale l'ampleur actuelle de l'endettement.
De là à l'idée que la crise est le produit de la rapacité des capitalistes, il n'y a qu'un pas.
Ainsi, comme nous venons de le mettre en évidence et comme il est très clair pour quiconque aborde cette question sérieusement et avec honnêteté, MR défend sur la question des causes fondamentales des crises économiques du capitalisme une analyse différente de celle défendue en leur temps par Marx et Engels. C'est tout à fait son droit, et même sa responsabilité s'il l'estime nécessaire. En effet, quelles que soient la valeur et la profondeur de la contribution, considérable, qu'il a apportée à la théorie du prolétariat, Marx n'était pas infaillible et ses écrits ne sont pas à considérer comme des textes sacrés. Ce serait là une démarche religieuse totalement étrangère au marxisme, comme à toute méthode scientifique d'ailleurs. Les écrits de Marx doivent eux aussi être soumis à la critique de la méthode marxiste. C'est la démarche qu'a adoptée Rosa Luxemburg dans L'Accumulation du capital (1913) lorsqu'elle relève les contradictions contenues dans le livre II du Capital. Cela dit, lorsqu'on remet en cause une partie des écrits de Marx, l'honnêteté politique et scientifique commande d'assumer explicitement et en toute clarté une telle démarche. C'est bien ce qu'a fait Rosa Luxemburg dans son livre, ce qui lui a valu une levée de boucliers de la part des "marxistes orthodoxes", scandalisés qu'on puisse critiquer ouvertement un écrit de Marx. Ce n'est pas, malheureusement, ce que fait MR lorsque il s'écarte de l'analyse de Marx tout en prétendant y rester fidèle. Pour notre part, si sur cette question nous reprenons les analyses de Marx, c'est parce que nous considérons qu'elles sont justes et qu'elles rendent compte de la réalité de la vie du capitalisme.
En particulier, nous nous revendiquons pleinement de la vision révolutionnaire qu’elles contiennent, fermant résolument la porte à toute vision réformiste. Malheureusement, ce n’est pas le cas de MR dont la fidélité affichée aux textes de Marx, de même que ses petits tours de passe-passe, constituent justement le moyen de faire passer "en douceur" une telle vision réformiste. Et c’est là, incontestablement, l’aspect le plus déplorable de son livre.
Comment caractériser les courants qui prônent la résolution de la crise du capitalisme au moyen de l'augmentation des salaires?
Marx défendait la nécessité de la lutte pour des réformes, mais il dénonçait de toute son énergie les tendances réformistes qui tentaient d'y enfermer la classe ouvrière, qui "ne voyaient dans la lutte pour les salaires que des luttes pour les salaires" et non une école de combat où la classe forge les armes de son émancipation définitive. En fait Marx critiquait Proudhon qui ne voyait "dans la misère que la misère" et les trade-unions qui "manquent entièrement leur but dès qu'elles se bornent à une guerre d'escarmouches contre les effets du régime existant, au lieu de travailler en même temps à sa transformation et de se servir de leur force organisée comme d'un levier pour l'émancipation définitive de la classe travailleuse, c'est-à-dire pour l'abolition définitive du salariat".[24] Lorsque l'entrée du capitalisme en décadence a mis la révolution prolétarienne à l'ordre du jour et rendu impossible toute réelle politique réformiste au sein du système, une mystification majeure pour essayer de détourner le prolétariat de sa tâche historique a consisté à lui faire croire qu'il pouvait encore s'aménager une place au sein du système, en particulier en portant au pouvoir les bonnes équipes, les bonnes personnes, appartenant en général à la gauche ou à l'extrême-gauche de l'appareil politique du capital. En ce sens, depuis que la révolution prolétarienne est historiquement à l'ordre du jour, la défense de la lutte pour des réformes n'est plus seulement un travers opportuniste au sein du mouvement ouvrier, elle est ouvertement contre-révolutionnaire. C'est pourquoi une responsabilité des révolutionnaires est de combattre toutes les illusions véhiculées par la gauche du capital visant à faire croire à la possibilité de réformer le capitalisme, tout en encourageant les luttes de résistance de la classe ouvrière contre la dégradation de ses conditions de vie sous le capitalisme; celles-ci sont la condition pour n'être pas broyé par les empiètements incessants du capitalisme en crise et constituent une préparation indispensable pour la confrontation à l'État capitaliste.
A ce sujet, il convenait, comme nous l'avons fait précédemment, de signaler les ouvertures béantes qu'offre au réformisme la théorie de MR. Son livre fait mention de son engagement politique. Qu'il nous soit permis d'en douter quelque peu au vu de ses accointances avec des représentants du "marxisme", eux aussi engagés politiquement, mais très clairement dans la défense de thèses réformistes. C'est pourquoi nous avons pensé nécessaire de relever l'hommage appuyé qu'il rend à la contribution de "certains économistes marxistes": "il existe trop peu de considérations sur l'évolution du taux de plus-value, les problèmes de répartition, l'état de la lutte de classe et l'évolution de la part salariale. Ce n'est qu'avec les travaux de certains économistes marxistes (Jacques Gouverneur, Michel Husson, Alain Bihr, etc.) que ces préoccupations reviennent quelque peu sur le devant de la scène. Nous les partageons et espérons qu'elles seront suivies par d'autres". (Dyn p.86)[25] Le premier, Jacques Gouverneur, qui "a fourni" à MR "de nombreuses clés pour approfondir le Capital" (Dyn p.8) est l'auteur d'un "document de travail"[26] au titre évocateur, "Quelles politiques économiques contre la crise et le chômage ?", où il plaide, contre les politiques néolibérales, pour le retour à des politiques keynésiennes assorties de "politiques alternatives" ("augmentation des prélèvements publics - essentiellement sur les profits - pour financer des productions socialement utiles, …"). Quant à Michel Husson, membre du Conseil scientifique d’Attac, qui "a beaucoup appris" à MR "par la rigueur et l'énorme richesse de ses analyses" (Dyn p. 8), écoutons ses réflexions pour lutter contre le chômage et la précarité: "C’est donc sur le terrain de l’emploi qu’il faut interroger les projets de gauche. Sur ce sujet, le programme du Parti socialiste est très faible, même s’il comporte des propositions intéressantes (comme tous les programmes) (…) plutôt que de vouloir augmenter la richesse, il faut en changer la répartition. Autrement dit, ne pas compter sur la croissance, et surtout en changer le contenu, ce qui est rigoureusement impossible avec la répartition des revenus actuelle. Cela veut dire, en premier lieu, dégonfler les rentes financières et refiscaliser sérieusement les revenus du capital." (Chronique du 6 mai 2001. www.regards.fr/nos-regards/michel-husson/la-gauche-et-l-emploi [59]). Et, enfin, Alain Bihr, moins connu que ses prédécesseurs réformistes, s'il est moins marqué à droite que Husson, il n'est pas le dernier à apporter son soutien à la campagne visant à faire endosser par le libéralisme les ravages du capitalisme: "L’adoption de politiques néolibérales, leur mise en œuvre résolue et leur poursuite méthodique depuis près de trente ans auront donc produit ce premier effet de créer les conditions d’une crise de surproduction en comprimant par trop les salaires: en somme, une crise de surproduction par sous-consommation relative des salariés." Tous ces gens ont appris à MR, s'il ne le savait déjà, qu'à la racine des crises du capitalisme on trouve, non pas les contradictions insurmontables de celui-ci, mais les politique néolibérales, une mauvaise répartition des richesses et qu'en conséquence il faut faire appel à l'État pour mettre en place des politique keynésiennes, taxer les revenus du capital, augmenter les salaires, en un mot tenter de réguler l'économie.
MR semble également sympathiser avec l'idée, chère à Alain Bihr, selon laquelle le prolétariat serait en crise du fait de la crise du capitalisme et que la désyndicalisation serait une manifestation de cette prétendue crise de la classe ouvrière[27] lorsqu'il écrit: "la peur de perdre son travail détruit les solidarités ouvrières et le taux de syndicalisation s'inverse pour amorcer un déclin rapide à partir de 1978-79. Significatif de ce phénomène est l'isolement dans lequel restera la longue lutte menée par les mineurs anglais en 1984-85". (Dyn p. 84) Ce n'est pas là une mince contribution au discours de la bourgeoisie, lorsqu'on sait que le principal facteur de l'isolement et de la défaite des mineurs anglais a été le syndicat, et les illusions persistantes dans la classe ouvrière vis-à-vis de ses versions radicales, "à la base".
Le capitalisme est-il condamné à un effondrement catastrophique?
Arrivé à une certaine étape de son histoire, le capitalisme ne peut que plonger la société dans des convulsions croissantes, détruisant les progrès qu'il avait apportés à celle-ci auparavant. C'est dans ce contexte que se déploie la lutte de classe du prolétariat dans la perspective du renversement du capitalisme et de l'avènement d'une nouvelle société. Si le prolétariat ne parvient pas à hisser ses luttes aux niveaux élevés de conscience et d'organisation nécessaires, les contradictions du capitalisme ne permettront pas l'avènement d'une nouvelle société mais mèneront à "la ruine commune des classes en lutte", comme ce fut le cas de certaines sociétés de classes passées: "… oppresseurs et opprimés se sont trouvés en constante opposition; ils ont mené une lutte sans répit, tantôt cachée, tantôt ouverte, une guerre qui chaque fois finissait soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la ruine commune des classes en lutte."[28]
Ce cadre étant posé, il nous importe de comprendre si, au-delà même de la barbarie croissante inhérente à la décadence du capitalisme, les déterminations économiques de la crise ont nécessairement pour conséquence, à un moment donné, une impossibilité pour le système de continuer à fonctionner en conformité avec ses propres lois, l'accumulation devenant ainsi impossible[29]. C'est effectivement le point de vue d'un certain nombre de marxistes et nous le partageons[30]. Ainsi, pour Rosa Luxemburg, "L'impossibilité du capitalisme apparaît alors clairement" dès lors que "le développement du capitalisme est si avancé que sur toute la surface du globe tout est produit de façon capitaliste" (cf. citations précédentes de l'Introduction à l'économie politique)[31]. Toutefois Rosa Luxemburg apporte la précision suivante: "Cela ne signifie pas que le point final ait besoin à la lettre d'être atteint. La seule tendance vers ce but de l'évolution capitaliste se manifeste déjà par des phénomènes qui font de la phase finale du capitalisme une période de catastrophes"[32]
De même, Paul Mattick[33], qui considère aussi que les contradictions du système doivent aboutir à un effondrement économique tout en pensant que ces contradictions s'expriment fondamentalement sous la forme de la baisse du taux de profit et non pas de la saturation des marchés, rappelle comment historiquement cette question a été posée: "De la polémique engagée à propos de la théorie marxienne de l'accumulation et des crises se dégagèrent deux points de vue antithétiques qui firent eux-mêmes l'objet de plusieurs variantes. Selon l'une, des barrières absolues s'opposent à l'accumulation, avec pour conséquence à plus ou moins long terme un effondrement économique du système; selon l'autre, c'était là un raisonnement absurde, la disparition du système ne pouvant avoir de causes économiques. Comme on se doute bien, le réformisme, ne serait-ce que pour se justifier, avait fait sienne cette dernière conception. Mais d'un point de vue d'extrême-gauche également, celui de Pannekoek notamment, l'idée d'un effondrement aux causes purement économiques était étrangère au matérialisme historique. (…). Les déficiences du système capitaliste telles que Marx les a décrites et les phénomènes de crise concrets qui résultent de l'anarchie de l'économie lui apparaissaient de nature à faire mûrir la conscience révolutionnaire du prolétariat et, au-delà, la révolution prolétarienne."[34]
MR ne partage pas cette vision d'un capitalisme condamné par ses contradictions fondamentales (saturation des marchés, baisse du taux de profit) à une crise catastrophique. À celle-ci, il oppose le point de vue suivant: "En effet, il n'existe pas de point matériel alpha où le capitalisme s'effondrerait, que ce soit un pourcentage X de taux de profit, ou une quantité Y de débouchés, ou un nombre Z de marchés extra-capitalistes. Comme le disait Lénine dans L'impérialisme stade suprême: "il n'y a pas de situation d'où le capitalisme ne peut sortir"[35]!" (Dyn p.117 et 118)
MR précise sa vision: "Les limites des modes de production sont avant tout sociales, produites par leurs contradictions internes, et par la collision entre ces rapports devenus obsolètes et les forces productives. Dès lors, c'est le prolétariat qui abolira le capitalisme, et pas ce dernier qui mourra de lui-même suite à ses limites 'objectives'. Telle est la méthode posée par Marx: "La production capitaliste tend constamment à surmonter ces limites [NDLR: la dépréciation périodique du capital constant s'accompagnant de crises du processus de production] inhérentes; elle n'y réussit que par des moyens qui dressent à nouveau ces barrières devant elle, mais sur une échelle encore plus formidable, de nouveau, et à une échelle plus imposante, dressent devant elle les mêmes barrières." (Le Capital, p.1032. Éd. La Pléiade Économie II). Nulle vision catastrophiste ici, mais développement croissant des contradictions du capitalisme posant les enjeux à une échelle chaque fois supérieure. Cependant, il est clair que si le capitalisme ne s'effondrera pas de lui-même, il n'échappera pas davantage à ses antagonismes destructeurs." (Dyn p.53)
On voit mal comment le prolétariat pourrait renverser le capitalisme si, comme MR n'a de cesse de vouloir le prouver dans son livre, toute l'histoire de ce système depuis la seconde moitié du 20e siècle dément la réalité de l'existence d'entraves au développement des forces productives.
Ceci étant dit, s'il est tout à fait juste de dire que seul le prolétariat pourra abolir le capitalisme, cela n'implique en rien que le capitalisme ne pourra pas s'effondrer sous l'effet de ses contradictions fondamentales, ce qui évidemment n'est en rien équivalent à son dépassement révolutionnaire par le prolétariat. Nulle part dans son texte, MR ne démontre formellement une telle impossibilité. Au lieu de cela, il plaque sur la crise de la période de décadence des caractéristiques des crises telles que celles-ci se manifestaient à l'époque de Marx. De plus, pour décrire ces dernières, il ne s'appuie pas sur des citations de Marx relatives à la saturation des marchés, comme celle-ci: "dans le cycle de sa reproduction — un cycle dans lequel il n'y a pas seulement reproduction simple, mais élargie —, le capital décrit non pas un cercle, mais une spirale: il arrive un moment où le marché semble trop étroit pour la production. C'est ce qui arrive à la fin du cycle. Mais cela signifie simplement que le marché est sursaturé. La surproduction est manifeste. Si le marché s'était élargi de pair avec l'accroissement de la production, il n'y aurait ni encombrement du marché ni surproduction."[36]. MR préfère des passages où Marx traite uniquement du problème de la baisse du taux de profit. Cela lui permet de proclamer, en se couvrant de l'autorité de Marx, que le capitalisme récupérera toujours de ses crises. En effet, dans ce cadre, la dévalorisation du capital opérée par la crise est souvent la condition de la récupération d'un taux de profit permettant à nouveau la reprise de l'accumulation sur une échelle supérieure. Le seul problème c'est que faire découler la crise actuelle d'abord et avant tout de la contradiction "baisse du taux de profit", c'est passer à côté de la réalité qui a produit un endettement tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il existe un autre problème à cette démarche et qui renvoie MR aux contradictions de ses constructions spéculatives, c'est que par ailleurs il affirme: "Il est totalement incongru d'affirmer – comme c'est trop souvent le cas – que la perpétuation de la crise depuis les années 1980 serait due à la baisse tendancielle du taux de profit". (Dyn p.82)
En fait, l'évolution même du capitalisme, déjà avant la Première Guerre mondiale, ne permettait plus de caractériser l'occurrence des crises comme un phénomène cyclique. C'est cette évolution que signale Engels dans une note au sein du Capital, où il dit: "la forme aigüe du processus périodique avec son cycle décennal semble avoir fait place à une alternance plus chronique, plus étendue (…) chaque facteur qui s'oppose à une répétition des anciennes crises recèle le germe d'une crise future bien plus puissante"[37]. Cette description par Engels du surgissement de la crise ouverte est une préfiguration de la crise de la décadence du capitalisme, dont la manifestation violente, généralisée et profonde n'a aucun caractère cyclique mais est préparée par toute une accumulation de contradictions, comme en ont témoigné les deux guerres mondiales, la crise de 1929 et des années 1930, la phase actuelle de la crise qui a été ouverte à la fin des années 1960.
Dire comme le fait MR, en s'appuyant sur des citations de Marx toujours relatives à la baisse du taux de profit, sorties de leur contexte, "Le mécanisme même de la production capitaliste élimine donc les obstacles qu'il se crée"[38], ne peut contribuer qu'à minimiser la profondeur des contradictions qui minent le capitalisme dans sa phase de décadence. Cela ne peut que conduire à sous-estimer la gravité de la phase actuelle de la crise, en particulier en reléguant au second plan les contradictions en question et en invoquant des sornettes selon lesquelles le capitalisme peut être régulé.
On pourrait nous objecter que les prévisions de Rosa Luxemburg se sont révélées inexactes puisque l'assèchement des derniers marchés extra-capitalistes conséquents dans les années 1950 n'a pas donné lieu à une "impossibilité" du capitalisme. C'est en effet à présent une évidence qu'à cette date le capitalisme ne s'est pas écroulé. Cependant, il n'a pu poursuivre son développement qu'en hypothéquant son avenir à travers l'injection de doses de plus en plus importantes de crédit irremboursable. Le problème insurmontable auquel est confrontée actuellement la bourgeoisie, c'est que, quelles que soient les cures d'austérité qu'elle fera subir à la société, en aucun cas celles-ci ne pourront améliorer la situation de l'endettement. Par ailleurs, les défauts de paiement et les faillites de certains acteurs économiques, y compris des États, ne pourront que favoriser une situation similaire chez leurs partenaires, accentuant les conditions de l'effondrement du château de cartes. Par ailleurs, ne pouvant relancer suffisamment l'économie au moyen de nouvelles dettes ou de la planche à billets, le capitalisme ne peut s'éviter une plongée dans la récession. Et, contrairement aux formules enchanteresses déroulées dans ce livre, cette plongée ne prépare pas, grâce à la dévalorisation du capital dont elle va s'accompagner, une future reprise. En revanche, elle prépare le terrain de la révolution.
Silvio (décembre 2011)
[1] Éditions Contradictions. Bruxelles, 2010.
[2] Marx. Matériaux pour l'"Économie" – "Les crises", p.484. Éd. La Pléiade Économie II.
[3] Marx. Principes d'une critique de l'économie politique, p.268. Éd. La Pléiade Économie II.
[4] Idem p.268.
[5] Marx, Le Capital. Livre III, section V, Chap.XVII, p.1206. Éd. La Pléiade Économie II.
[6] "Cette analyse des bases de la régulation keynésiano-fordiste n'a que très rarement été comprise dans le camp du marxisme. À notre connaissance, ce n'est qu'en 1959 qu'est énoncée, pour la première fois, une compréhension cohérente des Trente Glorieuses" (Dyn p. 74). MR reproduit à la suite un extrait d'article publié dès octobre 1959 dans le Bulletin intérieur du groupe Socialisme ou Barbarie. Effectivement le groupe Socialisme ou Barbarie a tellement compris les Trente Glorieuses qu'il achoppera sur le boom des années 1950 et, abusé par celui-ci, il remettra en cause les fondements de la théorie marxiste. Lire à ce propos, pour d'avantage d'explications, l'article "Le boom d'après-guerre n'a pas renversé le cours du déclin du capitalisme", dans la Revue internationale n° 147, https://fr.internationalism.org/rint147/decadence_du_capitalisme_le_boom_d_apres_guerre_n_a_pas_renverse_le_cours_du_declin_du_capitalisme.html [27]. Paul Mattick est cité par MR pour la compréhension qu'il a également su développer du phénomène des Trente Glorieuses. Nous doutons réellement que l'auteur partage ce passage suivant de Mattick: "Les économistes ne font pas la distinction entre économie tout court et économie capitaliste, ils n'arrivent pas à voir que la productivité et ce qui est "productif pour le capital" sont deux choses différentes, que les dépenses, et publiques et privées, ne sont productives que dans la mesure où elles sont génératrices de plus-value, et non simplement de biens matériels et autres agréments de la vie". (Crise et théorie des crises, Paul Mattick. Éditions Champ libre. Souligné par nous.) En d'autres termes, les mesures keynésiennes, non productrices de plus-value, aboutissent à une stérilisation de capital.
[7] Le Capital. Livre III, section III.
[8] Marx, Le Capital livre IV, tome 3, 19e chapitre : "Malthus ; Critique par les Ricardiens de la conception de Malthus des "consommateurs improductifs"". p.60. Éd sociales.
[9] Marx; idem, pp.61 et 62.
[10] Marx, Le Capital livre IV, tome 2. p.560. Éd sociales.
[11] Marx, Le Capital. Livre III, section III: "La loi tendancielle de la baisse du taux de profit", Chapitre X: "Le développement des contradictions immanentes de la loi, Pléthore de capital et surpopulation [60]".
[12] Marx. Le Manifeste communiste; "Bourgeois et prolétaires". P. 165. Éd. La Pléiade Économie I.
[13] Marx, Le Capital. Livre II, section I: "Le mouvement circulaire du capital", Chapitre II: "Les trois formes du processus de circulation", partie II: "Les trois circuits en tant que formes particulières et exclusives". p. 553. Éd. La Pléiade Économie II.
[14] Conformément à ce qu'ils firent dans la préface à l'édition de 1872 pour indiquer des insuffisances révélées par l'expérience de la Commune de Paris, et à ce que fit Engels dans l'édition de 1890 pour indiquer des évolutions intervenues au sein de la classe ouvrière depuis la première édition du Manifeste.
[15] Sur ces questions, nous recommandons la lecture des articles "Rosa Luxemburg et les limites de l'expansion du capitalisme", "Le Comintern et le virus du 'Luxemburgisme' en 1924" dans les Revue internationale n° 142 et 145.
[16] Nous reproduisons in extenso le contexte de la citation de Marx, où, en fait, celui-ci traite du rapport entre le capitalisme et la libre concurrence: "Le règne du capital est la condition de la libre concurrence, tout comme le despotisme des empereurs romains était la condition du libre droit de Rome. Tant que le capital est faible, il cherche à s'appuyer sur les béquilles d'un mode de production disparu ou en voie de disparition; sitôt qu'il se sent fort, il se débarrasse de ses béquilles et se meut conformément à ses propres lois. De même, sitôt qu'il commence à se sentir et à être ressenti comme une entrave au développement, il cherche refuge dans des formes qui, tout en semblant parachever le règne du capital, annoncent en même temps, par les freins qu'elles imposent à la libre concurrence, la dissolution du capital et du mode de production dont il est la base."
[17] Marx. Le Manifeste communiste; "Bourgeois et prolétaires". P. 163. Éd. La Pléiade Économie I.
[18] Cité dans Howard Zinn, Une histoire populaire des Etats-Unis, p. 344. Éditions Agone 2002.
[19] Fritz Sternberg, Le conflit du siècle. p. 75. Éditions du Seuil.
[20] Marx. Matériaux pour l'"Économie, p.489. La Pléiade, Économie II.
[21] L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. "Le partage du monde entre les grandes puissances [61]".
[22] Rosa Luxembourg, Introduction à l’économie politique, "Les tendances de l'économie mondiale". https://www.marxists.org/francais/luxembur/intro_ecopo/intro_ecopo_6.htm [62]
[23] Suite de la citation extraite de l'Introduction à l’économie politique.
[24] Marx. Salaire, prix et profit; "La lutte entre le Capital et le Travail et ses résultats". Éditions sociales.
[25] Michel Husson est, d'après Wikipédia, un ancien militant du Parti socialiste unifié (PSU, social-démocrate), de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR, trotskiste) dont il a fait partie du comité central. Il est membre du Conseil scientifique d’Attac et a soutenu la candidature de José Bové (altermondialiste) à l'élection présidentielle française de 2007. Alain Bihr, toujours selon la même source, se réclame du communisme libertaire et est connu comme un spécialiste de l'extrême droite française (en particulier du Front national) et du négationnisme.
[26] www.capitalisme-et-crise.info/telechargements/pdf/FR_JG_Quelles_politiques_ [63]Žéconomiques_contre_la_crise_et_le_chômage_1.pdf
[27] Idée que nous avions déjà critiquée dans un article de notre Revue internationale n° 74, "Le prolétariat est toujours la classe révolutionnaire" (https://fr.internationalism.org/rinte74/proletariat [64])
[28]Marx. Le Manifeste communiste; "Bourgeois et prolétaires". Éd. La Pléiade Économie I.
[29]Lire à ce propos l'article "Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme", Revue internationale n° 144. https://fr.internationalism.org/rint146/pour_les_revolutionnaires_la_grande_depression_confirme_l_obsolescence_du_capitalisme.html [28]
[30] MR avance l'idée selon laquelle l'impossibilité économique objective du capitalisme contenue dans la vision luxemburgiste aurait été responsable de l'immédiatisme qui s'était manifesté au 3e Congrès de l'Internationale communiste où "le KAPD (scission oppositionnelle du parti communiste allemand) défend une théorie de l'offensive à tout prix en s'appuyant sur la vision luxemburgiste selon laquelle le prolétariat serait face à "l'impossibilité économique objective du capitalisme" et confronté à "l'effondrement économique inévitable du capitalisme... " (Rosa Luxemburg, L'Accumulation du capital)". (Dyn p. 54) Lorsque Rosa Luxemburg défend effectivement la perspective d'une impossibilité du capitalisme, une telle perspective ne s'applique clairement pas au futur proche. Mais il se trouve que justement l'auteur, ou ses proches, défendent frauduleusement une vision attribuant à Rosa Luxemburg une telle perspective pour l'immédiat, étant donné l'insuffisance des marchés extra-capitalistes relativement aux besoins de la production. C'est ce que nous explicitons dans la note suivante. Pour un aperçu plus juste des causes de l'immédiatisme s'étant manifesté dans le mouvement ouvrier par rapport à la perspective, nous renvoyons le lecteur à l'article "Décadence du capitalisme: l'âge des catastrophes". Revue internationale n° 143. https://fr.internationalism.org/rint143/decadence_du_capitalisme_l_age_des_catastrophes.html [65].
[31]"Pour une bonne explication et critique de la théorie de l'accumulation de Rosa Luxemburg" (Dyn p. 36), MR nous aiguille vers l'article suivant: "Théorie des crises: Marx – Luxemburg (I)" (https://www.leftcommunism.org/spip.php?article110 [66]). Sur le site recommandé, nous avons lu l'article "L’accumulation du capital au XXe siècle – I" (https://www.leftcommunism.org/spip.php?article223 [67]) et avons eu la surprise d'y apprendre que, selon Rosa Luxemburg, citée à partir de son ouvrage L'Accumulation du capital, "le capitalisme avait atteint "la phase ultime de sa carrière historique: l’impérialisme" car "le champ d’expansion offert à celui-ci apparaît comme minime comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces productives capitalistes…" ". N'en croyant pas nos yeux, nous sommes retournés à l'ouvrage cité et c'est une autre réalité qui s'est offerte à nous. Ce qui pour Rosa Luxemburg est minime (comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces productives capitalistes), ce n'est pas, comme le dit l'article, le champ d’expansion offert au capitalisme, mais les derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. La différence est de taille puisqu'à l'époque les colonies contiennent une proportion importante de marchés extra-capitalistes vierges ou non épuisés, alors que de tels marchés n'existent effectivement que de façon beaucoup plus rare en dehors des colonies et des pays industrialisés. La restitution exacte de ce que dit réellement Rosa Luxemburg met en évidence le petit tour de passe-passe opéré par les amis de MR. Dans cette citation, nous avons souligné ce qui est reproduit dans l'article incriminé, et mis en caractères gras une idée importante écartée par l'auteur de l'article: "L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. Géographiquement, ce milieu représente aujourd'hui encore la plus grande partie du globe. Cependant le champ d'expansion offert à l'impérialisme apparaît comme minime comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces productives capitalistes", L'Accumulation du capital, III: "Les conditions historiques de l'accumulation", 31: "Le protectionnisme et l'accumulation", https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/index.htm [68]
[32] L'Accumulation du capital, III: "Les conditions historiques de l'accumulation", 31: "Le protectionnisme et l'accumulation", https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/index.htm [68]
[33] Pour davantage d'informations sur le positionnement politique de Paul Mattick lire l'article "Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme" dans la Revue internationale n° 146. https://fr.internationalism.org/rint146/pour_les_revolutionnaires_la_grande_depression_confirme_l_obsolescence_du_capitalisme.html [28]
[34] Paul Mattick. Crises et théories des crises. pp.136 et 137. Éditions Champ libre.
[35] NDLR: Ce passage est absent de la version de L'impérialisme stade suprême en ligne sur marxists.org (https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1916/vlimperi/vlimp.htm [69]). Par contre, il en existe un autre qui lui ressemble comme un frère correspondant également à des paroles de Lénine dans le Rapport sur la situation internationale et les tâches fondamentales de l'I.C: "Il n'existe pas de situation absolument sans issue" (). Cependant il n'est pas relatif à la crise économique mais à la crise révolutionnaire.
[36] Matériaux pour l'"Économie", "Les crises". p.489. La Pléiade - Économie II.
[37] Note d'Engels au Capital, livre III, section V: "Le capital productif d'intérêt", Chapitre XVII: "Accumulation du capital monétaire et crises", partie III "Capital monétaire et capital réel". p.1210. Éd. La Pléiade Économie II.
[38]La référence donnée par MR est la suivante, Le Capital, Livre I, 4e édition allemande; Éditions sociales 1983, p.694. Elle ne comporte pas d'avantage de précisions quant à la section du Livre considéré. Il n'existe pas l'équivalent évident de cette phrase en français sur marxists.org.
Questions théoriques:
- Décadence [37]
Décadence du capitalisme (XIII) : Rejet et régressions
- 2801 reads
Dans le précédent article de cette série[1], nous avons mis en évidence que la "théorie de la décadence", qu’une minorité intransigeante avait persisté à défendre malgré le triomphe apparent du capitalisme durant le boom d’après-guerre, avait gagné de nouveaux adhérents, car elle fournissait un cadre historique cohérent aux positions révolutionnaires que cette nouvelle génération avait acquises d’une façon plus ou moins intuitive: l’opposition aux syndicats et au réformisme, le rejet des luttes de libération nationale et des alliances avec la bourgeoisie, la compréhension que les pays prétendument "socialistes" étaient une forme de capitalisme d'État et ainsi de suite.
À la fin des années 1960 et au début des années 1970, la crise ouverte du capitalisme ne faisait que commencer; au cours des quatre décennies suivantes, il est apparu de plus en plus clairement qu’elle était insurmontable. De ce fait, on aurait pu s’attendre à ce que la majorité des éléments attirés par l'internationalisme au cours de cette période soient plus facilement convaincus du fait que le capitalisme était vraiment un système social obsolète et décadent. Non seulement cela n’a pas été le cas mais on pourrait même parler d'un rejet persistant de cette théorie de la décadence – et c’est particulièrement vrai pour les nouvelles générations de révolutionnaires qui ont commencé à surgir au cours de la première décennie du 21e siècle – et, simultanément, d’une tendance à la remettre en question, voire à la rejeter ouvertement, de la part de beaucoup d’éléments qui y adhéraient auparavant.
L’attraction de l’anarchisme
En ce qui concerne le rejet de la part des nouvelles générations de révolutionnaires, nous parlons essentiellement des éléments internationalistes influencés par les différentes sortes d’anarchisme. L’anarchisme a connu un renouveau important au cours des années 2000, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi il a eu une telle attraction sur de jeunes camarades désireux de combattre le capitalisme mais profondément critiques envers la gauche "officielle", dont une partie a vu comme une catastrophe l’effondrement du "socialisme existant réellement" dans le bloc de l’Est. Ainsi, la nouvelle génération se tourne souvent vers l’anarchisme parce qu’elle le voit comme un courant qui n’a pas trahi la cause du socialisme comme l’ont fait les courants social-démocrate, stalinien et trotskiste.
L’analyse des raisons pour lesquelles, dans les pays capitalistes centraux en particulier, tant d'éléments de la nouvelle génération ont été attirés par les différents courants de l’anarchisme et non par la Gauche communiste, qui constitue certainement le plus cohérent des courants politiques restés loyaux aux principes prolétariens après la terrible défaite de la période qui va de la fin des années 1920 à la fin des années 1960, prendrait un article à lui tout seul. Le problème de l’organisation des révolutionnaires – la question du "parti" - qui a toujours été une pomme de discorde entre les marxistes et les éléments révolutionnaires de l’anarchisme, constitue certainement un élément central. Mais dans cet article, notre préoccupation principale est la question spécifique de la décadence du capitalisme. Pourquoi la majorité des anarchistes, y compris ceux qui s’opposent authentiquement aux pratiques réformistes et défendent la nécessité d’une révolution internationale, rejettent-ils cette notion de façon si véhémente?
Il est vrai que certains des meilleurs éléments du courant anarchiste n’ont pas toujours eu cette réaction. Dans un article précédent de cette série[2], nous avons montré comment face à la crise économique mondiale et à la poussée vers la seconde guerre impérialiste mondiale, des camarades anarchistes comme Maximoff n’ont eu aucune difficulté à expliquer ces phénomènes comme des expressions d’un rapport social devenu une entrave au progrès de l’humanité, d’un mode de production en déclin.
Mais ce point de vue a toujours été minoritaire au sein du mouvement anarchiste. À un niveau plus profond, bien que beaucoup d’anarchistes reconnaissent que la contribution de Marx à la compréhension de l’économie politique est irremplaçable, leur point de vue sur la méthode historique qui sous-tend la critique du capital par Marx est bien plus sévère. Depuis Bakounine, il y a toujours eu chez les anarchistes une forte tendance à considérer le "matérialisme historique" (ou, si l’on préfère, la démarche matérialiste vis-à-vis de l’histoire) comme une forme de déterminisme rigide qui sous-estime et déprécie l’élément subjectif dans la révolution. Bakounine en particulier considérait que c’était un prétexte pour une pratique fondamentalement réformiste de la part du "parti de Marx", qui défendait à l’époque que le capitalisme n’avait pas encore épuisé son utilité historique pour l’humanité, que la révolution communiste n’était pas encore à l’ordre du jour et que la classe ouvrière devait développer ses forces et prendre confiance en elle-même dans le cadre de la société bourgeoise; ce point de vue était la base de la défense par Marx du travail syndical et de la constitution de partis ouvriers qui devaient, entre autres choses, participer aux élections bourgeoises. Pour Bakounine, le capitalisme avait toujours été mûr pour la révolution. Par extension, si les marxistes de l’époque historique actuelle défendent que les anciennes tactiques ne sont plus valables, cette position est souvent ridiculisée par les anarchistes d’aujourd’hui comme étant une justification rétrospective des erreurs de Marx et une façon d’éviter la conclusion désagréable que les anarchistes ont toujours eu raison.
Nous ne faisons qu’effleurer la question ici; nous y reviendrons plus loin en traitant une version plus élaborée de cette argumentation défendue par le groupe Aufheben dans une série d’articles critiquant la notion de décadence et que beaucoup dans le milieu communiste libertaire considèrent comme étant le dernier mot sur la question. Mais il y a d’autres éléments à examiner dans le fait que la génération actuelle rejette ce qui est pour nous la pierre de touche théorique d’une plateforme révolutionnaire aujourd’hui et qui sont moins liés à la tradition anarchiste.
Le paradoxe auquel nous sommes confrontés est le suivant: tandis que, pour nous, le capitalisme semble se décomposer de plus en plus, au point que nous pouvons parler de phase finale de son déclin, pour beaucoup d’autres, la capacité du capitalisme à prolonger ce processus de déclin constitue la preuve que le concept même de déclin est réfuté. En d’autres termes, plus un capitalisme, sénile depuis longtemps, approche de sa fin catastrophique, plus certains révolutionnaires le considèrent capable de se renouveler quasiment sans fin.
Il est tentant de faire un peu de psychologie ici. Nous avons déjà noté[3] que la perspective de sa propre fin constitue un élément du rejet par la bourgeoisie non seulement du marxisme mais même de ses propres tentatives pour appréhender de façon scientifique le problème de la valeur, une fois qu’il est apparu clairement que le comprendre impliquait aussi la compréhension du caractère transitoire du système capitaliste et de sa condamnation à périr de ses propres contradictions internes. Il serait étonnant que cette idéologie du déni n’affecte pas aussi ceux qui cherchent à rompre avec la vision bourgeoise du monde. En fait, puisque cette fuite de la réalité par la bourgeoisie grandit désespérément au fur et à mesure qu’elle s’approche de sa véritable fin, on peut s’attendre à voir ce mécanisme de défense pénétrer toutes les couches de la société, y compris la classe ouvrière et ses minorités révolutionnaires. Après tout, qu’est ce qui est plus terrifiant, plus susceptible de susciter une réaction de fuite ou de se cacher la tête dans le sable que la possibilité réelle d’un capitalisme agonisant nous écrasant tous dans les affres de ses derniers moments?
Mais le problème est plus complexe. D’abord il est connecté à la façon dont la crise a évolué au cours des quarante dernières années, qui a rendu le diagnostic de la véritable gravité de la maladie mortelle du capitalisme plus difficile.
Comme nous l’avons noté, les premières décennies qui ont suivi 1914 étaient une preuve très claire du fait que le capitalisme était en déclin. Ce n’est que lorsque le boom d’après-guerre s’est vraiment déployé dans les années 1950 et 1960 qu’un certain nombre d’éléments du mouvement politique prolétarien ont commencé à exprimer de profonds doutes envers l’idée que le capitalisme était dans sa phase de décadence. Le retour de la crise – et de la lutte de classe – à la fin des années 1960 a permis de voir la nature passagère de ce boom et de redécouvrir les fondements de la critique marxiste de l’économie politique. Mais tandis que la nature "permanente" de la crise depuis la fin des années 1960 et, par-dessus tout, l’explosion plus récente de toutes les contradictions qui s’étaient accumulées au cours de cette période (la "crise de la dette") ont confirmé cette analyse au niveau fondamental, la longueur de la crise a aussi témoigné de l’extraordinaire capacité du capitalisme à s’adapter et à survivre, même si c’était en trichant avec ses propres lois et en accumulant des problèmes encore plus dévastateurs pour lui-même à long terme. Le CCI a certainement, en certaines occasions, sous-estimé ces capacités: certains des articles publiés dans les années 1980 – décennie au cours de laquelle le chômage massif a de nouveau fait partie de la vie quotidienne – ne prévoyaient pas le "boom" (ou plutôt les booms, puisqu’il y a eu aussi de nombreuses récessions) des années 1990 et 2000, et il est certain que nous n’avions pas prévu la possibilité qu’un pays comme la Chine s'industrialise au rythme frénétique qu’on a connu au cours des années 2000 grosso modo. Pour une génération élevée dans de telles conditions où le consumérisme rampant et éhonté des pays développés fait paraître la société de consommation des années 1950 et 1960 surannée en comparaison, il est compréhensible que parler de déclin du capitalisme puisse paraître quelque peu dépassé. L’idéologie officielle des années 1990 et des premières années 2000 était que le capitalisme avait triomphé sur toute la ligne et que le néo-libéralisme et la mondialisation ouvraient la porte à une nouvelle ère de prospérité sans précédent. En Grande-Bretagne, par exemple, le porte-parole économique du gouvernement de Tony Blair, Gordon Brown, proclamait, dans son discours sur le budget en 2005, que le Royaume-Uni connaissait la période de croissance économique la plus longue depuis les premiers relevés qui commencèrent en 1701. Il n’est pas surprenant que des versions "radicales" de ces idées soient reprises, même parmi des défenseurs de la révolution. Après tout, la classe dominante elle-même continue de se quereller sur la question de savoir si elle s’est débarrassée en fin de compte du cycle "expansion-récession". Beaucoup de "pro-révolutionnaires", qui sont capables de citer Marx sur les crises périodiques du 19e siècle et d’expliquer que même s’il peut encore y avoir des crises périodiques, celles-ci servent à nettoyer l’économie de ses branches mortes et à apporter un regain de croissance, se sont fait écho de cette problématique.
Régressions à partir de la cohérence de la gauche italienne
Tout cela est très compréhensible, mais on peut peut-être moins le pardonner quand cela vient des rangs de la Gauche communiste, qui avait déjà une certaine connaissance du caractère maladif de la croissance capitaliste à l’époque de son déclin. Et pourtant, depuis les années 1970, nous avons connu une série de défections vis-à-vis de la théorie de la décadence dans les rangs de la Gauche communiste, et dans le CCI en particulier, s’accompagnant souvent de sévères crises organisationnelles.
Ce n’est pas le lieu d’analyser l’origine de ces crises. Nous pouvons dire que les crises dans les organisations politiques du prolétariat constituent un moment inévitable de leur vie, comme un coup d’œil rapide à l’histoire du Parti bolchevique ou des gauches allemande et italienne le confirme. Les organisations révolutionnaires sont une partie de la classe ouvrière, qui est une classe constamment soumise à l’immense pression de l’idéologie dominante. L’avant-garde ne peut échapper à cette pression et est contrainte de mener un combat permanent contre elle. Les crises organisationnelles éclatent en général à un moment où une partie voire l'ensemble de l’organisation est confrontée – ou succombe – à une dose particulièrement forte d’idéologie dominante. Très souvent, ces convulsions sont initiées ou exacerbées par la nécessité de faire face à de nouvelles situations ou à des crises plus larges dans la société.
Les crises du CCI ont presque toujours été centrées sur des questions d’organisation et de comportement politique. Mais il est également notable que pratiquement toutes les scissions importantes dans nos rangs ont mis en question également notre vision de l’époque historique.
Le GCI : le progrès est-il un mythe bourgeois?
En 1987, dans la Revue internationale n° 48, nous avons commencé la publication d’une nouvelle série intitulée "Comprendre la décadence du capitalisme". C’était une réponse au fait que, de plus en plus, des éléments à l’intérieur ou autour du mouvement révolutionnaire étaient en train de changer d’avis sur la notion de décadence. Le premier des trois articles de la série[4] était une réponse aux positions du Groupe communiste internationaliste (GCI) qui était à l’origine une scission du CCI à la fin des années 1970. Certains des éléments qui avaient initialement formé le GCI se voyaient comme des continuateurs du travail de la Fraction italienne de la Gauche communiste, s’opposant à ce qu’ils considéraient comme des déviations conseillistes du CCI. Mais à la suite de nouvelles scissions au sein du GCI lui-même, le groupe évolua vers ce que l’article de la Revue internationale qualifiait de "bordiguisme anarcho-punk": une étrange combinaison de concepts tirés du bordiguisme tels que "l’invariance" du marxisme et une régression vers une vision volontariste à la Bakounine. Ces deux éléments menèrent le GCI à s’opposer de façon véhémente à l’idée que le capitalisme avait connu une phase ascendante et une phase décadente, principalement dans l’article "Théories de la décadence ou décadence de la théorie?" (Le Communiste n° 23, 1985).
L’article de la Revue internationale réfute un certain nombre d’accusations portées par le GCI. Il critique le sectarisme grossier du GCI qui mettait dans le même sac les groupes défendant l’idée que le capitalisme était décadent et les Témoins de Jéhovah, la secte Moon ou les néo-nazis; le GCI montrait son ignorance quand il déclarait que le concept de décadence était né après la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23 et que "certains produits de la victoire de la contre-révolution se mirent à théoriser une ‘longue période’ de stagnation et de ‘déclin’"; surtout, l’article montre que ce qui sous-tend "l’anti-décadence" du GCI, c’est un abandon de l’analyse matérialiste de l’histoire en faveur de l’idéalisme anarchiste.
Ce que le GCI rejette vraiment dans le concept de décadence, c’est l’idée que le capitalisme ait été autrefois un système ascendant, qu’il ait joué un rôle progressiste pour l’humanité: en fait le GCI rejette la notion même de progrès historique. Pour lui, c’est de la simple idéologie pour justifier la mission "civilisatrice" du capitalisme: "La bourgeoisie présente tous les modes de production qui l’ont précédée comme ‘barbares’ et ‘sauvages’ et deviendraient, avec l’évolution historique, progressivement ‘civilisés’. Le mode de production capitaliste est évidemment l’incarnation finale et la plus haute de la Civilisation et du Progrès. La vision évolutionniste correspond donc à ‘l’être social capitaliste’ et ce n’est pas pour rien que cette vision a été appliquée à toutes les sciences (c’est-à-dire toutes les interprétations partielles de la réalité du point de vue bourgeois): les sciences de la nature (Darwin), la démographie (Malthus), la logique, l’histoire, la philosophie (Hegel)…" (Ibid.)
Mais ce n’est pas parce que la bourgeoisie a une certaine vision du progrès où tout culmine dans la domination du capital que tout concept de progrès est faux: c’est précisément la raison pour laquelle Marx n’a pas rejeté les découvertes de Darwin mais les a considérées – en les interprétant correctement et en utilisant une vision dialectique plutôt que linéaire – comme un argument supplémentaire en faveur de sa vision de l’histoire.
Cela ne veut pas dire non plus que la vision marxiste du progrès historique signifie l’adhésion et l’alignement sur la classe dominante, comme le GCI le proclame: "Les décadentistes sont donc pour l’esclavage jusqu’à une certaine date, pour le féodalisme jusqu’à une autre… pour le capitalisme jusqu’en 1914! Ainsi, à cause de leur culte du progrès, ils s’opposent à chaque étape à la guerre de classe menée par les exploités, s’opposent aux mouvements communistes qui ont eu le malheur d’éclater dans la ‘mauvaise période’." (Ibid.) Le mouvement marxiste au 19e siècle, tout en reconnaissant généralement que le capitalisme n’avait pas encore créé les conditions de la révolution communiste, a toujours considéré son rôle comme étant de défendre de façon intransigeante les intérêts de classe du prolétariat au sein de la société bourgeoise et il a reconnu "rétrospectivement" l’importance absolument vitale des révoltes des exploités dans les sociétés de classes précédentes, tout en considérant que ces révoltes ne pouvaient aboutir à la société communiste.
On rencontre souvent le radicalisme superficiel du GCI chez ceux qui épousent ouvertement les conceptions anarchistes et il leur a même parfois fourni une justification semi-marxiste plus "élaborée" pour maintenir leurs vieux préjugés. Alors que les anarchistes peuvent reconnaître à Marx certaines contributions théoriques (critique de l’économie politique, concept d’aliénation, etc.), ils ne tolèrent pas sa pratique politique qui était de construire des partis ouvriers participant au parlement, de développer des syndicats et même, dans certains cas, de soutenir des mouvements nationaux. Selon eux, toutes ces pratiques (à l’exception peut-être du développement de syndicats) étaient déjà bourgeoises (ou autoritaires) à l’époque et elles sont toujours bourgeoises (ou autoritaires) aujourd’hui.
Dans la pratique cependant, ce rejet général de toute une partie du passé du mouvement ouvrier n’est pas une garantie de la radicalité des positions aujourd’hui. Comme le conclut le deuxième article de la série: "… pour les marxistes, les formes de lutte du prolétariat dépendent des conditions objectives dans lesquelles celle-ci se déroule et non des principes abstraits de révolte éternelle. C'est seulement en se fondant sur l'analyse objective du rapport de forces entre les classes envisagé dans sa dynamique historique que l'on peut fonder la validité ou non d'une stratégie, d'une forme de combat. En dehors de cette base matérialiste, toute prise de position sur les moyens de la lutte prolétarienne repose sur du sable mouvant; c'est la porte ouverte au déboussolement dès que les formes superficielles de la ‘révolte éternelle’ - la violence, l'anti-légalité - font leur apparition"[5]. L’article en veut pour preuve le flirt du GCI avec le Sentier lumineux au Pérou. C’est une position idéologique que le GCI a reprise dans des déclarations plus récentes sur la violence du Jihad en Irak.[6]
PI : l’accusation de "productivisme"
La série publiée dans les années 1980 contenait également une réponse à un autre groupe né d’une scission du CCI en 1985: la Fraction Externe du CCI (FECCI) qui publiait la revue Perspective Internationaliste (PI). La FECCI, proclamant faussement avoir été exclue du CCI et dédiant une grande partie de ses premières polémiques à apporter la "preuve" de la "dégénérescence du CCI" et même de son "stalinisme", était née en déclarant qu’elle avait l’intention de défendre la plateforme du CCI à l’encontre du CCI lui-même – d’où son nom. Ce nom de ‘FECCI’ fut finalement abandonné et le groupe adopta le titre de sa publication. Contrairement au GCI, cependant, PI n’a jamais dit qu’il rejetait la notion même d’ascendance et de décadence du capitalisme: il a expliqué qu’il voulait approfondir et clarifier ces concepts. C’est certainement un projet louable. Le problème est que ses innovations théoriques ajoutent peu de chose qui soit vraiment profond et servent principalement à diluer l’analyse de base.
D’une part, PI a de plus en plus développé une périodisation "parallèle" du capitalisme, basée sur ce qu’il appelle la transition de la domination formelle à la domination réelle du capital qui, dans la version de PI, correspond plus ou moins au même cadre historique que celui du changement "traditionnel" du capitalisme passant à sa période de déclin dans la première partie du 20e siècle. Dans la vision de PI, la pénétration globale croissante de la loi de la valeur dans tous les domaines de la vie économique et sociale constitue la domination réelle du capital, et c’est cela qui nous fournit la clé pour comprendre les frontières de classe que le CCI avait basées auparavant sur la notion de décadence: la banqueroute du travail syndical, du parlementarisme et du soutien à la libération nationale, etc.
Il est certain que l’émergence réelle du capitalisme comme une économie mondiale, sa "domination" effective sur le globe correspondent à l’ouverture de la période de décadence; et que, comme le souligne PI, cette période a été marquée par une pénétration croissante de la loi de la valeur dans quasiment tous les recoins de l’activité humaine. Mais comme nous le défendons dans notre article de la Revue internationale n° 60[7], la définition que donne PI de la transition entre la domination formelle et la domination réelle part d’un concept élaboré par Marx et l’élargit au-delà de la signification spécifique que ce dernier lui attribuait. Pour Marx, la transition en question concernait le passage de la période de la manufacture – quand le travail artisanal était regroupé par des capitalistes individuels sans véritablement transformer les anciennes méthodes de production – à celui du système d’usines, basé sur le travailleur collectif. Dans son essence, ce changement avait déjà eu lieu à l’époque de Marx, quand le capitalisme ne "dominait" encore qu’une petite partie de la planète: son expansion ultérieure allait se baser sur la "domination réelle" du processus de production. Notre article montrait que le point de vue des bordiguistes de Communisme ou Civilisation était plus conséquent quand il défendait la possibilité du communisme dès 1848, puisque, pour ce groupe, cette date marquait en fait la transition à la domination réelle.
Mais PI développait un autre argument dans sa mise en question du concept de décadence hérité du CCI: l'accusation de "productivisme". Dans l’une de ses premières salves (PI n° 28, automne 1995), Mac Intosh affirmait que tous les groupes la Gauche communiste, depuis Bilan jusqu’aux groupes existants tels que le CCI ou le BIPR, souffraient de la même maladie: ils étaient "désespérément et inextricablement empêtrés dans le productivisme qui est le cheval de Troie du capital dans le camp du marxisme. Ce productivisme fait du développement de la technologie et des forces productives l’étalon du progrès historique et social; dans cette optique théorique, tant qu’un mode de production assure le développement technologique, on doit le considérer comme historiquement progressiste." La brochure du CCI, La décadence du capitalisme[8], fit particulièrement l’objet de critiques. Rejetant l’idée de Trotsky, exprimée dans le document programmatique de 1938: Programme de Transition - L’agonie du capitalisme et les tâches de la Quatrième Internationale[9], selon laquelle les forces productives de l’humanité avaient cessé de croître, notre brochure définissait la décadence comme une période au cours de laquelle les rapports de production agissaient comme une entrave au développement des forces productives mais non comme une barrière absolue, et menait une sorte d’expérience intellectuelle en cherchant à montrer combien le capitalisme aurait pu se développer s’il n’avait pas été limité par ses contradictions internes.
Mac Intosh se focalisa sur ce passage et le contredit par différents chiffres qui indiquaient, à son avis, des taux de croissance si formidables à l’époque de la décadence que toute notion de décadence vue comme ralentissement du développement des forces productives devait être remplacée par l’idée que c’était précisément la croissance du système qui était profondément inhumaine – comme en témoigne, par exemple, le développement de la crise écologique.
D’autres membres de PI poursuivirent dans le même sens, par exemple dans l’article: "For a Non-productivist Understanding of Capitalist Decadence" par E.R. dans PI n° 44[10]. Mais il y avait déjà eu une réponse assez profonde à Mac Intosh dans le n° 29 de PI[11] par M. Lazare (ML). Si l’on ne tient pas compte de la caricature occasionnelle des prétendues caricatures du CCI, cet article montre bien comment la critique du productivisme par Mac Intosh est elle-même prise dans une logique productiviste[12]. D’abord il met en question l’utilisation par Mac Intosh des chiffres prétendant montrer que le capital avait crû d’un facteur 30 entre 1900 et 1980. ML montre que ce chiffre est bien moins impressionnant si on le rapporte à un taux annuel qui nous donne une croissance moyenne de 4,36% par an. Mais, surtout, il défend l’idée que si nous parlons en termes quantitatifs, malgré les taux de croissance impressionnants que le capitalisme en déclin a pu connaître, quand on regarde le gigantesque gaspillage de forces productives qu’entraînent la bureaucratie, les armements, la publicité, la finance, une multitude de "services" inutiles ainsi que la crise économique quasi-permanente ou récurrente, l’expansion à proprement parler de l’activité productrice réelle aurait pu être alors bien plus grande. En ce sens, l’idée que le capitalisme est une entrave qui freine mais ne bloque pas totalement le développement des forces productives, même en termes capitalistes, reste totalement valable. Comme Marx l’a écrit, le capital est la contradiction vivante et "la véritable barrière de la production capitaliste, c’est le capital lui-même" (Livre III du Capital[13]).
Cependant, et de façon tout à fait correcte, ML ne s’arrête pas là. La question de la "qualité" du développement des forces productives dans la période de décadence se pose dès qu’on fait entrer des facteurs comme le gaspillage et la guerre dans l’équation. Contrairement à certaines insinuations de ML, la vision que le CCI a de la décadence n’a jamais été purement quantitative, mais a toujours pris en compte le "coût" humain de la survie prolongée du système. Et il n’y a rien dans notre vision de la décadence excluant l’idée, également mise en avant par ML, que nous avons besoin d’une conception bien plus profonde de ce que signifie exactement le développement des forces productives. Les forces productives ne sont pas intrinsèquement du capital – illusion entretenue à la fois par les primitivistes qui considèrent le progrès technologique comme la source de tous les maux et par les staliniens qui mesurent le progrès vers le "communisme" à l’aune du ciment et de l’acier. À la base des forces productives de l’humanité, il y a sa puissance créatrice, et le mouvement vers le communisme ne peut se mesurer qu’en fonction du degré de libération des capacités de créativité humaine. L’accumulation du capital – "la production pour la production" - a constitué une étape dans ce sens, mais une fois qu’elle eut établi les prérequis pour une société communiste, elle a cessé de jouer un rôle progressiste. En ce sens, loin d’être gouvernée par une vision productiviste, la Gauche communiste italienne fut l’une des premières à critiquer ouvertement cette vision, puisqu’elle rejetait les hymnes de Trotsky sur les miracles de la production "socialiste" dans l’URSS stalinienne et qu’elle insistait sur le fait que les intérêts de la classe ouvrière (même dans un "État prolétarien") étaient nécessairement antagoniques aux besoins de l’accumulation (ML note aussi cela, contrairement aux accusations portées par Mac Intosh à la tradition de la Gauche communiste).
Pour Marx, et pour nous, la "mission progressiste" du capital se mesure au degré de sa contribution à la libération de la puissance créatrice de l’homme, vers une société où la mesure des richesses n’est plus le temps de travail mais le temps libre. Le capitalisme a constitué une étape inévitable vers cet horizon, mais sa décadence se signale précisément par le fait que ce potentiel ne peut être réalisé qu’en abolissant les lois du capital.
Il est crucial d’envisager ce problème dans toute sa dimension historique, qui embrasse aussi bien le futur que le passé. Les tentatives du capital pour maintenir l’accumulation dans le carcan imposé par ses limites globales créent une situation où ce n'est pas seulement le potentiel de l’humanité qui est ainsi emprisonné, c’est aussi la survie de l'humanité elle-même qui est menacée au fur et à mesure que les contradictions des rapports sociaux capitalistes s’expriment de plus en plus violemment, entraînant la société à sa ruine. C’est sûrement ce à quoi Marx fait allusion dans les Grundrisse quand il parle du développement comme déclin[14].
Une illustration actuelle: la Chine, dont les taux de croissance vertigineux obsèdent tant les anciens inconditionnels de la théorie de la décadence. Le capital chinois a-t-il développé les forces productives? Selon ses propres critères, oui, mais quel est le contexte historique global dans lequel cela a lieu? Il est certainement vrai que l’expansion du capital chinois a accru la taille du prolétariat industriel mondial, mais cela s’est produit à travers un vaste processus de désindustrialisation à l’Ouest et la perte de beaucoup de secteurs centraux de la classe ouvrière dans les pays d’origine du capital, allant de pair avec la perte d’une grande partie de ses traditions de lutte. En même temps, le coût écologique du "miracle" chinois est gigantesque. Les besoins de la Chine en matières premières pour sa croissance industrielle amènent au pillage accéléré des ressources mondiales et toute la production qui en découle porte avec elle une grande augmentation de la pollution globale. Au niveau économique, tandis que la Chine dépend entièrement du marché occidental de consommation. Tant du point de vue du marché intérieur que de celui des exportations, les perspectives économiques, à terme, de l'économie chinoise sont à la baisse, Ttout comme le sont celles de l'Europe et des Etats-Unis. La seule différence c'est que ce pays part de plus haut [15]. Mais il pourrait bien perdre son avance, ou du moins une partie de celle-ci si, à son tour, il devait être ébranlé par des faillites en série[16]. Tôt au tard la Chine ne pourra que s'inscrire pleinement dans la dynamique récessioniste de l'économie mondiale.
Marx, à la fin du 19e siècle, voyait des raisons d’espérer que le développement capitaliste ne serait pas nécessaire en Russie, car il pouvait voir que, à l’échelle mondiale, les conditions du communisme étaient déjà en train d’être réunies. Cela n’est-il pas encore plus vrai aujourd’hui?
Des hésitations dans le BIPR?
En 2003-04, nous avons commencé une nouvelle série d’articles sur la décadence, en réponse à un certain nombre de charges contre ce concept mais, en particulier, à cause de signes alarmants de la part du Bureau international pour le Parti révolutionnaire (BIPR) – maintenant Tendance communiste internationaliste (TCI) – qui avait généralement fondé ses positions sur une notion de décadence, et semblait à présent être aussi influencé par les pressions "anti-décadentistes" prédominantes.
Dans une prise de position "Éléments de réflexion sur les crises du CCI" de février 2002 et publiée dans la revue Internationalist Communist n° 21, le concept de décadence est critiqué ainsi: "aussi universel que confus", "étranger à la critique de l’économie politique", " étranger à la méthode et à l’arsenal de la critique de l’économie politique". On nous demande aussi: "Quel rôle joue donc le concept de décadence sur le terrain de la critique de l’économie politique militante, c’est à dire de l’analyse approfondie des phénomènes et des dynamiques du capitalisme dans la période que nous vivons? Aucun. Au point que le mot lui-même n’apparaît jamais dans les trois volumes qui composent le Capital."[17]
Une contribution publiée en italien dans Prometeo n° 8, Série VI (décembre 2003) et en français sur le site, "Pour une définition du concept de décadence"[18] contenait toute une série d’affirmations inquiétantes.
La théorie de la décadence, apparemment, est considérée comme une notion fataliste de la trajectoire du capitalisme et du rôle des révolutionnaires: "L'ambiguïté réside dans le fait que l'idée de décadence ou de déclin progressif du mode de production capitaliste, provient d'une sorte de processus d'autodestruction inéluctable dépendant de son essence propre. (…) [la] disparition et [la] destruction de la forme économique capitaliste [serait] un événement historiquement daté, économiquement inéluctable et socialement prédéterminé. Outre une approche infantile et idéaliste, cela finit par avoir des répercussions négatives sur le plan politique, générant l’hypothèse que pour voir la mort du capitalisme, il suffit de s’asseoir sur la berge, ou, au mieux, d’intervenir dans une situation de crise, et seulement celle-ci, les instruments subjectifs de la lutte de classe sont perçus comme le dernier coup de pouce d’un processus irréversible."
La décadence ne semble plus aboutir à l’alternative "socialisme ou barbarie" puisque le capitalisme est capable de se renouveler sans fin: "L’aspect contradictoire de la forme capitaliste, les crises économiques qui en dérivent, le renouvellement du processus d’accumulation qui est momentanément interrompu par les crises mais qui reçoit de nouvelles forces à travers la destruction de capitaux et des moyens de production excédentaires, ne mettent pas automatiquement en cause sa disparition. Ou bien c’est le facteur subjectif qui intervient, dont la lutte de classe est l’axe matériel et historique, et les crises la prémisse économique déterminante, ou bien, le système économique se reproduit, rééditant à un niveau supérieur toutes ses contradictions, sans pour cela créer les conditions de sa propre destruction."
Comme dans la prise de position de 2002, ce nouvel article défendait l’idée que le concept de décadence n’avait pas grand-chose à voir avec une critique sérieuse de l’économie politique: il n’était considéré comme utile que si l’on pouvait le "prouver" économiquement en examinant les tendances du taux de profit: "La théorie évolutionniste suivant laquelle le capitalisme se caractérise par une phase progressiste et décadente ne vaut rien, si l’on n’en donne pas une explication économique cohérente. (…) La recherche sur la décadence conduit soit à identifier les mécanismes qui président au ralentissement du processus de valorisation du capital avec toutes les conséquences que cela comporte, soit à demeurer dans une fausse perspective, vainement prophétique (…) Mais l’énumération des phénomènes économiques et sociaux une fois identifiés et décrits, ne peut être considérée elle-même comme la démonstration de la phase de décadence du capitalisme; en effet, ces phénomènes n’en sont que les effets et la cause première qui les impose, réside dans la loi de la crise des profits."
Les deux articles de la Revue internationale en réponse[19] montraient que si le Parti communiste internationaliste (PCInt) - Battaglia comunista, la section du BIPR/TCI en Italie - qui a écrit la contribution d’origine, avait toujours été assez inconséquent dans son adhésion à la notion de décadence; celui-ci traduisait ici une réelle régression vers la vision bordiguiste qui avait été l’un des éléments conduisant à la scission de 1952 du PCInt. Bordiga – dont la position était fortement combattue par Damen comme nous l’avons vu dans un article précédent de cette série[20] - affirmait que la "théorie de la courbe descendante" était fataliste tout en niant toute limite objective à la croissance du capital. Quant à l’idée de prouver "économiquement" la décadence, la reconnaissance que 1914 avait ouvert une nouvelle phase qualitative dans la vie du capital avait été défendue par des marxistes comme Lénine, Luxemburg et la Gauche communiste, avant tout sur la base de facteurs sociaux, politiques et militaires – comme tout bon médecin, ils avaient diagnostiqué la maladie à partir de ses symptômes les plus évidents, avant tout la guerre mondiale et la révolution mondiale.[21]
Nous ne savons pas comment la discussion s’est déroulée dans le BIPR/TCI suite à la publication de cet article par Battaglia comunista.[22] En tous cas, il reste que les deux articles que nous venons de mentionner sont le reflet d’un rejet plus général de la cohérence de la gauche italienne, ils sont l'expression de cette tendance au sein d'un des groupes les plus solides de cette tradition.
La régression vis-à-vis de la théorie de la décadence de la part d’éléments de la Gauche communiste peut être vue comme une libération par rapport à un dogmatisme rigide et une ouverture vers un enrichissement théorique. Mais alors que nous sommes les derniers à rejeter la nécessité d’élucider et d’approfondir toute la question de l’ascendance et du déclin du capitalisme[23], il nous semble que ce à quoi nous sommes principalement confrontés ici, c’est à un recul par rapport à la clarté de la tradition marxiste et à une concession envers le poids énorme de l’idéologie bourgeoise, qui se fonde nécessairement sur la foi dans la nature éternelle et auto-renouvelable de cet ordre social.
Aufheben. C’est le capital qui est "objectiviste", pas le marxisme
Comme nous l’avons dit au début de cet article, ce problème – l’incapacité de voir le capitalisme comme une forme transitoire d’organisation sociale qui a déjà montré son obsolescence – domine particulièrement dans la nouvelle génération de minorités politisées fortement influencées par l’anarchisme. Mais, comme tel, l’anarchisme n’a pas grand-chose à proposer au niveau théorique, surtout quand il s’agit de la critique de l’économie politique, et a l’habitude d’emprunter au marxisme s’il veut se donner une apparence de véritable profondeur. Dans une certaine mesure, c'est le rôle du groupe Aufheben dans le milieu communiste libertaire en Grande-Bretagne et internationalement. Beaucoup attendent impatiemment la parution annuelle de la revue Aufheben qui propose des analyses solides sur les questions de l’heure, du point de vue du "marxisme autonomiste". La série sur la décadence en particulier ("Decadence: The Theory of Decline or the Decline of Theory?" - Décadence: la théorie du déclin ou le déclin de la théorie? – qui a commencé dans le n° 2 d’Aufheben, été 1993) est considérée par beaucoup comme la réfutation définitive du concept de déclin du capitalisme qui serait un héritage de la Deuxième Internationale, exprimant un point de vue "objectiviste" sur la dynamique du capitalisme qui sous-estime totalement la dimension subjective de la lutte de classe.
"Pour les social-démocrates de gauche, insister sur le fait que le capitalisme est en déclin, qu’il approche de son effondrement, est considéré comme essentiel. Le sens du "marxisme" est de s’inscrire dans l’idée que le capitalisme est en banqueroute et que l’action révolutionnaire est donc nécessaire. Les marxistes s’engagent donc dans l’action révolutionnaire mais, comme nous l’avons vu, parce que le centre d’attention porte sur les contradictions objectives du système et que l’action subjective révolutionnaire est une réaction à celles-ci, ils n’ont rien à voir avec les véritables prérequis nécessaires à la fin du capitalisme – le développement concret du sujet révolutionnaire. Il semblait aux membres les plus révolutionnaires du mouvement comme Lénine et Luxemburg qu’une position révolutionnaire était une position croyant dans l’effondrement alors que la théorie de l’effondrement avait en fait permis l’adoption d’une position réformiste au début de la Deuxième Internationale. La question, c’est que la théorie du déclin du capitalisme en tant que théorie de son effondrement du fait de ses propres contradictions objectives implique un état d’esprit essentiellement contemplatif face au caractère objectif du capitalisme tandis que ce qui est vraiment requis pour la révolution, c’est de rompre avec cette attitude contemplative."[24]
Aufheben considère que les trotskystes comme les communistes de gauche d’aujourd’hui sont les héritiers de cette tradition social-démocrate (de gauche): "Notre critique est que leur théorie contemple le développement du capitalisme; les conséquences pratiques sont que les trotskystes courent après tout ce qui bouge afin de recruter pour leur confrontation finale tandis que les communistes de gauche se tiennent à l’écart en attendant le pur exemple d’action révolutionnaire des ouvriers. Derrière cette opposition apparente dans la façon de voir la lutte, ils partagent une conception de l’effondrement du capitalisme qui signifie qu’ils n’apprennent pas du mouvement réel. Bien qu’ils prennent des positions qui glissent vers l’idée de l’inévitabilité du socialisme, en général pour les théoriciens de la décadence cet avènement n’est pas inévitable – nous ne devons pas tous sortir au pub – mais le capitalisme s’effondrera. Cette théorie peut ainsi s’accompagner de la construction d’une organisation léniniste maintenant ou bien, comme pour Mattick, on peut attendre le moment de l’effondrement quand il sera possible de créer une véritable organisation révolutionnaire. La théorie du déclin et de la Crise est détenue et comprise par le parti, le prolétariat doit se mettre derrière sa bannière. Ça veut dire "Nous comprenons l’Histoire, suivez-nous". La théorie du déclin va très bien avec la théorie léniniste de la conscience qui, bien sûr, s’est beaucoup inspirée de Kautsky qui a terminé son commentaire sur le Programme d’Erfurt par la prévision que les classes moyennes allaient s’engager "dans le Parti socialiste et, main dans la main avec le prolétariat qui avance irrésistiblement, suivront sa bannière jusqu’à la victoire et au triomphe".
Comme on peut le voir de cette affirmation selon laquelle la théorie de la décadence amène logiquement à la théorie "léniniste" de la conscience de classe, la vision globale d’Aufheben a été influencée par Socialisme ou Barbarie (S ou B), dont l’abandon de la théorie marxiste de la crise dans les années 1960 a été examiné dans un article précédent de cette série[25]) et plus encore par l’autonomisme italien[26]. Ces deux courants partageaient la critique d’un "objectivisme" de Marx, en faisant une lecture d’après laquelle l’étude constante des lois économiques du capital minimiserait l’impact de la lutte de classe sur l’organisation de la société capitaliste et ne parviendrait pas à saisir l’importance de l’expérience subjective de la classe ouvrière face à son exploitation. En même temps, Aufheben est conscient que la théorie de l’aliénation de Marx est fondée, précisément, sur la subjectivité et critique Paul Cardan/Cornelius Castoriadis (le principal théoricien de S ou B) pour avoir érigé une critique de Marx ne prenant pas en compte cet élément-clé de sa pensée: "La "contradiction fondamentale" de S ou B est de ne pas saisir pleinement le radicalisme de la critique de l’aliénation par Marx. En d’autres termes, il présentait comme une innovation ce qui était en réalité un appauvrissement de la critique de Marx."[27]
Les autonomes sont aussi allés au-delà de l’idée superficielle de Cardan selon laquelle Marx avait écrit "un ouvrage monumental [Le Capital] analysant le développement du capitalisme, ouvrage d’où la lutte des classes est totalement absente."[28] Le livre de Harry Cleaver, Reading Capital Politically, publié en 1979 et qui s’identifie explicitement à la tradition du "marxisme autonomiste", démontre très bien que, dans la démarche de Marx, le capital est défini comme un rapport social et, comme tel, inclut nécessairement la résistance du prolétariat à l’exploitation qui, à son tour, modifie la façon dont le capital s’organise. C’était évident par exemple dans la lutte pour la réduction du temps de travail, dans le passage de l’extraction de la plus-value absolue à la plus-value relative (au 19e siècle) et dans le besoin croissant du système d’une planification de l'État pour faire face au danger prolétarien (au 20e siècle).
Ceci apporte un correctif valable à une vision mécaniste "kautskyste", qui s’est vraiment développée à l’époque de la Deuxième Internationale et selon laquelle les lois inexorables de l’économie capitaliste garantissaient plus ou moins que le pouvoir tomberait "comme un fruit mûr" dans les mains d’un parti social-démocrate bien organisé. De plus, souligne Cleaver, cette démarche qui sous-estime réellement le développement subjectif de la conscience de classe n’épargne pas une sorte d’ultra-léninisme qui intercale le parti comme seul élément de subjectivité, comme dans la fameuse formule de Trotsky selon laquelle "La crise historique de l’humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire" (Programme de Transition - L’agonie du capitalisme et les tâches de la Quatrième Internationale[29]). Le parti est vraiment un facteur subjectif mais sa capacité à grandir et à influencer le mouvement de la classe dépend d’un développement bien plus grand de la conscience et du combat prolétariens.
Il est également juste que la bourgeoisie a besoin de tenir compte de la lutte de la classe ouvrière dans ses efforts pour gérer la société – pas seulement sur le plan économique mais aussi aux niveaux politique et militaire. Et les analyses du CCI de la situation mondiale prennent assurément en compte cet aspect. On peut donner plusieurs exemples: quand nous interprétons le choix des équipes politiques qui doivent diriger l'État "démocratique", nous considérons toujours la lutte de classe comme un élément central; c’est pourquoi au cours des années 1980 nous écrivions que la bourgeoisie préférait maintenir les partis de gauche dans l’opposition pour mieux affronter les réactions prolétariennes face aux mesures d’austérité; de même, la stratégie de privatisation n’a pas seulement une fonction économique dictée par les lois abstraites de l’économie (généralisant la sanction du marché à chaque étape du processus du travail) mais, aussi, une fonction sociale ayant pour but de fragmenter la réponse du prolétariat aux attaques contre ses conditions de vie, qui n’apparaissent plus comme émanant d’un seul patron, l'État capitaliste. Sur un plan plus historique, nous avons toujours défendu que la lutte de classe, qu’elle soit ouverte ou potentielle, joue un rôle crucial dans la détermination du cours historique vers la guerre ou vers la révolution. Nous donnons ces exemples pour montrer qu’il n’y a pas de lien logique entre le fait de défendre une théorie du déclin du capitalisme et la négation du facteur subjectif de la classe pour déterminer la dynamique générale de la société capitaliste.
Mais les autonomes perdent complètement la tête quand ils concluent que la crise économique, qui a refait surface à la fin des années 1960, était elle-même un produit de la lutte de classe. Même si, à certains moments, les luttes ouvrières peuvent exacerber les difficultés économiques de la bourgeoisie et faire barrage à ses "solutions", nous ne savons que trop bien à quel point la crise économique peut atteindre des proportions catastrophiques dans des phases où la lutte de classe connaît un profond reflux. La Grande Dépression des années 1930 en est le plus clair exemple. Cette vision selon laquelle les luttes ouvrières provoquent la crise économique pouvait sembler plausible dans les années 1970 vu la concomitance des deux phénomènes, mais Aufheben lui-même en voit les limites dans l'article de la série sur la décadence consacré notamment aux autonomes: "La théorie de la crise provoquée par la lutte de classe a quelque peu déraillé dans les années 1980 car, alors que dans les années 1970 la rupture des lois objectives du capital sautait aux yeux, avec le succès partiel du capital le sujet qui émergeait a été repoussé. Durant les années 1980, nous avons vu les lois objectives du capital donner libre cours à leur folie furieuse dans notre vie. Une théorie qui faisait le lien entre les manifestations de la crise et le comportement concret de la classe trouvait peu de luttes offensives sur lesquelles s’appuyer et, pourtant, la crise a continué. Cette théorie est devenue moins appropriée aux conditions."[30]
Alors que reste-t-il de l’équation entre la théorie de la décadence et "l’objectivisme"? Plus haut, nous avons mentionné qu’Aufheben avait critiqué à juste raison Cardan parce qu’il ignorait les véritables implications de la théorie de l’aliénation de Marx. Malheureusement, Aufheben commet la même erreur quand il amalgame la théorie du déclin du capitalisme avec la vision "objectiviste" du capital comme n'étant rien d’autre qu’une machine réglée comme une horloge, par des lois inhumaines. Mais, pour le marxisme, le capital n’est pas quelque chose qui plane au-dessus de l’humanité comme Dieu; ou, plutôt, comme Dieu, il est engendré par l’activité humaine. Cependant, c’est une activité aliénée, ce qui veut dire qu’il devient indépendant de ses créateurs – en fin de compte tant de la bourgeoisie que du prolétariat, puisque tous deux sont menés par les lois abstraites du marché vers l’abîme du désastre économique et social. Cet objectivisme du capital est précisément ce que la révolution prolétarienne veut abolir, non en humanisant ses lois mais en les remplaçant par la subordination consciente de la production aux besoins humains.
Dans World Revolution n° 168 (octobre 1993)[31], nous avions publié une réponse au premier article d’Aufheben sur la décadence. L’argument central de cette réponse est qu’en critiquant la théorie de la décadence, Aufheben rejetait toute la démarche de Marx vis-à-vis de l’histoire. En particulier, en portant l’accusation d’ "objectivisme", il ignorait l’avancée cruciale faite par le marxisme rejetant à la fois la méthode matérialiste vulgaire et la méthode idéaliste et surmontant ainsi la dichotomie entre l’objectif et le subjectif, entre la liberté et la nécessité[32].
Il est intéressant de noter que, dans ses premiers articles sur la décadence, Aufheben ne reconnait pas seulement l’inadéquation de l’explication de la crise par les autonomes: dans une introduction très critique de la série publiée en ligne sur libcom.org[33], il admet qu’il n’a pas réussi à saisir de façon précise la relation entre les facteurs objectifs et subjectifs chez un certain nombre de penseurs marxistes (y compris Rosa Luxemburg qui défendait clairement la notion de déclin du capitalisme) et admet que la critique que nous avions portée sur un certain nombre d’aspects de cette question-clé était tout à fait valable. Après la publication du troisième article, il a réalisé que toute la série faisait fausse route et, pour cette raison, il l’a abandonnée. Cette autocritique n’est pas particulièrement connue tandis que la série d’origine continue de servir de référence comme étant le dernier mot contre la théorie de la décadence.
Cet auto-examen ne peut qu’être bienvenu mais nous ne sommes pas convaincus que ses résultats aient été particulièrement positifs. L’indication la plus évidente étant que, précisément dans une période où l’impasse économique à laquelle ce système est confronté paraît de plus en plus évidente, les dernières publications du groupe montrent qu’il s’est engagé dans une montagne de travaux qui ont accouché d’une souris: la "crise de la dette" qui a éclaté en 2007 n’est pas, selon lui, l’expression d’un problème sous-jacent du processus d’accumulation mais provient fondamentalement des erreurs du secteur financier. De plus, celle-ci pourrait très facilement mener à un nouveau et vaste "redressement" du même type que ceux qui l’ont précédé dans les années 1990 et dans les années 2000[34]. Nous n’avons pas la place de développer plus longuement cette question ici, mais il semble que l’anti-décadentisme est en train d’atteindre la phase finale de son déclin.
Nous arrêterons ici cette polémique mais le débat sur cette question doit se poursuivre. Il est rendu d’autant plus urgent qu'un nombre croissant de personnes, et par-dessus tout la nouvelle génération, est de plus en plus conscient du fait que le capitalisme n’a vraiment pas d’avenir et que la crise est vraiment une crise terminale. C’est une question qui doit de plus en plus être débattue dans les batailles de classe et les révoltes sociales que la crise provoque sur toute la planète. Il est plus que jamais vital de fournir un cadre théorique clair pour comprendre la nature historique de l’impasse dans laquelle se trouve le système capitaliste, d’insister sur le fait que c’est un mode de production hors de contrôle et qui va à son autodestruction, et donc de souligner l’impossibilité de toutes les solutions réformistes ayant pour but de rendre le capital plus humain ou plus démocratique. Bref, de démontrer que l’alternative "socialisme ou barbarie", annoncée fortement et clairement par les révolutionnaires en 1914, est plus valable aujourd’hui que jamais. Cet appel n’a rien à voir avec un plaidoyer pour l’acceptation passive de la voie suivie par la société. Au contraire, c’est un appel à ce que le prolétariat agisse, devienne de plus en plus conscient et ouvre la voie à un avenir communiste qui est possible, nécessaire, mais en aucune façon garanti.
Gerrard (printemps 2012)
[1] https://fr.internationalism.org/rint148/40_annees_de_crise_ouverte_montrent_que_le_capitalisme_en_declin_est_incurable.html [70]
[2] "Décadence du capitalisme (X) : Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme [28]".
[3] "Quelle méthode scientifique pour comprendre l'ordre social existant, les conditions et moyens de son dépassement" https://fr.internationalism.org/node/3485 [71]
[4] https://fr.internationalism.org/rinte48/decad.htm [72], https://fr.internationalism.org/french/rinte49/decad.htm [73], https://fr.internationalism.org/french/rinte50/decadence.htm [74]
[10] internationalist-perspective.org/IP/ip-archive/ip_44_decadence-2.html en français : « Une contribution au débat sur la décadence" qui comporte quelques variations par rapport à la version anglaise, internationalist-perspective.org/PI/pi-archives/pi_44_decadence-2.html.
[11] internationalist-perspective.org/IP/ip-archive/ip_29_decadence.html. L’article n’est pas publié en français sur le web.
[12] Mac Intosh n’est ni le premier ni le dernier des anciens membres du CCI à être si ébloui par les taux de croissance du capitalisme qu’il finit par mettre en question ou par abandonner le concept de décadence du capitalisme. À la fin des années 1990, dans le sillage d’une grave crise centrée une fois de plus sur la question de l’organisation, un certain nombre d’anciens membres du CCI ont constitué le Cercle de Paris, parmi lesquels RV, rédacteur de la brochure La décadence du capitalisme et des articles de réponse à la critique par le GCI du « décadentisme". Bien que la question de la décadence n’ait jamais été un objet de débat dans la crise interne, le Cercle de Paris publia rapidement un texte important rejetant le concept de décadence – son argument essentiel portant sur le développement considérable des forces productives depuis 1914 et surtout depuis 1955.(cercledeparis.free.fr/indexORIGINAL.html [78])
[13] Le Capital, Livre III, Troisième section, Éd. La Pléiade, p. 1032
[14] Lire à ce propos notre article "L'étude du Capital et des fondements du communisme" de la série "Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle" (https://fr.internationalism.org/rinte75/communisme.htm [79]).
[15] En fait une estimation du FMI prévoit que "l'économie chinoise pourrait voir sa croissance divisée par deux si la crise de la zone euro s'aggrave". (Les Echos. www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0201894521951-... [80]).
[16] Pour maintenir sa croissance, malgré le ralentissement de la conjoncture économique mondiale, la Chine a misé sur son marché intérieur à travers un endettement renforcé des administrations locales. Mais, ici aussi, il n'y a pas de miracle possible. On ne peut pas s'endetter sans fin sans créer des risques de faillite, en l'occurrence des banques commerciales chinoise. Or, justement, "Pour éviter des défauts de paiements en cascade", celles-ci ont "repoussé dans le temps les échéances d'une grande partie des titres de la dette des collectivités locales, ou s'apprêtent à le faire" (Les Echos).
[17] www.leftcom.org/fr/articles/2002-02-01/el%C3%A9ments-de-r%C3%A9flexion-sur-les-crises-du-cci [81]
[18] www.leftcom.org/fr/articles/2003-12-01/pour-une-d%C3%A9finition-du-concept-de-d%C3%A9cadence [82]
[19] https://fr.internationalism.org/rinte119/decadence.htm [83] et https://fr.internationalism.org/rint/120_decadence [84]
[20] https://fr.internationalism.org/rint147/decadence_du_capitalisme_le_boom_d_apres_guerre_n_a_pas_renverse_le_cours_du_declin_du_capitalisme.html [27]
[21] L’article de la Revue internationale n° 120 dénonce aussi les affirmations hypocrites d’un groupe d’éléments exclus du CCI pour leur comportement inacceptable: la « Fraction interne du CCI", qui avait publié un article flagorneur sur la contribution de Battaglia comunista. Ayant attaqué le CCI pour avoir « abandonné" le concept de décadence à travers la théorie de la décomposition (qui n’est aucunement en dehors du concept de décadence), le projet politique de cette « fraction" - celui d’attaquer le CCI tout en flattant le BIPR – se démasquait très clairement dans cet article.
[22] Il semblerait que l’article de Prometeo n°8 était un document de discussion et non une prise de position du BIPR ou de l’un de ses affiliés, ce qui rend le titre de notre réponse (« Battaglia comunista abandonne le concept marxiste de décadence") en quelque sorte inadapté.
[23] Par exemple, le débat sur la base économique du boom d’après-guerre (https://fr.internationalism.org/rint133/les_causes_de_la_periode_de_prosperite_consecutive_a_la_seconde_guerre_mondiale.html [85] et les articles dans les numéros suivants) et la reconnaissance que la décadence a une histoire, menant au concept de décomposition en tant que stade final du déclin du capitalisme.
[24] https://libcom.org/library/decadence-aufheben-2 [86] (toutes les citations sont traduites de l’anglais par nous)
[25] https://fr.internationalism.org/rint147/decadence_du_capitalisme_le_boom_d_apres_guerre_n_a_pas_renverse_le_cours_du_declin_du_capitalisme.html [27]
[28] Cornelius Castoriadis. Brochure n°10. Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne. Chap. II : « La perspective révolutionnaire dans le marxisme traditionnel".
[29] https://fr.internationalism.org/rint146/pour_les_revolutionnaires_la_grande_depression_confirme_l_obsolescence_du_capitalisme.html [28]
[32] Voir aussi l’article de cette série dans la Revue internationale n° 141 https://fr.internationalism.org/rint140/la_theorie_du_declin_du_capitalisme_et_la_lutte_contre_le_revisionnisme.html [90] , qui contient une critique de l’idée d’Aufheben selon laquelle la notion de décadence trouve son origine dans la Deuxième Internationale.
[33] https://libcom.org/article/aufheben-decadence [91]. Dans cette introduction, Aufheben dit clairement qu’au début, les écrits du CCI avaient constitué un point de référence important pour le groupe. Cependant, il dit aussi que notre démarche dogmatique et sectaire à son égard (par exemple lors d’une réunion à Londres sur l'avenir de l'Union européenne) l’avait convaincu du fait qu’il n’était pas possible de discuter avec nous. Il est vrai que le CCI a eu, dans une certaine mesure, une démarche sectaire envers Aufheben – ce qui se reflète dans notre article de 1993, par exemple lorsque nous écrivons, à la fin, que ce serait mieux que le groupe disparaisse.
[34] Voici les derniers paragraphes d'un article datant de 2011: « il n’y a pas grand-chose qui suggère que nous soyons entrés dans une longue descente ou que le capitalisme soit maintenant embourbé dans la stagnation sinon la crise financière elle-même. En fait, la reprise rapide des profits et la confiance de la plus grande partie de la bourgeoisie dans les perspectives à long terme d’une accumulation renouvelée du capital semblent suggérer l’inverse. Mais si le capitalisme dans son ensemble est encore au milieu du chemin d’un long redressement, avec historiquement de hauts taux de profit, comment expliquer la crise financière imprévue de 2007-2008?
Comme nous l’avons depuis longtemps défendu contre l’orthodoxie « stagnationniste", la théorie du « redressement" s’est avérée correcte en comprenant que la restructuration de l’accumulation globale du capital qui a eu lieu au cours de la dernière décennie, en particulier par l’intégration dans l’économie mondiale de la Chine et de l’Asie, a mené à la restauration des taux de profit et, en conséquence, à un redressement économique soutenu. Mais comme nous le reconnaissons aujourd’hui, le problème est que la théorie du redressement n’a pas réussi à saisir de façon adéquate l’importance de l’émergence des banques et de la finance au niveau global, ni le rôle qu’elles ont joué dans cette restructuration.
Ainsi, afin de surmonter les limites des théories « stagnationniste" et « redressementiste" sur la crise, il était nécessaire d’examiner les rapports entre l’émergence et le développement des secteurs bancaire et financier au niveau global et la restructuration de la véritable accumulation du capital qui a eu lieu au cours des trente dernières années. Sur la base de cet examen, nous avons pu conclure que la crise financière de 2007-08 n’avait pas eu lieu par hasard à cause d’une politique erronée ni que c’était une crise du système financier qui ne faisait que refléter une crise sous-jacente de stagnation de la réelle accumulation du capital. Mais, au contraire, la cause sous-jacente de la crise financière était une trop grande fourniture de capital-monnaie empruntable au sein du système bancaire et financier dans son ensemble qui s’est développée à la fin des années 1990. Ceci à son tour était le résultat de développements dans l’accumulation réelle de capital – comme la montée de la Chine, le décollage de la « nouvelle économie" et la liquidation continue de la « vieille économie" - qui ont été centraux pour soutenir la longue montée.
De cela, nous pourrions tenter de conclure que la nature et la signification de la crise financière ne sont pas à un tournant décisif menant à une descente économique ou à la fin du néolibéralisme comme beaucoup l’ont supposé mais, plutôt, un point d’inflexion indiquant une nouvelle phase à long terme. La signification de cette phase et les implications que cela a pour le développement futur du capitalisme et de la lutte contre lui sont une question que nous n’avons pas la place de traiter ici." Aufheben n° 19, « Return of the crisis: Part 2 - the nature and significance of the crisis", https://libcom.org/article/return-crisis-part-2-nature-and-significance-crisis [92]
Questions théoriques:
- Décadence [37]
Rubrique:
Revue Internationale n° 150 - 3e et 4e trimestre 2012
- 1370 reads
Sommet de l'Euro de juin 2012 : derrière les illusions, un nouveau pas dans la catastrophe
- 1243 reads
Le 29 juin 2012 au matin, comme par enchantement, une douce euphorie gagnait rapidement les politiciens et dirigeants de la zone Euro. Les médias bourgeois et les économistes n’étaient pas en reste. Le dernier sommet européen venait de prendre apparemment des "décisions historiques". Contrairement à ceux, nombreux, qui l'avaient précédé au cours des dernières années et qui avaient tous échoué. Mais, aux dires de beaucoup de commentateurs, ce temps était désormais révolu ; la bourgeoisie de cette zone, pour une fois unie et solidaire, venait d’adopter les mesures nécessaires pour sortir du tunnel de la crise. Pour peu, on se serait cru dans le monde d’Alice aux pays des merveilles. Mais en y regardant de plus près et une fois les brumes matinales dissipées, apparaissent alors les vraies questions : Quel est le contenu réel de ce sommet ? Quelle va être sa portée ? Va-t-il réellement apporter une solution durable à la crise de la zone Euro et donc pour l'économie mondiale ?
Le dernier sommet européen : des décisions en trompe l’œil
Si le sommet européen du 29 juin 2012 a été présenté comme "historique" c'est qu'il est censé constituer un tournant dans la façon dont les autorités affrontent la crise de l'Euro. D'une part, au niveau de la forme, ce sommet, pour la première fois, ne s'est pas contenté, suivant les commentateurs, d'entériner les décisions prises auparavant par "Merkozy", c'est-à-dire le tandem Merkel-Sarkozy (en réalité, la position de Merkel entérinée par Sarkozy) 1 mais a tenu compte des demandes de deux autres pays importants de la zone, l'Espagne et l'Italie, des demandes appuyées par le nouveau président français, François Hollande. Par ailleurs, ce sommet devait inaugurer une nouvelle donne dans la politique économique et budgétaire au sein de la zone : après des années où la seule politique promue par les instances dirigeantes de l'Euro consistait en une austérité de plus en plus impitoyable, on prenait enfin en compte une des critiques à cette politique (portée notamment par les économistes et politiciens de gauche) suivant laquelle, sans relance de l'activité économique, les États surendettés seraient incapables de trouver les ressources fiscales pour payer leurs dettes.
C'est pour cela que le président de gauche François Hollande, venu pour arracher un "pacte pour la croissance et l’emploi" tenait la scène comme un acteur de théâtre fier de sa prestation et des résultats obtenus. Il était accompagné, dans sa satisfaction, par deux hommes pourtant de droite, Monti chef du gouvernement italien et Rajoy son homologue espagnol qui, eux-aussi, paradaient : leurs calculs ayant apparemment payé, l’étau financier sur leur pays devait se desserrer. La situation réelle était bien trop grave pour que tous ces messieurs prennent un air triomphant, mais l’humeur y était : "on pouvait espérer voir le début de la fin de la sortie du tunnel de la crise dans la zone euro !" Cette déclaration particulièrement alambiquée aurait été prononcée par le chef du gouvernement italien !
Avant de soulever le voile sur ce matin qui s’annonçait ainsi presque radieux, un petit retour dans le temps s’impose. Souvenons-nous : depuis six mois, la zone Euro s’est retrouvée deux fois en situation de voir ses banques s’effondrer. La première fois, cela a donné naissance à ce qui a été appelé LTRO (Long Term Refinancing Operation) : la Banque centrale européenne (BCE) a accordé pour 1000 milliards environ de prêts à celles-ci. En réalité 500 milliards avaient déjà été provisionnés dans ce sens. Quelques mois après, voilà à nouveau que ces mêmes banques appellent au secours ! Racontons maintenant une petite histoire dérisoire qui illustre ce qui se passe réellement dans la finance européenne. Au début de cette année 2012 les dettes souveraines (celles des États) explosent. Les marchés financiers font alors eux-mêmes grimper les taux auxquels ils acceptent de prêter de l’argent à ces États. Certains d'entre eux, notamment l’Espagne, ne peuvent plus aller chercher de prêts sur le marché. C’est trop cher. Pendant ce temps-là les banques espagnoles rendent l’âme. Que faire ? Que faire en Italie, au Portugal et ailleurs ? Une idée géniale germe alors dans les grands esprits de la BCE. Nous allons prêter massivement aux banques, qui vont elles-mêmes financer les dettes souveraines de leur État national et l’économie "réelle" sous forme de prêts à l'investissement ou à la consommation. Cela se passait l'hiver dernier, la Banque centrale européenne faisait "bar ouvert et boissons à discrétion". Le résultat est là, début juin tout le monde se réveille avec une cirrhose du foie. Les banques n’ont pas prêté à l’économie "réelle" ; elles ont mis cet argent en sécurité, en rapportant elles-mêmes son équivalent à la Banque centrale, avec en plus un petit intérêt en retour. En quoi cet équivalent consistait-il ? En des obligations d’État qu’elles venaient d’acheter avec l’argent de cette même Banque centrale. Véritable tour de passe-passe et d’illusion qui ne pouvait tenir que le temps d’un spectacle décidément totalement dérisoire !
Au mois de juin, les "médecins économistes" crient à nouveau haut et fort : nos malades sont en train de mourir. Il faut immédiatement des mesures radicales prises conjointement par les hôpitaux de toute la zone Euro. Nous sommes maintenant au moment de la tenue du sommet du 29 juin. Après toute une nuit de négociations, un accord "historique" semble trouvé. Les décisions prises :
les fonds de stabilisation financière (FESF et MES 2) vont pouvoir renflouer directement les banques, après accord de la BCE, ainsi qu’acheter de la dette publique afin de détendre les taux auxquels les États empruntent sur les marchés financiers ;
les européens vont confier à la BCE la supervision du système bancaire de la zone Euro ;
une extension de la règle de contrôle des déficits public des États de cette zone est adoptée ;
enfin, à la grande satisfaction des économistes et politiciens de gauche, un plan de 100 milliards d’euros de relance de l’activité est mis en scène.
Pendant quelques jours les mêmes discours fleurissent. La zone Euro a enfin pris les bonnes décisions. Si l’Allemagne a réussi à maintenir sa "Règle d’or" en matière de dépenses publiques (qui impose aux États d'inscrire dans leur loi fondamentale l'élimination du déficit budgétaire), elle a par contre accepté d’aller dans le sens de la mutualisation des dettes des États de la zone Euro et de la monétisation de ces dettes, c'est-à-dire de la possibilité de les rembourser en imprimant de la monnaie.
Comme toujours dans ce genre d’accord, la réalité se cache dans le calendrier et dans la mise en pratique des décisions qui sont prises. Cependant, dès ce fameux petit matin, un élément sautait aux yeux. Une question essentielle semblait avoir été écartée, celle des moyens financiers et de leurs sources réelles. Tout le monde s’accordant par ailleurs pour sous-entendre que l’Allemagne finirait par payer puisqu’elle seule semble apparemment en avoir les moyens ! Et puis, pendant le mois de juillet, oh surprise ! Tout paraît remis en question. Grâce à des manœuvres juridiques, l'application des accords est renvoyée au plus tôt en septembre. Il y a en effet un tout petit problème. Au 16 juillet l’ardoise de l’Allemagne devenait tout simplement insupportable. Lorsqu’on additionne tous les engagements en termes de garanties déguisées et lignes de crédits, l’exposition totale de ce pays à ses voisins européens aux abois s’élève à 1500 milliards d’euros. Le PNB de l’Allemagne est de 2650 milliards d’euros et ceci avant la prise en compte de la contraction de son activité qui a commencé il y a quelques mois. C’est là une somme ahurissante équivalant à plus de la moitié de son PNB. Les derniers chiffres annoncés en matière de dette pour la zone Euro s’élèvent eux à environ 8000 milliards dont une grande partie représente des actifs dits "toxiques" (c'est-à-dire des reconnaissances de dette qui ne seront jamais honorées). Il n’est pas bien difficile de comprendre que l’Allemagne est incapable d’assurer un tel niveau d’endettement. Elle n’est pas en mesure non plus, dans la durée, de cautionner, avec suffisamment de crédibilité, par sa seule signature, ce mur de la dette auprès des marchés financiers. La preuve effective de cette réalité existe ; elle s’exprime dans un paradoxe dont seule une économie en plein désarroi a le secret. L’Allemagne place sa dette à court et moyen terme à des taux négatifs. En clair les acheteurs de cette dette acceptent de ne percevoir que des intérêts ridicules tout en perdant du capital avec l’évolution de l’inflation. La dette souveraine allemande semble être un refuge de montagne capable d’affronter toutes les tempêtes mais, en même temps, les prix des assurances contractées par les acheteurs pour assurer cette dette en leur possession grimpe au niveau de ceux de la Grèce ! Finalement ce refuge se révèle bien vulnérable ! Les marchés savent pertinemment que si l’Allemagne continue de financer la dette de la zone Euro, elle deviendra alors elle-même insolvable et c'est pour cela que chacun des prêteurs veille à s’assurer au mieux en cas de chute brutale.
Alors reste la tentation de l’arme ultime. Celle qui consisterait à dire à la Banque centrale européenne de faire comme le Royaume-Uni, le Japon ou les États-Unis : "Imprimons des billets et encore des billets sans regarder la valeur de ce que l’on prend en échange". Les banques centrales peuvent bien se transformer à leur tour en banques "pourries", ce n’est pas le problème. Ce n’est plus le problème. Le problème est d’éviter que tout s’arrête aujourd’hui ! Nous verrons bien ce qui se passera demain, le mois prochain, l’année prochaine. C’est cela l’avancée du dernier sommet européen. Mais la BCE ne l’entend pas de cette oreille. Certes cette banque centrale n’a pas la même autonomie que les autres banques centrales du monde. Elle est liée aux différentes banques centrales de chaque nation composant la zone Euro. Mais le problème de fond est-il là ? Si la BCE pouvait opérer comme la Banque centrale du Royaume-Uni ou des États-Unis, par exemple, l’insolvabilité du système bancaire et des États de la zone Euro serait-elle résolue ? Qu'en est-il dans ces autres pays, par exemple aux États-Unis ?
Des banques centrales plus fragilisées que jamais
Alors que de lourds nuages s'amoncellent au-dessus de l’économie américaine, pourquoi les États-Unis n’ont-ils pas encore sorti de leur manche un troisième plan de relance, une nouvelle phase de monétisation de leur dette ?
Il faut se rappeler que le président de la Banque centrale américaine, Ben Bernanke a été surnommé "Monsieur Hélicoptère". Il y a déjà eu aux États-Unis, en quatre ans, deux plans de création monétaire massive, les fameux "quantitative easings". Ce monsieur semblait pouvoir survoler sans relâche les États-Unis et balancer de l’argent, inondant tout sur son passage. Un raz de marée ininterrompu de liquidités, et que chacun s’enivre à satiété ! Et bien non, désolé, cela ne marche pas comme cela. Depuis quelques mois une nouvelle création monétaire massive est indispensable aux États-Unis. Mais elle ne vient pas, elle se fait attendre. Parce qu’un "quantitative easing" n°3 est à la fois indispensable, vital et en même temps impossible, comme l’est en Europe une mutualisation et une monétisation globale de la dette de la zone Euro. Le capitalisme est engagé dans une rue qui finit en cul de sac ! Même la première puissance économique au monde ne peut pas fabriquer ex-nihilo de l’argent à l’infini. Toute dette a besoin d’être financée à un moment ou à un autre. La Banque centrale américaine a, comme toute banque centrale, deux sources de financement qui sont de fait liées et interdépendantes. La première consiste à capter l’épargne, l’argent qui existe au-dedans ou en-dehors du pays, soit à un coût d’emprunt tolérable, soit par un renforcement de la fiscalité. La seconde consiste à fabriquer de l’argent en contrepartie de reconnaissances de dettes, notamment en achetant ce qu’on appelle les obligations représentant la dette publique ou d’État. La valeur de ces obligations est en dernière instance déterminée par l’évaluation qu’en font les marchés financiers. Une voiture d’occasion est à vendre. Son prix est affiché sur le pare-brise par le vendeur. Les acheteurs potentiels vérifient l’état du véhicule. Des offres de prix d’achat sont proposées et le vendeur choisira sans aucun doute la moins mauvaise pour lui. Si l’état de la voiture est trop dégradé alors le prix devient dérisoire et celle-ci reste pourrir dans la rue. Ce petit exemple illustre le danger d’une nouvelle création monétaire aux États-Unis… et ailleurs. Depuis quatre ans, des centaines de milliards de dollars ont été injectées dans l’économie américaine sans que la moindre relance durable ne soit au rendez-vous. Pire : la dépression économique a poursuivi de manière souterraine son bonhomme de chemin. Nous voici arrivés au cœur du problème. L’évaluation de la valeur réelle de la dette souveraine est connectée de fait à la solidité de l’économie du pays, tout comme la valeur de notre voiture à son état réel. Si une Banque centrale (que ce soit aux États-Unis, au Japon ou dans la zone Euro) imprime des billets pour acheter des obligations, ou des reconnaissances de dettes, qui ne pourront jamais être remboursés (parce que les emprunteurs sont devenus insolvables) elle ne fait qu'inonder le marché de morceaux de papier qui ne correspondent à aucune valeur réelle car ils n'ont pas de contrepartie effective en termes d'épargne ou de richesses nouvelles en garantie. En d'autres termes, elles fabriquent de la fausse monnaie.
En route vers une récession généralisée
Une telle affirmation peut toujours paraître un peu exagérée ou aventureuse et pourtant ! Voici ce qui est écrit dans le bulletin Global Europe Anticipation de janvier 2012 : "Pour générer un dollar de croissance en plus, les USA doivent désormais emprunter autour de 8 dollars. Ou bien l’inverse, si on préfère, chaque dollar emprunté ne génère que 0,12 dollar de croissance. Cela illustre l’absurdité du moyen-long terme des politiques menées par la FED et le Trésor US ces dernières années. C’est comme une guerre où il faut tuer de plus en plus de soldats pour gagner de moins en moins de terrain." La proportion n’est sans doute pas exactement la même dans tous les pays du monde. Mais la tendance générale suit le même chemin. C'est pour cela, notamment, que les 100 milliards d'euros prévus par le sommet du 29 juin en vue de financer la croissance ne seront pas autre chose qu'un sparadrap sur une jambe de bois. Les profits réalisés sont dérisoires au regard de l’évolution du mur de la dette. Un film comique célèbre avait pour titre : "Y a-t-il un pilote dans l’avion ?". Pour ce qui concerne l’économie mondiale, il faudrait rajouter : "Il n’y a plus de moteur non plus". Voilà un avion et ses passagers en bien mauvaise posture.
Face à cette débandade générale des pays les plus développés, certains, afin de minimiser la gravité de la situation du capitalisme, tentent d'opposer l'exemple de la Chine et des pays "émergents". Il y a quelques mois encore, la Chine nous était vendue comme étant la prochaine locomotive de l’économie mondiale, aidée dans ce rôle par l’Inde et le Brésil. Qu'en est-il en réalité ? Ces "moteurs" connaissent à leur tour de très sérieux ratés. La Chine a annoncé officiellement, le vendredi 13 juillet, un taux de croissance de 7,6% ce qui en fait le taux le plus bas pour ce pays depuis le début de la phase actuelle de la crise. Le temps des taux à deux chiffres est bien fini. Et pourtant, même à 7%, ces chiffres n’intéressent plus les spécialistes. Tous savent qu’ils sont faux. Ces gens avisés préfèrent se tourner vers d’autres chiffres qu’ils jugent plus fiables. Voici ce qui était dit le même jour sur une radio économique spécialisée française (BFM) : "En regardant l’évolution de la consommation électrique, on peut déduire que la croissance chinoise se situe en réalité autour de 2 à 3%. Soit moins de la moitié des chiffres officiels." En ce début d’été, tous les chiffres de la croissance de l’activité sont en berne. Ils diminuent partout. Le moteur tourne au ralenti, proche de zéro. L’avion s’apprête à plonger et l'économie mondiale avec lui.
Le capitalisme entre dans la zone des grandes tempêtes
Face à la récession mondiale et à l’état financier des banques et des États, la guerre économique va faire rage entre différents secteurs de la bourgeoisie. La relance de l’activité par une politique keynésienne classique (qui suppose un endettement de l'État) ne peut plus être, comme on l'a vu, réellement efficace. Dans ce contexte de récession, l’argent collecté par les États ne peut que diminuer et, malgré l’austérité généralisée, leur dette souveraine ne pourra que continuer à exploser comme en Grèce ou maintenant en Espagne. La question qui va déchirer la bourgeoisie est la suivante : "Faut-il prendre le risque insensé de relever une nouvelle fois le plafond de la dette ?" De manière croissante, l’argent ne veut plus aller à la production, à l’investissement ou à la consommation. Ce n’est plus rentable. Mais les intérêts et les remboursements des dettes à échéances sont là. Il est nécessaire au capital de fabriquer de la monnaie nouvelle et factice au moins pour retarder la cessation de paiements généralisée. Bernanke, le patron de la banque centrale américaine, et son homologue Mario Draghi dans la zone Euro, comme tous leurs confrères sur cette planète sont pris en otage par l’état de l’économie capitaliste. Soit ils ne font rien et alors la dépression et les faillites vont prendre à court terme l’allure d’un cataclysme. Soit ils injectent à nouveau massivement de l’argent et alors commencera à sonner le glas pour la valeur de la monnaie. Une chose est certaine, même si elle perçoit maintenant ce danger, la bourgeoisie, divisée irrémédiablement sur ces sujets, ne réagira que dans des situations d’urgence absolue, au dernier moment, et dans des proportions toujours plus insuffisantes. La crise du capitalisme malgré tout ce que nous avons connu depuis l’année 2008 n’en est qu’à ses débuts.
Tino (30-07-2012)
1 Il faut noter que depuis que cet article a été écrit, le gouvernement français est revenu à plus de coopération avec la chancelière allemande. Peut-être faudra-t-il parler bientôt de "Merkhollande". En tout cas, en septembre 2012, le nouveau président Hollande et la direction du Parti socialiste font campagne pour forcer la main aux parlementaires de leur majorité afin qu'ils votent en faveur du Pacte de stabilité (la "règle d'or") que le candidat Hollande avait promis de renégocier. Comme le disait un vieux routard du gaullisme réputé pour son cynisme, Charles Pasqua, "les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient".
2 Fonds européen de stabilité financière et Mécanisme européen de stabilité.
Récent et en cours:
- Crise économique [5]
Rubrique:
Le Mexique entre crise et narcotrafic
- 4503 reads
La presse et les informations télévisées du monde entier transmettent régulièrement des images du Mexique dans lesquelles sont mis au premier plan les affrontements, la corruption et les assassinats, qui résultent de la "guerre contre le narcotrafic". Mais tout ceci apparaît comme un phénomène étranger au capitalisme ou anormal, alors que toute la réalité barbare qui va de pair est profondément enracinée dans la dynamique du système d’exploitation actuel. C'est, dans toute son étendue, la façon d’agir de la classe dominante qui est ainsi révélée, à travers la concurrence et les rivalités politiques exacerbées entre ses différentes fractions. Aujourd'hui, un tel processus de plongée dans la barbarie et la décomposition du capitalisme est effectivement dominant dans certaines régions du Mexique.
Au début de la décennie 1990, nous disions que "parmi les caractéristiques majeures de la décomposition de la société capitaliste, il faut souligner la difficulté croissante de la bourgeoisie à contrôler l'évolution de la situation sur le plan politique" 1. Ce phénomène apparaît plus clairement dans la dernière décennie du xxe siècle où il tend à devenir une tendance majeure.
Ce n'est pas seulement la classe dominante qui est affectée par la décomposition, le prolétariat et les autres couches exploitées en subissent aussi les effets les plus pernicieux. Au Mexique, les groupes maffieux et le propre gouvernement enrôlent, en vue de la guerre qu'ils se livrent, des éléments appartenant aux secteurs les plus paupérisés de la population. Les affrontements entre ces groupes, qui tirent sans distinction sur la population, laissent des centaines de victimes sur le carreau que gouvernement et maffias qualifient de "dommages collatéraux". Il en résulte un climat de terreur que la classe dominante a su utiliser pour éviter et contenir les réactions sociales aux attaques continues des conditions de vie de la population.
Le narcotrafic et l’économie
Dans le capitalisme, la drogue n’est rien de plus qu’une marchandise dont la production et la distribution nécessitent obligatoirement du travail, même si celui-ci n’est pas toujours volontaire ou salarié. L’esclavage dans ce milieu est courant, quoique soit aussi employé le travail volontaire et rémunéré d’un milieu lumpen pour des activités criminelles, mais aussi de journaliers et autres travailleurs comme des charpentiers (par exemple, pour la construction de maisons et de magasins) qui se voient contraints, pour survivre dans la misère qu’offre le capitalisme, de servir des capitalistes producteurs de marchandises illégales.
Ce qui est vécu aujourd’hui au Mexique a déjà existé (ou existe encore) dans d’autres parties du monde : les maffias tirent profit de la misère pour leurs agissements, et leur collusion avec les structures étatiques leur permet de "protéger leurs investissements" et leurs activités en général. En Colombie, dans les années 1990, l’enquêteur H. Tovar-Pinzón donnait un certain nombre d’éléments pour expliquer pourquoi les paysans pauvres devenaient les premiers complices des maffias du narcotrafic : "Une propriété produisait, par exemple, dix cargaisons de maïs par an qui permettaient une recette brute de 12 000 pesos colombiens. Cette même propriété pouvait produire cent arrobes de coca, qui représentaient pour le propriétaire un revenu brut de 350 000 pesos par an. N’est-il pas tentant alors de changer de culture quand l’une permet de gagner trente fois plus ?" 2.
Ce qui se passait en Colombie s’est étendu à toute l’Amérique latine, entraînant vers le narcotrafic, non seulement les paysans propriétaires, mais aussi la grande masse des journaliers sans terre qui vendent leur force de travail à ces derniers. Cette grande masse de salariés devient ainsi la proie facile des maffias, à cause du niveau extrêmement bas des salaires octroyés par l’économie légale. Au Mexique, par exemple, un journalier employé à couper la canne à sucre perçoit un peu plus de deux dollars par tonne (27 pesos) et voit son salaire amélioré lorsqu’il produit une marchandise illégale. Ce faisant, une grande partie des travailleurs employés dans cette activité perd sa condition de classe. Ces travailleurs sont toujours plus impliqués dans le monde du crime organisé et au contact direct des pistoleros et des transporteurs de drogue dont ils partagent directement le quotidien, dans un contexte de banalisation des assassinats et du crime. Mêlés étroitement à cette ambiance, la contagion les amène progressivement vers la lumpenisation. C’est un des effets nocifs de l’avancée de la décomposition affectant directement la classe ouvrière.
Il existe des estimations selon lesquelles les maffias du narcotrafic au Mexique emploieraient 25 % de personnes en plus que McDonald’s dans le monde entier 3. Il faut en outre ajouter qu’au-delà de l'utilisation d'agriculteurs, l’activité des maffias implique le racket et la prostitution imposés à des centaines de jeunes. Aujourd’hui, la drogue est une branche supplémentaire de l’économie capitaliste, c’est-à-dire que l’exploitation y est présente comme dans n’importe quelle autre activité économique mais, de plus, les conditions de l’illégalité poussent la concurrence et la guerre pour les marchés à prendre des formes bien plus violentes.
La violence pour gagner les marchés et augmenter les profits est d’autant plus acharnée que le gain est important. Ramón Martinez Escamilla, membre de l’Institut de recherches économiques de l’Université nationale autonome du Mexique, considère que "le phénomène du narcotrafic représente entre 7 et 8 % du PIB du Mexique" 4. Ces chiffres, comparés aux 6% du PIB mexicain que représente la fortune de Carlos Slim, le plus grand magnat du monde, donnent une idée de l’importance prise par le narcotrafic dans l’économie, permettant d'en déduire la barbarie que celui-ci engendre. Comme n’importe quel capitaliste, le narcotrafiquant n’a d’autre objectif que le profit. Pour expliquer les raisons de ce processus, il suffit de reprendre les paroles du syndicaliste Thomas Dunning (1799-1873), cité par Marx :
"Que le profit soit convenable, et le capital devient courageux : 10 % d'assurés, et on peut l'employer partout; 20 %, il s'échauffe !, 50 %, il est d'une témérité folle ; à 100 %, il foule aux pieds toutes les lois humaines ; 300 %, et il n'est pas de crime qu'il n'ose commettre, même au risque de la potence. Quand le désordre et la discorde portent profit, il les encourage tous deux" 5.
Fondées sur le mépris des vies humaines et sur l’exploitation, ces immenses fortunes trouvent certes refuge dans les paradis fiscaux mais sont aussi utilisées directement par des capitaux légaux qui se chargent de la besogne de blanchiment. Les exemples ne manquent pas pour l’illustrer, comme celui de l’entrepreneur Zhenli Ye Gon ou plus récemment de l’Institution financière HSBC. Dans ces deux exemples, il a été mis en lumière que ce personnage ou cette institution brassaient d’immenses fortunes de cartels de la drogue, que ce soit pour la promotion de projets politiques (au Mexique et ailleurs) ou pour "d’honorables" investissements.
Edgar Buscaglia 6 affirme que des entreprises de toute sorte ont été "désignées comme douteuses par les agences de renseignement d’Europe et des États-Unis, dont l’Office de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain, mais que personne n’a voulu les mettre en cause au Mexique, fondamentalement parce que plusieurs d’entre elles financent les campagnes électorales" 7.
Il existe d’autres processus marginaux (mais non moins significatifs) qui permettent l’intégration de la maffia à l’économie, tels que le dépouillement violent de propriétés et d’immenses territoires, à tel point que certaines zones du pays sont à présent des "villes fantômes". Certains chiffres parlent du déplacement, ces dernières années, d’un million et demi de personnes fuyant "la guerre entre l’armée et les narcos" 8.
Il est indispensable à présent de signaler l’impossibilité, pour les projets des maffiosi de la drogue, d'exister hors du domaine des États. Ceux-ci sont la structure qui les protège et les aide à déplacer leur argent vers les géants financiers, mais sont aussi le siège des équipes gouvernementales de la bourgeoisie qui ont mêlé leurs intérêts à ceux des cartels de la drogue. Il est évident que les maffias ne pourraient guère avoir autant d’activités si elles ne recevaient pas le soutien de secteurs de la bourgeoisie mêlés aux gouvernements. Comme nous l’avancions dans les "Thèses sur la décomposition", "il devient de plus en plus difficile de distinguer l'appareil gouvernemental du milieu des gangsters" 9.
Le Mexique, exemple de l’avancée de la décomposition capitaliste
Depuis 2006, ce sont presque soixante mille personnes qui ont été abattues, que ce soit sous les balles des unités de la maffia ou celles de l’armée officielle ; une grande partie de ces tués a été victime de la guerre entre cartels de la drogue, mais ceci ne diminue en rien la responsabilité de l’État, quoi qu’en dise le gouvernement. Il est impossible de rejeter la responsabilité sur les uns ou les autres, à cause des liens existant entre les groupes maffieux et l’État lui-même. Si les difficultés ont à ce niveau été croissantes, c’est précisément parce que les fractures et divergences au sein de la bourgeoisie se sont amplifiées et que, à tout instant, n’importe quel lieu peut devenir le champ de bataille entre fractions de la bourgeoisie ; bien entendu, la structure étatique elle-même est aussi un lieu privilégié pour que s’expriment ces conflits. Chaque groupe de la maffia surgit sous la houlette d’une fraction de la bourgeoisie, et tant la concurrence économique que les querelles politiques font que ces conflits croissent et se multiplient de jour en jour.
Au milieu du xixe siècle, pendant la période ascendante du capitalisme, le commerce de la drogue (l’opium par exemple) était déjà à l'origine de difficultés politiques aboutissant à des guerres, celles-ci révélant tant l’essence barbare de ce système que la participation directe des États dans la production et la distribution de marchandises telles que la drogue. Cependant, une telle situation était alors inséparable de la vigilance stricte des États et la classe dominante pouvait maintenir le cadre d'une ferme discipline sur cette activité, permettant de parvenir à des accords politiques et évitant qu'elle n'affaiblisse la cohésion de la bourgeoisie 10. Ainsi, même si la "guerre de l’opium" – déclarée principalement par l’État britannique – illustrait un trait de comportement du capital, nous pouvons comprendre pourquoi le commerce de la drogue n’était cependant pas un phénomène dominant du xixe siècle.
L’importance de la drogue et la formation de groupes maffieux prennent une importance croissante durant la phase de décadence du capitalisme. La bourgeoisie tente certes de limiter et ajuster par des lois et des règlements la culture, la préparation et le trafic de certaines drogues pendant les premières décennies du xxe siècle, mais seulement dans le but de bien contrôler le commerce de cette marchandise.
L’évidence historique montre que la "filière de la drogue" n’est pas une activité répudiée par la bourgeoisie et son État. Bien au contraire, c’est cette même classe qui se charge d’étendre son usage et de profiter des bénéfices qu’elle procure, et dans le même temps d'étendre ses effets ravageurs chez l’être humain. Les États, au xxe siècle, ont distribué massivement de la drogue aux armées. Les États-Unis donnent le meilleur exemple d'un tel usage pour "stimuler" les soldats pendant la guerre : le Viêt-Nam fut ainsi un grand laboratoire et il n’est pas surprenant que ce soit effectivement l’Oncle Sam qui ait encouragé la demande de drogue pendant les années 1970, et y ait répondu en impulsant sa production dans les pays de la périphérie.
Au début de la seconde moitié du xxe siècle au Mexique, l’importance de la production et de la distribution de drogue est encore loin d’être significative et reste sous le contrôle strict des instances gouvernementales. Le marché est alors strictement contrôlé par l’armée et la police. À partir des années 1980, l’État américain encourage le développement de la production et de la consommation de drogue au Mexique et dans toute l’Amérique latine.
L’affaire "Iran-Contra" (1986) avait mis en lumière que le gouvernement de Ronald Reagan, pour pallier la limitation du budget destiné à soutenir les bandes militaires opposées au gouvernement du Nicaragua (les "contras"), utilisait des fonds provenant de la vente d’armes à l’Iran et, surtout, du trafic de drogue via la CIA et la DEA. Le gouvernement des États-Unis poussait les maffias colombiennes à augmenter leur production, déployant même, à cette fin, un soutien militaire et logistique auprès des gouvernements du Panama, du Mexique, du Honduras, du Salvador, de la Colombie et du Guatemala, destiné à faciliter le passage de cette si convoitée marchandise. Pour "élargir le marché", la bourgeoisie américaine s'était mise à produire des dérivés de la cocaïne bien moins coûteux et donc plus faciles à commercialiser massivement, quoique bien plus ravageurs.
Ces mêmes pratiques, utilisées par le grand parrain américain pour se procurer des fonds lui permettant de mener à bien ses aventures putschistes, ont aussi été utilisées en Amérique latine pour lutter contre la guérilla. Au Mexique, ladite "sale guerre" menée par l’État dans les années 1970 et 80 contre la guérilla fut financée par l’argent qui venait de la drogue. L’armée et des groupes paramilitaires (comme la Brigade blanche ou le groupe Jaguar) avaient alors carte blanche pour assassiner, séquestrer et torturer. Certains projets militaires comme "l’Opération Condor" (qui soi-disant visait la production de drogue), étaient en réalité dirigés contre la guérilla et servirent en même temps à protéger les cultures de pavot et de marijuana.
À cette époque, la discipline et la cohésion de la bourgeoisie mexicaine lui permettaient de maintenir sous contrôle le marché de la drogue. De récentes enquêtes journalistiques affirment que pas la moindre cargaison de drogue n'échappait au contrôle et à la surveillance de l’armée ou de la police fédérale 11. L’État assurait, sous un corset de fer, l’unité de tous les secteurs de la bourgeoisie et, quand un groupe ou capitaliste individuel manifestait des désaccords, il était soumis pacifiquement par le biais de privilèges ou de parts de pouvoir. C’est ainsi que se maintenait unie la soi-disant "famille révolutionnaire" 12.
Avec l’effondrement du bloc impérialiste de l’Est disparut aussi l’unité du bloc opposé dirigé par les États-Unis, ce qui en retour provoqua une accentuation du chacun pour soi parmi les différentes fractions nationales de certains pays. Au Mexique, cette rupture s’exprima à travers la dispute au grand jour des fractions de la bourgeoisie à tous les niveaux : partis, clergé, gouvernements régionaux, fédéral… Chaque fraction cherchait à s'octroyer une plus grande part de pouvoir, sans qu'aucune d'entre elles ne prenne pour autant le risque de remettre en question la discipline historique derrière les États-Unis.
Dans ce contexte de bagarre générale, des forces bourgeoises opposées se sont disputées la répartition du pouvoir. Ces pressions internes ont débouché sur des tentatives de remplacer le parti au pouvoir et de "décentraliser" les responsabilités du maintien de l’ordre. C'est ainsi que les pouvoirs locaux, représentés par les gouvernements des États fédérés et les présidents municipaux, ont décrété leur contrôle régional. Ceci, en retour, n'a fait qu'accentuer le chaos : le gouvernement fédéral et chaque gouvernement de région ou municipalité, afin de renforcer son contrôle politique et économique, s’est associé avec telle ou telle bande maffieuse. Chaque fraction au pouvoir protège et renforce tel ou tel cartel en fonction de ses intérêts, lui assurant ainsi l’impunité, ce qui explique l’arrogance violente des maffias.
L’ampleur de ce conflit peut se vérifier dans les règlements de comptes entre personnalités politiques. On peut estimer par exemple que, ces cinq dernières années, vingt-trois maires et huit présidents municipaux ont été assassinés, et que les menaces faites à des secrétaires d’État et des candidats ont été innombrables. La presse bourgeoise tente de faire passer les personnalités assassinées pour des victimes alors que, dans la majeure partie des cas, celles-ci ont été l'objet de règlements de comptes entre bandes rivales ou bien au sein même des bandes, pour cause de trahison.
En analysant de la sorte ces événements, on peut comprendre que les problèmes de drogue ne pourront pas être résolus dans le capitalisme. Pour limiter les excès de la barbarie, la seule solution de la bourgeoisie est d’unifier ses intérêts et de se regrouper autour d’une seule bande maffieuse, isolant ainsi les autres bandes pour les maintenir dans une existence marginale.
L’issue pacifique de cette situation est très improbable du fait en particulier de la division aiguë entre fractions de la bourgeoisie au Mexique, rendant difficile et peu probable que puisse être atteinte ne serait-ce qu’une cohésion temporaire permettant une pacification. La tendance dominante semble bien être à l’avancée de la barbarie… Dans une interview datée de juin 2011, Buscaglia faisait une estimation de l’ampleur que prenait le narcotrafic dans la vie de la bourgeoisie : "près de 65 % des campagnes électorales au Mexique sont contaminées par de l’argent provenant de la délinquance organisée, principalement du narcotrafic" 13.
Les travailleurs sont les victimes directes de l’avancée de la décomposition capitaliste qui s’exprime à travers des phénomènes comme "la guerre contre le narco" et ils sont aussi la cible des attaques économiques que la bourgeoisie impose face à l’approfondissement de la crise ; c’est sans le moindre doute une classe qui souffre de grandes pénuries, mais ce n’est pas une classe contemplative, c’est un corps social capable de réfléchir, de prendre conscience de sa condition historique et de réagir collectivement.
Décomposition et crise… le capitalisme est un système en putréfaction
Drogue et assassinats font partie des faits divers majeurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, et si la bourgeoisie leur donne une telle importance c'est aussi parce que cela lui permet de faire passer au second plan les effets de la crise économique.
La crise du capitalisme n’a pas son origine dans le secteur financier, comme le prétendent les "experts" bourgeois. C’est une crise profonde et générale du système qui n’épargne aucun pays. La présence active des maffias au Mexique, bien qu’elle pèse d’un poids très lourd sur les exploités, n’efface pas les effets de la crise sur ceux-ci ; bien au contraire, elle les aggrave.
La cause principale des tendances à la récession qui affecte actuellement le capitalisme mondial est l’insolvabilité généralisée, mais ce serait une erreur de croire que le poids de la dette souveraine est l’unique indicateur permettant d'évaluer l’avancée de la crise. Dans certains pays, comme le Mexique, le poids de la dette ne crée pas encore de difficultés majeures, quoiqu’au cours de la dernière décennie, selon la Banque du Mexique, la dette souveraine ait augmenté de 60 % pour atteindre 36,4 % du PIB fin 2012 selon les prévisions. Ce montant est bien sûr modeste quand on le compare au niveau de l’endettement de pays comme la Grèce (où il atteint 170 % du PIB), mais cela implique-t-il que le Mexique ne soit pas exposé à l’approfondissement de la crise ? La réponse est non, bien entendu.
Tout d’abord, que l'endettement ne soit pas aussi important au Mexique que dans d'autres pays ne signifie pas qu’il ne va pas le devenir.
Les difficultés de la bourgeoisie mexicaine à relancer l’accumulation de capital s’illustrent particulièrement dans la stagnation de l’activité économique. Le PIB n’est même pas parvenu à atteindre ses niveaux de 2006 (voir graphique 1) et, qui plus est, les fugaces embellies récentes ont concerné le secteur des services, en particulier le commerce (comme l’explique la propre institution de l’État chargée des statistiques, l’INEGI). Par ailleurs, il faut prendre aussi en considération que si ce secteur dynamise le commerce intérieur (et permet ainsi au PIB de croître), c’est parce que le crédit à la consommation a augmenté (fin 2011 l’usage des cartes de crédit avait augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente).
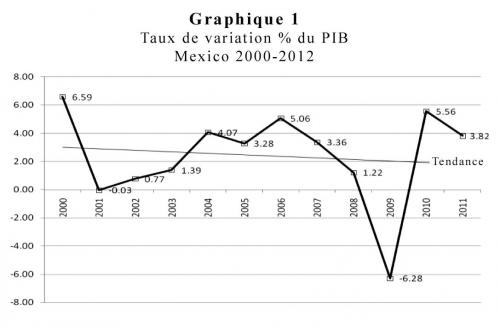
Les mécanismes utilisés par la classe dominante pour affronter la crise ne sont ni nouveaux ni particuliers au Mexique : augmenter les niveaux d’exploitation et doper l’économie à travers le crédit. L’application de mesures de ce genre avait permis aux États-Unis, dans les années 1990, de donner l’illusion d’une croissance. Anwar Shaikh, spécialiste de l’économie américaine, l’explique ainsi : "La principale impulsion en faveur du boom était venue de la dramatique chute du taux d’intérêt et de l’effondrement spectaculaire des salaires réels en rapport avec la productivité (croissance du taux d’exploitation), qui ensemble élevèrent considérablement le taux de profit de l’entreprise. Les deux variables jouèrent des rôles différents dans différents endroits…" 14.
De telles mesures se répètent au rythme de l’avancée de la crise, et bien que leurs effets soient toujours plus limités, il n’y a pas d’autre solution que de continuer à y recourir, en attaquant toujours davantage les conditions de vie des travailleurs. Les chiffres officiels, pour maquillés qu’ils soient, témoignent de la précarité des solutions. Il n’est pas surprenant que l’alimentation des travailleurs mexicains soit basée sur les calories les moins chères provenant du sucre (le pays étant le second consommateur de sodas derrière les États-Unis, chaque Mexicain en consommant quelques 150 litres en moyenne par an) ou des céréales.
Ce n'est donc pas surprenant si le Mexique est un des pays dont la population adulte est la plus en proie aux problèmes d’obésité et où culminent des maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension. La dégradation des conditions de vie atteint de tels extrêmes que toujours plus d’enfants entre 12 et 17 ans sont obligés de travailler (selon la CEPALC, 25 % en zone rurale et 15 % en ville). En compressant les salaires, la bourgeoisie parvient à se réapproprier les ressources financières auparavant destinées à la consommation des ouvriers, cherchant ainsi à augmenter la masse de plus-value que s’approprie le capital. Cette situation est d'autant plus grave pour les conditions de vie de la classe ouvrière que, comme le montre le graphique 2, les prix de la nourriture augmentent plus vite que l’indice général des prix utilisé par l’État pour affirmer que le problème de l’inflation est sous contrôle.
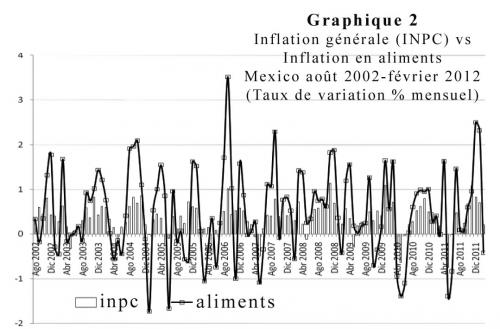
Les porte-paroles des gouvernements en Amérique latine partent du principe que si les conflits économiques majeurs touchent les pays centraux (États-Unis et Europe), le reste du monde est épargné par cette dynamique, d’autant plus que le FMI et la BCE sont alimentés en liquidités par les gouvernements de ces régions, y compris celui du Mexique. Mais ceci ne signifie en rien que ces économies ne soient pas menacées par la crise. Ces mêmes processus d’insolvabilité que traverse aujourd’hui l’Europe furent le lot de l’Amérique latine pendant les années 1980 et, avec elles, les sévères mesures découlant de plans d'austérité draconiens (qui donnèrent lieu à ce qui fut nommé le Consensus de Washington).
La profondeur et l’amplitude de la crise peuvent se manifester différemment selon les pays, mais la bourgeoisie recourt aux mêmes stratégies dans tous les pays, même ceux qui sont moins étranglés par l’accroissement de la dette souveraine.
Les plans de réduction des coûts de production que la bourgeoisie applique de moins en moins discrètement, licenciements massifs et augmentation de l'exploitation, ne peuvent en aucun cas favoriser un quelconque redressement.
Les taux de chômage et de paupérisation atteints par le Mexique nous aident à comprendre comment s’étend et s’approfondit la crise partout ailleurs. Coparmex, l’association patronale, reconnaît qu’au Mexique 48 % de la population économiquement active se trouve dans "le sous-emploi" 15, ce qui dans un langage plus franc signifie en situation précaire : bas salaires, contrats temporaires, journées de plus en plus longues sans assurance médicale. Cette masse de chômeurs et de précaires est le fruit de la "flexibilisation du travail" imposée par la bourgeoisie pour amplifier l’exploitation et faire retomber sur nos épaules les principaux effets de la crise.
La misère et l’exploitation sont les moteurs du mécontentement
Nombreuses sont les régions, essentiellement dans les zones rurales, qui sont soumises au couvre-feu et au contrôle permanent par les patrouilles armées, qu’elles soient militaires, policières ou maffieuses (si ce n’est les deux), qui assassinent sous le moindre prétexte, faisant de la vie des exploités un véritable cauchemar. À cette terreur s’ajoutent des attaques permanentes sur le plan économique. Début 2012, la bourgeoisie mexicaine a annoncé une "réforme du travail" qui, comme ailleurs dans le monde, va porter le coût de la force de travail à un niveau plus intéressant pour le capital, réduisant ainsi les coûts de production et amplifiant davantage les taux d’exploitation.
La "réforme du travail" a pour but l’augmentation des cadences et de la durée du travail, mais aussi la baisse des salaires (réduction du salaire direct et élimination de parts substantielles du salaire indirect), le projet prévoyant par ailleurs l’augmentation du nombre d’années de travail nécessaires pour avoir droit à la retraite.
Cette menace a commencé à se concrétiser dans le secteur de l’éducation. L’État a choisi ce secteur pour porter une première attaque qui devra en appeler d'autres ailleurs. Il peut se le permettre car, bien que les travailleurs y soient nombreux et aient une grande tradition de combativité, il est très fermement contrôlé par la structure syndicale, tant officielle (Syndicat national des travailleurs de l’Education – SNTE) que "démocratique" (Coordination nationale des travailleurs de l’Éducation – CNTE). C'est ainsi que le gouvernement a pu y déployer la stratégie suivante : d’abord provoquer le mécontentement en annonçant une "Évaluation universelle" 16, et ensuite mettre en scène toute une série de manœuvres (manifestations interminables, tables de négociations séparées par région…) reposant sur les syndicats pour user, isoler et ainsi vaincre les grévistes, convaincre de l'inutilité de "la lutte" et enfin démoraliser et intimider l’ensemble des travailleurs.
Bien que les enseignants aient fait l'objet d’un traitement particulier, les "réformes" s’appliquent cependant progressivement et discrètement à tous les travailleurs. Les mineurs, par exemple, subissent déjà ces attaques qui réduisent le coût de leur force de travail et précarisent leurs conditions de travail. La bourgeoisie considère normal que, pour un salaire de misère (le salaire maximum auquel peut prétendre un mineur est de 455 dollars mensuels), les ouvriers passent au fond des puits et galeries des mines de longues et intensives journées de travail qui excèdent bien souvent les huit heures, dans des conditions de sécurité innommables dignes de celles qui prévalaient au xixe siècle. C’est ce qui explique, d’une part, que le taux de profit des entreprises minières au Mexique soit parmi les plus élevés du monde et, d’autre part, l’augmentation spectaculaire des "accidents" dans les mines, avec leur lot croissant de blessés et de morts. Depuis l’an 2000, dans le seul état de Coahuila, la plus active des zones minières du pays, plus de 207 travailleurs sont morts à la suite d’effondrements de galeries ou de coups de grisou.
Cette misère, à laquelle s’ajoutent les agissements criminels des gouvernements et des maffias, provoque un mécontentement croissant parmi les exploités et opprimés qui commence à s’exprimer, même si c'est encore avec de grandes difficultés. Dans d’autres pays comme l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Chili ou le Canada, les rues ont été envahies par les manifestations exprimant ainsi le courage de lutter contre la réalité du capitalisme, même si ce n'était pas encore clairement en tant que force d'une classe de la société, la classe ouvrière.
Au Mexique, les manifestations massives convoquées par des étudiants du mouvement "#yo soy 132" (#je suis le 132), bien qu’ayant été dès l’origine encadrées par la campagne électorale de la bourgeoisie en vue des présidentielles, n’en sont pas moins le produit d'un malaise social qui couve. Ce n’est pas pour nous consoler que nous affirmons cela ; nous ne nous berçons pas de l'illusion d'une classe ouvrière avançant sans faiblir dans un processus de lutte et de clarification, nous nous efforçons simplement de comprendre la réalité. Nous devons pour cela prendre en compte que le développement des mobilisations sur l’ensemble de la planète n’est pas homogène et qu'au sein de celles-ci, la classe ouvrière comme telle n’a pas assumé une position dominante. Du fait de sa difficulté à se reconnaître en tant que classe de la société ayant la capacité de constituer une force au sein de celle-ci, la classe ouvrière n’a pas confiance en elle, elle craint de se lancer dans la lutte et de prendre la tête du combat. Une telle situation favorise, au sein des mouvements, l'influence des mystifications bourgeoises qui présentent des "solutions" réformistes comme des alternatives possibles à la crise du système. Cette tendance générale est aussi présente au Mexique.
Ce n’est qu’en constatant les difficultés rencontrées par la classe ouvrière que l’on peut comprendre que le mouvement animant la création du regroupement "#yo soy 132" exprime aussi le ras-le-bol envers les gouvernements et partis de la classe dominante. Cette dernière a su réagir très rapidement à la menace en enchaînant le regroupement au faux espoir porté par les élections et la démocratie, et le convertir en un organe creux, inutile au combat des exploités (qui s'étaient rapprochés de ce groupe en croyant y trouver un moyen de lutter) mais très utile à la bourgeoisie qui continue à utiliser "#yo soy 132" afin d’encadrer la combativité des jeunes ouvriers révoltés par la réalité du capitalisme.
La classe au pouvoir sait parfaitement que l’aggravation des attaques provoquera inévitablement une réponse de la part des exploités. José A. Gurría, secrétaire général de l’OCDE, l’exprime en ces termes le 24 février : "Que peut-il se passer quand on mixe la baisse de la croissance, un taux élevé de chômage et une inégalité croissante ? Le résultat ne peut être que le Printemps arabe, les Indignés de la Puerta del Sol et ceux de Wall Street". C’est pourquoi, face à ce mécontentement latent, la bourgeoisie mexicaine favorise la campagne de contestation de l’élection de Peña Nieto 17 à la présidence de la république, mot d’ordre fédérateur qui stérilise toute combativité réelle, d’autant plus qu’au-delà des déclarations radicales de López Obrador 18 et de "#yo soy 132" rien n’ira plus loin que la défense de la démocratie et de ses institutions.
Accentuée par les effets nocifs de la décomposition, la crise capitaliste a généralisé la paupérisation des prolétaires et autres opprimés mais elle a, ce faisant, montré la réalité à nu, dans toute sa cruauté : le capitalisme ne peut plus offrir que chômage, misère, violence et mort.
La crise profonde du capitalisme et l’avancée destructive de la décomposition annoncent les dangers que représente la survie du capitalisme, affirmant la nécessité impérative de sa destruction par la seule classe capable de l’affronter, le prolétariat.
Rojo (mars 2012)
1 Cf. Revue internationale no 62,
"La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme [94]".
2 Nueva sociedad no 130, Colombie, 1994, "L’économie de la coca en Amérique latine. Le paradigme colombien" (notre traduction).
3 Cf. "Narco SA, una empresa global" [95] sur www.cnnexpansion.com [96].
4 La Jornada, 25 juin 2010 (notre traduction).
5 Karl Marx, Le Capital, Livre premier, "Le développement de la production capitaliste" ; VIIIe section, "L'accumulation primitive" ; Chapitre XXXI, "Genèse du capitaliste industriel". https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-31.htm [97].
6 Coordinateur du Programme international de Justice et Développement de l’Institut technologique autonome du Mexique (ITAM).
7 La Jornada, 24 mars 2010 (notre traduction).
8 Dans des états du nord du pays comme Durango, Nuevo León et Tamaulipas, certaines zones sont considérées comme "villes fantômes" car abandonnées par la population. Les villageois qui se consacraient à l’agriculture se sont vus dans l’obligation de fuir, liquidant leur propriété à bas prix dans le meilleur des cas ou les abandonnant purement et simplement. Le sort des ouvriers est encore plus grave car leur mobilité est limitée faute de moyens ; quand ils parviennent à fuir vers d’autres régions, ils sont forcés de vivre dans les pires conditions de précarité, devant en outre continuer à rembourser les crédits des logements qu’ils ont été forcés d’abandonner.
9 Cf. Revue internationale no 62, op. cit., point 8.
10 Aujourd’hui encore, pour certains pays comme les États-Unis, qui sont cependant les plus grands consommateurs de drogues, les affrontements armés et les victimes qu’ils provoquent restent surtout concentrés hors des frontières.
11 Cf. Anabel Hernández, Los Señores del narco (les Seigneurs de la drogue), Editions Grijalbo, México 2010.
12 C’est ainsi que l’on appelait l’unité que la bourgeoisie avait atteinte avec la création du Parti national révolutionnaire (PNR, 1929), qui se consolida en se transformant en Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) et qui se maintint au pouvoir jusqu’en 2000.
13 Cf. "Edgardo Buscaglia : el fracaso de la guerra contra el narco - Pour le Journal allemand Die Tageszeitung" [98] sur nuestraaparenterendicion.com
14 In "The first great depression of the 21st century" [99], 2010.
15 L’institution officielle (INEGI) calcule pour sa part que le taux de travailleurs “informels” est de 29,3 %.
16 "L’Évaluation universelle" est une partie du projet "Alliance pour la qualité de l’Éducation" (ACE) Cette mesure vise non seulement à imposer un système d’évaluation pour amener les travailleurs à rivaliser entre eux et réduire les postes, mais aussi pour augmenter les charges de travail, comprimer les salaires, faciliter les protocoles de licenciement rapide et à bas coût, attaquer les retraites…
17 Dirigeant du Parti révolutionnaire institutionnel [100] (social-démocrate).
18 Dirigeant du Parti de la révolution démocratique [101] (social-démocrate de gauche).
Géographique:
- Mexique [102]
Rubrique:
L'État dans la période de transition au communisme (II) : notre réponse au groupe Oposição Operária (Opposition ouvrière) - Brésil
- 3380 reads
Nous publions ci-après notre réponse à l'article "Conseils ouvriers, État prolétarien, dictature du prolétariat" du groupe Oposição Operária (OPOP) 1 au Brésil, paru dans le numéro 148 de la Revue internationale 2.
La position développée dans l'article de OPOP se réclame intégralement de l'ouvrage de Lénine, L'État et la révolution, et c'est à partir de ce point de vue que cette organisation rejette une idée centrale de la position du CCI. Cette dernière, tout en reconnaissant la contribution fondamentale de L'État et la révolution à la compréhension de la question de l'État durant la période de transition, met à profit l'expérience de la révolution russe, des réflexions de Lénine lui-même durant cette période et des écrits fondamentaux de Marx et Engels, pour en tirer des enseignements conduisant à remettre en question l'identité entre État et dictature du prolétariat, admise classiquement jusque-là par les courants marxistes.
Dans son article, OPOP développe également une autre position qui lui est propre à propos de ce qu'elle appelle le "pré-État", c'est-à-dire l'organisation des conseils, avant la révolution, appelée à renverser la bourgeoisie et son État. Nous reviendrons ultérieurement sur cette question car nous estimons qu'il est prioritaire de faire préalablement toute la lumière sur nos divergences avec OPOP concernant la question de l'État de la période de transition.
L'essentiel de la thèse défendue par OPOP dans son article
Afin d'éviter au lecteur des allers et retours incessants avec l'article de OPOP de la Revue internationale n° 148, nous en reproduisons les passages que nous estimons les plus significatifs.
Pour OPOP, la "séparation antinomique entre le système des conseils et l'État postrévolutionnaire" "s'éloigne de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État", revenant ainsi à "briser l'unité qui doit exister et persister dans le cadre de la dictature du prolétariat". En effet, "une telle séparation place, d'un côté, l'État comme une structure administrative complexe, devant être gérée par un corps de fonctionnaires - une aberration dans la conception de l'État simplifié de Marx, Engels et Lénine – et, de l'autre, une structure politique, dans le cadre des conseils, devant exercer une pression sur la première (l'État en tant que tel)."
C'est une erreur qui, selon OPOP, s'explique par les incompréhensions suivantes relatives à l'État-Commune et ses relations avec le prolétariat :
-
"une accommodation à une vision influencée par l'anarchisme qui identifie l'État-Commune avec l'État bureaucratique (bourgeois)." Celle-ci "place le prolétariat hors de l'État postrévolutionnaire, créant ainsi une dichotomie qui, elle, constitue le germe d'une nouvelle caste se reproduisant dans le corpus administratif organiquement séparé des conseils."
-
"l'identification entre l'État surgi dans l'URSS postrévolutionnaire - un État nécessairement bureaucratique - avec la conception de l'État-Commune de Marx, Engels et de Lénine lui-même".
-
"La non prise en compte du fait que les tâches organisationnelles et administratives mises à l'ordre du jour par la révolution sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux. Ainsi, des questions brûlantes comme la planification centralisée (…) ne sont pas des questions purement "techniques" mais hautement politiques et, comme telles, ne peuvent être déléguées, même si elles sont "vérifiées" de l'extérieur par les conseils, au moyen d'un corps d'employés situés en dehors du système des conseils où se trouvent les travailleurs les plus conscients".
-
"la non perception que la véritable simplification de l'État-Commune, telle qu'elle est décrite par Lénine (…) implique un minimum de structure administrative et que cette structure est si minime et en voie de simplification/extinction, qu'elle peut être assumée directement par le système des conseils"
Enfin, un autre facteur intervient, selon OPOP, pour expliquer les leçons erronées tirées par le CCI de la Révolution russe quant à la nature de l'État de transition ; il s'agit de la non prise en compte par notre organisation des conditions défavorables que la révolution a dû confronter : "une incompréhension des ambiguïtés ayant résulté de circonstances historiques et sociales spécifiques, qui ont bloqué non seulement la transition mais même le début de la dictature du prolétariat en URSS. Ici, on cesse de comprendre que la dynamique prise par la Révolution russe - à moins d'opter pour l'interprétation facile mais peu consistante selon laquelle les déviations du processus révolutionnaire ont été le fruit de la politique de Staline et de son entourage – n'obéissait pas à la conception de la révolution, de l'État et du socialisme qu'en avait Lénine, mais aux restrictions qui émanaient du terrain social et politique d'où émergea le pouvoir en URSS caractérisé, entre autres et pour rappel, par l'impossibilité de la révolution en Europe, par la guerre civile et la contre-révolution à l'intérieur de l'URSS. La dynamique qui en résulta était étrangère à la volonté de Lénine. Lui-même se pencha sur celle-ci, la marquant de façon réitérée par des formulations ambiguës présentes dans sa pensée ultérieure et ce jusqu'à sa mort."
L'inévitabilité d'une période de transition et de l'existence d'un État durant celle-ci
La différence entre les marxistes et les anarchistes ne réside pas en ceci que les premiers concevraient le communisme avec un État et les seconds comme étant une société sans État. Sur ce point, il y accord total : le communisme ne peut être qu'une société sans État. C'est donc plutôt avec les pseudo-marxistes de la social-démocratie, héritiers de Lassalle, qu'une telle différence fondamentale a existé vu que, pour eux, c'est l'État qui était le moteur de la transformation socialiste de la société. C'est contre eux qu'Engels avait écrit le passage suivant de l'Anti-Dühring : "Dès qu'il n'y a plus de classe sociale à tenir dans l'oppression ; dès que, avec la domination de classe et la lutte pour l'existence individuelle motivée par l'anarchie antérieure de la production, sont éliminés également les collisions et les excès qui en résultent, il n'y a plus rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression, un État. Le premier acte dans lequel l'État apparaît réellement comme représentant de toute la société, la prise de possession des moyens de production au nom de la société, est en même temps son dernier acte propre en tant qu'État. L'intervention d'un pouvoir d'État dans des rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l'autre, et entre alors naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses et à la direction des opérations de production. L'État n'est pas "aboli", il s'éteint. Voilà qui permet de juger la phrase creuse sur l'"État populaire libre 3", tant du point de vue de sa justification temporaire comme moyen d'agitation que du point de vue de son insuffisance définitive comme idée scientifique ; de juger également la revendication de ceux qu'on appelle les anarchistes, d'après laquelle l'État doit être aboli du jour au lendemain" 4. Le vrai débat avec les anarchistes porte sur leur méconnaissance totale d'une période de transition inévitable et sur le fait qu'ils dictent à l'histoire un saut à pieds joints, immédiat et direct, du capitalisme à la société communiste.
Sur cette question de la nécessité de l'État durant la période de transition, nous sommes donc parfaitement d'accord avec OPOP. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous étonner que cette organisation nous reproche de nous "éloigner de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État". En quoi, en effet, d'un point de vue marxiste, notre position peut-elle s'approcher de celle des anarchistes selon laquelle "il est possible d'abolir l'État du jour au lendemain" ?
Si on se base sur ce qu'écrit Lénine dans L'État et la révolution, à propos de la critique marxiste de l'anarchisme sur la question de l'État, il apparaît que cette dernière est loin de confirmer le point de vue de OPOP : "Marx souligne expressément — pour qu'on ne vienne pas dénaturer le sens véritable de sa lutte contre l'anarchisme — la "forme révolutionnaire et passagère" de l'État nécessaire au prolétariat. Le prolétariat n'a besoin de l'État que pour un temps. Nous ne sommes pas le moins du monde en désaccord avec les anarchistes quant à l'abolition de l'État en tant que but. Nous affirmons que, pour atteindre ce but, il est nécessaire d'utiliser provisoirement les instruments, les moyens et les procédés du pouvoir d'État contre les exploiteurs, de même que, pour supprimer les classe, il est indispensable d'établir la dictature provisoire de la classe opprimée" 5. Le CCI fait pleinement sienne cette formulation, à un mot près. Il s'agit de la qualification, par Lénine, de "révolutionnaire" de cette forme passagère qu'est l'État. Cette différence peut-elle être apparentée à une variante des conceptions anarchistes, comme le pense OPOP, ou bien au contraire renvoie-t-elle à un débat beaucoup plus profond sur la question de l'État ?
Quel est le véritable débat ?
Sur la question de l'État, notre position diffère effectivement de celle de L'État et la révolution et de celle de la Critique du programme de Gotha pour qui, durant la période de transition, "l'État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat" 6. C'est le fond du débat entre nous : pourquoi ne peut-il y avoir d'identité entre la dictature du prolétariat et l'État de la période de transition qui surgit après la révolution ? Voila une idée qui heurte beaucoup de marxistes, lesquels ont souvent posé la question : "D'où le CCI tire-t-il sa position sur l'État de la période de transition ?" Nous pouvons répondre : "Non pas de son imagination mais bien de l'histoire, des leçons qu'en ont tirées des générations de révolutionnaires, des réflexions et élaborations théoriques du mouvement ouvrier". Ainsi en particulier :
- les perfectionnements successifs à la compréhension de la question de l'État apportés par le mouvement ouvrier jusqu'à la révolution russe et dont L'État et la révolution de Lénine rend compte de façon magistrale ;
- la prise en compte de l'ensemble des considérations théoriques de Marx et Engels sur la question de l'État, qui vient en fait contredire l'idée que l'État de la période de transition constituerait le vecteur de transformation socialiste de la société ;
- la dégénérescence de la Révolution russe qui illustre que l'État a constitué le vecteur principal de développement de la contre-révolution au sein du bastion prolétarien ;
- au sein de ce processus, certaines prises de positions critiques de Lénine en 1920-21 démontrant que le prolétariat devait pouvoir se défendre contre l'État et qui, tout en restant prisonnières des limitations propres à la dynamique de dégénérescence qui allait mener à la contre-révolution, apportent un éclairage essentiel sur la nature et le rôle de l'État de transition.
C'est avec cette démarche qu'un travail de bilan de la vague révolutionnaire mondiale a été effectué par la Gauche communiste d'Italie 7. Selon cette dernière, si l'État subsiste après la prise du pouvoir du prolétariat du fait qu'il subsiste des classes sociales, celui-ci est fondamentalement un instrument de conservation de la situation acquise mais nullement l'instrument de la transformation des rapports de production vers le communisme. En ce sens, l'organisation du prolétariat comme classe, à travers ses conseils ouvriers, doit imposer son hégémonie sur l'État mais ne jamais s'identifier à celui-ci. Il doit être capable, si nécessaire, de s'opposer à l'État, comme l'avait compris partiellement Lénine en 1920-21. C'est justement parce que, avec l'extinction de la vie des soviets (inévitable du fait de l'échec de la Révolution mondiale), le prolétariat avait perdu cette capacité d'agir et de s'imposer sur l'État que ce dernier a pu développer ses tendances conservatrices propres au point de se faire le fossoyeur de la révolution en Russie en même temps qu'il absorbait dans ses rouages le parti bolchevique lui-même et en faisait un instrument de la contre-révolution.
La contribution de l'histoire à la compréhension de la question de l'État de la période de transition
L'État et la révolution de Lénine avait constitué, en son temps, la meilleure synthèse de ce que le mouvement ouvrier avait élaboré concernant la question de l'État et de l'exercice du pouvoir par la classe ouvrière 8. En effet, cet ouvrage offre une excellente illustration quant à la manière dont s'est éclaircie, à travers l'expérience historique, la question de l'État. En se basant sur son contenu, nous rappelons ici les perfectionnements successifs ayant été apportés par le mouvement ouvrier à la compréhension de ces questions :
- Le Manifeste communiste de 1848 met en évidence la nécessité pour le prolétariat de prendre le pouvoir politique, de se constituer en classe dominante et conçoit que ce pouvoir sera exercé au moyen de l'État bourgeois qui aura été investi par le prolétariat : "Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher peu à peu toute espèce de capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production dans les mains de l'État - du prolétariat organisé en classe dominante - et pour accroître le plus rapidement possible la masse des forces productives" 9.
- Dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852), la formulation devient déjà plus "précise" et "concrète" (selon les propres termes de Lénine) par rapport à celle du Manifeste communiste. En effet, il est question, pour la première fois, de la nécessité de détruire l'État : "Toutes les révolutions perfectionnèrent cette machine au lieu de la briser. Les partis qui se disputèrent à tour de rôle le pouvoir considéraient la mainmise sur cet énorme édifice d'État comme le butin principal du vainqueur" 10.
- À travers l'expérience de la Commune de Paris (1871), Marx voit, comme le dit Lénine, "un pas réel bien plus important que des centaines de programmes et de raisonnements" 11 qui justifie, à ses yeux et à ceux d'Engels, que le programme du Manifeste communiste, ayant " perdu, par endroits, son actualité " 12 soit modifié à travers une nouvelle préface. La Commune a notamment démontré, poursuivent-ils, que la " classe ouvrière ne peut pas simplement prendre possession de la machine d'État telle quelle et l'utiliser pour ses propres fins." 13.
La révolution de 1917 n'a pas laissé le temps à Lénine d'écrire dans L'État et la révolution des chapitres dédiés aux apports des révolutions russes de 1905 et février 1917. Lénine s'est limité à identifier les soviets comme les successeurs naturels de la Commune de Paris. On peut ajouter que, même si aucune de ces deux révolutions n'a permis au prolétariat de prendre le pouvoir politique, elles fournissent cependant des enseignements supplémentaires par rapport à l'expérience de la Commune de Paris concernant le pouvoir de la classe ouvrière : les soviets de députés ouvriers basés sur des assemblées dans les lieux de travail s'avèrent plus adaptés à l'expression de l'autonomie de classe du prolétariat que ne l'étaient les unités territoriales de la Commune.
En plus de constituer une synthèse de ce que le mouvement ouvrier a écrit de meilleur sur ces questions, L'État et la révolution contient des développements propres à Lénine qui, à leur tour, constituent des avancées. En effet, alors qu'ils tiraient les leçons essentielles de la Commune de Paris, Marx et Engels avaient laissé une ambiguïté quant à la possibilité que le prolétariat arrive pacifiquement au pouvoir à travers le processus électoral dans certains pays, précisément ceux qui disposaient des institutions parlementaires les plus développées et de l'appareil militaire le moins important. Lénine n'a pas eu peur de corriger Marx, en utilisant pour cela la méthode marxiste et replaçant la question dans le contexte historique adapté : "Aujourd'hui, en 1917, à l'époque de la première grande guerre impérialiste, cette restriction de Marx ne joue plus. (…). Maintenant, en Angleterre comme en Amérique, "la condition première de toute révolution populaire réelle", c'est la démolition, la destruction de la "machine de 1’État toute prête". " 14
Seule une vision dogmatique pourrait s'accommoder de l'idée que L'État et la révolution de Lénine devrait constituer la dernière et suprême étape dans la clarification de la notion d'État dans le mouvement marxiste. S'il est un ouvrage qui est l'antithèse d'une telle vision c'est bien celui-là. OPOP elle-même ne craint pas de s'éloigner de ce que dit littéralement Lénine dans L'État et la révolution en poussant à son terme l'idée de la citation précédente : "Aujourd'hui, la tâche consistant à établir les conseils comme une forme d'organisation de l'État ne se situe pas seulement dans la perspective d'un seul pays mais à l'échelle internationale et c'est bien là le défi principal qui est posé à la classe ouvrière" 15
Écrit en août-septembre 1917, c'est très rapidement, avec l'éclatement de la révolution d'octobre, que L'État et la révolution a servi d'arme théorique en vue de l'action révolutionnaire pour le renversement de l'État bourgeois et la mise en place de l'État-Commune. Les leçons tirées jusque là de la Commune de Paris se trouvent ainsi mises à l'épreuve de l'histoire à travers des événements historiques d'une portée bien plus considérable encore, la Révolution russe et sa dégénérescence.
Peut-on tirer des leçons de la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 sur le rôle de l'État ?
OPOP répond négativement à cette question dans la mesure où, nous dit-elle, les conditions en Russie étaient tellement défavorables qu'elles ne permettaient pas la mise en place d'un État ouvrier tel que Lénine le décrit dans L'État et la révolution. Ainsi, elle nous reproche d'identifier "l'État surgi dans l'URSS postrévolutionnaire - un État nécessairement bureaucratique - avec la conception de l'État-Commune de Marx, Engels et de Lénine lui-même". Et d'ajouter : "Ici, on cesse de comprendre que la dynamique prise par la révolution russe (…) n'obéissait pas à la conception de la révolution, de l'État et du socialisme qu'en avait Lénine, mais aux restrictions qui émanaient du terrain social et politique d'où émergea le pouvoir en URSS".
Nous sommes d'accord avec OPOP pour dire que la première leçon à tirer de la dégénérescence de la révolution russe est que celle-ci est le produit de l'isolement international du bastion prolétarien du fait de la défaite des autres tentatives révolutionnaires en Europe, en Allemagne en particulier. En effet, non seulement il ne peut y avoir de transformation des rapports de production vers le socialisme dans un seul pays mais encore il n'est pas possible qu'un pouvoir prolétarien se maintienne indéfiniment isolé dans un monde capitaliste. Mais n'existe-t-il pas d'autres enseignements de grande importance à tirer de cette expérience ?
Si, bien sûr ! Et OPOP reconnaît l'un d'entre eux, bien que celui-ci contredise explicitement le passage suivant de L'État et la révolution relatif à la première phase du communisme : "... l'exploitation de l'homme par l'homme sera impossible, car on ne pourra s'emparer, à titre de propriété privée, des moyens de production, fabriques, machines, terre, etc.". 16 En effet, ce qu'ont montré la révolution russe et, surtout, la contre-révolution stalinienne, c'est que la simple transformation de l'appareil productif en une propriété d’État ne supprime pas l'exploitation de l'homme par 1’homme.
En fait, la révolution russe et sa dégénérescence constituent des événements historiques d'une telle portée qu'on ne peut pas ne pas en tirer des enseignements. Pour la première fois dans l'histoire, se produit la prise du pouvoir politique par le prolétariat dans un pays, comme expression la plus avancée d'une vague révolutionnaire mondiale, avec le surgissement d'un État alors appelé prolétarien ! Et ensuite il se produit ce fait, également totalement inédit dans l'histoire du mouvement ouvrier, la défaite d'une révolution, non pas clairement et ouvertement battue par la répression sauvage de la bourgeoisie comme ce fut le cas de la Commune de Paris, mais comme conséquence d'un processus de dégénérescence interne ayant pris par la suite le visage hideux du stalinisme.
Dans les semaines suivant l'insurrection d'octobre, l’État-Commune est déjà autre chose que "les ouvriers en armes" décrits dans L'État et la révolution 17. Par-dessus tout, avec l'isolement croissant de la révolution, le nouvel État est de plus en plus infesté par la gangrène de la bureaucratie, répondant de moins en moins aux organes élus par le prolétariat et les paysans pauvres. Loin de commencer à dépérir, le nouvel État est en train d'envahir toute la société. Loin de se plier à la volonté de la classe révolutionnaire, il est devenu le point central d'une sorte de dégénérescence et de contre-révolution internes. Dans le même temps, les soviets se vident de leur vie. Les soviets ouvriers sont transformés en appendices des syndicats dans la gestion de la production. Ainsi, la force qui avait fait la révolution et aurait dû garder son contrôle sur celle-ci perdait son expression politique autonome et organisée. Le vecteur de la contre-révolution n'a été ni plus ni moins que l'État et, plus la révolution était en difficulté, plus le pouvoir de la classe ouvrière était affaibli et plus l'État-Commune manifestait sa nature non prolétarienne, son côté conservateur, voire réactionnaire. Nous allons nous expliquer sur cette caractérisation.
De Marx, Engels à l'expérience russe : la convergence vers une même caractérisation de l'État de la période de transition
Ce serait une erreur que de s'arrêter définitivement à la formulation de Marx de la Critique du programme de Gotha, concernant la caractérisation de l'État de la période de transition, identifié à la dictature du prolétariat. En effet, il existe d'autres caractérisations de l'État faites par Marx et Engels eux-mêmes, plus tard par Lénine et ensuite par la Gauche communiste, qui contredisent dans le fond la formule "État-Commune = dictature du prolétariat" pour converger vers l'idée d'un État conservateur par nature, y inclus l'État-Commune de la période de transition.
L'État de transition est l'émanation de la société et non pas du prolétariat
Comment explique-t-on le surgissement de l'État ? À ce propos, Engels ne laisse aucune ambiguïté : "L'État n'est donc pas un pouvoir imposé du dehors à la société ; il n'est pas davantage "la réalité de l'idée morale", "l'image et la réalité de la raison", comme le prétend Hegel 18. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement ; il est l'aveu que cette société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s'étant scindée en oppositions inconciliables qu'elle est impuissante à conjurer. Mais pour que les antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés, ne se consument pas, elles et la société, en une lutte stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de "l'ordre"; et ce pouvoir, né de la société, mais qui se place au-dessus d'elle et lui devient de plus en plus étranger, c'est l'État." 19 Lénine reprend à son compte ce passage d'Engels en le citant, dans L'État et la révolution. Malgré tous les aménagements apportés par le prolétariat à l'État-Commune de transition, celui-ci conserve en commun, avec tous les États des sociétés de classes du passé, le fait d'être un organe conservateur au service du maintien de l'ordre dominant, c'est-à-dire celui des classes économiquement dominantes. Ceci a des implications, au niveau théorique et pratique, concernant les questions suivantes : qui exerce le pouvoir durant la société de transition, l'État ou le prolétariat organisé en conseils ouvriers ? Qui est la classe économiquement dominante de la société de transition ? Quel est le moteur de la transformation sociale et du dépérissement de l'État ?
L'État de transition ne peut, par nature, être au service des seuls intérêts de classe du prolétariat
Là où le pouvoir politique de la bourgeoisie a été renversé, les rapports de production demeurent des rapports capitalistes, même si la bourgeoisie n'est plus là pour s'approprier la plus-value produite par la classe ouvrière. Le point de départ de la transformation communiste a pour condition la défaite militaire de la bourgeoisie dans un nombre suffisant de pays déterminants permettant de donner l'avantage politique à la classe ouvrière au niveau mondial. C'est la période pendant laquelle se développent lentement les bases du nouveau mode de production, au détriment de l'ancien, jusqu'à le supplanter et constituer le mode de production dominant.
Après la révolution et tant que n'aura pas été réalisée la communauté humaine mondiale, c'est-à-dire tant que l'immense majorité de la population mondiale n'aura pas été intégrée au sein du travail libre et associé, c'est le prolétariat qui demeure la classe exploitée. Ainsi, contrairement aux classes révolutionnaires du passé, le prolétariat n'est pas destiné à devenir la classe économiquement dominante. C'est la raison pour laquelle, même si l'ordre établi après la révolution n'est plus celui de la domination politique et économique de la bourgeoisie, l'État, qui surgit pendant cette période en tant que garant du nouvel ordre économique, ne peut pas être intrinsèquement au service du prolétariat. C'est au contraire à ce dernier qu'il appartient de le contraindre dans le sens de ses intérêts de classe.
Le rôle de l'État de transition : intégration de la population non exploiteuse dans la gestion de la société et lutte contre la bourgeoisie
Dans L'État et la révolution, Lénine lui-même dit que le prolétariat a besoin de l’État, non seulement pour supprimer la résistance de la bourgeoisie, mais aussi pour mener le reste de la population non exploiteuse dans la direction socialiste : "Le prolétariat a besoin du pouvoir d'État, d'une organisation centralisée de la force, d'une organisation de la violence, aussi bien pour réprimer la résistance des exploiteurs que pour diriger la grande masse de la population — paysannerie, petite bourgeoisie, semi-prolétaires — dans la "mise en place" de l'économie socialiste" 20.
Nous soutenons ce point de vue de Lénine selon lequel, pour renverser la bourgeoisie, le prolétariat doit pouvoir entraîner derrière lui l'immense majorité de la population pauvre et opprimée, au sein de laquelle il peut être lui-même minoritaire. Il n'existe pas d'alternative à une telle politique. Comment s'est-elle concrétisée dans la révolution russe ? Pendant celle-ci surgirent deux types de soviets : d'une part, les soviets basés essentiellement sur les lieux de production et regroupant la classe ouvrière, appelés encore conseils ouvriers ; d'autre part, les soviets basés sur des unités territoriales (les soviets territoriaux) dans lesquels participaient activement toutes les couches non exploiteuses à la gestion locale de la société. Les conseils ouvriers organisaient l'ensemble de la classe ouvrière, c'est-à-dire la classe révolutionnaire. Les soviets territoriaux 21, quant à eux, élisaient des délégués révocables destinés à faire partie de l'État-Commune 22, ce dernier ayant pour fonction la gestion de la société dans son ensemble. En période révolutionnaire, l'ensemble des couches non exploiteuses, tout en étant pour le renversement de la bourgeoisie et contre la restauration de sa domination, ne sont pas pour autant acquises à l'idée de la transformation socialiste de la société. Elles peuvent même y être hostiles. En effet, au sein de celles-ci, la classe ouvrière est souvent très minoritaire. C'est la raison pour laquelle, en Russie, des mesures avaient été prises dans le mode d'élection des délégués pour renforcer le poids de la classe ouvrière au sein de l'État-Commune : 1 délégué pour 125 000 paysans, 1 délégué pour 25 000 ouvriers des villes. Il n'en demeure pas moins que la nécessité de mobiliser la population largement paysanne contre la bourgeoisie et de l'intégrer dans le processus de gestion de la société donna naissance, en Russie, à un État qui n'était pas seulement constitué des délégués ouvriers des soviets, mais aussi de délégués de soldats et de paysans pauvres.
Les mises en garde du marxisme contre l'État, fût-il de la période de transition
Dans son introduction de 1891 à La Guerre civile en France et rédigée à l'occasion du 20e anniversaire de la Commune de Paris, Engels ne craint pas de mettre en évidence des traits communs à tous les États, qu'ils soient de classiques États bourgeois ou l'État-Commune de la période de transition : "Mais, en réalité, l'État n'est rien d'autre qu'un appareil pour opprimer une classe par une autre, et cela, tout autant dans la république démocratique que dans la monarchie ; le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'il est un mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe et dont, tout comme la Commune, il ne pourra s'empêcher de rogner aussitôt au maximum les côtés les plus nuisibles, jusqu'à ce qu'une génération grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres soit en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l'État." 23 Considérer l'État comme un "mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe" est une idée qui se situe parfaitement dans le prolongement du fait que l'État est une émanation de la société (L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État), et non du prolétariat révolutionnaire. Et cela a de lourdes implications quant aux relations nécessaires entre cet État et la classe révolutionnaire. Même si celles-ci ne purent pas être complètement clarifiées avant la Révolution russe, Lénine saura s'en inspirer à travers une forte insistance, dans L'État et la révolution, sur la nécessité que les ouvriers soumettent tous les membres de l’État à une supervision et à un contrôle constant, en particulier les éléments de l’État qui incarnent avec le plus d'évidence une certaine continuité avec l'ancien régime, tels les "experts" techniques et militaires que les soviets seront forcés d'utiliser.
Lénine élabore également un fondement théorique concernant cette nécessité d'une attitude de méfiance saine du prolétariat envers le nouvel État. Dans le chapitre intitulé "Les bases économiques de l'extinction de l'État", il explique que, vu que son rôle sera de sauvegarder à certains égards la situation de "droit bourgeois", on peut définir 1’État de transition comme "l’État bourgeois, sans la bourgeoisie !" 24. Même si cette formulation représente plus un appel à la réflexion qu'une claire définition de la nature de classe de l’État de transition, Lénine a saisi l'essentiel : puisque la tâche de 1’État est de sauvegarder un état de choses qui n'est pas encore communiste, 1’État-Commune révèle sa nature fondamentalement conservatrice et c'est ce qui le rend particulièrement vulnérable à la dynamique de la contre-révolution.
Une intervention de Lénine en 1920-21 mettant en avant la nécessité pour les ouvriers de pouvoir se défendre contre l'État
Ces perceptions théoriques ont certainement favorisé une certaine lucidité de Lénine, à propos de la nature de l'État en Russie, lors du débat de 1920-21 sur les syndicats 25. Il s'opposait en particulier à Trotsky, alors partisan de la militarisation du travail et pour qui le prolétariat devait s'identifier à "l'État prolétarien" et même s'y subordonner. Bien que lui-même ait été pris dans le processus de dégénérescence de la révolution, Lénine défend alors la nécessité pour les ouvriers de maintenir des organes de défense de leurs intérêts 26, même contre l’État de transition, de même qu'il renouvelle ses avertissements sur la croissance de la bureaucratie d’État. C'est dans les termes suivants qu'il pose le cadre de la question dans un discours à une réunion de délégués communistes à la fin de 1920 : "(…) le camarade Trotsky (…) prétend que, dans un État ouvrier, le rôle des syndicats n'est pas de défendre les intérêts matériels et moraux de la classe ouvrière. C'est une erreur. Le camarade Trotsky parle d'un "État ouvrier". Mais c'est une abstraction. Lorsque nous parlions de l'État ouvrier en 1917, c'était normal ; mais aujourd'hui, lorsque l'on vient nous dire : "Pourquoi défendre la classe ouvrière, et contre qui, puisqu'il n'y a plus de bourgeoisie, puisque l'État est un État ouvrier", on se trompe manifestement car cet État n'est pas tout à fait ouvrier, voilà le hic. C'est l'une des principales erreurs du camarade Trotsky. (...) En fait, notre État n'est pas un État ouvrier, mais ouvrier-paysan, c'est une première chose. De nombreuses conséquences en découlent. (Boukharine : "Comment ? Ouvrier-paysan ?") Et bien que le camarade Boukharine crie derrière : "Comment ? Ouvrier -paysan ?", je ne vais pas me mettre à lui répondre sur ce point. Que ceux qui en ont le désir se souviennent du Congrès des Soviets qui vient de s'achever ; il a donné la réponse.
Mais ce n'est pas tout. Le programme de notre parti, document que l'auteur de L'ABC du communisme connaît on ne peut mieux, ce programme montre que notre État est un État ouvrier présentant une déformation bureaucratique. Et c'est cette triste, comment dirais-je, étiquette, que nous avons dû lui apposer. Voilà la transition dans toute sa réalité. Et alors, dans un État qui s'est formé dans ces conditions concrètes, les syndicats n'ont rien à défendre ? On peut se passer d'eux pour défendre les intérêts matériels et moraux du prolétariat entièrement organisé ? C'est un raisonnement complètement faux du point de vue théorique.(...) Notre État est tel aujourd'hui que le prolétariat totalement organisé doit se défendre, et nous devons utiliser ces organisations ouvrières pour défendre les ouvriers contre leur État, et pour que les ouvriers défendent notre État." 27
Nous considérons cette réflexion lumineuse et de la plus haute importance. Lui-même happé dans la dynamique dégénérescente de la révolution, Lénine n'a malheureusement pas été en mesure de lui donner suite en l'approfondissant (au contraire de cela, il reviendra sur sa caractérisation d'État ouvrier-paysan). Par ailleurs, cette intervention n'a pas été à même de susciter (surtout du propre fait de Lénine lui-même), une réflexion et un travail commun avec l'Opposition ouvrière menée par Kollontaï et Chliapnikov, laquelle exprimait à l'époque une réaction prolétarienne à la fois contre les théorisations bureaucratiques de Trotsky et contre les véritables distorsions bureaucratiques qui étaient en train de ronger le pouvoir prolétarien. Néanmoins, cette précieuse réflexion n'a pas été perdue pour le prolétariat. En effet, comme nous l'avons signalé précédemment, elle a constitué le point de départ d'une réflexion plus approfondie sur la nature de l'État de la période de transition menée par la Gauche communiste d'Italie que celle-ci a pu transmettre aux générations suivantes de révolutionnaires.
C'est le prolétariat et non l'État qui est la force de transformation révolutionnaire de la société
Une des idées fondamentales du marxisme c'est que la lutte de classe constitue le moteur de l'histoire. Ce n'est évidemment pas par hasard que cette idée est exprimée dès la première phrase, juste après l'introduction, du Manifeste communiste : "L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte de classe" 28. Ce n'est donc pas l'État qui peut jouer ce rôle de moteur puisque sa fonction historique est justement d'"estomper le conflit, le maintenir dans les limites de "l'ordre"" (L'origine de la famille, …). Cette caractéristique de l'État des sociétés de classes, s'applique encore à la société de transition, où c'est la classe ouvrière qui demeure la force révolutionnaire. Déjà Marx, à propos de la Commune de Paris, avait clairement distingué d'une part la force révolutionnaire du prolétariat et d'autre part l'État-Commune : "... la Commune n'est pas le mouvement social de la classe ouvrière, et, par suite, le mouvement régénérateur de toute l'humanité, mais seulement le moyen organique de son action. La Commune ne supprime pas les luttes de classes, par lesquelles la classe ouvrière s'efforce d'abolir toutes les classes, et par suite toute domination de classe... mais elle crée l'ambiance rationnelle dans laquelle cette lutte de classes peut passer par ses différentes phases de la façon la plus rationnelle et la plus humaine." 29
La caractéristique du prolétariat après la révolution, à la fois classe dominante politiquement et encore exploitée sur le plan économique, fait que c'est à la fois sur le plan économique et sur le plan politique que, par essence, État-Commune et dictature du prolétariat sont antagoniques :
-
c'est en tant que classe exploitée que le prolétariat doit défendre ses "intérêts matériels et moraux" (comme le dit Lénine) contre la logique économique de l'État-Commune, représentant de la société dans son ensemble à un instant donné ;
-
c'est en tant que classe révolutionnaire que le prolétariat doit défendre ses orientations politiques et pratiques en vue de transformer la société contre le conservatisme social de l'État et ses tendance à l'autoconservation en tant qu'organe qui, selon Engels "se place au-dessus [de la société] et lui devient de plus en plus étranger" (L'origine de la famille, …)
Afin de pouvoir assumer sa mission historique de transformation de la société pour en finir avec toute domination économique et politique d'une classe sur une autre, la classe ouvrière assume sa domination politique sur l'ensemble de la société à travers le pouvoir international de conseils ouvriers, le monopole du contrôle des armes et le fait qu'elle est la seule classe de la société qui soit armée en permanence. Sa domination politique s'exerce également sur l'État. Ce pouvoir de la classe ouvrière est par ailleurs inséparable de la participation effective et illimitée des immenses masses de la classe, de leur activité et organisation et il prend fin lorsque tout pouvoir politique devient superflu, lorsque le classes ont disparu.
Conclusion
Nous espérons avoir répondu de la façon la plus argumentée possible aux critiques que notre position sur l'État dans la période de transition a suscitées chez OPOP. Nous sommes bien conscients de n'avoir pas répondu spécifiquement à un certain nombre d'objections concrètes et explicites (par exemple, "les tâches organisationnelles et administratives mises à l'ordre du jour par la révolution sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux".). Si nous ne l'avons pas fait cette fois-ci, c'est parce qu'il nous apparaissait nécessaire de présenter en priorité les grandes lignes historiques et théoriques de notre cadre d'analyse et que, très souvent, celles-ci constituaient une réponse implicite aux objections de OPOP. Nous pourrons y revenir, si nécessaire, dans un prochain article.
Enfin, nous pensons que, pour être essentielle, cette question de l'État dans la période de transition n'est pas la seule dont la clarification théorique et pratique ait pu avancer considérablement suite à l'expérience de la Révolution russe : il en est ainsi également de la question du rôle et de la place du parti prolétarien. Son rôle est-il l'exercice du pouvoir, sa place était-elle au sein de l'État, au nom de la classe ouvrière ? Non, pour nous, il s'agit là d'erreurs qui ont contribué à la dégénérescence du Parti bolchevik. Nous espérons également pouvoir revenir sur cette question dans un prochain débat avec OPOP.
Silvio (9/8/2012)
1 OPOP, Oposição Operária (Opposition ouvrière), qui existe au Brésil. Voir sa publication sur revistagerminal.com. Le CCI entretient avec OPOP depuis des années une relation fraternelle et de coopération s'étant déjà traduite par des discussions systématiques entre nos deux organisations, des tracts ou déclarations signés en commun ("Brésil : des réactions ouvrières au sabotage syndical", https://fr.internationalism.org/ri373/bresil.html [6]) ou des interventions publiques communes ("Deux réunions publiques communes au Brésil, OPOP-CCI : à propos des luttes des futures générations de prolétaires", https://fr.internationalism.org/ri371/opop.html [7]) et la participation réciproque de délégations aux congrès de nos deux organisations.
2 "L'État dans la période de transition au communisme (I) (débat dans le milieu révolutionnaire) [103]", Revue internationale n° 148.
3 Note présente dans le passage cité de l'Anti-Dühring : "L'État populaire libre, revendication inspirée de Lassalle et adoptée au congrès d'unification de Gotha, a fait l'objet d'une critique fondamentale de Marx dansla Critique du programme de Gotha."
4 Friedrich Engels, Anti-Dühring. Troisième partie : Socialisme. Chapitre II : Notions théoriques. https://www.marxists.org/francais/engels/works/1878/06/fe18780611.htm [104]
5 Lénine. L'État et la révolution. Chapitre IV : Suite. Explications complémentaires d'Engels. 2. Polémique avec les anarchistes. https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/08/er00t.htm [10].
6 Karl Marx. Critique du programme du Parti ouvrier allemand. Partie IV, Éd. La Pléiade, Économie I, p. 1429..
7 Gauche communiste italienne. De la même manière que le développement de l’opportunisme de la Seconde Internationale avait suscité une réponse prolétarienne sous la forme de courants de gauche, la montée de l'opportunisme dans la Troisième Internationale allait rencontrer la résistance de la gauche communiste. La gauche communiste était essentiellement un courant international et avait des expressions dans de nombreux pays, depuis la Bulgarie jusqu’à la Grande-Bretagne et des États-Unis à l’Afrique du Sud. Mais ses représentants les plus importants allaient se trouver précisément dans ces pays où la tradition marxiste était la plus forte : l’Allemagne, l’Italie et la Russie. En Italie, la gauche communiste – qui était au début majoritaire au sein du Parti communiste d’Italie – avait une position particulièrement claire sur la question de l'organisation. Cela lui a permis non seulement de mener une bataille courageuse contre l’opportunisme au sein de l’Internationale dégénérescente, mais aussi de donner naissance à une fraction communiste qui a été capable de survivre au naufrage du mouvement révolutionnaire et de développer la théorie marxiste pendant les sombres années de la contre-révolution. Au début des années 1920, ses arguments en faveur de l’abstentionnisme vis à vis des parlements bourgeois, contre la fusion de l’avant-garde communiste avec de grands partis centristes pour donner l’illusion "d’une influence sur les masses", contre les mots d’ordre de front unique et de "gouvernement ouvrier" étaient déjà fondés sur une profonde assimilation de la méthode marxiste. Pour d'avantage d'informations lire "La Gauche Communiste et la continuité du marxisme". https://fr.internationalism.org/icconline/1998/gauche-communiste [105].
8 Lire à ce propos notre article "L'État et la révolution, une vérification éclatante du marxisme" au sein de la série "Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [2° partie]". Revue Internationale n° 91. https://fr.internationalism.org/french/rint91/communisme.htm [106]. Beaucoup des thèmes abordés dans notre réponse à OPOP, sont développés plus largement dans cet article.
9 Le Manifeste communiste. "II. Prolétaires et communistes". Éd. La Pléiade, Économie I, pp. 181-182.
10 Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Chapitre VII Éd. La Pléiade, Politique I, p. 531.
11 L'État et la révolution. Chapitre III : L'expérience de la Commune de Paris. "1. En quoi la tentative des communards est-elle héroïque". En fait, l'expression ici utilisée par Lénine est une adaptation de paroles de Marx dans une lettre à Bracke du 5 mai 1875 à propos du programme de Gotha : "Un seul pas du mouvement réel est plus important qu'une douzaine de programmes". Critique du programme Parti ouvrier allemand. " Marx à W. Bracke". Éd. La Pléiade, Économie I, p. 1411.
12 Préface à la réédition allemande de 1872 du Manifeste communiste. Éd. La Pléiade, Économie I, Appendice V, p. 1481.
13 Idem
14 L'État et la révolution chapitre III. Idem.
15 Cf. "L'État dans la période de transition au communisme (débat dans le milieu révolutionnaire)". Revue internationale n° 148. https://fr.internationalism.org/rint148/l_État_dans_la_periode_de_transition_au_communisme_debat_dans_le_milieu_revolutionnaire.html [103]
16 L'État et la révolution. Chapitre V : les bases économiques de l'extinction de l'État. "3. Première phase de la société communiste."
17 Cette expression est extraite de la phrase suivante : "Une fois les capitalistes renversés, la résistance de ces exploiteurs matée par la main de fer des ouvriers en armes, la machine bureaucratique de l'État actuel brisée, nous avons devant nous un mécanisme admirablement outillé au point de vue technique, affranchi de "parasitisme", et que les ouvriers associés peuvent fort bien mettre en marche eux-mêmes en embauchant des techniciens, des surveillants, des comptables, en rétribuant leur travail à tous, de même que celui de tous les fonctionnaires "publics", par un salaire d'ouvrier". L'État et la révolution. Chapitre III : L'État et la révolution. L'expérience de la Commune de Paris (1871). Analyse de Marx. "3. Suppression du parlementarisme"
18 Note présente dans le passage cité de L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État : "Hegel: Principes de la Philosophie du droit, §§ 257 et 360."
19 L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. IX : Barbarie et civilisation. https://www.marxists.org/francais/engels/works/1884/00/fe18840000.htm [107]
20 L'État et la révolution chapitre II : l'expérience des années 1848-1851.
21 Dans notre série de 5 articles de la Revue internationale, "Qu'est-ce que les conseils ouvriers", nous mettons en évidence les différences sociologiques et politiques entre les conseils ouvriers et les soviets territoriaux. Les conseils ouvriers sont les conseils d'usine. À côté de ceux-ci on trouve également des conseils de quartier, ces derniers intégrant les travailleurs des petites entreprises et des commerces, les chômeurs, les jeunes, les retraités, les familles qui faisaient partie de la classe ouvrière comme un tout. Les conseils d'usine et de quartiers (ouvriers) jouèrent un rôle décisif à différents moments du processus révolutionnaire (voire à ce propos les articles de la série publiés dans les Revue internationale n° 141 et 142). Ce n'est donc pas un hasard si, avec le processus de dégénérescence de la révolution, les conseils d'usine disparurent fin 1918 et les conseils de quartier fin 1919. Les syndicats eurent un rôle décisif dans la destruction de ces derniers (voire à ce propos l'article de la Revue n° 145).
22 Participèrent en fait aussi à cet État, de façon de plus en plus importante, des experts, des dirigeants de l'Armée rouge et de la Tcheka, etc.
23 F. Engels, introduction de 1891 à La Guerre civile en France. Avant-dernier paragraphe. https://www.marxists.org/francais/engels/works/1891/03/fe18910318.htm [108]
24 Le contexte de cette expression extraite du texte de Lénine est le suivant :
"Dans sa première phase, à son premier degré, le communisme ne peut pas encore, au point de vue économique, être complètement mûr, complètement affranchi des traditions ou des vestiges du capitalisme. De là, ce phénomène intéressant qu'est le maintien de l'"horizon borné du droit bourgeois", en régime communiste, dans la première phase de celui-ci. Certes, le droit bourgeois, en ce qui concerne la répartition des objets de consommation, suppose nécessairement un État bourgeois, car le droit n'est rien sans un appareil capable de contraindre à l'observation de ses normes.
Il s'ensuit qu'en régime communiste subsistent pendant un certain temps non seulement le droit bourgeois, mais aussi l'État bourgeois — sans bourgeoisie !" (Chapitre 5. "4. Phase supérieure de la société communiste")
25 Lire en particulier à ce propos notre article "Comprendre la défaite de la révolution russe" dans la série "Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire" (Revue internationale n° 100). https://fr.internationalism.org/french/rint/100_communisme_ideal [109]
26 Il s'agit ici des syndicats qui sont alors considérés, par tous les points de vue en présence, comme d'authentiques défenseurs des intérêts du prolétariat. Cela s'explique par les conditions d'arriération de la Russie, la bourgeoisie n'ayant pas développé un appareil d'État sophistiqué capable de reconnaître la valeur des syndicats en tant qu'instruments de la paix sociale. De ce fait, tous les syndicats qui s'étaient formés avant et même pendant la révolution de 1917, n'étaient pas nécessairement des organes de l'ennemi de classe. Il y a eu notamment une forte tendance à la création de syndicats industriels qui exprimaient toujours un certain contenu prolétarien.
27 "Les syndicats, la situation actuelle et les erreurs de Trotsky", 30 décembre 1920. https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/12/vil19201230.htm [110]
28 Le Manifeste communiste. "I. Bourgeois et Prolétaires". Éd. La Pléiade, Économie I, pp. 161.
29 La guerre civile en France, Premier essai de rédaction, Ed. sociales, p. 217.
Vie du CCI:
Questions théoriques:
Rubrique:
À propos du livre Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était (I): le communisme primitif et le rôle de la femme dans l'émergence de la culture
- 5034 reads
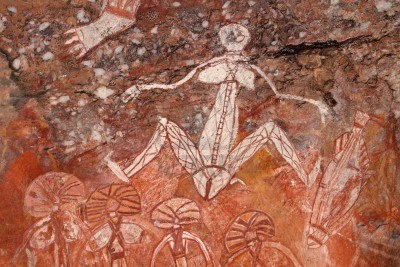 Pourquoi écrire aujourd'hui à propos du communisme primitif ? Alors que la chute abrupte dans une crise économique catastrophique et le développement des luttes à travers la planète posent de nouveaux problèmes aux travailleurs du monde entier, que l'avenir du capitalisme s'assombrit et que la perspective d'un monde nouveau peine tant à percer, on peut se demander quel est l'intérêt d'étudier la société qui fut celle de notre espèce, de son apparition (il y a environ 200 000 ans) jusqu'à la période néolithique (débutant il y a plus de 10 000 ans), une société dans laquelle vivent encore aujourd'hui certaines populations humaines. Et pourtant, nous restons convaincus que la question est aussi importante pour les communistes d'aujourd'hui qu'elle le fut pour Marx et Engels au 19e siècle, à la fois pour son intérêt scientifique général en tant qu'élément d'étude de l'humanité et de son histoire, et pour la compréhension de la perspective et de la possibilité d'une société communiste future qui pourrait remplacer la société capitaliste moribonde.
Pourquoi écrire aujourd'hui à propos du communisme primitif ? Alors que la chute abrupte dans une crise économique catastrophique et le développement des luttes à travers la planète posent de nouveaux problèmes aux travailleurs du monde entier, que l'avenir du capitalisme s'assombrit et que la perspective d'un monde nouveau peine tant à percer, on peut se demander quel est l'intérêt d'étudier la société qui fut celle de notre espèce, de son apparition (il y a environ 200 000 ans) jusqu'à la période néolithique (débutant il y a plus de 10 000 ans), une société dans laquelle vivent encore aujourd'hui certaines populations humaines. Et pourtant, nous restons convaincus que la question est aussi importante pour les communistes d'aujourd'hui qu'elle le fut pour Marx et Engels au 19e siècle, à la fois pour son intérêt scientifique général en tant qu'élément d'étude de l'humanité et de son histoire, et pour la compréhension de la perspective et de la possibilité d'une société communiste future qui pourrait remplacer la société capitaliste moribonde.
C'est pour cette raison qu'on ne peut que saluer la publication en 2009 d'un livre intitulé Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était par Christophe Darmangeat ; de même, on ne peut qu’être encouragé par le fait que le livre en soit déjà à sa deuxième édition, ce qui indique un intérêt certain pour le sujet parmi le public.1 À travers une lecture critique de ce livre, nous chercherons dans cet article à revenir sur les problèmes posés par la question des premières sociétés humaines ; nous profiterons aussi de l'occasion pour explorer les thèses exposées il y a maintenant plus de 20 ans par Chris Knight 2 dans son livre Blood Relations 3.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, précisons d'abord une chose : la question de la nature du communisme primitif, et de l'humanité en tant qu'espèce, sont des questions non pas politiques mais scientifiques. Dans ce sens, il ne peut y avoir de "position" de la part d'une organisation politique au sujet de la nature humaine, par exemple. Si nous sommes convaincus que l'organisation communiste doit stimuler le débat et la soif de connaissance pour les questions scientifiques parmi ses militants et plus généralement au sein du prolétariat, le but est d'encourager le développement d'une vision matérialiste et scientifique du monde basée autant que possible, pour les non scientifiques que nous sommes pour la plupart, sur une connaissance des théories scientifiques modernes. Les idées présentées dans cet article ne sont donc pas des "positions" du CCI et n'engagent que l'auteur. 4
Pourquoi la question des origines est-elle importante ?
Pourquoi donc la question des origines de l'espèce et des premières sociétés humaines est-elle importante pour les communistes ? Les termes du problème ont sensiblement changé depuis le 19e siècle lorsque Marx et Engels s'enthousiasmèrent pour les travaux de l'anthropologue américain Lewis Morgan. En 1884, quand Engels publie L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, on était à peine sorti d'une époque où les estimations de l'âge de la Terre et de la société humaine se basaient sur les calculs bibliques de l'évêque Ussher, pour qui la Création avait eu lieu en 4004 avant J.-C. Engels écrit dans sa Préface de 1891 : "Jusqu'en 1860 environ, il ne saurait être question d'une histoire de la famille. Dans ce domaine, la science historique était encore totalement sous l'influence du Pentateuque. La forme patriarcale de la famille, qui s'y trouve décrite avec plus de détails que partout ailleurs, n'était pas seulement admise comme la plus ancienne, mais, déduction faite de la polygamie, on l'identifiait avec la famille bourgeoise actuelle, si bien qu'à proprement parler la famille n'avait absolument pas subi d'évolution historique." 5 Il en était de même pour les notions de propriété, et la bourgeoisie pouvait encore opposer au programme communiste de la classe ouvrière l'objection selon laquelle la "propriété privée" était inscrite dans la nature même de la société humaine. L'idée de l'existence d'un état communiste primitif de la société était à ce point inconnue en 1847 que le Manifeste Communiste commence son premier chapitre par les mots "L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de luttes de classes." (affirmation qu'Engels a estimé nécessaire de rectifier dans une note en 1888).
Le livre de Morgan, Ancient Society, a largement contribué à démanteler la vision ahistorique de la société humaine éternellement basée sur la propriété privée, même si son apport a été souvent escamoté ou passé sous silence par l'anthropologie officielle, notamment anglaise. Comme le dit Engels, encore dans sa Préface, "Morgan dépassa la mesure non seulement en critiquant la civilisation, la société de la production marchande, forme fondamentale de notre société actuelle, d'une façon qui rappelle Fourier, mais aussi en parlant d'une transformation future de cette société en termes qu'aurait pu énoncer Karl Marx".
Aujourd'hui en 2012, la situation a bien changé. Les découvertes successives ont repoussé encore et encore plus loin dans le passé les origines de l'Homme, si bien que maintenant nous savons que non seulement la propriété privée n'est pas un fondement éternel de la société mais qu'elle est, au contraire, une invention relativement récente puisque l'agriculture - et donc la propriété privée et la division de la société en classes - ne datent que de 10 000 ans environ. Certes, comme Alain Testart l'a montré dans son livre Les chasseurs-cueilleurs ou l'origine des inégalités, la formation des classes et des richesses ne s'est pas faite en une nuit ; il a dû s’écouler une longue période avant l'émergence de l'agriculture proprement dite où le développement du stockage a favorisé l'émergence d'une répartition inégale des richesses accumulées. Néanmoins, il est clair aujourd'hui que la partie de loin la plus longue de l'histoire humaine n'est pas celle de la lutte des classes, mais d'une société sans classes, communiste : c'est ce qu'on appelle le communisme primitif.
L'objection qu'on entend aujourd'hui à l'idée d'une société communiste n'est donc plus qu'elle violerait les principes éternels de propriété privée mais, plutôt, qu'elle serait contraire à "la nature humaine". "On ne peut changer la nature humaine" dit-on, et par cela on veut dire la nature prétendument violente, compétitive et égocentrique de l’Homme. L'ordre capitaliste ne serait donc plus éternel, mais seulement le résultat logique et inévitable d'une nature immuable. Cette argumentation n'est pas limitée à des idéologues de droite. Des scientifiques humanistes, en pensant suivre la même logique d'une nature humaine déterminée par la génétique, en arrivent à des conclusions similaires. Le New York Review of Books (journal intellectuel plutôt orienté à gauche) nous en donne un exemple dans un numéro d'octobre 2011 : "Les êtres humains se font concurrence pour les ressources, l'espace vital, les partenaires sexuels, et presque tout le reste. Chaque être humain se trouve au sommet d'une lignée de concurrents ayant réussi, qui remonte jusqu'aux origines de la vie. La pulsion compétitive entre dans pratiquement tout ce que nous faisons, qu'on le reconnaisse ou non. Et les meilleurs concurrents sont souvent les mieux remerciés. Il suffit de regarder Wall Street pour en trouver un exemple flagrant (...) Le dilemme humain de surpopulation et surexploitation des ressources est fondamentalement déterminé par les impulsions primordiales qui ont permis à nos ancêtres d'atteindre un succès reproductif au-dessus de la moyenne". 6
Cet argument peut sembler a priori inattaquable : on n'a pas besoin de chercher bien loin pour trouver des exemples à ne plus en finir de la cupidité, de la violence, de la cruauté et de l'égoïsme dans la société humaine de nos jours ou dans son histoire. Mais est-ce que cela prouve que ces tares sont le résultat d'une nature déterminée - dirait-on aujourd'hui – génétiquement ? Rien n'est moins sûr. Pour faire une analogie, un arbre qui pousse sur une falaise balayée par le vent marin risque fort de pousser chétif et tordu : ce n'est pas pour autant que ce qui apparaît ainsi de sa structure soit intégralement inscrit dans ses gènes - dans des conditions plus favorables l'arbre pousserait droit.
Peut-on en dire de même pour les êtres humains ?
C'est une évidence, souvent relevée dans nos articles, que la résistance du prolétariat mondial est bien en deçà du niveau des attaques qu'il subit de la part d'un capitalisme en crise. La révolution communiste n'a peut-être jamais semblé aussi nécessaire et, en même temps, aussi difficile. Et l’une des raisons en est certainement, à notre avis, le fait que les prolétaires manquent de confiance non seulement dans leurs propres forces mais dans la possibilité même du communisme. "Une belle idée", nous dit-on, "mais vous savez, la nature humaine"...
Pour prendre confiance en lui, le prolétariat doit affronter non seulement les problèmes immédiats de la lutte mais aussi les problèmes plus vastes, historiques, posés par la confrontation révolutionnaire potentielle avec la classe dominante. Parmi ces problèmes, il y a précisément celui de la nature humaine ; et nous devons traiter ce problème avec un esprit scientifique. Il ne s'agit pas de prouver que l'Homme est "bon", mais d'arriver à une meilleure compréhension de quelle est précisément sa nature, de façon à pouvoir intégrer cette connaissance dans le projet politique du communisme. Ainsi, nous ne faisons pas dépendre le projet communiste de la "bonté naturelle" de l'Homme : le besoin du communisme est aujourd'hui inscrit dans les données de la société capitaliste comme seule solution au blocage de la société, qui amènera sans nul doute l'humanité à un avenir catastrophique si le capitalisme n'est pas renversé par la révolution communiste.
Méthode scientifique
Le passage qui précède nous amène, avant d'entrer dans le vif du sujet, à quelques considérations sur la méthode scientifique et, plus particulièrement, la méthode scientifique appliquée à l'étude de l'histoire et du comportement humain. Un passage situé au début du livre de Knight, relatif à la place de l'anthropologie dans les sciences, nous semble poser la question très justement : "Plus que tout autre domaine de connaissance, l'anthropologie prise dans son ensemble enjambe le gouffre qui a traditionnellement divisé les sciences naturelles et humaines. En puissance, sinon toujours en pratique, elle occupe donc une place centrale parmi les sciences dans leur ensemble. Les éléments cruciaux qui, s'ils pouvaient seulement être rassemblés, pourraient relier les sciences naturelles aux sciences humaines, traversent l'anthropologie plus que tout autre domaine. C'est ici que les deux bouts se rejoignent ; ici que l'étude de la nature prend fin, et que celle de la culture commence. À quel moment de l'évolution est-ce que les principes biologiques ont laissé la place à de nouveaux principes dominants, plus complexes ? Où, précisément, se trouve la ligne de partage entre la vie animale et la vie sociale ? La différence est-elle de nature, ou seulement de degré ? Et, à la lumière de cette question, est-il réellement possible d'étudier les phénomènes humains avec la même objectivité désintéressée dont un astronome peut faire preuve envers des galaxies, ou un physicien envers des particules subatomiques ?
Si ce domaine des rapports entre les sciences semble confus pour beaucoup, ce n'est qu'en partie à cause des difficultés réelles que cela implique. À un bout, la science est enracinée dans la réalité objective mais, à l'autre, elle est enracinée dans la société et en nous-mêmes. En fin de compte, c'est pour des raisons sociales et idéologiques que la science moderne, fragmentée et distordue par des pressions politiques immenses et pourtant largement non reconnues, a rencontré son plus grand problème et son plus grand défi théorique : réunir les sciences humaines et les sciences naturelles en une seule science unifiée sur la base d'une compréhension de l'évolution de l'humanité, et de la place de cette dernière dans l'univers." (pp. 56-57).
La question de la "ligne de partage" entre le monde animal non-humain où le comportement est déterminé surtout par le patrimoine génétique, et le monde humain où le comportement dépend beaucoup plus de l'environnement, notamment social et culturel, nous semble effectivement la question cruciale pour comprendre la "nature humaine". Les grands singes sont capables d'apprendre, d'inventer et de transmettre, jusqu'à un certain point, des comportements nouveaux, mais cela ne veut pas dire qu'ils possèdent une "culture" au sens humain du terme. Ces comportements appris restent "périphériques à la continuité sociale et structurelle du groupe" (ibid., p. 11). 7 Ce qui a permis à la culture de prendre le dessus, dans une "explosion créative" (ibid., p. 12), c'est le développement de la communication entre groupes humains, le développement d'une culture symbolique basée sur le langage et le rite. Knight fait par ailleurs la comparaison entre la culture symbolique et le langage, qui ont permis aux humains de communiquer et de transmettre les idées et donc la culture de manière universelle, et la science, qui est basée sur un symbolisme ayant rencontré un accord universel entre scientifiques au niveau de la planète et, potentiellement au moins, entre tous les êtres humains. La pratique de la science est inséparable du débat, et de la capacité de chacun de vérifier les conclusions auxquelles elle arrive ; elle est donc l'ennemi de toute forme d'ésotérisme qui ne vit que par la connaissance secrète, fermée aux non-initiés.
Parce qu'elle est une forme de connaissance universelle, que depuis la Révolution industrielle elle est également une force productive à part entière nécessitant le travail associé de scientifiques dans le temps et l'espace,8 la science dépasse le cadre national par nature et, en ce sens, le prolétariat et la science sont des alliés naturels.9 Cela ne veut absolument pas dire qu'il puisse exister une "science prolétarienne". Dans son article "Marxisme et science", Knight cite ces mots d'Engels : "plus la science avance de manière implacable et désintéressée, plus elle se trouve en harmonie avec les intérêts des ouvriers". Et Knight de poursuivre : "La science, en tant que seule forme de connaissance universelle, internationale, unificatrice de l'espèce, que l'humanité possède, doit venir en premier. Si elle doit s'enraciner dans les intérêts de la classe ouvrière, ce n'est que dans la mesure où elle doit s'enraciner dans les intérêts de l'humanité dans son ensemble, et dans la mesure où la classe ouvrière donne corps à ces intérêts dans l'époque actuelle."
Il y a deux autres aspects de la pensée scientifique, qui ont été mis en exergue dans le livre de Carlo Rovelli à propos du philosophe grec Anaximandre de Milet 10, et que nous reprenons ici car ils nous semblent fondamentaux : le respect pour les prédécesseurs et le doute.
Rovelli montre que l'attitude d'Anaximandre envers son maître Thalès a rompu avec les attitudes caractéristiques de son époque : soit un rejet total pour s'établir comme nouveau "maître" à la place de l'ancien, soit un dévouement à la lettre aux paroles du "maître" pour les maintenir à l'état momifié. L'attitude scientifique, au contraire, est de se baser sur les travaux des "maîtres" qui nous ont précédés tout en critiquant leurs erreurs et en cherchant à aller plus loin dans la connaissance. C'est cette attitude qu'on doit saluer chez Knight envers Lévi-Strauss, et chez Darmangeat envers Morgan.
Le doute - à l'inverse de la pensée religieuse qui cherche toujours la certitude et la consolation dans l'invariance d'une vérité établie à tout jamais - est fondamental pour la science. Comme le dit Rovelli 11, "La science offre les meilleures réponses justement parce qu’elle ne considère pas ses réponses comme certainement vraies ; c’est pourquoi elle est toujours capable d’apprendre, de recevoir de nouvelles idées". C'est tout particulièrement le cas de l'anthropologie et de la paléoanthropologie, dont les données sont éparses et souvent incertaines, et dont les théories les plus en vogue du moment peuvent se trouver remises en question, voire bouleversées, du jour au lendemain par de nouvelles découvertes.
Mais est-il possible d'avoir une vision scientifique de l'histoire ? Karl Popper 12, qui est une référence chez la plupart des scientifiques, pensait que non, puisqu'il considérait l'histoire comme un "événement" unique, non reproductible, et que la vérification d'une hypothèse scientifique dépendait de la reproductibilité des expériences ou des observations. Popper, pour les mêmes raisons, avait également considéré la théorie de l'évolution comme non scientifique de prime abord et, pourtant, il est aujourd'hui une évidence que la méthode scientifique a pu mettre à nu les mécanismes fondamentaux de l'évolution des espèces au point de permettre à l'humanité de manipuler le processus de l'évolution grâce au génie génétique. Sans suivre Popper, il est clair qu'utiliser la méthode scientifique pour faire des prévisions sur la base de l'étude de l'histoire reste un exercice fort hasardeux : d'un côté parce que l'histoire humaine - comme la météorologie par exemple - incorpore un nombre incalculable de variables, de l'autre, et surtout, parce que - comme le disait Marx - "les hommes font leur propre histoire" ; l'histoire est donc déterminée non seulement par des lois mais aussi par la capacité ou non des êtres humains de baser leurs actions sur la pensée consciente et la connaissance de ces lois. L'évolution de l'histoire reste toujours soumise à des contraintes : à un moment donné, certaines évolutions sont possibles, d'autres non. Mais la façon dont une situation donnée évoluera est aussi déterminée par la capacité des hommes de devenir conscients de ces contraintes et d'agir en conséquence.
Il est donc particulièrement hardi de la part de Knight d'accepter toute la rigueur exigée par la méthode scientifique, et de soumettre sa théorie à l'épreuve de l'expérience. Évidemment, il n'est pas possible de "reproduire" l'histoire expérimentalement. À partir de ses hypothèses sur les débuts de la culture humaine, Knight fait donc des prévisions (en 1991, date de la publication de Blood Relations) quant aux découvertes paléontologiques à venir : notamment qu'on trouverait parmi les traces les plus anciennes de la culture symbolique chez l'Homme une utilisation importante de l'ocre rouge. En 2006, 15 ans plus tard, il semblerait que ces prévisions aient été confirmées par les découvertes dans les cavernes de Blombos (Afrique du Sud) des premiers vestiges connus de la culture humaine (voir les travaux de la Conférence de Stellenbosch réunis dans The cradle of language, OUP, 2009, ou encore l'article publié sur le site web de La Recherche en novembre 2011)13 ; on y trouve de l’ocre rouge et également des collections de coquillages utilisés apparemment comme décoration corporelle, ce qui s'intègre dans le modèle évolutif proposé par Knight (nous y reviendrons plus loin). Évidemment, ceci ne constitue pas en soi une "preuve" de sa théorie mais il nous semble indéniable que cela lui donne une plus grande consistance.
Cette méthodologie scientifique est très différente de celle suivie par Darmangeat. Celui-ci, nous semble-t-il, reste cantonné dans la logique inductiviste, qui part d'un rassemblement de faits observés pour essayer d'en extraire les traits communs. La méthode n'est pas sans valeur pour l'étude historique et scientifique : toute théorie doit, après tout, se conformer aux faits observés. Darmangeat semble d'ailleurs très réticent vis-à-vis de toute théorie qui cherche à aller au-delà. Ceci nous paraît une démarche empiriste plutôt que scientifique : la science n'avance pas par induction à partir des faits observés, mais par hypothèses qui doivent certes être conformes aux observations, mais qui doivent également proposer une démarche (expérimentale si possible) à suivre pour avancer vers de nouvelles découvertes, donc de nouvelles observations. En physique, la théorie des cordes nous en offre un exemple éclatant : bien qu'en accord, autant que faire se peut, avec les faits observés, elle ne peut être vérifiée de façon expérimentale puisque les éléments dont elle postule l'existence sont inaccessibles de par leur petite taille aux appareils de mesure dont nous disposons aujourd'hui. La théorie des cordes reste donc une hypothèse spéculative, mais sans ce genre de spéculation hardie, il n'y aurait pas non plus d'avancée scientifique.
Un autre inconvénient de la méthode inductiviste est que, par la force des choses, elle doit opérer une sélection au préalable dans l'immensité de la réalité observée. C'est ce que fait Darmangeat lorsqu'il se base uniquement sur des observations ethnographiques en laissant de côté toute considération évolutionniste ou génétique, ce qui nous semble rédhibitoire dans une œuvre qui cherche à mettre au clair "l'origine de l'oppression des femmes" (le sous-titre du livre dont il est question).
Morgan, Engels et la méthode scientifique
Après ces considérations (bien modestes) sur la méthodologie, revenons maintenant au livre de Darmangeat qui a motivé cet article.
L’œuvre est divisée en deux parties : la première examine le travail de l'anthropologue Lewis Morgan sur lequel Engels a basé son Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État; la deuxième reprend la question que pose Engels à propos de l'origine de l'oppression des femmes. Dans cette deuxième partie, Darmangeat s'attaque surtout à l'idée de l'existence d'un communisme primitif, aujourd'hui disparu, qui aurait été basé sur le matriarcat.
La première partie du livre nous paraît particulièrement intéressante 14 et nous ne pouvons qu'abonder dans le sens de l'auteur quand il s'insurge contre une certaine conception prétendument "marxiste" qui érige les travaux de Morgan (et a fortiori d'Engels) au statut de textes religieux intouchables. Rien ne pourrait être plus étranger à l'esprit scientifique du marxisme. Si les marxistes se doivent d'avoir une vision historique de l'émergence et du développement de la théorie sociale matérialiste, et donc de tenir compte des théories antérieures, il nous semble absolument évident que nous ne pouvons pas prendre des textes du 19e siècle comme le fin mot de l'histoire en ignorant l'accumulation impressionnante de connaissances ethnographiques réunies depuis. Certes, il convient de garder un esprit critique sur l'utilisation de ces connaissances : Darmangeat, tout comme Knight d'ailleurs, a bien raison d'insister sur le fait que la lutte contre les théories de Morgan est loin de la science "pure" et "désintéressée". Lorsque les adversaires contemporains et ultérieurs de Morgan signalaient les erreurs qu'il a commises ou lorsqu'ils mettaient en avant les découvertes qui ne cadraient pas avec sa théorie, le but n'était pas neutre en général. En s'attaquant à Morgan, on s'attaquait à la vision évolutionniste de la société humaine et on cherchait à rétablir ces catégories "éternelles" de la société bourgeoise que sont la famille patriarcale et la propriété privée comme les fondements de toute société humaine passée, présente et future. Ceci est parfaitement explicite chez Malinowski, un des plus grands ethnographes de la première moitié du 20e siècle, dont Knight (dans "Early Human Kinship was Matrilineal", publié dans Early Human Kinship: From Sex to Social Reproduction, 2008, Blackwell Publishing Ltd.15) cite les propos dans une émission radiodiffusée : "Je crois que l'élément le plus perturbateur des tendances révolutionnaires modernes est l'idée que la parentalité peut être rendue collective. Si jamais nous nous débarrassions de la famille individuelle comme élément essentiel de notre société, nous serions confrontés à une catastrophe sociale par rapport à laquelle les bouleversements politiques de la Révolution française et les changements économiques du bolchevisme seraient insignifiants. La question de savoir si la maternité de groupe a jamais existé comme institution, si elle est un arrangement compatible avec la nature humaine et l'ordre social, est donc d'un intérêt pratique considérable". Quand on fait dépendre ses conclusions sur le plan scientifique d’un parti pris politique, on est loin de l'objectivité scientifique...
Passons donc à la critique de Morgan faite par Darmangeat. Celle-ci est à notre sens d'un grand intérêt, ne serait-ce que parce qu'elle commence par un résumé assez détaillé de sa théorie, et qui rend cette dernière éminemment accessible pour un lecteur non expert. Nous avons particulièrement apprécié le tableau qui fait le rapprochement entre les stades de l’évolution sociale ("sauvagerie", "barbarie", etc.) définis par l'anthropologie de Morgan avec ceux utilisés aujourd'hui (paléolithique, néolithique, etc.), ce qui permet de mieux se situer dans le temps, et les diagrammes explicatifs des différents systèmes de parenté. Le tout est accompagné d'explications claires et didactiques.
Le fond de la théorie de Morgan est de relier type de famille, système de parenté et développement technique, dans une évolution progressive qui passe de "l’état sauvage" (première étape de l'évolution sociale humaine, qui correspondrait au paléolithique), à la "barbarie" (le néolithique et l'âge des métaux) et, enfin, à la civilisation. Cette évolution serait déterminée par l'évolution de la technique, et les contradictions apparentes que Morgan notait chez de nombreux peuples (dont les Iroquois en particulier) entre le système de parenté et le système familial, représenteraient justement des étapes intermédiaires entre d'une part une économie et une technique plus primitive et, d'autre part, une technique plus évoluée. Malheureusement pour la théorie, il se trouve en y regardant de plus près que ce n'est pas le cas. Pour ne prendre qu'un des multiples exemples que nous propose Darmangeat : le système "punaluen" de parenté qui est censé, d'après Morgan, représenter une des étapes sociales et techniques les plus primitives, se trouve à Hawaï ; c'est une société qui connaît richesses, inégalités sociales, une couche sociale aristocratique, et qui serait sur le point de passer le cap vers une société étatique. La famille, les systèmes de parenté y sont donc déterminés par des besoins sociaux, mais non pas en ligne droite depuis les plus primitifs jusqu’au plus modernes.
Est-ce que cela veut dire que l'évolutionnisme social marxiste est à jeter aux oubliettes ? Pas du tout, selon l'auteur. Par contre, il faut dissocier ce que Morgan, puis Marx et Engels après lui, avaient essayé d'associer : l'évolution de la technique (donc de la productivité) et les systèmes de famille. "Les modes de production, bien que différents d'un point de vue qualitatif, possèdent tous une quantité commune, la productivité, qui permet de les ordonner en une série croissante, qui se trouve de surcroît correspondre globalement à la chronologie (...) [Pour la famille] il n'existe aucune quantité à laquelle les différentes formes puissent être ramenées et à partir de laquelle on pourrait constituer une série croissante" (p. 136). Il est évident que l'économie est déterminante "en dernière instance", pour reprendre les termes d'Engels : s'il n'y avait pas d'économie (c'est à dire la reproduction de tout ce qui est nécessaire à la vie humaine), alors il n'y aurait pas de vie sociale non plus. Mais cette "dernière instance" laisse beaucoup de place aux autres influences, géographiques, historiques, culturelles, etc. Les idées, la culture - dans son sens le plus large - sont aussi des déterminants de l'évolution de la société. Et c'est Engels lui-même qui a regretté, vers la fin de sa vie, que la nécessité pour lui et pour Marx d'établir le matérialisme historique sur des bases sûres, et de se battre pour le défendre, les ait amenés parfois à laisser insuffisamment de place dans leurs analyses aux autres déterminants historiques.16
Critique de l'anthropologie
C'est dans la deuxième partie de son livre que Darmangeat expose ses propres réflexions. On y trouve, en quelque sorte, deux trames : d'une part, une critique historique des théories anthropologiques sur la position des femmes dans les sociétés primitives ; d’autre part, l'exposé de ses propres conclusions sur le sujet. Cette critique historique est axée autour de l'évolution de ce que Darmangeat considère être la vision marxiste, ou au moins marxisante, du communisme primitif, du point de vue de la place des femmes dans la société primitive, et constitue une dénonciation en règle des tentatives de mettre en avant une vision "féministe" qui cherche à défendre l'idée d'un matriarcat originel dans les premières sociétés humaines.
Le choix se défend mais, à notre avis, il n'est pas toujours heureux et amène l'auteur à ignorer certains théoriciens du marxisme qui auraient dû y avoir leur place, et à en inclure d'autres qui n'y ont rien à faire. Pour ne prendre que quelques exemples, Darmangeat consacre plusieurs pages à critiquer les idées d'Alexandra Kollontaï17, alors qu'il passe Rosa Luxemburg quasiment sous silence. Or, quel qu'ait pu être son rôle dans la Révolution russe et dans la résistance à sa dégénérescence (elle était une figure importante de l'Opposition ouvrière après la révolution), Kollontaï n'a jamais joué un rôle important dans le développement de la théorie marxiste, et encore moins dans l'anthropologie. Luxemburg, par contre, était non seulement une théoricienne de premier plan, elle est également l'auteur de l’Introduction à l'économie politique qui accorde une place importante à la question du communisme primitif en se basant sur les connaissances de l'époque. Le seul motif qui justifie ce déséquilibre est que Kollontaï a été très engagée, au sein du mouvement socialiste puis dans la Russie soviétique, dans la lutte pour les droits des femmes, alors que Luxemburg ne s'est jamais intéressée de près au féminisme. Deux autres auteurs marxistes qui ont écrit sur le thème des sociétés primitives ne sont même pas évoqués : Karl Kautsky (L'éthique et la conception matérialiste de l'histoire), et Anton Pannekoek (Anthropogenèse).
Du côté des "inclusions" malheureuses, prenons par exemple, celle d'Evelyn Reed : ce membre du Socialist Workers' Party américain (organisation trotskiste qui a soutenu de façon "critique" la participation à la Seconde Guerre mondiale) trouve sa place dans l'œuvre pour avoir écrit en 1975 un livre à succès dans les milieux de gauche, Féminisme et anthropologie. Mais comme le dit Darmangeat, le livre a été ignoré quasi-systématiquement par les anthropologues, en grande partie à cause de la faiblesse de son argumentation, soulignée même par des critiques bienveillantes par ailleurs.
Mêmes absences parmi les anthropologues : Claude Lévi-Strauss, une des figures les plus importantes du 20e siècle dans ce domaine, et qui a basé sa théorie du passage de la nature à la culture sur la notion de l'échange de femmes entre les hommes18, n'est mentionné qu’en passant, et Bronislaw Malinowski n'y figure pas du tout.
L'absence la plus surprenante, peut-être, est celle de Knight. Le livre de Darmangeat est axé tout particulièrement sur la situation des femmes dans les sociétés communistes primitives et sur la critique des théories se trouvant dans une certaine tradition marxiste, ou du moins marxisante, sur le sujet. Or, Blood Relations de Chris Knight, qui se revendique explicitement de la tradition marxiste, traite précisément du problème qui préoccupe Darmangeat. On aurait pu imaginer que ce dernier y prêterait la plus grande attention, d'autant plus qu'il reconnaît lui-même la "grande érudition" de Knight. Mais il n'en est rien, bien au contraire : Darmangeat n'y consacre qu'une page (p. 321), où il nous dit, entre autres, que la thèse de Knight "réitère les plus graves fautes de méthode présentes chez Reed et Briffault (Knight garde le silence sur la première, mais cite le second abondamment)", ce qui peut laisser croire au lecteur n'ayant pas lu le livre que Knight ne fait que suivre des gens dont Darmangeat aurait déjà démontré le peu de sérieux.19 Mais un simple coup d'œil à la bibliographie de Blood Relations suffit à montrer que si Knight cite effectivement Briffault, il donne beaucoup plus de place à Marx, Engels, Lévi-Strauss, Marshall Sahlins,... et nous en passons. Et que si on se donne la peine de consulter les références à Briffault, on constate immédiatement que Knight considère que le livre de ce dernier20 (publié en 1927) "date dans ses sources et sa méthodologie" (p. 328).
En somme, notre sentiment est que le choix de Darmangeat nous laisse plutôt "le cul entre deux chaises" : on finit avec une narration critique qui n'est ni une vraie critique des positions défendues par les marxistes, ni une vraie critique des théories anthropologiques, et cela nous donne parfois l'impression d'être les témoins d'une joute contre des moulins à vent. Notre impression est que ce choix de départ tend à obscurcir une argumentation fort intéressante par ailleurs.
À suivre
Jens (août 2012)
1 Éditions Smolny, Toulouse 2009. Nous avons pris connaissance de la parution de la 2e édition du livre de Darmangeat (Smolny, Toulouse 2012) alors que nous nous préparions à mettre cet article sous presse. Nous nous sommes évidemment demandé s’il n’allait pas falloir entièrement reprendre notre critique. Après avoir eu la nouvelle édition en mains, il nous a semblé que nous pouvions légitimement laisser l’essentiel de cet article tel quel. L’auteur lui-même nous signale dans la nouvelle préface ne pas avoir "modifié les thèses essentielles du texte et les arguments sur lesquels elles s’appuient", ce qui, à la lecture, se confirme. Nous nous sommes donc limités à élaborer certains arguments sur la base de la 2e édition. Sauf indication contraire, les citations et les références aux numéros de page sont celles de la première édition.
2 Chris Knight est un anthropologue anglais, membre du "Radical Anthropology Group". Il a participé aux débats sur la science au 19e Congrès du CCI, et nous avons publié sur notre site ses textes "Marxisme et science" (https://fr.internationalism.org/node/4850 [111]) et "La solidarité humaine et le gène égoïste" (https://fr.internationalism.org/ri434/la_solidarite_et_le_gene_egoiste_article_de_l_anthropologue_chris_knight.html [112]).
3 Yale University Press, New Haven and London, 1991. Le livre n'est malheureusement disponible qu'en langue anglaise.
4 Ceci dit, il aurait été impossible de développer ces idées sans la stimulation des discussions avec les camarades au sein de l’organisation.
7 On peut faire ici une analogie avec la production marchande et la société capitaliste. Si la production marchande et le commerce existent depuis le début de la civilisation, et peut-être même avant, ce n'est qu’avec le capitalisme qu'ils deviennent déterminants.
8 Voir à ce sujet notre article "Reading notes on science and marxism", https://en.internationalism.org/icconline/201203/4739/reading-notes-science-and-marxism [115]
9 Il en va ainsi de la science comme des autres forces productives sous le capitalisme : "Au cours de sa domination de classe à peine séculaire, la bourgeoisie a créé des forces productives plus massives et plus colossales que ne l'avaient fait toutes les générations passées dans leur ensemble. Asservissement des forces de la nature, machinisme, application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, navigation à vapeur, chemins de fer, télégraphe électrique, défrichement de continents entiers, canalisation des rivières, populations entières surgies du sol - quel siècle antérieur aurait soupçonné que de pareilles forces de production sommeillaient au sein du travail social ? […] Les forces productives dont elle dispose ne jouent plus en faveur de la civilisation bourgeoise et du régime de la propriété bourgeoise ; elles sont, au contraire, devenues trop puissantes pour les institutions bourgeoises qui ne font plus que les entraver ; et dès qu'elles surmontent ces entraves, elles précipitent dans le désordre toute la société bourgeoise et mettent en péril l'existence de la propriété bourgeoise." Karl Marx et Friedrich Engels, Le Manifeste communiste, "I – Bourgeois et prolétaires", Éd. La Pléiade, Économie I, pp. 166-167.
10 Anaximandre de Milet, ou la naissance de la pensée scientifique, éditions Dunod, juin 2009.
11 Cité dans notre article "La place de la science dans l'histoire humaine", Révolution internationale n° 422,
12 Karl Popper (1902-1994) est un des philosophes des sciences les plus influents du 20e siècle et une référence incontournable pour tout scientifique qui s’intéresse à des questions de méthodologie. Il insiste notamment sur la notion de "réfutabilité", l’idée que toute hypothèse, pour être scientifique, devrait permettre l’élaboration d’expériences ou d'observations qui pourraient permettre de la réfuter : en l’absence de possibilité de telles expériences ou observations, une hypothèse ne pourrait être qualifiée de scientifique. C’est sur cette base que Popper considérait que le marxisme, la psychanalyse et – dans un premier temps – le darwinisme, ne pouvaient prétendre au statut de science.
13 Il s’agit de restes d’ocre rouge gravé et de coquillages percés. L’article de La Recherche signale même la découverte d’un "nécessaire à peinture" vieux de 100 000 ans (voir www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=30891 [117]).
14 C’est sans doute par une forme d'ironie que Darmangeat, dans la 2e édition de son livre, a préféré déplacer toute la partie sur Morgan en appendice, apparemment par crainte de rebuter le lecteur non spécialiste à cause de son "aridité" selon le terme de l’auteur.
15 Ce texte est disponible à l'adresse : www.chrisknight.co.uk/wp-content/uploads/2007/09/Early-Human-Kinship-Was-Matrilineal1.pdf [118]
16 " C'est Marx et moi-même, partiellement, qui devons porter la responsabilité du fait que, parfois, les jeunes donnent plus de poids qu'il ne lui est dû au côté économique. Face à nos adversaires, il nous fallait souligner le principe essentiel nié par eux, et alors nous ne trouvions pas toujours le temps, le lieu, ni l'occasion de donner leur place aux autres facteurs qui participent à l'action réciproque. Mais dès qu'il s'agissait de présenter une tranche d'histoire, c’est-à-dire de passer à l'application pratique, la chose changeait et il n'y avait pas d'erreur possible. Mais, malheureusement, il n'arrive que trop fréquemment que l'on croie avoir parfaitement compris une nouvelle théorie et pouvoir la manier sans difficulté, dès qu'on s'en est approprié les principes essentiels, et cela n'est pas toujours exact. Je ne puis tenir quitte de ce reproche plus d'un de nos récents “marxistes”, et il faut dire aussi qu'on a fait des choses singulières." (Lettre d'Engels à J. Bloch, 21-22 septembre 1890 : https://www.marxists.org/francais/engels/works/1890/09/18900921.htm [119])
17 Dans la 2e édition, Kollontaï a même droit à un sous-chapitre qui lui est entièrement dédié.
18 La critique de la théorie de Lévi-Strauss est traitée de manière approfondie dans Blood Relations.
19 La critique de Knight n’est pas plus étoffée dans la 2e édition que dans la 1ère, à une exception près : l’auteur cite une revue critique du livre de la part de Joan M. Gero, anthropologue féministe et auteur de Engendering archaeology. Cette critique nous paraît très superficielle et inclut un fort parti pris idéologique. En voici un échantillon : "Ce que Knight met en avant en tant que perspective, vue sous l'angle du sexe, des origines de la culture est une vision paranoïaque et distordue de la 'solidarité féminine', présentant (toutes) les femmes comme exploitant sexuellement et manipulant (tous) les hommes. Les relations hommes-femmes sont caractérisées de tout temps et en tout lieu comme des relations entre victimes et manipulatrices : les femmes exploiteuses sont supposées avoir toujours voulu piéger les hommes d'une manière ou d'une autre, et leur conspiration pour ce faire est la base fondamentale même du développement de notre espèce. Les lecteurs peuvent être également offensés par l'idée que les hommes ont toujours été volages et que seule une activité sexuelle agréable, distribuée parcimonieusement et avec coquetterie par des femmes calculatrices, peut les retenir à la maison et maintenir leur intérêt pour leur progéniture. Ce scénario est non seulement improbable et non démontré, répugnant pour les féministes tout comme les non féministes, mais le raisonnement sociobiologique balaye d'un revers de main toutes les versions nuancées de la construction sociale des relations entre genres, des idéologies et des activités qui sont devenues si centrales et fascinantes pour les études de genre aujourd'hui." (traduit par nos soins). En somme, non seulement Gero n'a visiblement pas compris grand chose à l'argumentation qu'elle prétend critiquer, mais, pire encore, elle nous invite à rejeter une thèse scientifique, non pas parce qu'elle est fausse – ce que Gero ne se donne même pas la peine d'essayer de démontrer – mais parce qu'elle est "répugnante" pour (entre autres) les féministes.
20 The Mothers : A Study of the Origins of Sentiments and Institutions, 1927
Personnages:
- Christophe Darmangeat [120]
- Lewis Morgan [121]
- Chris Knight [122]
- Bronislaw Malinowski [123]
Rubrique:
Le mouvement syndicaliste-révolutionnaire dans la révolution allemande de 1918-19
- 4700 reads
Histoire du mouvement ouvrier : le syndicalisme révolutionnaire en Allemagne, partie IV
L'article précédent a donné un aperçu des efforts du courant syndicaliste révolutionnaire en Allemagne pour défendre une position internationaliste contre la guerre de 1914-18. L’Union Libre des Syndicats Allemands (Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften - FVDG) avait survécu à la guerre avec seulement quelques centaines de membres dans la clandestinité qui, dans des conditions de brutale répression, avaient été, comme d'autres révolutionnaires, la plupart du temps condamnés au silence. Fin 1918 les événements se précipitent en Allemagne. Avec le déclenchement des luttes en novembre 1918, l'étincelle de la révolution russe d'Octobre 1917 embrasait finalement le prolétariat en Allemagne.
La réorganisation de la FVDG en 1918
Au cours de la première semaine de novembre 1918, la révolte des matelots de la flotte de Kiel met à genoux le militarisme allemand. Le 11 novembre, l'Allemagne signe l'armistice. La FVDG écrit : "Le gouvernement impérial a été renversé, non par la voie parlementaire et légale, mais par l'action directe ; non par le bulletin de vote, mais par la force des armes des ouvriers en grève et des soldats mutinés. Sans attendre la consigne de chefs, des conseils ouvriers et de soldats ont partout été formés spontanément et ont immédiatement commencé à écarter les anciennes autorités. Tout le pouvoir aux conseils ouvriers et de soldats ! Voilà quel est maintenant le mot d’ordre." 1
Avec le déclenchement de la vague révolutionnaire s’ouvre pour le mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne une ère turbulente d'afflux rapide de militants. Celui-ci passe d’environ 60 000 membres au moment de la Révolution de novembre 1918 jusqu’à mi 1919 à plus de 111 000 fin 1919. La large radicalisation politique de la classe ouvrière à la fin de la guerre pousse vers le mouvement syndicaliste-révolutionnaire de nombreux ouvriers qui se sont détachés des grands syndicats sociaux-démocrates en raison du soutien ouvert de ces derniers à la politique de guerre. Le mouvement syndicaliste-révolutionnaire constitue incontestablement un lieu de rassemblement de travailleurs intègres et combatifs.
A travers la publication de son nouveau journal, Der Syndikalist, à partir du 14 décembre 1918, la FVDG fait de nouveau entendre sa voix : "Dès les premiers jours d’août [1914], notre presse a été interdite, nos camarades les plus en vue placés en ‘détention préventive’, toute activité publique a été rendue impossible aux agitateurs et aux unions locales. Et pourtant, les armes du syndicalisme révolutionnaire sont aujourd'hui utilisées dans tous les recoins de l'Empire allemand, les masses ressentent instinctivement que le temps de la revendication et de la requête est passé et que commence celui où c’est à nous de prendre." 2 Les 26 et 27 décembre, Fritz Kater organise à Berlin une Conférence à laquelle assistent 43 syndicats locaux de la FVDG et où celle-ci se réorganise après la période de clandestinité de la guerre.
C’est dans les agglomérations industrielles et minières de la région de la Ruhr que la FVDG connaît l’accroissement numérique le plus important. L'influence des syndicalistes-révolutionnaires est particulièrement forte à Mülheim et contraint les syndicats sociaux-démocrates à se retirer du conseil d’ouvriers et de soldats le 13 décembre 1918, celui-ci rejetant clairement leur rôle de représentants des ouvriers pour prendre ce rôle directement en main. A partir des mines de la région de Hamborn, des grèves massives de mineurs dirigées par le mouvement syndicaliste-révolutionnaire se produisent de novembre 1918 à février 1919. 3
Conseils ouvriers ou syndicats ?
Face à la guerre de 1914, le mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne avait passé le test historique auquel il était soumis : défendre l’internationalisme contre la guerre, et non, comme la grande majorité des syndicats, se ranger derrière les buts guerriers de la classe dirigeante. L’éclatement de la Révolution de 1918 pose un nouvel enjeu énorme : comment la classe ouvrière s’organise pour renverser la bourgeoisie et passer à l’action révolutionnaire ?
Comme elle l’avait fait en Russie en 1905, puis en 1917, en novembre 1918 en Allemagne, la classe ouvrière fait surgir des conseils ouvriers, marquant l’éclosion d’une situation révolutionnaire. L’ensemble de la période depuis la constitution des "Localistes" en 1892 et la fondation formelle en 1901 de la FVDG n'avait pas connu de soulèvement révolutionnaire. Contrairement à la Russie, où, en 1905, apparurent les premiers conseils ouvriers, la réflexion sur les conseils est restée très abstraite en Allemagne jusqu'en 1918. Au cours de l’enthousiasmant mais bref "hiver des Conseils" de 1918/19 en Allemagne, la FVDG concevait toujours clairement sa forme d'organisation comme un syndicat et c’est en tant que syndicat qu’elle réapparaît sur la scène. La FVDG répond à la situation inédite du surgissement des conseils ouvriers avec un grand enthousiasme. Le cœur révolutionnaire de la majorité des membres de la FVDG palpite pour les conseils ouvriers, de telle sorte que Der Syndikalist n°2 du 21 décembre 1918 revendique clairement : "Tout le pouvoir aux conseils ouvriers et de soldats révolutionnaires".
Mais la conscience théorique retarde souvent sur l’intuition prolétarienne. En dépit de l'émergence des conseils ouvriers, et comme si rien de bien nouveau ne s’était produit, Der Syndikalist n°4 écrit, que la FVDG est la seule organisation ouvrière "dont les représentants et les organes n’ont pas besoin de se remettre à jour", une expression qui résume l’orgueil de la Conférence de réorganisation de la FVDG de décembre 1918 et qui devint la devise du courant syndicaliste révolutionnaire en Allemagne. Mais pour le mouvement ouvrier s’était ouverte une ère de grand bouleversement, où il avait justement beaucoup à remettre à jour, notamment en ce qui concerne ses formes d’organisation !
Pour expliquer les politiques honteuses des principaux syndicats de soutien à la guerre et d’opposition aux conseils ouvriers, la FVDG avait tendance à se contenter d'une demi-vérité, et à en ignorer l’autre moitié. Seule "l’éducation sociale-démocrate" était mise en cause. La question des différences fondamentales entre la forme syndicale et celle des conseils ouvriers est complètement négligée.
Sans aucun doute la FVDG et l’organisation qui lui fit suite, la FAUD, furent des organisations révolutionnaires. Mais elles ne voyaient pas que leur organisation procédait des mêmes germes que les conseils ouvriers : la spontanéité, l’aspiration à l’extension et l'esprit révolutionnaire – tous caractères allant bien au-delà de la tradition syndicale.
Dans les publications de l’année 1919 de la FVDG, il est quasiment impossible de trouver une tentative de traiter la contradiction fondamentale entre la tradition syndicale et les conseils ouvriers, instruments de la révolution. Au contraire, celle-ci concevait les "syndicats révolutionnaires" comme la base du mouvement des conseils. "Les syndicats révolutionnaires doivent exproprier les expropriateurs. (...) Les conseils ouvriers et les conseils d’usine doivent prendre en charge la direction socialiste de la production. Le pouvoir aux conseils ouvriers ; les moyens de production et les biens produits au corps social. Tel est l'objectif de la révolution prolétarienne : le mouvement syndicaliste révolutionnaire est le moyen d’y parvenir."Mais le mouvement révolutionnaire des conseils en Allemagne surgissait-il effectivement du mouvement syndical ? "C’étaient des ouvriers qui s’étaient rassemblés au sein de ‘comités d'usine’ qui agissaient comme les comités d'usine des grandes entreprises de Petrograd en 1905, sans en avoir connu l’activité. En juillet 1916, la lutte politique ne pouvait pas être menée à l'aide des partis politiques et des syndicats. Les dirigeants de ces organisations étaient les adversaires d'une telle lutte ; après la lutte, ils ont également contribué à livrer les leaders de cette grève politique au fléau de la répression des autorités militaires. Ces "comités d'usine", le terme n'est pas tout à fait exact, peuvent être considérés comme les précurseurs des conseils ouvriers révolutionnaires d'aujourd'hui en Allemagne. (...) Ces luttes n'ont pas été soutenues et dirigées par les partis et les syndicats existants. Il y avait là les prémices d'un troisième type d’organisation, les conseils ouvriers." 4 C’est ainsi que décrit Richard Müller, membre des Revolutionäre Obleute (‘Hommes de confiance’ révolutionnaires) le "moyen d’y parvenir."
Les syndicalistes de la FVDG n’étaient pas les seuls à ne pas remettre en cause la forme syndicale d'organisation. A cette époque, il était extrêmement difficile pour la classe ouvrière de tirer pleinement et en toute clarté l’ensemble des conséquences qu’impliquait l’irruption de la "période des guerres et des révolutions". Les illusions quant à la forme d'organisation syndicale, la faillite de celle-ci devant la révolution devaient encore être inévitablement, douloureusement et concrètement soumises à l’expérience pratique. Richard Müller cité plus haut écrivait seulement quelques semaines plus tard, lorsque les conseils ouvriers sont dépossédés de leur pouvoir : "Mais si nous reconnaissons la nécessité de la lutte revendicative quotidienne – et personne ne peut la contester – alors nous devons également reconnaître la nécessité de préserver les organisations qui ont pour fonction de mener cette lutte, et ce sont les syndicats. (...) Si nous reconnaissons la nécessité des syndicats existants (…) alors nous devons examiner plus en avant si les syndicats peuvent trouver une place au sein du système des conseils. Dans la période de mise en place du système des conseils, il faut inconditionnellement répondre à cette question par l'affirmative." 5
Les syndicats sociaux-démocrates avaient perdu leur crédit vis-à-vis des larges masses de travailleurs et les doutes croissaient de plus en plus quant à savoir si ces organisations pouvaient encore représenter les intérêts de la classe ouvrière. Dans la logique de la FVDG, le dilemme de la capitulation et de la faillite historique de la vieille forme d’organisation syndicale se résolvait par la perspective d'un "syndicalisme révolutionnaire."
En ce début de l'ère de la décadence du capitalisme, l'impossibilité de la lutte pour des réformes pose à terme l'alternative suivante pour les organisations de masse permanentes de la classe ouvrière : soit le capitalisme d'État les intègre à l'État (comme en général cela a été le cas avec les organisations sociales-démocrates - mais aussi pour des syndicats syndicalistes-révolutionnaires comme la CGT en France), soit il les détruit (ce qui fut finalement le sort de la FAUD syndicaliste-révolutionnaire). Se pose alors la question de savoir si la révolution prolétarienne exige d'autres formes d'organisation. Avec l'expérience dont nous disposons aujourd'hui, nous savons qu’il n’est pas possible d’apporter de nouveaux contenus à d’anciennes formes, telles que les syndicats. La révolution n'est pas seulement une affaire de contenu, mais aussi de forme. C'est ce que le théoricien de la FAUD, Rudolf Rocker, formulait de façon très juste en décembre 1919 dans son approche contre les fausses visions de "l’État révolutionnaire" : "L'expression d'État révolutionnaire ne peut pas nous convenir. L'État est toujours réactionnaire et qui ne le comprend pas n'a pas compris la profondeur du principe révolutionnaire. Chaque instrument possède une forme adaptée au but auquel il doit servir ; et c'est aussi le cas pour les institutions. Les pinces du maréchal-ferrant ne sont pas adaptées pour arracher des dents et avec les pinces du dentiste on ne peut pas former un fer à cheval (...)" 6. C’est exactement ce que, malheureusement, le mouvement syndicaliste-révolutionnaire a manqué d’appliquer de façon conséquente à la question de la forme d’organisation.
Contre le piège des "comités d’entreprise"
Pour émasculer politiquement l'esprit du système des conseils ouvriers, les sociaux-démocrates et leurs syndicats au service de la bourgeoisie commencèrent adroitement à saper de l'intérieur les principes d'organisation autonome de la classe ouvrière dans les conseils. Cela n’a été possible que parce que, les conseils ouvriers ayant émergé des luttes de novembre 1918, ceux-ci avaient perdu leur force et leur dynamisme avec le premier reflux de la révolution. Le premier Congrès des Conseils du 16 au 20 décembre 1918, sous l'influence subtile du SPD et du poids persistant des illusions de la classe ouvrière sur la démocratie, avait abandonné son pouvoir et proposé l’élection d’une Assemblée Nationale, se désarmant ainsi complètement de lui-même.
Au printemps de 1919, après la vague de grèves dans la Ruhr, il a été proposé, à l'initiative du gouvernement SPD, d’instaurer dans les usines des "comités d’entreprises" - des représentations de facto de la main-d'œuvre remplissant en fait la même fonction de négociation et de collaboration avec le capital que les syndicats traditionnels. Sous les auspices des responsables du Parti social-démocrate et des syndicats, Gustav Bauer et Alexander Schlicke, les comités d'entreprise sont définitivement inscrits dans la Constitution bourgeoise de l'État allemand en février 1920.
Il fallait développer l’illusion dans la classe ouvrière que son esprit combatif porté vers les conseils trouvait son incarnation dans cette forme de représentation directe des intérêts des ouvriers. "Les comités d’entreprise sont conçus pour régler toutes les questions relatives à l'emploi et aux salariés. Il leur revient d’assurer la poursuite et l'augmentation de la production dans l’entreprise et de veiller à éliminer tout obstacle pouvant survenir. (...) Les comités de district en collaboration avec les directions régissent et supervisent le rendement du travail dans le district, ainsi que la répartition des matières premières." 7 Après la répression sanglante contre la classe ouvrière, l'intégration démocratique dans l'État devait sceller définitivement l’œuvre de la contre-révolution. De façon encore plus directe qu’avec les syndicats et en liaison encore plus étroite avec les entreprises, la mise en place de ces comités venait compléter sur place la collaboration avec le capital.
La presse de la FVDG au printemps de 1919 a pris position avec courage et clarté contre ce stratagème des comités d’entreprise : "Le capital et l'État admettent uniquement les comités ouvriers que l’on nomme désormais comités d’entreprise. Le comité d’entreprise ne vise pas à représenter seulement les intérêts des travailleurs, mais aussi ceux de l’entreprise. Et puisque ces sociétés sont la propriété du capital privé ou d'État, les intérêts des travailleurs doivent être subordonnés aux intérêts des exploiteurs. Il s'ensuit que le comité d’entreprise défend l'exploitation des travailleurs et incite ceux-ci à la poursuite docile du travail comme esclaves salariés. (...) Les moyens de lutte des syndicalistes-révolutionnaires sont incompatibles avec les fonctions du comité d’entreprise." 8
Cette attitude était largement partagée parmi les syndicalistes révolutionnaires parce que, d’une part les comités d’entreprise apparaissaient de façon évidente pour ce qu’ils étaient, un outil de la social-démocratie et, d'autre part, la combativité du mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne n'avait pas encore été brisée. L'illusion d'avoir "obtenu quelque chose", et "d’avoir franchi une étape concrète" ne trouvait que peu de prise en 1919 dans les fractions les plus déterminées du prolétariat - la classe ouvrière n'avait pas encore été défaite. 9
Plus tard, après le déclin évident du mouvement révolutionnaire à partir de 1921, il n'est donc pas surprenant qu’au sein de la FAUD syndicaliste-révolutionnaire des débats houleux éclatent durant une année à propos de la participation aux élections aux comités d'entreprise. Une minorité développait l’orientation qu'il fallait désormais, à travers les comités d’entreprises légalisés, établir "une liaison avec les masses laborieuses pour déclencher des luttes massives dans les situations favorables."10 La FVDG en tant qu’organisation refusa de s’engager dans "la voie morte des comités d’entreprise voués à neutraliser l'idée révolutionnaire des conseils" selon la formulation du militant August Beil. C'est du moins la position qui prévalut jusqu'à novembre 1922, lorsque, en conséquence de l'impuissance produite par la défaite de la révolution, le 14ème Congrès de la FAUD l’atténua, octroyant le droit à ses membres de participer aux élections aux comités d’entreprise.
La dynamique de la révolution rapproche les syndicalistes révolutionnaires et la Ligue Spartacus
Comme en Russie en Octobre 1917, le soulèvement de la classe ouvrière en Allemagne avait d’emblée suscité un élan solidaire au sein la classe ouvrière. Pour le mouvement syndicaliste-révolutionnaire en Allemagne, la solidarité avec la lutte de la classe ouvrière en Russie avait, jusque fin 1919, constitué incontestablement une référence importante, partagée internationalement avec d'autres révolutionnaires. La Révolution russe, du fait de soulèvements révolutionnaires dans d'autres pays, possédait encore une perspective en 1918-1919 et n'avait pas encore succombé à sa dégénérescence intérieure. Pour défendre leurs frères de classe en Russie et contre la politique même du SPD et des syndicats sociaux-démocrates, la FVDG dénonçait dans le deuxième numéro de son journal Der Syndikalist : "(...) qu’aucun moyen ne leur était trop répugnant, aucune arme trop ignoble pour calomnier la Révolution russe et vitupérer la Russie soviétique et ses conseils d’ouvriers et de soldats." 11 Malgré de nombreuses réserves quant aux conceptions des Bolcheviks - dont toutes n’étaient pas infondées - les syndicalistes révolutionnaires restèrent solidaires avec la Révolution russe. Même Rudolf Rocker, théoricien influent au sein de la FVDG et critique véhément des Bolcheviks, appela deux ans après la révolution d’Octobre, lors de son célèbre discours de présentation de la Déclaration de Principes de la FAUD en décembre 1919, à manifester sa solidarité avec la Révolution russe : "Nous nous tenons unanimement du côté de la Russie soviétique dans sa défense héroïque contre les puissances des Alliés et les contre-révolutionnaires, et ceci, non pas parce que nous sommes Bolcheviks, mais parce que nous sommes des révolutionnaires."
Bien que les syndicalistes révolutionnaires en Allemagne eussent leurs réserves traditionnelles envers le "marxisme" qui "veut conquérir le pouvoir politiquement", ce qu'ils croyaient discerner également dans la Ligue Spartacus, ils défendaient clairement l’action commune avec toutes les autres organisations révolutionnaires : "Le syndicalisme révolutionnaire estime donc inutile la division du mouvement ouvrier, il veut la concentration des forces. Pour l’instant, nous recommandons à nos membres d’agir, dans les questions économiques et politiques, partout en commun avec les groupes les plus à gauche du mouvement ouvrier : les Indépendants, la Ligue Spartacus. Nous mettons en garde, cependant, contre toute participation au cirque des élections à l'Assemblée nationale." 12
La révolution de novembre 1918 ne fut pas l’œuvre d'une organisation politique particulière telle que la Ligue Spartacus et les Revolutionnäre Obleute (les délégués syndicaux révolutionnaires), même si ceux-ci ont adopté lors des journées de novembre la position la plus claire et la plus grande volonté d’action. Ce fut un soulèvement de l’ensemble de la classe ouvrière où s'est exprimé, pendant une courte période, l'unité potentielle de cette classe. Une expression de cette tendance à l’unité a été le phénomène répandu de double affiliation à la Ligue Spartacus et à la FVDG. "A Wuppertal, les militants de la FVDG s’engagèrent dans un premier temps au sein du Parti communiste. Une liste établie en avril 1919 par la police sur les communistes de Wuppertal contient le nom de tous les futurs principaux membres de la FAUD (...)" 13. A Mülheim, à partir du 1er décembre 1918 parut le journal "Die Freiheit, organe de défense des intérêts de l’ensemble du peuple du Travail. Organe de presse des Conseils d’ouvriers et de soldats", édité en commun par des syndicalistes révolutionnaires et des membres de la Ligue Spartacus.
Au début 1919, il existait au sein du mouvement syndicaliste révolutionnaire une aspiration prononcée à l’union avec d'autres organisations de la classe ouvrière. "Ils ne sont toujours pas unis, ils sont toujours divisés, ils ne sont pas tous encore de véritables socialistes en pensée et à l’attitude honnête et ils ne sont toujours pas unitairement et indissociablement associés par la merveilleuse chaine de la solidarité prolétarienne. Ils sont toujours divisés entre socialistes de droite, socialistes de gauche, Spartakistes, et autres. La classe ouvrière doit enfin en finir avec l’absurdité grossière du particularisme politique." 14 Cette attitude de large ouverture reflétait la situation de forte hétérogénéité politique, voire de confusion, au sein de la FVDG qui avait connu une croissance rapide. Sa cohésion interne reposait moins sur la clarification programmatique ou la démarcation vis-à-vis des autres organisations prolétariennes que sur le lien de solidarité ouvrière, comme le montre la caractérisation sans discrimination de tous les "socialistes".
L'attitude solidaire envers la Ligue Spartacus s’était développée dans les rangs des syndicalistes révolutionnaires suite à la répression de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg au cours de la guerre et a continué jusqu'à l'automne 1919. Mais par contre, elle n’a pas permis d'asseoir une histoire commune avec la Ligue Spartacus. Jusqu'à la période de la conférence de Zimmerwald en 1915, c’était bien plus une méfiance réciproque qui avait dominé. La cause principale du rapprochement a été la clarification politique, mûrie au sein de la classe ouvrière tout entière et de ses organisations révolutionnaires au cours de la révolution de novembre : le rejet de la démocratie bourgeoise et du parlementarisme. Le mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne, qui avait rejeté depuis longtemps le système parlementaire, voyait cette position comme faisant partie de son patrimoine propre. La Ligue Spartacus, qui avait pris position avec une grande clarté contre les illusions sur la démocratie, considérait la FVDG, qui empruntait la même voie, comme l’organisation la plus proche d’elle en Allemagne.
Cependant, dès le départ, Rudolf Rocker, qui devait prendre en charge l’orientation politique du mouvement syndicaliste-révolutionnaire en Allemagne après décembre 1919, "ne porte pas dans son cœur les appels lancés aux camarades à soutenir l'aile gauche du mouvement socialiste, les Indépendants et les Spartakistes, ni l’intervention du journal en faveur de la ""dictature du prolétariat " (...)"15. De retour d'internement en Angleterre durant la guerre, Rocker, anarchiste syndicaliste-révolutionnaire fortement influencé par les idées de Kropotkine, adhéra à la FVDG en mars 1919.
Malgré les divergences d’opinions à l'égard de la Ligue Spartacus entre Rocker et la tendance réunie autour de Fritz Kater, Carl Windhoff et Karl Roche, la plus influente dans la FVDG dans les premiers mois de la Révolution de 1918-19, il serait erroné de parler à cette époque de luttes de tendances au sein de la FVDG telles qu'il en éclatera plus tard, à partir de 1920 au sein de la FAUD comme symptôme de la défaite de la révolution allemande. Il n'existe pour lors aucune tendance significative parmi les syndicalistes-révolutionnaires voulant a priori se démarquer du KPD. Au contraire, la recherche d'une unité d'action avec les Spartakistes était le produit de la dynamique vers l'unité des luttes ouvrières et de la "pression de la base" de ces deux courants dans les semaines et les mois où la révolution semblait à portée de main. Ce furent la défaite douloureuse du soulèvement prématuré de janvier 1919 à Berlin et l’écrasement consécutif de la vague de grèves en avril dans la Ruhr, soutenue par les syndicalistes-révolutionnaires, le KPD et l'USPD, qui, par le sentiment de déception qu’ils provoquèrent, suscitèrent des récriminations mutuelles et émotionnelles, exprimant un manque de maturité des deux côtés.
L’"alliance informelle" avec Spartacus, et le Parti communiste, devait par conséquent se briser dès l’été 1919. L'initiative en incombait moins à la FVDG qu’à l’attitude agressive que le KPD commença à adopter vis-à-vis des syndicalistes-révolutionnaires.
Le "programme provisoire" des syndicalistes-révolutionnaires au printemps 1919
Au printemps 1919, la FVDG publia une brochure rédigée par Roche, "Que veulent les syndicalistes-révolutionnaires ?". Celle-ci devait servir de programme et de texte d’orientation à son organisation jusqu’en décembre 1919. Il est difficile de juger le mouvement syndicaliste-révolutionnaire à l’aune d’un seul texte, vu la coexistence dans ses rangs d'idées différentes. Toutefois, ce programme du printemps 1919 constitue un jalon, et à plusieurs points de vue, l’une des prises de position les plus achevées du mouvement syndicaliste-révolutionnaire en Allemagne. En dépit des expériences passées douloureuses de leur propre histoire avec les sociaux-démocrates et de la diabolisation permanente de la politique 16 qui en résulte, celui-ci conclut : "La classe ouvrière doit se rendre maître de l'économie et de la politique." 17
La force des positions que propage la FVDG à l’aide de ce programme au sein de la classe ouvrière en Allemagne au printemps se trouve ailleurs : dans son attitude envers l'État, la démocratie bourgeoise et le parlementarisme. Il est fait spécifiquement référence à la description que Friedrich Engels fait de l'État en tant que produit de la société divisée en classes : "l’État est un produit de la société à une certaine étape de son développement" ; il est "l’aveu que cette société s’est empêtrée dans une insoluble contradiction avec elle-même, qu’elle s’est divisée en antagonismes inconciliables" et n’est pas "une force imposée à la société du dehors" ni un instrument de la classe dirigeante créé de façon purement arbitraire par elle. La FVDG appelle de façon conséquente à la destruction de l'État bourgeois.
Avec cette position, à une époque où la social-démocratie constituait sans doute l'arme la plus insidieuse de la contre-révolution, la FVDG mettait le doigt sur un point névralgique. Contre la farce du SPD visant à soumettre les conseils ouvriers par leur intégration au parlement bourgeois, son programme exhortait : "Le ‘socialisme’ social-démocrate a assurément besoin d’un État. Et d’un État qui aurait à utiliser de tous autres moyens contre la classe ouvrière que l’État capitaliste. (...) Il sera le fruit d'une demi-révolution prolétarienne et la cible de la révolution prolétarienne totale. C’est parce que nous avons reconnu la nature de l'État et que nous savons que la domination politique des classes possédantes s’enracine dans leur puissance économique, que nous n'avons pas à lutter pour la conquête de l'État, mais pour son élimination."
Karl Roche a aussi tenté de formuler dans le programme de la FVDG les leçons fondamentales des journées de novembre et décembre 1918 allant bien au-delà du rejet rebelle ou individualiste de l'État qu’on prête à tort aux syndicalistes révolutionnaires et démasquant clairement dans son essence le système de la démocratie bourgeoise. "La démocratie n'est pas l'égalité, mais l’utilisation démagogique d’une comédie d’égalité. (...) Les possédants ont, pour autant qu’ils affrontent les ouvriers, toujours les mêmes intérêts. (...) Les travailleurs n’ont d’intérêt commun qu’entre eux, et non avec la bourgeoisie. Là, la démocratie est une absurdité générale. (...) La démocratie est l'un des slogans les plus dangereux dans la bouche des démagogues qui comptent sur la paresse et l'ignorance des salariés. (...) Les démocraties modernes en Suisse, en France, en Amérique ne sont qu’une hypocrisie capitaliste démocratique sous la forme la plus répugnante." Face aux pièges de la démocratie cette formulation précise reste plus pertinente que jamais.
Nous pouvons porter de nombreuses critiques au programme de la FVDG du printemps 1919, notamment un certain nombre d’idées syndicalistes-révolutionnaires classiques que nous ne partageons pas comme "l’autodétermination complète" et "le fédéralisme". Mais sur des points cruciaux à ce moment-là, comme le rejet du parlementarisme, le programme, écrit par Roche, est demeuré inflexible. "Il en va du parlementarisme comme de la social-démocratie : si la classe ouvrière veut se battre pour le socialisme, elle doit écarter la bourgeoisie comme classe. Elle ne doit pas alors lui accorder de droit au pouvoir, ne doit pas voter avec elle ni traiter avec elle. Les conseils ouvriers sont les parlements de la classe ouvrière. (...) Ce ne sont pas les parlements bourgeois, mais la dictature du prolétariat qui mettra en œuvre le socialisme." A ce moment-là, le Parti communiste revenait sur ses positions initiales claires contre le parlementarisme et le travail dans les syndicats-sociaux-démocrates et commençait à régresser dramatiquement en deçà des positions de son Congrès de fondation.
Quelques mois plus tard, en décembre 1919, la Déclaration de principes de la FAUD mettait l’accent sur des points différents. Karl Roche qui, dans les premiers temps après la guerre avait influencé la FVDG de façon décisive au plan programmatique, rejoignit l’AAU en décembre 1919.
La rupture avec le Parti communiste
Lors de la Révolution de novembre 1918, de nombreux points communs rassemblent les révolutionnaires de la FVDG syndicaliste-révolutionnaire et ceux de la Ligue Spartacus : la référence au soulèvement de la classe ouvrière en Russie en 1917, la revendication de tout le pouvoir aux conseils ouvriers, le rejet de la démocratie et du parlementarisme, ainsi qu’un rejet très clair de la social-démocratie et de ses syndicats. Comment expliquer alors qu'au cours de l'été 1919 ait commencé un dur règlement de comptes entre les deux courants qui avaient auparavant partagé tant de choses ?
Il existe différents facteurs faisant qu'une révolution peut échouer : la faiblesse de la classe ouvrière et le poids de ses illusions ou l'isolement de la révolution. En Allemagne en 1918-19, c’est surtout son expérience qui a permis à la bourgeoisie allemande, au moyen de la social-démocratie, de saboter de l'intérieur le mouvement, de fomenter des illusions démocratiques, de précipiter la classe ouvrière dans le piège de soulèvements isolés et prématurés comme en janvier 1919 et de la priver, par le meurtre, de ses révolutionnaires les plus clairs et de milliers de prolétaires engagés.
Les polémiques entre le KPD et les syndicalistes-révolutionnaires suite à l’écrasement de la grève d'avril 1919 dans Ruhr montrent des deux côtés la même tentative de rechercher les raisons de l'échec de la révolution chez les autres révolutionnaires. Roche s’était déjà laissé emporter par cette tendance dès avril dans la conclusion du programme de la FVDG affirmant "(...) ne pas laisser les Spartakistes diviser la classe ouvrière", mettant ainsi de façon confuse ces derniers dans le même sac que les "socialistes de droite". À partir de l'été 1919 cela devint la mode dans la FVDG de parler des "trois partis sociaux-démocrates", c’est-à-dire SPD, USPD et KPD - une attaque polémique qui dans l’atmosphère de frustration par rapport aux échecs de la lutte de classe, ne faisait plus aucune distinction entre les organisations contre-révolutionnaire et les organisations prolétariennes.
Le Parti communiste (KPD) publia en août une brochure sur les syndicalistes-révolutionnaires à l’argumentation tout aussi malheureuse. Il considérait désormais la présence de syndicalistes-révolutionnaires dans ses rangs comme une menace pour la révolution : "Les syndicalistes-révolutionnaires invétérés doivent enfin se rendre compte qu’ils ne partagent pas les choses fondamentales avec nous. Nous ne devons plus consentir que notre parti offre un terrain de jeu à des gens qui y propagent toutes sortes d'idées étrangères au parti." 18
La critique du Parti communiste envers les syndicalistes-révolutionnaires était axée sur trois points : la question de l'État et de l'organisation économique après la révolution, la tactique et la forme d’organisation – en fait les débats classiques avec le courant syndicaliste-révolutionnaire. Bien que le Parti communiste ait eu raison de conclure que : "Dans la révolution, l'importance des syndicats pour la lutte des classes régresse de plus en plus. Les conseils ouvriers et les partis politiques deviennent les protagonistes et les dirigeants exclusifs de la lutte", la polémique envers les syndicalistes révolutionnaires révéla surtout les faiblesses du Parti communiste sous la direction de Levi : une fixation sur la conquête de l'État. "Nous pensons que nous allons nécessairement utiliser l'État après la révolution. La Révolution signifie justement en premier lieu la prise du pouvoir au sein de l'État" ; la croyance erronée que la coercition au sein du prolétariat peut être un moyen pour mener à bien la révolution : "Disons avec la Bible et les Russes : ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Ceux qui ne travaillent pas ne recevront que ce dont les actifs pourront se passer" ; le flirt avec la reprise de l’activité parlementaire : "Notre attitude à l'égard du parlementarisme montre que pour nous la question de la tactique se pose différemment des syndicalistes révolutionnaires. (...) Et comme l’ensemble de la vie du peuple est quelque chose de vivant, de changeant, un processus qui prend constamment de nouvelles formes, toute notre stratégie doit ainsi aussi s'adapter en permanence aux nouvelles conditions" ; et pour finir la tendance à considérer le débat politique permanent, en particulier sur les questions fondamentales, comme quelque chose qui n’est pas positif : "Nous devons prendre des mesures contre les gens qui nous rendent difficile de planifier la vie du parti. Le parti est une communauté de combat unie et non un club de discussions. Nous ne pouvons pas continuellement avoir des discussions sur les formes d’organisation et autres."
Le Parti communiste tentait ainsi de se débarrasser des syndicalistes-révolutionnaires également membres du Parti communiste. En juin 1919, dans son appel Aux syndicalistes-révolutionnaires du Parti communiste !, celui-ci les présente certes comme "remplis d'honnêtes aspirations révolutionnaires." Mais le KPD définit cependant leur combativité comme un risque tendanciel au putschisme et leur pose l’ultimatum suivant : ou bien ils s'organisent dans un parti strictement centralisé ; ou bien "Le Parti communiste d'Allemagne ne peut pas tolérer dans ses rangs des membres qui, dans leur propagande par la parole, l'écriture et l'action, contreviennent à ces principes. Il se voit contraint de les exclure." Compte tenu de l’amorce de confusions et de dilution des positions du Congrès de fondation du Parti communiste, cet ultimatum sectaire contre les syndicalistes révolutionnaires était plutôt une expression d'impuissance face au reflux de la vague révolutionnaire en Allemagne. Il a privé le Parti communiste du contact vivant avec les parties les plus combatives du prolétariat. L'échange de coups entre le KPD et les syndicalistes révolutionnaires au cours de l'été 1919 montre également que l’atmosphère de défaite accompagnée de tendances renforcées à l'activisme forme une combinaison défavorable à la clarification politique.
Un bref cheminement commun avec les Unions
Au cours de l'été de 1919, l'atmosphère en Allemagne se caractérisait d'une part par une grande déception consécutive aux défaites et, d'autre part, par une radicalisation de certaines parties de la classe ouvrière. Il se produisit des défections en masse dans les syndicats sociaux-démocrates, et un afflux massif vers la FVDG, qui doubla le nombre de ses membres.
En plus des syndicalistes révolutionnaires il commença à se développer un second courant contre les syndicats traditionnels, lui aussi alimenté par un important afflux. Dans la région de la Ruhr apparurent l’Allgemeine Arbeiter Union-Essen (AAU-E : Union Générale des Travailleurs – Essen) et l'Allgemeine Bergarbeiter Union (Union générale des mineurs) sous l'influence de fractions de radicaux de gauche au sein du Parti communiste de Hambourg, et soutenues par la propagande active de regroupements proches des International Workers of the World (IWW) américains autour de Karl Dannenberg à Brunswick. À l’inverse de la FVDG syndicaliste-révolutionnaire, les Unions voulaient abandonner le principe d’organisation syndicale par branches d’industrie pour regrouper la classe ouvrière par entreprises entières dans des "organisations de combat". De leur point de vue, c’étaient désormais les entreprises qui exerçaient leur force et possédaient une puissance dans la société et c’est de là, par conséquent, que la classe ouvrière tire sa force - quand elle s'organise conformément à cette réalité. Ainsi, les Unions recherchaient-elles une plus grande unité et considéraient les syndicats comme une forme historiquement obsolète de l'organisation de la classe ouvrière. On peut dire que les Unions constituaient d’une certaine façon une réponse de la classe ouvrière à la question qui lui était posée concernant de nouvelles formes d'organisation ; la question même que le courant syndicaliste-révolutionnaire en Allemagne a cherché à éviter jusqu'à aujourd'hui 19.
Nous ne pouvons pas dans cet article développer notre analyse sur la nature des Unions, qui ne sont ni des conseils ouvriers, ni des syndicats, ni des partis. Pour cela il faudra y revenir dans un texte spécifique.
Il est souvent difficile dans cette phase de distinguer précisément les courants unioniste et syndicaliste-révolutionnaire. Au sein des deux courants il existait des réticences vis-à-vis des "partis politiques", même si les Unions étaient finalement beaucoup plus proches du Parti communiste. Ces deux tendances constituaient une expression directe des fractions les plus combatives de la classe ouvrière en Allemagne, se positionnaient contre la social-démocratie et préconisaient, au moins jusqu'à la fin 1919, le système des conseils.
Dans une première phase qui va jusqu'à l'hiver 1919-20, le courant unioniste dans la région de la Ruhr s’incorpora au mouvement syndicaliste révolutionnaire, qui était plus fort, avec la Conférence dite ‘de fusion’ des 15-16 septembre 1919 à Düsseldorf. Les unionistes prirent part ainsi à la fondation de la Freie Arbeiter Union (FAU) de Rhénanie-Westphalie. Cette Conférence était la première étape vers la création de la FAUD, qui devait avoir lieu trois mois plus tard. La FAU-Rhénanie-Westphalie exprimait dans son contenu un compromis entre le syndicalisme-révolutionnaire et l’unionisme. Les lignes directrices adoptées disaient que "(...) la lutte économique et politique doit être menée avec conséquence et fermeté par les travailleurs (...)" et que "en tant qu’organisation économique, la Freie Arbeiter Union ne tolère aucune politique de parti dans ses réunions, mais laisse à la libre appréciation de chaque membre d’adhérer aux partis de gauche et d’y exercer une activité s’il l’estime nécessaire."20 L’Allgemeine Arbeiter Union-Essen et l'Allgemeine Bergarbeiter Union allaient se retirer en grande partie de l'Alliance avec les syndicalistes-révolutionnaires dès avant la fondation de la FAUD en décembre.
La fondation de la FAUD et sa Déclaration de principes
La croissance numérique rapide de la FVDG au cours de l'été et de l’automne 1919, la propagation du mouvement syndicaliste révolutionnaire en Thuringe, en Saxe, en Silésie, dans le Sud de l'Allemagne, dans les régions côtières de la Mer du Nord et de la Baltique réclamaient une structuration du mouvement au plan national. Le 12ème Congrès de la FVDG du 27 au 30 décembre à Berlin, se transforma en Congrès de fondation de la FAUD, auquel participent 109 délégués.
Ce Congrès est souvent décrit comme le "tournant" du syndicalisme révolutionnaire allemand vers l'anarcho-syndicalisme ou comme le début de l’ère Rudolf Rocker – une étiquette utilisée surtout par les adversaires catégoriques du syndicalisme-révolutionnaire y voyant un "pas en avant dans le sens négatif". La plupart du temps, on montre du doigt dans la fondation de la FAUD l’apologie du fédéralisme, les adieux à la politique, le rejet de la dictature du prolétariat et le retour au pacifisme. Cette analyse ne rend cependant pas justice à la FAUD de décembre 1919. "L'Allemagne est l'eldorado des slogans politiques. On prononce des paroles, on se grise de leurs flonflons sans se rendre compte du véritable sens de celles-ci" commente Rocker (que nous citons ci-dessous) dans son discours sur la Déclaration de principes à propos des allégations portées contre les syndicalistes-révolutionnaires.
Il ne fait aucun doute que les idées de Rocker, anarchiste resté internationaliste durant la guerre et rédacteur de la nouvelle Déclaration de principes, acquirent une influence notable au sein de la FAUD, favorisée par sa présence physique au sein de cette organisation. Mais la fondation de la FAUD reflètait d'abord et avant tout la popularité des idées syndicalistes-révolutionnaires au sein de la classe ouvrière en Allemagne et indiquait une claire démarcation vis-à-vis du Parti communiste et de l’unionisme naissant. Les positions fortes que la FVDG avait propagées depuis la fin de la guerre au sein de la classe ouvrière, l’expression de sa solidarité envers la Révolution russe, le rejet explicite de la démocratie bourgeoise et de toute forme d’activité parlementaire, la récusation de toutes "les frontières politiques et nationales arbitrairement tracées" étaient réaffirmés dans la Déclaration de principes de décembre 1919. La FAUD se situait ainsi sur le terrain des positions révolutionnaires.
Par rapport au programme de la FVDG du printemps 1919, le Congrès prit une plus grande distance critique vis-à-vis de l'enthousiasme envers la perspective des conseils ouvriers. Les signes d’affaiblissement des conseils ouvriers en Russie étaient pour le Congrès la marque du risque global latent que présentent les "partis politiques", et la preuve que la forme syndicale d'organisation est plus résistante et défend mieux l’idée des conseils 21. La dépossession des conseils ouvriers de leur pouvoir en Russie à cette époque était en effet une réalité et les Bolcheviks y avaient tragiquement contribué. Mais ce que la FAUD ne voyait pas dans son analyse, c’était tout simplement le carcan de l'isolement international de la révolution russe qui devait inévitablement conduire à l’asphyxie de la vie de la classe ouvrière.
"On nous combat, nous syndicalistes-révolutionnaires, principalement parce que nous sommes des partisans déclarés du fédéralisme. Les fédéralistes, nous dit-on, sont les diviseurs des luttes ouvrières", dit Rocker. L'aversion de la FAUD vis-à-vis du centralisme et son engagement en faveur du fédéralisme ne se fondaient pas sur une vision de la fragmentation de la lutte des classes. La réalité et la vie du mouvement syndicaliste révolutionnaire après la guerre ont suffisamment fait la preuve de son engagement pour l'unité et la coordination de la lutte. Le rejet exagéré de la centralisation trouvait ses racines dans le traumatisme de la capitulation de la social-démocratie : "Les comités centraux ordonnaient d’en haut, les masses obéissaient. Puis vint la guerre ; le parti et les syndicats étaient confrontés à un fait accompli : nous devons soutenir la guerre pour sauver la patrie. Désormais, la défense de la patrie devint un devoir socialiste, et les mêmes masses qui, la semaine précédente, protestaient contre la guerre, étaient désormais pour la guerre, mais sur ordre de leurs comités centraux. Cela vous montre les conséquences morales du système de la centralisation. La centralisation, c’est l'extirpation de la conscience du cerveau de l'homme, et rien d’autre. C’est la mort du sentiment d'indépendance." Pour beaucoup de militants de la FAUD, le centralisme était dans son principe même une méthode héritée de la bourgeoisie dans "(...) l'organisation de la société de haut en bas, afin de maintenir les intérêts de la classe dominante." Nous sommes absolument d'accord avec la FAUD de 1919 que c'est la vie politique et l'initiative de la classe ouvrière "par en bas" qui sont porteuses de la révolution prolétarienne. La lutte de la classe ouvrière doit être menée solidairement, et en ce sens, il s’engendre toujours spontanément une dynamique à l'unification du mouvement, et donc à sa centralisation au moyen de délégués élus et révocables. "L'eldorado des slogans politiques" a incité la majorité des syndicalistes révolutionnaires de la FAUD en décembre 1919 à s’affubler du slogan du fédéralisme, une étiquette qui ne représentait pas la véritable tendance après la fondation de la FAUD.
Le Congrès de fondation de la FAUD a-t-il effectivement rejeté l'idée de "dictature du prolétariat" ? "Si sous le terme de la dictature du prolétariat on entend la prise en main de la machine de l’État par un parti, si l’on entend là uniquement l’établissement d’un nouvel État, alors les syndicalistes-révolutionnaires sont les ennemis jurés d'une telle dictature. Si par contre on veut dire que le prolétariat va dicter aux classes possédantes de renoncer à leurs privilèges, s’il ne s’agit pas de la dictature du haut vers le bas, mais de la répercussion de la révolution du bas vers le haut, alors les syndicalistes révolutionnaires sont des partisans et des représentants de la dictature du prolétariat." 22 Absolument juste ! La réflexion critique sur la dictature du prolétariat, qui à ce moment-là était associée à la situation dramatique en Russie, était une question légitime à l'égard du risque de dégénérescence interne de la révolution en Russie. Il n’était pas encore possible de faire le bilan de la révolution russe en décembre 1919. Les assertions de Rocker étaient plus un baromètre des contradictions déjà perceptibles, et le tout début d'un débat qui durera des années dans le mouvement ouvrier sur les raisons de l'échec de la vague révolutionnaire mondiale après la guerre. Ces doutes n’émergèrent pas par hasard dans une organisation comme la FAUD, laquelle devait fortement fluctuer avec les hauts et les bas de la vie "à la base" de la classe ouvrière.
Même le catalogage classique du Congrès de fondation de la FAUD comme "étape vers le pacifisme" qui sans aucun doute sabote la détermination de la classe ouvrière, ne correspond pas à la réalité. Comme la discussion sur la dictature du prolétariat, les débats sur la violence dans la lutte des classes a été plutôt le signe d'un véritable problème auquel était confrontée la classe ouvrière au plan international. À l’aide de quels moyens est-il possible de maintenir l’élan de la vague révolutionnaire qui marque le pas et de briser l'isolement de la classe ouvrière en Russie ? En Russie, comme en Allemagne il était inévitable pour la classe ouvrière d’utiliser des armes pour se défendre contre les attaques de la classe dominante. Mais l’extension de la révolution par des moyens militaires, voire la "guerre révolutionnaire" était impossible, si ce n'est absurde. Particulièrement en Allemagne, la bourgeoisie tentait avec perfidie de provoquer en permanence le prolétariat militairement. "L'essence de la révolution ne réside pas dans l’utilisation de la violence, mais dans la transformation des institutions économiques et politiques. La violence en soi n'est absolument pas révolutionnaire, mais au contraire réactionnaire au plus haut degré. (...) Les révolutions sont la conséquence d'une grande transformation spirituelle dans les opinions des hommes. Elles ne peuvent pas s’accomplir arbitrairement par la force des armes (...) Mais je reconnais aussi la violence comme un moyen de défense, lorsque les conditions elles-mêmes nous refusent tout autre moyen", argumente Rocker contre Krohn, un défenseur du Parti communiste. Les événements tragiques de Cronstadt en 1921 ont confirmé que l’attitude critique envers les faux espoirs que les armes puissent sauver la révolution, n'a rien à voir avec le pacifisme. La FAUD, dans la foulée de son Congrès fondateur, n’a pris aucune position pacifiste. Une grande partie de l'Armée Rouge de la Ruhr qui a riposté au putsch de Kapp au printemps de 1920 était formée de syndicalistes-révolutionnaires.
Dans le présent article, c'est intentionnellement que, par delà nos critiques, nous avons également fait ressortir les points forts des positions des syndicalistes-révolutionnaires en Allemagne à l'époque de 1918-19. La partie suivante de notre article traitera de la période allant de la fin des années 1920 jusqu’à l’avènement d'Hitler en 1933 et la destruction de la FAUD.
Mario (16/ 6/ 2012)
1 Der Syndikalist n° 1, "Was wollen die Syndikalisten? Der Syndikalismus lebt!", 14 décembre 1918
2 Ibidem
3 Voir Ulrich Klan, Dieter Nelles, Es lebt noch eine Flamme, Ed Trotzdem Verlag
4 Richard Müller, 1918: Räte in Deutschland, p. 3
5 Richard Müller, Hie Gewerkschaft, hie Betriebsorganisation!‘, 1919
66 Discours de présentation de la Déclaration de Principes de la FAUD par R. Rocker.
7 Protokoll der Ersten Generalversammlung des Deutschen Eisenbahnerverbandes in Jena, 25-31 mai 1919, p. 244
8 Der Syndikalist n°36, „Betriebsräte und Syndikalismus“, 1919
9 Plus largement, au-delà de l’illusion des comités d’entreprise comme "partenaires de négociation" avec le capital, il existait celle, émanant de la Ruhr à Essen – mais présente aussi dans les rangs des syndicalistes révolutionnaires – de la possibilité de la "socialisation" immédiate, c'est-à-dire la nationalisation des mines et des entreprises. Cette faiblesse commune à l’ensemble de la classe ouvrière en Allemagne constituait avant tout une expression de son impatience. Le gouvernement Ebert créa dès le 4 décembre 1918 à l’échelle nationale une commission à la socialisation comprenant des représentants du capital et des sociaux-démocrates renommés tels que Kautsky et Hilferding. Ceci dans le but déclaré du maintien de la production grâce aux nationalisations.
10 Voir à ce propos les débats du 15ème Congrès de la FAUD en 1925.
11 Der Syndikalist n°2, „Verschandelung der Revolution“, 21 décembre 1918
12 Der Syndikalist n°1, „Was wollen die Syndikalisten? Der Syndikalismus lebt!“, 14 décembre1918
13 Ulrich Klan, Dieter Nelles, Es lebt noch eine Flamme, Ed Trotzdem Verlag, p. 70
14 Karl Roche in Der Syndikalist n°13, „Syndikalismus und Revolution“, 29 mars 1919
15 Rudolf Rocker, Aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten, Ed. Suhrkamp, p. 287
16 Roche écrit : "La politique de parti est la méthode bourgeoise de lutte pour s’accaparer le produit du travail extorqué aux ouvriers. (...) Les partis politiques et les parlements bourgeois sont complémentaires, ils entravent tous les deux la lutte de classe prolétarienne et produisent la confusion." comme si la possibilité de partis révolutionnaires de la classe ouvrière n’existait pas. Qu’en est-il du compagnon de lutte de la Ligue Spartacus, qui était un parti politique ?
17 Was wollen die Syndikalisten? Programm, Ziele und Wege der „Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften“, mars 1919
18 Syndikalismus und Kommunismus, F. Brandt, KPD-Spartakusbund, août 1919
19 En réalité, beaucoup de sections de la FAU en Allemagne telles qu'elles existent aujourd'hui, jouent depuis des décennies bien plus un rôle de groupe politique que de syndicat, en s’exprimant sur de nombreuses questions politiques et en ne se limitant nullement à la "lutte économique" - ce que nous, en dehors de savoir si nous sommes d'accord ou non, trouvons positif.
20 Der Syndikalist, n° 42, 1919
21 En dépit de la méfiance à l'égard des partis politiques existants Rocker affirmait clairement que : "(...) la lutte n'est pas seulement économique, mais doit aussi être une lutte politique. Nous disons la même chose. Nous rejetons seulement l'activité parlementaire, mais en aucune manière la lutte politique en général. (...) Même la grève générale est un outil politique tout comme la propagande antimilitariste des syndicalistes-révolutionnaires, etc." Le rejet théorisé de la lutte politique ne dominait pas la FAUD à cette époque, bien que sa forme d’organisation ait été clairement conçue pour la lutte économique.
22 Rocker, Der Syndikalist, n°2, 1920