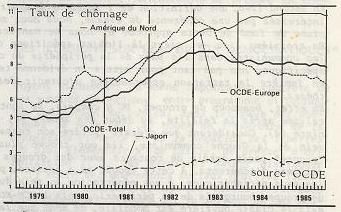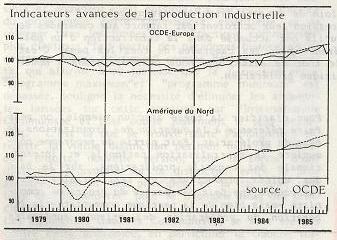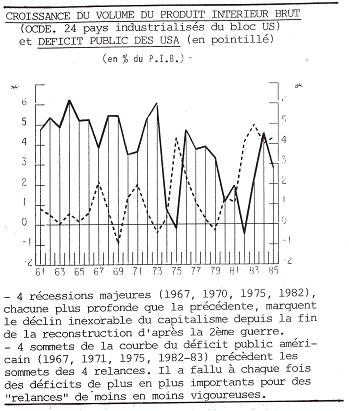Revue Int. 1986 - 44 à 47
- 3437 reads
Revue Internationale no 44 - 1e trimestre 1986
- 2585 reads
Les luttes ouvrières seul frein a la guerre
- 2302 reads
LE DEVELOPPEMENT LENT ET PROFOND DE LA LUTTE DE CLASSE
Des pays développés aux pays sous-développés, le capitalisme en crise impose l'austérité à tous les ouvriers, dans tous les secteurs. En Europe, le taux de chômage atteint 11%.Même dans les pays où "l'Etat-providence" était une tradition bien établie, comme la Hollande, la Suède, la Grande-Bretagne, les budgets sociaux et les dépenses de santé sont dramatiquement réduites. Partout le prolétariat est attaqué. Et partout, il est obligé de se défendre, de se défendre le plus massivement possible, de plus en plus violemment, de plus en, plus contre les gouvernements, la police et le sabotage des luttes par les syndicats et les partis de gauche sans responsabilité gouvernementale.
Simultanéité des luttes et tendances à l'extension
Face aux attaques de la bourgeoisie qui touchent toute la classe ouvrière, celle-ci réagit dans tous les secteurs : le privé comme le public, les secteurs traditionnels comme l'industrie de pointe, le secteur directement productif comme celui des services, et dans tous les pays. La simultanéité des luttes, notamment au coeur de la plus grande concentration prolétarienne du monde, en Europe, se poursuit. Cette simultanéité, la bourgeoisie veut à tout prix la cacher pour tenter d'empêcher les ouvriers :
- de prendre conscience qu'ils ne sont pas isolés, que, confrontés aux mêmes problèmes, à l'autre bout du pays, de l'autre côté de la frontière, leurs frères de classe luttent aussi ;
- de prendre confiance en leurs propres forces ;
- d'unifier leurs luttes.
La simultanéité des luttes pose concrètement la possibilité d'étendre les luttes. La tendance à l'extension s'est manifestée à plusieurs reprises avec dynamisme, au sein d'un même secteur, mais également dans quelques conflits de grande ampleur où plusieurs secteurs ont lutté : Brésil, Grèce. Les luttes aujourd'hui sont d'autant plus significatives de la combativité actuelle de la classe que faire grève dans les conditions difficiles de la crise, de la menace du chômage, de la répression renforcée de l'Etat, et face à la stratégie de démobilisation et de division des syndicats, est un choix autrement important que dans les périodes de lutte antérieures. Même si, quantitativement, le nombre de jours de grève est moins important qu'au début des années 70, ce sont cependant, rien qu'au cours de ces derniers mois, des millions d'ouvriers qui ont été impliqués dans des mouvements de lutte.
La nécessité d'une lutte massive
Parallèlement à un strict contrôle de l'information sur la situation sociale, se mène une campagne permanente sur le thème "lutter ne sert à rien". Les images de défaites ouvrières sont étalées jusqu'à l'écoeurement : fins moroses des grèves, impuissance face à la répression, divisions entre ouvriers, etc. Le but d'une telle propagande est de freiner l'expression ouverte du mécontentement, de profiter de la désillusion grandissante à l'égard des syndicats pour la transformer en passivité, pour induire un sentiment d'échec, de démoralisation, d'atomisation individuelle.
De même que la prétendue "passivité" de la classe ouvrière est un mensonge, la prétendue "inefficacité" de la lutte en est un autre. Le niveau actuel de la lutte de classe n'empêche pas les attaques croissantes contre les conditions de vie de la classe ouvrière, mais il limite la marge de manoeuvre de la classe dominante dans son offensive et freine cette attaque. Cela ne se traduit pas en soi dans les résultats de chaque conflit, mais c'est au niveau de l'ensemble de la classe ouvrière que l'attaque est freinée. Même s'il n'y a pas d'acquis durable pour chaque conflit, chaque expression du mécontentement et de la résistance des ouvriers participe d'une résistance d'ensemble de la classe ouvrière qui a un effet. Plus la classe ouvrière résiste aux attaques de la bourgeoisie, plus elle restreint la marge de manoeuvre de celle-ci et rend la planification des attaques difficile. La campagne actuelle de dénigrement des luttes ouvrières, par son ampleur, montre l'inquiétude de la classe dominante. Abandonner le terrain de la lutte signifierait pour la classe ouvrière laisser les mains libres à la bourgeoisie pour attaquer encore plus fortement sur le plan économique, pour entretenir l'impuissance et l'isolement.
La nécessité de l'auto organisation contre et en dehors des syndicats
Plus que les résultats sur le plan économique qui ne peuvent être que temporaires et extrêmement limités, les résultats de ses luttes pour la classe ouvrière se trouvent sur le plan de la confiance en elle-même et de sa prise de conscience. La première victoire, c'est la lutte elle-même, la volonté de relever la tête face aux attaques, aux humiliations, à la répression de la bourgeoisie. Tout ce qui manifeste une volonté de lutter du prolétariat par ses propres moyens, par les grèves, les rassemblements, les manifestations, est un encouragement pour toute la classe ouvrière. La multiplication de conflits bouscule le mur du silence, brise le sentiment d'isolement, développe la conscience de sa force par le prolétariat, et renforce l'idée que pour faire face à la bourgeoisie, il faut lutter massivement, être nombreux, que pour cela, il faut étendre la lutte, que non seulement c'est nécessaire, mais que c'est possible.
En luttant, les ouvriers obligent la bourgeoisie à se dévoiler, à dévoiler ses armes et notamment les plus pernicieuses : les partis de gauche et les syndicats, parce qu'ils prétendent défendre les intérêts ouvriers.
En Suède, en France, en Grèce, en Espagne, les Partis Socialistes au gouvernement imposent les mêmes mesures d'austérité que les gouvernements de droite en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Etats-Unis, que les Partis Communistes dans les pays de l'Est, où comme le PC en France de 1981 à 1984. Partout les ouvriers au travail et les ouvriers au chômage font face aux mêmes attaques, et partout les partis de gauche et les syndicats, même lorsqu'ils ne sont pas les promoteurs directs de l'austérité au gouvernement, quand ils sont dans "l'opposition", sont le fer de lance du sabotage des luttes ouvrières. Parce qu'ils se réclament de la classe ouvrière, parce qu'en son nom ils agissent en son sein, les syndicats ont été et sont au coeur de l'action ouvrière, la "cinquième colonne" de la bourgeoisie.
Dans les grèves de Renault en France, dans les mines du Limbourg en Belgique, la division entre syndicats a été savamment utilisée pour diviser les ouvriers, pour casser l'action ouvrière et faire reprendre le travail. Le dernier Congrès des syndicats britanniques (TUC) a été clair : organiser et coordonner la division entre les différents syndicats corporatistes (en particulier les mines avec le NUM qui a brisé la grève de 1984, et la métallurgie), afin de lutter encore plus efficacement contre la tendance à la solidarité et à l'unité parmi les ouvriers.
Face aux syndicats qui mettent toute leur énergie à limiter le conflit entre les classes dans les limites de l'usine, de la corporation, du secteur, la méfiance se développe dans la classe ouvrière : c'est ce que montre la tendance à des mouvements spontanés qui démarrent hors des consignes syndicales, des grèves "sauvages" : en France dans les chemins de fer, en Belgique dans les chemins de fer et dans les postes, en Suède dans quasiment toutes les grèves, plus de 200 en deux ans, et fin 85 dans les grèves du personnel de garde des enfants et du nettoyage de l'usine sidérurgique de Borlange.
Dans tous les conflits qui démarrent hors de consignes syndicales, le dispositif d'alerte de la bourgeoisie est rapidement mis en place : campagnes des médias, répression et intimidation policière, jeu des partis politiques pour permettre aux syndicats de reprendre le contrôle des opérations, pour mener la mobilisation ouvrière à la défaite.
La radicalisation des syndicats, notamment sous la forme d'un syndicalisme de "base" ou "de combat", qui redore le blason syndical en tentant de faire croire à la possibilité d'un "vrai" et d'un "bon" syndicalisme, joue un rôle très pernicieux.
En Grande-Bretagne en octobre 85, dans le chantier naval de Tyneside, les délégués d'ateliers (shop-stewards), soutenus par les gauchistes, ont détourné la grève spontanée au départ sur la "démocratie syndicale". En Belgique, dans les mines du Limbourg, les gauchistes ont détourné la solidarité et l'extension sur l'idée qu'il faut d'abord que toutes les mines soient en grève pour ensuite contacter les autres secteurs ; ils ont joint le geste à la parole en s'opposant manu militari à l'intervention du CCI dans la grève.
Le prolétariat fait face aux mystifications les plus sophistiquées de la classe dominante et particulièrement les syndicats qui sont son arme la plus adaptée. Face à cela, la méfiance ne suffit pas ; il faut que la classe ouvrière se donne les moyens de contrôler sa lutte, de la prendre elle-même en charge pour pouvoir briser l'isolement, et par l'extension établir un véritable rapport de forces en sa faveur face à la bourgeoisie.
C'est cette conscience de 'a nécessité de l'auto organisation pour parvenir à une réelle extension de la lutte qui est en train de mûrir dans les entrailles du prolétariat et à laquelle les organisations révolutionnaires doivent contribuer activement.
Dans ces conditions, comment lutter ? Là encore, la lutte des ouvriers a déjà donné des débuts de réponse ces derniers mois :
- imposer dans chaque usine ou heure de travail le principe de l'assemblée générale souveraine, avec comme seul représentant un comité de délégués élus et révocables devant l'assemblée à tout moment ;
- imposer que la coordination entre les différents lieux et assemblées en lutte soit exclusivement aux mains de comités de délégués responsables ;
- rejeter la délégation des décisions et des actions aux syndicats.
Le développement de la lutte de classe n'en est qu'au début d'une vague internationale ; il est lent et se heurte à la question cruciale du rôle du syndicalisme. L'approfondissement de la crise économique va pousser de plus en plus la classe ouvrière à exprimer son potentiel de combativité. De la capacité du prolétariat à lutter sur son terrain, à prendre confiance en lui, à ne pas céder aux campagnes de propagande que la bourgeoisie assène à dose massive, à déjouer l'obstacle du syndicalisme, dépend le succès de sa lutte d'émancipation de la barbarie du capital.
Si l'approfondissement de la crise pousse la classe ouvrière à combattre, il pousse aussi la bourgeoisie a sa "solution" : la guerre généralisée, ce dont a témoigne fin 1985 la rencontre entre Reagan et Gorbatchev.
REAGAN-GORBATCHEV :LA COURSE AUX ARMEMENTS LE MENSONGE D'UN CAPITALISME "PACIFIQUE"
Cette rencontre a été l'occasion d'un intense martelage idéologique des deux côtés du "rideau de fer", pour prétendre montrer qu'aussi bien l'URSS que les USA sont des puissances impérialistes "responsables", qui veulent "la paix", et que le Sommet de Genève a été un pas en avant "vers la paix".
Après l'invasion de l'Afghanistan en 1980 les deux "grands" en étaient venus aux diatribes menaçantes de la "guerre froide" : Reagan, dans des discours menaçants, a dénoncé "l'Empire du mal" que constitue le bloc russe adverse, tandis que Gorbatchev, sitôt arrivé au pouvoir a affirmé que "jamais la tension n'avait été aussi forte depuis les années 30". Et après ces campagnes bellicistes et agressives qui se sont succédées, marquant le retour de la peur de la guerre au coeur du monde capitaliste, justifiant la course accélérée aux armements les plus perfectionnés dans la capacité a semer la mort ei la destruction, les paroles de "paix" des leaders des deux blocs assis autour d'une tasse de café, images véhiculées par les médias du monde entier, peuvent rencontrer un écho favorable parmi des populations inquiètes de voir plantée au dessus de leurs têtes l'épée de Damoclès de l'holocauste nucléaire.
Beaucoup d'événements historiques depuis des décennies l'ont démontré : quand la bourgeoisie développe des prêches pacifistes, c'est pour mieux préparer la guerre. Les exemples ne manquent pas : les accords de Munich qui en 1938 précèdent l'éclatement de la 2ème guerre mondiale ; le pacte germano-soviétique de 1939, rompu deux ans plus tard par l'invasion de l'Ukraine par les forces de l'armée allemande ; les accords de Yalta, en 1945, qui ont été suivis par 40 ans de rivalités et de guerres permanentes entre les deux blocs, à la périphérie du capitalisme ; et, plus proches de nous, les accords d'Helsinki en 1975, sur les "droits de l'homme" dont on a pu voir l'inanité, et le sommet Carter-Brejnev qui a précédé de six mois seulement l'entrée des troupes russes en Afghanistan. Qu'est-ce qui a déterminé la propagande de "paix" autour de la rencontre Reagan-Gorbatchev ? Côté russe, c'est essentiellement le changement de l'équipe au pouvoir qui a été déterminant. Paralysée par une crise de succession, la bourgeoisie russe, sur le plan de la politique étrangère, a été marquée par la passivité et un repli frileux. L'arrivée de l'équipe Gorbatchev a montré un plus grand dynamisme de la politique russe vis-à-vis de l'Occident, afin d'essayer de briser l'isolement que lui impose l'étau occidental. Côté américain la propagande ne pouvait rester indifférente, face aux multiples "propositions de désarmement" de Gorbatchev, au risque de paraître comme le fauteur de guerre. Les discours bellicistes de Reagan dénonçant "l'Empire du mal" ont été le support idéologique de l'offensive militariste occidentale, caractérisée par la mise en place d'un gigantesque programme d'armements (dont l'orientation avait été décidée par Carter), qui a englouti des sommes de plus en plus fabuleuses (Budget US : 230 milliards de Dollars en 1985, 300 prévus en 1986), et par l'intervention de plus en plus fréquente des troupes occidentales à l'étranger. Ce processus est maintenant mis sur rails. C'est un autre volet de la propagande qui commence à être mis en place, basé sur des paroles de "paix". en effet, pour mobiliser les ouvriers dans un effort de guerre, pour obtenir leur adhésion à la défense militaire du capital national, il ne faut pas que les ouvriers considèrent de la faute de leur propre gouvernement une poussée vers la guerre. Il faut faire apparaître que l'agresseur, c'est "l'autre". Toutes les belles paroles de Reagan et Gorbatchev aujourd'hui n'ont pas d'autre but que d'apparaître comme "pacifiques" pour endormir la méfiance de "leurs" ouvriers, faire apparaître le bloc adverse comme l'agresseur.
Dans le capitalisme, la paix est un mensonge. Ce n'est pas la responsabilité des chefs d'Etat qui permet la paix, c'est le non embrigadement du prolétariat dans la guerre. Pour faire la guerre, il ne faut pas seulement à la classe dominante des armes ; la guerre se fait avec des hommes ; il lui faut des hommes pour produire ses engins de mort, pour combattre. Le seul frein réel à la guerre, ce n'est pas "l'équilibre de la terreur" que chaque bloc essaie de bousculer par une course aux armements sans répit (dernièrement le programme spatial US de "guerre des étoiles"), le seul frein à la guerre, c'est la capacité ou prolétariat à résister aux programmes d'austérité imposés pour les besoins de l'économie de guerre, de la production d'armements.
La lutte des ouvriers en Pologne en 1980-81 qui, durant de longs mois, a perturbé l'ensemble du dispositif militaire soviétique, a montre., comment sans adhésion de la population, de la classe ouvrière, à la défense du capital national, il ne pouvait y avoir embrigadement dans la guerre. L'obstacle que la bourgeoisie rencontre dans son cheminement vers la guerre, c'est la volonté du prolétariat de ne pas accepter de sacrifier ses conditions de vie. Même si le niveau actuel de la lutte de classe n'empêche pas l'accentuation des tensions impérialistes, il ne permet pas pour autant à la bourgeoisie d'avoir les mains libres pour imposer sa "solution" à la crise : la destruction de l'humanité.
La classe ouvrière doit étendre, généraliser, unifier les combats qu'elle a entrepris et qui sont encore contenus par la gauche et les syndicats, vers une confrontation politique ouverte avec la bourgeoisie.
LES LUTTES OUVRIERES DANS LE MONDE : QUELQUES EXEMPLES
Brésil : grèves face au programme d'austérité ; plus de 400 depuis l'instauration de la "nouvelle démocratie" ; octobre 85, les transports sont paralysés par une grève générale ; novembre, 500 000 ouvriers de Sao-Paulo en grève pour les salaires.
Grèce : après la victoire électorale du Parti Socialiste face au gel des salaires pour deux ans, le 6 novembre 100 000 travailleurs des secteurs public et privé sont en grève ; le 14 novembre, 1,5 millions d'ouvriers sont présents à une "journée d'action" appelée par l'aile gauche du syndicat grec ; ambiance générale d'instabilité sociale, affrontements et émeutes à partir des universités d'Athènes.
Japon : novembre 85, grève des chemins de fer face aux menaces de licenciements.
Suède : face à l'austérité imposée par la Social-Democratie nouvellement réélue, grèves dans les abattoirs, les dépôts ferroviaires de tout le pays, avec assemblées générales ; cette tendance à l'auto organisation et à l'extension culmine dans un mouvement de grève du personnel de garde des enfants ; le 23 novembre, des manifestations ont lieu en 150 points du pays, rassemblant plusieurs milliers de personnes et dirigées ouvertement contre l'Etat et les syndicats.
Hollande : des débrayages ont eu lieu dans plusieurs usines de Philips, contre les tentatives de baisser les salaires ; à Amsterdam, grève en octobre 85 des conducteurs de tramways et des pompiers ; au port de Rotterdam, le 23 octobre, débrayages sans les syndicats ; les dockers protestaient contre l'accord entre syndicats et patronat sur les cadences et la baisse des salaires.
France : en septembre 85, grèves dans les chantiers navals et poursuite de la grève malgré l'avis syndical a Dunkerque ; le 30 septembre, deux jours après une "journée d'action" des syndicats très peu suivie, grève des chemins de fer hors des consignes syndicales, étendue en 48 heures à tout le réseau ; en octobre, grèves à Renault ; en novembre grève à l'agence de presse AFP et à la Banque de France ; 22 novembre, la quasi-totalité des mineurs de Lorraine sont en grève contre les licenciements.
Belgique : dans les chemins de fer, 11000 emplois ont été supprimés ces trois dernières années ; en octobre 85 la bourgeoisie a voulu faire payer des impôts nouveaux sur les primes de nuit avec effet rétroactif depuis 1982 ; devant la force et la vitesse du déclenchement de la grève à tout le réseau ferré, les mesures ont été reportées ; les syndicats ont présenté cela comme une victoire, pour empêcher les ouvriers de profiter du rapport de forces pour obtenir le retrait complet des mesures et surtout pour étendre la lutte aux autres secteurs, comme en septembre 83. Dans ce contexte, dans le Limbourg, contre la menace de 4000 licenciements, 3500 ouvriers sont partis en grève ; au bout d'une semaine, 18000 mineurs les avaient rejoint. Il a fallu l'apport des gauchistes syndicalistes de base organisant des actions bidon pour épuiser les ouvriers les plus déterminés, empêcher la solidarité vers les autres secteurs.
Etats-Unis : dans la sidérurgie, trois mois de grève à l'automne 85 ont paralysée Wheeling Pittsburgh ; dans l'automobile, Chrysler, grève de dix jours sur les salaires ; sur le chantier de la centrale nucléaire de Seabrooke, près de Boston, 2500 ouvriers de toutes les professions font grève ensemble malgré les barrières interprofessionnelles syndicales ; dans le plus grand centre de conserverie alimentaire du pays, en Californie, Watsonville, la combativité ouvrière s'est manifestée dans des assemblées générales et par un refus de l'accord syndical.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [1]
Questions théoriques:
6eme Congres du CCI
- 2542 reads
Début novembre, s'est tenu le 6ème congrès du Courant Communiste International. Le congrès est l'instance suprême d'une organisation communiste. C'est au congrès que l'ensemble de l'organisation fait un bilan de ses activités durant toute la période écoulée depuis le précédent congrès, qu'elle se prononce sur la«validité des orientations définies par ce dernier tant au plan de l'analyse de la situation internationale qu'au plan des perspectives d'activité qui en découlent pour l'organisation elle-même. Ce bilan permet que soient tracées à leur tour des perspectives sur ces deux plans pour la période allant jusqu'au prochain congrès. Il est clair que ce n'est pas seulement à l'occasion du congrès que l'organisation se préoccupe et discute de l'évolution de la situation internationale et de ses propres activités. C'est de façon permanente qu'elle réalise ce travail afin d'être à chaque riment en mesure d'assumer le mieux possible ses responsabilités au sein du combat de classe. Mais ce qui distingue les travaux du congrès des autres réunions régulières qui se tiennent au sein de l'organisation c'est qu'à cette occasion c'est toute l'organisation qui se prononce collectivement et de façon directement unitaire sur les orientations générales et essentielles constituant le cadre au sein duquel vont se développer et s'articuler toutes ses activités. En d'autres termes, ce qui distingue les congrès c'est qu'ils doivent se confronter aux enjeux primordiaux de toute la vie de l'organisation.
Quels étaient les enjeux de ce 6ème congrès du CCI ?
LES ENJEUX DU CONGRES
L'organisation révolutionnaire n'existe pas par elle-même ni pour elle-même. Sécrétion de la classe révolutionnaire, elle ne peut exister que comme facteur actif dans le développement de la lutte et de la conscience de celle-ci. En ce sens, les enjeux de ce congrès pour le CCI étaient directement tributaires des enjeux de 1'évolution présente de la lutte de classe. Or ces derniers enjeux sont considérables. Face à un système capitaliste qui s'enfonce de plus en plus et de façon irréversible dans sa crise mortelle, crise dont l'unique aboutissement sur le terrain de ce système ne peut être qu'une troisième guerre mondiale qui détruirait l'humanité, la lutte du prolétariat, sa capacité de mobilisation sur son propre terrain de classe, constitue le seul obstacle en mesure de s'opposer à un tel aboutissement comme nous l'avons souvent mis en évidence et comme nous le rappelons dans l'éditorial de ce numéro de la Revue. Si aujourd'hui la crise du capitalisme n'a pas débouché sur un holocauste généralisé, c'est dû fondamentalement à la reprise historique des combats de classe depuis la fin des années 60, une reprise, qui, malgré des moments de repli et de déboussolement provisoires de la classe, ne s'est jamais démentie. Ainsi, alors que le 5ème congrès du CCI eut notamment pour tâche de comprendre et d'analyser le recul de la classe au niveau mondial qui avait permis et suivi sa défaite de 1981 en Pologne, le 6ème congrès s'est tenu par contre deux ans après le début d'une nouvelle vague de luttes qui a touché la plupart des pays industrialisés et notamment tous ceux d'Europe occidentale. Cette vague de luttes (la 3ème depuis 1968) se situe à un moment crucial de la vie de la société.
Elle se situe au milieu d'une décennie dont notre organisation a démontré en de multiples reprises la gravité des enjeux, une décennie où la "réalité du monde actuel se révélera dans toute sa nudité", où "se décidera pour une bonne part l'avenir de l'humanité" (Revue Internationale n° 20, "Années 80, les années de vérité"). C'est dire toute l'importance de la question centrale à laquelle était confronté notre 6ème congrès : comment armer notre organisation face à la 3ème grande vague de luttes depuis la reprise historique de 1968 et qui prend place au milieu d'une décennie aussi décisive, comment faire pour que le CCI soit non un simple observateur, même avisé, ou même un "supporter" enthousiaste des combats menés par la classe, mais, comme c'est sa responsabilité, un acteur du drame historique qui se joue, partie prenante de ces combats ?
S'ils étaient en premier lieu déterminés par la situation mondiale et particulièrement par l'évolution de la lutte de classe, les enjeux du 6ème congrès du CCI résultaient également de la situation particulière dans laquelle s'est trouvée notre organisation durant ces dernières années. En effet, si elle est un produit historique du mouvement de la classe révolutionnaire vers sa prise de conscience, l'organisation communiste n'en est pas un produit mécanique ou immédiat. La classe se donne des organisations communistes pour répondre à un besoin : participer activement à l'élaboration, l'approfondissement et la diffusion dans l'ensemble de la classe de la théorie et des positions révolutionnaires, mettre en avant de façon claire les buts ultimes de son mouvement et les moyens pour y parvenir, mener un combat permanent et acharné contre toutes les facettes de l'idéologie dominante qui pèse de façon constante sur l'ensemble de la classe et tend à paralyser son combat. C'est là un mandat que la classe confie aux organisations révolutionnaires mais dont il n'est pas donné a priori qu'elles pourront s'acquitter au mieux, à chaque moment de leur existence. Au même titre que la classe dont elles constituent une partie, celles-ci, ainsi que leurs militants, sont soumises à la pression permanente de l'idéologie de la classe dominante, et si elles sont mieux armées que le reste du prolétariat pour y résister, la menace n'en existe pas moins pour elles d'un affaiblissement de leur résistance et, en fin de compte, de l'incapacité d'accomplir les tâches pour lesquelles elles ont surgi. C'est ainsi que la gravité des enjeux des années 80 constituait pour l'ensemble des organisations du milieu révolutionnaire un défi considérable que ce milieu a éprouvé les plus grandes difficultés à relever. Les "années de vérité" pour l'ensemble de la société l'étaient également pour les organisations révolutionnaires et les convulsions qui ont marqué la situation mondiale dès le début de cette décennie tant au plan des conflits impérialistes (comme l'Afghanistan) qu'au plan des luttes de classe (comme en Pologne) , se sont répercutées par des convulsions importantes au sein du milieu révolutionnaire qui s'était développé avec la reprise historique de la classe dès la fin des années 60. Cette crise du milieu révolutionnaire que nous avons signalée et analysée à plusieurs reprises dans cette Revue ([1] [3]) n'a pas épargné le CCI lui-même comme nous l'avons mis en évidence. La conférence extraordinaire du CCI de janvier 82 devait représenter un moment important du ressaisissement de notre organisation et son 5ème congrès (juillet 83) pouvait, avec raison, tirer un"bilan positif de la façon dont le CCI fait face à cette crise" (Présentation du 5ème congrès dans la Revue n°35). Mais, comme nous l'avons constaté par la suite (cf. notamment l'article de la Revue n°42, "Les glissements centristes vers le conseillisme"), si ce redressement était "effectif", il était encore "incomplet". C'est ce que constate dans sa partie bilan la résolution d'activités adoptée au 6ème congrès :
"1. Le 5ème congrès du CCI, en juillet 83, a réaffirmé à juste titre la validité du cadre général de redressement organisationnel et politique assumé par la conférence extraordinaire de 1982 en riposte à la crise qui avait secoué le CCI au début des années 80, comme 1 'ensemble du milieu révolutionnaire, face aux enjeux des années de vérité.
Cependant le 5ème congrès, en laissant subsister des flous sur la compréhension de la situation internationale, en particulier sur les perspectives immédiates de la lutte de classe (sur un long recul du prolétariat, 1 'attente d'un saut qualitatif) n'a pas donné, dans la résolution d'activités, d'orientation, d'intervention dans le surgissement pourtant prévisible de luttes ouvrières face à 1 'accentuation des attaques de la bourgeoisie.
La consigne ‘faire moins mais mieux’ ([2] [4]) au lieu d'être clairement posée et comprise comme la consolidation et la préparation de 1'organisation en vue d'explosions inévitables de la lutte de classe dans les deux années suivant le congrès, a été conçue et perçue comme reconduisant le même 'repli dans l'ordre' de la conférence extraordinaire de 1982. Le CCI restait ainsi en partie tourné vers la période de déboussolement du prolétariat alors que la prise en compte des caractéristiques générales de la lutte de classe en période de décadence et 1'analyse des conditions présentes déterminaient la reconnaissance de la sortie de ce déboussolement et de la reprise des luttes ouvrières, ce qui s'est confirmé trois mois à peine après le congrès par 1 'irruption des grèves en Belgique en septembre 1983.
2. Au cours des deux années écoulées, le CCI s'est donc affronté au rattrapage de ces faiblesses, et notamment celles du mandat qu'il s'était donné au 5ème congrès, réajustant 1'orientation de celui-ci pour hisser son activité à la hauteur des exigences posées aux révolutionnaires par le mouvement d'accélération de 1'histoire sur tous les plans qui conditionnent 1'évolution de la société vers des affrontements de classe décisifs' ([3] [5]) et, en particulier pour assurer une intervention conséquente dans la reprise générale des combats de classe.
Face aux retards et aux positions erronées dans la compréhension des événements après le congrès le CCI (...) a commencé à réajuster ses orientations, soulignant le rythme plus rapide de 1'évolution de la situation internationale, dégageant 1'idée de 1'accélération de 1'histoire en donnant la signification des événements face aux retards dans les analyses et en rejetant les conceptions erronées tendant à amoindrir a responsabilité de 1'organisation."
Le 6ème Congrès du CCI, se devait donc, en vue d'élever l'organisation à la hauteur des responsabilités qui sont les siennes dans le moment présent, de consolider tous les acquis auxquels nous étions parvenus dans les années précédentes sur les différents plans évoqués dans la résolution d'activités. Il se devait en particulier de tourner résolument le dos aux hésitations, aux tergiversations, aux tendances conservatrices qui s'étaient manifestées face à l'effort développé par l'organisation en vue de parvenir à ces acquis et qui avaient trouvé dans la minorité constituée en tendance en janvier 85 leur expression la plus accentuée pour ne pas dire la plus caricaturale. Il se devait, en ce sens, de se prononcer clairement non seulement sur les perspectives de la situation internationale, de la lutte de classe et de l'intervention que celle-ci requiert de notre part, mais également sur les questions essentielles qui avaient été longuement débattues dans l'organisation tout au long de cet effort, débat que nous avions rendu public dans les colonnes de notre Revue Internationale (cf. Revue n°40, 41, 42 et 43) et qui portait principalement sur :
- la reconnaissance de glissements centristes vers le conseillisme au sein du CCI ;
- l'importance du danger de conseillisme pour la classe et ses organisations révolutionnaires dans la période présente et à venir ;
- la menace que fait peser sur ces dernières, aujourd'hui autant ou plus que par le passé, l'opportunisme et notamment sa variante centriste.
Voilà quels étaient les enjeux et les exigences du 6ème congrès du CCI. Dans quelle mesure a-t-il su y répondre ?
LES DISCUSSIONS ET LES TEXTES DU 6ème CONGRES
L'analyse de la situation internationale
Les lecteurs de notre Revue ont pu constater que c'est de façon permanente que le CCI examine la situation internationale. Aussi ne revenait-il pas au 6ème congrès la tâche de traiter tous les aspects de celle-ci mais de se concentrer sur les aspects les plus importants, les plus récents et déterminant le plus directement les tâches de notre organisation. Il se devait en particulier de souligner les enjeux majeurs de la période et notamment face à toute une série de campagnes idéologiques de la bourgeoisie tendant à "montrer" :
- que l'économie capitaliste se porte mieux, qu'elle est en "convalescence" ;
- que grâce à la sagesse des dirigeants des grandes puissances, les tensions entre celles-ci se sont atténuées ;
- que la classe ouvrière lutte de moins en moins, qu'elle a "compris" la nécessité de se montrer "raisonnable" pour favoriser la sortie de la crise.
La résolution adoptée par le congrès, et que nous publions à la suite, réfute - au même titre que les rapports présentés à ce congrès et sur lesquels elle est basée- ces différents mensonges. Reconnaître les principaux enjeux de la période présente cela consiste en particulier à mettre en évidence :
- l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie capitaliste et la barbarie dans laquelle elle plonge toute la société (points 2 à 5) ;
- l'aggravation inéluctable des tensions impérialistes et le caractère mensonger de tous les discours de paix (points 6 à 8) ;
- que "la clé de toute la situation historique est entre les mains de la classe ouvrière" (point 9) ; que "la situation présente recèle d'énormes potentialités de surgissements prolétariens de très grande envergure" et qu'"il importe que les révolutionnaires soient particulièrement vigilants face aux potentialités de la période présente et, en particulier, qu'ils ne sous-estiment pas ces potentialités" (point 15).
La mise en évidence des enjeux de la lutte de classe s'appuie donc, en premier lieu, sur la capacité à réfuter tous les mensonges sur la "passivité" de la classe ouvrière (les points 9, 10 et surtout 11 y sont consacrés), mais également sur une analyse des caractéristiques présentes du développement de cette lutte (notamment aux points 10 et 13) et des multiples pièges tendus par la bourgeoisie et en particulier ses syndicats pour la paralyser (points 12 et 13). Elle repose enfin sur une analyse claire du phénomène du chômage comme un aiguillon majeur du combat de classe :
L'examen du développement de la lutte de classe devait occuper la plus grande part des discussions sur la situation internationale (la moitié de la résolution y est consacrée). C'était la traduction de toute l'importance que le CCI accorde à cette question en vue d'intervenir du mieux possible, avec ses forces encore bien faibles, dans cette lutte afin que s'en dégagent toutes les potentialités qu'elle recèle.
L'intervention du CCI
La nécessité de l'intervention des révolutionnaires imprègne la résolution sur la situation internationale qui se termine sur ce point :
"C'est notamment à travers cette intervention, si elle est capable de mettre en avant des propositions de marche correspondant aux besoins de la classe, que les révolutionnaires feront la preuve concrète auprès des ouvriers de la nécessité d'une organisation révolutionnaire jetant ainsi les bases du futur parti de la révolution communiste. " (point 15) .
Mais elle est surtout au centre de la résolution d'activités adoptée au congrès :
"L'intervention dans la lutte de classe basée sur des revendications de classe doit être la priorité du CCI. Cette présence politique de 1'organisation par 1'intervention, sur le terrain de classe, sur la défense des intérêts immédiats des ouvriers face aux attaques du capital, par les moyens de lutte propres à la classe ouvrière (grèves, manifestations, réunions, assemblées, groupes ouvriers, comités de chômeurs) est non seulement possible, mais elle est nécessaire et a une influence parmi les ouvriers, que ce soit formellement les syndicats qui appellent ou non, que les ouvriers y soient présents en masse ou en petit nombre. C'est la condition pour que l'organisation remplisse en pratique la tâche pour laquelle elle existe dans la classe ouvrière, pour qu'elle soit capable de dénoncer les caricatures de lutte des syndicats et leur stratégie de démobilisation que sont les opérations médiatiques, les ‘actions-commando' , les délégations et pétitions syndicales, les 'revendications' corporatistes et nationalistes, pour qu'elle soit capable de mettre en avant des propositions concrètes de marche pour pousser à la réflexion, l'unité, l'action collective de la classe, à chaque moment et dans chaque lieu de la défense des intérêts ouvriers.
Cette maîtrise [du cadre organisationnel en vue de 1'intervention] suppose la conviction que ces deux années à venir vont voir surgir des explosions de la lutte de classe, que nous n'avons pas les réponses toutes faites aux problèmes nouveaux qui vont surgir mais que la fermeté sur ce que nous avons acquis est la condition pour être à la hauteur de la situation. L'organisation doit être prête à tout instant à un embrasement possible de la lutte de classe, ce qui implique de participer à chaque moment qui annonce, prépare et rapproche des mouvements de grande ampleur dont elle a besoin pour remplir sa mission historique."
C'est donc de façon particulièrement déterminée que le congrès a confirmé et renforcé l'engagement de l'organisation vers une intervention de plus en plus active au sein des luttes ouvrières, une intervention qui soit à la hauteur de 1'importance de celles-ci. Il a confirmé cette orientation par l'adoption d'une résolution spéciale sur la presse du CCI qui précise notamment que :
"La presse demeure le principal instrument d'intervention de1'organisation et elle se situe donc au centre de notre effort pour développer les moyens de participation active au combat de classe. Même si 1'intervention par tracts et les prises de parole deviennent partie intégrante du travail régulier de 1 'organisation, cela ne diminue en rien 1'importance de la presse, au contraire. Celle-ci incarne la continuité de notre intervention et constitue l’outil indispensable qui permet de replacer chaque intervention dans un cadre plus large, donnant les dimensions historiques et mondiales de chaque combat."
Enfin, à l'image du 5ème congrès qui avait adopté une "Adresse aux groupes politiques prolétariens" (Revue n°35), le 6ème congrès s'est à nouveau penché sur cette question en considérant notamment "que 1 'orientation actuelle vers 1'accélération et le renforcement de 1'intervention du CCI dans la lutte de classe est également valable et doit être appliquée rigoureusement dans notre intervention envers le milieu." La résolution adoptée affirme notamment que :
Le CCI [...] doit se préoccuper d'utiliser pleinement la dynamique positive de la situation actuelle de lutte afin de pousser le milieu de l'avant et d'insister sur une intervention claire et déterminée des organisations révolutionnaires dans ces luttes.(...)
Afin de faire le meilleur usage de ces potentialités qui sont à leur tour simplement une concrétisation du fait que la période de lutte pour la formation du parti est ouverte, il est nécessaire de mobiliser les forces de tout le CCI afin d'oeuvrer au mieux à la défense du milieu politique, ce qui passe par (...) une attitude déterminée pour participer au regroupement des révolutionnaires, à leur unité."
Si 1'importance et les modalités de l’intervention du CCI dans les luttes ouvrières ont mobilisé beaucoup d'attention et d'effort au 6ème congrès, la capacité politique de l'organisation conditionnant cette intervention a également été une préoccupation centrale. C'est ainsi que le danger que représente le conseillisme pour l'ensemble de la classe et pour ses organisations politiques a été clairement mis en avant tant dans la résolution sur la situation internationale (point 15) que dans la résolution sur les activités qui précise que :
"Ce danger qui remet en question la capacité de l'organisation 'être un facteur actif dans les luttes quotidiennes de la classe, ne peut être combattu que si 1 'organisation développe et renforce de manière constante sa clarté politique et sa volonté militante".
Mais cette préoccupation d'armer politiquement l'organisation ne s'est pas arrêtée là. Elle a donné lieu à la discussion d'une résolution particulière "sur l'opportunisme et le centrisme dans la période de décadence" et d'une contre-résolution présentée par une minorité du CCI "sur le centrisme et les organisations politiques du prolétariat", toutes deux publiées dans cette Revue.
L'opportunisme et le centrisme
La reconnaissance de la permanence du phénomène historique de l'opportunisme dans la période ae décadence du capitalisme fait partie intégrante du patrimoine politique de la gauche communiste qui s'est dressée contre la dénégénérescence de 1'Internationale Communiste, justement au nom de la lutte contre l'opportunisme et le centrisme.
Le CCI a éprouvé à ses débuts quelques difficultés à se réapproprier cet acquis. Mais dès son 2ème congrès (1977) c'était chose faite pour l'ensemble de l'organisation avec la "Résolution sur les groupes politiques prolétariens" (Revue Internationale n°11). La remise en cause de cet acquis par certains camarades de la minorité qui allait se constituer en "tendance" participait donc d'une régression contre laquelle le CCI a engagé le combat à travers une longue discussion que notre Revue a répercutée, notamment dans ses numéros 42 et 43. La richesse de ces débats, l'approfondissement des acquis qu'ils ont permis et qui renforcent notre organisation contre les menaces permanentes de l'opportunisme et du centrisme, ont trouvé leur conclusion logique au congrès par l'adoption de la "Résolution sur l'opportunisme et le centrisme dans la période de décadence" et le rejet de la contre-résolution. Pour l'essentiel, cette dernière reprend les arguments figurant dans l'article "Le concept du 'centrisme' : le chemin de l'abandon des positions de classe" publié dans la Revue n°43 et auxquels le CCI a déjà apporté une réponse dans ce même numéro ("Le rejet de la notion de centrisme : la porte ouverte à l'abandon des positions de classe"). C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de revenir ici sur la critique de ces arguments sinon pour souligner que les conceptions mises en avant par cette contre-résolution conduisent à la fois à un sectarisme total ("en dehors des organisations défendant sur tous les points un marxisme intransigeant il n'y a que la bourgeoisie") et à la fois, même si elle s'en défend, à amoindrir la vigilance de l'organisation contre la principale des formes de pénétration de l'idéologie bourgeoise.
L'adoption par le congrès de la résolution s'est accompagnée de l'adoption d'une courte résolution indiquant la nécessité pour le CCI de rectifier sa plate-forme. En effet, le degré de clarté qui s'était fait dans les débats et que la résolution résume, avait fait apparaître la nécessité d'une telle rectification en particulier sur la question des conditions de passage des partis ouvriers (PS et PC) dans le camp bourgeois. Cette rectification était d'ailleurs prévue à l'ordre du jour et des amendements avaient été préparés depuis plusieurs mois. Mais si les débats du congrès ont fait la preuve d'une grande clarté autour de la résolution elle-même, ils ont fait apparaître une maturité encore incomplète sur les formulations qu'il convenait d'insérer dans la plate-forme. Partant de ce constat, et conscient du fait que sur la question primordiale de l'opportunisme et du centrisme -laquelle a des implications immédiates sur la vie de l'organisation- celle-ci s'était solidement armée avec la résolution, le congrès a décidé de reporter au prochain congrès la rectification de la plate-forme.
Par contre, le congrès a adopté plusieurs amendements aux statuts permettant, dans le même esprit qui est le leur et qui s'exprime dans le "Rapport sur la structure et le fonctionnement de l'organisation des révolutionnaires" (Revue n°33), de préciser certains points et de fermer en particulier la porte à toute idée que l'organisation pourrait fonctionner sur la base de groupes de travail comme c'était le cas dans la gauche hollandaise. Cette précision était devenue nécessaire dans la mesure où, entraînés par leurs glissements conseillistes, les camarades minoritaires s'étaient acheminés, sans le reconnaître, vers une telle conception.
Le déboussolement de ces camarades sur les questions organisationnelles devait d'ailleurs se traduire lors du congrès par leur départ de celui-ci et de l'organisation.
LA DESERTION DE LA "TENDANCE"
Dans l'article de la Revue n°43 en réponse à l'article de la "tendance", nous mettions ces camarades en garde contre le danger d'être "broyés par les engrenages de la démarche centriste qu'ils ont adoptée". Leur attitude lors du congrès a montré que la mise en garde n'était pas vaine. En effet, face aux affirmations de certains membres de cette "tendance" sur leur prochain départ de l'organisation, le congrès a d'emblée demandé aux camarades qui en faisaient partie ce qu'il en était de leur engagement militant dans l'organisation. En effet, il est parfaitement concevable qu'une minorité (ou une majorité) d'une organisation se présente à un congrès en annonçant la nécessité d'une scission et demande que soit immédiatement mise aux voix la question qui la motive : c'est ainsi qu'a agi la majorité de la SFIO au congrès de Tours en 1920 et la minorité du PSI au congrès de Livourne en 1921 sur la question de l'adhésion à l'Internationale Communiste. Mais telle n'a pas été l'attitude de la "tendance" qui, afin de ne pas mettre en évidence les désaccords existant en son sein entre ceux qui voulaient se retirer et ceux qui voulaient rester des militants du CCI, a préféré escamoter la question qui lui était posée. Voici comment, dans une résolution adoptée à l'unanimité des délégués présents, le congrès a pris position sur l'attitude de la "tendance" :
"Considérant que :
- la tendance s'est présentée au 6ème congrès en posant un ultimatum inacceptable selon lequel elle pourrait mettre en question son appartenance à 1’organisation au cas où celle-ci adopterait les orientations présentées par 1'organe central sortant ; la tendance a refusé de répondre à la demande du congrès qu 'elle se prononce clairement sur son engagement militant dans 1'organisation à la suite du congrès, le congrès a demandé à la tendance de se retirer afin de réfléchir, préparer et fournir une réponse à la séance suivante.
Au lieu de cela, la tendance et deux camarades de 1'organisation, tout en faisant parvenir une déclaration au présidium du congrès prétendant être exclus du congrès et affirmant continuer à faire partie de 1'organisation, ont quitté définitivement le congrès sans même 1'en avertir.
Malgré 1'adoption par le congrès d'une résolution exigeant leur retour, malgré que cette résolution leur ait été communiquée par téléphone, la tendance et les deux camarades ont refusé de revenir s'expliquer au congrès, se contentant d'une déclaration mensongère présentant leur attitude comme une 'exclusion de la tendance des travaux du congrès'.
Face à cela, le congrès considère que 1'attitude de la tendance et des deux camarades
- premièrement traduit un mépris du congrès et de son caractère de moment d'action militante de 1'organisation ;
- deuxièmement, constitue une véritable désertion des responsabilités qui sont celles de tout militant de l'organisation."
Après le congrès, le CCI a reçu des camarades de la "tendance" une déclaration où est renouvelée l'affirmation mensongère suivant laquelle elle aurait été exclue du congrès. Aux termes de la déclaration, cette prétendue "exclusion" marque de "façon irrévocable la dégénérescence de la vie interne du CCI" et en conséquence la "tendance" décide de se "constituer en fraction à 1'extérieur du cadre organisationnel du CCI" afin notamment de "représenter la continuité programmatique et organique avec le pôle de regroupement que fut le CCI, avec sa plateforme et ses statuts qu'il a cessé de défendre".
Ainsi, le milieu politique prolétarien déjà lourdement marqué par le sectarisme et la dispersion vient-il de "s'enrichir" d'un nouveau groupe basé sur la même plateforme que celle du CCI. La trajectoire lamentable de cette "tendance" qui réalise une "première historique" en se constituant en "fraction" (qui veut dire "partie de") après son départ de l'organisation d'origine, qui a besoin des mensonges les plus grossiers pour justifier ses contorsions, traduit bien le danger que représente la constitution d'une "tendance" sur des bases inconsistantes comme nous le signalions dans la Revue n°42 :
"... le CCI considère qu'il ne s'agit pas là d'une véritable tendance présentant une orientation alternative positive à celle de 1'organisation, mais d'un rassemblement de camarades dont le véritable ciment n'est ni la cohérence de leurs positions, ni une profonde conviction de ces positions, mais une démarche contre les orientations du CCI dans son combat contre le conseillisme."
Le réel dévouement, le sincère engagement militant d'un certain nombre de camarades de la "tendance" n'y a rien pu : dès lors qu'ils se sont laissés happer par la dynamique aberrante de celle-ci, ils ont fini par s'aligner sur les éléments qui étaient fatigués de militer et qui cherchaient le moindre prétexte, même le plus fallacieux, pour se désengager tout en "sauvant la face".
Tout au long de l'existence des organisations communistes, celles-ci ont perdu de leurs militants. A certains moments de l'histoire, comme au cours de la terrible contre-révolution des années 30 à 50, cette perte constituait un phénomène tragique qui a pu venir à bout des organisations elles-mêmes. Aujourd'hui, la situation est toute autre et le départ des camarades de la "tendance" ne saurait compromettre la capacité du CCI à faire face à ses responsabilités tout comme il n'a pas empêché le 6ème congrès d'assumer les taches qu'il s'était données.
EN CONCLUSION. . .
Après plusieurs jours de débats intenses, où se sont exprimées les délégations de toutes les sections territoriales qui composent le CCI, où ont été examinés, discutés et mis aux voix différents rapports, résolutions et de nombreux amendements, il nous faut donc considérer que le 6ème congrès du CCI a globalement atteint les objectifs qu'il s'était fixés, qu'il a valablement armé l'organisation face aux enjeux de la période présente. Les années qui viennent jugeront de la validité d'une telle appréciation, elles montreront en particulier si l'analyse dont s'est doté le CCI sur la situation internationale et notamment sur l'évolution de la lutte dardasse est bien conforme à la réalité, ce que contestent la plupart des autres groupes révolutionnaires. Mais dès à présent, les résolutions que nous publions dans ce numéro de la Revue Internationale font la preuve que le CCI s'est engagé dans une direction bien précise, laissant le moins possible la porte ouverte à toute ambiguïté (comme c'est le cas malheureusement de la part de beaucoup de ces groupes) , une direction qui, sur la base de l'analyse des énormes potentialités de combat qui mûrissent et se développent dans la classe, exprime la ferme volonté d'être à la hauteur de ces combats, d'en être partie prenante et de contribuer activement à leur orientation vers l'issue révolutionnaire.
F.M.
Conscience et organisation:
Résolution : la situation internationale
- 2491 reads
1) A la veille des années 80, le CCI a désigné celles-ci comme les "années de vérité", celles où les enjeux majeurs de toute la vie de la société allaient clairement se révéler dans leur formidable ampleur. A la moitié de cette décennie, l'évolution de la situation internationale a pleinement confirmé cette analyse :
- par une nouvelle aggravation des convulsions de l'économie mondiale qui se manifeste dès le début des années 80 par la récession la plus importante depuis celle des années 30 ;
- par une intensification des tensions entre blocs impérialistes qui se révèle notamment durant ces mêmes années, tant par un bond considérable des dépenses militaires que par le développement d'assourdissantes campagnes bellicistes dont s'est fait le chantre Reagan, chef de file du bloc le plus puissant ;
- par la reprise, dans le seconde moitié de 1983, des combats de classe après leur repli momentané de 1981 à 1983 à la veille et à la suite de la répression des ouvriers de Pologne, reprise qui se caractérise en particulier par une simultanéité des combats sans exemple par le passé, notamment dans les centres vitaux du capitalisme et de la classe ouvrière en Europe occidentale.
Mais, au moment même où se confirme toute la gravité des enjeux de la période présente, où se dévoilent toutes les potentialités qu'elle contient, la bourgeoisie lance toute une série de campagnes idéologiques visant à :
- accréditer le mythe d'une amélioration de la situation du capitalisme mondial dont les "succès" de l'économie américaine en 1983 et 84 (taux de croissance élevés, baisse de l'inflation, recul du chômage) seraient l'incarnation ;
- faire croire à une atténuation des tensions impérialistes avec la modification en 1984 des discours reaganiens et la "main tendue" aux négociations avec l'URSS qui trouvent leur pendant avec l'offensive de séduction diplomatique du nouveau venu Gorbatchev ;
- ancrer dans la tête des ouvriers l'idée que le prolétariat ne lutte pas, qu'il a renoncé à défendre ses intérêts de classe, qu'il n'est plus un acteur de la scène politique internationale.
En réalité, ce ne sont là que des rideaux de fumée destinés à masquer aux yeux des ouvriers toute l'importance des enjeux présents au moment même où se développe en profondeur une nouvelle vague de combats de classe. Ce que révèle en fait l'examen de la réalité mondiale d'aujourd'hui, c'est une confirmation éclatante des tendances fondamentales de la période historique présente qui s'étaient révélées dès le début de la décennie.
LA CRISE ECONOMIQUE
2) Le mythe d'une amélioration de la situation de l'économie mondiale éclate comme une bulle de savon dès qu'on constate la terrible réalité qui est celle des pays de la périphérie du capitalisme. L'endettement gigantesque (900 milliards de dollars) des pays appelés par une sinistre ironie "en voie de développement" (PVD), l'échec flagrant des potions -pourtant très amères- préparées "pour leur bien" par les "experts du FMI" (baisse de 30 % en deux ans du pouvoir d'achat au Mexique, de 20 % en six mois en Argentine, etc.). La faillite complète des derniers parmi ces pays dont on avait vanté la croissance miraculeuse (Hong-Kong, Singapour...), les taux d'inflation invraisemblables qu'ils connaissent (400 % au Brésil, le "pays modèle" des années 70, 10 000 % en Bolivie...), la terrible misère qui accable toutes les populations du tiers-monde, qui, avec la malnutrition, les famines, les épidémies qu'elle provoque, est responsable chaque jour de la mort de 40 000 personnes, qui transforme la vie quotidienne de plusieurs milliards d'êtres humains en un enfer permanent, toute cette effroyable réalité -que la bourgeoisie des pays avancés n'hésite pas à exhiber dès qu'il s'agit de présenter comme "enviables" la situation économique ainsi que le sort des ouvriers de ces pays- ne révèle en fait qu'une chose : l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie mondiale, l'incapacité définitive du mode de production capitaliste à surmonter ses contradictions mortelles dont les pays de la périphérie sont les premiers à payer les conséquences.
De même, l'incapacité permanente des pays dits "socialistes" à réaliser des plans pourtant de moins en moins ambitieux, la pénurie totale et permanente de biens de consommation qui s'y installe, le recul de la production en Tchécoslovaquie et en Pologne (dans ce dernier pays on en est aujourd'hui au niveau de 1974), les 150 % d'inflation en deux ans en Pologne comme la baisse de l'espérance de vie en URSS (66 ans en 1964, 62 ans en 1984), toutes ces caractéristiques, non seulement démasquent clairement le mensonge de leur nature "socialiste" mais font un sort définitif aux "théories" ayant eu cours même au sein du milieu révolutionnaire sur la capacité du capitalisme d'Etat à surmonter les contradictions du capitalisme classique, à se libérer des contraintes de la loi de la valeur. Elles révèlent que si ces pays ne sont pas moins capitalistes que les autres, c'est un capitalisme peu développé et peu compétitif qui y règne, un capitalisme qui, par bien des aspects, s'apparente à celui des pays du tiers-monde (comme la prédominance des matières premières dans ses exportations) et qui, à ce titre, est particulièrement fragile face aux coups de boutoir de la crise.
3) Le mythe de la convalescence du capitalisme se heurte également aux dures réalités qui sont celles des plus vieux pays bourgeois : ceux d'Europe occidentale où est localisée la plus forte concentration industrielle du monde. Dans cette zone, les quelques améliorations constatées ces dernières années pour certains pays en termes de taux d'inflation et de croissance du PNB ne sauraient masquer les réalités suivantes : - malgré son recul, résultant des attaques répétées contre les conditions de vie des ouvriers, le niveau présent de l'inflation (7,2 %) pour l'ensemble de ces pays représente encore plus du double de celui de 1967 (3,3 %) ;
- le niveau de la production industrielle n'était pas plus élevé en 1984 qu'en 1981 ;
- ce sont des pans entiers et considérables de l'appareil industriel qui sont éliminés (dans la sidérurgie, les chantiers navals, les mines, l'automobile, etc.) au nom d'un "assainissement" qui ressemble aux amputations répétées pratiquées sur un corps atteint de gangrène ;
- le fléau du chômage n'a cessé de se développer jusqu'à frapper 25 millions d'ouvriers, soit plus de 11% de la population active (entre 1981 et 84 le nombre des chômeurs a augmenté autant que durant les 20 années précédentes) ; la réalité quotidienne de ces pays, c'est l'extension à des échelles inconnues depuis des décennies des soupes populaires et de la paupérisation absolue.
Relatives à un des centres vitaux du capitalisme mondial, ces données prouvent à quel point les bavardages sur la "reprise", l'"assainissement" ne sont que purs rideaux de fumée.
4) De même, apparaissent comme totalement mensongers les discours sur la "santé" de l'économie américaine dès que sont dévoilées les recettes véritables de ces "reagonomics* sensées avoir fait des miracles. En effet, ce qui réside derrière l'augmentation "éblouissante" de 6,8 % de son PNB en 1984 (seule augmentation sensible de tous les pays importants en dehors du Japon, que sa grande compétitivité a préservé jusqu'à présent des atteintes les plus fortes de la crise), derrière le recul du chômage et derrière la baisse du taux d'inflation, ce sont respectivement :
- une relance de la production par des déficits considérables du budget fédéral (au total 379 milliards de dollars pour les années 83 et 84), ce qui est en totale contradiction avec les principes affichés par Reagan lors de son arrivée à la tête de l'Etat ;
- la poursuite de l'élimination de vastes pans du secteur industriel (et qui commence à affecter même les secteurs de haute technologie censés créer des quantités mirifiques de nouveaux emplois), la création d nouveaux emplois qui ont fait baisser le chômage revenant au secteur des services, ce qui n'a pu que détériorer la compétitivité d'ensemble de l'économie américaine ;
- la baisse des prix des importations du fait de l'augmentation considérable du taux de change du dollar lequel reposait sur les énormes emprunts faits par l'Etat fédéral pour combler ses déficits.
Comme le mettait en évidence la résolution du 5ème congrès du CCI pour expliquer la récession de 1980-1982 : "Les politiques 'monétaristes' orchestrées par Reagan et suivies par la totalité des dirigeants des pays avancés rendent compte de cette faillite des politiques néo-keynésiennes en laissant émerger la cause profonde de la crise du capitalisme, la surproduction généralisée et ses conséquences inéluctables : la chute de la production, 1'élimination du capital excédentaire, la mise au chômage de millions d'ouvriers, la dégradation massive du niveau de vie de 1 'ensemble du prolétariat." (REVUE INTERNATIONALE N° 35 - 4e trimestre 1983)
La "reprise" de l'économie américaine a été permise par l'abandon momentané de cette politique laquelle avait pour but d'empêcher que "le montant astronomique des dettes sur lequel repose aujourd'hui l'économie mondiale [n'aboutisse] à la mort du malade par un emballement apocalyptique de la spirale inflationniste et l'explosion du système financier international" (ibid).
Ainsi, les limites qu'on voit, dès aujourd'hui, de la "reprise" aux USA sont contenues dans la même réalité qui avait obligé dès 1980 le gouvernement de ce pays à opérer un coup de frein brutal plongeant le monde entier dans la brutale récession de 1980-82 : face à l'engorgement inévitable et croissant des marchés solvables, il ne peut exister pour le capital d'autre perspective que la réduction de la production, des profits, de la force de travail qu'il exploite, des salaires versés à celle-ci. De ce fait, il ne peut exister d'autre "relance" que celle de la fuite en avant de l'endettement, c'est-à-dire l'accumulation à une échelle inconnue par le passé et toujours plus vaste des contradictions qui font de l'économie mondiale un véritable baril de poudre.
5) En réalité, depuis l'entrée de celle-ci dans sa phase de crise ouverte au milieu des années 60, elle n'a eu d'autre alternative que d'osciller de plus en plus brutalement entre la récession (traduction directe des causes de la crise : la saturation des marchés) et l'inflation (qui ne fait que révéler l'abus du crédit et de la planche à billets par lesquels les Etats et les capitalistes ont tenté de contourner cette saturation; Chacune des "reprises" qu'a connues l'économie mondiale à la suite des récessions de 1971, de 1974-75 et de 1980-82 s'est basée sur une nouvelle flambée de l'endettement. C'est principalement le formidable endettement du tiers-monde dans la seconde moitié des années 70 -endettement alimenté par les prêts des banques occidentales en mal de "recyclage" des "pétrodollars"- qui a permis pour un temps aux puissances industrielles de redresser leurs ventes et de relancer leur production.
Après 1982, c'est donc l'endettement encore plus considérable des USA, tant extérieur (qui en fera bientôt le premier débiteur du monde) qu'intérieur (plus de 6 000 milliards de dollars en 1984, soit l'équivalent de la production totale de la RFA pendant 10 ans), qui a permis à ce pays de connaître ses taux de croissance records en 1984 de même que ce sont ses énormes déficits commerciaux qui ont bénéficié momentanément aux exportations de quelques autres pays (telle la RFA) et donc au niveau de leur production.
En fin de compte, de même que l'endettement astronomique des pays du tiers-monde n'avait pu aboutir qu'à un choc en retour catastrophique, en forme d'une austérité et d'une récession sans précédent, l'endettement encore plus considérable de l'économie américaine ne peut, sous peine d'une explosion de son système financier (dont on mesure dès à présent toute la vulnérabilité avec la succession ininterrompue de faillites bancaires), que déboucher sur une nouvelle récession tant de cette économie que des autres économies dont les marchés extérieurs vont se réduire comme peau de chagrin.
La seule perspective qui s’offre au monde, y compris aux pays les plus industrialisés incluant pour la première fois de façon explicite les 2e et 3e puissances industrielles du "bloc de l'Ouest, le Japon et l'Allemagne", est donc :
- un nouveau recul du commerce mondial doublé d'une intensification de la guerre commerciale notamment entre les USA et ses grands "partenaires" tels le Japon et l'Europe de l'ouest ;
- une nouvelle plongée de la production se traduisant par une terrible aggravation du chômage; l'intensification des attaques contre les conditions de vie des ouvriers en forme de baisse des salaires, de réduction des prestations sociales ainsi que d'une aggravation sans précédent des rythmes et des conditions de travail.
Ce que recouvrent les discours sur la "reprise" et sur l"'assainissement" de l'économie c'est une nouvelle progression de la paupérisation absolue qui va atteindre dans les grandes métropoles du capital des niveaux qui, depuis plus de trois décennies, étaient réservés aux pays arriérés. Ainsi les "années de vérité" viennent confirmer un des enseignements importants du marxisme que toutes sortes d'"experts" prétendaient "faux" ou "dépassé " : ce système ne conduit pas seulement à la paupérisation relative de la classe exploitée, c'est bien une paupérisation absolue que subit maintenant de façon grandissante celle-ci, notamment avec le développement du chômage à une échelle massive.
La vérité que ces années révèlent de façon sinistrement éclatante, c'est toute la barbarie dans laquelle le capitalisme décadent enfonce l'ensemble de la société.
LES CONFLITS IMPERIALISTES
6) Cette barbarie du capitalisme décadent se révèle également en filigrane derrière les discours de paix qui occupent en ce moment le devant de la scène. Aussi bien le changement de ton de Reagan laissant de côté ses péroraisons sur "l'empire du mal" au bénéfice d'une main tendue au chef de file du bloc adverse que l'offensive diplomatique "bon enfant" de Gorbatchev, de même que la prochaine rencontre entre ces deux personnages, tout cela ne saurait masquer la poursuite des préparatifs guerriers des deux blocs ni le développement entre eux des tensions impérialistes.
En fait, le seul examen des efforts considérables faits par chacun des deux blocs en faveur des armements démontre la vanité des discours sur la "détente". Ainsi, durant la seule année 1984, les Etats industriels ont dépensé pour 1 000 milliards de dollars d'armements, soit plus que toute la dette cumulée des pays du tiers-monde. Les pays du bloc occidental sont en train de rejoindre ceux du bloc de l'Est dans la soumission complète de l'appareil productif au service de l'effort d'armement :
- dès à présent, ce sont deux tiers des laboratoires de recherche américains qui travaillent directement pour l'armée ;
- dans tous les secteurs de pointe (aéronautique, électronique, télécommunications, robotique, matériels et logiciels informatiques, etc.) les efforts de recherche et d'innovation sont directement déterminés par les besoins militaires lesquels canalisent les meilleures compétences scientifiques et techniques. C'est bien cela qu'illustre de façon éclatante le projet américain de "guerre des étoiles" et son pendant ouest-européen "Eurêka".
A l'échelle mondiale, alors que l'humanité s'enfonce dans une pauvreté et une misère de plus en plus intenables, que se développent les famines et les catastrophes "naturelles" aux effets meurtriers parfaitement évitables, ce sont plus de 10 % de la production qui sont non seulement stérilisés pour les armements mais qui participent indirectement ou directement par les destructions que ces derniers provoquent, à l'aggravation et à la multiplication de toutes ces calamités (comme par exemple en Ethiopie et au Mozambique où les terribles famines qui y sévissent résultent bien moins des conditions climatiques que de la guerre qui dévaste en permanence leur territoire).
La croissance des armements des deux blocs n'est pas seule à révéler la dimension et l'intensité présentes des tensions impérialistes. Cette intensité est à la mesure des enjeux considérables qui sont en cause dans toute la chaîne des conflits locaux qui déchirent la planète. Cette dimension est donnée par l'ampleur et les objectifs de l'offensive présente du bloc US.
7) Cette offensive a pour objectif de parachever l'encerclement de l'URSS, de dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct. Cette offensive a pour priorité une expulsion définitive de l'URSS du Moyen-Orient, une mise au pas de l'Iran et la réinsertion de ce pays dans le bloc US comme pièce importante de son dispositif stratégique. Elle a pour ambition de se poursuivre par une récupération de l'Indochine. Elle vise en fin de compte à étrangler complètement l'URSS, à lui retirer son statut de puissance mondiale.
La phase présente de cette offensive qui débute au lendemain de l'invasion de l'Afghanistan par les armées de l'URSS (qui constitue une avancée importante de celle-ci en direction des "mers chaudes") a d'ores et déjà atteint des objectifs importants :
- la prise de contrôle complète du Proche-Orient où la Syrie, précédemment liée au bloc russe et grande perdante avec l'OLP de l'invasion du Liban par Israël en 1982, est devenue une des pièces du dispositif américain se partageant avec Israël le rôle de "gendarme" de cette région et où la résistance des fractions bourgeoises récalcitrantes (OLP) est progressivement brisée ;
- l'alignement de l'Inde suite à l'assassinat d'Indira Gandhi en 1984 ;
- l'épuisement progressif de l'Iran (qui est la condition de son retour complet dans le giron américain) suite à la terrible guerre menée avec l'Irak qui bénéficie du soutien du bloc US par la France interposée ;
- une plus grande intégration de la Chine dans sa stratégie envers l'URSS et l'Indochine.
Une des caractéristiques majeures de cette offensive est l'emploi de plus en plus massif par le bloc de sa puissance militaire, notamment par l'envoi de corps expéditionnaires américains ou d'autres pays centraux (France, Grande-Bretagne, Italie) sur le terrain des affrontements (comme ce fut en particulier le cas au Liban pour "convaincre" la Syrie de la "nécessité" de s'aligner sur le bloc US et au Tchad, afin de mettre un terme aux velléités d'indépendance de la Libye), ce qui correspond au fait que la carte économique employée abondamment par le passé pour mettre la main sur les positions de l'adversaire ne suffit plus :
- du fait des ambitions présentes du bloc US;
- du fait de l'aggravation de la crise mondiale elle-même qui crée une situation d'instabilité interne dans les pays du tiers-monde sur lesquels s'appuyait auparavant ce bloc.
L'offensive présente du bloc US n'est pas en contradiction avec le fait que, dans la période de décadence du capitalisme, ce soit le bloc le moins bien loti dans le partage du monde qui, en dernier ressort, entraîne l'ensemble de la société dans la guerre généralisée (puissances "centrales" en 1914, de l'"Axe" en 1939). Certes, la situation présente se différencie de celle qui a précédé la seconde guerre mondiale par le fait que c'est maintenant le bloc le mieux loti qui est à l'offensive :
- parce qu'il dispose d'une énorme supériorité militaire et notamment d'une très grande avance technologique ;
- dans la mesure où, en se prolongeant beaucoup plus longtemps que lors des années 30, sans qu'elle puisse déboucher sur un conflit généralisé, la crise prolonge et provoque un déploiement beaucoup plus vaste des préparatifs à un tel conflit, préparatifs pour lesquels, évidemment, le bloc économiquement le plus puissant est le mieux armé.
Cependant, pour l'URSS, les enjeux sont considérables; c'est, pour ce pays, une question de vie ou de mort qui est au bout de l'offensive du bloc US comme l'a démontré son acharnement à conserver jusqu'au dernier moment, avec la Syrie, une position au Moyen-Orient. Et si, finalement, cette offensive atteint ses objectifs ultimes (ce qui suppose qu'elle ne soit pas entravée par la lutte de classe), il ne restera à l'URSS pas d'autre alternative que de jouer la carte désespérée d'une percée vers les métropoles européennes -enjeu réel de tout conflit inter impérialiste-, en d'autres termes de faire appel aux terribles moyens de la guerre généralisée.
8) L'aggravation présente des tensions impérialistes, la menace qu'elles font peser sur la vie même de l'humanité sont la traduction directe de l'impasse dans laquelle se trouve l'économie capitaliste, de la faillite historique totale du système.
Dans les "années de vérité" se révèle donc dans une hideuse clarté, le fait qu'avec l'aggravation des convulsions de l'infrastructure économique de la société la guerre économique débouche nécessairement sur la guerre des armes, que les moyens économiques cèdent le pas aux moyens militaires. Si, autrefois, la force militaire venait appuyer et garantir les positions économiques acquises ou à acquérir, aujourd'hui l'économie sert de plus en plus d'auxiliaire aux besoins de la stratégie militaire. Toute l'activité économique a pour base le soutien à la force militaire. L'économie mondiale s'enfonce dans le gouffre béant de la production d'armements. Le militarisme qui, contrairement à l'affirmation de Rosa Luxemburg, n'a jamais constitué un véritable champ d'accumulation, est devenu par contre le terrain où se réalise l'effondrement de la production capitaliste et du capitalisme, dans son ensemble, comme système historique.
Il ne s'agit là nullement d'un abandon du marxisme lequel considère qu'en dernière instance c'est la base économique qui détermine toute la vie de la société. En effet, l'entrée du capitalisme dans la période de décadence est déterminée par des causes économiques et l'histoire de la décadence suit l'enfoncement de plus en plus complet de l'économie capitaliste dans l'impasse. De même, il est clair que c'est l'aggravation actuelle de la crise qui provoque une accentuation de la pression vers la guerre généralisée, pression qui est une donnée permanente de la vie de la société depuis le début de la décadence.
Mais ce qu'il importe de souligner c'est que, dans la décadence du capitalisme, la guerre -même si elle est déterminée par la situation économique- a perdu toute rationalité économique, contrairement au siècle dernier où elle était, malgré le coût et les massacres qu'elle occasionnait, un moyen de la marche en avant du développement des forces productives du capitalisme, ce qui en quelque sorte la "rentabilisait" pour l'ensemble de ce système.
Ce qui s'est révélé déjà dans les deux premières guerres mondiales : le caractère uniquement destructeur de la guerre dans la période de décadence, le fait que même les pays vainqueurs (à l'exception des USA dont le territoire se situait hors du champ de bataille) sortaient considérablement affaiblis du conflit, trouve aujourd'hui son plein épanouissement avec le fait patent qu'une troisième guerre mondiale n'apporterait aucun avantage économique ni au capitalisme dans son ensemble ni même à une quelconque de ses fractions nationales. Et si ce fait évident n'empêche cependant pas la bourgeoisie de la préparer, cela traduit bien cette réalité que dans la période de décadence le processus qui conduit à la guerre est un mécanisme qui échappe complètement au contrôle de la bourgeoisie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est le plein développement d'une tendance qui existe depuis le début du siècle et non un phénomène "nouveau". Cependant, en atteignant son point extrême, cette tendance introduit une donnée nouvelle : la menace d'une destruction totale de l'humanité que seule la lutte du prolétariat peut empêcher. Jamais dans l'histoire n'aura été posée avec autant de terrible clarté l'alternative "socialisme ou barbarie". Jamais le prolétariat n'aura eu une si formidable responsabilité que celle qui est la sienne dans la période présente.
LA LUTTE DE CLASSE
9) La clé de toute la situation historique est entre les mains de la classe ouvrière. C'est justement ce que la bourgeoisie essaie de lui cacher en s'employant à la convaincre qu'elle est impuissante, que ses grands combats contre le capitalisme appartiennent à un passé définitivement révolu. C'est ce que ne voient pas non plus beaucoup de groupes révolutionnaires qui sont incapables de comprendre la nature du cours historique actuel et qui aujourd'hui se lamentent sur la "faiblesse des luttes ouvrières", montrant par là qu'ils sont eux-mêmes victimes des campagnes de la bourgeoisie.
En effet, le constat de l'aggravation des tensions impérialistes, de même que celui d'un certain nombre de défaites comme celles de 1981 en Pologne ne saurait conduire à la conclusion que la bourgeoisie a les mains libres pour donner sa seule réponse propre à la crise de son système : la guerre impérialiste généralisée. L'analyse du cours historique telle que l'a développée le CCI prend en effet en compte les éléments suivants :
a) par définition, un cours historique est donné pour toute une période historique. Il n'est pas conditionné par des événements conjoncturels ou de faible portée. Seuls des événements majeurs dans la vie de la société sont en mesure de le remettre en cause : la longue dégénérescence opportuniste de la 2ème Internationale, le complet déboussolement du prolétariat qu'elle traduisait et qu'elle a aggravé, étaient la condition de l'ouverture du cours vers la 1ère guerre mondiale ; trois années de guerre impérialiste généralisée, provoquant des massacres et des souffrances d'une ampleur inconnue auparavant, furent le prix à payer pour un nouveau renversement du cours en faveur du prolétariat ;. la longue série de défaites du prolétariat depuis l'Allemagne en 1919 jusqu'à la Chine en 1927, défaites aggravées par la dégénérescence de la révolution en Russie et de l'Internationale communiste ainsi que par le rétablissement momentané de l'économie capitaliste entre 1923 et 1929, furent nécessaires à la bourgeoisie pour se libérer de l'entrave prolétarienne à sa propre logique ; l'apparition de nouvelles générations ouvrières n'ayant connu ni la défaite, ni la guerre mondiale, l'épuisement tant du mythe de l'URSS -patrie du socialisme"- que de la mystification anti-fasciste, l'entrée du capitalisme dans une nouvelle crise ouverte de son économie, ont été les conditions nécessaires au rétablissement d'un cours aux affrontements de classe.
b) Le cours historique actuel ne saurait être remis en causes par des défaites partielles ou frappant, même durement, le prolétariat dans des pays secondaires ou périphériques comme la Pologne en 1981. Seule une succession de défaites à la suite de combats décisifs menés par le prolétariat dans les pays centraux, et notamment ceux d'Europe occidentale, serait en mesure d'ouvrir les portes à un cours vers la guerre.
c) L'existence d'un cours aux affrontements de classe n'implique nullement la disparition ni des antagonismes impérialistes ni des conflits entre blocs ni de l'aggravation de ces conflits ni des préparatifs militaires en vue d'une troisième guerre mondiale. En particulier, dans la période présente, seules des luttes d'une ampleur exceptionnelle, comme celles de Pologne en 80, peuvent avoir un impact immédiat sur les tensions entre l'Est et l'Ouest. A l'intérieur du cadre qui lui est tracé par le cours historique, la bourgeoisie continue à disposer d'une certaine marge de manoeuvre. Ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est donc pas la capacité de telle ou telle poussée des luttes à faire reculer les productions d'armements ou de faire taire tel ou tel conflit entre les blocs, c'est le fait que les réserves de combativité que ces luttes expriment interdisent que ces conflits impérialistes ne se développent jusqu'à leur aboutissement extrême : la conflagration mondiale.
d) L'existence d'un cours historique aux affrontements de classe ne signifie nullement que le prolétariat développe ses luttes de façon continue, que les combats de classe atteignent mois après mois ou année après année une ampleur et une profondeur toujours croissantes. Une telle vision serait totalement en désaccord avec toute l'expérience historique du prolétariat, elle serait en contradiction avec ce que Marx signalait déjà dans son texte sur "le 18 Brumaire" et que Rosa Luxemburg, avec beaucoup d'autres grands révolutionnaires, a analysé par la suite : le mouvement d'avancées et de reculs de la lutte de la classe dans sa progression vers les affrontements décisifs contre le capitalisme. Elle contredirait également le fait qu'avec la période de décadence, loin de disparaître, un tel phénomène ne fait que s'amplifier, ce qui conduit à l'existence au sein d'un cours aux affrontements de classe (lui-même traduction à une grande échelle de ce phénomène) d'une succession . de vagues de luttes, d'assauts répétés contre la forteresse capitaliste, entrecoupés par des moments de défaite partielle, de désarroi, de démoralisation.
10) La thèse de la "passivité" de la classe ouvrière, que la propagande bourgeoise a réussi à faire avaler à certains révolutionnaires, si elle pouvait avoir une apparence de réalité à certains moments du passé comme lors de la défaite du prolétariat en Pologne en 1981, est aujourd'hui totalement contredite par les faits. Elle est en particulier démentie par le formidable développement des luttes ouvrières à partir de la deuxième moitié de 1983 dont le CCI, dès janvier 1984, a analysé les conditions de surgissement et les caractéristiques : "La vague présente de lutte s'annonce d'ores et déjà comme devant dépasser en ampleur et en importance les deux vagues qui l'ont précédée depuis la reprise historique de la fin des années 60 : celle de 1968-74, et celle de 1978-80 [...] Elle tire sa source de 1'épuisement de ce qui avait permis le recul de 1'après-Pologne :
- reste des illusions propres aux années 70 qui ont été définitivement balayées par la très forte récession de 1980-82 ;
- désarroi momentané provoqué tant par le passage de la gauche dans l'opposition que par la défaite en Pologne.
Elle démarre :
- à partir d'une longue période d'austérité et de montée du chômage, d'une intensification des attaques économiques contre la classe ouvrière dans les pays centraux ;
- à la suite de plusieurs années d'utilisation de la carte de la gauche dans 1'opposition et de l'ensemble des mystifications qui y sont associées.
Pour ces raisons, elle va se poursuivre par des engagements de plus en plus puissants et déterminés du prolétariat des métropoles contre le capitalisme dont le point culminant se situera de ce fait à un niveau supérieur a celui de chacune des vagues précédentes.
Les caractéristiques de la vague présente, telles qu'elles se sont déjà manifestées et qui vont se préciser de plus en plus, sont les suivantes :
- tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de 1'extension géographique des luttes ;
- tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant, en particulier à leur début, un certain débordement des syndicats ;
- simultanéité croissante des luttes au niveau international, jetant les jalons pour la future généralisation mondiale des luttes ;
- développement progressif au sein de 1 'ensemble du prolétariat de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité de s'opposer comme classe aux attaques capitalistes ;
- rythme lent du développement des luttes dans les pays centraux et notamment de 1'aptitude à leur auto organisation, phénomène qui résulte du déploiement par la bourgeoisie de ces pays de tout son arsenal de pièges et mystifications". (Revue Internationale N° 37, pp. 4-5).
11) Aujourd'hui, cette analyse reste tout à fait valable. Elle a été confirmée par l'étendue et la simultanéité sans précédent de cette 3ème vague de luttes. Cette simultanéité a été la plus marquée en Europe occidentale, épicentre de la révolution prolétarienne. Elle s'accompagne de luttes massives qui se sont développées dans le tiers-monde. En conséquence, cette analyse n'est pas contradictoire avec le constat du faible nombre de jours de grève dans un certain nombre de pays (telles la France et l'Italie) au cours de l'année écoulée, constat sur lequel s'appuient les médias bourgeois pour asséner de façon répétée l'idée d'une "passivité" de la classe ouvrière, d'une acceptation résignée de son sort. En particulier, rien n'autorise à dire que la 3ème vague de luttes serait d'ores et déjà épuisée, que nous serions entrés dans une situation semblable à celle de l'après-Pologne. En effet :
- on ne peut juger de façon immédiate, sur la base de faits qui ne couvrent qu'une courte durée dans un pays donné, de la situation d'ensemble à l'échelle internationale d'autant plus que la vague actuelle se distingue, comme nous l'avons mis en évidence, par le rythme lent de son développement : lorsque des révolutionnaires emploient une telle méthode à courte vue, comme c'est le cas aujourd'hui pour certains d'entre eux, ils ne l'empruntent pas au marxisme mais à l'idéologie bourgeoise et ne font que refléter passivement les hésitations qui traversent la classe dans son ensemble ;
- le surgissement de mouvements de grande ampleur, tels que les grèves de septembre 1983 en Belgique, les luttes des mineurs et des dockers en Grande-Bretagne, ou la grève générale au Danemark au printemps 1983, s'ils expriment une tendance de la 3ème vague de luttes, n'en sont pas pour autant une donnée permanente. Dans les expressions de combativité ouvrière -même plus limitées- qui continuent de se manifester à l'échelle internationale et où la classe ouvrière fait l'expérience concrète des obstacles à l'extension de sa lutte, mûrissent les conditions de nouveaux affrontements d'ensemble ;
- le prolétariat s'est engagé depuis deux ans dans un combat de longue haleine. Un tel combat passe également inévitablement par des moments de répit, de maturation, de réflexion. Mais, contrairement à la situation de l'après-Pologne où un court mais réel recul s'est ouvert sur une défaite internationale de la classe et a pris la forme d'une chape de plomb de deux années pesant sur l'ensemble des pays centraux d'Europe occidentale, les actuels moments de répit (reflétés par la diminution du nombre de jours de grève dans tel ou tel pays) que peut s'accorder aujourd'hui la classe restent limités dans le temps comme dans l'espace, et bien que la bourgeoisie fasse tout pour transformer cet effort de réflexion qui s'opère dans la classe en expectative et en passivité, la situation reste caractérisée par une accumulation de mécontentement et de combativité potentielle prête à exploser d'un moment à l'autre, comme l'ont montré les récents événements en France (Dunkerque, SNCF, etc.) ;
- le fait que dans des pays où la classe ouvrière est traditionnellement combative, comme la France et surtout l'Italie, les grèves se soient situées ces derniers temps à un niveau numérique particulièrement bas ne saurait enlever toute la signification qu'apporte à l'ensemble du mouvement de la classe la très forte combativité qui s'est manifestée au même moment dans les pays habitués à la "paix sociale" comme notamment les pays Scandinaves;
- en tout état de cause, les statistiques sur les jours de grève, si elles sont un élément que les révolutionnaires doivent savoir étudier et prendre en considération, ne sauraient traduire à elles seules le degré exact de mécontentement, de combativité et de conscience qui existe au sein de la classe ; en particulier il existe aujourd'hui un indice beaucoup plus significatif de l'état d'esprit qui règne dans le prolétariat et de ses potentialités de combat : c'est la méfiance de plus en plus massive qui se développe partout à l'égard des syndicats et qui se traduit notamment par un chute accélérée de leurs effectifs.
12) Si le phénomène présent de désyndicalisation revêt une telle importance, c'est du fait du rôle spécifique que joue à l'heure actuelle le syndicalisme en tant que fer de lance de la carte bourgeoise de la gauche dans l'opposition. En effet, si les partis politiques de gauche sont tout naturellement désignés pour détenir le rôle moteur dans la stratégie de la gauche au pouvoir ou candidate au pouvoir (comme au milieu des années 70), la stratégie de la gauche dans l'opposition qui se caractérise par un langage et une pratique sensés traduire de façon directe les préoccupations et les revendications ouvrières, s'appuie principalement sur les institutions bourgeoises les plus proches de la vie quotidienne des ouvriers et présentes sur les lieux de travail : les syndicats.
Face aux deux nécessités vitales de la lutte ouvrière: l'extension et l'auto organisation, c'est en effet aux syndicats qu'il revient :
- de désorienter les ouvriers, de développer chez eux un sentiment d'impuissance par de multiples divisions entre centrales différentes ou entre "base" et "sommet" ;
- d'enfermer et d'isoler les luttes sur le terrain corporatiste, sectoriel et localiste ;
- de promouvoir, face au danger d'extension réelle, de fausses extensions tendant à noyer les secteurs les plus combatifs -comme ce fut le cas en Belgique en septembre 1983- ou bien tendant à faire de l'extension l'affaire d'une branche industrielle (grève des mineurs en Grande-Bretagne) ou même des différentes usines d'une même entreprise (Renault en France, en octobre 1985) ;
- de prévenir tout surgissement spontané de luttes, toute tendance à l'auto organisation en prenant les devants par des appels à "l'action" démobilisateurs et en s'installant à la tête des mouvements dès leur surgissement.
Cette tactique de la bourgeoisie visant à occuper le terrain, et qui constitue la composante essentielle de sa stratégie de gauche dans l'opposition, a été large ment employée en 1985. Elle constitue à l'heure actuelle une véritable offensive politique de la bourgeoisie contre le prolétariat.
Ce dernier ne peut éviter cette bataille politique qui lui est imposée. Il ne peut, ni ne doit, laisser les partis de gauche et les syndicats manoeuvrer librement sur le terrain de la défense de ses conditions de vie, mais s'opposer et s'affronter résolument et systématiquement sur ce terrain à leurs manoeuvres.
C'est au premier rang de ce combat politique que le prolétariat doit assumer que les révolutionnaires doivent s'imposer sur le terrain, par la mise en avant des nécessités d'extension et d'auto organisation et par la dénonciation des manoeuvres et obstacles des syndicats.
C'est par les confrontations répétées du prolétariat à toutes ces manoeuvres, notamment dans les métropoles du capitalisme d'Europe occidentale où ses secteurs les plus concentrés, anciens et développés politiquement font face à la bourgeoisie la plus expérimentée, celle qui est en mesure d'élaborer les pièges les plus sophistiqués, ce n'est qu'à travers ces confrontations dès à présent engagées qu'il forge ses armes, qu'il se rend et se rendra de plus en plus capable de développer l'arme de la grève de masse, d'étendre et de généraliser ses combats à l'échelle internationale et d'engager les affrontements décisifs contre le capitalisme, ceux de la période révolutionnaire.
13) C'est pour cet ensemble de raisons que le développement actuel de la méfiance à l'égard des syndicats constitue une donnée essentielle du rapport de forces entre les classes et donc de toute la situation historique. Cependant, cette méfiance elle-même est en partie responsable, de façon immédiate", de la réduction du nombre de luttes dans différents pays et plus particulièrement là où justement le discrédit des syndicats est le plus fort (comme en France, suite à l'arrivée accidentelle de la gauche au pouvoir en 1981). Lorsque pendant des décennies les ouvriers ont eu l'illusion qu'ils ne pouvaient mener des combats que dans le cadre des syndicats et avec l'appui de ceux-ci, la perte de confiance en ces organes s'accompagne de façon momentanée d'une perte de confiance en leur propre force et les conduit à opposer la passivité à tous les soi-disant "appels à la lutte" qui en émanent. C'est justement là-dessus que tendent de plus en plus à jouer les syndicats : incapables d'enrôler plus longtemps les ouvriers derrière leurs banderoles et leurs slogans, ils utilisent habilement la passivité et le scepticisme que rencontrent leurs appels pour tenter de transformer cette passivité en démoralisation, pour participer à leur façon, tout en s'en défendant évidemment, aux campagnes sur la "disparition des luttes de classe" qui visent à saper la confiance en soi du prolétariat. En ce sens, la passivité qu'observent encore à l'égard des "actions" appelées par les syndicats (grèves et manifestations) beaucoup d'ouvriers parmi les plus combatifs, si elle est parfaitement explicable et traduit la nécessaire perte d'illusions à l'égard du syndicalisme, ne doit pas être considérée en elle-même comme un élément positif puisqu'elle correspond exactement à ce qu'attend la bourgeoisie de ces ouvriers en cette circonstance. Le seul moyen pour eux de déjouer ce type de pièges consiste -et les révolutionnaires doivent les encourager dans ce sens- non pas à se détourner de ce type d'actions mais au contraire de mettre à profit toutes les occasions de rassemblement des ouvriers sur des questions touchant à la défense de leurs intérêts de classe et même si elles proviennent de manoeuvres syndicales, pour y participer activement et le plus massivement possible afin de transformer ces rassemblements en des lieux où s'expriment l'unité de la classe au-delà des divisions sectorielles, sa combativité et sa détermination comme ce fut le cas par exemple le 1er mai 1983 à Hambourg. De même qu'il n'existe aucun principe pour les révolutionnaires de refuser d'appeler à des mouvements "lancés" par les syndicats, l'appel à la présence dans ce type de mouvements ne saurait être une recette applicable en toutes circonstances, mais doit être évalué en fonction des potentialités immédiates de transformation de ces actions, sachant que les conditions de ces transformations seront de plus en plus souvent réunies.
Du fait de l'énorme mécontentement qui se développe dans la classe et qui ne pourra que s'accroître avec le nouveau déferlement des attaques capitalistes qui accompagneront nécessairement la récession qui s'annonce, du fait du potentiel considérable de combativité qui s'accumule en profondeur et dont on a pu deviner la force encore dernièrement avec la grève des chemins de fer en France, du fait que l'extension des luttes est ressentie comme un besoin impérieux par des masses croissantes d'ouvriers, toute manifestation de réelle combativité ouvrière, toute tentative décidée d'extension des luttes est et sera de plus en plus grosse de surgissements de classe de très grande ampleur. Et c'est principalement dans le combat pour l'extension, face aux obstacles que les syndicats opposent et opposeront à de tels mouvements que s'imposera de plus en plus aux ouvriers des grandes métropoles capitalistes, notamment ceux d'Europe occidentale, la nécessité de l'auto organisation de leur combat.
14) La question de l'extension des luttes, du dépassement des barrières sectorielles et professionnelles, est donc au centre de toute la perspective des combats de la classe dans la période présente. Et c'est par la généralisation à tous les secteurs ouvriers de l'attaque capitaliste que se développent les conditions d'une réponse à cette question. Or l'accroissement présent dans des proportions inconnues depuis un demi-siècle du nombre des chômeurs, et qui est le résultat le plus marquant de cette attaque généralisée, constitue un facteur puissant de maturation de ces conditions dans la mesure où :
- c'est toute la classe ouvrière, et non seulement les ouvriers chômeurs, qui est touchée par le chômage, notamment par la baisse du niveau de vie que représente pour nombre de familles ouvrières le fait de compter en leur sein un ou plusieurs chômeurs ;
- le chômage fait disparaître les barrières catégorielles du fait même de l'éjection des ouvriers des lieux de production, qui a également comme conséquence un moindre encadrement par l'appareil syndical ;
- par la paupérisation absolue qu'il représente, le chômage indique le futur qui attend l'ensemble de la classe ouvrière et, partant, la perspective de ses combats futurs vers le renversement du capitalisme.
En fait, au même titre que le développement vertigineux du militarisme, mais de façon beaucoup plus directement compréhensible pour les ouvriers, l'accroissement irrémédiable du chômage est l'indice irréfutable de l'aberration que constitue aujourd'hui le capitalisme lequel plonge des masses croissantes d'ouvriers dans la misère totale non pas parce qu'il produit trop peu mais parce qu'il produit trop. Plus généralement, l'éjection hors du travail salarié de masses toujours croissantes d'ouvriers signe la faillite totale d'un mode de production dont le rôle historique était justement d'étendre le salariat.
Pour l'ensemble de ces raisons, le chômage constituera de plus en plus un facteur essentiel de prise de conscience pour l'ensemble de la classe des véritables enjeux des combats qu'elle mène, du fait qu'il lui échoit la tâche historique d'abolir un système qui conduit la société à de telles aberrations.
En ce sens, le chômage va jouer, plus lentement mais de manière infiniment plus profonde et positive, le rôle de la guerre dans l'émergence de la révolution en Russie et en Allemagne en 1917-18.
De même, les ouvriers au chômage tendront de plus en plus à se retrouver aux avant-postes des combats de classe jouant ainsi un rôle comparable à celui des soldats dans la révolution russe de 1917.
Contrairement donc à ce que prétendent la bourgeoisie et certains révolutionnaires particulièrement myopes, et même s'il peut dans un premier temps créer un certain désarroi dans la classe, le chômage n'est nullement un facteur d'atténuation des luttes ouvrières. Il deviendra au contraire un élément essentiel de leur développement jusqu'à la période révolutionnaire.
15) C'est l'affrontement révolutionnaire avec le capitalisme qui constitue la perspective ultime des luttes que mène dès aujourd'hui la classe ouvrière. Par ailleurs, la situation présente recèle d'énormes potentialités de surgissements prolétariens de grande envergure.
La faillite totale du capitalisme que révèlent les années de vérité, de même qu'elle conduit à une accélération de l'histoire sur le plan des conflits impérialistes, provoque également une telle accélération sur le plan du développement de la lutte de classe, ce qui se traduit en particulier par le fait que les moments de recul de la lutte (comme celui de 1981-83) sont de plus en plus brefs alors que le point culminant de chaque vague de combats se situe à un niveau plus élevé que le précédent. Et cette accumulation d'expériences de lutte du prolétariat, comme la proximité de plus en plus grande entre chacune d'elles, constitue un élément essentiel de prise de conscience par l'ensemble de la classe des véritables enjeux de son combat. C'est pour cela qu'il importe que les révolutionnaires soient particulièrement vigilants face aux potentialités de la période présente et en particulier qu'ils ne sous-estiment pas ces potentialités.
Cependant, cela ne veut nullement dire que nous soyons déjà entres dans la phase des combats qui conduisent directement à la période révolutionnaire. Celle-ci se trouve encore loin devant nous. Il en est ainsi à cause du rythme lent avec lequel se réalise l'effondrement irréversible du capitalisme et du fait de la formidable capacité de résistance politique de la bourgeoisie qu'affronte aujourd'hui le prolétariat là où se décide la situation historique mondiale, les grandes métropoles du capitalisme, et plus particulièrement celles d'Europe de l'Ouest.
Mais ce ne sont pas là les seuls éléments. Pour comprendre toutes les données de la période présente et à venir, il faut également prendre en considération les caractéristiques du prolétariat qui aujourd'hui mène le combat :
- il est composé de générations ouvrières qui n'ont pas subi la défaite, comme celles qui sont arrivées à maturité dans les années 30 et au cours de la 2ème guerre mondiale; de ce fait, en l'absence de défaite décisive que la bourgeoisie n'a pas réussi à leur infliger jusqu'à présent, elles conservent intactes leurs réserves de combativité ;
- ces générations bénéficient d'une usure irréversible des grands thèmes de mystification (la patrie, la civilisation, la démocratie, l'anti-fascisme, la défense de l'URSS) qui avaient permis par le passé l'embrigadement du prolétariat dans la guerre impérialiste.
Ce sont ces deux caractéristiques essentielles qui expliquent que le cours historique actuel soit aux affrontements de classe et non à la guerre impérialiste. Cependant, ce qui fait la force du prolétariat actuel fait aussi sa faiblesse : du fait même que seules des générations qui n'avaient pas connu la défaite étaient aptes à retrouver le chemin des combats de classe, il existe entre ces générations et celles qui ont mené les derniers combats décisifs, dans les années 20, un fossé énorme que le prolétariat d'aujourd'hui paie au prix fort :
- d'une ignorance considérable de son propre passé et de ses enseignements ;
- du retard dans la formation du parti révolutionnaire.
Ces caractéristiques expliquent en particulier le caractère éminemment heurté du cours actuel des luttes ouvrières. Elles permettent de comprendre les moments de manque de confiance en soi d'un prolétariat qui n'a pas conscience de la force qu'il peut constituer face à la bourgeoisie. Elles montrent également la longueur du chemin qui attend le prolétariat, lequel ne pourra faire la révolution que s'il a consciemment intégré les expériences du passé et s'est donné son parti de classe.
Avec le surgissement historique du prolétariat à la fin des années 1960 a été mise à l'ordre du jour la formation de celui-ci mais sans que cela puisse se réaliser du fait :
- du "creux d'un demi-siècle qui nous sépare des anciens partis révolutionnaires ;
- de la disparition ou de l'atrophie plus ou moins marquée des fractions de gauche qui s'en étaient dégagées ;
- de la méfiance de beaucoup d'ouvriers à l'égard de toute organisation politique (qu'elle soit bourgeoise ou prolétarienne) qui est une expression du danger de conseillisme, tel qu'il a été identifié par le CCI, une traduction d'une faiblesse historique du prolétariat face à la nécessaire politisation de son combat.
Il appartient aux groupes révolutionnaires qui existent aujourd'hui de préparer activement les conditions de cette formation, non pas en s'autoproclamant le Parti, ou en ne présentant d'autre perspective aux masses ouvrières que de se rallier à leur drapeau comme aiment à le faire les bordiguistes, mais en développant un travail systématique de regroupement des forces révolutionnaires et d'intervention dans la classe. C'est notamment à travers cette intervention, si elle est capable de mettre en avant des propositions de marche correspondant aux besoins de la classe, que les révolutionnaires feront la preuve concrète auprès des ouvriers de la nécessité d'une organisation révolutionnaire jetant ainsi les bases du futur parti de la révolution communiste.
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Résolution : l'opportunisme et le centrisme dans la période de décadence
- 3111 reads
1. Il existe une différence fondamentale entre l'évolution des partis de la bourgeoisie et l'évolution des partis de la classe ouvrière.
Les premiers, du fait qu'ils sont les organes politiques d'une classe dominante, ont la possibilité d'agir dans la classe ouvrière et certains d'entre eux le font effectivement car ceci fait partie d'une division du travail au sein des forces politiques de la bourgeoisie dont une partie a la tâche particulière de mystifier le prolétariat, de mieux le contrôler en le faisant de l'intérieur, et de le détourner de sa lutte de classe. À cette fin, la bourgeoisie utilise de préférence d'anciennes organisations de la classe ouvrières passées dans le camp de la bourgeoisie.
Par contre, la situation inverse d'une organisation prolétarienne agissant dans le camp de la bourgeoisie ne peut jamais exister. Il en est ainsi du prolétariat, comme de toute classe opprimée, parce que la place que lui fait occuper dans l'histoire le fait d'être une classe exploitée ne peut jamais faire de lui une classe exploiteuse.
Cette réalité peut donc être résumée dans l'affirmation lapidaire suivante :
- il peut, il doit exister et il existe toujours des organisations politiques bourgeoises agissant dans le prolétariat ;
- il ne peut jamais exister, par contre, comme le démontre toute l'expérience historique, des partis politiques prolétariens agissant dans le camp de la bourgeoisie.
2. Ceci n'est pas seulement vrai pour ce qui concerne des partis politiques structurés. C'est également vrai pour ce qui concerne des courants politiques divergents pouvant naître éventuellement au sein de ces partis. Si des membres des partis politiques existants peuvent passer d'un camp dans l'autre et cela dans les deux sens (du prolétariat à la bourgeoisie et de la bourgeoisie au prolétariat) , cela ne peut être qu'un fait individuel. Par contre, le passage collectif d'un organisme politique déjà structuré ou en formation dans les partis existants ne peut obligatoirement se produire que dans un sens unique : des partis du prolétariat à la bourgeoisie et jamais dans le sens contraire : des partis bourgeois au prolétariat. C'est-à-dire qu'en aucun cas un ensemble d'éléments en provenance d'une organisation bourgeoise ne peut évoluer vers des positions de classe sans une rupture consciente avec toute idée de continuité avec son éventuelle activité collective précédente dans le camp contre-révolutionnaire. Autrement dit, s'il peut se former et se développer des tendances, dans les organisations du prolétariat, évoluant vers des positions politiques de la bourgeoisie et véhiculant cette idéologie au sein de la classe ouvrière, ceci est absolument exclu concernant les organisations de la bourgeoisie.
3. L'explication du constat qui précède réside dans le fait essentiel que la classe économiquement dominante dans la société est également dominante sur les plans politique et idéologique. Ce fait explique également :
- l'influence qu'exerce l'idéologie de la bourgeoisie sur 1'immense majorité de la classe ouvrière, idéologie dont celle-ci ne peut se dégager que très partiellement jusqu'au moment de la révolution ;
- les vicissitudes et les difficultés du procès de prise de conscience par l'ensemble de la classe de ses intérêts et surtout de son être historique, lesquelles déterminent un mouvement constant de victoires partielles et de défaites dans ses luttes, se traduisant par des avancées et des reculs dans l'extension de sa prise de conscience ;
- le fait obligatoire et inéluctable que ce soit seulement une petite minorité de la classe qui puisse parvenir à se dégager suffisamment (mais non totalement) de la chape de plomb de l'idéologie bourgeoise dominante pour entreprendre un travail théorique systématique et cohérent ainsi que d'élaboration des fondements politiques fécondant ainsi le processus de prise de conscience et le développement de la lutte immédiate et historique de la classe ;
- la fonction indispensable et irremplaçable dont la classe charge les minorités qu'elle secrète, fonction qui ne peut être accomplie par des individus ou de petits cénacles intellectuels, mais uniquement par des éléments qui se hissent à la compréhension des tâches pour lesquelles la classe, dans le développement de sa lutte, les a produits: ce n'est qu'en se structurant, en donnant naissance à une organisation politique centralisée et militante au sein des luttes ouvrières, que cette minorité, produit de la classe, peut assumer sa fonction d'être un facteur actif, un creuset dans lequel et avec lequel la classe forge les armes indispensables de sa victoire finale ;
- la raison pour laquelle des courants opportunistes et centristes peuvent se manifester au sein de la classe exploitée et révolutionnaire ainsi que dans les organisations de cette classe, et uniquement dans cette classe et ses organisations. En ce sens, parler d'opportunisme et de centrisme (par rapport au prolétariat) dans la bourgeoisie n'a aucun sens car jamais une classe dominante ne renonce, de par sa propre volonté, à ses privilèges en faveur de la classe qu'elle exploite (ce qui fait d'elle justement une classe dominante).
4. Deux sources sont à la base de l'apparition des tendances opportunistes et centristes dans la classe ouvrière : la pression et l'influence de l'idéologie de la bourgeoisie et le difficile procès de la maturation et de la prise de conscience par le prolétariat. Ce qui se traduit notamment par la caractéristique majeure de l'opportunisme qui consiste à isoler, séparer le but final du mouvement prolétarien des moyens qui y conduisent pour finalement les opposer, alors que toute remise en cause des moyens amène à la négation du but final, de même que toute remise en cause de ce but tend à ôter leur signification prolétarienne aux moyens mis en œuvre. Dans la mesure même où il s'agit là de données permanentes dans l'affrontement historique entre prolétariat et bourgeoisie, il apparaît donc que l'opportunisme et le centrisme sont bien des dangers qui menacent la classe de façon permanente, tant dans la période de décadence que dans la période ascendante. Cependant, de la même façon que ces deux sources sont liées entre elles, elles sont également en liaison quant à la façon dont elles affectent le mouvement de la classe, avec l'évolution générale du capitalisme et le développement de ses contradictions internes. De ce fait, les phénomènes historiques de l'opportunisme et du centrisme s'expriment de façon différente, avec des caractères de gravité plus ou moins grands suivant les moments de cette évolution et de ce développement.
5. Si l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence posant directement la question de la nécessité de la révolution est une condition favorable facilitant le procès de maturation de la conscience dans la classe ouvrière, cette maturation n'est pas pour autant une donnée automatique, mécanique, fatale.
La période de décadence du capitalisme voit d'une part la bourgeoisie concentrer à outrance son pouvoir de répression ainsi que s'employer à perfectionner au maximum les moyens de pénétration de son idéologie dans la classe et, d'autre part, s'accroître de façon considérable l'importance et l'urgence de la prise de conscience par la classe dans la mesure où l'enjeu historique de "socialisme ou barbarie se pose de façon immédiate et dans toute sa gravité : l'histoire ne laisse pas au prolétariat un temps illimité. La période de la décadence se posant en termes de guerre impérialiste ou révolution prolétarienne, de socialisme ou barbarie, non seulement ne fait pas disparaître l'opportunisme et le centrisme mais rend donc plus âpre, plus acharnée, la lutte des courants révolutionnaires contre ces tendances, en proportion directe de l'enjeu même de la situation.
6. Comme l'histoire l'a démontré, le courant opportuniste ouvert, du fait qu'il se situe sur des positions extrêmes et tranchées, aboutit, dans les moments décisifs, à effectuer un passage définitif et sans retour dans le camp de la bourgeoisie. Quant au courant qui se définit corme se situant entre la gauche révolutionnaire et la droite opportuniste -courant le plus hétérogène, en constante mouvance entre les deux et recherche de leur réconciliation au non d'une unité organisationnelle impossible- il évolue pour sa part selon les circonstances et les vicissitudes de la lutte du prolétariat.
Au moment de la trahison ouverte du courant opportuniste, en même temps que s'effectue une reprise et une montée de la lutte de la classe, le centrisme peut constituer au début une position passagère des masses ouvrières vers les positions révolutionnaires. Le centrisme, en tant que courant structuré, organisé sous forme de parti, est appelé, dans ces circonstances favorables, à exploser et à passer dans sa majorité, ou pour une grande partie, dans l'organisation de la gauche révolutionnaire nouvellement constituée, comme cela s'est produit pour le Parti Socialiste français, le Parti Socialiste d'Italie et l'USPD en Allemagne dans les années 1920-21, après la première guerre mondiale et la révolution victorieuse en Russie.
Par contre, dans les circonstances d'une série de grandes défaites du prolétariat ouvrant un cours vers la guerre, le centrisme est immanquablement destiné à être happé dans l'engrenage de la bourgeoisie et à passer dans son camp tout comme le courant opportuniste ouvert.
Avec toute la fermeté qui doit être la sienne, il est important pour le parti révolutionnaire de savoir comprendre les deux sens opposés de l'évolution possible du centrisme dans des circonstances différentes pour pouvoir prendre une attitude politique adéquate à son égard. Ne pas reconnaître cette réalité mène à la même aberration que la proclamation de l'impossibilité de l'existence de l'opportunisme et du centrisme au sein de la classe ouvrière dans la période de décadence du capitalisme.
7. Concernant cette dernière "théorie", toute l'histoire de la IIIème Internationale et des partis communistes est là pour en attester l'inanité, pour démontrer qu'elle n'est pas autre chose qu'une énormité. Non seulement l'opportunisme et le centrisme ont pu apparaître au sein même de l'organisation révolutionnaire mais, se renforçant avec les défaites et le recul du prolétariat, le centrisme est également parvenu à dominer ces partis et, après une lutte sans merci qui a duré de longues années pour battre les oppositions et fractions de la gauche communiste, à expulser celles-ci de tous les partis communistes : ayant vidé ces derniers de toute substance de classe il a fait de chacun d'eux des organes de leurs bourgeoisies nationales respectives.
La "théorie" de l'impossibilité d'existence de courants opportunistes et centristes au sein du prolétariat dans la période de décadence du capitalisme suppose en réalité l'existence d'un prolétariat et de partis révolutionnaires purs, absolument et à jamais immunisés et imperméabilisés contre toute pénétration de l'influence de l'idéologie bourgeoise en leur sein. Une telle "théorie" est non seulement une aberration mais repose sur une vision idéaliste abstraite de la classe et de ses organisations. Elle relève de la "méthode Coué" (se consoler en se répétant que tout va bien) et tourne résolument le dos au marxisme. Loin de renforcer le courant révolutionnaire, elle l'affaiblit en lui voilant ce danger réel qui le menace, en détournant son attention et sa vigilance indispensable contre ce danger.
Le CCI doit combattre de toute son énergie de telles "théories" en général, et dans son sein en particulier, car elles ne font que permettre au centrisme de se camoufler derrière une phraséologie radicale qui, sous couvert de "pureté programmatique", tend à isoler les organisations révolutionnaires du mouvement réel de la lutte de leur classe.
----------------------------
Résolution (rejetée)
LE CENTRISME ET LES ORGANISATIONS POLITIQUES DU PROLETARIAT
1. Il n'y a pas de débat académique possible sur la question du centrisme. Le centrisme est né et s'est développé comme concept dans le mouvement ouvrier face à la nécessité de délimiter les forces politiques en présence dans la lutte de classe, en particulier en vue de la constitution des partis de classe à l'époque actuelle des guerres et des révolutions. Ce n'est pas un hasard si cette question se repose aujourd'hui au CCI dans une période où s'annoncent des affrontements de classe décisifs et, avec eux, la perspective d'un nouveau parti de classe : de la réponse à cette question dépendra la nature du parti de demain, et dépend dès aujourd'hui l'attitude des groupes révolutionnaires dans la préparation de cette perspective. L'expérience pratique de la faillite tragique de la IIIIème Internationale, puis de la débâcle de la prétendue "IVème Internationale" trotskyste, par leur politique de compromission avec des fractions de la bourgeoisie sous le couvert du concept de centrisme, d'une part, le cadre théorique de la nature de la classe ouvrière, de la décadence du capitalisme et du capitalisme d'État comme mode d'existence du capitalisme à l'époque actuelle, d'autre part, fournissent tous les matériaux nécessaires au prolétariat pour passer au crible de la critique le concept de centrisme et ses implications .
2. De par sa condition de classe exploitée dans le capitalisme en même temps que de classe révolutionnaire portant en elle la destruction du capitalisme, le prolétariat est constamment soumis à deux tendances contradictoires :
- son mouvement propre vers la conscience de sa situation et de son devenir historique ;
- la pression de l'idéologie bourgeoise dominante, qui tend à détruire sa conscience.
Ces deux tendances inconciliables déterminent le caractère heurté de la lutte de classe qui voit se succéder avancées ou tentatives révolutionnaires et reculs ou contre-révolution, de même que le surgissement de minorités d'avant-garde organisées en groupes, fractions ou partis, appelés à catalyser le mouvement de la classe vers sa conscience.
Le prolétariat ne peut avoir qu'une seule conscience : une conscience révolutionnaire, mais, parce qu’il naît de la société bourgeoise et ne peut s'en libérer complètement que lorsqu'il disparaît en tant que classe, sa conscience est un processus en développement, jamais achevé dans le capitalisme, qui s'affronte en permanence à l'idéologie bourgeoise imprégnant l'ensemble de la société.
Cette situation détermine la dynamique des organisations politiques du prolétariat : soit elles assument leur fonction de développement de la conscience de classe contre l'idéologie bourgeoise et se situent pratiquement dans le camp prolétarien, soit elles succombent à 1’idéologie bourgeoise et s'intègrent pratiquement dans le camp bourgeois.
3. La délimitation des camps parmi les organisations politiques est elle-même un processus historique en développement, déterminé par les conditions objectives du développement du capitalisme et du prolétariat en son sein. Depuis le début du mouvement ouvrier s'est opéré un processus de décantation qui a progressivement rétréci et délimité les paramètres du terrain politique du prolétariat.
À l'époque de la 1ère Internationale, le développement du capitalisme est encore caractérisé, même au cœur de l'Europe, par l'introduction de la production industrielle à grande échelle et la formation du prolétariat industriel à partir de l'artisanat en déclin et de la paysannerie dépossédée. A ce stade de développement du prolétariat et de sa conscience, les frontières du mouvement ouvrier pouvaient inclure des courants aussi disparates que l'anarchisme bakouniniste et proudhonien, ancré dans le passé petit-bourgeois et paysan, le blanquisme ancré dans l'intelligentsia jacobine, le mazzinisme avec son programme de républicanisme radical, et le marxisme, expression développée du prolétariat révolutionnaire.
À l'époque de la IIème Internationale, la fin de la période des révolutions nationales et de l'enfance du prolétariat industriel ont considérablement rétréci les frontières du mouvement ouvrier, en obligeant le prolétariat à se constituer en parti politique distinct, en opposition à tous les courants bourgeois et petit-bourgeois. Mais la nécessité de lutter pour des réformes à l'intérieur d'un capitalisme ascendant, la coexistence des programmes "minimum" et "maximum" dans cette période permettaient à des courants comme l'anarcho-syndicalisme, le centrisme et l'opportunisme d'exister dans le camp politique prolétarien à côté du marxisme révolutionnaire.
À l'époque actuelle de la décadence du capitalisme, à l'ère du capitalisme d'État, de l'intégration des partis de masse et des syndicats dans les rouages de l'État totalitaire du capital, de l'impossibilité des réformes dans une situation de crise permanente et de la nécessité objective de la révolution communiste - époque ouverte par la première guerre mondiale, le camp politique prolétarien est définitivement 1imité au marxisme révolutionnaire. Les différentes tendances opportunistes et centristes, avec leur programme de parlementarisme, de légalisme avec leur stratégie d'usure, avec leur base dans les partis de masse et les syndicats, sont irrémédiablement passées dans le camp du capitalisme. Il en va de même de toute organisation qui abandonne d'une quelconque autre façon le terrain de la révolution mondiale, comme ce sera le cas de la IIIème Internationale lors de l'adoption du "socialisme en un seul pays" et du trotskysme lors de son soutien "critique" à la 2ème guerre mondiale.
4. La question que doit se poser le marxisme face au phénomène historique de l'opportunisme et du centrisme n'est pas de savoir si les organisations du prolétariat sont menacées ou non de pénétration de l'idéologie bourgeoise, mais de comprendre dans quelles conditions particulières celle-ci a pu aboutir à l'existence de courants distincts du marxisme révolutionnaire et de la bourgeoisie. De par sa nature même la classe ouvrière et ses organisations - les plus claires soient-elles - sont toujours pénétrées par l'idéologie bourgeoise. Cette pénétration prend les formes les plus variées, et c'est gravement la sous-estimer que de n'en rechercher qu'une seule forme générique. L'issue du combat entre conscience de classe et idéologie bourgeoise dans une organisation consiste soit en le développement de la première contre la seconde, soit en la destruction de la première par la seconde. Dans l'époque de décadence du capitalisme où les antagonismes de classe s'expriment de façon claire et tranchée, ceci signifie soit le développement du programme révolutionnaire, soit la capitulation face à la bourgeoisie.
La possibilité d'une "troisième voie" à l'époque ascendante du capitalisme, c'est-à-dire l'existence de courants et de positions ni vraiment bourgeois ni vraiment révolutionnaires à l'intérieur même du mouvement ouvrier résulte de la marge laissée alors par le capitalisme en expansion à une lutte permanente du prolétariat pour des améliorations de ses conditions de vie à l'intérieur du système sans mettre immédiatement celui-ci en péril. L'opportunisme - la politique visant la recherche de succès immédiats au détriment des principes, c'est-à-dire des conditions du succès final et le centrisme - variante de l'opportunisme cherchant à concilier ce dernier avec une référence au marxisme - se développèrent comme formes politiques de la maladie réformiste qui gangrena le mouvement ouvrier à cette époque. Leur base objective résidait non dans une différenciation fondamentale d'intérêts économiques au sein du prolétariat, comme le présentait la théorie de 1'"aristocratie ouvrière" de Lénine, mais dans les appareils permanents des syndicats et partis de masse, qui tendaient à s'institutionnaliser dans le cadre du système, à s'intégrer à l'Etat capitaliste et à s'éloigner de la lutte de classe. Avec l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence, ces organisations basculèrent définitivement dans le camp du capital et, avec elles, les courants réformistes, opportunistes ou centristes.
Désormais, l'alternative immédiate qui est posée à la classe ouvrière est révolution ou contre-révolution, socialisme ou barbarie. Réformisme, opportunisme et centrisme ont cessé d'être une réalité objective à l'intérieur du mouvement ouvrier, car leur base matérielle - l'obtention de réformes et de succès immédiats, sans lutte pour la révolution, et les organisations de masse correspondantes - n'existe plus. Toute politique visant des succès immédiats en s'éloignant de la révolution, est devenue, du point de vue du prolétariat, une illusion et non une réalité objective ; elle représente une capitulation directe face à la bourgeoisie, une politique contre-révolutionnaire. Tous les exemples historiques de telles politiques à l'époque de décadence, comme celle d' "aller aux masses" de l'Internationale Communiste, montrent que, loin d'aboutir à des succès immédiats, elles aboutissent à des échecs complets, à la trahison des organisations et à la perte de la révolution dans le cas de l'I.C. Ceci ne veut pas dire que toute organisation prolétarienne qui dégénère passe immédiatement en tant que telle à la bourgeoisie ; en dehors des moments cruciaux de guerre et de révolution, la capitulation face à la bourgeoisie peut être partielle et progressive, comme le montre l'histoire du bordiguisme. Mais ceci ne change pas la caractéristique générale du processus, la contradiction permanente entre révolution et contre-révolution, la dénaturation de la première en la seconde sans passer par des courants et des idéologies de type intermédiaire comme l'étaient l'opportunisme et le centrisme.
5. La thèse, développée par Trotsky dans les années 30 et reprise aujourd'hui dans le CCI, selon laquelle l'opportunisme et le centrisme représentent par essence la pénétration de l'idéologie bourgeoise au sein des organisations du prolétariat, définie simplement en termes de "comportements politiques" (manque de fermeté sur les principes, hésitation, conciliation entre positions antagoniques), s'écarte radicalement de la méthode matérialiste historique du marxisme :
- du matérialisme, parce qu'elle met la réalité la tête en bas en considérant les courants politiques comme produits des comportements, au lieu de considérer les comportements comme produits de courants politiques, définis par leur rapport à la lutte de classe ;
- de l'histoire, parce qu'elle remplace toute l'évolution générale du prolétariat et de ses organisations par des catégories figées de comportements particuliers, incapables d'expliquer cette évolution historique.
Ses conséquences sont désastreuses sur une série d'aspects essentiels du programme révolutionnaire:
1) En situant l'origine des faiblesses des organisations prolétariennes dans le comportement d'hésitation, elle y oppose un autre comportement : la volonté, et base ainsi sa perspective sur le volontarisme, déviation typique du trotskysme des années 30.
2) En étant appliquée à l'époque de décadence du capitalisme, elle mène à la réhabilitation, dans le camp du prolétariat, du courant "centriste" et par là de la social-démocratie après sa participation à la première guerre mondiale et à l'écrasement de la révolution d'après-guerre, du stalinisme après l'adoption du "socialisme en un seul pays" et du trotskysme après sa participation à la deuxième guerre mondiale ; en d'autres termes à l'abandon du critère objectif de l'internationalisme, de la participation à la guerre ou à la révolution, pour délimiter le camp prolétarien du camp bourgeois ; à la reconnaissance de positions nationalistes - telles que le "socialisme en un seul pays" du stalinisme et le "soutien critique" à la guerre impérialiste du trotskysme - en tant qu'expressions du prolétariat.
3) De ce fait, elle altère en outre toutes les leçons tirées de la vague révolutionnaire et justifie, quoique de façon critique, la politique d'ouverture de la IIIème Internationale aux éléments et partis contre-révolutionnaires de la social-démocratie et comporte ainsi un grave danger pour la révolution et le parti de demain.
4) En fin de compte, elle implique une remise en cause de la nature révolutionnaire du prolétariat et de sa conscience, car si le centrisme désigne toute cohabitation de positions contradictoires, alors le prolétariat et ses organisations sont toujours et par nature centristes, puisque le prolétariat traîne nécessairement en lui les marques de la société dans laquelle il existe, de l'idéologie bourgeoise, tout en affirmant son projet révolutionnaire.
6. La vérité d'une théorie réside dans la pratique. C'est l'application du concept de centrisme par la IIIème Internationale dans la formation des partis communistes en Europe et par l'Opposition de gauche trotskyste dans la formation de la prétendue "IVème Internationale" qui apporte la démonstration historique définitive de sa faillite à l'époque de la décadence du capitalisme. C'est par manque de clarté sur la nature désormais bourgeoise du "centrisme" que l'IC fut amenée à une politique de compromissions avec des tendances et partis social-démocrates contre-révolutionnaires en leur ouvrant les portes de 1'Internationale, comme ce fut le cas en Allemagne où le KPD dut fusionner avec l'USPD, ou en France où le PCF fut formé à partir de la SFIO qui avait participé à l'Union sacrée pendant la guerre impérialiste. C'est de même sa conception du centrisme qui entraîna Trotsky dans une politique volontariste de construction d'une nouvelle internationale et d'entrisme dans la social-démocratie contre-révolutionnaire. Dans les deux cas, ces politiques précipitèrent la mort de l'IC et du trotskysme de façon spectaculaire.
Le fait que les gauches communistes aient continué à utiliser les termes de "centrisme" et d'"opportunisme" n'est en rien une preuve de l'adéquation de ceux-ci, mais une expression de la difficulté des gauches à tirer immédiatement les leçons théoriques de l'expérience vécue. Ces gauches étaient tout au moins claires sur l'essentiel, à savoir la fonction contre-révolutionnaire assumée par les courants qualifiés de "centristes", mais leur analyse en était affaiblie par le recours à des concepts applicables à la dégénérescence de la IIème Internationale. En témoignent les positions intenables de "Bilan" sur la dualité entre "nature" (prolétarienne) et "fonction" (contre-révolutionnaire) du stalinisme après 1927 et sur la qualification de l'URSS comme "Etat prolétarien" jusque dans la deuxième guerre mondiale.
7. La nature de classe d'une organisation est donnée par la fonction historique qu'elle remplit dans la lutte de classe, car une organisation ne surgit pas comme reflet passif d'une classe mais comme organe actif de celle-ci. Tout critère basé uniquement sur la présence d'ouvriers (comme pour le trotskysme) ou de révolutionnaires (comme pour le CCI aujourd'hui) dans une organisation pour délimiter sa nature de classe s'inspire du subjectivisme idéaliste et non du matérialisme historique. Le passage d'une organisation du prolétariat dans le camp bourgeois est par essence un phénomène objectif, indépendant de la conscience qu'en ont les révolutionnaires sur le moment, puisqu'il signifie que l'organisation fait face au prolétariat comme partie des conditions objectives, adverses, de la société capitaliste, et qu'elle échappe ainsi à l'action subjective du prolétariat. Le maintien d'ouvriers, et même parfois temporairement de fractions révolutionnaires en son sein n'est nullement contradictoire avec ce fait, puisque la fonction qu'elle remplit alors pour la bourgeoisie est précisément l'encadrement du prolétariat.
Il existe des critères historiques décisifs qui tranchent le passage d'une organisation dans le camp du capitalisme: l'abandon de l'internationalisme, la participation à la guerre et à la contre-révolution. Ce passage s'est effectué pour la social-démocratie et les syndicats lors de la première guerre mondiale, pour l'IC lors de l'adoption du "socialisme en un seul pays", pour le courant trotskyste lors de la deuxième guerre mondiale. Une fois ce passage accompli, l'organisation est définitivement morte pour le prolétariat, car désormais s'applique à elle le principe que Marx a dégagé face à l'Etat capitaliste, dont elle est partie prenante : celui-ci ne peut être conquis, il doit être détruit.
La mort d'une Internationale signifie simultanément la trahison de la majorité ou de l'ensemble des partis qui la composent, par l'abandon de l'internationalisme et l'adoption d'une politique nationaliste. Mais parce que les partis s'intègrent chacun dans un Etat capitaliste national, il peut exister des exceptions déterminées par des conditions nationales spécifiques, comme ce fut le cas dans la IIème Internationale. Ces exceptions qui ne se reproduisirent pas lors de la faillite de la IIIème Internationale avec l'adoption unanime du nationalisme stalinien par les PC, n'infirment en rien la règle générale, ni la nécessité pour ces partis de rompre totalement avec la politique de leurs ex-partis "frères". En outre, au sein de ces derniers subsistent parfois pendant quelque temps des courants ou fractions révolutionnaires qui n'ont pas réussi à comprendre immédiatement le changement de la situation et qui sont amenés par la suite à rompre avec le parti passé à la contre-révolution : ce fut le cas des spartakistes dans le SPD puis l'USPD en Allemagne. Ce processus n'est en rien assimilable à une impossible naissance d'une organisation prolétarienne à partir d'une organisation bourgeoise : ces fractions rompent organisationnellement avec le parti passé à la bourgeoisie mais représentent la continuité programmatique avec l'ancien parti dans lequel elles sont nées. Il traduit le phénomène général du retard de la conscience sur la réalité objective, qui se manifeste même lorsque les fractions ont quitté le parti : ainsi, alors que toutes les fractions de gauche avaient été exclues de l'IC dès 1927, la fraction italienne continua à analyser l'IC et les PC comme prolétariens jusqu'en 1933 et 1935 respectivement, et une minorité importante en son sein défendit encore le maintien de la référence au PC après l'analyse de sa mort en 1935.
La méthode subjectiviste prenant la subsistance de révolutionnaires dans une organisation comme critère de sa nature de classe désarme complètement les révolutionnaires dans la formation du parti. Car les révolutionnaires se battent jusqu'au bout pour garder un parti au prolétariat, et si ce parti est gardé au prolétariat par leur simple présence en son sein, cela signifie qu'il n' y a pour eux aucune raison de rompre avec une organisation tant qu'ils n'en sont pas exclus. Ce raisonnement circulaire revient à laisser l'initiative à l'ennemi. D'une part, il favorise la condamnation précipitée d'un parti en cas d'exclusion hâtive, mais d'autre part, il paralyse les révolutionnaires dans le cas opposé où un parti passé à la bourgeoisie est prêt à garder des révolutionnaires en son sein comme caution de son apparence "ouvrière", comme cela se passa avec l'USPD et une série de partis social-démocrates dans les mouvements révolutionnaires du début du siècle. En supprimant le critère objectif de la nature de classe des partis, il supprime ainsi la nécessité objective de la formation du parti révolutionnaire. Et la boucle est bouclée : la théorie du centrisme engendre le "centrisme" qu'elle prétend décrire et combattre, et par là s'engendre elle-même dans un cercle vicieux qui ne peut que l'amener à conclure à la nature centriste de la classe ouvrière et de sa conscience.
8. Lorsqu'elle est amenée à ses conclusions, la théorie du centrisme comme maladie permanente du mouvement ouvrier apparaît pour ce qu'elle est : une capitulation face à l'idéologie bourgeoise qu'elle prétend combattre, un refus de tirer les leçons de l'expérience historique, une altération du programme révolutionnaire.
Rejeter cette théorie, poursuivre l'analyse marxiste des leçons du passé et des conditions de la lutte de classe à l'époque présente sur base du travail des gauches communistes et reconnaître l'impossibilité du centrisme à cette époque, c'est tout le contraire d'un désarmement de l'organisation révolutionnaire face à l'idéologie bourgeoise, c'est son armement indispensable pour combattre celle-ci sous toutes ses formes et pour préparer la formation d'un réel parti révolutionnaire.
CCI
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
Zimmerwald (1915-1917) : de la guerre à la révolution
- 6255 reads
DEBUT DU REVEIL DU PROLETARIAT CONTRE LA 1ère GUERRE MONDIALE QUELQUES LEÇONS POUR LE REGROUPEMENT DES REVOLUTIONNAIRES
Qui se souvient aujourd'hui de Zimmerwald, petit village suisse, où en septembre 1915 se réunit la première conférence socialiste internationale depuis le début de la première guerre mondiale ? Ce nom pourtant rendit confiance aux millions d'ouvriers jetés dans les horreurs de la guerre impérialiste. Embrigadée dans la guerre par les partis ouvriers, qu'elle avait créés au cours de décennies d'évolution pacifique du capitalisme, littéralement trahie, obligée de s'entretuer pour les intérêts des puissances impérialistes, la classe ouvrière internationale était plongée dans la crise la plus profonde, sous l'effet du traumatisme le plus violent qu'elle ait eu à subir.
Zimmerwald a été la première réponse d'ampleur internationale du prolétariat au carnage des champs de bataille, à l'immonde tuerie à laquelle le capital l'obligeait de participer. Il a symbolisé la protestation de tous les exploités contre la barbarie guerrière. Il a préparé la réponse révolutionnaire du prolétariat à la guerre en Russie et en Allemagne. Zimmerwald a relevé le drapeau de l'internationalisme traîné dans la boue de l'Union sacrée. Il a constitué la première étape du regroupement des révolutionnaires pour la IIIe Internationale. C'est pourquoi Zimmerwald est notre héritage. Il est encore très riche de leçons pour le prolétariat, leçons qui doivent être réappropriées pour préparer la révolution de demain.
LES PREMIERES REACTIONS
La première guerre mondiale provoqua la crise la plus profonde du mouvement ouvrier. Cette crise coupe les partis socialistes en deux : une partie passe directement à la bourgeoisie en adhérant à l'Union sacrée ; une autre refuse de marcher dans la guerre impérialiste. La guerre pose la question de l'éclatement de ces partis et d'une scission. La formation de nouveaux partis révolutionnaires et d'une nouvelle Internationale, excluant les fractions passées à l'ennemi, est posée dès l'éclatement de la guerre.
Le 4 août 1914, le vote des crédits de guerre par les partis socialistes allemand et français, partis déterminants dans la lutte contre la guerre, était l'acte de décès de la IIe Internationale. Les directions de ces partis, et d'autres comme les partis belge et anglais, portaient la responsabilité directe de l'embrigadement des prolétaires derrière la bannière du capital national. Au nom de la "défense de la patrie en danger" et de "l'Union sacrée contre l'ennemi", elles entraînaient des millions d'ouvriers dans la première grande boucherie mondiale. Les résolutions contre la guerre des précédents congrès de l'Internationale, à Stuttgart et Bâle, étaient foulées aux pieds, le drapeau de l'Internationale souillé du sang des ouvriers envoyés au front. Dans la bouche des social-patriotes, le mot d'ordre "prolétaires de tous les pays, unissez-vous !" devenait "prolétaires de tous les pays, entre-égorgez-vous !".
Jamais l'infamie de la trahison ne se révéla avec autant d'impudence. Vandervelde, président de l'Internationale, devenait du jour au lendemain ministre du gouvernement belge. Jules Guesde, en France, chef du parti socialiste, devenait ministre. La direction du Parti socialiste britannique (BSP) allait jusqu'à organiser pour le compte du gouvernement la campagne de recrutement militaire.
La trahison des dirigeants de ces partis ne découlait pas d'une trahison de l'Internationale. Celle-ci avait fait faillite par sa dislocation en partis nationaux autonomes soutenant leur bourgeoisie respective au lieu d'appliquer les décisions des congrès contre la guerre. En cessant d'être un instrument aux mains de tout le prolétariat international, elle n'était plus qu'un cadavre. Sa faillite était l'aboutissement de tout un processus où le réformisme et l'opportunisme avaient fini par triompher dans les plus grands partis. La trahison des dirigeants était l'aboutissement ultime d'une longue évolution que n'avaient pu empêcher les tendances de gauche de l'Internationale. Néanmoins, la trahison du 4 août n'était pas celle de tous les partis ni même de la totalité de certains -comme la social-démocratie allemande- puisqu'elle se heurte dès le départ à l'intransigeance de la Gauche.
C'est la résistance -d'abord limitée- de quelques partis mais aussi au sein des grands partis dont les directions étaient devenues social-patriotes, contre l'Union sacrée, qui posa dans les faits la question de la scission. Quelques partis furent capables courageusement d'aller contre le courant de furie nationaliste, se séparant nettement du courant chauvin. Le petit parti socialiste serbe -dès le début de la guerre votait contre les crédits militaires, rejetant toute idée d'une guerre "nationale défensive" pour les petites nations. Comme l'affirmait l'un des dirigeants: "Pour nous. le fait décisif fut que la guerre entre la Serbie et l'Autriche n'était qu'une petite partie d'un tout, rien d'autre que le prologue de la guerre européenne universelle; et cette dernière nous en étions profondément convaincus- ne pouvait avoir nul autre caractère qu'un caractère impérialiste nettement prononcé. " ([1] [13])
Tout aussi magnifique fut l'attitude du SDKPIL de Rosa Luxemburg qui appela -dès le déclenchement de la guerre- à la grève, rejetant toute idée de guerre nationale ou de "libération nationale".
Mais le cas le plus connu d'intransigeance internationaliste est celui du parti bolchevik dont les députés à la Douma- avec les députés mencheviks, votent contre les crédits de guerre et sont bientôt envoyés en Sibérie. Dès le début de la guerre, ils prennent de fait l'opposition la plus résolue à la guerre, car elle est l'une des seules à proclamer -en pleine démoralisation de toutes les fractions révolutionnaires- la nécessité de "la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile" comme "seul slogan prolétarien juste" ([2] [14]). C'est la seule opposition qui des le départ montre la perspective de la révolution et pour cela celle d'un regroupement de tous les internationalistes dans une nouvelle Internationale : "La IIe Internationale est morte vaincue par l'opportunisme. A bas l'opportunisme et vive la IIIe Internationale débarrassée non seulement des transfuges, mais aussi de l'opportunisme. A la IIIe Internationale d'organiser les forces du prolétariat pour l'assaut révolutionnaire des gouvernements capitalistes, pour la guerre civile contre la bourgeoisie de tous les pays, pour le pouvoir politique, pour la victoire du socialisme." (Lénine, 1er novembre 1914)
Mais aucun parti, même le parti bolchevik, ne put échapper à la crise profonde du mouvement ouvrier créée par le choc de la guerre. A Paris, une minorité de la section bolchevik s'engageait dans l'armée française.
Moins connues que les bolcheviks, d'autres organisations révolutionnaires ont tenté -au prix d'une crise plus ou moins grande- d'aller contre le courant et réussi à maintenir une attitude internationaliste. En Allemagne :
- le groupe "Die Internationale", constitué de fait en août 1914 autour de Luxemburg et Liebknecht
- les "Lichtstrahlen" -ou socialistes internationaux- de Borchardt constitués dès 1913 ;
- la Gauche de Brème (Bremerlinke) de Johann Knief, influencée par Pannekoek et les bolcheviks.
L'existence de ces trois groupes montre que la résistance à la trahison a été dès le départ très forte en Allemagne au sein même du parti social-démocrate. En dehors de l'Allemagne et de la Russie, de la Pologne et de la Serbie, on doit mentionner pour leur importance future :
- le groupe de Trotsky, qui se concentra d'abord autour de la revue de Martov -"Golos"- puis eut sa revue propre "Nache slovo" dans l'immigration russe en France, influençant dans un sens révolutionnaire une partie du syndicalisme révolutionnaire français (Monatte et Rosmer), et la social-démocratie roumaine de Racovski ;
- le Parti tribuniste de Gorter et Pannekoek en Hollande, qui dès le départ adhère aux thèses des bolcheviks et mène une vigoureuse campagne contre la guerre et pour une nouvelle Internationale.
A côté des social-chauvins et des révolutionnaires intransigeants se développait un troisième courant issu de la crise de tout le mouvement socialiste. Ce courant qu'on peut qualifier de centriste ([3] [15]) se manifestait par toute une attitude d'oscillation et d'hésitations : tantôt radical en paroles, tantôt opportuniste, gardant l'illusion d'une unité du parti les amenant à chercher à renouer avec les traîtres social-chauvins. Les mencheviks, le groupe de Martov à Paris, seront parcourus par ces hésitations, oscillant entre une attitude d'appel à la révolution et une position pacifiste. Typique est la politique du Parti socialiste italien, qui cherche dès septembre 1914 à renouer les liens internationaux brisés par la guerre et vote en mai 1913 contre les crédits de guerre. Il se proclame pourtant "neutre" dans la guerre avec son slogan "ni adhérer ni saboter". En Allemagne, les meilleurs éléments révolutionnaires, comme Liebknecht, marquent encore leur rupture avec l'Union sacrée ("Burgfriede") avec des mots d'ordre pacifistes: "pour une paix rapide et qui n'humilie personne, une paix sans conquêtes". ([4] [16])
C'est progressivement et dans la douleur que se développait le mouvement révolutionnaire, lui-même parcouru d'hésitations. Il se trouvait confronté avec un Centre -le "marais"- qui se situait encore dans le camp prolétarien. C'est avec les groupes issus de ce centre, et par la confrontation avec lui, que pouvait être initiée une lutte contre la guerre. Le regroupement international des révolutionnaires ayant rompu avec le social-patriotisme, en vue de la formation d'une nouvelle Internationale, passait par une confrontation avec les hésitants et les centristes.
Tel fut le sens profond des conférences de Zimmerwald et Kienthal : d'abord relever le drapeau de l'Internationale, par le rejet de la guerre impérialiste, et préparer les conditions subjectives, par la scission inévitable dans les partis socialistes, de la révolution, qui seule pourrait mettre fin à la guerre.
LA CONFERENCE SOCIALISTE INTERNATIONALE DE ZIMMERWALD
Au milieu du fracas de la guerre impérialiste, entraînant dans la mort des millions d'ouvriers, face à la misère effroyable régnant dans une classe ouvrière surexploitée et peu à peu réduite à la famine, la Conférence de Zimmerwald sera le cri de ralliement des exploités victimes de la barbarie capitaliste. En devenant le phare de l'internationalisme, par delà les frontières, par delà les fronts militaires, Zimmerwald va symboliser le réveil du prolétariat international, jusqu'alors traumatisé par le choc de la guerre ; il va stimuler la conscience du prolétariat qui une fois dissipées les vapeurs délétères du chauvinisme, passera progressivement d'une volonté de retourner à la paix à la prise de conscience de ses buts révolutionnaires. En dépit de toutes les confusions régnant en son sein, le Mouvement de Zimmerwald va être l'étape décisive sur le chemin menant à la révolution russe et à la fondation de la Ille Internationale.
A l'origine, l'idée d'une reprise des relations internationales entre partis de la IIe Internationale, qui refusent la guerre, naît dans des partis de pays "neutres". Dès le 27 septembre 1914 se déroulait à Lugano (Suisse), une conférence des partis socialistes suisse et italien, qui se proposait de "combattre par tous les moyens l'extension ultérieure de la guerre à d'autres pays". Une autre conférence de partis "neutres" se tenait les 17 et 18 janvier 1913 à Copenhague, avec des délégués des partis Scandinaves et de la social-démocratie hollandaise (la même qui avait exclu les révolutionnaires tribunistes en 1909). Les deux conférences, qui n'eurent aucun écho dans le mouvement ouvrier, se proposaient de réaffirmer "les principes de l'Internationale", d'une Internationale qui était définitivement morte. Mais alors que les Scandinaves et les Hollandais, dominés par le réformisme, faisaient appel au Bureau socialiste international pour tenir une conférence de la "paix" entre partis ayant adhéré au social-chauvinisme, les partis italien et suisse s'engageaient timidement vers une rupture. Ainsi, en janvier 1913, le parti socialiste suisse décidait de ne plus verser de cotisations à la feue IIe Internationale. Rupture très timide, puisqu'en mai de la même année la conférence des deux partis suisse et italien, tenue à Zurich, demandait dans une résolution" d'oublier les faiblesses (!) et les fautes ( !!) des partis frères des autres pays" ([5] [17]). Et que dire des mots d'ordre de "désarmement général" en plein carnage militaire et &"aucune annexion violente" (sic) en pleine guerre de brigandage!
En fait, c'est la renaissance de la lutte de classe dans les pays en guerre et le réveil des minorités hostiles à la guerre dans les partis social-chauvins qui vont impulser le mouvement de Zimmerwald. En Grande-Bretagne, en février 1915, dans la vallée de la Clyde, débutaient les premières grandes grèves de la guerre. Au même moment, en Allemagne, éclataient les premières émeutes alimentaires, émeutes de femmes ouvrières protestant contre le rationnement. Les oppositions à la guerre se font plus déterminées. Le 20 mars 1915, Otto Rühle -futur théoricien du "conseillisme" et député au Reichstag- qui jusqu'alors avait voté les crédits .de guerre "par discipline", vote contre avec Liebknecht, tandis que trente députés social-démocrates s'abstiennent en quittant la salle du parlement. Plus significatif était le développement des forces révolutionnaires. A côté des "socialistes internationaux", publiant "Lichtstrahlen" ("Rayons de lumière") et proches des bolcheviks et des "Radicaux" de Brème, le groupe de Rosa Luxemburg diffusait des centaines de milliers de tracts contre la guerre et publiait la revue "Die Internationale". C'est une telle activité révolutionnaire qui pouvait réellement poser les bases d'un regroupement international. En France même, où le chauvinisme était particulièrement puissant, les réactions contre la guerre se faisaient jour. Il est significatif que ces réactions, à la différence de l'Allemagne, turent d'abord le fait des syndicalistes-révolutionnaires, autour de Monatte, influencé par Trotsky et son groupe ("Nache Slovo"). Dans les fédérations de l'Isère, du Rhône, chez les métallos et les instituteurs, une majorité se dégageait contre l'Union sacrée. Dans le parti socialiste lui-même, des fractions significatives -comme la Fédération de la Haute-Vienne ([6] [18])-suivaient la même voie. Telles étaient les prémisses de Zimmerwald. Une scission de fait s'effectuait progressivement sur la question de la guerre, et en conséquence sur. le soutien aux luttes de classe qui inévitablement deviendraient les prémisses de la révolution. La question de la rupture avec le social-chauvinisme était posée. Les deux conférences internationales qui se tinrent à Berne au printemps 1915 la posèrent. La première, celle des femmes socialistes, les 25-27 mars, négativement, bien qu'elle déclarât "la guerre à la guerre" : la conférence refusait en effet de condamner les social-patriotes et d'envisager la nécessité d'une nouvelle Internationale. C'est pourquoi les délégués bolcheviks refusèrent de cautionner toute attitude ambiguë et quittèrent la conférence. La deuxième conférence, celle de la Jeunesse socialiste internationale, positivement : elle décida de fonder un Bureau international de la Jeunesse autonome et de publier une revue "Jugend Internationale", de combat contre la Ile Internationale. Dans un manifeste sans ambiguïté, les délégués affirmèrent leur soutien à "toutes les actions révolutionnaires et les luttes de classe".
- "Il (valait) cent fois mieux mourir dans les prisons comme victimes de la lutte révolutionnaire que de tomber sur le champ de bâtai lie en lutte contre nos camarades d'autres pays, pour la soif de profit de nos ennemis." ([7] [19])
C'est à l'initiative du comité directeur du Parti italien et de socialistes suisses, comme Grimm et Platten, que fut convoquée pour septembre 1915 la première conférence socialiste internationale. Bravant la police, les calomnies des social-chauvins et l'hystérie nationaliste, trente-huit délégués venant de douze pays se retrouvèrent dans un petit village à côté de Berne. Le lieu de la conférence avait été tenu secret pour échapper aux espions des différentes puissances impérialistes. Il est significatif que les délégations les plus nombreuses étaient celles des immigrés de Russie, bolcheviks, mencheviks et socialistes-révolutionnaires, et de l'Allemagne, les deux pays clefs de la révolution mondiale.
Cette conférence revêtit une importance historique décisive pour l'évolution de la lutte de classe et la formation d'une gauche communiste internationale.
En effet, de la conférence sortit une "Déclaration commune des socialistes et des syndicalistes franco-allemands", signée par les syndicalistes français Merrheim et Bourderon et les députés allemands Ledebour et Hoffmann. En appelant à "la cessation de cette tuerie" et en affirmant que "cette guerre n'est pas notre guerre", la déclaration eut un effet formidable tant en Allemagne qu'en France. Elle dépassait les intentions des signataires, qui étaient loin d'être des révolutionnaires mais des éléments timorés du centre, Ledebour, malgré les appels très fermes de Lénine, refusait de voter contre les crédits de guerre, préférant "s'abstenir". Parce qu'elle émanait de socialistes de pays belligérants, la déclaration apparut vite comme une incitation à la fraternisation des soldats des deux camps.
Enfin, le Manifeste, rédigé par Trotsky et Grimm, adressé aux prolétaires d'Europe, parce qu'adopté à l'unanimité par les socialistes de douze pays, allait avoir un impact considérable sur les ouvriers et les soldats. Traduit et diffusé dans plusieurs langues, le plus souvent sous forme de tracts et de brochures clandestins, le Manifeste apparut comme une vivante protestation des internationalistes contre la barbarie : "L'Europe est devenue un gigantesque abattoir d'hommes. Toute la civilisation, produit du travail de plusieurs générations, s'est effondrée. La barbarie la plus sauvage triomphe aujourd'hui sur tout ce qui était l'orgueil de l'humanité." Il dénonçait les représentants des partis qui "se sont mis au service de leur gouvernement et ont tenté, par leur presse et leurs émissaires, de gagner à la politique de leurs gouvernants les pays neutres", et le Bureau socialiste international qui a complètement failli à sa tâche". "Par-dessus les frontières, par-dessus les champs de bataille, par-dessus les campagnes et les villes dévastées, prolétaires de tous les pays, unissez-vous '"([8] [20])
Devant la gravité de la situation, les ambiguïtés contenues dans le Manifeste passèrent au second rang dans l'esprit des ouvriers qui y virent la première manifestation d'internationalisme. Le Manifeste était en fait le fruit d'un compromis entre les différentes tendances de Zimmerwald, qui voulait apparaître comme un mouvement uni face aux puissances impérialistes. Les bolcheviks critiquèrent avec intransigeance révolutionnaire le ton pacifiste -"entraîner la classe ouvrière dans la lutte pour la paix"- et l'absence de perspectives de révolution. Le "Manifeste ne contient aucune caractéristique claire des moyens de combattre la guerre." ([9] [21]) Les délégués qui allaient former la Gauche de Zimmerwald proposèrent une résolution qui seule se plaçait sur le terrain du marxisme en appelant à "la lutte la plus intransigeante contre le social-impérialisme comme première condition pour la mobilisation révolutionnaire du prolétariat et pour la reconstruction de l'Internationale" ([10] [22])
Il est significatif, cependant, que la Gauche, sans abandonner ses critiques, vota le Manifeste. Lénine justifiait ainsi de façon très juste l'attitude de la Gauche '."Notre comité central devait-il signer ce manifeste inconséquent et timoré ? Nous pensons que oui... Nous n'avons rien dissimulé de notre opinion, de nos mots d'ordre, de notre tactique.. Que ce manifeste constitue un pas en avant (souligné par Lénine, NDR) vers la lutte réelle avec l'opportunisme, vers la rupture et la scission, c'est un fait acquis. Il serait d'un sectaire de se refuser à faire ce pas en avant avec la minorité des Allemands, des Français, des Suédois, des Norvégiens, des Suisses, alors que nous conservons notre pleine liberté de mouvement et la possibilité entière de critiquer les inconséquences présentes en travaillant pour de plus grands résultats." (10)
La Gauche qui regroupait sept à huit délégués, une infime minorité, était consciente de ce pas en avant. La bourgeoisie internationale ne se trompa pas en effet sur le sens de Zimmerwald. Ou bien elle utilisa les calomnies les plus infâmes pour présenter les révolutionnaires comme des "agents de l'ennemi", aidée en cela par les social-chauvins, ou bien, tant que ce fut possible, elle censura tout article faisant part des résultats de la Conférence. Avec raison, la bourgeoisie des deux camps prenait peur. L'établissement d'une Commission socialiste internationale, qui allait par la suite recueillir des adhésions de plus en plus nombreuses au Mouvement de Zimmerwald, était un pas en avant, de rupture avec la seconde Internationale, même si les initiateurs déclaraient ne vouloir "se substituer au secrétariat international" et la "dissoudre aussitôt que ce dernier pourra remplir à nouveau sa mission". En France, la création par les lecteurs de "La Vie Ouvrière" et de la "Nache Slovo" en novembre 1913 d'un comité pour la reprise des relations internationales, est une conséquence directe, positive, de la Conférence.
LE DEVELOPPEMENT DE LA GAUCHE ZIMMERWALDIENNE
La conférence fut un révélateur important de l'état des forces en présence :
- une droite représentée par les mencheviks, les socialistes-révolutionnaires, les syndicalistes et les députés allemands, les Italiens et les Suisses, et prête à toutes les concessions avec le social-chauvinisme. Elle exprimait un centrisme de droite qui révéla, sur la question de la révolution et non plus de la "paix", dans les années à venir, son caractère contre-révolutionnaire en 1917 et 1919; -un centre, orienté vers la gauche, poussé à la conciliation par indécision et manque de fermeté sur les principes. Trotsky, les délégués du groupe "Die Inter- nationale", ceux des partis balkaniques et polonais traduisaient les hésitations de ce centre ;
- la Gauche de Zimmerwald, regroupée autour des bolcheviks, des Scandinaves, de Radek, de Winter (représentant d'un groupe en Lettonie lié aux bolcheviks), affirmait avec clarté et sans hésitation la nécessité de la lutte pour la révolution, consciente de plus en plus que la révolution et non la lutte contre la guerre serait la ligne de partage. "Guerre civile et non pas union sacrée, voilà notre devise. Il est du devoir des partis socialistes et des minorités oppositionnelles au sein des partis devenus social-patriotes d'appeler les masses ouvrières à la lutte révolutionnaire contre les gouvernements impérialistes pour la conquête du pouvoir politique, en vue de l' organisation socialiste de la société. "([11] [23])
La lutte sans concession de la Gauche pour opérer un clivage dans les rangs centristes est très significative. Elle montre que la lutte des révolutionnaires amène inévitablement à une décantation ; que les forces ne sont pas figées : sous la pression de la lutte de classe et des avant-gardes marxistes, une crise se produit qui entraîne une partie des hésitants sur la voie révolutionnaire. Le combat politique, comme volonté, est une force historique consciente qui opère la sélection la plus impitoyable. A l'heure des choix historiques, il est impossible de rester longtemps dans le marais.
Pour la gauche, il s'agissait, tout en adhérant au Mouvement de Zimmerwald, de garder l'autonomie d'action et de se compter dans un organisme, qui tout en participant à la Commission socialiste internationale, symbolisa le drapeau de la future Internationale : le "Bureau permanent de la gauche zimmer-waldienne" composé de Lénine, Zinoviev et Radek, fut chargé de mener son propre travail à l'échelle internationale.
L'attitude de la Gauche de Zimmerwald est pleine d'enseignements pour les révolutionnaires d'aujourd'hui. Pour la Gauche, tout en dénonçant impitoyablement les oscillations centristes, il ne s'agissait pas de proclamer artificiellement la nouvelle Internationale, mais de la préparer. La préparer) cela passait par la rupture nette avec le social-patriotisme, et donc par l'établissement de critères aux conférences excluant ce courant passé à la bourgeoisie.
En deuxième lieu, cela supposait une condamnation absolue de toute forme de pacifisme, professé par les centristes qui ne recherchaient rien de moins que la conciliation avec le social-chauvinisme et le retour à la IIe Internationale d'avant 14. Le chemin de la révolution ne pouvait passer que sur le corps du pacifisme. Comme l'affirmait Gorter dès octobre 1914 dans sa brochure "L'impérialisme, la guerre mondiale et la social-démocratie" :"Le mouvement pacifiste est la tentative que sont en train de faire la bourgeoisie, les réformistes et les radicaux, à L'heure où le prolétariat se trouve confronté au choix entre impérialisme et socialisme, pour le pousser vers l'impérialisme. Le mouvement pacifiste c'est la tentative de l'impérialisme de la bourgeoisie contre le socialisme du prolétariat." Ainsi la seule alternative n'était pas guerre ou paix mais guerre ou révolution. Seule la révolution pourrait mettre fin à la guerre, comme le montra 1917 en Russie et 1918 en Allemagne.
En troisième lieu, sur le plan pratique, il s'agissait de constituer des partis marxistes indépendants du centrisme, sur des bases réellement révolutionnaires. Comme l'affirmait le groupe "Arbeiterpohtik" (Gauche de Brème) -soutenu par les bolcheviks- "la scission (à l'échelle nationale et internationale) [est] non seulement inévitable mais une pré condition l'une réelle reconstruction de l'Internationale, l'une nouvelle croissance du mouvement ouvrier prolétarien" ("Unité ou scission du Parti ?",Arbeiterpolitik, n° 4-8 et 10, 1916).
Cette lutte de la Gauche zimmerwaldienne ne fut pas sans porter ses fruits. Sur la lancée d'une forte reprise de la lutte de classe internationale, la conférence de Kienthal (en mars 1916) s'orienta nettement plus à gauche. Déjà la circulaire d'invitation de la Commission socialiste internationale (C.S.I.) affirmait en février 1916 une nette rupture avec la IIe Internationale : "Toute tentative de ressusciter l'Internationale par une amnistie réciproque des chefs socialistes compromis, persistant dans leur attitude de solidarité avec les gouvernements et les classes capitalistes, ne peut être en réalité que dirigée contre le socialisme et aura pour effet de briser le réveil révolutionnaire de la classe ouvrière."([12] [24])
Enfin, la résolution de la même CSI à Kienthal en avril 1916 marquait une nette rupture avec la phraséologie pacifiste ; il s'agissait maintenant "d'attiser l'esprit de mécontentement et de protestation des masses ; de les éclairer dans le sens du socialisme révolutionnaire, afin que les étincelles et les tisons de révolte se confondent en une puissante flamme de protestation active des masses et que le prolétariat international -conformément à sa mission historique- accélère l'accomplissement de sa tâche et amène la chute du capitalisme qui seule peut libérer les peuples." ([13] [25])
Certes il y avait -malgré la croissance de la gauche qui avait plus de délégués qu'à Zimmerwald- encore une grande aile droite dans le mouvement zimmerwaldien. Mais il s'agissait d'un grand pas en avant vers la nouvelle Internationale. Comme le soulignait Zinoviev, au lendemain de Kienthal, "la deuxième conférence de Zimmerwald constitue indiscutablement un progrès, c'est un pas en avant. L'influence de la Gauche s'est trouvée beaucoup plus forte que dans le premier Zimmerwald. Les préjugés contre la Gauche se sont affaiblis à présent, il y a plus de chances qu'il n'y en eut après Zimmerwald pour que l'affaire tourne ainsi à l 'avantage des révolutionnaires, du socialisme. " ("Contre le Courant", tome 2, Maspéro, 1970). "Pas d'illusions/'; concluait néanmoins Zinoviev.
VERS LA IIIe INTERNATIONALE
"Plus d'illusions!", "L'ennemi principal se trouve dans notre propre pays" (Liebknecht) ; ces mots d'ordre trouvaient un écho pratique par le développement de la lutte de classe en 1917 dans les plus grands pays impérialistes : en Allemagne, avec des grèves gigantesques dans le Reich ; en Italie, à Turin où les ouvriers s'affrontaient les armes à la main à l'armée ; et surtout en Russie, où éclatait la révolution, prodrome de la révolution mondiale. C'est la question de la révolution qui, d'autre part, entraînait la scission dans les partis. Au printemps 1917 se formait en Allemagne le parti des Indépendants (USPD), au sein duquel l'Union spartakiste constituait une fraction ([14] [26]) ; en Italie se formait la fraction de Bordiga ; en Russie la révolution poussait les "centristes" de Zimmerwald -menchéviks officiels et socialistes-révolutionnaires de droite (à l'exception du groupe de Martov et des S.R. de gauche) dans le camp de la contre-révolution. En France, où triomphait pourtant l'idéologie nationaliste la plus crue, la minorité -composée elle-même d'une majorité de partisans de Longuet ("longuettistes"), centriste, et d'une petite minorité révolutionnaire- était sur le point de devenir la majorité face à la direction social-patriote en 1918.
La rupture avec les éléments centristes se posait avec netteté, comme condition de la naissance de la IIIe Internationale. Si cette rupture était valable théoriquement, sa réalisation a nécessité plusieurs années et passait par un nécessaire éclatement de ce courant. Que ce processus devrait durer plus longtemps que prévu, aucun révolutionnaire, dans le feu de la Révolution russe, ne pouvait l'envisager, face aux tâches de l'heure. C'est pourquoi les bolcheviks, et Lénine surtout, les Linksradikalen de Brème et les partisans de Gorter, étaient portés à accélérer la liquidation du Mouvement de Zimmerwald.
- "La tare principale de l'Internationale, la cause de sa faillite (car elle a déjà fait faillite moralement et politiquement ) réside dans ses flottements, dans son indécision sur la question essentielle qui détermine pratiquement toutes les autres, celle de la rupture avec le social-chauvinisme et la vieille Internationale social-chauvine. . . Il faut rompre sans délai avec cette Internationale. Il ne faut rester à Zimmerwald qu'à des fins d‘ information. " (Lénine, "Les objectifs du prolétariat dans notre révolution", 10 avril 1917)
La position de Lénine s'expliquait en fait par l'orientation des centristes mencheviks et socialistes-révolutionnaires vers le camp capitaliste. D'autre part, la majorité centriste de Zimmerwald était prête à céder aux sirènes des sociaux-patriotes de différents pays qui projetaient une conférence à Stockholm au printemps 1917, dans le but d'entraîner la Russie révolutionnaire dans la guerre. En réalité, une conférence se déroula bien à Stockholm, les 5-7 septembre 1917, mais ce fut la troisième (et dernière) conférence de Zimmerwald. Les bolcheviks, mencheviks internationalistes -les mencheviks se retirèrent avant la fin-, les indépendants et spartakistes avaient envoyé leurs délégués. Contrairement aux craintes des bolcheviks, la Gauche était en majorité dans la conférence. Celle-ci publia un manifeste appelant à une grève internationale contre la guerre et soutenant la révolution russe. Il concluait de façon frappante par ces mots : "Ou la révolution tuera la guerre ou la guerre tuera la révolution." ([15] [27])
La présence des bolcheviks à cette ultime conférence était un désaveu de fait de la position de Lénine en avril 1917 de quitter -selon ses mots "l'organisation pourrie de Zimmerwald" pour fonder la IIIe Internationale. La thèse de Lénine fut rejetée à la fin de 1917 par le comité central du parti bolchevik, à l'instigation de Zinoviev. Il fallait constater que malheureusement la thèse de Lénine de fonder rapidement de nouveaux partis et l'Internationale, tout à fait juste comme perspective, était encore prématurée, en l'absence d'une révolution en Allemagne, et de la formation de réels partis communistes indépendants, ayant rompu dans la plus grande clarté avec le centrisme impénitent, après avoir fait éclater le courant centriste. Il fallut encore attendre, compte tenu de la lente maturation de la conscience révolutionnaire du prolétariat, un an et demi, un an et demi de batailles révolutionnaires, pour que fût fondée l'Internationale communiste (mars 1919). Zimmerwald n'avait plus de raison d'être et fut dissoute officiellement par le congrès. La nécessaire décantation,passant par la scission, s'était en partie réalisée: une partie des Zimmerwaldiens adhérait à l’IC; le reste -une partie des indépendants et des centristes- s'unissait aux sociaux-patriotes "utilisant la bannière de Zimmerwald au profit de la réaction".La déclaration des participants de gauche (Zinoviev, Lénine, Trotsky, Platten et Racovski) pouvait conclure : "Les conférences de Zimmerwald et de Kienthal eurent leur importance à une époque où il était nécessaire d'unir tous les éléments prolétariens décidés, sous une forme ou une autre, à protester contre la boucherie impérialiste. Mais il pénétra dans les groupements de Zimmerwald, à côté d'éléments nettement communistes, des éléments "centristes" pacifistes et hésitants. Le courant communiste s'est renforcé dans toute une série de pays et la lutte contre les éléments du centre qui empêchent le développement de la révolution socialiste est devenue maintenant une des tâches les plus urgentes du prolétariat révolutionnaire. Le groupement de Zimmerwald a fait son temps. Tout ce qui était véritablement révolutionnaire dans le groupement de Zimmerwald passe et adhère à l'Internationale communiste. " ([16] [28])
Ainsi, malgré ses faiblesses, le Mouvement de Zimmerwald a eu une importance décisive dans l'histoire du mouvement révolutionnaire. Symbole de l'internationalisme, bannière du prolétariat dans sa lutte contre la guerre et pour la révolution, il a été le pont indispensable entre la Ile et la IIIe Internationales. Il a posé, sans pouvoir la résoudre, la question du regroupement des forces révolutionnaires dispersées par la guerre.
Aujourd’hui à 70 années de distance, les leçons de restent toujours fondamentales pour le révolutionnaire. Elles le sont dans la les révolutionnaires comprennent la différence historique entre aujourd'hui et 1915 :
a) Alors que la guerre impérialiste est une donnée permanente du capitalisme décadent, sous forme généralisée ou localisée, les leçons de Zimmerwald restent bien vivantes aujourd'hui.
Dans les guerres locales, qui en permanence touchent les pays du tiers-monde -par exemple la guerre actuelle Irak-Iran, les révolutionnaires de ces contrées comme ceux du monde entier ont le devoir de lutter énergiquement contre la guerre impérialiste. Pour cela, comme leurs prédécesseurs du mouvement de Zimmerwald, ils doivent appeler à la fraternisation des soldats des deux camps et oeuvrer, dans la classe ouvrière, à la transformation de la guerre impérialiste en guerre de classe. Leur activité est indissociable de la lutte de classe du prolétariat des grands pays impérialistes pour la révolution mondiale.
b) Comme à Zimmerwald, le regroupement des minorités révolutionnaires se pose aujourd'hui de façon brûlante. Mais il se pose dans des conditions qui sont heureusement différentes : le cours actuel n'est pas un cours vers la guerre généralisée ; le cours de lutte de classe dans les grands pays industrialisés conduit à des affrontements de classe décisifs, dont l'enjeu est la marche vers la révolution et le renversement du capitalisme. Face aux enjeux actuels la responsabilité historique des groupes révolutionnaires est posée. Leur responsabilité est engagée dans la formation du parti mondial de demain, dont l'absence aujourd'hui se fait cruellement sentir. Le regroupement des révolutionnaires ne peut être une agglomération de tendances éparses. Il est un processus organique, sur la base des acquis de la Gauche communiste, dont l'aboutissement nécessaire est la formation du parti. La reconnaissance de la nécessité du parti est la pré condition d'un véritable regroupement. Cette reconnaissance n'a rien de platonique, à la manière de diverses sectes "bordiguistes", mais se base avant tout sur un réel engagement militant dans la lutte de classe actuelle.
c) Sur la base de la reconnaissance de la nécessité du parti et d'un engagement militant, les conférences internationales des groupes et organisations se revendiquant de la Gauche communiste sont des étapes décisives du regroupement des révolutionnaires. L'échec des premières tentatives de conférences (1977-80) ([17] [29]) n'invalide pas la nécessité de tels lieux de confrontation. Cet échec est relatif : il est le produit de l'immaturité politique, du sectarisme et de l'irresponsabilité d'une partie du milieu révolutionnaire qui paie encore le poids de la longue période de contre-révolution. Les conférences passées ont été et resteront un moment important dans l'histoire du mouvement 'révolutionnaire actuel. Elles ont constitué un premier pas, bien que limité, vers le regroupement. Demain, de nouvelles conférences des groupes se revendiquant de la Gauche se tiendront : elles devront se revendiquer des conférences passées de 1977-80, mais aussi de façon plus générale des conférences ou congrès qui ont déterminé l'existence du mouvement révolutionnaire. Sans être de "nouveaux Zimmerwald" ([18] [30]), les conférences internationales futures devront travailler dans un esprit "zimmerwaldien", celui de la Gauche : toute conférence n'est pas un peu de bavardage mais engage, implique de façon militante, par les prises de positions, manifestes, résolutions, les groupes présents.
d) Toute l'histoire du mouvement prolétarien montre une profonde hétérogénéité. Il est nécessairement divisé, compte tenu de son immaturité mais aussi de la pression de l'idéologie dominante, en différentes tendances.
Moins que tout autre, le courant du centre ("centrisme") n'est un courant politique homogène. D'où ses constantes oscillations entre les positions communistes et un opportunisme plus ou moins grand. Les groupes actuels qui subissent ces oscillations, voire se trouvent dans un marais anarchisant ou contamines par des positions gauchistes, ne sont pas des groupés bourgeois. Ces groupes, pour être plus ou moins éloignés chacun -selon leur histoire- du pôle révolutionnaire le plus cohérent, n'appartiennent pas au camp du capital. En dépit de leurs hésitations, confusions, opportunisme, ils ne sont pas fatalement perdus pour la révolution. La fermeté théorique et politique des groupes révolutionnaires d'avant-garde -et particulièrement le CCI aujourd'hui- est absolument cruciale pour le développement de tout le milieu prolétarien. Il n'y a pas d'évolution fatale, de déterminisme absolu. Comme Zimmerwald l'a montré, des groupes révolutionnaires qui subissent les oscillations centristes (ceux de Trotsky et de Rosa Luxemburg, par exemple) peuvent par la suite pleinement s'engager dans un regroupement révolutionnaire, sous la pression de l'avant-garde la plus claire et intransigeante. Au fur et a mesure que l'histoire s'accélère s'approchant des dénouements décisifs, les éléments ou groupes qui barbotent dans le marais, sont obligés de choisir leur camp, au prix d'un éclatement, voire de leur - passage dans le camp ennemi. A cet égard, l'histoire des mencheviks et des indépendants en 1917 et 1919 est riche d'enseignements.
Pour le mouvement révolutionnaire actuel, Zimmerwald n'est pas une simple date anniversaire. Il est aujourd'hui comme hier le drapeau des internationalistes. Mais dans des conditions différentes de 1915, les militants communistes sont aujourd'hui engagés dans la lutte de classe montante, sans laquelle ne peuvent se poser les conditions du triomphe de la révolution. Le regroupement des révolutionnaires se fera dans la seule perspective possible de transformer la crise mondiale en une lutte pour la révolution mondiale. Celle-ci est la condition préalable pour empêcher la possibilité d'une troisième guerre mondiale, dont le résultat ne peut être que la destruction de l'humanité, et donc de la perspective du communisme.
Ch.
[1] [31] Cité par Rosmer : "Le mouvement ouvrier pendant la guerre"
[2] [32] Cf. "Contre le Courant", col. Maspéro (1970)
[3] [33] Sur la question du centrisme, se reporter aux articles de la Revue Internationale n° 42
[4] [34] Cf. Liebknecht : "Militarisme, guerre et révolution", Maspéro (1970)
[5] [35] Cf. Humbert-Droz:"L'origine de l'Internationale communiste (de Zimmerwald à Moscou)", col. La Baconnière ( 1968)
[6] [36] Cf. Rosmer : "Le' mouvement ouvrier pendant la guerre" (1936)
[7] [37] Cf. Humbert-Droz, op. cit.
[8] [38] Cité par Rosmer et Humbert-Droz
[9] [39] Cf. Humbert-Droz
[10] [40] Cf. Humbert-Droz
[11] [41] Lénine, Zinoviev, "Contre le Courant",
[12] [42] Cités par Humbert-Droz
[13] [43] Cités par Humbert-Droz
[14] [44] Plus tard, Franz Mehring, l'un des principaux dirigeants spartakistes, devait reconnaître, avec d'autres militants, que l'adhésion à l'USPD avait été une erreur : "Nous nous sommes trompés sur un seul point : c'est d'avoir en effet rallié l'organisation du Parti des Indépendants après sa fondation -tout en conservant bien sûr l 'autonomie de nos positions- dans l'espoir de le faire progresser. Nous avons dû renoncer à cette espérance." (Lettre ouverte aux bolcheviks du 3 juin 1918, citée dans "Dokumente und Materialien Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung", tome II, Berlin, 1958).
[15] [45] Cités par Humbert-Droz
[16] [46] Cf. "Premier congrès de l'Internationale communiste", E.D.I. (1974)
[17] [47] Les procès-verbaux et les textes à ces conférences ont été publiés par le "Comité technique" et sont disponibles (CCI-RI, PCI-Battaglia, CWO)
[18] [48] En 1976, Battaglia comunista voulait appeler à un Zimmerwald bis...contre l'eurocommunisme des PC voués à la "social démocratisation" . ; une façon de transformer un symbole révolutionnaire en farce !
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [49]
Conscience et organisation:
Evènements historiques:
Questions théoriques:
- Guerre [52]
Heritage de la Gauche Communiste:
Milieu politique : salut a "Comunismo" n° 1
- 3110 reads
Nous avons déjà présenté dans cette revue le COLLECTIF COMMUNISTE ALPTRAUM du Mexique (REVUE INTERNATIONALE N° 40). Nous y avions publié les thèses par lesquelles les camarades du C.C.A. se situaient et se présentaient au milieu révolutionnaire et au prolétariat international. Les thèses ne constituaient pas la plateforme d'un groupe politique prolétarien. Le C.C.A. n'est pas encore un groupe politique constitué, mais un "collectif" en évolution et en pleine clarification politique. Les positions qui étaient présentées dans ces thèses s'inscrivaient sans doute possible dans le camp révolutionnaire.
En particulier, les camarades rejetaient tout nationalisme et tout mouvement de lutte de libération nationale.
Salut à COMUNISMO ! C'est avec joie et enthousiasme que nous voulons présenter ici le premier numéro de la revue semestrielle du Collectif Communiste Alptraum du Mexique : Comunismo.
Comunismo paraît au moment où l'histoire connaît une terrible accélération de par l'accentuation de la crise économique et par l'existence d'une troisième vague internationale de lutte d'un prolétariat international qui n'accepte pas la misère et la barbarie croissantes du capitalisme.
La publication de Comunismo et l'existence d'articles sur la situation de la lutte de classe tant au Mexique qu'au niveau international sont la preuve d'un souci militant d'intervention dans la lutte de classe. C'est la preuve de la compréhension croissante des camara-du CCA du rôle actif des révolutionnaires dans le développement de la lutte de classe et de la perspective de la révolution prolétarienne. Comunismo N° l et le surgissement d'un petit milieu révolutionnaire au Mexique est aussi la preuve que l'heure n'est pas à la dispersion et à la disparition des énergies révolutionnaires comme dans les années de contre-révolution , mais bien au contraire au surgissement et au regroupement de nouvelles forces partout dans le monde, dans le cadre d'un cours historique au développement de la lutte de classes et aux affrontements de classes, face à l'alternative historique que nous impose le capitalisme : socialisme ou barbarie.
L'apparition d'une nouvelle voix prolétarienne en Amérique Latine est un pas important pour le prolétariat international. Historiquement, économiquement, politiquement et géographiquement, le Mexique tient une place centrale sur le continent américain ; et le prolétariat y est appelé à jouer un grand et difficile rôle dans la généralisation et l'unification du combat de classe entre le prolétariat des U.S.A. et celui d'Amérique Latine.
La volonté politique d'intervention des camarades du C.C.A.dans la lutte de classe s'accompagne d'un effort de réappropriation historique et de débat avec le milieu révolutionnaire international :
- c'est tout à l'honneur des camarades de reprendre le nom de la publication des années 30 du Groupe des Travailleurs Marxistes du Mexique dont nous avons déjà publié des textes dans cette revue (Nos 10, 19 et 20). Rappelons que le G.T.M. était en contact avec la Fraction Italienne et la Gauche Communiste Internationale. Comunismo N°1 contient un texte de 1940 dénonçant la guerre impérialiste et l'antifascisme ;
- les camarades du C.C.A. publient une série de textes de discussion avec le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR) et nous promettent leur réponse a notre critique de leurs thèses dans le prochain numéro.
QUELQUES CRITIQUES
C'est donc un bilan positif que nous tirons de l'évolution et des discussions qu'ont menées les camarades du C.C.A. depuis plus de quatre ans avec le milieu révolutionnaire international. Alors, le lecteur sera peut-être surpris de nous voir maintenant adresser des critiques aux camarades après tant d'éloges. Mais l'activité révolutionnaire est ainsi faite qu'elle exige la discussion, la contradiction et la critique pour pouvoir se développer. Dans la mesure où nos critiques sont situées à leur place, c'est-à-dire dans le cadre d'une évolution et d'une dynamique positive tant de la part des camarades que de la situation historique actuelle, elles peuvent être à leur tour un facteur dynamique et actif dans la discussion et la clarification politiques.
Groupe en évolution, le C.C.A. n'a pas encore des positions politiques clairement définies et arrêtées. Il n'est donc nullement étonnant de trouver des positions contradictoires entre les différents articles, voire dans les articles mêmes. Nous voulons en relever deux ici. Deux qui renvoient à des questions de première importance. Nous n'allons pas développer notre position. Nous voulons juste avertir les camarades des contradictions et des dangers qui, à notre avis, peuvent les guetter s'ils n'y prennent garde.
1) Les camarades restent des plus vagues et des plus flous sur l'entrée en décadence du capitalisme. Ils considèrent "que le système se trouve en décadence" et que nous "pouvons situer le début de la décadence globale du système capitaliste à partir de 1858". Affirmation pour le moins originale que nous avons rapidement critiquée sur le plan "économique" dans la Revue Internationale" n°40.
Nous voulons souligner ici les contradictions dans lesquelles les camarades risquent de s'enfermer. Leur affirmation sur "1858" reste abstraite et sans aucune référence historique. Mais dès qu'ils sont amenés à fonder les positions politiques de classe qu'ils défendent, dès qu'ils sont obligés de défendre dans les discussions leur position juste sur le cours historique et le développement de la lutte de classe (voir la réponse au BIPR dans Comunismo) ils ne se réfèrent plus à 1858, mais à la rupture historique que constitue 1914 et la première guerre mondiale qui marque le passage du capitalisme dans sa phase de décadence "par sa situation irréproductible et unique dans l'histoire..." selon les propres termes du C.C.A.
Et ne croyez pas que cette question ne concerne que des historiens pointilleux sur les dates, ni qu'elle constitue une question théorique en soi sans implications pratiques pour les révolutionnaires. La reconnaissance et la compréhension de la fin de la période historiquement progressiste du capitalisme et son entrée en déclin sont à la base de la formation de la IIIème Internationale sur les ruines de la IIème Internationale morte en 1914. Elles fondent la cohérence de l'ensemble des positions de classe que les camarades partagent avec le CCI. Et en particulier la dénonciation des syndicats comme organes de l'Etat capitaliste au 20ème siècle et des mouvements de libération nationale comme moment des antagonismes inter-impénalistes aujourd'hui.
2) Deuxième point que nous voulons soulever. Les contradictions des camarades dans leur effort de clarification sur la question des organisations et du parti politiques du prolétariat. Les camarades pensent que "la question de l'organisation des révolutionnaires et la constitution du parti politique du prolétariat sont des aspects centraux de toute réflexion théorique-politique qui essaie de se situer dans une perspective communiste". Nous sommes d'accord.
Mais du coup les camarades - pour le moins dans ce numéro de Comunismo- ont tendance à reprendre tels quels les thèses et les textes de l'Internationale Communiste et de Bordiga sans esprit critique et sans référence aux différents apports des fractions de gauche sur cette question. Camarades du C.C.A., vous risquez de tomber dans les erreurs du bordiguisme :
- en affirmant à tort l'invariabilité du programme communiste (cf. Revue Internationale n°32). Nous nous contenterons de réaffirmer l'unité et la continuité historiques du programme communiste. Ce qui ne change pas, ce qui est invariable c'est le but : la destruction du capitalisme et l'avènement du communisme. Les moyens et les implications immédiats, eux, varient, changent et sont enrichis par l'expérience même de la lutte de classe, du prolétariat. Pour ne donner que deux exemples de ces enrichissements : l'impossibilité pour le prolétariat de s'emparer de l'Etat bourgeois pour l'utiliser à ses fins révolutionnaires et la nécessité de le détruire pour imposer sa dictature de classe est la leçon principale que tirèrent Marx et Engels de la Commune de Paris contrairement à ce qu'ils avaient exprimé auparavant ; l'impossibilité d'utilisation par le prolétariat du syndicat dans la période de décadence contrairement au 19ème siècle.
C'est Bordiga et ses "héritiers" qui ont développé dans les années 40 et 50, contre les idées que le marxisme était dépassé, l'idée poussée jusqu'à l'absurde de l'invariance du programme communiste depuis 1848, depuis la première édition du Manifeste Communiste. Au contraire, c'est justement une des forces de la fraction italienne de la Gauche Communiste - avec laquelle était en rapport et en accord le GTM du Mexique dont se revendiquent les camarades du C.C.A. -d'avoir su passer au crible de la critique la vague révolutionnaire des années 1917-23 et les positions de la IIIème Internationale ;
- en reprenant telle quelle la citation de Bordiga (I1 Soviet, 21 septembre 1919) :"Tant qu'existe le pouvoir bourgeois, l'organe de la révolution est le parti ; après la liquidation du pouvoir bourgeois, c'est le réseau des conseils ouvriers". Là, Bordiga commet une erreur en confondant les organisations politiques du prolétariat dont le rôle sera sans aucun doute plus important après la prise du pouvoir par le prolétariat, d'avec les organisations unitaires de la classe que sont les conseils ouvriers existant sur la base des assemblées regroupant tous les ouvriers ; et ces "soviets (les conseils) sont les organes de préparation des masses à l'insurrection et, après la victoire, les organes du pouvoir." (Trotsky, Histoire de la Révolution Russe). Camarades du C.C.A., cette vision de Bordiga et du bordiguisme d'une "invariance du programme" et d'un parti pouvant se substituer à la classe ouvrière mène aujourd'hui soit à la sclérose, soit au néant, soit à la contre-révolution comme l'a illustré l'évolution récente du courant "bordiguiste".
LE REGOUPEMENT DES REVOLUTIONNAIRES.
La publication de Comunismo et le développement d'un petit milieu révolutionnaire autour du C.C.A., aussi faible soit-il, confirme la possibilité d'apparition et de regroupement d'éléments révolutionnaires dans le monde entier, y compris dans les pays du "Tiers-Monde". Mais ' pour cela, les éléments révolutionnaires doivent rompre clairement, nettement et sans hésitation avec le "tiers-mondisme", avec tout type de nationalisme et le gauchisme. C'est à ce prix qu'ils pourront développer une réelle clarification politique et une réelle activité révolutionnaire. C'est ce qui constitue la force de Comunismo.
Les organisations politiques du prolétariat déjà existantes (principalement situées en Europe) doivent être très fermes sur cette indispensable rupture avec tout nationalisme si elles veulent assumer la tâche de pôle de référence et de regroupement au niveau international, si elles veulent participer et aider au surgissement d'éléments et de groupes révolutionnaires. C'est une des tâches essentielles que le CCI s'est toujours donnée et qu'il essaie de remplir avec ses faibles forces : "concentrer les faibles forces révolutionnaires dispersées dans le monde est aujourd'hui, dans cette période de crise générale, grosse de convulsions et de tourmente sociales, une des tâches les plus urgentes et les plus ardues qu'affrontent les révolutionnaires" (Revue Internationale n°1, avril 1975).
C'est dans ce sens que le CCI aidera autant qu'il le peut les camarades du C.C.A. dans leur effort militant d'intervention dans la lutte de classe et dans leur volonté de débat dans le milieu révolutionnaire. L'accomplissement de ces tâches par Comunismo permettra le développement d'un milieu révolutionnaire au Mexique et surtout, à terme, - et là est le plus împortant- une réelle présence politique du prolétariat. Pour cela Comunismo est l'instrument indispensable dont avait besoin le prolétariat au Mexique. Longue vie à Comunismo !
CCI
Géographique:
- Mexique [54]
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 45 - 2e trimestre 1986
- 2458 reads
La lutte ouvrière en 1985 : bilan et perspectives
- 2538 reads
Une année de combats particulièrement difficiles, qui se sont heurtes a une bourgeoisie de plus en plus adroite, mais aussi de plus en plus apeurée. La perspective de ces combats : l'unification a travers un long processus d'expériences et d'affrontements.
Comme toujours au début de l'année, les médias de la classe dominante ont tiré le "bilan social" de l'année précédente. A les entendre et les lire, ils sont tous d'accord sur un point : l'année 1985 a été marquée par un recu1 généralisé de la lutte ouvrière.
A longueur de pages, ils publient des statistiques montrant la diminution du nombre de grèves et de "journées perdues pour fait de grève". Puis ils expliquent : en ces temps de crise, les ouvriers ont enfin compris que leurs intérêts ne sont pas contradictoires avec ceux des entreprises qui les emploient. Alors, pour mieux défendre leur emploi, ils s'abstiennent de faire grève.
En quelque sorte, la crise économique, loin d'exacerber les antagonismes entre les classes, les aurait au contraire estompé. La crise démontrerait la véracité de la vieille chanson qu'entonnent les exploiteurs aux exploités lorsque leurs affaires vont mal : "nous sommes tous dans le même bateau". Même la plupart des groupes du milieu politique prolétarien se rangent à l'analyse d'un recul de la lutte de classe.
Il n'y a -pour ainsi dire- que le CCI qui développe une vision contraire, reconnaissant une reprise internationale de la lutte 'ouvrière depuis la fin 1983. Une reprise (la troisième après les vagues de 1968-74 et 1978-80) qui touche toutes les parties du monde ; évidente dans les pays sous-développés, elle apparaît clairement dans les pays développés -en particulier en Europe occidentale- à condition de regarder la réalité de la lutte de classe en sachant la resituer dans sa dynamique historique et internationale.
Le paradoxe de cette situation, c'est que la bourgeoisie, ses gouvernements et l'ensemble de son appareil politique (partis et syndicats), malgré leur propagande, ne se trompent pas, et n'ont de cesse de développer et d'employer un arsenal d'instruments économique, politique et idéologique, pour conjurer, affronter, la combativité prolétarienne. La bourgeoisie montre dans la pratique sa peur de la menace ouvrière, alors que des groupes révolutionnaires se lamentent pitoyablement sur le fait que le mouvement de leur classe ne soit pas plus rapide, plus spectaculaire, ou plus immédiatement révolutionnaire.
Nous nous attacherons dans cet article :
1°) à démontrer que la réalité de la lutte de classe en 1985 dément radicalement cette idée de la soumission passive du prolétariat mondial aux nécessités du capital en crise ;
2°) à dégager les perspectives qui en découlent pour le combat prolétarien mondial.
COMMENT ENVISAGER LES FAITS
Avant de tracer un rapide tableau chronologique des luttes ouvrières dans le monde au cours de l'année1985, il est indispensable de faire quelques remarques :
Il est vrai que, de façon générale, dans les pays d'Europe occidentale les statistiques officielles du nombre de grèves et de journées de travail perdues pour fait de grève est resté bas en 1985, en comparaison des niveaux atteints à la fin des années 60 ou pendant les années 70. Mais un tel constat ne suffit pas pour déterminer le sens de la dynamique de la lutte ouvrière... encore moins pour conclure à un ralliement des ouvriers' aux nécessités de la logique économique capitaliste.
Premièrement, les statistiques de grèves (pour autant qu'elles ne soient pas trop faussées par la volonté des gouvernements toujours soucieux de démontrer leur capacité à maintenir "la paix sociale") sont généralement gonflées par de longues grèves sectorielles, isolées (telle la grève des mineurs britanniques). Or, une des caractéristiques majeures de l'évolution de la lutte ouvrière au cours des dernières années, particulièrement confirmée en 1985, c'est la tendance à abandonner cette forme d'action -spécialité des syndicats- dont l'inefficacité apparaît de plus en plus clairement aux yeux des travailleurs européens.
Comme nous le verrons, le type de lutte courte et explosive, surgissant généralement hors de toute consigne syndicale et cherchant rapidement à s'étendre, telles la grève d'octobre en. Belgique ou celle du métro parisien en décembre 1985, beaucoup plus caractéristiques et significatives de la période à venir, ne comptent que pour très peu (ou pas du tout) dans les statistiques off4cielles de grèves.
De ce point de vue, la faiblesse des statistiques du nombre de jours de grève ne traduit pas mécaniquement un recul de la lutte ouvrière mais exprime une certaine maturation de sa conscience.
Deuxièmement, faire grève en 1985 n'a pas la même signification que faire grève en 1970. La menace de chômage qui pèse sur chaque travailleur comme une épée de Damoclès d'une part, l'action concertée de l'ensemble des forces de la bourgeoisie -avec les syndicats aux premiers rangs- pour empêcher toute mobilisation de classe d'autre part, font qu'au milieu des années 80 il est beaucoup plus difficile pour les travailleurs de se lancer à la lutte que pendant les années 70 ou à la fin des années 60. Ce serait faire abstraction de toute la gravité de l'évolution historique des quinze dernières années que de vouloir comparer quantitativement et mettre sur le même plan une "journée de grève" d'aujourd’hui avec une de la décennie précédente. En ce sens on peut dire qu'une grève du milieu des années 80 est plus significative qu'une grève des années 70 ou 60.
Troisièmement : aucune statistique de grèves ne peut rendre compte de cet autre aspect crucial de l'action ouvrière que constitue à notre époque la lutte des chômeurs. Même si celle-ci reste encore pour le moment à ses premiers balbutiements, les débuts d'organisation de comités de chômeurs en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en France, représentent un élément important -et ignoré par ces statistiques- de l'actuelle combativité ouvrière.
1985 : LA CLASSE OUVRIERE MONDIALE REFUSE DE SE PLIER PASSIVEMENT A LA LOGIQUE DU CAPITAL EN CRISE.
L'idée d'après laquelle la crise pousserait les ouvriers à épouser la logique de la rentabilité capitaliste est peut-être un rêve chimérique de la classe dominante. Mais la réalité mondiale dément quotidiennement ces mensonges propagandistes.
En tenant compte des remarques que nous venons de formuler sur la signification des luttes ouvrières actuelles dans les pays les plus développés, un rapide aperçu des principales luttes ouvrières qui ont marqué mois par mois, aux quatre coins de la planète, l'année 1985, suffit à ridiculiser ces assertions.
La liste qui suit ne prétend évidemment pas rassembler toutes les luttes importantes de l'année. La bourgeoisie a mené consciemment une politique de "black-out" systématique sur les informations concernant les luttes ouvrières. Ceci est déjà vrai au niveau de chaque pays, mais l'est encore plus au niveau international. C'est ainsi, par exemple, que nous, ne pourrons pour ainsi dire pas citer de luttes dans les pays dits "communistes", même si nous savons que la classe ouvrière s'y bat tout comme en occident.
Si le mois de janvier fut marqué par le déclin de la grève des mineurs britanniques, dès le mois de février au moment même où celle-ci se concluait, une nouvelle vague de luttes ouvrières commençait en Espagne et allait durer jusqu'en mars touchant entre autres les chantiers navals, l'automobile (en particulier Ford-Valencia), les postes de Barcelone (grève spontanée et qui resta longtemps sous le seul contrôle de l'assemblée des grévistes) et les journaliers agricoles de la région du Levant.
Le mois d'avril commença par l'explosion des luttes ouvrières dans ce "paradis du socialisme Scandinave" qu'est le Danemark avec une grève générale qui mobilise plus d'un demi million de travailleurs. Au cours du même mois, en Amérique latine, dans le pays du "miracle brésilien", en pleine "transition démocratique", 400 000 ouvriers partent en grève et paralysent la très moderne banlieue industrielle de Sao Paolo, la principale concentration industrielle du subcontinent américain (malgré les appels des nouveaux syndicats, les ouvriers refusent d'arrêter leur lutte à l'occasion de la mort spectaculaire du nouveau président "démocratique").
Le mois de mai voit l'éclatement des premières luttes importantes des mineurs d'Afrique du Sud. Le mois de juin commença marqué par la grève de 14 000 employés des hôtels de New York qui vit les travailleurs organiser par eux-mêmes l'extension de la lutte par l'envoi de piquets massifs. Le mythe des USA comme pays réduit à la paix sociale musclée de Reagan était encore une fois démenti et le sera encore à plusieurs reprises au cours de 1985. Toujours au mois de juin et toujours en réponse à des mesures d'austérité prises par le gouvernement local, en Colombie les grèves se multiplient et, le 20, les syndicats sont contraints d'organiser une grève générale. Le mois de juillet commence par le début, aux USA, de la grève des métallurgistes de Wheeling Pittsburg : le secteur de l'acier est violemment frappé aux USA. Leur lutte -dans une des principales zones industrielles de la première puissance mondiale- durera jusqu'à fin octobre.
En Grande-Bretagne, où depuis la fin de la grève des m meurs, les grèves n'ont jamais cessé, éclate hors de coûte consigne syndicale une importante grève clans les chemins de fer : elle s'étend rapidement et l'on verra dans le Pays de Galles des piquets de grève de cheminots briser les barrières corporatistes pour aider Les piquets d'une aciérie en grève. En France les principaux chantiers navals du pays partent en grève et par deux occasions, à Lille et à Dunkerque, les ouvriers débordent l'encadrement syndical et affrontent la police pendant plusieurs heures. En Israël, toujours en juillet, à l'annonce par le gouvernement du "socialiste" Pérès d'une série de mesures d'austérité (hausse de certains prix de 100 %, baisse des salaires de 12 à 40 %, licenciement de 10 000 fonctionnaires), les réactions ouvrières ne se font pas attendre : le syndicat (lié au parti au gouvernement) doit organiser une grève générale de 24 heures (suivie par 90 % de la population active). Mais au moment de la reprise du travail, des secteurs entiers tentent de continuer la lutte. Les bonzes syndicaux parlent de "risques réels de débordement". Au mois d'août, en Yougoslavie "socialiste", un train 4e mesures d'austérité déclenche une vague de grèves qui touche diverses régions du pays : des grèves particulièrement importantes mobilisent les mineurs et les travailleurs des ports.
Au mois de septembre c'est en Bolivie, un des pays les plus pauvres du monde mais où il existe une vieille tradition de luttes ouvrières -en particulier dans les mines- que l'annonce de mesures économiques particulièrement draconiennes (multiplication par 4 du prix du pain, par 10 du prix de la nourriture, par 20 du gaz domestique, en même temps qu'un gel des salaires des fonctionnaires pendant quatre mois 0 déclenche une réaction générale des travailleurs. Le principal syndicat, la C.O.B., appelle à une grève de 48 heures, largement suivie. Le mouvement est violemment réprimé. Du coup, les ouvriers prolongent la grève générale pendant encore 16 jours. En France, fin septembre, éclate, hors de toute consigne syndicale, dans les chemins de fer, la grève la plus importante dans ce secteur depuis la fin des années 60. Elle s'étend rapidement contraignant le gouvernement à suspendre -du moins pour l'immédiat- l'application des mesures de contrôle qui avaient déclenché le mouvement.
Au mois d'octobre, en Belgique, éclatent des grèves dans les postes, les chemins de fer, le métro de Bruxelles et les mines du Limbourg, qui suivent le même déroulement : démarrage hors des consignes syndicales et extension rapide dans leur propre secteur, "recul" momentané du gouvernement par crainte d'extension des mouvements. Au même moment, la Hollande connaît une vague de grèves analogues qui touche principalement les pompiers, les conducteurs de camions et différents secteurs du port de Rotterdam. Le 6 novembre, au moment même où les mineurs du Limbourg reprenaient le travail, en Grèce, 100 000 travailleurs du secteur public et privé faisaient grève contre les mesures d'austérité du gouvernement socialiste. Au cours du même mois une vague de grèves secouait à nouveau le Brésil (600 000 grévistes). En Argentine, où le nouveau gouvernement "démocratique" a imposé en 1985 des baisses de revenus allant jusqu'à 45 %, commence toute une période d'agitation et de luttes ouvrières qui se prolonge jusqu'en janvier 1986. Toujours en novembre, la Suède -encore un "paradis socialiste"- connaît, elle, la plus importante période de luttes ouvrières depuis la fin des années 60 : ouvriers des abattoirs dans le nord, mécaniciens de locomotives dans tout le pays, nettoyeuses industrielles de Borlange et surtout la grève des nourrices ("mères de jour") qui ont organisé par elles-mêmes, contre l'Etat et les syndicats, leur lutte dans tout le pays, culminant le 23 novembre par des manifestations Simultanées dans 150 villes différentes. Dans une manifestation, les travailleuses scandaient "le soutien des syndicats est notre mort !".
Au Japon, pays réputé pour l'absence de luttes ouvrières, une grève éclate contre la menace de licenciements massifs dans les chemins de fer. Le mois de décembre -pour terminer ce bref tour d'horizon de l'année 85- est, lui, marqué par une nouvelle reprise des grèves en Espagne : hôpitaux et services de santé à Barcelone ; les mines des Asturies (contre une recrudescence sans précédents des accidents de travail) ; la région de Vigo (Galice) et surtout la région de Bilbao, sont touchées par des grèves dans divers secteurs, à nouveau les chantiers navals mais aussi les chômeurs embauchés par la municipalité. En France, les conducteurs du métro de Pans, à la suite de mesures prises à rencontre de l'un d'eux, partent spontanément en grève et paralysent en quelques heures la capitale. Au Liban, déchiré par les guerres entre fractions de la bourgeoisie locale et les antagonismes internationaux, une hausse des prix de 100 % provoque une grève générale et des appels des travailleurs du secteur musulman au secteur chrétien disant : "la famine ne connaît pas de couleurs politiques et touche tout le monde sauf la minorité dominante".
C'est volontairement que nous avons présenté cet aperçu des principaux moments de la lutte ouvrière mondiale "en vrac", suivant uniquement leur succession chronologique.
Quelles que soient les différences qui existent entre les combats prolétariens dans les pays de la périphérie et ceux des pays centraux, ceux-ci ne sont que des moments d'une même lutte, une même réponse à une même attaque du capital mondial en crise. Il était nécessaire, dans un premier temps, de montrer clairement l'aspect mondial de la résistance ouvrière pour démentir cette absurdité suivant laquelle la crise économique aurait atténué la lutte de classe. Il était en outre nécessaire de mettre en évidence cette unité pour mieux dégager, à partir des différences entre les luttes ouvrières, la dynamique globale de celles-ci.
DIFFERENCES DE LA LUTTE OUVRIERE DANS LES PAYS CENTRAUX INDUSTRIALISES ET DANS CEUX DE LA PERIPHERIE
Un regard global aux luttes ouvrières dans le monde actuellement met en évidence le fait que dans les pays sous-développés celles-ci tendent à prendre rapidement une forme unifiée -même si c'est encore derrière les centrales syndicales- alors que dans les pays industrialisés les luttes, au cours de 1985, ont eu tendance à être moins massives à la fin de l'année qu'au début : après des mouvements comme ceux des mineurs britanniques ou la grève générale au Danemark, on assiste à une multiplicité de luttes plus courtes, plus explosives, plus simultanées mais aussi plus isolées les unes des autres.
Cela tient essentiellement à la différence des effets de la crise suivant le degré de développement économique du pays et aux stratégies que la classe dominante est amenée à réaliser en fonction des conditions socio-politiques auxquelles elle est confrontée.
Dans les pays sous-développés dont l'économie est en banqueroute totale, les mesures dites "d'austérité" qu'est contraint de prendre le capital contre les travailleurs revêtent inévitablement un caractère beaucoup plus violent, direct et massif. Le capital n'y possède aucune marge de manoeuvre économique. Des mesures comme les hausses vertigineuses des prix des biens de consommation, les réductions des salaires réels de l'ordre de 30, 40 %, les licenciements immédiats et massifs comme on les a vus au cours de 1985 dans des pays comme la Bolivie, l'Argentine ou le Brésil, sont des attaques qui touchent simultanément et immédiatement l'ensemble des travailleurs.
Cela crée les bases objectives pour des mouvements d'ampleur pouvant rapidement unifier des millions de travailleurs.
Pour faire face à de tels mouvements, les bourgeoisies locales n'ont généralement eu d'autre recours que la plus sauvage et impitoyable répression. Répression qui est rendue possible par la faiblesse numérique et historique du prolétariat local et par le fait que la classe dominante peut recruter ses forces de répression dans une masse gigantesque de sans-travail marginalisés depuis des générations.
Mais de telles méthodes s'avèrent de moins en moins, suffisantes et créent le risque d'une déstabilisation totale de la société (comme on l'a vu en Bolivie, la répression n'a fait cette fois qu'exacerber la lutte ouvrière). C'est pourquoi l'on assiste à des simulacres de "démocratisation" des régimes des pays sous-développés souvent sous la pression des puissances impérialistes (voir les pressions des USA et ses alliés européens en ce sens en Amérique du Sud, Afrique du Sud, Haïti, Philippines), dans le seul but de créer des appareils syndicaux et politiques capables de contrôler les luttes ouvrières (autrement plus dangereuses que les émeutes de la faim devenues chroniques dans certains de ces pays) et les conduire dans les impasses nationalistes.
Ces nouveaux appareils d'encadrement jouissent en outre de la force que leur octroie le manque d'expérience de la "démocratie" bourgeoise des travailleurs de ces pays et les illusions que ceux-ci entretiennent -du moins au début- à leur égard après avoir subi des années de dictature militaire ou civile.
Wans les pays développés -et plus particulièrement en Europe occidentale- la situation est tout autre. Sur le plan économique, la bourgeoisie dispose encore d'une marge de manoeuvre qui -même si elle ne cesse de se réduire chaque jour sous l'effet de la crise de son système- lui permet de mieux étaler, planifier ses attaques de façon à éviter la prise de mesures trop directement globales, frappant immédiatement et violemment un grand nombre de travailleurs à la fois. Les attaques qu'elle porte sont de plus en plus puissantes et massives mais elle s'applique à en disperser les retombées de sorte qu'elles apparaissent à chaque secteur de la classe ouvrière comme une attaque particulière, spécifique. Si l'on compare l'année 1984 avec l'année 1985 à ce niveau, on constatera qu'il s'agit d'une politique consciente de la bourgeoisie.
Les fameuses politiques de "privatisation" du secteur public de l'économie et de développement d'un soi-disant libéralisme économique au niveau de la vie des entreprises s'inscrivent parfaitement dans cette stratégie ([1] [57]). Les licenciements "pour raison de restructuration industrielle" apparaissent ainsi comme une affaire particulière d’embaucher dans les nouvelles entreprises privées qui "sauvent" les vieilles grandes entreprises en faillite. Le nombre de licenciements est le même- mais ceux-ci apparaissent éparpillés en autant d'entreprises, de "cas particuliers".
Sur ce plan, la bourgeoisie mondiale semble avoir tiré les leçons de la grande peur qu'elle eut avec la Pologne en 1980 : dans les pays de la périphérie elle comprend que lorsque la répression brutale et massive ne suffit plus, il est indispensable de créer des "Solidarnosc" locaux capables de saboter les mouvements sociaux de l'intérieur ; dans les pays les plus industrialisés elle sait que des attaques économiques trop grossièrement menées (comme celle qui, en août 80, déclencha l'explosion des villes ouvrières de la Baltique) lui font courir des risques trop importants pour le maintien de l'ordre social.
L'EUROPE OCCIDENTALE : LIEU DES AFFRONTEMENTS LES PLUS DETERMINANTS
Comme nous lavons à maintes reprises démontré en particulier au moment de tirer des leçons de la Pologne 80- c'est en Europe occidentale, la plus ancienne et la plus importante concentration industrielle du monde, que se jouent les affrontements les plus décisifs pour la lutte ouvrière mondiale ([2] [58]). C'est là que se trouve le prolétariat le plus concentré et le plus expérimenté. Mais c'est aussi là que règne la bourgeoisie la plus rompue à la lutte de classes. Cette politique de dispersion des luttes ouvrières par une apparence de dispersion de l'attaque économique n'est en réalité qu'un volet, un aspect de l'arsenal complexe et systématiquement développé par la bourgeoisie dans cette partie du monde pour affronter les luttes ouvrières.
Au cours de l'année 1985 on a pu voir la bourgeoisie européenne recourir à l'ensemble de ces moyens et les développer de façon de plus en plus concertée.
C'est ainsi qu'elle a eu recours simultanément
1°) au partage du travail entre ses différentes forces politiques et' syndicales ;
2°) aux campagnes idéologiques ;
3°) à la répression.
Le partage du travail entre, d'une part des gouvernements qui -de droite ou de gauche- ont systématiquement appliqué des politiques de "rigueur", c'est-à-dire de renforcement de l'exploitation et, d'autre part des forces de "gauche" (partis et syndicats) qui, chargés d'assurer l'encadrement des rangs ouvriers, ont radicalisé leur langage pour mieux canaliser les réactions prolétariennes dans des impasses ou, plus simplement, saboter toute mobilisation importante sur un terrain de classe.
Au cours de l'année 1985 ce mouvement de "radicalisation" des forces de gauche de l'appareil politique du capital s'est manifesté d'abord par le développement et le recours de plus en plus fréquent au "syndicalisme de base", c'est-à-dire à des tendances syndicalistes (généralement animées par des gauchistes) qui critiquent les directions et les appareils des grandes centrales mais pour mieux défendre le terrain syndical. Particulièrement actives en Belgique (mines du Limbourg), elles ont joué un rôle important dans les grèves en Grande-Bretagne (appui aux shop stewards), en Espagne, aux Etats-Unis, en Suède... Les grandes centrales elles-mêmes ont radicalisé leur langage. Cela a été notoire pour la CGT en France qui cherche à faire oublier la participation de son parti tuteur, le PCF, au gouvernement pendant trois ans ; pour L.O. en Suède, syndicat lié au parti socialiste au gouvernement et qui s'est vu de plus en plus débordé au cours des luttes en fin d'année ; pour l'UGT en Espagne qui, appuyant trop ouvertement le PSOE au pouvoir, passait de plus en plus pour un syndicat jaune.
Mais ce radicalisme de langage n'a servi qu'à mieux masquer un travail systématique de démobilisation.
Contrairement à ce qu'ils faisaient au cours des années 60 ou 70, lorsqu'ils pouvaient se permettre d'organiser de grandes manifestations de rue pour mieux redorer leur blason de "défenseurs des travailleurs", les syndicats européens ne prennent plus de tels risques aujourd'hui. Ils savent que la méfiance croissante des travailleurs à leur égard (qui se concrétise par une désertion massive des syndicats) n'a d'égal que la colère sourde qui gronde dans les rangs des exploités. Ils savent que toute manifestation importante de travailleurs sur un terrain de défense claire de leurs revendications de classe ([3] [59]) risque à tout moment d'échapper à leur contrôle. C'est pourquoi on assiste dans la plupart des pays européens à une stratégie syndicale qui consiste soit à convoquer des manifestations en ne donnant l'heure et le lieu de rassemblement qu'à la dernière minute et de la façon la plus discrète possible, de façon à n'y voir que les éléments les plus proches des appareils syndicaux, soit à convoquer de nombreux rassemblements mais dans des lieux différents d'une même ville en prenant soin d'éviter que les cortèges ne puissent se rencontrer (en Espagne, en France, en Grande-Bretagne, les syndicats sont devenus maîtres à ce jeu de dispersion de la combativité prolétarienne).
Les campagnes idéologiques - Sur ce terrain encore, l'action de la bourgeoisie a été particulièrement fertile. Les ouvriers européens ont été matraqués quotidiennement par des campagnes sur :
- l'inutilité de la lutte en temps de crise -surtout après la défaite de la grève des mineurs britanniques;
- le bonheur de vivre dans des pays "démocratiques" surtout au moment des luttes en Afrique du Sud ;
- le terrorisme, cherchant à assimiler toute lutte contre l'Etat à du terrorisme en Belgique cette campagne a pris des proportions gigantesques et a abouti, entre autres, à la décision de mettre des forces armées d'élite à la porte de certaines usines...afin de mieux les défendre contre le terrorisme!; la défense des régions, du secteur, voire de l'entre prise, cherchant à faire croire aux travailleurs en lutte que la défense de leurs conditions d'existence devrait se confondre avec celle des instruments de leur exploitation ("défense du charbon national" (Limbourg, Ecosse, Asturies) défense de la région (Pays Basque en Espagne, la Lorraine en France, la Wallonie en Belgique, etc, etc.).
La répression - A côté des moyens économiques, politiques, idéologiques, la bourgeoisie européenne n'a cessé de développer aussi les instruments de la répression policière. L'année 1985 a été marquée à ce niveau en particulier par les exemples de la Belgique, dont nous avons fait déjà mention, et surtout celui de la Grande-Bretagne où, à la suite de la grève des mineurs et les émeutes de Birmingham et Brixton, la bourgeoisie a procédé à un renforcement sans précédents dans l'histoire de ce pays des forces et des moyens de répression des luttes sociales.
PERSPECTIVES DE LA LUTTE DE CLASSE
Mais si la bourgeoisie mondiale -et en particulier celle d'Europe occidentale- a été conduite au cours de 1985 à développer de telle sorte tous les moyens de la défense de son système, c'est parce qu'elle a peur. Et elle a raison d'avoir peur.
La troisième vague internationale de luttes ouvrières n'en est qu'à ses débuts et la lenteur de son développement exprime la profondeur du bouleversement qu'elle prépare.
La tendance en Europe occidentale -dont dépend l'avenir de la lutte ouvrière mondiale- à l'abandon par les ouvriers des formes de lutte consistant en des grèves longues, isolées dans des forteresses symboliques, traduit -même si cela prend encore une forme trop dispersée- une assimilation d'années d'expériences et de défaites dont la grève des mineurs britanniques a été un des derniers exemples spectaculaires. En ce sens, l'année 1985 a marqué en Europe une avancée.
Quant à cette dispersion, les bases sur lesquelles .repose l'actuelle stratégie d'éparpillement des luttes ouvrières en Europe occidentale, sont appelées à s'user de plus en plus rapidement sous l'effet de l'aggravation de la crise économique et de l'expérience cumulée de l'affrontement de la combativité ouvrière avec les carcans syndicaux.
La faible marge de manoeuvre économique dont dispose encore la bourgeoisie des pays industrialisés ne peut aller qu'en s'amenuisant au fur et à mesure que s'exacerbent les contradictions internes de son système et que s'épuisent ses palliatifs à la crise, tous fondés sur le recul des échéances par une fuite en avant dans le crédit. Sur ce plan-là, ce sont les pays sous-développés qui montrent l'avenir aux régions plus industrialisées.
Quant â la capacité de sabotage des luttes ouvrières que possèdent encore syndicats et autres forces "de gauche" du capital, la confrontation permanente, le heurt répété et omniprésent entre la poussée des forces prolétariennes et les barrières idéologiques et pratiques de ces institutions, conduit lentement, mais Irréversiblement, vers la création des conditions de l'épanouissement d'une véritable autonomie de la lutte ouvrière. L'abandon des casernes syndicales par un nombre toujours croissant d'ouvriers à travers toute l'Europe la multiplication- des luttes qui démarrent et cherchent à s'étendre en dehors des consignes syndicales en sont un témoignage in équivoque. La conscience de sa force, les moyens de développer celle-ci face aux attaques du capital, la classe ouvrière ne peut les obtenir que par le combat lui-même un combat qui l'affronte non seulement aux gouvernements et aux patrons, mais aussi aux syndicats et aux forces politiques de la gauche du capital.
La perspective de la lutte de classe c'est la poursuite de la lutte. Et la poursuite de la lutte est et sera de plus en plus le combat contre la dispersion, pour l'unification.
Au bout de l'actuel processus de développement d'une effervescence omniprésente internationalement, il y a l'internationalisation des luttes ouvrières.
R.V.
UNE MEME LUTTE DANS DES MOMENTS HISTORIQUES DIFFERENTS
Grèves d'hier et d'aujourd'hui
Voilà près de deux siècles que la classe ouvrière fait des grèves pour résister et combattre l'exploitation Capitaliste qu'elle subit plus directement que toute autre classe exploitée. Cependant toutes les grèves n'ont évidemment pas la même signification suivant la période historique dans laquelle elles se situent. Les grèves ouvrières de notre époque traduisent, comme celles du début du XIX° siècle, le même antagonisme et la même guerre entre la classe exploitée porteuse du communisme et la classe exploiteuse qui profite, défend et assure la reproduction de l'ordre social établi. Mais les luttes ouvrières actuelles n'affrontent pas, comme au XIX° siècle, un capitalisme en pleine jeunesse, conquérant le monde et faisant faire à l'humanité des progrès sans précédents dans tous les domaines. Les grèves des "années 80" combattent la réalité d'un système sénile, décadent, qui après avoir plongé par deux fois l'humanité dans les horreurs des deux guerres mondiales, après avoir connu à partir des années 50 vingt ans de prospérité relative en reconstruisant ce qu'il avait détruit auparavant et en développant un armement capable de détruire plusieurs fois la planète, se débat depuis la fin des années 60 dans une crise économique sans précédent.
Les luttes ouvrières actuelles, parce qu'elles constituent la seule résistance effective, réelle, à la barbarie totalitaire du capitalisme décadent, représentent la seule source de lumière pour une humanité en proie à "l'effroi sans fin" ".
Mais la blessure mortelle que porte le capitalisme, dont les lois sont devenues historiquement obsolètes, ne rend pas pour autant celui-ci plus conciliant envers ses esclaves. Au contraire. La classe ouvrière affronte aujourd'hui une bourgeoisie cyniquement expérimentée, adroite, capable d'agir de concert au niveau national et international (Pologne 80), pour faire face aux luttes ouvrières.
Parce que les enjeux historiques sont plus graves, parce que les difficultés rencontrées sont plus grandes, toute manifestation de résistance ouvrière prend aujourd'hui une signification d'autant plus importante. Ceux qui actuellement, au nom d'un "radicalisme" de parole, regardent grève après grève, lutte après lutte, avec un "mépris transcendental" parce qu'ils ne les trouvent pas encore assez "révolutionnaires", ne font qu'exprimer l'impatience de celui qui ignore tout de la révolution et de la complexité du processus qui la %' prépare. On ne peut rien comprendre aux luttes ouvrières présentes si on "oublie" cette nécessité élémentaire de les replacer dans leur contexte, dans leur dynamique historique.
R.V.
[1] [60] Sur le plan économique, le poids de l'Etat n'a jamais été aussi grand qu'actuellement...et il ne cesse de se développer. Il suffit de voir l'augmentation incessante de la part du revenu national qui, sous une forme ou sous une autre, passe par les mains de l'Etat, pour s'en convaincre La seule utilité qu'a sur le plan strictement économique cette politique dite "libérale", c'est d'accélérer les concentrations de capitaux par l'élimination plus rapide de secteurs et entreprises non rentables au profit des grands capitaux.
[2] [61] Voir "Le prolétariat d'Europe de l'Ouest, au coeur de la lutte de classe" (Revue Internationale n° 31).
[3] [62] Evidemment, les forces de gauche sont toujours prêtes à mobiliser les travailleurs mais sur des terrains inter-classistes ou ambigus : voir la campagne anti-OTAN en Espagne actuellement ou celle pour les "droits démocratiques" de grève en R.F.A.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [1]
Où en est la crise économique ?
- 2469 reads
BAISSE DU PRIX DU PETROLE, BAISSE DU DOLLAR, LA RECESSION A L'HORIZON
Le texte qui suit est composé d'extraits de la partie sur la crise économique du rapport sur la situation internationale du 6ème congrès du CCI. Ce rapport a été rédigé à la mi-85; les éléments chiffrés les plus récents qu'il contient datent 'donc de cette période; cependant les analyses et orientations qu'il défend ont été amplement confirmées depuis.
Ces derniers mois, le marché mondial a été soumis à d'importantes secousses :
- la chute du dollar s'est accélérée et un an après avoir battu des records historiques (10,61 Frs le 28.2. 85), le roi dollar se retrouve à son niveau d'octobre 1977 (6,79 Frs et 2,20 DM le 28.2.86).
- depuis le début de l'année 86 les cours du pétrole ont fait le grand plongeon, le prix du baril passant de 28 $ à 14 $, soit une diminution de moitié du prix de l'or noir ;
- tous les cours des matières premières ont dans l'ensemble chuté et depuis l'automne la bourse des métaux de Londres est secouée par l'effondrement des cours de l'étain dont la cotation est interrompue depuis le 24.10.85, sans avoir repris depuis;
- la spéculation boursière est acharnée et partout les cours boursiers ont fortement progresse : à New York, à Londres, Paris, Tokyo etc., mais cette situation est fragile et en janvier la bourse de New York a connu une sérieuse alerte avec la plus forte chute de l'indice Dow Jones depuis la chute historique du jeudi noir de 1929.
Cette liste qui pourrait être encore allongée illustre les ravages de plus en plus importants de la crise de surproduction généralisée sur l'économie mondiale, l'accélération de la crise et l'instabilité croissante du marche mondial.
Pourtant, la classe dominante ne cesse de proclamer que "tout va bien !" : les politiciens de tous bords promettent toujours l'amélioration pour demain et les technocrates prétendent en se voulant rassurants; maîtriser la situation. Les travailleurs peuvent dormir tranquilles : malgré les records de chômage battus en Europe, malgré la misère qui recouvre le monde, il ne faut pas s'inquiéter car nos gouvernants contrôlent la situation !
Pourtant en fait l'inquiétude monte avec la déstabilisation grandissante de l'économie mondiale et les discours lénifiants de la bourgeoisie sont une litanie dont elle-même voudrait bien parvenir à se convaincre. La baisse du dollar est posée comme une mesure d"'assainissement" du marché mondial tandis que la chute des cours du pétrole est présentée comme une "aubaine" : la réalité est cependant bien inquiétante Car ce qui se profile au-delà c'est l'horizon de la récession. C'est cette perspective dont nul aujourd'hui n'est capable au sein de la classe dominante d'en mesurer les conséquences qui fait monter une angoisse Sourde au sein de la bourgeoisie.
La baisse du dollar à la suite de la première réunion du groupe des cinq (USA, Japon, RFA, Grande-Bretagne, et France) pourrait faire croire à une parfaite maîtrise des échanges monétaires de la part des grandes puissances. Pourtant, cette baisse traduit une nécessite impérieuse pour l'économie américaine, celle de retrouver sa compétitivité sur le marché mondial. Elle traduit l'échec et la fin de la politique de reprise menée par le gouvernement Reagan. La maîtrise dont fait preuve la bourgeoisie ne parvient qu'à limiter provisoirement les dégâts, si elle freine la dégradation de l'économie mondiale, elle ne parvient cependant pas à l'empêcher et celle-ci inéluctablement se poursuit.
Les conséquences de la baisse du dollar sont catastrophiques pour l'Europe et le Japon qui voient leur compétitivité grevée d'autant et se profiler ainsi le spectre de la récession. Face à une telle situation la 2ème réunion du groupe des cinq avait pour but de poser l'éventualité d'une baisse concertée des taux d'intérêts afin de relancer les marchés intérieurs et la production. Cette réunion a été présentée comme un échec devant les risques que constitueraient pour le dollar une baisse trop forte et trop rapide des taux américains :
- crise de confiance des spéculateurs du monde entier;
- relance accélérée de l'inflation.
Cependant ce n'est certainement pas un hasard si c'est au lendemain de cette réunion que s'est brutalement accélérée la chute des cours du pétrole. Cette chute n'est pas déterminée en soi par la bourgeoisie, elle est d'abord l'expression de la crise de surproduction; cependant elle tombe à point pour donner un ballon d'oxygène provisoire aux économies les plus développées. Non seulement, elle permet de faire baisser l'inflation, mais surtout elle permet de faire diminuer de moitié le coût de la première importation des principaux pays développés, et de faire de substantielles économies notamment en Europe et au Japon. Voilà les fonds pour financer une mini relance!
Conjoncturellement, la bourgeoisie du bloc occidental avait intérêt à faire accélérer la chute des cours du pétrole ; cependant, cette "politique" traduit la marge die manoeuvre de plus en plus restreinte de la bourgeoisie qui, sur le plan économique, en est réduite à des expédients pour gagner quelques mois de répit. En effet, à terme, la chute des cours du pétrole signifie un nouveau rétrécissement significatif du marché mondial, qui va se traduire par une nouvelle baisse des échanges, et donc une baisse des exportations des pays^ industrialisés, et donc de leur production : c'est la récession.
Quelles que soient les arguties de la propagande capitaliste et la capacité de la bourgeoisie de manoeuvrer au mieux de ses intérêts, la crise est là, de plus en plus aiguë, et les prétendus succès économiques ne font en fait que traduire l'incapacité de plus en plus, grande de la classe dominante à y faire face. Irrésistiblement, la récession se profile à l'horizon, et les soubresauts présents du marché mondial annoncent les tempêtes futures qui vont le secouer.
23 février 86.
Situation internationale : extraits du rapport au 6eme congres du CCI (août 1985)
UNE CRISE DE SURPRODUCTION GENERALISEE
L'ACCELERATION DE LA TENDANCE A LA PAUPERISATION ABSOLUE
Aujourd'hui en 1985, 40 000 êtres humains meurent de faim chaque jour et la FAO nous prédit qu'avant l'an 2000 ce seront 200 millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui périront faute de nourriture. Selon la FAO toujours, 1/3 de la population du tiers-monde ne dispose pas du minimum reconnu nécessaire pour subsister physiquement, 835 millions d'habitants de la planète disposent de moins de 75 $ par an.
Le ministre de la santé du Brésil, pays naguère présenté comme un exemple de développement, avoue que près de la moitié (55 millions de personnes) de la population est malade : tuberculose, lèpre, malaria, schisostomiose et autres maladies parasitaires ; 18 millions souffrent de troubles mentaux. Dans les sept Etats du Nordeste brésilien, plus de la moitié des enfants meurt avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans. Des millions d'autres sont aveugles (carence en protéines), sous-alimentés, infirmes. Le gouvernement brésilien évalue à 15 millions le nombre d'enfants mineurs abandonnés. Le miracle brésilien est bien oublié.
Les 450 millions d'habitants d'Afrique ont l'espérance de vie la plus courte du monde : 42 ans en moyenne. L'Afrique a le plus fort taux de mortalité infantile : 137 décès au cours de la première année de vie pour 1000 naissances. Du Maroc à l'Ethiopie, la famine fait rage tout au long du Sahel : en 1984, 300 000 morts de faim en Ethiopie, 100 000 au Mozambique. Au BenglaDesh, depuis 1982, 800 000 personnes ont perdu la vue par suite de manque de protéines. Pour plus des 2/3 des hommes de notre planète, chaque jour et chaque nuit sont un interminable calvaire.
Les années 80, qui ont vu s'aggraver sans cesse la misère dans le monde jusqu'à un point jusqu'alors inconnu de l'humanité dans toute son histoire, qui n'avait jusqu'à présent jamais vécu une telle extension de la famine sur la planète, ont définitivement mis fin à l'illusion d'un quelconque développement des pays sous-développés.
L'écart entre les pays développés et les pays en constant sous-développement ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui 30% de la population du monde vit dans les pays industrialisés d'Europe (URSS comprise), d'Amérique du Nord, du Japon et d' Australie, représentant 82 % de la production mondiale et 91 % de toutes les exportations.
Ce n'est certainement pas un des moindres paradoxes que de voir la bourgeoisie utiliser la misère dont son système d'exploitation est responsable pour faire croire aux prolétaires des pays industrialisés qui produisent l'essentiel des richesses de la planète qu'ils sont des privilégiés qui, finalement, auraient; bien tort de se plaindre. Les incessantes campagnes médiatiques sur la famine, plus que de soulager la misère des affamés - plan sur lequel elles ont depuis longtemps montré leur inefficacité - ont pour but de culpabiliser cette fraction déterminante du prolétariat mondial qui se trouve au coeur des métropoles industrielles, de lui faire accepter sans réagir sa propre misère qui va en s'aggravant.
La première moitié des années 80 a été marquée par une dégradation brutale des conditions de vie dans les pays développés. A cet égard, l'évolution du chômage est particulièrement significative : ainsi, pour les pays européens de l'OCDE, il était de 2,9% en 1968, de 6,2% en 1979 et de 11,1% début 85, atteignant 21,6% pour l'Espagne et 13,3% pour le plus vieux pays industriel du monde, la Grande-Bretagne. Et encore, ces chiffres officiels (OCDE) sont-ils profondément sous-estimés, en deçà de la réalité. 25 millions d'ouvriers sont au chômage en Europe de l'Ouest et voient leurs conditions de vie, ainsi que celles de leur famille, se dégrader avec la baisse des indemnisations de l'Etat.
Mais le chômage n'est qu'un indice encore insuffisant de la pauvreté qui se développe dans les pays industrialisés. Ainsi, en France, si le chômage atteint 2,5 millions de personnes, ce sont 5 à 6 millions de personnes qui survivent avec moins de 50 francs par jour.
Aux Etats-Unis, pays le plus riche du monde, la faim gagne du terrain. Si, en 1978, il y avait 24 millions d'américains en dessous du seuil de pauvreté, ils sont aujourd'hui 35 millions.
Quant à l'URSS, ce ne sont certainement pas les chiffres du chômage qui peuvent donner un indice de la dégradation des conditions de vie de la population. Citons seulement un chiffre qui donne une idée de la misère croissante : l'espérance de vie est passée de 66 ans en 1964 à 62 ans en 1984.
"Nouveaux pauvres", "quart-monde", les termes ont fleuri pour décrire cette misère que l'on croyait réservée aux pays sous-développés. La tendance à la paupérisation absolue s'affirme aujourd'hui comme une sinistre réalité partout dans le monde, non seulement dans les mouroirs des bidonvilles et des campagnes du "tiers-monde", mais aussi au coeur des métropoles industrielles du capitalisme "développé". La catastrophe économique est mondiale et les dernières illusions sur les 'îlots de prospérité" que paraissaient constituer les pays industrialisés en contraste avec le sous-développement du reste du monde, disparaissent avec la généralisation de la misère de la périphérie vers le centre du capitalisme.
Plus que l'accroissement dramatique de la misère à la périphérie du capitalisme c'est l'enfoncement dans la pauvreté du prolétariat des pays industriels sous les coups de boutoir des programmes d'austérité de la bourgeoisie qui est significatif de l'approfondissement quantitatif et qualitatif de la crise au début des années 80. La marge de manoeuvre de la bourgeoisie s'est rétrécie avec le travail de sape de la crise ; reporter les sévices essentiels de la crise sur les pays les plus faibles n'est plus suffisant pour éviter une attaque frontale contre les conditions de vie de la fraction décisive de la classe ouvrière mondiale qui vit dans les pays développés, qui produit les 4/5 des richesses mondiales, qui a le plus d'expérience historique, qui est la plus concentrée. Si la bourgeoisie s'attaque ainsi aujourd'hui aux plus forts bastions de son ennemi historique, la classe ouvrière, c'est qu'elle ne peut faire autrement.
Au milieu des années 80, la faillite de l'économie capitaliste n'est plus évidente seulement dans la misère du sous-développement, mais elle l'est quotidiennement par la classe ouvrière partout : dans les files d'attente du chômage, dans les fins de mois impossibles à boucler, dans l'accentuation de l'exploitation au travail, dans les soucis et les tracas de tous les jours, dans l'angoisse des lendemains, voilà, par-delà tous les chiffres, le bilan vécu par la classe ouvrière de la crise du capitalisme ; c'est le bilan de la faillite d'un système qui n'a plus rien à offrir.
Face à cette vérité qui s'impose avec de plus eh plus de force, la classe dominante n'a que des mensonges à offrir. Depuis le début de la crise ouverte de son économie à la fin des années 60, la bourgeoisie ne cesse de proclamer qu'elle possède des remèdes à la crise, que les lendemains chanteront, et pourtant la situation tout au long de ces années n'a cessé de se dégrader. Aujourd'hui, Reagan et là bourgeoisie américaine nous resservent la même propagande éculée sous forme de "Reaganomics" à la sauce d'une nouvelle révolution technologique et, pour preuve de leurs affirmations, on nous présente la reprise de l'économie américaine. Qu'en est-il exactement de cette fameuse reprise dont on nous rebat tant les oreilles ? Où en est l'économie mondiale ?
LA FIN DE LA REPRISE AMERICAINE
Avec l'année 1985 déjà se marque le ralentissement de 1'économie américaine qui commence à montrer des signes d'essoufflement. Le colossal déficit budgétaire est de moins en moins suffisant pour maintenir l'activité de l'économie américaine : de 6,8% en 1984, le taux de croissance est retombé à un petit 1,6% pour les six premiers mois de 1985. L'industrie américaine souffre du cours élevé du dollar qui grève ses exportations et sa compétitivité face à ses rivales japonaises et européennes qui lui taillent des croupières sur le marché mondial et même à l'intérieur du marché américain. De mai 1984 à mai 1985, les exportations américaines ont chuté de 3,1%.
Reflétant le ralentissement de la croissance, le revenu net des 543 principales entreprises US a chuté de 11% au premier trimestre 1985 et de 14% au second. Les trois grands constructeurs automobiles américains ont enregistré une baisse de leurs profits de 25,4% tandis que la chute du secteur de la haute technologie, avec une baisse de 15% des bénéfices d'IBM et des pertes sèches pour Wang Laboratories, Apple et Texas Instruments (3,9 millions de dollars pour ce dernier au 2ème trimestre 85), fait voler en éclats le mythe d'une prétendue révolution technologique qui donnerait un nouveau souffle au capital.
Alors que toute une série de secteurs importants de l'économie américaine ne sont pas sortis du marasme depuis la fin des années 70, comme le secteur pétrolier, celui de la sidérurgie et surtout celui de l'agriculture (alors que la dette des fermiers américains est aujourd'hui supérieure à celle du Mexique et du Brésil réunis), ce sont aujourd'hui de nouveaux secteurs cruciaux qui viennent rejoindre ces derniers dans la crise, corme le bâtiment, l'électronique, l'informatique et l'automobile. Face à une telle situation, il faudrait, pour maintenir un minimum de santé économique au sein des pays les plus industrialisés, que l'Etat américain laisse se creuser des déficits commerciaux et budgétaires toujours plus énormes. Même la première puissance économique du monde ne peut se permettre cela, qui signifierait à terme un endettement qui trouve ses limites dans les disponibilités financières du marché mondial.
Malgré tous les discours de la bourgeoisie qui, chaque jour, prétend terrasser le monstre de la crise, la reprise de l'économie américaine a été l'arbre qui cache la forêt de la récession mondiale. L'économie planétaire n'est pas sortie de la récession amorcée à l'aube des années 80. Ainsi, si en 1984 le commerce mondial voyait la valeur des importations et des exportations croître respectivement de 6,5 et 6,1 %, c'est à la suite de trois années consécutives de régression. La relance n'a pas été suffisante pour retrouver le niveau de 1980. Par rapport à cette année-là, les pays industrialisés ont vu leurs exportations et importations régresser respectivement de 2 et 4,5 %. Ce recul est encore plus important pour les pays du tiers-monde qui, dans la même période, ont vu leurs exportations diminuer de 13,7 % et leurs importations de 12,5 %.
UNE CRISE DE SURPRODUCTION GENERALISEE
Les stocks de minerais qui s'accumulent, les mines qui ferment, les produits agricoles qui croupissent dans les silos et les frigos, tandis que l'arrachage des cultures se pratique à grande échelle, les usines qui ferment et les ouvriers qui se retrouvent massivement au chômage, tout cela exprime une chose: la crise de surproduction généralisée.
Prenons un seul exemple : le pétrole, tout un symbole malgré la paralysie de la production de l'Iran et de l'Irak en guerre et qui ont été, durant les années 70, de gros exportateurs, la surproduction fait rage. La fameuse pénurie qui, paraît-il, menaçait l'économie mondiale en 1974, est définitivement oubliée. L'OPEP est au bord de l'éclatement. Les stocks s'accumulent sur terre et sur mer, les supertankers rouillent dans les fjords de Norvège ou bien sont mis à la casse. Les chantiers navals n'ont plus de commandes, les compagnies pétrolières ont des problèmes de trésorerie et les banquiers qui ont fait des prêts commencent à se ronger les ongles. L'or noir ne parvient pas à sortir le Nigeria, le Mexique, le Venezuela ou l'Indonésie du sous-développement et de la misère tandis que même des pays "riches" comme l'Arabie Saoudite annoncent une balance commerciale déficitaire. La surproduction pétrolière affecte toute l'économie mondiale et rentre en résonance avec la surproduction dans les autres secteurs.
La crise de surproduction généralisée montre les contradictions du monde capitaliste de manière criante. Les fermiers américains entraînent les banquiers qui leur ont prêté de 1'argent dans leur faillite, alors que les céréales pourrissent dans les silos faute de débouchés solvables, tandis que la famine fait ses ravages dans le monde. Mais ce contraste insupportable a aujourd'hui fait irruption dans les pays "riches" où les chômeurs et autres "nouveaux pauvres" ne sont séparés que par une mince vitrine de ces "richesses" qui ne parviennent plus à se vendre et s'entassent jusqu'à devenir périmées.
Le cycle infernal de la surproduction se développe. Face à des marches saturés, la concurrence s'exacerbe, les coûts de production doivent baisser, donc les salaires, donc le nombre d'employés, ce qui réduit d'autant le marché Solvable et relance la concurrence...Chaque pays essaie ainsi de diminuer ses importations et d'augmenter ses exportations et le marché se rétrécit inexorablement.
LA PERSPECTIVE D'UNE NOUVELLE PLONGEE DANS LA RECESSION.
Au bout d'à peine deux ans, la fameuse reprise victorieuse de l'économie américaine, si chère à Reagan, montre des signes d'épuisement. Cela illustre clairement la tendance de l'économie mondiale à des mouvements de reprise de plus en plus courts et aux effets de plus en plus faibles, tandis que les périodes de récession se font de plus en plus longues et profondes. Cela montre l'accélération de la crise et la dégradation de plus en plus large que ses effets occasionnent à l'économie mondiale.
Avec le ralentissement de l'économie américaine, ce qui se profile à l'horizon, c'est la perspective d'une plongée encore plus profonde dans la récession. Nul économiste de la bourgeoisie n'ose prévoir les conséquences d'une récession durable de l'économie mondiale. La récession de 1981-82 a été la plus forte depuis 1929 et celle qui s'annonce, parce qu'elle traduit 1'impuissance et l'usure des recettes mises en place depuis par l'administration Reagan, ne peut qu'être plus profonde et plus durable encore pour les pays développés, car les pays sous-développés, eux, ne sont pas sortis du mouvement de récession amorcé à l'aube des années 80.
La plongée dans la récession implique :
- une nouvelle chute des échanges mondiaux consécutive au rétrécissement des marchés solvables, alors que pourtant, en 1984, le niveau de 1980 n'a pas été encore retrouvé ;
- une chute de la production qui va toucher le coeur des pays industrialisés encore plus fortement qu'en 1981-82, tandis que la production des pays sous-développés n'a cessé de chuter depuis 1981 ;
- de nombreuses faillites d'entreprises, de nouvelles fermetures d'usines, des millions d'ouvriers licenciés qui iront rejoindre les cohortes de chômeurs qui, en dehors des USA, n'ont cessé de se développer dans tous les pays malgré la "reprise" ;
- et, au bout du compte, une fragilisation du système financier international qui risque de culminer dans des tempêtes monétaires, tandis que l'inflation fera un retour remarqué.
On comprend que devant de telles perspectives, la bourgeoisie veuille freiner des quatre fers cet enfoncement dans la crise, car derrière l'effondrement du capital ce qui se profile c'est le développement de l'instabilité sur tous les plans : économique, politique, militaire et surtout social. Sa marge de manoeuvre se restreint au fur et à mesure que la crise s'approfondit et après avoir vu la faillite de toutes leurs théories, l'efficacité des mesures qu'ils ont préconisées s'user irrémédiablement, les savants économistes de la classe dominante guettent avec inquiétude le futur, ce qu'ils appellent eux-mêmes les "zones inexplorées de l'économie", avouant par là leur propre ignorance et impuissance.
La bourgeoisie n'a plus de politique économique à proposer, de plus en plus ce sont des mesures au jour le jour qui s'imposent. La bourgeoisie navigue à vue pour tenter de retarder la catastrophe et de sauver les meubles. Le fait que sa marge de manoeuvre se restreigne ne signifie pourtant pas que celle-ci n'existe plus et à un certain point de vue, le rétrécissement même de sa marge de manoeuvre pousse la classe dominante à développer son intelligence manoeuvrière. Cependant, toutes les mesures prises, si elles retardent les échéances, les reportent dans le futur, permettent un ralentissement des effets dévastateurs de la crise, contribuent à rendre ces échéances plus catastrophiques, à accumuler les contradictions propres du capitalisme, créant une tension chaque jour plus proche du point de rupture.
Le système financier international est un bon exemple de cette situation et des contradictions dans lesquelles se débattent les théoriciens et les gestionnaires du capital. Si la politique de crédit facile et de dollar pas cher menée dans les années 70 a permis, en absorbant une part du surplus produit, de reculer les échéances tout en assurant la suprématie du dollar, elle se traduit aujourd'hui par une montagne de dettes dans le monde entier, que de plus en plus d'Etats, d'entreprises, de particuliers, avec le développement de la récession depuis le début des années 80, sont aujourd'hui incapables de rembourser. Le vent de panique qui a soufflé sur les différentes places financières du monde durant l'hiver 1981-82 devant l'incapacité des pays du tiers-monde à rembourser leurs dettes de 800 milliards de dollars, n'a pu être calmé que par l'intervention des grands organismes de prêt internationaux, tels que la Banque Mondiale et le FMI qui ont imposé aux pays les plus endettés des programmes d'austérité draconiens comme condition à l'obtention de nouveaux crédits qui, s'ils ne permettaient pas le remboursement de la dette globale, en maintenant le paiement des intérêts, ont permis aux banques de souffler en attendant les résultats concrets des plans d'austérité mis en place précipitamment. .
Cependant, si la crise a été évitée, la fragilité du système monétaire international n'en a pas moins continué réellement à se développer. La faillite de la Continental Illinois en 1983, qui a fait les prêts les moins faibles, a obligé l'Etat américain à intervenir rapidement pour mobiliser les 8 milliards de dollars destinés à combler le trou et éviter une .réaction en chaîne dans le système bancaire américain qui aurait pu mener, là encore, à une crise majeure. Malgré la reprise américaine, ces dernières années ont connu un nombre de faillites record de banques américaines, et ce sont ainsi une centaine de faillites qui sont encore prévues en 1985 avec le ralentissement de l'économie américaine.
Mais si l'endettement des pays du tiers-monde est important, il n'est rien comparé aux 6000 milliards de dette accumulés par l'Etat, les entreprises et les particuliers aux USA. On peut comprendre que Volker, président de la banque fédérale puisse dire que "l'endettement est un revolver pointé sur l'économie américaine".
La crise du secteur agricole américain, qui a vu sa compétitivité sur le marché mondial anéantie par la hausse du dollar, s'est directement traduite par des faillites en série des caisses d'épargne agricoles où, pour la première fois depuis 1929, les queues d'épargnants paniques se sont allongées devant les banques fermées. L'intervention fédérale a permis d'éviter une panique plus grande, mais aujourd'hui c'est l'organisme fédéral de prêts aux agriculteurs, la Farmer Bank, qui est au bord de la faillite avec un trou de plus de 10 milliards de dollars que l'Etat va devoir conibler. Le simple ralentissement de 1'économie américaine au premier semestre 85 s'est traduit pour la deuxième banque américaine, la Bankamerica, par des pertes énormes au second trimestre 85 : 338 milliards de dollars. A ce rythme l'Etat fédéral risque d'avoir de plus en plus de difficulté à combler les trous béants qui s'ouvrent dans les comptes des banques américaines, et cette situation porte en germe la banqueroute de tout le système financier international, avec au coeur de cette banqueroute le dollar. La spéculation qui a porté le dollar vers des sommets risque de se retourner contre lui, accentuant encore le mouvement de yoyo qui, en six mois, de mars à août 85, a vu le dollar passer de 10,60 F à 8,50 F et qui a déjà mis bien à mal l'équilibre du système bancaire international.
L'IRRESISTIBLE RETOUR DE L'INFLATION
On comprend, dans ces conditions, l'inquiétude qui s'empare des capitalistes avec le ralentissement de l'économie américaine et la récession mondiale aggravée qui se profile à l'horizon et qui signifie pour les banques - avec des millions d'ouvriers mis au chômage, des milliers d'entreprises en faillite et de nouveaux Etats en cessation de paiements, qui ne pourront payer leurs dettes - une aggravation dramatique de leur situation. Les contradictions du capital sur le plan financier vont devenir explosives et risquent de se traduire par des crises de panique des capitalistes spéculateurs sur le marché financier mondial - surtout parce que le système bancaire international est indissolublement lié au système monétaire international, centré sur le dollar - par des tempêtes monétaires qui manifesteront le retour en force de l'inflation.
Celle-ci, même si elle a diminué, n'a certainement pas disparu;et si l'on considère que l'inflation des années 70 a été réduite essentiellement grâce à la chute des cours des matières premières qui, à part le pétrole, ont vu leur indice passer de 100 en 1980 à 72 en 1985-c'est-à-dire une chute de 28%-et grâce à une baisse des coûts de production consécutive à l'attaque contre les salaires et aux licenciements, son maintien même à un niveau plus faible dans la première moitié des années 80 montre a contrario le poids accru des pressions inflationnistes liées à la dette énorme et au poids des secteurs improductifs (notamment l'armée et la police) et des secteurs déficitaires, mais stratégiques que chaque Etat doit financer. Donc, même sur le plan de l'inflation, dans la réalité,la situation est loin de s'être améliorée et les pressions inflationnistes sont bien plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été dans les années 70, c'est-à-dire qu'un retour de l'inflation signifie bien plus rapidement que par le passé une tendance vers l'hyper inflation.
Si les années 70 ont montré la capacité de la bourgeoisie de reporter les effets de la crise à la périphérie du capitalisme, les années 80 montrent qu'aujourd'hui cela n'est plus suffisant pour permettre aux économies les plus développées d'échapper au marasme et à la récession. De plus en plus, les contradictions du capitalisme tendent à se manifester à un niveau central, à se polariser autour du roi dollar et de l'économie américaine qui en est la garante et dont de plus en plus l'ensemble de l'économie mondiale est dépendante. C'est pourquoi aujourd'hui les yeux des capitalistes du monde entier sont fixés au jour le jour sur les résultats obtenus par l'économie américaine ; de sa santé dépend la stabilité économique et monétaire du monde entier.
C'est pourquoi, avec les premiers signes annonciateurs du ralentissement de son économie, Washington a sonné le branle-bas pour résorber le déficit budgétaire, alléger l'endettement de l'Etat, et résorber le déficit commercial en restaurant la compétitivité de l'économie américaine. Mais une telle politique ne peut se faire qu'au détriment des exportations des industries européennes et japonaise qui ont profité de la relance américaine et du déficit commercial du plus grand marché du monde, relançant ainsi la guerre commerciale entre les pays les plus développés ; cependant, les USA, par leur puissance économique et militaire et parce qu'ils contrôlent le dollar, ont les moyens de détourner à leur profit les règles du marché pour imposer leurs diktats avec en plus le chantage protectionniste.
La baisse de 20% du dollar ces derniers mois a pour but premier de restaurer la compétitivité de l'économie américaine qui avait été sérieusement entamée (de 40% depuis 1980) par les hausses précédentes, afin de restaurer sa balance commerciale. Cependant, une telle mesure ne peut avoir que deux résultats :
- d'une part, plonger l'Europe et le Japon dans la récession en leur fermant le marché américain et en concurrençant leurs exportations dans le monde entier ;
- d'autre part, un retour de l'inflation dans la mesure où cette baisse du dollar est en fait une dévaluation, ce qui va surenchérir le cours des produits importés vendus sur le marché américain. La tentation est extrêmement forte pour les capitalistes américains de laisser chuter le dollar et se développer l'inflation, car c'est encore le meilleur moyen de rembourser leurs dettes en monnaie de singe après avoir engrangé des capitaux en provenance du monde entier.
Maintenir à flot l'économie américaine est une nécessité vitale pour éviter une catastrophe économique planétaire. Cependant, cela ne peut se faire qu'au détriment des principaux alliés des USA au sein de leur bloc.
Pourtant, dans la mesure où l'Europe et le Japon sont des pièces indispensables du puzzle impérialiste du bloc occidental et devant l'instabilité sociale qui ne peut que se développer en Europe - première concentration prolétarienne de la planète dont la classe ouvrière depuis l'automne 83 est au coeur de la reprise internationale de la lutte de classe qui continue à se développer - la bourgeoisie ne peut qu'être extrêmement prudente et essayer de ralentir au maximum les effets de la récession pour parvenir à contrôler la situation. C'est pour cela que Reagan parle d'un atterrissage "en douceur" de l'économie américaine et invite les capitalistes européens et japonais en même temps qu'il leur demande des concessions économiques (ouverture de leurs marchés, limitation de leurs exportations aux USA, internationalisation du yen afin d'épauler le dollar et d'affaiblir la compétitivité de 1'industrie japonaise en réévaluant sa monnaie) à faire la même politique que celle menée ces dernières années par les USA, c'est-à-dire une politique de déficit budgétaire et d'endettement afin de combler les effets néfastes de la chute de leurs exportations sur leur activité économique. Mais l'Europe et le Japon ne sont pas les USA et une telle politique ne peut se faire sans développer rapidement l'inflation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Washington prône l'inverse de la politique imposée cinq ans auparavant.
Cependant, même si la bourgeoisie parvient à ralentir le mouvement, ce freinage est de moins en moins efficace et les années 80 sont d'abord marquées par une accélération de la crise et des à-coups de plus en plus graves de l’économie mondiale. Si les années 80, dans leur première moitié, ont été marquées par l'enfoncement dans la stagnation et la récession avec une baisse de l'inflation, la deuxième moitié de la décennie va être marquée à la fois par une nouvelle plongée dans la récession qui va toucher de plein fouet les économies les plus développées et un retour en force de l'inflation que la bourgeoisie croyait avoir jugulée, dans une situation d'instabilité économique et monétaire grandissante qui va culminer dans des crises aiguées caractérisant l'accélération des effets dévastateurs de la crise.
J.J.
Récent et en cours:
- Crise économique [63]
Milieu politique : le développement d'un milieu révolutionnaire en Inde
- 2902 reads
Après la crise qui a traversé le milieu révolutionnaire au début des années 80 ([1] [64]), l'avant-garde politique du prolétariat montre à nouveau des signes d'une force nouvelle. L'une de ses expressions les plus évidentes est l'apparition d'un certain nombre de groupes évoluant vers une cohérence communiste. Quelques exemples :
- en Belgique, l'apparition de RAIA ([2] [65]) dans un processus de rupture avec l'anarchisme ; en Autriche, l'apparition d'un cercle de camarades qui ont rompu avec Kommunistische Politik à cause de son académisme et qui évolue vers des positions révolutionnaires plus conséquentes ;
- en Argentine, le développement de groupes comme Emancipacion Obrera et Militancia Clasista Revolucionaria, qui semblent proches du Groupe Communiste Internationaliste (GCI), mais ont également eu des contacts avec d'autres groupes ([3] [66]) ;
- au Mexique, le développement du Colectivo Comunista Alptraum et la publication du premier numéro de sa revue Comunismo ([4] [67]).
Un des développements les plus importants est peut être celui qui est en train d'avoir lieu en Inde. Le but de cet article est de présenter, à grands traits, les origines et la trajectoire du milieu là-bas, en se basant sur ses publications, la correspondance et sur un récent voyage d'une délégation du CCI en Inde.
LE SURGISSEMENT DE REVOLUTIONNAIRES A LA PERIPHERIE DU CAPITALISME
Avant de parler des groupes spécifiques du milieu indien, il est nécessaire de faire quelques remarques sur le fait que la majorité de ces nouveaux groupes est apparue dans des pays périphériques du capitalisme. Dans le prochain numéro de la Revue Internationale, nous critiquerons la position du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR) qui défend que dans ces régions où les institutions démocratiques et Syndicales ont moins d'emprise sur la vie sociale, les conditions pour un développement "massif" des organisations communistes sont "meilleures". Le GCI exprime le même genre de préférence "exotique" quand il dénonce sans cesse ce qu'il appelle le "soi-disant milieu révolutionnaire" qui ignorerait l'apparition de révolutionnaires à la périphérie (une contre-vérité flagrante comme on le verra par le contenu même de cet article).
Le surgissement de groupes révolutionnaires en Inde et en Amérique Latine est certainement l'expression de la portée internationale de la présente reprise de la lutte de classe et confirme - à rencontre de toutes les théories gauchistes sur la nécessité de révolutions!"démocratiques" dans les pays "dominés"- l'unité des tâches communistes auxquelles doit s'affronter le prolétariat. Mais cela ne prouve pas que la conscience communiste soit plus profonde ou plus étendue dans la périphérie que dans les métropoles et que, en conséquence (bien que ceci ne soit pas toujours clairement conclu) la révolution y soit plus à portée de main.
Pour commencer, nous devons nous rappeler que le point de vue du BIPR ou d'autres est déformé par l'incapacité à distinguer entre l'apparition d'authentiques groupes révolutionnaires et la "radicalisation" des groupes gauchistes, comme sa malheureuse alliance avec le Parti Communiste d'Iran et Revolutionary Proletanan Platform (RPP) d'Inde l'a montré. Deuxièmement, cette version revue et corrigée de la théorie du "maillon le plus faible" de Lénine, se base sur un empirisme très étroit qui se fixe sur les faits immédiats et n'arrive pas à situer l'émergence de ces groupes dans le contexte historique de la reprise générale de la lutte de classe qui a commencé en 1968, et qui constitue l'arrière-plan des différentes vagues de luttes caractérisant cette période. Une fois qu'on a saisi ce contexte, il apparaît clairement que ces groupes surgissent dix à vingt ans plus tard que ceux des métropoles -la plupart de ceux-ci étant sortis de la première vague de combats de classe en 1968-74. Et, troisièmement, s'il y a un important aspect de spontanéité dans l'apparition d'éléments à la recherche de positions de classe, nous ne devrions pas avoir à dire à des groupes comme le BIPR que cette spontanéité est insuffisante, qu'il y aurait peu de chances pour que ces groupes trouvent une cohérence communiste solide s'il n'y avait pas l'intervention des groupes d'Europe occidentale qui ont un rapport plus direct avec les traditions de la Gauche communiste. Il apparaîtra clairement à travers cet article que, plus les groupes en Inde se sont ouverts au milieu politique international, plus ils ont été capables de développer pleinement une pratique communiste.
Il est extrêmement dangereux de sous-estimer les difficultés et problèmes auxquels sont confrontés les révolutionnaires dans les pays sous-développés:
- problèmes "physiques" posés par l'isolement géographique par rapport au principal coeur du mouvement prolétarien; les barrières linguistiques (y compris l'analphabétisme) ; la pauvreté matérielle ; des choses que les révolutionnaires à l'ouest considèrent comme acquises aujourd'hui en tant qu'outils de leur intervention - machines à écrire, téléphone, ronéos, voitures, etc.- sont bien moins accessibles aux groupes dans des pays comme l'Inde ;
- profonds problèmes politiques créés précisément par la domination ouverte de l'impérialisme et l'absence de normes "démocratiques" qui rend la classe ouvrière de ces pays plus vulnérable en dernière analyse à la mythologie de la "libération nationale", de la "démocratisation", etc. Ceci rend à son tour encore plus difficile le combat des révolutionnaires de ces pays contre ces illusions, à la fois dans la classe et dans leurs propres rangs ;
- absence d'une tradition historique de la Gauche communiste dans la plupart de ces pays ; prédominance de déformations gauchistes, en particulier le stalinisme maoïsme, qui est capable de se parer de couleurs très "radicales" dans ces régions. Oublier toutes ces difficultés n'aidera pas l'évolution des camarades qui commencent un travail révolutionnaire malgré ces problèmes et contre eux. Il ne faut pas non plus sous-estimer le poids mort des idéologies plus traditionnelles dans ces pays : en Inde, par exemple, il est extrêmement difficile que des femmes participent au mouvement révolutionnaire.
EN INDE : LE DIFFICILE PROCESSUS DE RUPTURE AVEC LE GAUCHISME COMMUNIST INTERNATIONALIST
"Une organisation révolutionnaire est toujours indispensable, même dans une période de très grande défaite de la classe. Bien sûr, le rôle et l'impact changeants d'une organisation révolutionnaire dans une période de défaite de la classe ou de développement de la lutte de classe., ne peuvent être compris qu'avec les concepts de fraction et de parti. Aujourd'hui dans une période de crise mondiale accélérée et d'effondrement du capital et de révoltes de classe croissantes, tendant vers la confrontation avec l'Etat et s'ouvrant vers la révolution, le rôle des révolutionnaires devient de plus en plus important et décisif. Il est d'appeler au regroupement international des révolutionnaires et à la formation du parti révolutionnaire." (Lettre du Cercle de Faridabad au CCI, 11 janvier 1985).
La plupart des éléments qui constituent le milieu prolétarien en Inde, viennent .d'une rupture plus ou moins claire avec le gauchisme radical, facilitée par l'intervention directe des groupes du milieu international, en particulier le CCI et le BIPR. Mais comme le CCI l'a toujours souligné, l'avenir d'un groupe qui surgit de cette façon dépend en grande partie de la clarté de cette rupture, du degré de conscience atteint par les éléments impliqués en ce qui concerne leur provenance et combien ils ont à avancer. Le groupe en Inde qui a fait la rupture la plus complète avec le gauchisme est celui qui, par ses positions et son attitude politique, est le plus proche du CCI : Communist Internationalist (CI).
Comme nous l'avons écrit dans la Revue Internationale n° 42, un certain nombre de camarades de CI étaient auparavant impliqués dans la politique gauchiste radicale, et, plus récemment, dans Faridabad Workers News, journal militant et syndicaliste dans un important centre industriel près de Delhi.
En Inde, comme dans beaucoup de pays sous-développés, les syndicats se conduisent habituellement d'une façon si ouvertement anti-ouvrière (corruption, tabassage des ouvriers combatifs, etc.) que les ouvriers leur sont souvent profondément hostiles, tout comme vis-à-vis des partis de gauche auxquels ils sont liés (PC d'Inde, PCM d'Inde, etc.). Une anecdote pour l'illustrer : voyageant en train de Delhi au Bengale occidental, les camarades du CCI et de CI, sont entrés en discussion avec des cheminots qui les avaient invités dans leur wagon de travail ; après quelques minutes de conversation générale, et sans que le CCI et CI n'aient poussé dans ce sens, ces ouvriers (qui avaient participé à la grande grève des chemins de fer en 1974) ont commencé à dire que tous les partis de gauche étaient bourgeois, tous les syndicats des voleurs, et que seule la révolution pourrait changer les choses pour les ouvriers. De telles attitudes, qui sont assez répandues en Inde aujourd'hui, ne veulent pas dire que la révolution est imminente, car les ouvriers ont de grandes difficultés à voir comment transformer leurs désillusions en une lutte active contre le capital. Mais elles indiquent l'étendue de" l'antipathie ouvrière envers les syndicats et les partis de gauche. Ceci explique toute l'importance en Inde des formes très radicales de gauchisme qui sont tout à fait capables de dénoncer les syndicats et la gauche comme agents de la bourgeoisie -afin d'enfermer les ouvriers dans une variété plus extrême de la même chose. A Faridabad même, il y a eu toute une série de luttes durant lesquelles, après la mise à nu de la réelle fonction d'un appareil parti/syndicat un autre, au langage plus à gauche, est intervenu pour combler la brèche. Le cercle de Faridabad a fait de nombreux tournants avant d'arriver au moment où le Faridabad Workers Group était sur le point de former un syndicat ultra-radical dans certaines usines; Mais la lecture des publications du CCI sur la question syndicale lui a permis de se sortir de ce cercle vicieux. Et puisque cela s'est doublé d'un processus de clarification sur la question nationale, qui est une question de vie ou de mort pour un groupe prolétarien qui surgit à la périphérie, les camarades ont su s'orienter sur le difficile chemin de la rupture avec leur passé gauchiste.
A partir de l'effondrement du Faridabad Workers Group, un cercle de discussion a été formé qui s'est rapidement trouvé d'accord avec ce qu'il comprenait des positions et des analyses du CCI. Les camarades ont reconnu que la discussion n'était pas suffisante ni assez homogène avec le CCI pour envisager la possibilité d'une intégration rapide dans le courant ; mais la nécessité d'intervenir dans la lutte de classe, de défendre les positions révolutionnaires, a poussé les camarades à se former en un groupe qui, tout en étant encore engagé dans la clarification des positions et analyses fondamentales, puisse intervenir en publiant une revue, des tracts, etc. Ainsi naquit Communist Internationalist.
Dans les discussions avec CI, nous avons exprimé notre soutien à la décision d'évoluer du cercle de discussion au groupe politique, tout en soulignant que la priorité pour les camarades est l'approfondissement théorique et l'homogénéisation, ce qui veut dire que l'ensemble du groupe doit prendre connaissance, non seulement des positions du CCI, mais de l'histoire du mouvement ouvrier et des positions des autres groupes du milieu révolutionnaire. Mais dans la période actuelle, les révolutionnaires ne peuvent rester silencieux même quand leur compréhension des positions de classe n'en est qu'au stade initial. CI continuera donc à intervenir avec des tracts, une présence dans les importants moments de la lutte de classe ; il maintiendra la publication de Communist Internationalist en hindi et afin de rendre son travail plus accessible à la fois envers le milieu en Inde (où l'anglais est une langue plus répandue que l'hindi) et surtout le milieu international, il publiera un supplément en anglais à CI.
La perspective pour CI est l'intégration dans le milieu révolutionnaire. CI et le CCI sont pleinement conscients des problèmes qu'un tel processus contient.
Pour qu'ait lieu un regroupement solide et qu'il dure, c'est tout un travail organisationnel et politique qu'il faut réaliser. Il faut affronter les incompréhensions et les divergences existantes. Il n'y a rien de prédestiner ou d'automatique dans un tel processus. Mais nous sommes confiants que la convergence croissante de CI avec les positions du CCI, et en particulier concernant la nature du gauchisme, le milieu politique prolétarien et les dangers qui le guettent, fournit une base ferme et sure pour que le groupe achève sa rupture d'avec le passé gauchiste, et assume les énormes responsabilités qu'il porte en Inde et internationalement.
Comme c'est souvent le cas, le pas qu'a fait le cercle de Faridabad en formant CI, ne l'a pas été sans prix : la scission d'un camarade qui avait joué un rôle déterminant dans la rupture' initiale avec le gauchisme et qui, du coup, a formé de son côté un petit cercle. Les raisons de cette scission ont été pendant longtemps obscurcies par des questions "personnelles", mais à partir de ses interventions dans la situation qui avaient pour but d'apaiser les tensions d'une scission injustifiée ou, au moins, de faire ressortir les divergences réelles, le CCI considère maintenant que la question essentielle était la suivante : CI, avec toutes ses faiblesses et son immaturité, a compris qu'il ne pouvait rien faire sans un cadre collectif pour homogénéiser le groupe, et qu'il devait commencer au minimum à assumer des tâches d'intervention politique dans la classe. Les conceptions du camarade scissionniste, par contre, exprimaient une plus grande difficulté à rompre avec des attitudes gauchistes. Son argument selon lequel CI n'était pas un groupe politique parce qu'il n'y avait pas d'homogénéité suffisante en son sein, se basait en réalité, d'un côté sur un élitisme gauchiste classique qui juge individuellement les camarades comme étant fixés pour toujours à un niveau plus ou moins grand de compréhension, et ne voit pas comment la conscience peut avancer à travers un processus de discussion collective ; et, de l'autre, comme c'est souvent Je cas avec des camarades en réaction à un passé dans l'activisme gauchiste, sur une approche académique qui ne saisit pas les rapports entre l'approfondissement théorique et l'intervention pratique. Ceci s'est exprimé, par exemple, par une tendance à se fixer sur la théorie de la décadence de Rosa Luxemburg, sans en voir les implications militantes pour les révolutionnaires aujourd'hui.
L'académisme apparaît de nos jours comme un aspect du poids de l'idéologie conseilliste, de la sous-estimation de la nécessité d'une organisation de combat politique dans la classe. Si CI avait suivi les orientation du camarade scissionniste, il aurait indéfiniment | repoussé son travail d'intervention. Nous regrettons cette évolution car ces camarades auraient pu faire une importante contribution au travail de CI. Mais nous pensons que ces camarades vont devoir passer par un processus d'échecs amers avant de pouvoir comprendre l'erreur qu'ils font.
Ce n'est pas par hasard que la question du travail Collectif a été si centrale dans cette scission. Nous considérons que CI, par son évolution vers une conception conséquente de l'organisation, l'intervention et le milieu politique, va jouer un rôle clé au sein de ce milieu, grâce à la défense non seulement des positions communistes, mais aussi par son approche globale du processus de discussion et de clarification. Ceci s'est exprimé après plusieurs jours de discussion avec la délégation du CCI, par l'un des camarades de CI qui pendant des années a été impliqué dans des groupes maoïstes. Pour lui, l'une des preuves les plus évidentes qu'il n'y a pas de terrain commun quel qu'il soit entre le gauchisme et la politique révolutionnaire était justement le contraste total entre les "discussions" bidon qui ont lieu dans un groupe gauchiste, basées sur la vieille division bourgeoise du travail entre ceux qui pensent et ceux qui font, et l'effort de clarification réellement collectif, où tous les camarades doivent prendre position et développer leurs capacités politiques et organisationnelles dans le contexte de responsabilités centralisées et clairement définies. La défense de cette vision de l'organisation contre le point de vue hiérarchique hérité du gauchisme ainsi que les névroses anti-organisationnelles du conseillisme, sera une tâche primordiale des groupes révolutionnaires en Inde.
LAL PATAKA
Le CCI est peut-être le pôle international de référence le plus clair pour les révolutionnaires, mais il n'est pas le seul. Depuis l'effondrement du PCI (Programme Communiste), le BIPR dont les positions tendent à être à mi-chemin entre le CCI et le bordiguisme a développé une présence internationale, d'une façon cependant très marquée par l'opportunisme ([5] [68]).
En Inde, à peu près en même temps que se formait CI, une scission avait lieu dans le groupe gauchiste radical Revolutionary Proletanan Platform (RPP) qui avait été critiqué à la fois par les positions du CCI et du BIPR. Le camarade responsable de la publication du journal bengali du RPP, Lal Pataka (Drapeau Rouge), était expulsé de l'organisation après avoir appelé le RPP à se restructurer conformément aux positions fondamentales du BIPR.
Avant de décrire les discussions entre le CCI et Lal Pataka, nous voulons rappeler notre position sur le RPP.
Quand nous avons reçu pour la première fois les publications en anglais du RPP, nous n'étions pas entièrement clairs sur le fait de savoir si c'était une tentative de rompre avec le gauchisme, ou bien un autre groupe stalinien radical comme le PC d'Iran. Ces incertitudes ont persisté dans l'article sur le milieu en Inde dans World Révolution n°77 qui, tout en étant plus clair sur la nature bourgeoise du RPP, fait encore certaines concessions à la notion de "mouvement d'éloignement du gauchisme" de la part de ce groupe. Mais en s'appuyant sur nos propres discussions internes sur l'opportunisme et le centrisme([6] [69]) et en ayant une meilleure connaissance de l'histoire et des positions du RPP (en grande partie due au travail des camarades de CI), nous avons pu juger plus clairement ce groupe. Comme le dit la résolution du 6ème Congrès du CCI sur l'opportunisme : ".le passage collectif d'un organisme politique déjà structuré ou en formation dans les partis existant ne peut obligatoirement se produire que dans un sens unique : des partis du prolétariat à la bourgeoisie et jamais dans le sens contraire : des partis bourgeois au prolétariat." (Revue Internationale n° M, p. 17)
En effet, un bref survol de la préhistoire du RPP montre clairement que ce groupe a toujours été un "organisme politique déjà structuré" de la bourgeoisie. Au début de la 2ème guerre mondiale s'est formé le Parti Socialiste Révolutionnaire (RSP) d'Inde, en rupture avec le Parti Communiste d'Inde, mais pas du tout sur une base prolétarienne : au contraire, la politique du RSP était de se battre pour la "libération nationale" de l'Inde en s'alliant avec les ennemis de la Grande-Bretagne, l'impérialisme allemand et japonais. L'intégration ouverte du RSP dans des gouvernements de gauche de l'Inde "indépendante" a mené à une scission en 1969, faisant naître le RSPI (ML) qui se caractérisait par certaines positions apparemment radicales (dénonciation de la Chine, de la Russie, des PC, et même des syndicats comme capitalistes), mais qui n'a jamais critiqué les origines nationalistes du RSP. Le RPP s'est formé au début des années 80 à partir d'une scission dans le RSPI (ML), non pour défendre des positions de classe, mais en réaction aux "déviations ultra-gauchistes" du RSPI (ML) (pour citer le RPP lui-même dans Proletanan Emancipation, décembre 85). Le RPP se définit en particulier depuis le début comme un loyal défenseur des syndicats en tant qu'organisations de base des ouvriers et ne s'est jamais éloigné de là : de façon significative, la question syndicale était au coeur de la scission avec Lal Pataka. Le RPP n'a pas mis en question non plus le passé nationaliste du groupe ni le dogme du "droit des nations à disposer d'elles-mêmes". Toute la trajectoire du RPP et de ses ancêtres exprime donc des moments de la radicalisation du gauchisme, mais jamais une rupture qualitative avec son point de départ bourgeois.
La rencontre du RPP avec des groupes du camp prolétarien ne l'a pas dévié de sa trajectoire. Si le BIPR, répétant les erreurs déjà faites avec les gauchistes iraniens, a persisté, en se rapportant au RPP comme s'il était un groupe prolétarien confus, le RPP lui-même est, d'une certaine façon, plus conscient du fait qu'il n'a rien à voir avec le mouvement communiste. Malgré les protestations du BIPR comme quoi le RPP ne doit pas le confondre avec le CCI, le RPP a maintenant dénoncé publiquement les deux organisations comme "anarchistes petites-bourgeoises" et s'est identifié au niveau international avec le PC d'Iran et les "ex"-maoistes américains de l'organisation Pour un Parti Ouvrier Marxiste-Léniniste. De plus, le tableau décrit dans la Revue Communiste n°3 du BIPR de la désintégration du RPP sous l'impact des positions du Bureau, semble complètement fausse. C'est vrai que Lai Pataka (qui, de façon significative, existait avant de rejoindre le RPP et a toujours eu une certaine autonomie) est parti pour défendre des positions prolétariennes, mais ce départ n'a pas eu pour résultat l'effondrement du RPP qui, dans la mesure de ce que nous croyons savoir, a encore plusieurs centaines de membres et une certaine implantation dans l'appareil syndical (une autre petite scission qui a eu lieu en même temps que celle de Lal Pataka s'est faite sur une base entièrement gauchiste, puisque ces éléments veulent défendre la position du PC d'Iran sur la "révolution démocratique" et s'opposent ouvertement aux positions de la Gauche communiste, comme on l'a découvert en les rencontrant).
Dans nos discussions avec Lal Pataka, il est devenu clair qu'il était déjà au delà de la position du BIPR et de sa propre position précédemment exprimée dans le dernier texte de Lal Pataka au sein du RPP (publié dans la Revue Communiste n°3) où il appelait le RPP à adopter la plate-forme du BIPR. Nous avons souligné l'ambiguïté de ce texte et du fait que ce n'est pas Lal Pataka qui a quitté lui-même formellement le RPP, mais qu'il a été "suspendu" sur la base de différentes accusations organisationnelles inventées de toutes pièces. Nous avons insisté sur la nécessité d'une prise de position claire dans le prochain numéro du journal, dénonçant le RPP comme gauchiste (comme il le caractérise maintenant) et expliquant la rupture avec lui. Nous avons argumenté que le nom du journal devait changer afin de montrer cette totale rupture de continuité.
L'une des conséquences positives des discussions avec Lal Pataka s'exprime dans une lettre écrite au CCI :
"Nous préparons une déclaration sur les positions actuelles de Lal Pataka au Bengale qui définira clairement notre rupture totale avec le gauchisme ; nous n'avons pas d'hésitation sur le fait que ce qui reste du RPP est un groupe capitaliste de gauche. ..Bien qu'il soit un groupe éclectique en transition politique, le RPP a eu au moins un aspect positif dans son attitude quand il a déclaré faire un projet de plate-forme qui... pouvait être changé de façon adéquate et amélioré à travers des discussions et 1'analyse des conditions matérielles objectives qui prévalent en Inde et à 1'échelle mondiale...Cependant en réalité, la majorité du Comité central du RPP a refusé de confronter les implications politiques et organisationnelle de l'accomplissement d'une rupture avec la contre-révolution... Aussi ce qui reste du RPP n'est qu'une fraction de la gauche capitaliste dont 1'inévitable résultat est 1'éclatement de l'organisation elle-même. Lal Pataka reste dans sa préhistoire, 1'histoire du capitalisme de gauche". (28 décembre 1985).
Dans notre réponse à Lal Pataka, nous avons salué l'intention de publier une prise de position définissant le RPP comme un "groupe capitaliste de gauche". D'un autre côté, comme nous le soulignons dans notre réponse, les formulations de Lal Pataka contiennent un certain nombre de confusions '."Quand vous dites: 'Bien qu'il soit un groupe éclectique en transition politique, le RPP a eu au moins un aspect positif dans son attitude', etc. Vous évitez la question de la nature bourgeoise de ce groupe dès le début. Le RPP n'a pas commencé son existence comme une rupture, même confuse, même éclectique du gauchisme. En tant que groupe gauchiste bien structuré avec une certaine implantation dans l'appareil syndical, il ne pouvait, par définition, être 'en évolution' vers autre chose que vers une forme de gauchisme plus radical". "En parlant de 'ce qui reste du RPP',vous donnez 1'impression que ce n'est que maintenant que le RPP peut être clairement défini comme gauchiste. En fait, après votre départ, ce n'est pas 'ce qui reste du RPP', mais le RPP."(4 février 1986).
Néanmoins, cette discussion a été fructueuse parce qu'elle pose une question vitale à tout le mouvement révolutionnaire : la nécessité d'une méthode cohérente pour appréhender les rapports et les distinctions entre organisations bourgeoises et prolétariennes. Les discussions entre Lal Pataka, CI et le CCI ont eu lieu dans une atmosphère fraternelle. Nous avons été capables de parler de façon constructive sur la Conférence proposée des éléments révolutionnaires qui surgissent, dans la préparation de laquelle Lal Pataka a joué un rôle galvaniseur. Nous pensons que ces discussions indiquent la possibilité de surmonter le sectarisme, de confronter les divergences dans un contexte de solidarité fondamentale de classe. Pas un instant, nous n'atténuons notre critique de l'opportunisme et du confusionnisme quand ils apparaissent dans le camp prolétarien ; mais nous ne devons pas non plus oublier l'unité d'intérêts sous-jacente entre les différents composants du mouvement révolutionnaire, parce qu'à la racine cette unité exprime l'indivisibilité des intérêts du prolétariat comme un tout.
MA3DOOR MUKTI
Au travers de Lal Pataka, nous sommes entrés en contact avec un autre groupe : Majdoor Mukti (Emancipation ouvrière), qui est apparu récemment de manière plutôt "spontanée", rompant avec le milieu gauchiste, essentiellement sur la question du parti et de la conscience de classe. Dans un environnement politique dominé par la version gauchiste du point de vue "léniniste" sur l'organisation, il est vraiment significatif qu'un groupe apparaisse avec, dans ses déclarations de principes, des positions telles que : "Contre les tentatives de remplacer le rôle de la classe ouvrière dans sa propre émancipation par différentes sortes de soi-disant agents libérateurs, les communistes doivent défendre de manière claire que l'émancipation de la classe ouvrière ou la construction du socialisme sont impossibles sans l'activité consciente des masses prolétariennes ." Ou encore :
"Contre l’usurpation et la monopolisation du pouvoir politique par de soi-disant partis communistes et désignant ce pouvoir comme pouvoir prolétarien, les communistes doivent carrément déclarer que le pouvoir du parti ne peut jamais être synonyme du pouvoir ouvrier. .".
En fait, parmi les sept principes de base élaborés dans la déclaration, au moins cinq sont des critiques des conceptions substutionnistes. Bien que cela exprime une saine préoccupation du besoin d'auto-organisation ouvrière, c'est encore un déséquilibre qui démontre -dans un pays sans tradition conseilliste- l'immense pression du conseillisme aujourd'hui sur le mouvement prolétarien. De plus, les fixations conseillâtes ne représentent pas un barrage contre le gauchisme, au contraire. A partir, de la déclaration du groupe et de nos discussions avec eux, il est clair que le groupe ne voit pas les frontières de classe entre le gauchisme et le mouvement prolétarien, une difficulté renforcée par ses confusions entre le substitutionnisme (une erreur au sein du camp prolétarien) et la nature anti-prolétarienne de la gauche capitaliste ; bien qu'il insiste sur le fait que "le socialisme n'a pas encore été réalisé dans une partie du monde quelle qu'elle soit" , il hésite à définir la Russie, la Chine, etc. comme des Etats capitalistes ; et en n'ayant pas une claire conception de la décadence, il reste extrêmement flou sur la nature des syndicats, du réformisme, etc.
Pour toutes ces raisons et d'autres encore, il est évident que la rupture du groupe avec le gauchisme est loin d'être complète. Mais nous' pourrions difficilement attendre plus d'un groupe qui initialement est apparu sans référence directe aux forces communistes existantes. Ce qui nous permet d'espérer que ce groupe rejette ses influences gauchistes et conseillâtes, c'est sa confiance dans les capacités révolutionnaires de la classe ouvrière ; son rejet du nationalisme et son insistance sur les tâches internationales du prolétariat, sa défense du besoin d'organisation "communiste et d'un parti communiste, pour intervenir activement dans toutes les luttes de la classe ; et ce qui n'est pas le moindre, son attitude ouverte, sa volonté de discuter avec et d'apprendre des groupes révolutionnaires.
CONFERENCES DES REVOLUTIONNAIRES
L'émergence de ces groupes en Inde exprime un réel développement dans l'avant-garde du prolétariat. Il est absolument essentiel que les relations entre les différents composants du milieu soient établies sur une base organisée et sérieuse pour permettre la nécessaire confrontation des idées, pour permettre la coopération et la solidarité pratiques. Aussi, nous soutenons de tout coeur la proposition de Lal Pataka d'organiser une conférence pour ces éléments qui apparaissent.
Cependant dans l'incapacité d'assister à cette première rencontre, le CCI tient à marquer sa présence politique en envoyant une déclaration à la conférence :
- soulignant l'importance de la conférence en la situant dans la période actuelle. d'accélération de la crise et de la lutte de classe ;
- soutenant le choix du thème central : "les fondements et les implications de la décadence capitaliste", car une compréhension de la décadence est indispensable à l'élaboration des frontières de classe qui séparent le prolétariat de la bourgeoisie. En même temps, nous avons souligné la nécessité d'éviter les débats académiques et d'appliquer le concept de décadence aux développements présents de la réalité et aux tâches qui en résultent pour les révolutionnaires (en conjonction avec CI, le CCI a soumis à la conférence trois de ses textes déjà publiés sur la théorie des crises, la lutte prolétarienne dans la décadence et la situation internationale présente) ;
- appelant la conférence à adopter des critères pour une future participation suffisamment "large" pour la garder ouverte aux éléments prolétariens qui émergent mais suffisamment "étroite" pour exclure les gauchistes radicaux ;
- insistant sur le besoin pour la conférence de ne pas rester muette mais de prendre position au travers de résolutions communes, pour définir clairement les points d'accord et de désaccord ;
- défendant le besoin pour la conférence de s'ouvrir au milieu révolutionnaire international, particulièrement en publiant ses résultats en anglais ;
- en pointant le lien entre cette conférence et la nécessité d'un cadre international pour le débat entre révolutionnaires. Comme la déclaration le pose : "Bien que les Conférences de 1976-80 aient échoué sous le poids du sectarisme dominant dans le mi lieu, nous pensons que la résurgence de la lutte de classe et l'apparition de nouveaux groupes révolutionnaires dans de nombreux pays (Inde, Autriche, Mexique, Argentine, etc.) vient encore confirmer la nécessité d'un cadre international de discussion et d'activité au sein du milieu prolétarien. Même si un nouveau cycle de conférences internationales n'est pas encore une possibilité immédiate, la réunion en Inde, en brisant la fragmentation et le sectarisme, peut jouer son rôle dans le développement de nouvelles et fructueuses conférences à l'échelle internationale dans le futur".
Le développement du mouvement révolutionnaire en Inde peut donc être un facteur de vitalité dans l'ensemble du milieu international. C'est une confirmation de la promesse profondément contenue dans la période actuelle, un encouragement aux révolutionnaires partout, une claire indication du besoin pour les organisations révolutionnaires' des pays centraux d'assumer leurs responsabilités internationales. Pour sa part, le CCI n'a pas de doute sur le fait qu'il doit faire tout son possible pour soutenir et stimuler le travail de nos camarades de la "section en Inde" du mouvement prolétarien mondial.
MU.
[1] [70] Voir la Revue Internationale n° 32.
[2] [71] RAIA : BP 1724 1000 BRUXELLES 1
[3] [72] Lire "Le Communiste" n° 23.
[4] [73] Voir la Revue Internationale n° 44.
[5] [74] Voir Revue. Internationale n° 43, p. 17 : "Discussion : opportunisme et centrisme dans la classe ouvrière et ses organisations", et n° 44 : "Résolution adoptée sur l'opportunisme et le centrisme dans la période de décadence" (p. 16) et résolution rejetée sur "Le centrisme et les organisations politiques du prolétariat" (p. 18).
[6] [75] Voir Revue. Internationale n° 43, p. 17 : "Discussion : opportunisme et centrisme dans la classe ouvrière et ses organisations", et n° 44 : "Résolution adoptée sur l'opportunisme et le centrisme dans la période de décadence" (p. 16) et résolution rejetée sur "Le centrisme et les organisations politiques du prolétariat" (p.18).
Géographique:
- Inde [76]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [77]
La gauche hollandaise (1900-1914) : naissance d'un courant révolutionnaire en Europe (1900 - 1909)
- 3719 reads
Cet article est la première partie d'un chapitre portant sur le courant tribuniste hollandais jusqu'à la première guerre mondiale Le chapitre en question fait partie d'une étude critique d'ensemble du courant de la Gauche communiste germano-hollandaise.
La gauche hollandaise est fort mal connue. Traitée d'anarchiste par les défenseurs intéressés du capitalisme d'Etat russe ou chinois, ou d' "illuministe" et d'"idéaliste" par les bordiguistes plus "léninistes" que le roi, elle a été fort mal servie par ses zélateurs conseillistes. Ceux-ci ont vite "oublié" qu'elle avait mené le combat au sein de la 2ème puis de la 3ème Internationales ; qu'elle était un courant marxiste et non une secte anarchiste ; qu'elle était pour l'organisation et non anti organisation ; qu'elle faisait partie d'un courant international et qu'elle se refusait d'être une secte locale ouvriériste ou une espèce de club de propagande et d'études
Certes, la Gauche hollandaise, pour des raisons historiques, est restée moins connue que la Gauche italienne. Elle n'a pas connu -comme la Fraction italienne des années 30- l'émigration qui lui aurait permis de rayonner dans plusieurs pays Liée chair et sang à la Gauche allemande dans les années 20 et 30, elle s'est étiolée dans le cadre étriqué de la petite Hollande La majorité de ses contributions, écrites bien souvent en hollandais, n'ont pas connu une audience aussi grande que celles des gauches italienne et allemande. Seuls les textes de Pannekoek écrit en allemand et traduits en français et anglais, espagnol et italien peuvent donner un idée de l'apport théorique de cette fraction de la Gauche communiste internationale.
Cette première partie se propose de montrer les difficultés de surgissement du courant marxiste dans un pays qui restait dominé encore par le capital commercial, un capital parasitaire reposant sur l'exploitation de ses colonies. La croissance du prolétariat a été un processus long qui s'est surtout réalisée après la 2ème guerre mondiale et la décolonisation Pendant très longtemps, le prolétariat reste marqué par un environnement artisanal et un isolement dans une population encore agricole. D'où la force des idées et du courant anarchiste pendant très longtemps. Ce retard historique fait cependant contraste avec le développement très affirmé d'un vigoureux courant marxiste représenté par la Gauche, et qui se signale –à 1' image des bolcheviks dans la Russie paysanne- au sein de l'Internationale par une nette avance théorique, au point d'influencer directement le KAPD en Allemagne, lequel considérera toujours Pannekoek et Gorter comme ses théoriciens La Gauche hollandaise, malgré sa faiblesse –après la scission de 1909- sur le plan numérique, a un poids international énorme sur le plan théorique (question de l'Etat, conscience de classe, grève de masses). Au premier plan, avec Luxemburg et les bolcheviks, dans la lutte contre le révisionnisme, elle sera l'une des .pierres essentielles dans la formation delà future Gauche communiste internationale
Faire un bilan des apports et des faiblesses de la Gauche hollandaise, c'est contribuer au développement de la conscience de classe prolétarienne, qui est inséparablement liée à la mémoire critique de tout son passé révolutionnaire.
RETARD DU CAPITALISME HOLLANDAIS
Le poids politique de la Hollande dans le mouvement ouvrier international avant et après la première guerre mondiale apparaît démesuré eu égard au sous-développement industriel du pays et à la domination écrasante de l'agriculture. Pays classique de la révolution bourgeoise au XVIIe siècle, le royaume des Pays-Bas avait connu son plein essor sous la forme de capital commercial soutiré de ses colonies. L'âge d'or de la Compagnie des Indes orientales (Ost-Indische Kompagnie), qui exploitait l'Indonésie coïncidait avec la mainmise de l'Etat (1800) sur son fructueux commerce, tandis que le roi obtenait le monopole commercial d'Etat pour l'exploitation de cette colonie.
Grugée par le roi des profits des colonies, qui ne s'investissaient pas dans le secteur industriel mais de façon spéculative, la bourgeoisie hollandaise -malgré sa longue histoire- jouait encore jusqu'à la fin du XIXe siècle un rôle secondaire, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique. C'est ce qui explique son "radicalisme" verbal pendant cette période où elle végétait à l'ombre de l'Etat et l'enthousiasme chez certains pour le marxisme, enthousiasme qui disparut vite dès les premiers affrontements de classe au début du siècle. Comme en Russie, où la bourgeoisie libérale était encore faible, les Pays-Bas produisirent une variété locale de Struve, libéraux déguisés en marxistes "légaux". Mais à la différence de la Russie, les Struve hollandais finirent par l'emporter dans le Parti ouvrier social-démocrate. ([1] [78])
Le déclin de la bourgeoisie marchande dès la fin du XVIIe siècle, son incapacité à développer un capital industriel, la recherche de placements spéculatifs dans la terre, tous ces facteurs expliquent l'arriération économique des Pays-Bas au milieu du XIXe siècle. Ainsi, en 1849, 90 % du produit national hollandais provient de l'agriculture. Si 75 % de la population vit dans les villes, la majorité végète dans un état de chômage permanent et ne vit que des aumônes des possédants et des Eglises. En 1840, à Haarlem, ville de 20 000 habitants, 8 000 "pauvres" sont recensés, chiffre bien en deçà de la réalité. La dégénérescence physique de ce sous-prolétariat était telle que, pour la construction des premières lignes de chemin de fer, les capitalistes hollandais durent faire appel à la main-d'oeuvre anglaise. Dans son étude "Kapitaal en Arbeid in Nederland" ([2] [79]) la théoricienne socialiste Roland Holst notait que : "Depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle, notre pays était entré en décadence, puis dans un état de stagnation et de développement défectueux, anormalement lent. En l'espace de plusieurs générations, notre prolétariat dégénéra physiquement et spirituellement." Et Engels, dans le même sens, analysait les Pays-Bas du XIXe siècle comme "un pays dont la bourgeoisie se nourrit de sa grandeur passée et dont le prolétariat s'est tari" ([3] [80])
Ces caractéristiques historiques expliquent la lenteur du développement du mouvement ouvrier et révolutionnaire aux Pays-Bas. Le mouvement ouvrier fut au départ un mouvement d'artisans et d'ouvriers de petites entreprises artisanales, où les cigariers et les ouvriers diamantaires -qui formaient un prolétariat juif à Amsterdam- jouaient un rôle de premier plan. La classe ouvrière proprement "néerlandaise" -c'est-à-dire d'origine rurale- était encore au milieu du XIXe siècle extrêmement réduite. Le prolétariat était soit d'origine juive soit allemand. Cette particularité explique la réceptivité très grande au marxisme. Mais le caractère tardif du développement industriel, laissant subsister les traits archaïques du travail artisanal, simultanément, fit de la Hollande pendant plusieurs décennies une terre d'élection pour l'anarchisme.
Jusqu'en 1848, les mouvements sociaux restèrent très limités prenant la forme d'explosions de révolte qui en tant que telles ne pouvaient se donner des buts conscients. Les manifestations de chômeurs d'Amsterdam et la marche de la faim de La Haye, en 1847, n'étaient pas encore des expressions claires d'une conscience de classe ouvrière, en l'absence d'un prolétariat développé et concentré. Pendant la Révolution de 1848, les manifestations et les pillages de magasins à Amsterdam avaient été le fait d'un véritable lumpenprolétariat dont les actions désespérées étaient étrangères à un prolétariat devenu conscient, et donc organisé.
Les premières formes d'organisation du prolétariat en Hollande traduisent immédiatement la nature internationale du mouvement ouvrier naissant. En 1847, se crée un Club communiste d'ouvriers allemands qui déploie ses activités dans le prolétariat néerlandophone ([4] [81]). Un an plus tard, la Ligue des communistes, qui avait plusieurs sections aux Pays-Bas, pouvait introduire illégalement des exemplaires, tout juste sortis de l'imprimerie, de la première édition du "Manifeste communiste". Mais ces premiers pas du mouvement marxiste restèrent pendant plus de vingt années sans lendemain, en l'absence d'un véritable développement industriel qui ne se manifesta qu'à partir des années 70. La section de l'A.I.T. resta sous l'influence des idées anarchistes et syndicalistes, lorsque se forma en 1871 la Ligue ouvrière des Pays-Bas. En effet, en 1872, au congrès de La Haye, les délégués hollandais se rallièrent aux thèses de Bakounine.
C'est l'industrialisation naissante, favorisée par l'afflux de capitaux allemands, à la suite de la victoire de la Prusse sur la France, qui permet finalement la naissance du mouvement socialiste hollandais. En 1878 est fondée à Amsterdam l'Association social-démocrate (Sociaal-Democratische Vereeniging) qui va bientôt entraîner localement (La Haye, Rotterdam, Haarlem) le surgissement de groupes se fixant comme tâche la direction de la lutte de classe. Le regroupement de ces associations ouvrières prend le nom d'Union social-démocrate (Sociaal Democratische Verbond). Le terme d'union montre déjà toute l'ambiguïté d'une organisation qui va osciller entre le marxisme et l'anarchisme anti-centraliste. LA "SOCIAAL DEMOCRATISCHE BOND"
La personnalité qui va marquer à ses débuts le mouvement ouvrier hollandais est Domela Nieuwenhuis, un ancien pasteur converti au socialisme. A l'époque, Nieuwenhuis n'était pas encore anarchiste et menait de grandes campagnes pour le suffrage universel. L'activité de son mouvement consistait à diriger les grèves économiques et à favoriser l'édification de syndicats. La fondation en 1879 de la revue "Recht voor aile" -organe du Sociaal-democratische Bond (SDB) amena une grande agitation dans les groupes d'ouvriers. Son activité était multiple : diffusion de tracts dans les usines et les casernes, tâches d'éducation du prolétariat par des cours sur le marxisme ; manifestations et meetings contre l'armée, les Eglises, la monarchie, l'alcoolisme et la justice de classe.
Bientôt la répression allait s'abattre sur le mouvement ouvrier naissant. Nieuwenhuis fut arrêté et condamné à une année de prison. Pour la première fois de son histoire, la police commença à s'armer, aidée par l'intervention de l'armée "en cas de conflit". La police avait le droit d'être présente dans les réunions publiques, de les dissoudre et d'arrêter les orateurs socialistes.
Se considérant comme un disciple de Marx et d'Engels, Nieuwenhuis maintint pendant, longtemps des contacts épistolaires avec les théoriciens du socialisme scientifique. Ceux-ci, bien que suivant avec sympathie le développement du mouvement socialiste en Hollande, étaient très réservés sur les conceptions immédiatement "révolutionnanstes" de Domela Nieuwenhuis. Marx mettait en garde contre tout doctrinarisme qui chercherait à dresser des plans- sur "un programme d'action pour le premier jour après la révolution" ([5] [82]). Le bouleversement de la société ne pouvait être un "rêve de la fin du monde prochaine".
Au contraire, "la notion scientifique de la décomposition inévitable et constante du régime social existant, les masses de plus en plus exaspérées par des gouvernements qui incarnent les spectres du passé, et d'autre part le développement positif des moyens de production, tout cela nous garantit qu'au moment où la véritable révolution prolétarienne éclatera, modus operandi (toutes les conditions de son progrès immédiat (rien moins qu'idylliques, évidemment) auront été créées". ([6] [83])
Dans les années 80, Nieuwenhuis et le SDB ne rêvaient nullement d'un "Grand Soir", à la façon des anarchistes de l'époque qui faisaient abstraction de la maturation des conditions de la révolution. Comme les socialistes de son temps, Nieuwenhuis était convaincu de la justesse de la tactique parlementaire, comme tribune pour le mouvement ouvrier naissant. Très populaire parmi les ouvriers, mais aussi chez les petits paysans du Nord des Pays-Bas, il fut élu député en 1889. Pendant deux années, il proposa des réformes : sécurité sociale, indépendance des colonies, suppression du salaire en nature pour les ouvriers, réformes qui constituaient le "programme minimum" de la social-démocratie.
Mais bientôt, Domela Nieuwenhuis ne tarda pas à rejeter le parlementarisme, et devint le seul dirigeant social-démocrate antiparlementaire au sein de ia Ile Internationale nouvellement créée. Ce rejet du parlementarisme le rapprochait insensiblement des positions anarchistes. Cette évolution s'explique par l'essor de la lutte de classe au cours des années 90 aussi bien en Hollande que dans d'autres pays, et qui se traduit par une croissance numérique du mouvement ouvrier organisé. Sous la pression d'une- crise cyclique, qui se traduit par un développement du chômage, des troubles éclatent. Aux Pays-Bas, les ouvriers s'affrontent à la police, laquelle soutient des bandes de la pègre qui donnent l'assaut aux locaux du SDB. Dans ce climat, qui entretenait l'espoir d'une proche "lutte finale", Nieuwenhuis et les militants du SDB se mirent à douter de la tactique parlementaire.
FAUSSES REPONSES A L'OPPORTUNISME
Cette remise en cause du parlementarisme n'était pas le simple fait du parti hollandais. Les années 90 voient se développer aussi bien l'opposition anarcho-syndicaliste qu'une opposition dans la social-démocratie internationale qui nient toute activité de type parlementaire. La domination de la fraction parlementaire sur le parti, comme dans la social-démocratie allemande, les tendances opportunistes qu'elle véhicule, autant de facteurs qui expliquent la révolte d'une partie des nouveaux adhérents contre la direction du parti. Ceux qui se nommeront les "Jeunes" (Jungen) en Allemagne, et dont l'exemple se propagera dans d'autres pays comme la Suède et le Danemark, vont être à la pointe d'une contestation souvent ambiguë, en dénonçant les tendances réformistes gangrenant la direction parlementaire ([7] [84]), souvent de façon juste, mais en cédant progressivement à des tendances anarchisantes anti-organisation ([8] [85]). En fait, il s'agissait de savoir si la période était une période révolutionnaire, ou au contraire une période de croissance du capitalisme impliquant une activité immédiate dans les syndicats et dans les parlements.
Sur cette question, Nieuwenhuis et les "Jeunes" en Allemagne, ainsi que les anarchistes, cristallisaient une impatience petite-bourgeoise, d'autant plus vive qu'elle se nourrissait d'une opposition saine aux tendances réformistes.
En Hollande même, le débat sur la tactique à employer par le mouvement ouvrier allait être faussé par le fait que l'opposition à Nieuwenhuis était conduite dans le SDB autant par des réformistes avérés, comme Troelstra, que par des marxistes, comme Van der Goes, qui restaient fermement révolutionnaires. Le SDB ayant majoritairement décidé -par une résolution- en 1892, de ne pas participer aux élections, il se forma autour des futurs chefs révisionnistes de la social-démocratie (Troelstra, Van Kool, Vliegen) et des jeunes intellectuels qui venaient d'adhérer au parti une opposition parlementanste. Uniquement pour participer aux élections, qu'une récente loi avait modifiées dans Je sens de l'abolition du système censitaire, et sans chercher à convaincre la majorité, la minorité scissionna. Ainsi, dans la pire confusion et avec des arrière-pensées électoralistes, naissait en 1894 la social-démocratie hollandaise, le SDAP. Cette scission était non seulement confuse mais prématurée. La majorité du SDB devait en effet progressivement se rallier à 'la tactique de participation aux élections : ce qu'elle fit dans les faits, en présentant en 1897 des candidats. Cette nouvelle orientation rendait caduque l'existence séparée du SDB, dont les 200 adhérents décidaient en 1899 la fusion de leur parti avec celui de Troelstra. Cette fusion eut pour conséquence la sortie de Nieuwenhuis et de Cornelissen. Ce dernier, avec Nieuwenhuis, représentait la tendance anarchiste du SDB. A son instigation avait été créé le NAS, d'orientation plus syndicaliste révolutionnaire qu'anarchiste, en 1893. Ce petit syndicat radical jouera par la suite un grand rôle dans le mouvement ouvrier : non seulement il représentera une attitude militante dans la lutte de classe, à la différence du syndicat social-démocrate NVV créé par le SDAP et qui jouera un rôle de saboteur des grèves (cf. infra), mais il constituera progressivement l'organisation syndicale des Tribunistes puis celle du parti communiste ([9] [86]).
L'évolution de Nieuwenhuis vers les positions anarchistes n'enlève rien au fait qu'il demeure une grande figure du mouvement ouvrier international. Devenu anarchiste, il ne trahira pas la classe ouvrière, à la différence des chefs anarchistes comme Kropotkine qui trempèrent dans la guerre impérialiste ; il sera l'un des rares anarchistes à demeurer internationa-tionaliste ([10] [87]). Il n'en demeure pas moins nécessaire de voir toutes les limites de l'apport de Nieuwenhuis, puisque ce dernier est devenu pour beaucoup le symbole de l'impossibilité de demeurer dans une Ile Internationale, qui aurait été "bourgeoise" dès le début ([11] [88]). Il est important donc d'évaluer la portée de la critique faite par Nieuwenhuis à la social-démccratie allemande. Celle-ci est valable dans la mesure où elle rejoint celle faite par Engels à la même époque, puis par la suite par la Gauche. Dans son livre "Le socialisme en danger", publié en 1897, au moment de sa sortie du SDB, il dénonce avec justesse un certain nombre de tares de la direction de la social-démocratie, qui allaient se cristalliser en la théorie révisionniste de Bernstein : la pénétration des éléments petits-bourgeois dans le parti, mettant en danger la nature prolétarienne du parti, et se manifestant par des concessions idéologiques à leur égard, notamment lors des élections ; la théorie du socialisme d'Etat qui conçoit la révolution comme une simple prise en main réformiste de l'Etat par le mouvement ouvrier : "...les social- démocrates sont de simples réformateurs qui veulent transformer la société actuelle selon le socialisme d'Etat" ([12] [89])
Mais la portée des critiques de Nieuwenhuis reste limitée. Il représente une tendance anarchiste religieuse, tolstoienne, très présente dans le mouvement ouvrier hollandais, qui subsistera jusqu'à la première guerre mondiale où elle représentera le courant pacifiste. En niant la nécessité d'une violence de classe -nécessaire pour la prise du pouvoir par le prolétariat- et d'une dictature du prolétariat sur la bourgeoisie, Nieuwenhuis rompait définitivement avec le marxisme qu'il avait contribué à introduire en Hollande et évoluait vers le pacifisme tolstoien : "..les anarchistes communistes demandent l'abolition de l'autorité politique, c'est-à-dire de l'Etat, car ils nient le droit d'une seule classe ou d'un seul individu à dominer une autre classe ou un autre individu. Tolstoï l'a dit d'une manière si parfaite qu'on ne peut rien ajouter à ses paroles." ([13] [90])
Ceux qui se réclament -comme les anarchistes et leurs successeurs actuels- de Nieuwenhuis pour proclamer la IIe Internationale "bourgeoise dès l'origine" nient un certain nombre d'évidences : la IIe Internationale a été le lieu où s'est développé éduqué et trempé le prolétariat développé des grandes concentrations industrielles, quittant ses caractéristiques artisanales, celles qu'il avait encore au temps de la 1ère Internationale et qui expliquent le poids de l'anarchisme. C'est à travers cette Internationale, qui n'avait pas encore failli, que s'est développé numériquement, mais aussi qualitativement le prolétariat socialiste en Europe et hors d'Europe ;
- c'est au sein de l’internationale que s'est développée la résistance au révisionnisme, à l'opportunisme. C'est en son sein que s'est enrichi le marxisme par les contributions de Luxemburg, Pannekoek. D'un corps bourgeois n'aurait pu sortir aucun corps prolétarien;
- c'est le fédéralisme, et non le centralisme qui ont fini par miner l'Internationale, au point de la transformer en une simple addition de sections nationales. C'est sur cette base que s'est développé le pouvoir exorbitant des cliques parlementaires qui ont fini par dominer les partis de toute leur autorité. En effet, dès le départ, il était affirmé en 1889 dans une résolution que "dans aucun cas et sous aucune pression" il n'était question de"porter atteinte à l'autonomie des groupements nationaux, ceux-ci étant seuls les meilleurs juges de la tactique à employer dans leur propre pays". ([14] [91])
De fait, la Gauche -dans les pays où elle surgit- luttera toujours pour un strict centralisme et pour le respect de la discipline de l'Internationale dans les partis nationaux, contre la volonté des chefs de ces partis organisés en fraction parlementaire autonome par rapport à l'organisation. Comme les bolcheviks, puis plus tard Bordiga, la Gauche hollandaise -ainsi d'ailleurs que les Gauches allemande et polonaise- mène ce combat pour le respect des principes d'une Internationale centralisée.
LES DEBUTS DE LA GAUCHE HOLLANDAISE
Que la social-démocratie hollandaise ne fût pas "bourgeoise" dès le commencement, la preuve en est donnée par l'adhésion au parti après 1897 d'une pléiade de marxistes dont les contributions au mouvement révolutionnaire international allaient être considérables.
Cette Gauche marxiste présente la particularité d'avoir été composée d'artistes et de scientifiques qui ont compté dans l'histoire de la Hollande. Gorter, le plus connu, est certainement le plus grand poète des Pays-Bas. Né en 1864 d'un père pasteur et écrivain, après avoir écrit une thèse sur Eschyle, il se fit connaître comme le poète de "Mai" -son poème le plus célèbre (1889). Après une crise spirituelle qui le mena vers une forme de panthéisme - s'inspirant de l'Ethique de Spinoza qu'il traduisit du latin en hollandais- Gorter se mit à étudier Marx, pour finir par adhérer en 1897 au SDAP. Très dynamique et remarquable orateur, Gorter a été surtout un bon vulgarisateur du marxisme qu'il a exposé dans un style très vivant, facilement compréhensible par la grande majorité des ouvriers ([15] [92]).
Moins pratiquement, et plus théoriquement, Pannekoek s'inscrivit dans le mouvement de la gauche marxiste internationale, et fut le moins "hollandais" de tous. Astronome réputé, il adhéra au mouvement socialiste en 1899. Né en 1873, fils d'un directeur d'entreprise, il sut se dégager de son milieu bourgeois pour se consacrer sans réserve à la cause prolétarienne. D'esprit rigoureux, par sa formation scientifique et philosophique, Pannekoek a été l'un des principaux théoriciens de la Gauche ; dans bien des domaines et débats théoriques -comme celui mené sur la signification de la grève de masses (cf. infra)- il s'est trouvé l'égal de Luxemburg, par la profondeur de sa réflexion, et a influencé Lénine dans son livre "L'Etat et la Révolution". L'un des premiers, parmi les marxistes, Pannekoek a mené le combat contre le révisionnisme naissant. Par son étude sur "La philosophie de Kant et le marxisme", publiée en 1901, il attaquait la vision néo-kantienne des révisionnistes qui faisaient du socialisme scientifique non une arme de combat mais une simple éthique bourgeoise. Cependant, plus- théoricien qu'homme d'organisation, son influence s'exerça essentiellement dans le domaine des idées, sans qu'il soit capable d'être une force active dans le combat organisationnel contre la majorité opportuniste du SDAP ([16] [93]).
Moins connus, d'autres intellectuels de la Gauche ont pesé d'un poids énorme et ont contribué souvent par leurs confusions à ternir l'image de cette Gauche. La poétesse Roland-Holst, bien qu'ayant contribué avec force à la théorie marxiste et à l'histoire du mouvement ouvrier ([17] [94]), symbolise à la fois une certaine religiosité mal digérée dans le socialisme naissant et les hésitations "centristes" au moment des grandes décisions à prendre sur le plan organisationnel. En dehors d'elle, des militants comme Wijnkoop et Van Ravesteyn se sont imposés par la suite comme les véritables organisateurs du mouvement tribuniste. Oscillant entre un radicalisme verbal et une pratique qui devait se révéler à la longue comme opportuniste, ils allaient contribuer à affaiblir le rayonnement de la Gauche hollandaise, qui apparut plus comme une somme de théoriciens brillants que comme un véritable corps.
Le drame de la Gauche hollandaise à sa naissance a été que des théoriciens marxistes reconnus internationalement, d’une grande force de conviction révolutionnaire, comme Gorter et Pannekoek, se soient peu impliqués dans la vie organisationnelle de leur parti. En cela, ils diffèrent de Lénine, Luxemburg, qui étaient aussi bien des théoriciens que des hommes de parti. Gorter, au sein du mouvement, était constamment déchiré entre son activité de poète -à laquelle par périodes il se consacrait totalement- et son activité militante de propagandiste et d'orateur du parti. D'où son activité hachée, et même épisodique au point de disparaître parfois des congrès du parti ([18] [95]). Pannekoek, pris à la fois par ses recherches d'astronome et son activité de théoricien marxiste, ne se sentait nullement un homme d'organisation ([19] [96]). Il ne se donna vraiment à plein au mouvement socialiste qu'à partir de 1909 jusqu'en 1914, en Allemagne, où il donnait des cours, comme professeur rémunéré, à l'école du parti de la social-démocratie allemande. Il se trouva donc absent de la Hollande au moment le plus crucial, quand se précipitait le processus de la scission au sein du SDAP. Dans cette période de développement du mouvement ouvrier, le poids des personnalités, des individus brillants, restait énorme. Il était d'autant plus négatif que les chefs des partis étaient des révisionnistes avérés qui écrasaient de toute leur personnalité la vie du parti. Tel était Troelstra, un avocat qui était poète frison à ses heures perdues. Il était un pur produit du parlementarisme. Constamment élu non par des secteurs ouvriers, mais par les paysans arriérés de la Frise, il avait tendance à se placer du point de vue des intérêts de la petite-bourgeoisie. Proche de Bernstein, il se définissait comme un révisionniste, voire un "libéral" bourgeois au point de déclarer en 1912 que "la social-démocratie tient aujourd'hui le rôle que le Parti libéral a tenu vers 1848" ([20] [97]). Mais il avait suffisamment d'habileté pour se montrer, lors des congrès de l'Internationale proche du Centre de Kautsky, pour pouvoir avoir les coudées franches dans son territoire national en toute autonomie. Soucieux de garder son poste de parlementaire et de chef du SDAP, il était prêt à n'importe quelle manoeuvre pour éliminer toute critique dirigée contre son activité opportuniste, voire exclure les opposants. Toute critique ne pouvait être, du point de vue de Troelstra et d'autres révisionnistes comme Vliegen et Van Kol, que de l'anarchisme ou de pures critiques "personnelles". Le poids des chefs dans ce parti récent, et issu d'une scission ambiguë, allait être un obstacle considérable auquel dut faire front l'ensemble de la Gauche.
La lutte de la Gauche allait se mener dès l'adhésion d'éléments nouveaux et jeunes, comme Gorter, Pannekoek, Roland-Holst, Wijnkoop et Van Ravesteyn Groupés autour de la revue "Nieuwe Tijd" (Temps nouveau), qui voulait rivaliser avec la revue théorique de Kautsky, "N'eue Zeit", ils commencèrent à mener un combat pour la défense des principes du marxisme foulés au pied par une pratique réformiste croissante. Leur combat allait être d'autant plus intransigeant que des militants comme Gorter et Pannekoek avaient des relations d'amitié avec Kautsky et crurent trouver son soutien dans la lutte contre le révisionnisme au sein de la Deuxième Internationale.
Chardin
[1] [98] Peter Struvé était l'un de ces bourgeois libéraux russes qui à 'la fin» du 19e siècle s'étaient pris de "passion" pour le marxisme, en lequel il ne voulaient voir qu'une théorie du passage pacifique du féodalisme au capitalisme industriel. Leur marxisme "légal", car toléré et même encouragé par la censure tsariste était un apologie du capitalisme. Struve devint bientôt l'un des chefs du parti libéral Cadet et se trouva au premier rang de la contre-révolution bourgeoise en 19 17.
[2] [99] Ce livre a été publié en 1932.Citation extraite de M.C.Wiessing :"Die Hollandische Schule des Marxismus" (L'école hollandaise du marxisme), VSA Verlag, Hambourg, 1980.
[3] [100] Marx-Engels Werke (MEW), volume 23, p.335-336
[4] [101] Cf, livre de Wiessing, déjà cité.
[5] [102] Lettre de Nieuwenhuis à Marx du 28 mars 1882, citée par Wiessing, p. 19.
[6] [103] Lettre h Nieuwenhuis du 22 février 1881 (MFM, volume 35, p.159).
[7] [104] Des exemples concrets de l'opportunisme des dirigeants parlementaires Liebknecht et Bebel sont donnés -citations à l'appui- par Nieuwenhuis dans "Le socialisme en danger" (1894, reprint Payot 1975)
[8] [105] On trouvera les critiques d'Engels aux "Jeunes" dans le recueil de textes de Marx-Engels sur "La social-démocratie allemande" (10/18, Paris 1975).
[9] [106] Cf. R. de Jong :"Le mouvement libertaire aux Pays-Bas"("Le mouvement social" n°83, avril-juin 73)
[10] [107] Pendant la guerre, Nieuwenhuis distribuait les brochures de Gorter.
[11] [108] Les conseillistes de "Daad en Gedachte" (Action et Pensée), en Hollande, affirment dans leur numéro de février 1984 que "en réalité, la social-démocratie n'est pas devenue un parti de réformes bourgeois ; elle l'était dès le commencement..." Un groupe comme le G.CI. (Groupe communiste internationaliste), de tendance bordiguiste, ne fait que reprendre les thèses anarchistes et conseillistes en affirmant exactement la même chose : ".ce sont ces tendances bourgeoises dénoncées par Marx qui domineront entièrement la social-démocratie et ce dès la naissance de la seconde Internationale". Citant abondamment le préfacier du livre de Nieuwenhuis, republié par Payot, Bériou -l'un des "théoriciens" du modernisme qui font du prolétariat une "classe pour le capital"- le G.C.I. rejoint la constellation politique des modernistes et conseillistes. Voir à ce sujet son article "Théories de la décadence, décadence de la théorie", in "Le Communiste", n° 23, novembre 1985.
[12] [109] Toutes ces citations sont extraites du livre de Nieuwenhuis, republié par Payot en 1975.
[13] [110] Toutes ces citations sont extraites du livre de Nieuwenhuis, republié par Payot en 1975.
[14] [111] Cf. le livre de C Haupt : "La Deuxième Internationale, étude critique des sources. Essai biblio graphique", Mouton, Paris-La Haye, 1964. Beaucoup d'éléments sur l'absence de centralisation.
[15] [112] li. n. ve Liagre Bohl : "Herman Gorter", SUN, Nijmegen, 1973. Biographie de Gorter, la seule existante et en langue hollandaise.20
[16] [113] Sur Pannekoek, il existe une introduction par un ancien communiste des conseils, B.A. Sijes, qui a publié les "Mémoires" écrites par le théoricien des conseils ouvriers en 1944 : "Herinnerigen", Van Gennep, Amsterdam, 1982. En langue française, est disponible une importante notice biographique sur Pannekoek dans 1'ouvrage de Serge Bricianer, "Pannekoek et les conseils ouvriers" (EDI, Paris 1969), recueil et commentaires des textes du grand militant communiste hollandais.
[17] [114] Les contributions de Roland-Holst sur la "grève de masses" attendent toujours d'être republiées et traduites dans des langues autres que le hollandais. Cf. "De revolutionaire masssa-aktie. Een Studie", Rotterdam, 1918
[18] [115] En 1903, Gorter publiait ses "Versen", d'inspiration individuelle. Par la suite, il chercha à écrire des poèmes d'inspiration "socialiste", qui étaient loin d'avoir la force et la valeur poétiques de son inspiration première. "Een klein heldendicht" (1906) -"Une petite épopée"- chante l'évolution u'un jeune prolétaire vers la conviction du socialisme. "Pan" (1912), composé après la scission de 1909, est un poème moins idéologique et plus inspiré par une vision poétique de l'émancipation de l'homme et de la femme aimée. Sans que son inspiration se soit vraiment tarie, Gorter était écartelé entre son activité de propagandiste et sa création poétique où il oscillait entre le lyrisme personnel et l'épopée socialiste didactique.
[19] [116] Pannekoek écrivait à Kautsky qu'il préférait en général "n'apporter que des éclaircissements théoriques". Il ajoutait : "Vous savez que... je ne me laisse entraîner dans les luttes pratiques que contraint et forcé." (Cité par Sijes, op. cit., p. 15). On est très loin de l'attitude d'autres dirigeants du courant de gauche international, qui -comme Lénine et Luxemburg-, n'hésitaient pas, en menant de front leurs travaux théoriques, à se plonger et se laisser entraîner dans les luttes quotidiennes
[20] [117] Cité par Sam de Wolff -un social-démocrate d'origine juive qui finit par devenir sioniste- : "Voor het land van Belofte. Een terugblik op mijn leven" (Avant la terre promise. Un coup d'oeil en arrière sur ma vie), SUN, Nijmegen, 1978
Géographique:
- Hollande [118]
Conscience et organisation:
La "fraction externe du CCI" (polémique)
- 2885 reads
QUESTION D'ORGANISATION : UNE CARICATURE DE SECTE IRRESPONSABLE
Le milieu politique prolétarien, déjà fortement marqué par le poids du sectarisme, comme le CCI l'a souvent mis en évidence et déploré, vient de "s'enrichir" d'une nouvelle secte. Il vient en effet de paraître le n° 1 d'une nouvelle publication intitulée Perspective Internationaliste, organe de la "Fraction Externe du CCI" qui "revendique la continuité du cadre programmatique élaboré par le CCI". Ce groupe est composé des camarades appartenant à la "tendance" qui s'était formée dans notre organisation et qui l'a quittée lors- de son 6ème Congrès ([1] [120]) pour "défendre la plate-forme du CCI". Nous avons déjà rencontré et mis en évidence beaucoup de formes de sectarisme parmi les révolutionnaires d'aujourd'hui, mais la création d'un CCI-bis ayant les mêmes positions programmatiques que le CCI constitue un sommet en ce domaine, un sommet jamais atteint jusqu'à présent. De même, ce qui peut être considéré comme un sommet, c'est la quantité de calomnies que P.I. déverse su le CCI ; il n'y a guère que le Communist Bulletin (formé également d'ex-membres du CCI) qui soit allé aussi loin dans ce domaine. Dès sa création, ce nouveau groupe se place donc sur un terrain que seul des voyous politique (qui s'étaient distingués en volant du matériel et des fonds du CCI avaient par le passé exploité avec autant de ferveur. Même si les membres de la "Fraction" ne se sont nullement rendus responsables de tels actes, on peut dire que son sectarisme et sa prédilection pour 1'insulte gratuite augurent mal de l'évolution future de ce groupe et de sa capacité d'être une contribution à l'effort de prise de conscience du prolétariat En effet, les petits jeux de la FECCI ne traduisent qu'une chose : une irresponsabilité totale face aux tâches qui incombent aujourd'hui aux révolutionnaires, une désertion du combat militant.
Calomniez, calomniez,...il en restera toujours quelque chose.
Dans le principal article de" P.I. consacré au CCI, on peut lire que "ce texte ne visera ni à régler des comptes, ni à tomber dans une basse polémique. On peut se demander ce que ce texte aurait été si tel avait été le cas. En effet, dans cet article, on peut lire, entre autres compliments, qu'au cours de ces deux dernières années, le CCI aurait fait preuve d'un mépris intolérable pour les principes révolutionnaires, traînés dans la boue de volte-face tactiques", qu'il aurait développé "une vision tout à fait stalinienne de l'organisation", qu'il se serait "enfoncé dans la pourriture" et que, "pour faire avaler la couleuvre de ses revirements à 180°", il aurait employé comme moyen de "semer la peur, terroriser et paralyser, l'ensemble des militants par des insinuations malsaines". En même temps, le CCI aurait, contre les camarades minoritaires qui ont constitué la FECCI, "mis en marche une machine infernale visant à broyer toute résistance" et dont la liste des exactions est impressionnante : "pratiques organisationnelles sordides", "chasse aux sorcières", "attaques personnelles de toutes sortes", "calomnies", "suspicion", "procédés inqualifiables", "multiples pressions et manoeuvres", "chantage". Ce n'est là qu'un petit échantillon de ce qu'on peut trouver dans cet article mais on peut se demander qui se livre à des"incantations hystériques", le CCI comme l'écrit la FECCI ou la FECCI elle-même ?
On pourrait écarter d'un revers de main ces calomnies ; mais elles sont d'une telle ampleur et en telle quantité qu'on peut craindre qu'elles ne finissent par impressionner les lecteurs mal informés de la réalité du CCI, que du fait qu'elles émanent d'une organisation prétendant défendre la plateforme du CCI, ce qui devrait être un gage de sérieux-elles n'insinuent l'idée "qu'il n'y a pas de fumée sans feu". Aussi, même si nous ne répondons pas à toutes les accusations de la FECCI (ce qui occuperait la totalité de ce numéro de la Revue), nous sommes contraints de récuser quelques uns des mensonges qu'on peut trouver dans les pages de P.I. ridicules jusqu'à des accusations d'une malveillance odieuse.
C'est ainsi que l'article sur le "déclin du CCI" commence par un "petit mensonge". La première phrase affirme que "la plupart des camarades qui ont constitué la Fraction externe du CCI ont été à la base de la constitution de cette organisation en "1975". C'est faux : des dix camarades qui ont quitté le CCI pour constituer la FECCI, trois seulement était dans l'organisation à la fondation du CCI en janvier 75.
L'article de PI fourmille de ce genre de "petits mensonges" ridicules. Il reprend par exemple un vieux dada de la "tendance" suivant lequel l'analyse présente du CCI sur l'opportunisme et le centrisme constituerait un revirement de ses positions classiques. Nous avons montré dans la Revue n° 42, citations à l'appui, que c'est en réalité l'analyse de la tendance qui constitue une révision des positions du CCI et de la gauche communiste. Nous ne lui chercherons pas ici querelle pour cette révision. Mais il faut constater que le procédé qui consiste à refuser d'assumer une démarche en l'attribuant aux autres est bien symptomatique de ce qu’a été le comportement de la "tendance" et que reprend aujourd'hui la FECCI : obscurcir par des contorsions et par la mauvaise foi les véritables questions posées.
Cette même propension à reprocher à autrui (en l'occurrence le CCI) ce qui lui revient de droit, nous la retrouvons lorsque P.I. accuse le CCI de "manque d'esprit fraternel". C'est de nouveau le monde à l'envers, nous n'allons pas ennuyer le lecteur en énumérant les multiples exemples où ce sont des camarades de la "tendance" qui se sont illustrés par un tel "manque d'esprit fraternel". Il suffit de lire dans P.I. la collection d'insultes odieuses, animée par la hargne et un esprit de revanche, qui s'intitule "Le déclin du CCI" pour se rendre compte de quel côté se situe le "manque d'esprit fraternel".
"PERSPECTIVE INTERNATIONLISTE"
Ils sont en nombre incalculable et prennent plusieurs formes en partant de petites contre vérités
Nous pourrions poursuivre la réfutation de ces petits mensonges mais ce serait fastidieux. Il est préférable de mettre en évidence les mensonges énormes qu’emploie la FECCI pour justifier sa thèse de la dégénérescence du CCI.
Le premier d'entre eux dépasse toute mesure : les camarades de la "tendance" auraient été exclus du CCI. Mal à l'aise pour soutenir une telle affirmation, la FECCI prend le soin de préciser dans certaines phrases qu'il s'agissait d'une exclusion "de fait". Il faut le réaffirmer nettement : c'est totalement faux. Ces camarades n'ont pas été exclus, ni formellement ni "de fait". Dans le précédent n° de la Revue nous expliquons, les circonstances du départ de ces camarades. En particulier nous y donnions connaissance d'une résolution adoptée à l'unanimité par le 6ème congrès montrant clairement que le départ de ces camarades était de leurs seules responsabilité et volonté. Sans y revenir dans le détail, rappelons ici :
- que le congrès a demandé aux camarades de la "tendance" quelles étaient leurs intentions pour après celui-ci, en particulier s'ils comptaient rester des militants du CCI, dans la mesure où certains d'entre eux avaient affirmé à plusieurs reprises qu'ils comptaient se retirer après le congrès ;
- que les camarades de la tendance ont constamment refusé de répondre à cette question dans la mesure où, en fait, ils n'étaient pas d'accord entre eux là-dessus ;
- que face à ce refus de répondre, le congrès a demandé à ces camarades de se retirer de la séance pour qu^ils puissent réfléchir, discuter et revenir à la séance suivante avec une réponse claire ;
- que les camarades ont pris prétexte de cette demande pour se retirer du congrès en prétendant qu'on les avait exclus de celui-ci, ce qui est parfaitement faux ;
- que le congrès a adopté une résolution transmise par téléphone à ces camarades exigeant leur retour au congrès ;
- que ces camarades ont opposé une fin de non recevoir à cette demande en la qualifiant de "tentative de justification ignoble de l'exclusion de la tendance" ;
- que le congrès a adopté une résolution condamnant cette attitude qui "traduit un mépris du congrès et de son caractère de moment d'action militante de l'organisation" et "constitue une véritable désertion des responsabilités qui sont celles de tout militant de l'organisation".
Cette résolution prévoyait des sanctions contre ces camarades mais nullement leur exclusion.
Prétendre après cela que la "tendance" a été exclue du CCI, ou mené du congrès, est un mensonge aussi odieux que ridicule car le procès-verbal du congrès prouve exactement le contraire. D'ailleurs ces camarades savaient pertinemment en partant qu'ils n'avaient pas été exclus de l'organisation puisque dans la déclaration remise au moment de leur départ ils affirmaient qu'ils restaient "comme tendance et comme camarades minoritaires au sein du CCI".
Un autre mensonge énorme et tout aussi odieux qu'on peut lire dans P.I., c'est l'affirmation que le CCI aurait "étouffé" les débats, y compris par l'utilisation do mesures disciplinaires, et aurait censuré – l’expression publique des positions de la "tendance". Encore une fois, c'est le monde à l'envers ! En janvier 84, il a fallu insister auprès des camarades qui avaient émis des "réserves" pour qu'ils fassent parvenir à l'ensemble de l'organisation leurs explications de votes. Un an plus tard, c'est l'organe central qui demande que "les éventuelles contributions doivent être conçues en vue de l'ouverture du débat vers l'extérieur".
Franchement, affirmer que le CCI, ou son organe central, a "étouffé" le débat, qu'il a évolué vers le monolithisme comme le prétend la FECCI, c'est se moquer du monde. Les bulletins internes de l'organisation ont publié sur plus d'un an environ 120 textes portant sur la discussion soit environ 700 pages. Tous les textes des camarades minoritaires sans exception ont été publiés. |En fait de "monolithisme", c'est de façon permanente que l'organisation a insisté sur l'exigence de clarté, sur la nécessité que s'expriment de la façon la plus précise possible les différentes positions existant en son sein.
Il en est de même en ce qui concerne la publication vers l'extérieur des débats internes. C'est une calomnie grossière et stupide que de prétendre que le CCI "n'en a pratiquement rien laissé filtrer depuis deux ans et qu'il a établi autour un "mur du silence" (page 14). Tout lecteur a pu se rendre compte que les cinq derniers numéros de notre Revue ont donné une large place au débat (au total une quarantaine de pages avec trois textes de la "tendance" et trois textes défendant les positions du CCI). Toute aussi calomnieuse est l'affirmation suivant laquelle le CCI "a systématiquement censuré les textes dans lesquels nous essayions de dégager les enjeux réels du débat actuel" (p.25). En fait de censure systématique, les textes non publiés sont au nombre total de deux. L'un était destiné à la presse territoriale de Grande-Bretagne mais par le nombre même des questions traitées, il trouvait plus sa place dans la Revue Internationale, ce qui a été proposé à la "tendance" et refusé par elle. L'autre était la "Déclaration sur la formation d'une tendance" publiée dans P.I. (page 25). A son propos, l'organe central du CCI a adopté une résolution qui "relève dans la 'Déclaration' sur un certain nombre d'affirmations ou d'insinuations diffamatoires pour l'organisation" (suit la liste des passages concernés), qui "estime que, pour la dignité même du débat public, et donc de la crédibilité de l'organisation, de telles formulations ne peuvent paraître telles quelles dans le prochain numéro de la Revue" et "demande donc aux camarades signataires de la 'Déclaration', soit de les enlever du texte qui sera publié, soit de les argumenter, afin que ce débat public puisse se dérouler dans la clarté et s'éviter l'emploi des insultes gratuites". Cela est interprété par la FECCI : "le CCI s'arrogerait le droit de dicter à la minorité ce qu'elle pouvait (et ne pouvait pas) écrire et penser" (p.25).
Voilà comment on écrit l'histoire !
Si la "tendance" avait vraiment été intéressée à faire connaître la totalité de ses critiques, il lui suffisait de se donner la peine d'argumenter quelque peu les points qui, dans son texte, apparaissaient comme de simples insultes gratuites. Mais tel n'était pas son souci. Elle s'est drapée dans sa dignité offensée et a "catégoriquement refusé d'entrer dans ce jeu de compromissions" (P.I. p. 25), comme si expliciter un désaccord ou une critique était une "compromission".
C'est d'ailleurs là une constante dans la démarche de la "tendance" : elle a tout fait pour convaincre le reste du CCI de son manque de sérieux ...à elle, et a pleinement réussi.
LE "GLORIEUX COMBAT" DE LA TENDANCE
Lorsqu'une minorité apparaît dans une organisation pour essayer de la convaincre qu'elle fait fausse route, son comportement est au moins aussi important pour atteindre ce but que la validité de ses arguments politiques. P.I. dépeint comme un exemple de sérieux son action en vue de "redresser le CCI menacé de dégénérescence" : "les minoritaires avaient toujours mené leur lutte ouvertement de façon militante et responsable sans aucune atteinte au fonctionnement général de l'organisation, dans le but de convaincre le CCI de ses erreurs" (p. 22).
C'est une triste blague !
Dans les précédents numéros de la Revue nous avons mis en évidence l'inconsistance des arguments politiques de la "tendance". Le comportement de ses camarades tant dans le débat que dans la vie organisationnel le du CCI en a été le pendant fidèle. Comment peuvent-ils affirmer, par exemple, qu'ils n'ont porté "aucune atteinte au fonctionnement général de l'organisation" alors :
- qu'un membre de l'organe central a tenté d'annoncer à l'ensemble de l'organisation sa démission de celui-ci sans même le prévenir ;
- que plusieurs membres du même organe central ont communiqué à une section locale un document signé en tant que membres de cet organe et critiquant celui-ci sans le porter d'abord à sa connaissance ;
- qu'à plusieurs reprises se sont tenues des réunions dites "informelles" sans que l'organisation en ait été informée à l'avance »;
- que des membres de l'organe central ont manqué une réunion de celui-ci afin de pouvoir tenir une réunion de la "tendance".
Il ne manque pas d'autres exemples de l'absence de sérieux des camarades minoritaires dans le débat. Eux-mêmes en étaient d'ailleurs conscients lorsque, fin 84, ils faisaient (dans un texte justifiant la tenue régulière de réunions séparées) un "constat de carence dans (leur) contribution au débat en cours dans le CCI" : on est bien loin des affirmations satisfaites qu'on peut lire dans P.I. sur "l'inlassable impulsion des débats" par la minorité contre le "verrouillage" de l'organisation.
Nous ne citerons ici que deux exemples de cet "admirable" sérieux de la minorité :
- en juin 84, quatre camarades minoritaires, membres de l'organe central, votent à cinq minutes d'intervalle de façon totalement contradictoire sur la question du centrisme : dans un premier vote ils placent le centrisme dans la bourgeoisie, et dans un second vote ils en font un phénomène
au sein de la classe ouvrière;
- depuis le début du débat, les camarades minoritaires n'ont cessé d'affirmer la nécessité de "s'atteler enfin à la tâche difficile de développer à un niveau supérieur la théorie marxiste sur la conscience de classe et le rôle du parti sur les fondements déjà établis par le CCI". Et depuis deux ans, nous n'avons rien vu venir de la part de ces camarades. Rien ! Aucun texte ! Cela en dit long sur le sérieux avec lequel ils ont mené le débat.
UNE CARICATURE DE SECTE IRRESPONSABLE
Une question se pose : comment se fait-il que des membres de longue date de l'organisation, à l'expérience et aux capacités politiques souvent indiscutables, membres pour la moitié d'entre eux de l'organe central du CCI, aient pu se laisser aller à une telle régression qui les a conduits à des comportements de plus en plus irresponsables, jusqu'à scissionner de l'organisation et à déchaîner une telle quantité de mensonges odieux et ridicules contre celle-ci ? Toutes proportions gardées, nous assistons aujourd'hui à un phénomène très similaire à celui qui s'est développé au cours et à la suite du 2ème congrès du Parti Ouvrier Social Démocrate de Russie en 1903 et qui conduisit à la scission entre bolcheviks et mencheviks. A la tête des mencheviks il y avait également des militants de vieille date et d'une capacité politique reconnue, qui, pendant des années, avaient apporté beaucoup à la cause de la révolution socialiste, notamment à la rédaction de l'ancienne "Iskra" (1900-1903).
Et ce sont ces éléments (notamment Martov, rejoint par la suite par Plekhanov) qui allaient impulser un courant opportuniste dans le POSDR, courant qui s'achemina progressivement vers la trahison de classe.
Pour caractériser le phénomène du menchevisme à ses débuts et analyser ses causes, laissons la parole à Lénine, le chef de file de l'aile marxiste révolutionnaire dans le POSDR :
"…la nuance politique qui a joué un rôle immense au congrès et qui se distingue justement par sa veulerie,sa mesquinerie, par 1'absence d'une ligne propre,(...), par des oscillations perpétuel les entre les deux parties nettement déterminées, par la peur d'exposer ouvertement son credo, en un mot par son ' embourbement ' (dans le "marais"). (Il en est maintenant dans notre parti qui, à entendre ce mot, sont saisis d'horreur et crient à une polémique dénuée d'esprit de camaraderie... JI n'est guère de parti politique qui, connaissant la lutte intérieure,se soit passé de ce terme dont on se sert toujours pour désigner les éléments instables, qui oscillent^entre les combattants. Et les Allemands, qui savent faire tenir la lutte intérieure dans un cadre parfaitement convenable, ne se forma lisent pas au sujet du mot 'versumpft' (marais), et ne se sentent pas saisis d'horreur, ne font pas preuve d'une officielle et ridicule pruderie.)
Oeuvres, Tome 7, page 230.
"Mais le plus dangereux n 'est pas que Martov soit tombé dans le marais; c'est qu'y étant tombé fortuitement, loin de chercher à en sortir, il s'y soit enfoncé toujours davantage."
Oeuvres, Tome 7, page 78.
Nous avons là, à plus de 80 ans de distance, une caractérisation de la démarche dans laquelle se sont engagés les camarades de la minorité. Sur la base de réelles faiblesses conseillistes un certain nombre de camarades sont tombés fortuitement dans une démarche centriste à l'égard du conseillisme. Une partie d'entre eux s'est ressaisie mais il est arrivé aux autres ce qui était arrivé à Martov : refusant d'admettre qu'ils aient pu être victimes du centrisme (à entendre ce mot ils furent "saisis d'horreur et ont crié à la polémique dénuée d'esprit de camaraderie") ils s'y sont enfoncés toujours davantage. C'est ce que nous signalions déjà dans notre article de réponse à la "tendance" de la Revue n°43 ("Le rejet de la notion de centrisme : la porte ouverte à l'abandon des positions de classe"). Ces camarades ont mal supporté qu'on puisse les critiquer, ils ont interprété un texte et une résolution se donnant pour but de mettre en garde contre le danger de centrisme dans l'organisation, et qui illustrait ce danger, entre autres, par leur attitude conciliante face au conseillisme, comme une insulte personnelle. Ce n'est nullement là une explication "subjectiviste" de leur démarche. Lénine explique en des termes similaires celle des Menchéviks :
"Lorsque je considère la conduite des amis de Martov après le congrès, leur refus de collaborer (…), leur refus de travailler pour le Comité Central.. je puis dire seulement que c'est là seulement une tentative insensée, indigne de membres du Parti...Et pourquoi? Uniquement parce qu'on est mécontent de la composition des organismes centraux car, objectivement, c'est uniquement cette question qui nous a séparés, les appréciations subjectives (comme offense, insulte, expulsion, mise à 1'écart, flétrissure, etc.) n'étant que le fruit d'un amour propre blessé et d'une imagination malade."
Oeuvres, Tome 7, page 28
Il faut d'ailleurs ajouter que même l'attitude de certains camarades minoritaires face aux organes centraux s'est apparentée à celle des mencheviks puisqu'ils ont à plusieurs reprises boycotté ceux-ci (en refusant de participer à leurs réunions ou d'assumer les responsabilités qu'on. voulait leur confier) et qu'ils ont fait une affaire d'Etat de ce que P.I. appelle (p.22) "la mise à l'écart de membres minoritaires de certaines fonctions qu'ils remplissaient, sous prétexte que leurs 'divergences' les mettaient dans l'incapacité de les remplir".
Pour quelles raisons ces camarades ont-ils été conduits à adopter cette démarche ? Là aussi, l'exemple des mencheviks est significatif :
"Sous le nom de 'minorité ' se sont groupés dans le Parti, des éléments hétérogènes qu'unit le désir conscient ou non, de maintenir les rapports de cercle, les formes d'organisation antérieures au Parti.
Certains militants éminents des anciens cercles les plus influents, n'ayant pas 1'habitude des restrictions en matière d'organisation, que l'on doit s ' imposer en raison de la discipline du Parti, sont enclins à confondre machinalement les intérêts généraux du Parti et, leurs intérêts de cercle qui, effectivement, dans la période des cercles, pouvaient coïncider."
Oeuvres, Tome 7, page 474.
Il est de nouveau frappant de constater, lorsqu'on examine la démarche des camarades qui allaient former la "tendance", puis la FECCI, sa similitude avec ce que décrit Lénine.
Fondamentalement, la "tendance" a été formée par des camarades qui se connaissaient depuis très longtemps (avant même la formation du CCI pour la plupart) et qui ont établi entre eux une solidarité l'artificielle basée essentiellement sur leurs vieux liens d'amitié et non sur une homogénéité politique. Nous avons déjà signalé dans notre Revue le manque d'homogénéité de la "tendance" composée de camarades qui, au départ, avaient des positions totalement divergentes tant sur la question de la conscience de classe que sur celles du danger de conseillisme, de la définition du centrisme et de l'importance de notre intervention à l'heure actuelle. Cette hétérogénéité s'est encore manifestée au 6ème congrès du CCI entre ceux qui voulaient quitter l'organisation et ceux qui voulaient y rester. Elle se révèle de nouveau dans P.I. si on compare le ton hystérique de l'article "Le déclin du CCI" et celui, incomparablement plus fraternel, intitulé "Critique de l'intervention du CCI". La seule chose qui cimentait la "tendance", outre et en conséquence de cet esprit de cercle "légué" par le passé des camarades, c'est la difficulté commune à supporter la discipline de l'organisation qui les f a conduits à de multiples manquements organisationnels.
Mais la similitude entre les mencheviks de 1903 et les camarades de la "tendance" ne s'arrête pas là :
"Le gros de 1 'opposition a été formé principalement par les éléments intellectuels de notre Parti. Comparés aux prolétaires, les intellectuels sont toujours plus individualistes, ne fût-ce qu'en raison de leurs conditions essentielles d'existence et de travail, qui les empêchent de se grouper largement spontanément, d'acquérir directement cette éducation qu'assure un travail en commun organisé.
Aussi est-il plus difficile aux éléments intellectuels de s 'adapter à la discipline de la vie du Parti, et ceux d'entre eux qui ne peuvent y parvenir, lèvent naturellement 1'étendard de la révolte contre les restrictions indispensables qu'exigent 1'organisation, et ils érigent leur anarchisme spontané en principe de lutte, qualifiant à tort cet anarchisme... de revendication en faveur de la 'tolérance', etc."
Oeuvres, Tome 7, page 474-475
Là encore, la ressemblance est frappante : si nous avions voulu faire enrager les camarades de la "tendance", nous aurions appelée celle-ci "la tendance de professeurs, des universitaires et des cadres supérieurs". Il est clair également que la susceptibilité et la vanité sont en général beaucoup plus fortes chez ces "individualités", habituées dans leur vie quotidienne à rencontrer une écoute respectueuse de la part de leurs interlocuteurs, que chez les ouvriers.
Nous pourrions poursuivre la mise en évidence de bien d'autres ressemblances entre la "tendance-fraction" et le courant menchevik de 1903. Nous nous bornerons à en signaler deux autres :
- le sectarisme,
- l'absence de sens des responsabilités face aux exigences de la lutte de classe.
1°) Le sectarisme
En de fréquentes occasions, Lénine a dénoncé le sectarisme des mencheviks qui portaient l'entière responsabilité de la scission alors que pour sa part, il estimait que :
"Les divergences de principe entre 'Vperiod' (le journal bolchevik) et la nouvelle 'Iskra' (menchévique)sont essentiellement celles qui existaient entre l'ancienne 'Iskra' et le 'Robotchéïé Diélo' (les'économistes '). Ces divergences, nous les considérons comme importantes, mais nous ne les considérons pas comme constituant en elles-mêmes un obstacle au travail commun au sein d'un seul parti..,v
Oeuvres, Tome 8, page 127
Le CCI estime également que les divergences politiques qui l'opposaient à la "tendance" notamment sur la conscience de classe et sur le danger de centrisme sont importantes. Si les positions de la "tendance" avaient gagné l'ensemble de l'organisation, cela aurait constitué une menace pour elle. Mais nous avons toujours affirmé que ces divergences sont parfaitement compatibles au sein d'une même organisation et ne devaient pas compromettre un travail commun. Telle n'est pas la conception de la "fraction" qui, à l'image des mencheviks, veut de plus nous faire porter la responsabilité de la séparation organisationnelle. Lorsque le milieu politique prolétarien sérieux prendra connaissance des questions de fond qui, selon la "fraction", interdisent un travail commun, il ne pourra que se demander quelle mouche a piqué ces camarades. De même, que pourront penser les ouvriers qui auront entre leurs mains deux tracts ou deux journaux qui, sur les questions essentielles auxquelles ils se confrontent : la nature de la crise, l'attaque de la bourgeoisie, le rôle de la gauche et des syndicats, la nécessité d'étendre, d'unifier et d'auto organiser leurs luttes, les perspectives de celles-ci, diront la même chose ? Ils ne pourront qu'en conclure que les révolutionnaires (ou certains d'entre eux) sont des gens bien peu sérieux.
Le sectarisme est le corollaire de "l'esprit de, cercle", de l'individualisme, de l'idée que "bougnat est maître chez soi". Tout cela, les camarades de la "tendance" l'avaient appris au sein du CCI au cours des multiples combats que nous avions menés contre le sectarisme qui pèse sur le milieu politique prolétarien actuel.
C'est en particulier pour tenter de masquer leur sectarisme fondamental, parce qu'ils savent bien, eux qui se réclament du "vieux CCI", que les divergences de fond qui les séparent du CCI n'ont jamais motivé pour nous une rupture organisationnelle, qu'ils ont inventé toutes les fables abracadabrantes, tous les mensonges odieux et imbéciles dont ils couvrent aujourd'hui notre organisation.
La "fraction" accuse le CCI de "monolithisme". Rien n'est plus absurde. En réalité, c'est la "fraction" qui est "monolithique", comme toutes les sectes : à partir du moment où on estime que n'importe quelle divergence surgissant dans une organisation ne peut aboutir qu'à la scission, c'est qu'on (refuse l'existence de telles divergences au sein de cette organisation : c'est le propre du monolithisme. D'ailleurs ce monolithisme se manifeste déjà dans P.I. : aucun des articles n'est signé comme s'il ne pouvait exister la moindre nuance en son sein (alors que nous savons que c'est tout le contraire qui est vrai).
2°) L'absence du sens des responsabilités face aux exigences de la lutte de classe.
Les mencheviks avaient entrepris tout leur travail scissionniste à la veille de la première révolution en Russie, le PQSDR se trouvait on ne peut plus mal armé pour l'affronter. Lénine n'a cessé de dénoncer le tort que portaient les agissements irresponsables des mencheviks à l'impact des idées révolutionnaires et à la confiance que les ouvriers pouvaient accorder au Parti. C'est également à ce moment crucial pour la lutte de classe que les camarades de la "tendance" choisissent de disperser les forces révolutionnaires. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent dans P.I. sur "l'importance déterminante de l'intervention des révolutionnaires à l'heure actuelle", leurs actes démentent leurs paroles. Ce qu'ils prouvent en réalité c'est que leurs intérêts de cercle et de secte priment sur les intérêts généraux de la classe ouvrière. Face aux exigences que la période actuelle impose aux révolutionnaires, ils font preuve d'une irresponsabilité bien plus grande encore que celle que le CCI a depuis longtemps dénoncée chez les autres groupes.
LES PERSPECTIVES DE LA "FRACTION"
Marx constate dans "Le 18 brumaire" que si l'histoire se répète, c'est la première fois sous forme de tragédie et la seconde fois sous forme de farce. Les événements de 1903 dans le POSDR étaient une tragédie dans le mouvement ouvrier. Les aventures de la "tendance" ressemblent beaucoup plus à une farce, ne serait-ce que par le fait de l'extrême faiblesse numérique de cette formation. On retrouve tant de ressemblances entre la démarche de la "tendance" et celle des mencheviks qu'on ne peut s'empêcher de faire le constat qu'il s'agit là d'un danger permanent au sein du mouvement ouvrier. Mais en même temps il y a bien peu de chances pour que la "fraction" joue un jour un rôle comparable à celui des mencheviks : se transformer en dernier rempart de la bourgeoisie au cours de la révolution, s'allier avec les armées blanches. Il est très probable qu'au moment de la révolution, la "fraction" aura disparu, que ses militants se seront depuis longtemps dispersés dans la démoralisation ou que, comprenant leurs erreurs, certains d'entre eux, auront repris une activité révolutionnaire responsable (comme ce fut le cas de Trotski qui, en 1903, s'était trouvé avec les mencheviks). Mais en attendant, la "fraction" joue un rôle essentiellement néfaste face à la classe.
D'une part, par son sectarisme, elle tend à renforcer la méfiance très forte qui existe aujourd'hui au sein de la classe ouvrière, y compris parmi les ouvriers les plus combatifs, à l'égard des organisations révolutionnaires.
D'autre part, en prétendant défendre la plateforme du CCI, elle porte un tort important aux idées de cette plateforme. Une défense sectaire et irresponsable des principes révolutionnaires clairs et cohérents est bien pire encore qu'une défense conséquente de positions révolutionnaires moins élaborées ou moins cohérentes. Elle ne fait que détourner de cette clarté et de cette cohérence les éléments en recherche qui sont dégoûtés par le comportement irresponsable de ceux qui prétendent s'en faire les porte-parole. D'ailleurs, l'expérience montre, qu'à terme, cette défense irresponsable se répercute nécessairement sur les principes eux-mêmes comme ce fut le cas des mencheviks qui ont progressivement tourné le dos au programme qu'ils avaient adopté en 1903 avant leur scission d'avec les bolcheviks.
Enfin, la comparaison que la FECCI établit entre elle et la fraction de gauche du Parti Communiste d'Italie ne peut que discréditer les énormes apports de cet organisme dans le mouvement ouvrier. Jusqu'à la seconde guerre mondiale, "Bilan, "Prometeo", "Communisme" sont un exemple de fermeté sur les principes révolutionnaires face aux reniements successifs des autres organisations prolétariennes emportées par la chape de la contre-révolution. Ils sont ainsi un exemple de sérieux, de sens des responsabilités au niveau le plus élevé. C'est sur ces mêmes bases, et en suivant son exemple, que le CCI a en permanence essayé de développer son activité militante. La "fraction" avait lutté jusqu'au bout au sein du Parti communiste dégénérescent pour tenter de le redresser. Elle ne l'avait pas quitté mais en avait été exclue comme la grande majorité des fractions révolutionnaires de 1'histoire. Elle a, en particulier, élaboré un apport inestimable sur la question de la lutte et du rôle d'une fraction communiste. Ce sont justement ces enseignements fondamentaux que la FECCI jette par la fenêtre en quittant le CCI et en usurpant le terme de "fraction", en créant cette nouveauté historique de "fraction (ce qui veut dire "partie de quelque chose") externe" sans jamais avoir développé un travail de fraction interne ou même de véritable tendance. Nous avons souvent écrit dans notre Revue que la caricature de Parti que constituait le PCI-Programme ridiculisait l'idée même de parti. La caricature de fraction que représente la FECCI ridiculise l'idée même de fraction.
Du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, la FECCI n'a aucune raison d'exister. Bien au contraire. A propos du "Communist Bulletin Group" qui avait quitté le CCI en 81 en gardant une partie de ses fonds, nous écrivions :
"Que représente le CBG face au prolétariat ? Une version provinciale de la plateforme du CCI avec la cohérence en moins et le vol en plus." (Revue n°36).
Pour la FECCI, le vol n'y est pas, mais le sectarisme et l'irresponsabilité font bon poids. Comme à l'égard du CBG, nous pouvons conclure à propos de la FECCI : "voilà un autre groupe dont l'existence est parasitaire" (Ibid.).
La meilleure chose que nous puissions souhaiter pour la classe ouvrière, de mené d'ailleurs que pour les camarades qui la composent, c'est la disparition la plus rapide possible de la FECCI.
F.M.
[1] [121] La Revue Internationale n°44, dans l'article consacré au 6ème Congrès du CCI, rend compte du départ de ces camarades et de leur constitution en "Fraction". Le lecteur pourra s'y reporter, ainsi qu'aux articles publiés dans les Revues n°40 à 43 reflétant l'évolution du débat au sein du CCI.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 46 - 3e trimestre 1986
- 2584 reads
Grèves massives en Norvège, en Finlande, en Belgique : de la dispersion, vers l'unification
- 3538 reads
Les luttes ouvrières qui, ce printemps 1986, en Scandinavie et surtout en Belgique, ont pris un caractère massif, au point de quasiment paralyser l'activité de ces pays, annoncent l'ouverture d'une nouvelle période de la lutte de classe. Une période où se conjugueront de plus en plus, d'une part la contrainte pour la bourgeoisie de se livrer à des attaques de plus en plus frontales et massives, et d'autre part, au niveau de la conscience ouvrière, les concrétisations des leçons apprises au cours des combats, nombreux mais dispersés, qui ont caractérisé, surtout en Europe occidentale, la période précédente.
Plus s'avance la décomposition d'une société décadente, et plus la vérité, la réalité sociale quotidienne, devient contradictoire avec l'idéologie dominante. L'idéologie qui défend et justifie l'existence d'un ordre social et économique qui pourrit sur pied, provoquant les plus grandes famines de l'histoire de l'humanité, la menace d'auto-destruction de l'espèce, la barbarie et le manque d'avenir partout, avec l'étreinte du plus insidieux totalitarisme politique, une telle idéologie ne peut plus que reposer sur le mensonge, car la vérité est sa négation.
Les luttes ouvrières sont les porteuses de cette vérité simple qui dit que le mode de production -capitaliste' doit et peut être détruit si l'humanité veut survivre et poursuivre son développement.
C'est pourquoi, avec une minutie scientifiquement planifiée, la bourgeoisie internationale organise le silence sur les luttes ouvrières, en particulier sur le plan international.
Combien de prolétaires dans le monde savent-ils que dans la mythique Scandinavie, cette "patrie" du "socialisme à l'occidentale", la classe ouvrière connaît une attaque économique sans précédent, et que, en réponse, les prolétaires du Danemark (printemps 85), de Suède (hiver 85-86), puis ceux de Finlande et de Norvège (printemps 86) viennent de déployer leurs combats les plus importants depuis le 2ème guerre mondiale ? Combien de travailleurs savent que la Belgique connaît aux mois d'avril et mai 86 le développement d'une effervescence des luttes ouvrières qui a, à plusieurs reprises, pratiquement bloqué la vie économique du pays ? Que dans ce petit pays au coeur de l'Europe la plus industrialisée, au milieu de la plus grande concentration ouvrière du monde, les travailleurs ont multiplié les grèves spontanées, éclatant hors des consignes syndicales, pour répondre à l'accélération et aux menaces de nouvelles attaques économiques du gouvernement ; qu'ils ont commencé à chercher l'unification des luttes en agissant collectivement, sans attendre les syndicats, en envoyant des délégations massives - tels les 300 mineurs du Limbourg venus aux assemblées de travailleurs des services publics à Bruxelles - pour proposer l'unification des combats.
Les journaux, les médias n'en disent mot en dehors des pays concernés ; ils déversent à la place, à grands flots, les nauséabondes campagnes idéologiques orchestrées internationalement sur "l'anti-terrorisme", sur le besoin de "renforcement de l'ordre" (appelé pour la circonstance "sécurité") ou sur l'impuissance des pauvres êtres humains devant la "fatalité de la crise économique". Sur la lutte ouvrière internationale, c'est le silence ([1] [122]) organisé. Tout au plus quelque entrefilet ici et là, surtout pour annoncer la fin de telle ou telle grève. La bourgeoisie a peur de la réalité, et ses fanfaronnades de matamore reaganien traduisent plus une sourde et croissante inquiétude que la sérénité d'une classe sûre de son pouvoir et de son avenir. Et pour cause.
DES LUTTES QUI MONTRENT LE CHEMIN
La caractéristique majeure des luttes de ce printemps 1986, c'est leur caractère massif : en Norvège, il y a eu jusqu'à 120 000 travailleurs touchés par les grèves, y compris les lock-outés (10 % de la population active) ; en Finlande, ce sont 250 000 grévistes qui, ensemble, ont affronté l'Etat ; en Belgique, c'est aussi par centaines de milliers qu'il faut compter le nombre de travailleurs qui, au moment où nous écrivons, ont déjà pris part aux luttes contre l'accélération de l'attaque économique du capital.
Il ne s'agit plus ici d'une série de luttes isolées, éparpillées, enfermées dans des usines en faillite. Ce sont des mobilisations massives qui parviennent à paralyser en grande partie l'économie. Des plateformes pétrolières de la Mer du Nord en Norvège, aux mines du Limbourg, des postes finlandaises aux transports ferroviaires et urbains en Belgique, le prolétariat vient de déployer en quelques semaines, dans des pays hautement industrialisés, une puissance et une force qui annoncent que les politiques bourgeoises de dispersion des luttes commencent à atteindre les limites de leur efficacité. La situation en Belgique est plus particulièrement significative pour dégager les caractéristiques de la période qui s'ouvre. D'une part parce qu'il s'agit d'un des pays industrialisés qui a été depuis longtemps parmi les plus frappés par la crise, d'autre part du fait de ses caractéristiques historiques. Le capitalisme belge, situé entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, est un des plus anciens du monde. Le prolétariat y est un des plus expérimentés et possède une longue tradition de luttes contre une bourgeoisie qui dispose d'un vieil et très expérimenté arsenal d'encadrement politique et syndical des ouvriers. Aussi les luttes ouvrières actuelles y possèdent une puissance d'exemple particulièrement importante -plus que celles de Norvège ou Finlande- quant aux moyens de la lutte de classe. Et cela d'autant plus que c'est en Belgique, a l'automne de" 1983, que les grèves massives des travailleurs du secteur public ont marqué la fin du recul qui suivit la défaite en Pologne et le début d'une nouvelle reprise de luttes ouvrières au niveau international.
Mais que ce soit par les conditions objectives économiques qui ont fait surgir ces luttes (obligation pour la bourgeoisie de porter des attaques de plus en plus massives et frontales), ou que ce soit par les conditions subjectives qui les ont caractérisées surtout en Belgique (maturation de la conscience ouvrière, tendance à l'unification), elles traduisent le début d'une nouvelle accélération de la lutte de classes : l'ouverture d'une nouvelle phase du combat historique du prolétariat mondial pour son émancipation.
I - LES CONDITIONS OBJECTIVES : LA BOURGEOISIE PEUT DE MOINS EN MOINS DISPERSER SON ATTAQUE ECONOMIQUE
Dans le numéro précédent de la Revue Internationale, nous avons montré comment, au cours de l'année 1985 la bourgeoisie des pays industrialisés du bloc occidental avait mené une politique consciente de dispersion de son attaque économique (licenciements planifies dans le temps, attaques secteur par secteur, etc.) afin d'empêcher des réactions frontales, unifiées, de la part des travailleurs.
Nous insistions sur le fait que la bourgeoisie tirait les leçons d'expériences telles celle de la Pologne en 1980 ou des combats qui ont marqué l'ouverture de ce que nous appelons "la troisième vague internationale de luttes" depuis 1968 (après celles de 1968-74 et de 1978-80), à savoir les grèves du secteur public en Belgique et Hollande à l'automne 1983. Mais nous soulignions aussi que cette politique menée en étroite coopération par gouvernements, partis politiques et syndicats, reposait en grande partie sur la marge de manoeuvre économique qu'a donnée à l'Europe la mini-reprise américaine.
Or, cette "marge se réduit aujourd'hui de façon accélérée sous la pression du ralentissement de l'économie américaine, et sous la pression de l'affaiblissement de la compétitivité des produits d'exportation européens face aux produits nord-américains (voir la page 6 : "Où en est la crise économique ?") La "nouvelle politique" américaine dont la forte baisse du dollar n'est que l'aspect le plus spectaculaire, n'est pas un cadeau pour l'Europe, mais une déclaration de guerre commerciale à l'échelle de la planète. Quelles que soient les économies que peuvent faire les pays européens sur la "facture pétrolière" dans l'immédiat, ils sont plus que jamais contraints de baisser leurs dépenses et leurs coûts de production, ce qui veut dire en premier lieu s'attaquer plus violemment aux revenus des exploités.
Qui plus est, cette attaque implique -surtout en Europe- des réductions drastiques de dépenses "sociales" de l'Etat (en Europe occidentale, surtout dans les pays du Nord, les dépenses des administrations publiques équivalent à plus de la moitié du produit national !) Cela veut dire prendre des mesures qui touchent immédiatement et simultanément l'ensemble des prolétaires :
- les chômeurs car leur seule source de revenus, quand ils en ont, ce sont les allocations gouvernementales ;
- l'ensemble des salariés car c'est la part du salaire dite "sociale" qui se trouve attaquée (sécurité sociale, allocations familiales, éducation, etc.)
- les employés de l'Etat parce que ce sont des milliers d'emplois qui sont supprimés.
C'est cette réalité qui est la toile de fond des agressions économiques globales qui ont provoqué les luttes en Scandinavie et en Belgique. Les faiblesses économiques spécifiques de ces pays n'en font pas des "cas exceptionnels" ; ces faiblesses expliquent seulement pourquoi les gouvernements y ont été parmi les premiers en Europe à porter de telles attaques ([2] [123]). L'impossibilité de continuer à organiser la dispersion des attaques économiques, le recours à des attaques de plus en plus frontales et massives contre la classe ouvrière, tel est l'avenir pour l'ensemble des gouvernements européens.
II - LES CONDITIONS SUBJECTIVES : LA MATURATION DE LA CONSCIENCE DE CLASSE
De même que les politiques gouvernementales qui ont déclenché les luttes de ce printemps sont une indication de l'avenir pour tous les gouvernements capitalistes, de même les pas en avant réalisés par le prolétariat dans ces luttes, en particulier en Belgique, montrent le chemin au reste du prolétariat mondial.
La volonté de se battre
L'ensemble de ces luttes confirme la tendance au développement d'une simultanéité internationale des combats de classe.
La Suède, la Grande-Bretagne, l'Espagne, pour ne parler que de l'Europe, connaissent au même moment un développement des luttes ouvrières. Et l'on a pu voir des travailleurs des plateformes pétrolières britanniques se joindre à la grève de leurs collègues norvégiens ([3] [124]). C'est internationalement qu'existe un ras-le-bol profond, non résigné, une combativité qui dément quotidiennement les propagandes officielles d'après lesquelles les ouvriers auraient enfin - avec la crise -compris que leurs intérêts sont les mêmes que ceux de "leur" capital national.
Dans la pratique, ces luttes sont la négation vivante des lots économiques basées sur le profit marchand du capital, où l'on répond au développement de la misère par plus de misère (baisse des salaires, des allocations ; chômage, etc.) et par la destruction des moyens de combattre la misère (fermetures d'usines, destruction de stocks d'invendus, production d'armement et frais militaires, etc.), toujours aux dépens des exploités.
Cette volonté de se battre montre que pour les ouvriers, il est de plus en plus clair que la question de leurs moyens de subsistance est posée en termes simples : ou la vie du capital ou la leur. Il n'y a pas de conciliation possible entre les intérêts du capital décadent et ceux des exploités. C'est d'abord en cela que les luttes de ce printemps annoncent l'avenir en montrant le chemin.
Les moyens de se battre
Ne pas attendre les consignes syndicales pour faire démarrer les luttes
Une des principales armes dont dispose l'Etat à travers son appareil syndical contre les luttes ouvrières, c'est le pouvoir de décider du moment du combat. La force de la classe ouvrière repose en premier lieu sur son unité, sa capacité à frapper ensemble. Les syndicats, en décidant de faire partir des luttes de façon dispersée, échelonnée dans le temps, évitant la simultanéité source d'unité, en empêchant que le combat n'éclate au moment où la colère est la plus généralisée ont un grand pouvoir de division et d'affaiblissement du mouvement. Pouvoir dont ils hésitent rarement à se servir.
En Belgique les syndicats n'ont cessé de tenter de le faire. C'est ainsi que, parmi tant d'autres exemples, ils ont appelé les travailleurs des services publics à faire grève le 6 mai ; les enseignants le 7 mai ; les ouvriers des chantiers navals trois jours après, etc. Systématiquement, minutieusement, ils tentent d'organiser...la dispersion du mouvement. La réponse des ouvriers a été -comme c'est de plus en plus le cas dans tous les pays- les grèves "spontanées", c'est-à-dire en dehors des consignes syndicales.
C'est ainsi que la grève des 16 000 mineurs du Limbourg, qui marque le début de toute la période de grèves qui allait suivre, éclata à la mi-avril, spontanément, contre l'avis des syndicats qui considéraient toute grève "prématurée". Il en est de même de la plupart des mouvements qui depuis lors, dans les chemins de fer, les postes, les télécommunications, l'enseignement, les transports urbains, les ministères, les hôpitaux, les chantiers navals, certaines parties du secteur privé, etc., ont démarré ou se sont arrêtées pour redémarrer peu de temps après, spontanément, en dehors - parfois contre- les consignes syndicales.
A partir du mois de mai, les syndicats ont organisé, sous la pression ouvrière, des journées de "grève générale" (le 6, le 16 puis le 21 mai) en vue de reprendre un contrôle plus efficace sur les événements. Mais ces journées pour importante qu'ait été la mobilisation qu'elles ont connue, restent comme des moments particuliers au milieu d'une effervescence générale qui cherche souvent de façon maladroite et heurtée à gagner la maîtrise d'elle-même. La bourgeoisie belge ne se trompe pas sur les risques que de telles formes de l'action ouvrière impliquent pour son pouvoir. Et, par la bouche d'un responsable syndical de la FGTB (J.C. Wardermeeren) elle déclarait le 23 mai au journal "Le Soir" "Le gouvernement pourra imposer sa volonté par la force jusqu'au moment où le ras-le-bol provoquera des explosions qui ne seront plus contrôlées par le mouvement syndical. Et qui seront de plus en plus difficiles à rattraper par la concertation. Voyez toute la différence entre des négociations précises, menées sur un cahier de revendications, et celles qui suivent des actions spontanées. Et calculez les risques." (Souligné par nous) Les syndicats connaissent mieux que quiconque "les risques" de laisser la force de vie prolétarienne échapper au carcan syndicaliste professionnel de l'encadrement et du sabotage, ils sont maîtres dans l'art de "prendre le train en marche". Face aux explosions spontanées, ils savent parfaitement "radicaliser" autant que nécessaire leur langage, pour reprendre le plus rapidement possible la direction et l'organisation du mouvement. Ils sont puissamment aidés en cela par le "syndicalisme de base" dont les critiques aux centrales constituent un dernier filet pour retenir les prolétaires dans la logique syndicaliste.
Le prolétariat en Belgique n'est pas encore parvenu à se débarrasser suffisamment de toutes les entraves syndicalistes (nous y reviendrons plus loin). Mais la "dynamique des actions qu'il a entreprises s'oriente clairement dans le bon sens.
La nécessité et la possibilité de développer la capacité à engager le combat sans attendre le feu vert des centrales syndicales, tel est un premier enseignement sur les moyens de se battre que confirment les luttes en Belgique. Nous disons "confirme" parce que la tendance à la multiplication des grèves spontanées n'a cessé de se confirmer, depuis 3 ans, depuis le début de la troisième vague.
Rechercher l'extension et l'unité
Mais probablement les enseignements principaux qui, resteront des luttes de ce printemps en Belgique, se situent au niveau des moyens de construire pratiquement l'unité des prolétaires. Les luttes en Belgique montrent clairement :
1°) que cette unité ne peut se faire qu'à travers la lutte. Le capital divise les ouvriers, son appareil politique et syndical organise la dispersion des forces ouvrières. L'unité, les prolétaires ne peuvent la bâtir qu'en combattant ce qui les divise, en combattant le capital et ceux qui le représentent;
2°) que cette unité ne tombe pas du ciel, ni des syndicats qui en sont les principaux saboteurs. Elle doit être bâtie pratiquement, volontairement, consciemment La recherche de cette unité doit constituer un objectif permanent. L'envoi de délégations massives pour rechercher la solidarité active, celle de l'extension et l'unification des luttes brisant les divisions catégorielles, linguistiques ou professionnelles, comme l'ont fait les mineurs du Limbourg qui ont, des le début de la lutte envoyé des délégations massives, d'une à plusieurs centaines de grévistes vers d'autres secteurs de la classe : la grande usine de Ford-Genk (10 000 ouvriers), vers les travailleurs des Postes, vers les cheminots de la SNCB, vers les lycéens en tant que futurs chômeurs pour les appeler à la grève ; comme l'ont fait les ouvriers des chantiers navals de Boel , près d'Anvers , qui ont envoyé des délégations vers les mineurs en se joignant à la lutte. Après l'explosion de la lutte elle-même, c'est le premier pas pratique pour répondre à la nécessité de la constitution des prolétaires en classe, en force unie capable d'agir sur le cours de la société ;
3°) que "la rue", les manifestations, les meetings, jouent un rôle essentiel dans la constitution de l'unité de classe. Il ne suffit pas que les luttes démarrent ; il ne suffit pas que par le moyen de délégations massives, les secteurs en lutte se rencontrent, il faut aussi que l'ensemble des forces au combat se reconnaissent dans l'action commune, qu'elles puissent se compter, mesurer et sentir l'ampleur de leur puissance. En Belgique, dans la rue, les chômeurs ont rencontré leur classe ; dans la rue, les mineurs et les enseignants, les sidérurgistes et les conducteurs de transports publics ont cherché à agir comme ce qu'ils sont, comme une seule classe. Dans la rue se rencontrent les énergies qui naissent dans les combats de mille lieux de travail. Si la dynamique de fond du mouvement est suffisante, si elle parvient à neutraliser les forces de division et de dispersion des appareils syndicaux et politiques de la bourgeoisie, ces énergies reviennent sur les lieux de travail, décuplées. ([4] [125])
A travers la recherche de l'unité, les luttes de Belgique tirent les leçons des défaites passées, de celle des mineurs britanniques en 84-85, comme de toutes celles, petites ou grandes, mortes dans l'isolement. Il existe une mémoire collective dans les classes qui ont une mission historique. Il y a un progrès de la conscience collective, une maturation, tantôt explicite tantôt souterraine, qui fait le lien entre les principaux moments d'action collective de la classe. "Ne pas se faire avoir comme en 83 !" Par cette phrase, si souvent entendue dans les discussions entre grévistes en Belgique (référence à l'isolement des grèves du service public en septembre 83), était posé explicitement le problème de la recherche de l'extension et de l'unité comme une priorité qu'il fallait assumer consciemment si on voulait aller plus loin que par le passé.
C'est ainsi que progresse l'expérience, la conscience collective de la classe révolutionnaire. Les réponses pratiques apportées par les prolétaires de Belgique concernent les problèmes de toute la classe ouvrière mondiale ; leurs luttes actuelles auront des conséquences aussi en dehors de Belgique. Car ici encore, elles montrent l'avenir.
Rechercher l'auto-organisation : la lutte pour la maîtrise de sa propre force.
En déclenchant des grèves, en unifiant les luttes, en prenant la rue ensemble, le prolétariat crée une force gigantesque, redoutable. Mais à quoi peut-elle lui servir s'il n'en a pas la maîtrise ? Sans un minimum de maîtrise sur elle-même, sur le cours des événements, cette force ne tarde pas à s'effriter, d'abord et avant tout sous l'impact du torpillage systématique et démoralisateur des manoeuvres syndicales. Si les prolétaires en Belgique ont pu déployer une telle force, ce n'est pas grâce aux syndicats mais malgré ou contre eux. Ce n'est pas la une interprétation exagérée des faits. Le principal responsable des forces d'encadrement politique et syndical en Belgique le leader du Parti Socialiste (qui contrôle le plus grand syndicat du pays, la FGTB) le reconnaît le 30 mai clairement, dans un interview au journal "Le Soir" ""le mouvement part des gens et non des appareils syndicaux. Chez nous, les gens veulent la peau de Martens. Ceux qui croient que les organisations syndicales ont prémédité des plans ou ceux qui croient que les partis contrôlent les actions commettent une erreur monumentale. En beaucoup d'en droits, les travailleurs ne suivent pas les mots d'ordre syndicaux. Ils ne veulent pas reprendre le travail." C'est clair.
Cependant, s'il est vrai qu'"en beaucoup d'endroits les travailleurs (en lutte) ne suivent pas les mots d'ordre syndicaux", il n'en a pas découlé pour autant, du moins jusqu'au moment où nous écrivons, la création par les ouvriers d'une forme d'organisation centralisée regroupant des délégués de comités de grève élus par les assemblées, capable de donner des orientations pour l'ensemble des forces en lutte, capable de permettre au mouvement de devenir effectivement maître de sa force.
Les travailleurs en Belgique ne sont pas encore parvenus à ce stade de la lutte. Mais ils ont avancé dans ce sens. Ils ont développé leur capacité à déjouer les manoeuvres démobilisatrices des syndicats : par la capacité à démarrer les luttes sans attendre les consignes syndicales, ils ont su limiter les dégâts que provoque l'effort permanent des syndicats pour disperser les luttes dans le temps ; en prenant en main eux-mêmes l'organisation de l'extension par des délégations sans se reposer, sur les structures syndicales, ils limitent l'effet de l'action des syndicats pour disperser les luttes dans l'espace. En faisant des assemblées de vrais centres de décision de la lutte, ils déjouent les manoeuvres des syndicats pour ramener les ouvriers au travail ([5] [126]).
Et c'est là encore une source de riches enseignements pour les luttes à venir du prolétariat mondial.
L'AFFRONTEMENT AVEC L'ETAT, C'EST AUSSI L'AFFRONTEMENT AVEC LES SYNDICATS.
Les travailleurs belges affrontent une bourgeoisie qui s'est longuement préparée à cette attaque, qui se présente en rangs de bataille, avec ses forces de gauche, les forces "ouvrières" de la bourgeoisie, non pas au gouvernement (où l'obligation de prendre de violentes mesures anti-ouvrières les dévoilerait dangereusement) mais dans l'opposition, au milieu des ouvriers en lutte, pour mieux saboter de l'intérieur. Les "socialistes" n'ont aucune intention pour le moment d'abandonner leurs responsabilités étatiques de policiers dans les rangs ouvriers. Cela se voit clairement dans leur pratique dans la rue :
"L'imposant cortège a défilé dans le calme et "là sérénité" écrit un article du "Soir" racontant, le 23 mai, une manifestation de 10 000 personnes à Charleroi (les syndicats s'attendaient à 5000 personnes seulement). "Parmi les manifestants proches des milieux socialistes, on s'inquiétait pourtant de voir la 'tiédeur' des discours ou l'absence des chefs de 1'état-major du PS. Beaucoup voyaient là le signe d'un 'renoncement au pouvoir'."
La bourgeoisie a besoin d'une gauche dans l'opposition et continuera de s'en donner les moyens. La politique de dispersion des luttes -telle que nous l'analysions dans le numéro précédent de cette revue- repose d'une part sur l'action concertée de l'Etat et du patronat privé qui dispersent les attaques, d'autre part sur l'action de division des forces politiques et syndicales de la gauche du capital. L'impossibilité croissante dans laquelle se trouvent Etat et patronat de continuer à disperser l'attaque économique conduit à ce que ce soit de plus en plus essentiellement sur l'action des syndicats et partis de gauche que reposera l'action de la bourgeoisie pour empêcher l'unification et le renforcement de la résistance prolétarienne.
Les ouvriers belges ont trouvé devant eux, tout au long de leur lutte, dans leurs propres rangs, le syndicalisme, avec ses trois volets : le "modéré" syndicat chrétien), le "combatif" (socialistes), celui "de base" (les maoïstes -en particulier dans les mines du Limbourg).
En cela aussi les luttes en Belgique annoncent l'avenir.
Les ouvriers de Belgique comme ceux du monde entier ont encore un long processus de combat à mener pour se débarrasser véritablement des entraves syndicalistes et avoir une entière maîtrise de leur force. Mais cette maîtrise sera le résultat des combats actuels.
Le mouvement de classe en Belgique est un mouvement politique, non parce qu'il nierait ses objectifs économiques mais parce qu'il assume les aspects politiques de ce combat : ce n'est pas contre le propriétaire d'une petite entreprise de province que combattent les travailleurs ; c'est contre l'Etat et à traders lui, contre toute la classe dominante. C'est la politique économique de la classe exploiteuse que combat le prolétariat. Le mouvement est politique parce qu'il affronte l'Etat sous toutes ses formes : le gouvernement, la police dans les nombreux affrontements de rue et enfin les syndicats.
"La lutte économique est l'élément qui conduit perpétuellement d'un noeud politique à l'autre, la lutte politique est la fécondation périodique pour la lutte économique. Cause et effet permutent à tous instants de place, et ainsi l'élément économique et l'élément politique, dans la période de grèves en masse, bien loin de se distinguer nettement ou même de s'exclure comme le veut le pédantisme schématique, ne constituent, au contraire, que deux faces entremêlées de la lutte de classe prolétarienne" (Rosa Luxemburg "Grève de masses, parti et syndicats", chap. 4)
C'est là un trait des luttes prolétariennes particulièrement renforcé dans le capitalisme décadent où la classe ouvrière doit affronter un capitalisme étatisé à l'extrême.
L'Etat belge a entrepris une attaque particulièrement forte sur la classe ouvrière pendant ces dernières années. Il a imposé des sacrifices économiques tout en organisant un gigantesque renforcement de la répression sous prétexte d"'anti-terrorisme". La bourgeoisie a suivi de près le déroulement de cette attaque : certains journaux parlaient même de "test belge" ; comment réagirait la classe ouvrière ? Celle-ci vient de leur répondre et, ce faisant, elle a indiqué la voie au reste de ses frères de classe.
Au moment où nous terminons cet article la vague de luttes en Belgique semble encore loin d'être épuisée. Mais dès à présent, et quel que soit le développement ultérieur des événements, on peut affirmer que les combats de classe qui secouent ce pays depuis plusieurs semaines sont les plus importants en Europe depuis la Pologne 80.
Leur signification est cruciale. Ils confirment, après les luttes ouvrières qui viennent d'ébranler la Norvège et la Finlande, qu'en Europe occidentale et dans le monde, la lutte de classe entre dans une nouvelle phase.
R.V., le 30 mai 86.
[1] [127] Revue Internationale n°46, 2ème trim.86, "La lutte ouvrière en 1985 : bilan et perspectives".
[2] [128] Le capital norvégien, qui tire une grande part de ses profits de l'exportation du pétrole, a violemment subi les conséquences de la surproduction et de la chute des cours mondiaux de l'or noir (chute de 70 % de ses revenus pétroliers). La bourgeoisie n'a pas tardé à répercuter ces pertes à travers une attaque sans précédent sur la classe ouvrière. Quant à l'économie belge (certainement une des plus sensibles à la conjoncture économique internationale puisqu'elle importe de l'étranger 70 % de ce qu'elle consomme et exporte 70 % de ce qu'elle produit !), c'est une des plus frappées par la crise mondiale, et cela depuis le début des années 80 : les secteurs industriels qui avaient fait la force de la Belgique (sidérurgie, textile, charbon) sont parmi les plus frappés par la surproduction mondiale ; le taux de chômage (14 %) est un des plus élevés d'Europe ; le déficit des Administrations publiques atteint en 1985 10 % du PNB, taux qui n'est dépassé en Europe que par l'Italie (13,4%), l'Irlande(12,3 %) et la Grèce (11,6 %). Le capital belge est aussi un des plus endettés internationalement, puisque sa dette équivaut à 100 % du PNB annuel ! Le gouvernement Martens s'est fait voter par 1'Assemblée des "Pouvoirs spéciaux" pour décréter un nouveau plan d'austérité draconien, afin de mieux rentabiliser l'exploitation de la force de travail : licenciements massifs, en particulier dans la Fonction publique, les mines, les chantiers navals ; réduction drastique de toutes les allocations sociales, en particulier suppression de 1'allocation chômage pour les moins de 21 ans, etc.
[3] [129] La bourgeoisie suédoise, certainement consciente du danger de contagion, a appliqué au niveau national un black-out quasi total sur les informations concernant les grèves en Norvège et en Finlande, pays limitrophes. Lorsque le besoin s'en fait ressentir, les très "modernes" gouvernements démocratiques européens savent se comporter comme n'importe quel Duvalier.
Se donner les moyens d'informer internationalement le reste du prolétariat mondial est un objectif que les prochains mouvements de masses devront se fixer dès les premiers moments.
[4] [130] Les syndicats savent ce qu'ils font lorsqu'ils organisent dans chaque manifestation -avec une minutie et des moyens matériels dignes d'une meilleure cause- un quadrillage serré séparant les manifestants par paquets (par usine, ville, région, secteur, organisation syndicale, tout et n'importe quoi qui permette de diviser en catégories).
[5] [131] C'est l'assemblée de cheminots de Charleroi qui le soir du 22 mai fut capable de dire non aux appels du syndicat chrétien à l'arrêt de la grève ; non à la proposition de la FGTB d'organiser un vote car, d'après elle le "lâchage" du compère syndical était un terrible affaiblissement pour le mouvement. Quelques jours après, à La Louviere, près de Charleroi, un local du syndicat chrétien subit les dégâts de la colère d'une manifestation ouvrière qui passait par là. Ce ne fut pas le seul cas d'affrontement brutal entre ouvriers et forces syndicales en Belgique.
Géographique:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [1]
Où en est la crise économique ? : L’Europe en première ligne.
- 7979 reads
La bourgeoisie n'a pas de solution à la crise de son système et ses remèdes ne sont que des palliatifs provisoires qui répercutent les effets de la crise à un niveau toujours plus grave et plus dramatique. La fin de la "reprise" américaine implique une nouvelle plongée dans la récession de l'économie mondiale. Et l'Europe, moins bien placée que les Etats-Unis et le Japon, va se retrouver en première ligne.
Cette nouvelle aggravation de la crise, conjuguée avec le développement de la vague de lutte de classe commencée en 1983, qui manifeste la combativité intacte du prolétariat, est un facteur déterminant de l'évolution future de la situation internationale, et va tendre à se traduire par une perte des illusions au coeur même des métropoles industrielles, et notamment en Europe, où se trouve la plus forte concentration du prolétariat mondial.
Avec la perspective d'une nouvelle plongée accélérée dans la récession, c'est une rupture qui est en train de s'opérer dans la situation mondiale, où même les pays les plus développés n'arrivent plus à se préserver des effets les plus graves de la crise, et la tragédie du tiers-monde montre sur quel chemin économique ils sont engagés.
Depuis le début des années 80, et sous l'impulsion de Reagan qui donne le ton, la classe dominante ne cesse de proclamer par tous ses médias que la situation de l'économie mondiale s'assainit, que tout va bien, et que les sacrifices imposés sont nécessaires pour sortir définitivement de la crise. L'économie est devenue une star des médias. Un brouhaha permanent de chiffres divers annoncés pêle-mêle jusqu'à saturation, des émissions didactiques programmées régulièrement, des déclarations contradictoires de "responsables" politiques et économiques commentées à satiété, des reportages sur le bon exemple de l'entreprise "modèle" et "performante à l'exportation", etc., tout cela sert à masquer l'essentiel : la crise ne cesse de s'aggraver et la bourgeoisie est impuissante à la juguler. Le capitalisme, en .tant que système économique, est en train de faire faillite, et il entraîne l'humanité dans son effondrement. Les déclarations optimistes actuelles des dirigeants capitalistes sur la durée de la "reprise" de l'économie américaine, sur le déploiement de ses effets bénéfiques à l'Europe, sur les effets positifs de la chute du cours du dollar et du pétrole, tout cela n'est que pur mensonge.
LE MYTHE DE LA REPRISE
Avec une chute de la croissance aux USA à 3 %, après avoir atteint 6,8 % l'année précédente, 1983 marque la fin de la "reprise américaine". Mais sur le plan mondial, cette "reprise" n'a pu que compenser, essentiellement par la création d'un imposant déficit commercial, la chute des marchés du tiers-monde durement secoués par la baisse des matières premières. La courbe des échanges mondiaux est restée désespérément stagnante depuis le début des années, 80, montrant par là que l'économie mondiale n'est en fait pas sortie de la récession depuis la fin des années 70.
L'EUROPE ET LE JAPON SOUS LES COUPS DE LA CRISE
Même les USA qui sont la première puissance économique mondiale n'ont plus les moyens, par les déficits budgétaires et commerciaux qu'ils ont accumulés, de soutenir l'activité de l'économie mondiale. La chute des cours du dollar de 35 % par rapport aux monnaies de ses principaux concurrents européens et japonais va redonner une compétitivité recouvrée aux produits américains qui s'étaient retrouvés pénalisés par le cours élevé du dollar, ce qui avait permis aux Européens et aux Japonais de développer leurs exportations. Cette situation signifie à terme une fermeture du marché américain aux exportations européennes et japonaises, fermeture accentuée par les mesures protectionnistes.
De la même manière, la chute des cours du pétrole (principale matière première dans le commerce mondial) de moitié, en quelques mois, si dans un premier temps, conjuguée à la chute du dollar, elle permit aux pays industriels importateurs de réaliser de substantielles économies, dans un second temps, cela signifie une réduction du marché à l'exportation que constituent les pays producteurs, et notamment de l'OPEP et du COMECON dont c'est la principale exportation.
Cela signifie que 1/5ème des exportations européennes et près de la moitié des exportations japonaises vont être directement touchées par la réduction des marchés consécutive à la chute du dollar et du prix du pétrole.
Ce qui commence c'est un nouveau pas en avant dans la récession ; la chute inéluctable des exportations ne peut se traduire que par un ralentissement de la production et donc des fermetures d'usines, des faillites, des licenciements.
UNE CONCURRENCE EXACERBEE
Dans ces conditions, la concurrence va être acharnée pour préserver "sa" part de marché, et les pays les moins bien lotis vont subir de plein fouet les effets de la crise, et notamment en Europe. Parce qu'ils sont la puissance dominante, les Etats-Unis sont évidemment les plus à même de défendre les intérêts de leur capital national face à leurs rivaux. En imposant la baisse du dollar, en recourant à des mesures protectionnistes pour protéger leur marché intérieur, et en recourant à toute la panoplie de moyens à leur disposition pour placer leurs exportations (subventions, pressions économiques et militaires, etc.), les USA affichent leur ambition : rétablir leur balance commerciale, et cela ne peut se faire qu'aux dépens de leurs rivaux européens et japonais.
La guerre commerciale bat d'ores et déjà son plein, et dans cet exercice difficile, c'est le Japon qui s'est particulièrement illustré ces dernières années tandis que l'Europe est restée en arrière. Dans la perspective d'une concurrence renforcée, c'est l'Europe qui est la plus fragile, c'est elle qui déjà a le moins profité des effets de la "reprise" de 1983, son indice de production est resté quasiment stagnant depuis la fin de 1979.
UNE ATTAOUE RENFORCEE CONTRE LA CLASSE OUVRIERE
La bourgeoisie, tout au moins dans ses cliques dirigeantes, n'est certainement pas dupe de ses bonnes paroles optimistes. Chaque fraction nationale de la classe dominante met en place de manière accélérée de nouveaux programmes d'austérité afin de faire baisser les coûts de la main-d'oeuvre pour rester concurrentiels face à une accélération prévisible du rétrécissement des marchés d'exportation. C'est toujours au nom de la défense de la compétitivité de l'économie nationale que les sacrifices sont exigés de la part de la classe ouvrière. Comme la même chose se passe dans tous les pays, les mêmes sacrifices sont exigés et partout le pouvoir d'achat baisse, si bien que la baisse du niveau de vie de la classe ouvrière, loin d'être une solution à la crise, signifie en fait une nouvelle réduction du marché. C'est la contradiction même que l'économie capitaliste ne peut surmonter. C'est la surproduction qui entraîne la récession.
Le chômage qui atteint déjà des proportions dramatiques ne peut que croître encore plus, comme il n'a cessé de le faire depuis le début des années 80 en Europe. Le chiffre de 10,8 % de la population active au chômage dans la CEE en 1983 va être largement dépassé dans la période qui vient.
Développement du chômage, gel des salaires, augmentation des prélèvements sociaux, depuis quelques mois, les attaques s'accentuent en Europe contre la classe ouvrière, toujours justifiées au nom de la santé de l'économie mondiale. Les résultats ne seront pas différents des programmes d'austérité précédents; ils seront pires pour la classe ouvrière et sans effet sur la crise qui continue de s'approfondir.
Jusqu'à présent, la classe dominante a su utiliser au mieux la stagnation économique pour essayer de répartir son attaque contre le prolétariat, et ainsi permettre la dispersion des luttes, empêcher leur unification. Une nouvelle chute des échanges mondiaux, et donc de la production, va réduire drastiquement la marge de manoeuvre de la bourgeoisie qui va être obligée d'attaquer frontalement la classe ouvrière. L'évolution même de la crise économique détermine les formes que prend l'attaque de la bourgeoisie et donc la dynamique de la lutte de classe.
L'évidence du fait que le capitalisme n'a plus rien à offrir va déchirer l'écran de la propagande capitaliste. Dans la période qui vient, partout dans le monde, le prolétariat va être durement attaqué, poussé à exprimer ses réserves de combativité. Mais c'est en Europe, première et plus ancienne concentration prolétarienne de la planète, que la situation est particulièrement significative. De la capacité du prolétariat le plus ancien et expérimenté du monde à tirer les leçons de la faillite économique du capital, à résister à l'attaque redoublée de la classe dominante, à traduire la perte de confiance dan? L’économie capitaliste en une prise de conscience de la nécessité ce détruire ce système économique et politique dépend l'avenir. La fin des années 80, marquée par l'accélération dramatique de la crise, sera décisive.
28/5/86.
Géographique:
- Europe [133]
Récent et en cours:
- Crise économique [63]
Polémique avec le BIPR : TACHES DES REVOLUTIONNAIRES DANS LES PAYS DE LA PERIPHERIE
- 3869 reads
Battaglia Comunista a publié dans le n° 9 de sa revue théorique Prometeo un "Projet de thèses sur la tactique communiste dans les pays périphériques", qui devrait bientôt paraître dans les versions anglaise et française de la Revue communiste, organe du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR), dans le but de les faire adopter par celui-ci ([1] [134]).
Le CCI ne peut que saluer avec plaisir cette tentative de se donner une ligne d'intervention bien défi nie dans un secteur d'une telle importance, un secteur où l'absence de ligne claire avait conduit Battaglia Comunista (BC) à côtoyer inconsidérément des groupes bourgeois tels que l'UCM iranienne ([2] [135]) ou le RPP indien.
Le projet traite de trois types de problèmes : en premier lieu la réaffirmation des positions générales de BC sur ces pays, positions qui coïncident en général avec les nôtres (fin de la phase de développement du capitalisme, nature contre-révolutionnaire des soi-disant luttes de libération nationale, etc.). En second lieu, une définition de l'approche à avoir envers les groupes qui dans ces pays se déclarent intéressés par une cohérence de classe, Nous nous sommes déjà maintes fois exprimés ([3] [136]) sur l'opportunisme de fond de cette approche et nous ne manquerons pas d'y revenir de manière plus systématique. En troisième lieu -et c'est là l'objet spécifique de ces thèses : quelle tactique doivent appliquer les communistes dans les pays de la périphérie du capitalisme. Notre critique porte donc sur ce point spécifique, non pas tant pour mettre en évidence telle ou telle erreur particulière, mais pour mettre en lumière la tentation opportuniste d'obtenir des succès immédiats qui parcourt et empoisonne les thèses.
En effet, beaucoup de groupes, BC y compris, se sont convertis au travail envers la périphérie du capitalisme après la faillite, au début des années 80, des Conférences internationales de la Gauche communiste ([4] [137]). Considérant que c'était "perdre son temps" que de poursuivre les "éternelles discussions" au sein de la Gauche communiste, ils ont trouvé plus gratifiant et excitant de cultiver en paix leur "propre" petit jardin de contacts avec des groupes qui se vantaient d'avoir des centaines, voire des milliers d'adhérents. A cette époque on a assisté, plutôt qu'à une diffusion des idées communistes dans les pays périphériques, à une pénétration au sein du milieu révolutionnaire des métropoles, des idées de groupes bourgeois de la périphérie, tels l'UCM-KOMALA ([5] [138]).
Mais la classe ouvrière est mondiale, de même que la reprise de ses luttes et cette reprise à la longue fait sentir ses effets même dans les lieux où le prolétariat est dispersé et peu nombreux. Il ne nous vient plus des pays périphériques seulement des versions améliorées des sirènes nationalistes et tiers-mondistes, mais aussi la jeune voix de petits groupes qui, à travers mille difficultés, s'approchent d'une cohérence de classe. Et cette voix est une voix critique, qui demande avant tout aux organisations communistes des métropoles de la clarté, de la clarté sur leurs propres positions et sur les divergences effectives qui les séparent des autres groupes.
Le débat entre groupes révolutionnaires, interrompu depuis des années en Europe, revient aujourd'hui avec force à l'ordre du jour, justement par l'intermédiaire de ces camarades de la périphérie, au nom desquels on avait précipitamment déclaré mort et enterré le débat entre les groupes de la Gauche communiste ( [6] [139]).
Les communistes internationalistes des métropoles, loin de se satisfaire de l'avantage que 1'histoire et l'expérience des prolétariats dont ils sont l'expression leur octroient par rapport aux camarades de la périphérie, devraient réfléchir sur le retard qu'ils ont accumulé dans la construction d'un pôle commun de clarification qui serve de point de référence pour les camarades de tous les pays. C'est celui-là le but (tant pis s'iln'est pas réalisable tout de suite) que nous nous assignons à nous-mêmes, aux camarades du BIPR et à tout le milieu politique prolétarien.
LA NECESSAIRE UNITE ENTRE "PROGRAMME" ET "TACTIQUE"
« Les "objectifs" partiels, contingents, justement tactiques, ne peuvent en aucun cas être assimilés à des objectifs programmatiques du Parti Communiste. Cela revient à dire qu'ils ne peuvent et ne doivent en aucun cas faire partie du programme communiste.
Pour clarifier la thèse avec un exemple, on peut faire référence à la question des organisations de base du prolétariat. Fait partie du programme communiste la centralisation nationale et internationale des conseils prolétariens, sur la base des unités productives et territoriales (...) Par contre, ne fait pas partie du programme communiste -mais bien de la tactique communiste- la libération du prolétariat des prisons syndicales dans la lutte contre le capitalisme à travers son organisation autonome dans les assemblées générales d'usine, coordonnées et centralisées à travers des délégués élus et révocables." (Préambule) La raison d'une telle séparation serait que si le mouvement prolétarien atteint cet objectif ["tactique"] indépendamment d'une stratégie globale d'attaque au pouvoir bourgeois, il est rapidement récupéré [par la» bourgeoisie]» (Ibid)
C'est vrai que toute victoire ouvrière partielle peut être récupérée par la bourgeoisie, mais cela, quel que soit son objectif, même celui que le projet signale comme l'essence du programme : "la dictature du prolétariat et la construction du socialisme". En effet si "la dictature du prolétariat" reste isolée dans un seul pays elle peut être et l'est même obligatoirement récupérée par le capitalisme, comme l'expérience de la révolution russe nous l'a démontré. Mais l'objection de fond que nous opposons aux arguments de BC est que, de tout temps, nous communistes "ne nous présentons pas au monde en doctrinaires avec un nouveau principe : voici la vérité, mets-toi à genoux! Nous ne lui disons pas : renonce à tes luttes car ce sont des sottises) Nous ne faisons que montrer au monde pourquoi il lutte en réalité. " (Marx). Se limiter à écrire dans le programme la nécessité de la centralisation des conseils ouvriers cela revient à présenter aux ouvriers une sorte d'idéal qu'il serait beau d'atteindre mais qui n'aurait rien à voir avec les luttes dans lesquelles il est déjà engagé. Le rôle des communistes est plutôt celui indiqué par Marx : montrer que l'objectif final de la centralisation mondiale des conseils ouvriers n'est autre que le point final du processus qui prend déjà forme dans les tentatives encore sporadiques aujourd'hui d'auto organisation des grèves au niveau de simples usines ou dans les tentatives d'extension des luttes d'un secteur à un autre. Le fait que l'écrasante majorité des ouvriers ne soit pas encore consciente de l'enjeu réel de ses luttes ne fait que confirmer la nécessité pour les communistes de mettre en avant, face au prolétariat, avec un maximum de clarté "pourquoi il lutte en réalité, car "la conscience est quelque chose qu'il devra faire sienne, qu'il le veuille ou non". (Marx)
Le programme ne contient donc pas seulement "où nous voulons arriver" mais aussi "pourquoi c'est possible et comment c'est possible d'y parvenir". Exclure du programme cette composante essentielle et la reléguer dans les limbes d'une "tactique communiste" plus élastique "fait partie des paradoxes historiques de certaines forces politiques" comme Battaglia Comunista, qui affirme avec justesse que la distinction entre "programme maximum"et "programme minimum" est dépassée, souligne la nécessité d'éliminer les ambiguïtés laissées sur cette question par l'Internationale Communiste et puis oublie justement le plus important. C'est là que se trouve toute l'ambiguïté : BC rejette la vieille distinction périmée mais la réintroduit ensuite, nouvelle version, sous la forme d'une insistance croissante sur la distinction entre le programme, bastion des principes, et la tactique, plus libre de "manoeuvrer" pour le triomphe final des principes.
Les différentes Gauches Communistes se sont élevées contre cette insistance, en particulier la Gauche italienne qui a réaffirmé, par la bouche de Bordiga, que la tactique ne peut être autre chose que l'application concrète de la stratégie, c'est-à-dire du programme. En effet, le but de la direction de l'I.C, en soulignant cette distinction, était double : d'une part Se donner une certaine marge de manoeuvre dans le domaine tactique, d'autre part s'assurer que les vire- voltes tactiques momentanées ne contaminent pas l'essentiel et donc la pureté du programme. Naturellement, cette distinction entre tactique et programme existait seulement, dans la tête des chefs de l'Internationale : l'opportunisme, introduit par la porte de service de la tactique, s'est infiltré de plus en plus dans le programme et a fini par ouvrir grand les portes à la contre-révolution stalinienne. Il semblerait que les camarades de BC se font eux aussi des illusions en croyant qu'il suffit de déclarer que les tactiques particulières pour les pays périphériques n'ont pas leur place dans le programme, pour ménager la chèvre et le chou. Ils veulent croire que les "petites" concessions tactiques, nécessaires pour accrocher plus solidement des groupes et des éléments des pays périphériques, n'ont aucune influence sur le programme ; ainsi, le programme restant pur, il sera facile de corriger les éventuelles déviations au niveau tactique. L'Internationale Communiste aussi pensait que c'était facile...et on a vu comment elle a fini. Si BC -et le BIPR- ne renversent pas rapidement la vapeur, ils risquent sérieusement de prendre un chemin sans retour.
LES ILLUSIONS SUR LES "DROITS DEMOCRATIQUES"
Voyons maintenant où mène l'application concrète de ces subtiles distinctions entre programme et tactique. "La domination du capital dans les pays périphériques se maintient au moyen de l'exercice de la répression violente et de la négation des libertés les plus élémentaires (de parole, de presse, d'organisation [...] Les marxistes savent distinguer [...] entre des mouvements sociaux pour les libertés et la démocratie, et les forces politiques libérales-démocratiques qui se servent de ces mouvements pour la conservation du capitalisme. [...] Ce n'est pas une politique communiste que. [...] de condamner, en même temps que la direction politique, 1'ensemble du mouvement matériel et social et ses mêmes revendications [...] de même qu'il n'est pas communiste d'ignorer dans les pays métropolitains les revendications immédiates, économiques du prolétariat, sous prétexte qu'en soi elles ne nient pas le mode de production capitaliste. " (Thèse n° 11).
Les énormes différences qui existent dans les conditions sociales et politiques des pays périphériques par rapport à celles des métropoles sont tellement évidentes que personne ne peut les nier. Le problème est : qu'est-ce que "la liberté et la démocratie" viennent faire ici ? Qu'est-ce que cela signifie d'affirmer que "C'est la domination du capitalisme -libéral et démocratique dans ses métropoles- qui nie la liberté et la démocratie dans les aires périphériques"? Ce que le capitalisme nie, ou plutôt, ce qu'il n'est pas capable de garantir, c'est un minimum de développement dans un sens capitaliste de ces aires, qui permette au" moins d'assurer la survivance physique de leurs populations. Le capitalisme n'est "démocratique", nulle part et encore moins dans les métropoles. Ce qu'il arrive encore à garantir dans les métropoles -mais de moins en moins- c'est un niveau de vie suffisant pour alimenter des illusions démocratiques au sein de la classe ouvrière. Par contre, si on veut parler du fait que dans les métropoles il existe une plus grande liberté d'organisation, de presse, etc. que dans la périphérie, il ne faut pas oublier la part que joue dans cet état de fait l'existence d'un rapport de forces plus favorable au prolétariat de par sa force et sa concentration. Lancer le mot d'ordre "droits démocratiques" là où le prolétariat n'a pas la force de les imposer et où le capitalisme n'a pas la force de les donner, cela revient à agiter devant les masses non pas une misérable carotte, mais l'illusion d'une misérable carotte.
La distinction entre les mouvements sociaux pour la démocratie et leurs directions est alors encore plus opportuniste. Comme l'admettent les thèses mêmes, les "désirs de liberté et de démocratie qui s'élèvent de toutes les couches de la population" (thèse 11) sont partagées par la bourgeoisie aussi. Le tableau n'est donc pas celui d'un vague "mouvement social" parasité par une direction bourgeoise qui en substance, lui serait étrangère. Au contraire, le mouvement contre l'Apartheid en Afrique du Sud (pour reprendre l'exemple cité par les thèses) est un mouvement interclassée dans lequel les ouvriers noirs sont obligés de marcher aux côtés des bourgeois noirs, sous la direction de bourgeois noirs et sur des mots d'ordre qui défendent les intérêts des bourgeois noirs en particulier, et du capitalisme en général. Le fait que ces revendications "surgissent naturellement dans le processus de la vie sociale de ces pays" est, en termes marxistes, une banalité dénuée de sens : la revendication pour des "réformes de structures" surgit aussi "naturellement" en Italie et dans d'autres pays industrialisés, et ce n'est pas pour cela que les communistes renoncent à la combattre et la dénoncer de toutes leurs forces. Dans la tentative de rendre plus acceptable l'appui "critique" à ces mouvements, les thèses s'efforcent de souligner leur caractère "réel", "naturel", "matériel" et ainsi de suite. Un peu comme les philosophes bourgeois du 18e siècle qui pensaient que "tout ce qui est réel est rationnel" (c'est-à-dire bourgeois), BC semble penser que tout ce qui est matériel est prolétarien ou, au moins, pas anti prolétarien. Nous regrettons de devoir refroidir ces enthousiasmes faciles, mais des phénomènes comme le nationalisme, le syndicalisme, le racisme (ou l'anti-racisme) sont des forces réelles, qui exercent leur poids matériel dans un sens bien précis et qui surgissent tout naturellement en défense de l'existence du capitalisme. Le parallèle avec les revendications "immédiates" ouvrières, qui est supposé attribuer le brevet de marxisme à l'appui de ces mouvements, montre seulement combien BC est obligée d'embrouiller les cartes pour tenter de retomber sur ses pieds. Une chose est la revendication immédiate ouvrière (plus de salaires, moins d'heures de travail) qui, même si elle est limitée, va dans le sens de la défense des intérêts de classe et doit donc être soutenue par les communistes, tout autre chose est la revendication pour des "élections libres" ou pour plus de pouvoir pour sa propre bourgeoisie "opprimée" qui, tant dans l'immédiat qu'en perspective, ne sert qu'à dévoyer les luttes ouvrières dans une voie sans issue. Dans le premier cas les communistes sont au premier rang dans la lutte, dans le second cas, ils sont toujours au premier rang mais pour mettre en garde les travailleurs contre les pièges que lui tend la bourgeoisie.
C'est là le point central : Battaglia Comunista a la conscience tranquille en rejetant "l'inscription au programme communiste d'objectifs politiques démocratiques qui ajournerait le contenu réel du programme communiste" elle utilise en même temps ces objectifs "dans la définition de lignes tactiques, de mots d'ordre pour la lutte immédiate [...] en lien étroit avec des revendications, lignes tactiques et slogans agitatrices de la lutte économique, de manière à rendre matériellement praticable la pénétration du programme proprement communiste au sein des masses prolétariennes et .déshéritées." L'ennui est que les objectifs politiques démocratiques, c'est-à-dire bourgeois, ne font pas qu'"ajourner" le programme communiste ; ils le nient et le détruisent de fond en comble. Soutenir que la pratique de ces objectifs favorise justement "la pénétration du programme communiste au sein des masses", cela revient à soutenir que pour apprendre à quelqu'un à nager, il faut d'abord commencer par lui attacher les mains avant de le jeter à l'eau.
En proclamant que ces objectifs démocratiques doivent aller de pair avec les revendications économiques, les camarades de BC tournent volontairement le dos à la réalité : l'expérience des mouvements prolétariens de la périphérie du capitalisme montre que c'est exactement le contraire qui arrive, c'est-à-dire que la soumission aux bavardages démocratiques entraîne comme premier résultat le renoncement aux revendications économiques prolétariennes. Pour rester encore sur l'exemple de l'Afrique du Sud : au printemps 85, les mineurs noirs ont décidé de faire grève pour de fortes augmentations de salaires ; les syndicats et les partis noirs ont décidé qu'il fallait "élargir" les revendications à des objectifs politiques tels que l'abolition de l'Apartheid. Puis les revendications économiques ont été éliminées "pour ne pas trop demander à la fois", tandis que la grève était repoussée de semaine en semaine pour permettre aux patrons de se préparer. Résultat : la grève, désormais vidée de toute force prolétarienne, a échoué le jour même où elle a commencé, avec un lavage de cerveau des ouvriers en conséquence : "la lutte ne paie pas, seules des élections libres peuvent changer réellement les choses".
Le plus inquiétant c'est qu'avec cette insistance sur le fait que la poursuite d'objectifs démocratiques peut servir à entraîner les masses sur des positions communistes, on se rapproche dangereusement de la thèse réactionnaire bien connue des trotskystes, pour qui le prolétariat n'est pas mûr pour les positions de classe et doit y être porté à petits pas, à travers des objectifs intermédiaires, codifiés dans un beau manuel appelé "Programme de Transition". Certes, BC ne partage pas ces assertions contre-révolutionnaires et les combats au sein du prolétariat occidental, mais elle n'est pas aussi ferme sur l'exclusion de la possibilité d'une tactique semblable sur certains aspects, pour le prolétariat des pays périphériques. Une telle ambiguïté n'ouvre même pas une petite fenêtre aux positions communistes dans la périphérie, par contre elle risque d'ouvrir grand les portes à l'infiltration opportuniste partout.
LES CONDITIONS DE LA LUTTE ET DU PROGRAMME COMMUNISTE DANS LES PAYS PERIPHERIQUES
"...Le fait que le mode de production capitaliste dans les pays périphériques s'est imposé en bouleversant les anciens équilibres et que sa conservation se fonde et se traduit par une misère croissante pour des masses de plus en plus nombreuses de prolétaires et de déshérités, 1'oppression politique et la répression qui sont donc nécessaires pour que les masses subissent ces rapports, tout cela détermine dans les pays périphériques un potentiel de radicalisation des consciences plus élevé que dans les formations sociales des métropoles." [...]
"Ceci, à la différence des pays métropolitains, rend possible l'existence et l'action d'organisations communistes de masse" (Thèse 5)
"La possibilité d'organisations de masse dirigées par les communistes [...] ne doit pas se traduire par une massification des partis communistes eux-mêmes."
"C'est au fond le même problème qui se présente dans les pays avancés et auquel notre courant répond par ses thèses sur les 'groupes d'usine' communistes gui regroupent autour des cadres du parti les avant-gardes ouvrières orientées par lui et sous son influence directe. La particularité des pays périphériques réside dans le fait que cette condition existe non seulement dans les usines et dans la très restreinte (pour le moment) aire d'action de la minorité révolutionnaire, en période de paix sociale, mais bien à plus large échelle sur le territoire, dans les villes et les campagnes. Dans ces pays, pour les raisons qu'on a vues, l'organisation de forts groupes communistes territoriaux devient donc possible." (Thèse 6).
Comme on peut voir, BC avance deux thèses étroitement liées sur la "particularité" des pays périphériques.
La première thèse est que la faiblesse de l'implantation capitaliste dans ces pays en met à nu les contradictions, facilitant "la circulation du programme au sein des masses".
La deuxième thèse est que cette plus grande disponibilité envers la propagande révolutionnaire rend dès aujourd'hui possible dans ces pays la construction d'organisations de masse sous l'influence directe du parti.
Deux thèses, deux erreurs. D'abord, la thèse selon laquelle, les pays périphériques, de par les contradictions particulièrement aiguës qu'ils vivent, offrent de meilleures conditions pour l'activité révolutionnaire, n'est pas une idée nouvelle de BC ; elle dérive d'une idée défendue par Lénine connue comme la théorie "du maillon faible du capitalisme", dont à voulu généraliser la validité après la victoire de la révolution dans ce pays périphérique qu'était la Russie tsariste. Le CCI a soumis à une critique approfondie cette théorie, critique qu'il n'y a pas lieu de reprendre ici en entier ([7] [140]). Il suffira simplement de rappeler que le système mondial de domination bourgeoise n'est pas composé d'autant, de maillons indépendants pouvant être pris séparément ; quand un des maillons les plus faibles est en difficulté (par exemple la Pologne en 1980) c'est toute la bourgeoisie mondiale qui intervient pour soutenir cette bourgeoisie nationale contre le prolétariat. Dans ces pays le processus d'une révolte prolétarienne, confronté à "sa propre" bourgeoisie seulement, aurait certainement de grandes possibilités d'extension et de radicalisation ; mais face au front uni que la bourgeoisie mondiale oppose de fait, ses possibilités sont très rapidement réduites. En conséquence, la circulation du programme communiste dans ces pays n'est pas du tout plus facile, malgré le haut niveau de radicalité et de violence souvent atteint par les luttes. Quiconque a eu des contacts avec des camarades de ces pays peut en témoigner, et peuvent en témoigner surtout les camarades mêmes qui travaillent dans ces pays. La réalité quotidienne à laquelle on a affaire dans un pays comme l'Iran par exemple, c'est l'énorme influence du radicalisme islamique sur les masses semi-prolétaires et déshéritées. La réalité à laquelle on se heurte chaque jour en Inde c'est la subsistance, au sein du prolétariat lui-même, du sectarisme tribal qui existe entre les milliers de communautés ethniques présentes dans le pays, la réalité de la séparation des individus en fonction du système des castes. Parler de la facilité avec laquelle circule le programme communiste dans des pays où une journée de salaire ouvrier ne suffit pas à payer un seul numéro d'un journal révolutionnaire, des pays où les ouvriers ne peuvent pas lire le soir après dix heures d'usine parce que le courant électrique n'est fourni que pendant quelques heures par jour, c'est faire de l'humanisme bon marché ou, plus simplement, n'y avoir jamais mis les pieds.
La réalité est exactement le contraire : de très petits noyaux de camarades commencent à travailler dans les pays de la périphérie du capitalisme et doivent conquérir la rue centimètre par centimètre, luttant à coups de griffes et à coups de dents contre des difficultés inouïes. Pour ne pas plier sous les difficultés ambiantes, ces camarades ont besoin de tout l'appui et de toute la force des organisations communistes des métropoles, et non de paroles sur la facilité de leur travail.
La conclusion pratique que BC fait découler de la soi-disant facilité pour la propagande communiste est la possibilité de construire des organisations de masse dirigées par les communistes. Il faut voir là un cas typique de pénétration de l'idéologie bourgeoise à travers les interstices laissés par une faiblesse persistante dans les positions révolutionnaires. En l'occurrence, il s'agit de la rencontre des mensonges éhontés des nationalistes du PC d'Iran quant à l'existence d'"organisations communistes de masse" sur les montagnes du Kurdistan et dans tout l'Iran, et de la volonté désespérée de BC de croire ces mensonges qui semblent redonner du souffle à sa vieille fixation Sur les "groupes communistes d'usine". Cela fait des années que le CCI polémique avec BC sur sa prétention de construire sur les lieux de travail des groupes d'usine, regroupant aussi bien des militants du parti que des prolétaires influencés politiquement par lui.
LA CHIMERE DE B.C. : LES "GROUPES COMMUNISTES D'USINE"
Pour répondre à nos critiques et mises en garde sur le danger de glissements opportunistes, les camarades de BC ont toujours insisté sur le fait que les "groupes communistes d'usine" ne s'écartent pas de la ligne du parti et donc leur existence n'est en fait pas basée sur une dilution du programme.
Or, la question est justement celle-là. Tant que les groupes d'usine sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire de simples copies du parti avec quelques rares sympathisants en plus et un peu de cohérence programmatique en moins, il ne peut effectivement pas surgir de gros problème, au moins dans l'immédiat, car seulement ce qui a une existence réelle peut réellement entraîner des avantages ou des problèmes. La question se pose différemment dans l'hypothèse d'un élargissement de ces groupes, hypothèse qui, en fait, n'est pas irréaliste : à mesure que la crise s'approfondit, un nombre croissant de prolétaires sera poussé à chercher une alternative aux faux partis ouvriers et à tous les organismes soi-disant "intermédiaires" (groupes ouvriers, groupes d'usine, etc.) et nous verrons affluer un grand nombre de ces éléments. Le jour où ils existeront vraiment, les groupes d'usine seront constitués d'un certain nombre de prolétaires dégoûtés par les faux partis ouvriers, mais encore en partie liés à eux du point de vue idéologique, plus quelques rares militants ayant effectivement une cohérence programmatique. Cette perspective semble être la "Terre promise" pour les militants de BC : enfin la cohérence programmatique du parti pourra influencer un plus grand nombre d'ouvriers ! Cela elle le comprend très bien. Par contre, ce qui n'arrive pas à lui rentrer dans la tête est que dans la nature tous les échanges se font dans les deux sens. Cela veut dire que si les groupes d'usine offrent un terrain organisationnel commun à la cohérence programmatique et aux illusions qui pèsent encore sur les prolétaires, alors ce ne sont pas seulement les 1’illusions qui cèdent le pas devant les positions révolutionnaires, mais aussi les positions révolutionnaires qui doivent faire quelques petites concessions aux illusions des prolétaires afin de maintenir un terrain commun d'entente.
Si on ajoute à la pression normale ambiante de l'idéologie dominante la pression interne des tendances activistes, localistes, ouvriéristes de dizaines d'ouvriers à peine éveillés à la nécessité de "faire quelque chose", où iraient finir ces groupes d'usine ? Le point de rencontre entre cohérence et confusion tendrait nécessairement à se faire plus près de la confusion, contaminant les militants révolutionnaires mêmes présents dans les groupes.
La réponse de BC à ces mises en garde peut facilement se réduire de l'insistance du projet de thèses sur le fait que "dans les organismes de parti se trouvent concentrées les meilleures qualités, les meilleurs cadres du prolétariat révolutionnaire et les mieux préparés." (Thèse 6)
En somme, la garantie de non déviation des groupes d'usine ou des groupes territoriaux résiderait dans l'existence d'un parti homogène et sélectionné, qui en assurerait la direction correcte. En fait BC se fait encore une fois des illusions sur la possibilité de ménager la chèvre et le chou en s'imaginant des séparations à cloisons étanches entre le parti et les ouvriers qui, dans la réalité, n'existent pas.
Nous avons déjà vu comment, au niveau des positions politiques, plus on laisse du champ libre aux "mots d'ordre agitatoires" et de la marge de manoeuvre à la "tactique communiste", plus on se fait des illusions sur la possibilité de sauver son âme en proclamant que tout cela "ne doit en aucun cas faire partie du programme communiste" (Préambule). Il en va de même au niveau organisationnel : plus on ouvre les portes de soi-disant organismes "communistes" à des masses de prolétaires convaincus seulement à moitié, plus on croit sauver son âme en proclamant qu'au parti, le vrai, n'entrent que les éléments "aptes". Que signifie cette corrélation ?
En premier lieu que ces fameux organismes territoriaux de masse ne sont pas autre chose que la concrétisation organisationnelle de la division opportuniste entre tactique et programme (dans les groupes on pratique la tactique, le parti, lui, s'occupe de maintenir le programme).
En second lieu, cela signifie que, étant donné qu'une tactique opportuniste finit toujours par souiller le programme dont elle est censée s'inspirer, ainsi chaque oscillation de la masse d'éléments semi-conscients encadrés par les groupes a forcément des répercussions sur l'organisation révolutionnaire qui est responsable de ces groupes du point de vue politique et organisationnel.
En fin de comptes, toute cette argumentation sur la tactique et les organisations "de masse" ne conduit pas à la "pénétration du programme proprement communiste au sein des masses prolétariennes et déshérités"? Thèse 11), mais plus banalement, à la pénétration de l'influence idéologique bourgeoise au sein des rares et précieuses organisations communistes.
LIMITES D'UN AMENDEMENT : UNE REACTION SALUTAIRE MAIS NETTEMENT INSUFFISANTE
C'est un vieil acquis de la Gauche Communiste que de savoir que toute tentative d'adapter les thèses communistes aux conditions particulières des divers pays (arriération, etc.) comporte les plus grands risques de déviation opportuniste. L'accentuation des connotations opportunistes que l'on remarque à chaque pas du projet était donc amplement prévisible, de même qu'on pouvait prévoir une réaction au sein du BIPR contre cette accentuation. À la dernière réunion du Bureau, un "amendement de forme" (!) a été approuvé, remplaçant "organisations communistes de masse" par "organisations de masse dirigées par les communistes".Donc,"aucune concession, pas même formelle, aux organisations politiques communistes de masse, mais une étude sérieuse des différentes possibilités offertes au travail des communistes dans les pays périphériques." (Battaglia Comunista n°l, 1986). En fait, pour les camarades de BC "l'argumentation ultérieure ne laissait aucune place au doute" Changer un terme est plus que suffisant pour tout clarifier. C'est peut-être vrai. Mais commençons par faire remarquer que ces groupes sont destinés à se voir attacher un adjectif de trop : pendant trente ans, BC les a définis comme des "groupes syndicalistes d'usine" et ce n'est qu'après les premières polémiques avec nous qu'elle les a rebaptisés "Groupes internationalistes d'usine". Nous avions alors commenté : "S'il suffisait d'éliminer le terme 'syndical' pour éliminer les ambiguïtés sur le syndicat, tout serait réglé." (Revue Internationale n° 39 p.16 : Polémique avec la CWO). Ceci dit, ici il ne s'agissait pas seulement d'un adjectif en trop : dans les thèses on ne se limite pas à appeler communistes ces groupes territoriaux. On prend aussi la peine de préciser qu'ils sont "communistes parce qu'ils sont dirigés par et en fonction des lignes communistes, parce qu'ils sont animés et guidés par les cadres et les organismes du parti". (Thèse 6). Si on prenait au sérieux ces affirmations, on jetterait à l'eau, en une seule phrase, toute la tradition politique-organisationnelle de la Gauche italienne, faisant passer pour une organisation communiste un organisme de masse composé de non-communistes et obligatoirement soumis aux oscillations des prolétaires qui le composent.
La logique liquidatrice du parti qui se trouve derrière ces organisations ne peut être extirpée par une simple élimination d'adjectifs. En écrivant ces formulations particulièrement opportunistes, les rédacteurs du projet des thèses n'ont fait que développer logiquement et jusqu'au bout ce que les camarades de BC ont toujours dit : que les groupes d'usine sont des organismes communistes, des organismes de parti, même s'ils encadrent des ouvriers qui n'adhèrent pas au parti. L'hypothèse actuelle d'une entrée en masse de non-communistes, de non-militants du parti au sein de ces organismes de parti, ne fait que rendre plus évidente et macroscopique une contradiction qui existait déjà. Si BC veut comme d'habitude ménager la chèvre et le chou, il faut précisément admettre qu'un organisme puisse être communiste même si l'écrasante majorité de ses militants ne l'est pas (il suffit que la direction le soit), et alors on ne comprend pas la nécessité de l'amendement approuvé, ou alors il faut admettre qu’il ne s'agit pas d'organismes de parti mais d'organismes semi-politiques, intermédiaires entre classe et parti, ce que BC a toujours nie. Et même si elle l'admettait, ce né serait pas un grand pas en avant : elle abandonnerait en fait une de ses confusions particulières, seulement pour s'enfoncer dans la confusion générale répandue dans le milieu prolétarien au sujet des "organismes intermédiaires" et autres "courroies de transmission".
Dans les deux cas toute la tentative de développer une proposition spécifique politique-organisationnelle pour les camarades des pays périphériques craque sur ses propres bases constitutives. Les camarades du BIPR doivent y réfléchir très sérieusement.
BEYLE
[1] [141] Le BIPR s'est constitué à l'initiative de Battaglia Comunista et de la Communist Workers'Organisation (CWO)
[2] [142] Voir Revue Internationale n°36 : "A propos de l'adresse aux groupes politiques prolétariens du 5e congrès du CCI - Réponse aux réponses"
[3] [143] Voir par exemple la 2ème partie de l'article "Bluff d'un regroupement" dans la Revue Internationale n° 41.
[4] [144] Voir les brochures contenant les procès-verbaux de ces Conférences.
[5] [145] Voir Revue Internationale n°36 : "A propos de l'adresse aux groupes politiques prolétariens du 5e congrès du CCI - Réponse aux réponses"
[6] [146] Voir Revue Internationale n°36 : "A propos de l'adresse aux groupes politiques prolétariens du 5e congrès du CCI - Réponse aux réponses"
[7] [147] Voir dans les Revues Internationales n°31 (4ème d'Europe de l'Ouest au coeur de la lutte de classe", trim.82) et 37 (2ème trim.84) : "Le prolétariat "A propos de la critique de la théorie du 'maillon faible')
Courants politiques:
- TCI / BIPR [148]
Heritage de la Gauche Communiste:
Correspondance internationale : Emancipacion Obrera, Militancia Clasista Revolucionaria (Argentine, Uruguay)
- 2704 reads
Présentation
Nous venons de recevoir d'Argentine une "Proposition Internationale" qui s'adresse aux éléments et aux groupes révolutionnaires. Elle appelle à la discussion et au regroupement des forces révolutionnaires aujourd'hui faibles et dispersées de par le monde. Cette proposition que nous présentons ici avec notre réponse est clairement et sans équivoque possible prolétarienne : elle dénonce la démocratie bourgeoise, tout type de frontisme "anti-fasciste" et le nationalisme ; elle défend et affirme la nécessité de l'internationalisme prolétarien face à la guerre impérialiste.
Nous saluons l'esprit et la démarche dont les camarades font preuve dans leur document : nécessité de la discussion ouverte, de la "polémique", de la confrontation des différentes positions politiques, de la lutte politique fraternelle en vue de constituer un pôle de référence politique international. Un pôle de référence qui soit capable de regrouper et d'aider au surgissement d'éléments et de groupes révolutionnaires. Comment ne pourrions-nous pas appuyer 1'esprit et la préoccupation des camarades, nous qui affirmions, lors de la constitution du CCI, dans le premier numéro de notre Revue Internationale d'avril 1975, nos propres ambitions:"Concentrer les faibles forces révolutionnaires dispersées de par le monde est aujourd'hui, dans cette période de crise générale, grosse de convulsions et de tourmentes sociales, une des tâches les plus urgentes et les plus ardues qu'affrontent les révolutionnaires. Cette tâche ne peut être entreprise qu'en se plaçant d'emblée et dès le départ sur le plan international. Ce souci est au centre des préoccupations de notre Courant. C'est à ce souci que répond également notre Revue, et en la lançant nous entendions en faire un instrument, un pôle pour le regroupement international des révolutionnaires". Même si les résultats ont été modestes jusqu'à présent, notre ambition est toujours là et c'est dans ce sens que nous publions cette "Proposition Internationale" signée par deux groupes : "Emancipacion Obrera" et "Militancia Clasista Révolueionaria" ([1] [151]).
Ce dernier groupe ne nous est pas connu. Par contre, nous savons qu'"Emancipacion Obrera" est un groupe qui a surgi après la guerre des Malouines. Il ne se rattache à aucune organisation déjà existante. Ce groupe s'est constitué petit à petit au cours des terribles années 70 en Argentine. Il a dû affronter la répression de 1'Etat bourgeois sous toutes ses formes :
-.1'officielle : la démocratique, la péroniste, la syndicale, et bien sûr la policière et la militaire;
- 1'officieuse, para-étatique : d'une part, celle des tristement célèbres commandos d'extrême droite A.A.A et, d'autre part, celle du trotskisme ([2] [152]) quand nos camarades dénonçaient l'appui et la participation de ceux-ci à la guerre des Malouines et défendaient une politique de "défaitisme révolutionnaire".
C'est en 1978 que la répression a atteint son sommet lors de la coupe du monde de football en Argentine. C'est en 1978 que Ces camarades ont décidé "de commencer à réaliser un travail de lutte idéologique, de sortir une publication clandestine"."C'est cette activité qui, quand le gouvernement militaire a envahi les îles Malouines, a permis de sortir des tracts dans la rue s'opposant à la guerre dès le deuxième jour de celle-ci. C'est à partir de là que de vieilles et de nouvelles connaissances se sont regroupées dans la lutte contre le nationalisme et la guerre inter-bourgeoise. Durant ces deux mois, des petits groupes ont surgi réalisant une activité internationaliste" ("Emancipacion Obrera").Après la guerre, ces groupes se sont réunis et "ont décidé de poursuivre le processus de lutte politique et ont discuté de 1'avenir : produit de la discussion, est sorti un document sur les élections futures et ce document fut signé : "Emancipacion Obrera".
Nous allons peut-être manquer de pudeur, mais c'est avec émotion et joie que nous saluons ces camarades et présentons ici leur "Proposition Internationale". Dans un pays où le prolétariat avait subi une répression féroce, l'apparition d'une voix prolétarienne est une promesse de plus, après le Mexique, après l'Inde, pour l'issue victorieuse des gigantesques affrontements de classe qui se préparent.
C'est aussi la promesse de plus de travail et de responsabilité pour les groupes déjà constitués du milieu révolutionnaire international. Pour sa part, le CCI essaiera de remplir du mieux possible la tâche qu'il s'est assignée.
"Proposition internationale" aux partisans de la révolution prolétarienne mondiale
Les 22 et 23 février 1986, un groupe de. Militants que, (spécialement d'Argentine et d'Uruguay) se sont réunis en Uruguay pour discuter de la situation mondiale actuelle et des tâches du prolétariat
Entre eux, il y eut un accord général sur le fait que face aux attaques que la bourgeoisie porte mondialement contre le prolétariat et face à la situation actuelle de faiblesse, de dispersion et d'isolement des petites forces classistes et révolutionnaire il était nécessaire de travailler de manière associée pour renverser la situation en combattant le sectarisme et le nationalisme implicites dans certaines conceptions du travail international. Et comme tentative pour modifier cette situation, les camarades présents donnent à connaître les idées et la proposition suivantes.
QUELQUES CONSIDERATIONS ET FONDEMENTS PREALABLES.
Il peut paraître étrange que, ici, d'un seul coup, quelques groupes et militants peu nombreux, sûrement inconnus en général, lancent un appel, une proposition à tous ceux qui, en diverses parties du monde, avec plus ou moins de force, avec plus ou moins de clarté, brandissent bien haut le drapeau de l'internationalisme prolétarien, de la révolution prolétarienne mondiale.
Mais ce n'est pas "d'ici" ni "d'un seul coup" que surgit une fois encore le cri angoissé de minorités révolutionnaires qui cherchent à rompre le cordon tendu par le capital, qui assistent impuissantes aux coups terrifiants que la bourgeoisie porte sur le prolétariat et sur elles-mêmes, qui, tant dans les périodes de montée de la lutte de classe que dans les moments de la contre-révolution la plus violente, découvrent l'une et l'autre ce que signifient l'isolement, la faiblesse de leurs petites forces ; faiblesse non seulement numérique, mais fondamentalement politique car il est impossible localement ou nationalement de résoudre les problèmes que le moment actuel impose aux révolutionnaires.
Nous sommes convaincus qu'en différents lieux, ont surgi des groupes, des militants qui, ne s'identifiant pas à la gauche traditionnelle (stalinienne, trotskyste et ses variantes.), aux politiques visant à aider la bourgeoisie à résoudre ses problèmes, avec la position de changer la forme étatique de la domination bourgeoise ou de l'appuyer dans ses guerres, ont essayé d'élaborer une politique distincte revendiquant l'autonomie de la classe ouvrière face à la bourgeoisie et la lutte pour détruire sa domination et son Etat sans admettre des phases ou des étapes préliminaires (démocratiques).
Et nous savons ce que c'est que d'aller à contre-courant, sans aucune aide sur laquelle compter, sans possibilité immédiate de réappropriation des expériences historiques du prolétariat révolutionnaire, sans textes théorico-politiques fondamentaux et dans une ambiance de répression et de danger.
Si, pour quelques uns, certaines définitions ou positions sont aussi évidentes que l'alphabet, au point qu'il ne leur paraît pas nécessaire d'en parler ou d'écrire dessus, pour d'autres, arriver à écrire la lettre "A" a signifié tout un processus de luttes, de ruptures, de peurs et d'incertitudes.
Ici, dans les écoles, on enseigne une phrase d'un homme illustre du siècle passé : "on ne peut tuer les idées". Cependant, nous avons appris qu'on tue ceux qui ont certaines idées (ou positions), et que la classe dominante peut entraver pour une longue période la réappropriation, la connaissance, le lien et le développement des expériences ; idées et positions que vit et construit le prolétariat révolutionnaire dans différentes aires du monde.
C'est ainsi que, paradoxalement, il a fallu une répression monstrueuse (avec l'exil qui s'en est suivi) et une guerre (les Malouines) pour savoir ici, qu'existaient dans le monde divers courants et groupes radicalisés ; pour connaître -et encore très peu- les expériences d'Allemagne et d'ailleurs après la première guerre ; pour connaître d'autres positions dans la guerre civile espagnole qui ne soient ni franquistes ni républicaines. Et qu'il y a une autre histoire plus proche (que nous ne connaissons pratiquement pas).
A partir de là, nous avons eu la confirmation qu'actuellement il existe des groupes qui ne s'inscrivent pas dans les courants politiques traditionnels, beaucoup que nous ne connaissons pas encore et d'autres dont nous ne savons ni quand ni comment ils ont rompu avec le capital et ses fractions, mais qui expriment à divers degrés des moments différents de rupture avec la politique du capital.
Mais si aujourd'hui nous savons que cela existe, ceci ne signifie nullement que la situation actuelle d'isolement et de faiblesse ait changé. Au contraire, nous n'arrivons même pas encore à savoir ce qui se passe, non dans un pays lointain ou limitrophe, mais dans une ville proche ou un quartier voisin. Et il ne faut pas comprendre cela comme une curiosité ou une question journalistique : en Argentine, par exemple, il y a continuellement des jours où plusieurs millions d'ouvriers sont en conflit... sans qu'il existe une quelconque coordination entre eux, parfois même sans qu'on sache qu'il y a une lutte ; ce qui arrive de tous côtés. Et s'il en est ainsi des mouvements relativement massifs, c'est encore pire pour ce qui concerne les contacts et la connaissance des avant-gardes qui surgissent au cours de ces luttes ou sous leur influence.
Et nous sommes convaincus que dans les pays dans lesquels nous vivons, comme dans d'autres parties du monde, des groupes d'ouvriers ou de militants surgissent qui essaient de rompre avec les politiques de conciliation, de subordination à la bourgeoisie, mais qui, en l'absence de référence internationale, avec la forte présence de la bourgeoisie dans le mouvement ouvrier, finissent par succomber absorbés par quelque fraction du capital ou simplement désagrégés, disparus.
Peu nombreux sont ceux qui réussissent à surmonter les premiers coups, et ceux qui le font ont devant eux une perspective incertaine ou la solitude politique, le devoir de passer des étapes et de rebrousser chemin, de se retrouver dans des impasses, partir presque à zéro sur de nombreux sujets, se transformer en une réalité quotidienne épuisante qui mine les petites forces déjà tant frappées politiquement et économiquement. N'y a-t-il pas d'autre alternative que celle-ci ? Est-ce que la gestation d'une politique internationaliste révolutionnaire, ou tout au moins une ébaucha de celle-ci, se fera ainsi, étape par étape, groupe par groupe, ville par ville, nation par nation, génération par génération ? Chacun doit-il repasser par les mêmes étapes, affronter les mêmes problèmes, recevoir les mêmes coups, déchiffrer les mêmes lettres, élaborer les noues mots, pour qu'après un temps et un chemin assez longs, une fois forts et constitués en "Parti", se réunir avec d'autres "égaux" ou, en leur absence, "s'étendre à d'autres nations ?
Nous ne croyons pas que ce soit la seule option ; nous ne croyons même pas qu'on puisse en tirer quelque chose de positif.
Au contraire, nous pensons que la seule alternative vers laquelle nous allons est internationale. Tout comme c'est une mystification de parler de Société Communiste tant qu'il existe un seul pays capitaliste dans le monde, c'en est une aussi de parler d'internationalisme en ne concevant celui-là que comme la solidarité avec les luttes ouvrières dans le monde ou en l'assimilant à quelques phrases pompeuses de temps en temps contre la guerre, le militarisme ou l'impérialisme.
L'internationalisme prolétarien a pour nous une autre signification et implique de faire un effort pour dépasser la solidarité générique car les dimensions internationales de la révolution prolétarienne exigent d'entrelacer et d'unifier les efforts pour délimiter une stratégie unique au niveau mondial et son corollaire politique dans les tâches auxquelles nous nous confrontons dans les > différentes aires et pays.
Naturellement, on ne résoudra pas ce problème par volontarisme ni du jour au lendemain ; il ne sera pas le fruit d'un travail long et prolongé d'"éducation" ou "scientifique" comme le concevait la 2ème Internationale (et pas seulement elle), un travail d' "accumulation de forces" ("en gagnant des militants un à un", en "élaborant LA théorie" et en "structurant LA direction qui devra être reconnue à son heure) pour un affrontement repoussé à un futur toujours plus lointain, alors que la résistance et la lutte du prolétariat contre le capital sont quotidiennes (pour ces courants politiques ces luttes quotidiennes doivent être contrôlées, cachées, isolées, afin de pouvoir s'en servir, comme ils l'ont toujours fait, pour soutenir une fraction de la bourgeoisie contre une autre supposée pire).
Si le parti de la classe ouvrière n'est pas un de ces groupes politiques qui se donne un tel nom dans un ou plusieurs pays ; si ne pas être d'accord avec "le parti pour la classe ouvrière" et revendiquer "la classe ouvrière organisée en classe, c'est-à-dire en parti" n'est pas un simple jeu de mots ; si nous rejetons les idées social-démocrates (staliniennes, trotskystes etc...) du parti comme étant l'appareil (intellectuels, ouvriers etc...) porteur de la Vérité et qui se constitue volontairement et au sein d'une nation , qui attend d'être reconnu par les masses incultes, et de l'Internationale comme étant une fédération de partis (ou d'un parti qui s'étend à d'autres nations), tout ceci implique de rompre avec ces conceptions et ces pratiques totalement opposées à l'internationalisme prolétarien et qui ne sont qu'une manière de manifester et de défendre le nationalisme.
Parmi celles-ci, la plus évidente est celle qui conçoit le développement de son propre groupe (ou de ses propres groupes) comme une question locale ou nationale, avec pour objectif d'obtenir une force déterminée afin de se dédier plus tard à prendre contact avec d'autres groupes dans d'autres pays, groupes qu'il faut absorber ou démasquer généralement par des discussions et des déclaration.
Les contacts internationaux sont considérés comme une question de"propriété privée"où règne la pratique de la bilatéralité, celle qui inclut chaque "X" année des périodes de rencontres pour se réunir dans des "Nations Unies" de "révolutionnaires". La pratique des partis de la 2ème Internationale en est un bon exemple.
Nous pensons que ce chemin ne peut conduire qu'à de nouvelles frustrations et de nouvelles mystifications ; c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de lutter contre tous les intérêts, les conceptions et les sectarismes que produisent et reproduisent les divisions créées par la bourgeoisie dans la défense de ses marchés internes, de ses Etats, de "ses" prolétaires, c'est-à-dire de la plus-value qu'elle leur extrait.
Personne ne pense à faire un travail commun, ni même un tract, avec ceux qui se situent dans le camp ennemi. Et avec l'ennemi de classe, il ne peut y avoir de conciliation ou d'entrisme. Mais il n'existe pas que des ennemis. Et on ne peut nier qu'entre les groupes et les personnes qui n'en sont pas, il y a très souvent des intolérances, des visions statiques et du sectarisme. Il y a une pratique des différences, une dispute de la "clientèle" commune, un nationalisme ou "une défense de sa propre chapelle" vêtue d'intransigeance.
Nous ne pouvions éluder ce problème dans une proposition internationale. Il est évident que personne ne pense à travailler dans une perspective commune avec un groupe se réclamant de la 4ème Inter- I nationale ou avec un groupe maoïste tiers mondistes. Mais si le caractère d'ennemi de classe est évident dans certains cas, dans d'autre il est plus subtil et rend difficile l'élaboration d'une ligne de démarcation, et ceci d'autant plus lorsque nous cherchons un point qui implique un pas en avant dans la situation actuelle de faiblesse, d'isolement et de dispersion
Nous pensons qu'il est impossible d'élaborer un ensemble de points "programmatiques" qui soient à l'abri des opportunistes sauf s'il est défini de telle sorte que seul le groupe lui-même puisse être en accord, et encore.
Cri ne peut prétendre non plus que, dans chaque pays du monde, des groupes ou des militants isolés aient mûrit de la même manière que dans d'autres zones et qu'ils aient telles ou telles définitions qui, si diffusées qu'elles soient en certains lieux, sont le produit d'une histoire non partagée et de laquelle, comme nous l'avons déjà signalé, rien ou peu n'est connu dans d'autres aires.
En contrepartie, la grève de presque un an des mineurs anglais, qui n'a suscité aucune tentative sérieuse de coordonner une réponse commune de l'ensemble des différents groupes et militants éparpillés dans le monde, n'indique pas seulement une faiblesse et une limitation : elle indique le sectarisme, des conceptions sur la lutte de classe et le Parti identiques à celles de la social-démocratie. Et face à la guerre entre l'Irak et l'Iran ? Et face à l'Afrique du Sud ? Et la Bolivie et tant d'autres lieux où le prolétariat se bat ou reçoit les coups les plus durs ? Quelle réponse, même minime, a-t-on essayé d'intégrer au niveau international ?
Comment faire pour résoudre cela ? Comment définir des critères pour nous reconnaître afin d'éviter que, dès le départ, la proposition pour commencer à dépasser la situation actuelle ne soit pas mort-née ? (parce qu'elle serait si ambiguë qu'elle serait une "auberge espagnole" ou qu'elle serait si stricte que seuls entreraient ceux qui réalisent déjà un travail ensemble ?) Pour nous, ce critère pour nous reconnaître c'est la pratique. Et c'est de celle-ci que la seconde partie de la proposition va traiter. Même si ni cette pratique, ni rien d'autre ne peut éluder le fondement, l'unique "garantie" : la lutte.
SUR QUELQUES PREVENTIONS
Nous ne savons pas si ce qui précède suffit pour présenter cette proposition et la fonder ou si elle requiert un plus grand développement. Cependant, nous pensons qu'il faut préciser quelques préventions.
Beaucoup demanderont sûrement : avec qui, jusqu' où et comment va-t-on se regrouper dans la perspective internationaliste prolétarienne ? Comment la déterminer ? Qui doit le faire ? Il est évident que
PROPOSITION INTERNATIONALE
Avec l'objectif de :
- contribuer à modifier la situation actuelle de faiblesse de petites forces révolutionnaires et classistes éparpillées de par le monde pour augmenter les possibilités d'action dans la lutte de classe ;
- de consolider et d'élargir ce qui est aujourd'hui des convergences sporadiques, dans la perspective d'organiser et de centraliser une tendance internationaliste prolétarienne qui, avec ses limites et des erreurs, existe aujourd'hui, nous proposons de promouvoir :
1) une réponse coordonnée face à certaines attaques du capital (exemple : dans la question des mineurs anglais, des travailleurs en Afrique du Sud, en Iran-Irak etc...) : tracts et campagnes communes, informations politiques, moments de relations effectives et d'orientations face aux questions concrètes et graves qui touchent le prolétariat mondial ;
2) une information internationale :
a- des luttes ouvrières, en faisant de la propagande en fonction des possibilités, sur les plus importantes qui se déroulent dans chaque région (ou pays) pour les répercuter ailleurs et pour renforcer la réalité de 1'internationalisme prolétarien et la fraternité prolétarienne ;
b- des différents groupes politiques, non seulement des participants à la proposition mais aussi des ennemis, car c'est un élément nécessaire pour la lutte politique contre eux ;
c- de l'expérience historique, des textes et des documents produits dans la longue lutte du prolétariat contre le capital et toute exploitation ;
3) la polémique théorico-politique en vue de prises de positions communes et comme contribution au développement d'une politique révolutionnaire.
Pour ceux qui non seulement partagent cet ensemble de points mais qui se retrouvent effectivement en accord avec une pratique qui mette en avant tous les points de cette proposition -en particulier le point (action commune)-, il est vital d'organiser la discussion. Et pour ceux-là uniquement nous proposons deux choses :
4) l'organisation internationale de la correspondance, ce qui implique la création d'un réseau fluide d'échange et de communication qui doit être une des bases matérielles pour le point 7 ;
5) une revue internationale qui ne doit pas être conçue comme un ensemble de positions politiques des différents groupes réunies sous une couverture "collective". Au contraire, elle doit être un instrument pour consolider l'activité réalisée en commun, pour fonder et propager les positions partagées et, bien sûr, pour développer la discussion publique nécessaire sur les questions vitales qui touchent aux tâches du moment, aux activités proposées et sur des thèmes "ouverts" considérés d'un commun accord comme étant nécessaire à inclure ;
6) dans la mesure où les accords le permettent, stimuler la participation d'autres groupes dans la presse et vice versa ainsi que la diffusion de textes des groupes intervenants ;
7) tendre à créer une discussion interne commune ; c’est-à-dire ne pas se limiter à la polémique "officielle et publique" de groupe à groupe, mais aussi à la discussion des communistes face aux problèmes "ouverts".
Toutes les activités et toutes les décisions que
- prendront les groupes intervenants seront prises d'un commun accord, c'est-à-dire à l'unanimité.
A QUI FAISONS-NOUS CETTE PROPOSITION ?_
1- A ceux qui, dans le monde, réalisent une lutte contre les attaques du capital, contre toutes les guerres impérialistes ou inter bourgeoisies, contre tous les Etats bourgeois (quelles que soient leur forme ou couleur) avec pour objectif la dictature de la classe ouvrière contre la bourgeoisie, son système social et contre toute forme d'exploitation ;
2- A ceux qui n'appuient aucun secteur bourgeois contre un autre, mais qui luttent contre tous, qui ne défendent pas des fronts interclassistes ni n'y adhèrent ou participent ;
3- à ceux qui assument dans la pratique que "les ouvriers n'ont pas de patrie" ; phrase consacrée qui ne dit pas seulement que les ouvriers ne peuvent pas défendre ce qu'ils n'ont pas, mais qu'on "peut" et qu'on "doit" intervenir dans les luttes et les tâches qui se posent dans les différents pays du monde, en dépit du fait que, du point de vue bourgeois, cette intervention puisse être considérée comme une intromission et contre le "droit des nations à l'auto-détermination". Droit qui est revendiqué et défendu à chaque fois que le prolétariat révolutionnaire ou ses avant-gardes renforcent les liens internationaux face à leur ennemi de classe, droit qui est foulé aux pieds à chaque fois qu'il s'agit de réprimer et de massacrer les mouvements révolutionnaires ;
4- Et justement pour cela, à ceux qui luttent contre les politiques de "défense de l'économie nationale" de relance économique, de "sacrifices pour résoudre la crise", à ceux qui n'avalisent pas les politiques d'expansion de leur propre bourgeoisie même quand celle-ci subit des attaques économiques, politiques ou militaires ; à ceux qui luttent toujours contre toute la bourgeoisie, tant la locale comme celle étrangère.
5- A ceux qui combattent les forces et les idéologies qui prétendent enchaîner les prolétaires à l'économie et la politique d'un Etat national, et les désarmer sous prétexte de "réalisme" et de "moindre mal";
6- A ceux qui ne se donnent pas comme but de "récupérer" ou "reconquérir" les syndicats mais, au contraire, les caractérisent comme des instruments et des institutions de la bourgeoisie et son Etat -raison pour laquelle ils ne peuvent aucunement représenter les intérêts immédiats et encore moins historiques du prolétariat, ni être perméables aux intérêts révolutionnaires de la classe.
7- A ceux qui sont d'accord qu'une des tâches sur ce terrain est de mener jusqu'au bout la bataille contre la ligne politique de collaboration de classes soutenue par les syndicats et de contribuer à rendre irréversible la rupture entre la classe les syndicats.
8- A ceux qui dans la mesure de leurs possibilités contribuent à renforcer toutes les tentatives d'unification du prolétariat pour s'affronter, même partiellement, au capital, toutes les tentatives d'extension, de généralisation et d'approfondissement des luttes de résistance contre le capital.
9- A ceux qui défendent la lutte contre toutes les variantes de la répression capitaliste, tant celle exercée par les forces militaires officielles (étatiques) de l'ordre, comme celle de collègues civils de droite et de gauche du capital. A ceux qui dans la mesure de leurs possibilités, collaborent avec les groupes qui subissent des coups de la répression.
10-A ces avant-gardes qui, dans la lutte contre la bourgeoisie et son Etat,combattent implacablement ceux qui se limitent à critiquer une des formes qu' assume la dictature de la bourgeoisie (la plus violente, militaire en fait) et défendent la démocratie ou luttent pour son développement.
11-Dans ce sens, dans l'optique bourgeoise fascisme-antifascisme, à ceux qui dénoncent le caractère de classe bourgeois des fronts antifascistes et de la démocratie, et posent la nécessité de lutter pour la destruction de l'Etat bourgeois, peu importe sous quelle forme il se présente, avec l'objectif d'abolir le système de travail salarié et d'éliminer mondialement la société de classes et toute forme d'exploitation.
12-A ceux pour qui l'internationalisme prolétarien implique, en premier lieu, la lutte contre sa propre bourgeoisie, le défaitisme révolutionnaire en cas de guerre qui ne soit pas la guerre de classe du prolétariat contre la bourgeoisie et pour la révolution prolétarienne mondiale.
13- A ceux qui, au-delà des différentes théorisations sur le parti, sont d'accord sur le fait qu'il sera international dès sa naissance, ou ne sera pas.
14- Enfin, à ceux qui, en accord avec leur force et leur situation, définissent leurs tâches dans la lutte contre la bourgeoisie orientées vers deux aspects fondamentaux :
a) impulser le développement de l'autonomie de classe du prolétariat ;
b) contribuer à la construction et au développement de la politique internationaliste prolétarienne et de son parti mondial.
C'est-à-dire que, si en fonction des situations particulières,les moyens, les tâches et les priorités peuvent revêtir des formes différentes, toutes doivent être en relation avec une seule perspective : la constitution de la classe ouvrière en force mondiale pour détruire le système capitaliste.
ECLAIRCISSEMENTS FINAUX
Nous croyons que les formulations antérieures peuvent et doivent être améliorées, corrigées, complétées. Nous n'allons pas défendre au pied de la lettre cette proposition, mais son sens général.
Dans les premières discussions que nous avons eues sur la situation actuelle et sur comment commencer à la changer, il y a eu des camarades qui ont manifesté un certain pessimisme sur la réception qu'elle recevrait et les possibilités de sa réalisation.
Nous croyons que, face aux coups terribles que la bourgeoisie porte contre le prolétariat dans sa recherche, parfois désespérée, de résoudre ses problèmes, que, face aux possibilités (et aux réalités) de la guerre inter bourgeoisies, que face aux massacres de travailleurs, d'enfants et de vieux, qui se répètent dans diverses parties du monde, et que face à la montagne toujours croissante des tâches qui s'imposent aux révolutionnaires à l'heure actuelle, la politique de secte, les mesquineries, les "laisser pour plus tard", et la défense implicite ou explicite de l'actuel "statu quo" ne conviennent pas.
La reconnaissance de la situation actuelle doit se traduire dans une initiative politique capable de récupérer le terrain perdu et de dépasser les graves faiblesses. Pour cela, l'engagement commun doit être la lutte pour un changement radical dans les relations internationales entre révolutionnaires, c'est-à-dire passer du simple échange de positions (parfois même pas) à la prise de positions - communes face à 1'attaque de la bourgeoisie contre le prolétariat, aux coordinations indispensables orientant la réflexion et le débat sur des questions qui consolident une perspective commune.
Parmi les "objections" qui peuvent exister par rapport à la viabilité de cette proposition, il y a celle de comment la concrétiser ?
Ici, se trouvent cinq points pour, si on est d'accord avec tous, étudier comment organiser leur réalisation. Nous ne prétendons pas ici donner une réponse à chacune des questions et à chaque problème, mais manifester un engagement de lutte pour sa concrétisation.
Il est évident que, compter sur une exécution et une rapidité pour certaines choses, implique des rencontres physiques. Nous ne croyons pas que ce soit absolument nécessaire, c'est à dire qu'actuellement il nous parait difficile d'y arriver, au moins pour ceux d'entre nous qui vivons dans cette région du monde.
A l'heure actuelle, nous ne voyons pas comment réaliser une réunion vraiment internationale : voyager à l'étranger est pour nous (économiquement) interdit. Un voyage de plus de 8 000 kms équivaut à plus de quinze salaires mensuels (plus de vingt, si nous prenons le minimum défini par le gouvernement).
C'est pour cela que nous estimons que, dans un premier temps, les rapports, les discussions, au moins entre les non-européens et ceux-ci, se feront par correspondance. Cela nous retardera, rendra encore plus difficile la tâche, mais elle n'est pas impossible, loin de là (une lettre d'Europe par exemple, si il n'y a pas de grève, met de 15 à 20 jours).
Les conditions de sécurité (celui qui a confiance dans la légalité n'est pas seulement un crétin ingénu, mais un danger pour les révolutionnaires) posent aussi des obstacles, mais ils peuvent et doivent être résolus.
La langue aussi présente des inconvénients. De notre côté, et jusqu'à maintenant, la seule dans laquelle nous pouvons écrire est l'espagnol. Certains peuvent lire avec difficultés l'italien, le portugais et l'anglais. Avec de l'imagination, quelqu'un pourra comprendre un peu de français, mais rien à faire avec l'allemand. Les autres langues "n'existent pas". En tenant compte de cela, ce qui viendra en castillan n'aura pas la même diffusion, ni la même rapidité que les autres langues dans l'ordre établi.
Pour terminer, l'initiative présentée est exposée dans sa partie fondamentale. Ceux qui se montrent intéressés ou sont d'accord avec, recevront une partie dite "plus organisatrice", c'est-à-dire comment nous voyons, nous, pouvoir la réaliser et la concrétiser.
A tous ceux qui nous écriront, nous garantissons qu'ils recevront une copie de toutes les réponses reçues. L'organisation postérieure de la correspondance, des discussions, etc. se fera avec ceux qui sont d'accord et dépendra de la manière avec laquelle ils s'entendront entre eux.
A ceux qui sont d'accord avec l'esprit de la proposition, nous leur demandons sa diffusion et le détail des groupes (si possible avec leur adresse) à qui ils ont fait parvenir cette convocation.
Uruguay, février 1986.
Note du CCI. : Nous ne publions pas une "note d'éclaircissement" en post-scriptum par manque de place. Cette note a été rédigée après la réunion en mars 1986.Les camarades précisent leur proposition quant à l'aspect "technique" et la répartition des articles. Ils proposent une division en trois parties de la revue "une commune à tous les groupes intervenants élaborées d'un commun accord entre tous qui expliquerait et/ou fonderait les positions partagées. Une seconde partie, où le SUJET serait choisi d'un commun accord et les positions seraient individuelles. Et une troisième partie où le sujet serait choisi librement par chaque participant,où il pourrait impulser la discussion de thèmes qu'il considère importants et qui -selon lui- ne sont pas pris ou considérés correctement par les autres. Ou un sujet"nouveau" ou une argumentation particulière.
Nous considérons comme fondamentale 1'inclusion des TROIS PARTIES dans cette proposition internationale. (Emancipacion Obrera et Militancia Clasista Revolucionaria)
REPONSE DU CCI
Chers camarades
Nous venons juste de prendre connaissance de votre brochure d'appel : "Proposition Internationale à tous les partisans de la révolution prolétarienne mondiale".
Après une première lecture et discussion, nous tenons, avant toute chose, à saluer l'esprit qui anime votre "Proposition" à laquelle nous ne pouvons qu'adhérer avec détermination.
Nous ne pouvons que souscrire au constat que vous faites non seulement de l'extrême faiblesse dans laquelle se trouve le mouvement révolutionnaire aujourd'hui -son extrême faiblesse numérique, politique, et plus encore, organisationnelle- mais surtout de l'immense dispersion et isolement des faibles groupes qui s'en réclament. Comme vous, nous pensons qu'une des premières tâches -voire même la première tâche aujourd'hui- de chaque groupe se situant vraiment sur le terrain révolutionnaire du prolétariat consiste à oeuvrer de toutes ses forces pour mettre fin à cet état déplorable, à réagir vigoureusement contre la dispersion et l'isolement, contre l'esprit sectaire de chapelle, pour le développement de liaisons, de contacts, de discussions, de regroupements et d'actions communes entre les groupes, à l'échelle nationale et internationale. Ceux qui, parmi ces groupes, ne ressentent pas cette nécessité -et ceux-là existent malheureusement- montrent leur incompréhension de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et, de ce fait, leur tendance à se scléroser.
Qu'un groupe en Argentine découvre à son tour cette nécessité urgente -ce qui est tout à son honneur- n'est pas pour nous surprendre : 1°) parce que le fait qu'il ait ressenti cette nécessité prouve la vitalité révolutionnaire qui est la sienne et 2°) parce que nous avons retrouvé cette même préoccupation dans d'autres groupes qui ont surgi récemment tel le groupe Alptraum au Mexique ou encore celui des "Communistes Internationalistes" en Inde.
A quoi est due la constatation de cette nécessité précisément aujourd'hui ? Pour le comprendre il ne suffit pas de dire que ce n'est pas "d'un coup" que surgit, une fois encore, le cri anxieux des minorités révolutionnaires qui cherchent à rompre le cordon sanitaire tendu par le capital ; il ne suffit , pas de dire que tant dans les périodes de montée de la lutte de classe que dans les moments de la contre-révolution la plus violente ces minorités "découvrent^ l'une après l'autre, ce que signifient l'isolement, la faiblesse de leurs petites forces, une faiblesse non seulement numérique, sinon fondamentalement politique...". S'il est vrai que c'est de tout temps que les révolutionnaires s'efforcent de rompre le "cordon sanitaire" de la bourgeoisie visant à les disperser et à les isoler de leur classe, on ne peut mettre sur le même plan "les périodes de montée de la lutte de classe" et "les moments de la contre-révolution la plus violente".
Sans tomber dans le fatalisme, l'expérience historique de la lutte de classe nous enseigne qu'une période de recul et de défaites profondes du prolétariat entraîne inévitablement une dispersion des forces révolutionnaires et la tendance à leur isolement. La tâche qui s'impose alors aux groupes révolutionnaires est celle de chercher à limiter autant que possible l'avalanche de l'ennemi de classe afin d'empêcher que celle-ci ne les emporte vers le néant. Dans une certaine mesure, l'isolement, dans une telle situation, est non seulement inévitable mais nécessaire pour leur permettre de mieux résister à la violence momentanée du courant et au risque d'y être emporté. Ce fut le cas, par exemple, de l'attitude politique de Marx et Engels dissolvant la Ligue Communiste au lendemain des violentes défaites subies par le prolétariat durant la tourmente sociale de 1848-51, dissolvant la 1ère Internationale après l'écrasement sanglant de la Commune de Paris, de même que celle de Lénine et Luxembourg au moment de la faillite de la 2ème Internationale lors du déclenchement de la première guerre mondiale. On peut citer également en exemple la constitution et l'activité de la Fraction de gauche italienne après la banqueroute de la 3ème Internationale sous la direction stalinienne.
Toute autre se présente l'activité des groupes révolutionnaires dans une période de montée de la lutte de classe. Si, dans une période de recul, les groupes révolutionnaires nagent à contre-courant, et donc forcément sur les bords et par petits paquets, dans une période de montée, il est de leur devoir d'être dans le courant et le plus massivement, le plus internationalement organisés possible. Les groupes révolutionnaires qui ne le comprennent pas, qui n'agissent pas dans ce sens, soit parce qu'ils ne comprennent pas la situation, la période dans laquelle se trouve la lutte de classe et les perspectives de sa dynamique, soit parce que, ayant difficilement survécu à la période de recul et de dispersion, ils se sont plus ou moins sclérosés, se trouvent alors incapables d'assumer la fonction pour laquelle la classe les a fait surgir.
Le sectarisme que vous dénoncez à juste titre avec tant de force n'est, au fond, rien d'autre que la survivance de la tendance à se replier sur soi-même correspondant à une période de recul. Hisser cette tendance à la hauteur d'une théorie et d'une pratique, à un esprit de chapelle, surtout dans une période de montée, est le signe d'un processus de sclérose extrêmement dangereux et finalement mortel pour tout groupe révolutionnaire.
Seules une analyse et une compréhension justes de la période ouverte à la fin des années 60 avec l'éclatement de la crise mondiale du capitalisme décadent et le resurgissement de la lutte de classe d'une nouvelle génération du prolétariat n'ayant pas connu la défaite et gardant ainsi toutes ses potentialités et combativité permet de comprendre la nécessité impérieuse qui se pose aujourd'hui aux groupes révolutionnaires existant dans le monde et surgissant dans divers pays : celle de s'engager consciemment dans la voie de la recherche des contacts, de l'information, de la discussion, de la clarification, de la confrontation des positions politiques, de prises de position et d'actions communes entre les groupes s'engageant résolument dans un processus de décantation et de regroupement. Cette voie est la seule qui mène à la perspective de l'organisation du futur parti mondial du prolétariat. Cette compréhension de la période et de ses exigences est aussi la condition majeure pour combattre efficacement le sectarisme et ses manifestations qui sévissent aujourd'hui encore dans le milieu révolutionnaire.
Nous nous sommes attardés longuement sur cette question, non pour critiquer mais pour appuyer votre "Proposition" en lui apportant une argumentation que nous pensons susceptible de renforcer encore son fondement. La lutte contre la dispersion et l'isolement, la lutte contre le sectarisme ont toujours été et restent une préoccupation majeure du CCI depuis sa constitution. Retrouver cette préoccupation aujourd'hui venant d'un groupe aussi isolé que le vôtre ne peut que nous réjouir et renforcer notre conviction de sa validité. C'est pourquoi nous nous proposons de traduire et de publier sans tarder votre texte dans le prochain numéro de notre Revue Internationale en français et en en anglais (et probablement ultérieurement dans les Revues Internationales en langues espagnole et italienne lors de leur parution). Nous sommes convaincus que vous ne verrez aucun inconvénient à cette publication (bien entendu, nous ne donnerons pas, pour des raisons de sécurité, votre adresse sans une autorisation explicite de votre part).
Cette préoccupation de la nécessité de rompre avec la dispersion et l'isolement des groupes révolutionnaires, de même que la conviction de sa validité, ont été à la base de tentatives telles que les trois conférences internationales des groupes révolutionnaires impulsées par nous et Battaglia Comunista durant les années 1977 à 1980. Ces conférences, qui auraient pu devenir un lieu de rencontre et un pôle de référence et de regroupement pour de nouveaux groupes surgissant dans différents pays, ont échoué en se heurtant justement au sectarisme de groupes comme Battaglia Comunista pour qui ces conférences devaient rester muettes, être un lieu uniquement de confrontation de groupes à la recherche de recrutement et de "pêche à la ligne". Sur notre insistance, les comptes rendus de ces Conférences ont été publiés en français, anglais et italien. Nous nous ferons un devoir de vous les communiquer au plus vite.
Le besoin urgent de rompre avec 1'éparpillement et l'isolement n'est certes pas une tâche facile de même qu'il ne peut se réaliser du jour au lendemain. Pour autant, cela ne constitue pas une raison pour abdiquer mais, au contraire, cette difficulté même devrait stimuler les efforts de chaque groupe révolutionnaire digne de ce nom de s'y engager résolument.
Nous ne pouvons, dans le cadre de cette lettre, nous livrer à un examen détaillé de chaque paragraphe et encore moins de chaque formulation. Comme' vous le dites vous-mêmes, ce texte ne prétend ni être complet ni définitif .Nous aurons largement le temps de discuter de telle ou telle formulation, de tel ou tel argument. Pour le moment, ce qui importe c'est le principe, la démarche-même qui sous-tend votre "Proposition". C'est là-dessus que porte notre accord. Toutefois, il faut retenir deux questions fondamentales que soulève cette "Proposition" :
1°) A qui s'adresse une telle "Proposition" ?
Pour répondre à cette question, il est évident que nous recherchons la participation la plus large possible des groupes authentiquement révolutionnaires,, même si des divergences sur des points particuliers mais secondaires existent entre ces groupes. Cependant, il ne s'agit pas de réunir n'importe qui, ce qui donnerait l'image d'un panier de crabes et constituerait une démarche négative, une entrave et non un renforcement du mouvement révolutionnaire. Il n'existe pas, surtout au stade actuel du mouvement -avec la dispersion et les différents degrés de maturité des groupes existants- de critères discriminatoires et sélectifs pouvant garantir, d'emblée, de façon absolue, une telle sélection. Mais il existe -et on doit pouvoir les formuler- un minimum de critères permettant d'établir un cadre général dans lequel les groupes qui s'y inscrivent puissent adhérer tout en maintenant des positions qui leur sont propres mais qui restent néanmoins compatibles avec ce cadre. Il nous faut rejeter tant le monolithisme que le rassemblement de forces fondamentalement hétérogènes sur la base de positions politiques vagues et incohérentes.
Dans votre chapitre;"A qui faisons-nous cette proposition ?vous essayez de donner une réponse en énumérant longuement (peut-être trop longuement) certaines positions devant servir de critères. Quelles que puissent être les améliorations toujours possibles dans leurs formulations, ces positions erronées sont, dans leur fond politique, absolument juste, à notre avis.
Cependant, le manque de prise de position claire et explicite sur des questions très importantes peut inquiéter. Nous en citerons quelques-unes :
- le rejet de toute participation aux campagnes électorales dans la période actuelle du capitalisme décadent ;
- la nécessité de se concevoir et de se situer dans la continuité de l'histoire du mouvement ouvrier, de ses acquis théoriques et politiques (non pas une continuité passive et de simple répétition, mais une continuité dynamique et de dépassement étroitement liée aux expériences et à l'évolution des exacerbations de toutes les contradictions du système capitaliste mettant désormais à l'ordre du jour la nécessité objective de sa destruction). Ceci implique la reconnaissance du marxisme comme la théorie révolutionnaire du prolétariat, le fait de se revendiquer des apports successifs des 1ère, 2ème et 3ème Internationales et des gauches communistes qui en sont issues ;
- la reconnaissance, sans ambiguïté, de la nature prolétarienne du parti bolchevik (avant sa banque route et son passage définitif dans le camp de la contre-révolution) et de la révolution d'octobre. ?
Il est surprenant de ne trouver, dans votre tex- i te, aucune référence à ces questions, pas plus qu'à la reconnaissance des Conseils Ouvriers, "forme enfin trouvée" de l'organisation unitaire de la classe en vue de la réalisation concrète de la révolution prolétarienne. Nous nous étonnons également de ne trouver aucune mention sur la question du terrorisme, des guérillas (urbaines ou non), et sur le rejet catégorique de ce type d'actions (armes propres aux couches désespérées de la petite-bourgeoisie, du nationalisme, et qui sont efficacement entretenues et manipulées par tous les Etats), non pas au nom du pacifisme qui n'est que ' l'autre face de la même médaille, mais au nom de son inefficacité et de sa prétention, , au mieux, à réveiller et, au pire, à se substituer à la seule violence de classe adéquate : celle de la lutte ouverte, massive et généralisée des grandes masses de la classe ouvrière. Votre silence est d'autant plus étonnant que vous vivez et luttez dans un continent et un pays qui ont tristement connu ce type d'actions aventuristes, les tupamaros et autres guérillas guévaristes.
2°) La deuxième question se rapporte à vos propositions concrètes de réalisation de ce grand projet, notamment à la publication d'une revue commune aux groupes adhérents et au mode de fonctionnement d'une telle coordination. Commençons par ce dernier point. Vous proposez l'unanimité comme règle de toute activité et décision. Une telle règle ne nous semble par forcément la plus appropriée. Elle comporte le risque soit de l'exigence d'un accord constant -et donc, du monolithisme-, soit de la paralysie de l'ensemble des groupes participants à chaque fois que l'un d'entre eux se trouve en désaccord. Le point 5 de votre "Proposition" porte sur l'éventualité d'une publication commune. Il est inutile d'ouvrir une discussion sur la structure d'une telle publication (division en 3 parties, etc...) puisque le projet-même d'une telle publication immédiate nous semble, en tout état de cause, largement prématuré. Une publication commune à de nombreux groupes présuppose deux conditions :
a) une connaissance plus approfondie de la trajectoire politique des différents groupes et de leurs positions actuelles, un constat de l'intégration effective de ces positions dans le cadre des critères élaborés de même que leur tendance à converger à plus ou moins long terme ;
b) et sur cette base, une avancée sérieuse de l'expérience d'une activité commune permettant à ces groupes de s'engager davantage sur le plan organisationnel avant de pouvoir affronter vraiment les difficultés inhérentes à une publication (questions politiques et techniques de la nomination d'une rédaction responsable, question de langues dans lesquelles doit être publiée une telle revue et, enfin, questions d'administration et de ressources financières).
Aucune de ces deux conditions n'étant actuellement remplie, ce point de la "Proposition" nous semble, de ce fait, irréalisable pour le moment et, en conséquence, il serait erroné de vouloir en faire un point central. Il serait plus judicieux et davantage à notre portée de nous contenter, pour le moment, de la tâche réalisable consistant à assurer la circulation de textes de discussion entre les groupes adhérents sur des thèmes importants et, autant que possible, convenus en commun.
Reste la proposition de 1'information réciproque, de l'échange de publications, de favoriser réciproquement la diffusion de la presse des différents groupes adhérents, la possibilité de publication d'articles dans la presse des autres groupes et, enfin, l'éventualité de prises de position communes sur des événements importants et, donc, l'éventualité d'une intervention publique commune. Cette partie de votre proposition générale peut être réalisée dans une échéance relativement brève, toujours dans le souci de rompre l'isolement, de resserrer les contacts entre les groupes révolutionnaires existants et surgissants, de développer les discussions et de favoriser un processus de décantation et de regroupement des révolutionnaires.
En un mot, mieux vaut partir avec prudence et arriver au but que de partir au galop, de s'essouffler et de s'arrêter à mi-chemin.
Avec nos salutations communistes.
[1] [153] Nous ne publions pas l'adresse de ces groupes; pour tout contact, les lecteurs peuvent écrire à la boîte postale de R.I. qui transmettra.
[2] [154] "Emancipacion Obrera" a du subir la répression et la violence du MAS, groupe trotskyste qui a appelé à participer à la guerre des Malouines, appuyant les généraux
Géographique:
- Argentine [155]
- Amérique Centrale et du Sud [156]
Courants politiques:
La Gauche hollandaise (1900-1914) : naissance d'un courant révolutionnaire en Europe (1903-1907) 2ème partie
- 3215 reads
Nous publions, dans ce numéro de la Revue Internationale, la suite de l'étude sur 1'histoire de la Gauche hollandaise. Cette partie de l'étude embrasse la période qui va de 1903 à 1907. L'histoire de la Gauche hollandaise est très mal connue du public et, à ce titre, l'étude que nous publions apporte une documentation qui ne pourrait qu'être fort appréciée par nos lecteurs.
L'histoire de la Gauche hollandaise comporte nécessairement beaucoup de particularités. Néanmoins, pour bien la comprendre, il est nécessaire de ne jamais perdre de vue qu'elle est partie intégrante d'un mouvement général, celui de la classe ouvrière internationale, de même qu'il est nécessaire de la situer dans le contexte de la période, c'est-à-dire à un moment précis de 1 'histoire du mouvement ouvrier,
A la lecture de cette étude, il se dégage deux enseignements capitaux :
1) l'extrême difficulté de la classe ouvrière à s'organiser comme classe distincte et à former ses propres organisations ;
2) la fragilité de ces organisations traversées par des crises qui les secouent périodiquement.
Le premier point se rattache à la nature-même de la classe ouvrière, nature qui la distingue de toutes les autres classes qui, à certains moments de 1'histoire humaine, furent appelées à jouer un rôle révolutionnaire en vue de la transformation de la société. Toutes les autres classes fondaient leur pouvoir politique sur la base d'un pouvoir économique préalablement conquis. Rien de tel pour le prolétariat qui n'a pas d'autre pouvoir économique que celui d'être complètement dépossédé et d'être contraint de vendre sa force de travail, de subir 1'exploitation au profit d'autrui. Classe révolutionnaire et exploitée à la fois, la classe ouvrière ne peut fonder ses organisations que sur la base d'une prise de conscience de ses intérêts immédiats et historiques sous l'aiguillon de l'oppression qu'elle subit par la classe exploiteuse.
Le deuxième point se rattache au fait que ses organisations, reflétant l'évolution du rapport de forces entre les classes dans leur lutte, sont constamment soumises à la pression de 1'idéologie régnant dans la société, idéologie qui est toujours celle de la classe dominante,
La raison de l'apparition de tendances révolutionnaires de gauche dans les organisations de la classe ouvrière trouve sa source dans la réaction à cette pénétration inévitable de 1'idéologie bourgeoise dans la classe. Chercher une organisation à jamais garantie contre cette pénétration, chercher une organisation révolutionnaire pure est aussi utopique que de chercher une humanité absolument invulnérable aux attaques microbiennes environnantes: C'est faire la politique de l'autruche cachant sa tête dans le sable pour ne pas voir le danger qui la guette. Les révolutionnaires n'ont que faire des illusions sur les organisations parfaites et infaillibles". Ils savent que ce n'est que la lutte -et une lutte incessante, intransigeante contre les influences bourgeoises environnantes- qui constitue la seule garantie pour les organisations sécrétées par la classe de rester un instrument dans la voie de la révolution.
Le chapitre que nous publions est un témoignage de cette lutte farouche menée par le courant révolutionnaire international du prolétariat à un moment de l'histoire et dans un pays donnés.
LA LUTTE CONTRE L'OPPORTUNISME
Comme bien souvent dans l'histoire du mouvement ouvrier, la lutte pour la défense des principes révolutionnaires s'est d'abord placée sur un terrain pratique. La lutte contre l'opportunisme au sein du Parti hollandais s'est centrée sur deux questions qui en apparence semblent aujourd'hui, avec le recul historique, anodines : la question paysanne et la question scolaire.
L'importance de la question paysanne était évidente dans un pays comme la Hollande, où le retard indus triel maintenu par l'existence d'un capital commercial spéculatif investi dans les colonies s'accompagnait d'un archaïsme des structures sociales à la campagne. Bien qu'en début de mutation, l'agriculture -en dehors de l'élevage- restait arriérée, avec une masse encore considérable de petits paysans tout aussi arriérés, particulièrement en Frise, le "fief" de Troelstra. A côté de ces paysans, on trouvait une masse d'ouvriers agricoles qui ne possédaient nulle terre et vendaient leur force de travail à des paysans, propriétaires ou fermiers. Pour s'attirer les voix des paysans auxquels le SDAP devait en grande partie ses députés, il fut proposé en 1901 de modifier le programme du Parti. Au lieu de l'abolition de l'ordre existant par la socialisation du sol et donc la suppression de la propriété privée, le nouveau programme proposait une régulation du "contrat de fermage".Ce qui était le pire du point de vue du programme socialiste se trouvait dans le point consacré aux ouvriers agricoles. Au lieu de rattacher leur lutte à celle des ouvriers des villes et de souligner leurs intérêts communs avec le reste du prolétariat, le programme proposait ni plus ni moins que leur transformation en paysans propriétaires :
"La disposition du sol et du matériel agricole contre un certain prix aux ouvriers* agricoles, pour leur assurer une existence autonome."
Cependant, sous la pression de la Gauche qui s'appuyait sur Kautsky, alors à gauche sur la question agraire, quatre ans plus tard, en 1905, au congrès de La Haye, les deux points furent rayés du programme agraire du partie était le premier conflit et la première victoire du marxisme. Mais aussi son unique victoire."
En effet la lutte contre le réformisme ne faisait que commencer et connut une étape nouvelle lors des débats au Parlement hollandais sur les subventions à accorder aux écoles religieuses. Le combat du marxisme contre une telle manoeuvre de la bourgeoisie conservatrice n'avait rien de commun avec l'anticléricalisme des radicaux et des socialistes français à la même époque, qui constituait surtout une diversion. Le soutien aux confessions religieuses s'expliquait essentiellement, aux Pays-Bas, par la montée de la lutte de classe, laquelle entraînait une réaction idéologique de la bourgeoisie conservatrice au pouvoir ([1] [157]). "De façon classique dans le mouvement ouvrier de l'époque, la Gauche constatait que : "lorsque surgit la lutte de classe du prolétariat, les libéraux comme partout, considèrent toujours plus la religion comme un rempart nécessaire au capitalisme, et ils abandonnent peu à peu leur résistance aux écoles religieuses."
Quelle ne fut pas la surprise des marxistes, groupés autour de la revue "Nieuwe Tijd", de voir le révisionnisme s'afficher publiquement au Parlement, en appelant à voter pour les subventions aux écoles religieuses. Pire, le Congrès de Groningue de la social-démocratie (1902) abandonnait nettement tout combat marxiste contre l'emprise religieuse sur les consciences. Dans un pays où le poids religieux pour des raisons historiques était très fort sous la triple forme du calvinisme, du catholicisme et du judaïsme, il s'agissait d'une véritable capitulation "Le Congrès constate qu'une plus grande partie de la classe laborieuse aux Pays-Bas exige pour ses enfants un enseignement religieux, et considère comme non souhaitable de s'opposer à elle, parce que la social-démocratie n'a pas à briser -pour des oppositions théologiques- l'unité économique de la classe travailleuse face aux capitalistes croyants et incroyants. "
L'argumentation utilisée, l'unité des ouvriers croyants et incroyants, sous-tendait l'acceptation de l'ordre existant, idéologique et économique. Ainsi, «avec cette résolution, le Parti [faisait] le premier pas sur le chemin du réformisme ; elle [signifiait] la rupture avec le programme révolutionnaire, dont la revendication, séparation de l'Eglise et de l'Etat, a certainement un tout autre sens que l'argent de l'Etat pour les écoles religieuses. " Il est intéressant de noter que la Gauche hollandaise ne se proposait nullement d'encenser l'école "laïque" dont elle dénonçait la prétendue "neutralité.". Elle se situait au-delà d'un faux choix, du point de vue marxiste, entre école "religieuse" et école "laïque". Son but était de se placer résolument sur le terrain de la lutte de classe ; cela signifiait un rejet de toute collaboration, sous quelque prétexte que ce soit, avec une fraction de la bourgeoisie. Les craintes des marxistes devant l'orientation révisionniste du Parti allaient se montrer fondées dans le feu de la lutte ouvrière.
LA GREVE DES TRANSPORTS DE 1903
Cette grève est le mouvement social le plus important qui ait agité avant la première guerre mondiale la classe ouvrière des Pays-Bas. Elle devait laisser de profondes traces dans le prolétariat qui se sentit trahi par la social-démocratie, et dont la partie la plus militante s'orienta encore plus vers le syndicalisme révolutionnaire. A partir de 1903, le processus de la scission entre le marxisme et le révisionnisme était engagé sans possibilité de retour en arrière. A ce titre, la grève de 1903 marque le vrai début du mouvement "tribuniste", comme mouvement révolutionnaire. ,
La grève des transports est d'abord une protestation contre des conditions d'exploitation qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Les ouvriers des chemins de fer subissaient des conditions de travail dignes de la période d'accumulation primitive du capital au début du 19e siècle ([2] [158]). Travaillant 361 jours par an ils ne disposaient vers 1900 que de k jours de congé. D'autre part, le corporatisme particulièrement fort réduisait les possibilités d'une lutte unitaire, par une division en catégories professionnelles. Ainsi, les mécaniciens, les conducteurs de locomotives, les ouvriers de l'entretien des voies avaient leur syndicat propre. Chaque syndicat pouvait déclencher des grèves sans que les autres s'unissent à la lutte. Les syndicats de métier en protégeant soigneusement leur exclusivisme se dressaient comme un obstacle à l'unité massive des ouvriers par-delà leurs différences de qualification ([3] [159]).
Contre de telles conditions, le 31 janvier 1901 surgissait de la base des cheminots, et non des syndicats corporatistes, une grève spontanée. Celle-ci se présente comme une grève de masse : non seulement elle touche toutes les catégories du personnel des transports, mais elle s'étend à tout le pays. Elle est aussi une grève de masses en partant non de revendications spécifiques, mais par solidarité avec les ouvriers du port d'Amsterdam, en grève. Refusant de servir de briseurs de grève, en continuant le travail, les ouvriers des transports empêchaient les tentatives des patrons de faire transiter leurs marchandises par les chemins de fer. Ce mouvement de solidarité, caractéristique des grèves de masse, faisait alors boule de neige : les boulangers et les métallos du matériel de transport donnaient leur appui. Mais l'originalité du mouvement -qui ne réussit pas à s'étendre aux autres couches du prolétariat néerlandais- se trouvait incontestablement dans la création d'un Comité de grève élu, surgi de la base et non dé signé par le syndicat des transports et le SDAP, même si leurs membres y participaient.
Par toutes ces caractéristiques, la grève de masse cessait d'être une simple grève catégorielle, purement économique ; elle devenait peu à peu une grève poli tique par une confrontation directe avec l'Etat. En effet, le 6 février, le gouvernement hollandais, par décret du ministre de la guerre, décidait la mobilisation des soldats ; il suscitait d'autre par un organisme, dans lequel étaient actifs les syndicats catholiques et protestants, rassemblant les briseurs de grève. Cette offensive de la bourgeoisie culminait enfin le 25 février par le dépôt d'un projet de loi contre la grève : les grévistes étaient menacés d'emprisonnement et le gouvernement décidait de mettre sur pied une compagnie de transport militaire pour briser la grève.
Mais plus que par les menaces et les mesures gouvernementales, la grève allait être sapée de l'intérieur, par le SDAP de Troelstra. Le 20 février, au cours d'un meeting représentant 60 000» grévistes, et non ouvert -à la différence du comité de grève- Troelsra proposait la création d'un "Comité de défense" composé de différentes organisations politiques et syndicales. Ce Comité était composé de Vliegen, un révisionniste du SDAP, du chef syndicaliste des transports Oudegeest, du NAS et de partisans anarchistes de Nieuwenhuis, ce dernier ayant refusé de participer à un tel organisme. L'orientation allait se révéler néfaste à la conduite de la grève projetée contre les mesures gouvernementales. Vliegen déclara que la grève ne pouvait être proclamée, en l'absence d'une promulgation des décrets du gouvernement Kuyper.
Dans les faits, l'attitude du "Comité de défense" autoproclamé par différentes organisations -et particulièrement celle du SDAP- allait vite se montrer négative. Non seulement l'opposition entre libertaires, partisans de Nieuwenhuis, et social-démocrates, paralysait le "Comité", mais le poids écrasant de Troelstra, qui n'en était pas membre bien que l'ayant suscité en faisait un organisme étranger à la lutte. Troelstra, prétextant la lutte contre "l'aventurisme anarchiste", se prononçait contre la grève politique ; il prétendait que celle-ci -si elle était décidée par les ouvriers des transports en réaction aux "lois scélérates"- ne ferait que renforcer la dureté des lois anti-grève à la Chambre des députés. Ces propos étaient tenus par le quotidien social-démocrate sans en référer ni au Comité de défense ni aux instances du Parti. De façon tangible, cet acte d'indiscipline était la preuve que la direction révisionniste estimait n'avoir aucun compte à rendre devant les ouvriers et les militants du Parti. Elle s'était rendue autonome pour mieux se placer sur le terrain de la conciliation avec la bourgeoisie. La Gauche, par la plume de Pannekoek, critiqua vivement cet acte, qui était le début d'une longue suite d'actes de trahison de la lutte:"Votre attitude molle et hésitante ne peut que servir la classe possédante et le gouvernement." écrivait-il à l'adresse de Troelstra.
C'est lors de la deuxième grève des transports, en avril, que la trahison devint ouverte. Le gouvernement avait fait voter les lois anti-grève interdisant la cessation du travail dans les transports publics. Au lieu d'avoir une attitude énergique, les chefs du Comité de tendance social-démocrate -comme Ouedegeest- se prononcent contre la grève générale de tous les ouvriers aux Pays-Bas. Pourtant, au même moment, se déroulaient des grèves qui donnaient un contexte social plus favorable à la lutte de classe qu'en janvier-février : à Amsterdam, se déroulaient la grève des bateliers, des forgerons, des cantonniers et terrassiers, des métallos ; et les travailleurs communaux s'étaient mis en grève par solidarité.
Néanmoins, sous la pression de la base, la grève générale fut proclamée. Sa faiblesse initiale fut que les réunions des ouvriers des chemins de fer étaient secrètes et non ouvertes par conséquent aux autres catégories de travailleurs. Malgré l'occupation des gares et des voies ferrées par la troupe, ce qui aurait dû développer la généralisation de la grève, celle-ci ne fut pas générale. Elle fut malgré tout spontanée dans son mouvement d'extension : à Utrecht, Amsterdam, les métallos et les maçons se joignirent au mouvement de solidarité. Ni la menace de cinq ans d'emprisonnement pour les "agitateurs" et de deux ans pour les grévistes,, peines prévues par les "lois scélérates", ni la présence de l'armée ne suffisaient à arrêter l'ardeur des ouvriers en grève, qui avaient connu dès janvier "la joie de lutter"
L'ardeur des ouvriers, leur élan furent arrêtés par les décisions prises par les dirigeants social-démocrates du "comité de défense" qui prétendait diriger la lutte. Le 9 avril, Vliegen fait décider la cessation du mouvement de grève. Devant l'incrédulité et la colère des ouvriers des transports, le "Comité" devient introuvable. Lors d'une réunion de masses, ceux-ci empêchent Vliegen de parler aux cris de : "Il nous a trahis !". Même la Gauche est privée de parole : ne faisant aucune distinction entre les révisionnistes et les marxistes, les ouvriers couvrent le discours de Roland-Holst par le cri : "Grève !". Ainsi, l'attitude des chefs révisionnistes allait entraîner pour longtemps un rejet de la social-démocratie, même marxiste, au profit de l'anarcho-syndicalisme, de la part de la classe ouvrière hollandaise.
La grève des transports de 1903 n'a pas de racines purement "hollandaises" ; elle marque un tournant dans la lutte de classe en Europe. C'est en tant que grève de masses spontané qu'elle surgit, devenant une force consciente capable de faire reculer sur le plan politique la bourgeoisie et donnant aux ouvriers un incontestable sentiment de victoire. Mais c'est en tant que grève générale, lancée par les syndicats et les partis, qu'elle échoue.
Elle s'inscrit dans toute une période historique marquée par la combinaison des grèves politiques et des grèves économiques, période qui culmine avec le mouvement révolutionnaire de 1905 en Russie. En effet, comme le souligne Rosa Luxemburg,
"Ce n'est que dans une situation révolutionnaire, avec le développement de l'action politique du prolétariat, que 1'importance et l'ampleur de la grève de masse apparaissent dans 'leur pleine dimension." Plus qu'aucun autre -sauf Pannekoek (cf. infra)- Luxemburg a su montrer dans sa polémique contre les révisionnistes l'homogénéité de la lutte, c'est-à-dire l'identité du phénomène dans sa simultanéité, dans toute l'Europe, Hollande incluse, et jusque sur le continent américain, au début du siècle: "En 1900, c'est la grève de masse des mineurs de Pennsylvanie qui selon les camarades américains, a fait davantage pour la diffusion des idées socialistes que dix ans d'agitation ; en 1900 encore, c'est la grève de masse des mineurs en Autriche, en 1902 celle des mineurs en France, en 1902 encore celle qui paralyse tout l'appareil de production à Barcelone, en solidarité avec les métallurgistes en lutte, en 1902 toujours, la grève de masse démonstrative en Suède pour le suffrage universel égalitaire, la même année en Belgique encore pour le suffrage universel égalitaire également ; la grève de masse des ouvriers agricoles dans l'ensemble de la Galicie orientale (plus de 200 000 participants) en défense du. droit de coalition, en janvier et avril 1903, deux grèves de masse des employés de chemins de fer en Hollande, en 1904 grève de masse des employés de chemins de fer en Hongrie, en 1904 grève démonstrative en Italie, pour protester contre les massacres , en Sardaigne, en janvier 1905, grève de masse des mineurs dans le bassin de la Ruhr, en octobre 1905 grève démonstrative à Prague et dans la région pragoise (100 000 travailleurs) pour le suffrage universel au Parlement de Bohême, grève de masse démonstrative à Lemberg pour le suffrage universel égalitaire au Parlement régional de Galicie, en novembre 1905 grève de masse démonstrative dans toute 1 'Autriche pour le suffrage universel égalitaire au Conseil d'Empire, en 1905 encore grève de masse des ouvriers agricoles en Italie, en 1905 toujours grève de masse des employés des chemins de fer en Italie..."
La grève de masse, en préparant la confrontation politique avec l'Etat, mettait à l'ordre du jour la question de la révolution, non seulement elle manifestait "l'énergie révolutionnaire" et "l'instinct prolétarien" des masses ouvrières -comme le soulignait Gorter après la grève de 1903- mais elle signifiait un profond changement de situation au début du siècle : "Nous avons toutes les raisons de penser que nous sommes entrés maintenant dans une période de combats dont l'enjeu est les institutions et le pouvoir d'Etat ; des combats qui peuvent au fil de vicissitudes diverses, durer des décennies, dont les formes et la durée ne sont pour le moment pas encore prévisibles, mais qui, très vraisemblablement, introduiront à brève échéance des changements fondamentaux dans les rapports de force en faveur du prolétariat, si ce n'est l'instauration de son pouvoir en Europe occidentale."
Ces remarques de Kautsky dans son livre "Le Chemin du pouvoir", la Gauche hollandaise allait les faire siennes contre Kautsky et ses partisans aux Pays-Bas tels Troelstra et Vliegen. La grève de 1903 posait en effet l'alternative "réforme ou révolution" et débouchait dans le SDAP inévitablement sur une confrontation avec les réformistes qui trahissaient non seulement l'esprit révolutionnaire du Parti, mais la lutte immédiate.
L'OPPOSITION DANS LE PARTI (1903-1907)
L'opposition dans le parti allait être d'autant plus vive que les conséquences de l'échec de la grève, sabotée par la direction Troelstra-Vliegen, étaient catastrophiques pour le mouvement ouvrier. Le total des ouvriers licenciés pour fait de grève était d'environ k 000. Le nombre des adhérents du NAS, qui avait pourtant pris une position militante dans la lutte et s'était opposé à Vliegen, tombait de 8 000 en 1903 à 6 000 en 1904. Le SDAP de Troelstra, traînant dorénavant une réputation de trahison, Derdart un nombre considérable d'adhérents : il comptait à la fin de 1903, 5 600 membres contre 6 500 à la fin de l'année 1902.Par contre, signe du reflux voire même de la démoralisation après l'échec de la grève, les syndicats religieux des transports, en particulier catholiques, connurent un rapide essor numérique. Politiquement, le mouvement syndical le plus combatif, le NAS, qui aurait pu devenir l'organisation économique du SDAP, se raccrochait aux positions anarchistes de Nieuwenhuis. Il continua sa chute numérique jusqu'au moment où apparut le mouvement tnbuniste qui 1' influença progressivement (cf. infra)... . Par contre, en 1905, les syndicats socialistes liés au SDAP créaient leur propre centrale syndicale : le NVV (Confédération des syndicats professionnels des Pays-Bas). Celui-ci, fortement influencé par le syndicat réformiste des ouvriers diamantaires de H. Polak, devenait la principale confédération syndicale des Pays-Bas. Dès le départ, le NVV se refusait à contribuer à l'extension de la lutte dans le bâtiment : les années suivantes il allait avoir la même attitude de retrait et de non-solidarité avec les ouvriers grévistes»
Face au développement du réformisme dans le Parti et à son affaiblissement comme parti ouvrier, l'attitude des marxistes fut d'abord modérée. Non seulement ils hésitaient à former une fraction résolue pour conquérir la direction du parti, mais leurs attaques contre Troelstra restaient encore extrêmement prudentes, bien que Troelstra ait par son action trahi la grève, ils hésitaient encore à parler de trahison. Lorsque au cours du 9ème congrès du SDAP, à la fin de 1903, fut discuté le bilan de la grève des transports, Gorter parla en termes très mesurés. Tout en affirmant qu'il était "un adversaire de la direction de Troelstra, non seulement dans cette grève, mais aussi dans les grandes affaires" il hésitait à parler de trahison de la direction :
"De trahison il n'est naturellement pas question, mais bien de la faiblesse de la conception de Troelstra et de ses oscillations permanentes."
Le congrès d'Enschede de 1903 n'eut pas l'effet souhaité par les marxistes du groupe "Nieuwe Tijd". Bien que Troelstra dût abandonner -au profit de Takla rédaction en chef de "Het Volk" ("Le Peuple"), Gorter fut contraint de lui serrer la main au nom de la "solidarité" et de "l'unité" dans le parti, contre "l'ennemi commun" extérieur. Il réussit à faire accroire que Gorter et ses partisans l'attaquaient non politiquement, mais personnellement ; se plaignant qu'on voulait le priver de ses responsabilités de chef, il posa la question de confiance. Au lieu d'apparaître comme l'un des principaux responsables de l'orientation opportuniste du parti, il se présenta comme victime, et comme telle il obtint la "confiance" de l'ensemble du Parti. De cette façon, la direction révisionniste évitait que la discussion s'engage sur les questions vitales de principes et de tactique dans la lutte de classe. Bien que complètement isolée, la minorité marxiste ne capitula pas et s'engagea avec résolution dans le combat. De 1905 à 1907, le courant marxiste se trouva confronté à une contre-offensive rigoureuse des révisionnistes.
a) les conséquences du congrès d'Utrecht de 905
En effet, la fraction parlementaire, qui dirigeait de fait le parti, alla toujours plus loin dans la collaboration avec la bourgeoisie. En 1905, lors des élections pour les Etats provinciaux, la question était posée par les révisionnnistes de soutenir les libéraux contre le gouvernement Kuyper, qui avait brisé la grève des ouvriers des transports. La Gauche, comme celle des autres partis ouvriers d'Europe, ne refusait pas -lors des ballottages électoraux- de soutenir les candidats libéraux qui se prononçaient pour le suffrage universel contre le suffrage censitaire. Dans ce sens, elle fit adopter une résolution, lors du congrès de La Haye en 1905 :
"(le parti) déclare vouloir soutenir lors des ballottages uniquement les candidats qui se prononcent pour l'urgence du suffrage universel, "
Pour les marxistes, il ne s'agissait pas de faire de ce soutien, purement tactique et temporaire, un principe. En aucun cas, comme le souhaitait Troelstra, il ne pouvait être question d'apporter les suffrages ouvriers aux "libéraux de tout aca bit, fussent-ils anticléricaux. D'un point de vue de classe, le combat n'avait pas à être mené contre un parti capitaliste déterminé mais contre le capitalisme comme totalité de façon à empêcher toute con fusion avec les éléments petits-bourgeois et petits- paysans. Il s'agissait d'éclairer les ouvriers sur leur identité :
"Il s'agissait que le parti à chaque occasion mette devant les yeux des ouvriers que leurs ennemis siégeant au Parlement aussi bien au côté gauche qu'au côté droit."
Or, au lieu de respecter la résolution du congrès, la direction du parti, la fraction parlementaire et le quotidien socialiste "Het Volk" laissèrent les électeurs socialistes libres de voter pourquoi leur semblerait bon parmi tous les candidats libéraux en ballottage. Bien que fermes sur des positions qui étaient classiques dans le mouvement ouvrier, les marxistes se trouvèrent isolés de la masse ouvrière. Troelstra joua à fond là-dessus.
Il y eut cependant des réactions dans le parti. Le parti, malgré les événements de 1903, était loin d'avoir succombé au révisionnisme ; il était encore capable de réactions prolétariennes face à la politique de la fraction parlementaire de Troelstra. Le congrès de La Haye de 1905, sans doute aussi la pression des événements révolutionnaires qui agitaient la Russie, nomma un nouveau comité directeur du parti, composé cette fois d'une majorité de marxistes, dont Gorter. Il s'en suivit une opposition entre le nouveau comité et la fraction parlementaire de Troelstra. Celui-ci voulait soutenir le nouveau gouvernement libéral "pour le pousser sur la voie des réformes". Pour le comité directeur, s'appuyant sur le groupe "Nieuwe Tiid", il n'en était pas question. Il s'agissait avant tout de développer l'agitation contre les limitations du droit de grève, quel que fût le gouvernement, libéral ou clérical. Une fois de plus, Troelstra viola la discipline du parti par une prise de position qui condamnait l'agitation ouvrière. Le 9 mars 1906 ouvertement, face aux parlementaires bourgeois, il renia l'action menée par les ouvriers et soutenue par le parti ; et cela malgré son appartenance au comité directeur.
Ce conflit posait une question vitale dans le mouvement ouvrier : est-ce la fraction parlementaire ou le comité directeur, élu par le parti, qui détermine la politique de l'organisation ? Il s'agissait de savoir si le parti était au service d'un groupe incontrôlé de parlementaires menant une politique de collaboration avec la bourgeoisie, ou si ce groupe était étroitement soumis dans son action aux décisions prises par les congrès. Ce conflit d'influence et de décision n'était pas propre aux Pays-Bas. En Allemagne, par exemple, Rosa Luxemburg eut à se battre ([4] [160]) contre la direction parlementaire. Le problème de la réelle direction du parti était celui du maintien de sa nature révolutionnaire. En Russie, après 1905, lorsque les bolcheviks eurent des députés à la Douma d'empire, leur fraction parlementaire se trouva étroitement placée sous le contrôle du comité central ; et ce n'est nullement un hasard si cette fraction fut l'une des rares qui en août 1914 vota contre les crédits de guerre.
Cette opposition entre Troelstra et le comité directeur allait poser la vraie question sous-jacente : réforme ou révolution. Dans une brochure qu'il fit paraître avant le congrès d'Utrecht -où il attaquait la nouvelle direction du parti -Troelstra, selon son habitude, prétendit qu'on l'attaquait personnellement, que la nouvelle centrale marxiste était "doctrinaire" et "dogmatique". Se présentant comme une victime "innocente" de la persécution du groupe de Gorter, il ne pouvait cependant dissimuler le fond de sa pensée : faire du SDAP non un parti internationaliste, mais un parti national. Le parti devait passer par des compromis avec la petite et la grande bourgeoisie non seulement il devait tenir compte des préjugés petit-bourgeois existant dans la classe ouvrière -"le caractère religieux et en partie petit-bourgeois du prolétariat" mais il devait "utiliser les oppositions des groupes bourgeois entre eux". Pour faire accepter cette orientation réformiste, Troelstra n'hésitait pas à afficher une démagogie anti-intellectuels: les marxistes étaient des "ultra-infantiles" voulant transformer le parti en un "club de propagande ". Au rêve marxiste, il fallait opposer la "solide" réalité du Parlement :
"Le parti flottera-t-il au-dessus des travailleurs réels, en s'enracinant dans un prolétariat de rêve ou bien, comme il l'a fait dès le début de son existence et de son action, au Parlement et dans les conseils municipaux, pénétrera-t-il toujours plus profondément dans la vie réelle de notre peuple ?"
Ainsi pour Troelstra, la seule existence possible du prolétariat -qu'il confond d'ailleurs de façon volontaire avec les autres couches "populaires"- jaillissait non plus de la lutte de classe mais du parlement.
Pour parvenir à ses fins -faire du parti, un parti purement parlementaire et national hollandais- Troelstra proposait ni plus ni moins que l'élimination de la direction marxiste, la réorganisation du parti en donnant' pleins pouvoirs à la fraction parlementaire, qui jusqu'alors statutairement n'avait que deux représentants dans le comité directeur. A l'exécutif du comité du parti, élu par les militants, devait se substituer "l'exécutif" de la fraction au parlement ; celle-ci -selon lui- "représente le parti, il est vrai non officiellement, mais de fait, au Parlement, de même dans la politique pratique". Il s'agissait en fait d'établir une véritable dictature de la fraction révisionniste ; elle ne souhaitait rien de moins que diriger tous les organes du parti pour empêcher toute liberté de critique à sa gauche de la tête des marxistes, en vue d'abord de les terroriser et ensuite, si possible, "les faire capituler devant le révisionnisme. Troelstra, après le congrès, pouvait ouvertement menacer Gorter : "si Gorter venait à parler encore une fois de "rapprochement avec la démocratie bourgeoise", la pointe de cette assertion serait extraite par la résolution".
Ce triomphe du diktat révisionniste laissait à présent la voie libre pour une révision du programme marxiste du parti. Une commission de révision du programme fut formée au mépris des règles de fonctionnement du parti : le comité du parti qui avait décidé de nommer la commission le faisait sans mandat du congrès, seule instance suprême à même de décider une révision du programme. La commission, sous l'influence des révisionnistes, ne proposait rien moins que modifier les conditions d'adhésion marxistes au parti : si le parti se basait sur le système de Marx, aucune acceptation de ses soubassements philosophiques matérialistes n'était nécessaire pour adhérer. La porte était ainsi ouverte à des éléments religieux, et même bourgeois, non marxistes.
Le congrès de Haarlem, en 1907, ne fit que confirmer le triomphe du révisionnisme. Les quelques marxistes entrés dans la commission ne firent que servir de caution, ne pouvant guère faire entendre leur voix. Il en sortit une déclaration du congrès situant le parti au centre, entre le marxisme et le révisionnisme : "Le programme ne peut être ni marxiste-orthodoxe ni révisionniste ni un compromis des deux orientations" ... Quant au marxisme représenté par Gorter, Pannekoek, Roland-Holst, il ne pouvait être qu'une "opinion privée".
La défaite du marxisme à ce congrès était telle que ni Pannekoek, ni Van der Goes ; ne purent diffuser leurs propres brochures contre la direction du parti. Une résolution du congrès, adoptée à l'unanimité, ne fit que durcir celle du congrès d'Utrecht : l'exercice du droit de critique était suspendu au respect de "l'unité du partie La démocratie dans le parti était ouvertement foulée au pied avec l'accord de la grande majorité de ses membres qui souhaitaient que cessent ce qu'elle considérait comme de "simples querelles personnelles".
Toute une habile campagne menée par Troelstra, Vliegen et Schaper auprès des militants leur permit de se présenter comme les victimes d'une chasse aux sorcières non contre le révisionnisme mais contre leur propre personne. Ils firent si bien qu'une résolution adoptée au congrès d'Utrecht se proposait de limiter la liberté de discussion et de critique dans le parti : "(considérant) que l'unité du parti est nécessairement menacée, le congrès déplore cet abus de la liberté de critique, qui dans notre parti est au-dessus de tout doute, "et impose à tous les camarades de maintenir la critique à l'intérieur de telles limites, que ces camarades entre eux respectent la dignité et l'union du parti."
b) le nouveau cours révisionniste (1906-1907)
Il ne faisait aucun doute que cette résolution était une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus
Pour les marxistes, très minoritaires, le choix était entre la capitulation et le combat : ils choisirent le combat pour sauver l'ancienne orientation marxiste du parti. Pour cela, ils fondèrent leur propre revue : "De Tribune" ("La Tribune"), qui allait donner son nom aux marxistes.
Chardin
[1] [161] En France, par contre, la bourgeoisie -pour lutter contre le développement du mouvement ouvrier et socialiste- joua à fond, en ce qui concerne sa fraction radical-socialiste, la carte anticléricale. Elle espérait aussi, compte tenu de la "popularité de l'anticléricalisme en milieu ouvrier entraîner le socialisme sur un terrain qui n'était pas le sien.
[2] [162] Il n'était pas rare que les ouvriers travaillent six jours par semaine plus de 14 heures par jour. Sur les conditions inhumaines des ouvriers des transports et le développement du mouvement ouvrier hollandais à cette époque, voir : "De spoorwegstakingen van 1903 -Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland" ("Les grèves des chemins de fer de 1903 ; un miroir du mouvement ouvrier aux Pays-Bas"), étude de A.J.C. Ruter Leiden, 1935.Réédition, sans date (années 70), par SUN reprints, Nijmegen.
[3] [163] Ces syndicats de métier, héritage de la période artisanale du mouvement ouvrier, furent remplacés progressivement par les syndicats d'industrie. Ceux-ci regroupaient tous les ouvriers par branche, quel que fut le métier exercé dans celle-ci. Le développement de la grève de masse au début du siècle allait montrer cependant que -lors de la lutte ouverte contre le capital- l'organisation en branches d'industries était dépassé par l'organisation massive des ouvriers de toutes les branches. L'idée d'une"grande union" propagée par les IWW américains allait vite se révéler inadéquate, en ne voyant que la lutte économique par branche, alors que la grève de masse tendait à devenir politique par la confrontation de toute la classe, et non de certaines de ses parties, contre l'Etat.
[4] [164] Rosa Luxemburg posait la véritable question sous-jacente : réforme ou révolution. Elle pouvait ainsi écrire : ". Ce qui compte avant tout, c'est l'organisation générale de notre agitation et de notre presse afin d'amener les masses laborieuses à compter de plus en plus sur leurs propres forces et sur leur action autonome et à ne plus considérer les luttes parlementaires comme 1'axe central de la vie politique." Du point de vue révolutionnaire, il était vital de "prévenir la classe ouvrière consciente contre cette illusion pernicieuse selon laquelle il est possible de ranimer artificiellement la démocratie et l'opposition bourgeoise au Parlement en modérant et en émoussant la lutte de classe social-démocrate." (Sachsische Arbeiterzeitung, 5-6 décembre 1904).
Géographique:
- Hollande [118]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [77]
Revue Internationale no 47 - 4e trimestre 1986
- 2532 reads
Les attaques frontales annoncent l'unification des luttes ouvrières
- 2433 reads
Les formidables combats de classe qui se sont déroulés en Belgique en avril-mai dernier -les plus importants depuis ceux de Pologne 80, depuis la fin des années 60 en Europe occidentale sont venus démontrer de façon éclatante toute la vanité des discours bourgeois sur le "réalisme de la classe ouvrière face à la crise", sa "compréhension de la nécessité de faire des sacrifices" et autres sornettes destinées à démoraliser les ouvriers, à les empêcher de voir la force qu'ils représentent face au capitalisme lorsqu'ils luttent et s'unissent. Ces combats ont mis en évidence que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour asséner aux ouvriers les coups de plus en plus brutaux que lui dicte 1'effondre ment croissant de son économie. Et cela non seulement en Belgique, mais dans l'ensemble des pays d'Europe occidentale qui se trouvent d'ores et déjà -ou ne tarderont pas à se trouver- dans une situation similaire à celle de ce pays. Mais ce mouvement a démontré plus encore. De même que celui du secteur public en septembre 1983 dans cette même Belgique avait donné le signal d'un renouveau magistral des luttes ouvrières dans les principales métropoles capitalistes - après le recul général qui avait accompagné la défaite de 1981 du prolétariat en Pologne- les combats du printemps 86 font la preuve que la lutte du prolétariat mondial est entrée dans une nouvelle phase de son développement. Alors qu'en 1985 la bourgeoisie des pays centraux avait réussi à émietter les manifestations de combativité, qu'avec une politique de découpage dans le temps et dans l'espace de ses attaques, elle était parvenue à disperser les ripostes ouvrières, les luttes massives du prolétariat en Belgique ont mis en évidence les limites d'une telle politique. En effet, l'approche d'une nouvelle récession bien plus considérable encore que celle de 1982-83 (voir 1'article "L'impasse" dans ce numéro de la Revue) oblige la bourgeoisie à renoncer de plus en plus à des attaques dispersées et la contraint à des attaques massives et frontales. Face à celles-ci, les luttes ouvrières, à l'image de celles de Belgique, en avril-mai 86, prendront à leur tour de façon croissante un caractère massif et tendront à l'unification par delà les divisions catégorielles et régionales.
Voilà ce qui constitue l'axe de l'analyse développée déjà dans l'article "De la dispersion, vers l'unification" dans le précédent n° de notre Revue ainsi que de la résolution adoptée par notre organisation en juin 86 et que nous publions dans ce n°. Depuis que cette résolution a été adoptée, la situation est venue clairement confirmer cette analyse. Si la période des vacances a été peu propice au déploiement de grands mouvements de la classe ouvrière, par contre, elle a été l'occasion pour la bourgeoisie d'un grand nombre de pays de déchaîner des attaques anti-ouvrières d'une brutalité et d'une ampleur sans précédent. Qu'on en juge...
DES ATTAQUES SANS PRECEDENT
C'est dans un pays réputé pour son haut niveau de vie et de "protection" sociale -les Pays-Bas- qu'on été portées les attaques les plus spectaculaires durant cet été. Avec quelques mois de décalage par rapport à la Belgique voisine, la bourgeoisie a décidé des mesures tout à fait comparables à celles qui, dans ce dernier pays, étaient à l'origine des grands mouvements du printemps. Dès sa mise en place, le 14 juillet, le gouvernement de centre droit issu des élections du 21 mai, a annoncé la nécessité de réduire de façon drastique les dépenses budgétaires pour l'année 87 : ce sont au moins 12 milliards de florins qui devront être économisés (l'équivalent de 360 dollars par habitant !). Le gouvernement a annoncé que si l'année 87 serait "dure", cela irait mieux par la suite et que le niveau des revenus de 90 retrouverait celui de 86. On sait ce que valent ce genre de promesses. En attendant, les mesures prévues se passent de commentaires :
- suppression de 40 000 emplois dans les services publics de l'Etat (sur un total de 170 000) et plus de 100 000 parmi les fonctionnaires régionaux et municipaux ;
- instauration d'une "auto-contribution" pour les soins de santé (par exemple, la 1ère journée d'un séjour à l'hôpital ne sera pas remboursée) ;
- augmentation de 5% de la contribution à la sécurité sociale, ce qui correspond à une baisse de 2% des salaires ;
- réduction de 25% de la masse totale des subventions pour le logement social (ce qui affecte en priorité les chômeurs et les ouvriers les plus pauvres) ;
- réduction de 41 000 à 30 000 par an du nombre des logements construits par l'Etat (dans un pays qui souffre d'une crise du logement permanente) : cette mesure, avec la précédente, aboutira à la suppression de 30 000 emplois dans le bâtiment ;
- réduction massive des allocations chômage (alors qu'il était versé 85% du salaire pendant 6 mois, 70% pendant 18 mois et 60% par la suite, l'indemnité passera à 60% dès le début) ;
- mise au travail obligatoire pour un salaire de misère des chômeurs de moins de 25 ans (un bon moyen de faire baisser à bon compte les chiffres du chômage) ;
- dans le secteur privé, limitation à 1,3% des hausses de salaires alors que l'inflation était de 2,5% en 85 et qu'elle va encore s'accélérer ;
- dans ce même secteur, réduction à 37 heures et demi de la semaine de travail sans aucune compensation salariale.
Au total, ces mesures représentent une baisse des revenus de 10% pour la classe ouvrière et une augmentation de 15% du nombre des chômeurs. Ce sont tous les secteurs de la classe ouvrière (secteur privé, secteur public, chômeurs), toutes les composantes du revenu ouvrier (salaire nominal, salaire "social") qui, à l'image de la Belgique, sont brutalement attaqués.
Bien que sous une forme moins spectaculaire, ce type de mesures a déferlé ces derniers mois sur les ouvriers de nombreux autres pays :
- réduction des effectifs de la fonction publique en Espagne et en France (30 000 pour 87 dans ce pays) ;
- suppression massive d'emplois dans les entreprises publiques (50 000 dans l'INI en Espagne, 20 000 à la régie Renault et 9000 dans les chemins de fer en France) ;
- poursuite et intensification des fermetures d'usines et des licenciements dans les secteurs "faibles" tels que la sidérurgie (10 000 suppressions d'emplois en RFA, 5000 en Espagne, 3000 en France, fermeture des aciéries de USX dans 7 Etats aux USA), la construction navale (10 000 suppressions d'emplois en RFA, 5000 en Espagne, fermeture de 3 sites de la Normed en France, soit 6000 emplois), les charbonnages (8000 suppressions d'emplois dans la Ruhr en RFA, par exemple) ;
- blocage ou baisse des salaires (gel des traitements de la fonction publique et des pensions vieillesse en France, nombreuses baisses de salaires aux USA, etc.) ;
- accroissement des charges sociales (amputation de 0,7% des salaires pour les cotisations vieillesse et prélèvement de 0,4% sur tous les revenus en France, mesures similaires en Espagne, etc.) ;
- démantèlement de la "couverture sociale" (nouvelle réduction de la liste des médicaments remboursés et suppression du remboursement à 100% des dépenses de santé par les mutuelles en France, mesures du même type encore plus brutales dans la plupart des entreprises aux USA) ;
- réductions de l'indemnisation du chômage (par exemple, suppression des primes particulières pour la nourriture, les vêtements et le logement en Grande-Bretagne).
La liste pourrait s'allonger beaucoup plus sans pour cela rendre compte de façon complète de la terrible attaque subie à l'heure actuelle par la classe ouvrière dans tous les pays. Et ce n'est pas fini : si de telles attaques peuvent permettre à chaque bourgeoisie nationale de ne pas être étouffée par ses concurrentes dans la guerre commerciale que toutes se livrent, elles ne peuvent en aucune façon empêcher l'effondrement global de l'économie mondiale et elles seront nécessairement suivies de nouvelles attaques encore plus brutales, massives et frontales : le pire est encore devant nous.
LA LUTTE DE CLASSE
Annoncées pour la plupart durant la période des vacances, ces mesures anti-ouvrières n'ont pas encore provoqué de réponses significatives dans les grandes concentrations d'Europe occidentale. Mais il ne faut pas s'y tromper : le mécontentement est partout explosif et il l'est d'autant plus que la sournoiserie de ces attaques portées dans le dos des ouvriers au moment où ils ne pouvaient se défendre n'a fait qu'accroître leur colère. D'ailleurs, la bourgeoisie sait à quoi s'en tenir : partout, elle a confié à sa gauche et à ses syndicats le soin de miner le terrain. Dans tous les pays on assiste à un même phénomène : les syndicats adoptent un langage de plus en plus "radical", "extrémiste" même. En Suède, par exemple, la centrale LO, pourtant contrôlée par le parti social-démocrate actuellement au gouvernement, surprend par le ton de ses discours d'une "combativité" et d'une "intransigeance" jamais vues. En France, c'est la CGT, contrôlée par le PC,qui aujourd'hui tient un langage, organise des actions qu'elle aurait dénoncés comme "gauchistes" et "irresponsables" il y a peu de temps encore : elle claironne que "seule la lutte paie"; elle appelle "partout à des ripostes massives et unitaires" contre les "mauvais coups" du gouvernement ; elle dénonce avec vigueur la politique du précédent gouvernement (qu'elle a pourtant soutenu pendant 3 ans) ; elle ne craint pas d'organisé des actions illégales (comme le blocage des trains et des autoroutes) ou violentes (affrontements contre la police). Si partout les syndicats durcissent ainsi le ton c'est ([1] [165]) pour une raison très simple : il faut qu'ils prennent les devants afin de ne pas être débordés par les mouvements qui se préparent et d'être capables de les saboter, de les diviser.
Mais si, en Europe occidentale, c'est essentiellement à travers les manoeuvres bourgeoises qu'on peut juger des potentialités de lutte, dans la première puissance mondiale -les USA- c'est la classe elle-même qui est venu faire la preuve de sa combativité et de sa prise de conscience du besoin d'unité. En effet, dans un pays où le battage sur les "succès" économiques du libéralisme reaganien, sur la "reprise" etc. a été assourdissant, il n'y a pas eu de vacances pour la lutte de classe :
- dans le secteur du téléphone, grève de 155 000 ouvriers à ATT en juin durant 26 jours, de 66 000 ouvriers d'autres compagnies en août ;
- dans la sidérurgie, grève à la LTV (2ème producteur US) en juillet, 22 000 ouvriers en grève à USX le 1er août (premier mouvement depuis 1959) ;
- plusieurs autres mouvements dans les transports aériens, dans les usines de papier (7 500 ouvriers), dans l'industrie alimentaire (usines Hormel dans le Minnesota, Watsonville en Californie) ;
- dans le secteur public, en juillet-août, grève de 32 000 employés communaux à Philadelphie et Détroit (deux très grandes métropoles industrielles de l'Est) notamment dans les secteurs des transports, de la santé et chez les éboueurs.
Dans ces deux dernières grèves, les actes de solidarité se multiplient parmi les ouvriers et déjouent en partie les manoeuvres de division organisées de concert par la direction et les syndicats (signature d'accords séparés pour chaque catégorie d'ouvriers). Et si à Philadelphie, les menaces de licenciements proférées par les tribunaux viennent finalement à bout, après 3 semaines de grève, de la combativité et de la solidarité, celles-ci sont suffisamment fortes dès le début à Détroit pour empêcher la bourgeoisie de recourir à de telles menaces et pour l'obliger à renoncer à un de ses objectifs majeurs : faire dépendre les augmentations de salaires pour les 3 prochaines années de la "santé financière" de la municipalité.
Dans un pays où la bourgeoisie s'est toujours distinguée par la brutalité et le cynisme de son attitude face à la classe ouvrière (qu'on se souvienne du licenciement de 12 000 aiguilleurs du ciel en août 81, par exemple) son recul face aux grévistes de Détroit constitue une nouvelle illustration de la résolution publiée plus bas :
"(Les luttes) "paient" et ... elles "paient" d'autant plus qu'elles sont menées à une grande échelle, de façon unie et solidaire... plus la bourgeoisie s'affrontera à une classe ouvrière forte et plus elle sera contrainte d'atténuer et reporter les attaques qu'elle se propose de mener"..
Ce que démontrent en fin de compte les luttes ouvrières aux USA, de même que l'extrême tension existant en Europe occidentale, c'est que l'heure n'est pas aux lamentations sur "la passivité de la classe ouvrière", son "embrigadement derrière les syndicats", lamentations dans lesquelles se complaisent encore nombre de groupes révolutionnaires. Dans la période qui vient, le prolétariat va livrer des combats d'une importance considérable ce qui va placer de plus en plus les organisations révolutionnaires devant leurs responsabilités : soit elles seront partie prenante de ces combats afin de les impulser, ce qui suppose qu'elles soient conscientes de leur enjeu et du rôle qu'elles doivent y jouer, soit elles seront balayées impitoyablement par l'histoire.
FM. 7 septembre 86
[1] [166] Cette affirmation ne saurait être contredite par le fait, qu'après un recul temporaire face aux grèves du printemps, le gouvernement belge a finalement décidé de maintenir 1'intégralité des coupes budgétaires projetées : ce qui est ici démontré c'est 1 'habileté de la bourgeoisie dont le gouvernement a annoncé les mesures peu de temps avant les, vacances9afin de pouvoir les confirmer durant cette période après la retombée de la mobilisation ouvrière, c'est la capacité que conservent les syndicats à saboter l'unité ouvrière, c'est la nécessité, par suite, pour les ouvriers, non seulement de les huer comme ce fut le cas en Belgique mais aussi de se confronter à eux, de ne pas leur laisser l'initiative, de pousser toujours plus avant la recherche de l'unification et, ce faisant, de prendre eux-mêmes en main leur lutte par leur auto-organisation.
Géographique:
- Europe [133]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [1]
Résolution sur la situation internationale 1986
- 2599 reads
1) La résolution sur la situation internationale du 6ème Congrès du CCI (Revue Internationale n°44) en novembre 85, était placée sous le signe de la dénonciation de toute une série de mensonges mis en avant par la bourgeoisie pour tenter de masquer les enjeux véritables de cette situation :
- "mythe d'une amélioration de la situation du capitalisme mondial dont les 'succès' de l'économie américaine en 1983 et 84, seraient l'incarnation','
- prétendue "atténuation des tensions impérialistes avec la modification en 1984 des discours reaganiens et la 'main tendue' aux négociations avec 1’URSS qui trouvent leur pendant avec 1'offensive de séduction diplomatique du nouveau venu Gorbatchev",
- battage sur "l'idée que le prolétariat ne lutte pas, qu'il a renoncé à défendre ses intérêts de classe, qu'il n'est plus un acteur de la scène politique internationale."
Si, à l'époque, ces mensonges pouvaient s'appuyer sur un semblant de réalité, huit mois après, cette même réalité s'est chargée de démentir ouvertement toutes les campagnes précédentes, confirmant une nouvelle fois que les années 80 sont bien celles où la faillite historique du capitalisme, sa nature décadente et barbare sont appelées à se révéler dans toute leur nudité, où se précisent de plus en plus ouvertement les véritables enjeux de toute la période historique que nous vivons. De plus, la rapidité avec laquelle les événements sont venus battre en brèche les mensonges de 85 illustre une autre caractéristique fondamentale de ces années de vérité : l'accélération croissante de l'histoire.
Ainsi, la présente résolution ne se propose pas de redémontrer, après celle de novembre 85, toute la vanité des discours bourgeois. Elle prend appui sur cette dernière résolution, dont elle constitue le complément, pour mettre en évidence en quoi les huit mois écoulés ont confirmé ses orientations, pour souligner cette accélération de l'histoire, de même qu'elle se propose de signaler les premiers enseignements des expériences de la classe ouvrière au cours de cette dernière période.
L'ACCELERATION DE L'EFFONDREMENT ECONOMIQUE
2) La résolution du 6ème Congrès du CCI indiquait les limites de la "reprise" aux USA de même que de la capacité de ce pays de servir de "locomotive" pour les économies des autres pays de son bloc :
"C'est principalement le formidable endettement du tiers-monde dans la seconde moitié des années 70... qui a permis pour un temps aux puissances industrielles de redresser leurs ventes et de relancer leur production.
Après 82, c'est... 1'endettement encore plus considérable des USA, tant extérieur... qu'intérieur...
qui a permis à ce pays de connaître ses taux de croissance records en 1984 de même que ce sont ses énormes déficits commerciaux qui ont bénéficié momentanément aux exportations de quelques autres pays (telle la RFA) et donc au niveau de leur production.
En fin de compte, de même que l'endettement astronomique des pays du tiers-monde n'avait pu aboutir qu'à un choc en retour catastrophique, en forme d'une austérité et d'une récession sans précédent, l'endettement encore plus considérable de l'économie américaine ne peut, sous peine d'une explosion dé son système financier... que déboucher sur une nouvelle récession tant de cette économie que des autres économies dont les marchés extérieurs vont se réduire comme peau de chagrin."
L'évolution de la situation ces derniers mois constitue une illustration concrète de ces limites :
- le déficit du budget fédéral des USA, qui avait permis la création d'une demande artificielle pour les entreprises de ce pays (380 milliards de $ pour 83 et 84), sera impérativement réduit (le Congrès US a adopté une loi (Gramm-Rudman) instaurant des coupes automatiques des budgets en cas de déficit),
- plus encore, la baisse du dollar de 30 % en quelques mois (baisse voulue et organisée par les autorités) signifie que les USA sont déterminés à réduire drastiquement leur déficit commercial devenu astronomique (et qui a placé ce pays dans le peloton de tête des pays les plus endettés du monde) et donc à repartir à la reconquête de leurs marchés tant intérieurs qu'extérieurs.
Ce dernier fait signifie donc une intensification de la guerre commerciale avec les concurrents (qui sont aussi les alliés) des USA (Japon et Europe occidentale), lesquels verront leurs propres marchés s'effondrer (sans que cela signifie d'ailleurs un regain de santé de l'économie US du fait du rétrécissement général du marché mondial). De même, cette baisse du dollar signifie que ces mêmes pays se voient rembourser leurs prêts 30 % moins cher que leur valeur initiale.
3) De même, cette baisse du dollar ne signifiera nul répit pour les pays du tiers-monde. Si, d'un côté, leur endettement de 1.000 milliards de dollars (la plupart du temps libellé en cette monnaie) sera partiellement réduit, les revenus de leurs exportations servant à son remboursement seront amputés d'autant (puisque exprimés également en dollars). De plus, leur situation ne pourra que s'aggraver avec la baisse souvent considérable des prix des matières premières qui, sous la pression de la surproduction généralisée, caractérise la période actuelle, dans la mesure où celles-ci constituent leur poste principal (sinon exclusif) d'exportation. Cette situation est particulièrement spectaculaire et dramatique en ce qui concerne la principale des matières premières, le pétrole (dont l'effondrement des prix démontre le caractère uniquement spéculatif, et nullement basé sur une quelconque "pénurie", des flambées de 1973 et 1979). Des pays comme le Mexique ou le Venezuela, déjà incapables de faire face à leurs dettes phénoménales lorsqu'ils vendaient leur baril à 30 dollars, sont plongés avec le baril à 15 dollars, dans une banqueroute totale. Ainsi s'amplifie encore cette barbarie sans nom, cet enfer permanent dans le tiers-monde, que la résolution de novembre 85 présentait comme un des indices les plus éloquents de l'effondrement de l'économie mondiale.
De même aussi, les pays du bloc russe, à commencer par l'URSS elle-même, dont les matières premières constituent (à l'image des pays sous-développés) la principale exportation, verront-ils encore s'aggraver une situation économique déjà déplorable et devront-ils renoncer encore plus à acheter en occident les équipements industriels modernes qui leur font tant défaut (ce qui viendra encore réduire les débouchés de leurs fournisseurs occidentaux).
4) Pour ce qui concerne l'Europe occidentale, dont la résolution de novembre 85 soulignait la gravité de la situation économique, la baisse des matières premières et notamment du pétrole, ne permet d'espérer aucune amélioration sensible. Contrairement aux déclarations satisfaites présentant ces baisses (cumulées avec celle du dollar) comme un "ballon d'oxygène" du fait de la réduction de l'inflation et des déficits commerciaux qu'elles sont censées provoquer, c'est une nouvelle aggravation de la situation qu'il faut en attendre à terme. D'une part des pays comme la Grande-Bretagne et la Norvège ou les Pays-Bas sont directement victimes de la baisse du pétrole (et du gaz naturel dont le prix est lié à celui du pétrole). D'autre part, et surtout, l'ensemble des pays d'Europe occidentale qui exportent une part importante de leur production vers les pays du tiers-monde et notamment les pays producteurs de pétrole, verront de plus en plus se fermer le marché de ces pays en même temps que s'épuiseront leurs sources de devises. En fait d'"oxygène"c'est du gaz asphyxiant que contient ce "ballon" tant vanté de la baisse des matières premières et du pétrole. D'ailleurs, derrière cette euphorie de façade, la bourgeoisie des pays d'Europe occidentale est consciente de l'extrême noirceur des perspectives économiques résultant du cumul de la fermeture croissante du marché des USA (du fait de la baisse du dollar et des mesures protectionnistes prises par ce pays), de 1'anémie du marché du COMECON et de l'épuisement des contrats mirifiques des pays de l'OPEP, alors que dès maintenant c'est plus de 11 % (en chiffres officiels, donc sous-estimés) de la force de travail qu'elle ne peut employer. C'est justement parce qu'elle ne se fait pas d'illusions que, dans tous les pays, cette bourgeoisie multiplie les mesures brutales d'austérité (comme celles du gouvernement Martens en Belgique) afin de préserver du mieux possible sa compétitivité déjà faible en prévision de la terrible guerre commerciale que va déchaîner la récession qui s'annonce.
Dans ces centres vitaux du capitalisme, où se trouvent les plus grandes et anciennes concentrations industrielles, et donc ouvrières, c'est donc une nouvelle et considérable détérioration de la situation économique - avec les terribles attaques antiouvrières qu'elle comporte - qui constitue la seule perspective, à court terme, détérioration qui ne pourra que se répercuter, en fin de compte, sur les pays (USA et Japon) jusqu'à présent les mieux lotis.
L'INTENSIFICATION DES CONFLITS IMPERIALISTES
5) Comme le CCI, avec tous les marxistes, l'a toujours souligné (et rappelé dans la résolution de novembre 85), 1'effondrement de 1'infrastructure économique de la société capitaliste ne peut déboucher que sur une fuite en avant vers un affrontement impérialiste généralisé. A peine 6 mois après le grand "show" au sommet de Genève, les embrassades des duettistes Reagan et Gorbatchev sont complètement oubliées (comme l'annonçait cette résolution). Avec autant de promptitude qu'il les avait abandonnées lors de sa campagne électorale, Reagan a repris ses diatribes contre "l'empire du mal" dénonçant avec une vigueur renouvelée les "violations des droits de l'homme" et les "intentions belliqueuses" de l'URSS de même que l'hypocrisie de ses propositions de réduction des armements, ce qui s'est notamment concrétisé tout récemment par la dénonciation, de la part de la Maison Blanche, des accords SALT II. Ainsi se confirme avec éclat l'offensive du bloc occidental en vue de "parachever l'encerclement de l'URSS, de dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct" (Résolution du 6ème Congrès du CCI). En ce domaine est particulièrement significatif de l'accélération générale dé l'histoire imprimée par l'effondrement économique du capitalisme, le bombardement par l'aviation américaine des deux plus grandes villes de Libye ainsi que des principales bases militaires de ce pays. C'est une nouvelle illustration du fait qu'une "des caractéristiques majeures de cette offensive est l'emploi de plus en plus massif par le bloc de sa puissance militaire" (Ibid.).
6) Si le raid américain d'avril 86 n'était pas directement dirigé contre l'URSS ou une de ses positions stratégiques, dans la mesure où la Libye n'a jamais été un membre du bloc de l'Est, c'est bien l'offensive d'ensemble contre ce bloc qui constitue l'arrière-plan de cette action d'éclat. En effet, celle-ci visait à :
- confirmer avec force et de façon spectaculaire que la Méditerranée est désormais un "mare nostrum" américain (à la veille des bombardements, l'URSS éloigne prudemment ses navires des côtes libyennes ce qui illustre bien qu'elle a renoncé à contester l'hégémonie totale des USA dans cette région du monde) ;
- envoyer un avertissement à tous les pays (et pas seulement à la Libye) qui, sans appartenir au bloc de l'Est, manifestent au gré des USA une trop grande indépendance à leur égard ou une soumission insuffisante.
En particulier, il était signifié à la Syrie qu'elle se devait d'exécuter avec plus d'efficacité le contrat passé avec elle en échange du départ des corps expéditionnaires occidentaux du Liban en 84 et consistant à faire, en compagnie d'Israël, "le gendarme" dans ce pays (notamment par la mise au pas des groupements pro-iraniens). Mais le principal destinataire du message porté par les Fil américains, c'est une nouvelle fois l'Iran dont la réinsertion dans le bloc US continue de constituer l'objectif majeur de l'étape présente de l'offensive occidentale. Et il semble bien que le message ait été reçu par ce pays : son récent rapprochement diplomatique avec la France (qui a fait "un geste" en "poussant" Massoud Radjavi hors de ses frontières tout en maintenant son plein soutien militaire à l'Irak) indique que le régime de Téhéran commence à comprendre "où se trouve son intérêt".
Cependant, la fonction du raid américain ne se limitait pas à des questions de stratégie impérialiste. Avec tout le battage médiatique qui l'a accompagné, notamment autour de la "dénonciation du terrorisme", cette opération se voulait également une contribution à toutes les campagnes idéologiques visant à détourner la classe ouvrière des luttes qui ne peuvent manquer de se déployer face à 1'intensification des attaques économiques qui se développent à l'heure actuelle. Car pour la bourgeoisie de tous les pays, plus important encore que le problème des antagonismes commerciaux entre nations, des affrontements impérialistes entre blocs, est le problème que lui pose l'énorme potentiel de combativité existant au sein du prolétariat, notamment celui des pays centraux du capitalisme, et qui constitue la clé de voûte de toute la situation mondiale présente, l'élément déterminant le cours historique actuel.
L'ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DES COMBATS DE CLASSE
7) S'il est un domaine où l'accélération de l'histoire se manifeste de façon particulièrement nette, c'est bien celui du développement de la lutte de la classe ouvrière. Cela "se traduit en particulier par le fait que les moments de recul de la lutte (comme celui de 1981-83) sont de plus en plus brefs, alors que le point culminant de chaque vague de combats se situe à un niveau plus élevé que le précédent" (Ibid.). De même, au sein de chacune de ces vagues, les "moments inévitables de répit, de maturation, de réflexion" (ibid.) sont eux-mêmes d'une durée de plus en plus courte. Ainsi toute la campagne récente sur la "passivité" de la classe ouvrière, basée sur une baisse apparente de la combativité en 1985, a fait aujourd'hui long feu avec les formidables combats de classe qui viennent de se dérouler en avril et mai en Belgique."Ces combats qui viennent après des mouvements de très grande ampleur en Scandinavie et surtout en Norvège (et qui, compte tenu du faible niveau des luttes ouvrières dans cette région auparavant, sont significatifs de la profondeur de la vague actuelle des combats de classe), constituent une confirmation éclatante de ce qu'affirmait la résolution du 6ème Congrès du CCI :
"...les actuels moments de répit... que peut s'accorder aujourd'hui la classe restent limités dans le temps comme dans l'espace, et bien que la bourgeoisie fasse tout pour transformer cet effort de réflexion qui s'opère dans la classe en expectative et en passivité, la situation reste caractérisée par une accumulation de mécontentement et de combativité potentielle prête à exploser d'un moment à l'autre."
Mais ce que traduit principalement le mouvement des ouvriers en Belgique c'est l'étroitesse des limites de la politique bourgeoise qui avait permis en 1985, non une extinction des manifestations de combativité, mais une dispersion de ces manifestations en une série de luttes isolées, menées par un nombre bien plus limité d'ouvriers que dans la première phase (83-84) de la troisième vague de luttes depuis la reprise historique de 1968 et qui avait débuté par les combats massifs du secteur public en septembre 83 dans ce même pays.
8) Cette politique de dispersion des luttes, la bourgeoisie l'avait basée essentiellement sur une dispersion des attaques économiques elles-mêmes, sur une planification et un étalement dans le temps et l'espace de celles-ci. Cela lui était permis par la petite marge de manoeuvre que lui laissaient les retombées de la "reprise" américaine de 83-84, ce qui d'emblée posait les limites objectives de cette politique du fait même que, pour l'économie capitaliste, ce répit ne pouvait être que de courte durée. De plus, cette politique contenait toute une série d'autres limites :
- dans la mesure où, dans les pays les plus avancés, une part non négligeable du prix de la force de travail est versée sous forme de prestations sociales de toutes sortes (sécurité sociale, allocations familiales, etc.) toute réduction de cette part de salaire ne peut se faire que de façon globale, au détriment de toutes les ouvriers et non de ceux de tel ou tel secteur;
- du fait que, dans ces mêmes pays, une énorme proportion (souvent la majorité) des ouvriers dépendent d'un "patron" unique, l'Etat, soit parce qu'ils travaillent dans le secteur public, soit parce que sans emploi, ils ne survivent que de ses subsides, le champ d'application de cette politique se limite essentiellement à un secteur particulier de la classe, celui qui travaille dans le secteur privé (ce qui explique en grande partie tous les efforts de beaucoup de gouvernements en vue de "reprivatiser" le plus possible l'économie).
Ce qui vient de se passer en Belgique confirme que 1'ensemble dé ces limites commence à être atteint, que c'est de façon de plus en plus massive et surtout frontale que la bourgeoisie est obligée de porter ses attaques, que la tendance générale des luttes n'est plus au maintien dans la dispersion mais au dépassement de cette dispersion. C'est particulièrement clair lorsqu'on constate que les mesures qui ont provoqué cette formidable réponse de la classe :
- sont dictées à la bourgeoisie par l'absence presque totale de marge de manoeuvre économique, par l'urgence d'"assainir" et d'adapter l'économie du pays notamment face à la perspective de 1'intensification sans précédent de la guerre commerciale que va provoquer la récession qui vient, urgence qui ne lui permet plus d'étaler ou de reporter ses attaques,
- concernent tous les secteurs de la classe ouvrière (privé, public et chômeurs) et mettent en cause toutes les composantes du salaire (salaire nominal et salaire "social").
C'est encore plus clair lorsqu'on voit pratiquement tous les secteurs de la classe ouvrière participer massivement au mouvement, non seulement d'une simple façon simultanée, mais avec des tentatives de plus en plus déterminées de rechercher la solidarité et l'unification des luttes d'un secteur à l'autre.
9) De même que la grève du secteur public en Belgique en 83 annonçait l'entrée de la classe ouvrière mondiale, et tout particulièrement en Europe occidentale, dans la première phase de la troisième vague de luttes, celle qui fut marquée par des luttes massives et d'une très grande simultanéité .internationale, les récentes grèves dans ce même pays, annoncent 1'entrée de cette même classe ouvrière dans une troisième phase de cette vague, celle qui après la deuxième phase marquée par la dispersion des luttes, va manifester des tendances de plus en plus nettes vers 1'unification de celles-ci. Le fait que dans les deux cas ce soit la classe ouvrière du même pays qui se soit retrouvée aux avant-postes n'est pas sans signification. En effet, malgré la petite taille de ce pays, la situation de la Belgique constitue un résumé des caractéristiques fondamentales de l'ensemble des pays d'Europe occidentale :
- situation catastrophique d'une économie nationale développée, par ailleurs extrêmement dépendante du marché mondial (70% de la production de ce pays est exportée)
- taux très élevé du chômage
- très forte concentration industrielle sur une surface réduite
- ancienneté tant de la bourgeoisie que du prolétariat
- vieille et forte expérience pour ces deux classes de leurs affrontements communs.
De ce fait, les combats qui viennent de se dérouler dans ce pays ne sauraient être considérés comme un feu de paille, un événement non significatif à l'échelle européenne et mondiale. Au contraire, ils ne font qu'augurer de ce qui attend les autres pays d'Europe occidentale, et plus généralement les principaux pays avancés, dans la période qui vient. Et cela notamment du point de vue de leurs principales caractéristiques dont la plupart avaient déjà été identifiées dès le début de la troisième vague de luttes :
1."tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de l'extension géographique des luttes;
2. tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant, en particulier à leurs débuts, un certain débordement des syndicats;
3. développement progressif au sein de l'ensemble du prolétariat de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité à s'opposer comme classe aux attaques capitalistes"(Ibid.);
4. recherche de la solidarité active et de l'unification par delà les usines, les catégories ou les régions, notamment sous forme de manifestations de rue et en particulier de délégations massives d'un centre ouvrier à l'autre, mouvement qui se fera en confrontation croissante avec tous les obstacles placés par le syndicalisme et au cours duquel "s'imposera de plus en plus aux ouvriers des grandes métropoles capitalistes, notamment ceux d'Europe occidentale, la nécessité de l'auto-organisation de leur combat" (Ibid.)
10) Cette nécessité de l'auto-organisation et cette tendance à la recherche active de l'unification, au-delà de la simple extension des luttes, constituent le trait majeur de la 3ème phase de la 3ème vague de luttes. Ce trait (qui n'avait pas encore été identifié lors du 6ème Congrès du CCI) découlait de la politique bourgeoise d ' éparpillement des luttes basée sur 1'éparpillement des attaques économiques (mise en évidence, par contre, au début de l'année 86 dans l'éditorial de la Revue Internationale n°45).
Du fait même qu'il fait suite à une offensive bourgeoise tendant à briser l'élan de la 3ème vague de luttes, et qu'il s'inscrit en dépassement des difficultés engendrées par cette offensive, ce trait introduit dans cette 3ème vague de luttes une dimension générale de la plus haute importance, d'une portée comparable à cette autre caractéristique mise en évidence dès son début : "la simultanéité croissante des luttes au niveau international, jetant les jalons pour la future généralisation mondiale des luttes." (Revue Internationale n°37, 1er trimestre 84). Cependant malgré leur importance comparable, ces deux caractéristiques n'ont pas la même signification du point de vue du développement concret des luttes ouvrières, et partant, de 1'intervention des révolutionnaires en leur sein. La simultanéité internationale, malgré toute sa dimension historique en tant que préfiguration de la future généralisation, est bien plus, à l'heure actuelle, un état de fait découlant notamment de la simultanéité des attaques bourgeoises dans tous les pays que d'une démarche délibérée, prise en charge de façon consciente par les ouvriers de ces pays, et cela notamment du fait de la politique systématique de black-out menée par la bourgeoisie. Par contre la tendance à l'unification des luttes, tout en ayant une portée historique comparable, en tant que jalon vers la grève de masse, et partant vers la révolution, constitue également une donnée immédiate au sein des combats prolétariens actuels, une composante de ces combats que les ouvriers doivent nécessairement prendre en charge de façon consciente. En ce sens, si la simultanéité internationale des luttes pose les jalons, le cadre historique de leur généralisation mondiale future, le chemin concret qui y conduit, dans la mesure où cette généralisation ne pourra être qu'un acte conscient, passe nécessairement par le développement des tendances à 1'unification qui s'expriment dès maintenant. C'est pour cela qu'il revient aux révolutionnaires de souligner dans leur intervention toute 1'importance de cette marche vers l'unification. Et cela d'autant plus que c'est dans cette marche que la classe sera contraint de développer de façon croissante son auto organisation face aux confrontations répétées contre les obstacles syndicaux.
11) Une des composantes de ce mouvement vers l'auto organisation, et qui s'était déjà manifestée dans les luttes récentes, s'est exprimée de façon très claire lors des derniers combats en Belgique : la tendance au surgissement spontané des luttes, en dehors de toute consigne syndicale, tendance déjà mise en évidence dès le début de la 3ème vague. A propos de cette tendance, il importe de souligner les points suivants :
11-1. Elle participe d'une composante générale de la lutte de classe dans la période de décadence déjà identifiée depuis longtemps par les révolutionnaires : "Un tel type de luttes, propre à la période de décadence, ne peut se préparer d'avance sur le plan organisationnel. Les luttes explosent spontanément et tendent à se généraliser...ce sont là des caractéristiques qui préfigurent l'affrontement révolutionnaire."(Revue Internationale N°23, "Le prolétariat dans le capitalisme décadent").
11-2. Cependant les mouvements spontanés ne traduisent pas nécessairement un niveau de conscience plus élevé que les mouvements se développant à l'appel des syndicats :
- d'une part, de nombreuses luttes surgies spontanément ont été et sont encore reprises en main facilement par les syndicats,
- d'autre part, l'occupation systématique du terrain social par la gauche dans l'opposition conduit souvent les syndicats à prendre les devants de combats porteurs d'un fort potentiel de prise de conscience,
- enfin, dans certaines circonstances historiques, notamment celles où la gauche est au gouvernement, comme ce fut le cas fréquemment au cours des années 60-70, des grèves spontanées ou même sauvages, peuvent n'être que la simple traduction pratique de 1'opposition déclarée des syndicats à toute lutte sans pour cela exprimer un niveau élevé de la conscience dans la classe.
11-3. Toutefois, le fait que la tendance à la multiplication des luttes spontanées se développe alors que la bourgeoisie a placé ses forces de gauche dans l'opposition, que celles-ci radicalisent de façon très importante leur langage, confère aux luttes spontanées d'aujourd'hui une signification toute différente de celle des luttes évoquées plus haut. Ce fait révèle notamment un discrédit croissant des syndicats aux yeux des ouvriers, discrédit qui, résultant de manoeuvres où les syndicats se présentent en permanence comme "l'avant-garde" des combats, et même s'il ne débouche pas mécaniquement sur une prise de conscience de fond de la véritable nature du syndicalisme et de la nécessité de l'auto-organisation, crée les conditions de cette prise de conscience.
11-4. Une des causes importantes de cette tendance aux surgissements spontanés réside dans l'accumulation d'un énorme mécontentement qui explose bien souvent de façon inattendue. Mais là encore, une des raisons de cette accumulation de mécontentement est constituée par le fait que le discrédit qui pèse sur les syndicats les empêche aujourd'hui d'organiser des "actions" destinées à servir de soupape de sécurité à ce mécontentement.
Ainsi, en exprimant globalement une maturation de la combativité et de la conscience, notamment du point de vue de la compréhension croissante du rôle du syndicalisme et des nécessités de la lutte, le développement actuel des mouvements spontanés de la classe s'inscrit pleinement dans le long processus historique qui conduit aux affrontements révolutionnaires.
12) Ce discrédit des syndicats, dont l'accroissement est une condition, certes insuffisante, mais indispensable au développement de la conscience dans la classe, est appelé à s'amplifier de façon significative dans la phase actuelle de la lutte de classe. En effet, si la mise à contribution depuis de nombreuses années,du syndicalisme et de la gauche en général comme élément central de la politique bourgeoise de division de la classe, de sabotage, dévoiement et épuisement des luttes, permet d'expliquer le degré de méfiance d'ores et déjà atteint par les ouvriers à 1'égard des syndicats, si le début de la 3ème vague correspondait déjà à une certaine usure de la gauche dans l'opposition après que cette carte jouée à partir de 78-79 ait été grandement responsable de l'épuisement prématuré de la 2ème vague et du désarroi qui accompagne la défaite en Pologne de 1981, la période pendant laquelle la bourgeoisie a été capable de mener sa politique de dispersion des attaques a permis à celle-ci, dans la plupart des pays, de s'épargner un emploi trop voyant de ses forces de gauche et de ses syndicats. En effet, durant cette période, ce sont les secteurs de droite et le patronat privé qui se sont trouvés aux avant-postes dans la mise en oeuvre de la stratégie de division des luttes ouvrières dans la mesure où celle-ci se basait avant tout, non sur les manoeuvres de la gauche, mais sur la façon dont les attaques directes étaient elles-mêmes conduites, les syndicats ne faisant qu'accentuer le caractère dispersé des luttes découlant de la forme même des attaques 'auxquelles ces luttes ripostaient.
Mais dès lors que par l'épuisement de sa marge de manoeuvre économique, la bourgeoisie est contrainte de renoncer à la dispersion des attaques, qu'elle est obligée de les mener de façon frontale, elle ne dispose plus pour poursuivre sa politique de division des ouvriers (politique qu'elle maintiendra jusqu'à la révolution) que de la gauche et des syndicats, lesquels sont beaucoup plus ouvertement mis à contribution et sont amenés, de ce fait, à dévoiler bien plus leur véritable fonction. La multitude de manoeuvres entreprises par les syndicats lors des récentes luttes en Belgique (notamment le saucissonnage des journées d'action par secteur) en vue de casser en morceaux la riposte ouvrière aux mesures gouvernementales, la prise de conscience constatée chez les ouvriers du rôle de diviseurs joué par les syndicats, constituent une première concrétisation probante de cette tendance générale à l'accentuation du discrédit de la gauche et des syndicats qui est propre à la phase actuelle du développement des combats de classe.
13) La méfiance croissante des ouvriers à l'égard de la gauche et des syndicats est riche, comme on l'a vu, de potentialités de surgissements massifs de la lutte du prolétariat, du développement de l'auto-organisation et de la conscience de celui-ci. En particulier, la période qui vient verra se manifester de plus en plus nettement une tendance à la formation au sein de la classe de groupements plus ou moins formels d'ouvriers cherchant à se défaire des nasses paralysantes du syndicalisme, à réfléchir sur les perspectives plus générales de leur combat.
C'est bien pour ces raisons que la bourgeoisie mettra de plus en plus en avant l'arme du"Syndicalisme "de base" ou "de combat" - comme cela s'est illustré clairement dans les luttes en Belgique - destiné, avec son langage "radical", à ramener à l'intérieur du carcan syndical (des syndicats existants ou du syndicalisme) les ouvriers qui tentent de briser ce carcan. Dans cette situation, il importe de pouvoir distinguer ce qui témoigne de la vitalité de la classe (l'apparition de groupes ou comités d'ouvriers combatifs engagés dans une démarche de rupture avec la gauche ou le syndicalisme) de ce qui relève d'une politique bourgeoise destinée notamment à entraver cette démarche (le développement du syndicalisme de base), d'autant qu'au début d'un tel processus, les éléments de la classe qui se sont engagés dans cet effort de rupture peuvent adopter des positions apparemment en retrait par rapport à celles du syndicalisme de base et des gauchistes, spécialistes de la phrase "radicale". Il appartient par conséquent aux révolutionnaires de ne pas juger de façon statique les phénomènes de ces deux types qui apparaîtront au cours du développement des luttes, mais d'avoir en vue, sur la base d'un examen attentif, la dynamique de chaque phénomène particulier afin de pouvoir combattre avec la plus grande vigueur toute manoeuvre "radicale" de la bourgeoisie mais aussi de savoir encourager et impulser les efforts encore embryonnaires de la classe en direction d'une prise de conscience et non les stériliser en les confondant avec ces manoeuvres bourgeoises.
14) Un des autres enseignements des récents combats en Belgique, qui vient confirmer ce que les marxistes ont toujours affirmé contre les proudhoniens et les lassaliens, et plus récemment contre les modernistes, c'est que la classe ouvrière, non seulement peut et doit lutter pour la défense de ses intérêts immédiats en préparation de sa lutte comme classe révolutionnaire, mais peut aussi sur ce terrain faire reculer la bourgeoisie. Si la décadence du capitalisme interdit à cette dernière d'accorder de réelles réformes à la classe ouvrière, si la phase de crise aiguë - comme celle où nous sommes entrés - ne lui offre d'autre possibilité que d'attaquer les ouvriers de plus en plus brutalement, cela ne signifie nullement que la classe ouvrière n'ait d'autre choix qu'entre faire (ou préparer) immédiatement la révolution et subir passivement ces attaques sans espoir de les limiter. Même lorsque la situation d'un capital national apparaît comme désespérée, comme c'est le cas de la Belgique aujourd'hui, que les attaques impliquées par cette situation ne semblent pas pouvoir être différées ou atténuées, la bourgeoisie conserve encore une petite marge de manoeuvre lui permettant de renoncer momentanément - et même au prix de difficultés futures bien pires encore - à certaines de ses attaques si elle se confronte à un niveau significatif de résistance de la part du prolétariat. C'est ce qu'on a pu également constater en Belgique avec le "réexamen" des mesures touchant les mines du Limbourg et les chantiers navals, de même qu'avec le report du plan d'austérité du gouvernement Martens.
Il en est en fin de compte du degré d'urgence et de gravité des attaques capitalistes comme du de gré de saturation des marchés qui les dicte : de même que, si elle tend à devenir de plus en plus totale, cette saturation n'atteint jamais un point absolu, la marge de manoeuvre économique de chaque capital national, tout en s'approchant toujours plus de zéro, n'atteint jamais une telle limite. Il importe donc que les révolutionnaires, s'ils doivent mettre en évidence la perspective d'effondrement de plus en plus total du capitalisme et donc la nécessité de le remplacer par la société communiste, soient également capables, en vue d'impulser les luttes immédiates, de montrer que celles-ci "paient" et qu'elles "paient" d'autant plus qu'elles sont menées à une grande échelle, de façon unie et solidaire, que plus la bourgeoisie s'affrontera à une classe ouvrière forte et plus elle sera contrainte d'atténuer, et reporter les attaques qu'elle se proposé de mener.
15) Une des autres confirmations qu'apportent les événements d'avril-mai 86 en Belgique, c'est l'importance croissante de la lutte des chômeurs, la capacité de ce secteur de la classe ouvrière de s'intégrer de plus en plus dans les combats généraux de la classe, même si ce phénomène n'a été constaté que sous une forme encore embryonnaire au cours de cette période. Avec cet autre phénomène constitué par l'apparition et le développement ces dernières années de nombreux comités de chômeurs dans les principaux pays d ' Europe occidentale, c'est bien une confirmation de l'analyse selon laquelle :
- le chômage deviendra "un élément essentiel du développement des luttes ouvrières jusque-là la période révolutionnaire...
- les ouvriers au chômage tendront de plus en plus à se retrouver aux avant-postes des combats de classe."(Résolution du 6ème Congrès du CCI).
Une autre confirmation apportée par la dernière période concerne l'organisation des chômeurs : ce qu'a montré une nouvelle fois 1'expérience de la Conférence de Gottingen en RFA (en 1985) de même que de plusieurs comités de chômeurs comme celui de Toulouse en France, c'est que, fondamentalement, l'organisation des chômeurs est à l'image de celle de l'ensemble de la classe : elle surgit et se centralise dans la lutte et pour les besoins de la lutte. Même si les comités de chômeurs peuvent exister de façon plus durable que les comités de grève, toute tentative pour maintenir en vie de tels organes, de les doter d'une structure centralisée en dehors de tels besoins, ne peut que les conduire à devenir tout autre chose que des organisations unitaires de lutte : au meilleur des cas, des groupes ouvriers de discussion, au pire de nouveaux syndicats.
16) Les luttes en Belgique apportent enfin une autre confirmation de ce que les révolutionnaires ont mis en évidence depuis le surgissement historique du prolétariat à la fin des années 60 et plus particulièrement avec 1'accélération considérable de l'histoire qui marque les années 80 : du fait que la crise laisse de moins en moins de répit à la bourgeoisie et que celle-ci est amenée à en laisser de moins en moins à la classe ouvrière,, cette dernière est conduite, au cours d'une même génération, à accumuler les expériences de lutte contre le capital et "cette accumulation d'expériences de lutte du prolétariat, comme la proximité de plus en plus grande entre chacune d'elles, constitue un élément essentiel de prise de conscience par l'ensemble de la classe (des conditions et des véritables enjeux de son combat."(Ibid.)
Ainsi, il est clair qu'en Belgique, les ouvriers ont été capables de donner une telle ampleur à leurs combats du printemps 86 parce qu'ils avaient tiré et conservé de nombreux enseignements des luttes menées trois ans auparavant. C'est là un phénomène qui tendra à se généraliser et s'intensifier dans tous les pays centraux du capitalisme, ce qui donne la mesure des potentialités de lutte considérables, d'une ampleur inconnue jusque-là présent, qui existent dans ces pays et que ne doivent pas sous-estimer les révolutionnaires. Et cela d'autant plus que, contrairement à ce qui s'était déroulé dans le passé où la récession de 74-75 avait frappé une classe ouvrière en recul momentané, où celle de 81-82 est intervenue alors que le prolétariat subissait encore le poids de la défaite de 81 en Pologne, la récession qui s'annonce va rencontrer et impulser des luttes ouvrières en plein essor.
Toutefois il serait faux et dangereux de s'imaginer que, d'ores et déjà, est ouvert un chemin rectiligne vers la période révolutionnaire, La classe ouvrière est encore loin d'une telle période. Pour y parvenir elle doit opérer en son sein toute une transformation qui fera de la classe exploitée qu'elle est au sein du capitalisme - et à travers ses luttes comme classe exploitée - la classe révolutionnaire capable de prendre en charge l'avenir de l'humanité. C'est dire toute la dimension et la difficulté du chemin qu'il lui reste à parcourir, notamment pour se défaire de toute la pression de 1’idéologie dominante qui pèse sur elle et tout particulièrement pour venir à bout, à travers des confrontations répétées et de plus en plus conscientes, des multiples mystifications et pièges que la bourgeoisie, sa gauche et ses syndicats, opposent et continueront d'opposer à ses luttes et à sa prise de conscience. Même condamnée historiquement, et telle un fauve blessé à mort, la bourgeoisie continuera à se défendre bec et ongles jusqu'au bout, et l'expérience montre à quel point elle est capable d'inventer en permanence de nouveaux pièges visant à défaire le prolétariat, ou au moins à ralentir sa progression.
C'est pourquoi il importe de souligner le caractère heurté du combat de la classe ouvrière, d'avoir en mémoire les enseignements déjà tirés par Rosa Luxemburg lors des combats de 1905 dans l'Empire russe, le fait notamment que la grève de masse, qui marque l'entrée dans une période révolutionnaire, est un "océan de phénomènes" aux apparences contradictoires, de multiples formes de lutte, d'avancées puis de reculs au cours desquels il semble que se soit éteint le feu de la lutte, mais qui ne font que préparer des combats encore plus vastes.
Malgré leurs limites et bien qu'elles fussent encore bien loin de la grève de masse (laquelle constitue une perspective à long terme dans les pays avancés) les récentes luttes en Belgique, avec leurs divers rebondissements, nous confirment la nécessité de prendre en compte cette démarche heurtée, de ne pas enterrer un mouvement dès ses premiers revers, de garder confiance dans toutes les potentialités qu'il peut receler et qui ne s'expriment pas immédiatement.
S'il appartient aux révolutionnaires de souligner aux yeux de leur classe toute l'importance et toutes les potentialités de ses luttes actuelles, il leur appartient aussi de lui montrer la longueur et la difficulté du chemin à parcourir et cela, non pour la démoraliser, mais au contraire pour lutter contre la démoralisation qui menace après chaque revers. C'est le propre des révolutionnaires que d'exprimer au plus haut point ces qualités de la classe porteuse du futur de l'humanité : la patience, la conscience de l'ampleur immense de la tâche à accomplir, une confiance sereine mais indestructible en l'avenir.
25/6/86
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Où en est la crise économique ? : l’impasse
- 2895 reads
LA CRISE S'APPROFONDIT LA GUERRE COMMERCIALE S'EXACERBE
LES ATTAQUES CONTRE LA CLASSE OUVRIERE S'INTENSIFIENT
Devant une population de travailleurs sceptiques, fatigués de voir le chômage s'accroître inexorablement depuis 15 ans et d'entendre tout aussi régulièrement que "la fin des difficultés de l'économie est proche", les gouvernements ont crié, au début 86, sur tous les toits, que cette fois-ci on commençait à voir le bout du tunnel -à condition, évidemment, que les travailleurs acceptent encore quelques sacrifices. Pourquoi ? Parce que les prix du pétrole s'effondraient sur le marché mondial et que le cours du dollar baissaient. La presse parlait de "contre-choc pétrolier", de la "manne pétrolière" qui allait tout résoudre. Le cauchemar tendrait à sa fin.
Six mois plus tard les faits sont là : les capitaux des pays industrialisés ont bien réalisé des économies sur la facture, pétrolière évaluées à 60 milliards de dollars, mais le chômage non seulement ne diminue pas mais ne fait que s'accroître et les annonces de nouveaux licenciements dans tous les secteurs se multiplient dans tous les pays.
Quant aux plans d'austérité, tous les gouvernements ne font quel es renforcer.
L'économie américaine ne cesse de ralentir sa croissance pour connaître au 2ème trimestre 86 son taux de croissance le plus faible depuis "l'année noire" de 1982 (+1,1%).
Le Japon, dont la production dépend plus que jamais directement de ses exportations vis-à-vis des USA, connaît pour la première fois depuis 1975 des taux de croissance négatifs (-0,5% du PNB au premier trimestre) et le spectre d'une récession imminente. L'Europe subit, tout carme le Japon, les effets de l'essoufflement de l'économie US et les prévisions de croissance sont toutes successivement révisées à la baisse.
OU EST PASSEE LA "MANNE PETROLIERE" ?
La chute du prix du pétrole et du dollar s'est bien traduite depuis la fin 85 par d'importantes économies en particulier pour les capitaux des pays industrialisés importateurs de pétrole (on parle de 60 milliards de dollars, soit l'équivalent de la production annuelle totale d'un pays comme l'Autriche ou le Danemark). Mais qu'ont fait jusqu'à présent les capitalistes avec cet argent ? Dans les pays sous-développés importateurs de pétrole il n'aura servi qu'à tenter d'éponger un peu de l'énorme endettement extérieur. Dans les pays industrialisés, il n'a fait pour le moment qu'alimenter les spéculations de toutes sortes (métaux précieux, taux de change des monnaies...) et en particulier celle effrénée qui enflamme depuis un an les principales places boursières d'occident.
Confrontés à la tâche quasi impossible de réaliser de véritables investissements productifs (ouverture de nouvelles usines, embauche de nouvelle main d'oeuvre) les capitaux se réfugient dans des manoeuvres spéculatives. Les capitaux affluent, entre autre, aux bourses et les actions des entreprises montent à des vitesses foudroyantes sans que pour autant celles-ci se préparent significativement à investir ou produire plus. C'est ainsi qu'on assiste à ce phénomène aussi absurde que lourd de menaces d'effondrements financiers où l'en voit en un an, entre mai 85 et mai 86, le cours des actions littéralement exploser : +25% en Grande-Bretagne, +30% aux USA et au Japon, +38% en France, +45% en Allemagne, +206% en Italie ! Alors que les indices de la production industrielle stagnent ou reculent carrément : -0,8% en Grande-Bretagne, +0,6% aux USA, -1,7% au Japon (du jamais vu depuis 75), -1,8% en France, +1% en Allemagne, +1,2% en Italie.
La spéculation en de telles proportions est toujours un signe majeur de crise : elle traduit l'impuissance de la machine productive et le déclin du capital' réel au profit de ce que Marx appelait le capital fictif. Pour l'avenir, c'est l'accumulation d'une bombe financière car les profits ainsi contenus sont tout aussi fictifs.
Les économies provoquées par la chute du prix du pétrole ne se transforment pas en facteur de croissance dans les pays industrialisés importateurs car le problème de fond du capitalisme n'est pas un manque de ressources financières mais le manque de débouchés, de marchés solvables pour ses marchandises. Par contre, cette chute a des effets catastrophiques pour les pays exportateurs qui voient se réduire d'autant leur principale source de revenus. Au premier plan de ces victimes, l'URSS, et à travers elle, les pays de l'Est.
LA CHUTE DE PETROLE ET DU DOLLAR : DES MANIFESTATIONS D'UNE NOUVELLE AGGRAVATION DE LA CRISE ECONOMIQUE
Le pétrole n'est pas une matière première tout à fait comme les autres du fait de son importance militaire et économique et du fait que sa distribution et son traitement dans le monde dépendent pour l'essentiel des grandes "multinationales" pétrolières américaines... donc du Pentagone. Mais il n'en demeure pas moins une marchandise soumise à la pression des lois du marché. L'effondrement de son cours nominal n'est pas un phénomène isolé. Il s'intègre entièrement dans le phénomène global de l'actuelle baisse des cours des matières premières (entre 1983 et 85, le prix des matières premières agricoles exportées par les pays en voie de développement ont chuté de 13%, celui des minéraux, minerais et métaux de 8% ; indice CNUCED). C'est là encore un symptôme typique de crise économique, capitaliste. Il y a surproduction de matières premières non pas parce que leur production a particulièrement augmenté, au contraire, mais parce que les industries manufacturières qui les consomment, sont elles-mêmes de plus en plus confrontées à la surproduction. La baisse de leur prix est le signe d'une insuffisance croissante du marché mondial, de la surproduction généralisée de toutes les marchandises.
Quant à la chute du dollar elle a une signification immédiate qui traduit la situation catastrophique de la première puissance mondiale. Pour sortir de l'effondrement de la récession de 1982 le capital américain a dû recourir à une nouvelle fuite en avant dans l'endettement, en particulier par une foudroyante augmentation de son déficit public (cf. graphique). Entre 82 et 85 celui-ci a presque doublé, passant de 128 à 224 milliards de dollars (et on estime qu'il ne sera pas inférieur à 230 milliards en 86), ce qui équivaut à peu près à la production annuelle de l'Espagne et de la Belgique réunis, ou à l'endettement total du Mexique, Brésil et Venezuela réunis ! Quant à sa balance commerciale -la différence entre la valeur des exportations et des importations- son déficit est passé de 34 milliards de dollars en 82 à 124 en 85, soit une augmentation de 265% en 3 ans. De ce fait, on est arrivé à cette situation particulièrement significative de l'état de santé du capitalisme mondial que la première puissance économique est devenue l'Etat le plus endetté du monde.
La chute du cours du dollar est la manifestation de cet état de fait. Le capital américain est contraint de laisser tomber le cours de sa monnaie car d'une part il y trouve le principal moyen de réduire le montant de sa dette astronomique (libellée en dollars), d'autre part parce qu'il n'a pas d'autre moyen pour améliorer la compétitivité de ses marchandises sur le marché mondial.
20 ANS APRES, LES PROBLEMES DES MARCHES POSES PAR LA FIN DE LA RECONSTRUCTION D'APRES-GUERRE REAPPARAISSENT AU GRAND JOUR AVEC UNE FORCE DECUPLEE
Mais au-delà de la signification immédiate de la baisse du dollar au niveau de l'économie américaine, on assiste à la manifestation de l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme mondial depuis la fin des années 60.
Pendant les années 50 et 60 (les "années dorées" disent aujourd'hui avec nostalgie les économistes bourgeois) l'économie mondiale a connu un développement basé essentiellement sur la dynamique de la reconstruction des puissances détruites pendant la 2è guerre mondiale. Les USA "exportaient massivement vers l'Europe et le Japon qui absorbaient tout aussi massivement les produits "made in USA" et le monde entier honorait le roi dollar comme de l'or. Cependant, dans la deuxième moitié des années 60, la reconstruction s'achève ([1] [167]) : l'Europe et le Japon sont devenus des puissances qui, non seulement sont capables d'exporter plus qu'elles n'importent, mais qui en outre ne peuvent plus vivre sans exporter de plus en plus. Dès 1967 un puissant ralentissement de la croissance en Allemagne occidentale déclenche une première récession mondiale. Eh 15 ans celle-ci sera suivie de trois autres récessions chacune plus profonde et étendue que la précédente : 1970, 1975, 1982.
Le capitalisme occidental a jusqu'à présent surmonté ces récessions, en un premier temps -au début des années 70- en "trichant" sur ses propres lois, en abandonnant certains des aspects les plus contraignants de ses propres mécanismes, un peu comme un navire qui, commençant à faire eau de toutes parts, jette à l'eau une partie de son intérieur pour ralentir sa perte. Mais il y est parvenu partout en ayant recours de façon de plus en plus massive au crédit sous toutes ses formes, c'est-à-dire en repoussant à plus tard les échéances... et sans pour autant résoudre le problème de fond : son incapacité intrinsèque à créer lui-même de réels débouchés solvables suffisants pour absorber sa production.
Crédits massifs à certains pays sous-développés, aux, pays du bloc de l'Est, aux pays producteurs de pétrole, enfin crédits au gouvernement de la première puissance mondiale pour financer son armement.
C'est ainsi qu'on voit au cours des années 70 "le miracle brésilien", la modernisation industrielle de certains pays de l'Est (Pologne) avec des prêts occidentaux, le boom des pays pétroliers.
Mais au début des années 80 l'ensemble de ces crédits arrive à échéance : il ne suffit pas de construire des usines et de les faire tourner encore faut-il pouvoir vendre ce qu'elles produisent. Les pays qui ont acquis quelques nouvelles capacités industrielles, incapables de se faire une place dans un marché mondial sursaturé et dominé par les vieilles puissances, se déclarent les uns après les autres incapables de rembourser leurs dettes, et donc à posteriori incapables de continuer à acheter : on connaît la banqueroute du capital polonais en 1980.Celles des autres pays périphériques se succèdent les unes après les autres. Les importations des pays sous-développés non producteurs de pétrole qui croissaient encore en 1980 au rythme de 11% par an, chutent a -5% l’an en 1982. La croissance de celles des pays pétroliers de la périphérie passent de 21% en 1980 à 2% en 82 et -3% en 83.
La récession de 1982, la plus profonde et étendue depuis la 2de guerre mondiale fut la manifestation éclatante de la faillite de cette fuite en avant.
La "relance américaine" de 83-84, faite au prix des déficits que l'on cannait, empêchera que le système bancaire mondial, et donc le système économique lui-même, ne s'effondre totalement. Cependant, malgré les gigantesques moyens mis en oeuvre par le capital américain, la relance n'en sera pas une réellement : elle ne réussit pas à relancer l'économie des pays périphériques qui s'effondre, l'Europe elle-même ne parvenant qu'à stagner. Dès la mi-85 la "locomotive" donne tous les signes de l'essoufflement.
L'actuelle baisse du dollar, le développement vertigineux du protectionnisme américain, les mesures prises par le gouvernement US pour réduire son déficit public, sont la manifestation de la fin de cette quatrième tentative de "relance" d'un capitalisme mondial décadent qui, depuis près de 20 ans, s'enfonce dans des convulsions- toujours plus profondes et tragiques pour l'humanité, incapable de dépasser ses propres contradictions.
LES PERSPECTIVES
Contraction du marché mondial par la banqueroute des pays sous-développés - producteurs de pétrole ou non -, par celle de l'économie des pays de l'Est, par 1'incessibilité pour les grandes puissances de poursuivre la fuite en avant dans l'endettement, menaces d'effondrement bancaires et financiers, même les économistes bourgeois les plus optimistes ne se risquent plus à parler sérieusement de véritable relance.
L'avenir des différents capitaux du monde est celui de la plongée dans la récession et d'une exacerbation sans précédent d'une guerre commerciale sans quartiers pour les parts de marché entre les capitaux "survivants".
Plus le marché mondial se rétrécit et plus cette guerre devient et deviendra aiguë. Or l'arme principale dans cette concurrence pour les marchés, c'est la réduction des prix de vente et donc des coûts de production, celui de la force de travail en premier lieu.
Licenciements de la main d'oeuvre dans les secteurs considérés peu compétitifs, 'flexibilité" de la force de travail, généralisation du travail temporaire et précaire, réduction des salaires versés sous forme monétaire, réduction des salaires versés sous forme de prestations sociales - de la sécurité sociale aux allocations familiales en passant par les retraites, l'enseignement, la santé, etc.
De l'Australie à la Norvège, du Japon à la Belgique, de l'Argentine aux Etats-Unis, tous les gouvernements appliquent des plans dits "d'austérité" destinés à réduire les coûts de main d'oeuvre, à attaquer brutalement les conditions d'existence de la classe ouvrière, pour permettre au capital de survivre.
Plus que jamais la logique de l'exploitation capitaliste apparaît pour ce qu'elle est : la négation antagonique des intérêts les plus élémentaires des travailleurs.
La décomposition de ce système barbare et décadent se fait et se fera en réduisant les classes exploitées à une misère intenable. Mais, ce faisant, elle développe les conditions qui permettent au prolétariat mondial, à travers sa lutte de résistance, de réaliser enfin son unité internationale et de s'affronter à sa tâche historique : la destruction du capitalisme et la construction du communisme.
R.V.
[1] [168] Voir notre brochure "La décadence du capitalisme" sur 1'analyse de l'évolution du capitalisme depuis la seconde guerre mondiale
Récent et en cours:
- Crise économique [63]
1936 : la gauche mène le prolétariat à la boucherie impérialiste
- 4591 reads
Il y a 50 ans, en 1936, au printemps, explosait en
France une vague de grèves ouvrières spontanéescontre l'aggravation de
l'exploitation provoquée par la crise économique et le développement de l'économie
de guerre. En juillet, en Espagne, face soulèvement militaire de Franco,
l'ensemble de la classe ouvrière partait aussi en grève pour répondre à
l'attaque. Trotski crut voir le début d'une nouvelle vague
révolutionnaire internationale.
Cependant, en quelques mois, l'appareil politique de la gauche du capital, sachant se mettre à la tête de ces mouvements, parviendra à les saboter de l'intérieur, participera à leur répression et enfin, enfermant les ouvriers dans la fausse alternative fascisme/anti-fascisme, remplira le rôle de sergent-recruteur idéologique pour la préparation de ce qui allait être la 2ème boucherie inter-impérialiste mondiale.
Si nous consacrons, à l'occasion de cet anniversaire, deux articles sur ces événements, c'est parce qu'il est aujourd'hui indispensable :
- de dénoncer le mensonge colporté par "la gauche" du capital selon lequel celle-ci aurait été pendant ces événements 1'incarnation-des intérêts de la classe ouvrière, en montrant au contraire comment elle en fut le bourreau ;
- de rappeler les leçons tragiques de ces expériences, en particulier le piège fatal que constitue pour la classe ouvrière d'abandonner le terrain de la défense intransigeante de ses intérêts spécifiques, pour se soumettre aux nécessités d'un camp bourgeois contre un autre ;
- de mettre en évidence ce qui distingue les années 30 - marquées par la défaite de la vague révolutionnaire des années 1917-23 et le triomphe de la contre-révolution - de l'actuelle période historique Ou de nouvelles générations de prolétaires cherchent à se dégager des idéologies contre-révolutionnaires à travers une confrontation permanente et croissante contre le capital et cette même gauche ; une confrontation que le prolétariat ne pourra mener jusqu'à son terme, les révolution communiste, qu'en se réappropriant les leçons, si chèrement payées, de son expérience passée.
GUERRE D'ESPAGNE, répétition de la guerre mondiale
1986 marque le cinquantième anniversaire des événements de 1936 en Espagne. La bourgeoisie commémore cette date par des campagnes de falsification des faits, lançant le pernicieux message que les événements de 1936 auraient été une "révolution prolétarienne", alors qu'aujourd'hui, par contre, nous serions dans une situation de "recul et de défaites", de "crise de la classe ouvrière", de soumission toujours plus forte aux diktats du capitalisme.
Il est bien évident que cette leçon, que la bourgeoisie veut que nous tirions de ces événements passés, fait partie de toute sa tactique de dispersion, d'isolement, de division contre le développement des luttes ouvrières. Il s'agit de les noyer dans un soi-disant climat d'apathie et de démobilisation pour s'opposer à leur extension et leur unification.
Face à ces manoeuvres, notre position militante défend les potentialités immenses des luttes actuel les du prolétariat avec la même force qu'elle rejette le mensonge d'une "révolution sociale" en 1936. Nous nous réclamons du courage et de la lucidité de BILAN qui dénonçait, contre le courant, la tuerie impérialiste perpétrée en Espagne, et qui nous fournit la méthode qui nous permet d'affirmer aujourd'hui les potentialités de la lutte de classe dans les années 80 et d'assumer une intervention déterminée en son sein.
GUERRE IMPERIALISTE OU REVOLUTION PROLETARIENNE ?
Comment caractériser les événements qui se sont déroulés en Espagne à partir de 1931 et qui se sont accélérés à partir de 1936?
Notre méthode ne peut se fonder exclusivement sur la violence et la radicalité des heurts entre les classes qui secouèrent l'Espagne de l'époque, mais sur l'analyse du rapport de forces entre les classes à échelle capitaliste internationale et sur toute une époque historique
Cette analyse du cours historique nous permet de déterminer si les différents conflits et situations s'inscrivent dans un processus de défaites du prolétariat dans la perspective de la guerre impérialiste généralisée ou, par contre, dans un processus de montée de la lutte de classes s'orientant vers des affrontements de classe révolutionnaires.
Pour savoir dans quel cours s'inscrivent les événements de 1936, il faut répondre à une série de questions :
- quel était le rapport de forces mondial entre les classes ? Evoluait-il en faveur du prolétariat ou de la bourgeoisie ?
- quelle était l'orientation des organisations politiques du prolétariat ? Vers la dégénérescence opportuniste, la désagrégation et l'intégration dans le camp capitaliste ou, au contraire, vers la clarté et le développement de leur influence ? Plus concrètement : le prolétariat disposait-il d'un parti capable d'orienter ses combats vers la prise du pouvoir ?
- les conseils ouvriers se sont-ils développés et affirmés comme alternative du pouvoir ?
- les luttes prolétariennes ont-elles attaqué l'Etat capitaliste sous toutes ses formes et institutions ?
Face à ces questions notre méthode est celle de BILAN et des autres communistes de gauche (par exemple la minorité de la Ligue des Communistes Internationaux de Belgique à la tête de laquelle se trouvait Mitchell) : ils partent d'une analyse historique et mondiale du rapport de forces dans laquelle inscrivent les événements d'Espagne; ils constatent non seulement l'inexistence d'un parti de classe, mais la débandade et le passage dans le camp de la bourgeoisie de la grande majorité des organisations ouvrières; ils dénoncent la récupération rapide des organismes ouvriers embryonnaires du 19 juillet 1936 par l'Etat capitaliste et, surtout, ils élèvent leur voix contre le piège criminel d'une soi-disant "destruction" de l'Etat capitaliste républicain qui "disparaît" sous la couverture d'un "gouvernement ouvrier" détruisant le terrain de classe des ouvriers et les mène à la tuerie impérialiste de la guerre contre Franco.
Quel était le rapport de forces après les terribles défaites des années 20 ? De quelle manière la mort de l'Internationale communiste ainsi que la dégénérescence accélérée des partis communistes conditionnaient-elles la situation des ouvriers espagnols ? Que restait-il, en définitive, dans les années 30 ? Un cours vers l'affrontement entre les classes ?
Répondre à ces questions était vital pour déterminer s'il y avait ou non révolution en Espagne et, surtout, pour se prononcer sur la nature du violent conflit militaire établi entre les forces franquistes et les forces républicaines, pour voir leur rapport avec l'aggravation des conflits impérialistes qui frappent le monde à cette époque.
L'ABANDON DU TERRAIN DE CLASSE
Le 19 juillet 1936, les ouvriers déclarent la grève contre le soulèvement de Franco et vont massivement aux casernes pour désarmer cette tentative, sans demander la permission au Front Populaire ni au Gouvernement Républicain qui leur font autant de croche-pieds que possible. Unissant la lutte revendicative à la lutte politique, les ouvriers dans cette action arrêtent la main meurtrière de Franco. Mais une autre main meurtrière les paralyse en faisant semblant de leur serrer la main : c'est le Gouvernement Républicain, le Front Populaire, Companys, qui, avec l'aide de la CNT et du POUM, réussissent à faire que les ouvriers abandonnent le terrain de classe de la bataille sociale, économique et politique contre Franco et la République, et se déplacent sur le terrain capitaliste d'une bataille exclusivement militaire dans les tranchées et la guerre de positions, exclusivement contre Franco. Devant la riposte ouvrière du 19 juillet l'Etat républicain "disparaît", la bourgeoisie "n'existe plus", tous se cachent derrière le Front Populaire et les organismes "plus à gauche" tels que le Comité Central de Milices Antifascistes ou le Conseil Central de l'Economie. Au nom de ce "changement révolutionnaire" si facilement conquis, la bourgeoisie demande et obtient des ouvriers l'Union Sacrée autour du seul et unique objectif de battre Franco. Les sanglants massacres qui ont lieu par la suite en Aragon, à Oviedo, à Madrid, sont le résultat criminel de la manoeuvre idéologique de la bourgeoisie républicaine qui fait avorter les germes classistes du 19 juillet 1936.
Ayant quitté son terrain de classe, le prolétariat non seulement devra subir l’égorgement guerrier mais, en conséquence, il lui sera imposé toujours plus de sacrifices au nom de la production pour la guerre "de libération" : réduction des salaires, inflation, rationnements, journées de travail épuisantes... Désarmé politiquement et physiquement, le prolétariat de Barcelone se soulèvera de désespoir en mai 1937 et sera vilement massacré par ceux qui l'avaient bassement trompé : "Le 19 juillet 1936, les prolétaires de Barcelone, AVEC LEURS POINGS NUS, écrasèrent l'attaque de bataillons de Franco, ARMES JUSQU'AUX DENTS. Le 4 mai 1937, ces mêmes prolétaires, MUNIS D'ARMES, laissent sur le pavé bien plus de victimes qu'en juillet lorsqu'il doivent repousser Franco et c'est le gouvernement antifasciste -comprenant jusqu'aux anarchistes et dont le POUM est indirectement solidaire- qui déchaîne la racaille des forces répressives contre les ouvriers." (BILAN "Plomb, mitraille, prison : ainsi répond le front populaire aux ouvriers de Barcelone osant résister à l'attaque capitaliste") "Les fronts militaires : une nécessité imposée par les situations ? Non ! Une nécessité pour le capitalisme afin d'encercler et d'écraser les ouvriers ! Le 4 mai 1937 apporte la preuve éclatante qu'après le 19 juillet, le prolétariat avait à combattre Companys, Giral, tout autant que Franco. Les fronts militaires ne pouvaient que creuser la tombe des ouvriers parce qu'ils représentaient les fronts de la guerre du capitalisme contre le prolétariat. A cette guerre, les prolétaires espagnols -à 1 'exemple de leurs frères russes de 1917- ne pouvaient riposter qu'en développant le défaitisme révolutionnaire dans les deux camps de la bourgeoisie : le républicain comme le "fasciste", et en transformant la guerre capitaliste en guerre civile en vue de la 'destruction totale de l'Etat bourgeois. (BILAN, idem)
L'argument" selon lequel en Espagne 1936, il y a eu une "révolution" est d'une incroyable légèreté et implique une totale ignorance des conditions d'une réelle révolution prolétarienne.
Le contexte international était à la défaite et la désagrégation ouvrières :-"Si le critère internationaliste veut dire quelque chose, il faut affirmer que sous le signe d'une croissance de la contre-révolution au niveau mondial, 1'orientation politique de l'Espagne, entre 1931 et 1936, ne pouvait que poursuivre une direction parallèle et non le cours inverse, d'un développement révolutionnaire. La révolution ne peut atteindre son plein développement que comme produit d'une situation révolutionnaire à échelle internationale. Ce n'est que sur cette base que nous pouvons expliquer les défaites de la Commune de Paris et de la Commune russe de 1905, ainsi que la victoire du prolétariat russe en octobre 1917" (Mitchell : "La guerre en Espagne", janvier 1937).
Les organisations politiques prolétariennes souffraient, dans leur immense majorité, une terrible débandade : les PC s'intégraient définitivement à leurs capitaux nationaux respectifs, le trotskysme se perdait dramatiquement dans l'opportunisme, les rares organisations fidèles au prolétariat ("Bilan", etc.) souffraient d'un terrible isolement : "Notre isolement n'est pas fortuit : il est la conséouence d'une profonde victoire du capitalisme mondial qui est parvenu à gangrener jusqu'aux groupes de la gauche communiste dont le porte-parole a été jusqu'à ce jour Trotsky." (BILAN "L'isolement de notre fraction devant les événements d'Espagne"). "S'il restait le moindre doute sur le rôle fondamental du parti dans la révolution, l'expérience espagnole depuis juillet 1936 aurait suffi pour l'effacer définitivement. Même si on assimile l'attaque de Franco à l'aventure de Kornilov en août 1917(ce qui est faux historiquement et politiquement le contraste entre les deux évolutions est impressionnant L'une, en Espagne détermine la collaboration progressive entr les classes jusqu'à l'union sacrée de toutes les forces politiques ; l'autre, en Russie se dirige vers une élévation de la lutte de classes qui culmine dans 1'insurrection victorieuse, sous le contrôle vigilant du parti bolchevique, trempé, tout au long de quinze années de lutte, par la critique et la lutte armée".(Mitchell : "La guerre en Espagne", janvier 1937).
Il ne peut y avoir une débandade opportuniste vers la bourgeoisie de toutes les forces révolutionnaires en même temps que les masses ouvrières vont de victoire en victoire. C'est tout le contraire : la montée de la lutte de classes est le résultat, en même temps qu'elle l'impulse, d'un mouvement de clarification et de regroupement des révolutionnaires et le fait que ceux-ci se trouvent réduits à leur plus simple expression traduit, en même temps qu'il le renforce, un cours de défaites de la classe ouvrière.
LA SOUMISSION A L'ETAT BOURGEOIS
Malgré la propagande qui a été faite sur la "valeur révolutionnaire" des Comités d'Usine, les collectivités, etc. , il n'a pas existé non plus de conseils ouvriers en 1936 : "Immédiatement étouffés, les comités d'usine, les comités de contrôle des entreprises où l'expropriation ne fut pas réalisée (en considération du capital étranger ou pour d'autres considérations) se transformèrent en organes devant activer la production et, par là, furent déformés dans leur signification de classe. Il ne s'agissait pas d'organismes créés pendant une grève insurrectionnelle pour renverser l'Etat, mais d'organismes orientés vers 1'organisation de la guerre, condition essentielle pour permettre la survivance et le renforcement de cet Etat'.' (BILAN "La leçon des événements d'Espagne")
Pour entraîner les ouvriers dans la boucherie inter capitaliste, tous, de Companys au POUM, d'Azana à la CNT "cèdent le pouvoir" aux organismes ouvriers :
"En face d'un incendie de classe, le capitalisme ne peut même pas songer à recourir aux méthodes classiques de la légalité. Ce qui le menace, c'est 1'INDEPENDANCE de la lutte prolétarienne conditionnant l'autre étape révolutionnaire vers l'abolition de la domination bourgeoise. Le capitalisme doit donc renouer les fils de son contrôle sur les exploités. Ces fils, qui. étaient précédemment la magistrature, la police, les prisons, deviennent dans la situation extrême de Barcelone, les Comités des Milices, les industries socialisées, les syndicats ouvriers gérant les secteurs essentiels de l'économie, les patrouilles de vigilance, etc." (BILAN "Plomb, mitraille, prison : ainsi répond le front populaire aux ouvriers de Barcelone osant résister à l'attaque capitaliste")
En fin de comptes, le pire des mensonges a été le mirage criminel de la soi-disant "destruction" ou "disparition" de l'Etat républicain. Laissons la voix marxiste de BILAN et la minorité de la Ligue des Communistes dénoncer ce mensonge :
1) "En ce qui concerne 1'Espagne, on a souvent évoqué la révolution prolétarienne en marche, on a parlé de la dualité de pouvoirs, le pouvoir "effectif" des ouvriers, la gestion 'socialiste', la 'collectivisation' des usines et de la terre, mais à aucun moment n'ont été posés sur des bases marxistes le problème de l'Etat ni celui du parti." (Mitchell :"La guerre d'Espagne")
2) "Ce problème fondamental (il se réfère à la question de l'Etat) a été remplacé par celui de la destruction des 'bandes fascistes' et l'Etat bourgeois est resté debout en adoptant une apparence 'prolétarienne'. On a permis que ce qui domine soit l'équivoque criminelle sur sa destruction partielle et on a juxtaposé à l'existence d'un 'pouvoir ouvrier réel' le 'pouvoir de façade' de la bourgeoisie, qui se concrétisera en Catalogne dans deux organismes 'prolétariens' : le Comité Central des Milices Antifascistes et le Conseil d'Economie." (Mitchell, idem)
3) "Le Comité Central des milices représente l'arme inspirée par le capitalisme pour entraîner, par l'organisation des milices, les prolétaires en dehors des villes et de leurs localités, vers les fronts territoriaux où ils se feront massacrer impitoyablement. Il représente l'organe qui rétablit l'ordre en Catalogne, non avec les ouvriers, mais contre ceux-ci, qui seront dispersés sur les fronts. Certes l'armée régulière est pratiquement dissoute, mais elle est reconstituée graduellement avec les colonnes de miliciens dont 1'Etat-Major reste nettement bourgeois, avec les Sandino, les Villalba et consorts. Les colonnes sont volontaires et elles peuvent le rester jusqu'au moment où finiront la griserie et 1 'illusion de la révolution et réapparaîtra la réalité capitaliste. Alors on marchera à grands pas vers le rétablissement officiel de l'armée régulière et vers le service obligatoire." (BILAN "La leçon des événements d'Espagne")
4) "Les ressorts essentiels de l'Etat bourgeois sont restés intacts :
- l'armée a pris d'autres formes - en devenant des milices- mais elle a conservé son contenu bourgeois en défendant les intérêts capitalistes de la guerre antifasciste ;
-la police, formée par les gardes d'assaut et les gardes civils, n'a pas été dissoute mais s'est cachée pendant un temps dans les casernes pour reparaître au moment opportun ;
- la bureaucratie du pouvoir central a continué à fonctionner et a étendu ses ramifications à l'intérieur des milices et du Conseil de 1'Economie dont elle n'a pas du tout été un agent exécutif, mais au contraire à qui elle a inspiré des directives en accord avec les intérêts capitalistes." (Mitchell, idem)
5) "Les tribunaux ont été rétablis rapidement dans leur fonctionnement avec l'aide de 1'ancienne magistrature, plus la participation des organisations "antifascistes". Les Tribunaux populaires de Catalogne partent toujours de la collaboration entre les magistrats professionnels et des représentants de tous les partis. [...] Les banques et la Banque d'Espagne sont restées intactes et partout des mesures de précaution furent prises pour empêcher (même par la force des armes) la mainmise des masses." (BILAN, op. cit.)
ANNEES 30 - ANNEES 80
Nous avons déjà vu que, comme Marx l'a dit, l'idéologie bourgeoise nous présente la réalité cul par dessus tête : les années 30 seraient ainsi des années "révolutionnaires" tandis qu'aujourd'hui nous serions dans une époque "contre-révolutionnaire".
Si la bourgeoisie insiste tellement sur cette réalité renversée c'est précisément à cause de la profonde crainte qu'elle ressent devant les potentialités de la lutte ouvrière à notre époque et parce que, en même temps, elle regrette ces années 30 où elle a pu enrôler le prolétariat pour la boucherie impérialiste et lui présenter chacune de ses défaites comme de "grandes victoires".
A L'EPOQUE, en 1936, les mystifications sur l’anti-fascisme, la "défense de la démocratie", faire prendre parti entre fractions opposées du capital (fascisme/anti-fascisme, droite/gauche, Franco/République), polarisent de manière croissante le prolétariat mondial, augmentant sa démoralisation et son adhésion aux plans de guerre de la bourgeoisie, culminant dans la terrible boucherie de 1939-45.
AUJOURD'HUI les mystifications de l’anti-fascisme, la défense nationale, le soutien à la Russie "patrie du socialisme", convainquent de moins en moins les ouvriers qui montrent une hostilité et une méfiance croissantes devant de tels mensongers. Cela ne s'est certes pas traduit, pour le moment, en une compréhension massive de la nécessité d'opposer une alternative révolutionnaire à la débâcle du capitalisme, laissant prévaloir trop souvent encore une attitude de scepticisme et d'expectative. Mais cette attitude peut et doit se transformer, avec le développement des luttes ouvrières contre les attaques toujours plus brutales et massives du capital en crise, et avec l'intervention des révolutionnaires en leur sein.
A L'EPOQUE, les gouvernements de gauche, les Fronts Populaires, ont suscité une ample adhésion de la part de la classe ouvrière, au point que ce sont eux qui, dans beaucoup de pays (France, Suède, Espagne) ont assumé la tâche de convaincre les ouvriers d'accepter "pour le bien de la Patrie", tous les sacrifices imaginables.
AUJOURD'HUI, la classe ouvrière s'oppose, en défense de ses besoins en tant que classe, à tout gouvernement, fût-il de droite ou de gauche, au point d'"appliquer dans la pratique" la consigne que BILAN défendait sans succès dans les années 30 : "Ne pas faire le jeu de la gauche quand on lutte contre la droite et ne pas avantager la droite quand, on lutte contre la gauche". Une démonstration concluante en est que les gouvernements "socialistes" en France, en Grèce, en Espagne, en Suède, etc. ont eu affaire à des ripostes massives et acharnées des travailleurs qui ne se sont pas laissés tromper par le chantage selon lequel ils seraient en train de s'opposer à "leur" gouvernement.
A L'EPOQUE, les partis prolétariens, créés lors de la formation de la 3ème Internationale, les partis communistes, menaient à terme un processus tragique de dégénérescence opportuniste en s'intégrant définitivement au camp capitaliste et en utilisant leur passé ouvrier -qui était indiscutable- pour cautionner une politique de défense de l'Etat bourgeois. Quant aux fractions communistes qui s'en étaient dégagées et poursuivaient le travail de défense intransigeante des positions de classe, elles étaient de plus en plus réduites à l'isolement et se heurtaient à l'incompréhension croissante des ouvriers.
AUJOURD'HUI les organisations qui ont su rester fidèles à la continuité historique des positions communistes élargissent leur écho dans la classe, en même temps que surgissent, un peu partout, des noyaux, des groupes, des éléments, qui n'ont aucune illusion sur les forces de gauche du capital et recherchent véritablement une cohérence communiste. Tout cela, bien qu'à ses débuts et encore entravé par les doutes et les hésitations, constitue la base d'un processus de décantation politique qui conduit à la constitution du Parti Communiste Mondial, d'une nouvelle Internationale du prolétariat.
En d'autres termes, alors que les luttes ouvrières de 1936, en particulier en Espagne, s'inscrivaient dans le cours ouvert par la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23, et le triomphe de la contre-révolution en Allemagne, Italie, Europe centrale, Russie, les combats ouvriers de notre époque s'inscrivent dans un processus de reconstitution de l'unité du prolétariat mondial qui se dégage de l'emprise de l'idéologie de la classe dominante pour livrer de nouvelles batailles décisives contre le capital.
LES MANOEUVRES DE LA GAUCHE : UNE EXPERIENCE A NE PAS OUBLIER
La comparaison des deux époques nous conduit à une autre leçon fondamentale : la continuité qui existe dans le travail anti-ouvrier des partis de gauche et des syndicats, à l'époque et aujourd'hui. Leurs tactiques ne sont pas les mêmes car, comme nous venons de le voir, les différences dans le rapport de forces entre les classes et dans l'état de la conscience ouvrière sont évidentes, mais ce qui n'a pas changé est leur fonction anti-ouvrière en tant que bastion fondamental de l'Etat capitaliste contre les luttes ouvrières.
Malgré les conditions historiques différentes, un examen des virages, des manoeuvres des partis de gauche, des syndicats -particulièrement de la CNT- dans l'Espagne de 1936, peut nous offrir des leçons pour combattre leurs manoeuvres et pièges dans les luttes actuelles.
En 1931, le PSOE, qui avait déjà montré son intégration au capital espagnol avec sa collaboration ouverte avec la dictature de Primo de Rivera (Largo Caballero a été conseiller d'Etat du dictateur et l'UGT faisait office d'indicateur dans les usines) a fait alliance avec les républicains et, jusqu'en 1933, a participé à la féroce répression des luttes ouvrières et paysannes,
Mais, comme nous l'avons indiqué "La gauche n'accomplit pas [sa fonction capitaliste] uniquement et même pas généralement au pouvoir. La plupart du temps, elle 1'accomplit plutôt en étant dans 1'opposition parce qu'il est généralement plus facile de l'accomplir en étant dans l'opposition qu'au pouvoir. (...) Leur présence au gouvernement les rend plus vulnérables, leur usure au pouvoir plus grande et leur crédibilité se trouve plus rapide ment mise en- question. Dans une situation d'instabilité, cette tendance est encore accélérée. Or, la baisse de leur crédibilité les rend inaptes pour assurer leur fonction d'immobilisation de la classe ouvrière" (Revue Internationale n°18, p.25, 26 : "Dans l'opposition comme au gouvernement, la "gauche" contre la classe ouvrière").
Pour ces raisons, le PSOE qui, en janvier 1933, se tachait les mains de sang ouvrier à Casasviejas, quittait le gouvernement en mars et, suivi par l'UGT, "radicalisait" son langage au point que Largo Caballero, ancien conseiller d'Etat de Primo de Rivera et ministre du Travail de 1931 à 1933, devenait le "Lénine espagnol" !
Dans l'opposition, le PSOE promettait aux ouvriers la "révolution" et parlait partout d'"immenses dépôts d'armes prêts pour quand viendrait le moment opportun de réaliser l'insurrection". Avec cette "musique céleste", il s'opposait aux luttes revendicatives des ouvriers qui, soi-disant, "portaient préjudice aux plans d'insurrection" et tout ce qu'il visait était, de même que son compère en Autriche à la même époque, d'amener les ouvriers à un affrontement suicide avec l'Etat bourgeois pour les saigner cruellement.
En octobre 1934 les ouvriers des Asturies sont tombés dans ce piège. Leur héroïque insurrection dans les zones minières et dans la ceinture industrielle d'Oviedo et de Gijon s'est trouvée complètement isolée par le PSOE qui a empêché par tous les moyens que dans le reste de l'Espagne, particulièrement à Madrid, les ouvriers ne secondent le mouvement. Tout au plus a-t-il toléré des grèves "pacifiques", incapables d'étendre le front ouvert par les mineurs des Asturies.
Cette manoeuvre criminelle du PSOE et de l'UGT a permis au gouvernement républicain d'écraser la révolte ouvrière par une répression sauvage. A la tête des troupes du massacre se trouvait Franco, qualifié par les partis de l'époque de général "professionnel, loyal à la République".
Mais le massacre des Asturies a ouvert une répression féroce dans tout le pays : tout militant ouvrier remarqué était mis en prison sans que le "Lénine espagnol", Largo Caballero, ne bougeât le petit doigt.
Le doigt que le PSOE a bougé, en concordance avec une tactique générale mise en pratique dans d'autres pays européens, a été le fameux "Front Populaire". Ensemble avec le PSOE, l'UGT et les partis républicains (Azana et Cie) se sont ligués le PCE (illustrant par là son passage définitif dans la défense de l'Etat bourgeois), la CNT et le POUM, deux organismes qui avaient jusqu'alors été ouvriers, qui l'ont appuyé "de manière critique".
Le "Front Populaire" prétendait ouvertement remplacer la lutte ouvrière par la farce électorale, la lutte en tant que classe contre toutes les fractions du capital par la lutte sur le terrain de ce dernier contre sa fraction "fasciste" au bénéfice de son aile "antifasciste". A la lutte revendicative d'ouvriers et de paysans pauvres, il opposait un illusoire et ridicule "programme de réformes" qui ne serait jamais appliqué. A la seule perspective possible pour le prolétariat (sa révolution communiste) il opposait une fantasmagorique "révolution démocratique".
Il s'agissait là d'un crime de démobilisation des ouvriers, de dévoiement de leur combat sur le terrain de la bourgeoisie, c'était une manière concrète de les désarmer, de briser leur unité et leur conscience, de les livrer, pieds et poings liés, aux militaires qui, depuis le jour même du triomphe du Front Populaire (février 1936), préparaient tranquillement un bain de sang parmi les ouvriers avec l'assentiment tacite du gouvernement "populaire".
Quand enfin Franco s'est soulevé le 18 juillet, le Front Populaire, montrant son vrai visage, n'a pas seulement essayé de calmer les ouvriers et de les renvoyer chez eux, mais a refusé catégoriquement de répartir les armes. Dans une fameuse déclaration, le Front Populaire appelait au calme et lançait sa devise "LE GOUVERNEMENT COMMANDE, LE FRONT POPULAIRE OBEIT", ce qui revenait concrètement à demander aux ouvriers de rester passifs et obéissants afin de se laisser massacrer par les militaires. C'est ce qui est arrivé à Séville, où les ouvriers ont suivi les consignes de calme et d'attente "des ordres du gouvernement", données par le très "antifasciste" PCE, ce qui a permis au général Queipo del Llano de prendre facilement le contrôle et d'organiser un terrible bain de sang.
Ce ne fut, comme nous l'avons vu plus haut, que le soulèvement pour leur propre compte des ouvriers à Barcelone et dans d'autres centres industriels, sur leur propre terrain de classe, unissant la lutte revendicative à la lutte politique, qui a paralysé pour un moment le bourreau Franco.
Mais les forces de gauche du capital, les PSOE-PCE et compagnie, ont su réagir à temps et ont déployé une manoeuvre qui allait devenir décisive. Rapidement, en 24 heures, ils se sont mis à la tête du soulèvement ouvrier et ont essayé de l'acheminer -avec succès- vers l'affrontement exclusivement contre Franco -laissant ainsi le chemin libre à la République et au Front Populaire- et exclusivement sur un terrain militaire, hors du terrain social, revendicatif et politique, hors des grandes concentrations industrielles et urbaines.
En vingt-quatre heures le gouvernement de Martinez Barrio -formé pour négocier avec tes militaires rebelles et organiser avec eux le massacre des ouvriers- a été remplacé par le gouvernement de Giral, plus "intransigeant" et "antifasciste".
Mais l'essentiel a été de s'assurer l'appui inconditionnel de la CNT, qui regroupait le gros des ouvriers en Espagne et qui, rapidement, a déconvoqué la grève et a orienté les organismes ouvriers créés spontanément dans les usines et quartiers ouvriers -les Comités, les Milices, les Patrouilles de Contrôle- vers la collaboration "antifasciste" avec les autorités républicaines (les Companys, Azana, Front Populaire, etc.) et vers leur transformation en agences de recrutement d'ouvriers pour la boucherie sur le front.
Avec ce pas culminait la dégénérescence de la CNT qui s'intégrait définitivement à l'Etat capitaliste. La présence de ministres cénétistes au gouvernement catalan d'abord et au gouvernement central ensuite, présidé par l'inévitable Largo Caballero, ne faisait que sceller cette trajectoire. Tous les organismes dirigeants de la CNT déclarèrent une guerre féroce contre les rares courants qui, même dans une terrible confusion, luttaient pour défendre une position révolutionnaire. Ce fut le cas, par exemple, des groupes autour de la revue "Les Amis du Peuple". Ils se sont trouvés isolés, expulsés, envoyés aux positions les plus dangereuses du front, dénoncés indirectement à la police républicaine, etc., par toute la bande des Garcia Oliver, Montseny , Abad de Santillan, et Cie.
La manoeuvre du Front Populaire de la "guerre antifasciste, a été définitive et a conduit les ouvriers espagnols à une tuerie aux proportions monstrueuses : plus d'un million de morts. Mais la tuerie s'est pro longée par des souffrances incroyables à l'arrière pas seulement franquiste mais aussi républicaine. Là, au nom de la guerre "antifasciste", les quelques conquêtes ouvrières concédées pour calmer le soulèvement ouvrier du 19 juillet 1936, ont été immédiatement annulées, la CNT ayant été la première à le demander. Les salaires de misère, les journées épuisantes, les rationnements, la militarisation du travail, ont scellé une exploitation sauvage et totale des ouvriers.
Le PCE fut alors le principal parti de l'exploitation, du sacrifice pour la guerre et la répression anti-ouvrière.
Le parti stalinien avait comme mot d’ordre "Non aux grèves dans l'Espagne démocratique", et cela était plus qu'un mot d’ordre, c'était le drapeau pour empêcher, au moyen de la police -qu'il contrôlait en majorité- toute lutte, toute revendication dans les usines. C'est la succursale catalane du PCE, le PSUC, qui a organisé, en janvier 1937, une manifestation "populaire" contre les Comités d'Usine trop réticents aux impératifs de la militarisation.
Le PCE est devenu, dans l'Espagne républicaine, le parti de l'ordre. C'est comme ça qu'il a acquis l'estime de nombreux militaires, propriétaires agricoles et industriels, fonctionnaires de la police, et de nombreux et qualifiés "senontos" d'extrême-droite qui y ont adhéré ou l'ont appuyé. Avec cet aval, il a rapidement contrôlé les appareils répressifs de l'Etat républicain, vidant les prisons des fascistes et patrons et les remplissant d'ouvriers combatifs.
Le point culminant de ces bons et loyaux services rendus au capitalisme a été la tuerie de mai 1937. Les ouvriers de Barcelone, en ayant assez de tant de souffrances et d'exploitation, se sont soulevés devant la provocation de la police face aux travailleurs du téléphone. Le PCE a immédiatement organisé une répression féroce, déplaçant des troupes de Valence et du front d'Aragon. La CNT et le POUM, faisant des appels au "calme", à la "réconciliation entre frères", etc., ont collaboré en immobilisant les ouvriers. Franco a arrêté momentanément les hostilités pour faciliter aux bourreaux staliniens l'écrasement des ouvriers.
La guerre d'Espagne se prolongea jusqu'en 1939. Elle se conclut par la victoire de Franco et l'établissement du régime politique que l'on sait. L'effroyable répression qui s'en suivit sur les prolétaires qui a/aient participé à la guerre dans le camp républicain. acheva la saignée que la bourgeoisie venait d'effectuer sur un des secteurs les plus combatifs du prolétariat à cette époque. Les horreurs de la dictature obscurantiste firent en partie oublier celles de la "dictature-démocratique" de la République du début des années 30 et tout le travail de sabotage et répression des luttes ouvrières par les forces "de gauche" du capital (PCE, PSOE, CNT) pendant les années de la guerre civile. Cinquante ans après, les prolétaires espagnols subissent le pouvoir et l'exploitation capitaliste à nouveau sous la forme de la démocratie bourgeoise, franquistes et républicains réconciliés derrière une même armée et une même police pour préserver et gérer l'ordre social existant.
Cinquante ans après, alors que la résistance ouvrière contre les effets de la crise économique capitaliste fait de nouveau se reconstituer, aux quatre coins de la planète, l'armée des prolétaires de tous les pays, les avertissements de BILAN de 1936, les leçons de la tragédie espagnole, doivent être clairement assimilés : les prolétaires ne peuvent se défendre efficacement qu'en comptant uniquement sur leurs propres forces, imposant l'autonomie de leur classe. Tout abandon du terrain tracé par la défense intransigeante de leurs intérêts de classe au profit d'une quelconque alliance avec quelque fraction que ce soit de la classe dominante, se fait à leurs dépens et conduit aux pires défaites.
Adalen
LE "FRONT POPULAIRE" EN FRANCE, du dévoiement des grèves à l'union nationale (extraits de Bilan)
"Le Front Populaire s'est avéré être le processus réel de la dissolution de la conscience de classe des prolétaires, l'arme destinée à maintenir .dans toutes les circonstances de leur vie sociale et politique les ouvriers sur le terrain du maintien de la société bourgeoise." BILAN N° 31 - Mai-juin 1936
En ce début des années 30, 1 'anarchie de la production capitaliste est totale. La crise mondiale jette sur le pavé des millions de prolétaires. Seule 1'économie de guerre, pas seulement la production massive d'armement mais aussi toute 1'infrastructure nécessaire à cette production, se développe puissamment. Autour d'elle 1'industrie s'organise ; elle impose les nouvelles organisations du travail dont le "taylorisme" sera un des plus beaux rejetons.
Sur le front social, malgré la puissante contre-révolution "venue de l'intérieur" en Russie, malgré l'écrasement du prolétariat le plus puissant du monde, la classe ouvrière d'Allemagne, le monde vacille, semble encore hésiter à la croisée des chemins entre une nouvelle guerre mondiale ou un nouveau souffle révolutionnaire, seul capable d'endiguer la terrible perspective et d'ouvrir les portes d'un nouvel avenir. L'écrasement du mouvement ouvrier en Italie, les fronts populaires ([1] [169]) de France et d'Espagne, les idéologies d'union nationale, alimenté par la plus colossale duperie et escroquerie idéologique de ce siècle -1'"antifascisme"- auront finalement raison de ces dernières hésitations. En 1939 le monde basculera dans la boucherie, il est minuit dans le siècle. L'avenir n'a plus d'avenir, il est tout entier absorbé et détruit dans le présent de la haine, du meurtre et de la destruction massive.
Le mérite de ce grand service rendu au capitalisme d'avoir vaincu les dernières poches de résistance ouvrières en emprisonnant le prolétariat dans une idéologie nationaliste, démocratique, en lui faisant abandonner le terrain de la lutte contre les conséquences de la crise historique du capitalisme, revient à ceux qui aujourd'hui fêtent ce sinistre anniversaire : la gauche capitaliste et ses garde-chiourme syndicaux.
Fêter 1'anniversaire du Front Populaire, c'est fêter l'anniversaire de la guerre, de la victoire finale sur le prolétariat international de 1'idéologie nationaliste et de la collaboration de classes qui allait amener trois ans après les ouvriers de toutes les nations dans le colossal fratricide de la seconde guerre mondiale.
L'histoire du Front Populaire a été élevée au rang de mythe et la vérité, tant de ce qui l'a amené, de son contenu réel et surtout de ses conséquences, est bien loin de ce qu'en disent ceux qui se revendiquent de ce passé glorieux et qui 1'évoquent aujourd'hui avec nostalgie.
Pour faire parler la vérité sur ces années noires où la conscience de la classe ouvrière sabordée par ceux qui s'en réclamaient sombra dans la pire des servitudes, le nationalisme, nous avons choisi de laisser la parole à ceux qui, contemporains de cette bien triste époque, peut-être la plus triste de toute l'histoire du mouvement ouvrier, surent, à l'écart des grandes hystéries idéologiques, maintenir haut le drapeau de 1'émancipation ouvrière, à commencer par l'internationalisme. Nous laisserons donc la parole à la revue BILAN sur le contenu, le déroulement et 1'attitude de la gauche officielle dans les luttes ouvrières ainsi que sur les "acquis' ouvriers" du front populaire.
De tous les mythes sur l'histoire du Front Populaire, les acquis ouvriers, et parmi ceux-ci les "congés payés", sont de loin les plus répandus.
LES ACQUIS DU FRONT POPULAIRE : UNE LARGE FUMISTERIE
La lecture des longues citations de BILAN nous apprendra, si l'on ne le sait déjà, que la période du Front Populaire ne fut en rien idyllique en ce qui concerne la condition ouvrière, les longues et dures grèves qui ponctuent toute son histoire en sont déjà le meilleure indication. Quant aux congés payés, pour ne prendre qu'un exemple, il nous faut tout d'abord dire que les luttes qui les obtinrent furent toujours le fait spontané des ouvriers en butte à la militarisation du travail :
"Ce n'est pas par hasard que ces grandes grèves se déclenchent dans l'industrie métallurgique en débutant par les usines d'avions. C'est qu'il s'agit de secteurs qui travaillent aujourd'hui à plein rendement, du fait même de la politique de réarmement suivie dans tous les pays. Ce fait ressenti par les ouvriers fait qu'ils ont dû déclencher leurs mouvements pour diminuer le rythme abrutissant de la chaîne : améliorer leurs salaires : obtenir un contrat collectif de travail et la reconnaissance des syndicats par le patronat ; des vacances payées, sur la base d'une intensification du travail en métallurgie qui se fait en l'onction de la guerre. C'est donc là un paradoxe douloureux dont les ouvriers ne sont pas responsables mais qui revient aux forces du capitalisme qui ont réduit les travailleurs à cette situation." (BILAN n° 31, mai-juin 1936, p. 1013)
Si face à la tension de la force de travail dans le cadre du renforcement de 1'économie de guerre et aux nouvelles organisations du travail que celles-ci induisaient, les ouvriers furent acculés à la lutte pour, entre autres, obtenir une pause annuelle, dans les mains des syndicats cette victoire pour laquelle ceux-ci n'avaient d'ailleurs aucun mérite, devint un but final, une institution qui devait permettre 1'intégration de la classe ouvrière à 1'économie de guerre dans le cadre de la militarisation du travail.
A LA VEILLE DU FRONT POPULAIRE : LE POISON NATIONALISTE
Les articles de BILAN donnent de la période qui s'étend de juillet 1934 jusqu'au printemps 1937 un autre éclairage que le conte de fées traditionnellement raconté par la gauche. Sur quelles bases s'est constitué le Front Populaire ?
SOUS LE SIGNE DU 14 JUILLET
C'est' sous le signe d'imposantes manifestations de masses que le prolétariat français se dissout au sein du régime capitaliste. Malgré les milliers et les milliers d'ouvriers défilant dans les rues de Paris, on peut affirmer que pas plus en France qu'en Allemagne ne subsiste une classe prolétarienne luttant pour ses objectifs historiques propres. A ce sujet, le 14 juillet marque un moment décisif dans le processus de désagrégation du prolétariat et dans la reconstitution de l'unité sacro-sainte de la Nation capitaliste. Ce fut vraiment une fête nationale, une réconciliation officielle des classes antagonistes des exploiteurs et des exploités ; ce fut le triomphe du républicanisme intégral que la bourgeoisie, loin d'entraver par des services d'ordre vexatoires, laissa se dérouler en apothéose. Les ouvriers ont donc toléré le drapeau tricolore de leur impérialisme, chanté la "Marseillaise" et même applaudi les Daladier, Cot et autres ministres capitalistes qui avec Blum, Cachin, ont solennellement juré "de donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et la paix au monde" ou, en d'autres termes, du plomb, des casernes et la guerre impérialiste pour tous.
Il n'y a pas à dire, les événements vont vite. Depuis la déclaration de Staline, la situation s'est rapidement clarifiée. Les ouvriers ont désormais une patrie à défendre, ils ont reconquis leur place dans la Nation et, désormais, ils admettent que toutes les proclamations révolutionnaires concernant l'incompatibilité entre l'Internationale et la "Marseillaise", la révolution communiste et la Nation capitaliste, ne sont que des phrases que la révolution d'Octobre a lancées vainement, puisque Staline en a montré l'insuffisance [...].
Le 14 juillet vint donc une apothéose finale du dévouement prolétarien à la république démocratique. C'est l'exemple des militants communistes et socialistes qui détermina les ouvriers -hésitant à juste titre- d'entonner la Marseillaise. Quel spectacle inoubliable, écrira le "Populaire" ; quel triomphe, ajoutera l'"Humanité". Et les uns comme les autres feront intervenir le "vieil ouvrier" classique qui, "en pleurant", exprimera sa joie de voir l'hymne de ses exploiteurs, des bourreaux de juin, des assassins des communards, des civilisateurs du Maroc et de la guerre de 1914, redevenir prolétarien. Duclos, dans son discours, dira qu'en saluant le drapeau tricolore, les ouvriers saluent le passé "révolutionnaire" de la France, mais que leur drapeau rouge représente le futur. Mais ce passé se continue dans le présent, c'est-à-dire dans l'exploitation féroce des ouvriers, dans les guerres de rapine du capitalisme jetant au massacre des générations entières de prolétaires. En 1848 également, la bourgeoisie essaya de ressusciter le passé, les traditions de 93, les principes de Liberté, Egalité, Fraternité, pour voiler les contrastes présents des classes : la tuerie de juin fut la conséquence des illusions prolétariennes.[...]
Et après cette imposante manifestation de défaite de la classe appelée à renverser la société bourgeoise, à instaurer une société communiste, l'on se demande si, vraiment, une menace fasciste pourrait se poser en France. Jusqu'ici, il semble bien que les Croix de Feu aient plus été un moyen de chantage, un épouvantail pour accélérer la désagrégation des masses prolétariennes au travers du front commun qu'un danger réel. Mais on érigea l'antifascisme en loi suprême justifiant les pires capitulations, les compromissions les plus basses pour arriver par là à concentrer les ouvriers loin de leurs revendications immédiates, loin de leurs organisations de résistance, sur un front d'antifascisme comportant même Herriot. Ce n'est pas un hasard si les arrêtés-lois vinrent immédiatement après le 14 juillet et s'ils trouvèrent le prolétariat dans un état d'incapacité manifeste bien que des milliers d'ouvriers aient défilé en clamant "les Soviets" quelques jours auparavant. [...] (BILAN, juillet-août 1933)
FACE AUX LUTTES REVENDICATIVES
La préparation du Front Populaire annonçait donc déjà son futur déroulement, en particulier face aux luttes revendicatives des ouvriers. Comment s'est déroulée la fameuse année 1936 sur le front social ?
LA RECONCILIATION DES FRANÇAIS ET L'UNITE SYNDICALE
Un souffle d'air frais a traversé la France le 6 décembre dernier ; le parlement a vécu une "journée historique" lorsque Blum, Thorez, Ybarnegaray ont scellé la "réconciliation des Français". Désormais, plus de luttes meurtrières ne doivent ensanglanter la France républicaine et démocratique. T out le monde va fraternellement désarmer. Le fascisme est vaincu. Le Front Populaire a sauvé les institutions républicaines. Si ces événements n'entraînaient à leur suite des millions d'ouvriers français, s'ils ne contenaient tellement de faits répugnants, l'on serait tenté de rire aux éclats devant les bouffonneries qu'ils contiennent. Personne ne menaçait la République bourgeoise et tous la voulaient menacée. La droite accusait la gauche et vice-versa. Le Front Populaire proclamait son civisme républicain alors que La Roque et ses Croix de Feu répétaient la même litanie. Les formations Croix de Feu -certes plus puissantes et infiniment mieux armées que les ouvriers- ne menaçaient pas plus la République que les formations de combat ou d'auto-défense du Front Populaire, puisque les uns et les autres se mettaient à son service pour renforcer la domination capitaliste qui est d'autant plus républicaine qu'elle y trouve largement son compte.
Au point de vue de la situation immédiate, les dupes de la journée historique du 6 décembre .sont incontestablement les ouvriers. Déjà, après leur résistance de Brest et de Toulon, ils furent qualifiés de "provocateurs" par les chiens déchaînés du Front Populaire. Après la "réconciliation", le prolétaire qui tentera de résister par la violence à la violence capitaliste sera assommé, injurié et remis par les adeptes du front populaire entre les mains des agents de police. Contre les spartakistes, disait Rosa Luxemburg, les social-patriotes mobilisèrent ciel et terre, déchaînèrent le fer et le feu : Spartakus devait être massacré ! En France, le Front populaire, fidèle à la tradition des traîtres, ne manquera de provoquer au meurtre contre ceux qui ne se plieront pas devant le "désarmement des Français " et qui, comme à Brest et à Toulon, déclencheront des grèves revendicatives, des batailles de classe contre le capitalisme et en dehors de l'emprise des piliers du Front Populaire. (BILAN n°26, décembre-janvier 1936)
Cette attitude en ce début de l'année 1936 n'est que le prélude au fantastique travail de sape de la gauche et des syndicats lors du mouvement du printemps.
Les conditions qui accompagnent le triomphe du Front Populaire sont donc celles qui voient l'anéantissement de la conscience de classe des ouvriers. Le triomphe du gouvernement du Front Populaire consacre la disparition de toute résistance prolétarienne au régime bourgeois, du moins de toute résistance organisée du prolétariat. Des centristes ([2] [170]) aux socialistes, tous s'efforcent de bien faire ressortir que le gouvernement Blum ne sera pas un gouvernement révolutionnaire, qu'il ne touchera pas à la propriété bourgeoise, qu'il ne faut pas que les possédants prennent trop au sérieux la formule centriste : faire payer les riches. Le programme du Front Populaire porte comme premier point l'amnistie et non la révolution ; l'épuration des administrations ; la dissolution des Ligues et puis des mesures économiques de grands travaux que l'on exécutera, comme en Belgique M. de Man en exécute pour résorber le chômage. Les centristes seront satisfaits des dernières décisions du parti radical, déclarant participer au gouvernement Blum et exigeant l'unité de vote de ses élus au gouvernement. Deux bonnes décisions dira l'"Humanité" qui s'empressera de crier que le Front Populaire représente enfin la revanche des Communards sur Versailles. Toute la presse bourgeoise louera la modération des socialistes et des centristes et l'on ne prendra pas trop au sérieux les accusations de l'extrême droite criant que le PC prépare l'avènement des Soviets avec ses comités de Front Populaire. Mais dans cette atmosphère idyllique une seule note discordante : les menaces de conflits de salaires de prolétaires lassés des promesses "d'humanisation" des décrets-lois. A grande peine la CGT avait liquidé la menace d'une grève générale des mineurs du Pas-de-Calais, menace qui pouvait tomber comme un pavé dans une mare entre les deux tours électoraux. Après la victoire du Front Populaire des mouvements se déterminent progressivement jusqu'à embrasser ces derniers temps l'ensemble de la région parisienne. Un journaliste belge a fait remarquer très justement que les mouvements en France se sont déclenchés un peu sur le type des grèves de mai 1936 en Belgique : en dehors et contre les syndicats, en somme comme des mouvements "sauvages". [...]
A partir du 14 mai, le mouvement atteint la région parisienne. C'est à Courbevoie, où les ouvriers font la grève dans l'usine et arrachent 0,25 F d'augmentation et un contrat collectif de six mois. C'est à Villacoublay où les ouvriers obtiennent des vacances payées, puis à Issy-les-Moulineaux, à Neuilly, à Gennevilliers. Partout les mouvements se déclenchent en dehors de toute intervention des syndicats, spontanément, et acquièrent tous le même caractère : des grèves au sein de l'usine.
Le jeudi 28 mai, c'est enfin la grève chez Renault, où 32.000 ouvriers se mettent en branle. Le vendredi et samedi les entreprises métallurgiques de la Seine entrent dans le mouvement. [...] Dans l'"Humanité" et dans le "Populaire" on fit un particulier effort pour bien prouver que le Front Populaire n'était pour rien dans ces mouvements et surtout dans leurs formes. Il fallait à tout prix tranquilliser la bourgeoisie qui, comme le prouve l'article de Gallus dans l'"Intransigeant", n'était pas le moins du monde effrayée. Le capitalisme comprenait parfaitement qu'il ne pouvait être question d'une véritable occupation des usines, mais d'une lutte ouvrière prenant pour champ de combat l'intérieur de l'usine où l'intrusion des partis du Front Populaire, de la CGT est moins à craindre. En Belgique aussi les grèves des mineurs en mai 1935 eurent ce caractère et l'exprimèrent clairement en refusant de recevoir dans la mine des délégués officiels des syndicats socialistes du POB ou du PC.
De pareils mouvements sont symptomatiques et gros de dangers pour le capitalisme et ses agents. Les ouvriers sentent que leurs organisations de classe sont dissoutes dans le Front Populaire et que leur terrain d'action spécifique devient leur lieu de travail où ils sont unis par les chaînes de leur exploitation. Dans de pareilles circonstances une fausse manoeuvre du capitalisme peut déterminer des heurts, des chocs qui peuvent ouvrir les yeux aux travailleurs et les éloigner du Front Populaire. Mais Sarraut comprit encore une fois la situation. Il laissa faire. Pas de gardes mobiles, pas de brutale expulsion des travailleurs des usines. Des marchandages, et puis laisser faire socialistes et centristes.
Le 30 mai, Cachin tente de lier ces mouvements de classe en opposition au Front Populaire à ce dernier. Il écrit : "Le drapeau tricolore fraternise sur l'usine avec le drapeau rouge. Les ouvriers sont unanimes à soutenir les revendications générales : Croix de Feu, Russes blancs, étrangers, socialistes communistes, tous sont fraternellement unis pour la défense du pain et le respect de la loi". Mais le "Populaire" du même jour n'est pas complètement d'accord avec cette appréciation, car après avoir chanté victoire au sujet de la rentrée chez Renault, il écrit : "C'est fini. C'est la victoire. Seuls dans l'Ile Seguin, quelques exaltés -il y a des sincères, mais aussi des provocateurs Croix de Feu- semblent en douter". Il est probable que la "victoire chez Renault n'ait pas été approuvée par de nombreux ouvriers qui n'ont pas voulu faire preuve de 'cet esprit conciliant' dont Frachon parle dans l'"Humanité" et qui les détermina très souvent à reprendre le travail 'avec une partie seulement de ce qu'ils réclament'". Ceux-là seront les "provocateurs", les "Croix de Feu".
Ces messieurs du Front Populaire ont bien mis en évidence non seulement pour la bourgeoisie, mais aussi pour les ouvriers eux-mêmes, qu'il ne s'agissait pas d'événements révolutionnaires. Cela "une occupation révolutionnaire, écrit le "Populaire", allons donc ! Partout : joie, ordre, discipline". Et l'on montre des photos d'ouvriers dansant dans les cours des usines ; on parle de parties de plaisir : "les ouvriers se baignent, ou jouent à la belote ou flirtent." (BILAN n° 31, mai-juin 1936)
DU SABOTAGE A LA REPRESSION DIRECTE ET IMPITOYABLE
Ainsi, avant, pendant son règne, le Front Populaire ne fut jamais le front ouvrier contre le capitalisme mais le front de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. C'est en tant que tel qu'il signa son oeuvre contre-révolutionnaire avec le sang des ouvriers parisiens. C'est ce que nous montre la répression du printemps37.
LA FRANCE "LIBRE, FORTE ET HEUREUSE" ASSASSINE LES PROLETAIRES
Les sifflements des balles ont arraché le masque du Front Populaire. Les cadavres ouvriers ont expliqué la "pause" du gouvernement Blum. Dans les rues de Clichy, le programme du Front Populaire s'est manifesté au travers des fusils des gardes mobiles et rien ne pouvait mieux l'illustrer.
Ah ! Les défenseurs de l'ordre républicain, les bourreaux de la démocratie bourgeoise peuvent pousser leurs cris d'allégresse. L'émeute est matée et le vieux cri traditionnel : "l'ordre règne, dans Varsovie" peut retentir à nouveau car les cosaques de Max Dormoy veillent.
Mais le sang ouvrier n'a pas rougi impunément les pavés de Paris, ce Pans où l'on s'apprêtait à commémorer les Communards de 1871. Désormais l'Union Sacrée acquiert une signification de sang et les ouvriers pourront retirer de cette tragique expérience un précieux enseignement de classe. Ils sauront notamment que l'on ne peut "réconcilier les Français" par la capitulation volontaire du mouvement ouvrier. La garde mobile sera présente pour l'imposer avec ses fusillades. Ils sauront aussi que la démocratie bourgeoise, "la France libre, forte et heureuse" et le fameux mot d'ordre du "Front Populaire", "le Pain, la Paix, la Liberté" signifie : le surarbitre pour les revendications ouvrières, l'emprunt de la défense nationale et les fusils des gardes mobiles, pour les manifestations prolétariennes dépassant le cadre tracé par les socialo-centnstes. [...]
Voilà dix mois que les ouvriers sont aux prises avec le Front Populaire et la chanson commence à s'user. Pourquoi Blum ne réprime-t-il pas ce danger fasciste que l'on dit si imminent ? Pourquoi reprend-on aux ouvriers tout ce qu'ils avaient cru gagner avec leurs mouvements de grèves ? Pourquoi les traite-t-on de "provocateurs" lorsqu'ils passent à l'attaque malgré l'arbitrage ? Blum fait la "pause" uniquement pour les ouvriers qui doivent continuer à faire des sacrifices.
Tout cela a créé un état d'irritation parmi les ouvriers qui se manifeste particulièrement dans la région parisienne où les bonzes réformistes-centristes sont acculés dans les assemblées syndicales. Déjà, devant cet état de tension, ils avaient décidé d'organiser deux manifestations aux environs de Paris : l'une pour les chômeurs et l'autre pour les ouvriers. Enfin, en métallurgie l'on se trouvait devant des demandes d'ouvriers, de grève générale, afin de protester contre les décisions du surarbitre
C'est dans cette situation tendue que les socialo-centristes ont donné le dernier carré de l'antifascisme pour maintenir les ouvriers dans le chemin de l'Union Sacrée, consentie "volontairement" par les travailleurs. La contre-manifestation de Clichy devait être imposante : on allait montrer à de La Roque que "la Nation française" vit et lutte pour la démocratie bourgeoise dont Messieurs Daladier-Herriot sont d'authentiques représentants. La bourgeoisie aussi se préparait, car connaissant la situation parmi les ouvriers, elle se méfiait un peu des chefs socialo-centnstes pouvant être débordés par leurs troupes. Les gardes mobiles furent armés sérieusement comme s'ils partaient en guerre. Parmi les dirigeants des forces répressives existait la conviction que "la pause" de Blum était aussi la pause des mouvements ouvriers. La directive était donc de réprimer férocement ces derniers et l'ambiance nécessaire fut certainement créée parmi les gardes mobiles. Il n'y avait pas, et il ne pouvait y avoir de contradiction entre les chefs "fascistes" de la police et le gouvernement du Front Populaire. Celui-ci parlait de la "pause" en expliquait la nécessité aux ouvriers alors que les premiers ne faisaient que l'appliquer avec la mentalité bornée du policier qui applique brutalement ses instructions sans s'occuper des conséquences. [...]
Deux forces se sont heurtées à Clichy : le prolétariat et la bourgeoisie. Les travailleurs concentrés en masse pour des buts antifascistes ont trouvé dans leur nombre imposant la force d'exalter leur colère et d'exprimer la tension imprimée dans leurs chairs de prolétaires éternellement dupés : la bourgeoisie est passée à la répression là où le Front Populaire ne pouvait plus maintenir les ouvriers sur le front des intérêts capitalistes. [...]
Rien n'a pu dénaturer la bataille de Clichy, comme rien n'a pu dénaturer les massacres de la Tunisie et ceux qui se déroulent ces derniers temps en Algérie, en Indochine. C'est le Front Populaire, qui en voulant rester au pouvoir pendant "la pause" doit passer au massacre des prolétaires de la métropole et des colonies où l'accumulation des reculs imposés aux ouvriers par Blum, pousse à des batailles de plus en plus violentes. Le programme démagogique du Front Populaire arrive au bout de son rouleau et le nouveau programme passe par le massacre des ouvriers. Et que l'on ne cherche pas les "provocations" ailleurs que dans la situation qui est faite aux ouvriers. La vérité se dégage ici avec une clarté qui se passe de commentaires : les ouvriers en exigeant la grève la faisaient contre l'Etat capitaliste qui les avait mitraillés et où se trouvait le Front Populaire. Les socialo-centnstes conscients de cette^ situation (qui pourrait déterminer la bourgeoisie à employer un autre matériel que celui de Blum pour maintenir sa domination) essayait d'en faire une vulgaire manifestation antifasciste. C'est pourquoi il fallait en limiter strictement la durée (jusqu'à midi) ; bien marquer qu'il ne s'agissait pas de réaliser des ordres du jour demandant la grève générale pour défendre les revendications ouvrières (communiqué de la CGT et de l'Union des Syndicats parisiens).
Et enfin, il s'agissait non de lutter contre le gouvernement du Front Populaire mais de le consolider. (BILAN n° 40, avril-mai 1937)
Prénat
GLOSSAIRE :
Front Populaire : coalition électorale, puis ensuite gouvernementale (1936-37), de la gauche capitaliste, regroupant Parti Socialiste (SFIO), Parti Radical (ou "Radicaux"), Parti Communiste Français.
Croix de Feu : organisation d'"Anciens combattants", d'extrême-droite. Fondée en 1927, elle sera dissoute en 1936.
QUELQUES-UNS DES HOMMES POLITIQUES :
Duclos, Cachin : dirigeants du PCF.
Thorez : Secrétaire général du PCF.
Daladier : dirigeant du Parti Radical.
Blum : dirigeant du Parti Socialiste SFIO, mènera la coalition gouvernementale du Front Populaire.
Herriot : Président de la Chambre des députés de 1936 à 1940, dirigeant du Parti Radical Socialiste.
La Roque : dirigeant des Croix de Feu.
JOURNAUX :
L'Intransigeant : journal de droite, classique.
L'Humanité : organe quotidien du PCF.
Le Populaire : journal du Parti socialiste.
[1] [171] Un bref glossaire donnant les principaux partis et mouvements, hommes politiques, journaux, est disponible en fin d'article.
[2] [172] La Gauche communiste et Bilan considéraient comme « centristes » les staliniens et les partis communistes affiliés à l'Internationale. Sur « centrisme et opportunisme » voir la Revue Internationale n°44.
Géographique:
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [175]
Approfondir:
- Espagne 1936 [176]
Heritage de la Gauche Communiste:
Polémique avec le P.C.Int.-Battaglia Comunista : La période de transition
- 2835 reads
Le débat sur la période de transition a toujours été l'objet de polémiques acharnées entre groupes révolutionnaires. Avec le développement de la lutte de classe, les révolutionnaires sont obligés de porter leur attention sur des questions plus immédiates des luttes ouvrières, en particulier les questions de l'intervention et de l'organisation. Mais en jouant son rôle de force de propositions concrètes dans les luttes ouvrières, l'organisation révolutionnaire, parce qu'elle s'appuie sur ce qui est "général", ce qui concerne tous les ouvriers, l'ensemble de la classe, ne peut pas se permettre de négliger le problème des buts historiques de la lutte : la destruction révolutionnaire de l'Etat capitaliste, la dictature du prolétariat, la transformation communiste de la vie sociale.
En consacrant cet article aux positions du Parti Communiste Internationaliste-Battaglia Comunista (PCInt.) sur la période de transition, telles qu'elles ont été exprimées dans le document de son 5ème Congrès (Prometeo n°7), notre but est d'aider à la réanimation de cette importante discussion au sein du mouvement révolutionnaire.
Pour notre part, nous n'avons aucun doute sur le fait que le PCInt. partage avec nous une base commune importante d'acquis historiques du marxisme, en particulier :
- contre les théories idéalistes typiques de l'historiographie bourgeoise, il localise les origines de l'Etat dans l'évolution historique réelle et matérielle de la société de classes ;
- contre l'utopie anarchiste, il affirme la nécessité de la dictature du prolétariat et d'un Etat pendant la période de transition, qui sera encore marquée par des divisions de classes ;
- contre le réformisme, qui est maintenant une idéologie contre-révolutionnaire de la bourgeoisie, il affirme les leçons de La Commune de Paris sur la nécessité de détruire l'Etat bourgeois et de le remplacer par un Etat d'un nouveau type, un semi-Etat destiné à disparaître avec le dépassement des antagonismes de classe ;
- en accord avec L'Etat et la Révolution de Lénine, il affirme que le semi-Etat doit être basé sur la forme Soviet découverte par la classe ouvrière en 1905 et 1917 ;
- et enfin, dans la ligne de la contribution de la Fraction italienne de la Gauche communiste dans les années 30, il tire un certain nombre de leçons critiques de l'expérience russe :
.les causes du déclin de la révolution russe et la transformation de l'Etat des Soviets et du parti bolchevik en machine capitaliste contre-révolutionnaire, réside d'abord et surtout dans l'échec de la révolution à s'étendre au niveau international;
.au sein du cadre objectif de l'isolement de la révolution et des conditions d'arriération et de famine auxquelles s'est confrontée la révolution russe, certaines erreurs du parti bolchevik ont agi comme "accélérateur" du processus de dégénérescence ;
.la première de ces erreurs résidait dans une identification entre le parti et la dictature du prolétariat, aboutissant à la confusion entre parti et Etat, à la faille grandissante entre le parti et la classe, et l'incapacité croissante du parti à jouer son rôle réel d'avant-garde politique ; il y a aussi un écho - même si, comme nous le verrons plus loin, il est faible et inconsistant - de la position développée par la Fraction et plus élaborée par la Gauche Communiste de France(GCF) ([1] [178]) et le CCI selon laquelle non seulement le parti ne doit pas être identifié à l'Etat, mais aussi que l'Etat transitoire et la dictature du prolétariat ne sont pas identiques.
L ' importance de ces points communs ne doit pas être sous-estimée parce que ceux-ci constituent des frontières de classe sur le problème de l'Etat, le "point de départ" essentiel pour une compréhension marxiste de la question, l'exception ici étant la question de la non-identification de l'Etat avec la dictature du prolétariat qui, comme nous 1'avons toujours défendu est une "question ouverte" qui ne peut pas être définitivement tranchée avant la prochaine expérience révolutionnaire majeure.
Ayant brièvement défini ce que nous considérons être des zones d'accord, nous pouvons maintenant développer nos critiques aux inconséquences et insuffisances du PCInt. qui diminuent sa capacité à défendre et développer la position marxiste sur ces questions.
Une assimilation incomplète du travail de la GAUCHE ITALIENNE
Le PCInt. proclame que :
"Les positions politiques mentionnées ici, représentent le bagage théorique et la tradition de lutte de la Gauche Italienne, dont la présence historique a été assurée par la fondation du Parti Communiste d'Italie, et les acquis successifs de la Fraction et du PCInt. constitué au cours de la seconde guerre mondiale."
Comme nous l'avons dit, le texte reflète indubitablement le travail de la Fraction. Mais si le PCInt ne balaie pas purement et simplement ce travail comme le font les bordiguistes. On ne peut pas dire non plus qu'il a pleinement assimilé ce travail et surtout la méthode qui a permis à la Fraction d'entamer une critique fondamentale des positions de 1'Internationale Communiste (IC). Dans un certain nombre de cas, le PCInt. revient à l'orthodoxie "léniniste" que la Fraction avait osé mettre en doute. Ceci est particulièrement clair sur la question des relations entre le prolétariat et 1'Etat transitoire.
D'après le PCInt., le CCI régresse du marxisme à l'opportunisme quand il défend l'idée qu'une leçon cruciale de la révolution russe est que l'Etat transitoire, émanant d'un ordre social qui est encore divisé en classes, aura un caractère conservateur plutôt que dynamique, codifiant et administrant, au mieux, la poussée vers le communisme venant de la classe révolutionnaire, et au pire, s'y opposant et devenant le foyer de la contre-révolution renaissante ; et que, en conséquence, le prolétariat ne doit pas identifier son autorité de classe avec la machine d'Etat, mais doit subordonner rigoureusement celle-ci au contrôle de ses propres organes de classe.
Le PCInt. veut être très "orthodoxe" sur cette question et revient donc à la position de Marx selon laquelle dans la période de transition, "l'Etat ne peut être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat." (Marx s'attaquait ici aux déviations réformistes sur l'Etat). Pour le PCInt. -'l'Etat est un 'Etat ouvrier', et même un 'Etat socialiste (dans le sens où il permet la réalisation du socialisme)"; c'est la même chose que les Soviets : "L'erreur est de voir les Soviets (qui auront tout le pouvoir) comme étant différents de l'Etat ; mais l'Etat prolétarien n'est rien d'autre que la synthèse centralisée du réseau des Soviets."
En fait, le PCInt. ne peut rester très "orthodoxe" sur cette question qu'en ignorant certaines des questions fondamentales posées par la Fraction et les continuateurs de sa méthode. Le texte a, en fait, quelques lueurs des développements de la Fraction à ce propos, en ce sens que certains passages impliquent que l'Etat et la dictature du prolétariat ne sont pas identiques. Par exemple, le texte commence en disant :
"Parler de la période de transition, c'est parler de l'Etat ouvrier et de ses caractéristiques politiques et économiques, et des relations qui doivent s'établir entre celui-ci et la forme spécifique de la dictature du prolétariat : les Soviets"
Mais cette perspicacité est alors contredite par l'insistance du PCInt. à se définir contre les positions du CCI. Et ce faisant, il se définit inévitablement contre le travail de la Fraction. Les pages de Bilan contiennent beaucoup d'études profondes sur la question de l'Etat. Ses origines historiques, les différentes formes de l'Etat dans la société capitaliste, etc., sont analysées dans ... la série d'articles "Parti-Internationale-Etat". Les questions politiques et économiques posées par la période de transition sont examinées surtout dans la série d'articles de Mitchell "Problèmes de la Période de Transition" (que le CCI se propose de republier).A la lumière de l'expérience russe, où les Soviets ont été transformés en un monstrueux appareil bourgeois, Mitchell revient à certaines mises en garde de Marx et Engels à propos de l'Etat transitoire qui est un "mal nécessaire", un "fléau" que le prolétariat est contraint d'utiliser, et Mitchell conclut que les bolcheviks avaient fait une erreur fondamentale en identifiant la dictature du prolétariat avec l'Etat transitoire :
"Bien que Marx, Engels et surtout Lénine eussent maintes fois souligné la nécessité d'opposer à l'Etat son antidote prolétarien, capable d'empêcher sa dégénérescence, la Révolution russe, loin d'assurer le maintien et la vitalité des organisations de classe du prolétariat, les stérilisa en les incorporant à l'appareil étatique et ainsi dévora sa propre substance. Même dans la pensée de Lénine, la notion de "Dictature de l'Etat" devint prédominante : c'est ainsi qu'à la fin de 1918, dans sa polémique avec Kautsky ("La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky") il ne parvient pas à dissocier les deux notions opposées : Etat et Dictature du Prolétariat." (Bilan n°31, p.1038) Ou encore,
"La sauvegarde de la Révolution russe et son maintien sur les rails de la Révolution mondiale n'étaient donc pas conditionnés par l'absence de l'ivraie bureaucratique - excroissance accompagnant inévitablement la période transitoire - mais par la présence vigilante d'organismes prolétariens où pût s'exercer l'activité éducatrice du Parti conservant au travers de l'Internationale la vision de ses tâches internationalistes. Ce problème capital, les Bolcheviks ne purent le résoudre par suite d'une série de circonstances historiques et par ce qu'ils ne disposaient pas encore du capital expérimental et théorique indispensable. L'écrasante pression des événements contingents leur fit perdre de vue l'importance que pouvait représenter la conservation des Soviets et Syndicats en tant qu'organisations se juxtaposant à l'Etat et le contrôlant, mais ne s'y incorporant pas."(Id.p.1040).
Le lien entre cette position et celle du CCI est clair. Les organes de classe du prolétariat ne doivent pas être confondus avec l'Etat. Aussi, le PCInt. devrait se référer à BILAN sur cette question.
Bien sûr, la position du CCI n'est pas simplement une répétition de celle de BILAN. En assimilant le travail de la GCF il a rendu plus clairs un certain nombre de points :
- Sur la question du parti : BILAN a vu la nécessité de distinguer le prolétariat et son parti d'avec l'Etat, mais tendait à identifier le parti avec la dictature du prolétariat. Pour le CCI, le parti n'est pas un instrument pour exercer le pou voir politique. C'est là la tâche des "conseils ouvriers" et des autres organes unitaires de la classe ouvrière. La fonction du parti est de mener un combat politique au sein des conseils et de la classe dans son ensemble contre toutes les vacillations et l'influence bourgeoise, et pour la réalisation du programme communiste ;
- sur la question syndicale : le prolétariat dans la période de transition aura encore besoin de défendre ses intérêts immédiats contre les exigences de l'Etat, mais il n'y aura plus de syndicats, hérités des organisations par métier du siècle dernier dans la lutte pour des réformes et qui ont prouvé être antithétiques aux besoins de la lutte de classe' et sont passés dans le camp capitaliste à l'époque de la révolution sociale. Il y aura les conseils ouvriers et les comités d'usines, de quartier, milices, etc., qui en émanent (cf. infra).
- sur la question de l'Etat lui-même : la GCF et le CCI faisant des recherches plus approfondies sur les origines de l'Etat dans l'histoire et dans la période de transition ([2] [179]) ont rejeté la formulation "Etat prolétarien" qui apparaît encore dans le travail de BILAN.
Dans le passage de son document traitant des origines historiques de l'Etat, le PCInt. résume correctement les écrits d'Engels sur le sujet en disant que :
1) l'Etat est le produit de la société divisée en classes ;
2) l'Etat est l'instrument de domination de la classe économiquement dominante.
" Pourtant, il n'en tire pas toutes les conclusions appropriées, en particulier le fait que l'Etat n'émerge pas comme une simple création, ex-nihilo, de la classe dominante, mais il émerge "spontanément" des contradictions internes d'un ordre social divisé en classes. L'Etat est d'abord et avant tout un instrument de préservation de l'ordre social. Cette compréhension permet d'expliquer comment, dans le phénomène du "capitalisme d'Etat", l'Etat peut se "substituer" à la classe dominante traditionnelle, l'exemple le plus poussé étant l'Etat russe où cette classe dominante "traditionnelle"avait été renversée par le prolétariat. Cette compréhension du fait que l'Etat émerge d'une situation sociale divisée en classes permet de voir que l'Etat transitoire n'émane pas du prolétariat mais des exigences de la société transitoire elle-même. La destruction de l'Etat bourgeois représente une rupture dans une continuité millénaire, qui nous conduit, à un niveau supérieur, à la situation qui existait avant l'émergence des premières formes étatiques. L'Etat transitoire découle des "désordres" hérités de la destruction de l'Etat bourgeois. Mais, contrairement à tous les Etats antérieurs, cet Etat ne deviendra pas "automatiquement" l'expression organique, la prolongation d'une classe économiquement dominante, exploiteuse, parce qu'une telle classe n'existera plus. Le prolétariat devra mener une lutte politique constante pour s'assurer que l'Etat reste sous son contrôle ; aucun développement automatique des lois économiques n'assurera cela. Au contraire, la période de transition sera la champ de bataille entre la volonté humaine consciente et les automatismes économiques de toutes sortes, et ainsi entre le prolétariat communiste et l'Etat qui tendra à refléter la pression continue des lois économiques dans une société encore marquée par la pénurie et la division en classes.
Pour être plus précis, l'émergence de l'Etat dans la société transitoire signifie que celui-ci sera basé sur des organismes -les soviets territoriaux- qui regroupent l'ensemble de la population non-exploiteuse. Bien qu'ils contiennent des prolétaires, ces organes ne sont pas prolétariens en eux-mêmes et le prolétariat doit toujours maintenir une stricte indépendance politique, à travers ses organes de classe spécifiques, les conseils ouvriers, qui exerceront un contrôle rigoureux sur les soviets territoriaux et sur tous les organes administratifs ou répressifs qui émergeront de leur centralisation.
Il est frappant de voir que le texte du PCInt. évacue presque entièrement le problème de l'organisation des couches non-prolétariennes, non exploiteuses dans l'Etat transitoire, en particulier au vu de la "sensibilité" autoproclamée du PCInt vis-à-vis des problèmes que rencontrent ces couches à la périphérie du capitalisme, où elles dépassent largement en nombre la classe ouvrière et posent donc un problème central pour la révolution. En conséquence, quand le PCInt. est obligé d'aborder ce problème, il tombe dans deux erreurs symétriques :
- l'erreur "ouvriériste" (qui a été, dans le passé, particulièrement nette dans la Communist Workers'Organisation (CWO) consistant à nier que ces couches auront un rôle particulier quelconque dans l'Etat transitoire. Ainsi ils écrivent : "Les soviets seront élus exclusivement par les ouvriers, privant de tout droit électoral ceux qui profitent du travail salarié ou qui, d'une façon ou d'une autre, exploitent économiquement le travail du prolétariat."
L'exclusion des exploiteurs de toute participation aux soviets est une chose, et nous sommes d'accord avec cela. Mais ce passage ne nous dit rien de ce qu'il faut faire de toutes les vastes masses humaines -paysans, artisans, éléments marginalisés, etc.- qui n'appartiennent ni à la classe ouvrière ni à la bourgeoisie. Essayer d'exclure ces masses du système des soviets aurait été impensable aux Bolcheviks en 1917, et il devrait en être de même pour les communistes aujourd'hui. Pour entraîner ces couches derrière et dans la révolution ouvrière et non contre elle, pour élever leur conscience des buts et des méthodes de la transformation communiste, pour pousser en avant leur intégration dans le prolétariat, ces couches doivent être intégrées dans le système des soviets, à travers un réseau de Soviets élus sur la base d'assemblées de quartiers ou de village (au contraire des conseils ouvriers, qui seront élus sur les lieux de travail) ;
- l'erreur inter-classiste, qui consiste à faire , fusionner, ou à submerger les organes de classe du prolétariat dans des organes regroupant toute la population non-exploiteuse : le PCInt. parle ainsi de l'Etat transitoire comme "l'Etat de tous les exploités,. dirigés politiquement par une classe ouvrière organisée sur une base internationale."De nouveau, la formulation n'est pas totalement incorrecte ; la confusion provient de ce qui n'est pas dit. Qui sont "tous les exploités" ? La classe ouvrière seule, ou bien, comme le passage semble l'impliquer dans la phrase "dirigés politiquement par une classe ouvrière", les autres couches non-exploiteuses aussi ? Et si l'Etat doit être celui de toutes les couches non-exploiteuses, comment sera-t-il "dirigé politiquement" par la classe ouvrière si la classe ouvrière n'est pas organisée de façon indépendante ?
Ces deux erreurs se renforcent réciproquement, dans la mesure où elles viennent de la même source : une incapacité à analyser les conditions sociales réelles donnant naissance à l'Etat dans la période de transition.
LA QUESTION SYNDICALE
Sur la question syndicale, il est normal d'attendre des groupes révolutionnaires d'aujourd'hui une plus grande clarté que la Gauche italienne, dans la mesure où la faiblesse des luttes de classe autonomes dans les années 30 ne donnait pas à celle-ci tous les éléments pour résoudre cette question. Comme nous l'avons dit, à la fois Bilan, et à ses débuts la GCF considéraient que la nécessaire défense des intérêts immédiats du prolétariat contre les exigences de l'Etat transitoire, serait assurée par les syndicats. Ce qui est étrange, en tout cas, c'est de lire que le PCInt. - qui dit que les syndicats ne sont plus des organes prolétariens, et devront être détruits pendant la révolution - défend l'idée, dans son document sur la période de transition, écrit en 1983, selon laquelle :
"Les Soviets sont réellement des organes révolutionnaires et politiques. Ils ne doivent donc pas être confondus avec les syndicats qui, après la révolution, auront encore la fonction de défense des intérêts immédiats du prolétariat et d'organisation des luttes contre la bourgeoisie pendant le difficile processus 'd'expropriation des expropriateurs’. Ils ne doivent pas non plus être confondus avec les Conseils d’usine qui auront la tâche d'assurer le contrôle ouvrier sur la production."
Nous avons souvent dit que le PCInt. et la CWO gardent certaines confusions à propos des syndicats, vus comme organisations "intermédiaires" ou même "ouvrières" à notre époque, et cela le confirme tout à fait. Ils semblent incapables de comprendre pourquoi la forme syndicale ne correspond plus aux besoins de la lutte de classe de notre époque, époque de la décadence capitaliste et de la révolution prolétarienne. Les caractéristiques essentielles de la lutte de classe à cette époque - son caractère massif, la nécessité de rompre toutes les barrières sectorielles - ne changeront pas après la prise du pouvoir par les ouvriers. Nous avons déjà dit que nous reconnaissons la nécessité continué pour les ouvriers de pouvoir défendre leurs intérêts immédiats et spécifiques contre les exigences de l'Etat transitoire, mais pour cela il faut des organes qui regroupent les prolétaires sans tenir compte des branches ou secteurs : les comités d'usine et les Conseils ouvriers eux-mêmes. Dans la vision des choses du PCInt., où les Conseils ouvriers "sont" l'Etat, on nous présente le scénario bizarre dans lequel les ouvriers utilisent les syndicats pour se défendre... contre les Conseils ouvriers !
EN CONCLUSION
Cet article ne prétend en aucune façon être une étude exhaustive sur la question de la période de transition, ni même de la vision du PCInt. sur la question. Son but était plutôt de donner une nouvelle impulsion à la discussion sur là période de transition, de définir certains points de base, et de critiquer quelques une des confusions, contradictions ou concessions à l'idéologie bourgeoise contenues dans les positions d'une autre organisation révolutionnaire. Les positions du PCInt.,bien que se situant sur une base marxiste, montrent,sur certaines questions cruciales - les relations entre classe et Etat, Parti et Etat, la question syndicale - une difficulté à avancer à partir de cette base vers des conclusions plus cohérentes. Il reste à mi-chemin entre les positions les plus avancées de la Gauche communiste et les thèses dépassées de l'Internationale Communiste sous Lénine. Mais comme même la bourgeoisie révolutionnaire l'avait compris, on ne peut pas faire une révolution à moitié. Toutes les confusions et contradictions à propos du processus révolutionnaire seront mises à nu par la révolution elle-même. Et c'est précisément pour cela que le débat sur la période de transition ne peut pas être ignoré aujourd'hui : quand nous serons lancés dans l'océan de la révolution communiste, nous devrons être équipés de la boussole la plus précise possible que nous permet l'évolution présente de la théorie marxiste.
M.U.
Courants politiques:
- Bordiguisme [182]
- Battaglia Comunista [183]
Heritage de la Gauche Communiste:
La gauche hollandaise (1900-1914) : Le mouvement "Tribuniste" 3eme partie
- 4189 reads
Cet article est la dernière partie de l'étude sur l'histoire de la Gauche hollandaise entre 1900 et 1914. Après avoir traité des difficultés du surgissement du courant marxiste dans les conditions de la Hollande du début du siècle et des débuts de ce qui allait devenir la "Gauche hollandaise" (Revue Internationale n°45), puis de la fragilité des organisations politiques du prolétariat confrontées à la pression permanente de l'idéologie bourgeoise en leurs rangs (Revue Internationale n°46), l'étude traite dans cette partie de la naissance du mouvement "tribuniste" jusqu'à l'exclusion de ce courant de la social-démocratie (SDAP) par l'aile opportuniste.
C'est en octobre 1907 que les radicaux marxistes commencèrent à publier leur propre "hebdomadaire social-démocrate". A la tête de "De Tribune" on trouvait les futurs chefs de l'organisation tribuniste : Wijnkoop, Ceton et van Ravesteyn, qui disposaient du soutien inconditionnel du 3ème rayon d'Amsterdam, le plus révolutionnaire du parti. Pannekoek et Gorter y contribuèrent régulièrement, donnant des textes théoriques et polémiques parmi les plus importants. Tous étaient animés par l'espérance d'une future révolution ; la période était plus favorable que jamais historiquement avec le début d'une crise économique, qu'ils n'analysaient pas encore comme la crise générale du capitalisme.
L'orientation était déjà antiparlementaire; il s'agissait de rattacher la lutte des ouvriers à la lutte internationale en les libérant des illusions parlementaire et nationale. Le but était en effet "1° démasquer la signification réelle des manoeuvres trompeuses de la démocratie bourgeoise en matière de droit de vote et de transformations sociales, et 2° donner une'' idée aux ouvriers de la signification des relations internationales et de la lutte de classe à l'étranger." Il est remarquable de constater que cette ligne politique se rapproche considérablement de celle du futur courant de Bordiga, par la proclamation de la lutte politique et théorique contre la démocratie bourgeoise et l'affirmation de l'internationalisme. Il est certain que les "Tribunistes" ne pouvaient guère avoir une activité organisée, en dehors des sections comme celle d'Amsterdam où ils étaient majoritaires. Chassés par les révisionnistes des organes centraux, ils concevaient leur lutte essentiellement sous l'aspect théorique.
Mais le combat politique - avec la publication de "De Tribune" qui était sans concessions dans sa lutte contre le révisionnisme - allait vite se durcir et poser rapidement la question de la scission dans le parti. Une chasse aux "sorcières" marxistes était enclenchée. A Rotterdam, les chefs révisionnistes firent destituer la rédaction marxiste de l'organe local ; et cela juste après le Congrès d'Arnhem (1908) qui avait rejeté la proposition de Troelstra d'interdire "De Tribune". Par la suite, c'est le même processus d'interdiction des autres organes locaux d'inspiration marxiste qui se généralise.
La crise du parti était ouverte ; elle allait se précipiter avec les interventions publiques de Troeistra contre les positions marxistes en plein parlement, face aux partis politiques bourgeois.
a) La question de la période et de la crise
L'affrontement avec les "tribunistes" allait se produire à l'automne 1908. à l'occasion d'une prise de position de Troelstra au parlement. Celui-ci niait publiquement la nécessité pour les ouvriers d'appréhender le devenir du capitalisme de façon théorique, dans le cadre du marxisme ; il soutenait qu'il n'y avait "pas de besoin de théorie logique abstraite" dans la lutte de classe. Finalement - sans la nécessité d'une révolution, et donc de façon pacifique et "automatique" - "le capitalisme conduit de lui-même au socialisme" (Id.). Autant dire que le socialisme n'était plus déterminé par l'existence des conditions objectives de la crise et la maturation de la conscience du prolétariat ; il devenait une simple croyance religieuse. A ces affirmations, "De Tribune" réagit très violemment et de façon mordante contre la personne de Troelstra, symbole du révisionnisme dans le parti :
"Un politicien pratique de la social-démocratie doit aussi comprendre la théorie ; il doit la connaître et pouvoir la défendre. C'est peut-être pour un 'bourgeois' une lourde tâche, mais la classe ouvrière ne s'accorde pas moins avec son chef. Ce savoir, cette science socialiste est certes souvent plus facile à atteindre que pour un homme qui est issu de la bourgeoisie. L'ouvrier peut savoir immédiatement à partir de sa propre vie ce que le socialiste issu de la bourgeoisie doit auparavant apprendre de la théorie ; par exemple, ce qui pour Troelstra n'est pas encore certain : que le fossé économique entre les deux classes devient toujours plus profond... Si la possibilité existe que le fossé entre les classes ne devienne pas plus profond, alors notre socialisme sombre dans une croyance ; la certitude devient une attente. Avec la croyance et l'espoir les ouvriers sont suffisamment floués. Pour cela ils n'ont pas besoin de socialisme. L'Eglise aussi leur apporte la croyance que cela ira mieux dans l'au-delà et les braves libéraux et démocrates espèrent que cela ira mieux bientôt." Mais le plus important dans la dénonciation du révisionnisme par les Tribunistes était l'affirmation théorique du cours historique du capitalisme vers une crise mondiale.' En cela, la Gauche hollandaise - sauf Pannekoek plus tard (cf.infra) - rejoignait la position de Rosa Luxemburg qu'elle devait exposer en 1913 : "La prétendue 'prophétie' de Marx est aussi pleinement réalisée dans le sens que les périodes de développement capitaliste moderne deviennent toujours plus courtes, que. en général les 'crises' comme force transitoire d'une production forte à une production faible doivent toujours encore persister et que avec le développement du capitalisme elles s'élargissent, deviennent plus longues, les maux limités localement devenant toujours plus des calamités mondiales."
Ces attaques portées contre les théories révisionnistes de Troelstra furent considérées par une majorité du SDAP comme de simples attaques personnelles. Fait extrêmement grave dans l'histoire du mouvement ouvrier, en contradiction avec la liberté de critique dans un parti ouvrier, les révisionnistes interdirent le colportage de "De Tribune" lors d'une réunion publique où parlait Troelstra. C'était le début du processus -d'exclusion des positions marxistes, processus qui allait brutalement s'accélérer à la veille de l'année 1909.
b) Gorter contre Troelstra sur la "morale" prolétarienne
"De Tribune" avait sorti en feuilleton au cours de l'année 1908 l'une des contributions majeures de Gorter à la vulgarisation du marxisme : "Le matérialisme historique expliqué aux ouvriers". Prenant à titre d'exemple la grève de 1903, Gorter montrait que la lutte de classe faisait surgir une authentique morale de classe qui entrait en contradiction avec la morale "générale" commune défendue par les tenants de l'ordre existant. La conception matérialiste, défendue par Gorter, qui sapait les fondements de toute morale religieuse, fut violemment attaquée au Parlement par le député chrétien Savornin Lohman les 19 et 20 novembre. Celui-ci, en défendant l'unité de la nation, accusa la social-démocratie de vouloir susciter la guerre entre les classes et d'intoxiquer ainsi la classe ouvrière avec le marxisme.
Au heu de faire bloc avec Gorter face aux attaques d'un représentant de la conception bourgeoise,Troelstra se lança dans une diatribe contre Gorter,qu'il présenta comme non représentatif du parti et une simple caricature du marxisme. Pour lui, la morale n'était pas déterminée par les rapports sociaux ; elle était valable 'pour les prolétaires comme pour les bourgeois. Il s'appuyait pour cela sur les concepts ambigus qu'avait utilisés Marx dans les statuts de l'AIT, ceux de droits, de devoirs et de justice. - Mais Troelstra, en confondant à dessein les valeurs communes à l'espèce humaine et la morale officielle qu'il présentait comme universelle transformait la morale de la lutte ouvrière - guidée par des intérêts communs et une action tendue vers la victoire - en une monstruosité. Le matérialisme de Gorter serait un pur appel au meurtre et aboutirait à une vision de barbarie. Selon lui, Gorter, par exemple, serait contre le fait qu'"un ouvrier sauve un fils de capitaliste en train de se noyer". La démagogie de Troelstra dans l'argumentation était dans ce cas identique à celle de Lohman, à laquelle il se ralliait.
Gorter répliqua fougueusement, selon son habitude, aussi bien à Lohman qu'à Troelstra, par une brochure vite écrite et publiée pour les nécessités du combat. Après une période d'isolement politique, il se lançait totalement dans la lutte de parti. Il concentra la pointe acérée de la critique sur la personne de Troelstra qui "en réalité, au plus profond de ses paroles, a choisi le camp de la bourgeoisie". Il montrait d'autre part que Troelstra trahissait la pensée profonde de Marx en utilisant les termes ambigus des Statuts de l'AIT. La correspondance de Marx et Engels, publiée quelques années plus tard, devait permettre à Gorter de justifier triomphalement son argumentation. En effet, dans une lettre du 4 novembre 1864, Marx expliquait qu'il avait du faire quelques concessions face aux proudhoniens: "j'ai été obligé d'accueillir dans le préambule des Statut deux phrases contenant les mots 'devoir' (duty) et 'droit' (right) de même que les mots vérité, morale et justice' (truth, morality and justice), mais je les ai placés de telle sorte qu'ils ne causent pas de dommage."
D'autre part, Gorter répliquait vigoureusement à l'accusation que la morale du prolétariat visait à s'attaquer aux individus capitalistes, au mépris de tout sentiment d'humanité. La morale du prolétariat est essentiellement une morale de combat qui vise à la défense de ses intérêts contre la classe bourgeoise, comme catégorie économique, et non comme somme d'individus. Elle est une morale qui vise à s'abolir dans la société sans classes, laissant la place à une véritable morale, celle de l'humanité tout entière émancipée de la société de classes.
Suite à cette polémique, la scission devint inévitable. Elle était souhaitée par Troelstra, qui tenait à éliminer du parti toute tendance critique marxiste. Dans une lettre à Vliegen du 3 décembre, il avouait :
"Le schisme est là; la seule ressource ne peut être qu'une scission."
LA SCISSION DU CONGRES DE DEVENTER (13-14 février 1909)
Pour éliminer les Tribunistes et leur revue, les chefs révisionnistes proposèrent un référendum pour examiner la question de la suppression de la revue "De Tribune" lors d'un congrès extraordinaire. Le comité du parti était hésitant et même contre de telles mesures extraordinaires. Troelstra passa par dessus le comité et par référendum obtint des 2/3 du parti la convocation du congrès. Il se manifestait ainsi que la très grande majorité du SDAP était gangrenée par le révisionnisme; elle était même à la base plus révisionniste que le "sommet", que ses organes directeurs.
D'autre part, les- éléments marxistes issus du "Nieuwe Tijd" et collaborateurs de "De Tribune" capitulèrent devant Troelstra. Au cours d'une conférence tenue le 31janvier, sans même que soient invités les principaux rédacteurs tribunistes, Roland-Holst et Wibaut se déclarèrent prêts à quitter la rédaction de la revue pour diriger un futur supplément hebdomadaire ("Het Weekblad") de "Het Volk" le quotidien du SDAP débarrassé de toute critique marxiste contre le révisionnisme. Au lieu de se solidariser avec leurs camarades de combat, ils firent un serment d'allégeance à Troelstra en se déclarant pour "un travail commun de loyale camaraderie de parti". Ceux-ci se proclamèrent; "marxistes de paix", essayant de se réfugier dans une attitude centriste de conciliation entre la droite et la gauche marxiste. Dans le mouvement marxiste en Hollande, Roland-Holst conserva constamment cette attitude (cf. infra).
Les Tribunistes ne manquèrent pas de reprocher à Roland-Holst sa capitulation : son attitude ne faisait que rendre plus certaine la scission souhaitée par les révisionnistes.
Il est vrai que, de leur côté, la minorité marxiste j était loin d'être homogène pour mener jusqu'au bout le combat à l'intérieur du SDAP. Wijnkoop, Van Raveysten et Ceton, qui constituaient la véritable tête organisatrice de la minorité, s'étaient déjà résolus à la scission avant le congrès, pour maintenir en vie "De Tribune". Par contre, Gorter - qui n'était pas formellement dans la rédaction - restait beaucoup plus réservé. Il se méfiait de la fougue de cette triade et ne voulait en aucun cas précipiter la scission. Il souhaitait que Wijnkoop se modère et que les Tribunistes restent dans le parti, au prix même de l'acceptation j de la suppression de "De Tribune" en cas d'échec au congrès de Deventer :
"J'ai 'continuellement dit contre la rédaction de 'Tribune' : nous devons tout faire pour attirer les autres vers nous, mais si cela échoue après que nous nous soyons battus jusqu'au bout et que tous nos efforts aient échoué, alors nous devons céder." (Lettre à Kautsky, 16 février 1909)
De fait, lors du congrès extraordinaire de Deventer, les Tribunistes se battirent pendant deux jours avec acharnement et dans des conditions extrêmement difficiles. Souvent interrompus par Troelstra qui usait systématiquement d'une démagogie anti-"intellectuels" ironisant sur les "professeurs de "De Tribune" -, affrontant le plus souvent les rires d'incompréhension de la majorité du congrès, ils restèrent offensifs. Ils se battirent pour maintenir l'essence révolutionnaire du parti, "le sel du parti", selon la formule lancée par Gorter. Sans la liberté de critique marxiste contre l'opportunisme, liberté exercée dans les grands partis comme le parti allemand -, on supprimait la possibilité "d'éveiller la conscience révolutionnaire". Plus qu'aucun autre, Gorter sut exprimer lors du congrès la conviction révolutionnaire des Tribunistes ; une période décisive de guerre menaçante ,et de révolution future en Allemagne s'ouvrait, qui entraînerait la Hollande dans la tourmente :
"Internationalement, la période est très importante. Une guerre internationale menace. Alors le prolétariat allemand entrera en insurrection.
Alors la Hollande doit choisir sa couleur ; alors le parti doit se réjouir qu'il y ait eu des hommes qui mettaient au premier plan le côté révolutionnaire de notre lutte."
Conscient finalement du naufrage du SDAP, Gorter concluait à la fin du congrès par un vibrant appel au regroupement des révolutionnaires autour de "Tribune": "Venez vous joindre à nous autour de 'Tribune' ; ne laissez pas le navire couler !". Cet appel n'était cependant pas une invitation à la scission et à l'édification du nouveau parti. Gorter était encore convaincu de la nécessité de rester dans le parti, faute de quoi les Tribunistes perdraient toute possibilité de se développer : "Notre force dans le parti peut grandir; notre force en dehors du parti ne pourra jamais croître."
Mais ce combat pour rester à l'intérieur du parti échoua. Le processus de scission était irréversible avec les décisions prises majoritairement par le congrès.
Le congrès décida de façon écrasante - par 209 mandats contre 88 et 13 blancs la suppression de "De Tribune", remplacé par un hebdomadaire dirigé principalement par Roland-Holst. Mais, surtout, il excluait du parti les trois rédacteurs de "Tribune" : Wijnkoop Van Raveysten et Ceton. Dans l'esprit des révisionnistes, il s'agissait de décapiter la "tête" organisative, de séparer les "chefs" de la masse des sympathisants tribunistes dans le parti.
Cette manoeuvre échoua. Après le choc de l'exclusion des porte-parole du tribunisme, dans les sections les militants se ressaisirent et se solidarisèrent avec les trois rédacteurs. Rapidement, ce qui était jusque là une tendance informelle se transforma en groupe organisé. Aussitôt après le congrès - preuve que les Tribunistes avaient envisagé cette possibilité avant la scission - une commission permanente d'organisation fut formée pour regrouper la tendance "tribuniste". Des membres du groupe "Nieuwe Tijd", dont Gorter, finirent par rejoindre la commission. Gorter, après six semaines d'hésitations et de doute sur son attitude unitaire, finit par se résoudre à s'engager à fond dans un travail avec les Tribunistes exclus. Gorter mettait en garde, cependant, contre la fondation d'un second parti qui serait purement volontariste.
C'est en fait la publication le 13 mars par le SDAP du référendum dans le parti, pour approuver les décisions de Deventer, qui poussa les exclus à former un second parti. Par 3712 voix contre 1340, le SDAP avalisait l'exclusion du parti de toute la rédaction de "Tribune".
Or, entre-temps, avant que l'annonce d'exclusion définitive fut connue, Gorter et Winjkoop se rendirent à Bruxelles le 10 mars. Trois membres du Bureau socialiste international - Huysmans, Vandervelde et Anseele tous connus pour leur appartenance à la droite - dont le siège était dans la capitale belge, les attendaient pour résoudre la "question hollandaise". Contrairement à leurs craintes, Gorter et Wijnkoop trouvèrent une grande compréhension dans le BSI, lequel s'indigna de l'exclusion décidée à Deventer, et tenta d'obtenir la réintégration des exclus comme la libre expression du marxisme dans le SDAP. Pour jouer les médiateurs, Huysmans, le secrétaire en titre du BSI, se rendit en Hollande pour obtenir des instances du SDAP les décisions suivantes :
- l'annulation de la décision d'exclusion de Deventer ;
- l'acceptation d'un des rédacteurs exclus dans le nouvel hebdomadaire dirigé par Roland-Holst ;
- la reconnaissance du droit d'expression pour la minorité marxiste.
Sur tous ces points, les instances dirigeantes du SDAP semblèrent ébranlées par les avis de Huysmans suggérés le 15 mars. Mais, la veille, le 14 mars, s'était tenu à Amsterdam le congrès de fondation du parti tribuniste qui prit le nom de SDP (Parti social-démocrate). Sa fondation avait donc été décidée par ses membres sans même attendre les résultats des négociations du BSI avec le SDAP. Ce dernier, pourtant au courant des discussions menées depuis le 10 mars, avait fait avaliser l'exclusion le 13 mars.
C'est donc dans une situation d'extrême confusion que naquit le SDP. Il s'agissait d'un petit parti de 419 membres divisé en 9 sections. Son programme était celui de l'ancien parti d'avant 1906, avant les modifications révisionnistes.
Wijnkoop était nommé par le congrès président du parti, en raison de ses capacités d'organisateur.Gorter devenait membre de la direction du SDP. Mais son poids organisationnel était trop faible pour contrecarrer la politique personnelle, voire ambitieuse de Wijnkoop, prêt à sacrifier toute possibilité d'unité sur l'autel de "son" groupe. Une telle politique n'était pas sans arranger la majorité révisionniste du SDAP qui souhaitait la scission définitive d'avec le courant marxiste.
Pour toutes ces raisons, les tentatives faites par le BSI pour mettre fin à la scission échouèrent. Un congrès extraordinaire convoqué d'urgence pour le 21 mars, une semaine après celui de fondation, rejeta majoritairement les propositions faites par Huysmans de retourner dans le SDAP. Gorter était, avec quelques-uns qui appartenaient à la vieille garde du SDAP pour. Il jugeait particulièrement irresponsable l'attitude de Wijnkoop dont il dénonçait en privé "l'opiniâtreté sans limites". Il était à ce point démoralisé qu'il songea même un moment à quitter le SPD. Le rejet par le BSI et le SDAP des conditions de réintégration des militants tribunistes le décida cependant à s'engager complètement dans l'activité du nouveau parti.
En effet, le congrès du 21 mars, en dépit de l'attitude peu claire de Wijnkoop, avait laissé la porte ouverte à une réintégration dans l'ancien parti. Une résolution du congrès montrait le souhait de la majorité de maintenir aux Pays-Bas un seul parti ; pour cela le congrès posait des conditions qui permettraient aux Tribunistes de continuer leur travail de critique et d'activité marxistes dans le SDAP, si elles étaient acceptées :
"(le congrès) souhaite qu'en Hollande il y ait un seul parti social-démocrate et charge le comité du Parti, dans l'intérêt de l'unité, de lui donner pleins pouvoirs pour dissoudre le SDP, dès que :
- le SDAP, par référendum, lève 1'exclusion des trois rédacteurs;
- le SDAP reconnaît dans une résolution clairement formulée la liberté de tous ses membres ou de tout groupe de membres, ouvertement, sous toute forme, écrite et orale, de proclamer les principes consignés dans le programme et d'exercer leur critique"
Le rejet de ces conditions qui apparurent comme un ultimatum, par le BSI et le SDAP, créait une situation nouvelle dans l'Internationale : il y avait dans un pays comme les Pays-Bas deux partis socialistes se réclamant tous deux de la 2ème Internationale. Cette situation était - dans la 2ème Internationale - exceptionnelle. Même en Russie, après la scission entre les bolcheviks et les mencheviks, les deux fractions restaient adhérentes du même parti : le POSDR (Parti ouvrier social-démocrate russe). Mais aux Pays-Bas, il s'était révélé à travers la scission l'impossibilité politique - et aussi la non-volonté autant de la majorité révisionniste que de la minorité tribuniste - de demeurer membres du même parti.
Il était cependant très clair pour les militants marxistes du SDP que leur parti était un parti de l'Internationale. La scission était une scission locale et non une scission d'avec la 2ème Internationale.
Il était évident pour eux que la 2ème Internationale restait un corps vivant pour le prolétariat international et qu'elle n'avait nullement encore fait faillite. La faillite du SDAP de Troelstra n'était nullement celle de l'Internationale. Pour le SDP, le "modèle" de parti .restait encore, comme pour les bolcheviks, la social-démocratie allemande, avec laquelle il avait des liens étroits. Gorter, comme membre de la direction du SDP, restait en correspondance régulière avec Kautsky, du moins jusqu'en 1911, date de la rupture de la Gauche avec le Centre kautskyste. Pannekoek, qui s’était installé en Allemagne depuis 1906 et était depuis la scission membre du SDP, était membre de la section de Brème du SPD, après avoir enseigné dans l'école du Parti.
Pour devenir section de l'Internationale, le SDP entre prit promptement des démarches auprès du Bureau socialiste international. Gorter et Wijnkoop furent mandatés pour exposer au BSI les motifs de la scission en s'appuyant sur les rapports spécialement rédigés à l'adresse de l'Internationale. La demande d'acceptation du nouveau parti comme section à part entière fut en fait l'objet d'un conflit entre une gauche représentée par Singer (SPD) et Vaillant et une droite, dont l'autrichien Adler était le porte-parole. C'est à une faible majorité que l'acceptation du SDP dans l'Internationale fut rejetée : fa résolution Adler recueillait 16 voix, contre l'acceptation ; celle de Singer 11 voix, pour. Ainsi, le 7 novembre 1909, par ce vote, le SDP était de fait exclu du mouvement ouvrier international, par une majorité du BSI qui prenait fait et cause pour le révisionnisme.
Le SDP trouva néanmoins un appui inconditionnel dans la gauche bolchevique. Lénine -qui avait pris contact avec Gorter avant le BSI condamna avec indignation la décision du Bureau socialiste international de Bruxelles. Pour lui, il ne faisait aucun doute que les révisionnistes étaient responsables de la scission :
"[Le BSI] adopta une position formaliste et, prenant nettement parti pour les opportunistes, rendit les marxistes responsables de la scission."-
Il approuvait sans réserves les tribunistes qui n'avaient pas accepté la suspension de "De Tribune". Comme eux, il condamnait le centrisme de Roland-Holst "qui fit malheureusement preuve d'un désolant esprit de conciliation"
Ainsi débutait entre le SDP et les bolcheviks une communauté d'action qui allait devenir de plus en plus étroite. En partie grâce à la Gauche russe, le SDP finit par être accepté en 1910 comme section, de plein droit de l'Internationale. Disposant d'un mandat contre 7 au SDAP, il put participer aux travaux des congrès internationaux, à Copenhague en 1910 et à Bâle en 1912.
Ainsi, malgré les manoeuvres des révisionnistes, le SDP s'intégrait pleinement dans le mouvement ouvrier international. Son combat allait se mener conjointement avec la Gauche internationale, particulièrement avec la Gauche allemande, pour la défense des principes révolutionnaires.
JUSQU’A LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Jusqu'à la première guerre mondiale, pendant laquelle il allait connaître une audience croissante dans le prolétariat, le SDP connut une "traversée du désert". Il resta un petit parti, sans grande influence dans le prolétariat néerlandais : quelques centaines de militants contre plusieurs milliers au SDAP de Troelstra. Sa croissance numérique fut très lente et limitée, en dépit de son esprit militant : au moment de la scission, le SDP comptait 408 militants ; en 1914,' 525. Le nombre d'abonnés à "De Tribune" fut limité et fluctuant : 900 lors du congrès de Deventer ; 1400 en mai 1909 et 1266 en 1914. A cause de sa faible audience le SDP ne fut jamais un parti parlementaire le devint à la fin de la guerre ; sa participation aux élections fut toujours une débâcle. Lors des élections de juin 1909, il obtint 1,5 % des voix par district. Même Gorter, qui était réputé être le meilleur orateur du parti, le seul capable de susciter l'enthousiasme des ouvriers connut un échec retentissant : poussé à être candidat aux élections de 1913 à Amsterdam et dans la ville industrielle d'Enschede, il obtint 196 voix pour le SDP contre 5325 pour le SDAP, dans cette dernière ville. Mais, même s'il participait aux élections, le terrain du- SDP n'était pas les élections, terrain où s'était enlisé le SDAP.
Réduit à une petite cohorte, le SDP -par suite de mauvaises conditions dans lesquelles s'était accomplie la scission de Deventer- ne peut rallier l'organisation des jeunesses, qui traditionnellement se tenait à la pointe de la lutte contre le capitalisme et la guerre, de façon active et radicale. L'organisation de jeunesse, "De Zaaier" ("Le Semeur"), qui avait été créée en 1901, voulut rester autonome : ses sections étaient libres de se rattacher à l'un ou à l'autre des deux partis. Lorsque, en 1911, le SDAP créa sa propre organisation de jeunesse, essentiellement pour contrer l'activité antimilitariste du "Zaaier", celui-ci éclata. Les quelques militants restants (100 environ) refusèrent néanmoins de suivre le SDP, malgré l'orientation commune.
Le risque était grand, malgré la solidité théorique du parti, que le SDP s'enfonce dans le sectarisme. Les attaches du parti avec le prolétariat d'industrie étaient distendues depuis la scission. Moins de la moitié des militants travaillait dans les usines ou les ateliers ; une grosse partie était composée d'employés et d'instituteurs. Le sommet du parti -jusqu'en 1911 du moins était composé d'intellectuels, solides théoriciens, mais -sauf Gorter- souvent sectaires et doctrinaires. Cette direction d'enseignants était portée à transformer le parti en secte.
La lutte contre le sectarisme au sein du SDP se posa dès le départ. En mai 1909, Mannoury -un des chefs du parti et futur dirigeant stalinien- déclara que le SDP était le seul et unique parti socialiste, le SDAP étant devenu un parti bourgeois. Gorter, d'abord minoritaire, se battit avec acharnement contre cette conception, lui qui avait mené la bataille contre Troelstra avec le plus d'acharnement ; il montra que -bien que le révisionnisme " menât au camp bourgeois- le SDAP était avant tout un parti opportuniste au sein du camp prolétarien. Cette position avait des implications directes au niveau des activités d'agitation et de propagande dans la classe. Il était en effet possible de se battre avec le SDAP, chaque fois que celui-ci défendait encore un point de vue de classe, sans la moindre concession théorique.
"Secte ou parti", telle était la question que Gorter posa très clairement devant l'ensemble du parti en novembre 1910. Il s'agissait de savoir si le SDP s'associerait à une pétition lancée par le SDAP pour le suffrage universel. Le SDP, comme tous les partis socialistes de l'époque, se battait pour le suffrage universel. La question centrale était donc l'analyse de classe du SDAP, mais aussi la lutte contre l'inaction sectaire lors des luttes politiques. Au départ, seule une petite minorité, menée par Gorter, soutint l'idée de la pétition et de l'agitation sur le suffrage universel. Il fallut tout le poids de Gorter pour qu'enfin une faible majorité se dessinât en faveur d'une activité commune avec le SDAP. Gorter montra le danger d'une tactique de non-participation, qui risquait de pousser le parti à un isolement total. Face au SDAP, qui n'était certes "pas un vrai parti", mais "un rassemblement, une masse attroupée pour une troupe de démagogues", la tactique devait être celle du "frelon" aiguillonnant dans le bon sens. Cette attitude fut finalement. Celle du parti jusqu'à la guerre, moment où le SDAP franchit le Rubicon en votant les crédits de guerre.
L'évolution du SDAP confirmait en effet la validité du combat mené dès le début par les tnbunistes contre le révisionnisme. Celui-ci, progressivement, était happé par l'idéologie et l'appareil d'Etat bourgeois. En 1913, le SDAP se prononça pour la mobilisation militaire en cas de guerre, et Troelstra proclamait ouvertement l'adhésion du révisionnisme au nationalisme et au militarisme :"Nous devons accomplir notre devoir", écrivait-il dans le quotidien du SDAP.
Fort de ses succès électoraux en 1913, le SDAP qui avait obtenu 18 sièges, se déclarait prêt à prendre des portefeuilles ministériels dans le nouveau gouvernement libéral. La participation à un gouvernement bourgeois aurait signifié l'abandon total du reste de principes prolétariens du parti de Troelstra ; celui-ci devenait ainsi un parti bourgeois intégré dans l'appa reil d'Etat. Il y eut cependant un faible et dernier sursaut prolétarien dans ce parti : lors de son congrès tenu à Zwolle, contre l'avis de Troelstra, une faible majorité se dégagea (375 voix contre 320) finalement contre la participation ministérielle Il est vrai que l'agitation faite par le SDP sous la forme d'une lettre ouverte écrite par Gorter et adressée au con grès qui n'en eut même pas connaissance- contre la participation ne fut pas étrangère à ce dernier sur saut.
L'activité du SDP ne se limita pas à critiquer le SDAP. Elle se déploya essentiellement dans la lutte de classe, dans les luttes économiques et dans l'action contre la guerre :
- La reprise de la lutte de classe internationale au début des années 1910 favorisa l'activité du parti qui y puisa enthousiasme et confiance. Ses militants participèrent avec ceux du NAS aux luttes des maçons d'Amsterdam en 1909 et 1910, qui se défiaient du SDAP, jugé "parti d'Etat". En 1910, le parti formait avec le NAS un "comité d'agitation contre la vie chère". Ainsi débutait une longue activité commune avec les syndicalistes-révolutionnaires, qui ne fut pas sans développer l'influence du SDP avant et pendant la guerre, au sein du prolétariat néerlandais. Cette activité commune eut pour conséquence de réduire progressivement le poids des éléments anarchistes au sein du petit syndicat et de développer une réceptivité aux positions marxistes révolutionnaires,
La lutte politique contre la guerre menaçante fut une constante du SDP. Celui-ci participa très activement au congrès de Bâle en 1912, congrès centré sur la menace de guerre. Le SDP, comme d'autres partis, proposa un amendement pour la grève de protestation en cas d'éclatement d'un conflit mondial. Cet amendement, qui fut rejeté, prenait soin de se démarquer de l'idée de "grève générale" lancée par les anarchistes. Malheureusement, suite' à l'interdiction des débats dans le congrès, le discours qu'avait préparé Gorter et orienté contre le pacifisme, ne put être lu. La voix révolutionnaire du SDP ne put retentir dans l'Internationale, couverte par les discours de tribun du pacifiste Jaurès.
A la veille de la guerre, le SDP -après une crise d'isolement sectaire- avait incontestablement développé une activité dans le prolétariat néerlandais qui ne fut pas sans porter ses fruits. L'évolution du SDAP vers le- "ministérialisme" -c'est-à-dire la participation au gouvernement bourgeois-, son acceptation de la "défense nationale" avaient incontestablement confirmé les analyses du courant marxiste. Celui-ci, compte tenu des conditions très défavorables de la scission de Deventer, restait néanmoins faible .numériquement : le courant révolutionnaire était recouvert par le courant révisionniste, en pleine expansion numérique et électorale.
Dans un si petit parti, l'orientation politique restait en partie déterminée par le poids des personnalités. La clarté théorique d'un Gorter et son soutien actif étaient décisifs^ face aux ambitions organisationnelles et au manque de principes d'un Wijnkoop et d'un Revesteyn. Cette opposition était lourde d'une nouvelle scission.
Cependant, l'audience du courant marxiste hollandais et sa force dépassaient le cadre étroit de la petite Hollande. C'est dans l'Internationale et avec la Gauche allemande que le marxisme hollandais contribua de façon décisive à la naissance de la Gauche communiste. Cette contribution fut moins organisationnelle que théorique, et déterminée par l'activité de Pannekoek en Allemagne. C'était à la fois une force et une faiblesse du "tnbunisme" hollandais.
Chardin
Géographique:
- Hollande [118]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [77]