Revue Internationale numéro spécial: l'impérialisme en Orient
- 818 lectures
Depuis un bon nombre d'années déjà, il est devenu évident que la montée de la Chine en tant que puissance économique et militaire pose des questions de fond pour l'analyse de la situation mondiale. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer un numéro spéciale de le Revue internationale à une analyse de l'impérialisme d'Orient depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant, afin de situer les évènements d'aujourd'hui dans leur contexte historique.
Cette étude fut publiée en anglais en 2012, et certains des questions posées ont été dépassées depuis par la réalité concrète. Cela n'empêche pas les analyses historiques et actuelles de rester largement valables.
Le capitalisme ascendant : avant la Première Guerre mondiale
- 1230 lectures
Rubrique:
Japon: une nouvelle force capitaliste apparaît
- 1099 lectures
Entre le milieu du 17e siècle et celui du 19e, le Japon s’est isolé du reste du monde. Aucun étranger n’a alors le droit d’entrer dans le pays, aucun japonais n’est autorisé à le quitter sans permission, le commerce avec les autres pays est limité à quelques très rares ports. Même s’il existe une faible dynamique, très limitée, de développement d’un marché au sein du pays, la vraie rupture historique se produira lorsque le pays, après presque deux siècles d’isolement volontaire, s’ouvri par la force au capitalisme. Comme Marx et Engels l’ont analyfsé dans le Manifeste Communiste de 1848, "à la place de l’isolement d’autrefois des régions et des nations se suffisant à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations… Sous peine de mort, elle (la bourgeoisie) force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production" (premier chapitre : Bourgeois et Prolétaires).
En 1835, rapidement après que la première guerre de l’opium ait ravagé la Chine, des navires de guerre américains (États-Unis) apparaissent pour la première fois dans les eaux japonaises et imposent surtout le libre commerce. La résistance japonaise contre la pénétration de commerçants étrangers persistant, des bateaux hollandais, français et anglais bombardent la côte japonaise. Après cette agression militaire unie, qui montre qu’à cette époque, les nations capitalistes étrangères peuvent encore œuvrer ensemble à l’ouverture du Japon, la classe dominante japonaise renonce à toute résistance aux capitalistes étrangers et commence rapidement à introduire de profonds changements politiques et économiques.
Au Japon, l’ordre féodal-absolutiste désuet du shogunat de Tokugawa (la famille féodale régnante) est remplacé par un État très uni sous le gouvernement de l’empereur Mikado en 1868. "Le capitalisme n’y est pas parvenu au pouvoir parce qu’une bourgeoisie en ascension avait vaincu la classe féodale par une lutte révolutionnaire, mais parce qu’une classe féodale s’était transformée en une bourgeoisie"1. Bien qu’il y ait "des forces pour un changement de l’absolutisme féodal vers le capitalisme, [elles étaient] trop faibles pour entraîner une révolution".2. Elles ont dû s’appuyer sur l’ouverture au capitalisme de "l’extérieur". Les sages-femmes qui aident à l’accouchement du capitalisme au Japon sont les capitalistes étrangers qui donnent un grand élan à la bourgeoisie japonaise montante.
La transition entre société féodale et bourgeoise ne s’accompagne pas d’une révolution politique. À la différence de la plupart des pays européens, où le capital privé joue un rôle de locomotive dans l’économie et où le libéralisme propage une politique de laisser-faire, au Japon, c’est l’État japonais qui va jouer un rôle dominant dans l’avancée du capitalisme. En 1868, l’empereur nomme la première commission au plan. La classe dominante japonaise commence à étudier systématiquement les conditions du fonctionnement capitaliste dans les autres pays, avec pour objectif de les copier et de les appliquer aussi efficacement que possible.3
Quelques bateaux seulement auront suffi pour que les nations capitalistes étrangères réalisent leur pénétration au Japon. À la différence des autres pays d’Extrême-Orient, le Japon n’est pas occupé ; aucune armée étrangère n'est stationnée sur les îles.
En même temps, comme le Japon est un groupe d’îles presque sans matière première, il doit s’approvisionner en ces matières auprès d’autres pays. Le pays le plus près du Japon est la Corée – derrière laquelle il y a la région Mandchoue de la Chine et de la Russie. Au sud, il y a une autre île, Taiwan. Alors que la plupart des États européens ont dû rapidement diriger leur fièvre de conquêtes vers des régions très lointaines (souvent sur d’autres continents comme en Afrique, Asie, Amérique du Sud), le Japon a trouvé sa zone d’expansion dans la région immédiate. Dix ans seulement après avoir été ouvert par les capitalistes étrangers, le Japon s’attaque à Taiwan. En 1874, le Japon occupe la pointe sud de Formose.4 Mais ce premier gros effort pour s’étendre alarme l’Angleterre et la Chine qui envoient 11 000 soldats dans la partie sud de Taiwan. À cette époque, le Japon n’a pas encore une puissance militaire suffisante pour s’engager dans un combat plus large et se retire donc de Taiwan.
Peu après, le Japon commence à orienter ses ambitions vers la Corée. En 1855, le Japon et la Chine signent un traité, selon lequel aucun pays n’enverra de troupes en Corée sans l’assentiment des autres pays. Afin de sortir de cette impasse"" temporaire, le Japon décide de construire une flotte apte à contrôler la mer de Chine.
Comme nous le verrons, le Japon a engagé une première guerre avec la Chine en 1894 et dix ans après avec la Russie, en 1904. En gros, donc, à peine quatre décennies après que le capitalisme se soit installé au Japon, ce pays est entré en guerre avec deux de ses rivaux dans la région.
Ne subissant aucune entrave de la part d’une puissance coloniale dominante, le Japon en est rapidement devenu une, et même s’il est arrivé tard sur le marché mondial, il devient rapidement la principale force dans la région, et devenir le principal rival des autres puissances présentes dans la région.
En conséquence, ses dépenses militaires sont constamment en augmentation. À la fin du XIXème siècle, le Japon commence à financer son armée avec des emprunts alimentés par des fonds anglais et américains. 50 % des prêts étrangers vont dans la guerre et l’armement. Les dépenses gouvernementales triplent entre 1893 et 1903, et doublent de nouveau au cours de la guerre russo-japonaise de 1905. Sa flotte moderne est composée de bateaux de guerre fabriqués en Grande-Bretagne, ses canons sont fabriqués par la firme allemande de Krupp. Quand le Japon vainc la Chine dans la guerre de 1894, cela lui permet d’imposer un poids financier énorme à son voisin, le forçant à payer 360 millions de yens, dont une grande partie ne servira qu’à financer un programme guerrier de développement de l’armement. La dette nationale s’élève de 235 millions de yens en 1893, à 539 millions en 1903, pour grimper en flèche à 2,592 millions de yens en 1913, résultat d’une grande émission d’obligations pour la guerre.5
Le Japon devient ainsi le plus gros requin impérialiste dans la région déjà dans la période ascendante du capitalisme. Ce pays n’aurait pas pu accéder à cette position dominante sans le rôle central de l’État et de ses orientations militaires.
1Anton Pannekoek, Les conseils ouvriers, vol II, Livre 4, “L’impérialisme japonais”, p103, Ed Spartacus
2Pannekoek, op.cit., p103
3Il n’y avait presque pas d’industrie privée pendant cette première phase du capitalisme japonais. Le premier ministère de l’industrie est fondé en 1870. Au début des années 1870, la monnaie papier est introduite en 1872, la première ligne de chemin de fer s’ouvre entre Tokyo et Yokohama (c’est à dire 40 ans après les premières lignes en Grande Bretagne). Les routes du pays, qui étaient barrées par les potentats provinciaux, s’ouvrent au trafic général. Les octrois sont abolis. En 1869, les quatre classes (Samouraïs, paysans, commerçants et artisans) sont toutes déclarées égales, les différences d’habillement entre les classes sont abolies, les paysans peuvent cultiver ce qu’ils choisissent. Pour plus d’informations, voir : Anton Pannecoek : Les Conseils Ouvriers.
4L’île de Taiwan était connu, pour les européens, sous le nom de Formose, du portugais Ilha Formosa, “ la belle isle ”.
5"En conséquence surtout de la guerre sino-japonaise, et d’un armement croissant et d’entreprise coloniale qui suivent son éveil, les dépenses du gouvernement national triplent entre 1893 et 1903. Elles ont encore plus que doublé au cours de la guerre russo-japonaise (…) Pour financer ce fardeau, les impôts sont progressivement augmentés. L’indemnité de 360 millions de yens obtenue de la Chine en 1895 est aussi largement utilisée pour financer un programme de développement de l’armement entre les guerres. Ces ressources s’avèrent néanmoins inadéquates, d'où le recours à de vastes emprunts. La dette nationale va s’élever de 325 millions de yens en 1893 à 539 millions en 1903. Elle grimpe ensuite en flèche à 2592 millions de yens en 1913…50 % environ du budget total du gouvernement en 1913 est consacré à l’armée et à la marine, au service des pensions militaires et des dettes de guerre… En fait, les dépenses militaires "extraordinaires" causées par la guerre avec la Russie sont largement assumées au moyen d'emprunts à Londres et à Paris. Avant la guerre, (i.e., en 1903), le total des prêts nationaux japonais provenant de l’étranger ne s’élève qu’à 98 millions de yens. À la fin de 1913, ils vont monter jusqu’à 1525 millions (…). Les prêts étrangers ont un effet inflationniste dans le pays." (William Lockwood, The Economic Development of Japan, p. 35. Princeton, 1954).Voir aussi: W.W. Lockwood, The state and economic enterprise in Japan, Princeton, 1969).
Géographique:
- Japon [1]
Chine: une société en décomposition grande ouverte à l’opium et à la guerre
- 1391 lectures
Quand le capitalisme pénètre ces pays, la Chine aussi bien que le Japon sont gouvernés par des dynasties déclinantes. Comme au Japon, le mode local de production en Chine est incapable de concurrencer le capitalisme. La dynastie mandchoue n’est pas capable au niveau commercial, et encore moins au niveau militaire, de résister à la pénétration capitaliste étrangère. Comme au Japon, la marche triomphante du capitalisme n’a pas été imposée par une classe capitaliste commerçante à l’intérieur du pays, mais le capitalisme a été en grande partie imposé de l’extérieur.
Dans le cadre de cet article, nous n’avons pas la place d’entrer dans les détails des raisons de la profonde stagnation de la société chinoise. Dans les années 1850, Marx et Engels commencèrent à analyser les racines profondes de ce phénomène : "La Chine, un de ces empires asiatiques vacillant, qui l’un après l’autre tombent sous l’emprise de l’esprit d’entreprise du courant européen, était si faible, si désagrégée, qu’elle n’avait même pas la force de se sortir de la crise d’une révolution populaire, si bien qu’une vive indignation s’est transformée en maladie chronique et probablement incurable, un empire si décomposé qu’il en était presque incapable de gouverner son propre peuple ou d’offrir une quelconque résistance à ses agresseurs étrangers."1.
Dans son œuvre, Marx, afin de comprendre les raisons pour lesquelles les grandes civilisations non-européennes n’avaient pas évolué vers le capitalisme, a mis en avant le concept d’un mode asiatique de production.2
Deux guerres de l’opium ont joué un rôle crucial dans l’ouverture de la Chine au capitalisme.
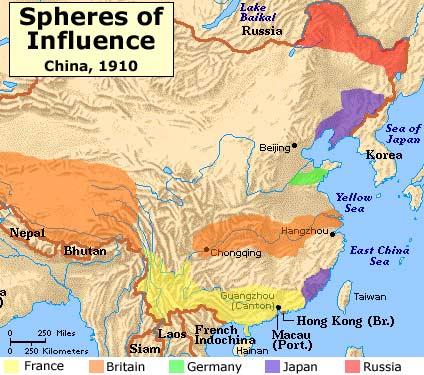 Après que l’opium ait été importé massivement par la Compagnie Anglaise des Indes orientales au début du 19ème siècle, la classe dominante chinoise, de crainte de perdre de sa compétitivité vis-à-vis de ses rivaux, essaie de freiner la consommation d’opium vers la fin des années 1830. Pas moins de 20 millions de personnes s’adonnent à ce vice à l’époque. Beaucoup d’hommes d’État sont dépendants de l’opium. Le niveau élevé de consommation est déjà en lui-même une expression de la décomposition sociale.
Après que l’opium ait été importé massivement par la Compagnie Anglaise des Indes orientales au début du 19ème siècle, la classe dominante chinoise, de crainte de perdre de sa compétitivité vis-à-vis de ses rivaux, essaie de freiner la consommation d’opium vers la fin des années 1830. Pas moins de 20 millions de personnes s’adonnent à ce vice à l’époque. Beaucoup d’hommes d’État sont dépendants de l’opium. Le niveau élevé de consommation est déjà en lui-même une expression de la décomposition sociale.
Le pays européen le plus avancé, l’Angleterre (rejointe plus tard par la France) a utilisé la résistance de la classe dominante chinoise à "l’invasion" massive d’opium comme prétexte pour envoyer des troupes. L’Angleterre, la nation "la plus civilisée" de l’occident devient le plus grand trafiquant d’opium et utilise la prohibition de la drogue par les autorités chinoises pour déclencher deux guerres.
Dans les deux guerres de l’opium (1839-42 ; 1856-60), l’Angleterre (avec la France à ses côtés dans la deuxième guerre) inflige une défaite militaire écrasante aux troupes chinoises, accompagnée d’une série de massacres.
Le résultat de la victoire militaire écrasante de l’Angleterre dans la première guerre de l’opium, fut qu’on lui accordât des concessions sur Hong Kong et cinq zones commerciales le long de la côte. Mais la seconde guerre de l’opium entraîne déjà un changement qualitatif. À cette époque ce que tous les pays européens recherchent avant tout sont de nouveaux marchés pour les produits manufacturés en Europe. Le résultat de la seconde guerre est donc d’ouvrir la Chine non seulement à l’opium mais surtout aux produits commerciaux européens.
"L’isolement complet a été la première condition de la préservation de la Chine antique. Cet isolement ayant pris fin brutalement grâce à l’Angleterre, la dissolution dut suivre aussi sûrement que celle d’une momie soigneusement préservée dans un cercueil hermétiquement scellé quand elle est mise à l’air libre.".3 Marx ajoutait: “nous n’entendons rien au sujet du commerce illicite d’opium, qui alimente chaque année le trésor britannique aux dépens de la vie humaine et de la morale".4
Comme partout, l’imposition du capitalisme s’accompagne de violence. "Chacun des plus de quarante ports affermés chinois (treaty-ports) a été acheté par des flots de sang, des massacres et des ruines".5 Les capitalistes étrangers (sous le mot d’ordre du libre-échange et accompagnés par l’opium et la guerre) abolissent les restrictions de la Chine gouvernée par les Mandchous pour permettre le développement capitaliste. À la différence du Japon, qui lui aussi a été ouvert violemment au capitalisme par les pays capitalistes étrangers, mais qui n’a jamais été occupé ou entraîné dans une série de guerres, la Chine va être divisée entre sphères d’influence.
Pendant la période 1860/70, tous les morceaux épars de l’empire chinois sont saisis par des puissances étrangères. Vers la fin du 19ème siècle, la Chine a perdu toute l’Indochine au profit de la France, la Birmanie à celui de la Grande-Bretagne, la Corée à celui du Japon, tous les territoires au nord du fleuve Amour vont à la Russie, le Tibet à la Grande-Bretagne, la Mandchourie est disputée par la Russie au Japon. Pour la Chine elle-même, ce n’est pas mieux que si elle avait été annexée.
A la fin du 19ème siècle, la Grande-Bretagne contrôle fortement toute la vallée du Yangtsé (le Fleuve Bleu), le centre de la vie économique de la Chine, la France s’approprie le Hunan, l’Allemagne s’empare de Shantung et de Tsingtao. Les États-Unis ne demandent aucune concession mais ils soutiennent "la “politique de la porte ouverte”" vis-à-vis de la Chine.
Il se développe au sein de la Chine une sorte "de imperium in imperio", (d’empire dans l’empire) sous la forme de colonies étrangères. De petites parties du territoire chinois prennent la forme d’autant d’avant-postes de l’impérialisme.
Alors que l’Inde est sous la seule coupe britannique (les anglais ayant battu les français en 1757), la Chine devient rapidement une sorte de colonie de l’impérialisme international, avec différents pays essayant d’en prendre des morceaux. Mais à cause de la présence de tant d’aspirants, la possibilité d’annexion de la Chine par n’importe quelle puissance à elle seul est alors hors de question et la colonisation de la Chine prend la forme de différentes "sphères d’influence". La résistance à l’annexion, en Chine et hors de la Chine, ne peut plus venir de la Chine elle-même, son annexion formelle est bloquée par la rivalité entre les puissances impérialistes.
Ainsi, jusqu’au début des années 1890, la division du territoire chinois en zones d’influence a pu se passer sans grand problème entre les rivaux européens. Cependant, lorsque le niveau des rivalités impérialistes, spécialement entre les pays européens, a atteint de nouvelles proportions et que ceux-ci ont tourné leur attention de l’Afrique en faveur de l’Europe et de l’Asie, le niveau de rivalités en Extrême-Orient prend une forme qualitativement nouvelle. Alors que les pays capitalistes étrangers ont imposé le capitalisme en Chine, le développement de celui-ci est en même temps entravé parce que ces mêmes puissances sont surtout intéressées à piller et à vendre leurs marchandises aux dépens des concurrents chinois. Elles freinent le développement d’une industrie chinoise autonome, barrant la route à toute réelle industrialisation. Ainsi, alors qu’aucune fraction de la classe dominante chinoise n’est capable d'impulser un développement capitaliste, les compagnies étrangères, à la fin du 19ème siècle, contrôlent presque la totalité de l’économie chinoise.
1Le succès de la politique russe en Extrême Orient. 1858, Marx-Engels Werke 12, p. 622 (la traduction est de nous).
2L’analyse des sociétés précapitalistes a été entreprise dans plusieurs textes par Marx et Engels. Comme leurs investigations évoluaient, leurs concepts ont aussi graduellement changé. Pour une analyse plus détaillé voir :Perry Anderson dans ‘Lineages of the Absolutist State’", Londres, 1974. Voir aussi Revue Internationale n°135, "Quelle méthode scientifique pour comprendre l’ordre social existant, les conditions et les moyens de son dépassement ? (II)" pour une discussion sur cette question.
3Marx, “Revolution in China and Europe”, 14/6/1853, New York Daily Tribune (la traduction est de nous)
4 “English cruelties in China”, écrit le 22/03/1857, publié le10/04/1857.
5Rosa Luxembourg, L’accumulation du capital, “ Les conditions historiques de l’accumulation ”
Géographique:
- Chine [2]
La révolte des Taiping – la bourgeoisie incapable de faire sa révolution
- 2053 lectures
Sur fond des résultats démoralisants de la guerre de l’opium, d’un ordre social en faillite, de révoltes paysannes contre la famine et le fardeau intolérable des impôts, d’une faillite irréversible de la machine d’État et de la pénétration de compagnies capitalistes étrangères, les paysans aussi bien que d’importantes factions des classes possédantes, qui n’avaient aucune allégeance vis-à-vis de la dynastie mandchoue au pouvoir, se lancent dans une révolte en 1850 – connue aujourd’hui sous le nom de révolte des Taiping.
 Poussés par une haine profonde de l’exploitation par la dynastie mandchoue, les paysans se jettent dans la révolte. Leur mouvement fusionne avec les aspirations d’une jeune classe commerçante, prête à promouvoir le commerce et l’industrie, qui elle aussi veut se débarrasser des entraves de la dynastie mandchoue. Le principal dirigeant du mouvement est Hong Xiuquan : issu de la classe paysanne, celui-ci avait échoué à plusieurs reprises aux examens pour entrer dans la fonction publique lorsqu’il reçoit une “ vision ” qui le proclame frère du Christ destiné à renverser le mal, qu’il identifie avec la dynastie Mandchou.
Poussés par une haine profonde de l’exploitation par la dynastie mandchoue, les paysans se jettent dans la révolte. Leur mouvement fusionne avec les aspirations d’une jeune classe commerçante, prête à promouvoir le commerce et l’industrie, qui elle aussi veut se débarrasser des entraves de la dynastie mandchoue. Le principal dirigeant du mouvement est Hong Xiuquan : issu de la classe paysanne, celui-ci avait échoué à plusieurs reprises aux examens pour entrer dans la fonction publique lorsqu’il reçoit une “ vision ” qui le proclame frère du Christ destiné à renverser le mal, qu’il identifie avec la dynastie Mandchou.
Souvent à l’instigation de sociétés secrètes, les révoltes commencent dans le sud du pays pour se répandre plus au nord. Le mouvement reçoit rapidement le soutien de centaines de milliers de paysans et d’opposants à la dynastie mandchoue. Un État séparé est même créé en 1851 – Taiping Tienkuo ("l’empire céleste de la paix") dont Hong Xiuquan est proclamé "empereur céleste". Ce mouvement établit une monarchie avec une coloration fortement théocratique, dirigée contre le pouvoir et les privilèges de l’aristocratie terrienne. Exprimant les aspirations de la paysannerie à lutter contre son exploitation, l’abolition de la propriété privée est déclarée, seuls les entreprises financières et les silos à grains collectifs sont autorisés, la propriété commune de la terre est proclamée, la terre cultivable est collectivisée et n’est plus considérée comme propriété privée, les impôts sont diminués, l’égalité de hommes et des femmes proclamée, le bandage des pieds interdit, le choix du mari ou de la femme devient libre, la consommation d’opium, de tabac et d'alcool interdite. Les artisans produisent des articles qui sont distribués sous le contrôle de l’État.
En 1852/53, le régime Taiping fait avancer rapidement ses troupes au Hunan et conquiert Nankin, proclamant cette ville capitale de leur État, qu’ils gardent de 1853 à 1864. Les rebelles Taiping lèvent une armée de plus de 50 000 soldats qui contrôle de vastes régions du sud et du sud-est de la Chine. Cependant, en 1864, l’édifice Taiping s’effondre. Plus de 20 millions de personnes sont tuées dans une série de guerres sanglantes,. Les troupes anglaises et françaises jouent un rôle décisif dans l’écrasement du mouvement par la dynastie mandchoue. Le communiste indien, M. N. Roy mentionne à juste titre certaines des raisons de la défaite quand il écrit : "la faiblesse du mode de production capitaliste, l’immaturité aboutissant à une absence pratique du prolétariat, qui provenait aussi du développement inadéquat du mode de production capitaliste et enfin l’intervention étrangère – tout cela a contribué à la défaite du premier grand mouvement qui tendait objectivement à la création d’une Chine moderne. ” 1. Roy voyait cependant un trop grand potentiel révolutionnaire dans ce mouvement. Dans un article précédent de la Revue internationale 2, nous avons traité des limites du mouvement Taiping, sur lesquelles nous ne revenons pas ici en détail.
Marx fit l’analyse suivante du mouvement et de ses limites : "Ce qui est original dans cette révolution chinoise, c’est son sujet. Ils ne savaient pas quelle était leur tâche, sinon changer de dynastie. Ils n’avaient pas de mots d’ordre. Ils sont une abomination encore plus grande pour les masses populaires que pour les anciens dirigeants. Leur destin semble n’avoir été rien de plus que de s’opposer à la stagnation conservatrice avec un règne de destruction grotesque et répugnant dans sa forme, une destruction sans base nouvelle ou en rien constructive. (…) La révolte Taiping est le produit d’une vie sociale fossilisée".3. Incapable de se débarrasser du poids de l’ordre social pourrissant, incapable de transformer la pénétration du capitalisme imposé par les pays étrangers en un puissant pour un développement capitaliste plus large, la classe dominante en Chine ne pouvait pas faire une révolution bourgeoise qui aurait pavé la route d’un développement sans entrave du capitalisme. La Chine a été transformée en handicapée au 19ème siècle – laissant le pays avec des chaînes qu’il allait traîner jusqu’au 20ème siècle.
1Roy, Revolution and counter-revolution in China, New Delhi, 1946.
2Revue Internationale, n° 81 et 84, "Chine 1928-1949 : maillon de la guerre impérialiste"
3Marx, 7/7/1862, dans Die Presse, "On China" (la traduction est de nous).
Géographique:
- Chine [2]
Evènements historiques:
La révolte des Boxer de 1900: un prétexte à l’intervention étrangère
- 1186 lectures
L’écrasement de la révolte Taiping a conduit à une aggravation drastique de la situation des paysans. Un ensemble de problèmes économiques contribuèrent à l’explosion de ce qui est connu comme la révolte des Boxers : l'accroissement du poids des impôts, la détérioration des conditions de vie de millions de paysans et artisans (contraints de rejoindre les villes n'ayant pourtant qu’un très faible développement industriel) , comme conséquence de l’importance croissante de l'importation de marchandise étrangères.
 En mai 1900, des masses de pilleurs, de paysans dépossédés et frustrés, conduites par une organisation secrète des Boxers, bloquent les chemins de fer, mettent à sac les usines et les missions diplomatiques occidentales. Dans une atmosphère de pogrom contre les étrangers et en l’absence de revendications politiques et sociales, la dynastie mandchoue prend le parti des émeutiers, parce que leur mouvement n’est pas dirigé contre une quelconque expression de la domination capitaliste mais seulement contre les chrétiens et les étrangers, n’offrant aucune perspective que ce soit aux classes exploitées.
En mai 1900, des masses de pilleurs, de paysans dépossédés et frustrés, conduites par une organisation secrète des Boxers, bloquent les chemins de fer, mettent à sac les usines et les missions diplomatiques occidentales. Dans une atmosphère de pogrom contre les étrangers et en l’absence de revendications politiques et sociales, la dynastie mandchoue prend le parti des émeutiers, parce que leur mouvement n’est pas dirigé contre une quelconque expression de la domination capitaliste mais seulement contre les chrétiens et les étrangers, n’offrant aucune perspective que ce soit aux classes exploitées.
Quand toutes les missions étrangères sont menacées par les pilleurs, les impérialistes étrangers unissent leurs forces pour réprimer le mouvement. En même temps, cette intervention commune pose la question d’un ordre hiérarchique parmi les impérialistes, parce qu’il est clair que la puissance qui prendrait la tête de la répression du soulèvement pourrait devenir la force dominante à Beijing. La bousculade pour être à la tête de la répression du mouvement révèle un nouveau niveau qualitatif des rivalités inter-impérialistes.
Comme Rosa Luxembourg dans Réforme ou Révolution l’avait déjà dit en 1889: "Si actuellement, la Chine devient le lieu de conflits menaçants, pour le capitalisme européen, la lutte n’est pas seulement pour la conquête de la Chine mais fait complètement partie des antagonismes entre pays européens qu’ils ont "transférés" en Chine et qui explosent maintenant sur le sol chinois".1
La Grande-Bretagne veut que le Japon prenne la tête parce qu’elle espère que le Japon fera contrepoids à la Russie. La Russie s’oppose fortement à l’intervention japonaise. À la fin, la Russie a accepté la proposition allemande d’une intervention conduite par les allemands, puisque ni la Grande-Bretagne ni le Japon n’auraient été d’accord pour une direction russe.
Mais avant que les troupes allemandes n’atteignent Beijing, les troupes russes ont déjà commencé (et presque complètement achevé) le massacre. La Russie a donc utilisé la révolte des Boxers comme un levier pour accroître son influence en Chine. En octobre 1900, la Russie occupe toute la Mandchourie, de façon à contrer l’influence croissante des puissances européennes occidentales en Chine. Mais la Russie est incapable de bloquer la pénétration des puissances européennes et du Japon. Face au danger de voir la Chine découpée en morceaux par les puissances européennes, en particulier face aux efforts de la Russie pour se saisir de grandes parties de la zone nord de la Chine, l’Allemagne et la Grande-Bretagne négocient en août 1900 dans le but de maintenir l’intégrité territoriale de ce pays et le principe de la "porte ouverte" sur celui-ci. La Grande-Bretagne espère utiliser les allemands contre la Russie en Mandchourie, l’Allemagne en retour vise à pousser la Grande-Bretagne et le Japon dans les hostilités contre la Russie. La présence de la Russie s’accroissant, le Japon et la Grande-Bretagne signent une alliance en juin 1902, avec l’objectif de limiter la menace russe. Alors que tous les États européens s’accordent sur la proposition des États-Unis d’une "porte ouverte" sur la Chine, la Russie, qui a beaucoup à perdre dans cette proposition, vote contre. Aussitôt après, les États-Unis rejoignent l’alliance anglo-nipponne contre la Russie. Une des caractéristiques permanentes de la situation depuis le début du 20ème siècle est donc l’opposition des États-Unis au renforcement de la Russie ou du Japon. Ils se sont toujours posés en «défenseur" de pays faibles (la Chine dans ce cas) pour empêcher la Russie ou le Japon de devenir trop puissant.
En ce qui concerne la Chine, à la suite de l’écrasement de la révolte des Boxers, les capitalistes étrangers contraignent l’État chinois à payer 450 millions de taels de "compensation" aux pays étrangers, alors qu'ils l’avaient déjà forcé au paiement d’une somme de 200 millions de taels au Japon après la défaite chinoise dans la guerre contre le Japon en 1894.
En 1911, l’empereur de Chine est déposé et la première république chinoise proclamée. Formellement, la bourgeoisie s’empare du gouvernement pour régner sur le pays. Mais bien qu’une république bourgeoise soit proclamée, cela ne signifie pas que le pays ait accompli une révolution bourgeoise, menant à la formation d’une nation capable d’être concurrentielle sur le marché mondial. En réalité, un puissant développement industriel ne démarre pas. En lieu et place de la constitution d’une nation "unie", des tendances centrifuges prennent le dessus, comme nous le verrons dans la deuxième partie de cet article.
Quoique formellement au pouvoir, la bourgeoisie n’est plus une classe révolutionnaire. Incapable d’engager le pays dans une grande industrialisation, la classe dominante ne peut que pousser l’ensemble de la nation dans la guerre et la destruction.
1Rosa Luxembourg, Réforme ou Révolution, chapitre sur les politiques douanières et le militarisme. Ce passage n’apparaît dans aucune des traductions en anglais ou en français que nous avons pu consulter, ni même dans la version allemande publiée sur marxists.org. Il n’est reproduit que dans la version définitive de ses œuvres complète : Gesammelte Werke, premier tome, p. 397.
Géographique:
- Chine [2]
Evènements historiques:
Le Conflit en Corée
- 890 lectures
A l’époque où le capitalisme européen et américain commence à pénétrer au Japon et en Chine, ces pays capitalistes tentent aussi d’entrer en Corée.
Le développement de la Corée est sous beaucoup d’aspects parallèle à celui de la Chine et du Japon. En Corée, comme au Japon, tout contact avec les occidentaux est source de danger. Seules les relations avec la Chine sont permises au milieu du 19ème siècle. Jusqu’au milieu des années 1850, les seuls étrangers présents en Corée sont les missionnaires. Quand les nations capitalistes ont commencé à se montrer dans la région, toute exaction coréenne contre des citoyens étrangers a été prise comme prétexte pour imposer leur présence par la force. C’est ainsi qu’en 1866, des missionnaires français ayant été tués en Corée, la France y envoie quelques bateaux militaires mais les troupes françaises sont battues. En 1871, les États-Unis envoient plusieurs navires remonter le fleuve Taedong jusqu’à Pyongyang, mais ceux-ci sont aussi défaits.
Cependant, à cette époque, les pays européens ou les États-Unis ne sont pas encore déterminés à occuper la Corée.
Les États-Unis sont encore sous le choc de la Guerre civile (1861-1865) et l’expansion du capitalisme vers l’ouest est encore en pleine action ; l’Angleterre est occupée à juguler les révoltes en Inde et concentre ses forces (avec la France) sur la pénétration en Chine. La Russie est encore en train de coloniser la Sibérie. Ainsi, tandis que les pays européens concentrent leurs forces sur la Chine et d’autres régions du monde, le Japon saisit l’occasion et commence rapidement à œuvrer pour que la Corée s’ouvre à ses produits.
Le Japon, par une démonstration de force, s’arrange pour obtenir un traité ouvrant trois ports coréens aux commerçants japonais. De plus, le Japon, de façon à contrecarrer l’influence chinoise "reconnaît" la Corée comme un pays indépendant. L’empire chinois déclinant ne peut rien faire d’autre que d’encourager la Corée à chercher la protection d’un troisième État pour résister à la pression japonaise. Les États-Unis sont parmi les premiers pays à reconnaître la Corée comme État indépendant en 1882. En 1887, les forces coréennes, pour la première fois se tournent vers les États-Unis pour demander "leur soutien contre des forces étrangères", i.e. le Japon, la Russie et la Grande-Bretagne.
Les exportations du Japon s’accroissant, le Corée devient de plus en plus dépendante du commerce avec ce pays. 90 % des exportations de la Corée vont vers le Japon au milieu des années 1890, plus de 50 % de ses importations proviennent du Japon.
L’afflux de produits étrangers inondant ce pays à dominante paysanne contribue largement à ruiner beaucoup de paysans. La paupérisation des campagnes est un des facteurs qui provoque un fort ressentiment anti-étranger.
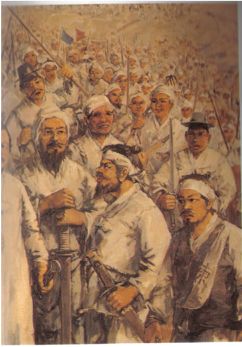 Une révolte populaire, similaire au mouvement Taiping en Chine dans les années 1850-1860, le Tonghak ("Doctrine Orientale") se développe en Corée dans les années 1890 (même si elle a eu des précurseurs déjà dans les années 1860), marquée par le fort poids de la révolte paysanne contre la pénétration de produits étrangers. La classe ouvrière n’est pas encore présente, vu le nombre très limité d’usines dans le pays.
Une révolte populaire, similaire au mouvement Taiping en Chine dans les années 1850-1860, le Tonghak ("Doctrine Orientale") se développe en Corée dans les années 1890 (même si elle a eu des précurseurs déjà dans les années 1860), marquée par le fort poids de la révolte paysanne contre la pénétration de produits étrangers. La classe ouvrière n’est pas encore présente, vu le nombre très limité d’usines dans le pays.
Les forces antiféodales et les paysans dominent le mouvement qui met en avant un mélange de revendications nationalistes, religieuses et sociales.
Des dizaines de milliers de paysans combattent avec des armes primitives contre les dirigeants locaux. La classe dominante féodale vacillante, se sentant menacée par le mouvement Tonghak et incapable de l’écraser seule, fait appel aux forces japonaises et chinoises pour l’aider à réprimer le mouvement.
La mobilisation pour la répression du mouvement Tonghak par les forces chinoises et japonaises leur sert de tremplin pour la lutte pour le contrôle de la Péninsule coréenne. La Chine et le Japon s’affrontent pour la première fois dans l’histoire moderne – non pas sur le contrôle de leur propre territoire mais sur celui de la Corée.
En juillet 1894, le Japon déclare à la Chine une guerre qui durera six mois. La plupart des combats ont lieu en Corée, bien que le principal objectif stratégique du Japon n’ait pas été le seul contrôle de la Corée mais ait inclus aussi celui de la péninsule chinoise Liaodong d’importance stratégique dans la mer de Chine.
Les troupes japonaises poussent l’armée chinoise de Corée, occupent Port-Arthur (une ville portuaire de la péninsule de Liaodong dans la mer de Chine), puis la péninsule de Liaodong, la Mandchourie – et commencent à se diriger vers Beijing. Face à la nette supériorité japonaise, le gouvernement chinois demande aux États-Unis de négocier une trêve.
Le résultat de la guerre est que la Chine doit concéder au Japon la péninsule de Liaodong, Port-Arthur, Dairen, Taiwan, et les îles Pescadores, accepter un paiement compensatoire de 200 millions de taels (360 millions de yens) et ouvrir les ports chinois au Japon. Le paiement "compensatoire" chinois devra alimenter le budget militaire japonais, parce que la guerre a coûté très cher au Japon, environ 200 millions de yens, soit trois fois le budget annuel du gouvernement. Ce paiement "compensatoire" va par ailleurs assécher encore plus les ressources de la Chine.
Mais déjà alors, à la suite de la première victoire éclatante des japonais, les requins impérialistes européens s’opposent à ce que la victoire japonaise ne soit trop écrasante. Ils ne veulent pas que soient concédés au Japon trop d’avantages stratégiques. Dans une "triple intervention", la Russie, la France et l'Allemagne s’opposent à l’occupation de Port-Arthur et de Liaodong. En 1885, le Japon renonce à Liaodong. Toujours sans allié à cette époque, le Japon doit se retirer (le traité anglo-nippon ne sera signé qu’en 1901). Au début, la France et la Grande-Bretagne souhaitent accorder des prêts à la Chine mais la Russie ne veut pas que la Chine devienne trop dépendante de ses rivaux européens et fait ele-même une offre de prêt Jusqu’en 1894, la Grande-Bretagne avait été la force étrangère dominante dans la région, en particulier en Chine et en Corée, mais jusque-là, la Grande-Bretagne avait considéré que la Russie constituait le plus grand danger dans la région.
Alors que la victoire militaire nippone sur la Chine a fait que les autres puissances impérialistes voyait dans le Japon un rival important en Orient, il est frappant que le principal champ de bataille de la première guerre entre la Chine et le Japon s’est trouvé en Corée.
Les raisons sont évidentes : entourée par la Russie, la Chine, et le Japon, la situation géographique de la Corée en fait un tremplin pour toute expansion d’un de ces pays vers un autre. La Corée se trouve prise inextricablement en tenailles entre l’empire insulaire du Japon et les deux empires continentaux de la Russie et de la Chine. Qui contrôle la Chine contrôle en puissance trois mers : celle du Japon, celle de la Chine orientale, et la Mer jaune. Sous le contrôle d’un pays, la Corée pouvait servir de couteau dans le dos des autres. Depuis les années 1890, la Corée est la cible des ambitions impérialistes des principales puissances de la région, bien qu’au départ seuls la Russie, la Chine et le Japon y prirent une part active, avec le soutien ou l’opposition des puissances européennes et des Etats-Unis qui agissaient dans l’ombre. Même si la partie nord du pays contient des réserves de matières premières importantes, c’est surtout sa situation stratégique qui en fait une telle plaque tournante de l’impérialisme dans la région.Depuis le 19ème siècle, pour le Japon qui apparaît comme la puissance impérialiste dominante en Extrême-Orient, la Corée est devenue le pont vital vers la Chine.
La guerre entre Chine et Japon pour la Corée va porter un grand coup à la classe dominante chinoise, et constituer en même temps un stimulus important des appétits impérialistes de la Russie.
Cependant, il est impossible de limiter le cadre de ce conflit à ces seuls deux rivaux parce qu’en réalité, il est l’illustration de l’accroissement général des tensions impérialistes.
Les principaux gains du Japon sur le territoire chinois – par exemple la péninsule Liaodong – sont immédiatement remis en cause par un groupe de puissances impérialistes. En 1899, la Grande-Bretagne renforce sa position en Chine (Hong Kong, Wehaiwei, les îles qui gardent les voies maritimes vers Beijing), garde le monopole sur la vallée du Yangtsé ; la Russie s’empare de Port-Arthur (voir plus loin) et Tailenwan (Dairen, Dalny), s’enracine en Mandchourie et en Mongolie ; l’Allemagne prend la Baie de Kaochow et Shantung, la France acquiert des privilèges spéciaux dans la Province du Hunan. "La guerre chinoise est le premier événement dans l’ère du monde politique dans lequel tous les Etats civilisés sont impliqués et à cette avancée de la réaction internationale, de la Sainte Alliance, aurait du répondre une protestation des partis ouvriers unis d’Europe". 1
La guerre sino-japonaise de 1884 pousse en fait tous les principaux rivaux impérialistes en Europe et en Extrême-Orient à entrer en conflit les uns avec les autres – un processus qui s’accélère dès qu’un autre requin impérialiste apparaît en Extrême-Orient.
1Rosa Luxembourg, dans une allocution à une conférence du parti à Mainz en septembre 1900, dans Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, vol 1/1, p 801 (traduit par nous).
Géographique:
- Corée du Sud [5]
Evènements historiques:
- Révolte Tonghak [6]
L’avancée de l’impérialisme russe
- 1791 lectures
Les menées expansionnistes de la Russie la conduisent en Asie Centrale et en Extrême Orient. À l’ouest, ses rivalités avec l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne s’aiguisent autour de la Mer Noire, elle s’affronte à l’empire ottoman (dans la guerre de Crimée en 1854-56, elle avait déjà affronté la Grande-Bretagne et la France), en Asie centrale, elle se dispute avec la Grande-Bretagne (L’Angleterre avait mené deux guerres en Afghanistan : en 1839-42 et en 1878-80, pour repousser l’influence russe hors de ce pays). En Extrême-Orient, elle entre surtout en conflit avec le Japon et la Grande-Bretagne en particulier – qui est la force impérialiste européenne dominante en Extrême-Orient.
Mais l’expansion de la Russie dans le dernier quart du 19ème siècle ne fait que cristalliser une tendance générale des nations capitalistes à conquérir de nouveaux territoires et de nouveaux marchés sur la terre entière.
En 1844, la France occupe l’Annam (Vietnam) et impose un blocus à l’isle de Taiwan ; la Grande-Bretagne annexe la Birmanie en 1885 ; la conférence de Berlin enregistre le dépeçage de l’Afrique en 1885.
En ce qui concerne l’Extrême-Orient, un nouveau niveau qualitatif est atteint dans cette zone de conflits avec l’apparition de la Russie. Avec la Russie en tant que pays européen défiant directement la domination croissante du Japon, on voit que chaque mouvement de celle-ci provoque toute une chaîne de réalignements chez les rivaux européens, en fonction de leurs rivalités ou d’une alliance possible avec elle.1
A la suite de l’ouverture du canal de Suez en 1869, et avec l’importance grandissante de l’ Extrême-Orient pour les rivaux impérialistes européens, la Russie met en œuvre la construction de la voie du Transsibérien en 1891. Incapable de financer ce projet gigantesque toute seule, elle emprunte du capital français. Le Japon, qui vise à s’étendre en Chine et en Corée, craint que toute avancée de la Russie à l’est mette en danger sa position.
La Russie met ses griffes sur l’ Extrême-Orient. Bénéficiant de l’affaiblissement de la Chine dans ses guerres avec le Japon en 1884, la Russie signe un traité secret avec la Chine en 1896, prétendant agir comme force protectrice contre le Japon. En 1898, la Russie s’empare de Port-Arthur.
Pour contrecarrer l’avancée de la Russie et ses manœuvres en Extrême-Orient et en Asie centrale, la Grande-Bretagne propose à la Russie de se répartir la Chine et l’empire ottoman – la Russie refuse.
Comme la rivalité entre Grande-Bretagne et Russie ne peut trouver de solution, la Russie doit essayer "d’apaiser" le Japon tant qu’elle peut. À la suite de l’échec de l’arrangement entre Russie et Grande-Bretagne, la Russie essaie de négocier avec le Japon différentes zones d’influence.
En 1902, les négociations entre le Japon et la Russie sur leurs zones respectives d’influence commencent. Au fond, la Russie propose de laisser les mains libres au Japon en Corée, pourvu qu’il n’utilise pas la péninsule comme base pour des opérations militaires. La Russie propose même que le territoire au nord du 38ème parallèle en Corée soit déclaré zone neutre, dans laquelle aucun pays ne serait autorisé à stationner des troupes, tandis qu’elle réclame le contrôle de la Mandchourie et d’autres zones frontière de la Chine (presqu’un demi-siècle plus tard, le pays sera divisé par ce même 38ème parallèle dans la guerre de Corée de 1953). Le Japon propose à la Russie de prendre le contrôle de la Corée et de lui permettre de prendre en charge la protection des voies de chemin de fer (seulement !) en Mandchourie, mais sans que ne lui soit donné un contrôle territorial.
Les négociations montrent qu’il est devenu impossible pour la Russie et le Japon d’essayer de se répartir leurs zones d’intérêt sans guerre.
Le Japon cherche des alliés. Le 30 janvier 1902, le Japon et la Grande-Bretagne signent un traité. Ils reconnaissent le droit du Japon et de la Grande-Bretagne d’intervenir dans les affaires chinoises et coréennes, se promettent d’être neutres si une des parties est en guerre dans sa zone d’intérêt et de se soutenir en cas de guerre contre d’autres pays. Ce traité entre la Grande-Bretagne et le Japon conduit le Japon à croire qu’il peut déclarer la guerre à la Russie avec l’espoir qu’aucun autre pays ne soutiendra la Russie puisqu’en arrière-plan, il y a la menace de la Grande-Bretagne. Le gouvernement allemand assure le gouvernement japonais qu’en cas de guerre entre Russie et Japon, l’Allemagne restera neutre. L’Allemagne espère que si la Russie commence une guerre en orient, cela laissera à l’Allemagne plus de place pour manœuvrer contre la France – une alliée de la Russie – et la Grande-Bretagne.
En traitant amplement et dans les détails ces stratégies compliquées, nous avons voulu montrer le développement de rivalités militaires extrêmement complexes et fortement imbriquées, si bien qu’il devient clair que, si un des principaux antagonistes intentait quelque chose, toute une réaction en chaîne se déclencherait chez les rivaux. Tous les pays ne faisaient pas que se positionner mais étaient aussi impliqués dans l’éclatement d’une guerre larvée.
1Pendant la première phase d’expansion de la Russie vers l’orient, i.e. pendant la première moitié du 19ème siècle et même jusque dans les années 1870, la division de nouveaux territoires pouvaient se faire au moyen de la vente et de l'achat de nouveaux territoires. Par exemple, la Russie vendit l’Alaska aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars US en 1867. En 1881 la Russie vend à la Chine ce qui deviendra sa province la plus occidentale, la Xinjiang, qu’elle avait saisie auparavant.
Géographique:
- Chine [2]
- Corée du Sud [5]
- Japon [1]
Evènements historiques:
La guerre russo-japonaise de 1904-1905: prélude à la Première Guerre mondiale
- 1671 lectures
À la suite du refus de la Russie d’accepter les revendications du Japon sur la Corée, le 8 février 1904, le Japon attaque la flotte russe à Port-Arthur et Tchemulpo.
La guerre russo-japonaise présente certaines des caractéristiques des guerres de la période de décadence.1 La première guerre du 20ème siècle entre deux grandes puissances conduit à une mobilisation inouïe des deux pays – impliquant de nouveaux niveaux de ressources humaines, économiques et militaires :
la guerre assèche les finances du pays vainqueur, engendrant un tombereau de dettes pour le Japon. Les dépenses du gouvernement font plus que doubler pendant la guerre, son budget présente un déficit gigantesque ;
Dans le pays vaincu, la Russie, la guerre met le feu au soulèvement prolétarien de 1905, montrant que seul le prolétariat peut constituer un verrou à la guerre. Rosa Luxembourg concluait au congrès de Stuttgart de la IIème Internationale en 1907, "Mais la révolution russe (de 1905) ne surgissait pas seulement de la guerre, elle a aussi servi à interrompre la guerre. Autrement le tsarisme aurait sûrement continué la guerre." " ;2
Même si le Japon est capable d’arracher des gains substantiels de territoire à la Russie, la nouvelle situation atteinte au tournant du siècle montre qu’aucun pays ne peut s’enrichir lui-même aux dépens d’un perdant sans interférer avec les intérêts impérialistes des autres rivaux.
10 ans avant la Première Guerre mondiale, le Japon triomphe sur la Russie, confirmant sa position dominante en Extrême-Orient et produisant une forte riposte de ses rivaux impérialistes.
 La première grande guerre au 20ème siècle – se déroulant en Extrême-Orient entre la Russie et le Japon – confirme ce que Rosa Luxembourg avait prédit au tournant du 19ème siècle. En 1898, elle écrivait dans le Leipziger Volkszeitung : « Avec la division et l’intégration de l’Asie, le capitalisme européen n’a plus désormais de nouvelles aires à conquérir à sa disposition, et après cela, le monde sera divisé et chaque partie du monde sera réclamée par un État ou un autre. Tôt ou tard, la nouvelle ‘Question orientale’ rentrera dans la même phase que celle dans laquelle l’ancienne s’est fossilisée : pas à pas, les opposants à l’Europe commenceront à se rapprocher les uns des autres si bien qu’à la fin ils s’arrêteront après avoir atteint le point où ils se retrouveront face à face. Les forces politiques et économiques qui ont été libérées, la grande industrie hautement développée, le militarisme gigantesque commenceront à être un terrible fardeau pour toute la société parce qu’ils ne trouveront plus de débouché".3 Seulement neuf ans après, la Première Guerre mondiale a confirmé le nouveau niveau des rapports impérialistes.
La première grande guerre au 20ème siècle – se déroulant en Extrême-Orient entre la Russie et le Japon – confirme ce que Rosa Luxembourg avait prédit au tournant du 19ème siècle. En 1898, elle écrivait dans le Leipziger Volkszeitung : « Avec la division et l’intégration de l’Asie, le capitalisme européen n’a plus désormais de nouvelles aires à conquérir à sa disposition, et après cela, le monde sera divisé et chaque partie du monde sera réclamée par un État ou un autre. Tôt ou tard, la nouvelle ‘Question orientale’ rentrera dans la même phase que celle dans laquelle l’ancienne s’est fossilisée : pas à pas, les opposants à l’Europe commenceront à se rapprocher les uns des autres si bien qu’à la fin ils s’arrêteront après avoir atteint le point où ils se retrouveront face à face. Les forces politiques et économiques qui ont été libérées, la grande industrie hautement développée, le militarisme gigantesque commenceront à être un terrible fardeau pour toute la société parce qu’ils ne trouveront plus de débouché".3 Seulement neuf ans après, la Première Guerre mondiale a confirmé le nouveau niveau des rapports impérialistes.
Les conséquences de la guerre russo-japonaise vont bien au-delà des deux pays belligérants.
Les États-Unis, qui juste un demi-siècle plus tôt (le milieu des années 1850) avaient été le fer de lance de l’ouverture du Japon au capitalisme, commencent à se confronter au Japon qui leur dispute la position dominante dans le Pacifique et l’Extrême-Orient.
Alors qu’après la guerre de 1894-1895 entre la Chine et le Japon, """" l'intervention conjointe de la France, l’Allemagne et la Russie avait empêché les conquêtes "excessives" du Japon, cette fois, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui s’opposent à une victoire trop éclatante et à un trop grand renforcement des positions japonaises.
Alors que les États-Unis et la Grande-Bretagne soutenaient le Japon au début de la guerre, ils retirent lui leur soutien financier vers la fin de la guerre pour faire pression sur lui, les États-Unis considèrant de plus en plus ce pays comme leur principal rival en Extrême-Orient. Quand les États-Unis soutiennent le "traité de paix" russo-japonais, qui admet l’hégémonie japonaise en Corée, le Japon doit concéder aux États-Unis leur droit d’intervention aux Philippines. En même temps, les États-Unis considèrent que le contrôle japonais sur la Corée est un moyen d’empêcher une nouvelle expansion russe vers l’orient. Les États-Unis sont encore "à la traîne" des pays européens dans leurs conquêtes impérialistes du 19ème siècle, parce qu’ils sont toujours occupés à favoriser l’expansion du capitalisme dans leur propre pays, dans sa partie occidentale, et sont arrivés "tard" dans la répartition du gâteau en Extrême-Orient. Le premier "gain" des États-Unis est les Philippines qu’ils arrachent à l’Espagne en 1898 dans la première guerre menée pendant cette période pour le repartage des conquêtes existantes (c’est la première guerre que les États-Unis mènent hors de leur propre territoire). Pendant cette période, les États-Unis annexent Hawaï et prennent le contrôle de l’atoll de Wake et de l’île de Guam dans le Pacifique.
Alors que les pays européens et le Japon apparaissent comme les "agresseurs" de la Chine, les États-Unis peuvent prétendre agir en tant que ses "défenseurs".
1 La guerre a duré 18 mois. Les principales zones de batailles furent Port Arthur, la voie de chemin de fer et la route menant à Mukden et Liaoyang. Au siège de Port Arthur, plus de 60 000 soldats japonais moururent. la plus grande bataille fut celle pour Mukden, du 23 février au 16 mars 1905 – plus de 750 000 soldats étaient engagés dans la bataille. Plus de 40 000 soldats japonais moururent. C’était à la fois une bataille navale et une guerre entre armées territoriales. La Russie envoya une grande partie de sa flotte (40 navires) de la Mer baltique en octobre 1904 qui longea la côte africaine pour arriver dans les eaux chinoises, mais les navires russes n’arrivèrent qu’en mai 1905 dans les eaux Extrême-Orientales. Dans une grande bataille navale, la marine japonaise bien préparée infligea à la Russie une défaite écrasante dans laquelle la plupart des bateaux russes furent coulés par les forces japonaises. La Russie dut concéder le sud de Sakhaline, la Mandchourie du sud et la Corée au Japon. Le Japon reçut Port-Arthur et Dairen. En conséquence, le Japon pouvait déclarer 5 ans plus tard, que la Corée était sa colonie.
2Discours prononcé dans la commission sur le Militarisme et les Conflits internationaux Gesammelte Werke, volume 2, page 236 (traduit par nous).
3Rosa Luxembourg, Gesammelte Werke, vol. 1, p.364, 13.3.1899 (traduit par nous). La ‘Question orientale’ était une expression qui désignait les rivalités inter-impérialistes autour de l’Empire ottoman en déliquescence
Géographique:
- Chine [2]
- Russie [8]
- Corée du Sud [5]
- Japon [1]
Evènements historiques:
Le capitalisme en déclin: l’Extrême-Orient devient un champ de bataille
- 847 lectures
En réexaminant le développement du Japon, de la Chine et de la Corée au 19ème siècle, nous pouvons voir que tous ces pays ont été ouverts au capitalisme par la force. Le capitalisme n’est pas venu de l’intérieur, mais il a été "importé" de l’extérieur. À la différence de beaucoup de pays européens, dans lesquels une classe révolutionnaire bourgeoise avait été capable de briser les chaînes du féodalisme, il n’y pas eu de telles révolutions bourgeoises réalisées par la bourgeoisie locale.
Bien que ces trois pays aient été ouverts par des capitalistes étrangers pendant la même période du 19ème siècle, ils ont suivi des chemins différents.
Le Japon est le seul pays à devenir rapidement une puissance capitaliste indépendante. Aussitôt après avoir été ouvert par le capitalisme étranger, le Japon commence à son tour à agir comme une force capitaliste en quête de nouveaux marchés et de zones de contrôle dans les régions voisines. En quelques décennies, le Japon devient la grande puissance régionale. À la différence de la Chine et de la Corée, le Japon entreprend d’accumuler rapidement du capital. Tout en n’étant pas handicapé dans son développement capitaliste comme ses voisins le sont par les pays étrangers, le rôle dominant du militarisme et de l’État est une caractéristique typique du développement de ce pays. Même si le Japon, très semblable à l’Allemagne en ce sens, est arrivé "tard" sur le marché mondial, à la différence de cette dernière qui a eu à se mesurer aux puissances impérialistes déjà "établies", il n’est pas pour autant un "démuni". C’est le premier pays dans la région à établir sa zone d’influence dans la "ruée vers les colonies" (en établissant son contrôle sur la Corée, des parties de la Mandchourie et le Taiwan). Le Japon a été impliqué et triomphant dans toutes les grandes guerres au moyen Orient – avec la Chine en 1894, avec la Russie en 1905 – et il a aussi été le grand gagnant régional de la Première Guerre mondiale bien que n’étant pas directement impliqué. Le Japon a donc pu grimper au "sommet" de l’échelle de l’impérialisme régional avant la Première Guerre mondiale, occupant cette position aux dépens des autres rivaux.
La Chine était gouvernée par une dynastie déclinante jusqu’à l’arrivée du capitalisme, qui là aussi a été "implanté" de l’extérieur. Alors que la classe dominante chinoise était incapable de déclencher un puissant développement capitaliste, les capitalistes étrangers – tout en ouvrant le pays au capitalisme – ont imposé de sérieuses limites au développement du capital national. Ainsi, au 19ème siècle déjà, le pays, qui présentait toutes les caractéristiques d’un développement "handicapé", a été mis en pièces par les puissances impérialistes étrangères. Comme nous le verrons plus tard, la Chine devait garder ces caractéristiques tout au long du 20ème siècle. Alors que le Japon était une force impérialiste dominante en expansion, la Chine était devenue la zone la plus disputée par les puissances impérialistes européennes et japonais.
La Corée, pour sa part, ouverte aussi par les capitalistes étrangers, est devenue la cible principale de l’impérialisme japonais. Étant un couloir d’invasion pour les appétits de tous ses voisins, elle fut condamnée à souffrir du fait de cette constellation géostratégique spécifique. Depuis que le capitalisme s’est implanté en Extrême-Orient, la Corée est devenue un champ de bataille permanent du combat entre rivaux régionaux et internationaux. Depuis 1905, la Corée a été disputée principalement par la Chine, le Japon et la Russie ; depuis le début de la décadence capitaliste, comme nous le verrons quand nous aborderons l’histoire du 20ème siècle, la Corée est restée une cible militaire et stratégique importante pour tous les pays impérialistes en Extrême-Orient.
Le quatrième rival dans la région, la Russie, dans son expansion vers l’ Extrême-Orient, tout en défendant ses propres intérêts impérialistes dans la région, a entraîné avec elle tout un troupeau de rivaux européens.
Pendant une période initiale de 2 ou 3 décennies, l’ouverture de l’ Extrême-Orient au capitalisme se déroule sous des conditions dans lesquelles les grandes puissances européennes et les États-Unis ne s’affrontent pas encore les uns aux autres, parce qu’il y a encore assez de "place pour l’expansion". La situation change, car la course aux colonies touche à sa fin et ce qui reste ne peut qu’être partagé avec un rival ou en gagnant quelque chose aux dépens d’autres. Les guerres entre la Chine et le Japon en 1894 et entre la Russie et le Japon en 1905 ont démontré qu’il était devenu impossible que tous les pays puissent avoir "une part du gâteau", mais que le partage était achevé et qu’une nouvelle distribution ne serait possible qu’au prix d’une guerre.
Trois ans avant l’éclatement de la Première Guerre mondiale, Rosa Luxembourg notait déjà : "au cours des dernières quinze années, il y a eu la guerre entre le Japon et la Chine en 1895, qui était le prélude à une période de politique mondiale en Extrême-Orient. En 1898, la guerre entre l’Espagne et les États-Unis, en 1899-1902, la guerre des Boers avec l’engagement de la Grande-Bretagne en Afrique du Sud, en 1900 l’expédition vers la Chine des grandes puissances européennes, en 1904, la guerre russo-japonaise, en 1904-1907 la guerre allemande contre les Hereros en Afrique, en 1908 l’intervention militaire russe en Perse, en ce moment (1911), l’intervention militaire française au Maroc, sans parler des escarmouches coloniales incessantes en Asie et en Afrique. Ces simples faits montrent que pendant les quinze dernières années, il n’y a eu presque aucune année sans guerre.1".
Les rivalités impérialistes ont pu être maintenues dans certaines limites jusqu’au début du 20ème siècle. Mais quand les antagonismes se sont aiguisés à l’échelle planétaire, les rivalités mondiales se sont aussi manifestées en Extrême-Orient. La guerre de 1905 entre la Russie et le Japon annonce la Première Guerre mondiale et toutes les guerres qui suivront au 20ème siècle.
Au tournant du 20ème siècle, l’ Extrême-Orient fait l’expérience du remaniement de la hiérarchie impérialiste. Après 1905, le Japon se hisse au sommet de l’ordre hiérarchique impérialiste dans la région mais il est déjà contesté par les deux géants impérialistes : les États-Unis et la Grande Bretagne. Les États-Unis commencent juste après à "contenir" le Japon – au début grâce à la politique de "des arrangements" (tel que celui sur les Philippines pour reconnaître les intérêts japonais en Corée) – plus tard, comme dans la Première Guerre mondiale, en rentrant en guerre l’un contre l’autre.
Le développement du capitalisme au 19ème siècle en Extrême-Orient illustre donc combien le changement qualitatif qui se produit au tournant du 19-20ème siècle représente une nouvelle époque dans le développement global du capitalisme.
Il n’y a plus de révolution bourgeoise à l’ordre du jour, la bourgeoisie au moyen orient est devenue aussi réactionnaire qu’ailleurs. Le système capitaliste va montrer toutes ses contradictions en Extrême-Orient, précipitant cette partie du globe très peuplée dans une série de guerres et de destruction.
1‘L’Utopie de la Paix’, Gesammelte Werke Volume 2, p.496, Leipziger Volkszeitung (traduit par nous).
Géographique:
- Chine [2]
- Russie [8]
- Corée du Sud [5]
- Japon [1]
La route vers la deuxième guerre mondiale
- 771 lectures
Géographique:
- Asie [9]
La position impérialiste du Japon
- 705 lectures
La constellation impérialiste en Extrême-Orient a subi de profonds changements à la fin de la Première Guerre mondiale.
A la fin de la guerre, les principaux rivaux du Japon ne sont plus les puissances européennes mais les États-Unis.
Le Japon a été un des principaux bénéficiaires de la Première Guerre sans avoir jamais été impliqué à une grande échelle dans les combats. À la différence des autres États vainqueurs en Europe (Grande-Bretagne, France), qui ont dû payer cher leur victoire, le Japon n’est pas été ruiné par la guerre. Le Japon au contraire se débrouille pour améliorer substantiellement sa position – d’abord il accélère son industrialisation, en second lieu, il améliore sa position sur le marché aux dépens de ses rivaux européens et devient un grand fournisseur d’armes. Ses importations et ses exportations triplent pendant la Première Guerre mondiale, la production d’acier et de béton double ; de grands progrès dans les équipements chimiques et électrotechniques sont réalisés et le Japon réussit à effacer ses dettes à l’étranger pendant la guerre – dettes qu’il avait "contractées" du fait de la guerre contre la Russie en 1905. Il devient une nation créditrice. Il agrandit aussi sa marine de commerce et devient une grande nation de construction navale, multipliant par 8 sa capacité de production.
Cependant, dès que la guerre prend fin en 1918, le boom prend fin et le Japon se retrouve confronté à une grave crise économique.
Au niveau impérialiste, le Japon renforce ses positions surtout par rapport à la Chine et aux dépens de l’autre pays vaincu, l'Allemagne, mais également aux dépens de ses autres rivaux impérialistes européens, qui sont touchés de plein fouet par le carnage guerrier en Europe. Après avoir occupé la Corée en 1909, le Japon espère devenir la puissance impérialiste incontestée en Chine aussi.
Déjà dans les premières semaines après l’éclatement de la guerre en 1914, le Japon s’empare de la position allemande de Tsingtao en Chine et occupe les possessions allemandes dans le Pacifique (les îles Marshall et Caroline), ce qu’il voit comme contrepoids à la présence américaine à Hawaï, aux Philippines et sur l’île de Guam.
Comme la Russie disparaît de la scène impérialiste, le Japon essaie de revendiquer la position dominante en Chine. Dès que les pays impérialistes déclenchent une offensive contre-révolutionnaire contre le bastion prolétarien en Russie en 1918, le Japon est le premier pays à participer à l’invasion et le dernier pays à quitter le territoire sibérien en 1922. Au lieu d’envoyer 7000 soldats comme demandé par les États-Unis, le Japon en envoie 72 000, dévoilant ouvertement ses appétits impérialistes à l’égard de la Russie.
A la suite de l’émergence du Japon comme le grand bénéficiaire de la guerre, les États-Unis essaient de limiter sa puissance militaire.
Tandis que les pays européens désarment en partie après la Première Guerre mondiale, le Japon ne réduit pas significativement ses dépenses militaires. Entre 1888 et 1938, ses dépenses militaires totales correspondent alors à 40-50 % du budget national. 1
Toutefois, alors que le Japon est un "vainqueur" de la Première Guerre mondiale, il n’a pas pour autant été capable d'effectuer de grandes conquêtes territoriales au cours de celle-ci. N’étant toutefois pas un "sans rien" (puisque la Corée est sous son contrôle depuis 1909), il a une forte tentation de remettre en cause le statu quo dans la région et d’essayer de s’étendre du côté du continent asiatique.
Tandis que les tensions impérialistes en Europe régressent après la Première Guerre mondiale, en grande partie à cause de la vague de luttes révolutionnaires, elles évoluent différemment en Extrême-Orient.
Une fois de plus, le Japon va affronter la Russie dès que cette dernière réapparaît sur la scène comme puissance impérialiste (voir plus loin). Le Japon occupe la Mandchourie et proclame la fondation d’un nouvel État – le Mandchoukouo. La création de ce nouvel État, qui n’était rien d’autre qu’un vassal du plus grand requin impérialiste dans la région, signifie surtout que la Japon a sous la main un tremplin pour une expansion ultérieure vers la Chine du Sud.
1Lockwood, Economic Development of Japan, p.292.
Géographique:
- Japon [1]
Chine: la descente dans le chaos militariste
- 961 lectures
Nous avons vu plus haut que la bourgeoisie chinoise avait été incapable de préparer la voie à la modernisation capitaliste. Bien que la république chinoise ait été proclamée en 1911 et la dynastie mandchoue chassée, aucun gouvernement bourgeois central fort n’avait pu être constitué. Cette faiblesse historique de la bourgeoisie chinoise signifie que la Chine va décliner, dans un cours sans fin à la militarisation, même si au début les puissances étrangères ne sont pas directement impliquées dans l’escalade militaire. Mais la Chine devient le berceau d’un nouveau phénomène - les seigneurs de guerre – qui va imprimer sa marque tout au long du 20ème siècle.
L'entrée en scêne des seigneurs de guerre
Confrontées à un gouvernement central de plus en plus impuissant, certaines provinces déclarent leur indépendance vis à vis de Beijing après 1915. Dans la plupart des provinces, les seigneurs de guerre deviennent la force dominante.
Ils tirent leur revenus de l'extorsion (par la force) d’impôts sur le dos principalement des paysans, du banditisme et du développement du commerce de l’opium. Ce n’est pas par hasard si le trafic de drogue, qui a été réprimé plus d’un demi-siècle auparavant, réapparaît alors. La production d’opium avait presque été stoppée en 1916, mais les seigneurs de guerre attribuent de vastes étendues de terre à la culture de l’opium ; ils instituent un "impôt sur la paresse" pour les fermiers qui ne plantent pas d’opium. L’impôt sur la terre est multiplié par 5 ou 6 par les seigneurs de guerre et beaucoup d’impôts sont collectés en avance – dans certaines régions, des décennies à l’avance. Les seigneurs de guerre recrutent un grand nombre de soldats dans la paysannerie et parmi les éléments lumpenisés. Avec la désintégration de la dynastie et la fragmentation de la Chine au début du 20ème siècle, un nombre croissant de pauvres et de paysans sans terre, perdus dans une masse errante, commencent à s’enrôler dans les armées professionnelles des seigneurs de guerre régionaux. La plupart de ces soldats sont incontrôlables car la plupart d’entre eux, sans travail et affamés, se battent sans autre raison que l’argent. En conséquence, beaucoup de ces soldats changent de camp ou s’enfuient pendant les batailles. C’est pourquoi, il faut sans arrêt recruter des soldats, souvent par la force. À la même époque, dans beaucoup de régions, les paysans sont contraints de s’affilier à des sociétés secrètes pour se protéger contre les troupes qui maraudent.
Du fait qu’il n’y a pas d’État, pas de nation avec un gouvernement central à sa tête capable de défendre l’unité nationale, chaque seigneur de guerre peut revendiquer son territoire. Mais en même temps, ils ne cherchent pas à se séparer de "l’empire" chinois, ni à créer une nouvelle nation. Généralement, ils ne sont pas liés à un secteur particulier de la société, ni particulièrement impliqués dans la défense de tel ou tel secteur de l’économie. Ce sont des "parasites" classiques, se nourrissant sur la population sans aucune base idéologique, ethnique ou religieuse spéciale. Les objectifs de leurs opérations militaires ne sont pas plus l’extension la plus large possible de leur aire de domination que la recherche de nouveaux marchés ou le pillage des matières premières. Dans un certain sens, ils font des guerres "improvisées" et pillent le pays. En conséquence, le commerce se restreint. Le système des transports souffre énormément, pas seulement des ravages directs de la guerre, mais parce qu’il doit charrier beaucoup de troupes et à cause du paiement de taxes spéciales aux militaires.
Toutes les ressources de la société sont absorbées par la militarisation. La saisie dictatoriale fréquente de biens, la gestion irresponsable de l’argent par les seigneurs de guerre (quand ils ont besoin d’argent pour financer leurs légions de soldats, ils impriment autant de monnaie qu’ils veulent) représentent un terrible fardeau sur l’économie. En bref, cela révèle un pur processus de décomposition, un pourrissement sur pied de la société. C’est l’expression de l’incapacité de la bourgeoisie nationale d’unifier le pays. La fragmentation du pays en tout un tas de fiefs (des unités plus petites), qui sont sous le contrôle de seigneurs de guerre pillards, représente un handicap gigantesque au développement des forces productives ; cela montre aussi que la libération nationale en Chine n’est plus à l’ordre du jour, parce que le nation ne peut plus être un cadre adéquat au développement des forces productives.
Même si pendant la Première Guerre mondiale, les impérialistes étrangers ont essayé d’influencer et vaincre les différents seigneurs de guerre, les guerres menées par les seigneurs de guerre locaux ne sont pas encore dominées par la rivalité entre les requins étrangers.
Le résultat désastreux de la politique du Comintern.
En 1915, la province du sud, le Hunan, déclare son indépendance, et entre 1916 et 1918, une polarisation croissante entre seigneurs de guerre du nord et du sud conduit à une vague de conflits militaires. Ensuite, quand la Première Guerre mondiale prend fin en 1918 en Europe, la Chine est démantelée par les régimes militaires rivaux au point qu’il n’y a plus d’autorité capable de subordonner tous les rivaux et de créer une structure politique unifiée et centralisée. L’État national doit être aboli complètement si la société veut éviter de tomber dans le militarisme et le chaos. Comme le reconnaissait l’Internationale Communiste dans son Manifeste de 1919 : "L'État national, après avoir donné une impulsion vigoureuse au développement capitaliste, est devenu trop étroit pour l'expansion des forces productives"
Mais si l’Internationale Communiste était vraiment claire sur la nécessité d’abolir tous les États, cette vision devint plus fumeuse par la suite. Plus la révolution recule, et plus le Comintern fait des efforts désespérés pour obtenir un soutien à la révolution isolée en Russie, et met en pratique une politique opportuniste. Au 4ème Congrès mondial en 1922, le Comintern fait de la propagande pour un front uni entre certains partis communistes et ce qu’il appelle l’aile "gauche" ou "démocrate" de leurs bourgeoisies respectives. En Chine, le parti Communiste Chinois (PCC), en accord avec le Comintern en 1922, déclare dans son "Premier Manifeste du PCC sur la situation actuelle" (10 juin 1922) : "Nous saluons une guerre pour assurer le triomphe de la démocratie, pour renverser les militaires…La tâche urgente du prolétariat est d’agir en commun avec le parti démocrate pour établir un front uni pour la révolution démocratique… Ce combat sur un large front uni est une guerre pour libérer le peuple chinois de son double joug – le joug des étrangers et le joug du puissant militarisme dans notre pays."1.
Cette orientation, la création d’une coalition de forces bourgeoises et prolétaires pour mener une guerre contre le capital étranger rencontre une forte opposition des forces de la Gauche Communiste.2
La marche vers le Front unique du Parti Communiste Chinois, (PCC) est un désastre pour la classe ouvrière car il oblige les travailleurs à se soumettre au Kuomintang3 (KMT) et contribue au triomphe de ce dernier en tant que force dominante de la bourgeoisie chinoise.
Comme nous l’avons rapporté dans d’autres articles de notre presse, l’expérience de la vague de luttes en 1925-27 montre que la politique de front unique imposée par le Comintern pave le chemin d’un niveau de militarisation encore plus élevé.
Alors qu’en Europe, deux décennies séparent la fin de la Première Guerre mondiale du début de la deuxième (annoncée par la Guerre d’Espagne en 1936), la Chine continue sa descente irrésistible dans le militarisme, immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale. À partir du début des années 1920, une série de guerres entre différents seigneurs de guerre continuent à ravager le pays. Les effectifs des troupes régulières passent de 500 000 en 1916 à deux millions en 1928. Le nombre de gens armés augmente, chaque défaite d’une armée conduisant à une explosion du nombre de bandits.
Parmi les forces de la bourgeoisie chinoises, le KMT est la plus cohérente et la plus déterminée dans sa défense des intérêts du capital national. Le parti de Chiang Kai Shek ne peut que poursuivre les essais d’unification du pays par la voie militaire. Avec le soutien du PCC, au printemps 1926, Chiang Kai Shek organise une expédition militaire pour éradiquer les différents seigneurs de guerre féodaux dans le centre et le nord de la Chine. Au printemps 1927, tandis qu’une grande vague de grèves secoue la ville chinoise la plus importante, Shanghai, le KMT, la force qui pendant des années a été saluée par le Comintern comme "parti démocratique" avec qui la classe ouvrière devait lutter pour une "révolution démocratique", montre son vrai visage. Le KMT supervise le massacre de milliers d’ouvriers à Shanghai et à Nankin. Le premier gouvernement dirigé par le KMT – connu comme premier "gouvernement national" - s’installe à Nankin le 18 avril 1927. Ce premier gouvernement d’une Chine "unifiée" n’a pu se hisser au pouvoir que par un massacre de la classe ouvrière. Mais même si le gouvernement de Nankin représente le plus haut degré de centralisation du capital national depuis 1911, le militarisme ne cesse pas. Parce que, bien que l’unité de la Chine ait été formellement établie autour du gouvernement de Nankin en 1928, le gouvernement central est forcé de continuer sans interruption son combat contre les seigneurs de guerre – parce que ceux-ci n’ont été éliminés ni dans le nord ni dans d’autres régions, même après la formation du gouvernement central de Nankin.
Le premier programme gouvernemental de la Chine unifiée : plus de militarisation
Même si la période après 1928 n’est pas marquée par des guerres de même ampleur et intensité que les guerres précédentes, les années suivantes voient cependant nombre de campagnes militaires qui ensanglantent le pays. Par exemple :
1929 : Des tentatives pour démanteler les armées pléthoriques échouent ; l’insurrection de l’armée du Kwangsi et une révolte dans le Hunan sont réprimées ;
1930 : Une guerre sanglante impliquant un million d’hommes éclate dans la Chine du Nord, de mars à septembre 1930. Entre 1931 et1935, plusieurs campagnes sont menées contre les troupes du Parti Communiste.
Même si le règne des seigneurs de guerre s’éteint lentement au début des années 30, une réelle unification du pays n’est jamais achevée et, plus le gouvernement centralisé gagne, plus le régime se militarise. Le poids des conflits armés dans une société peut être mesuré à l’aune des dépenses militaires gouvernementales qui, en Chine, ne tombent jamais en dessous de 44 % du budget de l’État entre 1926 et 1934.
La population civile – otage de tous les rivaux
A la suite de l’offensive des troupes du gouvernement de Nankin contre les forces du PCC, certaines forces de l’armée rouge, 90 000 hommes mal équipés, sont poursuivis à travers le pays dans ce qui fut appelé par la suite la "Longue Marche". Seulement 7000 soldats de l’armée rouge atteigneront la région reculée du Yunnan au nord-est du Shaanxi. Dans cette guerre entre deux forces "inégales", le PCC a appliqué systématiquement une tactique militaire qui allait marquer les conflits militaires pendant depuis le 20ème siècle. ""Incapable de lever une "armée permanente régulière", avec l’équipement complet d’une armée financée et entretenue par l’État et son gouvernement, les forces de l’Armée Rouge commencent à développer une guerre de guérilla. Quoique dans les guerres précédentes du 19ème siècle, il y ait eu certaines activités partisanes limitées, ce phénomène prend une nouvelle proportion dans le maelström chinois.
L’Armée Rouge transforme les civils en bouclier humain, i.e. en cibles pour protéger le mouvement des soldats de l’armée régulière. En même temps, la terreur brutale exercée sur les paysans et l’extorsion d’impôts faramineux par le gouvernement de Nankin forcent des millions de paysans soit à abandonner leurs terres et à fuir, soit à se précipiter dans les bras de l’Armée Rouge. Ils deviennent de la chair à canon pour les deux antagonistes. La guerre commence à ravager de façon presque permanente, non seulement les grandes villes mais le pays tout entier.
La guerre fait rage
Soutenir la guerre ""juste"" de la Chine c’est aujourd’hui se lier avec les impérialismes anglais, américain, français : c’est travailler pour l’Union Sacrée au nom d’un ""demain révolutionnaire"" qui sera illustré - comme en Espagne - par des monceaux de cadavres ouvriers et le triomphe de ""l’ordre"".
Des deux côtés des fronts il y a une bourgeoisie rapace, dominatrice et qui ne vise qu’à faire massacrer les prolétaires : des deux côtés des fronts il y a des prolétaires conduits à l’abattoir. Il est faux, archi-faux de croire qu’il existe une bourgeoisie avec laquelle les, ouvriers chinois peuvent, même provisoirement, faire un "bout de chemin ensemble" alors que seul l’impérialisme japonais doit être abattu pour permettre aux ouvriers chinois de lutter victorieusement pour la révolution. Partout l’impérialisme mène la danse et la Chine n’est que le jouet des autres impérialismes. Pour entrevoir le chemin des batailles révolutionnaires il faut que les ouvriers chinois et japonais trouvent le chemin de classe qui les conduira les uns vers les autres : la fraternisation devant cimenter leur assaut simultané contre leurs propres exploiteurs….
Seules, les fractions de la Gauche Communiste Internationale seront opposées à tous les courants traîtres et opportunistes et brandiront hardiment le drapeau de la lutte pour la révolution. Seules, elles lutteront pour la transformation de la guerre impérialiste qui ensanglante l’Asie en une guerre civile des ouvriers contre leurs exploiteurs : fraternisation des ouvriers chinois et japonais ; destruction des fronts de la "guerre nationale" ; lutte contre le Kuomintang, lutte contre l’impérialisme japonais, lutte contre tous les courants qui agissent parmi les ouvriers pour la guerre impérialiste. (Journal de la Gauche Italienne, Bilan, n° 44, octobre 1937, p. 1475)
La guerre héroïque de la mystification maoïste est en réalité le fléau d’une guerre "mobile avec ses millions de réfugiés et sa politique de la terre brûlée.
Plus les tensions impérialistes s’aiguisent internationalement, plus la Chine est impliquée dans celes-ci. À cette époque, quand à l’intérieur de la Chine les expéditions militaires contre les différents seigneurs de guerre continuent après 1928, le premier grand clash avec un pays étranger se produit avec la Russie en 1928/29. À peine installé à Nankin, le "gouvernement central" réclame et occupe les chemins de fer dans le nord de la Mandchourie, jusque-là sous contrôle russe. Dans une première confrontation violente entre la Russie stalinienne et ses rivaux impérialistes en Extrême-Orient, la Russie mobilise 134 000 soldats et réussit à défaire les troupes chinoises, qui ne peuvent offrir grande résistance du fait de la dispersion de leurs forces dans les combats contre différents seigneurs de guerre.
Toutefois, le principal antagonisme se développe entre la Chine et le Japon. En 1931/32, le Japon occupe la Mandchourie et proclame le nouvel État du Manchoukuo. Début 1932, le Japon attaque et bombarde Shanghai. À ce moment là – i.e . après que le Japon ait occupé la Mandchourie – le gouvernement dirigé par le KMT continue sa politique consistant à essayer d’éliminer les autres seigneurs de guerre et surtout le Parti Communiste. C’est seulement en 1937, une fois que le Japon a commencé à étendre la guerre de Mandchourie à la Chine, que la bourgeoisie chinoise s’unifie et met de côté temporairement ses rivalités – mais cette unification ne peut être que celle d’un front uni dans la guerre contre le Japon.
La nécessité de développer un "front de guerre uni" contre le Japon signifie aussi que la bourgeoisie chinoise doit se repositionner dans ses rapports avec les impérialistes étrangers.
Jusqu’en 1937, chaque aile de la bourgeoisie chinoise a des orientations différentes en politique étrangère. Alors que le PCC penche pour la Russie stalinienne et reçoit un soutien de Moscou, le KMT compte sur l’aide de l’Allemagne et d’autres États. Chiang Kaï Chek lui-même, qui a eu le soutien du Comintern dégénérescent et du stalinisme montant jusqu’en 1927, essaie d’éviter une confrontation frontale avec le Japon. En 1930, il signe une "trêve" de facto avec le Japon, dans le seul but d’avoir le champ libre pour attaquer les troupes du Parti Communiste. Mais avec l’avancée des troupes japonaises du Mandchoukuo vers Beijing et Shanghai en 1937, Chiang doit laisser tomber son alliance avec l’Allemagne – laquelle est en train de faire alliance avec le Japon. Les rivalités impérialistes au niveau planétaire obligent chaque rival local à choisir ses alliés et la marche historique à la guerre au niveau mondial va aussi déterminer les antagonismes en Extrême-Orient. 4
1‘First Manifesto of the CCP on the Current Situation’"", 10 juin 1922, dans Conrad Brandt, Benjamin Schwarz et John K. Fairbanks, A documentary History of chinese communism, New York, Atheneum, 1971, pp 61-63. La traduction est de nous.
2Voir "Chine 1928-1949 : Maillon dans la chaîne de la guerre impérialiste", Revues internationales, N°81, 84, 94
3Le Kuomintang (Parti nationaliste chinois) fut fondé en 1912 dans le but de renverser la dynastie Qing régnante et d’établir une république. Son premier président était Sun Yat-Sen, un des principaux figures du mouvement chinois républicain à la fin du 19e et le début du 20e siècle. Après sa mort en 1925, la direction passa à Chiang Kai-shek qui entreprit une campagne militaire, avec l’aide du pouvoir soviétique, afin de renverser le gouvernement des seigneurs de guerre installés à Beijing, ainsi que les divers seigneurs de guerre régionaux. La campagne fut une réussite, et le KMT prit Beijing en 1928 ; le peu après, le capitale fut transféré à Nanking.
4En 1921 déjà, l’Allemagne avait commencé à fournir des armes à la Chine. Des armes de tout type étaient requises pour les guerres chinoises continuelles. La plupart des armes allemandes qui arrivèrent en Chine au début des années 20 provenaient clairement des stocks que l’Allemagne avait cachés aux inspecteurs d’armes de Versailles. Un chef d’État-major avant Ludendorff – Max Bauer – devint conseiller militaire de Chiang Kaï Chek en 926. En 1928, alors que l’armée chinoise avait quelques 2,25 millions d’hommes en armes, le conseiller militaire allemand Bauer recommanda à la Chine de ne garder qu’une petite armée essentielle et d’intégrer le reste des soldats dans les milices. Les conseillers militaires allemands entraînaient une armée centrale de 80 000 hommes, qui bientôt s’élargit à 300 000. Dans la bataille de Shanghai, en 1937, les conseillers militaires allemands portaient des uniformes chinois et dirigeaient les troupes chinoises jusque sur les lignes de front japonaises. Les conseillers militaires allemands recommandèrent à Chiang de mener une guerre d’usure contre le Japon et d’utiliser des tactiques de la guérilla contre l’armée japonaise. Ce n’est qu’à l’été 1938 que les conseillers militaires allemands furent rappelés de Chine, une fois que le régime nazi eut choisi de travailler à une alliance avec le Japon. Juste avant que les conseillers allemands ne s’en aillent, Chiang avait signé un traité engageant les conseillers allemands à entraîner toute l’armée chinoise jusqu’en 1940. (German Military Mission to China,1927-38.Arvo L. Vecamer, voir aussi: https://www.feldgrau.com/china.html [10])
Géographique:
- Chine [2]
La guerre entre la Chine et le Japon: l’autre grand théâtre de guerre dans la deuxième guerre mondiale
- 898 lectures
La guerre sino-japonaise: l'opportunisme
"Dans ma déclaration à la presse bourgeoise, je disais que c’est un devoir pour toutes les organisations ouvrières en Chine de participer activement et de combattre sur le front dans la guerre contre le Japon, sans renoncer en aucune manière en quoique ce soit à leur programme et à leur autonomie. Mais c’est du ‘patriotisme social’ - crient les Eiffelistes (le Grupo de Trabajodores Marxistas/ Communismo). C’est une capitulation devant Chiang Kaï Chek ! C’est abandonner le principe de la lutte de classe ! "Pendant la guerre impérialiste, le bolchevisme faisait de la propagande pour le défaitisme révolutionnaire. Dans le cas de la guerre civile en Espagne et de la guerre sino-japonaise, nous sommes face à des guerres impérialistes. (…) Sur la guerre chinoise, nous prenons la même position. Le seul salut pour les ouvriers et les paysans en Chine est de combattre en tant que force autonome contre les deux armées, contre l’armée chinoise aussi bien que contre l’armée japonaise"". Ces quelques lignes des documents des Eiffelistes du 1 septembre 1937 nous permettent déjà de conclure : soit ils sont des traîtres, soit des idiots complets… La Chine est un pays semi-colonial qui, - sous nos yeux – est en train d’être transformé en pays colonial par le Japon. Dans le cas du Japon, c’est combattre une guerre impérialiste réactionnaire. Dans le cas de la Chine, c’est se battre dans une guerre progressiste de libération… Le patriotisme japonais est le visage horrible du banditisme international. Le patriotisme chinois est légitime et progressiste." (Lettre à Diego de Rivera, dans Trotsky on China, p. 547, Trotsky, Werke Hambourg 1990) (Notre traduction).
La guerre entre les deux pays allait être une des guerres les plus sanglantes, les plus destructrices et les plus longues du 20ème siècle. Tandis que lors de la Première Guerre mondiale l’Extrême-Orient avait été épargnée une escalade militaire, dans la Deuxième il devient le second plus grand théâtre de guerre.1
Dans la première phase, entre 1937 et 1941, la guerre est plus ou moins "limitée" au combat entre le Japon et la Chine principalement soutenue par la Russie. La deuxième phase commence en 1941, quand un nouveau front s’ouvre entre le Japon et les États-Unis. Quand le Japon commence à occuper la Chine, l’armée espère faire un grand coup et tout avoir sous son contrôle en quelques mois. C’est le contraire qui se produit. En août 1937 le Japon déclenche une bataille massive avec plus d’un demi-million de soldats engagés dans les combats pour la ville de Shanghai. D’autres grandes batailles suivent autour de Wuhan et en décembre 1937 à Nankin. Il est estimé qu’entre août 1937 et novembre 1938 seulement, quelques deux millions de chinois et environ 500 000 soldats japonais tombent au combat.
Malgré leurs lourdes pertes, l’armée japonaise se révèle incapable de mettre à genou les troupes chinoises. Entre octobre 1938 et l’attaque de Pearl Harbour, (le 7 décembre 1941), la guerre en Chine "stagne. Le Japon ne fait que gérer certaines enclaves qui correspondent à 10 % du territoire. De plus, le gouvernement japonais perd le contrôle financier des dépenses (la part de l’armement dans le budget grimpe de 31 % en 1931-32 à 47 % en 1936-37, et à la fin des années 30, les dépenses d’armement montent à 70 % du budget).
Plus la stratégie militaire japonaise devient désespérée, plus elle se sert de la terreur, avec le mot d’ordre : "tuez, brûlez, pillez autant que vous pouvez".
Quand les troupes japonaises entrent dans la ville de Nankin en 1937, elles commettent un des plus affreux massacresde la guerre : dans cette seule ville, environ 300 000 personnes sont tuées, dans un carnage sans pitié. Les troupes chinoises, en retour, mènent des attaques de partisans et la politique de la terre brûlée.
Pendant la guerre avec le Japon, la bourgeoisie chinoise ne réussit à établir qu’un "Front unique" très fragile. Même si, à la suite des attaques japonaises contre la Chine en 1937, elle avait resserré les rangs, en janvier 1941, les troupes nationalistes du KMT et les armées maoïstes s’affrontent de nouveau. Au cours du développement de la guerre, les forces de l’Armée Rouge – après beaucoup d’avancées et de retraites – deviennent dominante, inversant rapport de force existant au début du conflit.
Ainsi, après 1941, suite à des décennies de guerres répétées en Chine, à quatre ans de guerres plus ou moins bilatérales entre la Chine et le Japon, le conflit en Asie connaît alors une escalade dans une confrontation générale dans toute l’Asie. Entre 1941 et 1945, la guerre implique tous les pays d’ Extrême-Orient et aussi l’Australie.
Au début, le Japon gagne rapidement certaines positions – après sa victoire éclatante à Pearl Harbour. En quelques mois, le Japon conquiert de vastes régions du Sud-est asiatique. Ses troupes occupent les colonies britanniques de Hong Kong et de Singapore, de grandes parties des Philippines, débarquent dans les Indes hollandaises (plus tard, l’Indonésie) et pénètrent en Birmanie. En 100 jours, ils atteignent les côtes australiennes et indiennes2.
1Les conquêtes japonaises en Asie du Sud-Est ont exigé un énorme tribut en vies humaines. La bataille aux Philippines a été une des plus sanglantes. Par exemple, quelques 80 000 soldats japonais moururent dans la bataille pour l’île de Leyte, 190 000 dans la bataille pour Luzon, , la défense d’Okinawa a coûté la vie à 110 000 soldats japonais, l’armée US a perdu quelques 50 000 soldats dans la seule conquête d’Okinawa.
2Dans beaucoup de pays, le Japon a essayé d’attirer dans son orbite les défenseurs locaux de "l’indépendance nationale" au sein des colonies britanniques et hollandaises. Ainsi, en Inde, le Japon obtient le soutien des nationalistes indiens qui voulaient se séparer de leur puissance coloniale britannique. Le régime nazi allemand était parvenu à recruter des nationalistes au Moyen Orient pour son offensive, l’impérialisme japonais se présentait comme une force de "libération" du colonialisme anglais.
Géographique:
Evènements historiques:
Une spirale destructrice
- 737 lectures
Pour la première fois, les USAÉtats-Unis utilisent des bombes au napalm contre les régions habitées au Japon. Le 9-10 mars 1945, le raid de bombardiers sur Tokyo coûte la vie à 130 000 personnes, détruit 267 000 constructions sur une superficie surface de 41 mille105 kilomètres carrés, et plus d’un million de gens personnes se retrouvent sans abri. La deuxième ville du Japon, Osaka, est bombardée depuis le 13 mars jusqu’au dernier jour de la guerreet, : quelques 10 000 personnes périssent et environ 100 000 maisons sont détruites. Globalement, plus de 600 000 constructions seront détruites au Japon en quatre séries de bombardements. En juin 1945 – deux mois avant que les bombes atomiques ne soient envoyées – environ 50 % des maisons à Kobe et Tokyo étaient en ruine. La même politique de terre brûlée est appliquée à Nagoya, Osaka et Kawasaki.
A la fin de la guerre, plus de deux millions de maisons sont détruites et quelques 13 millions de personnes sans abris du seul fait des bombes au napalm. Alors que les États-Unis ont tenté de justifier leur attaque barbare avec l'arme atomique sur Hiroshima et Nagasaki, présentées comme des exceptions visant à sauver la vie de milliers de soldats américains, en réalité, les bombes atomiques sur ces deux villes ne représentent que le point culminant de toute une spirale de destructions et d’annihilation, qui, de plus, va conduire dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale à l'édification systématique d’un arsenal nucléaire1
Le bilan de la guerre 1937-1945 est particulièrement désastreux pour les deux principales puissances en Asie, la Chine et le Japon.
La guerre a coûté la vie à 15-20 millions de personnes dans les deux pays. Le Japon, le pays qui a déclenché la guerre, est le grand perdant et en sort complètement ruiné et militairement paralysé. C’est la première fois, depuis des siècles, que la guerre fait rage sur le territoire japonais. Le Japon perd toutes ses conquêtes (de ses colonies, la Corée et la Mandchourie, jusqu’à ses conquêtes de guerre éphémères dans le Sud Est asiatique). À la différence de l’Allemagne, le Japon n’est pas divisé en plusieurs zones d’occupation : la principale raison étant que le conflit entre les États-Unis et l’URSS a déjà pris des proportions beaucoup plus vastes en Orient qu’en Europe, quelques mois avant que la guerre ne s’arrête en mai 1945. La plupart des villes japonaises sont détruites, la population meurt de faim, et une bonne partie de la flotte est coulée ou endommagée. Pendant la guerre, le Japon a perdu environ 1200 bateaux de commerce (ce qui correspond à 63 % du tonnage commercial). En résumé, le pays est "amputé".
Ayant perdu le contrôle de la spirale de guerre, le Japon doit se soumettre à la domination américaine et est occupé pour la première fois. Il perd son statut de première puissance impérialiste dans la région.
Les destructions en Chine sont tout autant dévastatrices. Paradoxalement, la Corée, la colonie japonaise, est largement épargnée par les hostilités, mais seulement pour devenir un nouveau théâtre de guerre quelques années plus tard.
1"Le vaisseau amiral USS Indianapolis américain, qui avait transporté la première bombe atomique dans le Pacifique avant qu’elle ne soit jetée sur Hiroshima, fut coulé par les torpilles japonaises. Alors que la majorité de l’équipage survécut, quelques 600 marines – s’accrochant à leurs bateaux de sauvetage une fois que le bateau se fut retourné – furent tués par les requins. Désastre nucléaire pour la population de Hiroshima ! Mort par les requins pour les soldats US qui transportaient la bombe !" (Andrew West, Campaigns of World War II, The Pacific War, London, 2000).
Géographique:
- Japon [1]
Evènements historiques:
La Seconde Guerre mondiale se termine, la guerre froide commence
- 1251 lectures
Une fois la guerre en Europe finie en mai 1945, et le butin en Europe partagé entre les vainqueurs, la bataille pour la domination de l’Asie commence. Déjà, quand la bataille touche à sa fin en Europe, 3 zones de conflits deviennent immédiatement des champs de bataille en Asie orientale.
La première zone de conflit concerne celle où le Japon était dominant. Il est évident que l’effondrement du régime militaire japonais et son élimination de la Chine et de la Corée laissent une place vide, ce qui ne peut qu’aiguiser les appétits de tous les gangsters impérialistes.
Le premier pays à tenter sa chance et à occuper ce "vide" est la Russie qui, presque quatre décennies plus tôt, dans la guerre de 1904-1905, avait subi une grosse défaite contre le Japon. Cependant, dans une première phase, c'est_à-dire après l’attaque japonaise de Pearl Harbour en décembre 1941, (et aussi plus tard, fin 1944/début 1945, au moment de la Conférence de Yalta tenue en février 1945) les États-Unis pensent encore que, la bataille avec le Japon ayant atteint une intensité inouïe en Extrême-Orient, ils auront besoin de la chair à canon russe pour la bataille finale avec le Japon. Bien qu’économiquement très affaiblie et ayant perdu plus de 20 millions de morts dans la guerre, l’URSS a été capable de se renforcer sur l’échiquier impérialiste À la Conférence de Yalta, l’URSS réclame la Mandchourie, l’archipel des Kouriles, Sakhaline, et la Corée au nord du 38ème parallèle, ainsi que les ports chinois de Dalian et Lüshün (appelé Port-Arthur quand il était occupé par les russes) qui deviendront des bases navales russes. Le régime de Staline vise directement le Japon. La Russie cherche de nouveau à étendre sa domination en Extrême-Orient. La guerre tirant à sa fin en Europe, les intérêts stratégiques de la Russie changent. La Russie a bénéficié du carnage entre la Chine et le Japon et plus tard, de la guerre entre le Japon et les États-Unis. Pendant la guerre, le Japon étant prisonnier de sa guerre avec la Chine et les États-Unis, il n’allait pas être capable d’attaquer la Russie en Sibérie, comme les nazis allemands l’avaient poussé à faire. Comme la Russie et le Japon partagent l’intérêt commun de protéger leurs arrières de toute agression (la Russie voulant éloigner le Japon, l’allié de son ennemi, l’Allemagne; le Japon voulant le maintien de la Russie, alliée des États-Unis, dans une position de neutralité), les deux pays pratiquent une politique "de non-agression" l’un vis-à-vis de l’autre pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais vers la fin de 1944-1945, quand la fin de la guerre en Europe est en vue, les États-Unis poussent la Russie à prendre part à la tempête sur le Japon. Staline s’arrange même pour arracher un soutien militaire et logistique américain pour armer et transporter les troupes russes à l’est.
A Yalta, l’URSS et les États-Unis sont encore d’accord : Une fois la guerre terminée en Europe, l’URSS recevra sa part après la défaite du Japon. Cependant, une fois la guerre terminée en Europe, qui voit la Russie comme grand vainqueur obtenant de vastes parties de l’Europe de l’est et la partie est de l’Allemagne, l’impérialisme américain change sa stratégie afin d’éviter une participation russe à la fin de la guerre contre le Japon.
L’impérialisme russe, cependant, persiste et signe et mobilise une armée d’un million et demi de soldats, plus de 5000 chars, et 3800 avions dans les cents jours après la fin de la guerre en Allemagne1. Ses troupes traversent la Chine du Nord et occupent un territoire de la taille de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de l’Allemagne et de la Pologne réunies. La Russie déclare la guerre au Japon le 9 août, le jour où les États-Unis lancent la première bombe atomique sur Hiroshima et, le 10 août, les troupes russes prennent d’assaut la Corée occupée par les japonais, avançant rapidement jusqu‘au 38ème parallèle, jusqu'au nord de Séoul. Les troupes russes deviennent la force d’occupation de grandes parties de la Chine et de la Corée du Nord et se mobilisent pour un débarquement au Japon. Les États-Unis voient alors leurs positions menacées.
Bien que le Japon ait été substantiellement affaibli par les bombardements incessants d’avant août 1945, et alors que certaines parties de la bourgeoisie japonaise aient essayé d’établir une trêve, les États-Unis décident de lancer les premières bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki : elles sont destinées non pas tant à la défaite d’un Japon déjà à genoux, mais surtout à servir d’avertissement envers la Russie dans la nouvelle polarisation entre les deux grands blocs impérialistes, russe et américain.
Ainsi, le premier grand choc, quoiqu’indirect, entre la Russie et les États-Unis se produit à cause du Japon. Mais un second théâtre de confrontation se prépare déjà : la bataille pour la Chine où l’écroulement de la domination japonaise aiguise l’appétit de tous les gangsters impérialistes.
1"La défaite de l’armée russe en 1904 avait laissé des souvenirs amers dans le cœur de notre peuple. C’était une tache sur notre nation. Notre peuple a attendu, croyant qu’il devrait un jour défaire le Japon et laver cette tâche. Notre génération d’anciens a attendu 40 ans que ce jour arrive." (cité par Jörg Friedrich,Yalu : An den Ufern des dritten Weltkrieges (à la veille de la 3e guerre mondiale), Berlin, 2007).
Evènements historiques:
- Yalta [16]
Corée: de sa libération en tant que colonie au plongeon dans la guerre et la division
- 824 lectures
Deux guerres pour le contrôle de la péninsule coréenne ont déjà été menées au tournant du 20ème siècle. La Chine et le Japon s’y affrontent en 1894 ; en 1904, la Russie et le Japon entrent en guerre pour la domination de la Corée et de la Mandchourie. Staline, à la Conférence de Yalta en 1945, insiste pour que la Corée soit divisée au niveau du 38ème parallèle, i.e. une division entre nord et sud que la Russie réclamait déjà en 1904 avant d’être éjectée de la région par l’impérialisme japonais.
Auparavant, en août 1945, la Russie occupe la Corée jusqu’au 38ème parallèle juste au nord de Séoul. Cette configuration durera de 1945 à 1950, c'est-à-dire pendant la période de la guerre en Chine. Cependant, la formation de la République Populaire chinoise ajoute un nouvel élément au panier de crabes impérialistes. Après avoir reçu le feu-vert des russes, Kim Il Sung,1 qui s’est battu pour eux pendant la Seconde Guerre mondiale, passe à l’offensive au-delà du 38ème parallèle avec l’espoir de rejeter, par une attaque éclair, les forces américaines du territoire coréen.
La guerre se développe en quatre phases :
dans un premier temps, les troupes nord coréennes fondent sur Séoul le 25 juin 1950. En septembre 1950, toute la Corée du Sud a été conquise par la Corée du Nord, seule la région autour de la ville de Pusan résiste à l’offensive nord-coréenne et à un siège sanglant, et reste dans les mains sud-coréennes.
Dans une seconde phase – à la suite de la mobilisation massive de troupes sous direction américaine – Séoul est repris le 27 septembre. Les troupes des Nations Unies conduites par les États-Unis continuent leur offensive vers le Nord et, à fin novembre 1950, occupent Pyongyang et atteignent le Yalou, frontière entre la Chine et la Corée ;
Dans une troisième phase, la Chine entre ouvertement dans la guerre avec l’envoi de millions de "volontaires" chinois qui se battront du côté nord coréen. Le 4 janvier 1951, Séoul est repris par les troupes chinoises et nord coréennes (avec une mobilisation de 400 000 soldats chinois et de 100 000 soldats nord-coréens)
Suite à une nouvelle contrattaque, Séoul retombe dans les mains américaines en mars 1951. Entre le printemps 1951 et la fin de la trêve (27 juillet 1953), le front ne bouge presque plus. La guerre tombe rapidement dans une impasse et il n’y aura pas de victoires majeures pendant deux ans.
Cette guerre est une confrontation horrifiante entre les deux superpuissances et devient l’une des plus meurtrières et destructrices de la période de la guerre froide.
Pendant la guerre, les États-Unis testent toutes sortes d’armes (par exemple, les armes chimiques, Anthrax et napalm). L’intensité des destructions est telle que presque toutes les villes attaquées sont rasées jusqu’au sol ; par exemple, les deux capitales, Séoul et Pyongyang sont toutes les deux écrasées sous les bombardements américains. Le commandement américain dit : "nous ne pouvons plus penser à bombarder une quelconque ville en Corée du Nord, il n’y a presque plus de maison qui tienne debout". Les forces aériennes ont pour ordre de "détruire tous les moyens de communication et toute installation, usine, ville et village". Dans l’espace d’une année, presque tout le pays est réduit à des ruines par les bombardements. Aucun camp ne réussit à imposer ses objectifs militaires. La guerre se répand rapidement mais il faudra des années pour arriver à une trêve. Au niveau militaire, la guerre finit où elle a commencé, la frontière (telle qu’elle avait été établie avant le déclenchement de la guerre) ne bouge pas.
On estime à environ deux millions le nombre des morts en Corée du Nord et à un million au Sud. Le Général Curtis Le May, qui dirigea le bombardement de Tokyo en 1945, fit ce bilan : "nous avons détruit chaque ville en Corée du Nord et certaines en Corée du Sud aussi. Sur une période de trois ans à peu près, nous avons tué 20 % de la population de Corée, soit du fait de la guerre, soit à cause de la famine et du manque d’abri".2
La Corée du Nord perd 11 % de sa population, avec un tribut élevé de morts dans la population civile. L’armée nord-coréenne perd quelques 500 000 soldats (tués, blessés, disparus), l’armée chinoise déplore environ 900 000 victimes, l’armée sud coréenne à peu près 300 000 et les États-Unis subissent le quatrième plus grand nombre de victimes de leur histoire ; 142 000 soldats au total périssent.
Cette guerre voit la première apparition de l’impérialisme chinois. La Chine, qui a été dépendante des ventes d’armes russes, essaie en même temps de compenser les limites de son arsenal d’armes par l’emploi presque illimité de chair à canon humaine. Mao ne cache pas les ambitions et le cynisme de son régime, quand il déclare en 1952 : "la guerre a été une grande expérience et un apprentissage pour nous… Ces exercices sont mieux que n’importe quelle académie militaire. Si nous continuons à combattre une autre année, nous aurons alors réussi à ce que toute nos troupes se familiarisent avec la guerre".3 Même quand la guerre touche à sa fin, en 1953, la Chine prépare sa sixième offensive contre les États-Unis. En octobre 1951 déjà, la Chine avait mobilisé 1,5 millions de soldats, et le pays consacrait la moitié de son budget étatique à la guerre.
En octobre 1951, les États-Unis durent quadrupler leurs dépenses militaires pour couvrir les coûts croissant de la guerre.
Les deux côtés sont prêts à jeter dans la balance tout leur poids économique et militaire. Staline, Mao, Chiang et Truman avaient tous fait un front contre le Japon 6 ans avant seulement, au temps de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre de Corée, ils cherchaient tous les moyens possibles de s’annihiler les uns les autres. Les autorités militaires américaines envisagèrent un bombardement nucléaire sur 24 villes chinoises, parmi les cibles programmées il y avait Shanghai, Nankin, Beijing, Mukden.
Depuis lors, le pays a été une zone de conflit permanent, au niveau le plus élevé de militarisation. La Corée du Sud est soutenue par les États-Unis pour qui ce pays est une importante tête de pont. À l’image du Japon, la Corée du Sud fut rapidement reconstruite avec l’aide américaine.
Le Nord, qui est à la fois une zone tampon mais aussi une tête de pont importante pour menacer le Japon, est un point crucial pour les stratégies impérialistes de la Chine et de la Russie. Reconstruite sur le modèle stalinien, la partie nord présente de nombreuses similitudes avec les ex-régimes de l’Est européens. Quoique plus développée économiquement que le Sud avant 1945, et plus riche en matières premières et ressources énergétiques, le Nord montre une arriération similaire – typique des régimes étouffés par le militarisme et gouvernés par une clique stalinienne. Tout comme l’union Soviétique, la Corée du Nord est incompétitif sur le marché mondial et ne survit que grâce à une militarisation à outrance. Pratiquement ses seules exportations sont les armements.
La fin de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée a laissé la Chine continentale, le Japon et la péninsule coréenne en ruines. La guerre a ravagé de grandes régions de l’Asie. Une des conséquences de la création d’une nouvelle constellation impérialiste dans la guerre froide a de plus été que deux pays, la Chine et la Corée, ont été divisés en deux parties (la République Populaire de Chine et la République de Chine sur Taiwan, la Corée du Nord et du Sud), chacune étant alliée de l’un des deux blocs. Le Japon et la Corée du Sud, qui avaient été détruits par la guerre ont tous les deux reçu rapidement des fonds américains pour accélérer leur reconstruction de façon à devenir des appuis militaires et économiques solides pour les États-Unis dans leur confrontation avec leur rival russe et ses alliés.
1Kim Il Sung, né à Pyongyang mais dont la famille s’installe en Mandchourie, entre dans le mouvement de résistance contre l’occupation japonaise et y participe à la guérilla. Lorsque les japonais décident de liquider la guérilla une fois pour toutes, Kim est le seul dirigeant qui survit l’assaut : il est obligé de se retirer en Russie où lui et ses hommes intègrent l’Armée rouge russe. Il deviendra par la suite des évènements le premier dirigeant de la Corée du Nord.
2Jörg Friedrich, Yalu, p. 425. Notre traduction.
3Jörg Friedrich, Yalu, p. 516. Notre traduction.
Géographique:
- Corée du Sud [5]
Evènements historiques:
- Guerre de Corée [17]
La République Populaire de Chine: un nouveau monstre impérialiste et militariste
- 720 lectures
Durant la Seconde guerre mondiale, alors qu'une alliance des États-Unis, de l’URSS et des deux factions rivales de la bourgeoisie chinoise, le Kuomintang et l’Armée Rouge dirigée par les Maoïstes, se battent contre le Japon, Mao propose ses "bons services" aux États-Unis, vantant ses troupes comme étant des alliées plus déterminées et plus capables (une opinion partagée par plusieurs envoyés américains auprès de l’Armée rouge).
Quand la guerre cesse avec le Japon, le conflit au sein de la bourgeoisie chinoise éclate de nouveau au grand jour – alimenté par les appétits impérialistes de la Russie et des États-Unis. Après 1945, les États-Unis, qui ont soutenu le Front Unique Chinois contre le Japon, se mobilisent pour soutenir le KMT. Dans un premier temps, à la suite de la reddition du Japon, les États-Unis rapatrient, grâce à leurs moyens logistiques, environ un million de soldats japonais de la Chine au Japon (à peu près un cinquième de toute l’armée japonaise), pour que les soldats japonais ne tombent pas aux mains des Russes.
A la suite de cette opération de sauvetage des troupes japonaises, entre octobre et décembre 1945, un demi-million de soldats du Kuomintang sont aussi aéroportés par les troupes américaines du sud-ouest au nord de la Chine et vers les centres côtiers.
Comme nous l’avons montré plus haut, le Front Unique entre l’Armée Rouge stalinienne et les forces du KMT est vraiment précaire, déchiré par des conflits répétés et des confrontations directes. Le Japon s’est battu contre deux ailes rivales du capital chinois qui sont constamment à couteaux tirés. Une fois l’ennemi commun - l’impérialisme japonais – disparu, l’antagonisme entre les deux factions chinoises en conflit explose en guerre ouverte en juin 1946. une nouvelle guerre succède à celle de huit ans contre le Japon. Avec quelques trois millions de soldats de son côté au début du conflit, le KMT affiche au début une supériorité numérique sur l’Armée Rouge. De plus, il bénéficie d’un soutien massif des États-Unis. À l’inverse, la Russie, qui revient en force sur le front impérialiste en Asie orientale en août 1945, et occupe la Mandchourie que le Japon a dû abandonner, ne peut dans la première phase fournir autant de matériel (surtout militaire) aux troupes de l’Armée Rouge. Au contraire, du fait de son manque de ressources, la Russie démantèle les équipements locaux et les rapatrie chez elle.
Sur fond d’effondrement économique, largement dû à une économie de guerre incessante (80-90 % du budget alloué à l’armée), le KMT perd une grande partie de ses soutiens et beaucoup de soldats changent de camp. Entre 1937 et 1945, la création monétique est multipliée par 500. Après 1945, sous l’impact de la guerre économique, l’hyper-inflation continue, paupérisant la classe ouvrière et les paysans qui se détournent massivement du KMT.
Après presque 3 ans de combats continuels, l’Armée Rouge parvient à infliger une défaite cuisante aux troupes du KMT. Deux millions au moins de soldats du KMT, et de ceux qui le soutenaient, s’échappent vers l’île de Taiwan.
En octobre 1949, les troupes de Mao déclarent que la Chine continentale est un État indépendant. La République Populaire est proclamée. Cependant, il ne s’agit pas d’une révolution socialistemais du triomphe militaire d’une aile de la bourgeoisie chinoise (soutenue par la Russie) sur une autre aile du capital chinois (soutenue par les États-Unis). La nouvelle République Populaire s’érige sur les ruines d’un pays qui est passé par 12 ans de guerre – précédés par trois décennies de conflits entretenus par des seigneurs de guerre insatiables. Comme tant d’autres "nouveaux" États fondés au 20ème siècle, elle se fonde sur une division en deux parties, Taiwan et la Chine "continentale", entraînant un antagonisme permanent qui va perdurer jusqu’à nos jours.
Ravagée par des décennies d’économie de guerre, soutenue non par un pays techniquement supérieur, les États-Unis, mais par la Russie qui a, comme en Europe de l’Est, pillé les matières premières et démantelé les équipements en Mandchourie et ne peut pas offrir le même soutien matériel, la République Populaire sera marquée par une grande arriération.
A peine finie la guerre en Chine en 1949, la guerre entre la Corée du nord et du sud éclate.
Géographique:
- Chine [2]
Evènements historiques:
- Kuomintang défaite [18]
- Guerre civile en Chine [19]
L'impérialisme en Asie au 21ème siècle
- 2224 lectures
Géographique:
- Chine [2]
- Corée du Sud [5]
- Inde [20]
- Japon [1]
- Pakistan [21]
- Philippines [22]
- Asie [9]
- Australasie [23]
Rubrique:
L'impérialisme en Asie au 21ème siècle - Introduction
- 1967 lectures
Au cours de la première moitié de 2012, plusieurs essais, réussis ou non, de missiles à longue portée, effectués par la Corée (du Nord comme du Sud), la Chine, l’Inde et le Pakistan ont ouvert les yeux sur les ambitions de tous les plus grands pays d’Asie. En même temps, des commandes gigantesques de bateaux de guerre reflètent la militarisation en cours en haute mer,1 dans les océans qui baignent l’Asie. En fait, tous les pays asiatiques ont été forcés de se positionner par rapport aux nouvelles puissances "émergentes", la Chine et l’Inde. Leurs ambitions et la stratégie américaine de créer un contrepoids à la Chine ont déclenché une course aux armements dans tous les pays d’Asie.
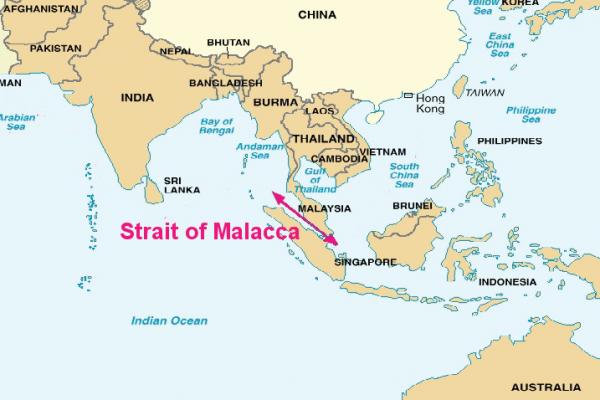 Alors que les commentaires dans la presse se sont jusqu‘à maintenant concentrés principalement sur leur croissance à deux chiffres, la montée économique des deux puissances asiatiques s’est inévitablement accompagnée d’une montée de leurs ambitions impérialistes. Pour comprendre cette situation, nous devons la replacer dans un contexte historique plus large.
Alors que les commentaires dans la presse se sont jusqu‘à maintenant concentrés principalement sur leur croissance à deux chiffres, la montée économique des deux puissances asiatiques s’est inévitablement accompagnée d’une montée de leurs ambitions impérialistes. Pour comprendre cette situation, nous devons la replacer dans un contexte historique plus large.
Le poids global de l’Asie dans la production mondiale revient aux normes historiques avant le développement du capitalisme européen. Entre le 11ème et le 17ème siècle, la Chine avait la plus grande flotte du monde. Jusqu’au 18ème siècle, la Chine était en avance sur l’Europe au niveau technologique dans beaucoup de domaines. En 1750, la part mondiale de la Chine dans les produits manufacturés était de presque 1/3 alors que l’Europe n’en était encore qu’à 1/4. Mais l’expansion des puissances capitalistes en Chine et en Inde au 19ème siècle a signifié pour ces deux pays2 un "déclassement" et leur part relative dans la production mondiale déclinait.
Aujourd’hui, la Chine est de retour sur la scène. Son "retour" peut-il se passer d’une "manière harmonieuse" et "pacifique" comme le proclament ses dirigeants?
Tous les pays d’ Extrême-Orient3 dépendent largement des voies maritimes des trois goulots d’étranglement : la Mer de Chine du Sud, le détroit de Malacca (entre la Malaisie, Singapour, l’Indonésie) et le détroit d’Ormuz (entre l'Iran et Dubaï). "Plus de la moitié du tonnage annuel de la flotte marchande mondiale passe par les détroits de Malacca, Sunda et Lombok (Indonésie) et la plus grande partie continue vers la Mer de Chine du Sud. Le trafic de pétroliers passant par le détroit de Malacca pour gagner la Mer de Chine du Sud est plus de trois fois celui du canal de Suez et bien 5 fois plus grand que le trafic dans le canal de Panama. Pratiquement, tout le fret qui passe par les détroits de Malacca et Sunda, doit passer à proximité des Iles Spratly." 4
90 % du pétrole importé par le Japon passe par la Mer de Chine du Sud. Presque 80 % du pétrole de la Chine passe par le détroit de Malacca. Pour le moment, les États-Unis contrôlent la plupart de ces passages obligés. En tant que puissance émergente, la Chine trouve cette situation insupportable –parce que leur contrôle par une seule puissance telle que les États-Unis pourrait étrangler la Chine.
Alors que le premier grand conflit impérialiste du 20ème siècle a pris place entre deux puissances asiatiques (la guerre russo-japonaise de 1905), les principales batailles de la Première Guerre mondiale ont eu lieu en Europe et les champs de bataille en Asie étaient très marginaux, la Seconde Guerre mondiale a aspiré beaucoup plus l’Asie dans la destruction générale et une puissance asiatique en était un des principaux participants. Quelques-unes des batailles les plus féroces et les plus sanglantes ont eu lieu en Asie. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que le continent européen était divisé par le "rideau de fer", établi au sein de l’Europe centrale au travers de l’Allemagne divisée, l’Asie faisait l’expérience de la division de quatre pays en deux parties : Corée, Chine, Vietnam (réuni depuis) et Inde. Alors que le "rideau de fer" en Europe était détruit en 1989, les divisions en Asie ont continué à exister, chacune d’elles entraînant des conflits permanents et créant des zones frontières parmi les plus militarisées (Corée du Nord/Corée du Sud, République Populaire de Chine/Taiwan, Pakistan/Inde). Mais maintenant, ce ne sont pas seulement les conflits entre pays divisés qui continuent à alimenter les tensions impérialistes, ce sont surtout l’apparition d’un nouveau challenger, la Chine, et les réactions des pays voisins et de la superpuissance rivale, les États-Unis, qui aggravent les tensions.
1 Cela se réfère à la notion de marine de haute mer (les "eaux bleues" en anglais, c’est à dire en eaux profondes), un terme plutôt imprécis qui désigne en général une marine de guerre capable d’assurer le pouvoir dans les eaux internationales en dehors de ses propres eaux côtières.
2L’Inde n’était pas un pays au 19ème siècle bien sûr. D’ailleurs, on ne peut pas dire que l’Inde comme unité politique ait existé avant le Raj britannique.
3Le terme « Extrême-Orient » est bien sur complètement euro-centriste. Pour les États-Unis, les région est le « Far ouest » alors que pour les pays asiatiques eux-mêmes la région est évidemment centrale. Nous utiliserons donc ce terme uniquement par convention et facilité d’écriture.
4https://globalsecurity.org/military/world/war/spratly-ship.htm [24] et https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shipping_routes_red_black.png [25]
Géographique:
Asie 1945 -1989
- 854 lectures
Alors que la confrontation entre les pays du bloc russe et le bloc américain était au centre de la guerre froide après 1945, c’est une spécificité de la Chine d’avoir rompu avec les deux blocs leaders de l’époque, les États-Unis et la Russie. Les rivalités impérialistes en Orient n’ont donc jamais été limitées au conflit entre les deux blocs, mais depuis sa "libération" du colonialisme japonais, la Chine a montré une tendance à défier tous les autres pays et à essayer "de s’en sortir toute seule". Quand la confrontation Est-Ouest a pris fin en 1989, les germes de l’exacerbation d’une nouvelle confrontation entre Chine et États-Unis, qui avait été "freinée" entre 1972 et 1989, réapparaissaient. Dans le contexte d’un chaos général sur la scène impérialiste, l’émergence économique de Chine sonne nécessairement le réveil de nouvelles confrontations militaires avec les États-Unis.
Le développement de l’impérialisme en Asie a été marqué par une spécificité de l’Inde et de la Chine.
La Chine est entrée dans la période de l'après-guerre dévastée par le militarisme : l’intervention répétée de l’impérialisme occidental pendant le 19ème siècle, l’effondrement du pouvoir d’État central et la montée de celui des seigneurs de guerre, l’invasion japonaise et plus de dix ans de guerre amère et barbare, ensuite la guerre civile entre le Kuomingtang et l’Armée Rouge, jusqu’à ce que le Parti Communiste de Chine (PCC) s’empare du pouvoir en 1949. Tout cela laissait le pays dans un état d’arriération économique extrême (rendu encore plus catastrophique par l’essai de rattraper le monde développé pendant le "Grand Bond en Avant") et faible militairement, dépendante du simple poids du nombre dans une armée de paysans pauvrement armés. Dans le cas de l’Inde, dont l’économie était aussi arriérée par rapport à ses concurrents étrangers, à cause d’une longue période de colonialisme, la nouvelle classe dirigeante qui a pris le pouvoir après l’indépendance en 1947 a encore aggravé cette situation du fait de sa politique semi-isolationniste. L’Inde et la Chine se sont coupées, à des degrés différents, du marché mondial. Ainsi, le stalinisme sous sa forme spécifique de maoïsme en Chine, le "semi-isolationnisme" sous la forme spécifique du "ghandisme" en Inde, ont été des chaînes historiques, ce qui signifie que les deux rivales ont entamé leur émergence à partir d’un niveau très bas de développement. Cela rend d’autant plus frappante la détermination de la classe dominante chinoise à adapter ses forces de façon conséquente, avec une vision à long terme, pour défier les États-Unis.
Après 1989, un changement de la hiérarchie impérialiste en Asie a pris place : globalement, la Chine et l’Inde ont été en progression, le Japon en déclin relatif, alors que la Russie, après avoir presque disparu de la scène mondiale après l’implosion de l’URSS fait une sorte de comeback. La position de la seule superpuissance restante, les États-Unis, s’est affaiblie, non seulement en Asie mais dans le monde entier. Les États-Unis se battent maintenant avec énergie pour maintenir leur supériorité en Asie.
La situation en Asie est dominée par un réseau complexe d’alliances mouvantes et de contre-alliances. Chaque État essaie de se défendre des ambitions de ses rivaux, alors que tous veulent limiter la domination de la Chine sans devenir de simples marionnettes de la seule puissance capable de faire face à la Chine : les États-Unis. Ce réseau d’alliances se voit dans toutes les zones de conflit de la Corée du Nord via Taiwan, la Mer de Chine du Sud, le détroit de Malacca, l’Océan Indien, jusqu’au Golfe Persique et au Moyen Orient.
Géographique:
- Asie [9]
Les ambitions impérialistes de la Chine dans la continuité de décennies de militarisme
- 1005 lectures
La République Populaire de Chine (RPC) a été fondée sur la base d’une partition entre la République Populaire de Chine et Taiwan –chacun étant soutenu par un bloc (l’URSS et les États-Unis respectivement). L’histoire de la République Populaire a été marquée depuis sa fondation par une série de conflits militaires avec ses voisins.
1952 : la Chine est largement impliquée dans la guerre de Corée. C’était le premier gros choc dans la région, entre les États-Unis d’un côté, l’Union soviétique et la Chine de l’autre ;
1950-51 : les troupes chinoises occupent le Tibet. Entre 1950 et 1959, il y a eu des combats incessants entre l’armée chinoise et la guérilla tibétaine ;
1958 : la Chine bombarde les Iles Quemoy et Matsu de Taiwan ;
1962 : la Chine est engagée dans un conflit frontalier avec l’Inde dans l’Himalaya. Depuis lors, la Chine a été un défenseur inébranlable du Pakistan dans son bras de fer avec l’Inde ;
1963-1964 : après avoir été des alliés durant plus d’une douzaine d’années, la Chine et l’Union Soviétique se séparent. Alors que l’Union Soviétique est engagée dans une course aux armements avec le bloc dirigé par les États-Unis, survient une confrontation entre la Chine et l’URSS. En mars 1969, un sérieux affrontement se produit sur la rivière Ussuri, avec des douzaines de soldats russes tués ou blessés. En 1972, 44 divisions soviétiques stationnent sur les 7000 km de frontière avec la Chine (alors que la Russie en a "seulement" 31 stationnées en Europe). Un quart de l’aviation soviétique est transférée à la frontière orientale. En 1964, les États-Unis avaient encore envisagé la possibilité d’une attaque nucléaire –avec la Russie – contre la Chine. En 1969, les Russes prévoyaient encore d’envoyer des missiles nucléaires sur la Chine1. Le conflit entre les États-Unis et la Chine commence à perdre de l’importance début 1970. Après une longue guerre sanglante pour essayer d’empêcher le Sud Vietnam de tomber aux mains des Russes, en 1972, les États-Unis réussissent à "neutraliser" la Chine, alors que la confrontation entre Chine et Russie continue et prend la forme de guerres "par procuration". Ensuite, entre 1975 et 1979, juste après la fin de la guerre au Vietnam, une première guerre par procuration se déclenche entre le Vietnam (soutenu par la Russie) et le Cambodge (soutenu par la Chine), d’autres suivent, en particulier en Afrique ;
1979 : la Chine mène une guerre désastreuse de 16 jours avec le Vietnam, dans laquelle les deux belligérants ont mobilisé en tout plus d’un million de soldats et qui a fait des dizaines de milliers de victimes. L’armée chinoise étale de manière criante ses faiblesses. En 1993, elle abandonne la tactique de "guerre du peuple" ou de la "guerre d’usure", basée sur le sacrifice d’un nombre infini de soldats. L’adaptation à la guerre dans des conditions "high tech" commence après cette expérience.
Quand l’Union soviétique envahit l’Afghanistan, en décembre 1979, la RPC devient membre d’une alliance tripartie avec les États-Unis et le Pakistan, pour soutenir la résistance armée afghane islamiste à l’occupation soviétique (1979-1989). La Chine reçoit des équipements militaires des États-Unis pour se défendre contre des attaques soviétiques. L’Armée de Libération Populaire chinoise entraîne et soutient les Moujahidins afghans pendant la guerre de l’Union soviétique en Afghanistan2.
Ainsi, pendant les 4 premières décennies de l’existence de la République Populaire de Chine, le pays est rentré en conflit et a mené des guerres avec presque tous les pays voisins : Union Soviétique, Corée et États-Unis, Japon, Taiwan, Vietnam, Inde. Et pendant de nombreuses années de la guerre froide, la Chine a été simultanément en conflit avec les deux blocs dominants. Sur les 14 nations qui ont des frontières avec la Chine, dix ont connu des conflits frontaliers marquants avec elle. Ainsi, l’exacerbation actuelle des tensions, en particulier avec les États-Unis, n’est pas un phénomène nouveau, c’est dans la continuité de décennies de conflits. Cependant, au cours des dernières années, une nouvelle polarisation sur la Chine se développe.
Alors que pendant des décennies, la RPC a massé ses troupes à la frontière russe, concentré ses forces pour la protection de sa côte, et s’est tenue prête à mener une guerre avec Taiwan, au début des années 1990, la RPC commence à s’adapter à la nouvelle situation mondiale créée par l’effondrement de l’URSS.
Géographique:
- Chine [2]
- Russie [8]
- Vietnam [28]
- Corée du Sud [5]
La Chine s’oriente vers la mer
- 741 lectures
La politique de Beijing durant les vingt dernières années a poursuivi différents objectifs :
de développer une stratégie à long terme pour opérer en haute mer, combinée à des efforts pour acquérir ou développer des armes pour le cyberespace et l’espace et renforcer la puissance de frappe et le niveau de l'aviation. Le but à long terme est d’empêcher les États-Unis d’être la force dominante dans le Pacifique –les militaires appellent ça une capacité "anti-accès/interdiction de zone". L’idée est d’utiliser des attaques au sol ciblées, et des missiles anti-navires, une flotte croissante de sous-marins modernes, des armes cybernétiques et anti-satellites pour détruire ou endommager de loin les équipements militaires d’autres nations. Cet objectif marque un tournant par rapport à la politique qui consistait à concevoir l'essentiel de la modernisation de l’Armée de Libération Populaire dans le but de s’emparer de Taiwan. Alors que, historiquement, le but de conquérir Taiwan et d’agir comme une force côtière qui défend son rivage avec une certaine vision "continentale" était la principale orientation stratégique, la stratégie de la Chine aujourd’hui est d’aller "plus" au large. Cette attitude plus assurée a été influencée par la crise du détroit de Taiwan dans les années 1995-96 qui a vu deux porte-avions US humilier Beijing dans ses eaux territoriales. La Chine investit énormément dans des "capacités asymétriques" dans le dessein d’amoindrir la capacité jadis écrasante des États-Unis à propulser sa puissance dans la région. La Chine vise donc à devenir capable de déclencher des attaques qui désorganisent les bases américaines dans le Pacifique Occidental et de repousser les porte-avions américains au-delà de ce qu’elle appelle la "première chaîne d’îles", délimitant la Mer Jaune, la Mer de Chine du Sud et la Mer de Chine Orientale à l’intérieur d’un arc allant des Aléoutiennes au nord jusqu’à Bornéo au sud. Dans le Pacifique occidental, cela voudrait dire cibler ou mettre en péril les porte-avions américains et ses bases aériennes à Okinawa, en Corée du Sud et même à Guam. Depuis la deuxième guerre mondiale, les alliés des américains dans la région Pacifique de l’Asie ont compté sur le parapluie US pour leur sécurité. Mais maintenant, "croire que les navires de surface des États-Unis et de leurs alliés peuvent opérer en toute sécurité partout dans le Pacifique occidental n’est plus valable" dit un rapport américain. Les groupes de choc de porte-avions, dit aussi ce rapport, devient "de plus en plus vulnérables" à la surveillance et à l’armement chinois jusqu’à 1200 miles nautiques de la côte chinoise1
En même temps, la Chine veut montrer qu’elle est présente aux passages obligés, ce qui veut dire étendre sa présence en Mer de Chine du sud et dans l’Océan Indien. Incapable d’arracher des territoires à ses voisins au nord, à l’est et à l’ouest, elle doit concentrer ses forces sur l’affirmation de sa présence dans la Mer de Chine du Sud et dans l’Océan Indien (défense des mers lointaines) et vers le Moyen Orient. Cela signifie surtout qu’elle doit "déstabiliser", saper la position toujours dominante des États-Unis en haute mer. Tout en revendiquant une position dominante dans la Mer de Chine du Sud, elle a commencé à construire un "collier de perles" autour de l’Inde et à s’infiltrer au Moyen Orient.
1 https://www.fpif.org/articles/asias_mad_arms_race [29]
Géographique:
- Chine [2]
Un "collier de perles" mortel
- 1200 lectures
En plus des liens étroits de longue date avec les régimes du Pakistan et du Myanmar, la Chine a développé une stratégie dite du "collier de perles", en établissant des bases et en tissant des liens diplomatiques. Quelques exemples :
un accord militaire avec la Cambodge a été signé ;
la construction d’un canal à travers l’isthme de Kra en Thaïlande va être financée. Le canal doit faire 102 km de long et 500 mètres de large et va relier l’Océan Indien à la côte Pacifique de la Chine – un projet à l’échelle du canal de Panama. Il pourrait faire basculer les rapports de force en Asie en faveur de la Chine en donnant à sa flotte militaire et commerciale un accès facile à un vaste continuum océanique s’étirant de l’Afrique de l’Est au Japon et à la péninsule coréenne. Ce projet de canal met en question la position de Singapour en tant que principal port de la région et permettrait aux navires chinois d’éviter le détroit de Malacca. Cela a une forte signification stratégique pour le déploiement de la flotte, et remet fortement en question la position prédominante actuelle de l’Inde dans le golfe du Bengale1 ;
Construction d’infrastructures stratégiques au Tibet et au Myanmar ;
Développement d’installations portuaires à Sittwe, Myanmar ;
Installations de services de renseignements électroniques sur des îles dans le golfe du Bengale ;
Ventes de navires lance-missiles au Bangladesh et aide au développement de son port en mer profonde à Chittagong, au Bangladesh ;
Aide militaire étendue au Sri Lanka. La Chine a aidé le Sri Lanka à gagner la guerre contre les Tigres Tamouls en 2009, elle a aussi investi dans le développement du port à Hambantota ;
Construction d’une base navale à Marao aux Maldives ;
Etablissement aux Seychelles de sa première base militaire à l’étranger ;
Construction du port de Gwadar au Pakistan. L’engagement de la Chine dans la construction du port en eau profonde de Gwadar sur la côte sud-ouest du Pakistan a été, en particulier, suivi avec une grande attention à cause de sa position stratégique, à 70 km environ de la frontière iranienne et 400 km à l’est du détroit d’Ormuz – la principale route d’approvisionnement en pétrole. On a dit que çà donnerait à la Chine "un poste d’écoute" d’où elle pourrait surveiller l’activité navale US dans le Golfe Persique et l’activité indienne dans la mer d’Arabie ;
Participation à mission anti-pirates dans le Golfe d’Aden.
 La construction de ce "collier de perles" permettrait à la Chine de menacer le transport maritime aux trois points de passage obligés dans l’Océan Indien – Bab el Mandeb (reliant la Mer Rouge au Golfe d’Aden), le Détroit d’Ormuz et le Détroit de Malacca. Les officiers de marine chinois parlent de développer à long terme trois flottes de haute mer pour patrouiller devant le Japon et la Corée, le Pacifique occidental, le détroit de Malacca et l’Océan Indien.
La construction de ce "collier de perles" permettrait à la Chine de menacer le transport maritime aux trois points de passage obligés dans l’Océan Indien – Bab el Mandeb (reliant la Mer Rouge au Golfe d’Aden), le Détroit d’Ormuz et le Détroit de Malacca. Les officiers de marine chinois parlent de développer à long terme trois flottes de haute mer pour patrouiller devant le Japon et la Corée, le Pacifique occidental, le détroit de Malacca et l’Océan Indien.
En tant que puissance émergente, la Chine réclame plus de poids et d’influence, mais cela ne peut être qu’aux dépens des autres pays, en particulier, au détriment des États-Unis. C’est ce qui polarise toute la situation régionale. Les pays sont poussés vers la Chine ou dans les bras des États-Unis, qu’ils le veuillent ou non.
La classe dominante en Chine veut nous faire croire que l’ascension de Beijing se veut pacifique, que la Chine n’a aucune intention expansionniste, qu’elle sera une sorte différente de grande puissance. La réalité dans les 20 dernières années, c’est que la montée de la Chine est inséparable de ses ambitions impérialistes et militaires croissantes. Il est certainement impensable pour le moment que la Chine puisse défaire les États-Unis ou se mettre à la tête d’un nouveau bloc chinois. Cependant, alors que le principal impact de l’ascension de la Chine a été de saper la supériorité américaine, ses ambitions ont déclenché une nouvelle course aux armements. De plus, le poids accru de la Chine au niveau mondial a encouragé la tête de l’ex-bloc déclinant, la Russie, à se positionner aux côtés de la Chine dans beaucoup de conflits avec les États-Unis (par exemple en Syrie, Iran) et à soutenir (ouvertement ou de façon cachée) tous ces régimes qui sont dénoncés par les États-Unis comme des États "voyous" (Corée du Nord, Iran) ou qui sont des "États défaillants" comme le Pakistan. Bien que la Russie ne soit pas non plus intéressée à voir la Chine devenir trop forte, et que Moscou ne veuille pas devenir un vassal de la Chine, la Russie a l’impression d’avoir une nouvelle marge de manœuvre en agissant avec la Chine contre les États-Unis. La Russie a ainsi fait plusieurs exercices militaires avec la Chine dans la Mer Jaune.
Géographique:
- Chine [2]
- Vietnam [28]
- Corée du Sud [5]
- Japon [1]
- Australasie [23]
La course aux armements entre la Chine et ses rivaux
- 1055 lectures
Depuis 1989, le budget militaire a augmenté en moyenne de 12,9 % par an, selon GlobalSecurity.org, et c’est maintenant le second budget le plus élevé sur la planète. Le budget global des États-Unis pour la sécurité nationale –ne prenant pas en compte les différentes guerres dans lesquelles Washington est impliqué– s’élève à un peu plus de 800 milliards de dollars, encore que quelques estimations le chiffrent à plus de mille milliards de dollars. Le groupe de recherche globale IHS a prévu que les dépenses militaires de Beijing verraient doubler leur chiffre de 2011, 119.8 milliards de dollars US pour atteindre 238.2 milliards en 2015. Cela dépasse les sommes dépensées par les 12 marchés clefs de la défense de la région, y compris le Japon et l’Inde. En 2011, les dépenses militaires étaient plus élevées de 80 % que celles du Japon et de 200 % que celles de l’Inde. Le budget militaire de la Chine en 2011 était 2,5 fois plus grand qu’en 2001 et a doublé tous les 5 ans. Le budget militaire de la Chine représente 30 % du total des budgets militaires en Asie, bien que selon les officiels de la défense occidentale, ces totaux n’incluent pas les importations d’armes. En réalité, le budget militaire global est donc beaucoup plus élevé. Si les prévisions se réalisent, les dépenses militaires de la Chine vont dépasser le montant réuni des dépenses militaires des 8 principaux membres de l’OTAN, États Unis non compris. Alors qu’en 2000, le budget militaire des États-Unis était encore 20 fois plus élevé que celui de la Chine, en 2011/2012, le rapport est de 7,11
Les efforts de modernisation de la Chine ont été principalement axés sur l’augmentation de ses capacités balistiques, en mettant au point par exemple des fusées à plus longue portée, et sur l’accroissement de ses capacités de guerre cybernétique. La flotte chinoise est aujourd’hui considérée comme la troisième du monde derrière les États-Unis et la Russie. Le nombre de fantassins dans l’Armée Populaire de Libération a été réduit alors que les troupes dans la marine, les forces aériennes et dans le second corps d’artillerie –qui entretient les missiles nucléaires chinois– ont augmenté.
Alors que la Chine a connu des taux de croissance très élevés, souvent à deux chiffres, le taux de croissance de son budget militaire a été encore plus rapide. L’armée chinoise est certainement partie d’un niveau très bas car la majorité de ses forces était des forces terrestres, mal équipées et vues en grande partie comme de la chair à canon pour les grandes batailles terrestres. Les militaires chinois ont peu d’expérience de combats. Ils n’ont pas été engagés dans un conflit depuis 1979 quand ils se sont fait botter les fesses par le Vietnam. Au contraire, les troupes américaines ont combattu, se sont modernisées, ont adapté leur armement et leurs tactiques de façon constante –en développant leurs capacités antisatellites, des missiles balistiques contre les navires, des missiles de croisière, des capacités pour mener une cyberguerre. La capacité de l’Armée Populaire de Libération (APL) à mener des opérations conjointes et complexes dans un environnement hostile n’a pas été testée. Les missiles et les forces sous-marines chinoises représenteraient une menace pour les porte-avions américains près des côtes de la Chine, mais pas plus loin, au moins pendant un certain temps. Apprendre à utiliser dans les batailles toutes ces armes nouvellement acquises prendra probablement des années. Néanmoins, le projet d’armement ambitieux et la stratégie d’expansion de la Chine ont amené les États-Unis à percevoir ce pays comme un pays parmi "les puissances majeures et émergentes" qui a "le plus grand potentiel pour concurrencer militairement" les États-Unis. Même si, selon le Pentagone, les militaires chinois sont "encore à des décennies de posséder une pleine capacité de combattre et de défaire un adversaire moderne au-delà des frontières de la Chine", des leaders aux États-Unis mettent en garde : "l’armée chinoise grossit et se modernise". "Nous devons être vigilants. Nous devons être forts. Nous devons nous préparer à affronter tout défi. Mais la clef pour cette région va être de développer une nouvelle ère de coopération défensive entre nos pays, ceux qui partagent le fardeau de la sécurité pour faire avancer la paix." (Le secrétaire de la Défense US, Panetta)2
La construction du "collier de perles" et la présence croissante de la Chine dans le Pacifique, ont pour conséquence que tous les pays voisins sont obligés d’adapter leur plans militaires. Quelques exemples :
-
Le Japon qui avait ses armes dirigées principalement contre l’Union Soviétique a changé pour les orienter plus sur la Chine. Malgré les effets de la crise économique, le Japon a planifié de dépenser 284 milliards de dollars entre 2011 et 2015 -entre autres, en déployant plus de missiles Patriot US, et en fournissant plus de navires de haute mer à la Marine. Le Japon et la Chine sont actuellement en bisbille à propos d’une île située entre les deux pays (en japonais, Ile Senkaku, en chinois, Ile Dianoyu), un groupe d’îlots rocheux à limite du plateau continental à environ 100 miles au nord-est de Taiwan3
-
En 2006, la Corée du Sud a entamé un programme à 15 ans de modernisation militaire qui va coûter environ 5,5 milliards de dollars, dont un tiers est prévu pour l’achat d’armes. En 2012, des missiles de croisière ont été testés, avec une portée de 930 miles, donc capables d’atteindre n’importe quel lieu en Corée du Nord. Au vu des derniers clashes avec la Corée du Nord, l’argent disponible pour acheter des armes supplémentaires a été augment4.
-
L’Australie a augmenté son budget militaire. Elle a donné son accord pour l’arrivée de 2500 soldats US en plus et la permission de construire une nouvelle base US dans le pays.
1 Sources: defensetech.org/2011/05/19/pla-chinese-military-doesntcompare-to-u-s-military.
csis.org/press/csis-in./panetta-outlines-us-military-strategy-asia
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm [31]
Shen Dingli in Le Monde Diplomatique, May 2012
Géographique:
- Chine [2]
La Mer de Chine méridionale, premier maillon d’une série de conflits
- 998 lectures
"[La Mer de Chine du Sud] renferme non seulement du pétrole et des sources de gaz situées près de pays grands consommateurs d’énergie, mais elle est aussi la deuxième voie de navigation du monde en terme de trafic qui relie l’Asie du Nord Est et le Pacifique occidental à l’Océan Indien et au Moyen Orient, en la traversant. Plus de la moitié du tonnage mondial du transport maritime passe par la Mer de Chine Méridionale chaque année. Plus de 80 % du pétrole pour le Japon, la Corée du Sud et Taiwan passe par cette région.
Jose Almonte, ancien conseiller pour la sécurité nationale dans le gouvernement philippin, parle sans fard de l’importance stratégique de cette région. La grande puissance qui contrôle la Mer de Chine méridionale exercera sa domination à la fois sur la péninsule et l’archipel de l’Asie du Sud Est, et jouera un rôle décisif dans l’avenir du Pacifique occidental et de l’Océan Indien – de même que sur les voies de navigation stratégiques pour le pétrole du Moyen Orient"1
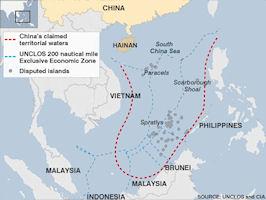 La Mer de Chine du Sud n’est pas seulement la route maritime la plus importante, on estime aussi que la zone est riche en pétrole, gaz naturel et matières premières précieuses et en pêcheries sur lesquelles il n’y a pas encore d’accord sur les droits d’exploitation. Ces facteurs militaro-économico-stratégiques constituent un mélange explosif.
La Mer de Chine du Sud n’est pas seulement la route maritime la plus importante, on estime aussi que la zone est riche en pétrole, gaz naturel et matières premières précieuses et en pêcheries sur lesquelles il n’y a pas encore d’accord sur les droits d’exploitation. Ces facteurs militaro-économico-stratégiques constituent un mélange explosif.
Les conflits entre les États côtiers pour la domination de cette zone sont très anciens. La Chine et le Vietnam se sont affrontés, en 1978, pour contrôler les Iles Spratly (le Vietnam qui était soutenu par Moscou à cette époque les réclamait) ; le leader chinois, Deng Tsiao Ping, a alors averti Moscou que la Chine était préparée à une guerre à grande échelle contre l’URSS). La position plus agressive de la Chine vis-à-vis de cette zone a pris un tournant après 1991. À cette époque, la Chine a pris les premières mesures pour s’installer dans la Mer de Chine du Sud et remplir le vide créé par le retrait des forces US des Philippines en 1991). La Chine a réaffirmé ses revendications "historiques" et fondées en rien sur le droit légal international, sur toutes les petites îles, y compris les archipels Paracels et Spratly et sur 80 % des eaux le long de la ligne en neuf traits,2 sur la carte de la mer de Chine du sud. Malgré des négociations, aucune solution n’a été trouvée pour les deux grands groupes d’îles –les Paracels (ou Xisha et Zhongsha) à propos desquelles la Chine a encore eu des conflits militaires avec le Vietnam en 1988 et 1992. Ces îles peuvent être utilisées comme bases aériennes et navales pour des services de renseignements et de surveillance ainsi que des activités de reconnaissance, et en tant qu’argument de base pour revendiquer la partie la plus profonde de la Mer de Chine du Sud pour les sous-marins chinois équipés de missiles balistiques et d’autres navires. On dit que la Chine construit une base de missiles terre-mer dans la province de Guangdong au sud de la Chine, avec des missiles capables d’atteindre le Vietnam et les Philippines. Cette base est considérée comme le fruit d’un effort pour donner du poids aux revendications territoriales chinoises sur de grandes zones de la Mer de Chine du Sud revendiquées par les pays voisins et pour faire face aux porte-avions américains qui patrouillent actuellement sans problème dans cette zone. La Chine a même déclaré la zone comme étant d’un "intérêt fondamental" pour elle, mettant la zone marine au même niveau de signification que le Tibet et Taiwan pour la Chine.
La Mer de Chine du Sud est la zone la plus fragile, la plus instable -parce que la Chine n’y est en concurrence avec aucun de ses grands rivaux. Elle fait face à nombre de petits pays plus faibles –Vietnam, Philippines, Brunei, Malaisie, Singapour, Indonésie– qui sont tous trop petits pour se défendre seuls. En conséquence tous ces pays voisins sont obligés de chercher l’aide d’un plus grand allié. Cela veut dire d’abord et avant tout les États-Unis, mais aussi le Japon et l’Inde qui ont offert leur "protection" à ces États. Ces deux derniers pays ont participé, par exemple, à plusieurs manœuvres avec le Vietnam et Singapour.
Une des principales cibles de cette course aux armements qui s’est déclenchée en Asie se trouve dans les pays de la Mer de Chine du sud. Bien que le Vietnam n’ait pas les moyens militaires et financiers pour s’aligner sur la Chine, il a acheté des armes à des compagnies européennes et russes –y compris des sous-marins. Les importations d’armes augmentent en Malaisie. Entre 2005 et 2009, ce pays a multiplié ses importations d’armes par 7 par rapport à la période couvrant les 5 années précédentes. La petite Cité-État de Singapour, qui planifie d’acquérir deux sous-marins, est maintenant parmi les dix premiers importateurs d’armes mondiaux. L’Australie planifie de dépenser au moins 279 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années dans des nouveaux sous-marins, destroyers et avions de combat. L’Indonésie veut acquérir des missiles à longue portée. Les Philippines dépensent presque 1 milliard de dollars pour un nouvel avion et des radars. La Chine a environ 62 sous-marins maintenant, et en attend 15 autres dans les prochaines années. L’Inde, la Corée du Sud et le Vietnam vont acquérir 6 nouveaux sous-marins chacun en 2020. Les plans de l’Australie sont d’en ajouter 12 dans les 20 ans à venir. Singapour, l’Indonésie et la Malaisie en ajoutent deux chacun. Toutes ensemble, ces acquisitions constituent une des plus grandes accumulations de sous-marins depuis les années du début de la guerre froide. On s’attend à ce que les nations asiatiques achètent jusqu’à 111 sous-marins dans les 20 prochaines années.3
1 https://www [35]. Japanfocus.org/-Suisheng-Zao/2978
3 www.wsj.com [37], February 12, 2011.
Géographique:
- Vietnam [28]
- Chine [2]
- Philippines [22]
Un autre point chaud: l’Océan Indien
- 815 lectures
Il n’y a pas que le Pacifique et la Mer de Chine Méridionale qui soient le théâtre de rivalités impérialistes, l’Océan Indien est aussi devenu une zone où se déploient toutes les rivalités.
Les voies maritimes dans l’Océan Indien sont considérées comme les plus importantes stratégiquement dans le monde – selon le "Journal de la région de l’Océan Indien", plus de 80 % du commerce maritime du pétrole transite par des goulots d’étranglement dans l’Océan Indien, avec 40 % passant par le détroit d’Ormuz, 35 % par le détroit de Malacca et 8 % par le détroit de Bab-el-Mandeb. La moitié des porte-containers du monde naviguent sur cette route maritime vitale. Mais il ne s’agit pas seulement de voies maritimes et de commerce. Plus de la moitié des conflits armés dans le monde se situent actuellement dans la région de l’Océan Indien. En plus d’être le théâtre des ambitions impérialistes de la Chine et de l’Inde, il y a le danger d’une confrontation nucléaire entre Inde et Pakistan, les interventions américaines en Irak et en Afghanistan, le conflit permanent autour de l’Iran, le terrorisme islamiste, la fréquence croissante des actes de piraterie dans et autour de la Corne de l’Afrique et des conflits dus à la diminution des ressources halieutiques.
En fait, l’Océan Indien est une "interface" cruciale entre la vieille zone de tensions impérialistes au Moyen Orient, et celle où les tensions sont en train de croître en Asie du Sud Est, dans la Mer de Chine méridionale et dans tout le Pacifique. Bien qu’il y ait des spéculations sur la possibilité que l’Océan Indien puisse receler 40 % de la production mondiale de pétrole, et qu’il y a eu des explorations pétrolières récentes dans les mers de l’Inde, du Sri Lanka et du Myanmar, l’importance de cet océan s’est surtout accrue depuis que le déclin relatif de la puissance des États-Unis dans la région a laissé un vide qui est de plus en plus rempli par la Chine et l’Inde.
Il n’y pas que la Chine qui essaie de renforcer sa présence dans l’Océan Indien. Le Japon est prêt à participer aux efforts pour contenir la Chine et a promis au Myanmar, à la Thaïlande, au Vietnam, Laos et Cambodge, 7,18 milliards de dollars d’aide au développement dans les trois prochaines années pour contribuer à la construction d’infrastructure, y compris un train à grande vitesse, un port et des projets d’adductions d’eau. Mais c’est surtout le plus grand pays du littoral de l’Océan Indien, l’Inde, qui a traditionnellement une vision stratégique orientée vers le territoire, qui a été obligée de contrer la pénétration de la Chine dans l’Océan Indien. Il y a beaucoup en jeu pour l’Inde : elle importe quelques 70 % de son pétrole et de son gaz dont environ les deux-tiers sont acheminés via l’Océan Indien. L’Inde est le quatrième plus grand consommateur de pétrole du monde et dépend des cargaisons de brut en provenance des pays du Moyen Orient, y compris l’Arabie Saoudite et l’Iran. Elle importe aussi de grandes quantités de charbon d’Indonésie et d’Australie. Cette dépendance et le rôle crucial des voies maritimes le long de ses côtes ont rendu l’Inde très vulnérable côté mer. Bien sûr, l’émergence de l’Inde en tant que nouvel acteur régional a accru ses appétits impérialistes.
Géographique:
L’Inde - fermement sous l’emprise du cancer militariste
- 1494 lectures
Historiquement, l’Inde a été considérée comme le joyau de la couronne par le colonialisme britannique. Quand, après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants coloniaux anglais n’ont plus été en mesure de la contrôler, ils l’ont divisée. Presque en même temps que la Corée et la Chine, l’ancien Raj a aussi été divisé en deux parties –le Pakistan dominé par les musulmans, et l’Inde multi-religieuse à majorité Hindou1. Les deux pays sont engagés dans une guerre froide permanente avec 4 guerres intenses depuis lors. Dès que l’indépendance a été déclarée en 1947, un conflit militaire a éclaté entre eux pour le contrôle du territoire contesté et stratégiquement vital du Cachemire. Le Pakistan a occupé un tiers du Cachemire, l’Inde en a occupé les trois cinquième (une partie du Cachemire est toujours occupée par la Chine). Dans la guerre indo-pakistanaise de 1965, l’Inde a attaqué le Pakistan sur tous les fronts à la suite de tentatives de troupes pakistanaises de s’infiltrer dans la partie du Cachemire contrôlée par l’Inde.
La guerre indo-pakistanaise de 1971 s’est menée sur la question de l’autonomie au Pakistan oriental, l’Inde a battu le Pakistan de façon décisive, ce qui a eu pour résultat la création du Bangladesh (note)2
En 1999, le Pakistan et l’Inde ont eu des accrochages frontaliers pendant 11 semaines dans la province septentrionale disputée du Cachemire. Ces dernières années, des attaques terroristes répétées -soutenues par le Pakistan- ont contribué à maintenir l’inimitié entre ces deux puissances nucléaires.
A l’époque de l’indépendance de l’Inde, la classe dominante indienne était encore capable de se tenir en dehors de la confrontation entre le bloc dirigé par les États-Unis et le bloc de l’Est dirigé par l’URSS. L’Inde a pris part à la création du Mouvement des non-alignés, fondamentalement parce que les principaux fronts de la confrontation entre les deux blocs était en Europe et en Asie du Sud Est (cf. la Guerre de Corée). En tant que membre des nations non-alignées3, l’Inde s’est coupée du soutien militaire des États-Unis, et a été forcée de se tourner vers la Russie pour les fournitures et équipements militaires et même pour certains investissements industriels, bien que le pays n’ait jamais fait partie du bloc russe. Cependant, la tentative de l’Inde de se tenir à l’écart de la confrontation Est-Ouest n’a pas empêché un clash avec la Chine et, en 1962, ces deux pays se sont engagés dans une courte guerre sur la frontière de l’Himalaya. La guerre a convaincu les militaires indiens de se réorienter sur la fabrication d’armes et d’améliorer les relations avec les États-Unis.
L’Inde fait face à deux ennemis jurés –le Pakistan et la Chine, cette dernière soutenant fortement le Pakistan. Malgré de nombreux efforts diplomatiques, les disputes sur la frontière entre l’Inde et la Chine n’ont pas disparu. L’Inde affirme que la Chine occupe plus de 36 000 km² du territoire indien dans l’Aksai Chin, le long de sa frontière au nord du Cachemire (communément appelé le secteur occidental) tandis que la Chine réclame plus 88 000 km² de l’État indien Arunachadal Pradesh (communément appelé le secteur oriental), au nord est. L’Inde héberge aussi depuis longtemps le Dalaï Lama et environ 100 000 réfugiés tibétains qui se sont enfuis après que la Chine ait annexé le Tibet en 1950. Ces dernières années, la Chine a aussi intensifié ses constructions militaires le long de la frontière indienne, en particulier au Tibet. Par exemple, l’aviation de l’Armée Populaire de Libération a établi au moins quatre bases aériennes au Tibet et 3 dans le sud de la Chine, capables de monter des opérations contre l’Inde.4
A l’exception des britanniques, tous ceux qui ont régné sur l’Inde avaient une vision orientée surtout sur le territoire. Depuis l’indépendance de l’Inde, les plus grands conflits dans lesquels le pays a été impliquée ou qui ont éclaté dans la région, (Afghanistan, Irak, Iran) ont eu lieu sur terre, sans grandes batailles en mer. Le développement rapide de la puissance navale indienne est un phénomène récent qui ne peut donc s’expliquer que par la confrontation générale qui se dessine en Asie. Après avoir fixé son regard surtout sur une menace du Pakistan et de la Chine sur son flanc nord-est, l’Inde fait maintenant face à un nouveau défi –défendre ses positions dans l’Océan Indien.5
Il n’est donc pas étonnant que l’Inde ait commandé à la Russie environ 350 tanks T-90S et quelques 250-300 avions de combat et qu'elle ait décidé de produire à peu près 1000 tanks en Inde même.6
Pour faire face à la stratégie chinoise du "collier de perles", la marine indienne a accru ses moyen maritimes en acquérant des porte-avions, des tankers et des bateaux pour le transport de troupes. Dans la prochaine décennie, l’Inde prévoit d’ajouter 100 nouveaux bateaux de guerre à sa force navale. L’Inde a maintenant la cinquième flotte du monde. Alors que ce pays continue à moderniser ses forces terrestres, et a besoin de garder des milliers de soldats mobilisés à ses frontières avec le Pakistan, l’armée chinoise a mis plus l'effort sur ses navires de haute mer et sur l’accroissement de ses capacités balistiques "hors zone".
L'Inde étant inférieure à la Chine sur le plan militaire et économique, l’expansion chinoise dans l’Océan Indien l'a obligée à chercher un allié dont les intérêts sont aussi opposés à ceux de la Chine. D’où la convergence d’intérêts entre les États-Unis et l’Inde. Il est révélateur que l’Inde, qui a pu dans les années 1950 rester en dehors de la zone des conflits majeurs entre l’Est et l’Ouest, soit poussée maintenant à une lutte de pouvoir avec la Chine et forcée de se rapprocher des États-Unis. L’Inde fait déjà annuellement plus de manœuvres militaires conjointes avec les États-Unis que n’importe quel pays dans le monde. Malgré de fortes hésitations dans certaines parties de la classe dominante indienne, qui se méfient des États-Unis après tant d’années de liens étroits avec l’Union Soviétique, l’Inde et les États-Unis sont condamnés à un "partenariat". Les États-Unis n’ont d’autre choix que de favoriser la modernisation et l’armement de l’Inde. Dans ce contexte, ils ont tacitement ou directement soutenu les pas en avant qu’a fait l’Inde pour développer une puissance nucléaire –ce qui ne peut être vu, à la fois par le Pakistan et la Chine, que comme une menace directe.
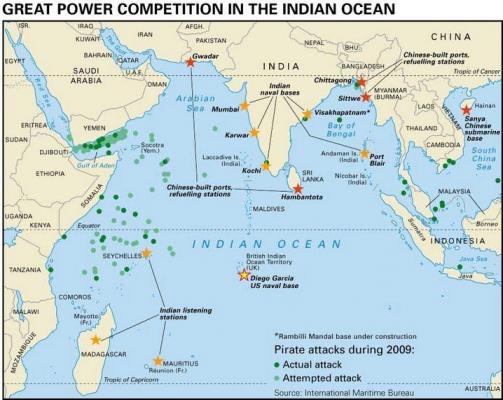
"Avant tout, le raisonnement géostratégique d’une alliance entre les États-Unis et l’Inde est l’encerclement ou le "containment" de la République Populaire de Chine. L’Inde peut être le seul contre-poids à la Chine dans la région. L’autre raisonnement ou l’intention présidant à une telle coopération est la neutralisation de la Russie comme acteur en Asie Centrale et la sécurisation des ressources énergétiques à la fois pour l’Inde et pour les États-Unis. Les États-Unis ont aussi utilisé l’Inde dans le but d’essayer d’isoler l’Iran."7
Comme beaucoup de pays d’Asie du Sud-Est et comme la Chine, l’Inde a aussi intensifié sa course aux armements. Le budget de la défense, qui est en gros de 3,2 milliards de dollars en 2011 s’est accru de 151 % au cours de la dernière décennie. Les dépenses de l’Inde pour la défense vont augmenter de 17 % au cours de l’exercice financier 2012-2013. Le gouvernement prévoit que les dépenses militaires vont augmenter de 8,3 % par an dans les prochaines années. Les importations des principales armes se sont accrues de 38 % entre 2002-2006 et 2007-2011. L’Inde a dépensé quelques 12,7 milliards de dollars en armes, 80 % provenant de la Russie, entre 2007 et 2011, selon le SIPRI8.
L’Inde a établi des postes d’écoute au nord de Madagascar, aux Seychelles et sur l’Ile Maurice ; fin 2009, elle a réussi à coopter les Maldives comme participant au commandement de sa flotte du Sud. L’Inde a établi sa première base militaire en terre étrangère, à Ayni au Tadjikistan. Dans ce contexte, les derniers essais de missiles à longue portée font partie de la stratégie globale de l’impérialisme indien.
Le pays a commencé à développer des relations économiques et surtout militaires plus étroites avec la Japon et le Vietnam. L’Inde a fait du renforcement de ses liens avec le Japon une priorité, en accroissant les contacts au niveau militaire, la coopération au niveau maritime, les rapports commerciaux et les investissements. Tokyo, en retour, a engagé 4,5 milliards de dollars en prêts bonifiés dans la construction de la voie ferrée destinée au transport entre Delhi et Mumbai. Une déclaration commune sur la sécurité a été signée en 2008 avec le Japon, qui stipule que leur partenariat est "un pilier essentiel pour la future architecture de la région" 9 Le Japon a participé à plusieurs reprises à des manœuvres navales aux Malabar dans l’Océan Indien. Non seulement l’Inde se sent particulièrement menacée, par la connexion entre Chine et Pakistan, elle est aussi alarmée par le soutien financier et militaire grandissant de la Chine au Sri Lanka stratégiquement important. L’attitude du régime au Myanmar, qui pendant des années a eu des liens privilégiés avec la Chine, est un autre facteur d’incertitude. L’Inde est donc confrontée à la fois sur ses frontières à l’ouest, au nord, au sud et à l’est et le long de ses côtes à une pression croissante de la Chine. Comme on l’a dit plus haut, l’armée indienne est bloquée par la défense permanente de ses frontières terrestres. La Chine fait des incursions périodiques dans l’État indien du nord, l’Arunachal Pradesh, qui a une frontière avec le Tibet et est revendiqué par Beijing comme étant sien. La Chine, pour contrer le soutien des États-Unis à la puissance nucléaire indienne, a vendu deux nouveaux réacteurs nucléaires au Pakistan. De plus, l’Armée Populaire de Libération est présente dans les zones du Cachemire administrées par le Pakistan de l’Azad Kashmir et du Giltit-Baltistan. Avec la Chine qui contrôle déjà un cinquième de Jammu et du Cachemire, l’armée indienne est face à la réalité d’une présence chinoise des deux côtés, est et ouest, de la fragile région du Cachemire.
Comme nous le verrons plus loin, les intérêts antagoniques dans l’Océan Indien et la stratégie d’armement et de recherche d’alliés recèlent beaucoup d’éléments imprévisibles. Par exemple, début 2008, l’Inde a lancé un satellite espion israélien (TechSAR/Polaris) dans l’espace. Le satellite israélien semblait principalement viser l’Iran. Israël fournit l’Inde en technologie électronique de pointe et il y a des indications qui montrent une coopération plus étroite entre les États-Unis, l’Inde et Israël10 Dans ce contexte de tensions croissantes en Asie, l’Inde fait partie d’un ensemble naval majeur qui va de la côte de l’Afrique de l’Est et de la Mer d’Arabie jusqu’aux rivages de l’Océanie. À côté des flottes américaines et des alliés des États-Unis dans l’OTAN, les flottes de l’Iran, de l’Inde, de la Chine, du Japon, et de l’Australie ont étendu leur présence, avec la justification des problèmes réels causés par les actes de pirateries, en tant que11 Du point de vue international, cela montre le contraste entre d'une part les vieux pays industriels, asphyxiés par le poids croissant de la crise économique, qui ont été forcés de réduire ou de geler leurs dépenses militaires et, d'autre part tous les pays émergents en Asie qui accroissent leurs budgets d’armement. Selon les dernières données fournies par le SIPRI, les 5 plus grands importateurs d’armes en 2007-2011 sont tous des États asiatiques. L’Inde est celle qui reçoit le plus d’armes dans le monde, représentant 10 % du total des armes importées, suivie par la Corée (6 %), le Pakistan (5 %), la Chine (5 %) et Singapour (4 %). 30 % du volume des importations internationales d’armes sont à destination de ces cinq pays, selon le SIPRI. Cette constitution simultanée d’un armement moderne dans la région du Pacifique asiatique et dans l’Asie du Sud-est se fait à une échelle et à une vitesse jamais vues depuis la course aux armements de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union Soviétique.
Alors que les tensions grandissent en Asie orientale et en Asie du Sud Est, l’escalade récente des tensions au Moyen Orient fait que, très vraisemblablement, toute aggravation des conflits au Moyen-Orient et dans la région va avoir des répercussions importantes sur les constellations impérialistes en Asie.
1 La partition a été une des plus grandes opérations de l’histoire de purification ethnique, déplaçant jusqu’à 10 millions de personnes et faisant jusqu’à un million de morts.
3 Le Mouvement des Non-Alignés a été fondé en 1961 à Belgrade, par les dirigeants de la Yougoslavie, l’Egypte, l’Inde et l’Indonésie. Il essayait de créer un espace entre les deux blocs en jouant l’un contre l’autre. Sa marge de manœuvre peut être évaluée d’après le fait que le Cuba de Castro – à l’époque dépendant de la Russie pour sa survie – en était aussi un membre.
6 Source : https://www.defense [41] industrydaily.com/indian-army-wants-to-add-another-1000-190-tanks-by-2020-updated-02697/
7 Voir : https://www.globalresearch.ca/geo-strategic-chessboard-war-between-india... [42], Geostrategic chessboard : War between India and China ? by Mahdi Darius Nazemroaya, October 2009.
8 Stokholm International Peace Research Institute, https://www.sipri.org.media/pressreleases/rise-in-international-arms-tra... [43]
Géographique:
- Inde [20]
Le point chaud le plus ancien et le danger de contagion en Orient
- 839 lectures
Pendant les soixante dernières années, le Moyen-Orient a été le théâtre de conflits et de guerres sans fin (Israël-Palestine, Afghanistan, Irak, Iran et maintenant la Syrie). Jusqu’à récemment, l’Asie de l’Est et du Sud-Est n’avait jamais été fortement impliquée dans ces conflits. Mais les rivalités entre les plus grandes puissances asiatiques et les antagonismes entre la Chine et les États-Unis se font de plus en plus sentir également dans les différents conflits au Moyen Orient.
Le Pakistan est courtisé à la fois par les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont besoin du Pakistan pour contrer les différentes variétés de terrorisme qui opèrent dans ce pays et en Afghanistan. Cependant, les factions de la classe dominante au Pakistan ne veulent pas toutes être soumises aux États-Unis. L’engagement du Pakistan dans les guerres américaines déstabilise encore plus le pays (par exemple, les récentes frappes aériennes au Pakistan révèlent la nouvelle stratégie "frapper et tuer", visant les "terroristes" et qui embrasent des régions encore plus grandes du pays). Cette déstabilisation œuvre de plusieurs façons contre la Chine qui, elle, veut un Pakistan fort contre l’Inde.
En ce qui concerne l’Afghanistan, l’Inde a participé aux côtés des forces dirigées par les américains à la mise en place d’un "dispositif de sécurité" en Afghanistan, sous les yeux méfiants de la Chine. Beijing a, de son côté, signé des contrats économiques majeurs avec Kaboul.
L’aggravation du conflit autour de l’Iran a de grandes implications sur les rivalités en Asie. Alors que l’Iran jusqu’en 1978-79 était un avant-poste important du bloc américain contre la Russie, une fois le régime du Shah explosé et le pouvoir pris par les Mollahs, un fort anti-américanisme s’est développé. Plus l’hégémonie américaine faiblissait, plus l’Iran pouvait prétendre être une puissance régionale. Le défi iranien vis-à-vis des États-Unis devait inévitablement recevoir le soutien de la Chine. Au niveau économique, la Chine a bénéficié de l’espace laissé vacant par les sanctions imposées à l’Iran : elle est maintenant le plus grand partenaire commercial de l’Iran. Alors que Beijing s’engage de plus en plus économiquement avec l’Iran, la présence de l’Inde diminue. Elle craint d’être marginalisée en Iran au profit de la Chine, alors même que 12 % de sa consommation de Pétrole est importé d’Iran (le deuxième plus grand fournisseur après l’Arabie Saoudite) elle.
Bien que l’Iran chiite et l’Arabie saoudite sunnite soient des ennemis jurés, et malgré le soutien de la Chine au régime de Téhéran, la Chine a signé un pacte de coopération sur l’énergie nucléaire civile avec l’Arabie Saoudite, un pays qui fournit presque un cinquième de son pétrole à la Chine. La Chine est contrainte d’éviter les antagonismes avec ses fournisseurs importants de pétrole. C’est une expression de la pratique diplomatique versatile chinoise dans la région, qui consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quels que soient les antagonismes existant les différents "partenaires". La démarche de la Chine pour maintenir un équilibre dans ses liens avec l’Iran et les États arabes du Golfe, limite les choix économiques et militaires de l’Inde, parce que les saoudiens ont aussi établi des liens spéciaux avec le Pakistan, dont ils ont financé et encouragé le programme nucléaire pendant des années. Il est plausible que le Pakistan puisse secrètement transférer la technologie nucléaire à l’Arabie Saoudite –ce qui doit être vu comme une grande menace pour l’Iran et l’Inde. Cependant, d’autres facteurs rendent la constellation encore plus compliquée et contradictoire1
L’Iran a beaucoup d’ennemis dans la région. Par exemple, l’Arabie Saoudite, lourdement armée (qui projette d’acheter 600-800 tanks allemands et qui a signé récemment un contrat gigantesque pour 130 avions de combat avec les États-Unis)2, et l’Irak, contre qui il a mené une guerre pendant 8 ans dans les années 1980. Israël se sent vulnérable face à une attaque de missiles (nucléaires ?) iraniens et fait fortement pression sur les États-Unis pour frapper militairement les supposés sites nucléaires. Toute escalade autour de l’Iran va donc vraisemblablement créer de grands bouleversements entre les rivaux de l’Iran et ses défenseurs.
Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, tout conflit au Moyen Orient favorise le retour sur la scène de l’ex-leader de bloc, la Russie. En se liguant avec la Chine, la Russie s’oppose fortement à toute intervention militaire contre l’Iran, et fait tout ce qu’elle peut pour saper la stratégie américaine. La Chine et la Russie, toutes deux, doivent protéger l’Iran de la pression américaine, parce que si le régime de Téhéran tombait, cela renforcerait la position américaine au Moyen Orient et non seulement menacerait, la fourniture de pétrole à la Chine, mais encore affaiblirait la présence stratégique tant de la Russie et que de la Chine dans la région.
Le blocage de la situation impérialiste en Syrie pendant l’été 2012 ne peut se comprendre sans prendre en compte les manœuvres secrètes et la présence non dissimulée de la Chine, de la Russie et de l’Iran dans le conflit. Sans le soutien de ces trois puissances, les pays occidentaux –malgré leurs différences et d’autres facteurs qui les font hésiter– auraient pu être tentées d’intervenir militairement beaucoup plus rapidement.
Les liens chaotiques et contradictoires résultant des rivalités impérialistes au Moyen-Orient, où les conflits entre la puissance régionale, l’Iran, (appuyé par la Chine et la Russie) et les États-Unis (appuyés par Israël, l’Inde, l’Arabie Saoudite), de même que les tensions croissantes entre les puissances rivales locales auront des conséquences imprévisibles, non seulement sur les rivalités entre l’Inde et la Chine, mais à l'échelle de la planète toute entière.
Alors que les tensions au Moyen-Orient sont au centre de l’arène des rivalités impérialistes depuis plusieurs décennies, les tensions en Extrême-Orient et en Asie du Sud prennent rapidement leur élan. Bien qu’une escalade immédiate des rivalités culminant dans une guerre ouverte en Extrême-Orient ne paraisse pas une perspective immédiate, parce que nous sommes seulement au début de cette course, le renforcement militaire permanent et irréversible fait pressentir pour l'avenir un nouveau niveau de destruction.
Géographique:
- Afghanistan [48]
- Syrie [49]
- Arabie Saoudite [50]
- Pakistan [21]
- Asie [9]
- Moyen Orient [51]
Les conséquences du militarisme
- 1694 lectures
En Asie, ce ne sont pas des puissances secondaires qui se font face mais les deux puissances les plus peuplées du monde : la Chine et l’Inde. En même temps, les plus grandes puissances économiques du monde, les États-Unis et la Chine, qui sont plus dépendantes l’une de l’autre que jamais, au niveau économique et financier, sont engagées dans une course aux armements. La zone de conflits concerne quelques-unes des voies maritimes les plus importantes du monde et il y a le risque, à long terme, d’un embrasement de l’Extrême-Orient jusqu’au Moyen-Orient, avec des répercussions imprévisibles sur toute l’économie mondiale. Alors qu'à l'occasion de la Première Guerre mondiale, les principales batailles avaient pris place en Europe et seulement très marginalement en Asie, un siècle plus tard, aujourd’hui, toute l’Asie avec ses deux océans et ses voies maritimes cruciales, s’est engouffrée dans la spirale mortelle. La capacité de destruction atteinte éclipse la puissance des bombes atomiques jetées sur Hiroshima et Nagasaki. Plus de 60 ans plus tard, en plus des États-Unis, une demi-douzaine de pays dans la région ont des armes nucléaires ou cherchent à en avoir : la Chine, l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, l’Iran, la Russie1.
Les États-Unis, la seule superpuissance restante dans le monde, se sentent très menacés par l’émergence de la Chine. Ceci les a forcé à réorienter leur stratégie militaire. Alors que jusqu’à maintenant 40 % de la flotte américaine opérait dans l’Océan Atlantique, Washington projette de déployer 60 % de la flotte américaine en Asie. La récente décision du président Obama de faire "pivoter" la puissance américaine vers l’Orient a conduit au redéploiement de 60 % de la flotte américaine dans le Pacifique. Les États-Unis doivent nécessairement faire tout ce qui est en leur pouvoir pour encercler la Chine et donc s’adapter en conséquence au niveau militaire. Dans un certain sens, cette confrontation est une question de vie ou de mort pour les États-Unis.2
En mars 1946, Winston Churchill a fait son fameux discours sur le "rideau de fer" en décrivant la domination soviétique en Europe de l’Est : l’expression est entrée dans le langage commun durant les 43 années qui ont suivi, jusqu’à l’effondrement en 1989 du bloc formé autour de l’URSS. Un mois seulement avant (février 1946), George Kennan (basé à l’ambassade américaine à Moscou) faisait ses propositions de "containment" de l’URSS –propositions qui allaient constituer la base de la politique américaines vis-à-vis de l’impérialisme russe. Ces deux moments clefs illustrent une caractéristique importante de l’impérialisme dans le capitalisme décadent, à savoir la formation de blocs impérialistes qui est basée dans une grande mesure pas tant sur des intérêts communs que sur une peur commune de la menace du rival. Le bloc des Alliés, qui s’est confronté à l’Axe germano-italo-japonais n’a réellement commencé à exister qu’en 1941 –l’année où Roosevelt a signé l’accord Lend-Lease qui garantissait la fourniture d’armes à la Grande-Bretagne, et où la Russie entrait en guerre à la suite de son invasion par l’Allemagne (Opération Barbarossa) et l’ouverture de la guerre dans le Pacifique à la suite de l’attaque de Pearl Harbour par le Japon.
Le bloc Allié n’a duré que 11 ans et a fini d’exister avec l’anéantissement de l’Allemagne nazie et de l’Axe, alors que ce qui devenait à l'ordre du jour était une nouvelle confrontation entre un bloc russe basé sur l’occupation militaire de ses voisins (renforcée par une invasion quand nécessaire : Hongrie 1956, Tchécoslovaquie 1968) et un bloc américain essentiellement basé sur la crainte commune de l’URSS. Quand la désintégration de l’URSS a mis fin à la guerre froide avec une claire victoire de l'impérialisme américain, le ciment qui avait assuré la cohésion du bloc américain a disparu et ce dernier s’est disloqué.
Les États-Unis restent la puissance dominante de manière écrasante dans le monde, avec un budget militaire global plus grand que celui des dix plus grandes puissances combinés (45 % des dépenses militaires mondiales). Néanmoins, la montée en puissance régionale de la Chine représente une réelle menace potentielle pour ses voisins : le facteur "peur commune" est plus fort que les vieilles inimitiés et pousse à des séries d’alliances et de rapprochements visant à limiter la puissance chinois3. En clair, il y a deux pôles puissants dans la région –la Chine et les États-Unis– et les autres pays tendent à graviter autour de ces pôles.
Certaines de ces alliances sont apparemment stables : l’alliance de la Chine avec le Pakistan et la Corée du Nord, le regroupement Inde-Japon-États-Unis. En dehors de cela, il y a un paysage changeant de rivalités régionales : le Vietnam et les Philippines craignent la Chine mais ont leurs propres conflits territoriaux dans la Mer de Chine méridionale ; le Cambodge a une histoire compliquée de conflits avec le Vietnam. L’Indonésie a peur des ingérances australiennes depuis l’indépendance du Timor Oriental ; le Sri Lanka et le Bangladesh ont des raisons de craindre une Inde super puissante, et ainsi de suite. L’alliance de la Russie avec la Chine dans sa confrontation avec les États-Unis à propos de la Syrie et de l’Iran, de la Corée du Nord, est essentiellement une opportunité essentiellement régionale4.
 Ce à quoi nous avons affaire aujourd’hui, ce n’est donc pas la formation imminente d’un nouveau système de blocs impérialistes mais plutôt l’émergence de certaines des mêmes tendances stratégiques et politiques qui avaient conduit à la formation des anciens blocs militaires. Il y a cependant une différence majeure. Les blocs, dans le système précédent étaient en grande partie en autarcie les uns par rapport les autres, (le commerce entre le COMECON et les pays de l’OCDE, ou entre la Chine sous Mao et le reste du monde, était insignifiant). La Chine et les États-Unis, et bien sur tous les pays de l’Asie du Sud Est, sont au contraire liés les uns aux autres par de puissants rapports et intérêts commerciaux et financiers.
Ce à quoi nous avons affaire aujourd’hui, ce n’est donc pas la formation imminente d’un nouveau système de blocs impérialistes mais plutôt l’émergence de certaines des mêmes tendances stratégiques et politiques qui avaient conduit à la formation des anciens blocs militaires. Il y a cependant une différence majeure. Les blocs, dans le système précédent étaient en grande partie en autarcie les uns par rapport les autres, (le commerce entre le COMECON et les pays de l’OCDE, ou entre la Chine sous Mao et le reste du monde, était insignifiant). La Chine et les États-Unis, et bien sur tous les pays de l’Asie du Sud Est, sont au contraire liés les uns aux autres par de puissants rapports et intérêts commerciaux et financiers.
Parmi toutes ces dépendances, celles entre la Chine et les États-Unis sont les plus fortes. La Chine détient plus d’obligations américaines que n’importe quel pays dans le monde (1,15 milliards de dollars), situation grâce à laquelle le capital américain a été capable de financer son déficit budgétaire astronomique, lui permettant ainsi de repousser les effets de la crise et bien sûr de financer son appareil militaire. En même temps, la Chine a besoin des États-Unis en tant que marché pour l’exportation de ses marchandises. Et pourtant les deux pays se considèrent l’un l’autre comme les principaux rivaux du monde, nécessitant qu'ils se mobilisent l'un contre l'autre. Les pays côtiers de la Mer de Chine du Sud dépendent tous de la Chine en tant que marché pour leurs produits et des investissements chinois dans leur économie, et la Chine a besoin tout autant de ces pays comme fournisseurs de matière première et comme marché.
Il est sûrement absurde d’imaginer que des pays aussi dépendants les uns des autres s’engagent dans une confrontation militaire qui nuirait autant à leurs propres intérêts.
De telles idées ne sont pas nouvelles, d’ailleurs elles datent du début du 20ème siècle quand le danger d’une confrontation impérialiste était une question immédiate et brûlante. Sans son étude de l’impérialisme de 1902, l’économiste anglais John Hobson dénonçait l’impérialisme comme étant le fruit de la domination économique du capital financier et pensait que le développement d’une véritable et vigoureuse démocratie pouvait agir comme antidote à ses dangers. En 1909, le futur prix Nobel, Norman Angell, un autre économiste britannique, publiait Europe’s optical illusion (L’illusion d’optique de l’Europe) dans lequel il démontrait que l’interdépendance économique des puissances européennes faisait que la guerre impérialiste entraînerait une ruine mutuelle, et était donc une entreprise irrationnelle.
Hobson et Angell posaient en effet la question d’un possible impérialisme "pacifique" ou d’un capitalisme débarrassé de ses défauts impérialistes. Des conceptions similaires ont fait leur chemin dans le mouvement ouvrier avant 1914 : Kautsky imaginait l’émergence d’une alliance générale "super impérialiste" des grandes puissances, dont les prémisses, pensait-il, pouvaient se trouver dans la coopération entre les puissances européennes (avec le Japon et les États-Unis) pour écraser la rébellion des Boxers en Chine.
Lénine répond sans ménagement à Kautsky et Hobson dans "L’impérialisme, stade suprême du capitalisme" : Aussi, les alliances "inter-impérialistes" ou "ultra-impérialistes" dans la réalité capitaliste (…) quelles que soient les formes de ces alliances, qu'il s'agisse d'une coalition impérialiste dressée contre une autre, ou d'une union générale embrassant toutes les puissances impérialistes, que des "trêves" entre des guerres. Les alliances pacifiques préparent les guerres et, à leur tour, naissent de la guerre; elles se conditionnent les unes les autres, engendrant des alternatives de lutte pacifique et de lutte non pacifique sur une seule et même base, celle des liens et des rapports impérialistes de l'économie mondiale et de la politique mondiale"5 Dans un certain sens, Lénine et Angell avaient cependant une vision correcte : Angell montrait que la guerre dans l’économie capitaliste avancée ne pouvait mener qu’à la catastrophe alors que Lénine (comme Luxembourg l’avait fait avant lui) démontrait que le conflit impérialiste était malgré tout inhérent au capitalisme "à l’agonie" (pour employer l’expression de Lénine).
La situation en Asie du Sud-Est offre une illustration frappante de cette double réalité. Les plus petits pays de la région dépendent tous économiquement les uns des autres et de la Chine et cependant tous voient dans leur grand voisin, la Chine, une menace majeure et dépensent des sommes d’argent pharamineuses pour s’armer contre elle ! Pourquoi la Chine suscite-t-elle cet antagonisme de tous ces pays à son égard bien qu’elle soit dépendante d’eux économiquement et financièrement ? Pourquoi tant de bourgeoisies nationales se tournent vers les États-Unis en quête "d’aide", sachant qu’elles courent le risque d’un chantage de la part de ce pays ? Cela nous amène à la question plus profonde de pourquoi une dérive permanente vers le militarisme ? La question militaire "s’impose" d’elle-même –apparemment même contre la volonté de certaines factions de la classe dominante de ces pays.
Le fond du problème est que l’émergence économique d’un pays doit nécessairement s’accompagner d’une puissance militaire. Une simple compétitivité économique, aussi grande soit-elle, n’est pas suffisante à long terme. Chaque pays doit avoir accès à des matières premières, bénéficier des meilleurs flux de marchandises, c'est-à-dire assurer la libre circulation de ses voies maritimes et autres moyens de transport. Aucun pays, qu’il soit "déclinant" ou "émergent", qu'il soit un "perdant" ou un "gagnant" ne peut échapper à cette tendance inhérente au capitalisme.
Quand le capitalisme était encore dans sa phase ascendante, en expansion sur tout le globe terrestre, cette situation pouvait mener à des tensions, voire à des conflits (entre la Grande-Bretagne et la France pendant la guerre américaine d’indépendance ou en Inde par exemple6. Aujourd’hui, la situation est très différente : la planète toute entière est morcelée entre les différentes puissances impérialistes, grandes et petites, et la montée d’une puissance ne peut se faire qu’aux dépens d’une autre –il n’y a pas de situation "tout le monde est gagnant"
Ce n’est pas vrai seulement au niveau de la prospérité économique et de l’équipement militaire. L’activité humaine est aussi déterminée par des facteurs moins tangibles –qui n’en font pas pour autant moins partie de la base matérielle. Dans les affaires internationales, le prestige national est aussi important que la possession d’une puissance militaire, car le prestige d’une nation rend la force de sa menace convaincante, lui donnant le pouvoir (pour utiliser une expression favorite de la diplomatie britannique) de "boxer dans une catégorie supérieure à la sienne propre". L’empire byzantin a survécu longtemps après le déclin de sa puissance militaire, en partie grâce au prestige de sa richesse et au nom de Rome. Plus près de nous, d’abord les bolcheviks et ensuite –après la défaite de la révolution russe– les gouvernants staliniens de l’URSS, ont énormément surestimé la puissance de l’empire britannique gravement affaibli par la Première Guerre mondiale. Même à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont pensé pendant un moment qu’ils pouvaient laisser les armées anglaises défendre le front contre l’URSS en Europe, tel était le pouvoir persistant du mythe impérial britannique. 7
La capacité de faire de grandes manifestations extravagantes est cruciale pour le prestige –d’où les dépenses colossales d’au moins 16 milliards de dollars pour les Jeux Olympiques de 2008 à Beijin8. Plus importante malgré tout est la capacité à exercer une domination militaire, spécialement dans sa propre zone immédiate.
Ainsi, au commencement de l’époque impérialiste, çà a été la puissance montante , l’Allemagne, qui a commencé à défier l’impérialisme britannique dominant en mettant en œuvre (en 1889) un plan ambitieux d’expansion navale destiné explicitement à concurrencer la puissance de la Flotte Royale. C’était, et ce ne pouvait être perçu par la Grande-Bretagne que comme une menace mortelle sur ses voies maritimes et son commerce, dont le pays était et est complètement dépendant.
Le parallèle avec la situation d’aujourd’hui est frappant, jusque dans les protestations des puissances impérialistes quant à leurs intentions pacifiques. Le Chancelier von Bülow parlait ainsi en 1900 : "J’ai expliqué (…) que j’entends par une politique mondiale simplement le soutien et la mise en œuvre des tâches issues de l’expansion de notre industrie, de notre commerce, de la puissance de travail, de l’activité et de l’intelligence de notre peuple. Nous n’avions aucune intention de mener une politique d’expansion agressive. Nous voulions seulement protéger les intérêts vitaux que nous avons acquis dans le monde dans le cours naturel des événements"9. Et maintenant, c’est Hu Jin Tao en 2007 : "le gouvernement et le peuple chinois voudront toujours brandir le drapeau de la paix, du développement et de la coopération, développer une politique étrangère indépendante pour la paix, la sauvegarde des intérêts chinois en termes de souveraineté, sécurité et développement, et défendre ses buts en politique étrangère de maintenir la paix mondiale et de promouvoir un développement commun (…) La Chine s’oppose au terrorisme, à l’hégémonisme et aux politiques de pouvoir sous quelque forme que ce soit, et ne s’engage pas dans la course aux armements ou ne représente une menace militaire pour d’autres pays, et ne cherchera jamais l’hégémonie ni ne s’engagera dans l’expansion10.
Comme nous l’avons montré dans cet article, la Chine s’est engagée dans un vaste programme de réarmement et d’expansion de sa flotte avec le but de dominer son "chapelet d’îles intérieures". Malgré toutes les protestations des dirigeants chinois, cette politique menace inévitablement l’ensemble des positions américaines dans le Pacifique et met en danger, non seulement le transport maritime et le commerce des États-Unis, mais aussi leur prestige et leur crédibilité, en tant qu’allié de pays du Sud-Est asiatique qui se sentent aussi menacés par la montée de la Chine, en particulier le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam et les Philippines. Que les États-Unis soient conscients de cette menace, la "réorientation" par Obama de la puissance militaire américaine vers le Pacifique le démontre clairement. Presque 100 ans après la Première Guerre mondiale, le capitalisme n’a pas changé de nature : la compétition capitaliste dans la phase décadente représente plus que jamais une menace mortelle pour la survie de l’humanité. La responsabilité de la classe ouvrière mondiale, la seule puissance capable d’arrêter la guerre impérialiste n’a jamais été aussi grande11.
Dv/Jens, novembre 2012
2 Voir Le Monde Diplomatique, mars 2012, Michael Klare
3 Le cas du Vietnam illustre la tendance : le Vietnam, qui a été colonisé par la France et a subi les tapis de bombes de toutes sortes des États-Unis pendant plus d’une décennie, confronté au nouveau géant, la Chine, a commencé à chercher du soutien auprès des États-Unis et a, par exemple, ouvert son port à Cam Ranh Bay aux navires étrangers, poussant d’autres pays (en particulier les États-Unis, l’Inde, le Japon) à développer plus de muscles contre la Chine. L’histoire d’amour soudaine de la Junte au pouvoir au Myanmar avec la « démocratie », après des années passées sous l’aile de la Chine, peut aussi être vue comme une tentative de conquérir le soutien américain et occidental contre son voisin superpuissant.
4 Les différents regroupements autour de la Chine et des États-Unis, à la différence du vieux système des blocs, restent pour le moment en grande partie une affaire régionale, malgré les intérêts de la Chine en Afrique et au Moyen-Orient et la nervosité des puissances européennes confrontées à l’ours russe.
5 Chapitre "La critique de l'impérialisme". https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1916/vlimperi/vlimp.htm [52]
6 On pourrait penser que les guerres napoléoniennes, qui ont duré pendant 20 ans, sont en contradiction avec cela. Cependant, ces dernières doivent plutôt être vues probablement comme une continuation de la révolution française et du renversement révolutionnaire du féodalisme en Europe, plutôt que comme une guerre entre puissances capitalistes, même si elles en contiennent inévitablement quelques aspects.
7 Nous avons déjà soulevé ce point dans un article sur le programme spatial Apollo (https://en.internationalism.org/icconline/2009/10/apollo-11-lunar-landing [53])
8 Ce n’est pas nouveau : on pourrait faire remonter une « histoire du prestige » au moins aussi loin qu’aux cérémonies de potlatch des tribus indiennes nord-américaines, sinon plus loin encore.
9 Cité dans EJ Hobshawn, L’Age de l’Empire, éditions Cardinal, p. 302
10 Cité par Xinhua : https://news.xinhuanet.com/english/2007-10/15/content_6884160.htm [54]
11 Une analyse de la lutte de classe en Chine est en dehors du sujet de cet article, mais nous pouvons dire que la classe dominante chinoise est consciente de la menace qui vient "d’en bas" : le budget pour la sécurité intérieure de la Chine a récemment dépassé, pour la première fois, les dépenses militaires lorsque Beijing a intensifié la surveillance et la répression. En 2012, la Chine dépense 111,4 milliards de dollars pour la sécurité publique, ce qui inclut la police et les forces sécuritaires d’État – une somme qui officiellement excède même le budget de la défense. Voir https://www.reuters.com/articles/2012/03/05/us-china-parliament-security... [55].