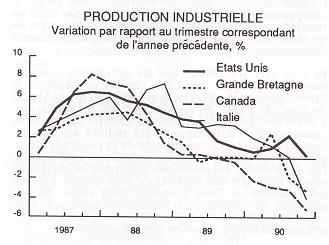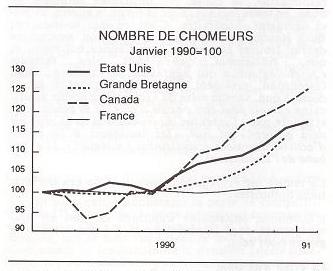Revue Internationale no 65 - 2e trimestre 1991
- 2655 lectures
Guerre du Golfe : massacres et chaos capitalistes
- 2666 lectures
Seule la classe ouvrière Internationale peut Instaurer un véritable nouvel ordre mondial
Au moment où nous mettons sous presse, la guerre du Golfe est officiellement terminée. Elle a été rapide, bien plus rapide que les états-majors ne le laissaient prévoir ou peut-être même ne l'escomptaient. L'article éditorial qui suit a été écrit au début de l'offensive terrestre de la coalition américaine contre l'Irak, il est donc daté, cependant, la dénonciation qu'il contient de la boucherie qu'a représentée cette guerre est toujours d'actualité. L'introduction reprend en quoi les positions politiques et les analyses qui y sont défendues sont confirmées dès les premiers jours de I'« après-guerre ».
Introduction
Fin de la guerre du Golfe : les USA, « gendarme du monde »
La fin de la guerre est venue confirmer les véritables objectifs de la bourgeoisie américaine : la démonstration de son énorme supériorité militaire vis-à-vis, non seulement des pays périphériques, tel l'Irak, que l'impasse économique risque de plus en plus de pousser vers des aventures militaires, mais aussi et surtout vis-à-vis des autres puissances du monde, et particulièrement celles qui constituaient le bloc occidental : le Japon et les grands pays européens.
La disparition du bloc de l'Est, en faisant disparaître, pour ces/puissances, le besoin du « parapluie » militaire américain, portait avec elle la disparition du bloc occidental lui-même et la tendance vers la reconstitution d'un nouveau bloc impérialiste. L'effacement complet, au cours de la guerre, des deux seuls candidats sérieux au « leadership » d'un tel nouveau bloc éventuel, l'Allemagne et le Japon, la mise en évidence de leur impuissance militaire constituent un avertissement pour l'avenir : quel que soit le dynamisme économique de ces pays (en réalité, leur capacité à mieux résister à la crise que leurs rivaux), les USA ne sont nullement disposés a les laisser piétiner leurs plates-bandes. De même, toutes les petites velléités de la France « d'affirmer sa différence » (voir l'éditorial de la Revue Internationale, n° 64) jusqu'à la veille du 17 janvier, se sont volatilisées dès que les USA ont réussi à imposer LEUR « solution » à la crise : l'écrasement militaire de l'Irak. Aujourd'hui, la bourgeoisie française en est réduite à frétiller de la queue comme un petit caniche lorsque Schwarzkopf félicite les troupes françaises pour leur « absolutely superb job » et que Bush reçoit Mitterrand en lui prodiguant des amabilités. Quant à la Communauté européenne, que certains présentaient comme le futur grand rival des USA, elle a été parfaitement inexistante tout au long de la guerre. En somme, s'il était encore nécessaire d'identifier les véritables objectifs des USA eh rendant cette guerre inévitable et en la menant, ses résultats sont la pour mettre en évidence ces objectifs.
Une « victoire à la Pyrrhus »
De même, avec la fin des combats est apparu très vite ce que nous annoncions dès le début du conflit (voir Revue Internationale, n° 63) : à la guerre ne succédera pas la paix, mais le chaos et encore la guerre. Chaos et guerre en Irak même comme l'illustrent tragiquement les affrontements et les massacres dans les villes du sud ainsi qu'au Kurdistan. Chaos, guerre et désordres dans toute la région : Liban, Israël et les territoires occupés. Bref, la glorieuse victoire des « alliés », l'instauration du « nouvel ordre mondial » que l'on veut mettre en oeuvre, donnent leurs premiers fruits : le désordre, la misère et les massacres pour les populations, les guerres qui couvent. Le nouvel ordre mondial ? D’ores et déjà c'est une instabilité encore plus grande dans tout le Moyen-Orient !
Et cette instabilité n'est pas prête à se limiter à cette région. La fin de la guerre contre l'Irak n'ouvre pas la perspective d'une baisse des tensions entre grandes puissances impérialistes. Bien au contraire. Ainsi, les différentes bourgeoisies européennes se préoccupent toutes déjà de la nécessité d’adapter, moderniser et renforcer leurs armements. Ce n'est sûrement pas en vue d'une « nouvelle ère de paix ». En outre, on commence à voir des pays comme le Japon, l'Allemagne et même l'Italie, revendiquer une réévaluation de leur statut international, par leur entrée au Conseil de Sécurité de l'ONU comme membres permanents. Ainsi, les USA, s'ils ont réussi avec la guerre à administrer la preuve de leur énorme supériorité militaire, s'ils sont parvenus, de ce fait, à ralentir pour un temps la tendance au chacun pour soi, ont remporté en réalité une victoire à la Pyrrhus. L'exacerbation des tensions impérialistes et l'engloutissement de la planète dans un chaos croissant sont inévitables, au même titre que l'aggravation de la crise économique qui se trouve à leur origine. Et il faudra encore bien d'autres « punitions » comme celle infligée à l'Irak, bien d'autres « exemples » sous forme de monstrueux massacres pour « garantir le droit et l'ordre ».
Le « nouvel ordre mondial » : ,
Misère, famines, barbarie, guerres
Il y a encore un an, après la chute du mur de Berlin, la bourgeoisie, les gouvernements, les médias, nous ont clamé triomphalement que le capitalisme «libéral» avait gagné, qu'une ère de paix et de prospérité s'ouvrait avec la disparition du bloc impérialiste de l'Est et l'ouverture des marchés de ces pays. Ces mensonges ont été anéantis : à la place clés marchés de l'Est, se trouvent des économies ravagées et le chaos; à la place de la prospérité retrouvée, se développe la récession mondiale à partir des USA. A la place de la paix, nous avons eu l'intervention sanglante de la force militaire la plus gigantesque depuis la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, toujours aussi triomphalement, les secteurs dominants de la bourgeoisie internationale nous affirment qu'avec la défaite de l'Irak, l'instauration d'un « nouvel ordre mondial » est maintenant une chose acquise : la paix sera atteinte, la stabilité internationale gagnée. Le mensonge ne pourra que tomber à son tour.
La conclusion rapide de la guerre, le faible nombre de tués du côté des « coalisés », ont permis à la bourgeoisie de plonger momentanément dans le désarroi la classe ouvrière des métropoles capitalistes, celle dont dépend en fin de compte le sort de l'affrontement entre le prolétariat et la bourgeoisie à l'échelle mondiale et historique. Même si beaucoup d'ouvriers ressentent comme une blessure l'extermination de dizaines ou de centaines de milliers d'exploités irakiens, ils se sentent impuissants face à la campagne de triomphalisme chauvin qui, pour un temps, grâce aux mensonges des médias, étourdissent les esprits. Mais l'avenir de misère, de famine, de chaos, de massacres impérialistes toujours plus monstrueux qui est le seul que la classe dominante puisse proposer va nécessairement ouvrir les yeux des masses ouvrières et permettre que leurs combats s'imprègnent de plus en plus de la conscience de la nécessité de renverser ce système. C'est à cette prise de conscience que doivent participer activement les révolutionnaires.
RF, 11/3/91
Editorial
Horreur, barbarie et terreur. Voilà la réalité du capitalisme mise à nu par la guerre contre l'Irak.
Horreur et barbarie. La guerre, la guerre entre gangsters impérialistes, continue. C'est l'heure de l'offensive terrestre des forces de la coalition. Et l'Irak en sortira défait. Des centaines de milliers de morts -on ne sait exactement pour l'instant-, sans doute autant de blessés, de disparus, des destructions massives en Irak, au Koweït seront, et sont déjà, le résultat sanglant et terrible du conflit.
Horreur et cynisme de la bourgeoisie des pays « coalisés ». Sans aucune pudeur, se vautrant dans le sang et en jouissant, elle se vante de ses prouesses techniques dans la guerre. Dans un premier temps, afin d'endormir les réticences à la boucherie, c'était « la guerre propre »: les missiles ne touchaient que des cibles militaires, rentraient par les fenêtres et les cages d'escalier, mais ne tuaient personne, tout au moins parmi les civils. Quelle merveille. Il s'agissait d'une opération « chirurgicale ». Puis la macabre réalité ne put être plus longtemps masquée. Des milliers de civils sont morts sous les bombardements massifs des B52 et des missiles de croisière. Saurons-nous jamais l'effroyable vérité? Comble du cynisme: lorsque l'explosion de l'abri de Bagdad a fait sans doute 400 morts, c'est tout juste si le Pentagone ne désignait pas comme coupables ces civils qui n'auraient pas du se réfugier dans cet abri et se mettre sur le chemin des bombes !
L'admiration sans borne des médias, des journalistes, des spécialistes militaires, à l'égard des prouesses techniques, scientifiques, mises au service de la mort et de la destruction, est absolument écoeurante. Pendant ce temps, le capitalisme est incapable d'enrayer les épidémies de toutes sortes dans le monde, le choléra en Amérique Latine, le SIDA, et combien d'autres encore. La science et la technique sont au service de la mort et de la destruction à une échelle de masse. Voilà la réalité du capitalisme.
La terreur, la terreur capitaliste, la terreur d'une société pourrissante, s'est abattue sur les populations. Terreur à grande échelle sur l'Irak et sur le Koweït. La coalition américaine use des armes les plus sophistiquées, les plus meurtrières, les plus « scientifiques » et massives. Nous ne sommes pas des spécialistes militaires, et reconnaissons-le, ne trouvons aucun goût dans le sinistre décompte. Au bas mot: 100 000 tonnes de bombes ont été larguées, 108 000 sorties aériennes accomplies. Combien de missiles lancés des bateaux de guerre croisant dans 1e Golfe Persique, dans la Méditerranée ? La bourgeoisie américaine et ses alliées n'hésitent pas à utiliser les moyens de destruction les plus massifs -exception faite de l'arme nucléaire, la prochaine fois sans doute - tels que les bombes à souffle et le napalm. En comparaison les exactions, tout aussi horribles, de la soldatesque de Saddam Hussein ne sont que de l'artisanat.
Même au sein des abris, les populations civiles ne sont pas en sécurité. Peut-on imaginer les dégâts, les peurs, la panique, l'angoisse, des enfants, des femmes, des hommes vieux ou jeunes au milieu des bombardements, des explosions - quand Bassorah est touchée, la terre tremble jusqu'en Iran -, des sirènes, et souvent des morts et des blessés lorsqu'on sait que l'aviation US bombardait 24 heures sur 24. Lorsqu'on sait que, la première nuit de guerre, il avait été largué sur l’Irak une fois et demi équivalent de la bombe atomique d'Hiroshima. Lorsqu'on sait qu'au bout d'un mois, l'Irak et le Koweït ont reçu plus de bombes que l'Allemagne durant toute la deuxième guerre mondiale !
Le coût d'un missile « Patriot » est d'un million de dollars US. Le coût d'un avion furtif de 100 millions de dollars. Le coût total de la guerre va très certainement dépasser les 80 milliards de dollars dans les cas de figure les plus minimes. En fait, certainement beaucoup plus, ne serait-ce qu'en prenant en compte les destructions massives de l'Irak, du Koweït, des puits de pétrole. Au bas mot, on parle déjà de 100 milliards de dollars pour chacun des deux pays. Vingt années de travail des prolétaires en Irak viennent d'être anéanties. Est-il besoin de rappeler que la dette de l'Irak avant l'invasion du Koweït était seulement -si l'on peut dire - de 70 milliards ? Nous assistons à un immense gaspillage de biens et de richesses qui partent en fumée.
Pendant ce temps, les trois quarts de l'humanité ne mangent pas à leur faim et vivent dans le dénuement le plus total, et chaque jour plus tragique. Pendant ce temps, 40 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de sous-alimentation dans le monde ! Combien, sans en mourir, en souffrent et en seront marqués de manière irréversible, à vie ?
Les capacités de production sont au service des moyens de destruction et de mort, non au service de l'humanité et de son bien-être. Telle est la réalité sans fard du capitalisme.
La dictature et le totalitarisme du capitalisme
Horreur et mensonges éhontés. Au bombardement de l'Irak, répond le bombardement médiatique, propagandiste, des populations, et spécialement de la classe ouvrière, du monde entier. Les médias apparaissent réellement pour ce qu'ils sont : au service de la bourgeoisie, au service de ses buts de guerre. Depuis le premier jour de celle-ci, du temps de la « guerre propre », la mobilisation et l'enthousiasme des médias sont à vomir. Mais la manipulation des informations et les propos « va-t-en-guerre » des journalistes bourgeois ne devaient pas suffire encore. Les différents Etats capitalistes belligérants, surtout les plus « démocratiques », en premier lieu les USA, ont imposé la censure militaire, tout comme de vulgaires Etats fascistes ou staliniens, afin d'imposer la dictature la plus complète sur les informations et sur «l'opinion publique». Voilà ce qu'il en est de la démocratie bourgeoise tant vantée.
Autre mensonge: il s'agirait d'une guerre pour le respect du Droit international transgressé par la bourgeoisie irakienne. De quel Droit s'agit-il, sinon de celui du plus fort, du droit capitaliste ? C'est soit par intérêt, telles la Syrie, l'Egypte, la Grande-Bretagne, soit par le chantage et les menaces, envers l'URSS, la Chine, la France, etc., que les USA ont obtenu l'accord de l'ONU pour intervenir militairement.
Saddam Hussein a beau jeu de crier au scandale quand il affirme qu'il y a deux poids, deux mesures et que jamais l'ONU, ni bien sûr les USA, n'ont déployé les mêmes forces armées pour qu'Israël respecte les résolutions lui enjoignant de quitter les territoires occupés. La bourgeoisie ne s'embarrasse guère du Droit, de son Droit, du Droit capitaliste, quand celui-ci ne la sert plus directement.
Apres la guerre, ni paix, ni reconstruction : encore la guerre impérialiste
Une fois le conflit déclenché, toute « raison », toute « morale », ont complètement disparu. Les USA veulent mettre à genoux l'Irak, lui infliger des destructions colossales et insurmontables. A n'importe quel prix. Tel est le processus implacable de la guerre impérialiste. La bourgeoisie américaine n'a pas le choix. Pour remplir ses objectifs politiques, pour affirmer sans ambiguïté son hégémonie impérialiste sur le monde, son leadership, elle est contrainte d'aller jusqu'au bout de la guerre en utilisant les énormes moyens de destruction dont elle dispose. Raser l'Irak, raser le Koweït, jusqu'à la capitulation complète, sont les objectifs de la bourgeoisie US. Telles sont ses consignes aux militaires.
Saddam Hussein, dans sa tentative désespérée de s'en sortir, est poussé à l'utilisation sans retenue, sans frein, suicidaire, de tout ce qui lui tombe sous la main: les Scuds, la marée noire dans le Golfe Persique, l'incendie des puits de pétrole pour se protéger des vagues incessantes des bombardiers. Lui non plus, il n'a pas le choix.
Les deux pays, l'Irak et le Koweït, à feu et à sang. Leur principale richesse, le pétrole, flambe et les puits seront certainement dévastés pour un bon moment. C'est tout l'environnement de la région qui est gravement menacé. Les dégâts sont sans doute déjà considérables. Peut-être même en grande partie irréversibles.
Et dans ce bain de sang, nous avons entendu les pleurs mensongers et hypocrites des opposants bourgeois à la guerre. Les pacifistes, les gauchistes qui quant ils ne soutiennent pas ouvertement 1’impérialisme irakien comme le font les trotskistes appellent à manifester « contre la guerre pour le pétrole » et pour la paix. La paix est impossible dans le capitalisme. Elle n'est qu'un moment de préparation a la guerre. Le capitalisme porte en lui la guerre impérialiste. La guerre au Proche-Orient vient encore de le confirmer avec éclat.
Même si le contrôle du pétrole reste important, l'objet central de la guerre n'est pas là. La paralysie depuis le 2 août des puits de pétrole d'Irak et du Koweït, leur embrasement par la suite, n'ont pas vu un renchérissement du baril, mais au contraire sa baisse. Il n'y a aucun risque de pénurie. Il y a surproduction de pétrole comme il y a surproduction généralisée de marchandises, et récession mondiale.
La guerre n'est pas encore finie et que ne voit-on pas déjà ? Les ignobles vautours baptisés « hommes d'affaires » fondre sur les décombres et s'arracher, au titre de la reconstruction, les dépouilles du carnage. Les compagnies anglaises s'indigner de la rapacité de leurs concurrentes américaines. Mener la guerre ensemble est une chose morale et juste, mais business is business. Contre ces nouveaux mensonges, soyons clairs il n'y aura pas de reconstruction qui puisse permettre une reprise de l'économie mondiale. Un pays comme l'Irak était déjà incapable de rembourser sa dette de 70 milliards de dollars avant la guerre. C'est d'ailleurs une des raisons de son aventure tragique. Alors comment, avec quoi, reconstruire? Alors que le capitalisme mondial s'avère impuissant à remettre un tant soit peu en état de fonctionner les économies ruinées des pays de l'ex-bloc capitaliste stalinien.
Tout cela n'est que mensonges et propagande afin de faire passer la guerre et ses sacrifices auprès des populations et, tout particulièrement auprès de la classe ouvrière des pays les plus industrialisés. Afin de présenter des « raisons » de soutenir l'effort de guerre.
Mais de raison pour soutenir cette guerre, comme dans toute guerre impérialiste, pour l'humanité comme un tout il n'y en a pas. Pour le prolétariat comme classe exploitée et révolutionnaire, il y en a encore moins. Ni sur un plan historique, ni économique, ni humanitaire (voir "Le prolétariat face à la guerre", p.14). Ce n'est qu'un massacre de vies humaines, un gaspillage incroyable de moyens techniques et de forces productives, qui disparaissent à jamais. Et au bout, ce n'est pas la « paix» qui apparaît, mais de nouveau la guerre, la guerre impérialiste.
Car, contre tous les mensonges dont on nous abreuve, de paix il n'y en aura pas. Ni au Proche-Orient, ni sur le reste de la planète. Bien au contraire.
La guerre contre l'Irak prépare les guerres de demain
La défaite de l'Irak bien évidemment va marquer une grande victoire des USA. Loin de ses déclarations pacifiques, morales sur le bien et le mal, la bourgeoisie américaine menace en réalité tous ceux qui vont être tentés ou contraints de suivre l'exemple de Saddam Hussein. Les USA sont la première puissance impérialiste mondiale, la seule « super-puissance » depuis l'effondrement de l'URSS. A ce titre, parce que c'est le seul pays qui puisse réellement le faire, ils ne resteront pas sans réaction face à la multiplication des guerres locales, aux remises en cause des frontières, au développement du chacun pour soi entre Etats, au chaos. Tel est l'avertissement. Il en va de leur autorité, de leur hégémonie, d'un « ordre mondial » dont ils sont le principal bénéficiaire. Voilà une des raisons du jusqu’au-boutisme sanglant des USA, de leur volonté délibérée de raser l'Irak, de mener la guerre jusqu'à la reddition complète. Mais cet avertissement ne s'adresse pas qu'aux imitateurs potentiels - ils sont nombreux - de Saddam Hussein. Il y a une autre raison plus fondamentale au jusqu'auboutisme américain.
C'est aussi et surtout un avertissement aux autres grandes puissances, l'Allemagne, le Japon, les pays européens, et dans une moindre mesure l'URSS. La domination impérialiste américaine est toujours d'actualité. Envoyer les forces armées au Proche-Orient, faire la démonstration évidente et meurtrière de leur immense supériorité militaire, entraîner les autres - la France par exemple - dans l'intervention, mener la guerre jusqu'au bout, écraser l'Irak dans le feu et le sang, est l'occasion de renforcer leur « leadership » mondial. Et surtout d'essayer d'éteindre toute velléité de politique indépendante alternative, d'émergence d'un éventuel autre pôle impérialiste concurrent capable de remettre en cause leur domination. Même si ce dernier est hautement improbable dans l'immédiat.
Voilà la raison de leur refus systématique de tous les plans de paix et propositions de négociation menant au retrait de l'Irak, proposés tour à tour par la France le 15 janvier, et par l'URSS avant l'offensive terrestre -à chaque fois soutenus par l'Allemagne, l'Italie... Voilà la raison des réponses à chaque fois plus intransigeantes, des ultimatums chaque fois plus durs, renvoyés à la figure de ceux qui présentaient ces plans de paix.
La guerre, les dizaines de milliers de tonnes de bombes, les centaines de milliers de morts, les destructions innombrables, l'Irak et le Koweït rasés pour que la bourgeoisie américaine affirme et renforce sa domination et son pouvoir impérialistes dans un monde en crise, en guerre, en pleine décomposition. Voilà les véritables buts de la guerre !
C'est par la perspective de la guerre et son déclenchement que la bourgeoisie américaine a réussi tant bien que mal à imposer aux autres puissances la « coalition » derrière ses buts de guerre. A chaque fois que la pression s'est relâchée, Tes tendances centrifuges, a l'opposition aux USA, à l'émergence d'une alternative aux menées guerrières des USA, se sont exprimées (voir Revue internationale, n°64, Editorial). Preuve que ces pays étaient bien conscients du piège et du terrain dans lesquels leur rival impérialiste américain les menait, les enfermait et les rendait impuissants, encore plus affaiblis.
Une fois la guerre finie, les tensions entre les USA et les pays européens, l'Allemagne tout particulièrement, et le Japon, vont se développer inévitablement. Devant la force économique de ces pays, leur montée en puissance, les USA vont être amenés de plus en plus à imposer un corset de fer sur ces antagonismes naissants, à utiliser la force dont ils disposent, c'est-à-dire la force militaire et donc la guerre.
La guerre contre l'Irak est la préparation des autres guerres impérialistes. Non de la paix. D'un côté, l'aggravation de la crise économique et la situation de décomposition, de chaos, dans laquelle s'enfonce le capitalisme, poussent inévitablement à d'autres aventures guerrières de même nature que celle de l'Irak. De l'autre, et dans cette situation, la première puissance impérialiste, face au chaos, face à ces nivaux potentiels, va utiliser de plus en plus sa force militaire et les guerres pour essayer d'imposer son « ordre » et sa domination. Tout pousse à l'accentuation des tensions économiques et guerrières. Tout pousse à la multiplication des guerres impérialistes.
Voilà ce qu'annonce la victoire militaire sanglante de la coalition occidentale.
Cette guerre impérialiste au Proche-Orient, comme toute guerre impérialiste, c'est en premier lieu la classe ouvrière qui la paye, qui en est la victime. De sa vie quand elle est sous 1’uniforme, enrôlée de force sur les terrains de bataille, ou quand elle se trouve tout simplement sous les bombes et les missiles. De sa sueur, de son labeur et de sa misère, quand elle a le « bonheur » de n'être pas directement massacrée.
Marx et Lénine sont morts et enterrés, clamait la bourgeoisie lors de l'effondrement du stalinisme. Pourtant le «Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » de K.Marx est d'une actualité et d'une urgence brûlantes face à la folie nationaliste et guerrière qui s'abat sur l'ensemble de l'humanité.
Oui, le prolétariat international reste bien la seule force, la seule classe sociale qui puisse s'opposer à cette machine chaque fois plus infernale et folle qu'est le capitalisme en décomposition. Elle est la seule force qui puisse mettre à bas cette barbarie et construire une autre société où toute cause de guerre et de misère aura disparu.
Le chemin est encore long. Il faut pourtant s'y engager avec détermination car les échéances dramatiques se rapprochent chaque jour.
Refuser les sacrifices économiques, la logique de la défense de l'économie nationale, est la première des étapes. Refuser l'unité et la discipline nationale, la logique de la guerre impérialiste, refuser la paix sociale, voilà le chemin. Voilà les mots d'ordre que les révolutionnaires doivent lancer.
La crise économique, la guerre commerciale accrue, exacerbent l'impérialisme et la guerre. Crise et guerre sont au capitalisme ce que pile et face sont à la pièce de monnaie. La première, la crise, mène à la guerre. Celle-ci à son tour aggrave la crise. Les deux sont liées. La lutte économique, revendicative, de la classe ouvrière contre les attaques et les sacrifices, et la lutte contre la guerre impérialiste, sont une seule et même lutte: la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière, la lutte pour le communisme.
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !
RL, 2/3/91.
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [1]
Questions théoriques:
- Guerre [2]
Où en est la crise ? : crise économique et militarisme
- 3183 lectures
La guerre dans le Golfe est présentée tour à tour et de manière contradictoire par la bourgeoisie, comme étant à l'origine de la crise et comme étant un moyen de surmonter celle-ci en instaurant un « nouvel ordre mondial » de « prospérité » et de « stabilité ». Ce ne sont là que mensonges destinés à masquer la réalité d'une crise qui se développe depuis plus de vingt ans et s'accélère dramatiquement aujourd'hui. Le résultat de la guerre ne peut être qu'une aggravation de la crise dont les prolétaires du monde entier vont subir les effets.
LA GUERRE PERMANENTE DANS LE CAPITALISME DECADENT
La guerre est indissociable de la vie du capital ([1] [3]). Depuis la seconde guerre mondiale, quasiment aucune année ne s'est écoulée, sans que, dans une partie ou l'autre du monde, ne se fasse entendre le fracas des armes. En général, lorsque la classe dominante a pu parler de période de paix, cela signifiait seulement que les grandes puissances impérialistes n'étaient pas massivement impliquées dans une confrontation directe. Et même cette simple affirmation reste à relativiser : depuis la seconde guerre mondiale on a vu sans discontinuer, la France en Indochine puis la guerre en Algérie, les Etats-Unis en Corée et la guerre du Vietnam, l'affaire de Suez, les guerres israélo-arabes, l'Armée rouge en Afghanistan, la guerre Iran-Irak, les troupes US au Liban et au Panama, et aujourd'hui le Koweït. Autant de conflits où les « grandes puissances » se sont trouvées, peu ou prou, directement impliquées. On peut dénombrer actuellement une douzaine de conflits rien qu'en Afrique. Les multiples guerres depuis 1945 ont fait pratiquement autant de morts que la 2e guerre mondiale.
La réalité de la nature intrinsèquement guerrière du capital a marqué d'une empreinte de plus en plus profonde l'ensemble de son économie. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, s'ils interdisent aux puissances vaincues, l'Allemagne et le Japon, toute politique importante de réarmement, les pays vainqueurs ne relâchent pas pour autant leur effort guerrier. Au contraire, avec la nouvelle rivalité entre F« Est » et l'« Ouest », l'ensemble de l'économie mondiale va être soumise aux nécessités de la course aux armements. Le mode d'organisation « économique » qui apparaît avec la guerre de 1914-1918, et qui s impose durant les années 1930, celui du capitalisme d'Etat, qui met les moyens de l'économie au service du militarisme, n'a cessé de se développer, de se perfectionner depuis cinquante ans.
La situation des deux puissances impérialistes majeures durant les années 1980, les USA et l'URSS, est particulièrement significative.
La première puissance économique du globe, les USA, consacre, durant cette période, environ 6 % de son PNB annuel au budget d'armement. Une telle somme représente en valeur l'équivalent de 7 à 8 fois le PNB annuel de tout le continent africain, et 3 fois et demie celui de toute l'Amérique latine. L'ensemble des industries de pointe dépend des commandes d'armement du Pentagone. Les Boeing, MacDonnell-Douglas, Texas Instruments, General Electric, Chrysler, etc., seraient en faillite s'ils devaient se passer de cette manne, qui sert aussi à les subventionner.
L'ex-grand, l'URSS, n'a pu soutenir son effort d'armement, pour rester au niveau de son grand rival, qu'en y consacrant une part de plus en plus prépondérante de son économie. Alors qu'il y a peu, au début de sa présidence, Gorbatchev prétendait que seulement 7 % du PNB de l'URSS était consacré au budget militaire, en 1989 ses conseillers déclaraient qu en fait, la réalité se situait plus près des 30 % ! Il serait tout à fait erroné de croire que, durant toutes ces années, la Nomenklatura stalinienne a eu le monopole du mensonge à propos de ses dépenses d'armement.
Par définition, les programmes militaires sont soumis au secret et constamment minimisés. Ce qui est vrai pour l'URSS, l'est aussi, même si c'est probablement dans une moindre mesure, pour tous les autres pays. Et si d'un coté, on constate que les commandes de l'armée subventionnent les industries de pointe et orientent la recherche, de l'autre, de nombreux programmes, budgets de recherche et d'équipement « civils » sont en fait utilisés à des fins militaires. Ainsi par exemple, si la France se retrouve aujourd'hui dotée d'un des parcs de centrales atomiques « civiles » les plus importants du monde, c'est d'abord parce que cela correspondait aux besoins de son armée de se doter de plutonium pour sa «force de frappe» nucléaire. Les français ont ainsi financé l'armée même, en payant leur facture d'électricité. Ce n'est pas seulement en URSS que les usines de tracteurs servent à produire des chars d'assaut, ou bien en Irak et en Libye que les usines d'engrais produisent des gaz de combat. Aux USA, 90 % des laboratoires et centres de recherche sont contrôlés et financés plus ou moins directement et discrètement par le Pentagone.
Non seulement la part de la production consacrée aux armes de toutes sortes est partout sous-évaluée, mais surtout, aucun chiffre ne peut traduire la distorsion qualitative que le développement de l'économie de guerre impose à l'ensemble de l'économie : implantation de centres de production en fonction d'impératifs stratégico-militaires plus qu'économiques, orientation de la recherche civile en fonction des besoins des armées aux dépens d'autres nécessités.
Les exemples ne manquent pas, depuis les premières autoroutes construites durant les années 1930 en Allemagne et en Italie, avant tout pour faire passer les chars le plus rapidement possible d'un bout à l'autre du pays, jusqu'au premier ordinateur, l'ENIAC, construit aux USA pour les besoins du Pentagone, dont le centre d'expérimentation nucléaire de Los Alamos est, depuis lors, systématiquement doté du premier exemplaire de l'ordinateur le plus puissant du moment.
La production d'armements est une destruction de richesses
Aujourd'hui, les armes cristallisent le nec plus ultra du perfectionnement technologique. La fabrication de systèmes de destruction sophistiqués est devenue le symbole d'une économie moderne et performante. Pourtant, ces «merveilles» technologiques qui ont montré leur efficacité meurtrière au Moyen-Orient ne sont, du point de vue de la production, de l'économie, qu'un gigantesque gaspillage.
Les armes, contrairement à la plupart des autres marchandises; ont ceci de particulier qu'une fois produites elles sont éjectées du cycle productif du capital. En effet, elles ne peuvent servir ni à élargir ni à remplacer le capital constant (contrairement aux machines par exemple), ni à renouveler la force de travail des ouvriers qui mettent en oeuvre ce capital constant. Non seulement les armes ne servent qu'à détruire, mais elles sont déjà en elles-mêmes une destruction de capital, une stérilisation de la richesse.
Lorsque les USA, par exemple, annoncent que le budget de la défense représente 6 % du PNB, cela, signifie en fait que 6% de la richesse produite annuellement est détruite. Ces 6 % doivent donc être retirés de la richesse globale, ce qui signifie que la production militaire doit être soustraite de la croissance annuelle et non y être ajoutée comme le font les économistes.
La réalité de la ponction stérilisatrice de l'économie de guerre sur l'appareil productif se trouve parfaitement illustrée par l'évolution économique des grandes puissances ces dernières années. L'exemple de l'URSS est lumineux : loin de dynamiser l'économie, le sacrifice de celle-ci aux besoins de l'Armée rouge s'est traduit par un délabrement de plus en plus dramatique de r appareil productif. Alors que, pour ses besoins impérialistes, PURSS a développé une indus-\ trie aérospatiale de pointe, dans le même temps, faute d'investissements, la production agricole, exemple parmi tous les autres, a stagné. L'ancien grenier à blé de l'Europe doit aujourd'hui importer des céréales pour éviter la famine. L'économie russe s'est finalement effondrée essentiellement sous le poids de son économie de guerre monstrueuse.
Ce qui est vrai pour l'URSS, l'est pour les USA, même si c'est évidemment de manière moins spectaculaire. Il suffît pour cela de constater la perte de compétitivité des USA vis-à-vis de leurs principaux concurrents économiques que sont l'Allemagne et le Japon. Ces derniers, qui se sont vus interdire toute politique de réarmement au lendemain de la dernière guerre mondiale, ont donc subi une ponction relativement faible sur leur économie, pour 1’entretien de leurs armées. Il ne faut pas chercher ailleurs, même si elle n'est pas la seule, la raison principale des records de productivité atteints par ces pays.
Dans ces conditions, pourquoi entretenir une armée, si le résultat en est finalement un affaiblissement de tout l'appareil productif ?
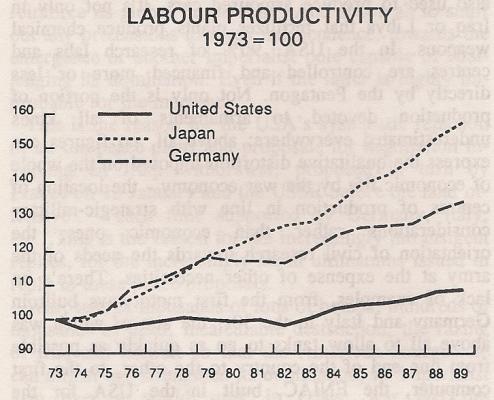
La crise pousse le capital a la fuite en avant dans la guerre
Du strict point de vue économique, la production d'armements est en effet une aberration. Cependant, la production n'est pas tout. Bien sûr, il s'agit pour chaque capital national de s'assurer des sources d'approvisionnement stables en matières premières, et des débouchés rentables pour écouler les produits de ses industries, afin de réaliser la plus-value qu'ils contiennent. Mais ces intérêts économiques s'insèrent dans la géostratégie globale de l'impérialisme qui est déterminante et impose ses propres objectifs.
Depuis le début du siècle, alors que l'ensemble des marchés de la planète sont contrôlés par l'une ou l'autre des grandes puissances, les pays les plus mal lotis sont contraints, pour sauver leur économie, pour trouver les nouveaux marchés à exploiter, ou simplement à piller, afin de maintenir le processus d'accumulation, de se les ouvrir à coups de canon.
C'est ce qu'a tenté de faire l'Allemagne en 1914 et 1939, le Japon en 1941, et l'URSS depuis 1945. Plus la concurrence s'est exacerbée sur un marché mondial fondamentalement saturé, plus la tendance à la fuite en avant dans la politique d'armement, dans le renforcement de la puissance militaire, c'est-à-dire le développement de l'impérialisme, s'est renforcée.
Face à l'impasse économique, les solutions du militarisme tendent à imposer leur propre logique qui n'est pas simplement économique. Si la guerre peut être, pour un pays vainqueur, un moyen de renforcer sa position, de faire main basse sur de nouvelles richesses, cela n'est pas le cas en général. Il suffit, pour le vérifier, de constater, au lendemain de la 2e guerre mondiale, l'affaiblissement de la Grande-Bretagne et de la France, pourtant pays « vainqueurs ». Et, quoi qu'il en soit, du point de vue du capital global, c'est-à-dire des valeurs accumulées mondialement, le bilan est absolument négatif, des richesses ont été irrémédiablement détruites. Cela démontre amplement l'irrationalité même de la guerre, du point de vue économique.
La situation présente, caractérisée :
- par une plongée accélérée de l'économie dans la récession ouverte dans les principales puissances industrielles ;
- par l'effondrement de pans entiers du capital mondial, en dernier lieu tout l'ancien « bloc de l'Est»;
- par une guerre au Moyen-Orient qui mobilise la plus importante concentration de forces de destruction depuis la seconde guerre mondiale ; est caractéristique de la spirale apocalyptique dans laquelle le capitalisme mondial est enfermé.
Crise, chaos et guerre
La « guerre du Golfe » est, en dernière analyse, le produit de la crise économique qui, depuis la fin des années 1960, secoue le capitalisme mondial ([2] [4]). L'effondrement économique de l'URSS a eu pour première conséquence l'éclatement de son bloc et, par contrecoup, un effet déstabilisateur sur l'ensemble de la situation mondiale. La tendance au « chacun pour soi », exacerbée car la crise, s'est engouffrée dans le vide béant laissé par la disparition de la discipline imposée par les blocs.
Les pays du glacis est-européen se sont empressés de se débarrasser de la tutelle russe. Les vassaux des USA, quant à eux, n'ayant plus besoin de la protection américaine face au danger russe, ont multiplié leurs velléités d'indépendance, tandis que beaucoup de puissances régionales de la périphérie du capitalisme se sont retrouvées devant la tentation de profiter de la situation pour améliorer leur position. L'Irak est dans ce dernier cas : confronté à une dette pharamineuse, estimée à 70 milliards de dollars (près de deux fois son PNB annuel), dans l'incapacité de la rembourser, il a mis à profit sa surpuissance militaire dans la région pour faire main basse sur le richissime Koweït.
Un tel exemple est significatif du chaos qui se développe internationalement et dont l'éclatement de l'URSS est un aspect marquant. La détermination des USA d'en découdre avec l'Irak, de faire un exemple est d'abord l'expression de la nécessité de mettre un frein au chaos planétaire.
L'analyse de ceux qui ne voient dans la guerre du Golfe qu'une lutte pour le pétrole ne résiste pas à la réalité économique. Même si l'Irak se trouve au centre de la principale zone de production pétrolière du monde, il n'en reste pas moins vrai que les sources d'approvisionnement se sont diversifiées et accrues, et le pétrole de cette région ne joue plus aujourd'hui le même rôle central que dans les années 1970. Il suffît de constater, après une brève poussée spéculative, la nouvelle chute des cours du pétrole, malgré l'arrêt de la production de l'Irak et du Koweït, pour mesurer à quel point la surproduction sévit, et pour comprendre que la question de l'heure n'est pas celle du danger d'une pénurie d'or noir.
Même si d'autres facteurs existent qui justifient l'intervention US : démanteler la puissance militaire de l'Irak, renforcer la « pax americana » au Moyen-Orient et le contrôle des USA sur la manne pétrolière, ils restent secondaires par rapport à l'objectif essentiel du capital américain : faire face au chaos grandissant.
La première puissance mondiale, parce que l'intérêt de son capital national coïncide avec la défense de l’« ordre mondial » qui est avant tout le sien, est particulièrement sensible au désordre grandissant dans les relations internationales. Elle est aussi la seule oui ait les moyens militaires d'assumer le rôle de gendarme du monde.
Et c'est avec inquiétude que les principaux compétiteurs économiques des USA voient se déployer la supériorité américaine, eux qui rêvent, depuis la fin du bloc de l'Est, de s'émanciper de la tutelle US. L'illusion d'un nouveau bloc en Europe autour de la puissance de l'Allemagne a été réduite en miettes, comme le montre la cacophonie de la politique étrangère européenne devant les exigences américaines. Les puissances économiques d'Europe et du Japon savent bien que les Etats-Unis vont mettre à profit leur position de force présente, pour exiger de leur part plus de sacrifices sur le plan économique, à un moment où, avec l'accélération de la crise économique, s'exacerbe la guerre commerciale.
La récession ouverte frappe de plein fouet
Le premier effet de la guerre dans le golfe a été de repousser la crise économique au second plan des préoccupations, de la masquer. Le contraste, à 'écoute et à la lecture des médias bourgeois, est étonnant entre la période qui précède l'éclatement de la guerre et la période qui suit.
L'alarmisme au sujet d'un nouvel effondrement boursier, d'une flambée catastrophique des cours du pétrole, qui prévalait avant la guerre s'est révélé sans fondement jusqu'à présent, et du coup, un optimisme de façade est de nouveau de mise. La propagande bat son plein pour minimiser l'importance de la crise et de ses effets dramatiques.
Avec la guerre, la récession, à peine officialisée par le gouvernement américain a « trouvé » une « explication » toute prête : c'est Saddam le grand responsable, la cause des difficultés actuelles, et donc, en toute logique, avec la fin de la guerre, celles-ci devraient disparaître. C'est ce que sous-entend Bush lorsqu'il déclare que la récession américaine devrait trouver son terme dans l'année qui vient, et que, finalement, ce sont des facteurs «psychologiques » qui aggravent la situation ! Alan Greenspan, président de la FED, quant à lui, a déclaré que, sans la crise du Golfe, l'économie américaine « serait peut-être passée à coté de la récession », et ajoute que « l'essentiel du choc initial de la crise est déjà absorbé» et que «les tendances à la baisse d'activité devraient actuellement s'atténuer». (La Tribune de l'Expansion).
La réalité est évidemment bien loin de ces déclarations optimistes.
L'économie américaine s'enfonce de plus en plus rapidement dans la récession et n'a pas attendu la guerre pour cela.
La crise aux USA et dans les pays industrialisés
En novembre 1990, les commandes de biens durables aux USA ont chuté de 10,1 %, et l'embellie de décembre, + 4,4 %, est due essentiellement à une progression de 57 % des commandes militaires. Pour l'ensemble de l'année 1990, c'est en fait une baisse de 1,6 %, le plus mauvais score de l'économie américaine depuis 1982, année de pleine récession.
Certains secteurs et non des moindres sont carrément sinistrés. Par exemple l'automobile et les compagnies de transport aériens. A la mi-décembre 1990, la chute des ventes dans l'automobile prend des allures de catastrophe avec -19 %. Les pertes de General Motors atteignent 2 milliards de dollars en 1990, celles de Ford pourtant le plus compétitif des constructeurs américains, s'établissent, pour les deux derniers trimestres de l'année 1990, à 736 millions de dollars. Les compagnies aériennes voient leurs ailes brisées : TWA est a déclarée en faillite, Eastern Airlines est en liquidation, PanAm et Continental sont en très mauvaise posture. Au total, les compagnies aériennes américaines ont cumulé 2 milliards de dollars de pertes en 1990. Record historique.
En conséquence les licenciements se multiplient. Au second semestre 1990, le chômage aux USA a progressé à une allure record.
Alors qu'aux USA, en 1989, 2 500 000 emplois ont été créés, il y en eut seulement 500 000 en 1990, et encore, ce résultat global sur Tannée cache la réalité catastrophique du second semestre durant lequel 900 000 emplois ont été supprimés.
Résultat, les banques américaines, déjà bien ébranlées par l'effondrement de la spéculation immobilière et boursière, voient les impayés s'accumuler. Durant le dernier trimestre 1990, 11,6% des banques ont enregistré des pertes sèches, et la plupart n'ont pu maintenir un solde positif que par la vente d'actifs qui permettait de restaurer les bilans, ce qui en définitive représente en fait un affaiblissement. En 1990, 169 banques ont fait faillite, totalisant 16 milliards d'actifs. Pour 1991, est prévue la faillite de 180 banques qui totaliseraient 70 milliards d'actifs. A cela, il faut ajouter la faillite, depuis 1988, de plus de 500 caisses d'épargne qui ont laissé à l'Etat une ardoise dont l'estimation oscille entre 500 et 1000 milliards de dollars !
Lorsque la première économie du monde subit une telle crise, l'économie mondiale en essuie évidemment le contrecoup. Au sein de l'OCDE, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont entrés en récession ouverte. La production industrielle de la France et de l'Italie reflue. Partout la croissance diminue.
En Europe, les ventes d'automobiles ont baissé de 3,7 % en un an, notamment : -5 % en Italie, -8 % en France, -18 % en GB. Les ventes de poids lourds ont chuté quant à elles de 5 %. Les bénéfices de Fiat se sont effondrés de 55 %. Symboliquement, Rolls Royce décide de cesser sa production d'automobiles prestigieuses, et Saab enterre le « modèle » suédois en fermant sa toute nouvelle usine de Malmô ouverte en 1989.
A l'instar de leurs concurrentes américaines, les compagnies aériennes européennes s'enfoncent dans la crise. Pour la première fois depuis 1981, le résultat d'exploitation global devrait être négatif pour 1990. Air France, Lufthansa, British Airways, Swissair suppriment les lignes les moins rentables. Air France demande un report de la livraison des nouveaux Airbus déjà commandés. British Airways annonce 4 900 suppressions d'emploi et la compagnie Scandinave SAS prévoit de mettre 3 500 salaries à la porte.
Au coeur du monde industrialisé, la concurrence s'exacerbe et prend la dimension d'une guerre commerciale acharnée. La guerre des tarifs des transports aériens bat son plein : British Airways, le 11 février, annonce une baisse de 33 % sur Londres - New-York et, dans les heures qui suivent, TWA et PanAm lui emboîtent le pas. Ces compagnies, pourtant financièrement déjà mal en point, rognent encore sur leur marge bénéficiaire, pour protéger leur marché et grappiller quelques clients. Une telle politique ne peut avoir pour résultat final que d'accélérer la dégradation du bilan global de ce secteur. Et ce qui est vrai pour le transport aérien est vrai ailleurs. Dans tous les secteurs, de nombreuses entreprises voient leur bilan virer au rouge, et dans un réflexe de survie, tous les coups sont permis pour se maintenir sur le marché.
« Le chacun pour soi » dans la concurrence économique exacerbée
La concurrence économique ne se limite pas simplement à une guerre des tarifs. Chaque Etat, soucieux de défendre son économie nationale, utilise toutes les ressources que lui permet sa puissance. Du plan strictement économique les rivalités ont tendance à se déplacer sur un terrain qui n'a plus grand chose à voir avec les règles de la « libre concurrence ».
Depuis des décennies, la puissance tutélaire de ce qui a constitué le « bloc occidental », les USA, a impose à ses vassaux un contrôle du fonctionnement de l'économie mondiale, qui lui était d'abord profitable, et cela au prix d'une gigantesque tricherie avec la loi de la valeur. Les avocats intransigeants de la « loi du marché », de la « libre concurrence », du « capitalisme libéral», sont ceux qui ont certainement le plus distordu ces règles pour la défense des intérêts de leur capital national. Les derniers événements sur la scène internationale en sont une preuve flagrante. Avec la fin de l'année 1990, les négociations du GATT qui duraient depuis des années se sont brutalement envenimées. Agacés par les résistances européennes sur le dossier des subventions à l'agriculture et à l'industrie, les USA ont ajourné sine die ces réunions.
La démonstration de force américaine face à l'Irak a remis les pendules à l'heure. Elle a montré que l'Europe n avait pas les moyens de ses ambitions, et cela pas tant sur le plan économique, que sur le plan militaire. Il suffit de constater le changement de ton des médias à propos de l'Allemagne ou du Japon. Ces derniers, jusqu'alors présentés comme 1’exemple même des économies solides et fortes, les nouveaux géants, les nouveaux challengers d'une puissance américaine sur le déclin, se retrouvent aujourd'hui au banc des accusés pour leur égoïsme économique. Géants économiques, l'Allemagne et le Japon restent des nains sur le plan politique et militaire. Face à la super-puissance impérialiste américaine, ils sont bien obligés, pour le moment, de constater leur faiblesse. Malgré toutes les velléités de résistance sur le front économique qu'ils peuvent encore manifester, ils ne peuvent que céder du terrain.
Depuis le début de la « guerre du Golfe », les signes d'allégeance se sont multipliés de la part de ceux qui, il y a encore quelques semaines, manifestaient des réticences. La Commission européenne propose aujourd'hui de réduire les subventions agricoles et de supprimer les subventions au nouveau programme Airbus. Ce sont précisément ces deux points qui avaient constitué la pomme de discorde durant de nombreux mois de négociations entre la CEE et les USA, au sein du GATT. Sans nouvelles discussions, devant l'évidence des faits militaires, la CEE a donc cédé, toute honte bue, aux demandes US, et ces concessions seront encore probablement insuffisantes aux yeux des USA. Quant au Japon et à l'Allemagne, ils ont finalement accédé aux sollicitations pressantes de Washington, pour financer l'opération « Tempête du désert », en acceptant de verser respectivement 13 et 7,7 milliards de dollars, une « obole » significative.
Parce qu'ils sont les plus forts, les USA imposent leur loi sur le marché mondial. Cela est particulièrement illustré par le rôle du dollar. La valeur du dollar ne correspond que de loin à la réalité économique. Elle est d'abord l'expression de la domination US sur le marché mondial, et un instrument essentiel de cette domination. La baisse organisée du dollar a pour but premier de restaurer artificiellement la compétitivité des produits américains aux dépens de leurs concurrents européens et japonais. Son résultat est de faire diminuer le déficit commercial US, et par conséquent de réduire les excédents des autres pays.
La baisse du taux d'escompte a aussi pour résultat de rendre le crédit moins cher, et donc de freiner la chute de la production en facilitant la consommation et l'investissement.
La situation encore apparemment prospère de l'Allemagne et du Japon est tout à fait provisoire. Pendant des années, ces pays ont constitue les exceptions qui permettaient de perpétuer le mythe qu'une saine gestion capitaliste était la condition nécessaire pour surmonter la crise. Non seulement ces deux pays sont, aujourd'hui, dans la ligne de mire des exigences US pour la sauvegarde de leur propre capital, mais aussi et surtout, ils commencent a leur tour à être fortement secoués par les effets de la crise.
La chute du dollar commence à se faire sentir fortement sur leurs exportations qui diminuent encore plus rapidement que ne se redresse la balance commerciale US. Pour le seul mois de novembre 1990, l'excédent commercial allemand s'est contracté de 60 %. Du fait de l'effet dollar, qui a atteint son plus bas niveau historique face au Yen et au Mark, les pertes de change des entreprises exportatrices commencent à atteindre un niveau catastrophique. Ainsi, en Allemagne, Deutsche Airbus a perdu pour cette raison la moitié de son capital.
Le chiffre de croissance record de la production allemande, 4,6% pour 1990, est à relativiser pour deux raisons. Premièrement il ne tient pas compte de la chute de moitié de la production dans l'ex-RDA. Deuxièmement il n'est pas le produit d'une croissance des exportations qui, pour leur part, ont diminué, mais de l'endettement de l'Etat pour subventionner la reconstruction de l'Allemagne de l'Est. Indice de la mauvaise santé de l'économie allemande, le chômage recommence à croître à l'Ouest, tandis qu'à l'Est, si le chômage officiel est de 800 000 personnes, en fait 1800 000 sont en chômage partiel, tandis que plus d'un million de licenciements est annoncé dans la période qui vient !
Le Japon voit aussi ses exportations chuter rapidement. Mais surtout, la crise économique se manifeste par une crise financière d'une ampleur jamais vue. Le Japon a été le haut lieu de la spéculation internationale, et aujourd'hui, plus que tout autre pays, il en paye le prix.
La chute de la bourse de Tokyo a été la plus importante, avec -39 % en 1990. Les banques japonaises sont aujourd'hui menacées d'un côté par l'effondrement de la spéculation immobilière, et de l'autre, par le non-remboursement des crédits astronomiques consentis partout dans le monde. La Far Eastern Review estime ainsi que la moitié du crédit privé international qui a été consenti, l'a été par les banques nipponnes entre 1985 et 1990. Comme, pour l'essentiel, ces crédits ont été consentis en dollars, et que celui-ci se dévalue chaque jour, les remboursements ne représenteront en fait qu'une faible part de la valeur qu ils représentaient à un moment où le dollar valait bien plus. Ceci en dehors du fait que, avec la récession qui se développe, une bonne partie de ces crédits ne seront jamais remboursés du tout. La dette US, la principale, libellée en dollars, se trouve aujourd'hui dévalorisée de 50 % par rapport au yen. La catastrophe financière est dans ces conditions prévisible et inévitable, et elle pèsera de tout son poids sur l'économie japonaise.
Les économies japonaise et allemande ont mangé leur pain blanc, et l'avenir pour elles, comme pour toutes les autres fractions du capital mondial, s'annonce noir.
S'ils sont de loin la première puissance mondiale, les USA n'en sont pas pour autant omnipotents : ils restent évidemment soumis aux contradictions insurmontables du capitalisme qui font aujourd'hui plonger l'économie mondiale dans une crise d'une ampleur inconnue jusque là.
La plongée irréversible de l'économie des USA
La politique américaine est aujourd'hui une politique de fuite en avant. La baisse du dollar porte en elle ses limites. En restaurant la balance commerciale américaine, elle diminue les excédents des autres pays exportateurs, et aura donc pour conséquence de limiter leurs importations, donc à terme les exportations US. La baisse du taux d'escompte américain a pour but, en rendant le crédit plus Facile, de relancer le marché intérieur. Mais là aussi, cette politique se heurte à la réalité économique.
Alors que la dette globale des USA se situe autour de 10 000 milliards de dollars, la fuite présente dans l'endettement ne peut avoir pour résultat que de polariser toujours plus les contradictions de l'économie mondiale autour du « roi-dollar», annonçant la crise monétaire qui se rapproche inéluctablement. Pour le vérifier il suffît de constater l'attitude présente des banques américaines qui, malgré les sollicitations incessantes de l'Etat fédéral, sont rétives à desserrer es vannes du crédit, car elles sont déjà confrontées à la réalité des dettes impayées qui s'accumulent. Visiblement, la confiance ne règne guère au sein de la bourgeoisie américaine sur la solvabilité de son économie.
Avec la récession, le futur déficit budgétaire des Etats-Unis est estimé à 350 milliards de dollars, nouveau record historique en perspective, sans compter le coût de la guerre, estime pour le moment, pour les seuls USA, à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le premier résultat de la guerre va donc être d'aggraver encore les effets de la crise mondiale, en dégradant les déficits budgétaires des pays participants. Les gigantesques destructions en Irak et au Koweït sont présentées de manière cynique par les médias, comme la source de nouveaux débouchés, avec la reconstruction en «perspective». Si tant est que celle-ci ait lieu, ces nouveaux marchés seront de toute façon bien insuffisants pour éponger le trop-plein de la production sous lequel croule l'économie mondiale. Reconstruire les capacités de production pétrolière de l'Irak et du Koweït n'aura pour seul résultat que d'aggraver la crise de surproduction du pétrole.
Le répit que les Etat-Unis essayent de s'octroyer, par leur démonstration de force, ne peut être que de très courte durée, si répit il y a. Il ne permettra certainement pas de sortir de la récession, qui sévit en fait depuis le début des années 1980 de manière larvée, et qui n'a pas attendu la reconnaissance officielle de la fin 1990 pour faire subir ses effets. Au contraire, la récession va s'en trouver aggravée.
La seule question réelle n'est pas l'existence de la crise, mais la vitesse de son développement et sa profondeur. Pour toutes les fractions du capital mondial, le problème n'est plus de prétendre la surmonter, mais d'en limiter les dégâts sur son propre capital et de tenter d'en reporter les effets les plus pernicieux sur les autres. C'est ce qui se passe déjà.
Depuis le début de la crise, à la fin des années 1960, les pays les plus puissants ont reporté les effets les plus brutaux de la crise de surproduction généralisée, qui trouve son origine au coeur des grands centres de production du monde capitaliste, sur les pays les plus faibles. La situation dramatique de l'Afrique, ravagée par les guerres, les épidémies et la famine ; la situation de l’Amérique Latine, qui est en train de prendre le même chemin, où en 1990, la richesse par habitant a diminué de 6 % officiellement, et où se développe aujourd'hui une épidémie de choléra à l'échelle du continent, la situation des pays du défunt COMECON où la production 1’année dernière a chuté globalement de 30 % ; témoignent de l'effondrement croissant de l'économie mondiale qui aujourd'hui menace à leur tour les grands centres industriels des pays développés.
***
Comme elles paraissent lointaines les belles paroles de Bush au lendemain de l'effondrement au bloc russe, il n'y a encore que quelques mois. La promesse d'un nouveau monde de « paix » et de « prospérité » a été un mensonge de plus. La guerre commerciale qui est en train de s'exacerber porte en elle l'abandon des « belles » idées sur le « libre-échange », sur la « fin des frontières européennes », sur « la croissance et la sécurité ». Les prolétaires du monde entier vont subir de plein fouet la vérité du capitalisme : guerre, misère, chômage, famine, épidémies.
L'irrationalité de la guerre, qui n'aura pour seul résultat que d'aggraver la crise économique, exprime de manière brutale la dimension catastrophique de l'impasse du capitalisme.
JJ, 24/2/91
« Le mode de production capitaliste a cette particularité que la consommation humaine qui, dans toutes les économies antérieures, était le but, n'est plus qu'un moyen au service du but proprement dit : l'accumulation capitaliste. La croissance du capital apparaît comme le commencement et la fin, la fin en soi et le sens de toute la production. L'absurdité de tels rapports n'apparaît que dans la mesure où la production capitaliste devient mondiale. Ici, à l'échelle mondiale, l'absurdité de l'économie capitaliste atteint son expression dans le tableau d'une humanité entière gémissant sous le joug terrible d'une puissance sociale aveugle qu'elle a elle-même créée inconsciemment : le capital. Le but fondamental de toute forme sociale de production : l'entretien de la société par le travail, la satisfaction des besoins, apparaît ici complètement renversé et mis la tête en bas, puisque la production pour le profit et non plus pour l'homme devient la loi sur toute la terre et que la sous-consommation, l'insécurité permanente de la consommation et par moments la non-consommation de l'énorme majorité de l'humanité deviennent la règle. »
Rosa Luxemburg
Introduction à l'économie politique, chap. 6, "Les tendances de l'économie capitaliste"
[1] [5] Lire « Guerre, militarisme et blocs impérialistes », Revue internationale n° 52 et 53, 1er et 2e trimestres 1988.
[2] [6] Lire « La guerre dans la décomposition du capitalisme », Revue internationale, n° 63, 4e trimestre 1990, « Militarisme et décomposition », Revue internationale, n°64, 1er trimestre 1991
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [1]
- Crise économique [7]
Résolution sur la situation internationale 1991
- 2816 lectures
Qu'y a-t-il derrière le « nouvel ordre mondial » annoncé par les puissances occidentales ? Quelle est la signification historique de la guerre du Golfe ? Où en est la crise économique mondiale ? Quelles sont les perspectives pour la lutte de classe ? Quels doivent être les axes de l'intervention des révolutionnaires ?
Ce sont ces questions que traite cette résolution adoptée par le CCI en janvier 1991.
Le phénomène d'accélération de l'histoire, déjà mis en évidence par le CCI au début des années 1980, a connu depuis un an et demi une accentuation considérable. En quelques mois, c'est toute la configuration du monde, telle que l'avait laissée la fin de la seconde guerre mondiale, qui s'est trouvée bouleversée. En fait, l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est, qui a clos les années 1980, annonce et ouvre la porte à une fin de millénaire dominée par une instabilité et un chaos comme jamais l'humanité n'en a connus.
l) La scène immédiatement la plus significative et dangereuse sur laquelle s'exprime aujourd'hui, non pas le « nouvel ordre », mais bien le nouveau chaos mondial, est celle des antagonismes impérialistes. La guerre du Golfe a mis en évidence la réalité d'un phénomène oui découlait nécessairement de la disparition du bloc de l'Est : la désagrégation de son rival impérialiste, le bloc de l'Ouest. Ce phénomène était déjà à l'origine du « hold up » irakien contre le Koweït : c'est bien parce que le monde avait cessé d'être partagé en deux constellations impérialistes qu'un pays comme l'Irak a cru possible de faire main basse sur un ex-allié du même bloc. Ce même phénomène a révélé de façon évidente, courant octobre, toute son ampleur avec les diverses tentatives des pays européens (notamment la France et l'Allemagne) et du Japon de torpiller, à travers des négociations séparées menées au nom de la libération des otages, la politique américaine dans le Golfe. Cette politique vise à faire de la punition de l'Irak un «exemple» censé décourager toute tentation future d'imiter le comportement de ce pays (et c'est bien en vue de cet « exemple » que les Etats-Unis ont tout fait, avant le 2 août, pour provoquer et favoriser l'aventure irakienne ([1] [8]). Elle s'applique aux pays de la périphérie où le niveau des convulsions constitue un facteur puissant d'impulsion de ce genre d'aventures. Mais elle ne se limite pas à cet objectif. En réalité, son but fondamental est beaucoup plus général : face à un monde de plus en plus gagné par le chaos et le «chacun pour soi», il s'agit d'imposer un minimum d'ordre et de discipline, et en premier lieu aux pays les plus importants de l'ex-bloc occidental. C'est bien pour cette raison que ces pays (à l'exception de la
2) En fait, la guerre du Golfe constitue un révélateur particulièrement significatif des principaux enjeux de la nouvelle période sur le plan des antagonismes impérialistes. Le partage de la domination mondiale entre deux super-puissances a cessé d'exister, et, avec lui, la soumission de l'ensemble des antagonismes impérialistes à l'antagonisme fondamental qui les opposait. Mais en même temps, et comme le CCI l'avait annoncé il y a plus d'un an, une telle situation, loin de permettre une résorption des affrontements impérialistes, n'a fait que déboucher, en l'absence du facteur de discipline que représentaient malgré tout les blocs, sur un déchaînement de ces affrontements. En ce sens, le militarisme, la barbarie guerrière, l'impérialisme, qui sont des caractéristiques essentielles de la période de décadence du capitalisme, ne pourront qu'être encore aggravés dans la phase ultime de cette décadence que nous vivons aujourd'hui, celle de la décomposition générale de la société capitaliste. Dans un tel monde dominé par le chaos guerrier, par la « loi de la jungle », il revient à la seule superpuissance qui se soit maintenue, parce que c'est le pays qui a le plus à perdre dans le désordre mondial, et parce que c'est le seul qui en ait les moyens, de jouer le rôle de gendarme du capitalisme. Et ce rôle, il ne sera en mesure de le tenir qu'en enserrant de façon croissante l'ensemble du monde dans le corset d'acier du militarisme. Dans une telle situation, pour longtemps encore, et peut-être jusqu'à la fin du capitalisme, les conditions n'existent pas pour un nouveau partage de la planète en deux blocs impérialistes. Des alliances temporaires et circonstancielles pourront se nouer, autour ou contre les Etats-Unis, mais en l'absence d'une autre super-puissance militaire capable de rivaliser avec eux (et ils feront tout leur possible pour en empêcher la constitution), le monde sera livré au déchaînement d'affrontements militaires de tous ordres qui, même s'ils ne pourront pas déboucher sur une troisième guerre mondiale, risquent de provoquer des ravages considérables, y compris, en se combinant avec d'autres calamités propres à la décomposition (pollution, famines, épidémies, etc.), la destruction de l'humanité.
3) Une autre conséquence immédiate de l'effondrement du bloc de l'Est réside dans l'aggravation considérable de la situation qui se trouvait à son origine : le chaos économique et politique dans les pays de l'Est européen, et particulièrement le premier d'entre eux, celui qui se trouvait à leur tête il y a moins de deux ans, l'URSS. En fait, dès à présent, ce pays a cessé d'exister en tant qu'entité étatique : par exemple, la réduction considérable de la participation de la Russie au budget de l’« Union », décidée le 27 décembre 1990 par le parlement de cette république, ne fait que confirmer l'éclatement, la dislocation sans retour de l'URSS. Une dislocation que la probable réaction des forces « conservatrices », et particulièrement des organes de sécurité (mise en évidence par la démission de Chevarnadze), ne pourra que retarder quelque peu tout en déchaînant un chaos encore plus considérable en même temps que des bains de sang.
Pour ce qui concerne les ex-démocraties populaires, leur situation, tout en n'atteignant pas le degré de gravité de celui de PURSS, ne peut que plonger vers un chaos croissant comme le révèlent dès a présent les chiffres catastrophiques de la production (chutant jusqu'à 40 % pour certains pays) et l'instabilité politique qui s'est manifestée ces derniers mois dans des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne (élections présidentielles) et la Yougoslavie (déclaration d'indépendance de la Slovénie).
4) La crise du capitalisme, qui se trouve, en dernière instance, à l'origine de toutes les convulsions que subit le monde à l'heure actuelle, est elle-même aggravée par ces convulsions :
- la guerre au Moyen-Orient, l'accroissement des dépenses militaires qui en résulte, ne peuvent qu affecter de façon négative la situation économique du monde (contrairement à ce qui fut le cas, par exemple, pour la guerre du Vietnam qui permit de repousser l'entrée en récession de l'économie américaine et mondiale, au début des années 1960), dans la mesure où l'économie de guerre constitue, depuis longtemps déjà, un des facteurs de premier ordre d'aggravation de la crise ;
- la dislocation du bloc de l'Ouest ne peut que porter un coup mortel à la coordination des politiques économiques à l'échelle du bloc qui, par le passé, avait permis de ralentir le rythme d’effondrement de l'économie capitaliste ; la perspective est à une guerre commerciale sans merci (comme vient de 'illustrer l'échec récent des négociations du GATT) dans laquelle tous les pays laisseront des plumes ;
- les convulsions dans la zone de l'ancien bloc de l'Est vont également constituer un facteur croissant d'aggravation de la crise mondiale en participant a l'amplification du chaos général, et, en particulier, en contraignant les pays occidentaux à consacrer des crédits importants a la limitation de ce chaos (par exemple avec l'envoi d'une « aide humanitaire » destinée à ralentir les émigrations massives vers l'Occident).
5) Ceci dit, il importe que les révolutionnaires mettent bien en évidence ce qui constitue le facteur ultime de l'aggravation de la crise :
- la surproduction généralisée propre à un mode de production qui ne peut créer des débouchés en mesure d'absorber la totalité des marchandises produites, et dont la nouvelle récession ouverte, qui frappe dès à présent la première puissance mondiale, constitue une illustration flagrante ;
- la fuite effrénée dans l'endettement extérieur et intérieur, public et privé, de cette même puissance tout au long des années 1980, qui, si elle a permis de relancer momentanément la production d'un certain nombre de pays, a fait des Etats-Unis de très loin le premier débiteur mondial ;
- l'impossibilité de poursuivre éternellement cette fuite en avant, d'acheter sans payer, de vendre contre des promesses dont il est de plus en plus évident qu'elles ne seront jamais tenues, fuite en avant qui n'a fait que rendre les contradictions encore plus explosives.
La mise en évidence de cette réalité est d'autant plus importante qu'elle constitue un facteur de premier ordre dans la prise de conscience du prolétariat contre les campagnes idéologiques actuelles. Comme en 1974 (avec la « cupidité des rois du pétrole ») et en 1980-1982 (avec la «folie de Khomeiny»), la bourgeoisie va tenter encore une fois (et elle a déjà commencé) de faire endosser la responsabilité de la nouvelle récession ouverte à un « méchant ». Aujourd'hui, Saddam Hussein, le « dictateur mégalomane et sanguinaire », le « nouvel Hitler » de notre époque, est tout à fait bien dans ce rôle. Il est donc indispensable que les révolutionnaires fassent clairement ressortir que la récession actuelle, pas plus que celles de 1974-1975 et de 1980-1982, ne résulte pas de la simple hausse des prix pétroliers, mais qu elle avait débuté dès avant la crise du Golfe et qu'elle révèle les contradictions fondamentales du mode de production capitaliste.
6) Plus généralement, il importe que les révolutionnaires fassent ressortir, de la réalité présente, les éléments les plus aptes à favoriser la prise de conscience du prolétariat.
Aujourd'hui, cette prise de conscience continue à être entravée par les séquelles de l'effondrement du stalinisme et du bloc de l'Est. Le discrédit qu'a subi il y a un an, sous l'effet notamment d'une campagne gigantesque de mensonges, l'idée même de socialisme et de révolution prolétarienne est encore loin d'avoir été surmonté. En outre, l'arrivée massive qui s'annonce d'immigrants originaires d'une Europe de l'Est en plein chaos, ne pourra que créer un surcroît de désarroi dans la classe ouvrière des deux côtés de feu le « rideau de fer » : parmi les ouvriers qui s'imagineront pouvoir échapper à une misère insupportable en s'exilant vers l'« Eldorado » occidental et parmi ceux qui auront le sentiment que cette immigration risque e les priver des maigres « acquis » qui sont les leurs et qui seront, de ce fait, plus vulnérables aux mystifications nationalistes. Et un tel danger sera particulièrement redoutable dans les pays, tel l'Allemagne, qui se retrouveront en première ligne face aux flux d'immigrants.
Cependant, la mise en évidence croissante tant de la faillite irréversible du mode de production capitaliste, y compris et surtout sous sa forme « libérale », que de la nature irrémédiablement guerrière de ce système, vont constituer un facteur puissant d'usure des illusions issues des événements de la fin 1989. En particulier, la promesse d'un « ordre mondial de paix », telle qu'elle nous a été faite avec la disparition du bloc russe, a subi en moins d'un an un coup décisif.
En fait, la barbarie guerrière dans laquelle se vautre de plus en plus le capitalisme en décomposition va imprimer sa marque de façon croissante dans le processus de développement dans la classe de la conscience des enjeux et des perspectives de son combat. La guerre ne constitue pas en soi et automatiquement un facteur de clarification de la conscience du prolétariat. Ainsi, la seconde guerre mondiale a débouché sur un renforcement de l'emprise idéologique de la contre-révolution. De même, les bruits de bottes qui se sont faits entendre depuis l'été dernier, s'ils ont eu le mérite de démentir les discours sur « la paix éternelle », ont aussi engendré dans un premier temps un sentiment d'impuissance et une paralysie indiscutable dans les grandes masses ouvrières des pays avancés. Mais les conditions actuelles de développement du combat de la classe ouvrière ne permettront pas que se maintienne de façon durable un tel désarroi :
- parce que le prolétariat d'aujourd'hui, contrairement à celui des années 1930 et 1940, s'est dégagé de la contre-révolution, qu'il n'est pas embrigadé, tout au moins ses secteurs décisifs, derrière les drapeaux bourgeois (nationalisme, défense de la « patrie socialiste », de la démocratie contre le fascisme) ;
- parce que la classe ouvrière des pays centraux n'est pas directement mobilisée dans la guerre, soumise au bâillon que représente l'enrôlement sous l'autorité militaire, ce qui lui laisse beaucoup plus de latitude pour développer une réflexion de fond sur la signification de la barbarie guerrière dont elle supporte les effets par un surcroît d'austérité et de misère ;
-parce que l'aggravation considérable, et de plus en plus évidente, de la crise du capitalisme, dont les ouvriers seront évidemment les principales victimes et contre laquelle ils seront contraints de développer leur combativité de classe, les conduira de façon croissante à faire le lien entre la crise capitaliste et la guerre, entre le combat contre celle-ci et les luttes de résistance aux attaques économiques, leur permettant de se garantir contre les pièges du pacifisme et des idéologies a-classistes.
En réalité, si le désarroi provoqué par les événements du Golfe peut ressembler, en surface, à celui résultant de l'effondrement du bloc de l'Est, il obéit à une dynamique différente : alors que ce qui vient de l'Est (élimination des restes du stalinisme, affrontements nationalistes, immigration, etc.) ne peut, et pour un bon moment encore, qu'avoir un impact essentiellement négatif sur la conscience du prolétariat, la présence de plus en plus permanente de la guerre dans la vie de la société va tendre, au contraire, à réveiller cette conscience.
7) Si, malgré un désarroi temporaire, le prolétariat mondial détient donc toujours entre ses mains les clés du futur, il importe de souligner que tous ses secteurs ne se trouvent pas au même niveau dans la capacité d'ouvrir une perspective pour l'humanité. En particulier, la situation économique et politique qui se développe dans les pays de l'ex-bloc de l'Est témoigne de l'extrême faiblesse politique de la classe ouvrière dans cette partie du monde. Ecrasé par la forme la plus brutale et pernicieuse de la contre-révolution, le stalinisme, ballotté par les illusions démocratiques et syndicalistes, déchiré par les affrontements nationalistes et entre cliques bourgeoises, le prolétariat de Russie, d'Ukraine, des pays baltes, de Pologne, de Hongrie, etc., se trouve confronté aux pires difficultés pour développer sa conscience de classe. Les luttes que les ouvriers de ces pays seront contraints de mener, face à des attaques économiques sans précédent, se heurteront, quand elles ne seront pas directement dévoyées sur un terrain bourgeois comme le nationalisme, à toute la décomposition sociale et politique qui est en train de s'y développer, étouffant de ce tait leur capacité à constituer un terreau pour la germination de la conscience. Et il en sera ainsi tant que le prolétariat des grandes métropoles capitalistes, et particulièrement celles d'Europe occidentale, ne sera pas en mesure de mettre en avant, même de façon embryonnaire, une perspective générale de combat.
8) La nouvelle étape du processus de maturation de la conscience dans le prolétariat, dont la situation actuelle du capitalisme détermine les prémisses, n'en est, pour le moment, qu'à ses débuts. D'une part, c'est un chemin important que doit parcourir la classe pour se dégager des séquelles du choc provoqué par l'implosion du stalinisme et l'utilisation qu'en a faite la bourgeoisie. D'autre part, même si sa durée sera nécessairement moindre que celle de l'impact de cet événement, le désarroi produit par les campagnes entourant la guerre du Golfe n'est pas encore surmonté. Pour franchir ce pas, le prolétariat se trouvera confronté aux difficultés que la décomposition générale de la société sème devant lui, de même qu'aux pièges des forces bourgeoises, et en particulier syndicales, qui tenteront de canaliser sa combativité dans des impasses, y compris en le poussant dans des engagements prématurés. Dans ce processus, les révolutionnaires auront une responsabilité croissante :
- dans la mise en garde contre l'ensemble des dangers que représente la décomposition, et particulièrement, il va de soi, la barbarie guerrière ;
- dans la dénonciation de toutes les manoeuvres bourgeoises, dont un des aspects essentiels sera de dissimuler, ou de dénaturer, le lien fondamental entre la lutte contre les attaques économiques et le combat plus général contre une guerre impérialiste de plus en plus présente dans la vie de la société ;
- dans la lutte contre les campagnes visant à saper la confiance du prolétariat en lui-même et en son devenir ;
-dans la mise en avant, contre toutes les mystifications pacifistes et, plus généralement, contre l'ensemble de l'idéologie bourgeoise, de la seule perspective qui puisse s'opposer à l'aggravation de a guerre : le développement et la généralisation du combat de classe contre le capitalisme comme un tout en vue de son renversement.
4 janvier 1991.
[1] [9] Mais s'ils n'en étaient pas totalement maîtres (l'Irak aussi y était pour quelque chose), la date choisie par les Etats-Unis pour le début du conflit, le 2 août 1990, n'est pas le fait du hasard. Pour cette puissance, il fallait faire vite avant que ne s'accentue encore plus la dislocation de son ancien bloc, mais aussi avant que ne se manifeste trop ouvertement (après la « gueule de bois » consécutive à l'effondrement du bloc de 1 Est) la tendance à la reprise des luttes ouvrières, impulsée par la récession mondiale, qui avait commencé à s'exprimer avant l'été 1990.
Grande-Bretagne qui a choisi depuis longtemps une alliance indéfectible avec les Etats-Unis) ont fait plus que traîner les pieds pour s'aligner sur la position américaine et s'associer à son effort de guerre. S'ils ont besoin de la puissance américaine comme gendarme du monde, ils redoutent qu'un étalage trop important de celle-ci, inévitable lors d'une intervention armée directe, ne porte ombrage à leur propre puissance.
Vie du CCI:
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [1]
Questions théoriques:
- Guerre [2]
Le prolétariat face à la guerre
- 3383 lectures
LE PROLÉTARIAT FACE À LA GUERRE
Avec une violence inouïe, la guerre du Golfe est venue rappeler que le capitalisme c'est la guerre. La responsabilité historique de la classe ouvrière mondiale, seule force capable de s'opposer au capital, n'en a été que plus mise en relief. Mais, pour assumer cette responsabilité, la classe révolutionnaire doit se réapproprier sa propre expérience théorique et pratique de lutte contre le capital et la guerre. C'est dans cette expérience qu'il doit puiser la confiance dans sa capacité révolutionnaire et les moyens pour mener à bien son combat.
LE PROLÉTARIAT FACE A LA GUERRE DU GOLFE : L'ENJEU DE LA SITUATION HISTORIQUE
La classe ouvrière mondiale a subi la guerre du Golfe comme un massacre d'une partie d'elle-même, mais aussi comme un gigantesque coup de massue, comme une gifle monumentale assenée par la classe dominante.
Mais les rapports de force entre prolétariat et classe dominante locale ne sont pas les mêmes dans les deux parties belligérantes.
En Irak, le gouvernement a pu envoyer au massacre le contingent, les ouvriers, les paysans et leurs enfants (15 ans d'âge parfois). La classe ouvrière y est minoritaire, noyée dans une population agricole ou semi-marginalisée dans les bidonvilles. Elle ne possède quasiment aucune expérience historique de combat contre le capital. Et surtout, l'absence de luttes suffisamment significatives de la part des prolétaires des pays les plus industrialisés l'empêche de concevoir la possibilité d'un véritable combat internationaliste. Aussi lui a‑t‑il été impossible de résister à l'embrigadement idéologique et militaire qui l'a contrainte à servir de chair à canon pour les visées impérialistes de sa bourgeoisie. Le dépassement des mystifications nationalistes ou religieuses, parmi les travailleurs de ces régions, dépend tout d'abord de l'affirmation internationaliste, anti‑capitaliste des prolétaires des pays centraux.
Dans les métropoles impérialistes comme les Etats-Unis, la Grande‑Bretagne, la France, la situation est différente. La bourgeoisie n'a pu envoyer à la boucherie qu'une armée de professionnels. Pourquoi ? Parce que le rapport de forces entre les classes est différent. La classe dominante sait que les prolétaires n'y sont pas prêts à payer, encore une fois, l'impôt du sang. Depuis la fin des années 1960, depuis la reprise des luttes marquée par les grèves massives de 1968 en France, la plus vieille classe ouvrière du monde ‑ qui a déjà subi deux guerres mondiales ‑ a développé la plus grande méfiance vis‑à‑vis des hommes politiques de la bourgeoisie et leurs promesses, tout comme vis‑à‑vis des organisations dites « ouvrières » (partis de gauche, syndicats) destinées à l'encadrer. C'est cette combativité, ce détachement de l'idéologie dominante. Qui a empêché jusqu'à présent l'issue d'une troisième guerre mondiale et, cette fois encore, l'embrigadement des prolétaires dans un conflit impérialiste.
Mais, comme le démontrent les derniers événements, cela ne suffit pas pour empêcher le capitalisme de faire la guerre. Si la classe ouvrière doit n'en rester qu'à cette sorte de résistance implicite, le capital finira par mettre à feu et à sang l'ensemble de la planète jusqu'à y plonger ses principaux centres industriels.
Face à la guerre impérialiste, le prolétariat a démontré par le passé, lors de la vague révolutionnaire de 1917‑23 qui mit fin à la Première guerre mondiale, qu'il était la seule force capable de s'opposer à la barbarie guerrière du capitalisme décadent. La bourgeoisie fait tout aujourd'hui pour le lui faire oublier et l'enfermer dans un sentiment d'impuissance, en particulier à travers la gigantesque campagne autour de l'effondrement de l'URSS avec son ignoble mensonge : « La lutte ouvrière révolutionnaire ne peut mener qu'au goulag et au militarisme le plus totalitaire ».
Pour le prolétariat aujourd'hui, « oublier » sa nature révolutionnaire c'est aller au suicide, et y entraîner l'humanité entière. Dans les mains de la classe capitaliste, la société humaine va au désastre définitif. La barbarie technologique de la guerre du Golfe vient encore de le rappeler. Si le prolétariat producteur de l'essentiel des richesses, y compris des armes les plus destructrices, se laisse endormir par les sirènes pacifistes et leurs hymnes hypocrites à la possibilité d'un capitalisme sans guerres, s'il se laisse dévorer par l'ambiance décomposée du « chacun pour soi », s'il ne parvient pas à retrouver le chemin de la lutte révolutionnaire contre le capitalisme comme système, l'espèce est définitivement condamnée à la barbarie et à la destruction. « Guerre ou révolution. Socialisme ou barbarie », plus que jamais, c'est ainsi qu'est posée la question.
Plus que jamais, il est indispensable, urgent, que le prolétariat se réapproprie sa lucidité historique et son expérience, le résultat de près de deux siècles de lutte contre le capital et ses guerres.
LA LUTTE DU PROLETARIAT CONTRE LA GUERRE
Parce qu'il est la classe porteuse du communisme, le prolétariat est la première classe de l'histoire à pouvoir considérer la guerre autrement que comme un inévitable et éternel fléau. Dès les premiers moments, le mouvement ouvrier affirma son opposition générale aux guerres capitalistes. Le Manifeste Communiste, dont la parution en 1848 correspond aux premières luttes où le prolétariat s'affirme comme, force indépendante sur la scène de l'histoire, est sans équivoque : « Les travailleurs n'ont pas de patrie... Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »
Le prolétariat et la guerre au XIXe siècle
L'attitude des organisations politiques prolétariennes vis‑à‑vis de la guerre a logiquement été différente suivant les périodes historiques. Au XIXe siècle, certaines guerres capitalistes possèdent encore un caractère progressiste anti‑féodal ou permettent, par la constitution de nouvelles nations, le développement des conditions nécessaires à la future révolution communiste. C'est ainsi que le courant marxiste fut amené en plusieurs occasions à se prononcer en faveur de la victoire de tel ou tel camp dans telle ou telle guerre nationale, ou à soutenir la lutte pour la libération nationale de certaines nations (par exemple, la Pologne contre l'empire russe, bastion du féodalisme en Europe).
Mais, dans tous les cas, le mouvement ouvrier a considéré la guerre comme un fléau capitaliste dont les classes exploitées sont les premières victimes. Il eut des confusions importantes du fait de l'immaturité des conditions historiques puis du poids du réformisme en son sein. Ainsi, à l'époque de la fondation de la Ie Internationale (1864), on croyait avoir trouvé un moyen de supprimer les guerres en exigeant la suppression des armées permanentes et leur remplacement par des milices du peuple. Cette position trouva au sein même de l'Internationale sa propre critique qui affirmait, dès 1867 « qu'il ne suffit pas de supprimer les armées permanentes pour en finir avec la guerre, mais qu'une transformation de tout l'ordre social était à cette fin également nécessaire. » La IIe Internationale, fondée en 1889, se prononce aussi vis-à‑vis des guerres en général. Mais c'est l'époque dorée du capitalisme et du développement du réformisme. Son premier congrès reprend l'ancien mot d'ordre de « substitution des milices populaires aux armées permanentes ». Au congrès de Londres, en 1896, une résolution sur la guerre affirme : « la classe ouvrière de tous les pays doit s'opposer à la violence provoquée par les guerres ». En 1900, les partis de l'Internationale ont grandi et ont même des députés aux parlements des principales nations. Un principe est solennellement affirmé : « les députés socialistes de tous les pays sont tenus de voter contre toutes les dépenses militaires, navales et contre les expéditions coloniales. »
En réalité la question de la guerre ne se pose pas encore dans toute son acuité. Mis à part les expéditions coloniales, la période charnière entre les deux siècles est encore marquée par la paix entre les principales nations capitalistes. C'est le temps de « la Belle époque ». Alors que mûrissent les conditions qui vont conduire à la Première guerre mondiale, le mouvement ouvrier semble aller de conquêtes sociales en triomphes parlementaires, et la question de la guerre apparaît pour beaucoup comme une question purement théorique.
« Tout cela explique ‑ et nous écrivons d'après une expérience vécue ‑ le fait que nous, de la génération qui lutta avant la guerre impérialiste de 1914, avons peut-être considéré le problème de la guerre plus comme une lutte idéologique que comme un danger réel et imminent : le dénouement de conflits aigus, sans le recours aux armes, tels Fachoda ou Agadir, nous avait influencés dans le sens de croire fallacieusement que grâce à "l'interdépendance" économique, aux liens toujours plus nombreux et plus étroits entre pays, il s'était ainsi constitué une sûre défense contre l'éclosion d'une guerre entre puissances européennes et que l'augmentation de préparatifs militaires des différents impérialistes, au lieu de conduire inévitablement à la guerre, vérifiait le principe romain "si vis pacem para bellum", si tu veux la paix prépare la guerre. » Gatto Mammone, in Bilan n° 21, 1935. ([1] [11])
Les conditions de cette période d'apogée historique du capitalisme, le développement des partis de masses avec leurs parlementaires et leurs énormes appareils syndicaux, les réformes réelles arrachées à la classe capitaliste, tout cela favorise le développement de l'idéologie réformiste au sein du mouvement ouvrier et son corollaire, le pacifisme. L'illusion d'un capitalisme sans guerres gagne les organisations ouvrières.
Face au réformisme, et contre lui, se dégage une gauche qui maintient les principes révolutionnaires et comprend que le capitalisme est en train d'entrer dans sa phase de décadence impérialiste. Rosa Luxemburg et la fraction bolchevique du parti social‑démocrate russe maintiennent et développent les positions révolutionnaires sur la question de la guerre. En 1907, au congrès de l'Internationale, à Stuttgart, ils parviennent à faire adopter un amendement qui ferme la porte aux conceptions pacifistes. Celui‑ci stipule qu'il ne suffit pas de lutter contre l'éventualité d'une guerre ou de la faire cesser le plus rapidement possible mais qu'il s'agit au cours de celle‑ci de « tirer de toute façon parti de la crise économique et politique pour soulever le peuple et précipiter, par là même, la chute de la domination capitaliste. » En 1912, sous la pression de cette même minorité, le congrès de Bâle dénonce la future guerre européenne comme « criminelle » et « réactionnaire » et ne pouvant qu ’» accélérer la chute du capitalisme en provoquant immanquablement la révolution prolétarienne. »
Malgré ces prises de position, deux ans plus tard, lorsqu'éclate la Première guerre mondiale, l'Internationale s'effondre. Rongées en profondeur par le réformisme et le pacifisme, les directions des différents partis nationaux se rangent du côté de leurs bourgeoisies au nom de la « défense contre l'agresseur ». Les parlementaires sociaux‑démocrates votent les crédits de guerre.
La reprise de la lutte des classes depuis 1968
Depuis la Seconde guerre mondiale, le monde n'a pas connu une minute de paix. Essentiellement à travers des conflits locaux, guerre de Corée, guerres israélo-arabes, mais aussi les soi‑disant luttes de libération nationale (Indochine, Algérie, Vietnam, etc.), les principales puissances impérialistes ont continué de s'affronter militairement. La classe ouvrière n'a pu que subir ces guerres comme l'ensemble des aspects de la vie du capitalisme.
Mais avec la grève massive de 1968 en France, et l'ensemble des luttes qui la suivent en Italie 1969, Pologne 1970 et dans la plupart des pays, le prolétariat revient sur la scène de l'histoire. Retrouvant le chemin du combat massif sur son terrain de classe, il se dégage du poids de la contre‑révolution. Au moment même où la crise capitaliste, provoquée par la fin de la reconstruction, pousse le capital mondial vers l'issue d'une troisième guerre mondiale, la classe ouvrière se détache lentement, mais suffisamment de l'idéologie dominante pour rendre impossible un embrigadement immédiat pour une troisième boucherie impérialiste.
Aujourd'hui, après vingt ans de cette situation de blocage, où la bourgeoisie n'a pas pu se lancer vers sa « solution » apocalyptique généralisée, mais où le prolétariat n'a pas eu la force d'imposer sa solution révolutionnaire, le capitalisme vit sa décomposition en engendrant un nouveau type de conflit, dont la guerre du Golfe constitue la première grande concrétisation.
Pour la classe ouvrière mondiale, et celle des principaux pays industrialisés en particulier, l'avertissement est clair : ou bien elle parvient à développer ses combats jusqu'à leur aboutissement révolutionnaire ou bien la dynamique guerrière du capitalisme en décomposition, de guerre « locale » en guerre « locale », finira par mettre en question la survie même de l'humanité.
COMMENT LUTTER CONTRE LA GUERRE AUJOURD'HUI ?
Et tout d'abord, ce que la classe ouvrière doit rejeter.
Le pacifisme c'est l'impuissance
Avant la guerre du Golfe, comme avant la Première et la Seconde guerres mondiales, à côté de la préparation de ses armes matérielles, à côté du bourrage de crâne belliciste, la bourgeoisie a préparé cette autre arme idéologique qu'est le pacifisme.
Ce qui définit le « pacifisme » ce n'est pas la revendication de la paix. Tout le monde veut la paix. Les va-t-en-guerre eux‑mêmes ne cessent de clamer qu'ils ne veulent la guerre que pour mieux rétablir la paix. Ce qui distingue le pacifisme c'est de prétendre qu'on peut lutter pour la paix, en soi, sans toucher aux fondements du pouvoir capitaliste. Les prolétaires qui, par leur lutte révolutionnaire en Russie et en Allemagne, mirent fin à la Première guerre mondiale, voulaient eux aussi la paix. Mais s'ils ont pu faire aboutir leur combat, c'est parce qu'ils ont su mener leur combat non pas AVEC les « pacifistes » mais malgré et CONTRE ceux‑ci. À partir du moment où il devint clair que seule la lutte revolutionnaire permettrait d'arrêter la boucherie impérialiste, les travailleurs de Russie et d'Allemagne se sont trouvés confrontés non seulement aux « faucons » de la bourgeoisie mais aussi et surtout à tous ces pacifistes de la première heure, les « mencheviks », les « socialistes révolutionnaires », les sociaux‑démocrates qui, armes à la main, défendaient ce dont ils ne pouvaient plus se passer et qui leur était le plus cher : l'ordre capitaliste.
La guerre n'existe pas « en soi », en dehors des rapports sociaux, en dehors des rapports de classes. Dans le capitalisme décadent, la guerre n'est qu'un moment de la vie du système et il ne peut y avoir de lutte contre la guerre qui ne soit lutte contre le capitalisme. Prétendre lutter contre la guerre sans lutter contre le capitalisme, c'est se condamner à l'impuissance. Rendre inoffensive pour le capital la révolte des exploités contre la guerre, tel a toujours été le but du pacifisme.
Sur ces manœuvres, l'histoire nous livre des expériences édifiantes. La même entreprise que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui, les révolutionnaires la dénonçaient déjà il y a plus de cinquante ans avec la dernière énergie : « La bourgeoisie a précisément besoin que, par des phrases hypocrites sur la paix, on détourne les ouvriers de la lutte révolutionnaire », énonçait Lénine en mars 1916. L'usage du pacifisme n'a pas changé : « En cela réside l'unité de principe des sociaux‑chauvins (Plekhanov, Scheidemann) et des sociaux‑pacifistes (Turati, Kautsky) que les uns et les autres, objectivement parlant, sont les serviteurs de l'impérialisme : les uns le servent en présentant la guerre impérialiste comme "la défense de la patrie", les autres servent le même impérialisme en le déguisant par des phrases sur la paix démocratique, la paix impérialiste qui s'annonce aujourd'hui. La bourgeoisie impérialiste a besoin des larbins de l'une et de l'autre sorte, de l'une et de l'autre nuance : elle a besoin des Plekhanov pour encourager les peuples à se massacrer en criant : "À bas les conquérants" ; elle a besoin des Kautsky pour consoler et calmer les masses irritées pas des hymnes et dithyrambes en l'honneur de la paix. » (Lénine, janvier 1917)
Ce qui était vrai au moment de la Première guerre mondiale s'est, depuis, invariablement confirmé. Aujourd'hui encore, face à la guerre du Golfe, dans toutes les puissances belligérantes, la bourgeoisie a organisé la machine pacifiste. Des partis ou des fractions de partis politiques « responsables », c'est‑à‑dire ayant fait largement leurs preuves de fidélité absolue à l'ordre bourgeois (ayant participé au gouvernement, au sabotage des grèves et autres formes de lutte des classes exploitées, ayant joué le rôle de sergents recruteurs dans des guerres passées) sont chargés de prendre la tête de mouvements pacifistes. « Demandons ! », « Exigeons ! », « Imposons ! » ... un capitalisme pacifique. De Ramsey Klark (ancien conseiller du président Johnson) aux USA, à la social-démocratie en Allemagne (celle‑là même qui envoya le prolétariat allemand à la Première guerre mondiale et se chargea directement de l'assassinat des principales figures du mouvement révolutionnaire de 1918/19 Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg), des fractions pacifistes du Labour Party britannique à celles de Chevènement et Cheysson dans le PS français, en passant pas les PC staliniens de France, d'Italie, d'Espagne (avec leurs inévitables acolytes trotskystes), devenus depuis longtemps maîtres dans l'art de recruter la chair a canon, tout ce beau monde s'est retrouvé à la tête des grandes manifestations pacifistes de janvier 1991 à Washington, Londres, Bonn, Rome ou Paris. Tous ces patriotes (qu'ils défendent de grandes ou de petites patries ‑ l'Irak par exemple ‑ ne change rien à l'affaire) ne croient évidemment pas plus à la paix aujourd'hui qu'hier. Tout simplement ils remplissent le role du pacifisme : canaliser le mécontentement et la révolte provoqués par la guerre dans une impasse d'impuissance.
Après les signatures de « pétitions », après les balades dans la rue, en compagnie des « bonnes consciences » de la classe dominante, les prêtres « progressistes », les vedettes du spectacle et autres « amoureux de la paix »... capitaliste, que reste‑t‑il dans l'esprit de ceux qui sincèrement ont cru y trouver un moyen de s'opposer à la guerre, si ce n'est un sentiment de stérilité et d'amère impuissance ? Le pacifisme n'a jamais empêché les guerres capitalistes. Il n'a fait que les préparer et les accompagner.
Le pacifisme s'accompagne presque toujours d'un frère « radical » : l'antimilitarisme. Celui‑ci se caractérise en général par le refus total ou partiel du pacifisme « pacifique ». Pour combattre la guerre il préconise des méthodes plus radicales, directement orientées contre la force militaire : désertion individuelle et « exécution des officiers » sont ses mots d'ordre les plus caractéristiques. À la veille de la Première guerre mondiale, Gustave Hervé en fut le représentant le plus connu. Face à la mollesse du pacifisme ambiant de la social‑démocratie réformiste, il eut un certain écho. Il y eut même à Toulon, en France, un pauvre soldat qui, influencé par ce langage « radical », alla jusqu'à tirer sur son colonel. Cela ne mena évidemment nulle part... sauf Hervé qui aboutit au cours de la guerre au plus abject patriotisme et à l'appui de Clemenceau.
Il est évident que la révolution se traduit par la désertion des soldats de l'armée et par le combat contre les officiers. Mais il s'agit alors, comme pendant les révolutions russe et allemande, d'actions massives des soldats se fondant dans la masse des prolétaires en lutte. Il est absurde de penser qu'il puisse y avoir une solution individualiste a un problème aussi éminemment social que la guerre capitaliste. Il s'agit dans le meilleur des cas de l'expression du désespoir suicidaire de la petite‑bourgeoisie incapable de comprendre le rôle révolutionnaire de la classe ouvrière, et dans le pire, d'une impasse sciemment mise en avant par des forces policières pour renforcer le sentiment d'impuissance face au problème du militarisme et de la guerre. La dissolution des armées capitalistes ne peut être l'œuvre d'actions individuelles de révolte nihiliste, mais le résultat de l'action révolutionnaire, consciente, massive et collective du prolétariat.
Les conditions de la lutte ouvrière aujourd'hui
La lutte contre la guerre ne peut être que la lutte contre le capital. Mais aujourd'hui les conditions de cette lutte sont radicalement différentes de celles qui ont présidé aux mouvements révolutionnaires du passé. De façon plus ou moins directe, les révolutions prolétariennes du passé ont été liées à des guerres : la Commune de Paris fut le résultat des conditions créées par la guerre franco‑allemande de 1870 ; la révolution de 1905 en Russie répondait à la guerre russo‑japonaise ; la vague de 1917‑23 à la Première guerre mondiale. Certains révolutionnaires en ont déduit que la guerre capitaliste constitue une condition nécessaire, ou du moins très favorable pour la révolution communiste. Cela n'était que partiellement vrai dans le passé. La guerre crée des conditions qui poussent effectivement le prolétariat à agir de façon révolutionnaire. Mais, premièrement, cela ne se produit que dans les pays vaincus. Le prolétariat des pays vainqueurs reste généralement beaucoup plus soumis idéologiquement à ses classes dirigeantes, ce qui contrecarre l'indispensable extension mondiale qu exige la survie du pouvoir révolutionnaire. Deuxièmement, lorsque la lutte parvient à imposer la paix à la bourgeoisie, elle se prive par là même des conditions extraordinaires qui ont fait naître cette lutte ([2] [12]). En Allemagne par exemple, le mouvement révolutionnaire APRÈS l'armistice pâtira fortement de la tendance de toute une partie des soldats, revenant du front et n'ayant qu'un désir : jouir de cette paix tant désirée et si chèrement acquise.
Nous avons vu par ailleurs comment, lors de la Deuxième guerre mondiale, la bourgeoisie avait su tirer les leçons de la Première guerre et agir en vue d'éviter des explosions sociales révolutionnaires.
Mais surtout, et au‑delà de toutes ces considérations, si le cours historique actuel est renversé, si jamais il devait y avoir une guerre à laquelle seraient appelés à participer massivement les prolétaires des métropoles impérialistes, elle impliquerait la mise en œuvre de moyens de destruction si terribles que toute possibilité de fraternisation et d'action révolutionnaire serait extrêmement difficile, voire impossible.
S'il est une leçon que les prolétaires doivent retenir de leur expérience passée c'est que, pour lutter contre la guerre aujourd hui, ils devront agir AVANT une guerre mondiale ; pendant, il sera trop tard.
L'analyse des conditions historiques actuelles permet d'affirmer que les conditions d'une nouvelle situation révolutionnaire internationale pourront se créer sans que le capitalisme ait pu embrigader le prolétariat des pays centraux dans une boucherie généralisée.
Les processus qui conduisent à une réponse révolutionnaire du prolétariat ne sont ni rapides ni faciles. Ceux qui aujourd'hui se lamentent de ne pas voir le prolétariat des pays industrialisés répondre immédiatement à la guerre, oublient qu'il lui fallut trois ans de souffrances indescriptibles, entre 1914 et 1917, pour parvenir à engager sa réponse révolutionnaire. Nul ne peut dire quand et comment la classe ouvrière mondiale pourra cette fois‑ci porter son combat à la hauteur de ses tâches historiques. Ce que nous savons, c'est qu'il se heurte aujourd'hui à des difficultés énormes, dont la moindre n'est pas l'ambiance de la décomposition délétère qu'engendre la décadence avancée du capitalisme avec sa généralisation de l'esprit du « chacun pour soi » et l'odeur nauséabonde du stalinisme en putréfaction. Mais nous savons aussi que, contrairement à la période de la crise économique des années 1930, contrairement à la période de la Seconde guerre mondiale, le prolétariat des pays centraux n'est ni écrasé physiquement, ni vaincu dans sa conscience.
Le fait même que le prolétariat des grandes puissances n'ait pu être embrigadé dans la guerre du Golfe, obligeant les gouvernements à recourir à des professionnels, les multiples précautions auxquelles ont dû recourir ces gouvernements pour justifier la guerre, sont une manifestation de ce rapport de forces.
Quant aux effets de cette guerre sur la conscience dans la classe, ils se sont traduits par une relative paralysie de la combativité dans l'immédiat mais aussi par une réflexion inquiète et profonde sur les enjeux historiques.
À ce niveau, la guerre du Golfe se distingue des guerres mondiales du passé sur un aspect particulièrement important : les guerres mondiales ont eu la particularité de cacher, aux yeux des prolétaires, la crise économique qui était à leur origine. Pendant la guerre, les chômeurs disparaissaient sous l'uniforme de soldats, les usines arrêtées reprenaient leur activité pour fabriquer les armes et les marchandises nécessaires à une guerre totale : la crise économique semblait disparue. Il en est tout autrement aujourd'hui. Au moment même où la bourgeoisie déclenchait son enfer de feu au Moyen‑Orient, son économie, au cœur de ses zones les plus industrialisées, plongeait dans une récession sans précédent... sans espoir de nouveau plan Marshall. Nous avons assisté simultanément à une guerre qui a clairement révélé la perspective apocalyptique qu'offre le capital, et à 1'approfondissement de la crise économique. La première a donné la mesure de l'enjeu historique pour le prolétariat, la seconde crée et créera les conditions pour que celui‑ci, contraint de répondre aux attaques, s'affirme en tant que classe et se reconnaisse comme tel.
La situation actuelle est pour les générations présentes de prolétaires un nouveau défi de l'histoire. Celles‑ci peuvent le relever si elles savent tirer profit des vingt dernières années de luttes revendicatives au cours desquelles elles ont appris ce que valent les promesses des capitalistes sur l'avenir de ce système ; si elles savent porter jusqu'au bout la méfiance et la haine qu'elles ont développées contre les organisations soi‑disant ouvrières (syndicats, partis de gauche) qui ont systématiquement saboté tous les combats importants; si elles savent comprendre que leur lutte n'est que la suite de deux siècles de combats de la classe révolutionnaire de notre époque.
Pour cela, loin du terrain interclassiste du pacifisme et autres pièges nationalistes, le prolétariat n'a d'autre chemin que le développement de sa lutte contre le capital, sur son propre terrain de classe.
Un terrain qui se définit de façon simple et tranchante comme une façon de concevoir chaque moment de la lutte : se battre en tant que classe en mettant en avant les intérêts qui sont communs à tous les ouvriers ; défendre ces intérêts de façon intransigeante contre ceux du capital. Ce n'est pas le terrain syndicaliste, qui divise les ouvriers par nations, régions, corporations... Ce n'est pas le terrain des syndicats et partis de gauche, qui prétendent que « la défense des intérêts ouvriers est la meilleure défense de la nation », pour en conclure que les ouvriers doivent tenir compte, dans leurs luttes, des intérêts de la nation, donc du capital national. Le terrain de classe est défini par l'irréconciliabilité entre les intérêts de la classe exploitée et ceux du système capitaliste moribond.
Le terrain de classe n'a pas de frontières nationales, mais des frontières de classe. Il est par lui‑même la négation de la base des guerres capitalistes. Il est le terrain fertile où se développe la dynamique qui conduit le prolétariat à assumer, à partir de la défense de ses intérêts « immédiats », la défense de ses intérêts historiques : la révolution communiste mondiale.
La guerre capitaliste n'est pas plus une fatalité que les aberrations du capitalisme en décomposition. Pas plus que la société antique esclavagiste ou que la société féodale, le capitalisme n'est un mode de production éternel. Seule la lutte pour le bouleversement de cette société, pour la construction d'une société vraiment communiste, sans exploitation ni nations, peut débarrasser l'humanité de la menace de disparition dans le feu de la guerre capitaliste.
Seule la lutte contre le capitalisme est une lutte contre la guerre. C'est la seule « guerre » qui vaille la peine d'être menée.
RV
[1] [13] ) Les travailleurs qui comme Gatto Mammone croyaient voir dans la question de la guerre, avant 1914 une question « idéologique », oubliaient (comme ceux qui, il y a peu, se laissaient endormir par les hymnes à « la fin de la guerre froide » et l'Europe unie de 1992) que le développement de « l'interdépendance » économique, loin de résoudre les antagonismes inter‑impérialistes, ne fait que les exacerber. Ils oubliaient une des découvertes fondamentales du marxisme : la contradiction irrémédiable qui oppose d'une part le caractère de plus en plus international de la production capitaliste et, d'autre part la nature privée, nationale de l'appropriation de cette production par les capitalistes.
La recherche de fournitures comme de débouchés solvables pour sa production, conduit inévitablement chaque capital national, sous la pression de la concurrence, à développer irréversiblement la division internationale du travail. Il se développe ainsi en permanence une interdépendance économique internationale de tous les capitaux nationaux â l'égard des autres. Cette tendance, effective depuis les premiers temps du capitalisme, s'est vue renforcée par l'organisation du monde en blocs au lendemain de la Seconde guerre mondiale, tout comme par le développement des entreprises dites « multinationales ». Cependant le capitalisme ne peut pas pour autant abandonner la base de son existence : la propriété privée et son organisation en nations. Qui plus est, la décadence capitaliste s'est accompagnée simultanément du renforcement de la tendance au capitalisme d'État, c'est‑à‑dire â la dépendance de chaque capital national à l'égard de son appareil d'État national devenu maitre d'œuvre de toute la vie sociale. Cette contradiction essentielle entre production organisée internationalement et maintien de l'appropriation par nations, constitue un des bases objectives de la nécessité et de la possibilité d'une société communiste sans propriété privée ni nations. Mais pour le capitalisme, elle est une impasse insoluble qui ne peut le conduire qu'au chaos et à la barbarie guerrière.
[2] [14] « La guerre, incontestablement, a joué un rôle énorme dans le développement de noire révolution, elle a désorganisé matériellement l'absolutisme ; elle a disloqué l'armée ; elle a donné de l'audace à la masse des hésitants. Mais heureusement elle n'a pas créé la révolution et c'est une chance parce que la révolution née de la guerre est impuissante : elle est le produit de circonstances extraordinaires, repose sur une force extérieure et en définitive se montre incapable de conserver les positions conquises. » Trotsky dans « Notre révolution », parlant du rôle de la guerre russo‑japonaise dans l'éclatement de la Révolution de 1905 en Russie.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Guerre [2]
Heritage de la Gauche Communiste:
MARC : De la révolution d'octobre 1917 à la deuxième guerre mondiale
- 3882 lectures
Comme les lecteurs de notre presse territoriale l'ont déjà appris, notre camarade Marc est mort. Dans le numéro de décembre de notre publication territoriale en France, on pouvait trouver, associé à une souscription, le texte suivant signé MC : "En réponse à de nombreuses lettres qui m'ont profondément touché et pour un premier dur combat, livré et gagné, cette souscription pour la presse du CCI..." C'est avec beaucoup de lucidité et de courage, comme à son habitude, que notre camarade avait livré combat contre la maladie. Mais celle-ci, une des formes les plus foudroyantes du cancer, devait finalement prendre le dessus, le 20 décembre 1990. Avec Marc, ce n'est pas seulement notre organisation qui perd son militant le plus expérimenté et le plus fécond ; c'est tout le prolétariat mondial qui se trouve privé d'un de ses meilleurs combattants.
Depuis longtemps, et contre toutes les visions propres à l’individualisme bourgeois, le marxisme a montré que ce ne sont pas les individualités qui font l'histoire mais que, depuis l'apparition des classes sociales : "L'histoire de toutes les sociétés, jusqu'à ce jour, est l'histoire de la lutte des classes". Il en est de même, et c'est particulièrement vrai, de l'histoire du mouvement ouvrier dont le principal protagoniste est justement la classe qui, bien plus que toutes les autres, travaille de façon associée et mène son combat de façon collective. Au sein du prolétariat, c'est également, et en conséquence, de façon collective qu'agissent les minorités communistes qu'il secrète comme manifestation de son devenir révolutionnaire. En ce sens, l'action de ces minorités revêt un caractère avant tout anonyme et n'a pas à sacrifier au culte des personnalités. Leurs membres n'ont de raison d'exister, en tant que militants révolutionnaires, que comme partie d'un tout, l'organisation communiste. Cependant, si l'organisation doit pouvoir compter sur tous ses militants, il est clair que tous ne lui apportent pas une contribution équivalente. L'histoire personnelle, l'expérience, la personnalité de certains militants, de même que les circonstances historiques, les conduisent à jouer dans les organisations où ils militent un rôle tout à fait particulier et marquant en tant qu'élément d'impulsion des activités de ces organisations, et notamment de l'activité qui se trouve à la base de leur raison d'existence : l'élaboration et l'approfondissement des positions politiques révolutionnaires.
Marc était justement un de ceux-là. En particulier, il appartenait à la toute petite minorité de militants communistes qui a survécu et résisté à la terrible contre-révolution qui s'est abattue sur la classe ouvrière entre les années 1920 et les années 1960, tels Anton Pannekoek, Henk Canne-Meijer, Amadeo Bordiga, Onorato Damen, Paul Mattick, Jan Appel ou Munis. De plus, outre sa fidélité indéfectible à la cause du communisme, il a su à la fois conserver sa pleine confiance dans les capacités révolutionnaires du prolétariat, faire bénéficier les nouvelles générations de militants de toute son expérience passée, et ne pas rester enfermé dans les analyses et positions dont le cours de l'histoire exigeait le dépassement [1] [17]. En ce sens, toute son activité de militant constitue un exemple concret de ce que le marxisme veut dire : la pensée vivante, en constante élaboration, de la classe révolutionnaire, porteuse de l'avenir de l'humanité.
Ce rôle d'impulsion de la pensée et de l'action de l'organisation politique, notre camarade l'a joué de façon éminente dans le CCI, évidemment. Et cela, jusqu'aux dernières heures de sa vie. En fait, toute sa vie militante est animée par la même démarche, par la même volonté de défendre bec et ongles les principes communistes, tout en gardant en permanence l'esprit critique en éveil afin d’être capable, chaque fois que nécessaire, de remettre en cause ce qui semblait à beaucoup des dogmes intangibles et "invariants". Une vie militante de plus de soixante-dix ans et qui a trouvé ses sources à la chaleur même de la révolution.
L'engagement dans la lutte révolutionnaire
Marc est né le 13 mai 1907 à Kichinev, capitale de la Bessarabie (Moldavie), à une époque où cette région faisait partie de l'ancien Empire tsariste. Il n’a donc pas encore dix ans lorsque éclate la révolution de 1917. Voici comment lui-même, à l'occasion de son 80e anniversaire, décrit cette formidable expérience qui a marqué toute sa vie :
"J'ai eu la chance de vivre et de connaître, tout en étant enfant, la révolution russe de 1917, aussi bien de Février que d'Octobre. Je l'ai vécue intensément. Il faut savoir et comprendre ce qu'est un Gavroche, ce qu'est un enfant dans une période révolutionnaire, où on passe ses journées dans des manifestations, de l'une à l'autre, d'un meeting à l'autre ; où on passe les nuits dans des clubs où sont les soldats, les ouvriers, où ça parle, où ça discute, où ça s'affronte ; lorsque,à chaque coin de rue, tout d'un coup, brusquement, un homme se lève sur le bord d'une fenêtre et commence à parler : immédiatement, il y a 1000 personnes qui sont autour et ça commence à discuter. C'est quelque chose d'inoubliable comme souvenir, qui a marqué toute ma vie, évidemment. J'ai eu la chance, par dessus le marché, d'avoir mon frère aîné qui était soldat et qui était bolchevik, le secrétaire du parti dans la ville, et avec qui je pouvais courir, la main dans la main, d'un meeting à l'autre où il portait la défense des positions des bolcheviks.
J'ai eu la chance d'être le dernier enfant - le cinquième- d'une famille où tous les membres furent, les uns après les autres, militants du Parti jusqu'à être tués ou exclus. Tout cela m'a permis de vivre dans une maison qui était toujours pleine de gens, de jeunes, où il y avait toujours des discussions car, au début, un seul était bolchevik, les autres étant plus ou moins socialistes. C'était un permanent débat avec tous leurs camarades, tous leurs collègues, etc. Et c'était une chance énorme pour la formation d'un enfant."
En 1919, durant la guerre civile, lorsque la Moldavie est occupée par les troupes blanches roumaines, toute la famille de Marc, menacée par les pogroms (le père était rabbin), émigré en Palestine. Ce sont d'ailleurs ses frères et soeur aînés qui sont à l'origine de la fondation du parti communiste de ce pays. C'est à ce moment là, début 1921, que Marc (qui n'a pas encore 13 ans) devient militant, puisqu'il entre aux jeunesses communistes (en fait, c'est l'un de leurs fondateurs) et au parti. Très vite, il se heurte à la position de l'Internationale communiste sur la question nationale qui, suivant ses propres termes, lui "passait difficilement par la gorge". Ce désaccord lui vaut d'ailleurs, en 1923, sa première exclusion du parti communiste. Dès cette époque, alors qu'il est encore adolescent, Marc manifeste donc déjà ce qui sera une de ses principales qualités tout au long de sa vie militante : une intransigeance indéfectible dans la défense des principes révolutionnaires, même si cette défense devait le conduire à s'opposer aux "autorités" les plus prestigieuses du mouvement ouvrier comme l'étaient à ce moment-là les dirigeants de l'Internationale communiste, notamment Lénine et Trotsky [2] [18]. Son adhésion totale à la cause du prolétariat, son implication militante dans l'organisation communiste et l'estime profonde qu'il portait aux grands noms du mouvement ouvrier ne l'ont jamais conduit à renoncer au combat pour ses propres positions lorsqu'il estimait que celles de l'organisation s'écartaient de ces principes ou qu'elles étaient dépassées par les nouvelles circonstances historiques. Pour lui, comme pour tous les grands révolutionnaires, tels Lénine ou Rosa Luxemburg, l'adhésion au marxisme, la théorie révolutionnaire du prolétariat, n'était pas une adhésion à la lettre de cette théorie mais à son esprit et à sa méthode. En fait, l'audace dont a toujours su faire preuve notre camarade, à l'image des autres grands révolutionnaires, était le pendant, l'autre face, de son adhésion totale et indéfectible à la cause et au programme du prolétariat. C'est parce qu'il était profondément attaché au marxisme, qu'il en était pénétré jusqu'au bout des ongles, qu'il n'a jamais été paralysé par la crainte de s'en écarter lorsqu'il critiquait, sur la bse du même marxisme, ce qui était devenu caduc dans les positions des organisations ouvrières. La question du soutien aux luttes de libération nationale qui, dans le seconde, puis dans la troisième internationale était devenue une sorte de dogme, fut donc le premier terrain sur lequel il eut l'occasion d'appliquer cette démarche [3] [19].
Le combat contre la dégénérescence de l'Internationale
En 1924, Marc, en compagnie d'un de ses frères, vient vivre en France. Il obtient alors son intégration dans la section juive du Parti communiste, redevenant membre de cette même Internationale dont il avait été exclu peu avant. Immédiatement, il fait partie de l'opposition qui combat le processus de dégénérescence de l’IC et des partis communistes. C'est ainsi qu'avec Albert Treint (secrétaire général du PCF de 1923 à 1926) et Suzanne Girault (ancienne trésorière du Parti), il participe à la fondation, en 1927, de l'Unité léniniste. Lorsque parvient en France la plateforme de l'Opposition russe rédigée par Trotsky, il se déclare en accord avec elle. En revanche, et contrairement à Treint, il rejette la déclaration de Trotsky affirmant que sur toutes les questions où il y avait eu désaccord entre lui et Lénine avant 1917, c'est Lénine qui avait raison. Marc estimait qu'une telle attitude n'était absolument pas correcte, d'abord parce que Trotsky n'était pas réellement convaincu de ce qu'il avançait, ensuite parce qu'une telle déclaration ne pouvait qu'enfermer Trotsky dans des positions fausses défendues dans le passé par Lénine (notamment au moment de la révolution de 1905 sur la question de la "dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie"). De nouveau se manifeste cette capacité de notre camarade à conserver une attitude critique et lucide face aux grandes "autorités" du mouvement ouvrier. Son appartenance à l'Opposition de gauche internationale, après son exclusion du PCF en février 1928, ne signifiait pas une allégeance à toutes les positions de son principal dirigeant, malgré toute l'admiration qu'il pouvait, par ailleurs, lui porter. C'est en particulier grâce à cet esprit qu'il est capable, par la suite, de ne pas se laisser entraîner dans la dérive opportuniste du mouvement trotskiste contre laquelle il engage la lutte au début des années 1930. En effet, après sa participation, avec Treint, à la formation du Redressement communiste, il adhère en 1930 à la Ligue communiste (l'organisation qui représente l'Opposition en France) dont il devient, de même que Treint, membre de la commission exécutive en octobre 1931. Mais tous deux, après y avoir défendu une position minoritaire face à la montée de l'opportunisme, quittent cette formation en mai 1932 avant de participer à la constitution de la Fraction communiste de gauche (dite Groupe de Bagnolet). En 1933, cette organisation connaît une scission et Marc rompt avec Treint qui commence à défendre une analyse de l'URSS comparable à celle développée plus tard par Burnham et Chaulieu ("Socialisme bureaucratique"). Il participe alors, en novembre 1933, à la fondation de l'Union communiste en compagnie de Chazé (Gaston Davoust, mort en 1984), avec qui il avait entretenu des relations étroites, depuis le début des années 1930, alors que ce dernier était encore membre du PCF (il est exclu en août 1932) et qu'il animait le 15e Rayon (banlieue ouest de Paris) qui défendait des orientations d'opposition.
Les grands combats des années 1930
Marc est resté membre de l'Union communiste jusqu'au moment de la guerre d'Espagne. Nous vivons une des périodes les plus tragiques du mouvement ouvrier : suivant les termes de Victor Serge, "il est minuit dans le siècle". Comme Marc le dit lui-même : "Passer ces années d'isolement terrible, voir le prolétariat français arborer le drapeau tricolore, le drapeau des Versaillais et chanter la Marseillaise, tout cela au nom du communisme, c'était, pour toutes les générations qui étaient restées révolutionnaires, source d'une horrible tristesse". Et c'est justement au moment de la guerre d'Espagne que ce sentiment d'isolement atteint un de ses points culminants lorsque nombre d'organisations qui avaient réussi à maintenir des positions de classe sont entraînées par la vague "antifasciste". C'est notamment le cas de l'Union communiste qui voit dans les événements d'Espagne une révolution prolétarienne dans laquelle la classe ouvrière aurait l'initiative du combat. Cette organisation ne va certes pas jusqu'à soutenir le gouvernement de "Front populaire". Mais elle préconise l'enrôlement dans les milices antifascistes et elle noue des relations politiques avec l'aile gauche du POUM, une organisation antifasciste qui participe au gouvernement de la "Generalitat" de Catalogne.
Défenseur intransigeant des principes de classe, Marc ne peut évidemment pas accepter une telle capitulation devant l'idéologie antifasciste ambiante, même si elle se pare de justifications comme la "solidarité avec le prolétariat d'Espagne". Après avoir mené le combat minoritaire contre une telle dérive, il quitte l'Union communiste et rejoint individuellement, début 1938, la Fraction de gauche italienne avec qui il était resté en contact. Celle-ci avait été pour sa part, également, confrontée à un minorité favorable à l'enrôlement dans les milices anti-fascistes. Au milieu de la tourmente que représente la guerre d'Espagne, de toutes les trahisons qu'elle occasionne, la Fraction italienne, fondée à Pantin, dans la banlieue parisienne, en mai 1928, est une des rares formations à résister sur des principes de classe. Elle base ses positions de rejet intransigeant de toutes les sirènes antifascistes sur la compréhension du cours historique dominé par la contre-révolution. Dans une telle période de recul profond du prolétariat mondial, de victoire de la réaction, les événements d'Espagne ne peuvent être compris comme l'essor d'une nouvelle vague révolutionnaire, mais comme une nouvelle étape de la contre-révolution. Au bout de la guerre civile qui oppose non pas la classe ouvrière à la bourgeoisie, mais la République bourgeoise, alliée au camp impérialiste "démocratique", contre un autre gouvernement bourgeois, allié au camp impérialiste "fasciste", il ne peut y avoir la révolution mais la guerre mondial. Le fait que les ouvriers d'Espagne aient pris spontanément les armes face au putsch de Franco en juillet 1936 (ce qui est évidemment salué par la Fraction) ne leur ouvre aucune perspective révolutionnaire à partir du moment où, embrigadés par les organisations antifascistes telles le PS, le PC et la CNT anarcho-syndicaliste, ils renoncent au combat sur leur terrain de classe pour se transformer en soldats de la République bourgeoise dirigée par le "frente popular". Et une des meilleures preuves de l'impasse tragique dans laquelle se trouve le prolétariat en Espagne est, pour la Fraction, constituée par le fait qu’il n'y a dans ce pays aucun parti révolutionnaire [4] [20].
C'est donc comme militant de la Fraction italienne, qui est exilée en France et en Belgique [5] [21], que Marc poursuit le combat révolutionnaire. En particulier, il devient très proche de Vercesi (Ottorino Perrone) qui en est le principal animateur. Bien des années après, Marc a souvent expliqué aux jeunes militants du CCI combien il avait appris aux cotés de Vercesi pour qui il avait une estime et une admiration considérables. "C'est auprès de lui que j'ai appris vraiment ce qu'était un militant", a-t-il dit à plusieurs reprises. En effet, la remarquable fermeté dont fait preuve la Fraction, elle la doit en grande partie à Vercesi qui, militant depuis la fin de la première guerre mondiale dans le PSI puis dans le PCÎ, a mené de façon permanente le combat pour la défense des principes révolutionnaires contre l'opportunisme et la dégénérescence de ces organisations. A la différence de Bordiga, principal dirigeant du PCI lors de sa fondation en 1921 et animateur de la gauche de celui-ci par la suite, mais qui s'est retiré de la vie militante après son exclusion du PCI en 1930, il a mis son expérience au service de la poursuite du combat face a la contre-révolution. En particulier, il apporte une contribution décisive à l'élaboration de la position concernant le rôle des fractions dans la vie des organisations prolétariennes, notamment dans les périodes de réaction et de dégénérescence du Parti [6] [22]. Mais sa contribution est bien plus vaste. Sur la base de la compréhension des tâches qui incombent aux révolutionnaires après l'échec de la révolution et la victoire de la contre-révolution, faire un bilan (d'où le nom de la publication de la Fraction en langue française) de l'expérience passée afin de préparer "les cadres pour les nouveaux partis du prolétariat", et cela sans "aucun interdit non plus qu'aucun ostracisme" (Bilan, n°1), il impulse dans la fraction tout un travail de réflexion et d’élaboration théorique qui en fait une des organisations les plus fécondes de l'histoire du mouvement ouvrier. En particulier, bien que de "Léniniste", il n'a pas peur de reprendre à son compte les positions de Rosa Luxemburg rejetant le soutien aux luttes d'indépendance nationale et sur l'analyse des causes économiques de l'impérialisme. Sur ce dernier point, il tire profit des débats avec la Ligue des communistes internationalistes de Belgique (une formation issue du trotskisme mais qui s'en est éloignée), dont la minorité rejoint les positions de la fraction lors de la guerre d'Espagne, pour constituer avec elle, à la fin de 1937, la Gauche communiste internationale. Par ailleurs, Vercesi (en compagnie de Mitchell, membre de la LCI), en s'appuyant sur les enseignements du processus de dégénérescence de la révolution en Russie et du rôle de l'Etat soviétique dans la contre-révolution, élabore la position suivant laquelle il ne peut y avoir identification entre la dictature du prolétariat et l'Etat qui surgit après la révolution. Enfin, en matière d'organisation, il donne un exemple, au sein de la commission exécutive de la Fraction, de comment il s'agit de mener un débat lorsque surgissent des divergences graves. En effet, face a la minorité qui rompt toute discipline organisationnelle en allant s'engager dans les milices antifascistes, qui refuse de payer ses cotisations, il combat l'idée d'une séparation organisationnelle précipitée (alors que, conformément aux règles de fonctionnement de la Fraction, les membres de la minorité auraient parfaitement pu être exclus) afin de donner le maximum de chances au développement de la plus grande clarté dans le débat. Pour Vercesi, comme pour la majorité de la Fraction, la clarté politique constitue en effet une priorité essentielle dans le rôle et l'activité des organisations révolutionnaires.
Tous ces enseignements qui, sur bien des points correspondent déjà à sa démarche politique antérieure, Marc les a pleinement assimilés au cours des années où il a milité aux côtés de Vercesi. Et c'est d'ailleurs sur ces mêmes enseignements qu'il va s'appuyer lorsque, à son tour, Vercesi commencera à les oublier et à s'écarter des positions marxistes. En effet, celui-ci, au moment même où se constitue la GCI, où Bilan est remplacé par Octobre, commence à développer une théorie de l'économie de guerre comme antidote définitif à la crise du capitalisme. Désorienté par le succès momentané des politiques économiques du New Deal et du nazisme, il en conclut que la production d'armes, qui ne vient pas encombrer un marché capitaliste sursaturé, permet au capitalisme de surmonter ses contradictions économiques. Selon lui, le formidable effort d'armement réalisé par tous les pays à la fin des années 1930 ne correspond donc pas aux préparatifs de la future guerre mondiale mais constitue au contraire un moyen d'y échapper en éliminant sa cause fondamentale : l'impasse économique du capitalisme. Dans ce contexte, les différentes guerres locales qui se sont développées, notamment la guerre d'Espagne, ne doivent pas être considérées comme les prémisses d'un conflit généralisé, mais comme un moyen pour la bourgeoisie d'écraser la classe ouvrière face à une montée des combats révolutionnaires. C'est pour cela que la publication que se donne le Bureau international de la GCI s'appelle Octobre : nous sommes entrés dans une nouvelle période révolutionnaire. De telles positions constituent une sorte de victoire posthume pour l'ancienne minorité de la Fraction.
Face à un tel dérapage, qui remet en cause l'essentiel des enseignements de Bilan, Marc engage le combat pour la défense des positions classiques de la Fraction et du marxisme. C'est pour lui une épreuve très difficile puisqu'il doit combattre les errements d'un militant à qui il porte la plus haute estime. Dans ce combat, il est minoritaire car la majorité des membres de la fraction, aveuglés par leur admiration envers Vercesi, le suivent dans cette impasse. En fin de compte, cette conception conduit la Fraction italienne, de même que la Fraction belge, à une totale paralysie au moment de l'éclatement de la guerre mondiale face à laquelle Vercesi estime qu il n'y a plus lieu d'intervenir puisque le prolétariat a "disparu socialement". A ce moment-là, Marc qui a été mobilisé dans l'armée française (bien qu'apatride) ne peut engager immédiatement le combat [7] [23]. Ce n'est qu'en août 1940, à Marseille, dans le Sud de la France, qu'il peut se replonger dans l'activité politique pour regrouper les éléments de la Fraction italienne qui se sont retrouvés dans cette ville.
Face a la guerre impérialiste
Ces militants refusent pour la plupart la dissolution des fractions prononcée, sous 1’influence de Vercesi, par le Bureau international de celles-ci. Ils tiennent en 1941 une conférence de la Fraction reconstituée qui se base sur le rejet de la dérive introduite à partir de 1937 : théorie de l'économie de guerre comme dépassement de la crise, guerres "localisées" contre la classe ouvrière, "disparition sociale du prolétariat", etc. De même, la Fraction abandonne sa vieille position sur l'URSS présentant celle-ci comme un "Etat ouvrier dégénéré" [8] [24] et reconnaît sa nature capitaliste. Tout au long de la guerre, dans les pires conditions de clandestinité, la Fraction va tenir des conférences annuelles regroupant des militants de Marseille, Toulon, Lyon et Paris de même que, malgré l'occupation allemande, elle va établir des liens avec les éléments de Belgique. Elle publie un Bulletin intérieur de discussion abordant toutes les questions qui ont conduit à la faillite de 1939. Quand on lit les différents numéros de ce bulletin, on peut constater que la plupart des textes de fond combattant les dérives impulsées par Vercesi ou élaborant les nouvelles positions requises par l'évolution de la situation historique sont signés Marco. Notre camarade, qui n'avait rejoint la Fraction italienne qu'en 1938, et qui en était le seul membre "étranger", en est durant toute la guerre le principal animateur.
En même temps, Marc a entrepris un travail de discussion avec un cercle de jeunes éléments, dont la plupart viennent du trotskisme, et avec qui, en mai 942, il constitue le Noyau français de la Gauche communiste sur les bases politiques de la GCI. Ce noyau se donne pour perspective la formation de la Fraction française de la Gauche communiste mais, rejetant la politique de "campagnes de recrutement" et de "noyautage" pratiquée par les trotskistes, il se refuse, sous l'influence de Marc, à proclamer de façon précipitée la constitution immédiate d'une telle fraction.
La Commission exécutive de la Fraction italienne reconstituée, dont Marc fait partie, ainsi que le noyau français, sont conduits à prendre position face aux événements d'Italie de 1942-1943 où des combats de classe très importants conduisent au renversement de Mussolini le 25 juillet 1943 et à son remplacement par l'amiral Badoglio qui est pro-allié. Un texte signé Marco pour la CE affirme que "les révoltes révolutionnaires qui arrêteront le cours de la guerre impérialiste créeront en Europe une situation chaotique des plus dangereuses pour la bourgeoisie" tout en mettant en garde contre les tentatives du "bloc impérialiste anglo-américano-russe" de liquider ces révoltes de l'extérieur, et contre celles des partis de gauche de "museler la conscience révolutionnaire". La conférence de la Fraction qui, malgré l'opposition de Vercesi, se tient en août 1943, déclare, suite à l'analyse des événements d'Italie, que "la transformation de la fraction en Parti" est à l'ordre du jour dans ce pays. Cependant, à cause des difficultés matérielles et, aussi, de l'inertie que Vercesi oppose à une telle démarche, la Fraction ne réussit pas à rentrer en Italie pour intervenir activement dans les combats qui ont commencé à s'y dérouler. En particulier, elle ignore qu'à la fin 1943 s'est constitué dans le nord de ce pays, sous l'impulsion d'Onorato Damen et de Bruno Maffi, le Partito comunista internazionalista (PCInt), auquel participent d'anciens membres de la Fraction.
Durant cette même période, la Fraction et le Noyau ont entrepris un travail de contacts et de discussions avec d'autres éléments révolutionnaires et particulièrement avec des réfugiés allemands et autrichiens, les Revolutionäre Kommunisten Deutschlands (RKD), qui se sont dégagés du trotskisme. Avec eux, ils vont mener, et particulièrement le Noyau français, une action de propagande directe contre la guerre impérialiste adressée aux ouvriers et soldats de toutes les nationalités, y compris aux prolétaires allemands en uniforme. C'est évidemment une activité extrêmement dangereuse car elle doit affronter non seulement la Gestapo mais aussi la Résistance. C'est d'ailleurs cette dernière qui se montre la plus dangereuse pour notre camarade qui, fait prisonnier avec sa compagne par les FFI où grouillent les staliniens, échappe a la mort que ces derniers lui promettaient en s'évadant au dernier moment. Mais la fin de la guerre va sonner le glas de la Fraction.
A Bruxelles, fin 1944, après la "Libération", Vercesi sur la lancée de ses positions aberrantes tournant le dos aux principes qu'il avait défendus par le passé, est conduit à prendre la tête d'une "Coalition antifasciste" qui publie ltalia di Domani, un journal qui, sous couvert d'aide aux prisonniers et émigrés italiens, se situe clairement aux côtés de l'effort de guerre des Alliés. Dès qu'elle a pu vérifier la réalité d'un tel fait, qui avait d'abord rencontré son incrédulité, la CE de la Fraction, sous l'impulsion de Marc, exclut Vercesi, le 25 janvier 1945. Une telle décision ne résultait pas des désaccords qui existaient sur les différents points d'analyse entre ce dernier et la majorité de la Fraction. Comme avec l'ancienne minorité de 1936-37, la politique de la CE, et de Marc en son sein qui reprenait à son compte l'attitude de Vercesi à l'époque, était de mener les débats avec la plus grande clarté. Mais ce qui était reproché à Vercesi en 1944-1945, ce n'était pas simplement des désaccords politiques, c'était sa participation active, et même dirigeante, à un organisme de la bourgeoisie impliqué dans la guerre impérialiste. Mais cette dernière manifestation d'intransigeance de la part de la Fraction italienne n'était que le chant du cygne.
Découvrant l'existence du PCInt en Italie, la majorité de ses membres, à la conférence de mai 1945, décide l’auto-dissolution de la Fraction et l'intégration individuelle de ses militants dans le nouveau "parti". Marc combat avec la dernière énergie ce qu'il considère comme une complète négation de toute la démarche sur laquelle s'était fondée la Fraction. Il demande le maintien de celle-ci jusqu'à la vérification des positions politiques de cette nouvelle formation qui sont mal connues. Et l'avenir donnera parfaitement raison à sa prudence quand on constatera que le parti en question, auquel se sont ralliés les éléments proches de Bordiga se trouvant dans le Sud de l'Italie et dont certains pratiquaient l'entrisme dans le PCI), a évolué vers les positions les plus opportunistes qui soient, jusqu'à se compromettre avec le mouvement des partisans antifascistes (voir Revue Internationale n°8, 4e trimestre 1976, et n°32, 1er trimestre 1983). Pour protester contre un tel reniement, Marc annonce sa démission de la CE et quitte la conférence, laquelle a également refusé de reconnaître la Fraction française de la Gauche communiste (FFGC) qui avait été constituée à la fin 1944 par le Noyau français et qui avait fait siennes les positions de base de la Gauche communiste internationale. De son côté, Vercesi a rejoint le nouveau "Parti" qui ne lui demande aucun compte sur sa participation à la coalition antifasciste de Bruxelles. C'en est fini de tout l'effort que lui même avait mené durant des années pour que la Fraction puisse servir de "pont" entre l'ancien parti passé à l'ennemi et le nouveau parti qui devrait se constituer avec le ressurgissement des combats de classe du prolétariat. Loin de reprendre le combat pour ces positions, il oppose au contraire une hostilité farouche, et avec lui l'ensemble du PCInt, à la seule formation qui soit restée fidèle aux principes classiques de la Fraction italienne et de la Gauche communiste internationale : la FFGC. Il va même encourager, au sein de celle-ci, une scission qui constitue une FFGC bis ([9] [25]. Ce groupe publie un journal portant le même nom que celui de la FFGC, L'Etincelle. Il accueille dans ses rangs les membres de l'ex-minorité de Bilan, combattue à l'époque par Vercesi, de même que d'anciens membres de l'Union Communiste. C'est la FFGC bis que le PCInt et la Fraction belge (reconstituée après la guerre autour de Vercesi resté à Bruxelles) reconnaîtront comme "seul représentant de la Gauche communiste".
Désormais, Marc reste le seul membre de la Fraction italienne à poursuivre le combat et les positions qui avaient fait la force et la clarté politique de cette organisation. C'est au sein de la Gauche communiste de France, nouveau nom que s'est donné la FFGC, qu'il engage cette nouvelle étape de sa vie politique.
CCI
Lorsqu'il s'agit de traiter de la vie d'un camarade et d'un hommage à son engagement, il s'agit d'un tout, et il eût été préférable de publier in extenso l'article que nous lui consacrons dans cette Revue internationale. Mais parce que sa vie se confond avec l'histoire de ce siècle et des minorités révolutionnaires du mouvement ouvrier, nous avons pensé nécessaire de ne pas traiter seulement de la vie du camarade, mais également de développer plus longuement quelles furent les questions politiques les plus importantes auxquelles il fut confronté, ainsi que la vie des organisations dans lesquelles il a milité. Etant donné les impératifs de la situation internationale d'aujourd'hui, l'article a donc été divisé en deux parties, pour des raisons de place, et la suite paraîtra dans le prochain numéro de la Revue Internationale.
[1] [26] Les militants qui sont évoqués ici ne sont que les plus connus parmi ceux qui ont réussi à traverser la période de contre-révolution sans abandonner leurs convictions communistes. Il faut signaler que, contrairement à Marc, la plupart d'entre eux n'ont pas réussi à fonder ou à maintenir en vie des organisations révolutionnaires. Il en est ainsi, par exemple, de Mattick, Pannekoek et Canne-Meijer, figures de proue du mouvement "conseilliste" qui ont été paralysés par leurs conceptions sur l'organisation ou même, comme ce fut le cas du dernier (voir dans notre Revue Internationale n° 37, "La faillite du conseillisme, Le socialisme perdu") par l'idée que le capitalisme serait capable de surmonter ses crises indéfiniment écartant toute possibilité pour le socialisme. De même Munis, valeureux et courageux militant venu de la section espagnole du courant trotskiste, n'ayant jamais pu rompre complètement avec les conceptions de ses origines et enfermé dans une vision volontariste qui rejetait le rôle de la crise économique dans le développement de la lutte de classe, n'a pu donner aux nouveaux éléments qui l'ont rejoint dans le Ferment ouvrier révolutionnaire (FOR) un cadre théorique les rendant capables de poursuivre sérieusement l'activité de cette organisation après la disparition de son fondateur. Bordiga et Damen, pour leur part, se sont montrés capables d'animer des formations qui leur ont survécu (le Parti communiste international et le Parti communiste internationaliste) ; cependant, ils ont éprouvé les plus grandes difficultés (surtout Bordiga) à dépasser les positions de l'Internationale communiste devenues caduques, ce qui a constitué un handicap pour leurs organisations, qui leur a valu une crise extrêmement grave au début des années 1980 (dans le cas du PCI) ou une ambiguïté permanente sur des questions vitales comme celles du syndicalisme, du parlementarisme et des luttes nationales (cas du PCInternationaliste, comme on a pu voir lors des conférences internationales de la fin des années 1970). C'était d'ailleurs un peu le cas de Jan Appel, un des grands noms du KAPD qui est resté marqué par les positions de cette organisation sans être vraiment en mesure de les actualiser. Cependant, dès la constitution du CCI, ce camarade s'est reconnu dans l'orientation générale de notre organisation et lui a apporté tout le soutien que lui permettaient ses forces. Il faut noter qu'à l'égard de tous ces militants, malgré les désaccords souvent très importants qui pouvaient le séparer d'eux, Marc nourrissait la plus grande estime et qu'il éprouvait pour la plupart d'entre eux une profonde affection. Cette estime et cette affection ne se limitaient pas d'ailleurs à ces camarades. Elles s'étendaient à des militants moins en vue mais qui avaient, aux yeux de Marc, l'immense mérite d'avoir conservé leur fidélité à la cause révolutionnaire dans les pires moments de l'histoire du prolétariat.
[2] [27] Marc aimait évoquer cet épisode de la vie de Rosa Luxemburg qui, lors du congrès de l'Internationale socialiste, en 1896 (elle a 26 ans) ose se dresser contre toutes les "autorités" de l'Internationale pour combattre ce qui semblait être devenu un principe intangible du mouvement ouvrier : la revendication de l'indépendance de la Pologne.
[3] [28] Cette démarche se trouve à l'opposé de celle d'un Bordiga pour qui le programme du prolétariat est "invariant" depuis 1848. Cela dit, elle n'a évidemment rien à voir avec celle des "révisionnistes" à la Bernstein ou, plus récemment, à la Chaulieu, mentor du groupe "Socialisme ou Barbarie" (1949-1965). Elle est également complètement différente de celle du mouvement conseilliste qui, parce que la révolution russe de 1917 avait débouché sur une variante du capitalisme, a considéré qu'il s'agissait d'une révolution bourgeoise, ou qui se revendiquait d'un "nouveau" mouvement ouvrier par opposition à l'"ancien" (la deuxième et la troisième Internationales) qui aurait fait faillite.
[4] [29] Concernant l'attitude de la Fraction face aux événements d'Espagne, voir notamment la Revue internationale n°4, 6 et 7, 1976
[5] [30] Sur la Fraction italienne, voir notre brochure La Gauche communiste d'Italie.
[6] [31] Sur la question des rapports parti-fraction voir notre série d'articles dans la Revue Internationale n° 59, 61, 64 et 65 (1989-91).
[7] [32] Pendant quinze ans, notre camarade n'avait eu d'autre papier officiel qu'un ordre d'expulsion du territoire français dont il était obligé, toutes les deux semaines, de faire prolonger le délai d'exécution auprès des autorités. C'était une épée de Damoclès que le très démocratique gouvernement de la France, "terre d'asile et des droits de l'homme", avait suspendu au-dessus de sa tête, puisque Marc était obligé en permanence de s'engager à ne pas avoir d'activités politiques, engagement que, évidemment, il ne respectait pas. Au moment de la guerre, ce même gouvernement décrète que cet "apatride indésirable" est tout à fait apte à servir de chair à canon pour la défense de la patrie. Fait prisonnier par les troupes allemandes, il réussit à s'évader avant que les autorités d'occupation ne découvrent qu'il est juif. Il se rend alors, avec sa compagne Clara, à Marseille où la police, redécouvrant sa situation d'avant guerre, refuse de lui délivrer le moindre papier. Ironiquement, ce sont les autorités militaires qui obligeront les autorités civiles à changer d'avis en faveur de ce "serviteur de la France" d'autant plus "méritoire" à leurs yeux que ce n'était pas son pays.
[8] [33] Il faut noter que cette analyse, similaire à celle des trotskistes, n'a jamais conduit la Fraction à appeler à la "défense de l'URSS". Depuis le début des années 1930, et les événements d'Espagne ont parfaitement illustré cette position, la Fraction considérait l'Etat "soviétique" comme un des pires ennemis du prolétariat.
[9] [34] Il faut signaler que, malgré les errements de Vercesi, Marc lui a toujours conservé une grande estime personnelle. Cette estime s'étendait d'ailleurs à l'ensemble des membres de la Fraction italienne qu'il évoquait toujours dans les termes les plus chaleureux. Il faut l'avoir entendu parler de ces militants, presque tous des ouvriers, les Piccino, Tulio, Stefanini, dont il a partagé le combat dans les heures les plus sombres de ce siècle, pour mesurer tout l'attachement qu'il leur portait.
Conscience et organisation:
Personnages:
- Marc Chirik [36]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [37]
Polémique avec Battaglia Comunista : le rapport fraction-parti dans la tradition marxiste (3° partie - II. Lénine et les bolcheviks)
- 2819 lectures
Troisième partie : de Marx à Lénine, 1848-1917. II. Lénine et les bolcheviks
L'accélération actuelle de l'histoire, pleinement rentrée dans la phase de décomposition du capitalisme, pose de façon aiguë la nécessité de la révolution prolétarienne, comme seule issue à la barbarie du capitalisme en crise. L'histoire nous a enseigné qu'une telle révolution ne peut triompher que si la classe réussit à s'organiser de manière autonome (conseils ouvriers) par rapport aux autres classes et à sécréter l'avant-garde qui la guide vers la victoire : le parti de classe. Cependant, aujourd'hui, ce parti n'existe pas, et beaucoup baissent les bras parce que face aux tâches gigantesques qui nous attendent, l'activité des petits groupes révolutionnaires existants paraît dénuée de sens. Au sein même du camp révolutionnaire, la majorité des groupes réagit à l'absence de parti en répétant à l'infini son Très Saint Nom, invoqué comme le deus ex machina capable, grâce à sa seule évocation, de résoudre tous les problèmes de la classe. La désimplication individuelle et l'engagement déclamatoire sont deux manières classiques de fuir la lutte pour le parti, lutte qui se mène ici, aujourd'hui, en continuité avec l'activité des fractions de gauche qui se sont séparées dans les années 1920 de l'Internationale Communiste en dégénérescence.
Dans les deux premières parties de ce travail, nous avons analysé l'activité de la Gauche Communiste d'Italie, organisée en fraction dans les années 1930-1940, et la fondation prématurée d'un Parti Communiste Internationaliste, complètement artificiel, par des camarades de Battaglia Comunista en 1942.([1] [38])
Dans cette troisième partie, nous avons d'abord montré ([2] [39]) que la méthode de travail de fraction, dans les périodes défavorables où il n'était pas possible qu'existât un parti de classe, a été la seule méthode, employée par Marx lui-même. Dans ce numéro, nous montrerons en plus qu'une telle méthode marxiste de travail pour le parti a trouvé sa définition essentielle grâce à la lutte tenace de la fraction bolchevik du Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie (POSDR). Contre tous ceux qui se gargarisent des éloges du parti de fer de Lénine et d'ironie envers « les petits groupuscules des fractions de gauche », nous répétons que « l'histoire des fractions est l'histoire de Lénine » ([3] [40]) et que c'est seulement sur la base du travail qu'elles ont accompli qu'il sera possible de reconstruire le parti communiste mondial de demain.
« Sans les fractions, Lénine lui-même serait reste un rat de bibliothèque »
Avec les citations que nous avons données dans le numéro précédent, nous avons vu comment Battaglia Comunista (BC) ne perd pas une occasion d'ironiser sur le fait que le « Que Faire ?» de Lénine, de 1902, serait le vade-mecum du parfait fractionniste et, en conséquence, ne laisse pas passer une opportunité de faire le dégoûté pour la énième fois ([4] [41]). Si ces camarades arrêtaient de s'exciter à scander le mot parti et commençaient plus sobrement à étudier l'histoire du parti, ils découvriraient que « Que Faire ? » pouvait difficilement parler de la fraction bolchevik, étant donné qu'elle s'était constituée à Genève en juin... 1904 (réunion des «22») ([5] [42]). C'est à partir de là que les bolcheviks ont commencé à développer la notion de la fraction et de ses rapports avec l'ensemble du Parti, notion qui prendra sa forme définitive avec 'expérience de la révolution de 1905 et surtout de la phase de réaction qui suivit sa défaite ([6] [43]) :
« Une fraction est une organisation à l'intérieur du parti, qui est unie non pas par le lieu de travail, par la langue ou par quelque autre condition objective, mais par un système de conceptions communes sur les problèmes qui se posent au parti. » ([7] [44])
«A l'intérieur du parti, on peut trouver toute une gamme d'opinions diverses dont les extrêmes peuvent être tout à fait contradictoires (...). Mais dans une fraction, les choses sont différentes. Une fraction est un groupe fondé sur l'unité de pensée, dont l'objectif premier est d'influencer le parti dans une direction bien déterminée et de faire adopter ses principes, sous leur forme la plus pure, par le parti. Pour cela, une unité de pensée véritable est indispensable. Quiconque veut comprendre comment se pose réellement le problème des divergences internes au sein de la fraction bolchevik doit bien se rendre compte que l'unité de la fraction et celle du parti ne relèvent pas pour nous des mêmes exigences. » ([8] [45])
«Mais une fraction, en tant qu'expression d'une unité de pensée dans le parti, ne peut subsister si ses militants «ne se rencontrent pas sur les problèmes fondamentaux. Quitter une fraction, ce n est pas quitter le parti. Les camarades qui se sont séparés de notre fraction ont toujours la possibilité de travailler dans le parti. » ([9] [46])
La fraction est donc une organisation à l'intérieur du parti, bien identifiée par une plate-forme précise, qui se bat pour influencer le parti, et qui se donne pour objectif final le triomphe dans le parti de ses principes « sous leur forme la plus pure » c'est-à-dire sans médiation ou non-homogénéité. Pendant ce temps, la fraction travaille dans le parti, avec les autres fractions qui défendent d'autres plates-formes, de façon à ce que l'expérience pratique et le débat politique public permettent à l'ensemble du parti de se rendre compte de quelle est la plate-forme qui est juste. Cette coexistence est possible à condition que, dans le parti, il n'y ait pas de place pour ceux qui ont déjà fait des choix qui les mènent à l'extérieur du parti et dont le maintien à l'intérieur de l'organisation ne peut que mener à la liquidation de l'organisation elle-même. C'est ce que représentait en Russie le courant des « liquidateurs » qui se battait pour la dissolution du parti illégal et sa soumission à la « légalité » tsariste. a divergence de fond entre les bolcheviks et les autres fractions résidait justement en ceci que les autres, tout en condamnant en général les liquidateurs, continuaient à les considérer comme des membres du parti, alors que les bolcheviks estimaient qu'il devait y avoir de la place dans le parti socialiste pour toutes les opinions, exceptées celles qui étaient anti-socialistes :
« C'est le fondement de la conciliation qui est erroné ; sa volonté d'édifier l'unité du parti du prolétariat sur l'alliance de tous, y compris des fractions anti-social-démocrates, non prolétariennes, c'est l'absence de principes de sa perspective " unificatrice " qui est erronée et conduit à l'absurde, ce sont les phrases contre les "fractions" (qui s'accompagnent en fait de la formation d'une nouvelle fraction). » ([10] [47])
Il est intéressant de noter que ces lignes de Lénine sont dirigées contre Trotsky qui fut dans le POSDR le principal ennemi de l'existence organisée de fractions qu'il rejetait comme inutiles et dommageables pour le parti. L'incompréhension totale de la part de Trotsky de la nécessité du travail de fraction aura des conséquences catastrophiques pendant et après la dégénérescence de la révolution russe.
« On doit noter que Trotsky - dans toutes les questions relatives à la révolution de 1905, comme pendant toute la période qui suivit - fut généralement avec les bolcheviks pour toutes les questions de principe et avec les mencheviks pour toutes les questions d'organisation. Son incompréhension de la juste notion du Parti, au cours de cette période, détermina sa position "hors fraction" en faveur de l'unité à tout prix. Sa pitoyable position actuelle - qui le pousse dans les bras de la social-démocratie- nous prouve que Trotsky n'a, à ce sujet, rien appris des événements. » ([11] [48])
Naturellement, Lénine a été violemment attaqué, soit dans le mouvement russe, soit dans le mouvement international, pour sa folie sectaire et scissionniste, pendant que tous en choeur réclamaient la « fin du ractionnisme ». En fait, le premier à vouloir la fin du fractionnisme, c'était Lénine lui-même, qui savait bien que l'existence de fractions était un symptôme de crise dans le parti. Mais il savait aussi que la lutte ouverte, pratique, de fraction, était l'unique remède valable pour la maladie du parti, parce que ce n'était que de la confrontation publique des plates-formes que pouvait naître la clarté sur la voie à suivre :
« Toute fraction est convaincue que sa plate-forme et sa politique sont les meilleures pour supprimer les fractions, car personne ne considère l'existence de celles-ci comme un idéal. La différence est seulement que les fractions qui ont une plate-forme claire, conséquente, cohérente, défendent ouvertement leur plate-forme, tandis que les fractions sans principe se cachent derrière des protestations gratuites de vertu, de non-fractionnisme). » ([12] [49])
Un des principaux mensonges hérités du stalinisme est celui d'une tradition bolchevik monolithique, où il n'y avait pas de place pour les vains bavardages et les débats pour intellectuels, mensonge par ailleurs dans le fil des accusations mencheviks de « fermeture aux débats » constamment adressées aux bolcheviks. Bien sur, il est tout à fait vrai qu'entre les mencheviks et les conciliateurs, la discussion était « libre », alors que, entre les bolcheviks, elle était « obligée». Mais c est vrai dans le sens où les premiers se sentaient libres de discuter quand cela les arrangeait et de se taire quand ils avaient des divergences à cacher. Pour les bolcheviks au contraire, la discussion n'était pas libre mais obligatoire et devenait d'autant plus obligatoire que des divergences naissaient à l'intérieur de la fraction, divergences qu'il fallait discuter publiquement pour qu'elles se résorbent ou soient poussées jusqu'au bout avec une séparation organisationnelle fondée sur des motifs clairs :
« C'est dans ce but que nous avons ouvert une discussion sur ces problèmes dans les colonnes du Proletari. Nous avons publié tous les textes qui nous ont été envoyés et nous avons reproduit tout ce qui, en Russie, a été écrit sur la question par des bolcheviks. Jusqu'à présent nous n'avons pas refusé une seule contribution à la discussion et nous continuerons à agir ainsi. Malheureusement les camarades otzovistes et ceux qui sympathisent avec leurs idées ne nous ont encore envoyé que peu de matériaux, et, d'une façon générale, ils se sont montres réticents à exposer leur credo théorique clairement et complètement dans la presse, préférant les conversations "privées". Mous invitons tous les camarades, qu'ils soient otzovistes ou bolcheviks orthodoxes à exposer leur opinion dans les colonnes du Proletari. Il le faut, nous éditerons les textes qui nous parviendront en brochure spéciale. (...) Notre fraction, par contre, ne doit pas craindre la lutte idéologique interne, à partir du moment où elle est nécessaire. Dans cette lutte en effet, elle va encore se renforcer). »([13] [50])
Tout ceci démontre largement l'énorme contribution faite par Lénine à la définition historique de la nature et de la fonction de la fraction, malgré toute l'ironie que Battaglia réserve aux « dix commandements du bon fractionniste». Notons en passant que c'est ce même BC qui, dans une phrase, parle d'alternative de Parti à partir de 1902, et qui, dans une autre, dit que e parti a agi en tant que tel « au moins à partir de 1912 ». Et alors, de 1902 à 1912, qu'a donc fait Lénine - étant donné qu'il ne faisait pas de travail de fraction -, de la cuisine macrobiotique ? En réalité, pour BC, ce qui lui tient à coeur, c'est d'affirmer que es bolcheviks ne se sont pas limités à faire du travail théorique et de formation de cadres, mais qu'ils faisaient aussi un travail en direction des masses et, donc, qu'ils ne pouvaient pas être une fraction. Dans les faits, pour Battaglia, le choix de travailler comme fraction est un choix de fuir la lutte de classe, de refuser de se salir les mains avec les problèmes des masses, ce qui mène « à se limiter à une politique édulcorée de prosélytisme mesuré et de propagande et à se centrer sur les études des soi-disant problèmes de fond, réduisant ainsi les tâches du parti à des tâches de fraction sinon de secte.» ([14] [51])
Les jeux sont faits : d'un côté, il y a Lénine, qui pense aux masses, et qui ne peut donc qu'être le parti, de l'autre, en opposition, il y a la Gauche Italienne à l'étranger, dans les années 1930, qui oeuvre comme fraction et qui ne peut donc être qu'un cénacle d'étudiants et de petits professeurs. Nous avons déjà vu quelle a été la véritable activité de Lénine, examinons maintenant quelle a été la véritable activité de la Gauche Italienne :
« Il pourrait sembler que les tâches de la fraction soient exclusivement didactiques. Mais une telle critique peut être repoussée par les marxistes avec les mêmes arguments à l'égard de tous les charlatans qui considèrent la lutte du prolétariat pour la révolution et pour la transformation du monde au même titre que l'action électorale..
Il est parfaitement exact que le rôle spécifique des fractions est surtout un rôle d'éducation de cadres au travers des événements vécus, et grâce à la confrontation rigoureuse de la signification de ces événements. Cependant, il est vrai que ce travail, surtout idéologique, est fait en considération des mouvements de masse et fournit constamment la solution politique pour la réussite. Sans le travail des fractions, Lénine lui-même serait resté un rat de bibliothèque et ne serait pas devenu un chef révolutionnaire
Les fractions sont donc les seuls endroits historiques où le prolétariat continue son travail pour son organisation en classe. De 1928 jusqu'à maintenant, le camarade Trotsky a complètement négligé ce travail de construction des fractions, et, de ce fait, il n'a pas contribué à réaliser les conditions effectives pour les mouvements de masse ). »([15] [52])
Comme on le voit, l'ironie de Battaglia sur la fraction comme secte, qui fuit les masses, tombe encore une fois mal à propos. Le souci qui anime Bilan est le même que celui qui animait les bolcheviks, celui de contribuer à réaliser les conditions effectives pour les mouvements de masse. Le fait que l'ampleur des liens avec les masses qu'avaient les bolcheviks dans les années 1910 et la Gauche italienne dans les années 1930 ait été très différente, ne dépend certes pas des tendances personnelles de celui-ci ou de celui-la, mais des conditions objectives de la lutte de classe, qui différaient énormément. La fraction bolchevik n'était pas constituée d'un groupe de camarades qui avaient survécu au passage du parti à l'ennemi de classe dans une période de contre-révolution et de profonde défaite du prolétariat. C'était une partie (souvent majoritaire) d'un parti prolétarien de masse (comme tous les partis de la 2e Internationale), qui s'était constituée dans une phase immédiatement prérévolutionnaire (1904) et qui s'était développée au sein d'une gigantesque vague révolutionnaire qui, pendant deux ans (1905-1906), va secouer l'empire russe tout entier, de l'Oural à la Pologne. Si on veut faire des comparaisons quantitatives entre l'action de la fraction de gauche italienne et celle des bolcheviks, il faut se référer à une période qui a certains aspects historiquement comparables, c'est-à-dire aux années révolutionnaires entre 1917 et 1921. Dans ces années-là, la Fraction Communiste Abstentionniste (fraction de gauche du PSI) se développe au point qu'elle finit par comprendre, au moment de sa constitution en Parti Communiste d'Italie, un tiers des inscrits au vieux parti socialiste de masse et la totalité de la fédération des jeunes. Les camarades qui ont été capables d'orienter ce processus militaient, dix ans après, dans la Fraction de Gauche à l'étranger, en nombre réduit à une dizaine de cadres. Qu'est-ce qui avait changé ? Est-ce que ces camarades n'avaient plus la volonté de diriger des mouvements de masse ? Evidemment non :
« Depuis que nous existons, il ne nous a pas été possible de diriger des mouvements de classe, il faut bien se mettre en tête que cela n'a pas dépendu de notre volonté, de notre incapacité, ou du fait que nous étions fraction, mais d'une situation dont nous avons été les victimes comme en est victime le prolétariat révolutionnaire du monde entier. » (Bilan n° 28, 1935)
Ce qui avait changé, c'était donc la situation objective de la lutte de classe, qui était passée d'une phase pré-révolutionnaire mettant à l'ordre du jour la transformation de la fraction en parti, à une phase contre-révolutionnaire qui obligeait la fraction à résister à contre-courant, contribuant par son travail au développement de nouvelles situations qui remettraient à 1 ordre du jour sa transformation en parti.
De la fraction bolchevik du POSDR au parti communiste russe
Comme toujours, quand on critique les positions de BC, on revient au point crucial, c'est-à-dire aux conditions pour la naissance du parti. On a vu comment BC aimerait bien blanchir Lénine de l'infâme qualificatif de « bon fractionniste », à partir de 1902 déjà. En voulant faire des concessions, BC est prête à admettre, du bout des lèvres, que le parti bolchevik n'a existé qu'à partir de 1917, a condition qu'il soit clair qu'il existait avant la période révolutionnaire qui s'est ouverte en février 1917. Ce qu'il faut éviter à tout prix d'admettre, c'est que la lutte de la fraction bolchevik du POSDR s'est conclue sur sa transformation en Parti Communiste Russe (bolchevik) en 1917 seulement, parce que ce serait admettre que «la transformation de la fraction en parti est conditionnée (...) par le surgissement de mouvements révolutionnaires qui pourront permettre à la fraction de reprendre la direction des luttes pour l'insurrection » (Bilan n° 1, 1933). Il faut donc clarifier si cette transformation s'est produite ou non en 1912, cinq ans avant la révolution.
Qu'est-il arrivé en 1912? Il s'est tenu à Prague une conférence des organisations territoriales du POSDR qui travaillent en Russie, conférence qui a réorganisé le parti démoli par la réaction qui a suivi la défaite de la révolution de 1905, et élu un nouveau comité central, pour remplacer l'ancien désormais dissout. La Conférence et le nouveau comité central sont dominés par les bolcheviks, alors que les autres tendances du POSDR ne participent pas à l'initiative « scissionniste » de Lénine. A première vue, il semblerait que Battaglia ait raison : une conférence de bolcheviks a pris l'initiative de reconstruire le parti, indépendamment des autres fractions, donc, à partir de ce moment-là, les bolcheviks agissent comme parti, sans attendre l'ouverture d'une phase prérévolutionnaire. Mais si nous regardons les choses de plus près, nous voyons qu'il en va tout à fait différemment. La naissance d'une fraction révolutionnaire au sein du vieux parti se produit en réaction aux maladies du parti, à son incapacité à élaborer des réponses adéquates aux nécessités historiques, aux lacunes de son programme. La transformation de la fraction en parti ne veut pas dire qu'on retourne simplement au statu quo antérieur, au vieux parti épuré des opportunistes ; cela veut dire formation d'un nouveau parti, fondé sur un nouveau programme qui élimine les ambiguïtés précédentes en recourant aux principes de la fraction révolutionnaire «sous leur forme la plus pure ». Dans le cas contraire, on retournerait au point de départ en posant les bases pour que ressurgisse inévitablement la même déviation opportuniste qui vient d'être chassée. Et c'est ce qu'aurait fait Lénine en 1912, la transformation de la fraction en parti basé sur un nouveau programme ? Pas même en idée. En premier lieu, la résolution approuvée par la conférence déclare s'être réunie «pour rassembler toutes les organisations russes du parti sans distinction de fractions et pour reconstituer notre parti. » ([16] [53]) Il ne s'agit donc pas d'une conférence purement bolchevik, d'autant plus que son organisation a été en grande partie confiée au comité territorial de Kiev dominé par les mencheviks partidistes, et que ce fut justement un menchevik qui présidait la commission de vérification des mandats ([17] [54]). Modifier le vieux programme, on n'en parla pas, et les décisions prises consistaient simplement à mettre en pratique des résolutions condamnant les liquidateurs, approuvées en 1908 et en 1910 par « les représentants de toutes les fractions». Donc la Conférence non seulement se compose de « membres du partisans distinction de fractions», mais se base encore sur une résolution approuvée par « des représentants de toutes les fractions». Il est évident qu'il ne s'agit pas de la constitution du nouveau parti bolchevik, mais de la simple réorganisation du vieux parti social-démocrate. Cela vaut la peine de souligner qu'une telle réorganisation n'était considérée comme possible qu'« en rapport avec le resurgissement du mouvement ouvrier» ([18] [55]) après les années de réaction de 1907 à 1910. Comme on le voit. Lénine, non seulement ne pensait pas du tout fonder un nouveau parti avant les batailles révolutionnaires, mais ne se donnait même pas l'illusion de réorganiser ce vieux parti en l'absence d'une nouvelle période de lutte de classe. Les camarades de Battaglia - et pas seulement eux - sont tellement hypnotisés par le mot parti qu'ils en deviennent incapables d'analyser les faits lucidement, prenant pour un tournant décisif ce qui n'était qu'une étape très importante dans le processus de démarcation d’avec 1'opportunisme. L'élection en 1912 du comité central par une conférence à prédominance bolchevik ne peut pas être considérée comme la preuve de la fin de la phase de fraction et le début de celle du parti, pour le simple motif que, à Londres en 1905, il y avait déjà eu une conférence exclusivement bolchevik qui s'était proclamée 3e congrès du parti et qui avait élu un comité central entièrement bolchevik, considérant les mencheviks en dehors du parti. Mais l'année suivante déjà, Lénine s'était rendu compte de l'erreur qui avait été commise et, au congrès de 1906, le parti s'était réunifié en maintenant les deux fractions comme fractions d'un même parti. De manière analogue, de 1912 à 1914, Lénine estime que la phase de lutte de fraction est désormais en voie d'extinction et que l'heure de la sélection définitive a sonné. Cela pouvait être vrai d'un point de vue strictement russe, mais c'était certainement prématuré d'un point de vue international :
« Ce travail fractionnel de Lénine s'effectue uniquement au sein du parti russe, sans qu'il essayât de le porter à l'échelle internationale. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire ses interventions aux différents congrès et l'on peut affirmer que ce travail resta complètement inconnu en dehors des sphères russes. » ([19] [56])
Dans les faits, la sélection définitive se fera entre 1914 et 1917, face à la double épreuve de la guerre et de la révolution, divisant les socialistes en sociaux-patriotes et internationalistes. Lénine s'en est parfaitement rendu compte et, de même qu'en 1906 il s'était battu pour la réunification du parti, de même, en février 1915, en répondant au groupe « Naché Slovo » de Trotsky, il écrivait : « Nous sommes absolument d'accord avec vous pour dire que le rassemblement de tous les véritables sociaux-démocrates internationalistes est l’une des tâches les plus urgentes du moment présent. » ([20] [57]) Le problème tenait en cela que, pour Lénine, l'unification des internationalistes ans un parti effectivement communiste n'était possible qu'a condition d'en écarter ceux qui ne se montraient pas vraiment internationalistes jusqu'au bout, alors que Trotsky - comme d'habitude - voulait concilier l'inconciliable, entendait fonder l'unité du parti internationaliste « sur l'union de toutes les fractions », y compris celles qui n'étaient pas disposées à rompre avec les ennemis de l'internationalisme. Pendant trois années, Lénine s'est battu de façon incessante contre ces illusions en transférant sa lutte de fraction pour la clarté du terrain purement russe à celui, international, de la « gauche de Zimmerwald » ([21] [58]).
Cette grandiose lutte internationale constitue l'apogée et la conclusion du travail de fraction des bolcheviks qui allaient avoir les cartes en main à l'éclatement de la révolution en Russie. Grâce à cette tradition de lutte et au développement d'une situation révolutionnaire, Lénine peut, dès son retour en Russie, proposer l'unification des bolcheviks avec les autres internationalistes conséquents, sur la base d'un nouveau programme et sous le nom de Parti Communiste, en remplacement du vieux terme social-démocrate. C'est alors qu'intervient la dernière sélection avec la droite bolchevik (Voitinsky, Goldenberg), qui passe au menchevisme, tandis que le centre des « vieux bolcheviks » (Zinoviev, Kamenev) s'oppose à Lénine au nom ... du vieux programme sur lequel s'était basée la conférence de 1912. Lénine sera accusé d'être le «fossoyeur de la tradition du parti » et répliquera en démontrant que toute la lutte des bolcheviks n'a été qu'une préparation à un vrai parti communiste : « Fondons un parti communiste prolétarien ; les meilleurs partisans du bolchevisme en ont déjà créé les éléments. » ([22] [59])
C'est ici que se conclut la grande lutte de la fraction bolchevik, c'est ici qu'on a la réelle transformation en parti. Nous disons réelle parce que, d'un point de vue formel, le nom de Parti Communiste ne sera adopté qu'en mars 1918, alors que la version définitive du nouveau programme sera ratifiée seulement en mars 1919. Mais le passage -en substance- se produit en avril 1917 (8e conférence pan-russe bolchevik). Il ne faut pas oublier que ce qui différencie un parti d'une fraction, c'est sa capacité à influer directement sur les événements. Le parti est en fait « un programme, mais aussi une volonté d'action » (Bordiga), à condition, évidemment, que cette volonté puisse s'exprimer dans des circonstances objectivement favorables au développement d'un parti de classe. En février 1917, les bolcheviks étaient quelques milliers et n'avaient joué aucun rôle de direction dans le soulèvement spontané qui ouvrit la période révolutionnaire. A la fin d'avril, ils sont plus de 60 000 et ils se profilent déjà comme l'unique opposition réelle au gouvernement provisoire bourgeois de Kérenski. Avec l'approbation des Thèses d'avril et de la nécessité d'adopter un nouveau programme, la fraction devient parti et pose les bases de 1’octobre Rouge.
***
Dans la prochaine partie de ce travail, nous verrons comment les conditions particulières et historiquement originales de la dégénérescence de la révolution russe ont empêché le surgissement d'une fraction de gauche pour reprendre, dans le parti bolchevik en dégénérescence, la bataille de Lénine à l'intérieur du parti social-démocrate. L'incapacité de l'opposition russe de se constituer en fraction sera ensuite a la base de la faillite historique de l'Opposition Internationale trotskiste, alors que la Gauche Italienne, en reprenant la méthode de travail de Marx et de Lénine, arrivera à partir de 1937 à se constituer en Gauche Communiste Internationale ([23] [60]). Nous verrons de plus comment l'abandon de cette méthode de travail par les camarades qui ont fondé le PC Internationaliste en 1943 a été à la base de leur incapacité d'agir comme pôle de regroupement révolutionnaire entre les organisations (Battaglia Comunista et Programma Comunista) qui provenaient de ce parti.
Beyle
[1] [61] Les deux premières parties ont été publiées dans les Revue Internationale n° 59 et 61. Pour une analyse approfondie de l'activité de ce courant, il est recommandé de lire nos deux volumes : La Gauche Communiste d'Italie, 1927-1952 et Rapports entre la fraction de gauche du PC d'Italie et l'Opposition de Gauche Internationale, 1929-1933.
[2] [62] Voir «Troisième partie : de Marx à Lénine, 1848-1917. Lénine et les bolcheviks » dans la Revue Internationale n° 64.
[3] [63] Intervention de Bordiga au 6e comité exécutif élargi de l'Internationale Communiste, en 1926.
[4] [64] «En 1902 déjà, Lénine avait jeté les bases tactiques et organisationnelles sur lesquelles avait dû se construire l'alternative à l'opportunisme de ta social-démocratie russe, alternative de parti, à moins qu'on ne veuille faire passer le «Que Faire?» pour les dix commandements du bon fractionniste » (« Fraction et parti dans l'expérience de la Gauche italienne», dans Prometeo n°2, mars 1979.)
[5] [65] Les bolcheviks du Congrès de 1903 du POSDR étaient le fruit de l'alliance temporaire entre Lénine et Plekhanov. La fraction de 1904 s'appelle bolchevik (majoritaire) pour se réclamer des positions défendues par la majorité au congrès de 1903.
[6] [66]Il est significatif que la théorisation complète du concept de fraction effectuée par Lénine arrive seulement dans les années de féroce réaction à la suite de la révolution de 1905. Ce n'est que l'activité de fraction qui permet de résister dans les périodes défavorables.
[7] [67] «Au sujet d'une nouvelle fraction de conciliateurs, les vertueux», Social-Démocrate n°24, 18(31) octobre 1911, Lénine, Oeuvres complètes, tome 17, Editions de Moscou.
[8] [68] « Conférence de la rédaction élargie du "Proletari", 8-17 (21-30) juin 1909, supplément au n°46 du Proletari, Oeuvres complètes, tome 15, p. 40l.
[9] [69] « La liquidation en voie d'être liquidée », Proletari n° 46, 11 (24) juillet 1909. Cité par Lénine, Oeuvres complètes, tome 15, p. 490.
[10] [70] Au même endroit, note n° 7.
[11] [71] « Le problème des fractions dans la 2e Internationale», dans Bilan n° 24, 1935.
[12] [72] Au même endroit, note n° 7.
[13] [73] « A propos de l'article "Sur les questions actuelles" », Proletari n°42, 12 (25) février 1909. Cité par Lénine, Oeuvres complètes, tome 15, p. 383. L'otzovisme constituait une dissidence interne à la fraction bolchevik dans les années les plus noires du reflux, tendant à tomber d'un travail de fraction dans celui d'un réseau.
[14] [74] Plate-forme politique du PC Internationaliste (BC) de 1952. Dans une récente remise à jour de 1982, ce morceau a été reproduit sans changement.
[15] [75] «Vers l'internationale 2 et 3/4 ». dans Bilan n° 1, 1933, extraits publiés dans le Bulletin d'Etude et de Discussion publié par Révolution Internationale, n° 6, avril 1974.
[16] [76] « Résolution de la conférence, point sur la commission d'organisation de Russie chargée de la convocation de la conférence », texte de la 6e conférence générale (dite de Prague) du POSDR, 6-17 (18-30) janvier 1912. Cité par Lénine, Oeuvres complètes, tome 17, p. 467.
[17] [77] « La situation dans le POSDR et les tâches immédiates du Parti », texte du 16 juillet 1912, Gazeta Robotnicza n° 15-16. Cité par Lénine, Oeuvres complètes, tome 18, p. 155 : « (...) C'est précisément le délégué de cette organisation (de Kiev) qui fut président de la commission des mandats a la conférence ! ».
[18] [78] Tiré des résolutions de la conférence. Lénine revient encore en 1915 sur ce sujet : « Les années 1912-1914 ont marqué le début d'un nouvel et prodigieux essor révolutionnaire en Russie. Nous avons de nouveau assiste à un vaste mouvement de grève, sans précédent dans le monde. La grève révolutionnaire de masse a englobe en 1913, selon les estimations les plus modestes, un million et demi de participants ; en 1914, elle en comptait plus de 2 millions et se rapprochait du niveau de 1905. » (Le socialisme et la guerre, juillet-août 1915, chap. 2. « Les classes et les partis en Russie. La classe ouvrière et la guerre. ». Oeuvres complètes 6e Lénine, tome 21, p. 330).
[19] [79] « Le problème des fractions dans la 2e Internationale », dans Bilan n° 24, 1935.
[20] [80] Lettre du comité central du POSDR à la rédaction du Naché Slovo, 10 (23) mars 1915. Cité par Lénine, Œuvres complètes, tome 21, p.164.
[21] [81] Pour mieux comprendre le rôle des bolcheviks dans la gauche de Zimmerwald, voir l’article publié dans la Revue Internationale, n°57.
[22] [82] « Sur la dualité de pouvoir », Pravda n°28, 9 avril 1917. Cité par Lénine, Œuvres complètes, tome 24, p.31.
[23] [83] Pour une analyse du travail de la fraction italienne du PC d’Italie dans les années 1930, voir la première partie du présent article dans la Revue Internationale, n°59
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [84]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [85]