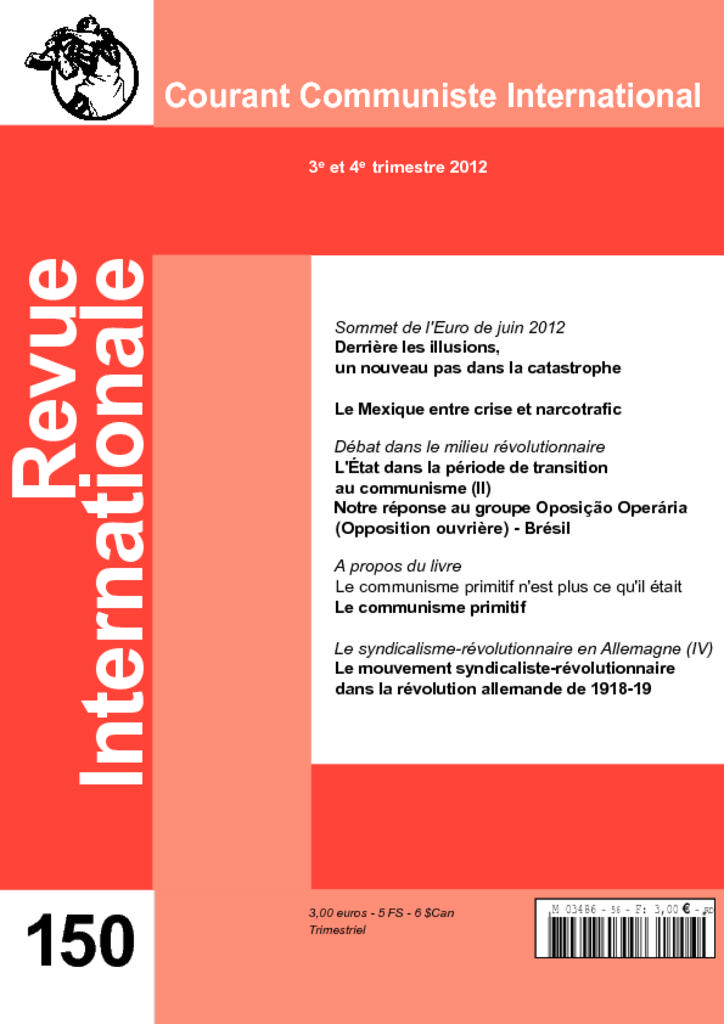Revue Internationale n° 150 - 3e et 4e trimestre 2012
- 1370 lectures
Sommet de l'Euro de juin 2012 : derrière les illusions, un nouveau pas dans la catastrophe
- 1243 lectures
Le 29 juin 2012 au matin, comme par enchantement, une douce euphorie gagnait rapidement les politiciens et dirigeants de la zone Euro. Les médias bourgeois et les économistes n’étaient pas en reste. Le dernier sommet européen venait de prendre apparemment des "décisions historiques". Contrairement à ceux, nombreux, qui l'avaient précédé au cours des dernières années et qui avaient tous échoué. Mais, aux dires de beaucoup de commentateurs, ce temps était désormais révolu ; la bourgeoisie de cette zone, pour une fois unie et solidaire, venait d’adopter les mesures nécessaires pour sortir du tunnel de la crise. Pour peu, on se serait cru dans le monde d’Alice aux pays des merveilles. Mais en y regardant de plus près et une fois les brumes matinales dissipées, apparaissent alors les vraies questions : Quel est le contenu réel de ce sommet ? Quelle va être sa portée ? Va-t-il réellement apporter une solution durable à la crise de la zone Euro et donc pour l'économie mondiale ?
Le dernier sommet européen : des décisions en trompe l’œil
Si le sommet européen du 29 juin 2012 a été présenté comme "historique" c'est qu'il est censé constituer un tournant dans la façon dont les autorités affrontent la crise de l'Euro. D'une part, au niveau de la forme, ce sommet, pour la première fois, ne s'est pas contenté, suivant les commentateurs, d'entériner les décisions prises auparavant par "Merkozy", c'est-à-dire le tandem Merkel-Sarkozy (en réalité, la position de Merkel entérinée par Sarkozy) 1 mais a tenu compte des demandes de deux autres pays importants de la zone, l'Espagne et l'Italie, des demandes appuyées par le nouveau président français, François Hollande. Par ailleurs, ce sommet devait inaugurer une nouvelle donne dans la politique économique et budgétaire au sein de la zone : après des années où la seule politique promue par les instances dirigeantes de l'Euro consistait en une austérité de plus en plus impitoyable, on prenait enfin en compte une des critiques à cette politique (portée notamment par les économistes et politiciens de gauche) suivant laquelle, sans relance de l'activité économique, les États surendettés seraient incapables de trouver les ressources fiscales pour payer leurs dettes.
C'est pour cela que le président de gauche François Hollande, venu pour arracher un "pacte pour la croissance et l’emploi" tenait la scène comme un acteur de théâtre fier de sa prestation et des résultats obtenus. Il était accompagné, dans sa satisfaction, par deux hommes pourtant de droite, Monti chef du gouvernement italien et Rajoy son homologue espagnol qui, eux-aussi, paradaient : leurs calculs ayant apparemment payé, l’étau financier sur leur pays devait se desserrer. La situation réelle était bien trop grave pour que tous ces messieurs prennent un air triomphant, mais l’humeur y était : "on pouvait espérer voir le début de la fin de la sortie du tunnel de la crise dans la zone euro !" Cette déclaration particulièrement alambiquée aurait été prononcée par le chef du gouvernement italien !
Avant de soulever le voile sur ce matin qui s’annonçait ainsi presque radieux, un petit retour dans le temps s’impose. Souvenons-nous : depuis six mois, la zone Euro s’est retrouvée deux fois en situation de voir ses banques s’effondrer. La première fois, cela a donné naissance à ce qui a été appelé LTRO (Long Term Refinancing Operation) : la Banque centrale européenne (BCE) a accordé pour 1000 milliards environ de prêts à celles-ci. En réalité 500 milliards avaient déjà été provisionnés dans ce sens. Quelques mois après, voilà à nouveau que ces mêmes banques appellent au secours ! Racontons maintenant une petite histoire dérisoire qui illustre ce qui se passe réellement dans la finance européenne. Au début de cette année 2012 les dettes souveraines (celles des États) explosent. Les marchés financiers font alors eux-mêmes grimper les taux auxquels ils acceptent de prêter de l’argent à ces États. Certains d'entre eux, notamment l’Espagne, ne peuvent plus aller chercher de prêts sur le marché. C’est trop cher. Pendant ce temps-là les banques espagnoles rendent l’âme. Que faire ? Que faire en Italie, au Portugal et ailleurs ? Une idée géniale germe alors dans les grands esprits de la BCE. Nous allons prêter massivement aux banques, qui vont elles-mêmes financer les dettes souveraines de leur État national et l’économie "réelle" sous forme de prêts à l'investissement ou à la consommation. Cela se passait l'hiver dernier, la Banque centrale européenne faisait "bar ouvert et boissons à discrétion". Le résultat est là, début juin tout le monde se réveille avec une cirrhose du foie. Les banques n’ont pas prêté à l’économie "réelle" ; elles ont mis cet argent en sécurité, en rapportant elles-mêmes son équivalent à la Banque centrale, avec en plus un petit intérêt en retour. En quoi cet équivalent consistait-il ? En des obligations d’État qu’elles venaient d’acheter avec l’argent de cette même Banque centrale. Véritable tour de passe-passe et d’illusion qui ne pouvait tenir que le temps d’un spectacle décidément totalement dérisoire !
Au mois de juin, les "médecins économistes" crient à nouveau haut et fort : nos malades sont en train de mourir. Il faut immédiatement des mesures radicales prises conjointement par les hôpitaux de toute la zone Euro. Nous sommes maintenant au moment de la tenue du sommet du 29 juin. Après toute une nuit de négociations, un accord "historique" semble trouvé. Les décisions prises :
les fonds de stabilisation financière (FESF et MES 2) vont pouvoir renflouer directement les banques, après accord de la BCE, ainsi qu’acheter de la dette publique afin de détendre les taux auxquels les États empruntent sur les marchés financiers ;
les européens vont confier à la BCE la supervision du système bancaire de la zone Euro ;
une extension de la règle de contrôle des déficits public des États de cette zone est adoptée ;
enfin, à la grande satisfaction des économistes et politiciens de gauche, un plan de 100 milliards d’euros de relance de l’activité est mis en scène.
Pendant quelques jours les mêmes discours fleurissent. La zone Euro a enfin pris les bonnes décisions. Si l’Allemagne a réussi à maintenir sa "Règle d’or" en matière de dépenses publiques (qui impose aux États d'inscrire dans leur loi fondamentale l'élimination du déficit budgétaire), elle a par contre accepté d’aller dans le sens de la mutualisation des dettes des États de la zone Euro et de la monétisation de ces dettes, c'est-à-dire de la possibilité de les rembourser en imprimant de la monnaie.
Comme toujours dans ce genre d’accord, la réalité se cache dans le calendrier et dans la mise en pratique des décisions qui sont prises. Cependant, dès ce fameux petit matin, un élément sautait aux yeux. Une question essentielle semblait avoir été écartée, celle des moyens financiers et de leurs sources réelles. Tout le monde s’accordant par ailleurs pour sous-entendre que l’Allemagne finirait par payer puisqu’elle seule semble apparemment en avoir les moyens ! Et puis, pendant le mois de juillet, oh surprise ! Tout paraît remis en question. Grâce à des manœuvres juridiques, l'application des accords est renvoyée au plus tôt en septembre. Il y a en effet un tout petit problème. Au 16 juillet l’ardoise de l’Allemagne devenait tout simplement insupportable. Lorsqu’on additionne tous les engagements en termes de garanties déguisées et lignes de crédits, l’exposition totale de ce pays à ses voisins européens aux abois s’élève à 1500 milliards d’euros. Le PNB de l’Allemagne est de 2650 milliards d’euros et ceci avant la prise en compte de la contraction de son activité qui a commencé il y a quelques mois. C’est là une somme ahurissante équivalant à plus de la moitié de son PNB. Les derniers chiffres annoncés en matière de dette pour la zone Euro s’élèvent eux à environ 8000 milliards dont une grande partie représente des actifs dits "toxiques" (c'est-à-dire des reconnaissances de dette qui ne seront jamais honorées). Il n’est pas bien difficile de comprendre que l’Allemagne est incapable d’assurer un tel niveau d’endettement. Elle n’est pas en mesure non plus, dans la durée, de cautionner, avec suffisamment de crédibilité, par sa seule signature, ce mur de la dette auprès des marchés financiers. La preuve effective de cette réalité existe ; elle s’exprime dans un paradoxe dont seule une économie en plein désarroi a le secret. L’Allemagne place sa dette à court et moyen terme à des taux négatifs. En clair les acheteurs de cette dette acceptent de ne percevoir que des intérêts ridicules tout en perdant du capital avec l’évolution de l’inflation. La dette souveraine allemande semble être un refuge de montagne capable d’affronter toutes les tempêtes mais, en même temps, les prix des assurances contractées par les acheteurs pour assurer cette dette en leur possession grimpe au niveau de ceux de la Grèce ! Finalement ce refuge se révèle bien vulnérable ! Les marchés savent pertinemment que si l’Allemagne continue de financer la dette de la zone Euro, elle deviendra alors elle-même insolvable et c'est pour cela que chacun des prêteurs veille à s’assurer au mieux en cas de chute brutale.
Alors reste la tentation de l’arme ultime. Celle qui consisterait à dire à la Banque centrale européenne de faire comme le Royaume-Uni, le Japon ou les États-Unis : "Imprimons des billets et encore des billets sans regarder la valeur de ce que l’on prend en échange". Les banques centrales peuvent bien se transformer à leur tour en banques "pourries", ce n’est pas le problème. Ce n’est plus le problème. Le problème est d’éviter que tout s’arrête aujourd’hui ! Nous verrons bien ce qui se passera demain, le mois prochain, l’année prochaine. C’est cela l’avancée du dernier sommet européen. Mais la BCE ne l’entend pas de cette oreille. Certes cette banque centrale n’a pas la même autonomie que les autres banques centrales du monde. Elle est liée aux différentes banques centrales de chaque nation composant la zone Euro. Mais le problème de fond est-il là ? Si la BCE pouvait opérer comme la Banque centrale du Royaume-Uni ou des États-Unis, par exemple, l’insolvabilité du système bancaire et des États de la zone Euro serait-elle résolue ? Qu'en est-il dans ces autres pays, par exemple aux États-Unis ?
Des banques centrales plus fragilisées que jamais
Alors que de lourds nuages s'amoncellent au-dessus de l’économie américaine, pourquoi les États-Unis n’ont-ils pas encore sorti de leur manche un troisième plan de relance, une nouvelle phase de monétisation de leur dette ?
Il faut se rappeler que le président de la Banque centrale américaine, Ben Bernanke a été surnommé "Monsieur Hélicoptère". Il y a déjà eu aux États-Unis, en quatre ans, deux plans de création monétaire massive, les fameux "quantitative easings". Ce monsieur semblait pouvoir survoler sans relâche les États-Unis et balancer de l’argent, inondant tout sur son passage. Un raz de marée ininterrompu de liquidités, et que chacun s’enivre à satiété ! Et bien non, désolé, cela ne marche pas comme cela. Depuis quelques mois une nouvelle création monétaire massive est indispensable aux États-Unis. Mais elle ne vient pas, elle se fait attendre. Parce qu’un "quantitative easing" n°3 est à la fois indispensable, vital et en même temps impossible, comme l’est en Europe une mutualisation et une monétisation globale de la dette de la zone Euro. Le capitalisme est engagé dans une rue qui finit en cul de sac ! Même la première puissance économique au monde ne peut pas fabriquer ex-nihilo de l’argent à l’infini. Toute dette a besoin d’être financée à un moment ou à un autre. La Banque centrale américaine a, comme toute banque centrale, deux sources de financement qui sont de fait liées et interdépendantes. La première consiste à capter l’épargne, l’argent qui existe au-dedans ou en-dehors du pays, soit à un coût d’emprunt tolérable, soit par un renforcement de la fiscalité. La seconde consiste à fabriquer de l’argent en contrepartie de reconnaissances de dettes, notamment en achetant ce qu’on appelle les obligations représentant la dette publique ou d’État. La valeur de ces obligations est en dernière instance déterminée par l’évaluation qu’en font les marchés financiers. Une voiture d’occasion est à vendre. Son prix est affiché sur le pare-brise par le vendeur. Les acheteurs potentiels vérifient l’état du véhicule. Des offres de prix d’achat sont proposées et le vendeur choisira sans aucun doute la moins mauvaise pour lui. Si l’état de la voiture est trop dégradé alors le prix devient dérisoire et celle-ci reste pourrir dans la rue. Ce petit exemple illustre le danger d’une nouvelle création monétaire aux États-Unis… et ailleurs. Depuis quatre ans, des centaines de milliards de dollars ont été injectées dans l’économie américaine sans que la moindre relance durable ne soit au rendez-vous. Pire : la dépression économique a poursuivi de manière souterraine son bonhomme de chemin. Nous voici arrivés au cœur du problème. L’évaluation de la valeur réelle de la dette souveraine est connectée de fait à la solidité de l’économie du pays, tout comme la valeur de notre voiture à son état réel. Si une Banque centrale (que ce soit aux États-Unis, au Japon ou dans la zone Euro) imprime des billets pour acheter des obligations, ou des reconnaissances de dettes, qui ne pourront jamais être remboursés (parce que les emprunteurs sont devenus insolvables) elle ne fait qu'inonder le marché de morceaux de papier qui ne correspondent à aucune valeur réelle car ils n'ont pas de contrepartie effective en termes d'épargne ou de richesses nouvelles en garantie. En d'autres termes, elles fabriquent de la fausse monnaie.
En route vers une récession généralisée
Une telle affirmation peut toujours paraître un peu exagérée ou aventureuse et pourtant ! Voici ce qui est écrit dans le bulletin Global Europe Anticipation de janvier 2012 : "Pour générer un dollar de croissance en plus, les USA doivent désormais emprunter autour de 8 dollars. Ou bien l’inverse, si on préfère, chaque dollar emprunté ne génère que 0,12 dollar de croissance. Cela illustre l’absurdité du moyen-long terme des politiques menées par la FED et le Trésor US ces dernières années. C’est comme une guerre où il faut tuer de plus en plus de soldats pour gagner de moins en moins de terrain." La proportion n’est sans doute pas exactement la même dans tous les pays du monde. Mais la tendance générale suit le même chemin. C'est pour cela, notamment, que les 100 milliards d'euros prévus par le sommet du 29 juin en vue de financer la croissance ne seront pas autre chose qu'un sparadrap sur une jambe de bois. Les profits réalisés sont dérisoires au regard de l’évolution du mur de la dette. Un film comique célèbre avait pour titre : "Y a-t-il un pilote dans l’avion ?". Pour ce qui concerne l’économie mondiale, il faudrait rajouter : "Il n’y a plus de moteur non plus". Voilà un avion et ses passagers en bien mauvaise posture.
Face à cette débandade générale des pays les plus développés, certains, afin de minimiser la gravité de la situation du capitalisme, tentent d'opposer l'exemple de la Chine et des pays "émergents". Il y a quelques mois encore, la Chine nous était vendue comme étant la prochaine locomotive de l’économie mondiale, aidée dans ce rôle par l’Inde et le Brésil. Qu'en est-il en réalité ? Ces "moteurs" connaissent à leur tour de très sérieux ratés. La Chine a annoncé officiellement, le vendredi 13 juillet, un taux de croissance de 7,6% ce qui en fait le taux le plus bas pour ce pays depuis le début de la phase actuelle de la crise. Le temps des taux à deux chiffres est bien fini. Et pourtant, même à 7%, ces chiffres n’intéressent plus les spécialistes. Tous savent qu’ils sont faux. Ces gens avisés préfèrent se tourner vers d’autres chiffres qu’ils jugent plus fiables. Voici ce qui était dit le même jour sur une radio économique spécialisée française (BFM) : "En regardant l’évolution de la consommation électrique, on peut déduire que la croissance chinoise se situe en réalité autour de 2 à 3%. Soit moins de la moitié des chiffres officiels." En ce début d’été, tous les chiffres de la croissance de l’activité sont en berne. Ils diminuent partout. Le moteur tourne au ralenti, proche de zéro. L’avion s’apprête à plonger et l'économie mondiale avec lui.
Le capitalisme entre dans la zone des grandes tempêtes
Face à la récession mondiale et à l’état financier des banques et des États, la guerre économique va faire rage entre différents secteurs de la bourgeoisie. La relance de l’activité par une politique keynésienne classique (qui suppose un endettement de l'État) ne peut plus être, comme on l'a vu, réellement efficace. Dans ce contexte de récession, l’argent collecté par les États ne peut que diminuer et, malgré l’austérité généralisée, leur dette souveraine ne pourra que continuer à exploser comme en Grèce ou maintenant en Espagne. La question qui va déchirer la bourgeoisie est la suivante : "Faut-il prendre le risque insensé de relever une nouvelle fois le plafond de la dette ?" De manière croissante, l’argent ne veut plus aller à la production, à l’investissement ou à la consommation. Ce n’est plus rentable. Mais les intérêts et les remboursements des dettes à échéances sont là. Il est nécessaire au capital de fabriquer de la monnaie nouvelle et factice au moins pour retarder la cessation de paiements généralisée. Bernanke, le patron de la banque centrale américaine, et son homologue Mario Draghi dans la zone Euro, comme tous leurs confrères sur cette planète sont pris en otage par l’état de l’économie capitaliste. Soit ils ne font rien et alors la dépression et les faillites vont prendre à court terme l’allure d’un cataclysme. Soit ils injectent à nouveau massivement de l’argent et alors commencera à sonner le glas pour la valeur de la monnaie. Une chose est certaine, même si elle perçoit maintenant ce danger, la bourgeoisie, divisée irrémédiablement sur ces sujets, ne réagira que dans des situations d’urgence absolue, au dernier moment, et dans des proportions toujours plus insuffisantes. La crise du capitalisme malgré tout ce que nous avons connu depuis l’année 2008 n’en est qu’à ses débuts.
Tino (30-07-2012)
1 Il faut noter que depuis que cet article a été écrit, le gouvernement français est revenu à plus de coopération avec la chancelière allemande. Peut-être faudra-t-il parler bientôt de "Merkhollande". En tout cas, en septembre 2012, le nouveau président Hollande et la direction du Parti socialiste font campagne pour forcer la main aux parlementaires de leur majorité afin qu'ils votent en faveur du Pacte de stabilité (la "règle d'or") que le candidat Hollande avait promis de renégocier. Comme le disait un vieux routard du gaullisme réputé pour son cynisme, Charles Pasqua, "les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient".
2 Fonds européen de stabilité financière et Mécanisme européen de stabilité.
Récent et en cours:
- Crise économique [2]
Rubrique:
Le Mexique entre crise et narcotrafic
- 4503 lectures
La presse et les informations télévisées du monde entier transmettent régulièrement des images du Mexique dans lesquelles sont mis au premier plan les affrontements, la corruption et les assassinats, qui résultent de la "guerre contre le narcotrafic". Mais tout ceci apparaît comme un phénomène étranger au capitalisme ou anormal, alors que toute la réalité barbare qui va de pair est profondément enracinée dans la dynamique du système d’exploitation actuel. C'est, dans toute son étendue, la façon d’agir de la classe dominante qui est ainsi révélée, à travers la concurrence et les rivalités politiques exacerbées entre ses différentes fractions. Aujourd'hui, un tel processus de plongée dans la barbarie et la décomposition du capitalisme est effectivement dominant dans certaines régions du Mexique.
Au début de la décennie 1990, nous disions que "parmi les caractéristiques majeures de la décomposition de la société capitaliste, il faut souligner la difficulté croissante de la bourgeoisie à contrôler l'évolution de la situation sur le plan politique" 1. Ce phénomène apparaît plus clairement dans la dernière décennie du xxe siècle où il tend à devenir une tendance majeure.
Ce n'est pas seulement la classe dominante qui est affectée par la décomposition, le prolétariat et les autres couches exploitées en subissent aussi les effets les plus pernicieux. Au Mexique, les groupes maffieux et le propre gouvernement enrôlent, en vue de la guerre qu'ils se livrent, des éléments appartenant aux secteurs les plus paupérisés de la population. Les affrontements entre ces groupes, qui tirent sans distinction sur la population, laissent des centaines de victimes sur le carreau que gouvernement et maffias qualifient de "dommages collatéraux". Il en résulte un climat de terreur que la classe dominante a su utiliser pour éviter et contenir les réactions sociales aux attaques continues des conditions de vie de la population.
Le narcotrafic et l’économie
Dans le capitalisme, la drogue n’est rien de plus qu’une marchandise dont la production et la distribution nécessitent obligatoirement du travail, même si celui-ci n’est pas toujours volontaire ou salarié. L’esclavage dans ce milieu est courant, quoique soit aussi employé le travail volontaire et rémunéré d’un milieu lumpen pour des activités criminelles, mais aussi de journaliers et autres travailleurs comme des charpentiers (par exemple, pour la construction de maisons et de magasins) qui se voient contraints, pour survivre dans la misère qu’offre le capitalisme, de servir des capitalistes producteurs de marchandises illégales.
Ce qui est vécu aujourd’hui au Mexique a déjà existé (ou existe encore) dans d’autres parties du monde : les maffias tirent profit de la misère pour leurs agissements, et leur collusion avec les structures étatiques leur permet de "protéger leurs investissements" et leurs activités en général. En Colombie, dans les années 1990, l’enquêteur H. Tovar-Pinzón donnait un certain nombre d’éléments pour expliquer pourquoi les paysans pauvres devenaient les premiers complices des maffias du narcotrafic : "Une propriété produisait, par exemple, dix cargaisons de maïs par an qui permettaient une recette brute de 12 000 pesos colombiens. Cette même propriété pouvait produire cent arrobes de coca, qui représentaient pour le propriétaire un revenu brut de 350 000 pesos par an. N’est-il pas tentant alors de changer de culture quand l’une permet de gagner trente fois plus ?" 2.
Ce qui se passait en Colombie s’est étendu à toute l’Amérique latine, entraînant vers le narcotrafic, non seulement les paysans propriétaires, mais aussi la grande masse des journaliers sans terre qui vendent leur force de travail à ces derniers. Cette grande masse de salariés devient ainsi la proie facile des maffias, à cause du niveau extrêmement bas des salaires octroyés par l’économie légale. Au Mexique, par exemple, un journalier employé à couper la canne à sucre perçoit un peu plus de deux dollars par tonne (27 pesos) et voit son salaire amélioré lorsqu’il produit une marchandise illégale. Ce faisant, une grande partie des travailleurs employés dans cette activité perd sa condition de classe. Ces travailleurs sont toujours plus impliqués dans le monde du crime organisé et au contact direct des pistoleros et des transporteurs de drogue dont ils partagent directement le quotidien, dans un contexte de banalisation des assassinats et du crime. Mêlés étroitement à cette ambiance, la contagion les amène progressivement vers la lumpenisation. C’est un des effets nocifs de l’avancée de la décomposition affectant directement la classe ouvrière.
Il existe des estimations selon lesquelles les maffias du narcotrafic au Mexique emploieraient 25 % de personnes en plus que McDonald’s dans le monde entier 3. Il faut en outre ajouter qu’au-delà de l'utilisation d'agriculteurs, l’activité des maffias implique le racket et la prostitution imposés à des centaines de jeunes. Aujourd’hui, la drogue est une branche supplémentaire de l’économie capitaliste, c’est-à-dire que l’exploitation y est présente comme dans n’importe quelle autre activité économique mais, de plus, les conditions de l’illégalité poussent la concurrence et la guerre pour les marchés à prendre des formes bien plus violentes.
La violence pour gagner les marchés et augmenter les profits est d’autant plus acharnée que le gain est important. Ramón Martinez Escamilla, membre de l’Institut de recherches économiques de l’Université nationale autonome du Mexique, considère que "le phénomène du narcotrafic représente entre 7 et 8 % du PIB du Mexique" 4. Ces chiffres, comparés aux 6% du PIB mexicain que représente la fortune de Carlos Slim, le plus grand magnat du monde, donnent une idée de l’importance prise par le narcotrafic dans l’économie, permettant d'en déduire la barbarie que celui-ci engendre. Comme n’importe quel capitaliste, le narcotrafiquant n’a d’autre objectif que le profit. Pour expliquer les raisons de ce processus, il suffit de reprendre les paroles du syndicaliste Thomas Dunning (1799-1873), cité par Marx :
"Que le profit soit convenable, et le capital devient courageux : 10 % d'assurés, et on peut l'employer partout; 20 %, il s'échauffe !, 50 %, il est d'une témérité folle ; à 100 %, il foule aux pieds toutes les lois humaines ; 300 %, et il n'est pas de crime qu'il n'ose commettre, même au risque de la potence. Quand le désordre et la discorde portent profit, il les encourage tous deux" 5.
Fondées sur le mépris des vies humaines et sur l’exploitation, ces immenses fortunes trouvent certes refuge dans les paradis fiscaux mais sont aussi utilisées directement par des capitaux légaux qui se chargent de la besogne de blanchiment. Les exemples ne manquent pas pour l’illustrer, comme celui de l’entrepreneur Zhenli Ye Gon ou plus récemment de l’Institution financière HSBC. Dans ces deux exemples, il a été mis en lumière que ce personnage ou cette institution brassaient d’immenses fortunes de cartels de la drogue, que ce soit pour la promotion de projets politiques (au Mexique et ailleurs) ou pour "d’honorables" investissements.
Edgar Buscaglia 6 affirme que des entreprises de toute sorte ont été "désignées comme douteuses par les agences de renseignement d’Europe et des États-Unis, dont l’Office de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain, mais que personne n’a voulu les mettre en cause au Mexique, fondamentalement parce que plusieurs d’entre elles financent les campagnes électorales" 7.
Il existe d’autres processus marginaux (mais non moins significatifs) qui permettent l’intégration de la maffia à l’économie, tels que le dépouillement violent de propriétés et d’immenses territoires, à tel point que certaines zones du pays sont à présent des "villes fantômes". Certains chiffres parlent du déplacement, ces dernières années, d’un million et demi de personnes fuyant "la guerre entre l’armée et les narcos" 8.
Il est indispensable à présent de signaler l’impossibilité, pour les projets des maffiosi de la drogue, d'exister hors du domaine des États. Ceux-ci sont la structure qui les protège et les aide à déplacer leur argent vers les géants financiers, mais sont aussi le siège des équipes gouvernementales de la bourgeoisie qui ont mêlé leurs intérêts à ceux des cartels de la drogue. Il est évident que les maffias ne pourraient guère avoir autant d’activités si elles ne recevaient pas le soutien de secteurs de la bourgeoisie mêlés aux gouvernements. Comme nous l’avancions dans les "Thèses sur la décomposition", "il devient de plus en plus difficile de distinguer l'appareil gouvernemental du milieu des gangsters" 9.
Le Mexique, exemple de l’avancée de la décomposition capitaliste
Depuis 2006, ce sont presque soixante mille personnes qui ont été abattues, que ce soit sous les balles des unités de la maffia ou celles de l’armée officielle ; une grande partie de ces tués a été victime de la guerre entre cartels de la drogue, mais ceci ne diminue en rien la responsabilité de l’État, quoi qu’en dise le gouvernement. Il est impossible de rejeter la responsabilité sur les uns ou les autres, à cause des liens existant entre les groupes maffieux et l’État lui-même. Si les difficultés ont à ce niveau été croissantes, c’est précisément parce que les fractures et divergences au sein de la bourgeoisie se sont amplifiées et que, à tout instant, n’importe quel lieu peut devenir le champ de bataille entre fractions de la bourgeoisie ; bien entendu, la structure étatique elle-même est aussi un lieu privilégié pour que s’expriment ces conflits. Chaque groupe de la maffia surgit sous la houlette d’une fraction de la bourgeoisie, et tant la concurrence économique que les querelles politiques font que ces conflits croissent et se multiplient de jour en jour.
Au milieu du xixe siècle, pendant la période ascendante du capitalisme, le commerce de la drogue (l’opium par exemple) était déjà à l'origine de difficultés politiques aboutissant à des guerres, celles-ci révélant tant l’essence barbare de ce système que la participation directe des États dans la production et la distribution de marchandises telles que la drogue. Cependant, une telle situation était alors inséparable de la vigilance stricte des États et la classe dominante pouvait maintenir le cadre d'une ferme discipline sur cette activité, permettant de parvenir à des accords politiques et évitant qu'elle n'affaiblisse la cohésion de la bourgeoisie 10. Ainsi, même si la "guerre de l’opium" – déclarée principalement par l’État britannique – illustrait un trait de comportement du capital, nous pouvons comprendre pourquoi le commerce de la drogue n’était cependant pas un phénomène dominant du xixe siècle.
L’importance de la drogue et la formation de groupes maffieux prennent une importance croissante durant la phase de décadence du capitalisme. La bourgeoisie tente certes de limiter et ajuster par des lois et des règlements la culture, la préparation et le trafic de certaines drogues pendant les premières décennies du xxe siècle, mais seulement dans le but de bien contrôler le commerce de cette marchandise.
L’évidence historique montre que la "filière de la drogue" n’est pas une activité répudiée par la bourgeoisie et son État. Bien au contraire, c’est cette même classe qui se charge d’étendre son usage et de profiter des bénéfices qu’elle procure, et dans le même temps d'étendre ses effets ravageurs chez l’être humain. Les États, au xxe siècle, ont distribué massivement de la drogue aux armées. Les États-Unis donnent le meilleur exemple d'un tel usage pour "stimuler" les soldats pendant la guerre : le Viêt-Nam fut ainsi un grand laboratoire et il n’est pas surprenant que ce soit effectivement l’Oncle Sam qui ait encouragé la demande de drogue pendant les années 1970, et y ait répondu en impulsant sa production dans les pays de la périphérie.
Au début de la seconde moitié du xxe siècle au Mexique, l’importance de la production et de la distribution de drogue est encore loin d’être significative et reste sous le contrôle strict des instances gouvernementales. Le marché est alors strictement contrôlé par l’armée et la police. À partir des années 1980, l’État américain encourage le développement de la production et de la consommation de drogue au Mexique et dans toute l’Amérique latine.
L’affaire "Iran-Contra" (1986) avait mis en lumière que le gouvernement de Ronald Reagan, pour pallier la limitation du budget destiné à soutenir les bandes militaires opposées au gouvernement du Nicaragua (les "contras"), utilisait des fonds provenant de la vente d’armes à l’Iran et, surtout, du trafic de drogue via la CIA et la DEA. Le gouvernement des États-Unis poussait les maffias colombiennes à augmenter leur production, déployant même, à cette fin, un soutien militaire et logistique auprès des gouvernements du Panama, du Mexique, du Honduras, du Salvador, de la Colombie et du Guatemala, destiné à faciliter le passage de cette si convoitée marchandise. Pour "élargir le marché", la bourgeoisie américaine s'était mise à produire des dérivés de la cocaïne bien moins coûteux et donc plus faciles à commercialiser massivement, quoique bien plus ravageurs.
Ces mêmes pratiques, utilisées par le grand parrain américain pour se procurer des fonds lui permettant de mener à bien ses aventures putschistes, ont aussi été utilisées en Amérique latine pour lutter contre la guérilla. Au Mexique, ladite "sale guerre" menée par l’État dans les années 1970 et 80 contre la guérilla fut financée par l’argent qui venait de la drogue. L’armée et des groupes paramilitaires (comme la Brigade blanche ou le groupe Jaguar) avaient alors carte blanche pour assassiner, séquestrer et torturer. Certains projets militaires comme "l’Opération Condor" (qui soi-disant visait la production de drogue), étaient en réalité dirigés contre la guérilla et servirent en même temps à protéger les cultures de pavot et de marijuana.
À cette époque, la discipline et la cohésion de la bourgeoisie mexicaine lui permettaient de maintenir sous contrôle le marché de la drogue. De récentes enquêtes journalistiques affirment que pas la moindre cargaison de drogue n'échappait au contrôle et à la surveillance de l’armée ou de la police fédérale 11. L’État assurait, sous un corset de fer, l’unité de tous les secteurs de la bourgeoisie et, quand un groupe ou capitaliste individuel manifestait des désaccords, il était soumis pacifiquement par le biais de privilèges ou de parts de pouvoir. C’est ainsi que se maintenait unie la soi-disant "famille révolutionnaire" 12.
Avec l’effondrement du bloc impérialiste de l’Est disparut aussi l’unité du bloc opposé dirigé par les États-Unis, ce qui en retour provoqua une accentuation du chacun pour soi parmi les différentes fractions nationales de certains pays. Au Mexique, cette rupture s’exprima à travers la dispute au grand jour des fractions de la bourgeoisie à tous les niveaux : partis, clergé, gouvernements régionaux, fédéral… Chaque fraction cherchait à s'octroyer une plus grande part de pouvoir, sans qu'aucune d'entre elles ne prenne pour autant le risque de remettre en question la discipline historique derrière les États-Unis.
Dans ce contexte de bagarre générale, des forces bourgeoises opposées se sont disputées la répartition du pouvoir. Ces pressions internes ont débouché sur des tentatives de remplacer le parti au pouvoir et de "décentraliser" les responsabilités du maintien de l’ordre. C'est ainsi que les pouvoirs locaux, représentés par les gouvernements des États fédérés et les présidents municipaux, ont décrété leur contrôle régional. Ceci, en retour, n'a fait qu'accentuer le chaos : le gouvernement fédéral et chaque gouvernement de région ou municipalité, afin de renforcer son contrôle politique et économique, s’est associé avec telle ou telle bande maffieuse. Chaque fraction au pouvoir protège et renforce tel ou tel cartel en fonction de ses intérêts, lui assurant ainsi l’impunité, ce qui explique l’arrogance violente des maffias.
L’ampleur de ce conflit peut se vérifier dans les règlements de comptes entre personnalités politiques. On peut estimer par exemple que, ces cinq dernières années, vingt-trois maires et huit présidents municipaux ont été assassinés, et que les menaces faites à des secrétaires d’État et des candidats ont été innombrables. La presse bourgeoise tente de faire passer les personnalités assassinées pour des victimes alors que, dans la majeure partie des cas, celles-ci ont été l'objet de règlements de comptes entre bandes rivales ou bien au sein même des bandes, pour cause de trahison.
En analysant de la sorte ces événements, on peut comprendre que les problèmes de drogue ne pourront pas être résolus dans le capitalisme. Pour limiter les excès de la barbarie, la seule solution de la bourgeoisie est d’unifier ses intérêts et de se regrouper autour d’une seule bande maffieuse, isolant ainsi les autres bandes pour les maintenir dans une existence marginale.
L’issue pacifique de cette situation est très improbable du fait en particulier de la division aiguë entre fractions de la bourgeoisie au Mexique, rendant difficile et peu probable que puisse être atteinte ne serait-ce qu’une cohésion temporaire permettant une pacification. La tendance dominante semble bien être à l’avancée de la barbarie… Dans une interview datée de juin 2011, Buscaglia faisait une estimation de l’ampleur que prenait le narcotrafic dans la vie de la bourgeoisie : "près de 65 % des campagnes électorales au Mexique sont contaminées par de l’argent provenant de la délinquance organisée, principalement du narcotrafic" 13.
Les travailleurs sont les victimes directes de l’avancée de la décomposition capitaliste qui s’exprime à travers des phénomènes comme "la guerre contre le narco" et ils sont aussi la cible des attaques économiques que la bourgeoisie impose face à l’approfondissement de la crise ; c’est sans le moindre doute une classe qui souffre de grandes pénuries, mais ce n’est pas une classe contemplative, c’est un corps social capable de réfléchir, de prendre conscience de sa condition historique et de réagir collectivement.
Décomposition et crise… le capitalisme est un système en putréfaction
Drogue et assassinats font partie des faits divers majeurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, et si la bourgeoisie leur donne une telle importance c'est aussi parce que cela lui permet de faire passer au second plan les effets de la crise économique.
La crise du capitalisme n’a pas son origine dans le secteur financier, comme le prétendent les "experts" bourgeois. C’est une crise profonde et générale du système qui n’épargne aucun pays. La présence active des maffias au Mexique, bien qu’elle pèse d’un poids très lourd sur les exploités, n’efface pas les effets de la crise sur ceux-ci ; bien au contraire, elle les aggrave.
La cause principale des tendances à la récession qui affecte actuellement le capitalisme mondial est l’insolvabilité généralisée, mais ce serait une erreur de croire que le poids de la dette souveraine est l’unique indicateur permettant d'évaluer l’avancée de la crise. Dans certains pays, comme le Mexique, le poids de la dette ne crée pas encore de difficultés majeures, quoiqu’au cours de la dernière décennie, selon la Banque du Mexique, la dette souveraine ait augmenté de 60 % pour atteindre 36,4 % du PIB fin 2012 selon les prévisions. Ce montant est bien sûr modeste quand on le compare au niveau de l’endettement de pays comme la Grèce (où il atteint 170 % du PIB), mais cela implique-t-il que le Mexique ne soit pas exposé à l’approfondissement de la crise ? La réponse est non, bien entendu.
Tout d’abord, que l'endettement ne soit pas aussi important au Mexique que dans d'autres pays ne signifie pas qu’il ne va pas le devenir.
Les difficultés de la bourgeoisie mexicaine à relancer l’accumulation de capital s’illustrent particulièrement dans la stagnation de l’activité économique. Le PIB n’est même pas parvenu à atteindre ses niveaux de 2006 (voir graphique 1) et, qui plus est, les fugaces embellies récentes ont concerné le secteur des services, en particulier le commerce (comme l’explique la propre institution de l’État chargée des statistiques, l’INEGI). Par ailleurs, il faut prendre aussi en considération que si ce secteur dynamise le commerce intérieur (et permet ainsi au PIB de croître), c’est parce que le crédit à la consommation a augmenté (fin 2011 l’usage des cartes de crédit avait augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente).
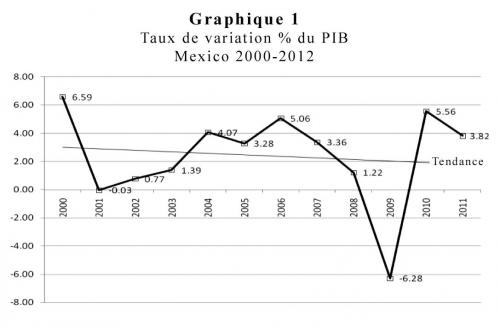
Les mécanismes utilisés par la classe dominante pour affronter la crise ne sont ni nouveaux ni particuliers au Mexique : augmenter les niveaux d’exploitation et doper l’économie à travers le crédit. L’application de mesures de ce genre avait permis aux États-Unis, dans les années 1990, de donner l’illusion d’une croissance. Anwar Shaikh, spécialiste de l’économie américaine, l’explique ainsi : "La principale impulsion en faveur du boom était venue de la dramatique chute du taux d’intérêt et de l’effondrement spectaculaire des salaires réels en rapport avec la productivité (croissance du taux d’exploitation), qui ensemble élevèrent considérablement le taux de profit de l’entreprise. Les deux variables jouèrent des rôles différents dans différents endroits…" 14.
De telles mesures se répètent au rythme de l’avancée de la crise, et bien que leurs effets soient toujours plus limités, il n’y a pas d’autre solution que de continuer à y recourir, en attaquant toujours davantage les conditions de vie des travailleurs. Les chiffres officiels, pour maquillés qu’ils soient, témoignent de la précarité des solutions. Il n’est pas surprenant que l’alimentation des travailleurs mexicains soit basée sur les calories les moins chères provenant du sucre (le pays étant le second consommateur de sodas derrière les États-Unis, chaque Mexicain en consommant quelques 150 litres en moyenne par an) ou des céréales.
Ce n'est donc pas surprenant si le Mexique est un des pays dont la population adulte est la plus en proie aux problèmes d’obésité et où culminent des maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension. La dégradation des conditions de vie atteint de tels extrêmes que toujours plus d’enfants entre 12 et 17 ans sont obligés de travailler (selon la CEPALC, 25 % en zone rurale et 15 % en ville). En compressant les salaires, la bourgeoisie parvient à se réapproprier les ressources financières auparavant destinées à la consommation des ouvriers, cherchant ainsi à augmenter la masse de plus-value que s’approprie le capital. Cette situation est d'autant plus grave pour les conditions de vie de la classe ouvrière que, comme le montre le graphique 2, les prix de la nourriture augmentent plus vite que l’indice général des prix utilisé par l’État pour affirmer que le problème de l’inflation est sous contrôle.
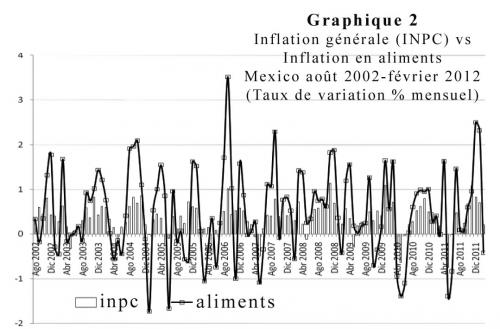
Les porte-paroles des gouvernements en Amérique latine partent du principe que si les conflits économiques majeurs touchent les pays centraux (États-Unis et Europe), le reste du monde est épargné par cette dynamique, d’autant plus que le FMI et la BCE sont alimentés en liquidités par les gouvernements de ces régions, y compris celui du Mexique. Mais ceci ne signifie en rien que ces économies ne soient pas menacées par la crise. Ces mêmes processus d’insolvabilité que traverse aujourd’hui l’Europe furent le lot de l’Amérique latine pendant les années 1980 et, avec elles, les sévères mesures découlant de plans d'austérité draconiens (qui donnèrent lieu à ce qui fut nommé le Consensus de Washington).
La profondeur et l’amplitude de la crise peuvent se manifester différemment selon les pays, mais la bourgeoisie recourt aux mêmes stratégies dans tous les pays, même ceux qui sont moins étranglés par l’accroissement de la dette souveraine.
Les plans de réduction des coûts de production que la bourgeoisie applique de moins en moins discrètement, licenciements massifs et augmentation de l'exploitation, ne peuvent en aucun cas favoriser un quelconque redressement.
Les taux de chômage et de paupérisation atteints par le Mexique nous aident à comprendre comment s’étend et s’approfondit la crise partout ailleurs. Coparmex, l’association patronale, reconnaît qu’au Mexique 48 % de la population économiquement active se trouve dans "le sous-emploi" 15, ce qui dans un langage plus franc signifie en situation précaire : bas salaires, contrats temporaires, journées de plus en plus longues sans assurance médicale. Cette masse de chômeurs et de précaires est le fruit de la "flexibilisation du travail" imposée par la bourgeoisie pour amplifier l’exploitation et faire retomber sur nos épaules les principaux effets de la crise.
La misère et l’exploitation sont les moteurs du mécontentement
Nombreuses sont les régions, essentiellement dans les zones rurales, qui sont soumises au couvre-feu et au contrôle permanent par les patrouilles armées, qu’elles soient militaires, policières ou maffieuses (si ce n’est les deux), qui assassinent sous le moindre prétexte, faisant de la vie des exploités un véritable cauchemar. À cette terreur s’ajoutent des attaques permanentes sur le plan économique. Début 2012, la bourgeoisie mexicaine a annoncé une "réforme du travail" qui, comme ailleurs dans le monde, va porter le coût de la force de travail à un niveau plus intéressant pour le capital, réduisant ainsi les coûts de production et amplifiant davantage les taux d’exploitation.
La "réforme du travail" a pour but l’augmentation des cadences et de la durée du travail, mais aussi la baisse des salaires (réduction du salaire direct et élimination de parts substantielles du salaire indirect), le projet prévoyant par ailleurs l’augmentation du nombre d’années de travail nécessaires pour avoir droit à la retraite.
Cette menace a commencé à se concrétiser dans le secteur de l’éducation. L’État a choisi ce secteur pour porter une première attaque qui devra en appeler d'autres ailleurs. Il peut se le permettre car, bien que les travailleurs y soient nombreux et aient une grande tradition de combativité, il est très fermement contrôlé par la structure syndicale, tant officielle (Syndicat national des travailleurs de l’Education – SNTE) que "démocratique" (Coordination nationale des travailleurs de l’Éducation – CNTE). C'est ainsi que le gouvernement a pu y déployer la stratégie suivante : d’abord provoquer le mécontentement en annonçant une "Évaluation universelle" 16, et ensuite mettre en scène toute une série de manœuvres (manifestations interminables, tables de négociations séparées par région…) reposant sur les syndicats pour user, isoler et ainsi vaincre les grévistes, convaincre de l'inutilité de "la lutte" et enfin démoraliser et intimider l’ensemble des travailleurs.
Bien que les enseignants aient fait l'objet d’un traitement particulier, les "réformes" s’appliquent cependant progressivement et discrètement à tous les travailleurs. Les mineurs, par exemple, subissent déjà ces attaques qui réduisent le coût de leur force de travail et précarisent leurs conditions de travail. La bourgeoisie considère normal que, pour un salaire de misère (le salaire maximum auquel peut prétendre un mineur est de 455 dollars mensuels), les ouvriers passent au fond des puits et galeries des mines de longues et intensives journées de travail qui excèdent bien souvent les huit heures, dans des conditions de sécurité innommables dignes de celles qui prévalaient au xixe siècle. C’est ce qui explique, d’une part, que le taux de profit des entreprises minières au Mexique soit parmi les plus élevés du monde et, d’autre part, l’augmentation spectaculaire des "accidents" dans les mines, avec leur lot croissant de blessés et de morts. Depuis l’an 2000, dans le seul état de Coahuila, la plus active des zones minières du pays, plus de 207 travailleurs sont morts à la suite d’effondrements de galeries ou de coups de grisou.
Cette misère, à laquelle s’ajoutent les agissements criminels des gouvernements et des maffias, provoque un mécontentement croissant parmi les exploités et opprimés qui commence à s’exprimer, même si c'est encore avec de grandes difficultés. Dans d’autres pays comme l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Chili ou le Canada, les rues ont été envahies par les manifestations exprimant ainsi le courage de lutter contre la réalité du capitalisme, même si ce n'était pas encore clairement en tant que force d'une classe de la société, la classe ouvrière.
Au Mexique, les manifestations massives convoquées par des étudiants du mouvement "#yo soy 132" (#je suis le 132), bien qu’ayant été dès l’origine encadrées par la campagne électorale de la bourgeoisie en vue des présidentielles, n’en sont pas moins le produit d'un malaise social qui couve. Ce n’est pas pour nous consoler que nous affirmons cela ; nous ne nous berçons pas de l'illusion d'une classe ouvrière avançant sans faiblir dans un processus de lutte et de clarification, nous nous efforçons simplement de comprendre la réalité. Nous devons pour cela prendre en compte que le développement des mobilisations sur l’ensemble de la planète n’est pas homogène et qu'au sein de celles-ci, la classe ouvrière comme telle n’a pas assumé une position dominante. Du fait de sa difficulté à se reconnaître en tant que classe de la société ayant la capacité de constituer une force au sein de celle-ci, la classe ouvrière n’a pas confiance en elle, elle craint de se lancer dans la lutte et de prendre la tête du combat. Une telle situation favorise, au sein des mouvements, l'influence des mystifications bourgeoises qui présentent des "solutions" réformistes comme des alternatives possibles à la crise du système. Cette tendance générale est aussi présente au Mexique.
Ce n’est qu’en constatant les difficultés rencontrées par la classe ouvrière que l’on peut comprendre que le mouvement animant la création du regroupement "#yo soy 132" exprime aussi le ras-le-bol envers les gouvernements et partis de la classe dominante. Cette dernière a su réagir très rapidement à la menace en enchaînant le regroupement au faux espoir porté par les élections et la démocratie, et le convertir en un organe creux, inutile au combat des exploités (qui s'étaient rapprochés de ce groupe en croyant y trouver un moyen de lutter) mais très utile à la bourgeoisie qui continue à utiliser "#yo soy 132" afin d’encadrer la combativité des jeunes ouvriers révoltés par la réalité du capitalisme.
La classe au pouvoir sait parfaitement que l’aggravation des attaques provoquera inévitablement une réponse de la part des exploités. José A. Gurría, secrétaire général de l’OCDE, l’exprime en ces termes le 24 février : "Que peut-il se passer quand on mixe la baisse de la croissance, un taux élevé de chômage et une inégalité croissante ? Le résultat ne peut être que le Printemps arabe, les Indignés de la Puerta del Sol et ceux de Wall Street". C’est pourquoi, face à ce mécontentement latent, la bourgeoisie mexicaine favorise la campagne de contestation de l’élection de Peña Nieto 17 à la présidence de la république, mot d’ordre fédérateur qui stérilise toute combativité réelle, d’autant plus qu’au-delà des déclarations radicales de López Obrador 18 et de "#yo soy 132" rien n’ira plus loin que la défense de la démocratie et de ses institutions.
Accentuée par les effets nocifs de la décomposition, la crise capitaliste a généralisé la paupérisation des prolétaires et autres opprimés mais elle a, ce faisant, montré la réalité à nu, dans toute sa cruauté : le capitalisme ne peut plus offrir que chômage, misère, violence et mort.
La crise profonde du capitalisme et l’avancée destructive de la décomposition annoncent les dangers que représente la survie du capitalisme, affirmant la nécessité impérative de sa destruction par la seule classe capable de l’affronter, le prolétariat.
Rojo (mars 2012)
1 Cf. Revue internationale no 62,
"La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme [3]".
2 Nueva sociedad no 130, Colombie, 1994, "L’économie de la coca en Amérique latine. Le paradigme colombien" (notre traduction).
3 Cf. "Narco SA, una empresa global" [4] sur www.cnnexpansion.com [5].
4 La Jornada, 25 juin 2010 (notre traduction).
5 Karl Marx, Le Capital, Livre premier, "Le développement de la production capitaliste" ; VIIIe section, "L'accumulation primitive" ; Chapitre XXXI, "Genèse du capitaliste industriel". https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-31.htm [6].
6 Coordinateur du Programme international de Justice et Développement de l’Institut technologique autonome du Mexique (ITAM).
7 La Jornada, 24 mars 2010 (notre traduction).
8 Dans des états du nord du pays comme Durango, Nuevo León et Tamaulipas, certaines zones sont considérées comme "villes fantômes" car abandonnées par la population. Les villageois qui se consacraient à l’agriculture se sont vus dans l’obligation de fuir, liquidant leur propriété à bas prix dans le meilleur des cas ou les abandonnant purement et simplement. Le sort des ouvriers est encore plus grave car leur mobilité est limitée faute de moyens ; quand ils parviennent à fuir vers d’autres régions, ils sont forcés de vivre dans les pires conditions de précarité, devant en outre continuer à rembourser les crédits des logements qu’ils ont été forcés d’abandonner.
9 Cf. Revue internationale no 62, op. cit., point 8.
10 Aujourd’hui encore, pour certains pays comme les États-Unis, qui sont cependant les plus grands consommateurs de drogues, les affrontements armés et les victimes qu’ils provoquent restent surtout concentrés hors des frontières.
11 Cf. Anabel Hernández, Los Señores del narco (les Seigneurs de la drogue), Editions Grijalbo, México 2010.
12 C’est ainsi que l’on appelait l’unité que la bourgeoisie avait atteinte avec la création du Parti national révolutionnaire (PNR, 1929), qui se consolida en se transformant en Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) et qui se maintint au pouvoir jusqu’en 2000.
13 Cf. "Edgardo Buscaglia : el fracaso de la guerra contra el narco - Pour le Journal allemand Die Tageszeitung" [7] sur nuestraaparenterendicion.com
14 In "The first great depression of the 21st century" [8], 2010.
15 L’institution officielle (INEGI) calcule pour sa part que le taux de travailleurs “informels” est de 29,3 %.
16 "L’Évaluation universelle" est une partie du projet "Alliance pour la qualité de l’Éducation" (ACE) Cette mesure vise non seulement à imposer un système d’évaluation pour amener les travailleurs à rivaliser entre eux et réduire les postes, mais aussi pour augmenter les charges de travail, comprimer les salaires, faciliter les protocoles de licenciement rapide et à bas coût, attaquer les retraites…
17 Dirigeant du Parti révolutionnaire institutionnel [9] (social-démocrate).
18 Dirigeant du Parti de la révolution démocratique [10] (social-démocrate de gauche).
Géographique:
- Mexique [11]
Rubrique:
L'État dans la période de transition au communisme (II) : notre réponse au groupe Oposição Operária (Opposition ouvrière) - Brésil
- 3380 lectures
Nous publions ci-après notre réponse à l'article "Conseils ouvriers, État prolétarien, dictature du prolétariat" du groupe Oposição Operária (OPOP) 1 au Brésil, paru dans le numéro 148 de la Revue internationale 2.
La position développée dans l'article de OPOP se réclame intégralement de l'ouvrage de Lénine, L'État et la révolution, et c'est à partir de ce point de vue que cette organisation rejette une idée centrale de la position du CCI. Cette dernière, tout en reconnaissant la contribution fondamentale de L'État et la révolution à la compréhension de la question de l'État durant la période de transition, met à profit l'expérience de la révolution russe, des réflexions de Lénine lui-même durant cette période et des écrits fondamentaux de Marx et Engels, pour en tirer des enseignements conduisant à remettre en question l'identité entre État et dictature du prolétariat, admise classiquement jusque-là par les courants marxistes.
Dans son article, OPOP développe également une autre position qui lui est propre à propos de ce qu'elle appelle le "pré-État", c'est-à-dire l'organisation des conseils, avant la révolution, appelée à renverser la bourgeoisie et son État. Nous reviendrons ultérieurement sur cette question car nous estimons qu'il est prioritaire de faire préalablement toute la lumière sur nos divergences avec OPOP concernant la question de l'État de la période de transition.
L'essentiel de la thèse défendue par OPOP dans son article
Afin d'éviter au lecteur des allers et retours incessants avec l'article de OPOP de la Revue internationale n° 148, nous en reproduisons les passages que nous estimons les plus significatifs.
Pour OPOP, la "séparation antinomique entre le système des conseils et l'État postrévolutionnaire" "s'éloigne de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État", revenant ainsi à "briser l'unité qui doit exister et persister dans le cadre de la dictature du prolétariat". En effet, "une telle séparation place, d'un côté, l'État comme une structure administrative complexe, devant être gérée par un corps de fonctionnaires - une aberration dans la conception de l'État simplifié de Marx, Engels et Lénine – et, de l'autre, une structure politique, dans le cadre des conseils, devant exercer une pression sur la première (l'État en tant que tel)."
C'est une erreur qui, selon OPOP, s'explique par les incompréhensions suivantes relatives à l'État-Commune et ses relations avec le prolétariat :
-
"une accommodation à une vision influencée par l'anarchisme qui identifie l'État-Commune avec l'État bureaucratique (bourgeois)." Celle-ci "place le prolétariat hors de l'État postrévolutionnaire, créant ainsi une dichotomie qui, elle, constitue le germe d'une nouvelle caste se reproduisant dans le corpus administratif organiquement séparé des conseils."
-
"l'identification entre l'État surgi dans l'URSS postrévolutionnaire - un État nécessairement bureaucratique - avec la conception de l'État-Commune de Marx, Engels et de Lénine lui-même".
-
"La non prise en compte du fait que les tâches organisationnelles et administratives mises à l'ordre du jour par la révolution sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux. Ainsi, des questions brûlantes comme la planification centralisée (…) ne sont pas des questions purement "techniques" mais hautement politiques et, comme telles, ne peuvent être déléguées, même si elles sont "vérifiées" de l'extérieur par les conseils, au moyen d'un corps d'employés situés en dehors du système des conseils où se trouvent les travailleurs les plus conscients".
-
"la non perception que la véritable simplification de l'État-Commune, telle qu'elle est décrite par Lénine (…) implique un minimum de structure administrative et que cette structure est si minime et en voie de simplification/extinction, qu'elle peut être assumée directement par le système des conseils"
Enfin, un autre facteur intervient, selon OPOP, pour expliquer les leçons erronées tirées par le CCI de la Révolution russe quant à la nature de l'État de transition ; il s'agit de la non prise en compte par notre organisation des conditions défavorables que la révolution a dû confronter : "une incompréhension des ambiguïtés ayant résulté de circonstances historiques et sociales spécifiques, qui ont bloqué non seulement la transition mais même le début de la dictature du prolétariat en URSS. Ici, on cesse de comprendre que la dynamique prise par la Révolution russe - à moins d'opter pour l'interprétation facile mais peu consistante selon laquelle les déviations du processus révolutionnaire ont été le fruit de la politique de Staline et de son entourage – n'obéissait pas à la conception de la révolution, de l'État et du socialisme qu'en avait Lénine, mais aux restrictions qui émanaient du terrain social et politique d'où émergea le pouvoir en URSS caractérisé, entre autres et pour rappel, par l'impossibilité de la révolution en Europe, par la guerre civile et la contre-révolution à l'intérieur de l'URSS. La dynamique qui en résulta était étrangère à la volonté de Lénine. Lui-même se pencha sur celle-ci, la marquant de façon réitérée par des formulations ambiguës présentes dans sa pensée ultérieure et ce jusqu'à sa mort."
L'inévitabilité d'une période de transition et de l'existence d'un État durant celle-ci
La différence entre les marxistes et les anarchistes ne réside pas en ceci que les premiers concevraient le communisme avec un État et les seconds comme étant une société sans État. Sur ce point, il y accord total : le communisme ne peut être qu'une société sans État. C'est donc plutôt avec les pseudo-marxistes de la social-démocratie, héritiers de Lassalle, qu'une telle différence fondamentale a existé vu que, pour eux, c'est l'État qui était le moteur de la transformation socialiste de la société. C'est contre eux qu'Engels avait écrit le passage suivant de l'Anti-Dühring : "Dès qu'il n'y a plus de classe sociale à tenir dans l'oppression ; dès que, avec la domination de classe et la lutte pour l'existence individuelle motivée par l'anarchie antérieure de la production, sont éliminés également les collisions et les excès qui en résultent, il n'y a plus rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression, un État. Le premier acte dans lequel l'État apparaît réellement comme représentant de toute la société, la prise de possession des moyens de production au nom de la société, est en même temps son dernier acte propre en tant qu'État. L'intervention d'un pouvoir d'État dans des rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l'autre, et entre alors naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses et à la direction des opérations de production. L'État n'est pas "aboli", il s'éteint. Voilà qui permet de juger la phrase creuse sur l'"État populaire libre 3", tant du point de vue de sa justification temporaire comme moyen d'agitation que du point de vue de son insuffisance définitive comme idée scientifique ; de juger également la revendication de ceux qu'on appelle les anarchistes, d'après laquelle l'État doit être aboli du jour au lendemain" 4. Le vrai débat avec les anarchistes porte sur leur méconnaissance totale d'une période de transition inévitable et sur le fait qu'ils dictent à l'histoire un saut à pieds joints, immédiat et direct, du capitalisme à la société communiste.
Sur cette question de la nécessité de l'État durant la période de transition, nous sommes donc parfaitement d'accord avec OPOP. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous étonner que cette organisation nous reproche de nous "éloigner de la conception de Marx, Engels et Lénine en reflétant une certaine influence de la conception anarchiste de l'État". En quoi, en effet, d'un point de vue marxiste, notre position peut-elle s'approcher de celle des anarchistes selon laquelle "il est possible d'abolir l'État du jour au lendemain" ?
Si on se base sur ce qu'écrit Lénine dans L'État et la révolution, à propos de la critique marxiste de l'anarchisme sur la question de l'État, il apparaît que cette dernière est loin de confirmer le point de vue de OPOP : "Marx souligne expressément — pour qu'on ne vienne pas dénaturer le sens véritable de sa lutte contre l'anarchisme — la "forme révolutionnaire et passagère" de l'État nécessaire au prolétariat. Le prolétariat n'a besoin de l'État que pour un temps. Nous ne sommes pas le moins du monde en désaccord avec les anarchistes quant à l'abolition de l'État en tant que but. Nous affirmons que, pour atteindre ce but, il est nécessaire d'utiliser provisoirement les instruments, les moyens et les procédés du pouvoir d'État contre les exploiteurs, de même que, pour supprimer les classe, il est indispensable d'établir la dictature provisoire de la classe opprimée" 5. Le CCI fait pleinement sienne cette formulation, à un mot près. Il s'agit de la qualification, par Lénine, de "révolutionnaire" de cette forme passagère qu'est l'État. Cette différence peut-elle être apparentée à une variante des conceptions anarchistes, comme le pense OPOP, ou bien au contraire renvoie-t-elle à un débat beaucoup plus profond sur la question de l'État ?
Quel est le véritable débat ?
Sur la question de l'État, notre position diffère effectivement de celle de L'État et la révolution et de celle de la Critique du programme de Gotha pour qui, durant la période de transition, "l'État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat" 6. C'est le fond du débat entre nous : pourquoi ne peut-il y avoir d'identité entre la dictature du prolétariat et l'État de la période de transition qui surgit après la révolution ? Voila une idée qui heurte beaucoup de marxistes, lesquels ont souvent posé la question : "D'où le CCI tire-t-il sa position sur l'État de la période de transition ?" Nous pouvons répondre : "Non pas de son imagination mais bien de l'histoire, des leçons qu'en ont tirées des générations de révolutionnaires, des réflexions et élaborations théoriques du mouvement ouvrier". Ainsi en particulier :
- les perfectionnements successifs à la compréhension de la question de l'État apportés par le mouvement ouvrier jusqu'à la révolution russe et dont L'État et la révolution de Lénine rend compte de façon magistrale ;
- la prise en compte de l'ensemble des considérations théoriques de Marx et Engels sur la question de l'État, qui vient en fait contredire l'idée que l'État de la période de transition constituerait le vecteur de transformation socialiste de la société ;
- la dégénérescence de la Révolution russe qui illustre que l'État a constitué le vecteur principal de développement de la contre-révolution au sein du bastion prolétarien ;
- au sein de ce processus, certaines prises de positions critiques de Lénine en 1920-21 démontrant que le prolétariat devait pouvoir se défendre contre l'État et qui, tout en restant prisonnières des limitations propres à la dynamique de dégénérescence qui allait mener à la contre-révolution, apportent un éclairage essentiel sur la nature et le rôle de l'État de transition.
C'est avec cette démarche qu'un travail de bilan de la vague révolutionnaire mondiale a été effectué par la Gauche communiste d'Italie 7. Selon cette dernière, si l'État subsiste après la prise du pouvoir du prolétariat du fait qu'il subsiste des classes sociales, celui-ci est fondamentalement un instrument de conservation de la situation acquise mais nullement l'instrument de la transformation des rapports de production vers le communisme. En ce sens, l'organisation du prolétariat comme classe, à travers ses conseils ouvriers, doit imposer son hégémonie sur l'État mais ne jamais s'identifier à celui-ci. Il doit être capable, si nécessaire, de s'opposer à l'État, comme l'avait compris partiellement Lénine en 1920-21. C'est justement parce que, avec l'extinction de la vie des soviets (inévitable du fait de l'échec de la Révolution mondiale), le prolétariat avait perdu cette capacité d'agir et de s'imposer sur l'État que ce dernier a pu développer ses tendances conservatrices propres au point de se faire le fossoyeur de la révolution en Russie en même temps qu'il absorbait dans ses rouages le parti bolchevique lui-même et en faisait un instrument de la contre-révolution.
La contribution de l'histoire à la compréhension de la question de l'État de la période de transition
L'État et la révolution de Lénine avait constitué, en son temps, la meilleure synthèse de ce que le mouvement ouvrier avait élaboré concernant la question de l'État et de l'exercice du pouvoir par la classe ouvrière 8. En effet, cet ouvrage offre une excellente illustration quant à la manière dont s'est éclaircie, à travers l'expérience historique, la question de l'État. En se basant sur son contenu, nous rappelons ici les perfectionnements successifs ayant été apportés par le mouvement ouvrier à la compréhension de ces questions :
- Le Manifeste communiste de 1848 met en évidence la nécessité pour le prolétariat de prendre le pouvoir politique, de se constituer en classe dominante et conçoit que ce pouvoir sera exercé au moyen de l'État bourgeois qui aura été investi par le prolétariat : "Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher peu à peu toute espèce de capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production dans les mains de l'État - du prolétariat organisé en classe dominante - et pour accroître le plus rapidement possible la masse des forces productives" 9.
- Dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852), la formulation devient déjà plus "précise" et "concrète" (selon les propres termes de Lénine) par rapport à celle du Manifeste communiste. En effet, il est question, pour la première fois, de la nécessité de détruire l'État : "Toutes les révolutions perfectionnèrent cette machine au lieu de la briser. Les partis qui se disputèrent à tour de rôle le pouvoir considéraient la mainmise sur cet énorme édifice d'État comme le butin principal du vainqueur" 10.
- À travers l'expérience de la Commune de Paris (1871), Marx voit, comme le dit Lénine, "un pas réel bien plus important que des centaines de programmes et de raisonnements" 11 qui justifie, à ses yeux et à ceux d'Engels, que le programme du Manifeste communiste, ayant " perdu, par endroits, son actualité " 12 soit modifié à travers une nouvelle préface. La Commune a notamment démontré, poursuivent-ils, que la " classe ouvrière ne peut pas simplement prendre possession de la machine d'État telle quelle et l'utiliser pour ses propres fins." 13.
La révolution de 1917 n'a pas laissé le temps à Lénine d'écrire dans L'État et la révolution des chapitres dédiés aux apports des révolutions russes de 1905 et février 1917. Lénine s'est limité à identifier les soviets comme les successeurs naturels de la Commune de Paris. On peut ajouter que, même si aucune de ces deux révolutions n'a permis au prolétariat de prendre le pouvoir politique, elles fournissent cependant des enseignements supplémentaires par rapport à l'expérience de la Commune de Paris concernant le pouvoir de la classe ouvrière : les soviets de députés ouvriers basés sur des assemblées dans les lieux de travail s'avèrent plus adaptés à l'expression de l'autonomie de classe du prolétariat que ne l'étaient les unités territoriales de la Commune.
En plus de constituer une synthèse de ce que le mouvement ouvrier a écrit de meilleur sur ces questions, L'État et la révolution contient des développements propres à Lénine qui, à leur tour, constituent des avancées. En effet, alors qu'ils tiraient les leçons essentielles de la Commune de Paris, Marx et Engels avaient laissé une ambiguïté quant à la possibilité que le prolétariat arrive pacifiquement au pouvoir à travers le processus électoral dans certains pays, précisément ceux qui disposaient des institutions parlementaires les plus développées et de l'appareil militaire le moins important. Lénine n'a pas eu peur de corriger Marx, en utilisant pour cela la méthode marxiste et replaçant la question dans le contexte historique adapté : "Aujourd'hui, en 1917, à l'époque de la première grande guerre impérialiste, cette restriction de Marx ne joue plus. (…). Maintenant, en Angleterre comme en Amérique, "la condition première de toute révolution populaire réelle", c'est la démolition, la destruction de la "machine de 1’État toute prête". " 14
Seule une vision dogmatique pourrait s'accommoder de l'idée que L'État et la révolution de Lénine devrait constituer la dernière et suprême étape dans la clarification de la notion d'État dans le mouvement marxiste. S'il est un ouvrage qui est l'antithèse d'une telle vision c'est bien celui-là. OPOP elle-même ne craint pas de s'éloigner de ce que dit littéralement Lénine dans L'État et la révolution en poussant à son terme l'idée de la citation précédente : "Aujourd'hui, la tâche consistant à établir les conseils comme une forme d'organisation de l'État ne se situe pas seulement dans la perspective d'un seul pays mais à l'échelle internationale et c'est bien là le défi principal qui est posé à la classe ouvrière" 15
Écrit en août-septembre 1917, c'est très rapidement, avec l'éclatement de la révolution d'octobre, que L'État et la révolution a servi d'arme théorique en vue de l'action révolutionnaire pour le renversement de l'État bourgeois et la mise en place de l'État-Commune. Les leçons tirées jusque là de la Commune de Paris se trouvent ainsi mises à l'épreuve de l'histoire à travers des événements historiques d'une portée bien plus considérable encore, la Révolution russe et sa dégénérescence.
Peut-on tirer des leçons de la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23 sur le rôle de l'État ?
OPOP répond négativement à cette question dans la mesure où, nous dit-elle, les conditions en Russie étaient tellement défavorables qu'elles ne permettaient pas la mise en place d'un État ouvrier tel que Lénine le décrit dans L'État et la révolution. Ainsi, elle nous reproche d'identifier "l'État surgi dans l'URSS postrévolutionnaire - un État nécessairement bureaucratique - avec la conception de l'État-Commune de Marx, Engels et de Lénine lui-même". Et d'ajouter : "Ici, on cesse de comprendre que la dynamique prise par la révolution russe (…) n'obéissait pas à la conception de la révolution, de l'État et du socialisme qu'en avait Lénine, mais aux restrictions qui émanaient du terrain social et politique d'où émergea le pouvoir en URSS".
Nous sommes d'accord avec OPOP pour dire que la première leçon à tirer de la dégénérescence de la révolution russe est que celle-ci est le produit de l'isolement international du bastion prolétarien du fait de la défaite des autres tentatives révolutionnaires en Europe, en Allemagne en particulier. En effet, non seulement il ne peut y avoir de transformation des rapports de production vers le socialisme dans un seul pays mais encore il n'est pas possible qu'un pouvoir prolétarien se maintienne indéfiniment isolé dans un monde capitaliste. Mais n'existe-t-il pas d'autres enseignements de grande importance à tirer de cette expérience ?
Si, bien sûr ! Et OPOP reconnaît l'un d'entre eux, bien que celui-ci contredise explicitement le passage suivant de L'État et la révolution relatif à la première phase du communisme : "... l'exploitation de l'homme par l'homme sera impossible, car on ne pourra s'emparer, à titre de propriété privée, des moyens de production, fabriques, machines, terre, etc.". 16 En effet, ce qu'ont montré la révolution russe et, surtout, la contre-révolution stalinienne, c'est que la simple transformation de l'appareil productif en une propriété d’État ne supprime pas l'exploitation de l'homme par 1’homme.
En fait, la révolution russe et sa dégénérescence constituent des événements historiques d'une telle portée qu'on ne peut pas ne pas en tirer des enseignements. Pour la première fois dans l'histoire, se produit la prise du pouvoir politique par le prolétariat dans un pays, comme expression la plus avancée d'une vague révolutionnaire mondiale, avec le surgissement d'un État alors appelé prolétarien ! Et ensuite il se produit ce fait, également totalement inédit dans l'histoire du mouvement ouvrier, la défaite d'une révolution, non pas clairement et ouvertement battue par la répression sauvage de la bourgeoisie comme ce fut le cas de la Commune de Paris, mais comme conséquence d'un processus de dégénérescence interne ayant pris par la suite le visage hideux du stalinisme.
Dans les semaines suivant l'insurrection d'octobre, l’État-Commune est déjà autre chose que "les ouvriers en armes" décrits dans L'État et la révolution 17. Par-dessus tout, avec l'isolement croissant de la révolution, le nouvel État est de plus en plus infesté par la gangrène de la bureaucratie, répondant de moins en moins aux organes élus par le prolétariat et les paysans pauvres. Loin de commencer à dépérir, le nouvel État est en train d'envahir toute la société. Loin de se plier à la volonté de la classe révolutionnaire, il est devenu le point central d'une sorte de dégénérescence et de contre-révolution internes. Dans le même temps, les soviets se vident de leur vie. Les soviets ouvriers sont transformés en appendices des syndicats dans la gestion de la production. Ainsi, la force qui avait fait la révolution et aurait dû garder son contrôle sur celle-ci perdait son expression politique autonome et organisée. Le vecteur de la contre-révolution n'a été ni plus ni moins que l'État et, plus la révolution était en difficulté, plus le pouvoir de la classe ouvrière était affaibli et plus l'État-Commune manifestait sa nature non prolétarienne, son côté conservateur, voire réactionnaire. Nous allons nous expliquer sur cette caractérisation.
De Marx, Engels à l'expérience russe : la convergence vers une même caractérisation de l'État de la période de transition
Ce serait une erreur que de s'arrêter définitivement à la formulation de Marx de la Critique du programme de Gotha, concernant la caractérisation de l'État de la période de transition, identifié à la dictature du prolétariat. En effet, il existe d'autres caractérisations de l'État faites par Marx et Engels eux-mêmes, plus tard par Lénine et ensuite par la Gauche communiste, qui contredisent dans le fond la formule "État-Commune = dictature du prolétariat" pour converger vers l'idée d'un État conservateur par nature, y inclus l'État-Commune de la période de transition.
L'État de transition est l'émanation de la société et non pas du prolétariat
Comment explique-t-on le surgissement de l'État ? À ce propos, Engels ne laisse aucune ambiguïté : "L'État n'est donc pas un pouvoir imposé du dehors à la société ; il n'est pas davantage "la réalité de l'idée morale", "l'image et la réalité de la raison", comme le prétend Hegel 18. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement ; il est l'aveu que cette société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s'étant scindée en oppositions inconciliables qu'elle est impuissante à conjurer. Mais pour que les antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés, ne se consument pas, elles et la société, en une lutte stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de "l'ordre"; et ce pouvoir, né de la société, mais qui se place au-dessus d'elle et lui devient de plus en plus étranger, c'est l'État." 19 Lénine reprend à son compte ce passage d'Engels en le citant, dans L'État et la révolution. Malgré tous les aménagements apportés par le prolétariat à l'État-Commune de transition, celui-ci conserve en commun, avec tous les États des sociétés de classes du passé, le fait d'être un organe conservateur au service du maintien de l'ordre dominant, c'est-à-dire celui des classes économiquement dominantes. Ceci a des implications, au niveau théorique et pratique, concernant les questions suivantes : qui exerce le pouvoir durant la société de transition, l'État ou le prolétariat organisé en conseils ouvriers ? Qui est la classe économiquement dominante de la société de transition ? Quel est le moteur de la transformation sociale et du dépérissement de l'État ?
L'État de transition ne peut, par nature, être au service des seuls intérêts de classe du prolétariat
Là où le pouvoir politique de la bourgeoisie a été renversé, les rapports de production demeurent des rapports capitalistes, même si la bourgeoisie n'est plus là pour s'approprier la plus-value produite par la classe ouvrière. Le point de départ de la transformation communiste a pour condition la défaite militaire de la bourgeoisie dans un nombre suffisant de pays déterminants permettant de donner l'avantage politique à la classe ouvrière au niveau mondial. C'est la période pendant laquelle se développent lentement les bases du nouveau mode de production, au détriment de l'ancien, jusqu'à le supplanter et constituer le mode de production dominant.
Après la révolution et tant que n'aura pas été réalisée la communauté humaine mondiale, c'est-à-dire tant que l'immense majorité de la population mondiale n'aura pas été intégrée au sein du travail libre et associé, c'est le prolétariat qui demeure la classe exploitée. Ainsi, contrairement aux classes révolutionnaires du passé, le prolétariat n'est pas destiné à devenir la classe économiquement dominante. C'est la raison pour laquelle, même si l'ordre établi après la révolution n'est plus celui de la domination politique et économique de la bourgeoisie, l'État, qui surgit pendant cette période en tant que garant du nouvel ordre économique, ne peut pas être intrinsèquement au service du prolétariat. C'est au contraire à ce dernier qu'il appartient de le contraindre dans le sens de ses intérêts de classe.
Le rôle de l'État de transition : intégration de la population non exploiteuse dans la gestion de la société et lutte contre la bourgeoisie
Dans L'État et la révolution, Lénine lui-même dit que le prolétariat a besoin de l’État, non seulement pour supprimer la résistance de la bourgeoisie, mais aussi pour mener le reste de la population non exploiteuse dans la direction socialiste : "Le prolétariat a besoin du pouvoir d'État, d'une organisation centralisée de la force, d'une organisation de la violence, aussi bien pour réprimer la résistance des exploiteurs que pour diriger la grande masse de la population — paysannerie, petite bourgeoisie, semi-prolétaires — dans la "mise en place" de l'économie socialiste" 20.
Nous soutenons ce point de vue de Lénine selon lequel, pour renverser la bourgeoisie, le prolétariat doit pouvoir entraîner derrière lui l'immense majorité de la population pauvre et opprimée, au sein de laquelle il peut être lui-même minoritaire. Il n'existe pas d'alternative à une telle politique. Comment s'est-elle concrétisée dans la révolution russe ? Pendant celle-ci surgirent deux types de soviets : d'une part, les soviets basés essentiellement sur les lieux de production et regroupant la classe ouvrière, appelés encore conseils ouvriers ; d'autre part, les soviets basés sur des unités territoriales (les soviets territoriaux) dans lesquels participaient activement toutes les couches non exploiteuses à la gestion locale de la société. Les conseils ouvriers organisaient l'ensemble de la classe ouvrière, c'est-à-dire la classe révolutionnaire. Les soviets territoriaux 21, quant à eux, élisaient des délégués révocables destinés à faire partie de l'État-Commune 22, ce dernier ayant pour fonction la gestion de la société dans son ensemble. En période révolutionnaire, l'ensemble des couches non exploiteuses, tout en étant pour le renversement de la bourgeoisie et contre la restauration de sa domination, ne sont pas pour autant acquises à l'idée de la transformation socialiste de la société. Elles peuvent même y être hostiles. En effet, au sein de celles-ci, la classe ouvrière est souvent très minoritaire. C'est la raison pour laquelle, en Russie, des mesures avaient été prises dans le mode d'élection des délégués pour renforcer le poids de la classe ouvrière au sein de l'État-Commune : 1 délégué pour 125 000 paysans, 1 délégué pour 25 000 ouvriers des villes. Il n'en demeure pas moins que la nécessité de mobiliser la population largement paysanne contre la bourgeoisie et de l'intégrer dans le processus de gestion de la société donna naissance, en Russie, à un État qui n'était pas seulement constitué des délégués ouvriers des soviets, mais aussi de délégués de soldats et de paysans pauvres.
Les mises en garde du marxisme contre l'État, fût-il de la période de transition
Dans son introduction de 1891 à La Guerre civile en France et rédigée à l'occasion du 20e anniversaire de la Commune de Paris, Engels ne craint pas de mettre en évidence des traits communs à tous les États, qu'ils soient de classiques États bourgeois ou l'État-Commune de la période de transition : "Mais, en réalité, l'État n'est rien d'autre qu'un appareil pour opprimer une classe par une autre, et cela, tout autant dans la république démocratique que dans la monarchie ; le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'il est un mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe et dont, tout comme la Commune, il ne pourra s'empêcher de rogner aussitôt au maximum les côtés les plus nuisibles, jusqu'à ce qu'une génération grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres soit en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l'État." 23 Considérer l'État comme un "mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe" est une idée qui se situe parfaitement dans le prolongement du fait que l'État est une émanation de la société (L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État), et non du prolétariat révolutionnaire. Et cela a de lourdes implications quant aux relations nécessaires entre cet État et la classe révolutionnaire. Même si celles-ci ne purent pas être complètement clarifiées avant la Révolution russe, Lénine saura s'en inspirer à travers une forte insistance, dans L'État et la révolution, sur la nécessité que les ouvriers soumettent tous les membres de l’État à une supervision et à un contrôle constant, en particulier les éléments de l’État qui incarnent avec le plus d'évidence une certaine continuité avec l'ancien régime, tels les "experts" techniques et militaires que les soviets seront forcés d'utiliser.
Lénine élabore également un fondement théorique concernant cette nécessité d'une attitude de méfiance saine du prolétariat envers le nouvel État. Dans le chapitre intitulé "Les bases économiques de l'extinction de l'État", il explique que, vu que son rôle sera de sauvegarder à certains égards la situation de "droit bourgeois", on peut définir 1’État de transition comme "l’État bourgeois, sans la bourgeoisie !" 24. Même si cette formulation représente plus un appel à la réflexion qu'une claire définition de la nature de classe de l’État de transition, Lénine a saisi l'essentiel : puisque la tâche de 1’État est de sauvegarder un état de choses qui n'est pas encore communiste, 1’État-Commune révèle sa nature fondamentalement conservatrice et c'est ce qui le rend particulièrement vulnérable à la dynamique de la contre-révolution.
Une intervention de Lénine en 1920-21 mettant en avant la nécessité pour les ouvriers de pouvoir se défendre contre l'État
Ces perceptions théoriques ont certainement favorisé une certaine lucidité de Lénine, à propos de la nature de l'État en Russie, lors du débat de 1920-21 sur les syndicats 25. Il s'opposait en particulier à Trotsky, alors partisan de la militarisation du travail et pour qui le prolétariat devait s'identifier à "l'État prolétarien" et même s'y subordonner. Bien que lui-même ait été pris dans le processus de dégénérescence de la révolution, Lénine défend alors la nécessité pour les ouvriers de maintenir des organes de défense de leurs intérêts 26, même contre l’État de transition, de même qu'il renouvelle ses avertissements sur la croissance de la bureaucratie d’État. C'est dans les termes suivants qu'il pose le cadre de la question dans un discours à une réunion de délégués communistes à la fin de 1920 : "(…) le camarade Trotsky (…) prétend que, dans un État ouvrier, le rôle des syndicats n'est pas de défendre les intérêts matériels et moraux de la classe ouvrière. C'est une erreur. Le camarade Trotsky parle d'un "État ouvrier". Mais c'est une abstraction. Lorsque nous parlions de l'État ouvrier en 1917, c'était normal ; mais aujourd'hui, lorsque l'on vient nous dire : "Pourquoi défendre la classe ouvrière, et contre qui, puisqu'il n'y a plus de bourgeoisie, puisque l'État est un État ouvrier", on se trompe manifestement car cet État n'est pas tout à fait ouvrier, voilà le hic. C'est l'une des principales erreurs du camarade Trotsky. (...) En fait, notre État n'est pas un État ouvrier, mais ouvrier-paysan, c'est une première chose. De nombreuses conséquences en découlent. (Boukharine : "Comment ? Ouvrier-paysan ?") Et bien que le camarade Boukharine crie derrière : "Comment ? Ouvrier -paysan ?", je ne vais pas me mettre à lui répondre sur ce point. Que ceux qui en ont le désir se souviennent du Congrès des Soviets qui vient de s'achever ; il a donné la réponse.
Mais ce n'est pas tout. Le programme de notre parti, document que l'auteur de L'ABC du communisme connaît on ne peut mieux, ce programme montre que notre État est un État ouvrier présentant une déformation bureaucratique. Et c'est cette triste, comment dirais-je, étiquette, que nous avons dû lui apposer. Voilà la transition dans toute sa réalité. Et alors, dans un État qui s'est formé dans ces conditions concrètes, les syndicats n'ont rien à défendre ? On peut se passer d'eux pour défendre les intérêts matériels et moraux du prolétariat entièrement organisé ? C'est un raisonnement complètement faux du point de vue théorique.(...) Notre État est tel aujourd'hui que le prolétariat totalement organisé doit se défendre, et nous devons utiliser ces organisations ouvrières pour défendre les ouvriers contre leur État, et pour que les ouvriers défendent notre État." 27
Nous considérons cette réflexion lumineuse et de la plus haute importance. Lui-même happé dans la dynamique dégénérescente de la révolution, Lénine n'a malheureusement pas été en mesure de lui donner suite en l'approfondissant (au contraire de cela, il reviendra sur sa caractérisation d'État ouvrier-paysan). Par ailleurs, cette intervention n'a pas été à même de susciter (surtout du propre fait de Lénine lui-même), une réflexion et un travail commun avec l'Opposition ouvrière menée par Kollontaï et Chliapnikov, laquelle exprimait à l'époque une réaction prolétarienne à la fois contre les théorisations bureaucratiques de Trotsky et contre les véritables distorsions bureaucratiques qui étaient en train de ronger le pouvoir prolétarien. Néanmoins, cette précieuse réflexion n'a pas été perdue pour le prolétariat. En effet, comme nous l'avons signalé précédemment, elle a constitué le point de départ d'une réflexion plus approfondie sur la nature de l'État de la période de transition menée par la Gauche communiste d'Italie que celle-ci a pu transmettre aux générations suivantes de révolutionnaires.
C'est le prolétariat et non l'État qui est la force de transformation révolutionnaire de la société
Une des idées fondamentales du marxisme c'est que la lutte de classe constitue le moteur de l'histoire. Ce n'est évidemment pas par hasard que cette idée est exprimée dès la première phrase, juste après l'introduction, du Manifeste communiste : "L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte de classe" 28. Ce n'est donc pas l'État qui peut jouer ce rôle de moteur puisque sa fonction historique est justement d'"estomper le conflit, le maintenir dans les limites de "l'ordre"" (L'origine de la famille, …). Cette caractéristique de l'État des sociétés de classes, s'applique encore à la société de transition, où c'est la classe ouvrière qui demeure la force révolutionnaire. Déjà Marx, à propos de la Commune de Paris, avait clairement distingué d'une part la force révolutionnaire du prolétariat et d'autre part l'État-Commune : "... la Commune n'est pas le mouvement social de la classe ouvrière, et, par suite, le mouvement régénérateur de toute l'humanité, mais seulement le moyen organique de son action. La Commune ne supprime pas les luttes de classes, par lesquelles la classe ouvrière s'efforce d'abolir toutes les classes, et par suite toute domination de classe... mais elle crée l'ambiance rationnelle dans laquelle cette lutte de classes peut passer par ses différentes phases de la façon la plus rationnelle et la plus humaine." 29
La caractéristique du prolétariat après la révolution, à la fois classe dominante politiquement et encore exploitée sur le plan économique, fait que c'est à la fois sur le plan économique et sur le plan politique que, par essence, État-Commune et dictature du prolétariat sont antagoniques :
-
c'est en tant que classe exploitée que le prolétariat doit défendre ses "intérêts matériels et moraux" (comme le dit Lénine) contre la logique économique de l'État-Commune, représentant de la société dans son ensemble à un instant donné ;
-
c'est en tant que classe révolutionnaire que le prolétariat doit défendre ses orientations politiques et pratiques en vue de transformer la société contre le conservatisme social de l'État et ses tendance à l'autoconservation en tant qu'organe qui, selon Engels "se place au-dessus [de la société] et lui devient de plus en plus étranger" (L'origine de la famille, …)
Afin de pouvoir assumer sa mission historique de transformation de la société pour en finir avec toute domination économique et politique d'une classe sur une autre, la classe ouvrière assume sa domination politique sur l'ensemble de la société à travers le pouvoir international de conseils ouvriers, le monopole du contrôle des armes et le fait qu'elle est la seule classe de la société qui soit armée en permanence. Sa domination politique s'exerce également sur l'État. Ce pouvoir de la classe ouvrière est par ailleurs inséparable de la participation effective et illimitée des immenses masses de la classe, de leur activité et organisation et il prend fin lorsque tout pouvoir politique devient superflu, lorsque le classes ont disparu.
Conclusion
Nous espérons avoir répondu de la façon la plus argumentée possible aux critiques que notre position sur l'État dans la période de transition a suscitées chez OPOP. Nous sommes bien conscients de n'avoir pas répondu spécifiquement à un certain nombre d'objections concrètes et explicites (par exemple, "les tâches organisationnelles et administratives mises à l'ordre du jour par la révolution sont des tâches politiques incontournables, dont la mise en œuvre doit être effectuée directement par le prolétariat victorieux".). Si nous ne l'avons pas fait cette fois-ci, c'est parce qu'il nous apparaissait nécessaire de présenter en priorité les grandes lignes historiques et théoriques de notre cadre d'analyse et que, très souvent, celles-ci constituaient une réponse implicite aux objections de OPOP. Nous pourrons y revenir, si nécessaire, dans un prochain article.
Enfin, nous pensons que, pour être essentielle, cette question de l'État dans la période de transition n'est pas la seule dont la clarification théorique et pratique ait pu avancer considérablement suite à l'expérience de la Révolution russe : il en est ainsi également de la question du rôle et de la place du parti prolétarien. Son rôle est-il l'exercice du pouvoir, sa place était-elle au sein de l'État, au nom de la classe ouvrière ? Non, pour nous, il s'agit là d'erreurs qui ont contribué à la dégénérescence du Parti bolchevik. Nous espérons également pouvoir revenir sur cette question dans un prochain débat avec OPOP.
Silvio (9/8/2012)
1 OPOP, Oposição Operária (Opposition ouvrière), qui existe au Brésil. Voir sa publication sur revistagerminal.com. Le CCI entretient avec OPOP depuis des années une relation fraternelle et de coopération s'étant déjà traduite par des discussions systématiques entre nos deux organisations, des tracts ou déclarations signés en commun ("Brésil : des réactions ouvrières au sabotage syndical", https://fr.internationalism.org/ri373/bresil.html [12]) ou des interventions publiques communes ("Deux réunions publiques communes au Brésil, OPOP-CCI : à propos des luttes des futures générations de prolétaires", https://fr.internationalism.org/ri371/opop.html [13]) et la participation réciproque de délégations aux congrès de nos deux organisations.
2 "L'État dans la période de transition au communisme (I) (débat dans le milieu révolutionnaire) [14]", Revue internationale n° 148.
3 Note présente dans le passage cité de l'Anti-Dühring : "L'État populaire libre, revendication inspirée de Lassalle et adoptée au congrès d'unification de Gotha, a fait l'objet d'une critique fondamentale de Marx dansla Critique du programme de Gotha."
4 Friedrich Engels, Anti-Dühring. Troisième partie : Socialisme. Chapitre II : Notions théoriques. https://www.marxists.org/francais/engels/works/1878/06/fe18780611.htm [15]
5 Lénine. L'État et la révolution. Chapitre IV : Suite. Explications complémentaires d'Engels. 2. Polémique avec les anarchistes. https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/08/er00t.htm [16].
6 Karl Marx. Critique du programme du Parti ouvrier allemand. Partie IV, Éd. La Pléiade, Économie I, p. 1429..
7 Gauche communiste italienne. De la même manière que le développement de l’opportunisme de la Seconde Internationale avait suscité une réponse prolétarienne sous la forme de courants de gauche, la montée de l'opportunisme dans la Troisième Internationale allait rencontrer la résistance de la gauche communiste. La gauche communiste était essentiellement un courant international et avait des expressions dans de nombreux pays, depuis la Bulgarie jusqu’à la Grande-Bretagne et des États-Unis à l’Afrique du Sud. Mais ses représentants les plus importants allaient se trouver précisément dans ces pays où la tradition marxiste était la plus forte : l’Allemagne, l’Italie et la Russie. En Italie, la gauche communiste – qui était au début majoritaire au sein du Parti communiste d’Italie – avait une position particulièrement claire sur la question de l'organisation. Cela lui a permis non seulement de mener une bataille courageuse contre l’opportunisme au sein de l’Internationale dégénérescente, mais aussi de donner naissance à une fraction communiste qui a été capable de survivre au naufrage du mouvement révolutionnaire et de développer la théorie marxiste pendant les sombres années de la contre-révolution. Au début des années 1920, ses arguments en faveur de l’abstentionnisme vis à vis des parlements bourgeois, contre la fusion de l’avant-garde communiste avec de grands partis centristes pour donner l’illusion "d’une influence sur les masses", contre les mots d’ordre de front unique et de "gouvernement ouvrier" étaient déjà fondés sur une profonde assimilation de la méthode marxiste. Pour d'avantage d'informations lire "La Gauche Communiste et la continuité du marxisme". https://fr.internationalism.org/icconline/1998/gauche-communiste [17].
8 Lire à ce propos notre article "L'État et la révolution, une vérification éclatante du marxisme" au sein de la série "Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [2° partie]". Revue Internationale n° 91. https://fr.internationalism.org/french/rint91/communisme.htm [18]. Beaucoup des thèmes abordés dans notre réponse à OPOP, sont développés plus largement dans cet article.
9 Le Manifeste communiste. "II. Prolétaires et communistes". Éd. La Pléiade, Économie I, pp. 181-182.
10 Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Chapitre VII Éd. La Pléiade, Politique I, p. 531.
11 L'État et la révolution. Chapitre III : L'expérience de la Commune de Paris. "1. En quoi la tentative des communards est-elle héroïque". En fait, l'expression ici utilisée par Lénine est une adaptation de paroles de Marx dans une lettre à Bracke du 5 mai 1875 à propos du programme de Gotha : "Un seul pas du mouvement réel est plus important qu'une douzaine de programmes". Critique du programme Parti ouvrier allemand. " Marx à W. Bracke". Éd. La Pléiade, Économie I, p. 1411.
12 Préface à la réédition allemande de 1872 du Manifeste communiste. Éd. La Pléiade, Économie I, Appendice V, p. 1481.
13 Idem
14 L'État et la révolution chapitre III. Idem.
15 Cf. "L'État dans la période de transition au communisme (débat dans le milieu révolutionnaire)". Revue internationale n° 148. https://fr.internationalism.org/rint148/l_État_dans_la_periode_de_transition_au_communisme_debat_dans_le_milieu_revolutionnaire.html [14]
16 L'État et la révolution. Chapitre V : les bases économiques de l'extinction de l'État. "3. Première phase de la société communiste."
17 Cette expression est extraite de la phrase suivante : "Une fois les capitalistes renversés, la résistance de ces exploiteurs matée par la main de fer des ouvriers en armes, la machine bureaucratique de l'État actuel brisée, nous avons devant nous un mécanisme admirablement outillé au point de vue technique, affranchi de "parasitisme", et que les ouvriers associés peuvent fort bien mettre en marche eux-mêmes en embauchant des techniciens, des surveillants, des comptables, en rétribuant leur travail à tous, de même que celui de tous les fonctionnaires "publics", par un salaire d'ouvrier". L'État et la révolution. Chapitre III : L'État et la révolution. L'expérience de la Commune de Paris (1871). Analyse de Marx. "3. Suppression du parlementarisme"
18 Note présente dans le passage cité de L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État : "Hegel: Principes de la Philosophie du droit, §§ 257 et 360."
19 L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. IX : Barbarie et civilisation. https://www.marxists.org/francais/engels/works/1884/00/fe18840000.htm [19]
20 L'État et la révolution chapitre II : l'expérience des années 1848-1851.
21 Dans notre série de 5 articles de la Revue internationale, "Qu'est-ce que les conseils ouvriers", nous mettons en évidence les différences sociologiques et politiques entre les conseils ouvriers et les soviets territoriaux. Les conseils ouvriers sont les conseils d'usine. À côté de ceux-ci on trouve également des conseils de quartier, ces derniers intégrant les travailleurs des petites entreprises et des commerces, les chômeurs, les jeunes, les retraités, les familles qui faisaient partie de la classe ouvrière comme un tout. Les conseils d'usine et de quartiers (ouvriers) jouèrent un rôle décisif à différents moments du processus révolutionnaire (voire à ce propos les articles de la série publiés dans les Revue internationale n° 141 et 142). Ce n'est donc pas un hasard si, avec le processus de dégénérescence de la révolution, les conseils d'usine disparurent fin 1918 et les conseils de quartier fin 1919. Les syndicats eurent un rôle décisif dans la destruction de ces derniers (voire à ce propos l'article de la Revue n° 145).
22 Participèrent en fait aussi à cet État, de façon de plus en plus importante, des experts, des dirigeants de l'Armée rouge et de la Tcheka, etc.
23 F. Engels, introduction de 1891 à La Guerre civile en France. Avant-dernier paragraphe. https://www.marxists.org/francais/engels/works/1891/03/fe18910318.htm [20]
24 Le contexte de cette expression extraite du texte de Lénine est le suivant :
"Dans sa première phase, à son premier degré, le communisme ne peut pas encore, au point de vue économique, être complètement mûr, complètement affranchi des traditions ou des vestiges du capitalisme. De là, ce phénomène intéressant qu'est le maintien de l'"horizon borné du droit bourgeois", en régime communiste, dans la première phase de celui-ci. Certes, le droit bourgeois, en ce qui concerne la répartition des objets de consommation, suppose nécessairement un État bourgeois, car le droit n'est rien sans un appareil capable de contraindre à l'observation de ses normes.
Il s'ensuit qu'en régime communiste subsistent pendant un certain temps non seulement le droit bourgeois, mais aussi l'État bourgeois — sans bourgeoisie !" (Chapitre 5. "4. Phase supérieure de la société communiste")
25 Lire en particulier à ce propos notre article "Comprendre la défaite de la révolution russe" dans la série "Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire" (Revue internationale n° 100). https://fr.internationalism.org/french/rint/100_communisme_ideal [21]
26 Il s'agit ici des syndicats qui sont alors considérés, par tous les points de vue en présence, comme d'authentiques défenseurs des intérêts du prolétariat. Cela s'explique par les conditions d'arriération de la Russie, la bourgeoisie n'ayant pas développé un appareil d'État sophistiqué capable de reconnaître la valeur des syndicats en tant qu'instruments de la paix sociale. De ce fait, tous les syndicats qui s'étaient formés avant et même pendant la révolution de 1917, n'étaient pas nécessairement des organes de l'ennemi de classe. Il y a eu notamment une forte tendance à la création de syndicats industriels qui exprimaient toujours un certain contenu prolétarien.
27 "Les syndicats, la situation actuelle et les erreurs de Trotsky", 30 décembre 1920. https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/12/vil19201230.htm [22]
28 Le Manifeste communiste. "I. Bourgeois et Prolétaires". Éd. La Pléiade, Économie I, pp. 161.
29 La guerre civile en France, Premier essai de rédaction, Ed. sociales, p. 217.
Vie du CCI:
Questions théoriques:
Rubrique:
À propos du livre Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était (I): le communisme primitif et le rôle de la femme dans l'émergence de la culture
- 5034 lectures
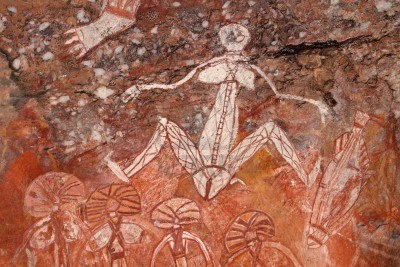 Pourquoi écrire aujourd'hui à propos du communisme primitif ? Alors que la chute abrupte dans une crise économique catastrophique et le développement des luttes à travers la planète posent de nouveaux problèmes aux travailleurs du monde entier, que l'avenir du capitalisme s'assombrit et que la perspective d'un monde nouveau peine tant à percer, on peut se demander quel est l'intérêt d'étudier la société qui fut celle de notre espèce, de son apparition (il y a environ 200 000 ans) jusqu'à la période néolithique (débutant il y a plus de 10 000 ans), une société dans laquelle vivent encore aujourd'hui certaines populations humaines. Et pourtant, nous restons convaincus que la question est aussi importante pour les communistes d'aujourd'hui qu'elle le fut pour Marx et Engels au 19e siècle, à la fois pour son intérêt scientifique général en tant qu'élément d'étude de l'humanité et de son histoire, et pour la compréhension de la perspective et de la possibilité d'une société communiste future qui pourrait remplacer la société capitaliste moribonde.
Pourquoi écrire aujourd'hui à propos du communisme primitif ? Alors que la chute abrupte dans une crise économique catastrophique et le développement des luttes à travers la planète posent de nouveaux problèmes aux travailleurs du monde entier, que l'avenir du capitalisme s'assombrit et que la perspective d'un monde nouveau peine tant à percer, on peut se demander quel est l'intérêt d'étudier la société qui fut celle de notre espèce, de son apparition (il y a environ 200 000 ans) jusqu'à la période néolithique (débutant il y a plus de 10 000 ans), une société dans laquelle vivent encore aujourd'hui certaines populations humaines. Et pourtant, nous restons convaincus que la question est aussi importante pour les communistes d'aujourd'hui qu'elle le fut pour Marx et Engels au 19e siècle, à la fois pour son intérêt scientifique général en tant qu'élément d'étude de l'humanité et de son histoire, et pour la compréhension de la perspective et de la possibilité d'une société communiste future qui pourrait remplacer la société capitaliste moribonde.
C'est pour cette raison qu'on ne peut que saluer la publication en 2009 d'un livre intitulé Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était par Christophe Darmangeat ; de même, on ne peut qu’être encouragé par le fait que le livre en soit déjà à sa deuxième édition, ce qui indique un intérêt certain pour le sujet parmi le public.1 À travers une lecture critique de ce livre, nous chercherons dans cet article à revenir sur les problèmes posés par la question des premières sociétés humaines ; nous profiterons aussi de l'occasion pour explorer les thèses exposées il y a maintenant plus de 20 ans par Chris Knight 2 dans son livre Blood Relations 3.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, précisons d'abord une chose : la question de la nature du communisme primitif, et de l'humanité en tant qu'espèce, sont des questions non pas politiques mais scientifiques. Dans ce sens, il ne peut y avoir de "position" de la part d'une organisation politique au sujet de la nature humaine, par exemple. Si nous sommes convaincus que l'organisation communiste doit stimuler le débat et la soif de connaissance pour les questions scientifiques parmi ses militants et plus généralement au sein du prolétariat, le but est d'encourager le développement d'une vision matérialiste et scientifique du monde basée autant que possible, pour les non scientifiques que nous sommes pour la plupart, sur une connaissance des théories scientifiques modernes. Les idées présentées dans cet article ne sont donc pas des "positions" du CCI et n'engagent que l'auteur. 4
Pourquoi la question des origines est-elle importante ?
Pourquoi donc la question des origines de l'espèce et des premières sociétés humaines est-elle importante pour les communistes ? Les termes du problème ont sensiblement changé depuis le 19e siècle lorsque Marx et Engels s'enthousiasmèrent pour les travaux de l'anthropologue américain Lewis Morgan. En 1884, quand Engels publie L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, on était à peine sorti d'une époque où les estimations de l'âge de la Terre et de la société humaine se basaient sur les calculs bibliques de l'évêque Ussher, pour qui la Création avait eu lieu en 4004 avant J.-C. Engels écrit dans sa Préface de 1891 : "Jusqu'en 1860 environ, il ne saurait être question d'une histoire de la famille. Dans ce domaine, la science historique était encore totalement sous l'influence du Pentateuque. La forme patriarcale de la famille, qui s'y trouve décrite avec plus de détails que partout ailleurs, n'était pas seulement admise comme la plus ancienne, mais, déduction faite de la polygamie, on l'identifiait avec la famille bourgeoise actuelle, si bien qu'à proprement parler la famille n'avait absolument pas subi d'évolution historique." 5 Il en était de même pour les notions de propriété, et la bourgeoisie pouvait encore opposer au programme communiste de la classe ouvrière l'objection selon laquelle la "propriété privée" était inscrite dans la nature même de la société humaine. L'idée de l'existence d'un état communiste primitif de la société était à ce point inconnue en 1847 que le Manifeste Communiste commence son premier chapitre par les mots "L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de luttes de classes." (affirmation qu'Engels a estimé nécessaire de rectifier dans une note en 1888).
Le livre de Morgan, Ancient Society, a largement contribué à démanteler la vision ahistorique de la société humaine éternellement basée sur la propriété privée, même si son apport a été souvent escamoté ou passé sous silence par l'anthropologie officielle, notamment anglaise. Comme le dit Engels, encore dans sa Préface, "Morgan dépassa la mesure non seulement en critiquant la civilisation, la société de la production marchande, forme fondamentale de notre société actuelle, d'une façon qui rappelle Fourier, mais aussi en parlant d'une transformation future de cette société en termes qu'aurait pu énoncer Karl Marx".
Aujourd'hui en 2012, la situation a bien changé. Les découvertes successives ont repoussé encore et encore plus loin dans le passé les origines de l'Homme, si bien que maintenant nous savons que non seulement la propriété privée n'est pas un fondement éternel de la société mais qu'elle est, au contraire, une invention relativement récente puisque l'agriculture - et donc la propriété privée et la division de la société en classes - ne datent que de 10 000 ans environ. Certes, comme Alain Testart l'a montré dans son livre Les chasseurs-cueilleurs ou l'origine des inégalités, la formation des classes et des richesses ne s'est pas faite en une nuit ; il a dû s’écouler une longue période avant l'émergence de l'agriculture proprement dite où le développement du stockage a favorisé l'émergence d'une répartition inégale des richesses accumulées. Néanmoins, il est clair aujourd'hui que la partie de loin la plus longue de l'histoire humaine n'est pas celle de la lutte des classes, mais d'une société sans classes, communiste : c'est ce qu'on appelle le communisme primitif.
L'objection qu'on entend aujourd'hui à l'idée d'une société communiste n'est donc plus qu'elle violerait les principes éternels de propriété privée mais, plutôt, qu'elle serait contraire à "la nature humaine". "On ne peut changer la nature humaine" dit-on, et par cela on veut dire la nature prétendument violente, compétitive et égocentrique de l’Homme. L'ordre capitaliste ne serait donc plus éternel, mais seulement le résultat logique et inévitable d'une nature immuable. Cette argumentation n'est pas limitée à des idéologues de droite. Des scientifiques humanistes, en pensant suivre la même logique d'une nature humaine déterminée par la génétique, en arrivent à des conclusions similaires. Le New York Review of Books (journal intellectuel plutôt orienté à gauche) nous en donne un exemple dans un numéro d'octobre 2011 : "Les êtres humains se font concurrence pour les ressources, l'espace vital, les partenaires sexuels, et presque tout le reste. Chaque être humain se trouve au sommet d'une lignée de concurrents ayant réussi, qui remonte jusqu'aux origines de la vie. La pulsion compétitive entre dans pratiquement tout ce que nous faisons, qu'on le reconnaisse ou non. Et les meilleurs concurrents sont souvent les mieux remerciés. Il suffit de regarder Wall Street pour en trouver un exemple flagrant (...) Le dilemme humain de surpopulation et surexploitation des ressources est fondamentalement déterminé par les impulsions primordiales qui ont permis à nos ancêtres d'atteindre un succès reproductif au-dessus de la moyenne". 6
Cet argument peut sembler a priori inattaquable : on n'a pas besoin de chercher bien loin pour trouver des exemples à ne plus en finir de la cupidité, de la violence, de la cruauté et de l'égoïsme dans la société humaine de nos jours ou dans son histoire. Mais est-ce que cela prouve que ces tares sont le résultat d'une nature déterminée - dirait-on aujourd'hui – génétiquement ? Rien n'est moins sûr. Pour faire une analogie, un arbre qui pousse sur une falaise balayée par le vent marin risque fort de pousser chétif et tordu : ce n'est pas pour autant que ce qui apparaît ainsi de sa structure soit intégralement inscrit dans ses gènes - dans des conditions plus favorables l'arbre pousserait droit.
Peut-on en dire de même pour les êtres humains ?
C'est une évidence, souvent relevée dans nos articles, que la résistance du prolétariat mondial est bien en deçà du niveau des attaques qu'il subit de la part d'un capitalisme en crise. La révolution communiste n'a peut-être jamais semblé aussi nécessaire et, en même temps, aussi difficile. Et l’une des raisons en est certainement, à notre avis, le fait que les prolétaires manquent de confiance non seulement dans leurs propres forces mais dans la possibilité même du communisme. "Une belle idée", nous dit-on, "mais vous savez, la nature humaine"...
Pour prendre confiance en lui, le prolétariat doit affronter non seulement les problèmes immédiats de la lutte mais aussi les problèmes plus vastes, historiques, posés par la confrontation révolutionnaire potentielle avec la classe dominante. Parmi ces problèmes, il y a précisément celui de la nature humaine ; et nous devons traiter ce problème avec un esprit scientifique. Il ne s'agit pas de prouver que l'Homme est "bon", mais d'arriver à une meilleure compréhension de quelle est précisément sa nature, de façon à pouvoir intégrer cette connaissance dans le projet politique du communisme. Ainsi, nous ne faisons pas dépendre le projet communiste de la "bonté naturelle" de l'Homme : le besoin du communisme est aujourd'hui inscrit dans les données de la société capitaliste comme seule solution au blocage de la société, qui amènera sans nul doute l'humanité à un avenir catastrophique si le capitalisme n'est pas renversé par la révolution communiste.
Méthode scientifique
Le passage qui précède nous amène, avant d'entrer dans le vif du sujet, à quelques considérations sur la méthode scientifique et, plus particulièrement, la méthode scientifique appliquée à l'étude de l'histoire et du comportement humain. Un passage situé au début du livre de Knight, relatif à la place de l'anthropologie dans les sciences, nous semble poser la question très justement : "Plus que tout autre domaine de connaissance, l'anthropologie prise dans son ensemble enjambe le gouffre qui a traditionnellement divisé les sciences naturelles et humaines. En puissance, sinon toujours en pratique, elle occupe donc une place centrale parmi les sciences dans leur ensemble. Les éléments cruciaux qui, s'ils pouvaient seulement être rassemblés, pourraient relier les sciences naturelles aux sciences humaines, traversent l'anthropologie plus que tout autre domaine. C'est ici que les deux bouts se rejoignent ; ici que l'étude de la nature prend fin, et que celle de la culture commence. À quel moment de l'évolution est-ce que les principes biologiques ont laissé la place à de nouveaux principes dominants, plus complexes ? Où, précisément, se trouve la ligne de partage entre la vie animale et la vie sociale ? La différence est-elle de nature, ou seulement de degré ? Et, à la lumière de cette question, est-il réellement possible d'étudier les phénomènes humains avec la même objectivité désintéressée dont un astronome peut faire preuve envers des galaxies, ou un physicien envers des particules subatomiques ?
Si ce domaine des rapports entre les sciences semble confus pour beaucoup, ce n'est qu'en partie à cause des difficultés réelles que cela implique. À un bout, la science est enracinée dans la réalité objective mais, à l'autre, elle est enracinée dans la société et en nous-mêmes. En fin de compte, c'est pour des raisons sociales et idéologiques que la science moderne, fragmentée et distordue par des pressions politiques immenses et pourtant largement non reconnues, a rencontré son plus grand problème et son plus grand défi théorique : réunir les sciences humaines et les sciences naturelles en une seule science unifiée sur la base d'une compréhension de l'évolution de l'humanité, et de la place de cette dernière dans l'univers." (pp. 56-57).
La question de la "ligne de partage" entre le monde animal non-humain où le comportement est déterminé surtout par le patrimoine génétique, et le monde humain où le comportement dépend beaucoup plus de l'environnement, notamment social et culturel, nous semble effectivement la question cruciale pour comprendre la "nature humaine". Les grands singes sont capables d'apprendre, d'inventer et de transmettre, jusqu'à un certain point, des comportements nouveaux, mais cela ne veut pas dire qu'ils possèdent une "culture" au sens humain du terme. Ces comportements appris restent "périphériques à la continuité sociale et structurelle du groupe" (ibid., p. 11). 7 Ce qui a permis à la culture de prendre le dessus, dans une "explosion créative" (ibid., p. 12), c'est le développement de la communication entre groupes humains, le développement d'une culture symbolique basée sur le langage et le rite. Knight fait par ailleurs la comparaison entre la culture symbolique et le langage, qui ont permis aux humains de communiquer et de transmettre les idées et donc la culture de manière universelle, et la science, qui est basée sur un symbolisme ayant rencontré un accord universel entre scientifiques au niveau de la planète et, potentiellement au moins, entre tous les êtres humains. La pratique de la science est inséparable du débat, et de la capacité de chacun de vérifier les conclusions auxquelles elle arrive ; elle est donc l'ennemi de toute forme d'ésotérisme qui ne vit que par la connaissance secrète, fermée aux non-initiés.
Parce qu'elle est une forme de connaissance universelle, que depuis la Révolution industrielle elle est également une force productive à part entière nécessitant le travail associé de scientifiques dans le temps et l'espace,8 la science dépasse le cadre national par nature et, en ce sens, le prolétariat et la science sont des alliés naturels.9 Cela ne veut absolument pas dire qu'il puisse exister une "science prolétarienne". Dans son article "Marxisme et science", Knight cite ces mots d'Engels : "plus la science avance de manière implacable et désintéressée, plus elle se trouve en harmonie avec les intérêts des ouvriers". Et Knight de poursuivre : "La science, en tant que seule forme de connaissance universelle, internationale, unificatrice de l'espèce, que l'humanité possède, doit venir en premier. Si elle doit s'enraciner dans les intérêts de la classe ouvrière, ce n'est que dans la mesure où elle doit s'enraciner dans les intérêts de l'humanité dans son ensemble, et dans la mesure où la classe ouvrière donne corps à ces intérêts dans l'époque actuelle."
Il y a deux autres aspects de la pensée scientifique, qui ont été mis en exergue dans le livre de Carlo Rovelli à propos du philosophe grec Anaximandre de Milet 10, et que nous reprenons ici car ils nous semblent fondamentaux : le respect pour les prédécesseurs et le doute.
Rovelli montre que l'attitude d'Anaximandre envers son maître Thalès a rompu avec les attitudes caractéristiques de son époque : soit un rejet total pour s'établir comme nouveau "maître" à la place de l'ancien, soit un dévouement à la lettre aux paroles du "maître" pour les maintenir à l'état momifié. L'attitude scientifique, au contraire, est de se baser sur les travaux des "maîtres" qui nous ont précédés tout en critiquant leurs erreurs et en cherchant à aller plus loin dans la connaissance. C'est cette attitude qu'on doit saluer chez Knight envers Lévi-Strauss, et chez Darmangeat envers Morgan.
Le doute - à l'inverse de la pensée religieuse qui cherche toujours la certitude et la consolation dans l'invariance d'une vérité établie à tout jamais - est fondamental pour la science. Comme le dit Rovelli 11, "La science offre les meilleures réponses justement parce qu’elle ne considère pas ses réponses comme certainement vraies ; c’est pourquoi elle est toujours capable d’apprendre, de recevoir de nouvelles idées". C'est tout particulièrement le cas de l'anthropologie et de la paléoanthropologie, dont les données sont éparses et souvent incertaines, et dont les théories les plus en vogue du moment peuvent se trouver remises en question, voire bouleversées, du jour au lendemain par de nouvelles découvertes.
Mais est-il possible d'avoir une vision scientifique de l'histoire ? Karl Popper 12, qui est une référence chez la plupart des scientifiques, pensait que non, puisqu'il considérait l'histoire comme un "événement" unique, non reproductible, et que la vérification d'une hypothèse scientifique dépendait de la reproductibilité des expériences ou des observations. Popper, pour les mêmes raisons, avait également considéré la théorie de l'évolution comme non scientifique de prime abord et, pourtant, il est aujourd'hui une évidence que la méthode scientifique a pu mettre à nu les mécanismes fondamentaux de l'évolution des espèces au point de permettre à l'humanité de manipuler le processus de l'évolution grâce au génie génétique. Sans suivre Popper, il est clair qu'utiliser la méthode scientifique pour faire des prévisions sur la base de l'étude de l'histoire reste un exercice fort hasardeux : d'un côté parce que l'histoire humaine - comme la météorologie par exemple - incorpore un nombre incalculable de variables, de l'autre, et surtout, parce que - comme le disait Marx - "les hommes font leur propre histoire" ; l'histoire est donc déterminée non seulement par des lois mais aussi par la capacité ou non des êtres humains de baser leurs actions sur la pensée consciente et la connaissance de ces lois. L'évolution de l'histoire reste toujours soumise à des contraintes : à un moment donné, certaines évolutions sont possibles, d'autres non. Mais la façon dont une situation donnée évoluera est aussi déterminée par la capacité des hommes de devenir conscients de ces contraintes et d'agir en conséquence.
Il est donc particulièrement hardi de la part de Knight d'accepter toute la rigueur exigée par la méthode scientifique, et de soumettre sa théorie à l'épreuve de l'expérience. Évidemment, il n'est pas possible de "reproduire" l'histoire expérimentalement. À partir de ses hypothèses sur les débuts de la culture humaine, Knight fait donc des prévisions (en 1991, date de la publication de Blood Relations) quant aux découvertes paléontologiques à venir : notamment qu'on trouverait parmi les traces les plus anciennes de la culture symbolique chez l'Homme une utilisation importante de l'ocre rouge. En 2006, 15 ans plus tard, il semblerait que ces prévisions aient été confirmées par les découvertes dans les cavernes de Blombos (Afrique du Sud) des premiers vestiges connus de la culture humaine (voir les travaux de la Conférence de Stellenbosch réunis dans The cradle of language, OUP, 2009, ou encore l'article publié sur le site web de La Recherche en novembre 2011)13 ; on y trouve de l’ocre rouge et également des collections de coquillages utilisés apparemment comme décoration corporelle, ce qui s'intègre dans le modèle évolutif proposé par Knight (nous y reviendrons plus loin). Évidemment, ceci ne constitue pas en soi une "preuve" de sa théorie mais il nous semble indéniable que cela lui donne une plus grande consistance.
Cette méthodologie scientifique est très différente de celle suivie par Darmangeat. Celui-ci, nous semble-t-il, reste cantonné dans la logique inductiviste, qui part d'un rassemblement de faits observés pour essayer d'en extraire les traits communs. La méthode n'est pas sans valeur pour l'étude historique et scientifique : toute théorie doit, après tout, se conformer aux faits observés. Darmangeat semble d'ailleurs très réticent vis-à-vis de toute théorie qui cherche à aller au-delà. Ceci nous paraît une démarche empiriste plutôt que scientifique : la science n'avance pas par induction à partir des faits observés, mais par hypothèses qui doivent certes être conformes aux observations, mais qui doivent également proposer une démarche (expérimentale si possible) à suivre pour avancer vers de nouvelles découvertes, donc de nouvelles observations. En physique, la théorie des cordes nous en offre un exemple éclatant : bien qu'en accord, autant que faire se peut, avec les faits observés, elle ne peut être vérifiée de façon expérimentale puisque les éléments dont elle postule l'existence sont inaccessibles de par leur petite taille aux appareils de mesure dont nous disposons aujourd'hui. La théorie des cordes reste donc une hypothèse spéculative, mais sans ce genre de spéculation hardie, il n'y aurait pas non plus d'avancée scientifique.
Un autre inconvénient de la méthode inductiviste est que, par la force des choses, elle doit opérer une sélection au préalable dans l'immensité de la réalité observée. C'est ce que fait Darmangeat lorsqu'il se base uniquement sur des observations ethnographiques en laissant de côté toute considération évolutionniste ou génétique, ce qui nous semble rédhibitoire dans une œuvre qui cherche à mettre au clair "l'origine de l'oppression des femmes" (le sous-titre du livre dont il est question).
Morgan, Engels et la méthode scientifique
Après ces considérations (bien modestes) sur la méthodologie, revenons maintenant au livre de Darmangeat qui a motivé cet article.
L’œuvre est divisée en deux parties : la première examine le travail de l'anthropologue Lewis Morgan sur lequel Engels a basé son Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État; la deuxième reprend la question que pose Engels à propos de l'origine de l'oppression des femmes. Dans cette deuxième partie, Darmangeat s'attaque surtout à l'idée de l'existence d'un communisme primitif, aujourd'hui disparu, qui aurait été basé sur le matriarcat.
La première partie du livre nous paraît particulièrement intéressante 14 et nous ne pouvons qu'abonder dans le sens de l'auteur quand il s'insurge contre une certaine conception prétendument "marxiste" qui érige les travaux de Morgan (et a fortiori d'Engels) au statut de textes religieux intouchables. Rien ne pourrait être plus étranger à l'esprit scientifique du marxisme. Si les marxistes se doivent d'avoir une vision historique de l'émergence et du développement de la théorie sociale matérialiste, et donc de tenir compte des théories antérieures, il nous semble absolument évident que nous ne pouvons pas prendre des textes du 19e siècle comme le fin mot de l'histoire en ignorant l'accumulation impressionnante de connaissances ethnographiques réunies depuis. Certes, il convient de garder un esprit critique sur l'utilisation de ces connaissances : Darmangeat, tout comme Knight d'ailleurs, a bien raison d'insister sur le fait que la lutte contre les théories de Morgan est loin de la science "pure" et "désintéressée". Lorsque les adversaires contemporains et ultérieurs de Morgan signalaient les erreurs qu'il a commises ou lorsqu'ils mettaient en avant les découvertes qui ne cadraient pas avec sa théorie, le but n'était pas neutre en général. En s'attaquant à Morgan, on s'attaquait à la vision évolutionniste de la société humaine et on cherchait à rétablir ces catégories "éternelles" de la société bourgeoise que sont la famille patriarcale et la propriété privée comme les fondements de toute société humaine passée, présente et future. Ceci est parfaitement explicite chez Malinowski, un des plus grands ethnographes de la première moitié du 20e siècle, dont Knight (dans "Early Human Kinship was Matrilineal", publié dans Early Human Kinship: From Sex to Social Reproduction, 2008, Blackwell Publishing Ltd.15) cite les propos dans une émission radiodiffusée : "Je crois que l'élément le plus perturbateur des tendances révolutionnaires modernes est l'idée que la parentalité peut être rendue collective. Si jamais nous nous débarrassions de la famille individuelle comme élément essentiel de notre société, nous serions confrontés à une catastrophe sociale par rapport à laquelle les bouleversements politiques de la Révolution française et les changements économiques du bolchevisme seraient insignifiants. La question de savoir si la maternité de groupe a jamais existé comme institution, si elle est un arrangement compatible avec la nature humaine et l'ordre social, est donc d'un intérêt pratique considérable". Quand on fait dépendre ses conclusions sur le plan scientifique d’un parti pris politique, on est loin de l'objectivité scientifique...
Passons donc à la critique de Morgan faite par Darmangeat. Celle-ci est à notre sens d'un grand intérêt, ne serait-ce que parce qu'elle commence par un résumé assez détaillé de sa théorie, et qui rend cette dernière éminemment accessible pour un lecteur non expert. Nous avons particulièrement apprécié le tableau qui fait le rapprochement entre les stades de l’évolution sociale ("sauvagerie", "barbarie", etc.) définis par l'anthropologie de Morgan avec ceux utilisés aujourd'hui (paléolithique, néolithique, etc.), ce qui permet de mieux se situer dans le temps, et les diagrammes explicatifs des différents systèmes de parenté. Le tout est accompagné d'explications claires et didactiques.
Le fond de la théorie de Morgan est de relier type de famille, système de parenté et développement technique, dans une évolution progressive qui passe de "l’état sauvage" (première étape de l'évolution sociale humaine, qui correspondrait au paléolithique), à la "barbarie" (le néolithique et l'âge des métaux) et, enfin, à la civilisation. Cette évolution serait déterminée par l'évolution de la technique, et les contradictions apparentes que Morgan notait chez de nombreux peuples (dont les Iroquois en particulier) entre le système de parenté et le système familial, représenteraient justement des étapes intermédiaires entre d'une part une économie et une technique plus primitive et, d'autre part, une technique plus évoluée. Malheureusement pour la théorie, il se trouve en y regardant de plus près que ce n'est pas le cas. Pour ne prendre qu'un des multiples exemples que nous propose Darmangeat : le système "punaluen" de parenté qui est censé, d'après Morgan, représenter une des étapes sociales et techniques les plus primitives, se trouve à Hawaï ; c'est une société qui connaît richesses, inégalités sociales, une couche sociale aristocratique, et qui serait sur le point de passer le cap vers une société étatique. La famille, les systèmes de parenté y sont donc déterminés par des besoins sociaux, mais non pas en ligne droite depuis les plus primitifs jusqu’au plus modernes.
Est-ce que cela veut dire que l'évolutionnisme social marxiste est à jeter aux oubliettes ? Pas du tout, selon l'auteur. Par contre, il faut dissocier ce que Morgan, puis Marx et Engels après lui, avaient essayé d'associer : l'évolution de la technique (donc de la productivité) et les systèmes de famille. "Les modes de production, bien que différents d'un point de vue qualitatif, possèdent tous une quantité commune, la productivité, qui permet de les ordonner en une série croissante, qui se trouve de surcroît correspondre globalement à la chronologie (...) [Pour la famille] il n'existe aucune quantité à laquelle les différentes formes puissent être ramenées et à partir de laquelle on pourrait constituer une série croissante" (p. 136). Il est évident que l'économie est déterminante "en dernière instance", pour reprendre les termes d'Engels : s'il n'y avait pas d'économie (c'est à dire la reproduction de tout ce qui est nécessaire à la vie humaine), alors il n'y aurait pas de vie sociale non plus. Mais cette "dernière instance" laisse beaucoup de place aux autres influences, géographiques, historiques, culturelles, etc. Les idées, la culture - dans son sens le plus large - sont aussi des déterminants de l'évolution de la société. Et c'est Engels lui-même qui a regretté, vers la fin de sa vie, que la nécessité pour lui et pour Marx d'établir le matérialisme historique sur des bases sûres, et de se battre pour le défendre, les ait amenés parfois à laisser insuffisamment de place dans leurs analyses aux autres déterminants historiques.16
Critique de l'anthropologie
C'est dans la deuxième partie de son livre que Darmangeat expose ses propres réflexions. On y trouve, en quelque sorte, deux trames : d'une part, une critique historique des théories anthropologiques sur la position des femmes dans les sociétés primitives ; d’autre part, l'exposé de ses propres conclusions sur le sujet. Cette critique historique est axée autour de l'évolution de ce que Darmangeat considère être la vision marxiste, ou au moins marxisante, du communisme primitif, du point de vue de la place des femmes dans la société primitive, et constitue une dénonciation en règle des tentatives de mettre en avant une vision "féministe" qui cherche à défendre l'idée d'un matriarcat originel dans les premières sociétés humaines.
Le choix se défend mais, à notre avis, il n'est pas toujours heureux et amène l'auteur à ignorer certains théoriciens du marxisme qui auraient dû y avoir leur place, et à en inclure d'autres qui n'y ont rien à faire. Pour ne prendre que quelques exemples, Darmangeat consacre plusieurs pages à critiquer les idées d'Alexandra Kollontaï17, alors qu'il passe Rosa Luxemburg quasiment sous silence. Or, quel qu'ait pu être son rôle dans la Révolution russe et dans la résistance à sa dégénérescence (elle était une figure importante de l'Opposition ouvrière après la révolution), Kollontaï n'a jamais joué un rôle important dans le développement de la théorie marxiste, et encore moins dans l'anthropologie. Luxemburg, par contre, était non seulement une théoricienne de premier plan, elle est également l'auteur de l’Introduction à l'économie politique qui accorde une place importante à la question du communisme primitif en se basant sur les connaissances de l'époque. Le seul motif qui justifie ce déséquilibre est que Kollontaï a été très engagée, au sein du mouvement socialiste puis dans la Russie soviétique, dans la lutte pour les droits des femmes, alors que Luxemburg ne s'est jamais intéressée de près au féminisme. Deux autres auteurs marxistes qui ont écrit sur le thème des sociétés primitives ne sont même pas évoqués : Karl Kautsky (L'éthique et la conception matérialiste de l'histoire), et Anton Pannekoek (Anthropogenèse).
Du côté des "inclusions" malheureuses, prenons par exemple, celle d'Evelyn Reed : ce membre du Socialist Workers' Party américain (organisation trotskiste qui a soutenu de façon "critique" la participation à la Seconde Guerre mondiale) trouve sa place dans l'œuvre pour avoir écrit en 1975 un livre à succès dans les milieux de gauche, Féminisme et anthropologie. Mais comme le dit Darmangeat, le livre a été ignoré quasi-systématiquement par les anthropologues, en grande partie à cause de la faiblesse de son argumentation, soulignée même par des critiques bienveillantes par ailleurs.
Mêmes absences parmi les anthropologues : Claude Lévi-Strauss, une des figures les plus importantes du 20e siècle dans ce domaine, et qui a basé sa théorie du passage de la nature à la culture sur la notion de l'échange de femmes entre les hommes18, n'est mentionné qu’en passant, et Bronislaw Malinowski n'y figure pas du tout.
L'absence la plus surprenante, peut-être, est celle de Knight. Le livre de Darmangeat est axé tout particulièrement sur la situation des femmes dans les sociétés communistes primitives et sur la critique des théories se trouvant dans une certaine tradition marxiste, ou du moins marxisante, sur le sujet. Or, Blood Relations de Chris Knight, qui se revendique explicitement de la tradition marxiste, traite précisément du problème qui préoccupe Darmangeat. On aurait pu imaginer que ce dernier y prêterait la plus grande attention, d'autant plus qu'il reconnaît lui-même la "grande érudition" de Knight. Mais il n'en est rien, bien au contraire : Darmangeat n'y consacre qu'une page (p. 321), où il nous dit, entre autres, que la thèse de Knight "réitère les plus graves fautes de méthode présentes chez Reed et Briffault (Knight garde le silence sur la première, mais cite le second abondamment)", ce qui peut laisser croire au lecteur n'ayant pas lu le livre que Knight ne fait que suivre des gens dont Darmangeat aurait déjà démontré le peu de sérieux.19 Mais un simple coup d'œil à la bibliographie de Blood Relations suffit à montrer que si Knight cite effectivement Briffault, il donne beaucoup plus de place à Marx, Engels, Lévi-Strauss, Marshall Sahlins,... et nous en passons. Et que si on se donne la peine de consulter les références à Briffault, on constate immédiatement que Knight considère que le livre de ce dernier20 (publié en 1927) "date dans ses sources et sa méthodologie" (p. 328).
En somme, notre sentiment est que le choix de Darmangeat nous laisse plutôt "le cul entre deux chaises" : on finit avec une narration critique qui n'est ni une vraie critique des positions défendues par les marxistes, ni une vraie critique des théories anthropologiques, et cela nous donne parfois l'impression d'être les témoins d'une joute contre des moulins à vent. Notre impression est que ce choix de départ tend à obscurcir une argumentation fort intéressante par ailleurs.
À suivre
Jens (août 2012)
1 Éditions Smolny, Toulouse 2009. Nous avons pris connaissance de la parution de la 2e édition du livre de Darmangeat (Smolny, Toulouse 2012) alors que nous nous préparions à mettre cet article sous presse. Nous nous sommes évidemment demandé s’il n’allait pas falloir entièrement reprendre notre critique. Après avoir eu la nouvelle édition en mains, il nous a semblé que nous pouvions légitimement laisser l’essentiel de cet article tel quel. L’auteur lui-même nous signale dans la nouvelle préface ne pas avoir "modifié les thèses essentielles du texte et les arguments sur lesquels elles s’appuient", ce qui, à la lecture, se confirme. Nous nous sommes donc limités à élaborer certains arguments sur la base de la 2e édition. Sauf indication contraire, les citations et les références aux numéros de page sont celles de la première édition.
2 Chris Knight est un anthropologue anglais, membre du "Radical Anthropology Group". Il a participé aux débats sur la science au 19e Congrès du CCI, et nous avons publié sur notre site ses textes "Marxisme et science" (https://fr.internationalism.org/node/4850 [25]) et "La solidarité humaine et le gène égoïste" (https://fr.internationalism.org/ri434/la_solidarite_et_le_gene_egoiste_article_de_l_anthropologue_chris_knight.html [26]).
3 Yale University Press, New Haven and London, 1991. Le livre n'est malheureusement disponible qu'en langue anglaise.
4 Ceci dit, il aurait été impossible de développer ces idées sans la stimulation des discussions avec les camarades au sein de l’organisation.
7 On peut faire ici une analogie avec la production marchande et la société capitaliste. Si la production marchande et le commerce existent depuis le début de la civilisation, et peut-être même avant, ce n'est qu’avec le capitalisme qu'ils deviennent déterminants.
8 Voir à ce sujet notre article "Reading notes on science and marxism", https://en.internationalism.org/icconline/201203/4739/reading-notes-science-and-marxism [29]
9 Il en va ainsi de la science comme des autres forces productives sous le capitalisme : "Au cours de sa domination de classe à peine séculaire, la bourgeoisie a créé des forces productives plus massives et plus colossales que ne l'avaient fait toutes les générations passées dans leur ensemble. Asservissement des forces de la nature, machinisme, application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, navigation à vapeur, chemins de fer, télégraphe électrique, défrichement de continents entiers, canalisation des rivières, populations entières surgies du sol - quel siècle antérieur aurait soupçonné que de pareilles forces de production sommeillaient au sein du travail social ? […] Les forces productives dont elle dispose ne jouent plus en faveur de la civilisation bourgeoise et du régime de la propriété bourgeoise ; elles sont, au contraire, devenues trop puissantes pour les institutions bourgeoises qui ne font plus que les entraver ; et dès qu'elles surmontent ces entraves, elles précipitent dans le désordre toute la société bourgeoise et mettent en péril l'existence de la propriété bourgeoise." Karl Marx et Friedrich Engels, Le Manifeste communiste, "I – Bourgeois et prolétaires", Éd. La Pléiade, Économie I, pp. 166-167.
10 Anaximandre de Milet, ou la naissance de la pensée scientifique, éditions Dunod, juin 2009.
11 Cité dans notre article "La place de la science dans l'histoire humaine", Révolution internationale n° 422,
12 Karl Popper (1902-1994) est un des philosophes des sciences les plus influents du 20e siècle et une référence incontournable pour tout scientifique qui s’intéresse à des questions de méthodologie. Il insiste notamment sur la notion de "réfutabilité", l’idée que toute hypothèse, pour être scientifique, devrait permettre l’élaboration d’expériences ou d'observations qui pourraient permettre de la réfuter : en l’absence de possibilité de telles expériences ou observations, une hypothèse ne pourrait être qualifiée de scientifique. C’est sur cette base que Popper considérait que le marxisme, la psychanalyse et – dans un premier temps – le darwinisme, ne pouvaient prétendre au statut de science.
13 Il s’agit de restes d’ocre rouge gravé et de coquillages percés. L’article de La Recherche signale même la découverte d’un "nécessaire à peinture" vieux de 100 000 ans (voir www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=30891 [31]).
14 C’est sans doute par une forme d'ironie que Darmangeat, dans la 2e édition de son livre, a préféré déplacer toute la partie sur Morgan en appendice, apparemment par crainte de rebuter le lecteur non spécialiste à cause de son "aridité" selon le terme de l’auteur.
15 Ce texte est disponible à l'adresse : www.chrisknight.co.uk/wp-content/uploads/2007/09/Early-Human-Kinship-Was-Matrilineal1.pdf [32]
16 " C'est Marx et moi-même, partiellement, qui devons porter la responsabilité du fait que, parfois, les jeunes donnent plus de poids qu'il ne lui est dû au côté économique. Face à nos adversaires, il nous fallait souligner le principe essentiel nié par eux, et alors nous ne trouvions pas toujours le temps, le lieu, ni l'occasion de donner leur place aux autres facteurs qui participent à l'action réciproque. Mais dès qu'il s'agissait de présenter une tranche d'histoire, c’est-à-dire de passer à l'application pratique, la chose changeait et il n'y avait pas d'erreur possible. Mais, malheureusement, il n'arrive que trop fréquemment que l'on croie avoir parfaitement compris une nouvelle théorie et pouvoir la manier sans difficulté, dès qu'on s'en est approprié les principes essentiels, et cela n'est pas toujours exact. Je ne puis tenir quitte de ce reproche plus d'un de nos récents “marxistes”, et il faut dire aussi qu'on a fait des choses singulières." (Lettre d'Engels à J. Bloch, 21-22 septembre 1890 : https://www.marxists.org/francais/engels/works/1890/09/18900921.htm [33])
17 Dans la 2e édition, Kollontaï a même droit à un sous-chapitre qui lui est entièrement dédié.
18 La critique de la théorie de Lévi-Strauss est traitée de manière approfondie dans Blood Relations.
19 La critique de Knight n’est pas plus étoffée dans la 2e édition que dans la 1ère, à une exception près : l’auteur cite une revue critique du livre de la part de Joan M. Gero, anthropologue féministe et auteur de Engendering archaeology. Cette critique nous paraît très superficielle et inclut un fort parti pris idéologique. En voici un échantillon : "Ce que Knight met en avant en tant que perspective, vue sous l'angle du sexe, des origines de la culture est une vision paranoïaque et distordue de la 'solidarité féminine', présentant (toutes) les femmes comme exploitant sexuellement et manipulant (tous) les hommes. Les relations hommes-femmes sont caractérisées de tout temps et en tout lieu comme des relations entre victimes et manipulatrices : les femmes exploiteuses sont supposées avoir toujours voulu piéger les hommes d'une manière ou d'une autre, et leur conspiration pour ce faire est la base fondamentale même du développement de notre espèce. Les lecteurs peuvent être également offensés par l'idée que les hommes ont toujours été volages et que seule une activité sexuelle agréable, distribuée parcimonieusement et avec coquetterie par des femmes calculatrices, peut les retenir à la maison et maintenir leur intérêt pour leur progéniture. Ce scénario est non seulement improbable et non démontré, répugnant pour les féministes tout comme les non féministes, mais le raisonnement sociobiologique balaye d'un revers de main toutes les versions nuancées de la construction sociale des relations entre genres, des idéologies et des activités qui sont devenues si centrales et fascinantes pour les études de genre aujourd'hui." (traduit par nos soins). En somme, non seulement Gero n'a visiblement pas compris grand chose à l'argumentation qu'elle prétend critiquer, mais, pire encore, elle nous invite à rejeter une thèse scientifique, non pas parce qu'elle est fausse – ce que Gero ne se donne même pas la peine d'essayer de démontrer – mais parce qu'elle est "répugnante" pour (entre autres) les féministes.
20 The Mothers : A Study of the Origins of Sentiments and Institutions, 1927
Personnages:
- Christophe Darmangeat [34]
- Lewis Morgan [35]
- Chris Knight [36]
- Bronislaw Malinowski [37]
Rubrique:
Le mouvement syndicaliste-révolutionnaire dans la révolution allemande de 1918-19
- 4700 lectures
Histoire du mouvement ouvrier : le syndicalisme révolutionnaire en Allemagne, partie IV
L'article précédent a donné un aperçu des efforts du courant syndicaliste révolutionnaire en Allemagne pour défendre une position internationaliste contre la guerre de 1914-18. L’Union Libre des Syndicats Allemands (Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften - FVDG) avait survécu à la guerre avec seulement quelques centaines de membres dans la clandestinité qui, dans des conditions de brutale répression, avaient été, comme d'autres révolutionnaires, la plupart du temps condamnés au silence. Fin 1918 les événements se précipitent en Allemagne. Avec le déclenchement des luttes en novembre 1918, l'étincelle de la révolution russe d'Octobre 1917 embrasait finalement le prolétariat en Allemagne.
La réorganisation de la FVDG en 1918
Au cours de la première semaine de novembre 1918, la révolte des matelots de la flotte de Kiel met à genoux le militarisme allemand. Le 11 novembre, l'Allemagne signe l'armistice. La FVDG écrit : "Le gouvernement impérial a été renversé, non par la voie parlementaire et légale, mais par l'action directe ; non par le bulletin de vote, mais par la force des armes des ouvriers en grève et des soldats mutinés. Sans attendre la consigne de chefs, des conseils ouvriers et de soldats ont partout été formés spontanément et ont immédiatement commencé à écarter les anciennes autorités. Tout le pouvoir aux conseils ouvriers et de soldats ! Voilà quel est maintenant le mot d’ordre." 1
Avec le déclenchement de la vague révolutionnaire s’ouvre pour le mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne une ère turbulente d'afflux rapide de militants. Celui-ci passe d’environ 60 000 membres au moment de la Révolution de novembre 1918 jusqu’à mi 1919 à plus de 111 000 fin 1919. La large radicalisation politique de la classe ouvrière à la fin de la guerre pousse vers le mouvement syndicaliste-révolutionnaire de nombreux ouvriers qui se sont détachés des grands syndicats sociaux-démocrates en raison du soutien ouvert de ces derniers à la politique de guerre. Le mouvement syndicaliste-révolutionnaire constitue incontestablement un lieu de rassemblement de travailleurs intègres et combatifs.
A travers la publication de son nouveau journal, Der Syndikalist, à partir du 14 décembre 1918, la FVDG fait de nouveau entendre sa voix : "Dès les premiers jours d’août [1914], notre presse a été interdite, nos camarades les plus en vue placés en ‘détention préventive’, toute activité publique a été rendue impossible aux agitateurs et aux unions locales. Et pourtant, les armes du syndicalisme révolutionnaire sont aujourd'hui utilisées dans tous les recoins de l'Empire allemand, les masses ressentent instinctivement que le temps de la revendication et de la requête est passé et que commence celui où c’est à nous de prendre." 2 Les 26 et 27 décembre, Fritz Kater organise à Berlin une Conférence à laquelle assistent 43 syndicats locaux de la FVDG et où celle-ci se réorganise après la période de clandestinité de la guerre.
C’est dans les agglomérations industrielles et minières de la région de la Ruhr que la FVDG connaît l’accroissement numérique le plus important. L'influence des syndicalistes-révolutionnaires est particulièrement forte à Mülheim et contraint les syndicats sociaux-démocrates à se retirer du conseil d’ouvriers et de soldats le 13 décembre 1918, celui-ci rejetant clairement leur rôle de représentants des ouvriers pour prendre ce rôle directement en main. A partir des mines de la région de Hamborn, des grèves massives de mineurs dirigées par le mouvement syndicaliste-révolutionnaire se produisent de novembre 1918 à février 1919. 3
Conseils ouvriers ou syndicats ?
Face à la guerre de 1914, le mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne avait passé le test historique auquel il était soumis : défendre l’internationalisme contre la guerre, et non, comme la grande majorité des syndicats, se ranger derrière les buts guerriers de la classe dirigeante. L’éclatement de la Révolution de 1918 pose un nouvel enjeu énorme : comment la classe ouvrière s’organise pour renverser la bourgeoisie et passer à l’action révolutionnaire ?
Comme elle l’avait fait en Russie en 1905, puis en 1917, en novembre 1918 en Allemagne, la classe ouvrière fait surgir des conseils ouvriers, marquant l’éclosion d’une situation révolutionnaire. L’ensemble de la période depuis la constitution des "Localistes" en 1892 et la fondation formelle en 1901 de la FVDG n'avait pas connu de soulèvement révolutionnaire. Contrairement à la Russie, où, en 1905, apparurent les premiers conseils ouvriers, la réflexion sur les conseils est restée très abstraite en Allemagne jusqu'en 1918. Au cours de l’enthousiasmant mais bref "hiver des Conseils" de 1918/19 en Allemagne, la FVDG concevait toujours clairement sa forme d'organisation comme un syndicat et c’est en tant que syndicat qu’elle réapparaît sur la scène. La FVDG répond à la situation inédite du surgissement des conseils ouvriers avec un grand enthousiasme. Le cœur révolutionnaire de la majorité des membres de la FVDG palpite pour les conseils ouvriers, de telle sorte que Der Syndikalist n°2 du 21 décembre 1918 revendique clairement : "Tout le pouvoir aux conseils ouvriers et de soldats révolutionnaires".
Mais la conscience théorique retarde souvent sur l’intuition prolétarienne. En dépit de l'émergence des conseils ouvriers, et comme si rien de bien nouveau ne s’était produit, Der Syndikalist n°4 écrit, que la FVDG est la seule organisation ouvrière "dont les représentants et les organes n’ont pas besoin de se remettre à jour", une expression qui résume l’orgueil de la Conférence de réorganisation de la FVDG de décembre 1918 et qui devint la devise du courant syndicaliste révolutionnaire en Allemagne. Mais pour le mouvement ouvrier s’était ouverte une ère de grand bouleversement, où il avait justement beaucoup à remettre à jour, notamment en ce qui concerne ses formes d’organisation !
Pour expliquer les politiques honteuses des principaux syndicats de soutien à la guerre et d’opposition aux conseils ouvriers, la FVDG avait tendance à se contenter d'une demi-vérité, et à en ignorer l’autre moitié. Seule "l’éducation sociale-démocrate" était mise en cause. La question des différences fondamentales entre la forme syndicale et celle des conseils ouvriers est complètement négligée.
Sans aucun doute la FVDG et l’organisation qui lui fit suite, la FAUD, furent des organisations révolutionnaires. Mais elles ne voyaient pas que leur organisation procédait des mêmes germes que les conseils ouvriers : la spontanéité, l’aspiration à l’extension et l'esprit révolutionnaire – tous caractères allant bien au-delà de la tradition syndicale.
Dans les publications de l’année 1919 de la FVDG, il est quasiment impossible de trouver une tentative de traiter la contradiction fondamentale entre la tradition syndicale et les conseils ouvriers, instruments de la révolution. Au contraire, celle-ci concevait les "syndicats révolutionnaires" comme la base du mouvement des conseils. "Les syndicats révolutionnaires doivent exproprier les expropriateurs. (...) Les conseils ouvriers et les conseils d’usine doivent prendre en charge la direction socialiste de la production. Le pouvoir aux conseils ouvriers ; les moyens de production et les biens produits au corps social. Tel est l'objectif de la révolution prolétarienne : le mouvement syndicaliste révolutionnaire est le moyen d’y parvenir."Mais le mouvement révolutionnaire des conseils en Allemagne surgissait-il effectivement du mouvement syndical ? "C’étaient des ouvriers qui s’étaient rassemblés au sein de ‘comités d'usine’ qui agissaient comme les comités d'usine des grandes entreprises de Petrograd en 1905, sans en avoir connu l’activité. En juillet 1916, la lutte politique ne pouvait pas être menée à l'aide des partis politiques et des syndicats. Les dirigeants de ces organisations étaient les adversaires d'une telle lutte ; après la lutte, ils ont également contribué à livrer les leaders de cette grève politique au fléau de la répression des autorités militaires. Ces "comités d'usine", le terme n'est pas tout à fait exact, peuvent être considérés comme les précurseurs des conseils ouvriers révolutionnaires d'aujourd'hui en Allemagne. (...) Ces luttes n'ont pas été soutenues et dirigées par les partis et les syndicats existants. Il y avait là les prémices d'un troisième type d’organisation, les conseils ouvriers." 4 C’est ainsi que décrit Richard Müller, membre des Revolutionäre Obleute (‘Hommes de confiance’ révolutionnaires) le "moyen d’y parvenir."
Les syndicalistes de la FVDG n’étaient pas les seuls à ne pas remettre en cause la forme syndicale d'organisation. A cette époque, il était extrêmement difficile pour la classe ouvrière de tirer pleinement et en toute clarté l’ensemble des conséquences qu’impliquait l’irruption de la "période des guerres et des révolutions". Les illusions quant à la forme d'organisation syndicale, la faillite de celle-ci devant la révolution devaient encore être inévitablement, douloureusement et concrètement soumises à l’expérience pratique. Richard Müller cité plus haut écrivait seulement quelques semaines plus tard, lorsque les conseils ouvriers sont dépossédés de leur pouvoir : "Mais si nous reconnaissons la nécessité de la lutte revendicative quotidienne – et personne ne peut la contester – alors nous devons également reconnaître la nécessité de préserver les organisations qui ont pour fonction de mener cette lutte, et ce sont les syndicats. (...) Si nous reconnaissons la nécessité des syndicats existants (…) alors nous devons examiner plus en avant si les syndicats peuvent trouver une place au sein du système des conseils. Dans la période de mise en place du système des conseils, il faut inconditionnellement répondre à cette question par l'affirmative." 5
Les syndicats sociaux-démocrates avaient perdu leur crédit vis-à-vis des larges masses de travailleurs et les doutes croissaient de plus en plus quant à savoir si ces organisations pouvaient encore représenter les intérêts de la classe ouvrière. Dans la logique de la FVDG, le dilemme de la capitulation et de la faillite historique de la vieille forme d’organisation syndicale se résolvait par la perspective d'un "syndicalisme révolutionnaire."
En ce début de l'ère de la décadence du capitalisme, l'impossibilité de la lutte pour des réformes pose à terme l'alternative suivante pour les organisations de masse permanentes de la classe ouvrière : soit le capitalisme d'État les intègre à l'État (comme en général cela a été le cas avec les organisations sociales-démocrates - mais aussi pour des syndicats syndicalistes-révolutionnaires comme la CGT en France), soit il les détruit (ce qui fut finalement le sort de la FAUD syndicaliste-révolutionnaire). Se pose alors la question de savoir si la révolution prolétarienne exige d'autres formes d'organisation. Avec l'expérience dont nous disposons aujourd'hui, nous savons qu’il n’est pas possible d’apporter de nouveaux contenus à d’anciennes formes, telles que les syndicats. La révolution n'est pas seulement une affaire de contenu, mais aussi de forme. C'est ce que le théoricien de la FAUD, Rudolf Rocker, formulait de façon très juste en décembre 1919 dans son approche contre les fausses visions de "l’État révolutionnaire" : "L'expression d'État révolutionnaire ne peut pas nous convenir. L'État est toujours réactionnaire et qui ne le comprend pas n'a pas compris la profondeur du principe révolutionnaire. Chaque instrument possède une forme adaptée au but auquel il doit servir ; et c'est aussi le cas pour les institutions. Les pinces du maréchal-ferrant ne sont pas adaptées pour arracher des dents et avec les pinces du dentiste on ne peut pas former un fer à cheval (...)" 6. C’est exactement ce que, malheureusement, le mouvement syndicaliste-révolutionnaire a manqué d’appliquer de façon conséquente à la question de la forme d’organisation.
Contre le piège des "comités d’entreprise"
Pour émasculer politiquement l'esprit du système des conseils ouvriers, les sociaux-démocrates et leurs syndicats au service de la bourgeoisie commencèrent adroitement à saper de l'intérieur les principes d'organisation autonome de la classe ouvrière dans les conseils. Cela n’a été possible que parce que, les conseils ouvriers ayant émergé des luttes de novembre 1918, ceux-ci avaient perdu leur force et leur dynamisme avec le premier reflux de la révolution. Le premier Congrès des Conseils du 16 au 20 décembre 1918, sous l'influence subtile du SPD et du poids persistant des illusions de la classe ouvrière sur la démocratie, avait abandonné son pouvoir et proposé l’élection d’une Assemblée Nationale, se désarmant ainsi complètement de lui-même.
Au printemps de 1919, après la vague de grèves dans la Ruhr, il a été proposé, à l'initiative du gouvernement SPD, d’instaurer dans les usines des "comités d’entreprises" - des représentations de facto de la main-d'œuvre remplissant en fait la même fonction de négociation et de collaboration avec le capital que les syndicats traditionnels. Sous les auspices des responsables du Parti social-démocrate et des syndicats, Gustav Bauer et Alexander Schlicke, les comités d'entreprise sont définitivement inscrits dans la Constitution bourgeoise de l'État allemand en février 1920.
Il fallait développer l’illusion dans la classe ouvrière que son esprit combatif porté vers les conseils trouvait son incarnation dans cette forme de représentation directe des intérêts des ouvriers. "Les comités d’entreprise sont conçus pour régler toutes les questions relatives à l'emploi et aux salariés. Il leur revient d’assurer la poursuite et l'augmentation de la production dans l’entreprise et de veiller à éliminer tout obstacle pouvant survenir. (...) Les comités de district en collaboration avec les directions régissent et supervisent le rendement du travail dans le district, ainsi que la répartition des matières premières." 7 Après la répression sanglante contre la classe ouvrière, l'intégration démocratique dans l'État devait sceller définitivement l’œuvre de la contre-révolution. De façon encore plus directe qu’avec les syndicats et en liaison encore plus étroite avec les entreprises, la mise en place de ces comités venait compléter sur place la collaboration avec le capital.
La presse de la FVDG au printemps de 1919 a pris position avec courage et clarté contre ce stratagème des comités d’entreprise : "Le capital et l'État admettent uniquement les comités ouvriers que l’on nomme désormais comités d’entreprise. Le comité d’entreprise ne vise pas à représenter seulement les intérêts des travailleurs, mais aussi ceux de l’entreprise. Et puisque ces sociétés sont la propriété du capital privé ou d'État, les intérêts des travailleurs doivent être subordonnés aux intérêts des exploiteurs. Il s'ensuit que le comité d’entreprise défend l'exploitation des travailleurs et incite ceux-ci à la poursuite docile du travail comme esclaves salariés. (...) Les moyens de lutte des syndicalistes-révolutionnaires sont incompatibles avec les fonctions du comité d’entreprise." 8
Cette attitude était largement partagée parmi les syndicalistes révolutionnaires parce que, d’une part les comités d’entreprise apparaissaient de façon évidente pour ce qu’ils étaient, un outil de la social-démocratie et, d'autre part, la combativité du mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne n'avait pas encore été brisée. L'illusion d'avoir "obtenu quelque chose", et "d’avoir franchi une étape concrète" ne trouvait que peu de prise en 1919 dans les fractions les plus déterminées du prolétariat - la classe ouvrière n'avait pas encore été défaite. 9
Plus tard, après le déclin évident du mouvement révolutionnaire à partir de 1921, il n'est donc pas surprenant qu’au sein de la FAUD syndicaliste-révolutionnaire des débats houleux éclatent durant une année à propos de la participation aux élections aux comités d'entreprise. Une minorité développait l’orientation qu'il fallait désormais, à travers les comités d’entreprises légalisés, établir "une liaison avec les masses laborieuses pour déclencher des luttes massives dans les situations favorables."10 La FVDG en tant qu’organisation refusa de s’engager dans "la voie morte des comités d’entreprise voués à neutraliser l'idée révolutionnaire des conseils" selon la formulation du militant August Beil. C'est du moins la position qui prévalut jusqu'à novembre 1922, lorsque, en conséquence de l'impuissance produite par la défaite de la révolution, le 14ème Congrès de la FAUD l’atténua, octroyant le droit à ses membres de participer aux élections aux comités d’entreprise.
La dynamique de la révolution rapproche les syndicalistes révolutionnaires et la Ligue Spartacus
Comme en Russie en Octobre 1917, le soulèvement de la classe ouvrière en Allemagne avait d’emblée suscité un élan solidaire au sein la classe ouvrière. Pour le mouvement syndicaliste-révolutionnaire en Allemagne, la solidarité avec la lutte de la classe ouvrière en Russie avait, jusque fin 1919, constitué incontestablement une référence importante, partagée internationalement avec d'autres révolutionnaires. La Révolution russe, du fait de soulèvements révolutionnaires dans d'autres pays, possédait encore une perspective en 1918-1919 et n'avait pas encore succombé à sa dégénérescence intérieure. Pour défendre leurs frères de classe en Russie et contre la politique même du SPD et des syndicats sociaux-démocrates, la FVDG dénonçait dans le deuxième numéro de son journal Der Syndikalist : "(...) qu’aucun moyen ne leur était trop répugnant, aucune arme trop ignoble pour calomnier la Révolution russe et vitupérer la Russie soviétique et ses conseils d’ouvriers et de soldats." 11 Malgré de nombreuses réserves quant aux conceptions des Bolcheviks - dont toutes n’étaient pas infondées - les syndicalistes révolutionnaires restèrent solidaires avec la Révolution russe. Même Rudolf Rocker, théoricien influent au sein de la FVDG et critique véhément des Bolcheviks, appela deux ans après la révolution d’Octobre, lors de son célèbre discours de présentation de la Déclaration de Principes de la FAUD en décembre 1919, à manifester sa solidarité avec la Révolution russe : "Nous nous tenons unanimement du côté de la Russie soviétique dans sa défense héroïque contre les puissances des Alliés et les contre-révolutionnaires, et ceci, non pas parce que nous sommes Bolcheviks, mais parce que nous sommes des révolutionnaires."
Bien que les syndicalistes révolutionnaires en Allemagne eussent leurs réserves traditionnelles envers le "marxisme" qui "veut conquérir le pouvoir politiquement", ce qu'ils croyaient discerner également dans la Ligue Spartacus, ils défendaient clairement l’action commune avec toutes les autres organisations révolutionnaires : "Le syndicalisme révolutionnaire estime donc inutile la division du mouvement ouvrier, il veut la concentration des forces. Pour l’instant, nous recommandons à nos membres d’agir, dans les questions économiques et politiques, partout en commun avec les groupes les plus à gauche du mouvement ouvrier : les Indépendants, la Ligue Spartacus. Nous mettons en garde, cependant, contre toute participation au cirque des élections à l'Assemblée nationale." 12
La révolution de novembre 1918 ne fut pas l’œuvre d'une organisation politique particulière telle que la Ligue Spartacus et les Revolutionnäre Obleute (les délégués syndicaux révolutionnaires), même si ceux-ci ont adopté lors des journées de novembre la position la plus claire et la plus grande volonté d’action. Ce fut un soulèvement de l’ensemble de la classe ouvrière où s'est exprimé, pendant une courte période, l'unité potentielle de cette classe. Une expression de cette tendance à l’unité a été le phénomène répandu de double affiliation à la Ligue Spartacus et à la FVDG. "A Wuppertal, les militants de la FVDG s’engagèrent dans un premier temps au sein du Parti communiste. Une liste établie en avril 1919 par la police sur les communistes de Wuppertal contient le nom de tous les futurs principaux membres de la FAUD (...)" 13. A Mülheim, à partir du 1er décembre 1918 parut le journal "Die Freiheit, organe de défense des intérêts de l’ensemble du peuple du Travail. Organe de presse des Conseils d’ouvriers et de soldats", édité en commun par des syndicalistes révolutionnaires et des membres de la Ligue Spartacus.
Au début 1919, il existait au sein du mouvement syndicaliste révolutionnaire une aspiration prononcée à l’union avec d'autres organisations de la classe ouvrière. "Ils ne sont toujours pas unis, ils sont toujours divisés, ils ne sont pas tous encore de véritables socialistes en pensée et à l’attitude honnête et ils ne sont toujours pas unitairement et indissociablement associés par la merveilleuse chaine de la solidarité prolétarienne. Ils sont toujours divisés entre socialistes de droite, socialistes de gauche, Spartakistes, et autres. La classe ouvrière doit enfin en finir avec l’absurdité grossière du particularisme politique." 14 Cette attitude de large ouverture reflétait la situation de forte hétérogénéité politique, voire de confusion, au sein de la FVDG qui avait connu une croissance rapide. Sa cohésion interne reposait moins sur la clarification programmatique ou la démarcation vis-à-vis des autres organisations prolétariennes que sur le lien de solidarité ouvrière, comme le montre la caractérisation sans discrimination de tous les "socialistes".
L'attitude solidaire envers la Ligue Spartacus s’était développée dans les rangs des syndicalistes révolutionnaires suite à la répression de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg au cours de la guerre et a continué jusqu'à l'automne 1919. Mais par contre, elle n’a pas permis d'asseoir une histoire commune avec la Ligue Spartacus. Jusqu'à la période de la conférence de Zimmerwald en 1915, c’était bien plus une méfiance réciproque qui avait dominé. La cause principale du rapprochement a été la clarification politique, mûrie au sein de la classe ouvrière tout entière et de ses organisations révolutionnaires au cours de la révolution de novembre : le rejet de la démocratie bourgeoise et du parlementarisme. Le mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne, qui avait rejeté depuis longtemps le système parlementaire, voyait cette position comme faisant partie de son patrimoine propre. La Ligue Spartacus, qui avait pris position avec une grande clarté contre les illusions sur la démocratie, considérait la FVDG, qui empruntait la même voie, comme l’organisation la plus proche d’elle en Allemagne.
Cependant, dès le départ, Rudolf Rocker, qui devait prendre en charge l’orientation politique du mouvement syndicaliste-révolutionnaire en Allemagne après décembre 1919, "ne porte pas dans son cœur les appels lancés aux camarades à soutenir l'aile gauche du mouvement socialiste, les Indépendants et les Spartakistes, ni l’intervention du journal en faveur de la ""dictature du prolétariat " (...)"15. De retour d'internement en Angleterre durant la guerre, Rocker, anarchiste syndicaliste-révolutionnaire fortement influencé par les idées de Kropotkine, adhéra à la FVDG en mars 1919.
Malgré les divergences d’opinions à l'égard de la Ligue Spartacus entre Rocker et la tendance réunie autour de Fritz Kater, Carl Windhoff et Karl Roche, la plus influente dans la FVDG dans les premiers mois de la Révolution de 1918-19, il serait erroné de parler à cette époque de luttes de tendances au sein de la FVDG telles qu'il en éclatera plus tard, à partir de 1920 au sein de la FAUD comme symptôme de la défaite de la révolution allemande. Il n'existe pour lors aucune tendance significative parmi les syndicalistes-révolutionnaires voulant a priori se démarquer du KPD. Au contraire, la recherche d'une unité d'action avec les Spartakistes était le produit de la dynamique vers l'unité des luttes ouvrières et de la "pression de la base" de ces deux courants dans les semaines et les mois où la révolution semblait à portée de main. Ce furent la défaite douloureuse du soulèvement prématuré de janvier 1919 à Berlin et l’écrasement consécutif de la vague de grèves en avril dans la Ruhr, soutenue par les syndicalistes-révolutionnaires, le KPD et l'USPD, qui, par le sentiment de déception qu’ils provoquèrent, suscitèrent des récriminations mutuelles et émotionnelles, exprimant un manque de maturité des deux côtés.
L’"alliance informelle" avec Spartacus, et le Parti communiste, devait par conséquent se briser dès l’été 1919. L'initiative en incombait moins à la FVDG qu’à l’attitude agressive que le KPD commença à adopter vis-à-vis des syndicalistes-révolutionnaires.
Le "programme provisoire" des syndicalistes-révolutionnaires au printemps 1919
Au printemps 1919, la FVDG publia une brochure rédigée par Roche, "Que veulent les syndicalistes-révolutionnaires ?". Celle-ci devait servir de programme et de texte d’orientation à son organisation jusqu’en décembre 1919. Il est difficile de juger le mouvement syndicaliste-révolutionnaire à l’aune d’un seul texte, vu la coexistence dans ses rangs d'idées différentes. Toutefois, ce programme du printemps 1919 constitue un jalon, et à plusieurs points de vue, l’une des prises de position les plus achevées du mouvement syndicaliste-révolutionnaire en Allemagne. En dépit des expériences passées douloureuses de leur propre histoire avec les sociaux-démocrates et de la diabolisation permanente de la politique 16 qui en résulte, celui-ci conclut : "La classe ouvrière doit se rendre maître de l'économie et de la politique." 17
La force des positions que propage la FVDG à l’aide de ce programme au sein de la classe ouvrière en Allemagne au printemps se trouve ailleurs : dans son attitude envers l'État, la démocratie bourgeoise et le parlementarisme. Il est fait spécifiquement référence à la description que Friedrich Engels fait de l'État en tant que produit de la société divisée en classes : "l’État est un produit de la société à une certaine étape de son développement" ; il est "l’aveu que cette société s’est empêtrée dans une insoluble contradiction avec elle-même, qu’elle s’est divisée en antagonismes inconciliables" et n’est pas "une force imposée à la société du dehors" ni un instrument de la classe dirigeante créé de façon purement arbitraire par elle. La FVDG appelle de façon conséquente à la destruction de l'État bourgeois.
Avec cette position, à une époque où la social-démocratie constituait sans doute l'arme la plus insidieuse de la contre-révolution, la FVDG mettait le doigt sur un point névralgique. Contre la farce du SPD visant à soumettre les conseils ouvriers par leur intégration au parlement bourgeois, son programme exhortait : "Le ‘socialisme’ social-démocrate a assurément besoin d’un État. Et d’un État qui aurait à utiliser de tous autres moyens contre la classe ouvrière que l’État capitaliste. (...) Il sera le fruit d'une demi-révolution prolétarienne et la cible de la révolution prolétarienne totale. C’est parce que nous avons reconnu la nature de l'État et que nous savons que la domination politique des classes possédantes s’enracine dans leur puissance économique, que nous n'avons pas à lutter pour la conquête de l'État, mais pour son élimination."
Karl Roche a aussi tenté de formuler dans le programme de la FVDG les leçons fondamentales des journées de novembre et décembre 1918 allant bien au-delà du rejet rebelle ou individualiste de l'État qu’on prête à tort aux syndicalistes révolutionnaires et démasquant clairement dans son essence le système de la démocratie bourgeoise. "La démocratie n'est pas l'égalité, mais l’utilisation démagogique d’une comédie d’égalité. (...) Les possédants ont, pour autant qu’ils affrontent les ouvriers, toujours les mêmes intérêts. (...) Les travailleurs n’ont d’intérêt commun qu’entre eux, et non avec la bourgeoisie. Là, la démocratie est une absurdité générale. (...) La démocratie est l'un des slogans les plus dangereux dans la bouche des démagogues qui comptent sur la paresse et l'ignorance des salariés. (...) Les démocraties modernes en Suisse, en France, en Amérique ne sont qu’une hypocrisie capitaliste démocratique sous la forme la plus répugnante." Face aux pièges de la démocratie cette formulation précise reste plus pertinente que jamais.
Nous pouvons porter de nombreuses critiques au programme de la FVDG du printemps 1919, notamment un certain nombre d’idées syndicalistes-révolutionnaires classiques que nous ne partageons pas comme "l’autodétermination complète" et "le fédéralisme". Mais sur des points cruciaux à ce moment-là, comme le rejet du parlementarisme, le programme, écrit par Roche, est demeuré inflexible. "Il en va du parlementarisme comme de la social-démocratie : si la classe ouvrière veut se battre pour le socialisme, elle doit écarter la bourgeoisie comme classe. Elle ne doit pas alors lui accorder de droit au pouvoir, ne doit pas voter avec elle ni traiter avec elle. Les conseils ouvriers sont les parlements de la classe ouvrière. (...) Ce ne sont pas les parlements bourgeois, mais la dictature du prolétariat qui mettra en œuvre le socialisme." A ce moment-là, le Parti communiste revenait sur ses positions initiales claires contre le parlementarisme et le travail dans les syndicats-sociaux-démocrates et commençait à régresser dramatiquement en deçà des positions de son Congrès de fondation.
Quelques mois plus tard, en décembre 1919, la Déclaration de principes de la FAUD mettait l’accent sur des points différents. Karl Roche qui, dans les premiers temps après la guerre avait influencé la FVDG de façon décisive au plan programmatique, rejoignit l’AAU en décembre 1919.
La rupture avec le Parti communiste
Lors de la Révolution de novembre 1918, de nombreux points communs rassemblent les révolutionnaires de la FVDG syndicaliste-révolutionnaire et ceux de la Ligue Spartacus : la référence au soulèvement de la classe ouvrière en Russie en 1917, la revendication de tout le pouvoir aux conseils ouvriers, le rejet de la démocratie et du parlementarisme, ainsi qu’un rejet très clair de la social-démocratie et de ses syndicats. Comment expliquer alors qu'au cours de l'été 1919 ait commencé un dur règlement de comptes entre les deux courants qui avaient auparavant partagé tant de choses ?
Il existe différents facteurs faisant qu'une révolution peut échouer : la faiblesse de la classe ouvrière et le poids de ses illusions ou l'isolement de la révolution. En Allemagne en 1918-19, c’est surtout son expérience qui a permis à la bourgeoisie allemande, au moyen de la social-démocratie, de saboter de l'intérieur le mouvement, de fomenter des illusions démocratiques, de précipiter la classe ouvrière dans le piège de soulèvements isolés et prématurés comme en janvier 1919 et de la priver, par le meurtre, de ses révolutionnaires les plus clairs et de milliers de prolétaires engagés.
Les polémiques entre le KPD et les syndicalistes-révolutionnaires suite à l’écrasement de la grève d'avril 1919 dans Ruhr montrent des deux côtés la même tentative de rechercher les raisons de l'échec de la révolution chez les autres révolutionnaires. Roche s’était déjà laissé emporter par cette tendance dès avril dans la conclusion du programme de la FVDG affirmant "(...) ne pas laisser les Spartakistes diviser la classe ouvrière", mettant ainsi de façon confuse ces derniers dans le même sac que les "socialistes de droite". À partir de l'été 1919 cela devint la mode dans la FVDG de parler des "trois partis sociaux-démocrates", c’est-à-dire SPD, USPD et KPD - une attaque polémique qui dans l’atmosphère de frustration par rapport aux échecs de la lutte de classe, ne faisait plus aucune distinction entre les organisations contre-révolutionnaire et les organisations prolétariennes.
Le Parti communiste (KPD) publia en août une brochure sur les syndicalistes-révolutionnaires à l’argumentation tout aussi malheureuse. Il considérait désormais la présence de syndicalistes-révolutionnaires dans ses rangs comme une menace pour la révolution : "Les syndicalistes-révolutionnaires invétérés doivent enfin se rendre compte qu’ils ne partagent pas les choses fondamentales avec nous. Nous ne devons plus consentir que notre parti offre un terrain de jeu à des gens qui y propagent toutes sortes d'idées étrangères au parti." 18
La critique du Parti communiste envers les syndicalistes-révolutionnaires était axée sur trois points : la question de l'État et de l'organisation économique après la révolution, la tactique et la forme d’organisation – en fait les débats classiques avec le courant syndicaliste-révolutionnaire. Bien que le Parti communiste ait eu raison de conclure que : "Dans la révolution, l'importance des syndicats pour la lutte des classes régresse de plus en plus. Les conseils ouvriers et les partis politiques deviennent les protagonistes et les dirigeants exclusifs de la lutte", la polémique envers les syndicalistes révolutionnaires révéla surtout les faiblesses du Parti communiste sous la direction de Levi : une fixation sur la conquête de l'État. "Nous pensons que nous allons nécessairement utiliser l'État après la révolution. La Révolution signifie justement en premier lieu la prise du pouvoir au sein de l'État" ; la croyance erronée que la coercition au sein du prolétariat peut être un moyen pour mener à bien la révolution : "Disons avec la Bible et les Russes : ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Ceux qui ne travaillent pas ne recevront que ce dont les actifs pourront se passer" ; le flirt avec la reprise de l’activité parlementaire : "Notre attitude à l'égard du parlementarisme montre que pour nous la question de la tactique se pose différemment des syndicalistes révolutionnaires. (...) Et comme l’ensemble de la vie du peuple est quelque chose de vivant, de changeant, un processus qui prend constamment de nouvelles formes, toute notre stratégie doit ainsi aussi s'adapter en permanence aux nouvelles conditions" ; et pour finir la tendance à considérer le débat politique permanent, en particulier sur les questions fondamentales, comme quelque chose qui n’est pas positif : "Nous devons prendre des mesures contre les gens qui nous rendent difficile de planifier la vie du parti. Le parti est une communauté de combat unie et non un club de discussions. Nous ne pouvons pas continuellement avoir des discussions sur les formes d’organisation et autres."
Le Parti communiste tentait ainsi de se débarrasser des syndicalistes-révolutionnaires également membres du Parti communiste. En juin 1919, dans son appel Aux syndicalistes-révolutionnaires du Parti communiste !, celui-ci les présente certes comme "remplis d'honnêtes aspirations révolutionnaires." Mais le KPD définit cependant leur combativité comme un risque tendanciel au putschisme et leur pose l’ultimatum suivant : ou bien ils s'organisent dans un parti strictement centralisé ; ou bien "Le Parti communiste d'Allemagne ne peut pas tolérer dans ses rangs des membres qui, dans leur propagande par la parole, l'écriture et l'action, contreviennent à ces principes. Il se voit contraint de les exclure." Compte tenu de l’amorce de confusions et de dilution des positions du Congrès de fondation du Parti communiste, cet ultimatum sectaire contre les syndicalistes révolutionnaires était plutôt une expression d'impuissance face au reflux de la vague révolutionnaire en Allemagne. Il a privé le Parti communiste du contact vivant avec les parties les plus combatives du prolétariat. L'échange de coups entre le KPD et les syndicalistes révolutionnaires au cours de l'été 1919 montre également que l’atmosphère de défaite accompagnée de tendances renforcées à l'activisme forme une combinaison défavorable à la clarification politique.
Un bref cheminement commun avec les Unions
Au cours de l'été de 1919, l'atmosphère en Allemagne se caractérisait d'une part par une grande déception consécutive aux défaites et, d'autre part, par une radicalisation de certaines parties de la classe ouvrière. Il se produisit des défections en masse dans les syndicats sociaux-démocrates, et un afflux massif vers la FVDG, qui doubla le nombre de ses membres.
En plus des syndicalistes révolutionnaires il commença à se développer un second courant contre les syndicats traditionnels, lui aussi alimenté par un important afflux. Dans la région de la Ruhr apparurent l’Allgemeine Arbeiter Union-Essen (AAU-E : Union Générale des Travailleurs – Essen) et l'Allgemeine Bergarbeiter Union (Union générale des mineurs) sous l'influence de fractions de radicaux de gauche au sein du Parti communiste de Hambourg, et soutenues par la propagande active de regroupements proches des International Workers of the World (IWW) américains autour de Karl Dannenberg à Brunswick. À l’inverse de la FVDG syndicaliste-révolutionnaire, les Unions voulaient abandonner le principe d’organisation syndicale par branches d’industrie pour regrouper la classe ouvrière par entreprises entières dans des "organisations de combat". De leur point de vue, c’étaient désormais les entreprises qui exerçaient leur force et possédaient une puissance dans la société et c’est de là, par conséquent, que la classe ouvrière tire sa force - quand elle s'organise conformément à cette réalité. Ainsi, les Unions recherchaient-elles une plus grande unité et considéraient les syndicats comme une forme historiquement obsolète de l'organisation de la classe ouvrière. On peut dire que les Unions constituaient d’une certaine façon une réponse de la classe ouvrière à la question qui lui était posée concernant de nouvelles formes d'organisation ; la question même que le courant syndicaliste-révolutionnaire en Allemagne a cherché à éviter jusqu'à aujourd'hui 19.
Nous ne pouvons pas dans cet article développer notre analyse sur la nature des Unions, qui ne sont ni des conseils ouvriers, ni des syndicats, ni des partis. Pour cela il faudra y revenir dans un texte spécifique.
Il est souvent difficile dans cette phase de distinguer précisément les courants unioniste et syndicaliste-révolutionnaire. Au sein des deux courants il existait des réticences vis-à-vis des "partis politiques", même si les Unions étaient finalement beaucoup plus proches du Parti communiste. Ces deux tendances constituaient une expression directe des fractions les plus combatives de la classe ouvrière en Allemagne, se positionnaient contre la social-démocratie et préconisaient, au moins jusqu'à la fin 1919, le système des conseils.
Dans une première phase qui va jusqu'à l'hiver 1919-20, le courant unioniste dans la région de la Ruhr s’incorpora au mouvement syndicaliste révolutionnaire, qui était plus fort, avec la Conférence dite ‘de fusion’ des 15-16 septembre 1919 à Düsseldorf. Les unionistes prirent part ainsi à la fondation de la Freie Arbeiter Union (FAU) de Rhénanie-Westphalie. Cette Conférence était la première étape vers la création de la FAUD, qui devait avoir lieu trois mois plus tard. La FAU-Rhénanie-Westphalie exprimait dans son contenu un compromis entre le syndicalisme-révolutionnaire et l’unionisme. Les lignes directrices adoptées disaient que "(...) la lutte économique et politique doit être menée avec conséquence et fermeté par les travailleurs (...)" et que "en tant qu’organisation économique, la Freie Arbeiter Union ne tolère aucune politique de parti dans ses réunions, mais laisse à la libre appréciation de chaque membre d’adhérer aux partis de gauche et d’y exercer une activité s’il l’estime nécessaire."20 L’Allgemeine Arbeiter Union-Essen et l'Allgemeine Bergarbeiter Union allaient se retirer en grande partie de l'Alliance avec les syndicalistes-révolutionnaires dès avant la fondation de la FAUD en décembre.
La fondation de la FAUD et sa Déclaration de principes
La croissance numérique rapide de la FVDG au cours de l'été et de l’automne 1919, la propagation du mouvement syndicaliste révolutionnaire en Thuringe, en Saxe, en Silésie, dans le Sud de l'Allemagne, dans les régions côtières de la Mer du Nord et de la Baltique réclamaient une structuration du mouvement au plan national. Le 12ème Congrès de la FVDG du 27 au 30 décembre à Berlin, se transforma en Congrès de fondation de la FAUD, auquel participent 109 délégués.
Ce Congrès est souvent décrit comme le "tournant" du syndicalisme révolutionnaire allemand vers l'anarcho-syndicalisme ou comme le début de l’ère Rudolf Rocker – une étiquette utilisée surtout par les adversaires catégoriques du syndicalisme-révolutionnaire y voyant un "pas en avant dans le sens négatif". La plupart du temps, on montre du doigt dans la fondation de la FAUD l’apologie du fédéralisme, les adieux à la politique, le rejet de la dictature du prolétariat et le retour au pacifisme. Cette analyse ne rend cependant pas justice à la FAUD de décembre 1919. "L'Allemagne est l'eldorado des slogans politiques. On prononce des paroles, on se grise de leurs flonflons sans se rendre compte du véritable sens de celles-ci" commente Rocker (que nous citons ci-dessous) dans son discours sur la Déclaration de principes à propos des allégations portées contre les syndicalistes-révolutionnaires.
Il ne fait aucun doute que les idées de Rocker, anarchiste resté internationaliste durant la guerre et rédacteur de la nouvelle Déclaration de principes, acquirent une influence notable au sein de la FAUD, favorisée par sa présence physique au sein de cette organisation. Mais la fondation de la FAUD reflètait d'abord et avant tout la popularité des idées syndicalistes-révolutionnaires au sein de la classe ouvrière en Allemagne et indiquait une claire démarcation vis-à-vis du Parti communiste et de l’unionisme naissant. Les positions fortes que la FVDG avait propagées depuis la fin de la guerre au sein de la classe ouvrière, l’expression de sa solidarité envers la Révolution russe, le rejet explicite de la démocratie bourgeoise et de toute forme d’activité parlementaire, la récusation de toutes "les frontières politiques et nationales arbitrairement tracées" étaient réaffirmés dans la Déclaration de principes de décembre 1919. La FAUD se situait ainsi sur le terrain des positions révolutionnaires.
Par rapport au programme de la FVDG du printemps 1919, le Congrès prit une plus grande distance critique vis-à-vis de l'enthousiasme envers la perspective des conseils ouvriers. Les signes d’affaiblissement des conseils ouvriers en Russie étaient pour le Congrès la marque du risque global latent que présentent les "partis politiques", et la preuve que la forme syndicale d'organisation est plus résistante et défend mieux l’idée des conseils 21. La dépossession des conseils ouvriers de leur pouvoir en Russie à cette époque était en effet une réalité et les Bolcheviks y avaient tragiquement contribué. Mais ce que la FAUD ne voyait pas dans son analyse, c’était tout simplement le carcan de l'isolement international de la révolution russe qui devait inévitablement conduire à l’asphyxie de la vie de la classe ouvrière.
"On nous combat, nous syndicalistes-révolutionnaires, principalement parce que nous sommes des partisans déclarés du fédéralisme. Les fédéralistes, nous dit-on, sont les diviseurs des luttes ouvrières", dit Rocker. L'aversion de la FAUD vis-à-vis du centralisme et son engagement en faveur du fédéralisme ne se fondaient pas sur une vision de la fragmentation de la lutte des classes. La réalité et la vie du mouvement syndicaliste révolutionnaire après la guerre ont suffisamment fait la preuve de son engagement pour l'unité et la coordination de la lutte. Le rejet exagéré de la centralisation trouvait ses racines dans le traumatisme de la capitulation de la social-démocratie : "Les comités centraux ordonnaient d’en haut, les masses obéissaient. Puis vint la guerre ; le parti et les syndicats étaient confrontés à un fait accompli : nous devons soutenir la guerre pour sauver la patrie. Désormais, la défense de la patrie devint un devoir socialiste, et les mêmes masses qui, la semaine précédente, protestaient contre la guerre, étaient désormais pour la guerre, mais sur ordre de leurs comités centraux. Cela vous montre les conséquences morales du système de la centralisation. La centralisation, c’est l'extirpation de la conscience du cerveau de l'homme, et rien d’autre. C’est la mort du sentiment d'indépendance." Pour beaucoup de militants de la FAUD, le centralisme était dans son principe même une méthode héritée de la bourgeoisie dans "(...) l'organisation de la société de haut en bas, afin de maintenir les intérêts de la classe dominante." Nous sommes absolument d'accord avec la FAUD de 1919 que c'est la vie politique et l'initiative de la classe ouvrière "par en bas" qui sont porteuses de la révolution prolétarienne. La lutte de la classe ouvrière doit être menée solidairement, et en ce sens, il s’engendre toujours spontanément une dynamique à l'unification du mouvement, et donc à sa centralisation au moyen de délégués élus et révocables. "L'eldorado des slogans politiques" a incité la majorité des syndicalistes révolutionnaires de la FAUD en décembre 1919 à s’affubler du slogan du fédéralisme, une étiquette qui ne représentait pas la véritable tendance après la fondation de la FAUD.
Le Congrès de fondation de la FAUD a-t-il effectivement rejeté l'idée de "dictature du prolétariat" ? "Si sous le terme de la dictature du prolétariat on entend la prise en main de la machine de l’État par un parti, si l’on entend là uniquement l’établissement d’un nouvel État, alors les syndicalistes-révolutionnaires sont les ennemis jurés d'une telle dictature. Si par contre on veut dire que le prolétariat va dicter aux classes possédantes de renoncer à leurs privilèges, s’il ne s’agit pas de la dictature du haut vers le bas, mais de la répercussion de la révolution du bas vers le haut, alors les syndicalistes révolutionnaires sont des partisans et des représentants de la dictature du prolétariat." 22 Absolument juste ! La réflexion critique sur la dictature du prolétariat, qui à ce moment-là était associée à la situation dramatique en Russie, était une question légitime à l'égard du risque de dégénérescence interne de la révolution en Russie. Il n’était pas encore possible de faire le bilan de la révolution russe en décembre 1919. Les assertions de Rocker étaient plus un baromètre des contradictions déjà perceptibles, et le tout début d'un débat qui durera des années dans le mouvement ouvrier sur les raisons de l'échec de la vague révolutionnaire mondiale après la guerre. Ces doutes n’émergèrent pas par hasard dans une organisation comme la FAUD, laquelle devait fortement fluctuer avec les hauts et les bas de la vie "à la base" de la classe ouvrière.
Même le catalogage classique du Congrès de fondation de la FAUD comme "étape vers le pacifisme" qui sans aucun doute sabote la détermination de la classe ouvrière, ne correspond pas à la réalité. Comme la discussion sur la dictature du prolétariat, les débats sur la violence dans la lutte des classes a été plutôt le signe d'un véritable problème auquel était confrontée la classe ouvrière au plan international. À l’aide de quels moyens est-il possible de maintenir l’élan de la vague révolutionnaire qui marque le pas et de briser l'isolement de la classe ouvrière en Russie ? En Russie, comme en Allemagne il était inévitable pour la classe ouvrière d’utiliser des armes pour se défendre contre les attaques de la classe dominante. Mais l’extension de la révolution par des moyens militaires, voire la "guerre révolutionnaire" était impossible, si ce n'est absurde. Particulièrement en Allemagne, la bourgeoisie tentait avec perfidie de provoquer en permanence le prolétariat militairement. "L'essence de la révolution ne réside pas dans l’utilisation de la violence, mais dans la transformation des institutions économiques et politiques. La violence en soi n'est absolument pas révolutionnaire, mais au contraire réactionnaire au plus haut degré. (...) Les révolutions sont la conséquence d'une grande transformation spirituelle dans les opinions des hommes. Elles ne peuvent pas s’accomplir arbitrairement par la force des armes (...) Mais je reconnais aussi la violence comme un moyen de défense, lorsque les conditions elles-mêmes nous refusent tout autre moyen", argumente Rocker contre Krohn, un défenseur du Parti communiste. Les événements tragiques de Cronstadt en 1921 ont confirmé que l’attitude critique envers les faux espoirs que les armes puissent sauver la révolution, n'a rien à voir avec le pacifisme. La FAUD, dans la foulée de son Congrès fondateur, n’a pris aucune position pacifiste. Une grande partie de l'Armée Rouge de la Ruhr qui a riposté au putsch de Kapp au printemps de 1920 était formée de syndicalistes-révolutionnaires.
Dans le présent article, c'est intentionnellement que, par delà nos critiques, nous avons également fait ressortir les points forts des positions des syndicalistes-révolutionnaires en Allemagne à l'époque de 1918-19. La partie suivante de notre article traitera de la période allant de la fin des années 1920 jusqu’à l’avènement d'Hitler en 1933 et la destruction de la FAUD.
Mario (16/ 6/ 2012)
1 Der Syndikalist n° 1, "Was wollen die Syndikalisten? Der Syndikalismus lebt!", 14 décembre 1918
2 Ibidem
3 Voir Ulrich Klan, Dieter Nelles, Es lebt noch eine Flamme, Ed Trotzdem Verlag
4 Richard Müller, 1918: Räte in Deutschland, p. 3
5 Richard Müller, Hie Gewerkschaft, hie Betriebsorganisation!‘, 1919
66 Discours de présentation de la Déclaration de Principes de la FAUD par R. Rocker.
7 Protokoll der Ersten Generalversammlung des Deutschen Eisenbahnerverbandes in Jena, 25-31 mai 1919, p. 244
8 Der Syndikalist n°36, „Betriebsräte und Syndikalismus“, 1919
9 Plus largement, au-delà de l’illusion des comités d’entreprise comme "partenaires de négociation" avec le capital, il existait celle, émanant de la Ruhr à Essen – mais présente aussi dans les rangs des syndicalistes révolutionnaires – de la possibilité de la "socialisation" immédiate, c'est-à-dire la nationalisation des mines et des entreprises. Cette faiblesse commune à l’ensemble de la classe ouvrière en Allemagne constituait avant tout une expression de son impatience. Le gouvernement Ebert créa dès le 4 décembre 1918 à l’échelle nationale une commission à la socialisation comprenant des représentants du capital et des sociaux-démocrates renommés tels que Kautsky et Hilferding. Ceci dans le but déclaré du maintien de la production grâce aux nationalisations.
10 Voir à ce propos les débats du 15ème Congrès de la FAUD en 1925.
11 Der Syndikalist n°2, „Verschandelung der Revolution“, 21 décembre 1918
12 Der Syndikalist n°1, „Was wollen die Syndikalisten? Der Syndikalismus lebt!“, 14 décembre1918
13 Ulrich Klan, Dieter Nelles, Es lebt noch eine Flamme, Ed Trotzdem Verlag, p. 70
14 Karl Roche in Der Syndikalist n°13, „Syndikalismus und Revolution“, 29 mars 1919
15 Rudolf Rocker, Aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten, Ed. Suhrkamp, p. 287
16 Roche écrit : "La politique de parti est la méthode bourgeoise de lutte pour s’accaparer le produit du travail extorqué aux ouvriers. (...) Les partis politiques et les parlements bourgeois sont complémentaires, ils entravent tous les deux la lutte de classe prolétarienne et produisent la confusion." comme si la possibilité de partis révolutionnaires de la classe ouvrière n’existait pas. Qu’en est-il du compagnon de lutte de la Ligue Spartacus, qui était un parti politique ?
17 Was wollen die Syndikalisten? Programm, Ziele und Wege der „Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften“, mars 1919
18 Syndikalismus und Kommunismus, F. Brandt, KPD-Spartakusbund, août 1919
19 En réalité, beaucoup de sections de la FAU en Allemagne telles qu'elles existent aujourd'hui, jouent depuis des décennies bien plus un rôle de groupe politique que de syndicat, en s’exprimant sur de nombreuses questions politiques et en ne se limitant nullement à la "lutte économique" - ce que nous, en dehors de savoir si nous sommes d'accord ou non, trouvons positif.
20 Der Syndikalist, n° 42, 1919
21 En dépit de la méfiance à l'égard des partis politiques existants Rocker affirmait clairement que : "(...) la lutte n'est pas seulement économique, mais doit aussi être une lutte politique. Nous disons la même chose. Nous rejetons seulement l'activité parlementaire, mais en aucune manière la lutte politique en général. (...) Même la grève générale est un outil politique tout comme la propagande antimilitariste des syndicalistes-révolutionnaires, etc." Le rejet théorisé de la lutte politique ne dominait pas la FAUD à cette époque, bien que sa forme d’organisation ait été clairement conçue pour la lutte économique.
22 Rocker, Der Syndikalist, n°2, 1920