ICConline - décembre 2010
- 1615 lectures
Brève chronologie des événements de la lutte contre la réforme des retraites (suite et fin)
- 2178 lectures
La première partie [1] de cette chronologie détaillait les événements qui se sont déroulés entre le 23 mars et le 19 octobre. Elle s'achevait provisoirement par ces quelques phrases :
"Le mouvement se développe comme une lame de fond depuis 7 mois. La colère est immense. Les revendications contre la réforme des retraites tendent à passer au second plan : les médias reconnaissent que le mouvement se "politisent". C'est toute la misère, la précarité, l'exploitation, etc. qui sont ouvertement rejetées. La solidarité entre les différents secteurs, aussi, s'accroît. Mais, pour l'instant, la classe ouvrière ne parvient pas à prendre réellement en mains SES luttes. Elle le souhaite de plus en plus, elle s'y essaye de-ci de-là par des tentatives minoritaires, elle se méfie de façon croissante de l'intersyndicale, mais elle ne parvient pas encore réellement à s'organiser collectivement à travers des Assemblées Générales autonomes et souveraines, et donc en dehors des syndicats. C'est pourtant de telles AG qui avaient constituées le cœur du mouvement contre le CPE en 2006 et qui lui avaient donné sa force. La classe ouvrière semble encore manqué de confiance en elle. Le déroulement à venir de la lutte va nous dire si elle va parvenir à dépasser cette difficulté cette fois-ci. Ce sera sinon pour la prochaine fois ! Le présent est riche de promesses pour l'avenir des luttes."
Alors, comment à finalement évolué le mouvement ?
A partir du 19 octobre…
La question du blocage des raffineries occupe, à partir de la mi-octobre, tous les esprits.
Les médias et les politiques braquent leurs projecteurs sur la pénurie d'essence, sur la "galère des automobilistes" et le bras de fer entre les bloqueurs et les forces de l'ordre. Dans toutes les AG (syndicales ou non), les débats ne tournent plus que presque exclusivement autour de "comment aider les travailleurs des raffineries ?", "comment exprimer notre solidarité ?", "que pouvons-nous bloquer à notre tour ?"… Et dans les faits, quelques dizaines de travailleurs de tous secteurs, de chômeurs, de précaires, de retraités se rendent effectivement chaque jour devant les portes des 12 raffineries paralysées, pour "faire nombre" face aux CRS, apporter des paniers-repas aux grévistes, un peu d'argent et de chaleur morale.
Cet élan de solidarité est un élément important, il révèle une nouvelle fois la nature profonde de la classe ouvrière.
Néanmoins, malgré la détermination et les bonnes intentions des grévistes et de leurs soutiens, de façon plus générale, ces blocages participent non au développement du mouvement de lutte mais à sa décrue. Pourquoi ?
Ces blocages ont été initiés et sont contrôlés entièrement, de bout en bout, par la CGT (principal syndicat français). Il n'y a pratiquement aucune AG permettant aux travailleurs des raffineries de discuter collectivement. Et quand une assemblée a tout de même lieu, elle n'est pas ouverte aux autres travailleurs ; ces "étrangers" venus participer aux piquets ne sont pas invités à venir discuter et encore moins participer aux décisions. L'entrée leur est même interdite ! La CGT veut bien de la solidarité… platonique… point barre ! En fait, sous couvert d'une action "forte et radicale", la CGT organise l'isolement des travailleurs très combatifs de ce secteur de la raffinerie.
Les piquets restent d'ailleurs "fixes" et non pas "volants" : il serait pourtant bien plus efficace pour entraîner un maximum de travailleurs dans la lutte d'organiser des "piquets volants", allant d'entreprises en entreprises, pour créer des débats, des AG spontanées… C'est exactement ce genre d'extension dont les syndicats ne veulent pas !
21 octobre
A la veille des vacances de la Toussaint, les principaux syndicats lycéens et étudiants (l’UNL, la Fidl et l’Unef), appellent à manifester. Il faut dire que la colère de la jeunesse est de plus en plus forte. Et ils sont effectivement plusieurs milliers à descendre dans la rue ce jour-là.
Du 22 au 27 octobre
Le texte de loi sur les retraites franchit toutes les étapes de la "démocratie", du sénat à l'assemblée.
28 octobre
Nouvelle journée de mobilisation appelée par l'intersyndicale. 1,2 millions de participants, prêt de trois fois moins que la manifestation précédente du 19 octobre. La décrue est brutale et la résignation commence à regagner du terrain.
De plus, cette journée d'action se déroule en plein milieu des vacances scolaires. Les lycéens qui avaient commencé à se joindre au mouvement (et qui ont été partout violemment réprimés1) sont donc très largement absents.
Jusqu'à lors, les syndicats avaient tout fait pour, soit réduire le nombre des AG, soit les fermer aux autres secteurs. Mais maintenant que le mouvement commence son reflux, ils tentent d'organiser des "rencontres nationales" des différentes Interprofessionnelles de l'hexagone. L'appel de ces "Syndicalistes unitaires" ose même affirmer :
"La lutte contre la réforme des retraites arrive à un moment décisif. Alors que le gouvernement et les médias nous annoncent la fin de la mobilisation, des actions de blocage et de solidarité sont menées dans tout le pays, dans un cadre interprofessionnel, souvent organisées à partir d’Assemblées Générales interpros. Cependant, au-delà de cette structuration au niveau local, il n’y a pas ou très peu de communication entre les AG Interprofessionnelles, de façon à se coordonner à une échelle plus large. Or, si nous voulons donner un coup d’arrêt à la politique gouvernementale, il faudra se structurer davantage et coordonner nos actions. Il s’agit pour les travailleurs, chômeurs, jeunes et retraités mobilisés de se doter d’un outil pour organiser leur propre lutte au-delà de l’échelle locale. C’est pourquoi l’Assemblée générale de Tours, réunie le 28 octobre 2010, se propose d’organiser et d’accueillir une rencontre interprofessionnelle de mandatés des Assemblées Générales qui se tiennent dans tout le pays."2
Il s'agit là d'une mascarade. Ceux-là même qui n'ont eu de cesse de nous diviser, appellent maintenant, après la bataille, à "structurer davantage et coordonner nos actions". Eux qui nous ont dépossédé intentionnellement de NOTRE lutte, appellent maintenant les travailleurs, après la bataille, à "organiser leur propre lutte". Des participants d'interpro non-syndicales (telle que celle de la Gare de l'Est – Paris) et des militants du CCI se sont rendus à cette "rencontre nationale". Tous soulignent la manipulation syndicale, le verrouillage des débats et l'impossibilité de mettre en question le bilan de l'action de l'intersyndicale. Le NPA et Alternative Libertaire (deux groupes gauchistes, l'un 'trotskiste', l'autre 'anarchiste'), semblent très actifs au sein de cette coordination nationale.
6 novembre
Nouvelle journée de mobilisation : 1,2 million de manifestants battent une nouvelle fois le pavé. Cela fait maintenant huit mois que ce type de manifestations se succèdent les unes aux autres. Pourtant, plus personne ne croit plus à la possibilité d'un quelconque retrait, même partiel, de l'attaque. Preuve en est de la profondeur de la colère ! Les travailleurs ne luttent pas contre cette attaque mais pour exprimer leur raz le bol généralisé face à leur paupérisation.
10 novembre
La loi est votée et promulguée. L'intersyndicale appelle immédiatement à une nouvelle mobilisation le… 23 novembre ! Et encore, pour être bien sûre d'enterrer définitivement ce mouvement, l'intersyndicale propose une journée d' "actions multiformes". Concrètement, aucune consigne nationale n'est donnée. Chaque département, chaque section syndicale, chaque secteur fait le «type d'actions » qu'il lui plaît.
23 novembre
Quelques milliers de personnes seulement manifestent. A Paris, les syndicats orchestrent une "action symbolique" : faire le tour plusieurs fois du Palais Brongniard, siège de la Bourse avec le slogan « Encerclons le Capital ». Le but est atteint : c'est un fiasco décourageant. Cette journée est même rebaptisée "la manifestation pour rien". Dans ces conditions, la présence de 10 000 manifestants à Toulouse dénote que la colère gronde toujours. Ce qui est prometteur pour l'avenir et les luttes futures. La classe ouvrière ne sort pas abattue, rincée, épuisée de ce long mouvement. Au contraire, l'état d'esprit dominant semble être "on va voir ce qu'on va voir la prochaine fois".
Conclusion
Ce mouvement contre la réforme des retraites, avec ses manifestations massives, est donc terminé. Mais le processus de réflexion, lui, ne fait que commencer.
Cette lutte est en apparence une défaite, le gouvernement n'a pas reculé. Mais en fait, il est un pas en avant supplémentaire pour notre classe. Les minorités qui ont émergé et qui ont essayé de se regrouper, de discuter en AG Interpro ou en assemblée populaire de rue, ces minorités qui ont essayé de prendre en main leurs luttes en se méfiant comme de la peste des syndicats, révèlent le questionnement qui mûrit en profondeur dans toutes les têtes ouvrières.
Cette réflexion va continuer de faire son chemin et elle portera, à terme, ses fruits.
Il ne s'agit pas là d'un appel à attendre, les bras croisés, que le fruit mûr tombe de l'arbre. Tous ceux qui ont conscience que l'avenir va être fait d'attaques ignobles du capital, d'une paupérisation croissante et de luttes nécessaires, doivent œuvrer à préparer les futurs combats. Nous devons continuer à débattre, à discuter, à tirer les leçons de ce mouvement et à les diffuser le plus largement possible. Ceux qui ont commencé à tisser des liens de confiance et de fraternité dans ce mouvement, au sein des cortèges et des AG, doivent essayer de continuer de se voir (en Cercles de discussion, Comités de lutte, Assemblées Populaires ou "lieux de parole"…) car des questions restent entières :
-
Quelle est la place du "blocage économique" dans la lutte de classe ?
-
Quelle est la différence entre la violence de l'Etat et celle des travailleurs en lutte ?
-
Comment faire face à la répression ?
-
Comment prendre en main nos luttes ? Comment nous organiser ?
-
Qu'est-ce qu'une AG syndicale et une AG souveraine ?
-
Etc., etc.,…
CCI (le 6 décembre)
Annexe
Une partie de ceux qui se réunissaient au sein de l'AG "Gare de l'Est – Ile de France"3 continuent de se voir et essayent de tirer un bilan général du mouvement. Ils ont par exemple produit et distribué ainsi le texte ci-dessous :
Ils préparent 2012
Préparons la Grève de masse
Des travailleurs et précaires de l'AG interpro Gare de l'Est et IDF
Depuis le début septembre, nous avons été des millions à manifester et des milliers à entrer grève reconductible dans certains secteurs (raffineries, transports, éducation, lycées, facs...) ou à participer à des blocages.
Nous aurions « gagné la bataille de l’opinion »
Le gouvernement, lui, a gagné la bataille des retraites
Aujourd'hui, ils nous annoncent tous que la lutte est terminée. Nous aurions « gagné la bataille de l’opinion ». Tout serait joué et, résignés, on n'aurait plus qu'à attendre 2012. Comme si, maintenant, la seule issue serait les élections. Il n’est pas question d’attendre 2012, pour « l’alternance ». Aujourd’hui, ce sont les partis de gauches qui mènent les attaques, en Grèce comme en Espagne, contre les travailleurs. Il n’y a rien de bon à attendre des prochaines élections.
La crise du capitalisme est toujours là
Les attaques continuent et se feront plus violentes
Nous devons nous préparer dès maintenant à faire face aux prochaines attaques et à celles qui se poursuivent comme les milliers de licenciements et les suppressions de postes L’attaque sur les retraites est l’arbre qui cache la forêt. Aussi demander le retrait ne pouvait être que l’exigence minimale. Cela n’aurait pu suffire. Depuis le début de la crise, c’est ce gouvernement au service du patronat qui mène détruit nos conditions de vie et de travail alors qu’il verse des milliards aux banques et au privé.
Pendant que des centaines de milliers de vieux travailleurs survivent avec moins de 700 euros par mois, et des centaines de milliers de jeunes vivotent avec le RSA, quand ils l’ont, faute de travail. Pour des millions d’entre nous, le problème crucial, c’est déjà de pouvoir manger, se loger et se soigner. Avec l’aggravation de la crise, ce qui guette la majorité d’entre nous, c’est la paupérisation.
Parler dans ces conditions de « pérennité des retraites » comme le fait l’intersyndicale alors que le capitalisme en pleine putréfaction remet en cause toutes nos conditions de vie et de travail, c’est nous désarmer face à la bourgeoisie.
La classe capitaliste mène une guerre sociale contre les travailleurs de tous les pays
C’est à l’échelle internationale que les capitalistes mènent les attaques contre les classes ouvrières. C’est donc les trusts financiers et industriels (BNP, AXA, Renault…) qui nous pillent et veulent nous écraser. En Grèce, il n’y a presque plus remboursement des frais médicaux. En Angleterre ce sont plus de 500.000 licenciements de fonctionnaires. En Espagne c’est la casse des contrats de travail.
Comme nous, les travailleurs de Grèce d’Espagne, d’Angleterre, du Portugal sont confrontés aux mêmes attaques et luttent pour se défendre, même si nous n’avons pas toujours pas fait reculer nos gouvernements et patronat respectifs.
Pour autant, nous sommes encore des centaines de milliers à ne pas accepter cette issue et à garder en nous une profonde colère, une révolte intacte. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi notre combativité et notre mobilisation n'ont pas pu faire plier les patrons et leur Etat ?
Pour faire reculer ce gouvernement et les capitalistes, nous devons mener une lutte de classe
Il aurait fallu, dès le départ, s’appuyer sur les secteurs en grève, ne pas limiter le mouvement à la seule revendication sur les retraites alors que les licenciements, les suppressions de postes, la casse des services publics, les bas salaires continuent dans le même temps. C'est cela qui aurait pu permettre d’entrainer d’autres travailleurs dans la lutte et d’étendre le mouvement gréviste et de l’unifier.
Seule une grève de masse qui s’organise à l’échelle locale et se coordonne nationalement, au travers de comités de grève, d’assemblées générales interprofessionnelles, de comités de lutte, pour que nous décidions nous-mêmes des revendications et des moyens d’action tout en contrôlant le mouvement, peut avoir une chance de gagner.
Laisser la direction des luttes à l’intersyndicale…
A aucun moment, l'intersyndicale n’a tenté de mener cette politique. Bien au contraire elle appelé à deux nouvelles journée d’action le 28 octobre et 6 novembre, alors que les secteurs en grève reconductible s’essoufflaient. Limiter le mouvement de grève reconductible à quelques secteurs et aux seules retraites ne pouvait qu’entraver le mouvement gréviste. Voilà pourquoi, nous n’avons pas été en mesure de faire reculer le gouvernement.
Nous ne pouvions rien attendre d’autre de la part d’un Chérèque (CFDT) qui défendait les 42 annuités, ou encore d’un Thibault (CGT) qui n’a jamais revendiqué le retrait de la loi ? Et ce n’est certainement pas le faux radicalisme d’un Mailly (FO), serrant la main d’Aubry en manif, alors que le PS vient de voter les 42 annuités qui ouvre une autre voie. Quant à Solidaires/Sud-Rail, il ne proposait que de suivre la CGT. Aucun d’entre eux ne voulait l’organisation indépendante des travailleurs pour que nous nous défendions et passions à l’offensive.
Aussi se sont-ils mis à la tête des luttes et ont enfourché le cheval de la grève reconductible pour éviter de se faire déborder. Ils ne voulaient pas faire reculer ce gouvernement. Tout au long du mouvement l’intersyndical cherchait seulement à apparaître comme un interlocuteur responsable auprès du gouvernement et du patronat afin de « faire entendre le point de vue des organisations syndicales dans la perspective de définir un ensemble de mesures justes et efficaces pour assurer la pérennité du système de retraites par répartition. » dans le cadre « d’un large débat public et une véritable concertation en amont ».
Mais quel dialogue peut avoir l’intersyndicale avec ce gouvernement qui matraque les infirmiers anesthésistes, les lycéens, déloge les travailleurs des raffineries et expulse les Roms et les travailleurs sans papiers, si ce n’est de négocier des reculs comme en 2003, 2007 et 2009. Cela fait des années qu’ils ont fait le choix de collaborer avec le patronat et leur Etat pour gérer la crise.
…c’est finir à la soupe populaire
Empêcher la misère généralisée dans laquelle les classes dirigeantes veulent nous plonger, dépend de notre capacité à mener une lutte de classe pour nous accaparer les richesses produites et les moyens de production afin de subvenir aux besoins de toute la population au lieux de ceux d’une petite minorité.
Nous ne devrons pas hésiter à remettre en cause la propriété privée industrielle, financière et la grande propriété foncière. Pour nous engager dans cette voie, nous ne devons avoir confiance que dans notre propre force. Et certainement pas dans les partis de la gauche (PS, PCF, PG…) qui n’ont jamais remis en cause la propriété privée et dont les homologues mènent actuellement l’offensive contre les travailleurs en Espagne et en Grèce.
Dans cette lutte, les travailleurs doivent défendre les intérêts de tous les exploités y compris les petits paysans, marins pêcheurs, petits artisans, petits commerçants, qui sont jetés dans la misère avec la crise du capitalisme. Que nous soyons salariés, chômeurs, précaires, travailleurs avec ou sans papiers, syndiqués ou non et ce cela quelque soit notre nationalité, nous sommes tous dans le même bateau.
1 Lire par exemple le témoignage [2] d'un de nos lecteurs qui a vécu de l'intérieur les charges et les coups des CRS à Lyon.
2 www.syndicalistesunitaires.org/Appel-a-une-rencontre [3]
3 Pour les contacter : [email protected] [4]
Situations territoriales:
La reprise de la lutte de classe des ouvriers aux Etats-Unis
- 2489 lectures
Partout aux Etats-Unis ces derniers mois, il y a eu un certain nombre de grèves importantes. Le refus de la classe ouvrière d'accepter l'austérité s'exprime dans sa volonté croissante de lutte. Bien que ces luttes soient restées largement sous le contrôle des syndicats et aient, pour la plupart, abouti à une défaite, les révolutionnaires doivent saluer ces signes de combativité croissante dans la classe et les suivre de près. Avec la crise de la dette publique et les luttes contre l'austérité en Europe, les luttes majeures en Inde, en Afrique du Sud, en Amérique latine et en Chine, les grèves récentes aux Etats-Unis font partie d'une dynamique internationale, qui a commencé autour de 2003, où la classe ouvrière renoue avec la solidarité et la confiance en soi. Cette dynamique a été interrompue par la crise financière mondiale en 2008 (malgré des luttes impressionnantes en Grèce, en Grande-Bretagne, et dans d'autres pays), mais depuis le début de l'année, la classe ouvrière retrouve le chemin de la lutte de classes, et montre qu'elle n'acceptera plus l'austérité sans combattre.
Depuis le printemps dernier, les ouvriers ont fait grève à Philadelphie, à Minneapolis, dans les Etats de l’Illinois, de Washington et de New York, à l'échelle nationale dans l'industrie aéronautique, et, au moment où nous mettons sous presse, un mouvement de grève sauvage des dockers s'étend dans les villes portuaires de la côte Est. C'est de façon significative que ces luttes ont repris un grand nombre des questions centrales des grèves d'avant 2008 : la couverture santé, les allocations, les retraites, les licenciements, et la perspective générale de l'avenir que le capitalisme a à offrir. En 2003, par exemple, le mouvement de grève des ouvriers de l'épicerie, dans le sud de la Californie, se préoccupait principalement de la création de nouveaux volets de prestations de santé et de retraite pour les nouvelles recrues, et en 2005 la grève dans les transports de la ville de New York sur l'avenir d'un régime de retraite pour les nouveaux employés a exprimé une avancée majeure dans le développement de la solidarité intergénérationnelle dans la classe ouvrière sur ces mêmes questions.
Avec le début de la crise, les ouvriers se sont d'abord trouvés quelque peu paralysés, comme des chevreuils éblouis par des phares, avec la menace très réelle de chômage et de fermeture de l'usine. La décision de faire grève et d'affronter les patrons n'a pas été prise à la légère - personne ne peut se permettre d'être mis à pied dans un pays comptant plus de 10% de chômage officiel et plus de 16% de chômage réel1 - la plupart des ouvriers se sont retirés de la lutte de classe, en exprimant parfois l'espoir que la prochaine génération pourrait regagner le terrain perdu lorsque le moment sera plus favorable à la lutte.
Un autre facteur qui a retardé la réponse de la classe ouvrière aux attaques liées à la récente crise financière a sans aucun doute été la mystification démocratique et le formidable espoir que les gens ont ressenti avec la promesse de « changement » de l'administration Obama nouvellement élue. Le soir des élections, les électeurs ravis étaient dans la rue et célébraient l'événement en frappant sur des casseroles et des poêles. Au lieu de cela, ce que nous avons vu, depuis près de deux ans de présidence Obama, ce n'est nullement une baisse réelle du chômage, mais une économie réelle qui continue à stagner malgré des injections massives de crédits de l'Etat, une « réforme » du système de santé qui commence déjà par augmenter les cotisations des soins de santé des ouvriers et le retour de l'augmentation spectaculaire du coût de la vie, tandis que les employeurs continuent de profiter de la crise pour attaquer les salaires, les retraites, les allocations et poursuivre la réduction générale des effectifs. En général, les syndicats avaient placé leurs espoirs dans le nouveau régime Obama, misant sur le passage du désormais abandonné Employee Free Choice Act (La Loi sur le Libre Choix des Employés, note du traducteur), vendant la réforme du système de santé et promettant toutes sortes d'autres réformes, de la part de la nouvelle administration, qui seraient favorables aux ouvriers. Le mécontentement actuel des ouvriers ne peut plus être totalement canalisé vers les réformes gouvernementales et le cirque électoral : les ouvriers sont de plus en plus prêts à lutter pour défendre leur avenir.
Les premiers signes d'une lutte à une échelle massive se sont fait sentir au printemps, dans le secteur de l'éducation en Californie. Lorsque, avec la faillite de l'Etat, les frais de scolarité ont augmenté de 30% et que le personnel a été confronté à de graves attaques sur les conditions de vie et de travail, les étudiants ont occupé les universités, bloqué les routes et tenté de créer des assemblées et d'obtenir le soutien des enseignants, du personnel et d'autres parties de la classe ouvrière californienne2.
Mais ce n'était qu'un début. Peu de temps après, les infirmiers à Philadelphie se sont mis en grève contre les provocations des employeurs qui supprimaient les allocations de scolarité et instauraient une « gag clause » (clause limitative des libertés et des droits, note du traducteur) contre le fait de pouvoir critiquer l'administration de leur hôpital, et se sont attirés une grande sympathie de la part d’autres ouvriers dans toute la région. Début Juin, 12 000 infirmiers de 6 hôpitaux de Minneapolis-Saint Paul se sont engagés dans un arrêt de travail d'une journée et ont voté pour l'autorisation d'une grève illimitée, ce qui aurait été la plus grande grève des infirmiers de l'histoire des Etats-Unis. Là, les infirmiers se sont principalement battus pour la restauration des niveaux de dotation en personnel et pour que les ratios spécifiques infirmier-patients soient inscrits dans leur contrat de travail, alors que les hôpitaux cherchaient à institutionnaliser les bas niveaux de dotation de postes qu'ils avaient obtenu depuis le début de la récession de 2008. Après l'autorisation de grève, comme le contrat de travail arrivait à échéance, le syndicat des infirmiers (Minnesota Nurses Association) a accepté un arbitrage non contraignant du gouvernement fédéral et une période de réflexion de 10 jours, au cours de laquelle ils ont annoncé, plus d'une semaine à l'avance, leur plan pour une grève d'une journée, le 10 juin. Malgré la réelle combativité des infirmiers et leur volonté de défendre leurs conditions de travail, le syndicat a eu les mains libres pour mener la lutte, et immédiatement après cette grève d'une journée, il a annoncé un accord de principe qui abandonnait la revendication centrale sur la question des ratios obligatoires infirmier-patients, acceptait l'offre de salaires des hôpitaux, et n'apportait aucune modification aux plans de santé et d’allocations. Les gauchistes et les syndicalistes n'ont cessé dans tout le pays de saluer ceci comme une victoire majeure de la classe, mais la propre page Facebook des infirmiers a révélé une réelle insatisfaction devant l'abandon de la revendication centrale sans réelle contrepartie.3
Un mois plus tard, plus de 15 000 ouvriers de la construction de deux syndicats différents sont entrés en lutte, dans la région de Chicago, pour une augmentation de salaire nécessaire pour couvrir les coûts des dépenses de santé, compenser le chômage endémique et la diminution des heures de travail dans l'une des industries les plus durement touchées par la récession. Pour le seul mois de juillet, l'industrie de la construction de l'Illinois a perdu 14 900 emplois.4 Pendant la grève, une déclaration du président de la section syndicale 150 de l'International Union of Operating Engineers (IUOE)5, James Sweeney, signale que les membres de cette dernière ont vu leurs heures de travail réduites de 40%, et que sur 8500 membres, 1000 dépendent des banques alimentaires et 1200 ont perdu leur couverture santé.6 Au bout de 19 jours, les ouvriers ont mis fin à la grève, acceptant l'augmentation de salaire la plus basse en 10 ans sans compensation ni de la hausse du coût de la couverture santé, ni du chômage, ni de la diminution des heures de travail. Pourtant, malgré la mainmise des syndicats, de nombreux ouvriers d'autres métiers ont respecté les piquets de grève et ont lancé un projet de grève en solidarité. Fait intéressant, le Département des Transports de l'Illinois a menacé l'association des entrepreneurs de la construction de refuser de prolonger les délais pour les projets d'Etat, et a indiqué qu'il pouvait invoquer une clause d'interdiction de se mettre en grève contre les luttes futures. De même à Chicago, début septembre, les ouvriers de l'hôtel Hyatt ont organisé une grève d'une journée (tout comme l'avait fait le syndicat des infirmiers) pour protester contre les licenciements et ont demandé des concessions dans leur contrat de travail à venir.
L'été a également vu 700 ouvriers dans le Delaware entrer en grève pour la première fois contre Delmarva Power et Conectiv Energy contre des coupes dans les pensions de retraite et la suppression de la « couverture santé de retraite » pour les nouvelles recrues, retournant travailler après un vote sans majorité claire sur le contrat de travail et des appels répétés à un recomptage des voix. Les enseignants sont entrés en grève à Danville (Illinois), pour la réintégration des personnes licenciées au cours des dernières compressions budgétaires d'urgence et contre un contrat de travail incluant un gel de salaire et l'institution de primes fondées sur la performance des étudiants, et à Bellevue (Etat de Washington), pour les salaires et contre les programmes scolaires communs. A Bellevue aussi, les ouvriers de Coca-Cola ont organisé une grève d'une semaine concernant un nouveau contrat de travail les obligeant à payer 25% de toutes les cotisations santé, par opposition à leur précédent tarif forfaitaire ; mais ils sont retournés travailler après que la société eut annulé leur assurance maladie et que le syndicat eut déposé un recours collectif, insistant sur le fait qu'il valait mieux retourner au travail. A Bellevue se trouve aussi l'une des usines Boeing en grève cet été (des usines à St. Louis dans le Missouri et à Long Beach en Californie ont également fait grève), où les ouvriers sont retournés au travail après 57 journées sans aucune modification du contrat de travail proposé par la compagnie à l'exception d'une augmentation de 1$ de l'heure pour certains parmi les plus mal payés.
La plus longue grève de cet été (et peut-être celle qui a reçu le plus de sympathie du reste de la classe) a eu lieu à l'usine de compote de pommes Mott's à Williamson (Etat de New York) où la société a décrété, bien qu’elle eût fait des profits records, que le salaire qu'elle versait à ses 300 employés était non conforme aux normes de l'industrie et a exigé des réductions de salaire de 1,50 $ de l'heure dans le nouveau contrat de travail. La grève a attiré l'attention dans le pays en raison de l’attaque particulièrement sauvage et inutile de la part de l'entreprise et après une guerre d'usure de 16 semaines, isolante et démoralisante, le syndicat a « gagné » un contrat de travail qui maintenait les niveaux de salaire et de retraite pour les seuls employés en poste, mais qui supprimait les retraites à pensions déterminées pour toutes les nouvelles embauches, réduisait les paiements correspondants à la « couverture santé de retraite » et obligeait les ouvriers à payer 20% des cotisations santé et la moitié de toute augmentation au-delà des premiers 10%. Malgré le cri de « victoire » du syndicat, même les syndicalistes pur jus se sont demandés si la grève avait vraiment été un succès.7
Plus récemment, dans les derniers jours de septembre, les dockers à Camden (New Jersey) et à Philadelphie se sont engagés dans une grève non officielle de deux jours contre Del Monte qui avait transféré 200 emplois dans un port non syndiqué à Gloucester (New Jersey), grève qui a été rejointe par des dockers, depuis le New Jersey jusqu’à Brooklyn, qui ont refusé de franchir le piquet de grève officieux. Dès le début de la grève, la New York Shipping Association a obtenu une injonction d'un juge fédéral de Newark déclarant la grève illégale et, le deuxième jour de l'action, l'ILA8 a désavoué toute association avec les grévistes, appelant les délégués syndicaux à renvoyer les piquets de grève au travail, et promettant qu'elle avait convaincu les associations de transport maritime et les patrons d'industrie de la rencontrer une semaine plus tard pour « discuter » des postes supprimés.
Bien que tous ces mouvements de grève soient restés, soit essentiellement, soit complètement, dans le carcan syndical et, en tant que tels, aient été défaits (en général accompagnés d'une déclaration de « victoire » de la part du syndicat), le retour de la classe sur le chemin de la lutte contribue au regain de la nécessaire confiance et au réapprentissage des leçons des luttes passées. Cela mettra en relief, de façon saisissante, le rôle des syndicats. Etant donné que les « victoires » qu'ils sont capables de gagner par des grèves d'une journée avec préavis, des guerres d’usure isolées, l'arbitrage du gouvernement fédéral, des recours collectifs, et le reste des règles du jeu syndicales, se révèlent être des défaites, la classe ouvrière à travers ses luttes devra réapprendre les leçons de l'auto-organisation et de l'extension que la classe dirigeante s'est tellement efforcée de lui faire l'oublier. Ces luttes sont une expression du même mouvement international de la classe ouvrière qui a amené des grèves en Grande-Bretagne, en Espagne, en Turquie et en Grèce face aux mesures d'austérité étatiques, une grève à l'échelle nationale en Inde, des grèves sauvages dans les usines d'automobiles en Chine et des mouvements de grève importants en Amérique latine. Le retour à la lutte et le rétablissement de la solidarité, la préoccupation de l'avenir et la volonté de faire grève pour le défendre sont une expression du retour de la classe ouvrière internationale à sa lutte historique et devrait partout être salué comme tel par les révolutionnaires.
JJ, 10/10/10.
(Internationalism, organe du CCI aux Etats-Unis, n° 156, octobre 2010/janvier 2011)
1 Voir Internationalism n° 154, “Against Mass Unemployment, The United Struggle Of The Whole Working Class”, https://en.internationalism.org/inter/154/lead [6]
2 Voir Internationalism n° 154 et 155, “Students in California Fight Back Austerity Attacks” (https://en.internationalism.org/inter/154/california-students [7]) and “Lessons of the California Students Movement” (https://en.internationalism.org/inter/155/california-students [8]).
3 Lerner, Maura. “Deal Was ‘a Win for Both Sides.” Minneapolis Star-Tribune. 2 juillet 2010.
4 Knowles, Francine. “State Loses Jobs but Gains in Manufacturing.” The Chicago Sun-Times. 20 août 2010.
5 La section syndicale 150 de l’IUOE syndique des ouvriers de la construction des Etats de l’Illinois, de l’Indiana et de l’Iowa, NDT.
6 Citation du blog du Chicago Union News.
7 Voir Elk, Mike. “Was the Mott’s ‘Victory’ Really a Victory?” Huffington Post. 14 septembre 2010.
8 L’International Longshoreman’s Association (ILA) est un syndicat de dockers de voies navigables intérieures et de la côte atlantique des Etats-Unis et du Canada, NDT.
Géographique:
- Etats-Unis [9]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [10]
Le "Daily Mail" démasque un complot du CCI
- 1966 lectures
Le 22 novembre, le journal Daily Mail a publié sur son site Web un article "analysant" la réaction des lycéens et étudiants face à l'augmentation des frais de scolarité. Ce journal "accuse" nommément notre organisation d'être l'un des acteurs principaux des actions de blocage et d'occupation.
Nos camarades vivant en Angleterre ont évidemment immédiatement réagi. Nous publions ci-dessous la traduction de l'article du Daily Mail et la réponse de Worl Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne.
L'article du Daily Mail
Des étudiants combatifs bloquent les portes des lycées en réaction à l'augmentation des frais de scolarité
"Des étudiants combatifs ont uni leurs forces à des communistes français pour bloquer les entrées d'établissements secondaires anglais, exhortant les élèves ayant à peine 15 ans à se mettre en grève par rapport aux frais universitaires de scolarité.
Les partisans de l'utilisation de la 'force légitime' pour tenter d'arrêter la hausse des frais ont été rejoints par des membres du Courant Communiste International (CCI) pour mobiliser des enfants encore en âge scolaire.
Les activistes veulent diffuser des tracts dans les établissements scolaires de tout le pays, lors de la dernière journée d'action, prévue pour mercredi.
Plus de 20 000 jeunes se sont inscrits pour participer à une 'grève nationale’ le mercredi. La majorité sont des élèves ou, tout au plus, des étudiants en formation continue.
Le groupe de campagne Education Activist Network a tenu une réunion de planification de la contestation, samedi, à Birkbeck College, Londres.
Celle-ci a vu la participation d'au moins un membre du CCI.
Le CCI a une longue tradition d'action directe datant de la contestation étudiante de 1968 qui a paralysé la France.
Le chef de file de l’EAN est Mark Bergfeld, 23 ans, qui a soutenu l'utilisation de la 'force légitime' pour faire tomber le gouvernement et qui a appelé à 'dresser des barricades dans les écoles'.
M. Bergfeld, qui fréquente l'Université d'Essex, a déclaré lors de la réunion de samedi: ‘Ce que vous pouvez faire, c'est, entre aujourd'hui et le 24, donner des tracts à l'extérieur des écoles pour qu'ils sachent ce que nous faisons. Ainsi, ils pourront vous rejoindre ce jour-là.’
Étaient également présents des employés de la mairie et du Service de Santé, des enseignants et des professeurs d'université."
Notre réponse
Notre première réaction à cet article dans le Daily Mail fut celle d'une hilarité générale. La seconde pensée fut « pas de publicité est une mauvaise publicité ». Mais la troisième fut : « Qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? »
La théorie du complot du journalisme bourgeois, qui ne peut jamais envisager un véritable mouvement de révolte qui viendrait de la base mais qui doit toujours remonter à quelque Moriarty1 diaboliquement rusé, qui tisse sa toile dans l'ombre, a une longue histoire, remontant certainement à l'époque de Marx et de la Première Internationale. La presse capitaliste avait l'habitude de critiquer l'Association Internationale des Travailleurs parce qu'elle attisait tout acte de résistance à l'ordre bourgeois, de la plus petite grève locale à la puissante Commune de Paris, en 1871. L'Internationale avait une certaine influence à cette époque, bien sûr, mais ce n'était rien comparé à la version très exagérée, évoquée par les serviteurs de la classe dirigeante.
Nous sommes un groupe minuscule. Nous participons à la lutte de classe du mieux que nos forces le permettent et, oui !, nous avons été actifs dans un certain nombre de discussions, de réunions et de manifestations qui font partie du mouvement actuel des étudiants contre les frais de scolarité et l'abolition des paiements EMA. Nous étions en effet présents à la réunion de EAN citée plus haut. Nous sommes fiers d'être une organisation internationale (ce qui est évidemment différent d'en être une uniquement française) et on peut en effet faire remonter nos origines à l'énorme vague de grèves qui a secoué la France en mai 1968.
Mais nous n'avons pas la prétention d'être les organisateurs du mouvement actuel - nous ne pensons même pas que c'est notre rôle. Il n'y a toutefois guère de raisons de polémiquer avec le Daily Mail, parce qu'il se moque de savoir si, oui ou non, ses écrivaillons croient qu'ils ont vraiment découvert la puissance secrète derrière la rébellion actuelle de la jeunesse ouvrière au Royaume-Uni.
La véritable raison de cet article et d'autres similaires est ailleurs. Et il y a bien eu un certain nombre d'articles du même genre récemment : des groupes anarchistes, comme Solidarity Federation et Anarchist Federation ont été identifiés comme les organisateurs de l'occupation et du saccage du siège du Parti Conservateur, en novembre 2010, et après l'événement lui-même, un article particulièrement pernicieux a été publié dans le Daily Telegraph qui désigne un intervenant sur le forum Internet de Libcom, en le nommant, ainsi que son père, et en insinuant, sans aucune preuve, qu'il était directement responsable des dommages causés à Millbank.
Des 'exposés' de ce type visent à discréditer les révolutionnaires et les organisations révolutionnaires, à les faire paraître aussi sinistres et peu attractives que possible, et, finalement, à créer une atmosphère où elles peuvent être directement attaquées par les forces de l'ordre. Après tout, nous préconiserions 'la force légitime' et nous serions même prêts à attirer d'innocents écoliers dans nos projets diaboliques. Et bien sûr, nous serions des étrangers, alors pourquoi devrions-nous même être tolérés ici ?
Le 'kettling' (l'encerclement, ndt) de la manifestation étudiante du 24 novembre à Londres a été une démonstration de force flagrante visant à intimider un mouvement que la bourgeoisie n'est pas encore certaine de pouvoir contenir, notamment parce qu'il n'obéit pas aux règles habituelles de l'engagement que les syndicats et la gauche doivent normalement imposer. Les insinuations contre les anarchistes et les communistes sont une autre expression du même genre de réaction de la classe dirigeante. Elles correspondent à son besoin de bloquer un processus émergent de politisation chez les jeunes, une politisation qui menace d'aller bien au-delà de la fausse opposition offerte par la gauche capitaliste.
Il n'est pas ici nécessaire d'envisager un complot : ce genre de réaction est presque aussi «spontané » pour la classe dirigeante qu'une manifestation organisée sur Facebook. Mais il y a aussi de la conscience dans cela : nos dirigeants apprennent de ce qui s'est passé avant et de ce qui se passe ailleurs. Ils ont en face d'eux les images de la Grèce et de la France, par exemple, où, dans les récents mouvements contre l'austérité, nous avons vu des minorités petites, mais bien visibles, posant des questions très politiques : l'auto-organisation et l'extension des luttes, l'avenir que la société capitaliste nous réserve. Les étudiants en Grande-Bretagne soulèvent également la question de l'avenir et la classe dirigeante préfererait éviter qu'ils soient encouragés à se concevoir comme partie d'un mouvement allant dans la direction de la révolution.
World Revolution (27 novembre 2010)
1 Moriarty est l'ennemi juré de Sherlock Holmes, grand criminel prêt à tous les complots et coups fourrés.
Géographique:
- Grande-Bretagne [11]
Les révoltes dans les universités, les collèges, les écoles en Grande-Bretagne sont un phare pour toute la classe ouvrière
- 2411 lectures
Toute une série de manifestations de haut en bas du pays: grèves des universitaires, dans la formation continue, étudiants des écoles supérieures et des lycées, occupations pour une longue liste d'universités, de nombreuses réunions pour discuter de la voie à suivre ... la révolte des étudiants et élèves contre la hausse des frais de scolarité et l'abolition des paiements EMA est toujours en marche. Les étudiants et ceux qui les soutiennent sont venus aux manifestations de bonne humeur, fabriquant leurs propres bannières et leurs propres slogans, certains d'entre eux rejoignant pour la première fois le mouvement de protestation, beaucoup d'entre eux trouvant de nouvelles façons d'organiser les manifestations. Les grèves, manifestations et occupations ont été tout sauf ces sages événements que les syndicats et les 'officiels' de la gauche ont habituellement pour mission d'organiser. Les débrayages spontanés, l'investissement du siège du parti conservateur à Millbank, le défi face aux barrages de police, ou leur contournement inventif, l'invasion des mairies et autres lieux publics, ne sont que quelques expressions de cette attitude ouvertement rebelle. Et le dégoût devant la condamnation des manifestants à Millbank par Porter Aaron, le président du NUS (Syndicat National des Etudiants) s'est tellement répandu qu'il a dû présenter ses plus plates excuses.
Cet élan de résistance à peine contrôlée a inquiété nos gouvernants. Un signe clair de cette inquiétude est le niveau de la répression policière utilisée contre les manifestations. Le 24 novembre à Londres, des milliers de manifestants ont été encerclés par la police quelques minutes après leur départ de Trafalgar Square, et malgré quelques tentatives réussies pour percer les lignes de police, les forces de l'ordre ont bloqué des milliers d'entre eux pendant des heures dans le froid. A un certain moment la police montée est passée directement à travers la foule. A Manchester, à Lewisham Town Hall et ailleurs, nous avons des témoignages de déploiements similaires de la force policière brutale. Après Millbank, les journaux ont tenu leur partition habituelle en affichant des photos de présumés 'casseurs', faisant courir des histoires effrayantes sur les groupes révolutionnaires qui prennent pour cible les jeunes de la nation avec leur propagande maléfique. Tout cela montre la vraie nature de la 'démocratie' sous laquelle nous vivons.
La révolte étudiante au Royaume-Uni est la meilleure réponse à l'idée que la classe ouvrière dans ce pays reste passive devant le torrent d'attaques lancées par le nouveau gouvernement (en continuité avec le précédent gouvernement) sur tous les aspects de notre niveau de vie: emplois, salaires, santé, chômage, prestations d'invalidité ainsi que l'éducation. Elle est un avertissement pour les dirigeants que toute une nouvelle génération de la classe exploitée n'accepte pas leur logique de sacrifices et d'austérité. En cela, les étudiants font écho aux luttes massives qui ont secoué la Grèce, la France et l'Italie, et qui menacent d'exploser en Irlande, au Portugal et dans de nombreux autres pays.
Mais la classe capitaliste, face à la pire crise économique de son histoire, ne se contente pas de pratiquer la politique de l'autruche devant nos exigences. S'ils font ces attaques, ce n'est pas par idéologie, mais c'est la logique matérielle même de leur système moribond qui les y oblige. Et pour les contraindre à faire même les concessions les plus temporaires, nous devons réaliser leur plus grande crainte: une classe ouvrière qui est organisée, unie et consciente de ce pourquoi elle se bat.
Ceci n'est pas une utopie. C'est déjà en train de prendre forme devant nous. La capacité d'auto-organisation peut être vue dans les initiatives des manifestants dans les rues, et l'insistance par rapport à la prise de décision collective dans les occupations et dans les réunions, dans le rejet de la manipulation par les candidats à la bureaucratie, quelle que soit leur prétention d'appartenir à la 'gauche'. La tendance à l'unification de la classe ouvrière peut être perçue quand les enseignants , les parents, les retraités, les travailleurs d'autres secteurs ou les chômeurs participent aux assemblées générales dans les bâtiments universitaires occupés ou rejoignent les manifestations d'étudiants, lorsque les étudiants vont à la rencontre des piquets de grève des travailleurs du métro. La conscience par rapport aux objectifs du mouvement peut être vue à la fois dans la formulation d'exigences claires pour aujourd'hui et dans la prise de conscience croissante que cette société ne peut pas nous offrir un avenir humain.
Mais nous devons également discuter de la façon avec laquelle nous devons poursuivre ces efforts, car ils ne sont qu'un début. A notre avis qui, nous le pensons, est basé sur l'expérience des luttes passées et présentes de la classe ouvrière, il y a des mesures concrètes qui peuvent être prises dès maintenant, même si leur forme exacte peut varier d'un endroit à l'autre :
- Pour que la lutte reste sous notre contrôle, pour rendre efficientes les décisions qui sont prises collectivement et non pas imposées d'en haut, nous avons besoin d'organiser des réunions massives dans les écoles, les collèges et les universités, ouvertes aux étudiants et aux employés. Tous les comités et toutes les coordinations qui parlent au nom de ces réunions doivent être élus et révocables.
- Nous devons établir des liens directs entre les différentes écoles, collèges et universités. Ne pas les laisser dans les mains de l'appareil syndical ou de leaders auto-proclamés.
- Pour élargir le mouvement au-delà du secteur de l'éducation, les étudiants ont besoin d'aller directement à la rencontre des travailleurs salariés, dans les usines, bureaux et hôpitaux les plus proches et des bureaux, en leur demandant de venir à leurs réunions, de se joindre leurs occupations et manifestations, de marcher de concert avec eux et de porter leurs revendications dans une lutte commune contre l'austérité et la répression.
David Cameron ne cesse de nous répéter que nous sommes tous dans le même bateau. Et il est certainement dans le même bateau que celui de sa classe et de son Etat et de ses partis, y compris le parti travailliste, tout autant que les libéraux-démocrates et les conservateurs. Tous sont dans la même embarcation pour sauver le système capitaliste, à nos frais. Mais nous, nous sommes liés à tous ceux qui sont exploités et opprimés par ce système, dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, nous sommes unis pour nous défendre contre encore plus d'exploitation. Demain nous serons unis pour mettre un terme à l'exploitation.
(2 décembre 2010)
Tract diffusé dans les récentes luttes et manifestations par "World Revolution", organe de presse du CCI en Grande-Bretagne.
Géographique:
- Grande-Bretagne [11]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [10]
Manifestations étudiantes/ouvrières : nous avons besoin de contrôler nos propres luttes ! (tract)
- 1690 lectures
Le tract ci-dessous a été distribué lors de la grande assemblée tenue au King's College le lundi 15 novembre, sous l'égide de l'aile gauche des syndicats (Education Activists Network). Nous saluerions tous commentaires, toutes critiques, et surtout, proposition de distribution ou d'amélioration et de mise jour, dans la semaine qui précède le Jour de l'Action. Un camarade de la section du CCI de Toulouse, qui a été très actif dans le mouvement pour les comités de lutte et les assemblées, a pu prendre la parole lors de la réunion, et en dépit d'une attaque frontale de la part de la stratégie syndicale française, a été largement applaudi. Nous allons essayer de rassembler plus d'éléments sur cette réunion.
Pendant longtemps, il a semblé que la classe ouvrière en Grande-Bretagne était réduite au silence devant la brutalité des attaques lancées par le nouveau gouvernement : contrainte des personnes handicapées de retourner au travail, obligation pour les chômeurs de travailler pour rien, augmentation de l'âge de la retraite, coupes budgétaires féroces dans le secteur de l'éducation, des centaines de milliers d'emplois supprimés dans le secteur public, le triplement des frais de scolarité universitaire et l'abolition des EMA (indemnités pour frais de scolarité ) pour les étudiants de 16 à 18 ans ..., la liste est interminable. Les luttes ouvrières qui ont eu lieu récemment à British Airways, les employés du métro, chez les pompiers, ont toutes été maintenues dans un strict isolement.
Mais nous sommes une classe internationale et la crise de ce système est également internationale. En Grèce, en Espagne, et plus récemment France, il y a eu des luttes massives contre les nouvelles mesures d'austérité. En France, la réaction contre la 'réforme' de la retraite ont provoqué un mécontentement croissant dans la société mais surtout parmi les jeunes.
L'énorme manifestation à Londres du 10 novembre a montré que le même potentiel de résistance existe au Royaume-Uni. La taille de la manifestation, la participation des étudiants et des travailleurs de l'éducation, le refus de se limiter à une sage marche d'un point à un autre, tout cela exprime le sentiment qui va grandissant que nous ne pouvons accepter la logique d'agression de l'Etat contre nos conditions de vie. L'occupation temporaire du siège des conservateurs n'était pas le résultat d'un complot ourdi par une poignée d'anarchistes, mais le produit d'une colère beaucoup plus large, et la grande majorité des étudiants et des travailleurs qui ont soutenu la manifestation ont refusé de s'associer à la condamnation de cette action par la direction du NUS et par les médias.
Beaucoup l'ont dit : cette manifestation n'est qu'un début. Déjà une deuxième journée d'action et de manifestation est organisée pour le 24 novembre. Pour l'instant, ces actions sont organisées par des organismes 'officiels' comme le NUS qui ont déjà montré qu'ils font partie des forces de l'ordre. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas participer massivement aux manifestations. Au contraire, se rassembler en grand nombre possible est la meilleure base pour la création de nouvelles formes d'organisation qui peuvent exprimer les besoins réels de la lutte.
Avant de telles manifestations ou journées d'action, comment pouvons-nous aller de l'avant ? Nous avons besoin d'appeler des réunions et des assemblées générales dans les universités, les collèges et les écoles, ouvertes à tous les étudiants et travailleurs, à la fois pour renforcer le soutien aux manifestations et pour discuter de leurs objectifs.
L'initiative prise par quelques camarades pour former des 'blocs d'étudiants et travailleurs radicaux' dans les manifestations doit être soutenue, mais, dans la mesure du possible, ils devraient se réunir à l'avance pour discuter exactement sur comment ils entendent exprimer leur indépendance par rapport aux organisateurs officiels.
Nous avons besoin d'apprendre des expériences récentes en Grèce, où les occupations (y compris l'occupation du siège des syndicats), ont été utilisées pour créer un espace où les assemblées générales pouvaient avoir lieu. Et quelle a été l'expérience en France ? Nous avons vu une importante minorité d'étudiants et de travailleurs dans de nombreuses villes tenir des assemblées de rue non seulement à la fin des manifestations, mais sur une base régulière, alors que le mouvement allait de l'avant.
Nous devons aussi être clairs qu'à l'avenir, les forces de l'ordre ne se contenteront plus d'une approche toute en douceur, comme celle du 10 novembre. Ils seront équipés en conséquence et chercheront à nous provoquer dans des affrontements prématurés qui leur donneront un prétexte pour déployer leur force. Cela a été une tactique courante en France. L'organisation de l'auto-défense et de la solidarité contre les forces de répression a besoin d'être créée grâce la discussion et aux décisions collectives.
La lutte ne doit pas se faire seulement dans le secteur de l'éducation. La classe ouvrière tout entière est soumise aux attaques et la résistance doit être étendue de façon consciente, à la fois dans les secteurs publics et privés Contrôler nos propres luttes est le seul moyen de les étendre.
Courant Communiste International, 15/11/2010.
Vie du CCI:
Géographique:
- Grande-Bretagne [11]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [10]
Notes de lecture: Bruno Astarian, Luttes de classes dans la Chine des réformes (1978-2009)
- 3135 lectures
Chine: L'empereur a-t-il encore des habits ?
Dans l'article 'Le capitalisme mondial au tournant de la crise (1), dans 'Le prolétaire'n°497 de juil-oct 2010', il y avait déjà des données intéressantes qui semblent aller dans le sens du cadre d’analyse présenté dans le livre que nous commentons ci-dessous. On y constate aussi que, bien que la Chine soit «le premier producteur mondial d'électroménager, de composants électroniques, de matériaux de construction, le deuxième producteur dans la chimie (…) une caractéristique peu connue mais très importante de l'économie chinoise actuelle [est]: la domination du capital étranger sur les secteurs les plus dynamiques et les plus productifs de l'industrie».
Il arrive assez peu qu'un petit livre d'à peine 180 pages puisse donner autant d'informations et d'analyses qui permettent d'avoir un cadre clair sur un sujet aussi vaste que l'émergence économique de la Chine actuelle. Et pourtant, c'est bien le cas avec le livre de Bruno Astarian 'Luttes de classes dans la Chine des réformes (1878-2009)'.(2)
En fait comme le signale l'auteur lui-même l'essentiel du matériel du livre avait été élaboré avant la crise financière. Selon lui: «Il n'y a pas de pays, et dans chaque pays une classe capitaliste et son prolétariat, mais il existe un capital et un prolétariat mondiaux, segmentés en pays par des États, comme ils le sont en entreprises par des capitalistes».
«D'un point de vue temporel, ce texte vient trop tard où trop tôt : trop tard parce qu'il a été rattrapé par la crise mondiale... et trop tôt parce qu'il est certain que l'approfondissement de cette crise imposera de corriger et d'approfondir la réflexion...»
D'un point de vue théorique le livre pose de nombreuses interrogations, qui vont du capitalisme d'État à la révolution mondiale, en passant par le développement endogène du capital national à notre époque... et en analysant le fait que beaucoup de médias en Occident proclament que la Chine sera la prochaine puissance mondiale. C'est d’abord à ce questionnement qu'essaie de répondre ce livre.
D’emblée, il faut saluer le travail de recherche de l'auteur et son courage d'aller à l'encontre des idées reçues, comme celle qui affirme que la Chine monte inexorablement vers l'hégémonie mondiale. Il essaie de contrer ces affirmations souvent gratuites par une argumentation, chiffres à l'appui, sans pour autant alourdir le texte et en comprimant toutes ces informations dans 160 pages bien synthétisées en 6 chapitres clairs et lisibles.
Dans les chapitres 1 à 3, il analyse essentiellement la composition du capital chinois au sein du pays et sa place sur l’échiquier mondial entre les autres requins impérialistes.
En parcourant les différentes étapes depuis les réformes, l'auteur constate que les entreprises privées, qui se sont développées après les réformes de 1978, se sont trouvées étouffées par le manque de crédit et la reprise en main des autorités locales: «Ces quelques éléments n'augurent pas bien d'un développement 'endogène' d'un capitalisme chinois appelé à dominer le monde – voire le seul territoire chinois … L'hypothèse … d'un développement autocentré d'un petit capitalisme chinois en grand capitalisme national puis international est bloqué par la saturation du monde en capital. … Comment faire le recentrage de l'économie chinoise sur son marché intérieur … si la faiblesse des salaires urbains et celles des revenus agricoles est le principe même de la survie du capitalisme chinois dans la concurrence internationale» (p.21)
En ce qui concerne le fameux transfert technologique si 'redouté' par les médias occidentaux et le Japon, l'auteur constate que «depuis l'adhésion à l'OMC, la Chine a dû accepter que les investissements étrangers puissent se faire sans co-entreprise, de sorte que «la plupart des investissements étrangers basés sur la technologie se situent maintenant dans des entreprises entièrement contrôlées par l'étranger» (R & D, but mostly D, China Economic Quarterly, 2003, IV). Autant pour les transferts de technologie»(p.31). Il s'avère donc que là aussi les informations qu'on reçoit par la presse bourgeoise sont pour le moins exagérées: «Les médias placent la recherche chinoise en haut du tableau des pays scientifiques … Mais si on tient compte de la valeur qualitative de la recherche, la Chine tombe à la dixième place (Les Echos, 24 février 2009) (p.32).. Sur le vaste marché dont se vantent les médias il voit la aussi qu'il «est déjà proche de la saturation» (p.33). En fait: «Pour ne pas mourir, il va falloir se développer. Pour se développer, il va falloir investir. Pour investir, il va falloir du crédit. Or les entreprises privés n'en obtiennent pas, ou peu, des banques chinoises».(p.34)
Est-il donc étonnant que la seule compagnie qui fleurisse (Huawei, télécommunications, avec un personnel de 34.000 personnes dans le monde) «ne publie pas de comptes et est comme par hasard lié à l'armée (qui se soucie peu de la rentabilité de l'affaire) et a pu bénéficier en 2004 d'un crédit de 10 milliards de dollars de la China Development Bank (banque publique)». (p.36). Hors depuis l'entrée en décadence du capitalisme, les pays qui ont davantage dû investir dans leur secteur militaire au détriment des autres secteurs, ont toujours été les régimes impérialistes en position de faiblesse.
Il en arrive à la conclusion que bien qu'il y ait des essais de la part de l'État et du PCC de se mettre en valeur, ils sont tout à fait pris dans les étaux d'une contradiction insoluble :
Après avoir recherché comment est organisé le capitalisme endogène il en arrive à la conclusion que : «Les aides et protections dont bénéficient les entreprises chinoises publiques et privées semblent plus importantes et nécessaires qu'ailleurs.(...) Contrairement à l'image d'un capitalisme chinois triomphant, cet état de fait n'exprime-t-il pas plutôt une faiblesse? En plus l'auteur constate que «la crise actuelle accentue … le protectionnisme régional. La fragmentation du territoire et de l'économie entraine un surinvestissement systématique» et il en donne un exemple, cité du livre de Christian Milelli (3): «Dans le Delta de la Rivière des Perles (région de Canton/Shenzhen), on trouve cinq aéroports, sans aucune connexion entre eux, dans un rayon de 90 kilomètres» (32) (p.38). Pour lui, en se basant sur des données de Jean-Louis Rocca '4) , il est donc évident que : «le capitalisme chinois réformé … requiert cependant tant de protections et d'aides qu'on est en droit de parler d'un 'capitalisme peu conquérant', vivant de rentes et de monopoles locaux» (33) Il mentionne une autre auteur (Marie-Claire Bergère)(5) qui avait aussi souligné les effets peu prometteurs des réformes et de la vision à long terme, qui est court-circuitée par la corruption et des politiques à court terme : «l'amélioration de la rentabilité des entreprises de l'État après leur réforme est en partie due à la privatisation des logements et de la dānwèi [système] «qui garantissait à ses membres un travail, mais aussi leur logement, leur santé, la maternité, l'éducation des enfants, les retraites... Ces avantages pouvaient représenter jusqu'à 120% du salaire versé en argent» !!!! (p.11) … à peu près 250 milliards de dollars» (p.35). «Cet argent était censé être placé dans un fonds spécial de réserve. Il l'a rarement été, et est donc parti avec les dépenses courantes». On peut donc se demander où reste donc la marge de manœuvre du capital national chinois ? Et très logiquement l'auteur conclut : «Cette image est évidemment contradictoire avec le sentiment général en Occident que la Chine est la prochaine grande puissance du monde»
Il fait aussi le constat très juste que le battage sur la puissance de la Chine sert plutôt à faire du chantage envers le prolétariat occidental et japonais : «En revanche, on ne peut refuser à tous ces entrepreneurs privés et publics le compliment que leur adressent leurs collègues du monde entier en investissant en Chine : ils sont absolument féroces avec leurs prolétaires».(p.39)
Pour le reste il y a deux chapitres: sur les paysans et le système 'hừkŏu' (permis de résidence, attaché à un lieu précis), «document administratif qui permet à l'État chinois un fichage policier nécessaire pour que la dictature du PCC dispose d'un quadrillage policier». (p.48)
A travers des chiffres sur la productivité de la paysannerie apparaît une fois de plus comment cette situation est une preuve accablante des contradictions du capitalisme et de son incapacité d'intégrer l'ensemble de la population paysanne dans la modernisation de l'agriculture capitaliste. Tout au plus le capital chinois peut utiliser cette masse de paysans sous-productifs comme un chantage contre la classe ouvrière dans son ensemble, au moyen de salaires extrêmement bas pour les ouvriers migrants. «Si l'agriculture chinoise élevait sa productivité au niveau de la moyenne mondiale … cela libérerait pratiquement 300 millions de candidats à la prolétarisation !!!» (p.53) «Pour porter la surface moyenne des exploitations à un hectare, ce qui est très peu, mais le double de la situation actuelle), il faudrait expulser environ 150 millions de paysans, ce qui est énorme» (p.59). Sans être exhaustif, l'auteur se limite à citer plusieurs révoltes selon leurs raisons: à cause d'impôts excessifs, de confiscations de terres, des tarifs de bus, de la politique de l'enfant unique (qui est exécutée souvent de façon féroce), révoltes auxquelles participent chaque fois plusieurs milliers de paysans (p.61). Là il faut sans doute se référer à d'autres œuvres qui donnent des informations plus amples.
Le prolétariat chinois et ses conditions de vie épouvantables
L’auteur nous donne des informations intéressantes sur ce sujet peu connu depuis les réformes de 1978. Il distingue d'abord les deux fractions du prolétariat chinois: le 'vieux' prolétariat des vieilles industries étatisées et les míngōng, les ouvriers et ouvrières surexploités venant de l'exode rural (pour l'essentiel des sans-papiers de l'intérieur), qui travaillent surtout dans des nouvelles industries, privées pour la plupart. Selon l'agence Xinhua le 16 juin 2007, il y en aurait 120 millions dans les grandes villes et 80 millions dans les petites, donc presque un tiers de la population active totale d'environ 750 millions (p.64). L'auteur fournit des données importantes à propos de cette surexploitation: durée hebdomadaire de 98 heures avec un jour de repos par mois(!), calcul scandaleux des salaires avec des heures non payées, considérées comme volontaires (!), systèmes d'amendes (!) pour baisser les salaires, frais de séjour pour des logements insalubres et une bouffe épouvantable, retard dans le payement des salaires pour empêcher que les travailleurs s'en aillent, etc... (pp. 68-71). Pourtant les ouvriers réagissent souvent et en dépit de la grave répression, forcent de temps en temps les patrons escrocs à reculer, obtiennent des hausses de salaires presque annuelles (+ 2,8 en 2004; +6,5% en 2005; + 11% en 2006) jusqu'en 2008, où le gouvernement a ordonné le gel des salaires minimaux (p.73). Mais ces travailleurs migrants doivent lutter durement pour chaque amélioration minimale, comme pour la scolarisation de à peu près 20 millions de leurs enfants qui se retrouvent en ville.
Les 'vieux' travailleurs du secteur public se sont battus surtout contre le démantèlement du système de dānwèi, l'unité du travail (qui garantissait emploi à vie, logement, scolarisation des enfants, etc..). Si pendant la première période de réformes le nombre de salariés a augmenté considérablement jusqu'en 1995, après il baisse de 113 à 64 millions en 2006 (!) (...) Du point de vue des travailleurs, cette évolution a été d'une rapidité, d'une brutalité et d'une profondeur difficilement imaginable en Occident. Elle a donné lieu à d'importants conflits sociaux» (pp. 83-84)
Ce sont précisément ces luttes contre la loi de 1995, qui met officiellement fin à l'emploi à vie, qui ont débouché sur «une nouvelle loi sur le contrat de travail en 2008, qui est plus favorable aux travailleurs que le précédent texte (de 1995), et dont les représentants de l'Union Européenne et des États-Unis ont essayé d'infléchir la rédaction» (!!!!) (p.85). Et encore, comme toujours, faut-il se méfier de son application réelle. Une autre donnée importante est: «qu'il ne semble pas avoir eu de concurrence massive entre les migrants et les licenciés des entreprises publiques»(p. 90).
Les luttes les plus importantes durant les trois décennies, allant de 1978 à 2008
Il est curieux que l'auteur ne mentionne aucune lutte avant et autour de la répression de Tian An Men, qu'on peut retrouver dans un excellent livre publié à Hong Kong en 1990, mais apparemment retiré sous pression de Beijing (2). En fait il n'y réfère qu'indirectement quand il traite de la répression «des 'syndicats libres', florissants en 1989, en citant Han Dongfeng, qui mentionne que la 'Beijing Workers Autonomous Federation'(…) fondée par les étudiants, n'avait pas d'adhérents ouvriers, car ceux-ci se méfiaient» (6) (p.132). En conséquence l'auteur ne mentionne que les luttes depuis 1997: Quand le gouvernement a décidé «de 'lâcher les petites pour maintenir les grandes entreprises'. Il y a eu alors une importante vague de luttes, parfois insurrectionnelles (... ) Certaines luttes cherchèrent à s'organiser durablement en fondant un syndicat à la base. Ce sont celles qui furent le plus durement réprimées (…) ces luttes importantes mais numériquement faibles par rapport aux millions d'ouvriers concernés par les restructurations ne parvinrent jamais à ébranler le pouvoir (…) Combiné à la répression, un semblant de prise en charge du chômage, l'apparition d'emplois dans le privé et les multiples combines de survie ont permis … de faire refluer la vague des luttes en défense de la dānwèi (pp. 10-101).
Cependant il y a eu d'importantes luttes insurrectionnelles: en février 1997, 20.000 mineurs licenciés à Yang-jiazhang (Liaoning), bloquant la ville plusieurs jours; en juillet 1997 de véritables émeutes éclatent dans le Henan et le Shandong; au même moment à Mianyang (Sichuan), 100.000 personnes se rassemblent; entre 1997 et 1998, de nombreuses révoltes dans le Heilongjiang et en 1988 à Pun Ngai à cause du retard de huit mois des salaires, etc... Beaucoup de ces conflits se terminent par des offres de mise à la retraite qui ne sont pas tenues (p.102).
Mais ensuite il y a eu des conflits beaucoup plus durs parce que les autorités ou les entreprises ne se tiennent presque jamais aux accords conclus: de 2000 à 2002, les travailleurs du pétrole du Nord-Est contre la restructuration et des dizaines de milliers de licenciements, une lutte qui dure plusieurs années; à Daqing (Heilongjiang) contre 80.000 licenciements allant jusqu'à des manifestations de 50.000 personnes et des blocages de trains vers la Russie et des manifestations de solidarité d'autres travailleurs du pétrole; à Fashun en 2001, quand 300.000 travailleurs du charbon, du ciment, etc. furent transformés en 'xiagang'(…) 10.000 d'entre eux tentèrent des barrages réguliers de routes et de voies ferrées pendant plusieurs semaines; en mars 2002 au complexe métallurgique Liaoyang Tiejehin où le non-respect des promesses et les mensonges provoquent des grèves et manifestations de solidarité allant jusqu'à 30 ou 80.000 personnes (...) suivies par une répression systématique» (pp.104-106).
«Aiqing Zheng signale que pour la seule année 1994, il y a eu 12.000 'conflits collectifs' du travail dans les entreprises publiques. Dans 2.500 cas, les ouvriers ont occupé les locaux, détruit des machines, pris en otage des dirigeants du parti ou de l'entreprise (7) . En 2002 la province de Anhui promulgua un règlement pour protéger les patrons, car plusieurs d'entre eux avaient récemment été assassinés» (p.107)
Un rapport du CLB (8) confirme que les luttes des travailleurs licenciés des entreprises de l'Etat et celles des travailleurs migrants sont «de plus en plus souvent rejointes par la lutte des salariés des entreprises d'Etat restructurées ou privatisées. Parfois aussi les travailleurs (cfr supra) payent durement leurs illusions de créer un syndicat, «même en pensant à se faire enregistrer à la FSC (Confédération Syndicale Unique) comme en 2004 à Xianyang (Shaanxi), où les meneurs sont arrêtés. Depuis 2005 on a aussi connu des grèves pour des augmentations de salaires, dans la Changha Lead-Zinc Mine et dans le textile: Feyia Textile Company à Huabei (Anhui) et Heze Textile Factory (Shandong), des entreprises d'Etat. Preuve que la 'vielle' classe ouvrière développe aussi des luttes plus offensives» (p.109-110).
L'auteur fournit encore quelques exemples de luttes de la 'nouvelle' classe ouvrière, qui démontrent que même en absence d'expérience historique, la colère des ouvriers provoque des luttes assez impressionnantes: «en 2004 à Dongguan, chez Stella International et chez Xing Ang Shoe Factory, dans les usines Xing Lai et Xing Peng les travailleurs, avec l'implication très active des femmes, ont obtenu une augmentation de leurs salaires, un conflit relaté par le CL qui déplore que dans les usines Xing Xiong et Xing Ang, ils n'aient pas eu de représentants, comme dans le autres deux usines, car cela aurait permis d'éviter les violences: 'Ces travailleurs non-organisés sont plus dangereux' car ils sont plus enclins aux débordements» [sic]; «en 2005 chez Uniden (Shenzhen) qui emploie 16.000 ouvrières à la fabrication de téléphones pour Wal-Mart [multinationale US très anti-syndicale], à cause de la non-tenue des promesses lors de la première grève, les ouvrières ont tenu une AG permanente (...) avec comité de grève élu de 29 membres, avec dix ouvrières arrêtées après la grève et condamnées à trois ans et demi de prison, mais amnistiées après une campagne internationale (!); été 2005 à Dalian avec une vague de grèves dans plusieurs usines ; en novembre 2007 chez Alco Holding à Dongguan contre l'augmentation des prix de la cantine; en janvier 2008 chez Maersk encore à Dongguan (au port de Machong) contre les amendes et chicaneries des gardes de l'usine. Selon Han Dongfen (6) il y a chaque jour au moins une grève de plus de 1.000 grévistes dans le Delta de la Rivière des Perles (source Radio Free Asia)» (pp. 112-118).
«Depuis la crise, le gouvernement estime qu'il y avait 20 millions de migrants au chômage depuis 2008 sur lee 200 millions de migrants en tout» (p.120). D'autres sources parlent de 30 millions et des nouveaux projets gouvernementaux de construction de villes intermédiaires (pour des millions de migrants) pour les occuper et en même temps pour empêcher qu'ils restent en ville ou qu'ils retournent à la campagne où ils causeraient des problèmes sociaux. Mais ce n'est qu'un déplacement temporaire du problème de l’impossibilité de les intégrer de façon durable dans la classe ouvrière.
Le livre traite aussi des luttes de la nouvelle classe ouvrière jusqu'à la crise de 2008 et s’arrête au moment du gel des salaires minimaux. Comme l'auteur le dit, il n'est pas toujours facile d'interpréter les sources qui utilisent souvent la notion d'«incidents de masse», qui «recouvrent les grèves, les manifestations, les émeutes, aussi bien en milieu urbain qu'à la campagne. C'est un indicateur très flou, qui donne une idée générale de la montée des luttes depuis quinze ans: 1993: 8.700; 1994: 12.000; 1998: 25.000; 1999: 32.000; 2000: 40.000; 2002: 50.000; 2003: 58.000; 2004: 74.000; 2005: 87.000; 2006: 90.000; 2007 (estim.) 116.000; 2008 (estim.): 127.000; 2009 (1er trim): 58.000» (p. 123). Donc une montée impressionnante.
Beaucoup d'éléments sont aussi fournis sur les moyens de luttes et «le relatif succès de la police à empêcher les ouvriers de sortir de l'usine pour chercher la solidarité de la population extérieure, le succès du gouvernement à acheter la paix sociale, le recours à la violence en l’absence de toute médiation sociale (…) En l'absence de données plus précises (…) on ne peut que conclure très provisoirement que le contexte de la lutte pousse plutôt les travailleurs à chercher à sortir des solidarités qu'à s'enfermer (…) une tendance (…) positive du point de vue d'un processus révolutionnaire éventuel» (p.125-126).
Pour notre part, nous exprimerons certaines réserves quand l’auteur traite de la question syndicale. Pour lui il «ne s'agit pas de savoir s’il faut être pour ou contre les syndicats libres. Les syndicats sont un rouage normal de la lutte des classes (..), mais il sont défavorables à la révolution (..) mais peut être, dans certaines circonstances, un instrument efficace de marchandage de la force de travail. En fait si on voit ce qu'a fait le syndicat 'libre' Solidarnosc à partir de 1980 pour saboter les luttes autonomes du prolétariat en Pologne, on ne comprend pas en se référent à l'histoire (mille fois confirmée) et aux luttes en Chine même, en quoi cela serait différent en Chine.
Quel avenir pour la Chine capitaliste et le prolétariat chinois?
L'auteur conclut à juste titre que la crise réduit en miettes toutes les illusions: «il n'y a pas de place dans le monde pour une Chine dont la consommation ouvrière 'monte en gamme'. Sa place est celle de pourvoyeuse de plus-value absolue, d'ouvriers misérables, etc (…) il n'y a pas de place pour un nouveau club de sociétés multinationales qui domineraient le monde. Celui que constitue l'axe États-Unis-Union Européenne-Japon occupe déjà tout le terrain» (p.163).
Pour le futur des luttes, il souligne que chez le prolétariat chinois, «vivant dans un extrême précarité, en n’ayant pas d'illusion sur l'autogestion … il est probable que l'absence … de tradition ouvrière chez les travailleurs migrants est aussi un facteur favorable à un dépassement non économique de la crise … en plus de la place importante des femmes … qui ne reculent pas devant les nécessités de la lutte» (p. 167)
Et il finit par se poser quelques questions légitimes qui découlent de son analyse: «Le prolétariat chinois est-il le mieux placé pour comprendre que la liberté démocratique est la meilleure forme d'oppression? La réponse est non, bien sûr (…) La revendication d'un régime démocratique, y compris de la part du prolétariat, peut ainsi servir de vecteur important de la contre-révolution. Autrement dit, avec la crise qui s'approfondit, la révolte mondiale du prolétariat viendra peut-être de Chine, mais la révolution communiste viendra d'ailleurs, et sans doute d'une zone d'accumulation hautement développée» (p.170-171).
Espérons que ces commentaires inciteront de nombreux lecteurs à lire ce livre qui donne des éléments très valables de clarification dans les débats entre ceux qui réfléchissent au futur de la lutte des classes et aux questions qui se posent pour son internationalisation.
Dans Le prolétaire on constate que bien que «le prolétariat chinois est le plus nombreux du monde (…) la Chine n'a pas la possibilité comme l'ont eue les 'fabriques du monde' britanniques et américaines, d'anesthésier leurs prolétaires en leur concédant des hauts salaires et des conditions de vie supérieures à celles des ouvriers des autres pays, puisque c'est sur leur surexploitation forcenée que se fonde sa croissance (…) et les autorités chinoises … ont affirmé qu'une croissance inférieure à 6% mettait en péril la paix sociale. Mais cette croissance accélérée débouche inévitablement sur la surproduction … Cette surproduction frappera inévitablement la Chine, avec une force bien plus grande qu'en 2008. Et comme partout ce seront les prolétaires qui en feront les frais...» (9 ibidem)
Même si dans un premier temps beaucoup d'ouvriers combattifs gardent encore des illusions dans les 'syndicats libres', le fait qu'ils lancent des appels comme «Nous appelons tous les ouvriers à maintenir un haut degré d'unité et à ne pas laisser les capitalistes nous diviser» (10) révèle une base nécessaire pour dépasser aussi cette mystification comme le reste de leur frères et sœurs de classe dans le monde entier, condition pour pouvoir établir une vraie autonomie de classe, ouvrant la perspective d’une libération pour l'humanité entière.
JZ / 4.12.2010
(1) ISBN 962-7145-11-4: China, A moment of truth, Hong Kong Trade Union Education Centre, 1990.
(2) Bruno Astarian, Luttes de classes dans la Chine des réformes (1978-2009).: édité chez Acratie, septembre 2009. ISBN: 978-2-909899-34-3
(3) Christian Milielli, L'investissement direct japonnais en Chine, in Yunnan Shi et Françoise Hay (sous la dir.) : La Chine, forces et faiblesses d'une économie en expansion, p. 381)
'4) Jean-Louis Rocca, La condition chinoise
(5) Marie-Claire Bergère: Capitalismes et capitalistes en Chine, ed. Perrin, Paris 2007, p. 214.
(6) Han Dongfeng, Chinese Labour Struggles, New left Review, juillet-août 2005.
(7) Aiqing Zheng, Libertés et droits fondamentaux des travailleurs en Chine, L'Harmattan 2007, p. 171 sq.
(8) Communiqué du China Labour Bulletin, du 1er novembre 2004.
(9 ibidem) Le Prolétaire'n°n°497 de juil-oct 2010
(10) Cité de businessweek.com, dans RI n°415, Une vague de grèves parcourt la Chine, septembre 2010.
Géographique:
- Chine [13]
Réunion publique à Budapest
- 2103 lectures
Crise économique mondiale et perspective de la lutte de classe
La librairie Gondolkodo Antikvàrium à Budapest a initié une série de débats publics sur les perspectives de la lutte de classe et a invité le CCI, le 5 novembre, à animer une discussion sur le thème "Crise économique mondiale et perspective de la lutte de classe".
Notre exposé introductif avait pour axes principaux la mise en évidence de :
l'extrême gravité de la crise dans tous les pays du monde signant la faillite irrémédiable du mode de production capitaliste
la dégradation inexorable des conditions d'existence du prolétariat et sa paupérisation croissante sur tous les continents;
le développement lent, heurté, mais incontestable des luttes ouvrières à l'échelle internationale;
les causes principales des difficultés actuelles du prolétariat à hisser ses combats à la hauteur des enjeux de la situation historique actuelle, et notamment ses difficultés à retrouver son identité de classe et à affirmer sa propre perspective révolutionnaire (suite aux campagnes de la bourgeoisie consécutives à l'effondrement du bloc de l'Est et des régimes staliniens);
le rôle de sabotage des luttes des syndicats en Europe comme dans tous les pays;
le surgissement de minorités de la classe ouvrière à la recherche d'une perspective révolutionnaire face à l'impasse de plus en plus évidente du capitalisme.
C’est la première fois que nous avons pu participer à une telle rencontre en Hongrie et pour la plupart des personnes présentes, c’était aussi la première fois qu’ils rencontraient le CCI. La réunion a donc, presque inévitablement, pris un aspect « question/réponse », les participants cherchant à situer et à comprendre les idées et les analyses du CCI et plus largement de la gauche communiste. De notre côté, nous avons beaucoup apprécié la possibilité qui nous a été offerte de mieux comprendre les débats en cours dans le milieu révolutionnaire en Hongrie, et la façon dont les questions politiques sont posées.
La discussion s'est polarisée essentiellement sur la perspective révolutionnaire de la lutte de classe, et notamment autour des questions suivantes :
La révolution prolétarienne va poser le problème de l'affrontement violent avec la bourgeoisie. Le CCI développe-t-il une intervention en direction des soldats afin de les convaincre (comme le préconisait Engels) et de les agréger à la lutte révolutionnaire du prolétariat ?
Notre réponse a mis essentiellement en évidence les arguments suivants:
Il est évident que le renversement du capitalisme ne sera pas possible sans une décomposition des forces de répression. Mais ce processus ultime ne peut intervenir que dans une période où le rapport de forces entre la bourgeoise et le prolétariat mondial sera en faveur de la classe révolutionnaire, lorsque cette dernière sera suffisamment forte pour arracher le pouvoir à la bourgeoisie et ouvrir à toute la société la perspective du communisme. Dans une telle situation, les militaires, et même des membres de la police, seront amenées à choisir le camp le plus fort. Nous avons rappelé comment Trotsky, en 1917, est allé convaincre les cosaques, démoralisés, de ne pas se retourner contre la révolution. Nous avons également rappelé que, aujourd'hui, les soldats, dans les principales armées du monde, ne sont pas des ouvriers en uniforme embrigadés dans la guerre (comme c'était le cas lors de la première guerre mondiale), mais des engagés volontaires dans des armées de métier. De ce fait, les forces de répression ont pour objectif de maintenir l'ordre social capitaliste. Même si les soldats et les policiers sont salariés, ils n'appartiennent pas à la classe ouvrière, ils mettent leur force de travail au service du capital contre la classe ouvrière. Les organisations révolutionnaires n'ont donc pas pour vocation aujourd'hui de "convaincre" les forces de répression, mais de développer leur intervention afin de permettre au prolétariat d'affirmer sa propre perspective contre toute la classe dominante, contre l'État bourgeois et contre ses forces de répression dont la seule fonction est le maintien de l'ordre capitaliste.
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème très grave : le capitalisme est en train de détruire l'environnement. Il y a une certaine urgence pour sauver la planète. Mais la classe ouvrière ne se mobilise pas autour de cette question. Elle est réformiste et veut seulement améliorer sa condition dans le système capitaliste. Elle n'a pas une conscience révolutionnaire. Aurons-nous le temps de construire le communisme avant que la planète ne soit détruite par la catastrophe écologique ?
A cette intervention, le CCI a répondu que la destruction de notre écosystème est effectivement un vrai problème pour le devenir de l'espèce humaine, et que le temps ne joue pas en faveur du prolétariat. Mais nous ne pouvons pas aller plus vite que la musique puisque la lutte du prolétariat se joue à l'échelle historique. La bourgeoisie elle-même est très inquiète. Elle a conscience du problème mais est incapable d'y remédier.
Le prolétariat (comme l'ensemble de, la population) est aussi très préoccupé, mais la question écologique (tout comme la question de la guerre) n'est pas un facteur de mobilisation des luttes ouvrières. Le prolétariat aujourd’hui se mobilise essentiellement à partir des questions économiques, des attaques immédiates de ses conditions matérielles d'existence. Ce n'est qu'en développant ses luttes contre la misère et l'exploitation qu'elle pourra développer sa conscience et englober dans sa lutte révolutionnaire toutes les autres questions (la guerre, l'écologie et tous les autres fléaux engendrés par le mode de production capitaliste).
D'autres participants sont intervenus pour critiquer certains aspects de notre analyse. L'un d'entre eux a affirmé qu'il n'était pas convaincu par la conception du CCI concernant la maturation actuelle de la conscience de classe. Il a donné comme argument que même s'il y a aujourd'hui des grèves, les masses prolétariennes sont passives et ne sont pas révolutionnaires.
Un autre intervenant a également affirmé que l'analyse du CCI de la conscience de classe n'est pas matérialiste car elle n'est pas basée sur les buts finaux du mouvement prolétarien : mettre la production au service de la société.
A ces objections, nous avons rappelé que notre exposé a souligné l'existence de luttes ouvrières significatives dans de nombreux pays du monde. Face aux attaques capitalistes, les masses ouvrières ne sont donc pas passives. En témoigne aujourd'hui encore la mobilisation du prolétariat en France contre la réforme du système des retraites où ce sont plus de 3 millions de prolétaires (salariés de tous les secteurs, précaires, chômeurs, étudiants, lycéens) qui sont descendus massivement dans la rue dans les manifestations. Nous avons également rappelé que les révolutionnaires doivent avoir une vision historique et faire preuve de patience. Un mouvement révolutionnaire international ne peut pas surgir du jour au lendemain du fait de l'immensité de la tâche du prolétariat. Nous pensons également qu’il faut se garder de toute vision idéaliste suivant laquelle la conscience révolutionnaire du prolétariat serait introduite subitement, ex nihilo, c'est-à-dire indépendamment d'une maturation des conditions matérielles et subjectives dans lesquelles vivent les masses prolétariennes. La conscience révolutionnaire des masses se forme dans un processus historique nécessairement lent et heurté qui ne peut se développer qu'à partir des luttes de plus en plus massives face aux attaques économiques du capital.
Face à l'argument suivant lequel le but du prolétariat serait la socialisation de la production, nous avons surtout mis en évidence qu'il fallait rompre avec la logique de la loi du profit. Il ne s’agit pas seulement de la question de l’appropriation sociale ou privée, mais surtout du but de la production et de sa distribution : production pour la satisfaction des besoins humains de tous au lieu de l’accumulation de valeurs d’échange, de l’argent (avec son corollaire : la misère et la paupérisation pour un nombre croissant de prolétaires).
D' autres participants ont posé les questions suivantes : quel est le but de la production communiste ? Comment concevez-vous l'organisation de cette production ?
Faute de temps, notre réponse n'a pu être que très succincte (car elle se réfère aux questions économiques posées par l'analyse du CCI de la période de transition du capitalisme vers le communisme). Nous avons simplement affirmé que le but de la production dans la société communiste est la satisfaction des besoins de toute l'humanité. Une production qui mettra fin au règne de la marchandise et du profit. Cette production de biens de consommation (et leur distribution) devra nécessairement être centralisée à l'échelle mondiale.
Un autre participant est intervenu pour affirmer que le mouvement de Mai 68 en France était un mouvement révolutionnaire car c'était un mouvement massif impliquant toute la classe ouvrière et les étudiants. Les usines et les universités étaient occupées, les manifestations étaient massives, les grévistes se sont affrontés aux forces de répression, etc.
Dans notre réponse, nous avons affirmé que Mai 68 en France, fut, certes, la plus grande grève de l'Histoire qui a ouvert une nouvelle période historique dans la lutte de classe. Mais ce n'était pas un mouvement révolutionnaire. Il n'y avait pas de conseils ouvriers et la question de la prise du pouvoir était loin d'être posée.
Enfin, un intervenant nous a posé la question suivante : comment se fait-il que, malgré votre critique du syndicalisme, le CCI ait noué des relations avec un groupe anarcho-syndicaliste comme la CNT en France ?
A cette question, tout à fait pertinente, nous avons apporté la réponse suivante.
Pour le CCI, le critère essentiel de l'appartenance au camp prolétarien est aujourd'hui la question de l'internationalisme. C'est la raison pour laquelle nous nous gardons de tout ostracisme, de toute attitude sectaire à l'égard de groupes qui ne partagent pas nos positions sur la question de l’anarcho-syndicalisme. Nos liens récents avec la CNT ne concernent que le groupe CNT-AIT de Toulouse (et non pas la CNT Vignolles) du fait de sa position clairement internationaliste et également de son attitude fraternelle à l'égard du CCI. Nous avons également rappelé que dans d'autres pays (tel la Russie par exemple), le CCI entretient également des rapports fraternels (au-delà des divergences) avec des groupes se réclamant du courant anarcho-syndicaliste.
Cette première réunion publique animée par le CCI à Budapest et organisé par la librairie G., fut très riche et animée. Malgré un certain scepticisme dans le débat sur les potentialités révolutionnaires du prolétariat, les participants qui ont pris la parole ont manifesté leur conviction que le capitalisme doit céder la place à un autre système social : le communisme. Toutes les interventions ont convergé dans le même sens : face à la gravité de la situation mondiale, l'avenir de la société humaine est plus que jamais entre les mains de la classe ouvrière.
Le débat s'est déroulé dans un climat très sérieux et fraternel où chacun a pu exprimer son point de vue, ses divergences, ses questionnements et préoccupations. C’est d’autant plus significatif dans un pays où la classe ouvrière a encore d'énormes difficultés à engager la lutte contre les attaques du capital, et qui est encore très fortement marqué par le poids de l'idéologie nationaliste et par les conséquences de l'effondrement des régimes staliniens, notamment par la subsistance d'idéologies réactionnaires (xénophobie à l'égard des minorités ethniques, exactions de groupuscules d'extrêmes droite…).
Nous tenons ici à remercier chaleureusement la librairie Gondolkodo Antikvàrium d'avoir pris l'initiative d'inviter le CCI à animer cette réunion publique.
Nous tenons également à remercier les organisateurs de cette réunion pour les traductions en deux langues qui ont permis à tous les participants de suivre l'exposé du CCI et à nous-mêmes de participer activement au débat.
Le fait que notre organisation ait pu, grâce à cette invitation, exposer publiquement ses analyses dans la capitale hongroise est, à notre avis, une nouvelle manifestation d’une maturation en profondeur de la conscience de classe. Cette maturation s'exprime aujourd'hui par l'existence de minorités et éléments politisés à travers le monde qui cherchent à nouer des liens pour rompre l'isolement et clarifier à la fois leurs divergences et leurs points d’accord.
CCI (8 novembre)
Vie du CCI:
- Réunions publiques [14]
Géographique:
- Hongrie [15]
Sur les manifestations contre les coupes budgétaires en Grande-Bretagne
- 2184 lectures
Le premier samedi après l'annonce de la révision gouvernementale des dépenses publiques, le 23 octobre, se sont déroulées un certain nombre de manifestations contre les coupes budgétaires, partout dans le pays, appelées par divers syndicats. Le nombre de participants, variant de 300 à Cardiff à 15 000 à Belfast ou 25 000 à Edimbourg, montre que les ouvriers en Grande-Bretagne sont profondément en colère, tout comme le sont les ouvriers en France.
Cependant, les manifestations syndicales ne fournissent pas un cadre viable pour lutter contre les coupes dans les emplois, les salaires et les services, bien au contraire. C'est pourquoi nous avons soutenu l'appel « à tous les anarchistes et ouvriers militants à se joindre à nous pour former un « Bloc Ouvrier Radical »1 dans la manifestation, non pour prier les bureaucrates syndicaux de prendre des mesures, mais pour faire valoir que nous luttons contre les coupes budgétaires en nous fondant sur les principes de solidarité, d'action directe, et de contrôle de nos propres luttes ». Ceci émane de la SF-IWA2 de Londres Sud (voir le site libcom.org).
Le problème avec l'approche des syndicats et de leurs partisans, c'est qu'ils polarisent la question sur les « coupes des conservateurs », accusés de creuser le déficit par le renflouement des banquiers, par la spéculation financière, alors que tout ceci ne constitue que les symptômes de la crise du capitalisme. Les coupes budgétaires ne seraient liées qu'à un certain choix politique opéré par un « gouvernement de millionnaires » (tract du SP) alors que « Le gouvernement aurait pu taxer les riches » (Karen Reissman, militante du domaine de la santé et membre du SWP3, lors du rassemblement à Manchester). Ces menteurs professionnels savent parfaitement qu'en réalité, jusqu'il y a 6 mois, le gouvernement travailliste, incluant des députés parrainés par des syndicats, imposait les mêmes coupes et les mêmes sacrifices. Les tracts distribués à la manif de Londres pouvaient même nous le rappeler - mais uniquement dans le but d'essayer de nous attirer à nouveau dans la version alternative des mêmes vieilles politiques derrière les syndicats ou quelque bloc électoral alternatif (par exemple, la TUSC4).
Après tous les discours radicaux sur l’action commune au TUC5 cette année, la campagne sur les coupes budgétaires s’est focalisée sur une manifestation prévue à la fin du mois de mars de l'année prochaine. Aussi, le message que nous entendons est « Nous devons bombarder le TUC et les dirigeants syndicaux de demandes pour agir maintenant » (d'après le NSSN6), « Poussons les dirigeants syndicaux à appeler à des grèves locales et nationales » (Socialist Worker7 en ligne). En premier lieu, si nous devons faire tous ces "bombardements", ces demandes et ces pressions en direction du TUC et des dirigeants syndicaux, cela soulève vraiment la question de savoir pourquoi nous avons besoin d'eux ; après tout, de très nombreux ouvriers se sont mis en lutte sans le moindre soutien d'un quelconque syndicat en Chine et au Bangladesh, et les ouvriers de Vestas sur l'île de Wight ont occupé l'usine sans appartenir au préalable à un syndicat.
La réalité est que les syndicats ne sont pas seulement inutiles pour l'organisation des luttes ; ce n'est pas simplement une question de « léthargie » de leur part comme le prétend le tract de la SF-IWA de Londres Sud. Non ! En fait, ils nous divisent volontairement et consciemment. Par exemple, ils ont maintenu séparés les stewards et hôtesses de l’air de British Airways et les ouvriers de la British Airports Authority alors même qu'ils luttaient au même moment. La manifestation de Londres a été un autre exemple de ce que font vraiment les syndicats. Appelée par les syndicats RMT, FBU et UCU, aux querelles incessantes, la manifestation n'a attiré que 2000 personnes, moins d'un dixième du chiffre atteint à Edimbourg. Il est clair que les syndicats n'ont pas mobilisé leurs membres, de peur de ce qui pourrait arriver si les grévistes s'unissaient dans les rues. C'est ainsi que nous comprenons l'appel de Bob Crow8 pour que le TUC agisse rapidement afin d’organiser une action de masse contre les coupes budgétaires, comme moyen d'empêcher les ouvriers de prendre leur lutte en main.
Le Bloc Ouvrier Radical a attiré entre 50 et 100 personnes, d'après les estimations parues sur le site libcom.org, démontrant qu'une minorité dans la classe ouvrière remet les syndicats en question, même ici où ils sont traditionnellement si forts. Ceux du Bloc ont fait des efforts pour faire entendre leur voix distinctive en amenant mégaphone, tracts et presse, bien que cela ait été difficile étant donné la myriade de groupes concurrents syndicaux, trotskistes et « anti-coupes ». A la fin, un camarade du CCI a discuté avec quelqu'un de l‘AF9 pour savoir si le Bloc devait essayer de prendre la parole, concluant qu'il le devait, la prochaine fois. La prochaine fois aussi, nous pourrons apprendre de l'exemple des récentes luttes en France où des anarchistes internationalistes et des communistes de gauche ont travaillé ensemble pour appeler à des réunions à la fin des manifestations où, au lieu d'écouter les discours syndicaux, les véritables enjeux de la lutte ont été discutés. Comme la SF-IWA le dit : « Nous ne pouvons pas mettre notre confiance en autre chose qu’en notre solidarité et notre capacité à nous organiser ».
World Revolution, organe du CCI en Grande-Bretagne n°339, novembre 2010.
1 Radical Workers’ Block, NDT.
2 La Solidarity Federation - International Workers Association (SF-IWA ou SolFed) est la section en Grande-Bretagne de l’AIT anarchosyndicaliste, NDT.
3 Le Socialist Party (SP) et le Socialist Workers Party (SWP) sont des organisations trotskistes, NDT.
4 La Trade Unionist and Socialist Coalition (TUSC) est une alliance électorale regroupant principalement des organisations trotskistes (dont le SP et le SWP) et des syndicalistes, NDT.
5 Le Trades Union Congress (TUC) est une confédération affiliant la majorité des syndicats britanniques, NDT.
6 Le National Shop Stewards Network (NSSN) est un réseau national regroupant des délégués radicaux de différents syndicats, NDT.
7 Le Socialist Worker est le journal hebdomadaire du SWP, NDT.
8 Bob Crow est le secrétaire général du syndicat RMT et est membre du conseil général du TUC, NDT.
9 L’Anarchist Federation (AF) est une organisation anarchiste des îles britanniques, membre de l’Internationale des Fédérations Anarchistes, NDT.
Géographique:
- Grande-Bretagne [11]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [10]
Tournée d'une délégation d'ouvriers de Tekel (Turquie) en Europe : transmettre l'expérience de la lutte de classe
- 1971 lectures
A la fin de 2009, une lutte ouvrière a commencé en Turquie et s’est fait connaître bien au-delà de ses frontières, et en particulier parce qu’une délégation de grévistes est venue en Europe de l’ouest en juin et juillet 2010. Elle venait répercuter son expérience et tirer les leçons avec ceux qui étaient intéressés à le faire.
Un court récapitulatif : des milliers de travailleurs des entreprises de tabac et de liqueurs Tekel, précédemment étatisées, protestaient contre la privatisation de la compagnie et par-dessus tout contre les attaques qui y étaient liées, les baisses de salaire et les licenciements en particulier. Les travailleurs se sont rassemblés à Ankara, la capitale, pour protester et ont reçu nombre de marques de sympathie et de solidarité de la part de la population locale. De plus, ils cherchèrent le soutien de secteurs plus larges de la classe ouvrière – en particulier, dans les usines où des luttes étaient en cours dans tout le pays. Au cours de leurs manifestations et de leurs efforts pour étendre la lutte, les travailleurs de Tekel en vinrent à s’élever contre la résistance des syndicats, qui se sont révélés faire partie eux-mêmes de l’appareil d’Etat. Aux côtés des ouvriers en grève des autres entreprises d’Etat (par exemple, les dockers, les travailleurs de la construction et les pompiers), ils créèrent, à Istanbul, une plate-forme des ouvriers en lutte. A la manifestation du premier mai à Istanbul, qui regroupait 350 000 personnes sur la place Taskim, ils occupèrent le podium de la place et lurent une déclaration contre la complicité des syndicats avec l’Etat. Les dirigeants syndicaux furent éjectés du podium et envoyèrent la police contre les ouvriers. Malgré le soutien donné à la lutte de Tekel, celle-ci n’a pas abouti dans la mesure où la privatisation et les attaques ne furent pas retirées.
Cependant, ceux qui avaient combattu décidèrent que leur expérience devait être transmise à d’autres ouvriers, pas seulement en Turquie, mais au-delà des frontières. Pendant les luttes, des contacts avaient déjà été pris avec des gens politisés dans d’autres pays. C’était en particulier le cas en Allemagne, où se trouve le plus grand nombre d’ouvriers émigrés et où la lutte était suivie avec une sympathie toute particulière. Grâce au soutien de différents groupes du milieu anarchiste et de la Gauche communiste, une tournée a été rendu possible en Europe notamment en Allemagne et en Suisse. Une délégation des ouvriers de Tekel a pu se rendre dans dix villes en Allemagne et en Suisse dans lesquelles toutes sortes de personnes ont pu bénéficier des informations et des discussions qui avaient lieu, et que nous voulons rapporter ici.
La tournée
Les villes visitées entre mi-juin et début juillet furent Hanovre, Berlin, Brunswick, Hambourg, Duisburg, Cologne, Dortmund, Francfort, Nuremberg, Zurich et Milan. Le CCI a fait en sorte que cette tournée en Europe soit rendue possible. La plupart des réunions ont été organisées par le Free ArbeiterInnen Union (FAU/Free Workers Union) et à Berlin, par le Cercle Révolutionnaire de Discussion tandis qu’à Zurich, le meeting était organisé par le groupe Karakok Autonomie. Ceux-ci et d’autres groupes se sont mobilisés et ont uni leurs forces pour la tenue de ces réunions. Le nombre de participants a oscillé entre 10 et 40. Il faut tenir compte qu’au même moment avait lieu la Coupe du monde de football en Afrique du Sud et que les matchs étaient souvent retransmis à la télévision à la même heure que celle des réunions. Les personnes qui sont venues étaient jeunes pour la plupart, mais pas exclusivement. Dans ces villes où vivent beaucoup d’ouvriers turcs et kurdes, la génération des parents des jeunes de 20-30 ans était aussi présente.
Un travailleur de Tekel a fait une présentation expliquant l’histoire de la lutte entre décembre 2009 et mai 2010. Il a raconté de manière vivante l’expérience des ouvriers en lutte, comment ils avaient essayé vainement de pousser les syndicats à déclarer une grève générale des travailleurs du secteur étatique, comment ils avaient occupé brièvement le siège du syndicat Turk-Is à Ankara et comment la police avait protégé les syndicats, comment ils avaient campé dans la ville d'Ankara, recevant la solidarité de la population locale. Il ont dit combien la lutte des ouvriers de Tekel avait permis de dépasser les divisions entre Kurdes et Turcs ou entre femmes et hommes, ou entre ceux qui avaient voté pour tel ou tel parti. Par exemple, la police avait arrêté les bus qui transportaient 8 000 ouvriers aux portes d’Ankara, prétextant ne laisser passer que ceux qui ne venaient pas des usines Tekel dans les zones kurdes. En réponse, tous les grévistes sont descendus ensemble des bus et ont commencé à marcher vers le centre qui était éloigné, au plus grand étonnement de la police. Pour elle, la division entre ouvriers kurdes et turcs ne pouvait être remise en question.
Les discussions
Les discussions qui ont suivi la présentation montraient que les participants étaient très intéressés par les luttes en Turquie. L’atmosphère était fraternelle, pleine de solidarité et d’empathie – certains camarades ont même pleuré. La plupart des participants se reconnaissaient dans le but des ouvriers de Tekel. Ceux qui, dans l’assemblée, ne connaissaient encore pas grand-chose de la lutte ont posé des questions concrètes, montrant qu’en Allemagne et en Suisse, on réfléchissait aussi sur ces luttes.
L’unité des travailleurs au-delà des différentes frontières visibles et invisibles était saluée dans presque toutes les discussions comme ayant été de la plus grande importance.
L’Etat turc a essayé de diviser les combattants. Mais ceux-ci ne l’ont pas permis. Au contraire, ils ont recherché la plus grande solidarité possible des autres secteurs de la classe. Ce n’est que de cette façon qu’a pu émerger un sentiment d’être forts, mais aussi créer un vrai rapport de force en notre faveur. La lutte en Turquie, il est vrai, n’a pas atteint le but qu’elle s’était fixée. Mais elle allait dans la bonne direction. Précisément, dans un pays où le nationalisme turc, kurde (mais aussi arménien) a été monté en épingle par l’Etat et toutes sortes de groupes, un tel développement de la tendance à l’unité est particulièrement remarquable.
Pour beaucoup, la question syndicale a été au centre de leur intérêt. Au niveau de l’expérience immédiate, il y avait un accord : le Türki-Is a joué dans cette lutte un rôle similaire à celui que nous connaissons si bien avec les syndicats dans d’autres pays. Il a essayé de rendre les ouvriers passifs, ne se mobilisant que sous la pression des travailleurs eux-mêmes et de façon à disperser les énergies. Au même moment, au printemps, il y avait des luttes en Grèce où les grandes confédérations syndicales jouaient le même rôle et se démasquaient comme étant les défenseurs de la classe dominante et de l’Etat. En Allemagne et en Suisse aussi, on connaît bien ce rôle des syndicats. Le public, aux réunions sur Tekel, était impressionné par la façon dont les ouvriers de Tekel et ceux qui avaient participé à leurs luttes s’étaient opposés aux syndicats et les avaient combattu ouvertement. Mais est-ce qu’ils n’auraient pas eu besoin de syndicat « à eux » ? Est-ce que la lutte de Tekel n’a pas réussi du fait du manque d'un tel syndicat ? Dans presque toutes les discussions que la FAU a organisées, la question était de savoir si un nouveau syndicat « révolutionnaire » ou « anarchiste » aurait pu être créé ou non. Dans quelques villes, à Duisburg par exemple, des camarades parmi ceux qui soutiennent la FAU théorisaient que Tekel avait été moins un mouvement de grève et plus un combat avec des manifestations de protestation. Ne serait-ce pas dû au fait qu’il manquait un syndicat prolétarien ? Le délégué ouvrier de Tekel qui avait fait la présentation ne partageait pas ce point de vue. Il fondait son argumentation sur sa propre expérience, montrant que les syndicats, du fait de leur rôle, prendraient en dernière instance le parti de l’Etat, même s’ils avaient été créés par les travailleurs ou les révolutionnaires et pouvaient au début répondre aux besoins immédiats de la lutte. Mais quelle autre possibilité avons-nous ? Comment pouvons nous organiser notre lutte ? La réponse donnée par l’ouvrier de Tekel était claire: les comités de lutte ou de grève. Tant que la lutte se mène, ils doivent être organisés par les travailleurs eux-mêmes avec des délégués révocables à tout moment. L’assemblée générale doit élire un comité de grève qui rend son mandat à l’assemblée. A l’opposé, toute représentation permanente et indépendante de la mobilisation de ceux qui se battent est condamnée à devenir un syndicat bureaucratique « normal ». Cette discussion ne s’est pas tenue partout avec la même clarté et la même profondeur. Mais à Brunswick par exemple, ces alternatives ont été posées de manière analogue et la majorité de ceux qui assistaient semblait convaincue par le point de vue du camarade. En d’autres mots, la majorité avait tendance à être d’accord sur le fait qu’on devait rejeter la possibilité de fonder des syndicats « révolutionnaires ». Cette discussion sur la question syndicale, à partir de l’expérience de la lutte de Tekel, nous semble d’autant plus importante et d’actualité que, comme nous le savons, il y a au sein du milieu anarcho-syndicaliste une controverse sur la tentative de se faire reconnaître par l’Etat comme un syndicat officiel (la FAU à Berlin est même allée au tribunal pour cela) ? Ce n’est pas que du point de vue marxiste, de la Gauche communiste, mais aussi du point de vue de l’anarcho-syndicalisme lui-même que cela apparaît comme contradictoire.
Une autre question qui a surgi dans les discussions menées dans les différentes villes, a été celle des occupations d’usine. Pourquoi les ouvriers n’ont-ils pas occupé les usines ? Pourquoi est ce qu’ils ne les ont pas fait tourner sans les patrons ? Ces questions étaient posées sur la base de certaines luttes ces derniers temps en Allemagne, Italie et Suisse, dans lesquelles les employés étaient confrontés au problème de fermeture d’usine. A Tekel, ce n’est pas exactement le cas puisque beaucoup d’usines n’allaient pas être fermées mais privatisées. Là, la production a continué sous la direction des patrons. Le délégué des ouvriers de Tekel soulignait néanmoins que les ouvriers ne se sont pas retranchés dans les usines Tekel isolées dans différentes parties du pays, mais s’étaient rassemblés pour aller à Ankara. Ce n’était qu’en rassemblant des milliers d’ouvriers qu’il était possible de faire émerger le sentiment d’être une force, ce qui était caractéristique de la lutte (même si elle ne s’est pas terminée sur une victoire matérielle)1.
Que reste-t-il de ce combat ?
Est-ce que cette série de réunions publiques nous a fait avancer ? Nous pensons que des avancées peuvent être identifiées à différents points de vue.
En premier lieu, le fait que différents groupes, en particulier la FAU, anarcho-syndicaliste, et le CCI de la Gauche communiste, aient collaboré à l’occasion de cette tournée, mérite d’être mentionné. La collaboration avec les anarchistes internationalistes est enracinée depuis longtemps dans notre tradition, mais ici et à cette occasion, quelque chose de nouveau s’est concrétisé et qui, à notre avis, n’est pas pure coïncidence. Le travail en commun accompli est un signe que le besoin d’unité sur une base prolétarienne se fait jour, un besoin de la classe de dépasser un certain égoïsme de groupe. Bien sur, nous nous connaissions déjà et nous avions déjà utilisé d’autres occasions pour discuter telle ou telle question. Mais une collaboration comme celle que nous avons eue au début de l’été de cet année était quelque chose de nouveau. La recherche de l’unité de la classe ouvrière, du dépassement des divisions, était dès le début, à la base de l’initiative de la tournée de ceux de Tekel. Ce voyage avait pour but de transmettre les expériences et les leçons d’une lutte par delà niveau local ou national. La dimension internationale était au cœur cette initiative. La question n’était pas de présenter une spécialité turque au monde comme quelque chose d’exotique, mais de voir les points communs au niveau international et d’en discuter. Comme on a pu s’en rendre compte, l’expérience des ouvriers de Tekel avec les syndicats et de comment ceux-ci ont réagi, n’est pas un fait isolé, mais une tendance prévue de long terme et qui se répète sans arrêt. Pendant les luttes du printemps en Grèce, les travailleurs s’en sont aussi pris aux syndicats et ont commencé à se dresser contre eux. En France, pendant la mobilisation contre la « réforme des retraites », des jeunes, surtout, se sont rassemblés dans différentes villes, appelaient à des assemblées à la fin des manifestations pour discuter la question suivante : comment pouvons nous développer notre lutte indépendamment des syndicats ? Comment pouvons nous dépasser les divisions au sein de la classe ouvrière entre les différentes professions, entre retraités et actifs, entre chômeurs et ceux qui ont encore un travail, entre précaires et ceux sur contrat ? Quel est le but de nos luttes ? Comment pouvons nous nous rapprocher du but d’une société sans classe ? En Italie, en juin et en octobre de cette année, deux assemblées d’ouvriers combatifs venus de toute l’Italie se désignant comme « coordinamenti » se sont tenues, dont une à Milan, regroupant une centaine de personnes pour discuter de questions similaires : comment dépasser les divisions au sein de la classe ouvrière, comment résister au sabotage des syndicats ? Comment aller au-delà de ce système capitaliste miné par la crise ?
Turquie, Grèce, France, Italie – quatre exemples qui montrent que la classe ouvrière en Europe, depuis le début de 2010, a commencé à sortir de l’état de léthargie dans lequel elle était plongée après la crise financière de 2008. La classe dans son ensemble ne se sent pas encore assez confiante en elle-même pour prendre ses luttes en main. Mais des minorités de la classe posent justement cette question et essaient d’avancer. Le fait que de telles discussions aient pris place simultanément en différents endroits est l’expression d’un besoin qui va au-delà des frontières. Le grand voyage de ceux de Tekel était une réponse à cette nécessité. La délégation de Tekel avait pour but de montrer la dimension internationale de nos luttes locales et des discussions. La solidarité est le sentiment qui exprime l’unité de la classe ouvrière. En de nombreuses occasions, pendant ces réunions, la question était posée : comment pouvons nous soutenir les luttes « à l’étranger » ? La réponse de l’ouvrier de Tekel était : en luttant vous-mêmes.
Les minorités politiques de la classe ouvrière ressentent que la lutte est mondiale et qu’elle doit être menée comme telle de façon consciente. Les rapports sur la solidarité avec la lutte de Tekel ont été une source d’inspiration pour les participants aux réunions. Et c’est notre intention de transmettre ce message du mieux que nous pouvons. Les minorités politiques et combatives de la classe sont des catalyseurs des futures luttes. La lutte de Tekel n’a pas eu lieu en vain, même si les licenciements n’ont pu être empêchés.
Novembre 2010.
1Les délégués de Tekel se sont rendus à Milan pour rencontrer un groupe d'ouvriers de l'INNSE (entreprise de fabrication de machines-outils et d'équipements pour les aciéries) en grève avec occupation de leur usine. Là aussi, les discussions ont porté les mêmes questions essentielles de la lutte : le rôle des syndicats et le débat sur la stratégie d'occupation des entreprises.
Géographique:
- Turquie [16]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [10]
Une brochure du CCI : mai 68 et la perspective révolutionnaire
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 2.33 Mo |
- 1932 lectures
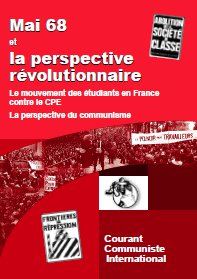 [17]Le CCI publie une nouvelle brochure consacrée à mai 68 et la perspective révolutionnaire. Cette brochure est constituée d’un recueil d’articles publiés dans notre presse à l’occasion de la commémoration des 40 ans de Mai 68.
[17]Le CCI publie une nouvelle brochure consacrée à mai 68 et la perspective révolutionnaire. Cette brochure est constituée d’un recueil d’articles publiés dans notre presse à l’occasion de la commémoration des 40 ans de Mai 68.
La première partie relate les événements qui se sont déroulés en France et à l’échelle internationale ainsi que leur signification historique.
La deuxième partie est constituée par un article publié dans notre Revue internationale no 136 sur les mouvements de la jeunesse scolarisée, notamment en Grèce en décembre 2008, et qui sont significatifs de l’entrée d’une nouvelle génération de la classe ouvrière sur la scène de l’histoire.
La troisième partie de cette brochure rassemble une série d’articles sur la perspective du communisme publiés également sur notre site Internet. Ces articles montrent pourquoi le communisme est devenu une nécessité et une possibilité matérielles face à la faillite de l’économie capitaliste.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [18]
Approfondir:
- Mai 1968 [19]