Revue Internationale no 115 - 4e trimestre 2003
- 3800 lectures
Le prolétariat face à l'aggravation dramatique de toutes les contradictions du capitalisme
- 2587 lectures
La canicule de l'été 2003 a tragiquement révélé à la face du monde comment, en Europe aussi, le développement de la pauvreté et de la précarité exposaient les populations aux ravages de catastrophes dites naturelles inconnues jusqu'à récemment dans ces régions. En effet, dans de nombreux pays européens, le taux de mortalité a fait un bond en ce mois d'août, avec un record pour la France où près de 15 000 décès sont directement imputables à la vague de chaleur. Les victimes se comptent en majorité parmi les personnes âgées, mais aussi les handicapés, les SDF morts de soif dans les rues, c'est-à-dire parmi ceux que le capitalisme condamne à une marginalisation et à une misère toujours plus grandes. Pour la bourgeoisie, il s'agit de bouches improductives, devenues inutiles à ses yeux, et qui constituent un fardeau toujours trop lourd pour elle, si bien qu'elle cherche en permanence à rogner sur les dépenses affectées à leur entretien. Loin de constituer un accident de l'histoire, un tel drame illustre crûment la situation que nous façonne le capitalisme puisque, aussi bien la dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière que les dérèglements climatiques ne peuvent qu'empirer. Encore ne s'agit-il ici que d'une partie du paysage social qu'envahissent toutes les manifestations de la putréfaction du monde capitaliste transformant la vie sur terre en un enfer pour le plus grand nombre : violence, délinquance, drogue, regain du mysticisme, de l'irrationalité, de l'intolérance, du nationalisme. En dehors des deux conflits mondiaux du 20e siècle, la guerre elle-même n'a jamais été aussi omniprésente sur le globe. L'intensification des tensions entre grandes puissances qui, depuis deux ans, ne peuvent même plus être dissimulées, se trouve être le principal facteur d'un chaos mondial qui ne pourra que devenir de plus en plus sanglant.
Toutes les calamités qui accablent aujourd'hui l'humanité expriment la faillite du système qui régit la vie de la société, le système capitaliste. Mais la simultanéité croissante avec laquelle leurs manifestations se conjuguent sont à l'image de la rapidité avec laquelle le capitalisme, dans la phase ultime de sa décadence, celle de sa décomposition, entraîne l'humanité vers sa destruction.
La crise économique au coeur des contradictions du capitalisme
Pour entraver la prise de conscience de la faillite de son système, la bourgeoisie livre à une publicité abrutissante et décervelante tout ce qui constitue des expressions patentes de cette faillite. Ainsi, elle banalise toutes les calamités qui accablent la société, elle habitue les populations à accepter l'inacceptable, poussant chacun, face à des images souvent insoutenables servies par les actualités télévisées aux heures des repas, à se détourner du problème. Le drame de l'été a donné lieu, en France, à de multiples "expressions d'opinion" à travers les médias, souvent très critiques à l'encontre du gouvernement, mais toutes plus partielles ou fausses les unes que les autres, afin d'empêcher que ne se dévoile le fond du problème. Celui-ci réside dans le fait que, depuis les années 1980, la bourgeoisie de tous les pays industrialisés, de gauche comme de droite, prise à la gorge par la crise économique et contrainte de maintenir la compétitivité du capital national sur l'arène mondiale, s'est employée à effectuer, à un rythme de plus en plus soutenu, des coupes sombres dans tous les budgets sociaux, de santé en particulier. Il en a résulté un appauvrissement et une précarisation générale dont l'ampleur a été révélée brutalement par la vague de chaleur de l'été. De la même manière mais à une tout autre échelle, l'épidémie de grippe espagnole après la Première Guerre mondiale avait révélé, en fauchant plus de 20 millions de vies humaines, la profondeur d'un mal social constitué par des conditions épouvantables d'insalubrité et l'affaiblissement extrême des populations suite aux ravages de la guerre. Ainsi ces morts sont, elles aussi, imputables à la folie meurtrière du capital, au même titre que les 10 millions de tués sur les champs de bataille.
Dans ses discours, la bourgeoisie présente les calamités qui accablent l'humanité comme étant sans lien entre elles et surtout sans rapport avec le système qui régit la vie des hommes sur la planète, le capitalisme. Pour la classe dominante et les défenseurs de son système, les événements historiques sont soit le fruit du pur hasard, soit l'expression de la volonté divine, soit le simple résultat des passions ou des pensées des hommes, voire de la "nature humaine".
Pour le marxisme, c'est au contraire l'économie qui, en dernière instance, détermine les autres sphères de la société : les rapports juridiques, les formes de gouvernement, les modes de pensée. C'est cette vision matérialiste que vérifie avec éclat la situation du capitalisme depuis son entrée en décadence au début du 20e siècle sous l'effet de contradictions économiques insurmontables. Depuis cette époque et en dehors des périodes de reconstruction ayant succédé aux deux guerres mondiales, il vit en situation de crise permanente. Pendant la période de décadence du capitalisme, la guerre et le militarisme expriment, avant tout, la fuite en avant des différents pays face à l'impasse économique dans un marché mondial saturé. Ils sont devenus le mode de vie permanent du capitalisme comme en attestent les deux guerres mondiales et la chaîne ininterrompue des conflits locaux, de plus en plus destructeurs, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces deux conflits mondiaux ainsi que la phase actuelle de décomposition de la société illustrent à quel point ce système devenu caduc menace l'existence même de l'humanité. Dans sa fuite en avant, le capitalisme imprime sa marque à toutes les sphères de l'activité humaine, y inclus ses rapports avec la nature. C'est ainsi que, pour maintenir ses profits, il se livre massivement, depuis plus d'un siècle, au saccage et au pillage à grande échelle de l'environnement. Si bien qu'aujourd'hui, sous l'effet de l'accumulation de pollutions de tous ordres, le désastre écologique constitue une menace tangible pour l'écosystème de la planète lui-même. Le capitalisme étant par nature un système concurrentiel qui met en compétition au plus haut niveau les différentes nations, l'approfondissement de la crise économique signifie donc aussi l'intensification de la guerre économique entre celles-ci. Après la disparition des blocs impérialistes constitués depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le maintien d'une coordination des politiques économiques entre les différents Etats, pour encadrer la guerre commerciale, a permis d'éviter une détérioration plus importante du système des relations économiques internationales, des échanges en particulier. En agissant de la sorte, les fractions de la bourgeoisie mondiale des pays les plus développés avaient conscience de devoir éviter la répétition du scénario des années 1930. En effet, pour essayer de se protéger face à la dépression, la bourgeoisie avait alors réagi en élevant des barrières douanières qui eurent pour conséquence de réduire massivement le commerce mondial et d'aggraver la crise. Tout au long des années 1990, les décisions de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) ont éliminé des barrières douanières et des mesures protectionnistes, mais essentiellement celles des pays les plus faibles au bénéfice des pays les plus forts. Lorsque des accords sont conclus entre les membres de cette organisation, ils viennent sanctifier un rapport de forces entre eux et, sur cette base, définissent les règles pour la poursuite de la guerre économique. Qu'un tel accord ne puisse être obtenu, comme cela vient d'arriver à la conférence ministérielle de Cancun (10 au 14 septembre), cela ne change strictement rien aux relations ni au rapport de forces entre les pays les plus riches et les autres, contrairement à ce qu'en dit la propagande mensongère des alter-mondialistes. En effet, cette dernière présente comme une victoire remportée par les pays du Tiers-Monde le fait qu'aucun accord ne soit sorti de Cancun (1). Ce type d'argument rejoint parfaitement la mystification tiers-mondiste selon laquelle l'issue aux problèmes tragiques que pose l'agonie du capitalisme ne réside pas dans le renversement de ce système mais dans la lutte entre le Nord, les pays développés, et le Sud, les pays sous-développés. Au moment où cette propagande nauséabonde est à nouveau développée, il faut se souvenir que c'est elle qui, dans les années 1960 à 80, a servi de justification à l'enrôlement de masses paysannes dans les conflits et guérillas, en général pour le compte du bloc russe, tout aussi impérialiste que le bloc adverse américain. Un tel positionnement ne doit pas nous étonner de la part du courant altermondialiste. Depuis quelques années, son slogan, "un autre monde est possible" et ses thèses dénonçant le libéralisme et soutenant la nécessité d'un Etat plus fort se sont trouvés propulsés sur le devant de la scène, grâce aux bons offices de la bourgeoisie, afin de faire obstacle au développement de la prise de conscience par le prolétariat de la faillite du capitalisme. Ce prétendu "autre monde" n'a rien de neuf ni de social, c'est celui dans lequel nous vivons actuellement où l'Etat, quoi qu'en en dise, est et restera le pilier de la défense des intérêts de la bourgeoisie et du capitalisme.
L'Etat, fer de lance des attaques
Si la bourgeoisie ne peut pas nier ce qui constitue une évidence criante, à savoir que la crise économique constitue le fondement des attaques contre la classe ouvrière, elle essaie cependant de brouiller cette réalité en incriminant le "manque de civisme de certains patrons immoraux", la "mauvaise gestion" de certains autres... bref, en faisant tout pour que la vraie question, une fois de plus, ne soit pas posée, à savoir l'inéluctabilité de la crise économique en tant qu'expression des contradictions insurmontables du capitalisme. Néanmoins, lorsque c'est l'Etat lui-même, que le gouvernement soit de gauche ou de droite, qui est amené à assumer, au nom de toute la bourgeoisie, des attaques profondes, massives et générales comme celle sur les retraites, cela ne peut signifier qu'une chose : le capitalisme est de moins en moins capable d'assurer les nécessités vitales d'entretien de la classe qu'il exploite. Dans notre précédent numéro de la Revue internationale, nous mettions en évidence comment l'Etat dans différents pays avait pris en charge une telle politique d'attaque contre les retraites (France, Autriche, Brésil) et contre la sécurité sociale ou l'indemnisation du chômage (Allemagne, Hollande, Pologne). A présent c'est le gouvernement italien qui prévoit à son tour de s'engager dans une réforme du système des retraites, accusé pour l'occasion d'être "parmi les plus coûteux de l'Union européenne". Depuis le printemps, les réductions d'effectifs dans la fonction publique et les plans de licenciements sur tous les continents, dans tous les pays, dans tous les secteurs n'ont pas cessé. Pour l'illustrer nous pouvons citer les plus récents : - En cinq ans Philips a déjà fermé ou vendu 120 sites de production dans le monde et supprimé 50 000 emplois depuis mai 2001. Il va fermer ou vendre 50 de ses 150 sites sur lesquels se répartissent 170 000 personnes ; - Schneider Electric, qui emploie 75 000 salariés dans 130 pays va supprimer 1000 emplois en France ; - ST Microélectronics annonce la fermeture de son site de Rennes en France qui compte 600 salariés ; - 10% des employés de Cadence Design System (Californie), soit 500 personnes, sont licenciés ; - Volkswagen annonce un plan de 3 933 licenciements à Sao Bernardo do Campo (Etat de Sao Paulo, Brésil). Face aux risques de mobilisation ouvrière, le président de la firme menace de licencier sur le champ quiconque se mettra en grève ; - Matra automobiles ferme une usine en France en licenciant près de mille employés ; - Giat Industries (armement en France) annonce un plan de 3750 licenciements d'ici 2006 ; - L'entreprise manufacturière de tabac Altadis supprime près de 1700 emplois en Espagne et en France ; - La société métallurgique Eramet supprime 2000 emplois en Europe.
Face à la contraction du marché mondial, artificiellement entretenu par une montagne de dettes, les entreprises publiques ou privées se débarrassent d'une partie de leur main d'oeuvre pour maintenir leur compétitivité sur l'arène internationale. C'est l'Etat qui, en dernière instance, approuve les modalités des plans de licenciements et, dans le même temps, prend les dispositions permettant que ces dégraissages n'occasionnent pas par ailleurs de dépenses supplémentaires pour l'Etat lui-même. Ainsi, partout, des mesures sont prises pour revoir à la baisse les conditions d'indemnisation du chômage. Après les mesures prises au printemps dernier par l'Etat allemand, c'est au tour de l'Etat français de radier par milliers des ouvriers des listes du chômage, en application d'une loi adoptée quelques mois auparavant. Afin d'éviter que l'aggravation de la crise et des attaques ne favorise au sein de la classe ouvrière une remise en cause en profondeur du système, la fonction des fractions de gauche et d'extrême-gauche de la bourgeoisie est d'intoxiquer la conscience des prolétaires en proclamant que des solutions sont possibles au sein du système, notamment en redonnant à l'Etat le rôle plus central que le libéralisme lui aurait confisqué. Mais, comme on vient de le voir, c'est l'Etat lui-même, avec à sa tête des gouvernements de gauche comme de droite qui orchestre les attaques les plus massives depuis la fin des années soixante. Contrairement à la thèse d'une diminution du rôle de l'Etat dans la vie de la société et quelles que soient les apparences, celui-ci occupe une place de plus en plus prépondérante, au service de la défense des intérêts du capital national, comme l'illustrent sur un autre plan les exemples suivants : - en 1998, l'Etat japonais volait au secours d'institutions bancaires pour leur éviter la faillite ; - le 23 septembre de la même année, la Réserve fédérale américaine faisait de même en organisant le sauvetage du fonds d'arbitrage "Long Term Capital Management", au bord du dépôt de bilan ; - aujourd'hui, en France, l'Etat français n'agit pas différemment lorsqu'il se porte au secours d'Alstom (fabrication de TGV) pour le sauver. Dans tous les cas, ce sont des mesures de capitalisme d'Etat qui sont prises dans le but de maintenir à flot des entreprises, soit parce que celles-ci sont jugées stratégiques sur le plan industriel, soit parce que c'est le seul moyen d'éviter des catastrophes financières plus importantes encore. Il ne s'agit nullement de mesures sociales comme en témoigne la prévision de près de 5000 licenciements à Alstom et de 10 500 dans 15 banques au Japon qui perçoivent des fonds publics. En effet, dans ce dernier cas, si ces banques veulent continuer à bénéficier du soutien de l'Etat sans lequel elles couleraient, elles n'ont d'autre choix que d'appliquer ses directives : améliorer, par des "dégraissages", leur bilan financier menacé et fragilisé par 50 milliards de dollars de créances douteuses qui risquent de ne jamais être récupérées. Et encore, de telles estimations qui émanent de l'Etat sont, d'après des analystes indépendants, bien en deçà de la réalité (d'après BBC News du 19 septembre).
Un retour vers les conditions de vie de la classe ouvrière au 19e siècle
Pour rendre plus acceptables aux yeux des prolétaires leurs conditions de vie actuelles, il arrive que la bourgeoisie se plaise à rappeler ce qu'elles étaient aux 18e et 19e siècle. Ils s'entassaient dans de véritables taudis insalubres ; hommes, femmes, enfants subissaient des conditions de travail inhumaines, avec en particulier des journées de travail pouvant atteindre 18 heures dans certains cas. L'affaiblissement de la force de travail qui en résultait risquait de constituer une entrave à l'exploitation et donc à l'accumulation capitaliste. De même, les poches de misère qui se développaient dans les villes industrielles devenaient une source croissante d'épidémies meurtrières en premier lieu pour la classe ouvrière elle-même, mais menaçant également toute la population, petite-bourgeoisie et bourgeoisie incluses. C'est la raison pour laquelle le développement de la lutte ouvrière pour obtenir des réformes permettant une amélioration des conditions de vie coïncidait avec les intérêts généraux du capitalisme dès lors que le développement de celui-ci n'avait pas encore atteint ses limites historiques. C'est cette situation qu'illustre la citation suivante de Marx extraite de Salaires, prix et profits à propos de la lutte pour la diminution de la journée de travail : "[les économistes officiels] nous annoncèrent de grands maux (au cas où la loi des dix heures serait obtenue par les travailleurs) : l'accumulation diminuée, les prix en hausse, les marchés perdus, la production ralentie, avec réaction inévitable sur les salaires, enfin la ruine (...) Le résultat ? Une hausse des salaires en argent pour les ouvriers des fabriques, en dépit du raccourcissement de la journée de travail, une augmentation importante des bras employés, une chute continue du prix des produits, un développement merveilleux des forces productives de leur travail, une expansion inouïe des marchés pour leurs marchandises". En revanche, dès lors que, ayant cessé d'être un système progressiste, le capitalisme est entré dans une période de déclin, il a été poussé par ses propres contradictions à attaquer toujours plus profondément les conditions de vie de la classe ouvrière. Toutes les luttes de résistance que la classe ouvrière a développées au cours du 20eme siècle, bien qu'ayant effectivement freiné la violence des attaques, ont cependant été impuissantes à inverser la tendance globale à la dégradation de ses conditions de vie. Cela, seul le renversement du capitalisme sera en mesure de le permettre.
Des situations de plus en plus catastrophiques dues à la détérioration de l'environnement
Des torrents de boue qui engloutissent des habitations de fortune, des cyclones qui les démantèlent, des tremblements de terre qui disloquent des immeubles construits à bon marché, avec plus de sable que de ciment, la perte par milliers de vies humaines, complètement démunies face aux éléments naturels déchaînés du fait de la misère qui les étreint, tout cela constitue, depuis des décennies, le lot commun des contrées du Tiers-Monde à la dérive. Mais, désormais, de telles catastrophes n'épargnent plus le coeur du monde industrialisé qui, lui aussi, compte de plus en plus de démunis et où commencent nettement à se faire sentir, depuis quelques années, les effets du dérèglement climatique de la planète. Même si les différences demeurent considérables, il apparait de plus en plus clairement que c'est bien la situation du Tiers-Monde qui indique le futur des grands pays industrialisés et non pas l'inverse. Alors que l'humanité n'avait jamais été aussi près de pouvoir dominer la nature pour vivre en harmonie avec elle, grâce à l'énorme pas en avant dans le développement des forces productives qu'avait permis le capitalisme, l'Europe, le berceau du développement de ce système, est de plus en plus impuissante face aux éléments naturels, comme en témoigne la courte rétrospective suivante sur un an seulement : - Eté 2003 : la canicule a aussi été à l'origine des incendies de forêts les plus importants jamais recensés dans ces contrées et faisant de nombreux morts. Près de 20% des surfaces boisées d'un pays comme le Portugal sont parties en fumée. - Janvier 2003 : la vague de froid qui s'est abattue sur l'Europe s'est soldée par de nombreux morts, comme c'est désormais régulièrement le cas chaque fois que le thermomètre affiche moins de zéro degré en hiver : un millier en Russie, quelques dizaines en Europe de l'Ouest. Ce dernier chiffre peut sembler dérisoire au regard de certains autres, mais il mérite néanmoins d'être relevé dans la mesure où il correspond à un phénomène tout à fait nouveau. - Septembre 2002 : une gigantesque montagne d'eau descend des Cévennes (Sud-Est de la France) en dévastant tout ce qui se trouve sur son passage, transformant en marécage toute une région couvrant trois départements. Bilan : une quarantaine de morts, ponts effondrés, chemins de fer, autoroutes, lignes téléphoniques coupés. - Août 2002 : depuis les rives de la Mer Noire jusqu'aux régions de l'Allemagne de l'Est, la Bavière, la République tchèque, l'Autriche se trouvent noyées par les eaux débordées de l'Elbe, du Danube et de leurs affluents. Les inondations, conséquence de pluies interminables, ont touché les campagnes, les villes, petites et grandes : 100 000 personnes évacuées à Dresde, des quartiers entiers dévastés à Prague, à Vienne, ponts de chemins de fer détruits, complexes chimiques menacés, pertes financières pharamineuses et surtout, des morts qui se comptent par dizaines un peu partout. Tout comme les autres aspects de la décomposition de la société capitaliste, la menace qui pèse sur l'environnement souligne le fait que, plus le prolétariat tarde à faire sa révolution, plus grand est le danger que le cours vers la destruction et le chaos n'atteigne le point de non retour qui rendrait impossible la lutte pour la révolution et la construction d'une société nouvelle (cf. Revue Internationale n° 63 ; "Mensonges et vérités de l'écologie ; c'est le capitalisme qui pollue la terre").
Le chaos et la guerre sont les seules perspectives offertes par le capitalisme
Comme nous l'avons exposé à différentes reprises dans nos colonnes, la première puissance mondiale est en permanence contrainte de prendre l'initiative sur le plan militaire, là où s'exprime son écrasante supériorité par rapport à tous ses rivaux, afin de défendre face à ceux-ci un leadership mondial qui lui est de plus en plus contesté. Depuis la première guerre du Golfe, les conflits majeurs ont été le produit d'une fuite en avant de la part des Etats-Unis talonnés par cette contradiction insurmontable : chaque nouvelle offensive, tout en faisant taire momentanément la contestation du leadership américain, crée en même temps les conditions pour une relance de celle-ci en favorisant les frustrations et le développement d'un sentiment anti-américain. L'escalade qui, depuis septembre 2001, a amené les Etats-Unis (sous prétexte de guerre contre le terrorisme et les "dictateurs dangereux") à occuper militairement, sans se soucier de l'ONU et l'OTAN, l'Afghanistan et l'Irak, n'échappe pas à cette logique. Néanmoins, aucun des conflits précédents n'avait comme l'Afghanistan, mais surtout l'Irak, engendré une situation aussi difficile à gérer pour les Etats-Unis. Forte de la facilité de sa victoire militaire sur l'Irak de Saddam Hussein, la bourgeoisie américaine ne s'attendait certainement pas à des problèmes aussi importants que ceux que lui posent actuellement l'occupation et le contrôle du pays. L'enlisement militaire des Etats-Unis en Irak renvoie à un avenir pour le moins hypothétique les belles promesses de l'administration Bush sur la reconstruction et la démocratie en Irak. Les implications d'une telle situation sont multiples. Pour tenter de maintenir l'ordre et contrôler la situation, les Etats-Unis sont contraints d'augmenter les effectifs de leurs troupes d'occupation. Signe de l'impopularité de cette mission, les professionnels volontaires deviennent plus difficiles à trouver et les troupes sur place expriment ouvertement leurs états d'âme, quand ce n'est pas leur nervosité en tirant sur tout ce qui bouge, de peur de recevoir la première balle.
Avant de lancer les Etats-Unis dans cette nouvelle offensive militaire, Bush avait annoncé que la libération de ce pays allait bouleverser le paysage géopolitique de la région. C'était effectivement un objectif, non avoué évidemment, que la domination américaine sur l'Irak permette un renforcement de son influence sur toute la région, notamment en tant que moyen d'encerclement de l'Europe. Un tel scénario incluait nécessairement que les Etats-Unis soient en mesure d'imposer la "pax americana" sur tous les foyers de tensions, en particulier sur le plus explosif d'entre eux, le conflit israélo-palestinien. Bush avait d'ailleurs annoncé le règlement prochain de celui-ci. Il était tout à fait exact, comme l'a fait Bush, de considérer que l'évolution de la situation en Irak aurait une incidence sur celle des territoires occupés par Jérusalem. C'est ce que démontre aujourd'hui, à contrario des espérances de Bush, l'aggravation des affrontements dans ces territoires. L'échec actuel de la bourgeoisie américaine en Irak constitue en effet un handicap vis-à-vis de la politique de mise au pas de son turbulent allié israélien pour lui faire respecter une "feuille de route" qu'il n'a de cesse de saboter. De telles difficultés de la bourgeoisie américaine pour imposer ses exigences à Israël ne sont pas nouvelles et expliquent en partie l'échec des différents plans de paix tentés depuis 10 ans. Néanmoins, elles n'ont jamais été aussi lourdes de conséquences qu'aujourd'hui. C'est ce qu'illustre la politique à courte vue qu'un Sharon est capable d'imposer au Moyen-Orient, basée exclusivement sur la recherche de l'escalade dans la confrontation avec les palestiniens en vue de les chasser des territoires occupés. Même si, à l'image du reste du monde, il n'y a pas de paix possible dans cette région, la carte jouée par Sharon, le boucher de Sabra et Chatila (2), ne pourra qu'aboutir à des bains de sang qui ne régleront pas pour autant, pour Israël, le problème palestinien. Au contraire, celui-ci reviendra, tel un boomerang, notamment à travers une recrudescence du terrorisme encore plus incontrôlable qu'actuellement. Une telle issue ne pourra que rejaillir négativement sur les Etats-Unis qui, évidemment, ne pourront pas pour autant lâcher leur meilleur allié dans la région. Les déboires des Etats-Unis en Irak affectent leur crédit et leur autorité sur le plan international, ce dont tous leurs rivaux ne peuvent que se réjouir et qu'ils vont tenter d'exploiter. A la faveur de ces circonstances, le plus bruyant d'entre eux, la France s'est permis l'outrecuidance, par la voix de Chirac à l'assemblée générale de l'ONU, sous prétexte d'exprimer sa différence par rapport à son "grand allié de toujours", de signifier à Bush qu'il a commis une erreur en intervenant en Irak, malgré les réserves que ce projet avait suscité de la part de nombreux pays, dont la France. Plus préoccupant pour les Etats-Unis, ils n'ont pas jusqu'à aujourd'hui pu obtenir, malgré leurs appels renouvelés, qu'une autre grande puissance, en dehors de la Grande-Bretagne qui a participé dés le début à l'opération militaire, vienne renforcer à leurs côtés le contingent des troupes d'occupation en Irak. L'Espagne, qui n'est pas une grande puissance, a expédié un détachement militaire tout à fait symbolique. Seule la Pologne, qui est une puissance encore moins grande, a répondu positivement aux avances américaines l'invitant à parader au soleil dans la cour des grands. Il sera également difficile pour les Etats-Unis de trouver beaucoup de volontaires pour financer avec eux le coût de la stabilisation et de la reconstruction de l'Irak. En fait la bourgeoisie américaine se trouve dans une impasse résultant elle-même de l'impasse de la situation mondiale qui ne peut se résoudre, du fait des circonstances historiques actuelles, à travers la marche vers une nouvelle guerre mondiale. En l'absence de cette issue bourgeoise radicale à la crise mondiale actuelle, qui signifierait à coup sûr la disparition de l'humanité, cette dernière s'enfonce progressivement dans le chaos et la barbarie qui caractérisent la phase ultime actuelle de décomposition du capitalisme. La situation présente de faiblesse relative des Etats-Unis a suscité une ardeur renouvelée de ses rivaux à reprendre l'offensive. Ainsi le 20 septembre avait lieu à Berlin une rencontre entre G. Schröder, J. Chirac et T. Blair où s'est dégagé un accord des trois dirigeants sur l'idée de doter l'Europe d'un état-major opérationnel autonome, modalité qui se heurtait jusqu'alors à l'hostilité de la bourgeoisie britannique. Les quelques pas de cette dernière en direction de rivaux avérés des Etats-Unis ne sont pas étrangers au fait que la Grande-Bretagne fait aussi les frais de la mésaventure irakienne et qu'il est plus que nécessaire pour elle d'équilibrer ses alliances, à travers différents contrepoids à l'influence américaine. La déclaration de Blair au terme de cette rencontre est tout à fait éloquente : "Nous avons sur la défense européenne une position de plus en plus commune" (cité par le journal Le Monde du 23 septembre). De même, à l'occasion de l'assemblée plénière de l'ONU qui vient de se tenir au mois de septembre, les 25 membres de l'Europe Elargie ont tous voté, vraisemblablement sous l'initiative de l'Allemagne et de la France, en faveur d'un texte qui ne peut qu'accentuer l'embarras des Etats-Unis face à la politique de son allié Israël, puisqu'il condamne la décision de Sharon d'expatrier Arafat (3). A travers ce vote symbolique, ce qui est visé c'est l'image des Etats-Unis pour la ternir davantage encore. Parmi les vingt-cinq membres de l'Europe Elargie qui ont ainsi implicitement critiqué les Etats-Unis, une majorité avait, avant le déclenchement de la guerre en Irak, peu ou prou soutenu l'option américaine contre le trio France, Allemagne, Russie. Ce fait, de même que l'évolution récente de la position de la Grande-Bretagne à propos de l'état-major opérationnel autonome européen, viennent illustrer une caractéristique de la période ouverte par la disparition des blocs impérialistes, mise en évidence par le CCI suite à la guerre du Golfe : "Dans la nouvelle période historique où nous sommes entrés, et les évènements du Golfe viennent de le confirmer, le monde se présente comme une immense foire d'empoigne, où jouera à fond la tendance au "chacun pour soi", où les alliances entre Etats n'auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictées par les nécessités du moment." (cf. Revue Internationale n°64 ; "Militarisme et décomposition"). C'est à juste titre que les révolutionnaires ont comparé les moeurs de la bourgeoisie à celles des gangsters. Mais, alors que par le passé il existait des règles chez les uns et les autres destinées à "encadrer" leurs forfaits, celles-ci volent aujourd'hui en éclat laissant la place à des comportements sans foi ni loi. Schröder en a récemment donné une brillante illustration en déclarant être entièrement d'accord avec G. Bush suite à la rencontre qu'il venait d'avoir avec lui en marge des travaux de l'assemblée de l'ONU, alors que jusqu'à présent il était avec la France, le porte drapeau de l'anti-américanisme.
Les responsabilités de la classe ouvrière
Avec l'effondrement du bloc de l'Est et la désintégration du bloc occidental disparaissait, au début des années 1990, la menace d'un conflit nucléaire mondial qui, en anéantissant l'humanité, aurait mis un terme brutal aux contradictions du capitalisme. C'est dans un contexte différent, éliminant pour toute une période la possibilité d'un conflit mondial, que ces contradictions ont continué à s'exprimer depuis lors sous la forme d'un phénomène de plus en plus accentué de décomposition du capitalisme, imprimant sa marque à tous les aspects de la vie de la société. Cela ne peut pas constituer un motif de consolation puisque : "La décomposition mène, comme son nom l'indique, à la dislocation et à la putréfaction de la société, au néant. Laissée à sa propre logique, à ses conséquences ultimes, elle conduit l'humanité au même résultat que la guerre mondiale. Etre anéanti brutalement par une pluie de bombes thermonucléaires dans une guerre généralisée ou bien par la pollution, la radioactivité des centrales nucléaires, la famine, les épidémies et les massacres de multiples conflits guerriers (où l'arme atomique pourrait aussi être utilisée), tout cela revient, à terme, au même" (cf. Revue Internationale n°107 ; "La décomposition phase ultime de la décadence du capitalisme"). Tant que la menace de destruction de la société était représentée uniquement par la guerre impérialiste, le fait que les luttes du prolétariat soient en mesure de se maintenir comme obstacle décisif à un tel aboutissement, suffisait à barrer la route à cette destruction. En revanche, contrairement à la guerre impérialiste généralisée qui, pour pouvoir se déchaîner, requiert l'adhésion du prolétariat aux idéaux de la bourgeoisie, la décomposition n'a nul besoin de l'embrigadement de la classe ouvrière pour détruire l'humanité. En effet, de même qu'elles ne peuvent s'opposer à l'effondrement économique, les luttes du prolétariat dans ce système ne sont pas non plus en mesure de constituer un frein à la décomposition. Pour mettre fin à la menace que constitue la décomposition, les luttes ouvrières de résistance aux effets de la crise ne suffisent plus : seule la révolution communiste peut venir à bout d'une telle menace. Malgré le coup porté par l'effondrement du bloc de l'Est à la prise de conscience du prolétariat, dont les répercussions sur le niveau de la lutte de classe sont encore loin d'être dépassées, celui-ci n'a subi aucune défaite majeure et sa combativité reste pratiquement intacte. Si l'aggravation inexorable de la crise du capitalisme est à l'origine de la progression de la décomposition, elle constitue en même temps le stimulant essentiel de la lutte et de la prise de conscience de la classe ouvrière, lesquelles sont la condition même de sa capacité à résister au poison idéologique du pourrissement de la société. En effet, la crise met à nu les causes ultimes de l'ensemble de la barbarie qui s'abat sur la société, permettant ainsi au prolétariat de prendre conscience de la nécessité de changer radicalement de système, et de l'impossibilité d'en améliorer certains aspects. Néanmoins, si la lutte défensive est nécessaire, elle est en elle-même insuffisante pour jalonner le chemin qui mène à la révolution. La compréhension des moyens et des buts de son combat par le prolétariat ne peut être que le produit d'un effort conscient de sa part, au sein duquel les organisations révolutionnaires ont un rôle primordial, pour comprendre les enjeux de sa lutte, la tactique et les pièges tendus par la classe ennemie, et pour tendre vers toujours plus d'unité.
LC (3 octobre)
(1) José Bové, porte-parole de la Confédération paysanne et un des leaders français les plus en vue de l'alter-mondialisation, archi-médiatisé par la bourgeoisie française et entretenant de bonnes relations avec toutes les composantes de la gauche et de l'extrême gauche dans ce pays, déclarait le 10 septembre à la fête de l'Humanité (quotidien du Parti communiste français) qu'il fallait " faire capoter Cancun".
(2) Sharon avait conduit avec une barbarie toute particulière l'expédition punitive israélienne dans ces deux camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth Ouest, en septembre 1982, laquelle avait fait des milliers de morts et de blessés, hommes, femmes et enfants.
(3) Les principaux rivaux européens des Etats-Unis ont su exploiter la position très inconfortable dans laquelle se trouvent les Etats-Unis dans cette affaire. En effet, bien qu'ayant critiqué publiquement cette position d'Israël, ceux-ci ne pouvaient néanmoins pas se permettre de lâcher leur allié, ce qui les a conduit à faire usage de leur droit de veto à l'ONU pour éviter à Israël d'être condamné par une résolution.
Récent et en cours:
- Crise économique [1]
Questions théoriques:
- Le cours historique [2]
- L'économie [3]
La crise économique signe la faillite historique des rapports de production capitalistes
- 5492 lectures
Cela fait maintenant plus de deux ans et demi que la bourgeoisie annonce la reprise et qu'elle est obligée à chaque trimestre d'en reporter l'échéance. Cela fait aussi plus de deux ans et demi que les performances économiques sont systématiquement en deçà des prévisions forçant la classe dominante à les revoir constamment à la baisse. Commencée au second semestre 2000, la récession actuelle est d'ores et déjà l'une des plus longues depuis la fin des années 60 et, si des signes de reprise se font jour outre-atlantique, c'est encore loin d'être le cas pour l'Europe et le Japon. Encore faut-il rappeler que, si les États-Unis remontent la pente, c'est essentiellement le produit d'un interventionnisme étatique parmi les plus vigoureux de ces 40 dernières années et d'une fuite en avant dans un endettement sans précédent qui fait craindre l'éclatement d'une nouvelle bulle spéculative, immobilière cette fois. Concernant l'interventionnisme étatique visant à soutenir l'activité économique, il faut noter que le gouvernement américain a laissé filer sans retenue le déficit budgétaire. De positif qu'il était en 2001, à hauteur de 130 milliards de dollars, le solde budgétaire en est arrivé à un déficit estimé à 300 milliards en 2003 (3,6% du PNB). Aujourd'hui, l'ampleur de ce déficit ainsi que ses prévisions en augmentation, compte tenu du conflit irakien et de la diminution des recettes fiscales consécutives à la baisse des impôts, inquiètent de plus en plus la classe politique et les milieux d'affaire des États-Unis. Concernant l'endettement, la baisse drastique des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale a non seulement eu pour objectif de soutenir l'activité mais a surtout visé au maintien de la demande des ménages grâce à la renégociation de leurs prêts hypothécaires. L'allégement du poids des remboursements des emprunts immobiliers a ainsi permis un surcroît d'endettement octroyé par les banques. La dette hypothécaire des ménages américains s'est ainsi accrue de 700 milliards de dollars (plus de deux fois le déficit public !). L'accroissement de la triple dette américaine, de l'État, des ménages et extérieure explique que les États-Unis ont pu rebondir plus rapidement que les autres pays. Cependant, le rebond de ce pays ne pourra se maintenir que si son activité économique reste soutenue à moyen terme sous peine de se retrouver comme le Japon, il y a plus d'une dizaine d'années, face à l'éclatement d'une bulle spéculative immobilière et d'être en cessation de paiements face à toutes une série de créances non recouvrables. L'Europe ne peut guère se payer un tel luxe puisque ses déficits étaient déjà imposants au moment de l'éclatement de la récession et que les conséquences de cette dernière n'ont fait que les creuser un peu plus. Ainsi, l'Allemagne et la France qui représentent le coeur économique de l'Europe sont aujourd'hui désignées comme les plus mauvaises élèves de la classe avec des déficits publics s'élevant à 3,8% pour la première et 4% pour la seconde. Ces niveaux sont déjà bien au-delà du plafond fixé par le traité de Maastricht (3%) et menacent ainsi ces pays de subir les foudres de la Commission européenne et les amendes prévues à l'égard des contrevenants. Ceci restreint d'autant les capacités de l'Europe à mener une politique conséquente de relance à la mesure des enjeux. De plus, en organisant la baisse du Dollar face à l'Euro pour réduire leur déficit commercial, les États-Unis vont peser sur la relance dans une Europe qui a de plus en plus de peine à dégager des excédents à l'exportation. Il n'est pas étonnant dès lors que les pays de l'axe centre européen comme l'Allemagne, la France, la Hollande et l'Italie soient en récession et que les autres n'en soient pas loin.
Ceux qui, lors de la chute du mur de Berlin, ont cru aux discours de la bourgeoisie sur l'avènement d'une nouvelle ère de prospérité et l'ouverture du 'marché des pays de l'Est' en sont pour leurs frais. Ainsi la réunification de l'Allemagne, loin de représenter un tremplin pour la 'domination allemande', constitua et constitue toujours un lourd fardeau pour ce pays. L'Allemagne, qui était la locomotive de l'Europe, est devenue depuis la réunification le wagon de queue qui peine à suivre le rythme du train. L'inflation est basse et frise la déflation, les taux d'intérêts réels élevés dépriment encore plus l'activité et l'existence de l'Euro interdit désormais de mener des politiques de dévaluation compétitive de la monnaie nationale. Le chômage, la modération salariale et la récession ont pour effet une stagnation du marché intérieur encore jamais observée lors des précédents replis de la conjoncture dans ce pays. De même, la future intégration des pays de l'Est au sein de l'Europe pèsera encore plus sur la conjoncture économique. Tout ceci a pour conséquence inéluctable un accroissement drastique des attaques contre les conditions de travail et le niveau de vie de la classe ouvrière. Mesures d'austérité, licenciements massifs et aggravation sans précédent de l'exploitation au travail sont sur tous les agendas de la bourgeoisie partout dans le monde. Selon les statistiques officielles largement sous-estimées, le chômage est en route pour atteindre les 5 millions en Allemagne, 6,1% aux États-Unis et les 10% en France à la fin de cette année. En Europe, l'axe franco-allemand, avec le plan Raffarin et l'Agenda 2010 de Schröder, donne le ton de la politique qui est menée un peu partout : creusement du déficit budgétaire, réduction des impôts pour les hauts revenus, assouplissement du droit de licenciement, réduction des indemnités de chômage et allocations diverses, diminution du remboursement des soins de santé et recul de l'âge de la retraite. Les pensionnés font aujourd'hui particulièrement les frais de l'austérité laquelle détruit définitivement l'idée de la possible existence d'un 'repos bien mérité' après une vie de dur labeur. Ainsi, aux États-Unis, avec la faillite ou les pertes de nombreux fonds de pension suite au krach boursier, l'on assiste à une entrée massive de retraités sur le marché de l'emploi, contraints qu'ils sont de se remettre au travail pour survivre. La classe ouvrière doit faire face à une vaste offensive d'austérité à tout crin qui n'aura d'ailleurs d'autre conséquence sur le plan économique que de prolonger encore plus la récession et d'engendrer de nouvelles attaques.
La crise, une expression de l'obsolescence des rapports de production capitalistes
Le déclin ininterrompu du taux de croissance depuis la fin des années 60 (Cf. Notre article "Les oripeaux de la 'prospérité économique' arrachés par la crise" dans la Revue internationale n°114 ainsi que le graphique ci-dessous) démasque bien l'immense bluff savamment entretenu par la bourgeoisie tout au long des années 90 sur la prétendue prospérité économique retrouvée du capitalisme grâce à la 'nouvelle' économie, la mondialisation et les recettes néo-libérales. Et pour cause, la crise n'est en rien une affaire de politique économique : si les recettes keynésiennes des années 50-60 puis néo-keynésiennes des années 70 sont arrivées à épuisement et si les recettes néo-libérales des années 80 et 90 n'ont rien pu résoudre c'est bien parce que la crise mondiale ne résulte pas fondamentalement d'une "mauvaise gestion de l'économie" mais qu'elle relève des contradictions de fond qui traversent la mécanique du capitalisme. Si la crise n'est pas une affaire de politique économique, c'est encore moins une affaire d'équipe gouvernementale. Qu'ils soient de gauche ou de droite, les gouvernements ont utilisé tour à tour toutes les recettes disponibles. Ainsi, les gouvernements américain et anglais actuels, identifiés comme les plus néo-libéraux et pro-mondialisation sur le plan économique, sont de couleurs politiques différentes et utilisent aujourd'hui les recettes les plus vigoureusement néo-keynésiennes qui soient en laissant filer leurs déficits publics. De même, à regarder de plus près les programmes d'austérité du gouvernement Schröder (social-démocrate - écologiste) et Raffarin (droite libérale), force est de constater qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et mettent en application les mêmes mesures.
Face à cette spirale de crise et d'austérité ininterrompue depuis plus de 35 ans, l'une des responsabilités majeures des révolutionnaires est de démontrer qu'elle trouve ses racines dans l'impasse historique du capitalisme, dans l'obsolescence de ce qui est au coeur de son rapport de production fondamental, le salariat (1). En effet, le salariat concentre en lui à la fois toutes les limites sociales, économiques et politiques à la production du profit capitaliste et, de par son mécanisme même, pose également les obstacles à la réalisation pleine et entière de ce dernier (2). La généralisation du salariat fut à la base de l'expansion du capitalisme au 19e siècle et, à partir de la première guerre mondiale, de l'insuffisance relative des marchés solvables eu égard aux besoins de l'accumulation. Contre toutes les fausses explications mystificatrices de la crise, il y va de la responsabilité des révolutionnaires de souligner cette impasse, de montrer en quoi le capitalisme, s'il a été un mode de production nécessaire et progressif, est aujourd'hui historiquement dépassé et mène l'humanité à sa perte. Comme pour toutes les phases de décadence des modes antérieurs de production (féodal, antique, etc.) cette impasse réside dans le fait que le rapport social de production fondamental est devenu trop étroit et ne permet plus d'impulser comme auparavant le développement des forces productives (3). Pour la société d'aujourd'hui, le salariat constitue désormais ce frein au plein développement des besoins de l'humanité. Seules l'abolition de ce rapport social et l'instauration du communisme permettront à l'humanité de se libérer des contradictions qui l'assaillent.
Or, depuis la chute du mur de Berlin, la bourgeoisie n'a eu de cesse de mener des campagnes sur 'l'inanité du communisme', 'l'utopie de la révolution' et la 'dilution de la classe ouvrière' en une masse de citoyens dont la seule forme d'action légitime serait la réforme 'démocratique' d'un capitalisme présenté désormais comme le seul horizon indépassable de l'humanité. Dans cette vaste escroquerie idéologique, c'est aux altermondialistes qu'est dévolu le monopole de la contestation. La bourgeoisie ne ménage pas sa peine pour leur donner un rôle de premier plan comme interlocuteurs privilégiés de sa propre critique : une large place est laissée dans les médias aux analyses et actions de ce courant, des invitations occasionnelles sont faites lors de sommets et autres rencontres officielles à leur plus éminents représentants, etc. Et pour cause, le fond de commerce des altermondialistes est le complément parfait à la campagne idéologique de la bourgeoisie sur 'l'utopie du communisme' puisqu'ils partent des mêmes postulats : le capitalisme serait le seul système possible et sa réforme la seule alternative. Pour ce mouvement, avec l'organisation ATTAC en tête et son conseil 'd'experts en économie', le capitalisme pourrait être humanisé pour autant que le 'bon capitalisme régulé' chasse le 'mauvais capitalisme financier'. La crise serait la conséquence de la dérégulation néo-libérale et de la mainmise du capitalisme financier imposant sa dictature des 15% comme rendement obligé au capitalisme industriel... le tout ayant été décidé dans une obscure réunion tenue en 1979 appelé 'le consensus de Washington'. L'austérité, l'instabilité financière, les récessions, etc. ne seraient que les conséquences de ce nouveau rapport de forces qui se serait établi au sein de la bourgeoisie au profit du capital usuraire. D'où les idées de 'réguler la finance', la 'faire reculer' et de 'réorienter les investissements vers la sphère productive', etc.
Dans cette ambiance de confusion générale sur les origines et les causes de la crise, il s'agit pour les révolutionnaires de rétablir une compréhension claire des bases de celle-ci et, surtout, de montrer qu'elle est le produit de la faillite historique du capitalisme. En d'autres termes, il s'agit pour eux de réaffirmer la validité du marxisme dans ce domaine. Malheureusement, à regarder les analyses de la crise proposées par les groupes du milieu politique prolétarien comme le PCInt - Programme Communiste ou le BIPR, force est de constater qu'ils sont loin d'une telle réaffirmation et notamment d'être capables de se démarquer de l'idéologie ambiante véhiculée par l'altermondialisme. Certes, ces deux groupes appartiennent incontestablement au camp prolétarien et se distinguent fondamentalement de la mouvance altermondialiste par leurs dénonciations des illusions réformistes et par la défense de la perspective de la révolution communiste. Cependant, leur propre analyse de la crise est largement empruntée au gauchisme défroqué de cette mouvance. Morceaux choisis : "Les gains issus de la spéculation sont si importants qu'ils ne sont pas seulement attractifs pour les entreprises 'classiques' mais aussi pour bien d'autres, citons entre autres, les compagnies d'assurance ou les fonds de pension dont Enron est un excellent exemple (...) La spéculation représente le moyen complémentaire, pour ne pas dire principal, pour la bourgeoisie, de s'approprier la plus-value (...) Une règle s'est imposée, fixant à 15% l'objectif minimum de rendement pour les capitaux investis dans les entreprises. Pour atteindre ou dépasser ce taux de croissance des actions, la bourgeoisie a dû accroître les conditions d'exploitation de la classe ouvrière : les rythmes de travail ont été intensifiés, les salaires réels baissés. Les licenciements collectifs ont touché des centaines de milliers de travailleurs." (BIPR in Bilan et Perspectives n°4, p. 6). On peut déjà relever que c'est une curieuse façon de poser le problème pour un groupe qui se proclame "matérialiste" et qui considère même que le CCI est "idéaliste". "Une règle s'est imposée" nous dit le BIPR. S'est-elle imposée toute seule ? Nous ne ferons pas l'injure au BIPR de lui attribuer une telle idée. C'est une classe, un gouvernement ou une organisation humaine donnée qui a imposé cette nouvelle règle ; mais pourquoi ? Parce que certains puissants de ce monde sont brusquement devenus plus rapaces et méchants que d'habitude ? Parce que les "méchants" l'on emporté sur les "bons" (ou les "moins méchants"). Ou tout simplement, comme le considère le marxisme, parce les conditions objectives de l'économie mondiale ont obligé la classe dominante à intensifier l'exploitation des prolétaires. Ce n'est malheureusement pas ainsi que ce passage pose le problème. De plus, et c'est encore plus grave, c'est un discours que l'on pourrait lire dans n'importe quel opuscule altermondialiste : c'est la spéculation financière qui est devenue la principale source du profit capitaliste (!), c'est la spéculation financière qui impose sa règle des 15% aux entreprises, c'est la spéculation financière qui est responsable de l'aggravation de l'exploitation, des licenciements massifs et de la baisse des salaires et c'est même la spéculation financière qui est à la source d'un processus de désindustrialisation et de la misère sur l'ensemble de la planète "L'accumulation des profits financiers et spéculatifs alimente un processus de désindustrialisation entraînant chômage et misère sur l'ensemble de la planète" (idem p. 7). Quant au PCInt - Programme Communiste, ce n'est guère mieux même si c'est dit en termes plus généraux et qu'il se couvre de l'autorité de Lénine : "Le capital financier, les banques deviennent en vertu du développement capitaliste les véritables acteurs de la centralisation du capital, accroissant la puissance de gigantesques monopoles. Au stade impérialiste du capitalisme, c'est le capital financier qui domine les marchés, les entreprises, toute la société, et cette domination conduit elle-même à la concentration financière jusqu'au point où "le capital financier, concentré en quelques mains et exerçant un monopole de fait, prélève des bénéfices énormes toujours croissants sur la constitution de firmes, les émissions de valeurs, les emprunts d'État, etc., affermissant la domination des oligarchies financières et frappant la société tout entière d'un tribut au profit des monopolistes" (Lénine, in L'impérialisme stade suprême du capitalisme). Le capitalisme qui naquit du minuscule capital usuraire, termine son évolution sous la forme d'un gigantesque capital usuraire" (Programme Communiste n°98, p.1). Voici à nouveau une dénonciation sans appel du capital financier parasitaire qui pourrait plaire au plus radical des altermondialistes (4). On chercherait en vain dans ces quelques extraits une quelconque démonstration que c'est bien le capitalisme comme mode de production qui a fait son temps, que c'est le capitalisme comme un tout qui est responsable des crises, des guerres et de la misère du monde. On chercherait en vain la dénonciation de l'idée centrale des altermondialistes selon laquelle ce serait le capital financier qui serait la cause des crises alors que c'est le capitalisme comme système qui est au coeur du problème. En reprenant des pans entiers de l'argumentation altermondialiste, ces deux groupes de la Gauche Communiste laissent la porte grande ouverte à l'opportunisme théorique envers les analyses gauchistes. Celles-ci présentent la crise comme la conséquence de l'instauration d'un nouveau rapport de forces qui se serait instauré au sein de la bourgeoisie entre l'oligarchie financière et le capital industriel. Les oligopoles financiers auraient pris le dessus sur le capital des entreprises au moment de la décision prise à Washington de brusquement relever les taux d'intérêt.
En réalité, il n'y a guère eu de 'triomphe des banquiers sur les industriels', c'est la bourgeoisie comme un tout qui est passée à la vitesse supérieure dans son offensive contre la classe ouvrière.
Les 'profits financiers' comme bases d'un capitalisme usuraire ?
La dénonciation de la financiarisation est aujourd'hui un thème commun à tous les économistes dit 'critiques'. L'explication en vogue à l'heure actuelle parmi ces 'critiques du capitalisme' est de prétendre que le taux de profit a effectivement augmenté mais qu'il a été confisqué par l'oligarchie financière de sorte que le taux de profit industriel ne s'est pas rétabli significativement, expliquant par là l'absence de redémarrage de la croissance (cf. graphique ci-dessous).
Il est exact que depuis le début des années 80, suite à la décision prise en 1979 de faire remonter les taux d'intérêt, une part importante de la plus-value extraite n'est plus accumulée via l'autofinancement des entreprises mais est distribuée sous forme de revenus financiers. La réponse dominante à ce constat est de présenter cette croissance de la financiarisation comme une ponction sur le profit global qui l'empêcherait ainsi de s'investir productivement. La faiblesse de la croissance économique s'expliquerait donc par le parasitisme de la sphère financière, par l'hypertrophie du 'capital usuraire'. De là les 'explications' pseudo marxistes s'appuyant sur les maladresses de Lénine "le capital financier, concentré en quelques mains et exerçant un monopole de fait, prélève des bénéfices énormes toujours croissants sur la constitution de firmes, les émissions de valeurs, les emprunts d'État, etc. affermissant la domination des oligarchies financières et frappant la société tout entière d'un tribut au profit des monopolistes" selon lesquelles les profits financiers exerceraient une véritable 'ponction' sur les entreprises (le fameux return de 15%). Cette analyse est un retour à l'économie vulgaire où le capital pourrait choisir entre l'investissement productif et les placements financiers en fonction de la hauteur relative du taux de profit d'entreprise et du taux d'intérêt. Sur un plan plus théorique, ces approches de la finance comme élément parasitaire renvoient à deux théories de la valeur et du profit. L'une, marxiste, dit que la valeur existe préalablement à sa répartition et est exclusivement produite dans le procès de production à travers l'exploitation de la force de travail. Dans le Livre III du Capital, Marx précise que le taux d'intérêt est "...une partie du profit que le capitaliste actif doit payer au propriétaire du capital, au lieu de la mettre dans sa poche". En cela Marx se distingue radicalement de l'économie bourgeoise qui présente le profit comme l'addition des revenus des facteurs (revenus du facteur travail, revenus du facteur capital, revenus du facteur foncier, etc.). L'exploitation disparaît puisque chacun des facteurs est rémunéré selon sa propre contribution à la production : "pour les économistes vulgaires qui essaient de présenter le capital comme source indépendante de la valeur et de la création de valeur, cette forme est évidemment une aubaine, puisqu'elle rend méconnaissable l'origine du profit" (Marx). Le fétichisme de la finance consiste dans l'illusion que la détention d'une part de capital (une action, un Bon du Trésor, une obligation, etc.) vont, au sens propre du terme, 'produire' des intérêts. Détenir un titre c'est s'acheter un droit à recevoir une fraction de la valeur créée mais cela ne crée en soi aucune valeur. C'est le travail et exclusivement lui qui confère de la valeur à ce qui est produit. Le capital, la propriété, une action, un livret d'épargne, un stock de machines ne produisent quoi que ce soit par eux-mêmes. Ce sont les hommes qui produisent (5). Le capital 'rapporte', au sens où un chien de chasse rapporte le gibier. Il ne crée rien, mais il donne à son propriétaire le droit à une part de ce qu'à créé celui qui s'en est servi. En ce sens le capital désigne moins un objet qu'un rapport social : une partie du fruit du labeur de certains aboutit entre les mains de qui possède le capital. L'idéologie altermondialiste inverse l'ordre des choses en confondant l'extraction de la plus-value d'avec sa répartition. Le profit capitaliste tire exclusivement sa source de l'exploitation du travail, il n'existe pas de profits spéculatifs pour l'ensemble de la bourgeoisie (même si tel ou tel secteur particulier peut gagner à la spéculation) ; la Bourse ne crée pas de valeur. L'autre théorie, flirtant avec l'économie vulgaire, conçoit le profit global comme la somme d'un profit industriel d'un côté et d'un profit financier de l'autre. Le taux d'accumulation serait faible parce que le profit financier serait supérieur au profit industriel. C'est une vision héritée en droite ligne des défunts partis staliniens qui ont répandu une critique 'populaire' du capitalisme vu comme la confiscation d'un profit 'légitime' par une oligarchie parasitaire (les 200 familles, etc.). L'idée est ici la même ; elle repose sur un véritable fétichisme de la finance selon laquelle la Bourse serait un moyen de créer de la valeur au même titre que l'exploitation du travail. C'est en cela que réside toute la mystification sur la taxe Tobin, la régulation et l'humanisation du capitalisme répandue par les altermondialistes. Tout ce qui transforme une contradiction subséquente (la financiarisation) en contradiction principale porte en soi le danger d'un glissement typiquement gauchiste consistant à séparer le bon grain de l'ivraie : d'un côté le capitalisme qui investit, de l'autre celui qui spécule. Cela mène à voir la financiarisation comme une espèce de parasite sur un corps capitaliste sain. La crise ne disparaîtra pas, même après l'abolition du 'gigantesque capital usuraire' si cher à Programme Communiste. D'une certaine manière, insister sur la financiarisation du capitalisme conduit à sous-estimer la profondeur de la crise en laissant entendre qu'elle proviendrait du rôle parasite de la finance qui exigerait des taux de profit trop élevés aux entreprises les empêchant ainsi de réaliser leurs investissements productifs. Si telle était bien la racine de la crise, alors une "euthanasie des rentiers" (Keynes) suffirait à la résoudre.
Ces glissements gauchistes au niveau de l'analyse mènent à présenter un certain nombre de données économiques qui cherchent à démontrer, en citant des chiffres qui donnent le vertige, cette domination absolue de la finance, et l'énormité des ponctions qu'elle opère : "... les grandes entreprises virent leurs investissements s'orienter vers les marchés financiers, supposés plus 'porteurs' (...) Ce marché phénoménal se développe à une vitesse bien supérieure à celui de la production (...) En ce qui concerne la spéculation monétaire sur les 1300 milliards de dollars qui se déplaçaient en 1996, chaque jour entre les différentes monnaies, 5 à 8% au maximum correspondaient au paiement de marchandises ou de services vendus d'un pays à l'autre (il convient d'y ajouter les opérations de change non spéculatives). 85% de ces 1300 milliards correspondaient donc à des opérations quotidiennes purement spéculatives ! Les chiffres sont à réactualiser, gageons que les 85% sont aujourd'hui dépassés" (BIPR, Bilan et Perspectives n°4, p.6). Oui ils ont été dépassés et les montants ont atteints les 1500 milliards de dollars, soit presque la totalité de la dette du Tiers-Monde... mais ces chiffres ne font peur qu'aux ignorants car ils n'ont aucun sens ! En réalité cet argent ne fait que tourner et les sommes annoncées sont d'autant plus importantes que le carrousel va vite. Il suffit de s'imaginer une personne convertissant 100 chaque demi-heure pour spéculer entre les monnaies ; au bout de 24 heures les transactions totales se seront élevées à 4800, et si elle spéculait chaque quart d'heure les transactions totales auront doublé... mais cette somme est purement virtuelle car la personne ne possède toujours que 100 plus 5 ou moins 10 suivant son talent dans l'art de la spéculation. Malheureusement cette présentation médiatique des faits, reprise par le BIPR, crédibilise les interprétations de la crise comme un produit de l'action parasitaire de la finance. En réalité, c'est l'augmentation de la sphère financière qui s'explique par celle de la plus-value non-accumulée. C'est la crise de surproduction et donc la raréfaction des lieux d'accumulation rentables qui engendrent la rétribution de plus-value sous forme de revenus financiers, et non la finance qui s'oppose ou se substitue à l'investissement productif. La financiarisation correspond à l'augmentation d'une fraction de la plus-value qui ne trouve plus à être réinvestie avec profit (6). La distribution de revenus financiers n'est pas automatiquement incompatible avec l'accumulation basée sur l'autofinancement des entreprises. Lorsque les profits tirés de l'activité économique sont attractifs, les revenus financiers sont réinvestis et participent de manière externe à l'accumulation des entreprises. Ce qu'il faut expliquer, ce n'est pas que les profits sortent par la porte sous forme de distribution de revenus financiers, mais que ces derniers ne reviennent pas par la fenêtre pour se réinvestir productivement dans le circuit économique. Si une partie significative de ces sommes était réinvestie, cela devrait se traduire par une élévation du taux d'accumulation. Si cela ne se produit pas c'est parce qu'il y a crise de surproduction et donc raréfaction des lieux d'accumulation rentables. Le parasitisme financier est un symptôme, une conséquence des difficultés du capitalisme et non la cause à la racine de ces difficultés. La sphère financière est la vitrine de la crise parce que c'est là que surgissent les bulles boursières, les effondrements monétaires et les turbulences bancaires. Mais ces bouleversements sont la conséquence de contradictions qui ont leur origine dans la sphère productive.
Le salariat au coeur de la crise de surproduction
Que s'est-il passé depuis une vingtaine d'années ? L'austérité et la baisse des salaires (7) ont permis de rétablir le taux de profit des entreprises mais ces profits accrus n'ont pas conduit à un relèvement du taux d'accumulation (l'investissement) et donc de la productivité du travail. La croissance est ainsi restée dépressive (Cf. graphique ci-dessous).
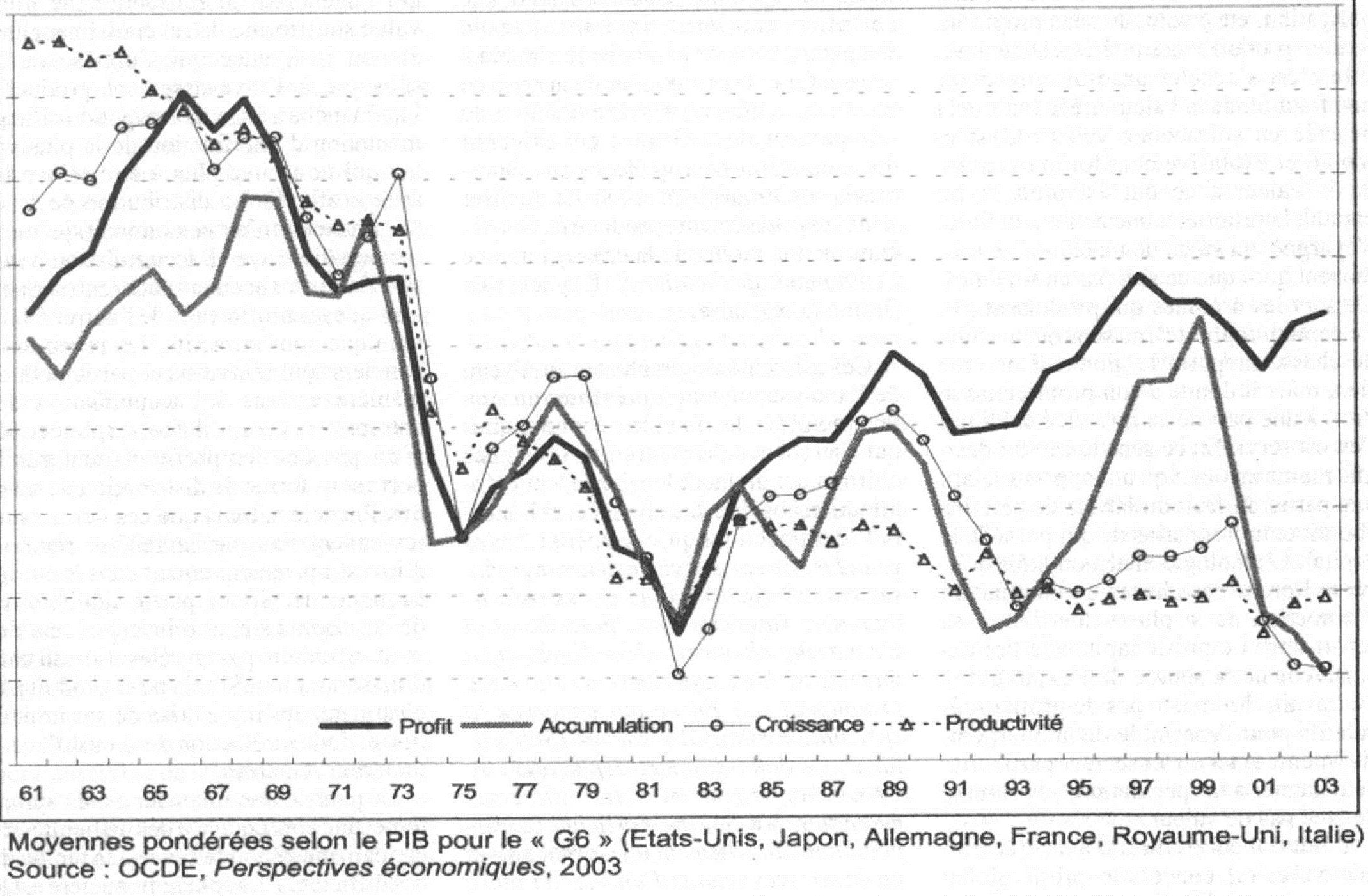
En bref, le freinage du coût salarial a restreint les marchés, nourri les revenus financiers et non le réinvestissement des profits. Mais pourquoi aujourd'hui y a-t-il un si faible réinvestissement alors que les profits des entreprises ont été rétablis ? Pourquoi l'accumulation ne redémarre-t-elle pas suite à la remontée du taux de profit depuis plus de vingt ans ? Marx, et Rosa Luxemburg à sa suite, nous ont enseigné que les conditions de la production (l'extraction de la plus-value) sont une chose et que les conditions de réalisation de ce surtravail cristallisé dans les marchandises produites en sont une autre. Le surtravail cristallisé dans la production ne devient de la plus-value sonnante et trébuchante, de la plus-value accumulable, que si les marchandises produites ont été vendues sur le marché. C'est cette différence fondamentale entre les conditions de la production et celles de la réalisation qui nous permet de comprendre pourquoi il n'y a pas de lien d'automatique entre le taux de profit et la croissance.
Le graphique ci-dessus résume bien l'évolution du capitalisme depuis la Seconde Guerre mondiale. L'exceptionnelle phase de prospérité après la reconstruction voit toutes les variables fondamentales du profit, de l'accumulation, de la croissance et de la productivité du travail augmenter ou fluctuer à des niveaux élevés jusqu'à la réapparition de la crise ouverte au tournant des années 1960-70. L'épuisement des gains de productivité qui commence dès les années 60 entraîne les autres variables dans une chute de concert jusqu'au début des années 80. Depuis, le capitalisme est dans une situation tout à fait inédite sur le plan économique marquée par une configuration qui associe un taux de profit élevé avec une productivité du travail, un taux d'accumulation et donc un taux de croissance médiocres. Cette divergence entre l'évolution du taux de profit et les autres variables depuis plus de 20 ans ne peut se comprendre que dans le cadre de la décadence du capitalisme. Il n'en va pas ainsi pour le BIPR qui estime aujourd'hui que le concept de décadence est à reléguer aux poubelles de l'histoire : "Quel rôle joue donc le concept de décadence sur le terrain de la critique de l'économie politique militante, c'est-à-dire de l'analyse approfondie des phénomènes et des dynamiques du capitalisme dans la période que nous vivons ? Aucun. (...) Ce n'est pas avec le concept de décadence que l'on peut expliquer les mécanismes de la crise, ni dénoncer le rapport entre la crise et la financiarisation, le rapport entre celle-ci et les politiques des super-puissances pour le contrôle de la rente financière et de ses sources" (BIPR, "Éléments de réflexion sur les crises du CCI"). Ainsi, le BIPR préfère abandonner le concept clef de décadence qui fondait ses propres positions (8) pour lui substituer les concepts en vogue dans le milieu altermondialiste de 'financiarisation' et de 'rente financière' pour 'comprendre la crise et les politiques des super-puissances'. Il en arrive même à affirmer que "...ces concepts [notamment de décadence] sont étrangers à la méthode et à l'arsenal de la critique de l'économie politique" (idem). Pourquoi le cadre de la décadence est-il indispensable pour comprendre la crise aujourd'hui ? Parce que le déclin ininterrompu des taux de croissance depuis la fin des années 60 au sein des pays de l'OCDE, avec respectivement 5,2%, 3,5%, 2,8%, 2,6% et 2,2% pour les décennies 60, 70, 80, 90 et 2000-02, confirme le retour progressif du capitalisme à sa tendance historique ouverte par la Première Guerre mondiale. La parenthèse de l'exceptionnelle phase de croissance (1950-75) est définitivement close (9). Tel un ressort cassé qui, après un ultime sursaut, retrouve sa position d'origine, le capitalisme en revient inexorablement aux rythmes de croissance qui prévalaient en 1914-50. Contrairement à ce que crient sur tous les toits nos censeurs, la théorie de la décadence du capitalisme n'est en rien un produit spécifique de la stagnation des années trente (10). Elle constitue l'essence même du matérialisme historique, le secret enfin trouvé de la succession des modes de production dans l'histoire et, à ce titre, elle donne le cadre de compréhension pour analyser l'évolution du capitalisme et, en particulier, de la période qui s'est ouverte au moment de la Première Guerre mondiale. Elle a une portée générale ; elle est valable pour toute une ère historique et ne dépend aucunement d'une période particulière ou d'une conjoncture économique momentanée. D'ailleurs, même en intégrant l'exceptionnelle phase de croissance entre 1950 et 1975, deux guerres mondiales, la dépression des années 30 et plus de trente-cinq années de crise et d'austérité présentent un bilan sans appel de la décadence du capitalisme : à peine 30 à 35 années (en comptant large) de 'prospérité' pour 55 à 60 années de guerre et/ou de crise économique (et le pire est encore à venir !). La tendance historique au frein de la croissance des forces productives par des rapports capitalistes de production devenus obsolètes constitue la règle, le cadre qui permet de comprendre l'évolution du capitalisme, y compris l'exception de la phase de prospérité d'après la seconde guerre mondiale (nous y reviendrons dans de prochains articles). Par contre, à l'image du courant réformiste qui s'est laissé berner par les performances du capitalisme de la Belle Époque, c'est l'abandon de la théorie de la décadence qui est un pur produit des années de prospérité. Par ailleurs le graphique ci-dessus nous montre clairement que le mécanisme qui est à la base de la remontée du taux de profit n'est ni un regain de la productivité du travail, ni un allégement en capital. Ceci nous permet aussi de tordre définitivement le cou aux bavardages sur la prétendue 'nouvelle révolution technologique'. Certains universitaires, émerveillés qu'ils sont par l'informatique et tombant dans le panneau des campagnes de la bourgeoisie sur la 'nouvelle économie'... confondent la fréquence de leur ordinateur avec la productivité du travail : ce n'est pas parce que le Pentium 4 tourne deux cent fois plus rapidement que la première génération de ce processeur que l'employé de bureau tapera deux cent fois plus vite à sa machine et pourra accroître sa productivité d'autant. Le graphique ci-dessus montre clairement que la productivité du travail continue sa décroissance depuis les années 60. Et pour cause, malgré des profits restaurés, le taux d'accumulation (les investissements à la base de possibles gains de productivité) n'a pas repris. La 'révolution technologique' n'existe que dans les discours des campagnes bourgeoises et dans l'imagination de ceux qui les gobent. Plus sérieusement, ce constat empirique du ralentissement de la productivité (du progrès technique et de l'organisation du travail), ininterrompu depuis les années 60, contredit l'image médiatique, bien ancrée dans les esprits, d'un changement technologique croissant, d'une nouvelle révolution industrielle qui serait aujourd'hui portée par l'informatique, les télécommunications, Internet et le multimédia. Comment expliquer la force de cette mystification qui inverse la réalité dans la tête de chacun d'entre nous ? Tout d'abord, il faut rappeler que les progrès de productivité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale étaient bien plus spectaculaires que ce qui nous est présenté à l'heure actuelle comme 'nouvelle économie'. La diffusion de l'organisation du travail en trois équipes de 8 heures, la généralisation de la chaîne mobile dans l'industrie, les rapides progrès dans le développement et la généralisation des transports de tous types (camion, train, avion, voiture, bateau), la substitution du charbon par un pétrole meilleur marché, l'invention des matières plastiques et le remplacement de matériaux coûteux par ces dernières, l'industrialisation de l'agriculture, la généralisation du raccordement à l'électricité, au gaz naturel, à l'eau courante, à la radio et au téléphone, la mécanisation de la vie domestique via le développement de l'électroménager, etc. sont bien plus spectaculaires en termes de progrès de productivité que tout ce qu'apportent les développements dans l'informatique et les télécommunications. Dès lors, les progrès de productivité du travail n'ont fait que décroître depuis les Golden Sixties. Ensuite, parce qu'une confusion est entretenue en permanence entre l'apparition de nouveaux biens de consommation et les progrès de productivité. Le flux d'innovations, la multiplication de nouveautés aussi extraordinaires soient-elles (DVD, GSM, Internet, etc.) au niveau des biens de consommation ne recouvre pas le phénomène du progrès de la productivité. Ce dernier signifie la capacité à économiser sur les ressources requises pour la production d'un bien ou d'un service. L'expression progrès technique doit toujours être entendue dans le sens de progrès des techniques de production et/ou d'organisation, du strict point de vue de la capacité à économiser sur les ressources utilisées dans la fabrication d'un bien ou la prestation d'un service. Aussi formidables soient-ils, les progrès du numérique ne se traduisent pas dans des progrès significatifs de productivité au sein du processus de production. Là est tout le bluff de la 'nouvelle économie'. Enfin, contrairement aux affirmations de nos censeurs qui nient la réalité de la décadence et la validité des apports théoriques de Rosa Luxemburg - et qui font de la baisse tendancielle du taux de profit l'alpha et l'oméga de l'évolution du capitalisme -, le cours de l'économie depuis le début des années 80 nous montre clairement que ce n'est pas parce que ce taux remonte que la croissance repart. Il y a certes un lien fort entre le taux de profit et le taux d'accumulation mais il n'est ni mécanique, ni univoque : ce sont deux variables partiellement indépendantes. Ceci contredit formellement les affirmations de ceux qui font obligatoirement dépendre la crise de surproduction de la chute du taux de profit et le retour de la croissance de sa remontée : "Cette contradiction, la production de la plus-value et sa réalisation, apparaît comme une surproduction de marchandises et donc comme cause de la saturation du marché, qui à son tour s'oppose au processus d'accumulation, ce qui met le système dans son ensemble dans l'impossibilité de contrebalancer la chute du taux de profit. En réalité, le processus est inverse. (...) C'est le cycle économique et le processus de valorisation qui rendent 'solvable' ou 'insolvable' le marché. C'est partant des lois contradictoires qui règlent le processus d'accumulation que l'on peut arriver à expliquer la 'crise' du marché" (Texte de présentation de Battaglia Comunista à la première conférence des groupes de la Gauche communiste, mai 1977). Aujourd'hui nous pouvons clairement constater que le taux de profit remonte depuis près d'une vingtaine d'années alors que la croissance reste déprimée et que la bourgeoisie n'a jamais autant parlé de déflation qu'à l'heure actuelle. Ce n'est pas parce que le capitalisme parvient à produire avec suffisamment de profit qu'il crée automatiquement, par ce mécanisme même, le marché solvable où il sera capable de transformer le surtravail cristallisé dans ses produits en plus-value sonnante et trébuchante lui permettant de réinvestir ses profits. L'importance du marché ne dépend pas automatiquement de l'évolution du taux de profit ; tout comme les autres paramètres conditionnant l'évolution du capitalisme, c'est une variable partiellement indépendante. C'est la compréhension de cette différence fondamentale entre les conditions de la production et celles de la réalisation, déjà bien mise en évidence par Marx et magistralement approfondie par Rosa Luxemburg, qui nous permet de comprendre pourquoi il n'y a pas d'automatisme entre le taux de profit et la croissance.
Décadence et orientations pour les luttes de résistance
Rejetant la décadence comme cadre de compréhension de la période actuelle et de la crise, pointant la spéculation financière comme la cause de tous les malheurs du monde, sous-estimant le développement du capitalisme d'État sur tous les plans, les deux plus importants groupes de la Gauche communiste en dehors du CCI - Programme Communiste et le BIPR - ne peuvent offrir une orientation claire et cohérente aux luttes de résistance de la classe ouvrière. Il suffit de lire les analyses qu'ils font de la politique de la bourgeoisie en matière d'austérité et les conclusions qu'ils tirent de leur analyse de la crise pour s'en rendre compte : "Courant des années 50 les économies capitalistes se remirent en route et la bourgeoisie vit enfin refleurir de manière durable ses profits. Cette expansion, qui s'est poursuivie la décennie suivante, s'est donc appuyée sur un essor du crédit et s'est faite avec l'appui des États. Elle s'est traduite indéniablement par une amélioration des conditions de vie des travailleurs (sécurité sociale, conventions collectives, relèvement des salaires...). Ces concessions faites, par la bourgeoisie, sous la pression de la classe ouvrière, se traduisirent par une baisse du taux de profit, phénomène en lui-même inéluctable, lié à la dynamique interne du capital. (...) Si au début du stade de l'impérialisme, les profits engrangés grâce à l'exploitation des colonies et de leurs peuples avaient permis aux bourgeoisies dominantes de garantir une certaine paix sociale en faisant bénéficier la classe ouvrière d'une fraction de l'extorsion de la plus-value, il n'en est plus de même aujourd'hui, la logique spéculative impliquant une remise en cause de tous les acquis sociaux arrachés lors des décennies précédentes par les travailleurs des 'pays centraux' à leur bourgeoisie" (BIPR, in Bilan et perspectives n°4, p. 5 à 7). Ici aussi, nous pouvons constater que l'abandon du cadre de la décadence ouvre toutes grandes les portes aux concessions envers les analyses gauchistes. Le BIPR préfère recopier les fables gauchistes sur les 'acquis sociaux (sécurité sociale, conventions collectives, relèvement des salaires,...)' qui auraient été des 'concessions faites par la bourgeoisie sous la pression de la classe ouvrière' et que 'la logique spéculative' actuelle remet en cause, plutôt que de s'appuyer sur les contributions théoriques léguées par les groupes de la Gauche communiste internationale (Bilan, Communisme, etc.), qui analysaient ces mesures comme des moyens mis en place par la bourgeoisie pour faire dépendre et rattacher la classe ouvrière à l'État ! En effet, dans la phase ascendante du capitalisme, le développement des forces productives et du prolétariat était insuffisant pour menacer la domination bourgeoise et permettre une révolution victorieuse à l'échelle internationale. C'est pourquoi, même si la bourgeoisie a tout fait pour saboter l'organisation du prolétariat, ce dernier a pu, au fur et à mesure de ses combats acharnés, se constituer en tant que 'classe pour soi' au sein du capitalisme au travers de ses propres organes qu'étaient les partis ouvriers et les syndicats. L'unification du prolétariat s'est réalisée au travers des luttes pour arracher au capitalisme des réformes se traduisant par des améliorations des conditions d'existence de la classe : réformes sur le terrain économique et réformes dans le domaine politique. Le prolétariat a acquis, en tant que classe, le droit de cité dans la vie politique de la société, ou, pour reprendre les termes de Marx dans la Misère de la philosophie : la classe ouvrière a conquis le droit d'exister et de s'affirmer de façon permanente dans la vie sociale en tant que 'classe pour soi', c'est-à-dire en tant que classe organisée avec ses propres lieux de rencontre quotidiens, ses idées et son programme social, ses traditions et même ses chants. Lors de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence en 1914, la classe ouvrière a démontré sa capacité à renverser la domination de la bourgeoisie en forçant celle-ci à arrêter la guerre et en développant une vague internationale de luttes révolutionnaires. Depuis ce moment, le prolétariat constitue un danger potentiel permanent pour la bourgeoisie. C'est pourquoi elle ne peut plus tolérer que sa classe ennemie puisse s'organiser de façon permanente sur son propre terrain, puisse vivre et croître au sein de ses propres organisations. L'État étend sa domination totalitaire sur tous les aspects de la vie de la société. Tout est enserré par ses tentacules omniprésents. Tout ce qui vit dans la société doit se soumettre inconditionnellement à l'État ou affronter ce dernier dans un combat à mort. Le temps où le capital pouvait tolérer l'existence d'organes prolétariens permanents est révolu. L'État chasse de la vie sociale le prolétariat organisé comme force permanente. De même, "Depuis la Première Guerre mondiale, parallèlement au développement du rôle de l'État dans l'économie, les lois régissant les rapports entre capital et travail se sont multipliées, créant un cadre strict de 'légalité' au sein duquel la lutte prolétarienne est circonscrite et réduite à l'impuissance." (extrait de notre brochure Les syndicats contre la classe ouvrière). Ce capitalisme d'État sur le plan social signifie la transformation de toute vie de la classe en ersatz sur le terrain bourgeois. L'État s'est saisi, par le biais des syndicats dans certains pays, directement dans d'autres, des différentes caisses de grèves ou d'organisations de secours et mutuelles en cas de maladie ou de licenciement qui avaient été mis en place par la classe ouvrière tout au long de la seconde moitié du 19e siècle. La bourgeoisie a retiré la solidarité politique des mains du prolétariat pour la transférer en solidarité économique aux mains de l'État. En subdivisant le salaire en une rétribution directe par le patron et une rétribution indirecte par l'État, la bourgeoisie a puissamment consolidé la mystification consistant à présenter l'État comme un organe au dessus des classes, garant de l'intérêt commun et garant de la sécurité sociale de la classe ouvrière. La bourgeoisie est parvenue à lier matériellement et idéologiquement la classe ouvrière à l'État. Tel était l'analyse de la Gauche italienne et de la Fraction belge de la Gauche communiste internationale à propos des premières caisses d'assurances chômage et de secours mutuel mis en place par l'État pendant les années 30 (11). Que dit le BIPR à la classe ouvrière ? Tout d'abord que la 'logique spéculative' serait responsable de la "remise en cause de tous les acquis sociaux" ... et revoilà le mal absolu de la 'financiarisation' ! Le BIPR oublie au passage que la crise et les attaques contre la classe ouvrière n'ont pas attendu l'apparition de 'la logique spéculative' pour pleuvoir sur le prolétariat. Le BIPR croit-il réellement, comme sa prose le sous-tend, que les lendemains chanteront pour la classe ouvrière une fois la 'logique spéculative' éradiquée ? Au contraire, cette mystification gauchiste qui prétend que la lutte contre l'austérité dépendrait de la lutte contre la logique spéculative est à combattre le plus vigoureusement possible ! Mais il y a plus grave ! C'est une grossière mystification que de faire croire au prolétariat que la sécurité sociale, les conventions collectives et même le mécanisme de relèvement des salaires via l'indexation ou l'échelle mobile seraient des 'acquis sociaux arrachés de haute lutte'. Oui, la réduction horaire de la journée de travail, l'interdiction de l'exploitation des enfants, l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, etc. ont constitué de véritables concessions arrachées de haute lutte par la classe ouvrière en phase ascendante du capitalisme. Par contre, les prétendus 'acquis sociaux' comme la sécurité sociale ou les conventions collectives consignées dans les Pactes Sociaux pour la Reconstruction n'ont rien à voir avec la lutte de la classe ouvrière. Classe défaite, épuisée par la guerre, enivrée et mystifiée par le nationalisme, saoulée d'euphorie à la Libération, ce n'est pas elle qui, par ses luttes, aurait arraché ces 'acquis'. C'est à l'initiative même de la bourgeoisie au sein des gouvernements en exil que des Pactes Sociaux pour la Reconstruction ont été élaborés mettant en place tous ces mécanismes de capitalisme d'État. C'est la bourgeoisie qui a pris l'initiative, entre 1943 et 1945, en pleine guerre (!), de réunir toutes 'les forces vives de la nation', tous les 'partenaires sociaux', au travers de réunions tripartites composées de représentants du patronat, du gouvernement et des différents partis et syndicats, c'est-à-dire dans la plus parfaite des concordes nationales du mouvement de la Résistance, pour planifier la reconstruction des économies détruites et négocier socialement la difficile phase de reconstruction. Il n'y a pas eu de 'concessions faites par la bourgeoisie sous la pression de la classe ouvrière' dans le sens d'une bourgeoisie contrainte d'accepter un compromis face à une classe ouvrière mobilisée sur son terrain et développant une stratégie en rupture avec le capitalisme, mais des moyens mis en place de concert par toutes les composantes de la bourgeoisie (patronat, syndicat, gouvernement) pour contrôler socialement la classe ouvrière afin de réussir la reconstruction nationale (12). Faut-il rappeler que c'est aussi la bourgeoisie qui, dans l'immédiat après-guerre, a carrément créé de toutes pièces des syndicats comme la CFTC en France ou la CSC en Belgique ? Il est évident que les révolutionnaires dénoncent tout empiétement tant sur le salaire direct que sur le salaire indirect, il est évident que les révolutionnaires dénoncent les atteintes au niveau de vie lorsque la bourgeoisie réduit la sécurité sociale à une peau de chagrin, mais jamais les révolutionnaires ne peuvent défendre le principe même du mécanisme mis en place par la bourgeoisie pour relier la classe ouvrière à l'État (13) ! Les révolutionnaires doivent au contraire dénoncer les logiques idéologiques et matérielles qui sous-tendent ces mécanismes comme la prétendue 'neutralité de l'État', la 'solidarité sociale organisée par l'État', etc. Face aux enjeux posés par l'aggravation générale des contradictions du mode de production capitaliste et face aux difficultés que rencontre la classe ouvrière pour faire face à ces enjeux, il appartient aux révolutionnaires de développer l'approfondissement nécessaire pour répondre aux nouvelles questions posées par l'histoire. Mais cet approfondissement ne saurait se baser sur les analyses frelatées colportées par les secteurs d'extrême gauche de l'appareil politique de la bourgeoisie. C'est uniquement en s'appuyant sur le marxisme et sur les acquis de la Gauche communiste, notamment sur l'analyse de la décadence du capitalisme, que les révolutionnaires seront à la hauteur de leur responsabilité.
C. Mcl
(1) Puisque, comme l'écrit Marx, "Le capital suppose donc le travail salarié, le travail salarié suppose le capital. Ils sont la condition l'un de l'autre; ils se créent mutuellement." (Travail salarié et capital)
(2) Nous ne pouvons, dans le cadre de cet article, revenir sur ce que Marx et les théoriciens marxistes ont écrit sur les contradictions qu'engendre la généralisation du travail salarié, c'est-à-dire de la transformation de la force de travail en marchandise. Pour plus de précisions sur ces travaux des marxistes, nous renvoyons le lecteur notamment à notre brochure "La décadence du capitalisme" ainsi qu'à nos articles de la Revue internationale.
(3) "À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient ces rapports en deviennent des entraves." (Karl Marx, Préface de "Introduction à la critique de l'économie politique")
(4) Malheureusement, Lénine n'est pas ici d'un grand secours car son étude sur l'impérialisme, pour décisive qu'elle soit sur certains aspects de l'évolution du capitalisme et des enjeux inter-impérialistes au tournant du 19e au 20e siècle, accorde une importance démesurée au rôle du capital financier et passe à côté de processus bien plus fondamentaux à l'époque comme le développement du capitalisme d'État (cf. Revue internationale n°19 "Sur l'impérialisme" et Révolution Internationale n°3 et 4 "Capitalisme d'État et loi de la valeur"). Capitalisme d'État qui, contrairement à l'analyse de Hilferding-Lénine, restreindra drastiquement le pouvoir de la finance à partir de l'expérience de la crise de 29 pour ensuite lui réouvrir progressivement les portes d'une certaine liberté à partir des années 80. Ce qui est décisif ici, c'est que ce sont les États nations qui ont commandé le mouvement et non l'internationale fantôme de l'oligarchie financière qui aurait imposé son diktat un soir de 1979 à Washington.
(5) Il suffit, pour bien s'en convaincre, d'imaginer deux situations limites : dans l'une toutes les machines ont été détruites et seuls les hommes subsistent et dans l'autre toute l'humanité est décimée et seules les machines restent !
(6) D'ailleurs, le fait que les taux d'autofinancement des entreprises sont supérieures à 100% depuis un bon moment réduit cette thèse à néant puisque cela veut dire que les entreprises n'ont pas besoin de la finance pour financer leurs investissements.
(7) La part des salaires dans la valeur ajoutée en Europe est passée de 76% à 68% entre 1980 et 1998 et, comme les inégalités salariales se sont notablement accrues au cours de la même période, cela signifie que la diminution du salaire moyen des travailleurs est bien plus conséquente que ne le laisse entrevoir cette statistique.
(8) Citons, entre autre, le texte du BIPR présenté à la première conférence des groupes de la Gauche communiste ; extrait du paragraphe intitulé "Crise et décadence" : "Quand ceci a commencé à se manifester le système capitaliste a cessé d'être un système progressif, c'est-à-dire nécessaire au développement des forces productives, pour entrer dans une phase de décadence caractérisée par des essais de résoudre ses propres contradictions insolubles, se donnant de nouvelles formes organisatives d'un point de vie productif (...) En effet, l'intervention progressive de l'État dans l'économie doit être considérée comme le signe de l'impossibilité de résoudre les contradictions qui s'accumulent à l'intérieur des rapports de production et est donc le signe de sa décadence".
(9) Nous renvoyons le lecteur à la publication du rapport de notre 15e congrès international sur la crise économique dans le numéro précédent de cette revue qui, sans que cela n'enlève rien au caractère exceptionnel de la période 1950-75, démystifie tout d'abord les taux de croissance calculés dans la période de décadence et ensuite démystifie ceux concernant en particulier la période d'après la Seconde Guerre mondiale qui sont très nettement surestimés.
(10) * "... la théorie de la décadence, telle qu'elle découle des conceptions de Trotski, de Bilan, de la GCF et du CCI, n'est plus adaptée aujourd'hui à la compréhension du développement réel du capitalisme tout au long du 20e siècle, et notamment à compter de 1945 (...) En ce qui concerne les communistes de la première moitié du siècle, cela peut s'expliquer assez facilement : les événements qui se succèdent sur trois décennies, entre 1914 et 1945, sont tels (...) qu'ils paraissent donner du crédit à la thèse du déclin historique du capitalisme et confirmer les prévisions faites ; il était logique de ne voir dans le capitalisme qu'un système en putréfaction, à bout de souffle et décadent" (Cercle de Paris, in "Que ne pas faire ?", p.31). * "Le concept de décadence du capitalisme a surgi dans la 3e Internationale, où il a été développé en particulier par Trotsky (...) Trotsky précisa sa conception en assimilant la décadence du capitalisme à un arrêt pur et simple de la croissance des forces productives de la société (...) Cette vision semblait assez bien correspondre à la réalité de la première moitié de ce siècle (...) La vision de Trotsky fut reprise pour l'essentiel par la Gauche italienne regroupée dans Bilan avant la 2ème guerre mondiale, puis par la Gauche Communiste de France (GCF) après celle-ci." (Perspective Internationaliste, "Vers une nouvelle théorie de la décadence du capitalisme"). * "L'hypothèse d'un 'frein irréversible' des forces productives n'est que la déduction, sur le plan théorique, d'une impression générale léguée par la période qui marque l'entre deux guerres où l'accumulation capitaliste a, de manière conjoncturelle, du mal à redémarrer." (Communisme ou Civilisation, 'Dialectique des forces productives et des rapports de production dans la théorie communiste'). * "Après la Deuxième Guerre mondiale, tant les trotskistes que les communistes de gauche ré-émergèrent avec la conviction raffermie que le capitalisme était décadent et au bord de l'effondrement. Considérant la période qui venait tout juste de s'écouler, la théorie ne paraissait pas si irréaliste, le krach de 1929 avait été suivi par la dépression durant la majeure partie des années 30 et ensuite par une autre guerre catastrophique (...) Maintenant, de même que nous pouvons dire que les communistes de gauche ont défendu les vérités importantes de l'expérience de 1917-21 contre la version léniniste des trotskistes, leur objectivisme économique et la théorie mécanique des crises et de l'effondrement, qu'ils partagent avec les léninistes, les rendirent incapables de répondre à la nouvelle situation caractérisée par un 'boom' de longue durée (...) Après la Deuxième Guerre mondiale, le capitalisme entra dans une de ses périodes d'expansion les plus soutenues, avec des taux de croissance non seulement plus hauts que ceux de l'entre-deux-guerres mais même plus hauts que ceux du grand 'boom' du capitalisme classique..." (Aufheben, "Sur la décadence, théorie du déclin ou déclin de la théorie").
(11) Lire "Une autre victoire du capitalisme : l'assurance chômage obligatoire" dans Communisme n°15, juin 1938 ; ainsi que "Les syndicats ouvriers et l'État" dans le n°5 de la même revue.
(12) Des luttes sociales il y en eut pendant la guerre, mais aussi et surtout dans l'immédiat après-guerre, compte tenu des conditions de vie catastrophiques. Mais en général, à quelques exceptions notables près comme dans le Nord de l'Italie ou dans la vallée de la Ruhr, elles ne présentaient aucune menace réelle pour le capitalisme. Ces luttes étaient toutes bien encadrées, contrôlées et souvent brisées par les partis de gauche et les syndicats au nom de la nécessaire concorde nationale en vue de la reconstruction.
(13) Ce qui est proprement incroyable c'est que le BIPR range également dans la catégorie des 'acquis sociaux' les 'conventions collectives' qui sont, on ne peut plus clairement, la codification et l'imposition de la paix sociale par la bourgeoisie dans les entreprises !
Récent et en cours:
- Crise économique [1]
Questions théoriques:
- L'économie [3]
Réponse au MLP (Russie) : Révolution socialiste du prolétariat contre 'Droit des nations a l'autodétermination'
- 4498 lectures
Dans de précédents numéros de la Revue Internationale (1) nous avons publié un nombre important de courriers échangés avec le Marxist Labour Party en Russie. L'axe principal de cet échange portait sur nos désaccords à propos du problème de la décadence du capitalisme et de ses implications pour certaines questions-clés, en particulier celles de la nature de classe de la révolution d'Octobre et du problème de la "libération nationale".
Nous avons reçu des nouvelles d'une scission au sein du groupe ; il y aurait maintenant deux MLP, l'un se faisant appeler le MLP (Bolchevik) et l'autre - celui avec lequel nous avons mené le débat jusqu'à présent- le MLP (Bureau Sud). Dans le but de clarifier une situation plutôt confuse et de mieux comprendre la position du MLP (Bureau Sud) concernant des questions fondamentales de l'internationalisme prolétarien, nous lui avons envoyé une série de questions (pour le reste de cet article, MLP signifie MLP Bureau Sud, sauf indication contraire). Nous publions une partie de la réponse du MLP et la nôtre, une fois de plus centrées sur nos divergences sur la question nationale. Entre temps, nous avons reçu une nouvelle réponse du MLP sur cette question ; nous y reviendrons ultérieurement ainsi que sur d'autres questions, en particulier l'anti-fascisme et la nature de la Seconde guerre mondiale.
LETTRE du MLP
Camarades !
Bien que votre lettre soit adressée au "Bureau Sud du MLP", nous avons également transmis son contenu à nos camarades de l'organisation qui ne vivent pas seulement dans le Sud de la Russie. Voici notre réponse collective :
1. Considérez-vous le soutien aux luttes de libération nationale possible au 20ème siècle ?
Nous pensons qu'avant de se prononcer pour ou contre le soutien aux luttes de libération nationale au 20ème siècle, il faut bien comprendre ce qu'est une lutte de libération en tant que telle. Mais en retour, c'est difficile à faire si on n'a pas au préalable déterminé plus ou moins clairement ce qu'est une "nation".
De plus, selon nous, on devrait clarifier ce qu'était l'attitude de Marx et Engels par rapport à cette question à leur époque, ainsi que la position des bolcheviks-léninistes, aussi bien avant qu'après la révolution d'Octobre 1917. Finalement, il faudrait considérer l'évolution du point de vue de l'Internationale communiste sur ces problèmes.
2. Reconnaissez-vous un "droit à l'autodétermination des nations", ou rejetez-vous une telle formule ?
Le mouvement de libération nationale est quelque chose d'objectif. Il indique qu'un peuple ou un autre a pris le chemin de son propre développement capitaliste et que le groupe ethnique correspondant est soit sur le point de devenir une nation BOURGEOISE, soit a déjà franchi ce pas. Contrairement à ce que veut la tradition de l'Internationale communiste bolchevique qui non seulement apportait son soutien aux mouvements de libération nationale comme étant bourgeois progressifs, mais en plus s'orientait vers la création de partis communistes (!) dans des pays arriérés, partis constitués de la paysannerie sous la direction de l'intelligentsia nationale progressive/révolutionnaire, et s'engageait à lutter pour l'établissement d'un pouvoir soviétique sans la présence minimale d'un prolétariat industriel sur place (la fameuse théorie du "développement non capitaliste" ou de "l'orientation socialiste dans les pays en développement"), le MLP (à ne pas confondre avec le MLP (B) !) considère que le soutien à des mouvements de libération nationale ne fait que créer l'illusion qu'on peut résoudre les problèmes sociaux à l'intérieur de frontières nationales. En particulier, cette illusion trouve son expression dans le slogan "marxiste-léniniste" : "de la libération nationale à la libération sociale ! ".
Seule la révolution sociale mondiale est capable de résoudre les problèmes nationaux, entre autres. La participation à quelque mouvement de libération nationale que ce soit, par exemple pour la séparation étatique d'une nouvelle nation bourgeoise, n'est pas une tâche spécifique des marxistes. En même temps, nous ne sommes pas des opposants aux mouvements de libération nationale. Comme, par exemple, pour ce qui est du mouvement politique qui a surgi en faveur de la séparation de la Tchétchénie d'avec la Russie, auquel certains membres du MLP(B) participent activement. Si la majorité de la population d'une certaine nationalité, sur un territoire historique déterminé, a décidé de faire usage du "droit des nations à l'autodétermination" contre "l'expansion impérialiste", nous ne nous opposerons pas à une telle position, à deux conditions: a) si la séparation territoriale est à même de mettre fin au massacre sanglant de nombreuses victimes dans les rangs de la population travailleuse des deux bords; b) si l'indépendance étatique d'une nouvelle nation bourgeoise mène plus vite à la situation dans laquelle cette nation verra émerger et se renforcer son propre prolétariat industriel, qui lancera alors sa lutte de classe contre la bourgeoisie nationale locale, ne se faisant plus d'illusion sur toute autre "libération" que la libération sociale. Avant que les prolétaires de tous les pays puissent s'unifier, il faut tout simplement qu'il existe des prolétaires dans ces pays !
3. Considérez-vous toutes les fractions de la bourgeoisie également réactionnaires au 20ème siècle - depuis le début de la Première guerre mondiale- et si ce n'est pas le cas, quels sont vos critères ?
Ici aussi, il est nécessaire de définir d'abord ce qu'il faut entendre par "réactionnaire". Le mot "réactionnaire" signifie dans son premier sens "agissant contre le progrès" ou, plus exactement, "contrecarrant les pas en avant". Il est clair, cependant, que cette définition est très générale. Etant marxistes, nous pouvons et devons parler de cette sorte de réaction qui s'oppose au désir d'en finir avec le mode de production bourgeois-capitaliste et la société de classe (propriété privée et exploitation) comme un tout, qui empêche le genre humain d'avancer vers le communisme. En même temps, les classiques du marxisme nous ont appris à comprendre le caractère progressif du mode de production bourgeois-capitaliste en regard des modes de production le précédant et des structures socio-économiques arriérées coexistant avec lui dans le cadre de la société de classe. Ils nous ont aussi appris à distinguer les étapes progressives du développement de ce mode de production lui-même. Selon nous, toute autre démarche serait scolastique et dogmatique, mais ni historique ni dialectique ! Au 20ème siècle, la production petite-bourgeoise et paysanne faisait place à la production capitaliste à grande échelle. Du point de vue marxiste, les forces productives changent la structure sociale de la société au cours de leur développement. Ceci est objectivement progressif. Selon nous, quand on se réfère au 20ème siècle, on devrait parler non de décadence du capitalisme en soi, mais seulement du processus par lequel la forme d'Etat national du capitalisme survit à sa nécessité, c'est à dire qu'une étape bien définie de son développement est épuisée. Et on ne peut pas dire qu'avec le début de la Première Guerre mondiale, le capitalisme a sans équivoque épuisé son caractère progressif. Selon nous, ce processus ne prend cours que vers le milieu du vingtième siècle. Une manifestation évidente en est l'actuelle mondialisation et l'unification économique de l'Europe, par exemple. C'est à notre époque que le capitalisme a commencé à épuiser son caractère progressif. Le moment approche de le liquider à l'échelle internationale par la révolution sociale mondiale. (...)
REPONSE DU CCI
Les Communistes et la question nationale
Parmi les différentes questions posées par ce courrier, nous avons choisi de répondre en premier lieu à celle que nous estimons particulièrement importante à clarifier. C'est une question qui est aussi présente parmi les éléments et les groupes politiques émergents en Russie. C'est la question nationale et, en particulier, la position communiste par rapport aux luttes de libération nationale et le fameux slogan de Lénine sur le "droit des nations à l'autodétermination". Bien que dans sa réponse à notre lettre, le MLP souligne qu'il ne soutient pas les mouvements de libération nationale, parce que ceux-ci "créent l'illusion qu'on peut résoudre les problèmes sociaux à l'intérieur de frontières nationales", en même temps, il trouve certaines occasions où il ne s'y opposerait pas. C'est quand "la majorité de la population d'une certaine nationalité, sur un territoire historique déterminé, a décidé de faire usage du "droit des nations à l'autodétermination" contre "l'expansion impérialiste"�" Ces occasions sont les suivantes : dans le cas où la séparation peut mettre fin à un massacre sanglant, ou dans le cas où la création d'un nouvel Etat indépendant pourrait conduire au renforcement du prolétariat dans cette nouvelle nation et plus tard, à une lutte de classe contre la bourgeoisie nationale locale.
Ce que cela signifie concrètement pour le MLP, c'est qu'il ne "[s'oppose pas] aux mouvements de libération nationale. Comme, par exemple, pour ce qui est du mouvement politique qui a surgi en faveur de la séparation de la Tchétchénie d'avec la Russie, auquel certains membres du MLP(B) participent activement". Tout d'abord, nous trouvons très étrange que le MLP dise qu'il n'est pas contre le mouvement de libération nationale et, en même temps, qu'il n'est pas pour. Le MLP est-il indifférent ou simplement ne combat-il pas activement l'idéologie de la libération nationale qui pourtant, comme il le dit, "crée l'illusion qu'on peut résoudre les problèmes sociaux à l'intérieur de frontières nationales" ? Que veut dire le MLP quand il écrit que la participation aux mouvements de libération nationale "n'est pas une tâche spécifique des marxistes"? Et pourtant, le MLP ne s'oppose pas aux activités de membres du MLP(B) qui "participent activement" à un mouvement séparatiste tchétchène. Comment interpréter tout cela?
Selon nous, cela exprime une position hautement opportuniste sur la question des mouvements de libération nationale. Nous avons l'impression que ce flou dans les prises de position n'est rien d'autre qu'une ouverture de certains membres du MLP à la participation à de tels mouvements. En fait, la position du MLP ouvre la porte au soutien à n'importe quelle lutte de libération nationale, parce qu'il sera toujours possible de trouver un critère d'application. Il y a beaucoup d'occasions où le MLP pourrait prétendre qu'une séparation nationale pourrait mettre fin à un massacre sanglant. Par exemple, en 1947, cette position aurait logiquement poussé le MLP à soutenir la séparation de l'Inde et du Pakistan pour faire cesser les massacres entre musulmans et hindous. La querelle qui s'en est suivie à propos du Jammu-et-Cachemire entre l'Inde et le Pakistan est sans doute aussi un bon exemple de comment le "droit des nations à l'autodétermination" (à ce moment-là au nom de l'Independence Act britannique) ne peut conduire qu'à des bains de sang plus nombreux encore. Aujourd'hui, nous voyons comment les dangereux conflits et les tensions constantes entre Pakistan et Inde menacent de morts par millions cette zone très densément peuplée au travers d'un conflit nucléaire entre les deux pays - qui se rajouteraient à tous les morts du conflit autour du Cachemire (2). Cet exemple montre à quel point le critère mis en avant par le MLP pour "ne pas s'opposer" à la séparation d'un nouvel Etat est absurde et non marxiste. L'autre critère utilisé par le MLP est l'hypothèse qu'une séparation pourrait mener à un développement de l'industrie et par conséquent à un développement du prolétariat et, à terme, à l'augmentation de la lutte de classe contre la "bourgeoisie nationale locale".
Le MLP ne partage pas l'analyse d'un "déclin du capitalisme" (le passage du capitalisme d'une phase progressiste à une phase de décadence) avant le milieu du 20ème siècle. Pour ce qui est de la seconde moitié de ce siècle, il devrait alors tirer les conséquences du changement de période. Ce que ne furent pas capable de faire, dans les années 1970 en Europe, plusieurs groupes qui, bien que proches des positions prolétariennes, apportaient leur soutien "critique" au FLN vietnamien parce que, disaient-ils, celui-ci devait instaurer un nouvel Etat bourgeois qui ferait avancer l'industrialisation et développerait le prolétariat. Dès que la bourgeoisie nationale serait victorieuse, disaient-ils, le prolétariat devrait immédiatement se retourner contre celle-ci. Cette fausse application du marxisme était et est encore aujourd'hui (dans le meilleur des cas) une couverture vis-à-vis de concessions opportunistes à l'idéologie bourgeoise. Cette position est très proche de celle du trotskisme qui trouve toujours une excuse pour soutenir les prétendues luttes de libération nationale, alors qu'en fait, elles ne sont rien d'autre à notre époque qu'une couverture des conflits impérialistes qui déchirent le monde. Ces remarques préliminaires mettent en évidence la nécessité de recourir à un cadre marxiste à travers la question suivante (et qui est aussi posée par le MLP au début de sa réponse à nos questions) : quelle a été l'attitude de Marx et Engels envers les luttes de libération nationale et quelle était la position des communistes sur cette question, depuis la gauche de Zimmerwald jusqu'à l'Internationale communiste ? Finalement, quelle doit être la position des communistes sur cette question aujourd'hui?
L'Etat national
Le MLP dit fort judicieusement qu'avant de prendre position pour ou contre les luttes de libération nationale, il faut comprendre le point de vue marxiste sur la nature de ces luttes et aussi sur le concept de nation. Le concept de nation n'est pas un concept abstrait et absolu, mais peut seulement être compris dans un contexte historique. Rosa Luxemburg donne une définition de ce concept dans sa Brochure de Junius: "L'Etat national, l'unité et l'indépendance nationales, tels étaient les drapeaux idéologiques sous lesquels se sont constitués les grands Etats bourgeois du c�ur de l'Europe au siècle dernier. Le capitalisme est incompatible avec le particularisme des petits Etats, avec un émiettement politique et économique ; pour s'épanouir, il lui faut un territoire cohérent aussi grand que possible, d'un même niveau de civilisation ; sans quoi on ne pourrait élever les besoins de la société au niveau requis pour la production marchande capitaliste, ni faire fonctionner le mécanisme de la domination bourgeoise moderne. Avant d'étendre son réseau sur le globe tout entier, l'économie capitaliste a cherché à se créer un territoire d'un seul tenant dans les limites nationales d'un Etat."". C'est dans ce sens que Marx et Engels, à différentes occasions, ont défendu le soutien à certaines luttes de libération nationale. Ils n'ont jamais fait cela par principe, mais seulement dans les cas où ils pensaient que la création de nouveaux Etats pouvait conduire à un réel développement du capitalisme contre les forces féodales. La création de nouveaux Etats nationaux pouvait, à cette époque en Europe, être accomplie uniquement par des mesures révolutionnaires et jouer un rôle historiquement progressif dans la lutte de classe de la bourgeoisie contre le pouvoir féodal: "Le programme national n'a joué un rôle historique en tant qu'expression idéologique de la bourgeoisie montante, aspirant au pouvoir dans l'Etat, que jusqu'au moment où la société bourgeoise s'est tant bien que mal installée dans les grands Etats du centre de l'Europe et y a créé les instruments et les conditions indispensables de sa politique." (Rosa Luxemburg, Brochure de Junius).
La méthode qu'utilisaient Marx et Engels n'était pas basée sur un slogan abstrait mais toujours sur l'analyse de chaque cas, sur une analyse du développement politique et économique de la société. "Marx, cependant, qui n'accordait pas le moindre crédit à cette formule abstraite [au droit des nations à l'autodétermination],condamna alors les Tchèques et leurs aspirations à la liberté, car il les considérait comme une complication nuisible de la situation révolutionnaire, et sa condamnation vigoureuse était d'autant plus justifiée que, selon Marx, les Tchèques étaient une nationalité en déclin, vouée à disparaître rapidement". (Rosa Luxemburg, La question nationale et l'autonomie)
Marx et Engels n'ont pas toujours eu raison dans leurs analyses, comme Rosa Luxemburg a pu le montrer par exemple dans le cas de la Pologne. La définition d'une nation n'est pas basée sur quelque critère abstrait comme une langue et une culture communes, mais sur un contexte historique précis. Dans une société de classe, une nation n'est pas quelque chose d'homogène, mais est divisée en classes dont les intérêts, les points de vue, la culture, l'éthique, etc. sont antagoniques. La notion abstraite de "droits" des nations ne peut recouvrir que les "droits" de la bourgeoisie.
De tout ceci découle qu'il ne peut pas exister quelque chose comme la volonté uniforme d'une nation, la volonté d'autodétermination. Derrière ce slogan, il y a une concession à l'idée que, pour atteindre le socialisme, il est indispensable de passer par le stade démocratique. Derrière cela, il y a aussi l'idée qu'il doit y avoir un moyen de déterminer la "volonté" du peuple. Le MLP utilise l'expression "la majorité de la population d'une certaine nationalité". Dans cette expression, il y a deux concepts abstraits. D'abord la "volonté de la population" suppose qu'il y aurait une voie pacifique, par-dessus les réels antagonismes de classe, permettant de décider (peut-être par un référendum -comme c'était proposé par les bolcheviks) du sort des nations. Deuxièmement, l'utilisation du terme "nationalité" est très vague. S'il signifie un groupe ethnique ou culturel spécifique, la relation à l'autodétermination est très incertaine. La nation est une catégorie historique et la création de l'Etat national joue un certain rôle historique pour la bourgeoisie. L'Etat national n'est pas seulement un cadre dans lequel la bourgeoisie peut développer et défendre son économie et son système d'exploitation, c'est aussi en même temps un outil offensif contre d'autres Etats nationaux pour la conquête et la domination politiques, pour la suppression d'autres nations. Ainsi, le "droit des nations à l'autodétermination" est dans la vie réelle, un "droit" de toute bourgeoisie de supprimer les "droits" des autres nations, des autres groupes ethniques, des autres langues et des autres cultures. Le "droit des nations à l'autodétermination" n'est rien d'autre qu'une utopie abstraite qui ne fait que laisser entrer par la porte de derrière le nationalisme de la bourgeoisie.
Le débat dans la Gauche de Zimmerwald
Au sein de la Gauche de Zimmerwald - courant internationaliste qui s'est opposé le plus fermement à la Première Guerre mondiale - une discussion a vu le jour sur la question du slogan du "droit des nations à l'autodétermination". Ce slogan émanait de la Seconde Internationale : "Dans la Seconde Internationale, il jouait un rôle double : d'une part, il était supposé exprimer une protestation contre toute oppression nationale et, d'autre part, il montrait l'empressement de la social-démocratie à 'défendre la patrie'. Le slogan n'était appliqué à des questions nationales spécifiques que pour mieux éviter l'investigation de son contenu concret et des tendances de son développement". (Impérialisme et oppression nationale) (3).
Les adhérents néerlandais et polonais de la Gauche de Zimmerwald ont rejeté le slogan des bolcheviks hérité de la social-démocratie. Très tôt - déjà en 1896 à l'occasion du Congrès de Londres de la Seconde Internationale et plus tard, avec Radek et d'autres, dans le SDKPiL- Rosa Luxemburg avait critiqué ce slogan qui, pensait-elle, était une concession opportuniste. Egalement dans le Parti bolchevique, représentée par Piatakov, Bosh et Boukharine, il existait une position critique envers le slogan du "droit des nations à l'autodétermination". Ceux-ci basaient leur critique sur le fait qu'à l'époque de l'impérialisme, "la réponse à la politique impérialiste de la bourgeoisie doit être la révolution socialiste du prolétariat ; la social-démocratie ne doit pas avancer de revendications minimales dans le domaine de la politique étrangère actuelle.
1.Il est par conséquent impossible de lutter contre l'asservissement de nations autrement que par une lutte contre l'impérialisme. Donc une lutte contre l'impérialisme; donc une lutte contre le capital financier, donc une lutte contre le capitalisme en général. Contourner ce chemin de quelque façon que ce soit et avancer des tâches "partielles" de "libération des nations" dans les limites de la société capitaliste détourne les forces prolétariennes de la réelle solution au problème et les enchaîne aux forces de la bourgeoisie des groupes nationaux correspondants" (Thèses sur le droit à l'autodétermination des nations, Piatakov, Bosh, Boukharine, extrait du livre Lenin's struggle for a revolutionary International).
Lénine avait une autre réponse à cette question qui étayait toute la question de la mise en avant de revendications minimales et le lien entre la question nationale et celle de la démocratie : "Ce serait une erreur radicale de penser que le combat pour la démocratie pourrait détourner le prolétariat du chemin de la révolution socialiste, ou le lui cacher, l'éclipser, etc. Au contraire, de la même façon qu'aucune victoire du socialisme n'est possible sans pratiquer la pleine démocratie, le prolétariat ne peut se préparer à sa victoire sur la bourgeoisie sans une lutte totale, cohérente et révolutionnaire pour la démocratie" (4) Il y a dans ce passage une certaine tendance à confondre la "démocratie" avec la dictature du prolétariat, et plus particulièrement, à voir la future dictature prolétarienne sous les formes de la démocratie bourgeoise. Ceci est faux à plusieurs niveaux, en particulier la domination prolétarienne ne peut se maintenir qu'à une échelle mondiale, alors que la démocratie capitaliste adopte nécessairement une forme nationale, inséparablement liée à l'Etat national. De façon plus immédiate, il y a une confusion entre la lutte pour des revendications démocratiques -y compris les "droits des nations"- et le combat pour le pouvoir prolétarien et la destruction de l'Etat bourgeois. C'était une erreur de Lénine de reprendre le vieux slogan social-démocrate sur "le droit des nations à l'autodétermination" -qui exprimait vraiment la vision opportuniste selon laquelle le socialisme ne pouvait être atteint que par la démocratie, par la conquête pacifique du pouvoir au travers du parlement- et d'essayer de le greffer sur un programme révolutionnaire. Indirectement, cette vision apportait aussi un soutien aux arguments des Mencheviks pour qui la révolution en Russie devait passer par une période de démocratie bourgeoise avant d'être prête pour le socialisme. Lénine et les Bolcheviks tiraient des conclusions totalement différentes de cette idée, dans ce sens qu'ils soutenaient la lutte révolutionnaire et y travaillaient, alors que les Mencheviks s'opposaient à toute lutte qui, selon leur théorie, dépasserait "la réalité objective" du capitalisme. Cette idée réformiste avait encore une grande influence parmi les Bolcheviks comme le révèlent les premières réactions de la majorité des "vieux Bolcheviks" en Russie face à la révolution de février. Cette position (qui n'était pas soutenue par les couches les plus radicales du parti) était dominante dans les organes dirigeants avant que Lénine ne soit de retour à Petrograd et attaque immédiatement cet opportunisme, et elle impliquait un soutien au gouvernement de Kerensky et à son effort de guerre. Lénine a combattu plus tard ce point de vue dans ses fameuses "Thèses d'avril". Maintenant Lénine comprenait que la révolution en Russie n'était pas une révolution bourgeoise, mais le premier pas de la révolution mondiale. C'est la pratique révolutionnaire de Lénine et des Bolcheviks qui allait réfuter le dogme menchevique d'une nécessaire étape démocratique avant que la révolution socialiste soit possible. En fait, l'histoire montre (contrairement à ce que croyait Lénine en 1916, quand il défendait le "droit à l'autodétermination") que ce n'est pas seulement en Russie que les illusions dans la démocratie se sont avérées le poison le plus dangereux contre la révolution : dans presque tous les pays secoués par la révolution russe, la question de la démocratie a été l'arme principale utilisée par la bourgeoisie pour s'opposer au mouvement révolutionnaire.
Contre l'idée que tous les pays devaient nécessairement passer par un certain stade de leur mode de production pour arriver à un nouveau mode de production, Rosa Luxemburg a écrit : "C'est pourquoi, historiquement parlant, l'idée selon laquelle le prolétariat moderne en tant que classe séparée et consciente ne peut rien faire sans commencer par créer un nouvel Etat-nation équivaut à demander à la bourgeoisie de chaque pays de restaurer l'ordre féodal là où ce processus n'a pas eu lieu normalement ou pris des formes particulières comme, par exemple, en Russie. La mission historique de la bourgeoisie est la création d'un Etat "national" moderne ; mais la tâche historique du prolétariat est d'abolir cet Etat en ce qu'il est une forme politique du capitalisme dans laquelle lui-même émerge en tant que classe consciente, afin d'établir le système socialiste" (La question nationale et l'autonomie, Rosa Luxemburg, souligné par nous). Voilà ce que Rosa Luxemburg a dit de la décision du Congrès de Londres de 1896 d'adopter le "droit des nations à l'autodétermination": "on propose de passer en fraude la position nationaliste sous la bannière internationale" (5). Bien que la position de Lénine n'ait rien à voir avec le social-chauvinisme des vieux partis sociaux-démocrates qui ont fini par "défendre la patrie", ses tentatives d'intégrer le "droit à l'autodétermination" au programme révolutionnaire n'en restaient pas moins une erreur. La question nationale dans la révolution russe Il faut envisager la révolution en Russie dans un cadre mondial historique, en même temps partie et signal d'une révolution mondiale. La révolution de Février n'était pas la révolution bourgeoise nécessaire avant que puisse avoir lieu la révolution socialiste, mais la première phase de la révolution prolétarienne en Russie, où s'est établie une situation de double pouvoir pour préparer l'étape suivante, la prise du pouvoir en Octobre. C'est à peu de choses près la vision défendue par Lénine dans ses "Thèses d'avril" qui sont de fait une attaque contre la vision mécanique, nationale, opportuniste de la révolution prolétarienne. Dans la Préface de Lénine à la première édition (août 1917) de son livre L'Etat et la révolution, il développe clairement sa vision de la révolution russe en écrivant: "Enfin, nous tirerons les principaux enseignements de l'expérience des révolutions russes de 1905 et surtout de 1917. A l'heure présente (début d'août 1917) cette dernière touche visiblement au terme de la première phase de son développement ; mais, d'une façon générale, toute cette révolution ne peut être comprise que si on la considère comme un des maillons de la chaîne des révolutions prolétariennes socialistes provoquées par la guerre impérialiste". Et c'est aussi en partant de cette vision de la révolution russe comme n'exprimant rien d'autre que la dynamique d'une révolution prolétarienne mondiale que Rosa Luxemburg répétait avec une intransigeance accrue sa critique du slogan du "droit à l'autodétermination" et de son utilisation par le parti bolchevique au pouvoir : "Au lieu de viser, selon l'esprit même de la nouvelle politique internationale de classe, qu'ils représentaient par ailleurs, à grouper en une masse la plus compacte possible les forces révolutionnaires sur tout le territoire de l'empire russe, en tant que territoire de la révolution, d'opposer, en tant que commandement suprême de leur politique, la solidarité des prolétaires de toutes les nationalités à l'intérieur de l'empire russe à toutes les séparations nationalistes, les bolcheviks ont, par leur mot d'ordre nationaliste retentissant du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, jusque et y compris la séparation complète", fourni à la bourgeoisie, dans tous les pays limitrophes, le prétexte le plus commode, on pourrait même dire la bannière, pour leur politique contre-révolutionnaire. Au lieu de mettre en garde les prolétaires dans les pays limitrophes contre tout séparatisme, comme piège de la bourgeoisie, ils ont, au contraire, par leur mot d'ordre, égaré les masses, les livrant ainsi à la démagogie des classes possédantes. Ils ont, par cette revendication nationaliste, provoqué, préparé eux-mêmes, le dépècement de la Russie, et mis ainsi aux mains de leurs propres ennemis le poignard qu'ils devaient plonger au c�ur de la Révolution russe" (La révolution russe, Rosa Luxemburg).
Dans tous les cas où le slogan des Bolcheviks du "droit à l'autodétermination" a été appliqué, il a ouvert la porte à des illusions sur la démocratie et le nationalisme -mythes sacrés que la bourgeoisie elle-même a toujours foulés au pied dès qu'elle devait défendre sa survie contre la révolution prolétarienne. Face à cette dernière, les bourgeoisies nationales ont toujours bien vite mis en poche l'idée d'indépendance nationale et abandonné leurs rêves nationaux pour appeler les puissances bourgeoises étrangères rivales à les soutenir et les aider à défaire "leur propre" classe prolétarienne. En même temps, et précisément pour la même raison, toute l'histoire de "l'ère des guerres et des révolutions" (termes employés par l'Internationale communiste pour l'époque du déclin capitaliste) montre que partout où le prolétariat a eu des illusions sur la possibilité de mener une lutte commune avec la bourgeoisie, cela n'a mené qu'à des massacres du prolétariat. La Finlande et la Géorgie sont des exemples criants de la façon dont la bourgeoisie, dès qu'elle eut accédé à son "indépendance", a demandé de l'aide pour écraser le bastion prolétarien en Russie - le tout sous la bannière de l'indépendance nationale. En Finlande, des troupes allemandes ont été envoyées pour réprimer la Garde rouge finlandaise, et la révolution en Finlande s'est transformée en une terrible défaite pour le prolétariat. L'Armée rouge était obligée de rester "neutre" en vertu du traité de Brest-Litovsk et n'est pas intervenue officiellement (bien que beaucoup de Bolcheviks dans l'Armée Rouge aient aidé la Garde rouge finlandaise). La bourgeoisie finlandaise a mobilisé des paysans pauvres pour combattre "l'ennemi russe" ; beaucoup des recrues de la "Garde blanche" finlandaise étaient convaincues qu'elles affrontaient des troupes russes. En Géorgie, les Mencheviks (maintenant passés à la bourgeoisie nationale, défendant le "droit à l'autodétermination nationale") ont également appelé à l'aide l'impérialisme allemand.
Il y a eu certains changements de la part des Bolcheviks sur la question nationale au début de la révolution russe : ils voyaient plus le slogan comme une nécessité purement tactique que comme un principe politique. Cela s'est exprimé dans le fait que non seulement le slogan de "l'autodétermination" a été atténué à l'intérieur du Parti bolchevique lui-même mais aussi que le Premier Congrès de la Troisième Internationale a adopté à son égard une démarche beaucoup plus claire et s'est beaucoup plus centré sur la lutte internationale du prolétariat, sur l'indépendance de celui-ci vis-à-vis de tout mouvement national, ne le laissant jamais se subordonner à la bourgeoisie nationale. Mais avec le développement d'un l'opportunisme grandissant dans l'Internationale communiste, qui était lié à la confusion croissante entre la politique de l'IC et la politique étrangère de l'Etat soviétique dégénérant, il y a eu une véritable rechute sur la question nationale, une tendance à perdre de vue la relative clarté du Premier Congrès. Une expression de ceci a été la politique de soutien aux alliances, en Turquie et en Chine, entre les partis communistes et les bourgeoisies nationalistes, qui a conduit dans les deux cas à un massacre du prolétariat et à la décimation des communistes par leurs anciens alliés "nationaux-révolutionnaires". Au bout du compte, les erreurs de Lénine et des Bolcheviks sur ces questions se sont transformées en idéologie de défense de la guerre impérialiste, en particulier par le trotskisme. Ce qui était une erreur opportuniste de la part des Bolcheviks permet aujourd'hui à la gauche du capital d'utiliser le nom de Lénine pour défendre les guerres impérialistes. Au lieu de répéter ces erreurs, les communistes doivent fonder leurs positions sur la critique internationaliste la plus cohérente qui a été développée par la gauche marxiste, de Luxemburg à Piatakov et du KAPD à la Gauche italienne.
Olof, 15.6.03
(1) Nous renvoyons le lecteur aux autres articles de la Revue Internationale sur le MLP, en particulier les numéros 101, 104 & 111. Les camarades du MLP nous ont fait savoir que la traduction correcte du nom russe de leur groupe est Marxist Workers Party (Parti marxiste ouvrier) et non Marxist Labour Party (Parti marxiste du travail). Nous avons cependant gardé le sigle MLP, pour assurer la continuité avec nos précédentes publications.
(2) Le Pakistan réclame un référendum pour déterminer à quel pays doit revenir cette région, alors que pour l'Inde, la question est réglée.
(3) Imperialism and National Oppression, thèses présentées en 1916 par Radek, Stein-Krajewski et M. Bronski, qui appartenaient à une fraction du SDKPiL et avaient des positions similaires à celles de Luxemburg.
(4) The discussion on self-determination summed up, Lénine, 1916
(5) The Polish Question at the International Congress in London,, Rosa Luxemburg, 1896
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Notes sur l'histoire des conflits impérialistes au Moyen-Orient, 1e partie
- 3885 lectures
Au cours de la plupart des cent dernières années, le Moyen-Orient a été le théâtre de guerres impérialistes.
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce sont succédées trois guerres « ouvertes » entre Israël et ses voisins rivaux (1949, 1967, 1973), un état de guerre permanent entre Israël et les combattants armés palestiniens (avec les groupes terroristes organisés et les attentats suicide d'un côté, et la terreur d'Etat israélienne de l'autre), une guerre longue de huit ans entre l'Irak et l'Iran, des combats incessants entre les nationalistes kurdes et l'Etat turc, vingt ans de guerre en Afghanistan, la guerre du Golfe en 1991, et l'invasion de l'Irak en 2003, qui n'a eu comme conséquence qu'une aggravation de l'état de guerre.
Aucune autre partie du monde n'illustre plus clairement que le capitalisme ne petit survivre qu'à travers la guerre et la destruction, que tous les pays sont impérialistes (qu'ils soient petits ou grands), qu'il n'existe pas de solution à l'intérieur du système capitaliste à ses contradictions, que la guerre a développé sa propre dynamique et que les ouvriers doivent s'unir sur le terrain internationaliste et combattre tous les nationalismes.
Le but de cette brève histoire du Moyen-Orient est de montrer que la multitude de conflits régionaux et locaux qui ont affecté cette région ne peuvent être compris que dans le contexte global de l'impérialisme.
Le Moyen-Orient, point de convergence des intérêts impérialistes de toutes les puissances capitalistes
Situé entre l'Océan indien et la Méditerranée, au carrefour entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, le Moyen-Orient a toujours représenté nue pomme de discorde, bien avant que ses ressources pétrolières soient découvertent.
Dès le début de l'expansion de l'Europe capitaliste dans cette région, les préoccupations stratégiques globales ont dominé la politique des différentes puissances qui ne se sont jamais affrontées uniquement pour la recherche de telle ou telle matière première.
Déjà, dans sa phase préliminaire d'expansion, bien avant que la révolution industrielle ait atteint son plein essor, le capitalisme britannique s'est empress de prendre pied en Inde, d'où il a pu évincer son rival français. C'est dès le début du 19e siècle que la Grande-Bretagne est devenue la principale force, en s’employant à occuper les points d'importance stratégique sur la route des Indes. En 1839, Aden d'actuel Yémen a été occupé, et les Britanniques y ont joué le rôle de police de la côte du Golfe, où les pirates entravaient le développement du commerce.
Mais le Moyen-Orient devint également vite une cible de l'expansion du capitalisme russe. Après les heurts avec la Perse (1828) et ses guerres à répétition contre l'Empire ottoman (1828, 1855, 1877) au cours du seul 19e siècle, la Russie et la Turquie sont entrées en guerre trois fois, durant la guerre de Crimée en 1853-56, ainsi qu'à l'occasion des affrontements avec la Turquie, l'Angleterre, la France et l'Italie en Mer Noire -la Russie a cherché à se déplacer vers le Caucase, la Mer Caspienne et vers les régions appelées maintenant Kazakhstan et Tadjikistan. Son objectif global était d'avoir accès à l'Océan indien via l'Afghanistan et l'Inde.
Dans le but de parer à l'expansion russe vers cette zone, la Grande-Bretagne envahit par deux fois l'Afghanistan (1839-42 et 1878-80). Après sa victoire dans la deuxième guerre afghane, la Grande-Bretagne mit en place un régime fantoche dans ce pays ([1] [6]).
A la fin du 19e siècle, l'Angleterre et la Russie décidèrent de résoudre leur conflit sur la domination en Asie, car l'impérialisme allemand commençait à s'étendre vers les Balkans et le MoyenOrient. Ils tombèrent d'accord pour se partager la zone autour de l'Afghanistan afin d'y contenir la pénétration allemande. En même temps, la GrandeBretagne établit la "ligne Durand" en Afghanistan en 1893, qui fut conçue pour empêcher la Russie d'avoir une frontière commune avec l'Inde (Durand prit soin, malgré les objections du roi d'Afghanistan, de prolonger cette frontière vers l'Est par une étroite bande de terre, le Wakhan, qui s'étend jusqu'à la Chine à travers le massif du Pamir, de façon à bien séparer l'empire russe de l'empire des Indes, Lacoste, Dictionnaire de géopolitique, p.53). En 1907, l'Angleterre et la Russie signèrent un traité de partage des zones autour de l'Iran.
Par dessus tout, la Grande-Bretagne a remporté une importante victoire stratégique en occupant militairement l'Egypte en 1882 et en en évinçant son rival français qui avait construit le canal de Suez ouvert en 1809. Le canal de Suez devint la pierre angulaire de l'implantation britannique au Moyen-Orient et d'importance vitale pour sa domination en Inde et dans d'autres parties de l'Asie et de l'Afrique. Et c'est jusqu'en 1950 que la Grande-Bretagne (de concert avec la France) envoya des troupes pour défendre le contrôle sur le canal, en s'opposant aux Etats-Unis.
Depuis le début du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a pu jouer un rôle prépondérant au Moyen-Orient, mettant à l'écart ses rivaux européens, la Russie et la France.
Comme on l'a dit plus haut, en s'appropriant leurs colonies et en définissant leurs visées impérialistes, les puissances coloniales européennes ne considéraient pas comme primordiales les questions de matières premières, que ce soit le pétrole ou d'autres. Au début du 20e siècle, les ressources pétrolières du Moyen-Orient étaient de moindre un importance et les autres matières premières ne jouaient pas de rôle décisif ([2] [7]). Déjà, les considérations stratégiques et militaires jouaient un rôle dominant.
Cependant, la nature des conflits impérialistcs prit un caractère qualitativement nouveau une fois que le globe fut divisé entre les principales puissances européennes, au début du 20e siècle.
Dès que celles-ci commencèrent à s'affronter dans différentes parties du monde, après qu'elles se le furent partagé (entre la France et l'Italie en Afrique du Nord, entre la France et l'Angleterre en Egypte et à Fachoda au Soudan, entre l'Angleterre et la Russie en Asie centrale, entre la Russie et le Japon en Extrême-Orient, entre le Japon et l'Angleterre en Chine, entre les Etats-Unis et le Japon dans le Pacifique. entre l'Allemagne et la France au sujet du Maroc, etc. ), les tensions au Moyen-Orient allèrent crescendo.
Déjà au début du 20e siècle, l'Allemagne, pays arrivé trop tard sur le marché mondial et tentant désespérément de s'approprier des colonies, ne pouvait que les arracher à un autre pays déjà "installé". Ce qui signifiait que l'Allemagne pouvait essentiellement tenter d'affaiblir les positions de la seule puissance mondiale
: l'Angleterre. L'effort allemand de ce constituer une puissance militaire datait déjà de la fin du 19e siècle. Cependant, comme nous le verrons, même si l'impérialisme allemand a pu menacer et ébranler les intérêts an(Ilais dans la région, jamais il ne fut capable d'en renverser la domination. Bien que constituant un challenger et un fauteur de troubles préjudiciable aux intérêts anglais, Contrairement à l'impérialisme britannique, il n'avait pas les moyens d'imposer sa présence dans la région.
L'Allemagne essaya alors de s'étendre vers l'Est en direction des Balkans (ce n'est pas par hasard si la Première Guerre mondiale fut déclenchée, après une accélération des antagonismcs impérialistes lors de deux guerres balkaniques, en 1912-1913, à l'issue desquelles l'Empire ottoman perdit ses territoires en Europe, en faveur de la Bulgarie, de la Serbie, de la Grèce et de l'Albanie). L'Empire ottoman en décomposition devint le point de convergence des appétits impérialiates allemands au MoyenOrient.
Alors que Marx appuyait encore la revendication d'intégrité territoriale de la Turquie comme une barrière aux ambitions russes vers le Moyen-Orient, Rosa Luxemburg avait déjà compris, au début du 20e siècle, que la situation globale avait changé et que cet appui à la Turquie était réactionnaire. "Etant donnée la multitude de revendication nartionales qui déchirent l'Etat turc : arméniennes, kurdes, syriennes, arabes, grecques (et jusqu'à récemment albanaises et macédoniennes), étant donnée la pléthore de problèmes socioéconomiques dans les différentes parties de l'Empire otoman… il est clair pour tout un chacun, et en particulier depuis longtemps pour la social-démocratie allemande qu'une véritable régénération de l’Etat turc relève de la plus complète utopie et que tous les efforts déployés pour maintenir debout ces ruines pourries et en pleine décomposition ne peuvent que constituer une entreprise réactionnaire. "(Rosa Luxemburg, Brochure de Junius, chapitre 4),
Pour l'impérialisme allemand, la Turquie représentait un atout maître dans le jeu de ses ambitions ([3] [8]).
L'Allemagne appuyait la Turquie militairement (elle entraînait l'état-major turc, fournissait des armes et signa, en 1914, un traité d'alliance et de soutien mutuel en cas de guerre) ; elle devint aussi son principal fournisseur d'aide financière et technique. C'est pourquoi "la position de l'impérialisme allemand le mit en situation de conflit avec les autres Etats européens au Moyen-Orient, en particulier avec la Grande-Bretagne. La construction de lignes de chemin de fer stratégiques et le soutien de l’Allemagne au militarisme turc heurta les intérêts' les plus sensibles de la Grande-Bretagne : ils intervinrent au carrefour de l'Asie centrale, de la Perse, de l'Inde et de l'Egypte." (Ibid.) ([4] [9])
L'ambition principale de l'impérialisme allemand au moment de la construction de la ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad était de créer un support logistique aux troupes allemandes ([5] [10]). L'effondrement de l’empire ottoman allait être d'une importance décisive pour l'éclatement des conflits impérialistes, aussi bien dans les Balkans qu'au MoyenOrient.
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la plus grande partie du Moyen-Orient était sous le contrôle de l'Empire ottoman. Sur le continent asiatique, la Turquie contrôlait la Syrie (qui incluait la Palestine), une partie de la péninsule arabique (qui n'avait, à cette époque, pas de frontières fixées), une partie du Caucase et de la Mésopotamie (allant aussi loin que Bassorah).
L'effondrement de l'Empire ottoman n'offrit pas d'opportunité pour la création d'une grande nation industrielle ni dans les Balkans, ni au Moyen-Orient, nation qui aurait été capable d'entrer en compétition sur le marché mondial. Au contraire, la pression de l'impérialisme conduisit à sa fragmentation et au développement d'Etats embryonnaires. De la même manière que ces mini-Etats dans les Balkans sont restés l'objet des rivalités impérialistes entre les grandes puissances tout au long du 20e siècle jusqu'à nos jours, la partie asiatique des ruines de l'Empire ottoman, le Moyen-Orient, a été et reste le théâtre de conflits impérialistes permanents.
Contrairement à l'Extrême-Orient qui, mis à part quelques conflits de moindre importance, est resté à l'écart de la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient, était depuis toujours un champ de bataille des affrontements entre les puissances belligérantes ([6] [11]). Déjà, à l'époque de la Première Guerre mondiale, bien avant que fussent posées les questions Palestiniennes et d'un Etat hébreu, la région était devenue un véritable champ de mines impérialiste. Comme nous le verrons, les conflits autour de la Palestine et du sionisme ont constitué des facteurs aggravants dans cette zone de conflits impérialistes entre puissances rivales.
La chute de l'Empire ottoman et les conditions de l'impérialisme à la fin de la Première Guerre mondiale
Durant la Première Guerre mondiale, les puissances européennes essayèrent de mobiliser leurs "alliés" dans la région en vue de leurs efforts de guerre.
L'Angleterre, qui combattait l'Allemagne et la Turquie aux côtés de la Russie, essaya d'attirer la bourgeoisie arabe dans son camp, contre les dirigcants ottomans. Les Anglais encouragèrent les tentatives des tribus du Hedjaz (partie orientale de la péninsule arabique) à lutter pour leur autonomie visà-vis des Turcs et appuyèrent Shérif Hussein de La Mecque.
Déjà durant la guerre, les chefs locaux servirent de pions dans la lutte pour la domination de la région que se livrèrent les puissances europènnes. Les Anglais, dont Laurence d'Arabie qui joua un rôle important en tant qu'agent de liaison avec les rebelles arabes, utilisèrent leur soulèvement contre les Turcs. Les immigrants juifs furent aussi recrutés pour servir de chair à canon à l'impérialisme anglais. Après que l'Allemagne eut poussé la Turquie à lancer une offensive contre les positions anglaises en Egypte en février 1915, essayant par là de se saisir du canal de Suez (offensive qui s'écroula après quelques jours seulement à cause du manque de soutien logistique et de fournitures d'armement), la Turquie apparut alors comme le grand perdant de cette guerre.
Ceci eut pour conséquence d'augmenter les appétits impérialistes des puissances européennes et des dirigeants arabes locaux. Espérant profiter de l'occasion, les troupes arabes, commandées par Shérif Hussein de La Mecque livrèrent une véritable course contre l'armée anglaise en été 1917 afin de se saisir de portions de territoire turc. En octobre 1918, ces mêmes troupes entrèrent dans Damas et proclamèrent la création d'un Royaume arabe. Ainsi, après avoir jouè le rôle de chair à canon pour les intérêts impérialistes anglais en Turquie, les dirigeants arabes affichèrent leurs propres ambitions impérialistes en voulant créer un "empire pan-arabe" avec Damas comme capitale. Mais ces ambitions se heurtèrent immédiatement aux intérêts anglais et français : il n'y avait pas de place pour les appétits impérialistes arabes.
Au fur et à mesure que l'Empire ottoman s'effondrait et que la défaite germano-turque devenait évidente, la France et l'Angleterre élaboraient des plans pour se partager le Moyen-Orient, tout en cherchant à s'en évincer mutuellement.
Les Etats arabes allaient être exclus du partage du butin. Historiquement, la formation d'une grande nation arabe qui aurait regroupé les morceaux de l'Empire ottoman, était devenue impossible. Les espoirs des classes dirigeantes arabes de voir se créer une grande nation arabe étaient voués à l'échec car les requins impérialistes européens ne pouvaient tolérer de rival local.
Au printemps 1915, par un accord tenu secret, les puissances européennes, Angleterre, France, Russie, Italie et Grèce se partagèrent le Moyen-Orient. Mais un autre accord signé par l'Angleterre et la France en mai 1916 et ignoré des autres pays, stipulait que :
- l'Angleterre contrôlerait Haïfa, Acca, le désert du Néguev, le Sud de la Palestine, l'Irak, l'Arabie et la Transjordanie d'actuelle Jordanie),
- la France recevrait le Liban et la Syrie.
Après la guerre, en avril 1920, l'Angleterre reçut un mandat de la Société des Nations sur la Palestine, la Transjordanie, l'Iran, l'Irak ; la France en reçut un sur la Syrie et le Liban, et dut rendre le contrôle de Mossoul (avec ses riches puits de pétrole) à l'Angletere contre des concessions anglaises sur l'Alsace-Lorraine et la Syrie.
A cette époque, l'Allemagne, pays vaincu, et la Russie, après la Révolution d'Octobre 1917, n'allaient plus être présents sur la scène impérialiste au Moyen-Orient pour une longue période. Le nombre de rivaux dans la région baissa considérablement et l'Angleterre et la France devinrent les deux forces dominantes, l'Angleterre ayant clairement la plus forte position.
Durant la guerre et jusque dans les années 1930, les forces en présence étaient européennes, les Etats-Unis ne jouant pas encore de rôle significatif.
Pour défendre son empire colonial, qui était convoité par d'autres puissances, la Grande-Bretagne devait s'appuyer sur la Palestine, région vitale stratégiquement.
Pour l'Angleterre, la Palestine représentait le lien entre le Canal de Suez et la future Mésopotamie britannique. Aucune autre puissance, fût elle européenne ou arabe, ne pouvait s'y installer et, dès 1916, l'Angleterre avait Clairement déclaré que le contrôle de la Palestine était le but de sa politique.
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, tant qu'existait l'Empire ottoman, la Palestine avait toujours été considérée comme faisant partie de la Syrie. Mais maintenant que l'Angleterre avait reçu un mandat sur la Palestine, les puissances impérialistes avaient créé une nouvelle "unité". Comme toutes ces nouvelles "unités" créées au cours de la décadence du capitalisme, elle était destinée à devenir un théâtre permanent de conflits et de guerres.
Les dirigeants palestiniens étaient encore plus faibles que les autres dirigeants arabes. Ne disposant ni de base industrielle ni de capitaux financiers, à cause de leur retard économique, ils n'avaient aucun potentiel économique et ne pouvaient compter que sur les moyens militaires pour défendre leurs intérêts.
En 1919 fut convoquè le premier congrès national palestinien et Amin al Hussein fut nommé mufti de Jérusalem. Les nationalistes palestiniens prirent contact avec la France afin d'ébranler la domination anglaise sur la Palestine. Un soulèvement militaire fut organisé avec le soutien de la Syrie et l'aide des forces françaises qui l'occupaient. Cependant, ce soulèvement fut rapidement écrasé par l’armée britannique.
En même temps les dirigeants palestiniens qui proclamaient leur autonomie dans un monde où il n'y avait plus de place pour un nouvel Etat-nation, étaient confrontés avec un nouveau "rival" venu de l'extérieur.
Comme l'Angleterre avait promis. dans la Déclaration Balfour en novembre 1917, un soutien à l'installation d'un foyer juif en Palestine, le nombre d'immigrants juifs ne cessait de croître. Les colons juifs entamèrent une lutte sanglante contre les dirigeants palestiniens pour assurer leur survie.
La Grande-Bretagne utilisa les colons juifs sur deux fronts. Après avoir incorporé dans les rangs de son armée le "Zion Mule Corps" en vue de combats contre son rival turc durant la guerre. l'Angleterre utilisait maintenant les nationalistes juifs à la fois contre son rival principal, la France et contre les nationalistes arabes. C'est pourquoi l'Angleterre incita les sionistes à proclamer à la Société des Nations qu'ils ne désiraient en Palestine ni protection française, ni protection internationale, mais la protection britannique.
Bien qu'étant rivales la France et l'Angleterre agirent de concert contre les nationalistes arabes quand ceux-ci réclamèrent leur indépendance. Après les avoir poussés contre les Turcs durant la guerre, ils utilisaient maintenant des moyens militaires pour écraser leurs ambitions indépendantistes. Après la proclamation par Fayçal, en octobre 1918 à Damas, d'un Empire arabe indépendant, qui devait inclure la Palestine, les troupes françaises le renversèrent en Juillet 1920, utilisant des bombardiers contre les nationalistes.
En Egypte, en mars 1918, au cours de nombreuses manifestations, des nationalistes égyptiens, des ouvriers et des paysans réclamèrent des réformes sociales. Elles furent réprimées à la fois par l'armée britannique et par l'armée Egyptienne, tuant plus de 3000 manifestants. En 1920, l'Angleterre écrasa un mouvement de protestation à Mossoul en Irak. Dans aucun des pays ou des protectorats arabes la bourgeoisie locale n'avait les moyens d'installer des Etats indépendants, libérés de l'emprise coloniale et des puissances "protectrices".
La revendication de libération nationale n'était rien d'autre qu'une demande réactionnaire. Alors que Marx et Engels avaient pu soutenir certains mouvements nationaux, à la seule condition que la formation d'Etat-nations pût accélérer la croissance de la classe ouvrière et la renforcer, celle-ci pouvant agir comme fossoyeur du capitalisme, ce que les développements guerriers de la situation au Moyen-Orient avaient montré était qu'il n'y avait pas de place pour la formation d'une nouvelle nation arabe ni palestinienne.
Comme partout ailleurs dans le monde, une fois le capitalisme entré dans sa phase de déclin, plus aucune fraction nationale du capital ne pouvait jouer de rôle progressiste.
Incapables de conquérir de nouveaux débouchés capitalistes, les rivaux ne pouvaient que réagir militairement : au Moyen-Orient, les puissances coloniales empêchèrent la formation d'une nouvelle nation arabe et les bourgeoisies arabes locales empêchèrent la création d'un nouvel Etat-nation palestinien.
Pour résumer la situation au Moyen-Orient, après l'effondrement de l'Empire ottoman et la fin de la Première Guerre mondiale, nous pouvons souligner les points suivants :
- les deux puissances européennes, la France et l'Angleterre, rivales entre elles et qui avaient choisi leurs "protégés", dominaient la région ;
- l'Allemagne et la Russie, qui avaient de grandes ambitions impérialistes dans la région, en avaient été rejetées ;
- la bourgeoisie arabe était incapable de créer un Etat-nation panarabe stable ;
- unité nouvellement formée, le protectorat de Palestine, avec à sa tête une classe dirigeante faible et retardataire, entrait dans un conflit contre son "protecteur", l'Angleterre, tout en étant incapable de représenter une véritable menace, et contre son nouveau rival sioniste venu de l'extérieur ;
- la bourgeoisie arabe, qui s'affrontait aux puissances coloniales qui voulaient l'empêcher de créer un nouvel Etat viable, s'opposait à son tour à la formation d'une nouvelle "unité" palestinienne ;
- les Etats-Unis, grands bénéficiaires de la guerre, n'étaient pas encore réellement présents dans la région ;
- le coeur des rivalités impérialistes n'était pas la conquête d'une matière première particulière, mais plutôt la conquête de positions stratégiques.
Nous pouvons voir que la situation au Moyen-Orient confirme totalement l'analyse faite par Rosa Luxemburg au cours de la Première Guerre mondiale : "L'Etat national, l'unité et l'indépendance nationales, tels étaient les drapeaux idéologiques sous lesquels ce sont cortstitués les grands Etats bourgeois du coeur de l'Europe au siècle dernier. Le capitalisme est incompatible avec le particularisme des petits Etats, avec un émiettement politique et économique ; pour s’épanouir il faut un territoire cohérent aussi grand que possible, d’un même niveau de civilisation : sans quoi on ne pourrait élever les besoins de la société au niveau requis pour la production marchande capitaliste, ni faire fonctionner le mécanisme de la domination bourgeoise moderne. Avant d'étendre son réseau sur le globe tout entier, l’économie capitaliste à cherché à se créer un territoire d’un seul tenant dans les limites nationales d’un Etat (...) Aujourd'hui, (la phrase nationale) ne sert qu'à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elle ne soit utilisées comme cri de guerre, dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l’attention des masses populaires et de leur faire jouer le rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes" (Brochure de Junius).
DE
[1] [12] Engels, 10.08.1857.
[2] [13] En 1900, la consommation de pétrole sélevait à environ 20 millions de tonnes et cette demande était satisfaite par les puits américains et russes (à cette époque la principale région de production était le Golfe du Mexique). La militarisation accrue et le fait que les moteurs industriels et les locomotives n'étaient plus mus par le charbon mais par le pétrole entraîna une forte demande de celui-ci. Entre 1900 et 1910, la production de pétrole brut a plus que doublé pour atteindre 43,8 millions de tonnes. L'invention du moteur Diesel pour entrainer les locomotives et les paquebots en constitua la base technique, mais les besoins d’une économie militarisée entraina le doublement de la production de brut. Cependant, avant la guerre, cette région ne jouait qu'un rôle secondaire dans l’approvisionnement mondial en pétrole. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale avec la demande importante induite par le développement de l'industrie automobile, que la production pétrolière s'accrut considérablement au Moyen-Orient.
[3] [14] L'impérialisme allemand balançait entre le soutien à la Turquie ou aux colons nationalistes juifs. Si les sionistes établissaient un foyer juif en Palestine, avec le soutien allemand, cela aurait provoqué un conflit avec l'Empire ottoman. Mais l'Allemagne ne voulait pas prendre le risque de briser son alliance avec la Turquie, car elle représentait son allié le plus important dans son antagonisme global avec la Grande-Brelagne.
[4] [15] Rosa Luxemburg fut l'une des premieres à saisir les implications historiques des conditions nouvelles qu'entraînait le début de la décadence. Déjà dans son livre sur Le développement industriel de la Pologne en 1898, elle montrait que les commnistes ne pouvaient plus soutenir la formation d'une nation polonaise. Dans le texte Les 1uttes nationales en Turquie et la sociale-démocratie, en 1896 et dans La question nationale et l'autonomie de 1908, elle a montré le changement historique intervenu entre l'ascendance et la décadence, qui rendait impossible tout soutien à la Turquie.
[5] [16] Rohrbach écrivait dans son livre Le chemin fer de Bagdad : « l’Angleterre ne peut attaquer depuis l'Europe, par la terre ferme, et touchée brutalement qu'en Egypte… Mais la Turquie ne peut envisager de conquérir l’Egypte que si elle dispose d’un réseau ferré en Asie Mineure et en Syrie. Dés le début, le ligne de chemin de fer de Bagdad a été prévue comme une loigne directe entre Constantinople et les positions militaires clés de la Turquie en Asie Mineure, avec la Syrie et les provinces du Tigre et de l’Euphrate . Bien sûr, dans ce plan était inclus le projet de transport de troupe turcs vers l’Egypte »
( Paul Rohrbach, cite par Rosa Luxembourg dans La Guerre et la politique germanique).
[6] [17] Bien que le Moyen-Orient fût un théatre périphérique de la Première Guerre mondiale, sur ses 20 millions de morts, quelque 350 000 provenaient du Moyen-Orient. La Turquie. ainsi que le blocus des ports arabes par les alliés et les épidémies et la famine furent responsables de nombre de morts. 30% des Egyptiens furent enrôlés par les Anglais et les Australiens pour servir de main d'euvre.
Géographique:
- Moyen Orient [18]
Questions théoriques:
- Impérialisme [19]
Il y a 30 ans, la chute d'Allende au Chili : Dictature et démocratie sont les deux visages de la barbarie capitaliste
- 5779 lectures
Le 11 septembre 1973 un coup d'État militaire dirigé par le général Pinochet renversait dans un bain de sang le gouvernement de l'Unité Populaire de Salvador Allende au Chili. La répression qui s'est abattue sur la classe ouvrière fut terrible : des milliers de personnes (1), pour la plupart des ouvriers, furent systématiquement massacrés, des dizaines de milliers furent emprisonnés et torturés. A cette barbarie effroyable se sont encore ajoutées plusieurs centaines de milliers de licenciements (un ouvrier sur dix au cours de la première année de la dictature militaire). L'ordre qui régnait à Santiago (et qui s'est installé avec le soutien de la CIA) (2) n'était rien d'autre que l'ordre de la terreur capitaliste dans sa forme la plus caricaturale. A l'occasion du trentième anniversaire du renversement du gouvernement "socialiste" d'Allende toute la bourgeoisie "démocratique" a mis à profit la commémoration de cet événement pour tenter une fois encore de dévoyer la classe ouvrière de son propre terrain de lutte. Une fois encore, la classe dominante cherche à faire croire aux ouvriers que le seul combat dans lequel ils doivent s'engager, c'est celui de la défense de l'Etat démocratique contre les régimes dictatoriaux dirigés par des voyous sanguinaires. C'est bien le sens de la campagne orchestrée par les médias consistant à faire le parallèle entre le coup d'État de Pinochet le 11 septembre 1973 et l'attentat contre les Tours jumelles à New York (voir le titre du journal Le Monde du 12 septembre : "Chili 1973 : l'autre 11 septembre").
Et dans ce choeur unanime de toutes les forces démocratiques bourgeoises, on trouve au premier plan les partis de gauche et les officines gauchistes qui avaient pleinement participé, aux côtés du MIR (3) chilien, à embrigader la classe ouvrière derrière la clique d'Allende, les livrant ainsi pieds et poings liés au massacre (voir notre article dans RI nouvelle série n° 5 : "Le Chili révèle la nature profonde de la gauche et des gauchistes"). Face à cette gigantesque mystification consistant à présenter Allende comme un pionnier du "socialisme" en Amérique Latine, il appartient aux révolutionnaires de rétablir la vérité en rappelant les faits d'armes de la démocratie chilienne. Car les prolétaires ne doivent jamais oublier que c'est le "socialiste" Allende qui a envoyé son armée "populaire" pour réprimer les luttes ouvrières et a permis ensuite à la junte militaire de Pinochet de parachever le travail. Nous publions ci-dessous un article adapté du tract diffusé début novembre 1973 par "World Revolution" ainsi que le tract diffusé peu après le coup d'État par "Révolution Internationale", c'est-à-dire les groupes qui allaient constituer les sections du CCI en Grande-Bretagne et en France.
TRACT DE WORLD REVOLUTION (organe du CCI en Grande-Bretagne)
Au Chili comme au Moyen Orient, le capitalisme a montré une fois de plus que ses crises se paient du sang de la classe ouvrière. Tandis que la Junte massacrait les travailleurs et tous ceux qui se sont opposé à la loi du capital, la "gauche" du monde entier s'unissait dans un même ch�ur hystérique et mystificateur. Les résolutions parlementaires, les glapissements de "Cassandre" des partis de gauche, la fureur des trotskistes criant : "Je vous l'avais bien dit", les grandes manifestations, tout cela n'était qu'un rabâchage soigneusement préparé par la gauche officielle et les gauchistes. Leur partenaire chilien, le défunt gouvernement de l'Unité Populaire d'Allende a préparé le massacre après avoir désarmé, matériellement et idéologiquement les travailleurs chiliens pendant trois ans. En considérant la coalition d'Allende comme celle de la classe ouvrière, en l'appelant "socialiste", toute la "gauche" a essayé de cacher ou de minimiser le rôle réel d'Allende et aidé à perpétuer les mythes créés par le capitalisme d'État au Chili. La nature capitaliste du régime d'Allende Toute la politique de l'Unité Populaire consistait à renforcer le capitalisme au Chili. Cette large fraction du capitalisme d'État, qui s'est appuyée sur les syndicats (aujourd'hui devenus partout des organes capitalistes) et sur les secteurs de la petite bourgeoisie et de la technocratie s'est scindée pendant quinze ans dans les partis communiste et socialiste. Sous le nom de Front des Travailleurs, FRAP ou Unité Populaire, cette fraction voulait rendre le capital chilien arriéré compétitif sur le marché mondial. Une telle politique, appuyée sur un fort secteur d'État, était purement et simplement capitaliste. Recouvrir les rapports de production capitalistes d'un vernis de nationalisations sous "contrôle" ouvrier n'aurait rien changé à la base : les rapports de production capitalistes sont restés intacts sous Allende, et ont même été renforcés au maximum. Sur les lieux de production des secteurs public et privé, les travailleurs devaient toujours suer pour un patron, toujours vendre leur force de travail. Il fallait satisfaire les appétits insatiables de l'accumulation du capital, exacerbés par le sous-développement chronique de l'économie chilienne et une insurmontable dette extérieure, surtout dans le secteur minier (cuivre) dont l'État chilien tirait 83% de ses revenus dans l'exportation. Une fois nationalisées, les mines de cuivre devaient devenir rentables. Dès le début, la résistance des mineurs contribua à détruire ce plan capitaliste. Au lieu d'accorder crédit aux slogans réactionnaires de l'Unité Populaire :"Le travail volontaire est un devoir révolutionnaire", la classe ouvrière industrielle du Chili, particulièrement les mineurs, a continué à lutter pour l'augmentation des salaires, et a brisé les cadences par l'absentéisme et les débrayages. C'était la seule façon de compenser la chute du pouvoir d'achat pendant les années précédentes, et l'inflation galopante sous le nouveau régime qui avait atteint 300% par an à la veille du coup d'État. La résistance de la classe ouvrière à Allende a débuté en 1970. En décembre 1970, 4000 mineurs de Chuquicamata se mirent en grève réclamant des augmentations de salaires. En juillet 1971, 10 000 mineurs du charbon se mirent en grève à la mine de Lota Schwager. Dans les mines d'El Salvador, El Teniente, Chuquicamata, La Exotica, et Rio Blanco, de nouvelles grèves s'étendirent à la même époque, réclamant des augmentations de salaire. Allende déchaîne la répression contre les ouvriers La réponse d'Allende fut typiquement capitaliste : alternativement, il calomnia puis cajola les travailleurs. En novembre 1971 Castro vint au Chili pour renforcer les mesures anti-ouvrières d'Allende. Castro tempêta contre les mineurs, et les traita d'agitateurs "démagogues" ; à la mine de Chuquicamata, il déclara que "cent tonnes de moins par jour signifiait une perte de 36 millions de dollars par an". Alors que le cuivre est la principale source de devises du Chili, les mines représentent seulement 11% du produit national brut, et emploient seulement 4% de la force de travail, c'est-à-dire environ 60 000 mineurs du cuivre. Quoi qu'il en soit, l'importance numérique de ce secteur de la classe est tout à fait hors de proportion avec le poids que les mineurs représentent dans 1'économie nationale. Peu nombreux mais très puissants et conscients de l'être, les mineurs obtinrent de l'État l'échelle mobile des salaires et donnèrent le signal de l'offensive sur les salaires qui surgit dans toute la classe ouvrière chilienne en 1971. Toute la presse bourgeoise était d'accord pour affirmer que "la voie chilienne au socialisme" était une forme de "socialisme" qui a échoué. Les staliniens et les trotskistes bien sûr ont acquiescé, en conservant leurs différences talmudiques. De ces derniers, le capitalisme d'Allende a reçu un "soutien critique". Les anarchistes n'ont pas été en reste : "La seule porte de sortie pour Allende aurait été d'appeler la classe ouvrière à prendre le pouvoir pour elle-même et de devancer le coup d'État inévitable" écrivait le Libertarian Struggle (octobre 1973). Ainsi Allende n'était pas seulement "marxiste". C'était aussi un Bakounine raté. Mais ce qui est vraiment risible, c'est d'imaginer qu'un gouvernement capitaliste puisse jamais appeler les travailleurs à détruire le capitalisme ! En mai-juin 1972, les mineurs ont recommencé à se mobiliser : 20 000 se mirent en grève dans les mines d'El Teniente et Chuquicamata. Les mineurs d'El Teniente revendiquèrent une hausse des salaires de 40%. Allende plaça les provinces d'O' Higgins et de Santiago sous contrôle militaire, parce que la paralysie d'El Teniente "menaçait sérieusement l'économie". Les managers "marxistes", membres de l'Unité Populaire ont vidé des travailleurs et envoyé des briseurs de grève. 500 carabiniers attaquèrent les ouvriers avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. 4000 mineurs firent une marche sur Santiago pour manifester le 14 juin, la police les chargea sauvagement. Le gouvernement traita les travailleurs d'"agents du fascisme". Le PC organisa des défilés à Santiago contre les mineurs, appelant le gouvernement à faire preuve de fermeté. Le MIR, "opposition loyale" extraparlementaire à Allende, critiqua l'utilisation de la force et prit parti pour la "persuasion". Allende nomma un nouveau ministre des mines en août 1973 : le général Ronaldo Gonzalez, le directeur des munitions de l'armée. Le même mois, Allende alerta les unités armées dans les 25 provinces du Chili. C'était une mesure contre la grève des camionneurs, mais aussi contre quelques secteurs ouvriers qui étaient en grève, dans les travaux publics et les transports urbains. Pendant les derniers mois du régime d'Allende, la politique à l'ordre du jour fut celle des attaques généralisées et des meurtres contre les travailleurs et les habitants des bidonvilles, par la police, l'armée et les fascistes. A partir de ce moment, le cheval de Troie du capitalisme, l'Unité Populaire avait tenté de renforcer son électorat dans toutes sortes de "comités populaires" hiérarchisés, comme les 20 000 environ qui existaient en 1970, dans ces "comités de soutien au peuple" (JAPS) et finalement dans ces cordons industriels si vantés, que les anarchistes et trotskistes présentaient à l'époque comme des types de "soviets" ou de comités d'usine. Il est vrai que les cordons étaient dans la majorité des cas, l'�uvre spontanée des travailleurs, de même que beaucoup d'occupations d'usine, mais ils finirent par être récupérés par l'appareil politique de l'Unité Populaire. Comme un journal trotskiste l'admettait lui-même : "en septembre 1973 de tels cordons avaient surgi dans tous les faubourgs industriels de Santiago et les partis politiques de gauche poussaient à leur instauration dans tout le pays" ("Red Weekly", 5 octobre 1973). Les cordons n'étaient pas armés et n'avaient aucune indépendance par rapport au réseau des syndicats de l'Unité Populaire, des comités locaux de la police secrète etc. Leur indépendance n'aurait pu s'affirmer que si les travailleurs avaient commencé à s'organiser séparément et contre l'appareil d'Allende. Cela aurait signifié ouvrir la lutte de classe contre l'Unité Populaire, l'armée et le reste de la bourgeoisie. En décembre 1971, Allende avait déjà laissé Pinochet l'un des nouveaux dictateurs du Chili, se déchaîner dans les rues de Santiago. L'armée avait imposé des couvre-feux, la censure de la presse, et des arrestations sans mandat. En octobre 1972, l'armée (la chère "armée populaire" d'Allende) fut appelée à participer au gouvernement. Allende avouait par là l'incapacité de la coalition gouvernementale à mater et écraser la classe ouvrière. Il avait durement essayé mais avait échoué. Le travail dut être continué par l'armée sans fioritures parlementaires. Mais au moins l'Unité Populaire avait permis de désarmer les travailleurs idéologiquement : cela facilita la tâche des massacreurs le 11 septembre 1973. La gauche et l'extrême-gauche mystifient les ouvriers En réalité, Allende a pris le pouvoir en 1970 pour sauver la démocratie bourgeoise dans un Chili en crise. Après avoir renforcé le secteur d'État de façon à rentabiliser la totalité de l'économie chilienne en crise, après avoir mystifié une grande partie de la classe ouvrière avec une phraséologie "socialiste" (ce qui était impossible aux autres partis bourgeois) son rôle était terminé. Exit the King. L'aboutissement logique de cette évolution, un capitalisme totalement contrôlé par l'État, n'était pas possible au Chili qui restait dans la sphère d'influence de l'impérialisme américain et devait commercer avec un marché mondial hostile dominé par cet impérialisme. La "gauche" et tous les libéraux, humanistes, charlatans et technocrates se lamentèrent sur la chute d'Allende. Ils encouragèrent le mensonge du "socialisme" d'Allende pour tenter de mystifier la classe ouvrière. Déjà en septembre 1973, à Helsinki, les sociaux-démocrates de tous bords qui représentaient 50 nations s'étaient réunis pour "chasser" la junte chilienne. On a ressorti le slogan pourri de l'anti-fascisme, pour détourner la lutte de classe, pour cacher que les prolétaires n'ont rien à gagner en luttant et mourant pour une quelconque cause bourgeoise ou "démocratique". En France, Mitterrand et le "Programme Commun de la Gauche", tous les curés progressistes et les canailles bourgeoises ont entonné le ch�ur antifasciste. Sous couvert de l'"antifascisme" et de soutien à l'Unité Populaire, les divers secteurs de la classe dirigeante tentèrent de mobiliser les travailleurs pour leur replâtrage parlementaire. Face à cette nouvelle "brigade internationale" de la bourgeoisie, la classe ouvrière ne peut que montrer du mépris et de l'hostilité. Les fractions de l'"extrême gauche" du capitalisme d'État ont joué (évidemment !) le même rôle dans ce concert que le MIR dans celui d'Allende. Mais (quel subtil mais !) leur soutien était "critique". La question n'est pas "parlement contre lutte armée", mais capitalisme contre communisme, antagonisme entre la bourgeoisie du monde entier et les travailleurs du monde entier. Les prolétaires n'ont qu'un seul programme : l'abolition des frontières, l'abolition de l'État et du parlement, l'élimination du travail salarié et de 1a production marchande par les producteurs eux-mêmes, la libération de l'humanité tout entière amorcée par la victoire des conseils ouvriers révolutionnaires. Tout autre programme est celui de la barbarie, la barbarie et la duperie de la "voie chilienne au socialisme".
TRACT DE REVOLUTION INTERNATIONALE (organe du CCI en France)
A BAS LA "VOIE CHILIENNE" AU MASSACRE !
C'est par milliers que la racaille militaire massacre les ouvriers au Chili, Maison par maison, usine par usine on traque les prolétaires, on les arrête, on les humilie, on les tue. L'ordre règne. Et l'ordre du capital, c'est la BARBARIE. Plus horrible, plus révoltant encore, c'est que les travailleurs sont acculés, qu'ils le veuillent ou non à se battre dans un combat, où ils sont vaincus d'avance sans aucune perspective, sans qu'à aucun moment ils puissent avoir la conviction de mourir pour leurs propres intérêts. La "gauche" crie au massacre. Mais cette pègre armée, c'est le gouvernement d'Union Populaire qui l'a appelée au pouvoir. Ce que la "gauche" tait soigneusement, c'est qu'il y a dix jours, elle gouvernait encore avec ces mêmes assassins, qu'elle qualifiait "d'Armée Populaire". A ces criminels, ces tortionnaires, elle donnait l'accolade au même moment où DEJA ils commençaient à arrêter des ouvriers, perquisitionner dans les usines. Une chose doit être claire. Depuis trois ans de gouvernement de gauche, JAMAIS les ouvriers n'avaient cessé d'être trompés, exploités, réprimés. C'est la "gauche" qui a organisé l'exploitation. C'est elle qui a réprimé les mineurs en grève, les ouvriers agricoles, les affamés et sans-logis des bidonvilles. C'est elle qui a dénoncé les travailleurs en lutte comme des "provocateurs", c'est elle qui a appelé les militaires au gouvernement, Jamais l'Union Populaire n'a été autre chose qu'une façon particulière de maintenir l'ordre en trompant les travailleurs. Face à la crise qui s'approfondit à l'échelle mondiale, le capital chilien particulièrement en difficulté, devait d'abord avant de la régler à sa manière, mater le prolétariat écraser sa capacité de résistance. Et pour cela, il fallait procéder en deux temps. En premier lieu le mystifier. Cette mystification accomplie, on a amené les travail1eurs embrigadés derrière les drapeaux bourgeois de la "démocratie", pieds et poings liés au peloton d'exécution.
La gauche et 1a droite au Chili comme ailleurs, ne représentent que les deux aspects d'une même politique du Capital : écraser la classe ouvrière. On utilise les cadavres des ouvriers chiliens pour mystifier les ouvriers français La gauche et les gauchistes ne se contentent pas d'avoir amené les travailleurs au massacre. Mais de plus, ici en France, ils ont le culot d'utiliser les cadavres des prolétaires chiliens pour entamer une opération de DUPERIE à grande échelle : ils n'attendent même pas que le sang qui coule à Santiago ait séché pour appeler les ouvriers à manifester, à débrayer pour défendre la "démocratie" contre les militaires. Ce faisant, les Marchais, Mitterrand, Krivine et Cie se préparent déjà à jouer en France le même rôle que les Allende, le P.C. et le MIR gauchiste au Chili. Car en France, comme dans le monde entier, avec l'approfondissement de la crise, se posera le problème de briser le prolétariat.
En organisant la tromperie "démocratique" sur le Chili, la gauche se prépare déjà à prendre en main l'opération qui consistera a embrigader les ouvriers derrière les drapeaux des "nationalisations", de la république" et autres niaiseries, pour les clouer sur un terrain qui n'est pas le leur et les livrer à l'écrasement. Et en refusant de dénoncer la gauche, pour ce qu'elle est, les gauchistes se placent, eux aussi dans le camp du capital. La leçon Au Chili, la crise a frappé plus tôt et plus vite qu'ailleurs. Et avant même que le prolétariat ait vraiment engagé le combat, son propre combat, toutes les forces de la gauche, ce cheval de Troie de la bourgeoisie parmi les travailleurs, se sont employées à le museler pour l'empêcher d'apparaître comme force indépendante sur son propre terrain, avec son programme, qui n'est pas une quelconque réforme "démocratique", ou étatique du capital, mais la révolution sociale. Et tous ceux qui, comme les trotskistes, ont apporté la moindre caution à cette castration de la classe ouvrière, en soutenant ne serait ce que du bout des lèvres et de façon "critique" ces forces, portent aussi la responsabilité du massacre. Ces mêmes trotskistes en France prouvent qu'ils sont du même coté de la barricade que la fraction de gauche du capital, puisqu'ils polémiquent avec elle sur les moyens "tactiques" et militaires d'arriver au pouvoir et reprochent a Allende de ne pas avoir mieux embrigadé les ouvriers derrière lui !
Depuis la France en 1936 jusqu'au Chili en passant par la guerre d'Espagne, la Bolivie, l'Argentine, la même leçon s'y est dégagée des dizaines et des dizaines de fois.
Le prolétariat ne peut passer aucune alliance, ne faire aucun front avec les forces du capital, même si celles-ci se parent du drapeau de la "liberté" ou du socialisme. Toute force qui contribue à lier aussi faiblement que ce soit les ouvriers à une quelconque fraction de la classe capitaliste se situe de l'autre côté. Toute force qui entretient la moindre illusion sur la gauche du capital est un maillon d'une chaîne unique dont l'aboutissement est le carnage des ouvriers. Une seule "unité" : celle de tous les prolétaires du monde. Une seule ligne de conduite : l'autonomie totale des forces ouvrières. Un seul drapeau : la destruction de l'État bourgeois et l'extension internationale de la révolution. Un seul programme : l'abolition de l'esclavage salarié.
Quant à ceux qui seraient tentés de se laisser duper par les belles paroles, les discours creux sur la "république", les rengaines éc�urantes de l'"Unité Populaire", qu'ils regardent bien l'image horrible du Chili. Avec l'approfondissement de la crise, une seule alternative : reprise révolutionnaire ou écrasement du prolétariat !
Révolution Internationale, 18 septembre 1973
(1) Les chiffres officiels sont de 3000 morts mais les associations d'aide aux victimes parlent de plus de 10 000 morts et disparus.
(2) Il faut noter que les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir apporté un soutien aux "gorilles" sud-américains. Ainsi, la junte qui a pris le pouvoir en Argentine quelques temps après, qui a fait pour sa part 30 000 morts et qui a coopéré activement avec celle du Chili dans le cadre de l'Opération "Condor" pour assassiner des opposants, a reçu un soutien "technique" précieux d'experts militaires français qui lui ont enseigné leur "savoir-faire" acquis pendant la Guerre d'Algérie dans le domaine de la lutte contre la "subversion".
(3) MIR : "Mouvement de la Gauche Révolutionnaire"
Géographique:
Histoire du mouvement ouvrier : Notes pour une histoire du mouvement ouvrier au Japon, 3e partie
- 3460 lectures
Nous publions ci-dessous la dernière partie d'une étude sur l'histoire du mouvement révolutionnaire au Japon dont les deux premiers volets sont parus dans les Revue internationale n°112 et 114.
L'Internationale communiste et le Japon
Bien que la classe ouvrière ait conquis le pouvoir en Russie en Octobre 1917, il a fallu beaucoup de temps avant que les révolutionnaires du Japon n'établissent un contact direct avec le centre de la révolution et le mouvement international. C'est ainsi qu'il n'y eut aucun contact entre les révolutionnaires japonais et russes en 1917 et 1918. En outre, au Congrès de fondation de l'Internationale Communiste en mars 1919, aucune délégation venant du japon n'était présente, et même si S. Katayama - établi aux Etats-Unis - avait été mandaté comme délégué de Tokyo et Yokohama, il ne put assister au Congrès. Les premier et second Congrès des Organisations Cornmunistes d'Orient eurent lieu en novembre 1918 et 1919 à Moscou, des délégués du Japon y étaient invités mais ils ne purent non plus y assister. Par contre, à la Conférence de Bakou en septembre 1920, un participant japonais provenant des Etats-Unis était présent ; il était membre des Industrial Workers of thc World (IWW) mais il n'avait aucun mandat d'aucune organisation du Japon et était venu de son propre chef.
Cet isolement prolongé vis-à-vis du reste du monde des révolutionnaires du Japon s'explique d'abord par le fait que les communications entre la Russie et le Japon étaient en grande partie interrompues à cause de la guerre civile durant laquelle l'armée japonaise - opposante des plus féroces à la révolution prolétarienne - fut impliquée jusqu'cn 1922 cri Sibérie et, ensuite, du fait de la faiblesse politique des révolutionnaires eux-mêmes. Il n'y avait aucun groupe parmi eux pouvant agir comme élément moteur en vue de la construction d'une organisation et de son intégration dans le mouvement révolutionnaire international. Ainsi l'Internationale Communiste n'avait aucun pôle de référence au Japon bien qu'elle ait toujours cherché à établir le contact.
L'absence d'une fraction capable de jeter les bases d'une nouvelle organisation, se révéla une grande faiblesse et le travail de préparation qu'accomplit une fraction pour la construction d'un parti ne peut être lui-même que le résultat d'un long processus de maturation, d'un combat difficile pour la compréhension marxiste de la question organisationnelle.
Ce n'est qu'après le début du reflux du mouvement révolutionnaire que l'Internationale Communiste, en s'appuyant sur une politique totalement opportuniste, s'est mise à oeuvrer de façon précipitée à la construction d'une organisation.
Après que la Troisième Internationale eut créé en 1920 à Shanghai un secrétariat pour l'Extrême-Orient auxquels participaient des révolutionnaires de Corée et de Chine, un contact fut établi en octobre de la même année avec l'anarchiste japonais Osugi. Le secrétariat de l'IC pour l'Extrême-Orient lui fit parvenir 2000 yens en vue de fonder une organisation au Japon.
Mais quelle crédibilité programmatique et organisationnelle pouvait avoir un anarchiste dans la construction d'un parti communiste ? Osugi lui-même demandait l'autonomie pour chaque "section nationale" et n'était d'accord que sur la fondation d'un bureau de coordination internationale. De plus, il n'avait aucun mandat de quelque groupe que ce soit mais lorsqu'il revint de Shanghai, il fonda le journal Rodo Undo deabour Movement). Les autres révolutionnaires toujours très dispersés ne montrèrent que peu de détermination dans ces années 1920-1921 pour mener à bien un tel projet. Quant à Osugi, il resta fidèle à ses principes anarchistes tout au long des événements qui se développaient en Russie et appela au renversement du gouvernement soviétique après la tragédie de Kronstadt en 1921. L'Internationale Communiste mit alors fin à tout contact avec lui et les efforts pour créer une organisation furent de ce fait un échec.
Au Japon même, à partir de la fin 1920, Yamakawa, Sakai et Arahata s'efforcèrent de regrouper des forces. C'est ainsi que Hachigatsu Domei dea Ligue d'Août) fut fondée en août 1920 ; en décembre 1920, elle se transforma en Nippon Shakai-shugi Domei (Japanese Socialist League). Différents courants venant d'horizons programmatiques et théoriques divers se regroupèrent et quelques 1000 membres s'y affilièrent. Son journal officiel s'appela Shakaishugi (Socialisme).
Dès le début, la police s'employa à réprimer l'organisation : entre août et novembre 1920, des réunions de préparation du travail furent dispersées et, le 9 décembre de la même année, la conférence de fondation prévue à Tokyo fut également dispersée par la police. Là encore, la tentative d'édifier une organisation échoua sous la forte pression policière. La dispersion et la fragmentation l'emportèrent, le processus de clarification et de regroupement ne purent faire une percée et, par contrecoup, les différents groupes continuèrent à publier différents journaux tels les Studics in Socialism - édité par Sakai et Yamakawa - Japan Labour News d'Arahata et Labour Movement d'Osugi. En mai 1921, la Socialist League fut officiellement interdite.
Le groupe Socialist League qui aurait dû jouer le rôle de pôle de regroupement, ne fut jamais en mesure d'établir une claire démarcation, d'entraîner une sélection à travers la clarification ni de poser les bases de la création d'une organisation révolutionnaire unie. Au lieu de cela, l'existence de différentes personnalités qui avaient regroupé des éléments autour d'elles et qui avaient chacune son journal, continua à dominer la scène révolutionnaire.
Le fiasco rencontré avec Osugi amena les délégués du bureau de l'IC de Shanghai à proposer à Yamakawa en avril 1921 de s'atteler à la tâche de créer un parti. Jusqu'alors, Yamakawa et Sakai qui était très proche de lui, avaient eu une attitude attentiste mais dorénavant, Yamakawa, Kondo et Sakai se tinrent à travailler à l'élaboration d'une plate forme et élaborèrent les statuts d'un "Comité Communiste provisoire". Mais ces camarades, même au printemps 1921, n'avaient pas encore l'intention de fonder un parti communiste. Le concept d’une organisation communiste comme organisation de combat qui aurait à jouer un rôle d'avant-garde dans la lutte révolutionnaire, n'était pas encore ancré dans les esprits. L'accent était seulement mis sur la diffusion des idées et sur la propagande communiste. Cependant, la volonté de ces camarades allait dans le sens d'intensifier les contacts avec ]'Internationale Communiste.
Kondo fut envoyé à Shan-liai en mai 1921 afin d'accélérer le rapprochement avec l'Internationale Communiste. Sa trajectoire politique avait été influencée par les IWW quand il était aux Etats-Unis et il avait participé au journal d'Osugi auparavant, Rondo Undo. Il exagéra les progrès effectués quand il s'entretint avec les délégués de l'IC parce qu'en réalité, très peu d'évolution était intervenue en vue de la création de l'organisation. Impressionnés par Kondo, les délégués lui promirent une aide fïnanciere et Kondo revint au Japon avec 6 500 yens mais n'utilisa pas l'argent pour construire l'organisation ([1] [21]).
A son retour à Tokyo, contrairement aux accords établis avec l'Internationale, Kondo fonda son propre groupe "Gyomin Kysanto" (Enlightened People's Communist Party) dont il devint le président en août 1921. Yakamawa et Sakai rejetèrent sa proposition de transformer le "Groupe de propaande communiste" en parti car ils n'avaient toujours pas digéré le revers de la dissolution de la Socialist League En mai 1921. Après une descente de police en décembre 1921, le groupe de Kondo fut mis hors-la-loi et dissous. Un délégué de l'IC, Grey, qui était également porteur de fonds de l’IC ainsi que d'une liste de contacts fut arrêté en même temps et les documents tombèrent aux mains de la Police : un autre revers pour l’IC dans ses efforts pour aider à la construction d'un parti.
Au moment du 3e Congrès de la Troisième Internationale durant l'été 1921, il n'y avait toujours pas de délégué du Japon ; les seuls camarades présents venaient des Etats-Unis (Gentaro était membre du Japonese Socialist Group et Unzo, des IWW). Une fois de plus, les révolutionnaires au Japon étaient coupés du débat central à Moscou concernant la situation et les méthodes de l'!C. A ce Congrès, les délégués des courants qui, plus tard, allaient se faire connaïtre comme la Gauche Communiste combattirent la tendance à l'opportunismc croissant dans l'IC.
Entre-temps, l'Internationale Communiste elle-même avait crée des comités pour le Japon, avec Radek pour coordinateur. Elle décida une campagna pour l'introduction du droit de vote généralisé, campagne qui survenait alors que le 1e Congrès de l'IC avait dénoncé le rôle dangereux de la démocratie bourgeoise et du parlementarisme et qu'aux 2e et 3e Congrès, les camarades de la Gauche italienne et de la Gauche germano-hollandaise mettaient en garde contre la tentation d'utiliser le parlementarisme. Au 3e Congrès, Taguchi Unzo, membre des IWW, s'opposa aussi à cette campagne.
L'Internationale Communiste appela à une Conférence des Peuples d'ExtrêmeOrient a l'automne 1921 ; elle fut organisée directement comme conférence alternative face au sommet des puissances impérialistes réunies à Washington en novembre 1921 où ces dernières avaient projeté de se partager les zones d'influence en Extrême-Orient.
Différents groupes du Japon furent invités à assister à cette Conférence d'Extrême-Orient. Le groupe de Yamakawa et celui de Kondo, Enlightened People's Communist Party, envoyèrent des délégués : s'y joignirent deux anarchistes ainsi que d'autres éléments. A la Conférence, qui se tint finalement en janvier 1922 à Petrograd, Takase, qui s'exprimait au nom du Enlightened People's Communist Party de Kondo, déclara qu'un parti communiste avait déjà été formé. De façon patente, c'était du bluff. Par ailleurs, l'anarchiste Yoshida, impressionné par le Congrès, annonça qu'il avait été `converti' au communisme : cependant, sur le chemin même du retour au Japon, il revint sur sa déclaration et réaffirma son allégeance aux positions anarchistes.
Boukharine, à cette même Conférence, demanda que la prochaine phase des luttes ouvrières au Japon se concentre sur la construction d'un régime entièrement démocratique à la place du projet d'établissentent immédiat de la dictature du prolétariat. De plus, l'objectif principal devrait être d'abolir le système impérial. En janvier 1922, Zinoviev parlait encore du Japon comme d'une puissance impérialiste mais quelques mois plus tard, quand le Parti communiste allait être fondé, le Japon n'allait plus être considéré comme impérialiste.
Malgré les efforts des forces révolutionnaires rassemblées à Petrograd enjanvicr 1922, les révolutionnaires du Japon continuèrent à rester dispersés ([2] [22]).
Les difficultés à accomplir des progrès décisifs dans la construction d'une organisation provenaient du fait que, à cause de l'isolement et des efforts insuffisants pour établir des liens au-delà du Japon, l'Internationale Communiste connaissait à peine les différentes composantes du milieu révolutionnaires au Japon, sans compter les raisons plus sérieuses : la sous-estimation de la question organisationnelle parmi les éléments les plus responsables, leur manque d'initiative pour établir le contact dans des circonstances difficiles, tous ces facteurs ont pesé dans les échecs répétés de l'IC.
Si l'IC choisit l'anarchiste Osugi et le très individualiste et imprévisible Kondo comme "hommes deconfiance", c'est parce que les éléments les plus sérieux au lapon n'avaient pas compris la nécessité de prendre directement contact avec l'Internationale communiste. Ils laissèrent cette initiative aux anarchistes et aux éléments les moins sérieux.
Même si l'Internationale a tenté d'offrir toutes sortes d'aide aux forces révolutionnaires du Japon, elle ne pouvait pallier au manque de conviction des révolutionnaires envers la nécessité d'un parti mondial dans le pays même. La responsabilité des révolutionnaires envers leur classe n'est jamais unie responsabilité "nationale", limitée à une zone géographique où les révolutionnaires vivent mais elle doit se baser sur une démarche internationaliste.
Ainsi, l'absence de tentatives critiques pour tirer les leçons de la décadence sur la question du parlementarisme d'un point de vue marxiste fui d'autant plus dramatique que les révolutionnaires au Japon n'avaient aucun contact avec les forces de la Gauche communiste qui émergeaient au même moment. Ces difficultés à rompre l'isolement ont contribué à la confusion politique et programmatique.
Quand, à partir de 1920. la vague révolutionnaire reflua, la classe ouvriére japonaise avait combattu sans qu'ait lieu en son sein une véritable intervention des révolutionnaires. Alorsq ue l'Internationale Communiste était déjà embarquée dans un cours opportuniste, celle-ci s'employa à regrouper les révolutionnaires du Japon désireux de participer à la construction du parti. C'est dans ce contexte qu'eut lieu la fondation du Parti communiste japonais ( PCJ) le l5 juillct 1922.
La fondation du Parti communiste japonais (PCJ)
Le parti était formé de dirigeants et de membres de différents groupes qui avaient peu d'expérience organisationnelle et il ne comportait aucune aile marxiste véritable et, notamment, aucune aile marxiste sur la question organisationnelle. D'anciens dirigeants, contactés et formés par I'IC, comme Sakai, Yamakawa, Arahata le rejoignirent et avec eux les groupes qu'ils avaient dirigés jusqu'alors tel e "Wednesday Society Group" de Yamakawa et la publication Vanguard, le cercle autour du Prolétariat de Sakai, "The Enlightened People's Communist Party", des membres des syndicats formés en 1921. En 1923, il était constitué de quelques 50 membres mais le concept même d'adhésion était un problème du fait que le parti ne comptabilisait aucun membre individuel, ces derniers appartenant à l'un des différents groupes qui s'étaient réunis pour former le parti. De plus, il n'y avait ni plate-forme ni statuts, aucun organe central élu. Les membres du parti étaient surtout actifs au sein de leur groupe d'origine, les groupes autour de Yamakawa et Sakai représentant le plus grand nombre de membres.
Au lieu de s'atteler à la tâche de colismiction d'un seul corps unifié, la vic du Parti allait être "fragmentée" et très fortement influencée par ces groupes et par le poids des anciennes personnalités dirigeantes. Du fait que la clarification programmatique n'avait pas été suffisamment effectuée, aucun programme n'avait été réellement élaboré.
De plus le parti ne possédait aucune presse autonome car du fait de sa situation d'illégalité, il ne pouvait publier aucune déclaration publique. C’est pourquoi, les membres prenaient position individuellement dans différentes publications politiques. C'est seulement en avril 1923 que 3 Journaux - Vanguard The Prolétariat, Studices in Socialism - fusionnèrent en un seul journal Sekki (Red Flag) qui devait représenter l'organe du parti.
Au même moment, le parti chercha à devenir un parti de masse et Yaniakima, suivant les orientations de l'Internationale, s'orienta dans ce sens. Ce parti de masse devait englober tous "les ouvriers organisés ou non-organisés ainsi que les paysans, les couches subalternes des classes moyenness et tous les mouvements et organisations anti-capitalites ". Le PCJ reprenait donc l'orientation de l'Internationale C'ommuniste mais c'était l’expression de sa politique opportuniste. En effet, la période des partis de masse était revolue commc cela avait été explicitement analysé par le KAfD allemand à l'époque.
Un programme pour le Japon fut élaboré en novembre 1922 par une commission de l'Internationale à la tête de laquelle se trouvait Boukharine. Le projct traitait du développement économique rapide du Japon pendant la Première Guerre mondiale mais surtout, il mettait l'accent sur le fait que « le capitalisme japonais montre encore des restes de rapports féodaux du passé, le plus importnat vestige étant l’empereur (mikado) à la tête du gouvernement (…) Les résidus du féodalisme joue également un rôle dominant dans toute la structure étatique actuelle. Les organes de l’Etat sont toujours aux mains d’un bloc composé de différentes parties de al bourgeoisie commerciale et industrielle et des grands propriétaires fonciers. Cette nature semi-féodale particulière de l’Etat est surtout illustrée par le rôle prédominant de la genro (noblesse, propriétaires féodaux) dans la constitution. A partir de cet arrière plan, les forces qui s’opposent à l’Etat, proviennent non seulement de la classe ouvrière, de la paysannerie et de la petite bourgeoisie mais émergent égaelment de couches plus larges de la soit disant bourgeoisie libérale – dont les intérêts sont aussi en opposition au gouvernement actuel (…) L’achèvement de la révolution bourgeoise peut devenir le prologue, le prélude à la révolution prolétarienne, visant à la domination de la bourgeoisie et l’établissement de la dictature du prolétariat (…) La lutte entre les seigneurs féodaux et la bourgeoisie prendra très certainement un caractère révolutionnaire."(Cité dans Houston, p.60, notre traduction.)
Alors qu'à son Congrès de fondation, l'Internationale Communiste dans son Manifeste avait mis la révolution à l'ordre du jour partout, l'IC dégénérescente commençait en 1922 à assigner des tâches historiques différentes au prolétariat selon les différentes zones du le monde.
Plaçant le Japon, la Chine et l'Inde sur le même plan car il y avait toujours une forte proportion de paysans au Japon et surtout parce qu'il y avait encore un empereur et des restes féodaux, l'IC proposa que la classe ouvrière du Japon fasse alliance avec des groupes bourgeois. L'Internationale communiste mais aussi le PCJ sous-estimaient le réel développement du capitalisme d'Etat qui s'était déjà profondément implanté au Japon.
Bien que l'empereur jouât encore un rôle en que représentant politique, cela ne changeait en rien la composition de classe de la société japonaise, ni les tâches historiques auxquelles la classe ouvrière était confrontée. L'industrie privée était certainement moins développée au Japon que dans d'autres pays industriels, du fait de l'histoire du développement du capitalisme dans ce pays. Mais depuis l'expansion du mode de production capitaliste, cette spécificité du capital japonais, la proportion relativement faible de capital privé par rapport au capital étatique, était "compensée" par la croissance rapide de l'Etat. Très tôt, l'Etat a joué un rôle actif et interventionniste pour défendre les intérêts nationaux japonais. A l'arrière-plan de cette position du PCJ et de l'Internationale Communiste, il y avait une sérieuse sous-estimation du niveau de capitalisme d'Etat qui avait pris des proportions bien plus énormes et qui, jusqu'à un certain point, était plus développé au Japon que dans la plupart des autres pays occidentaux.
Même si, du fait du faible développement du secteur capitaliste privé pendant la phase ascendante du capitalisme, il n'y avait pas autant de partis bourgeois qu'en Europe et si, globalement, le parlementarisme avait moins de poids et d'influence que dans les autres pays, cela ne voulait pas dire que la classe ouvrière du Japon avait des tâches historiques différentes et qu'elle devait combattre pour un parlementarisme démocratique bourgeois.
Cette orientation du PCJ devait rencontrer une résistance en son sein. Ainsi, Yamakawa affirmait que s'il n'y avait aucune démocratie bourgeoise et que le Japon était dirigé par des cliques militaires et bureaucratiques, contrairement à l'analyse de l'Internationale, il n'y avait aucune utilité de passer par une révolution bourgeoise. En conséquence, il prit position contre la mobilisation du parti sur le terrain électoral.
La thèse fut discutée à Lille conférence du parti en mars 1923, mais aucune décision ne fut arrêtée. Sano Manabu proposa une plate-forme alternative dont l'idée principale était que la révolution Prolétarienne était également à l'ordre du jour au Japon. Il existait aussi des divergences par rapport à la revendication du droit de vote généralisé et le même Sano Manabu rejeta la participation au parlement. Yamakawa se prononça aussi contre la participation aux élections.
Etant donné que la voix de la Gauche communiste d'Europe ne pouvait être entendue au Japon, ce qui aurait pu aider à l'approfondissement de cette critique cette dernière ne put être poussée plus avant et s'enraciner sur une base programmatique.
Du fait que les luttes de la vague révolutionnaire étaient sur le déclin à la fois internationalement et au Japon lui-même, le PC fut privé du test de l'intervention dans le feu du combat. En considérant son expérience organisationnelle limitée et ses positions politiquement confuses et opportunistes, on peu présumer que le parti aurait eu les plus grandes difficultés pour agir comme une organisation de combat et jouer son rôle d'avant-garde.
La stratégie de la bourgoisie japonnaise fut semblable à celle de n'importe quelle autre classe dominante - utilisation de la répression et infiltration du PC.J. Le 5 juin 1923 le parti fut interdit, quelques 100 à 200 membres furent arrêtés, tous les membres du parti connus de la police furent jetés en prison.
Le 24 mars 1924, le parti fut totalement dissous : Arahata s'opposa à la dissolution, défendant le besoin de lutter pour maintenir son existence et Sakai soutinrent la dissolution, déclarant qu'un parti d'avant-garde illégal n'était plus nécessaire ni désirable. Selon Yamakawa, un tel parti serait séparé des ouvriers et la proie de la répression bourgeoise, les révolutionnaires marxistes se devaient de rejoindre les organisations de masse telles les syndicats et les organisations paysannes et préparer le parti prolétarien légal du futur. C’est ainsi que le premier PC, qui ne fut jamais un corps solide mais plutôt un regroupement de diverses personnalités, n'ayant aucun tissu organisationnel, ne travaillant pas avec un esprit de parti ne fut jamais en mesure d'accomplir ses taches.
Après le reflux des luttes au niveau mondial, les révolutionnaires furent confrontés à la même tache : alors que l'IC dégénérescente avait mis en avant le mot d'ordre de construction de partis de masse et la politique du front unique, augmentant de la sorte la confusion parmi les ouvriers de plus en plus épuisés et désorientés, les révolutionnaires devaient, en conséquence, s'atteler à la tâche de développer le travail de fraction.
Mais une fois de plus, les révolutionnaires au Japon eurent à faire face à de grandes difficultés Pour remplir cette tâche. Aucune fraction ne surgit de leurs rangs pour combattre la dégénérescence de l'Internationale et pour poser les bases d'un futur parti.
La contre-révolution montante au Japon.
La bourgeoisie utilisa le rapport de forces qui penchait en sa faveur pour accroitre ses attaques contre la classe ouvriére au Japon. Alors que la classe ouvrière, pendant la Première Guerre mondiale et la vague révolutionnaire qui s'ensuivit, ne s'était pas autant radicalisée qu'ailleurs et qu'elle ne prit part à ces luttes que de manière périphérique, cette dernière allait être frappée durement à son tour pendant les années 1920 par la contre-révolution montante. Après l'interdiction du parti en 1923, le gouvernement saisit l'opportunité des effets d'un tremblement de terre dévastateur qui secoua Tokyo le 1er septembre 1923, où plus de 100 000 personnes périrent et où de larges parties de la ville furent détruites, pour accroître la répression contre lu classe ouvrière. Une "police de la pensée" spéciale (Tokko) fut créée procédant dans les années qui suivirent à des arrestations massives : 4000 ouvriers arrêtés en 1928, 5000 en 1929, 14 000 en 1932. 14 000 encore en 1933.
Tandis qu'en Europe il y eut une faible et courte reprise economique au cours des années 1920, le Japon fut frappé plus tôt par la crise économique mondiale provoquant des attaques accrues contre la classe ouvrière de ce pays. Jusqu'à l'éclatement de la grande crise au Japon qui débuta en 1927, deux ans avant le krach de 1929, la production avait déjà chuté de 40% dans les principales zones industrielles. La vaIeur des exportations japonaises se réduisit de 50%a entre 1929 et 1931 .
Le capital japonais se dirigeait à nouveau vers des conquétes militaires. Le budget pour l'armement. qui aux environs de 1921 - moment le plus fort de l'intervention contre la Russie - atteignait quasiment 50% du budget de l'Etat, ne fut jamais réellement réduit après la Premiére Guerre mondiale. Contrairement à l'Europe et aux Etats-Unis, il n'y eut pas véritablement de démilitarisation. Quelque diminution qu'il y ait pu avoir dans les budgets militaires, l'argcnt sorti de là fut immédiatcmcnt réinjecté dans la modernisation de l'armement. La classe ouvrière du Japon ne put offrir qu'une faible résistance aux attaques capitalistes et au cours vers la guerre. Dans ce contexte, I'Etat se trouva en position dominante dans l'économie beaucoup plus tôt que les Etats en Europe et commença à développer un régime capitaliste d'Etat très étendu, s'engageant de façon déterminée dans un cours à des conquètes militaires.
Le niveau de vie des ouvriers qui était beaucoup plus bas qu'en Europe chuta d'autant plus : leur revenu réel baissa d'une base de 100 en 1926 à 81 en 1930 jusqu'à 69 en 1931. La famine se répandit dans les campagnes ([3] [23]). Dans cet environnement d'une classe ouvrière affaiblie, avec un capital à l'offensive, il existait que les révolutionnaires tentent de dépasser à tout prix le rapport de forces défavorable en provoquant artificiellement des luttes et en essayant de construire un parti de masse.
Le P.C.J. devient un laquais du stalinisme
A la fin de la vague révolutionnaire en 1923 et alors que le stalinisme en Russie et au sein de l'IC se renforçait, de plus en plus de partis communistes se soumirent à la domination de Moscou, devenant son instrument. Le développement du PCJ illustre de façon aveuglante cet état de fait.
L'IC tenta de construire un nouveau parti à tout prix pour défendre les intérêts russes. Après la dissolution du parti en mars 1924, l'Internationale Communiste fonda un nouveau groupe communiste en août 1925 qui se proclama nouveau parti le 4 décembre 1926 mais qui n'était rien d'autre que le perroquet de Moscou. Déjà, en 1925, l'Internationale communiste avait commencé à critiquer dans les Thèses de Shanghai les positions et le travail du précédent parti. Les orientations de l'Internationale étaient que la révolution démocratique bourgeoise, qui avait été inaugurée avcc la restauration des Meiji, devait être achevée puisque des vestiges féodaux (surtout les propriétaires terriens féodaux) et la bourgeoisie subsistaient encore. L'internationale conlmuniste mettait donc l'accent sur les vestiges féodaux tout en admettant que : « l'Etat japonnais lui-même est un élement puissant du capitalisme japonnis. Aucun pays européen n 'est encore allé aussi loin dans l'introduction du capitalisme d’Etat que le Japon où 30% de tous Les investissements dans l'industrie et dans le secteur financier sont finances par l 'Etat ».
Cependant, selon l'Internationale, l'Etat japonais devait devenir réellement démocratiquebourgeois. Yamakawa s'opposa â cette analyse, mettant en exergue l'amalgame effectué entre l' Etat et le grand capital financier. Il affirma que la bourgeoisie détenait le pouvoir au Japon depuis longtemps et que le prolétariat devait établir une alliance anti-bourgeoise avec la paysannerie, rejetant la "révolution en deux temps" comme le défendait Moscou. Yamakawa soutenait l'idée qu'une aile gauche au sein du mouvement ouvrier ou un parti paysan-ouvrier pouvait prendre la place du PCJ interdit. Yamakawa se mit à publier un journal Rono (Paysan-Ouvrier) en décembre 1927.
L'Internationale communiste poursuivit sa politique "de noyautage et de conquête des syndicats". obtenant une grande influence dans le "Nippon Rodo Hyogikai" ("Labor Union Council of Japan")- fondé en mai 1925.
Aux élections parlementaires de 1928, le PC.I défendit "un front unique" avec les autres partis « capitalistes dee gauche », dont le nombre avaient autgmenté et dont sept d'entre eux avaient fusionné pour former le "Musan taishuto" ("Parti des Masses prolétariennes").
Après une autre vague de répression en mars 1928, tous les partis de gauche furent interdits et leurs dirigeants envoyés en prison. ils furent menacés de peine de mort s'ils poursuivaient des activités politiques clandestines. Cependant. une fois que la police emprisonné les leaders de l'ancien PC, Moscou put reconstituer à nouveau le parti en novembre 1921; et mettre en place un autre comité central qui pourrait suivre à la lettre les instructions de Moscou. Le comité central et le bureau politique du PCJ furent remplacés les années suivantes en fonction des changements de politique de l'Internationale. Après chaque nouvelle vaguc de répression et arrestations, une nouvelle direction était toujours envoyée par Moscou si bien que le parti était maintenu « artificiellement » en vie ; mais en dépit de tous les efforts déployés, Moscou ne réussit jamais à accroître de façon significative les adhésions. Le PCJ était devenu un simple laquais de Moscou.
Quand. en 1928. l'Internationale communiste déclara "le socialisme en seul pays" comme étant sa politique officielle et qu'il expulsa tous les militants dee la Gauche communistc qui restaient ainsi que les forces d'opposition trotskistes, le PCJ ne fit aucune objection. Il ne considéra pas cela comme une trahison des intérêts de la classe ouvrière par l' Internationale Communiste. Le PC,I. "alimenté" depuis 5 ans par Moscou a tous les niveaux, organisationnellement et programmatiquement, défenseur totalement loyal de Moscou, ne put opposer la moindre résistance à cette situation. Déjà en 1927, un groupe arrêté du PCJ mené par Mizino Shigeo, rejeta l'internationalisme et se mit à défendre l'idée du "socialisme national".
Des problèmes de langue et la difficulté d'accès aux textes de cette période, requierent de notre part de la prudence dans l'évaluation définitive de l'attitude du PCJ, mais au moment de l'écriture de ce texte, nous n’avons pas connaissance de groupes exclus ou de scissions du PCJ comme conséquence de leur opposition à la stalinisation ou a l'idée du "socialisme dans un seul pays". C’est pourquoi on petit présumer que le PCJ ne fit aucune critique et n'opposa aucune résistance à la stalinisation. En tout état de cause, s'il y eut des voix oppositionnelles, elles n'eurent aucun contact avec l'opposition en Russie, ni avec les courants de la Gauche communiste en dehors de la Russie. Même à propos des événements qui eurent lieu en 1927 en Chine voisine et qui furent durement débattus au sein de l'Internationale et internationalement, autant que l'on sache, il n'y eut aucune voix critique provenant du Japon dénonçant la politique désastreuse de l'Internationale.
Même si le parti n'avait pas encore trahi après l'annonce du "socialisme en un seul pays" par l'Internationale Communiste, il ne fut pas en mesure de donner naissance à une quelconque résistance prolétarienne, luttant pour une position internationaliste.
Le chemin vers la guerre de l'impérialisme japonais : l'élimination des voix internationalistes par le stalinisme.
Du fait que le capital japonais avait affronté une classe ouvrière offrant moins de résistance que le prolétariat en Europe, cela lui permit de s'engager dans un cours à la guerre systematique plus tôt que ses rivaux européens. En septembre 1931, l'armée japonaise cnvahissait la Mandchourie et installait un Etat mandchou fantoche.
Tandis que le cours à la guerre s’accélérait internationalement et alors que la guerre en Espagne milieu des années 1930 représentait la répétition générale en vue des confrontations en Europe et de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre entre le .lapon et la Chine se déroula de 1937 à 1945.
L'impérialisme japonais enclencha la spirale de la barbarie à un haut niveau avant même le début de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 200 000 chinois furent massacrés en quelques jours à Nankin en 1937 et au total 7 millions de personnes furent tuées lors de cette guerre.
Le groupe de la Gauche communiste qui a publié Bilan était un des rares à défendre une position internationaliste (même au prix d'une scission) pendant la guerre d' Espagne : il représente le pôle de référence pour toutes les forces révolutionnaires. Au Japon, cependant, la précieuse tradition de l'internationalisme qui avait existé lors de la guerre de 1905 entre le Japon et la Russie et pendant la Première Guerre mondiale, avait été réduite au silence par le stalinisme. Le "Nippon Kukka Shakaito" ("Japonese State Socialist Party") - qu'on peut comparer au NSDAP de Hitler en Allemagne - qui fut fondé en 1931 et le Social Démocratie Party du Japon soutinrent ouvertement le cours impérialiste à la guerre du capital japonais. Le "Shakai Taishuto" ("Social Masses Party") se rallia également aux "efforts de défense" de l'armée japonaise en octobre 1934 dans la mesure où "l'armée combattait à la fois le capitalisme et le fascisme". La direction du "Shakai Taishuto" ("Socialist Party") qualifia la guerre contre la Chine de "guerre sacrée de la nation japonaise". Le congrès des syndicats japonais, Zenso, mit les grèves ouvrières hors-la-loi en 1937.
D'un autre côté, alors que les forces de la Gauche communiste défendaient seules l'internationalisme, le PCJ stalinien et Trotsky lui-même appelèrent à la défense de la Chine contre le Japon.
En septembre 1932, le PCJ déclarait : « La guerre de l’impérialisme japonais en Mandchourie marque le début d'une nouvelle série de guerres imperialistes dirigées en priorité contre la révolution chinoise et l'URSS (...) Si les imperialistes du monde entiers s’avisaient de lencer un défi à notre patrie, l'URSS, nous leur montrerions que le prolétariat mondial se souléverait par les armes contre eux (...) Vive l'Armée rouge d'Union soviétique et vive l 'Armée rouge de la Chine soviétique ! » (Langer. Red Flag in Japan, 1968, notre traduction). Avec les mots d'ordre de "A bas la guerre impérialiste" "Bas les pattes en Chince" "Défendons la Chine révolutionnaire et l'union soviétique !", le PC.J. appela à soutenir la Russie et la Chine contre le capital japonais. Le PC.J était devenu le meilleur laquais de Moscou.
Mais Trotsky jeta aussi par-dessus bord sa propre position qu'il avait maintenue pendant la Première Guerre mondiale. Partant d'une vision totalement erronée selon laquelle "L’aventure japonaise actuelle en Mandchourie peut mener le Japon à la révolution " (1931), (Le fascisme peut-il réellement triompher ? l’Allemagne clé de la situation internationale, 26/11/1931, notre traduction) - il appela l'Union soviétique à armer la Chine : "Dans la gigantesque lutte historique entre la Chine el le Japon, le gouvernement des soviet ne peut rester neutre, il ne peut prendre la même position par rapport à la Chiite et par rapport au Japon. Il se doit de soutenir pleinement le peuple chinois.". Considérant qu'il existait encore "des guerres progressistes possibles" il déclara : "S'il y a une guerre juste en ce monde, alors c'est celle du peuple chinois contre ses oppresseurs. Toutes les organisations de la classe ouvrière, toutes les forces rpgressistes de Chine, rempliront leur devoir dans celle guerre de libération, sans abandonlier le programme et leur indépendance politique. "(30/07/1937, notre traduction)
"Dans ma déclaration à la presse bourgeoise, j'ai parlé du devoir de toutes les organisationts ouvrières de Chine de participer activement et en première ligne à la guerre contre le Japon, sans renoncer le moins du monde à leur programme et à leurs activités autonomes. Mais les Eiffelistes ([4] [24]) appellent cela du socialpatriotisme'. Cela signifie la capitulation devant Tchang-Kaï-Chek ! Cela veut dire tourner le clos aux principe de la lutte de classe (...) Dans la guerre impérialiste, le Bolchevisme militait pour le défaitisme révolutionnaire. La guerre civile espagnole et la guerre sino-japonaise sont toutes deux desguerres impérialistes. (...) Nous prenons la même position par rapport à la guerre en Chine. Le seul salut pour les ouvriers et paysans de Chine est d'agir en tant que force autonome contre les deux armées, à la fois contre la chinoise et la japonnaise. (...) C'es quatre lignes du document des Eiffelistes du 1e septembre 1937 révèlent qu 'ils sont soit des traitres soit de parfaits idiots. Mais quand la stupidité atteint de telles proportions, cela revient à de la trahison.(...) Parler de défaitisme révolutionnaire en général sans faire la distinction entre les pays opprimés et les pays oppresseurs, c'est défigurer le Bolchevisme en une lamentable caricature et mettre cette caricature au service de l’impérialisme. La Chine est un pays semi-colonial qui va être transformer sous nos yeux en pays colonial par le Japon. En ce qui concerne ce dernier, il mène unc guerre impérialiste réactionnaire. Pour ce qui est de lar Chine, elle mène une guierre de libération progressiste. (...) Le patriotisme japonais à le visage hideux et abject du banditisme international. Le patriotisme chinois est lui légitime e progressiste. Placer ces deux patriotisme sur le même plan et parler de ‘social-patriotisme’montre que vous n’avait rien lu de Lénine, que vous n’avait rien compris à l'attitude des Bolcheviks dans la guerre impérialiste et défendre cela est tout simplemet faire insulte au marxisme. (...) Nous devons insister fortement sur le fait que la 4e Internationale est aux côtés de la Chine contre le Japon." ("Sur la guerre sinojaponaise", Lettre à Diego
Toute la tradition d'une lutte impitoyable contre les deux camps impérialistes était abandonnée par Trotsky. Seuls les groupes de la Gauche communiste défendirent clairement une position internationaliste lors de cette confrontation impérialiste. Le groupe de Bilan prit la position suivante à propos de cette guerre : "L'experience a prouvé que le proletariat international, lorsqu'il fut amené par l’Internationale communiste et pur la Russie soviétique, à envisager la possibilité de révolutions bourgeoises et anti-impérialistes en Chine (en 1927), s'est, en fait, sacrifie sur l’autel du capitalisme mondial" ("Résolution de la C.E. de la fraction italienne de la Gauche communistc internationale sur le Conflit sinojaponais", nov.-déc. 1937)
« Et c'est dans cette phase historique, où les guerres nationales sont reléguées au musée des antiquités, que l'on voudrait mobiliser les ouvriers autour de 'guerre d’émancipatin nationale ' du peuple chinois »
"Qui donc soutient aujourd'hui la 'guerre d’indépendance' de la Chine (...) : La Russie, l'Angleterre, les Etats-Unis, la France. Tous les impérialismes la soutiennent (...) Et jusqu'à Trotsky qui se laisse emporter à nouveau par le courant de la guerre impérialiste et qui préconise le soutien de la ‘guerre juste’ du peuple chinois" (... )
"Des deux côtés des fronts il y a une bourgeoisie rapace, dominatrice et qui ne vise qu’à faire massacrer les prolétaires. Il est faux, archi faut de croire qu 'il existe une bourgeoisie avec laquelle es ouvriers chinois peuvent, même provisoirement, faire un ‘bout de chemin ensemble' et que seul l'impérialisme japonais doit être abattu pour permettre aux ouvriers chinois de lutter victorieusement pour la revolution. Partout l’imparialisme mène ladanse et la Chine n’est que le jouet des autres impérialistes. Pour entrevoir le chemin des batailles révolutionnaires il faut que les ouvriers chinois et japonnais trouvent le chemin de classe qui les conduira les uns vers les autres : la fraternisation devant cimenter leur assauts simultanés contre leurs propres exploiteurs (...)"
« Seules, les fractions de la Gauche communiste internationale seront oppsoées à tous les courants traîtres et opportunistes et brandiront hardiment le drapeau de la lutte pour la révolution. Seules, elles lutteront pour la transformation de la guerre impérialiste qui ensanglante l'Asie en une guerre civile des ouviers contre leurs exploiteurs : fraternisation des ouvriers chinois et japonnais ; destruction des fronts de la 'guerre nationale' ; lutte contre le Kuomintang, lte contre l’impérialisme japonnais, luute contre tous les courants qui agissent parmis les ouvriers pour la guerre impérialiste »
"Le prolétaiat international doit trouver dans cette nouvelle guerre la force d 'échapper à ses bourreaux, aux traîtres et de manifester sa solidatité avec ses frères d'Asie en déclenchant des batailles contre sa propre bourgeoisie.
A bas la guerre impérialiste de Chine Vive la guerrc civile de tous les exploité contre la bourgeoisie chinoise et l'imperialisme japonnais !"(Bilan, "A bas le carnage impérialiste en Chine ! : Contre tous les bourreaux, pour la transformation immédiate de la guerre en guerre civile oct.-nov. 1937).
Ceci représentait la tradition internationaliste de la Gauche communiste la seule véritable continuité avec les positions des révolutionnaires de la Première Guerre mondiale. Cependant, aucune force révolutionnaire au Japon ne reprit, semble-t-il, cet étendard internationaliste.
En Europe, la bourgeoisie inaugura la politique des "fronts populaires" afin d'enrôler la classe ouvrière dans la bataille impérialiste de la défense des "Etats démocratiques" contre l'Allemagne fasciste de Hitler. Afin de mobiliser les ouvriers dans la guerre, la bourgeoisie avait besoin de tromper les ouvriers par la défense de la "démocratie". Cependant, au Japon, la classe ouvrière avait en grande partie déjà été défaite.
Les appels initiaux du PCJ en vue de l'établissement d'un front unique des partis de gauche afin de défendre l'Union soviétique, furent rejetés par ces mêmes partis qui s'étaient rangés derrière les intérêts de l'Etat japonais. Le PC.J. de son côté avait choisi son camp.
Les résidus du PCJ qui, une fois de plus, avait été interdit avant même le déclenchement de la guerre sino-japonaise, appela à la défense de l'Union soviétique contre le Japon.
Pendant la guerre, ce qui restait du PCJ appela à "la destruction de 1'ordre militaro-féodal du Japon par ‘une révolution démocratique-bourgeoise’, déclarant "qu’au sein de ce processu une active coopération avec les nations capitalistes serait nécessaire. " Sur la base de tels arguments, le P.C.J. soutint les Etats-Unis et la Russie dans leur conflit contre le « Japon impérial ! »
Durant l'hiver 1945-1946, le P.C.J. se réforma pendant l'occupation américaine. Un programme fut élaboré qui, à l'instar des thèses de 1927 et 1932, prévoyait un projet de "révolution en deux temps". La tâche immédiate consistait à "dépasser le système impérial, réaliser la démocratie du Japon, une réforme agraire ".
Cette stratégie offrit la base à une coopération avec les Etats-Unis pour la démilitarisation et la démobilisation du Japon. Le commandement suprême des forces alliées et des Etats-Unis était considéré comme une partie de la bourgeoisie progressiste dont la fonction historique était d'accomplir la révolution démocratiquebourgeoise.
Comme partout ailleurs dans le monde, la classe ouvrière au sortir de la guerre était plus faible que jamais.
La reconstruction eut lieu avec une classe fortement défaite et démoralisée. Pendant des décennies, la classe dominante se fit le plaisir de présenter la classe ouvrière au Japon comme l’exemple même d'une classe docile, servile, défaite et humiliée, travaillant pendant de longues heures et recevant de très bas salaires.
Quand en 1968, après les grèves massives en Europe et particulièrement en France, la classe ouvrière mondiale réapparut sur la scène de l'histoire, mettant fn à plus de cinquante ans de contre-révolution, la classe redonna naissance à une série de petits groupes révolutionnaires dont certains purent retrouver la tradition de la Gauche Communiste. Mais au Japon, les groupes de la gauche capitaliste dominaient totalement la scène politique. De ce que nous savons aucune force ne put établir des contacts avec le milieu politique prolétarien historique, c'est-à-dire les groupes se réclamant de la tradition de la Gauche communiste.
Après la période de reconstruction, avec l'entrée en crise et la récession ouverte au Japon depuis pratiquement une décennie, ce n'est qu'une question de temps pour que la classe ouvrière au Japon ne se trouve contrainte de se défendre contre les attaques de la crise à un niveau qualitativement plus élevé. Ces confrontations de classe nécessiteront l'intervention la plus déterminée des révolutionnaires. Néanmoins, pourque les révolutionnaires puissent remplir leur tâche, les éléments politiques prolétariens qui surgiront, devront établir un lien avec le milieu politique prolétarien international et se concevoir eux-mêmes comme une partie de cette entité internationale.
Plus de cent années d'isolement politique quasi complet doivent être surmontées. Les conditions pour entreprendre cette tâche n'ont jamais été aussi favorables.
DA
[1] [25] Après son arrivée dans le port japonais de Shimonoscki, il rata son train pour Tokyo. II dut pasaer la nuit en ville - où il dépensa une partie des fonds de l’IC en se payant les services d'une prostituée et en boissons alcoolisées. pendant la nuit il tomba, ivre, aux mains de la police qui lui contisqua le reste de l'argent que la prostituée ne lui avait pas arnaqué. Parlant à un espion de la police dans sa cellule de prison, il avoua sa mission en Chine, mais il fut néanmoins relâché.
[2] [26] Au moment même où la Conférence s’ouvrait à Petrograd, le groupe autour de Yamakawa conunençait à publier un journal, Zenei de’avant-garde). A partir d'avril 1922, le groupe autour de Sakai publia Musankaikyu dee Prolétariat) et à partir de juin 1922, Rodo Kumiai deabour Union) parut également. Entre-temps, à partir de janvier 1922, l'anarchiste Osugi avait aussi fait paraître Labour Movement.
[3] [27] La famine parmi la population à la campagne était un phénomène très répandu. La journée dee travail dans l'industrie du textile tournait autour de l2 heures et plus. Dans les annécs 1930, il y avait encore une proportion de 44% de femmes travaillant dans les usines et dans les industrie, textiles, 91% de la force de travail féminine vivait dans des dortoirs, afin qu'elle soit toujours plus disponible pour l'exploitation.
[4] [28] Eiffel, nom de guerre de Paul Kirchoff (1900-1972), membre du KAPD (Parti Communiste ouvrier allemand). Après la prise du pouvoir par les nazis en 1933, il émigra en France, travailla pour la direction trotskiste allemande en exil, mais s'opposa à la politique trotskiste d'entrisme. Pendant son séjour au Mexique entre 1930 et 1940, il coopéra à la publication de Communismo, journal du "Grupo de trabajadores marxistas", cf. Revue Interrnationale n° 10. juin-août 1977.
Géographique:
- Japon [29]