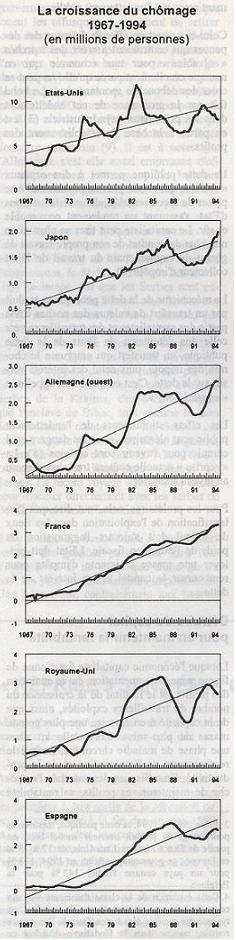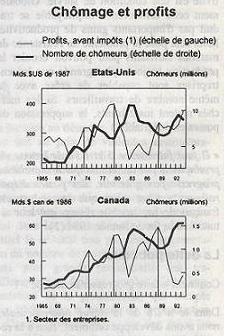Revue Internationale no 80 - 1e trimestre 1995
- 3389 lectures
Crise économique : une « reprise » sans emplois
- 4137 lectures
Apparemment, presque tous les indicateurs économiques statistiques sont clairs : l'économie mondiale est enfin en train de sortir de la pire récession qu'elle ait connue depuis la guerre. La production augmente, les profits sont de retour. L'assainissement semble avoir été payant. Et pourtant aucun gouvernement n'ose chanter victoire, tous appellent à encore de nouveaux sacrifices, tous restent extrêmement prudents et, surtout, tous disent que, de toutes façons, pour ce qui est du chômage, c'est-à-dire l'essentiel, il n'y a pas grand chose de vraiment bon à attendre. ([1] [1])
Mais, qu'est-ce qu'une « reprise » qui ne crée pas d'emplois ou qui ne crée que des emplois précaires ?
Au cours des deux dernières années, dans les pays anglo-saxons, qui sont censés être les premiers à être sortis de la récession ouverte commencée à la fin des années 1980, la « reprise » s'est concrétisée essentiellement par une modernisation extrême de l'appareil productif dans les entreprises qui ont survécu au désastre. Celles qui survivent l'ont fait au prix de violentes restructurations, entraînant des licenciements massifs et des dépenses non moins massives pour remplacer le travail vivant par du travail mort, par des machines. L'augmentation de la production que les statistiques enregistrent dans les derniers mois, est pour l'essentiel le résultat non pas d'une augmentation du nombre de travailleurs intégrés mais d'une plus grande productivité des travailleurs ayant déjà un emploi. Cette augmentation de la productivité, qui compte pour 80 % dans la hausse de la production au Canada, par exemple, un des pays les plus avancés dans la «reprise», est due pour l'essentiel à de très forts investissements pour moderniser les machines, les communications, développer l'automatisation, et non à l'ouverture de nouvelles usines. Aux Etats-Unis ce sont les investissements en biens d'équipement, principalement l'informatique, qui expliquent pour l'essentiel la croissance de l'investissement au cours des dernières années. L'investissement en construction non-résidentielle est resté presque stagnant. Ce qui veut dire qu'on modernise les usines existantes mais qu'on n'en construit pas de nouvelles.
Une reprise « Mickey Mouse »
Actuellement en Grande-Bretagne, où le gouvernement ne cesse de claironner ses statistiques faisant état d'une baisse continue du chômage, environ 6 millions de personnes travaillent une moyenne de seulement 14,8 heures par semaine. C'est ce genre d'emplois, aussi précaires que mal payés, qui dégonfle les statistiques du chômage. Les travailleurs britanniques appellent ça les « Mickey Mouse jobs ».
Pendant ce temps, les programmes de restructuration des grandes entreprises continuent : 1 000 suppressions d'emplois dans une des plus grandes compagnies d'électricité en Grande-Bretagne, 2 500 dans la deuxième entreprise de télécommunications.
En France, la Société nationale des chemins de fer annonce, pour 1995, 4 800 suppressions de postes, Renault 1 735, Citroën 1 180. En Allemagne, le géant Siemens annonce qu'il supprimera « au moins » 12 000 emplois en 1994-1995, après les 21 000 qu'il a déjà supprimés en 1993.
L'insuffisance de marchés
Pour chaque entreprise, accroître sa productivité est une condition de survie. Globalement cette concurrence impitoyable se traduit par d'importants gains de productivité. Mais cela pose le problème de l'existence de marchés suffisants pour pouvoir écouler la production toujours plus grande que les entreprises sont capables de créer avec le même nombre de travailleurs. Si les marchés restent insuffisants, la suppression de postes est inévitable.
« Il faut faire entre 5 et 6 % de hausse de productivité par an, et tant que le marché ne progresse pas plus vite, des postes disparaissent. » C'est ainsi que les industriels français de l'automobile résumaient leur situation à la fin de l'année 1994 ([2] [2]).
La dette publique
Comment « faire progresser le marché » ?
Dans le n° 78 de la Revue internationale, nous avons développé comment, face à la récession ouverte depuis la fin des années 1980, les gouvernements ont eu massivement recours à l'endettement public.
Celui-ci permet en effet de financer des dépenses qui contribuent à créer des marchés « solvables » pour une économie qui en manque cruellement parce qu'elle ne peut se créer des débouchés spontanément. Le bond fait par la croissance de cet endettement dans les principaux pays industriels ([3] [3]) est en partie à la base du rétablissement des profits.
La dette publique permet à des capitaux « oisifs », qui ont de plus en plus de mal à se placer de façon rentable, de le faire en Bons d'Etat, s'assurant un rendement convenable et sûr. Le capitaliste peut tirer sa plus-value non plus du résultat de son propre travail de gérant du capital, mais du travail de l'Etat collecteur d'impôts ([4] [4]).
Le mécanisme de la dette publique se traduit par un transfert de valeurs des poches d'une partie des capitalistes et des travailleurs vers celle des détenteurs de Bons de la dette publique, un transfert qui emprunte le chemin des impôts, puis celui des intérêts versés sur la dette. C'est ce que Marx appelle le « capital fictif ».
Les effets stimulateurs de l'endettement public sont aléatoires, mais les dangers qu'il cumule pour l'avenir sont certains ([5] [5]). La « reprise » actuelle coûtera très cher demain au niveau financier.
Pour les prolétaires, cela veut dire qu'à l'intensification de l'exploitation dans les lieux de travail doit s'ajouter l'aggravation du poids de l'extorsion fiscale. L'Etat doit prélever une masse croissante d'impôts pour rembourser le capital et les intérêts de la dette.
Détruire du capital pour en maintenir la rentabilité
Lorsque l'économie capitaliste fonctionne de façon saine, l'augmentation ou le maintien des profits est le résultat de la croissance du nombre de travailleurs exploités, ainsi que de la capacité à en extraire une plus grande masse de plus-value. Lorsqu'elle vit dans une phase de maladie chronique, malgré le renforcement de l'exploitation et de la productivité, l'insuffisance des marchés l'empêche de maintenir ses profits, sa rentabilité sans réduire le nombre d'exploités, sans détruire du capital.
Alors que le capitalisme tire son profit de l'exploitation du travail, celui-ci se trouve dans « l'absurdité » de payer des chômeurs, des ouvriers qui ne travaillent pas, ainsi que des paysans pour qu'ils ne produisent pas et mettent leurs terres en jachère.
Les frais sociaux de « maintien du revenu » atteignent jusqu'à 10% de la production annuelle de certains pays industrialisés. Du point de vue du capital c'est un « péché mortel », une aberration, du gaspillage, de la destruction de capital. C'est avec toute la sincérité d'un capitaliste convaincu que le nouveau porte-parole des républicains à la Chambre des représentants, aux Etats-Unis, Newt Gingrich, est parti en guerre contre toutes « les aides du gouvernement aux pauvres ».
Mais, le point de vue du capital est celui d'un système sénile, qui s'auto-détruit dans des convulsions entraînant le monde dans un désespoir et une barbarie sans fin. Ce qui est une aberration, ce n'est pas que l'Etat bourgeois jette quelques miettes à des hommes qui ne travaillent pas, mais qu'il y ait des hommes qui ne puissent participer au processus productif alors que le cancer de la misère matérielle s'étend chaque jour un peu plus sur la planète.
C'est le capitalisme qui est devenu une aberration historique. L'actuelle « reprise » sans emplois en est encore une confirmation. Le seul « assainissement » possible de l'organisation « économique » de la société c'est la destruction du capitalisme lui-même, l'instauration d'une société où l'objectif de la production n'est plus le profit, la rentabilité du capital, mais la satisfaction pure et simple des besoins humains.
RV, 27 décembre 94
« Il va de soi que l'économie politique ne considère le prolétaire qu'en tant que travailleur : c'est celui qui, n'ayant ni capital ni rente foncière, vit uniquement de son travail, d'un travail abstrait et monotone. Elle peut donc affirmer que, tout comme une bête de somme quelconque, le prolétaire mérite de gagner suffisamment pour pouvoir travailler. Quand il ne travaille pas, elle ne le considère pas comme un être humain ; cette considération, elle l'abandonne à la justice criminelle, aux médecins, à la religion, aux statistiques, à la politique, à la charité publique. »
Marx, Ebauche d'une critique de l'économie politique, Ed. La Pléiade, II
25 ans d'augmentation du chômage
Depuis un quart de siècle, depuis la fin des années 1960, le fléau du chômage n'a cessé de s'étendre et de s'intensifier dans le monde. Ce développement s'est fait de façon plus ou moins régulière, connaissant des accélérations et des reculs plus ou moins violents. Mais la tendance générale à la hausse s'est confirmée récession après récession.
Les données représentées dans ces graphiques sont les chiffres officiels du chômage. Elles sous-estiment fortement la réalité puisqu'elles ne prennent pas en compte les chômeurs en « stage de formation », ni les jeunes participant à des programmes de travail à peine rémunérés, ni les travailleurs « préretraités », ni les travailleurs contraints à se vendre « à temps partiel », de plus en plus nombreux, ni ceux que les experts appellent les « travailleurs découragés », c'est-à-dire les chômeurs qui n'ont plus l'énergie de continuer à chercher du travail.
Ces courbes ne rendent en outre pas compte des aspects qualitatifs de ce chômage. Elles ne montrent pas que, parmi les chômeurs, la proportion de ceux de « longue durée » ne cesse de croître, ou que les allocations de chômage sont de plus en plus maigres, de courte durée et difficiles à obtenir.
Non seulement le nombre de chômeurs a augmenté pendant plus de 25 ans, mais en outre la situation de chômeur est devenue de plus en plus intenable.
Le chômage massif et chronique est devenu partie intégrante de la vie des hommes de la fin du 20e siècle et ce faisant, il a entrepris de détruire le peu de sens que le capitalisme pouvait encore donner à cette vie. On interdit aux jeunes d'entrer dans le monde des adultes, et on devient « vieux » plus vite. Le manque d'avenir historique du capitalisme prend la forme de l'angoisse du désespoir chez les individus.
Le fait que le chômage soit devenu massif et chronique constitue la preuve la plus indiscutable de la faillite historique du capitalisme comme mode d'organisation de la société.
Pourquoi les capitalistes suppriment-ils des emplois ?
Ce n'est pas par plaisir que les capitalistes refusent d'exploiter un plus grand nombre de prolétaires ou de continuer à exploiter les anciens. Leur profit, ils le tirent du travail vivant, digéré par la machine d'exploitation salariale. Le travail des autres est la « poule aux oeufs d'or » du capital. Celui-ci ne tient pas, en soi, à la tuer. Mais le capital n'a qu'une seule religion : le profit. Un capitaliste qui ne fait pas de profit est condamné à disparaître. Le capital n'embauche pas par humanisme mais parce que ça lui rapporte. Et si ses profits sont insuffisants, il licencie, il supprime des postes de travail. Le profit est l'alpha et l'oméga de la bible du capital.
Les graphiques ci-dessous reproduisent, pour les Etats-Unis et le Canada, l'évolution simultanée des profits des entreprises et du nombre de chômeurs depuis 1965. Ils montrent comment les chutes de la masse des profits commencées en 1973-74, puis en 1979 et en 1988, se sont accompagnées d'une hausse du chômage. Lorsque les profits baissent, et parce que les profits baissent, les capitalistes licencient. Le chômage ne diminue que lorsque ces profits augmentent à nouveau. Mais, comme on peut le voir sur les courbes, le nombre de chômeurs ne redescend jamais aux niveaux antérieurs. Les périodes d'embauche ne sont que des répits dans une tendance générale à l'augmentation du chômage.
Le capital ne peut assurer l'existence de son profit qu'en rejetant dans le chômage un nombre toujours plus grand de prolétaires.
[1] [6] Les prévisions officielles de l'OCDE annoncent une diminution des taux de chômage en 1995 et 1996. Mais le niveau de ces baisses est ridicule : elle serait de 0,3 % en Italie (11,3 % de chômage officiel en 1994, 11 % prévu pour 1996) ; de 0,5 % aux Etats-Unis (de 6,1 % en 1994 à 5,6 % en 1996) ; de 0,7 % en Europe Occidentale (de 11,6 % à 10,9 %) ; au Japon aucune diminution n'est prévue.
[2] [7] Libération, 16/12/1994.
[3] [8] Entre 1989 et 1994, la dette publique, mesurée en pourcentage du produit intérieur annuel brut, est passée de 53 à 65 % aux Etats-Unis, de 57 à 73 % en Europe ; ce pourcentage atteint, en 1994, 123 % pour un pays comme l'Italie, 142 % pour la Belgique.
[4] [9] Cette évolution de la classe dominante vers un corps parasite qui vit aux dépens de son Etat est typique des sociétés décadentes. Dans le Bas-empire romain, comme dans le féodalisme décadent ce phénomène fut un des principaux facteurs du développement massif de la corruption.
[5] [10] Voir « Vers une nouvelle tourmente financière », Revue Intarnationale, n° 78.
Récent et en cours:
- Crise économique [11]
Questions théoriques:
- Décadence [12]
La première et la deuxième internationale devant le problème de la guerre - Bilan n°21, juillet-août 1935
- 6212 lectures
Document
C'est à propos de la guerre des Balkans, à la veille de la 1re guerre mondiale que les révolutionnaires, en particulier Rosa Luxemburg et Lénine, affirment au congrès de Bâle en 1912 la position internationaliste caractéristique de la nouvelle phase historique du capitalisme : « Il n'y a plus de guerres défensives ou offensives ». Dans la phase « impérialiste », « décadente » du capitalisme, toutes les guerres entre puissances sont également réactionnaires. Contrairement à ce qui se passait au 19e siècle, lorsque la bourgeoisie pouvait encore mener des guerres contre le féodalisme, les prolétaires n'ont plus de camp à soutenir dans ces guerres. La seule réponse possible à la barbarie guerrière du capitalisme décadent est la lutte pour la destruction du capitalisme lui-même. Ces positions, ultra-minoritaires en 1914, au moment de l'éclatement de la 1re guerre mondiale, allaient cependant constituer la base des plus grands mouvements révolutionnaires de ce siècle : la révolution russe de 1917, la révolution allemande de 1919, qui mirent fin au bain de sang commencé en 1914.
Aujourd'hui que pour la première fois depuis la fin de la 2e guerre mondiale, la guerre sévit en Europe, encore dans les Balkans, il est indispensable de se réapproprier l'expérience de la lutte des révolutionnaires contre la guerre. C'est pourquoi nous publions cet article qui résume de façon remarquable un aspect crucial de l'action des révolutionnaires face à un des pires fléaux du capitalisme.
CCI, décembre 1994
BILAN n°21, juillet-août 1935
La première et la deuxième internationale devant le problème de la guerre - BILAN n°21, juillet-août 1935
Ce serait fausser l'histoire que d'affirmer que la lre et la 2e Internationale n'ont pas songé au problème de la guerre et qu'elles n'ont pas essayé de le résoudre dans l'intérêt de la classe ouvrière. On pourrait même dire que le problème de la guerre fut à l'ordre du jour dès le début de la lre Internationale (guerre de 1859 de la France et du Piémont contre l'Autriche ; de 1864 : la Prusse et l'Autriche contre le Danemark ; de 1866 : la Prusse et l’Italie contre l'Autriche et l'Allemagne du Sud ; 1870 : la France contre l'Allemagne et nous ne mentionnons pas la guerre de Sécession de 1861-65 aux Etats-Unis, l'insurrection de la Bosnie-Herzégovine, en 1878 contre l'annexion autrichienne -qui passionna beaucoup les internationalistes de l'époque- etc., etc.)
Ainsi, si on considère le nombre de guerres qui surgirent pendant cette période, il est permis d'affirmer que le problème fut plus «brûlant» pour la lre Internationale que pour la 2e qui fut surtout l'époque des expéditions coloniales, du partage de l'Afrique, car pour les guerres européennes - exception faite de la courte guerre de 1897 entre la Turquie et la Grèce- il faut attendre les guerres balkaniques, celle entre l’Italie et la Turquie pour la Libye, qui sont déjà des signes avant-coureurs de la conflagration mondiale.
Tout cela explique - et nous écrivons après une expérience vécue - le fait que nous, de la génération qui lutta avant la guerre impérialiste de 1914, avons peut-être considéré le problème de la guerre, plus comme une lutte idéologique que comme un danger réel et imminent ; le dénouement de conflits aigus, sans le recours aux armes, tels Fachoda ou Agadir nous avait influencés dans le sens de croire fallacieusement que grâce à « l'interdépendance » économique, aux liens toujours plus nombreux et plus étroits entre pays, il s'était ainsi constitué une sûre défense contre l'éclosion d'une guerre entre puissances européennes et que l'augmentation des préparatifs militaires des différents impérialistes au lieu de conduire inévitablement à la guerre, vérifiait le principe romain « si vis pacem para bellum » si tu veux la paix prépare la guerre.
A l'époque de la lre Internationale la panacée universelle pour empêcher la guerre était la suppression des armées permanentes et leur remplacement par des milices (type suisse). C'est d'ailleurs ce qu'affirma la 2e Conférence de Lausanne - en 1867 - de l'Internationale envers un mouvement de pacifistes bourgeois qui avaient constitué une Ligue pour la Paix qui tenait des congrès périodiques. L'Internationale décida d'y participer (ce congrès se tint à Genève où Garibaldi fit son intervention pathétiquement théâtrale avec sa célèbre phrase « l'esclave seul a le droit de faire la guerre aux tyrans ») et fit souligner par ses délégués « qu'il ne suffit pas de supprimer les armées permanentes pour en finir avec la guerre, mais qu'une transformation de tout l'ordre social était à cette fin également nécessaire »
Au 3e congrès de l'Internationale -tenu à Bruxelles en 1868 - on vota une motion sur l'attitude des travailleurs dans le cas d'un conflit entre les grandes puissances d'Europe où ils étaient invités à empêcher une guerre de peuple à peuple et où on leur recommandait de cesser tout travail en cas de guerre. Deux ans après, l'Internationale se trouva devant le fait de la guerre franco-allemande qui éclata en juillet 1870.
Le premier manifeste de l'Internationale est assez anodin : «... sur les ruines que vont faire les deux armées ennemies, est-il écrit, il ne restera d'autre puissance réelle que le socialisme. Ce sera alors pour l'Internationale le moment de se demander ce qu'elle doit faire. D'ici là, soyons calmes et veillons. »(!!!)
Le fait que la guerre fut menée par Napoléon « le petit », détermina une orientation plutôt défaitiste parmi les larges couches de la population française dont les internationalistes se firent l'écho dans leur opposition à la guerre.
D'autre part, parce que l'on considère généralement l'Allemagne comme « injustement » attaquée par « Bonaparte », on fournit ainsi une certaine justification - puisqu'il s'agissait d'une guerre « défensive » - à la position de défense du pays des travailleurs allemands.
La chute de l'Empire, après le désastre de Sedan, apporta un bouleversement de ces positions.
« Nous répétons ce que nous déclarions en 1793 à l'Europe coalisée, écrivaient les internationalistes français dans leur manifeste au peuple allemand : le peuple français ne fait pas la paix avec un ennemi qui occupe notre territoire, seulement sur les rives du fleuve contesté (le Rhin) les ouvriers se tendront les mains pour créer les Etats-Unis d'Europe, la République Universelle. »
La fièvre patriotique s'intensifia jusqu'à présider à la naissance même de la glorieuse Commune de Paris.
D'un autre côté pour le prolétariat allemand c'était maintenant une guerre de la monarchie et du militarisme prussiens contre la « république française », le « peuple français ». De là vint le mot d'ordre de « paix honorable et sans annexions » qui en déterminant la protestation de Liebknecht et Bebel contre l'annexion de l'Alsace-Lorraine au Reichstag les fit condamner pour « haute trahison ».
Au sujet de la guerre franco-allemande de 1870, et de l'attitude du mouvement ouvrier, il reste encore à élucider un autre point.
En réalité à cette époque Marx envisageait la possibilité de « guerres progressives » - la guerre contre la Russie du tsar avant tout - dans une époque où le cycle des révolutions bourgeoises n'était pas encore clos, de même qu'il envisageait la possibilité d'un croisement du mouvement révolutionnaire bourgeois avec la lutte révolutionnaire du prolétariat avec l'intervention de ce dernier, fut-ce au cours d'une guerre, pour hâter son triomphe final.
« La guerre de 1870, écrivit Lénine dans sa brochure sur Zimmerwald, fut une "guerre progressive" comme celles de la révolution française qui tout en portant en elles, incontestablement, des éléments de pillage et de conquêtes eurent la fonction historique de détruire ou d'ébranler le féodalisme et l'absolutisme de la vieille Europe dont les fondements reposaient encore sur le servage. »
Mais si une telle perspective était admissible pour l'époque où vécut Marx, bien que déjà elle s'avéra dépassée par les événements, bavarder sur la guerre « progressive » ou « nationale » ou «juste », c'est plus qu'une tromperie, c'est une trahison dans la dernière étape du capitalisme, dans sa phase impérialiste. En effet, comme l'écrivit Lénine, l'union avec la bourgeoisie nationale de son propre pays c'est l'union contre l'union du prolétariat révolutionnaire international, c'est en un mot l'union avec la bourgeoisie contre le prolétariat, la trahison de la révolution, du socialisme.
D'autre part, on ne doit pas oublier d'autres problèmes qui en 1870 influencèrent le jugement de Marx et qu'il mit d'ailleurs en évidence dans une lettre à Engels, le 20 juillet 1870. La concentration du pouvoir de l'Etat, suite à la victoire de la Prusse, ne pouvait qu'être utile à la concentration de la classe ouvrière allemande, favorable à ses luttes de classe et aussi, écrivit Marx « la prépondérance allemande transportera le centre de gravité du mouvement ouvrier européen de France en Allemagne et en conséquence déterminera le triomphe définitif du socialisme scientifique sur le proudhonisme et le socialisme utopique. » ([1] [13])
Pour en terminer avec la lre Internationale, nous marquerons encore que, chose étrange, la Conférence de Londres de 1871 de cette dernière ne traita pas de ces problèmes pourtant d'actualité pas plus d'ailleurs que le Congrès de La Haye en septembre 1872, où une relation fut donnée par Marx en langue allemande sur les événements s'étant déroulés depuis 1869 -date du dernier Congrès de l'Internationale. On traita, en réalité, très superficiellement des événements de l'époque pour se limiter à exprimer : l'admiration du Congrès pour les héroïques champions tombés victimes de leur dévouement et ses salutations fraternelles aux victimes de la réaction bourgeoise.
Le premier Congrès de l'Internationale reconstituée à Paris en 1889 reprit l'ancien mot d'ordre de la « substitution des milices populaires aux armées permanentes » et le congrès suivant, tenu à Bruxelles en 1891, adopta une résolution appelant tous les travailleurs à protester par une agitation incessante, contre toutes les tentatives de guerre en y ajoutant comme une sorte de consolation, que la responsabilité des guerres retomberait en tout cas, sur les classes dirigeantes...
Le Congrès de Londres de 1896 - où eut lieu la séparation définitive avec les anarchistes - dans une résolution programmatique sur la guerre affirma génériquement que « la classe ouvrière de tous les pays doit s'opposer à la violence provoquée par les guerres ».
En 1900, à Paris, en conséquence de l'accroissement de la force politique des partis socialistes, fut élaboré le principe - qui devint l'axiome de toute agitation contre la guerre : « les députés socialistes de tous les pays sont tenus à voter contre toutes les dépenses militaires, navales et contre les expéditions coloniales ».
Mais c'est à Stuttgart (1907) qu'eurent lieu les plus amples débats sur le problème de la guerre.
A côté des fanfaronnades de l'histrion Hervé sur le devoir de « répondre à la guerre par la grève générale et l'insurrection » fut présentée la motion de Bebel d'accord substantiellement avec Guesde, laquelle bien que juste dans ses prévisions théoriques était insuffisante par rapport au rôle et aux tâches du prolétariat.
Ce fut à ce Congrès que pour « empêcher de lire les déductions orthodoxes de Bebel à travers les lunettes opportunistes » (Lénine), Rosa Luxemburg - en accord avec les bolcheviks russes - fit ajouter des amendements qui soulignaient que le problème consistait non seulement à lutter contre l'éventualité de la guerre ou de la faire cesser le plus rapidement possible, mais aussi et surtout à utiliser la crise causée par la guerre pour accélérer la chute de la bourgeoisie ; « à tirer de toute façon parti de la crise économique et politique pour soulever le peuple et précipiter, par là même, la chute de la domination capitaliste ».
En 1910, à Copenhague, on confirma la résolution précédente surtout pour ce qui regarde le strict devoir des élus socialistes de refuser tous les crédits de guerre.
Finalement, comme on le sait, pendant la guerre des Balkans et devant le danger imminent d'une conflagration mondiale surgissant de cette poudrière de l'Europe - aujourd'hui les poudrières se sont multipliées à l'infini - un congrès spécial tenu à Bâle en novembre 1912 rédigea le célèbre manifeste qui en reprenant toutes les affirmations de Stuttgart et de Copenhague, flétrissait la future guerre européenne comme « criminelle » et comme « réactionnaire » pour tous les gouvernements et ne pouvant qu' « accélérer la chute du capitalisme en provoquant immanquablement la révolution prolétarienne ».
Mais le manifeste tout en affirmant que la guerre qui menaçait était une guerre de rapines, une guerre impérialiste pour tous les belligérants et qu'elle devait conduire à la révolution prolétarienne, s'efforçait avant tout à démontrer que cette guerre imminente ne pouvait être justifiée par l'ombre d'un intérêt de défense nationale. Cela signifiait implicitement que l'on admettait qu'en régime capitaliste et en pleine expansion impérialiste pouvaient exister des cas de participation justifiée à une guerre de « défense nationale » de la classe exploitée.
Deux ans après éclatait la guerre impérialiste et avec elle l'effondrement de la 2e Internationale. Cette débâcle était la conséquence directe des équivoques et des contradictions insurmontables contenues dans toutes les résolutions. Plus particulièrement l'interdiction de voter les crédits de guerre ne résolvait pas le problème de la « défense du pays » devant l'attaque d'un pays « agresseur ». C'est par cette brèche que se rua toute la meute des chauvins et des opportunistes. « L'Union sacrée » était scellée sur l'effondrement de l'entente de classe internationale des travailleurs.
Comme nous l'avons vu pour la seconde Internationale, si on regarde superficiellement le langage de ses résolutions, elle aurait adopté envers la guerre non seulement une position de principe de classe, mais aussi aurait donné des moyens pratiques en arrivant jusqu'à la formulation, plus ou moins explicite de la transformation de la guerre impérialiste en révolution prolétarienne. Mais si l'on va au fond des choses, on constate que la seconde Internationale dans son ensemble, tout en posant le problème de la guerre, l'a résolu d'une façon formaliste et simpliste. Elle dénonça la guerre avant tout pour ses horreurs et atrocités, parce que le prolétariat devait fournir la chair à canon aux classes dominantes. L'antimilitarisme de la seconde Internationale eut une forme purement négative et fut laissé presque exclusivement à la jeunesse socialiste et dans certains pays avec l'hostilité manifeste du parti lui-même.
Aucun parti, excepté les bolcheviks pendant la révolution russe de 1904-05, n'a pratiqué ou même envisagé la possibilité d'un travail illégal systématique dans l'armée. On s'est borné à des manifestes ou à des journaux contre la guerre et contre l'armée au service du capital, que l'on collait sur les murs ou que l'on distribuait à la rentrée des classes, en invitant les ouvriers à se rappeler que malgré l'uniforme de soldat ils devaient rester des prolétaires. Devant l'insuffisance et la stérilité de ce travail Hervé eut beau jeu, surtout dans les pays latins, avec sa démagogie verbale du « drapeau dans le fumier » et en propageant la désertion, le rejet des armes et le fameux « tirez sur vos officiers ».
En Italie - où seul exemple dans la 2e Internationale le parti socialiste devait en octobre
1912 protester par une grève générale de 24 heures contre une expédition coloniale, celle de la Tripolitaine - un jeune ouvrier, Masetti, sut être conséquent avec les suggestions de Hervé et soldat à Boulogne tira sur son colonel pendant les exercices militaires. C'est l'unique fait positif de toute la comédie hervéiste.
Moins d'un mois après, le 4 août, momentanément ignoré des masses ouvrières englouties dans le carnage, le manifeste du Comité central bolchevik relevait le drapeau de la continuité de la lutte ouvrière avec ses affirmations historiques : la transformation de la guerre impérialiste actuelle en guerre civile.
La révolution d'Octobre était en marche.
Gatto Mammone
[1] [14] Si l'on tient compte de tous ces éléments qui eurent une influence décisive surtout dans la première phase de la guerre franco-allemande, sur le jugement et la pensée de Marx-Engels, on peut expliquer certaines expressions hâtives et très peu heureuses de ces derniers telles : « Les Français ont besoin d'être rossés », « C'est nous qui avons gagné les premières batailles », « Ma confiance dans la force militaire prussienne croît chaque jour » et enfin le fameux « Bismarck comme en 1866 travaille pour nous ».
Toutes ces expressions extraites d'une correspondance strictement intime de Marx et Engels fournirent aux chauvins de 1914 -entre autre au vieux James Guillaume qui ne pouvait oublier son exclusion de l'Internationale avec Bakounine en 1872 - l'occasion de transformer les fondateurs du socialisme scientifique en précurseurs du pangermanisme et de l’hégémonie allemande...
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [17]
Questions théoriques:
- Guerre [18]
- Impérialisme [19]
Enseignements de 1917-23 : La première vague révolutionnaire du prolétariat mondial
- 7231 lectures
Il y a de cela 80 ans, la Première Guerre mondiale inaugurait la période de décadence du capitalisme mondial, « l’ère des guerres et des révolutions » comme l'avait définie l'Internationale communiste. Si la guerre impérialiste mettait en lumière la réalité et l'avenir qu'offrait le capitalisme décadent à l'humanité, la vague révolutionnaire qui s'ensuivit et qui mit un terme à la boucherie impérialiste, secouant l'ordre bourgeois de fond en comble, d'Afrique du Sud jusqu'en Allemagne, de Russie jusqu'au Canada, montra quelle était la seule alternative à cette barbarie capitaliste : la révolution prolétarienne mondiale.
Cette vague révolutionnaire dont le point culminant fut la Révolution russe (voir Revue internationale n° 72, 73 et 75) constitue une véritable mine d'enseignements pour le mouvement ouvrier. Véritable vitrine à l'échelle mondiale de la lutte de classe dans la période de décadence capitaliste, la vague révolutionnaire de 1917-23 confirma pleinement et définitivement la plupart des positions politiques que défendent aujourd'hui les révolutionnaires (contre les syndicats et les partis « socialistes », contre les luttes de « libération nationale », la nécessité de l'organisation générale de la classe ouvrière en conseils ouvriers, etc.). Cet article se concentre sur quatre questions :
-comment la vague révolutionnaire transforma la guerre impérialiste en guerre civile entre les classes ;
- comment elle démontra la thèse historique des communistes quant à la nature mondiale de la révolution prolétarienne ;
-comment la guerre, tout en étant le facteur à l'origine de cette vague révolutionnaire, ne pose cependant pas les conditions les plus favorables pour la révolution prolétarienne ;
- l'importance déterminante de la lutte du prolétariat dans les pays les plus industrialisés du capitalisme.
La vague révolutionnaire met un terme à la Première Guerre mondiale
Dans la Revue internationale n° 78 («Polémique
avec Programme communiste », IIe partie), nous démontrons que la
déclaration de guerre en 1914 n'obéit pas directement à des causes
économiques, mais qu'elle survient parce que la bourgeoisie est parvenue, grâce
au réformisme dominant dans les partis sociaux-démocrates, à défaire
idéologiquement la classe ouvrière. Dans le même sens, la fin de la guerre
n'est pas le fruit d'une décision de la bourgeoisie mondiale qui, pour ainsi
dire, aurait «fait un bilan » et conclu que l'hécatombe était «
suffisante », qu'il fallait faire évoluer les «affaires », passant
de la destruction à la reconstruction. En novembre 1918, on ne relève pas la
moindre défaite significative des puissances centrales ([1] [20]). Ce
qui met vraiment le Kaiser dans l'obligation de demander l'armistice, c'est
le besoin urgent de faire face à la révolution qui s'étendait en Allemagne. Et
si, pour leur part, les forces de l'Entente ne profitent pas alors de cette faiblesse
de leur ennemi impérialiste, c'est parce qu'elles sont conscientes de la nécessité
de resserrer les rangs contre l'ennemi commun, contre le danger représentant,
pour tout le capitalisme, l'extension de la révolution prolétarienne qui mûrit
jusque dans les propres pays composant l'Entente, même si à un niveau plus
embryonnaire.
Comment s'est développée cette réponse du prolétariat à la guerre ?
Avec l'accroissement de la barbarie de la boucherie mondiale, le prolétariat se défaisait progressivement du poids de la défaite d'août 1914([2] [21]). Dès février 1915, les ouvriers de la vallée de la Clyde (Grande-Bretagne) lancent une grève sauvage (c'est-à-dire contre l'avis du syndicat), et cet exemple sera repris par les ouvriers des usines d'armement et les métallos de Liverpool. Des grèves éclatent en France, celles des travailleurs du textile de Vienne et de Lagors. En 1916, les ouvriers de Petrograd empêchent par la grève générale une tentative par le gouvernement de militarisation des travailleurs. En Allemagne, la Ligue Spartakus appelle à une manifestation d'ouvriers et de soldats, qui joint rapidement le mot d'ordre « A bas le gouvernement ! » à celui de « A bas la guerre ! ». C'est dans ce climat d'accumulation de signes de mécontentement que parviennent les premières nouvelles de la Révolution de février en Russie...
Une vague de grèves se répand en avril 1917 en Allemagne (Halle, Kiel, Berlin...). L'insurrection est évitée de justesse à Leipzig et les premiers conseils ouvriers se constituent tout comme en Russie. Sur le front oriental, le Premier mai, les drapeaux rouges flottent sur les tranchées russes et allemandes. Un tract circule parmi les soldats allemands : « Nos frères héroïques de Russie ont mis à terre dans leur pays le joug maudit des bouchers (...) Votre bonheur, votre progrès, dépendent de votre capacité à poursuivre et mener plus loin l'exemple de vos frères russes... Une révolution victorieuse demande moins de sacrifices qu'une guerre sauvage... »
En France, ce même Premier mai, dans un climat de grèves ouvrières (celle des métallos de Paris s'étend à 100 000 travailleurs d'autres secteurs), un meeting de solidarité avec les ouvriers russes proclame : « La révolution russe est le signal de la révolution universelle ». Sur le front, des conseils clandestins de soldats font circuler de la propagande révolutionnaire et collectent de l'argent pris sur la solde misérable pour soutenir les grèves à l'arrière.
De grandes manifestations contre la guerre se déroulent aussi en Italie. L'une d'elles, à Turin, voit surgir le mot d'ordre «Faisons comme en Russie » qui est repris rapidement dans tout le pays. Et effectivement, quand les regards de tous les ouvriers et soldats du monde entier se tourneront vers Petrograd en octobre 1917, ce mot d'ordre deviendra un puissant stimulant à des mobilisations destinées à en finir une fois pour toutes avec la boucherie impérialiste.
Ainsi, les ouvriers en Finlande, qui avaient déjà tenté une première insurrection quelques jours après Petrograd, prennent les armes en janvier 1918 et occupent les édifices publics à Helsinki et dans le sud du pays. Dans le même temps, une rébellion dans la flotte de la Mer noire oblige la Roumanie, où la Révolution russe avait un écho immédiat, à signer l'armistice avec les puissances centrales. En Russie même, la Révolution met un terme à l'implication du pays dans la guerre impérialiste, la révolution se trouvant à la merci - dans l'attente de son extension sur le plan international - de la rapine des puissances centrales sur de vastes territoires russes, lors de la paix dite « de Brest-Litovsk ».
En janvier 1918, les travailleurs de Vienne connaissent les conditions « de paix » draconiennes que leur gouvernement veut imposer à la Russie révolutionnaire. Face à la menace d'intensification de la guerre, les ouvriers de Daimler provoquent une grève qui en quelques jours va s'étendre et toucher 700 000 travailleurs dans tout l'Empire, au cours de laquelle s'organisent les premiers conseils ouvriers. A Budapest, le mot d'ordre de ralliement de la grève est : « A bas la guerre ! Vivent les ouvriers russes ! ». Il faut les appels au calme incessants des « socialistes » pour parvenir, non sans mal, à apaiser cette vague de luttes et écraser les révoltes de la flotte basée à Carthage ([3] [22]). Fin janvier, on compte 1 million de grévistes en Allemagne. Malheureusement, les ouvriers laissent la direction de leur lutte entre les mains des « socialistes » qui s'allient avec les syndicats et l’Etat-major militaire pour y mettre fin et envoyer au front plus de 30 000 travailleurs qui s'étaient illustrés dans le combat prolétarien. C'est dans cette même période que surgissent les premiers conseils ouvriers en Pologne, dans les mines de Dombrowa et Lublin...
Le mouvement de solidarité avec la Révolution russe se développe aussi en Angleterre. La visite du délégué soviétique Litvinov, en janvier 1918, coïncide avec une grande vague de grèves et provoque de telles manifestations à Londres qu'un journal bourgeois, The Herald, les qualifie « d'ultimatum pour la paix des ouvriers au gouvernement ». En mai 1918 éclate en France la grève de Renault, qui s'étend rapidement à 250 000 travailleurs de Paris. En solidarité, les travailleurs de la région de la Loire se remettent en grève, contrôlant la région pendant dix jours.
Les dernières offensives militaires provoquent cependant une paralysie momentanée des luttes, mais leur échec convainc les ouvriers que la lutte de classe est le seul moyen de mettre un terme à la guerre. En octobre, en Autriche, éclatent les luttes des journaliers et la révolte contre l'envoi au front des régiments les plus « rouges » de Budapest, ainsi que des grèves et des manifestations massives. Le 4 novembre, la bourgeoisie de la « double couronne » se désengage enfin de la guerre.
En Allemagne, le Kaiser tente une « démocratisation » du régime (libération de Liebknecht, participation des « socialistes » au gouvernement) pour exiger du peuple allemand « qu'il verse jusqu'à la dernière goutte de son sang ». Mais les marins de Kiel refusent, le 3 novembre, d'obéir aux officiers qui veulent tenter une ultime bataille suicide de la flotte ; ils hissent le drapeau rouge sur l'ensemble de la flotte et organisent un conseil ouvrier avec les ouvriers de la ville. L'insurrection s'étend en quelques jours aux principales villes d'Allemagne ([4] [23]). Le 9 novembre, quand l'insurrection gagne Berlin, la bourgeoisie allemande ne commet pas l'erreur du Gouvernement provisoire russe (qui avait maintenu sa participation dans la guerre, ce qui avait été un facteur de fermentation et de radicalisation de la révolution) et sollicite l'armistice. Le 11 novembre, la bourgeoisie met fin à la guerre impérialiste pour s'affronter à la classe ouvrière.
Le caractère international de la classe ouvrière et de sa révolution
Alors que les révolutions bourgeoises se limitaient à implanter le capitalisme dans le cadre de la nation, la révolution prolétarienne est nécessairement mondiale. Si les révolutions bourgeoises pouvaient s'échelonner sur plus d'un siècle, la lutte révolutionnaire du prolétariat, de par sa propre nature, tend à prendre la forme d'une gigantesque vague qui parcours la planète. Telle est depuis toujours la thèse historique des révolutionnaires. Dans ses Principes du communisme, Engels soulignait déjà :
« Cette révolution pourra-t-elle se produire en un seul pays ?
Réponse : non. La grande industrie, en créant le marché mondial, a déjà établi entre tous les peuples de la terre, principalement entre les peuples civilisés, des relations telles que chaque peuple ressent le contrecoup de ce qui se passe chez les autres. Elle a par ailleurs amené tous les pays civilisés à un même stade d'évolution sociale : dans tous ces pays la bourgeoisie et le prolétariat sont devenus les deux classes les plus importantes de la société et la lutte entre ces deux classes est devenue la lutte capitale de notre époque. La révolution communiste ne sera donc pas une révolution nationale uniquement, elle se fera simultanément dans tous les pays civilisés c'est-à-dire au moins en Angleterre, en Amérique, en France et en Allemagne. (...) Ce sera une révolution universelle, dont le terrain sera lui aussi universel. »
La vague révolutionnaire de 1917-23 a confirmé cela de façon éclatante. En 1919, le premier ministre britannique Lloyd George écrit : « L'Europe entière est envahie par l'esprit de la révolution. Il existe un sentiment profond parmi les ouvriers contre les conditions existantes, non de mécontentement mais de colère et de révolte (...). L'ensemble de l'ordre politique, social et économique est remis en question par les masses de la population, d'un bout à l'autre d'Europe » (cité par E.H. Carr, La Révolution bolchevique).
Mais le prolétariat ne parvient pas à transformer cette formidable vague de luttes en combat unifié. Nous verrons d'abord les faits pour mieux pouvoir par la suite analyser les obstacles sur lesquels a trébuché le prolétariat dans la généralisation de la révolution.
De novembre 1918 à août 1919 : les tentatives insurrectionnelles dans les pays vaincus...
Quand la révolution démarre en Allemagne, trois importants détachements du prolétariat d'Europe sont déjà pratiquement neutralisés (Hollande, Suisse et Autriche). En octobre 1918 éclatent des mutineries dans l'armée en Hollande (le propre commandement militaire coule sa flotte plutôt que de laisser les marins s'en emparer) et des conseils ouvriers se forment à Rotterdam et Amsterdam. Les « socialistes » prennent part à la révolte pour mieux pouvoir la neutraliser. Leur leader, Troëlstra, le reconnaît plus tard : « Si je n'étais pas intervenu révolutionnairement, les éléments ouvriers les plus énergiques auraient pris le chemin du bolchevisme » (P.-J. Troëlstra, De Revolutie en de SDAP). Désorganisée par ses propres « organisateurs », privée de l'appui des soldats, la lutte prend fin avec le mitraillage des ouvriers qui, le 13 novembre, s'étaient réunis dans un meeting près d'Amsterdam. La « Semaine rouge » se conclut par 5 morts et des dizaines de blessés.
Ce même jour, en Suisse, une grève générale de 400 000 ouvriers a lieu pour protester contre l'usage de la troupe contre les manifestations de commémoration du premier anniversaire de la Révolution russe. Le journal Volksrecht proclame : « Résister jusqu'au bout. Sont en notre faveur la révolution en Autriche et en Allemagne, les actions des ouvriers en France, le mouvement des prolétaires de Hollande et, principalement, le triomphe de la révolution en Russie ».
Là aussi, les « socialistes » et les syndicats donnent la consigne de cesser la lutte « pour ne pas jeter les masses désarmées sous les balles de l'ennemi », alors que c'est précisément ce pas en arrière qui va désorienter les masses et les diviser, ouvrant alors les vannes de la terrible répression qui mettra fin à la « Grande grève ». De son côté, le gouvernement de la « paisible » Suisse militarise les cheminots, organise une garde contre-révolutionnaire, rase sans scrupule les locaux des ouvriers, en emprisonne des centaines et instaure la peine de mort contre les « subversifs ».
La République est proclamée en Autriche le 12 novembre. Au moment de hisser le drapeau national rouge et blanc, des groupes de manifestants arrachent la frange blanche.
Hissés sur les épaules de la statue de Pallas Athénée, dans le centre de Vienne, les divers orateurs appellent l'assemblée composée de dizaines de milliers de travailleurs à passer directement à la dictature du prolétariat. Mais les « socialistes », appelés en renfort parce qu'ils sont les seuls à avoir une influence sur les masses ouvrières, déclarent : « Le prolétariat détient déjà le pouvoir. Le parti ouvrier gouverne la république » et entreprennent systématiquement d'affaiblir les conseils ouvriers, les transformant en conseils de production, comme ils transforment les comités de soldats en comités de régiments (massivement infiltrés par les officiers). Cette contre-offensive de la bourgeoisie va paralyser le prolétariat en Autriche, et servir de modèle de la contre-révolution pour la bourgeoisie allemande.
En Allemagne, l'armistice et la proclamation de la République vont provoquer un sentiment naïf de « victoire » que paiera très cher le prolétariat. Alors que les travailleurs ne parviennent pas à unifier les différents foyers de lutte et hésitent à se lancer dans la destruction de l'appareil d'Etat bourgeois ([5] [24]), la contre-révolution s'organise et coordonne les syndicats, les partis « socialistes » et le haut-commandement militaire. A partir de décembre, la bourgeoisie passe à l'offensive par de constantes provocations au prolétariat de Berlin, dans le but de le faire partir en lutte et de l'isoler du reste du prolétariat allemand. Le 4 janvier 1919, le gouvernement destitue le préfet de police Eischorn, défiant l'opinion des travailleurs. Le 6 janvier, un demi million de prolétaires berlinois sort dans la rue. Le lendemain même, à la tête des corps-francs (officiers et sous-officiers démobilisés payés par le gouvernement), le « socialiste » Noske écrase les ouvriers de Berlin. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont assassinés quelques jours plus tard.
Bien que les événements de Berlin alertent les ouvriers d'autres villes (en particulier à Brème où les locaux syndicaux sont pris d'assaut et le contenu de leurs caisses distribué entre les chômeurs), le gouvernement parvient malgré tout à diviser cette riposte, de façon à concentrer ses forces dans un premier temps sur Brème, ensuite sur les ouvriers de Rhénanie et de la Ruhr, pour finir par revenir éteindre les dernières braises à Berlin, au cours de la tristement célèbre « Semaine sanglante » au cours de laquelle sont assassinés 1 200 ouvriers en mars. Ensuite seront écrasés les ouvriers de Mansfeld, de Leipzig et la République des Conseils de Magdebourg...
En avril 1919, les travailleurs proclament à Munich la République des Conseils de Bavière, qui constitue avec la Révolution hongroise et l'Octobre russe les seules expériences de prise de pouvoir par le prolétariat. Les ouvriers bavarois en armes sont même capables de défaire la première armée contre-révolutionnaire envoyée contre eux par le Président destitué Hoffmann. Mais hélas, comme nous l'avons vu, le reste du prolétariat allemand a déjà subi de sévères défaites et ne peut apporter son soutien à ses frères, cependant que la bourgeoisie lève une armée qui écrasera l'insurrection au cours des premiers jours de mai. Parmi les troupes qui sèment la terreur à Munich s'illustrent alors des noms tels que Himmler, Rudolf Hess, Von Epp..., futurs dignitaires du nazisme encouragés dans leur furie anti-prolétarienne par un gouvernement qui se proclame « socialiste ».
Le 21 mars 1919, à la suite d'une formidable vague de grèves et de meetings, les conseils ouvriers prennent le pouvoir en Hongrie. Par une erreur tragique, les communistes s'unifient dans ce même temps avec les « socialistes » qui vont s'employer à saboter la révolution, alors même que les «démocraties » occidentales (et en particulier la France et l'Angleterre) imposent un blocus économique auquel s'ajoute une intervention militaire des armées roumaine et tchèque. En mai, alors que sont vaincus les conseils ouvriers de Bavière, la situation de la révolution hongroise est désespérée. Une formidable réaction ouvrière parvient toutefois à rompre l'encerclement militaire, réaction à laquelle participent aussi bien des travailleurs hongrois, autrichiens, polonais et russes, que des tchèques ou des roumains. A la longue, cependant, le sabotage des « socialistes » et l'isolement de la révolution vont avoir raison de la résistance prolétarienne et les troupes roumaines prennent Budapest le 1er août, instaurant un gouvernement syndical qui liquidera les conseils ouvriers. Mission accomplie, les syndicats confient le pouvoir à l'amiral Horty (lui aussi futur collaborateur des nazis) qui déchaînera alors une terreur sanglante contre les ouvriers (8 000 exécutions, 100 000 déportations...). La chaleur de la révolution hongroise pousse les mineurs de Dombrowa (Pologne) à prendre le pouvoir dans la région et ils forment une Garde ouvrière pour se défendre de la sanglante répression d'un autre « socialiste », Pilsudski. La République rouge de Dombrowa s'éteint avec les conseils ouvriers hongrois.
La révolution hongroise provoque les dernières réactions ouvrières en Autriche et en Suisse, en juin 1919. La police de Vienne, forte des leçons apprises de ses acolytes allemands, machine une provocation (l'assaut du local du PC) pour précipiter l'insurrection alors que le prolétariat est encore faible et désorganisé. Les ouvriers tombent dans ce piège et laissent dans les rues de Vienne plus de 30 morts. Il advient la même chose en Suisse, après la grève générale des ouvriers de Zurich et Bâle.
...et dans les pays « vainqueurs »
A nouveau dans la région de La Clyde en Grande-Bretagne, plus de 100 000 ouvriers sont en grève dès janvier 1919. Le 31 janvier (le « Vendredi rouge »), au cours d'une concentration ouvrière à Glasgow, les prolétaires s'affrontent durement aux régiments appuyés par l'artillerie que le gouvernement à dépêchés sur place. Les mineurs sont prêts à entrer en lutte, mais les syndicats parviennent à stopper ce mouvement pour « donner une marge de confiance au gouvernement afin que celui-ci étudie la nationalisation (!) des mines » (Hinton et Hyman, Trade Unions and Révolution).
A Seattle, aux Etats-Unis, éclate une grève dans les chantiers navals qui s'étend à toute la ville en quelques jours. Grâce à des assemblées massives et un comité de grève élu et révocable, les ouvriers contrôlent le ravitaillement et la défense contre les troupes envoyées par le gouvernement. La « Commune de Seattle » restera cependant isolée et, un mois plus tard, au prix de centaines d'emprisonnements, les travailleurs des chantiers navals reprendront le travail. Plus tard éclateront d'autres luttes comme celle des mineurs de Buttle (Montana), qui va jusqu'à s'organiser en conseil d'ouvriers et de soldats, et la grève de 400 000 ouvriers de la sidérurgie. Mais, là non plus, les luttes ne parviennent pas à s'unifier.
Au Canada, pendant la grève générale de Winnipeg, en mai 1919, le gouvernement local organise un meeting patriotique pour tenter de contrecarrer la pression ouvrière avec le chauvinisme de la victoire. Mais les soldats, après avoir décrit les horreurs de la guerre, proclament la nécessité de « transformer la guerre impérialiste en guerre de classes », et cette radicalisation pousse le mouvement jusqu'à s'étendre aux travailleurs de Toronto. Les travailleurs laissent une fois de plus la direction de la lutte entre les mains des syndicats, ce qui les conduit immanquablement à l'isolement et à la défaite, puis à subir la terreur du « lumpen » de la ville dont le gouvernement a nommé certains éléments « commissaires extraordinaires ».
Mais la vague révolutionnaire ne reste pas cantonnée aux pays directement concernés par la boucherie impérialiste. En Espagne éclate en 1919 une grève à La Canadien se qui s'étend rapidement à tout le cordon industriel de Barcelone. Sur les murs des haciendas andalouses, les journaliers à moitié analphabètes écrivent « Vivent les soviets ! » et « Vive Lénine ! ». Les mobilisations des journaliers durant les années 1918-19 resteront dans l'histoire sous le nom des « deux années bolcheviques ».
Mais des épisodes de cette vague se déroulent également loin des grandes concentrations ouvrières d'Europe et d'Amérique du Nord. En Argentine, en 1919, durant la « Semaine sanglante » de Buenos Aires, les ouvriers répliquent par la grève générale à la répression déchaînée par le gouvernement contre les ouvriers de l'usine « Talleres Vasena ». Après cinq jours de combats de rue, l'artillerie bombarde les quartiers ouvriers causant 3 000 morts. Au Brésil, la grève de 200 000 travailleurs à Sao Paolo fraternise avec les régiments envoyés par le gouvernement pour les réprimer. Dans les favelas de Rio de Janeiro, une «République ouvrière » est proclamée en 1918, qui reste isolée et cède sous la pression de l'état de siège décrété par le gouvernement.
En Afrique du Sud, pays de la « haine raciale », les luttes ouvrières mettent en évidence la nécessité et la possibilité de lutter unis : « La classe ouvrière d'Afrique du Sud ne pourra s'émanciper tant qu'elle n'aura pas dépassé les préjugés racistes et l'hostilité envers les travailleurs d'une autre couleur » (The International, journal des Ouvriers industriels d'Afrique). En mars 1919, la grève des tramways s'étend à tout Johannesburg, avec assemblées et meetings de solidarité avec la Révolution russe. Et au Japon, en 1918, se déroulèrent les fameux « meetings du riz » contre l'expédition de riz aux troupes japonaises envoyées contre la révolution en Russie.
1919-1921 : le redressement tardif du prolétariat des pays « vainqueurs » et le poids de la défaite en Allemagne
Le prolétariat jouait très gros durant cette première phase de la vague révolutionnaire. D'abord, il fallait que le bastion révolutionnaire russe sorte de l'asphyxie de l'isolement ([6] [25]). Mais se jouait aussi le cours même de la révolution, puisque des détachements du prolétariat (Allemagne, Autriche, Hongrie...) s'étaient engagés dans le combat, ce qui était déterminant pour le futur de la révolution mondiale du fait de leur force et de leur expérience. Mais la première phase de la vague révolutionnaire va se solder, nous l'avons vu, par de profondes défaites que le prolétariat ne parviendra pas à surmonter.
Les travailleurs d'Allemagne appuient en 1920 la grève générale convoquée par les syndicats contre le « putsch de Kapp », pour rétablir le soi-disant gouvernement démocratique de Scheidemann. Les travailleurs de la Ruhr refusent cependant de remettre au pouvoir celui qui a déjà assassiné 30 000 ouvriers, prennent les armes et forment « l'Armée rouge de la Ruhr ». Dans certaines villes (Duisbourg), ils vont jusqu'à emprisonner les leaders socialistes et les syndicalistes. Mais la lutte reste à nouveau isolée. Début avril, l'armée allemande réorganisée écrase la révolte de la Ruhr.
En 1921, la bourgeoisie allemande va se consacrer à « nettoyer » les révolutionnaires irréductibles en Allemagne centrale, utilisant toujours de nouvelles provocations (l'assaut des usines Leuna à Mansfeld). Les communistes du KAPD, en pleine désorientation, tombent dans le piège et appellent à « l'action de mars », au cours de laquelle les ouvriers de Mansfeld, Halle, etc., ne parviennent pas à vaincre la bourgeoisie malgré des combats héroïques. Celle-ci profitera de la dispersion du mouvement pour d'abord massacrer les ouvriers en Allemagne centrale, ensuite les ouvriers qui à Hambourg, Berlin et dans la Ruhr s'étaient solidarisés avec le mouvement.
Pour la lutte de la classe ouvrière, internationale par nature, ce qui advient dans une partie du monde a des répercussions dans les autres. C'est ce qui explique que quand le prolétariat des pays vainqueurs de la guerre (Angleterre, France, Italie...) entre massivement en lutte, une fois passée l'euphorie chauvine de la « victoire », les répercussions des défaites successives du prolétariat en Allemagne le rendront plus vulnérable aux pires mystifications : nationalisations, « contrôle ouvrier » de la production, confiance aux syndicats, manque de confiance en ses propres forces...
Une grève générale des cheminots, extrêmement dure, éclate en Angleterre en septembre 1919. Malgré les manoeuvres d'intimidation de la bourgeoisie (navires de guerre à l'embouchure de la Tamise, patrouilles de soldats dans les rues de Londres), les ouvriers ne cèdent pas. Bien au contraire, les ouvriers des transports veulent à leur tour partir en grève, mais les syndicats les en empêchent. Il adviendra la même chose plus tard, quand les mineurs appelleront à la solidarité des cheminots. Le bonze syndical de service proclamera : « A quoi bon l'aventure d'une grève générale, puisque nous avons à notre disposition un moyen plus simple, moins coûteux et certainement moins dangereux. Nous devons montrer à tous les travailleurs que le meilleur moyen est d'utiliser intelligemment le pouvoir que nous offre la Constitution la plus démocratique du monde, qui leur permet d'obtenir tout ce qu'ils désirent » ([7] [26]).
Comme les travailleurs peuvent le constater immédiatement, la « bourgeoisie la plus démocratique du monde » n'hésite pas à engager des tueurs, des briseurs de grève, des provocateurs, et la vague de licenciements qui s'ensuit touche un million d'ouvriers.
Malgré tout, les ouvriers continuent à faire confiance aux syndicats. Ils le paieront très cher: en avril 1921, les mineurs décident une grève générale, mais le syndicat fait machine arrière en laissant les ouvriers isolés et désorientés (le 15 avril reste le « Vendredi noir » dans la mémoire ouvrière), à la merci des attaques gouvernementales. Une fois qu'elle aura défait les principaux bastions ouvriers, cette bourgeoisie qui « permet aux ouvriers d'obtenir tout ce qu'ils désirent » réduira les salaires de plus de 7 millions d'ouvriers.
En France, l'aggravation des conditions de vie de la classe ouvrière (essentiellement la pénurie d'aliments et de combustible) provoquera une vague de luttes ouvrières au cours des premiers mois de 1920. Dès février, les cheminots constituent le centre du mouvement de grèves qui parvient à s'étendre et provoquer la solidarité d'autres secteurs malgré l'opposition des syndicats. Prenant le train en marche, si l'on peut dire, le syndicat CGT décide de prendre la tête de la lutte et décide alors d'une tactique de « vagues d'assaut », qui consiste à faire débrayer un jour les mineurs, le lendemain les métallos, etc. ; de cette façon, ils parviennent à empêcher le mouvement de s'unifier, l'éparpillent et le font péricliter. Le 22 mai, il ne reste plus que les cheminots en grève, c'est la défaite : 18 000 licenciements disciplinaires. Les syndicats sont bien sûr déconsidérés à l'issue de cette bataille (plus de 60 % de démissions) mais leur sabotage des luttes a porté ses fruits : le prolétariat français est défait et se trouve à la merci des expéditions punitives des « Ligues civiques».
En Italie, où s'étaient développées de formidables luttes ouvrières contre la guerre impérialiste tout au long de 1917-18, et d'autres encore contre l'expédition d'approvisionnement aux armées qui combattaient la révolution en Russie ([8] [27]), le prolétariat est cependant incapable de se lancer à l'assaut de l'Etat bourgeois. En réaction à la faillite de nombreuses entreprises, l'été 1920 voit une fièvre « d'occupations » embraser le pays, impulsées par les syndicats : elles dévient le prolétariat de la perspective d'affrontement contre l’Etat, tout en l'enchaînant au « contrôle de la production » dans chaque usine. Il suffit de rappeler que le propre gouvernement Giolitti prévient les chefs d'entreprise qu'il «n'utilisera pas l'armée pour déloger les ouvriers, car cela déplacerait la lutte de l'usine vers la rue » (cité par M. Ferrara, Conversations avec Togliatti). La combativité ouvrière s'effiloche dans ces occupations d'usines. La défaite de ce mouvement, quoiqu'il soit prolongé par de nouvelles mais isolées grèves en Lombardie, à Venise, etc., ouvrira les vannes de la contre-révolution qui, dans ce cas précis, a pris la forme du fascisme.
La classe ouvrière subit aussi d'importantes défaites aux Etats-Unis (grèves dans les mines de charbon, dans les mines de lignite d'Alabama, dans les chemins de fer) en 1920. La contre-offensive capitaliste impose les « conventions ouvertes » (impossibilité de conventions collectives) qui aboutissent à une baisse des salaires de l'ordre de 30 %.
Les derniers soubresauts de la vague révolutionnaire
Bien qu'elle continue à exploser dans d'héroïques combats, la vague révolutionnaire est entrée dans sa phase finale à partir de 1921. D'autant plus que le poids des défaites conduit les révolutionnaires de l'Internationale communiste à commettre des erreurs toujours plus graves (application de la politique de «front unique », soutien aux luttes de « libération nationale », expulsion de 1’IC des fractions révolutionnaires de la Gauche communiste...), qui provoquent encore plus de confusions et à leur tour, dans une spirale dramatique, provoquent de nouvelles défaites.
En Allemagne; la combativité ouvrière est toujours plus dévoyée vers « l’antifascisme » (par exemple lorsque l'extrême-droite assassine Ersberger, ou quand un belliciste exige que Kiel soit rasée de la carte en novembre 1918) ou vers le nationalisme. Quand la Ruhr est envahie par les armées belge et française en 1923, le KPD brandit le drapeau abject du « national-bolchèvisme » en appelant le prolétariat à défendre la « patrie allemande », soi-disant progressiste, contre l'impérialisme représenté par les puissances de l'Entente. En octobre de cette même année, le Parti communiste, qui siège au gouvernement en Saxe et Thuringe, prend la décision de provoquer des insurrections, dont la première a lieu le 20 octobre à Hambourg. Le KPD revient sur sa décision quand les ouvriers sont déjà dans la rue, et ces derniers doivent seuls faires face à une terrible répression. Exsangue, démoralisé, cruellement réprimé, le prolétariat allemand est défait. Quelques jours plus tard, Hitler lancera son fameux «putsch de la bière », tentative de coup d’Etat lancée depuis une brasserie de Munich, qui échouera (comme on sait, Hitler parviendra au pouvoir par la « voie parlementaire » dix ans plus tard).
Le prolétariat polonais, qui en 1920 avait fait front avec sa bourgeoisie contre l'invasion du pays par l'Armée rouge, retrouve son terrain de classe en 1923 avec une nouvelle vague de grèves. Mais l'isolement international permet à la bourgeoisie de garder le contrôle de la situation et de monter toute une série de provocations (l'incendie de la poudrerie de Varsovie, dont seront accusés les communistes) pour s'affronter aux travailleurs tant que ceux-ci sont encore dispersés. Une insurrection éclate le 6 novembre à Cracovie, mais les mensonges des « socialistes » parviennent à désorienter et démoraliser les travailleurs (notamment en parvenant à ce que ceux-ci leur rendent les amies). Malgré la vague de grèves de solidarité avec Cracovie (Dombrowa, Gornicza, Tarnow...), la bourgeoisie parvient en quelques jours à éteindre cette flambée ouvrière.
En 1926, le prolétariat polonais servira de chair à canon dans la rivalité entre fractions de la bourgeoisie qui opposa le gouvernement « philo-fasciste » et Pilsudski soutenu par la gauche en tant que « défenseur de la liberté ».
En Espagne, les vagues de luttes seront systématiquement freinées par le PSOE (Parti socialiste) et le syndicat UGT, ce qui permettra au général Primo de Rivera d'imposer sa dictature en 1923 ([9] [28]).
En Angleterre, après quelques mouvements divisés et très isolés (marche des chômeurs sur Londres en 1921 et 1923, grève générale dans le bâtiment en 1924), la bourgeoisie confirmera sa victoire en 1926. Face à une nouvelle vague de luttes des mineurs, les syndicats organisent une « grève générale » qu'ils annuleront 10 jours plus tard, abandonnant les mineurs qui reprendront le travail en décembre au prix de milliers de licenciements. La défaite de cette lutte consacrera la victoire de la contre-révolution en Europe.
Dans cette phase définitive de déclin de la vague révolutionnaire, les mouvements révolutionnaires du prolétariat dans les pays de la périphérie du capitalisme sont à leur tour défaits. En Afrique du Sud, c'est le cas avec la « Révolte rouge du Transvaal » contre le remplacement des travailleurs de race blanche par des travailleurs de race noire moins payés, en 1922, qui s'était étendue à d'autres secteurs d'industrie (mines de charbon, chemins de fer...), toutes races confondues, et qui avait pris parfois des tournures insurrectionnelles. En 1923, l'armée hollandaise et les tueurs à gage engagés par les planteurs locaux s'unissent pour venir à bout de la grève des chemins de fer à Java, qui s'était étendue à Surabaj et à Jemang (Indonésie).
En Chine, le prolétariat avait été conduit (par la néfaste thèse de 1’IC sur l'appui aux mouvements de « libération nationale ») à soutenir les actions de la bourgeoisie nationaliste organisée dans le Kuomintang, qui pourtant n'hésitait pas à réprimer sauvagement les travailleurs quand ceux-ci luttaient sur leur terrain de classe, comme à Canton en 1925, lors de la grève générale. En février et mars 1927, les ouvriers de Shanghaï préparent par des insurrections l'entrée dans la ville du général nationaliste Tchang Kaï-Chek. Ce leader « progressiste » (selon 1’IC) n'hésite pas non plus, sitôt la ville prise, à s'allier avec les commerçants, les paysans, les intellectuels et surtout le « lumpen » pour réprimer par le sang et le feu la grève générale décrétée par le Conseil ouvrier de Shanghaï pour protester contre l'interdiction du droit de grève décrétée par le « libérateur ». Et malgré les horreurs commises dans les quartiers ouvriers de Shanghaï pendant les deux mois de la répression, 1’IC appellera encore à soutenir « l'aile gauche » du Kuomintang, installée à Wuhan. Cette gauche nationaliste a fusillé sans sourciller les ouvriers qui, par leurs grèves, « irritaient les industriels étrangers (...), en gênant leurs intérêts commerciaux » (M. N. Roy, Révolution et contre-révolution en Chine). Quand le PC décide enfin l'insurrection, alors que le mouvement ouvrier est défait, il ne fait qu'augmenter les dégâts : lors de la Commune de Canton, en décembre 1927, 2 000 ouvriers périssent assassinés.
Cette lutte du prolétariat en Chine n'est que l'épilogue tragique de la vague révolutionnaire mondiale et, comme l'analysèrent les révolutionnaires de la Gauche communiste, elle marque une étape décisive dans le passage des partis « communistes » dans les rangs de la contre-révolution. Cette contre-révolution s'étend comme une immense et profonde nuit qui durera plus de 40 ans, pour s'achever avec le resurgissement des combats de la classe ouvrière à la fin des années 1960.
La guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la révolution
Pourquoi cette vague révolutionnaire a-t-elle échoué ? Il ne fait pas de doute que les incompréhensions du prolétariat et de ses minorités révolutionnaires quant aux conditions de la nouvelle période historique ont pesé lourdement ; mais il faut aussi comprendre que les conditions objectives créées par la guerre impérialiste ont empêché ces torrents de luttes de se rejoindre dans un combat unifié. Dans l'article « Les conditions historiques de la généralisation de la lutte de la classe ouvrière » (Revue Internationale n° 26), nous disions : « La guerre est un grave moment de la crise du capitalisme, mais nous ne pouvons pour autant nier que c'est également une réponse du capitalisme à sa propre crise, un moment avancé de sa barbarie et que, en tant que tel, il ne joue pas forcément en faveur des conditions de la généralisation de la révolution ».
On peut le vérifier à la lumière des faits de cette vague révolutionnaire.
La guerre suppose un bain de sang pour le prolétariat
Comme l'explique Rosa Luxemburg :
« Mais pour que le socialisme puisse faire sa trouée et remporter la victoire, il faut qu'existent des masses dont la puissance réside tant dans leur niveau culturel que dans leur nombre. Et ce sont ces masses précisément qui sont décimées dans cette guerre. La fleur de l'âge viril et de la jeunesse, des centaines de milliers de prolétaires dont l'éducation socialiste, en Angleterre et en France, en Belgique, en Allemagne et en Russie, était le produit d'un travail d'agitation et d'instruction d'une dizaine d'années, d'autres centaines de milliers qui demain pouvaient être acquis au socialisme - ils tombent et ils tuent misérablement sur les champs de bataille. Le fruit de dizaines d'années de sacrifices et d'efforts de plusieurs générations est anéanti en quelques semaines, les troupes d'élite du prolétariat international sont décimées » (Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie, Chap. VII).
Une très grande partie des 70 millions de soldats était constituée de prolétaires qui avaient dû laisser leur place dans les usines aux femmes, aux enfants, à la main d'œuvre immigrée des colonies n'ayant que très peu d'expérience des luttes. En outre, l'armée dilue ces prolétaires dans une masse inter-classiste avec les paysans, le lumpen... C'est ce qui fait que les actions de ces soldats (désertions, insubordinations...) ne se si tuent pas sur un terrain de lutte authentiquement prolétarien, même si, pour autant, la bourgeoisie n'en profite pas. Les désertions dans l'armée austro-hongroise, par exemple, sont en grande partie dues au refus des tchèques et des hongrois... de se battre pour l'Empereur de Vienne. Les mutineries dans l'armée française ne se dirigent pas contre la guerre elle-même, mais contre « une certaine façon de mener la guerre » (l'inefficacité de certaines manoeuvres, etc.). La radicalité et la conscience qui se développent chez certains soldats (fraternisations, refus de réprimer des luttes ouvrières...) sont surtout la conséquence de la mobilisation à l'arrière. Et quand la question se pose, après l'armistice, de détruire le capitalisme pour en finir une bonne fois avec les guerres, les soldats sont le secteur le plus hésitant et rétrograde. C'est d'ailleurs pour cela que la bourgeoisie allemande, par exemple, fait en sorte de surdimensionné le poids des Conseils de soldats face aux Conseils ouvriers.
Le prolétariat « ne contrôle pas » la guerre
La guerre mondiale exige une défaite préalable du prolétariat. Et même dans les pays où le poids de l'idéologie réformiste qui a présidé à cette défaite est le plus faible, les luttes cessent en 1914 : en Russie, par exemple, la vague croissante de luttes qui s'était développée en 1912-1913 s'interrompt brusquement.
Mais en outre, au cours même de la guerre, la lutte de classe est mise au second plan derrière le vacarme des opérations militaires. Quand bien même les défaites militaires accentuent le mécontentement (l'échec de l'offensive de l'armée russe en juin 17 provoque les Journées de juin), il n'en est pas moins vrai que les offensives du rival impérialiste et les succès militaires de son propre impérialisme poussent le prolétariat dans les bras des « intérêts de la Patrie ». C'est ainsi qu'en automne 1918 ont lieu les dernières offensives militaires allemandes, à un moment historique crucial pour la révolution mondiale (quelques mois à peine après le Révolution russe) :
- elles paralysent la vague de grèves qui se propageait depuis janvier en Allemagne et en Autriche, grâce aux « conquêtes » réalisées en Russie et en Ukraine, présentées comme étant « la paix du pain » par les propagandistes des armées ;
- elles poussent les soldats français, qui commençaient à fraterniser avec les ouvriers de la Loire, à resserrer les rangs derrière leur bourgeoisie ; ces mêmes soldats seront ceux qui réprimeront les grèves dès l'été.
Et surtout, lorsque la bourgeoisie voit menacée sa domination de classe par le prolétariat, elle peut priver la révolution montante de son principal stimulant. Si la bourgeoisie russe n'avait pas compris cela, tel n'est pas le cas de la bourgeoisie en Allemagne qui est beaucoup plus expérimentée (et avec elle l'ensemble de la bourgeoisie mondiale). Pour intenses que soient les antagonismes impérialistes entre les fractions capitalistes nationales, c'est la solidarité qui les unit dès qu'il s'agit de manifester une solidarité de classe pour s'affronter au prolétariat.
Le sentiment de soulagement que provoque l'Armistice parmi les ouvriers affaiblit leurs luttes (en Allemagne par exemple) mais renforce par contre le poids des mystifications bourgeoises. En présentant la guerre impérialiste comme une « anomalie » du fonctionnement du capitalisme (la Grande guerre devait être la « der des der »), la bourgeoisie tente de faire croire aux ouvriers que la révolution n'est pas nécessaire, que tout « redevient comme avant ». Cette sensation de « retour à la normale » renforce les moyens de la contre-révolution : les partis « socialistes » et leur fameuse « évolution progressive vers le socialisme » et les syndicats avec leurs armes habituelles (« contrôle ouvrier de la production », nationalisations...).
La guerre brise la généralisation des luttes
Enfin, la guerre brise la généralisation des luttes en divisant la riposte ouvrière entre pays vainqueurs et pays vaincus. Les gouvernements de ces derniers sont certainement affaiblis par la défaite militaire, mais l'effondrement d'un gouvernement ne signifie pas forcément un renforcement du prolétariat. Après la chute de l'Empire hongrois, par exemple, le «prolétariat des nations opprimées » est entraîné à la guerre pour « l'indépendance » de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Yougoslavie... ([10] [29]). Les ouvriers hongrois qui ont pris Budapest le 30 octobre, la grève générale en Slovaquie de 1918..., sont dévoyés de leur cours et entraînés sur le terrain pourri de la « libération nationale ». En Galicie (alors en Autriche), les mouvements qui s'étaient développés contre la guerre cèdent le pas aux manifestations « pour l'indépendance de la Pologne et la défaite de l'Allemagne ! ». Le prolétariat de Vienne se retrouve pratiquement isolé lors de sa tentative insurrectionnelle de novembre 1918.
Dans les pays vaincus, la révolte est plus immédiate mais aussi plus désespérée, et en conséquence dispersée et inorganisée. Parce qu'isolée de la lutte des ouvriers des pays vainqueurs, la rage des prolétaires dans les pays vaincus peut finalement être facilement déviée vers le « revanchardisme ». Tel sera le cas en Allemagne en 1923, après l'invasion de la Ruhr par les années franco-belges.
Par contre, dans les pays vainqueurs, la combativité ouvrière se voit étouffée par l'euphorie chauvine de la victoire ([11] [30]), ce qui fait que les luttes ne peuvent se développer que plus lentement, comme si les ouvriers attendaient les « dividendes de la victoire » ([12] [31]). Il faudra attendre que les mystifications s'évanouissent au feu des terribles conditions de vie de l'après-guerre (en particulier quand le capitalisme entrera en 1920 dans une phase de crise économique) pour que les ouvriers entrent massivement en lutte, en Angleterre, France, Italie... Mais alors le prolétariat des pays vaincus a déjà subi des défaites décisives, comme nous l'avons vu. La fragmentation des luttes ouvrières entre pays vainqueurs et pays vaincus permet en outre à la bourgeoisie de coordonner l'ensemble de ses forces, les engageant en renfort dans les pays où se mène ponctuellement le combat contre le prolétariat. Comme le dénonçait Karl Marx après l'écrasement de la Commune de Paris : « Le fait sans précédent qu'après la guerre la plus terrible des temps modernes, le vaincu et le vainqueur fraternisent pour massacrer en commun le prolétariat (...) La domination de classe ne peut plus se cacher sous un uniforme national, les gouvernements nationaux ne font qu'UN contre le prolétariat » (Marx, La Guerre civile en France, Chap. IV).
Les exemples ne manquent pas :
- Avant même la fin de la guerre, les pays de l'Entente ferment les yeux quand l'armée allemande écrase la révolution ouvrière de Finlande en mars 1918, et aussi quand elle écrase, en septembre 1918, la révolte dans l'armée hongroise à Vladai.
- Contre la révolution en Allemagne, c'est le président des USA Wilson lui-même qui impose au Kaiser l'entrée des « socialistes » au gouvernement, car c'est la seule force capable de s'affronter à la révolution. L'Entente fournit peu après 5 000 mitrailleuses au gouvernement allemand pour massacrer les révoltes ouvrières. Et en mars 1919, l'armée de Noske manoeuvrera avec le complet accord de Clemenceau à travers la zone « démilitarisée » de la Ruhr pour écraser l'un après l'autre tous les foyers de révolution.
- Sous les ordres du colonel anglais Cunningham, de sinistre mémoire, un centre coordinateur de la contre-révolution fonctionne dès la fin de 1918 à Vienne ; c'est lui qui coordonne l'action des armées tchèque et roumaine en Hongrie. Quand en juillet 1919 l'armée des Conseils en Hongrie tente une action militaire sur le front roumain, l'armée roumaine l'attend, prévenue de cette opération par les « socialistes » hongrois qui en avaient avisé le « centre anti-bolchevique » de Vienne.
- Le chantage de « l'aide humanitaire » de l'Entente s'ajoute à la collaboration militaire, pour forcer le prolétariat à accepter sans rechigner l'exploitation et la misère. Quand les Conseils hongrois appellent, en mars 1919, les ouvriers autrichiens à se joindre à la lutte, le « révolutionnaire » F. Adler leur répond : « Vous nous appelez à suivre votre exemple. Nous le ferions de tout coeur mais nous ne le pouvons malheureusement pas. Il n'y a plus trace de nourriture dans notre pays. Nous sommes totalement les esclaves de l'Entente ». (Arbeiter-Zeitung, 23 mars 1919).
En conclusion, nous pouvons donc affirmer que, contrairement à ce que pensaient nombre de révolutionnaires ([13] [32]), la guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à la généralisation de la révolution. Cela ne veut en rien dire que nous serions « pacifistes », comme le colportent les groupes révolutionnaires bordiguistes. Au contraire, nous défendons avec Lénine que « la lutte pour la paix sans action révolutionnaire n'est qu'une phrase creuse et mensongère ». C'est précisément notre rôle d'avant-garde de cette lutte révolutionnaire qui exige de nous que nous tirions les leçons des expériences ouvrières, et d'affirmer (Op. cit., Revue internationale n° 26.) que le mouvement de luttes contre la crise économique du capitalisme qui s'est développé à partir de la fin des années 1960, s'il peut paraître moins « radical », plus tortueux et contradictoire, établit une base matérielle autrement plus ferme pour la révolution mondiale du prolétariat :
- La crise économique frappe tous les pays sans exception. Indépendamment du niveau de dévastation que la crise peut provoquer dans les différents pays, il est absolument sûr qu'il n'y a ni « vainqueurs », ni « vaincus », pas plus qu'il n'y a de pays « neutre ».
- Contrairement aux conditions créées par la guerre impérialiste, qui font que la bourgeoisie peut décréter la paix pour contrer le danger d'une révolution ouvrière, la crise économique ne peut être interrompue, pas plus que ne peuvent être évitées les attaques toujours plus violentes contre les travailleurs.
- Il est très significatif que ces groupes qui nous taxent de « pacifistes » soient les mêmes qui tendent à sous-estimer les luttes ouvrières contre la crise.
Le rôle décisif des principales concentrations ouvrières
Quand le prolétariat prend le pouvoir en Russie, les mencheviks et, avec eux, l'ensemble des « socialistes » et centristes dénoncent « l'aventurisme » des bolcheviks : d'après eux, la Russie est un pays « sous-développé », pas encore mûr pour la révolution socialiste. C'est précisément la juste défense du caractère prolétarien de la Révolution d'Octobre qui conduit les bolcheviks à expliquer le « paradoxe » du surgissement de la révolution mondiale à partir de la lutte d'un prolétariat « sous-développé » comme le prolétariat russe ([14] [33]), au moyen de la thèse erronée selon laquelle la chaîne de l'impérialisme mondial se briserait d'abord en ses maillons les plus faibles ([15] [34]). Mais une analyse de la vague révolutionnaire permet de réfuter d'une manière marxiste aussi bien le mythe selon lequel le prolétariat des pays du tiers-monde ne serait pas prêt pour la révolution socialiste que son apparente « antithèse », selon laquelle il disposerait de plus grandes facilités.
1) Précisément, la Première Guerre mondiale marque le moment historique de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. Cela signifie que les conditions de la révolution prolétarienne (développement suffisant des forces productives, mais aussi de la classe révolutionnaire chargée d'enterrer la société moribonde) existent au niveau mondial.
Le fait que la vague révolutionnaire s'étende aux quatre coins de la planète et que, dans tous les pays, les luttes ouvrières affrontent l'action contre-révolutionnaire de toutes les fractions de la bourgeoisie, met clairement en évidence que le prolétariat (indépendamment du degré de développement qu'il ait pu atteindre dans chaque pays) n'a pas de tâches différentes en Europe et dans le « tiers-monde ». Il n'y a donc pas un prolétariat « prêt » pour le socialisme (dans les pays développés) et un prolétariat « immature pour la révolution » qui devrait encore traverser la «phase démocratico-bourgeoise ». Précisément, la vague révolutionnaire internationale que nous sommes en train d'analyser montre comment les ouvriers d'un pays en retard, comme la Norvège, découvrent que : « les revendications des travailleurs ne peuvent être satisfaites par des moyens parlementaires, mais par les actions révolutionnaires de tout le peuple travailleur » (Manifeste du conseil ouvrier de Cristiania, mars 1918). Cette vague révolutionnaire montre aussi comment les ouvriers des plantations indonésiennes, ou bien ceux des favelas de Rio, construisent des Conseils ouvriers ; comment les travailleurs berbères s'unissent aux immigrés européens contre la bourgeoisie « nationaliste » dans une grève générale dans les ports d'Algérie en 1923...
Proclamer aujourd'hui, comme le font certains groupes du milieu révolutionnaire, que le prolétariat de ces pays sous-développés, contrairement à celui des pays avancés, devrait construire des syndicats, ou soutenir la révolution « nationale des fractions progressistes » de la bourgeoisie, équivaut à jeter par dessus bord les leçons des défaites sanglantes subies par ces prolétaires de la main de l'alliance de toutes les fractions (« progressistes » et « réactionnaires ») de la bourgeoisie, ou de syndicats (y compris dans leurs variantes les plus radicales comme les syndicats anarchistes en Argentine) qui ont montré qu'ils étaient devenus des agents anti-ouvriers de l'Etat capitaliste, autant dans le centre comme à la périphérie du capitalisme.
2) Cependant, le fait que l'ensemble du capitalisme et du prolétariat mondial soient « mûrs » pour la révolution socialiste ne signifie pas que la révolution mondiale puisse commencer dans n'importe quel pays, ou que la lutte des travailleurs des pays plus retardés du capitalisme aient la même responsabilité, le même caractère déterminant, que les combats du prolétariat dans les pays plus avancés. Précisément, la vague révolutionnaire de 1917-23 démontre d'une manière frappante que la révolution ne pourra partir dans l'avenir que du prolétariat des concentrations plus développées, c'est-à-dire de ces bataillons de la classe ouvrière qui, de par leur poids sur la société, de par l'expérience historique accumulée au fil des années de combat contre l'Etat capitaliste et ses mystifications, jouent un rôle central et décisif dans la confrontation mondiale entre le prolétariat et la bourgeoisie.
Eclairés par la lutte du prolétariat de ces pays plus développés, les travailleurs forment des Conseils ouvriers jusqu'en Turquie (où en 1920 existera un groupe spartakiste), en Grèce, en Indonésie même, au Brésil... En Irlande (où d'après Lénine le prolétariat devait encore lutter pour la « libération nationale », ce qui était une analyse erronée), l'influx de la vague révolutionnaire ouvre une parenthèse lumineuse, quand les travailleurs, au lieu de lutter avec la bourgeoisie irlandaise pour son « indépendance » vis-à-vis de la Grande-Bretagne, luttent sur le terrain du prolétariat international. Durant l'été 1920 surgissent des Conseils ouvriers à Limerick, et des révoltes de journaliers éclatent à l'ouest du pays, en butte à la répression autant des troupes anglaises que de l'IRA (quand ces ouvriers occupent des propriétés appartenant à des irlandais).
Quand la bourgeoisie parvient à défaire les bataillons ouvriers décisifs en Allemagne, France, Angleterre, Italie..., la classe ouvrière mondiale se trouve gravement affaiblie, et les luttes ouvrières dans les pays de la périphérie capitaliste ne pourront pas renverser le cours de la défaite du prolétariat mondial. Les énormes preuves de courage et de combativité que donnent les ouvriers en Amérique, Asie..., privés de la contribution des bataillons centraux de la classe ouvrière, se perdront, comme nous l'avons vu, dans de gravissimes confusions (comme par exemple lors de l'insurrection en Chine) qui vont les conduire inévitablement à la défaite. Dans les pays où le prolétariat est plus faible, ses maigres forces et expériences sont cependant confrontées à l'action combinée des bourgeoisies qui ont plus d'expérience dans leur lutte de classe contre le prolétariat ([16] [35]), quand les bourgeoisies française, anglaise et américaine entreprennent d'une manière coordonnée une action contre-révolutionnaire. En Chine aussi, les « démocraties » occidentales apportent leur appui financier et militaire tout d'abord aux « seigneurs de la guerre », puis aux leaders du Kuomintang.).
De ce fait, le maillon crucial où se jouait le devenir de la vague révolutionnaire était l'Allemagne, dont le prolétariat représentait un authentique phare pour les travailleurs du monde entier. Mais en Allemagne, le prolétariat plus développé et aussi plus conscient affrontait, et c'est logique, la bourgeoisie qui avait accumulé une vaste expérience de confrontations avec le prolétariat. Il suffit de voir la « puissance » de l'appareil spécifiquement anti-ouvrier de l'Etat capitaliste allemand : un Parti socialiste et des syndicats qui se sont maintenus à tous moments organisés et coordonnés pour saboter et écraser la révolution.
Pour rendre possible l'unification mondiale du prolétariat, il faut dépasser les mystifications les plus subtiles de la classe ennemie, il faut affronter les appareils anti-ouvriers les plus sophistiqués... En fait, il faut défaire la fraction la plus forte de la bourgeoisie mondiale. Seuls les bataillons les plus développés et conscients de la classe ouvrière mondiale peuvent être à la hauteur de cette tâche.
La thèse selon laquelle la révolution devait surgir nécessairement de la guerre, ainsi que celle du « maillon le plus faible », furent des erreurs des révolutionnaires dans cette période-là, dans leur désir de défendre la révolution prolétarienne mondiale. Ces erreurs, cependant, furent transformées en dogmes par la contre-révolution triomphante après la défaite de la vague révolutionnaire, et aujourd'hui elles font malheureusement partie du « corps de doctrine » des groupes bordiguistes.
La défaite de la vague révolutionnaire du prolétariat de 1917-23 ne signifie pas que la révolution prolétarienne soit impossible. Au contraire, presque 80 ans plus tard, le capitalisme a prouvé, guerre après guerre, barbarie après barbarie, qu'il ne peut sortir du bourbier historique de sa décadence. Et le prolétariat mondial a dépassé la nuit de la contre-révolution, débutant malgré ses limitations un nouveau cours ouvert vers des affrontements de classe décisifs, vers une nouvelle tentative révolutionnaire. Dans ce nouvel assaut mondial contre le capitalisme, la classe ouvrière devra, pour pouvoir triompher, s'approprier les leçons de ce qui constitue sa principale expérience historique. Il est de la responsabilité de ses minorités révolutionnaires d'abandonner le dogmatisme et le sectarisme pour pouvoir discuter et clarifier le bilan indispensable de cette expérience.
Etsoem
[1] [36] Le retrait des troupes allemandes de leurs positions en France et en Belgique coûta 378 000 hommes à la Grande-Bretagne et 750 000 à la France.
[2] [37] La défaite idéologique du prolétariat en 1914 n'avait pas été une défaite physique, ce qui explique que réapparaissent immédiatement les grèves, les assemblées, la solidarité... Celle de 1939, par contre, est complète, joignant la défaite physique (l'écrasement de la vague révolutionnaire) à la défaite idéologique (l'antifascisme).
[3] [38] Cf. « De l’austromarxisme à l’austrofascisme », Revue Internationale, n° 10.
[4] [39] Cf. « Il y a 70 ans, la révolution en Allemagne », Revue Internationale, n° 55 et 56.
[5] [40] Hésitations qui malheureusement touchèrent aussi les révolutionnaires. Cf. noire brochure La Gauche hollandaise.
[6] [41] Cf. «r L'Isolement est la mort de la révolution », Revue Internationale, n° 75.
[7] [42] Cité par Edouard Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier.
[8] [43] Cf. « Révolution et contre-révolution en Italie », Revue Internationale, n° 2 et 3.
[9] [44] Cf. Bilan de 70 ans de "libération nationale', Revue Internationale, n° 66
[10] [45] Cf. « Bilan de 70 ans de "libération nationale" », Revue Internationale, n° 66
[11] [46] En France, ce n'est que dans la partie <r vaincue » (l'Alsace et la Lorraine) qu'éclatèrent des grèves importantes en novembre 1918 (dans les chemins de fer et les mines) et qu'il y eut des Conseils de soldats.
[12] [47] Le pays capitaliste le plus faible, celui qui perd la guerre, est précisément celui qui l'avait déclarée, ce qui permet à la bourgeoisie de renforcer le chauvinisme par des campagnes sur les « indemnités de guerre ».
[13] [48] Même les groupes révolutionnaires qui tirèrent le bilan le plus sérieux et lucide de cette vague révolutionnaire se trompèrent sur cette question ; ce qui fut le cas par exemple de la Gauche communiste de France qui attendait de la Seconde Guerre mondiale une nouvelle vague révolutionnaire.
[14] [49] Dans notre brochure Russie 1917, début de la révolution mondiale, nous montrons d'une part, que la Russie n'était pas un pays si en retard (5e puissance industrielle au niveau mondial), et que d'autre part, le fait qu'elle ait été en avant par rapport au reste du prolétariat ne peut être attribué à ce supposé « retard » du capitalisme russe, mais plutôt au fait que, la révolution surgissant de la guerre, la bourgeoisie mondiale n'a pas pu venir en aide à la bourgeoisie russe (de la même façon qu'elle put le faire en 1918-20 durant la «guerre civile »)t ceci ajouté à l'absence d'amortisseurs sociaux (syndicats, démocratie...) du tsarisme.
[15] [50] Nous avons exposé notre critique de cette « théorie du maillon le plus faible » dans « Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classes », et dans « A propos de la théorie du maillon le plus faible », Revue Internationale n° 31 et 37.
[16] [51] Comme on le vit dans la Révolution russe elle-même (Cf. Revue Internationale, n° 75).
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Internationalisme [53]
Heritage de la Gauche Communiste:
Guy Debord : La deuxième mort de l’« Internationale situationniste »
- 8598 lectures
Guy Debord s'est donné la mort le 30 novembre 1994. En France, où il vivait, toute la presse a parlé de ce suicide car Debord, bien qu'il ait toujours limité ses apparitions publiques, était un personnage connu. Sa célébrité, il ne la devait pas aux « oeuvres » qu'il avait produites dans ce qui constituait le « métier » que lui ont attribué les médias, cinéaste, et qui ont toujours eu une diffusion limitée, mais en tant qu'écrivain (La société du spectacle, 1967) et surtout comme fondateur et principal animateur de l'Internationale Situationniste. En tant qu'organisation révolutionnaire, c'est ce dernier aspect de la vie de Guy Debord qui nous intéresse dans la mesure où l'IS, si elle a disparu il y a plus de 20 ans, a eu, en son temps, une certaine influence sur des groupes et éléments qui s'orientaient vers des positions de classe.
Nous ne ferons pas ici une histoire de l’IS ni l'exégèse des 12 numéros de sa revue publiée entre 1958 et 1969. Nous nous contenterons de rappeler que l’IS est née non pas en tant que mouvement politique à proprement parler, mais en tant que mouvement culturel regroupant un certain nombre « d'artistes » (peintres, architectes, etc.) provenant de diverses tendances (Internationale Lettriste, Mouvement pour un Bauhaus Imaginiste, Comité psycho géographique de Londres, etc.) qui se proposaient de faire une critique « révolutionnaire » de l'art tel qu'il existe dans la société actuelle. C'est ainsi que dans le premier numéro de la revue de l'IS (juin 1958) on trouve reproduite une Adresse distribuée lors d'une assemblée générale des critiques d'art internationaux où l'on peut lire : «Dispersez-vous, morceaux de critiques d'art, critiques de fragments d'art. C'est maintenant dans l'Internationale situationniste que s'organise l'activité artistique unitaire de l'avenir. Vous n'avez plus rien à dire. L'Internationale situationniste ne vous laissera aucune place. Nous vous réduirons à la famine. »
Il faut remarquer que, même si l'IS se revendique d'une révolution radicale, elle estime qu'il est possible d'organiser au sein même de la société capitaliste « l'activité artistique de l'avenir ». Plus : cette activité est conçue comme une sorte de marchepied vers cette révolution puisque : « Des éléments d'une vie nouvelle doivent être déjà en formation parmi nous - dans le champ de la culture -, et c'est à nous de nous en servir pour passionner le débat. » ([1] [55]). L'auteur de ces dernières lignes était d'ailleurs un peintre danois relativement célèbre.
Le type de préoccupations qui animait les fondateurs de l’IS révélait qu'il ne pouvait s'agir d'une organisation exprimant un effort de la classe ouvrière vers sa prise de conscience, mais bien une manifestation de la petite bourgeoisie intellectuelle radicalisée. C'est pour cela d'ailleurs que les positions proprement politiques de 1’IS, si elles voulaient se réclamer du marxisme tout en rejetant le stalinisme et le trotskisme, étaient de la plus grande confusion. C'est ainsi qu'en annexe du n°1 de la publication paraît une prise de position à propos du coup d'Etat du 13 mai 1958 qui a vu l'armée française basée en Algérie se dresser contre le pouvoir du gouvernement de Paris : on y parle du « peuple français », des « organisations ouvrières » pour désigner les syndicats et les partis de gauche, etc. Deux ans plus tard, on trouve encore des accents tiers-mondistes dans le n°4 de la revue : « Nous saluons dans l'émancipation des peuples colonisés et sous-développés, réalisée par eux-mêmes, la possibilité de s'épargner les stades intermédiaires parcourus ailleurs, tant dans l'industrialisation que dans la culture et l'usage même d'une vie libérée de tout » ([2] [56]). Quelques mois plus tard, Debord est un des 121 signataires (principalement artistes et intellectuels) de la « Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie » où l'on peut lire : « La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres ». L’IS n° 5 revendique collectivement ce geste sans même la moindre critique aux concessions à l'idéologie démocratique et nationaliste que contient la «Déclaration ».
Notre but ici n'est pas d'accabler l'IS ni de tirer sur l'ambulance (ou plutôt sur le cercueil de l'IS). Mais il est important qu'il reste clair, notamment pour ceux qui ont pu être influencés par les positions de cette organisation, que la réputation de « radicalisme » dont elle était entourée, son intransigeance et son refus de toute compromission étaient très fortement exagérés. C'est avec les plus grandes peines que l'IS a commencé à se dégager des aberrations politiques de ses origines, et en particulier des concessions aux conceptions gauchistes ou anarchistes. Ce n'est que progressivement qu'elle va se rapprocher des positions communistes de gauche, en fait celles du conseillisme, en même temps que les pages de sa publication font une place croissante aux questions politiques au détriment des divagations « artistiques ». Debord qui pendant une période est en lien étroit avec le groupe qui publie Socialisme ou Barbarie (S. ou B.), est l'instigateur de cette évolution. C'est ainsi qu'en juillet 1960, il publie un document, « Préliminaires pour une définition de l’unité du programme révolutionnaire », en compagnie de P. Canjuers, membre de S. ou B. Cependant, S. ou B. qui pendant un temps inspire l'évolution de l’IS, est lui-même un courant politique des plus confus. Issu d'une scission tardive (1949) au sein de la « 4e internationale » trotskiste, ce courant ne sera jamais capable de rompre son cordon ombilical avec le trotskisme pour rejoindre les positions de la Gauche communiste. Après avoir engendré à son tour plusieurs scissions qui donneront le « Groupe de Liaison pour l'Action des travailleurs », la revue Information et Correspondance Ouvrières et le groupe « Pouvoir Ouvrier », S. ou B. va terminer sa trajectoire, sous la haute autorité de Cornélius Castoriadis (qui au début des années 1980 apportera sa caution aux campagnes reaganiennes sur la prétendue « supériorité militaire de l'URSS ») en cénacle d'intellectuels rejetant explicitement le marxisme.
La confusion extrême des positions politiques de l'IS, on la retrouve encore en 1966 quand elle essaie de prendre position sur le coup d'Etat militaire de Boumédienne en Algérie et qu'elle ne trouve rien d'autre à faire que de défendre de façon « radicale » l'autogestion (c'est-à-dire la vieille recette anarchiste d'origine proudhonienne qui conduit à faire participer les ouvriers à leur propre exploitation) :
« Le seul programme des éléments socialistes algériens est la défense du secteur autogéré, pas seulement comme il est, mais comme il doit devenir... De l'autogestion maintenue et radicalisée peut partir le seul assaut révolutionnaire contre le régime existant... L'autogestion doit devenir la solution unique aux mystères du pouvoir en Algérie, et doit savoir qu'elle est cette solution. » ([3] [57]). Et même en 1967, avec le n°11 de sa revue qui contient pourtant les positions politiques les plus claires, l'IS continue encore à cultiver l'ambiguïté sur un certain nombre de points, particulièrement sur les prétendues luttes de « libération nationale ». C'est ainsi qu'à côté d'une dénonciation vigoureuse du tiers-mondisme et des groupes gauchistes qui s'en font les promoteurs, l'IS finit par faire des concessions à ce même tiers-mondisme : « Il est évidemment impossible de chercher, aujourd'hui, une solution révolutionnaire à la guerre du Vietnam. Il s'agit avant tout de mettre fin à l'agression américaine, pour laisser se développer, d'une façon naturelle, la véritable lutte sociale du Vietnam, c'est-à-dire de permettre aux travailleurs vietnamiens de retrouver leurs ennemis de l'intérieur : la bureaucratie du Nord et toutes les couches possédantes et dirigeantes du Sud. » (...) « Seul un mouvement révolutionnaire arabe résolument internationaliste et anti-étatiste, peut à la fois dissoudre l'Etat d'Israël et avoir pour lui la masse de ses exploités. Seul, par le même processus, il pourra dissoudre tous les Etats arabes existants et créer l'unification arabe par le pouvoir des Conseils » ([4] [58]).
En fait, les ambiguïtés dont ne s'est jamais départie l'IS, notamment sur cette question, permettent en partie d'expliquer le succès qu'elle a connu à un moment où les illusions tiers-mondistes étaient particulièrement fortes au sein de la classe ouvrière et surtout dans le milieu étudiant et intellectuel. Il ne s'agit pas de dire que l’IS a recruté ses adeptes sur la base de ses concessions au tiers-mondisme mais de considérer que si l’IS avait été parfaitement claire sur la question des prétendues « luttes de libération nationale », il est probable que beaucoup de ses admirateurs de l'époque se seraient détournés d'elle. ([5] [59])
Une autre raison du « succès » de l’IS dans le milieu des intellectuels et des étudiants consiste évidemment dans le fait qu'elle a adressé en priorité sa critique aux aspects idéologiques et culturels du capitalisme. Pour elle, la société actuelle est celle du « spectacle », ce qui est un nouveau terme pour désigner le capitalisme d'Etat, c'est-à-dire un phénomène spécifique de la période de décadence du capitalisme déjà analysé par les révolutionnaires : l'omniprésence de l'Etat capitaliste dans toutes les sphères du corps social, y compris dans la sphère culturelle. De même, si l’IS est très claire pour affirmer que seul le prolétariat constitue une force révolutionnaire dans la société actuelle, elle donne une définition de cette classe qui permet à la petite bourgeoisie intellectuelle révoltée de se considérer comme en faisant partie et donc d'être une force « subversive » : « Suivant la réalité qui s'esquisse actuellement, on pourra considérer comme prolétaires les gens qui n'ont aucune possibilité de modifier l'espace-temps social que la société leur alloue à consommer... » ([6] [60]). Et la vision typiquement petite-bourgeoise de l’IS sur cette question est confirmée par son analyse, proche de celle de Bakounine, du « lumpenproletariat » qui serait appelé à constituer une force pour la révolution puisque « ... le prolétariat nouveau tend à se définir négativement comme un "Front contre le travail forcé" dans lequel se trouvent réunis tous ceux qui résistent à la récupération par le pouvoir » ([7] [61]).
Ce qui plaît particulièrement aux éléments révoltés de « l'intelligentsia », ce sont les méthodes qu'emploie l’IS pour sa propagande : le sabotage spectaculaire des manifestations culturelles et artistiques ou le détournement de bandes dessinées et de photos-romans (par exemple, on fait dire à une pin up nue le slogan célèbre du mouvement ouvrier : « L'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes »). De même, les slogans situationnistes ont un franc succès dans cette couche sociale : « Vivre sans temps mort et jouir sans entrave », « Demandons l'impossible », « Il faut prendre ses désirs pour la réalité ». L'idée d'une mise en application immédiate des thèses situationnistes sur la « critique de la vie quotidienne » ne fait en réalité qu'exprimer l'immédiatisme d'une couche sociale sans avenir, la petite bourgeoisie. Enfin, une brochure écrite par un situationniste, en 1967 : De la misère en milieu étudiant, où les étudiants sont présentés comme les êtres les plus méprisés au monde avec les curés et les militaires, contribue à la notoriété de l’IS dans une couche de la population dont le masochisme est à la mesure de l'absence de tout rôle sur la scène sociale et historique.
Les événements de mai 1968 en France, c'est-à-dire le pays où l'IS a le plus d'écho, constituent une sorte d'apogée du mouvement situationniste : les slogans « situs » sont sur tous les murs ; dans les médias, « situationniste » est synonyme de « révolutionnaire radical » ; le premier Comité d'Occupation de la Sorbonne est composé en bonne partie de membres ou de sympathisants de l'IS. A cela, il n'est rien de surprenant. En effet, ces événements marquent à la fois les derniers feux des révoltes étudiantes qui avaient débuté en 1964, en Californie, et inaugurent, de façon magistrale, la reprise historique du prolétariat après 4 décennies de contre-révolution. La simultanéité des deux phénomènes et le fait que la répression de l’Etat contre la révolte étudiante a constitué le déclic d'un mouvement de grève massif dont les conditions avaient mûri avec les premières atteintes de la crise économique, a permis aux situationnistes d'exprimer les aspects les plus radicaux de cette révolte tout en ayant un certain impact sur certains des secteurs de la classe ouvrière qui commençaient à rejeter les structures bourgeoises d'encadrement que sont les syndicats ainsi que les partis de gauche et gauchistes.
Cependant, la reprise des combats de classe, qui a provoqué l'apparition et la floraison de toute une série de groupes révolutionnaires, dont notre propre organisation, a signé l'arrêt de mort de 1’IS. Elle s'avère incapable de comprendre la signification véritable des combats de 1968. En particulier, persuadée que c'est contre le « spectacle » que les ouvriers s'étaient dressés et non contre les premières atteintes d'une crise ouverte et sans issue de l'économie capitaliste, elle écrit stupidement: «L'éruption révolutionnaire n'est pas venue d'une crise économique... ce qui a été attaqué de front en Mai, c'est l'économie capitaliste FONCTIONNANT BIEN» ([8] [62]) ([9] [63]). Partant d'une telle vision, il n'est pas surprenant qu'elle puisse considérer, de façon totalement mégalomane, que: «L'agitation déclenchée en janvier 68 à Nanterre par quatre ou cinq révolutionnaires qui allaient constituer le groupe des enragés [influencé par les idées situationnistes], devait entraîner, sous cinq mois, une quasi liquidation de l'Etat » ([10] [64]) A partir de là, l’IS va entrer dans une période de crise qui va aboutir à sa dissolution en 1972.
C'est « par défaut » que 1’IS avait pu avoir un impact, avant et au cours des événements de 1968, sur les éléments Rapprochant vers les positions de classe, du fait de la disparition ou de la sclérose des courants communistes du passé au cours de la période de contre-révolution. Dès lors que s'étaient constituées, sur la lancée de 1968, des organisations se rattachant à l'expérience de ces courants, et alors que la révolte étudiante était morte, il n'existait plus de place pour l’IS. Son auto-dissolution était la conclusion logique de cette faillite, de la trajectoire d'un mouvement qui, en refusant de se rattacher fermement aux fractions communistes du passé, ne pouvait avoir un avenir. Le suicide de Guy Debord ([11] [65]) appartient probablement à cette même logique.
Fabienne.
[1] [66] IS n° 1, p.23, « Les situationnistes et l'automation », par Asger Jorn.
[2] [67] « La chute de Paris », IS n°4, page 9.
[3] [68] IS n° 10, page 21, mars 66
[4] [69] IS n° 11, « Deux guerres locales », pp. 21 -22
[5] [70] La meilleure preuve du manque de rigueur (pour ne pas dire plus) de l'IS sur cette question nous a été donnée par le fait que celui à qui elle avait confié le soin d'exposer ses thèses sur ce sujet (voir « Contributions servant à rectifier l'opinion du public sur la révolution dans les pays sous-développés », IS n° 11, pp. 38-40), Mustapha Khayati, s'est engagé peu après dans les rangs du Front Populaire Démocratique de Libération Palestinien sans que cela provoque son exclusion immédiate de l'IS, puisque c'est lui-même qui en a démissionné. A sa conférence de Venise, en septembre 1969, l'IS s'est contentée d'accepter cette démission avec l'argument qu'elle n'acceptait pas la « double appartenance ». En somme, que Khayati devienne membre d'un groupe conseilliste comme ICO ou bien qu'il s'enrôle dans une année bourgeoise (pourquoi pas dans la police, c'est la même chose), cela ne fait pas de différence pour l'IS.
[6] [71] IS n° 8, « Domination de la nature, idéologie et classes »
[7] [72] « Banalités de base », IS n° 8, page 42
[8] [73] Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations, René Viennet, p. 209.
[9] [74] Dans une polémique contre notre publication en France, l'IS écrit : « Quant aux débris du vieil ultra-gauchisme non trotskyste, il leur fallait au moins une crise économique majeure. Ils subordonnaient tout mouvement révolutionnaire à son retour, et ne voyaient rien venir. Maintenant qu'ils ont reconnu une crise révolutionnaire en mai, il leur faut prouver qu'il y avait donc là, au printemps 68, cette crise économique "invisible". Ils s'y emploient sans crainte du ridicule, en produisant des schémas sur la montée du chômage et des prix. Ainsi, pour eux, la crise économique n'est plus cette réalité objective, terriblement voyante, qui fut tant vécue et décrite jusqu'en 1929, mais une sorte de présence eucharistique qui soutient leur religion. » (IS n° 12, p. 6) Si cette crise était « invisible » pour l'IS, elle ne l'était pas pour notre courant puisque notre publication au Venezuela (la seule qui existait à l'époque), Internacionalismo, y avait consacré un article en janvier 1968, et l'histoire s'est chargée de donner raison au CCI sur la réalité de la crise du système capitaliste.
[10] [75] Ibidem, page 25
[11] [76] Si toutefois il s'est suicidé... Une autre hypothèse est toujours envisageable : son ami Gérard Lebovici a été assassiné en 1984.
Géographique:
- France [77]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [78]
Courants politiques:
Construction de l'organisation révolutionnaire : les 20 ans du Courant Communiste International.
- 10556 lectures
Il y a 20 ans, en janvier 1975, était constitué le Courant Communiste International. C'est une durée importante pour une organisation internationale du prolétariat si l'on pense que l'AIT n'avait vécu que 12 ans (1864-1876), l'Internationale Socialiste 25 ans (1889-1914) et l'Internationale Communiste 9 ans (1919-1928). Evidemment, nous ne prétendons pas que notre organisation ait joué un rôle comparable à celui des internationales ouvrières. Cependant, l'expérience des vingt années d'existence du CCI appartient pleinement au prolétariat dont notre organisation est une émanation au même titre que les internationales du passé et que les autres organisations qui défendent aujourd'hui les principes communistes. En ce sens, il est de notre devoir, et cet anniversaire nous en donne l'occasion, de livrer à notre classe quelques uns des enseignements que nous tirons de ces deux décennies de combat.
Lorsqu'on compare le CCI aux organisations qui ont marqué l'histoire du mouvement ouvrier, notamment les internationales, on peut être saisi d'un certain vertige : alors que des millions ou des dizaines de millions d'ouvriers appartenaient, ou étaient influencés par ces organisations, le CCI n'est connu de par le monde que par une infime minorité de la classe ouvrière. Cette situation, qui est aujourd'hui d'ailleurs le lot de toutes les autres organisations révolutionnaires, si elle doit nous inciter à la modestie, n'est pas pour nous, cependant, un motif de sous-estimation du travail que nous accomplissons, encore moins de découragement. L'expérience historique du prolétariat, depuis que cette classe est apparue comme un acteur de la scène sociale, il y a un siècle et demi, nous a montré que les périodes où les positions révolutionnaires ont exercé une réelle influence sur les masses ouvrières sont relativement réduites. C'est d'ailleurs en s'appuyant sur cette réalité que les idéologues de la bourgeoisie ont prétendu que la révolution prolétarienne est une pure utopie puisque la majorité des ouvriers ne croit pas qu'elle soit nécessaire ou possible. Mais ce phénomène, qui était déjà sensible lorsqu'il existait des partis ouvriers de masse, comme à la fin du siècle dernier et au début du 20e siècle, s'est encore amplifié après la défaite de la vague révolutionnaire qui a surgi au cours et à la suite de la première guerre mondiale.
Après que la classe ouvrière ait fait trembler la bourgeoisie mondiale, celle-ci a pris sa revanche en lui faisant subir la plus longue et profonde contre-révolution de son histoire. Et ce sont justement les organisations que la classe s'était données pour son combat, les syndicats ainsi que les partis socialistes et les partis communistes, qui ont constitué, en passant dans le camp bourgeois, le fer de lance de cette contre-révolution. Les partis socialistes, dans leur grande majorité, s'étaient déjà mis au service de la bourgeoisie lors de la guerre elle-même, appelant les ouvriers à « l’Union nationale », participant même, dans certains pays, aux gouvernements qui déchaînaient la boucherie impérialiste. Puis, quand la vague révolutionnaire s'est déployée, avec et à la suite de la révolution d'octobre 1917 en Russie, ces mêmes partis se sont faits les exécuteurs des hautes oeuvres de la bourgeoisie, soit en sabotant délibérément le mouvement, comme en Italie en 1920, soit en jouant directement le rôle de « chien sanglant », en prenant la direction du massacre des ouvriers et des révolutionnaires, comme en Allemagne en 1919. Par la suite, les partis communistes, constitués autour des fractions des PS qui avaient refusé de marcher dans la guerre impérialiste et qui avaient pris la tête de la vague révolutionnaire en se ralliant à l'Internationale Communiste (fondée en mars 1919), ont suivi le chemin de leurs prédécesseurs socialistes. Entraînés par la défaite de la révolution mondiale et par la dégénérescence de la révolution en Russie, ils ont rejoint au cours des années 1930 le camp capitaliste pour se faire, au nom de l'antifascisme et de la «défense de la Patrie socialiste », les meilleurs sergents recruteurs pour la seconde guerre mondiale. Principaux artisans des mouvements de « résistance » contre les armées occupantes d'Allemagne et du Japon, ils ont poursuivi leur sale besogne en encadrant férocement les prolétaires dans la reconstruction des économies capitalistes détruites.
Tout au cours de cette période, l'influence massive que pouvaient avoir les partis socialistes ou « communistes » sur la classe ouvrière était à la mesure de la chape idéologique qui étouffait la conscience des prolétaires saoulés de chauvinisme et qui, soit s'étaient détournés de toute perspective de renversement du capitalisme, soit étaient conduits à confondre cette perspective avec le renforcement de la démocratie bourgeoise, soit subissaient le mensonge suivant lequel les Etats capitalistes du bloc de l'Est étaient des incarnations du « socialisme ». Alors qu'il était « minuit dans le siècle », les forces réellement communistes qui avaient été chassées de l'Internationale communiste dégénérescente se sont retrouvées dans un isolement extrême, quand elles n'étaient pas, purement et simplement, exterminées par les agents staliniens ou fascistes de la contre-révolution. Dans les pires conditions de l'histoire du mouvement ouvrier, les quelques poignées de militants qui ont réussi à échapper au naufrage de l'IC ont poursuivi un travail de défense des principes communistes afin de préparer le futur resurgissement historique du prolétariat. Beaucoup y ont laissé leur vie ou s'y sont épuisés à tel point que leurs organisations, les fractions et groupes de la Gauche communiste, ont disparu ou bien ont été frappées de sclérose.
La terrible contre-révolution qui a écrasé la classe ouvrière après ses combats glorieux du premier après-guerre s'est prolongée pendant près de 40 ans. Mais lorsque les derniers feux de la reconstruction du second après-guerre se sont éteints et que le capitalisme a de nouveau été confronté à la crise ouverte de son économie, à la fin des années 1960, le prolétariat a redressé la tête. Mai 1968 en France, le « Mai rampant » de 1969 en Italie, les combats ouvriers de l'hiver 1970 en Pologne et toute une série de luttes ouvrières en Europe et sur d'autres continents : c'en était fini de la contre-révolution. Et la meilleure preuve de ce changement fondamental du cours historique a été le surgissement et le développement en de nombreux endroits du monde de groupes se rattachant, souvent de façon confuse, à la tradition et aux positions de la Gauche communiste. Le CCI s'est constitué en 1975 comme regroupement d'un certain nombre de ces formations que la reprise historique du prolétariat avait fait surgir. Le fait que, depuis cette date, le CCI non seulement se soit maintenu, mais qu'il se soit étendu, en doublant le nombre de ses sections territoriales, constitue la meilleure preuve de cette reprise historique du prolétariat, le meilleur indice que celui-ci n'ait pas été battu et que le cours historique reste toujours aux affrontements de classe. C'est là la première leçon qu'il s'agit de tirer de ces 20 ans d'existence du CCI ; en particulier contre l'idée partagée par beaucoup d'autres groupes de la Gauche communiste qui considèrent que le prolétariat n'est pas encore sorti de la contre-révolution.
Dans la Revue Internationale n° 40, à l'occasion du 10e anniversaire du CCI, nous avions déjà tiré un certain nombre d'enseignements de notre expérience au cours de cette première période. Nous ne les rappellerons que brièvement ici afin de souligner plus particulièrement ceux que nous tirons de la période qui a suivi. Cependant, avant de dresser un tel bilan, il faut revenir rapidement sur l'histoire du CCI. Et pour les lecteurs qui n'ont pu prendre connaissance de l'article d'il y a dix ans, nous en reproduisons ici de larges extraits qui traitent justement de cette histoire.
Revue Internationale n° 80
La constitution d'un pôle de regroupement international
La « préhistoire » du CCI
« La première expression organisée de notre courant a surgi au Venezuela en 1964. Elle consistait en un petit noyau d'éléments très jeunes qui ont commencé à évoluer vers les positions de classe à travers des discussions avec un camarade plus âgé [il s'agit du camarade Marc dont nous reparlerons plus loin] ayant derrière lui toute une expérience militante au sein de l'Internationale Communiste, dans les fractions de gauche qui en avaient été exclues à la fin des années 1920, et notamment dans la "Fraction de gauche du Parti Communiste d'Italie", et qui avait fait partie de la "Gauche Communiste de France" jusqu'à sa dissolution en 1952. D'emblée donc, ce petit groupe du Venezuela - qui, entre 1964 et 1968, a publié une dizaine de numéros de la revue Internacionalismo- s'est situé en continuité politique avec les positions qui avaient été celles de la Gauche communiste et notamment de la GCF. Cela s'est particulièrement exprimé par un rejet très net de toute politique de soutien aux prétendues "luttes de libération nationale" dont le mythe, dans ce pays d'Amérique latine, pesait très lourdement sur les éléments qui essayaient de s'approcher vers les positions de classe. Cela s'est exprimé également par une attitude d'ouverture et de contact vers les autres groupes communistes, attitude qui avait déjà caractérisé la Gauche Communiste Internationale avant la seconde guerre mondiale et la GCF après celle-ci. C'est ainsi que le groupe Internacionalismo a établi ou tenté d'établir des contacts et des discussions avec le groupe américain News and Letters... et, en Europe, avec toute une série de groupes se situant sur des positions de classe (...) Avec le départ de plusieurs de ses éléments vers la France en 1967 et 1968, ce groupe a interrompu pendant plusieurs années sa publication avant de reprendre Internacionalismo Nouvelle Série (en 1974) et d'être une partie constitutive du CCI en 1975.
La deuxième expression organisée de notre courant est apparue en France sur la lancée de la grève générale de mai 1968 qui marque le resurgissement historique du prolétariat mondial après plus de 40 ans de contre-révolution. Un petit noyau se forme à Toulouse autour d'un militant d’Internacionalismo, noyau qui participe activement dans les discussions animées du printemps 1968, adopte une déclaration de principes en juin et publie le premier numéro de la revue Révolution Internationale à la fin de la même année. Immédiatement, ce groupe reprend la politique d'Internacionalismo de recherche des contacts et discussions avec les autres groupes du milieu prolétarien tant au niveau national qu'international (...) A partir de 1970, il établira des liens plus étroits avec deux groupes qui surnagent au milieu de la décomposition générale du courant conseil liste qui a suivi mai 1968 : l’ "Organisation Conseil liste de Clermont-Ferrand" et les Cahiers du Communisme de Conseil (Marseille) après une tentative de discussion avec le "Groupe de Liaison pour l'Action des Travailleurs" (GLAT) qui avait fait apparaître que ce groupe s'éloignait de plus en plus du marxisme. La discussion avec les deux groupes précédents s'avérera par contre beaucoup plus fructueuse et, après toute une série de rencontres où ont été examinées de façon systématique les positions de base de la gauche communiste, aboutira à une unification en 1972 de RI de l' "Organisation Communiste de Clermont" et des Cahiers du Communisme de Conseil autour d'une plate-forme qui reprend de façon plus précise et détaillée la déclaration de principes de RI de 1968. Ce nouveau groupe va publier la revue Révolution Internationale (Nouvelle Série) ainsi qu'un Bulletin d'Etude et de Discussion et va constituer l'animateur du travail de contacts et discussions internationales en Europe, jusqu'à la fondation du CCI deux ans et demi plus tard.
Sur le continent américain, les discussions engagées par Internacionalismo avec News and Letters ont laissé des traces aux USA et, en 1970, se constitue à New York un groupe (dont font partie d'anciens militants de News and Letters...,) autour d'un texte d'orientation reprenant les mêmes positions fondamentales que Internacionalismo et RL Ce groupe commence la publication de la revue Internationalism et s'engage dans la même orientation que ses prédécesseurs d'établissement de discussions avec les autres groupes communistes. C'est ainsi qu'il maintient des contacts et discussions avec Root and Branch de Boston (qui est inspiré par les positions conseillistes de Paul Mattick) mais qui se révèlent infructueux, ce groupe évoluant de plus en plus vers un cénacle de marxologie. C'est ainsi surtout qu'en 1972, Internationalism envoie à une vingtaine de groupes une proposition de correspondance internationale dans les termes suivants :
(...) "Avec le réveil de la classe ouvrière, il y a eu un développement considérable de groupes révolutionnaires qui se revendiquent d'une perspective communiste internationaliste. Cependant, les contacts et la correspondance entre groupes ont été malheureusement négligés et laissés au hasard. C'est pourquoi Internationalism propose, en vue d'une régularisation et d'un élargissement de ces contacts, une correspondance suivie entre groupes se réclamant de cette perspective..."
Dans sa réponse positive RI précise : "Comme vous, nous sentons la nécessité de ce que les activités et la vie de nos groupes aient un caractère aussi international que les luttes actuelles de la classe ouvrière. C'est pour cette raison que nous avons entrepris des contacts épistolaires ou directs avec un certain nombre de groupes européens auxquels a été envoyée votre proposition (...) Nous pensons que votre initiative permettra d'élargir le champ de ces contacts et, tout au moins, de mieux connaître et faire connaître nos positions respectives. Nous pensons également que la perspective d'une éventuelle conférence internationale est la suite logique de cette correspondance (...)"
Par sa réponse RI soulignait donc la nécessité de s'acheminer vers la tenue de conférences internationales de groupes de la gauche communiste. Cette proposition se trouvait en continuité des propositions répétées (en 1968, 69 et 71) qui avaient été faites au "Partito Comunista Internazionalista" (Battaglia) d'appeler à de telles conférences dans la mesure où cette organisation était à l'époque en Europe la plus importante et sérieuse dans le camp de la Gauche Communiste (à côté du PC/-Programma qui, lui, se confortait dans son "splendide isolement". Mais ces propositions, en dépit de l'attitude ouverte et fraternelle de Battaglia, avaient été à chaque fois repoussées...
En fin de compte, l'initiative l’Internationalism et la proposition de RI devaient aboutir à la tenue, en 1973 et en 1974, d'une série de conférences et rencontres en Angleterre et en France au cours desquelles s'étaient opérées une clarification et une décantation qui se sont traduites notamment par une évolution vers les positions de Rl-Internationalism, du groupe anglais World Révolution (issu d'une scission de Solidarity London qui allait publier le premier numéro de sa revue en mai 1974. Cette clarification et cette décantation avaient également et surtout créé les bases qui allaient permettre la constitution du CCI en janvier 1975. Pendant cette même période, en effet, RI avait poursuivi son travail de contacts et discussions au niveau international, non seulement avec des groupes organisés mais également avec des éléments isolés, lecteurs de sa presse et sympathisant avec ses positions. Ce travail avait conduit à la constitution de petits noyaux en Espagne et en Italie autour de ces mêmes positions et qui, en 1974, ont commencé la publication de Action Proletaria et Rivoluzione Internazionale.
Ainsi, à la conférence de janvier 1975, étaient présents Internacionalismo, Révolution Internationale, Internationalism, World Révolution, Accion Proletaria et Rivoluzione Internazionale partageant les orientations politiques développées à partir de 1964 par Internacionalismo. Etaient également présents Revolutionary Perpectives (qui avait participé aux conférences de 1973-74), le "Revolutionary Workers Group" de Chicago (avec qui RI et Internationalism avaient engagé des discussions en 1974) et "Pour une Intervention Communiste" (qui publiait la revue Jeune Taupe et était constitué de camarades ayant quitté RI en 1973...). Quant au groupe Workers Voice qui avait participé activement aux conférences des années précédentes, il avait rejeté l'invitation à cette conférence car il estimait désormais que RI, WR, etc. étaient des groupes bourgeois (sic) à cause de la position de la majorité de leurs militants (...) sur la question de l'Etat dans la période de transition du capitalisme au communisme. Cette question figurait d'ailleurs à l'ordre du jour de la conférence de janvier 1975... Cependant, elle n'y fut pas discutée, la conférence préférant consacrer un maximum de temps et d'attention à des questions beaucoup plus cruciales à ce moment là :
- l'analyse de la situation internationale ;
- les tâches des révolutionnaires dans celle-ci ;
- l'organisation dans le courant international.
Finalement, les six groupes dont les plates-formes étaient basées sur les mêmes orientations décidaient de s'unifier en une organisation unique dotée d'un organe central international et publiant une revue trimestrielle en trois langues anglais, français et espagnol (...) qui prenait la relève du Bulletin d'Etude et de Discussion de RI. Le CCI était fondé. Comme l'écrivait la présentation du n° 1 de la Revue Internationale "Un grand pas vient d'être fait". En effet, la fondation du CCI constituait l'aboutissement d'un travail considérable de contacts, de discussions, de confrontations entre les différents groupes que la reprise historique des combats de classe avait fait surgir... Mais surtout, elle jetait les bases pour un travail bien plus considérable encore. »
Les dix premières années : la consolidation du pôle international
« Ce travail, les lecteurs de la Revue Internationale (ainsi que de notre presse territoriale) ont pu le constater depuis 10 ans et vient confirmer ce que nous écrivions dans la présentation du numéro 1 de la Revue : "D'aucuns pensent que c'est là [la constitution du CCI et la publication de la Revue] une action précipitée. Rien de tel. On nous connaît assez pour savoir que nous n'avons rien de ces braillards activistes dont l'activité ne repose que sur un volontarisme aussi effréné qu'éphémère." ([1] [80]) (...) Tout au long de ses dix années d'existence, le CCI a évidemment rencontré de nombreuses difficultés, a dû surmonter de nombreuses faiblesses, dont la plupart étaient liées à la rupture d'une continuité organique avec les organisations communistes du passé, à la disparition ou à la sclérose des fractions de gauche qui s'étaient détachées de l'Internationale Communiste lors de sa dégénérescence. Il a également dû combattre l'influence délétère de la décomposition et de la révolte des couches de la petite bourgeoisie intellectuelle, influence particulièrement sensible après 1968, à la suite des mouvements estudiantins. Ces difficultés et faiblesses se sont par exemple traduites par plusieurs scissions (dont nous avons rendu compte dans notre presse) et par des soubresauts importants en 1981, en même temps que l'ensemble du milieu révolutionnaire et qui ont notamment abouti à la perte de la moitié de notre section en Grande-Bretagne. Face à ses difficultés de 1981, le CCI a même été conduit à organiser une conférence extraordinaire en janvier 1982 en vue de réaffirmer et de préciser ses bases programmatiques, en particulier sur la fonction et la structure de l'organisation révolutionnaire. De même, certains des objectifs que s'était fixés le CCI n'ont pu être atteints. C'est ainsi que la diffusion de notre presse est restée en deçà de nos espérances. (...)
Cependant, s'il nous faut faire un bilan global de ces 10 années, il faut affirmer qu'il est nettement positif. Il est particulièrement positif si on le compare à celui des autres organisations communistes qui existaient au lendemain de 1968. Ainsi, les groupes du courant conseilliste, même ceux qui avaient fait un effort pour s'ouvrir au travail international, comme ICO, ont soit disparu, soit sombré dans la léthargie : le GLAT, ICO, l'Internationale Situationniste, le Spartacusbond, Root and Branch, le PIC, les groupes conseillistes du milieu Scandinave, la liste est longue (et non exhaustive) ... Quant aux organisations se rattachant à la gauche italienne et qui, toutes, s'auto-proclamaient LE PARTI, soit elles ne sont pas sorties de leur provincialisme, soit elles se sont disloquées ou ont dégénéré en groupes gauchistes, tel Programme Communiste ([2] [81]), soit elles en sont aujourd'hui encore à imiter ce que le CCI a réalisé il y a dix ans, et ceci de façon poussive et dans la confusion comme c'est le cas de Battaglia Comunista et de la CWO (avec le BIPR). Aujourd'hui, après l'effondrement comme un château de cartes du (prétendu) Parti Communiste International, après les échecs du FOR... aux USA (Focus), le CCI reste la seule organisation communiste vraiment implantée au niveau international.
Depuis sa fondation en 1975, le CCI non seulement a renforcé ses sections territoriales d'origine, mais il s'est implanté dans d'autres pays. La poursuite du travail de contacts et de discussions à l'échelle internationale, l'effort de regroupement des révolutionnaires ont permis l'établissement de nouvelles sections du CCI : -1975, constitution de la section en Belgique qui publie en deux langues la revue, puis le journal Internationalisme et qui comble le vide laissé par la disparition, au lendemain de la seconde guerre, de la Fraction Belge de la Gauche Communiste Internationale.
-1977, constitution du noyau aux Pays-Bas qui entreprend la publication de la revue Wereld Revolutie ; c'est un événement de premier plan dans ce pays qui fut la terre d'élection du conseillisme.
-1978, constitution de la section en Allemagne qui commence la publication de la Revue Internationale en langue allemande et l'année suivante de la revue territoriale Weltrevolution ; la présence d'une organisation communiste en Allemagne est évidemment de la plus haute importance compte tenu de la place prise par le prolétariat de ce pays dans le passé et qu'il prendra dans l'avenir.
- 1980, constitution de la section en Suède qui publie la revue Internationell Révolution (...).
Si nous soulignons le contraste entre la relative réussite de l'activité de notre courant et l'échec des autres organisations c'est parce que cela met en évidence la validité des orientations qui furent les nôtres depuis 20 ans (1964) dans le travail de regroupement des révolutionnaires, de construction d'une organisation communiste, orientations qu'il est de notre responsabilité de dégager pour l'ensemble du milieu communiste (...) »
Les principales leçons des dix premières années
« Les bases sur lesquelles s'est appuyé, dès avant sa constitution formelle, notre courant dans son travail de regroupement ne sont pas nouvelles. Elles ont toujours, par le passé, constitué les piliers de ce type de travail. On peut les résumer ainsi :
- la nécessité de rattacher l'activité révolutionnaire aux acquis passés de la classe, à l'expérience des organisations communistes qui ont précédé, de concevoir l'organisation présente comme un maillon de toute une chaîne d'organismes passés et futurs de la classe ;
- la nécessité de concevoir les positions et analyses communistes, non comme un dogme mort, mais comme un programme vivant, en constant enrichissement et approfondissement ;
- la nécessité d'être armés d'une conception claire et solide sur l'organisation révolutionnaire, sur sa structure et sa fonction au sein de la classe. »
Ces enseignements que nous tirions il y a déjà dix ans (et qui étaient plus développés dans la Revue Internationale n° 40 à laquelle nous recommandons à nos lecteurs de se reporter) restent évidemment toujours valables et notre organisation a veillé en permanence à les mettre en pratique. Cependant, alors que sa tâche centrale au cours de sa première décennie d'existence était de construire un pôle de regroupement international des forces révolutionnaires, sa responsabilité essentielle, dans la période qui a suivi, a consisté à faire face à toute une série d'épreuves (à « l'épreuve du feu », en quelque sorte) découlant en particulier des bouleversements qui allaient se produire sur la scène internationale.
L'épreuve du feu
Ainsi, lors du 6e congrès du CCI, qui s'est tenu en novembre 1985, quelques mois après les dix ans du CCI, nous disions : « A la veille des années 1980, le CCI a désigné celles-ci comme les "années de vérité", celles où les enjeux majeurs de toute la société allaient clairement se révéler dans leur formidable ampleur. A la moitié de cette décennie, l'évolution de la situation internationale a pleinement confirmé cette analyse :
-par une nouvelle aggravation des convulsions de l'économie mondiale qui se manifeste dès le début des années 1980 par la récession la plus importante depuis celle des années 1930; - par une intensification des tensions entre blocs impérialistes qui se révèle notamment durant ces mêmes années, tant par un bond considérable des dépenses militaires que par le développement d'assourdissantes campagnes bellicistes dont s'est fait le chantre Reagan, chef de fie du bloc le plus puissant; - par la reprise, dans la seconde moitié de 1983, des combats de classe après leur repli momentané de 1981 à 1983 à la veille et à la suite de la répression des ouvriers de Pologne, reprise qui se caractérise, en particulier, par une simultanéité des combats sans exemple par le passé, notamment dans les centres vitaux du capitalisme et de la classe ouvrière en Europe occidentale" (Résolution sur la situation internationale, Revue internationale n° 44, page 9).
Ce cadre s'est révélé valable jusqu'à la fin des années 1980, même si, évidemment, la bourgeoisie s'est fait, pendant un temps, un devoir de présenter la « reprise » de 1983 à 1990, basée sur un formidable endettement de la première puissance mondiale, comme une « sortie définitive » de la crise. Les faits sont têtus, comme disait Lénine, et depuis le début des aimées 1990, les tricheries capitalistes ont débouché sur une récession ouverte encore plus longue et brutale que les précédentes et qui est venue transformer l'euphorie du bourgeois moyen en une profonde morosité.
De même, la vague des luttes ouvrières ouverte en 1983 s'est poursuivie, avec des moments de répit et des moments de plus grande intensité jusqu'en 1989, obligeant notamment la bourgeoisie à mettre en avant des formes variées du syndicalisme de base (telles les coordinations) afin de suppléer au discrédit croissant des structures syndicales officielles.
Cependant, il est un des aspects de ce cadre qui a été radicalement remis en cause en 1989 : celui des conflits impérialistes, non pas que la théorie marxiste ait été brusquement mise en défaut par leur « dépassement », mais parce qu'un des deux principaux protagonistes de ces conflits, le bloc de l'Est, s'est brutalement effondré. Ce que nous avions appelé les « années de vérité » ont été fatales à un régime aberrant établi sur les ruines de la révolution de 1917 et au bloc sur lequel il imposait son emprise. Un événement historique d'une telle ampleur, qui a bouleversé la carte du monde, a créé une situation nouvelle, inédite dans l'histoire, dans le domaine des conflits impérialistes. Ceux-ci n'ont pas disparu, mais ils ont pris des formes inconnues jusqu'à présent que les révolutionnaires avaient le devoir de comprendre et d'analyser.
En même temps, ces bouleversements qui affectaient les pays qui se présentaient comme « socialistes » ont porté un coup très dur à la conscience et à la combativité de la classe ouvrière internationale laquelle a dû faire face au recul le plus important depuis sa reprise historique de la fin des années 1960.
Ainsi, la situation internationale depuis dix ans a imposé au CCI de faire face aux défis suivants :
- être partie prenante des combats de classe qui se sont déroulés entre 1983 et 1989 ;
-comprendre la nature des événements de 1989 et les conséquences qu'ils allaient avoir, tant dans le domaine des conflits impérialistes que dans celui de la lutte de classe ;
-plus généralement, élaborer un cadre de compréhension de la période de la vie du capitalisme dont l'effondrement du bloc de l'Est a constitué la première grande manifestation.
Etre partie prenante des combats de classe
A la suite du 6e congrès de la section en France (la plus importante du CCI) tenu en 1984, le 6e congrès du CCI a inscrit cette préoccupation au centre de son ordre du jour. Cependant, l'effort que faisait notre organisation internationale depuis plusieurs mois pour se porter à la hauteur de ses responsabilités face à la classe s'était heurté, dès le début de 1984, à la survivance, en notre sein, de conceptions qui sous-estimaient la fonction de l'organisation des révolutionnaires comme facteur actif du combat prolétarien. Le CCI a identifié ces conceptions comme participant de glissements centristes vers le conseillisme résultant, pour une bonne partie, des conditions historiques qui avaient présidé à sa constitution alors qu'il existait, parmi les groupes et éléments qui avaient participé à celle-ci une forte méfiance envers tout ce qui pouvait ressembler au stalinisme. Dans la lignée du conseillisme, ces éléments avaient tendance à mettre sur un même plan le stalinisme, les conceptions de Lénine en matière d'organisation et l'idée même du parti prolétarien. Dans les années 1970, le CCI avait fait la critique des conceptions conseillistes, mais de façon encore insuffisante, si bien qu'elles continuaient de peser sur certaines parties de l'organisation. Lorsque le combat contre les vestiges de conseillisme a débuté, à la fin de 1983, un certain nombre de camarades ont refusé de voir la réalité de leurs faiblesses conseillistes s'imaginant que le CCI était en train de mener une « chasse aux sorcières ». Pour esquiver le problème qui était posé, celui de leur centrisme envers le conseillisme, ils ont fait la « découverte » que le centrisme ne pouvait plus exister dans la période de décadence du capitalisme ([3] [82]). A ces incompréhensions politiques, il s'ajoutait de la part de ces camarades, dont la plupart étaient des intellectuels peu préparés à subir la critique, un sentiment d'orgueil blessé ainsi que de « solidarité » envers leurs amis qu'ils estimaient injustement « attaqués ». C'était une sorte de « remake » du 2e congrès du POSDR, comme nous le faisions apparaître dans la Revue Internationale n° 45, où le centrisme en matière d'organisation et le poids de l'esprit de cercle, dans lequel les liens affinitaires priment sur les liens politiques, avaient conduit à la scission des mencheviks. La « tendance » qui s'est formée au début de 1985 allait suivre le même chemin pour scissionner lors du 6e Congrès du CCI et constituer une nouvelle organisation, la « Fraction Externe du CCI » (FECCI). Cependant, il existe une différence majeure entre la fraction des mencheviks et la FECCI puisque si la première allait prospérer en rassemblant les courants les plus opportunistes de la social-démocratie Russe pour finir dans le camp de la bourgeoisie, la FECCI, pour sa part, s'est contentée de jouer un rôle de parasite, consacrant l'essentiel de ses énergies à discréditer les positions et les organisations communistes sans être capable de regrouper autour d'elle. Pour finir, la FECCI a rejeté la plate-forme du CCI alors qu'elle expliquait, au moment de sa constitution, qu'elle se donnait comme tâche principale de défendre cette plateforme que le CCI, « dégénérescent » à ses dires, était en train de trahir.
En même temps que le CCI menait le combat en son sein contre les vestiges de conseillisme, il participait activement aux combats de la classe ouvrière comme notre presse territoriale en a rendu compte régulièrement au cours de cette période. Malgré ses faibles forces, notre organisation était présente dans les différentes luttes. Non seulement elle y a diffusé sa presse et des tracts, mais elle a participé directement, chaque fois que c'était possible, aux assemblées ouvrières pour y défendre la nécessité de l'extension des luttes et de leur prise en main par les ouvriers en dehors des différentes formes de syndicalisme, syndicalisme « officiel » ou syndicalisme « de base ». Ainsi, en Italie, lors de la grève de l'école de 1987, l'intervention de nos camarades avait eu un impact non négligeable dans les COBAS (Comités de Base) où ils étaient présents, avant que ces organismes, avec le reflux du mouvement, ne soient récupérés par le syndicalisme de base.
Au cours de cette période, un des meilleurs indices du début d'impact que nos positions commençaient à rencontrer parmi les ouvriers consistait dans le fait que le CCI était devenu une sorte de « bête noire » pour certains groupes gauchistes. Ce fut particulièrement le cas en France où, lors de la grève des chemins de fer de la fin 1986 et lors de la grève des hôpitaux de l'automne 1988, le groupe trotskiste « Lutte Ouvrière » avait mobilisé ses « gros bras » pour empêcher nos militants d'intervenir lors des assemblées convoquées par les « coordinations ». En même temps, les militants du CCI ont participé activement -et souvent ils en étaient les animateurs - à plusieurs comités de lutte rassemblant les travailleurs qui ressentaient la nécessité de se regrouper en dehors des syndicats pour pousser en avant le combat.
Il ne s'agit évidemment pas de « gonfler » l'impact que les révolutionnaires, et notre organisation en particulier, ont pu avoir sur les luttes ouvrières entre 1983 et 1989. Globalement, le mouvement est resté prisonnier du syndicalisme, ses variantes « de base » venant prendre le relais des syndicats officiels là où ils étaient trop discrédités. Notre impact est resté très ponctuel et était de toutes façons limité par le fait que nos forces sont encore très réduites. Mais s'il est une leçon que nous devons tirer de cette expérience, c'est que, au moment où se développent les luttes, les révolutionnaires rencontrent un écho là où ils sont présents car les positions qu'ils défendent et les perspectives qu'ils mettent en avant apportent une réponse aux questions que se posent les ouvriers. Et pour cela, ils n'ont nullement besoin de « cacher leur drapeau », de faire la moindre concession aux illusions qui peuvent encore peser sur la conscience des ouvriers, en particulier concernant le syndicalisme. C'est un enseignement qui vaut pour tous les groupes révolutionnaires qui, souvent, restent paralysés face aux luttes parce que celles-ci ne se posent pas encore la question du renversement du capitalisme, ou bien qui se croient obligés, pour « se faire entendre », de travailler dans les structures du syndicalisme de base, apportant par ce fait leur caution à ces organismes capitalistes.
Comprendre la nature des événements de 1989
Autant il est de la responsabilité des révolutionnaires d'être présents « sur le terrain » au moment des luttes ouvrières, autant il leur revient d'être capables, à chaque instant, de donner à l'ensemble de la classe ouvrière un cadre d'analyse clair des événements qui se déroulent dans le monde.
Cette tâche concerne au premier chef la compréhension des contradictions économiques qui affectent le système capitaliste : les groupes révolutionnaires qui n'ont pas été capables de mettre en évidence le caractère insoluble de la crise dans laquelle est plongé ce système, montrant par là qu'ils n'avaient pas compris le marxisme dont pourtant ils se revendiquent, n'ont été d'aucune utilité pour la classe ouvrière. Ce fut le cas, par exemple, d'un groupe comme le « Ferment Ouvrier Révolutionnaire » qui s'est même refusé à reconnaître qu'il y avait une crise. Les yeux braqués sur les caractéristiques spécifiques de la crise de 1929, il a nié l'évidence pendant des années... jusqu'à en disparaître.
Il appartient aussi aux révolutionnaires d'être en mesure d'évaluer les différents pas qu'accomplit le mouvement de la classe, de reconnaître ses moments d'avancée comme aussi ses moments de recul. C'est un tâche qui conditionne étroitement le type d'intervention qu'ils mènent parmi les ouvriers puisque leur responsabilité, lorsque le mouvement va de l'avant, est de pousser celui-ci le plus loin possible et, en particulier, d'appeler à son extension, alors qu'aux moments de repli, appeler à la lutte revient à pousser les ouvriers à se battre dans l'isolement et appeler à l'extension contribue à l'extension... de la défaite. C'est d'ailleurs souvent à ce moment-là que les syndicats appellent, pour leur part, à l'extension.
Enfin, le suivi et la compréhension des différents conflits impérialistes constituent aussi une responsabilité de premier ordre des communistes. Une erreur dans ce domaine peut avoir des conséquences dramatiques. Ainsi, à la fin des années 1930, la majorité de la Fraction communiste italienne, avec à sa tête son principal animateur, Vercesi, considère que les différentes guerres de l'époque, notamment la guerre d'Espagne, n'augurent en aucune façon un conflit généralisé. L'éclatement de la guerre mondiale, en septembre 1939, laissera la Fraction complètement désemparée et il faudra deux années pour qu'elle puisse se reconstituer, dans le sud de la France, et reprendre un travail militant.
Pour ce qui concerne la période actuelle, il était de la plus grande importance de comprendre clairement la nature des événements qui se sont déroulés au cours de l'été et de l'automne 1989 dans les pays du bloc de l'Est. Pour sa part, dès l'arrivée de Solidarnosc au gouvernement en Pologne, en plein coeur de l'été, dans une période où habituellement « l'actualité est en vacances », le CCI se mobilise pour comprendre cet événement ([4] [83]). Il adopte la position que ce qui se passe en Pologne signe l'entrée de l'ensemble des régimes staliniens d'Europe dans une crise sans commune mesure avec les précédentes : « La perspective pour l'ensemble des régimes staliniens n'est... nullement celle d'une "démocratisation pacifique" ni d'un "redressement" de l'économie. Avec l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme, ces pays sont entrés dans une période de convulsions d'une ampleur inconnue dans leur passé pourtant déjà "riche" de soubresauts violents. » (Revue Internationale n° 59, « Convulsions capitalistes et luttes ouvrières»). Cette idée est développée dans des « Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est» rédigées dès le 15 septembre (près de 2 mois avant la chute du mur de Berlin) et adoptées début octobre par le CCI. Dans ces thèses ont peut lire (voir la Revue Internationale n° 60) :
« ... dans la mesure même où le facteur pratiquement unique de cohésion du bloc russe est la force armée, toute politique tendant à faire passer au second plan ce facteur porte avec elle l'éclatement du bloc. Dès à présent, le bloc de l'Est nous présente le tableau d'une dislocation croissante... Dans cette zone, les forces centrifuges sont tellement fortes qu'elles se déchaînent dès qu'on leur en laisse l'occasion. (...)
C'est un phénomène similaire qu'on retrouve dans les républiques périphériques de l'URSS... Les mouvements nationalistes qui, à la faveur du relâchement du contrôle central du parti russe, s'y développent aujourd'hui... portent avec eux une dynamique de séparation d'avec la Russie. » (Point 18) « ... quelle que soit l'évolution future de la situation dans les pays de l'Est, les événements qui les agitent actuellement signent la crise historique, l'effondrement définitif du stalinisme... Dans ces pays s'est ouverte une période d'instabilité, de secousses, de convulsions, de chaos sans précédent dont les implications dépasseront très largement leurs frontières. En particulier, l'effondrement qui va encore s'accentuer du bloc russe ouvre les portes à une déstabilisation du système de relations internationales, des constellations impérialistes qui étaient sorties de la seconde guerre mondiale avec les accords de Yalta. » (point 20)
Quelques mois plus tard (janvier 1990), cette dernière idée est précisée dans les termes suivants :
« La configuration géopolitique sur laquelle a vécu le monde depuis la seconde guerre mondiale est désormais complètement remise en cause par les événements qui se sont déroulés au cours de la seconde moitié de l'année 1989. Il n'existe plus aujourd'hui deux blocs impérialistes se partageant la mainmise sur la planète. Le bloc de l'Est, c'est une évidence (...) a cessé d'exister. (...) Cette disparition du bloc de l'Est signifie-t-elle que, désormais, le monde sera dominé par un seul bloc impérialiste ou que le capitalisme ne connaîtra plus d'affrontements impérialistes ? De telles hypothèses seraient tout à fait étrangères au marxisme. (...) Aujourd'hui, l'effondrement de ce bloc ne saurait remettre en selle ce genre d'analyses : cet effondrement porte avec lui, à terme, celui du bloc occidental. (...) La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux "partenaires" d'hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l'heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial... En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible...
La disparition des deux constellations impérialistes qui étaient sorties de la seconde guerre mondiale porte, avec elle, la tendance à la recomposition de deux nouveaux blocs. Cependant, une telle situation n'est pas encore à l'ordre du jour... » (Revue Internationale n°61, «Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos »)
Les événements qui se sont déroulés par la suite, en particulier la crise et la guerre du Golfe en 1990-91 ([5] [84]), sont venus confirmer notre analyse. Aujourd'hui, l'ensemble de la situation mondiale, notamment ce qui se passe dans l'ex-Yougoslavie, fait la preuve plus qu'évidente de la disparition complète de tout bloc impérialiste en même temps que certains pays d'Europe, notamment la France et l'Allemagne, essayent péniblement d'impulser la reconstitution d'un nouveau bloc, basé sur l'Union Européenne, qui pourrait tenir tête à la puissance américaine.
Pour ce qui concerne l'évolution de la lutte de classe, les « thèses » de l'été 1989 se prononçaient également dessus : « Même dans sa mort, le stalinisme rend un dernier service à la domination capitaliste : en se décomposant, son cadavre continue encore à polluer l'atmosphère que respire le prolétariat... C'est donc à un recul momentané de la conscience du prolétariat... qu'il faut s'attendre... En particulier, l'idéologie réformiste pèsera très fortement sur les luttes de la période qui vient, favorisant grandement l'action des syndicats... Compte tenu de l'importance historique des faits qui le déterminent, le recul actuel du prolétariat, bien qu'il ne remette pas en cause le cours historique, la perspective générale aux affrontements de classe, se présente comme bien plus profond que celui qui avait accompagné la défaite de 1981 en Pologne » (point 22)
Là aussi, les cinq dernières années ont amplement confirmé cette prévision. Depuis 1989, nous avons assisté au recul le plus important de la classe ouvrière depuis son surgissement historique, à la fin des années 1960. C'est une situation à laquelle les révolutionnaires devaient être préparés afin de pouvoir y adapter leur intervention et, surtout, ne pas «jeter l'enfant avec Veau du bain » en considérant que ce long recul remettait en cause de façon définitive la capacité du prolétariat à mener et développer ses combats contre le capitalisme. En particulier, les manifestations de regain de la combativité ouvrière, notamment à l'automne 1992 en Italie et à l'automne 1993 en Allemagne (voir la Revue Internationale n° 72 et n° 75) ne devaient être ni surestimées (compte tenu de la profondeur du recul prolétarien) ni sous-estimées en ce qu'elles constituent les signes avant-coureurs d'une reprise inévitable des combats et du développement de la conscience de la classe dans tous les pays industrialisés.
Le marxisme est une méthode scientifique. Cependant, à l'opposé des sciences de la nature, il ne peut vérifier la validité de ses thèses en les soumettant à l'expérience de laboratoire ou en faisant appel à des moyens d'observation plus puissants. Son « laboratoire », c'est la réalité sociale, et il démontre sa validité en étant capable de prévoir l'évolution de celle-ci. Ainsi, le fait que le CCI ait été capable de prévoir, dès les premiers symptômes de l'effondrement du bloc de l'Est, les principaux événements qui allaient bouleverser le monde depuis 5 ans n'est pas à considérer comme une aptitude particulière à lire dans le marc de café où à interpréter la configuration des astres. C'est tout simplement la preuve de son attachement à la méthode marxiste, et c'est donc à celle-ci qu'il faut attribuer le succès de nos prévisions.
Cela dit, il ne suffit pas de se réclamer du marxisme pour être capable de l'utiliser efficacement. En fait, notre capacité à comprendre rapidement les enjeux de la situation mondiale découlait de la mise en application de la même méthode que nous avions reprise de Bilan et dont soulignions il y a déjà dix ans qu'elle était un des enseignements principaux de notre propre expérience : la nécessité de se rattacher fermement aux acquis du passé, la nécessité de concevoir les positions et analyses communistes, non comme un dogme mort mais comme un programme vivant.
Ainsi, les thèses de 1989 commencent par rappeler, dans les dix premiers points, quel est le cadre que s'était donné notre organisation au début des années 1980, à la suite des événements de Pologne, pour la compréhension des caractéristiques des pays et du bloc de l'Est. C'est à partir de cette analyse que nous avons été en mesure de mettre en évidence que c'en était fini des régimes staliniens d'Europe et du bloc de l'Est. Et c'est en nous appuyant sur un acquis encore plus ancien du mouvement ouvrier (notamment mis en évidence par Lénine contre Kautsky) : il ne peut exister un seul bloc impérialiste, que nous avons annoncé que l'effondrement du bloc de l'Est ouvrait la porte à la disparition du bloc occidental.
De même, il nous fallait, pour comprendre ce qui était en train de se passer, remettre en cause le schéma qui avait été valable pendant plus de quarante ans : le partage du monde entre le bloc occidental dirigé par les Etats-Unis et le bloc de l'Est dirigé par 1’URSS. Il nous fallait également être en mesure de considérer que ce dernier pays, progressivement constitué depuis Pierre le Grand, ne survivrait pas à l'effondrement de son empire. Encore une fois, nous n'avons aucun mérite particulier d'avoir fait preuve de la capacité à remettre en cause les schémas du passé. Cette démarche, nous ne l'avons pas inventée. Elle nous a été enseignée par l'expérience vivante du mouvement ouvrier et particulièrement par ses principaux combattants : Marx, Engels, Rosa Luxemburg, Lénine...
Enfin, la compréhension des bouleversements de la fin des années 1980 devait être replacée dans une analyse générale de l'étape actuelle de la décadence du capitalisme.
Le cadre de compréhension de la période présente du capitalisme
C'est ce travail que nous avions commencé à faire depuis 1986 en indiquant que nous étions entrés dans une phase nouvelle de la décadence capitaliste, celle de la décomposition de ce système. Cette analyse a été précisée au début de 1989 dans les termes suivants :
« Jusqu'à présent, les combats de classe qui, depuis vingt ans, se sont développés sur tous les continents, ont été capables d'empêcher le capitalisme décadent d'apporter sa propre réponse à l'impasse de son économie : le déchaînement de la folie ultime de sa barbarie, une nouvelle guerre mondiale. Pour autant, la classe ouvrière n'est pas encore en mesure d'affirmer, par des luttes révolutionnaires, sa propre perspective ni même de présenter, au reste de la société ce futur qu'elle porte en elle. C'est justement cette situation d'impasse momentanée, où, à l'heure actuelle, ni l'alternative bourgeoise, ni l'alternative prolétarienne ne peuvent s'affirmer ouvertement, qui est à l'origine de ce phénomène de pourrissement sur pied de la société capitaliste, qui explique le degré particulier et extrême atteint aujourd'hui par la barbarie propre à la décadence de ce système. Et ce pourrissement est amené à s'amplifier encore avec l'aggravation inexorable de la crise économique. » (Revue Internationale n° 57, « La décomposition du capitalisme »)
Evidemment, dès que s'est annoncé l'effondrement du bloc de l'Est, nous avons replacé un tel événement dans ce cadre de la décomposition :
«En réalité, l'effondrement actuel du bloc de l'Est constitue une des manifestations de la décomposition générale de la société capitaliste dont l'origine se trouve... dans l'incapacité pour la bourgeoisie d'apporter sa propre réponse, la guerre généralisée, à la crise ouverte de l'économie mondiale. » (Revue Internationale n° 60, « Thèses... », point 20)
De même, en janvier 1990, nous avons dégagé les implications pour le prolétariat de la phase de décomposition et de la nouvelle configuration de l'arène impérialiste : « Dans un tel contexte de perte de contrôle de la situation par la bourgeoisie mondiale, il n'est pas dit que les secteurs dominants de celle-ci soient aujourd'hui en mesure de mettre en oeuvre l'organisation et la discipline nécessaires à la reconstitution de blocs militaires. (...) C'est pour cela qu'il est fondamental de mettre en évidence que, si la solution du prolétariat - la révolution communiste - est la seule qui puisse s'opposer à la destruction de l'humanité (qui constitue la seule "réponse" que la bourgeoisie puisse apporter à sa crise), cette destruction ne résulterait pas nécessairement d'une troisième guerre mondiale. Elle pourrait également résulter de la poursuite, jusqu 'à ses conséquences extrêmes (catastrophes écologiques, épidémies, famines, guerres locales déchaînées, etc.) de cette décomposition. (...) la poursuite et l'aggravation du phénomène de pourrissement de la société capitaliste exercera, encore plus qu'au cours des années 1980, ses effets nocifs sur la conscience de la classe. Par l'ambiance générale de désespoir qui pèse sur toute la société, par la décomposition même de l'idéologie bourgeoise dont les émanations putrides viennent empoisonner l'atmosphère que respire le prolétariat, ce phénomène va constituer pour lui, jusqu'à la période prérévolutionnaire, une difficulté supplémentaire sur le chemin de sa prise de conscience. » (Revue Internationale n°61, « Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos »)
Ainsi, notre analyse sur la décomposition nous permet de mettre en évidence l'extrême gravité des enjeux de la situation historique présente. En particulier, elle nous conduit à souligner que le chemin du prolétariat vers la révolution communiste sera beaucoup plus difficile que les révolutionnaires n'avaient pu le prévoir dans le passé. C'est là aussi un autre enseignement qu'il s'agit de tirer de l'expérience du CCI au cours des dix dernières années et qui rejoint une préoccupation mise en avant par Marx au milieu du siècle dernier : les révolutionnaires n'ont pas pour rôle de consoler la classe ouvrière mais au contraire de souligner aussi bien l'absolue nécessité de son combat historique que la difficulté de celui-ci. Ce n'est qu'en ayant une claire conscience de cette difficulté que le prolétariat (et avec lui les révolutionnaires eux-mêmes) sera en mesure de ne pas se démoraliser face aux embûches qu'il affrontera, qu'il trouvera la force et la lucidité pour les surmonter pour parvenir au renversement de la société d'exploitation ([6] [85]).
Dans le bilan des dix dernières années du CCI, nous ne pouvons passer sous silence deux faits très importants touchant à notre vie organisationnelle.
Le premier fait est très positif. C'est l'extension de la présence territoriale du CCI avec la constitution en 1989 d'un noyau en Inde qui publie, en langue hindi, Communist Internationalist et d'une nouvelle section au Mexique, pays de la plus haute importance sur le continent américain, et qui publie Révolution Mundial.
Le deuxième fait est beaucoup plus désolant : c'est la disparition de notre camarade Marc, le 20 décembre 1990. Nous ne reviendrons pas ici sur le rôle de premier plan qu'il a joué dans la constitution du CCI et, avant cela, dans le combat des fractions communistes aux moments les plus noirs de la contre-révolution. La Revue Internationale (n° 65 et 66) y a consacré un long article. Disons simplement que, à côté de « l'épreuve du feu » qu'ont représenté pour le CCI, comme pour l'ensemble du milieu révolutionnaire, les convulsions du capitalisme mondial depuis 1989, la perte de notre camarade était aussi pour nous une autre « épreuve du feu ». Beaucoup de groupes de la gauche communiste n'ont pas survécu à la disparition de leur principal animateur. Cela a été le cas du FOR, par exemple. Et d'ailleurs, certains « amis » nous ont prédit avec « sollicitude » que le CCI ne survivrait pas à Marc. Pourtant, le CCI est encore là, et il a réussi à tenir le cap depuis 4 ans malgré les tempêtes qu'il a rencontrées.
Là dessus non plus nous ne nous accordons aucun mérite particulier : l'organisation révolutionnaire n'existe pas grâce à tel ou tel de ses militants, aussi valeureux soit-il. Elle est un produit historique du prolétariat et si elle ne survit pas à l'un de ses militants, c'est qu'elle n'a pas correctement assumé la responsabilité que la classe lui a confiée et que ce militant lui-même a failli d'une certaine façon. Si le CCI a réussi à franchir avec succès les épreuves qu'il a rencontrées, c'est avant tout parce qu'il a eu le souci permanent de se rattacher à l'expérience des organisations communistes qui l'ont précédé, de concevoir son rôle comme un combat à long terme et non en vue de « succès » immédiats. Depuis le siècle dernier, cette démarche a été celle des militants révolutionnaires les plus lucides et solides : nous nous en revendiquons et c'est notre camarade Marc qui, en grande partie, nous a appris à le faire. Il nous a aussi appris, par son exemple, ce que veut dire le dévouement militant sans lequel une organisation révolutionnaire ne peut survivre, aussi claire qu'elle puisse être :
« Sa grande fierté, ce n'est pas dans sa contribution exceptionnelle qu'il l'a placée mais dans le fait que, jusqu'au bout, il est resté fidèle, de tout son être, au combat du prolétariat. Et cela aussi était un enseignement précieux pour les nouvelles générations de militants qui n'ont pas eu l'occasion de connaître l'énorme dévouement à la cause révolutionnaire qui était celui des générations du passé. C'est en premier lieu sur ce plan que nous voulons être à la hauteur du combat que, désormais sans sa présence vigilante et lucide, chaleureuse et passionnée, nous sommes déterminés à poursuivre. » (« Marc », Revue Internationale n°66).
Vingt après la constitution du CCI, nous poursuivons le combat.
FM
[1] [86] Le fait que nous en soyons aujourd'hui au n° 80 de la Revue Internationale démontre donc que sa régularité a été maintenue sans défaillance.
[2] [87] Au début des années 1980, le PCl-Programma avait changé le titre de sa publication en Combat qui dériva assez rapidement vers le gauchisme. Depuis, quelques éléments de ce groupe ont repris la publication de Programma Comunista qui défend les positions bordiguistes classiques.
[3] [88] Voir à ce sujet les articles que nous avons publiés dans les n° 41 à 45 de notre Revue Internationale.
[4] [89] Il faut noter que pratiquement tous les groupes du milieu prolétarien sont passes à côté de la compréhension des événements de 1989 comme nous le mettons en évidence dans nos articles « Le vent d'Est et la réponse des révolutionnaires» et « Face aux bouleversements à l'Est, une avant-garde en retard» dans la Revue Internationale n°61 et 62. La palme revient sans contestation possible à la FECCI (qui avait quitté le CCI en prétextant que celui-ci dégénérait et était incapable de faire un travail théorique) : il lui a fallu DEUX ANS pour se rendre compte que le bloc de l'Est avait disparu (voir notre article « A quoi sert la FECCI ? » dans la Revue internationale n° 70).
[5] [90] Nous avons rendu compte de ces événements dans la Revue Internationale n° 64 et 65. En particulier, nous écrivions, avant même la « tempête du désert » : « Dans la nouvelle période historique où nous sommes entrés, et les événements du Golfe viennent de le confirmer, le monde se présente comme une immense foire d'empoigne, où jouera à fond la tendance au "chacun pour soi", où les alliances entre Etats n'auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictés par les nécessités du moment. Un monde de désordre meurtrier, de chaos sanglant, dans lequel le gendarme américain tentera de faire régner un minimum d'ordre par l'emploi de plus en plus massif et brutal de sa puissance militaire. » («Militarisme et décomposition », Revue Internationale n° 64, p. 13). De même nous rejetions l'idée, colportée par les gauchistes mais partagée par la plupart des groupes du milieu prolétarien, que la guerre du Golfe était une «r guerre pour le pétrole » (« Le milieu politique prolétarien face à la guerre du Golfe»).
[6] [91] Il n'est pas nécessaire ici de revenir plus longuement sur notre analyse sur la décomposition. Elle apparaît dans chacun de nos textes traitant de la situation internationale. Ajoutons simplement que, à travers un débat en profondeur dans notre organisation, cette analyse a été progressivement précisée (voir à ce propos nos textes : « La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme», «Militarisme et décomposition» et « Vers le plus grand chaos de l'histoire » publiés respectivement dans les n° 62, 64 et 68 de la Revue internationale).
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [17]