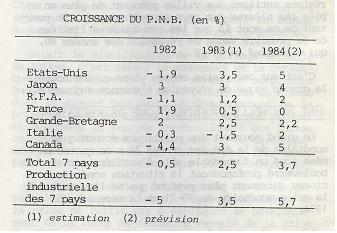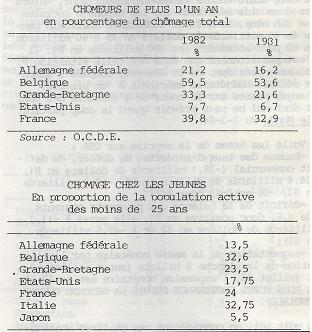Revue Internationale no 39 - 4e trimestre 1984
- 2697 lectures
Quelle méthode pour comprendre : la reprise des luttes ouvrières
- 2419 lectures
Le développement, dans le contexte général de la reprise historique des combats de classe depuis 68, d'une troisième vague de luttes ouvrières après celles de 68-74 et de 78-80, est maintenant évident. La succession de combats ouvriers qui, depuis le milieu de 1983, a affecté la presque totalité des pays avancés - et notamment ceux d'Europe occidentale - et qui trouve, avec la présente grève des mineurs de Grande Bretagne, son expression la plus élevée, est venue démontrer clairement que la classe ouvrière mondiale est maintenant sortie de l'apathie qui avait permis et suivi sa défaite cuisante en Pologne en décembre 81. C'est ce que nous mettons une nouvelle fois en évidence (après nos articles de la Revue Internationale n°37 et n°38) dans la première partie de cet article. Cette reprise, même avec du retard, tous les groupes révolutionnaires l'ont maintenant reconnue. Cependant, ce retard, manifesté par beaucoup de 'révolutionnaires dans la compréhension de la situation présente, pose le problème de la méthode avec laquelle il faut analyser cette situation. C'est cette méthode, condition de la capacité des communistes d'être un facteur actif dans le développement des luttes de classe, que nous examinons dans la deuxième partie de cet article.
OU EN EST LA REPRISE ACTUELLE DE LA LUTTE DE CLASSE ?
Le prolétariat a mis deux ans pour tirer les leçons et se remettre de la fin de la vague de lutte des années 78-81 marquée notamment par les mouvements dans la sidérurgie en France et en Grande Bretagne, les grèves des mineurs aux USA, celle du port de Rotterdam avec son comité de grève, et surtout la grève de masse en Pologne d'août 80. Le prolétariat international' a mis deux ans pour encaisser, digérer et comprendre la défaite qu'il a subie en Pologne, défaite dont l'aboutissement fut le coup de force du 13 décembre 81 et la terrible répression qui s'en est suivie.
La durée du recul des luttes que cette défaite a provoquée au niveau international ne pouvait qu'être courte. Avant même de pouvoir reconnaître clairement le renouveau de combativité du prolétariat qui allait s'exprimer d'abord aux USA en juillet 83 (grève du téléphone) puis surtout en Belgique en septembre (grève du secteur public), nous affirmions lors du 5ème congrès du CCI, en juillet 83, que .- "Si jusqu'à présent le prolétariat des pays centraux avait subi moins brutalement que ses frères de classe de la périphérie les rigueurs de l'austérité, l'enfoncement du capitalisme dans la crise contraint la bourgeoisie à une attaque de plus en plus sévère du niveau de vie de la classe ouvrière au sein de la plus importante concentrât ion industriel le mondiale, celle d'Europe occidentale"."Cette crise, que le prolétariat vit comme une contrainte, le pousse à généraliser ses luttes et sa conscience, à mettre pratiquement en avant la perspective révolutionnaire. " (Revue Internationale n°35, "Rapport sur la situation internationale, p.14).
L'année 83-84 a largement confirmé cette analyse. Sans revenir dans le détail (cf. Revue Internationale n°37, 38 et les différentes presses territoriales du CCI), nous pouvons rappeler rapidement que cette vague de luttes a touché tous les continents, le Japon et l'Inde, la Tunisie et le Maroc lors des émeutes de la faim de l'hiver dernier, le Brésil, l'Argentine, le Chili, la République Dominicaine, les USA et l'Europe occidentale. Dans cette dernière, ce sont tous les pays qui ont été touchés et sont encore touchés par les révoltes ouvrières. Aucun n'a été épargné : Espagne, Italie, Grèce, Suède, Hollande, Belgique, France, Grande Bretagne, Allemagne. Là se trouve le coeur économique et surtout historique du capitalisme. Là se trouve la concentration ouvrière la plus grande, la plus vieille et la plus expérimentée du monde.
Après un été où la combativité ouvrière ne s'est démentie ni même ralentie (Angleterre), nous nous trouvons à l'aube d'une année au cours de laquelle les événements vont s'accélérer. Face à l'accentuation de la crise du capitalisme et à la nécessité pour la bourgeoisie d'attaquer encore plus la classe ouvrière, l'heure est toujours au maintien et au renforcement de la tactique bourgeoise de la "gauche dans l'opposition". Cette dernière "opposée" à des équipes gouvernementales de droite, est spécialement chargée maintenant de saboter les réactions ouvrières aux mesures d'austérité et de licenciements prises dans tous les pays. Deux événements sont particulièrement significatifs de cette tactique de la bourgeoisie : l'élection présidentielle aux USA. Pour celle-ci, qui a lieu en novembre, la bourgeoisie américaine possède en Reagan le "ticket" gagnant apte à remplir le rôle dévolu aux gouvernements de droite en place aujourd'hui. Il a déjà largement fait ses preuves. Pour ceux qui douteraient encore du "machiavélisme" de la bourgeoisie (cf. Revue Internationale n°31), de la mise en place réfléchie de sa "gauche dans l'opposition", de la volonté de la bourgeoisie américaine d'éviter toute mauvaise surprise, la publicité des médias sur la feuille d'impôts de la candidate démocrate à la vice-présidence n'est que le dernier, à ce jour, des "scandales" et des manipulations dans lesquels les bourgeoisie occidentales sont passées maîtres pour organiser les élections et... leur résultat. Le maintien dans l'opposition du parti démocrate doit permettre à celui-ci de prendre un langage de plus en plus "populaire", de "gauche", et de renforcer les liens traditionnels avec la grande centrale syndicale américaine, l'AFL-CIO ; - d'autre part, le départ du PC français du gouvernement. Cette décision du PCF, et son opposition croissante et ouverte à Mitterrand le socialiste, visent à regarnir le front social qui était dangereusement découvert. En 81, l'arrivée accidentelle au gouvernement de la France du PS et du PC, ce dernier étant traditionnellement la force principale d'encadrement et de contrôle de la classe ouvrière dans ce pays, avait mis l'appareil politique de la bourgeoisie en état d'extrême faiblesse face au prolétariat. C'était le seul pays a'Europe occidentale sans parti de gauche important dans l'opposition pour saboter les luttes ouvrières "de l'intérieur". La bourgeoisie n'a pas fini de payer son dérapage de mai 81, de trois ans de gouvernement de "l'union de la gauche", gouvernement qui a asséné l'attaque la plus violente contre la classe ouvrière en France depuis la seconde guerre mondiale et la période de "reconstruction" qui l'a suivie. Cependant, le départ du PCF du gouvernement et son passage dans une opposition de plus en plus ouverte et "radicale", constitue une première disposition de la bourgeoisie française tendant à surmonter cette situation de faiblesse.
Ces deux événements, le passage du PCF dans l'opposition, et surtout l'élection présidentielle à venir aux USA, prennent place dans le cadre du renforcement et de la préparation de l'appareil politique de la bourgeoisie pour affronter le prolétariat, et ce au niveau international. Ces deux événements signifient que la bourgeoisie sait que la crise économique du capital va encore s'accentuer et qu'elle, la bourgeoisie, va devoir attaquer encore plus la classe ouvrière ; ils signifient qu'elle a su reconnaître à sa manière la reprise internationale des luttes ouvrières.
A- Les ouvriers en Grande Bretagne au premier rang de la reprise internationale des luttes.
C'est dans cette situation générale que se situe le mouvement de luttes ouvrières en Grande Bretagne. Avec, à sa tête, la grève des mineurs longue maintenant de sept mois (!), ce mouvement de lutte est devenu le fer de lance de la lutte du prolétariat mondial. Il a atteint le niveau le plus haut de lutte depuis la grève de masse d'août 80 en Pologne.
Pourtant, le prolétariat se trouve confronté, dans ce pays, à une bourgeoisie particulièrement forte politiquement et qui s’était préparée de longue date à des affrontements avec la classe ouvrière. La Grande Bretagne est le plus vieux pays capitaliste. La bourgeoisie britannique domine le monde tout au long du siècle dernier. Elle a une expérience de domination politique que ses consoeurs des autres nations capitalistes lui en vient ; en particulier à travers son jeu démocratique et parlementaire. C'est cette expérience politique sans égale qui lui a permis d'être la première à vouloir et à pouvoir mettre en place la tactique de "la gauche dans l'opposition-. Consciente du danger des réactions ouvrières que ne manquaient pas de provoquer les attaques économiques dues à la crise et à l'usure du parti travailliste au pouvoir, elle sut, en mai 79, renvoyer celui-ci dans l'opposition, et trouver en Thatcher la "Dame de fer" qui lui convenait. Elle sut diviser (création du parti social-démocrate) et affaiblir électoralement le parti travailliste, mais aussi le garder suffisamment fort pour empêcher - avec son organisation syndicale, le TUC - le surgissement de luttes ouvrières et les saboter.
La grève des mineurs, tout comme la reprise internationale des luttes, nous enseigne que cette carte bourgeoise de "la gauche dans l'opposition" n'arrive plus à empêcher ni à étouffer le surgissement des réactions ouvrières, même si elle arrive encore assez bien à les saboter. Dans ce sabotage, la bourgeoisie britannique dispose, là encore, d'une arme que lui envient toutes les autres bourgeoisies : ses syndicats. Tout comme dans le jeu parlementaire et électoral, la classe dominante anglaise est passée maître dans l'art de présenter au prolétariat de fausses oppositions : entre la direction nationale du TUC d'un côté et, de l'autre, Scargill (le chef du syndicat des mineurs) et les shop stewards, institutions vieilles de plus de 60 ans et qui jouent le rôle du syndicalisme de base, de dernière barrière du syndicalisme, la plus "radicale" contre la lutte des ouvriers. Mais si la bourgeoisie est ancienne et expérimentée, le prolétariat est aussi ancien, expérimenté et très concentré. C'est dans ce sens que le mouvement de grèves actuel prend une signification particulière.
La lutte des mineurs, dont la renommée et l'expérience ont déjà traversé la Manche pour atteindre le continent européen, a déjà contribué à détruire une mystification importante tant en Grande-Bretagne que dans les autres pays : le mythe de la démocratie britannique et du policier anglais sans arme. La violente répression qu'ont subie les mineurs a peu à envier à celle de n'importe quelle dictature sud-américaine : 5000 arrestations, 2000 blessés et 2 morts ! Les villes et les villages des mineurs occupés par la police anti-émeute, les ouvriers attaqués dans la rue, dans les pubs, chez eux, les stocks de nourriture destinés aux familles saisis, etc. La dictature de l'Etat bourgeois a vite tombé son masque démocratique.
Pourquoi la bourgeoisie a-t-elle employée une telle violence ? Pour démoraliser les mineurs ; pour décourager les autres secteurs de la classe ouvrière tentés de les rejoindre. Certes. Mais c'est surtout pour empêcher les piquets de grève d'étendre la grève aux autres puits de mine, aux autres usines, pour empêcher une extension générale du mouvement. Car la bourgeoisie a peur. Elle a peur des débrayages spontanés qui ont eu lieu dans les chemins de fer (à Paddington), à British Leyland, des occupations de chantiers navals comme à Birkenhead, ou à l'Aerospace à côté de Bristol.
Et c'est cette peur de l'extension qui l'a retenue d'utiliser cette même violence étatique, une fois les dockers entrés en grève de solidarité au mois de juillet. L'utilisation de la répression aurait risqué en cette circonstance de mettre le feu aux poudres, d'accélérer l'extension de la grève à toute la classe ouvrière. Grâce aux manoeuvres des syndicats (lire World Révolution No 75) et aux médias, cette première grève s'est terminée au bout de 10 jours.
Le mouvement de luttes en Grande-Bretagne reprend toutes les caractéristiques des luttes internationales actuelles que nous avons mises en évidence dans nos "Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe" dans le No 37 de cette Revue : nous n'y reviendrons pas dans cet article. Mais il nous faut souligner l'extraordinaire combativité qu'exprime le prolétariat en Grande-Bretagne : après 7 mois, malgré une violente répression, des pressions de toutes parts, les mineurs sont toujours en grève. A l'heure où nous écrivons, les travailleurs des docks sont en grande partie de nouveau en grève en solidarité avec les mineurs malgré l'échec de la première tentative du mois de juillet ; ils sont conscients que leur intérêt de classe immédiat est le même que celui des mineurs, et des autres secteurs de la classe ouvrière.
C'est l'ensemble de la classe ouvrière qui, peu à peu, prend conscience de son intérêt de classe exprimé dans les mines. A travers cette lutte, la question ouvertement posée, est celle de l'extension réelle des luttes. Il faut souligner, qu'outre les dockers, les chômeurs et les femmes des ouvriers luttent avec les mineurs et se battent avec eux contre la police. Avec la question de la solidarité, c'est la perspective de l'extension consciente qui s'affirme aujourd'hui ouvertement en Grande-Bretagne pour le prolétariat mondial, et surtout européen. Et à travers cette extension, et l'affrontement avec les syndicats et les partis de gauche, ce sont les conditions de la grève de masse dans les métropoles du capitalisme que développe le mouvement de luttes ouvrières.
B- La signification des grèves en Allemagne de l'Ouest
Après les combats en Grande-Bretagne, l'un des aspects les plus probants de cette reprise internationale de la lutte de classe a été le retour du prolétariat allemand sur le terrain des affrontements de classe, comme en témoignent les occupations des chantiers navals à Hambourg et à Brème en septembre 83, la grève des métallurgistes et des imprimeurs au printemps 84. C'est la fraction la plus nombreuse, la plus concentrée et aussi la plus centrale de la classe ouvrière d'Europe de l'Ouest. Ce renouveau des luttes ouvrières au coeur de l'Europe industrielle a une signification historique qui va bien au delà de 1'importance immédiate des grèves elles-mêmes. C'est la fin de 1'importante marge de manoeuvre de la bourgeoisie contre la classe ouvrière en Europe que lui assurait le relatif calme social maintenu en RFA dans les années 70.
Ce développement des luttes en Allemagne confirme deux aspects importants de l'analyse marxiste de la situation mondiale développée par le CCI :
- la crise économique dans le contexte historique d'une classe ouvrière non battue, agit comme le principal allié des ouvriers, en poussant progressivement les principaux bataillons du prolétariat mondial dans le combat de classe, et au premier rang de celui-ci ;
- le resurgissement historique de la lutte de classe depuis 1968 a permis au prolétariat de se débarrasser de plus en plus des effets terribles de la contre-révolution la plus longue et la plus sauvage qui se soit jamais abattue sur le prolétariat ; or, l'Allemagne, tout comme la Russie, fut le principal centre de la contre-révolution qui a suivi la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-
Quelle est la signification de la reprise des affrontements de classe en Allemagne, signification que la propagande bourgeoise voudrait cacher? Ces luttes montrent la banqueroute du "miracle économique" de l'après-guerre, la banqueroute de l'affirmation selon laquelle le travail dur, la discipline et la "collaboration capital-travail", la "paix" sociale peuvent éviter la crise économique. Plus important encore : ces luttes montrent que le prolétariat n'a jamais été "intégré" au capitalisme (souvenons-nous des théories de 1968 à la Marcuse), que toutes les attaques de la Social-Démocratie et du nazisme n'ont pas réussi à détruire le coeur du prolétariat européen. Nous affirmons, qu'à l'image du reste du prolétariat international, les ouvriers allemands n'en sont qu'au début de leur retour dans le combat de classe.
Tout cela ne doit pas nous faire perdre de vue que le retour du prolétariat allemand à sa vraie place, à la tête de la lutte de classe internationale, ne fait que commencer, et que ce processus sera long et difficile. En particulier, il faut nous rappeler que :
- le degré de combativité des ouvriers allemands a encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau déjà atteint en Grande-Bretagne, où les conditions matérielles des ouvriers sont bien pires qu'en Allemagne, et où la classe ouvrière a déjà développé une tradition de luttes et de combativité tout au long des années 70 ;
- les potentialités à court terme de la situation en Allemagne ne sont en aucun cas aussi riches qu'en France, le voisin, car la bourgeoisie de l'Est du Rhin est bien plus puissante et mieux organisée que celle de l'Ouest (elle a en particulier depuis déjà un certain temps réalisé sa tactique de la mise en place de ses fractions de gauche -syndicats et parti Social-démocrate- dans "l'opposition", mise en place juste entamée en France). De plus, la génération présente des ouvriers allemands manque de l'expérience politique de ses camarades en France ;
- dans les luttes jusqu'aujourd'hui, la proportion des ouvriers directement en grève a été bien plus faible qu'en Belgique, et a touché moins de secteurs qu'en Espagne par exemple.
Loin d'être à la tête du mouvement, les ouvriers d'Allemagne en sont en fait encore à rattraper leur retard sur le reste des ouvriers d'Europe. Ceci est vrai au niveau de la combativité, de l'étendue des mouvements, du degré de politisation et de la confrontation avec la stratégie de la gauche dans l'opposition, en particulier avec le syndicalisme de base, l'arme que la bourgeoisie allemande n'a pas eu encore à employer beaucoup jusqu'à présent. Ce "rattrapage" en Allemagne est devenu un des aspects les plus importants du processus d'homogénéisation de la conscience de classe dans le prolétariat européen et des conditions de la lutte en Europe de l'Ouest.
La présente reprise des luttes ouvrières, le nouveau pas qu'elle représente dans le développement historique des combats de classe depuis 68, assignent aux organisations révolutionnaires des responsabilités accrues, et en particulier celle d'intervenir activement dans le processus de prise de conscience qui s'opère actuellement dans la classe. Une telle intervention s'appuie nécessairement sur la plus grande clarté sur la compréhension des véritables enjeux de la situation présente. C'est dire toute l'importance que revêt pour les révolutionnaires - et pour la classe dans son ensemble - la méthode avec laquelle ils analysent la réalité sociale.
LA METHODE D'ANALYSE DE LA REALITE SOCIALE
La reconnaissance et la compréhension de la reprise internationale des luttes ouvrières ne peut s'acquérir qu'en s'appropriant la méthode marxiste d'analyse de la réalité sociale.
Cette méthode rejette la démarche phénoménologique. Aucun phénomène social ne peut être compris et expliqué à partir de lui-même, par lui-même et pour lui-même. C'est seulement en le situant dans le mouvement social général en développement que le phénomène social, la lutte de classe, peut être saisi. Le mouvement social n'est pas une somme de phénomènes, mais un tout les contenant tous et chacun.
Le mouvement de la lutte prolétarienne est à la fois international et historique. C'est de ces deux points de vue, mondial et historique, que les révolutionnaires peuvent appréhender la réalité sociale, la situation de la lutte de classe.
D'autre part, le travail théorique et d'analyse des révolutionnaires n'est pas une réflexion passive, un simple reflet de la réalité sociale, mais tient un rôle actif, indispensable dans le développement de la lutte prolétarienne. Il n'est pas quelque chose d'extérieur au mouvement de la lutte de classe, mais en est une partie intégrante. Tout comme les révolutionnaires sont une partie, bien précise et particulière, de la classe ouvrière, de même leur activité théorique et politique est un aspect de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
Les communistes ne peuvent s'approprier la méthode marxiste qu'en se situant comme facteur actif dans le mouvement de la lutte de classe, et d'un point de vue mondial et historique.
En prenant chaque lutte en soi, en l'examinant de manière statique, immédiate, photographique, on s'ôte toute possibilité d'appréhender la signification des luttes et,en particulier, de la reprise actuelle de la lutte de classe. Si nous reprenons parmi les principales caractéristiques des luttes d'aujourd'hui (cf. Revue Internationale No 37, "Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe"), la tendance au surgissement de mouvements spontanés, à des mouvements de grande ampleur touchant des secteurs entiers dans un même pays, leur tendance à l'extension et à l'auto organisation, si nous reprenons donc toutes ces caractéristiques en soi, de manière statique, mécanique, et si nous les comparons avec la révolte ouvrière d'août 80 en Pologne, il est effectivement difficile de voir une reprise du combat de classe du prolétariat international. Les mouvements spontanés de solidarité des dockers et d'autres secteurs ouvriers avec les 135 000 mineurs en grève en Grande-Bretagne, les manifestations violentes et spontanées débordant les syndicats en mars dernier en France, les 700 000 manifestants ouvriers à Rome le 24 mars, même la grève des services publics en septembre 83 en Belgique, paraissent bien en deçà du niveau de lutte atteint par la vague précédente ; et surtout bien loin de la grève de masse en Pologne. Et pourtant...
Et pourtant, la méthode marxiste ne peut se contenter de comparer deux photos prises à quelques années de distance. Elle ne peut se contenter de rester à la surface des choses. Pour les révolutionnaires conséquents, il s'agit d'essayer de saisir la dynamique profonde, le mouvement des luttes ouvrières.
La reprise de la lutte de classe se situe principalement, mais pas uniquement, dans les principaux centres industriels du monde, en Europe occidentale, et aux USA. Ce n'est donc plus dans un pays du bloc de l'Est, ni seulement en Afrique du Nord, à Saint-Domingue et au Brésil que ces mouvements spontanés et de grande ampleur surgissent. C'est dans les principaux, les plus vieux pays capitalistes, dans les pays "les plus prospères", dans le bastion industriel de l'Europe. C'est le prolétariat le plus ancien, le plus expérimenté et le plus concentré qui réagit aux attaques de la bourgeoisie.
C'est dire que deux des principales armes employées avec succès contre le prolétariat dans la vague de luttes précédente, et particulièrement en Pologne, n'ont plus assez d'efficacité aujourd'hui pour maintenir les ouvriers dans les illusions et la démoralisation :
- l'arme de la spécificité nationale des pays du bloc de l'Est qui avait permis l'isolement en Pologne en présentant la crise économique qui sévissait dans ce pays comme le résultat de la*mauvaise gestion des bureaucrates" locaux. Les luttes actuelles en Europe occidentale mettent à bas les illusions sur des issues nationales, pacifiques à la crise économique. La révolte ouvrière ne frappe plus seulement les pays de l'Est et du Tiers-monde mais aussi les pays "démocratiques" et "riches". C'est la fin des illusions sur la nécessité de sacrifices momentanés pour sauver l'économie nationale. Avec l'apparition de soupes populaires dans les grandes villes d'occident et qui éclairent d'un autre jour les queues et les privations supportées par les ouvriers d'Europe de l'Est, la reprise actuelle des luttes dans les métropoles industrielles de l'Ouest signifie donc la compréhension progressive par le prolétariat international du caractère irréversible, catastrophique et international de la crise du capital.
- l'arme de "la gauche dans l'opposition" qui avait si bien fonctionné, et en Europe de l'Ouest, et à travers le syndicat Solidarité en Pologne. La reprise internationale actuelle nous enseigne que cette arme n'arrive plus à empêcher directement l'éclatement de grèves ouvrières (même si elle est encore très efficace dans leur sabotage). Ce sont donc les illusions sur la "Démocratie de l'Ouest" et sur les partis de gauche et les syndicats qui tendent à tomber.
Cette prise de conscience du caractère inévitable et irréversible de la crise du capital dans le monde entier, et du caractère bourgeois des partis de gauche même sans responsabilités gouvernementales, ne pouvait -et ne peut- se développer qu'à partir des luttes ouvrières dans les pays industriels les plus développés et les plus vieux, dans les pays où la bourgeoisie dispose d'un appareil d'Etat rodé au jeu démocratique et parlementaire, dans les pays où les illusions sur "la société de consommation", sur la "prospérité éternelle", prenaient leur source et avaient été les plus fortes.
C'est en répondant à ces deux obstacles et en les dépassant, que le prolétariat reprend le combat aujourd'hui là où il l'avait laissé en Pologne.
Saisir la signification de la période actuelle de luttes, c'est saisir le mouvement et la dynamique qui les animent ; c'est saisir et comprendre que c'est la maturation de la conscience de classe dans la classe ouvrière, le développement de la prise de conscience chez les ouvriers qui produit et détermine la reprise internationale des luttes ouvrières. C'est cette maturation et ce développement de la conscience qui donnent tout leur sens, toute leur signification aux luttes ouvrières.
En effet, condition indispensable du développement de la lutte de classe, l'approfondissement de la crise ne suffit pas à expliquer le développement de la lutte de classe. L'exemple de la crise de 1929 et des années qui ont précédé la seconde guerre mondiale nous le prouve. Dans les années 30 les attaques terribles de la crise économique n'avaient provoqué qu'une plus grande démoralisation et qu'un plus grand déboussolement dans un prolétariat qui venait d'essuyer la plus grande défaite de son histoire et qui subissait à plein le poids des mystifications "antifascistes" et sur la "défense de la patrie socialiste" visant à l'enchaîner au char de l'Etat bourgeois derrière les partis de gauche et les syndicats. La situation est bien différente à l'heure actuelle. Le prolétariat d'aujourd'hui n'est pas battu et nous avons vu précédemment que c'est sa capacité à digérer, à mûrir ses défaites partielles, à donner une réponse aux armes idéologiques que lui oppose la bourgeoisie qui détermine la reprise présente de la lutte de classe. Les conditions objectives, la crise économique, la misère qui se généralise, ne sont pas seules ; s'y ajoutent des conditions subjectives favorables : la volonté consciente des ouvriers de ne plus accepter de sacrifices pour la sauvegarde de l'économie nationale, la non adhésion du prolétariat aux projets bourgeois (économique et politique), la compréhension de plus en plus grande du caractère anti-ouvrier de la gauche et des syndicats.
Et plus le facteur subjectif devient important dans le développement des luttes ouvrières, et plus devient crucial le rôle des révolutionnaires dans celles-ci. En effet, expression la plus haute de la conscience de classe, les communistes sont indispensables, non seulement par leur travail théorique, politique, leur propagande ; non seulement ils seront indispensables demain dans la période révolutionnaire, mais déjà, dès aujourd'hui, ils sont indispensables dans le processus actuel de la reprise de la lutte de classe, de maturation de la grève de masse. En dénonçant les pièges et les impasses que le capitalisme oppose au prolétariat, ils stimulent, catalysent, accélèrent le développement dans la classe d'une claire conscience de la nature de ces pièges et impasses, du rôle véritable de la gauche et des syndicats. De plus, même s'ils ne se font pas d'illusion sur l'importance de leur impact immédiat, ils contribuent à orienter les luttes dans le sens de l'autonomie la plus grande de la classe ouvrière face à la bourgeoisie, dans le sens de l'extension et de la coordination des luttes par l'envoi 02 délégations massives, de piquets de grève, de manifestations, dans le sens de l'organisation par les ouvriers eux-mêmes dans les assemblées générales, de cette extension ; dans le sens du développement le plus larg3 de la lutte de classe.
La non reconnaissance ou la sous-estimation de la reprise actuelle, la vision mécanique du développement de la lutte de classe, l'incompréhension du rôle actif de la conscience de classe dans le processus de développement de cette lutte de classe,, mènent au rejet -au moins implicite- de la nécessité de l'intervention des révolutionnaires et, partant, du parti communiste mondial de demain.
En effet, il ne suffit pas de clamer à cors et à cris la nécessité du parti, comme le font certains groupes, pour contribuer efficacement au processus qui mène à sa future constitution. C'est, dès aujourd'hui, dans les luttes présentes que se préparent les conditions de son édification, que se forgent les organisations qui en seront des parties constitutives, que- les communistes font la preuve de leur capacité à se trouver à l'avant-garde des combats révolutionnaires à venir. Et ils ne feront une telle preuve que s'ils se montrent capables de défendre avec rigueur la méthode marxiste dont l'ignorance et l'oubli désarment politiquement le prolétariat, le mènent à l'impuissance et à la défaite.
R.L. 9/9/84
Géographique:
- Europe [1]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [2]
Où en est la crise économique ? : Crise historique de l'économie
- 2563 lectures
Le rapport sur la situation internationale adopté au 6ème Congrès de Révolution Internationale (juillet 1984), comportait trois parties : crise historique de l'économie, conflits inter impérialistes et développement de la lutte de classe. Dans la rubrique régulière sur la crise économique de cette Revue, nous publions la première partie de ce rapport ([1] [3]) qui fait le point sur les manifestations actuelles et les perspectives de la crise dans le bloc de l'Ouest vers une nouvelle grande vague de récession.
Nous pouvons aujourd'hui contempler les conséquences désastreuses de la première vague de récession des années 80 sur l'ensemble de la planète, le spectacle désolant des conséquences catastrophiques du choc violent des forces productives contre les rapports sociaux.
On dirait que des populations entières ont subi un cataclysme ou sortent d'un conflit extrêmement violent et meurtrier. Famines, disettes, émeutes de la faim sont aujourd'hui chose courante sur des continents entiers (la seule année 84 a connu des émeutes au Brésil, en Inde, en Tunisie, au Maroc... ou encore des expulsions, l'exode forcé de dizaines de millions de personnes). Dans les pays développés, que ce soit dans les métropoles de la vieille Europe ou dans les Etats Unis d'Amérique, des régions entières, des villes prennent de plus en plus les allures des pays sous-développés. Et pourtant ce ne sont là que les conséquences limitées de la première vague de récession des années 80, qui a culminé en 81-82.
C'est sur ces plaies encore vives qu'une nouvelle grande vague de récession s'annonce aujourd'hui.
UNE NOUVELLE GRANDE VAGUE DE RECESSION
Le grand tournant des politiques économiques mondiales de la fin des années 70 a en quatre années joué un formidable rôle d'accélérateur et bouleversé profondément la situation mondiale à un niveau autrement plus profond que ne l'avaient fait la crise monétaire de 70-71 et la récession de 1974.
Les conséquences des coups portés ces dernières années contre les politiques que nous appelons par commodité "keynésiennes" et qui avaient prévalu avec plus ou moins de force depuis la seconde guerre mondiale ont provoqué la plus grande récession mondiale depuis l'avant-guerre, aux conséquences sociales et humaines que personne n'ignore. Bien que des Etats, comme l'Etat français, ou l'Etat anglais, aient été des précurseurs en la matière, c'est encore l'Etat américain qui a mené la danse. Comme après la seconde guerre, pendant toute la période de reconstruction et depuis la crise ouverte à la fin des années 60, l'économie mondiale a été dépendante de la situation du capitalisme aux USA. Pendant les années de reconstruction, il procurait à l'Europe les moyens de sa reconstruction, de même que dans les années 70, il jouait le rôle de locomotive de l'économie mondiale, par le crédit facile et bon marché, les déficits publics et la planche à billets.
En deux ans, le Tiers-monde s'est effondré, et on se demande vraiment jusqu'où le capitalisme peut enfoncer l'humanité ; les pays sous-développés ou "en voie de développement" sont à genoux, écroulés sous le poids de leurs dettes, leur économie prête à rendre l'âme. Les "miraculés" d'hier deviennent en un espace de temps très réduit les agonisants d'aujourd'hui. Les pays producteurs de pétrole croulent sous la surproduction : Venezuela, Mexique pour l'Amérique latine sont en faillite potentielle (en un an le niveau de vie au Mexique ainsi qu'au Venezuela a chuté de 50%). Le Moyen-Orient est dans un état lamentable : un des principaux financiers international et producteur de pétrole, l'Arabie Saoudite, est en déficit commercial, surproduction aussi, alors que deux autres producteurs très importants, l'Irak et l'Iran ont, à cause de la guerre, fait chuter leur production de 75%. En Afrique, 1e Nigeria, "pays du soleil", exception économique au milieu d'un continent où la misère est indescriptible, à cause aussi de la surproduction de pétrole, expulse un million et demi de personnes en deux semaines (en janvier83). Partout éclatent des émeutes de la faim : Brésil, Colombie, Inde, Maroc, Tunisie, et dernièrement encore aux Caraïbes. Telles sont les conséquences de la surproduction mondiale dans les pays peu ou pas développés. Le bilan historique est rapide à tirer, d'une netteté extrême. Ces pays sont passés de la forme coloniale à la décolonisation pour aboutir aujourd'hui dans l'effondrement. Cela est une manifestation de l'incapacité du capital à assurer son processus d'accumulation et donc d'extension de son mode de production, d'intégration à celui-ci d'autres secteurs de la société.
Dans les pays industrialisés, le choc a là aussi été très rude. Les mesures en vue de mettre fin à la politique d'endettement et de déficit public, le coup de frein brutal à la politique de locomotive mondiale de la part des USA ont brutalement bouleversé le paysage et les habitudes économiques des pays de la métropole, en particulier en Europe. Les pourcentages d'expansion, dans lesquels s'expriment les taux d'accumulation du capital, sont brutalement tombes à zéro ou en dessous.
En 1'esnace de trois ans, 1'évolution du chômage a subi une accélération considérable alors que les salaires continuaient à baisser-. La fraction de salaire versée par l'Etat a elle, sous toutes ses formes, été réduite énormément. En résumé tout ce que la classe ouvrière considérait comme des acquis inaltérables a été brutalement balayé ou est en voie de l'être.
Nous avons toujours mis en avant dans nos analyses que plus nous irions en avant dans la crise, plus les périodes de "reprise" seraient courtes et limitées, alors que les périodes de récession, elles, seraient de plus en plus longues, étendues et profondes. Les faits semblent particulièrement nous donner raison. Mais pour caractériser la situation actuelle, nous devons ajouter que contrairement aux périodes de récession précédentes, la récession de 81-82 n'a pas été suivie d'une nouvelle relance de style keynésien. Au contraire, les conséquences inflationnistes de ces politiques, qui, "à côté" d'une surproduction profonde avaient conduit l'économie mondiale à la limite du krach financier menaçant de faire exploser le système monétaire, ne pouvaient, être poursuivies. C'est ainsi que c'est une politique de "purge" générale qui a suivi la première récession des années 80 et qui se poursuit aujourd'hui. (Les USA constituent sous certains aspects un cas à part mais nous y reviendrons plus loin).
La surproduction ne pouvant plus être épongée par les déficits, nous la voyons ainsi gagner tous les secteurs de la production et les bloquer en partie. Cette caractéristique des crises de la période de décadence, LA CRISE GENERALISEE A TOUS LES SECTEURS DE LA PRODUCTION, ressort aujourd'hui avec une clarté éblouissante :
-secteur de production des moyens de production, de la machine outil à l'industrie lourde (tel l'acier) ;
-secteur des matières premières et de l'énergie;
-secteur de production des moyens de consommation, avec une prime pour l'agriculture et le logement ;
-secteur de production des moyens de transports, de l'aéronautique à l'industrie navale en passant par l'automobile ;
-secteur dit "tertiaire", celui de la circulation du capital (les banques en particulier, principales bénéficiaires de la période "inflationniste" et qui se présentaient comme les institutions les plus assises et les plus solides, ont particulièrement été secouées durant les deux premières années de cette décennie ) ([2] [4]);
-et enfin le secteur appelé "service public", largement gonflé lors des périodes précédentes a particulièrement été visé par la politique générale de purge.
Nous pouvons déjà voir ici l'importance du caractère généralisé de la crise à tous les secteurs pour le développement et l'unification de la lutte de classe. Il nous faut maintenant considérer les années 83 et 84 et plus particulièrement ce qu'on appelle "la reprise" aux USA pour être capables de tirer un bilan de la première moitié des années 80, mais surtout pour dégager une perspective pour les mois et les années à venir.
LA REPRISE AUX USA
Tous les commentateurs de la situation économique s'accordent pour dire que l'ensemble des pays industrialisés (la France mise à part) semblent avoir amorcé une "reprise économique", en particulier les USA. Pour le début de l'année 84, des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne peuvent inscrire à leur actif une baisse assez nette de l'inflation, une stabilisation du chômage et une évolution de la production (PNB) de 2 ou 3% (ce qui correspond d'ailleurs tout juste à l'évolution de la population) . Nous ne nous attarderons pas sur la situation des pays européens dans la mesure où leur évolution est totalement dépendante de la situation économique aux USA. En effet le réajustement des balances commerciales des pays européens ou du Japon n'a pu se faire qu'au prix d'un déficit commercial gigantesque de l'économie américaine.
Seuls les USA peuvent inscrire pour l'année 84 une augmentation de leur PNB d'une moyenne de 5%, mais à quel prix et dans quelle perspective ?
Au delà des aspects de manipulations monétaires, nous pouvons déjà donner un aperçu de la réalité de la "reprise" de l'économie aux USA et de ce qu1 elle contient. Ainsi, fin 83, à un des plus forts moments de ce qui est appelé "reprise", on pouvait apprendre :
"Les commandes de biens durables aux entreprises américaines ont augmenté de 4% en novembre, s'établissant à 37,1 milliards de dollars, annonce le département du commerce. Cette progression, la plus forte depuis le mois de juin dernier (+7,6%) est due en grande partie à la hausse des commandes militaires (+46%) et des commandes d'automobiles et de camions (+17,7%). Les commandes d'appareils domestiques, elles, n'ont progressé que de 3% et les commandes d'équipements de production ont baissé de 4,4%'.' (Le Monde du 24-12-83, nous soulignons).
Ce financement qui pour 50% a été destiné à l'effort de guerre nécessité par l'offensive des USA n'a été rendu possible que par les manipulations sur le dollar, monnaie sur laquelle repose le commerce mondial. La hausse vertigineuse des taux d'intérêts (jusqu'à 18%) a permis de rapatrier vers les USA des millions de dollars qui pendant des années ont été répandus dans le monde entier. Et cela était encore largement insuffisant. Malgré les économies réalisées sur lés dépenses sociales aux USA même, le déficit budgétaire américain passe de 30 milliards de dollars en 79 à 60 milliards en 80 pour atteindre les 200 milliards en 84. Il n'est pas étonnant que dans une telle situation,P. Volcker, président de la Réserve, compare l'immense déficit budgétaire américain à "un pistolet chargé, pointé sur le coeur de l'économie des USA, et dont nul ne peut prévoir quand le coup partira." (Le Monde du 3-3-84).
Voilà les bases de la reprise aux USA :
-hausse des taux d'intérêts, du dollar, du déficit commercial (-28,1 milliards de dollars en 81, -36,4 milliards de dollars en 82, -63,2 milliards en 83, -80 estimés pour 84);
-déficit de la balance des paiements courants (de 4,6, donc positive en 81, elle passe à -11,2 milliards de dollars en 82 et à -42,5 milliards en 83);
-augmentation de la masse monétaire par l'utilisation de la planche à billets (entre juillet 82 et juillet 83, l'expansion monétaire est de 13,5%, LA PLUS PORTE CROISSANCE DEPUIS LA SECONDE GUERRE MONDIALE).
On voit ici, en considérant ces chiffres pharamineux, l'immense baudruche que constitue la reprise aux USA et comment derrière une baisse en chiffres absolus de l'inflation de la monnaie américaine (13,5% en 80, 10,4% en 81, 6,1% en 82, 3,5% en 83) DUE ESSENTIELLEMENT A LA HAUSSE DU DOLLAR (la hausse du dollar a réduit de 10% le prix des marchandises importées), se cache une HYPER INFLATION (la surestimation du prix du dollar étant évaluée en janvier 84 à 40%).
Cette situation économique explosive, telle une bombe atomique amorcée, nous invite à jeter un rapide regard en arrière pour dégager quel peut être l'avenir de la situation.
En 1979, la fuite généralisée devant le dollar, monnaie de référence pour le commerce international, menace de krach le système monétaire international. Face à cette situation qui signe la faillite de plusieurs années de fuite en avant, les autorités américaines portent à 18% le taux d'intérêt de la monnaie américaine pour soutenir leur monnaie et éponger la dette internationale immense que représentent les millions de dollars répandus dans le monde. Résultat : en 81-82, on assiste à la plus forte récession depuis la veille de la seconde guerre mondiale, dans les pays industrialisés (en particulier aux USA), les industries s'écroulent comme des châteaux de cartes, les pays "en développement" ne peuvent plus rembourser leur dette et au delà de leur faillite c'est la faillite de tout le système bancaire des pays développés qui se profile.
En 1982, l'asphyxie générale de l'économie, par les mêmes moyens volontaristes, pousse les autorités américaines à ramener leurs taux d'intérêts à 11%. Taux suffisamment hauts pour continuer à ramener vers les USA des masses de dollars et les capitaux qui dans le reste du monde fuient les investissements et pour permettre aux entreprises américaines d'emprunter à nouveau.
En 83-84, la dégringolade semble marquer une pause, mais comme on l'a vu plus haut, ce n'est qu'au prix de déficits pharamineux. De nouveau, une nouvelle fuite internationale devant le dollar fait trembler le système monétaire international ; en un moi s, le prix du dollar perd en volume (nominal, bien sûr) ce qu'il avait mis six mois à gagner, l'inflation double presque (de 3,5% à 5,5%). Seule solution, les autorités américaines sont obligées à nouveau de hausser les taux d'intérêts et la récession menace à nouveau.
Cette menace ou plutôt cette réalité d'une nouvelle vague de récession aux conséquences encore difficilement calculables (mais que nous laissent imaginer le début# des années 80) et les conditions dans lesquelles elle s'annonce va venir mordre encore plus profondément dans la chair de l'humanité alors que partout dans le monde le champ d'activité du capital se rétrécit de plus en plus.
D'ailleurs la bourgeoisie ne se fait pas d'illusion sur la perspective des mois à venir et c'est à un nouveau choc extrêmement violent qu'elle se prépare. L'attitude du capital aux USA est, à cet égard extrêmement significative. Ces deux dernières années, et ces derniers mois en particulier, on a pu assister aux USA à une considérable accélération de la concentration du capital, financée en grande partie par l'afflux des capitaux étrangers. Mais cette concentration n'a rien à voir avec la concentration du capital qui correspond à une extension de l'activité du capital telle qu1 elle se développe dans les phases d'expansion. Cette concentration, nourrie par un empirisme comme seul le capital peut se le permettre, est l'expression d'une bête blessée à mort qui concentre ses dernières forces en un seul point. La meilleure preuve que nous puissions mettre en avant pour démontrer ce que nous avançons, c'est que la plus grande concentration d'entreprises a eu lieu aux USA dans les industries les plus touchées par la crise de surproduction mondiale : l'industrie du pétrole et celle du bâtiment.
"Quatre ans plus tard, (que 1977), les opérations de fusion sont près de quatorze fois plus importantes et représentent 82.000 millions de dollars. Cette année là, le seul rachat de Conoco (9ème compagnie pétrolière américaine) par Dupont de Nemours (première société chimique) met en jeu 73 milliards de dollars, soit une somme supérieure à la valeur totale des fusions effectuées en 1977V (bilan économique et social 83 "Le Monde").
Ainsi, pour faire face à une chute vertigineuse des taux de profit, et surtout en préparation des prochains chocs, les industries américaines rassemblent leurs dernières forces et rien que cela laisse exsangue le reste du monde qui ressemble de plus en plus à un pantin disloqué, à un corps dont le sang reflue et quitte peu à peu tous les membres pour les laisser engourdis et glacés.
Le déficit commercial américain permet encore pour quelques mois à l'Europe et au Japon de maintenir un certain niveau d'activité. Mais là aussi à quel prix : non seulement celui du déficit commercial américain, mais aussi le prix du dollar, qui est colossal, et, malgré cela, la bagarre pour maintenir un niveau suffisant d'exportation nécessite pour l'Europe déjà à genoux d'asséner des coups de hache et un sabrage des conditions ouvrières sans précédents.
C'est dans ces conditions qu'un nouvel assaut de la récession mondiale qui dégonflera, cette fois -ci, complètement la baudruche de la "reprise" aux USA, se prépare. Quand et comment ? Cela est difficile à dire, mais on peut raisonnablement penser que celle-ci se développera au lendemain des élections aux USA (novembre 84).
Mais qu'importe la date du nouvel assaut, ce qui est certain c'est son proche avenir, et surtout les caractéristiques de la situation mondiale qu' il impliquera et dont les premières années 80, les mois que nous vivons aujourd'hui, nous ont donné un avant-goût.
La dynamite de l'inflation accumulée dans les déficits, concentrée au sein de la puissance économique sur laquelle repose l'économie mondiale donne la mesure de la puissance de la nouvelle vague de récession à venir. La dernière vague de récession a propulsé les taux de chômage à des niveaux record, atteignant dans certains pays des taux sans précédents depuis la veille de la seconde guerre mondiale, (en moyenne pour les pays développés, 12% de la population active). Pour les mois et les années à venir, le taux de chômage qui a presque doublé en seulement trois ans, est encore appelé à doubler, voire tripler, c'est à dire atteindre 20 ou 30% de la population active.
Les chiffres donnés en perspective par l'OCDE en 83 étaient déjà très pessimistes et encore tablaient sur la "reprise internationale" :
"On y apprenait notamment que, pour maintenir le chômage à son niveau actuel, en fonction de l'augmentation prévisible de la population active, il faudrait créer de dix huit à vingt millions d'emplois d'ici la fin de la décennie. De plus les experts de l'OCDE estimaient qu'il faudrait encore quinze millions d'emplois supplémentaires si on voulait revenir au niveau de chômage de 1979, soit dix-neuf millions de personnes sans travail.
Au total, ajoutaient-ils, cela reviendrait à créer 20.000 emplois par jour entre 84 et 89, alors que, après le premier choc pétrolier, entre 1975 et 1980, les 24 pays membres n'en avaient dégagé que 11.500 quotidiennement. S'ensuivaient des prévisions très pessimistes, tablant sur 34,75 millions de chômeurs en 1984, dont 19,75 pour l'Europe et 2,45 pour la France." (Rapport de l'OCDE 1983).
Mais plus encore que le nombre absolu de chômeurs, les caractéristiques et les conditions dans lesquelles le chômage se développe de façon accélérée sont significatifs de l'ampleur de la crise. Les allocations sont réduites aux portions les plus congrues, quand elles ne sont pas tout simplement supprimées. Le chômage touche les plus larges fractions de la classe ouvrière, bien que les "jeunes" et les immigrés en subissent encore la plus forte pression ; d'autre part sa durée est de plus en plus longue et sans issue pour des milliers de personnes.
A la suite de son rapport, l'OCDE ne manquait d'ailleurs pas de mentionner certains de ces aspects, et d'en tirer des conclusions :
"Au delà du tollé que provoqua cette projection, l'OCDE mettait en lumière les caractéristiques profondes du chômage...Un premier élément concerne l'allongement de la durée du chômage, qui prive d'activité une part de plus en plus importante de la population. On constate, un peu partout, le découragement des chômeurs de longue durée. Ceux-ci en viennent à prendre des "petits boulots" ou des emplois d'attente, ou pis, à ne même plus se déclarer comme demandeurs d'emplois. Cette situation, à tous égards est lourde de risques sociaux." (idem) .
Le chômage est à la pointe de l'attaque du capitalisme contre la classe ouvrière. En lui, il résume toute la condition ouvrière, il est l'expression au niveau humain de la surproduction, de la surproduction de la force de travail, de la condition de marchandise, chair à travail et à canon. D'autre part, si la crise historique du capitalisme conduit à une paupérisation absolue ([3] [5]) de la 'classe ouvrière, elle opère aussi, et cet aspect est fondamental, une modification des structures de classe de la société telles qu'elles ont pu être modelées dans les périodes de croissance et d'expansion du capital.
Stratification de la classe ouvrière entre plusieurs couches d'ouvriers qualifiés et non qualifiés, entre cols bleus et cols blancs, entre immigrés et non-immigrés. Possibilité pour certaines fractions, couches d'ouvriers les plus qualifiés d'atteindre après des années "d'efforts" une situation qui les rapproche par leurs conditions de couches moyennes, par l'accession aux emplois d'encadrement ou de maîtrise pour eux-mêmes, par l'accession aux emplois de cols blancs, le plus souvent ceux de techniciens pour eux ou leurs enfants. Avec la crise, telle qu'elle se déroule sous nos yeux, tout cela est fini. Ce n'est plus vers le haut que le regard de la classe ouvrière se tourne, mais effrayé, vers le bas, où tout ce qui hier apparaissait encore comme distinction disparaît. Dans ce processus qui se déroule sous nos yeux de façon accélérée, le chômage joue un puissant rôle, et en particulier quand il menace d'atteindre 20 à 30% de la population active. De plus au travers du chômage, les couches moyennes sont déchirées, et rejoignent les rangs de la classe ouvrière dans ce que sa condition a de plus misérable.
Ce n'est pas là une simple projection que nous faisons, mais la description d'un processus qui se déroule concrètement, sous nos yeux, processus qui non seulement met face à face les classes sociales, mais distingue nettement leurs intérêts irréductibles. Cette réalité balaie radicalement l'écran de fumée constitué par la formation de couches moyennes particulièrement gonflée dans l'époque "keynésienne" ainsi que toutes les théories sur l'aristocratie ouvrière.
CONCLUSIONS
1- Le rapide tableau, encore limité et imprécis, du bilan économique des premières années de la décennie 80 et des perspectives pour les années à venir, établit en partie les conditions dans lesquelles la lutte de classe, et sa nouvelle impulsion qui se manifeste aujourd'hui dans tous les pays va s'affronter à la classe dominante. Rosa Luxembourg déclarait à juste raison que "pour que la révolution ait lieu, il faut que le champ social soit labouré de fond en comble, il faut que ce qui était enfoui profondément monte à la surface, que ce qui était à la surface soit enfoui profondément." (Grèves de masses, parti et syndicats).
Cette tâche là, l'unité de la lutte de classe, de l'expérience de la classe ouvrière et d'une crise économique sans précédents est en train de l'accomplir... La paupérisation rapide et absolue qu'opère la crise économique pousse la classe ouvrière avant de pouvoir plonger son regard dans l'avenir,à se plonger dans son passé, et là, c'est soixante dix ans de décadence qu'elle peut contempler.
2-Nous avons consacré une longue partie à l'ana lyse de la situation du capital aux USA dans la me sure où,comme nous l'avons dit, cette économie qui représente 45% de la production des pays occidentaux et un quart de la production mondiale détermine l'évolution du reste de l'économie mondiale. Mais ce n'est pas tout ; il est un autre aspect dans la profonde crise que traversent les USA qui est extrêmement important du point de vue historique : ce n'est que grâce au capitalisme aux USA, qui s'est développé en pleine période de décadence, avec toutes ses caractéristiques (capitalisme d'Etat, militarisme) , au début grâce à un marché extra-capitaliste intérieur immense, ensuite grâce à la guerre mondiale qui a éliminé ses rivaux, que l'Europe en pleine décrépitude, totalement épuisée par deux guerres mondiales, a pu se maintenir depuis les années du milieu de ce siècle : par sa reconstruction capitaliste de 45 aux années 60, pendant la décennie des années 70 où les USA ont joué un rôle de locomotive mondiale, et d'une certaine manière en 83-84 où seul l'immense déficit commercial américain lui permet de ne pas s'effondrer complètement.
Aujourd'hui, cette période est complètement révolue, du point de vue tant idéologique qu'économique. Les USA ne peuvent plus jouer un rôle d'appui matériel, ni celui, idéologique, de faire croire à un développement infini et prospère du capitalisme au travers du "rêve américain", lequel est devenu un véritable cauchemar.
3-La dernière conclusion de cette partie consacrée à la crise de 1'économie nous amène à critiquer un point de vue que nous avons été amenés à mettre en avant en particulier dans le rapport dout le 5ème Congrès de RI ([4] [6]) selon lequel la fin des années 70 signait la fin des politiques d'endettement. Le CCI avait tout à fait raison de dire que les années 80 marquaient la faillite de toutes les politiques keynésiennes de fuite en avant qui avaient marqué les années précédentes, mais de là à en tirer la conclusion que c'était la fin de l'endettement pour le capitalisme, il y avait un pas à ne pas franchir.
La réalité s'est d'ailleurs chargée elle-même de rectifier cette vision erronée. En l'espace de deux ans, tant dans les pays les plus développés (USA) que dans les pays sous-développés, l'endettement sous les forme:; diverses que nous avons décrites plus haut n'a pas seulement "augmenté" mais il a été multiplié par 2,3 ou 4 par rapport à celui accumulé durant une période de dix ou vingt ans.
Cette situation est liée à la nature more de la crise du capitalisme, la crise de surproduction et à l'incapacité d'assumer un processus d'accumulation sans lequel le capital n'existe pas et ne peut exister.
Nous devons distinguer, et c'est cela qui était la préoccupation du CCI au début des années 80, l'endettement tel qu'il s'est développé par exemple dans les années 70 et celui de la situation actuelle. Dans la première période, malgré une large part de déficit dû à l'armement, l'endettement mondial a permis un certain niveau d'accumulation et d'expansion. Mais les années 80 ont largement illustré comment cette tendance générale du capitalisme décadent à substituer à son processus d'accumulation de capital une accumulation d'armement s'amplifie. C'est ainsi que les déficits colossaux, bien supérieurs à ceux des années 70 ont pour l'essentiel eu pour terrain d'investissement l'armement.
Ce n'est un secret pour personne que le déficit du budget américain est en rapport exact avec l'accroissement pharamineux des armements. Les capitaux fuient l'Europe pour participer à l'effort de guerre du bloc occidental, les missiles les remplacent. Partout ailleurs, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique du Sud, les "aides" au développement sont remplacées par une accumulation d'armes gigantesques. Aux USA même, à la caution de la force économique, se substitue la caution de la force militaire. C'est ce que Reagan appelle "retrouver la force, la puissance de l'Amérique". Pantin stupide !
Aujourd'hui se manifeste clairement et avec une acuité sans précédent comment la crise du capitalisme, la crise de surproduction, l'impossibilité de continuer un processus d'accumulation entraîne impitoyablement et immanquablement un processus d'autodestruction du capital. Autodestruction non pas du capitalisme, mais du capital et de l'existence de centaines de millions d'êtres humains qu'il a attachés au char de son esclavage.
Cette question de l'autodestruction du capital n'est pas une simple question d'"intérêt théorique'. C'est une question fondamentale, pour plusieurs raisons :
-parce qu'elle illustre et explicite les rapports entre la crise historique du capitalisme et la guerre;
-parce qu'elle montre qu'il ne suffit pas de dire que la crise"joue en faveur du prolétariat". En effet, nous avons eu à combattre pendant des années les conceptions qui ne voyaient la révolution prolétarienne que comme une affaire de volonté, bref, toutes les conceptions idéalistes. Aujourd'hui que la crise est manifeste et se livre sans fard, il ne faudrait pas tomber dans l'erreur inverse et penser que, de toutes façons la crise est là et qu'elle se transformera nécessairement en révolution sociale. Cette conception est aussi fausse que la première. Nous devons combattre, en nous appuyant sur les faits historiques et présents, 1'idée que la crise du capitalisme, la crise de surproduction se présenterait comme une simple accumulation de biens, invendus et invendables, que cette surproduction liée à une baisse profonde des taux de profit mènerait le capitalisme à s'effondrer de lui-même et qu'ainsi le prolétariat n'aurait qu'à cueillir la révolution comme on cueille une fleur.
Cette vision est fausse et les années 80 que nous avons déjà vécues l'illustrent amplement.
RI.juillet 1984
[1] [7] Pour les orientations du rapport sur les autres points, adoptées à ce Congrès, se reporter à la Résolution sur la situation internationale publiée dans Révolution Internationale n°123, août 1984.
[2] [8] "Le nombre des faillites continue d'être très élevé et jamais les banques américaines n'ont enregistré des pertes aussi importantes que celles qu'elles essuyaient encore pendant la deuxième partie de 1983. Plusieurs d'entre elles ont dû, en conséquence, déposer leur bilan".("Le Monde de l'année économique et sociale-bilan 83", p.11).
[3] [9] Où sont-ils aujourd'hui ces fervents critiques de Marx, qui soumettaient à la critique la plus virulente la notion de paupérisation. Cela, sans jamais d'ailleurs distinguer ce qui était, dans la notion de paupérisation, paupérisation absolue ou paupérisation relative. Non seulement aujourd'hui la paupérisation relative de la classe ouvrière s'est développée de manière accrue par le développement de la productivité, mais de plus celle-ci s'ajoute et se confond par ailleurs à une paupérisation absolue qui chaque jour s'accroît sans cesse. Jamais l'histoire n'a autant donné raison à ce Marx qu'on prétend dépassé et qui déclarait : " le capitalisme est né dans le sang, la boue et les larmes, il finira dans la boue, le sang et les larmes."
[4] [10] Revue Internationale n°31,
Récent et en cours:
- Crise économique [11]
Polémique avec la CWO : comment se réapproprier les apports de la gauche communiste internationale
- 3289 lectures
L'histoire du mouvement ouvrier n'est pas seulement l'histoire des grandes batailles révolutionnaires. Lorsque des millions de prolétaires se lancent "à l'assaut du ciel", elle n'est pas seulement deux siècles de résistance permanente, de grèves, de combats inégaux et incessants pour limiter la brutalité de l'oppression du capital. L'histoire du mouvement ouvrier c'est aussi celle de ses organisations politiques, les organisations communistes. La façon dont celles-ci se sont constituées, divisées, regroupées, les débats théoriques-politiques qui les ont toujours traversées comme un sang qui nourrit la passion révolutionnaire, tout cela appartient non pas aux individus particuliers qui les constituent mais à la vie de l'ensemble de la classe. Les organisations politiques prolétariennes ne sont qu'une partie du prolétariat. Leur vie est partie de celle du prolétariat.
Comprendre la vie de la classe révolutionnaire, son histoire, son devenir historique, c'est aussi comprendre la vie des organisations communistes, leur histoire.
L'article que nous publions ci-dessous -une polémique avec la Communist Workers Organisation (CWO) a propos de l'histoire des organisations communistes entre les années 20 et les années 50 - ne répond pas à des soucis académistes d'historiens universitaires, mais à la nécessité pour les révolutionnaires de notre époque de fonder leurs orientations politiques sur le solide granit de l'expérience historique de leur classe.
Pour différentes que soient les années 80 des années 20, l'essentiel des problèmes auxquels se trouvent confrontés les combats prolétariens d'aujourd’hui est le même que pendant les années 20. La compréhension des tendances historiques du capitalisme (décadence, impérialisme), la validité pour le prolétariat des formes de combat syndicalistes ou parlementaires, des luttes de libération nationale, la dynamique de la grève de masse, le rôle des organisations révolutionnaires, toutes ces questions sont au coeur des analyses et prises de position des organisations communistes aussi bien pendant les années 20 (marquées par les révolutions russe et allemande), que pendant les années 30 (marquées par le triomphe de la contre-révolution et l'embrigadement du prolétariat), les années 40 (années de la guerre impérialiste mondiale), que pendant les années 50, au temps du début de la reconstruction.
Pour une organisation politique, ignorer les apports successifs des différents courants du mouvement ouvrier pendant ces années, ou pire, en falsifier la réalité, en déformer le contenu, en altérer l'histoire avec le dérisoire objectif de se dessiner un plus bel arbre généalogique, c'est non seulement tourner le dos à toute rigueur méthodologique -instrument indispensable de la pensée marxiste- mais c'est en outre désarmer la classe ouvrière, entraver le processus qui la conduit à se réapproprier sa propre expérience historique.
C'est à un exercice de ce style que s'est livrée la CWO dans le No 21 de sa publication théorique 9 Revolutionary Perspectives (R.P).
On y trouve un article qui se veut une critique de notre brochure consacrée à l'histoire de La Gauche Communiste d'Italie. La CWO nous avait déjà habitués à des manifestations de son manque de sérieux : pendant des années, elle dénonçait le CCI comme force contre-révolutionnaire parce que nous avons toujours affirmé qu'il y avait encore une vie prolétarienne au sein de l'Internationale Communiste au delà de 1921 (Kronstadt), jusqu'en 1926 (adoption du "socialisme dans un seul pays"). Encore dans le No 21 de R.P., la CWO accuse, avec toujours aussi peu de sérieux, le CCI de défendre des positions "euro-chauvines", ce qui, s'il y avait la moindre rigueur dans la pensée de la CWO, devrait nous exclure ipso facto du camp révolutionnaire.
C'est avec cette même légèreté irresponsable que la CWO a fait de notre brochure une lecture selon une méthode d'échantillonnage de type Gallup : on lit une page sur dix. La critique que cette lecture prétend fonder a en réalité un objectif à peine caché : minimiser sinon effacer de l'histoire du mouvement ouvrier l'apport spécifique -et irremplaçable- des groupes qui ont publié Bilan puis Internationalisme ; c'est-à-dire, éliminer de l'histoire du mouvement ouvrier les courants de la gauche communiste autres que ceux dont se réclament spécifiquement la CWO et son organisation soeur, le Parti Communiste Internationaliste (Battaglia Comunista).
L'article qui suit, en répondant, s'attache non seulement à rétablir certaines vérités historiques, mais encore à montrer comment les organisations révolutionnaires doivent envisager, comprendre, intégrer et dépasse critiquement les apports successifs de l'ensemble du mouvement communiste et plus particulièrement ceux de la Gauche Communiste Internationale.
- "Le CCI aime se présenter comme la fusion des meilleurs éléments de la gauche allemande (KAPD) et de la gauche italienne, regrettant que l'attitude sectaire de Bordiga les ait empêchés de s'unir contre l'opportunisme du Komintern (...l'idée du CCI selon laquelle seul le sectarisme empêcha la fusion entre la gauche italienne et la gauche allemande contre le Komintern et qu'une fusion similaire est nécessaire aujourd'hui pour la formation d'un nouveau parti, est sapée par leur propre dire) " (R.P. n°21).
Ces extraits montrent clairement dans quelles confusions de départ la CWO s'attache à embrouiller la motivation des différents parcours à travers lesquels s'est historiquement exprimée la Gauche communiste. D'après la CWO le CCI aurait voulu une fusion politique et organisationnelle entre la Gauche italienne et la Gauche allemande dans un front unique contre l'I.C. On ne sait vraiment pas d'où les camarades peuvent tirer une telle bêtise. Même un enfant comprendrait que proposer une telle fusion à une telle époque aurait été une folie. Ceci non seulement parce que la Gauche italienne n'aurait de son côté jamais accepté de s'unir avec une tendance qui condamnait les syndicats et le travail dans les syndicats (même si par ailleurs cette dernière préconisait un néo-syndicalisme "révolutionnaire" sous la forme des "unions") et arrivait par ailleurs sur quelques autres points à remettre parfois en cause l'importance du rôle du parti de classe. Mais aussi parce que la Gauche allemande n'aurait jamais, de son côté, accepté de s'unir à une tendance qui ne comprenait pas l'intégration des syndicats dans l'appareil d'Etat et acceptait les yeux fermés le soutien de Lénine aux luttes de libération nationale. Ce qui était à l'ordre du jour, ce n'était pas une fusion aussi impossible qu'inutile mais une bataille commune contre la dégénérescence dénoncée par les deux tendances. Pour porter en avant avec clarté cette bataille commune, les différentes forces de gauche auraient été obligées de clarifier en premier lieu leurs divergences sur des questions cruciales comme les syndicats, les luttes de libération nationale, le parti. De cette façon, ces débats fondamentaux auraient pu se faire au sein de l'I.C. et non contre l'I.C. En l'absence de ce débat l'I.C. est passée à côté des questions essentielles, proposant des réponses qui n'allaient pas au fond des problèmes et qui ne permettaient pas de se défendre contre la dégénérescence.
Avec le reflux des luttes, la Gauche allemande -qui était plus l'expression d'une profonde poussée de luttes ouvrières que d'une clarté programmatique complète- fut ultérieurement incapable de contribuer à la clarification du programme prolétarien et se transforma rapidement en une myriade de petites sectes. Ce fut la Gauche d'Italie (GI), mieux armée du point de vue théorique, essentiellement sur la nécessité et la fonction de l'organisation des révolutionnaires, qui comprit les caractéristiques de la nouvelle période et qui porta en avant ce débat en terme de bilan que l'I.C. de Lénine n'avait pas réussi à faire et qui était nécessaire pour intégrer dans une solide perspective marxiste la profonde bien qu'incomplète intuition de la Gauche allemande (GA) :
- "Le programme international du prolétariat résultera du croisement idéologique -donc de l'expérience de classe de la révolution russe et des batailles des autres pays, particulièrement de l'Allemagne et de l'Italie (...). Car il est probable, que si dans certains domaines Lénine domine Luxemburg, il est évident que dans d'autres Rosa voit plus clair que celui-ci. Le prolétariat ne s'est pas trouvé dans des conditions permettant, comme en Russie, une clarification absolue des tâches révolutionnaires, mais par contre, évoluant face au capitalisme le plus avancé d'Europe, il ne pouvait pas ne pas percevoir certains problèmes mieux et plus profondément que les bolcheviks (...). Comprendre veut dire compléter des fondements trop étroits, non traversés par l'idéologie résultant des batailles de classe dans tous les pays,les compléter par des notions liées au cours historique dans son ensemble jusqu'à la révolution mondiale. Cela, l'Internationale de Lénine ne pouvait le faire. C'est à nous qu'incombe ce travail. " ("Deux époques : en marge d'un anniversaire" Bilan n°15, janvier 1935).
Quand la CWO se rappelle que le "Réveil Communiste", petit groupe de militants italiens qui avaient rejoint les positions du KAPD, finit dans le conseillisme puis dans le néant, elle ne fait que confirmer notre thèse centrale : qu'il n'était pas possible de fondre mécaniquement 50 % de Gauche italienne et 50 % de Gauche allemande. Il s'agissait au contraire d'ancrer dans un cadre marxiste conséquent "les problèmes que le prolétariat allemand a perçus mieux et de façon plus profonde que les bolcheviks". C'est cela que Bilan s'est donné comme tâche à accomplir.
L'histoire ne se fait pas avec des si. L'incapacité des Gauches Communistes d'imposer au centre du débat de l'I.C. les différents problèmes posés par la classe ouvrière à l'entrée du capitalisme dans la phase décadente, ne peut être imputée ni à Bordiga ni à Pannekoek. Cette incapacité est plutôt le fruit de l'immaturité avec laquelle le prolétariat mondial a affronte ce premier combat décisif, immaturité dont les "erreurs" de l'avant-garde révolutionnaire sont un reflet. Une fois l'occasion passée, le travail fut fait dans de terribles conditions de reflux de la lutte, par la GI et par elle seule parce qu'elle avait une position théorique adéquate pour remplir un tel rôle. Et c'est sur cette voie, la voie de Bilan, que la GI a intégré les contributions et expériences des différentes Gauches Communistes pour parvenir à "l'élaboration d'une idéologie politique de gauche internationale" ("Lettre de Bordiga à Korsch", , 1926). C'est grâce à ce travail de synthèse historique que la GI a réussi à "compléter des fondements trop étroits" et à tracer les grandes lignes du programme de la Gauche Communiste Internationale (GCI), valables encore aujourd'hui pour le prolétariat de tous les pays. L'accusation que la CWO nous porte (de vouloir aujourd'hui fusionner les différentes gauches) ne montre pas seulement son incapacité à distinguer une "gauche historique" d'une union mécanique, mais montre surtout son incapacité congénitale à comprendre que ce travail a déjà été fait et que ne pas en tenir compte signifie retourner en arrière de 60 ans. La conséquence est qu'hier la CWO ne réussissait pas à aller au delà des positions de la Gauche allemande des années 30 et qu'aujourd'hui elle retourne aux positions de la GI des années 20 et plus en arrière encore à celles de Lénine. Les positions changent, la régression reste.
Des années 30 aux années 40 : maintenir la barque dans la tempête
- "En fait pour le CCI,la GI est assimilée à une période d'exil, et c'est dans cette période que les vraies leçons de la vague révolutionnaire auraient été tirées. Quel point de vue pessimiste ! On rejette les périodes pendant lesquelles les idées communistes s'emparent des masses alors que l'on idéalise la période de défaite. Mais cette idéalisation de Bilan est déplacée. Il est certain que ces camarades ont fait des contributions importantes au programme communiste (...) mais ce serait stupide de nier les faiblesses de Bilan (...) sur la question des perspectives, le manque de bases économiques marxistes claires (Bilan était luxemburgiste) les a conduits à des visions erratiques et erronées sur le cours historique. Soutenant que la production d'armes était une solution à la crise capitaliste, ils n'ont pas compris le besoin d'une autre guerre impérialiste. (...) Bilan s'est dissout dans la revue Octobre en 1939 et la Fraction a formé un Bureau International pensant que la révolution prolétarienne était à l'ordre du jour ; ainsi, ils furent totalement bouleversés quand la guerre éclata en 1939, conduisant à la dissolution de la Fraction dans son ensemble. Le CCI essaie de nier que tel était le point de vue de Bilan." (R.P n°21, p.30-31).
Ces extraits posent trois types de problèmes :
- 1) notre "idéalisation" de Bilan ;
- 2) le rôle des révolutionnaires dans les périodes de contre-révolution ;
- 3) la "faillite" finale de la Fraction Italienne à l'étranger.
Procédons par ordre. Premièrement, liquidons cette idée selon laquelle nous idéalisons Bilan : "Bilan n'avait pas la prétention stupide d'avoir apporté une réponse définitive à tous les problèmes de la révolution. Il avait conscience de balbutier souvent, il savait que les réponses définitives ne peuvent être que le résultat de l'expérience vivante de la lutte de classe, de la confrontation et de la discussion Sur bien des questions, la réponse donnée par Bilan restait insuffisante... Il ne s'agit pas de rendre hommage à ce petit groupe..., mais encore d'assimiler ce qu'il nous a légué en faisant nôtre son enseignement et son exemple, et de poursuivre cet effort avec une continuité qui n'est pas une stagnation, mais un dépassement." (Introduction aux textes de Bilan sur la Guerre d'Espagne, Revue Internationale n° 4 1976).
Telle a toujours été notre position. Il est vrai que dans ces années-là la CWO nous définissait comme contre-révolutionnaires justement parce que nous défendions la Gauche italienne aussi au-delà de 1921, année choisie par eux comme date magique au-delà de laquelle l'I.C. devenait réactionnaire. Ceci peut expliquer le peu d'attention avec laquelle la CWO lit aussi bien les textes de Bilan que nous avons republiés que nos introductions.
Passons au second point. Nous ne préférons pas les périodes de défaite à celles de lutte ouverte du prolétariat, mais nous ne nous réfugions pas derrière une telle banalité pour occulter le fait historique essentiel, à savoir que dans les années de la vague révolutionnaire, l'I.C. n'a pas réussi à faire tout le travail de clarification des nouvelles frontières de classe du programme prolétarien. Ce travail, pour l'essentiel, est revenu aux minorités révolutionnaires qui ont survécu à la dégénérescence. Il est sûr que nous aurions aimé aussi que cette synthèse fût faite quand les prolétaires allemands descendaient en armes dans les rues de Berlin, ceci non seulement parce qu'elle aurait été mieux faite, mais parce que cela aurait probablement donné une issue tout autre à la première vague révolutionnaire du prolétariat mondial. Malheureusement, l'histoire ne se fait pas avec des si et ce travail revint principalement à Bilan.
Si nous insistons tant sur le travail de la Fraction Italienne à l'étranger, ce n'est pas parce que nous préférons les années 30 aux années 20, mais parce que les groupes qui devraient en être les "continuateurs" (le PCInt artificiellement constitué à la fin de la guerre) l'ont recouverte d'un mur de silence, permettant ainsi qu'elle soit rayée de la mémoire historique du mouvement ouvrier. Si on regarde la presse de tous les groupes qui se réclament de la Gauche italienne (y compris Battaglia) on ne peut que rester stupéfait du fait qu'au cours de quarante années "le nombre d'articles repris de Bilan peut se compter sur les doigts d'une seule main" (Revue Internationale No 4). Encore aujourd'hui, après que le CCI en ait publié des centaines de pages en différentes langues auxquelles s'ajoute une étude critique de plus de deux cents pages, quelques uns de ces groupes continuent à faire semblant d'ignorer l'existence même de Bilan. Il faut donc a juste titre dire qu'il s'agit de la "politique de l'autruche" et que nous avions pleinement raison d'insister sur cela. Une fois clarifiés ces détails, il reste une question de fond, que la CWO dans son article n'a pas saisie : comment expliquer qu'une telle contribution au programme prolétarien ait été élaborée dans les années de défaite et de recul général et profond du mouvement autonome de classe ?
Dans la logique de la CWO il ne peut y avoir que deux réponses :
- soit nier ou minimiser la contribution théorique de la Fraction italienne de la Gauche communiste du fait que son travail s'est fait dans une période de défaite et dans un cours vers la guerre, c'est ce que font couramment la CWO et Battaglia, ainsi que le PCInt (Programme communiste) ;
- soit reconnaître cette contribution comme illustration de l'idée que la conscience communiste ne naît pas des luttes, mais de l'organisation révolutionnaire qui, nécessairement, doit l'introduire de l'extérieur au sein de la classe ouvrière.
De telles réponses n'expliquent rien et montrent seulement une conception mécanique de l'influence de la lutte de classe sur la réflexion des minorités révolutionnaires. Avec une telle conception, l'unique expérience sur laquelle Bilan aurait pu compter ce sont les défaites des années 30. Mais les origines de Bilan ne se trouvent pas dans les années 30. Elles se trouvent "à l'époque où les idées communistes s'emparaient des masses". Ses militants ne se sont pas formés à la queue des Fronts Populaires, mais à la tête des mouvements révolutionnaires de masse des années 20. Ce qui permet à Bilan de continuer à contre-courant l'approfondissement des positions révolutionnaires, c'est la confiance inébranlable dans la capacité révolutionnaire de la classe ouvrière, confiance acquise non à travers quelques lectures mais dans la participation de militants à la plus grande tentative de cette classe d'instaurer une société sans classes. De ce point de vue, le travail théorique des fractions de gauche n'est absolument pas indépendant ou séparé des expériences historiques des masses prolétariennes. Non seulement le travail de Bilan se fait sous la poussée de la vague révolutionnaire précédente, mais il n'aurait aucun sens en dehors de la perspective d'une nouvelle vague. La preuve a contrario de l'influence très étroite mais non immédiatiste que le mouvement de classe exerce sur la réflexion des révolutionnaires nous est donnée par le fait que la plus grande stagnation des minorités révolutionnaires n'a pas lieu dans les années 30, mais dans les années 50, parce que la bourgeoisie avait réussi à terminer la seconde guerre mondiale sans qu'il y ait eu surgissement d'une nouvelle vague révolutionnaire et que la poussée de la vague précédente était érodée par trente années de contre-révolution.
Nous nous rendons compte qu'une telle conception de l'approfondissement de la conscience de classe, à travers un parcours complexe, non rectiligne, parfois hésitant, est dur à digérer ; mais c'est la seule conception fidèle à la méthode marxiste qui la sous-tend. Il est sans doute plus simple d'imaginer que le parti élabore par lui-même, de son côté, un beau programme tout propre et que, quand le moment arrive, il l'envoie à la classe ouvrière comme une lettre à la poste. Rêver ne coûte rien.
Il reste la dernière question, celle de la faillite de la Fraction du fait de la théorie de Vercesi sur l'économie de guerre qui rendait inutile une nouvelle guerre impérialiste. En premier lieu, nous notons qu'il s'agit d'une nouvelle orientation développée de 1937 à 1939 et qui contredisait toute la perspective affirmée depuis 1928 d'un rapport de force défavorable au prolétariat et s'orientant vers un nouveau conflit mondial. En second lieu, cette position n'était pas la seule existante dans la Gauche Communiste Internationale. Cette analyse fut violemment critiquée par une majorité de la Fraction belge et par une importante minorité de la Fraction italienne. Le résultat de cette bataille fut qu'avec l'éclatement de la guerre la Fraction ne s'est pas dissoute définitivement, comme cherche a le faire croire la CWO, mais fut reconstituée par la minorité regroupée à Marseille, dans le sud de la France non occupé par les Allemands. Le travail s'est poursuivi régulièrement pendant toute la guerre avec une systématisation et un approfondissement remarquables des positions programmatiques. A partir de 1941, se tinrent des conférences annuelles dont sortit entre autres, la condamnation des théories révisionnistes de Vercesi sur l'économie de guerre ("Déclaration politique", mai 1944). Quand la Fraction apprit que le déboussolement de Vercesi avait fini par le conduire à participer à un comité anti-fasciste à Bruxelles, elle réagit immédiatement en l'expulsant pour indignité politique ("Résolution sur le cas Vercesi", janvier 1945). Comme on le voit, la Fraction n'a pas cessé le travail en suivant Vercesi mais l'a poursuivi en expulsant celui-ci.
Notons au passage que la CWO fait la nième pathétique tentative de soutenir une de ses idées fixes, à savoir que ceux qui, comme le CCI, défendent la théorie économique de Luxemburg sur la saturation des marchés ne peuvent maintenir une ligne politique révolutionnaire. Mettons alors au clair que Bilan n'était pas luxemburgiste, au sens strict, mais se limitait surtout à accepter les conséquences politiques des analyses économiques de Rosa (rejet des luttes de libération nationale, etc.). Ce n'est pas un hasard si la défense de ces analyses économiques revient pour une grande part à des camarades provenant d'autres groupes révolutionnaires, comme Mitchell (ex-Ligue des Communistes Internationalistes) ou Marco (ex-Union Communiste). Le luxemburgiste Mitchell sera le chef de file de la critique aux théories révisionnistes de Vercesi avant la guerre, et ce sera le luxemburgiste Marco qui, pendant la guerre, corrigera les points les plus faibles de l'analyse économique de Rosa. Que démontre cela ? Que seuls des luxemburgistes peuvent être des marxistes cohérents? Non, comme le prouve la présence de camarades non luxemburgistes à côté de Mitchell et de Marco. Alors ? Alors, cela montre que la CWO doit arrêter de cacher des faits essentiels derrière des questions secondaires.
Et ceci nous amène au fait essentiel, à savoir que la CWO dans son compte-rendu a carrément fait disparaître six années d'existence de la Fraction (et quelles années : celles de la guerre impérialiste). De façon significative, la même opération désinvolte fut faite par Programma Comunista quand il fut finalement contraint de parler de la Fraction, provoquant de notre part la réponse qu'aujourd'hui nous adressons à la CWO :
- "L'article parle de l'activité de la Fraction de 30 à 40. Passant complètement sous silence son existence et activité entre 1940 et 1945, date de sa dissolution. Est-ce par simple ignorance ou pour s'éviter d'être obligé de faire une comparaison entre les positions défendues par la Fraction pendant la guerre et celles du PCInt constitué en 1943-44 ?" (Revue Internationale No 32, 1983).
Etant donné que notre étude sur la GI consacre pour le moins 17 pages à l'activité de la Fraction entre 1939 et 45, ce n'est pas d'ignorance qu'il faut accuser la CWO, mais de cécité. Pour la CWO aussi, il s'agit de la politique de l'autruche.
Des années 40 aux années 50 :
UN PAS EN AVANT, DEUX PAS EN ARRIERE.
"Le CCI présente la formation du PCInt comme une régression par rapport à Bilan, idéalisé dans leur presse. Mais pourquoi était-ce un pas en arrière? Selon le rédacteur, 'la gauche italienne avait dégénéré profondément après 1945, jusqu'à se fossiliser complètement', (p. 186). Mais était-ce réellement une fossilisation que d'engager des milliers de travailleurs dans la politique révolutionnaire après les grandes grèves de 1943 ? Et que dire de la plateforme du Parti, publiée en 52? Représentait-elle un pas en arrière ? (...) Et sur la guerre après les confusions et prévarications de Bilan, les positions (du PCInt) constituaient sans aucun doute un pas en avant, (...) en avance sur les théories sur la disparition du prolétariat durant la guerre impérialiste". (Revolutionary Perspectives, n°21, p.31).
- "Quand le 'PCInt fut formé en 1943, les ancêtres du CCI (Internationalisme) refusaient de s'y joindre non seulement parce qu'ils pensaient que les bases théoriques du nouveau Parti étaient peu solides mais aussi parce qu'ils (.. .) croyaient qu'une nouvelle guerre allait éclater à cette époque et concluaient qu'il n'y avait rien à faire '.Quand le capitalisme 'termine' une guerre impérialiste qui a duré 6 ans sans qu'explose aucun surgissement révolutionnaire, cela signifie la défaite du prolétariat". (Internationalisme 1946) (R.P n°20, p.35). "En fait, la Fraction française, qui publiait Internationalisme, fut exclue de la Gauche Communiste pour avoir publié un tract commun avec deux groupes trotskystes français pour le 1er mai 1945.. .." {R.P., No 21, p.31).
Au lieu de procéder par argumentation politique, la CWO semble adopter la technique des spots publicitaires, dans lesquels la propreté des draps lavés avec une super lessive se démontre en les plaçant à côté de draps sales lavés avec une lessive ordinaire. Que prend-on comme point de référence pour déterminer si le PCInt représente un pas en avant ou un pas en arrière ? La théorie révisionniste de Vercesi qui en arrivait à nier toute activité révolutionnaire pendant la guerre, étant donnée "l'inexistence sociale" du prolétariat ! Qu'offre-t-on comme seule alternative ? Un petit groupe qui flirte avec les trotskystes, qui déclare inutile toute activité révolutionnaire et, dans les faits, suspend ses publications en 52 ! Face à ce désolant tableau de "nuit noire", il est trop facile de faire paraître les positions du PCInt brillantes de clarté.
Mais combien de falsifications et d'omissions ont été nécessaires pour faire ce spot publicitaire ? Pour mettre en avant l'activité du PCInt à partir du milieu de la guerre, ils font disparaître 6 années d'activité de la Fraction italienne à partir du début de la guerre et jusqu'à sa conclusion. On identifie la Gauche italienne avec les dernières positions de Vercesi, alors qu'au cours de la guerre, la tendance Vercesi fut d'abord combattue, puis condamnée, enfin expulsée. Toujours dans le but d'effacer toute l'activité de la Gauche Communiste Internationale durant la guerre, on porte ensuite l'attaque la plus féroce contre la Gauche Communiste de France (constituée à partir de 1942) qui fut la plus ardente à soutenir cette activité et la lutte contre Vercesi. Ici, la CWO n'a pas honte d'utiliser les mêmes falsifications que Vercesi, responsable du travail international du PCInt à partir de 1945, pour exclure cette tendance combative de la Gauche Communiste Internationale.
En réalité le RKD allemand et les CR français ([1] [12]), les deux groupes prolétariens avec lesquels Internationalisme diffuse un appel à la fraternisation prolétarienne, rédigé en plusieurs langues, avaient déjà rompu en 1941 avec le trotskysme et maintenu une attitude internationaliste pendant la guerre, comme le prouve totalement la documentation dans la brochure aux pages 153 et 154. Quant au soi-disant refus de toute activité de la part d'Internationalisme après 1945, la CWO devrait nous expliquer comment est-ce possible que la seule force de la gauche communiste présente dans la fameuse grève sauvage de 1947 à Renault et dans son comité de grève, ce fut précisément la Gauche Communiste de France, tandis que la fraction française "bis", liée au PCInt, brillait par son total désintérêt envers le seul mouvement significatif du prolétariat dans le second après-guerre. Même sans se faire d'illusions sur une quelconque possibilité de révolution, les camarades d'Internationalisme n'ont jamais manqué à leurs tâches de militants communistes. C'est ainsi que la GCF a participé activement à la Conférence Internationale de 1947 convoquée par la gauche hollandaise, a publié 12 numéros du journal mensuel "L'Etincelle" et 48 numéros de sa revue "Internationalisme". Sa dissolution en 1952 avait pour raison la dispersion extrême de ses membres (La Réunion, Amérique du Sud, Etats-Unis, Paris où très peu de membres étaient restés), ce qui rendit matériellement impossible la continuation de son existence et la poursuite de son activité.
En vérité, il n'est ni intéressant, ni utile de suivre la CWO dans toutes ses contorsions. Dans R.P n°20, on cite la reconnaissance de "positions claires envers les partisans" du PCInt, faite par nous à la page 170 de la brochure, pour démontrer que, quand nous parlons de déboussolement du PCInt vis-à-vis des partisans, nous mentons en sachant que nous mentons. Mais pourquoi la CWO ne cite-t-elle pas aussi la page 171, où nous montrons le changement de ligne opéré en 1944 et la page 177 ou un dirigeant du PCInt reconnaît à quels désastreux résultats a abouti, en 1945, ce changement ? La CWO ne lit-elle qu'une page sur 10 ? Il est en tout cas certain qu'elle choisit soigneusement chaque page à lire et à citer... Mais cela ne suffit pas. Dans R.P n°21, on cite les discussions d'Internationalisme avec "Socialisme ou Barbarie" comme preuve de son caractère opportuniste. Dans le numéro précédent de R.P, on présentait par contre les discussions de Battaglia Comunista avec Socialisme ou Barbarie comme une preuve du caractère "vivant et non sectaire" de B.C. La même action est utilisée comme preuve d'esprit révolutionnaire lorsqu'elle est le fait de B.C, et comme preuve d'esprit éclectique lorsqu'elle est le fait d'Internationalisme ! Comment répondre sérieusement à de tels arguments ?
Nous n'idéalisons pas plus Internationalisme que Bilan. Nous savons bien combien il a "balbutié" dans son effort permanent de clarification des positions de classe. C'est pour cela que nous ne nous limitons pas à nous les remémorer, mais essayons de les approfondir, sans avoir peur de les dépasser de façon critique, quand c'est nécessaire. Cela ne nous embarrasse nullement de reconnaître que certaines de ces erreurs, qui ont conduit à la dispersion géographique des militants ont contribué à rendre impossible le maintien d'une presse régulière, ce qui fut un grave coup pour l'ensemble du milieu révolutionnaire. La CWO pense au contraire que l'arrêt des publications en 1952 était simplement la démonstration définitive du manque de sérieux d'Internationalisme. En procédant ainsi, la CWO donne le bâton pour se faire battre. La CWO devrait en fait nous expliquer comment et pourquoi la fraction belge et la fraction 'française-Bis’, liée au PCInt, ont suspendu leurs publications dès 1949 (et donc 3 ans avant Internationalisme) sans que le parti italien "fort de milliers de militants" ait remué le petit doigt pour l'empêcher? Comment est-il possible qu'un petit groupe, qui ne pensait à autre chose qu'à s'échapper en Amérique du Sud, ait réussi à résister à contre courant pendant des années, alors que les représentants du PCInt à l'étranger avaient déjà jeté l'éponge ? A la CWO de répondre... En attendant que la CWO s'interroge sur ces "mystérieux" événements, revenons au problème essentiel: le PCInt est-il, oui ou non, une régression par rapport à la Fraction à l'étranger ? Nous avons déjà vu que la Fraction à l'étranger est restée active jusqu'en 1945, clarifiant ultérieurement de nombreux problèmes laissés en suspens par Bilan (par exemple, la nature contre révolutionnaire, capitaliste et impérialiste de l'Etat russe). Nous avons aussi vu comment la Gauche Communiste de France s'est constituée dans la poussée du dernier grand effort de la Fraction italienne, comment elle en a été partie active et le prolongement après la dissolution de la Fraction italienne. Passons maintenant à l'examen de l'autre élément de la comparaison : le PCInt fondé en Italie en 1943.
A première vue, on ne peut que rester abasourdi par la présentation qu'en fait la CWO : non seulement les positions du PCInt étaient parfaitement claires - voir la plateforme de 1952 - mais, en outre, il disposait de milliers d'adhérents ouvriers. Cela apparaît évidemment comme un beau pas en avant par rapport aux "balbutiements" de quelques dizaines d'émigrés à l'étranger ! Mais pour peu qu'on examine ce "pas" avec attention, on remarque immédiatement les premières notes discordantes : pourquoi écrire une plateforme seulement en 1952 alors que le PCInt avait été fondé 10 ans auparavant et que dès 1949 il avait perdu tout suivi de masse ? Cette plateforme n’arrive-t-elle pas un peu en retard ? Qui plus est, la plateforme de 1952 n'existait évidemment pas en 1943 : sur quelle base ont donc adhéré ces "milliers d'ouvriers" ? La réponse est simple. Sur la base de la plateforme du PC Internationaliste écrite par Bordiga en 1945 et diffusée en 1946 par le parti à l'étranger dans une édition française avec une introduction politique de Vercesi ([2] [13]). Cette plateforme n'était claire ni sur la nature capitaliste de l'Etat russe, ni sur les "mouvements partisans" ; elle affirmait, par contre, très clairement que "la politique programmatique du Parti est celle développée... dans les textes constitutifs de l'Internationale de Moscou" et que "le Parti aspire à la reconstitution de la confédération syndicale unitaire". C'est sur la base de ces positions qui constituaient un retour pur et simple à l'Internationale Communiste des années 20, qu'il a été possible d'enrôler "des milliers d'ouvriers", puis plus tard, de les perdre dans la nature. Il s'agissait d'un double pas en arrière, non seulement par rapport aux conclusions tirées par la Fraction dans sa période finale (1939-45), mais même par rapport aux positions de la Fraction dans sa première période (1928-30). Le poids de milliers de nouveaux adhérents, enthousiastes, certes, mais très peu formés, entrava puissamment les efforts de vieux militants qui n'avaient pas oublié le travail de la Fraction. Ainsi, Stefanini, qui, à la Conférence Nationale de décembre 1945 défendit une position anti-syndicale analogue à celle d'Internationalisme ; ainsi, Danielis qui, au Congrès de 1948 devait amèrement reconnaître : "On peut se demander s'il y a vraiment eu une soudure idéologique entre le Parti et la Fraction à l'étranger ; au Congrès de Bruxelles de la Fraction, on nous avait assuré que les matériaux théoriques étaient régulièrement envoyés en Italie" (compte-rendu du 1er Congrès du PCInt, p.20). A travers ces paroles de désillusion d'un dirigeant du Parti même, on peut mesurer l'ampleur du pas en arrière fait pas le PCInt, au regard des apports théoriques de la Fraction.
Il reste une dernière question, à savoir comment situer la plateforme sur laquelle, en 1952, la tendance Damen (Battaglia Comunista) se sépare définitivement de celle de Bordiga, qui devait constituer Programme Communiste aujourd'hui en déroute ?
Il suffit d'un coup d'oeil pour comprendre que les positions centrales de cette plateforme (dictature de la classe et non du Parti, impossibilité de récupération des syndicats, rejet des luttes nationales) représentent un évident pas en avant par rapport à la plateforme de 1945. Nous avons toujours affirmé ceci avec le maximum de clarté, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui. LE PROBLEME, C'EST QU’UN PAS EN AVANT NE SUFFIT PAS APRES DEUX PAS EN ARRIERE. De plus, après 7 ans d'affrontements de tendance à l'intérieur du PCInt, on pouvait s'attendre à des progrès substantiels dans la clarté des termes puisque les formulations encore "ouvertes" en 42 ne l'étaient plus 10 ans après. Au lieu de ces pas en avant, sur tous les terrains abordés, B.C fait des petits pas en avant, et puis s'arrête à mi-chemin sans conclure réellement (dictature exercée par la classe et non par le Parti, MAIS c'est le Parti qui organise et dirige la classe comme un état-major ; les syndicats ne sont pas récupérables, MAIS on peut travailler dedans ; le parlementarisme révolutionnaire est impossible, MAIS le Parti ne peut exclure l'utilisation tactique des élections, et ainsi de suite)
Sa plateforme de 1952 fait davantage penser à une vision ultra-extrêmiste des thèses dé l'Internanationale qu'à une synthèse effective du travail effectué jusqu'alors par la GCI. Certes, elle constituait une bonne base de départ pour rattraper le retard accumulé du fait de l'incohérence des bases théoriques de 1943-45. Cependant, le poids du cycle contre-révolutionnaire, qui atteignait en ces années son maximum, empêcha BC de faire des pas substantiels en avant, même si quelques unes des naïvetés les plus grandes ont été récemment éliminées (cf. par exemple, la transformation des "Groupes syndicaux internationalistes" en "Groupes d'usines internationalistes"). S'il suffisait d'éliminer le terme "syndical" pour éliminer les ambiguïtés sur le syndicat, tout serait réglé... Ce qui constituait en 1952 des obstacles inachevés à la pénétration opportuniste, risque aujourd'hui de devenir une espèce de passoire à travers laquelle tout peut se glisser, comme l'a montré la récente mésaventure de BC avec les nationalistes de l'UCI iranien.
Les années 80 ne sont pas les années 30.
- "Le CCI aimait à se présenter comme la fusion des meilleurs éléments des gauches allemande et italienne (...). Bien que le CCI y voie une vertu, la nature a horreur du déséquilibre. Il ne peut y avoir de fusion éclectique entre des traditions politiques dissemblables. Aujourd'hui, les révolutionnaires doivent se placer fermement sur le terrain de la gauche italienne, corrigeant ses erreurs avec ses propres armes, la dialectique marxiste." (Revolutionary Perspectives n°21, p.30).
Dans un article récent, nous avons cherché à montrer comment B.C et la CWO, avec leur vision d'une contre-révolution encore active, n'arrivaient pas à comprendre la différence entre aujourd'hui et les années 30 du point de vue des rapports de force entre les classes. Dans cette conclusion, nous chercherons à montrer comment ce n'est pas seulement "sur ce terrain que B.C et la CWO se présentent avec plus de 40 années de retard" (Revue Internationale n°36, p.19). La CWO nous accuse de faire de l'éclectisme entre gauche allemande et italienne, soutenant qu'elles ne peuvent pas "fusionner". Mais nous sommes parfaitement d'accord sur ce point. L'involution théorique de "Réveil Communiste" dans les années 30 [et du Groupe Communiste Internationaliste (GCI) plus récemment] le démontre de manière irrévocable. Ce qui était, par contre, possible, c'était de passer ensemble "au crible de la critique la plus intense" (Bilan n°1) l'expérience accumulée par le prolétariat de tous les pays dans la première vague révolutionnaire, pour arriver, à travers des années de travail à une "synthèse historique" (Bilan n°15).
La DONNEE DE FAIT qui ne peut être niée, c'est que cette synthèse historique a été faite, principalement sous l'impulsion et par le travail de la gauche italienne, et qu'elle constitue le point de référence de toute prise de position aujourd'hui. Choisir entre la gauche italienne, la gauche allemande ou un cocktail des deux, c'est dans tous les cas un choix privé de sens parce que ces deux tendances, du point de vue du mouvement historique de la classe, n'existent plus. Le travail de synthèse historique accompli par la Fraction a permis "l'élaboration d'une idéologie politique de gauche internationale" réclamée par Bordiga en 1926. En conséquence, l'unique gauche communiste dont nous pouvons nous sentir partie prenante est la Gauche Communiste Internationale, constituée sur la base de ce travail. Cette acceptation constitue l'unique paramètre acceptable de nos jours. Le CCI, qui s'est constitué sur la base de ce travail et qui a largement contribué à le faire connaître, a clairement choisi. Avec autant d'esprit de décision mais avec une clarté moindre, Programme Communiste a rejeté ce travail, revenant aux positions de base des années 20. Comme nous l'avons vu, B.C (et la CWO) n'arrive pas à se déterminer clairement. Face au choix d'aujourd'hui : se baser sur les pas faits en avant par la Fraction italienne, belge et française ou se baser sur la régression du PCInt, ces camarades restent à mi-chemin de façon éclectique. "Le problème avec B.C, c'est que sa réponse à notre Adresse, comme ses positions politiques, est insaisissable. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. (. . ) Si Programma a une cohérence dans ses erreurs, Battaglia a ses erreurs dans l'incohérence " (Revue Internationale n°36).
La CWO soutient que tout groupe pratiquant l'éclectisme sur les questions fondamentales finit par se déséquilibrer définitivement et mettre ainsi en cause également les pas en avant déjà faits. Nous acceptons sans réserve ce jugement qui est d'autre part confirmé par les faits : le CCI, à une dizaine d'années de sa fondation, n'a altéré aucun de ses points programmatiques de départ ; la CWO, à partir du moment où elle s'est approchée des positions éclectiques de B.C, a retourné comme un gant sa propre plateforme, abandonnant une par une les avancées de la gauche internationale en se retournant vers le léninisme des années 20 sur toutes les questions fondamentales. Avant que ce processus ne devienne irréversible, il serait bon que les camarades de la CWO se rappellent qu'à l'époque actuelle le soi-disant "léninisme", n'ayant plus rien à voir avec l'oeuvre révolutionnaire de Lénine, est seulement une des idéologies contre-révolutionnaires de la gauche du capital.
BEYLE.
[1] [14] Les RKD (Communistes Révolutionnaires d'Allemagne) les CR (Communistes Révolutionnaires) cf. Revue Internationale No 32, p.24, notes
[2] [15] CWO nous reproche amèrement et longuement d’avoir employé dans un article n°32 de la Revue Internationale, le terme de « Bordiguiste » pour qualifier Battaglia Communista et la CWO. Nous voulons bien reconnaître qu’il y avait de notre part un manque de précision qui peut introduire des confusions. Cependant, CWO ne fait que se servir d’une virgule mal placée pour escamoter le débat de fond. Car, premièrement, jusqu’en 1952,la tendance qui allait devenir B.C. se réclame de cette plate-forme de Bordiga. Deuxièmement, parce que les critiques de B.C. à Bordiga, dont CWO se réclame, restent toujours ambiguë, à mi-chemin.
Courants politiques:
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire : le Communistenbond Spartacus et le courant conseilliste 1942-1948, II
- 4973 lectures
Dans la première partie de cet article (cf. Revue Internationale n°38) consacré à l'histoire de la gauche hollandaise, nous avons montré l'évolution du Communistenbond Spartacus, issu d'un mouvement situé à la droite du trotskisme dans les années 30, vers des positions révolutionnaires, lui conférant entre 1942 et 1945 - malgré de nombreuses confusions théoriques tant sur la période historique du second après-guerre que sur la nature de l'URSS, les luttes de libération nationale etc..- une lourde responsabilité politique au niveau international dans le regroupement des révolutionnaires en Europe occidentale.
Première organisation révolutionnaire en Hollande, et consciente de cette responsabilité, le Communistenbond, en proclamant en décembre 45 la nécessité du parti international du prolétariat comme facteur actif dans le processus d'homogénéisation de la conscience de classe, était, alors, encore loin des conceptions ouvertement conseillistes qu'il va développer à partir de 1947. Conceptions qui, de régression théorique en régression théorique, vont progressivement 1'acheminer vers le conseillisme achevé : rejet de 1'expérience prolétarienne du passé - notamment de 1'expérience de la révolution russe -, abandon de toute idée d'organisation politique, négation de toute distinction entre communistes et prolétaires, tendance à1'ouvriérisme et à 1'immédiatisme, chaque grève étant considérée comme "une révolution en petit".
Cette 2ème partie s'attachera à analyser les différentes étapes de la dégénérescence du courant conseilliste (dont les germes étaient déjà contenus dans les positions du Communistenbond en 45) qui conduira à sa disparition dans les années 70, pour ne laisser aujourd'hui que des épigones, dont le groupe Daad en Gedach se rattachant au courant libertaire anti-parti.
Il était inévitable que l'orientation du Bond vers une organisation centralisée et que l'importance accordée à la réflexion théorique - sous forme de débats et de cours de formation - ne satisfassent pas les éléments les plus activistes du Bond. Ceux-ci, autour de Toon van den Berg, gardaient le vieil esprit syndicaliste-révolutionnaire du NAS. Très présents dans le milieu prolétarien de Rotterdam, lors des grèves du port, ils avaient contribué à la construction d'un petit syndicat, l'EVB (Union syndicale unitaire), né de la lutte. Il est symptomatique que le Bond - lors de son congrès des 24-26 décembre 1945 - acceptât de travailler dans l'EVB. Condamnant l'activité de l'organisation dans les syndicats, appendices de l'Etat, sa position sur les syndicats restait théorique. En quittant le Bond, Toon van den Berg et ceux qui le soutenaient allaient jusqu'au bout dans la logique d'une participation "tactique" à de petits syndicats indépendants. ([1] [20])
Le Bond se trouvait dans une phase de réappropriation des positions politiques du GIC. Et à tâtonnements, il dégageait peu à peu, de façon plus ou moins claire, ses positions politiques et théoriques propres.
D'autre part, la centralisation que requérait ce travail politique heurtait les éléments anarchisants du Bond. C'est à propos du journal hebdomadaire "Spartacus" que se développa un grave conflit dans l'organisation. Certains - soutenus par une partie de la rédaction finale (Eind-redactie) - qui était la Commission de rédaction -trouvaient que le style du journal était "un style journalistique" ([2] [21]). Ils voulaient que le journal soit le produit de tous les membres et non d'un organe politique. Le conflit connut son point le plus haut en mars 1946, lorsqu'un clivage se fit entre la Commission politique, dont Stan Poppe était le secrétaire, et la Commission de Rédaction finale. Il en ressortit que "la Rédaction finale est soumise à la commission politique" ([3] [22]) dans le choix politique des articles, mais non dans le style laissé à l'appréciation de la Rédaction. La commission politique défendait le principe du centralisme par un travail commun entre les deux organes. La Rédaction finale pensait que son mandat était valable uniquement devant l'assemblée des membres du Bond. Elle s'appuyait sur les jeunes qui voulaient que le journal soit l'expression de tous alors que la majorité de la Commission politique et en particulier Stan Poppe, défendait le principe d'un contrôle politique des articles par un organe ; en conséquence, la Rédaction ne pouvait être qu'une "subdivision" de la Commission politique. La participation des membres à la rédaction se faisait selon le principe de la "démocratie ouvrière" qui prévalait dans les organisations de "vieux style" ([4] [23]). Il ne s'agissait pas d'une"politique de compromis", comme l'en accusaient la majorité de la rédaction et des membres à Amsterdam, mais d'une question pratique de travail commun entre les deux organismes, s'appuyant sur le contrôle et la participation de tous les membres du Bond.
Ce débat confus, où se mêlaient des antagonismes personnels et des particularismes de commissions, ne faisait que porter au grand jour la question de la centralisation. La non-distinction au départ entre Rédaction intégrée dans la commission politique et cette dernière n'avait fait qu'envenimer les choses. Cette grave crise du Bond se traduisait par le départ de plusieurs militants, et loin de triompher la centralisation du Bond devint de plus en plus vague au cours de l'année 1946.
Mais dans les faits, le départ des éléments les moins clairs du Bond, ou les plus activistes, renforçait la clarté politique du Bond qui se démarquait plus nettement du milieu politique ambiant. Ainsi -à l'été 1946 - des membres du Bond qui votaient dans les élections pour le PC le quittèrent. Il en fut de même des membres de la section de Deventer qui avaient pris contact avec les trotskystes du CRM pour faire un travail "entriste" dans le Parti communiste néerlandais. ([5] [24])
Ces crises et ces départs étaient en fait une crise de croissance du Communistenbond, qui en"s'épurant" gagnait en clarté politique.
En 1945-1946, sont examinées plusieurs questions théoriques, sur lesquelles le Bond était resté flou pendant sa période de clandestinité : les questions russe, nationale, syndicale. Celles des conseils ouvriers, de la lutte de classe dans l'après-guerre, de la barbarie et de la science, de la caractérisation de la période suivant la Deuxième Guerre mondiale étaient abordées à la lumière de l'apport de Pannekoek.
1) La question russe
La nature de l'Etat russe n'avait pas été vraiment abordée par le Bond, à sa naissance. Les conférences tenues en 1945 et la publication d'un, article théorique sur la question permirent une prise de position sans ambiguïté ([6] [25]). Cet article, tout en rendant hommage à la position de défaitisme révolutionnaire du MLL Front lors de la guerre germano-russe en 1941, notait que "seulement à l'égard de l'Union soviétique, leur attitude était encore hésitante". Cette hésitation était en fait celle du Bond en 1942-1944. Ce n'était plus le cas en 1945.
Les révolutionnaires, notait le rédacteur de l'article, ont eu des difficultés énormes à reconnaître la transformation de la Russie soviétique en un Etat impérialiste comme les autres :
"On ne pouvait et on ne voulait pas croire que la Russie révolutionnaire de 1917 s'était transformée en une puissance semblable aux autres pays capitalistes."
Il est intéressant de noter ici que le Bond, à la différence du GIC des années 30, ne définit pas la Révolution russe comme une "révolution bourgeoise". Il essaye de comprendre les étapes de la transformation de la révolution en contre-révolution. Comme la Gauche Italienne "Bilan"), il voit le processus contre-révolutionnaire surtout dans la politique extérieure de l'Etat russe, qui marque son intégration dans le monde capitaliste. Ce processus se développe par étapes : Rapallo en 1922 ; l'alliance du Komintern avec le Kuomintang en Chine; l'entrée de l'URSS dans la SDN en 1929. Cependant, le Bond estime que c'est en 1939 seulement que la Russie est vraiment devenue impérialiste. La définition qui est donnée ici de l'impérialisme est purement militaire, et non économique : "Depuis 1939, il est devenu clair que aussi la Russie est entrée dans une phase d'expansion impérialiste".
Cependant, le Bond montre que le processus contre-révolutionnaire est aussi interne, dans la politique intérieure, où "sous la direction de Staline naquit une bureaucratie d'Etat". La nature de classe de la bureaucratie russe est bourgeoise :
"La bureaucratie dominante remplit la fonction d'une classe dominante qui, dans ses buts essentiels, correspond au rôle que remplit la bourgeoisie dans les pays capitalistes modernes".
Il est à noter ici que la "bureaucratie" russe est la bourgeoisie par sa fonction plus que par sa nature. Elle est un agent du capital étatisé. Bien qu'il soit clair dans le reste de l'article que cette "bureaucratie" est la forme que revêt la bourgeoisie d'Etat en URSS, l'impression donnée est qu'il s'agit d'une "nouvelle classe". En effet, il est affirmé que "la bureaucratie est devenue la classe dominante". Cette "classe dominante" deviendra - quelques années plus tard, sous l'influence de "Socialisme ou Barbarie" - pour le Bond "une nouvelle classe".
Le Bond montre qu'il existe deux classes dans la société russe, dans les rapports d'exploitation capitaliste basés sur "l'accumulation de plus-value" : la classe ouvrière et lardasse dominante". L'existence du capitalisme d'Etat - comme capital collectif - explique la politique impérialiste de l'Etat russe :
"L'Etat lui-même est ici l'unique capitaliste, en excluant tous les autres agents autonomes du capital ; il est l'organisation monstrueuse du capital global. Ainsi, il y a d'un côté les travailleurs salariés qui constituent la classe des opprimés ; de l'autre côté l'Etat qui exploite la classe opprimée et dont l'assise s'élargit par l'appropriation du surproduit créé par la classe ouvrière. C'est le fondement de la société russe ; c'est aussi la source de sa politique impérialiste".
La distinction faite ici -implicitement, et non explicitement - entre "dominés" et "dominants" n'est pas sans annoncer la future théorie du groupe "Socialisme ou Barbarie" ([7] [26]). Mais à la différence de ce dernier, le Communistenbond "Spartacus" n'abandonna jamais la vision marxiste d'antagonismes au sein de la société capitaliste.
Malgré les hésitations dans son analyse théorique, le Bond était très clair dans les conséquences politiques qui découlaient de son analyse théorique. La non défense de l'URSS capitaliste était une frontière de classe entre bourgeoisie et prolétariat :
"Prendre parti pour la Russie signifie que l'on a abandonné le front de classe entre ouvriers et capitalisme".
La non-défense de l'URSS ne pouvait être révolutionnaire que si elle s'accompagnait d'un appel au renversement de l'Etat capitaliste en Russie par la lutte de classe et la formation des conseils ouvriers :
"Seuls les soviets, les conseils ouvriers -"comme pouvoir ouvrier autonome - peuvent prendre en main la production, dans le but de produire pour les besoins de la population travailleuse. Les ouvriers doivent, en Russie aussi, former le Troisième front. De ce point de vue la Russie ne se distingue pas des autres pays."
2) La question coloniale et nationale
En 1945, la position du Bond sur la question coloniale n'est guère différente de celle du MLL Front. Alors que débutait une longue guerre coloniale en Indonésie qui allait durer jusqu'en 1949, date de l'indépendance, le Bond se prononce pour la"séparation" entre les Indes néerlandaises et la Hollande. Sa position reste "léniniste" dans la question coloniale, et il participe même - pendant quelques mois - à un "Comité de lutte anti-impérialiste" (Anti-imperialistisch Strijd Comité) . Ce comité regroupait les trotskystes du CRM, le groupe socialiste de gauche "De Vonk" et le Com-munistenbond, jusqu'à ce que ce dernier le quitta en décembre 1945. Le Bond avouait ([8] [27]) que ce comité n'était rien d'autre qu'un "cartel d'organisations".
Le Bond, en fait, n'avait pas de position théorique sur la question nationale et coloniale. Il reprenait implicitement les positions du 2° Congrès de l'IC. Il affirmait ainsi que "la libération de l'Indonésie est subordonnée à et constitue une sous-partie de la lutte de classe du prolétariat mondial". ([9] [28]) En même temps il montrait que 1 ' indépendance de 1'Indonésie était une voie sans issue pour le prolétariat local : "Il n'y a aucune possibilité présente d'une révolution prolétarienne (en Indonésie)".
Peu à peu triomphait la conception de Pannekoek. Ce dernier - dans les conseils ouvriers - sans prendre position vraiment contre les mouvements nationalistes de "libération nationale", considérait qu'ils se feraient sous la férule du capital américain et entraîneraient une industrialisation des pays "libérés". Telle était la position officielle du Bond en septembre 1945, à propos de l'Indonésie ([10] [29]). Il considérait que "la seule voie qui reste ne peut être autre qu'une future industrialisation de l'Indonésie et une ultérieure intensification du travail". Le mouvement de décolonisation se ferait avec le"soutien du capital américain". Il se traduirait par l'instauration d'un appareil d'Etat"tourné contre la population pauvre".
Le Bond avait encore beaucoup de mal à se déterminer théoriquement vis-à-vis de la "question nationale". Issu de deux courants, dont l'un acceptait les Thèses de Bakou, l'autre se revendiquait de la conception de Luxembourg, il était amené à se prononcer pour 1'une de ces deux conceptions de façon claire. C'est ce qu'il fit en 1946 dans un numéro de "Spartacus - Weekblad" (N° 12, 23 mars. Dans un article consacré à l'indépendance nationale ("Nationale onafhankelijkheid"), il attaquait la position trotskyste du RCP qui propageait le mot d'ordre : "Indonésie los van Holland, nu!" (Séparation de l'Indonésie d'avec la Hollande maintenant!). Un tel mot d'ordre ne pouvait être qu'un appel à l'exploitation des prolétaires indonésiens par d'autres impérialismes :
"Indonésie los van Holland. Nu! " veut dire : exploitation des prolétaires indonésiens par 1'Amérique-Angleterre, l'Australie et/ou leurs propres dirigeants ; et cela en réalité ne peut être! 'Contre toute exploitation' la lutte des masses indonésiennes doit surgir".
Plus profondément, le Bond se réclamait sans ambiguïté de la conception de Rosa Luxemburg et rejetait tout mot d'ordre 'léniniste' d'un 'droit à 1'autodétermination nationale'. Ce dernier ne pouvait être qu'un abandon de l'internationalisme au profit d'un camp impérialiste :
"Avoir de la sympathie pour ce mot d'ordre c'est mettre la classe ouvrière du côté d'un des deux colosses impérialistes rivaux, tout comme le mot d'ordre pour le ‘droit à l'autodétermination des nations' en 1914 et celui (de lutte) contre le fascisme allemand' au cours de la 2°guerre mondiale. '''
Ainsi, le Bond abandonnait définitivement la position qui avait été la sienne en 1942. Par la suite lors de 1'indépendance de pays comme la Chine ou l'Inde, il se préoccupe surtout de voir dans quelle mesure "l'indépendance" pouvait amener un développement des forces productives, et donc objectivement favoriser le surgissement d'un puissant prolétariat d'industrie. Implicitement, le Bond posait la question des 'révolutions bourgeoises' dans le tiers monde (cf. Infra).
3) La question syndicale
Bien que débarrassée de la tendance syndicaliste de Toon van den Berg, l'Union communiste Spartacus reste marquée jusqu'en 1949-1950 par le vieil esprit syndicaliste révolutionnaire du NAS.
Pendant la guerre, le Bond avait participé - avec des membres du PC hollandais - à la construction du petit syndicat clandestin EVC (Centrale syndicale unitaire). Rejetant tout travail" syndical depuis son congrès de Noël 1945, il avait néanmoins envoyé des délégués au congrès de l'EVC le 29 juillet 1946 ([11] [30]). Mais, par"tactique", le Bond travaillait dans les petits syndicats "Indépendants" nés de certaines luttes ouvrières. Après avoir travaillé dans le syndicat EVB - dont l'origine était la transformation d'un organisme de lutte des ouvriers de Rotterdam en structure permanente - le Bond défendait l'idée d'"organisations d'usine" créées par les ouvriers. Ces organisations étaient des "noyaux" (Kerne) qui devaient regrouper les"ouvriers conscients" par "localité et entreprise". ([12] [31])
Il est évident que le Bond ne faisait que reprendre ici la vieille conception du KAPD sur les Unions et les organisations d'entreprise (Betrieb-organisation). Mais à la différence du KAPD, il menait parallèlement un travail de type syndicaliste, sous la pression des ouvriers qui nourrissaient des illusions sur la formation de véritables syndicats"révolutionnaires". Il en fut ainsi en 1948-1949, lorsque naquit l'OVB (Union indépendante d'organisations d'entreprise). L'OVB était en fait une scission - provoquée en mars 1948 par Van den Berg - de l'EVC à Rotterdam, dont l'origine était la main mise du PC sur l'EVC. Croyant que l'OVB serait la base d'"organisations d'entreprise autonomes", le Bond devait reconnaître tardivement qu'il n'était rien d'autre qu'une"petite centrale syndicale". ([13] [32])
Cette 'tactique' du Bond était en contradiction avec sa position théorique sur le rôle et la fonction des syndicats dans la "société semi-totalitaire" des pays occidentaux. Les syndicats sont devenus des organes de l'Etat capitaliste :
"... Il ne peut être question de lutte pour les conditions de travail par le biais des syndicats. Les syndicats sont devenus une partie intégrante de l'ordre social capitaliste. Leur existence et leur disparition sont irrévocablement liées au maintien et à la chute du capitalisme. Dans l'avenir, il ne peut plus être question que la classe ouvrière puisse encore trouver des avantages dans les syndicats. Ils sont devenus des organes briseurs de grèves, là où les ouvriers passent spontanément à la grève et la dirigent." ([14] [33])
La propagande du Bond était donc une dénonciation sans équivoque des syndicats. Les ouvriers devaient non seulement mener leur lutte contre les syndicats par la"grève sauvage", mais comprendre que toute lutte dirigée par les syndicats était une défaite :
"La propagande révolutionnaire n'est pas d'appeler à la transformation des syndicats ; elle consiste à montrer clairement que dans la lutte les ouvriers doivent écarter toute direction syndicale, comme la vermine de leur corps. Il faudra dire clairement que toute lutte est perdue d'avance, dès que les syndicats parviennent à la prendre en charge".
La"grève sauvage" menée contre les syndicats était la condition même de la formation d'organismes prolétariens dans la lutte.
4) Le mouvement de la lutte de classe et les conseils
La publication des "Conseils ouvriers" en janvier 1946 a été déterminante pour l'orientation du Bond vers des positions typiquement "conseillistes". Alors qu'auparavant l'Union communiste Spartacus avait une vision essentiellement politique de la lutte de classe, elle développe des positions de plus en plus économistes. La lutte de classe était conçue plus comme un mouvement économique que comme un processus d'organisation croissante du prolétariat.
La vision de Pannekoek de la lutte de classe insistait d'avantage sur la nécessité d'une organisation générale de la classe que sur le processus de la lutte. Il affirmait, en effet, que "l'organisation est le principe vital de la classe ouvrière, la condition de son émancipation" ([15] [34]). Cette nette affirmation montrait que la conception du communisme des conseils de cette période n'était pas celle de 1'anarchisme. A la différence de ce courant, Pannekoek soulignait que la lutte de classe est moins une "action directe" qu'une prise de conscience des buts de la lutte, et que la conscience précède l'action.
"Le développement spirituel est le facteur le plus important dans la prise du pouvoir par le prolétariat. La révolution prolétarienne n'est pas le produit d'une force brutale, physique ; c'est une victoire de 1'esprit... au commencement était l'action. Mais l'action n'est rien de plus que le commencement...Toute inconscience, toute illusion sur l'essence, sur le but, sur la force de l'adversaire se traduit par le malheur et la défaite instaure un nouvel esclavage" ([16] [35]).
C'est cette conscience se développant dans la classe qui permettait l'éclatement spontané de grèves "sauvages (illégales ou non officielles) par opposition aux grèves déclenchées par les syndicats en respectant les règlements et les lois"." La spontanéité n'est pas la négation de l'organisation ; au contraire "l'organisation naît spontanément, immédiatement".
Mais ni la conscience ni l'organisation de la lutte ne sont un but en soi. Elles expriment une praxis où conscience et organisation s'inscrivent dans un processus pratique d'extension de la lutte qui conduit à l'unification du prolétariat :
"...la grève sauvage, tel le feu dans la prai rie, gagne les autres entreprises et englobe des masses toujours plus importantes. La première tâche à remplir, la plus importante, c'est faire de la propagande pour essayer d'étendre la grève".
Cette idée de l'extension de la grève sauvage était néanmoins en contradiction avec celle d'occupation des usines propagée par Pannekoek. Pannekoek, comme les militants du Bond, avaient été très marqués par le phénomène d'occupation d'usines dans les années 30. L'action d'occupation des entreprises était passée dans l'histoire sous le nom de "grève polonaise", depuis que les mineurs polonais en 1931 avaient été les premiers à appliquer, cette tactique. Celle-ci s'était ensuite étendue en Roumanie et en Hongrie, puis en Belgique en 1935, et enfin en France en 1936.
A l'époque, la Gauche communiste italienne, autour de"Bilan", tout en saluant ces explosions de lutte ouvrière ([17] [36]), avait montré que ces occupations étaient un enfermement des ouvriers dans les usines, qui correspondait à un cours contre-révolutionnaire menant à la guerre. D'autre part, un cours révolutionnaire se traduisait essentiellement par un mouvement d'extension de la lutte culminant avec le surgissement des conseils ouvriers. L'apparition des conseils n'entraînait pas nécessairement un arrêt de la production et l'occupation des usines. Au contraire, dans la Révolution russe, les usines continuaient à fonctionner, sous le contrôle des conseils d'usine ; le mouvement n'était pas une occupation d'usines mais la domination politique et économique de la production par les conseils sous la forme d'assemblées générales quotidiennes. C'est pourquoi, la transformation des usines du Nord de l'Italie en "forteresses" par les ouvriers en 1920, qui occupaient l'entreprise, traduisait un cours révolutionnaire déclinant. C'est la raison pour laquelle Bordiga avait vivement critiqué Gramsci qui s'était fait le théoricien du pouvoir dans l'usine occupée.
Pour la Gauche communiste italienne il était nécessaire que les ouvriers brisent les liens les rattachant à leur usine, pour créer une unité de classe dépassant le cadre étroit du lieu de travail. Sur cette question, Pannekoek et le Spartacusbond se rattachaient aux conceptions usinistes de Gramsci en 1920. Ils considéraient la lutte dans l'usine comme une fin en soi, considérant que la tâche des ouvriers était la gestion de l'appareil productif, comme première étape avant la conquête du pouvoir :
" dans les occupations d'usines se dessine cet avenir qui repose sur la conscience plus claire que les usines appartiennent aux ouvriers, qu'ensemble ils forment une unité harmonieuse et que la lutte pour la liberté sera menée jusqu'au bout dans et par les usines ... ici les travailleurs prennent conscience de leurs liens étroits avec 1'usine... c'est un appareil productif qu'ils font marcher, un organe qui ne devient une partie vivante de la société que par leur travail." ([18] [37])
A la différence de Pannekoek, le Bond avait tendance à passer sous silence les différentes phases de la lutte de classe, et à confondre lutte immédiate (grève sauvage) et lutte révolutionnaire (grève de masses donnant naissance aux conseils) . Tout comité de grève - quelle que soit la période historique et la phase de la lutte de classe -était assimile à un conseil ouvrier :
"Le comité de grève comprend des délégués de diverses entreprises. On l'appelle alors "comité général de grève" ; mais on peut l'appeler "conseil ouvrier". ([19] [38])
Au contraire, Pannekoek soulignait dans ses "5 Thèses sur la lutte de classe" (1946) que la grève sauvage ne devient révolutionnaire que dans la mesure où elle est "une lutte contre le pouvoir d'Etat ; dans ce cas "les comités de grève doivent alors remplir des fonctions générales, politiques et sociales, c'est-à-dire remplir le rôle des conseils ouvriers".
Dans sa conception des conseils, Pannekoek était loin de se rapprocher des positions anarchistes, qui allaient par la suite triompher dans le mouvement "conseilliste" hollandais. Fidèle au marxisme, il ne rejetait pas la violence de classe contre 1' Etat ni la notion de dictature du prolétariat. Mais celles-ci en aucun cas ne pouvaient être une fin en soi ; elles étaient étroitement subordonnées au but communiste : l'émancipation du prolétariat rendu conscient par sa lutte et dont le principe d'action était la démocratie ouvrière. La révolution par les conseils n'était pas"une force brutale et imbécile (qui) ne peut que détruire". "Les révolutions, au contraire, sont des constructions nouvelles résultant de nouvelles formes d'organisation et de pensée. Les révolutions sont des périodes constructives de 1'évolution de 1'humanité." C'est pourquoi "si l'action armée (jouait) aussi un grand rôle dans la lutte de classe", elle était au service d'un but : non pas briser les crânes, mais ouvrir les cervelles". Dans ce sens, la dictature du prolétariat était la liberté même du prolétariat dans la réalisation de la véritable démocratie ouvrière :
"La conception de Marx de la dictature du prolétariat apparaît comme identique à la démocratie ouvrière de l'organisation des conseils."
Cependant, chez Pannekoek, cette conception de la démocratie des conseils évacuait la question de son pouvoir face aux autres classes et face à l'Etat. Les conseils apparaissaient comme le reflet des différentes opinions des ouvriers. Ils étaient un parlement où coexistaient différents groupes de travail, mais sans pouvoirs ni exécutif ni législatif. Ils n'étaient pas un instrument de pouvoir du prolétariat, mais une assemblée informelle :
"Les conseils ne gouvernent pas; ils transmettent les opinions, les intentions, la volonté des groupes de travail".
Comme très souvent, dans les "Conseils ouvriers", une affirmation est suivie de son antithèse, de telle sorte qu'il est difficile de dégager une pensée cohérente. Autant dans le passage cité, les conseils ouvriers apparaissent comme impuissants, autant plus loin ils sont définis comme un puissant organe "devant remplir des fonctions politiques", où "ce qui est décidé... est mis en pratique par les travailleurs". Ce qui implique que les conseils "établissent" le nouveau droit, la nouvelle loi."
Par contre, nulle part il n'est question d'antagonisme entre les conseils et le nouvel Etat surgi de la révolution. Bien que la question se fût posée dans la Révolution russe, Pannekoek semble implicitement concevoir les conseils comme un Etat, dont les tâches seront de plus en plus économiques, une fois que les ouvriers "se sont rendus maîtres des usines". Du coup, les conseils cessent d'être des organes politiques et "sont transformés...en organes de production". ([20] [39]). Sous cet angle, il est difficile de voir en quoi la théorie des conseils de Pannekoek se différencie de celle des bolcheviks après 1918.
Ainsi, en l'espace de deux ans -de 1945 à 1947 -la conception théorique du Communistenbond Sparta-cus se rapprochait de plus en plus des théories "conseillistes" du GIC et de Pannekoek, bien que ce dernier ne fut en aucune façon militant du Bond. ([21] [40])
Bien des facteurs entraient en jeu qui expliquaient le contraste brutal entre le Bond de 1945 et le Bond de 1947. Dans un premier temps, l'afflux de militants après mai 1945 avait donné l'impression que s'ouvrait une période de cours révolutionnaire ; inévitablement, croyait le Bond, de la guerre surgirait la révolution. L'éclatement de grèves sauvages à Rotterdam, en juin 1945, dirigées contre les syndicats confortait le Bond dans ses espérances. Plus profondément, l'organisation ne croyait pas à une possibilité de reconstruction de l'économie mondiale ; elle pensait en août 1945 que "la période capitaliste de l'histoire de l'humanité touche à sa fin" ([22] [41]). Elle était confortée par Pannekoek qui écrivait : "Nous sommes aujourd'hui témoins du début de l'effondrement du capitalisme en tant que système économique." ([23] [42]).
Bientôt le Bond dut reconnaître que ni la révolution ni l'effondrement économique n'étaient à attendre, avec le début de la période de reconstruction. Cependant le Bond et Pannekoek restèrent toujours convaincus de la perspective historique du communisme : certes "toute une grande partie du chemin vers la barbarie (avait été) parcourue, mais l'autre chemin, le chemin vers le socialisme, restait) ouvert". ([24] [43])
Le début de la "guerre froide" laissait le Bond indécis sur le cours historique de 1'après -guerre. D'un côté il pensait -avec Pannekoek - que l'après-guerre ouvrait de nouveaux marchés pour le capital américain, avec la reconstruction et la décolonisation, voire l'économie d'armements ; de l'autre côté, il lui semblait que chaque grève était une "révolution en petit". Bien que les grèves se déroulassent de plus en plus dans le contexte de l'affrontement des blocs,"Spartacus" pensait - dans cette période - que "c'est la lutte de classe qui freine les préparatifs d'une 3° guerre mondiale" ([25] [44]).
. La révolution escomptée ne venait pas, dans un cours profondément dépressif pour les révolutionnaires de l'époque. L'autorité morale de Pannekoek et de Canne Meijer pesait de plus en plus dans le sens d'un retour au mode de fonctionnement qui prévalait dans l'ex-GIC. Au printemps 1947, les critiques commencèrent à se faire jour sur la conception du Parti. Les anciens membres du GIC préconisaient un retour à la structure des "groupes d'études" et des "groupes de travail". Ce retour avait été en fait préparé dès 1946, lorsque le Bond avait demandé à Canne Meijer ([26] [45]) de prendre la responsabilité d'éditer une revue en espéranto et donc de former un groupe espérantiste. De fait, se créaient des groupes à l'intérieur du Bond. Dans leur intervention, les militants du Bond avaient de plus en plus tendance à se concevoir comme une somme d'individus au service des luttes ouvrières.
Cependant, le Communistenbond n'était pas isolé malgré le cours non révolutionnaire qu'il devait finalement reconnaître ([27] [46]) plus tard. En Hollande, s'était constitué le groupe "Socialisme von onderop" (Socialisme par en bas), de tendance "conseilliste" . Mais c'est surtout avec la Belgique néerlandophone que le Bond avait les contacts les plus étroits. En 1945, s'était constitué un groupe très proche du Bond qui éditait la revue "Arbeiderswil" (Volonté ouvrière). Il avait pris par la suite la dénomination de "Vereniging van Radensocialisten" (Association de socialistes des conseils). Le groupe se déclarait partisan du "pouvoir des conseils" et "antimilitariste". Par son principe d'organisation fédératif, il se rapprochait beaucoup de l'anarchisme.([28] [47]) Un tel environnement politique de groupes localistes n'était pas sans pousser le Bond à se replier sur la Hollande. Cependant, en 1946, le Bond avait pris soin de faire connaître à ses membres les positions du courant bordiguiste, en traduisant la déclaration de principes de la Fraction belge de la Gauche communiste ([29] [48]). En juillet 1946, Canne Meijer s'était déplacé à Paris pour prendre contact avec différents groupes, en particulier "Internationalisme". Théo Maassen avait par la suite renouvelée cet effort de prendre contact avec le milieu internationaliste en France. Il est notable que les contacts étaient pris par d'anciens membres du GIC, et non par les ex-RSAP qui n'avaient eu de contact politique qu'avec le groupe de Vereeken. Issus du mouvement communiste des conseils des années 20 et 30, ils avaient déjà discuté avec le courant "bordiguiste" regroupé autour de la revue "Bilan"»
Le Bond en 1947 restait très ouvert à la discussion internationale et souhaitait briser les frontières nationales et linguistiques où il était enfermé :
"Le Bond ne veut point être une organisation spécifiquement néerlandaise. Les frontières é-tatiques ne sont pour lui - à cause de l'histoire et du capitalisme - que des obstacles à l'unité de la classe ouvrière internationale." ([30] [49])
C'est dans cet esprit que le Communistenbond prit l'initiative de convoquer une conférence internationale des groupes révolutionnaires existant en Europe. La conférence devait se tenir les 25 et 26 mai 1947 à Bruxelles. Comme document de discussion le Bond avait écrit une brochure : "De nieuwe wereld" (Le nouveau monde) qu'il avait traduite par ses soins en français.
La tenue de la première conférence de l'après-guerre des groupes internationalistes devait se fonder sur des critères de sélection. Sans l'affirmer explicitement, le Bond éliminait les groupes trotskystes pour leur soutien à l'URSS et leur participation à la Résistance. Il avait cependant choisi des critères d'adhésion à la conférence très larges, voire vagues :
"Nous considérons comme essentiel : le rejet de toute forme de parlementarisme ; la conception que les masses doivent s'organiser elles-mêmes dans l'action, en dirigeant ainsi elles-mêmes leurs propres luttes. Au centre de la discussion, il y a aussi la question du mouvement de masse, tandis que les questions de la nouvelle économie communiste (ou communautaire), de la formation de partis ou groupes, de la dictature du prolétariat, etc. ne peuvent être considérées que comme conséquences du point précédent. Car le communisme n'est pas une question de parti, mais celle de la création du mouvement de masses autonome". ([31] [50])
En conséquence, le Bond éliminait le PC internationaliste bordiguiste italien qui participait aux élections. Etaient par contre invités la Fédération autonome de Turin, qui avait quitté le PCint en raison de ses divergences sur la question parlementaire et le groupe français "Internationalisme", qui s'était détaché du bordiguisme. Etaient par contre invités les groupes bordiguistes belges et français qui étaient en divergence avec le PCint sur les questions parlementaire et coloniale.
En dehors de ces groupes, issus du bordiguisme ou en opposition, le Communistenbond avait invité des groupes informels, voire des individus ne représentant qu'eux-mêmes, de tendance anarcho-conseilliste : de Hollande, "Socialisme van onderop"; de Belgique, le "Vereniging van Radensocialisten" ; de Suisse, le groupe conseilliste "Klassenkampf" ; de France, les ccmmunistes-révolutionnaires du "Prolétaire". ([32] [51])
L'invitation faite à la Fédération anarchiste française fut vivement critiquée par "Internationalisme" qui tenait à ce que les critères de la conférence soient rigoureux. Pour marquer la nature internationaliste de la conférence, les mouvements anarchistes officiels qui avaient participé à la guerre en Espagne, puis aux maquis de la Résistance devaient être éliminés. "Internationalisme", déterminait quatre critères de sélection des groupes participant à une conférence internationaliste :
- le rejet du courant anarchiste officiel "pour la participation de leurs camarades espagnols au gouvernement capitaliste de 1936-1938"; leur participation "sous l'étiquette de 1'antifascisme à la guerre impérialiste en Espagne", puis "aux maquis de la Résistance en France" faisaient que ce courant "n'avait pas de place dans un rassemblement du prolétariat" ;
- le rejet du trotskisme "comme corps politique se situant hors du prolétariat";
- de façon générale rejet de tous les groupes qui "ont effectivement participé d'une façon ou d'une autre à la guerre impérialiste de 1939-1945".
- la reconnaissance de la signification historique d'Octobre 1917 comme "critère fondamental de toute organisation se réclamant du prolétariat".
Ces quatre critères "ne faisaient que marquer les frontières de classe séparant le prolétariat du capitalisme". Cependant le Bond ne retira pas son invitation au "Libertaire" (Fédération anarchiste), qui annonça sa participation et ne vint pas. Le Bond dut reconnaître de fait que 1'antiparlementarisme et la reconnaissance de l'organisation autonome par les masses étaient des critères flous de sélection.
A ce titre la conférence internationale ne pouvait qu'être une conférence de prise de contact entre groupes nouveaux surgis après 1945 et les organisations internationalistes de l'avant-guerre que le conflit mondial avait condamne à rester isolées dans leur pays respectif. Elle ne pouvait aucunement être un nouveau Zimmerwald, comme le proposait le groupe "Le Prolétaire", mais un lieu de confrontation politique et théorique permettant leur "existence organique" et "leur développement idéologique".
Comme le notait "Internationalisme" qui participa très activement à la conférence, le contexte international n'ouvrait pas la possibilité d'un cours révolutionnaire. La conférence se situait dans une période où "le prolétariat a essuyé une désastreuse défaite, ouvrant un cours réactionnaire dans le monde". Il s'agissait donc de resserrer les rangs et d'oeuvrer à la création d'un lieu politique de discussion permettant aux faibles groupes d'échapper aux effets dévastateurs de ce cours réactionnaire.
Tel était aussi l'avis des membres de l'ex-GIC du Bond. Et ce ne fut pas l'effet du hasard si deux anciens du GIC (Canne Meijer et Willem)- et aucun membre de la direction du Bond - participèrent à la conférence. Les anciens RSAP restaient en effet très localistes, en dépit du fait que le Bond avait crée une "Commission internationale de contact".
De façon générale régnait une grande méfiance entre les différents groupes invités dont beaucoup avaient peur d'une confrontation politique. Ainsi ni la Fraction française ni "Socialisme van onderop" ne participèrent à la conférence. Lucain, de la Fraction belge, ne se laissa convaincre d'assister aux débats que sur la demande expresse de Marco d'Internationalisme. Seuls finalement, 1!Internationalisme" et la Fédération autonome avaient envoyé une délégation officielle. Quant aux éléments de l'ex-GIC, déjà en désaccord au sein du Spartacusbond ils ne représentaient qu'eux-mêmes. Ils nourrissaient une certaine méfiance vis à vis d'"Internationalisme" qu'ils accusaient de "se perdre dans d'interminables discussions sur la révolution russe". ([33] [52])
Présidée par Willem du Spartacusbond, Marco et un vieil anarcho-communiste qui militait depuis les années 1890, la conférence révéla une plus grande communauté d'idées qu'on aurait pu le soupçonner.
- la majorité des groupes rejetèrent les théories de Burnham sur la "société de managers" et le développement indéfini du système capitaliste. La période historique était celle "du capitalisme décadent, de la crise permanente, trouvant dans le capitalisme d'Etat son expression structurelle et politique".
- sauf les éléments anarchisants présents, les communistes de conseils avec les groupes issus du"bordiguisme" étaient d'accord sur la nécessité d'une organisation des révolutionnaires. Cependant, à la différence de leur conception de 1945, ils voyaient dans les partis un rassemblement d'individus porteurs d'une science prolétarienne : "Les 'partis' révolutionnaires nouveaux sont ainsi les porteurs ou les laboratoires de la connaissance prolétarienne". Reprenant la conception de Pannekoek sur le rôle des individus, ils affirmaient que "ce sont d'abord des individus qui ont conscience de ces vérités nouvelles".
- une majorité de participants soutient l'intervention de Marco, d1"Internationalisme", que ni le courant trotskyste ni le courant anarchiste n'avaient leur place dans une conférence de groupes révolutionnaires" ([34] [53]). Seul le représentant du "Prolétaire" - groupe qui devait par la suite évoluer vers l'anarchisme - se fit l'avocat de l'invitation de tendances non officielles ou "de gauche" de ces courants.
- les groupes présents rejetaient toute "tactique" syndicale ou parlementeriste. Le silence des groupes "bordiguistes" en opposition signifiait leur désaccord avec les positions du Parti bordiguiste italien.
Il est significatif que cette conférence - la plus importante de l'immédiat après-guerre - de groupes internationalistes ait réuni des organisations issues des deux courants "bordiguiste" et communiste des conseils. Ce fut la première et dernière tentative de confrontation politique de l'après-guerre. Dans les années 30, une telle tentative avait été impossible, principalement en raison du plus grand isolement de ces courants et des divergences sur la question espagnole. La conférence de 1947 permettait essentiellement d'opérer une délimitation - sur les questions de la guerre et de 1'antifascisme - d'avec les courants trotskyste et anarchiste. Elle traduisait de façon confuse le sentiment commun que le contexte de la guerre froide clôturait une période très brève de deux années qui avait vu se développer de nouvelles organisations, et ouvrait un cours de désagrégation des forces militantes si, consciemment, celles-ci ne maintenaient pas un minimum de contacts politiques.
Cette conscience générale manquait à la conférence qui se termina sans décisions pratiques ni résolutions communes. Seuls, les ex-membres du GIC et "Internationalisme" se prononçaient pour la tenue d'autres conférences. Ce projet ne put se réaliser en raison de la sortie -le 3 août 1947 ([35] [54]) - du Bond de la plupart des anciens du GIC : sauf Théo Maassen qui jugeait la scission injustifiée, ils pensaient que leurs divergences étaient trop importantes pour rester dans le Communistenbond. En fait ce dernier avait décidé de créer - artificiellement une"Fédération internationale de noyaux d'entreprise" (IFBK) à l'image des "Betriebsorganisationen" du KAPD. Mais la cause profonde de la scission était la poursuite d'une activité militante et organisée dans les luttes ouvrières. Les anciens du GIC é-taient accusés par les miltants du Bond de vouloir transformer l'organisation en un"club d'études théoriques" et de nier les luttes ouvrières immédiates :
" Le point de vue de ces anciens camarades (du GIC-NDR), c'était que - tout en poursuivant la propagande pour 'la production dans les mains des organisations d'usine', 'tout le pouvoir aux conseils ouvriers' et pour une production communiste sur la base d'un calcul des prix en fonction du temps de travail moyen'- le Spartacusbond n'avait pas à intervenir dans la lutte des ouvriers telle qu'elle se présente aujourd’hui. La propagande du Spartacusbond doit être pure dans ses principes et, si les masses ne sont pas intéressées aujourd'hui, cela changera quand les mouvements de masses redeviendront révolutionnaires". ([36] [55])
Par une ironie de l'histoire, les anciens du GIC reprenaient les mêmes arguments que la tendance de Gorter -dite d'Essen - dans les années 20, alors que précisément le GIC s'était constitué en 1927 contre elle. Parce qu'il défendait l'intervention active dans les luttes économiques - position de la tendance de Berlin du KAPD - il avait pu échapper au rapide processus de désagrégation des partisans de Gorter. Ceux-ci avaient soit disparu politiquement soit évolué - comme organisation - vers des positions trotskystes et socialistes de gauche "antifascistes" pour finalement participer à la résistance néerlandaise : Frits Kief, Bram Korper, et Barend Luteraan - chefs de la tendance "gortérienne"- suivirent cette trajectoire ([37] [56]).
Constitués à l'automne 1947 en "Groep van Raden communisten" (Groupe de communistes des conseils), Canne Meijer, B.A. Sijes et leurs partisans eurent quelque temps une activité politique. Ils voulaient malgré tout, maintenir les contacts internationaux en particulier avec "Internationalisme". En vue d'une conférence - qui n'eut jamais lieu - ils éditèrent un "Bulletin d'information et de discussion internationales" en novembre 1947, qui n'eut qu'un seul numéro. ([38] [57]) Après avoir édité deux numéros de "Radencommunisme", en 1948, le groupe disparut. Canne Meijer versa dans le plus grand pessimisme sur la nature révolutionnaire du prolétariat et commença à douter de la valeur théorique du marxisme. ([39] [58]) B.A. Sijes se consacra entièrement à son travail d'historien de la "Grève de février 1941" pour finalement adhérer à un "Comité international de recherche des criminels de guerre nazis" qui le mena à témoigner au procès contre Eichmann, à Jérusalem. ([40] [59]) Bruun van Albada, qui n'avait pas suivi les anciens du GIC dans la scission, cessait bientôt de militer en 1948, alors qu'il était nommé directeur de l'observatoire astronomique de Ban-doeng, en Indonésie. Inorganisé, il ne tarda pas à exprimer qu'il n'avait"plus aucune confiance dans la classe ouvrière" ([41] [60]).
Ainsi, en dehors de toute activité militante organisée, la plupart des militants du GIC finissaient par rejeter tout engagement marxiste révolutionnaire. Seul Théo Maasen, demeuré dans le Bond, maintint cet engagement.
Que la scission fut injustifiée - de l'avis de Théo Maasen - c'est ce que devait montrer l'évolution du Bond dès la fin de 1947, lors de sa conférence de Noël. Cette conférence marquait une étape décisive dans l'histoire du Communistenbond "Spartacus". La conception de l'organisation du GIC triomphait complètement et marquait un abandon des positions de 1945 sur le Parti. C'était le début d'une évolution vers un conseillisme achevé, qui allait mener finalement à la quasi-disparition du Spartacusbond aux Pays-Bas.
L'affirmation d'une participation du Bond à toutes les luttes économiques du prolétariat l'amenait à une dissolution de l'organisation dans la lutte. Le Bond n'était plus une partie critique du prolétariat mais un organisme au service des luttes ouvrières : "Le Bond et les membres du Bond veulent servir la classe ouvrière en lutte". ([42] [61]) La théorie ouvriériste triomphait, et les communistes du Bond étaient confondus avec la masse des ouvriers en lutte. La distinction faite par Marx entre communistes et prolétaires, distinction reprise par les "Thèses sur le parti" de 1945, disparaissait :
"Le Bond doit être une organisation d'ouvriers qui pensent par eux-mêmes, font de la propagande par eux-mêmes, font grève par eux-mêmes, s'organisent par eux-mêmes, et s'administrent par eux-mêmes."
Cependant cette évolution vers l'ouvriérisme n'était pas totale et le Bond n'avait pas encore peur de s'affirmer comme une organisation à la fonction indispensable dans la classe : "Le Bond fournit une contribution indispensable à la lutte. Il est une organisation de communistes devenus conscients
que l'histoire de toute société jusqu'à maintenant est l'histoire de la lutte de classe, basée sur le développement des forces productives". Sans utiliser le terme de parti, le Bond se prononçait pour un regroupement des forces révolutionnaires au niveau international : "Le Bond estime... souhaitable que l'avant-garde ayant la mène orientation dans le monde entier se regroupe dans une organisation internationale".
Les mesures organisatives prises à la conférence étaient en opposition avec ce principe de regroupement, qui ne pouvait se réaliser que si le centralisme politique et organisationnel du Bond était maintenu. Or, le Bond cessait d'être une organisation centralisée avec des statuts et des organes éxécutifs. Il devenait une fédération de groupes de travail, d'étude et de propagande. Les sections locales (ou "noyaux") étaient autonomes, sans autre lien qu'un "groupe de travail" spécialisé dans les rapports inter-groupes locaux, et le Bulletin interne "Uit eigen Kring" (Dans notre cercle). Il y avait autant de groupes de travail autonomes qu'il y avait de fonctions à remplir : rédaction ; correspondance ; administration ; maison d'édition "De Vlam" du Bond ; contacts internationaux ; "activités économiques" liées à la fondation de l'Internationale des noyaux d'entreprise (IFBK) .
Ce retour au principe fédéraliste du GIC amenait en retour une évolution politique de plus en plus "conseilliste" sur le terrain théorique. Le "conseillisme" a deux caractéristiques : la caractérisation de la période historique depuis 1914 comme une ère de "révolutions bourgeoises" dans les pays sous-développés ; le rejet de toute organisation politique révolutionnaire. Cette évolution fut particulièrement rapide dans les années 50. L'affirmation d'une continuité théorique avec le GIC - marquée par la réédition en 1950 des "Principes fondamentaux de la production et de la répartition communiste" ([43] [62]) - signifiait la rupture avec les principes originels du Bond de 1945.
Dans les années 1950, le Bond fit un grand effort théorique en publiant la revue "Daad en Gedachte" {Pote et pensée), dont la responsabilité rédactionnelle incombait avant tout à Cajo Brendel, entré dans l'organisation depuis 1952. Avec Théo Maasen, il contribuait grandement à la publication des brochures : sur l'insurrection des ouvriers est-allemands en 1953, sur les grèves du personnel communal d'Amsterdam en 1955, sur les grèves de Belgique en 1961. A côté de brochures d'actualité, le Bond publiait des essais théoriques qui montraient une influence croissante des théories de "Socialisme ou Barbarie". ([44] [63])
Cette influence de ce dernier groupe - avec lequel des contacts politiques avaient été pris dès 1953 et dont les textes étaient publiés dans "Daad en Gedachte" - n'était pas l'effet d'un hasard. Le Bond avait été le précurseur inconscient de la théorie de Castoriadis sur le "capitalisme moderne" et l'opposition "dominant s /dominés". Mais autant le Bond restait fidèle au marxisme en réaffirmant l'opposition entre prolétariat et bourgeoisie, autant il faisait des concessions théoriques à S.O.B." en définissant la "bureaucratie" russe comme une "nouvelle classe". Mais pour le Bond, cette classe était "nouvelle" surtout par ses origines ; elle prenait la forme d'une "bureaucratie" qui "(faisait) partie de la bourgeoisie" ([45] [64]). Néanmoins, en l'assimilant à une couche de "managers", non propriétaire collectif des moyens de production, le Bond faisait sienne la théorie de Burnham, qu'il avait rejetée à la conférence de 1947. Derechef, le Bond avait été en 1945 le précurseur inconscient de cette théorie, qu'il n'avait jusqu'alors jamais pleinement développée. Le maître devenait le propre "élève" de son disciple : "Socialisme ou Barbarie". Comme ce dernier, il glissait progressivement sur une pente qui devait le mener à sa dislocation.
Cette dislocation a deux causes profondes : -le rejet de toute expérience prolétarienne du passé, en particulier l'expérience russe ; - l'abandon par la tendance du GIC - au sein du Bond- de toute idée d'organisation politique.
Le rejet de l'expérience russe
Après avoir essayé de comprendre les causes de la dégénérescence de la Révolution russe, le Bond cessait de la considérer comme une révolution prolétarienne pour n'y voir - comme le GIC - qu'une révolution "bourgeoise". Dans une lettre à Castoriadis-Chaulieu du 8 novembre 1953 - qui fut publiée par le Bond -([46] [65]) Pannekoek considérait que cette "dernière révolution bourgeoise" avait été "l'oeuvre de la classe ouvrière" russe. Ainsi était niée la nature prolétarienne de la révolution (conseils ouvriers, prise de pouvoir en octobre 1917). Ne voulant pas voir le processus de la contre-révolution en Russie (soumission des conseils à l'Etat, Kronstadt) Pannekoek et le Bond aboutissaient à 1'idée que les ouvriers russes avaient lutté pour la révolution "bourgeoise" et donc pour leur auto exploitation. Si octobre 17 n'était rien pour le mouvement révolutionnaire, il était logique que Pannekoek affirmât que "la révolution prolétarienne appartient au futur". De ce fait, toute l'histoire du mouvement ouvrier cessait d'apparaître comme une source d'expériences du prolétariat et le point de départ de toute réflexion théorique. L'ensemble du mouvement ouvrier, dès le I9ème siècle devenait"bourgeois" et ne se situait que sur le terrain de la "révolution bourgeoise".
Cette évolution théorique s'accompagnait d'un immédiatisme de plus en plus grand vis-à-vis de toutes les grèves ouvrières. Le Bond considérait que sa tache était de se faire l'écho de toutes les grèves. La lutte de classe devenait un éternel présent, sans passé car il n'y avait plus d'histoire du mouvement ouvrier, et sans futur car le Bond se refusait d'apparaître comme un facteur actif pouvant influencer positivement la maturation de la conscience ouvrière.
L'autodissolution de l'organisation Lors de la discussion avec "Socialisme ou Barbarie", le Bond n'avait pas renoncé au concept d'organisation et de parti. Comme l'écrivait Théo Maasen, "l'avant-garde est une partie de la classe militante, se composant des ouvriers les plus militants de toutes les directions politiques". L'organisation était conçue comme l'ensemble des groupes du milieu révolutionnaire. Cette définition floue de l'avant-garde qui dissolvait le Bond dans l'ensemble des groupes était néanmoins un dernier sursaut de vie des principes originels de 1945.Bien que le Parti lui apparut comme dangereux, car ayant "une vie propre" et se développant "selon ses propres lois", le Bond en reconnaissait encore le rôle nécessaire ; il devait "être une force de la classe". ([47] [66])
Mais "cette force de la classe" devait disparaître dans la lutte des ouvriers pour ne pas rompre "leur unité". Ce qui revenait à dire que le parti - et l'organisation du Bond en particulier - était un organisme invertébré, qui devait se "dissoudre dans la lutte".
Cette conception était la conséquence de la vision ouvriériste et immédiatiste du conseillisme hollandais. Le prolétariat lui apparaissait dans son ensemble comme la seule avant-garde politique, "l'instituteur" des militants "conseillistes", qui de ce fait se définissaient comme une "arrière-garde". L'identification entre communiste conscient et ouvrier combatif amenait une identification avec la conscience immédiate des ouvriers. Le militant ouvrier d'une organisation politique ne devait plus élever le niveau de conscience des ouvriers en lutte mais se nier en se mettant au niveau d'une conscience immédiate et encore confuse dans la masse des ouvriers :
"Il en découle que le socialiste ou communiste de notre époque devrait se conformer et s'identifier à l'ouvrier en lutte" ([48] [67]).
Cette conception était particulièrement défendue par Théo Maasen, Cajo Brendel et Jaap Meulenkamp. Elle menait à la scission de décembre 1964 dans le Bond. La tendance qui défendait jusqu'au bout la conception anti-organisation du GIC devenait une revue : "Daad en Gedachte". Cette dislocation ([49] [68]) du Bond avait été en fait préparée par l'abandon de tout ce qui pouvait symboliser l'existence d'une organisation politique. A la fin des années 50, le Cbmmunistenbond Spartacus était devenu le "Spartacusbond". Le rejet du terme "communiste" signifiait un abandon d'une continuité politique avec l'ancien mouvement "communiste des conseils". L'atmosphère de plus en plus familiale du Bond, où avait été banni le mot "camarade" pour celui d'"ami", n'était plus celle d'un corps politique rassemblant les individus sur la base d'une acceptation commune d'une même vision et d'une même discipline collectives.
Désormais, il y avait deux 'organisations'"conseillistes" en Hollande. L'une - le Spartacusbond- après avoir connu un certain souffle de vie après mai 1968 et s'être ouvert à la confrontation internationale avec d'autres groupes finissait par disparaître à la fin des années 1970. S'ouvrant à des éléments plus jeunes et impatients, plongés dans la lutte des "kraakers (squatters) d'Amsterdam, elle se dissolvait dans un populisme gauchiste, pour finalement cesser de publier la revue "Spartacus".([50] [69])
"Daad en Gedachte", par contre, subsiste sous la forme d'une revue mensuelle. Dominée par la personnalité de Cajo Brendel, après la mort de Théo Maassen, la revue est le point de convergence d'éléments anarchisants. La tendance"Daad en Gedachte" a été jusqu'au bout de la logique "conseilliste" en rejetant le mouvement ouvrier du XIX° siècle comme "bourgeois" et en se coupant de toute tradition révolutionnaire, en particulier celle du KAPD, tradition qui lui apparaît comme marquée trop par "1'esprit de parti".
Mais surtout "Daad en Gedachte" s'est progressivement détaché de la tradition véritable du GIC, sur le plan théorique. Elle est avant tout un Bulletin d'information sur les grèves, alors que les revues du GIC étaient de véritables revues théoriques et politiques.
Cette rupture avec la véritable tradition du communisme des conseils l'ont amené progressivement sur le terrain du tiers-mondisme, propre aux groupes gauchistes :
"... Les luttes des peuples coloniaux ont apporté quelque chose au mouvement révolutionnaire. Le fait que des populations paysannes mal armées aient pu faire face aux forces énormes de l'impérialisme moderne a ébranlé le mythe de l'invincibilité du pouvoir militaire, technologique et scientifique de l'Occident. Leur lutte a aussi révélé à des millions de gens la brutalité et le racisme du capitalisme et a conduit beaucoup de gens - surtout parmi les jeunes et les étudiants - à entrer en lutte contre leurs propres régimes." ([51] [70])
Il est frappant de remarquer ici que, comme pour la PV° Internationale trotskyste et le bordiguisme, les luttes qui ont jailli du prolétariat industriel d'Europe sont comprises comme un produit des "luttes de libération nationale". Elles apparaissent comme un sous-produit des révoltes étudiantes, voire sont niées en tant que telles.
Une telle évolution n'est pas surprenante. En reprenant la théorie de "Socialisme ou Barbarie" d'une société traversée non par les antagonismes de classes mais par les révoltes des "dominés" contre les "dominants", le courant "conseilliste" ne peut concevoir l'histoire que comme une suite de révoltes de catégories sociales et de classes d'âge. L'histoire cesse d'être celle de la lutte de classe.
La théorie marxiste du communisme des conseils des années 30 puis du communistenbond des années 40 cède le terrain à la conception anarchiste. ([52] [71])
Aujourd'hui aux Pays-Bas, le communisme des conseils a disparu en tant que courant véritable. Il a laissé subsister des tendances "conseillistes" très faibles numériquement - comme "Daad en Gedachte" - qui se sont rattachées progressivement au courant libertaire anti-parti.
Au niveau international, après la deuxième guerre mondiale, le courant "communiste des conseils" ne s'est maintenu qu'au travers de personnalités comme Mattick, qui sont restées fidèles au marxisme révolutionnaire. Si des groupes - se revendiquant du "Rate-Kommunismus" - ont surgi dans d'autres pays, comme en Allemagne et en France, ce fut des bases bien différentes de celles du "Communistenbond Spartacus",
Chardin
[1] [72] Sur Toon van den Berg (1904-1977), cf. article du Spartacusbond : "Spartacus", n°2, février-mars 1978.
[2] [73] "Uit eigen kring", n°2, mars 1946 : "Nota van de politike commissie" (Notes de la Commission politique)
[3] [74] Cf. UEK n°2 mars 1946, Idem
[4] [75] En même temps que surgissait la question du centralisme se créait un clivage entre éléments "académistes" et militants qui souhaitaient plus de propagande. Ces derniers comme Johan van Dïnkel, dénonçaient le risque pour le Bond de devenir "un club d'études théoriques" Cf. UEK, n°2, mars 1946, "Waar staat de Communistenbond ? Théoretisch studieclub of wordende Party" (Où va le Communistenbond ? Club d'étude théorique ou parti en devenir ?) .
[5] [76] Cf. Circulaire du 17 août 1946 contenant le procès-verbal de la réunion de la commission politique nationale le 14 juillet. Interventions de Stan Poppe, Bertus Nansink, Van Albada, Jan Vastenhouw et Théo MajBsen sur l'état de l'organisation.
(42) "Maandlad Spartacus", n°12, décembre 1945 : "Het russische impérialisme en de revolutionaire arbei-ders".(L'impérialisme russe et les ouvriers révolutionnaires)
[6] [77] Maandlad Spartacus", n°12, décembre 1945 : "Het russische impérialisme en de revolutionaire arbeiders".(L'impérialisme russe et les ouvriers révolutionnaires)
[7] [78] Le groupe "Socialisme ou Barbarie", scission du trotskysme, publia son premier numéro en 1949 Son élément moteur était C. Castoriadis (Chaulieu ou cardan). Ce sont surtout les sous-produits de "Socialisme ou Barbarie : ICO et "Liaisons" d'Henri Simon qui pousseront jusqu'au bout la théorie "dominants/dominos , dirigeants /diriges .
[8] [79] Conférence du Bond des 27 et 28 octobre 1945, Cf UEK n°6, décembre 1945.
[9] [80] Rapport d'un membre de la Commission politique sur la question indonésienne, in UEK, n°6décembre 1945.
[10] [81] "Maandlad Spartacus", n°9 septembre 1945 : "Nederland- Indonésie".
[11] [82] Décision de la Commission politique, le 14 juillet 1946. Cf. Circulaire du 27 août avec le procès-verbal de la réunion de l'organe central.
[12] [83] "Spartacus" (Weekblad) n°23, 7 juin 1947 : "Het wezen der revolutionaire bedrijfsorganisatie" (ia nature de l'organisation révolutionnaire d'entreprise).
[13] [84] En 1951, quelques membres du Bond pensaient que l'OVB n'était rien d'autre qu'un "vieux syndicat", dans lequel ils n'avaient rien à faire. C'était le point de vue de Spartacus en 1978 qui définit l'OVB comme "une petite centrale syndicale", Cf. article "Toon van den Berg (n°2, février-mars) . Le débat sur la nature de l'OVB se trouve dans "Uit eigen kring", n°17, 22 juillet 1951.
[14] [85] "De nieuwe wereld", avril 1947, traduit dans un français maladroit pour la conférence de 1947 et publié en brochure :"Le monde nouveau".
[15] [86] "Les conseils ouvriers" chapitre "l'Action directe".
[16] [87] "Les conseils ouvriers", chapitre "Pensée et action".
[17] [88] Cf."La Gauche communiste d'Italie", chapitre 4.
[18] [89] "Les conseils ouvriers", chapitre 3 :"L'occupation d'usine".
[19] [90] Cf. "Le nouveau monde", 1947, p. 12. Chez le Bond, comme chez Pannekoek, il y a une tendance à considérer les comités de grève comme des organismes permanents, qui subsistent après la lutte. D'où chez Pannekoek l'appel à former - après la grève - de petits syndicats indépendants, "formes intermédiaires., regroupant, après une grande grève, le noyau des meilleurs militants en un syndicat unique. Partout où une grève éclaterait spontanément, ce syndicat serait présent avec ses organisateurs et ses propagandistes expérimentés". ("Les conseils ouvriers", p.157.)
[20] [91] "Les conseils ouvriers", chapitre "La révolution des travailleurs".
[21] [92] Pannekoek n'avait de contacts qu'individuels avec les anciens membres du GIC : Canne Meijer, B.A. Sijes .
[22] [93] "Maandblad Spartacus", n°8, août 1945 : "Het zieke Kapitalisme" (Le capitalisme malade).
[23] [94] "Les conseils ouvriers", p. 419. Cette affirmation d'un effondrement du capitalisme était en contradiction avec l'autre thèse des "Conseils ouvriers" que le capitalisme connaissait avec la décolonisation un nouvel essor : "Une fois qu'il aura fait entrer dans son domaine les centaines de millions de personnes qui s'entassent dans les terres fertiles de Chine et d'Inde, le travail essentiel du capitalisme sera accompli." p.194). Cette dernière idée n'est pas sans rappeler les thèses de Bordiga sur le capitalisme juvénile".
[24] [95] "Maandblad Spartacus", n°8 août 1945, op. cit.
[25] [96] "Spartacus" (Weekblad) n°22, 31 mai 1947 :"Nog twe jaren" (Encore deux ans)
[26] [97] Le Bond avait demandé à Canne Meijer d'assurer la sortie d'une revue espérantiste : "Klasbatalo". Il y eut encore une tentative en 1951 d'éditer "Spartacus" en espéranto. Cette fixation sur cette langue, pratiquée par des intellectuels, explique le peu d'efforts que fit le Bond d'éditer ses textes en anglais, allemand et français.
[27] [98] La préface de 1950 aux "Grondbeginselen der communistische productie en distributie" parle d'une "situation certainement non révolutionnaire" ; elle n'utilise pas le concept de contre-révolution pour définir la période. Cette préface présente un double intérêt : a) examiner la tendance mondiale au capitalisme d'Etat et ses différences : en Russie l'Etat dirige l'économie ; aux USA les monopoles s'emparent de l'Etat ; b) affirmer la nécessité de la lutte économique immédiate comme base de "nouvelles expériences" portant les germes d'une"nouvelle période".
[28] [99] Le Statut provisoire du*Vereniging van Raden-socialisten" a été publié en avril 1947 dans "Uit ei-gen kring" n°5
[29] [100] La traduction et les commentaires du noyau de Leiden sur le "Projet de programme de la Fraction belge" se trouvent dans le bulletin-circulaire du 27 août 1946.
[30] [101] "Uit eigen kring", bulletin de la Conférence de Noël, décembre 1947.
[31] [102] Cité par "Spartakus", n°1, octobre 1947 :"Die internationale Versammlung in Brussel, Pfingsten 1947". "Spartakus" était l'organe des RKD liés au groupe français "Le Prolétaire" (Communistes-Révolutionnaires).
[32] [103] Comptes-rendus de la conférence dans le numéro de "Spartakus", déjà cité, et dans "Internationalisme n°23, 15 juin 1947 : "Lettre de la GCF au Communistenbond 'Spartacus'" ; "Une conférence internationale des groupements révolutionnaires"; "Rectificatif" dans le n°24, 15 juillet 1947.
[33] [104] Compte -rendu d'un voyage de contact avec les groupes français RKD et "Internationalisme" en août 1946. Cf. "Uit eigen kring", n°4, avril 1947.
[34] [105] Citations du compte-rendu du congrès, "Internationalisme", n° 23.
[35] [106] Lettre-circulaire du 10 août 1947 : "De splijting in de Communistenbond 'Spartacus' op zontag 3 augus-tus 1947". Citée par Frits Kool, in "Die Linke gegen die Parteiherrschaft", p. 626.
[36] [107] "Uit eigen kring" numéro spécial, décembre 1947 : "De plaats van Spartacus in de klassenstrijd" (La place de Spartacus dans la lutte de classe).
[37] [108] Frits Kief, après avoir été secrétaire du KAPN de 1930 à 1932, avait fondé avec les Korper le groupe "De Arbeidersraad", qui évolua progressivement vers des positions trotskysantes et antifascistes. Pendant la guerre, Frits Kief participa à la Résistance hollandaise, devint après la guerre membre du "Parti du travail", pour finir par se faire le chantre du "socialisme yougoslave". Bram Korper et son neveu retournèrent au PC. Quant à Barend Luteraan (1878-1970) qui - plus que Gorter déjà malade - avait été le fondateur_du KAPN, il suivit le même itinéraire que_Fris Kief.
[38] [109] La préparation technique de cette conférence (bulletins) devait être prise en charge par le "Groep van Raden-Communisten". Dans une lettre écrite en octobre 1947, "Internationalisme" précisait qu'une future1 conférence ne pouvait se faire sur une"simple base affective" et devait rejeter le dilletantisme dans la discussion.
[39] [110] Sur l'évolution de Canne Meijer, cf, son texte des années 50 : "Le socialisme perdu", publié dans la "Revue internationale" du Courant communiste international, n°37, 1984.
[40] [111] B.A. Sijes (1908-1981) cependant, contribua dans les années 60 et 70 au mouvement communiste des conseils en rédigeant des préfaces à la réédition des oeuvres de Pannekoek. L'édition des "Mémoires" de ce dernier fut son dernier travail.
[41] [112] B. van Albada (1912-1972) , bien que cessant de militer traduisit en hollandais - avec sa femme-"Lénine philosophe" de Pannekoek.
[42] [113] Cette citation et les suivantes sont extraites de "Uit eigen kring", numéro spécial, décembre 1947 : "Spartacus:Eigen werk, organisatie en propaganda".
[43] [114] Les "Principes" ont été écrits en prison, dans les années 20, par Jan Appel. Ils ont été revus, remaniés par Canne Msijer. Jan Appel écrivit - selon le Spartacusbond dans sa préface de 1972 - avec Sijes et Canne Meijer en 1946 l'étude : "De economische grondslagen van de radenmaatqchappij" (Les fondements économiques de la société des conseils) . Or il ne semble pas que Jan Appel devînt en 1945 membre du Bond. Il était en désaccord avec les ex-membres du GIC et avec le Bond qui refusaient de faire un travail révolutionnaire en direction de l'armée allemande. D'autres raisons (tensions personnelles) l'ont tenu à l'écart d'un travail politique militant qu'il aurait souhaité réaliser.
[44] [115] Les brochures citées et la revue "Daad en Gedachte" sont disponibles à l'adresse suivante : Schouw 48-11, Lelystad (Pays-Bas)
[45] [116] Brochure écrite par Théo Maasen en 1961 : Van Beria tôt Zjoekof - Sociaal-economische achter grond van destalinisatie". Traduction en français :"L'arrière-fond de la déstalinisation", in "Cahiers du communisme des conseils", n°5, mars 1970.
[46] [117] Cf. "une correspondance entre A.Pannekoek et P. Chaulieu", avec une introduction de Cajo Brendel, in "Cahiers du communisme des conseils" n°8, mai 1971.
[47] [118] Citations d'une lettre de Théo Maasen à "Socialisme ou Barbarie", publiée dans le n°18, janvier-mars 1956, sous le titre : "Encore sur la question du parti".
[48] [119] Citations de la brochure "Van Beria tôt Zjoekof", déjà mentionnée.
[49] [120] Meulenkamp quitta le Bond en septembre 1964. Cajo' Brendel et Théo Maassen, avec deux de leurs ca-rades, furent exclus en décembre. La scission ne se fit pas en "douceur" : le Bond récupéra les machines et les brochures qui lui appartenaient, bien que ces dernières aient été écrites par Brendel et Maassen. Cf. témoignage de Jaap Meulenkamp, qui parle de "méthodes staliniennes" :"Brief van Jaap aan Radencommunisme", in Initiatief tôt een bijeenkomst van revolutionaire groepen", bulletin du 20 janvier 1981. Par la suite "Daad en Gedachte", malgré les invitations du Bond, refusa de s'asseoir "à la même table" lors de conférences et de rencontres, comme celle de janvier 1981.
[50] [121] Cf. articles du Courant communiste international, dans la "REVUE INTERNATIONALE" :n°2, 1975 : "Les épigones du conseillisme à l'oeuvre 1) "Spartacusbond" hanté par les fantômes bolcheviks, 2) Le conseillisme au secours du tiers-mondisme" ; n°9, 1977 : "Rupture avec Spartacusbond","Spartacusbond : seul au monde ?"; n°16 et 17, 1979 :"La gauche hollandaise".
[51] [122] Cajo Brendel : Thèses sur la révolution chinoise", in "Liaisons" n° 27, Liège (Belgique), février 1975. La citation est extraite de l'introduction à la traduction anglaise, éditée en 1971 par le groupe "Solidarity" d'Aberdeen.
[52] [123] Un résumé des conceptions anarchisantes de "Daad en Gedachte" se trouve dans le Bulletin du 20 janvier 1981 en vue d'une conférence de divers groupes, à laquelle participèrent le CCI et plusieurs individus qui ne représentaient qu'eux-mêmes : Kanttekeningen van 'Daad en Gedachte'" (Notes margina les de 'Daad en Gedachte1). "Daad en Gedachte" participa à la conférence, non comme groupe mais à titre individuel.
Géographique:
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [16]
Correspondance internationale : conscience et stratégie de la bourgeoisie
- 2679 lectures
Dans la Revue Internationale n°34 nous avons publié un texte d'un camarade de Hong Kong, LLM, sur la question de la gauche dans l'opposition, constituant un effort sérieux - hors de notre Courant - pour comprendre les bases des manoeuvres politiques actuelles de la classe dominante, puisque, à la différence des "critiques empiristes" qui n'ont fait que tourner notre analyse en dérision, le texte de LLM, dans la mesure où il va au fond de la question, perçoit l'organisation et la conscience de la bourgeoisie. Le texte soutenait que notre méthode d'analyse était valable, même s'il ne partageait pas toutes les conclusions que nous en avons tirées.
Diverses réactions au sein du milieu révolutionnaire ont poussé LLM à écrire une "élaboration" du texte originel. Dans 1'article ci-dessous, nous répondons aux argumentations développées dans ce second texte que nous ne publions pas et qui, loin d'être une élaboration ou un développement du texte précédent, ne fait qu'exprimer la déroute affolée de LLM retournant dans le camp des empiristes - ce qui montre que, sur cette question comme sur toutes les autres, il n'y a pas de place pour un arbitre impartial distribuant 1es bons et les mauvais points aux diverses parties du mouvement révolutionnaire. La régression dans la pensée de LLM est évidente, tant dans la forme que dans le contenu du texte : dans la forme, de par son attitude condescendante, son argumentation zigzagante et son fréquent recours à des ouï-dire ; mais surtout dans le contenu, puisque ça n'est ni plus ni moins qu'un abandon de tous les aperçus que le camarade avait pu avoir auparavant sur le machiavélisme de la bourgeoisie.
Le texte adopte, par la même occasion, une théorie erronée du cours parallèle vers la guerre et vers la révolution, et de fait, ne se distinguant pas des idées couramment répandues par d ' autres groupes tels que Battaglia Comunista et la Communist Workers' Organisation.
Dans la Revue Internationale n°34, dans son argumentation contre les empiristes qui nient la capacité de la bourgeoisie à s'unifier contre le prolétariat, LLM pouvait écrire :
"Je suis sûr que personne ne niera que les différents Etats sont capables de conspirer pour atteindre des buts communs. Pour tous ceux qui ont des yeux pour voir, la conspiration entre les USA et la Grande-Bretagne dans la guerre des Falkland, la conspiration entre les USA et Israël lors de la dernière invasion du Liban, etc... sont claires comme la lumière du jour. Ou, si nous remontons un peu dans 1'histoire, les leçons de la Commune de Paris et de la révolution russe ne sont-elles pas suffisantes pour enfoncer à fond la leçon que, menacée par le prolétariat, la bourgeoisie est capable de mettre de côté ses antagonismes, même les plus forts, pour s'unir contre lui, comme l'a montré correctement le CCI ? Pourquo , alors, lorsqu'il se produit une conspiration entre la droite et la gauche de la bourgeoisie à 1'intérieur des frontières nationales, cela devient-il inimaginable ? Est-ce que Noske assassina le prolétariat allemand inconsciemment ou consciemment ?".
Aujourd'hui, à la suite d'un voyage en Europe - évidence empirique, s'il en fut jamais - LLM a décidé que le CCI avait bien, après tout, une théorie idéaliste conspirative de l'histoire. C'est maintenant à son tour de trouver "inimaginable" que le mouvement pacifiste soit organisé par la bourgeoisie, que le conflit au Salvador ait été exacerbé pour alimenter les mystifications anti prolétariennes à d'autres endroits, de même que les sandinistes soient venus au pouvoir au Nicaragua avec l'approbation de l'impérialisme US ([1] [127]). Dans ce texte, la bourgeoisie de LLM est identique à celle des empiristes.
Par exemple, lorsque le CCI affirme que les campagnes pacifistes font partie de la stratégie de la bourgeoisie pour dévoyer la lutte de classe, LLM chante le vieux refrain de tous ceux qui ne peuvent simplement comprendre ce que signifie le fait de dire que la bourgeoisie agit en tant que classe : "Qui est-elle? La bourgeoisie comme un tout ? Dans ce cas, la bourgeoisie dans son ensemble est marxiste", etc.. Il est certain qu' "elle" est effectivement incompréhensible du point de vue de l'empirisme bourgeois qui, désorienté par l'apparente désunion du monde, a toujours châtié le marxisme pour sa vision conspirative de la vie sociale, tout simplement parce qu'il parle des classes et de leur activité consciente.
Il est vrai que LLM affirme reconnaître qu' "il ne fait aucun doute que la bourgeoisie soit consciente de ses propres besoins" ; mais quand il en vient à l'épreuve consistant à appliquer son observation générale à la réalité concrète telles que les campagnes actuelles, LLM réduit cette conscience à la réaction complètement déterminée, "instinctive" d'une classe incapable d'élaborer quelque stratégie que ce soit :
"Quant aux soi-disant campagnes que la bourgeoisie est supposée mener consciemment contre le prolétariat, il est nécessaire d'ajouter seulement...que le nationalisme (un des fondements principaux de ces 'campagnes ') est 'naturel' pour la bourgeoisie. la bourgeoisie sait 'instinctivement' que le nationalisme fait partie de ses intérêts et elle le stimule à tout moment (match international de football, lancement d'un vaisseau spatial...). Même si on ne tient pas compte du problème de la 'conscience' de la bourgeoisie, on n'a pas besoin de cela pour savoir que la stimulation du nationalisme l'aide à démobiliser le prolétariat ; elle en connaît le revers ' instinctivement ' "
Et parce que le CCI rejette cette vision de la bourgeoisie et toutes les conclusions qui en découlent, on nous dit que "le CCI voit la bourgeoisie comme une classe consciente de ses propres besoins au point d'atteindre une compréhension matérialiste marxiste de l'histoire..."
LA COMPREHENSION BOURGEOISE DE L'HISTOIRE.
Bien entendu, la bourgeoisie ne possède pas une "compréhension matérialiste marxiste de l'histoire". Mais il existe effectivement une vision matérialiste bourgeoise de l'histoire, et il y a une bien grande coupure historique entre cette vision et le niveau de conscience réellement instinctif que les êtres humains ont dépassé quand ils sont sortis du reste du monde animal. Comme l'expliquait Marx dans sa petite parabole à propos de l'abeille et l'architecte, la capacité de réfléchir avant, de planifier à l'avance (et par conséquent, la conscience d'un mouvement temporel, historique entre le passé et le futur) constitue la distinction fondamentale entre l'activité animale et l'activité humaine.
Mais tandis que cette conscience "historique" est caractéristique de l'activité humaine, antérieurement à la société capitaliste, l'homme restait au sein de l'économie naturelle, qui engendrait des visions statiques ou circulaires du mouvement historique. Ces visions cycliques étaient également, par définition, des projections mythico-religieuses. En brisant les limites des économies naturelles, la bourgeoisie a également sapé ces conceptions traditionnelles, et s'est constituée en une classe à l'esprit le plus historique et le plus scientifique de toutes les classes dominantes précédentes.
Certes, toutes ces avancées prennent place aux confins de l'aliénation, et donc de l'idéologie. En fait, la vision du monde "rationnelle", "scientifique" de la bourgeoisie coïncide avec le véritable sommet de l'aliénation (question jamais comprise par ces "marxistes" qui voient le marxisme et la conscience communiste comme une simple continuation ou un simple raffinement du rationalisme et de la science bourgeoise). Sous le règne de l'aliénation, l'activité consciente de l'homme est implacablement subordonnée aux forces qui sont à peine comprises ou contrôlées ; la conscience, bien qu'étant par essence un produit collectif et social, est éparpillée en d'innombrables fragments par la division du travail, surtout dans les conditions d'extrême atomisation qui caractérisent une société dominée par des rapports marchands.
Mais, de même que Rosa Luxemburg a démontré que le capital global est une réalité qui existe malgré et même comme résultat des capitaux individuels antagoniques, le marxisme affirme qu'il existe, malgré toutes ses divisions internes, une bourgeoisie "globale" qui a une conscience "globale", une classe réelle qui s'engage dans une activité vitale- consciente. Le fait que celle-ci reste une activité fragmentée, aliénée, hiérarchique, dominée par des mobiles inconscients, ne l'empêche pas de fonctionner comme facteur actif dans la vie sociale, comme force déterminante et non pas simplement déterminée.
Cela signifie que la bourgeoisie est capable d'élaborer par dessus tout, des stratégies pour la défense de ses intérêts les plus essentiels, même si 1'ensemble de la bourgeoisie ne peut jamais participer à ces plans, et même si chaque bourgeois ne peut embrasser la stratégie comme un tout.
"Stratégie" signifie planification à l'avance, avoir une sérieuse capacité à évaluer les forces en présence et à prévoir les potentialités futures. Dans une grande mesure, et particulièrement à l'époque de la décadence, la bourgeoisie a compris (encore une fois, de son propre point de vue mystifié - bien que nous puissions supposer de façon empirique que la bourgeoisie en dit toujours moins qu'elle n'en sait) que la défense de ses besoins les plus fondamentaux ne peut être confiée à quelque "fraction" du capital ; c'est pourquoi elle a développé d'énormes structures étatiques, et à l'échelle du bloc, pour s'assurer de l'accomplissement de cette tâche quels que soient les caprices de telle ou telle fraction ou parti.
Si nous considérons l'ensemble de la guerre des Falklands, que LLM citait auparavant comme un bon exemple de la capacité de la bourgeoisie à conspirer, nous pouvons avoir quelque idée de la manière dont cette division du travail s'effectue. Il ne fait aucun doute que les différents protagonistes sont entrés dans ce conflit avec différents objectifs immédiats. Galtieri, par exemple, était certainement "aspiré" par les gesticulations des USA et de la Grande-Bretagne. D'autre part, il est évident qu'il existe un fond de vérité dans l'argument des gauchistes suivant lequel la guerre des Falkland était la "guerre à l'image de Maggie", reflétant les ambitions politiques "sectorielles" de Thatcher et du parti Tory. Mais la fonction du gauchisme consiste précisément à se fixer sur ces aspects secondaires de l'activité de la bourgeoisie et donc de détourner l'attention du véritable pouvoir dans ce système social - l'Etat capitaliste, et au-dessus de celui-ci, le bloc impérialiste. En dernière analyse, les Thatcher, Reagan ou Galtieri ne sont que des figures de proue,des acteurs destinés à jouer un rôle particulier à un moment particulier. Les véritables stratégies de la bourgeoisie sont le produit des organismes d'Etat et de bloc qui représentent la véritable "communauté" du capital ; et elles sont élaborées suivant une évaluation des besoins de l'ensemble du système. Ainsi, la guerre des Falkland, malgré toutes les motivations les plus opportunistes et particulières, qui ont participé à son déclenchement, ne peut être véritablement comprise que dans le contexte des plans de guerre du bloc impérialiste occidental dans son ensemble.
Quoi que puissent penser certains révolutionnaires, la classe dominante, en élaborant ces plans, mobilise certainement ses techniques et ses découvertes les plus sophistiquées ; il est vraiment "inimaginable" que la classe dominante puisse élaborer ces plans sans prendre en compte la question la plus brûlante de notre époque - la question sociale, la nécessité de préparer la population, et surtout la classe ouvrière, à accepter la marche à la guerre. Le conflit des Falkland n'était pas simplement un match de football de plus, mais faisait partie d'une stratégie à long terme visant à liquider toute véritable résistance à la marche du capital vers un nouveau bain de sang impérialiste généralisé.
DE FAUST A MEPHISTOPHELES.
LLM nous accuse également de faire de plus en plus usage de notre analyse "machiavélique", de la prendre comme point de départ pour analyser chaque action de la classe dominante. Nous ne faisons ici aucune apologie parce que nous ne faisons que reconnaître une réalité historique - celle qui, puisque nous nous dirigeons vers la plus importante confrontation de classe de l'histoire, nous fait attester que la bourgeoisie devient plus unifiée, plus intelligente qu'à n'importe quel autre moment dans le passé.
Certes, cette intelligence de la bourgeoisie constitue une dégénérescence totale de ses grandes visions historiques, des philosophies optimistes qu'elle a élaborées dans les jours héroïques de sa jeunesse. Si, à l'époque de Goethe, Beethoven et Hegel, la bourgeoisie pouvait être personnifiée par Faust, point culminant dans les fiévreux efforts ascendants de l'humanité; dans la décadence, le côté obscur de la bourgeoisie est entré en possession de son bien - et le côté obscur de Faust c'est Méphistophélès, dont l'intelligence et le savoir immenses sont une mince couverture au-dessus d'un puits de désespoir. Le caractère méphistophélien de la conscience bourgeoise à cette époque est déterminé par les nécessités fondamentales de la période : c'est l'époque où la possibilité et la nécessité sont enfin réunies pour réaliser l'émancipation de l'humanité de la division historique de la société en classes antagoniques, de l'exploitation de l'homme par l'homme; et néanmoins, toute la science de la bourgeoisie, toute sa technologie, tous les vestiges de sa propre sagesse sont dirigés vers la préservation et la conservation du même système de l'exploitation et de l'oppression de l'homme au prix des pires monstruosités. De là le cynisme fondamental et le nihilisme de la bourgeoisie à cette époque. Mais précisément parce que c'est la période de l'histoire qui exige "de l'homme une conscience de soi positive", la maîtrise consciente de l'activité productive et des forces productives, la bourgeoisie, elle, est uniquement capable de survivre en son sein en gérant son système anarchique comme s'il était sous le contrôle conscient de l'homme. Ainsi, le capitalisme, dans la décadence, avec sa planification centralisée, son organisation internationale, et bien sûr son idéologie "socialiste" que l'on trouve partout, tend à se présenter lui-même comme une caricature grotesque du communisme. La bourgeoisie ne peut plus tolérer le libre jeu des "forces du marché" (c'est-à-dire de la loi de la valeur) ni au sein des Etats nationaux, ni entre Etats nationaux : elle a été contrainte de s'organiser et de se centraliser d'abord à l'échelle nationale, ensuite à l'échelle des blocs impérialistes uniquement pour prévenir la tendance accélérée du capital vers l'effondrement économique. Mais cette organisation nationale et internationale de la bourgeoisie atteint son point culminant lorsque la bourgeoisie se sent menacée par le réveil prolétarien - un fait qui, comme le remarque LLM lui-même, a été démontré par la réponse à tous les plus grands soulèvements prolétariens de l'histoire (cf. 1871, 1918). Comparée à ces mouvements, la grève de masse en Pologne 1980 n'était qu'un événement précurseur des événements à venir; néanmoins, la réponse unifiée de la bourgeoisie, basée sur des structures mises en place depuis des décennies, a fonctionné, d'un certain point de vue, à une échelle bien plus grande que toute collaboration antérieure entre les puissances impérialistes. Cela suppose que, dans les luttes révolutionnaires à venir, nous nous trouverons face à un ennemi qui manifestera un degré d'unité sans précédent. Nous nous dirigeons, en somme, vers la concrétisation finale du scénario envisagé par Marx et Engels dans le Manifeste Communiste : "La société dans son ensemble est de plus en plus divisée en deux grands camps ennemis, en deux grandes classes s'affrontant directement : bourgeoisie et prolétariat."
En termes plus immédiats, cela veut dire qu'aujourd'hui, alors que se préparent déjà ces immenses confrontations, nous pouvons discerner une tendance de la bourgeoisie à agir de façon de plus en plus concertée, à tenter de réduire autant que possible les effets regrettables des aspects les plus imprévisibles du système. Ainsi, par exemple, si on compare la manière dont les récentes élections en Grande-Bretagne et en RFA ont été organisées par la bourgeoisie ([2] [128]), la part du hasard a été beaucoup plus réduite qu'il y a une ou deux décennies. Nous pouvons également comparer la manière dont les campagnes pacifistes sont maintenant coordonnées dans tout le bloc occidental (et imitées dans le bloc de l'Est) avec la manière dispersée avec laquelle elles ont été menées dans les années 50 et 60. Même si ces stratégies sont souvent pleines de contradictions, même si elles ne représentent pas encore le point culminant de la conscience et de l'unité bourgeoises, elles expriment une tendance déterminée vers la création d'un unique "parti de l'ordre" pour affronter le danger prolétarien.
Nous le répétons, pour les"durs d'oreilles": cela ne signifie en rien que la bourgeoisie puisse avoir une compréhension marxiste de l'histoire ; elle ne peut surtout pas saisir le postulat marxiste suivant lequel son système peut être remplacé à travers l'action révolutionnaire de la classe ouvrière. Mais, comme nous l'expliquions il y a quelques années en réponse à certains arguments typiques des gauchistes contre notre vision de la complémentarité entre fascisme et anti-fascisme, la bourgeoisie est capable de voir que le prolétariat constitue la principale menace pour la simple préservation de son système :
"S'il est vrai qu'ils ne peuvent croire en la possibilité d'une nouvelle société édifiée par les ouvriers, ils comprennent cependant que, afin d'assurer le fonctionnement de la société, il doit y avoir de 1 'ordre, les ouvriers doivent aller travailler régulièrement, en acceptant leur misère sans broncher, en respectant humblement leurs patrons et leur Etat. L'exploiteur le plus crétin le sait parfaitement, même s'il ne sait ni lire ni écrire.
Lorsque tous ces illettrés de l'histoire commencent a sentir qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur règne, lorsqu'ils sont contraints de fermer les usines, d 'augmenter les prix et de baisser les salaires, lorsque les germes de la révolte commencent à pousser dans les usines.... 1'histoire a mille fois montré que, après une période plus ou moins longue d'affolement, la bourgeoisie finit toujours par mettre sa confiance en une solution politique qui permet le rétablissement de 1'ordre.
Sous la pression de ses intérêts de classe, des événements en général, de façon empirique, pragmatique, telle est la manière dont la bourgeoisie en arrive finalement à accepter des solutions qu'elle avait jusqu'ici considérées comme "subversives" ou "communistes"."
("L'anti-fascisme : une arme du capital", in World Révolution n°5 et Révolution Internationale n"14).
Non, la bourgeoisie ne pourrait jamais devenir marxiste, mais au 20ème siècle, surtout depuis 1917, la bourgeoisie a appris à se draper du manteau du marxisme afin de dénaturer et de dévier les buts véritables de la lutte de classe. Dans la période particulière que nous traversons, le modèle "socialiste" de la bourgeoisie, dans les pays avancés d'occident, est contraint de prendre la forme de la gauche dans l'opposition ; demain, face à la révolution elle-même, elle pourrait bien représenter une nouvelle version, plus extrême, de la gauche au pouvoir. En aucun cas la bourgeoisie ne pourra devenir marxiste, mais elle peut et pourra imaginer des poisons idéologiques suffisamment puissants pour paralyser le mouvement vers la révolution prolétarienne ; c'est ce qui constitue; pour nous le problème essentiel. Aucune faiblesse ne pourrait être plus fatale pour la révolution que le manque de lucidité du prolétariat et de ses minorités politiques en ce qui concerne l'ensemble de toutes les armes dont dispose notre ennemi de classe.
SUR LE COURS HISTORIQUE.
A partir de ce qui vient d’être dit, nous sommes évidemment d'accord avec LLM lorsqu'il signale le lien entre notre vision des stratégies de la bourgeoisie et la question du cours historique. L'argument selon lequel la bourgeoisie tend à unifier ses forces est fondé sur l'idée suivant laquelle la classe dominante s'y trouve contrainte par un mouvement inexorable vers des confrontations de classe majeures.
Mais la régression de LLM dans sa compréhension du mode de vie de la bourgeoisie s'accompagne d'une autre régression celle du cours "parallèle", théorie de Battaglia Comunista et de la CWO, théorie adoptée également maintenant par le Communist Bulletin Group qui prétend même que telle était leur vision dès le début. L'influence du CBG sur la pensée de LLM apparaît sur de nombreuses questions, notamment celle de l'organisation -cf. son texte dans le No 5 de The Communist Bulletin. Dans un numéro antérieur de cette Revue, nous avons consacré un article à la vision de Battaglia sur cette question et nous n'avons pas l'intention ici de nous étendre sur ce point. Nous nous limiterons donc à répondre uniquement à l'une des assertions de LLM, celle qui affirme que le CCI "suspend l'histoire" lorsqu'il prétend que le prolétariat constitue un obstacle à la marche vers la guerre de la bourgeoisie.
Sur ce point, il n'y a personne d'autre que LLM qui "suspend l'histoire". Ainsi, il signale les grèves combatives en Russie avant la guerre de 14 et dit : "Vous voyez, ces grèves n'ont pas arrêté la guerre ; aussi, comment pouvez-vous prétendre qu'aujourd'hui la combativité est un obstacle à la guerre ?". Cette méthode fige l'histoire à 1914 et prend à son compte le fait que la bourgeoisie -limitée, après tout, par l'idéologie, n'est ce pas ?- n'a tiré aucune leçon de son expérience où elle est entrée dans une guerre mondiale avec un prolétariat dont la combativité n'avait pas été complètement écrasée. En fait, l'horrible exemple de 1917 a donné à la bourgeoisie une leçon qu'elle n'oubliera jamais. C'est pourquoi elle consacre toute la période des années 30 à s'assurer que la dernière goutte de la résistance prolétarienne a été effectivement asséchée et c'est précisément ce qu'elle essaie de faire aujourd'hui à nouveau.
On doit également dire que l'exemple des grèves en Russie, prises hors du contexte, ne prouve rien quant à 1914. Il nous est nécessaire de rappeler ici la citation d'Internationalisme 1945 que nous avons mentionnée dans notre article sur Battaglia:
"Ainsi la reprise partielle, la recrudescence de luttes et de mouvements de grèves constatés en 1913 en Russie ne diminue en rien notre affirmation. A regarder les choses de plus près, nous verrons que la puissance du prolétariat international à la veille de 1914, les victoires électorales, les grands partis sociaux-démocrates et les organisations syndicales de masse, gloire et fierté de la 2ème Internationale, n'étaient qu'une apparence, une façade cachant sous son vernis le profond délabrement idéologique. Le mouvement ouvrier miné et fourré par 1'opportunisme régnant en maître, devait s'écrouler comme un château de cartes devant le premier souffle de la guerre."(Rapport à la conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France).
Et si l'exemple de la Russie 1913 ne tient aucun compte du véritable rapport de forces entre les classes de l'époque, la "preuve" avancée par LLM affirmant que les ouvriers du monde sont prêts à aller à la guerre parce que les ouvriers en Grande-Bretagne ont eu tendance à manifester leur "indifférence" devant le spectacle des Falkland, montre que LLM est lui-même privé de toute méthode sérieuse pour appréhender ces questions.
Il est plutôt amusant de voir le CCI accusé de suspendre l'histoire par quelqu'un qui ne prend pas en considération la force motrice réelle de l'évolution historique -la lutte de classes. Pour LLM le lien entre la crise et la guerre (de même que le lien entre la crise et la conscience de la bourgeoisie de celle-ci) est entièrement mécanique et automatique : "si la dynamique profonde du capital (l'accumulation) requiert la guerre, la guerre éclatera... quelle que soit la situation de la lutte de classe". Donc, les contradictions inhérentes au capital sont réduites à leur aspect le plus réifié -les lois économiques objectives de l'accumulation- tandis que la contradiction entre le capital et le travail, la principale contradiction sociale, est évoquée hors de l'existence. Au lieu d'un combat dynamique entre deux forces sociales, on nous donne un tableau complètement statique : soit le prolétariat fait la révolution, soit il "reste sous l'emprise de l'idéologie dominante" et est "déjà défait idéologiquement" (Battaglia défend la même idée quand il nous dit que nous vivons sous le "joug de la contre-révolution jusqu'au surgissement de la révolution). C'est comme si les deux classes se dressaient telles des statues, l'une face à l'autre, dans leur position de combat, au lieu d'engager une lutte qui monte et descend, qui avance et recule, et sans laquelle le renforcement de l'agression d'un côté exige une réaction correspondante de l'autre. Une véritable suspension du mouvement de l'histoire...
Il est une chose que LLM pouvait reconnaître : c'est le fait que la vision de Battaglia et de la CWO du cours historique est conditionnée par leur incapacité à voir le prolétariat comme une force sociale même quand il n'a pas encore fait surgir le parti mondial. Un tel aveuglement peut conduire les libertaires et conseillistes d'aujourd'hui (voir l'article essentiellement anti-centraliste de LLM dans le Communist Bulletin) à commencer à caresser l'idée que tout est une question de "direction" et que le surgissement du parti est le seul facteur actif dans la situation. Mais pour nous, la possibilité réelle de reconstitution du parti est fondée sur le fait que nous allons vers des affrontements de classe massifs au coeur du système. Ces affrontements, non seulement clarifieront la question du cours historique, mais nous permettront également de faire un gigantesque pas en avant dans notre compréhension du problème de la conscience -non seulement celle de la bourgeoisie, mais plus encore, celle du prolétariat et de la société humaine qui émergera de la révolution. Un saut qualitatif dans la lutte de classe exigera un saut correspondant sur le plan théorique ; mais en cherchant refuge dans les abris des empiristes et des sceptiques du mouvement révolutionnaire, le camarade LLM laisse passer la possibilité de faire une contribution réelle sur cette question fondamental .
CDW
[1] [129] LLM recourt ici à une subtile déformation des mots, laissant supposer que, pour le CCI, les campagnes pacifistes, et même le conflit au Salvador, ont été créés ex nihilo, tels quels, par une bourgeoisie omnipotente. Il laisse même supposer dans une note (que nous n'avons pas mentionnée, faute de place) que cette vision était implicitement contenue dans notre résolution sur la situation internationale au Sème Congrès du CCI, malgré la concurrence interne. Que dit, en réalité, la résolution ? Le texte parle des "grandes campagnes pacifistes qui touchent - avec un certain succès - la plupart des pays occidentaux" et qui "s'appuient sur une réelle inquiétude suscitée par les préparatifs guerriers". En d'autres termes, les campagnes pacifistes existent parce que la bourgeoisie a besoin de récupérer cette inquiétude et de 1'utiliser à des fins anti-ouvrières ; il ne s'agit pas d'une création ex nihilo mais d'un subtil travail de transformation de la combativité. Mais LLM prétend-t-il que ces campagnes ne sont pas organisées par la bourgeoisie ? Peut-être a-t-il momentanément oublié que la gauche, le CND (Campagne pour le Désarmement Nucléaire), etc. font partie de la bourgeoisie ?
Nous aurions pu faire une remarque semblable à propos du Salvador : de tels conflits dans des régions sous-développées ont évidemment leurs bases objectives. La question pour nous est de savoir quel usage la bourgeoisie mondiale fait de ces conflits qui peut inclure, bien sûr, leur exacerbation pour des raisons de propagande et de mystification. Enfin, en ce qui concerne 1'approbation des USA à la prise de pouvoir des sandinistes, voir WR n°27 "Les sandinistes, agents de1'impérialismeUS".
[2] [130] L'organisation des dernières élections en RFA pour mettre en place l'orientation classique droite au pouvoir / gauche dans l'opposition était si évidente que la CWO, qui se situe habituellement sur la ligne de front de la critique empirique, pouvait écrire un article dans Workers'Voice n° 11 prenant clairement comme point de départ l'idée suivant laquelle le gouvernement a été mis en place non pas par la libre décision du "peuple allemand", mais par 1'ensemble du bloc occidental.
Questions théoriques:
- Décadence [131]
- Le cours historique [132]