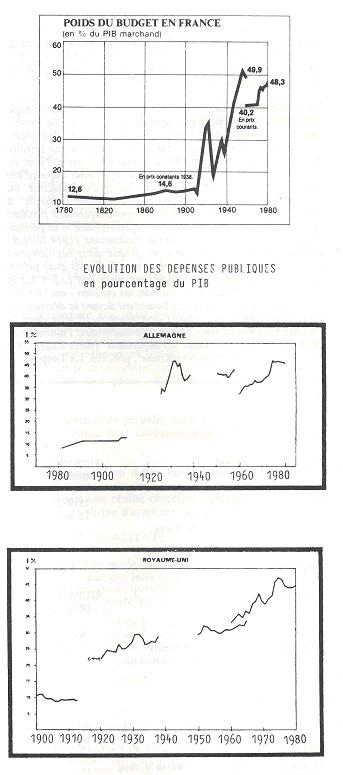Revue Internationale no 54 - 3e trimestre 1988
- 2744 lectures
Editorial : Reagan-Gorbatchev, Afghanistan, mensonges du "désarmement" et de la "paix"
- 3215 lectures
"Réduction des armements" et marche à la guerre
Une propagande quotidienne est faite en cette année 88 sur la "réduction des armements" et les "pourparlers de paix" entre USA et URSS avec les rencontres Reagan-Gorbatchev, le tout sur fond de "droits de l'homme" et de "perestroïka". Le "désarmement" est une fois encore à la mode, mais en réalité, comme chaque fois, la "réduction des armements" est un énorme mensonge. C'est une façade de propagande qui couvre dans les faits la marche forcée du capitalisme vers une recherche permanente pour perfectionner les moyens militaires. La part consacrée à l'armement dans les budgets nationaux de tous les pays n'a jamais été aussi élevée, et elle ne va en aucune manière diminuer. Comme nous l'avons largement développé dans les numéros précédents de cette Revue ([1] [1]), le capitalisme, dans sa période de déclin depuis la Ire guerre mondiale, survit dans une économie de guerre permanente et "même en période de 'paix' ce système est rongé par le cancer du militarisme". La course aux armements est de plus en plus démesurée et n'a de dénouement possible, dans le cadre des lois capitalistes, que la guerre généralisée, ce qui signifie, avec les moyens de notre époque, la destruction de la planète et de l'humanité.
La modernisation de l'armement
La propagande actuelle ne doit tromper personne. Le retrait de certains missiles en Europe sert pour les USA, à faire prendre en charge les dépenses militaires beaucoup plus directement par leurs alliés, le retrait étant tout à fait négligeable quant à la puissance de feu du bloc de l'ouest globalement. Pour l'URSS, cela lui permet de supprimer du matériel complètement dépassé face à la sophistication des armements occidentaux actuels. Les accords "START", de "limitation" des armements", comme le sont toujours ce genre de conférences de représentants des grandes puissances, sont une nouvelle concertation sur le renouvellement du matériel et ne constituent en rien une véritable réduction de celui-ci. Comme les accords "SALT 2" de l'été 79 avaient amené l'installation des fameux missiles de moyenne portée, avec pour justification à l'époque celle du "désarmement" d'ogives intercontinentales devenues obsolètes, les accords actuels font passer comme "réduction des armements" ce qui est en réalité l'abandon de matériel hors d'usage, tandis qu'on fait le point dans les "coulisses" sur les nouveaux systèmes militaires pour assurer leur modernisation.
Il est vrai aussi que, pour chaque Etat national, les dépenses d'armement ne font qu'aggraver la crise et ne permettent en rien de résoudre celle-ci. Mais ce ne sont pas des raisons d'économies qui expliquent la campagne sur la "réduction des armements". Le capitalisme n'a pas la possibilité de réduire l'armement. Lorsque les USA, dans leur volonté de diminuer leur gigantesque déficit, envisagent de diminuer leurs dépenses militaires, ce n'est pas pour les réduire globalement dans le bloc de l'ouest, mais pour accroître la part payée par leurs alliés européens et japonais pour la "défense du monde libre". Il en est de même pour l'URSS, de plus en plus étranglée par la crise économique, quand elle s'efforce de "rationaliser" ses dépenses militaires. La course aux armements est inhérente à l'impérialisme tel qu'il s'est développé dans la période de décadence, impérialisme de toutes les nations, de la plus petite à la plus grande "et auquel aucun Etat ne saurait se soustraire" comme le disait déjà Rosa Luxemburg.
Si actuellement les discours parlent de "fin de guerre froide" et autres formules du genre, cela doit être compris non dans le sens que la "paix" serait maintenant à l'ordre du jour, mais bien plutôt comme un avertissement que c'est une "guerre chaude" à laquelle le capitalisme est de plus en plus poussé mondialement. D'ailleurs, malgré la volonté de promouvoir la justification des menées guerrières par un langage pacifiste, l'administration Reagan, plus à l'aise dans le bellicisme, comme en général toute la droite de l'appareil politique de la bourgeoisie, n'a pas manqué d'émailler les déclarations de l'acteur pantin de la Maison Blanche de "soyons vigilants", "restons forts" et de saluer particulièrement Tchatcher parce que "sans jamais sacrifier son brevet d'anti-communisme, elle a été aussi la première à suggérer que l'on discute affaires avec Gorbatchev"; les "affaires" en question n'étant pas autre chose que la facette diplomatique de la pression militaire qui s'exerce sur le terrain.
L'intensification du conflit EST-OUEST
Les discours pacifistes d'aujourd'hui recouvrent la même réalité que les discours bellicistes du début des années 1980, quand Reagan pérorait sur "l'empire du mal" à propos de l'URSS. Lorsque aujourd’hui la diplomatie américaine rencontre à Moscou la diplomatie soviétique, la discussion porte sur les "règles" de la confrontation croissante à l'échelle mondiale sous le leadership de Moscou et de Washington, en aucun cas sur la fin de cette confrontation.
Seul le discours a changé. La réalité est toujours celle de la marche à la guerre du capitalisme mondial, marche qui se caractérise aujourd'hui par une offensive occidentale tous azimuts contre les positions stratégiques de l'URSS et par la recherche de moyens pour résister et riposter à cette offensive, là où c'est possible, de la part du bloc impérialiste russe.
Aujourd'hui règne une grande discrétion sur les incessants combats au Moyen-Orient et surtout sur la présence massive de la flotte des grandes puissances dans la région. Il semble évident que les médias aux ordres ont consigne de faire le moins de bruit possible sur ce qui se trame dans le Golfe Persique, sur les navires de guerre les plus perfectionnés, sur l'armement embarqué, qui sont à pied d'oeuvre depuis l'été 1987. Depuis ces vingt dernières années, la présence militaire directe de pays comme les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, et même la soi-disant "désarmée" RFA, n'a jamais été aussi forte hors de leurs frontières, sur ce que les "stratèges" appellent le "théâtre des opérations". Peut-on vraiment croire que toute cette armada n'est là que pour "régler pacifiquement la circulation des bateaux"? Bien évidemment, non. Cette présence fait partie de la stratégie militaire occidentale et celle-ci n'est pas dictée par les quelques vedettes iraniennes et les remorqueurs qui les ravitaillent, mais par la rivalité historique entre Est et Ouest. L'offensive occidentale vise l'URSS et elle vient de marquer des points avec le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan.
L'URSS est obligée de céder sous la pression militaire directe de la "résistance" afghane équipée de missiles Stingers américains qui ont permis à celle-ci de renforcer considérablement sa puissance de feu, sous la pression "indirecte" de la flotte occidentale dans le Golfe, et doit abandonner en partie l'occupation d'un des seuls pays hors de son "glacis" est européen. Et, à la différence des USA qui gagnèrent l'alliance avec la Chine lors de leur retrait du Vietnam en 1975, l'URSS aujourd'hui ne peut compter sur aucun marchandage. Les USA ne céderont rien; c'est d'ailleurs là le contenu réel du "parler affaires" de Reagan avec Gorbatchev au cours des dernières rencontres. Le bloc de l'ouest est déterminé à maintenir sa pression, ce que confirme également le projet de retrait de l'armée vietnamienne du Cambodge.
Mais que l'URSS recule ne signifie pas le retour de la "paix", au contraire. Tout comme les accords de "paix israélo-arabe" de Camp David il y a plus de dix ans entre Egypte et Israël, sous la bénédiction de Carter et Brejnev, se sont soldés en fait par un élargissement des conflits, des massacres de populations et de la décomposition sociale de la situation au Moyen-Orient, le retrait actuel des troupes russes n'ouvre pas une perspective de "paix" et de "stabilité", mais bien plutôt un renforcement des tensions, et en particulier une probable "libanisation" de l'Afghanistan comme c'est la tendance dans tous les pays de cette région.
La "perestroïka" de Gorbatchev, tout comme elle n'est qu'un vernis "démocratique" à l'intérieur pour tenter de faire passer en réalité des mesures anti-ouvrières redoublées, n'est également qu'un vernis "pacifiste" d'une politique extérieure d'occupation militaire de plus en plus impopulaire, mais qui va cependant se poursuivre et se renforcer, même si c'est sous la forme plus "discrète" du soutien politique et militaire à des fractions, clans et cliques des bourgeoisies nationales qui ne trouvent pas leur compte dans le camp de la "pax americana", notamment les Partis Communistes locaux et leurs appendices gauchistes.
Le conflit entre les grandes puissances se poursuivra en jouant en permanence sur les différentes fractions gouvernementales ou d'opposition dans des "conflits locaux" extrêmement sanglants, avec la participation militaire de plus en plus importante des principaux protagonistes, jusqu'à les mettre face à face directement, si ceux-ci ont les mains libres à l'intérieur pour faire régner l'ordre social et entraîner l'adhésion à leurs desseins impérialistes. Mais ceci est encore loin d'être le cas aujourd'hui.
Le "pacifisme" : un mensonge dirigé contre la classe ouvrière
C'est fondamentalement parce que la bourgeoisie est aux prises avec un prolétariat qui ne se plie pas docilement aux attaques de l'austérité, un prolétariat qui ne manifeste aucune adhésion profonde aux manoeuvres diplomatico-militaires qu'entraîne l'accélération des tensions inter impérialistes, que la propagande actuelle, d'une part fait le silence sur les grèves et les manifestations ouvrières, et d'autre part a converti son discours, hier "belliciste", en campagne "pacifiste" et de "désarmement".
Au début des années 1980, le prolétariat était sous le coup du reflux de plusieurs luttes importantes qui s'étaient développées internationalement, de 1978 à la défaite des ouvriers en Pologne en 1981. La propagande de la bourgeoisie pouvait au début des années 80 s'appuyer sur le sentiment diffus de déboussolement qu'avait engendré une telle situation, et elle ne s'est pas privée d'essayer d'entretenir un sentiment de fatalité, d'impuissance, d'immobilisation et d'intimidation, en particulier par un battage guerrier: guerre des Malouines, invasion US de l'île de La Grenade, diatribes de Reagan contre "l'Empire du mal", "Guerre des étoiles", etc., le tout accompagnant des actions militaires impliquant de plus en plus les grandes puissances sur les lieux des opérations jusqu'à l'installation de troupes occidentales au Liban en 1983.
Depuis 1983-84 grèves et manifestations ouvrières se sont multipliées contre les différents plans d'austérité dans les pays industrialisés et également dans les pays moins développés, marquant la fin de la courte période précédente de reflux et de passivité. Et si beaucoup de groupes révolutionnaires prolétariens sont malheureusement incapables de voir, au-delà de l'image quotidienne que distille la propagande de la bourgeoisie et de ses médias, la réalité du développement actuel de la lutte de classe ([2] [2]), la bourgeoisie, elle, a ressenti le danger. Au travers des différents moyens politiques et syndicaux dont elle dispose, il est évident que la bourgeoisie sait que le problème essentiel est la "situation sociale", partout, et particulièrement en Europe de l'ouest où se concentrent tous les enjeux de la situation mondiale. Et de plus en plus nombreux sont les bourgeois "éclairés" qui tirent la sonnette d'alarme sur le danger de la désyndicalisation de la classe ouvrière et le risque de mouvements "imprévisibles" et "incontrôlés". C'est à cause de ce danger que s'impose à la bourgeoisie de mettre en avant la fausse alternative de "guerre ou paix", l'idée que l'avenir dépend de la "sagesse" des dirigeants de ce monde, alors qu'il dépend de la prise en mains et de l'unification des combats de la classe ouvrière internationale pour son émancipation. C'est à cause de ce danger que tout est fait pour cacher et minimiser les mobilisations de travailleurs et de chômeurs, pour entretenir l'idée de faiblesse, d'impuissance ou même de "dislocation" de la classe ouvrière.
Si la bourgeoisie est une classe divisée en nations regroupées autour de blocs impérialistes, prêts à aiguiser leurs rivalités, jusqu'à en découdre avec tous les moyens dont ils disposent jusqu'à la guerre impérialiste généralisée, elle est par contre une classe unie lorsqu'il s'agit d'attaquer la classe ouvrière, de l'encadrer et de contenir ses luttes, de la maintenir au rang de classe exploitée soumise aux impératifs de chaque capital national. C'est seulement face à la classe ouvrière que la bourgeoisie trouve une unité, et le choeur unanime actuel sur la "paix" et le "désarmement" n'est qu'une mascarade destinée essentiellement à anesthésier la menace prolétarienne que la bourgeoisie rencontre de plus en plus.
Car, malgré leurs limites et de nombreux échecs, les luttes qui se déroulent depuis plusieurs années dans tous les pays, touchant tous les secteurs, de l'Espagne à la Grande-Bretagne, de la France à l'Italie, y compris dans un pays comme la RFA jusqu'à présent moins touché par les effets dévastateurs de la crise ([3] [3]), sont non seulement le signe que la classe ouvrière n'est pas prête à accepter passivement les attaques sur le terrain économique, mais aussi que les tentatives précédentes d'intimidation par les campagnes idéologiques "bellicistes", ou le battage sur la "reprise économique", ont fait long feu et n'ont pas eu l'impact escompté. Egalement symptomatique de la maturation de la conscience qui s'opère dans la classe ouvrière est le fait, qu'après l'Italie et l'Espagne l'an dernier, on a vu pendant les campagnes électorales, traditionnellement périodes de "trêve sociale", pour la première fois en France se déclencher de nombreuses grèves particulièrement combatives.
C'est ce développement de la lutte de classe qui pousse la bourgeoisie à travestir de "pacifisme" la propagande actuelle aussi bien en URSS et dans les pays de l'Est , que dans les pays de l'ouest.
MG. 6/7/88
Questions théoriques:
- Décadence [7]
- Impérialisme [8]
Pologne : les grèves sabotées par le syndicat "Solidarnosc"
- 3596 lectures
Une nouvelle démonstration éclatante du rôle de sabotage de la lutte par le syndicalisme vient d'être donné par les dernières grèves en Pologne au printemps. Solidarnosc, présenté par tous comme l’émanation du formidable mouvement des ouvriers polonais de 1980, vient de confirmer ouvertement, sept ans plus tard, la vraie raison de son existence : ramener les ouvriers dans le giron des institutions nationales capitalistes de la Pologne.
Face à un mouvement qui surgit spontanément pour réclamer des augmentations de salaires, contre une accumulation sans précédent de mesures prises par le gouvernement, Solidarnosc va déployer toute une panoplie de manoeuvres, digne des plus vieilles manigances du syndicalisme des pays occidentaux. L'élève a bien appris de ses maîtres : les multiples rencontres de Walesa et ses acolytes avec nombre de syndicats, en France et en Italie notamment, ont porté leur fruits.
En 1980, en quelques jours, la classe ouvrière par ses propres moyens était parvenue à s'organiser à l'échelle de tout le pays, sur la base des assemblées générales dans les usines, étendant et unifiant le mouvement, le centralisant dans les comités interentreprises de délégués des assemblées (les MKS), obligeant le pouvoir à venir discuter et négocier publiquement face à tous les ouvriers dans les usines. Il faudra plus d'un an d'efforts conjugués du gouvernement et de Solidarnosc fraîchement constitué comme pare-feu à la grève de masse pour faire rentrer dans le rang les ouvriers. Cette année, le syndicat "libre et indépendant", soigneusement "toléré" depuis lors par le gouvernement et qui, derrière les mascarades de répression de ses dirigeants, dispose d'un nombre non négligeable de moyens de contact et de propagande dans le pays, a pu cette fois-ci dès le début jouer son rôle de pompier social au service du capital national polonais.
Au début du mouvement, fin avril, lorsque les travailleurs des transports de Bygdoszcz, puis les ouvriers des aciéries de Nowa Huta près de Cracovie, suivis par ceux des autres aciéries Stalowa Wola, partent en grève, ils soulèvent les espoirs de toute la classe ouvrière, qui subit des attaques considérables sur les salaires et les conditions de travail. Dans une situation où règne un rationnement draconien des biens de consommation de première nécessité, où de plus viennent d'être annoncées des hausses de 40% des denrées de première nécessité et de 100% pour l'électricité et le gaz, tous les yeux sont braqués vers ces grèves qui mettent en avant des revendications générales pour tous les travailleurs, des aciéries, des hôpitaux, et d'autres secteurs. A ce moment-là, les dirigeants de Solidarnosc, Walesa et Kuron en tête, désapprouvent les grèves "qui sont des actes de désespoir compréhensibles mais qui ne peuvent que rendre les choses plus difficiles" (sic!), pour conseiller aux ouvriers de réclamer des "réformes politiques" et des "syndicats libres", jusqu'à un soutien ouvert à la "perestroïka" de Gorbatchev.
Le gouvernement se partage la tâche avec Solidarnosc, cédant rapidement aux revendications à Bygdoszcz et Stalowa Wola – car ces usines sont "compétitives"! -, emprisonnant pendant quelques heures des personnalités du syndicat, afin de crédibiliser pleinement leur rôle d'"opposants", ceci vis-à-vis en particulier des jeunes ouvriers auprès desquels passent très mal les appels de Solidarnosc à la modération. Enfin, face à la solidarité croissante qui se manifeste, solidarité caractéristique des luttes en Pologne depuis les combats de 1970, 1976 et surtout 1980, le syndicat va tout faire pour parvenir à chevaucher le mouvement. Il appuie l'entrée en grève aux chantiers navals de Gdansk, haut lieu du mouvement de 1980, et à l'usine de tracteurs d'Ursus près de Varsovie, focalisant l'élan de solidarité sur ces deux concentrations ouvrières où il est fortement implanté, au détriment bien sûr d'un véritable élargissement du mouvement. La manoeuvre est habile. Même si une réelle solidarité se manifeste parmi les ouvriers de ces usines, celles-ci sont des lieux où Solidarnosc a suffisamment de poids pour manoeuvrer. En particulier à Gdansk, il proclame un "comité de grève", nommé par lui et non par l'assemblée des ouvriers, manoeuvre typique du syndicalisme "démocratique" occidental. Il fait de même à Nowa Huta où il met en place son propre "comité de grève" alors que la lutte est déjà entamée depuis plusieurs jours sous le contrôle des ouvriers. Ensuite, alors que tout le début du mouvement est marqué par des revendications unificatrices (indexation des salaires sur l'inflation, amélioration du service de la santé, etc.), ces dernières disparaissent comme par enchantement lorsque Solidarnosc se retrouve "à l'avant" du mouvement, pour céder la place à la revendication "démocratique" de la "reconnaissance du syndicat". Enfin, ayant réussi à prendre le contrôle de la situation, Solidarnosc peut alors se permettre de lancer au gouvernement des "menaces" de "grève générale", "au cas où Jaruzelski enverrait les zomos (miliciens) à Nowa Huta", ce que ce dernier ne fera pas, bien sûr, Solidarnosc ayant rassuré le gouvernement en reprenant les choses en mains.
Malgré l'expérience considérable de la lutte, que les ouvriers polonais se sont forgée surtout depuis vingt ans au travers des trois précédentes vagues de grève, la classe ouvrière vient de se heurter au barrage syndical, à la manière dont celui-ci manoeuvre, à partir de P"opposition", dans les pays les plus industrialisés. Et ceci d'autant plus fortement que dans les régimes des pays de l'Est, les illusions sur le syndicalisme "libre et indépendant" sont très fortes, et qu'en Pologne Solidarnosc apparaît encore comme un résultat de la lutte de 1980.
La réponse aux obstacles auxquels viennent de se heurter les ouvriers en Pologne se trouve d'abord dans l'approfondissement des luttes actuelles dans les pays occidentaux. C'est dans ces pays que la bourgeoisie est la plus forte, c'est dans ces pays que se trouve la "clé" de sa domination sur le prolétariat international. Et surtout, pour le développement de l'expérience et de la conscience dans la classe, c'est dans ces pays que la classe ouvrière est la plus développée et confrontée aux obstacles à la lutte les plus sophistiqués, en particulier l'obstacle du syndicalisme et de ses variantes "à la base" ou "de combat".
Malgré le repli auxquels ils sont contraints dans l'immédiat, les ouvriers en Pologne viennent à nouveau de donner au prolétariat mondial un exemple de détermination, de combativité, de solidarité active, en reprenant le combat sept ans après la cuisante défaite de 1981. La réponse à cet exemple, la véritable solidarité avec les ouvriers en Pologne, c'est le renforcement des luttes dans les pays de l'Ouest et le développement de leur unification.
MG
Géographique:
- Pologne [9]
Heritage de la Gauche Communiste:
Où en est la crise économique ? : La perspective d'une récession n'est pas écartée, au contraire
- 4192 lectures
Six mois après l'effondrement boursier d'octobre 87, les "experts économiques" révisent à la hausse leurs prévisions de croissance pour l'année 1988. Au même moment les craintes d'un nouvel effondrement boursier mondial ne cessent de croître.
En réalité les gouvernements des principales puissances économiques avaient soigné les convulsions d'octobre 87 avec les remèdes les plus dangereux. Les récents indicateurs de la croissance économique aux Etats-Unis, moins pires que ceux attendus, produits de cette médication, ne peuvent cacher que les problèmes économiques de fond du capitalisme décadent loin d'avoir été résolus, n'ont fait que s'aggraver. Une fois déplus les remèdes des gouvernements face aux difficultés immédiates s'avèrent de véritables poisons dont les effets, pour lents qu'ils soient n'en sont pas moins mortels.
"Que se passe-t-il ici ? D'après toutes les estimations, l'expansion économique qui dure maintenant depuis cinq ans et demi devrait être en train de partir en fumée. Déjà assez longue, si on la compare à celles du passé, cette expansion semblait avoir subi un coup dévastateur lorsque la bourse s'est effondrée en octobre dernier. Mais, défiant toutes les prévisions, l'économie tourne encore et cela avec suffisamment de pression pour inspirer des craintes de surchauffe. Oubliez la récession, disent certains économistes, commencez à vous faire du souci pour l'inflation. " TIME, mai 1988.
A entendre certains commentateurs économiques, ou des ministres de l’économie, tel Lawson de Grande Bretagne, le danger d'une nouvelle récession économique serait écarté. Ce serait le retour du monstre de l'inflation qui serait aujourd'hui à craindre.
La réalité est que tout indique que l'inflation - ou plutôt l'accélération de l'inflation, car l'inflation, même si elle s'est décélérée dans les dernières années n'a jamais disparue -fait un retour certain dans l'économie mondiale. Mais, par contre, rien ne permet d'affirmer que les risques de récession soient écartés. Au contraire.
Pour se rendre à l'évidence il faut regarder de plus près la réalité et les fondements financiers de cette fameuse période "d'expansion économique" qui dure depuis cinq ans et demi.
Le bilan réel de cinq ans de "non effondrement" et de dévastation
Depuis la récession de 1982, la plus profonde et étendue depuis la guerre, le capitalisme a connu effectivement une croissance de la production. La croissance du produit intérieur brut de l'ensemble constitué par les 24 pays les plus industrialisés du bloc occidental, l'OCDE ([1] [11]), entre 1983 et 1987 est restée positive (+ 3 % par an en moyenne). C'est à dire que la masse de valeur produite - telle qu'elle peut être mesurée par les comptabilités nationales ([2] [12]) - n'a pas diminué. Cependant ce chiffre en lui même ne dit pas grand-chose. Derrière cette moyenne se cache une autre réalité.
Une croissance faible et localisée
La croissance de cette période est restée EN-DESSOUS DES TAUX atteints pendant les périodes d'"expansion" des années 70 : 5,5 % entre 1972 et 1973, 4 entre 76 et 79. (taux annuels moyens).
Depuis 1984, cette croissance n'a cessé de se RALENTIR systématiquement, passant de 4,9 % en 1984 à 2,8 en 1987. Elle s'est manifestée surtout aux Etats-Unis et au Japon ; en Europe elle est restée à des niveaux misérables, proches d'une simple STAGNATION. Dans la plupart des pays faiblement industrialisés, sauf quelques exceptions, elle s'est traduite par un EFFONDREMENT.
La désertification industrielle
La stagnation ou la faible croissance de la production s'est faite en ne maintenant en vie que les centres de production les plus rentables et DETRUISANT tous ceux qui suivant les lois d'un marché qui se réduit comme peau de chagrin, ne parvenaient pas à produire suffisamment bon marché pour faire partie des privilégiés qui peuvent encore écouler leurs marchandises. L'Europe, par exemple, produit aujourd'hui sensiblement le même nombre de voitures qu'il y a dix ans en 1978. Mais le capital n'en a pas moins fermé des dizaines d'usines et supprimé des centaines de milliers de postes de travail dans l'industrie automobile. Hauts fourneaux en parfait état de fonctionnement qu'on fait sauter à la dynamite aux Etats-Unis, complexes industriels entiers laissés à l'abandon et au travail de la rouille : on a parlé de désertification industrielle. La communauté Européenne décide de geler des millions d'hectares de terre cultivable. Se déplaçant des bords vers le centre, ce fléau touche de plus en plus le coeur même des principales puissances industrielles.
Le chômage
Pendant ces cinq années de "croissance", LE CHOMAGE dans le monde n'a cessé de se développer. Cela n'a été que la suite de ce qui constitue un phénomène jamais vu auparavant dans l'histoire du capitalisme : 20 années d'augmentation sans discontinuité du chômage. Seuls, parmi les grandes puissances, les Etats-Unis - et pour, la seule année 1987, la Grande-Bretagne- affichent des chiffres de diminution du chômage. Pour l'ensemble de l'Europe le manque d'emplois a au contraire battu des records historiques, même si sa croissance s'est "officiellement" ralentie. Dans la plupart des autres pays du monde, le désemploi atteint des proportions sans précédents.
Et encore s'agit-il de mesures officielles qui sous-estiment délibérément l'ampleur du désastre. Ainsi les comptabilités gouvernementales considèrent que celui qui travaille un jour par semaine, ou celui qui suit un stage de formation pour chômeurs, ou les jeunes à qui on donne un semblant d'emploi pendant quelques mois pour une misère qui ne permet pas de vivre, ou l'adulte mis en préretraite, tous ces sans emploi, ne sont pas des "chômeurs". Il y a d'autre part la généralisation de la précarité de tout emploi : le développement du travail à temps partiel, du travail suivant les besoins immédiats du capital : 12 heures par jour pendant une période, 2 heures pendant une autre - avec la diminution correspondante du salaire, la menace de licenciement toujours.
La production d'armements
A toutes ces formes de destruction de capital, (pour le capital, le développement du chômage au-delà du minimum d'une "armée de réserve" est une destruction de capital, tout comme la destruction d'usines ou la stérilisation des terres), qui marquent profondément ces cinq années d'"expansion économique", U faut ajouter le développement de la production de moyens de destruction, l'ARMEMENT, en particulier aux Etats-Unis. Le capital américain, qui a, par son déficit public, joué le rôle de principal marché pour la croissance au niveau mondial y a consacré des sommes gigantesques.
"Depuis 1982, les dépenses de l'Etat fédéral ont augmenté de 24 % en valeur réelle (4 % Van), Cette expansion est entièrement imputable aux crédits de la défense nationale, en hausse de 37 %, les autres dépenses étant abaissées de 7 %. Un effort considérable a été accompli pour l’acquisition de matériel, presque un doublement en cinq ans : + 78 %".([3] [13])
Tel est le bilan, en termes réels, de ces cinq années dites d'"expansion économique". Malgré des taux de croissance de la production faibles, mais qui restent encore positifs, la misère économique n'a jamais cessé de croître, même dans les pays les plus industrialisés. La base de production même du capital ne s'est pas élargie mais rétrécie. La recomposition du capital mondial se fait au travers du plus puissant mouvement de concentration des capitaux qu'ait connu l'histoire, dans une guerre de requins dévorant les cadavres des faillites, à travers les "OPA" les plus importantes de tous les temps, le sang des uns aiguisant la voracité des autres.
Les résultats dans le domaine réel de la production de ces cinq dernières années, loin de traduire une nouvelle force du système capable d'écarter la perspective d'une nouvelle récession mondiale, concrétise, au contraire l'impuissance chronique du système à rétablir une véritable croissance, une croissance capable ne serait-ce que de résorber le chômage.
Le bilan sur le plan financier
Les résultats au niveau du financement ne font que confirmer l’inéluctabilité d'une telle récession : une récession qui tout comme celles de 1974-1975 et de 1980-1982 s'accompagnera de l'aggravation de cette autre maladie du capitalisme décadent : l'inflation.
"Les assassinats sur la grande route me semblent des actes de charité comparés à certaines combinaisons financières".Balzac.
Financer une production c'est fournir l'argent pour la réaliser. Dans le capitalisme cet argent le capitaliste le trouve par la vente de ce qu'il produit, ou par un crédit, ce qui n'est qu'une avance sur cette vente.
A qui les capitalistes du monde entier ont-ils vendu ce petit surplus qu'ils ont réussi à dégager tant bien que mal pendant ces années ? Essentiellement aux Etats-Unis. Comme en 1972-1973, comme en 1976-1977, en 1983 les Etats-Unis ont joué à nouveau au niveau mondial le rôle de marché locomotive pour sortir de la récession de 1980-1982 : en 1983 le volume des importations américaines fait un bond de près de 10 % ; en 1984 ce bond est de 24 % ! (record historique). Le capital américain achète de tout à tout le monde. En 1982 la part des importations américaines dans le commerce mondial est de 15 %, en 1986 cette part est de 24 % ! C'est-à-dire qu'un quart de tout ce qui est exporté dans le monde est acheté par les Etats-Unis !
En cinq ans le déficit commercial américain passe de 30 milliards de dollars à 160. Ce déficit s'élargit vis à vis de toutes les zones du monde : 40 milliards de déficit en plus avec le Japon, 36 milliards avec les autres pays d'Asie, 32 avec l'Europe, 8 milliards avec l'Amérique Latine.
Avec quel argent le capital américain a-t-il payé ? D'une part avec des dollars surévalués. De 1982 à 1985 la valeur du dollar ne cesse d'augmenter contre celle de toutes les autres monnaies. Cela revenait à payer ce qu'il importait à des prix d'autant plus réduits.
D'autre part, et surtout, en s'endettant à tous les niveaux, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est une véritable explosion du crédit. De fin 1983 au milieu de 1987 le total des dettes s'est accru de 3000 milliards de dollars - trois fois l'augmentation du produit national pendant la même période. Les Etats-Unis sont devenus l'Etat le plus endetté du monde vis-à-vis de l'extérieur. En 1983 la part de l'économie américaine financée par l'extérieur était de 5 %. En 1987 elle frôle les 20 %. Le seul poids des intérêts à verser est devenu monstrueux.
Les Etats-Unis peuvent-ils rembourser ces dettes ? Ils doivent commencer par tenter de réduire l'augmentation vertigineuse de celles-ci. Et pour cela ils n'ont pas d'autre choix que de réduire leur déficit commercial, augmenter les exportations, diminuer les importations. C'est ce qu'ils s'attachent à faire, entre autres en laissant se dévaluer le dollar de façon à rendre plus difficiles les importations et plus compétitives les exportations "made in USA". Cela s'est déjà traduit en 1987 par une diminution de la croissance du volume des importations à 7 % et par une augmentation de celui des exportations de près de 13 %. Une telle évolution est encore loin de fournir au capital américain de quoi rembourser ses dettes. Mais par contre elle fait déjà l'effet d'une douche d'eau glaciale sur tous ceux qui voient leurs exportations diminuer d'autant. Le marché locomotive américain se rétrécit en même temps que les marchandises américaines se font de plus en plus agressives et efficaces sur le marché mondial. Ce qui avait constitué le stimulant de l'économie mondiale disparaît sans qu'aucune autre fraction du capital mondial ne puisse jouer un rôle de locomotive équivalent.
La dévaluation du dollar constitue par elle même un autre moyen de réduire l'endettement. Ce que le capital américain avait acheté avec un dollar surévalué, il le rembourse aujourd'hui avec une monnaie dévaluée. C'est autant de moins à rembourser, mais c'est aussi autant ne pas vers l'inflation et autant de perte sèche pour des créditeurs tels que l'Allemagne ou le Japon... supposés assurer la relève de la relance.
Il reste enfin un troisième moyen au capital américain pour rembourser ses dettes : contracter de nouveaux emprunts, de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes...tout comme les pays les moins industrialisés. C'est ce qu'il continue de faire, et c'est ce qui l'a contraint en 1987 à recommencer à augmenter ses taux d'intérêts en vue d'attirer les capitaux nécessaires au financement de son déficit. Le résultat de cette hausse, ainsi que de la dévaluation du dollar (qui dévalue d'autant les actions en dollars) ne fut autre que l'effondrement boursier d'octobre. L'écart entre les bénéfices tirés de la bourse et les coûts des emprunts nécessaires pour y participer était devenu trop grand.
Mais dans tous les cas de figure - augmentation des exportations américaines et diminution des importations, dévaluation du dollar et inflation généralisée, fuite en avant dans l'endettement - le problème posé par le financement de la dette accumulée par l'économie mondiale et celle de la première puissance économique en particulier, n'ouvrent d'autre perspective que celle d'une nouvelle récession inflationniste.
L'effondrement boursier
Le véritable miracle que saluent certains économistes aujourd'hui, tels ceux dont parle Time cité au début de cet article, c'est que la croissance ne se soit pas écroulé comme en 1929 au lendemain du "crash" d'octobre 1987.
La plupart des économistes avaient prédit un fort ralentissement de la croissance économique au lendemain de l'effondrement boursier d'octobre 1987. Les gouvernements avaient révisé à la baisse leurs déjà peu reluisantes prévisions de croissance.
C'était oublier, premièrement, qu'il ne s'agissait pas d'une situation comme celle de 1929. L'effondrement boursier de 1929 se situait au début d'une crise économique ouverte. Celui d'octobre 1987 explose après 20 ans de lent enfoncement du capitalisme dans la crise : il n'est pas l'ouverture de la crise mais une convulsion au niveau financier qui sanctionne le délabrement économique qui l'a précédé.
Deuxièmement, c'était oublier que le capital qui est comptabilisé à la bourse, est, pour une grande part du capital purement spéculatif, du papier, ce que Marx appelait déjà le capital fictif : pour une part donc, surtout lors d'un premier effondrement, la destruction de celui-ci n'est pas une destruction d'usines, mais de papier. Le secteur économique qui a été le plus touché est le secteur bancaire, plus directement lié à la spéculation.
Troisièmement c'était oublier que, contrairement à 1929, et contrairement aux légendes dites "libérales" sur une soi-disant réduction actuelle du rôle de l'Etat dans l'économie, le capitalisme d'Etat a atteint un développement aussi vertigineux que systématique et généralisé dans le capitalisme décadent. Tous les gouvernements du monde, derrière le premier d'entre eux, celui des Etats-Unis, ont immédiatement réagi pour parer au danger d'une dégénérescence sous forme d'effondrement économique immédiat et non contrôlé.
Mais les remèdes qu'ils ont apportés ne résolvent pas les problèmes de fond du système, au contraire ils les aggravent.
Ces remèdes ont consisté essentiellement dans une baisse forcée des taux d'intérêt et une plus grande facilité pour se procurer des crédits, surtout aux Etats-Unis. En d'autres termes, aux problèmes posés par l'excessif endettement, le capital n'a répondu que par un accroissement de l'endettement.
Cela a permis les "surprenants résultats de la croissance américaine" à la fin 1987 et début 1988. Mais cela n'a résolu en rien le problème de fond. Dès le mois de mai les pressions vers une nouvelle hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, qui doivent financer un nouvel emprunt d'Etat de 26 milliards de dollars, se font sentir puissamment. Or, comme le notait The Economist :
"Même si l'économie a surmonté le crash, le poids intérieur de sa dette Va laissée en un bien piètre état pour supporter des taux d'intérêt plus élevés. Et le Texas est prêt à déclencher une crise bancaire de plusieurs milliards de dollars." The Economist, 7 mai 1988.
Fondée sur l'endettement massif, sur une véritable explosion du crédit sans espoir de remboursement, l'actuelle évolution économique ne peut aboutir, une fois de plus, qu'à la conjugaison de ces deux maladies du capitalisme décadent : l'inflation ET la récession - comme ce fut déjà le cas pendant les récessions de 1970-71, 1974-75 et 1980-82 (dans les années 70 on avait déjà inventé un terme :"la stagflation"). Cette fois-ci il faudra ajouter les effondrements financiers.
Les experts économiques de la bourgeoisie ne se font d'ailleurs pas trop d'illusions. S'ils ont révisé à la hausse les taux de croissance pour 1988 c'est de façon fort modeste, et leurs prévisions pour l'année 1989 demeurent sombres.
Lorsque le capital est confronté à sa crise, on reproche souvent aux marxistes et à leurs "sombres perspectives" pour le capitalisme, d'être comme une horloge arrêtée qui a raison deux fois par jour. Pour les marxistes, et pour eux seulement, le capitalisme est, sur le plan économique, historiquement condamné, comme tous les systèmes économiques qui l'ont précédé dans l'histoire. Ils ont, il est vrai, parfois commis des erreurs dans leurs prévisions quant à l'imminence d'un nouvel effondrement économique. Ils ont parfois sous-estimé l'efficacité des mesures de capitalisme d'Etat, des "tricheries" du système avec ses propres lois (voir dans ce numéro l'article Comprendre la décadence du capitalisme) qui permettent au système de pallier à ses contradictions et de retarder les échéances. Mais aujourd'hui, lorsque les "économistes" comprennent aussi peu les causes profondes de la crise économique que les raisons qui empêchent une "véritable reprise", la théorie marxiste est la seule qui permet de comprendre pourquoi le "non effondrement" des cinq dernières années n'est que l'annonce d'une prochaine récession aussi profonde qu'inévitable.
RV
[1] [14] Tous les pays d'Europe Occidentale, plus les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie et la Nouvelle Zélande.
[2] [15] D'après ces
comptabilités, par exemple, un agent de police ou un fonctionnaire de l'armée
est censé créer une valeur équivalente à celle de son salaire.
[3] [16] Banque française du commerce extérieur, Actualités, décembre 1987.
Récent et en cours:
- Crise économique [17]
L’évolution du milieu politique depuis 1968 (2eme partie)
- 3481 lectures
La première partie de cet article est parue dans le numéro 53 de Revue Internationale.
Au milieu des années 70, le milieu politique prolétarien est écartelé entre deux pôles qui sont de manière caricaturale le produit de quarante ans de théorisation non pas de ce qui constituait la force des fractions de gauche italienne ([1] [18]) et germano hollandaise ([2] [19]), mais au contraire de leurs faiblesses et cela notamment par rapport à une question cruciale pour un milieu prolétarien qui renaît après des décennies d'effacement sur la scène de l'histoire, sans grande expérience historique : celle de l'organisation. D'un coté, il y a le courant conseilliste qui tend à nier la nécessité de l'organisation et, de l'autre, le courant bordiguiste qui s'exprime notamment au travers du PCI (Programme communiste) et qui fait du parti le remède mécanique à toutes les difficultés de la classe ouvrière. Le premier courant va connaître son heure de gloire dans la foulée des événements de 1968 et des années qui suivent, mais il va rencontrer de grands déboires avec le recul de la lutte de classe qui marque le milieu des années 70, tandis que le second, après être resté on ne peut plus discret durant la période de développement de la lutte de classe, connaît un regain d'écho avec le reflux des luttes ouvrières, notamment auprès d'éléments issus du gauchisme.
Dans la seconde moitié des années 70, le pôle conseilliste s'est effondré tandis que le PCI (Programme communiste) tient de manière arrogante le haut du pavé : il est LE PARTI et en dehors de lui, rien n'existe. Le milieu politique prolétarien est extrêmement dispersé, divisé. La question qui se pose avec le plus d'acuité -et qui est intimement liée à celle de l'organisation- est celle du développement des contacts entre les divers groupes existants sur la base d'une cohérence révolutionnaire, afin d'accélérer le processus de clarification indispensable pour le nécessaire regroupement des forces révolutionnaires. Le CCI, dans la continuité de Révolution Internationale, a montré l'exemple en 1974-75, et le Manifeste qu'il publie en 1976 est un appel à l'ensemble du milieu prolétarien à oeuvrer dans ce sens :
"Avec ses moyens encore modestes, le CCI s'est attelé à la tâche longue et difficile du regroupement des révolutionnaires à l’échelle mondiale autour d'un programme clair et cohérent. Tournant le dos au monolithisme des sectes, il appelle les communistes de tous les pays à prendre conscience des responsabilités immenses qui sont les leurs, à abandonner les fausses querelles qui les opposent, à surmonter les divisions factices que le vieux monde fait peser sur eux. Il les appelle à se joindre à cet effort afin de constituer avant les combats décisifs, l'organisation internationale et unifiée de son avant-garde. Fraction la plus consciente de la classe, les communistes se doivent de lui montrer son chemin en faisant leur le mot d'ordre : REVOLUTIONNAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !"
C'est dans ce contexte mouvant d'un milieu politique en pleine décantation et profondément marqué par la dispersion et le poids du sectarisme que se situe l'appel de Battaglia comunista ([3] [20]) à la tenue d'une conférence internationale des groupes de la gauche communiste en 1976.
En 1972, Battaglia comunista avait refusé de s'associer à l'appel d'Internationalism (USA) proposant le développement d'une correspondance internationale dans la perspective d'une conférence internationale, appel qui avait ouvert la dynamique qui a mené à la formation du CCI en 1975. A l'époque BC répondait au lendemain de 1968 :
"- qu'on ne peut pas considérer qu'il existe un développement conséquent de la conscience de classe,
- que même la floraison de groupes n'exprime pas autre chose que le malaise et la révolte de la petite-bourgeoise,
- qu'il nous fallait admettre que le monde est encore sous le talon de l'impérialisme."
Qu'est-ce qui a donc déterminé ce revirement? Une question fondamentale pour BC : la "social démocratisation" des PC staliniens! BC prend ainsi le tournant "euro-communiste" des PC, tournant purement conjoncturel au milieu des années 70, comme on peut le vérifier clairement aujourd'hui avec le recul du temps, comme raison de son changement d'attitude vis-à-vis des autres organisations du milieu politique. C'est pour discuter de cette question "fondamentale" que le PCI (Battaglia comunista) propose la tenue d'une conférence. Par ailleurs, il n'y aura aucun critère politique de délimitation du milieu prolétarien dans la lettre d'appel de Battaglia comunista, et BC exclura de son invitation les autres organisations du milieu prolétarien en Italie telles que le PCI (Programma Comunista) où II Partito comunista. Malgré l'orientation vers la tenue de conférences, "bougnat veut rester maître chez soi" !
Cependant, malgré ce manque de clarté de l'appel, le CCI conformément aux orientations déjà concrétisées par le passé dans sa propre histoire et réaffirmées dans le Manifeste publié en janvier 1976, va répondre positivement et se faire conjointement avec BC le promoteur de cette conférence en proposant des critères politiques délimitant les organisations du milieu prolétarien de celles de la bourgeoisie, en appelant à ouvrir cet appel aux organisations "oubliées" par Battaglia comunista, en essayant d'inscrire cette conférence dans une dynamique de clarification politique au sein du milieu communiste, étape nécessaire vers le regroupement des révolutionnaires.
La dynamique des conférences internationales des groupes de la Gauche Communiste
La première conférence ([4] [21])
A l'appel de Battaglia comunista plusieurs groupes vont répondre pour donner leur accord de principe : le FOR (Fomento Obrero Revolucionario) de France et d'Espagne, Arbetarmakt de Suède, la CWO (Communist Workers' Organisation) de Grande-Bretagne ([5] [22]), le PIC (Pour une intervention communiste) de France. Mais cet accord restera platonique et seul le CCI participera activement aux côtés de BC à la tenue de la première conférence, tandis que, sous divers prétextes plus ou moins valables, mais qui tous, de fait, traduisent une sous-estimation de l'importance des conférences, les autres groupes brilleront par leur absence.
Quant aux chantres du conseillisme et du bordiguisme : Spartakusbond (Hollande) et PCI (Programme communiste) ([6] [23]) inintéressés par de telles conférences, ils se réfugient dans un splendide isolement sectaire.
Cependant, cette première conférence qui se tient en mai 1977, si elle ne réunit finalement que deux organisations : le CCI et BC - ce qui témoigne bien de la réalité du sectarisme ambiant - est malgré tout un grand pas en avant pour l'ensemble du milieu prolétarien.
Cette première conférence n'a pas été un débat fermé entre seulement deux organisations mais va, au contraire, permettre de démontrer à l'ensemble du milieu prolétarien qu'il est possible de briser la méfiance sectaire, qu'il est possible de créer un lieu de confrontation et de clarification des positions divergentes. L'importance des questions abordées le prouve amplement :
- analyse de la situation de la crise économique et de l'évolution de la lutte de classe ;
- fonction contre-révolutionnaire des partis dits "ouvriers" : PS, PC et leurs acolytes gauchistes ;
- fonction des syndicats ;
- les problèmes du parti ;
- tâches actuelles des révolutionnaires ;
- conclusions sur la portée de cette réunion.
Cependant, une faiblesse importante de la conférence et de celles qui l'ont suivie, sera son incapacité à prendre une position commune sur les débats qui l'ont animée ; ainsi le projet de déclaration commune proposé par le CCI et synthétisant les accords et divergences qui se sont manifestés, notamment par rapport à la question syndicale, sera rejeté par BC sans proposition alternative.
La publication en deux langues (italien et français) des textes de contribution à la conférence et des comptes-rendus des discussions qui s'y sont déroulées, va susciter un grand intérêt dans l'ensemble du milieu prolétarien et permettre d'élargir la dynamique ouverte avec la première conférence. Cela va se concrétiser avec la tenue, un an et demi plus tard, de la deuxième conférence fin 1979.
La deuxième conférence ([7] [24])
Cette conférence a été mieux préparée, mieux organisée que la première, cela tant du point de vue politique qu'organisationnel. Ainsi l'invitation a été faite sur la base de critères politiques plus précis :
"- reconnaissance de la révolution d'octobre comme une révolution prolétarienne ;
•reconnaissance de la rupture avec la social-démocratie effectuée par le premier et le deuxième congrès de l’Internationale Communiste ;
- rejet sans réserve du capitalisme d'Etat et de l'autogestion ;
- rejet de tous les partis communistes et socialistes en tant que partis bourgeois ;
- orientation vers une organisation de révolutionnaires qui se réfère à la doctrine et à la méthodologie marxiste comme science du prolétariat".
Ces critères - certes insuffisants pour établir une plateforme politique pour un regroupement et dont le dernier point demande certainement à être précisé- sont, par contre, amplement suffisants pour permettre de délimiter le milieu prolétarien et de donner un cadre de discussion fructueux.
A la deuxième conférence qui se tient en novembre 1978, ce sont cinq organisations prolétariennes qui vont participer aux débats : le PCI (Battaglia comunista) d'Italie, la CWO de Grande-Bretagne, le Nucleo Comunista Internaziona-lista (NCI) d'Italie, Fur Komunismen de Suède et le CCI qui, à l'époque, était présent par ses sections dans neuf pays, tandis que le groupe II Leninista fait parvenir des textes de contribution aux débats de la conférence sans pouvoir physiquement y participer, et que Arbetarmakt de Suède et POCRIA de France apportent un soutien purement platonique à la conférence. Quant au FOR, son cas est un peu particulier. Après avoir apporté sa pleine adhésion à la première conférence, fait parvenir des textes pour la préparation de la seconde et y être venu pour y participer, il va provoquer Un coup de théâtre à l'ouverture de celle-ci : sous prétexte de ne pas être d'accord avec l'ordre du jour qui comportait un point sur la crise économique dont le FOR nie de manière surréaliste l'existence, il va quitter spectaculairement la conférence ! Les épigones du conseillisme et du bordiguisme pur quant à eux persévèrent dans leur rejet des conférences : le Spartacusbond de Hollande finalement imité par le PIC de France parce qu'ils rejettent la nécessité du Parti, le PCI (Programme communiste) et le PCI (Il Partito Comunista) d'Italie parce qu'ils se considèrent chacun comme le seul parti existant et donc qu'en dehors d'eux, aucune organisation prolétarienne ne peut exister.
L'ordre du jour de la conférence témoigne de la volonté militante qui l'anime :
- l'évolution de la crise et les perspectives qu'elle ouvre pour la lutte de la classe ouvrière ;
- la position des communistes face aux mouvements dits de "libération nationale" ;
- les tâches des révolutionnaires dans la période présente.
La deuxième conférence internationale des groupes de la gauche communiste est un succès, non seulement parce qu'un plus grand nombre de groupes y participe, mais aussi parce qu'elle permet une meilleure délimitation des accords et des divergences politiques existants entre les différents groupes y participant. En permettant aux diverses organisations présentes de mieux se connaître, la conférence offre un cadre de discussion qui permet d'éviter les faux débats et de pousser à la clarification des divergences réelles. En ce sens, les conférences sont un pas en avant dans le sens de la perspective du regroupement des révolutionnaires qui, même si elle n'est pas immédiate, à court terme, est cependant à l'ordre du jour, étant donné la situation de dispersion du milieu prolétarien après des décennies de contre-révolution.
Cependant, les faiblesses politiques dont souffre le milieu prolétarien pèsent aussi sur les conférences elles-mêmes. Cela va notamment se traduire dans l'incapacité des conférences à ne pas rester muettes, c'est-à-dire dans l'incapacité des groupes y participant à prendre collectivement position sur les questions qui ont été discutées afin de mettre au clair le point où elles sont parvenues. Le CCI a proposé des résolutions dans ce sens mais, en dehors du NCI, s'est heurté au refus des autres organisations présentes et notamment du PCI (Battaglia comunista) et de la CWO ; cette attitude traduit le climat de méfiance qui perdure au sein du milieu communiste, même chez les plus ouverts à la confrontation, et qui entrave le nécessaire processus de clarification politique qui doit se développer.
Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les propositions du CCI de voter une résolution fustigeant le sectarisme des groupes refusant de participer aux conférences se soient heurtées au refus des autres groupes ; cela touchait évidemment un point sensible.
Ces faiblesses vont malheureusement trouver leur concrétisation au lendemain de la deuxième conférence dans les polémiques qui vont être lancées par Battaglia comunista et la CWO qui qualifient allègrement le CCI d'"opportuniste" et nient qu'il existe un problème de sectarisme, la dénonciation du sectarisme n'étant, selon eux, qu'un moyen de nier les divergences politiques existantes. Cette position de BC et de la CWO ne voit pas que la question du sectarisme est une question politique à part entière puisqu'elle traduit la perte de vue d'une question essentielle : celle du rôle de l'organisation dans un de ses aspects déterminants qui est la nécessité permanente du regroupement des révolutionnaires. En niant le danger du sectarisme, ces organisations sont bien mal armées pour y faire face en leur propre sein, et malheureusement, cela va se concrétiser avec la troisième conférence.
La troisième conférence ([8] [25])
La IIIème conférence se tient au printemps 1980 à un moment où les luttes ouvrières de l'année précédente montrent que le reflux du milieu des années 70 est terminé, et où l'intervention des troupes "soviétiques" en Afghanistan montre l'actualité de la menace de la guerre mondiale, ce qui pose de manière aiguë la responsabilité des révolutionnaires.
De nouveaux groupes vont s'associer à la dynamique des conférences : I Nuclei Leninisti est le produit de la fusion du NCI et de II Leninista en Italie qui s'étaient déjà associés à la seconde conférence, le Groupe Communiste Internationaliste qui est le produit d'une scission bordiguisante du CCI en 1977, l'Eveil Internationaliste qui provient d'une rupture en France d'avec le maoïsme en pleine décomposition, le groupe américain Marxist Workers' Group qui s'associe à la conférence sans pouvoir y participer physiquement. Pourtant, malgré l'écho grandissant au sein du milieu révolutionnaire que rencontre la dynamique des conférences, la Illème conférence internationale des groupes de la gauche communiste va se solder par un échec.
La demande du CCI que la conférence adopte une résolution commune sur le danger de la guerre impérialiste à la lumière des événements d'Afghanistan, est rejetée par BC, la CWO et, à leur suite, par l'Eveil Internationaliste, car même si les différents groupes avaient une position commune sur cette question, il eût été selon eux "opportuniste" d'adopter une telle résolution, "parce qu'on a des divergences sur ce que sera le rôle du parti révolutionnaire de demain". Le contenu de ce brillant raisonnement "non-opportuniste" est le suivant : puisque les organisations révolutionnaires ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur toutes les questions, elles ne doivent pas parler de celles sur lesquelles elles sont d'accord depuis longtemps. Les spécificités de chaque groupe priment par principe sur ce qu'il y a de commun à tous. C'est cela le sectarisme. Le silence, l'absence de prise de position collective des groupes lors des trois conférences est la plus nette démonstration de l'impuissance à laquelle mène le sectarisme.
Deux débats étaient à l'ordre du jour de la IIIème conférence :
- où en est la crise du capitalisme et ses perspectives ?
- perspectives de développement de la lutte de classe et les tâches qui en découlent pour les révolutionnaires.
Le débat sur le deuxième point à l'ordre du jour va permettre que s'amorce le début d'une discussion sur le rôle du parti qui fut un des points discutés lors de la IIème Conférence. Cette question du rôle du parti est une des plus graves et des plus importantes à laquelle sont confrontés les groupes révolutionnaires actuels, en particulier eu égard à l'appréciation que Ton a sur les conceptions du parti bolchevik à la lumière de l'expérience historique qui s'est accumulée depuis et avec la Révolution russe.
Et pourtant le PCI (Battaglia comunista) et la CWO, par impatience... ou par peur, à moins que ce ne soit misérablement par tactique opportuniste, ce qui est malheureusement le plus probable, alors même que lors de la précédente conférence ils déclaraient sur cette question qu'elle "nécessitera de longues discussions", vont refuser de poursuivre ce débat sur le problème du parti et vont prendre prétexte de soi-disant conceptions "spontanéistes" du CCI pour déclarer la question close et faire de leur propre position un critère d'adhésion aux conférences, provoquant ainsi l'exclusion du CCI et finalement la dislocation des conférences. En brisant ainsi la dynamique qui avait permis de resserrer les liens entre différents groupes du milieu prolétarien et de pousser l'ensemble du milieu politique sur la voie de la clarification indispensable au nécessaire regroupement des forces révolutionnaires, la CWO et BC portent une lourde responsabilité dans le renforcement des difficultés qui devaient se répercuter sur l'ensemble du milieu.
La CWO et BC rejoignaient ainsi dans l'irresponsabilité, celle du GCI qui n'était venu à la troisième conférence que pour mieux en dénoncer le principe et y pratiquer la "pèche à la ligne" la plus éhontée.
L'éclatement, trois mois après l'échec de la conférence: de la grève de masse en Pologne ne peut que mettre pleinement en relief l'irresponsabilité de ces groupes qui ne croient exister qu'en fonction de leur propre ego et qui oublient que c'est la classe ouvrière qui pour ses besoins les a produits. Ces défenseurs "intransigeants" du Parti oublient que la première tâche de ce parti, ce n'est pas le repli sectaire, mais au contraire la volonté de confrontation politique afin d'accélérer le processus de clarification au sein du milieu prolétarien et de renforcer sa capacité d'intervention au sein de la classe.
La pseudo quatrième conférence qui va se tenir en 1982 n'aura dans ces conditions plus rien à voir avec la dynamique qui a présidé à la tenue des trois conférences internationales des groupes de la gauche communiste. La CWO et BC vont trouver un troisième larron pour tenir la bougie qui éclairera leurs amours en la personne du SUCM d'Iran. Ce groupe nationaliste mal dégagé du stalinisme était certainement un interlocuteur plus valable pour Battaglia comunista et la CWO que le CCI. Etait-ce parce qu'il défendait une position "correcte" sur le rôle du parti contrairement au CCI? Le sectarisme a de ces vicissitudes ; il mène au plus plat opportunisme et finalement à l'abandon des principes !
Quel bilan pour les conférences?
Le premier acquis des conférences c'est d'abord qu'elles aient eu lieu.
Les conférences internationales des groupes de la gauche communiste ont été un moment particulièrement important de l'évolution du milieu politique prolétarien international qui s'était reconstitué au lendemain de 1968. Elles ont constitué un cadre de discussion entre les différents groupes qui ont directement participé de leur dynamique et ainsi permis une clarification positive sur les débats qui animent le milieu prolétarien, offrant ainsi un cadre de référence politique pour toutes les organisations ou éléments du milieu prolétarien en recherche d'une cohérence politique révolutionnaire. Les bulletins publiés en trois langues à la suite de chaque conférence et contenant les diverses contributions écrites et le compte-rendu de toutes les discussions sont restés une référence indispensable pour tous les éléments ou groupes qui depuis ont rejoint les positions révolutionnaires.
En ce sens, malgré l'échec final qu'ont connu les conférences, celles-ci ont constitué un moment fructueux de l'évolution du milieu politique prolétarien en permettant aux différents groupes de mieux se connaître, en offrant un cadre qui a permis une clarification et une décantation politique positive.
Le rôle positif des conférences et l'écho grandissant qu'elles ont rencontré, ne se manifeste pas seulement dans le nombre croissant des groupes qui y participent, mais elles montrent à l'ensemble des groupes du milieu prolétarien l'intérêt de telles rencontres. La conférence d'Oslo en septembre 1977 qui regroupe des groupes Scandinaves et à laquelle participe le CCI, même si elle se tient sur des bases encore trop floues, témoigne du besoin ressenti dans le milieu prolétarien international.
Mais avec le recul, c'est dans le vide qui est créé par leur disparition, et dans la crise du milieu politique qui va suivre l'échec de la IIIème conférence, que se mesure paradoxalement le plus clairement l'apport positif des conférences.
La crise du milieu politique prolétarien
Au même moment où se tiennent les conférences, le milieu politique de la fin des années 70 est marqué par un double phénomène : d'une part l'effondrement de la mouvance conseilliste, pôle de débat dominant du début de la décennie, et d'autre part le développement du PCI (Programme communiste) qui devient l'organisation la plus développée du milieu prolétarien.
La dégénérescence politique du PCI bordiguiste
Si le PCI (Programme communiste) est devenu l'organisation la plus développée du milieu politique, ce n'est pas seulement par son existence internationale dans plusieurs pays: Italie, France, Suisse, Espagne, etc., publiant en français, italien, anglais, espagnol, arabe, allemand, mais aussi par ses positions politiques qui, dans une période de reflux de la lutte de classe, connaissent un succès certain pas uniquement auprès d'éléments produits par la décomposition du gauchisme mais aussi au sein même du milieu prolétarien constitué. L'incapacité du « conseillisme » à résister à la lutte de classe et à son reflux traduit concrètement la faillite où mène le rejet de la nécessité du parti politique de la classe ouvrière et la sous-estimation profonde de la question de l'organisation que cette position implique. L'insistance du PCI sur la nécessité du parti est donc tout à fait juste, cependant sa conception "substitutionniste" absolument caricaturale pour laquelle le parti est tout et la classe n'est rien, forgée durant les plus profondes années de contre-révolution au lendemain de la seconde guerre mondiale lorsque la classe exsangue est mystifiée comme elle ne l'avait jamais été auparavant, est la théorisation de la faiblesse du prolétariat. Le Parti est présenté comme la panacée à toutes les difficultés de la lutte de classe. A un moment où la lutte reflue le développement de l'écho des positions du PCI sur la question du parti est le reflet des doutes sur la classe ouvrière ; ce doute sur les capacités révolutionnaires de la classe ouvrière va trouver sa concrétisation éclatante dans la dérive opportuniste du PCI (Programme communiste) qui va aller en s'accélérant tout au long de ces années. Alors que les travailleurs des pays développés sont censés toucher les dividendes de l'impérialisme, gages de leur passivité, c'est à la périphérie du capitalisme, dans les soi-disant "luttes de libération nationale" que le PCI voit se développer les potentialités révolutionnaires. Cette dérive nationaliste va ainsi amener Programme communiste à soutenir la terreur des Khmers rouges au Cambodge, les luttes nationalistes en Angola et la "révolution palestinienne" ainsi que pour faire bonne mesure l'OLP, tandis qu'en France par exemple l'intervention privilégiée du PCI dans les luttes des travailleurs "immigrés" va tendre à renforcer le fardeau pesant des illusions nationalistes. Les conceptions fausses du bordiguisme sur la question du parti, sur la question nationale mais aussi sur la question syndicale sont autant de portes largement ouvertes à la pénétration de l'idéologie dominante à laquelle le PCI est en train de succomber. Le développement du bordiguisme comme principal pôle politique au sein du milieu prolétarien est l'expression du recul de la lutte de classe, sa théorisation. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le PCI (Programme communiste) qui préfère ouvrir les portes au gauchisme bourgeois plutôt que de discuter au sein du milieu communiste révolutionnaire, paye cette attitude d'une dégénérescence politique accélérée qui se traduit par un abandon des principes mêmes qui avaient présidé à sa naissance.
Les débats au sein du milieu prolétarien au début des années 80
Cependant, si le PCI (Programme communiste) pousse ses positions politiques jusqu'à la caricature, les conceptions erronées qui les sous-tendent et qui sont issues de positions débattues au sein de la IIIème Internationale, sont présentes dans les conceptions générales d'autres groupes (sans atteindre cependant le même niveau d'aberration), et notamment ceux qui comme le PCI de Bordiga trouvent leur origine à des degrés divers dans le Parti Communiste Internationaliste constitué principalement en Italie au lendemain de la IIème guerre impérialiste mondiale : le PCI (Battaglia comunista) qui en est la continuité la plus claire sur ses principes révolutionnaires, Il Partito comunista d'Italie scission de Programme communiste en 1973 et le NCI par exemple.
Dans ces conditions, il n'est donc pas surprenant que les débats qui ont lieu au sein des conférences, tendent à se polariser autour des mêmes questions fondamentales : question du parti, question nationale, question syndicale car ce sont les questions de l'heure déterminées par la situation mondiale et l'histoire propre du milieu prolétarien. Dans les conférences, le NLI(NCI+I1 Leninista) est le groupe le plus proche des positions bordiguistes, Battaglia comunista faisant des concessions à ces conceptions sur les questions nationale et syndicale. Quant à la question du parti, on a vu qu'elle fut un prétexte au sabotage de la dynamique des conférences. La CWO de son côté a poursuivi durant les conférences une évolution qui, à partir d'une plate-forme très proche de celle du CCI, la mène à se rapprocher des conceptions du PCI (Battaglia comunista).
L'accélération de l'histoire au début des années 80 et la décantation au sein du milieu politique
Avec l'échec des conférences, c'est donc un milieu prolétarien encore profondément divisé qui va se trouver confronté à une très forte accélération de l'histoire au début des années 80 qui sera marquée par :
- le développement international de la vague de luttes ouvrières qui met fin au reflux qui avait succédé à la vague commencée en 1968 et qui culmine avec la grève de masse en Pologne, sa répression brutale et le fort reflux international de la lutte de classe qui suit ;
- l'exacerbation des tensions inter impérialistes entre les deux "grands" avec l'intervention russe en Afghanistan et l'intense propagande guerrière qui se déchaîne tandis que la course aux armements s'accélère ;
- la plongée dans la crise de l'économie mondiale, la récession américaine de 1982, la plus forte depuis celle des années 30 entraîne celle de l'ensemble de l'économie mondiale.
Si les leçons de l'histoire peuvent échapper à certains, par contre nul ne peut échapper à celles-ci. Inévitablement, une décantation politique doit se faire au sein du milieu prolétarien, l'expérience historique doit apporter sa sanction.
La vague de lutte de classe qui se lance à la fin des années 70 va poser concrètement la nécessité de l'intervention des révolutionnaires.
Les luttes des sidérurgistes de Lorraine et du nord de la France en 1979, la grève des sidérurgistes de G.B. en 1980 et finalement la grève de masse des ouvriers de Pologne en 1980 vont se heurter à la radicalisation de l'appareil syndical, au syndicalisme de base. Les luttes vont être dévoyées, défaites et la victoire de Solidarnosc signifie l'affaiblissement de la classe ouvrière qui va permettre la répression. L'avortement de la vague internationale de lutte de classe et le brutal reflux qui suit vont être une épreuve de vérité pour le milieu politique prolétarien.
Dans ces conditions; alors que l'échec des conférences ne permet plus au milieu prolétarien d'avoir un lieu où se poursuit la confrontation des positions politiques,l'inévitable décantation ne pourra permettre que la sélection politique se traduise par la polarisation des énergies révolutionnaires dans la dynamique de regroupement ; au contraire, au feu de l'accélération de l'histoire, la sélection politique va se faire par le vide, par une hémorragie des énergies militantes qui sont happées par la débâcle des organisations incapables de répondre aux besoins de la classe ouvrière. Le milieu politique prolétarien est entré dans une phase de crise ([9] [26]).
La question de l'intervention : la sous-estimation du rôle des révolutionnaires et la sous-estimation de la lutte de classe
Confronté à la nécessité de l'intervention, le milieu prolétarien va réagir en ordre dispersé et montrer la profonde sous-estimation du rôle des révolutionnaires qui le mine. L'intervention du CCI au sein des luttes ouvrières, et notamment avec les événements de Longwy Denain en France va être la cible des critiques ([10] [27]) de l'ensemble du milieu prolétarien, mais au moins, celle-ci a le mérite d'exister. En dehors du CCI, le milieu politique brille plutôt par son absence du terrain des luttes ouvrières : le PCI (Programme communiste) par exemple, la principale organisation, qui s'était caractérisé par son activisme dans la période précédente, ne voit pas la lutte de classe sous ses yeux ; hypnotisé par ses rêves tiers-mondistes il continue par ailleurs sa dérive syndicaliste.
La faiblesse de l'intervention du milieu politique traduit sa profonde sous-estimation de la lutte de classe, son manque d'expérience et son incompréhension de celle-ci. Cela se cristallise particulièrement autour de la question syndicale, non seulement par les concessions politiques vis-à-vis de celle-ci exprimées à des degrés divers par les groupes issus du PCI de 1945, mais aussi par une tendance à rejeter l'importance et la positivité des luttes qui se mènent, car celles-ci restent prisonnières du carcan des syndicats, du terrain "économique". Ainsi, paradoxalement, les tendances conseillistes et celles issues du PCI de 1945 se rejoignent pour rejeter l'importance des luttes ouvrières au nom de l'emprise syndicale qui persiste. Programme communiste, Battaglia comunista comme bien d'autres, par exemple le FOR, persistent à nier la réalité du développement de la lutte de classe depuis 1968 et à affirmer que la contre-révolution continue son règne. Dans ce contexte, la CWO va se singulariser par son appel à l'insurrection en Pologne, mais cette grave surestimation ponctuelle ne fait que traduire les mêmes incompréhensions qui dominent malheureusement le milieu politique en dehors du CCI.
L'explosion du PCI (Programme communiste)
La défaite en Pologne, le recul international de la lutte de classe qui avec la plongée dans la récession économique vont être autant de coups de boutoir de la réalité, vont faire des ravages au sein d'un milieu qui n'avait pas su pleinement être à la hauteur de ses responsabilités historiques. Les plus touchés par la crise du milieu politique vont d'abord être les groupes qui se sont signalés par leur refus de la dynamique des conférences. C'est dans l'indifférence que le Spartakusbond en Hollande et le PIC en France (ainsi que sa continuité avortée, le Groupe Volonté Communiste au nom si mal choisi) vont être emportés comme des fétus de paille par la tempête de l'accélération de l'histoire. Par contre, l'explosion du PCI (Programme communiste) en 1982 va bouleverser le paysage du milieu politique. Le parti bordiguiste monolithique, l'organisation la plus "importante" du milieu, paye le prix de longues années de sclérose et de dégénérescence politique dans l’isolement le plus sectaire qui en a accéléré le processus : il va éclater sous l'impulsion des éléments nationalistes d'El Oumami, et imploser avec l'hémorragie brutale de ses forces militantes qui, déboussolées et démoralisées se perdent dans la nature. De cette crise le PCI sort exsangue, le centre s'est effondré, les liens internationaux se sont perdus, ce qu'il reste des sections à la périphérie se retrouve isolé ; le PCI n'est plus qu'un pâle reflet de l'organisation pôle qu'il a été au sein du milieu. Cette débandade du PCI (Programme communiste) marque l'effondrement définitif du bordiguisme comme pôle politique dominant au sein du milieu prolétarien.
Les effets de la crise sur les autres groupes du milieu prolétarien
Cependant, si l'éclatement du PCI (Programme communiste) est la preuve la plus claire de la crise du milieu politique, celle-ci est bien plus large et touche aussi les groupes qui ont participé à des degrés divers à la dynamique des conférences.
Les groupes les plus faibles, ceux qui sont le produit des circonstances immédiates, sans tradition et identité politiques propres vont disparaître avec la fin des conférences ; Arbetarmakt en Suède, l'Eveil internationaliste en France, le Marxist Workers' Group aux USA, etc. D'autres groupes plus solides, car mieux enracinés dans une tradition politique mais qui lors des conférences avaient montré leur faiblesse, non seulement par leurs positions politiques mais aussi, comme le FOR et le GCI, par leur irresponsabilité sectaire, vont connaître avec la confrontation à l'accélération historique une dégénérescence politique grandissante :
- le NLI en Italie va suivre un chemin identique à celui déjà tracé par Programme communiste par des abandons répétés des principes sur les questions nationales et syndicales et un flirt de plus en plus poussé avec le gauchisme bourgeois ;
- le GCI quant à lui, ses positions confuses sur la question de la violence de classe inspirées du bordiguisme vont, moins paradoxalement qu'il n'y paraît à première vue, l'amener à se rapprocher de la mouvance anarchiste ;
- le FOR dans sa folle négation de la réalité de la crise économique va prendre des positions de plus en plus surréalistes où le radicalisme de la phrase remplace toute cohérence.
Le CCI, lui-même ne sera pas à l'abri des effets de cette crise du milieu prolétarien. L'implication du CCI dans l'intervention a soulevé d'importants et riches débats en son sein, mais en même temps le manque d'expérience organisationnelle qui pèse encore lourdement sur la génération présente de révolutionnaires va permettre à un élément à l'aventurisme douteux, Chenier, de cristalliser les tensions par des manoeuvres secrètes et finalement fomenter un vol contre le matériel de l'organisation. Les quelques éléments qui suivront Chenier dans son aventure publieront l'Ouvrier Internationaliste qui ne survivra pas à son premier numéro. Au même moment le Communist Bulletin Group qui se forme dans la même dynamique douteuse avec des éléments issus de la section du CCI en GB se met en dehors du milieu prolétarien par son soutien aux comportements gangstéristes d'un Chenier.
La formation opportuniste du BIPR
La formation en 1983 du Bureau International pour le Parti Révolutionnaire ([11] [28]) qui regroupe la CWO de Grande-
Bretagne et le PCI (Battaglia comunista) d'Italie dans ce contexte de crise du milieu prolétarien semble être une réaction positive. Cependant si ce regroupement constitue une clarification du paysage politique sur le plan organisationnel, il n'en va pas de même sur le plan politique. Ce regroupement se situe dans la dynamique de l'échec des conférences, et ce sont les deux groupes qui sont responsables de cet échec qui en sont les acteurs ; il est dans la droite ligne de l'opportunisme et de l'esprit sectaire qu'ont manifesté ces deux organisations lors de la IIIème Conférence et par la suite.
Pour être un apport politique, il est indispensable que la dynamique de regroupement se fasse dans la clarté politique. Or, ce n'est certainement pas la dynamique qui préside au "regroupement" qui permet la formation du BIPR. Les débats qui déterminent la CWO à prendre ses distances d'avec sa plateforme d'origine qui d'ailleurs était très proche de celle du CCI - ce qui n'a pas empêché la CWO de refuser en 1974 tout regroupement avec Word Révolution, future section du CCI en GB car selon elle après 1921, après Kronstadt il n'y a plus de vie prolétarienne au sein du parti Bolchevik et des PCs, prétexte sectaire bien vite oublié quelques années plus tard- resteront un mystère pour l'ensemble du milieu politique. Ce ne sera que deux ans après la soi-disant IVème Conférence que seront publiés les comptes-rendus de discussion qui en fait n'apportent pas de réelle clarté sur l'évolution politique des deux groupes. La plate-forme d'adhésion au BIPR comporte les mêmes confusions et ambiguïtés caractéristiques que celles manifestées lors des conférences par BC sur la question syndicale, sur la question nationale, sur la possibilité du parlementarisme révolutionnaire, et évidemment sur la question du parti et du cours historique.
Mais surtout, la formation du BIPR traduit une conception fausse du regroupement des révolutionnaires. Le BIPR est un cartel d'organisations existantes plus qu'une nouvelle organisation produit d'un regroupement où les forces fusionnent autour de la clarté d'une plate-forme commune, chaque organisation adhérente garde sa spécificité. En plus de la plate-forme du BIPR, chaque groupe garde la sienne propre sans expliquer les importantes différences qui peuvent exister, cela permet de mesurer la fausse homogénéité du BIPR et l'opportunisme qui a présidé à sa formation.
La formation du BIPR n'est donc pas le signe annonciateur de la fin de la crise du milieu qui continue ses ravages, ni d'une nouvelle dynamique de clarification au sein des forces révolutionnaires mais l'expression d'un reclassement des forces du milieu politique qui se fait dans la confusion opportuniste et dans l'isolement sectaire.
En 1983, avec la crise qui a sévi, la face du milieu prolétarien est transformée. Le PCI bordiguiste a quasiment disparu et le CCI est devenu l'organisation la plus importante du milieu communiste, son pôle politique dominant et dans la mesure où l'histoire a apporté sa sanction historique, un pôle de clarté confirmé dans les débats qui animent le milieu. Le CCI est une organisation centralisée à l'échelle internationale qui par ses sections est présente dans dix pays et publie en sept langues. Cependant, si le CCI est devenu le principal pôle de regroupement, il n'est pas pour autant seul au monde. Le BIPR malgré la confusion qui a déterminé ses origines, par rapport à la déliquescence politique des autres groupes qui forment alors le milieu prolétarien constitue l'autre pôle de référence et de relative clarté politique qui va polariser les débats.
Comme on le voit les groupes qui ont le mieux résisté à la crise du milieu prolétarien, sont ceux qui ont su le mieux participer à la dynamique des conférences internationales ; ce seul fait permet de mesurer l'apport positif de celles-ci et rétrospectivement donc d'apprécier l'erreur politique majeure qu'a constitué leur dislocation dont le PCI (Battaglia comunista) et la CWO portent la lourde responsabilité.
A la mi-1983, après la courte mais profonde phase de recul de la lutte de classe qui a suivi la défaite en Pologne, les premiers signes d'une reprise des luttes ouvrières commencent à se manifester. Nous avons vu comment, à la fin des années 70 et au début des années 80, la question de l'intervention des révolutionnaires a été une épreuve de vérité pour le milieu prolétarien, c'est la question que l'histoire pose de nouveau aux révolutionnaires ; nous verrons dans la troisième partie de cette article si les organisations du milieu politique sauront, après 1983, se hisser à la hauteur des responsabilités qui sont les leurs.
JJ
[1] [29] Voir brochure "LA GAUCHE COMMUNISTE D'ITALIE".
[2] [30] Voir articles in Revue Internationale 11-16-17-21-25-28-36-37-38-45 et suivantes.
[3] [31] Voir article "Rencontre internationale convoquée par le PCI-"Battaglia comunista"(mai 1977) in Revue Internationale 10.
Voir Bulletin de la 1ère conférence des groupes de la gauche communiste.
[4] [32] Sur la CWO voir Revue Internationale 12-17-39.
[5] [33] Sur le PCI-Battaglia comunista voir Revue Internationale 13-33-34-36.
[6] [34] Sur le PCI-Programme communiste voir Revue Internationale 14-23-32-33.
[7] [35] Voir articles sur la Ilème conférence in Revue Internationale 16 et 17, sur le cours historique voir article in Revue Internationale 18. Voir Bulletin ( 2 volumes) de la Ilème conférence des groupes de la Gauche communiste.
[8] [36] Voir article sur la Ilème conférence in Revue Internationale 22. Voir Bulletin ( 3 volumes) de la Même conférence des groupes de la gauche communiste.
[9] [37] Sur la crise du milieu révolutionnaire, voir article in Revue Internationale 28-32.
[10] [38] Sur les débats sur l'intervention voir Revue Internationale 20-24.
[11] [39] Sur la formation du BIPR voir article in Revue Internationale 40-41.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [40]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [41]
Polémique : Comprendre la décadence du capitalisme (4)
- 4659 lectures
- Nous poursuivons ici la série d'articles entamée dans les n°48, 49 et 50 de la Revue Internationale qui s'attachait à défendre l'analyse de la décadence du capitalisme contre les critiques dont elle a été l'objet de la part de groupes du milieu révolutionnaire et plus particulièrement du GCI ([1] [42]).
- Dans le présent article nous tenterons de développer, sous différents aspects, les bases de la décadence du mode de production capitaliste et de répondre aux arguments qui les récusent.
- Au tournant des années 60-70 le CCI a dû se battre pour convaincre le milieu politique de la fin des "Golden Sixties" et de l'entrée du capitalisme mondial dans une nouvelle période de crise. Les graves secousses monétaires internationales d'octobre 87 et la stagnation effective de l'économie réelle depuis 10 ans ne laissent plus aucun doute et achèvent de démontrer l'ineptie de la position d'un groupe comme le FOR ([2] [43]) qui nie toujours la réalité de la crise économique. Mais il y a plus grave, alors qu'aujourd'hui le monde est au seuil de l'alternative Guerre ou Révolution, il se trouve encore des groupes révolutionnaires qui, reconnaissant pourtant la crise, se font le chantre de la vitalité du capitalisme.
Face à l'enjeu historique actuel (soit développement de l'actuel cours aux affrontements de classes vers une perspective révolutionnaire, soit défaite de la classe ouvrière et ouverture d'un cours vers la guerre) qui met en balance l'avenir de l'humanité, alors que la tâche des révolutionnaires est la démonstration de la faillite historique du mode de production capitaliste, de la nécessité et de l'actualité du socialisme, des groupes politiques se grattent le nombril sur les 'formidables taux de croissance de la reconstruction". Abandonnent la conception marxiste de la succession des modes de production en rejetant la notion de décadence et ils s'échinent à prouver que "... le capitalisme croît sans arrêt au-delà de toute limite". Il n'est pas étonnant que sur de telles bases, en l'absence d'un cadre d'analyse cohérent de la période, ces groupes défendent une perspective défavorable pour la classe ouvrière et des préoccupations essentiellement académistes pour l'activité des minorités révolutionnaires.
La réflexion théorique et la discussion constituent, pour la FECCI ([3] [44]) , la tâche prioritaire de l'heure (cf. Perspective Internationaliste. n°9 p38 et 32). Interloquée par l'urgent problème "d'une reconstruction de la longueur et de l'ampleur de celle qui a suivi la 2ème guerre mondiale", elle propose à tout le milieu de discuter des "graves questions" que cela pose (Perspective Internationaliste n°5 p30 et n°7 p20). Pour Communisme ou civilisation ([4] [45]) nous vivons toujours dans la période de contre-révolution qui perdure depuis les années 20 ("Communisme ou civilisation" n°22, p2); "avec la fin de la seconde guerre mondiale le mode de production capitaliste est entré dans une période d'accumulation pratiquement sans précédent" (p6) et "...en l'absence de rupture qualitative et quantitative..." de la lutte de classe, ce groupe se propose de produire par fascicule... semestriel... une grande fresque encyclopédique sur la théorie des crises et l'histoire du mouvement ouvrier. Pour le GCI, depuis la vague de luttes de 68-74 "la paix sociale, la paix des Versaillais règne" (éditorial du n°25 et n°26 p5, 6 et 9). La préoccupation essentielle de ce dernier groupe est la liquidation des acquis du socialisme; dans sa publication (Le Communiste n°23 pll) il assimile la conception marxiste de la décadence des modes de production aux visions religieuses du monde telles celles de Moon, des témoins de Jéhovah, etc.... La scission du GCI A Contre Courant ([5] [46]) reste sur le même terrain tant sur le plan historique "...nous rejetons dos à dos tant les schémas sclérosés de type décadentiste vulgaire (plaqués idéologiquenient sur une réalité qui les infirme chaque fois plus fort)...", que sur le plan actuel des rapports de force entre les classes "...ce qui matérialise pour nous essentiellement la dite crise boursière d'aujourd'hui est l'absence du prolétariat en tant que force révolutionnaire..." (A contre courant. n°1 p7).
La decadence du capitalisme
Pour voiler son involution anarchiste et l'abandon de toute référence au cadre marxiste d'analyse des sociétés, le GCI se couvre de l'autorité d'une conception erronée du "très marxiste" Bordiga ([6] [47]): "La conception marxiste de la chute du capitalisme ne consiste pas du tout à affirmer qu'après une phase historique d'accumulation, celui-ci s'anémie et se vide de lui-même. Ca, c'est la thèse des révisionnistes pacifistes. Pour Marx, le capitalisme croît sans arrêt au-delà de toute limite" (Le Communiste n°23 p10).
Si les décadences des modes de production antérieurs sont clairement identifiables (nous développerons ce point ultérieurement) soit parce qu'il y a recul absolu des forces productives -mode de production asiatique et antique- soit parce qu'il y a stagnation avec fluctuations séculaires -mode de production féodal- il n'en va pas de même pour le capitalisme. Mode de production éminemment dynamique, les bases de sa reproduction élargie ne lui permettent aucun répit, croître ou mourir tel est sa loi. Cependant tout comme dans les modes de production antérieurs, le capitalisme connait également une phase de décadence qui commence dans la seconde décennie de ce siècle et est caractérisée par le frein qu'exerce le rapport social fondamental de production (le salariat qui à terme se traduit par une insuffisance de marché solvables par rapport aux besoin de l'accumulation), devenu suranné, sur le développement des forces productives.
Ceci est violemment contredit par nos censeurs. Les affirmations péremptoires mises de côté, quels sont leurs argumcnts ?
1- Sur un plan théorique général l'on nous rétorque que l'analyse Luxembourgiste de la crise, sur laquelle nous nous appuyons, est incapable de féconder une explication cohérente de la "soit-disant" décadence du capitalisme: "Si nous suivons la logique luxembourgiste, c'est à dire la logique sur laquelle repose le raisonnement du CCI et la théorie de la décadence, on est amené à conclure que décadence doit rimer avec effondrement immédiat de la production capitaliste puisque toute Plus-Value destinée à l'accumulation ne peut être réalisée et, par suite, accumulée." (Communisme ou civilisation n°22 p5)
2- Sur un plan quantitatif général, il est affirmé que la dite période de décadence du capitalisme connaît, en réalité, une croissance bien plus rapide qu'en ascendance: "Pour l'ensemble du monde capitaliste, la croissance a été, au cours des vingt dernières années (1952-72 NDLR), au moins deux fois plus rapide qu'elle ne l'avait été de 1870 à 1914, c'est à dire pendant la période qui était généralement considérée comme celle du capitalisme ascendant. L'affirmation que le système capitaliste était entré depuis la première guerre mondiale dans sa phase de déclin est tout simplement devenue ridicule..." (P. Souyri cité dans Le Communiste n°23 pll), "Que plus de 70 ans après la date fatidique de 1914 le mode de production capitaliste accumule de la plus-value tandis que le taux et la masse de cette plus-value ont cru à un rythme supérieur à celui du 19ème siècle, siècle de la soi-disant phase ascendante du mode de production capitaliste ...".
3- Sur un plan circonstancié, en coeur avec tous les pourfendeurs du marxisme, les taux de croissance consécutifs à la seconde guerre mondiale (les plus élevés de toute l'histoire du capitalisme) sont brandis comme preuves décisives de l'inanité d'une décadence du mode de production capitaliste: "Car avec la fin de la seconde guerre mondiale, le mode de production capitaliste est entré dans une période d'accumulation pratiquement sans précédent depuis le passage à la phase de soumission réelle du travail au capital." (Communisme ou civilisation n°22 p6), "L'accumulation effrénée qui a suivi la 2ème guerre mondiale est venue balayer tous les sophismes à base de Luxembourgisme..." p41.
Sur le plan théorique
Nous n'allons pas revenir ici sur un sujet déjà largement traité et argumenté dans notre presse (Revue Internationale n°13,16,19,21,22,29,30). Bornons nous à relever le procédé foncièrement malhonnête de nos contradicteurs qui déforment sciemment nos propos afin de faire apparaître une absurdité qui n'existe que dans leur cerveau. Il consiste à prétendre que pour le CCI décadence = inexistence de marchés extra-capitalistes: "Si comme l'affirme par ailleurs le CCI les marchés extra capitalistes ont -du moins qualitativement- disparu, on ne voit pas ce que peut bien signifier cette exploitation des marchés anciens. Soit il s'agit de marchés capitalistes et alors leur rôle est nul pour l'accumulation soit il s'agit de marchés extra-capitalistes et on ne voit pas comment ce qui n'existe plus peut jouer un rôle quelconque."
Sur une telle base il n'est pas difficile à Communisme ou Civilisation de montrer l'impossibilité de toute accumulation élargie depuis 1914. Mais, pour Rosa Luxembourg et pour nous, la décadence du capitalisme se caractérise non par une disparition des marchés extra-capitalistes mais par une insuffisance de marchés extra-capitalistes par rapport aux besoins de l'accumulation élargie atteint par le capitalisme. C'est-à-dire que la masse de Plus-Value réalisée par les marchés extra-capitalistes est devenue insuffisante pour réaliser la part de Plus-Value produite par le capitalisme et destinée à être réinvestie. Une fraction du capital total ne trouve plus à s'écouler sur le marché mondial, signalant une surproduction qui, d'épisodique en période ascendante, deviendra un obstacle permanent auquel sera confronté le capitalisme en décadence. L'accumulation élargie s'en trouve donc ralentie mais n'en a pas disparu pour autant. L'histoire économique du capitalisme depuis 1914 est l'histoire du développement des palliatifs à ce goulot d'étranglement et l'histoire de l'inefficacité de ces derniers est signalée, entre autres, par les deux guerres mondiales (cf.ci-dessous).
Sur le plan quantitatif general
Pour illustrer la réalité d'un frein des forces productives par les rapports sociaux de production capitalistes, c'est-à-dire la décadence du mode de production capitaliste, nous avons calculé le développement qu'aurait eu la production industrielle sans le frein constitué par ces rapports sociaux de production depuis 1913. Ensuite nous comparons cet indice de production industrielle hypothétique (2401) à l'indice de production industriel réel (1440) pendant la même période (1913-83).
Pour ce faire, nous appliquons le taux de croissance de la dernière phase de l'ascendance du capitalisme à l'ensemble de la phase de décadence (1913-83) et nous comparons la croissance réelle en 83 (=1440) à la croissance potentiellement possible (=2401 -application du taux de croissance de 4,65% à la même période-) c'est à dire sans l'obstacle de l'insuffisance des marchés. Nous constatons que la production industrielle en décadence atteint 60% de ce qui eut été possible, bref que le freinage des rapports sociaux capitaIistes de production sur la croissance des forces productives est dé l'ordre de 40%. Et, ceci est encore sous-estimé pour trois raisons:
a- Nous devrions extrapoler non pas linéairement au taux de 4,65% mais sur base d'un taux à progression exponentielle car telle est la tendance au cours des différentes phases de prospérité du capitalisme ascendant étant donné le processus de technicité croissant du capital (1786-1820: 2,48%, 1840-70: 3,28%, 1894-1913: 4,65%).
b- La croissance réelle en décadence est surestimée dans la mesure où cette dernière est droguée par une série d'artifices (point que nous développerons dans un prochain article) qu'il faudrait défalquer. Par exemple, la part de la production d'armement -secteur improductif- dans le produit intérieur mondial augmente fortement en décadence (1,77% en 1908, 2,5% en 1913, 8,3% en 1981 ([7] [48])) et donc plus fortement encore dans la production industrielle mondiale car la part de cette dernière dans le produit intérieur mondial baisse au cours de la décadence.
c- La crise actuelle se poursuivant, la stagnation du taux de croissance après 1983 ne ferait qu'accroître davantage le décalage.
Si l'on additionne l'ensemble de ces phénomènes nous atteignons facilement un frein au développement des forces productives de l'ordre de 50% !
Pourquoi avoir choisi le taux de croissance de la période 1895-1913 et non le taux de l'ensemble de la phase ascendante?
a- Parce qu'il faut comparer des choses comparables. A ses débuts, le capitalisme est entravé par d'autres freins: la subsistance de rapports de production hérités de la féodalité. La production n'est pas encore pleinement capitaliste (forte subsistance du travail à domicile ([8] [49]), etc...), alors qu'elle l'est en 1895-1913.
b- Parce que la période 1895-1913 fait suite à la poussée majeure de l'impérialisme (conquêtes coloniales) qui s'est déroulée dans la phase précédente (1873-95) ([9] [50]). Nous avons donc là une période qui reflète au mieux les potentialités productives du capitalisme puisqu'il a à sa disposition un marché "sans limites". Ceci rejoint tout à fait notre objectif qui était de comparer un capitalisme sans frein et avec frein.
c- Parce qu'autrement l'on supprimerait la tendance exponentielle à l'accroissement des taux de croissance au cours du temps.
Ces éléments récusent définitivement toutes les affabulations sur "un capitalisme croissant deux fois plus rapidement en décadence qu'en ascendance". La "démonstration" de Souyri (cf. citation ci-dessus) sur laquelle s'appuie le GCI n'est qu'une grossière mystification car elle compare deux périodes incomparables :
a- Pour le GCI et Souyri, 1952-72 est la période censée représenter la décadence alors qu'elle exclut les deux guerres mondiales (14-18 et 39-45) et les deux crises (29-39 et 67-...) !
b- Elle compare une phase homogène de 22 ans de croissance droguée à une phase hétérogène de 44 ans de vie normale du capitalisme (cette dernière phase inclut une phase de ralentissement relatif du capitalisme 1870-94 (3,27%) qui se décloisonne par le colonialisme massif débouchant sur une phase de forte croissance 1894-1913 (4,65%).
c- Elle compare deux périodes dont les bases qui sous-tendent la croissance sont qualitativement différentes (cf. ci-dessous).
La décadence est loin d'être un "schéma sclérosé vulgaire plaqué idéologiquement sur une réalité qui l’infirme chaque fois plus" mais une réalité objective depuis le début de ce siècle qui se confirme d'avantage de jour en jour.
Sur le plan qualitatif
La décadence d'un mode de production ne saurait se mesurer à la seule aune des indices statistiques. C'est à un faisceau de manifestations quantitatives mais également qualitatives et superstructurelles qu'il faut se référer pour bien saisir le phénomène.
Nos censeurs feignent de les ignorer pour ne pas avoir à se prononcer, tout heureux d'avoir pu brandir un chiffre dont nous avons vu ce qu'il fallait en penser.
a/ Cycle de vie du capitalisme en ascendance et en décadence.
Le graphique n°1 est illustratif de la dynamique générale du capitalisme. En ascendance, la croissance est en progresston continue avec de faibles fluctuations. Elle est rythmée par des cycles de crise - prospérité - crise atténuée -prospérité accrue -etc... En décadence, outre un frein global sur la croissance (cf. ci-dessus), elle connait d'intenses fluctuations jamais vues auparavant. Deux guerres mondiales et un fort ralentissement ces quinze dernières années, voire une stagnation depuis moins de 10 ans. Le commerce mondial n'a lui-même jamais connu d'aussi fortes contractions (stagnation de 1913 à 48 et violent freinage ces dernières années) illustrant le problème permanent, en décadence, de l'insuffisance de marchés solvables.
Le Tableau n°l illustre le cycle qui rythme la vie du capitalisme en décadence: une spirale grandissante de crise - guerre - reconstruction - crise décuplée - guerre décuplée - reconstruction droguée.... Mais la décadence a une histoire et n'est pas un éternel recommencement du cycle. Nous vivons le début de la 3ème spirale et l'enjeu pour aujourd'hui c'est le vieux cri de guerre de Engels: "socialisme ou barbarie": "Le triomphe de l'impérialisme aboutit à l'anéantissement de la civilisation, sporadiquement pendant la durée d'une guerre moderne et définitivement si la période des guerres mondiales qui débute maintenant (1914 NDLR) devait se poursuivre sans entrave jusque dans ses demières conséquences. C'est exactement ce que F. Engels avait prédit, une génération avant nous, voici quarante ans (...). C'est là un dilemme de l'histoire du monde, un ou bien - ou bien encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Celui-ci doit résolument jeter dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire: l'avenir de la civilisation et de l'humanité en dépendent" (Rosa Luxembuug in "La crise de la social-démocratie", p68, Ed. La Taupe).
TABLEAU 1
1er spirale
Crise Guerre Reconstruction droguée
1913 1914-18 1918-24
1.5 ans de crise 4 ans et 20 millions de morts 10 ans
2ème spirale
Crise Guerre Reconstruction droguée
1929-39 1939-45 1945-67
10 ans de crise 6 ans, 50 millions de mort 26 ans
et destructions massives
3ème spirale
Crise Guerre Reconstruction droguée
1967-….
20ans de crise déjà guerre irrémédiable pour ……
L’humanité ou révolution
b/ Les guerres en ascendance et en décadence du capitalisme.
"Depuis l'ouverture de la phase impérialiste du capitalisme au début du siècle actuel, l'évolution oscille entre la guerre impérialiste et la révolution prolétarienne. A l'époque de la croissance du capitalisme, les guerres frayaient la voie de l'expansion des forces productives par la destruction des rappons surannés de production. Dans la phase de décadence capitaliste, les guerres n'ont d'autre fonction que d'opérer la destruction de l'excédent des richesses..." Résolution sur la constitution du Bureau International des Fractions de la Gauche Communiste, OCTOBRE n°1 de février 1938, p4 et 5.
En période ascendante, les guerres se manifestent essentiellement en phase d'expansion du capitalisme comme produit de la dynamique d'un système en expansion:
1790-1815: Guerres de la révolution, guerres de l'empire (Napoléon).
1850-1873: Guerres de Crimée, de Sécession, du Mexique, d'unification nationale (Allemagne et Italie), Franco-Prussienne (1870).
1895-1913: Guerres Hispano-U.S., Russo-Japonaise, Balkaniques.
Au 19ème siècle, la guerre a, en général, la fonction d'assurer à chaque nation capitaliste une unité (guerre d'unification nationale) et/ou une extension territoriale (guerres coloniales) nécessaire à son développement. En ce sens, malgré les calamités qu'elle entraîne, la guerre est un moment de la nature progressive du capital; tant qu'elle permet un développement de celui-ci, ce sont des frais nécessaires à l'élargissement du marché et donc de la production. C'est pourquoi Marx parlait de guerres progressives pour certaines d'entre elles. Les guerres sont alors: a) limitées à 2 ou 3 pays généralement limitrophes, b) elles sont de courte durée, c) elles provoquent peu de dégâts, d) elles sont le fait de corps spécialisés et mobilisent peu l'ensemble de l'économie et de la population, e) elles sont déclenchées dans un but rationnel de gain économique. Elles déterminent, tant pour les vaincus que pour les vainqueurs, un nouvel essor. La guerre franco-prussienne est typique de cc genre de guerre: elle constitue une étape décisive dans la formation de la nation allemande, c'est à dire la création des bases pour un formidable développement des forces productives et la constitution du secteur le plus important du prolétariat industriel d'Europe; en même temps, cette guerre dure moins d'un an, n'est pas très meurtrière et ne constitue pas, pour le pays vaincu, un réel handicap.
En période de décadence, par contre, les guerres se manifestent à l'issue des crises (cf. tableau 1) comme produit de la dynamique d'un système en contraction. Dans une période où il n'est plus question de formation d'unités nationales ou l'indépendance réelle, toute guerre prend un caractère inter-impérialiste. Les guerres sont par nature:
a) généralisées au monde entier car trouvant leurs racines dans la contraction permanente du marché mondial face aux nécessité de l'accumulation, b) elles sont de longue durée, c) elles provoquent d'énormes destructions, d) elles mobilisent l'ensemble de l'économie mondiale et de la population des pays belligérants, e) elles perdent, du point de vue du développement du capital global toute fonction économique progressistes, devenant purement irrationnelles. Elles ne relèvent plus du développement des forces productives mais de leur destruction. Elles ne sont plus des moments de l'expansion du mode de production mais des moments de convulsion d'un système décadent. Alors que par le passé un vainqueur émergeait et que l'issue de la guerre ne préjugeait pas du développement futur des protagonistes, dans les deux guerres mondiales ni les vainqueurs, ni les vaincus, n'en sortent renforcés mais affaiblis, au profit d'un troisième larron, les E.U.. Les vainqueurs n'ont pu faire payer leurs frais de guerre aux vaincus (comme la forte rançon en Marks OR payés à l'Allemagne par la France suite à la guerre franco-prussienne). Dans la période de décadence, le développement des uns se fait sur la ruine des autres. Autrefois, la force militaire venait appuyer et garantir les positions économiques acquises ou à acquérir; aujourd'hui, l'économie sert de plus en plus d'auxiliaire à la stratégie militaire.
A Contre Courant et Communisme ou Civilisation se refusent à reconnaître cette différence qualitative entre les guerres d'avant et d'après 1914 « A ce niveau nous tenons à relativiser même l'affirmation de guerre mondiale (...) Toutes les guerres capitalistes ont donc essentiellement un contenu international (...) Ce qui change réellement n'est pas le contenu mondial invariant (n'en déplaise aux décadentistes) mais bien l'étendue et la profondeur chaque fois plus réellement mondiale et catastrophique." (A Contre Courant n°l, p18). Communisme ou Civilisation, avec une pointe d'ironie, essaie de nous opposer Rosa Luxemburg pour qui "..le militarisme n'est pas caractéristique d'une phase particulière du mode de production capitaliste" (Communisme ou Civilisation n°22, p4). Ce groupe oublie que si effectivement pour Rosa Luxembourg "..le militarisme accompagne toutes les phases historiques de l'accumulation", pour elle également, la nature et la fonction des guerres et du militarisme changent avec l'entrée en décadence du système capitaliste "La force impérialiste d'expansion du capitalisme qui marque son apogée et constitue son dernier stade a pour tendance, sur le plan économique, la métamorphose de la planète en un monde où règne le mode de production capitaliste (...) La guerre mondiale est un tournant dans l'histoire du capitalisme (...) Aujourd'hui la guerre ne fonctionne plus comme une méthode dynamique susceptible de procurer au jeune capitalisme naissant les conditions de son épanouissement national (...) la guerre produit un phénomène que les guerres précédentes des temps modernes n'ont pas connu: la ruine économique de tous les pays qui y prennent part..." (Rosa Luxemburg in "La crise de la social-démocratie").
Si l'image de la décadence est celle d'un corps qui croît dans un habit devenu trop étroit, la guerre marque la nécessité pour ce corps de s'auto-phagocyter, de dévorer sa propre substance pour ne pas faire craquer l'habit, telle est la signification de ces destructions massives de forces productives. La vie en blocs rivaux, la guerre, sont devenues des données permanentes, le mode de vie même du capitalisme
LE DEVELOPPEMENT DU CAPITALISME D'ETAT
Le développement de l'Etat dans tous les domaines, son emprise croissante sur l'ensemble de la vie sociale est une caractéristique inéquivoque d'une période de décadence. Chaque mode de production antérieur, asiatique, antique, féodal, a connu une telle hypertrophie de l'appareil d'Etat (nous y reviendrons ultérieurement). Il en va de même pour le capitalisme. Un mode de production qui, sur le plan économique, devient une entrave au développement des forces productives, se matérialisant par un disfonctionnement et des crises d'ampleur croissante. Qui, sur le plan social, est contesté par la nouvelle classe révolutionnaire porteuse des nouveaux rapports sociaux de production et par la classe exploitée ([10] [51]) au travers d'une lutte de classe de plus en plus âpre. Qui, sur le plan politique, est constamment déchiré par les antagonismes internes à la classe dominante débouchant sur des guerres intestines de plus en plus meurtrières et destructrices. Qui, sur le plan idéologique, voit ses valeurs se décomposer, et réagit en blindant ses structures à l'aide d'une intervention massive de l'Etat.
Dans la décadence du capitalisme l'Etat supplante l'initiative privée qui survit de plus en plus mal au sein d'un marché sur-saturé. Au travers des anciennes organisations ouvrières (PS, PC et syndicats) et d'un ensemble de mécanismes sociaux rattachant la classe ouvrière à l’Etat (sécurité sociale, etc...) il encadre un prolétariat développé, devenu un danger permanent pour la bourgeoisie, et discipline les fractions particulières du capital derrière l'intérêt général du système. Une mesure, encore que très partielle, de ce processus nous est fournie par le développement de l'intervention de l'Etat dans la formation du P.N.B.. Nous reproduisons, ci-dessus les graphiques illustrant cet indicateur pour trois pays ([11] [52]).
La rupture en 1914 est nette, la part de l'Etat dans l'économie est constante tout au long de la phase ascendante du capitalisme alors qu'elle croît au cours de sa décadence pour atteindre aujourd'hui une moyenne avoisinant les 50% du P.N.B. ! (47% en 1982 pour les 22 pays les plus industrialisés de l'OCDE).
La FECCI ne critique pas encore ouvertement la théorie de la décadence du capitalisme mais elle l'abandonne petit à petit, insidieusement, au fil de ses "contributions à la discussion" qui constituent autant de bornes qui jalonnent sa régression. Sa "contribution" sur le capitalisme d'Etat dans "Perspective Intemationnaliste" n°7 en est une illustration flagrante.
Pour la FECCI la décadence ne s'explique plus essentiellement par l'insuffisance mondiale de marchés extra-capitalistes mais par le mécanisme du passage de la domination formelle à la domination réelle du capital: "C'est ce passage qui pousse le MPC vers sa crise permanente, qui rend insolubles les contradictions du procès de production capitaliste (...) le lien inextricable entre ce passage et la décadence du capitalisme" (p25 et 28). Il en va de même pour le développement du capitalisme d'Etat: 'A cet égard, il est essentiel de reconnaître le rôle non moins décisif joué par le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital dans le développement du capitalisme d'Etat (...) L'origine du capitalisme d'Etat doit également être cherchée dans la transformation économique fondamentale interne au mode de production capitaliste amenée par le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital" (p24 et 20). Sur cette base la FECCI, qui n'en est plus à une régression près, critique notre thèse de la restriction du champ d'application de la loi de la valeur sous le capitalisme d'Etat au nom du développement du libre-échange après la seconde guerre mondiale: "Donc, loin de s'accompagner d'une restriction de l'application de la loi de la valeur, le capitalisme d'Etat en marque la plus grande extension" (p20). Dans un même élan la FECCI introduit l'idée que le but de la guerre est la destruction de capital (p25 et 26). Découvrant le 6ème chapitre inédit du Capital de Marx avec 20 ans de retard sur les modernistes, la FECCI y trouve l'inspiration nécessaire pour abandonner la cohérence des positions révolutionnaires.
a/ Ce "groupe" confond deux choses diamétralement opposées, d'une part, le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital, c'est à dire, le passage à un mode d'organisation plus productif de la production et un mode d'extraction plus efficace de la plus-value et, d'autre part, le capitalisme d'Etat qui est une réponse face aux difficultés du capitalisme à survivre, à réaliser l'entièreté de la plus-value produite. L'un est une réponse à "comment mieux développer le capital", l'autre est une réponse au blo cage de ce développement. L'un propose un nouveau mécanisme d'extraction de la plus-value, l'autre est une perversion de ce mécanisme afin de survivre dans le cadre d'une crise permanente.
b/ En plaçant le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital à la charnière du 20ème siècle, la FECCI se trompe ... d'un siècle. Le capitalisme d'Etat se développe avec la décadence du capitalisme, le passage à la domination réelle se réalise au cours de la phase ascendante. Marx montre que les rapports capitalistes de production s'emparent tout d'abord de la production telle qu'elle est héritée des modes de production précédents, c'est la période de soumission formelle qu'il situe au 17ème, début du 18ème, ce n'est qu'ultérieurement que le capital se soumet réellement les forces de production déterminant la révolution industrielle du 18ème et du début du 19ème siècle. Comme l'explique très bien le G.P.I. critiquant le C.CA. ([12] [53]): "Si l'époque de la décadence correspondait au passage à la domination réelle du processus de travail, nous devrions la situer à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème. Encore une fois, nous nous trouvons en face de la tendance à diluer l'époque déterminée de la décadence dans le développement général du capitalisme" (Revue Internationale n°52 p19).
c/ Le capitalisme d'Etat est l'expression de la contradiction entre la socialisation mondiale de la production et la base nationale des rapports sociaux de production capitalistes. Il montre l'incapacité du capitalisme en décadence à dépasser le cadre de fEtat devenu trop étroit pour contenir le développement des forces productives. Toute la décadence du capitalisme est là pour nous le démontrer:
1- Les limites des organisations internationales (tant invoquées par la FECCI dans son argumentation). Nous assistons à un développement croissant des rivalités nationales que seul l'Etat peut prendre en charge et non 'à une coopération croissante entre Etats. Même si cela passe par , un minimum de coopération dans le cadre d'une politique obligée de blocs.
2- Dans ce cadre, chaque pays, en décadence, doit tricher avec la loi de la valeur s'il ne veut pas, soit être mangé par un pays plus puissant, soit voir son économie se désagréger sous le poids de ses contradictions insurmontables. La décadence correspond au plein développement des tricheries avec la loi de la valeur, à une restriction relative de son champ d'application. Quelques exemples: les pays dits "socialistes" (1/4 de la production manufacturière mondiale !) qui pour survivre ont du s'isoler du marché mondial et pratiquer sur leur propre marché une politique de prix en porte à faux avec la loi de la valeur, toute la production agricole européenne qui pour se vendre est artificiellement soutenue et vendue à un prix qui ne correspond pas à la logique de la loi de la valeur, il en va de même pour les prix de toute une série de produits des pays sous-développés, toutes les formes de protectionnisme déguisé qui touchent près des deux tiers du commerce mondiale selon le GATT (droits de douanes, quotas d'importation, subsides à l'exportation, réglementation à l'importation, etc...), les marchés 'protégés" (dotation d'une aide financière à la condition qu'elle serve à s'approvisionner en produits chez le pays donateur), marché des commandes publiques (monopole aux entreprises nationales), accords entre firmes nationales, cartels et monopoles sur les marchés et les prix, etc... Tous ces exemples illustrent ce processus de restriction relative du champ d'application de la loi de la valeur. Eblouie par la reconstruction, le GATT, la Banque Mondiale... et surtout par la propagande bourgeoise, la FECCI prend des vessies pour des lanternes.
d/ Enfin et surtout, la vision développée par la FECCI pour expliquer le développement du capitalisme d'Etat est celle d'un mécanisme strictement économique, une adaptation à un mode d'organisation de la production alors que le capitalisme d'Etat est une réaction d'un système qui craque de toute part et qui est obligé de blinder ses structures sur tous les plans tant social, politique, économique et militaire. Aspects que la FECCI se garde bien d'aborder.
S'il y a bien une chose sur laquelle Communisme ou Civilisation a raison c'est lorsqu'il parle de l'avenir de la FECCI en ces termes: "La FECCI a entrepris de penser, pour l'instant en se débattant dans les insurmontables contradictions de la théorie de la décadence, et elle ne fait que resserrer le noeud coulant qui l'étrangle. A toute cette agitation théorique il n'existe que deux issues: ou la FECCI rompra avec la théorie de la décadence, ou ce qui est pour l'instant plus probable, elle s'arrêtera de penser par elle même" (n°22 p24).
Toutes les décadences antérieures ont connu un arrêt de l'expansion géographique de leurs rapports sociaux de production et un frein dans l'intégration de forces de travail à ces derniers. Arrêt de l'expansion romaine, diminution de la population, expulsion croissante de travailleurs du processus de production, développement de nouveaux rapports de production à la périphérie de l'empire romain, tel est le tableau de la décadence de Rome. Arrêt des défrichements, stagnation de la population, émigration, fuite des paysans vers les villes, développement des rapports de production capitaliste, tel est le tableau de la décadence féodale.
Un processus analogue se développe au sein de la décadence du capitalisme (hormis pour le développement de nouveaux rapports de production qui ne pourront s'instaurer qu'après la prise du pouvoir au niveau mondial). En phase ascendante, l'existence de marchés vierges à conquérir, tant internes qu'externes, le faible capital nécessaire au démarrage industriel, la faiblesse de la pénétration du capital des pays dominants, permettaient à divers pays d'accrocher les wagons de leur économie au train de la révolution industrielle et d'acquérir une réelle indépendance politique.
TABLEAU 2
Evolution de l'écart entre le P.N.B./habitant des pays sousdéveloppés et développés de 1850 à 1980. Source: P. Bairoch et Banque, Mondiale.
Écart moyen
1850 1/5
1900 1/6
1930 1/7.5
1950 1/10
1970 1/14
1980 1/16
Depuis, la situation s'est quasi figée, les conditions économiques de la décadence n'offrent plus de possibilités réelles d'émergence et de développement de nouveaux pays, pire, l'écart relatif entre les premiers pays industrialisés et les autres se creuse.
Alors que l'écart est quasi constant au cours de la phase ascendante il saute de 1 à 6 à 1 à 16 en décadence. Bairoch, dans son livre "Le Tiers-monde dans l'impasse" (Ed. Idées/Gallimard, 1971) a publié un tableau illustrant l'arrêt de l'expansion géographique de la révolution industrielle et de la réduction relative de la population (!) touchée par celle-ci dans la décadence du capitalisme.
TABLEAU 3
Dates Nombre de pays: Pourcentage de la population mondiale:
1700 0 0
1760 1 1
1800 6 6
1860 11 14
1930 28 37
1960 28 32
1970 28 30
Alors qu'en phase ascendante la population intégrée au processus productif croissait plus rapidement que la population elle-même, aujourd'hui c'est au rejet d'une masse grandissante de travailleurs en dehors du système que nous assistons. Le capitalisme a achevé son rôle progressif notamment au travers de la fin du développement d'une des principales forces productives: la force de travail. Communisme ou Civilisation a beau nous bassiner des pages de sa prose avec des chiffres qui montrent l'augmentation plus importante dans la décadence de la part des salariés dans la population active pour la ... France ([13] [54]) cela ne change rien à la réalité du phénomène au niveau mondial (seule échelle valable pour appréhender le phénomène). A ce niveau les chiffres de la population active avancés par Communisme ou Civilisation ne démontrent rien du tout... si ce n'est l'explosion démographique du Tiers-Monde ! En effet, la population active n'est en rien un indicateur d'intégration de la population aux rapports de production capitaliste, il mesure tout simplement un rapport démographique de classes d'âges des actifs (15 ou 20 ans à 60 ou 65 ans selon les définitions) sur la population totale ([14] [55]). Si Communisme ou Civilisation se donnait la peine de raisonner, d'apprendre à lire des statistiques et à compter, il constaterait, ce qu'il entre-aperçoit au détour d'une phrase, l'ampleur du développement de cette "..masse croissante de sans réserves absolus qui n'ont d'autre ressources que de mourir de faim.." (p46).
Dans une prochaine contribution, nous développerons les bases qui ont rendu possible la reconstruction d'après guerre et ainsi répondre au 3ème type d'arguments qui nous sont rétorqués (taux de croissance « faramineux » consécutifs à la seconde guerre mondiale). Mais surtout, nous montrerons en quoi ce soubresaut du capitalisme dans sa phase de décadence est un soubresaut de croissance droguée qui constitue une fuite en avant d'un système aux abois. Les moyens mis en oeuvre (crédits massifs, interventions étatiques, production militaire croissante, frais improductifs, etc...) pour la réaliser viennent à épuisement ouvrant la porte à une crise sans précédent. Nous montrerons également que derrière le rejet de la notion de décadence, se cache en réalité le rejet de la conception marxiste de l'évolution de l'histoire qui fonde la nécessité du communisme.
C.McI
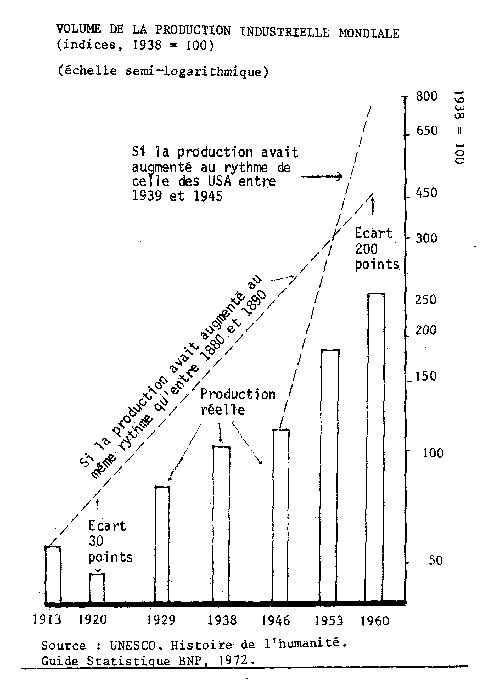
[1] [56] GCI : Groupe Communiste Internationaliste en Belgique, qui publie la revue Le Communiste (LC). , Bp 54, Bxl 31, lOGO Bruxelles
[2] [57] FOR: Ferment ouvrier Révolutionnaire. Cedex 13, France, qui publie la revue Alarme, BP 329, 75624 Paris
[3] [58] F.E.C.C.L: Fraction Externe du CCI, B.P. 1181 / 1000 Brux. / Belgique, qui publie la revue Perspective Internationaliste (P.L).
[4] [59] CoC: Communisme ou Civilisation, B.1'. 88 / 75722 Paris Cedex 15 / France, qui publie la revue du même nom.
[5] [60] A.C.C.: A Contre Courant, B.P. 1666 / Centre monnaie / 1000 Bruxelles / Belgique, qui publie la revue du même nom.
[6] [61] Fondateur et chef de file du P.C. d'Italie pendant ses premières années d'existence. Ensuite, après une éclipse politique, animateur du P.C. Internationaliste (1946) aujourd'hui disparu.
[7] [62] Pourcentage calculé à l'aide de la série du P.N.B.M. (1750-1980) de Bairoch P. ("International Industrial levels from 1750 to 1980" in Journal of european economic history) et des statistiques du S.I.P.R.I. sur les dépenses militaires mondiales depuis 1908 jusqu'à nos jours.
[8] [63] En G-B le sommet en effectif et en production du travail domestique et artisanal se situe autour de 1820. En France, autour de 1865-70. En Belgique, second pays à connaître la révolution industrielle après l'Angleterre, il y a en 1846, 406.000 travailleurs travaillant dans l'industrie mais encore 225.000 travailleurs à domicile (plus encore si l'on compte les travailleurs occasionnels). (Données tirées de Dockès P. et Rosier B. in "Rythmes économiques", Ed. Maspéro; et thèse de Doctorat, inédite, de Vandermotten C. sur l'industrialisation de la Belgique).
[9] [64] "Le capital trouve à vendre ses marchandises à l'extérieur de sa propre sphère. Il produit pour les paysans lorsque la montée du capitalisme agraire ne les a pas pratiquement remplacé par des salariés agricoles, comme en Angleterre, il produit pour les fermiers, pour les propriétaires fonciers, pour les autres rentiers, pour les classes "moyennes" commerçantes et artisanales (...) Lorsque le salariat se développe -seulement dans les années 1850-1860- en France, mais beaucoup plus tôt en Grande-Bretagne- sans qu'augmente suffisamment sa puissance consommatrice, lorsque la paysannerie se prolétarise et que l'importance de l'agriculture décline relativement (le cas de la GB), avec ses revenus et ses rentes foncières, une "solution" provisoire devra être et sera trouvée dans l'impérialisme et le colonialisme. Il y a là une explication possible de la précocité colonialiste britannique, mais à la fin du siècle, tous les pays capitalistes se conduiront de même. Rosa Luxemburg, comme d'ailleurs les capitalistes et les hommes politiques de ce temps (de Disraeli à Jules Ferry), comprend qu'il faut chercher là des débouchés pour les produits finis, ouvrir du même coup des perspectives de profits et donc développer sur cette base une demande interne de biens d'équipement (...) La grande dépression des années 1880 nous montre déjà les limites de la réalisation par la demande paysanne, d'où l'intensification des luttes impérialistes pour trouver à tout prix des acheteurs extérieurs. La grande dépression des années 1930, comme nous le verrons, est, de façon caractéristique, une crise de réalisation interne". (Rosier B., op. cité, p73 et 69).
[10] [65] Dans le capitalisme le prolétariat cumule ces deux caractéristiques, c'cst à dire d'être à la fois la classe exploitée et la future classe révolutionnaire, ce qui n'était pas le cas pour tous les modes de production antérieur.
[11] [66] Ces trois graphiques sont illustratifs d'une évolution qui est identique pour tous les pays. Pour d'autres graphiques et pour plus de renseignements, se référer au n°390, 1983/1, de la revue "Statistiques et Etudes financières":
"Matériaux pour une comparaison internationale des dépenses publiques en longues période".
[12] [67] G.P.L: Grupo Proletario Intemacionalista du Mexique (écrire à notre boîte postale). Pour une présentation de ce nouveau groupe révolutionnaire lisez la Revue Internationale n°52.
[13] [68] Ce pays constitue d'ailleurs une exceptiônpour iliustrer ce proreagus. Après 1871, avec les accords de Méline, la bovrgeoisie-dût s'appuyer-sur la fraction aisée de la paysannerie pour asseoir son pouvoir face à l'aristocratie.
La contre-partie à payer en fut le frein de la pénétration du capitalisme dans les campagnes. Ainsi, la France se retrouve en décadence avec une part importante de sa population active dans la petite agriculture (40% en 1930) contrairement aux autres pays (moins de 10% dès 1914 pour la GB). II n'est donc pas si étonnant de constater une telle croissance de la part des salariés dans la population active en décadence.
[14] [69] De plus, la comparaison de CoC est dénuée de sens dans la mesure ou les actifs en 1750 sont en grande majorité sous d'autres rapports de production que capitalistes.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [7]
Polémique : La confusion des groupes communistes sur la période actuelle
- 2928 lectures
LA SOUS-ESTIMATION DE LA LUTTE DE CLASSE
Dans sa lutte contre le capitalisme, en vue de son renversement et de l’édification de la société communiste, la classe ouvrière secrète des organisations politiques qui, non seulement expriment son devenir révolutionnaire, mais sont la condition indispensable de celui-ci. Si les buts généraux exprimés par ces organisations, leur programme, ne sont pas sujets à des fluctuations dans le temps, sinon à un constant enrichissement, les formes qu'elles prennent, leur impact, les moyens d'action et le mode d'intervention qu'elles se donnent dépendent, en revanche, des conditions historiques spécifiques dans lesquelles agit la classe, et tout particulièrement du rapport de forces existant entre elle et la classe ennemie. En d'autres termes, il ne suffit pas à une organisation communiste de défendre un programme révolutionnaire pour être un instrument efficace dans le développement de la lutte du prolétariat. Elle n'y parviendra réellement que si elle comprend les tâches qui lui incombent dans chacun des moments spécifiques de ce développement et si elle est capable, donc, d'analyser de façon correcte ces différents moments. Et c'est justement une question sur laquelle la plupart des organisations actuelles se situant sur un terrain de classe prolétarien éprouvent les plus grandes difficultés à s'orienter. En particulier des points aussi fondamentaux que le développement de la crise économique du capitalisme et les perspectives qui en découlent pour l'ensemble de la vie de la société : guerre impérialiste mondiale ou généralisation des combats de classe, constituent pour la plupart de ces organisations des sujets d'une énorme confusion alors que la plus grande clarté est plus que jamais indispensable pour contribuer au développement des combats présents de la classe ouvrière.
Ces derniers mois les confusions considérables qui pèsent sur le milieu politique prolétarien ont eu l'occasion de se manifester sous forme d'une sorte de tir groupé de plusieurs organisations contre les positions du CCI. Assurément, ce n'est pas de façon concertée que ces différentes organisations ont développé leurs attaques, mais cette simultanéité trouve en partie son origine dans une commune incapacité à apprécier la véritable importance des combats que mène à l'heure actuelle la classe ouvrière ([1] [71]). Parmi ces attaques, certaines comme celles du Groupe Communiste Internationaliste dans le n°26 du Communiste ([2] [72]), se situent sur un terrain d'une telle bassesse qu'elles ne sauraient donner lieu à une réponse dans le cadre de cet article de débat. De même, si on trouve dans le n°39 d'Alarme (publiée par le Ferment Ouvrier Révolutionnaire) et dans le n°10 de Perspective Internationaliste (publié par la "Fraction Externe du CCF), toute une série d'articles qui sont consacrés à notre organisation, et si les positions qui s'y expriment sont en partie tributaires d'une sous-estimation de l'importance des combats actuels de la classe ouvrière, nous n'y répondrons pas directement dans cet article car, sur cette question, nous avons affaire avec ces organisations à des caricatures (le FOR est probablement la seule organisation au monde qui reste encore incapable de reconnaître l'existence de la crise économique du capitalisme, ce qui est vraiment le comble quand on se veut "marxiste", et la FECCI, pour sa part, ne fait pas autre chose que nous présenter une caricature des positions du CCI). Plutôt que de nous attaquer à ces caricatures, il nous semble plus profitable, pour la clarté des questions que nous nous proposons d'aborder dans cet article, de nous intéresser à d'autres textes de polémique publiés récemment qui ont le mérite, outre qu'ils émanent d'organisations plus sérieuses que celles qu'on vient de citer, de présenter une orientation élaborée nettement différente de celle du CCI et représentant de façon claire la sous-estimation générale de la portée des combats actuels de la classe ouvrière. Ces articles nous les trouvons dans le n°4 de Comunismo, revue publiée par les camarades de l'ancien Colectivo Comunista Alptraum, et dans le n° ll (décembre 87) de Prometeo publié par le Par-tito Comunista Intemazionalista (Battaglia Comunista). Il s'agit, dans le premier cas, d'une lettre envoyée par la Communist Workers' Organisation (qui est associée au PCInt au sein du Bureau International Pour le Parti Révolutionnaire) au CCA à propos du communiqué de cette organisation "Sur les grèves récentes au Mexique" (avril 87) dont nous avons publié de larges extraits dans la Revue Internationale n°50. Dans le second cas, il s'agit d'un article intitulé "La crise du capital entre objectivité historique et subjectivité de classe" ("La crisi del capitale traoggettivita storica e sog-gettivita di classe") qui attaque, sans nommer à aucun moment le CCI, notre analyse du rapport de forces actuel entre bourgeoisie et prolétariat et particulièrement notre conception du cours historique.
Dans la mesure où la question du cours historique est la clé de voûte de toute compréhension de l'évolution présente de la lutte de classe, et bien que nous l'ayons déjà souvent abordée dans ces colonnes (en particulier dans la Revue Internationale n°50 où nous répondions déjà à un article de Battaglia Comunista n°3 de mars 87 intitulé "Le CCI et le cours historique, une méthode erronée"), nous devons y revenir ici pour mettre en évidence les absurdités auxquelles on est conduit lorsqu'on est incapable d'avoir une vision claire sur ce problème.
"Battaglia Comunista et le cours historique, une méthode inexistante
L'analyse du CCI sur la question du cours historique a été maintes fois exprimée dans l'ensemble de nos publications. On peut la résumer ainsi : dans la période de décadence du capitalisme qui débute avec le siècle, les crises ouvertes de ce mode de production, comme la crise des années 30 et la crise présente, n'offrent, du point de vue du capitalisme, d'autre perspective que la guerre impérialiste mondiale (1914-1918 et 1939-1945). La seule force qui puisse empêcher le capitalisme de déchaîner une telle "issue" est la classe ouvrière dont la bourgeoisie doit s'assurer de la soumission avant que de se lancer dans la guerre mondiale. Contrairement à la situation des années 30, la classe ouvrière d'aujourd'hui n'est pas défaite ni embrigadée derrière les idéaux bourgeois comme l'anti-fascisme, et c'est la combativité qu'elle a manifestée depuis une vingtaine d'années qui seule permet d'expliquer que la guerre mondiale n'ait pas encore été déclenchée.
Pour sa part, le PCInt partage une partie de cette analyse comme on peut le voir dans le passage qui suit :
"Le monde est constellé de telles tensions qui souvent dégénèrent en conflits ouverts (depuis sept ans fait rage la guerre entre l'Iran et l'Irak) et qui prennent les formes les plus variées (des coups d'Etat aux luttes de "libération nationale", etc.) : c'est là le signe des difficultés rencontrées par le capitalisme pour résoudre les questions internes au marché mondial
La crise pousse à une concurrence encore plus impitoyable. Dans les périodes "normales" les coups sont moins douloureux. Dans les périodes critiques les coups augmentent en fréquence et intensité et, de ce fait, très souvent, ils engendrent des ripostes. Pour survivre, le capitalisme ne peut qu'employer la force. Un coup aujourd'hui, un coup demain, on en arrive de cette façon à une situation véritablement explosive dans laquelle les conditions de la dégénérescence (élargissement et généralisation des conflits localisés) se trouvent désormais à l'ordre du jour. La phase qui conduira au déchaînement d'une nouvelle et terrifiante pierre impérialiste est ouverte.
POURQUOI LA GUERRE "MONDIALE" N'A-T-ELLE PAS ENCORE ECLATE ?
Tous les épisodes d'affrontements entre Etats, puissances et superpuissances nous indiquent qu'existe déjà la tendance qui nous conduira vers un troisième conflit mondial. Au niveau objectif sont présentes toutes les raisons pour le déclenchement d'une nouvelle guerre généralisée. Au niveau subjectif, de façon évidente, il n'en est pas ainsi. Le processus par lequel se meuvent les forces de la subjectivité est asymétrique par rapport à celui avec lequel s'exprime la situation historique objective* S'il n'en était pas ainsi, la guerre aurait déjà éclaté depuis un certain temps et des épisodes comme celui du Golfe persique, parmi d'autres, auraient pu constituer des motifs valables pour le déchaînement du conflit. Mais en quoi se manifeste le décalage entre les aspects subjectifs et le processus qui implique tout le monde de la structure ?"
On pourrait s'attendre à ce que BC fasse ici intervenir le prolétariat comme élément "subjectif" surtout qu'on trouve ailleurs dans le texte l'affirmation suivante :
"Il est clair qu'aucune guerre ne pourra jamais être menée sans la disponibilité (au combat et dans la production de guerre) du prolétariat et de toutes les classes laborieuses. Il est évident que, sans un prolétariat consentant et embrigadé, aucune guerre ne serait possible. Il est évident, de même, qu'un prolétariat en pleine phase de reprise de la lutte de classe serait la démonstration du surgissement d'une contre tendance précise, celle de l'antithèse à la guerre, celle de la marche vers la révolution socialiste. "
Cependant, BC poursuit ainsi :
"Nous sommes en présence, malheureusement, d'un phénomène inverse. Nous avons une crise à un niveau de gravité extrêmement élevé. La tendance à la guerre avance d'un pas rapide mais le niveau de l'affrontement de classe, par contre, est absolument en dessous de celui imposé par la situation objective ; il est en dessous de ce qui serait nécessaire pour repousser les pesantes attaques lancées par le capitalisme contre le prolétariat international. " (page 34)
Dans la mesure où la lutte du prolétariat ne permet pas, aux yeux de BC, d'expliquer le fait que la guerre n'ait pas encore eu lieu voyons par conséquent qu'elles sont les causes subjectives de ce "retard" :
"L'attention doit se tourner principalement vers des facteurs qui transcendent les initiatives particulières pour être situés dans un processus plus vaste qui voit les équilibres internationaux non encore définis et tracées en fonction de ce que seront les coalitions guerrières proprement dites, coalitions qui sont appelées à constituer les fronts de la guerre... Mais tout le cadre des alliances est encore assez fluide et plein d'inconnues. Le développement de la crise ne manquera pas de tracer de profonds sillons à l'intérieur desquels se glisseront les intérêts de chacun, qui iront s'y réunir avec ceux des autres. En un processus inverse et parallèle, le heurt des intérêts opposés tracera une ligne de division entre Etats qui se retrouveront dans des camps opposés de chaque côté de la barricade...
"Un autre aspect à prendre en considération est la dissuasion que représente la question nucléaire. Une guerre se déroulant dans les conditions historiques de prolifération maximale des armes nucléaires devient problématique pour un quelconque, hypothétique front militaire. La théorie du "suicide collectif, vers laquelle imprudemment et sentencieusement s'étaient tournés les apocalyptiques de service, s'est révélée - et il ne pouvait en être autrement - absolument dépourvue de fondement. Le retard dans le déclenchement de la guerre trouve une de ses causes dans l'absence d'un désarmement nucléaire (même partiel) auquel semblent vouloir parvenir, dans un proche avenir, les plus hauts représentants des plus grandes puissances impérialistes.
La rencontre au sommet entre Reagan et Gorbatchev, claironnée comme une volonté tenace de paix, se présente en réalité comme un sommet destiné à faire tomber les dernières barrières qui empêchaient la guerre d'éclater. Et cela en faisant abstraction de ce que peuvent penser réellement et subjectivement Reagan et Gorbatchev. La guerre naît de causes objectives. Les facteurs subjectifs n'en sont que des effets induits qui peuvent être, suivant les cas, retardés ou accélérés mais jamais empêchés." (page 34)
Il semble que nous ayons dans ces passages la quintessence de la pensée de Battaglia puisque ces deux idées apparaissent en de multiples occasions dans la presse de cette organisation. Il importe donc de les examiner de façon attentive. Nous commencerons par la plus sérieuse (en essayant de la formuler d'une façon un peu plus simple que ne le fait BC chez qui la boursouflure du langage semble avoir pour fonction de masquer l'indigence et l'imprécision des analyses).
"Si la guerre mondiale n'a pas encore eu lieu c'est parce que les alliances militaires ne sont pas encore suffisamment constituées et stabilisées".
Preuve qu'il s'agit là d'un point important dans l'analyse du PCInt, cette idée est reprise une nouvelle fois, et de façon détaillée, dans un tout récent article de Battaglia Comunista (^'Accord USA-URSS, Un nouveau pacte Molotov-Ribben-trop ?" dans BC n°5) où cet accord est supposé chercher "à délimiter, dans cette phase, les aires et les intérêts plus directement en conflit entre les USA et l'URSS et à permettre aux deux de concentrer les ressources et les stratégies à différents niveaux .et préparer de nouveaux et plus stables équilibres et systèmes d'alliances, en vue d'un futur affrontement plus profond et généralisé," De même on peut lire plus loin que "...l'aggravation de la crise générale du mode de production capitaliste...ne pouvait pas ne pas provoquer l'approfondissement des motifs de conflits entre les partenaires atlantiques même, et en particulier entre ceux qu'on appelle les 7 grands". Enfin, toute cette "démonstration" aboutit à la conclusion que "Tout cela (l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché mondial) ne peut que favoriser ultérieurement la guerre commerciale de tous contre tous, basée sur le dumping les contingentements, le protectionnisme, les accords secrets sur le dos d'autres rivaux, etc., mais aussi la formation de nouvelles agrégations d'intérêts tendant à leur concrétisation en alliances politico-militaires dont les nouveaux axes préférentiels trouveront leur place ou bien à différents niveaux au sein du même système, qui va en se déstructurant malgré les déclarations contraires et les diverses proclamations de "fidélité" durable, ou bien dans la perspective de possibles changements de camp,"
Cette analyse n'est pas nouvelle. Par le passé nous l'avons rencontrée à plusieurs reprises, notamment sous la forme développée par le groupe (aujourd'hui disparu) Pour une Intervention Communiste qui parlait de la tendance à "l'effritement" et à la recomposition des blocs en fonction des rivalités commerciales. De son côté, le PIC ne faisait que reprendre la thèse développée par le courant "bordiguiste" qui aboutissait à considérer que ces rivalités commerciales allaient provoquer une dislocation du bloc occidental et la formation d'une alliance entre les pays d'Europe de l'Ouest et l'URSS. Enoncée depuis plusieurs décennies, cette prévision attend encore sa réalisation. Précisons, pour compléter ce rappel, que le PIC attribuait, pour sa part, cette tendance vers la "dislocation des blocs" à... la force du développement de la lutte de classe (!) ce qui, évidemment, ne saurait être le cas de Battaglia.
A de nombreuses reprises dans notre presse, nous avons fait justice de la thèse suivant laquelle les blocs impérialistes se constituent directement sur la base des rivalités commerciales ([3] [73]). Nous ne reviendrons pas ici sur les arguments que nous avons développés pour réfuter cette analyse. Nous nous contenterons de rappeler que cette question n'est pas nouvelle dans le mouvement ouvrier et qu'elle a fait en particulier l'objet d'un débat au sein de l'Internationale Communiste où Trotski fut conduit à combattre la thèse majoritaire suivant laquelle les deux têtes de bloc pour la seconde guerre mondiale devaient être les USA et la Grande Bretagne qui, à l'époque, constituaient les deux principales puissances commerciales concurrentes ([4] [74]). L'histoire s'est chargée (avec quel sinistre éclat !) de valider la position de Trotski en confirmant que le lien - réel - existant entre exacerbation des rivalités commerciales et aggravation des antagonismes militaires n'est pas de nature mécanique. En ce sens, le système d'alliances existant à l'heure actuelle entre grandes puissances ne saurait être remis en cause par l'aggravation de la guerre commerciale entre tous les pays. Bien que les USA, le Japon et l'Europe occidentale constituent les principaux rivaux sur un marché mondial où la lutte pour les débouchés se fait chaque jour plus vive et impitoyable, cela ne saurait remettre en cause leur appartenance à la même alliance militaire.
Il faut donc être clair sur le fait que si la guerre mondiale n'a pas encore éclaté, cela n'a rien à voir avec une quelconque nécessité de modification ou de renforcement des alliances existant à l'heure actuelle. C'est vrai que les deux premières guerres mondiales ont été précédées de toute une série de conflits locaux et d'accords qui participaient de sa préparation et qui ont permis que se dégagent les alignements de l'affrontement généralisé (par exemple la constitution de la "Triple Entente" Grande-Bretagne-France-Russie au début du 20ème siècle et la création de l'"Axe" Allemagne-Italie au cours des années 30). Mais pour ce qui concerne la période historique actuelle, ces "préparatifs" se sont déroulés depuis des décennies déjà (en fait dès le lendemain de la seconde guerre mondiale avec l'ouverture de la "Guerre Froide") et il faut remonter à plus de vingt ans (rupture entre l'URSS et la Chine au début des années 60 et intégration de ce dernier pays dans le bloc occidental à la fin de cette décennie) pour constater un changement d'alliances important. En fait, à l'heure actuelle, les alliances impérialistes sont bien plus solidement constituées que celles existant à la veille des deux guerres mondiales où l'on a vu des pays majeurs entrer dans le conflit bien après qu'il se soit engagé (Italie en mai 1915, Etats-Unis en avril 1917, lors de la première, URSS en juin 1941, Etats-Unis en décembre 1941, lors de la seconde). De plus, chacun des deux blocs dispose depuis de très nombreuses années d'un commandement unique de l'essentiel de son dispositif militaire (OTAN dès avril 1949, Pacte de Varsovie en mai 1955), alors qu'un tel commandement unique n'a été créé (et uniquement par les puissances occidentales au niveau du front européen) que dans la seconde partie des deux guerres mondiales.
Ainsi, affirmer qu'aujourd'hui les préparatifs diplomatiques ou militaires pour une troisième guerre mondiale ne seraient pas encore achevés, c'est faire preuve d'une incroyable méconnaissance de l'histoire de ce siècle, ce qui est impardonnable pour une organisation révolutionnaire. Mais encore plus impardonnable est la thèse suivant laquelle :
"C'est l'existence des armements atomiques, du fait de la dissuasion qu'ils représentent, qui explique que la guerre mondiale n'ait pas encore eu lieu."
Est-il possible que des révolutionnaires sérieux puissent encore croire une telle fable ? La bourgeoisie l'a racontée un certain temps lorsqu'il s'agissait pour elle de déployer les arsenaux nucléaires. En particulier, la stratégie dite de "représailles massives", d'"équilibre de la terreur", était sensée agir comme moyen de dissuasion : dès lors qu'un pays aurait utilisé la bombe atomique, ou même qu'il aurait menacé les intérêts vitaux d'un autre, il s'exposerait à la destruction de ses principales concentrations urbaines et industrielles dans l’heure suivante. L'arme la plus meurtrière dont l'humanité se soit jamais dotée, aurait eu comme mérite d'empêcher désormais toute guerre mondiale. Qu'un tel mensonge ait pu avoir un certain impact sur des populations ayant des illusions sur la "raison" des gouvernements, et plus généralement dans la "rationalité" du système capitaliste, s'explique encore. Mais qu'aujourd'hui, alors que tous les derniers développements des armements nucléaires (bombes à neutrons, obus nucléaires, missiles à courte portée, missiles de "croisière" capables d'atteindre leur cible à quelques mètres près, programme de "la guerre des étoiles"), de même que l'élaboration de stratégies dites de "riposte graduée" (c'est la doctrine officielle de l'OTAN) font la preuve que les gouvernements et les états-majors envisagent sérieusement de mener une guerre atomique en vue de la "gagner", il se trouve encore des révolutionnaires qui se veulent "marxistes" pour croire et véhiculer de telles sornettes est proprement sidérant. Et pourtant, c'est malheureusement le cas avec nos camarades de "Battaglia" qui, sur ce point, défendent des absurdités dignes de celles du FOR lorsqu'il nie que le capitalisme soit aujourd'hui en crise. Car, la thèse qu'on trouve dans le n°11 de Prometeo n'est pas une erreur de plume, un raté d'un camarade un peu farfelu qui aurait échappé à la vigilance de l'organisation. Elle était déjà exposée avec encore plus de détail dans un article du n°4 de Battaglia Comunista (avril 86) intitulé 'Premières notes sur la guerre prochaine" où l'on peut lire :
"Un autre facteur à ne pas sous-évaluer, parmi ceux concourant à la dilatation des temps de préparation de la guerre ([5] [75]), est le chantage nucléaire, dans la mesure où l'affrontement direct entre les blocs ne peut raisonnablement dépendre du hasard des moments de plus grande tension entre les deux superpuissances, sous peine du risque-certitude de l’extinction de la vie sur la terre. "Le jour après la signature de l'accord sur le non-emploi des armes nucléaires, la guerre sera déclarée" est une boutade désormais classique entre nous et qui a tout le goût de la vérité. "
Nos camarades de Battaglia peuvent trouver à cette boutade le goût qu'ils veulent ; pour notre part nous dirons que leurs remarques ont "tout le goût" d'une naïveté affligeante. En effet, quel est le scénario-fiction que nous proposent les articles d'avril 86 dans BC et de décembre 87 dans Prometeo ? En poursuivant le processus de "désarmement nucléaire" engagé par l'accord de Washington de décembre 87 ([6] [76]), les deux super-puissances parviennent à une élimination totale des armements nucléaires ou bien à un accord de non-emploi de ces armements. Elles ont alors les mains libres pour déchaîner la guerre mondiale sans danger d"'extinction de la vie sur terre" dans la mesure où elles font confiance à leurs ennemis pour ne pas utiliser les armements prohibés ou pour n'en avoir pas conservé en secret. On peut se demander pourquoi les deux blocs, qui sont décidés à être "fair-play" en tout état de cause, n'ont pas poursuivi leur démarche de désarmement en éliminant ou en interdisant l'utilisation des armements conventionnels les plus meurtriers. Après tout, l'un et l'autre sont intéressés à limiter au maximum les destructions que pourraient provoquer ce type d'armements dont les ruines et les massacres de la seconde guerre mondiale ne nous donnent qu'une très faible idée. Et il n'y a pas de raison que les dirigeants du monde s'arrêtent en si bon chemin. Certes, ils n'ont pas renoncé à se faire la guerre puisque nous vivons toujours dans le capitalisme et que les antagonismes entre bourgeoisies rivales subsistent et s'attisent avec l'aggravation de la crise économique. Mais animés par le même souci initial que cette guerre soit la moins meurtrière possible, ces dirigeants en viennent progressivement à s'interdire tout emploi des armements modernes qui tous sont très meurtriers : interdiction des missiles, de l'aviation, des bombardements, de l'artillerie lourde, puis, sur la lancée, interdiction de l'artillerie légère, des mitrailleuses et, pourquoi pas, des armes à feu... On connaît la phrase célèbre : "Si la troisième guerre mondiale a lieu, la quatrième se déroulera avec des bâtons". La perspective qui se dégage de l'analyse de Battaglia est légèrement différente : c'est la troisième guerre mondiale qui se fera avec des bâtons. A moins qu'elle ne se déroule sous la forme d'un combat singulier, "à la loyale", entre les deux chefs d'Etat Major comme cela se pratiquait parfois au Moyen Age ou dans l'Antiquité. Si l'arme choisie était le jeu d'échecs, l'URSS aurait alors quelque chance de gagner la guerre.
Il va sans dire que les camarades de Battaglia ne racontent ni ne pensent de telles sornettes : ils ne sont pas fous. Mais ce conte de fées découle logiquement de l'idée qui se trouve au centre de leur "analyse" : la bourgeoisie est capable de se fixer des règles de "tempérence" dans l'utilisation de ses moyens de destruction, elle est disposée à respecter les traités qu'elle signe, et cela même quand elle est prise à la gorge, même quand ses intérêts vitaux sont menacés. Les deux guerres mondiales sont pourtant là pour montrer que tous les moyens dont dispose le capitalisme sont bons dans la guerre impérialiste, y compris - et surtout - les plus meurtriers ([7] [77]), y compris les armes nucléaires (nos camarades ont-ils oublié Hiroshima et Nagasaki ?). Nous ne prétendons pas qu'une troisième guerre mondiale devrait commencer d'emblée avec l'utilisation des armes de l'Apocalypse. Mais nous devons être sûrs que la bourgeoisie qui se retrouverait acculée le dos au mur après l'utilisation es armes conventionnelles, finirait par les employer quels Sue soient les traités qu'elle aurait pu signer auparavant. De même, il n'existe aucune chance pour que les .(très minimes) réductions actuelles des armements nucléaires puissent aboutir un jour à leur élimination totale. Aucun des deux blocs, et particulièrement celui qui se trouve en état d'infériorité technologique dans le domaine des armements conventionnels, le bloc de l'Est, ne consentira jamais à se démunir complètement de l'arme qui constitue son dernier recours, même s'il sait pertinemment que l'utilisation de cette arme signifie son propre arrêt de mort. Et cela n'a rien à voir avec un quelconque "comportement suicidaire" des dirigeants du monde capitaliste. C'est le système comme un tout, dans la barbarie engendrée par sa décadence, qui mène l'humanité vers son autodestruction ([8] [78]). En ce sens, l'article de Prometeo a tout à fait raison de souligner que le processus qui conduit à la guerre généralisée ne résulte pas "de ce que peuvent penser réellement et subjectivement Reagan et Gorbatchev" et que "la guerre naît de causes objectives". Le PCInt connaît les fondements du Marxisme. Le problème c'est qu'il lui arrive de les "oublier" et de se laisser piéger par les mystifications bourgeoises les plus éculées.
Ainsi on peut constater que pour tenter de défendre son analyse sur le cours historique actuel, le PCInt en est conduit non seulement à aligner contradiction après contradiction, mais aussi à "oublier" l'histoire du 20ème siècle et, plus grave encore, un certain nombre d'enseignements fondamentaux du marxisme au point de reprendre à son compte, avec la plus grande des naïvetés, un certain nombre des illusions répandues par la bourgeoisie pour peindre son système en rose.
La question qu'il faut donc se poser est donc : comment se fait-il qu'une organisation communiste, qui pourtant base ses positions sur le marxisme et qui connaît l'expérience du mouvement ouvrier soit victime de tels "trous de mémoire" et fasse preuve d'autant de naïveté vis à vis des mystifications capitalistes ? La réponse, nous la trouvons en partie dans l'article publié par BC n°5 de mars 87 et en Anglais dans la Communist Revue n°5 intitulé "Le CCI et le cours historique : une méthode erronée". Nous avons déjà répondu à cet article dans la Revue Internationale n°50. En particulier, nous avons rectifié un certain nombre d'erreurs sur l'histoire du mouvement ouvrier, et notamment sur l'histoire de la Fraction de Gauche du Parti Communiste dont pourtant se réclame en partie le PCInt. Il sera donc inutile d'y revenir longuement ici. Nous nous contenterons de mettre en évidence la complète incompréhension par le PCInt de la notion même de cours historique.
Cours historique ou cours fluctuant ?
Dans cet article, le PCInt écrit :
"Le procédé implicite du raisonnement du CCI est le suivant : pour toutes les années 30 le cours était vers le guerre impérialiste de façon univoque, comme le disait la Fraction en France. Cette période est terminée, révolue : maintenant le cours est de façon univoque vers la révolution (ou vers les affrontements qui la rendent possible).
C'est sur cette question nodale; ce point méthodologique, que nous divergeons de façon extrêmement profonde... La Fraction (particulièrement sa Commission Exécutive et, en son sein, Vercesi) évaluait dans les années 30 la perspective vers la guerre comme un absolu. Avait-elle raison ? Certes, l'ensemble des faits lui ont donné raison. Mais même alors, le fait de considérer le "cours' comme quelque chose d'absolu a conduit la Fraction à commettre des erreurs politiques...
L’erreur politique fut la liquidation de toute possibilité d'intervention politique révolutionnaire en Espagne avant même que le prolétariat ait été réellement défait...
L'erreur de méthode qui la soutenait se situait dans l’"absolutisation" du cours, dans l'exclusion méthodologique de toute possibilité de surgissements prolétariens significatifs dans lesquels pouvaient intervenir les communistes de façon active en vue de la perspective, toujours ouverte dans la phase impérialiste, d'une rupture révolutionnaire. "
Effectivement, c'est là le coeur de la divergence entre le PCInt et le CCI bien que, comme il est normal, le PCInt n'ait pas tout à fait compris notre analyse ([9] [79]). En particulier, nous n'établissons pas une complète symétrie entre un cours à la guerre et un cours aux affrontements de classe, de même que nous ne prétendons pas qu'un cours ne puisse s'inverser :
"...ce que nous voulons dire par cours aux affrontements de classe est que la tendance à la guerre -permanente en décadence et aggravée par la crise - est entravée par la contre-tendance aux soulèvements prolétariens. Par ailleurs, ce cours n'est ni absolu ni éternel: il peut être remis en question par une série de défaites de la classe ouvrière. En fait, simplement parce que la bourgeoisie est la classe dominante de la société, un cours vers les affrontements de classe est plus fragile et réversible qu'un coure à la guerre." (Revue Internationale n°50, "Réponse à Battaglia Comunista sur le cours historique'1)
"L'existence d'un cours vers la guerre, comme dans les années 30, signifie que le prolétariat a subi une défaite décisive qui l'empêche désormais de s'opposer à l'aboutissement bourgeois de la crise. L'existence d'un cours à "l'affrontement de classes" signifie que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour déchaîner une nouvelle boucherie mondiale ; auparavant elle devra affronter et battre la classe ouvrière. Mais cela ne préjuge pas de l'issue de cet affrontement, ni dans un sens ni dans un autre. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser ce terme plutôt que celui de "cours à la révolution"." (Revue Internationale n°35, "Résolution sur la situation internationale" du 5ème congrès du CCI, juillet 83)
Ceci étant rappelé, on peut donc voir facilement où se situe la divergence. Quand nous parlons d'un "cours historique" c'est pour qualifier une période... historique, une tendance globale et dominante de la vie de la société qui ne peut être remise en cause que par des événements majeurs de celle-ci (telle la guerre impérialiste, comme ce fut le cas au cours de la première mondiale avec le surgissement de la vague révolutionnaire de 1917, ou encore une série de défaites décisives, comme au cours des années 20). En revanche, pour Battaglia, qui emploie il est vrai plus souvent le terme "cours" que le terme "cours historique", il s'agit d'une perspective qui peut être remise en cause, dans un sens comme dans l'autre, à chaque instant puisqu'il n'est pas exclu qu'au sein même d'un cours à la guerre il puisse intervenir "une rupture révolutionnaire". C'est pour cela également, que ces camarades sont totalement incapables de comprendre les enjeux de la période historique présente et qu'ils attribuent le fait que la guerre généralisée n'ait pas encore eu lieu, bien que ses conditions objectives soient présentes depuis longtemps, à l'absence d'un désarmement nucléaire complet ou d'un traité de non-utilisation de l'arme atomique et autres stupidités retentissantes.
Là aussi la vision de Battaglia ressemble à une auberge espagnole : dans la notion de cours historique chacun apporte ce qu'il veut. On trouvera la révolution dans un cours vers la guerre comme la guerre mondiale dans un cours aux affrontements de classe. Ainsi chacun y trouve son compte : en 1981, le CWO qui partage la même vision du cours historique que BC, appelait les ouvriers de Pologne à la révolution alors que le prolétariat mondial était supposé n'être pas encore sorti de la contre révolution. Finalement c'est la notion de cours qui disparaît totalement ; voila où en arrive BC : éliminer toute notion d'une perspective historique.
En fait, la vision du PCInt (et du BIPR) porte un nom : l’immédiatisme. C'est le même immédiatisme qui se trouvait à l'origine de la proclamation du Parti au lendemain de la seconde guerre mondiale alors que le prolétariat était au plus profond de la contre révolution. C'est ce même immédiatisme qui explique qu'aujourd'hui les participants au BIPR fassent en permanence la fine bouche devant les combats que mène la classe dans la mesure où ces combats, et c'est normal, ne prennent pas encore une forme révolutionnaire et qu'ils continuent à se heurter aux multiples entraves des syndicats et de la gauche du capital.
La sous estimation des combats présents de la classe ouvrière
Notre appréciation des caractéristiques actuelles du combat prolétarien a été présentée de façon régulière dans la Revue Internationale (de même que dans l'ensemble de la presse territoriale du CCI). Nous n'y reviendrons pas ici. Par contre il est intéressant d'examiner, pour conclure cet article, comment le BIPR, à travers un document du CWO publié dans Comunismo n°4, concrétise l'analyse du cours historique qui est la sienne dans la critique de notre appréciation de ces luttes.
"... les événements en Europe montrent que la pression vers la lutte n'est pas directement liée à la gravité de la crise ni à la sévérité des attaques contre le prolétariat... Nous ne pensons pas que la fréquence et l'extension de ces formes de lutte indiquent -tout au moins jusqu'à aujourd'hui- une tendance vers leur développement progressif. Par exemple, après les luttes des mineurs britanniques, des cheminots en France, nous avons l'étrange situation dans laquelle les couches agitées sont celles... de la petite bourgeoisie I (docteurs, pilotes d'avion, magistrats, moyens et hauts fonctionnaires et maintenant, les enseignants)"
Il est déjà significatif que, pour le BIPR, les enseignants du primaire et du secondaire soient des "petits bourgeois" et que la lutte remarquable menée l'an dernier par ce secteur de la classe ne puisse rien représenter du point de vue prolétarien. On se demande pourquoi certains camarades de Battaglia, qui sont enseignants, ont tout de même jugé utile d'y intervenir (c'est vrai que les militants du CCI ont contribué de façon non négligeable à les réveiller en fustigeant leur passivité du départ).
S'adressant à Comunismo, le BIPR poursuit :
"Vous avez été probablement influencés par l'emphase mise par le CCI dans les luttes épisodiques des ouvriers en Europe
- emphase hors de toute proportion avec la réalité... à côté d'épisodes de lutte héroïque (en termes de durée et de sacrifices consentis par les travailleurs) comme ceux des mineurs britanniques, nous voyons, pour notre part, la passivité des autres secteurs de la classe en Angleterre et ailleurs en Europe."
Il ne nous paraît pas utile de rappeler ici tous les exemples donnés dans notre revue et dans notre presse territoriale qui contredisent cette affirmation. Nous y renvoyons le lecteur, de même que les camarades du BIPR, tout en sachant qu'ils n'y verront pas mieux pour cela : il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais poursuivons ces citations pour ce qui concernée les causes de cette triste situation et les conditions de son dépassement :
"Pour expliquer la relative passivité de la classe et son incapacité à répondre aux attaques du capital, les boucs émissaires (les syndicats, les partis) ne suffisent pas. Le pouvoir de persuasion des partis et des syndicats n'est pas la cause mais la manifestation du phénomène essentiel, qui est la domination réelle du capital sur la société... L'équilibre sur lequel repose la société bourgeoise existe encore. Il a été consolidé en Europe pendant près de 2 siècles et un mouvement de la classe puissant, matériel, est nécessaire pour le rompre...
Plus la domination capitaliste devient réelle, et plus elle s'exprime dans la superstructure, renforçant la domination réelle de telle façon que plus elle se cristallise, plus difficile et plus violent sera le processus qui la détruira."
Et voilà ! En jonglant un peu, pour "faire profond" sur le terme de "domination réelle du capital", que Marx utilisait dans un tout autre contexte (voir l'article sur la Décadence du capitalisme dans ce même n° de la Revue), on allonge de bonnes banalités quand ce ne sont pas des tautologies : "aujourd'hui le prolétariat est encore incapable de renverser le capitalisme parce que celui-ci exerce une domination réelle sur la société". Bravo le BIPR ! Voila une thèse qui fera date dans l'histoire du mouvement ouvrier et de la théorie marxiste. De même, l'histoire retiendra les phrases suivantes:
"L'intervention révolutionnaire du Parti est nécessaire pour vaincre toute influence bourgeoise, de quelque forme qu'elle soit, afin de rendre possible le passage des protestations et des revendications vers une attaque frontale contre l'Etat bourgeois...
La condition pour la victoire du programme révolutionnaire dans le prolétariat est la déroute de ce que nous avons défini comme les influences bourgeoises sur et dans la classe".
De nouveau, le BIPR nous propose des banalités agrémentées d'un raisonnement qui se mord la queue :
"Il n'existe pas un développement significatif des luttes parce qu 'il n 'existe pas le parti ; et le parti ne pourra exister sans que la classe ne se trouve dans un processus de développement des luttes". Comment peut-on rompre ce cercle vicieux ? Le BIPR ne nous le dit pas. C'est sans doute ce que ces camarades, qui sont très friands de formules "marxistes" tape à l'oeil, appellent la "dialectique"
En réalité, en sous estimant complètement la place qu'occupe le prolétariat dès à présent sur la scène de l'histoire, en empêchant le capitalisme de déchaîner une troisième guerre mondiale, la vision du BIPR sous estime de la même façon l'importance des combats actuels de la classe, tant par leur capacité de constituer un frein aux attaques bourgeoise que par l'expérience qu'elles représentent en vue des affrontements décisifs, révolutionnaires, contre l'Etat capitaliste. C'est pour cela que cette organisation, non seulement est conduite, comme on l'a vu plus haut, à tomber dans les pièges les plus grossiers de la propagande bourgeoise sur la "dissuasion nucléaire", mais qu'en plus elle néglige la responsabilité des révolutionnaires à l'heure actuelle-, tant du point de vue du travail de regroupement des forces communistes (voir article sur le Milieu politique dansée numéro de la revue) que du pointa vue du travail d'intervention dans les luttes. En particulier, le texte du BIPR est significatif à cet égard :
"Nous, les avant gardes révolutionnaires, nous pouvons seulement avoir une influence très limitée -presque inexistante -sur ce processus (de rupture de l’équilibre sur lequel repose le capitalisme), précisément parce que nous sommes en dehors de la dynamique matérielle de la société"
Si par "dynamique matérielle" le BIPR entend l'évolution de la crise, il est évident que les révolutionnaires n'ont aucun impact là dessus. Mais, il ne peut s'agir uniquement de cela puisque, par ailleurs, le BIPR estime que "l'affrontement de classe est absolument en dessous de celui imposé par la situation objective" : il faut donc supposer que d'après le BIPR, la crise est pour sa part suffisamment développée pour permettre la "rupture" qu'attend cette organisation. En fin de compte, derrière les jeux de mots sur la "domination réelle", etc., derrière le refrain perpétuel sur le "rôle indispensable du parti" (idée que nous revendiquons également d'ailleurs), le BIPR ne fait qu'abdiquer devant ses responsabilités. Ce n'est pas en clamant en permanence : "Il faut le Parti ! Il faut le Parti !) qu'on assume son rôle, dans la classe face aux besoins actuels du développement de sa lutte. Il existe un proverbe russe qui dit : "quand il n'y pas de vodka parlons de vodka". En fin de compte, beaucoup de groupes du milieu prolétarien font aujourd'hui la même chose. Seul le dépassement de cette attitude de scepticisme vis à vis des luttes de la classe, et notamment de leur impact sur le cours historique, leur permettra d'assumer réellement la responsabilité qui est celles des révolutionnaires, et contribuer efficacement à la préparation des conditions du parti mondial du prolétariat.
FM
[1] [80] Une autre raison permettant d'expliquer cette convergence des attaques contre les positions du CCI réside probablement dans le fait que notre organisation, qui depuis la dislocation du Parti Communiste International (bordiguiste) constitue la formation la plus importante du milieu révolutionnaire international, est devenue de ce fait le point de référence pour tous les groupes et éléments de ce milieu. Ce fait n'est pas pour nous un motif de satisfaction particulière : nous sommes bien trop conscients et préoccupés par la faiblesse générale du milieu révolutionnaire vis à vis des responsabilités qui sont les siennes dans la classe pour nous réjouir de cette situation.
[2] [81] Ce n° du Communiste contient un article dont le titre seul : "Une fois déplus... le CCI du côté des flics, contre les révolutionnaires" en dit long sur la teneur.
[3] [82] On peut se reporter en particulier à la Résolution sur la situation internationale adoptée lors de notre 3ème congrès (Revue Internationale n°18) et à l'article "Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme" publié dans la Revue Internationale n°52 et n°53.
[4] [83] Voir en particulier "Europe et Amérique".
[5] [84] Il faut remarquer que dans un passage précédent du même article, on explique la "dilatation des temps de préparation de la guerre" par les transformations économiques subies par le capitalisme depuis la seconde guerre mondiale, ce qui est en contradiction flagrante avec la thèse énoncée dans Prometeo n°ll suivant laquelle "au niveau objectif sont présentes toutes les raisons pour le déclenchement d'une nouvelle guerre généralisée". Quand on s'appuie sur une théorie fausse, il ne faut pas s'étonner de s'enfermer dans toutes sortes de contradictions lorsqu'on essaye de la faire cadrer avec la réalité.
[6] [85] A propos de cet accord, l'article déjà cité de BC de mai 88 souligne avec pertinence qu'il n'affecte que 3,5% du potentiel de destruction des signataires, et qu'il a pour but de leur permettre de "concentrer les efforts (économiques, de recherche, etc.) à la restructuration et la modernisation des armements nucléaires et conventionnels respectifs^. Décidément, les analyses du PCInt ressemblent à une auberge espagnole : il n'y a pas de menu fixe, chaque article de la presse y apporte ses propres conceptions, mêmes si elles sont en contradiction avec celles des autres articles. Il faudrait que BC et Prometeo accompagnent chacun des articles qui y sont publiés d'une note précisant s'il exprime les positions de l'organisation ou une position particulière d'un camarade afin que le lecteur puisse s'y retrouver. La même suggestion restant valable lorsque c'est au sein d'un même article qu'on énonce des affirmations contradictoires.
[7] [86] Les camarades de Battaglia estiment que la non utilisation des gaz de combat au cours de la seconde guerre mondiale illustre la capacité de la bourgeoisie à se donner un certain nombre de règles du jeu. Ce qu'illustre en fait leur affirmation c'est qu'ils prennent pour argent comptant les mensonges utilisés par la bourgeoisie lorsqu'elle veut démontrer qu'elle est capable de "raison" et d'"humanité" même dans les manifestations les plus extrêmes de la barbarie de son système. La seconde guerre mondiale n'a pas fait appel à ce type d'armes parce que la première avait montré qu'il était à double tranchant et pouvait se retourner contre ceux qui l'employaient. Depuis, l'Irak "barbare" dans la guerre du Golfe, et avant lui, les très "civilisés" Etats-Unis au Vietnam, ont fait la preuve qu'avec les moyens modernes on pouvait de nouveau les utiliser "efficacement".
[8] [87] Sur cette question voir l'article "Guerre, militarisme et blocs impérialistes..."
[9] [88] Il faut en finir avec le mensonge sur "la liquidation par la Fraction de toute possibilité d'intervention politique révolutionnaire en Espagne". La Fraction est intervenue par sa presse de façon publique et dans le milieu prolétarien, pour dénoncer la politique de collaboration de classe sous prétexte de "sauver la République", pour apporter un soutien total à la révolte des ouvriers de Barcelone en juillet 36 et en mai 37, par son soutien à la lutte des ouvriers des Asturies en 34. Mais il y a intervention et intervention : intervenir pour combattre "l'alliance républicaine anti-fasciste" ou intervenir pour s'intégrer dans les milices pour le soutien de la République bourgeoise. "Battaglia" condamne la position de la majorité de la Fraction (la première) même si elle critique aussi celle de la minorité (l'embrigadement anti-fasciste). Qu'elle était finalement la bonne position d'après le PCInt, celle qui a conduit cette organisation à lancer en 45 un "Appel aux comités d'agitation des partis à direction prolétarienne" (en fait les PC, les PS et les anarchistes) pour un "front unique de tous les travailleurs" (voir à ce sujet notre Revue Internationale n°32)
Courants politiques:
- Gauche Communiste [41]