Révolution Internationale - 1974
- 895 reads
Revolution Internationale N°08 - mars-avril (nouvelle série)
- 53 reads
Leçons de la lutte des ouvriers anglais
- 28 reads
Depuis que la crise générale a frappé le capital anglais, particulièrement vulnérable, les ouvriers ont réagi par une lutte pratiquement ininterrompue à 1'attaque contre leurs conditions d’existence. Depuis 1966-1967, pas une branche, pas une catégorie, pas une grande entreprise qui niait, à plusieurs reprises, engagé la bataille et mené des grèves longues et dures. Les conflits ont succédé aux conflits, désorganisant la production, jetant la consternation dans la classe dominante, aggravant la situation du capital national, faisant pousser des cris effarouchés à la presse. Ce n'est pas la combativité et la confiance en sa force qui ont fait défaut à la première fraction du prolétariat des pays avances à subir les effets de la crise.
Cette vague de luttes revendicatives semblait sans fin et susceptible de se transformer graduellement en un processus d'unification révolutionnaire. Au plus fort de la marée (1972), les occupations d'usines tendaient à devenir pratique courante, les piquets volants indiquaient la perspective d'un dépassement du corporatisme. Dix mille ouvriers de la métallurgie s'unissaient aux mineurs pour remporter une mémorable bataille contre la police à Birmingham, et, cinq mois plus tard, une manifestation de masse, qui risquait de faire tache d'huile, imposait la libération des dockers emprisonnés. À de tels moments, la lutte change de nature et devient une affirmation qui porte en elle-même un mouvement d'unification et de dépassement révolutionnaire, qui tend vers un affrontement de classe. Le capital le savait, il a reculé. Après ces deux victoires, un souffle parcourait les usines du pays : tout était-il possible ?
En fait, ces succès spectaculaires masquaient un épuisement des luttes revendicatives. Elles sont restées le point le plus haut atteint dans la première phase de réaction du prolétariat à l'attaque du capital. L'accélération de la crise à la fin de 1973, loin de porter la lutte à un niveau supérieur, a trouvé une classe ouvrière craintive, hésitante, désorientée et s’accrochant à ses illusions syndicalistes et électoralistes. Les ouvriers ont, à l'heure actuelle» peur de la crise, peur de lutter, Ils acceptent passivement des accords de salaires de 10 % au maximum (hausse des prix : 20 %). Les amputations de salaires dues à la semaine de trois jours n'ont pas provoqué de réaction significative. Au moment où tout laissait présager une flambée de luttes, les travailleurs se sont repliés dans un lourd silence. Au moment où la grève des mineurs semblait le prélude à une offensive générale, elle a été étouffée, isolée et, nous le verrons, utilisée par le capital. Au moment où le cynisme affiché par les ouvriers depuis des années envers le Labour laissait prévoir des abstentions massives, et alors que le caractère anti-ouvrier des élections était manifeste, les prolétaires sont allés aux urnes. Les rares révolutionnaires qui dénonçaient la farce ont été accueillis avec hostilité.
Comment expliquer ce reflux ? La classe est-elle défaite au moment où la crise cesse d'être une menace pour devenir une réalité tangible ? Les luttes menées de 1966 à 1972 l'ont-elles été pour rien ? Que signifie ce graphique éloquent ?
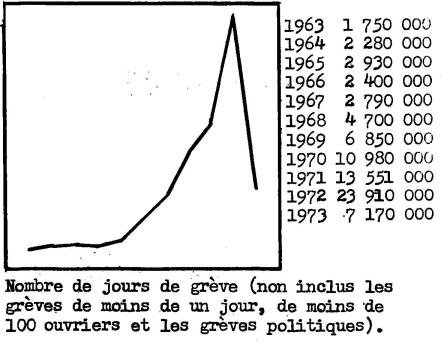
Ce ne sont certainement pas les apologistes du syndicalisme ni les braillards usinistes d'International Socialism, de Lutte Ouvrière ou de Potere Operaio qui pourront expliquer cette situation. Par contre, nous pensons que notre vision reçoit une illustration en Angleterre : impasse des luttes partielles, impossibilité du réformisme, nécessite d'un saut qualitatif vers l'unification révolutionnaire de la classe. C'est cette vision qui nous avait permis d'écrire, en juin 1973 :
"Dans les pays à forte tradition réformiste (USA, GB, Australie), la lutte a revêtu jusqu'ici un caractère de montée relativement continue. Mais l’échec des luttes trade-unionistes, qui est la cause du recul actuel dans ces pays, pourrait bien remettre en cause ce schéma." (R.I., n° 4, page 3)
L’Angleterre ne nous intéresse pas en elle-même, mais, par-delà ses aspects spécifiques, elle est un exemple particulièrement significatif du type de processus que devra parcourir le mouvement à l'échelle mondiale. L'Angleterre est un pays hyper-industrialisé, où le prolétariat représente la majorité de la population. Elle est frappée de plein fouet par la crise. Les syndicats y sont très forts, puissants, et regroupent la grande majorité des travailleurs. Elle est le pays des shop-stewards, délégués d'atelier élus et révocables à tout moment, dont les gauchistes voudraient nous faire croire qu'ils constitueraient une "meilleure forme" de syndicalisme, plus "près de la base[1]".
Et, dans ce paradis du trade-unionisme et de la démocratie d'atelier, après six ans de lutte intense, les travailleurs se replient en silence, élisent ceux qui avaient commencé l'attaque contre eux et acceptent passivement une réduction de leur pouvoir d'achat. Nous allons tenter d'expliquer pourquoi et montrer en quoi 1'Angleterre est la condamnation la plus claire de l'économisme, des illusions réformistes, du syndicalisme et des mystifications de gauche et gauchistes à cet égard.
Il faut nous expliquer tout de suite, pour écarter toute ambiguïté. Nous savons que les luttes immédiates sont nécessaires. Nous sommes parfaitement conscients que la classe devra faire et refaire l'expérience pratique de l'impossibilité du réformisme. Mais cette expérience, qu'elle forge de façon moléculaire, à travers un long processus de maturation, ne porte la possibilité d'un dépassement révolutionnaire, de sa négation, et de sa transcroissance, que si la classe saisit la signification de ses échecs, de ses revers. C'est le rôle des révolutionnaires, non de semer des illusions et de figer la lutte à ce stade en en faisant l'apologie, mais d'accélérer cette compréhension. Car la conscience de ce que le prolétariat sera historiquement contraint de faire est d’ores et déjà une partie intégrante de la pratique de la classe et devra le devenir de plus en plus.
LE POIDS DU PASSE
Les hommes ne bouleversent leurs rapports sociaux que lorsqu'ils ont épuisé toutes les possibilités de les rafistoler. Face à une transformation des conditions au sein desquelles ils agissent, ils tendent d'abord à réagir de façon conservatrice. La classe révolutionnaire tente d’utiliser toutes les armes qui lui ont permis de vivre dans l’ancienne société ; elle s’obstine à vouloir revenir en arrière, jusqu’au moment où la nécessité la contraint à rompre de façon radicale avec sa pratique révolue. La révolution naît précisément au moment où l’écart entre, d'une part, les conditions nouvelles et, d’autre part, la pratique et les idées anciennes, devient intolérable. Plus l’écart est grand et plus la révolution se présente comme un cataclysme, un renversement violent, soudain, apparemment inexplicable, des tendances. Comme l’a bien vu Trotsky dans sa préface à l'"Histoire de la révolution russe", la nécessité de la révolution provient du conservatisme de la conscience et de la pratique humaines, et non de leur souplesse. Il n'y a pas adaptation pacifique et évolutive au développement des forces productives, mais résistance, réaction, crise et donc nécessité d'un renversement brutal et révolutionnaire du cours social. Le conservatisme, qui ne dépérira que dans le communisme, plonge ses racines dans la domination des hommes par leurs propres rapports sociaux. La façon dont ils s’organisent à un moment donné pour produire se présente à eux comme une réalité naturelle, invariable, institutionnalisée. La ténacité avec laquelle les hommes perpétuent les rapports sociaux périmés, au risque de remettre en cause l’existence même de la société, exprime l’incapacité d'une humanité non encore unifiée de diriger sa propre autotransformation de façon créatrice et pacifique, en harmonie avec la transformation de ses conditions matérielles de reproduction.
Tant qu’existera une société déchirée en classes, aucune classe n’échappera à cette loi. Le prolétariat, classe de sans-réserves, n’ayant ni propriété, ni culture, ni "idéologie" particulière (au sens où l'ont les classes qui poursuivent un but propre : dominer la société) est, plus qu'une quelconque autre classe, soumis au conservatisme. Réduit à une collection d'individus sans autre communauté que leur opposition irréductible au capital, plongé dans une insécurité permanente, il subit l’exploitation la plus déshumanisante. C’est pourquoi, dans des conditions "normales", il est une classe profondément inerte, qui tend à reproduire obstinément la pratique qui, par le passé, lui a permis d'aménager sa survie. La classe ouvrière n'a rien ; il lui faut donc s'accrocher à l’illusion qu'il y a, à l’intérieur de la société et dans sa situation de classe exploitée, des organes, des institutions, des formes de pression qui constituent une garantie contre la déchéance et la misère : syndicats, négociations, grèves revendicatives, solidarité corporatiste, lois, "démocratie", partis "ouvriers", etc. Cette illusion se nourrit du passé, de l’époque ou ces moyens ont réellement permis d’aménager relativement la vie de la classe. Aujourd’hui, c'est par peur de couper le cordon ombilical avec cette époque que les travailleurs se laissent mystifier.
Mais, au même moment, par sa position dans les rapports de production, sa concentration, sa dépossession totale, lorsque les conditions le contraignent à agir, il apparaît soudain comme la classe la plus révolutionnaire, la plus audacieuse, la plus créatrice de l'Histoire, celle qui ne peut s'arrêter en chemin, car elle ne peut cesser de lutter que lorsqu’elle a créé une communauté humaine. Cette contradiction conservatisme-radicalisme, ni les ouvriéristes, qui attribuent aux ouvriers individuels en permanence des vertus révolutionnaires, ni ceux qui • nient la capacité révolutionnaire du prolétariat ne la comprennent. "Le prolétariat sera révolutionnaire ou ne sera rien", disait Marx. On cite souvent cette phrase, mais on ne voit pas que cela implique que la rupture avec le conservatisme est mille fois plus difficile pour les ouvriers que pour les autres classes, précisément parce que, une fois commencée, elle est contrainte de devenir mille fois plus radicale et profonde.
Plus que toute autre fraction du prolétariat mondial, les ouvriers anglais sont entrés dans la période historique de la révolution enfermés dans le corset de fer des illusions réformistes. Le trade-unionisme, l'électoralisme et la perception de la lutte de classe comme l'affirmation du travail salarié au sein de la nation, en harmonie avec le capital, n'ont jamais été sérieusement ébranlés, même au cours des années 1920. Pendant des dizaines d'années, depuis 1850, cette idéologie avait pris racine dans les luttes réelles de la classe et dans les conquêtes réelles que celle-ci avait pu arracher au capitalisme le plus puissant et le plus riche du monde. Pendant plus d'un siècle, les ouvriers avaient obtenu des droits politiques, une certaine sécurité, la journée de dix heures, des institutions pour réagir aux abus les plus flagrants du capital.
La première guerre mondiale et la crise révolutionnaire qui a suivi ont constitué une rupture trop soudaine pour être assimilée. En quelques années, la réalité criait aux travailleurs : "Ce que vous avez "créé par vos efforts inouïs a fait son temps et devient la pire des entraves. Vous n'avez pas de "conquêtes", pas d'"institutions", pas d'organisations permanentes, pas de place dans la nation. Vous êtes seuls et vous devez vous affronter aux syndicats et au Labour Party que vous avez construits." Seuls, quelques centaines de communistes de gauche, autour de Sylvia Pankhurst, ont commencé confusément à le comprendre. Mais pour la classe dans son ensemble, le saut était trop difficile.
D'où la suite : défaite (1920-1926), crise et misère, effondrement des conquêtes antérieures et mobilisation dans la guerre. Au cours de cette période, toutes les organisations "ouvrières", du Labour aux shop- stewards, révélèrent clairement leur fonction d'appendices du capital. Voilà l'expérience que dut parcourir la classe, ici peut-être encore plus qu'ailleurs. Même s’il s'agit d'une expérience surtout négative, elle a ébranlé en profondeur la conviction des ouvriers de pouvoir améliorer durablement leur condition.
La reprise de l'économie capitaliste de 1950-1965 a créé une situation complexe et hybride. Sur une toile de fond générale propre à la décadence du système (impossibilité de grandes réformes qualitatives, intégration État-syndicats, intervention de l’État dans les conflits, etc.) s'est greffé une conjoncture où des gains de salaires appréciables et une résistance partielle à la rationalisation étaient possibles. L’amélioration conjoncturelle pour le capitalisme permettait d’obtenir certains aménagements pour la classe ouvrière, mais la situation historique du capital ne permettait pas des luttes réformistes générales d’envergure. Les ouvriers n'avaient plus confiance dans la lutte d’ensemble (la défaite de 1926 reste un souvenir vivace), mais ils saisirent qu'ils pouvaient, par des luttes locales, limitées, corporatistes, et en s’appuyant sur l’institution des shop-stewards, pressurer des gains, principalement autour des taux de travail aux pièces, du boni, des conditions de travail (négociés par atelier). Ce fut l’âge d’or du militantisme d’atelier, l’illusion du petit groupe compact et solidaire autour de son shop-steward. Ce sursaut dégénéré du syndicalisme se produisit sur un fond d’agonie des syndicats. Au moment même où cette fragmentation corporatiste battait son plein, les branches syndicales et le Labour Party achevaient de devenir des appareils squelettiques sans aucune vie. C'est là une indication que cette phase de syndicalisme de section, particulariste, qui n'a obtenu de succès que pour les travailleurs les mieux placés, ne peut être comparée au syndicalisme du siècle passé.
Pendant cette période, les shop-stewards ont pu présenter l’apparence d'une indépendance à l’égard de l’appareil syndical. Beaucoup de grèves étaient sauvages ("unofficial"), non parce qu'antisyndicales, mais parce que les shop-stewards ne prévenaient même pas l'appareil.
Mais nous allons voir comment l’entrée à nouveau dans la crise a surpris la classe, engoncée dans le corporatisme et les illusions syndicalistes. Mais cette fois, contrairement aux années 1920, le déroulement progressif de la crise permet au prolétariat de rompre, à travers une longue maturation et des expériences répétées, avec le conservatisme et les institutions qui le cimentent.
1968-1972 : L'USURE DU SYNDICALISME
Dès que la crise a contraint la classe dominante à attaquer les positions acquises par les travailleurs au cours de la période de reconstruction, le localisme est devenu le talon d'Achille de la classe, L'étroitesse corporatiste, le crétinisme réformiste ont été dépouillés de leur vernis d'"efficacité" à court terme et se sont révélés une arme du capital. Les shop-stewards ont dévoilé leur fonction capitaliste d'encadrement de la force de travail.
Pour resserrer son contrôle sur les ouvriers et entamer leurs dérisoires gains, la bourgeoisie a précisément utilisé ce qui avait fait la force apparente du mouvement au cours du boom. Cette attaque s test déployée sur deux fronts complémentaires : accords de productivité et contrôle des salaires .
Les trotskystes d'International Socialism ont voulu voir dans les accords de productivité une "attaque contre les shop-stewards". Il est vrai qu'en remplaçant le travail aux pièces, négocié par atelier, par une détermination "scientifique" et "mesurée" du rythme de travail, négocié par la branche syndicale au niveau de l'entreprise, la classe capitaliste a sapé irrémédiablement la base de l'illusoire pouvoir local et l'autonomie formelle des délégués d'atelier[2]. Mais cela, elle l’a accompli avec la collaboration des shop-stewards, qui ont été les premiers à faire avaler la mesure à leur "base" contre de la monnaie de singe ; elle l'a accompli grâce à la mentalité étroite et bornée dont les délégués étaient l'expression institutionnalisée. Elle m’a fait que supprimer cet anachronisme intolérable que constituait une illusion de "contrôle" sur les conditions de travail et d'indépendance[3] des délégués, pour les remplacer par l'intégration ouverte et la transformation des stewards en flics avérés du capital. Résultat : désarroi des travailleurs privés de leurs moyens d'action traditionnels et désorientés par la collaboration de plus en plus ouverte de "leurs hommes" avec les patrons. Le prix : augmentation de l’exploitation, de l'intensité du travail et impuissance des travailleurs face à la "rationalisation".
L’attaque sur les salaires a été plus difficile. Très longtemps, l'issue a été indécise et il a fallu des années pour corroder la résistance de la classe. La série de défaites qui se sont accumulées depuis l'été 1972 (hôpitaux, gaz, bâtiment, etc.) ont finalement fait pencher la balance. Les travailleurs se sont bel et bien battus, mais au jeu "capital et État contre catégories d’ouvriers isolés", c'est le capital et son État qui devaient l'emporter. Contrairement à ce que pensaient les travailleurs, la force de la classe ne réside ni dans l'esprit de corps de chaque métier ou de chaque usine, ni dans la capacité de petits groupes de bloquer la production, ni dans la grève "dure", mais dans la possibilité de s'unir sur le terrain social global (politique) face au capital et à l'État. Fragmentés en petits groupes combatifs mais imbus d’égoïsme particulariste, enchaînés à leurs illusions syndicalistes, rivés aux shop-stewards, les ouvriers se sont heurtés aveuglément à un capital solidement défendu par l’État et ont fini par user leur potentiel de lutte.
"Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi il y a un apaisement dans la lutte salariale : les ouvriers sont confrontés à l’État, et les organisations traditionnelles (syndicats, comités de shop-stewards) sont soit directement contre eux, soit complètement inutilisables comme véhicules de la lutte de classe. Le trade-unionisme est si profondément enraciné dans la classe ouvrière de ce pays ... que la classe tente encore de lutter de l'ancienne manière, en reproduisant les divisions corporatistes créées par le capitalisme et que les syndicats maintiennent : l’usine, l’atelier, le métier, la branche d'industrie. C'est pourquoi la plupart des catégories d'ouvriers qui entrent en lutte se trouvent isolés et se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors, ils décident de réduire leurs pertes et de retourner au travail." (Workers Voice, février 1974)
C'est à partir de cette impuissance des travailleurs qu'on peut expliquer l'isolement et l'utilisation de la grève des mineurs.
Les mineurs ont obtenu satisfaction, mais leur grève a été utilisée par les partis et les syndicats pour préparer l'avenir. Cette opération est intéressante parce qu'elle montre que le capital est conscient qu'il ne peut se heurter à la classe de front, et qu'il lui faut donc clouer les luttes sur un terrain corporatistes, fragmentaire et institutionnalisé. À travers la comédie des "commissions de salaires", "commissions de relativités", on a créé une atmosphère totalitaire, où toute catégorie doit se justifier en faisant valoir qu'elle est un cas particulier. En venant témoigner du bien-fondé '“relatif" des revendications des mineurs, "lésés" par rapport aux autres, les syndicats ont clairement indiqué qu'ils sont et seront les gardiens du consensus national suivant : l'intérêt national exige que la masse salariale soit fixée par un accord État-syndicats. Pour poser une revendication, il faut démontrer qu'on a un cas spécial à faire valoir (spécial, soit parce qu'on a été défavorisé, soit parce que l'intérêt du pays justifie les demandes). Partager la misère entre les groupes concurrents d’ouvriers, voilà l'honorable tâche qui leur est dévolue.
Les capitalistes savent bien que les "commissions" sont des châteaux de cartes qui s'effondrent à la première lutte sérieuse. Par contre, ils savent aussi qu'ils créent une atmosphère où la moindre lutte sérieuse sera traitée d'"antipatriotique", de "démesurée" et, surtout, ils jouent à fond la carte du corporatisme, qui est, à 1«heure actuelle, leur arme la plus forte.
L'autre face de la médaille, c'est évidemment qu'à force d'utiliser le corporatisme contre les ouvriers, ils pousseront inévitablement les ouvriers à se révolter contre le corporatisme.
C'est la dynamique révolutionnaire potentielle qui donne son sens aux luttes revendicatives et à leur échec inévitable en général. En infligeant échec sur échec au trade-unionisme, le capital prépare les conditions du dépassement des divisions et de l'atomisation qui permettent aux syndicats d'encadrer le prolétariat. La lutte de la classe-en-soi (addition de catégories) forge les conditions objectives et subjectives pour le passage à la classe révolutionnaire qui balaiera le poids du passé. Il y a des défaites fécondes en ce qu'elles mettent à nu les institutions contre-révolutionnaires et sapent la crédibilité du réformisme.
C'est également l'absence de perspectives immédiates de lutte et l'essoufflement de la combativité qui forment la toile de fond de la participation massive des ouvriers aux élections derrière le Labour. L’inquiétude profonde et l'incertitude face à la crise ont fait réémerger avec virulence les vieux préjugés électoraux et les illusions. Il est vrai que personne n'attend du frétillant Wilson des améliorations. D’ailleurs, i ne les promet même pas. Mais les ouvriers re sentent, après tant d'échecs amers, la nécessité de croire qu'il y a quand même, dans la société, une force qui limite les dégâts et qui les protège contre les pires effets de la crise.
Mais, là encore, la lutte de classe aura contraint le capital à utiliser les illusions électoralistes des prolétaires contre eux, et, avec l'approfondissement de la crise le rejet de ces illusions en sera facilité.
C'est ainsi, à travers la lutte prolétarienne, la pratique de la classe, que s’infiltrent les leçons qui, silencieusement et de façon moléculaire, se cristallisent dans sa conscience et permettront aux surgissements futurs de se faire sur une base qualitativement supérieure.
LUTTE REVENDICATIVE ET LUTTE RÉVOLUTIONNAIRE
En Grande-Bretagne, comme ailleurs, derrière les hésitations, les coups de boutoir, les replis de la classe, se dessine l'immensité du saut à accomplir d'une catégorie qui tente d'aménager son exploitation à une classe qui devra détruire l'exploitation. Ce saut n'est pas un phénomène futur sans lien avec le présent, il sera à la fois le résultat et la négation des mouvements actuels.
Ce qu'il faut, c'est saisir la nature du lien entre luttes revendicatives, à l'intérieur du système, et luttes révolutionnaires, contre le système.
Le prolétariat est une classe exploitée et révolutionnaire. C'est donc l'être-même de la classe qui constitue le lien dynamique entre les différentes phases transitoires, le mouvement qui se pose et se nie à travers les divers moments de la lutte. Le prolétariat n'est ni une simple catégorie pour le capital, ni une classe-pour-soi achevée, mais le mouvement de l'une à l'autre. L'UNITE DU MOUVEMENT, LE FAMEUX "LIEN", C'EST LA PRATIQUE DE LA CLASSE ELLE-MÊME EN TANT QUE SUJET AGISSANT.
Les travailleurs tentent de lutter en tant que classe-pour-le-capital (par catégories, usines, branches, de façon concurrente à l'image de la concurrence capitaliste, pour négocier le prix de la force de travail). Mais leur rapport au capital (leur division, leur soumission, leur acceptation de mètre que du travail salarié) entre en contradiction avec leur propre mouvement et devient intenable. C'est alors que la classe doit commencer à se poser comme négation de son rapport avec le capital, donc non plus comme une catégorie économique, mais comme CLASSE-POUR-SOI. Elle brise alors les divisions qui sont propres à son état antérieur et se présente non plus comme somme de travailleurs salariés, mais comme un mouvement d'affirmation autonome, c'est-à-dire de négation de ce qu'elle était auparavant. Ce n'est pas le travail salarié qui s'affronte alors au capital, mais le travail salarié en train de devenir autre chose, de se dissoudre. L'affirmation du prolétariat n'est que ce mouvement de négation. Qualifiés, non-qualifiés, ouvriers, employés, "productifs", "improductifs", barrières des usines, etc., toutes ces déterminations sont dépassées. Et à ce stade ce mouvement se heurte à l'État bourgeois, dernier rempart avant le début de la transformation communiste de la société.
On voit donc que c'est l'être-même de la classe, sa situation à l'égard du capital, qui permet de comprendre comment elle forge elle-même le lien entre luttes revendicatives et révolution.
Les sociaux-démocrates et les trotskystes pensent que c'est le parti et un programme de transition (ou minimum) qui font le lien. C'est une médiation extérieure à la classe qui fait le "pont" entre la classe- pour-le-capital et la classe-pour-soi. Il n'y a donc pas de continuité et d'unité du sujet. La classe n'est pas le sujet, identique à travers ses diverses phases et qui s'identifie précisément à travers elles. L'être n'est pas l'artisan de soi-même, de sa conscience. Il a besoin de quelque chose d'extérieur, d'un pédagogue, d'un ingénieur "ès ponts", d'une conscience qui lui est séparée, pour devenir. Ce n'est pas l'être qui devient, c'est un autre être qui le fait devenir. En tant que telle, la classe est vue de façon statique, sans dynamique, comme simple classe-pour-le-capital incapable de se mouvoir hors de cette sphère.
Les mouvements partiels, immédiats, revendicatifs, ces métaphysiciens les appréhendent, non du point de vue révolutionnaire inhérent à la nature de la classe (ce qu'elle sera contrainte de devenir), mais comme autant d'entités statiques. Ils ne les voient pas comme moments, modes d'existence que l'être dépasse, mais ils les identifient à la classe, qui est ainsi figée dans un état dont seule une intervention extérieure pourrait la sortir. D'où la nécessité d'introduire de façon volontariste et manœuvrières le "coup de pouce" qui imprimerait une dynamique à cet être sans mouvement interne. Puisqu'il n'y a pas de nécessité inhérente à la classe qui la force à nier tour à tour ses différents états comme autant de moments indispensables, mais intenables, il faudrait une puissance externe, arbitraire. La vision des trotskystes c'est : entre une classe-pour-le-capital et une classe révolutionnaire, un parti extérieur. C'est pourquoi ils ne peuvent dire que deux choses aux ouvriers : 1500 F pour tous et construisons le parti.
Une deuxième erreur découle de la première. Puisque la classe n’est pas le sujet qui fait le lien entre sa propre pratique immédiate et son action révolutionnaire, elle n'est donc pas contrainte de nier brutalement et de façon révolutionnaire ses premières tentatives de lutter de façon purement revendicative. Grâce à la médiation parti-programme transitoire, le mouvement devient évolutif. Graduellement, de revendication en "acquis", à travers les ponts qui "font le lien" entre son être passé et futur, la classe se trouverait insensiblement amenée à la révolution. Il n'y a pas de saut qualitatif, de NEGATION ; le passage de la lutte revendicative à la lutte révolutionnaire n'est plus un combat radical qui, sous la contrainte de la crise, force la classe à se transformer, mais un procès évolutif, pacifique, purement quantitatif .
Pour eux, la classe ne forge pas sa propre conscience à travers une lutte douloureuse contre son propre conservatisme, elle est "amenée" à une conscience qui existerait en dehors d'elle.
AINSI, IIS NIENT A LA FOIS CE QUI FAIT L’UNITE DU MOUVEMENT, SA CONTINUITE : L’ÊTRE REVOLUTIONNAIRE DE LA CLASSE, ET CE QUI CONSTITUE, A L’INTERIEUR DE CE MOUVEMENT, LE SAUT, LA NEGATION, LA RUPTURE.
Pour comprendre comment la pratique de la classe forge elle-même le lien entre luttes revendicatives et révolution, il faut d'abord concevoir que ce lien n'est pas évolutif et graduel, mais négatif et brutal. Il n’y a pas d'"acquis"' révolutionnaires dans la société capitaliste. Il n'y a pas de petits embryons de révolution dans chaque lutte, qui grandiraient, fusionneraient jusqu'au moment où la classe serait assez puissante pour faire la révolution. De même que la classe révolutionnaire est la négation en mouvement de la classe-pour-le-capital, de même la lutte révolutionnaire est la négation de la lutte revendicative. Les luttes revendicatives ne deviennent pas révolutionnaires ; c'est la classe qui, en dépassant et en niant sa lutte immédiate, devient révolutionnaire. Il y a un lien entre ces deux mouvements contradictoires. Et ce lien est précisément l'être de la classe,
Il ne s'agit donc pas de pousser "plus loin" la lutte revendicative, comme se l'imaginent les volontaristes et les syndicalistes, en faisant de la surenchère, car d'abord, la lutte revendicative n'est pas provoquée artificiellement, ensuite, elle ne peut se gonfler à l'infini, enfin, elle ne prend son sens que comme prélude à autre chose. Il faut précisément comprendre que c’est la contrainte de nier cette lutte qui constitue le mouvement qui va "plus loin".
Négation, bouleversement par le prolétariat de son propre être et de sa propre conscience, désintégration des divisions, catégories, embrigadements et clivages de la classe-pour-le-capital, réorientation complète de la façon dont les ouvriers voient le monde et agissent les uns à l'égard des autres, voilà le mouvement qui mûrit dans l'accumulation des défaites, des revers, de l'impossibilité de se défendre comme une catégorie à l'intérieur du système.
"Mais alors, si c'est la classe qui forme le lien, que faisons-nous ?" demandent avec horreur syndicalistes et gauchistes, reconnaissant ainsi avec franchise qu'ils ne sont pas une fraction de la classe, mais une secte qui se pose comme extérieure au mouvement.
À partir du moment où on est une fraction du prolétariat, on ne voit pas sa tâche comme étant de "représenter" le lien entre luttes revendicatives et action révolutionnaire. On se considère comme une partie du mouvement qui fera le saut. C'est la vie de la classe qui produira les conditions de ce passage. Notre tâche, en tant que fraction avancée de CE mouvement, du processus qui se meut vers ce passage, est de défendre la nécessité de la négation des luttes actuelles, de leur dépassement. Ce faisant, nous ne pensons pas créer le lien entre aujourd'hui et demain, ni provoquer le saut, mais nous agissons pour que ce passage inévitable se fasse dans le maximum de clarté et de conscience. C'est-à-dire que nous contribuons à ce que le mouvement accède plus vite, mieux et de façon plus explicite à la conscience de soi.
Nous ne sommes qu'un moment de la conscience que la classe se forge, et notre tâche est d'exprimer (et donc d'accélérer et de généraliser) cette conscience de la pratique révolutionnaire de la classe, de son être historique. Nous participons ainsi, en jouant un rôle spécifique, à cette dynamique qui tend à faire de la classe prolétarienne un sujet.
La classe tend, dès maintenant, à devenir le sujet de sa propre transformation. Cela, elle l'accomplit en découvrant pratiquement son impuissance à survivre comme simple classe-pour-le-capital, simple travail salarié. Elle l'accomplit en épuisant, avec obstination, toutes les solutions qui lui permettent d'éviter de remettre en cause son inertie conservatrice. Les flux et reflux ne sont que des moments de cette œuvre longue et titanesque qui dégage les conditions où il ne sera plus possible de lutter autrement que comme classe-pour-soi contre le capital et son État.
Les communistes ne client pas 1500 F et grève "dure", quand les syndicats crient 1200 F et grève "molle". Les communistes ne couvrent pas les luttes immédiates de louanges hypocrites et lénifiantes, mais, au contraire, expriment et stimulent l'insatisfaction de la classe, sa tendance à devoir dépasser sa condition actuelle. Ils ne tentent pas à tout prix de déclencher des luttes artificielles, mais comprennent les moments de passivité comme des phases indispensables de maturation souterraine, de réflexion, d'assimilation des expériences. Ils comprennent les revers temporaires comme le moteur de la prise de conscience révolutionnaire des ouvriers.
Ils sont présents, dans la mesure du possible, dans les luttes, aussi petites soient-elles et ils y déploient autant d'énergie et d'imagination que les autres travailleurs combatifs, ne serait-ce que parce qu'ils subissent la même exploitation et ressentent la même révolte contre la vie actuelle. Mais ce qui les distingue, c'est qu'ils proclament ouvertement, à contre-courant lorsque les autres prolétaires refusent encore de le reconnaître, que l'approfondissement de la crise et les revers actuels sont la condition de la révolution, en ce qu'ils permettent l'expérience pratique de l'impossibilité, à notre époque, pour le prolétariat de se défendre comme simple travail salarié, à 'intérieur de la société capitaliste .
Il n'y a pas d'issue dans le système. Voilà la vérité simple que doit marteler la minorité révolutionnaire. Et c'est le mouvement de la classe tout entière qui transformera, à travers les flux et reflux, cette expression théorique de son expérience en une pratique concrète et une conscience généralisée .
Hembe
[1] Le rapport Donovan sur les relations industrielles (1966) partage l'enthousiasme des gauchistes sur les délégués d'atelier. Ce rapport, véritable manuel pour capitalistes intelligents, les qualifie de "lubrifiant indispensable pour la bonne marche de la production", précisément parce qu'ils sont "démocratiques" et "près de la base".
[2] (&) International Socialism a été jusqu'à défendre le travail aux pièces comme "moindre mal".
[3] Ce n'est bien sûr qu'une illusion. Dès que les choses devenaient sérieuses, les shop- stewards se montraient pour ce qu'ils étaient (1914-1918, 1920-1926, 1939-1945, etc.).
Vie du CCI:
- Débat [1]
Courants politiques:
Questions théoriques:
- Aliénation [3]
Rubrique:
MISERE DE L’INVARIANCE
- 70 reads
Cet article a été écrit en janvier dernier à l’occasion de réactions du PCI face à la guerre du Kippour.
Pendant longtemps la gauche italienne a constitué l’une des rares tendances qui a lutté avec acharnement pour préserver certains acquis du marxisme révolutionnaire face aux trotskystes et anarchistes de tout poil. Alors que la gauche allemande se dissolvait en divers courants confus, la gauche italienne des années trente, groupée autour de la revue "BILAN", tirait les leçons de la vague révolutionnaire de l9l7-2l et du processus contre-révolutionnaire : condamnation de toute espèce de frontisme, non-défense de l’URSS, dénonciation du caractère contre-révolutionnaire des luttes de libération nationale.
Nous reviendrons un jour sur la véritable histoire de la gauche. Disons simplement ici que depuis l943, date de sa fondation, le prétendu "PARTI COMMUNISTE INTERNATIONALISTE", créé en pleine période de contre-révolution[l], n’a cessé de dégénérer et d’abandonner les positions de classe que le courant dont il se réclamait défendait dans les années 30.
L’une des preuves les plus flagrantes de cette dégénérescence se trouve dans son soutien aux luttes de libération nationale, biais par lequel il rejoint le cloaque nauséabond où s’agitent les trotskystes et autres maoïstes. Nous verrons plus loin que cette position est sous-tendue par la fumeuse théorie de l’"Invariance du marxisme" de l847 à nos jours et le refus de reconnaitre la crise historique mondiale du capitalisme, ce qui les amène à déclarer que le capitalisme est encore "révolutionnaire dans certaines aires géo-historiques". Nous verrons ainsi que le mythe de l’invariance n’est pas seulement une farce idéologique, mais qu’il conduit à des positions contre-révolutionnaires.
LE PCI ET LA GUERRE DU KIPPOUR
Nous accordons bien volontiers à "Programme Communiste" (n°6l) que la question nationale "permet de vérifier si l’on sait assimiler la méthode matérialiste et la théorie révolutionnaire". C’est l’objet de cet article. Après la fin de la guerre du Kippour, le PCI a rappelé sa position théorique sur les luttes nationales et "les droits des peuples"; ou plutôt, il a ressorti un texte de l953 ("Les révolutions multiples") accompagné d’un extrait de la critique de Lénine à la brochure de Rosa Luxembourg ("La crise de la Social-Démocratie"). ("Le Prolétaire", n° l64.)
On aurait pu espérer qu’avec la guerre du Moyen-Orient certains éléments du PCI commencent à douter de l’analyse des guerres de libération nationale que leur "parti" s’obstine à "répéter".
Jamais, en effet, un conflit n’aura montré avec une telle évidence le caractère contre-révolutionnaire et inter-impérialiste de ces guerres. C’est au nom de la délivrance des territoires occupés, de la "défense de la patrie" que les bourgeoisies du Moyen-Orient ont assassiné des milliers de prolétaires juif et arabes. Jamais les petites nations ou "nationalités" n’auront autant servi de pions sur l’échiquier mondial où s’affrontent USA et URSS, à la recherche de nouvelles positions • Les rivalités nationales des petits pays sont apparus sous leur vrai jour : des moments du conflit inter-impérialiste que se livrent les grands impérialismes. Quant aux ouvriers et paysans palestiniens, la "cause sacrée" de cette guerre, ils avaient eu l’intelligence qui fait défaut au génial "parti historique" auto-proclamé de ne pas participer à cette guerre où ils ne pouvaient que servir de chair à canon (à l’exception de quelques fedayin téléguidés par les Etats arabes). Gageons que la constitution d’un Etat palestinien au Moyen Orient permettra au capitalisme mondial de mieux fractionner le prolétariat de cette région de mieux museler le prolétariat palestinien déjà faible.
Mais "Le Prolétaire" (n° l60) n’a voulu voir dans cette guerre qu’une "farce sanglante", une comedia dell’arte où "russes et américains ont fait semblant d’être prêts à en venir aux mains". Le PCI ne semble avoir trouvé dans ce conflit qui décimait les rangs du prolétariat que l’occasion de tremper sa plume dans l’encrier du moralisme le plus plat : "le nième conflit du Moyen-Orient passera à la postérité comme un moment de cynisme bourgeois… cynisme de l’Egypte… cynisme d’Israël… cynisme de différents Etats arabes… cynisme des Etats Européens… cynisme des super-grands…", "C’est le triomphe des Metternich modernes, l’âge d’or de la nouvelle Sainte-Alliance à deux (Kossyguine et Kissinger)."
Admirons le grand art avec lequel le PCI évite de prendre une position de classe.
Mais au moins, se dira le naïf lecteur du "Prolétaire", ils vont reconnaitre que les seules victimes de cette guerre, ce sont les prolétaires. Même pas ! "Quand la nouvelle guerre a éclaté entre arabes et israéliens, nous avons écrit -ce n’était pas un pronostic difficile pour des marxistes (sic)- que les véritables victimes (souligné par le "Prolétaire") en seraient les feddayin. " (NB, les "fedayin" même pas les travailleurs palestiniens !)
Toutes ces pitreries et jongleries de petits littérateurs n’arrivent pas à dissimuler une profonde indifférence à l’égard du prolétariat de ces pays, un extraordinaire "indifférentisme", pour reprendre l’expression chère au PCI. Leur solidarité ne va pas aux Palestiniens (encore que le terme ne veuille rien dire en bon vieux langage marxiste), pas plus aux ouvriers arabes et juifs tués ou mutilés à vie : non, ils versent des larmes sur les membres d’un organe militaire bourgeois milice du capital palestinien naissant : les commandos de fedayin. On ne peut plus nettement choisir son camp.
Poursuivant ce brillant exercice de style, dans le même numéro, "Le Prolétaire" affirme que les USA et l’URSS sont intervenus pour défendre leur "condominium sur la terre entière" De deux choses l’une : ou bien "Le Prolétaire" a "oublié" ses critiques de la théorie de l’ultra-impérialisme de Kautsky, ou bien tout ceci n’est que poudre aux yeux pour éviter de prendre position.
Derrière les clichés journalistiques du "Prolétaire», il y a la volonté de ne pas prendre une position sans ambigüité. Lénine, le Lénine révolutionnaire de l9l4, dont fait semblant de se revendiquer "le Prolétaire", n’hésitait pas à appeler à la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile et à féliciter -en totale contradiction avec ses positions sur la question nationale- les socialistes serbes d’avoir refusé de défendre la "patrie nationale serbe" naissante. Il fustigeait tous les centristes qui refusaient de mettre en avant le programme révolutionnaire de la classe, tout en tenant de vagues propos internationalistes. Lénine a su alors montrer que la révolution (en l4 comme aujourd’hui) ne tolère pas les demi-positions.
Même si cette position est théorique, sans effet immédiat -et c’est toujours le cas en dehors des périodes révolutionnaires- une telle position de PRINCIPE à l’effet PRATIQUE de constituer une frontière de classe entre les éléments prolétariens et les éléments bourgeois.
Cette absence de position prolétarienne, ou plutôt cette volonté marquée de faire alliance avec la bourgeoisie palestinienne range une fois de plus le PCI dans le parti des gauchistes, souteneurs "critiques" professionnels.
Les épigones de la gauche italienne, regroupés dans le PCI feraient bien de méditer ce qu’écrivait le courant dont ils se réclament sur les "luttes de libération nationales" :
- "Les soubresauts nationalistes, les gestes terroristes de représentants des nationalités opprimées expriment aujourd’hui l’impuissance du "prolétariat et l’approche de la guerre. Il serait faux de voir dans ces mouvements un apport à la révolution prolétarienne, car ils ne peuvent s’épanouir qu’à la faveur de l’écrasement des ouvriers et donc en connexion avec les mouvements d’impérialismes opposés". "BILA.N" (n°l4).
OU MENE L'INVARIANCE
Le PCI se croit encore, pour certaines aires géo-historiques, en l848. Il reprend à la lettre déformée la nécessité de soutenir certaines « révolutions démocratiques bourgeoises". Comme le disait Lénine contre Kautsky, l’une des méthodes les plus sournoises de l’opportunisme consiste à, répéter une position valable dans le passé sans tenir compte du changement de période. Ici, c’est de la même chose qu’il s’agit : on fait croire au lecteur que la Palestine de l973, c’est l’Allemagne de l848.
Cette conception parfaitement idéaliste de l’Invariance qui efface les différences de périodes historiques, entraine plusieurs conséquences :
- on affirme que, dans certaines aires, le capitalisme demeure révolutionnaire, alors que dans d’autres il serait sénile. Ce faisant, on nie son caractère mondial depuis le début du siècle.
- il s’ensuit que, toujours dans ces mêmes aires, la révolution bourgeoise est à l’ordre du jour (ou la "révolution double" si le prolétariat peut en prendre la tête). D’où le soutien aux "révoltes des peuples de couleur (?), et le dépit très amusant de nos invariants de ne pas voir surgir des "jacobins" sans-culotte de ces « révolutions".
- on abandonne ainsi le terrain de classe du prolétariat MONDIAL et on nie l’antagonisme fondamental et irréconciliable qui oppose au cours de la décadence du mode de production capitaliste, les deux seules classes décisives de la société : bourgeoisie et prolétariat.
l) Caractère révolutionnaire des luttes de libération nationale?
Les conséquences contre-révolutionnaires de la théorie de l’Invariance apparaissent très nettement dans le numéro l64 du "Prolétaire" cité plus haut même s’il affirme d’un côté, que le capitalisme est "réactionnaire depuis l848", il déclare qu’il faut soutenir son développement dans tout pays arriéré. Ceci tant pour la "formation de nouvelles aires où seront à l’ordre du jour les revendications socialistes" que par "les coups que ces insurrections et ces révoltes portent à l’impérialisme euro-américain". (nous soulignons)
Voilà qui devrait réjouir les tiers-mondistes en tout genre à la recherche de révoltes paysannes. Pour le PCI il ne semble exister qu’un impérialisme : "l’euro-américain", ce qui nie les rivalités inter-impérialistes entre chacune des nations européennes et américaine et oublie dans les faits l’existence d’un impérialisme russe ou chinois. ("L’anti-impérialisme" du PCI est ici à sens unique !). L’affaiblissement d’un impérialisme ne peut qu’entrainer, à une époque où l’impérialisme est devenu un système mondial, le renforcement d’un impérialisme rival ne serait-ce que par la vente fructueuse d’armement qui entraine d’ailleurs la dépendance du pays révolté à l’égard de l’impérialisme "ami". Fondamentalement l’impérialisme mondial ne peut être affaibli, il ne peut être que détruit par le prolétariat mondial.
Quant à l’idée de soutenir la "formation de nouvelles aires où seront à l’ordre du jour des revendications socialistes" elle nous laisse rêveurs. Après le socialisme en un seul pays, voici le "socialisme dans une seule aire" (et de surcroît dans une aire arriérée !). Depuis quand les "revendications (!) socialistes" se posent-elles donc au niveau d’aires géographiques ?
Logique avec sa position, le PCI peut alors se permettre les déclarations les plus incroyables qui feraient frémir même un Trotsky des années 30 :
- "Les révolutions multiples contiennent l’affirmation la plus vigoureuse de la valeur révolutionnaire, même d’un "Bloc des Quatre Classes" en Chine et même du stalinisme en "Russie. C’est là le courage (sic) de la vraie Gauche Communiste…"
Si la révolution bourgeoise est encore progressiste il faut la soutenir.
Voilà ce qu’implique cette stupéfiante déclaration. Si chaque aire doit parcourir le même cycle que l’aire euro-américaine, alors, il faut adopter dans chaque pays concerné l’attitude du mouvement ouvrier au siècle dernier : soutenir ce qu’il y a de révolutionnaire dans la bourgeoisie.
En fait, à la base de la conception du "Prolétaire" il y a l’idée que le développement des forces productives à l’échelle nationale reste progressiste.
Ce faisant, il nie qu’il y ait une coupure entre la période d’avant et d’après la constitution du marché mondial. Pour le PCI la nation n’est pas un héritage barbare et décadent qui s’oppose au seul progrès historique désormais à l’ordre du jour, le développement MONDIAL des forces productives -elle est un cadre adéquat, "révolutionnaire" pour le développement des forces productives. Suivant une telle logique, le PCI aurait dû soutenir le capital russe progressif pendant les deux guerres mondiales impérialistes. Quand on se rappelle le VRAI courage de la gauche italienne en l9l4-l8 et en l939-45, on voit comment nos "invariants" renient le meilleur de l’esprit de leurs prédécesseurs.
Depuis l9l4 le conflit mondial inter-impérialiste a montré que le marché mondial est constitué, le problème n’est plus d’aider le capitalisme à se développer, mais de l’abattre définitivement.
C’est cette vision de changement de période qu’avait le Premier Congrès de l’I.C. lorsqu’il affirmait qu’on était entré dans une ère de guerres, de crises et de révolutions.
L’alternative était désormais : Socialisme ou barbarie.
Désormais, le rétrécissement des marchés extérieurs par rapport aux nécessités croissantes de réalisation de la plus-value entraine des rivalités, des conflits incessants entre puissances impérialistes. Désormais, l’impérialisme est un système mondial qui s’impose à tous les Etats nationaux. Dans un marché mondial pressuré par le capital, chaque nation est obligée d’être impérialiste par rapport aux autres nations pour survivre : le dernier exemple de cela, c’est le conflit entre le Sud-Viet-Nam et la Chine pour la possession des îles Paracels où l’on espère trouver du pétrole. Derrière chaque guerre, entre grands, entre petits se profile l’antagonisme entre les forces productives mondiales et le capitalisme forcément national. Toute vision qui reste enfermée dans le cadre national est incapable de comprendre la nature du capitalisme actuel.
Or justement, pour le PCI(tout comme pour les trotskystes) le capital n’existe pas vraiment comme système mondial et chaque nation poursuit son propre cours comme un atome indépendant dont on pourrait déterminer isolément la juvénilité ou la sénilité. A qui fera-t-on croire que ce bidonville qu’est l’inde est ''juvénile" par opposition aux USA "séniles" ?
Le PCI prétend aussi que les luttes "révolutionnaires nationales" permettent un développement des forces productives dans les pays où elles ont lieu. C’est vrai. Mais il n’en découle pas que ces luttes soient pour autant révolutionnaires.
Faisons d’abord remarquer que les pays ou se sont déroulées de prétendues "révolutions démocratiques bourgeoises" ne se développent que par le secteur lourd de l’armement (Chine), ou croupissent dans leur misère paysanne (Cuba et son économie sucrière). Si le PCI était logique il devrait soutenir également les pays totalement dépendants de l’impérialisme USA comme le Brésil ou la Corée du Sud où les taux de croissance atteignent 20%. Ou pourquoi ne soutient-il pas le capital Français ou Italien qui ont prolétarisé des millions de paysans depuis l945 ?
Aucun système et encore moins le capitalisme, ne vit sans permettre d’une façon ou d’une autre un certain développement des forces productives. Ceci est évident pour sa phase historique ascendante, mais se vérifie aussi au cours de sa décadence. C’est seulement au cours des grandes crises ouvertes qu’il se produit de véritables BLOCAGES de ce développement. Ce qui change radicalement d’une période à une autre, ce qui rend un système historiquement sénile, ce n’est pas une impossible stagnation permanente du développement des forces productives, mais le bouleversement définitif de la relation qui lie l’ensemble des rapports de production qui le constituent avec le processus de développement des forces productives. Tant que ces rapports de production sont LES SEULS COMPATIBLES avec le degré de développement des forces productives, le système vit sa phase ascendante. La décadence, la mise à l’ordre du jour de l’avènement d’une société nouvelle, commence avec la transformation de ces rapports en FREINS, ENTRAVES à la croissance des forces productives.
Attribuer un caractère progressiste au capitalisme dans telle ou telle région parce qu’il y développe des forces productives est donc absurde, non seulement parce que le capital ne peut être jugé que d’un point de vue MONDIAL[2] mais aussi parce que EN LUI-MEME aucun développement ne possède une signification historique.
Le développement qu'on· pu connaitre les économies du Tiers Monde perd toute signification progressiste dans le cadre historique mondial au sein duquel il se déroule. Si le Tiers-Monde crève de quelque chose ce n’est pas du manque de nations souveraines mais bien de la subsistance des nations dans le monde. C’est l’incapacité de l’humanité à détruire le cadre national (ce cadre économique créé par le capital et dont deux guerres mondiales ont montré, dans la plus horrible barbarie, la définitive obsolescence) qui a engendré le Tiers Monde. C’est parce que le développement des forces productives est mondialement entravé depuis plus d’un demi-siècle dans les carcans nationaux que les "nations souveraines" du Tiers-Monde s’enfoncent toujours plus dans leur arriération.
"Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt", dit un proverbe chinois. Quand le cadre national plonge dans la misère la plus horrible les deux tiers de l’humanité, le PCI nous fait remarquer que dans tel coin du tiers-monde le "cadre national" a tout de même permis la construction de quelques usines et que c’est très important, etc., etc. Bref, c’est dans la partie du monde qui justement subit le plus cruellement l’absurdité des nations que les nationalismes seraient "progressistes" !
De deux choses l’une : ou bien l’on affirme comme l’IC en l9l9 que nous sommes entrés dans l’ère de la révolution prolétarienne et l’on ne peut soutenir les guerres nationales -ou bien on verse dans le sentimentalisme poujadiste des défenseurs des "petites" nations contre les ''grandes". C’est ce dernier choix que fait le PCI qui, s’en prenant aux révolutionnaires, affirme que le non-soutien aux luttes nationales est : "une vision idéaliste qui converge en fait, involontairement avec le social pacifisme et le social-chauvinisme, sinon dans le soutien de l’ordre établi, du moins dans le messianisme de grande nation qui condamne les peuples des colonies et des semi-colonies, à l’immobilité dans l’attente de la révolution prolétarienne dans les métropoles". ("Le Prolétaire" n°l64)
"Grande nation" , "petite nation", "peuples", voilà les piteux discours que tient la pure et dure invariance de l’opportunisme ! Seuls des petits bourgeois qui ne se sentent pas organiquement fraction d’une classe mondiale peuvent, à l’heure du massacre des prolétaires par le capital, nous servir de tels bavardages. Seuls des gens pénétrés d’égocentrisme, de culpabilité "nationale", d’identification à leur pays ou aire, peuvent sombrer dans ce mépris du prolétariat mondial.
2) Le PCI et le Chili
Si les révolutions démocratiques sont encore à l’ordre du jour à l’époque du capitalisme mondialement décadent, on comprend que le PCI se fasse le conseiller de la bourgeoisie "démocratique" du Tiers-monde, à qui il reproche d’être trop "girondine" et pas assez "jacobine". Nos Daniel Guérin bordiguistes en viennent à rêver d’une révolution sans-culotte :"Ni potences, ni guillotines, ni canons pour accompagner la marche rien moins que théorique de la bourgeoisie progressiste" (n° l58).
Le PCI en arrive à jouer le rôle du trotskiste Pablo conseillant Ben Bella en Algérie. Ainsi, ils écrivent : "Un gouvernement qui prétend faire œuvre révolutionnaire sans mettre hors la loi les partis incarnant le passé et le présent (parce que naturellement, Allende représente l’avenir –(NdR) qu’il faut révolutionner, prépare le terrain à sa propre destruction". (n° l58)
Le résultat, c’est qu’on laisse supposer qu’Allende, cet homme de la bourgeoisie, aurait pu révolutionner quelque chose. Comme si Allende n’était pas l’instrument d’une politique de la bourgeoisie, destinée à mettra au pas le prolétariat chilien, que la crise économique rendait de plus en plus remuant, par des "méthodes de gauche" ; comme si Allende n’avait pas constamment employé la violence de classe contre le prolétariat chilien et les ouvriers agricoles ; comme si les différences entre les méthodes de Pinochet et celles d’Allende cachaient autre chose qu’une inévitable continuité dans le but de classe : la défense du capital national face à l’étranger et aux classes exploitées.
Mais le clou de l’analyse du "Prolétaire" sur le Chili et les "Révolutions multiples", c’est l’accusation de "girondisme" lancée à Allende :
- "Un régime statistiquement (?) "Populaire (?) et même plébéien (? ?), mais organiquement incapable de faire preuve d’une audace sans culotte (!), un régime qui écarte la violence (et la répression anti-ouvrière ?) avec pour seul résultat de subir la violence, qui fuit les mesures despotiques pour capituler devant le despotisme, qui en n’attaquant pas s’interdit même de se défendre, qui vénère la loi et l’ordre et les retrouve devant lui sur la gueule des canons et des mitrailleuses, qui ne prêche la paix que pour récolter la guerre" ("Le Prolétaire", n° l58)
Les prolétaires chiliens n’ont plus qu’à supplier le PCI d’envoyer à ce qui reste de l’U.P. un audacieux Robespierre, muni des principes tactiques invariants.
Ces jacobins qui se piquent de marxisme, parlent de "régime" là où il y a dictature de la bourgeoisie, se gargarisent de "statistiques" et de "peuple", là où il y a des classes. Derrière tout cela, il y a en fait une admiration inavouée pour le "régime" "populaire" d’Allende, et en dernier lieu une apologie des fronts interclassistes. Toute l’histoire du mouvement révolutionnaire est là pour montrer que lorsque de pseudo marxistes commencent à parler de "peuple ", de "plèbe" ils sont inévitablement amenés à remplacer l’analyse de classe par le populisme le plus éhonté et se retrouvent nécessairement dans le camp de l’ennemi.
3) Abandon du terrain de classe
Dans la même lignée de l’invariance de l’opportunisme, se trouve la théorie des "peuples de couleur" propagée par les petits intellectuels bourgeois "blancs" pour soulager leur constipation de citoyens "riches" et par les intellectuels bourgeois "noirs" pour mystifier les ouvriers de la même couleur qu’eux. Démagogiquement, on substitue la guerre des races à la guerre des classes. On comprend que le PCI reproche aux révolutionnaires "le simplisme grossier de ceux qui réduisent toute lutte de classe au binôme, toujours et toujours répété de deux classes conventionnelles[3] qui seraient les seules à agir"
Eh bien, oui, nous nous réclamons de ce simplisme grossier sur l’arène mondiale où se joue le sort de la société humaine, il ne peut y avoir en fait que deux classes décisives en présence. Ce sont les deux classes "conventionnelles" de Marx : bourgeoisie et prolétariat.
Nous ne nions pas qu’il y en ait d’autres mais elles ne sont pas des SUJETS déterminants ; elles se rangent derrière la bourgeoisie ou sont neutralisées puis lentement intégrées au prolétariat.
Toute cette rhétorique sur les "binômes" et "conventions " ne peut avoir comme but que de mettre en valeur la petite bourgeoisie.
Le PCI a tout renié du passé révolutiorulaire de la gauche italienne qui l’avait amené à réviser les positions contre-révolutionnaires de Lénine sur la question nationale. Aujourd’hui, il réclame avec la meute des gauchistes des Allende "jacobins", se pâme devant l’embrigadement des jeunes chômeurs palestiniens dans l’appareil militaire du capital (fameux "fedayin"), aperçoit des couleurs là où il y a des classes et braille fièrement que Stalinisme et Bloc des Quatre Classes sont révolutionnaires. A l’heure où le capitalisme mondial, putréfié, craquant de toutes parts, n’a plus qu’une seule solution : des massacres sans cesse plus sanglants et la destruction de l’humanité, les petits écrivains du "Prolétaire" réclament des mouvements "audacieux", "despotiques" de "jacobins" et de "sans-culotte".
Voilà où mène l’incompréhension théorique de la période historique, incompréhension fondée sur une invariance mythique d •un programme intégral qui n’a jamais existé.
A force de répéter invariablement les mêmes erreurs, on devient intégralement contre-révolutionnaire.
Et, à force d’être con, on devient odieux.
Chardin.
[l] C’est de lui qu’est issu, après la scission de l952 le P.C.I., regroupé autour du "Prolétaire" et "Programa Communista"
[2] Il est, à notre époque aussi absurde de parler de "capitalisme progressiste" pour une nation ou même une région du monde que d’affirmer que le féodalisme était un système progressiste en l780 parce que dans telle ou telle baronnie du royaume de France les défrichements de terres et les techniques de production connaissaient encore quelques développements.
[3] Il faut se rendre compte (ainsi parle toujours l’opportunisme NDR) que, dans les pays d’Outre-mer, vivent d'immenses collectivités de race jaune, noire, olivâtre (sic), dont les peuples ( !) réveillés par le fracas du machinisme, semblent ouvrir le cycle d’une lutte patriotique (!) et d’indépendance et de libération nationale comr.le celle dont s’enivraient (sic) nos grands-parents…" (texte de l953, repris dans le "Prolétaire" N°l65).
Courants politiques:
Rubrique:
Sommes-nous sectaires ? Ce qui distingue les organisations révolutionnaires
- 20 reads
Au travers des différents articles de Révolution Internationale nous avons été maintes fois amenés à constater que, dans leur quasi-totalité, les groupes et partis qui se réclament actuellement de la révolution prolétarienne, des staliniens aux anarchistes, en passant par toutes les gammes de "socialistes", "tiers-mondistes" et divers "trotskysmes" n’ont rien de révolutionnaires.
Cette affirmation provoque souvent, nous le savons, toute une série d’accusations du style : "sectarisme", "puritanisme révolutionnaire", "isolement volontaire par rapport aux masses", etc.
Voici donc quelques rappels pour ces "révolutionnaires" de bonne volonté non-sectaires", que d’étranges soucis de "réalisme" semblent troubler au point de leur interdire toute compréhension de ce qu’est un principe révolutionnaire ou une organisation prolétarienne
Avant de parler de ce qu’est le "sectarisme", de ce que recèle l’accusation de "puriste" chez celui qui s’en sert, ou du sens de l’expression "se couper des masses", voyons les critères que l’histoire du mouvement ouvrier a permis de dégager pour définir une organisation de révolutionnaires[1]. Et en premier lieu, les critères qui se sont révélés ne peut pas en être.
Les faux critères
La composition sociale
En apparence, il semble logique de dire qu’une organisation politique dont la majorité des membres est constituée par des ouvriers est une "organisation ouvrière". L’histoire a cependant violemment démenti ce syllogisme superficiel.
Un des exemples les plus frappants est probablement celui du parti social-démocrate allemand. Ce parti, dont la fondation est liée à Marx et Engels, qui regroupa le plus d’ouvriers de l’histoire, ce parti qui constitua un authentique parti ouvrier passant définitivement dans le camp du capital, avec armes et bagages, au cours de la première guerre mondiale. C’est lui qui, à la fin de la guerre, se chargea de l’écrasement de l’insurrection prolétarienne de 1918-1919.
C’est l’ouvrier Noske qui dirigea personnellement les corps francs. C’est le gouvernement social-démocrate "ouvrier" d’Ebert qui assassina Rosa Luxembourg et Liebknecht.
Personne n’oserait affirmer que le parti des Ebert, Noske, Scheidemann continuait alors d’être un parti ouvrier. Et, pourtant, sa base demeurait encore essentiellement ouvrière. Qui plus est, il disposait d’une écrasante majorité au sein des conseils ouvriers à la veille de l’insurrection.
Parmi d’autres, citons un exemple tout aussi important et inéquivoque : celui du Parti menchevik en Russie en 1917. Il est connu que le parti de Tseretelli et Tchkeidze possédait une base ouvrière très importante pendant la période révolutionnaire qui aboutit à Octobre. Au début du mouvement son influence en milieu ouvrier était même plus importante que celle des mencheviks. C’est pourtant contre lui et le gouvernement dont il était un des principaux piliers que l’insurrection prolétarienne d’Octobre dut se faire.
Que l’on réalise simplement que presque toutes les insurrections prolétariennes de ce siècle ont été écrasées ouvertement ou détournées dans une impasse par des gouvernements de "gauche" et des partis "à large base ouvrière" (et, en premier lieu par les PC), et l’on comprendra à quel point ce critère de la "composition ouvrière" d’un parti est devenu totalement inopérant à notre époque, alors qu’il pouvait posséder une certaine validité lors des premiers pas du mouvement ouvrier, au XIXe siècle.
Ce raisonnement paraît insuffisant à certains experts "ès dialectiques". Pour ceux-ci, le fait d’avoir participé à l’écrasement d’une insurrection ouvrière ne suffit pas à prouver qu’on ne peut plus être une organisation prolétarienne. C’est ce que soutiennent tous les partisans de la métaphysique dite "de la double nature de classe" des organisations réformistes. L’explication du miracle de la transformation des organisations de la contre-révolution permanente en organes du prolétariat et "vice versa", sinusoïdalement en quelque sorte, est la suivant : en temps de calme social, des organisation réformistes défendraient tant bien que mal les intérêts immédiats de la classe. Mais, étant incapables d’en défendre les intérêts historiques globaux, du fait de l’essence même de leur rôle , en temps de lutte ouverte de la classe elles passeraient objectivement dans le camp des défenseurs du système. Puis le calme revenu, elles reprendraient leur place dans les rangs du prolétariat, et on recommencerait, etc....[2]
Cette vision conduit, dans la pratique concrète, ses auteurs à adopter une attitude de défense des organisations réformistes en temps d’apathie de la classe (bien sûr défense critique) et en période d’effervescence sociale à des cris d’indignation "surprise", des dénonciations de "trahison", bref des larmes de crocodile. Mais dans les deux cas sa fonction contre-révolutionnaire est la même : masquer aux yeux des travailleurs la nature des organisations dites réformistes: des organes de la bourgeoisie au sein du prolétariat.
Deux aberrations théoriques principales sous-tendent ce pragmatisme réactionnaire :
1) L’affirmation de la possibilité d’existence, dans une société déchirée en permanence par les antagonismes de classe, d’une organisation politique capable de représenter alternativement les intérêts des deux classes. Une telle idée est un non-sens du point de vue marxiste: un parti est toujours une fraction et une expression politique d’une classe sociale et d’une seule. Il arrive qu’un parti ou groupe politique change de nature de classe, mais,
- cette transformation, quand elle a lieu, se produit toujours en faveur de la classe dominante; on n’a jamais vu, et on ne verra jamais une organisation politique de la bourgeoisie devenir un organe du prolétariat. En effet, à l’époque de la décadence la classe ouvrière ne peut plus s’organiser de façon permanente à l’intérieur de la société capitaliste, et toutes ses organisations antérieures doivent, pour survivre, fonctionner au service du capital (de même que celles qui se créent sans dépasser les anciennes conceptions réformistes). Une fois qu’elles s’installent dans cette fonction, elles défendent bec et ongles leur existence et donc la conservation de l’ordre social dont elles se nourrissent.
- Une organisation politique ne "trahit" pas deux fois. La deuxième fois, ce n’est plus une trahison mais la continuation d’une politique déjà déterminée une fois pour toutes, non par tel ou tel chef, bureaucrate ou "mauvaise direction", mais par son intégration au capitalisme. Les chemins qui traversent les frontières de classe sont à sens unique et sans possibilité de retour.
L’opportunisme n’est pas un label d’appartenance à deux classes, mais la manifestation non équivoque d’une nature de classe : celle de la classe dominante. Parler de "trahison" quand les syndicats, les PC ou les partis socialistes sont systématiquement passés, dans toutes les luttes sérieuses, du côté du capital, c’est écrire un roman d’espionnage, pas une analyse marxiste.
2) L’affirmation qu’une organisation du prolétariat peut être réformiste dans la période de décadence du capitalisme est la seconde aberration. Avec la fin de l’ère progressive du capitalisme, avec l’entrée de celui-ci en crise permanente, la mise à l’ordre du jour de la révolution socialiste a rejeté dans le camp de la contre-révolution tous les programmes réformistes.
Dans le capitalisme sénile, le réformisme n’est pas réactionnaire seulement dans les moments où la classe se lance dans des luttes révolutionnaires, il est devenu en permanence l’arme principale de la bourgeoisie dans le camp du prolétariat. Il n’y a pas plus de terrain de conciliation économique réel entre prolétariat et bourgeoisie que de place pour les réformistes dans les rangs du prolétariat, autrement que pour embrigader la classe dans les intérêts du capital.
Les ouvriers ne peuvent plus trouver dans les organisations réformistes que le reflet de leur apathie, jamais celui de leur combativité, car les travailleurs sont, aujourd’hui, inévitablement contraints, pour s’affirmer comme classe, d’emprunter la voie révolutionnaire et donc de s’affronter aux organisations réformistes.
Par "temps calme", l’importance relative des organisations réformistes en milieu ouvrier est le résultat, non pas de leur prétendue nature de classe prolétarienne, mais, au contraire, de l’atomisation et de la non-combativité de la classe.
En présentant la défense des individus ouvriers contre quelques empiétements trop grossiers du capital (défense institutionnalisée et nécessaire au système) comme synonyme de défense des intérêts de la classe ouvrière, en jouant leur rôle d’assistante sociale, ces organisations cherchent à se faire décerner un label prolétarien. Ce faisant, elles ne défendent même pas les intérêts immédiats de la classe, mais se donnent par contre la crédibilité nécessaire pour avoir un minimum d’efficacité dans l’encadrement, et la répression au moment des luttes véritables, de la classe ouvrière.
Le soi-disant mouvement de va-et-vient entre les classes qui semble animer les organisations réformistes recouvre en fait les deux moments d’un même, rôle au service d’une seule classe : préparation de la répression, exercice de la répression. La défense de ces organisations, leur assimilation au mouvement ouvrier dans les périodes où elles ne le répriment pas ouvertement n’est ainsi qu’une participation effective à la préparation des futures repressions. "Critique" ou non, l’appui aux forces contrerévolutionnaires participe entièrement du rôle de celles-ci.
Toujours en quête des "masses" les gauchistes, et spécialement les léninistes, éprouvent une sincère admiration pour la capacité des organisations réformistes à "s’implanter en milieu ouvrier". Ils voient dans cette capacité une preuve de l’authenticité de classe d’une organisation. Quant à nous, nous affirmons que l’existence de masses ouvrières dans une organisation n’est plus depuis longtemps une preuve de sa nature de classe prolétarienne ; le capitalisme décadent ne peut plus vivre sans ses propres organisations ouvrières ; ses besoins de contrôle totalitaire le lui imposent. Le fait qu’une organisation bourgeoise possède une influence en milieu ouvrier n’a jamais poussé les révolutionnaires à la "ménager" ou à la défendre "par principe" ou solidarité. Au contraire, les forces les plus dangereuses de la contre-révolution sont celles qui parviennent à s’infiltrer dans les rangs de la classe révolutionnaire. Leur dénonciation, la destruction des illusions qu’elles entretiennent dans la classe sont, pour les révolutionnaires, des tâches d’autant plus importantes qu’ils sont les seuls à pouvoir les accomplir.
la violence
Une organisation révolutionnaire prolétarienne est obligatoirement amenée à préconiser la violence de sa classe contre le système et ses représentants. Elle est, tout aussi inévitablement, appelée à connaître la violence de la régression de la classe dominante. De là à déduire que toute organisation politique qui se dit socialiste -ou quelque chose dans le genre- et préconise ou subit la violence est une organisation révolutionnaire, il n’y a qu’un pas. Ceux qui le franchissent partent, la plupart du temps, de deux erreurs :
-l’ignorance totale des critères révolutionnaires. Incapables du moindre approfondissement théorique du point de vue prolétarien, les adeptes de ce type de raisonnement sont contraints aux "analyses" superficielles où l’apparence, le spectacle, tiennent lieu de réalité. "Ils sont violents, ils sont donc radicaux, donc révolutionnaires"; ou bien : "ils sont poursuivis par le gouvernement, le gouvernement est bourgeois, ils sont donc anti-capitalistes".
-la mauvaise conscience de l’impuissance. Face à l’apathie des travailleurs, ou face à sa propre impuissance, l’impatience se transforme en admiration sans bornes pour "ceux qui, au moins, font quelque chose" : détourner n’importe quel moyen de transport faire un hold-up, piller un magasin, mettre une bombe, kidnapper un bourgeois ou être violemment poursuivi par le gouvernement bourgeois en place, sont des actes qui, par eux-mêmes, octroient à la première organisation qui ne se dise pas ouvertement bourgeoise, un label de révolutionnaire. Plus grande est la sensation d’impuissance, plus s’exaspère l’impatience, et plus on réduit le contenu de l’action révolutionnaire à la violence pure et simple.
- En milieu étudiant cette absurdité atteint un tel degré, que le seul dessin d’une arme empoignée est compris comme symbole révolutionnaire ! Réaction impuissante mais "sincère" de la part d’éléments authentiquement révoltés par l’abjection du capitalisme décadent ? Peut-être[3]. Il n’en demeure pas moins que son seul aboutissement est la complicité avec n’importe quelle fraction de la bourgeoisie qui, s’affublant de l’épithète de socialiste pour parvenir à ses fins, prend les armes contre ses concurrents politiques -ou simplement subit la répression de ces derniers.
La violence préconisée ou subie ne peut en aucun cas constituer un critère suffisant (ni même important) pour juger de la nature de classe d’une organisation politique. Dans une société fondée sur l’exploitation, tous les rapports humains tendent à être des rapports de force. Dans la civilisation du capital qui connaît la traite des noirs dès sa naissance, s’épanouit dans le plus sanguinaire des impérialismes et vieillit dans les holocaustes des guerres mondiales, cette tendance atteint son paroxysme. Mais cette violence omniprésente ne régit pas seulement les rapports entre les classes antagonistes ; elle caractérise aussi l’essence même des rapports entre fractions de la classe dominante. Quand les moyens "pacifiques", "démocratiques" ne suffisent plus, les fractions de la bourgeoisie sont contraintes de recourir aux moyens de la violence armée (ceci est d’autant plus fréquent que les butins qu’elles ont à se partager s’amenuisent -crises et difficultés économiques). Ainsi, les pays capitalistes les plus pauvres sont les plus secoués par ce type de conflits dans lesquels, par ailleurs, les puissances impérialistes trouvent un moyen de s’affronter à peu de frais.
Sentimentalement, les victimes de l’État tendent souvent à bénéficier -a priori- d’une certaine sympathie de la part des exploités. A fortiori si elles sont présentées comme révolutionnaires. Mais rien n’est plus abject que l’utilisation de la haine de la répression du capital comme "couverture prolétarienne" pour les contre-révolutionnaires qui sont en conflit avec la clique de leurs confrères qui se trouve au pouvoir. C’est à travers ce genre de méthodes que les fractions de la bourgeoisie parviennent à recruter la chair à canon de leurs conflits. Ainsi, les trotskistes, qui, depuis plus de quarante ans ont toujours trouvé un camp à choisir ("le plus progressiste", le "moins réactionnaire", le "plus antifasciste", etc.) dans les conflits entre bourgeois, sont passés maîtres dans l’art de sergents-recruteurs de la contrerévolution -guerres de "libération nationale", conflits inter-impérialistes, guerres "anti-fascistes"... peu nombreux sont les événements de l’histoire bourgeoise où ils n «aient pas apporté leur grain de sable ou leur goutte de sang.
Mais peut-être nous dira-t-on : ce ne sont encore là que des raisonnements de "sectaires-puristes" : ce n’est pas la violence en soi qui est un critère mais la violence exercée ou subie par des éléments ou des organisations "sincèrement convaincus de leur volonté révolutionnaire". Voyons donc le contenu de cet autre avatar de la "dialectique gauchiste".
la sincérité des militants
Lorsque nous mettons en question la nature de classe d’une organisation politique qui se dit "ouvrière" ou "révolutionnaire", on nous répond avec l’argument de "la sincérité des militants" (surtout celle de la "base"). L’absurdité de cet argument repose sur une séparation métaphysique entre l’organisation et ses membres, entre "les bons militants" et les "mauvais dirigeants" -alors que les organisations n’ont que les chefs qu’elles méritent : on utilise des arguments concernant des problèmes de personnalité pour éviter de poser les problèmes en termes de classes.
Pour déterminer les camps en présence dans une société régie par les confits de classe, l’histoire ne laisse aucune place à la "psychologie individuelle". Les illusions ne cessent pas d’être des illusions du simple fait qu’elles soient "sincères". D’illusions et de bonnes intentions, le camp de la contre-révolution en est pavé. On ne juge pas un individu d’après l’idée qu’il a de lui-même, disait Marx ; on ne juge pas une organisation politique d’après ce qu’elle dit d’elle-même, ni même d’après l’idée qu’en ont ses membres.
Du point de vue individuel, Hitler pouvait être aussi sincère et dévoué que Marx ; le problème n’est pas d’être "sincère" ou "malhonnête" envers une cause, mais de savoir quelle cause on défend dans la réalité, et, plus exactement, les intérêts de quelle classe on sert.
De deux choses l’une : ou bien on raisonne en termes de classe et on fonde la nature politique d’une organisation sur des critères de classe -et, dès lors, la seule attitude révolutionnaire face aux illusions qui surgissent inévitablement parmi les éléments en rupture avec la société actuelle, est celle de la dénonciation sans fard de leurs illusions et du rôle qu’objectivement celles-ci les amènent à jouer. Ou bien on s’embourbe dans le terrain individualiste pour patauger inévitablement dans les métaphysiques moralisantes des "motivations individuelles", On commence par affirmer le "droit à l’erreur[4]" et on finit toujours par confondre le respect de l’individu qui se trompe avec le respect de son erreur. On se prétend "compréhensif" et, ne sachant plus ce qu’il faut comprendre, on ne contribue qu’à enfermer "l’incompris" dans son erreur. Toute cette attitude "non-sectaire" a sa source dans la confusion et ne peut servir que la confusion ; elle se nie d’avance tous les moyens pour aborder la question de la nature de classe d’une organisation politique, puisqu’elle quitte dès le départ la problématique de classe.
Une telle façon d’envisager le problème serait une simple confusion, une simple "incapacité", si cette confusion n’était pas une force contre-révolutionnaire, si son résultat concret n’était pas, encore une fois, de permettre la défense des organisations de la bourgeoisie au sein du mouvement ouvrier.
Posséder une origine historique prolétarienne, avoir une composition sociale ouvrière, être victime de la répression de l’État, préconiser ou pratiquer la violence, s’auto-proclamer révolutionnaire ou être constituée de militants sincèrement dévoués, aucun de ces traits (pris isolément ou dans leur ensemble) ne fait d’une organisation politique un organe de classe du prolétariat.
Aucun de ces arguments n’est politique . Ce sont pourtant eux qui tiennent le haut du pavé dans les milieux dits "gauchistes" et, de façon générale, partout où le marxisme est absent, ou présenté uniquement sous la forme d’une idéologie livresque. C’est pourquoi toute attitude politique, toute recherche de cohérence révolutionnaire y est automatiquement taxée de sectarisme.
Le vrai critère
Le rattachement d’une organisation politique à une classe est une question objective, qui se résout indépendamment des intentions et des illusions subjectives des membres qui la composent.
Être l’organe politique d’une classe, C’est tendre, dans le mouvement de cette classe, à exprimer et à défendre les positions des intérêts historiques de cette classe. La question n’est pas de savoir : si telle ou telle organisation croit ou non, cherche ou non à défendre les intérêts du prolétariat, mais objectivement, le fait-elle ? Ceci soulève au préalable deux questions :
1°- Comment se définissent ces intérêts ?
2°- En quoi consiste la défense de ces intérêts ?
Définir les intérêts de la classe
Pour beaucoup, c’est ce problème qui est au centre de la question du sectarisme. Définir les intérêts de la classe ? Oui, mais toute organisation qui se dit révolutionnaire, prolétarienne, est convaincue de posséder la vraie définition de ces intérêts. Le sectarisme ne serait, justement, rien d’autre que la conviction d’être les seuls à détenir cette vérité. Qu’est-ce qui prouve que telle pensée est celle qui correspond à la réalité objective des intérêts du prolétariat ?
La réponse ne peut être donnée que par la pratique.
"La discussion sur la réalité ou l’irréalité de la pensée, isolée de la pratique, écrit Marx, est purement scolastique.
La question de savoir si la pensée humaine peut aboutir à une réalité objective n’est pas une question théorique mais une question pratique. C’est dans la pratique qu’il faut que l’homme prouve la vérité, c’est-à-dire la réalité et la puissance, l’en-deçà de sa pensée". (Marx, Thèses sur Feuerbach)
Mais de quelle pratique peut-il s’agir dans la question qui nous préoccupe ?
La pratique immédiate de l’organisation ? Elle ne suffit pas. D’abord, parce qu’elle n’a aucun sens pratique matériel en dehors de celle de la classe, ensuite parce que cette pratique immédiate de l’organisation est réduite à son expression la plus faible tant que le prolétariat n’a pas entrepris, dans son ensemble, une action révolutionnaire .
La pratique des individus ouvriers ? Non plus. Ce serait croire à la démarché ouvriériste, qui voit dans l’intérêt de chaque ouvrier individuel, ou salarié, l’expression des intérêts généraux du prolétariat. La réalisation des besoins historiques d’une classe entraîne la satisfaction de ceux de ses membres. Mais l’inverse est totalement faux. C’est uniquement à partir de la pratique de la classe en tant que classe, face aux intérêts des autres classes, qu’un critère d’authenticité prolétarienne peut être établi.
Mais cette pratique de classe peut-elle se résumer à la pratique immédiate de la classe ? Et si les travailleurs se font mobiliser pour aller à la guerre impérialiste ? Ou s’ils demeurent dans la plus parfaite indifférence ou, du moins, dans une apathie larvée (ce qui est le cas le plus fréquent, puisque les périodes de véritable lutte de la classe sont rares dans l’histoire) ? C’est encore insuffisant.
La seule pratique qui permette de trancher sur l’authenticité de la définition des intérêts du prolétariat que peut donner une organisation, c’est la PRATIQUE DU MOUVEMENT HISTORIQUE de la classe, tel1e qu’elle s’est déroulée depuis plus d’un siècle et demi de luttes.
C’est au cours de la pratique de sa lutte historique que le prolétariat définit et prend conscience de ses intérêts. C’est en affrontant les autres classes que son propre "programme de classe" s’est forgé et continue de se définir. Les travailleurs rejoignent le véritable combat de leur classe lorsqu’ils retrouvent la ligne générale que les acquis du passé ont tracée et quand ils l’enrichissent par leur propre expérience.
Contrairement à ce que pensent les fanatiques de l’anti-sectarisme, la façon dont une organisation définit les intérêts du prolétariat ne vaut donc pas celle de n’importe quelle autre. Une idée n’en vaut une autre que tant que toutes deux ne sont pas confrontées à la pratique.
L’expérience historique du prolétariat a créé des critères objectifs, réels, capables de trancher impitoyablement parmi les subjectivités des différentes organisations qui se proclament révolutionnaires.
Lorsque nous formulons dans notre plate-forme politique les intérêts actuels du prolétariat mondial, nous ne le faisons pas à partir d’inventions théoriques nouvelles ou de découvertes de tel ou tel militant; nos positions sont toutes le résultat clair, indiscutable, de l’expérience de la lutte historique du prolétariat.
Lorsque nous affirmons que telle ou telle question constitue une frontière de classe (c’est-à-dire une question dont la réponse situe son auteur à l’intérieur ou à l’extérieur du camp prolétarien), c’est qu’il s’agit d’un problème que la pratique de la classe a déjà résolu de façon indiscutable et définitive.
Deux exemples importants permettront d’illustrer ce que nous affirmons :
La question de savoir si le prolétariat doit, pour son émancipation définitive, conquérir l’appareil d’État bourgeois ou le détruire, était une question théorique, ouverte, au sein du mouvement ouvrier avant la Commune de Paris. Avec la première expérience insurrectionnelle politique du prolétariat, la question fut tranchée définitivement.
La Commune coûta des milliers de morts au prolétariat. Mais, si elle fut une défaite, elle n’en fut pas moins utile à la lutte historique de la classe qui la réalisa. Avec elle, le prolétariat mondial s’était enrichi d’une expérience fondamentale, dont les acquis devaient devenir de précieuses armes pour ses futurs combats. Et parmi ces acquis, la certitude de l’impossibilité de conquérir l’appareil d’État bourgeois au profit de la révolution prolétarienne, donc la nécessité de le détruire.
La question syndicale fournit un autre exemple. Si, aujourd’hui, les révolutionnaires du monde entier peuvent affirmer que la forme d’organisation syndicale est devenue un simple instrument d’encadrement de la classe ouvrière au service du capital, ce n’est pas parce que quelques "puristes" géniaux auraient inventé ce principe à partir de leurs réflexions théoriques abstraites.
C’est parce que soixante années de répressions syndicales, larvées ou sanglantes, soixante années d’échecs sanctionnant toute tentative de former de "bons" syndicats, soixante années d’affrontements violents avec les syndicats à chaque fois qu’une lutte sérieuse s «est engagée, ont permis de savoir définitivement à quoi s «en tenir sur la question syndicale.
"Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes découverts par tel ou tel réformateur du monde. Elles ne font qu’exprimer en termes généraux les conditions réelles d’une lutte de classes qui existe, d’un mouvement historique qui se déroule sous nos yeux." (Marx et Engels : Manifeste...)
Parce qu’elle est la seule classe révolutionnaire de l’Histoire à être simultanément une classe exploitée, la classe ouvrière est la seule dont la victoire finale n’est pas le résultat d’une série de victoires partielles, mais, au contraire, d’une série de défaites fécondes. Cette suite de défaites ne peut contribuer à la victoire finale que si le prolétariat parvient à s’en approprier les résultats historiques.
Ces acquis, payés du prix de la vie de millions de prolétaires, sont la principale richesse du mouvement révolutionnaire prolétarien. Ce sont eux qui définissent de manière stricte le cadre minimal dans lequel s’inscrivent des "conceptions théoriques communistes". Ce sont eux qui obligent les révolutionnaires à dénoncer comme étrangères au mouvement prolétarien toutes les organisations qui, pour une raison ou pour une autre, ne les ont pas faits leurs.
Et il est évident que si, de ce qui précède, il découle que les questions autres que celles que 1«Histoire a tranchées restent ouvertes à la discussion, il n’en demeure pas moins que tout enrichissement, tout dépassement de notre plateforme ne peut se faire qu’en intégrant les acquis minimaux qui délimitent, sans aucune tergiversation possible, les frontières que l’histoire de ses luttes impose aujourd’hui à la classe prolétarienne. Défendre les intérêts historiques de la classe
En tant qu’organisation distincte, les révolutionnaires n’agissent pas directement, matériellement, contre le système qu’ils combattent. Seule la classe dans son ensemble peut entreprendre la transformation matérielle de la société. C’est pourquoi la "défense des intérêts historiques du prolétariat" consiste pour les révolutionnaires, d’abord et avant tout, à défendre au sein de leur classe l’acquis historique de sa propre lutte.
Aussi, ce qui garantit l’authenticité du lien d’une organisation politique avec le prolétariat, ce n’est :
- ni le "contact physique" avec les ouvriers (mythe de l’ouvriérisme gauchiste) ;
- ni l’affrontement violent avec l’État (mythe du terrorisme anarchiste), mais la capacité à faire siennes les positions politiques que l’histoire de la lutte prolétarienne a définies.
L’importance primordiale des positions politiques, des conceptions théoriques, ne transforme en aucune manière l’organisation révolutionnaire en un laboratoire théorique, un groupe d’études sociologiques. Le marxisme n’est pas une "interprétation du monde" mais la "théorie de sa transformation"
LA COHERENCE THEORIQUE REVOLUTIONNAIRE NE PEUT SURGIR ET SE DEVELOPPER QUE SOUS L’IM- PUISION PERMANENTE DU SOUCI MILITANT DE L’INTERVENTION POLITIQUE.
Il faut donc qu’il n’y ait aucune équivoque sur ce que nous défendons : nous ne sous-estimons en rien les responsabilités militantes d’une organisation prolétarienne. Ce que nous cherchons à mettre au clair, c’est que le souci politique d’intervention militante, s’il est nécessaire, ne suffit pas, à lui seul, à faire d’une organisation politique un organe véritable du prolétariat.
Sectarisme et intransigeance révolutionnaire
L’intransigeance révolutionnaire ne peut être comprise comme nécessité que par les révolutionnaires eux-mêmes. Pour l’esprit philistin, pour la pensée opportuniste, elle apparaît comme du "sectarisme".
La pensée révolutionnaire ne peut se former qu’en opposition aux idéologies dominantes. C’est pourquoi les organisations politiques que l’histoire du mouvement ouvrier a consacrées comme authentiquement prolétariennes (l’A.I.T. pendant la Commune de Paris, le parti bolchevik en 1917» le Spartakusbund en 1918-1919» par exemple) ont toutes été des organisations ultra-minoritaires pendant la quasi-totalité de leur existence. Le développement de leur influence ne s’est produit qu’au cours des phases avancées du mouvement révolutionnaire. En fait, seul le parti bolchevik connut un véritable épanouissement de son importance, du fait que le mouvement révolutionnaire du prolétariat russe fut le seul à vivre suffisamment de temps avant la défaite. Toutes ces organisations, sans exception,’ ont entendu en permanence les accusations de "sectaires", de "puristes romantiques", etc., de la part de partis que leur "tolérance" devait conduire hors du terrain de classe. Et il ne pouvait en être autrement.
L’intransigeance d’un Lénine en avril 1917 celle d’un Liebknecht en novembre 1918 demeurent parmi les plus grands exemples d’efficacité révolutionnaire dans le mouvement prolétarien. Et leur force ne leur venait pas d’un mystérieux talent pour "inculquer la conscience aux masses passives", ou d’un "magnétisme personnel", mais de leur capacité à exprimer clairement et sans concessions la volonté révolutionnaire qui mûrissait dans les entrailles de la classe, dont ils n’étaient qu’une fraction.
Si sectarisme veut dire intransigeance impitoyable envers tous les courants étrangers à la lutte historique du prolétariat, capacité à aller "contre le courant", quitte à se retrouver encore plus minoritaires lorsque les idées de la classe dominante aveuglent les travailleurs, alors toutes les organisations révolutionnaires ont été "sectaires".
Contrairement au lieu commun si cher aux "réalistes" de la bourgeoisie, la secte ne naît pas de la faiblesse numérique ou de l’intransigeance théorique, mais de l’incapacité à rattacher sa propre existence au mouvement réel, apparent ou non, qui anime la vie des sociétés.
Lorsque Lénine, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg se retrouvaient seuls, isolés, avec une petite poignée de révolutionnaires, mais combattant sans pitié ni faiblesse la gigantesque marée chauvine qui inondait le prolétariat européen embrigadé dans la première boucherie impérialiste mondiale, lorsqu’ils misaient sur l’inévitable réveil du prolétariat mondial, ils ne s’enfermaient pas dans une "secte". Les sectes ne pouvaient plus naître dans leur camp mais dans celui des défenseurs d’un système social qui venait de signer dans la plus horrible barbarie sa propre condamnation à mort.
Ceux qui ne voient dans l’intransigeance révolutionnaire que du "sectarisme" ne sont que ceux que 1» Histoire a définitivement condamnés à mourir dans des sectes.
Quant aux révolutionnaires, l’Histoire leur a appris que leur pensée est comme la révolution elle-même : elle est intransigeante ou elle n’est rien !
R. Victor
[1] Nous parlons ici des organisations minoritaires, fractions de la classe regroupant les révolutionnaires sur des positions politiques (groupes partis) et non des organisations unitaires de la classe (syndicats au XIX0 siècle, soviets) réunissant les membres de la classe de façon unitaire, sans autre critère que cel1u de la participation à l’action du prolétariat.
[2] "Pouvoir ouvrier", en 1968, a été une des seules organisations à avoir eu le courage de publier dans sa presse, dans des termes aussi clairs, un pareil raisonnement. Ce fut d’ailleurs dans le dernier numéro de son journal. Cela n’est pas moins le raisonnement implicite de l’ensemble des organisations gauchistes, professionnelles du syndicalisme de gauche.
[3] Le sentiment de révolte est commun à toute classe exploitée, mais dans le capitalisme, entre l’attitude de simple révolte et sa transformation en attitude révolutionnaire il y a l’écart qui sépare la petite-bourgeoisie du prolétariat. Seule classe à porter en elle le projet révolutionnaire de la nouvelle société, la classe ouvrière tend inévitablement à transformer sa révolte en œuvre révolutionnaire , constructive, ouvrant des perspectives infinies à l’humanité. Sa violence révolutionnaire demeure un moyen, jamais un but en soi. Incapable de véritable cohérence, révoltée essentiellement par la menace de disparition que fait peser sur elle le capitalisme, la petite-bourgeoisie sombre au contraire inévitablement dans le désespoir sans issue de l’impuissance. La violence pour la violence, caractéristique du mouvement petit-paysan, des petits commerçants et des étudiants n’a pas d’autre fondement.
[4] Nous ne disons pas que nous ne commettons pas d’erreurs sur d’autres points non encore élaborés. La conscience révolutionnaire n’est certes pas achevée. Mais ce que nous disons, c’est que la confusion sur les questions déjà réglées maintes et maintes fois par la pratique du prolétariat est devenue contre-révolutionnaire.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revolution Internationale N°09 - mai-juin (nouvelle série)
| Attachment | Size |
|---|---|
| 1.7 MB | |
| 1.73 MB | |
| 729.3 KB |
- 33 reads
Luttes revendicatives et surgissement de la CLASSE-POUR-SOI
- 26 reads
Ce texte de tendance s’inscrit dans la perspective ouverte par les articles "Où va la lutte de classe en France ?"(n°4), "Lip : combativité et mystification” (n°5), "Situation actuelle, perspectives et activité des révolutionnaires" (n°7) et "Leçons de la lutte des ouvriers anglais" (n°8). Il a été rédigé avant que nous prenions connaissance de l'article du camarade Victor, auquel une réponse sera faite ultérieurement.
Précisons tout de suite les points suivants :
1) Nous employons les expressions de "classe-pour-soi" et de "classe-pour-le-capital" non parce que ça ferait bien, mais parce que nous n'avons pas trouvé, pour l’instant, de meilleures expressions pour nous exprimer. Voici dans quel sens nous les utilisons :
La classe-pour-le-capital est la classe telle qu'elle est constituée par le rapport capitaliste. Concrètement, ce sont des hommes qui sont matériellement unifiés dans la production sociale, dans le travail associé, mais qui sont socialement divisés par leur rapport au capital (travail salarié) . Leur unité sociale leur est extérieure, ils la retrouvent dans une puissance étrangère : le capital. Ils ne constituent pas une classe pour eux-mêmes, mais c'est à travers le rapport capitaliste, pour le capital, qu'ils sont une classe. Ils sont effectivement unis par le fait très simple que le rapport salarial les contraint à pointer tous les jours à l'usine, à faire la queue au bureau de chômage ou à s'embrigader dans un syndicat. Mais cette unité pour le capital produit précisément leur division pour eux-mêmes (division du travail, parcellisation des taches, fragmentation par usine, par corporations* hiérarchie, division en productifs/improductifs, travailleur s/chômeurs, concurrence entre les ouvriers, etc.). La contradiction qui est le moteur du mouvement de maturation de la classe pour le capital est celle qui oppose leur être matériel unifié au rapport social qui le divise : rapport salarié. Pour se défendre comme ensemble d'hommes confrontés à des besoins matériels, ils se heurtent d'emblée au rapport salarié et doivent donc commencer concrètement à détruire ce rapport, c'est-à-dire à remettre concrètement en cause leur être-pour-le- capital.
La classe-pour-soi est à la fois la même classe et une classe différente. Elle est la même parce que son unité sociale repose sur les mêmes caractéristiques matérielles que celles caractérisant la classe-pour-le-capital (bien qu'elle commence à les bouleverser en réorganisant la production). Mais cette unité matérielle n' est plus une unité sociale pour le capital, elle l'est pour elle-même, pour ses besoins propres. Elle n'est plus classe du point de vue du capital, mais par sa propre action contre lui, qui est un mouvement de destruction du salariat par l'association des travailleurs. Cette action est un processus qui va de l'unification révolutionnaire des catégories du travail salarié (surgissements) à l’accomplissement de premières tâches rudimentaires du communisme inférieur et, après la victoire militaire à l’échelle mondiale, jusqu’à la communisation complète de la société, qui est la réalisation ultime de la classe-pour-soi et sa dissolution finale : la communauté humaine.
La classe-pour-le-capital, c’est les prolétaires soumis concrètement au rapport salarial, luttant et organisés comme travail salarié ; la classe-pour-soi, c’est les prolétaires refusant concrètement le rapport salarial, luttant et s’organisant de façon unie comme travail collectif et mouvement de communisation, donc tendant à englober dans leur classe toute l’humanité.
2) Ce que nous cherchons à cerner, ce ne sont pas des catégories fixes, mais des processus. Il va de soi que ce que nous dégageons sont des approximations théoriques. Dans la réalité, il y a effectivement des enchevêtrements, des retours en arrière et, par exemple, la classe-pour-soi ne se présente jamais de façon pure. De même que la négation du prolétariat, l’affirmation de la classe-pour-soi est, surtout au départ, une tendance qui se présente de façon confuse, balbutiante, non explicitée clairement. Cependant, ce n’est qu’à partir d’une compréhension de la rupture qu’on peut comprendre le mouvement et ses moments.
3) Pour la énième fois et une fois pour toutes, nous ne sommes pas "pour” ou "contre” les luttes revendicatives. C’est un faux problème. Les luttes revendicatives existent et sont nécessaires. Nous l’avons assez rabâché pour ne plus avoir à le répéter. Mais notre tâche est de comprendre et d’exprimer qu’elle doit les dépasser en les niant et en détruisant l’organisation qui y correspondait (les syndicats). Il n’y a pa^ comme le croient les trotskystes, de "dynamique des luttes". Les luttes ne se trans- forment pas ; les luttes ne font rien du tout, ce sont les hommes qui sont obligés de lutter de façon différente, c’est-à-dire pratiquement de se transformer. Nous ne "condamnons" ni ne "dédaignons" rien ni personne. Nous sommes partis d’une classe qui essaie de comprendre les conditions de sa pratique. De même que nous n’"appelons" pas à voter, ou à ne pas se syndiquer, ou à ne pas vendre sa force de travail, nous n'"appelons" pas à refuser les luttes revendicatives. Nous tentons seulement d’exprimer l’expérience historique et quotidienne de leur échec, la nécessité de leur dépassement, ce qui nous amène à affirmer la nécessité de détruire les syndicats, etc.
4) Nous avons définitivement abandonné les termes de luttes "économiques" et "politiques" qui ne font qu’embrouiller les choses et étaient la première forme confuse à travers laquelle nous avions tenté de saisir le processus.
L’IMPASSE DES LUTTES REVENDICATIVES
À l’époque de la décadence, le prolétariat ne peut plus s’unifier et s’affirmer en tant que catégorie économique pour le capital, travail salarié. Tant que les travailleurs luttent, se conçoivent et s' organisent dans le but d’aménager les conditions de la vente de la force de travail, ils se heurtent inexorablement aux limites inhérentes au rapport capitaliste (corporatisme, sectionalisme, nationalisme, concurrence). Le problème-clé, la division de l’être de la classe, n’est pas un problème de plus ou moins d’ouvriers en lutte. Une lutte de huit millions de prolétaires peut être parfaitement fragmentée et n’exprimer que l’atomisation du travail salarié (Mai 68 après quelques jours), alors qu’une lutte limitée géographiquement, à un quartier par exemple, et à quelques milliers de travailleurs, peut parfois être qualifiée de surgissement de la classe-pour-soi (certaines insurrections en Espagne, et Gdansk,..) Se contenter de critiquer le sectionalisme sans faire la critique de la lutte revendicative, c’est faire la critique d’une forme de lutte sans essayer de voir au-delà que c'est le sujet lui-même (le travail salarié) qui reproduit la division et la concurrence comme quelque chose qui est propre à sa nature et qui donc engendre cette forme. Le travail salarié, les ouvriers salariés se présenteront toujours, tant qu' ils n'auront pas enclenché un processus de négation de cet état, comme enfermés dans l'usine, la branche, le particularisme régional ou national, la hiérarchie, la division entre ceux qui ont du travail et ceux qui n'en ont pas, entre les cols bleus et blancs, etc. La division de la classe n'est pas quelque chose qu'elle pourrait surmonter sans s'engager dans un processus de transformation d'elle-même. L’unification du travail salarié est une utopie réformiste. Vouloir que les travailleurs se posent comme échangistes d’une marchandise (la force de travail) tout en supprimant la concurrence, le protectionnisme et le particularisme dans leurs rapports est tout aussi impossible que l’unification du capital. Reprendre le slogan syndicalo-gauchiste de 1’"unité des luttes revendicatives", c’est sombrer dans l’illusion qu’on pourrait unifier ce qui est par nature divisé.
Il faut poser la question : si les ouvriers pouvaient s’unifier sur le terrain revendicatif, celui des luttes salariales, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir des syndicats ? Si les syndicats, même créés par les travailleurs eux-mêmes, deviennent des instruments du capital, n’est-ce pas justement parce que le travail salarié est, à notre époque, complètement atomisé et que le rapport salarial ne peut plus être aménagé, négocié et encadré que par le capital lui-même et lui seul ? En ce sens, les syndicats sont des organes à travers lesquels le capital tente d’organiser le travail salarié. Les ouvriers ne s’organisent pas à travers eux ; c’est impossible, puisque le travail salarié ne peut plus s'unifier et s'organiser. Par contre, c’est vrai que les syndicats "organisent”, encadrent la force de travail dans le rapport salarié. Si la classe est contre les syndicats, c’est parce qu’elle se heurte à son embrigadement en travail salarié. Mais les ouvriers ne se battront pas "contre les syndicats”, ils les détruiront au passage, en s’affirmant contre le rapport salarial. Tant qu’ils restent ouvriers salariés, ils resteront, dans l'ensemble, "organisés" (c’est-à-dire atomisés, réprimés, étouffés) par les syndicats.
Cela est prouvé par les luttes ouvrières des dernières années. Dès que le processus d’unification de la classe-pour- soi s’épuise et que les ouvriers se replient, faute de pouvoir aller au-delà, sur des revendications, le syndicat, ancien ou nouveau, réémerge comme direction de la lutte et, à partir de ce moment, à moins d’un événement nouveau (répression policière, provocation, etc., l’unification qu’aurait pu provoquer le 14 août 1973 à Besançon, par exemple) qui crée les conditions d’un resurgissement du processus, c’est le déclin, plus ou moins chaotique mais inexorable. Dès que la lutte est posée comme moyen de pression des ouvriers pour aménager leur condition de travailleurs salariés, une place est offerte à un organe qui "négocie" la défaite et "organise", par la violence "démocratique" ou physique, le retour des prolétaires à leur division antérieure. À propos de la grève de Renault en 1947, "Internationalisme", dans son numéro du 15 mai, exprimait-on ne peut plus clairement l’impasse des grèves revendicatives :
- "La grève de Renault démontre une fois de plus l’impossibilité d’asseoir désormais les luttes du prolétariat sur une base économique. Les staliniens peuvent reprendre en main d’autant plus facilement le mouvement qu’il se confine dans les revendications économiques. C’est là une voie d’impasse uniquement favorable à la bourgeoisie qui; au travers des tractations et des marchandages, parvient à fourvoyer le mouvement. C’est sur ce terrain que le syndicat a ses racines solidement accrochées et sur lequel il est irremplaçable." (Souligné par nous.)
Et un peu plus loin : "Toute action menée sans direction syndicale et dans le cadre syndical ne peut en définitive être qu’une lutte contre la classe ouvrière[1]." (Souligné par nous.) (Voir note page 26)
Mai 68 est un autre exemple de ce processus. Dès que le mouvement d’unification, qui n’était essentiellement que 1’affirmation embryonnaire, silencieuse mais indéniable, de la classe-pour-soi, s’est heurté aux limites de sa propre immaturité, on a vu simultanément : 1) le cloisonnement par les syndicats de la lutte sur le plan revendicatif ; 2) l’isolement des travailleurs dans leurs usines transformées en prisons ; 3) l’unité des premières heures, forgée de manière informelle à travers l'initiative des plus avancés, voler en éclats : les ouvriers les moins combatifs sont restés chez eux et les plus combatifs se sont divisés en clans staliniens, cédétistes, gauchistes, pendant qu’ une infime minorité allait aux universités. Plusieurs aspects s’entremêlent dans la façon dont le caractère revendicatif fragmente la lutte :
- À partir du moment où il s’agit d'aménager les conditions du travail salarié, inconsciemment, mais parfois consciemment, les ouvriers tirent de leur expérience collective et individuelle un scepticisme extrêmement sain quant aux possibilités réelles d’améliorations .
- "0n n’obtiendra de toute façon pas grand-chose, donc autant ne pas s’attirer d’ ennuis, ne pas risquer l’aventure et laisser le représentant patenté du travail salarié faire son boulot.”
- Si la question est d’obtenir quelques revendications, les travailleurs tendent à se concevoir selon ce que le capital fait d’eux, c’est-à-dire non comme membres d’une force de travail associée mondiale, mais comme 0S2 de tel atelier, de telle usine, etc., ou comme chômeur français qui aurait du travail si les algériens n’étaient pas là, ou comme col blanc qui croit avoir échappé à l’enfer de la chaîne, etc. Par exemple, souvent ils pensent que leur force n’est pas dans une extension mais, au contraire, dans la position de force de tel ou tel groupe (voir le phénomène fréquent de catégories ou de branches qui n’acceptent pas de "noyer" leurs revendications dans les luttes d’ensemble, comme récemment dans la grève des banques où les services informatique ne comptaient que sur leurs positions strictement corporatistes, ou la métallurgie en juin 68 qui prolongea sa grève quinze jours de plus pour obtenir plus que les accords de Grenelle).
Nous pensons qu’il était nécessaire de préciser cela, qui n’était pas clair dans les articles que nous avons cités au début, ce qui leur donnait un tour parfois indéfini. Pour le reste, on peut renvoyer aux articles.
QU’EST-CE QUE L’UNIFICATION DE LA CLASSE-POUR-SOI ?
Il n’y a pas de définition statique et sociologique de la classe ouvrière. Le problème n’est d’ailleurs pas de ”définir” la classe ouvrière. Les classes ne sont pas définies, elles se définissent dans la lutte de classe. Au XIXè siècle, parce qu’une lutte de classe pour l’aménagement du rapport salarial était possible et relativement unificatrice, Marx et Engels ont misé sur un développement de la conscience et de l’organisation communistes au sein du mouvement syndical, c’est-à-dire sur un développement continu de la classe révolutionnaire au sein du mouvement de la classe-pour-le-capital. Leur vision était : en se définissant comme classe salariée aux intérêts distincts, les ouvriers tendent en même temps à se définir comme classe-pour-soi. Le passage de l'un à l’autre est continu. En se définissant comme classe au sein de la société bourgeoise, le prolétariat se prépare organisationnellement à la détruire. Cette vision détermine toute leur pratique : la classe peut se définir comme classe par rapport au capital. Au XXè siècle, au cours de la décadence, c'est le capital et la contre-révolution qui l’ont définie comme classe-pour-le-capital, complètement incapable de s’affirmer et de s'unifier comme travail salarié, ce qui exige d’elle qu’elle renverse brutalement ce rapport et se redéfinisse comme classe-pour-soi. La classe, au sens historique global du terme, est un mouvement de la classe pour-le-capital (travail salarié) à la classe-pour soi, qui s’affirme et se nie en même temps. Cela Marx le disait déjà; ce qui change à notre époque, c’est la forme que devra revêtir ce processus.
Dans la société capitaliste, la classe ouvrière se présente à la fois comme du travail salarié, un simple moment du rapport capitaliste (capital variable) et comme un ensemble d’hommes travaillant dans des rapports matériels donnés (travail associé, production de masse, rapports universels, etc.). Lorsque la contradiction entre les rapports sociaux capitalistes et ces rapports matériels éclate, les hommes qui vivent cette contradiction au cœur du système (les prolétaires) sont contraints, par l’échec répété des tentatives de se défendre comme catégorie du capital, de s'affirmer comme négation du travail salarié, comme un ensemble d'hommes qui se définissent non par le fait qu'ils vendent leur force de travail, mais par leur position matérielle. Tous ceux qui, parce qu’ils vendaient leur force de travail sous la domination d'une puissance sociale et mondiale, le capital, sont séparés des moyens de production, parce qu’ils travaillent de façon collective, associée -tous ceux-là tendent, sous la contrainte des conditions matérielles, à se défendre autrement.
Lorsque, sans revendications, sans organisation préétablie, poussés par un besoin irrémédiable, les travailleurs d’un atelier arrêtent le travail, partent en cortège dans l’usine et entraînent l’ensemble des ouvriers pris par une passion subite de s’affirmer comme une classe associée lorsque les ouvriers d’une usine sortent de l’entreprise, entraînent les badauds, les chômeurs, des couches semi-prolétariennes et appellent, sans aucune revendication, les autres travailleurs des autres usines à les rejoindre (Espagne) ; lorsque, au mépris de tout "sectionalisme”, ils attaquent des locaux syndicaux, des postes de police -c’est le début, le tout petit début de la classe- pour-soi.
La révolte n’est pas moins matérielle et sociale qu’une grève salariale ; ce qui change, ce qui s’affirme, c’est bien une classe (un ensemble d’hommes occupant une position déterminée par rapport aux moyens de production). Cependant, cette classe ne se définit pas à l’intérieur du rapport capitaliste, mais contre lui, et ce qu’elle affirme, c’est sa nature de classe matériellement et socialement collective, dépossédée, mondiale, et son besoin d’affirmer des rapports communistes inférieurs pour survivre.
Ce premier moment de la classe prolétarienne révolutionnaire est fragile, instable, comme une boule en haut d’une pyramide. D’une part, c’est une classe qui tend à se poser comme destructrice du rapport salarié, non que les prolétaires disent tous : "nous nous riions comme travail salarié", mais parce que la classe fait d’emblée reposer sa force sur une base qui est la négation de ce rapport (tendance à l’unité avec les chômeurs, à la destruction des barrières des entreprises, à l’"oubli" de toutes les caractéristiques du rapport salarié: hiérarchie, productifs-improductifs, consommation collective, production de valeurs d’ usage pour elle-même, etc.). D’autre part, cette classe reste, objectivement et subjectivement, modelée par la division du travail capitaliste et n’a fait encore que nier le rapport salarié, sans pourtant se transformer en transformant mondialement les rapports de production, les forces productives, etc. On peut donc dire qu’il s’agit de l’amorce du processus de la révolution. Jusqu’à présent, et peut-être encore pour longtemps, ces surgissements de la classe-pour-soi se cogneront très vite à cette contradiction et laisseront, après peu de temps, la place aux revendications (mai 68z Gdansk, Turin) ou seront écrasés militairement (Espagne, Cordoba, etc.). Le retour sur le terrain revendicatif, et donc syndical, n’est pas quelque chose à condamner, mais à comprendre: il exprime une impuissance, à la fois une lucidité sur l’absence de maturation de la classe et un retour aux illusions qui avaient été momentanément dépassées .
La classe-pour-soi est à la fois continuation de la classe-pour-le-capital et rupture avec elle. Continuation d’un point de vue matériel, parce que son noyau son élément moteur, la source d’où se diffuse la communisation de la société, recouvre, en général, ce qui était le cœur de la classe-pour-le-capital (travailleurs productifs concentrés dans la grande industrie moderne). C’est en effet là que le capital a accumulé une masse de capital constant gigantesque et des masses de travailleurs salariés, c’est-à-dire du point de vue communiste, c’est-à-dire de la valeur d’usage, les forces productives et l’association du travail, qui permettent l’amorce d’un processus de communisation immédiate de la production et de la consommation, qui tend à révolutionner à son tour, les forces productives et cette association en produisant autre chose que la merde actuelle et d’une autre façon. Continuité, maïs aussi rupture, parce que le rapport salarial qui enserrait la classe-pour-le-capital dans la logique de ce dernier, est brisé. Désormais, on a la plus grande contradiction qui puisse s’imaginer : une classe ouvrière qui n’est plus une classe définie par son rapport au capital et qui, dans ce sens, commence à se nier comme classe salariée en même temps qu’elle devient une classe pour elle-même; une classe qui s’affirme comme distincte du reste de la société et qui, pourtant, par le fait même qu’elle se définit comme un mouvement mondial , universel de socialisation, tend à englober toute l’humanité; une classe qui dit: "est prolétaire quiconque est prêt à travailler de façon associée et donc à consommer de façon socialisée”, c’est-à-dire une classe qui, au même moment, se limite et s’ouvre. C’est pourquoi on peut dire que la classe-pour- soi n’est pas seulement la destruction de la classe-pour-le-capital, mais également un mouvement simultané d’affirmation et de négation de soi. La classe-pour-le-capital était un mouvement sans cesse reproduit de prolétaires salariés. Désormais la tendance est renversée. La classe-pour-soi est un mouvement de création élargie de membres de la classe-pour-soi, de travailleurs associés et communistes (intégration des autres classes).
On nous dira : "Tout cela n’est vrai qu’après l’insurrection.” Il faudrait plutôt dire que ce mouvement ne prend son essor complet et libre qu’après l’insurrection mondiale, car s’il est vrai que c’est seulement après avoir violemment détruit l’État qu’il l’empêche de s’étendre et de prendre racine qu’il peut transformer matériellement les forces productives, le travail, universaliser les rapports communistes en incorporant à lui les secteurs précapitalistes -il n’en reste pas moins que ce qui détruit l’État, c’est CE mouvement vers le communisme et non le travail salarié. La vision classique était que le prolétariat resterait classe-pour-le-capital et s’organiserait de façon purement politique pour l’insurrection. En fait, pour avoir une politique révolutionnaire, il faut déjà qu’ il soit un mouvement social révolutionnaire une pratique consciente de transformation des rapports sociaux, qui tente de s’effectuer, un mouvement communiste.
La meilleure preuve que la classe-pour-soi est processus de négation du travail salarié dès qu’elle surgit sur la scène, c’est sa façon même de lutter qui dissout toute l’organisation de la classe-pour le-capital. Il faut, en surgissant, faire voler en éclats toute l’organisation antérieure. Pour étendre la lutte, même si les ouvriers manuels d’industrie restent le moteur de l’action, le noyau autour duquel se condensent les autres éléments de la classe-pour-soi (employés, chômeurs, ménagères, etc.), il faut "oublier" qui est ouvrier manuel ou intellectuel, productif ou non, syndiqué ou non, étranger ou non. Par exemple, la lutte militaire part des centres ouvriers mais englobe, en les fondant dans la classe-pour-soi, les chômeurs, les couches prolétarisées marginales (tous les sans-réserves). Il y a bien un noyau matériellement déterminé, une avant-garde pratique de la classe-pour-soi (ouvriers des grandes entreprises), mais ce noyau , en sortant du rapport capitaliste, tend, d’emblée, à précipiter" l’imminence du passage des classes moyennes au prolétariat"(Marx) en processus effectif. Concrètement, cela veut dire que le prolétariat ne demandera pas aux participants de la révolution s’ils ont un prix de leur force de travail à défendre ou des mains calleuses, mais s’ils sont prêts à participer à la lutte avec tout ce que cela implique: organisation militaire, participation à la production(d’armes, de nourriture) de façon communiste, participation à la distribution communautaire des valeurs d’usage. C’est ainsi que, dans la guerre civile mondiale, le prolétariat puise sa force de sa situation matérielle et de sa capacité à y attirer tous les éléments potentiels de la classe-pour-soi. Les usines restent le point de départ de l'action, mais ils sont les centres d’où s’effectue la destruction des usines comme entités juridiques séparées.
Le "danger” de "dissolution" du prolétariat dans la population non prolétarienne n’existe pas. Le vrai danger, c’est que le prolétariat n’arrive pas à se hisser à la classe-pour-soi, ce qui le contraindrait à passer des "alliances", des "fronts" avec les couches petites-bourgeoises, au lieu de commencer, à travers des taches militaires et sociales, à les assimiler aux rapports communistes. Cette dissolution-là ne serait que la dissolution dans les rapports marchands, la régression à l’état de classe-pour-le-capital, c’est-à-dire l’emprisonnement du prolétariat, travail salarié, dans la "population" de la société capitaliste. Le prolétariat ne peut s’affirmer qu’en commençant à se nier, c’est* à-dire à dissoudre dans les rapports communistes les couches semi-prolétariennes. Il n’a que l’alternative suivante: commencer à se dissoudre comme travail salarié ou être dissous comme classe révolutionnaire par le capital dans l’atomisation du travail salarié!
Cependant, à ce stade, le mouvement n’est qu’une tendance inachevée, incomplète qui ne peut se réaliser complètement. Très vite, l’unification de la classe-pour-soi entre en contradiction avec l’État, personnification du capital. C’est donc bien le mouvement social communiste qui ressent les superstructures capitalistes comme une entrave à son libre développement. Par exemple: on a distribué la nourriture des supermarchés, on a occupé les logements, on a commencé à produire pour la classe-pour-soi elle-même les biens de première nécessité, on a mis en place un rudiment de distribution gratuite(transports, gaz, électricité, etc.), mais ce processus fragile, mal coordonné, confus ne peut se généraliser aux autres secteurs, prendre véritablement son essor, s’unifier définitivement, sans se concentrer sur le terrain politique et ramasser toutes ses forces pour les diriger contre l’État capitaliste. C’est pourquoi le parti devra, au cours de la période révolutionnaire, indiquer à la fois la perspective d’une extension maximale des rapports communistes et celle d’ une préparation à la guerre civile, en liant indissolublement les deux aspects, car c’est de sa position matérielle que dépend la capacité militaire du prolétariat.
Derrière la vision de type social-démocrate classique: le travail salarié s’organise politiquement pour prendre le pouvoir puis, après l’"insurrection", commence à se nier, il n’y a pas seulement une conception purement "politique" du processus révolutionnaire et une incompréhension de la nature sociale de la révolution(dont la politique est un moment), il y a aussi une conception purement nationale de la révolution. Dès qu’on considère la révolution mondiale comme une guerre civile sociale et militaire, la séparation rigide et abstraite qu’on effectue "avant" et "après" l’"insurrection" s’évanouit. Le prolétariat impose sa dictature dans un ou plusieurs pays, une ou plusieurs régions, se trouve confronté à l’organisation de la production de la répartition, de la guerre, qu’il doit effectuer de façon communiste, lesquels rapports communistes embryonnaires étouffent dans le cadre local et sont en butte à la contre-révolution, ce qui mène à la nécessité de l’extension militaire de la révolution, laquelle permet le développement du mouvement communiste, etc. Ainsi 1’ internationalisme n’est pas une idée, un idéal, pour le prolétariat, il est un besoin qui découle de la nature même de son mouvement social. Le "danger" n’est pas que la révolution devienne sociale! Il est qu’ elle ne devienne pas assez sociale pour acquérir une force militaire invincible fondée sur l’unité matérielle de la classe- pour-soi, débarrassée de la fragmentation marchande. Au lieu de faire de l’ironie sur nos termes "philosophiques", que les camarades "concrets" nous expliquent comment l’organisation politique du travail salarié pourrait mener à bien une guerre civile mondiale. Une fois la guerre civile finie à l’échelle mondiale, alors débarrassé des taches militaires, le mouvement social trouve sa piste d’élan propre, son terrain de plein épanouissement: la planète et l’humanité.
LE PASSAGE DES LUTTES REVENDICATIVES DE LA CLASSE-POUR-LE-CAPITAL AUX SURGISSEMENTS REVOLUTIONNAIRES DE LA CLASSE-POUR-SOI
Définir la classe ouvrière seulement comme le mouvement de la classe-pour- soi sans montrer le processus qui forge la possibilité du surgissement de ce mouvement serait transformer le prolétariat en une idée. Nous avons essayé de montrer, dans l’article sur la Grande-Bretagne (RI n°8), quelle était la nature de ce processus: les ouvriers tentent de se défendre comme classe-pour-le-capital et devant l’échec des luttes salariales sont contraints de surgir comme classe-pour-soi. Puisqu’on a préféré nous chercher des poux dans la tête et caricaturer notre position en s’appuyant sur des formulations floues et maladroites au lieu de chercher à comprendre le problème que nous posions, voici quelques précisions.
A. - Le processus de maturation de la conscience à travers l’échec des luttes revendicatives n’est pas purement subjectif. Il est alimenté par le développement de la crise et par la nécessité matérielle de lutter autrement qui s’accumulent. Bien que cette maturation puisse sécréter des petits groupes d’ouvriers radicaux, annonciateurs des surgissements futurs, elle est essentiellement silencieuse et inconsciente ou préconsciente. Le processus n’est pas, comme on a voulu complaisamment nous le faire dire : les ouvriers se rendent compte explicitement qu'ils ne peuvent plus lutter sur le terrain salarial et décident de surgir . Il est : l’accumulation des défaites contraint, à travers un enchevêtrement inextricable de dégradation matérielle et sociale, de besoins exacerbés et insatisfaits et de conscience diffuse et latente, le prolétariat à utiliser le seul moyen qui lui reste pour satisfaire ses besoins : l’affirmation de la classe-pour-soi. Cette affirmation se présente au début sous la forme de feux de paille brefs, mais tendra de plus en plus à dévoiler son contenu communiste. Dans la classe-pour-le-capital, la conscience du processus de maturation est encore embryonnaire, non développée, fragmentaire, partielle, et trouve son expression la plus avancée, et donc la plus explicite à ce moment, dans les fractions communistes, et son expression implicite, atomisée et plus hétérogène dans la désertion des syndicats, les grèves sauvages, la méfiance à l’égard du capital, le cynisme envers le patriotisme, etc.
B. - Quand nous disons que la classe s’unifie en dehors du terrain revendicatif, nous ne décrivons pas une forme précise de lutte, mais nous explicitons l’essence du processus. Un surgissement peut apparaître à partir de n’importe quoi: 2 centimes, 20 centimes, une répression policière, un accident du travail, une décision du gouvernement, un événement politique, le meurtre d’un ouvrier ou, comme cela arrive très souvent, rien du tout : une rumeur, un chef qui insulte un ouvrier, et même un mot d’ordre syndical. Ce qui caractérise le mouvement de la classe-pour-soi, ce n’est pas ce qui le déclenche, mais que ce qui le déclenche est secondaire, fortuit -un véritable prétexte. Ce qui est frappant, c’est que même lorsqu’il subsiste une revendication, celle-ci passe à l’arrière-plan, et que l’énergie, l'"irréalisme", l’extension, les moyens mis en œuvre n’ont aucune commune mesure avec la revendication. Ces surgissements sont inéquivoques et il faut être un bonze syndical ou un nostalgique du passé pour ne pas déceler leurs traits caractéristiques: ou bien il n’y a pas de revendication ou bien tout le monde se fout des ”revendications” ; ce n’est pas que les besoins matériels ne s’expriment pas, au contraire, la révolte sociale, générale, exprime la seule véritable nécessité matérielle que peut ressentir la classe en tant que classe face à la dégradation de toute la vie sociale, c’est-à-dire la transformation des rapports sociaux. Et la classe tente de répondre à ses besoins matériels de la seule façon possible à notre époque, en étendant la lutte, en dépassant la fragmentation de la classe-pour-le-capital, en "oubliant” le rapport salarié et en s’affirmant de manière révolutionnaire, c’est-à-dire : communiste.
C. - Pour ceux qui lisent de travers, rappelons qu’il a déjà été indiqué ("Perspectives...", n°7) qu’il ne faut pas considérer qu’il y aura un seul surgissement, mais bien des cycles : luttes revendicatives / défaites de la classe-pour-le-capital / exaspération-apathie / surgissements de la classe révolutionnaire / nouvelles tentatives de se défendre comme travail salarié / etc. Nous n’avons formulé aucun pronostic sur la forme précise, le nombre et le rythme de ces cycles, car c’est impossible. Tout au plus pourrait-on avoir des hypothèses intuitives à ce sujet. Par contre, ce dont on ne nous fera pas départir, à moins de nous apporter des arguments sérieux, c’est de la discontinuité fondamentale, de la rupture entre classe-pour-le-capital et classe-pour-soi, travail salarié et négation du travail salarié. Ce qui est commun, continu, qui fait le "pont” entre la fin d’un cycle de luttes revendicatives et le début du mouvement de la classe-pour-soi, ce qui, dans la négation, assure l’identité de la classe, c’est la position matérielle du noyau (grandes usines, etc.) de la classe- pour-le-capital et de la classe-pour-soi, qui est le même. C’est la continuité dans la négation.
D.- Le rôle des fractions qui se disent communistes au sein du prolétariat est d’indiquer la perspective de cette rupture en explicitant le processus de maturation silencieux au sein de la classe. Si les révolutionnaires ne le disent pas, qui le dira ? Ils n’ont pas l’illusion qu’ils pourraient avoir une influence très large tant que la classe elle-même n’a pas entamé un processus de dépassement des combats salariaux, mais ils font partie du mouvement de décantation, l’accélèrent dans la mesure de leurs moyens et, surtout, accomplissent sérieusement leur fonction spécifique, qui reste essentiellement d’indiquer et d’approfondir ce que le mouvement dans son ensemble sera contraint de faire. Même lorsque ce travail reste sur tout théorique, ils sont pratiquement, activement une partie intégrante du mouvement qui se déroule dans les cerveaux et la pratique de millions d’hommes. Ceux qui en douteraient exprimeraient simplement leur mauvaise conscience de ne pas faire ce travail. Quant à la question de savoir s’il faut intervenir plus ou moins, où, comment, est une question qu’il ne leur appartient pas de résoudre abstraitement, mais que le mouvement leur impose. De même que le mouvement oblige tous les prolétaires à réfléchir à certains moments, à intervenir à d’autres, de même il impose aux révolutionnaires de doser leur activité "théorique” et "pratique" en fonction du moment de la lutte de classe. Là encore, les fractions communistes sont "coupées" de la classe lorsque celle-ci est coupée d’elle-même (division de la classe-pour- le-capital) . Les "révolutionnaires" sont isolés des "ouvriers" parce que les ouvriers sont isolés les uns des autres. Les révolutionnaires sont contraints à un travail de réflexion, de maturation, d’intervention réduite, comme toutes les fractions de la classe. Ceux qui ne le comprennent pas sombrent dans l’activisme, le volontarisme et l’organisation artificielle.
[1] Cette phrase très profonde éclaire la question des comités de grèves sauvages (organes temporaires qui se dissolvent après la lutte). S’ils agissent comme des organes de négociation, ils sont en fait des syndicats et se retournent contre la classe. Par contre, s’ils sont un moment dans le dépassement de la lutte salariale, alors ils ont une fonction pour la classe. La formation d’un comité de grève contre les syndicats existants exprime un moment contradictoire dans le processus de maturation de la classe-pour- le-capital : les ouvriers accèdent pratiquement à la conscience de la nécessité de détruire la forme syndicale, mais continuent à tenter de lutter comme travail salarié. Cette contradiction est insoutenable : soit le comité de grève se transforme en syndicat et c’est son arrêt de mort comme agent prolétarien, soit il se transforme en organe de la classe-pour-soi et son contenu change complètement. Le rôle des révolutionnaires n’est pas de préconiser ou d’encenser de tels comités, mais, lorsqu'ils naissent, d’œuvrer à ce que la classe les dépasse. Il n’y a pas de syndicat "anti-syndical". C’est très logiquement que les ouvriers de Renault, en 1947, étaient conséquents en exigeant que le comité de grève aille jusqu’au bout de sa logique d’instrument revendicatif : se transformer en un syndicat (le Syndicat Démocratique Renault, S.D.R., trotskyste).
Vie du CCI:
- Débat [1]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Revolution Internationale N°10 - juillet-août (nouvelle série)
- 24 reads
Rubrique:
LES ELECTIONS CONTRE LE PROLETARIAT
- 53 reads
LES GAUCHISTES TELS QU’EN EUX-MEMES
Une fois de plus, le terrain des élections s'est montré un excellent révélateur du caractère contre-révolutionnaire des groupes gauchistes de tout acabit.
Après les élections anglaises, où les gauchistes nationaux avaient appelé à voter travailliste après l'une des plus grandes grèves qu'a menée le prolétariat des mines, les élections françaises de mai 1974 ont permis aux gauchistes nationaux de se vautrer dans l'électoralisme.
La plupart des groupes gauchistes français, qui s'étaient développés depuis 1965, en partie sur leur opposition au soutien de Mitterrand par le PCF, lors des présidentielles, proclament ouvertement qu'"il faut voter Mitterrand", ancien garde des Sceaux sous la IVe République. Mieux, ils font spécialement campagne pour lui au second tour, en se glorifiant, comme l'affirmait L.O. après le premier tour, d'avoir ramené à la gauche les voix des ouvriers dégoûtés par le même Mitterrand. L'utilisation de la radio et de la télévision leur a permis de bavarder sans retenue sur la "démocratie pour tout le monde" (heureux patronat qui, grâce aux gauchistes, pourra exploiter très démocratiquement les ouvriers.), d'inviter , très sérieusement, Mitterrand à "ne pas faire à de compromis avec la bourgeoisie" (Krivine), de décréter sans rire que le socialisme c'est "l'égalité devant la loi et l'argent" (Laguiller).
Il n'y a là nul "opportunisme" des gauchistes, à qui l'électoralisme ferait perdre leurs principes révolutionnaires. Le terrain pourri des élections a mis à nu leur nature d'agents de la bourgeoisie. Contrairement à ce qu’affirment les journalistes du "Prolétaire", ces théoriciens professionnels du gauchisme, les organisations gauchistes, comme L.O., n'"abandonnent pas le marxisme", n'ayant jamais été sur son terrain. On ne peut pas plus les taxer de "centristes", une organisation ne pouvant avoir une double nature de classe. Quant à l'opportunisme, dans le sens donné par Lénine, c'est une maladie grave qui ne peut se manifester que dans le camp prolétarien. Les gauchistes, sans aucun "opportunisme", ont fait très bien leur travail en poussant les ouvriers combatifs vers les urnes. Remercions- les pour leur campagne : gageons qu'elle amènera les ouvriers avancés à comprendre la nature capitaliste du gauchisme !
POURQUOI ROUVRIR LE DEBAT ?
Depuis longtemps, en effet, la question des élections n'en est plus une pour les révolutionnaires. La Commune de 1871 puis la vague révolutionnaire des années 1917-21 ont montré, dans la pratique, non seulement que la dictature prolétarienne devait nécessairement passer par la destruction du parlement, rouage de l'Etat bourgeois, mais encore que le parlementarisme dit "révolutionnaire" et, plus généralement, toute participation aux élections ne sont qu'un substitut à la lutte de classe, empoisonnant le prolétariat d'illusions démocratiques. Le passage des partis communistes a la contre-révolution, accéléré par leur "parlementarisme révolutionnaire", devait prouver, ainsi que les gauches italienne, allemande et hollandaise des années 1930 le soulignèrent, puis, avec force, "Internationalisme" après la deuxième guerre, que désormais l'antiparlementarisme, la non-participation aux élections, était une des frontières de classe entre organisations prolétariennes et organisations bourgeoises.
Nous n'avons nullement l'intention d'ouvrir une polémique avec les gauchistes pour leur montrer qu'ils sont dans l'"erreur". Ils n'appartiennent pas au camp du prolétariat, et contrairement aux utopistes, nous né pensons pas que l'on puisse gagner la bourgeoisie -fût-ce sa fraction la plus à gauche- aux idées révolutionnaires. Nous ne devons pas cesser de combattre ceux dont le rôle est d'entraîner le prolétariat sur le terrain de prétendues "réformes". Nous devons dénoncer sans pitié devant le prolétariat cette "opposition de Sa Majesté le Capital", qui voit dans les élections une soupape de sûre- té -rêvée au mécontentement ouvrier, et invite donc les prolétaires à "manifester leur mécontentement", "avertir la bourgeoisie"...
Si nous remettons sur le tapis la question des élections, c'est que dans la période révolutionnaire qui s'annonce, une fraction du prolétariat révolutionnaire peut être amenée, faute d'une continuité organique avec le passé révolutionnaire de sa classe, à envisager une intervention sur le terrain des élections. Le mythe de la "tribune" (utilisation de la radio et de la télévision pour une "propagande révolutionnaire") risque de faire encore -du moins au début de la révolution- des ravages dans les rangs du prolétariat. Mais le danger le plus grave que court le prolétariat, au cours de la révolution, est encore son envoi de députés dans des formes rénovées et camouflées de parlements, par la transformation des soviets, organes de lutte du prolétariat, en assemblées consultatives dominées par les réformistes : "communes" locales rattachant le prolétariat à sa localité. Le "Grand Conseil ouvrier" de Budapest, en 1956, n'était qu'un parlement camouflé en conseil ouvrier, dont le but était de diluer la classe ouvrière hongroise dans la bourgeoisie et la petite-bourgeoise, derrière des mots d'ordre patriotiques. C'est ce qui faillit se produire en Russie avec les mencheviks jusqu'en septembre 1917 ; c'est ce qui se produisit effectivement en Allemagne, où la social-démocratie se chargea de transformer les conseils en chambres d'enregistrement de sa politique contre-révolutionnaire. C'est la maturité, la haute conscience de sa mission historique qui permet au prolétariat de donner un sens révolutionnaire au fait qu'il délègue ses pouvoirs à des députés ouvriers.
Voilà pourquoi notre position sur les élections -déjà abordée en détail dans R.I. n° 2, nouv. Série- doit être de nouveau affirmée. Avant de voir pourquoi les élections ne sont plus un terrain ou une tribune pour les ouvriers, il est nécessaire d'éclairer la question de l'antiparlementarisme, et donc de 1'abstentionnis me, à la lueur de l'expérience du prolétariat.
LA QUESTION DES ELECTIONS AU XIXe SIECLE
Au XIXe siècle, le parlement était le centre de la vie politique bourgeoise : c'est là que légiférait la classe dominante. Le prolétariat, à l'époque où le réformisme était possible non seulement, mais un mal inévitable, pouvait jouer des rivalités au sein de la bourgeoisie pour faire passer des réformes permettant d'améliorer sa position au sein du système capitaliste. Alors que le prolétariat se développait en nombre, les élections permettaient à la classe de se compter, de prendre conscience de sa force et de sa différence d'avec toutes les autres classes. Sur la participation aux élections, l'accord était total entre réformistes et révolutionnaires. Les révolutionnaires, eux, mettaient en garde sur le danger de corruption représenté par le parlement : ils dénonçaient le "crétinisme parlementaire", le parlement dont le rôle était de régulièrement "représenter" et "fouler aux pieds" la population laborieuse. De toute façon, pour les marxistes, le parlement était secondaire par rapport au terrain de la lutte de classe. C'était un mal inévitable en l'absence de luttes révolutionnaires, auquel le prolétariat payait un lourd tribut par des compromissions en tout genre. Seuls les anarchistes étaient par principe contre toute participation aux élections. Pour les "individualistes" dont la devise était "Ni Dieu, ni maître", le prolétariat qu'ils considéraient non comme une classe mais comme une somme d'individus, ne pouvait être représenté, d'après eux. Les partis sociaux-démocrates, en déléguant des députés au Parlement, aliénaient la volonté individuelle de chaque ouvrier. Les bakouninistes pensaient que la révolution était à tout moment à l'ordre du jour, appelaient au boycott du Parlement, et à la "propagande par le fait". En fait, la raison majeure de leur abstentionnisme était leur opposition à la formation du parti politique du prolétariat et à toute lutte politique pour le pouvoir.
Après 1914, lorsque le prolétariat rejette le Parlement, la non-compréhension du changement de période devait permettre à l'IC de qualifier d'"anarchistes" les gauches italienne et allemande, oubliant ce que disait Lénine de Kautsky, que "l'une des méthodes les plus sournoises de l'opportunisme consiste à répéter une position valable dans le passé" ("Le renégat Kautsky").
En effet, après 1914, avec la crise historique du capitalisme s'affirme le déclin du Parlement. Le centre politique de la bourgeoisie se déplace du législatif vers l'exécutif (Etat fort ou dictatorial). Les révolutionnaires sont unanimes pour reconnaître que l'alternative est désormais : socialisme ou barbarie; l'ère du réformisme est définitivement close; le prolétariat ne peut plus obtenir de réformes, ni par le syndicat, ni par le parlement qui devient l'ultime mystification de la bourgeoisie (Assemblées constituantes en Russie et en Allemagne).
Sur cela, les révolutionnaires étaient d'accord : le débat devait porter sur ce que Lénine appelait la "tactique". C'est sur cela que vont s'affronter bolcheviks et gauches européennes.
LE DEBAT DANS L'I.C.
Position des bolcheviksLes bolcheviks, contrairement aux gauchistes qui se revendiquent d'eux, a-
vaient, lorsqu'ils défendaient l'idée d'un "parlementarisme révolutionnaire", le souci constant de dénoncer le rôle du Parlement comme instrument de l'Etat bourgeois; leurs tracts les plus durs allaient contre le crétinisme parlementaire des sociaux-démocrates auxquels ils opposaient l'exemple de Liebknecht dénonçant en pleine guerre l'impérialisme allemand.
Leur position était d'ailleurs déterminée par la lutte de classe : en 1906, ils appelaient au boycott de la Douma, alors que la vague révolutionnaire de 1905 n'était pas encore tombée; en 1907, début du recul du prolétariat russe, ils envoient des députés à la même Douma. En Septembre 1917, ils se retirèrent du Pré-parlement. C'est le reflux de la vague prolétarienne dès 1920, qui les amena à remettre à l'honneur, au IIe Congrès de l'I.C., l'idée du "parlementarisme révolutionnaire", totalement absente au 1er Congrès.
Mais, ne comprenant pas que la nouvelle période entraînait l'abandon du terrain des élections, les bolcheviks et l'IC reprirent intégralement la vieille idée social-démocrate du Parlement, arène de la lutte de classe : "..., les intérêts et les conflits de classes se reflètent dans le Parlement" (Lénine). On pouvait entendre de la bouche de Lénine, au IIe Congrès, ceci : "... l'on peut tendre à détruire une organisation en y entrant (sic), en l'utilisant".
De détruire de l'intérieur, à la conquête du Parlement,... il n'y avait qu'un pas... vite franchi. D'abord la dénonciation des sociaux-démocrates comme piliers du capitalisme, se transforma très rapidement en collaboration de classe avec la social-démocratie ("gouvernement ouvrier" en 1923 en Allemagne); le "parlementarisme révolutionnaire" du IIe Congrès ne fit qu'ouvrir la voie au frontisme du IIIe Congrès dont se revendiquent, à juste titre, les gauchistes d'aujourd'hui.
La rapide mainmise des Cachin, Smeral, Lévi, sur les P.C., la prépondérance des chefs parlementaires "communistes" à la tête des partis transformèrent rapidement les nouveaux partis en bouges électoraux. Tel fut le haut fait du parlementarisme révolutionnaire.
Position des gauches communistesC'est contre cet abandon du terrain de classe que réagirent les gauches italienne, et surtout allemande et hollandaise.
Les gauches communistes insistaient sur le changement de période : le prolétariat ne pouvait plus employer les mêmes méthodes de lutte que par le passé. Il s'agissait de choisir entre préparation électorale et préparation révolutionnaire, dans le cours descendant du capitalisme qui ouvre la voie à la révolution mondiale. C'est ce que sentait Bordiga, même s'il limitait la non-utilisation du Parlement aux pays capitalistes avancés, lorsqu'il déclarait dans les "Thèses de la gauche italienne", présentées au IIe Congrès :
- "Dans la période historique actuelle (ouverte par la fin de la guerre mondiale, avec ses conséquences sur l'organisation sociale de la bourgeoisie; par la révolution russe, première réalisation de la conquête du pouvoir par le prolétariat, et par la constitution de la nouvelle Internationale en opposition au social-démocratisme des traîtres) et dans les pays où le régime démocratique a depuis longtemps achevé "sa formation, il n'existe plus, au "contraire, aucune possibilité d'utiliser la tribune parlementaire pour l'œuvre révolutionnaire des communistes, et la clarté de la propagande non moins que la préparation efficace de la lutte finale pour la dictature exigent que les communistes mènent une agitation pour le boycottage des élections par les ouvriers".
(On voit qu'à l'époque, il ne se trouvait pas de savants littérateurs "bordiguistes" pour disserter sur l'invariance du marxisme de 1847 à nos jours, sur la continuité "invariante" de la "tactique").
Néanmoins, c'est la gauche allemande qui avait la vision la plus claire; elle voyait très bien que la période ouverte par 1917 était celle du combat des masses prolétariennes donnant le meilleur d'elles-mêmes, et non plus celle de la social-démocratie (celle du jacobinisme de "Que Faire ?"), où des "chefs ouvriers" se substituaient à l'action des masses et discutaient avec les autres classes au sein du Parlement.
- "Le parlementarisme est la forme typique de la lutte par le moyen des chefs "où les masses elles-mêmes jouent un "rôle secondaire. Sa pratique consiste dans le fait que des députés, des personnalités particulières mènent la lutte essentielle. Ils doivent, par conséquent, éveiller dans les masses l'illusion que d'autres peuvent mener la lutte pour elles..."(Pannekoek).
La révolution mondiale demande que le prolétaire s'engage totalement, sans déléguer sa force vive à des chefs, pour s'émanciper par ses propres forces :
- "Vient la révolution. Maintenant (le prolétariat) doit faire tout par lui-même. L'ouvrier doit lutter seul avec sa classe contre le formidable ennemi, doit mener la lutte la plus terrible qui se soit jamais vue au monde... S'il fait confiance à ses chefs ou à d'autres classés au Parlement, un grand danger le menace : qu'il retombe dans "son ancienne faiblesse en laissant "agir les chefs, qu'il s'en remette à "son Parlement, qu'il se confine dans "la fiction selon laquelle d'autres "peuvent faire la révolution pour lui, "qu'il poursuive des illusions, qu'il "reste enfermé dans l'idéologie bourgeoise" (Gorter."Réponse à Lénine").
Cette position intransigeante de la gauche allemande ne fut pas tenue avec la même fermeté de principe par la gauche italienne.
Contrairement à ce que la gauche italienne affirmait et encore maintenant ses pâles épigones du P.C.I., il ne s'agissait nullement d'un débat sur l'utilisation tactique du Parlement, mais bien de la question de principe de la non-participation aux élections. A l'heure où le prolétariat révolutionnaire se moque bien de ces subtilités "tactiques", cette question devenait le point de rupture entre communistes et sociaux-démocrates reconvertis de fraîche date au communisme. N'en déplaise au P.C.I., la gauche italienne reconnaissait que c'était malgré tout une question fondamentale, ne serait-ce qu'en se constituant en fraction abstentionniste (1919). La soumission de Bordiga à l'I.C. allait entraîner la participation du P.C. d'Italie aux élections et précipiter la dégénérescence de ce parti. Qu'on en juge par cette proclamation de Bordiga lui-même (1924} qui flaire l'électoralisme le plus grossier :
- "Tout bon communiste n'a qu'un devoir : c'est de combattre... la tendance à l'abstention de nombreux prolétaires, conclusion erronée de leur hostilité au fascisme. En agissant ainsi, nous ferons une excellente propagande et nous contribuerons à former une conscience résolument révolutionnaire..." (Stato Operaio. Février 1924).
Telle était 1'utilisation "conséquente" -mot qu'affectionnent particulièrement les bordiguistes pour les zig-zig de leur invariance- du parlementarisme révolutionnaire : ramener les prolétaires combatifs et révolutionnaires sur le terrain électoral.
Il faut sans doute voir là l'origine de l'électoralisme du P.C.I. qui se présenta aux élections de 1948 en Italie (voir Bulletin d'Etude et de Discussion n° 7) tout en se déclarant par principe abstentionniste. Jusqu'à il y a peu de temps, le P.C.I. n'était plus pour le parlementarisme révolutionnaire, sauf ... "chez les peuples de couleur", "dans les pays où la révolution bourgeoise est encore en cours et où le parlement conserve son caractère originel d'institution anti-féodale et donc historiquement révolutionnaire (Russie 1917, pays coloniaux arriérés de 1920 et en partie d'aujourd'hui)". Mais la vertu des élections italiennes récentes, a ramené les courageux partisans de l'abstentionnisme sur le terrain des urnes : à l'occasion du referendum sur le divorce, "Programme Communiste" (n°9) a appelé les prolétaires à se prononcer en faveur du divorce sans appeler à voter. Le plus comique était que la section française du P.C.I., apparemment ignorante de ce fait, ou peu soucieuse d'en faire part aux lecteurs du Prolétaire, au même moment jetait ses foudres sur l'électoralisme des gauchistes. Vérité au-delà des Alpes, erreur en deçà. ? Nous attendons le point de vue "officiel" du P.C.I., qui n'a plus d'"international" que le nom et apparaît au grand jour comme une fédération de sections social-démocrates, cédant de plus en plus aux préjugés du prolétariat local[1].
LES ELECTIONS, NEGATION DE LA CLASSE OUVRIERE
L'expérience faite par le prolétariat des élections, il devait la payer chère dans les années 1930 : utilisation des élections pour l’embrigader dans la guerre (fronts populaires français et espagnol) comme chair à canon.
Le caractère totalitaire des élections est confirmé par la tendance mondiale à rendre obligatoires les élections tout comme les syndicats,(Belgique, pays du Tiers Monde légalement; pays à capitalisme d'Etat dans les faits). Ainsi partout a été mis en place le mécanisme de la démocratie bourgeoise. Les bourgeoisies qui proclament, en France, que le vote est plus un devoir qu'un droit, sont parfaitement conscientes du rôle mystificateur, totalitaire du vote dans le prolétariat. Les journalistes bourgeois qui se réjouissaient de l'exceptionnelle participation électorale pour le second tour des présidentielles étaient plus futés que tous ces théoriciens du "vote de classe", "utile", "révolutionnaire", "ouvrier", etc. Giscard aussitôt a d’ailleurs accordé le vote à 18 ans, revendiqué par le P.C. et les gauchistes.
Beaucoup diront : c'est vrai; mais malgré tout le vote est un signe du degré de la lutte de classe. Nous répondrons qu'on ne saurait tirer aucun argument de ce que les ouvriers votent en masse ou ne votent pas : cela peut montrer aussi bien une démoralisation profonde du prolétariat qu'une remontée de ses luttes et de sa combativité. La signification du vote global des ouvriers n'est que le reflet déformé du moment (recul ou remontée des luttes du prolétariat) . Avant toute chose, le vote des ouvriers ne peut que refléter les illusions profondes de leur classe sur la démocratie, ou leur attachement aux traditions électorales.
Mais avant toute chose, l'électoralisme est la négation absolue de la classe ouvrière. Même s'ils croient s'exprimer par le bulletin de vote (pour exprimer leur mécontentement), les ouvriers sont mystifiés enfermés, individu par individu, dans un isoloir, ils ne font qu'exprimer leur impuissance. En effet, le prolétariat, classe atomisée par la division du travail au sein de la société capitaliste (usines, ateliers, avec toute la hiérarchisation qui l'accompagne (qualifications) voit son atomisation renforcée par tout le jeu de la démocratie bourgeoise. Alors que même en l'absence des luttes revendicatives, même écrasé, le prolétariat existe en soi au sein de la société capitaliste, les élections ont pour fonction d'en faire une masse d'individus, atomes isolés, des "citoyens" privés de leur qualité de prolétaires. Le vote ne fait qu'isoler le prolétaire de sa classe, en fait un esclave docile prisonnier de la mystification démocratique, un "citoyen" comme les autres lié à sa "nation" à un prétendu intérêt commun, celui du capital national.
Le vote donne carte blanche à la bourgeoisie pour sa politique. C'est les élections de 1933 qui ont permis à Hitler de parachever le massacre du prolétariat allemand commencé par ses collègues sociaux- démocrates 'en 1919-1923. Les élections sont la corde que donne la bourgeoisie au prolétariat pour se pendre. Telle est la fonction du vote aujourd'hui : l'égalisation démocratique du pouvoir bourgeois. Noyés dans, un cloaque de bourgeois, épiciers, cadres, etc. le vote ne saurait permettre aux ouvriers révolutionnaires de se compter. Il y a tout un monde entre l'individu ouvrier qui vote et l'ouvrier qui lutte, participe à des grèves sauvages (ce sont parfois les mêmes ouvriers combatifs qui peuvent voter à droite) Le vote rend inconscient de sa force l'ouvrier le plus combatif.
Le mensonge de la "tribune"Mais le fin du fin de la justification de la participation aux élections, est de dire qu’on n’appelle pas à voter mais qu'on fait campagne pour utiliser la "tribune" des moyens de diffusion bourgeois.
Supposons une organisation qui aujourd'hui n'appellerait pas à voter mais se présenterait pour dénoncer impitoyablement le capital et ses agents (P.C., gauchistes): elle ne saurait être entendue en période de non-surgissement du prolétariat; pour se faire entendre, il faudrait faire des compromissions, pour se faire "comprendre", et donc flatter les préjugés des ouvriers. Se présenter aux élections, en période révolutionnaire où le prolétariat se lance dans l'action les armes à la main, relèverait d’une pure trahison.
Mais surtout, parler d'agitation, de "tribune" dans des périodes où le prolétariat ne se manifeste pas comme classe, est une mystification: les révolutionnaires, ultra-minoritaires en temps de calme social, d'intégration du prolétariat au capital par les syndicats, ne peuvent agiter que du vent! L'agitation des révolutionnaires ne peut plus s'effectuer que dans la lutte révolutionnaire de la classe, dans les usines et dans la rue. Mais le caractère le plus frappant de cette "tribune", c'est qu'elle est une tribune de théâtre dont on présente les marionnettes aux prolétaires, derrière l'écran d'une télévision.
Le jeu est réglé d'avance avec ses personnages principaux (Giscard, Chaban, Mitterrand) et ses bouffons (Dumont, Laguiller, Le Pen). Pour faire sérieux, tout doit donner l'impression de liberté, de démocratie - : on peut voir Krivine parler de révolution, de communisme; Arlette dénoncer la misère et l'exploitation et (démocratie oblige) les "abus" de la police. Dumont, bouffon attitré, peut faire son numéro de clown sur l'écologie. Tout ce bric-à-brac à idées et ce clinquant de liberté démocratique doivent donner l'impression au prolétariat que les élections c'est à la fois beau et sérieux. En effet, tout cela a pour fonction d'endormir la conscience du prolétaire devant son poste de télévision : au XIXe siècle, la religion était la consolation du prolétariat; au XXe, à l'époque où la religion ne fait plus recette, les élections — ce petit moment où surgit la politique au-delà de l'usine quotidienne — constituent le nouvel opium du prolétariat.
C'est pourquoi, dans ce ballet réglé à l'avance par la bourgeoisie, de prétendus révolutionnaires qui feraient campagne (même sans appeler à voter), ne pourraient que compléter le théâtre de marionnettes de la bourgeoisie; ils donneraient l'impression au prolétariat que, malgré tout, même s'ils disent la vérité ("Arlette dit la vérité" se disent les ouvriers, bien illusionnés sur le caractère révolutionnaire de la propagande de celle-ci), la "démocratie bourgeoise" du bon. Même les rouges peuvent s'exprimer !
LES REVOLUTIONNAIRES NE SONT PAS « ABSTENTIONNISTES »
Cependant, si la non-participation aux élections est une position active dans le camp révolutionnaire, elle ne saurait être un label de classe. Il suffit de rappeler que les gauchistes, unanimement, boycottèrent les élections de Juin 1968. Demain, si la classe ouvrière déserte le terrain électoral, les gauchistes se proclameront abstentionnistes pour ne pas se démasquer devant le prolétariat. On a pu voir d'ailleurs, lors de ces dernières élections présidentielles, maoïstes et anarchistes rivaliser d'abstentionnisme : 1'Humanité Rouge qui n'a de rouge que le sang des ouvriers massacrés par ses ancêtres staliniens, dénonçaient en Mitterrand un mauvais -patriote "bradant l’indépendance nationale au profit du social-impérialisme soviétique" (ce qui est faux, étant donné les sympathies atlantistes de Mitterrand); "Front Rouge" fort marri de n'avoir pu présenter son super patriote F.T.P., André Roustan, appelait aussi à l’abstention. Idem pour les francs- maçons et bourgeois libéraux du Monde Libertaire qui titrait "Elections, piège à cons", "oubliant" son soutien électoral au Front Populaire espagnol de 1936. En fait, ce qui déterminait anarchistes et maoïstes, c'était l'espoir de recruter les éléments dégoûtés par l'électoralisme des trotskystes et non des principes politiques. (Le plus comique de la campagne présidentielle aura été de voir les jeunes U.J.P. appeler à 1'abstention!).
Tout cela montre que les révolutionnaires ne peuvent en aucun cas se définir comme abstentionnistes, comme le faisait la gauche italienne en 1919. Aujourd’hui, faire campagne pour l'abstention ne ferait que donner une valeur au vote et même indirectement rentrer dans le grand jeu électoraliste par le décompte des "voix" abstentionnistes. Les communistes se battront bec et ongles en période révolutionnaire contre la gauche et les gauchistes qui manœuvreront tout ce qu'ils pourront pour amener les ouvriers à voter; à ce moment-là, les révolutionnaires et leur classe boycotteront par la violence les urnes; il n'y aura là aucune position abstentionniste qui, comme l'indique le terme, est purement défensive et passive.
Contrairement à ce que certains pourraient croire, nous ne nous définissons pas comme antiparlementaires, anti-syndicats ou anti-luttes de libération nationale. Les révolutionnaires ne peuvent se définir comme "anti-quoi que ce soit". Ils ne sont pas une collection de positions, même si des positions de classe, chèrement acquises par 1e prolétariat, permettent de les distinguer des agents gauchistes du capital. Les révolutionnaires sont une cristallisation consciente, organisée, du combat sans merci qui conduira le prolétariat à s'affirmer mondialement par la destruction politique de la bourgeoisie, ouvrant ainsi le règne de la société sans classes délivrée de l'esclavage salarié.
Chardin
[1] "Il s'agit de dire à la poignée de prolétaires que nous touchons par notre presse et notre intervention orale qu'il n'est pas indifférent (sic) à nous communistes que les prolétaires puissent ou ne puissent pas divorcer".(Programme Communiste n°9).
De plus en plus le P.C.I. apparaît comme une secte gauchiste trouvant au prolétariat des "acquis" à défendre (divorce) dans la société capitaliste, abandonnant l'abstentionnisme pour l'électoralisme honteux et le frontisme le plus vigoureux.
Questions théoriques:
- Démocratie [13]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
La bourgeoisie face à la crise (1ère partie)
- 15 reads
Nous commençons ici la publication d'un article du groupe Internationalism de New York où il est principalement question des effets de la crise mondiale sur les économies des États-Unis, du Japon et de l'Europe occidentale, et de la réponse que tentent d'y apporter les diverses bourgeoisies. Dans l'article "Crise économique et capitalisme d'État en Amérique du Sud ("Internationalism" n° 1) étaient analysées la crise et la réponse de la bourgeoisie dans le Tiers Monde. Cette analyse fut poursuivie avec l'article "l'irrésistible Chute d'Allende" ("Internationalism" n° 4). Dans des numéros ultérieurs d“Internationalism", il est prévu une analyse de la manière dont la crise affecte la Russie, les pays d'Europe orientale et la Chine.
La crise est là. Le premier trimestre de 1974 a été tellement désastreux pour l'économie américaine que la bourgeoisie elle-même a dû, pour décrire cette situation, utiliser un terme banni du vocabulaire capitaliste depuis trente ans, le mot : crise. La production globale, ainsi que l'indique le PNB, est tombée à - 5,8 % l'an ; les prix à la consommation ont monté au rythme de 14,3 %, et le chômage grimpe à 5,1 %, selon les données officielles, qui masquent une part importante du chômage réel.
Partout, la crise sape les bases fragiles de l'édifice capitaliste. Ses trois principales manifestations sont :
- chute de la production,
- chômage croissant,
- inflation galopante.
Les fluctuations du PNB ne peuvent en aucun cas donner une image précise des variations dans la production ; de telles données néanmoins peuvent indiquer la tendance générale vers la stagnation ou la baisse de la production qui frappent le monde capitaliste. Les graphiques suivants illustrent la détérioration des capitaux américains et japonais.
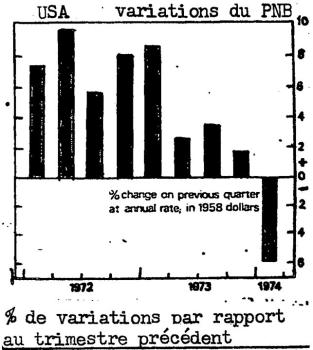
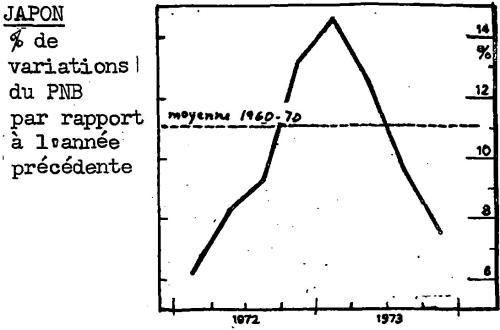
Le gouvernement japonais compte sur une croissance du PNB de 4,5% pour 1974. Mais, bien qu'un tel taux soit bien au-dessus de ce que les économies américaines et ouest-européennes à bout de souffle peuvent donner, il ne sera pas suffisant pour empêcher l'économie nipponne -habituée à un taux de croissance supérieur à 10 %- de tomber en vrille. La "croissance" au taux espéré ne sera pas assez forte pour éviter de sérieuses dislocations dans l'économie, un déferlement de banqueroutes et de luttes sociales. En Grande-Bretagne, le Trésor prévoit une baisse du PNB de 1% pour 1974, tout en misant sur une reprise de l'activité industrielle au cours du second semestre.
Le chômage .progresse à un rythme alarmant dans tous les pays capitalistes avancés. En Allemagne fédérale, il est passé de 273.000 chômeurs en 1973 à 517.000 en avril 1974. En France, il a grimpé de 210.000 en décembre 1969 à 430.000 en janvier 1974. En Grande-Bretagne, un rapport de l'institut national de recherche économique et sociale publié à la veille des élections générales prévoyait de 600.000 à un million de chômeurs pour la fin de l'année, sans tenir compte d'une éventuelle dégradation imprévue de l'économie. L'un des principaux porte-parole du capital britannique, le journal "The Economist", écrivait que "raisonnablement, le chômage pourrait même atteindre un million et demi de travailleurs l'hiver prochain, soit 6% de la force de travail" (6/4/1974).
L'inflation galopante a atteint des proportions catastrophiques dans les pays avancés. La bourgeoisie semble impuissante à contenir une inflation qui s'étend à une allure qui, jusqu'à présent, était le lot des pays sous-développés. Le Japon est le plus durement touché :
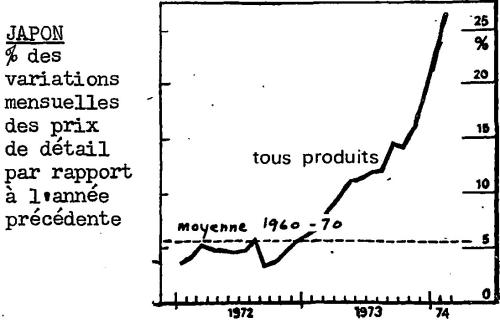
En Grande-Bretagne, les prix de détail augmenteront de 14 à 18% en 1974 ; et la situation présente mène à penser que cette estimation sera un minimum. En Allemagne, on prévoit un taux d'inflation de 10%, au Danemark il tourne maintenant autour de 16% l'an, et l'Italie semble tenir la tête avec un taux entre 18 et 20%. En France, pour le premier trimestre, les prix de détail ont progressé au rythme de 18% l'an.
Il y a quarante ans, l'état de santé de l'économie capitaliste pouvait être apprécié en prenant le pouls de la sidérurgie et de la métallurgie. Partout, les hauts barons de l'acier dominaient l'industrie capitaliste : Krupp et Vereinigte Stahlwerke en Allemagne, GKN Steel et Baldwins en Angleterre, Schneider et de Wendel en France, Bethlehem Steel et US Steel Corp. aux Etats-Unis. De nos jours, c'est l'industrie automobile qui est devenue la clé de voûte de l'édifice économique capitaliste. La santé d'une multitude d'industries -acier, pneus, verre, bureaux d'études- dépend de la prospérité des compagnies géantes d' automobiles. Une baisse brutale de leur production entraînerait des conséquences désastreuses pour toute l'économie. Et l'actuelle chute de production dans les pays avancés est précisément conduite par l'industrie automobile ! Volkswagen a annoncé le premier déficit de la compagnie depuis la dernière guerre mondiale : 34,4 millions de dollars pour le premier trimestre 1974. Encombrée d'un énorme stock de 472 000 véhicules invendus, elle a réduit les horaires de 45.000 ouvriers. En avril 1974, les ventes internationales de Toyota étaient de 32% inférieures à celles d'avril 1973, et celles de Nissan Motors chutaient de 33,4%. Citroën enregistre une baisse de ses ventes en France de 9% pour le premier trimestre, et des rumeurs circulent sur une éventuelle prise de participation de l'État pour sauver la société[1]. En mars, les ventes de véhicules ont dégringolé de 20 % en France par rapport à l'année précédente. En Italie, les affaires de Fiat tournent maintenant à moins de 15% de leur tenue déjà médiocre de l'année dernière. Aux Etats-Unis, toujours pour le premier trimestre, les ventes de Ford, General Motors et Chrys1er ont brusquement baissé, créant ainsi d'énormes parcs d'invendus. Lorsque les effets de ces baisses des ventes et de la production se seront répercutés à travers toute l'économie, la crise s'approfondira.
La bourgeoisie a réagi à la crise avec une panique qu'on ne lui avait plus vue depuis 1929. L'effondrement de la bourse de Londres le plus actif et le plus important, avec Wall Street, de tous les marchés boursiers est un signe révélateur de la peur qui s'empare de la bourgeoisie.
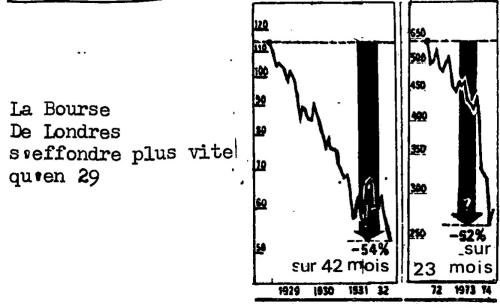
L'intensité de la crise économique a obligé les bourgeoisies nationales à tenter de définir une politique qui amortisse les chocs et protège le capital national. Les États capitalistes, impuissants à résoudre les insolubles contradictions du système, ont essayé, à travers une intervention politique, de "planifier" la crise pour l'atténuer. Les voies ouvertes à chaque État capitaliste pour retenir la débâcle quasi complète de sa propre économie et la chute "catastrophique" des profits du grand capital peuvent être classées en trois directions -chacune étant tentée simultanément avec les autres. La première voie consiste à tenter de détourner la crise sur un autre pays, ce qui laisse présager un accroissement des antagonismes inter-impérialistes. La seconde consiste à dévier la crise sur les secteurs faibles du capital, comme la petite-bourgeoisie et la paysannerie. Cela entraînerait une concentration et une centralisation du capital plus poussées, qui, prises en charge par l'État, accéléreraient la tendance vers le capitalisme d'État. La troisième voie revient à faire supporter la crise au prolétariat en s'attaquant à ses salaires et à ses conditions de vie, en programmant une austérité draconienne, etc. Dans cette tentative-ci, l'État le ferme soutien des syndicats.
Les deux dévaluations du dollar (août 1971 et février 1973) et la sensible réévaluation du mark et du yen ont été les deux premiers coups tirés dans la guerre commerciale que se livrent de plus en plus ouvertement les Etats-Unis, d'une part, et le Japon et l'Europe, d'autre part. Ces dévaluations ont contribué à restaurer la compétitivité du capital américain sur le marché mondial et à protéger son marché intérieur (aux dépens de l'Europe et du Japon). En 1973, des balances commerciales et des paiements positives ont permis au dollar de se rétablir. Le tableau suivant illustre l’irrésistible ascension du dollar contre les autres monnaies entre juillet 1973 (lorsqu’il fut annoncé que le solde de la balance commerciale était positif) et janvier 1974.
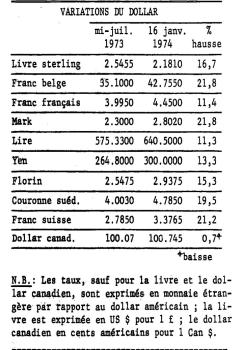
La manière dont les deux dévaluations du dollar furent appliquées et le fait que les bourgeoisies allemande et japonaise durent accepter une spectaculaire réévaluation de leurs monnaies qui affaiblit leur compétitivité sur le marché mondial démontrent à quel point l'Europe et le Japon sont dépendants du capital américain. La "crise du pétrole", particulièrement la hausse brutale des prix du brut, a encore plus fait pencher la balance en faveur des Etats-Unis.
Le tableau ci-après donne le montant des balances commerciales et des paiements pour 1973, ainsi que les estimations pour 1974, des Etats-Unis, du Japon et des principaux pays du Marché commun. Les estimations pour 1974 ont été calculées en tenant compte des effets de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz, et en présumant "que les principales nations industrielles parviendront à améliorer substantiellement leurs performances commerciales sauf en ce qui concerne le pétrole et le gaz" ("World Financial Markets" du 22/1/1974). Cette assertion, les événements de ces quatre derniers mois se sont chargés de la faire voler en éclats, comme nous le verrons plus loin.
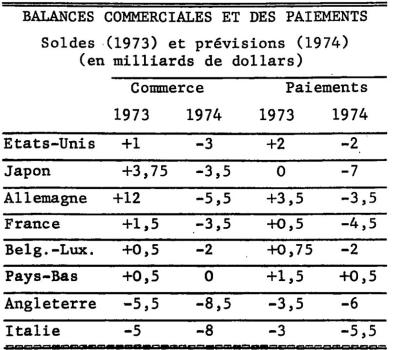
Devant l'impossibilité dans laquelle se trouvent tous ces pays d'augmenter leurs exportations et de diminuer leurs importations autres que celles de pétrole et de gaz, les déficits commerciaux et des paiements seront donc, pour au moins certains d'entre eux, bien plus importants que ces chiffres ne l'indiquent. Pour le moment, cependant, nous n'examinerons que les conséquences de l'augmentation des prix pétroliers sur la balance commerciale de ces huit pays.
Ce qui est frappant, c'est que le renchérissement du pétrole aura des effets beaucoup plus désastreux sur les économies japonaise et européennes que sur celle des Etats-Unis[2]; la Grande-Bretagne et l'Italie, déjà durement frappées par la crise avant même la hausse des prix du pétrole, auront, de ce fait, des déficits commerciaux "ingérables". Le Japon, la France, la Belgique et le Luxembourg, qui avaient un commerce assez notablement excédentaire, vont devoir faire face à un énorme déficit. Les États-Unis, quant à eux, même en perdant le bénéfice de l'excédent de leurs balances commerciales et des paiements, ne seront pas aussi durement touchés que leurs concurrents. Les bourses étrangères furent sensibles au fait que les Etats-Unis se montraient moins dépendants de l'étranger pour leur approvisionnement en énergie que la plupart des autres pays industrialisés, et qu'en outre ils possédaient une très grande capacité d'accroître leurs ressources énergétiques nationales. Au moment même où l'on annonçait, en octobre et décembre 1973, la hausse des prix pétroliers, le dollar reprit sensiblement de sa valeur sur le marché des changes.
Trouver le moyen de financer le déficit de leurs balances des paiements, prévenir l'affaiblissement de leurs monnaies, tel était, dans cette conjoncture le problème numéro un auquel les bourgeoisies européennes et japonaise durent s'affronter. L'inféodation complète de l'Europe et du Japon au capitalisme américain s'est douloureusement manifestée à cette occasion. L'Italie dut humblement aller quémander au FMI (dominé par les États-Unis) un crédit de secours de 1,2 milliard de dollars et, en outre, la couverture consentie à la Banque d'Italie par la Fédéral Reserve Bank de New York passa de 2 à 3 milliards de dollars. En Grande-Bretagne, le nouveau chancelier de 1'Echiquier, Denis Healy, dut s'agiter pour calmer l'affolement sur le sterling et redonner confiance aux milieux financiers internationaux et il négocia sur les chapeaux de roue et un emprunt de 2,5 milliards d’eurodollars (le plus formidable emprunt jamais réalisé sur ce marché !) et une extension de 2 à 3 milliards de dollars de la couverture accordée par la Fédéral Reserve Bank. Le gouvernement français dut s'endetter de 1,5 milliard dur le marché de l'eurodollar, et les banques japonaises profitaient de la suppression du contrôle américain sur les mouvements de capitaux pour décrocher d'importants crédits auprès de grandes banques américaines, tout en empruntant des eurodollars. La levée de ce contrôle, mis en place depuis dix ans, a été à la fois une expression de la compétitivité croissante du capital américain sur le marché mondial et un effort pour financer, dans un cadre général d'hégémonie américaine, les importations de pétrole du Japon et de l'Europe. Selon "World Financial Markets", "les États-Unis ont non seulement dû payer leurs propres importations de plus en plus cher, mais encore financer une part appréciable de celles d'autres pays[3]"(21/5/1974).
Le renchérissement des prix pétroliers a non seulement renforcé la dépendance financière structurelle de l'Europe et du Japon à l'égard des Etats-Unis, mais il a aussi, directement et indirectement, entamé la compétitivité de leurs marchandises par rapport aux biens américains. Le prix des marchandises européennes et japonaises s'est en effet alourdi avec 1' augmentation des prix du pétrole (plus force qu'aux Etats-Unis) et avec le fardeau que représentent les importantes dettes faites pour financer les énormes déficits des balances des paiements. Pour ne donner qu’un exemple, le récent emprunt britannique mentionné plus haut est assorti d' un intérêt d'environ 10,5% ! Confrontées à des balances commerciales déjà désastreuses, la dernière chose que pouvaient se permettre les bourgeoisies européennes et japonaise était un affaiblissement supplémentaire de leur position compétitive. La comparaison des balances commerciales américaine et anglaise au cours du premier trimestre de 1974 illustre à la fois les effets directs et indirects de la hausse des prix du pétrole. Le déficit global du commerce britannique était de 429 millions de livres en février et de 453 millions en mars. Le déficit dû aux produits pétroliers passait respectivement de 247 millions .à 294, tandis que celui dû aux autres produits baissait de 182 à 159 millions de livres. Ainsi, même mis à part le déficit pétrolier, la Grande-Bretagne traîne un déficit commercial spectaculaire, malgré une dévaluation de fait de 18% de la livre depuis décembre 1971 ! Et le relèvement économique que le gouvernement travailliste attendait de la fin de la semaine de travail de trois jours et d’un boom des exportations a fait long feu : en mai, le déficit du commerce britannique a atteint le record de 481 millions de livres...
Les Etats-Unis, pour leur part, présentait un solde bénéficiaire de 694 millions de dollars pour le premier trimestre, sans tenir compte du prix élevé du pétrole importé. En mars, alors que leur balance commerciale se détériorait gravement, le déficit n’atteignait que 171 millions de dollars -largement en dessous du record britannique de 453 millions de livres ! Et, à l'exception de l'Allemagne fédérale, le Japon et les autres pays européens font l'expérience, à un degré seulement un peu moins fort, des difficultés britanniques.
La tactique du capital américain
Alors que les deux dévaluations du dollar et les effets directs et indirects des prix plus élevés du pétrole ont sérieusement émoussé la compétitivité des produits japonais et européens sur le marché mondial et renforcé les liens de dépendance des pays capitalistes avancés à l’égard des Etats-Unis, la position du capital américain a été encore relativement améliorée par un autre effet de la hausse des produits pétroliers. Le transfert de milliards de dollars d'Europe, du Japon et des Etats-Unis aux pays producteurs soulève la question de la destination finale de ces fonds. Certains seront dépensés à la fois en biens de production et en biens de consommation (particulièrement pour importer d'indispensables produits agricoles), et la plus grande partie sera disponible pour investir à 1'"Ouest". Dans les deux cas, une énorme fraction de ces sommes ira aux États-Unis. Ainsi, en plein milieu de la crise qui s'approfondit, les Etats-Unis apparaissent comme une place relativement sûre pour des investissements, alors que le délabrement des économies européennes et japonaise n'offre que le risque d'une éventuelle tempête sociale.
De plus, l'industrie et l'agriculture américaines, plus compétitives, sont dans une meilleure position pour bénéficier des marchés ouverts dans les pays producteurs, lesquels constitueront un véritable canal pour le transfert pur et simple de richesses des économies affaiblies du Japon et de l'Europe vers l'économie américaine, plus robuste. Cela aggravera la crise dans ces pays et, dans une certaine limite, l'atténuera en Amérique.
Toutefois, la bourgeoisie américaine ne tient pas à ce que les économies européennes et japonaise s'effondrent. En premier lieu, les marchés qu'elles représentent sont les plus importants pour les produits américains, et si un choc trop rude les ébranlait, cela signifierait une réduction de la demande dont les exportations américaines souffriraient. En second lieu, le capital américain est profondément enraciné en Europe, particulièrement dans les industries les plus "modernes" (automobiles, électronique, pétrole, pétrochimie, produits pharmaceutiques, ordinateurs, etc.). Un effondrement de l'Europe affecterait sérieusement les profits des grandes compagnies américaines. Par ailleurs, les luttes ouvrières que provoquerait une débâcle économique en Europe et au Japon pourraient avoir l'effet soit de détruire de fond en comble l'ordre bourgeois, soit de permettre aux fractions de la bourgeoisie favorables à une orientation pro-russe de parvenir au pouvoir. La bourgeoisie américaine est extrêmement sensible à la menace d'un soulèvement prolétarien ou d'une extension du pouvoir russe en Europe ou au Japon.
Ce que la bourgeoisie américaine veut, c'est une réorganisation de l'économie occidentale ajustée aux nouvelles réalités imposées par la fin de la période de reconstruction d'après-guerre, par la saturation des marchés mondiaux et le développement de la crise sous une forme plus ouverte et plus aigüe. Dans cette nouvelle version de la "pax americana", les bourgeoisies européennes et japonaise doivent accepter une place plus modeste, réfréner leurs ambitions d'expansion et permettre à la bourgeoisie américaine de leur faire supporter certains effets de la crise. Toutefois, au fur et à mesure que la crise d’approfondira, la tendance de la bourgeoisie américaine sera d'infliger de plus en plus de contraintes à ses "alliés", afin de préserver ses propres profits.
L’éclatement de l’Europe
Impuissantes à contester effectivement l'hégémonie du capital américain, les bourgeoisies européennes ont tenté de protéger leurs intérêts nationaux aux dépend de 1'"unité" européenne tant vantée.
- "Aujourd'hui, le Marché commun est en miettes, et l'Europe comme "bloc" est complètement disloquée. Le Marché commun n'a jamais été autre chose qu'un "marché commun" pour la reconstruction d'une Europe ruinée par la guerre, et cela sous l'œil intéressé et paternaliste des Etats-Unis. Face aux Etats-Unis, pris eux-mêmes dans les difficultés de la crise, l'Europe, réduite à la portion congrue, ne peut que manifester sa mauvaise humeur, se soumettre davantage aux diktats des États-Unis, se déchirer encore plus, et les différents États qui la constituent sont amenés à chercher séparément et isolément leur salut en s'intégrant à l'un des grands blocs impérialistes mondiaux en voie de constitution." ("Révolution Internationale" -Bulletin d'études n°5, p.28-29)
La guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest a maintenant éclaté au sein du Marché commun. Des fractions importantes des bourgeoisies britannique et danoise sont déterminées à se retirer de la CEE ou, du moins, à renégocier les bases de leur engagement pour aboutir à des termes plus favorables. Le nationalisme économique, le protectionnisme, les barrières douanières et une tendance prononcée vers l'autarcie ébranlent le Marché commun ; même la libre circulation des marchandises à travers les frontières nationales, qui fut à sa base, connaît des restrictions. Chaque nation est déterminée à réduire ses importations au strict minimum, tout en développant ses exportations[4]. Le mot d'ordre de la politique économique est devenu : "Vendre des biens au voisin sans lui en acheter !"
Les économies les plus faibles (Italie, Danemark, Grande-Bretagne), qui, sous le régime de la libre circulation, seraient les victimes des offensives exportatrices de leurs voisins, s'emploient actuellement à ériger des barrières pour protéger leurs marchés intérieurs et tenter de mettre un frein à leurs déficits commerciaux. Quant aux économies dont la petite santé dépend du succès d'un boom des exportations (France, Allemagne), elles sont confrontées à la perspective d'un rétrécissement des marchés et vont donc bientôt ressentir de plein fouet les effets de la crise.
L'Italie fut le premier pays à réagir. Du fait que la position du capital italien est de moins en moins compétitive, en 1974, le déficit de la balance commerciale dépassera largement l'estimation de 8 milliards de dollars calculée en ne tenant compte que de l'incidence de l'augmentation des prix des produits pétroliers. Pour le premier trimestre de 1974, seulement, un déficit spectaculaire de 3 milliards de dollars a été enregistré ! Par ailleurs, la marge de manœuvre qui était jusqu'à présent en partie assurée par l'existence de revenus dits "invisibles" qui alimentaient la balance des paiements est maintenant menacée. En effet, particulièrement en ce qui concerne les sommes que deux millions de travailleurs italiens émigrés, soit 10 % de la force de travail, envoyaient à leur famille restée en Italie, ces versements risquent de diminuer fortement, car l'augmentation du chômage à travers toute l'Europe menace plus particulièrement ces travailleurs, qui, retournant au pays, viendraient gonfler l'armée grandissante des sans-emplois. La dégringolade de la lire et sa solvabilité de plus en plus douteuse ont conduit les représentants de la bourgeoisie à parler de banqueroute nationale au cas où l'Italie ne parviendrait pas à stopper l'aggravation des déficits commerciaux et des paiements[5].
En mai, le gouvernement italien a adopté une série de mesures protectionnistes destinées à restreindre les importations. Les entreprises importatrices de produits agricoles et de produits semi-finis ou finis, doivent placer la moitié de la valeur de leurs importations à la Banque d'Italie pendant six mois ; de plus, elles ne recevront aucun intérêt pour ces dépôts. Certaines importations de biens d'équipement et de matières premières nécessaires à l'industrie, et qui ne peuvent être produits à l'intérieur du pays, sont exemptées de cette mesure. Cependant, ces nouvelles règles affectent près de la moitié des importations du pays.
Le Danemark fut le pays suivant à élever des barrières aux importations, dans une tentative de mettre fin à l'augmentation de son déficit commercial, qui l'avait contraint, au cours de ces dernières années, à recourir à des emprunts de plus en plus importants. L'inflation galopante et la hausse des prix du pétrole importé ont amené le pays aux limites de la solvabilité. Traînant une industrie non compétitive dans le Marché commun et confrontée à un déficit de la balance des paiements d’un million de dollars, la bourgeoisie danoise a pris des mesures énergiques visant à réduire les importations et à arrêter l’hémorragie de ses réserves de devises. Une augmentation très forte sur toute une série de biens de consommation doit partiellement fermer le marché danois aux "partenaires".
La mise en place de barrières douanières par certains pays a provoqué de nombreuses réactions et mesures de rétorsion de part et d'autre. Les appels désespérés de l'Italie pour une aide financière des autres pays du Marché commun ont permis à la France et à l'Allemagne d'exiger la levée ou la modification de ses restrictions à l'importation, lesquelles, surtout pour les produits agricoles, commençaient à a- voir des effets désastreux sur les économies française et allemande. Giscard d'Estaing sait parfaitement que la santé de l'économie française et la prévention de soulèvements sociaux de masse dépendent de la possibilité de développer les exportations. La guerre commerciale croissante au sein du Marché commun et la détérioration de sa position compétitive ont d'avance compromis les chances d'un boom des exportations de la France, et on parle de plus en plus, à Paris, d'une restriction des importations (le déficit de la balance commerciale, pour le seul premier trimestre de 1974, a été de 1,6 milliard de dollars) .
La prospérité de la bourgeoisie allemande dépend d'une progression rapide et soutenue de ses exportations. Si les mesures protectionnistes, qui limitent déjà les exportations allemandes, restent en place (ou pire, si elles sont renforcées), cela entraînerait toute l'économie allemande à la catastrophe. La République fédérale est cependant en position de force en Europe, car, pour financer leurs déficits, de nombreux pays auront besoin de son secours. Et, sans aucun doute, la bourgeoisie allemande fera de l'abaissement des droits de douane et d'un engagement renouvelé de garantir la liberté du commerce la condition des énormes prêts qui lui seront sollicités Toutefois, pour ses partenaires commerciaux qui accepteraient ces conditions, le résultat pourrait être une véritable vassalisation à l'égard de l'Allemagne car, au fur et à mesure que les dettes augmenteraient, leur marché intérieur serait inondé de produits allemands. L'alternative serait un renforcement des mesures protectionnistes et l'exacerbation des tendances autarciques.
Le Japon dans l’impasse
Pendant ce temps, de l'autre côté du globe, la bourgeoisie japonaise prépare une nouvelle offensive de ses exportations. La seule manière d'éviter, sous le poids du coût élevé du pétrole et la saturation de son marché domestique, la débâcle économique est de lancer ses produits à l'attaque des marchés du monde entier. Selon 1'"Economist" du 6 avril 1974, la bourgeoisie nipponne , pour contenir le déficit de sa balance des paiements dans des limites supportables et conjurer la catastrophe économique, est déterminée à augmenter de plus de 30% ses exportations pour cette année. Son marché intérieur étant protégé par d'impénétrables barrières douanières, les industriels peuvent vendre leurs marchandises à l'étranger à des prix inférieurs à ceux pratiqués au Japon-même. Le ''dumping" est donc le fondement de sa politique commerciale. Cependant, sa tentative d'exporter sa crise ne peut que provoquer des réactions protectionnistes en Europe et aux Etats-Unis. Lorsque cette situation sera à l'ordre du jour, le Japon sera confronté à la crise dans toute son ampleur et, pour la première fois depuis la guerre de Corée, la bourgeoisie devra faire face à un chômage massif.
L’enjeu américain au Proche-Orient
La bourgeoisie américaine tente de reporter les effets de la crise sur l'Europe et le Japon. Et à son tour, chaque capital européen tente de les reporter sur son voisin, tandis que le capital nippon se défend tous azimuts. Il y a une accentuation incontestable des antagonismes inter-impérialistes au sein même du bloc dit "occidental". Ce phénomène ne doit toutefois pas masquer l'antagonisme inter-impérialiste fondamental qui prévaut aujourd'hui : celui qui oppose, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la Russie et les États-Unis .
En s'accentuant, la crise mondiale a exacerbé cet antagonisme. Alors que la presse parle de détente et de paix au Proche-Orient et que les bordiguistes font grand bruit au sujet d'un prétendu condominium mondial russo-américain, la lutte entre les capitalismes russe et américain s'intensifie. Le récent "coup" de Kissinger au Proche-Orient, loin de marquer une diminution de la menace permanente d'hostilités dans cette région, entre dans une stratégie agressive des Etats-Unis qui a pour but de déloger le capital russe de cette zone vitale. Il y a quatre ans, lors de l’"initiative de paix" de Rogers, Kissinger avait déclaré que l'objectif était d'extirper la présence militaire russe en Égypte. Le récent triomphe de la diplomatie Kissinger est un nouveau pas dans l'accomplissement de ce programme et indique la possibilité de son extension à la Syrie.
C'est l'armement et le soutien logistique américain qui ont rendu possible la contre-offensive israélienne contre les armées arabes équipées par la Russie, lors de la guerre de Kippour. Le fait que l'armée israélienne soit parvenue à une trentaine de kilomètres de Damas et se soit fermement installée sur la rive occidentale du canal de Suez , a démontré sans ambiguïté aux bourgeoisies arabes les limites du soutien russe. Les manœuvres diplomatiques qui ont amené la fin des hostilités, le détachement provisoire de l'Égypte du bloc russe et l'influence actuelle des Etats-Unis en Syrie ont déjà fortement affaibli les positions russes au Proche-Orient. En outre, les Américains ne souhaitent pas seulement une limitation de la présence militaire russe mais également un affaiblissement de son emprise économique sur certains pays de la région. La "réouverture" de l'Égypte au commerce et à l'influence financière américaines ainsi que la nouvelle position acquise en Syrie constituent une importante victoire pour Le capital américain dans sa lutte pour les marchés et le contrôle stratégique du Proche- Orient. Le nouveau comité américano-égyptien pour la coopération et le développement est destiné à faciliter la pénétration de l'impérialisme américain sur un marché qui lui était jusqu'ici fermé. L'industrie et les banques américaines sont avides de profiter de ces nouvelles possibilités. Les États producteurs de pétrole ont déjà promis 200 millions de dollars pour l'oléoduc de Sumed, 400 millions pour le complexe pétrolier d'Alexandrie et 200 millions pour le développement du logement et du tourisme. Le capital américain cherche à saisir la part du lion des contrats concernant ces projets. Des possibilités supplémentaires s'ouvrent avec la signature d'un important pacte économique et militaire entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite, qui prévoit la mise en place d'une commission paritaire à travers laquelle le capital américain aidera le roi Fayçal à réaliser un plan d'industrialisation de 10 milliards de dollars. Quant aux besoins de ce pays, qui augmentent fortement, ils seront pris en charge par une commission militaire qui l'aidera à assumer ses "responsabilités" dans la défense de la région.
Cependant, le Proche-Orient est une zone trop importante pour que les Russes y renoncent sans lutter ; c'est pourquoi une réponse de leur part à l'offensive américaine ne saurait tarder. La dernière chose qui soit possible, quand la crise s'intensifie, c'est une période de détente.
Mac Intosh.
(A suivre)
[1]Entre le moment où cet article a été rédigé et celui où nous le publions, ces rumeurs se sont confirmées, puisque le "sauvetage" de Citroën a été entrepris, non par l'État, mais par Peugeot.
[2] Nous ne prenons pas en considération le fait que les superprofits réalisés par les compagnies pétrolières internationales (principalement américaines) aideront le capital américain à compenser la hausse du coût du pétrole —avantage qui n'existe pas pour ses concurrents
[3] La faiblesse du dollar depuis janvier peut être en grande partie attribuée aux sorties de capitaux qui ont suivi la levée des contrôles en la matière et non à un quelconque affaiblissement de la compétitivité américaine.
[4] Les exportations sont devenues la seule façon d'éviter la catastrophe économique, au moment où les marchés intérieurs sont saturés sous la pression de l'inflation, de la chute des salaires réels, du chômage, des restrictions de crédit, de l'augmentation des impôts, des réductions des dépenses "sociales", bref de toute la panoplie des mesures déflationnistes. Nous verrons plus loin les problèmes que pose une telle politique.
[5] En juin, en réponse à la menace imminente d'une banqueroute nationale italienne, les ministres des Finances des "Dix" sont convenus que les principaux pays pourraient désormais gager leurs réserves d'or à un prix voisin de celui du marché en garantie de leurs emprunts. Cette décision ne donnera à la bourgeoisie italienne qu'un répit de courte durée. En effet, l'Italie devra emprunter près de 10 milliards de dollars à l'Allemagne et aux Etats-Unis, et, au prix de 150.$ l'once environ, les réserves italiennes vaudront 12 milliards de dollars. Ainsi, c'est la presque totalité de son stock qui risque d'être hypothéquée vers la fin de l'année, sans aucune perspective de pouvoir lever de nouveaux emprunts, mais le risque très sérieux de se trouver au bord de la faillite.
Questions théoriques:
- L'économie [15]
Quand donc les vrais conseils ouvriers surgiront-il ?
- 8 reads
Grèves, barricades, piquets armés, diatribes hystériques de la presse sur 1'"anarchie", troupes envoyées pour briser une grève menée par un soi-disant "conseil ouvrier"... tout pourrait faire croire que la révolution prolétarienne vient d'éclater en Ulster.
Il est sûr que la grève semble actuellement avoir le soutien actif de la majorité de la classe ouvrière protestante (il ne faut cependant pas oublier les méthodes d'intimidation auxquelles ont recours les organisations extrémistes protestantes, U.D.A., U .V .F . , etc.). Les ouvriers ont montré leur force, leur capacité à acculer le capitalisme au précipice. Mais tant que les travailleurs protestants permettront que cette force soit utilisée pour soutenir une fraction capitaliste dans ses règlements de compte avec une autre, ils agiront directement contre leurs propres intérêts. La grève n'est alors ni prolétarienne, ni révolutionnaire, elle n’est qu'un moment supplémentaire de la débâcle contre-révolutionnaire dans laquelle la classe ouvrière a été prise au piège depuis des décennies.
Les "troubles" irlandais
Les troubles en Irlande du Nord, qui commencèrent à faire la "une" à partir de 1969, sont en fait une des manifestations de la crise mondiale du capitalisme qui s'accélère depuis la fin des années 1960. Mais alors qu'en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Argentine, en Pologne et ailleurs, les ouvriers ont répondu aux restrictions de salaires, aux crises du logement, à l'inflation sur une base de classe (contre les patrons, les syndicats, l'État), en Irlande, les conditions historiques particulières ont entraîné la classe ouvrière dans l'impasse des solutions purement nationalistes.
La classe dirigeante loyaliste, fermement soutenue par le capital britannique, a pu maintenir un ordre social particulièrement archaïque, en réussissant à conserver vivantes les divisions religieuses et nationales au sein de la classe ouvrière. Ainsi, elle s'assura que les ouvriers protestants aient toujours les meilleurs logements et les meilleurs emplois, pendant que les travailleurs catholiques étaient traités comme des citoyens de seconde zone. Et cela maintint vives les mystifications religieuses et nationales qui, hors d'Irlande, ont depuis longtemps perdu une grande partie de leur emprise sur les ouvriers.
Quand, à la fin des années 1960, la crise économique mondiale commença à ronger l'économie irlandaise, la situation des ouvriers catholiques devint de plus en plus intolérable, et un mouvement de protestation commença à s'élever des ghettos catholiques. Mais parce que ce mouvement n'a jamais dépassé l'idée qu'il s'agirait là d'un problème catégoriel de "catholiques" ou d’"Irlandais" opprimés, pour voir plutôt que ce n'était qu'une forme particulière de l'exploitation capitaliste, il devint un terrain fertile pour les fausses solutions nationales et "démocratiques" de la bourgeoisie. Au début, le mouvement était dirigé par les charlatans du Mouvement pour les droits civiques, qui prit modèle sur le mouvement qui avait tenté d'émasculer la combativité des ouvriers noirs d'Amérique. Mais la réaction rapide et violente des loyalistes (attaque des ghettos catholiques par des gangs paramilitaires, par la populace ou les forces de police officielles) poussa la population catholique dans les bras de l'IRA, laquelle, jusqu'alors, n'était qu'un vestige moribond des conflits antérieurs. Se posant comme leur défenseur face aux assassins loyalistes, l'IRA pouvait ainsi devenir la police effective des ghettos catholiques. Le conflit tourna ainsi à l'affrontement entre fractions armées et l'armée britannique fut envoyée pour rétablir l'"ordre" et séparer les parties rivales. Mais ses méthodes brutales ne firent qu'exacerber le conflit, et, aujourd'hui, la classe ouvrière d'Irlande du Nord est dans une situation de cauchemar, où elle est divisée, torturée et embrigadée par une sainte-alliance du capital -armée britannique, IRA et gangs loyalistes- et où les travailleurs catholiques et protestants et les soldats britanniques servent de chair à canon à ces forces réactionnaires.
Face à ce chaos et en fonction de leur ambition nouvelle de moderniser l'Irlande et de l'intégrer dans le Marché commun, d'importants intérêts capitalistes, en Irlande comme en Grande-Bretagne, cherchent à mettre une fin à ces luttes de sectes et sont prêts à jeter par-dessus bord le vieil ordre d'Orange en faveur de capitalistes plus "rationnels", d'accord pour exploiter les ouvriers sur une base "égale", qu'ils soient catholiques ou protestants. C'est ce qui explique l'actuel conflit entre les loyalistes et l'État britannique.
Les ouvriers protestants redoutent particulièrement les conséquences de toute intégration à l'Irlande du Sud et de toute concession à la minorité catholique. Ils voient l'accord de Sunningdale comme le début de la fin de leur situation privilégiée, déjà menacée paf la crise économique. Leur volonté de conserver leurs très relatifs privilèges les pousse à l'action de masse ; mais, quelle que soit sa combativité, cette action n'a d'autre but que d'obtenir le droit de se faire exploiter par des patrons protestants et de se faire tuer par les soldats de l'État britannique — tout comme les ouvriers catholiques qui soutiennent 1'IRA ne font que défendre le droit pour la bourgeoisie catholique irlandaise d'étendre sa domination réactionnaire à toute 1'Irlande.
Nation ou Classe
Mais que ce soit un patron anglais, irlandais, blanc ou noir, américain ou russe qui commande, cela ne fait Aucune différence pour la classe ouvrière : elle reste des esclaves salariés écrasés sous le talon de l'État. La vérité, c'est que le capitalisme, qu'il soit orange ou vert (ou d'État, comme le souhaitent certains gauchistes dans la ligne idéologique de 1'IRA) n'a plus rien à offrir aux ouvriers d'Irlande ou d'ailleurs. À l'intérieur du système, il n'y aurait qu'une seule solution pour que les divisions en sectes en Irlande commencent à se résorber : que l'économie irlandaise dans son ensemble amorce une expansion soudaine assez rapide pour assurer des logements décents et de meilleurs emplois pour tous. Impossible rêve, puisque l'économie irlandaise n'est qu'un appendice arriéré de l'économie britannique, qui sombre elle-même dans la crise mondiale du capitalisme. Très vite, les ouvriers protestants n'auront plus aucun "privilège" à défendre, et le niveau de vie des ouvriers catholiques empirera encore.
La classe ouvrière irlandaise, catholique ou protestante, se trouve placée devant un choix historique : ou bien permettre que les fractions capitalistes en présence continuent de la manœuvrer et de l'exploiter, ou bien s'affirmer sur une base de classe contre ce conflit fratricide. C'est-à-dire prendre conscience que la "nation" n'est qu'un masque qui cache la domination du capital et que la seule identité que les travailleurs ont à défendre, c'est leur appartenance à une classe mondiale exploitée, dont les intérêts réels sont les mêmes partout. La crise du capitalisme est d'abord et avant tout une crise de l'État national, une manifestation du fait que la division du monde en capitaux nationaux concurrents est devenue un cadre trop étroit pour les forces productives que le capitalisme lui- même à développées. L'État national est un anachronisme monstrueux auquel ont été sacrifiées des millions de vies de travailleurs dans les guerres capitalistes de ce siècle ; c'est pourquoi la classe ouvrière d'Irlande ne peut avoir aucun intérêt à se battre pour un nouveau découpage national, que ce soit sous la forme d'une "Irlande unie" ou sous celle d'un "Ulster loyaliste". Au contraire, le seul moyen de se tirer du bourbier, c'est de devenir partie prenante d'un mouvement révolutionnaire mondial de la classe ouvrière contre les frontières et les États nationaux, pour la création d'une communauté mondiale des producteurs capable de mettre les richesses et les forces productives de cette planète au service des besoins humains et non à ceux du profit.
Si la classe ouvrière d'Irlande est trop profondément prise au piège des mystifications nationalistes pour pouvoir acquérir cette conscience par elle-même, c'est aux ouvriers hors d'Irlande -et surtout à ceux de Grande-Bretagne- de leur venir en aide, en répondant à l'approfondissement de la crise en termes de classe et avec un programme révolutionnaire : abolition du travail salarié, du système du profit, des États nationaux, etc. Ce programme sera appliqué par l'intermédiaire des conseils ouvriers, qui sont apparus dans chaque mouvement réellement révolutionnaire de la classe pendant ce siècle. Mais ces conseils-là n'auront rien à voir avec ce misérable ramassis de notables, de syndicalistes et de "généraux" loyalistes qui ont monté ce soi-disant "conseil ouvrier de 1'Ulster".
Les véritables conseils ouvriers seront des organes de toute la classe ouvrière élus et révocables, qui auront brisé toutes les divisions, religieuses, raciales, sexuelles, corporatives, etc., qui la paralyse, et qui transformeront radicalement toute la vie sociale. Quand ils surgiront, ces conseils balaieront pour toujours le "conseil ouvrier de l'Ulster", les gouvernements de Londres, de Dublin et le Storemont, l'IRA et toutes les institutions de la classe capitaliste mondiale.
Londres, le 29 mai 1974.
WORLD REVOLUTION
(Traduction d'un projet de tract.)
Géographique:
- Irlande [16]
Rubrique:
Revolution Internationale N°11 - septembre - octobre
- 650 reads
L'irrésistible chute du capital français
- 1034 reads
En quelques mois, l'espace d'un été, la situation s'est brusquement aggravée pour le Capital français. Alors qu'au début de l'été, le premier ministre Chirac déclarait triomphalement: "La France est épargnée',' une cascade de faillites dans les petites entreprises, une brusque flambée de chômage, l'accentuation de l'inflation ont provoqué un vent de panique dans la classe capitaliste: "Nous allons inéluctablement vers une crise économique dont personne ne peut imaginer l'ampleur.
Nous vivons la fin d'un monde.", déclare le Crésus de la boutique, Edouard Leclerc. (Entreprise N°992) A l'heure actuelle, les économistes bourgeois ne voient pas l'économie française sortir du bourbier où elle s'enlise avant 1980, voire même 1990. On ne cesse d'évoquer 1929: la chute irrésistible de la bourse qui s'est accélérée pendant les vacances permet à un journal officiel de constitution et de dissolution de sociétés (Petites affiches N° 103) d'affirmer: "Nous sommes très exactement... dans la même situation qu'en 1929, avec les coussins et les matelas en plus. Nous vivons un krach silencieux et différé...Tout le reste est vent dans les roseaux".
LA CRISE MONDIALE FRAPPE LE CAPITAL FRANÇAIS
La bourgeoisie française ne se fait donc plus aucune illusion: les lendemains ne chanteront pas.
Si la "France est épargnée", c'est seulement jusqu'à la fin de l'année. Elle "est épargnée" parce qu'apparemment elle dispose de plus d'atouts que l'Angleterre et l'Italie: une monnaie (encore) stable, une inflation relativement "modérée" (15% contre 16,57 pour l'Angleterre, 207 pour l'Italie et 307 pour le Japon), et surtout un taux de croissance encore nettement positif (4,757), alors que beaucoup d'autres pays sont en-deçà de la "croissance zéro"
(U.S.A -2,77; G.B.:-67; Japon:-6,57.). Elle bénéficie également d'une moindre dépendance par rapport au marché mondial: la production agricole très diversifiée réduit la part des importations; la part des importations dans l'industrie nationale est seulement de 157 (contre 207 en Allemagne). C'est cela qui permet à la bourgeoisie française d'espérer n'être frappée par la crise qu'à retardement, comme ce fut le cas après 1929 (la crise devient effective à partir de 1932).
Pour l'instant, les grosses entreprises semblent avoir encore quelques beaux jours à vivre: Peugeot embauche 800 ouvriers à Mulhouse et Berliet -qui vient de s'ouvrir des marchés au Moyen Orient- 1000 ouvriers. Appliquant le cri de guerre de la bourgeoisie en période de crise: "exporter", elles font partie de ces cent entreprises qui assurent 407. des exportations. L'industrie sidérurgique tourne au maximum de ses capacités et l'industrie d'armements est débordée de commandes. C'est cette situation que reflète Ceyrac, chef du C.N.P.F lorsqu'il déclare au début septembre: "la situation économique de la France est encore exceptionnellement bonne par rapport à tous les autres pays, y compris les Etats-Unis."
Néanmoins, de sinistres craquements se font entendre au sein du grand capital.
En l'espace de quelques mois, il vient de se produire: les faillites des usines de remorques Titan-Coder mettant au chômage 2700 ouvriers; la liquidation du France, symbole de l'expansion du capital*français au début des années soixante, liquidation qui entraîne le licenciement de 2000 marins invités à chercher du travail dans l'industrie hôtelière. On annonce aussi le licenciement de 6000 ouvriers à la SNIAS (ex-Sud Aviation). De sombres nuages s'amoncellent sur l'industrie automobile depuis un an (Citroën) et sur l'industrie lainière (-20% en l'espace d'un an à la veille de l’été): ce sont des milliers de licenciements qui guettent à l'avenir les travailleurs de ces industries.
A l'avenir, sinon dans l'immédiat, la "croissance zéro" ou plutôt la croissance négative va devenir réalité.
Sur le plan financier c'est carrément la ruine à plus ou moins brève échéance.
Alors que les marchés se rétrécissent comme peau de chagrin ne laissant la place qu'aux plus forts (USA, Allemagne, Japon ) que le commerce mondial se ralentit, que les exportations sont amenées à décroître dans l'économie française, la part des importations en valeur ne cesse de croître au sein de celle-ci. Le déficit commercial, du fait du renchérissement du coût des matières premières, est déjà de 11,7 milliards de francs. Selon l'OCDE, l'équilibre de la balance commerciale ne serait pas rétabli à la fin de 1975, ce qui signifie à terme une banqueroute à l'italienne.
Point ne sera besoin d'attendre si longtemps: déjà, aux dires des commentateurs bourgeois, la bourse française affronte son "septembre noir" (chute de -30% en moins d'un an des valeurs françaises). "Entreprise" parle même du danger d'un nouveau "Herstatt[1]" en France devant les krachs bancaires qui affectent les Etats-Unis et surtout l'Allemagne. Le krach est donc déjà là, même s'il est encore "silencieux et différé". .
La situation est si grave pour la France comme pour toutes les autres puissances capitalistes qu'une rencontre des représentants du grand capital international a eu lieu au château de Champs-sur-Marne, en vue d'établir un contrôle des changes et de soutenir les banques défaillantes: comme dans un château de cartes, la banqueroute d'une puissance capitaliste ne peut qu'entraîner celle de toutes les autres.
La situation relativement "privilégiée'’ du capital français, si l'on songe à la situation catastrophique de l'Angleterre, de l'Italie (production de -20% chez Fiat en un an) ou même du Japon (krach d'un important "zaibatsu" de l'électronique) sera donc d'une très courte durée.
LES PREMIERES VICTIMES: MOYENNE ET PETITE BOURGEOISIE
Ce sont les petits patrons et aussi les petits commerçants.
a) Les petites et moyennes entreprises.
Au même moment où Ceyrac chantait victoire Gingembre, le porte-parole des PME déclarait: "Les restrictions de crédit constituent un lent étranglement des entreprises industrielles qui doit conduire inéluctablement au chômage total et puis à la liquidation judiciaire ou à la faillite." La politique déflationniste menée par Giscard et qui s'est manifestée par la hausse du loyer de l'argent et le blocage des crédits par les banques aux PME a entraîné des faillites en cascade (tanneries d'Annonay, La Prairie en Charente). Durafour, ministre du travail, avoue que deux cents dossiers de petites entreprises sont entre ses mains. Les dépôts de bilan se multiplient et les cabinets de syndics sont débordés (6000 dépôts en un an: + 23% par rapport à 73).
Jusqu'ici le mécontentement des petits patrons s'est exprimé de manière verbale, dans les colonnes de l'Aurore ou du Nouvel Observateur.
Ce sont les paysans et les petits commerçants qui ont tenu le devant de la scène cet été par des explosions de violence (notons que depuis un certain temps, la petite bourgeoisie étudiante ne tient plus le haut du pavé) Les paysans.
En France comme dans toute la CEE ce sont eux qui ont fait le plus parler d'eux. Rien qu'en un an, le revenu global des paysans a baissé de 15%. Ils sont donc descendus sur les routes avec leurs tracteurs ou ont attaqué les préfectures comme en Corse. Laminés par l’inflation, ils demandent une réévaluation des prix agricoles, alors que le gouvernement mène une politique de blocage des prix. Couche condamnée à la ruine par le grand capital, elle tente de survivre en se raccrochant à son capital national: elle demande à la bourgeoisie la fermeture des frontières et, pour l'obtenir, s'attaque aux camionneurs étrangers qui transportent des produits agricoles, comme on a pu le voir dans le Nord. Bref, ce qu’elle demande à ses maîtres c'est de survivre, que la bourgeoisie soit "nationale", pour tout dire, protectionniste.
En tout cas, pour le moment du moins, le grand capital n'a pas l'intention de relever les prix agricoles(l)[2],il s'agit de juguler l'inflation pour éviter à la fois la banqueroute financière et une explosion prolétarienne. Cependant, lorsque ce géant endormi, le prolétariat, deviendra menaçant, la bourgeoisie, par calcul politique, n'hésitera pas à céder, au mépris de ses intérêts immédiats, à accorder ce que demande la paysannerie: la hausse des prix agricoles. Il s'agira en effet pour la bourgeoisie de trouver des alliés contre le prolétariat.
b) Les commerçants.
Pour les commerçants, les mêmes causes ont conduit non à un affrontement avec l'Etat mais à un conflit entre gros et petit commerce.
La crise qui s'est manifestée par l'augmentation de leurs impôts, le blocage plus ou moins autoritaire des prix (campagne du 5% de baisse volontaire menée par le gouvernement), le blocage des crédits ont précipité les faillites dans la petite boutique. Alors que leur mécontentement s'était manifesté l'an dernier contre l'Etat (attaques de perceptions, bagarres avec les CRS), il s'est tourné cette fois contre les grandes surfaces, chargées de tous les péchés du monde. Face au petit commerce symbolisé par Nicoud, les grandes surfaces par la voix de Leclerc, demandent l'abolition de la loi Royer, favorable aux petits commerçants, laquelle freine, sinon stoppe, l'implantation de celles-ci.
Tel est le sens des violents affrètements entre les troupes de Nicoud et celles de Leclerc qui ont éclaté à Rochefort à propos de l'extension des magasins Leclerc. Le fait que les troupes de Nicoud aient eu le dessous est significatif: il montre l'inéluctable disparition d’une couche de petits boutiquiers parasitant le système de distribution capitaliste. L'Etat capitaliste qui souhaite réduire les prix pour, en même temps, lutter contre l'inflation et éloigner la colère ouvrière face à la hausse des prix galopante, ne peut que favoriser maintenant (après avoir favorisé l'an dernier pour des motifs électoraux la petite boutique par la loi Royer), le développement des gros distributeurs qui, par leur concentration, peuvent se permettre des marges bénéficiaires plus petites et donc des prix moins élevés.
Il est à noter que, pendant ces événements ni les paysans ni les commerçants n'ont songé à s'attaquer au prolétariat ou à le rendre responsable de la situation actuelle. Les syndicats d'exploitants agricoles, Nicoud et Leclerc, n'ont cessé de proclamer qu'ils étaient le meilleur défenseur du brave consommateur ouvrier. Belles paroles et distributions gratuites de vin et de viande auront alterné pendant ces événements.
c) Et le prolétariat ?
La peur qu'il lui inspire, le spectre de 68, explique que la bourgeoisie ne se soit pas encore attaquée directement à lui.
Jusqu'ici, la classe ouvrière française a conservé son ancien niveau de vie malgré l'inflation. Aux dires des économistes pour 1974, la hausse moyenne des salaires devrait être de 207 «pour une hausse des prix de 157» (on en est à 13% en septembre). Ce caractère encore "privilégié" du prolétariat français par rapport à ses frères de classe italiens, anglais, et même américains qui ont vu leur niveau de vie diminuer, explique que les ouvriers ne se soient guère manifesté depuis presque un an, même s'ils ressentent avec inquiétude les vertigineuses hausses des prix ou la diminution de la température dans les immeubles pour cet hiver.
La réaction du prolétariat à la crise se manifeste essentiellement dans "la défense de l'hmploi": les ouvriers des usines liquidées occupent les lieux de travail ou manifestent dans la rue (Titan-Coder à Maubeuge et Marseille, occupation du France, occupation des tanneries d'Annonay).
Il s'agit là d'une réaction défensive d'un tout petit secteur du prolétariat qui suit encore les consignes syndicales de "défense de l'outil de travail".
C'est à la fin de l'année que l'affrontement risque de se produire et sans doute d'abord dans 1’automobile, qui a été obligée de réduire sa production et qui, malgré cela, n'arrive pas à écouler ses stocks.
Pour des raisons de paix sociale, les industries de l'automobile ont maintenu l'emploi; il semble inévitable que le capital s'attaque aux travailleurs de ce secteur.
Ce qui veut dire, étant donné l'effet d'entraînement des ouvriers de l'automobile sur l'ensemble des travailleurs, un affrontement inévitable du prolétariat au capital.
En tout cas, pour le moment, le prolétariat se place dans l'expectative. Une veillée d'armes avant la guerre de classe.
LES GRANDES MANŒUVRES DU CAPITAL
Elles se situent à trois niveaux: le gouvernement, la gauche, les gauchistes, face à leur ennemi commun: le prolétariat.
a) Le gouvernement essaie de faire oublier la crise. Giscard continue la politique qu'il a entreprise depuis sa venue au pouvoir: celle de la poudre aux yeux par toutes sortes de mesures libérales.
Après le vote à 18 ans, la pilule libres et presque gratuite, il continue sur cette lancée. Il préconise l'abolition de la censure cinématographique. La lecture des journaux, sauf celle de quelques feuilles antimilitaristes est autorisée dans les casernes: les gauchistes devront donc trouver d'autres "libertés démocratiques" à obtenir et aller gesticuler ailleurs. Bien plus -ce qui a fait frémir plus d'un bourgeois de droite pas encore habitué à ces hardiesses-, Giscard n'a pas hésité à aller visiter une prison à Lyon et à serrer la main d'un prisonnier après les émeutes du mois di juillet: ce qui est "un comble" de la part du chef de l'ordre social existant avec ses tribunaux et ses prisons!
Chez les gaullistes l'heure est à la main tendue vers les communistes. Après Charbonnel (gaulliste "de gauche") prêt à s'entendre avec les communistes, les jeunes gaullistes ont rencontré les jeunes communistes. Soucieux de se frayer une place au soleil des postes ministériels et aussi antiaméricains et nationalistes les uns que les autres, les compères ne peuvent que s'entendre. Encore une fois on voit qu'il n'existe aucune différence de fond dans le programme des diverses fractions du capital.
Malgré la grogne gaulliste, Giscard a la situation bien en main. Le "Nouvel Observateur", et avant lui Lecanuet, faisait remarquer à juste titre que Giscard était en train de réaliser tout le programme de la gauche. Bref, une concurrence déloyale de la part de la droite qui se met à empiéter sur les chasses gardées de la gauche.
b) La gauche se prépare à son rôle de gestionnaire du capital en crise. Malgré les appels du pied de Lecanuet aux socialistes pour s'entendre et gouverner dans l'avenir sans les communistes elle est restée unie.
Elle cherche à montrer que face à la crise économique, à la décomposition sociale c'est elle seule qui peut se charger de maintenir l'ordre.
Les syndicats ont repris la même chanson du calme nécessaire. Séguy parle de forcer le patronat à discuter avec lui, ce qui a fort étonné et même inquiété le patronat qui attendait de ses commis de se montrer plus crédibles vis-à-vis de la classe ouvrière.
En tout cas, chez les syndicats, il s'agit d'interdire toute lutte ouvrière:
- "La CGT a eu plusieurs fois l'occasion, par la voix de ses militants les plus autorisés, de préciser qu'elle n'entendait pas compromettre par des exigences immédiates, insoutenables pour l'économie du pays, la réalisation d'un programme de la gauche qu'elle a soutenu depuis son origine." (Séguy au Figaro)
De leur côté, les partis de gauche aiguisent leurs armes gouvernementales.
Le P.S s'apprête à devenir un grand parti social-démocrate. La bourgeoisie française -qui dans son ensemble est pro-américaine, par nécessité- préfère avoir un parti de gauche atlantiste contrebalançant le P.C encore pro-russe. Un tel parti, plus démocratique, ne peut que favoriser l'emprise de la bourgeoisie sur la classe ouvrière. Cette emprise du P.S, fort réduite d'ailleurs, sinon insignifiante commence à s' exercer par l'intermédiaire de la CFDT; l'adhésion prochaine du PSU au PS ne pourra que favoriser cette entreprise par l'apport d'éléments, ouvriers. Les trotskistes vont donc à nouveau s'interroger, et s'interrogent déjà sur la possibilité d'entrisme dans la nouvelle organisation "ouvrière". La grande maison est toute grande ouverte pour les enfants prodigues.
C'est le PC qui prépare le plus soigneusement son accession de futur garde- chiourme gouvernemental. Apparaissant comme le grand parti démocratique (grande fête de l'"Humanité" à La Courneuve) il lance une campagne de recrutement pour couper l'herbe sous le pied de son rival socialiste, ouvrant toutes grandes les portes de ses cellules. Pour montrer qu'il sera un parti social-démocrate comme les autres le PC ne manque pas une occasion de prendre ses distances à l'égard de la politique russe (vente des livres de Soljenitsyne à la fête de l'"Humanité", protestations contre la répression en URSS).
C'est lui qui représente le mieux le programme du capitalisme d'état qui s'impose à la bourgeoisie en période de crise, en dénonçant le capitalisme "monopoliste d'état" qui serait... occidental et non russe!
- "Globale, elle (la crise) affecte tous les domaines: économique, social, politique, culturel, idéologique, moral. Permanente, elle n'est pas une crise de conjoncture. Il s'agit de la crise du système capitaliste à son stade actuel où s'interpénètrent les monopoles et l'Etat, la crise du capitalisme monopoliste d’Etat".
Et, bien entendu, pour montrer que le capitalisme d'Etat ne subit pas la crise et que c'est le socialisme, on déclare: "Les pays socialistes ignorent l'inflation, la flambée des prix, le chômage, l'insécurité de la vie qui règnent dans le monde capitaliste." (Projet de résolution au XXI° Congrès extraordinaire) Ce type de propagande pro-russe risque d'ailleurs de disparaître étant donné l'état de crise avancée dans le bloc de l'Est (grèves sur les chantiers polonais de la Baltique en juillet; crise économique en Tchécoslovaquie)
Le PC représente en tout cas la défense la plus acharnée du capital national dans le sens le plus chauvin et le plus protectionniste. Ainsi, Ballanger, dirigeant du PCF, déclarait aux chambres d'agriculture qu'il fallait l’arrêt des importations qui concurrencent la production française et une véritable aide aux exportations.
c) Les gauchistes. Il est significatif que l'aile extrême du capital ait gardé le silence sur la crise dans ses journaux. Ils ne sont pas appelés pour l'instant à des responsabilités gouvernementales et leur rôle est de rabattre vers la gauche les ouvriers qu'ils influencent. Par exemple, Arlette Laguiller (Lutte Ouvrière), préconise un soutien pur et simple de la gauche: "C'est aux syndicats ouvriers, c'est aux partis qui se réclament des travailleurs de proposer un plan d'action, s'ils sont vraiment dignes de la confiance que les travailleurs leur prêtent".
La gesticulation gauchiste a surtout porté cet été sur les commerçants, les paysans, les prisons et l'armée.
Expression de la petite bourgeoisie en décomposition, il est normal que les gauchistes défendent son existence. Ainsi les trotskistes à la suite des maoïstes et du PC, affirment que les "petits commerçants et les ouvriers ont des intérêts communs" (Lutte Ouvrière) et citent le programme de transition de Trotsky qui demande aux ouvriers de marcher "la main dans la main" avec les paysans et les petits commerçants.
Etrangers au prolétariat, il était normal que les gauchistes s'agitent sur les prisons et l'armée. Et de s'acharner à montrer que la révolte des prisons est une expression du prolétariat car la majorité des prisonniers est d'extraction ouvrière. Et de prétendre, comme le fait «Rouge',' organe du Front Communiste Révolutionnaire, que la manifestation de rue des soldats du contingent à Draguignan est révolutionnaire, sinon la révolution. C'est une excellente occasion pour eux de détourner l'attention du prolétariat du seul, vrai problème: l'affrontement organisé du prolétariat avec le capital et la destruction de ce dernier. Occasion aussi de se présenter comme les seuls vrais démocrates. "Rouge" N° 265 demande des "réformes" dans l'armée, "la solde à mille francs". Laguiller (Lutte Ouvrière, N° 316) chante les mérites de l'apprentissage des armes sur les lieux de travail et d'habitation, à l'exemple suisse.
Une fois de plus, les gauchistes assument pleinement leur fonction de rabatteurs du capital tachant de détourner les prolétaires de leur terrain de classe pour les placer sur le terrain des "réformes", de la défense de la petite bourgeoisie ou des marginaux, et donc, du capital national.
Lénine faisait déjà observer que la condition de la révolution prolétarienne était que "ceux d’en bas ne veuillent plus" et que "ceux d’en-haut ne puissent plus !"
La crise, encore lente en France, pour peu de temps, laisse le prolétariat dans l’expectative et permet toutes les manœuvres des forces politiques du capital.
Le fait nouveau en France ce sont les révoltes dans les prisons et l’armée, le cœur même de l’appareil de répression d’Etat. Ce sont des signes d’une décomposition sociale prononcée, au même titre que le développement de la drogue et de la pornographie. Le fait que la bourgeoisie voit son appareil de répression se gripper est un signe de son impuissance à contrôler la crise. Aussi met-elle rapidement en avant des mesures de réforme dans les prisons et l'armée, seule condition du maintien de son ordre social. Mais voir dans ces signes de décomposition une expression du prolétariat, comme le font les gauchistes, c'est nier que le prolétariat est la seule classe révolutionnaire dans la société. "Le prolétariat est seul contre toutes les autres classes" disait Gorter.
Pour les révolutionnaires, il est important de dénoncer sans relâche les gauchistes qui, de ces signes de décomposition sociale font l'essence de la révolution.
En France, sur toute la planète dominée par le Capital il ne peut y avoir qu'une révolution: PROLETARIENNE.
Si déjà la bourgeoisie montre qu'elle ne "peut plus", le prolétariat français sera tôt ou tard amené à ne "plus vouloir", "à faire irruption sur la scène politique" (comme le disait Trotsky quand il était encore un combattant du prolétariat), avec ses frères de classe du monde entier.
CHARDIN.
[1] Banque allemande qui a sombré
[2](1) Ce n'est pas seulement la bourgeoisie française qui est intransigeante mais encore plus celle d'Allemagne et des Pays-Bas qui, dans les négociations récentes de Bruxelles ont imposé un maximum de 57» de hausse des produits agricoles.
Situations territoriales:
- France [17]
- Situation sociale en France [18]
LES COMMISSIONS OUVRIERES : UNE ILLUSION CONTRE REVOLUTIONNAIRE
- 28 reads
Toute organisation ouvrière de caractère permanent doit être analysée à partir des objectifs qu’elle poursuit. Dans le cas des commissions ouvrières, il existe une véritable résistance de la part des militants dits de "gauche" ou d’"avant-garde" à accepter l’idée que celles -ci soient orientées par une politique définie. Il existe toute une tendance qui voit dans les commissions ouvrières l’embryon de la future organisation de la classe sans autre objectif, dans le présent, que la "lutte contre l’exploitation".
Dans ce contexte, il est logique que ces militants pensent aussi que tout ouvrier combatif qui lutte se doive de rejoindre les commissions ouvrières. Il est logique également que, devant une dénonciation du caractère contre-révolutionnaire des C.O, ils n’y voient qu’une tentative de les liquider.
Pourtant, les C.O. ont effectivement une politique, et de plus bien définie et concrète : "La lutte contre la dictature et la lutte pour un syndicat de classe". Et ces objectifs politiques nous pouvons les trouver dans n’importe quel tract des commissions; nous les trouvons dans l’activité-pratique de ses militants.
Quels que soient leurs efforts pour faire semblant de l’ignorer, tous ceux qui appuient les commissions sont en fait en train de défendre la même politique qui en 36 s’est concrétisée par la consigne : "D’abord gagner la guerre, contre le fascisme, après la Révolution socialiste". La même qui essaye de faire croire à la classe ouvrière qu’en renversant le régime de Franco et en donnant le pouvoir à la fraction démocratique de la bourgeoisie, l’exploitation sera moins dure.
Le fait que les commissions ouvrières soient dans la pratique la seule organisation qui regroupe un minimum d’ouvriers en Espagne ne peut servir de justification à l’ouvriérisme de faux ouvriers disposés à accepter n’importe quelle politique, à la condition que la classe ouvrière s’organise.
Il est évident qu’il existe toujours des organisations "ouvrières" au sein du capitalisme. La preuve en est l’existence des syndicats de différentes tendances, des organisations corporatistes, etc. Mais le fait que ces organisations soient composées d’ouvriers ne signifie pas nécessairement que ce soient des organisations de la classe ouvrière.
Ce qui fait qu’une organisation est révolutionnaire, ce sont ses objectifs de classe. Si la classe ouvrière est la seule classe révolutionnaire, c’est uniquement par la défense des objectifs de la classe ouvrière qu’une organisation peut jouer un rôle révolutionnaire.
Les positions défendues par les commissions ouvrières (lutte purement corporatiste, lutte syndicale, lutte antifasciste), ainsi que leurs formes organisatrices (hiérarchisation, bureaucratisation, domination occulte des partis politiques), les invalident comme organisations de la classe ouvrière, et ceci quel que soit le nombre d'ouvriers qui peuvent les rejoindre. La tâche des révolutionnaires est de lutter pour empêcher la classe de leur faire confiance.
Cependant, parler aujourd'hui des commissions ouvrières, c’est parler d’une poignée de militants des partis de "gauche" qui, dans l’usine, s’organisent en commission ouvrière. Plus de dix années de pratique syndicale et volontairement réformiste ont été suffisantes pour commencer à dévoiler au prolétariat le mensonge et la mystification constitués par les commissions ouvrières.
Mais, le fait que les commissions soient en crise ne signifie pas que la lutte de la classe ouvrière ne continue pas à se développer. La disparition de ses militants dans beaucoup d’entreprises, l’abandon de la commission par beaucoup d’ouvriers ont signifié dans un grand nombre de cas le renforcement de la lutte à travers d’autres organes, comme les assemblées d’usine, avec des comités contrôlés et révocables par l’Assemblée.
C’est à partir des années 69-70, quand -principalement en Catalogne et dans le nord de l’Espagne- coïncidant avec le début de la crise des commissions ouvrières, commencent à surgir des luttes d’une extrême dureté, qui sont toutes menées et dirigées par des assemblées d’usine, que la classe peut ainsi se passer des bons offices des C.O.
C’est pour cela que la critique des C.O. et leur dénonciation ne sont, d’aucune façon, une activité liquidationniste : C’EST LE MOUVEMENT OUVRIER LUI-MEME QUI PAR SA PROPRE LUTTE LIQUIDE LES COMMISSIONS. Mais, en même temps, le fait que les C.O. soient en crise ne signifie pas qu’elles aient disparu ou qu’elles soient en train de disparaître.
Le pouvoir contre-révolutionnaire des C.O. résident dans les positions qu’elles défendent, et ces positions, parce qu’elles sont celles de la bourgeoisie, ne disparaîtront pas avec les commissions mais, uniquement, avec la liquidation de la bourgeoisie. C’est pour cela que notre devoir de révolutionnaires consiste à dénoncer toutes les tentatives qui aujourd’hui, sous le nom de commissions ouvrières, et demain sous n’importe quel autre, tendent à faire dévier le prolétariat du chemin de la révolution prolétarienne pour le conduire dans l’impasse des luttes antifascistes, démocratiques ou de libération nationale.
NAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DES COMMISSIONS OUVRIERES
Coïncidant avec l’accélération du développement industriel, la lutte pour l’amélioration des conditions de vie s’est peu à peu généralisée à toute l’Espagne.
En 1962, les conditions particulières et conjoncturelles de ce développement industriel - étape suivant le plan de stabilisation de 1959 - permettent aux ouvriers pour la première fois depuis 1939, de tenter de défendre leurs conditions d’existence contre les détériorations subies jusqu’alors, d’oublier les guerres et les cartes de rationnement des années précédentes et revivre à nouveau l’illusion du réformisme, sans craindre une répression inexpiable du capital. Avec l’apparition des conventions collectives, s’ouvre une étape de négociation salariale dans laquelle les travailleurs interviennent activement en faisant pression par leur lutte.
C’est dans cette situation (théoriquement favorable pour qu’aussi bien les vieilles organisations syndicales: C.N.T., U.G.T., que d’autres nées dans l’après-guerre d’Espagne : USO, OSO, ASO, puissent jouer un rôle significatif) qu’apparaît, indépendamment de tout groupe politique une forme d’organisation ouvrière pour la lutte revendicative, qui rapidement éclipse les autres organisations illégales: les commissions ouvrières, COMMISSIONS D’OUVRIERS ELUS PAR L’ASSEMBLEE D’USINE.
Cependant, il serait faux de déduire que la crise et le rejet des organisations syndicales existantes ont signifié le rejet du syndicalisme par la classe ouvrière. Les organisations syndicales qui existaient comme l’USO, l’OSO, l’ASO n’ont jamais réussi à se développer dans la classe ouvrière comme syndicats d’opposition au syndicat vertical CNS.
En réalité, ces organisations étaient constituées uniquement et exclusivement de quelques groupes de militants d’organisations politiques (PSOE, PCE) s’employant à maintenir les vieilles positions de la période républicaine.
Débordés par les premières assemblées massives et confrontés à la nécessité de contrôler le mouvement ouvrier, ils ont démonté leurs organisations syndicales pour tenter de dominer les commissions ouvrières en en faisant le syndicat qu’eux-mêmes n’avaient jamais réussi à construire. C’est pour cela que la rupture avec les anciennes organisations ne signifie pas la rupture avec les conceptions syndicalistes.
Les fait démontrent clairement que les C.O. se sont donné comme activité fondamentale la défense des intérêts économiques des travailleurs. A la base de toutes les luttes des C.O. on trouve depuis le premier instant les revendications économiques.
Bien qu’un grand nombre de luttes aient été, du point de vue revendicatif de grandes défaites, il n’est pas moins certain également que dans certains cas (principalement avant la récession internationale de 1967-1968, fortement ressentie en Espagne) le prestige et le renforcement numérique des commissions étaient dus justement à la possibilité d’obtenir des améliorations immédiates à travers leur lutte. La convention collective provinciale de la branche de la métallurgie, les améliorations obtenues par les mineurs asturiens, etc. ont constitué un important tremplin pour le développement des commissions dans toute l’Espagne.
Et ceci est tellement vrai, que rares ont été les usines où la lutte ne se soit accompagnée de l’apparition d’une C.O., soit que celle-ci ait été le produit de la lutte, soit qu’elle ait été créée pour l’impulser et la diriger[1].
Mais, même dans les cas où une victoire a été remportée, celle-ci n’a pas tardé à se transformer en défaite. L’inflation permanente, les augmentations de productivité obtenues principalement à travers les accélérations des cadences et la hausse constante des prix alimentaires et des biens de consommation se sont chargées de récupérer amplement les augmentations salariales arrachées avec difficulté. Ce n’est un secret pour personne que les salaires perdent progressivement leur pouvoir d’achat et que la situation de la classe ouvrière espagnole, au même titre que celle de la classe ouvrière dans le monde entier (bien qu’il reste des gens pour penser qu’il s’agit dans le premier cas d’une ’’mauvaise gestion” du capitalisme espagnol), ne fait qu’empirer.
Avec la récession de 1968 et l’état d’exception qui l’a suivie, les "illusions" de victoire des années antérieures se sont évanouies. Avec elles, les assemblées massives dans les champs, l’utilisation des "possibilités légales", la semi-légalité des dirigeants des commissions ouvrières, l’occupation des locaux syndicaux, les succès revendicatifs à l’occasion de la négociation des conventions collectives, etc. ont fait place aux arrestations, emprisonnements, déportations, expulsions ou démissions des charges syndicales, à l’impossibilité d’obtenir des améliorations réelles et durables. Tout cela a mis en lumière clairement et ouvertement le véritable visage d’un système devenu incapable d’accorder à la classe ouvrière la moindre amélioration.
LE SYNDICALISME DE GAUCHE
La crise des commissions ouvrières, leur incapacité à encadrer la classe ouvrière espagnole derrière les objectifs de lutte pour un ’’syndicat de classe” et pour la démocratie bourgeoise, ont provoqué le départ d’un nombre important de leurs militants et leur organisation autonome en dehors des dirigeants permanents du mouvement.
Cette rupture, qui dans certains cas suppose la, critique de la politique des commissions ; (syndicalisme, pacte pour la liberté), république démocratique, etc.), s’accordage en règle générale de 1’organisation de nouvelles commissions situées à la gauche du PCE et de "Bandera roja’.* Au sein de ces nouvelles commissions, on voit ndJliter en grande majorité des éléments d'organisations politiques minoritaires.
Mais pour la majorité de ceux-ci, la crise des commissions ouvrières se réduit à la "bureaucratisation", au manque "d'organisation réelle dans les entreprises" et au contrôla des partis politiques". Ce seraient les dirigeants' qui empêcheraient 1’extension et la consolidation des commissions ouvrières.
Dans un document édité par les "Groupes ouvriers autonomes", on trouve l’analyse suivante de la crise des C.O. :
- "Ceux qui ont supporté les conséquences de ce sectarisme, ce sont nous les travailleurs, à cause de notre inexpérience. Pendant que nous étions en train de lutter dans les usines et dans les mines, nous avons laissé nos prétendus représentants détruire ce que nous avions commencé à construire. Déboutés, déçus, nous avons abandonné tous ces faux représentants de la classe ouvrière et nous continuons de lutter sur nos lieux de travail ; Nous organisons des grèves comme on n’en avait vu depuis de nombreuses années. Au Pays basque : laminoirs de Bandas, hauts-fourneaux, la "Naval"; aux Asturies : les mines et la métallurgie; à Pampelune : "Eaton Ibérica" et "Potasses de Navarre". "Harry-Walker", "Blausol" , "Macosa", "Maquinista" à Barcelone; "Aviation" et "Saca" à Séville; "hauts-fourneaux à Sagunto, etc., sont des noms qu’on n’oubliera pas, car ils correspondent à des grèves héroïques, quelquefois modèles d’organisation, auxquelles il a manqué pourtant la solidarité et l’appui que permet seule une union large et solide."
"Le prolétariat espagnol a montré sa combativité, mais il a été incapable de créer une organisation en rapport avec ce haut niveau de lutte et facteur de son amplification. Pendant ce temps, les bureaucrates et les membres des partis se distribuaient la dépouille de ce qui aurait pu être la grande organisation de la classe.
Il ne faut accuser personne, sinon nous-mêmes, du fait que nous n’ayons pas encore été capables de créer une organisation ouvrière, capable de défendre nos intérêts. La tâche de la bourgeoisie et de ses alliés dans le mouvement ouvrier est de créer la division entre les travailleurs. Ce serait trop facile d’accuser les capitalistes qui essayent de défendre leurs intérêts. C’est là leur "mission.
- "Mais le nôtre est de nous organiser et d’empêcher l’infiltration d’éléments étrangers à notre organisation ; Pour cela les travailleurs, nous qui menons la lutte dans l’entreprise devons prendre la responsabilité d’établir la coordination indispensable entre les entreprises en vue du soutien mutuel et de l’élaboration d’un programme d’action. Cela doit être notre tâche, tâche que nous ne devons pas laisser entre les mains de professionnels au service d’intérêts de groupes qui ont la tête pleine de faux problèmes idéologiques, pour la défense desquels ils sont capables de détruire une organisation dont la construction nous a coûté des années d’efforts et de sacrifices..."
Pour eux donc tout le problème se résume à empêcher que les "dirigeants" des "partis” ne se glissent dans l’organisation des ouvriers. Comment l’empêcher?... En expliquant aux ouvriers la nécessité de s’organiser pour la lutte pour des améliorations économiques et sociales de tous types (plus de la moitié du document cité est consacrée à expliquer toutes les revendications capables d’impulser ou de radicaliser la lutte dans l’usine), en expliquant comment s’organise une commission ou autre organisation similaire, en expliquant comment élaborer une plate-forme revendicative qui ait un écho parmi la majorité des travailleurs de l’entreprise, ou les moyens pour la faire connaître (bombages, tracts, papillons, etc.), en organisant les ouvriers les plus conscients, etc.
La seule chose qu’ils ne proposent pas est la dénonciation constante de la politique desdits groupes -les intérêts de classe deviennent pour eux des intérêts de groupe !-, groupes avec de "faux problèmes idéologiques" qui détruisent l’organisation mise en place avec tant de sacrifices... Il s’agit seulement de "bureaucrates", "d'hommes de parti", de "professionnels", "d'éléments extérieurs".
Dénoncer les intérêts de classe défendus par les politiques de ces groupes supposerait de leur part la définition d'une autre politique distincte de celles-ci, et cela les convertirait automatiquement en un autre groupe du type de ceux qu'ils veulent combattre.
Ainsi, en évitant d'aborder les questions qui pourraient diviser la classe ouvrière en plusieurs fractions[2] (voir note 2 page suivante), telles que le syndicalisme dans la phase de décadence du capitalisme, les luttes de libération nationale, le capitalisme d'Etat, etc., ils proposent eux-mêmes le plus grand confusionnisme et finissent par défendre les mêmes positions que le PCE ou très semblables.
A la page 44 du même document déjà cité, ils donnent un exemple des avantages qu’apportera d'après eux au prolétariat "l’union" pour l'union :
..."Là où elle fut obtenue (il s’agit de l’union) : Russie, Chine, Cuba, Syrie, Algérie, Zambie, Vietnam, etc., les travailleurs ont arraché le pouvoir aux capitalistes. En d’autres endroits, ils sont sur le point d’atteindre ce résultat (Amérique du sud) et dans d’autres enfin, ils disposent d’organisations capables de défendre leurs droits les plus élémentaires : France, Angleterre, Italie" (souligné par nous).
C’est à dire, dans une série de pays où règne le capitalisme d’Etat, à différents degrés de son développement, les travailleurs auraient "arraché le pouvoir aux capitalistes". Dans d’autres d’Amérique latine où le prolétariat se débat dans la mystification de la lutte anti-impérialiste que fait peser sur lui ses différentes bourgeoisies nationales, il serait "sur le point d’atteindre ce résultat". Enfin, dans une série de pays d’Europe occidentale, où ces organisations (PC, syndicats) présentées comme un modèle, se révèlent être un des obstacles essentiels à leur lutte, les ouvriers disposeraient d’organisations "capables de défendre leurs droits les plus élémentaires"...
C’est pourquoi, quelles que soient les extinctions de voix gagnées à crier contre le bureaucratisme, entendant par intérêt de classe le droit de vote au sein d’organisations qui n’ont rien à voir avec la classe, entendant par autonomie ouvrière 1’exclusion des groupes politiques, "les groupes ouvriers autonomes" NE PEUVENT EVITER QUE LEURS COMMISSIONS ANTI-BUREAUCRATIQUES NE RESSEMBLENT COMME UNE GOUTTE D’EAU A UNE AUTRE, AUX COMMISSIONS DU PCE, DU PCI, OU DE "BANDERA ROJA".
Partir de la base, comme ils disent, et en s’appuyant sur leur longue expérience de lutte dans les usines, concevoir l’idée que pour pouvoir parler de socialisme aux ouvriers il est d’abord nécessaire de "gagner leur confiance" (vivre avec eux, parler des mêmes choses qu’eux) considérer que dans un premier temps les ouvriers ne s’organisent que pour la lutte économique et que par suite les révolutionnaires doivent baser leur travail d’organisation sur ce type de lutte comme condition nécessaire, pour pouvoir passer ultérieurement à un "niveau supérieur" et enfin qualifier toute cette activité de simple "procédé pédagogique " pour atteindre l’objectif fondamental (la révolution socialiste), tout cela suppose dans la pratique la défense des mêmes positions que celles des commissions ouvrières qu’ils accusent de bureaucratisme, suppose aussi agir de la même façon dirigiste et manœuvrière que celle de ceux qu’ils accusent d’être de "faux dirigeants" et des "éléments extérieurs" à la classe. En fait, il ne s’agit de rien d’autre que de bureaucratisme anti-bureaucratique.
A ces camarades attelés à la création de nouvelles C.O. nous disons : Ce ne sont pas les révolutionnaires qui créent à l’avance les organisations dans lesquelles le prolétariat s’affirmera comme classe dominante. C’est là PRATIQUE de la classe elle-même, à travers les différentes étapes de la société qui la conduit à la conscience de ses intérêts économiques et politiques. SON ORGANISATION est inséparable de sa CONSCIENCE. La tâche des révolutionnaires consiste à montrer à tout moment la véritable raison du combat et JAMAIS ni par pédagogie ni par "tactique", ni pour toute autre raison, ceux-ci ne peuvent cacher à la classe le véritable sens de sa lutte.
Si aujourd’hui les commissions ouvrières n’arrivent pas à s’implanter, à englober la majorité des travailleurs, être en définitive l’organisation unitaire, démocratique, autonome et représentative, ce n’est pas parce que certains groupes pleins de bureaucrates les boycottent.
C’est ailleurs qu’il faut chercher les raisons de leur crise. Et c’est dans la maturation de la conscience du prolétariat, dans l’assimilation de toutes les expériences de la lutte -aux côtés des commissions- qu’on les trouvera. Le syndicalisme, le réformisme impossible, la démocratie bourgeoise, la pactisation, la négociation, les formes de luttes civiques... toute une politique en définitive profondément étrangère aux intérêts du prolétariat. C’est cela qui constitue la raison de leur crise et de l’existence du bureaucratisme en leur sein.
Les bureaucrates sont le produit de leur politique. Attribuer la crise des commissions aux bureaucrates sans dénoncer leur politique contrerévolutionnaire équivaut à défendre l’idée qu’en remplaçant quelques dirigeants déloyaux par des révolutionnaires, il serait possible de changer toute l’organisation et de la rendre révolutionnaire. Mais ce ne sont pas les chefs qui font l’organisation, sinon exactement le contraire.
COMMISSIONS OUVRIERES ET LUTTE REVENDICATIVE
A la base des CO, qu’elles soient "locales", "de secteurs" ou de "plateformes", on trouve un même objectif : l’organisation de la classe ouvrière de façon permanente pour la lutte revendicative, la formulation de programmes "tactiques" plus ou moins réformistes.
C’est pourquoi, en tant que portes paroles infatigables de la lutte revendicative, les CO deviennent le frein le plus puissant pour l’unification de la classe ouvrière parce que celle-ci ne peut s’unir qu’à travers le mouvement qui la mène vers la révolution socialiste, c’est à dire à travers le mouvement qui brise les chaines qui tentent de la maintenir attachée à des programmes tactiques masquant ses véritables objectifs révolutionnaires.
Dans la période de décadence du capitalisme, toute organisation permanente de 1’ensemble de la classe ne peut exister que sur la base de la révolution socialiste.
En général, toutes les luttes revendicatives (pour des salaires plus élevés, des journées de travail plus réduites, des cadences moins épuisantes, etc.) conduisent à un affrontement avec l’état (occupations d’usine, heurts contre les forces répressives de l’état, arrestations, etc.) c’est à dire que de revendicatives, la majorité des luttes TENDENT A PRENDRE DE PLUS EN PLUS UN CARACTERE REVOLUTIONNAIRE.
L’activité systématique des commissions ouvrières dans ce processus est révélatrice : négociations constantes avec le patron, justification de l’affrontement avec l’état UNIQUEMENT à travers le caractère fasciste de celui-ci en masquant le fait que c’est la BOURGEOISIE COMME CLASSE QUI EXPLOITE LE PROLETARIAT et non les secteurs fascistes... En définitive les C.O. ne cessent d’agir comme le bouchon d’une bouteille pour que la force révolutionnaire qui existe à l’état latent en chaque lutte, pour petite qu’elle soit, ne puisse trouver de sortie.
De cette façon, l’unité de tout le mouvement ouvrier dont on jacasse tant, les mène à identifier l’organisation des commissions avec celle de la classe et celle-là avec un "syndicat de classe".
Voyons ce que dit le compte-rendu de la première réunion nationale des "secteurs de commissions ouvrières":
- "Avec toutes leurs imperfections, traînant avec elles de nombreux défauts et surtout avec un grand décalage entre leurs possibilités réelles et les véritables nécessités organisationnelles de la classe ouvrière, ces nouvelles commissions[3] apparaissent déjà comme l’embryon d’un syndicat de classe. Et elles le sont, non seulement parce qu’elles font de la conquête d’un syndicat leur objectif politique le plus important, mais aussi parce qu’elles essaient dès maintenant d’assumer les taches propres à un véritable syndicat ouvrier : améliorer les conditions de salaire et de vie des travailleurs, forger leur unité, impulser la lutte solidaire et la généralisation des conflits, encadrer tous les ouvriers derrière des objectifs politiques clairs et enracinés dans les masses" (document cité plus haut, p.3).
Il apparaît donc d’une façon parfaitement claire que la lutte revendicative pour laquelle elle se propose d’organiser la classe ouvrière n’exprime pas la nécessité d’une révolution prolétarienne sinon la nécessité de conquérir le droit au... "syndicat de classe".
En d’autres mots, elles veulent dire que pour la bonne marche de la lutte revendicative, pour obtenir des améliorations, il est nécessaire de faire appel à un syndicat. Ceux qui pensent ainsi doivent croire fermement dans les possibilités encore progressistes du système capitaliste ; pour eux, parler de la décadence et de la crise doit sonner comme une plaisanterie de mauvais goût : le capitalisme -nous diront-ils s’ils sont conséquents- n’est ni un système social mondial, ni un frein au développement des forces productives...!
Dans le cas contraire, comment peuvent- ils prétendre qu’un syndicat est l’instrument pour obtenir des améliorations de toute sorte (fondamentalement économiques) de la part d’un système qui, pour survivre, ne peut offrir autre chose qu’une exploitation tous les jours plus effrénée ?
Quant aux "objectifs politiques clairs derrière lesquels ils se proposent d'encadrer toute la classe travailleuse", ils les définissent comme la lutte contre la DICTATURE pour une DEMOCRATIE bourgeoise qui doit se concrétiser dans la "République Démocratique Bourgeoise".
C’est cela la clarté politique des ’’Commissions ouvrières de secteurs” et de "Bandera Roja". Nous ne pouvons faire moins que les féliciter pour la "clarté" et la "cohérence" avec lesquelles ils oublient et mettent aux archives la révolution prolétarienne. Au moins, la classe ouvrière et leurs propres militants ne se feront pas d’illusions sur les objectifs de ces organisations.
Devant cette définitions de la lutte revendicative identifiée avec la lutte syndicale, nous devons prendre en considération les faits qui se produisent dans le monde entier et qui indiquent la perspective révolutionnaire : c’est vrai que la lutte pour un "syndicat de classe" est une lutte "revendicative’,' mais sont également des luttes revendicatives toutes celles qui se déroulent dans les pays capitalistes (où les syndicats ouvriers existent) en dehors et contre les syndicats. Nous voulons parler concrètement des grèves dites "sauvages". Dans ce cas les luttes économiques qui sont aussi des luttes revendicatives, ne peuvent en aucune façon s’identifier avec la lutte syndicale. Aujourd'hui, dans le monde entier, et particulièrement en Europe, la lutte de la classe ouvrière pour ses revendications économiques tend à se développer avec de plus en plus de force en dehors des syndicats.
Et en même temps que se développe cette tendance, nous voyons comment les syndicats (ET L’EXEMPLE DU PORTUGAL LE REAFFIRME EN TOUTE CLARTE) sont les premiers à réclamer de leurs gouvernements respectifs la promulgation de lois contre les "grèves sauvages", en même temps qu’ils sont devenus les fers de lance de la répression de toute lutte qu’ils ne contrôlent pas : la grève général de mai 1968 en France a été un exemple limpide de l’efficacité de la CGT française (courroie de transmission du PC français) dans la tâche de liquidation de la lutte. En Pologne, en 70, les ouvriers de la Baltique ont été obligés d’affronter et de détruire matériellement leur "syndicat ouvrier".
Quand en Espagne, les Commissions ouvrières affirment que leur objectif fondamental est la conquête d’un "syndicat de classe", elles préparent dans la pratique, la subordination de toute lutte à l’atteinte de cet objectif. De cette façon, sous le slogan de "liberté syndicale", on essaie de mystifier le véritable contenu de la lutte. Quand celle-ci déborde à intervalles de plus en plus rapprochés le cadre syndical et fait montre de sa véritable perspective révolutionnaire, les C.O font tout leur possible pour canaliser toute l’énergie et le potentiel révolutionnaire du prolétariat et les DEVIER vers le syndicalisme stérile et contre-révolutionnaire. C’est là le sens véritable de la consigne ’’pour un syndicat de classe”.
Dans un autre paragraphe du document de la réunion nationale des C.O de secteur, sont analysées les causes de la crise des commissions. Voici les arguments :
- ”Et il ne s’agit pas seulement de l’existence de ces organisations -les C.O-, mais aussi de leur fonctionnement, de leurs critères organisationnels et de travail, de leurs objectifs politiques. Là se trouve réellement le problème.
Nous ne faisons rien de neuf en parlant des C.O. Nées comme on le sait en 1962, dix années de vie ont montré l’évidence que les orientations qu’elles ont reçu pendant une longue période n’ont pas contribué à faire des C.O une organisation vraiment unitaire, vraiment développée, vraiment enracinée. Dans beaucoup de cas, c’est le contraire qui est advenu, ces orientations (de concevoir les commissions comme un mouvement désorganisé, appuyé seulement sur des chefs plus ou moins prestigieux, de forcer la légalité au-delà-de-ce qui pouvait se faire sans mettre à découvert tout son appareil et squelette organisationnels, de transférer toute la responsabilité dans la direction des luttes à ceux de leurs militants occupant des charges syndicales) ont conduit les CO de plusieurs centres industriels importants à perdre leur efficacité, à être victimes de la répression, à l’incapacité à faire face aux nécessités croissantes de la lutte ouvrière" (document cité, page 2).
La remise en cause de toutes ces "PETITES CHOSES" facilement corrigibles(mettre leurs propres dirigeants à la place des autres, ne pas laisser la direction de la lutte à des chefs "prestigieux” ou assumant des charges syndicales)s’est traduite dans la pratique par la manipulation des luttes par de nouveaux dirigeants avec plus de "prestige’’(plus crédibles par les ouvriers)se substituant aux assemblées d’usine, par la direction des luttes en accord avec la légalité ,(en essayant de toujours respecter la législation bourgeoise du travail),par le pacte et la négociation et par leur canalisation à travers le syndicat vertical.
Avec ces "petites choses", les commissions "locales" et les autres ont boycotté la lutte de Macosa et encore plus clairement celle d’Harry Walker. Dans celle-ci, une des plus longues et dures de ces dernières années à Barcelone, parce qu’il n’y avait pas de commission pour se mêler du combat, parce qu’il n’y avait pas de charges syndicales qui puissent le "diriger" , c’est l’Assemblée Générale de tous les travailleurs de l’usine qui a dirigé leur propre lutte et Leur a permis de ne pas se laisser tromper aussi facilement.
Le seul fait d’observer que bien qu’ils n’arrivent pas à étendre les commissions, à les implanter réellement dans les entreprises, la lutte du prolétariat, AU LIEU DE FAIBLIR SE REFORCE CONSTAMMENT (même sans commission renforcée et coordinatrice) devrait suffire à ces gens pour les faire réfléchir sur la validité de leur politique, sur les intérêts de classe que celle-ci défend. Et encore plus quand leur tâche fondamentale ,1a lutte revendicative,(pour de meilleurs salaires, la durée du travail les cadences, etc. ;) est menée à bien, de façon spontanée, par les travailleurs sans une commission qui ait à leur dire : "camarades, il faut lutter.”
Mais non, il ne s’agit pas d’une question d'objectifs politiques. Il s'agit simplement de quelques "défauts" facilement corrigibles... quatre retouches par-ci par-là et le tour est joué ! Nous avons des commissions ouvrières toutes neuves!
C'est de cette façon que ceux qui défendent avec le plus d'abnégation la lutte revendicative du prolétariat, ceux qui se trouvent le plus souvent à sa tête, deviennent ses bourreaux les plus impitoyables quand celle-ci montre son caractère révolutionnaire. Et ils ne font pas cela par mauvaise foi ou mauvaise volonté.
TOUTE ORGANISATION SYNDICALE EST' INEVITABLEMENT CONDAMNEE A JOUER CE ROLE DANS LA PERIODE DE DECADENCE DU CAPITALISME.
Quelle est notre position à l'égard de la lutte revendicative ?
Depuis que le prolétariat existe comme classe, c'est à dire comme un ensemble d'individus socialement déterminés par une situation matérielle commune, sa lutte révolutionnaire garde inévitablement un caractère de lutte revendicative.
L'histoire du mouvement ouvrier se refuse obstinément à marquer une séparation entre lutte revendicative et lutte révolutionnaire.
Aussi bien la majeure partie des luttes n'ont pas réussi à dépasser le cadre purement revendicatif et n'ont pu être que potentiellement révolutionnaire, aussi bien il n'a pas existé une seule lutte révolutionnaire qui n'ait été simultanément revendicative.
Le mouvement révolutionnaire de 17 en Russie est extrêmement éloquent à cet égard. La classe ouvrière se lance dans la lutte révolutionnaire poussée par la misère économique et par la guerre. Le mouvement s'unifie et se renforce à travers la lutte pour une revendication : la PAIX.
La bourgeoisie ne peut céder à cette revendication et pour l'obtenir le prolétariat ne peut que poursuivre le combat jusqu'au bout: LA."DESTRUCTION DE L'ETAT BOURGEOIS.
Ce qui a distingué la fraction la plus avancée du prolétariat, le parti bolchevik, des fractions de la bourgeoisie russe(mencheviks et socialistes révolutionnaires) CE NE FUT PAS DE DEFENDRE LA LUTTE POUR LA PAIX CONTRE LA GUERRE, MAIS DE MONTRER LA VERITABLE SIGNIFICATION, LA VERITABLE RAISON DU COMBAT DU PROLETARIAT RUSSE : LA REVOLUTION PROLETARIENNE.
De la même façon, la réponse contre l'attaque fasciste de juillet 1936 était potentiellement révolutionnaire. Si elle a conduit à la défaite la plus tragique ce fut parce que la gauche du capital (les partis communistes dirigés par le P.C. d'Union Soviétique) a réussi à mystifier, encadrer et vider de son contenu révolutionnaire, le véritable sens du combat du prolétariat. La défaite du prolétariat espagnol a été la préparation au massacre du prolétariat mondial ; la seconde guerre impérialiste mondiale. La crise capitaliste a pu se résoudre momentanément à travers la guerre impérialiste et la perspective de la révolution socialiste a du s'éloigner.
En Espagne, durant la guerre de 1936, s'est exprimé le caractère révolutionnaire de la lutte contre le fascisme. Les partis socialiste, communiste, la C.N.T et le P.O.U.M, en compagnie des bourgeois républicains et nationalistes ont réussi à mystifier et encadrer le prolétariat derrière la république bourgeoise, et à vaincre la révolution. Octobre 1934 aux Asturies et mai 1937 à Barcelone sont des exemples clair: de la façon dont les partis du capital déguisés par les noms de "communiste" ou "socialiste" sont les bourreaux de la révolution.
On nous dira alors que nous, révolutionnaires, avons pour tâche principale de provoquer les luttes revendicatives. A ceux qui pensent ainsi, nous répondons que ce n'est PAS NOTRE TACHE. LA LUTTE REVENDICATIVE N'EST L'INVENTION GENIALE D'AUCUN REVOLUTIONNAIRE INSOMNIAQUE, elle existe depuis la naissance même du prolétariat et avec celle-ci, sa potentialité révolutionnaire.
Dans la phase ascendante du capitalisme (quand c'était un système social capable de développer les forces productives jusqu'à des limites insoupçonnables) le capital a connu ses moments de plus grande richesse et développement. Celui-ci pouvait concéder des réformes et des améliorations réelles et durables à la classe ouvrière en lutte, aussi bien dans le domaine économique (diminution de la journée de travail, augmentation de salaires, etc.) que social (droit à la libre association, à la syndicalisation, suffrage universel, etc.) sans que l’économie soit mise en danger. Il y avait dans le monde de nouveaux marchés à conquérir. Seuls, des "débordements révolutionnaires” des luttes revendicatives marquent cette période.
Pendant celle-ci, la classe ouvrière unifiée à travers les syndicats et les partis parlementaires, développe sa lutte sans que celle-ci conduise directement à l’affrontement avec l’Etat bourgeois. Le Capital est suffisamment riche et les marchés suffisamment nombreux pour que le système puisse ne pas être mis en péril par les concessions que la lutte ouvrière l’oblige à faire. La révolution sociale ne peut pas être à l’ordre du jour.
Quand le Capital entre dans sa phase de décadence, les luttes se transforment beaucoup plus rapidement et fréquemment en luttes révolutionnaires parce qu’il ne peut pas concéder de véritables réformes, parce que toute concession doit être rapidement RECUPEREE, parce que c’est AU SEUL PRIX DE LA CONSTANTE DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DE LA CLASSE OUVRIERE QU’IL PEUT RETARDER SA CRISE DEFINITIVE.
Ce qui a changé dans la phase de décadence du capitalisme, c’est que ces luttes revendicatives sont de moins en moins de simples luttes économiques, QUE LEUR NATURE ET LEUR POTENTIEL REVOLUTIONNAIRE SURGIT BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT QU’AU SIECLE DERNIER.
Mais aujourd’hui comme hier, la lutte revendicative de la classe ouvrière n’est l’invention d’aucun révolutionnaire, le résultat d’aucune "tactique miraculeuse". En elle, aujourd’hui comme hier, est contenue sa potentialité révolutionnaire. Et c’est fondamentalement parce que la classe ouvrière commence, après 50 années de contre-révolution, à comprendre le sens véritable de sa lutte, qu’elle rejette de plus en plus souvent à l’ECHELLE MONDIALE les tentations du Capital pour l'encadrer et l’intégrer.
Aujourd'hui les organes qui peuvent paraître idéaux pour mener à bien sa lutte (syndicats, organisations permanentes pour sa lutte revendicative, etc.) sont non seulement ABANDONNES par la classe mais aussi, POUR ETRE DEVENUS DES INSTRUMENTS DU CAPITAL, doivent être affrontés et détruits par celle-ci si elle veut développer de façon conséquente sa lutte.
Ceci est la leçon, entre autres, des luttes de la classe ouvrière polonaise, quand, en 1970, devant la hausse des prix décidée par le gouvernement "socialiste" de Gomulka, elle s'est jetée dans la lutte, affrontant les milices du gouvernement, le P.C polonais et les syndicats. Dans sa lutte elle a organisé des conseils ouvriers dans les usines et a généralisé la grève sauvage contre les syndicats. Ce n'est qu'avec les armes que les "socialistes" et les "syndicats ouvriers" ont pu vaincre la classe ouvrière polonaise.
Alors que la tâche des agents du Capital au sein de la classe ouvrière est de CACHER le caractère révolutionnaire de la lutte revendicative de la classe ouvrière, de la FREINER et de 1'ENCADRER derrière les objectifs du Capital pour qu’elle perde sa potentialité révolutionnaire, la tâche des révolutionnaires est de montrer à chaque instant son véritable contenu.
- "Nous ne nous présentons pas devant le monde en doctrinaires, armés d’un nouveau principe : voici la vérité, mets-toi à genoux ! Nous ne lui disons pas : abandonne tes luttes car ce sont des sottises ! Nous ne faisons que lui montrer la vraie raison de sa lutte : la conscience est quelque chose qu'il doit faire sienne qu’il le veuille ou non !" (Marx, lettre à Ruge)
NOTRE OBJECTIF N'EST PAS DIFFERENT. Ce qui distingue les révolutionnaires aujourd’hui ce n'est pas leur "popularité", leur "capacité à attirer les masses" ou leur talent pour "gagner la confiance des secteurs bourgeois".
Contrairement à ceux qui vendent la révolution et trahissent le prolétariat en défendant les objectifs du Capital pour ne pas "se voir isolés des masses ouvrières", les révolutionnaires savent qu’en indiquant les buts véritables de la lutte ils seront très souvent "impopulaires" qu’ils seront traités de "provocateurs gauchistes" dans les moments de recul de la lutte, de "diviseurs de la sacro-sainte unité", d’"Agents de la réaction", et même de collaborateurs avec le fascisme quand ils dénonceront le populisme et les fronts démocratiques tant à la mode, comme les feuilles de vigne du Capital.
ACCIÓN PROLETARIA.
[1] Durant toute une période, les commissions ont surgi dans une multitude d’usines, au feu des mouvements de grève qui se sont développés en Espagne à partir du début des années 60. Elles surgissaient, disparaissaient, reparaissaient au rythme des progressions et des reculs de la lutte.
Cette instabilité dans leur continuité, en tant qu’organisations, constituait une entrave énorme pour la formation d’un ’’syndicat de classe”. C’est pour cela que les partis de gauche avec en tête le PCE ont impulsé la création d’organismes permanents hiérarchisés et exécutifs (coordinations locales, régionales, provinciales, nationales) qui, indépendamment de la conjoncture et de la lutte, se sont efforcé d’orienter politiquement tous les ouvriers et toutes les luttes - aussi partielles et éparses qu’elles aient pu être - vers un même but : la lutte contre la dictature et pour des réformes corporatistes.
Et ce fut le PCE, grâce à son potentiel financier et propagandiste, qui put, dans presque toute l’Espagne, se rendre maître de ces organisations. Il n’a pu développer sa politique de "réconciliation nationale "et de" pacte pour la liberté" qu’à la condition de disposer d’un certain poids et d’un certain contrôle parmi les travailleurs. Avec les commissions ouvrières il a trouvé sa ’’chair à canon”.
L'impossibilité d'obtenir des améliorations réelles et durables a provoqué chez les ouvriers une apathie et une résistance à s'organiser de façon stable dans les commissions ouvrières. De plus en plus, et principalement à partir des années 70, les luttes -qui n’ont décru ni en quantité ni en intensité- se sont déroulées en marge de l’organisation officielle des commissions ouvrières.
De nouveau, les luttes se déroulent avec des assemblées d’usine, comités unitaires, etc. ; en dehors et quelquefois contre les commissions.
Aujourd'hui, on peut dire que les commissions ouvrières ne sont rien d’autre qu’une organisation formée uniquement par les militants des groupes politiques qui refont de celles-ci des organisations identiques à ce qu'étaient les USO, OSO, etc.
[2] la classe ouvrière ne peut se diviser en deux moitiés : l’une révolutionnaire, l’autre réactionnaire. La classe ouvrière est la classe révolutionnaire dans son ensemble. Des ouvriers pris comme individus (bien qu’en nombre ils puissent constituer une majorité) peuvent faire leurs les intérêts d’une autre classe et par là s’opposer aux intérêts de leur classe.
[3] Il s’agit des "secteurs" de C.O. opposés aux vieilles commissions "locales" où le PCE est prédominant.
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
La bourgeoisie face à la crise (2ème partie) - Centralisation du capital et des classes moyennes
- 14 reads
La crise accélère la tendance vers une centralisation du capital aux dépens des secteurs les plus faibles du capital, ainsi que de Ta petite-bourgeoisie et des petits paysans. La part de la plus-value globale qui est à présent appropriée par ces éléments sera de plus en plus appropriée par le grand capital, qu’il se présente sous sa forme monopolistique ou d’État. L’exemple le plus flagrant de l’accélération de ce processus a été l’attaque récemment menée par les compagnies pétrolières contre les entreprises de raffinerie et de distribution indépendantes. L’approvisionnement en pétrole brut des raffineries indépendantes a été coupé et les stations-service indépendantes, en plus des ”restrictions” de pétrole, se sont vu concurrencer par les ventes à plus bas prix des compagnies qui tentaient ainsi de les ruiner. De cette façon, ces dernières espéraient s’emparer des 20% du marché de raffinerie et de détail qui leur échappaient jusqu’à présent. Le même phénomène se produit dans l’industrie des transports, où les camionneurs indépendants ont dû faire face à une vigoureuse attaque des grandes compagnies de transports routiers qui, pour faire face à la crise, ont tenté d’étendre leur emprise en poussant à la faillite leurs concurrents aux moyens plus limités .
Les politiques déflationnistes qui sont appliquées partout ont des conséquences particulièrement catastrophiques pour le petit capitaliste, le boutiquier et le petit paysan. Des impôts plus élevés et une politique du crédit restrictive, à travers lesquels le capital espère freiner l’inflation galopante, font des ravages dans leurs rangs. Aux USA, le taux d’intérêt est monté jusqu’au chiffre record de 11,5% en mai. Les économistes gouvernementaux ont admis que les ”petites entreprises payent à présent 14 à 16% sur des prêts à court terme et les banques leur refusent des extensions” (Newsweek,10 juin 1974). Incapables de financer leurs opérations, les petits capitalistes et les boutiquiers font faillite à un rythme accéléré. La somme totale des dettes des compagnies banqueroutières dépasse de loin $ 200 millions par mois, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport à 1973. C’est évidemment le grand capital qui tirera profit de cette vaste opération de ”nettoyage".
Face à ces politiques gouvernementales, la petite bourgeoisie (boutiquiers, camionneurs indépendants, petites stations-service, etc.) a, contrairement aux propriétaires de petites et moyennes usines, démontré leur volonté de riposter par des formes violentes de lutte afin de défendre leurs privilèges de classe possédante.
En France, en Novembre 1973, à la suite de fortes augmentations d'impôts, les petits commerçants qui vendent au détail une grande part de la production agricole se sont mis en grève pour faire diminuer les nouveaux impôts qui venaient, menacer leurs profits. Partout en France les marchés de gros ont été fermés, et les supermarchés qui ne fermaient pas se sont vus attaqués ou entourés de piquets de grève; on crevait les pneus aux camions qui essayaient d'y livrer leur marchandise. A Paris, le 15 Novembre, presque tous les vendeurs au détail, les cafés et les restaurants, ont été fermés, et ceux qui refusaient d'observer le mot d'ordre de grève étaient menacés de violences.
Aux Etats-Unis, en Décembre 1973, des milliers de camionneurs indépendants se sont mis en grève contre la politique du gouvernement sur l'essence, qui les mettait en danger de faillite. Les autoroutes ont été bloquées et on tirait sur les camions qui continuaient à rouler. En Janvier, des propriétaires indépendants de stations d'essence de Long Island ont commencé une grève pour protester contre les restrictions sur l'essence. Les propriétaires qui gardaient leur station ouverte ont été menacés ou attaqués par les propriétaires en grève. La "gauche" a soutenu ces luttes de la petite bourgeoisie avec un enthousiasme effréné. En France, le P.C. et la C.G.T. ont soutenu inconditionnellement la lutte des petits commerçants. Les trotskystes de l'aile Mendel-Franck de la IV° Internationale (Rouge) ont suivi le P.C. en arguant que la petite bourgeoisie, comme la classe ouvrière est une victime des monopoles et donc l'alliée naturelle du prolétariat. Pris dans leur propre rhétorique ils sont allés jusqu'à affirmer que "les petits commerçants auraient tout à gagner dans un système de distribution socialiste où ils ne seraient plus à la merci du grand capital, où ils n'auraient plus à payer les conséquences des hasards de la vente".
Aux Etats-Unis pendant la grève des camionneurs indépendants, la Spartakist League trotskyste a signalé la nécessité de "gagner la direction des classes moyennes" en "donnant des garanties aux petits commerçants en lutte" (Workers' Vanguard. 4 Janvier 1974). Ceux d'international Socialism ne se sont pas contentés d'affirmer que la petite bourgeoisie est l'alliée naturelle du prolétariat dans la lutte pour le socialisme, ils ont aussi décidé d'incorporer la petite bourgeoisie dans la classe ouvrière.' Dans ses écrits sur la grève des camionneurs indépendants, International Socialism a fièrement proclamé qu'on ne saurait voir une image plus vivante du pouvoir des ouvriers américains” (Workers' Power n°88).
L'image d'un "socialisme" sécurisant les classes moyennes, d'un front unique de toutes les victimes des monopoles (petits capitalistes, professions libérales, petite bourgeoisie, paysans, ouvriers) et même la démagogie avec laquelle la petite bourgeoisie est transformée en "ouvriers", sont des caractéristiques de l'aile gauche du capital. Derrière ces alliances multi-classistes et ces programmes populistes, l'aile gauche de la bourgeoisie se prépare d'abord à dévier le prolétariat de l'assaut révolutionnaire contre l'État capitaliste pour ensuite paver le chemin du massacre des ouvriers.
La question des classes moyennes et des rapports du prolétariat envers celles-ci est extrêmement complexe et demande un développement bien plus détaillé que celui que nous pouvons faire ici. Nous pouvons cependant énoncer certains points fondamentaux. La "protection" des classes moyennes présuppose la survie du système capitaliste. L'existence même des classes moyennes est directement liée à la perpétuation du système de production de marchandise, du marché et de la loi de la valeur. Le socialisme ne "protège" pas les classes moyennes et ne leur garantit aucune "stabilité". Il représente leur destruction en tant que couches distinctes ayant des privilèges et des propriétés.
C'est vrai que les classes moyennes sont victimes de la tendance centralisatrice du capital. Cependant, il n'existe pas de mode de production correspondant à la domination de la petite bourgeoisie. Les classes moyennes ne peuvent pas avoir un pouvoir étatique correspondant à leurs propres intérêts de classe. En effet, la petite bourgeoisie ne peut pas lutter contre le capitalisme sans se suicider en tant que classe possédante. Afin de préserver ce qui leur reste de privilèges et de propriété, les classes moyennes ne peuvent que se tourner vers les représentants du grand capital dans sa forme monopoliste ou étatique.
Si la centralisation du capital condamne la petite bourgeoisie à une destruction progressive, le désordre et le trouble social qu’apporte le réveil d’une insurrection prolétarienne constituent une menace bien plus grande et immédiate à la sécurité et la stabilité des classes moyennes. Face à la menace de la révolution prolétarienne, las classes moyennes apportent leur soutien au capitalisme dans ses formes d’oppression les plus brutales, dans l’espoir de débarrasser la société de l’insécurité que représente un prolétariat militant.
Cela ne veut pas dire que des éléments des classes moyennes ne peuvent pas être gagnés par la lutte pour le socialisme. Cependant, la petite bourgeoisie rejoint le mouvement prolétarien non pas pour défendre ses intérêts de classe, mais avec la conscience que la révolution socialiste veut dire l’élimination de la petite bourgeoisie non pas en tant qu’individus, mais en tant que classe distincte et privilégiée.
Le contenu réel du programme de l’aile gauche de la bourgeoisie, quoique celle-ci puisse bien dire, n’est pas la protection des classes moyennes. Si la gauche sauve les classes moyennes de la domination des monopoles privés, ce n’est que pour les assujettir au contrôle total et à la domination du capitalisme d’État. Les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas nationalisées seront organisées et réglementées par l’État à travers son appareil de planification. Les producteurs indépendants seront organisés dans un réseau de ”coopératives” sous le contrôle total de l’État. Tandis que l’appareil de planification déterminera la répartition des matières premières, contrôlera les prix et les profits etc., les institutions du "crédit public" placeront les fonds dans ces entreprises déterminant ainsi les conditions de leur existence, leur taille etc. La base du programme de la gauche est la subordination stricte des plus petites entreprises et des producteurs indépendants les plus insignifiants aux besoins et aux diktats du grand capital
Dans le moment présent, les monopoles privés et leurs représentants dans le pouvoir d’État se trouvent devant un dilemme par rapport aux classes moyennes. À mesure que la crise s'approfondit, les monopoles ont besoin de se saisir de la part globale de plus-value que les classes moyennes s'approprient sous une forme ou une autre. Pour lutter contre l’inflation galopante, le grand capital a besoin d'une politique de restriction des crédits qui hâtera la destruction des petits capitalistes et de la petite bourgeoisie. Cependant, les politiques déflationnistes que requiert La conjoncture économique présente ont des ramifications politiques dangereuses dans la mesure où elles affectent les classes moyennes. La hausse des impôts et les restrictions de crédit peuvent provoquer des soubresauts violents de la petite bourgeoisie à une époque où le grand capital a besoin du soutien des classes moyennes contre le prolétariat. Pour pouvoir utiliser les classes moyennes contre le prolétariat, le grand capital doit au moins faire semblant de protéger leurs intérêts. La division dans les rangs du grand capital sur la question des classes moyennes (entre ceux qui suggèrent une vaste politique déflationniste et ceux qui parlent de la nécessité de protéger les classes moyennes) ne porte en fait que sur les moyens de s’attaquer aux couches moyennes. Face à la faillite économique, la grande bourgeoisie devra s’attaquer directement aux classes moyennes, même au risque de perdre leur soutien politique. Si la situation économique se stabilise, ne fût-ce que pour une courte période, le grand capital pourra se satisfaire d'une attaque indirecte sur les classes moyennes, ce qui permettrait la continuation du processus de centralisation sans entrave majeure, tout en essayant de garder le soutien politique de la petite bourgeoisie grâce aux promesses de protection du gouvernement.
La centralisation du capital, que la crise est en train d’accélérer, est aussi en train d’affecter le grand capital lui-même. À mesure que la crise s'approfondit, la tendance vers le capitalisme d'État se prononce de plus en plus. Dans les années à venir, la balance entre capital privé et capital d'État penchera de plus en plus en faveur de ce dernier. Il ne sera plus seulement question de nationaliser les industries qui marchent à perte, mais de nationaliser bon nombre d’industries les plus profitables. La perspective est à la fusion et non à une lutte violente entre les représentants du capital privé et d’État. Cependant, ce sera la force ou la faiblesse relative du capital national dans le marché mondial qui déterminera le nouveau point d'équilibre entre capital privé et étatisé. C'est la lutte entre les différentes fractions du capital pour un repartage du marché mondial, la nécessité de se préparer pour une guerre impérialiste mondiale, qui est à la base de la tendance inexorable vers le capitalisme d'État.
La "gauche" officielle est le véhicule de base des fractions de la bourgeoisie qui défendent le système capitaliste d'État le plus achevé. La "gauche" ne représente pas seulement l’aile la plus étatiste, elle représente aussi la plus nationaliste. Alors que l'aile "modérée" du Parti Travailliste anglais (Wilson, Healy) était le reflet fidèle des intérêts de la City et entretenait les relations les plus étroites possibles avec le capital américain, la "gauche" travailliste (Tony Benn, The Tribune Group) est le reflet d'une tendance grandissante à une; économie nationaliste et autarcique. Ainsi, la "gauche" travailliste est décidée à retirer l'Angleterre du Marché Commun et à utiliser le National Enterprise Board prévu pour, selon les mots mêmes de M.Benn "s'opposer aux multinationales et empêcher les industries anglaises d'investir outre-mer". Les nationalisations, les accords de planification, le N.E.B., les contrôles sur les échanges etc. voilà les instruments dont la "gauche" espère se servir pour conduire le capital britannique dans la voie de l'autarcie.
En France, aux récentes élections présidentielles, François Mitterrand, le candidat des partis Socialiste, Communiste et Radical de gauche a clairement fait savoir son intention de limiter les activités des compagnies multinationales, et de protéger l'"indépendance" du capital français. En réponse à un questionnaire de la revue "Entreprise", organe de pointe de l'aile "moderniste" du patronat, Mitterrand affirme :
- "Je veux préserver notre indépendance dans trois domaines essentiels :
Vis-à-vis des investissements étrangers dans les secteurs-clé.
- Technologiquement, surtout dans les industries de pointe (ordinateurs, énergie nucléaire).
- En tenant compte des approvisionnements en énergie et en matières premières.
C'est dans cet esprit que ces mesures envers les multinationales seront étudiées et votées." (Entreprise n°975)
Mitterrand voit aussi les nationalisations comme un moyen de sauvegarder les "intérêts nationaux" français :
- "Dans certains cas (les nationalisations) sont aussi une solution pour éviter que certaines compagnies ne tombent sous le contrôle étranger. Si Roussel-Uclaf avait été nationalisé, comme nous l'avons proposé en 1973, cela lui aurait évité de passer entre les mains du capital étranger. [1]" (Idem).
Comme l'indépendance du capital français ou anglais est une illusion, et que la seule alternative à la domination américaine est de se tourner vers le capital russe, la dégradation de la situation économique va renforcer l'influence de la fraction de gauche du capital, aussi sûr que la nationalisme et l'étatisme sont deux manifestations de l'orientation grandissante vers la guerre.
Les solutions de la bourgeoisie
Intensification du travail, blocage des salaires, programmes d'austérité et déflation servent à reporter la crise sur le prolétariat et à abaisser les salaires. Les énormes investissements en capital fixe sont de moins en moins en mesure d'aider le grand capital, entraîné, dans une crise qui s'approfondit, face à la saturation des marchés, à augmenter la productivité du travail. La baisse des profits, les taux d'intérêt élevés, les taxes qui augmentent rapidement ont d'ores et déjà entamé la capacité du capitalisme à faire de nouveaux investissements importants. Ainsi en Mai en Angleterre, la Confédération de l'industrie britannique "affirmait qu'il y avait eu un effondrement sans précédent dans les perspectives du capital" (Financial Times 4/6/74 Pour relever le taux de profit, la bourgeoisie devra de plus en plus utiliser la bonne vieille méthode d'intensification du travail, avec ses conséquences Inévitables: épuisement, maladies, accidents et mort précoce qui seront le sort des ouvriers qui auront encore du travail. Cette augmentation du taux d'exploitation entraînera dans son sillage un chômage massif, puisque moins de travailleurs produisent plus de plus-value.
La lutte pour les marchés s'intensifiant, chaque fraction nationale de la bourgeoisie doit tenter de réduire ses coûts de production. Pour renforcer sa compétitivité et élever son taux de profit, la bourgeoisie essaie aujourd'hui de diminuer ses frais salariaux, de réduire le coût de travail à son strict minimum, jusqu'à payer les ouvriers en-dessous de la valeur de leur force de travail.
Lors de la dernière grande crise économique des années 30, la bourgeoisie avait deux politiques de base qu'elle pouvait utiliser alternativement dans ses assauts contre le niveau de vie du prolétariat : la déflation, qui entraîna une réduction directe des salaires (Allemagne, Italie, Flandin et Laval en France) l'inflation, qui, elle, entraîna une baisse indirecte du pouvoir d'achat dû à la dépréciation de la valeur de la monnaie (Etats-Unis, Angleterre, Blum en France). Dans la mesure où les prix étaient tombés depuis cinq ans à un niveau sans précédent, et où le lourd fardeau des dettes (les crédits bancaires qui ont financé la reconstruction d'après-guerre) condamna bien des capitaux à l'oisiveté, le grand espoir de la bourgeoisie résidait dans une politique inflationniste comme celle de Roosevelt aux Etats-Unis, qui cherchait à relever les prix et à délivrer les capitalistes du poids de leur endettement grâce à la dévaluation de la monnaie. Les répercussions sur le prolétariat ne furent pas moins désastreuses que celles de la politique déflationniste allemande. D'après William Green, président de l'A.F.L., le revenu des ouvriers a augmenté de 7,5% entre Avril 1933 où le Dollar avait été dévalué et Février 1934, alors que le prix des produits alimentaires de base augmentait de 16,7% et les prix des vêtements et autres marchandises de 27,5%. "Il y eut une hausse du salaire nominal mais une baisse du salaire réel" (Lucien Laurat "Cinq Années de Crise Mondiale", Paris 1934, p.74).
L'actuelle crise mondiale bien que caractérisée par une chute de production et une augmentation du chômage (quoiqu'à un niveau différent de celui qui a suivi le krach de 1929) ne se manifeste pas par une chute vertigineuse des prix mais au contraire par l'inflation galopante. Le palliatif temporaire de politique inflationniste qu'avait utilisé le New Deal américain et le Front Populaire français dans les années 30 est aujourd'hui impossible. Les tentatives de renflouer l'économie à travers, soit la diminution des taxes, soit les mesures destinées à faciliter le crédit (mesures prônées par The Economist en Angleterre ou Keyserling aux Etats-Unis) entraîneraient une sur-inflation à côté de laquelle l'actuel chiffre d'inflation semble modeste et un risque d'effondrement économique. En Occident, la bourgeoisie a opté pour une politique déflationniste dans l'espoir d'enrayer l'inflation. Aux Etats-Unis, Arthur Burns, le président du Fédéral Reserve Board, a affirmé "l'inflation où elle en est risque de saper les fondements de notre société...l'avenir de notre pays est en danger". Le taux d'intérêt aux Etats-Unis s'est élevé à un niveau record de 11,5% et la bourgeoisie semble déterminée à sa politique d'argent cher, malgré la menace très réelle d'une crise des liquidités et d'une vague de banqueroutes. En Italie, Guido Carli, le gouverneur de la Banque d'Italie insiste sur la nécessité de prendre "de sévères mesures pour limiter le crédit", pour enrayer le déficit des paiements qui s'amorce et éviter la banqueroute nationale. En Italie, le taux d'intérêt est monté jusqu'à 15,5% en Juin ! En France, Wormser qui était le gouverneur de la Banque de France jusqu'en Juin, appelait à une "déflation orthodoxe',' seul moyen de sauver la France de la ruine économique. Sa politique semble avoir gagné l'accord du nouvel occupant de l'Élysée puisque le nouveau gouverneur de la Banque Centrale, B. Clappier a annoncé le 20 Juin que la Banque de France avait augmenté son taux d'escompte de 2%, la plus grande augmentation de l'histoire du pays (ce taux atteint le niveau sans précédent de 13%). Bien que la déflation ne signifie pas que l'État bourgeois va permettre l'effondrement des grandes banques et entreprises par manque de crédits (comme la théorie orthodoxe le recommanderait) rien ne dit que la bourgeoisie soit prête à accepter et supporter la dépression économique et le taux de chômage, impensables il y a quelques années dans un effort désespéré d'arrêter le cycle d'inflation. Entre la sur-inflation (style Weimar), d'un côté, et une crise des liquidités accompagnée d'une chute massive de la production de l'autre, la bourgeoisie a un champ de manœuvre restreint.
L'effet le plus désastreux de la politique déflationniste en sera les conséquences pour la classe ouvrière. C'est le prolétariat qui devra faire les sacrifices nécessaires pour rendre chaque capital national à nouveau compétitif sur le marché mondial, pour arrêter la baisse des profits . Les blocages de salaires, les politiques de revenus, et les "contrats sociaux" pour empêcher la hausse des salaires et par là-même pour amener une baisse du salaire réel. Plus encore, il est important de constater que la part du capital variable destiné à payer les salaires directement aux ouvriers décroît, contrairement à ce qui se passait à l'époque du capitalisme "libéral" (19° siècle.) Une part croissante des coûts destinés à entretenir et assurer la reproduction de la force de travail .des ouvriers est prélevée directement par l'État (le représentant du capital national global) grâce à des taxes directes ou indirectes, et ainsi ne passe pas dans les mains du patron individuel et n'apparaît pas dans la paye des ouvriers. Dans ces coûts sont inclus, en partie ou en totalité, le logement, l'éducation, les transports, l'hygiène, la sécurité sociale, etc. Ainsi les salaires ou les coûts d'entretien des ouvriers peuvent être largement réduits par l'action de l'État, sans que cela prenne la forme d'une réduction du salaire nominal directement payé aux ouvriers. Cette réduction peut prendre la forme d'une réduction de "services sociaux" ou d'une élévation de facto. De telles réductions de "salaires" ne peuvent être combattues au niveau de l'entreprise et demandent une réponse politique immédiate de la classe ouvrière. Enfin, la bourgeoisie se servira aussi du chômage massif pour baisser les salaires.
Les secteurs dirigeants de la bourgeoisie sont à présent engagés dans une politique déflationniste, mais l'application de cette politique s'avère difficile. Dans les années 30, la bourgeoisie affrontait un prolétariat physiquement vaincu ou dominé idéologiquement par les partis contre-révolutionnaires social-démocrates et staliniens. Le chemin était alors laissé libre à la bourgeoisie d’imposer ses solutions à la crise (d'abord Inflation ou déflation, ensuite guerre mondiale impérialiste). Aujourd'hui elle affronte un prolétariat qu'il reste encore à vaincre par la terreur ou l'affrontement armé, et qui n'est plus soumis au strict contrôle idéologique de la gauche officielle Les cinq dernières années ont vu un essor des luttes ouvrières caractérisé par une combativité accrue et une indépendance vis-à-vis des syndicats et des partis de "gauche". La tentative d'imposer son programme d'austérité est lourde de dangers pour la bourgeoisie, d'autant plus qu'elle risque de provoquer une forte explosion sociale et un affrontement armé avec le prolétariat, pour lequel les capitalistes ne sont pas encore préparés. Le problème pour la bourgeoisie est de trouver un cadre dans lequel elle puisse sans danger lancer son assaut contre la classe ouvrière. Les changements dans les gouvernements occidentaux, qui ont pris des proportions démesurées cette année (Angleterre, Belgique, Danemark, France, Italie ainsi que les difficultés de Tanaka au Japon et de Nixon aux U. S. A) sont les symptômes d'une crise politique de la bourgeoisie. La participation active des syndicats et des partis de "gauche" au gouvernement, que ce soit dans un gouvernement d’"Unité nationale" ou par la formation d’un bloc politique de gauche est la plus sûre garantie de la bourgeoisie pour imposer sa politique, calmer les ouvriers et préparer le massacre du prolétariat. Les trotskistes, maoïstes et autres gauchistes qui apportent leur "soutien critique" à la fraction de gauche du capital ne font que révéler une fois de plus leur participation active à la contre-révolution.
Le nouveau gouvernement travailliste anglais a proposé un budget déflationniste digne d'un Enoch Powell. Il a essayé de divertir la classe ouvrière par une brusque augmentation des taxes sur la part de plus-value consommée individuellement par les capitalistes, mais il agit d'une façon strictement orthodoxe (très appréciée dans les milieux financiers internationaux) en imposant une élévation des taxes sur l'industrie pour obtenir un effet de déflation sur l'économie. Plus important toutefois est le coup porté au prolétariat par le budget de Healy présenté au parlement. D'abord, il y a une série d'augmentations exorbitantes des prix des services sociaux de base, pour pallier au déficit énorme qui entrave les industries nationalisées. L’électricité à usage domestique augmentera de 30% (le budget d’origine parlait de 60% pour les tarifs de nuit, mais il a été modifié depuis). Le charbon à usage domestique, les chemins de fer et le téléphone augmenteront de 12 à 15%. Les impôts directs sur les revenus (même pour les bas salaires) augmenteront de 30 à 33% par rapport à leur taux actuel. La T.V.A a été étendue aux confiseries, boissons non-alcoolisées et au pétrole, tandis que la taxe à la vente a augmenté sur les cigarettes, la bière, le whisky et les paris. Comme toutes les taxes à la vente, c'est sur la classe ouvrière qu'elles pèseront plus lourd.
Pour maintenir les salaires à un bas niveau, le gouvernement travailliste a établi son fameux contrat social avec le T.U.C, avec l'accord des syndicats :
- ne pas renégocier tout de suite les contrats signés au cours de la "phase trois” de Heath.
- un écart de douze mois entre deux négociations
- "Les prochaines mesures permettront seulement aux salaires de rattraper les prix”. -"Il devra y avoir aussi peu de grèves que possible”.
Le contrat social doit encore être mis à l'épreuve, mais la perspective n'est pas bonne pour la bourgeoisie. Les syndicats ont réussi à détourner la lutte de classe dans des chemins corporatistes et sectoriels, mais ils risquent de perdre leur contrôle sur les ouvriers s'ils tentent d'étouffer les grèves qui revendiquent des augmentations de salaire. La stratégie de Wilson consiste à reporter la crise sur les ouvriers par le biais des réductions des services sociaux et une augmentation des taxes, tout en comptant sur l'impact dégrisant de la menace du chômage pour désamorcer la lutte de classe.
La réaction du prolétariat à cette érosion constante de son niveau de vie apparaîtra clairement en automne, lors de la nouvelle vague de grèves prévue. Si Wilson et les syndicats ne peuvent contenir la classe ouvrière grâce au contrat social et à la menace du chômage , l'actuel gouvernement travailliste aura échoué. Face à la sur-inflation, au déficit spectaculaire des paiements et à la chute raide de la production, la bourgeoisie doit trouver une nouvelle politique pour éviter le désastre économique et social. La tentation s va devenir forte de recourir à une série de mesures protectionnistes pour réduire les importations à leur strict minimum. La voie sera alors ouverte à la gauche travailliste qui réagira à la crise en se retirant du Marché Commun et en réorganisant l’économie sur une base autarcique. Benn et le "Tribune Group” sont persuadés qu’ils pourront imposer une telle politique aux ouvriers qui devront faire les sacrifices nécessaires à une Angleterre socialiste.
Il y a une autre alternative possible pour la bourgeoisie. Si la sur-inflation domine le contexte social, la bourgeoisie peut s'apprêter à se tourner vers Enoch Powell. En plein désastre social (entraîné par une inflation type Weimar), Powell pourrait mobiliser les classes moyennes, le lumpen-prolétariat, les petits capitalistes, etc. En imposant un chômage massif (la base de son programme économique) comme le dernier reste d'effort pour sauver la Grande-Bretagne et rendre à l’économie sa santé.
En Italie les différentes fractions de la bourgeoisie se sont aujourd’hui accordées sur la base d’un programme d'austérité. La bourgeoisie a déjà imposé de sévères restrictions sur les importations et une politique monétaire rigoureuse, et a décidé après la dernière crise politique du gouvernement, de la nature des sacrifices que les travailleurs seront obligés de faire. Les dépenses en services sociaux vont subir une réduction vertigineuse. Les prix des transports urbains et de l'électricité, du gaz et de l’eau vont être augmentés-sans parler de l’augmentation de l’essence. Les taxes sur les revenus et à la vente vont être relevées, de telle sorte que les propriétaires de voiture devront payer une taxe supplémentaire. Les nouvelles taxes sont destinées à soutirer au moins cinq milliards de dollars sur le pouvoir d'achat dans l'espoir de combattre l’inflation et de freiner ensuite les augmentations. La plus grande partie de ces cinq milliards de dollars seront enlevés de la poche des travailleurs.
Premier Mariano Rumor en plus de s’être de longue date engagée dans la consultation des leaders syndicaux en matière de politique économique, a été requis pour la coalition gouvernementale par ses partenaires socialistes, pour assurer une consultation régulière du PC avant toute décision importante. C’est le premier pas vers la coalition de "sécurité nationale’’ proposée par les syndicats. Bien que le PC ne soit pas encore au gouvernement, l’appel à un "compromis historique que Berlinguer a lancé aux démocrates-chrétiens montre que le PC est déjà prêt à prendre ses ’’responsabilités’’ pour assurer la mise en place du programme d’austérité. Giovanni Agnelli, la tête du gigantesque empire de Fiat et le nouveau président de la ”Confindustria" (l’association des patrons) a récemment fait savoir son adhésion à une telle ouverture "à gauche". Le nouveau programme d’austérité sera mis à l’épreuve dans les mois à venir, ainsi que la capacité que pourront avoir les syndicats comme la gauche de le faire accepter à la classe ouvrière.
En France, en Belgique et au Danemark, la bourgeoisie élabore désespérément de nouveaux programmes d’austérité qui seront dévoilés dans les semaines à venir. D’un bout de l’Occident à l’autre, de l’Angleterre et d’Italie au Japon, à l’Allemagne de l’Ouest et aux USA, la bourgeoisie s’est engagée dans une politique de déflation à l’intérieur et d’exportations accrues, pair tenter de résoudre la crise. Ces mesures déflationnistes, qui assaillent brutalement le prolétariat, ne peuvent pas arrêter l’inflation galopante. La réduction la plus énergique des coûts d’entretien des ouvriers, n’aura pas d’effet sur la croissance démesurée des dépenses improductives qui sont indispensables à la survie du système capitaliste dans sa phase de décadence[2]. Ces dépenses, qui sont la véritable cause de l’inflation dévastatrice qui est aujourd’hui en train de saper les bases du système capitaliste, s’étendront au fur et à mesure que la crise s’approfondira et que l’appareil productif sera consacré, de plus en plus, à la production de moyens de destruction. Les barrières de douane se dressant partout dans le monde et l’heure étant à l’économie nationale et à l’autarcie, les espoirs que la bourgeoisie met dans un boom des exportations pour enrayer les déficits grandissants du commerce et des paiements, se révéleront illusoires.
De même qu’il était impossible à la bourgeoisie dans les années 30 de résoudre la crise par de sévères mesures inflationnistes ou déflationnistes, de même aujourd’hui, ni la déflation, ni l’effort d’exportation ne constituent une porte de sortie à la bourgeoisie pour se libérer de la crise . Il n’y a qu’une solution capitaliste à la crise : la guerre mondiale impérialiste. La signification réelle des différentes mesures que prend la bourgeoisie en période de crise, c’est la préparation à la guerre. Cette préparation implique la forme la plus extrême de centralisation du capital -le capitalisme d’État- qui met en place les structures économiques nécessaires à la guerre. Les attaques contre le prolétariat sont le pendant indispensable de la préparation de la bourgeoisie à la guerre.
- "La destruction de la conscience de classe du prolétariat par la mystification idéologique et son écrasement physique par la terreur, sont les moyens employés tour à tour et simultanément pour obtenir l’adhésion ou tout au moins la passivité docile de la classe ouvrière, condition indispensable permettant au capitalisme d’aller à la guerre." (R.I. Bulletin d’étude et de discussion n° 5)
Que la bourgeoisie n’ait qu’une issue ne signifie pas que la perspective est à une guerre impérialiste mondiale. L’intensification de la lutte de classe montre à quel point le prolétariat peut barrer la route à la guerre. Les prochaines années seront décisives. Il dépend aujourd’hui de la réaction du prolétariat à la crise que la bourgeoisie puisse ou non imposer sa solution.
Mac Intosh.
Questions théoriques:
- L'économie [15]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Capitalisme d'Etat [19]
Rubrique:
Revolution Internationale N°12 - novembre-décembre
- 18 reads
Convulsion du capital mondiale et lutte de classe
- 14 reads
Le triomphe du marxisme
Marx constate quelque part que ce n'est que dans les périodes de crise que la bourgeoisie devient intelligente, qu'elle commence à prendre conscience des contradictions insolubles de son économie. Le reste du temps, dans les périodes dites de "prospérité", où les lois du système semblent assurer à celui-ci un développement harmonieux, les différents apologistes du mode de production capitaliste s'empressent de crier sur tous les toits que, grâce à leur "science", ce mode de production a enfin réussi à résoudre tous ses problèmes, que désormais les crises font partie d'une imagerie d'Épinal désuète et qu'un avenir d'infinie sérénité se présente qui mettra enfin un terme à toutes les plaies de la société.
Un tel optimisme était déjà coutumier des économistes bourgeois de la période ascendante du capitalisme quand les crises de surproduction n'étaient pas comme au XX” siècle des crises mortelles, mais de simples crises de croissance, les battements de cœur du système et non des râles de l'agonie. C'est ainsi qu'un grand nombre d'auteurs de cette époque, des plus insipides comme Jean-Baptiste Say aux géants de la pensée comme Ricardo, considéraient que, la production créant son propre marché, les crises générales étaient impossibles, ce qui n'empêchait pas évidemment celles-ci d'arriver tous les 7 ou 11 ans !
Mais l'optimisme dans lequel se plongent avec extase les économistes du XX° siècle à la moindre occasion n'est plus celui d'une classe historiquement progressive, partant à l'assaut de l'avenir, mais bien celui que manifeste le moribond à la plus petite rémission de son mal fatal. Ainsi, par une force d'inertie bien compréhensible, puisqu'elle lui permet de reculer le moment où elle sera confrontée au néant de son avenir, la bourgeoisie par la voix de ses idéologues appointés, se refuse à voir la crise quand elle est devant son nez ou quand elle est déjà plongée dedans.
Ainsi, le 16 Octobre 1929, une semaine avant le "Jeudi noir", le professeur Irving Fischer, une des sommités de l'époque, n'avait pas peur de déclarer :
"Les cours de la Bourse ont atteint un niveau élevé qui semble devoir être permanent". Rappelons que ceux-ci sont tombés de 86 % dans les mois qui ont suivi !
C'est ainsi également, que quand les premiers symptômes de la crise actuelle ont commencé à se manifester de façon évidente vers 1967-68, on a d'abord fait tout un battage autour de "la crise monétaire" qui aurait eu pour cause le vieillissement du S.M.I. mis en place en 1944 à Bretton Woods. Ensuite, toute1'attention de la bourgeoisie et de ses économistes s'est reportée sur ce nouveau serpent de mer que constituait "l'inflation galopante". À ceux qui commençaient à évoquer 1929, le chœur des économistes répondait :
"Mais cela n'a rien à voir ! En 1929, la Bourse s'est effondrée : aujourd'hui, elle tient. En 1929, la production a fait le grand plongeon : aujourd'hui, elle ne cesse d'augmenter. En 1929, les prix ont baissé : aujourd'hui, ils augmentent...et de quelle façon !"
La "crise du pétrole" a servi d'ultime alibi à la bourgeoisie de droite comme de gauche pour essayer de justifier la non existence d'une crise réelle. Mais que dire d'une économie qui serait à la merci, pour les uns, des caprices de quelques "rois du pétrole", pour les autres, de la cupidité d'une poignée de "firmes multinationales" ? Qu'une telle économie est décidément bien vulnérable malgré tous les efforts des États et des organismes internationaux, toutes les ressources de 1'"économétrie", de l'"informatique", etc. qui en avaient fait quelque chose de "moderne", de "rationnel", de "scientifique".
Que les représentants appointés du capital soient restés aussi longtemps plongés dans leur cécité s'explique, comme nous l'avons vu plus haut. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que des prétendus défenseurs de la Révolution Prolétarienne aient élevé en système les mêmes illusions que les premiers. Et ceci, quelquefois au nom même du marxisme.
C'est ainsi que "Socialisme ou Barbarie" a mis au point toute une théorie "montrant" que le capitalisme avait réussi à surmonter ses contradictions économiques et que la contradiction fondamentale de la société devenait la division entre dirigeants-dirigés.
C'est ainsi que tous les courants issus plus ou moins directement de ce groupe, qu'il s'agisse d'ICO[1], du GLAT[2], de l'IS[3], de PO-Gauche Marxiste[4] ou des groupes anglo-saxons "Solidarity-London" et "Solidarity-Philadelphia" ont opposé les plus grandes résistances à reconnaître l'arrivée de la crise ou continuent à raconter Ainsi, l'internationale Situationniste, dans son numéro 12, faisait des gorges chaudes sur les "débris du vieil ultra-gauchisme, (à qui) il fallait au moins une crise économique majeure..., (qui) subordonnaient tout mouvement révolutionnaire à Bon retour et ne voyaient rien venir".
De même, le courant "PO-Gauche Marxiste" déversait en 1971-72, une lourde ironie sur les "révolutionnaires qui n'avaient que trop souvent fondé leurs espoirs sur la perspective, présentée comme pierre de touche du marxisme, d'une catastrophe inévitable (et qui) ne semblaient plus que des esprits chimériques enfermés dans des rêves anachroniques"[5].
Quant à "Solidarity" de Londres,- son numéro de Janvier 1974 montre à quel stupide aveuglement ces conceptions peuvent mener :
"L'exemple de l'Angleterre est peu significatif du capitalisme moderne. Il y a le problème chronique de la balance des paiements. Il y a le problème de la sous-capitalisation (sic) et d'une gestion rétrograde. A ces problèmes est venu s'ajouter celui de la hausse des prix du pétrole.(...) Mais ces difficultés spécifiques du capitalisme britannique ne doivent pas être extrapolées, comme elles le sont par tant de révolutionnaires pour signifier une crise économique incontrôlable, du type de celles prévues par Marx, affectant le système dans son ensemble".
Le GLAT de son côté continue à affirmer que la contradiction insurmontable du système réside en l'opposition entre "les rapports sociaux communistes" noués par les prolétaires au sein du capitalisme et "les rapports sociaux capitalistes" issus des rapports de production du même nom. Et de même ce groupe a emboîté le pas aux bourgeois et politiciens les plus réactionnaires pour proclamer que "l'inflation et la crise actuelle tirent leurs origines des augmentations de salaires consécutives à la montée des luttes de la classe ouvrière" (qui elle, sans doute, est un effet du Saint-Esprit !).
"Socialisme ou Barbarie" et ses épigones "ICO", "PO-Gauche Marxiste" et "Internationale Situationniste" sont maintenant morts. Ils n’ont pas pu résister à l'approfondissement de la crise et au développement de la lutte de classe. Quant à "Solidarity" et au "GLAT", leur incapacité à comprendre la réalité actuelle, ou -à simplement en rendre compte,- leur confère un caractère de plus en plus marqué de secte qui ne leur annonce pas un sort meilleur.
Une autre école "révolutionnaire" s'est taillée un certain succès en affirmant que le capitalisme avait surmonté ses crises économiques. C'est celle du professeur Marcuse qui considérait que le prolétariat était intégré et qu'il ne pouvait plus jouer le rôle de classe révolutionnaire, rôle qui devait échoir aux couches marginales (étudiants, noirs, habitants affamés du Tiers-Monde, etc.). Quand on les relit aujourd'hui, ces théories ne peuvent provoquer qu'un grand éclat de rire et fort peu d'intérêt sinon sur le plan des curiosités historiques.
L'heure n'est plus à ces sornettes. Les "rénovateurs" du marxisme se taisent de plus en plus devant la gravité actuelle de la crise dont 1974 a marqué un brutal approfondissement.
Sur le plan de l’inflation, tous les records ont été battus dans la première moitié de l'année 1974 : USA, 11,5%; Canada, 11,5%; Japon, 29,75%; France, 15% ; Allemagne Fédérale, 7,75% ; Italie, 19,5% ; Grande-Bretagne, 16,5%. Pour l'ensemble des pays de l'OCDE, l'augmentation annuelle des prix à la consommation a été multipliée par 3,4 par rapport à la période 1961-71 et ce rapport s'élève à 4,2 pour le Japon, 4,8 pour le Portugal, et... 14,8 pour la Grèce[6].
Mais ce qui est relativement nouveau, c'est qu'un certain nombre de pays, et non des moindres, ont -rangé au musée leur belle croissance du PNB de 1973 pour se plonger dans une - non moins belle récession : USA, -2,75% au lieu de +5,9%; Grande-Bretagne, -6% au lieu de +5,4%; Japon, -6,5% au lieu de +10,3%[7]. De plus, les Bourses qui, jusqu'à présent, n'étaient pas trop secouées et permettaient à nos chers économistes de déverser des sommes d'idioties sur le thème "ce n'est pas 29" se sont mises à plonger à leur tour. Le mouvement, amorcé en 1973, s'est renforcé en 1974, ce qui fait que d'Août 73 à Août 74, la valeur des actions a évolué comme suit : USA, -22,5% ; Canada, -21,2% ; Japon, -19,8% ; France, -30,5% ; Allemagne, -20,1% ; Italie, -16,0% ; Grande-Bretagne, -47,8%[8]. D'ores et déjà, la Bourse de Londres a baissé plus rapidement qu'en 1929-30. Par ailleurs, ces chiffres ne tiennent pas compte de la hausse générale des prix qui ampute d'autant la valeur réelle des actions. En fait, si on raisonne en valeur constante, le prix moyen des actions traitées au Stock Exchange de New-York est tombé de 79% depuis 1968, ce qui n'est pas loin des 86% (toujours en valeur constante puisqu'alors les prix baissaient) de 1929-32[9].
A l'heure actuelle, même les plus crétins des économistes, y compris les lauréats du Prix Nobel, ont compris que la situation était mauvaise. C'est ainsi que Paul Samuelson a pu déclarer avec finesse : "Je vois venir des difficultés, mais elles ne ressembleront pas à celles de 1930-33". Décidément traumatisée à l'idée que la crise actuelle pourrait ressembler à celle de 1929, la revue américaine Newsweek du 30 Septembre 1974 ne consacre-t-elle pas tout un article à essayer de démontrer "Pourquoi ce n'est pas de nouveau 29"[10],(Why It Isn't "29 Again), la bourgeoisie se rend compte de plus en plus que c'est tout de même d'une CRISE dont il s'agit et non de quelconques petits problèmes monétaires ou autres, ce qui fait écrire à ce même numéro de Newsweek :
"...la vérité est que l'économie des USA en particulier, et celle de la plupart des pays du monde occidental en général sont sérieusement malades -et probablement le plus pénible de l'affaire, c'est que personne n'a la moindre idée vraiment nouvelle ou éprouvée sur comment les guérir".
C’est là le cri du cœur de la bourgeoisie ! Avec sa modération d'usage pour ne pas amplifier la panique qui l'envahit, elle montre avoir enfin compris que la situation est catastrophique et surtout QU'IL N'Y A RIEN A FAIRE.
Le président Giscard d'Estaing lui-même, réputé parmi ses collègues des autres pays par ses "compétences" en matière d'économie, n'a-t-il pas récemment déclaré à son tour[11] :
"Le monde est malheureux. Il est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va et parce qu'il devine que, s'il le savait, ce serait pour découvrir qu'il va à la catastrophe".
Au fur et à mesure qu'avec les PNB, les Bourses, l'emploi, s'effondrent les illusions de la bourgeoisie et toutes les théories fumeuses qu'elles-mêmes ou ses compagnons de route se proposant de "recommencer la révolution[12]" en dépassant le marxisme, avaient mises sur pied, s'affirme jour après jour avec plus d'éclat, LE TRIOMPHE DU MARXISME qui dès 1848 proclamait le caractère insoluble des contradictions économiques capitalistes, l'inévitabilité de crises de plus en plus profondes et l'enfoncement de la société dans une barbarie croissante.
La crise qui se développe et qui laisse un peu plus chaque jour la bourgeoisie terrifiée face à son avenir, ouvre de plus en plus, par la résistance croissante de , la classe ouvrière qu'elle provoque, la perspective de la solution aux contradictions actuelles de la société : la révolution prolétarienne, là encore, contre toutes les aberrations qui se sont développées sur l'intégration définitive du prolétariat, sur la disparition de son caractère de classe révolutionnaire, au bénéfice d' autres catégories sociales, le marxisme remporte UN NOUVEAU TRIOMPHE : LE PROLETARIAT EST BIEN LA CLASSE REVOLUTIONNAIRE DANS LA SOCIETE CAPITALISTE ET LA SEULE.
C'est parce qu'ils n'avaient pas, à l'image de tant de groupes "révolutionnaires" en mal de "nouveauté", jeté le marxisme aux orties mais en avaient fait leur instrument de compréhension de la réalité que nos camarades du groupe "Internacionalismo[13]" du Venezuela pouvaient écrire dès Janvier 1968, sous le titre : "68, une nouvelle convulsion du capitalisme commence" :
"L'année 67 nous a laissé la chute de la Livre Sterling et 68 nous apporte les mesures de Johnson, la lutte inter-capitaliste s'aiguise rendant chaque jour plus réelle la menace de guerre mondiale, voici que se dévoile la décomposition du système capitaliste, qui durant quelques années était restée cachée derrière l'ivresse du "progrès" qui avait succédé à la Seconde Guerre Mondiale... Au milieu de cette situation, lentement et par à-coups, la classe ouvrière se fraie un chemin dans un mouvement souterrain qui par moments paraît inexistant, explose ici, jette une lumière aveuglante pour s'éteindre subitement et se rallumer plus loin : c'est le réveil de la classe ouvrière, du combat ouvert...
Nous ne sommes pas des prophètes, et nous ne prétendons pas deviner quand et de quelle façon vont se dérouler les évènements futurs. Mais ce dont nous sommes effectivement sûrs et conscients, concernant le processus dans lequel est plongé actuellement le capitalisme, c'est qu'il n'est pas possible de l'arrêter avec des réformes, des dévaluations ni aucun autre type de mesures économiques capitalistes et qu'il mène directement à la crise. Et nous sommes sûrs également que le processus inverse, de développement de la combativité de la classe qu'on vit actuellement de façon générale, va conduire la classe ouvrière à une lutte sanglante et directe pour la destruction de l'État bourgeois".
Voilà ce qu'écrivaient les marxistes il y a presque sept ans, avant Mai 1968, "le mai rampant" italien, l'insurrection des ouvriers polonais en 1970, etc. et toutes les difficultés économiques qu'on connaît aujourd'hui alors que le devant de la scène était tenu par les jacassements de pie sur "la société de consommation", "la disparition des crises" et "l'intégration du prolétariat".
C'est donc avec le marxisme, que l'histoire impose de plus en plus comme SEULE ARME THEORIQUE DU PROLETARIAT, que nous devons analyser la situation présente de la société et tenter d'en dégager les perspectives.
La situation actuelle pose quatre types de problèmes :
- A quel moment de la crise se trouve l'économie capitaliste ?
- Comment se répercute la crise dans les rapports entre les nattons ?
- Comment se répercute la crise dans la politique interne de chaque nation ?
- Comment réagit le prolétariat ?
L'étape actuelle de la crise
L'année 1974 marque une étape importante dans l'approfondissement de la crise du capital qui la rend évidente même aux plus optimistes adorateurs du système. Mais les premiers symptômes de celle-ci remontent en fait au milieu des années 60. C'est vers 1964-65 qu'on assiste à un renversement des balances commerciales de la CEE et du Japon qui de négatives deviennent positives. Ce fait signifie que ces pays deviennent capables d'exporter ou, en d'autres termes, que la reconstruction d'après-guerre est terminée. C'est là un évènement d'une importance capitale. En effet, à partir du début du XX° siècle, au moment où les différents blocs impérialistes ont fini de se partager le marché mondial, le système capitaliste est entré dans une phase nouvelle de son développement historique : celle de sa DECADENCE.
Alors que l'époque antérieure était marquée par une formidable explosion des forces productives explosion liée à la conquête de vastes marchés coloniaux et extra-capitalistes (le rôle moteur du marché colonial dans la prospérité de la grande puissance de l'époque, l'Angleterre, n'est plus à démontrer), celle qui s'ouvre avec la première Guerre Mondiale est marquée par le cycle infernal CRISE-GUERRE-RECONSTRUCTION. Si les crises du siècle dernier trouvaient une solution dans les conquêtes de nouveaux marchés liés à une plus grande pénétration coloniale (c'était donc, en quelque sorte, des crises de croissance) celles de ce siècle ne peuvent plus se résoudre de cette façon. Les crises du XX° siècle ne peuvent déboucher que sur un REPARTAGE DES MARCHES EXISTANTS, c'est-à-dire SUR LA GUERRE IMPERIALISTE (ce sont des crises mortelles) et seule la reconstruction des forces productives détruites par ces guerres peut momentanément permettre à la machine économique de se remettre en marche. C'est là la signification des périodes de prétendue "prospérité" qui ont suivi les deux guerres mondiales. Le mécanisme de la reconstruction du deuxième après-guerre étant essentiellement fondé sur un flux presque unilatéral de marchandises et de capitaux des Etats-Unis vers l'Europe et le Japon, flux indispensable à la reconstitution du potentiel productif de ces derniers pays, il est donc logique de conclure que la reconstitution de ce potentiel et sa capacité nouvelle à exporter signifient la fin de la reconstruction et donc de la "prospérité" factice de cet après-guerre.
Cette situation nouvelle provoque immédiatement un ralentissement de la machine économique américaine dont les produits sont de plus en plus concurrencés sur le marché mondial par les produits européens et japonais. Ce n'est que la guerre du Viêt-Nam à partir de 1965 qui permet à ce ralentissement de ne pas se transformer en récession brutale. C'est pour cela que les premières manifestations importantes de la crise n'apparaissent qu'en 1967. Elles frappent un des pays qui a le moins profité de la période de reconstruction pour moderniser son appareil productif : la Grande-Bretagne. Celle-ci, face à un marché mondial de plus en plus encombré et incapable d'affronter la concurrence commerciale des autres pays est obligée de dévaluer la Livre Sterling.
Peu après, ce sont les Etats-Unis qui connaissent leur première crise financière : face à l'hémorragie de capitaux que représente la guerre du Viêt-Nam et que compense de moins en moins un excédent commercial en diminution, le président Johnson est obligé, en Janvier 1968, de prendre toute une série de mesures pour tenter de rétablir la balance des paiements et protéger le Dollar. C'est le début de la CRISE MONETAIRE qui s'accompagne aussi, au niveau international, par une forte poussée de l'inflation et par du chômage sans que ces deux derniers éléments deviennent la préoccupation dominante.
Ce qui est au centre de toutes les préoccupations, de tous les débats des "spécialistes" de l'économie, c'est ce qu'on appelle LA CRISE DU SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL, mis en place à la conférence de Bretton Woods en 194-A' sur la base de l'adoption du Dollar comme étalon équivalent de l’or (1 once d'or = 35 $). Tous les "spécialistes" jacassent sur la nécessité d'un "nouveau Bretton Woods" qui permettrait d'adapter le système "aux nouvelles réalités".
Dans la petite tête de tous ces experts, l’idée qu’il ne puisse s'agir d'autre chose que d'un problème uniquement monétaire ne trouve pas de place. D'ailleurs n'assiste-t-on pas sur le plan économique à des réussites remarquables ? Après le fléchissement de 1967, 68 et 69 sont en effet des années fastes sur le plan de la croissance et de l'expansion du commerce mondial.
- S'ils avaient daigné se pencher sur l'œuvre économique de Marx au lieu d'affirmer avec l'assurance de l'ignorance qu'elle est dépassée, ils auraient pu y lire :
que les questions monétaires dépendent étroitement du processus central de l'économie capitaliste : la valorisation du capital, production et réalisation de plus- value. - que les crises économiques connaissent en général deux phases, la première se situant sur un plan monétaire (instabilité et dévaluation des monnaies, hausse des prix, crise du crédit, etc.), la seconde constituant la crise ouverte sur le plan directement économique (engorgement des marchés, effondrement de la production, déferlement du chômage), l'ordre des deux faisant croire à tort aux "experts" que la seconde est conséquence de la première.
C'est effectivement ce schéma qui s'est déroulé dans la présente crise et les années 70 et surtout 71 marquent "le commencement de la fin" des illusions bourgeoises sur la croissance illimitée. Les taux de croissance y connaissent par rapport à la période antérieure, une chute importante : aux USA, -0,18 7» pour la production industrielle en 1971 au lieu de 4,82 7o dans la période 1963-70; en Allemagne, 1,76 7» au lieu de 6,28 7«; en Grande-Bretagne, 1,04 % au lieu de 3,25 %; en Italie, ..1,75 % au lieu de 5,85 7.. Parmi les grands pays occidentaux, seule la France avec 5,67 % et le Japon avec un taux supérieur à 10 7«, semblent échapper à la récession. C'est vers cette époque qu'un certain nombre de "spécialistes" 'parmi les plus lucides commencent à se poser la question "Allons-nous vers un nouveau 29 ?". Mais la situation en 1972 et 1973 fait, taire ces audacieux. Celle-ci se caractérise par une reprise importante de la production (avec 6,09 % en 1972, les USA par exemple connaissent leur taux le plus élevé depuis la guerre). Il est vrai que simultanément les taux d'inflation atteignent des sommets jusqu’alors considérés comme inaccessibles et que cette manifestation de la crise passe au premier plan des préoccupations des économistes, devant même la crise du S.M.I.
L'inflation est un phénomène caractéristique du capitalisme décadent. Elle a pour origine l'immense gaspillage de forces productives que celui-ci a besoin de faire pour se maintenir en vie et réaliser sa ' plus-value : markéting, commercialisation, bureaucratie d'État croissante, armement, etc. Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, elle était chronique sous sa forme "rampante", mais le phénomène nouveau de la fin des années 60 et surtout du début des années 70 est constitué par "l'inflation galopante". Celle-ci exprime, outre une augmentation massive des dépenses improductives liées à la montée des tensions inter-impérialistes (Vietnam, Moyen-Orient, Pakistan, etc.), une véritable fuite en avant du système qui tente de suppléer à l'encombrement croissant du marché par une explosion du crédit. L'État, pour payer ses dépenses improductives est le premier à s'endetter, mais l'ensemble de la société s'endette: ainsi, entre 1965 et 1974, la part des dettes dans l'ensemble de la valeur du capital des entreprises américaines passe de 25% à 507.
Ainsi la dette de l'économie américaine s'élève à 2500 milliards de dollars.
C'est ainsi également qu'un ministre brésilien a été amené à avouer[14]:
"Nous ne faisons rien d'autre que d'imprimer de la fausse monnaie pour financer notre expansion. Mais nous sommes bien décidés à continuer tant qu'il y aura des gens pour accepter notre signature.[15]"
Une telle situation de fuite en avant ne peut que conduire au désastre. Ainsi, pour l'ensemble des entreprises américaines, 1e rapport entre les profits bruts et le montant des remboursements de l'intérêt des dettes est passé de 12,5 en 1966 à 9 en 1968, 5 en 1970 et se situe actuellement entre 2 et 3 ; en d'autres termes, les profits du capital suffisent de moins en moins à payer ses dettes. Cet endettement croissant et de moins en moins solvable est à la base de l'approfondissement brutal de la crise à partir de 1974. Bien qu'elles aient servi de catalyseur du mouvement, les hausses de pétrole sont reconnues de plus comme en étant qu'un alibi à la crise actuelle. En fait, la signification des chiffres de l'année 74 est claire : NOUS SOMMES MAINTENANT DE PLEIN PIED ET DE FAÇON OUVERTE DANS LA CRISE DE SURPRODUCTION.
Une question reste cependant posée : allons-nous assister maintenant à un effondrement brutal du type de celui de 29 ? Ce qu'il faut remarquer, c'est que toutes les mesures ont déjà été tentées pour retarder l'échéance; et qu'on ne voit pas bien maintenant quel miracle pourrait tirer l'économie mondiale de cette impasse. Cependant, depuis 1967, le système a montré qu'il n'avait pas perdu les leçons de 1929 et que s'il est parfaitement incapable de trouver une solution à la crise, il peut cependant en ralentir l'évolution. De 1967 à 1974, c'est progressivement que le monde s'est enfoncé dans la crise même si ce rythme est parfois troublé par de brusques secousses comme en 1974. Il est probable qu'avec d'autres secousses éventuelles, ce rythme se maintiendra dans 1'avenir, grâce à une intervention de plus en plus massive des États dans l'économie. Mais cela n'empêchera pas la situation de s'aggraver inexorablement, imposant avec de plus en plus de force la seule alternative possible : GUERRE MONDIALE OU REVOLUTION PROLETARIENNE.
Le cours vers la guerre mondiale
Les guerres localisées, essentiellement déguisées en guerres de "libération nationale" n'ont pas cessé un seul instant depuis la fin du deuxième conflit impérialiste. Mais c'est au milieu des années 60, en liaison étroite- avec l'aggravation de la situation économique, que ces guerres deviennent de plus en plus fréquentes et violentes : Viêt-Nam, Laos, Cambodge, Biafra, Inde et Pakistan, Moyen Orient et tout dernièrement Chypre... On se demande quel sera le prochain pays à ajouter sur cette liste déjà longue.
Comme dans le passé, l'approfondissement de la crise conduit à une exaspération des tensions inter-impérialistes. Samuel Pisar, un des grands spécialistes des négociations internationales et particulièrement entre l'Est et l'Ouest résume la situation à une formule lapidaire : "Global needs, national means" ("Besoins globaux, moyens nationaux")[16] (1).
C'est là un des problèmes fondamentaux que ne peut résoudre l'économie capitaliste : la crise est mondiale alors que chacun des États doit tenter de la résoudre dans son propre pays et de la faire payer par d'autres. Après la ■ guerre commerciale, la guerre véritable est la conséquence logique de la situation.
Concernant cette aggravation des tensions internationales, il faut remarquer trois points :
1 - Les anciens foyers de guerre n'ont pas disparu alors que de nouveaux ne cessent d'apparaître.
C'est ainsi que périodiquement les journaux, viennent nous rappeler que la guerre n'a jamais cessé en Indochine, qu'elle est toujours prête à se rallumer au Moyen-Orient... C'est ainsi, par exemple, après plusieurs années d'accalmie que la question Kurde fait de nouveau parler d'elle. A l'heure actuelle, elle risque de revêtir une importance fondamentale. En effet, elle touche une région qui, entre la Méditerranée et le Golfe Persique s'étend le long de la frontière de l'Iran et de l'Irak qui sont deux très importants producteurs de pétrole et qui sont soutenus chacun par un des grands blocs : l’Irak par l’URSS, l'Iran par les Etats-Unis. La formidable accumulation actuelle d'armements par l'Iran et qui fait dire à un des proches du Shah que celui-ci se prend tantôt "pour un envoyé de Dieu sur la terre" tantôt "pour la Reine Victoria" en voulant "reconstituer l'empire britannique"[17], cette accumulation d'armements donc, est lourde de menaces pour l'avenir de cette région.
2 - Les blocs se renforcent de plus en plus et laissent de moins en moins de latitude aux nations secondaires qui les constituent. Ce phénomène avait déjà été illustré dès 1968 par 1'intervention russe en Tchécoslovaquie, pays qui tentait timidement de s'affranchir de la tutelle politique et économique de son "grand- frère". Il a été illustré plus récemment par une allégeance croissante de l'Europe Occidentale à l'égard des USA et tout dernièrement par l'affaire de Chypre. Dans ce dernier cas, l'évolution pro-russe de la politique de Makarios a été, sur ordre de Washington, brutalement interrompue par le coup d'État qui l'a renversé. Et la mainmise américaine a été renforcée par l'intervention de l'armée turque. Ces évènements ont montré à quel point les antagonismes nationaux qui depuis toujours opposent les différents États capitalistes, et qui en l'occurrence opposaient la Turquie et la Grèce, ne sont en fait que des cartes du jeu des grandes puissances, et qui, même s'ils sont exacerbés par l'intensification de la crise, doivent toujours céder le pas aux intérêts de celles-ci. Aujourd'hui les différentes tendances centrifuges que la crise fait surgir un peu partout n'ont aucune chance d'entamer la discipline croissante que chaque grande puissance exige de ses alliés dans la préparation des futurs affrontements inter-impérialistes.
3 - De la périphérie, les affrontements inter-impérialistes se rapprochent du centre.
D'abord localisé en Extrême-Orient, se rapprochant ensuite avec les conflits Indo-Pakistanais et du Moyen-Orient, l'affrontement Est-Ouest par petits peuples interposés a fait, avec la guerre de Chypre, un pas de plus vers le cœur du système. Cette fois c'est le contrôle de la Méditerranée qui était en cause, c'est-à-dire de la mer qui baigne à la fois l'Europe Occidentale et les champs pétrolifères du Moyen-Orient, qui est, du point de vue militaire, une des positions stratégiques les plus importantes du moment.
De la même façon que la crise a commencée d'abord par frapper les pays de la périphérie du système (Amérique Latine, Tiers-Monde) et qu'elle s'étend actuellement aux métropoles du capital, les champs d'affrontement des grands blocs impérialistes se rapprochent de plus en plus des centres nerveux de ces blocs.
Cela signifie-t-il que la guerre est maintenant inévitable entre les grands blocs eux-mêmes ?
La guerre est la seule réponse que le système puisse par lui-même apporter à la crise. Mais pour qu'il puisse la mettre en œuvre, Il doit disposer d'un prolétariat suffisamment brisé et mystifié pour que celui-ci accepte de marcher dans les sacrifices de la "défense nationale". Aujourd'hui, les premières atteintes de la crise ont jeté sur la scène historique un prolétariat d'une combativité inégalée depuis plus d'un demi-siècle. Les vieilles mystifications nationalistes et antifascistes ayant fait leur temps parmi les prolétaires des pays les plus avancés, la bourgeoisie est actuellement incapable de la mobiliser contre ses frères de classe des différents pays. Ceci signifie qu'avant que le capital puisse apporter "sa solution" à la crise, il doit d'abord briser le prolétariat. C'est pour cela que la perspective actuelle n'est pas GUERRE IMPERIALISTE GENERALISEE mais GUERRE CIVILE GENERALISEE. Et c'est à cette guerre-ci que la bourgeoisie devra se préparer de plus en plus.
Les préparatifs capitalistes à la guerre civile
N'étant pas marxiste, la bourgeoisie ne peut pas prévoir que la seule alternative à la crise actuelle est GUERRE ou REVOLUTION. Mais de la même façon qu'elle s'est rendu compte de la nécessité de se préparer de mieux en mieux à la guerre impérialiste, elle a pris conscience que la crise l'amènerait à affronter de plus en plus directement le prolétariat. A l'heure actuelle, pour chaque capital national, il n'y a pas 36 solutions pour tenter de tirer son épingle du jeu : il doit réduire le prix de ses marchandises pour prendre le marché de ses concurrents. Et pour ce faire, la bourgeoisie ne peut ni réduire dans ce prix la part revenant au capital constant utilisé, ni rogner sur ses profits qui lui sont indispensables pour rendre son capital plus productif et concurrentiel. La seule chose qu'elle puisse faire, c'est peser sur la composante "capital variable" du prix de ses marchandises : en d'autres termes, attaquer le salaire des ouvriers. Pour elle l'énoncé du problème est donc simple : comment faire accepter à la classe ouvrière une réduction de son niveau de vie ?
Pour que les ouvriers soient prêts à accepter le sacrifice que la situation requiert, il faut donc qu'ils aient l'impression que leur intérêt et celui du capital national sont identiques ; que l'État est d'une certaine façon leur État.
Ainsi, dans les pays du bloc oriental, la propagande officielle ne cesse de répéter aux ouvriers que leur patrie-est celle du socialisme, de la classe ouvrière et donc que la défense de celle-ci passe par la-défense de cette patrie. Et quand les ouvriers font preuve d'une trop grande combativité, comme en 1970 en Pologne, on les gratifie d'un nouveau dirigeant ancien ouvrier comme Gierek qui vient leur montrer ses mains encore calleuses et leur demander au creux de l'oreille d'ouvrier à ouvrier, de reprendre le travail.
Dans les pays occidentaux, c'est la gauche qui sera appelée de plus en plus à demander à la classe ouvrière ces sacrifices.
D'abord son programme de nationalisations, de contrôle étatique plus grand sur l'ensemble de l'économie, plus qu'une fonction économique (qui peut être à certains moments assumée par la droite : au Chili, Pinochet n'a pas remis en cause les nationalisations d'Allende) assume la fonction .politique de faire croire aux travailleurs qu'on s'attaque aux intérêts privés et qu'on est donc beaucoup mieux placé pour lier la classe ouvrière à son capital national que les partis de droite, défenseurs traditionnels des "intérêts privés", et partant.de lut faire accepter bien plus de sacrifices.
Ensuite, les références "ouvrières" de la gauche, ses liens plus ou moins étroits avec les syndicats, en font "la représentante des intérêts ouvriers" au sein même de l'État. Un gouvernement de gauche, par le caractère de sa propagande, par l'origine sociale même de son personnel est une arme importante du capital pour tenter de dissuader les ouvriers de la nécessité de s'attaquer à l'État. Il peut même tolérer un certain nombre d'atteintes aux intérêts capitalistes (expropriations et autogestion en Espagne durant la guerre civile par exemple) du moment que la classe ne se pose pas le problème central de sa lutte : destruction de l'État capitaliste et prise du pouvoir politique à travers ses organes autonomes.
Enfin, la gauche, les partis "ouvriers" sont les mieux placés pour assumer la tâche spécifique de bourreau du prolétariat. Dans une période de montée des luttes révolutionnaires, le capital ne peut pas attaquer immédiatement la classe ouvrière : avant de l'écraser, il doit d'abord détourner sa combativité dans une voie de garage, endormir sa vigilance et la diviser. Dans Les expériences révolutionnaires passées, c'est exactement cette politique que la bourgeoisie a déployée face à la classe. Et si elle a finalement échoué en Russie en étant incapable d'éviter Octobre 1917, elle a pleinement réussi entre 1918 et 1923 en Allemagne où la révolution a été écrasée dans le sang des ouvriers et des meilleurs révolutionnaires (Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, etc.) par le parti social- démocrate lui-même.
Aujourd'hui donc, chaque échelon gravi par la crise et chaque pas en avant de la lutte de classe met plus à l'ordre du jour la mise en place de "solutions de gauche" à la tête des États capitalistes. C'est ainsi qu'on a pu voir en Grande-Bretagne la fonction exercée par le Parti Travailliste dans la liquidation de la grève des mineurs au début de 1974. On a pu voir de quelle façon les syndicats ont été associés à la politique capitaliste contre la classe ouvrière à travers le "contrat social". Cependant la combativité déjà importante des ouvriers anglais, qui risque de s'approfondir en même temps que la crise, oblige les syndicats à "gauchir" leur vocabulaire afin de continuer d'exercer une emprise minimale sur eux. C'est en ce sens qu'il faut interpréter l'entrée d'un militant du parti communiste anglais (Ken -Gill) et de deux militants "gauchistes" (Clive Jenkins- et Jim Slater) à la direction du TUC lors du récent congrès de Brighton.
Dans un grand nombre d'autres pays, le capital prépare la relève de gauche et particulièrement en France, en Italie et en Espagne.
En France le reclassement de toute une partie de l'ancienne majorité derrière l'union de la gauche et particulièrement du Parti Socialiste (Jacques Delors, ancien conseiller de Chaban-Delmas vient de prendre sa carte du PS) s'accompagne de toute une campagne de séduction de la majorité gouvernementale actuelle en direction de François Mitterrand. Dans les milieux politiques, on parle de plus en plus ouvertement d'une équipe Giscard à l'Élysée et Mitterrand à Matignon. Le PCF de son côté, craignant de se faire doubler, a consacré son congrès- extraordinaire à "l'union du peuple de France" et a bien insisté sur le fait qu'il n'existe "aucune limite à l'union populaire".
En Italie, face à une situation économique et sociale inextricable la bourgeoisie se trouve confrontée à des problèmes politiques insurmontables. C'est dans ce contexte qu'on parle de plus en plus du "compromis historique" qui permettrait au puissant parti communiste italien de venir prêter main- forte au gouvernement, à la démocratie chrétienne. Ce parti "communiste" décidément très "réaliste" ne s'est pas gêné pour apporter son appui à Agnelli, directeur de Fiat, quand celui-ci a mis en chômage partiel plus de 60.000 ouvriers de son entreprise.
Ce parti a même réussi à rassurer une bonne partie de la bourgeoisie quant à sa politique extérieure qui se veut aussi européen et même atlantiste que celle de ses acolytes. C'est ainsi qu'Aurelio Peccei, président du "Club de Rome" a déclaré de lui:
"D'un point de vue strictement européen, nos communistes sont sans doute meilleurs que nos chrétiens-démocrates...Je pense qu'en Italie un homme comme Berlinguer peut beaucoup plus facilement que n'importe quel leader non socialiste fixer à l'Europe des objectifs suffisamment vastes, modernes et à long terme"[18].
La grande réconciliation de la démocratie chrétienne et du FCI pourrait se faire autour du thème de l'antifascisme qui aujourd'hui est agité de façon obsédante par toutes les fractions du capital, depuis celle qui est au pouvoir actuellement jusqu'aux gauchistes. Il n'y a pas de semaine sans que se produise un attentat "fasciste" immédiatement monté en épingle, sans qu'on découvre un nouveau "complot" d'extrême-droite, une nouvelle "piste noire".
En Espagne, après-franquisme est déjà en marche et même si le PCE semble pour le moment écarté des plans de la bourgeoisie, un nombre croissant d'anciens dignitaires du régime se tourne vers les partis démocratiques particulièrement vers le PSOE (Parti Socialiste Ouvrier) dont le récent Congrès de Suresnes (France) a reçu une publicité importante de la part de la presse. Quant au PCE, les ponts ne sont pas coupés entre lui et les milieux qui préparent la relève : ils sont maintenus à travers "la junte démocratique" qui regroupe également Calvo Serrer, ancien directeur du journal "Madrid" et proche collaborateur du Comte de Barcelone, le père de l'actuel successeur désigné de Franco.
Le capital de ces différents pays a les yeux fixés sur le Portugal où justement la relève de gauche vient de s’opérer. Les évènements du Portugal sont particulièrement significatifs de la tendance actuelle à faire de la gauche le "gérant de la crise". C'est d'une part le pays du monde où la droite était la plus forte. D'autre part, c'est une fraction habituellement rétrograde du capital qui - a amené la gauche au pouvoir. Enfin, les évènements qui se sont déroulés depuis le 25 Avril 1974 ont indiqué clairement dans la pratique que la gauche, et particulièrement les PC, est la fraction du capital la mieux armée pour garder en mains une situation de plus en plus insaisissable. C'est la gauche qui au Portugal seule a pu venir à bout des guerres coloniales. C'est le PCP qui s'est révélé le meilleur auxiliaire de l’État et de l'armée pour venir à bout des grèves ouvrières qui se sont prolongées après le 25 Avril et particulièrement pour briser- la grève des postiers et celle des travailleurs de la compagnie aérienne TAP. C'est également le PCP qui s'est montré le plus efficace pour mettre en échec la dernière tentative de reprise en nain par la droite de Spinola fin Septembre, et en même temps pour -mobiliser les ouvriers pour une journée de travail gratuite le dimanche 6 Octobre.
L'autorité manifestée au service de l'ordre capitaliste par le Parti Communiste et le Mouvement des Forces Armées, principaux piliers du gouvernement provisoire a même été saluée par La Confédération de l'industrie Portugaise par un message de soutien à ce gouvernement le 3 Octobre.
La situation au Portugal préfigure ce qui va arriver bientôt dans beaucoup d'autres pays. Elle indique également, partout où ce sera possible, que le capital utilisera le thème de l’antifascisme pour détourner la combativité du prolétariat de ses objectifs de classe. Elle indique enfin que dans cette tâche, les gauchistes seront, comme ils l’ont été au Portugal,- des- auxiliaires de choix pour la gauche officielle.
Face aux grandes manœuvres que le capital développe un peu partout pour pouvoir affronter la classe ouvrière, il faut maintenant tenter de dégager quels problèmes celle-ci sera amenée à affronter dans sa lutte vers la révolution communiste.
Les préparatifs de la classe ouvrière
La grève générale de Mai 1968 en France -la plus grande grève de l'histoire du mouvement ouvrier-, "le mai rampant" italien de 1969 sont les premières grandes réponses que la classe ouvrière a apporté aux premières atteintes de la crise. La puissance de ces mouvements alors que celle-ci était encore relativement faible (ce qui a amené certains à conclure que les grèves n'avaient pas de causes économiques mais correspondaient à une révolte contre "l'ennui de la vie quotidienne") a d'emblée signifié que la perspective immédiate ouverte par la crise n'était pas celle de la guerre mondiale mais celle de la guerre civile.
Ces circonstances placent le prolétariat devant une situation entièrement nouvelle pour lui. • En effet, alors que toutes les révolutions bourgeoises ont fait suite à des crises économiques (1789, 1848, etc.), les tentatives révolutionnaires du prolétariat ont, dans le passé, toujours fait suite à une guerre : Commune de Paris après-guerre de 1870; révolution de 1905 après-guerre russo-japonaise; 1917 en Russie et 1918 en Allemagne, pendant et après la Première Guerre Mondiale. La montée révolutionnaire actuelle de la classe ouvrière est donc la première qui ne viendra pas à l'issue d'une guerre mais directement à l'issue d'une crise économique (telle que Marx l'avait envisagée pourrait-on dire).
Au centre des problèmes posés par la révolution prolétarienne se trouve celui du pouvoir. L'étape fondamentale par laquelle doit passer le prolétariat avant la transformation de la société est celle de la destruction de l'État bourgeois et de la prise du pouvoir politique : les différentes expériences révolutionnaires de la classe n'ont fait que confirmer l'importance de ce problème déjà souligné dans le "Manifeste communiste".
Mais, comme on l'a vu, celles-ci se sont déroulées à la suite de guerres qui ont obligé d'emblée le prolétariat à se confronter à des problèmes politiques et rapidement à se poser la question du pouvoir puisque c'était la seule qui pouvait décider du problème de la guerre.
Par contre, dans la période actuelle, le prolétariat sera confronté d'abord à des problèmes économiques. Sa lutte prendra nécessairement un caractère de plus en plus politique dans la mesure où elle sera obligée de s'affronter de plus en plus à l'État, mais le contenu même de ses revendications restera sur une longue période, économique. En fait les deux problèmes qui seront au centre de la lutte seront celui des salaires et celui du chômage.
Pour pouvoir concurrencer les marchandises étrangères, chaque capital national s'attaquera de plus en plus directement aux salaires, ce qui obligera les ouvriers à développer leurs luttes pour le maintien de leur pouvoir d'achat (contrairement à ce qu'ont pu dire les théoriciens de la "société de consommation").
De même, l'effondrement des marchés et donc de la production jettera un nombre croissant d'ouvriers dans le chômage, chômage dont on peut voir dès aujourd'hui la montée en flèche. Ce chômage risque, à certains moments, d'être un facteur de démoralisation et de recul de la combativité. Parce qu'il prive les ouvriers qui en sont touchés de l'arme de la grève et qu'il permet au capital d'exercer un certain chantage sur ceux qui ont encore du travail, le chômage est certainement une calamité qui désoriente beaucoup d'ouvriers. Mais en même temps, ce phénomène signe la faillite économique du système qui ne peut même plus garantir à la classe travailleuse le plus élémentaire : du travail pour vivre. En ce sens, c'est un puissant facteur dans la prise de conscience prolétarienne de la nécessité de renverser un système qui a fait la preuve évidente de sa caducité.
Si dans une période de recul de la classe, comme celle que celle-ci connaissait en 1929 au moment de la crise, le chômage provoque essentiellement le premier type d'effets sur la combativité ouvrière, c'est essentiellement le deuxième type de conséquences qu'il provoque dans une période de montée des luttes comme c'est le cas actuellement. C'est là une loi qui s'applique plus généralement à l'ensemble des expériences de la classe qui veut que celles-ci se transforment en facteurs de passivité, dé démoralisation et de recul du niveau de conscience ou bien encore en facteurs de plus grande combativité, d'enthousiasme et d'élévation de la conscience suivant le cours général du mouvement ouvrier dans lequel prennent place ces expériences. L'exemple le plus frappant en est celui des défaites. Depuis que le capitalisme est entré dans sa phase de décadence, celles-ci sont le lot quotidien de la classe. Si au siècle dernier, la marge de manœuvre dont disposait le système lui permettait d'accorder aux ouvriers de réelles améliorations quand ceux-ci luttaient, dans l'époque actuelle et surtout maintenant en période de crise ouverte le système est incapable d'accorder quoi que ce soit. C'est pour cela que les luttes ouvrières du XX° siècle aboutissent généralement à des défaites qui deviendront d'autant plus sévères que l'économie s'enfoncera dans le marasme. Mais si, dans les périodes de recul général de la classe, chacune de ces défaites est un degré de plus en plus -descendu dan* la pente qui conduit au gouffre de la guerre impérialiste, dans une période ascendante- chaque- défaite est, pour le prolétariat, un marchepied pour se propulser vers un niveau supérieur de radicalisation et de conscience.
Dans la période actuelle, les luttes économiques que sera conduit à mener le prolétariat seront essentiellement des défaites, défaites qui seront inévitables. Mais ce sont ces échecs qui lui feront comprendre la faillite totale du système, son incapacité à accorder autre chose qu'une misère croissante, donc la nécessité de le détruire. Ils lui feront prendre conscience, face aux tentatives des syndicats et de la gauche d'isoler ses luttes et de les détourner de ses objectifs de classe, de la nécessité de généraliser ses luttes, de se donner, .une forme d'organisation autonome et d'affronter cette gauche et ces syndicats.
Certains prétendent que les luttes économiques sont et seront défaites parce "qu'elles sont des luttes du capital" et qu'il faudrait donc dissuader les ouvriers de se battre sur ce terrain afin de leur éviter ces défaites.
D'autres voudraient également épargner aux ouvriers ces défaites en les faisant se battre pour des "programmes transitoires", des "échelles mobiles", le "contrôle ouvrier" (sur sa propre exploitation ?) etc.
Quel que soit le radicalisme qu'elles puissent afficher, ces deux conceptions tendent, en fin de compte, à démobiliser la classe dans son combat : la première parce qu'elle conduit à dire aux ouvriers : "abandonnez vos luttes actuelles" ; la seconde parce qu'elle tente d'enfermer ces luttes dans un carcan au lieu d'en élargir toujours plus le cadre et le contenu.
Pour notre part, nous affirmons que ces luttes économiques et ces défaites sont une étape indispensable du combat de- la classe vers son émancipation et qu'il n'existe pas de recette magique, de "saut dialectique" ou de revendication miraculeuse pour les éviter. En cela, nous ne faisons que prendre la suite des autres communistes qui dans le passé ont souvent répliqué aux philanthropes qui voulaient faire faire aux ouvriers l'économie de leur lutte contre l'exploitation ou de la défaite. Parmi ces communistes, nous ne citerons que Marx qui déclarait qu'une classe qui ne lutte pas contre l'exploitation de chaque jour ne sera jamais capable de faire la révolution, ainsi que Rosa Luxembourg qui écrivait la veille d'être assassinée par le gouvernement socialiste Ebert-Noske-Scheidemann :
"La révolution est la seule forme de "guerre" -et c'est là aussi une loi de vie qui lui est propre- où la victoire finale ne peut être préparée que par une série de "défaites".
Une des autres grandes caractéristiques de la situation actuelle est, comme nous l'avons déjà signalé, que, contrairement à 1929, le rythme d'approfondissement de la crise est relativement lent. Ce fait a une grande importance sur les conditions dans lesquelles la classe est amenée à réagir à la crise.
Nous avons déjà constaté l'ampleur de ces premières réactions prolétariennes. Elles sont l'indice de formidables réserves de combativité dans les nouvelles générations ouvrières. Mais en même temps, compte tenu de la lenteur même de ce rythme ces réactions tendent à être relativement espacées dans le temps. Un des exemples les plus frappants en est sans doute la lutte de classe en France : il a fallu plus de six ans pour que les travailleurs reprennent, avec la grève des PTT, le chemin des luttes massives qu'ils avaient abandonné en Juin 1968. Entretemps, même si certaines luttes comme celle des OS de Renault, des vendeuses des Nouvelles Galeries, des Ouvriers de Lip, etc. avaient indiqué une radicalisation incontestable de certaines fractions de la classe ouvrière, le niveau moyen de la combativité n'était pas supérieur à celui d'avant 1968. La même situation se rencontre un peu partout : ce qui frappe, dans les luttes actuelles, c'est leur cours en dent de scie, les explosions brusques de combativité suivies d'une longue période d'apathie.
Ces conditions de la lutte font que le prolétariat éprouve les plus grandes difficultés à tirer les leçons de celle-ci. Entre chacune de leurs expériences dans un secteur donné, il s'écoule trop de temps pour que les travailleurs puissent encore réutiliser valablement les enseignements des premières dans les suivantes. Ainsi, les syndicats français qui en 1968 avaient été démasqués et débordés par un certain nombre de travailleurs ont réussi assez facilement par la suite à reprendre les choses en main et à se faire passer dans la grève des PTT comme les véritables défenseurs des travailleurs.
L'exemple est encore plus frappant en Italie : en 1969, la dénonciation des syndicats était devenue un des thèmes majeurs de beaucoup de grèves, aujourd'hui ceux-ci ont "regagné la confiance" de beaucoup d'ouvriers et maintiennent un contrôle important sur la classe.
La difficulté qu'éprouve la classe à tirer les leçons de ses expériences, ne provient pas seulement de l'irrégularité de ses luttes, elle est liée également aux circonstances historiques dans lesquelles se situe la montée actuelle du mouvement. Celle-ci intervient après la plus grande défaite de l'histoire du prolétariat, après une période d'un demi-siècle de contre-révolution -qui a privé celui-ci de la presque totalité de ses traditions quand elle n'a pas converti ces traditions en fétiches contre-révolutionnaires qui l'a privé des moyens mêmes de tirer parti de son expérience et au premier chef de ses partis et fractions communistes.
Et cette carence dans les moyens du prolétariat pour comprendre sa propre lutte est un facteur qui vient amplifier le cours en dent de scie de celle-ci. Pour la grande majorité des travailleurs la défaite qui suit chaque lutte importante est ressentie essentiellement sous cet aspect de défaite sans qu'elle puisse encore en comprendre l'aspect positif d'étape indispensable à ses combats futurs. C'est pour cela que ces luttes sont souvent suivies d'une période assez longue de démoralisation et d'apathie.
Mais il ne s'agit pas là d'un cercle vicieux, d'une situation sans issue. La crise générale du capitalisme ne pourra aller qu'en s'approfondissant contraignant les ouvriers à laisser de moins en moins de répit au capital. Un des exemples les plus frappants en est sans doute la Grande-Bretagne où la situation économique catastrophique - a conduit les ouvriers anglais à un combat continu contre la dégradation de ses conditions d'existence, combat que seule la mystification du gouvernement travailliste a pu momentanément tempérer.
Cette accélération du rythme de la lutte de classe, outre qu'elle permettra une accumulation d'expériences permettra ainsi de tirer un profit grandissant de celles-ci, d'intégrer de plus en plus les acquis de chacune dans la conduite des suivantes et donc d'approfondir le niveau de conscience et d'organisation de la classe.
Dès aujourd'hui, c'est dans un des pays où la lutte contre une des exploitations les plus dures d'Europe se donne le moins de répit, l'Espagne, que le prolétariat s'est également donné les formes les plus combatives et conscientes de cette lutte. Par certains de ces aspects le débordement des syndicats, la solidarité de classe, la pratique courante des assemblées générales, la tendance systématique à la généralisation des grèves d'une usine à l'autre, au niveau d'une ville ou d'une région (Vigo, El Ferrol, Pampelune, Bajo Llobregat, etc.), les affrontements avec les forces de répression -la lutte actuelle des ouvriers espagnols préfigure celle que devront de plus en plus mener les ouvriers du monde entier.
Aujourd'hui, le prolétariat est engagé dans une des plus grandes batailles de son histoire, probablement la plus grande. En face de lui, la bourgeoisie a compris que, plus que tout autre problème, celui que lui posera cette bataille sera difficile à résoudre. C'est pour cela qu'elle est en train de mettre en place les équipes politiques qui au lendemain de la première guerre mondiale lui ont permis de briser la première offensive généralisée de la classe ouvrière.
Depuis 1968, les ouvriers des quatre coins du monde ont répliqué massivement à la crise capitaliste. Mais le faible approfondissement de celle-ci et aussi leur manque d'expérience et de traditions ont permis encore au capital de contenir ces luttes, de les isoler ou de les détourner. Mais de plus en plus les ouvriers du monde entier seront confrontés à des situations comme celles qu'affrontent aujourd'hui les ouvriers israéliens qui ont vu, début novembre leur pouvoir- d'achat agressé sauvagement. Ils seront -alors obligés de reprendre le drapeau de la lutte qu'ils avaient pu ranger momentanément, et ils devront mener au capital un combat de plus en plus constant, profond et conscient.
Avec la misère croissante qui ne manquera pas d'accabler les masses travailleuses, leur vieux cri de guerre redeviendra de plus en plus à l'ordre du jour :
- "Que les classes régnantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'y ont à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à y gagner".
C.G.
[1] "Informations et Correspondance Ouvrières" venant d'"informations et Liaisons Ouvrières" qui fut une scission de "Socialisme ou Barbarie –(S ou B)" en 1958-59.
[2] "Groupe de Liaison pour l’Action des Travailleurs", issu d'une scission de S ou B en 1958-59.
[3]" Internationale Situationniste", dont un des théoriciens, Guy Debord a fait partie de S ou B avant de cracher dessus de toute la force de ses poumons.
[4] "Pouvoir Ouvrier" : tendance apparue dans S ou B au début des années 60 sur la base de "la défense du marxisme" rejeté par Cardan, pseudo de Castoriadis.
[5] Brochure "Organiser le courant marxiste - révolutionnaire".
[6] D'après "Perspectives économiques de l'OCDE", Juillet 1974.
[7] Idem.
[8] OCDE : Main économie indicators, Octobre 1973 et Octobre 1974.
[9] D'après "TIME" du 9 Septembre 1974.
[10] Article dans lequel on fait intervenir, entre autres différences, que les agriculteurs américains de l'époque étaient ruinés alors qu'aujourd'hui ils sont prospères...
[11] Réunion de presse du 24 Octobre.
[12] Titre d'une série d’articles de Cardan dans "Socialisme Ou barbarie".
[13] Seul groupe de notre courant international existant à l'époque.
[14] Cité par l’"Express" du 21-27 Octobre 1974.
[15] Cette déclaration à elle seule est significative parce qu'elle met à mal toutes les envolées sur la "magnifique expansion" du Brésil qui devint prouver pour certain la possibilité de développer les pays du Tiers-Monde dans la période actuelle.
[16] Cité par l'"Express" du 21-27 Octobre 1974.
[17] Cité par l'"Express" du 21-27 Octobre 1974.
[18] "Le Monde" du 1° Août 1974.
Questions théoriques:
- L'économie [15]
Rubrique:
Le capital français à la dérive
- 7 reads
En France, berceau du rationalisme, le petit bourgeois se plaît à expliquer le monde par de grandiloquents concepts métaphysiques de Droit, de Justice, d'Egalite ou de Liberté. Pour lui, l'échange international sur la base de l'entente loyale réciproque est le plus sûr garant de la marche en avant du progrès. C'est aux nations privilégiées de rivaliser pacifiquement entre elles suit le terrain économique pour faire bénéficier l'humanité entière des bienfaits de leur industrie et hisser toutes les autres à leur niveau par la sainte émulation de la libre-circulation des personnes et des biens.
Se pouvait-il alors qu'un pays qui a légué au monde moderne l'impérissable testament de la bourgeoisie triomphante, la "Déclaration de l'Homme", essaimé sa brillante civilisation sur les Cinq Continents, la France qui a montré aux autres nations l'image de leur propre avenir, puisse connaître les affres de la crise comme le dernier pays colonial ou semi-colonial ? "Que diable ! s'écrie notre buveur de camomille, la Touraine n'est pas le Sahel. Le peuple français qui a émerveillé le monde par les constructions de son génie doit être payé en retour; la voix de la France continuera à tonner dans les instances internationales pour faire respecter l'esprit des accords mondiaux ou alors gare à notre armée."
Il était si convaincu de l'universelle confiance placée par les peuples civilisés dans l'idéal français, il avait tellement nourri ses pensées de cette creuse philosophie que la réalité lui apparaît comme un maléfice jeté dans le dos de la démocratie française par quelque puissance occulte, en occurrence l'arabe qui surenchérit le prix du brut. Il ne peut plus dès lors se mettre au lit sans entrevoir aussitôt des places noires de monde, des ouvriers qui disputent la rue aux forces de police, bref le spectre de la sociale. Et de s'assurer que le verrou de son huis le protège vraiment des "partageux".
Si notre petit bourgeois, qui n'habite pas forcément les beaux quartiers, se trouve être membre "d'un parti pas comme les autres", il verra dans les malheurs de sa patrie la main des multinationales, ces forces étrangères à la nation, et, auxquelles se trouvent honteusement subordonné le gouvernement. "Que la France commerce avec les pays socialistes ! Qu'elle resserre les liens d'amitié qui lient notre peuple aux nations progressistes ! Et nous pourrons repartir de l'avant d'un nouveau pas" sera son cri du cœur, sa charte économique du bon sens et de la bonne volonté.
Mais aucun de ces deux citoyens respectueux de l'ordre capitaliste ne veut savoir que la contradiction .entre le développement de la production et le rétrécissement des marchés, forment une chaîne indestructible qui ne trouvera pas son Pinel parce que cette fois elle n'attache plus quelques malheureuses victimes de l'ordre asilaire, mais des pays dépendants tous des conditions mondiales dominantes.
De "droite" ou de "gauche", c'est le dénominateur commun de la bourgeoisie de voir, impuissante, son organisation sociale partir à la dérive, et ce en dépit de toute sa formation technique et intellectuelle acquise au cours de plusieurs siècles de pouvoir politique imposé soit par le knout, soit par des lois démocratiques "d'avant-garde". Cette faillite idéologique s'exprime avec force dans la science économique par un retour stérile à l'école keynésienne ou à opposer à celle-ci la rivale monétariste, l'une et l'autre incapables de saisir, dans toute leur ampleur, les tenants et les aboutissants d'une crise qualifiée "de civilisation". Toute intelligence de ce qu'est vraiment l'économie politique abandonnée pour un empirisme vulgaire, la vénérable Académie Royale de Suède couronnera la recherche économique de deux parfaits imbéciles au lieu de leur remettre le bonnet d'âne mille fois mérité, le suédois Myrdal et l'autrichien Von Hayek.
La première de ces deux lumières a écrit une bibliothèque pour expliquer la chose suivante : "L'un des dangers de l'inflation vient de l'irritation qu'elle provoque entre le mari et la femme, le travailleur et l'employeur, les citoyens et le gouvernement". Le second expose, avec tout le sérieux requis par sa fonction sociale, les thèses qui lui ont valu de partager le prix Nobel d'économie avec la première cité. Elles ne sont pas moins grotesques : "À chaque époque, il existe une proportion idéale entre la valeur des biens de production investie et celle des biens de consommation. Cette proportion idéale dépendrait, dans un système d'épargne volontaire, de la seule abstinence des individus" pour conclure à l'impossibilité du socialisme car pour ce plumitif, les tendances socialisantes portent la responsabilité des fascismes que les politiciens auraient dû empêcher en organisant le système libéral".
Tels sont les brevets de maîtrise intellectuelle décernés par les Harvard, Cambridge et les London School of Economies.
LA CRISE MONDIALE EN FRANCE
Chez certains "marxistes" à la vue basse, on en est encore à parler de crise de l'automobile, de crise de l'aéronautique, de crise du textile, de crise du bâtiment, de crise céréalière et, ainsi de suite jusqu'à l'infini. En outre, ce qu'ils ne peuvent comprendre, c'est l'impossibilité pour chaque fraction du capital de ' se détacher les unes des autres pour vivre une paisible robinsonnade autarcique.
Ainsi, le tassement intervenu dans la zone d'échanges commerciaux de la CEE au premier semestre de l'année 1974 était consécutif à la baisse prononcée de la production américaine et japonaise. Il faudrait que s'y produise le renversement d'un tel cours pour que la croissance française se ressaisisse. Et même si c'était le cas, le rythme de reprise s'élèverait tout au plus à 3,6% comme le prévoit le B.I.P.E.(Bureau d'information et de Prévisions Économiques). Mais en raison d'un chômage qui a crevé le plafond des 7% de la population active américaine, des 4 millions de chômeurs dans les pays de la CEE, cette perspective appartient au domaine des illusions.
Comment progresse la crise en France, pays membre de la CEE, nous le voyons au moyen de la bourse même si c'est au travers d'un prisme déformant. Depuis les huit premiers mois de l'année, l'hémorragie des valeurs continue sans qu'aucun garrot d'urgence n'ait pu arrêter le flot, et les observateurs boursiers notent un recul de l’indice général de 35%, au plus bas depuis une dizaine d'années. En raison des incertitudes générales planant sur les chances de reprise de la croissance "Industrielle, du progrès de l'inflation, des valeurs qui hier encore intéressaient d'éventuels investisseurs se raréfient. De cela ressort que le chancre inflationniste a entamé, en profondeur, des gains de productivité obtenus par une augmentation d'appropriation du surtravail. C'est pourquoi l'écroulement de la plupart des titres notamment ceux des sociétés Michelin, Moulinex, Poclain, auparavant vedettes du hit-parade boursier conduisent cambistes et actionnaires à multiplier les allusions à la crise de 1929. Lorsque l'ensemble des opérateurs en vient à parler de créer une "Croix Rouge" internationale des banques, c'est que le seuil de dislocation du marché mondial n'est pas loin.
Au Printemps "des barricades", à la grève généralisée du Mai 1968 avait succédé une vigoureuse reprise industrielle : les entreprises françaises se classaient parmi les quarante firmes européennes les plus rentables en 1972; sur les 105 entreprises mondiales réalisant un chiffre d’affaires au moins égal à deux milliards de Dollars, 9 étaient nationales, c'est-à-dire autant que le Japon et le Royaume-Uni. Durant une courte période au début de 1973, la France était parvenue à occuper le troisième rang mondial des pays exportateurs, derrière les Etats-Unis et l'Allemagne Fédérale, devant le Japon. Le taux de couverture des échanges passait de 100% en 1967 à- 104% en 1973. D'importantes restructurations opérées dans l'appareil de production, peu après la décolonisation, expliquerait en partie cette progression. (Péchiney-Ugine-Kulhman, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson).
A présent, s'agit-il de crise de "reconversion", de "crise passagère", ainsi que quelques manitous de l'idéologie dominante s'efforcent de l'accréditer ? Aucune véritable comparaison ne peut être établie avec la récession passagère des années 1957-60, corollaire de l'inévitable décolonisation, récession qui devait provoquer la fermeture de mines, d'usines textiles, le marasme local ou même régional. Il s'agissait à cette époque d'une refonte de l’appareil reproductif décidée par les représentants de pointe du patronat et de la haute administration français. Sous le capitalisme dirigiste, où l'État se donne les- moyens d'exercer la planification, de la prévision, la restructuration ne constitue pas une raison de crise réelle. La bourgeoisie continue d'avoir bien en mains les secousses qui s'en dégagent.
Qu'il fasse de la "mono" ou de la polyculture, qu'il produise des biens de consommation ou des biens de production, le paysan et l'entrepreneur industriel sont également touchés par une crise qui tient en ceci : la fin de la période de reconstruction d'après-guerre. Face à elle, aucune couche sociale ne se trouve être immunisée, aucun secteur d'activité ne peut s'y soustraire. La crise est générale à tous les pays, et, de son caractère véritablement international dépend l'avenir de la société humaine : ou guerre ou révolution prolétarienne.
Les faciles rodomontades du genre : "La France n'a pas de problème d'emploi global et notre taux de chômage est l'un des plus faibles au monde" faites par Fourcade lors de la présentation du budget de l'État le 19 Septembre, ou encore celles de Poniatowski déclarant au journal "Newsweek" : "En 1969, nous sommes parvenus, et sur la base de prévisions, à rattraper l'Angleterre" ont la clarté du borgne en voyage au royaume des aveugles. La difficulté grandissante de la bourgeoisie à travestir les faits introduits dans la "vie économico-sociale pour la bouleverser, l'amène à parler un langage social différent. Ceux-là mêmes qui élevaient du plus profond de leur poitrine d'idéologues des alléluias pour célébrer le "miracle français", son cortège d'augmentations constantes de la production, des profits du capital, se mobilisent sur l'heure pour se faire les apôtres d'une nouvelle règle de vie à la Spartiate. Leur fonction d'endormeurs de la classe ouvrière demeure au-delà de leur spécialisation idéologique du moment. .
Une énième fois, la vision marxiste triomphe sur le cadavre de ses détracteurs et, pour les petits maîtres poussés sous la serre universitaire, la pilule est amère.
Autre tarte à la crème pour régaler les gogos : la hausse du prix du pétrole a entraîné une formidable poussée inflationniste. Or, l'incidence de cette hausse, qui somme toute ne représente qu'un épiphénomène du marché mondial est comprise entre 2 et 2,5% sur une augmentation générale des prix à la consommation de 16%. Il s'agit donc, à un moment où le taux de couverture est descendu à 90%., de rééquilibrer la balance commerciale. Certes, une économie de 10% de la consommation pétrolière épargnerait 5 milliards de Francs à l'économie française, mais désorganiserait la production industrielle et agricole à tel point que le capitalisme devrait retourner en arrière. Le fardeau de la politique énergétique malthusienne sera donc rejeté sur les épaules de la classe ouvrière.
Le gouvernement prépare l'opinion à un rationnement de la consommation énergétique par la généralisation d'un plan de répartition appliqué dans l'hiver 1973 un première fois à 73 départements métropolitains. Dans son discours devant l'association de presse anglo-américaine du 19 Septembre, M. Chirac a apporté d'utiles précisions quant aux intentions gouvernementales: "...Mobiliser l'opinion publique contre le gaspillage d'énergie de façon libérale ce qui est notre vocation, de façon autoritaire ce qui est notre devoir". La solidarité nationale, ce mot que la bourgeoisie ressort chaque fois qu'elle s'avère incapable de se maintenir solidement dans son rôle de classe dominante de la société et d'imposer les règles de l'accumulation, voudrait que la classe ouvrière s'adapte à des mesures dites "consignes de lutte contre le gaspillage" acceptant du coup de voir son standard de vie directement attaqué. Sinon, ce sera la matraque du flic qui s'abattra très démocratiquement sur elle.
Si en 1973, le solde de la balance commerciale faisait apparaître un gain de 1500 millions de Dollars (36000 et 34500), fin 1974 il y aura un déficit de l'ordre de 4050 millions de Dollars (44950 et 49000). C'est pourquoi les programmes de redressement économique portent en priorité sur l'effort à l'exportation. La bourgeoisie l'a annoncé par la voix de son actuel ministre des finances, M. Fourcade. Traduit en langage marxiste, cette invite plusieurs fois réitérée, est synonyme de "retroussez vos manches !" et du "serrez-vous la ceinture !", car, le rétablissement de l'équilibre implique l'exportation de toute augmentation de la production et non sa consommation pour satisfaire les besoins intérieurs. Comparativement avec' la stratégie de relance, espérée quelques semaines plus tôt dans une allocution présidentielle pour retourner la conjoncture le contraste est énorme. C'est le moins qu'on puisse dire.
Des idéologues de la bourgeoisie en viennent à parler un langage typiquement maoïste : "Dans la période de transition qui s'imposerait, compter sur ses propres forces serait absolument essentiel" dixit C. Goux, ci-devant professeur à l'université de Paris-I et à qui le très sérieux "Monde Diplomatique" offrait l'hospitalité de ses colonnes dans son dernier numéro de Novembre 1974.
Comment l'intervention d'un Giscard d'Estaing pourrait-elle arrêter l'incendie dès lors que les conditions de fonctionnement antagoniques de la société renforcent leur caractère. La bourgeoisie française soumise à une rude loi économique dont elle reste l'objet, prend les dispositions rendues nécessaires par l'accentuation de la crise. Mais cette fuite en avant la conduit à une impasse : voulant chasser une inflation consécutive au lancement de travaux improductifs par la porte, elle fera rentrer le chômage par la fenêtre. ' Si besoin était, les compressions drastiques des dépenses courantes de l'Etat (1,6 milliards de Francs de crédit inscrits au Fonds d'Action Conjoncturelle et, 1 autre milliard de Francs sans étiquetée précise ne seront pas débloqués cette année), l'irréversible tendance à la stagnation démontre l'incapacité de la bourgeoisie à résoudre les contradictions immanentes au capitalisme et, dans lesquelles elle se débat en pure perte.
Il suffira que moins d'équipements soient réalisés par les grandes entreprises nationalisées, telles que la SNCF, les PTT, l'EDF..., que ce qui devait être renouvelé en temps utile serve jusqu'à la corde, pour que certains "marginaux" se croient autorisés à parler de succès des thèmes écologiques, de préservation des ressources de la nature, de sauvegarde de la qualité de la vie et autres bobards, de concert avec la bourgeoisie favorable à donner un tour de vis supplémentaire.
"De toute manière, la crise n'est pas de conjoncture. Elle constitue un avertissement: les ressources de la planète sont limitées. Il faut donc, de gré ou de force, réduire nos importations, c'est-à-dire renoncer au gaspillage. Cette nécessité économique rejoint les exigences de l'environnement puisque toute la dégradation du milieu de vie est finalement du gaspillage" (souligné par nous. N.d.R.) expliquera en substance M. Gruson, sous-fifre du Ministère de la Qualité de la Vie.
L'ACCROISSEMENT DU CHOMAGE EST UNE FATALITE DU CAPITALISME DECADENT
Dans la période ouverte avec l'irruption de la crise des débouchés, la bourgeoisie est contrainte de refuser de s'encombrer d'entreprises en difficulté. Que l'État modifie sa politique de subvention financière, qu'il brandisse ses foudres de guerre économique, à savoir la restriction du crédit et la fixation d'une taxe conjoncturelle, et c'est le surgissement en nombre des faillites. Pour en savoir plus long sur cette dernière décision qui a provoqué la levée de boucliers des PME, il faut écouter quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, M. A. Roux, vice-président du CNPF : "On peut se demander si l'on ' n'a pas fait preuve d'une pudeur excessive à tourner autour du pot alors qu'on aurait pu envisager simplement une taxe sur les augmentations de salaires abusives."
Leur président, M. Gingembre a beau rappeler la tradition libérale de l'économie française, protester auprès des pouvoirs publics comme un diable trempé dans un bénitier, descendre dans la rue entourée de ses troupes, n'empêche, à brève échéance, les PME finiront dans l'étouffement d'un crédit toujours plus rarissime et plus cher. Le temps où celles-ci pouvaient faire appel au capital financier, au crédit-bail dont la formule connaissait le succès que l'on sait, est révolu. Quand bien même les dirigeants des PME menaceraient de fermer leurs entreprises le 25 Novembre, le gouvernement n'entend nullement relâcher son étreinte. Bloch-Lainé, PDG du "Crédit Lyonnais" ne vient-il pas d'être sanctionné pour s'être cru au-dessus de la solidarité gouvernementale ?
Il reste que seules les grandes entreprises placées en situation de force sur un marché mondial pris de convulsions continueront à recevoir des crédits en augmentation de façon à consolider leur capacité concurrentielle. Tout naturellement, les dépenses de l'État-patron iront vers les entreprises nationalisées et publiques. Une partie de leur financement sera assuré par la hausse de leurs propres tarifs et, par des emprunts sur le marché .financier international. D'ores et déjà, tout ce que le pays compte de politiciens en place ou y aspirant a entrepris de flatter l'instinct à l'épargne du petit bourgeois français à qui est promis un taux d'intérêt indexé sur l'inflation.
En conséquence, on est largement en droit de s'attendre à une rapide crue de l'armée des sans travail, forte aujourd'hui de 630.000 unités :
- de Juillet 1973 à Juillet 1974, le chômage s'est accru de 15%, les offres d'emploi ont diminué de 25% pour le seul mois de Septembre, 100.000 travailleurs ont été rejetés de la production parce que sans utilité pour l'appétit d'accumulation de la bourgeoisie.
- dans les PME, dont les carnets de commandes se situent au plancher, le dépôt semestriel de bilans aura été de 8000, soit 23% de plus que durant une même période l'an passé.
Qu'est devenue l'industrie de construction automobile longtemps considérée comme l'épine dorsale et l'ambassadeur de la croissance industrielle française avec ses deux millions de salariés et des centaines d'entreprises sous-traitantes si ce n'est le malade qui donne des signes de faiblesse les plus inquiétants. Citroën ne pourra survivre que dans une association de type holding avec Peugeot. A ce jour, 1'exportation d'automobiles françaises qui avait atteint son maximum au cours du premier semestre 1974 a commencé sa chute et, sur le marché national par rapport à L'an passé, les préfectures ont enregistré une baisse d'immatriculations de 25%.
L'agriculture, le secteur des biens de consommation, la petite mécanique sont les branches touchées de plein fouet par la crise. Non parce qu'il y aurait une faillite de gestion mais parce que les partenaires de la France doivent, pour faire solder la crise aux travailleurs qu'ils tiennent sous leur coupe, cesser d'importer ces marchandises dont la France est grande exportatrice. Dans la longue liste des entreprises en difficulté on trouvera encore l'aéronautique qui n'a pas ' su se tirer de sa mauvaise- passe malgré les faramineuses commandes passées par l'industrie d'armement. Là, le directoire de la SNIAS a eu recours à un véritable tour de prestidigitation : le transfert des activités traditionnelles dévolues aux usines de Tarbes et de Bourges à celles de Toulouse afin d'y maintenir le niveau de l'emploi.
Avec une rapidité ignorée depuis bien des lustres, le chômage partiel ou total, est en train d'étendre ses ravages sur l'économie française, inéluctabilité engendrée par le capitalisme à sa période de décadence. Ce qui est fondamental, c'est qu'en fonction du caractère non cyclique mais permanent de la crise, ces centaines de milliers de chômeurs ne forment pas une armée de réserve dont les éléments pourraient retrouver leur place à l'usine à la -suite d'un nouvel essor du capitalisme. L'incertitude et, l'instabilité auxquelles l'exploitation capitaliste soumet le travail vivant n'a pas cessé de se renforcer. Ce qui est véritablement à l'ordre du jour est bien : "le combat ou la mort; la lutte sanguinaire ou le néant. C'est ainsi que la question est véritablement posée;" (Marx) car le capitalisme a cessé d'être un mode de production progressif.
A-t-il raison, le patronat d'espérer venir à bout de la classe ouvrière en agitant sous ses yeux l'épouvantail de "la crise ? Si lors de la dépression mondiale des années - 30, il était possible à la bourgeoisie de diviser le prolétariat en profitant au maximum de sa faim, de désamorcer la bombe sociale en jouant sur le réflexe d'autoconservation individuelle, cette perspective est sans objet. Aujourd'hui, la période est à la reprise mondiale de la classe, le prolétariat européen a conservé intact son potentiel de lutte qui, à tout moment peut embraser l'ordre capitaliste.
Contre l'attente de l'État, loin d'avoir levé un vent de panique chez les travailleurs, les menaces de licenciement, les réductions d'horaires sans compensation de salaire ont, au rebours, déclenché le regroupement combatif de leurs forces. Les risques de réaction brutale de la classe ouvrière demeurent trop réels pour que l'État se heurte de front à ses conditions d'existence. Jusqu'ici, la tactique de la bourgeoisie a été de procéder par petits paquets, et promettre des allocations de secours aux ouvriers chassés des usines.
Une chose est certaine : le refus de l'État à entretenir une force de travail désormais superflue puisqu'il n'y trouve plus le profit es- compté. Ce qui était possible de faire avec deux cents ou trois cents mille chômeurs ne l'est plus une fois franchi le cap des deux millions. Alors que, le triomphe facile, les syndicats claironnaient "victoire" (!) sur l'accord du 14 Octobre, le gouvernement n'a pas tardé à préciser qu'il laisserait presque entièrement à la charge des employeurs et des salariés le financement de la garantie des ressources aux chômeurs. L'allocation ne serait pas relevée de 10 à 16 Francs pour qu'elle soit au même niveau que l'allocation minimale de 1'UNEDIC.
Avant même d'avoir, pu chloroformer les travailleurs, le sens réel des accords patronat- syndicats relatifs à l'assistance apportée aux chômeurs s'est dissipé en fumée, ne pouvant plus cacher l'abandon de centaines de milliers de travailleurs, de femmes sans emploi, de jeunes à la recherche pour la première fois d'un travail. Qu'ils se fassent une raison eux pour qui les causes de leur souffrance sont d'ordre "démographique", "sociologique", comme l'a souligné Monsieur Durafour, Ministre du Travail, devant la sénile Assemblée Nationale.
Le capitalisme qui, sans lésiner, accorde droit d'asile, droit à la contraception, droit de vote à dix-huit ans a fait de toutes ces catégories de prolétaires de véritables parias. Ils ne recevront d'aide matérielle de personne si ce n'est de leurs familles, ceci parce que pour le prolétariat, seule classe non exploiteuse de la société, la fraternité n'est pas un mot creux et sournois mais sa véritable forme d'existence sociale.
LA POLITIQUE CAPITALISTE DU "PROGRAMME COMMUN"
On - aurait tort de croire qu'en décidant les grèves pour la défense de l'emploi -ou en les prenant en marche- les syndicats cégétistes et cédétistes luttent pour le maintien du niveau de vie de la classe laborieuse. Sous le leitmotiv d'empêcher "le démantèlement des établissements nationalisés", de fait ils veillent en cerbères à la défense de la Nation, de son économie, de son capital. Le sentiment que la défense des intérêts des travailleurs passe par celle de l'économie nationale est un poison que les staliniens distillent dans la classe ouvrière pour la river plus solidement à la galère capitaliste battue en brèche.
Toute la gauche mène campagne contre la "braderie" de l'économie nationale, contre la dépendance française à l'égard de la puissance américaine qui, après la disparition de De Gaulle, a pu augmenter ses apports de capitaux, ses prises de participation dans l'industrie hexagonale : 4 milliards de Francs de 1969 à 1971. N'est-il pas dans l'ordre des choses que l'autre grande famille de patriotes français, le gaullisme, lui emboite le pas ? Que Marchais se découvre devant la mémoire du général dont le nom reste attaché "à la fierté nationale recouvrée" ?
Qui analyse la politique du parti soi-disant communiste y verra une volonté forcenée de maintenir la classe des esclaves salariés sous la domination du capital, quel qu'en soit le prix payé par le prolétariat : "Après beaucoup de misères, souffrances et cadavres abandonnés sur le champ de bataille de 1'industrie"(Marx). Pour ces modernes marchands de chair humaine, il faut prouver, chiffres en main, la rentabilité des entreprises depuis les usines Coder jusque et y compris aux plus infâmes boyaux de mines lorrains. Des mains sclérosées d'une autre fraction de la bourgeoisie, ils ont recueilli le credo de la religion du capital : stimuler l'appétit d'accumulation en flétrissant toute consommation individuelle ne venant pas renforcer l'appareil de guerre économique. Et devant les travailleurs, ils exalteront l'idéal de la canaille : selon lequel plus le maître est gras, mieux se porte l'esclave. Si l'ouvrier ne trouve plus dans la classe ennemie l'acheteur de sa force de travail, son existence toute entière subordonnée au rapport salarial se trouve compromise. Le capitalisme, comme puissance sociale déterminée et non comme force personnelle, disparaît de la scène s'il ne fonctionne plus en tant que processus d'accumulation.
Quand, relayé par son réseau complexe d'organisations syndicales, culturelles, municipales, sportives, le PCF explique que "le petit et moyen capital non monopolistique est à son tour pillé par le grand capital", quand devant son XXI° Congrès Extraordinaire de Vitry il conclut à une solidarité entre travailleurs et petits patrons qui battent de l'aile, quand l'"Humanité",, son organe central, ironise dans ses colonnes que "si la gauche était arrivée au pouvoir, les PME seraient aujourd'hui en bien meilleure posture car le Programme Commun n'est pas un programme de collectivisme", c'est cette communauté d'intérêts qui est proclama entre le maître et l'esclave. Hier, les Pères de 1'Eglise glorifiaient le servage médiéval, aujourd'hui les sycophantes staliniens de l'économie politique se prosternent devant le Veau d'Or.
Qu'attend donc le gouvernement pour exploiter "des centaines de millions de tonnes de charbon (qui) dorment sous, le sol de la France, condamnés"? De faire fabriquer pour son compte : "l'industrie française est obligée d'acheter pour un milliard à l'étranger les machines dont elle a besoin et, qui pourraient être fabriquées ici". ' ("L'Humanité. 9/11/74). L'autre aile marchante de la contre-révolution, la CFDT, ne tient pas un langage différent; elle-même s'est livrée à une étude sur les prix à la production. Cela donne; par exemple : "la compétitivité du charbon national est donc indiscutable. Si l'on valorisait le prix du charbon national, compte tenu du coût de la thermie fuel, les charbonnages de France pourraient être une entreprise bénéficiaire" ("Le Monde" 14/11/74).
En dénonçant le mauvais coup de mise en chômage technique à Rhône-Poulenc ou à Citroën, le stalinisme tire très habilement profit de la situation de crise pour renouveler sa candidature au pouvoir, afin de gérer les intérêts capitalistes. Il a donc besoin du soutien indéfectible de la classe ouvrière, cette "grande force tranquille" qui- "luttant pour ses salaires a la conviction qu'elle défend l'intérêt national et l'avenir de notre pays, que la politique gouvernementale compromet gravement" ("L'Humanité" 9/11/74).
Réellement, il s'agira pour l'ennemi recouvert d'un masque "ouvrier" de prêcher la pratique du baise-main au patron, d'encenser la soumission aux intérêts suprêmes de la nation. Avec l'aide consciente des gauchistes qui après leur petit score au premier tour des législatives partielles d'Octobre se sont désistés par "discipline prolétarienne" au profit du candidat unique de la gauche, on tentera d'annihiler la combativité de la classe sur le terrain des mystifications électorales, syndicales et autogestionnaires. Dans un autre moment, si les travailleurs ne se sont pas laissés épuiser par des balades, on essaiera d'écraser sous une pierre tombale la saine réaction de classe, devenue pour les chiens de garde un crime pour la France républicaine.
Le prolétariat n'est pas un peu contre le régime de la libre concurrence et beaucoup contre les monopoles. Pas plus qu'il n'est contre les différentes formes revêtues par son exploitation, il n'est contre tel ou tel gouvernement qui y correspond et l'assume. Son opposition à la société qui fait de son travail, un article de commerce est irrépressible. Pour cette même raison, et parce qu'il "refuse de se laisser traiter en canaille" (Marx), le prolétariat est le seul sujet révolutionnaire conscient de la nécessaire transformation du monde, l'agent qui assurera "le passage du règne de la nécessité au règne de la liberté". Liberté qui ne commencera que là où le travail salarié aura cessé de s'imposer aux hommes.
R. C.
Situations territoriales:
Rubrique:
Les syndicats contre la classe ouvrière (*)
- 89 reads
(*) Cet article est une reprise de l'article paru dans le numéro 3 de R.I. n° 3, ancienne série (décembre 69),"GREVES SAUVAGES ET SYNDICATS". Plusieurs modifications et ajouts y ont été apportés.
Il y a un siècle, la constitution d'organisations syndicales était pour la classe ouvrière un sujet de lutte contre les gouvernements. Aujourd'hui, ce sont les gouvernements et le patronat qui luttent pour la syndicalisation des ouvriers.
- "Une certaine re-syndicalisation de la masse ouvrière française est nécessaire, car elle donnerait aux employeurs un interlocuteur valable et limiterait la gravité et la fréquence des conflits sociaux." (Schuman, lorsqu'il était ministre d'État chargé des Affaires Sociales, à France-Inter le 4 décembre 1968.)
"En contre-partie de la liberté des chefs d'entreprise, il est souhaitable que, comme élément d'équilibre, le syndicalisme ouvrier puisse s'affirmer. Personnellement, plus je suis partisan de la liberté, plus je souhaite un syndicalisme ouvrier fort. Et cela, c'est vraiment la conception d'une société cohérente." (F. Ceyrac, président du C.N.P.F., organe le plus représentatif du patronat français.)
Dans tous les pays, les gouvernements subventionnent plus ou moins grassement les centrales syndicales, et le patronat "éclairé" souhaite le "renforcement des syndicats ouvriers".
Quant aux ouvriers, ils se battent en dehors des syndicats, et contre eux. Les grèves anti-syndicales, les grèves sauvages, sont devenues le cauchemar du capital international. Qu'il s'agisse de grands éclats de la lutte ouvrière (comme Mai 68 en France, 69 en Italie ou 70 en Pologne, par exemple), ou des grèves parcellaires qui marquent chaque jour la vie du capitalisme mondial, une même règle se vérifie à chaque occasion : LE PROLETARIAT NE PARVIENT A SE BATTRE POUR SES INTERETS QU'EN SE HEURTANT AUX SYNDICATS. Le caractère "sauvage" d'une grève est devenu la première condition d'une véritable grève ouvrière.
Ainsi, les ouvriers se dressent aujourd'hui contre les organisations que leurs camarades avaient constituées, il y a cent ans, au prix de luttes acharnées.
Les ouvriers du siècle dernier avaient-ils donc tort de former des organisations syndicales ? Marx se trompait-il lourdement quand il y voyait un pas fondamental dans la lutte historique du prolétariat ? Toutes ces luttes ont-elles été inutiles, voire même néfastes pour l'avenir de la classe ouvrière ? Ou alors, est-ce que ce sont les ouvriers de notre é- poque qui ont perdu le "fil de l'histoire" ? Les grèves sauvages sont-elles seulement l'expression de leur incapacité à reprendre les tâches de leurs prédécesseurs et à former de "bonnes organisations syndicales"?
Il s'agit en fait de deux formes de luttes correspondant à deux époques historiques différentes.
Depuis le XIXe siècle, beaucoup de choses ont changé dans le capitalisme, et, fondamentalement le fait que d'un système en plein essor, il est devenu un système historiquement décadent.
La période ascendante du capitalisme
Détruisant les rapports de production féodaux et construisant un monde à son image, le capitalisme a connu au XIXe et au début du XXe siècle, une expansion extraordinaire et sans heurts importants.
L'organisation capitaliste de la production correspondait à des besoins historiques objectifs, réels. Après l'étouffoir qu'étaient devenus les rapports de production féodaux, elle permettait aux forces productives de reprendre un essor extraordinaire, sans précédents dans l'histoire de l'humanité. La bourgeoisie avait le monde entier à industrialiser, ses profits croissaient sans limites, les débouchés pour l'industrie semblaient intarissables, les frais improductifs de maintien du système étaient insignifiants. (L'État, principale source de dépenses improductives du capital, était essentiellement circonscrit à sa tâche de "gendarme" et constituait un appareil relativement restreint.)
Dans ce contexte, le capitalisme pouvait accepter, si la lutte de la classe ouvrière le lui imposait, une modification de la répartition du produit social. Il lui était possible de supporter une augmentation réelle des salaires, ou une diminution effective du temps de travail, sans pour cela courir à la faillite ou se lancer dans une spirale inflationniste. La prospérité du système était telle qu'elle créait au sein de l'antagonisme entre ouvrier et capital un terrain "d'entente", où des améliorations réelles de la condition ouvrière ne s'opposaient pas irrémédiablement à des avantages pour l'expansion du capital.
Lorsque le prolétariat arrachait la satisfaction d’une revendication, c'était de façon durable, réelle ; toutes les formes de lutte en étaient déterminées : partis politiques de masses, parlementarisme, syndicalisme. Le réformisme, non comme idéologie, mais comme forme de lutte, avait un sens pour la classe ouvrière parce qu'il était possible.
Un tel état de choses est difficile à concevoir aujourd'hui, après un demi-siècle au cours duquel toute augmentation générale des salaires a été immédiatement annulée par une hausse équivalente des prix et où toute promesse de réduction du temps de travail est pour l'essentiel restée lettre morte[1].
Afin de mieux comprendre les conditions historiques qui faisaient du syndicalisme un véritable instrument du prolétariat au XIXe siècle, voici comment Marx commentait dans "SALAIRE,PRIX et PROFIT" la conquête de la Loi des Dix Heures par les ouvriers anglais :
- "Vous connaissez tous le Bill des Dix Heures, ou plutôt des dix heures et demi, introduit depuis 1848. Ce fut là un des plus grands changements économiques dont nous n’ayons jamais été témoins. Hausse des salaires subite et forcée, et cela non pas dans quelques branches et localités, mais dans les branches principales de l'industrie qui donnent à l'Angleterre la suprématie sur les marchés mondiaux. Hausse des salaires effectuée dans des circonstances singulièrement défavorables.) Cette douzième heure qu'on voulait ôter aux capitalistes, c'était à les en croire (les économistes "officiels") la seule et unique heure de travail d'où ils tiraient leur profit. Ils nous annoncèrent de grands maux : l'accumulation diminuée, les prix en hausse, les marchés perdus, la production ralentie, avec réaction inévitable sur les salaires, enfin la ruine. (...) Le résultat ? Une hausse des salaires en argent pour les ouvriers des fabriques, en dépit du raccourcissement de la journée de travail, une augmentation importante des bras employés, une chute continue du prix des produits, un développement merveilleux des forces productives de leur travail, une expansion inouïe des marchés pour leurs marchandises."
Effectivement, un tel évènement serait tout simplement impensable à notre époque.
La phase de déclin du capitalisme
La guerre de 1914-1918 marque pour le capitalisme le début d'une nouvelle phase historique. C'est la période de l'inflation constante, de la saturation des marchés, de l'exacerbation des antagonismes impérialistes, du besoin de destructions massives par la guerre et l'économie d'armement. Les contradictions propres au système commencent à éclater violemment, provoquant des secousses de la taille de la crise de 1929 ou des guerres mondiales.
C'est la fin de l'âge d'or du capitalisme et LE DEBUT DE SA DECADENCE.C'EST AUSSI LE DEBUT DE L'ERE DE LA REVOLUTION PROLETARIENNE.
Notre but ici n'est pas d'expliquer les raisons économiques profondes qui ont provoqué ce changement. Pour les besoins de l'analyse des syndicats, nous nous contenterons de relever deux effets de cette décadence :
- l'impossibilité pour la classe dominante de concéder des - réformes réelles au prolétariat;
- l'accroissement et le renforcement du rôle de l'Etat dans la société.
1 - L'impossibilité des réformes.
Aujourd'hui, le capitalisme a étendu sa domination au monde entier. Depuis 1914 les débouchés manquent, les marchés sont saturés. Les forces productives ont subi un violent freinage. Chaque crise qui secoue l'économie l'ébranle plus profondément. Le capital oe peut plus assurer sa survie qu'en suivant le cycle absurde : CRISE - GUERRE - RECONSTRUCTION. ..CRISE...
La bourgeoisie est obligée d'extraire une quantité toujours plus grande de surtravail à la classe ouvrière,
a) pour affronter une concurrence internationale qui s'est exacerbée jusqu'à ses dernières limites ;
b) pour faire face à des dépenses improductives qui se sont accrues en proportion de l'approfondissement des contradictions du système :
- maintien de l'appareil administratif et policier de l'État, devenu monstrueux ;
- dépenses gigantesques de la production militaire, (jusqu'à 50% du budget de l'État dans des pays comme l'URSS ou les USA) ;
- frais de subventions aux entreprises devenues déficitaires de façon chronique ;
- frais absurdes tels ceux entraînés par les surplus agricoles, etc.
- enfin toutes les dépenses d’une gestion devenue d'autant plus coûteuse qu'elle a affaire à une économie contradictoire et absurde : marketing, publicité, et plus généralement l'essentiel du secteur dit "tertiaire".
Tous ces nouveaux frais improductifs, caractéristiques du capitalisme en déclin, ne sont pas un luxe du système, mais la forme même de sa survie.
Dans ce contexte, la bourgeoisie ne peut plus se permettre, même sous la pression des luttes ouvrières, d'accorder satisfaction aux revendications du prolétariat. Malgré les promesses du capital, les signatures apposées au bas d'accords solennels, malgré les illusions humanitaires que pourrait entretenir telle ou telle fraction "réformiste" ou "progressiste" de la bourgeoisie, malgré la crainte de mouvements sociaux importants, la réalité du capitalisme décadent est implacable : le capital ne peut plus accorder de réformes véritables au prolétariat.
Il est devenu banal de constater que depuis cinquante ans, toutes les luttes pour des revendications salariales n'aboutissent à rien. Les augmentations de salaires se traduisent immédiatement par une hausse correspondante -sinon supérieure- du niveau des prix. L'élévation des salaires arrachée en France en juin 1936 (accords de Matignon : 12% en moyenne) était annulée en six mois : rien que de septembre 1936 à janvier 37, les prix montèrent en moyenne de 11%. On sait aussi, par exemple, ce qui resta un an plus tard des augmentations obtenues en juin 68 avec les accords de Grenelle.
Sur le plan des conditions de travail, le phénomène est le même. Alors que dans la période ascendante du capitalisme, le temps de travail diminuait effectivement sous la pression des luttes ouvrières, -de 1850 à 1900 la durée hebdomadaire de travail dans l'industrie est passée de 72 à 64,5 heures en France et de 63 à 55,3 heures aux USA-, dans le capitalisme décadent, celui-ci va connaître une stagnation, sinon un accroissement (sans parler du temps de transport qui augmente de jour en jour). Eo mai- juin 68, la classe ouvrière devait reprendre la revendication qui soi-disant avait été obtenue en 36 : les quarante heures de 36 étaient devenues 44,3 en 1949, 45,7 en 1962!
La période de reconstruction qui s'ouvre en 45 après les misères de la crise et de la guerre, a pu faire croire cependant qu'un aménagement des conditions de travail et de vie était encore possible : la relative prospérité que connaissait le capital était parvenue à résorber en partie le chômage, offrant une certaine sécurité de l'emploi. Partout, les défenseurs du réformisme faisaient miroiter la "spectaculaire augmentation du niveau de vie" dans les pays industriels. Quelle réalité recouvre donc cette "amélioration" qui a même amené certains à dire que le prolétariat avait disparu, dilué par une prétendue "société de consommation"?
- une exploitation accrue:
Ce qui détermine les conditions de vie des travailleurs, c'est en priorité le temps de travail (plus-value absolue) et son degré d'intensification (plus-value relative).
Dans le domaine du temps de travail, aucune concession significative n'a été accordée (et cela suffit amplement pour dénoncer les défenseurs du réformisme comme les plus abjects adulateurs du capital). Si l'on ajoute à la journée de travail -qui n'a pas été diminuée- les heures supplémentaires et celles que l'ouvrier passe eu transport, quel temps lui reste-t-il pour profiter des fameuses jouissances de la "société de consommation"?
"Dans le domaine strictement économique, la situation de la classe ouvrière ne fut jamais pire. Dans de nombreux pays, le refus de faire des heures supplémentaires est cause immédiate de renvoi et partout l'introduction du ’ soi-disant salaire de base, délibérément mesquin, des primes et bonifications à la productivité, etc., forcent le travailleur à accepter de "son plein gré" des journées de 10 à 12 heures...
Dans l'aspect le plus profond de l'exploitation, celui de la productivité par tête et par heure, le prolétariat se voit acculé à une situation terrifiante. La production qu'on lui soutire chaque jour s'accroît prodigieusement. D'abord les innovations techniques, qui retirent à l'ouvrier toute intervention créatrice dans son travail, mesurent tous ses mouvements à la seconde et le transforment en un "mécanisme de servitude" vivant, assujetti à la même cadence que les mécanismes métalliques. Ensuite, le chronométrage, traquenard atroce et répugnant, force les hommes à travailler chaque fois d'avantage avec le même outillage et dans la même unité de temps. En troisième lieu, la discipline de chaque établissement rogne sur la plus petite suspension de travail, même pour allumer une cigarette ou pour déféquer. La production qu'on arrache par ces moyens à chaque homme est énorme, comme dans la même proportion son épuisement physique et psychique." (MUNIS "Les syndicats contre la révolution")
Les cadences infernales, l'exploitation scientifique grâce aux chronométreurs et autres psychologues, voilà le tribut que paye le travailleur au capitalisme décadent.
Quelle formidable amélioration peut "compenser" cela?
- l'augmentation du pouvoir d'achat.
Cette augmentation tant vantée par les réformistes consiste en gros dans l'acquisition de la télévision, de la voiture, du "confort" (appareils électroménagers). Mais il ne s'agit que du minimum que doit accorder le capital pour faire passer une exploitation intensifiée. Le meilleur exemple en est la télévision, qui en plus d'être le plus triste moyen de faire oublier au travailleur son épuisement pendant les trois ou quatre heures qui lui restent après sa journée de travail, constitue un instrument idéologique dont la réputation n'est plus à faire. Si les ouvriers refusaient de posséder la télévision du fait de son prix, le capital les rendrait gratuites.
Ce "minimum social" est la contrepartie indispensable pour que le prolétariat accepte ses conditions de vie, autant que sont nécessaires les congés payés pour récupérer une année de labeur inhumain. Tout ce que l'on veut peindre comme un super luxe dépassant de loin le minimum vital, n'est en fait que le strict minimum de l'époque moderne.
Pour faire accepter au travailleur une exploitation poussée jusqu'aux limites de l’épuisement, le capital disposait donc de deux armes, pendant toute la période où il a reconstruit sur ses ruines le mythe de la société de consommation et la sécurité de l'emploi.
Avec la crise qui se fait à nouveau cruellement sentir, ces deux remparts s'effondrent. Le spectre du chômage va de nouveau hanter les rues, et la voiture deviendra rapidement un luxe inabordable. Implacablement, le capital sera contraint d'intensifier encore son exploitation, sans que le prolétariat ait la moindre illusion de compensation. L'illusion syndicale apparaît dans toute sot\ abjection,
2 - L'accroissement et l'intensification du rôle de l'État dans la société.
Les crises et les guerres mondiales ont montré les difficultés croissantes auxquelles doit faire face le système pour survivre :
Développement des conflits entre capitalistes d'une même nation, des conflits entre différentes fractions du capital mondial, des conflits entre classes antagonistes, et de façon générale, exacerbation du conflit global entre le développement des forces productives et le cadre social devenu trop étroit. Le développement et le renforcement de l'État sont ceux de ces conflits.
De par ses propres mécanismes, la société capitaliste tend à se désagréger de toutes parts. La force totalitaire de son État intervenant à tous les niveaux, contrôlant tout, devient dès Lors un facteur essentiel pour le maintien du vieil édifice capitaliste.
Si, dans la prospérité du XIXème, le règne du "libre échange" et du non interventionnisme économique était possible, aujourd'hui le capital a besoin d'un État renforcé, coordinateur et contrôleur direct de toutes les forces productives. Il n’est pas de décision importante en ce qui concerne la production qui ne passe par l'État : les échanges internationaux et nationaux, les finances, les orientations générales des investissements, etc.… l'État doit tout centraliser, tout planifier, tout contrôler : il devient en fait partie intégrante et essentielle de la production.
Moins que tout autre aspect de la production, le rapport salarié, le rapport capital-travail, ne peut être laissé à l'initiative privée. Il est le cœur de la production, la base essentielle sur laquelle repose tout l'édifice. C'est aussi de ce cœur que surgit la mise en question du système, que se développent les forces de son futur fossoyeur. C'est pourquoi, il est essentiel à la survie du système, que l'État multiplie les organisations chargées de planifier scientifiquement la vente et l'utilisation de la force de travail, les organes d'encadrement de la classe ouvrière, les mesures destinées à donner des illusions de conciliation (salaire minimum, conventions collectives, etc.…) et renforce son appareil de répression.
L'impossibilité pour la classe dominante d'accorder des concessions au prolétariat s'est accompagnée en toute logique, du développement de son appareil d'oppression et d'encadrement de la classe exploitée.
Les syndicats dans la période de déclin du capitalisme
Impossibilité de véritables aménagements de l'exploitation et nécessité du développement du totalitarisme étatique, ces deux caractéristiques du capitalisme décadent ont ôté aux syndicats leur fonction initiale et donné à leur existence un sens nouveau, anti-ouvrier.
Ce qui constituait le rôle des syndicats au XIXème siècle, assurer constamment la défense des travailleurs au sein du système, négocier en permanence avec le capital les améliorations pour la classe ouvrière, est devenu dans le capitalisme en déclin une tâche impossible.
Or, un organe dont la fonction originale disparaît est condamné soit à disparaître lui- même, soit à acquérir une fonction nouvelle.
Avec l'impossibilité de négociation véritable pour le prolétariat, disparaît la possibilité d'existence d'une organisation ouvrière de négociation permanente. La seule solution qui reste à la classe ouvrière, c'est l'affrontement violent. Aujourd'hui, une organisation qui ne se propose pas l'alternative révolutionnaire ne peut être authentiquement ouvrière.
Incapables de dépasser le cadre du capitalisme, les syndicats sont inévitablement séparés de la lutte prolétarienne. Forcés par la nature même de leur fonction au "réalisme", c'est-à-dire à la réalité du capitalisme décadent, -impossibilité d'aménagements significatifs- ils ne peuvent "négocier" que les miettes destinées à cacher l'intensification de l'exploitation. Ils deviennent ainsi la courroie de transmission indispensable à l'État pour assurer sa domination sur le monde ouvrier.
Les syndicats sont devenus l'État présent à l'usine. C'est ainsi qu'ils ont aidé la classe dominante à entraîner les travailleurs dans toutes les boucheries de la guerre impérialiste. Ils ont freiné -sinon réprimé- tous les mouvements prolétariens importants des dernières années; chaque jour ils dévoilent un peu plus leur nature d'instruments de l'État capitaliste.
Les syndicats ont-ils une double fonction ?
On a souvent dit —en particulier en Mai 1968, lorsqu'on voyait les syndicats "trahir" le mouvement — qu'ils avaient - une double fonction à l'époque actuelle : -en temps "calme", lorsqu'il n'y a pas de luttes importantes, les syndicats défendraient la classe ouvrière face au patronat; en temps d'effervescence sociale, ils défendraient le patronat contre la classe ouvrière. Les syndicats seraient "contre la révolution" mais non "contre la classe ouvrière". Ce raisonnement n'est qu'une façon biaisée de rejustifier les syndicats tout en ayant l'air de les rejeter. C'est un argument d'autant plus contre-révolutionnaire qu'il cherche à se draper de radicalisme révolutionnaire. C'était par exemple la position du groupe Pouvoir Ouvrier qui spécifiait dans sa plateforme politique : "A l'étape présente, dans la plupart des pays capitalistes, les syndicats exercent objectivement une double fonction :
- défendre contre le patronat les intérêts immédiats des salariés,
- défendre la société capitaliste, dont ils acceptent les bases, contre tout mouvement des travailleurs qui pourrait la mettre en difficulté". (P.0. N°90, Mai 1968).
Cette pensée ne dépasse pas la profondeur de celle selon laquelle le corps des CRS défend les intérêts du travailleur lorsqu'il le sauve de la noyade sur la plage et qu’il ne les défend plus lorsqu'il le matraque lors d'une grève, servant alors le patronat.
Premièrement, rien n'est plus absurde que de prétendre que dans une société divisée en classes antagonistes et dont les intérêts sont chaque jour plus opposés, une organisation qui est aussi imbriquée dans la lutte de classes que les syndicats, puisse passer du service d'une des classes à celui de l'autre, puis de nouveau servir la première, etc. selon les circonstances et de plus sans subir la moindre transformation ni dans ses structures, ni dans sa direction.
Deuxièmement, on ne détermine pas la nature de classe d'une organisation par son attitude aux moments de "calme social", lorsque le prolétariat passif reste soumis au pouvoir de la bourgeoisie autant sur le plan économique qu'idéologique. Si l'on veut déterminer la nature de classe d'une organisation, c'est au moment où les classes s'affrontent ouvertement qu'il faut le faire. Alors les masques commencent à tomber car les contradictions de classe apparaissent clairement.
Si l'on veut avoir une idée réelle du rôle social des CRS dans la lutte des classes, on ne fonde pas le jugement sur leur -fonction au bord des plages en été, ou sur les routes, mais bien sur celle qu'ils ont lorsque la lutte des classes éclate au grand jour.
La fonction des syndicats est CLAIRE lorsqu'on les voit, aux moments comme Mai-Juin 1968, empêcher les contacts entre ouvriers de différentes usines, falsifier les revendications des travailleurs, utiliser le mensonge et la calomnie pour faire reprendre le travail, en un mot, lorsqu'ils jouent le rôle de force de répression contre les luttes des travailleurs.
Cependant, on sait que les syndicats sont OFFICIELLEMENT les "organisations représentatives de la classe ouvrière", que c'est eux qui sont chargés de défendre les intérêts des travailleurs aux Comités d'Entreprises, ainsi que dans les organisations économiques gouvernementales. On sait aussi que, par temps calme, ils organisent d.es "journées d'action" et que lorsque la base bouge, ils organisent des grèves (même si elles ne sont que de vingt-quatre heures). De même, il est vrai que dans certains pays, ou dans certaines usines en France, il vaut mieux être syndiqué pour assurer son emploi ou obtenir certains avantages.
Mais faut-il en déduire alors que les syndicats sont au service de la classe ouvrière ?
Non. Cette "seconde fonction" des syndicats n'est en fait qu'un aspect de la première.
D'une part, si aux occasions comme Mai-Juin 1968, les syndicats peuvent agir comme ils l’ont fait sans provoquer immédiatement une révolte généralisée des ouvriers contre eux, c'est entre autre parce qu'ils ont, pendant "la période tranquille" entretenu soigneusement le mythe du syndicat, représentant unique et légitime des travailleurs; et ceci avec l'aide de tous les gouvernements. Les petites grèves, les revendications pour des vestiaires plus propres, ou pour des primes de bleu de travail, les "journées d'action" etc. sont le moyen pour donner "l'autorité" aux syndicats d'ordonner la reprise du travail le jour des véritables luttes.
De même que les CRS doivent sauver des noyés ou maintenir l'ordre sur les routes pour justifier leur existence et agir les jours de répression au nom de l'intérêt de "tous", de même les syndicats doivent remplir ces tâches de "petites revendications" pour pouvoir assurer les jours de lutte leur fonction d'encadrement et de répression "au nom de la classe ouvrière". En ce sens, déjà, ce ne sont donc pas là deux fonctions de nature différente, ce sont deux moments d'une même fonction.
D'autre part, ces tâches dont sont chargés les syndicats, correspondent à des besoins précis du capitalisme décadent. En effet, considérons le cas des pays où les syndicats sont partie intégrante de l'État, au même titre que le Ministère de l'Éducation ou les forces de police. C'est ce qui se produit dans les pays fascistes (Espagne par exemple) ou dans les pays de capitalisme d'État, prétendus "socialistes" (URSS, Chine, Pays de l'Est, etc.). St dans ces pays -où même la grève est interdite dans les faits- il existe des syndicats, c'est parce qu'ils correspondent à un besoin réel de l'État capitaliste. En effet, ils remplissent une fonction devenue vitale pour le capitalisme décadent : l'encadrement de la classe ouvrière.
Il faut à l'État un encadrement efficace de la classe ouvrière :
1) Pour pouvoir manier la principale force productive (la force de travail) selon les besoins du capital national (planification et participation);
2) Pour permettre le jeu des lois économiques capitalistes au niveau du marché de la force de travail et éviter même des abus de capitalistes privés ou de gérants locaux qui risqueraient de provoquer des baisses de productivité ou des épuisements néfastes pour l'économie nationale;
3) Enfin, pour encadrer et briser toute tentative de réelle lutte ouvrière.
- "Le X° Congrès des syndicats soviétiques (1949) a défini les buts du syndicat dans l'ordre suivant :
l- Organiser l'émulation socialiste pour assurer l'exécution et le dépassement des plans de production, l'accroissement de la productivité, LA REDUCTION DES PRIX DE REVIENT (!);
(...) 5- Veiller au respect de la législation du travail et de la sécurité (...)".
En Chine : "... le Comité Exécutif de la CGT réuni le 10 Juillet 1953 prescrit à "tous les échelons syndicaux de considérer le renforcement de la discipline du travail comme leur devoir primordial et permanent". Si les résultats de cette campagne sont insuffisants, il faudra "punir d'une manière appropriée les éléments récalcitrants qui commettent constamment des infractions graves contre la discipline du travail". ("Le syndicalisme dans le monde" Georges Lefranc. Que-Sais-Je ? pg 102-107).
Personne ne s'aviserait de dire que les syndicats fascistes espagnols sont des organes de la classe ouvrière ou que les syndicats russes défendent les travailleurs contre leur patron, l'État; les syndicats n'étant qu'un outil de celui-ci.
Lorsque les syndicats des pays occidentaux participent aux organismes économiques gouvernementaux (en France, le Conseil du Plan, le Conseil Économique et Social, etc.), lorsqu'ils font partie des comités d'entreprises, lorsqu'ils concluent des conventions collectives, lorsqu'ils participent à la gestion d'entreprises nationalisées, quand ils constituent cet "interlocuteur valable" dont a besoin l'État, lorsque ces syndicats dénoncent quelques abus trop criants commis par un patron ou un gérant, ou bien lorsqu’ils brisent systématiquement tout mouvement de grève : ils ne font que remplir les mêmes tâches que les syndicats russes ou fascistes. Ce ne sont pas là des fonctions au service de la classe ouvrière. Ce sont au contraire des fonctions correspondant aux besoins du capitalisme décadent. C'est pourquoi, aussi bien dans les régimes totalitaires que dans les régimes libéraux, les gouvernements subventionnent ou créent des syndicats pour "représenter la classe ouvrière".
Ce qui différencie les syndicats des régimes "démocratiques" de ceux des autres pays, c'est le fait que leur intégration est faite au travers de partis politiques.
La fonction que la bourgeoisie reconnait à ses "partis de gauche", c'est le contrôle de la classe ouvrière. Le syndicat est l'outil indispensable dont ceux-ci ont besoin pour assurer leur implantation en milieu ouvrier. Face au danger de la montée des luttes prolétariennes, la bourgeoisie peut avoir recours à ces partis, en les appelant au gouvernement : l'intégration des syndicats à l'État est alors directe. Mais lorsque le parti ou le courant politique qui domine le syndicat est en opposition au gouvernement en place, il peut donner aux luttes ouvrières dont il se sert, un caractère plus "dur".
Un syndicat peut même provoquer des mouvements importants pour des raisons strictement politiques lui convenant : ce fut par exemple le cas des grèves lancées par la CGT en 1947 après l'exclusion du Parti Communiste du gouvernement et des manifestations organisées par la CGT et le PC en 1953 lors de la venue du Général Ridgeway à Paris. Fréquentes dans les années de contre-révolution triomphante, ces mobilisations artificielles, où les syndicats promènent les travailleurs en cortèges dociles et obéissants se font de plus en plus rares. Dans l'actuelle reprise de la lutte de classe, les syndicats réfléchissent à deux fois avant de se lancer dans n'importe quelle mobilisation, sachant qu'à chaque reprise ils seront de moins en moins capables de garder le contrôle de ce que la presse appelle "leurs troupes".
Par ailleurs, les courants dominants des syndicats sont généralement partisans des régimes du capitalisme d'État. Ils préconisent par conséquent les nationalisations.
Cela explique la crainte de certaines grandes entreprises privées à l'égard des syndicats. Mais dès que la lutte ouvrière secoue leur entreprise, ils se jettent dans les bras du syndicalisme. Voit par exemple Agnelli. Le rattachement à des partis préconisant le capitalisme d'État peut ainsi donner aux syndicats une apparence de combativité anti capitaliste mais en fait il suffit de connaître leur attitude lorsque LEUR parti est au pouvoir (PCF en France après la deuxième guerre, Labour Party en Angleterre actuellement), ou d'assister aux manipulations politiques auxquelles ils se livrent au sein des lieux de travail dans leur course aux adhérents, pour comprendre qu'il ne s'agit pas là de défendre des intérêts ouvriers mais ceux de leur organisation politique. Le délégué syndical -aussi dévoué soit-il- est vite entraîné à devenir consciemment ou inconsciemment, non plus le représentant des intérêts des travailleurs mais un instrument de sa centrale.
Au Congrès de 1946, la majorité communiste de la CGT fit voter un texte déclarant : "La CGT appelle les travailleurs à soutenir un effort de travail nécessaire pour atteindre une production maximum. Un salaire plus élevé doit être atteint comme fruit de ces efforts et de ce travail" ("Le Syndicalisme en France". G. Lefranc. Que-Sais-Je ? p.100).
Il n'y a donc pas "une double nature" des syndicats se traduisant par des fonctions ouvrières et des fonctions capitalistes alternativement. Il s'agit seulement de deux aspects d'une même et unique fonction capitaliste : encadrer la classe ouvrière au sein et au service du système.
La bureaucratisation des syndicats et les illusions sur leur "reconquête"
Lorsqu'on n'a pas compris la nature de classe des syndicats dans la décadence capitaliste, il est normal qu'on entretienne les plus absurdes illusions sur d'éventuelles "reconquêtes" et autres "débureaucratisations".
Au lieu de saisir la bureaucratie et les "mauvais" chefs syndicaux comme des produits inévitables de la nature capitaliste des syndicats, on voudrait les présenter comme des causes des "erreurs" et des "trahisons" syndicales.
La bureaucratisation d'une organisation n'est pas le renforcement du pouvoir de décision de ses organes centraux. Contrairement à ce que pensent les anarchistes, centralisation n'est pas synonyme de bureaucratisation. Au contraire. Dans une organisation traversée par l'activité consciente et passionnée de chacun de ses membres, la centralisation est le moyen le plus efficace pour stimuler la participation de chaque membre à la vie de l'organisation. Ce qui caractérise le phénomène de bureaucratisation, c'est le fait que la vie de l'organisation ne vient plus de l'ensemble de ses membres, mais qu'elle est artificiellement, formellement réduite à celle de ses "bureaux", de ses organes centraux.
Si un tel phénomène s'est généralisé à tous les syndicats dans la décadence capitaliste, ce n'est pas du fait de la "malveillance" des responsables syndicaux, ni d'un phénomène inexplicable de "bureaucratisation" sur lequel aucun homme n'aurait de prise.
Si la bureaucratie s'est emparée des syndicats, c'est parce que les travailleurs ne peuvent plus apporter ni vie, ni passion à un organe qui n'est plus le leur.
L'indifférence des ouvriers à l'égard de la vie syndicale n'est pas, comme le pensent les gauchistes, une preuve d'inconscience des travailleurs. Elle manifeste au contraire un sentiment plus ou moins clair dans le prolétariat de la nature capitaliste des syndicats.
Les rapports entre les travailleurs et leur syndicat ne sont pas des rapports d'une classe avec son instrument. Ils prennent la plupart du temps la forme des rapports entre des individus, avec des problèmes individuels, et une assistante sociale ("qui est bien avec le patron"). La propagande syndicale se résume d'ailleurs la plupart du temps à l'argument : nous, nous avons obtenu tel ou tel avantage du patron. Faites-nous confiance, etc.
Il y a bureaucratie parce qu'il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de vie ouvrière dans le syndicat. Celui-ci est un appareil extérieur à la classe qui ne rentre en contact réel avec elle comme classe, que pour l'encadrer et freiner ses luttes.
C'est parce que les syndicats ne sont plus des organisations ouvrières qu'ils ne peuvent avoir que des rapports bureaucratiques avec leurs membres ouvriers. Empêcher cette bureaucratisation est aussi impossible que d'empêcher la décadence du capitalisme.
Il en va de même pour les illusions sur les changements de chefs syndicaux. Le problème des syndicats n'est pas une affaire de bons ou de mauvais chefs. Ce n'est pas un hasard si, depuis plus de cinquante ans, les syndicats ont toujours eu de "mauvais dirigeants".
Ce n'est pas parce que les chefs sont mauvais que les syndicats ne se prêtent pas aux véritables luttes de la classe ouvrière. C'est au contraire parce que les syndicats comme organisations ne peuvent plus servir à la lutte prolétarienne que leurs chefs sont inévitablement "mauvais".
- Comme le faisait remarquer Pannekoek :
"Ce que Marx et Lénine ont dit et redit de l'État, à savoir que son mode de fonctionnement malgré l'existence d'une démocratie formelle, ne permet pas de l'utiliser comme instrument de la révolution prolétarienne, s’applique donc, aux syndicats. Leur puissance contre-révolutionnaire ne sera pas anéantie, pas même entamée, par un changement de dirigeants, le remplacement des chefs réactionnaires par Ses hommes de "gauche" ou des "révolutionnaires". C'est bel et bien la forme d'organisation elle-même qui réduit les masses à l'impuissance ou tout comme et qui leur interdit d'en faire les instruments de leur volonté".
L'idée chère aux "trotskistes" et "léninistes" de partir à la "reconquête" des syndicats est une utopie d'autant plus réactionnaire qu'elle est le prétexte pour la défense des syndicats.
Le syndicalisme révolutionnaire
En réaction à la dégénérescence des syndicats et des partis socialistes dès la fin du siècle dernier, a surgi l'idée de syndicats se donnant des buts révolutionnaires.
Mais un syndicat est une organisation 1) de masse, 2) permanente, 3) dont la tâche spécifique n'est pas la destruction de la société d'exploitation, mais l'aménagement de la place des travailleurs en son sein.
En se donnant un but qui n'est pas celui du syndicat tout en s'enfermant dans la logique syndicale, le syndicalisme révolutionnaire ne peut être qu'une source de confusion et de contradictions.
Comment donner un but révolutionnaire à une organisation de masse en dehors des périodes révolutionnaires ?
Pour construire une telle organisation, il faut des masses révolutionnaires. Or celles-ci n'existent -par définition- qu'en période d'insurrection. Dans une époque non révolutionnaire, le "syndicalisme révolutionnaire" ne peut donc qu'aboutir à deux réalités :
Ou bien le syndicat fait adhérer les travailleurs sans conviction révolutionnaire en considérant que la seule volonté des chefs suffit à faire de l'organisation un corps révolutionnaire, et alors il ne fait que se tromper et tromper ses adhérents.
Ou bien, il n'accepte en son sein que des travailleurs possédant de fermes convictions révolutionnaires et il se transforme alors en petit groupe politique n'ayant plus de syndicat que le nom.
Il ne reste donc à concevoir qu'un "syndicat révolutionnaire" ne pouvant qu'exister en période révolutionnaire. Mais, premièrement un syndicat qui n'existe pas de façon permanente n'est plus un syndicat, et deuxièmement, toutes les luttes révolutionnaires l'ont montré; la forme d'organisation que se donne la classe pour sa lutte révolutionnaire, celle qui s'adapte le mieux à ses besoins, ce n'est pas le syndicat, mais les conseils ouvriers.
À l'époque où le syndicalisme correspondait encore à une nécessité et à une possibilité pour le mouvement ouvrier, le syndicalisme révolutionnaire ne parvint jamais à remplir vraiment aucune des fonctions qu'il se donnait.
- "Le syndicalisme révolutionnaire présuppose chez l'ouvrier une mentalité révolutionnaire qui ne peut être que le résultat final d'une longue pratique. Les syndicats demeurent de petits groupes d'ouvriers aux sentiments révolutionnaires dont l'ardeur ne saurait remédier à la faiblesse de l'organisation. (...)
Voulant assurer une autre fonction que la sienne, le syndicat se trouve dans l'incapacité de remplir sa fonction propre, l'amélioration des conditions de travail. Ce qui lui incombe, organiser les masses, il ne le fait pas, et ce qu’il entreprend, l'éducation révolutionnaire, il le fait de travers." (Pannekoek, dans "Pannekoek et les Conseils Ouvriers", EDI, p.83).
À l'époque de la décadence du capitalisme, la logique syndicale dont il ne pouvait se débarrasser l'entraine tôt ou tard à perdre tout caractère prolétarien.
Ainsi, le syndicalisme révolutionnaire français , relativement fort avant la première Guerre Mondiale resta-t-il rapidement au niveau de simples vœux pieux : les centrales syndicales révolutionnaires (la CGT à l'époque) dégénérèrent comme les autres et comme elles participèrent à la guerre impérialiste à côté de leur bourgeoisie, les tendances qui s'opposèrent à la guerre étant demeurées quelques minorités insignifiantes vites oubliées.
Quant à la CNT espagnole, elle fut amenée à jouer pendant la guerre d'Espagne le rôle d’un parti politique de masse. Et, tout en se défendant de "faire de la politique'', elle dut cependant comme telle conclure le "Front Populaire" avec les staliniens et la bourgeoisie républicaine puis participer au gouvernement même de la république. Tenter de faire revivre la forme d'organisation syndicale alors qu'elle ne correspond plus aux besoins de la lutte mène à lui conférer obligatoirement des tâches anti-ouvrières[2].
L'apport principal du syndicalisme révolutionnaire au mouvement ouvrier, c'est d’avoir prouvé, avec toute sa "bonne volonté", le caractère néfaste de toute forme de syndicalisme, aussi radical se veuille-t-il, dans le capitalisme décadent.
Au cours de plus d’un demi-siècle de décadence capitaliste, le prolétariat a du cruellement constater :
1) L'impossibilité définitive d'obtenir des améliorations réelles des conditions de son exploitation.
2) L'impossibilité de se servir pour ses luttes de la forme d'organisation syndicale (organisations de masse, existant en permanence, c'est-à-dire survivant en dehors des périodes de lutte et se donnant pour but l'aménagement de l'exploitation.).
3) L'inévitable intégration de toute organisation de type syndical aux rouages de l'État capitaliste.
Les luttes ouvrières n'ont pas cessé pour autant. Au travers de grèves sauvages, d'insurrections sporadiques, son combat s'est poursuivi. Quel est donc le contenu de ces luttes ? Quelles en sont les formes d'organisation ?
Le contenu des luttes ouvrières dans le capitalisme décadent
Devant le constat du rôle ouvertement anti-ouvrier des syndicats, les grèves sauvages, anti-syndicales se sont multipliées dans tous les pays. Elles expriment dans la pratique l'antagonisme prolétariat-syndicats et traduisent une conscience de plus en plus claire de la nature capitaliste de ces organes. Mais quel est leur contenu ?
Le fait que le capitalisme ne soit plus en mesure d'accorder des aménagements véritables de l'exploitation du travail, a réduit les luttes prolétariennes à un combat de résistance contre l'attaque permanente du capital sur les conditions d'existence des travailleurs.
Nous avons montré, avec les exemples de 1936 et 1968 en France, comment le capital est contraint de reprendre immédiatement n'importe quelle amélioration que les luttes généralisées aient pu lut arracher. Mais 1936 et 1968, où l'on voit des augmentations de salaires être rattrapées postérieurement par des hausses de prix sont des exceptions correspondant à des luttes d'une particulièrement grande ampleur. La situation normale, celle qui caractérise le capitalisme actuel, ce n’est pas les hausses de prix courant derrière les hausses de salaires, mais l'inverse. Ce n'est pas le capital qui essaie de récupérer en permanence ce que les travailleurs lui arrachent, mais les travailleurs qui, par leurs luttes, tentent de résister à l'intensification de leur exploitation.
Mais ce qui caractérise le contenu des luttes ouvrières dans le capitalisme décadent, ce n'est pas le fait qu'elles soient des luttes de résistance en soi (ceci est commun à toutes les luttes prolétariennes depuis que les ouvriers affrontent leurs exploiteurs), mais :
- le fait qu'elles ne puissent plus être que des luttes de résistance (sans espoir de nouvelles conquêtes comme au XIX° Siècle).
- le fait qu'elles tendent à mettre immédiatement en question les conditions mêmes d'existence du système d'exploitation à devenir ouvertement révolutionnaires.
La résistance ouvrière dans le capitalisme décadent ne peut plus échapper à l'alternative suivante :
- soit accepter l'enfermement dans le terrain purement économique et elle doit alors se conformer aux impératifs de l'économie capitaliste en permanente difficulté : c'est le "réalisme" bien connu des syndicats qui transforment les luttes en tristes farces où les défilés carnavalesques, avec chansonnettes et chapeaux de papier, sur la tête, cachent mal qu'on a, en fait, accepté d'abandonner tout combat.
- soit elle s'affirme, conséquente, décidée, REELLE, et dès lors, elle mène inévitablement à l'affrontement avec la légalité bourgeoise et en premier lieu avec ses représentants au sein de l'usine : les syndicats.
Il n’y a plus de terrain de conciliation possible entre le capital et la force de travail. L'antagonisme originel est, dans la décadence capitaliste, constamment poussé à ses dernières limites. C'est pourquoi toute lutte ouvrière véritable se pose inévitablement et de façon immédiate en lutte politique et REVOLUTIONNAIRE.
Deux remarques à ce propos : Premièrement, le contenu révolutionnaire de ces combats n'est pas donné par le fait que las ouvriers se réclament de la "révolution communiste mondiale", ni par la conscience immédiate qu'ils peuvent avoir de la nature réelle de leur action. Ce contenu est un fait objectif imposé par les conditions historiques de la lutte générale. Comme disait Rosa . Luxembourg :
- "L'inconscient précède le conscient et la logique objective du processus historique précède la logique subjective de ses protagonistes".
Deuxièmement, ce contenu révolutionnaire éclate avec plus ou moins d'ampleur, suivant que :
- la lutte répond à une situation de crise plus ou moins approfondie,
- les conditions politiques auxquelles les travailleurs s'affrontent contiennent plus ou moins "d'amortisseurs sociaux" (syndicats, partis "ouvriers", libéralisme politique, etc.).Dans les pays où ces "amortisseurs" font défaut ou sont trop rigides pour remplir ce rôle (pays de l'Est, États fascistes par exemple) les luttes ouvrières tout en étant moins fréquentes, prennent beaucoup plus rapidement une tournure ouvertement révolutionnaire.
Mais quelles que soient les circonstances précises, qu’elle soit l'intensité des combats, la résistance ouvrière à notre époque ne peut plus s'affirmer sans acquérir immédiatement une substance révolutionnaire.
C'est cette nouvelle caractéristique de la lutte ouvrière qui a amené les révolutionnaires dès la première Guerre Mondiale, à proclamer désuète la vieille distinction social-démocrate entre "programme minimum" défini par un ensemble de réformes à obtenir au sein du capitalisme et le "programme maximum" (la révolution communiste). Désormais, seul le "programme maximum" pouvait exprimer les intérêts de la classe ouvrière.
Lorsque le réformisme est devenu une pure utopie contre-révolutionnaire, seul ce qui est révolutionnaire est ouvrier SEUL CE QUI CONDUIT VERS LA REVOLUTION PEUT ETRE AUTHENTIQUEMENT PROLETARIEN. Tout le reste n'est qu'idéalisme réactionnaire et supercherie capitaliste.
Il est devenu à la mode, surtout au cours des derniers mouvements étudiants des années 1967-69 d'interpréter cette position apparue dans le mouvement ouvrier dès les premières années de ce siècle en affirmant que les luttes "revendicatives", "salariales", étaient devenues une négation de la lutte véritablement révolutionnaire (la revue "Invariance" s'est fait un des plus ardents défenseurs de cette pensée). Ce faisant, loin de "radicaliser" la théorie révolutionnaire, on ne fait que la vider de son support matériel réel, c'est-à-dire, on la relègue au monde des utopies idéalistes?]
Les formes d’organisation
Avec la perte des syndicats, il se pose à la classe ouvrière le problème de se doter d'une NOUVELLE forme d'organisation. Mais ce n'est pas chose simple dans le capitalisme décadent.
La grande force des syndicats vient de leur capacité à se faire reconnaître comme le seul cadre possible pour la lutte. Ainsi, patronat et gouvernement n'acceptent pas d'autre "interlocuteur" que les syndicats. Tous les jours, inlassablement, par voie de tracts, presse, radio et télévision, etc. le capital répète systématiquement au prolétaire : "votre organisation, ce sont les centrales syndicales". Tout est mis en œuvre pour renforcer cette capacité mystificatrice des appareils syndicaux.
L'opération n'a pas toujours le succès escompté : dans un pays où le matraquage sur la représentativité des syndicats est aussi violent qu'en France, il n'y a pas plus d'un ouvrier sur cinq qui ressente le besoin de se syndiquer. Il faut par contre de plus en plus souvent la collaboration des organisations "gauchistes" pour maintenir auprès des travailleurs les plus combatifs la crédibilité de ces appareils du capital. À cet égard le récent changement d'attitude des grandes centrales françaises vis-à-vis des gauchistes, n'est rien d'autre que la reconnaissance des bons et loyaux services que ces derniers leur rendent quotidiennement comme "rabatteurs de moutons égarés", avec leur "appui critique".
Soumis sans relâche à pareille opération mystificatrice, les travailleurs des pays à forte "liberté syndicale" ont le plus grand mal à envisager la possibilité d'organiser leurs luttes en dehors des appareils traditionnels. Il faut une situation particulièrement insupportable pour qu'ils trouvent la force de s'opposer, ouvertement, à l'immense machine de l'État avec ses partis et ses syndicats. Car c'est bien cela qui caractérise et rend si difficile .la lutte du prolétariat dans le capitalisme décadent : en s'opposant aux syndicats, la classe ouvrière ne se heurte pas seulement à une poignée de bureaucrates syndicaux; c'est l’État capitaliste lui-même qu'elle affronte. Mais le fait même de cette difficulté rend plus significatif tout surgissement de la classe en dehors des syndicats. Il donne toute son importance à la question des formes d'organisation extra-syndicalistes.
Le problème des FORMES d'organisation de la lutte ouvrière n'est pas un problème indépendant ou séparé de celui du contenu de cette lutte. Il y a une interrelation étroite entre le contenu révolutionnaire que tendent à prendre immédiatement les luttes prolétariennes dans la décadence capitaliste, et les formes d'organisation que la classe se donne.
Au cours de ses plus grandes luttes révolutionnaires de ce siècle, le prolétariat abandonnant les syndicats s’est donné une nouvelle forme d'organisation adaptée à sa tâche historique : les Soviets ou Conseils Ouvriers. Il s'agit d'assemblées de délégués, mandatés par les assemblées générales de travailleurs dans les usines et dans les quartiers ouvriers. Ces organes permettent une véritable unification de la classe en créant le lieu où elle forge, au feu.de la lutte, les forces matérielles et théoriques de son attaque contre l'État, Mais par leur forme même, ils ont une particularité majeure. Du fait qu'ils sont des assemblées de délégués élus par des assemblées générales quasi permanentes, leur existence est entièrement dépendante de l'existence d'assemblées générales dans les usines et les quartiers ouvriers. Si la classe n'est pas en lutte dans l'ensemble des usines, s'il n'y a pas d'assemblées générales des travailleurs dans tous les lieux où ils combattent, les Conseils ne peuvent pas exister. Les Conseils sont un organe de lutte et ils ne peuvent vivre que pour et pendant cette lutte. Ils ne peuvent devenir des organes permanents que lorsque l'action révolutionnaire de la classe devient permanente, c'est-à- dire lorsque le prolétariat entre dans la phase insurrectionnelle de la lutte. Le combat insurrectionnel généralisé est toujours l'aboutissement d’une série de luttes plus ou moins parcellaires qui l’annoncent et le préparent. Son contenu révolutionnaire n'est pas distinct de celui des luttes antérieures. Il n'est que l’épanouissement logique du contenu de toutes les grèves qui l'ont précédé.
Ce lien qui existe dans le capitalisme décadent entre le contenu des grèves parcellaires et la lutte insurrectionnelle généralisée, se retrouve au niveau des formes d’organisation. L'expérience des grèves anti-syndicales de ce siècle montre que la forme d'organisation que se donne la classe dans ces luttes est une forme embryonnaire des Conseils ouvriers. En effet dans les grèves sauvages, les travailleurs opposent au comité de grève syndical, un comité de grève -ou comité d'usine- formé de délégués élus par l'assemblée générale des grévistes et responsable uniquement devant elle. L'assemblée générale des grévistes est ainsi le véritable cœur et cerveau de la lutte.
À première vue, la différence entre un comité de grève syndical et un comité de grève sauvage peut sembler formellement bien faible. Les grèves syndicales se donnent souvent des délégués élus par les assemblées générales. Et par ailleurs, un comité de grève élu, même en se déclarant anti-syndicaliste, peut se transformer en un simple organe syndical du moment qu’il accepte d'enfermer la lutte dans un cadre purement localiste et économique. Un comité de grève qui n'agit pas en vue de la généralisation de la lutte, qui entretient des illusions plus ou moins fortes sur la nature des syndicats, qui ne pose pas la question de l'affrontement avec l'État (et en premier lieu, avec les organes de l'État dans l'entreprise: les syndicats), un tel comité de grève ne serait pas sorti du cadre syndical.
De là à conclure que la forme d'organisation n’a aucune importance et que tout est une question de contenu, il n'y a qu'un pas; pas qui est allègrement franchi par les défenseurs "critiques" du syndicalisme.
Une forme d'organisation ne peut en aucun cas être, par elle-même, une garantie du contenu de la lutte. Conseils ouvriers ou assemblées générales et comités d'usine ne sont pas des CONDITIONS SUFFISANTES pour l'épanouissement de la lutte prolétarienne. Mais elles n'en sont pas moins des CONDITIONS NECESSAIRES. Un - comité de grève peut mener une grève à l'impasse économique et localiste, tout comme n'importe quel syndicat. Mais alors qu'un syndicat ne peut jamais mener une lutte vers la révolution, il n'est pas de marche vers la révolution qui ne passe par les assemblées générales, les comités d'usine et les Conseils.
C'est pourquoi il est impossible de parler du contenu de la lutte ouvrière sans parler de ses formes d'organisation. Seul celui qui ne comprend pas que les syndicats sont un organe de l'État peut négliger l'importance de ces formes d'organisation et de la capacité de la classe à se les donner. Il ne peut pas comprendre, en effet, que la capacité à s'organiser en dehors de l'appareil syndical est le début de la capacité à s’opposer à l'État.
En ce qui concerne la lutte elle-même, grève ou insurrection, les formes organisationnelles de la classe apparaissent donc bien définies. Mais un problème subsiste.
Dans le capitalisme ascendant, les syndicats constituaient de façon permanente, avec les partis de masse, des lieux de rencontre des travailleurs. Ils étaient ce qu'on appelait à l'époque des "écoles du communisme". Avec leur disparition comme organisations de la classe, il se crée un problème pour les travailleurs : comment s'organiser EN DEHORS DES LUTTES OUVERTES ?
Sur ce problème bien des révolutionnaires se sont cassé les dents. En effet, lorsque la lutte cesse, après une grève sauvage par exemple, les comités de grève disparaissent avec les assemblées générales. Les travailleurs tendent à redevenir une masse d'individus atomisés et vaincus, acceptant de plus ou moins bon gré la représentativité des syndicats. Ce retour à la passivité peut prendre plus ou moins de temps, mais s'il n'y a pas de nouvelle lutte ouverte, il est toujours inéluctable. Pour éviter un tel retour, il est fréquent qu'au lendemain d'une lutte, les travailleurs les plus combatifs tentent de rester organisés, de créer une organisation PERMANENTE qui permette de regrouper la classe en dehors de ses combats. L'échec a toujours été systématique pour ce genre de tentative. Cet échec prend généralement une des trois formes suivantes :
- Soit l'organisation d'usine créée se dissout après un certain temps sous l'effet de la démoralisation due à l'incapacité à regrouper l'ensemble des travailleurs; ce fut le cas - des AAU en Allemagne après les luttes de 1919-23 par exemple, ou de tous les comités d'action qui tentèrent de subsister dans les usines en France après Mai 1968.
- Soit elles se transforment en de nouveaux syndicats (ce fut le cas du comité de grève que les trotskystes essayèrent de faire subsister après la grève de Renault en 1947, ainsi que celui de la plupart des "comisiones obreras" en Espagne).
- Soit elles tentent de se transformer en une sorte de groupe politique mal défini.
Ce dernier type d'expérience est apparu depuis 68, aussi bien en France, qu' en Italie ou en Espagne. Son contenu est le suivant : à partir de cercles ouvriers subsistant dans les entreprises, généralement à la suite de luttes dures, on tente de bâtir une organisation qui refuse aussi bien d'être un syndicat qu'un parti politique. On nie le syndicalisme en refusant de se restreindre à la lutte purement économique. On nie l'organisation politique, le parti, en refusant de se donner une plateforme politique définie. Cette dernière issue, à l'égal des deux premières (dissolution par inefficacité et transformation en syndicat)a abouti tout aussi systématiquement à des échecs cuisants.
Pourquoi tous ces échecs?
Parce qu'on essaie de stabiliser, de figer un organe qui, par définition, est instable, provisoire.
Que ce soient les unions (AAU) en Allemagne entre 1919 et 23, ou les Comités d'Action en France en 1968-69, les CUB (Comités Unitaires de Base) et les "Assemblées Autonomes" en Italie, ou les Commissions Ouvrières en Espagne, il s'agit toujours à l'origine de cercles d'ouvriers formés par les travailleurs les plus combatifs.
Tous ces cercles expriment la tendance générale de la classe vers l'organisation. Mais, contrairement à ce que pensent les gauchistes étudiants qui se sont attachés à vouloir inventer de nouvelles formes d'organisation de la classe (des "Cahiers de Mai" en France aux "Assemblées Autonomes" en Italie actuellement) il n'y a pas quinze formes d'organisation possibles pour le prolétariat. Une forme d'organisation doit inévitablement être adaptée 'au but qu'elle poursuit. À chaque but il correspond une forme d'organisation la plus adaptée, la plus efficace. Or, la classe ne poursuit pas quinze buts. Elle en a un : lutter contre l'exploitation qu'elle subit; en combattre aussi bien les effets que la cause.
Le prolétariat ne dispose pour ce combat que de deux armes :
- sa conscience ;
- son unité.
Aussi, lorsqu'en dehors des luttes ouvertes, des travailleurs se regroupent afin de contribuer au combat général de leur classe, ils ne peuvent se donner que deux types de tâches principales :
- contribuer à l'approfondissement et à la généralisation de la conscience révolutionnaire de la classe ;
- contribuer à son unification.
Les formes d'organisation de la classe sont donc inévitablement marquées par la nécessité de remplir ces deux tâches. Mais c'est ici que surgissent les problèmes : ces deux tâches sont deux aspects d'une même tâche générale, deux contributions à un même combat. Mais elles n'en ont pas moins des caractéristiques contradictoires.
Pour pouvoir UNIFIER la classe, il faut une organisation à laquelle n'importe quel prolétaire puisse adhérer indépendamment de ses idées politiques, par le simple fait qu'il est ouvrier.
Pour ELEVER LE NIVEAU DE CONSCIENCE de l'ensemble des travailleurs, tl faut que ceux qui sont les plus avancés ne restent pas les bras croisés à attendre que ça se développe tout seul. C'est leur devoir de diffuser leurs convictions, de faire de la propagande, d'intervenir avec leurs positions politiques parmi le reste de leur classe. Tant que la classe ouvrière existera comme classe exploitée (et lorsqu'elle ne sera plus exploitée, elle ne sera plus une classe) il subsistera en son sein des différences immenses quant à la conscience et à la volonté révolutionnaire de ses membres. Au cours des luttes tous les prolétaires tendent, de par la situation même qu'ils occupent au sein de la production, vers la conscience révolutionnaire. Mais tous n'évoluent pas au même rythme. Il existe toujours des individus et des fractions de la classe plus décidés, plus conscients de la nécessité et des moyens de l'action révolutionnaire, et d'autres plus craintifs, plus hésitants, plus sensibles à l'idéologie de la classe dominante. C'est au cours du long processus des luttes de la classe que la conscience révolutionnaire se généralise. L'intervention des éléments les plus avancés est alors un facteur actif de ce processus. Mais ce travail exige un accord politique important entre ceux qui le font. Et, par ailleurs, il ne peut être fait que de façon organisée. Aussi, l'organisation qui se donne cette tâche ne peut être formée que par des individus d'accord sur une PLATEFORME POLITIQUE. Si une telle organisation acceptait en son sein toutes les convictions politiques existant dans la classe, c'est à dire, si elle refusait de se donner cette plateforme politique, elle deviendrait incapable d'accomplir sa tâche. Sans critères politiques strictes d'adhésion, elle est condamnée à devenir une source de confusion. .
S'unifier, d'une part, élever son niveau de conscience, d'autre part, ce sont là deux tâches dont la classe doit s'acquitter de façon organisée. Mais elle ne peut le faire avec un seul type organisation. C’est pourquoi elle s'est toujours donné deux formes fondamentales d'organisation :
- les organisations UNITAIRES, ayant pour tâche de regrouper tous les travailleurs sans égard à leurs idées politiques (c'étaient les syndicats dans le capitalisme ascendant, ce sont les conseils et les assemblées générales dans le capitalisme décadent);
- les organisations POLITIQUES, fondées sur une plateforme politique et sans critère social d'adhésion. (partis et groupes politiques).
Ces deux types d'organisation doivent être distincts, mais ne sont pas pour autant incompatibles. Ils sont au contraire complémentaires car ils correspondent à deux besoins d'une • même lutte, d'une même classe. C'est dans les organisations unitaires de la classe que l'organisation politique s'épanouit et remplit le plus efficacement la fonction pour laquelle la classe l'engendre.
Toute organisation de travailleurs qui se donne pour tâche de contribuer au combat prolétarien, TEND inévitablement vers l'une ou l'autre de ces deux formes d'organisation.
C'est à partir de la compréhension de cette double tendance organisationnelle de la classe que l'on peut saisir la nature de ces cercles ouvriers qu'on voit surgir dans le capitalisme décadent autour des luttes importantes de la classe (ils surgissent généralement peu avant les luttes et disparaissent peu après leur fin). Eo fait, ce ne sont ni des véritables organisations unitaires de la classe, ni des organisations politiques. Ils sont des DEBUTS D'ORGANISATION DE LA CLASSE, des TENTATIVES INACHEVEES D'ORGANISATION des travailleurs.
En tant que tels ils sont des organes totalement INSTABLES pouvant CONTRIBUER aussi bien à la constitution d'organisations unitaires de la classe (ce fut le cas en Russie en 1905), qu'à la formation du parti politique du prolétariat (c'est en leur sein que commencent à se regrouper les éléments les plus combatifs de la classe). Mais ils ne sont ni des conseils, ni des partis politiques. Ce sont des formes TRANSITOIRES, qui ne peuvent vivre qu'en EVOLUANT. Elles ont un creuset et une croisée de chemins pour l'organisation de la classe lorsque le mouvement de luttes est ascendant. C'est pourquoi la condition-même pour qu'ils soient un apport à la lutte prolétarienne est qu'ils soient fécondés par le développement des luttes. En dehors d'un tel développement, tenter de les maintenir en vie artificiellement conduit inévitablement à les transformer, en bloquant leur évolution, en des monstruosités aberrantes telles des syndicats comme ce fut le cas pour la plupart des "comisiones obreras" en Espagne) ou des groupes politiques inavoués, confusionnistes et donc réactionnaires (tels "les cahiers de mai" en France après 1968).
La reprise des luttes prolétariennes que provoque la crise actuelle du capitalisme mondial, fera renaître dans la classe des milliers de cercles de ce genre. À chaque reflux de la lutte, ils seront soumis aux mêmes dangers d'avortement et de dégénérescence. Mais en attendant les conseils et le parti révolutionnaire, ils constitueront un des lieux de renaissance du mouvement révolutionnaire prolétarien.
L'intervention des révolutionnaires
Les syndicats sont appelés à jouer dans les années à venir un rôle primordial sur la scène politique de la lutte des classes. Ils sont le principal rempart derrière lequel le capital peut se protéger contre l'assaut prolétarien. Pour le prolétariat, ils sont le premier ennemi à abattre, la première barrière à faire éclater. C'est pourquoi, leur dénonciation est une des premières tâches de l'intervention des révolutionnaires. Les communistes doivent expliquer uoe et mille fois aux travailleurs que ceux qui aujourd'hui sont en tête de leurs cortèges syndicaux et prennent tant de soin à les encadrer d'un service d'ordre à brassard rouge, sont les mêmes qui demain prendront les armes contre eux. Ils ont à dénoncer tout aussi inlassablement ceux qui, sous prétexte de "double nature des syndicats", "fronts uniques ouvriers" et autres "appuis critiques" s'escriment à présenter ces organes du capital comme des organisation ouvrières : les gauchistes, les autogestionnaires et autres rabatteurs de gibier du capitalisme décadent.
Les révolutionnaires renvoient dos à dos les syndicalistes qui s'attachent à enfermer les luttes dans un contenu purement économique, et les "anti-syndicalistes" qui ressentent "un dédain transcendantal" pour le caractère économique des luttes ouvrières parce que "intégré au capitalisme".
Les communistes ne défendent pas des revendications particulières. Ils font leurs toutes les revendications de la classe du moment qu'elles expriment la RESISTANCE du prolétariat à l'aggravation de son exploitation, car ils savent et proclament que dans cette lutte la classe forge les armes de son combat final contre l’État capitaliste. Leur tâche est de montrer que dans le capitalisme décadent il ne peut plus y avoir de lutte contre les effets de l’exploitation qui ne soit lutte contre les causes de l'exploitation ; qu'il n’y a d’autre victoire réelle dans les luttes revendicatives que celle d'acquérir les moyens de la lutte pour la destruction définitive du système lui-même.
La dénonciation des syndicats va inévitablement de pair avec la défense des formes d'organisation propres à la lutte prolétarienne dans le capitalisme décadent : conseils, comités d’usine, assemblées générales.
Les révolutionnaires insistent autant sur la nécessité de ces formes que sur la mystification qui consiste à les présenter comme des conditions suffisantes, des recettes miracle, afin d'escamoter le problème du contenu de la lutte.
Les révolutionnaires sont présents dans les cercles ouvriers pour y défendre leurs positions, tout en luttant contre toute tentative de les vider de leur vie en les figeant dans des formes bâtardes.
Face au problème syndical la tâche des communistes est d’exprimer à haute voix et de façon résolue- ce que les travailleurs ressentent plus ou moins confusément depuis cinquante ans, à savoir, que les syndicats devront être détruits, tout comme l'État capitaliste dont ils ne sont qu'un rouage.
R. Victor.
[1] Cette incompréhension de la période ascendante du capitalisme - qui va inévitablement de pair avec l'incompréhension de l'essence de la période actuelle - constitue par ailleurs la source principale d'aberrations au sujet du problème syndical : ainsi la "condamnation" de tout syndicalisme ou lutte pour des réforme6,(ceux du XIX siècle y compris), indépendamment de la période historique - attitude très en vogue depuis 68 en milieu étudiant contestataire n'est que le symétrique de la défense de ceux-ci dans la période actuelle.
[2] La CNT d’ESPAGNE, seul exemple d’organisation syndicale à avoir tenté plusieurs fois la réalisation de son programme maximum, la "révolution sociale" (en 33 et 34), ne le fit qu'après que les anarchistes de la FAI aient mené à l'intérieur de cette organisation une lutte sévère. Pendant toute la dictature de Primo de Ribera, la CNT, qui se caractérisait pourtant par son "apolitisme révolutionnaire" était en contact avec toute sorte de conspirateurs : Macia, l'Alliance Républicaine et les militants d'opposition dans le pays.
En juillet 1927 fut fondée la FAI. Ses membres, repoussant toute sorte de compromission d'ordre tactique, se proposaient la conquête de la CNT, afin de réaliser la révolution sociale. Elle fut le point de ralliement de tous ceux qui désapprouvaient l'orientation réformiste de l'anarcho-syndicalisme.
Lors du congrès national de 1930 les deux tendances s'affrontèrent. Les leaders de la CNT; qui mettaient surtout l'accent sur le syndicalisme de la CNT, et proposaient de s'allier avec d'autres groupes et fractions pour faciliter l'implantation de la république : et les "purs" de la FAI insistant sur l'anarchisme de la confédération, refusant toute compromission. Ceux-ci l'emportèrent, les vieux leaders furent-délogés ' de leurs postes, puis quittèrent avec leur fraction (les "trentistes'' organisèrent leur propre syndicat) la confédération. La CNT ne participa donc pas de justesse à cette ébauche de front populaire en 1930.
Sous l’impulsion de la FAI, elle aussi "apolitique", la CNT alla de grève générale en tentative d'insurrection jusqu’en 36. Fortement affaiblie par la répression, découragée par .-ses échecs successifs, la confédération avait ' suffisamment payé de sa personne l’impossibilité du syndicalisme révolutionnaire. Le congrès de 1935 vit revenir les "trentistes", qui entre temps avaient contracté toute sorte d'alliances avec la bourgeoisie. La tentative d'insurrection des droites le 18 juillet 36 et le soulèvement du prolétariat le 19 sonna le glas de l'organisation ; les forces "«ouvrières" montèrent au pouvoir CNT et FAI en tête. En Catalogne, la place forte, la CNT fit partie du Comité des Milices Antifascistes en marge du "Gubierno de la Generalidad" puis entre dans ce dernier, donnant ainsi l’appui ouvrier tant recherché. L’apolitisme Syndicaliste avait triomphé, les "purs" de la F.A.I. eux-mêmes n'allaient pas tarder à accepter d’être ministres de la république tant combattue.
Les "anti-autoritaires", partisans d’une "révolution sociale apolitique", agissant au nom de sacro-saints principes moraux, n’ont jamais compris la destruction de "l’appareil de l'État comme un moment de la lutte politique du prolétariat contre son ennemi de classe la bourgeoisie.
Défendant des positions révolutionnaires (anti-frontisme, antiparlementarisme au nom de la pureté d’une idéologie, les transgresser sous la pression des évènements ne revêtait pas grande importance à leur yeux, l'idéologie étant toujours "pure? Ainsi la CNT et la FAI s'allièrent aux partis bourgeois, participèrent au gouvernement de la république bourgeoise, laissèrent massacrer le prolétariat lors des journées de Barcelone en 37 "pour ne pas briser l’unité". En d’autres termes, ils révélèrent ce qui peut sembler une évidence, à savoir que l’apolitisme le refus des frontières de classe institutionnalisée en principe, est une arme pour la bourgeoisie.
Dès 1936, la politique d'unité anti-fasciste de la CNT lui fait tenir le rôle de tous les autres syndicats réformistes : l'encadrement de la classe ouvrière au service du capital. Malgré 1'honnéteté de ses militants, l'organisation "apolitique" a rejoint les rangs de la bourgeoisie.
D'avoir tant lutté et sacrifié tant de militants révolutionnaires pour en arriver à siéger dans des ministères de la république, voilà le triste destin du "sociétalisme révolutionnaire apolitique".
S'alliant avec ceux qui ne cessèrent jamais de tirer sur les ouvriers révolutionnaires (dont la plupart étaient ses propres militants) la CNT enterrait l'anarcho-syndicalisme dans les poubelles de l'histoire aux côtés des partis parlementaires, des syndicats réformistes, des trotskystes et des staliniens.
Questions théoriques:
- Syndicalisme [20]