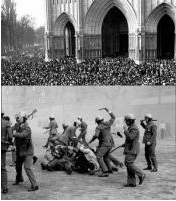ICConline - 2016
- 1273 reads
ICConline - janvier 2016
- 984 reads
Migrants et réfugiés : victimes du capitalisme (partie II)
- 1466 reads
A l'aube des années 1930, la défaite physique du prolétariat était bien assurée, la révolution mondiale avait été complétement écrasée. Les bains de sang successifs en Russie et en Allemagne après la défaite du prolétariat à Berlin en 1919, la recherche de boucs-émissaires, l'humiliation engendrée par le traité de Versailles et le besoin de revanche, tout cela provoquait un nouveau pas dans la spirale des horreurs capitalistes du XXe siècle.
L'émergence d’un monde concentrationnaire
En proclamant le "socialisme dans un seul pays", le nouveau régime stalinien en Russie était prêt à se lancer dans une course effrénée à l'industrialisation pour essayer de rattraper son retard. La planification de l'industrie lourde et la fabrication des armes renforçaient une exploitation extrême. Jusqu'à la terrible dépression des années 1930, les pays "vainqueurs" occidentaux cherchaient eux-aussi une main-d'œuvre à bas coûts qu'il fallait diviser et contrôler. Mais avec la crise économique et le chômage de masse, les migrants et réfugiés devenaient plus ouvertement "indésirables". Le mouvement des migrations allait ainsi être freiné assez brutalement dès 1929, notamment aux Etats-Unis (1). Lire notre article « L’immigration et le mouvement ouvrier », Revue internationale n° 140, 1er trimestre 2010
Ces derniers qui avaient adopté des quotas "filtraient" les migrants en les divisant, les séparant des autres prolétaires. Dans un tel contexte, les déplacements de populations, ceux des déportés et des réfugiés qui allaient s'effectuer de force le furent (pendant et après la guerre) dans des conditions terribles : souvent, ils se terminaient dans des camps de concentration qui commençaient à se généraliser un peu partout.
Alors que le développement des crises et que les tensions impérialistes devenaient croissantes, la classe ouvrière défaite ne pouvait opposer la force de sa résistance. Cela allait se traduire en Espagne, en 1936, par les débuts de l'embrigadement du prolétariat dans la guerre, au nom de "l'antifascisme". Cette nouvelle guerre totale mobilisait beaucoup plus brutalement et massivement les populations civiles (les femmes, les jeunes, les vieux) que la première Grande guerre. Elle allait s'avérer bien plus destructrice et barbare. L’Etat, en intervenant plus directement sur l'ensemble de la vie sociale, ouvrait une sorte d'ère concentrationnaire. Tout cela générait des déportations, des "nettoyages ethniques", des famines et des exterminations de masse.
Déportations, massacres et travaux forcés
La violence stalinienne, aussi brutale qu'imprévisible, en était un premier exemple. L'Etat n'hésitait pas lors des purges à arrêter les authentiques communistes, à exécuter 95% des dirigeants d'une région, à déporter des populations entières pour le contrôle et la maîtrise de son territoire. Dans les années 1931-1932, Staline allait utiliser froidement "l'arme de la faim" pour tenter de briser la résistance des Ukrainiens face à la collectivisation forcée. La terrible famine, provoquée de manière consciente, faisait en tout près de 6 millions de morts ! En Sibérie et ailleurs, des millions d'hommes et de femmes étaient condamnés aux travaux forcés. Pendant l'année 1935, par exemple, 200 000 détenus creusaient le canal Moscou-Volga-Don et 150 000 autres la deuxième voie du Transsibérien. La collectivisation brutale des campagnes, où plusieurs millions de koulaks étaient déportés vers des zones de colonisation inhospitalières, les plans de l'industrie lourde et l'exploitation à marche forcée où les ouvriers se tuaient au travail (au sens propre), permettaient de nourrir l'obsession de Staline consistant à vouloir "rattraper le retard sur les pays capitalistes" (2). Précisons que la Russie stalinisée elle-même était en fait un pays capitaliste, une expression caricaturale de la tendance au capitalisme d'Etat dans la décadence de ce système. Avant même son entrée dans la guerre, en 1941, l'Etat stalinien procédait à un véritable "nettoyage ethnique" sur ses frontières en vue d'assurer sa sécurité. Différentes populations étaient suspectées de "collaboration" avec l'ennemi allemand et allaient ainsi être soumises de force à de vastes déplacements collectifs. En 1937, la déportation vers l'Asie centrale de 170 000 Coréens, sur de simples motifs ethniques, conduisant à de lourdes pertes humaines, était un avant-goût de se qui se profilait. Parmi tous les déplacés qui suivirent, 60 000 Polonais étaient expédiés au Kazakhstan en 1941. Plusieurs vagues de déportations eurent lieu ensuite après la rupture du pacte germano-soviétique, en particulier pour les populations d’origine germanique, notamment dans les Républiques baltes devenus ouvertement "ennemis du peuple" : 1,2 millions d'entre eux se sont retrouvés du jour au lendemain exilés en Sibérie et en Asie centrale. Entre 1943 et 1944, c'était au tour des populations du Nord-Caucase (Tchétchènes, Ingouches...) et de Crimée (Tatars) d'être brutalement déplacées. Beaucoup de ces victimes affamées, criminalisées et bannies par l'Etat "socialiste" allaient mourir durant les transports dans des wagons à bestiaux (par manque d'eau, de nourriture ou par des maladies comme le typhus). Si généralement les populations locales témoignaient d'une grande solidarité à l'égard de ces malheureux proscrits, la propagande officielle entretenait contre ces nouveaux esclaves un climat de haine. Durant les transports, ils recevaient très souvent des jets de pierres accompagnés des pires insultes. A leur arrivée, selon un rapport de Beria datant de juillet 1944, "certains présidents de kolkhozes organisaient des passages à tabac destinés à justifier leurs refus d’embaucher des déportés physiquement dégradés" (3).
Isabelle Ohayon, La déportation des peuples vers l’Asie centrale. Le XXe siècle des guerres, Editions de l’Atelier, 2004.
Dans ces conditions extrêmes, ce sont finalement " dix à quinze millions de Soviétiques" qui ont été envoyés dans les "camps de rééducation par le travail", officiellement créés par le régime dès les années 1930 (4). Marie Jego, Le Monde, 3 mars 2003.
En Allemagne, au moment où les nazis arrivaient au pouvoir, bien avant l'entreprise d'extermination, les camps de concentration qui allaient se multiplier sur le territoire et surtout en Pologne étaient d'abord des camps de travail. Cette tendance au développement des camps qui allaient fleurir un peu partout, y compris dans les Etats démocratiques comme en France et aux Etats-Unis, pour les prisonniers ou réfugiés, avaient pour vocation, outre le contrôle sur la population, l'exploitation d'une force de travail quasi-gratuite. En vendant traditionnellement sa force de travail, le prolétaire permet au capitaliste d'extraire de la plus-value, c'est-à-dire du profit. Les termes de ce "contrat" assurent une exploitation poussant à la productivité maximale en garantissant par le bas niveau de salaire la simple reproduction de la force de travail. Dans les camps de concentration, la force de travail était exploitée de manière quasi-absolue. En Allemagne, les déportés travaillaient jusqu'à plus de 12 heures par jour, par tous les temps, sous les ordres de « kapos ». Des usines secrètes d'armements ou des filiales de grands groupes allemands se trouvaient dans les camps de concentration ou à proximité. Ces industries de guerre bénéficiaient d'une main-d’œuvre presque gratuite, très abondante et facilement renouvelable. La reproduction de la force de travail étant réduite à la simple survie du travailleur/prisonnier, la très faible productivité de cette main-d'œuvre était en partie compensée par des coûts d'entretien très bas. La nourriture était limitée au minimum vital, tout comme le transport, souvent réduit a l'unique déplacement vers un endroit reculé et isolé, celui du camp. Dans les Etats démocratiques, les camps allaient aussi être utilisés dans le cadre d'un renforcement du contrôle social étatique des populations prisonnières et/ou pour l'exploitation de leur force de travail. Ainsi, confronté à l'afflux des réfugiés espagnols (120 000 entre juin et octobre 1937. 440 000 en 1939) le gouvernement français agissait face à ces "indésirables" aux "agissements révolutionnaires". (5) P. J Deschodt, F. Huguenin, La République xénophobe, JC Lattès, 2001. En Afrique du Nord, 30 000 d'entre eux étaient utilisés pour des travaux forcés. Les réfugiés espagnols vivaient parqués sur le sol français dans des camps d'internement (les autorités parlent elles-mêmes de "camps de concentration") montés à la hâte dans le sud du pays (notamment sur les plages du Roussillon). Ces réfugiés atteignaient par exemple le nombre de 87 000 à Argelès, exploités comme main-d’œuvre servile, dans des conditions déplorables, dormant sur le sable, surveillés par les "kapos" de la garde républicaine ou des tirailleurs sénégalais. Entre février et juillet 1939, environ 15 000 réfugiés espagnols sont morts dans ces camps, la plupart d'épuisement ou du fait de la dysenterie.
Un peu plus tard, durant la guerre, parmi bien d'autres exemples, on pourrait relever celui des Etats-Unis qui ont aussi interné de mars 1942 à mars 1946 plus de 120 000 personnes. Il s'agissait d'une population nippo-américaine, parquée dans des camps de concentration au nord et à l'est de la Californie. Ces hommes furent traités de manière terrible au même titre que le sont les pires criminels et ceux qui subissent la xénophobie d'Etat. (6) Selon un vétéran de Guadalcanal : "le Japonais ne peut être considéré comme un intellectuel (...), c'est plutôt un animal » et un général des Marines a déclaré aussi : "tuer un Japonais, c'était vraiment comme tuer une vipère". Voir Ph Masson, Une guerre totale, coll. Pluriel.
Le génocide des Juifs : un des sommets de la barbarie capitaliste
Nous avons souligné que les camps de concentration en Allemagne étaient d'abord des camps de travail. Les plus gros déplacements de populations s'effectuaient en direction de l'Allemagne par la force, par des mesures telles que le STO (service de travail obligatoire) en France, le pillage, les déportations massives de Juifs et les rafles un peu partout en Europe. Dans les usines, l'agriculture ou l'exploitation minière, un quart de la force de travail était représentée par du travail forcé, notamment dans le cadre du "Generalplan Ost". Entre 15 et 20 millions de personnes étaient déportées en tout par l'Allemagne nazie en vue de faire tourner sa machine de guerre ! Une telle politique augmentait le nombre de réfugiés fuyant le régime et sa chasse à l'homme. Dans les années 1930, on comptait environ 350 000 réfugiés en provenance de l'Allemagne nazie, 150 000 en provenance de l'Autriche (après l'Anschluss) et des Sudètes (après le rattachement à l'Allemagne nazie).
A partir de l'année 1942 et son projet de "solution finale", les camps de concentration comme ceux d'Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Treblinka, Belzec, Sobibor, Maidaneck... vont se transformer en camps d'extermination. Dans des conditions atroces, parmi les très nombreuses victimes, six millions de Juifs étaient acheminés par convois et massacrés, la plupart gazés et brûlés dans des fours crématoires. Le contingent sinistre le plus imposant de victimes était fourni par la Pologne (300 0000) et l'URSS (100 0000). Les camps d'exterminations comme ceux d'Auschwitz (1 200 000) et de Treblinka (800 000) tournaient à plein régime. Cette barbarie est bien connue du fait qu'elle a été longuement exhibée et exploitée idéologiquement jusqu'à la nausée après la guerre par les Alliés, servant ainsi d'alibi pour justifier ou masquer leurs propres crimes.
Une mentalité de pogrom s'était installée durant les années 1920, sanctionnant la défaite sanglante du prolétariat et de ses grandes figures révolutionnaires assimilées à la "juiverie" : "même si beaucoup de révolutionnaires israélites comme Trotski ou Rosa Luxemburg se veulent non-juifs (...) l'Israelite apparait comme le fourrier de la subversion, comme un agent destructeur vis-à-vis des valeurs fondamentales : patrie, famille, propriété, religion. L'enthousiasme de nombre de Juifs à l'égard de toutes les formes de l'art moderne ou des nouveaux moyens d'expression comme le cinéma justifie encore cette réputation d'esprit corrosif".(7) Ph. Masson, op cit En fait, la défaite de la révolution permettait aux grandes démocraties de voir en Hitler ni plus ni moins qu'un "rempart" efficace "contre le bolchevisme". Pour tous les Etats à l'époque, l'amalgame juif et communiste était très courant. Churchill lui même accusait les Juifs d'être les responsables de la Révolution Russe :"Il n'y a pas besoin d'exagérer la part jouée dans la création du bolchevisme et dans l'arrivée de la Révolution russe par ces Juifs internationalistes et pour la plupart athées".(8) Illustrated Sunday Herald , 8 février 1920, cité par Wikipédia. L'idée d'un complot "judéo-marxiste", d'abord véhiculé par les "troupes blanches", murissait sur la base d'un antisémitisme répandu : "est-il besoin de souligner que Hitler n'est pas à l'origine de cet antisémitisme (...) au lendemain de la Première guerre mondiale, cet antisémitisme habite la plupart des pays européens". (9) Ph Masson, op. cit. Les Juifs allaient donc systématiquement pouvoir être stigmatisés, marginalisés, devenir des boucs-émissaires sans que cela ne gêne outre-mesure les dirigeants démocrates, dont certains, comme Roosevelt, avaient déjà ouvertement des penchants xénophobes et antisémites. Une grande partie des Juifs qui se trouvaient en Pologne, en URSS et dans des ghettos, avaient en fait déjà été bien souvent obligés de fuir les pays démocratiques du fait de cet antisémitisme (contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'antisémitisme du régime de Vichy, par exemple, n'est pas un phénomène spontané, ni qui lui est propre). Dès lors, les lois antisémites de Nuremberg en 1935 pouvaient, sans surprise, passer pratiquement inaperçues. En faisant des Juifs des citoyens à part et marginalisés, leurs biens allaient pouvoir être pillés en toute impunité, en toute bonne conscience, face à ceux qu'on percevait comme "des êtres nuisibles". C'est en réalité toute cette dynamique, tout ce terreau nauséabond qui faisait le lit de la propagande hygiéniste et eugéniste des nazis. Dès janvier 1940, l'"Aktion t4" en Allemagne préfigurait déjà l'holocauste, programmant méthodiquement l'élimination des handicapés physiques et mentaux. Face à la tragédie qui allait suivre, les Alliés refusaient l'aide aux Juifs "pour ne pas déstabiliser l'effort de guerre" (Churchill). Les Alliés se sont bien avérés comme les co-responsables et les complices d'un génocide qui était avant tout un produit du système capitaliste. Très tôt, les pays démocratiques se fermaient en refusant de porter assistance aux Juifs perçus comme des parias qu'on ne voulait pas chez soi (10) Lire notre brochure Fascisme et démocratie, deux expressions de la dictature du capital. Face à la répression nazie et aux persécutions, le gouvernement du Front populaire en France, par exemple, allait se montrer intraitable. Ainsi, derrière un vernis démocratique, une circulaire de la main de Roger Salengro, datée du 14 août 1936, soulignait : " ne plus laisser (...) pénétrer en France aucun émigré allemand et de procéder au refoulement de tout étranger, sujet allemand ou venant d'Allemagne, qui entré postérieurement au 5 août 1936, ne serait pas muni des pièces nécessaires..." (11) P. J Deschodt, F. Huguenin, op.cit.
La barbarie est celle des deux camps impérialistes
Toutes les actions et mesures administratives destinées à déporter, chasser, exterminer les populations étaient bien plus imposantes et surtout avec des conséquences bien plus dramatiques qu'en 1914-1918. Le nombre de réfugiés/migrants a été sans commune mesure. La violence utilisée - à partir des camps de concentration et leurs chambres à gaz, les bombardements en tapis, les gaz de phosphore, les bombes nucléaires, l'utilisation d'armes chimiques et biologiques - a fait de nombreuses victimes et causé des souffrances durables après la guerre, avec une quantité indénombrable de traumatismes. Le bilan est terrifiant ! Les destructions ont provoqué au total près de 66 millions de morts (20 millions de soldats et 46 millions de civils) contre 10 millions pour 1914-1918 ! A la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fallait réinstaller 60 millions de personnes, soit dix fois plus que pour la Première Guerre ! Au cœur de l'Europe même, 40 millions sont morts. En Asie de l'Est, en Chine, plus de 12 millions de personnes sont mortes dans les confrontations militaires directes et on a dénombré près de 95 millions de réfugiés en Chine. Durant la guerre, un certain nombre de sièges et de batailles militaires ont été parmi les plus sanglantes de l'histoire. Pour donner quelques exemples : à Stalingrad, près d'un million d'hommes des deux camps sont morts sous un feu infernal. Dans un siège qui a duré près de trois ans, au moins 1 800 000 sont morts. La bataille autour de la prise de Berlin a coûté la vie à 300 000 soldats allemands ou russes et à plus de 100 000 civils). La célèbre bataille d'Okinawa a tué 120 000 soldats mais aussi 160 000 civils. Les troupes japonaises ont massacré 300 000 Chinois à Nankin ! Les bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki, selon l’historien Howard Zinn, auraient fait jusqu'à 250 000 morts ! Les terribles bombardements américains sur Tokyo, en mars 1945, provoquèrent 85 000 morts. En URSS, on compte 27 millions de victimes. L'Ukraine perdra 20% de sa population, la Pologne 15% (majoritairement des Juifs). Des centaines de villes en Europe étaient en partie dévastées ou quasiment détruites. En Russie, 1700 villes ont été touchées, 714 en Ukraine et on comptera près de 70 000 villages anéantis ! En Allemagne, les tapis de bombes incendiaires au phosphore des Alliés et du "Bomber Command" ont fait un nombre énorme de victimes, rasant les villes de Dresde et Hambourg (près de 50 000 morts). Une ville comme Cologne a été détruite à 70% ! On a finalement évalué qu’il y avait à la fin de la guerre en Allemagne entre 18 et 20 millions de sans-abris, 10 millions en Ukraine ! Le nombre d'orphelins de guerre a été aussi éloquent : 2 millions en Allemagne, plus d'un million en Pologne. Quelques 180 000 enfants ont été réduits à l'état de vagabonds dans les rues de Rome, Naples et Milan.
Les souffrances effroyables générées par ces destructions s'accompagnaient très souvent de vengeances terribles et d'actes de barbarie sur les populations, les civils et réfugiés terrorisés. Ce fut le cas des Alliés, présentés pourtant comme "grands libérateurs" : "l'hybris, la foudre de la vengeance s'abat sur les survivants ; la découverte des atrocités commises par le vaincu ne fait qu'alimenter la bonne conscience du vainqueur". (12) Voir Ph. Masson, op. cit.
L'accumulation de violence générée par le capitalisme décadent, une fois libérée, produit les scènes les plus atroces, celles "d'épuration ethniques" et d'actes d'une barbarie inimaginable. Pendant et après le guerre en Croatie, près de 600 000 Serbes, musulmans et Juifs étaient tués par le régime oustachi désirant "nettoyer" le pays entier. Des communautés grecques étaient massacrées par l'armée bulgare, des Hongrois faisaient de même pour les Serbes en Voïvodine. Pendant la guerre, les défaites s'accompagnaient toujours de migrations tragiques. Ainsi, par exemple, cinq millions d'Allemands fuiront devant l'Armée rouge. Beaucoup mourront, seront lynchés le long des routes. Il s'agissait là d'un des épisodes "héroïques" des "libérateurs", de ces "chevaliers de la liberté" qui prendront cyniquement après la guerre le rôle de procureur malgré leurs crimes impunis :"on ne peut encore oublier l'effroyable calvaire des populations, allemandes de l'est au moment de l'avancée de l'armée rouge (...) le soldat soviétique devient l'instrument d'une volonté froide, délibérée d'extermination (...) Des colonnes de réfugiés sont écrasées sous les chenilles des chars ou systématiquement mitraillées par l'aviation. La population d'agglomérations entières est massacrée avec des raffinements de cruauté. Des femmes nues sont crucifiées sur les portes des granges. Des enfants sont décapités ou ont la tête écrasée à coups de crosse, ou bien sont jetés vivants dans des auges à cochons (...) La population allemande de Prague est massacrée avec un rare sadisme. Après avoir été violées, les femmes ont les tendons d'Achille coupés et sont condamnées à mourir sur le sol d'hémorragie dans d'atroces souffrances. Des enfants sont mitraillés à la sortie des écoles, jetés sur la chaussée depuis les étages des immeubles ou noyés dans des fontaines ; au total, plus de 30 000 victimes (...) la violence n'épargne pas les jeunes auxiliaires des transmissions de la Luftwaffe jetées vivantes dans des meules de foin enflammées. Pendant des semaines, la Vltava (Moldau) charrie des milliers de corps ; certains par familles entières sont cloués sur des radeaux."(13) Voir Ph. Masson, op. cit.
Il est difficile de dire combien de femmes ont pu être violées par les soldats allemands pendant la guerre. Ce qui est certain, c'est que les forces des Alliés avançant et occupant le territoire «libéré», une autre épreuve les attendait. Il y eut un million de femmes violées en Allemagne par les troupes alliées. Rien qu'à Berlin, autour de 100 000 cas. Les estimations pour Budapest se situent dans une fourchette allant de 50000 à 100 000 viols.
Ce que nous voulons surtout souligner, c'est que loin d'être intervenus pour la "défense de la liberté", les Alliés et les grandes démocraties ne se sont impliqués dans la guerre que pour défendre des intérêts purement impérialistes. Le sort des populations et des réfugiés, ils s'en fichaient royalement tant qu'ils n'en avaient pas la charge et tant qu'ils ne pouvaient s'en servir pour exploiter leur force de travail. Ils ne faisaient jamais mention du sort des Juifs dans leur propagande durant la guerre, leur refusant même assistance, les abandonnant ainsi aux mains les nazis. Le motif d'entrée en guerre des Alliés était tout autre que celui d'une volonté de "libération". Pour la France et la Grande-Bretagne, il s'agissait en réalité de défendre "l'équilibre européen". Pour les Etats-Unis, de bloquer l'expansion et les menaces de l'URSS. Pour cette dernière, d'étendre son influence vers l'Europe de l'Ouest. Bref, des motifs et des raisons purement stratégiques, impérialistes et militaires. Rien de plus classique ! Ce n'est absolument pas pour "libérer l'Allemagne" de la "peste brune" qu'ils ont agi. Cette fable n'est qu'un montage diabolique qui a été théâtralisé au moment de la libération des camps. Tout avait été élaboré par l'état-major allié et ses politiciens soucieux de masquer leurs propres crimes (à moins d'avoir la naïveté de penser que les militaires et politiciens démocrates ne font jamais de propagande !). Si la "libération" a bien pu mettre fin aux pratiques tortionnaires de l'ennemi, c'est avant tout une conséquence indirecte de l’atteinte d’un objectif purement militaire et non pour des motifs "humanitaires". La meilleure preuve en est que les principales puissances démocratiques ont continué après la guerre à défendre des intérêts impérialistes générant de nouvelles victimes, des massacres coloniaux, de nouvelles fractures qui ont apporté aussi leurs lots de réfugiés et de miséreux.
WH (18 juillet 2015)
Dans les prochains articles, nous aborderons la même question, depuis la Guerre froide jusqu'à la chute du mur de Berlin et la période actuelle.
Récent et en cours:
- réfugiés [1]
Rubrique:
ICConline - février 2016
- 1247 reads
La politique allemande et le problème des réfugiés : un jeu dangereux avec le feu
- 3339 reads
L'article qui suit, réalisé par Welt Revolution, organe de presse du CCI en Allemagne, est une contribution sur la question des réfugiés, telle qu'elle se pose aujourd'hui dans ce pays. Certains aspects de l'analyse ne sont pas facilement transférables à d'autres pays d'Europe. Par exemple le problème démographique traité dans cet article se présente autrement en Espagne ou en Italie où il existe un fort taux de chômage des jeunes malgré un faible taux de natalité. En raison du poids économique et politique de l'Allemagne dans l'Union Européenne et dans le monde, cet article a son importance en dehors des frontières nationales.
Lorsque, début septembre, la chancelière Merkel ouvrit largement, et de façon aussi fracassante que soudaine, les portes de la Terre promise allemande (plus ou moins ouvertes depuis) aux milliers de réfugiés campant dans des conditions indignes dans la gare centrale de Budapest et ses environs, lorsqu'elle défendit avec des paroles pleines d'émotion l'ouverture des frontières pour les réfugiés syriens face aux critiques émanant de son propre camp et qu'elle déclara malgré les protestations de plus en plus ouvertes de la part des communes littéralement débordées qu'il n'y avait pas de limite supérieure maximale à l'accueil de réfugiés politiques, le monde entier se demanda pourquoi Merkel, plutôt réputée "réfléchir en fonction des conséquences" et soupeser toutes ces conséquences avant d'agir, s'engageait dans cette "aventure". Car en fait, c'est une équation avec un bon nombre d'inconnues qui se présente à la Grande Coalition. Il se pose ainsi la question de comment stopper le flot des réfugiés ; il y a peu encore, il était question de 800 000 réfugiés devant arriver en Allemagne cette année ; des pronostics avançaient même qu'il s'agirait au moins d'un million et demi de réfugiés. Merkel semble également, ce qui est inhabituel, avoir mal calculé l'effet de la politique de la main tendue sur la population locale ; pour la première fois depuis une éternité, elle a, selon les sondages, régressé dans les faveurs de l'électorat et elle a même été dépassée par un social-démocrate (le ministre des affaire étrangères, Steinmeier). Elle rend un bien mauvais service à l'endiguement du populisme d'extrême-droite ; le flot sans fin des réfugiés majoritairement musulmans apportant de l'eau au moulin d'Alternative für Deutschland (AfD)1 qui a rattrapé dans les sondages, du moins en Thuringe, la troisième force politique, le SPD.
Pourquoi le gouvernement de coalition sous la direction de Merkel et Gabriel2 s'est-il engagé dans un jeu aussi périlleux ? S’agit-il d’une réponse au Merkel-bashing3 dans le contexte de la crise grecque pour améliorer son image ou même par pur sentimentalisme ? Peut-être l'attendrissement de Merkel, lors de son dernier "Townhall-meeting" concernant le sort de cette petite fille palestinienne menacée d'expulsion ou l'émotion débordante de Gabriel à propos du sort non moins cruel d'une famille syrienne dans le camp de réfugiés qu'il visitait en Jordanie, étaient-ils sincères. Même les politiciens bourgeois ont, c'est bien connu, une vie affective…
À notre avis, la politique de la porte ouverte a, de façon prépondérante, des causes de loin plus bassement matérielles. Elle a des motifs qui ne sont pas aussi altruistes et désintéressés que l'engagement des nombreux bénévoles au sein de la population, sans lesquels le chaos qui règne dans les centres d'accueils pour les demandeurs d'asile serait sans commune mesure encore bien plus grand. Ses mobiles ont une importance qui dépasse largement les risques et les effets induits d'une telle politique. Examinons en détail les objectifs secrètement poursuivis par la "politique de l'ouverture des frontières".
Les avantages économiques
Depuis des années déjà, le thème du "problème démographique" hante les médias. D'après l'institut fédéral de statistiques, la République Fédérale est menacée par le vieillissement et la baisse de la population nationale qui décroîtrait de sept millions d'habitants pour tomber à 75 millions en 2050. Déjà, depuis la réunification en 1989, la population de l'ensemble de l'Allemagne a décru de trois millions, en particulier du fait de la chute dramatique du taux de natalité dans l'Est de l'Allemagne. Comme le montre la nombreuse littérature de ces dernières années s'y rapportant, il est clair pour la bourgeoisie allemande que si ce processus n'était pas enrayé et devait se poursuivre, il débouchera à long terme sur une considérable perte d'influence et de prestige du capitalisme allemand, tant sur les plans économique, militaire que politique.
Déjà aujourd'hui, le manque de main-d'œuvre bien formées constitue un frein à la conjoncture au demeurant forte de l'économie allemande. Dans environ un sixième de toutes les branches professionnelles, il y a un manque de personnel qualifié qui prend une telle tournure qu'il met à mal la compétitivité de bon nombre d'entreprises, à en croire les dires des cadres. Selon une étude de Prognos AG ("Arbeitslandschaft 2030") : "en 2015, il manque un bon million de diplômés du supérieur - 180 000 de plus que le nombre auquel s'attendaient les économistes pour cette même année, avant l'arrivée des réfugiés. Concernant la main-d'œuvre professionnellement qualifiée, le trou est toujours estimé à 1,3 million. Et il va même manquer aux entreprises environ 550 000 ouvriers sans qualification en 2015."4 En Allemagne de l'Est, le manque de personnel qualifié entraîne d'ores et déjà le cercle vicieux suivant : la fuite de la main-d'œuvre jeune vers l'Allemagne de l’Ouest, au taux constamment supérieur à celui des arrivants, provoque la fermeture de petites et moyennes entreprises, ce qui à son tour accélère encore le processus de départ.
Dans cette situation, le flux de nombreux réfugiés de guerre de ces dernières semaines constitue une véritable manne céleste pour l'économie allemande. Et cette dernière se montre très reconnaissante : Telekom offre son aide pour le logement et le ravitaillement des réfugiés ainsi qu’un soutien personnalisé vis-à-vis des instances officielles, Audi a dépensé un million d'euros dans des initiatives en faveur des réfugiés, Daimler et Porsche envisagent de créer des places d'apprentis pour les jeunes réfugiés, Bayer soutient les initiatives de ses employés en faveur des réfugiés. Il va de soi que la "responsabilité sociale" dont se targuent les entreprises sert en réalité leurs intérêts. Il s'agit tout bonnement de tirer profit du potentiel d'exploitation que recèlent les réfugiés.
En particulier, les réfugiés syriens représentent une source intéressante de capital humain dont les entreprises d'ici ont un besoin pressant. Premièrement, ils sont dans leur grande majorité jeunes ; ils pourraient ainsi contribuer à rajeunir la pyramides des âges dans les entreprises et - en général - faire baisser la moyenne d'âge de la société. Deuxièmement, les réfugiés syriens sont clairement mieux formés que d'autres réfugiés, comme le montrent les enquêtes de l'Office Fédéral pour la Migration et les Réfugiés.5 Plus d'un quart d'entre eux possède une formation de niveau supérieur et représente une source particulièrement lucrative de main-d'œuvre, dont les qualifications d'ingénieurs, de techniciens, de médecins, de personnel soignant entre autres sont ici ardemment recherchées. Les entreprises allemandes profitent même de ces réfugiés à un double point de vue : tout d'abord, cela leur permet de combler les déficits en main-d'œuvre ; ensuite le capital allemand tire avantage de l'effet (thématisé dans les années 70 sous le terme de "brain drain") de siphonage de la main-d'œuvre hautement qualifiée dans le tiers-monde permettant de s'épargner une part considérable de ses coûts de reproduction (c'est-à-dire les coûts d'éducation, d'école, d'université, etc.) au détriment des pays d'origine.
Venons-en au troisième avantage rendant les réfugiés syriens à ce point attractifs pour l'économie allemande. Il s'agit de l'extraordinaire motivation de ces êtres humains qui fascine tant les chefs de l'économie, tel le président de Daimler, Dieter Zetsche. La mentalité de ces êtres humains complètement impuissants, exposés durant des années à la terreur des bombes incendiaires d'Assad et à l'horreur de l'État Islamique, qui ont tout perdu de leur vie antérieure et vécu la terrible expérience de la fuite vers l'Europe, en fait des proies reconnaissantes pour le système d'exploitation capitaliste. Échappés de l'enfer, ils sont prêts à trimer durement pour de petits salaires, tout en pensant que, pour eux, tout ne peut aller que mieux. C'est exactement avec la même mentalité que les Trümmerfrauen ("les femmes des décombres")6 qui, plutôt que de se soumettre à la fatalité et de rester les bras croisés, ont déblayé et débarrassé de leurs ruines les villes allemandes dévastées à mains nues, prenant ainsi une part décisive à la reconstruction et au "miracle économique" allemand de l'après-guerre (Wirtschaftswunder)7 comme l'oublient volontiers les économistes bourgeois.
Cette énergie et cet esprit d'initiative incroyables dont témoignent aussi les réfugiés syriens offrent pour la bourgeoisie allemande une source de capital humain prometteuse de profits. En outre, tout comme les immigrés des années 1960 et 1970, ils risquent à court terme de servir de masse de manœuvre à la disposition du capital pour maintenir ou même augmenter la pression sur les salaires.
Les rendements impérialistes
Mais les réfugiés syriens forment aussi une masse de manœuvre pour l'impérialisme allemand, comme cela s'est avéré dans les jours et semaines passés, dans le contexte de l'aggravation de la guerre civile. Et même à plus d'un point de vue. Ainsi, le gouvernement fédéral instrumentalise-t-il la question des réfugiés non seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan politique, en clouant au pilori les autres pays mais aussi comme par hasard le pays traditionnels de l'immigration, notamment les États-Unis, pour leurs hésitations à accueillir des réfugiés. Ces derniers jours, nous avons pu voir de clairs indices indiquant que l'Allemagne donnait une nouvelle orientation à sa politique vis-à-vis de la Syrie. Reliant savamment le drame des réfugiés à une prétendue solution du conflit syrien, les principaux représentants de la politique étrangère allemande (Steinmeier et Genscher entre autres) en sont venus à souligner la nécessité d'intégrer la Russie, l'Iran, et même (temporairement) le massacreur Assad au processus de paix en Syrie. Bien plus, Berlin et le Kremlin sont unanimes pour faire reculer la guerre en Ukraine, afin que toutes les forces se concentrent sur la gestion de la situation en Syrie. Même le passage à l'acte de Poutine, déployant des forces militaires supplémentaires dans la ville syrienne de Lattaquié, n'a pas été une cause particulière d'irritation pour le gouvernement fédéral. Le ministre de l’Économie Gabriel réclamant même la fin des sanctions économiques envers la Russie, affirmant qu'on ne "pouvait pas d'une part maintenir à long terme les sanctions et, d'autre part, réclamer (...) la collaboration."
Avec cette réorientation, la politique allemande s'achemine, pour la première fois depuis la guerre en Irak, à nouveau vers la confrontation ouverte avec les États-Unis. Ces derniers, par le biais du Département d’État (le ministère des Affaires Étrangères) ont, ces derniers temps, haussé le ton vis à vis d'Assad et se sont montrés loin d'être amusés par la dernière offensive diplomatique de Poutine lors de la dernière assemblée générale de l'ONU. Leur attitude par rapport à l’État Islamique est en revanche pour le moins très ambivalente ; leur rôle dans la percée de l’État Islamique comme mouvement de masse a été extrêmement douteux, et la tiédeur avec laquelle les États-Unis s'y attaquent, pose toute une série de questions quant aux véritables intentions de l'impérialisme américain vis-à-vis de cette organisation terroriste.
Le changement de cours intervenu dans la politique extérieure allemande semble en partie résulter des interventions et de la pression de l'industrie allemande. Au sein de celle-ci les critiques envers les sanctions prises contre la Russie montent d'autant plus qu'il apparaît nettement que c'est l'économie allemande qui en supporte les dommages les plus importants, tandis que les grandes entreprises américaines comme Bell ou Boeing continuent à réaliser de brillantes affaires avec la Russie en dépit des sanctions. Alors que le volume des transactions de l'économie allemande dans le commerce avec la Russie s'est effondré de 30%, dans la même période le négoce entre les États-Unis et la Russie a augmenté de 6%. En plus de ces raisons économiques, des arguments politiques entrent également en ligne de compte pour le capitalisme allemand contre le maintien de l'embargo économique envers la Russie. Ne disposant pas d'un potentiel militaire de menace et de dissuasion comparable à celui des États-Unis, l'impérialisme allemand doit avoir recours à d'autres moyens pour faire valoir son influence sur le plan mondial. L'un de ceux-ci est sa puissance économique et industrielle que la politique allemande utilise pour forcer et contraindre le développement de relations commerciales. Un aspect qui montre le mélange de la politique et du business ainsi que l'instrumentalisation politique de projets économiques sont les visites d’État officielles dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou la Russie où le chancelier (ou la chancelière) est systématiquement accompagné de tout une suite de hauts dirigeants de grandes entreprises allemandes, et même de représentants de la petite et moyenne industrie de la construction de machines-outils. En ce sens, la politique de sanction prive la bourgeoisie allemande de plus d'un contrat et va ainsi à l'encontre de ses intérêts impérialistes.
La masse de réfugiés syriens accueillie par l'Allemagne doit aussi être considérée comme un autre moyen de compenser sa faiblesse militaire - et là, la boucle est bouclée. Dans ce contexte, il ne faut pas sous-estimer l'effet politique à long terme de la pulsion profondément humaine de la reconnaissance et de la gratitude sur les relations entre des pays. L'évidente sympathie manifestée par les réfugiés profondément impressionnés par l'attitude secourable d'une grande partie de la population locale, est un point que la bourgeoisie allemande pourra faire prévaloir. Cette dette de remerciement, contractée à l'égard de l'Allemagne par bon nombre de ceux qui sont venus s'y échouer, peut à long terme devenir un sésame pour les intérêts de l'impérialisme allemand au Proche et au Moyen-Orient ; elle peut faire surgir des fractions pro-allemandes qui pourront faire du lobbying au profit des intérêts allemands dans leurs pays d'origine.
L'exploitation idéologique
Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est le changement d'apparat du nationalisme allemand. Jusqu'à récemment encore (dans la crise grecque), qualifiée à l'étranger de "IVème Reich" et ses représentants volontiers caricaturés parés d'emblèmes nazis, présentés comme sans cœur et sans merci, l'Allemagne se repaît désormais de la gloire fraîchement acquise en tant que sauveuse des damnés de la terre. Les Allemands passent mondialement pour les "bons". Jamais depuis sa fondation, la réputation de la République Fédérale Allemande n'a été aussi bonne qu'aujourd'hui. En plus de son effet à l'extérieur, ce lifting exerce son rayonnement aussi vers l'intérieur, sous la forme du démocratisme. L’État allemand se donne en ce moment des allures de parangon en matière de proximité du citoyen, d'ouverture au monde et de tolérance, mettant ainsi en œuvre un processus funeste pour la classe ouvrière - de dissolution des classes sociales dans l'unité nationale. Et la chancelière Merkel, la froide physicienne, trouve visiblement un plaisir croissant dans son nouveau rôle de Sainte Mère, protectrice des demandeurs d'asile. Comment disait-elle déjà ? "Si maintenant, nous commençons à devoir nous excuser de montrer un visage amical dans les situations d'urgence, alors cela n'est pas mon pays."
On ne peut pas le dire de façon plus pertinente. Dans les faits, il s'agit exclusivement de montrer un visage sympa ; et derrière la mine amicale, on continue allègrement à traquer et à diviser. Ainsi, parallèlement à la "culture de la bienvenue", on effectue une division cynique entre les réfugiés de guerre et les "pseudo-demandeurs d'asile", une sélection sans merci des "réfugiés économiques", la plupart du temps des jeunes gens des Balkans sans perspective autre que la paupérisation. En vitesse, l’État fédéral et les Länder se sont mis d'accord pour déclarer de façon délibérée le Kosovo, la Serbie et le Monténégro être des pays sûrs et supprimer ainsi tout fondement à la demande d'asile de la part des personnes originaires de ces régions. Cependant, même les "vrais" demandeurs d'asile ne sont eux-mêmes pas épargnés par les attaques venimeuses du monde politique ou des médias, comme le montrent celles du ministre fédéral de l'Intérieur de Maizière contre des réfugiés récalcitrants.
En outre, certains médias, en dépit de toute la rhétorique jusqu’au-boutiste de la part de la chancelière ("On va y arriver !") sont infatigables pour attiser la panique et les angoisses au sein de la population nationale. On parle là de peuples entiers qui se mettraient en route vers l'Europe, ici on dénonce le péril d'attaques terroristes fomentées par les "taupes" islamistes venues avec l'armée de réfugiés et on se demande quand l'atmosphère au sein de la population va-t-elle "changer". Mais surtout, le chœur de ceux qui mettent hystériquement en garde contre le "débordement" de l'Allemagne par les masses de réfugiés et vocifèrent que la barque est pleine, prend de l'ampleur.
Il n'est pas très difficile d'apprécier laquelle des deux voies, l'ouverture ou la fermeture des frontières, finira par s'imposer. La politique des "frontières ouvertes" n'a été, on peut partir de ce principe, qu'un intermède exceptionnel, unique dans le temps ; le futur proche sera marqué par un nouveau verrouillage des frontières, aussi bien au plan national que dans l'UE. À l'avenir, comme le prévoient ses plans, la sélection des demandeurs d'asile "utiles" pour l'Allemagne doit s'opérer directement sur place, dans les pays d'origine. La campagne contre les passeurs est particulièrement perfide ; elle ne vise vraiment pas uniquement les bandes mafieuses, mais aussi tous ceux qui aident professionnellement les réfugiés à fuir sans en tirer profit. "L'Union Européenne, qui veut être un espace de liberté, de sécurité et de droit ainsi que ses États-membres ont créé un système qui rend presque impossible aux personnes poursuivies, torturées et opprimées qui ont un besoin urgent d'assistance de trouver protection en Europe sans recours à des passeurs professionnels. Traduire ces derniers devant les tribunaux et les mettre en prison, c'est hypocrite, contradictoire et profondément inhumain." écrit à ce propos le Republikanische Anwältinnen-und Anwälteverein (RAV) dans sa Lettre d'Information "Éloge des passeurs".
Il est incontestable que le monde vit avec la vague actuelle de réfugiés un drame d'une dimension qu'il n'avait encore jamais connue. En 2013, on comptait 51,2 millions de personnes déplacées, fin 2014 leur nombre atteignait 59,5 millions, soit la plus importante augmentation en l'espace d'une année et record absolu enregistré par le HCR des Nations Unies jamais atteint au niveau mondial. Il est indéniable que peu à peu les choses échappent à tout contrôle. Après la Syrie, la Libye menace aussi de déraper dans une guerre civile totale, avec toutes les conséquences identiques à la Syrie. Dans les camps de réfugiés au Liban, en Jordanie et en Turquie, où la grande majorité des réfugiés de guerre syriens ont trouvé asile, se profile la menace d'une prochaine migration de masse en direction de l'Europe, suite aux réductions drastiques de ses aides par l'ONU, la faim s'ajoutant désormais à l'absence désespérante de toute perspective.
Cependant les médias sont justement portés à sur-dramatiser les conditions déjà dramatiques et d'en rajouter encore une couche. Ainsi depuis quelques temps, le spectre d'une migration de peuples entiers hante le grand public, la télévision diffuse le scénario effroyable de millions d'Africains attendant, tous bagages prêts, de saisir la moindre occasion pour déferler et tenter leur chance en Europe. De telles assertions ne servent qu'à semer l'angoisse et la peur dans la population européenne, et, pour le moins, ne correspondent en rien aux faits. Si l'on examine de plus près les mouvements de réfugiés, on peut constater que la plus grande partie des réfugiés dans le monde cherche un abri dans les pays voisins du pays d'origine ; ce n'est que lorsque tout espoir de retour a disparu que ceux des réfugiés qui ont les moyens financiers de se le permettre, prennent la route longue et périlleuse vers l'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Australie. La rumeur d'exodes de masse en provenance d'Afrique est jusqu’alors dépourvue de tout fondement ; les migrations sur le continent noir sont largement moins chaotiques que ne le font supposer les annonces épouvantables des médias. Fréquemment, des communautés villageoises entières vendent tous les biens et avoirs mobiliers pour financer le voyage vers l'Europe d'un seul jeune homme choisi par l'ensemble de la communauté, lequel est investi de la responsabilité de soutenir le village par la suite. Voilà quel est le modèle de migration du travail éprouvé depuis des décennies.
Cependant, effrayé par le nombre croissant de réfugiés, le gouvernement fédéral se voit contraint d'agir sur les causes profondes du drame des réfugiés, comme il dit. Mais la montagne accouche d'une souris. Tout ce qui vient à l'esprit de Merkel & Co en matière de solution sur le fond à ce problème global, ce ne sont que de belles paroles et quelques centaines de millions d'euros à sortir de la caisse pour financer les camps de réfugiés en Turquie et au Liban. Pas un mot sur la responsabilité des principales nations industrielles dans la destruction des bases d'existence de l'humanité dans le tiers-monde. Laissons encore une fois la parole au Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV) qui se rapproche des véritables causes de la misère des prétendus pays en développement, même s'il comporte d'une manière ou d'une autre une imprécision (que veut-on entendre par "les Européens", qui est ce "nous"?) : "L'Europe a, pour beaucoup de ces raisons, créé les causes et continue à le faire aujourd'hui encore. Les relations politiques que les puissances coloniales européennes ont laissé derrière elles après leur retrait, y inclus les tracés de frontières arbitraires, n'en sont qu'une partie. Du 16ème au 18ème siècle, les Européens ont envahi l'Amérique du Sud, pataugeant jusqu'aux cuisses dans le sang, dévalisé par bateaux entiers l'or et l'argent qui ont servi de capital de démarrage pour l'économie en train d'éclore. Les Européens ont transformé environ 20 millions d'Africains en esclaves pour les vendre dans le monde entier. Par la vampirisation de leurs matières premières, la surpêche à blanc de leurs mers, l'exploitation de leur main-d'œuvre pour la production à moindre coût et l'exportation de produits alimentaires hautement subventionnés qui anéantit l'agriculture de ces pays, nous nous trouvons aujourd'hui encore aux crochets de la population de la plupart des pays d'émigration." (Idem)
Populisme et pogromisme
La formation des États nationaux dans les pays industrialisés au XIXe siècle reposait sur deux fondements. Le premier d'entre eux, la centralisation économique, était très rationnel ; en revanche l'autre était de nature complètement irrationnelle. La constitution en nation aux XVIIIe et XIXe siècles a eu lieu sur la base de mythes fondateurs pouvant contenir toutes sortes de récits mais qu'une idée fondamentale, un même mythe commun fictif unissait : la fable d'une grande communauté nationale, d'une famille même, se définissant par une origine commune (la "parenté du sang"), la culture et la langue. Ce trait caractéristique de la nation bourgeoise de se tourner vers l'intérieur, de se replier sur soi vis-à-vis de l'extérieur d'une part, et la tendance orientée vers l'extérieur de chaque capitaliste aspirant à la conquête du monde d'autre part, forme l'une des principales contradictions étreignant inextricablement le capitalisme.
L'actuelle crise des réfugiés montre à quel point il est délicat de concilier ces deux principes. S'il dépendait seulement des dirigeants de l'économie, le flot de réfugiés au meilleur âge de travailler ne devrait si possible jamais cesser. Cela ne leur poserait aucun problème qu'un million de réfugiés arrive annuellement. Cependant, ce qui a du sens au plan économique, peut avoir politiquement des conséquences fatales. Car, dans le capitalisme, les réfugiés ne sont pas seulement de pauvres va-nu-pieds mais en même temps des concurrents dans la lutte pour les logements, l'assistance sociale, les emplois. Ce qui n'est pas un motif d'appréhension pour les capitalistes en est un pour les allocataires Hartz IV8, les employés à bas salaire, les déracinés locaux.
Ce n'est, bien sûr, pas la première fois qu'une vague de réfugiés déferle sur l'Allemagne. Dans les cinq années de l'après-guerre (1945-50), plus de douze millions d'expulsés des anciennes provinces de l'Est et de Bohème-Moravie se dirigèrent vers l'Allemagne en ruines dont la population souffrait de privations. Il est évident qu'à cette époque, il ne pouvait être question de "culture de la bienvenue". Au contraire, les expulsés se heurtaient à une rancune, une haine et un rejet massifs de la part de la population locale. Finalement, l'intégration sociale et non seulement professionnelle des expulsés parvint à s'accomplir avec bien moins de difficultés qu'il n'était à craindre, ce qui tint à deux conditions : premièrement, au fait que les expulsés provenaient du même espace linguistique et culturel, deuxièmement, au contexte de la reconstruction qui s'enclencha (au moins en Allemagne de l'Ouest) avec la création de l'union monétaire qui aspira toute la main-d'œuvre disponible à tel point que c'étaient les patrons qui se faisaient concurrence pour la main-d'œuvre devenue rare. Aujourd'hui en revanche, les masses de réfugiés proviennent tous sans exception d'une zone culturelle et linguistique étrangère et se heurtent à une société qui, depuis de longues années, se trouve dans un mouvement de crise générale en constante aggravation où la guerre pour le partage du travail, des logements, de la formation a pris une envergure insoupçonnée, tout en catapultant des fractions de la population toujours plus importantes dans la paupérisation.
Lorsqu'à la crise générale s'ajoute le manque de perspective, l'absence d'un contre-projet social à la misère capitaliste, le populisme politique est à la noce, se nourrissant d'un phénomène que Marx a appelé "la religion de la vie quotidienne". Il s'agit de la mentalité des "petites gens" qui refuse de reconnaître que le capitalisme, à la différence des formes sociales du passé, est un système dépersonnalisé, chosifié au sein duquel le capitaliste particulier n'est pas un acteur souverain sur le marché, mais au contraire est mu par celui-ci ou, comme Engels le dit, est dominé par son propre produit, et dans lequel la classe politique est animée par les "nécessités" et non ses propres prédilections. C'est l'état d'esprit du petit-bourgeois philistin outragé qui s'insurge contre la classe dominante et vitupère "ses" représentants, mais qui finit par se jeter dans les bras de ceux qu'il invectivait il y a peu encore de "traîtres au peuple" dans l'espoir d'y trouver une protection contre les "étrangers". C'est une mentalité complètement réactionnaire célébrant le conformisme comme idéal suprême et désireuse de déchaîner des pogroms contre ceux qui pensent autrement, qui ont une autre couleur, contre tout ce qui est différent.
Le mouvement Pegida9, principalement établi dans l'Est de l'Allemagne est un exemple tout aussi parlant qu'abject de cet état d'esprit extrêmement étroit, intolérant et tartuffe. Son cri de guerre "Nous sommes le peuple" ignore complètement que la classe ouvrière, le "peuple" (pour reprendre son jargon), en Allemagne et ailleurs n'a jamais (et aujourd'hui moins encore) présenté une composition homogène telle que ce mouvement le fantasme. Son boycott de la "presse du mensonge" ainsi que ses glapissements furieux envers les partis établis (allant jusqu'à des menaces de mort envers des hommes politiques) n'illustrent que sa déconvenue quant à la "trahison" de la politique et des médias, comme si le but de ces institutions profondément bourgeoises était de restituer ou de représenter la "volonté du peuple". En réalité, leur haine débridée n’est pas dirigé contre la classe dominante mais contre les plus faibles de la société, comme le prouvent jour après jour leurs rassemblements devant les foyers de réfugiés, leurs lâches attaques contre les hébergements de réfugiés et d'étrangers. Ce qui est complètement typique du pogromisme, c'est que ce sont justement les parties de la population les moins en mesure de se défendre qui doivent leur servir de boucs-émissaires et faire les frais de leurs existences détraquées (Que l'on se réfère seulement au passé de petit criminel d'un Lutz Bachmann !)10.
Le problème du populisme et du pogromisme contraint les partis établis, en particulier les partis de gouvernement à jouer avec le feu. Ils ressemblent, dans leur action, au célèbre apprenti-sorcier qui laisse s'échapper de sa bouteille le (mauvais) génie de la panique et de la haine des étrangers, risquant ainsi d'en perdre le contrôle. Jusqu’à maintenant, au contraire de la plupart des autres États européens, la bourgeoisie allemande est parvenue à empêcher l'émergence d'un parti populiste, de gauche comme de droite, ce qui, en raison de son passé funeste, est une préoccupation particulièrement importante. Il va aussi dépendre de la manière dont la crise des réfugiés sera traitée que les choses demeurent ainsi. Tout semble indiquer que ce sont particulièrement les milieux populistes de droite qui profitent de la politique de Merkel. En plus d'AfD qui, comme nous l'avons mentionné en introduction, progresse actuellement dans les sondages d'opinion, le mouvement Pegida cité plus haut semble avoir le vent en poupe. Les "manifestations du lundi"11 à Dresde sont à nouveau fréquentées par des foules de plus de 10 000 personnes, dont le potentiel d'agression a clairement augmenté, tant par la parole que par les voies de faits.
Comment la bourgeoisie allemande s'y prend-elle avec ce problème ? Premièrement, il faut constater que, d'une part, la classe politique ne s'oppose plus aux attentats des « bas de plafond » d'extrême-droite en les banalisant et en en minimisant la gravité comme elle l'a fait jusqu'alors, mais en les qualifiant désormais de "terroristes". Cela est important dans la mesure où, en Allemagne, le terme de "terrorisme" provoque certains réflexes et des associations d'idées à la Seconde Guerre mondiale, où l'on procédait massivement à l'exécution pure et simple de prétendus saboteurs, ou bien éveille le souvenir de "l'automne allemand" de 197712 où l'on a élevé les terroristes de la RAF au rang « d'ennemi public n°1 » de l’État. En outre, en usant de l'accusation de terrorisme, l'État emploie les grands moyens pour empêcher que le harcèlement ne dépasse trop les bornes. En même temps l'AfD s'est divisée et en prend pour son grade dans les médias. Enfin, on a pu observer aussi comment politiciens et médias se sont efforcés de situer le mouvement Pegida dans la proximité du néonazisme, ce qui a toujours constitué un moyen éprouvé pour isoler socialement en Allemagne les mouvements de protestation, quelle qu'en soit la couleur.
D'autre part, les partis établis mettent tout en œuvre pour donner l'impression qu'ils comprennent les préoccupations et les angoisses de la population. Ainsi, le gouvernement fédéral tente-t-il, à coups de promesses financières et de pression morale, de décider d'autres pays de l'UE de délester l'Allemagne d'une partie des réfugiés syriens - pour l'instant sans succès. La Grande Coalition a concocté à toute vitesse une loi permettant la reconduite immédiate aux frontières ("beschleunigtes Abschiebeverfahren") et a réalisé le tour de force de commencer à l'appliquer avant même qu'elle n'entre en vigueur, uniquement dans le but de pouvoir prêcher auprès de l'électorat qu'on le protège contre la "sur-colonisation étrangère" (Überfremdung)13 . Au sein du gouvernement, il est déjà question d'un taux de reconduite aux frontières de 50% des réfugiés arrivant en Allemagne. Ce sont essentiellement le président de la CSU Seehofer et son secrétaire général Söder qui, dans ce processus où il existe un partage du travail, assument le rôle des "bad guys" et réclament avec véhémence la fermeture des frontières ainsi que la limitation du droit d'asile inscrit dans la Constitution.
Les conséquences pour la situation de la classe ouvrière
En un certain sens, ces différentes conceptions au sein de la Coalition reflètent l'état d'esprit diffus existant dans la population, c'est-à-dire parmi les salariés et les chômeurs de ce pays. Il y a une minorité croissante et fortement bruyante au sein de la population en général et de la classe ouvrière en particulier, faisant plutôt partie de sa composante la moins qualifiée, le plus souvent socialisée dans le contexte de l'ex-RDA et/ou vivant des allocations étatiques, qui forme un terrain sensible aux campagnes antimusulmanes de certains chantres du monde de la politique ou de la culture (Sarrazin, Broder, Pirinçci, Buschkowsky, etc.) et dont les porte-paroles sont la CSU et certains secteurs de la CDU14. Et il y a la majorité silencieuse, qui, jusque lors avait laissé à de jeunes activistes, la plupart venant du milieu antifasciste, le soin de faire pièce au harcèlement raciste sous forme de blocages de rues et de contre-manifestations et qui s'est alors sentie obligée, au vu des images de misère des Balkans, d'exprimer fortement sa protestation contre l'inaction des États européens et son indignation vis-à-vis des exactions contre les étrangers à Dresde, Heidenau et Freital, applaudissant ostensiblement les réfugiés en leur faisant des haies d'honneurs à leurs arrivée dans les gares de Munich, Francfort ou d'ailleurs, ou en s'engageant par milliers en tant que bénévoles pour la gestion des masses de réfugiés ou en inondant les centres d'accueil de dons de toutes sortes.
La solidarisation spontanée de vastes parties de la population a, par sa force, surpris la classe dominante et l'a prise à contre-pied ; cette dernière n'étant pas disposée à promouvoir la sympathie envers les réfugiés de guerre mais plutôt à créer une atmosphère de panique et d'isolement. Cependant, Merkel révéla à nouveau son flair infaillible pour sentir les ambiances et les états d'âme au sein de la société. Exactement comme lors de l'accident nucléaire majeur (Grösster anzunehmender Unfall - GAU) de la centrale de Fukushima, où, pratiquement du jour au lendemain, elle s'est débarrassée des règles d'or des conservateurs en matière d'énergie atomique, Merkel a pris un même tournant abrupt en matière de politique d'asile résiliant au passage l'accord de Dublin qui avait jusque maintenant permis à la bourgeoisie allemande de se défausser élégamment de toute responsabilité par rapport aux réfugiés venus s'échouer en Italie et dans les autres pays de l'UE à 'frontières extérieures'.
Nous avons déjà mentionné quelques-uns des mobiles qui ont poussé Merkel à adopter sa "politique des frontières ouvertes". Il est cependant possible qu'un autre motif ait joué un rôle dans cette politique à risque. Depuis les élections au Bundestag de 2005, où la victoire qui lui paraissait acquise lui échappa parce que le chancelier en exercice Schröder était parvenu à instrumentaliser contre elle le tournant libéral qu'elle avait inauguré au congrès de Leipzig de la CDU en 2003, elle a appris quelles conséquences peut avoir la tendance des représentants politiques à ne pas tenir compte de l'état d'esprit "à la base". Imaginons quel impact auraient pu avoir les images de centaines de milliers de réfugiés abandonnés à la frontière hongroise, ainsi que les gros titres qui, dans cette éventualité, se seraient étalés pendant des mois, sur le comportement électoral de ceux qui souhaitent aujourd'hui la bienvenue aux réfugiés de guerre de Syrie.
Selon toute apparence, deux groupes dans la population sont particulièrement impliqués dans la solidarisation avec les réfugiés. D'une part des jeunes, qui, à d'autres moments et en autres lieux auraient tout aussi bien pu participer au mouvement anti-CPE ou à celui des Indignés. D'autre part, des gens plus âgés qui, ou bien du fait leur expérience propre, ou bien de par la tradition transmise par leurs parents concernant les expulsés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, savent ce qu'est le sort des réfugiés et ne peuvent être indifférents aux camps, aux barbelés et aux déportations. Ayant grandi dans les sombres décennies du XXe siècle, cette génération est impulsivement poussée à agir différemment aujourd'hui. L'importante participation de retraités témoigne de quelque chose d'autre encore : le profond désir de rajeunissement de la société, de présence d'enfants et d'adolescents chez de nombreuses personnes âgées. Ce désir de rajeunissement se distingue de la demande de main-d'œuvre jeune de l'économie allemande. Le vieillissement de la société constitue un problème central non seulement pour le capitalisme mais tout bonnement pour l'humanité, car l'absence de jeunesse ne signifie pas seulement une privation d'une source de joie et vivre et de vitalisation pour les vieux mais bien plus la mise à mal de l'une des fonctions les plus importantes dans l'évolution de l'humanité : la transmission du trésor d'expériences à la génération des petits-enfants.
Au final, se pose la question si cette vague de solidarisation forme un mouvement de classe. Nous pensons qu'il n'en possède aucune des caractéristiques. Ce qui saute aux yeux, c'est son caractère complètement apolitique ; et, au contraire, la solidarité qui se manifeste a un caractère complètement caritatif. Il n'y a quasiment aucune discussion, aucun échange d'expériences entre jeunes et vieux, entre natifs et réfugiés (en dernier lieu aussi du fait de la barrière de la langue). Tout point de départ pour une auto-organisation, pour des structures autonomes, extra-étatiques fait défaut ; au lieu de cela, les centaines de milliers de bénévoles se font les hommes de peine d'un État qui, en dépit des gesticulations pour la galerie de Merkel, manque de tout et dont les représentants après avoir mené les bénévoles à l'épuisement par leur propre inaction rabâchent désormais leurs discours sur les "limite des capacités".
Encore une fois, la vague de solidarisation qui a traversé l'Allemagne les semaines passées ne s'est pas déroulée sur un terrain de classe. La population laborieuse, sujet principal de la solidarité, s'est dissoute presque sans laisser de traces dans le "peuple". C'était aussi le cas lors du mouvement mondial de solidarité en faveur des victimes du tsunami de 2004. Alors, comme aujourd'hui, la solidarité était dépourvue de tout caractère de classe et s'exprima dans le cadre d'une campagne interclassiste. Cependant, à la différence du tsunami qui s'est produit très loin en Asie, la misère des réfugiés se développe sous nos yeux à notre porte, si bien que la solidarité et tout ce qui la concerne prennent une toute autre dimension.
En fait, la crise des réfugiés qui ne fait que juste commencer peut devenir une question décisive pour la classe ouvrière. Il n'est pas encore fixé comment la classe ouvrière, ou plutôt ses parties prépondérantes au plan national comme international, vont régir à cet enjeu : par le développement de la solidarité ou par la démarcation et l'exclusion. Si notre classe parvient à retrouver son identité de classe, la solidarité peut être un important moyen unificateur dans sa lutte. Si par contre, elle ne voit dans les réfugiés que des concurrents et une menace, si elle ne parvient pas à formuler une alternative à la misère capitaliste, permettant à tout individu de ne plus être contraint de fuir sous la menace de la guerre ou de la faim, alors nous serions sous la menace d'une extension massive de la mentalité pogromiste, dont le prolétariat en son cœur ne saurait être épargné.
FT, 07/11/2015
1 Alternative pour l'Allemagne est un parti eurosceptique créé en 2013, suite aux politiques présentées comme sans alternatives menées lors de la crise de la dette dans la zone euro, il est surnommé le « parti des professeurs » car comptant parmi ses membres fondateurs de très nombreux professeurs d'économie, de finances publiques et de droit. Se présentant comme anti-euro mais pas anti-Europe, sa proposition phare est la dissolution progressive de la zone euro. Les membres du parti (qui se revendique d'être "ni de droite ni de gauche") sont unis par le sentiment que l'Allemagne a trop payé pour les autres, notamment dans les fonds de secours pour la zone euro, et réclament le retour du Mark. Il ne demande pas tant que l'Allemagne quitte la zone euro, mais que ceux qui ne respectent pas la discipline budgétaire puissent le faire (d’après Wikipédia). (NdT)
2 Ministre de l'Économie (NdT)
3 Angela Merkel étant la personnalité servant alors de cible favorite de toutes les critiques. (NdT)
4 Handelsblatt, 9 octobre 2015.
5 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF
6 Les femmes des décombres désignent les femmes allemandes et autrichiennes, souvent veuves ou dont les maris sont absents (soldats prisonniers, disparus ou invalides), qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, reprennent les villes en main et entreprennent leur déblaiement et la reconstruction du pays (d’après Wikipédia). (NdT)
7 Le Wirtschaftswunder (le « miracle économique ») désigne, dans l'histoire économique de l'Allemagne, la rapide croissance économique en Allemagne de l'Ouest (RFA) et en Autriche après la Seconde Guerre mondiale (d’après Wikipédia). (NdT)
8 Les réformes Hartz (du nom de leur inspirateur) sont les réformes du marché du travail prétendument « de lutte contre le chômage en vue d'améliorer le retour à l’activité des bénéficiaires d'allocations » adoptées entre 2003 et 2005 sous le mandat du chancelier socialiste G. Schröder et mises en place sous la forme de quatre lois dont la plus importante est la loi Hartz IV. (NdT)
9 Abréviation de « Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes » (Patriotes Européens contre l'Islamisation de l'Occident) , mouvement d'extrême- droite contre l'immigration islamique en Allemagne. Le mouvement a été lancé le 20 octobre 2014 par Lutz Bachmann et une douzaine de personnes. (d’après Wikipédia) (NdT)
10 Organisateur du mouvement anti-islamisation Pegida de 2014 jusque début 2015. Ancien braqueur, il est condamné à trois ans et demi de prison ferme pour seize cambriolages perpétrés dans les années 1990. Il s'enfuit en Afrique du Sud et prend une fausse identité avant d'être extradé. Il est ensuite condamné pour trafic de stupéfiants (d’après Wikipédia). (NdT)
11 Depuis le mois d'octobre 2014, le mouvement Pegida manifeste chaque lundi à 18h30 dans un parc de la ville de Dresde contre la politique d'asile du gouvernement et « l'islamisation de l'Allemagne ». (NdT)
12 L'automne allemand a été un ensemble d'événements de la fin de 1977 associés à l'enlèvement par le groupe terroriste Fraction Armée Rouge (RAF) de l'industriel et "patrons des patrons allemands" Hans Martin Schleyer et au détournement du Boeing de la Lufthansa "Landshut" par le Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP). L'automne allemand a pris fin le 18 octobre avec la prise d'assaut par un commando des forces spéciales allemandes du "Landshut" sur l'aéroport de Mogadiscio, la mort de Schleyer et des figures de proue de la première génération de la RAF dans leur prison de Stammheim. Le chancelier social-démocrate Helmut Schmidt avait déclaré que "les ravisseurs [étaient] l'équivalent des nazis." (NdT)
13 Ce terme allemand difficile à rendre en français est souvent repris dans la presse tel quel sans le traduire. Dans le langage politique bourgeois, il a pris depuis les années 70 toute une palette de nuances. Actuellement, il prend plutôt l'acception de «proportion ‘excessive’ d'étrangers» et une nette coloration xénophobe. (NdT)
14 On appelle CDU/CSU la force politique formée en Allemagne au plan fédéral par les deux « partis-frères » de la droite démocrate-chrétienne et conservatrice, l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), présente dans tous les Länder sauf en Bavière, et l'Union chrétienne-sociale (CSU), présente en Bavière seulement.
Récent et en cours:
- réfugiés [1]
Rubrique:
ICConline - mars 2016
- 1091 reads
La classe ouvrière et les guerres du capitalisme en décomposition
- 1678 reads
Il y a un siècle, le premier mai 1916, sur la place de Postdam à Berlin, le révolutionnaire internationaliste Karl Liebknecht donnait la réponse de la classe ouvrière à la guerre qui dévastait l’Europe et massacrait toute une génération du prolétariat. Devant une foule de quelques 10 000 ouvriers qui manifestaient en silence contre les privations qui étaient une des conséquences obligée de la guerre, Liebknecht décrit l’angoisse des familles de prolétaires qui sont confrontées à la mort au front, à la famine chez eux, en finissant son discours (qui avait aussi été reproduit et distribué dans la manifestation sous forme de tract) en brandissant le mot d’ordre « à bas la guerre » et « à bas le gouvernement », ce qui a immédiatement provoqué son arrestation malgré les efforts de la foule pour le défendre. Mais le procès de Liebknecht, le mois suivant, s’est accompagné d’une grève de 55 000 ouvriers dans les industries d’armement, menée par une nouvelle forme d’organisation sur les lieux de travail, les syndicats de base révolutionnaires. Cette grève, à son tour, a été défaite, beaucoup de ses meneurs étant envoyés au front. Mais cette grève et d’autres luttes qui bouillonnaient au sein des deux camps en guerre étaient les germes de la vague révolutionnaire qui allait éclater en Russie en 1917 et revenir en Allemagne un an plus tard, obligeant la classe dominante, terrifiée par la propagation du « virus rouge » à mettre fin à la tuerie.i
Mais ce n’était qu’un arrêt temporaire, parce que la vague révolutionnaire n’a pas mis fin au capitalisme déclinant et à sa dérive inévitable vers la guerre. L’accord de paix « des prédateurs » imposé à l’Allemagne par les vainqueurs mettait déjà en mouvement un processus qui – sous le fouet de la crise économique mondiale des années 1930 – allait plonger le monde dans un holocauste encore plus destructeur en 1939-1945. Même avant que cette guerre ne soit finie, les lignes de front d’une autre guerre mondiale étaient déjà fixées, avec l’Amérique d’un côté et l’URSS de l’autre, des blocs militaires rivaux établis qui allaient manœuvrer pendant les 4 ou 5 décennies suivantes pour des positions à travers toute une série de conflits locaux : Corée, Vietnam, Cuba, Angola, guerres arabo-israéliennes…
Cette période – la soi-disant « guerre froide » qui n’était pas si froide pour des millions de gens qui sont morts sous le drapeau de la « libération nationale », ou la défense du « monde libre contre le communisme » - fait partie de l’histoire, mais la guerre elle-même est plus répandue que jamais. La désintégration des blocs impérialistes après 1989 n’a pas, en dépit des promesses des politiciens et de leurs philosophes appointés, mené à un « nouvel ordre mondial » ou à la « fin de l’histoire » mais à un désordre mondial grandissant, à une succession de conflits chaotiques qui portent en eux une menace pour la survie de l’humanité, comme le spectre de la troisième guerre mondiale avec l’arme nucléaire qui pesait sur la période précédente.
Nous nous trouvons donc en 2016 confrontés à tout un éventail de guerres, de l’Afrique, jusqu’à l’Asie centrale, en passant par le Moyen Orient ; avec des tensions croissantes en Orient où le géant chinois se dresse contre ses rivaux japonais et surtout américain ; avec un feu actif qui couve en Ukraine où la Russie cherche à regagner la gloire impérialiste qu’elle a perdue avec l’écroulement de l’URSS.
Comme la guerre en ex-Yougoslavie, un des premiers conflits majeurs dans la période « post-blocs », la guerre en Ukraine a lieu aux portes mêmes de l’Europe, proche des bastions classiques du capitalisme mondial, et donc des plus importantes fractions de la classe ouvrière internationale. Les flux de réfugiés qui cherchent à s’échapper des zones de guerre en Syrie, Irak, Libye, Somalie ou Afghanistan, fournissent une preuve de plus que l’Europe n’est pas une île coupée du cauchemar militaire qui s’est abattu sur une grande partie de l’humanité. Au contraire, les classes dominantes des pays centraux du capitalisme, des « grandes démocraties », ont été un élément actif dans la prolifération des guerres dans cette période, avec toute une série d’aventures militaires à la périphérie du système, depuis la première guerre du golfe en 1991 jusqu’à l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak au début du 21ème siècle et aux campagnes de bombardements plus récentes en Libye, Irak et Syrie. Ces aventures ont en retour mis un coup de pied dans le nid de frelons du terrorisme islamique, qui n’a cessé de prendre une revanche sanglante contre les centres capitalistes, depuis les attaques contre les Twin Towers en 2001 jusqu’au massacre à Paris en 2015.
La classe ouvrière en tant que frein à la guerre
Si la crise des réfugiés et les attaques terroristes nous rappellent constamment que la guerre n’est pas une réalité « étrangère », l’Europe et les Etats-Unis apparaissent encore comme des « paradis » comparés à une bonne partie du monde. Cela se voit dans le fait même que les victimes des guerres en Afrique ou au Moyen-Orient – ou de la pauvreté qui les broie et des guerres de la drogue au Mexique et en Amérique Centrale – sont prêtes à risquer leurs vies pour accéder aux rivages de l’Europe ou à traverser la frontière américaine. Et certainement, malgré toutes les attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière qu’on a connues au cours des dernières décennies, malgré la croissance de la pauvreté et de l’exclusion liée au logement dans les grandes villes d’Europe et des Etats-Unis, les conditions de vie moyennes du prolétariat paraissent encore comme un rêve inaccessible à ceux qui ont été directement soumis aux horreurs de la guerre – un contraste frappant avec la période 1914-1945.
Est-ce parce que les gouvernants ont appris des leçons de 1914-18 ou de 1939-45 et ont constitué de puissantes organisations internationales, que la guerre entre les grands pouvoirs est impensable ?
Il y a eu bien sur d’importants changements dans le rapport de force entre grandes puissances depuis 1945. Les Etats-Unis sont sortis de la 2ème guerre mondiale comme les réels vainqueurs et ont été à même d’imposer leurs conditions aux puissances prostrées d’Europe : plus de guerres entre puissances d’Europe de l’Ouest, mais cohésion économique et militaire en tant que partie du bloc impérialiste sous la houlette des Etats-Unis pour faire face à la menace de l’URSS. Même si le bloc occidental a perdu cette raison majeure de son existence après la chute de l’URSS et de son bloc, l’alliance entre les ex-rivaux acharnés au cœur de l’Europe – France et Allemagne – s’est maintenue relativement fermement.
Tout cela et d’autres éléments entrent dans l’équation et on peut en prendre connaissance dans le travail des historiens académiques et des politologues. Mais il y a un élément clef dont les commentateurs bourgeois ne parlent jamais. C’est la vérité contenue dans les premières lignes du Manifeste Communiste : que l’histoire est l’histoire de la lutte des classes, et que toute classe dominante digne de ce nom ne peut se permettre d’ignorer la menace potentielle que constitue la grande masse de l‘humanité qu’elle exploite et opprime. C’est particulièrement pertinent quand il s’agit de faire la guerre, parce que la guerre capitaliste plus que toute autre chose, requiert la soumission et le sacrifice du prolétariat.
Dans la période avant et après 1914, les classes dominantes en Europe ont toujours eu l’inquiétude qu’une grande guerre n’entraine une réponse révolutionnaire de la classe ouvrière. Elles ne se sentaient assez confiantes pour faire les derniers pas fatals vers la guerre que quand elles avaient l’assurance que les organisations que la classe ouvrière avait construites pendant des décennies, les syndicats et les partis socialistes, n’allaient plus adhérer à leurs déclarations internationalistes officielles et allaient en fait les aider à envoyer les ouvriers sur les champs de bataille. Comme nous l’avons déjà souligné, la même classe dominante (même si elle devait, dans certains cas, prendre une nouvelle forme, comme en Allemagne, où les « socialistes » ont remplacé le Kaiser) a été obligée de mettre fin à la guerre pour bloquer le danger d’une révolution mondiale.
Dans les années 1930, une nouvelle guerre se préparait grâce à une défaite bien plus brutale et systématique de la classe ouvrière – pas seulement via la corruption des ex-organisations révolutionnaires qui s’étaient opposées à la trahison des socialistes, pas seulement grâce à la mobilisation idéologique de la classe ouvrière sur la « défense de la démocratie » et de « l’antifascisme », mais aussi grâce à la terreur non déguisée du fascisme et du stalinisme. L’imposition de cette terreur a été aussi prise en main par les démocraties à la fin de la guerre : quand les possibilités de révoltes de la classe ouvrière se sont vues en Italie et en Allemagne, les Anglais en particulier, se sont assurés qu’elles n’atteindraient jamais les sommets d’un nouveau 1917, avec des frappes aériennes massives sur des concentrations ouvrières ou en donnant du temps aux bourreaux fascistes pour éliminer le danger sur le terrain.
Le boom économique qui suivit la 2ème Guerre mondiale et le déplacement des conflits impérialistes aux marges du système signifiaient qu’un conflit direct entre les deux blocs dans la période allant de 1945 à 1965 pouvait être évité, même s’il a été dangereusement proche à certains moments. Dans cette période, la classe ouvrière n’avait pas encore récupéré de sa défaite historique et n’était pas un facteur majeur dans le blocage de la marche à la guerre. La situation a cependant changé après 1968. La fin du boom d’après-guerre a été confrontée par une nouvelle génération de la classe ouvrière qui n’était pas défaite et qui s’est engagée dans une série de luttes importantes, dont le signal a été la grève générale en France en 1968 et « l’automne chaud » en Italie en 1969. Le retour de la crise économique ouverte a aiguisé les tensions impérialistes et donc le danger d’un conflit direct entre les blocs, mais ni d’un côté ni de l’autre des camps impérialistes, la classe dominante ne pouvait être sure qu’elle serait capable de persuader les ouvriers d’arrêter de lutter pour leurs propres intérêts matériels et de tout abandonner pour une nouvelle guerre mondiale. La grève de masse en Pologne en 1980 l’a fortement démontré. Bien qu’elle ait été finalement défaite, elle montrait clairement aux fractions les plus intelligentes de la classe dominante russe qu’ils ne pourraient jamais compter sur les travailleurs de l’Europe de l’Est (et probablement pas sur ceux en Russie même, qui avaient aussi commencé à lutter contre les effets de la crise), pour faire partie d’une offensive militaire désespérée contre l’occident.
Cette incapacité à faire adhérer la classe ouvrière à ses projets de guerre a donc été un élément essentiel dans l’éclatement des deux blocs impérialistes et le report de toute perspective d’une 3ème guerre mondiale classique.
Si la classe ouvrière, même quand elle n’a pas encore pris conscience du réel projet historique qui lui soit propre, peut avoir un poids aussi important dans la situation mondiale, cela doit surement être pris en compte quand on considère les raisons pour lesquelles le flux des guerres n’a pas encore atteint les pays centraux du capitalisme ? Nous devons aussi considérer la question sous un autre angle : s’il y a tant de barbarie et de destructions irrationnelles qui déferlent sur l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie centrale, n’est ce pas parce que la classe ouvrière y est faible, parce qu’elle a peu de traditions de lutte et de politique de classe indépendante, parce qu’elle est dominée par le nationalisme, par le fondamentalisme religieux – et aussi par les illusions qu’en parvenant à la « démocratie », un pas en avant serait fait ?
On peut mieux le comprendre en examinant le sort des révoltes qui ont balayé le monde arabe (et Israël…) en 2011. Dans les mouvements qui présentaient la plus forte empreinte de la classe ouvrière, même s’ils impliquaient différentes couches de la population, - Tunisie, Egypte et Israël – il y a eu des avancées importantes dans la lutte : tendances à l’auto-organisation et aux assemblées de rue, à abolir les divisions religieuses, ethniques et nationales. Ce furent ces éléments qui allaient inspirer les luttes en Europe et aux Etats-Unis la même année, et surtout le mouvement des Indignés en Espagne. Mais le poids de la classe dominante, l’idéologie sous la forme de nationalisme, de religion et les illusions sur la démocratie bourgeoise étaient encore très fortes dans chacune de ces trois de révoltes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les amenant à de fausses solutions, comme en Egypte où, après la chute de Moubarak, un gouvernement islamiste répressif a été remplacé par un gouvernement militaire encore plus répressif. En Libye et en Syrie, où la classe ouvrière est beaucoup plus faible et n’a eu que peu d’influence sur les révoltes au début, la situation a rapidement dégénéré dans des conflits militaires multiples, alimentés par des puissances régionales et mondiales qui cherchent à avancer leurs pions (comme on l’a décrit iciii, et iciiii). Dans ces pays, la société elle-même s’est désintégrée, démontrant de façon très illustrative ce qui peut arriver si les tendances d’un capitalisme sénile à l’autodestruction ne sont pas freinées. Dans une telle situation, tout espoir d’une réponse prolétarienne est perdu, et c’est pourquoi la seule solution pour tant de gens est d’essayer de s’en sortir, de fuir les zones de guerre, quels que soient les risques.
La nécessité d’une perspective prolétarienne
Dans la période entre 1968 et 1989, la lutte de classe a été un obstacle à la guerre mondiale. Mais aujourd’hui, la menace de guerre prend une forme différente et plus insidieuse. Pour embrigader la classe ouvrière dans deux grands blocs organisés, la classe dominante aurait besoin à la fois de briser toute résistance au niveau économique et d’entraîner la classe ouvrière derrière des thèmes idéologiques qui justifient un nouveau conflit mondial. En bref, cela exigerait la défaite idéologique et physique de la classe ouvrière, de façon similaire à ce que le capitalisme avait réussi à faire dans les années 30. Aujourd’hui, cependant, en l’absence de blocs, la propagation de la guerre peut prendre la forme d’un glissement graduel, sinon accéléré, dans une myriade de conflits locaux et régionaux qui impliquent de plus en plus de puissances locales, régionales et, derrière elles, mondiales, ravageant de plus en plus des parties de la planète et qui – combinés avec la destruction rampante de l’environnement naturel et du tissu même de la vie sociale – pourraient signifier une descente irréversible dans la barbarie, éliminant une fois pour toute et pour tous la possibilité de faire passer la société à un niveau supérieur.
Ce processus, que nous décrivons comme la décomposition du capitalisme, est déjà bien avancé dans des endroits comme la Libye et la Syrie. Pour empêcher que ce niveau de barbarie ne s’étende aux centres du capitalisme, la classe ouvrière a besoin de plus qu’une force passive – et plus qu’une simple résistance sur le plan économique. Elle a besoin d’une perspective politique positive. Elle a besoin d’affirmer la nécessité d’une nouvelle société pour le communisme authentique préconisé par Marx et tous les révolutionnaires dans son sillage. Aujourd’hui, il semble qu’il y ait peu de signes de l’émergence d’une telle perspective. La classe ouvrière a traversé une longue et difficile expérience depuis la fin des années 1980 : des campagnes intenses de la bourgeoisie sur la mort du communisme et la fin de la lutte de classe ont été menées contre toute idée que la classe ouvrière puisse avoir son propre projet pour la transformation de la société. En même temps, l’avancée sans répit de la décomposition ronge les entrailles de la classe, sapant sa confiance dans le futur, engendrant le désespoir, le nihilisme, toutes sortes de réactions désespérées depuis l’addiction à la drogue jusqu’au fondamentalisme religieux et à la xénophobie. La perte d’illusions dans les partis « ouvriers » traditionnels, en l’absence d’alternative claire, a accru l’éloignement de la politique ou a donné un élan à de nouveaux partis populistes de droite et de gauche. Malgré une certaine revitalisation des luttes entre 2003 et 2013, le reflux de la lutte de classe et de la conscience de classe, qui était palpable dans les années 1990, semble maintenant encore plus enraciné.
Ce ne sont pas les seules difficultés auxquelles fait face la classe ouvrière. Aujourd’hui, le prolétariat, à la différence de 1916, ne fait pas face à une situation de guerre mondiale dans laquelle toute forme de résistance est obligée de prendre un caractère politique dès le début, mais à une crise économique qui s’approfondit lentement, managée par une bourgeoisie très sophistiquée qui a jusqu’à maintenant réussi à épargner aux ouvriers des centres du système les pires effets de la crise et, surtout, une implication massive dans un conflit militaire. D’ailleurs, quand il s’agit d’une intervention militaire dans les régions périphériques, la classe dominante des centres est très prudente, n’employant que des forces professionnelles et même en préférant ensuite les frappes aériennes et les drones pour minimiser la perte en vies de soldats qui peut mener à la contestation dans l’armée et chez elle.
Une autre différence importante entre 1916 et aujourd’hui : en 1916, des dizaines de milliers d’ouvriers ont fait grève en solidarité avec Liebknecht. Il était connu des ouvriers parce que le prolétariat, malgré la trahison de l’aile opportuniste du mouvement ouvrier en 1914, n’avait pas perdu le contact avec toutes ses traditions politiques. Aujourd’hui, les organisations révolutionnaires sont une minuscule minorité pratiquement inconnue dans la classe ouvrière. C’est encore un autre facteur qui inhibe le développement d’une perspective politique révolutionnaire.
Avec tous ces facteurs apparemment accumulés contre la classe ouvrière, est-ce que cela a encore un sens de penser qu’un tel développement est possible aujourd’hui ?
Nous avons décrit la phase actuelle de décomposition comme la phase finale de la décadence du capitalisme. En 1916, le système entrait seulement dans son époque de déclin et la guerre s’est produite bien avant que le capitalisme ait épuisé toutes ses possibilités économiques. Au sein de la classe ouvrière, il y avait encore de profondes illusions sur l’idée que si on pouvait seulement mettre fin à la guerre, il serait possible de revenir à l’époque du combat pour des réformes graduelles au sein du système – illusions sur lesquelles a joué la classe dominante en mettant fin à la guerre et en installant le parti social-démocrate au pouvoir dans un pays central comme l’Allemagne.
Aujourd’hui, la décadence du capitalisme est beaucoup plus avancée et le manque d’un futur assuré ressenti par beaucoup est une réelle réflexion sur l’impasse du système. La bourgeoisie n’a manifestement aucune solution à la crise économique qui traîne depuis plus de quatre décennies, aucune alternative au glissement dans la barbarie militaire et à la destruction de l’environnement. En bref, les enjeux sont encore plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a cent ans. La classe ouvrière est face à un énorme défi – la nécessité de donner sa propre réponse à la crise économique, à la guerre et au problème des réfugiés, de donner une nouvelle vision des rapports de l’homme avec la nature. Le prolétariat a besoin de plus qu’une simple série de luttes sur ses lieux de travail – il a besoin de faire une critique totale de tous les aspects de la société capitaliste, à la fois théoriquement et pratiquement. Il n’est pas étonnant que la classe ouvrière, confrontée à la perspective offerte par la société capitaliste et à la difficulté immense de dégager sa propre perspective, tombe dans le désespoir. Et cependant, nous avons vu des lueurs d’un mouvement qui commence à chercher cette alternative, surtout le mouvement des Indignés en Espagne qui, en 2011, a ouvert la porte non seulement à l’idée d’une nouvelle forme d’organisation sociale – contenue dans le mot d’ordre « tout le pouvoir aux assemblées » - mais aussi à s’instruire lui-même sur le système qu’il remettait en question et avait besoin de remplacer.
La nouvelle génération de prolétaires qui ont mené cette révolte est sans doute encore extrêmement inexpérimentée, manque de formation politique et ne se voit pas elle-même comme classe ouvrière. Cependant les formes et les méthodes de lutte qui sont apparues dans ces mouvements – telles que les assemblées – étaient souvent profondément enracinées dans les traditions des luttes de la classe ouvrière. Et même plus important encore, le mouvement en 2011 a vu l’émergence d’un internationalisme authentique, expression du fait que la classe ouvrière d’aujourd’hui est plus globale qu’elle ne l’était en 1916 ; qu’elle fait partie d’un immense réseau de production, distribution et communication, qui relie toute la planète ; et qu’elle partage la plupart des mêmes problèmes fondamentaux dans tous les pays, en dépit des divisions que la classe exploiteuse essaie toujours d’imposer et de manipuler. Les Indignés étaient très conscients qu’ils repartaient de là où les révoltes au Moyen-Orient en étaient restées, et certains d’entre eux se voyaient même comme faisant partie d’une « révolution mondiale » de tous ceux qui sont exclus, exploités et oppressés par cette société.
Cet internationalisme embryonnaire est extrêmement important. En 1916-17, l’internationalisme était quelque chose de très concret et d’immédiat. Il prenait la forme de fraternisation entre soldats d’armées ennemies, de désertion de masse, de mutineries, de grèves et de manifestations contre la guerre sur le front intérieur. Ces actions étaient la réalisation pratique des mots d’ordre mis en avant par les minorités révolutionnaires quand la guerre a éclaté : « l’ennemi principal est dans notre pays » et « transformation de la guerre impérialiste en guerre civile ».
Aujourd’hui, l’internationalisme commence souvent sous des formes plus négatives et abstraites en apparence : dans la critique du cadre bourgeois de l’Etat-nation pour résoudre le problème de la guerre, du terrorisme et des réfugiés ; dans la reconnaissance de la nécessité d’aller au-delà des Etats- nations concurrents pour surmonter les crises économiques et écologiques. Mais, à certains moments, il peut prendre une forme plus concrète : dans les liens internationaux à la fois physiques et numériques, entre participants des révoltes de 2011 ; dans des actes spontanés de solidarité envers les réfugiés de travailleurs dans les pays centraux, souvent en bravant la propagande xénophobe de la bourgeoisie. Dans certaines parties du monde, bien sûr, la lutte directe contre la guerre est une nécessité, et là où existe une classe ouvrière significative, comme en Ukraine, nous avons vu des signes de résistance à la conscription et des manifestations contre les restrictions causées par la guerre, bien qu’ici encore, le manque d’une opposition prolétarienne cohérente au militarisme et au nationalisme ait sérieusement affaibli la résistance à la marche à la guerre.
Pour la classe ouvrière des pays centraux, l’implication directe dans la guerre n’est pas à l’ordre du jour immédiatement, et la question de la guerre peut encore sembler éloignée des préoccupations de tous les jours. Mais comme l’ont déjà montré la « crise des réfugiés » et les attaques terroristes dans ces pays, la guerre va devenir de plus en plus un souci quotidien pour les ouvriers des pays centraux du capital, qui sont les mieux placés, d’un côté, pour approfondir leur compréhension des causes sous-jacentes de la guerre et de sa connexion avec la crise globale, historique, du capitalisme ; et de l’autre côté pour frapper la bête au cœur, les pays centraux du système impérialiste.
Amos, 16.1.16
i Pour une vision plus en profondeur de ces événements, voir la Revue Internationale n°133 : « Allemagne 1918-19. Il y a 90 ans, la révolution allemande : face à la guerre le prolétariat renoue avec ses principes internationalistes [2] »
Questions théoriques:
- Décomposition [4]
- Guerre [5]
Rubrique:
Loi « Travail »: contre la loi El Khomri et la dénaturation de la lutte anti-CPE !
- 1656 reads
Dans ses interventions, comme pour bien d'autres personnalités, le porte-parole du PCF, Olivier Dartigolles, disait à propos du mouvement contre la loi « Travail » de la ministre El Khomri : « on va peut-être vers un mouvement type CPE... » Cette référence au CPE est effectivement très présente dans les médias et dans certains discours de syndicalistes. Il y a tout juste 10 ans se déployait un vaste mouvement de la jeunesse ouvert aux salariés, chômeurs et précaires, contre le CPE, qui avait conduit, fait assez unique depuis des années, à un recul du gouvernement, l'obligeant même à abandonner son projet. Ce mouvement de 2006 fut un affront pour la bourgeoisie française. Depuis, elle fait tout pour en effacer les traces en dénaturant chaque fois que possible la signification de ce que fut cette lutte. Ces traces sont en effet porteuses d'expériences et ont marqué les mémoires au sein de la classe ouvrière : aujourd'hui encore, avec bonheur, ceux qui, à l'époque, y ont participé le commémore alors que les plus jeunes cherchent à savoir ce que fut cette expérience, et cela, toute proportion gardée, un peu comme pour Mai 68 qui a laissé son empreinte dans les esprits.
Il n'est ainsi pas étonnant que la référence au mouvement anti-CPE soit assortie de contre-vérités. Un tel battage publicitaire aujourd'hui, dans la bouche de nos ennemis de classe bourgeois, de ceux qui veulent cette « réforme » à l'encontre des exploités, ne sert qu'une propagande destinée à faire passer l'attaque et à dénaturer au passage les leçons de ce mouvement anti-CPE contre la conscience ouvrière.
La première contre-vérité, c'est que les conditions du développement de ce mouvement de 2016 seraient similaires à celles de 2006, que les syndicats auraient été les promoteurs combatifs du mouvement anti-CPE et qu'ils seraient finalement encore aujourd'hui les seuls garants d'une lutte « efficace » et « victorieuse ». Mensonges ! La réalité est que le mouvement anti-CPE avait spontanément été pris en main dès le début par les étudiants eux-mêmes, en dehors et contre les directives syndicales qui faisaient alors profil bas pour tenter de « prendre le train en marche » (bon nombre de jeunes bureaucrates syndicalistes, voulant animer les AG, se faisaient d’ailleurs souvent éjecter, parfois manu-militari, par les participants, sur décision des mêmes AG). En essayant de faire oublier cela et en vantant « l'exemplarité » de la lutte anti-CPE, les syndicats se présentent donc comme les véritables artisans de cette lutte, redorant frauduleusement leur image à bon compte.
La deuxième contre-vérité est celle qui consiste à faire croire qu'il serait possible, dans l'état actuel du rapport de force politique entre les classes, de faire reculer le gouvernement. Rien n'est plus faux que d'affirmer que ce dernier serait « acculé ». En réalité, l'initiative du mouvement par les centrales syndicales a non seulement pour objet de dénaturer la lutte anti-CPE, mais aussi de permettre aux syndicats de tenter faire oublier leur complicité avec le PS et le gouvernement Hollande dans toutes les attaques qui ont été menées. Contrairement à l'ère Sarkozy, où ils pouvaient jouer plus facilement leur rôle mystificateur d'opposants, les syndicats ont été jusqu'ici particulièrement discrets et bienveillants à l'égard du PS et de ses attaques contre les conditions de vie des ouvriers.
Pour ces raisons, nous jugeons important de réfléchir à nouveau sur l’expérience de 2006. Nous republions donc ici certains de nos articles qui tentaient à l'époque de tirer les premières leçons de cette lutte qui reste très importante pour le futur et la lutte de classe.
RI, 19/03/2016
France : Salut aux jeunes générations de la classe ouvrière [6]
Solidarité de tous les travailleurs salariés avec les étudiants et lycéens en lutte contre le CPE! [7]
Le mouvement contre le CPE en 2006 : une lutte exemplaire pour la classe ouvrière [8]
Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [9]
Géographique:
- France [10]
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- CPE [12]
Rubrique:
ICConline - avril 2016
- 940 reads
En défense du CCI et de l’organisation marxiste révolutionnaire (réponse à un ex-membre)
- 2676 reads
Mon expérience dans le CCI de Devrim est parue d’abord sur le forum web anarchiste Libcom en 2012.1 C’était par définition un compte-rendu personnel, basé sur des anecdotes et des impressions sur la vie dans le CCI plutôt qu’une critique générale des principes politiques du CCI dans leur ensemble. Comme il ne pouvait y avoir d’argument sur des sentiments personnels, nous avons eu tendance à laisser passer les critiques, en particulier parce que Devrim avait déclaré qu’il ne voulait pas engager de débat sur ce compte-rendu. Il avait de toute façon quitté l’organisation sans justifier politiquement son départ.
Nous croyons maintenant que ces critiques personnelles demandent une réponse parce que les questions qu’elles soulèvent ont un intérêt général aujourd’hui, alors même que les conditions fondamentales du militantisme révolutionnaire sont remises en question, y compris parmi ceux qui se considèrent comme faisant partie de la Gauche Communiste.
Nous en sommes venus à réaliser que ce rapport personnel au CCI est supposé être une analyse politique en elle-même : une interprétation personnelle vue comme suffisante pour juger le CCI comme étant une organisation qui a fait son temps.
La vie et la mort des organisations révolutionnaires
La critique de Devrim l’a donc amené à répéter en plusieurs occasions sa conviction que le CCI allait mourir. Dans un e-mail à un membre du CCI en 2013, il a écrit, en réponse à la critique qu’il devrait partir des principes politiques du CCI : « Je pense que le point de vue selon lequel on devrait aborder les positions politiques d’une organisation appartient à la façon de penser d’un âge révolu. Le CCI va mourir, et il le fera, pas parce que les gens s’engagent ou réfutent ses positions politiques, mais précisément pour la raison opposée : parce que les gens ne veulent pas même se soucier de le faire. Bien sûr, cela renvoie à un problème plus général de dépolitisation au sein de la société, mais pour un observateur extérieur, il semble que le CCI essaie activement de boucler le cercle de son isolement.»
Le CCI mourra, affirme-t-il, non pas parce que ses positions politiques ou ses principes seraient erronés ou seraient devenus démodés et auraient besoin d’être remplacés par d’autres qui correspondent à l’évolution des besoins et des objectifs de la lutte de la classe ; il va plutôt disparaitre à cause d’un désintérêt général pour les positions politiques elles-mêmes. L’incapacité du CCI à s’adapter à ce désintérêt et à l’ennui actuel vis-à-vis de la politique dans la population et même chez ceux qui voudraient être révolutionnaires, et le fait qu’il insiste au contraire sur la défense et l’élaboration de ses principes politiques, conduira à son complet isolement et à sa disparition. C’est la pensée essentielle de Devrim.
Dans son rapport Mon expérience…, Devrim, fidèle à sa vision, ne « prend pas en compte les positions politiques » du CCI, mais donne une série d’impressions et d’opinions, pour la plupart négatives, sur la vie dans l’organisation, sur son processus d’intégration de nouveaux membres, sur son mode de centralisation et ses débats. Nous reviendrons sur certaines de ces questions plus loin dans cet article. Mais d’abord, nous voulons examiner à quel point les positions politiques et les principes sont importants dans la conception d’une organisation révolutionnaire.
Dans le passé, les partis et organisations marxistes ont fréquemment disparus, quelquefois à un âge relativement jeune. L’exemple le plus évident est l’effondrement brutal de la IIe Internationale en 1914, après que les principaux partis qui la constituaient aient trahi leurs principes politiques internationalistes, rejoint leurs bourgeoisies impérialistes et contribué à envoyer des millions d’ouvriers se massacrer entre eux dans les tranchées. La IIIe Internationale a péri aussi après l’adoption du slogan : « pour le socialisme dans un seul pays », puisqu’elle devenait un instrument de l’État russe et préparait la classe ouvrière au carnage impérialiste de la Seconde Guerre mondiale.2
Dans ces deux exemples majeurs du mouvement marxiste révolutionnaire, l’organisation a disparu à cause d’un abandon progressif des principes politiques, en particulier du plus important pour la classe ouvrière – l’unité et l’action internationales face à la guerre impérialiste ou face à ses préparatifs. Ces organisations marxistes sont donc mortes (au moins pour autant que les intérêts de la classe ouvrière étaient concernés) non pas du fait d’un échec à s’adapter à la tendance générale de la société, mais à l’inverse parce qu’elles s’y étaient adaptées en cédant à la pression de la bourgeoisie internationale et avaient abandonné les positions politiques prolétariennes. Nous pensons donc que la réalité est diamétralement opposée à la logique de Devrim. En fait, si nous utilisons l’histoire révolutionnaire comme guide, le CCI disparaîtrait vraisemblablement s’il abandonnait ou minimisait l’importance de ses positions politiques comme une façon de s’accommoder au désintérêt de la politique qui prévaut et s’il échouait à rester ferme et à développer théoriquement celles-ci et d’autres principes fondamentaux par crainte de se retrouver isolé. Nous tirons donc une conclusion opposée à celle de Devrim.
Si le mouvement marxiste révolutionnaire a connu des périodes de trahison et de mort organisationnelle comme celles déjà mentionnées, il peut aussi offrir des exemples magnifiques de ces périodes dans lesquelles les minorités marxistes ont souffert de l’isolement le plus brutal pour maintenir les positions politiques et créer une corde de sauvetage pour les nouvelles organisations révolutionnaires de l’avenir. Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg qui sont allés en prison (travaux forcés dans le cas de Liebknecht) et ont ensuite été assassinés à cause de leur combat internationaliste contre la Première Guerre mondiale, ont contribué à inspirer la Révolution d’Octobre et la formation de l’Internationale Communiste. Ou alors, les militants à peine connus de la Gauche Communiste qui se sont exposés (et en ont été souvent victimes) à la terreur à la fois de la Gestapo et des Résistants, pour défendre les principes internationalistes pendant la Deuxième Guerre mondiale, en maintenant en vie la tradition que nous défendons aujourd’hui.
Les organisations révolutionnaires d’aujourd’hui mériteraient difficilement l’appellation de « Gauche Communiste » si elles n’étaient pas capables de résister aux conditions relativement soft d’isolement qu’elles peuvent subir aujourd’hui face au dégoût général de la politique. Elles peuvent sûrement supporter la ridiculisation et l’ostracisme qui peuvent s’exercer sur les militants révolutionnaires aujourd’hui, quand on mesure les conditions terribles auxquelles ont été confrontés leurs prédécesseurs dans le passé.
La capacité de préserver et de développer une pensée politique révolutionnaire face à un isolement souvent extrême est importante pour évaluer si une organisation révolutionnaire mérite d’exister.
Le CCI mériterait donc de mourir en tant qu’authentique courant de la Gauche Communiste… s’il suivait les critiques de Devrim et sous-estimait l’importance des positions politiques en les prenant comme « façon de penser d’un âge révolu ». Le CCI se développe sur sa capacité à maintenir et développer les positions politiques appropriées pour la classe ouvrière dans la période actuelle et à venir. On reviendra aux conditions actuelles de la lutte de la classe ouvrière plus loin. D’abord, quelques observations générales sur l’importance des positions politiques.3
La révolution prolétarienne est politique
Marx, à la suite d’Aristote, le philosophe de la Grèce antique, a défini l’homme comme un animal politique : « L'homme est, au sens le plus littéral, un animal politique, non seulement un animal sociable, mais un animal qui ne peut se constituer comme individu que dans la société. » (Introduction générale à la critique de l’économie politique, 1857). Par extension, le terme « politique » a une signification générale (et va donc au-delà des machinations corrompues des partis de l’État bourgeois) : la tentative de l’homme de déterminer la direction de la société dans son ensemble et donc son propre futur.
Dans la longue histoire de la société divisée en classes, les masses exploitées ont été complètement exclues de sa direction politique. Cependant, dans le capitalisme, la dernière forme de société de classes, la classe ouvrière a été capable de s’imposer sur la scène politique et de former des partis politiques. Cette capacité d’exprimer ses intérêts sous une forme politique est en dernière instance un résultat du fait, qu’à la différence des classes exploitées précédentes, la classe ouvrière est une classe révolutionnaire qui porte en elle un mode de production entièrement nouveau pour remplacer le capitalisme.
La lutte de la classe ouvrière dans le capitalisme, quand elle est menée jusqu’à une conclusion couronnée de succès, mène au renversement de la bourgeoisie et à la dictature du prolétariat. L’acte politique suprême, l’arrivée au pouvoir politique de la classe ouvrière, est la condition pour l’établissement ultime d’une société sans classes – le communisme. Le développement de la conscience du prolétariat est la reconnaissance de ses intérêts politiques et historiques en tant que classe, exprimée, bien que non exclusivement, dans la formation de partis politiques. La classe ouvrière, ayant un besoin inné de mener la société au socialisme, doit s’unifier sur les définitions politiques de ce qu’elle est, de ce qu’elle doit faire en tant que classe. Les positions politiques sont les éléments constitutifs de la plateforme de l’organisation politique révolutionnaire – ce qui distingue les perspectives de la classe ouvrière des objectifs de la bourgeoisie et des autres classes dans la société. La nature précise de ce parti politique, quand il peut se former, le rôle qu’il joue dans la prise du pouvoir par le prolétariat, etc. a énormément évolué au cours des deux derniers siècles. Mais la conception marxiste de l’organisation révolutionnaire en tant qu’entité fondamentalement politique demeure.
C’est d’autant plus crucial quand on considère que la classe ouvrière, à la différence des classes révolutionnaires précédentes, ne peut pas construire une base de pouvoir économique dans la société existante, l’élaboration théorique et l’adoption de positions politiques prolétariennes deviennent donc d’autant plus vitales4. La formulation de positions politiques doit pour la même raison, précéder la prise réelle du pouvoir politique.
La classe ouvrière n’est donc pas simplement une catégorie économique ou sociologique au sein de la société bourgeoise, une classe exploitée comme les esclaves ou des serfs, mais surtout une classe historique avec un but révolutionnaire et donc une classe politique dans le sens le plus profond du terme. Le dédain pour l’importance centrale de la politique dans la lutte de la classe ouvrière, et pour les organisations qui affirment défendre ses intérêts, ne permet cependant pas d’éviter ou d’échapper aux pressions politiques, puisque la lutte entre les classes pour la direction de la société est invariablement un combat politique qui s’impose aux combattants qu’ils le veuillent ou non. L’apolitisme, en dépit de ses illusions d’y échapper, devient inévitablement politique... mais pas nécessairement d’une bonne façon. Au contraire, en raison de l’absence de positions et de principes clairs et développés, la démarche apolitique se met plutôt sous le joug des forces politiques dominantes de la classe au pouvoir.
Il n’y a nulle part de meilleur exemple que dans l’histoire de l’anarchisme et de ses tentatives d’apolitisme révolutionnaire. Dans les grands tests politiques de l’histoire, les anarchistes ont été pour la plupart incapables de résister aux pressions de la politique de la classe dominante et ont capitulé vis-à-vis d’elles, l’exemple le plus fameux étant celui de Pierre Kropotkine pendant la Première Guerre mondiale.
Kropotkine, Tcherkesoff et Jean Grave étaient les défenseurs les plus enthousiastes de la France : « ne laissez pas ces conquérants haineux balayer à nouveau la civilisation latine et le peuple français (…), ne les laissez pas imposer à l’Europe un siècle de militarisme ». (Lettre de Kropotkine à Jean Grave, 2 septembre 1914). C’est au nom de la défense de la démocratie contre le militarisme prussien qu’ils soutenaient l’Union Sacrée : « l’agression allemande a été une menace – réalisée – non seulement contre nos espoirs d’émancipation mais contre toute l’évolution humaine. C’est pourquoi nous, les anarchistes, nous, les antimilitaristes, nous les ennemis de la guerre, nous les partisans passionnés de la paix et de la fraternité entre les peuples, nous nous mettons du côté de la résistance et n’avons pas pensé séparer nos destinées de celles du reste de la population ». (Manifeste des Seize (le nombre de signataires, NdT), 28 février 1916.)5
Les principaux représentants de l’anarchisme se sont alignés derrière la politique de la classe dominante, comme l’ont fait les directions opportunistes des principaux partis sociaux-démocrates. Ces derniers ont abandonné les positions politiques internationalistes de la classe ouvrière ; les premiers, méprisant pour la plupart ces positions, ont découvert que leurs propres phrases qui sonnent bien mais creuses comme des coquilles vides sur la démocratie et l’émancipation, l’évolution humaine, contre la guerre, pour la paix et la fraternité, pouvaient être récupérées par la politique impérialiste de la bourgeoisie.6
Le dédain parmi les révolutionnaires eux-mêmes dans d’autres périodes comme celle d’aujourd’hui pour les positions révolutionnaires peut aussi être dommageable, même si elles sont moins décisives, en tendant à refléter, plutôt qu’à contrecarrer, la désorientation actuelle de la classe ouvrière.
Les positions politiques marxistes et la période actuelle
Devrim dit qu’il y a un problème de dépolitisation dans la société. Certes ! Mais quelles sont les caractéristiques particulières de la dépolitisation aujourd’hui qui affecte la classe ouvrière et ses minuscules minorités révolutionnaires ?
Depuis la résurgence de la lutte de classe au niveau historique en 1968, mettant fin à la longue époque de contre-révolution, la classe ouvrière a rencontré beaucoup de difficultés à développer sa lutte sur son propre terrain politique. Elle est largement restée sur la défensive et sous le joug de la social-démocratie, du stalinisme et des syndicats. La classe dominante, pour sa part, a été capable d’étaler sa crise économique croissante, de manœuvrer politiquement et intelligemment contre la menace de « ceux d’en bas ». Le blocage qui en a résulté entre les deux principales classes antagonistes de la société capitaliste a ouvert une période de décomposition sociale du capitalisme qui a mené à une désorientation profonde au sein de la classe ouvrière.7
La claire ouverture de la période de décomposition a été marquée par l’effondrement de l’URSS et cela a été délibérément utilisé par la classe dominante pour renforcer cette désorientation. Les énormes campagnes idéologiques de la bourgeoisie internationale depuis 1989 sur « la mort du communisme », du « marxisme » et sur « la fin de la classe ouvrière » en tant que force politique dans la société, ne sont pas fortuites. Les minorités marxistes comme le CCI, même si elles n’étaient en aucune façon polluées par le stalinisme, ont néanmoins subi pleinement la force de cette tentative de la classe dominante de dépolitiser la classe ouvrière et d’utiliser ainsi la décomposition sociale de son système pour infliger un coup sévère à son adversaire de classe.
Devrim, dans son témoignage personnel, Mon expérience…, exprime son accord avec l’analyse du CCI sur la décomposition sociale du capitalisme que nous avons brièvement résumée ci-dessus : « Personnellement, je pense que beaucoup de ce qui a été dit est une bonne description de la nouvelle période qui a commencé avec la chute de l’Union Soviétique, mais ce doit aussi être compris comme un moyen de justifier les erreurs qui sont présentes dans ‘ le truc’ sur les années de vérité (référence à l’analyse que la CCI a faite pour décrire les enjeux des années 1980).» Devrim n’analyse pas quelles sont les parties des Thèses sur la décomposition avec lesquelles il est d’accord ou quelles sont les parties avec lesquelles il est en désaccord, ou la nature des erreurs que nous sommes supposés avoir faites dans l’analyse des années 1980, pas plus qu’il n’explique ce qui ne va pas dans l’analyse des Thèses sur la décomposition et qui prouverait qu’elles sont un moyen de justifier cette dernière analyse.8
Néanmoins, nous pouvons déduire que Devrim ne suit pas les conclusions les plus importantes des Thèses selon lesquelles cette nouvelle période allait créer de nouvelles difficultés pour le prolétariat et donc pour ses organisations révolutionnaires :
« 13) En fait, il importe d'être particulièrement lucide sur le danger que représente la décomposition pour la capacité du prolétariat à se hisser à la hauteur de sa tâche historique. De la même façon que le déchaînement de la guerre impérialiste au cœur du monde "civilisé" constituait "Une saignée qui [risquait] d'épuiser mortellement le mouvement ouvrier européen", qui "menaçait d'enterrer les perspectives du socialisme sous les ruines entassées par la barbarie impérialiste en fauchant sur les champs de bataille (...) les forces les meilleures (...) du socialisme international, les troupes d'avant-garde de l'ensemble du prolétariat mondial" (Rosa Luxemburg, La Crise de la social-démocratie), la décomposition de la société, qui ne pourra aller qu'en s'aggravant, peut aussi faucher, dans les années à venir, les meilleures forces du prolétariat et compromettre définitivement la perspective du communisme. Il en est ainsi parce que l'empoissonnement de la société que provoque la putréfaction du capitalisme n'épargne aucune de ses composantes, aucune de ses classes ni même le prolétariat. » (Thèses sur la décomposition)
Devrim n’a pas tiré de cette analyse la conclusion que l’organisation révolutionnaire, en tant qu’émanation de la classe ouvrière, doit résister à ce processus de dépolitisation et explorer de la façon théorique la plus profonde toutes les implications de la nouvelle période pour le prolétariat comme classe politique, pour préparer son futur réveil qui est encore possible en dépit du poids négatif de la décomposition.
Il tire plutôt la conclusion opposée : si la société et la classe ouvrière ont été dépolitisées dans cette période, les révolutionnaires doivent s’adapter à cette dynamique en réduisant ou en gommant la signification des intérêts historiques du prolétariat et donc réduire leur préoccupation pour les positions politiques concernées et ajuster leur langage pour être acceptables. Mais ne serait-ce pas un retour aux façons éculées et à la théorie confuse de l’apolitisme anarchiste ?
Nous devons rappeler que la tendance actuelle à la dépolitisation dans la classe ouvrière n’est ni permanente ni totale, pas plus que la putréfaction capitaliste n’a atteint ses conclusions ultimes. Les contradictions du capitalisme mondial continueront à obliger les travailleurs à penser de nouveau en termes politiques, peu importe à quel point un tel processus de renaissance sera être long et difficile.
C’est pourquoi il continue à y avoir une petite minorité d’individus attirés par la politique marxiste. Aussi, nous ne pensons pas que Devrim parle pour toutes les personnes ou pour tous les « observateurs extérieurs » du CCI qu’il suggère être tous rebutés ou ennuyés par les positions politiques. Ce serait tragique si les organisations révolutionnaires, bien qu’encore minuscules, échouaient aujourd’hui à faire face au défi de cette tendance, à aller vers des positions politiques de classe, et n’arrivaient pas à donner à ces dernières un contenu historique, une consistance globale et une cohérence, ainsi que leurs fondements théoriques les plus profonds.
En ce sens, la prédiction de Devrim sur la disparition du CCI à cause de ses préoccupations pour les principes politiques prolétariens, exprime au contraire, à sa manière, la tendance actuelle du capitalisme en décomposition à la destruction de la conscience de classe et par conséquence des minorités révolutionnaires qui essaient de la préserver et de l’enrichir.
La politique et la vie interne de l’organisation marxiste révolutionnaire.
Les considérations personnelles de Devrim dans : Mon expérience dans le CCI, ne traite pas des principes politiques de l’organisation, de sa plateforme et ne cite que très brièvement certains textes clefs d’analyse du CCI comme les Thèses sur le parasitisme et les Thèses sur la décomposition.
Ce rabaissement du cadre de l’existence du CCI est une conséquence logique de son idée, exprimée dans l’e-mail à un membre du CCI que nous avons cité au début de cet article, selon laquelle traiter de positions politiques dans la plateforme est l’expression de la pensée d’un âge révolu. Au lieu de cela, la mémoire de Devrim se focalise sur son expérience de la vie interne du CCI. Ici, de nouveau, il ne traite pas des principes politiques sous-jacents au fonctionnement interne du CCI, mais fonde ses critiques sur des impressions, des anecdotes personnelles et des ouï-dire (tels que « un membre de l’organe central m’a dit »… ou « J’ai entendu parler de cas où les intégrations ont pris des années. »)9
Néanmoins, un certain nombre de thèmes de base ressortent de son rapport critique qu’il serait intéressant de discuter d’un point de vue général.
-
Les conditions pour être membre du CCI sont trop strictes et le processus d’intégration de nouveaux membres est trop long et trop exhaustif
« Le processus d’intégration au CCI est trop long et fastidieux… Fondamentalement, pour rentrer dans le CCI, vous devez être d’accord avec la plateforme et les statuts. J’ai entendu parler de cas au sein du CCI où ce processus a pris des années. Avec nous, cela a été plus rapide, mais c’était tout de même un processus de très longue durée… il semble que le CCI essaie activement d’éviter de recruter de nouvelles personnes10 en rendant l’intégration aussi difficile que possible. Le sentiment que j’ai eu a été que le centre ressentait que nous avions été intégrés trop rapidement, et qu’une partie du problème était que nous n’avions pas été d’accord avec eux sur certaines questions avant d’intégrer, en particulier sur les Thèses sur le parasitisme, mais aussi sur beaucoup d’autres. Cela représente une dichotomie pour le CCI parce que bien qu’être officiellement membre repose sur l’adhésion à la plateforme et aux statuts, il y avait de nombreux textes « supplémentaires » sur lesquels il était aussi suggéré de discuter. Mon sentiment est que dans le futur, le CCI insistera sur même plus d’autres textes, ce qui aura l’effet double, non seulement de rendre plus difficile de recruter des gens mais aussi signifiera qu’il y a moins d’idées neuves dans le CCI lui-même. »
-
Le CCI est « trop fortement centralisé »
« Le CCI se voit comme une organisation unique internationalement centralisée, et pas comme une collection de différentes sections nationales. Ceci dit, la quantité d’intervention de l’organe central dans la vie de tous les jours des différentes sections m’a semblé non seulement être excessive mais absolument autoritaire.
Sur le sujet du rapport entre les membres de l’organisation, j’ai le sentiment que celui qui existe au sein du CCI sert à affaiblir l’initiative des membres individuel et des sections aussi, en encourageant une culture organisationnelle qui, à mon avis, est trop fortement centralisée.
Bien que je considère un niveau extrêmement élevé d’accord politique comme étant un critère pour être membre, il me semble encore que, dans le CCI, les ordres viennent d’en haut et sont transmis à la base. Ce processus, c’est mon sentiment, agit dans le sens de décourager l’initiative des membres de l’organisation dans leur ensemble et, malgré les protestations du CCI qui soutient le contraire, tend à être le reflet des relations hiérarchiques qui prévalent dans la société toute entière. »
-
Il y a trop de discussion interne dans le CCI, qui demandent trop d’engagement politique…
« Il y a trop de ‘débat’ dans le CCI ce qui tend à rendre toute discussion réelle impossible. Cela mène à un problème, qui est que rien que suivre les affaires internes du CCI demande une quantité de temps que, j’imagine, beaucoup de gens dans d’autres organisations politiques consacrent à l’ensemble de leur activité politique… Tout doit être discuté en interne avant que ce soit présenté à l’extérieur… Je pense que ça donne l’impression que le CCI est composé d’une poignée de robots qui répètent la même chose comme des perroquets. Cependant, que cela puisse être vrai ou pas, c’est certainement une impression qu’ont beaucoup de gens en dehors du CCI, et que le CCI n’a cure de dissiper. La seconde est que le CCI produit un immense volume de textes, beaucoup d’entre eux, ayant déjà été discutés, ne sont même pas lus par tous ses membres. Il doit y avoir sûrement certaines personnes en dehors qui pourraient être intéressées par certains d’entre eux. »
… alors que la théorie du CCI est « trop cohérente »
« La théorie du CCI est un ensemble de travail impressionnant, surtout à cause de sa cohérence en profondeur. Tout s’emboite parfaitement, chaque bloc ayant sa place dans la structure entière. Pour ceux qui recherchent la cohérence théorique, cela peut être certainement très attractif, en particulier pour les nouveaux groupes, comme nous l’étions à l’époque, l’adoption d’un seul coup d’un travail théorique dans son ensemble peut être perçue comme profondément attirante plutôt que de faire un travail théorique rigoureux, ce qui est l’alternative. Le problème est cependant que c’est un château de cartes où chaque partie dépend des autres pour empêcher l’édifice de s’effondrer. »
Pris dans son ensemble, si vous enlevez de son point de vue personnel les impressions personnelles désobligeantes, les métaphores dénigrantes et pas mal de petits mensonges, ce que Devrim critique dans le CCI, c’est de trop être une organisation politique révolutionnaire : l’accord politique demandé pour devenir membre est trop élevé, le CCI est trop centralisé à l’échelle internationale, il y a trop de débats théoriques internes, il se démarque trop des autres tendances politiques, il exige trop de passion politique de la part de ses membres et finalement, il est trop cohérent théoriquement.
C’est vraiment trop flatteur pour une organisation révolutionnaire ! L’histoire du CCI montre qu’il a eu de nombreuses difficultés. Néanmoins, malgré toutes les erreurs et les insuffisances du CCI, être capable pour une organisation révolutionnaire de s’accrocher, pendant 40 ans, à la lignée de la gauche marxiste (celle de la Ligue Communiste, la Ière , IIe et IIIe Internationale et de la Gauche communiste, elle-même) ; de fournir une analyse approfondie de la période historique (la décadence du capitalisme) et également des principales caractéristiques de sa dernière phase de décomposition ; d’offrir une plateforme qui met en avant la perspective communiste ; de maintenir son indépendance vis-à-vis de la bourgeoise y compris de son aile d’extrême-gauche ; de fournir des analyses régulières de l’évolution de la situation internationale dans ses dimensions de la crise économique, des conflits impérialistes et de la lutte de classe ; d’intervenir d’une seule voix sur tous les continents (malgré sa petite taille) ; de donner naissance au niveau de discussion interne requis pour présenter ses débats de façon claire à l’extérieur ; de survivre à ses crises politiques internes et d’avancer…, tout cela au moins montre que les préoccupations de principes politiques tendent à soutenir une organisation révolutionnaire plutôt qu’à conduire à sa disparition.
Mais cette ténacité politique n’est pas notre seule réalisation politique. Finalement, la capacité que le CCI a montrée est un reflet du potentiel latent dans la classe ouvrière en tant que classe politique révolutionnaire, de sa capacité à devenir hautement consciente de ses buts historiques et à s’unifier autour de ses intérêts face à tous les obstacles qu’il y a eu et qui seront mis en travers de sa route.
Malgré tout, c’est cette capacité très politique que Devrim pense vieillotte et qui mènera à la disparition du CCI, une destinée, c’est ce qu’il sous-entend, qui devrait s’accélérer. La politique basée sur des principes détruit prétendument l’individu et l’initiative locale, décourage le développement d’idées neuves et isole l’organisation des sources extérieures d’inspiration et empêche donc sa croissance. En bref, le CCI restreint la liberté personnelle, la liberté individuelle nécessaire pour une organisation pleine d’énergie et qui grandit, comme le dit Devrim. Le processus d’intégration des nouveaux membres, le rôle des organes centraux, le cadre du débat interne et ses buts théoriquement cohérents, son attitude vis-à-vis des autres parties du milieu politique, sont, en un mot, autoritaires.
La liberté individuelle, du point de vue bourgeois et du point de vue prolétarien
Pour répondre à cette idée fausse que l’organisation marxiste révolutionnaire restreint la liberté de l’individu, nous devons essayer de clarifier quelques questions de façon à donner une certaine cohérence au problème.
Le désir de liberté, la capacité de forger sa propre destinée et d’être honnête avec soi-même est un des plus vieux besoins humains, un besoin intrinsèque à une espèce qui a la capacité d’être consciente d’elle-même et qui doit vivre en société. L’interaction entre les désirs les plus profonds de l’individu et les besoins des autres a toujours été un aspect fondamental de l’existence humaine.
Pendant une grande partie de l’histoire humaine précapitaliste, dominée par les classes et l’exploitation de l’homme par l’homme, le besoin spirituel de l’individu, de liberté personnelle et de contrôle sur son destin a été largement retourné contre lui par le spectre de « Dieu » et par les représentants auto-désignés de ce dernier sur terre qui, nullement par hasard, se trouvaient appartenir à la classe des propriétaires d’esclaves. La masse de la population qui produisait était enchaînée sur terre par la classe dominante et dans les cieux imaginaires par un tyran céleste.
La laïcisation et donc la politisation de la liberté personnelle et de la destinée, dans les révolutions bourgeoises – en particulier dans la révolution française de 1789-1793 – a été une étape fondamentale dans le progrès vers des solutions dans le monde réel de la liberté humaine. Mais c’est aussi parce qu’elle a ouvert la voie à la classe ouvrière pour s’imposer sur l’arène politique et se définir politiquement. Cependant, dans la déclaration des Droits de l’Homme de 1789, la bourgeoisie présentait sa liberté nouvellement gagnée comme une réalisation universelle qui profitait à tous. Cette tromperie résultait en partie de ses propres illusions et en partie des besoins de la bourgeoisie d’enrôler toute la population derrière ses drapeaux. Le concept de liberté restait une forme abstraite, mystifiée, qui cachait le fait que, dans la société capitaliste, les producteurs, tout en étant libres et égaux à leurs maîtres légalement, seraient alors enchaînés par une nouvelle forme d’exploitation, une nouvelle dictature. La bourgeoisie victorieuse a apporté avec elle la généralisation de la production de marchandises qui a accentué la division du travail, arrachant l’individu à la communauté. Les différentes formes du tissu social affrontaient l’individu comme une nécessité externe et faisaient de son semblable un concurrent. Paradoxalement, de cette atomisation et de cet isolement, a surgi la mystique de la liberté individuelle dans la société capitaliste. En réalité, seul le capitalisme était libre :
"Dans la société bourgeoise, le capital est indépendant et personnel, tandis que l'individu qui travaille n'a ni indépendance, ni personnalité.
Et c'est l'abolition d'un pareil état de choses que la bourgeoisie flétrit comme l'abolition de l'individualité et de la liberté ! Et avec raison. Car il s'agit effectivement d'abolir l'individualité, l'indépendance, la liberté bourgeoises."
(Marx et Engels, Le Manifeste Communiste)
Le développement vivant, historiquement concret de la liberté individuelle dépend donc de la solidarité de la lutte prolétarienne pour l’abolition des classes et de l’exploitation. La liberté réelle n’est possible que dans une société où le travail est libre, ce qui sera le mode de production communiste, où l’abolition de la division du travail permettra le développement et l’épanouissement complet de l’individu.
La promotion de libertés politiques prolétariennes dont dépend cette transformation révolutionnaire de la société et que les organisations politiques communistes doivent défendre, implique nécessairement la lutte contre les revendications acharnées de liberté bourgeoise que la société capitaliste fait sans cesse naître.
-
« Des conditions trop strictes pour être membre ».
Pour paraphraser le Manifeste Communiste : la bourgeoisie reproche aux conditions impérieuses du militantisme marxiste de restreindre la liberté de l’individu et ses initiatives. Avec raison. La prohibition des libertés et des initiatives individuelles bourgeoises visent sans aucun doute à cela.
Le principe politique d’opposition à la participation parlementaire, que le CCI partage avec le reste de la Gauche Communiste, empêche dans une grande mesure l’espèce de carriérisme et de prises de décisions hiérarchiques qui ont infecté les partis de la Deuxième Internationale et qui sont typiques de la vie politique bourgeoise. L’indépendance de principe vis-à-vis de l’appareil d’Etat bourgeois écarte la sorte d’ambition personnelle et d’aventurisme alimentés par l’attente d’argent facile qui anime les participants de la politique bourgeoise.
La lutte pour la liberté politique prolétarienne contre la liberté bourgeoise ne s’arrête pas là. Il y a ceux qui sont dégoûtés par le monde pourri de la politique bourgeoise, de gauche ou de droite, et qui veulent la combattre au sein d’une organisation révolutionnaire marxiste. Mais ils n’ont pas abandonné, au fond, le mot d’ordre vide et abstrait de « liberté individuelle » qui sert d’idéologie et de justification en dernier ressort au monde capitaliste.
Quand ils ne sont pas maîtrisés, ces restes de pensée bourgeoise conduisent, au sein de l’organisation, à une attitude de combat clandestin contre la prétendue rigidité des principes politiques prolétariens, la hiérarchie supposée de la centralisation, le « dogmatisme » du débat prolétarien, qui sont ressentis comme autant de restrictions des droits personnels, même si, superficiellement, on est d’accord avec ces vrais principes – la centralisaiton et la culture du débat. Cette attitude n’a pas d’alternative précise à proposer, pas de contours positifs distincts, mais se caractérise principalement par être contre, par le rejet de ce qui existe. Elle revendique le droit de ne pas attendre les décisions collectives, le droit de prendre des initiatives locales à l’encontre de celles du reste de l’organisation sans explication, le droit de ne pas être cohérent et surtout, de ne pas être tenu pour responsable de toute incohérence11.
Cette attitude anarchiste conserve la croyance bourgeoise dans la « liberté individuelle ». Elle rejette l’autorité des politiques capitalistes et l’exploitation mais finit aussi par rejeter tout autant l’autorité d’une alternative marxiste.
L’organisation révolutionnaire marxiste doit donc lutter aussi et se protéger contre cette défense creuse et plus diffuse de la liberté politique bourgeoise tout autant que contre son expression ouverte qu’on trouve dans les partis gauchistes et parlementaires.
Ce n’est pas par hasard, si dans l’histoire du mouvement ouvrier, la question de qui est et qui n’est pas un membre de l’organisation a pris une importance vitale. Au congrès de La Haye de la Première Internationale, les premiers jours ont été consacrés à la vérification de l’éligibilité des délégués, en particulier, parce qu’il y avait une cabale secrète au sein de l’organisation, l’Alliance de Bakounine.
Au Deuxième Congrès, du parti ouvrier social-démocrate de Russie en 1903, décisif pour sa constitution, une des principales divisions entre les bolcheviks et les mencheviks portait sur la définition de qui est membre, dans les statuts proposés.
Des conditions strictes pour être membres sont un moyen vital d’exclure à la fois les expressions classiques de la liberté politique bourgeoise comme l’aventurisme et le carriérisme, et les concessions à cette politique bourgeoise qui prennent la forme de l’opportunisme vis-à-vis des principes politiques généraux et qui favorisent la formation de cliques de personnes qui résistent à l’application rigoureuse des principes sur les questions organisationnelles.
Un manque de rigueur dans le processus d’intégration des militants est un bon moyen d’établir une hiérarchie au sein de l’organisation entre « ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas » les positions et les analyses de celle-ci. Evidemment, il n’est jamais possible d’éliminer complètement les inégalités et les différences de capacité entre militants, mais le « recrutement » sur des bases insuffisantes est le meilleur moyen de les renforcer plutôt que de les atténuer.
-
La centralisation et la conception non-hiérarchique de délégation
Tous les organismes ont besoin d’un certain niveau d’unité pour maintenir leur existence. C’est vrai dans la sphère politique comme dans les lois dialectiques de la nature. La centralisation est le principal moyen de garantir une unité complexe. C’est l’expression d’un argument universel fondamental : le tout est plus que la somme des parties. L’unité n’est pas le simple résultat de la collection ou de l’agrégation des différents constituants de l’ensemble. L’unité exige une autre qualité : la capacité de centraliser et de coordonner ces éléments par ailleurs disparates. Un orchestre a besoin d’un chef pour rassembler tous les musiciens, qui en retour, reconnaissent et respectent son rôle indispensable dans la création d’une œuvre d’art unifiée qui est qualitativement plus que le son de chaque instrument pris séparément.
Une organisation politique révolutionnaire est aussi plus qu’une collection d’individus qui se retrouvent en accord – elle exige aussi, de façon à se maintenir, une volonté d’unité et donc une volonté de centralisation de la part de chaque militant.
Le degré élevé de centralisation requis par les organisations politiques prolétariennes reflète le fait que le prolétariat n’a aucun intérêt économique ou politique différent en son sein, à la différence des autres classes. Cela exprime aussi un besoin important d’une classe exploitée : combattre le processus de division et d’atomisation que le travail salarié et la production généralisée de marchandises imposent au prolétariat et compenser l’absence de tout pouvoir économique pour consolider son combat.
La centralisation restreint nécessairement certaines initiatives individuelles – celles qui résistent au processus de centralisation et, à l’opposé, vont chacune dans une direction indépendante qui mène à une perte de cohésion et en définitive à la dissolution de l’ensemble. Mais la centralisation, au contraire, est entièrement dépendante des initiatives individuelles et de la diversité de tout l’organisme politique. La nature durable de la centralisation est précisément un résultat du besoin de résoudre collectivement des différences, de synthétiser les désaccords – la seule façon de resserrer l’ensemble et de l’enrichir dans une nouvelle unité.
Le concept marxiste de centralisation n’est donc pas monolithique. Il permet, en fait il exige, que les positions minoritaires s’expriment – avec pour objectif de gagner la majorité et qu’ainsi l’ensemble de l’organisation puisse s’orienter dans la bonne direction. La conception fédéraliste ou décentralisée selon laquelle la minorité ne devrait pas être ouverte à la critique, pas soumise à l’unité de l’organisation alors que le débat continue, est en fait autoritaire parce qu’elle signifie qu’une partie s’impose arbitrairement sur l’ensemble12.
La centralisation semble toujours être hiérarchique aux adeptes de la « liberté personnelle » parce qu’elle implique le principe de délégation. Les congrès, par exemple, qui formulent les buts généraux de l’organisation ne peuvent pas siéger de façon permanente et traiter l’énorme quantité des fonctions quotidiennes de l’organisation et, en particulier, son intervention au sein de la classe ouvrière. Ils doivent déléguer aux organes centraux la responsabilité de traduire leurs orientations dans la vie quotidienne de l’organisation. Mandater des organes centraux et la remise de leurs mandats par les organes centraux au congrès suivant pour être vérifiés sont une des marques d’authenticité des organisations politiques révolutionnaires marxistes.
Le principe de délégation et du maintien de l’unité pendant les débats sur des divergences n’est pas trop de centralisation, c’est la centralisation : le fluide vital de l’organisation révolutionnaire. L’hostilité vis-à-vis de ces principes représente finalement l’affirmation de la volonté unilatérale de l’individu ou d’une minorité par rapport aux intérêts de l’ensemble. C’est cela, et pas la centralisation, qui est autoritaire.
-
Débat, diversité et recherche de cohérence
Un aspect intéressant du compte-rendu personnel de Devrim est qu’il critique le CCI parce qu’il y aurait trop de débats internes, donc, trop d’initiatives individuelles, de diversité, d’un côté, alors que de l’autre, il critique l’organisation comme étant trop cohérente théoriquement, où tout est à sa place, et ainsi, sans laisser aucune place pour l’initiative individuelle.
Devrim n’a cure de résoudre cette contradiction apparente dans son point de vue : qu’une organisation puisse être en même temps intensément autocritique et intensément unie13. En fait, il n’y a pas de contradiction entre ces deux aspects de notre fonctionnement – nous pensons qu’ils sont à la fois complémentaires et interdépendants.
La tradition de la Gauche Communiste, à laquelle appartient le CCI, a toujours été caractérisée par un esprit critique qui n’est pas seulement axé sur la bourgeoisie et la société capitaliste, mais aussi sur elle-même, ses propres partis et sur leurs concessions à la bourgeoisie, les erreurs d’analyse et les insuffisances d’approfondissement théorique face au changement de la période historique et au cours des événements. Les principes politiques que le CCCI défend, sont le fruit de longs efforts pour réexaminer et vérifier la véracité des principes ou de la conception de ces principes, ce qui a permis de nous faire découvrir des manques à la lumière de l’évolution continuelle de la réalité sociale et de la création de nouvelles situations, qui demandent de nouvelles réponses et de nouvelles analyses. La vision du CCI du rôle du parti ou de l’Etat dans la période de transition, par exemple, est le produit d’un long développement théorique tortueux au sein de la Gauche Communiste qui a requis des décennies de débats et de confrontation après la défaite de la Révolution d’Octobre.
Dans l’histoire du CCI lui-même, le débat interne a conduit au rejet des analyses jadis axiomatiques de la tradition marxiste comme la théorie du maillon faible de Lénine – le concept selon lequel la transformation révolutionnaire socialiste viendrait des pays périphériques du capitalisme. Le CCI est allé à l’encontre de cette vision en affirmant que c’était en Europe occidentale, avec les bastions les plus expérimentés de la classe ouvrière et devant faire face aux bourgeoisies les plus intelligentes, que réside la force centrale pour la révolution prolétarienne14. Une attitude critique constante vis-à-vis des acquis de la tradition marxiste à la lumière des nouveaux problèmes posés par l’évolution des événements est donc un aspect nécessaire de la théorie marxiste.
Cela implique que chaque militant prenne à cœur cette démarche, reconnaisse le besoin de penser par lui ou par elle-même, et refuse de prendre les choses pour argent comptant.
En même temps, la critique marxiste ne peut être qu’assez sévère et rigoureuse dans la mesure où elle implique la recherche d’une nouvelle cohérence. Ce n’est que la recherche de nouvelles synthèses qui soit enrichissent, soit démentent les anciennes et qui peut aller aux racines des choses. L’objectif marxiste est toujours de créer une vision unifiée politiquement et théoriquement qui trace « la marche » de la lutte de classe ouvrière parce que cette marche évolue avec le temps et les changements des conditions matérielles. La nécessité d’une conception théorique unifiée des intérêts du prolétariat est une contrepartie vitale de l’unité organisationnelle. L’unité théorique ou la cohérence, comme l’organisation centralisée, n’est pas la même chose que la soumission ou l’uniformité. Toute cohérence contient des contradictions potentielles. Et ces oppositions latentes amènent de nouveaux débats et, nécessairement, de nouvelles conclusions.
La diversité n’est donc pas un but en soi, la célébration des différences en elles-mêmes, comme les anarchistes le croient, mais le moyen d’une plus grande conscience du prolétariat en tant que classe révolutionnaire unifiée.
De la même façon, le but des débats dans l’organisation n’est pas de renforcer l’autorité d’un quelconque « leader » mais de permettre la plus grande clarté, la plus grande homogénéité au sein de l’organisation, ce qui signifie précisément combattre les conditions qui engendrent la nécessité de nouveaux « leaders ».
Le pouvoir des idées de l’organisation dans la classe ouvrière, qui doit se mesurer sur le long terme, n’existe pas grâce à la dilution de ses principes et de ses analyses ou à l’abandon de la cohérence, comme le pense Devrim, mais grâce à la plus grande concentration et à la plus grande profondeur de sa théorie.
Tout cela implique des exigences pour le militant révolutionnaire. Une des plus importantes est qu’il doit voir au-delà de son ressenti émotionnel et de ses impressions personnelles.
Mais tout le rapport de Devrim sur son expérience négative dans le CCI en reste aux premiers stades des impressions personnelles qui ne s’élèvent jamais au niveau d’un débat sur les principes politiques et organisationnels qui sont l’essence d’une organisation révolutionnaire marxiste.
Conclusion
Il n’y a pas de conception alternative détaillée de l’organisation révolutionnaire dans la critique de Devrim. Mais par déduction, sa critique du CCI veut dire que l’alternative devrait être qu’il soit moins strict dans ses intégrations de nouveaux membres, moins centralisé, qu’il laisse plus d’autonomie aux différentes parties de l’organisation. Il devrait passer moins de temps sur les débats théoriques internes, moins de temps à se démarquer des autres tendances politiques. Il devrait donner moins d’importance au développement collectif de positions politiques cohérentes et plus de poids aux impressions et aux sentiments personnels. En bref, l’organisation révolutionnaire devrait moins être une expression politique de la classe ouvrière et plus un reflet des envies de ses membres individuels.
Comme Devrim ne donne aucun modèle historique ou de référence sur ce à quoi ressemblerait une telle organisation, ou de comment elle éviterait les échecs passés basés sur le même manque de paramètres, son alternative semble extrêmement fumeuses et ses contours indéterminés.
En définitive, la critique de Devrim exprime une vision complètement différente du militantisme révolutionnaire de celle d’une approche méthodique marxiste. Alors que cette dernière voit le libre développement du militant comme un processus d’interaction avec ses camarades, c'est-à-dire, comme une question de solidarité organisationnelle, Devrim voit le révolutionnaire comme quelqu’un qui doit conserver son autonomie personnelle à tout prix, même si cela signifie quitter l’organisation et donc ses camarades.
Dans une période dans laquelle la classe ouvrière a besoin de retrouver son identité en tant que classe politique, la suggestion qu’une organisation politique révolutionnaire existante, celle qui peut fournir une perspective politique communiste valable, serait obsolète et devrait être remplacée par une alternative conçue de façon vague mais qui serait indifférente aux positions politiques – est vraiment dérisoire, pas seulement dérisoire mais néfaste.
Aujourd’hui, il y a des groupes et des individus qui planifient délibérément de détruire les organisations révolutionnaires et le CCI en particulier. Alors que Devrim n’est pas d’accord avec notre définition de ces éléments comme « parasites », il a néanmoins par le passé rejeté leur comportement et leur objectif comme étant « anti-classe ouvrière » – c’est, admet-il, une des raisons qui l’a attiré dans le CCI. Mais son attitude présente, exprimée dans sa critique personnelle, qui implique maintenant que le CCI ne vaut pas d’être défendu face à de telles attaques, ne peut, quelles que soient ses intentions, que stimuler les appétits destructeurs des parasites.
Sa préoccupation de « la liberté personnelle contre l’autorité » se trouve prise dans un no man’s land entre deux alternatives : la détermination politique du marxisme d’un côté et le pouvoir politique hostile de la bourgeoisie et de ceux qui se sont mis au service de cette dernière, de l’autre. En réalité, il n’y a pas de terrain neutre entre ces deux pôles politiques.
Lequel de ces deux camps doivent choisir les révolutionnaires authentiques est clair.
Como.
2 Nous voulons dire qu’elles sont mortes en tant qu’organisations du prolétariat, mais n’ont pas nécessairement disparu entièrement. Le parti social-démocrate d’Allemagne, par exemple, qui s’est uni à l’effort de guerre impérialiste avant 1914, existe encore aujourd’hui comme un des principaux partis bourgeois de l’État allemand. Nous ne faisons pas ici une comparaison stricte entre le CCI et sa faible influence et les IIe et IIIe Internationales. Mais, l’aspect central du positionnement politique pour la vie ou la mort des organisations révolutionnaires reste au fond complètement adapté à ces références historiques. Nous n’avons pas la place ici de prendre d’autres exemples moins connus.
3 Rien de cela n’implique que Devrim ait abandonné une position internationaliste ou d’autres positions fondamentales de la Gauche Communiste. Mais il ne lui a pas semblé utile de les réaffirmer dans ses impressions – probablement parce qu’il voit une telle prise de position comme relativement peu importante. Notre propos est plutôt de critiquer cette idée plutôt que de se préoccuper de savoir si de telles positions politiques sont le produit d’un âge révolu.
4 Parce que la théorie « devient une force matérielle dès qu’elle s’empare des masses », Marx, dans Une Contribution à la critique de la Philosophie du droit de Hegel, en parlant des masses de la classe ouvrière.
5 en.internationalism.org/2009/wr/325/anarchism-war1
6 D’autres anarchistes ont, bien sûr, dénoncé et combattu la guerre impérialiste en grande partie sur la base des mêmes phrases. Cela montre seulement que ces dernières ne sont pas suffisantes pour élaborer une position de classe claire à propos de la guerre impérialiste : pour l’élaborer, le marxisme et l’organisation marxiste révolutionnaire étaient et sont nécessaires.
7 Voir les Thèses sur la décomposition du CCI, Revue Internationale n°62, 1990.
8 Nous n’en déduisons pas que Devrim est personnellement incapable de développer une telle explication mais, que de son point de vue, il ne considère pas que c’est un effort valable puisque cela représenterait une préoccupation archaïque sur des positions politiques.
9 Ce serait trop fastidieux de les conter ici. Et de toute façon, cela nous conduirait à révéler chaque détail quotidien et personnel de la vie interne du CCI qui n’intéresse que les bavards… ou la police.
10 En fait, nous ne « recrutons » pas : c’est une vision militaire ou gauchiste. Devenir un militant est une des décisions volontaires la plus personnelle dans la vie de chacun.
1111 Cette conception négative de la liberté individuelle n’est pas sans rapport avec la vision du philosophe utilitariste John Stuart Mill qui a défini la liberté comme essentiellement due à une absence de contraintes. Marx a répondu dans la Sainte Famille dans sa bataille critique contre le matérialisme vulgaire français que l’homme n’est pas libre « par la force négative d'éviter telle ou telle chose, mais par la force positive de faire valoir sa vraie individualité », qui dépend du contexte social pour le faire.
12 « Rapport sur la structure et le fonctionnement de l’organisation révolutionnaire », point 3. Revue Internationale n° 33, en.internationalism.org/specialtexts/IR033_functioning.htm
13 Le compte-rendu de Devrim est suffisamment candide pour réfuter la vieille calomnie selon laquelle « le CCI supprime le débat interne ».
14 « Critique de la théorie des maillons faibles », Revue Internationale n °31, 1982, en.internationalism.org/ir/1982/31/critique-of-the-weak-link-theory
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Réponse aux ex-membres de notre section en Turquie
- 3231 reads
L’éditorial de notre premier numéro de la Revue Internationale, publié en 1975, établit clairement que le but du tout jeune CCI se définit ainsi : « Dans la période de crise générale, marquée par des convulsions et des bouleversements sociaux, une des tâches les plus urgentes et ardues qui se dresse devant les révolutionnaires est celle d’unifier et de souder ensemble les forces révolutionnaires qui émergent et qui sont aujourd’hui dispersées de par le monde. Cette tâche ne peut être entreprise qu’en la concevant dès le départ au niveau international. Ceci a toujours été une préoccupation centrale pour le Courant ». Pour une telle organisation, perdre un militant est un malheur. Perdre une section entière est un échec. Nous nous devons donc, pour nous même mais aussi pour tous ceux qui s’identifient avec la tradition de la Gauche communiste à la classe ouvrière en général, d’examiner cet échec avec un esprit critique impitoyable et d’exposer nos conclusions à nos lecteurs.
Cette nécessité est d'autant plus pressante au vu de la nature du texte écrit par nos ex-camarades de Turquie, que nous devons désormais appeler « Pale Blue Jadal » (PBJ). Il y a des points dans ce texte avec lesquels nous pouvons être d’accord, mais globalement on y trouve un tel fatras de demi-vérités, de distorsions, de récriminations et une telle confusion générale qu'il en devient à peine reconnaissable pour ceux d'entre nous qui ont vécu les événements qu'ils tentent de décrire, et cela doit certainement être complètement inintelligible pour qui que ce soit en dehors du CCI. Bien entendu, ceci n’empêchera pas le texte de BPJ d’avoir un certain effet : les couards y puiseront de nouveaux arguments pour nourrir leur scepticisme et nos ennemis (dont certains nous portent une haine qui relève plus du domaine de la psychopathologie que de la politique) y liront ce qu’ils ont envie d’y lire.
Pour répondre à chacune des accusations de PBJ, nous devrions entreprendre un examen approfondi, comparable à celui que fit Lénine du congrès du POSDR de 1903 dans Un pas en avant, deux pas en arrière, mais sur une période de presque dix ans : nous devrions citer en détails une masse de notes de conférences et de congrès, sans parler des correspondances et notes de réunion. Ceci serait trop long et mettrait à l’épreuve la patience de nos lecteurs. Et par-dessus tout, cela étalerait le fonctionnement interne de notre organisation au grand jour, ce qu’aucune organisation révolutionnaire de bon sens ne ferait aujourd’hui. Nous allons donc nous limiter à statuer sur notre cas de manière aussi claire que possible, et à corriger en passant, les erreurs et insinuations les plus flagrantes de PBJ.
L’opportunisme organisationnel
Commençons par un point d’accord avec PBJ : notre intégration du groupe EKS comme section turque du CCI fut un processus infesté par l’opportunisme. Nous ne proposons pas d’en analyser les raisons maintenant : il suffit de dire que nous avons essayé de forcer le rythme de l’histoire et cela est une expression classique de l’opportunisme.
« Forcer le rythme » à notre propre et modeste niveau, bien sûr : principalement, cela entraînait la décision de « précipiter » les discussions avec le groupe EKS qui était sur le point de devenir notre section en Turquie. En particulier, nous avions décidé de :
-
Réduire drastiquement le temps passé à des discussions organisationnelles avec les membres d’EKS avant leur intégration, avec l’argument que l’art de construire une organisation s’apprend essentiellement de l’expérience.
-
Intégrer EKS en tant que groupe avec les individus qui le constituaient. Bien que nos statuts traitent de cette question, cela présentait le danger que les nouveaux militants ne se perçoivent pas, d’abord et avant tout, comme des militants individuels d’une organisation internationale, mais comme membres de leur groupe d’origine.
Avec du recul, notre approche de la question organisationnelle était à la fois incroyablement cavalière et impardonnable. Qu’était EKS, après tout ? Comme PBJ le dit, c’était « simplement un regroupement de cercles d’amis politisés », et de plus, des cercles issus du milieu politisé étudiant petit-bourgeois. Autrement dit, c’était précisément le genre de cercle que Lénine décrivait en 1903. Compte-tenu de notre expérience passée, de notre conscience que nos propres faiblesses passées découlaient, pour une grande part, des origines du CCI dans le mouvement étudiant des années 60-70, comment avons-nous pu oublier à ce point que la principale question qui se posait à nous avec l’intégration du groupe EKS était précisément celle de transmettre notre expérience organisationnelle ? Comment avons-nous pu perdre de vue notre propre critique de l’inanité et de la précipitation des intégrations opportunistes qui ont été pratiquées dans le passé par la TCI [15]1? En tant que telle, notre expérience avec la section en Turquie ne sert que de nouvelle confirmation – en admettant qu’elle ait été nécessaire – que cette critique est fondamentalement correcte et qu’elle s’applique à nous-mêmes aussi bien qu’aux autres.
L’article à propos de notre XXIe Congrès donne une réponse générale à ces questions : « Le Congrès a souligné que le CCI est toujours affecté par son ‘péché de jeunesse’, l’immédiatisme, qui nous a fait perdre de vue, de façon récurrente, le cadre historique et à long terme dans lequel s’inscrit la fonction de l’organisation ». Ces défaillances sont d’autant plus difficiles à dépasser qu’elles sont présentes dans l’organisation depuis ses origines1. Concrètement, cela ouvrait la porte à une illusion particulièrement répandue parmi des membres d’ EKS, suivant laquelle notre difficulté à faire passer nos positions parmi la jeune génération nouvellement politisée (en particulier par le média relativement nouveau du forum internet) était essentiellement une question de présentation2, et que nous pouvions augmenter notre influence en édulcorant notre insistance sur les principes organisationnels (ce que PBJ appelle « reconnaitre que nos traumatismes posent problème »). En conséquence, nous avons perdu de vue les fondements historiques et matérialistes de notre pratique organisationnelle incarnée par nos statuts, lesquels ne peuvent se comprendre que d’un point de vue historique, comme principes politiques3 et comme le résultat à la fois du mouvement ouvrier (les Internationales et les Fractions) et de notre propre expérience. Nous avons traité les statuts comme de simples « règles de comportement » et les « discussions » sur le sujet étaient bouclées en une journée (cela contraste avec les mois de correspondance et de discussion avec EKS sur les positions contenues par notre Plateforme). Il n’y a pas eu de discussion sur les « Commentaires sur les statuts » (un texte qui place nos statuts dans le contexte de l’expérience historique du mouvement ouvrier et du CCI lui-même), pas plus que sur les textes organisationnels de base. Nous n’avons pas non plus insisté pour que ces textes soient traduits en turc4.
Pour toutes ces raisons, nous le répétons, le CCI – et non les membres d’EKS – en porte l’entière responsabilité5.
Mais le résultat fut que l’attitude de la section turque à l’égard des statuts n’était pas celle de militants marxistes qui cherchent à comprendre et à mettre en pratique les principes qu’ils sous-tendent – ou si nécessaire d’argumenter l’idée qu’ils devraient être changés avec tout le débat international au sein de l’organisation que cela impliquerait : en pratique, c’était plus l’attitude du petit avocat de salon, sans scrupules, dont le seul intérêt est de disséquer chaque document pour le tourner à son propre avantage.6
« Nous devions partir »
Cela constitue, au final, la justification de PBJ pour leur démission : « nous devions partir ». Mais qu’est-ce que cela sous-entend exactement ? Après tout, les membres turcs n’étaient pas exclus, ni collectivement ni individuellement, pas plus qu’il n’y avait de sanction prise à leur encontre. Leurs « positions minoritaires » n’étaient pas étouffées – au contraire, ils étaient constamment poussés à exprimer leurs positions par écrit de manière à pouvoir les publier et les porter à la connaissance de l’ensemble de l’organisation.
Si nous essayons de dégager les points principaux du texte de PBJ, le tableau qui se dessine alors se compose des éléments suivants :
-
Le CCI souffre d’une « culture de l’accord », ce qui rend les débats difficiles. Là-dessus, nous pouvons être d’accord, au moins jusqu’à un certain point7. Nous reviendrons sur la « culture de l’accord » au sein de la section turque elle-même.
-
Les « vieux » militants essayaient d’imposer une « transmission unilatérale » de l’expérience aux jeunes.
-
« La section était dissoute ».
-
En bref, donc, « nous devions partir ».
Pour résumer, PBJ est la « gauche critique » du CCI, plus encore qu’il ne représente les « jeunes » qui refusent d’accepter la « transmission unilatérale », la « dictature » des vieux dont les « traumatismes » « posent problème ».
En effet, à peine quelques mois avant leur démission, la section s’est opposée à l’organisation avec une prise de position grandiloquente dans laquelle elle déclarait être « la gauche » au sein de l’organisation. Reprenons leurs propres mots et mesurons un instant ce que signifie être « la gauche » dans le contexte du CCI ?
De manière parfaitement consciente, le CCI déclare tirer ses origines de la Gauche communiste, mais plus explicitement, et d’autant plus en matière de questions organisationnelles, de la tradition de la Gauche communiste italienne. Qu’est-ce que cela signifiait, être une « fraction de gauche » du temps de la Gauche italienne, lors de la dégénérescence de l’Internationale communiste ? « La Fraction de Gauche se forme alors que le parti prolétarien dégénère sous l’influence de l’opportunisme, c’est- à- dire, par la pénétration de l’idéologie bourgeoise. Il est de la responsabilité de la minorité qui défend le programme révolutionnaire, de mener une lutte organisée pour sa victoire au sein du parti. (…) C’est la responsabilité de la Fraction de Gauche de continuer le combat au sein du parti aussi longtemps que demeure l’espoir de le redresser : c’est pourquoi, durant la fin des années 1920, et le début des années 30, les courants de gauche n’ont pas quitté les partis de l’IC, mais ils en furent exclus, souvent au moyen de sordides manœuvres ».8
En bref, la gauche se bat pour son organisation jusqu’au bout pour :
-
Convaincre, et étendre son influence dans l’organisation autant que possible ;
-
Sauver autant de militants que possible ;
-
Clarifier les raisons du déclin de l’organisation, pour eux-mêmes, pour les autres militants, et pour le futur.
Enfin, la gauche ne s’enfuit pas au premier signe de désaccord et d’opposition. Elle fait tout ce qui est possible pour rester dans l’organisation et pour défendre ses idées – jusqu’à son exclusion. Elle ne joue pas les saintes-nitouches en fuyant lamentablement.
La Fraction de la Gauche italienne se forma contre la dégénérescence de l’Internationale communiste lorsque les partis constituant celle-ci intégrèrent l’appareil politique de la classe dirigeante. Quels que soient nos défauts, ce n’est pas la situation du CCI et, d’ailleurs, la section en Turquie n’a pas fait de telle déclaration. Il n’y avait donc aucune raison de supposer que les nombreux désaccords exprimés par, ou au sein de la section puissent justifier la formation d’une « fraction » dans le CCI ; au contraire, nous pouvions espérer que la discussion ouverte au sein de l’organisation permettrait une clarification de ces désaccords, et peut être conduire à une position plus claire de l’ensemble de l’organisation.
Toutefois, le dernier point souligné reste valable. Il est de la responsabilité de la minorité au sein d’une organisation révolutionnaire de défendre ses positions aussi longtemps qu’elle en est capable, d’essayer au maximum de convaincre le reste de l’organisation de la validité de ses positions. Personne ne prétendra que c’est une chose facile – mais c’est l’unique moyen de construire une organisation révolutionnaire.
Pourquoi les camarades turcs ont-ils à ce point échoué ? Nous pouvons pointer deux principaux facteurs :
-
Le premier, et nous l’avions souligné en 2007 dans un texte sur la « culture du débat »9 qui posait la nécessité absolument vitale du débat au sein de l’organisation pour sa bonne santé interne : « La deuxième raison majeure pour que le CCI revienne sur la question de la culture du débat était notre propre crise interne au début des années 2000, caractérisée par le comportement le plus sournois que nous n’ayons jamais vu dans nos rangs (…) Une des conclusions à laquelle nous sommes parvenus est que la tendance au monolithisme a joué un rôle dans toutes les scissions dont nous avons souffert. Quand des divergences apparaissaient, certains membres ont commencé à affirmer qu’ils ne pouvaient pas travailler davantage avec les autres, et que le CCI était devenu une organisation stalinienne ou était dans un processus de dégénérescence. Ces crises ont éclaté en réponse à des divergences qui, en grande partie, auraient pu être parfaitement contenues au sein d’une organisation non monolithique, et dans tous les cas, devraient être discutés et clarifiés avant toute séparation ». Les camarades turcs se sentirent victimes de ce même « monolithisme de la minorité ».
-
Le second est que la conviction que l’organisation est une nécessité vitale, c’est une des pré-conditions pour que la gauche se battre jusqu’au bout plutôt que de quitter l’organisation en hâte. C’est précisément le problème dans le milieu politique aujourd’hui qui n’a pas d’expérience de la vie de parti (comme cela existait par exemple dans le parti bolchevik du temps de Lénine), pas d’expérience de l’agitation révolutionnaire par un parti avec une influence déterminante sur la lutte de classe. De plus, il est infesté non seulement par la vieille opposition conseilliste au Parti, mais plus largement, par une profonde suspicion contre toute forme organisée d’activité politique au-delà de celle de cercle en tant que tel. En fait, PBJ ne prend pas vraiment l’organisation au sérieux. C’est pour cela que PBJ est autant choqué par « les positions au sein de l’organisation qui développent l’idée que, si le CCI d’une manière ou d’une autre cessait d’exister, le parti ne pourrait pas être fondé, le prolétariat ne pourrait pas faire la révolution et le monde serait confronté à une inévitable ruine, [et] exprime l’espoir que nous ne serions pas seuls à poursuivre une activité communiste, s’il devait advenir une telle situation ». Nous devrions demander à PBJ : croyez-vous (comme vous deviez le croire lorsque vous avez rejoint le CCI) que l’existence d’une organisation politique révolutionnaire, internationale et centralisée, soit décisive pour le succès d’une future révolution ? Contrairement à certains, nous n’avons jamais prétendu être « le Parti », ni être le seul groupe au monde qui défend l’internationalisme prolétarien. Il y a trop peu de révolutionnaires dans le monde et, selon toute probabilité, cela sera encore le cas pour un bon moment. Le prolétariat a besoin de rassembler toutes les forces qu’il peut : l’existence d’une organisation révolutionnaire n’est pas une question d’individus mais un produit historique de la nature révolutionnaire du prolétariat. Comme Bilan l’avait souligné pendant la guerre d’Espagne dans les années 1930, s’il n’y a pas de parti – pas d’organisation politique reconnue comme sienne par la classe ouvrière internationale – il n’y a alors pas de révolution. Et pourtant, une telle organisation ne va pas surgir par un quelconque processus mystique de génération spontanée. Construire une organisation est immensément difficile et nécessite des années d’efforts laborieux, et pourtant, elle reste toujours fragile au point de pouvoir être démolie en quelques mois, ou même quelques semaines. Si le CCI, qui est aujourd’hui la plus grande organisation de la Gauche communiste10, venait à faillir dans sa tâche, qu’y aurait-il pour la remplacer ? Comment et sur quelles bases serait construite l’organisation internationale ? A ces questions, PBJ peut seulement répondre « nous espérons que nous ne serions pas seuls ». « L’espoir fait vivre », comme on dit, mais ici, la superficialité règne en maître.
Nous voulons conclure ce point en répondant à la prétendue « dissolution de la section turque ». Il n’y a pas de doute que des erreurs ont été commises des deux côtés, dans le processus qui a conduit au départ de la section ; il ne fait aucun doute qu’une certaine méfiance s’est développée et que nous avons été incapables de la dissiper11. Il n’est pas vrai, dans tous les cas, de suggérer que la section a été « dissoute ». Cette déclaration est basée sur deux points :
-
Premièrement, qu’il a été demandé à la section par une résolution de l’organe central, de remplacer ses propres réunions par la participation de tous ses membres (via internet) à des discussions avec d’autres sections du CCI.
-
Deuxièmement, qu’il a été demandé à la section de traduire tous ses articles en anglais et de les soumettre au BI avant de les publier.
Prenons-les dans l’ordre.
Comme dit le propre texte de PBJ, la participation des membres de la section turque à d’autres réunions était une tentative de casser le localisme dans lequel se retranchait la section – et qu’ils ne peuvent nier. Ce qu’ils ont oublié de mentionner, c’est que la même mesure était appliquée dans d’autres sections peu avant le congrès du CCI. Le but était d’ouvrir la vie locale des sections à la discussion internationale, pour faire rentrer de l’air frais et permettre à tous les camarades d’avoir une vision de la vie de l’organisation comme un tout, au-delà de leurs propres préoccupations immédiates, avant que les délégations n’arrivent au Congrès. À l’origine, cette mesure n’était pas prévue pour durer au-delà du Congrès lui-même. C’est par la suite – ce que PBJ oublie de dire à ses lecteurs-, une fois que la section turque était clairement en désaccord avec la mesure proposée (parce qu’ils ne la comprenaient pas), qu’elle a été retirée par l’organe central : la discipline communiste n’est pas une chose qui peut être imposée d’une manière bureaucratique.
En ce qui concerne la presse, nos statuts établissent sans ambiguïté que (même en Turquie) « les publications territoriales sont confiées par le CCI aux sections territoriales et plus spécifiquement à leurs organes centraux qui peuvent nommer des comités de rédaction à cette fin. Cependant, les publications sont l’émanation de la totalité du Courant et non des sections territoriales particulières. De ce fait, le B.I. (Bureau International) a la responsabilité d’orienter et de suivre le contenu de ces publications ». Étant donné que le BI en général ne parle pas turc et que la section – comme PBJ pourrait difficilement nier – n’était pas complètement en accord avec le reste du CCI sur toute une série de points (incluant par exemple l’analyse de la « révolte sociale » en Espagne, Égypte, Turquie et au Brésil), il n’était certainement pas irresponsable de la part du BI de demander que les articles lui soient soumis avant publication : dans tous les cas, le BI était pleinement dans ses droits statutaires en le demandant. Pour voir à quel point le BI avait raison, les lecteurs peuvent juger par eux-mêmes sur la base de l’article à propos du désastre de la mine de Soma, article dont PBJ souligne particulièrement qu’il n’a pas été publié. Dans cet article, nous lisons par exemple que « la mort d’ouvriers des chantiers navals ou de sur des sites de construction comme dans les guerres surviennent parce que la bourgeoisie souhaite consciemment qu’elles arrivent ; le massacre à Soma qui a été appelé accident, a été consciemment orchestré », et il poursuit en disant que « sur un champ de bataille ou sur leur lieu de travail, les ouvriers ont de la valeur s’ils meurent pour le capitalisme. » Même pour un spécialiste adepte du matérialisme vulgaire (et les membres de la section turque déclaraient à cette époque, être marxistes, nous régalant jusqu’à l’indigestion de leçons sur la « loi de la valeur »), c’est un sacré non-sens : les ouvriers ont de la valeur pour le capital s’ils produisent de la plus-value, ce qu’ils peuvent difficilement faire s’ils sont morts.
Loin de « dissoudre » la section, l’organisation avait tout intérêt à ce qu’elle participe à la vie internationale du CCI, incluant en particulier son congrès international. Certains auraient pu s’attendre à ce que « la gauche » saute sur l’occasion pour s’exprimer au congrès, d’autant plus que nos statuts exigent explicitement la surreprésentation des positions minoritaires. Mais pas pour PBJ : ses membres ont non seulement démissionné précipitamment avant le congrès, mais ont également rejeté notre invitation à y participer et à parler en tant que groupe extérieur. Ils étaient trop occupé par un « travail important » à faire – nous laissons nos lecteurs juger par eux-mêmes le résultat du « travail important » de PBJ sur leur propre site web. Après tout, « la preuve du pudding, c’est qu’on le mange ».
La transmission de l’expérience
PBJ parlait beaucoup de prétendus « camarades conservateurs »12, qui « mettaient en avant que la génération de 68 devait transmettre son expérience aux jeunes de manière unidirectionnelle. Cette insistance présupposait que les jeunes camarades étaient dépourvus de toute expérience sur la question de l’organisation ». Que « les jeunes camarades étaient dépourvus de toute expérience sur la question de l’organisation » est un état de fait 13, mais il vaut la peine de reprendre cette question avec un peu plus de profondeur, ce que PBJ peine à faire.
« Chaque génération constitue un maillon dans la chaîne de l'histoire de l'humanité. Chacune d'elle fait face à trois tâches fondamentales : recueillir l'héritage collectif de la génération précédente, enrichir cet héritage sur la base de son expérience propre, le transmettre à la génération suivante de sorte que cette dernière aille plus loin que la précédente.
Loin d'être faciles à mettre en œuvre, ces tâches représentent un défi particulièrement difficile à relever. Ceci est également valable pour le mouvement ouvrier. La vieille génération doit offrir son expérience. Mais elle porte aussi les blessures et les traumatismes de ses luttes ; elle a connu des défaites, des déceptions, elle a dû y faire face et prendre conscience du fait qu'une vie ne suffit souvent pas pour construire des acquis durables de la lutte collective. Cela nécessite l'élan et l'énergie de la génération suivante mais également les questions nouvelles qu'elle se pose et la capacité qu'elle a de voir le monde avec des yeux nouveaux.
Mais même si les générations ont besoin les unes des autres, leur capacité à forger l'unité nécessaire entre elles ne va pas automatiquement de soi. Plus la société s'éloigne d'une économie traditionnelle naturelle, plus le capitalisme "révolutionne" de façon constante et rapide les forces productives et l'ensemble de la société, plus l'expérience d'une génération diffère de celle de la suivante. Le capitalisme, système de la concurrence par excellence, monte aussi les unes contre les autres les générations dans la lutte de tous contre tous. »14
Schématiquement, nous pouvons dire qu’il y a trois réactions possibles à ce besoin de transmission de l’expérience propre à toute société humaine :
-
L’autorité du Maître ne peut être remise en cause, chaque génération doit souvent s’approprier et répéter les leçons de la précédente. Ceci est l’attitude caractéristique des vieilles sociétés asiatiques, qui a infecté le mouvement prolétarien sous la forme bordiguiste caricaturale de dévotion à l’intouchable travail du Maître.
-
La contestation qui dominait dans le mouvement de la jeunesse des années 1960, condamné – parce qu’il échoua à apprendre de ses prédécesseurs – à répéter leurs erreurs dans leurs moindres détails.15
-
Enfin, nous avons l’appropriation critique, scientifique et marxiste de l’expérience du passé. Comme montrait un article précédent16, c’est cette capacité à s’approprier le travail et la pensée des générations précédentes et de les développer de manière critique, qui caractérisa l’émergence de la pensée scientifique dans la Grèce antique.
Les exemples d’une telle réappropriation critique par une nouvelle génération de militants ne manquent pas dans l’histoire du mouvement ouvrier. Nous pouvons citer celui de Lénine à l’égard de Plekhanov, ou plus frappant encore, celui de Rosa Luxemburg au regard de Kautsky et du SPD en général, aussi bien qu’envers les théories de Marx qu’elle a à la fois critiquées et développées dans L’accumulation du capital. Ces exemples nous montrent qu’une des préconditions pour la critique est précisément l’appropriation des idées de nos prédécesseurs, c’est-à-dire la capacité à les comprendre – et une capacité à comprendre est dépendante d’une capacité à lire (alors que la moitié de la section ne lisait d’autres langues que le turc, ceci était clairement une impossibilité physique). Ce n’est qu’après avoir compris les idées que l’on peut les critiquer, particulièrement dans le contexte d’une organisation où le but est de convaincre les autres camarades, en polémiquant avec eux, ce que les membres de la section turque n’ont pas réussi à faire. PBJ prétend que ce n’est pas vrai17. Et pourtant, ils auraient du mal à pointer un seul texte sur la question organisationnelle (en dehors de « l’infâme » position sur le parasitisme) qui soit en prise avec les documents de base du CCI, internes ou externes. Si nos lecteurs ont besoin de se convaincre de la vacuité de la compréhension organisationnelle de PBJ, nous les invitons à consulter le texte de Jamal (Text by Jamal [16]), un contributeur régulier sur le forum du CCI) que PBJ a publié sur son site web sans le moindre commentaire critique : il se lit comme une sorte de manuel pour manageur produit par le service des ressources humaines d’une nouvelle start-up.
Ce que signifie rejoindre le CCI
Maintenant, nous voulons faire un pas en arrière et revenir à notre citation au début de cet article. « Une des tâches les plus urgente et ardue qui se dresse devant les révolutionnaires est celle d’unifier et de souder ensemble les forces révolutionnaires qui émergent et qui sont aujourd’hui dispersées de par le monde ». Face aux défaillances du CCI (et nul ne le sait mieux que nous), il est bien trop aisé d’oublier combien une telle tâche est difficile et ambitieuse. Rassembler des militants de toutes les parties du monde, d’origines et de cultures très différentes, au sein d’une même association internationale capable de s’impliquer, de prendre part et de stimuler la réflexion du prolétariat mondial (fort de plusieurs milliards) afin qu’il s’unisse - non dans une homogénéité sans vie mais dans un tout où l’unité d’action se fonde sur la diversité du débat au sein d’un cadre politique accepté -, c’est une entreprise gigantesque. Certainement, nous sommes loin de la réalisation de nos ambitions – mais nous devons seulement inciter à prendre en considération combien nos ambitions sont différentes de la mentalité de cercle qui dominait EKS, comme ses membres le reconnaissent eux-mêmes.
En fait, les membres de la section turque n’ont jamais compris la différence fondamentale entre être un cercle et être des militants d’une organisation révolutionnaire, en particulier une organisation internationale. Ce n’est pas entièrement leur faute, dans la mesure où nous avons échoué à leur transmettre nos conceptions organisationnelles – en partie parce que, jusqu’un certain point, nous les avions nous-mêmes perdues de vue.
Nous avons déjà largement traité de la question que Lénine appelle « l’esprit de cercle »18. Nous nous contenterons ici de rappeler quelques points essentiels.
Tout d’abord, le cercle se caractérise par une adhésion basée sur un mélange d’amitiés personnelles et d’accords politiques. Il en résulte que les conflits personnels et les désaccords politiques sont amalgamés – une recette infaillible pour la personnalisation des arguments politiques. Il est peu surprenant que la vie de la section en Turquie ait été marquée par une série d’animosités personnelles amères conduisant à des divisions et à des périodes de « paralysie ».
Pour maintenir sa cohésion, le cercle se referme vis-à-vis de l’extérieur, comme une huître. Cela devient alors une recette de la personnalisation des antagonismes entre le cercle et le reste de l’organisation : « Sous le nom de ‘minorité’, des éléments hétérogènes se regroupent au sein du parti s’unissent, mus par le désir, conscient ou non, de maintenir leur relations de cercle, formes d’organisations préalable au parti ».19 L’esprit de cercle au sein d’une organisation mène à une attitude de « eux et nous », le cercle contre les « organes centraux » ; le cercle perd complètement la vision de l’organisation comme un tout, et devient obsédé par les « organes centraux ». Un exemple que nous pouvons citer parmi bien d’autres est le texte écrit par un des membres de la section : Y a-t-il une crise dans le CCI ? ; la critique exprimée dans ce texte a été reprise et développée par une autre section qui y a également répondu, bien que cette réponse ait été complètement ignorée. Seuls « les organes centraux » sont jugés dignes de considération.
Le cercle maintient sa cohésion en s’opposant en bloc au reste de l’organisation, alors qu’il évite simultanément tout débat au sein du cercle sur ses propres divergences. Ceci était très flagrant dans le débat sur l’éthique et la morale engagé au sein du CCI où un camarade développait des arguments critiques (voir notes plus haut) qui étaient d’une certaine manière directement inspirés par les propres textes de l’organisation, alors qu’un autre mettait en avant une position qui bien plus redevable à Hobbes qu’à Marx – et pourtant, nous n’en avons jamais entendu la moindre critique de la part des autres camarades de Turquie20.
Un cas plus flagrant de cette fermeture au reste de l’organisation apparaît avec le débat sur les événements autour des manifestations massives de Gezi Park à Istanbul. D’après PBJ, « il a été dit que la section n’avait pas informé l’organisation de ses désaccords pendant le mouvement de Gezi alors qu’au plus chaud des événements, la section a eu une réunion avec les camarades du secrétariat pour tenter d’expliquer ses désaccords. » Il est certainement vrai qu’il y a eu une longue discussion entre les membres du secrétariat international et les membres de la section turque sur la modification éditoriale de leur article à propos des événements de Gezi. Il est également vrai que les membres du secrétariat international ont eu des difficultés à comprendre les tenants et les aboutissants de ces « désaccords », et cela pour une bonne raison : à la conférence de la section tenue peu après, il est devenu évident qu’il y avait au moins deux, sinon trois, différentes positions au sein de la section elle-même. Les membres de la section se sont engagés à écrire leurs différentes positions pour mener la discussion au sein de l’ensemble de l'organisation – nos lecteurs seraient étonnés d’apprendre que ces documents n’ont toujours pas vu le jour.
Les ex-camarades de Turquie restent encore silencieux sur un autre de leurs désaccords internes, à propos du « ton » de notre "Communiqué à nos lecteurs : le CCI attaqué par une nouvelle officine de l’État bourgeois [17]". D’après PBJ, « néanmoins, les membres de la section dans l’organe central du CCI n’ont pas manqué de critiquer le ton extrêmement virulent du communiqué écrit en réponse à cette attaque. » Parfaitement vrai. Mais le texte oublie de mentionner que deux autres membres de la section ont trouvé le communiqué tout à fait approprié, et l’on dit sans ambiguïté pendant une réunion tenue en juillet 2014 avec des membres de la section en France.
Nous avons déjà mentionné (voir la note 6), l’insistance de L. et Devrim pour poursuivre leurs débats sur les forums sans aucune restriction. Ceci rappelle, une fois de plus, les paroles de Lénine : « Certains militants éminents des vieux cercles les plus influents, n’étaient pas habitués aux restrictions organisationnelles que le Parti doit imposer, sont mécaniquement enclins à confondre les intérêts généraux du Parti et leurs intérêts de cercle qui peuvent coïncider pendant la période des cercles. » Ils « brandissent naturellement l’étendard de la révolte contre les restrictions indispensables de l’organisation et ils établissent leur anarchisme spontané comme un principe de lutte (…) montrant des exigences en faveur de la ‘tolérance’, etc. »21
Où va Pale Blue Jadal ?
« Une image vaut mille mots », comme dit le proverbe, et cela est certainement valable pour PBJ. Grace à la magie technique d’internet, nous avons découvert que l’image que PBJ a choisie pour représenter le groupe vient directement du monde « sentimental hippiedom.22 »
Leurs « principes politiques » sont dénués de toute référence à la Gauche communiste, ou encore de tout héritage du passé. PBJ déclare être un nouveau groupe basé seulement sur lui-même, sur l’ignorance et sur un amalgame de ressentiments, de mécontentements et de loyautés personnelles23.
Il n’y a par ailleurs aucune référence à la décadence du capitalisme, qui est pour le CCI qu’ils viennent tout juste de quitter, le fondement matérialiste de ses positions politiques. PBJ ne fait aucune critique de ses fondements théoriques, pas plus qu’il n’a d’alternative à donner. Les membres de PBJ n’en ont peut-être pas conscience, mais en évacuant toute référence au passé et toute tentative de donner une base matérialiste à leurs positions, ils compromettent déjà le processus de « discussion politique » qu’ils prétendent avoir engagé.24 Dans la liste des sujets de discussions proposés dans la « feuille de route » de PBJ (qui devrait les tenir occupés pendant les vingt prochaines années au moins), il vaut la peine de remarquer la présence de « La question nationale au Moyen-Orient »... et l'absence complète sur le site de PBJ du moindre commentaire sur la situation concrète en Turquie, la continuité de la guerre d'Erdogan contre les Kurdes, la résurgence du nationalisme kurde et la crise des réfugiés syriens, l'attaque à la bombe de Suruç, etc., etc.
Nous avons dit plus haut que l'existence d'une organisation révolutionnaire internationale est une condition préalable pour la réussite du renversement du capitalisme. Si le prolétariat se montre un jour capable de « se lancer à l’assaut du ciel » (pour utiliser une expression de Marx), alors sa force décisive proviendra de ces pays munis d’une classe ouvrière forte et d’une certaine expérience historique. La Turquie, passerelle entre l’Europe et l’Asie, est l’un de ces pays et un mouvement prolétarien montant produira nécessairement une expression politique qui ne peut être fondée que sur l’héritage de la Gauche communiste. En tournant le dos à cet héritage, les membres de PBJ se disqualifient pour participer à une telle expression politique, et ceci est leur tragédie.
Terminons tout de même sur une note optimiste. Toute notre expérience passée indique que PBJ est condamné à suivre la voie des cercles précédents - ceux qui refusent d'apprendre de l'histoire (et vous ne pouvez pas apprendre de l'histoire, si vous ne savez rien à son sujet) sont condamnés à la répéter. Mais restons ouverts à la possibilité que nous pouvons avoir tort et que PBJ, en dépit de toutes les apparences, pourra encore produire quelque chose d'utile pour le prolétariat et pour la révolution. Pour ce faire, ils devront trouver leur chemin pour revenir vers l’héritage révolutionnaire théorique et organisationnel de la Gauche communiste.
CCI, novembre 2015
1 La TCI-Tendance Communiste Internationaliste (ex-BIPR-Bureau International pour le Parti Révolutionnaire) offre une autre illustration frappante de cette extrême difficulté à dépasser les erreurs qui sont, pour ainsi dire, installées dans les gènes de l’organisation : ces origines dans le profond opportunisme qui présidait à la création du Partito Comunista Internazionalista en 1943 [18] dont elle est issue, ont toujours hanté cette organisation depuis lors.
2 Bien entendu, il ne s’agit pas non plus de nier que nous avons fait des erreurs dans ce domaine également, en grande partie comme résultat de notre tendance au schématisme.
3 C’est pourquoi nos statuts font explicitement partie de notre plateforme et ils constituent une partie des bases sur lesquelles les militants sont intégrés dans l’organisation.
4 Le manque de traductions en turc est devenu critique uniquement lorsque la section (sans demander l’opinion à qui que ce soit d’autre sur le sujet) a intégré des nouveaux membres qui ne pouvaient pas lire l’anglais.
5 Le lecteur attentif aura remarqué que notre vision de l’opportunisme du CCI en matière d’organisation est très différente de celle de PBJ. Au risque d’éprouver la patience de nos lecteurs, nous voulons répondre brièvement à l’un des petits « mythes » de PBJ (pour reprendre leur expression) : selon lequel « l’exemple le plus évident de l’opportunisme dans le processus d’intégration de la section, était que des camarades en désaccord avec la plateforme et les statuts étaient acceptés dans l’organisation. » À quoi cela se réfère-t-il exactement ? En fait, il y avait deux désaccords possibles soulevés par le processus de discussion. Le premier était un désaccord de Devrim sur l’interdiction par nos statuts d’être membre d’un syndicat (étonnamment, PBJ ne voit visiblement rien de malhonnête dans le fait d’accepter d’intégrer dans une organisation un élément qui est en désaccord avec les positions de celle-ci … ), le second se réfère à une camarade qui était en désaccord avec l’interdiction par les statuts d’appartenir à toute autre organisation politique. Prenons ces désaccords un à un.
Exclure l’appartenance à un syndicat vise toute concession à « l’entrisme » (l’idée qu’il serait possible d’influencer positivement les syndicats de l’intérieur, ou bien que l’on pourrait intervenir « plus efficacement » en étant membre d’un syndicat) ou au « syndicalisme rouge » selon sa variante bordiguiste, ou encore à son cousin, le syndicalisme révolutionnaire. Toutefois, les statuts l’autorisent pour des exceptions dues à des « contraintes professionnelles ». Cette disposition fut ajoutée pour prendre en compte les travailleurs des industries « closed-shop » (système d’affiliation obligatoire aux syndicats, NdT), où l’appartenance à un syndicat est une condition d’embauche – une situation très courante dans les années 1970 en Angleterre, mais aussi dans quelques industries dans d’autres pays (par exemple, l’industrie française de l’imprimerie lorsqu’elle était complètement dominée par la CGT). L’objection de Devrim était que les travailleurs pouvaient être forcés, pas nécessairement dans un « closed-shop » à se syndiquer pour accéder à la sécurité sociale, à un système de protection sociale ou d’assurance ou d’autres avantages critiques tels que la représentation légale dans une dispute personnelle ; à aucun moment (à notre connaissance), aussi bien aujourd’hui qu’à l’époque de l’argumentation de Devrim, cela ne fut en faveur de l’entrisme ou bien en faveur du syndicalisme révolutionnaire, et nous avions considéré (comme nous le lui avions expliqué) que les cas qu’il citait, dans les conditions des années 2000, tombaient dans la définition de ce que l’on nomme « des contraintes professionnelles ».
Dans le second cas, la camarade en question participait à un groupe de femmes et était réticente à l’abandonner. Nous avons demandé de quelle sorte de groupe il s’agissait. Elle a expliqué qu’il s’agissait d’un groupe de femmes qui se rencontraient pour discuter spécifiquement des problèmes de femmes (politiques et sociaux) et préféraient le faire sans la présence des hommes – ce qui est parfaitement compréhensible dans les conditions d’un pays tel que la Turquie. Ce groupe – pour autant que nous pouvions comprendre – n’avait pas de plateforme politique, ni même d’ordre du jour politique en tant que tel ; sur cette base, nous avons conclu qu’il ne s’agissait pas d’un groupe politique tel que défini dans les statuts mais plutôt d’un groupe de discussion et qu’en conséquence, non seulement nous ne pouvions avoir d’objection à sa participation mais qu’au contraire, nous considérions cela comme une partie de l’intervention de l’organisation.
6 Nous nous limiterons à un seul exemple. Selon nos statuts, le débat au sein de l’organisation est rendu public seulement lorsqu’il a atteint un degré de maturité tel que, premièrement, l’ensemble de l’organisation soit consciente des débats et de leurs implications, et deuxièmement, qu’il était possible de l’exprimer avec une clarté suffisante pour qu’il contribue à cette clarification et non à la confusion. Ces dispositions, rappelons-le, sont dans les mêmes statuts auxquels tous les membres d’EKS ont adhéré. Quoi qu’il en soit, deux d’entre eux ont continué à débattre entre eux en public sur divers forums internet qu’ils avaient l’habitude de fréquenter, sans jamais, à aucun moment, penser nécessaire de tenir informé le reste de l’organisation que ce soit de leur intervention ou de leurs désaccords. Lorsqu’il leur a été montré que c’est en contradiction directe avec à la fois la lettre et l’esprit des statuts, ils ont répondu que les statuts avaient été écrits avant l’existence d’internet, et que ces règles pouvaient uniquement être applicables à la presse imprimée.
Maintenant bien sûr, quelqu’un pourrait parfaitement argumenter sur ce point – mais ce que l’on ne peut pas faire, quand on accepte les statuts d’une organisation comme le CCI, c’est de tout simplement les ignorer lorsqu’ils ne nous conviennent pas et de tenter de se justifier a posteriori en pinaillant sur la différence entre la presse imprimée et la presse électronique.
7 L’article sur le Congrès parle de « dimension intellectuelle » de la crise du CCI et de la lutte nécessaire contre le « routinisme, la superficialité, la paresse intellectuelle, le schématisme, … ». Mais les membres de PBJ, peuvent-ils honnêtement prétendre être eux-mêmes à l’abri de ces défauts ?
8 Revue Internationale n° 90, La fraction italienne et la Gauche Communiste de France [19], voir également le « Rapport sur la Fraction » pour le XXIe Congrès du CCI.
9 Revue Internationale n° 131, La culture du débat : une arme de la lutte de classe [20].
10 Plus important encore, le CCI est actuellement la seule organisation dont les positions viennent de la synthèse des principales avancées des différents courants de la Gauche communiste. Les autres groupes s’identifient exclusivement soit à la Gauche germano-hollandaise, soit à la Gauche italienne.
11 PBJ mentionne une réunion du Bureau international dans laquelle le droit de participation du délégué de la section turque a été remis en question par une des autres délégations. Ceci était assurément une sérieuse erreur de la part de la délégation en question, mais aussi un indicateur de cette atmosphère de méfiance qui s’est développée dans l’organisation – mais comme PBJ le met en avant, l’idée que le délégué de la section turque ne devrait pas être admis a été fermement rejeté par le BI, comme étant contraire à nos statuts et à notre conception de l’organisation.
12 PBJ est très habitué à la « personnalisation » qui était supposée caractériser notre approche. Pourtant, tout au long de leur texte, les militants sont décrits comme étant « expansionniste s» ou « conservateurs », complètement indépendamment des arguments politiques invoqués. Laissons PBJ se préoccuper de la poutre dans leurs yeux, avant de se soucier de la paille dans les yeux des autres.
13 Certains militants de la section turque avaient une longue expérience organisationnelle avant de rejoindre le CCI… dans des sectes gauchistes. Mais quelles que soient les intentions conscientes de ces membres, ces groupes sont fondamentalement bourgeois et en tant que tels, ils sont profondément imprégnés de l’idéologie bourgeoise : c’est notre expérience avérée – confirmée à la lettre par PBJ – que, pour un ex-gauchiste, être militant dans une organisation communiste signifie avant tout désapprendre toutes les attitudes et pratiques acquises dans le gauchisme. Ceci est bien plus difficile que de venir au communisme sans expérience antérieure.
14 La culture du débat, 2007, op. cit
15 Dans la chanson Les bourgeois du chanteur belge Jacques Brel, trois étudiants se moquent du ridicule des « bourgeois » provinciaux… jusqu’à ce qu’eux-mêmes vieillissent et se retrouvent devant la police pour se plaindre de l’intolérable insolence des jeunes étudiants. Brel aurait pu écrire pour Joschka Fischer, Daniel Cohn-Bendit et tous les autres leaders politiques issus du mouvement étudiant de 1968.
16 Notes de lecture sur marxiste et science [21] (disponible uniquement en anglais).
17 Selon PBJ, « l’affirmation selon laquelle un texte interne sur l’éthique écrit par un membre de la section ignorait les textes écrits auparavant par l’organisation sur ce sujet était une autre légende parce que le texte en question ét)ait en fait écrit en réponse au texte d’orientation de l’organisation sur cette question. » En retour, nous pouvons citer une réponse au texte en question que PBJ a publié trop précipitamment : « Une précondition pour la ‘culture du débat’ est qu’il devrait y avoir un débat : cela signifie que les positions opposées doivent se répondre. Bien que le texte de L. commence par une brève citation du texte sur « Marxisme et éthique [22] » sur la définition de l’éthique et de la morale, et nous dit que ‘de ces définitions découlent toute une série de confusions, et de nombreuses autres erreurs’, ceci est l’unique endroit dans son texte où il fait référence à Marxisme et éthique, nous sommes laissés dans l’obscurité sur ce que sont exactement ces ‘erreurs et confusions’, et de quelle manière elles sont le résultat des idées avancées dans Marxisme et éthique. De plus, il est clair pour nous que des parties du texte de L. sont en accord ou sont directement inspirées par Marxisme et éthique, et pourtant, ces zones d’accord ne sont pas plus claires. »
18 Notamment dans La question du fonctionnement de l’organisation dans le CCI [23], Revue Internationale n° 109
19 Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière, cité dans le texte sur le fonctionnement organisationnel.
20 Pour donner une idée de l’influence de la philosophie de Hobbes de ce texte, nous en citons ce court passage : « La relation entre les êtres humains est une relation inégale. Cette inégalité découle de la valeur d’usage et de la valeur d’échange produite par les êtres humains [visiblement ici l’auteur n’a pas conscience des dizaines de milliers d’années de l’histoire de l’humanité où la valeur d’échange n’existait pas]. Cette réelle base matérielle détermine complètement les relations humaines de tout temps [l’objection bourgeoise classique à la possibilité du communisme]. Et cette inégalité produit une tendance à dominer. Pour les êtres humains, cette tendance émerge de la survie dans des conditions naturelles. De manière primordiale, c’est la tendance de chacun pour assurer sa propre survie ». Autrement dit, l’homme est un loup pour l’homme et la société humaine, c’est la guerre de chacun contre tous, comme l’énonçait Hobbes, etc. etc.
21 Citation de Lénine.
22 Ceux que cela intéresse peuvent trouver l’original ici : markhensonart.com/galleries/new-pioneers. Elle est accompagnée de l’édifiant texte suivant : « Le drame épique de la vie, de la mort, de la guerre, de la paix et le droit inaliénable de choisir est représenté dans un immense panorama. Des réfugiés sortent d'une zone de guerre, un pionnier arrive à un mur de graffitis où les choix sont rayés. Nous voulons tous vivre en paix, mais en quelque sorte, beaucoup sont attirés par des valeurs qui sont totalement différentes et la guerre semble être la seule option pour une humanité devenue folle. Les pionniers et les réfugiés vont, eux, vers un nouveau monde de la conscience éveillée. »
23 Il vaut la peine de noter qu’un camarade, dans sa lettre de démission, n’exprime absolument aucun désaccord politique avec l’organisation.
24 Nos lecteurs peuvent juger des limites dans lesquelles PBJ est engagé dans un processus de discussion et de clarification d’après leur refus, suite à notre invitation pour participer au dernier congrès du CCI, soit au titre de membres de l’organisation soit comme éléments extérieurs à celle-ci.
Vie du CCI:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [25]
Rubrique:
ICConline - mai 2016
- 1308 reads
1976-2016 : Il y a 40 ans, la démocratie espagnole naissante débutait avec des assassinats d’ouvriers à Vitoria
- 2627 reads
Introduction (2016)
Il y a aujourd’hui 40 ans que se sont déroulés les événements de Vitoria de 1976, dans un contexte d’importantes mobilisations ouvrières partout en Espagne, pour la défense des conditions de vie face à la dévalorisation des salaires due à la crise économique. Les manifestations dans cette ville étaient devenues de plus en plus massives, s’unifiant dans des assemblées générales, en élisant un Comité de délégués révocables. Et c’est justement au moment où allait avoir lieu une assemblée générale dans l’église de San Francisco, que la répression policière s’est abattue sur les ouvriers. Le ministre de l’Intérieur d’alors, Fraga Iribarne, fondateur et président du parti de droite espagnol (Parti populaire), jusqu’à son décès, et toujours salué comme un grand « démocrate », donna l’ordre de tirer sur les travailleurs. Il y eu 5 morts et beaucoup de blessés.
La réponse ouvrière fut très puissante, partout dans le pays il y eu des manifestations de solidarité, des assemblées massives se sont organisées à l’échelle d’une ville entière comme à Pampelune, exprimant ainsi une dynamique de lutte de masses, unifiant les revendications et refusant tout retour au travail jusqu’à ce que ces revendications aient été satisfaites. L’État a dû céder partiellement.
Début mars dernier, dans de son premier discours parlementaire lors du premier essai d’investiture de Pedro Sánchez (du Parti socialiste), Iglesias (chef de Podemos)1 a voulu s’appuyer sur cet anniversaire pour avaliser ses propositions d’un « renouvellement démocratique » et de « justice sociale ». Mais ce que les ouvriers, en 1976, avaient en face d’eux ce n’était pas tant un gouvernement post-franquiste agonisant, mais un projet de transition démocratique organisé avec le soutien international des vieilles démocraties européennes qui faisaient à ce moment-là partie du bloc américain (l’Allemagne et la France, en particulier), pour essayer de contenir le grand malaise existant en Espagne et les luttes. Les Pactes de la Moncloa, un an plus tard, montrèrent l’unité de toute la bourgeoisie pour attaquer le prolétariat sous le couvert idéologique de la réforme démocratique. Si Vitoria 76 a bien un rapport avec les assemblées massives du 15 M [pour 15 mai 2011], avec la dynamique de la lutte de masse (même si en 2011 n’a pas pu surgir clairement une identité prolétarienne)2; le parti d’Iglesias n’a rien à voir avec tout cela3.
Avant de passer à la lecture de cet article de 1976, nous voudrions faire part à nos lecteurs du regard critique que nous portons aujourd’hui à son contenu. Cet article fut rédigé alors que la section du CCI en Espagne n’était pas encore constituée4. L’inexpérience et les difficultés pour assimiler nos positions ont eu une influence sur la prise position que nous présentons ci-dessus. Aujourd’hui, 40 ans plus tard, nous la considérons toujours parfaitement valable, surtout sur les points suivants :
-
Avoir dénoncé la grande manœuvre du « rétablissement de la démocratie » en Espagne dont nous vivons encore les conséquences mensongères ;
-
Avoir démasqué la convergence contre le prolétariat, des agissements de toutes les forces politiques de la bourgeoisie, surtout de celles qui proclament être de gauche et d’extrême-gauche ;
-
Avoir défendu les moyens de lutte du prolétariat, en particulier, les Assembles générales et l’unification des luttes ;
-
Avoir défendu la perspective communiste du prolétariat, seule alternative face aux prétendues reformes d’un système qui fait plonger dans la misère, la guerre et la barbarie la grande majorité du genre humain.
Ceci dit, cet article contient des passages qui révèlent une surestimation des possibilités réelles immédiates du prolétariat. On y dit, par exemple : « Et, la prochaine fois, ce sera les commissariats, les casernes, la poste et le téléphone ». Ceci est bien l’expression d’une surestimation des possibilités que la situation offrait à ce moment-là qui est presque considéré comme un moment pré-révolutionnaire. La situation internationale du prolétariat était vraiment loin de rendre possible une telle proposition car les luttes étaient fortement retombées après les déflagrations de 1968 en France, 1969 en Italie et 1970 en Pologne, réalité ignorée tout en disant le contraire : « Aujourd’hui, partout dans le monde des grèves apparaissent contre les conditions de vie que la crise fait subir, et, même si elles sont réprimées, elles ressurgissent avec une combativité de plus en plus forte ». Mais, plus généralement, le prolétariat était bien loin de se donner les moyens de conscience et de politisation de son combat pour se mettre à réaliser une telle proposition.
On affirme aussi dans l’article que « les moyens de l’unité, de la conscience et de l’organisation, nous les avons grâce à l’expérience de cette vague de luttes » ; même s’il est vrai que l’unité s’est développée et que la multiplication des assemblées fut impressionnante, il n’y avait pas du tout, loin de là, une conscience claire pour comprendre la nécessité de la révolution prolétarienne mondiale et l’absence des moyens pour aller vers elle. Même l’unité de la classe ouvrière n’était pas comprise dans tout ce qu’elle implique. Pesaient encore sur elle très fortement les divisions sectorielles, régionales, etc. Les assemblées générales elles-mêmes n’avaient pas assumé toutes les conséquences et les implications de leur fonction dans la classe et les comités de délégués commençaient à être récupérés et manipulés par les syndicats et les forces de l’extrême-gauche de la bourgeoisie.
L’inexpérience et les difficultés dans l’assimilation des positions de classe auxquelles avait adhéré la jeune section du CCI, s’est exprimé, par exemple, dans la vision qu’on a eue sur l’insurrection ouvrière des Asturies de 1934 comme si elle avait été une « révolution ». Malgré l’énorme combativité déployée à l’époque par les mineurs asturiens, la lutte est restée totalement enfermée dans le périmètre régional et elle fut plus la réponse à une provocation qui entraîna les mineurs vers l’insurrection qu’une action consciemment décidée par eux. Par ailleurs, la situation mondiale était faite d’une accumulation de défaites physiques et idéologiques de la classe, du triomphe de la contre-révolution, de préparation de la deuxième boucherie impérialiste, tout ce qui empêchait que les luttes prennent la moindre perspective révolutionnaire. L’insurrection des Asturies doit être placée sur le même chapitre que la provocation dans laquelle les sociaux-démocrates autrichiens embarquèrent les ouvriers de ce pays en février 1934 qui les amena à une terrible défaite. Les collègues socialistes espagnols de ceux-là, avec Largo Caballero en tête, qu’on a eu le culot de présenter comme « le Lénine espagnol » (alors qu’il avait été au Conseil d’État sous la dictature de Primo de Rivera), amenèrent les mineurs dans une souricière en les laissant en plan, en sabotant toute tentative de solidarité à Madrid et ailleurs5.
Rosa Luxemburg disait que « l’autocritique, la critique cruelle et implacable qui va à la racine du mal, est la vie et l’air pour le prolétariat ». Le fait de bien montrer ces erreurs nous aide à la clarté et à la conviction dans notre combat.
CCI, mars 2016
Vitoria : l’alternative prolétarienne (Mars 1976)

La bourgeoisie n’a pas caché son inquiétude face à la force déployée par les travailleurs dans ces trois premiers mois de l’année. On voit cela dans la phraséologie de la presse et dans les déclarations des personnalités publiques : pour le cardinal primat « des jours d’incertitude sont proches pour l’Espagne », Ricardo de la Cierva voit que « l’horizon est si noir que je n’arrive pas à voir ». Le journal Informaciones, face à l’avalanche de grèves se demande : « sommes-nous face à une tentative révolutionnaire de base ? ».
Nos grèves ont secoué le pays tout entier, toutes les branches de production. Salamanque ou Zamora, « où il ne se passe jamais rien », ont connu des grèves dans le bâtiment et les industries métallurgiques ; même les aveugles ont fait des arrêts de travail et ont manifesté dans la rue.6
Même avant-guerre, on n’avait pas vu un mouvement aussi général ! Rien qu’en janvier, il y a eu plus de grèves que pendant toute l’année 1975. Une si énorme mobilisation doit nous faire prendre conscience de la force que nous possédons et que cette force ouvrière est sur le bon chemin pour en finir avec une exploitation capitaliste de plus en plus insupportable.
Voilà la première leçon à tirer, qui, avec plus ou moins de clarté, a été présente lors des dernières luttes : Pampelune, Vitoria, Elda (Alicante), Vigo, le bâtiment à Barcelone... C’est pour cela que nos camarades [de Vitoria] ont organisé les grèves par le moyen des assemblées générales, les ont unifiées dans un Comité de délégués avec aussi une Assemblée générale de ville ; ils ont cherché la solidarité de tous les travailleurs dans la rue ; et, soutenus par cette force accumulée et cette organisation autonome, ils ont occupé la ville, fermant des bars, des commerces, des banques, des établissements de l’administration...
Parler de communisme, d’émancipation ouvrière, ce n’est plus vu comme de l’utopie. On sait que le jour de la révolution est encore bien loin, mais, pour l’atteindre, nous possédons quelque chose de très solide sur laquelle nous appuyer : l’expérience de nos frères de Vitoria, Pampelune, Vigo etc., les moyens pour nous unifier, pour nous affronter au pouvoir bourgeois, pour le détruire et nous libérer. Cette expérience fait partie du resurgissement actuel du prolétariat dans le monde entier et qui reprend le flambeau révolutionnaire qui embrasa l’Europe au cours des années 1917-1921 en atteignant son sommet avec les Soviets de 1917 en Russie et les Conseils Ouvriers de 1918 en Allemagne.
Il faut perfectionner ces expériences, les généraliser partout, en leur donnant une organisation consciente réalisée par les ouvriers eux-mêmes. Les moyens sont clairs :
-
La grève générale.
-
L’occupation de villes, en fermant et en paralysant les commerces, les bars, les établissements de l’administration, et, la prochaine fois, les commissariats, les casernes, la poste et les téléphones...
-
L’organisation autonome de notre classe en Assemblées unifiées en Comités de délégués ouvriers.
-
La défense de nos Assemblées et nos manifestations contre les attaques des corps répressifs de l’État.
Le chemin est long, difficile, mais nous ne partons pas de zéro, nous avons les expériences de deux siècles de luttes ouvrières. Aujourd’hui, partout dans le monde, surgissent des grèves contre les conditions imposées par la crise, grèves qui, même réprimées, ressurgissent avec encore plus de combativité.
Assassinats et démocratie : deux faces de la même pièce
Nous avons les moyens de l’unité, de la conscience et de l’organisation grâce à l’expérience de cette période de luttes, mais il est aussi vrai que la bourgeoisie est puissante et a à sa disposition des moyens pour nous défaire, nous diviser et nous empêcher d’avancer sur notre chemin.
Il faut que nous ayons une très claire conscience de quels moyens va utiliser la bourgeoisie pour écraser notre lutte. On peut les résumer en deux : répression et démocratie.
En moins de deux semaines, le gouvernement pré-démocratique de Fraga a assassiné plus d’ouvriers que le gouvernement fasciste de Carrero Blanco en deux ans... Face à la force incontrôlable des luttes ouvrières de Vitoria, Elda, Vigo, Pamplona etc, ce gouvernement ne pouvait avoir d’autre réponse que la répression la plus brutale et la même chose aurait été faite par un gouvernement fasciste que par un autre démocratique ou encore un gouvernement prétendument « ouvrier et révolutionnaire ». Le capitalisme (sous toutes ses formes d’État) aura toujours le même langage. L'histoire en offre trop d’exemples : en 1919, le social-démocrate Ebert écrase dans le sang les ouvriers de Berlin, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont assassinés; en 1921, le gouvernement bolchevique utilise les bombardements de l’aviation pour en finir avec l’insurrection ouvrière de Kronstadt ; en 1931, le gouvernement conservateur suédois tua neuf mineurs à Adalen ; en 1933, sous la République espagnole, le progressiste Azaña n’hésita pas à se salir les mains avec le sang des anarchistes de Casas Viejas, et de son côté, l’ultra-droitier profasciste Gil Robles (aujourd’hui démocrate) écrasa en 1934 l’insurrection ouvrière dans les Asturies avec les légionnaires. Après la 2ème Guerre mondiale, les tueries ont continué de plus belle : en Italie 1947 sous la démocratie-chrétienne, à Berlin 1953 et en Hongrie 1956 sous des gouvernements « communistes » ; Pologne en 1970 ; en Afrique du Sud où 12 mineurs ont été assassinés pendant une grève générale en 1972 ; en Argentine, sous le régime militaire avec des travailleurs tués à Cordoba, Tucuman...
Les crimes de Vitoria ne sont pas le fait d’une fraction ultra-droitière de la bourgeoisie, comme le dit l’OICE7 dans son journal Revolución nº 7, mais la réponse obligatoire et consciente que donnent et donneront les capitalistes face à la menace prolétarienne, quelle que soit la forme de gouvernement ! Carrillo aurait fait la même chose que Fraga !
Mais la répression n’est pas suffisante lorsque la classe ouvrière ne cesse d’avancer après chaque lutte et d’apprendre après chaque défaite. Il faut reformer les institutions de l’État bourgeois pour qu’elles puissent encadrer la lutte ouvrière, la diviser et l’enfermer derrière des objectifs qui, loin de détruire le système, le consolident.
Les événements de Vitoria n’ont pas amoindri la volonté de réforme de la part du gouvernement. Ils n’ont pas ouvert la voie au retour du redouté « bunker ».8 Le conseil des ministres a fait la déclaration suivante : « Le gouvernement (face aux événements de Vitoria) est disposé à agir en conséquence, pas seulement pour maintenir fermement l’ordre public, mais aussi pour créer les conditions objectives permettant une paix sociale réelle. (...) Les événements comme ceux de Vitoria sont particulièrement lamentables, avec lesquels on essaie clairement d’entraver le programme de réformes que le peuple espagnol désire et auquel le gouvernement d’est pas disposé à renoncer ».
Il n’y a aucune contradiction dans la combinaison de la démocratie avec les assassinats. Les bains de sang ne sont pas le monopole des fascistes. Toutes les fractions du capital utilisent les mêmes armes contre la révolte ouvrière. Mais, pour la bourgeoisie espagnole, il est indispensable d’écraser par le feu et par le sang toute lutte ouvrière indépendante et, en même temps, de créer les institutions politiques démocratiques (syndicats, partis, suffrage universel, « libertés ») pour éviter les affrontements directs comme celui de Vitoria, en enlevant tout le sens des luttes ouvrières contre l’exploitation.
Le vote, le syndicat et les partis ont une fonction : celle d’encadrer la classe ouvrière, en neutralisant toute propre initiative, en l’enfermant dans le cadre de l’entreprise et la nation, en dévoyant le chemin de sa lutte vers des reformes « socio-politiques » : l’autodétermination des peuples, l’autogestion, l’antifascisme. C’est un effort tenace et résolu celui qui est fait par les politiciens du Capital pour empêcher qu’on prenne conscience du fait que la seule solution possible à nos problèmes est celle d’en finir avec l’exploitation.
Face à un gouvernement incapable de contrôler la situation dont le seul langage connu, c’est : crime-arrestations-provocations, l’opposition démocratique de droite (libéraux, démocrates-chrétiens, etc.) s’unit à la gauche et à l’extrême-gauche dans la même entreprise : canaliser le mouvement des grèves vers une réforme démocratique.
Dans un article paru dans Mundo Diario avec le titre « L’urgence d’un pacte politique », Solé Tura, porte-parole du PC de Catalogne tire les conclusions suivantes des luttes de Vitoria, Pampelune, Sabadell : « Il faut être aveugle pour ne pas voir que nous sommes sur le point de perdre une grande occasion d’établir et de stabiliser une démocratie dans notre pays », en finissant avec la proposition suivante d’action immédiate : « Ou bien on arrive rapidement à un accord qui englobe l’opposition et les réformistes conséquents9 pour rendre faisable une alternative démocratique ou bien on atteindra bientôt la limite. Et au-delà de cette limite, les choses seront bien plus difficiles pour tous, c’est-à-dire pour le pays ».
On ne peut être plus clair. Un parti qui se dit « ouvrier » et « communiste » évalue des luttes en fonction des intérêts de la « Nation », autrement dit des propriétaires de la patrie : les capitalistes. Les groupuscules à la gauche du PC sont moins directs parce qu’ils disent parler au nom de la « classe ouvrière et du peuple », mais leur intervention est encore plus criminelle parce qu’ils présentent les mêmes reformes défendues par les PC et le reste des partis bourgeois, comme « des grandes conquêtes du peuple travailleur » !, alors qu’au moins, le PC a l’aplomb de parler clairement au nom de la bourgeoisie et de la nation !
L’ORT, le MCE et le PTE10 dans une déclaration commune, après avoir bien pleurniché sur le sort des ouvriers assassinés et avoir déclamé « qu’est-ce qu’il est méchant et fasciste le roi Juan Carlos ! », la concluent en affirmant la nécessité « d’une véritable unité des forces démocratiques qui lutte de façon conséquente pour la démocratie contre le fascisme, face à la désunion et aux hésitations bourgeoises de la Junta et de la Plataforma »11.
LC12, dans sa publication Combate nº 40 critique Ruiz Giménez et Tierno Galván13 parce qu’ils ne sont pas allés à la manifestation pro-amnistie à Madrid le 20 janvier, en ajoutant que « les milliers de manifestants n’avaient pas besoin de leur présence pour défendre l’amnistie et autres aspirations démocratiques des masses qu’ils ne savent pas réellement défendre ». Donc, si les bourgeois ne savent pas lutter pour la démocratie dont ils ont besoin, alors la LC se chargera d’amener les ouvriers à leur tirer les marrons du feu !
Pour la très gauchiste OICE, le bilan de Vitoria est le suivant : attribuer les crimes à une fantomatique fraction prétendue « d’extrême-droite » de la bourgeoisie ; elle en arrive même à considérer l’autodéfense ouvrière à travers les manifestations et les assemblées générales comme de la provocation et de l’aventurisme; elle considère la classe « immature » pour accomplir une « rupture socialiste »; et elle finit par profiter des événements pour faire du bluff en s’attribuant ‘‘l’honneur » d’avoir dirigé la lutte. Cette organisation soi-disant « anticapitaliste » et représentante de la « Gauche communiste » ne dit pas un mot sur la valeur que cette lutte a eu pour l’avancée du mouvement ouvrier, elle ne tire la moindre leçon montrant les succès et les erreurs afin de se préparer pour des luttes futures, elle ne la resitue pas non plus dans le cadre de la situation mondiale et de la lutte générale de la classe. Pas un mot sur tout cela ; toute l’obsession de l’OICE est de montrer « son sens des responsabilités » et de ne pas tomber dans les « provocations ».
La gauche du capital
Nous ne donnons-là qu’un petit aperçu des différentes réactions des fractions de droite, de gauche et d’extrême-gauche vis-à-vis des événements de Vitoria non pas, une fois celles-ci mises à nu et dénoncées, pour pouvoir déballer ensuite à notre tour notre propre marchandise idéologique et la vanter comme étant la meilleure sur le marché.
Nous et tous ceux qui mettons en avant la nécessité d’une lutte permanente, collective et organisée contre le Capital, nous avons besoin de nous regrouper dans une organisation politique où l’on puisse forger un programme communiste et une intervention cohérente dans les luttes. Le problème qui se pose est celui de savoir si ces organisations de gauche et d’extrême-gauche qui se présentent comme l’avant-garde du prolétariat, sont réellement ou pas un instrument utile dans la lutte pour le communisme.
Notre réponse est non. Nous ne pouvons pas trouver cet instrument ni dans le programme, ni dans l’organisation, ni dans la conscience de ces groupes :
-
L’objectif de leurs programmes n’est jamais le communisme, pas plus leurs moyens pratiques de lutte pour l’atteindre, la conscience et l’organisation. Au contraire, ils défendent les « libertés » (les uns les appellent démocratiques, les autres « politiques »), le syndicat « ouvrier », l’autogestion, le contrôle ouvrier..., c’est-à-dire une espèce de programme minimum de reformes du capitalisme, alors que nous savons bien à travers l’expérience historique de notre classe et à travers l’expérience des pays démocratiques que ce programme n’est pas « un pas en avant », mais une impasse qui nous affaiblit, nous divise et nous amène à la défaite.
-
Leur organisation est un modèle de bureaucratie et de hiérarchisation, où toute discussion politique, même entre militants, est entravée par des raisonnements du genre « l’unité », ne pas tomber dans « l’anarchie », ne pas être « dogmatiques », ni « puristes »... En fait, ce qu’il est important d’en retenir, c’est le schéma organisationnel qu’ils proposent à la classe ouvrière, basé sur la division entre lutte économique et lutte politique. En effet, la gauche en général et l’extrême-gauche avec un jargon encore plus confus ont insisté sur cette division en disant que les luttes sont des luttes « économiques » (Camacho14 n’a pas cessé de le répéter partout durant le mois de janvier). Ce qui est le plus cocasse, c’est qu’ils utilisent le même raisonnement spécieux que la droite, laquelle dit : « grèves économiques, oui, grèves politiques, non ! » (… « parce qu’elles seraient contrôlées par Moscou... ou par la CGT française » !!!). La gauche rejette l’accusation de politisation, en faisant une séparation (un peu à la manière de la théologie médiévale et en déni de toute réalité) entre économique et politique. Tout simplement, parce que pour elle, la seule politique que les ouvriers peuvent faire est celle de la bourgeoisie d’opposition... Voilà, « circulez, il n’y plus rien à voir ni à discuter ! » Mais, dans quelle tête a pu germer l’idée saugrenue que de simples ouvriers puissent lutter politiquement de façon autonome ? Quant à l’extrême-gauche, elle nous ressort les plus mauvais textes de Lénine pour justifier, en fin de compte, la même idée contre-révolutionnaire : les ouvriers ne peuvent atteindre qu’un niveau de conscience « trade-unioniste » (syndicale et économiste) de la lutte...
Personne ne peut nier le fait que la conscience est un processus qui a tout un chemin à parcourir et que le plus souvent les grèves éclatent pour des questions économiques. Ce que, par contre, nous refusons totalement et que nous affirmons être contre-révolutionnaire, c’est de placer des frontières infranchissables avec le « politique », de nier les évidences, de proclamer des vérités décrétées d’en haut, en niant que la conscience s’enrichit dans l’action et qu’entre la conscience économique et la conscience politique, il y a un mouvement de constants allers-retours.
« Mais quand il s'agit de rendre compte avec exactitude des grèves, des coalitions et des autres formes dans lesquelles les prolétaires accomplissent devant nos yeux leur organisation comme classe, les uns sont saisis d'une crainte réelle, les autres affichent un dédain transcendantal. (…) Ne dites pas que le mouvement social exclut le mouvement politique. Il n'y a jamais de mouvement politique qui ne soit social en même temps. » (Marx, Misère de la philosophie).
Les coupables de Vitoria
On a dit que les morts de Vitoria, il faut les mettre sur le compte du bunker qui, par ses provocations continuelles, a amené les ouvriers à une boucherie. Les ouvriers ne voulaient que la réintégration des 22 licenciés de [l’entreprise sidérurgique] Forjas Alavesas, l’attitude provocatrice de la police et sa violence exacerbée entraînant la tragédie. Tout cela ne serait qu’une manœuvre du bunker pour bloquer la démocratisation.
Le gouvernement a suivi heure par heure les événements et l’ordre de tirer est venu du préfet d’Alava [province dont le chef-lieu est Vitoria], après consultation du ministère de l’Intérieur. Dans le quartier de Zaramaga où la tragédie a eu lieu, une conversation fut interceptée sur la radio de la police entre le chef des forces de police et le préfet où celui-ci ordonnait expressément de ne pas hésiter à tirer.
Le préfet d’Alava n’avait pas la réputation d’être d’extrême-droite, c’était un homme de confiance de Fraga, qui l’avait nommé. Par ailleurs, la Garde Civile –nid de l’ultra-droite– n’a pas du tout été mêlée au conflit.
Une autre cause qui a été mise en avant a été l’entêtement du patronat d’Alava, se refusant à négocier avec les ouvriers. Forjas Alavesas et d’autres entreprises isolées ont fini par accepter une partie très substantielle des revendications, avec la volonté claire de diviser et de négocier entreprise par entreprise. Mais les ouvriers ont refusé une telle manœuvre. Ils voulaient qu’on leur donne une réponse globale sans licenciements ni arrestations. C’était une décision politique qui mettait en avant l’unité de la classe face à la négociation et face à quelques améliorations qu’on considérait comme pas très sûres. Lors des assemblées, il y a eu des débats houleux où l’on a discuté sur tout cela et, à la fin, c’est la position « ou tous ou personne » qui a prévalu. Dans Forjas Alavesas, le patron a tout octroyé, l’assemblée d’usine décida de retourner au travail, alors que l’assemblée générale commune lui demanda de reconsidérer sa position et de reconduire la grève. Ceux de Forjas ont accepté cette décision.
Ceci est une leçon d’une grande valeur. Cela veut dire mettre en priorité l’unité de la classe face à la négociation, face à de possibles améliorations dans une seule entreprise, signifie comprendre la nature politique (affrontement direct contre le capital et son État) du combat pour nos revendications ; cela signifie reconnaitre le pouvoir de l’Assemblée Commune des entreprises en lutte, en tant que mouvement général de la classe.
Lorsqu’on nous parle du bunker ou de l’irresponsabilité du patronat d’Alava, on est en train de nous inventer des boucs- émissaires. On voit la cruauté de l’aile fasciste du capital, mais on met un voile sur la cruauté de l’aile démocrate. En définitive, on est en train de nous masquer le fait que nos intérêts de classe se heurtent directement à l’ordre capitaliste dans son ensemble et que face à nos luttes, tout gouvernement bourgeois n’hésitera pas à employer les mêmes méthodes criminelles.
Vitoria est un exemple de lutte consciente et organisée du prolétariat contre le pouvoir bourgeois. Elle montre que là on a compris que nos revendications n’avaient pas de solution à l’intérieur des institutions capitalistes (conventions collectives, négociations, syndicat…), signifiant qu’il est nécessaire de se préparer pour affronter dans les meilleures conditions possibles l’inévitable affrontement contre le capital et son État.
Mettre en avant des boucs-émissaires a un but précis. Il s’agit de nous faire croire qu’une lutte syndicale est viable et aussi de nous faire croire que c’est un secteur réactionnaire et « bunkériste » contre lequel il faudrait diriger tous nos efforts. En même temps, on essaie d’occulter tout le contenu révolutionnaire que Vitoria contient et d’éviter que l’on se mette en face de la réalité : si nous généralisons notre lutte et l’unifions de façon autonome avec des organes de classe, toute la répression de l’État nous tombera dessus, ce qui veut dire qu’il est indispensable de se poser la question d’une défense organisée et consciente de nos assemblées et de nos manifestations.
La solidarité avec Vitoria
La solidarité avec Vitoria ne pouvait pas se réduire à une protestation contre les crimes du gouvernement, elle devait se comprendre dans le sens de comment s’unir à la lutte des ouvriers de Vitoria en soutien à leur affrontement conscient et autonome contre le pouvoir bourgeois.
Dans certains endroits du pays (Navarre, Tarragone) il y a eu une réponse de classe, alors que dans d’autres (Pays basque, Catalogne) la gauche a tiré profit des morts pour mettre en avant son alternative démocratique- nationaliste, tout en noyant la lutte dans la pleurnicherie envers ces crimes.
Madrid a représenté une sorte de cas à part. La fatigue de la récente grève générale a beaucoup pesé, il y a eu des endroits avec des arrêts de travail symboliques de 5 minutes, tandis que dans d’autres entreprises (Torrejón, Intelsa et Kelvinator à Getafe) il y a eu grève et sortie dans la rue avec la volonté d’étendre la lutte, mais sans succès.
En Navarre, l’ambiance était favorable à la lutte lorsqu’on a appris les événements de Vitoria. Le mercredi 3 mars même, les industries textiles étaient arrêtées, tandis que 300 entreprises étaient en grève pour la Convention Générale de Navarre afin de favoriser les petites entreprises. Dans ces actions, le Conseil de Travailleurs15 (qui avait été noyauté depuis longtemps par les candidats des Commissions Ouvrières liées au parti stalinien), malgré son « efficacité », fut débordé par les ouvriers qui avaient élu une assemblée de délégués d’entreprise. Et ils étaient justement réunis ce mercredi dans l’après-midi lorsqu’on a su ce qui s’était passé à Vitoria ; 160 délégués d’usine ont alors décidé de proposer une grève générale à leurs assemblées. Le matin du lendemain, des entreprises ont commencé à se mettre en grève, surtout celles du Polygone Landaben. La décision principale prise dans la quasi-totalité de ces assemblées était de sortir dans la rue, d’étendre la grève, de paralyser la ville. Des piquets et des manifestations, surtout animés par les ouvriers de Superser, Torfinasa, Perfil en Frío, Inmenasa..., encourageaient les autres à sortir des usines, en allant dans la rue, en fermant des commerces et des bars. Comme lors de la grève générale de 1973, on a repris la chanson : « Une chanson traverse les rues, lève le poing… Travailleur, laisse les machines, sort de l’atelier, viens dans la rue en clamant d’une même voix : Révolution!, Révolution! »16
Après avoir hissé des barricades et résisté aux dures attaques de la flicaille, les travailleurs atteignirent le centre de Pampelune, où ils ont été rejoints par une multitude d’employés du commerce et des banques. Les cris le plus entendus étaient : « Nous sommes des ouvriers, rejoins-nous ! », « Vitoria, Solidarité ! », « A Vitoria, ce sont nos frères, on ne vous oublie pas ». Les quartiers ouvriers se sont mobilisés à fond, tout le monde sortant dans la rue. Ceci s’est surtout produit à Rochapea, San Juan, Chantrea,... mais il y a eu aussi la même chose dans des villages de Navarre, comme à Lesaca, où ceux de Laminaciones, une fois le bourg paralysé, sont partis à pied par la route vers Irun, mais la Garde Civil les dispersa à coups de fusil. À Estella, à Tafalla, à Tudela, la grève a tout paralysé... Le mouvement a duré jusqu’à la fin de la semaine. Pour en finir, les patrons ont fait de nouvelles propositions économiques pour la Convention générale. Par ailleurs, le Conseil des Travailleurs a mis en avant la réadmission des travailleurs licenciés à la suite du conflit de Potasas (1975), ce que le patron (pris de panique à cause de la situation) accepta de négocier.
Ces concessions ont eu raison de la lutte, ainsi que le travail de sape des Commissions Ouvrières (contrôlées, dans ce cas précis, non pas par le PC, mais par l’ORT et le MC) qui ont proposé « d’attendre », de « garder des forces » pour la journée de lutte convoquée partout au Pays basque qui devait avoir lieu le 8 mars. Mais, ce jour-là il n’y a eu que très peu d’arrêts de travail en Navarre.
À Tarragone, dans la raffinerie où travaillaient 3 000 ouvriers, ceux-ci se sont proposés de donner une réponse de classe. Le jeudi, l’ambiance était effervescente, mais rien ne s’est concrétisé. Cependant, vendredi, les ouvriers de certains chantiers ont commencé à sortir et à rallier des travailleurs d’autres chantiers de sorte qu’en une heure tout le monde était réuni en assemblée générale. On y a lancé l’idée de faire une marche jusqu’au centre-ville (plus de 10 kilomètres), en essayant de proposer que les travailleurs de toutes les usines de la zone industrielle les rejoignent. Il y a eu des avis contraires, mais, à la fin, les deux-tiers des personnes rassemblées ont décidé de s’y rendre. La tentative s’est soldée par un échec : très peu d’ouvriers d’autres entreprises ont rejoint ceux des chantiers de la Raffinerie. Des groupes d’ouvriers demandaient néanmoins aux manifestants un rendez-vous sur les Ramblas du centre de Tarragone pour y aller à la sortie du travail. Il y a eu aussi beaucoup de personnes du quartier de Buenavista. Sur les Ramblas, il y a eu beaucoup d’échauffourées pendant tout l’après-midi. Un ouvrier marocain fut tué par la police, laquelle a réprimé avec une sauvagerie inouïe.
L’expérience de Tarragone nous montre que les choses n’arrivent pas du premier coup, mais c’est en essayant encore et encore qu’on ouvre le chemin. Les ouvriers d’une entreprise avec un niveau de conscience plus élevé ne doivent pas concentrer leurs forces sur les luttes de « leur » entreprise, mais leur conscience plus grande doit les encourager à faire leur la tâche d’étendre et de généraliser l’action ouvrière. Dans presque toutes les zones il y a eu des exemples d’usines qui ont été le moteur du mouvement : Kelvinator à Getafe, Superser à Pampelune, Standard à Madrid, Duro-Felguera à Gijon ...
L’autre « solidarité »
Au Pays basque, toutes les organisations politiques et syndicales ont appelé unitairement à une journée de lutte pour le 8 mars. Elle a été suivie par quelques 500 000 personnes. Un succès en nombre, mais un échec du point de vue de la lutte consciente de la classe ouvrière. Comment expliquer, par exemple, que le lundi on avait tué un ouvrier à Basauri (Bilbao) et que personne ne bouge même pas le petit doigt le lendemain pour protester contre un tel crime ?
Les journées de lutte ont signifié toute une série de choses pour le mouvement ouvrier qu’il faut critiquer et démystifier :
-
D’abord, s’arrêter 24 heures et retourner au travail le lendemain comme si rien n’était passé. Cela sert à habituer les ouvriers à l’idée que leurs armes de lutte (la grève, la manifestation) ne sont pas des moyens de libération qui se forgent au fur et à mesure notre unité, mais des formes démocratiques de régulation de la vie sociale ;
-
En second lieu, les journées de lutte sont en fait des démonstrations de force et un moyen de pression des partis de gauche pour que l’État et d’autres fractions traditionnelles de la bourgeoisie prennent en considération leur capacité de mobilisation et d’encadrement afin qu’ils leur laissent une place de choix dans le jeu politique. Même si c’est avec des moyens différents que ceux de la politique parlementaire, ils ont les mêmes objectifs : instrumentaliser la lutte ouvrière dans les conflits qui opposent des fractions du capital entre elles.
En lien avec ce que veut dire journée de lutte, il y a aussi le fait de poser la question à l’échelle du Pays basque, avec une propagande qui insistait sur le fait que les morts étaient des « Basques » assassinés par le centralisme « espagnoliste ».
Et la gauche de tout le pays a scandaleusement tiré profit de ces morts pour faire passer l’idée dans la population de la nécessité d’une vraie démocratie. C’est ainsi que lors de leurs funérailles, la plupart des cortèges ont été placés sous le signe de la protestation contre la « violence de ce gouvernement » pour réclamer « un autre régime démocratique qui en finisse avec toutes sortes de violence »...
Accion Prolétaria, organe du CCI en Espagne, mars 1976
1 Iglesias n’a pas été le seul à « rendre hommage » aux cinq ouvriers tués pour la « démocratie » et la « justice sociale ». Vitoria étant une ville basque, la représentante de la gauche nationaliste basque (suite « légale » de l’ETA) a lâché elle-aussi son laïus d’anniversaire, présentant ainsi les assassinats de ces prolétaires comme des sacrifiés sur l’autel de la « démocratie » pour l’un et, implicitement, de « la patrie basque » pour l’autre. Cette utilisation de l’assassinat des prolétaires par la démocratie naissante en Espagne et non pas pour ce régime d’exploitation, est exécrable. Ces événements sont lointains et ces vendeurs de la camelote faisandée du national-gauchisme en profitent. On peut par ailleurs lire : Podemos, des habits neufs au service de l’empereur capitaliste (Mars 2016). https://fr.internationalism.org/revolution-internationale/201603/9315/podemos-des-habits-neufs-au-service-l-empereur-capitaliste [27]
2 Voir notre tract international : 2011, de l’indignation à l’espoir. https://fr.internationalism.org/ri431/2011_de_l_indignation_a_l_espoir.html [28]
3 Comme nous l’avons analysé dans un article de dénonciation de la mystification de Podemos que nous avons publié (en espagnol) [29] dans Acción Proletaria (2014).
4 Il y eu un premier noyau, constitué de quelques éléments en 1973, qui participa au processus de discussions qui amena à la fondation du CCI en 1975. Ce noyau s’est écarté de ce processus en 1974 à cause de divergences activiste et ouvriériste, ses éléments s’éloignant de toute activité politique. Un nouvel ensemble de militants prit contact avec le CCI en 1975 et après une série de discussions, il s’est intégré définitivement en septembre 1976.
5 Voir notre livre en espagnol : 1936: Franco y la República masacran al proletariado. https://es.internationalism.org/booktree/539 [30]
6 Il s’agit de la ONCE, à l’origine association à but non lucratif devenue entreprise bien lucrative, toujours existante, qui emploie des aveugles, notamment, pour vendre des jeux de loterie dans les rues. [NdT, 2016]
7 L’OICE, ou Organisation de la Gauche communiste d’Espagne, dont la revue s’appelait Revolución, était, en réalité, une des organisations d’extrême-gauche des années 70, dont les principaux militants ont fini en passant par d’autres partis ou groupuscules gauchistes qui foisonnaient alors, par atterrir dans d’autres partis « plus conventionnels » du capital (PSOE, …). Elle se revendiquait de quelques positions politiques de la Gauche communiste, mais pour les dénaturer et ainsi pouvoir encadrer des mouvements autonomes du prolétariat afin de les emmener dans des impasses. [NdlR, 2016]:
8 C’est avec cette éloquente expression que l’on nommait en ce temps-là la partie de l’État qui voulait rester ancrée dans le franquisme. [NdlR, 2016]
9 Cela voulait dire, à l’époque, ceux issus du franquisme favorables aux changements, contrairement au « bunker ». [NdlR, 2016]
10 ORT, Organisation Révolutionnaire de Travailleurs ; MCE, Mouvement Communiste d’Espagne ; PTE, Parti des Travailleurs d’Espagne, étaient à l’époque trois organisations gauchistes, aujourd’hui disparues [ NdT, 2016].
11 La « Junta » s’est formée autour du PCE, en 1974 pour préparer la transition, un regroupement allant de partis d’extrême-gauche à la droite. De suite après, c’est autour du PSOE que s’est formée la « Plataforma », dont l’obsession était de ne pas laisser le PCE apparaître comme la force principale de l’anti-franquisme. [NdT, 2016]
12 LC : Liga Comunista, groupe trotskiste.
13 Deux politiciens de cette « Plataforma », le premier démocrate-chrétien (et ancien ministre de Franco) et le second étant une personnalité professorale membre du PSOE.
14 Camacho, militant du PCE, (1918-2010) fut l’organisateur du dévoiement vers le terrain syndical des initiatives des commissions ouvrières créées dans les luttes, vers une perspective capitaliste d’une organisation permanente déjà du temps du franquisme. C’est ainsi que naquit le syndicat Commissions Ouvrières (CO), dont il fut le secrétaire général pendant des années.
15 Ce « conseil » était un organe du syndicat dit « vertical » franquiste, qui était encore en vigueur pendant ces mois-là.
16 Cruza las calles una canción, alza el puño trabajador; deja las maquinas, sal del taller, ven a la calle a una sola voz, ¡Revolución!, ¡Revolución!
Rubrique:
ICConline - juillet 2016
- 904 reads
Que défend le livre "On Vaut Mieux Que Ça" ?
- 1953 reads
Dernièrement, est sorti un petit livre, aux éditions Flammarion, titré : On Vaut Mieux Que Ça. Ce livre a été rédigé par un collectif du même nom fondé par plusieurs Youtubeurs1 à l’occasion de la loi El Khomri : « Il faut remercier le projet de loi El Khomri. Il a été la goutte d'eau qui a fait éclater notre indignation et il nous a réuni avec d'autres autour de l'initiative : On Vaut Mieux Que Ça. Alors que nous étions révoltés mais isolés, ce fut l'occasion d'inscrire notre projet collectif dans un mouvement plus vaste dont il ne fut ni l'initiateur, ni le moteur, ni le cerveau, mais un carburant parmi d'autres ». L’autre « carburant » de ce « projet collectif » fut sans doute l’extraordinaire publicité qu’en fit l’ensemble des partis de « gauche » et la presse bourgeoise alors que le mouvement contre la loi El Khomri n’avait pas encore débuté. Comme la mode est à « l’apolitisme », On Vaut Mieux Que Ça affirme n’avoir aucun « lien avec les politiciens ».2 Que cette affirmation soit sincère ou non, le discours du collectif est quant à lui parfaitement politisé et s’inscrit dans la droite ligne de ¡Democracia Real Ya!, d’ATTAC et toute la joyeuse compagnie des réformistes « radicaux » de l’appareil politique bourgeois. Leur ouvrage ne déroge malheureusement pas à la règle.
Pour montrer ce que vivent des millions de gens, les auteurs décrivent les angoisses de ceux qui travaillent, des précaires, de ceux qui sont au chômage, angoisses qui conduisent certains au suicide. La description de ce que vit une grande partie de la population est très parlante. Par contre, on ne trouve pas une seule fois ni le mot « prolétaires », ni le terme « classe ouvrière ». En fait, pour le collectif, les travailleurs, les salariés, n'appartiennent pas à une classe sociale. Ils ne sont que des « citoyens » au même titre qu'un commerçant, un patron ou un politicien. Sur le site internet du collectif, il est d’ailleurs souligné : « on invite tout le monde à témoigner : les salariés, les travailleurs, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs, les patrons des petites et moyennes entreprises ». La classe ouvrière délayée dans le grand fourre-tout national n’a plus qu’à se constituer, bras dessus bras dessous avec ses exploiteurs (seulement ceux qui respectent la législation en vigueur !), en somme de « citoyens » inoffensifs.
Quelle est la cause de cette vie indigne et inhumaine où nous ne sommes plus que des choses, un chiffre, une variable qu'on jette comme des kleenex, où l'on nous demande de tenir des cadences qui nous cassent les reins, le dos et qui nous stresse ? Le livre tente d’y répondre mais pas une seule fois on ne trouve une référence ou une dénonciation du système capitaliste. Par contre, on retrouve le même discours que les instigateurs des Nuits debout3, de DRY, d’ATTAC, du Front de Gauche, etc. C'est ainsi qu'on peut lire : « Beaucoup ont cru – même à moitié – que les politiciens (avec leurs discours si bien écrit) seraient nos défenseurs et qu'ils tiendraient les promesses faites la main sur le cœur au moment de nous convaincre de leur confier le pouvoir. Ils allaient sauver le climat, protéger notre santé, assurer notre sécurité, faire reculer le chômage et le monde de la finance. Qu'ont-ils faits ? Ce n'est pas qu'ils ont perdu la bataille contre les banques, les lobbies et les grandes entreprises, c'est qu'ils ont refusé de combattre. Pire, ils ne se cachent même plus, aujourd'hui, pour sabrer le champagne avec ceux qu'ils qualifiaient, parfois, hier, d'adversaires ». Mais pourquoi l’État irait-il mener une « bataille » contre sa raison d’être, la défense à tous prix des rapports de domination capitalistes ? En réalité, On Vaut Mieux Que Ça véhicule l’image d’un « État neutre », « au-dessus des classes » et qui pourrait, à force de bonne volonté, mener la « bataille » pour le bien de… la nation : « Nous rêvons d'un pays qui place ses citoyens au-dessus des critères d'équilibre budgétaires. Nous rêvons d'un pays qui garantisse à tous un environnement sain et durable. Nous rêvons d'un pays construit sur le bon sens, ou la valeur des gens passe avant celles des choses. Nous rêvons d'un pays qui protège tous ses enfants sans distinction. Nous rêvons d'un pays qui donne à tous les meilleurs soins, la meilleure nourriture, la meilleure éducation. Nous rêvons d'un pays qui nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes ».
On Vaut Mieux Que Ça, demande ensuite : « Que faire vis-à-vis d'un système bancal, ou nous ne pouvons plus avoir confiance dans les politiciens pour rendre plus digne et plus humaine nos vie ? » Pour le collectif, cela passe par des gestes et des actes de solidarité sur les lieux de travail et dans la vie de tous les jours. Le livre démontre que cette entraide se développe de plus en plus et qu'à travers cette solidarité « on est de plus en plus nombreux à comprendre qu'on rend déjà le monde plus vivable que ce à quoi leurs décisions nous destinent. Et un plus, on commence à se croiser les uns les autres. Certes, on peut parfois avoir l'impression d'être seul dans cette réalité, mais il suffit de lever les yeux pour reconnaître tous ceux qui la vivent aussi. Notre exaspération et nos aspirations, loin d'être marginales, sont en réalité partagées par une très grande majorité de personnes qui s'y reconnaissent. Nous commençons à comprendre : nous ne sommes pas seuls, nous sommes le monde qui tourne, nous sommes déjà ensemble. En prenant conscience, en nous reconnaissant dans l'autre, nous devenons plus qu'une somme d'individus esseulés. Nous devenons une force créatrice ». Si cette entraide peut permettre de ne pas se sentir seul, de se reconnaître dans l'autre parce qu'il vit la même galère, de développer des initiatives créatrices, cela suffit-il à rendre plus digne et plus humaine la vie des exploités ? En tant que révolutionnaires, nous ne le pensons pas. Retrouver de la dignité, avoir une vie véritablement humaine n’est possible qu'en luttant dans le but de détruire les rapports sociaux capitalistes, les nations, l'exploitation d'une classe par une autre, qui sont à la base de cette indigne et inhumaine existence. On Vaut Mieux Que Ça nous appelle à défendre des valeurs qui ne sont ni plus ni moins que celle de la bourgeoisie : la démocratie, la fausse solidarité de la citoyenneté et de la nation. Une réelle perspective ne passe que par la lutte unie de la classe ouvrière à l’échelle internationale pour une société sans classes : le communisme.
Cealzo, le 24 mai 2016.
1 Il s’agit de vidéastes publiant en ligne (sur la plateforme YouTube) des vidéos sur des sujets culturels, scientifiques, de divertissement, etc.
2 Cf. le site internet du collectif.
3 Voir notre article : Quel est la véritable nature du mouvement Nuits debout ? (RI n° 458)
Géographique:
- France [10]
Rubrique:
ICConline - août 2016
- 988 reads
ICConline - octobre 2016
- 1194 reads
Le mouvement du 15 Mai [15-M] cinq ans après
- 2858 reads
Lorsqu’on pose des questions à un lycéen sur la révolution russe de 1917, il répondra sans doute qu'il s'agissait d'un coup d’État bolchevique, que l’expérience, malgré les bonnes intentions des protagonistes, a fini en cauchemar : la dictature soviétique, le goulag, etc.
Et si on lui demande ensuite ce qui est arrivé le 15 Mai 2011, il est possible qu’il réponde qu’il s’agit-là d’un mouvement pour une « démocratie véritable » et qu’il est très lié au parti politique Podemos.1
Quiconque recherche la vérité ne se contentera pas de ces réponses simplistes qui n’ont rien à voir avec ce qui s’est réellement passé, imprégnées du « bon sens commun », de l’enseignement déformé qu’on subit et du matraquage des « moyens de communications », bref, de l’idéologie dominante de cette société.
Il est vrai que le prolétariat se trouve actuellement dans une situation de profonde faiblesse. Mais l’histoire de la société est celle de la lutte de classe et l’État capitaliste sait parfaitement que le prolétariat pourrait reprendre sa lutte. C’est pour cela qu’il l’attaque sur ses flancs les plus sensibles : l’un de ceux-ci est sa mémoire historique. La bourgeoisie a un très grand intérêt à détruire cette mémoire en réécrivant les expériences passées de notre classe. C’est comme si elle formatait un disque dur en y installant un système opérationnel radicalement opposé.
La réécriture la plus intelligente est celle qui se fait en tirant profit des faiblesses réelles et des erreurs des mouvements prolétariens. Ceux-ci traînent toujours un important magma d’erreurs qui permettront à posteriori leur réécriture dans un sens diamétralement opposé à ce qu’ils recherchaient.
Marx, en commentant la différence entre la lutte de la bourgeoisie et celle du prolétariat, met en avant le fait qu’alors que « les révolutions bourgeoises, comme celles du XVIIIe siècle, se précipitent rapidement de succès en succès, (…) les révolutions prolétariennes, par contre, comme celles du XIXe siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà être accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et de se redresser à nouveau formidable en face d'elles, reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts ».2
C’est ainsi que, pour le prolétariat, « le chemin pénible de sa libération n'est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d'erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l'atteindra s'il sait s'instruire de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l'autocritique, une autocritique sans merci, cruelle, allant jusqu'au fond des choses, c'est l'air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre. »3 Il ne s'agit pas dans cet article de faire une analyse critique de la révolution de 19174. Nous n’allons faire qu’un petit récapitulatif du mouvement des Indignés de 2011, le 15-M5. Cette réécriture, se basant surtout sur ses difficultés et ses aspects le plus faibles, nous allons commencer par ceux-ci.
2003-2011, les nouvelles générations prolétariennes entrent en lutte
Après la longue nuit de la contre-révolution qui écrasa la révolution de 1917, le prolétariat reprit sa lutte en 1968. Mais cette renaissance ne parvint pas à se politiser dans un sens révolutionnaire. En 1989, la chute des régimes prétendument « communistes » entraînait un recul important dans la conscience et la combativité dont les effets sont toujours présents aujourd’hui.6
A partir de 2003, les luttes reprirent de l’élan, mais elles concernaient surtout les nouvelles générations de la classe ouvrière (étudiants, chômeurs, précaires), alors que les travailleurs des grands centres industriels restaient passifs et que leurs luttes demeuraient sporadiques (la peur du chômage étant un élément central d’une telle inhibition). Il n’y eu pas de mobilisation unifiée et massive de la classe ouvrière, mais seulement d'une partie, la plus jeune. La révolte de la jeunesse en Grèce (2008), les mouvements en Tunisie et en Égypte (2011), ont à ce titre été les expressions d’une vague de fond dont les points culminants ont été la lutte contre CPE en France (2006) et le 15 M.7
Malgré les aspects positifs et prometteurs (nous en parlerons plus loin), ces mouvements eurent lieu dans un contexte de perte d’identité de la classe ouvrière et de manque de confiance en ses propres forces. La perte d’identité signifie que la grande majorité de ceux qui participent aux luttes ne se reconnaissent pas comme faisant partie de la classe ouvrière, ils se voient plutôt comme des citoyens. Même en se disant « ceux d’en bas », en affirmant être traités comme des « deuxième classe », ils ne brisent pas le cordon ombilical avec la dite « communauté nationale » car, « même si le slogan 'nous sommes 99% face à 1%', si populaire dans les mouvements d'occupation aux États-Unis, révèle un début de compréhension du fait que la société est cruellement divisée en classes, la majorité des participants dans ces mouvements se voyaient eux-mêmes comme des 'citoyens de base' qui veulent être reconnus dans une société de 'citoyens libres et égaux' ».8 Cela empêche de voir le fait que « la société est divisée en classes, une classe capitaliste qui possède tout et ne produit rien et une classe exploitée, le prolétariat, qui produit tout et possède de moins en moins. Le moteur de l’évolution sociale n’est pas le jeu démocratique de 'la décision d’une majorité de citoyens' (ce jeu est plutôt le masque qui couvre et légitime la dictature de la classe dominante) mais la lutte de classe. »9 Il y a donc deux faiblesses fondamentales au sein du mouvement du 15-M qui se renforcent mutuellement et qui permettent leur actuelle falsification : la plupart de ses protagonistes se concevaient comme des citoyens et aspiraient à un « renouveau du jeu démocratique ».
À cause de cela, le mouvement, malgré ses débuts prometteurs, ne s’est pas articulé « autour de la lutte de la principale classe exploitée qui produit collectivement l’essentiel des richesses et assure le fonctionnement de la vie sociale : les usines, les hôpitaux, les écoles, les universités, les ports, les travaux, la poste... »10, mais il a fini par se diluer dans une protestation impuissante de « citoyens indignés ». Malgré quelques timides tentatives d’extension aux centres de travail, cela fut un échec, le mouvement restant de plus en plus limités aux places. Malgré les sympathies qu’il avait suscitées, il perdit de plus en plus de force jusqu’à être réduit à une minorité de plus en plus désespérément activiste.
En plus, la difficulté à se reconnaître comme classe fut renforcée par le manque de confiance en ses propres forces, ce qui a donné un poids démesuré aux couches de la petite bourgeoisie radicalisée qui se sont jointes au mouvement en renforçant la confusion, l'inter-classisme et la croyance dans les pires formulations de la politique bourgeoise, telles que « la fin du bipartisme », « la lutte contre la corruption », etc.
Ces couches sociales ont fortement contaminé le mouvement avec cette idéologie qui réduit le capitalisme « à une poignée de 'méchants' (des financiers sans scrupules, des dictateurs sans pitié) alors que c’est un réseau complexe de rapports sociaux qui doit être attaqué dans sa totalité et non pas se disperser en poursuivant ses expressions multiples et variées (les finances, la spéculation, la corruption des pouvoirs politico-économiques). »11
Malgré quelques réponses solidaires basées sur l’action massive contre la violence policière, c’est la « lutte » conçue comme pression pacifique et citoyenne sur les institutions capitalistes qui amena le mouvement très facilement vers l’impasse.
Le mouvement Nuit debout reprend le pire du15 M
Comme l’affirme notre section en France.12 « Nuit debout n’a rien de spontané. C’est un mouvement mûrement réfléchi, préparé et organisé de longue date par des animateurs et défenseurs radicaux du capitalisme. Derrière ce mouvement prétendument 'spontané' et 'apolitique' se cachent des professionnels, des groupes de gauche et d’extrême-gauche qui mettent en avant 'l’apolitisme' pour mieux contrôler le mouvement en coulisses. »
Le but de ce montage est celui d’encadrer la protestation sociale sur le terrain de la « 'pression' sur les 'dirigeants' et les institutions étatiques afin de promouvoir un capitalisme plus démocratique et plus humain »13, car, comme le dit un tract du collectif qui l’anime, Convergence des luttes : « L’humain devrait être au cœur des préoccupations de nos dirigeants... » Ce joli « vœux pieux » ne fait que transmettre l’utopie réactionnaire de gouvernants qui s’occuperaient des êtres humains, ce qui sert à occulter que la seule chose dont ils s’occupent, ce sont des nécessités et des problèmes du capital. Demander à l’État de défendre les intérêts des exploités c’est comme demander à un voleur de s’occuper de notre maison.
Les revendications mises en avant dans Nuit debout sont toutes allées dans le sens de semer l’illusion qu'un capitalisme qui nous dépouille de plus en plus de tout pourrait nous offrir encore quelque chose. On exige un « revenu de base universel », une alimentation plus saine, un plus grand budget pour l’éducation et bien d’autres « reformes » qui se retrouvent systématiquement dans le catalogue des promesses électorales qui ne se réalisent jamais.
La revendication la plus « ambitieuse » que mettent en avant les promoteurs de Nuit debout est celle de la « république sociale » qui consisterait à « revenir aux idéaux révolutionnaires de 1789 » lorsque la bourgeoisie a démoli le pouvoir féodal au cri de « Liberté, Égalité et Fraternité ». On essaye de nous vendre l’utopie réactionnaire de la réalisation « d'une 'vraie démocratie' telle que la Révolution française de 1789 l’avait promis ; seulement ce qu’il y avait de révolutionnaire il y a deux siècles et demi, à savoir instaurer le pouvoir politique de la bourgeoisie en France, dépasser le féodalisme par le développement du capitalisme, bâtir une nation... tout cela est aujourd’hui devenu irrémédiablement réactionnaire. Ce système d’exploitation est décadent, il ne s’agit plus de l’améliorer, cela est devenu impossible, mais de le dépasser, de le mettre à bas par une révolution prolétarienne internationale. Ainsi, est semée l’illusion que l’État est un agent 'neutre' de la société sur lequel il faudrait 'faire pression' ou qu’il faudrait protéger des 'actionnaires', des 'politiciens corrompus', des 'banquiers cupides', de 'l’oligarchie' ».14
Le vrai antagonisme, celui entre le capital et le prolétariat, est remplacé par un 'antagonisme' imaginaire entre, d’un côté, une minorité supposée de corrompus, de financiers et de politiciens véreux et de l’autre côté de la barricade, une immense majorité où pourraient rentrer les bons politiciens, les capitalistes entrepreneurs, les militaires, le peuple et tous les citoyens… Le prolétariat est dévoyé de son terrain de la lutte de classe vers le scénario d’un affrontement de 'tous les citoyens' contre la poignée fantomatique des méchants d'un film.
Plus encore, de la même façon que le populisme de Trump ou du FN met tous les maux sur le compte de personnes et non pas sur les rapports sociaux de production, les « radicaux » de Nuit debout mettent en avant un projet bien répugnant : la personnalisation. Ceux-là proposent comme bouc émissaire les migrants, ceux-ci proposent quelques banquiers ou quelques politicards. C’est la même logique réactionnaire : les problèmes du monde seraient réglés en éliminant quelques personnes désignées comme étant la cause de tous les maux.
Que reste-il du 15-M ?
Nous avons vu la réécriture, le formatage du disque dur proposé par les promoteurs dans l’ombre du mouvement Nuit debout. Mais, alors, que reste-il du mouvement 15 M ? Que peut-on retenir pour les luttes futures ?
Les Assemblées
Nous reprenons ici ce que nous disions dans notre tract international de bilan du mouvement des Indignados, d’Occupy et d’autres :
« Les assemblées massives sont la concrétisation du slogan de la Première Internationale (1864) : 'L'émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ou elle ne sera pas'. Elles s'inscrivent dans la continuité de la tradition du mouvement ouvrier qui démarre avec la Commune de Paris et prend son expression la plus élevé en Russie en 1905 et en 1917, se poursuivant en 1918 en Allemagne, 1919 et 1956 en Hongrie, 1980 en Pologne.
Les assemblées générales et les conseils ouvriers sont les formes distinctives de l'organisation de la lutte du prolétariat et le noyau d'une nouvelle organisation de la société.
Des assemblées pour s'unir massivement et commencer à briser les chaînes qui nous accrochent à l'esclavage salarié : l'atomisation, le chacun pour soi, l'enfermement dans le ghetto du secteur ou de la catégorie sociale.
Des assemblées pour réfléchir, discuter et décider, devenir collectivement responsables de ce qui est décidé, en participant tous, autant dans la décision que dans l'exécution de ce qui a été décidé.
Des assemblées pour construire la confiance mutuelle, l'empathie, la solidarité, qui ne sont pas seulement indispensables pour mener en avant la lutte mais qui seront aussi les piliers d'une société future sans classes ni exploitation. »15
Les futures assemblées devront se renforcer avec un bilan critique des faiblesses apparues :
- Elles ne se sont étendues que très minoritairement vers les lieux de travail, les quartiers, les chômeurs… Si le noyau central des assemblées doit être l’assemblée générale de ville, en prenant les places et les bâtiments, il doit se nourrir de l’activité d’un large réseau d’assemblées dans les usines et lieux de travail principalement.
- Les commissions (de coordination, culture, activités etc.) doivent être sous le contrôle strict de l’assemblée générale devant laquelle elles doivent rendre des comptes scrupuleusement. Il faut éviter ce qui est arrivé lors du 15-M où les commissions sont devenues des instruments de contrôle et de sabotage des assemblées manipulées par des groupes en coulisse tel que DRY (Democracia Real Ya).16
La solidarité
La société capitaliste dégouline par tous ses pores « la marginalisation, l'atomisation des individus, la destruction des rapports familiaux, l'exclusion des personnes âgées, l'anéantissement de l'affectivité et son remplacement par la pornographie », c’est à dire, « l'anéantissement de tout principe de vie collective au sein d'une société qui se trouve privée du moindre projet, de la moindre perspective. »17 Un témoignage barbare de cette décomposition sociale est la haine envers les migrants encouragée par le populisme, qui a obtenu un triomphe spectaculaire avec le récent Brexit en Grande-Bretagne.
Face à tout cela, le mouvement 15 M (comme Occupy) a semé une première graine : « il y a eu des manifestations à Madrid pour exiger la libération des détenus ou empêcher que la police arrête des migrants ; des actions massives contre les expulsions de domicile en Espagne, en Grèce ou aux États-Unis ; à Oakland 'l'assemblée des grévistes a décidé l'envoi de piquets de grève ou l'occupation de n'importe quelle entreprise ou école qui sanctionne des employés ou des élèves d'une quelconque manière parce qu'ils auraient participé à la grève générale du 2 novembre'. On a pu vivre des moments, certes encore très épisodiques, où n'importe qui pouvait se sentir protégé et défendu par ses semblables, ce qui est en fort contraste avec ce qui est jugé «normal» dans cette société, autrement dit le sentiment angoissant d'être sans défense et vulnérable. »
Cette forteresse (ne vaut-il pas mieux dire expérience ?) pourrait être emportée par la puissance de la vague populiste actuelle (soutenue en fait par ses prétendus 'antagonistes' de l’État démocratique). La solidarité prolétarienne doit encore acquérir des racines solides.18
La culture du débat
La société actuelle nous condamne à l’inertie du travail, à la consommation, à la reproduction des modèles à succès qui entraînent des milliers d’échecs, la répétition de stéréotypes aliénants qui ne font qu’amplifier, ânonner l’idéologie dominante. Face à cela, autant de fausses réponses enfoncent encore plus dans la putréfaction sociale et morale, se font jour « la profusion des sectes, le regain de l'esprit religieux, y compris dans certains pays avancés, le rejet d'une pensée rationnelle, cohérente, construite, y inclus de la part de certains milieux 'scientifiques' et qui prennent dans les médias une place prépondérante notamment dans des publicités abrutissantes, des émissions décervelantes ; l'envahissement de ces mêmes médias par le spectacle de la violence, de l'horreur, du sang, des massacres, y compris dans les émissions et magazines destinés aux enfants ; la nullité et la vénalité de toutes les productions 'artistiques', de la littérature, de la musique, de la peinture, de l'architecture qui ne savent exprimer que l'angoisse, le désespoir, l'éclatement de la pensée, le néant ».19
Contre ces deux pôles de l’aliénation capitaliste, dans les mouvements comme le 15-M ou Occupy « des milliers de personnes ont commencé à rechercher une culture populaire authentique, construite par elles-mêmes, en essayant de forger ses propres valeurs, de manière critique et indépendante. Dans ces rassemblements, on a parlé de la crise et de ses causes, du rôle des banques, etc. On y a parlé de révolution, même si dans cette marmite on a versé beaucoup de liquides différents, parfois disparates ; on y a parlé de démocratie et de dictature, le tout synthétisé dans le slogan de ce distique aux deux strophes complémentaires : ‘'ils l’appellent démocratie mais ce n’est pas le cas!, C’est une dictature mais ça ne se voit pas!'. On a fait les premiers pas pour que surgisse une véritable politique de la majorité, éloignée du monde des intrigues, des mensonges et des manœuvres troubles qui est la caractéristique de la politique dominante. Une politique qui aborde tous les sujets qui nous touchent, pas seulement l’économie ou la politique, mais aussi l’environnement, l’éthique, la culture, l’éducation ou la santé. »20
L’importance de cet effort, même timide et lesté par des faiblesses démocratistes et des approximations petites-bourgeoises, est évident. Tout mouvement révolutionnaire du prolétariat ne peut que s’appuyer sur un débat de masse, sur un mouvement culturel basé sur la discussion libre et indépendante.
La Révolution russe de 1917 a eu comme colonne vertébrale le débat et la culture massive. John Reed rappelle que « la soif d'instruction, si longtemps réprimée, avec la révolution prit la forme d'un véritable délire. Du seul Institut Smolny, pendant les six premiers mois, sortaient chaque jour des trains et des voitures chargés de littérature pour saturer le pays. La Russie, insatiable, absorbait toute matière imprimée comme le sable chaud absorbe de l'eau. Et ce n'était point des fables, de l'histoire falsifiée, de la religion diluée et des romans corrupteurs à bon marché — mais les théories sociales et économiques, de la philosophie, les œuvres de Tolstoï, de Gogol et Gorki. ».21
Préoccupation pour une lutte internationale
Le prolétariat est une classe internationale avec les mêmes intérêts dans tous les pays. Les ouvriers n’ont pas de patrie et le nationalisme (sous toutes ses variantes) est la tombe de toute perspective possible de libération de l’humanité.
Le capitalisme actuel est pris d’assaut par une contradiction : d’un côté, l’économie est de plus en plus mondiale, la production est de plus en plus entremêlée et interdépendante. Mais, d’un autre coté, tous les États sont impérialistes et les conflits guerriers deviennent de plus en plus destructeurs ; l’environnement se détériore à cause de la barrière infranchissable que tous les capitaux nationaux érigent, en commençant par les plus puissants, les Etats-Unis et la Chine. Face à l’internationalisation patente de la vie économique, sociale et culturelle, se dresse un repli aveugle et irrationnel de prétendues communautés nationales, raciales, religieuses…
Ces contradictions ne pourront être dépassées que par la lutte historique du prolétariat. Le prolétariat est la classe de l’association mondiale. Il produit par-delà les frontières, lui-même est une classe de migrants, un creuset de races, de religions, de cultures. Aucune production, depuis un bâtiment jusqu’à une fraiseuse, ne peut être réalisée par une communauté isolée d’ouvriers enfermée dans un cadre national, encore moins local. La production a besoin de matières premières, de transports, de machines, qui circulent mondialement. Elle ne peut être réalisée que par des ouvriers instruits dans une culture universelle, dans les échanges incessants à une échelle internationale. Internet n’est pas seulement un instrument culturel, mais, surtout un moyen sans lequel la production capitaliste actuelle serait impossible.
En exprimant encore vaguement ces réalités et ce qu’elles peuvent signifier pour la lutte prolétarienne, en 2011, « le mouvement d’indignation s’est étendu internationalement. Il a surgi en Espagne où le gouvernement socialiste avait mis en place un des premiers plans d’austérité et un des plus durs ; en Grèce, devenue le symbole de la crise économique mondiale à travers l’endettement, aux États-Unis, temple du capitalisme mondial, en Égypte et en Israël pays pourtant situés de chaque côté du front du pire conflit impérialiste et le plus enkysté, celui du Moyen Orient.
La conscience du fait qu'il s'agit d'un mouvement global commence à se développer, malgré le boulet destructeur du nationalisme (présence de drapeaux nationaux lors des manifestations en Grèce, en Égypte ou aux États-Unis). En Espagne, la solidarité avec les travailleurs de Grèce s'est exprimée aux cris de 'Athènes tiens bon, Madrid se lève !' Les grévistes d'Oakland (États-Unis, novembre 2011) proclamaient leur 'solidarité avec les mouvements d'occupation au niveau mondial'. En Égypte a été approuvée une Déclaration du Caire en soutien au mouvement aux États-Unis. En Israël, les Indignés ont crié 'Netanyahou, Moubarak, Assad, c'est la même chose' et ont pris contact avec des travailleurs palestiniens. »22
Aujourd’hui, cinq ans après, ces acquis semblent avoir disparus sous des tombereaux de terre. Ceci est l’expression d’un trait indissociable des luttes prolétariennes mis en relief dans la citation de Marx cité au début de cet article : Elles « paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et de se redresser à nouveau formidable en face d'elles. »
Il existe, cependant, une tâche vitale que doivent mener les minorités avancées du prolétariat : tirer les leçons, les inscrire dans un cadre théorique marxiste en développement. Voilà la tâche à laquelle nous appelons tous les camarades intéressés et engagés : « En menant un débat le plus large possible, sans restriction ni entrave aucune, pour préparer consciemment de nouveaux mouvements, nous pourrons faire devenir réalité une autre société, différente du capitalisme ».
Acción Proletaria, section du CCI en Espagne, 06 juillet 2016.
1 Alors que le rôle de Podemos fut de neutraliser et faire dérailler tout ce qu’il y avait d’authentiquement révolutionnaire dans le mouvement des Indignés, ce que nous avons montré dans l’article : Podemos : des habits neufs au service de l’empereur capitaliste.
https://fr.internationalism.org/revolution-internationale/201603/9315/po... [27]
2 Karl Marx, Le 18 brumaire de L. Bonaparte.
3 Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie.
4 Voir notre brochure : Octobre 1917, début de la révolution mondiale.
5 Nous avons beaucoup écrit sur cette expérience dans laquelle participèrent activement nos militants, non seulement de la section d’Espagne, mais aussi d’ailleurs. Les 3 documents, entre autres, qui résument notre position sont :
- La mobilisation des indignés en Espagne et ses répercussions dans le monde : un mouvement porteur d'avenir.
https://fr.internationalism.org/node/4752 [32]
- Mouvement des indignés en Espagne, Grèce et Israël : de l’indignation à la préparation des combats de classe.
https://fr.internationalism.org/rint147/mouvement_des_indignes_en_espagn... [33]
- 2011 : de l'indignation à l'espoir.
https://fr.internationalism.org/isme354/2011_de_l_indignation_a_l_espoir... [34]
Voir aussi notre « dossier spécial ». https://fr.internationalism.org/icconline/2011/dossier_special_indignes.html [35]
6 Voir : Effondrement du bloc de l'Est : des difficultés accrues pour le prolétariat (1990).
7 Des échos plus faibles de ces mouvements ont eu lieu en 2012 au Canada, au Brésil et en Turquie, en 2014 à Burgos, en 2015 au Pérou.
8 Extrait de notre tract international cité plus haut.
9Idem.
10Idem.
11Idem.
12 Voir : Quelle est la véritable nature du mouvement Nuit debout ?
https://fr.internationalism.org/revolution-internationale/201605/9369/qu... [37]
13Idem.
14Idem.
15 Tract international du CCI déjà cité.
16 Voir : Le mouvement citoyen 'Democracia Real Ya !' : une dictature sur les assemblées massives.
https://fr.internationalism.org/icconline/2011/dossier_special_indignes/... [38]
17 Voir : La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste (mai 1990). Ce texte expose notre analyse sur la période historique actuelle, une période qui se caractérise par la continuité d’un capitalisme caduc et décadent que le prolétariat n’a pas encore réussi à éradiquer de la planète.
18 Voir notre texte d’orientation : Confiance et Solidarité.
19 La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste (mai 1990).
20 Tract international
21 John Reed, Dix jours qui ébranlèrent le monde.
https://www.marxists.org/francais/reed/works/1919/00/01.htm [39]
22 Tract international
Rubrique:
ICConline - novembre 2016
- 714 reads
ICConline - décembre 2016
- 709 reads
A propos du film de Ken Loach: «NOUS», Daniel Blake
- 1423 reads
Le dernier film de Ken Loach Moi, Daniel Blake, a déjà fait couler beaucoup d’encre. D’abord parce que c’est le film d’un cinéaste habitué à la critique sociale du monde capitaliste et très expressif dans son art. Ensuite parce qu’il a été propulsé Palme d’Or au festival de Cannes, à la surprise presque générale. Depuis, la presse a multiplié les articles pour encenser ou descendre ce film considéré par les uns comme un véritable brûlot social ou à l’inverse comme un mélodrame alarmiste destiné à faire pleurer dans les chaumières…
Il n’est pas question de faire de Ken Loach le nouvel Eisenstein1 ou de donner à ce film la valeur d’une sorte de nouveau Manifeste communiste, ni à l’inverse d’en faire l’expression d’un cinéma larmoyant ou même du Parti travailliste anglais, comme certains journalistes se sont plu à le faire. Même si Ken Loach dénonce la « cruauté consciente » et libérale de David Cameron et s’illusionne sur le nouveau leader travailliste, Jeremy Corbyn, peu nous importe en vérité ; une œuvre artistique échappe parfois à son auteur, comme se dotant d'une vie indépendante.
Dans son films, Ken Loach s’insurge contre la destruction de pans entiers d’activité tout en réclamant des chômeurs qu’ils se débrouillent pour « trouver un travail qui n’existe plus ». Cette réalité de la désindustrialisation et cette pratique de l’État, existent bel et bien. Ken Loach a le mérite de le montrer, sans s’arrêter à un simple constat émotionnel misérabiliste, mais en stimulant l’indignation chez le spectateur. Il a la qualité assez rare de donner, d’abord, une image lucide et dynamique de la crise capitaliste, ses conséquences, en Grande-Bretagne, mais que l’on peut facilement transposer ailleurs, ensuite de montrer le vrai visage totalitaire de l’État : exclusion et répression sociales, déshumanisation.
Tous les passages du film montrant le « traitement » du chômage par des « professionnels de santé » opérant par téléphone, transformés en garde-chiourmes du système, seraient risibles d’absurdité s’ils n’étaient pas, hélas, bien réels. Cette facette de l’État démocratique, sa dictature en fait, que certains ont dénoncé comme caricaturale, n’est pourtant pas une fiction : le système capitaliste, ses institutions démocratiques, y compris celles destinées à soi-disant soutenir ou protéger les personnes fragilisées, âgées, licenciées, malades... agissent comme des rouleaux-compresseurs et outils d’exclusion. Rechercher le minimum vital devient un parcours du combattant où la moindre erreur d’écriture, d’attitude se paie cash et signifie souvent la fin de tout droit sinon celui de crever de faim. Katie, l’amie de Daniel, y est presque acculée quand on la voit se jeter de manière instinctive sur une boîte de conserve au moment de retirer son sac dans une banque alimentaire !
Mais l’enjeu de ce film « social », comme de tous les autres, est la manière d’envisager la perspective pour résister, lutter contre la crise, contre le moloch capitaliste : cette lutte est-elle possible ? Qui peut la mener ? C’est sur ce plan que se jouent les qualités ou non de ce type de film et rares sont ceux qui sont à la hauteur. La plupart en restent à un constat d’impuissance crasse sous couvert d’idéal éthéré.
Sur la première question, le film de Ken Loach exprime toutes les difficultés de la classe ouvrière à résister, combattre et se confronter à l’État. Actuellement, toutes les tentatives pour résister, maintenir la tête hors de l’eau, restent cantonnées à la débrouille individuelle ou limitées à l’entraide réduite. Le titre du film lui-même, Moi, Daniel Blake, annonce déjà la couleur : l’affirmation de soi comme seule possibilité !
Nous sommes effectivement loin, très loin, d’une solidarité de classe offensive, collective, véritable arme de combat pour lutter et offrir une perspective à plus long terme de dépassement de la société capitaliste. Ce n’est certes pas la trame du film mais aucune question ou réaction en ce sens n’est posée par les personnages. La seule situation un peu collective s’exprime au moment où Daniel réagit en taguant les murs du job center. Réactions enthousiastes, applaudissements des passants : ils comprennent l’action de Daniel, vivent peut-être la même situation, mais à aucun moment ils ne seront solidaires en venant parler avec lui ou en s’opposant aux flics qui viennent l’embarquer. Ils ne restent que des spectateurs impuissants. Seul un individu réagit plus ouvertement ; c’est un SDF, qu'on imagine alcoolisé, marginalisé, tout un symbole, d’impuissance encore.
Mais le film fourmille, c’est vrai, de petits moments, certes très limités, de réactions d’humanité, d’écoute, de souci de l’autre, d’entraide, de plaisirs à partager. Entre Daniel et Katie, ses enfants, avec un ancien collègue, le voisin de palier, l’employée du job center qui aimerait vraiment aider mais se fait taper sur les doigts suite à ses initiatives, chacun d’entre eux est source d’humanité, sans savoir comment aller plus loin.
En clair, derrière l’impuissance immédiate à changer les choses, on sent poindre toutes ces étincelles de vie, ces potentialités susceptibles un jour de transformer les rapports humains, les liens sociaux. Rien à voir avec le film de Stéphane Brizé La loi du marché2 où derrière un même constat de difficultés sociales, de réalité du chômage, le nihilisme le plus effarant est affiché : aucune lueur, aucun espoir, aucune perspective, une vision totalement statique du monde social d’où ne peut émerger que la mort, un no future de première classe !
Un autre aspect émerge de manière très forte dans ce film : la dignité des personnages, leur amour-propre. C’est une des qualités du film. Le propre même de tout prolétaire qui se respecte est d’avoir des valeurs morales, de défendre sa dignité malgré les circonstances. La défense de cette moralité prolétarienne est l’expression même de la possibilité d’un futur où l’humanité pourra se défaire de la barbarie, du chacun pour soi. Daniel Blake l’exprime quand il découvre que Katie a dû passer par la prostitution pour ne pas mourir de faim : cela le désole plus que tout, plus que son propre drame. Dignité encore dans l’éloge funèbre où Daniel affirme qu’ « on est foutu si on perd son amour-propre ».
Mais cette dignité prolétarienne est carrément mise en pièces par les propos prêtés à Daniel dans l’éloge funèbre : « Moi, Daniel Blake, je suis un homme, pas un chien. Je suis un citoyen. Rien de plus mais rien de moins non plus. » Daniel se considère avant tout comme un citoyen avant d’être un prolétaire. Être citoyen signifie appartenir avant tout à une nation, pas à une classe sociale. La différence est fondamentale, particulièrement pour les prolétaires. C’est toujours au nom de la défense de la citoyenneté, la défense de la République ou de la démocratie que l’idéologie dominante appelle à se mobiliser pour la défense de ses intérêts de classe dominante. C’est le terrain bourgeois par excellence. La défense de cette logique, de la citoyenneté, n’est pas la nôtre. Elle ne mène qu’à la division, à la confrontation, à la concurrence, au chacun pour soi et à la perpétuation du monde capitaliste.
Comme Daniel Blake l’exprime, sa situation est vécue par des millions de prolétaires exploités, précarisés, exclus par le système capitaliste. Que ce soit en Grande-Bretagne, en France, en Chine ou partout dans le monde, les lois capitalistes soumettent à l'enfer du salariat, à la violence et à l'exclusion. Même sous son visage démocratique, le capital broie, divise et tue.
La véritable solidarité de classe, incontournable pour le futur de l’humanité, doit avant tout s’exercer par la lutte : une lutte collective, consciente et qui dépassera les frontières. La phrase du Manifeste Communiste, « les prolétaires n’ont pas de patrie », n’est pas un rêve : elle est la clé pour la transformation du monde.
Stopio, 15 décembre 2016
1 Eisenstein, cinéaste russe de la première partie du XXe siècle, eut une influence majeur dans l'histoire du cinéma. Si son œuvre a pu exprimer le souffle de la révolution de 1917, sa compromission avec le stalinisme en fit également un pionnier de la propagande cinématographique.
2 Lire notre article « A propos du film La loi du marché : une dénonciation sans réelle alternative ».
Personnages:
- Ken Loach [41]
Rubrique:
Migrants et réfugiés : victimes du capitalisme (Partie IV)
- 2075 reads
Avec le retour de la crise économique au milieu des années 1970, la politique d'immigration devait se réduire fortement. Les politiques migratoires devenaient beaucoup plus restrictives concernant les admissions aux frontières. Le capital continuait bien à embaucher une main-d’œuvre immigrée bon marché, malgré le chômage devenu massif, mais ne pouvait plus absorber toute la masse des étrangers se dirigeant vers les grands centres industriels.
Crise, États « bunkerisés » et explosion du nombre des migrants et réfugiés
Dès la fin des années 1980 et au début des années 1990, des charters entiers reconduisaient les immigrés vers leur pays d'origine. Cela, alors que le contexte d'exacerbation des conflits et l'approfondissement de la crise économique multipliaient en même temps le nombre de candidats aux migrations. Un nouveau phénomène allait ainsi partout exploser dans le monde : celui des « clandestins ». Avec la fermeture des frontières, l'immigration illégale, difficile à quantifier, s'accroissait de façon spectaculaire. Toute une économie mafieuse, faite de réseaux transnationaux pouvait alors se déployer en toute impunité, favorisant des rabatteurs sans scrupules, permettant d'alimenter toutes les formes d'esclavage moderne, comme la prostitution, mais aussi d'alimenter le marché du travail au noir et sous payé, en particulier dans le bâtiment et l'agriculture. Les États-Unis eux-mêmes allaient profiter de cette situation pour surexploiter la sueur des migrants illégaux venus surtout d'Amérique latine. Ainsi, par exemple, « le nombre de Mexicains enregistrés à l’extérieur de l’Amérique latine (la plupart aux États-Unis) a triplé entre 1970 et 1980, atteignant plus de deux millions. Si l’on considère l’énorme nombre de migrants clandestins, le chiffre exact est donc beaucoup plus élevé : entre 1965-1975, le nombre de clandestins a fluctué autour de 400 000 par an, pour atteindre entre 1975 et 1990 environ 900 000 migrants »1.
La chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide et celle des régimes staliniens quasi autarciques accéléraient ce processus et ouvraient une nouvelle spirale de guerres, de chaos, de crises et de bouleversements inédits. Alors qu'après 1945 les déplacements étaient essentiellement ceux des victimes de guerre, principalement des Allemands expulsés, puis des gens fuyant le régime de la République démocratique allemande avant la construction du mur en 1961, les migrations après 1989 étaient plutôt le fait de nouveaux flux internationaux. Jusqu'en 1989, les migrants d'Europe de l'est avaient été bloqués par le rideau de fer. Les flux migratoires s'orientaient donc plutôt du sud vers le nord, notamment en provenance de l'Afrique du nord et des pays de la Méditerranée vers les grands centres urbains des pays européens. Après la chute du mur de Berlin et avec l'intégration des pays d'Europe centrale dans l'Union Européenne (UE), une main-d’œuvre des pays de l'est pouvait de nouveau s'orienter vers les pays de l'ouest. A la même période, la croissance rapide et massive en Chine entraînait le début de la plus grande migration interne, attirant des centaines de millions de personnes venus des campagnes vers les villes. En raison de la croissance de l'économie chinoise, ces masses pouvaient être absorbées. A contrario, avec la crise avancée dans les pays en Europe et aux États-Unis, les flux provenant d’autres pays se restreignaient du fait des refoulements.
Les horreurs générées par le militarisme
La dynamique du militarisme et du chaos mondial qui faisait suite à la dislocation du bloc de l'Est et à la désintégration des alliances autour des États-Unis aggravait le chacun pour soi et les tensions entre les différentes nations, poussait les populations à fuir les combats et/ou la misère croissante. Le véritable fossé qui séparait l'est et l'ouest, qui avait eu pour objectif non seulement de démarquer la frontière sur le plan impérialiste, mais aussi de contenir les migrants, disparaissait en laissant place aux angoisses des gouvernements de l’Europe de l’ouest face à la menace présumée d'une « immigration massive » des pays de l'est. Après 1989, un flot de migrants s'était bien dirigé vers l'Occident, notamment venant de Roumanie, de Pologne et d'Europe centrale, à la recherche d'un travail, même misérablement payé. En dépit de l'épisode tragique de la guerre des Balkans entre 1990 et 1993 et du récent conflit en Ukraine, les flux migratoires au sein de l'Europe furent relativement « maîtrisés ». Cela, alors que la pression migratoire à la périphérie devenait en même temps de plus en plus forte sur l'UE.2
Au début des années 1990, les nouvelles guerres semant le chaos au Moyen-Orient, dans les Balkans, dans le Caucase et en Afrique, provoquaient des nettoyages ethniques et des pogroms de toutes sortes (Rwanda, Congo, Soudan, Côte d'Ivoire, Nigeria, Somalie, Irak, Syrie, Myanmar, Thaïlande, etc.). Des millions de personnes devaient chercher refuge mais la plupart des réfugiés demeuraient encore dans leur région. Seul un nombre limité d'entre eux s'orientaient vers l'Europe de l'ouest. Pendant la première guerre du Golf, la « coalition » dirigée par les États-Unis instrumentalisait ainsi sur place les populations kurdes et chiites pour son intervention qui fit au moins 500 000 morts et de nouveaux réfugiés.3 L'alibi « humanitaire » et/ou « pacificateur » avait permis de couvrir les pires exactions impérialistes au nom de la « protection des réfugiés » et des populations, en particulier les minorités kurdes. La bourgeoisie avait alors promis une ère de « paix », de « prospérité » et le triomphe de la démocratie. En réalité, comme on peut le voir aujourd'hui, les grandes puissances et tous les États allaient être entraînés par la logique du militarisme, celle d'un système dont la spirale est toujours plus meurtrière et destructrice. La guerre revint d’ailleurs rapidement en Europe, dans l’ex-Yougoslavie, faisant plus de 200 000 morts. En 1990, 35 000 Albanais du Kosovo commençaient à fuir vers l'Europe occidentale. Une année après, suite à la déclaration d'indépendance de la Croatie, 200 000 personnes quittaient l'horreur du conflit et 350 000 autres étaient déplacées au sein de l'ancien territoire morcelé. En 1995, la guerre s’étendit en Bosnie et chassa 700 000 personnes supplémentaires, notamment à la suite des bombardements quotidiens sur Sarajevo.4 Un an plus tôt, le génocide du Rwanda, également avec la complicité de l'impérialisme français, fit près d'un million de victimes (principalement au sein de la population d’origine tutsie, mais aussi des Hutus), provoquant l'afflux massif et tragique de réfugiés rwandais rescapés vers la province du Kivu au Congo (1,2 million de déplacés et des milliers de morts à cause du choléra, des règlements de comptes, etc.). A chaque fois, les réfugiés étaient otages et victimes des pires exactions. Au mieux, considérés comme des « dommages collatéraux », de simples objets gênants aux yeux de la logistique militaire.
Nombreux étaient prêts à croire que le spectre de la guerre s’était éloigné, mais dans la réalité et la logique du capitalisme, la spirale guerrière ne pouvait que poursuivre sa folie destructrice. Des zones entières de la planète se retrouvaient souillées par des seigneurs de guerre et l'appétit des grandes puissances, pourchassant et terrorisant les populations obligées de fuir toujours plus les zones de combat et la barbarie, les atrocités des gangs et des mafias, comme en Amérique latine face aux narcotrafics, ou celles des résidus laissés par l'effondrement d’États en lambeaux, comme en Irak autour des nébuleuses Al-Qaïda puis Daech et son « État islamique », de même en Afrique, où les tensions inter-ethniques et les bandes armées de terroristes égorgent, multiplient les attentats et sèment un peu partout le chaos. Les interventions des grandes puissances, notamment des États-Unis en Irak en 2003 puis en Afghanistan, réveillèrent les ambitions des puissances régionales, déstabilisaient davantage ces pays extrêmement fragilisés, dévastaient des zones encore plus grandes en les livrant à la guerre. Tout cela aggravant le phénomène des réfugiés, multipliant les camps et les tragédies. Les réfugiés étaient la proie des mafias, subissaient des sévices, des vols, des viols ; les femmes étaient souvent enrôlées ou enlevées par des réseaux de prostitution.5
Un peu partout sur le globe, ces mêmes phénomènes se conjuguent, fortement alimentés par la guerre sur les points les plus chauds, comme au Moyen-Orient, condamnant des familles entières à errer dans l'exil ou à croupir dans des camps.
Jusqu'à cette période, la plupart des victimes des guerres réfugiées autour de l'Europe, restaient dans leur région. Or, depuis quelques années, face des zones de guerre de plus en plus étendues, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, un nombre bien plus élevé de réfugiés se dirige vers l'Europe de l'ouest ; cela, en plus des migrants « économiques » de l'Europe de l'est, des Balkans, des pays méditerranéens ou autres secoués par la crise économique et le chaos. Il en va de même pour le continent américain : en plus des émigrés venant du Mexique, un nombre grandissant de réfugiés fuient la violence en Amérique centrale, essayant de s'échapper vers le Mexique pour se rendre aux États-Unis.
La guerre en Syrie et l'afflux massif des réfugiés
L'Irak, la Libye et la Syrie sont désormais la proie d'un chaos incontrôlable qui pousse encore plus les populations à fuir massivement. En même temps, des milliers de personnes sont pris en otages par les rivaux impérialistes sur place, comme à Alep par exemple, où ils sont condamnés à mourir sous les bombardements massifs et les balles, à crever de faim et de soif. Environ 15 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées rien qu'au Moyen-Orient. En 2015, plus d'un million de personnes se sont exilées, rien qu'en comptant les afflux vers l'Allemagne ! Pour la première fois depuis 1945, des vagues de réfugiés victimes de la guerre et des bombardements se dirigent massivement vers une Europe-forteresse perçue comme un « eldorado », mais qui les repousse brutalement. En Ukraine, la guerre a fait son retour et des milliers d'Ukrainiens ont fui les combats, demandant l'asile dans les pays voisins, notamment la Pologne de plus en plus hostile aux réfugiés.
Entre les années 2000 et 2014, 22 400 personnes sont mortes ou disparues en Méditerranées6 en tentant de regagner cette Union européenne idéalisée, malgré les dispositifs policiers rendant l'accès aux frontières très difficile, facilitant en cela le travail des passeurs mafieux, sans scrupules, dont les organisations prospèrent à une échelle devenue industrielle. Les États les plus riches deviennent de ce fait de véritables bunkers multipliant les murs, les barbelés, les patrouilles et les effectifs policiers qu'il faut contourner au prix le plus élevé : souvent la mort. Ironie du sort, les États-Unis, champions des « libertés démocratiques », qui n'avaient pas de mots assez durs pour stigmatiser le « mur de la honte » à Berlin, ont construit eux-mêmes un mur géant à leur frontière sud pour barrer la route des « chicanos » !7
Dans beaucoup de pays, les réfugiés sont devenus non seulement des indésirables, mais sont aussi présentés comme des criminels ou des terroristes potentiels, justifiant une paranoïa sécuritaire entretenue à dessein pour diviser, contrôler les populations et préparer la répression des futures grandes luttes sociales. A la répression policière s'ajoutent, outre la faim et le froid, le harcèlement administratif et bureaucratique. Les grandes puissances ont ainsi déployé tout un arsenal juridique destiné à filtrer les « bons migrants » (ceux qui peuvent être utiles pour valoriser le capital, notamment les cerveaux, le « Brain Drain »), les « demandeurs d'asile » et les « mauvais migrants », tous les crève-la-faim majoritaires, sans qualification, qui doivent... « crever chez eux ». En tout cas, ailleurs ! Selon les besoins démographiques et économiques, les différents États et capitaux nationaux « régulent » ainsi le nombre de réfugiés susceptibles d'intégrer le marché du travail.
Bon nombre sont refoulés brutalement. Hommes, femmes et enfants, notamment dans les camps en Turquie8, sont victimes des policiers qui, si les décharges électriques, coups de bâton, etc. ne suffisent pas, n'hésitent plus à leur tirer dessus de sang-froid. L'UE, parfaitement au courant de ces pratiques terrifiantes et des cadavres qui continuent de s'échouer sur les plages de la Méditerranée, laisse non seulement faire froidement, mais organise tout un appareil militaire et de chasse à l’homme pour refouler les réfugiés. C'est, pour elle, au-delà de la lâcheté et de l'hypocrisie, le simple prix à payer pour dissuader les candidats à l'exil !
Un enjeu immense et un combat moral pour le prolétariat
Avec ce tableau très général de l’histoire des réfugiés et les flux migratoires, nous avons essayé de montrer que le capitalisme a toujours utilisé la force et la violence, que ce soit de manière directe ou indirecte pour contraindre les paysans d’abandonner leur terre et vendre leur force de travail, là où ils le peuvent. Nous avons vu que ces migrations, leur nombre, leur statut (clandestins ou légaux), leur orientation, dépendent des fluctuations du marché mondial et changent selon la situation économique. La guerre, qui devient de plus en plus intense, fréquente et répandue pendant le XXe siècle, fait que le nombre de réfugiés et victimes de guerre a constamment augmenté. Avec les conflits récents, ce flux se dirige dans des proportions nouvelles vers l’Europe et les autres grands centres industriels. S’ajoute à cela, depuis un certain temps de plus en plus de réfugiés liés aux destructions de l’environnement. Aujourd'hui, les changements climatiques et désastres écologiques s'ajoutent à tous ces maux. En 2013, on comptait déjà 22 millions de réfugiés climatiques. Selon certaines sources, ils seraient trois fois plus nombreux que les réfugiés de guerre. Pour 2050, l'ONU prévoit l’afflux de 250 000 réfugiés climatiques, un chiffre fantaisiste et forcément sous-évalué quand on voit qu'aujourd'hui déjà certaines zones ou villes (comme Pékin ou New-Delhi) sont devenues irrespirables. La convergence de ces facteurs combinés augmente les tragédies. Un nombre croissant de réfugiés que le capital ne peut plus intégrer de façon suffisante dans la production du fait de sa crise historique.
Aussi, le sort tragique des réfugiés pose désormais un vrai problème moral pour la classe ouvrière. En effet, le système capitaliste pratique la chasse aux illégaux, le refoulement, la déportation, l’emprisonnement dans les camps, multiplie les campagnes xénophobes, nourrit finalement la préparation d'une violence en tous genres contre les migrants. En plus, en cherchant à dissocier les « vrais demandeurs d'asile » devenus très rapidement trop nombreux des « réfugiés économiques » indésirables, la bourgeoisie accentue les divisions. Face à la réalité de la crise économique, un peu partout en Europe, exploitant de nouveau les peurs et le contexte du terrorisme, elle induit la nécessité d'une « solution raisonnable », laissant planer avec un savant dosage la panique et le souffle de la xénophobie sur une partie de la population. Cela, tout en présentant l’État comme le seul rempart pouvant garantir la stabilité face aux menaces « d'invasions » et prétendument permettre de « lutter contre la xénophobie ». La propagande accentuant la crainte de la mise en concurrence pour le travail, le logement et la santé par les réfugiés, favorise une mentalité réactionnaire et pogromiste de plus en plus présente aujourd'hui. Tout cela constitue le sol fertile pour l’épanouissement du populisme.9
La bourgeoisie, nous l'avons vu, ne cesse de diviser les ouvriers et les populations entre elles, d'attiser et d'exploiter les sentiments xénophobes qui s'enkystent à travers le populisme, notamment contre les migrants. C'est ce qu’a confirmé la montée des partis politiques ultra-conservateurs contre les immigrés en Europe et aux États-Unis depuis quelques années, infestant notamment les parties du prolétariat le plus marginalisé dans les régions anciennement industrialisées. Le résultat du referendum en Grande-Bretagne, avec le Brexit, comme le phénomène Trump en Amérique, confirment cela de manière évidente. Particulièrement avec la question épineuse des migrants, la classe ouvrière doit désormais assumer des responsabilités croissantes, il lui faudra nécessairement bannir les discours haineux qui considèrent d'un côté qu'il faut « jeter dehors les immigrés » et ceux qui, dans leur élan patriotique et démocratique, pensent qu'« on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Il faut déjouer les pièges de la propagande officielle, les contraintes qui font obstacle à l'affirmation de la nécessaire solidarité comme expression consciente de ce combat moral. Si le chiffre des migrants explose, traduisant toujours plus de souffrances, il ne représente pourtant que 3% de la population mondiale. La bourgeoisie, qui craint à terme de perdre le contrôle d'une situation de plus en plus chaotique, entretient donc volontairement les peurs, exerce un climat de terreur poussant les individus isolés à s'en remettre à la « protection de l’État ». Derrière les discours officiels anxiogènes et les mesures sécuritaires des appareils étatiques, les prolétaires doivent absolument agir de manière consciente et rejeter les réflexes de peur conditionnés par les médias, prendre conscience que les réfugiés sont avant tout des victimes du capitalisme et des politiques barbares de ces mêmes États. C'est ce qu'a tenté de montrer notre série d'articles. La classe ouvrière devra, à terme, être capable de percevoir que derrière la question des migrants se pose l'unité internationale du combat révolutionnaire contre le système capitaliste.
« Si notre classe parvient à retrouver son identité de classe, la solidarité peut être un important moyen unificateur dans sa lutte. Si par contre, elle ne voit dans les réfugiés que des concurrents et une menace, si elle ne parvient pas à formuler une alternative à la misère capitaliste, permettant à tout individu de ne plus être contraint de fuir sous la menace de la guerre ou de la faim, alors nous serions sous la menace d’une extension massive de la mentalité pogromiste, dont le prolétariat en son cœur ne saurait être épargné »10.
WH, novembre 2016
1 Véronique PETIT, Les migrations internationales, publié dans : La population des pays en développement.
2 Pour cette raison, l'UE créa un espace unique (l'espace Schengen) permettant un contrôle drastique et un flicage plus serré aux frontières (tout en permettant la « libre circulation » de la force de travail à l'intérieur de cet espace).
3 Voir notre brochure : La Guerre du Golfe.
4 Lors d'une offensive serbe dans l'enclave de Srebrenica, les militaires français de la FORPRONU, sous l'ordre de leur état-major, gardaient leur « neutralité », permettant le massacre de plus de 8000 Bosniaques...
5 Le phénomène de la prostitution, exposant en première ligne les mineurs, est en pleine expansion dans le monde. On compte environ 40 millions de prostituées provenant du monde entier, souvent déplacées de force.
6 Fatal journeys,tracking lives lost during migration, Organisation internationale pour les migrations.
7 Voir nos articles : Migrants et réfugiés : la cruauté et l'hypocrisie de la classe dominante, RI n°454, sept./oct. 2015 et : Prolifération des murs anti-migrants : le capitalisme, c'est la guerre et les barbelés, RI n°455, nov./déc. 2015
8 La Turquie et le Mexique occupent une place cruciale pour les États-Unis et l’UE en raison de leur place stratégique pour retenir le plus grand nombre de réfugiés/migrants.
9 Voir nos articles sur ce sujet dans la Revue Internationale n°157.
10 La politique allemande et le problème des réfugiés : un jeu dangereux avec le feu, RI n° 457
Récent et en cours:
- Immigration [42]
- réfugiés [1]
Rubrique:
Trump ou Clinton : un mauvais choix pour la bourgeoisie et le prolétariat
- 1748 reads
Nous publions ci-dessous la traduction d'une contribution d'un contact proche du CCI aux États-Unis. Réalisé et posté sur notre site en langue anglaise avant la victoire de Trump, cet article présente un intérêt pour poursuivre la réflexion sur les élections américaines. L'article se penche sur les difficultés actuelles de la bourgeoisie américaine, révélées par la candidature de Trump et la montée du populisme. Bien qu’il ait été écrit avant le scandale concernant l’attitude insultante de Trump à l’égard des femmes, cet épisode confirme un point central de l’analyse de l’article : l’existence d’une tentative concertée au sein des fractions les plus sérieuses de la classe dirigeante, malgré les divisions du parti, d’empêcher Trump d’accéder à la Maison Blanche.
A mesure que la campagne présidentielle approche de sa conclusion, les médias nous promettent que cette élection sera la plus importante dans l’histoire des États-Unis. L’emphatique milliardaire Donald J. Trump, représentant le Parti républicain, et l’ancienne Première Dame au casier judiciaire chargé et Sénatrice démocrate de New York, Hillary Clinton, s’affrontent dans une épreuve de force tragique au milieu d’un spectacle médiatique conçu pour convaincre la population de la nécessité impérieuse de participer au processus électoral, même si aucun des deux candidats n’est particulièrement inspirant.
Pour la grande majorité des experts, commentateurs et analystes intervenant sur la télévision câblée chaque soir et dont les articles fournissent les ordures dont se nourrit Facebook, il est impératif pour les Américains de vaincre la menace raciste, xénophobe et même « fasciste » représentée par Trump, même si cela implique de voter pour la candidate Clinton qui n’a rien d’une sainte. Pendant ce temps, la minorité des têtes pensantes qui travaillent pour Trump implore l’électeur américain de rejeter la politique du statu quo, de courir le risque de voter pour un homme nouveau et d’abattre Clinton la criminelle, dont ils disent qu’elle mérite la prison de toutes façons. Cette rhétorique est exacerbée au maximum dans le but de faire croire à l’importance des enjeux de cette élection pour le pays et même pour le monde entier. Le thème principal mis en avant par les médias jour après jour est qu’une véritable crise existentielle de la civilisation mondiale nous tomberait dessus si jamais Trump gagnait les élections.
Contre l'escroquerie électorale
De notre point de vue, nous devons une nouvelle fois affirmer catégoriquement la position (éprouvée et confirmée par la réalité) de la Gauche communiste selon laquelle la classe ouvrière n’a rien à gagner à participer au cirque électoral. Que ce soit pour voter Clinton et empêcher le pays de tomber entre les mains d’un tyran dangereux faisant monter les enchères pour sortir du statu quo et « renouer avec la grandeur de l’Amérique », ou pour voter Trump, candidat minoritaire de son parti, pour manifester son dégoût des autres options, le vote ne sert qu’à attirer la classe ouvrière sur le terrain politique de la bourgeoisie et à la détourner de son combat autonome de défense de ses conditions de travail et de vie.
Au bout du compte, quel que soit le gagnant des élections et le futur président des États-Unis, les problèmes fondamentaux et sous-jacents de la société dans le capitalisme en décomposition, qui sont la cause de l’approfondissement des problèmes de la vie politique bourgeoise, seront toujours présent. L’élection de Clinton pourrait empêcher Trump de nuire, mais cela n’arrêtera pas les bouleversements économiques, sociaux et culturels qui font le lit du « trumpisme » (et plus largement la montée du populisme). Élire Trump pourrait empêcher Clinton, candidate ténébreuse, corrompue et néo-libérale d’entrer en fonction, mais est-ce que l’ancienne star de la TV réalité et politicien néophyte ne se tournerait pas comme avant vers la vieille clique d’ « experts » ? Et voter pour un le candidat d'un parti mineur comme Jill Stein (Parti Vert) ou Gary Johnson (Libertariens) permettra à certains de se sentir bien un petit moment, donnant l'impression de contester les deux candidats principaux, mais la constatation que seuls Trump ou Clinton peuvent être président sera une désillusion. Alors, qu’a-t-on à gagner d’aller voter ?
Non, la seule voie réelle pour lutter contre tout cela pour la classe ouvrière est de retourner sur son terrain de classe : défendre ses conditions de vie et de travail loin de tout ce sinistre cirque électoral et en dehors du contrôle des différents partis bourgeois de droite, du centre et de gauche. Alors que nous constatons que les conditions présentes peuvent certainement entraver ce processus et que, par conséquent, de nombreux pans de la classe ouvrière peuvent être entraînés sur le terrain électoral d’un côté ou de l’autre, il n’y a aucune raison de changer notre défense du principe d’abstention concernant les élections bourgeoises, principe qui a été une position fondamentale de la Gauche communiste au siècle dernier.
Nous devons également dire que, sur un plan objectif, l’évolution de la scène politique américaine ces dernières années a brutalement confirmé l’analyse que nous avons développée depuis au moins l’élection présidentielle ratée de 2000 qui a conduit Georges W. Bush à la Maison Blanche au lieu de Al Gore, contre le souhait des principales fractions de la bourgeoisie américaine. Selon cette analyse, les conditions de la décomposition sociale capitaliste exercent un effet sur la classe dominante elle-même, rendant de plus en plus difficile pour la bourgeoisie le contrôle de son appareil électoral afin d’obtenir les résultats escomptés. L’élection ratée de 2000 a conduit à huit ans de présidence Bush ; ces huit ans ont vu les attaques du 11 septembre 2001 qui ont donné aux États-Unis l’opportunité d’envahir l’Irak de manière unilatérale et sans précaution, conduisant à un déclin précipité du prestige des États-Unis au plan international et à l’échec de ses objectifs impérialistes.
Alors que la bourgeoisie américaine a été temporairement capable de tenir la barre des élections avec le premier président afro-américain Obama en 2008, revivifiant l’image internationale de l’État américain, renforçant les illusions électoralistes chez des millions de personnes, particulièrement les jeunes générations, et fournissant une réponse mesurée à l’éclatement de la grande récession de 2008, ces gains ont été désespérément éphémères. La présidence d’Obama a servi à initier une résistance féroce de l’aile droite sous la forme du Tea Party, et au cours de ce mandat, le Parti républicain est de plus en plus tombé sous l’influence idéologique incohérente d’une faction dirigée par des extrémistes de droite en qui il est impossible d’avoir confiance pour prendre les rênes du gouvernement fédéral.1
Au début de son mandat, Obama a été capable de mettre en place un plan de réforme des soins de santé, qui a jusqu’à présent réussi à survivre aux contestations judiciaires de la droite, comme sa présidence l’a montré ; cependant, il est devenu évident pour de larges pans de l’opinion publique qui ont voté pour lui qu’il ne serait pas le président du changement annoncé pendant sa campagne : il a poursuivi les programmes de surveillance de masse de son prédécesseur, il a intensifié agressivement les opérations de drones à l’étranger, a très peu fait pour réduire les inégalités de richesses, les expulsions d’immigrants, et s’est dès le début entouré d’anciens de Wall Street.
De plus, bien qu'Obama ait jusqu’ici évité de mêler l’État américain à des aventures de cow boy style Bush à l’étranger, sa politique internationale déclarée de « diriger depuis les coulisses » n’a pas plu aux va-t-en guerre de chaque parti, et il a été durement critiqué pour ne pas avoir tenu tête à Poutine, laissant Assad franchir la ligne rouge de l’utilisation des armes chimiques en Syrie sans se soucier des conséquences, pour avoir regardé la Libye sombrer dans le chaos et ne pas avoir bombardé suffisamment l’État Islamique. Sur le plan intérieur, le continuel accroissement des inégalités de revenus, l’érosion continue des revenus de la classe moyenne et l’échec à apporter une réponse satisfaisante à la question de l’immigration ont nourri un rejet « populiste » de la présidence d’Obama par un nombre important d’« ouvriers blancs ».2
Ce surgissement populiste, couplé à la tentation croissante du Parti républicain de défendre des positions idéologiques qui en proviennent, a créé une situation dangereuse pour la bourgeoisie américaine à la fin du mandat d'Obama. Les factions principales de la bourgeoisie américaine ne peuvent plus faire confiance au Parti républicain pour assurer des fonctions officielles et sont obligées de compter uniquement sur le Parti démocrate comme parti de gouvernement national. La difficulté croissante à manipuler les résultats des élections et l’existence d’institutions centenaires toujours en fonction ont fait qu'Obama a été obligé de composer avec un Congrès Républicain pendant une bonne partie de son mandat. Cela a augmenté la pression sur le Parti démocrate traditionnellement « Parti de la classe ouvrière » afin qu’il devienne un parti néo-libéral de gouvernement technocratique et qu’il montre de plus en plus cette nouvelle face au public américain.
En conséquence, au cours du mandat d'Obama, le Parti démocrate lui-même s’est dévoilé de plus en plus comme un parti « néo-libéral », attaché aux mêmes intérêts capitalistes que les Républicains (ce qui l’a discrédité aux yeux de millions d’Américains), particulièrement chez les ouvriers blancs et les ouvriers indépendants qui ont été séduits par le populisme de Trump, mais également chez les jeunes générations, dont beaucoup étaient attirées par la candidature « rebelle » du « démocrate socialiste » Bernie Sanders pendant les primaires de la campagne.
Telles sont les principales lignes de failles qui ont marqué la campagne présidentielle de 2016 pour la bourgeoisie américaine. D’un côté on a un personnage dangereux que les principales factions de la bourgeoisie ne peuvent tout simplement pas laisser prendre les rênes du pouvoir ; de l’autre côté, on a une représentante de la vieille garde politique, largement discréditée, méprisée par une large partie de la population, à droite comme à gauche, pour des raisons différentes. Comment la bourgeoisie peut-elle gérer une pareille situation ? Nous allons maintenant examiner cette question en détail.
La candidature de Trump : le suicide du Parti républicain
Une chose est certaine dans ces élections : les factions principales de la bourgeoisie américaine ne veulent pas de Trump à la tête de l’État. Cela est vrai indépendamment des partis politiques. L’élite du Parti républicain a aussi peur de la victoire de Trump que celle du Parti démocrate. Des représentants importants du Parti républicain comme la famille Bush ont d’ores et déjà annoncé qu’ils ne voteraient pas Trump. Des articles de la presse du « mouvement conservateur » comme la National Review s’opposent activement à lui et des candidats Républicains au Congrès et au Sénat gardent leurs distances de peur de s’aliéner l’important électorat indécis. Alors que Trump peut compter sur le soutien de quelques figures Républicaines soucieuses de leur avenir politique, et qui ne veulent pas aller à l’encontre du surgissement populiste, il est clairement considéré au sein du Parti républicain comme un personnage louche.3 Autrefois démocrate, il a soutenu le droit à l’avortement et la médecine sociale, il a même chanté les louanges des Clinton dans le passé, et son revirement social-conservateur laisse sceptique. De plus, sa volonté de liquider la guerre en Irak, de détruire la famille Bush, de courtiser le président Poutine ne va pas dans le sens des stratégies néo-conservatrices du Parti républicain en politique étrangère. Alors, comment se fait-il qu’il ait gagné les primaires du Parti républicain comme candidat à la présidentielle ?
La réponse se trouve autant dans l’histoire du Great Old Party lui-même que dans le personnage Trump. Pendant la présidence d’Obama, le Parti républicain (déjà sous le choc de la deuxième présidence désastreuse de Bush) adopta une position de plus en plus hostile au président. Lors des élections de mi-mandat en 2010, une nouvelle vague d’idéologues purs et durs associés au mouvement du Tea Party furent élus au Congrès, obligeant l‘establishment du Parti républicain à s’adapter à une aile droite de plus en plus bruyante et allergique aux compromis et même à toute gouvernance.
De l’opposition violente à la réforme d’Obama sur les soins médicaux aux fermetures de l’État imposées au gouvernement et même à la menace de faire défaut sur la dette nationale des États-Unis, l’insurrection du Tea Party procura au Parti républicain une nouvelle vie électorale, dans le sillage de la victoire enivrante d’Obama, tour en menaçant la stabilité des institutions du Great Old Party. Depuis 2009, le Parti républicain a joué un jeu dangereux avec le Tea Party grâce auquel il a engrangé des forces agressives en vue d’un succès électoral. Cela présentait le risque de la mainmise d’une hydre virtuelle issue de la droite dure dans ses propres rangs. Le porte-parole de la Chambre des représentants, John Boehner, a ainsi été obligé de jouer au jeu délicat du chat et de la souris avec ces « insurgés », cherchant l’équilibre entre les succès électoraux et politiques selon les besoins du moment de la gouvernance de l’État, qui nécessite sans arrêt des compromis avec les partenaires. Finalement, Boehner se lassa de contenir les insurgés du Tea Party et laissa en 2014 la place à l'ex-candidat à la vice-présidence de Mitt Romney, Paul Ryan4, qui prit le poste à contrecœur.
Au fur et à mesure du déroulement de la présidence Obama, il devint de plus en plus évident pour les principales factions de la bourgeoisie américaine que l’on ne pouvait pas faire confiance au Parti républicain pour contenir ses radicaux et c’est pourquoi ce n’était pas une option viable que de mettre un Républicain à la Maison Blanche. Avec un choix entre l’impasse et l’incertitude quant à ce qu’un Tea Party au pouvoir était capable d’apporter au Parti républicain, les factions principales de la bourgeoisie choisirent la deuxième option. C’est dans ce contexte que la bourgeoisie américaine commença à préparer le terrain pour Hillary Clinton, à l’époque secrétaire d’État, pour succéder à Obama.
Cependant, ce n’est pas parce que les principales factions de la bourgeoisie ont décidé de soutenir un candidat que la campagne est terminée. L’État doit encore glaner des candidats des principaux partis afin de préserver sa façade démocratique. Et même si, historiquement, l’État américain a su remarquablement manipuler le processus électoral pour produire les résultats escomptés, particulièrement à travers l’utilisation de la presse, le processus ne marche pas à tous les coups, comme l’élection de 2000 l’a montré. En politique, comme dans la vie, des accidents arrivent. A chaque élection existe le risque que le mauvais candidat gagne et la bourgeoisie américaine se retrouve coincée avec un boulet à la Maison Blanche. Dans le passé, cela n’a pas posé de problème dramatique, dans la mesure où les candidats étaient pilotés par les institutions d’État (la bureaucratie permanente) pour mener des politiques ayant l’aval des principales factions de la classe dominante ; aujourd’hui, la décadence du Parti républicain complique les choses, rendant encore plus nécessaire la victoire finale du candidat Démocrate.
Historiquement, le long processus pour sortir des primaires a été l’outil principal par lequel la bourgeoisie pouvait imposer son choix de candidats pour chaque parti important. La fonction des primaires est clairement d’éliminer les électrons libres et les rebelles, et de favoriser les candidats de la classe dirigeante ayant le soutien politique et financier de la hiérarchie du parti. Cependant, tout comme en 2012, la primaire 2016 du Parti républicain s’ouvrit dans une ambiance de carnaval. Avec 17 candidats représentant les différentes sensibilités du Parti, y compris le milliardaire frondeur Donald J. Trump, la primaire du parti ressemblait à un concours dont l’enjeu était de voir qui allait perdre l’élection générale contre Clinton.
Cependant, même si les principales factions de la bourgeoisie étaient généralement groupées derrière Clinton, il était nécessaire pour elles de mettre en avant un Républicain qui présenterait une alternative crédible si un « accident » arrivait ou si les ennuis judiciaires de Clinton s’avéraient être un handicap trop important. Ont été désignés pour cette tâche l’ancien gouverneur de Floride (frère et fils d’anciens présidents) Jeb Bush, Marco Rubio (un Hispanique favorable à la réforme de l’immigration), et le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker (un chouchou du Tea Party qui a néanmoins réellement gouverné, qui a eu à faire face à des protestations de masse contre sa loi sur le droit du travail de 2011 et a survécu à une tentative de destitution). Chacun de ces candidats avait son propre bagage politique mais s’était aussi montré souple par rapport à la nécessité d’un consensus politique des principales factions de la bourgeoisie.
Cependant, la primaire républicaine de 2016 n’a pas tourné comme celle de 2012, lorsque le candidat désigné par l’élite républicaine Mitt Romney (considéré comme une bonne alternative à Obama) avait résisté à une série d’adversaires pour consolider sa nomination. Le contexte de 2016 a vu Trump éliminer systématiquement ses rivaux sur le terrain des insultes personnelles et le rappel embarrassant de faiblesses politiques. Bush et Rubio ont été dénoncés pour leur faiblesse à l’égard de l’immigration, pendant que Scott Walker était décrit comme ayant conduit son État au désastre fiscal.5 Aucun de ces candidats de l’Institution n’a réellement menacé Trump, clouant le bec aux experts politiques et semblant répandre l’effroi dans le cœur des institutions bourgeoises. Le seul rival sérieux de Trump au Tea Party, le bouillonnant Ted Cruz, était lui-même un outsider radical méprisé par l’élite politique qui ne l’a soutenu que pour empêcher Trump d’aller plus loin.
Quand Trump a accepté sa nomination comme candidat à la présidentielle pour le Parti républicain à la convention de juillet, ç’a été l’acmé de quelques-unes des pires peurs des principales factions de la bourgeoisie américaine (en dehors de la révolution prolétarienne) : un personnage imprévisible, désordonné, dangereux, considéré par certains comme un messie, qui a usurpé le manteau de l’un des deux principaux partis politiques. Du point de vue des principales factions de la bourgeoisie, le système des deux partis était désormais en danger, et peut-être même l’appareil démocratique lui-même. Il n’y avait rien à faire, à part s’opposer furieusement à Trump dans l’élection générale, une chose que, comme nous allons le voir, les principales factions de la bourgeoisie avaient déjà tenté en choisissant Hillary Clinton comme candidate démocrate.
Mais comment Trump a-t-il fait ?
Comment a-t-il fait ? Comment a-t-il réussi là où tant de campagnes d’excités avaient échoué avant ? C’est une question sur laquelle vont se pencher beaucoup de chercheurs académiques en science politique pour les années à venir. Ce qui paraît évident, c’est que la conquête par Trump du Parti républicain est la résultante de son adhésion à une vague internationale de politique populiste associée à sa personnalité charismatique et sa richesse personnelle. N’étant pas dépendant de soutiens financiers ni de structures politiques de partis institutionnels, Trump était libre de mener une campagne de franc-tireur reprenant les thèmes du populisme politique qui émergent aujourd’hui au sein du vieux monde industriel : une critique des politiques néo-libérales, la promesse de défendre les industries locales et les emplois contre la délocalisation et la conclusion de marchés internationaux, un engagement pour renforcer le filet de sécurité concernant les travailleurs déplacés et une opposition farouche à l’immigration, vue par beaucoup de blancs de « classe inférieure » comme la cause de salaires plus bas, de la baisse du niveau de vie et de la désintégration de la vie sociale.6
Sur le fond, pour beaucoup, cette politique a des attraits, même si c’est seulement parce qu’elle semble à l’opposé de ce qui est défendu par la politique bourgeoise consensuelle des deux principaux partis au cours des dernières décennies. Imitant en partie le style du fascisme italien, Trump a bâti un culte de la personnalité virtuel autour de sa personne (quelque chose qui renvoie à ses jours de gloire comme icône de la pop-culture dans la télé-réalité) ; ce procédé a attiré l’attention de millions d’Américains qui sont complètement dégoûtés par la politique du consensus néo-libéral et ont envie d’essayer un homme dont les médias responsables et les experts disent qu’il est une catastrophe. De toutes façons, du point de vue de la base de Trump, le désastre est déjà advenu, il continue juste à s’approfondir et aucun des candidats « responsables » n’a l’air de s’en émouvoir. La candidature de Trump est en grande partie une révolte nourrie par le désespoir de millions d’ouvriers dont les emplois relativement stables d’avant et l’espoir d’une amélioration sociale ont été déçus précisément par le genre de politique libérale que l’élite consensuelle leur a vendue en disant que c’était leur intérêt (mondialisation, externalisation, libre-échange, etc…).
Pourtant, même si les préférences politiques énoncées par Trump ne sont pas conformes à celles des principales factions de la classe dominante aujourd’hui, il doit être clair que, en aucune façon, elles ne sortent de la sphère politique bourgeoise. En fait, il est probable que les positions politiques déclarées par Trump sont tout simplement incompatibles avec la réalité économico-politique du capitalisme aujourd’hui. S’il venait par hasard, contre toute attente, à gagner les élections, la classe ouvrière doit être convaincue que cela ne changerait pas sa vie pour revenir au bon vieux temps de l‘après-Deuxième Guerre mondiale et de la reconstruction. Au contraire, il échouerait plutôt lamentablement dans l’application de sa politique à cause de la résistance des autres factions bourgeoises, ou alors nous finirions par découvrir que son élection n’était qu’un gigantesque canular et qu’il a laissé le pouvoir exécutif réel aux politiciens professionnels et aux conseillers politiques de ces mêmes factions de la classe dominante qu’il dit haïr.7 Et, bien sûr, s’il parvenait à mettre en œuvre sa politique, cela rendrait les choses encore plus difficiles pour la majorité de la classe ouvrière, comme les ouvriers Britanniques en ont fait l’expérience, avec une chute de la livre sterling et la hausse abrupte de l’inflation qui en a été la conséquence. Le populisme dans le style de Trump n’est pas une réponse aux maux de la classe ouvrière.
Clinton versus Sanders : le Parti démocrate se révèle
Comme nous l’avons vu, le Parti républicain est devenu trop instable pour que les principales factions de la bourgeoisie puissent lui confier l’exécutif sur le long terme. Cependant, la descente aux enfers du Parti républicain a eu des effets sur le Parti démocrate, de sorte que celui-ci est de plus en plus amené à se défaire de son vernis de « parti de la classe ouvrière » et se révèle être une institution capitaliste néo-libérale. Ce processus s’est accéléré pendant la campagne 2016 et a été particulièrement visible dans l’épreuve de force qui a eu lieu entre Clinton, la candidate de l’establishment, et Sanders, le parvenu contestataire, le Sénateur « socialiste démocrate » du Vermont.
Au début de la saison des primaires 2016, les principales factions de la bourgeoisie avaient déjà choisi Hillary Clinton comme candidate préférée pour succéder à Obama à la Maison Blanche. Quelle qu’ait été leur rivalité féroce pendant les primaires de 2008, où l’on a vu Obama mettre un frein aux ambitions présidentielles de Hillary Clinton, les principales factions de la bourgeoisie pensaient que la présidence de Clinton permettrait une transition en douceur vers une nouvelle administration et ferait perdurer l’illusion électorale démocratique. Ayant élu le premier président afro-américain en 2008, le peuple américain allait maintenant avoir l’opportunité d’élire la première femme présidente. Étant supposés avoir éradiqué le racisme en 2008, les électeurs allaient maintenant apporter une grande victoire à la cause féministe. Ainsi, cette primaire démocrate était censée couronner la reine Hillary, vu qu’elle semblait ne devoir faire face à aucun candidat sérieux ; en fait, beaucoup d’experts craignaient que le manque de candidat sérieux à la primaire ne la mette hors-jeu, alors que la vraie campagne commençait en juillet contre un candidat Républicain aguerri au combat.
Hélas, le couronnement a été long à venir. La campagne de Clinton a dû se confronter à un candidat pugnace et étonnamment fort issu de la gauche, le Sénateur « démocrate socialiste » du Vermont, Bernie Sanders. La campagne gauchiste de Sanders n’avait pas été anticipée par les instances dirigeantes, qui pensaient probablement qu’il mènerait une campagne de protestation molle et qu’il gagnerait peu de voix. Cependant, quand Sanders a réussi à faire jeu égal avec Hillary dans l’état-pivot de l’Iowa et a réussi à lui passer devant dans la primaire du New Hampshire, les instances dirigeantes (à travers les institutions du Parti démocrate et les médias libéraux) ont quelque peu paniqué.
Porté par le soutien massif de la « génération du Millénaire », de jeunes électeurs qui voient en Clinton une représentante de la vieille garde discréditée des politiciens néo-libéraux hors du coup par rapport au consensus « progressiste » émergeant, Sanders menaçait de jouer son propre jeu. Même s’il n’a en fin de compte pas gagné la primaire, sa présence prolongée, la gestion d’une véritable campagne dans laquelle il a correctement et efficacement dépeint Clinton comme une amie néo-libérale de Wall Street, menaçait d’affaiblir la candidate préférée de la tête du Parti à l’élection générale. Risquant déjà des poursuites judiciaires à cause du scandale des emails, et déjà détestée par beaucoup d’électeurs après des années d’attaques de l’aile droite, Clinton ne pouvait accepter de perdre cette génération du Millénaire (si critique lors de la victoire d’Obama) au bénéfice du candidat d’un troisième parti ou d’un abstentionnisme de protestation.
Ce qui a suivi a tout d’un cauchemar politique pour le Parti démocrate et ses alliés des médias : on a apparemment utilisé tous les moyens pour faire gagner Clinton. Les médias ont promptement dénoncé Sanders comme un rêveur utopique en dehors de la réalité, et dépeint ses partisans comme des marmots privilégiés, blancs pour la plupart, qui voulaient tout simplement pouvoir disposer de tout gratuitement. La campagne de Clinton a employé une véritable armée d’opérateurs salariés afin de patrouiller dans les médias sociaux pour « corriger » les messages anti-Hillary et salir Sanders. Les partisans masculins de Sanders ont été taxés de « Bernie Bros » misogynes, tandis que Sanders lui-même était accusé de ne pas se sentir concerné par les inégalités économiques et de classe, et de desservir les positions du Parti démocrate sur les questions de race, de genre et d’orientation sexuelle. C’était évidemment une façon de calomnier Sanders et ses partisans en les dépeignant comme des Blancs hors du coup, aveuglés par la défense de leurs « privilèges de Blancs ». La campagne de Clinton a certainement rallié des soutiens afro-américains, comme l’ancien activiste des Droits civiques devenu membre du Congrès, John Lewis, qui a délégitimé Sanders comme militant pour les droits civiques dans les années 1960, alors qu’il était étudiant à l’Université de Chicago.
Par un bizarre concours de circonstances, avant que la primaire ne soit terminée, la campagne Clinton, ses substituts, le Parti démocrate lui-même et les médias libéraux ont tous critiqué le New Deal de Roosevelt, au motif que celui-ci était basé sur la défense des privilèges des Blancs, et que beaucoup de ses structures n’étaient plus adaptées à la réalité d’aujourd’hui.8 Clinton a critiqué la médecine sociale, la comparant à la « grande œuvre » de l’administration Obama, l’Obamacare, qui laisse encore des millions d’Américains sans assurance-maladie, et avança contre la proposition de Sanders sur la gratuité de l’enseignement dans les universités d’État qu’elle était tout simplement pratiquement impossible à mettre en œuvre. Plutôt que de lancer une campagne du type « espoir et changement » ou « yes we can » comme Obama en 2008, qui a gagné beaucoup de voix chez les jeunes, Hillary a été obligée de lancer le message « acceptez et soyez satisfaits » et « non, nous ne pouvons pas ». Loin de se présenter comme une candidate de la transformation et du changement progressiste, elle et son parti se sont révélés être des éléments de l’infrastructure capitaliste, des politiciens inutiles comme tous les autres politiciens, et ce pour des dizaines de milliers de jeunes gens qui ont été séduits par le message de Sanders sur l’expansion de la démocratie sociale et la mobilisation politique, dans le contexte de l’émergence de quelque chose qui ressemblait à une culture du mouvement.
Au fur et à mesure de l’avancement de la primaire, on a constaté des irrégularités de votes ; les partisans de Sanders ont fini par être convaincus que le Parti démocrate était en train de leur voler l’élection de leur candidat et de donner les voix de Sanders à Clinton, dans une sorte de coup d’État légal. Ces suspicions se sont trouvées confirmées l’été suivant quand Wikileaks a publié une série de courriels piratés du Comité national démocrate (DNC), montrant que les instances du Parti avaient en fait conspiré pour vaincre Sanders et assurer à Clinton l’investiture du Parti démocrate. Cependant, quelle que soit la véracité des allégations formulées par les partisans de Sanders au sujet du trucage des élections par le Parti démocrate, le fait que beaucoup y croient est un signe de mauvais augure. Le Parti démocrate et sa candidate apparaissent comme des magouilleurs à beaucoup de jeunes, ils semblent également fonctionner comme une dictature du Tiers-Monde. L’appareil électoral démocratique est maintenant remis en question à cause de la conduite déplorable du Parti pendant la primaire pour s’assurer à tout prix que Clinton serait la candidate du Parti.
Bien sûr, le Parti démocrate n’aurait pas engagé la campagne de Clinton dans de telles tactiques s’il avait pensé avoir à y perdre et en effet, tout cela était trop difficile à surmonter pour Bernie Sanders. Car quelle que soit la force du ralliement des jeunes électeurs et des libéraux et progressistes, déçus par l’héritage Obama, derrière Sanders, Sanders ne pouvait tout simplement pas réaliser de progrès important chez les vieux électeurs des minorités, les femmes âgées et les différents niveaux des « classes professionnelles », qui sont devenus la base électorale du Parti démocrate. La campagne électorale de Clinton a joué en sa faveur auprès des minorités déjà acquises, dans une sorte de complément absurde à la démagogie raciale de Trump. Lors d’un débat, Clinton promit de ne pas expulser les immigrants illégaux non criminels, une promesse dont quelques observateurs sérieux pensent qu’elle la tiendra si elle est élue.9 Le nouveau discours progressiste de Clinton sur les questions de race est en flagrante contradiction avec les propos qu’elle tenait en tant que Première Dame quand elle traitait les jeunes noirs de « super prédateurs » ou lors de la primaire démocrate de 2008, quand sa campagne attaqua Obama sur le terrain racial, alors qu’il était allé assister à l’office du controversé révérend Jeremiah Wright.10
La politique à géométrie variable de Clinton sur les questions raciales est apparue à beaucoup d’observateurs comme un autre exemple de sa volonté de « trianguler », ce qui veut dire que l’on se satisfait de ce qui convient politiquement à un moment donné pour un public particulier. Loin de représenter la candidate optimale pour un lendemain meilleur, Clinton est arrivée à se faire mépriser par la plupart des électeurs éventuels du Parti démocrate, qui la considèrent comme une femme politique habile mais sans épaisseur, qui dira tout ce qui peut servir ses intérêts dans sa quête du pouvoir politique. Beaucoup semblent la détester encore plus que Trump, ne serait-ce que parce qu’ils estiment que Trump est sincère dans son sectarisme, alors que Clinton cache ses idées politiques réactionnaires derrière de belles paroles profondément malhonnêtes en réalité.
Sanders est arrivé derrière Clinton
En fin de compte, les avantages de Clinton étaient trop importants pour être surmontés par le parvenu Sanders et Clinton a été en mesure d’obtenir l’investiture démocrate à la convention du parti en juillet 2016. Pourtant, en ayant remporté 45% des voix dans la primaire, le sénateur Sanders avait accumulé un capital politique considérable au sein du Parti démocrate. Alors que l’élite du Parti doit le haïr, elle sait aussi qu’elle a besoin de lui pour continuer le combat afin de placer Clinton à la Maison Blanche. Que peut faire Sanders ? Va-t-il se fâcher et courir tout seul comme le candidat d’un troisième parti, saboter le vote Démocrate et laisser Trump entrer à la Maison Blanche ? Va-t-il soutenir le candidat du Parti vert, Jill Stein, avec le même résultat ou va-t-il être beau joueur, accepter sa défaite et travailler à faire échouer le diable Donald J. Trump ?
Tous ceux qui ont suivi la carrière de Sanders depuis le début connaissent la réponse. Bien qu’apparemment indépendant politiquement, Sanders a toujours fait bloc avec les Démocrates au Congrès. Il a fait campagne pour Bill Clinton en 1996 et a publiquement critiqué les candidats d’un troisième parti dans le passé. Même si sa défaite politique cuisante est due au non-respect des règles par sa rivale, Sanders a néanmoins appliqué les règles du Parti et a soutenu le vainqueur de la primaire, et promis de tout faire pour empêcher Trump de devenir président. Il a prononcé un vibrant discours devant la convention Démocrate, martelant avec conviction (après avoir dit le contraire pendant des mois) que Clinton serait une « grande présidente ». Sanders est ainsi passé du statut de dangereux révolté menaçant de faire dérailler les plans de son parti, à celui d’« idiot utile », mais néanmoins personnalité incontournable de l’élection générale, chargée de rallier les jeunes électeurs à la cause de Clinton.
Le problème pour la classe dominante, était que, pour beaucoup de supporters de la première heure de Sanders, cette volte-face soudaine n’allait pas de soi. Comment le bien-aimé et incorruptible Bernie pouvait-il passer en une nuit de la critique impitoyable de cette va-t-en-guerre à sa célébration en vue de l’investiture démocrate ? Beaucoup ont refusé de le croire ou ont pensé qu’on avait fait pression sur Sanders. De quoi a-t-on pu le menacer ? Une dure leçon de la réalité de la politique électorale bourgeoise a été donnée à cette occasion. D’autres encore ont simplement abandonné le navire du Parti démocrate et ont conclu que Bernie était un homme politique vénal lui aussi, qu’il avait empoché des millions de dollars en dons modestes et qu’il avait promis monts et merveilles seulement pour défendre les intérêts de clique qu’il prétendait mépriser. Beaucoup de ces électeurs se sont tournés vers de verts pâturages (sans jeu de mots), tel le candidat du Parti vert, Jill Stein ; d’autres, séduits par la position du candidat du Parti libertarien, Gary Johnson, sur la légalisation de la marijuana, portent maintenant sa bannière.
De toutes façons, les difficultés récurrentes de Clinton avec les nouveaux électeurs sont maintenant un problème majeur pour les principales factions de la bourgeoisie. La fascination des « Millenials » pour Barack Obama était la principale cause de ses deux victoires électorales. Huit ans après cette élection historique, beaucoup de jeunes ont complètement abandonné le Parti démocrate, le voyant comme l’institution néo-libérale corrompue qu’il est vraiment. Dans leur quête immédiate pour l’élection de Clinton contre Trump, les principales factions de la bourgeoisie ont déchaîné une campagne massive afin de mobiliser les jeunes par tous les moyens. Cela a pris la forme d’une campagne anti-fasciste classique tentant de les convaincre que, quel que soit le désastre attendu avec Clinton, ce serait pire avec Trump. Le fascisme doit être arrêté même si cela implique de voter pour une clique méprisable.
Mais la campagne de propagande ne s’est pas arrêtée là. Une campagne d’une violence insidieuse et honteuse s’est développée sur les réseaux sociaux et dans les médias, montrant du doigt quiconque s’aviserait de dire qu’il voterait pour un tiers ou s’abstiendrait en novembre. Ces électeurs ont été dénoncés comme « corrompus », « privilégiés », ou ont été simplement harcelés comme hommes blancs intouchables. Les porte-parole de la classe dominante se sont engagés dans une intense campagne afin de discipliner la jeune génération et lui inculquer les règles propres à la démocratie bi-partite. Dans le système uninominal à un tour des États-Unis, la loi de Duverger11 s’applique : on a seulement deux choix. Le fait de voter pour le candidat d’un parti minoritaire ou de rester chez soi profitera uniquement au populisme néo-fasciste incontrôlable qui est en train de mûrir aujourd’hui. Si Trump gagne, ce sera la faute de cette jeune génération, ou la faute de Sanders, ou celle des politiciens « puristes », trop bons pour voter pour un mauvais candidat. Suivant cette campagne idéologique, si la nation et le monde entier sont obligés de supporter Trump, ce sera la faute de tout le monde sauf du Parti démocrate et de Clinton.
Alors qu’il est raisonnable de penser que la campagne de culpabilisation anti-fasciste aura le succès escompté, et que la plupart des anciens partisans de Sanders vont voter Clinton en novembre, beaucoup cependant ne le feront qu’à contre-cœur. Pour beaucoup de ces électeurs désenchantés, le Parti démocrate s’est révélé être une institution méprisable, indigne de loyauté électorale à long terme en l’absence d’une menace fasciste comme Trump. S’il y avait un autre candidat Républicain contre Hillary aujourd’hui, elle pourrait très bien perdre.12 Pour les principales factions de la bourgeoisie, cette situation est vraiment périlleuse. Au fur et à mesure que le Parti républicain dégringole dans l’idéologie, l’incohérence et une conduite imprévisible, le Parti démocrate doit montrer qu’il est le parti de la cohérence, de la responsabilité et de la rationalité, apte à remplir les fonctions de gouvernement. Cependant, à force de remplir ce rôle, sans autre parti crédible pour l’équilibrer, son vernis idéologique comme parti de la classe ouvrière et des opprimés va continuer à se révéler être une illusion, ce qui laisse augurer un avenir de crise pour l’idéologie électorale de la bourgeoisie.
Henk, 10 octobre 2016
1 Voir notre article : Le Tea Party, l’idéologie capitaliste en décomposition.
2 Nous ne prétendons pas qu’il n’y ait pas une bonne dose de bon vieux racisme derrière la colère contre Obama, parmi les ouvriers blancs, mais il est clair aussi qu’une partie des ouvriers blancs qui ont voté pour lui pendant la crise économique de 2008 ont été déçus par son incapacité à améliorer leur niveau de vie ; il a juste mis en place un plan bancal de réforme de santé qui n’a pas empêché la hausse des soins médicaux dans le seul grand pays au monde dépourvu de programme de santé publique.
3 Il est vrai qu'alors que beaucoup de Républicains de la première heure ont ouvertement rejeté Trump, les dirigeants des instances du Parti, tel le président du comité national républicain Reince Priebus, ont été obligés de se ranger derrière lui. La bourgeoisie a craint une possible division du Parti républicain pendant toute la campagne des primaires. Il était nécessaire pour la survie du système bi-partite qu’un fois que Trump avait gagné l’investiture, le Parti ne s’oppose pas à lui frontalement. Bien sûr, le risque d’éclatement du parti existe toujours, même s’il est mis en veilleuse.
4Paul Ryan est une figure du Tea Party. (NdT)
5 Le pauvre Rand Paul (un chouchou des libertariens, bien qu’il n’a jamais été un candidat sérieux pour la présidentielle) a été mis hors-jeu quand Trump a simplement laissé entendre qu’il est laid.
6 Bien sûr Trump, en course comme Républicain, a dû également s’approprier un certain nombre de positions standard du Parti et a adhéré du bout des lèvres à certaines positions conservatrices au sujet de l’avortement. On ne sait pas dans quelle mesure il croit vraiment à ce qu’il a défendu, mais en tout cas, il a activement courtisé le vote LGBTQ (Lesbiennes-Gays-Transsexuels-Questionneurs) dans le sillage de la tuerie d’Orlando, qu’il a dénoncée comme étant un produit de l’homophobie islamique, une tactique inhabituelle dans la politique américaine de droite, mais typique des façons de faire des différents partis populistes d’Europe.
7 Il apparaît que c’est exactement ce que Trump avait prévu de faire lorsqu’on a su qu’il avait proposé à son ancien rival John Kasich de concourir avec lui comme vice-président. Selon certains rapports, Trump avait promis à Kasich de lui laisser la politique étrangère et intérieure, se gardant un rôle d’ambassadeur du « rendre sa grandeur à l’Amérique ». Si le fait que Dick Cheney était aux commandes sous l'administration de G.W. Bush était plus ou moins un secret de Polichinelle, il est évident que, compte-tenu de la personnalité et du tempérament de Trump, un tel arrangement aurait été une bonne chose pour l’État américain.
8 Voir les commentaires de la « Left Business Doug henwood » à ce sujet.
9 Pour être juste, Sanders a fait la même promesse, la différence étant qu’il était probablement sincère.
10 Beaucoup de personnes à Droite ont suggéré que c’est au cours de la campagne de 2008 qu’a émergé la « conspiration raciste autour de la naissance », contestant la légitimité d’Obama pour la présidence. Alors que la campagne elle-même n’utilisa jamais cette arme contre Obama, la preuve a été faite que cela avait effectivement été suggéré par un stratège de campagne comme un outil pour invalider sa candidature.
11 Concept de la science politique universitaire, la loi de Duverger établit que la nature du système électoral d’un pays détermine le nombre de partis nationaux viables. Le système à un tour garantit généralement que seuls deux partis peuvent concourir pour l’élection. Dans cette configuration, voter pour un troisième parti favoriserait la victoire du parti le moins bien placé pour gagner.
12 Un bruit a circulé, qui a alimenté les théories du complot : la candidature de Trump serait un canular basé sur un pacte avec les Clinton afin de faire exploser le Parti républicain et assurer la victoire de Hillary en novembre. Pendant ce temps, Trump obtient une énorme exposition médiatique gratuite pour nourrir son ego et valoriser sa famille. Bien qu’il n’y ait aucun élément permettant d’accréditer cette thèse, la façon extrêmement bizarre dont Trump a dirigé sa campagne depuis son investiture soulève réellement des questions sur son sérieux. En fait, ce ne sont pas seulement des obsédés de la conspiration qui ont insinué cela : un des rivaux malheureux de Trump, Jeb Bush, l’a également suggéré.
Géographique:
- Etats-Unis [43]