Revue Internationale no 68 - 1e trimestre 1992
- 3016 reads
Explosion de l'URSS, massacres en Yougoslavie - Seule la classe ouvrière internationale peut sortir l'humanité de la barbarie
- 4788 reads
Le «nouvel ordre mondial» annoncé il y a moins de deux ans par le président Bush n'en finit pas d'accumuler l'horreur et les cadavres. A peine les massacres de la guerre du Golfe étaient-ils terminés (ceux provoqués directement par la coalition, car ceux des Kurdes se poursuivent encore) que la guerre se rallumait en pleine Europe, dans ce qui était la Yougoslavie. L'horreur qu'on a découvert avec la prise de Vukovar par l'armée serbe illustre donc, une nouvelle fois, à quel point étaient mensongers tous les discours sur l'«ère nouvelle», faite de paix, de prospérité et de respect des droits de l'homme, qui devait accompagner l'effondrement des régimes staliniens d'Europe et la disparition de l'ancien bloc de l'Est. En même temps, l'indépendance de l'Ukraine et, plus encore, la constitution d'une «Communauté d'Etats» comprenant cette dernière, la Russie et la Biélorussie1] [1] viennent contresigner le constat de ce qui était patent depuis l'été : l’URSS n'existe plus. Cela n'empêche pas, d'ailleurs, les différents morceaux de cet ex-pays de continuer à se décomposer: aujourd'hui c'est la fédération de Russie elle-même, c'est-à-dire la plus puissante des républiques de feu l'Empire soviétique, qui est menacée d'éclatement. Face à ce chaos dans lequel s'enfonce chaque jour un peu plus la planète, les pays les plus avancés, et particulièrement le premier d'entre eux, les Etats-Unis, veulent se présenter comme des îlots de stabilité, garants de l'ordre mondial. Mais, en réalité, ces pays eux-mêmes ne sont pas préservés des convulsions mortelles dans lesquelles s'enfonce la société humaine. En particulier, l'Etat le plus puissant de la terre, s'il met à profit son énorme supériorité militaire sur tous les autres pour revendiquer le rôle de gendarme du monde, comme on vient de le voir encore avec la conférence sur le Moyen-Orient, ne peut rien contre l'aggravation inexorable de la crise économique qui se trouve à l'origine de toutes les convulsions qui déferlent sur l'humanité. La barbarie du monde d'aujourd'hui met en relief l'énorme responsabilité qui repose sur les épaules au prolétariat mondial, un prolétariat qui doit faire face au déchaînement d'une campagne et de manoeuvres d'une intensité sans précédent destiné à le détourner non seulement de sa perspective historique mais aussi de la lutte pour la défense de ses intérêts élémentaires.
Nous avons régulièrement, dans notre revue, analysé l'évolution de la situation dans l'ancienne URSS2] [2]. En particulier, depuis la fin de l'été 1989 (c'est-à-dire près de deux mois avant la disparition du mur de Berlin), le CCI a mis en avant l'extrême gravité des convulsions qui secouaient l'ensemble des pays dits « socialistes»3] [3]. Aujourd'hui, chaque jour qui passe vient illustrer un peu plus l'ampleur de la catastrophe qui se déchaîne dans cette partie du monde.
L'ex-URSS dans le gouffre
Depuis le putsch avorté d'août 1991, les événements n'ont cessé de se précipiter dans l'ancienne URSS. Le départ des pays baltes de l’«Union» semble appartenir maintenant à un passé lointain. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui devient indépendante, c'est-à-dire la deuxième république de l'Union, forte de 52 millions d'habitants, qui constitue son «grenier à blé» et représente 25% de sa production industrielle. De plus, cette république possède sur son territoire une quantité considérable des armes atomiques de l'ancienne Union. A elle seule, elle dispose d'un potentiel de destruction nucléaire supérieur à ceux de la Grande-Bretagne et de la France réunis. En ce sens, la décision par Gorbatchev, le 5 octobre, de réduire de 12.000 à 2.000 le nombre des charges nucléaires tactiques de l'URSS n'était pas seulement la réponse à la décision similaire adoptée par Bush une semaine auparavant ni la simple concrétisation de la disparition de l'antagonisme impérialiste, qui avait dominé le monde pendant quatre décennies, entre les Etats-Unis et l'URSS. Elle constituait une mesure de prudence élémentaire pour empêcher les républiques sur lesquelles sont déployées ces armes, et particulièrement l'Ukraine, de s'en servir comme instrument de chantage.
C'est d'ailleurs pour cette même raison que les autorités ukrainiennes ont refusé, jusqu'à présent, de restituer ces armements. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ne s'illustre à quel point était justifiée l'inquiétude de Gorbatchev, et de la majorité des dirigeants du monde, face au problème de la dissémination nucléaire. C'est ainsi que, début novembre, éclatait le conflit entre l'autorité centrale de Russie et la république autonome de Tchétchéno-Ingouchie qui venait, elle aussi de proclamer son «indépendance». Face à la décision de Eltsine d'instaurer sur place l'état d'urgence grâce aux forces spéciales du KGB, Doudaev, ex général de l'armée «rouge» reconverti en petit potentat indépendantiste, menaçait de recourir a des actions terroristes sur les installations nucléaires de la région. De plus, face à la menace d'affrontements sanglants, les troupes chargées de la répression ont refusé d'obéir et c'est finalement le Parlement de Russie qui a sauvé la mise de Eltsine en annulant sa décision. Cet événement, outre qu'il soulignait la réelle menace que représentent les énormes moyens nucléaires déployés dans toute l'URSS au moment où cette ancienne puissance se désintègre, mettait également en relief le niveau de chaos dans lequel se trouve aujourd'hui cette partie du monde. Ce n'est pas seulement l'URSS qui est en train de se désintégrer, c est sa plus grande république, la Russie, qui est maintenant menacée d'explosion sans avoir les moyens, sinon par de véritables bains de sang à l'issue incertaine, de faire respecter l'ordre.
Une banqueroute économique totale
Cette tendance à la dislocation de la Russie même s'exprime également par les dissensions qui se développent au sein de la clique des «réformateurs» actuellement aux postes de commande de cette république. C'est ainsi que les mesures de «libéralisation sauvage» mises en avant par le président russe fin octobre ont déclenché une levée de boucliers de la part des maires des deux plus grandes villes du pays. Gavril Popov, maire de Moscou, a déclaré qu' «il ne portera pas la responsabilité de la libération des prix», et son collègue de Saint-Pétersbourg, Anatoh Sobtchak, a accusé Eltsine de vouloir «affamer la Russie». En fait, ces affrontements entre politiciens sur les questions économiques ne font que révéler l'impasse totale dans laquelle se trouve l'économie de l'URSS. Tous ses dirigeants politiques, à commencer par Gorbatchev, ne cessent de jeter des cris d'alarme face aux menaces de famine pour l'hiver qui vient. Le 10 novembre, Sobtchak prévenait : «Nous n'avons pas constitué les réserves alimentaires suffisamment importantes sans lesquelles les grandes villes soviétiques et les grands centres industriels du pays ne pourront simplement pas survivre».
Sur le plan financier, la situation est devenue également cauchemardesque. La banque centrale, la Gosbank, est obligée de faire tourner ses planches à billets à rythme intensif, ce qui conduit à une dévaluation du rouble de 3% par semaine. Le 29 novembre, cette même banque annonce que les salaires des fonctionnaires ne seront plus payés. A l'origine de cette décision, le refus par les députés russes (majoritaires) au Congres de voter une autorisation de crédit de 90 milliards de roubles demandée par Gorbatchev. Le lendemain, Eltsine, afin de pouvoir marquer un nouveau point dans sa lutte d'influence contre Gorbatchev, a assuré que la Russie se chargeait de prendre à son compte le paiement des fonctionnaires.
En réalité, la banqueroute de la banque centrale ne provient pas seulement du refus par les républiques de verser au «centre» le produit des impôts. Elles-mêmes sont incapables de collecter les fonds indispensables à leur fonctionnement. Ainsi, les républiques autonomes de Yakoutie et de Bouriatie, appartenant à la fédération de Russie, bloquent depuis plusieurs mois leurs livraisons d'or et de diamants qui permettaient d'alimenter en devises les caisses de la Russie et de l'Union. Pour leur part, les entreprises payent de moins en moins leurs impôts, soit parce que leurs propres caisses sont a sec, soit qu'elles considèrent (comme c'est le cas d'entreprises privées plus «prospères») que « libéralisation » veut dire abolition de la fiscalité. Ainsi, l'ex-URSS se trouve prise dans une spirale infernale. Aussi bien les reformes que les conflits politiques découlant de la catastrophe économique ne font qu'aggraver encore cette catastrophe, ce qui aboutit à une nouvelle fuite en avant dans ces «réformes» mort-nées et dans les affrontements entre cliques.
Les gouvernements des pays les plus avancés sont bien conscients de l'ampleur de cette catastrophe dont il est clair que les répercussions ne sauraient s'arrêter aux frontières de l'ancienne URSS4] [4]. C'est pour cette raison que sont élaborés des plans d'urgence pour acheminer vers cette région des produits de première nécessité, mais il n'y a aucune garantie que cette aide puisse parvenir à ses destinataires du fait de l'incroyable corruption qui règne à tous les échelons de l'économie, de la paralysie qui frappe l'ensemble de l'appareil politique et administratif (devant l'instabilité politique et les menaces de limogeage, la plupart des « décideurs » ont comme principale préoccupation de... ne pas prendre de décision), et la désorganisation totale des moyens de transport (manque de pièces détachées pour entretenir le matériel, rupture des approvisionnements en combustible, troubles affectant régulièrement différentes parties du territoire).
C'est également pour relâcher un peu l'étranglement financier de l'ex-URSS que le G7 a accordé un délai d'un an pour le remboursement des intérêts de la dette soviétique, laquelle se monte aujourd'hui à 80 milliards de dollars. Mais ce ne sera qu'un emplâtre sur une jambe de bois tant les crédits alloués semblent disparaître dans un puits sans fond. Il y a deux ans avaient été colportées toutes sortes d'illusions sur le «marché nouveau» ouvert par l'effondrement des régimes staliniens. Aujourd'hui, alors même que la crise économique mondiale se traduit, entre autres, par une crise aiguë des liquidités5] [5], es banques sont de plus en plus réticentes à placer leurs capitaux dans cette partie du monde. Comme le déplorait récemment un banquier français : «On ne sait plus à qui on prête ni auprès de qui on devra exiger les remboursements.»
Même pour les politiciens bourgeois les plus optimistes, il est difficile d'imaginer comment pourrait être redressée la situation tant sur le plan économique que politique dans ce qui était, il y a peu de temps encore, la deuxième puissance mondiale. L'indépendance de chacune des républiques, présentée par les différents démagogues locaux comme une «solution» pour ne pas sombrer avec l'ensemble du navire, ne pourra qu'aggraver encore plus les difficultés d'une économie basée pendant des décennies sur une extrême division du travail (certains articles ne sont produits que dans une seule usine pour toute l'URSS). En outre, une telle indépendance des républiques porte avec elle le surgissement des revendications particulières des minorités réparties sur l'ensemble du territoire (il existe une quarantaine de «régions autonomes» et encore plus d'ethnies). Dès à présent, avec des affrontements sanglants entre arméniens et azéris à propos du Haut-Karabakh, entre Ossètes et Géorgiens en Ossétie du Sud, entre Kirghizes, Ouzbeks et Tadjiks au Kirghizstan, on peut se faire une idée de ce qui attend l'ensemble du territoire de l'ex-URSS. En outre, les populations russes qui sont réparties dans toute l'Union (par exemple, 38 % de la population au Kazakhstan, 22% en Ukraine) risquent de faire les frais de ces « indépendances ». D'ailleurs, Eltsine a prévenu qu'il se considérait comme le «protecteur» des 26 millions de russes vivant hors de Russie et qu'il faudrait reconsidérer la question des frontières de cette république avec certaines autres. C'est un discours qu'on a entendu, il y a peu de temps, dans la bouche du dirigeant serbe Milosevic : en voyant la situation actuelle en Yougoslavie on comprend aisément quelle sinistre réalité il peut annoncer pour demain à une échelle bien plus vaste6] [6].
LA YOUGOSLAVIE : BARBARIE ET ANTAGONISMES ENTRE GRANDES PUISSANCES
En quelques mois, la Yougoslavie a plongé dans l'enfer. Tous les jours, tes journaux télévisés nous renvoient l'image de la barbarie sans nom qui se déchaîne à quelques centaines de kilomètres des métropoles industrielles d'Italie du Nord et d'Autriche. Des villes entièrement détruites, des monceaux de cadavres jonchant les rues, les mutilations, les tortures, les charniers. Jamais depuis la fin de la seconde guerre mondiale, un pays d'Europe n'avait connu de telles atrocités. Désormais, l'horreur qui semblait jusqu'à présent réservée aux pays du «tiers-monde», atteint des zones immédiatement voisines du coeur du capitalisme. Voici le «grand progrès» que vient de réaliser la société bourgeoise : créer un Beyrouth-sur-Danube à une petite heure de Milan et de Vienne. L'enfer que vivent depuis des décennies les pays les plus mal lotis de la planète a toujours été atroce, il a toujours constitué une honte pour l'humanité. Que cet enfer se trouve maintenant à nos portes n'est pas en soi plus scandaleux. Cependant, c'est le signe indiscutable du degré de pourriture atteint par un système qui avait réussi pendant quarante ans à reporter à sa périphérie les aspects les plus abominables de la barbarie qu'il engendre. C'est la manifestation évidente de l'entrée du capitalisme mondial dans une nouvelle étape, la dernière, de sa décadence : celle de la décomposition générale de la société7] [7].
Une des illustrations de cette décomposition est constituée par la totale irrationalité de la conduite de la plupart des forces politiques en présence.
Du côté des autorités de la Croatie, la revendication de l'indépendance pour cette république ne se base sur aucune possibilité d'une amélioration des positions de son capital national. La simple lecture d'une carte, par exemple, met en évidence les difficultés supplémentaires qui ne manqueront pas de surgir lorsque cette « nation » aura accédé à son «indépendance», du fait de la position et de la forme de ses frontières. Ainsi, pour aller de Dubrovnik à Vukovar, en supposant, ce qui aujourd'hui est peu vraisemblable, que ces deux villes soient reconstruites et reviennent un jour à la Croatie, ce n'est pas par Zagreb qu'il faut passer (sauf à parcourir 500 kilomètres supplémentaires) mais par Sarajevo, capitale d'une autre république, la Bosnie-Herzégovine.
Du côté des autorités «fédérales» (en réalité Serbes), la tentative de soumettre la Croatie, ou tout au moins de conserver au sein d'une «Grande Serbie» le contrôle des provinces croates où vivent des Serbes, ne permet pas non plus d'espérer de grands bénéfices sur le plan économique : le coût de la guerre actuelle et les destructions qu'elle provoque ne feront qu'aggraver encore plus le marasme économique total dans lequel se trouve le pays.
Les dissensions entre Etats européens
Depuis le début des massacres en Yougoslavie, les professionnels des bons sentiments médiatiques se sont émus : «il faut faire quelque chose !» Il est vrai que l'horreur réservée aux Kurdes d'Irak se vend moins bien aujourd'hui qu'il y a quelques mois8] [8]. Cependant, pour la Yougoslavie, la «sollicitude» a largement dépassé le niveau du « charity business » puisque la Communauté européenne a organisé une conférence spéciale, dite de la Haye, pour mettre fin à la guerre. Après une vingtaine de cessez-le-feu dérisoires et de multiples voyages du négociateur Lord Carrington, les massacres continuent de plus belle. En fait, cette impuissance de l'Europe à mettre fin à un conflit, dont chacun souligne la totale absurdité, constitue une illustration flagrante des dissensions qui existent entre les Etats qui la composent. Ces oppositions ne sont nullement de circonstance ou secondaires. Elles recouvrent des intérêts impérialistes bien déterminés et antagoniques. En particulier, le fait que l'Allemagne ait été, depuis le début, favorable à l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie n'est pas fortuit. C'est, pour cette puissance, la condition de son accès à la Méditerranée dont l'importance stratégique n'est pas à démontrer9] [9]. Pour leur part, es autres puissances impérialistes présentes en Méditerranée ne sont nullement intéressées à ce retour de l'Allemagne dans cette zone. C'est pour cela que, au début du conflit yougoslave, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France (sans compter l'URSS, traditionnel «protecteur» de la Serbie mais qui aujourd'hui a d'autres chats à fouetter) se sont prononcés pour le maintien d'une Yougoslavie unifiée10] [10].
Ainsi la tragédie yougoslave a mis en évidence que le «nouvel ordre mondial» était synonyme d'exacerbation des tensions non seulement entre des nationalités et des ethnies dans les parties du monde, comme eir Europe centrale et de l'Est, où le développement tardif du capitalisme a interdit la constitution d'un Etat national viable et stable, mais également entre les vieux Etats capitalistes constitués depuis longtemps et qui, jusqu'à présent, étaient alliés contre la puissance impérialiste soviétique. Le chaos dans lequel s'enfonce aujourd'hui la planète n'est pas seulement le fait des pays de la périphérie du capitalisme. Ce chaos concerne également, et concernera de plus en plus, les pays centraux dans la mesure où il trouve ses origines, non pas dans des problèmes spécifiques aux pays sous-développés mais bien dans un phénomène mondial : la décomposition générale de la société capitaliste qui ne pourra que s'aggraver en même temps que la crise irréversible de son économie.
La conférence sur le Moyen-Orient : affirmation du leadership des Etats-Unis
Face au chaos dans lequel bascule l'ensemble de la planète, il revient à la première puissance de celle-ci déjouer le rôle de «gendarme». Il n'y a évidemment pas à cette tache des Etats-Unis le moindre motif désintéressé. C'est à celui qui profite le plus de l’«ordre mondial» actuel d'en assurer, pour l'essentiel, la préservation. La guerre du Golfe a constitué une opération de police exemplaire pour dissuader tous les autres pays, petits ou grands, de participer à la déstabilisation de cet ordre. Aujourd'hui, la «conférence de paix» sur le Moyen-Orient constitue l'autre volet, complémentaire de la guerre, dans la stratégie américaine. Après avoir démontré qu'ils étaient prêts à «maintenir l’ordre» de la façon la plus brutale qui soit, les Etats-Unis devaient faire la preuve qu'eux seuls étaient en mesure d'être efficace dans le règlement des conflits qui ensanglantent la planète depuis des décennies. Et, pour ce faire, la question du Moyen-Orient est évidemment parmi les plus significatives.
En effet, il est nécessaire de souligner l'importance historique considérable d'un tel événement. C'est la première fois depuis 43 ans (depuis la partition de la Palestine par l'ONU en novembre 1947 et la fin du mandat anglais en mai 1948) qu'Israël se retrouve à la même table que l'ensemble de ses voisins arabes avec qui elle a mené déjà cinq guerres (1948, 1956, 1967, 1973, 1982). En fait, cette conférence internationale constitue une conséquence directe de l'effondrement du bloc russe en 1989 et de la guerre du Golfe du début de l'année 1991. Elle a été possible parce que les Etats arabes (y compris l'OLP) de même qu'Israël ne peuvent désormais plus jouer sur la rivalité Est-Ouest pour essayer de faire prévaloir leurs intérêts.
Les Etats arabes qui tentaient d'affronter Israël ont définitivement perdu leur «protecteur» soviétique. De ce fait, Israël a été privé d'une des attributions qui lui valaient un soutien sans faille des Etats-Unis : jouer le rôle de principal gendarme du bloc US dans la région face aux prétentions du bloc russe11] [11].
Cependant, bien qu'en soi la question du Moyen-Orient, par son importance historique et stratégique, donne à la conférence ouverte à Madrid fin octobre, et qui doit se poursuivre à Washington en décembre, un relief tout particulier, sa signification va bien au-delà des problèmes liés à cette partie du monde. Ce n'est pas seulement vis-à-vis des pays de la région que les Etats-Unis affirment leur autorité, mais aussi, et surtout vis-à-vis des autres grandes puissances qui seraient tentées de jouer une carte «indépendante» à leur égard.
La mise au pas des puissances européennes
En effet, à Madrid, du fait que l'ONU12] [12] n'ait eu aucune place (à la demande d'Israël, mais cela arrangeait bien les américains), la seule grande puissance présente, à côté des Etats-Unis, était... l'URSS (si on peut parler de «grande puissance» !) Le simple fait que Bush ait proposé la co-présidence de cette conférence à Gorbatchev, alors que ce dernier est complète ment dévalué et que son pays n'existe plus, constitue un véritable camouflet pour des pays qui, il y a peu encore, avaient des prétentions au Moyen-Orient. C'est notamment le cas de la France (définitivement chassée du Liban avec la prise de contrôle de ce pays par la Syrie), et même de la Grande-Bretagne (principale puissance de la région jusqu'à la seconde guerre mondiale et «ex-protecteur» de la Palestine, de l'Egypte et de la Jordanie). La chose n'est pas trop grave pour cette dernière puissance qui ne conçoit la défense de ses intérêts impérialistes que dans le cadre d'une alliance étroite avec le grand frère américain. En revanche, pour la France, c'est une nouvelle manifestation de la place de second ordre que les Etats-Unis lui assignent désormais malgré (et en partie à cause de) ses tentatives de mener une politique «indépendante». Et, au delà de la France, c'est également l'Allemagne qui est indirectement visée. En effet, même si cette puissance n'avait plus, depuis longtemps, d'intérêts (autres qu'économiques, évidemment) dans cette région, la gifle reçue par le pays sur qui elle tente de s'appuyer, à l'heure actuelle, notamment au sein des institutions européennes et sur le plan militaire, pour affirmer ses intérêts, ne peut que l'atteindre également, d’ailleurs, la place réservée à l'Europe à la conférence de Madrid : la présence, comme observateur, du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, en dit long sur le rôle que, désormais, les Etats-Unis comptent assigner aux Etats européens ou à toute alliance entre eux dans les grandes affaires du monde : un rôle de comparse.
Enfin, la tenue de la conférence sur le Moyen-Orient alors que ces mêmes Etats européens affichent, jour après jour, leur impuissance face à la situation en Yougoslavie, vient souligner une nouvelle fois que le seul «gendarme» en mesure d'assurer un peu d'ordre dans le monde est bien l'oncle Sam. Ce dernier a été capable d'apporter une «solution» à un des conflits les plus anciens et graves de la planète (qui pourtant se déroulait à 10 000 kilomètres de ses frontières), alors que les pays européens n'arrivent pas à faire la police de l'autre côté de leurs frontières. Ainsi, avec la conférence sur le Moyen-Orient est réaffirmé le message essentiel que les Etats-Unis avaient déjà envoyé avec la guerre du Golfe : c'est exclusivement de la puissance américaine, de son énorme supériorité militaire (et aussi économique) que dépend «l’ordre mondial.» Tous les pays, y compris ceux qui essaient de jouer leur propre carte, ont besoin de ce gendarme13] [13]. Leur intérêt est donc de faciliter la politique de la première puissance mondiale.
Ceci dit, la discipline que la première puissance mondiale réussit encore à imposer ne doit pas masquer la situation catastrophique ans laquelle se trouve le monde capitaliste aujourd'hui et qui ne pourra aller qu'en s'aggravant. En particulier, la méthode employée pour garantir cette discipline est elle-même génératrice de nouveaux désordres. C'est ce que nous avions déjà vu avec la Guerre du Golfe (avec toutes ses conséquences catastrophiques dans la région et particulièrement en ce qui concerne la question kurde) et que nous voyons aujourd'hui avec la Yougoslavie, où le maintien de 1 autorité américaine passait par une mise à feu et à sang du pays. Comme les marxistes l'ont toujours affirmé, il n'y pas de place, dans le capitalisme décadent, pour une quelconque « paix générale ». Même s'ils s'éteignent au Moyen-Orient, les foyers de tension entre bandes rivales des gangsters capitalistes ne peuvent que surgir ailleurs. Et cela d'autant plus que la crise économique du mode de production capitaliste qui, en dernière instance, se trouve à l'origine des affrontements impérialistes, est insoluble et ne peut que s'aggraver, comme on le voit à 1 heure actuelle.
Aggravation de la crise et attaques contre la classe ouvrière
Alors même que Bush célèbre ses triomphes diplomatiques et militaires, son «front intérieur» ne cesse de se dégrader, notamment sous la forme d'une nouvelle aggravation de la récession. Pendant quelques mois, la bourgeoisie américaine, et, avec elle, l'ensemble de la bourgeoisie mondiale, avait rêvé que la récession ouverte qui avait pris son essor avant la guerre du Golfe serait de courte durée. Aujourd'hui, c'est le temps des déceptions : malgré tous les efforts des gouvernements (qui continuent de prétendre, tout en faisant le contraire, qu'il ne faut pas intervenir dans l'économie et qu'il importe de laisser jouer les lois du marché) le marasme se prolonge sans qu'on en voit la sortie. En réalité, c'est une nouvelle aggravation considérable de la crise du capital qui s'annonce et qui déjà plonge de nombreux secteurs de la bourgeoisie dans la panique. Cette aggravation de la crise ne peut avoir d'autre conséquence que 'intensification des attaques contre la classe ouvrière. Dès à présent, ces attaques se sont déchaînées un peu partout dans le monde : licenciements massifs (y compris dans les secteurs «de pointe» comme l'informatique), blocage des salaires, érosion des prestations sociales (pensions de retraite, allocations chômage, remboursement des frais de maladie, etc.), intensification des cadences de travail : il serait fastidieux de faire la liste de ce type d'attaques dans les différents pays. Ce sont tous les ouvriers de tous les pays qui subissent maintenant dans leur chair les atteintes de la crise capitaliste. Ces attaques provoquent évidemment le developpement d'un mécontentement considérable au sein de la classe ouvrière. Et, dans beaucoup de pays, on voit effectivement se déployer toute une agitation sociale, lais ce qui est significatif, c'est que, contrairement aux grandes luttes qui avaient marqué le milieu des années 1980, et qui faisaient l'objet d'un black-out pratiquement total, l'agitation présente est répercutée de façon spectaculaire par toutes les médias. En réalité, nous assistons à l'heure actuelle à une vaste manoeuvre de la bourgeoisie de la plupart des pays les plus développés pour miner le terrain des véritables combats de classe.
Pour la classe ouvrière, il n'y a pas identité entre colère et combativité, ni entre combativité et conscience, même si, évidemment, il y a un lien entre elles. La situation des ouvriers des pays anciennement «socialistes» nous le démontre chaque jour. Ces ouvriers sont aujourd'hui confrontés à des conditions de vie, à une misère inconnues depuis des décennies. Pourtant, leurs luttes contre l'exploitation sont de faible ampleur, et lorsqu'elles se développent, c'est pour tomber dans les pièges les plus grossiers que leur tend la bourgeoisie (notamment les pièges nationalistes comme on l'a vu, par exemple au printemps 1991 avec la grève des mineurs d’Ukraine). La situation est loin évidemment d'être aussi catastrophique dans les pays «avancés», tant du point de vue des attaques capitalistes que des mystifications pesant sur la conscience des ouvriers. Cependant, il est nécessaire de mettre en évidence les difficultés que rencontre à l'heure actuelle le prolétariat de ces pays, justement parce que la classe ennemie emploie tous les moyens pour les utiliser et les renforcer.
Les événements considérables qui se sont succédés depuis deux ans ont été amplement utilisés par la bourgeoisie pour asséner des coups à la combativité et surtout à la conscience de la classe ouvrière. C'est ainsi que, en répétant à satiété, que le stalinisme était du «communisme», que les régimes staliniens, dont la faillite était devenue patente, constituaient la conséquence inévitable de la révolution prolétarienne, les campagnes de propagande bourgeoises ont visé à détourner les ouvriers de toute perspective d'une autre société et à leur faire entendre que la « démocratie libérale » était le seul type de société viable. Alors que c'était une forme particulière de capitalisme qui s'effondrait dans les pays de l'Est sous la pression de la crise générale de ce système, tous les médias n'ont cessé de nous présenter ces événements comme un «triomphe» du capitalisme.
Une telle campagne a obtenu un impact non négligeable parmi les ouvriers, affectant leur combativité et surtout leur conscience. Alors que cette combativité connaissait un nouvel essor au printemps 1990, notamment à la suite des attaques résultant du début d'une récession ouverte, elle a été de nouveau atteinte par la crise et la guerre du Golfe. Ces événements tragiques ont permis de faire justice du mensonge sur le «nouvel ordre mondial» annoncé par la bourgeoisie lors de la disparition du bloc de l'Est sensé être le principal responsable des tensions militaires. Les massacres perpétrés par les «grandes démocraties », par les «pays civilisés», contre les populations irakiennes ont permis à beaucoup d'ouvriers de comprendre combien étaient mensongers les discours de ces mêmes «démocraties» sur la «paix» et les «droits de l'homme». Mais en même temps, la grande majorité de la classe ouvrière des pays avancés, à la suite des nouvelles campagnes de mensonges bourgeois, a subi cette guerre avec un tort sentiment d'impuissance qui a réussi à affaiblir considérablement ses luttes. Le putsch de l'été 1991 en URSS et la nouvelle déstabilisation qu'il a entraînée, de même que la guerre civile en Yougoslavie, ont contribué à leur tour à renforcer ce sentiment d'impuissance. L'éclatement de l'URSS et la barbarie guerrière qui se déchaîne en Yougoslavie sont des manifestations du degré de décomposition atteint aujourd'hui par la société capitaliste. Mais grâce à tous les mensonges assénés par ses médias, la bourgeoisie a réussi à masquer la cause réelle de ces événements pour en faire une nouvelle manifestation de la « mort du communisme », ou bien une question de «droit des peuples à disposer d'eux-mêmes» face auxquelles les ouvriers n'ont d'autre alternative que d'être des spectateurs passifs et de s'en remettre à la « sagesse » de leurs gouvernements.
Les manoeuvres de la bourgeoisie contre la classe ouvrière
Après avoir subi pendant deux ans un tel tir de barrage, la classe ouvrière ne pouvait qu'accuser le coup sous forme d'un important désarroi et d'un fort sentiment d'impuissance. Et c'est justement ce sentiment d'impuissance que la bourgeoisie s'est employée à utiliser et à renforcer, par une série de manoeuvres visant à tuer dans l'oeuf toute renaissance de la combativité, grâce à des affrontements prématurés, sur un terrain choisi par la bourgeoisie elle-même, afin que ces affrontements s'épuisent ans l'isolement et s'enlisent dans des impasses. Les méthodes employées sont variées, mais elles ont pour point commun de toujours aire appel à une participation intensive des syndicats.
Ainsi, en Espagne c'est le terrain pourri du nationalisme qui a été utilisé par les syndicats (notamment les Commissions Ouvrières proches du PC et l'UGT proche du PS) pour conduire les ouvriers dans l'isolement. Le 23 octobre, ils ont appelé à une grève générale dans les Asturies, où ce sont près de 50 000 emplois qui vont disparaître avec les plans de « rationalisation » des mines et de la sidérurgie, derrière le mot d'ordre de « Défense des Asturies ». Avec un tel mot d'ordre, le «mouvement» a reçu le soutien des commerçants, des artisans, des paysans, des curés et même des joueurs de football. Du fait de la colère et de l'inquiétude qui anime les ouvriers, le mouvement a été très suivi mais, avec une telle revendication, il ne pouvait que favoriser l'enfermement des ouvriers dans leurs provinces ou même dans leurs localités comme on l'a vu au Pays-Basque où ils ont été appelés à se mobiliser derrière une motion du Parlement provincial pour «sauver la rive gauche de la rivière de Bilbao».
Aux Pays-Bas et en Italie, les syndicats ont utilisé d'autres moyens. Ils ont appelé à une mobilisation nationale avec de grandes manifestations de rue dès qu'a été connu le projet de budget pour l'année 1992 qui contient des attaques considérables contre les prestations sociales, les salaires et les emplois. Aux Pays-Bas, le mouvement a été un succès pour les syndicats : les deux manifestations du 17 septembre et du 5 octobre 1991 étaient lés plus importantes depuis la dernière guerre. C'était l'occasion pour les appareils syndicaux de renforcer leur encadrement de la classe ouvrière en prévision des futures luttes tout en dévoyant le mécontentement sur le terrain de la «défense des acquis sociaux de la démocratie néerlandaise». En Italie, où se trouve un des prolétariats les plus combatifs du monde et où les syndicats officiels sont largement discrédités, la manoeuvre a été plus subtile. Elle a consisté principalement à diviser et à décourager les ouvriers grâce à un partage des taches entre, d'un côté, les trois grandes centrales (CGIL, CSIL et UIL) qui ont appelé à une grève et à des manifestations pour le 22 octobre et, de l'autre côte, les syndicats «de base» (les COBAS) qui ont appelé à une «grève alternative» pour le... 25 octobre.
En France, la tactique a été différente. Elle a surtout consisté à enfermer les ouvriers dans le corporatisme. C'est ainsi que les syndicats ont lancé toute une série de « mouvements » amplement répercutés par les médias à des dates et pour des revendications différentes : dans les chemins de fer, les transports aériens et urbains, les ports, la sidérurgie, l'enseignement, chez les assistantes sociales, etc. On a assisté à une manoeuvre particulièrement répugnante dans le secteur de la santé où les syndicats officiels, largement déconsidérés, prônaient «l’unité» entre les différentes catégories alors que les coordinations, qui s'étaient déjà illustrées lors de la grève de l'automne 198814] [14], cultivaient le corporatisme et les «spécificités», notamment parmi les infirmières. Le gouvernement s'est d'ailleurs arrangé pour «radicaliser» très opportunément le mouvement de celles-ci grâce à des violences policières fortement médiatisées lors d'une de leurs manifestations. Le sommet a été atteint lorsque les travailleurs de ce secteur ont été appelés à manifester en compagnie des médecins libéraux, des «grands patrons» et des pharmaciens pour la «défense de la santé». En même temps, les syndicats, avec le soutien actif des organisations gauchistes, ont lance la grève dans l'usine de Cléon de Renault, c'est-à-dire l'entreprise «phare» pour le prolétariat en France. Pendant des semaines ils ont tenu des discours radicaux, tout en enfermant les ouvriers dans cette usine, jusqu'au moment où ils ont brusquement tourné casaque en appelant à la reprise alors que la direction n'avait cédé que des broutilles. Et dès que le travail a repris à Cléon, ils ont lancé la grève dans une autre usine du même groupe, au Mans.
Ce ne sont là que des exemples parmi beaucoup d'autres, mais ils sont significatifs de la stratégie d'ensemble élaborée par la bourgeoisie contre les ouvriers. Et c'est bien parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas remporté un succès définitif avec les campagnes déchaînées depuis deux ans que la classe dominante déploie aujourd'hui toutes ces manoeuvres en s'appuyant sur les difficultés présentes de la classe ouvrière.
En effet ces difficultés ne sont pas définitives. L'intensification et le caractère de plus en plus massif des attaques que le capitalisme devra nécessairement déchaîner vont obliger la classe ouvrière à reprendre des combats de grande envergure. En même temps, et c'est ce que craint en fin de compte le plus la bourgeoisie, le constat de la faillite croissante d'un capitalisme qu'on nous présentait comme «triomphant» permettra de saper les mensonges déchaînés avec la mort du stalinisme. Enfin, l'intensification inévitables des tensions guerrières impliquant, non seulement des petits Etats de la périphérie, mais bien les pays centraux du capitalisme, là où sont concentrés les plus forts détachements du prolétariat mondial, comme la guerre du Golfe nous en a donné un avant-goût, contribuera à porter un coup majeur aux mensonges de la bourgeoisie et à mettre en évidence les dangers que représente pour l'ensemble de l'humanité le maintien du capitalisme.
C'est un chemin encore long et difficile qui attend la classe ouvrière. Il appartient aux organisations révolutionnaires, par leur dénonciation, aussi bien des campagnes idéologiques sur «la fin du communisme» que des manoeuvres visant aujourd'hui à entraîner les ouvriers dans des impasses, de contribuer activement à la future reprise des combats de la classe sur ce chemin vers son émancipation.
FM, 6/12/91[1] [15] La nouvelle de la constitution de cette « communauté » étant parvenue au moment du bouclage de ce numéro, voir l'ajout de dernière minute note 6 sur cet événement.
[2] [16] Voir Revue Internationale n° 66 et 67.
[3] [17] «... Quelle que soit l’évolution future de la situation dans les pays de l'Est, les événements oui les agitent actuellement signent la crise historique, l'effondrement définitif du stalinisme... Dans ces pays s'est ouverte une période d'instabilité, de secousses, de convulsions, de chaos sans précédent dont les implications dépasseront très largement leurs frontières» (...). Les mouvements nationalistes qui, à la faveur du relâchement du contrôle central du parti russe, s'y [en URSS] développent aujourd'hui... portent avec eux une dynamique de séparation d'avec la Russie. En fin de compte, si le pouvoir central de Moscou ne réagissait pas, nous assisterions à un phénomène d'explosion, non seulement du bloc russe, mais également de sa puissance dominante. Dans une telle dynamique, la bourgeoisie russe, qui aujourd'hui domine la deuxième puissance mondiale, ne serait plus à la tête que d'une puissance de second plan, bien plus faible que l'Allemagne, par exemple ». (« Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'Est », 15/9/89, Revue Internationale n°60)
[4] [18] Voir éditorial, Revue Internationale n° 67.
[5] [19] Voir article sur la récession
dans ce numéro.
[6] [20] La constitution le 8 décembre d'une « communauté d'Etats » par la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie ne peut qu'aggraver cette situation. Cet ersatz d'Union qui ne regroupe que des républiques slaves ne peut qu'attiser le nationalisme parmi les populations non-slaves dans les autres républiques de l'ex-URSS mais aussi en Russie même. Loin de stabiliser la situation, l'accord entre Eltsine et ses acolytes contribue à la dégrader encore un peu plus dans une région du monde truffée d'armes nucléaires.
[7] [21] Sur la décomposition, voir notamment Revue Internationale n° 57, n° 62 et n° 64.
[8] [22] Avec l'approche de l'hiver, la situation des populations Kurdes est encore pire qu'elle n'était après la Guerre du Golfe. Mais comme on ne sait décidément pas qu'en faire et qu'elles deviennent « encombrantes » pour les pays voisins (notamment pour la Turquie qui n'hésite pas, bien qu'elle fasse partie des « bons », à utiliser contre elles les mêmes méthodes que Saddam Hussein, tels les bombardements aériens), il est préférable de suspendre discrètement toute aide internationale à leur égard et de se retirer sur la pointe des pieds en leur conseillant de retrouver leurs localités d'origine, c'est-à-dire de se jeter dans les bras de leurs bourreaux. Le massacre des Kurdes par la soldatesque de Saddam Hussein était un excellent sujet pour les « unes » des journaux télévisés lorsqu'il s'agissait de justifier a posteriori la guerre contre l'Irak. C'est pour cela que les « coalisés » avaient préparé ce massacre en incitant, pendant la guerre, ces populations à se soulever contre Bagdad et en laissant à Saddam, après celle-ci, les troupes nécessaires à cette « opération de police». Mais, aujourd'hui, le calvaire des Kurdes a perdu son intérêt pour les campagnes de propagande : désormais, pour la bourgeoisie « civilisée », il est préférable qu'ils crèvent en silence.
[9] [23] Voir « Vers le plus grand chaos de l'histoire » dans ce numéro.
[10] [24] Cela ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il y ait une réelle « harmonie » entre ces autre puissances. Ainsi, la France, par exemple, qui ambitionne de résister au leadership américain, a constitué, contre la Grande- Bretagne notamment, une alliance avec l'Allemagne au sein de la CEE avec l'objectif, à la fois de faire contre-poids à l'influence des Etats-Unis et « d'encadrer » les ambitions de grande puissance de son al lié allemand (sur lequel elle a au moins l'avantage de disposer de l'arme atomique). C'est bien pour cette raison, d'ailleurs, que la France est le plus chaud partisan des projets permettant à la communauté européenne, comme un tout, d'affirmer une certaine indépendance militaire : construction d'une navette spatiale européenne, constitution d'une division mixte franco-allemande, renforcement des compétences diplomatiques de l'exécutif européen, soumission de l'Union de l'Europe Occidentale (seul organisme européen ayant des attributions militaires) au Conseil de l'Europe (et non à l'OTAN oui est dominé par les Etats-Unis). Et c'est, bien entendu, ce dont la Grande- Bretagne ne veut pas.
[11] [25] Ceci dit, même si Israël n'a plus la même marge de manoeuvre que par le passé, ce pays, oui a su faire preuve lors de la guerre du Golfe de « sens des responsabilités » à l'avantage des Etats-Unis, reste le pion essentiel de la politique américaine dans la région : c'est lui qui dispose de l'armée la plus puissante et moderne (avec notamment plus de deux cents têtes nucléaires) et il ne cesse (grâce notamment aux 3 milliards de dollars annuels de l'aide américaine) de renforcer son potentiel militaire. En outre, il est dirigé par un régime bien plus stable que celui de tous les pays arabes. C'est pour cela que les Etats-Unis ne sont pas prêts de lâcher la proie pour l'ombre en renversant leurs alliances privilégiées. En ce sens, toutes les tergiversations d'Israël face à la pression des Etats-Unis avant la rencontre de Madrid et celle de Washington, étaient bien plus un moyen de faire monter les enchères auprès des pays arabes que l'expression d'une opposition de fond entre entre les deux Etats.
[12] [26] Ainsi on peut voir à quel point cette organisation est devenu un simple instrument de la politique américaine : elle est vivement sollicitée lorsqu'il s'agit de «mouiller» des alliés récalcitrants (comme lors de la guerre du Golfe) mais elle est mise à l'écart lorsqu'elle pourrait permettre à ces mêmes alliés de jouer un rôle sur la scène internationale.
[13] [27] C'est pour cela que, malgré la disparition du bloc occidental (résultant de celle de son rival de l'Est, .il n'existe pas actuellement de menace sur la structure fondamentale que s'était donné ce bloc et que dominent totalement les Etats-Unis, ÎOTAN. C'est bien ce qui s'exprime clairement dans le document adopté le 8 novembre par la réunion au sommet de cette organisation : « La menace d'attaque massive et simultanée sur tous les fronts européens de l'OTAN a bel et bien été éliminée ... [les nouveaux risques proviennent] des conséquences négatives d'instabilités qui pourraient découler des graves difficultés économiques, sociales et politiques, y compris les rivalités ethniques et tes litiges territoriaux que connaissent de nombreux pays d'Europe centrale et orientale. » Dans le contexte mondial de disparition des blocs, on assiste donc, à l'heure actuelle, à une reconversion de l'OTAN, ce qui a permis à Bush d'affirmer avec satisfaction à la fin de la rencontre : « Nous avons montré que nous n'avons pas besoin de la menace soviétique pour exister. »
[14] [28] Voir« France : les "coordinations" sabotent les luttes », Revue Internationale n° 56, 1er trimestre 1989
Questions théoriques:
- Décomposition [29]
- Impérialisme [30]
Crise économique : crise du crédit, relance impossible, une récession toujours plus profonde
- 3319 reads
L'économie américaine poursuit sa plongée dans l'enfer de la récession et entraîne la production mondiale dans son sillage. L'optimisme de façade affiché par les dirigeants américains depuis le printemps 1991 n'a pas survécu à l'été. Depuis septembre les chiffres pleuvent qui rendent toute illusion impossible. La confiance dans la perspective toujours renouvelée du capitalisme, qui, tel un phénix renaissant de ses cendres, serait toujours capable, après une récession passagère, de retrouver le chemin vers une croissance sans limite, n'est plus de mise. La dure réalité de la crise économique se charge défaire ravaler leurs déclarations triomphantes, à ceux qui, il y a à peine deux ans, avec l'effondrement économique du «modèle» stalinien du capitalisme, saluaient la victoire du capitalisme libéral comme seule forme viable de survie de l'humanité.
Le plongeon dans la récession
L'économie américaine patine depuis deux ans, incapable de sortir du marasme. Depuis l'arrivée de Bush a la présidence, la «croissance» du PNB a été, en moyenne, de 0,3%. Après trois trimestres de récession du PNB, en chiffres officiels, l'embellie du 3e trimestre, avec 2,4 % de croissance, n'a rassuré aucun capitaliste. Les responsables économiques s'attendaient à un résultat bien meilleur, de 3 à 3,5 %. La publication au même moment du chiffre de la croissance mensuelle de la production industrielle de septembre 1991: 0,1%, en baisse régulière depuis juin, est venue renforcer la sinistrose ambiante dans les milieux responsables de la bourgeoisie.
Le mensonge de la prospérité de l'économie capitaliste, le CCI l'a constamment dénoncé dans sa presse. La récession ouverte présente, dans toutes ses caractéristiques, n'est pas une surprise, mais la confirmation éclatante de la nature catastrophique et inéluctable de la crise de l'économie capitaliste mise en évidence par les marxistes depuis des générations, et que le CCI s'est attaché à démontrer tout au long de son histoire.
Sur l'analyse de la situation actuelle, voir les articles publiés ces dernières années dans la rubrique sur la crise économique de la Revue Internationale, que nous conseillons aux lecteurs intéressés :
« La perspective d'une récession n'est pas écartée, au contraire » (n° 54, 2e trim. 1988),
« Le crédit n'est pas une solution éternelle » (n° 56),
« Bilan économique des années 1980 : l'agonie barbare du capitalisme décadent » (n° 57),
« Après l'Est, l'Ouest » (n° 60),
« La crise du capitalisme d'État, l'économie mondiale s'enfonce dans le chaos » (n° 61),
« L'économie mondiale au bord du gouffre » (n° 64),
« La relance de la chute de l'économie mondiale » (n°66, 3e trim. 1991).
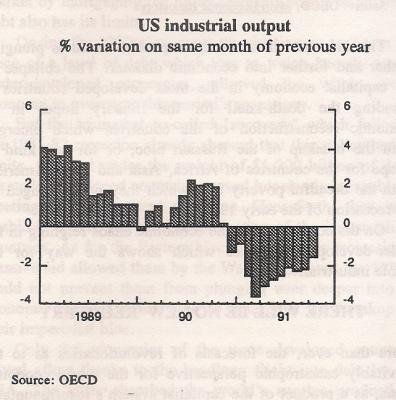
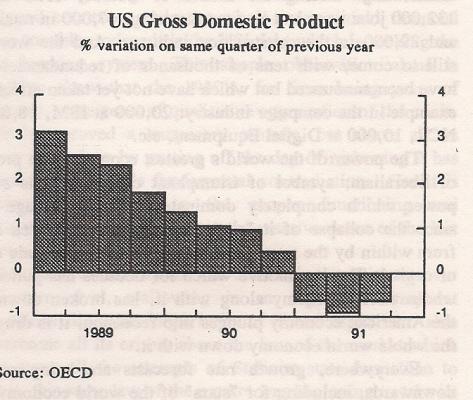
L'économie américaine voit s'avancer devant elle la perspective d'une plongée encore plus profonde dans a récession. Et toute l'économie capitaliste mondiale en tremble sur ses bases.
Au-delà des indices de toutes sortes qui sont quotidiennement publiés dans le monde entier, chaque jour qui passe amène son flot de mauvaises nouvelles.
Le chiffre « optimiste » de 2,4 % de croissance pour le 3e trimestre 1991 ne signifie même pas une amélioration pour les entreprises. Au contraire, la concurrence s'exacerbe, la guerre des prix fait rage et les marges bénéficiaires tondent comme neige au soleil. En conséquence, ce ne sont pas simplement les profits qui sont en chute libre, mais ce sont surtout des pertes énormes qui s'accumulent. Tous les secteurs sont touchés. On peut citer, comme exemples spectaculaires parmi bien d'autres, les résultats de quelques ténors de l'économie américaine durant cette période.
Pour redresser ces bilans désastreux les «plans de restructuration » succèdent aux « plans de redressement», ce qui concrètement signifie fermetures d'usines, donc licenciements, et attaques contre les salaires. Les entreprises les plus faibles font faillite et leurs employés, mis sur le pavé, viennent grossir la cohorte grandissante des chômeurs et des miséreux.
Tableau 1 : La chute des profits des grandes entreprises US
Alors qu'il y a peu, Reagan prétendait avoir terrassé le chômage, surtout en fait en permettant le développement des « petits boulots » précaires et mal rémunérés, et en truquant honteusement les modalités de calcul, celui-ci a crû régulièrement de 5,3 % de la population active, fin 1988, à 6,8%, en octobre 1991. Il faut savoir qu'un pourcentage de 0,1 % d'augmentation de ce taux, apparemment insignifiant, représente environ 130 000 chômeurs de plus. Tout cela, bien sur, en chiffres gouvernementaux, dont on sait combien ils sous-estiment la réalité. Et la tendance ne fait que s'accélérer. Pour le seul mois d'octobre 1991, 132000 emplois ont été perdus dans l'industrie manufacturière, 47 000 dans le commerce de détail, et 29 000 dans la construction. Et le plus dur est à venir, avec des dizaines de milliers de licenciements annoncés qui ne sont pas encore comptabilisés, entre autres dans le secteur informatique : 20 000 chez IBM, 18 000 chez NCR, 10 000 chez Digital Equipment, etc.
Le potentiel de la première économie du monde, chantre du libéralisme, symbole du capitalisme triomphant, super-puissance impérialiste qui, après l'effondrement économique de son grand rival « soviétique », domine de loin l'arène internationale, est miné de l'intérieur par les ravages de la crise économique du capital dans le monde entier. La locomotive qui tirait 1’économie mondiale depuis des décennies, est en panne. Avec la plongée de l'économie américaine dans la récession, c'est toute l'économie mondiale qui se ralentit et s'enfonce avec elle.
Dans tous les pays, les taux de croissance sont revus à la baisse, y compris pour les « stars » de l'économie mondiale que sont le Japon et l'Allemagne. Pour ceux qui étaient déjà dans la récession, tels le Canada et la rrande-Bretagne, les illusions de renouer avec la croissance s'envoient avec celles des USA.

Sur tous les plans, les USA donnent le LA à l'économie mondiale, et tout comme aux USA, la dynamique de récession en Europe et au Japon s'accompagne de son cortège de faillites, avec fermetures d'usines, entraînant bien entendu des licenciements massifs.

Le coeur industriel du monde capitaliste est en train de s'enfoncer plus encore dans la catastrophe économique. L'effondrement de l'économie capitaliste dans les pays les plus développés sonne le glas des espoirs illusoires d'une reconstruction économique des pays issus de l'éclatement du bloc russe, ou d'une quelconque sortie des pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie de la misère horrible dans laquelle les a fait plonger la récession du début des années 1980.
Dans la dynamique d'effondrement où se trouve l'économie mondiale, c'est au contraire le chaos économique qui règne dans les pays sous-développés qui représente la perspective vers laquelle se précipite l'ensemble du monde industriel.
Une nouvelle « relance » est impossible
Plus que jamais se trouvent confirmées les prévisions des révolutionnaires sur la perspective catastrophique inéluctable de la crise économique mondiale, comme produit des contradictions insurmontables du système capitaliste.
Ce constat de la faillite implacable de l'économie capitaliste, la classe dominante, évidemment, ne peut l'accepter, car il signifie sa propre perte. C'est pour cette raison, que les belles phrases sur la « relance » future de l'économie relèvent autant de la nécessaire propagande destinée à rassurer les foules inquiètes, que de l'auto persuasion de la bourgeoisie, qui a besoin de croire à l'éternité de son système. Il est vrai, d'ailleurs, que la capacité qu'a eu le capitalisme dans le passé pour pallier et masquer les effets les plus brutaux de la crise, ne peut que renforcer cette illusion.
Les mesures pour « relancer » sont usées et aggravent la situation
Depuis la fin des années 1960, depuis le retour de la crise ouverte du capitalisme qui met fin aux années de croissance de la reconstruction d'après la 2e guerre mondiale, l'économie américaine, et l'économie mondiale à sa suite, se sont offertes plusieurs plongeons successifs dans la récession : en 1967, en 1969-70, en 1974-75, en 1981-82. Chaque fois, les capitalistes ont cru avoir définitivement vaincu le spectre du recul de la production, avoir découvert le remède efficace qui renverrait aux poubelles de l'histoire les prévisions du marxisme authentique. Mais chaque fois, les effets de la crise se sont redéployés, de manière toujours plus large, toujours plus forte et toujours plus profonde.
Les fameux remèdes, chaque fois présentés comme des innovations décisives (il y a peu, les économistes parlaient encore pompeusement des « reaganomics », pour saluer les <r apports » déterminants de Reagan à a science économique), sont en fait les mesures théorisées et préconisées par Keynes, appliquées depuis les années 1930. C'est une politique de capitalisme d'Etat, qui se caractérise par : la baisse du taux d'escompte des banques centrales, le déficit budgétaire, une intervention de plus en plus massive et contraignante de l'Etat dans tous les secteurs de l'économie, avec, en plus, la mise en pratique généralisée de l'économie de guerre, qui relève autant de l'imitation de la politique économique de capitalisme d'Etat mise en place par Hitler, que de l'application des théories keynésiennes. Ces artifices économiques reposent en fait essentiellement sur le développement du crédit et un endettement croissant.
La crise économique du capitalisme est en réalité une crise de surproduction généralisée, produite par l'incapacité a trouver, à l'échelle mondiale, des débouchés solvables, capables d'absorber la production. Le développement du crédit est par excellence le moyen pour élargir artificiellement le marché en tirant des traites sur l'avenir. Mais cette politique d'endettement généralisé trouve aussi ses limites.
Durant les années 1970, la relance par le crédit facile, au prix d'un endettement qui va lourdement peser sur l'économie des pays sous-développés, permet à l'ensemble de l'économie mondiale de surmonter les phases de récession de cette période. Mais, la soi-disant «reprise» triomphale de l'économie qui succède à la récession de 1981-82 va déià montrer les limites de cette politique. Ecrasés par le poids d'une dette qui atteint alors 1 200 milliards de dollars, les pays sous-développés sont définitivement incapables de faire face aux échéances de leur dette. Ils sont dorénavant incapables d'absorber le surplus de la production des pays industrialisés. Quant aux pays de 'Est, malgré les crédits de plus en plus massifs octroyés par l'Occident tout au long des années 1980, ils vont s enfoncer dans le marasme économique qui déterminera l'implosion du bloc impérialiste qu'ils constituent.
Seules les économies des pays les plus développés sont maintenues à flot par la politique de fuite en avant dans l'endettement des USA. Ceux-ci absorbent le surplus de la production mondiale, qui ne peut plus s'écouler vers le « tiers-monde », en laissant se creuser des déficits commerciaux colossaux, et maintiennent la « croissance » de leur économie en accumulant des déficits budgétaires gigantesques qui financent essentiellement la production d'armements. Le développement d'une spéculation effrénée sur les marchés immobilier et boursier permet d'attirer aux USA des capitaux du monde entier. Mais il va surtout gonfler artificiellement les bilans des entreprises et créer l'illusion dangereuse d'une activité économique intense.
A la fin des années 1980 le capital US nage sur un océan de dettes phénoménal. Elles sont d'autant plus difficiles à quantifier que le dollar s'est imposé comme monnaie internationale utilisée dans le monde entier et que, par conséquent, il n'est pas réellement possible de distinguer la dette interne et externe. Si la dette extérieure des USA peut être estimée aujourd'hui à environ 900 milliards de dollars, et bat donc ainsi déjà tous les records, la dette interne atteint quant à elle le chiffre astronomique de 10 000 milliards de dollars, près de deux fois le PNB annuel des Etats-Unis. C'est-à-dire que, pour la rembourser, il faudrait que tous les travailleurs américains restent deux années à travailler sans toucher un sou !
Cette fuite effrénée des USA dans l'endettement, non seulement n'a pas permis de relancer réellement l'ensemble de l'économie mondiale durant les années 1980, mais surtout, elle n'a pas pu empêcher que, peu à peu, les signes de la crise ouverte et de la récession, ne ressurgissent avec déplus en plus de vigueur à la fin de la décennie. L'effondrement à répétition de la spéculation boursière à partir de 1987, l'effondrement de la spéculation immobilière depuis 1988 qui provoquent des faillites bancaires en série ont été les indicateurs de la chute de la production qui a déterminé la récession ouverte, officiellement reconnue fin 1990.
Le crédit à bout de souffle
Dans ces conditions, la nouvelle plongée dans la récession qui commence avec cette décennie, ne traduit pas seulement l'incapacité fondamentale du capitalisme à trouver des débouchés solvables pour écouler sa production, mais aussi l'usure des moyens économiques qu'il a jusque-là employés pour pallier cette contradiction insurmontable. Les différentes « reprises » qui ont eu lieu depuis 20 ans débouchent sur une crise du crédit avec, au coeur de cette crise, la première puissance économique mondiale : les USA.
Alors qu'au début des années 1980, c'est la dette des pays sous-développés qui faisait trembler le système financier international, au début des années 1990, c'est la dette des Etats-Unis qui fait vaciller le système bancaire mondial sur ses bases. Ce simple constat montre amplement que, loin d'être des années de prospérité, les années 1980 ont été des années d'aggravation qualitative de la crise. La potion du crédit a été un remède provisoire, et surtout illusoire, car en reculant les échéances, il ne pouvait que pousser les contradictions à s'aggraver toujours plus. Si le crédit est traditionnellement nécessaire au bon fonctionnement et au développement du capital, employé à dose massive, comme c est le cas depuis plus de 20 ans, il constitue un poison violent.
Alors même que le capitalisme occidental fêtait sa victoire sur son rival du bloc de l'Est, se vautrant avec délices dans une orgie de déclarations triomphantes sur la « supériorité du capitalisme libéral », capable de surmonter toutes les crises, sur la vérité de la loi du marché, qui balayait toutes les tricheries brutales et caricaturales du capitalisme d'Etat à la sauce stalinienne, cette même loi du marché commençait rapidement à prendre une revanche éclatante sur tous les mensonges qui se déversaient à l'Ouest. Bien que depuis deux ans, la Banque Fédérale américaine ait fait baisser 19 fois consécutivement son taux de base, mesure classique de capitalisme d'Etat s'il en est, l'économie réelle ne répond plus à cette stimulation. Non seulement l'offre de nouveaux crédits n'est pas suffisante pour relancer les investissements et la consommation intérieure, et donc ainsi la production, mais surtout les banques veulent de moins en moins prêter des capitaux, sachant pertinemment qu'ils ne leur seront jamais remboursés, ce qui, somme toute, est dans la logique du marché capitaliste.
Après les débâcles boursières de 1987 et 1989, Wall Street le 15 novembre 1991, enregistre la cinquième plus forte baisse de son histoire. Ce nouvel accès de faiblesse malgré la mise en place, après 1989, de toute une série de mesures de contrôle draconiennes, est le reflet de la contradiction de fond entre le développement de la spéculation effrénée, qui avait repris de plus belle après 1989, et la réalité de l'économie qui s'enfonce de plus en plus dans le rouge.
Cependant, l'événement conjoncturel, facteur déclenchant aux USA ce nouvel affaissement des cours de la bourse, est aussi significatif. Ce fut le mécontentement des banques devant la volonté du gouvernement d'imposer autoritairement la baisse des taux d'intérêt sur les cartes bancaires. Alors que les banques accumulent les défauts de remboursement et sont obligées de provisionner des pertes de plus en plus importantes, le haut niveau des taux sur les crédits à la consommation : 19 %, demeure le seul moyen pour rétablir leurs comptes déficients. Devant la ronde des milieux bancaires, Bush a du faire marche arrière pour rassurer le marché, comme il avait du reculer quelques jours plus tôt devant le refus du Congrès d'entériner son premier projet de réforme du système bancaire qui aurait signifié la faillite en série des banques les plus faibles. Tout le système de crédit aux USA est au bord de l'asphyxie, à un moment où l'Etat le sollicite toujours plus pour tenter de financer la relance. De nouvelles faillites retentissantes se profilent à l'horizon. Pour tenter d'y faire face le Congrès vient de voter l'allocation de 70 milliards de dollars au FDIC, le fond de garantie fédéral des banques. Cependant, cette somme qui déjà paraît énorme sera à l'évidence bien insuffisante pour combler les pertes qui s'annoncent. Pour s'en rendre compte il suffit de se remémorer le trou laissé par la faillite de centaines de caisses d'épargne avec l’effondrement du marché immobilier depuis 1989 : 1000 milliards de dollars !
Le fait que l'Etat vienne au secours des banques en faillite ne résout rien du tout. Au contraire, ceci ne fait que reporter le problème à un niveau plus élevé. Ces nouvelles ponctions sur le budget creusent un peu plus le déficit de l'Etat, accroissant les dépenses, au moment où les rentrées fiscales diminuent avec le ralentissement de l'activité économique. Pour 1991, certaines estimations tablent sur un nouveau déficit budgétaire record de 400 milliards de dollars. Pour combler ce trou qui ne cesse, année après année, de s'élargir, l'Etat américain a besoin de faire appel aux capitaux du monde entier en tentant de placer ses bons du trésor.
Plus de « locomotive » pour l'économie mondiale
Cette fuite en avant dans l'endettement de l'Etat américain commence elle aussi à trouver ses limites. Les investisseurs du monde entier commencent à considérer l'économie américaine avec une méfiance grandissante. Non seulement, l'endettement pharamineux du capital US pose la question de la capacité de celui-ci à rembourser les crédits contractés, mais en plus, la situation de récession présente fait à juste titre craindre le pire. Et, non seulement les faibles taux d'intérêts offerts, tentative de reprise oblige, ne sont guère attrayants, mais en plus 1’ensemble de la planète est confrontée à une pénurie de crédit.
Les principaux bailleurs de fond de la décennie précédente n'ont plus la même disponibilité: l'Allemagne, elle aussi, a besoin de capitaux pour financer la réintégration de l'ex-RDA, et le Japon, qui a prêté au monde entier, et qui ne voit pas ses crédits remboursés, commence à montrer des signes de faiblesse. L'effondrement de la spéculation immobilière locale et l'affaissement de la bourse de Tokyo placent les banques japonaises dans une situation délicate. La crise de confiance qui touche l'Amérique se voit concrètement dans la baisse de 70 % des investissements étrangers aux USA durant le 1er semestre 199 par rapport au même semestre de l'année précédente. Quant aux investissements japonais, qui ont été les pus importants durant les années 1980, ils ont chuté dans le même temps de 12,3 à 0,8 milliards de dollars.
Dans le monde entier la demande de nouveaux crédits augmente, alors que l'offre se contracte. L'URSS, dont les jours sont comptés, quémande avec insistance de nouveaux prêts simplement pour pouvoir passer l'hiver sans famine ; le Koweït a besoin de capitaux pour reconstruire ; les pays sous-développés ont besoin de nouveaux crédits pour pouvoir continuer à rembourser les anciens ; etc. Alors que l'économie mondiale plonge irrésistiblement dans la récession, tous les pays sont à la recherche frénétique de la même drogue qui les a rendus dépendants et les a plongés, durant des années, dans le rêve illusoire ? D’une sortie de la crise. Partout les mêmes signes sont là qui annoncent une crise financière majeure avec au coeur de la tourmente la principale monnaie du monde, le dollar.
Les capitalistes du monde entier attendent avec angoisse le moment fatidique où les USA n'arriveront plus à placer leurs bons du trésor sur le marché mondial, moment qui se rapproche inéluctablement et qui va ébranler tout le système financier, bancaire et monétaire international, précipitant l'économie mondiale encore plus profondément dans le gouffre insondable d'une crise généralisée qui l'affecte de manière explosive sur tous les plans de son existence.
Quelles que soient les fluctuations immédiates de l'économie américaine, qui focalisent, au jour le jour, l'attention des capitalistes du monde entier, la dynamique vers la chute est déjà tracée. Un sursaut de croissance dans ces conditions ()[1] [31] ne pourra que prolonger de quelques mois les illusions sur l'état du malade, sans rien résoudre. Face à une telle situation les économistes de toute la planète cherchent désespérément une solution. Toutes les mesures envisagées se heurtent à la réalité têtue des faits. Elles sont soit illusoires, soit porteuses de conséquences inévitablement catastrophiques, en tout cas impuissantes à juguler la crise.
Une récession inévitable et le retour de l'inflation
La méthode de la purge brutale, telle que l’avait pratiquée Reagan, après son arrivée à la présidence en 1980, en remontant le taux d'intérêt, ce qui avait provoqué la récession mondiale commencée en 1981, n'aurait pour seul résultat que d'accélérer immédiatement et dramatiquement la récession déjà là. Elle mènerait à déstabiliser violemment l'ensemble de l'économie mondiale, ouvrant une véritable « boite de Pandore» de phénomènes complètement chaotiques et incontrôlables, tout comme ce qu'il reste d'URSS nous en offre déjà l'exemple, mais à l'échelle mondiale.
Il faut d'ailleurs se rappeler que Reagan avait lui-même rapidement mis fin à cette politique de rigueur à haut risque, pour pratiquer ensuite exactement la politique inverse, ce qui permit au capitalisme américain de préserver une stabilité relative dans les pays les plus industrialisés, et donc aussi la défense de ses intérêts impérialistes.
C'est ce second volet de la politique reaganienne, celui de la «reprise», qui est aujourd'hui a bout de souffle. Relancer la consommation par la baisse des impôts est de moins en moins possible, alors que le déficit budgétaire a atteint une profondeur abyssale. Quant à la relance par le crédit, comme on l'a vu, elle se heurte aux limites du marché des capitaux, asséché par les emprunts à répétition de l'Etat américain depuis des années.
L'argent frais que l'Amérique ne peut plus trouver sur le marché mondial, pour faire carburer sa machine économique, elle n'a d'autre solution que de le produire par l'usage intensif de la « planche à billets ». Le retour en force de l'inflation sera le seul résultat d'une telle politique. Cette « solution », du « moins pire » en quelque sorte, freinera probablement quelque peu la chute dans la récession.
En dehors du fait qu'elle mettra définitivement fin au dogme de la lutte contre l'inflation, cheval de bataille de la classe dominante durant des années pour justifier les sacrifices imposés aux prolétaires, elle signifiera aussi un chaos croissant pour l'économie capitaliste, notamment sur le plan du système monétaire international.
La politique suivie par l'administration Bush est typiquement une politique inflationniste qui se traduit par une baisse des cours du dollar. Si l'inflation a pu, jusqu'à présent, être contenue aux USA et dans les pays développés, cela a été dû essentiellement à la concurrence qui s'exacerbe face à un marché qui se rétrécit, provoquant la chute des cours des matières premières, et poussant les entreprises à rogner sur leurs marges bénéficiaires, ainsi qu'aux attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière qui ont fait baisser le « coût de la force de travail ».
Ces aspects typiques des effets de la récession vont aussi rencontrer, à terme, leurs limites. Les conditions pour une nouvelle flambée inflationniste sont en train de se réunir. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'en dehors des pays les plus industrialisés, 1 inflation est toujours la, qui ravage l'économie des les pays sous-développés et qui est en train de se développer avec force dans les pays de l'ancien bloc de l'Est.
Jamais dans toute l'histoire du capitalisme la perspective n'a été aussi sombre sur le plan de son économie. Ce que les chiffres et les indices abstraits et froids des économistes annoncent, c'est la catastrophe dans laquelle le monde est en train de plonger.
Le coeur du capitalisme mondial, les pays les plus développés, où sont concentrés les principaux bastions du prolétariat mondial, est maintenant au centre de la tempête. Le grand manteau de misère qui recouvre les exploités du « tiers-monde » et des pays de l’ex-bloc de l'est depuis des années, se prépare à étendre son ombre sur les ouvriers des pays « riches ».
Cette vérité de l'impasse absolue dans laquelle le capitalisme mène l'humanité, de la perspective de misère et de mort qu'il représente, et face a cette tragédie, de la nécessité vitale pour toute l'espèce humaine de remettre à l'ordre du jour la véritable perspective communiste, les prolétaires et les exploités du monde entier vont devoir l'apprendre et la comprendre dans la douleur d'une amputation brutale et dramatique de leurs conditions de vie, à un point qu'ils n'ont jamais connu auparavant.
JJ, 28/11/1991
[1] [32] Dans la mesure où la classe dominante américaine est entrée en plein cirque électoral, il est probable qu'elle va tenter par tous les moyens à sa disposition de maintenir un tant soit peu son économie à flot, afin de perpétuer encore l’illusion, quitte pour cela à tricher encore plus avec ses statistiques. Cette situation ne peut évidemment qu’être tout à fait provisoire, même si un sursis de quelques mois est obtenu.
Récent et en cours:
- Crise économique [33]
Questions théoriques:
- Décadence [34]
Notes sur l'impérialisme et la décomposition : vers le plus grand chaos de l'histoire
- 4369 reads
Les gigantesques bouleversements provoqués par l'effondrement du bloc de l'Est et la dislocation de l'URSS ouvrent-ils une ère plus pacifique ? Face à la menace du chaos, la férocité des rapports entre puissances capitalistes va-t-elle s'atténuer ?La constitution de nouveaux blocs impérialistes est-elle encore possible ? Quelles nouvelles contradictions fait surgir la décomposition capitaliste au niveau de l'impérialisme mondial ?
Les rivalités entre puissances ne disparaissent pas : elles s'exacerbent
Si le monde s'est effectivement profondément modifié depuis l'effondrement du bloc de l'Est, les lois barbares qui régissent la survie de ce système moribond sont, elles, toujours bien présentes. Et, au fur et à mesure que le capitalisme s'enfonce dans la décomposition, leur caractère destructeur, et la menace qu'elles font peser sur la survie même de l'humanité, se renforcent. Le fléau de la guerre, cet enfant monstrueux, mais naturel, de l'impérialisme, est et sera toujours plus présent, et la lèpre du chaos, après avoir plongé les populations du « tiers-monde » dans un enfer sans nom, exerce maintenant ses ravages dans tout l'est de l'Europe.
En fait, derrière les proclamations pacifistes des grandes puissances impérialistes du désormais défunt « bloc » américain, derrière les masques de respectabilité et de bonne entente dont celles-ci s'affublent, les relations entre ces Etats sont en réalité régies par la loi des gangsters. Dans les coulisses, comme n'importe quel truand, c'est à qui volera à l'autre sa part de trottoir, avec qui s'allier pour se débarrasser d'un concurrent aux dents trop acérées, comment faire pour se débarrasser d'un parrain trop puissant. Telles sont les véritables questions qui font l'objet des « débats » entre les bourgeoisies de ces « grands pays civilisés et démocratiques».
«La politique impérialiste n'est pas l’oeuvre d'un pays ou d'un groupe de pays. Elle est le produit de l'évolution mondiale du capitalisme...C'est un phénomène international par nature... auquel aucun Etat ne saurait se soustraire. »([1] [35]). A partir de l'entrée en décadence du capitalisme, l'impérialisme domine la planète toute entière, il est « devenu le moyen de subsistance de toute nation grande ou petite » ([2] [36]). Ce n'est pas une politique «choisie» par la bourgeoisie, ou telle ou telle de ses fractions, c'est une nécessité absolue qui s'impose.
De ce fait, la disparition du bloc de l'Est et celle du bloc de l'Ouest qui en résulte, ne sauraient signifier la fin du «règne de l'impérialisme». La fin du partage du monde entre « blocs », tel qu'il était sorti de la 2e guerre mondiale, ouvre au contraire toute grande la porte au déchaînement de nouvelles tensions impérialistes, à la multiplication des guerres locales et à l'aiguisement des rivalités entre les grandes puissances auparavant disciplinées par le « bloc de l'Ouest».
Les rivalités au sein même des blocs ont toujours existé, et ont parfois éclaté ouvertement, comme par exemple entre la Turquie et la Grèce, tous deux membres de l'OTAN, à propos de Chypre en 1974. Ces rivalités étaient cependant solidement contenues par le corset de fer du bloc de tutelle. Ce corset ayant disparu, les tensions, jusque-là endiguées, ne peuvent que s'exacerber.
Le capital américain face au nouvel appétit de ses vassaux
Pendant des décennies, la soumission de l'Europe et du Japon aux Etats-Unis était le prix de la protection militaire que ces derniers leur accordaient face à la menace soviétique. Cette menace ayant aujourd'hui disparu, l'Europe et le Japon n'ont plus le même intérêt à suivre les diktats américains et le «chacun pour soi» tend à se déchaîner.
C'est ce qui s'est manifesté avec force durant tout l'automne 1990, l'Allemagne, le Japon et la France, essayant d'empêcher le déclenchement d'une guerre qui ne pouvait que renforcer la supériorité américaine ([3] [37]). Les Etats-Unis, en imposant la guerre, en obligeant l'Allemagne et le Japon à payer pour elle et en forçant la France à y participer, ont remporté une claire victoire, car ils ont fait la preuve de la faiblesse des moyens à la disposition de tous ceux qui pourraient être tentés de disputer leur domination. Ils ont fait étalage de leur énorme surpuissance militaire, visant à démontrer qu'aucun autre Etat, quelle que soit sa puissance économique, ne pourrait rivaliser avec eux sur le terrain militaire.
Le « Bouclier » puis la « Tempête du désert » de sinistre mémoire, guerre imposée et menée d'un bout à l'autre par Bush et son équipe, en faisant taire momentanément les velléités de « chacun pour soi » dans les pays centraux, avait en fait, en dernière instance, pour principale fonction de prévenir et de contrecarrer la reconstitution potentielle d'un bloc rival, à préserver pour les Etats-Unis leur statut de seule super-puissance.
«Cependant, cette réussite immédiate de la politique américaine ne saurait constituer un facteur de stabilisation durable de la situation mondiale dans la mesure où elle ne pouvait affecter les causes mêmes du chaos dans lequel s'enfonce la société. Si les autres puissances ont dû remiser pour un temps leurs ambitions, leurs antagonismes de fond avec les Etats-Unis n'ont pas disparu pour autant, c'est bien ce qui se manifeste avec l'hostilité larvée que témoignent des pays comme la France et l'Allemagne vis-à-vis des projets américains de réutilisation des structures de l'OTAN dans le cadre d'une "force de réaction rapide", dont le commandement reviendrait, comme par hasard, au seul allié fiable des Etats-Unis, la Grande-Bretagne. » ([4] [38])
Depuis, l'évolution de la situation a confirmé pleinement cette analyse. L'état des relations entre Etats de la CEE, et plus particulièrement entre certains d'entre eux comme la France et l'Allemagne, et les Etats-Unis, que ce soit à propos de l'avenir de l'OTAN et de la « défense européenne », ou vis-à-vis de la crise yougoslave, est une illustration des limites du coup de frein que la guerre du Golfe a exercé face au chacun pour soi au sein des principales puissances capitalistes.
Aujourd'hui, remettre en cause l'actuel partage impérialiste, partage qui est toujours imposé par la force, c'est obligatoirement s'attaquer à la première puissance mondiale, les Etats-Unis, ceux-ci étant les principaux bénéficiaires de ce partage. Et, comme l'ex-URSS n'a plus du tout les moyens de participer au premier rang à la curée impérialiste, désormais les plus grandes tensions impérialistes se situent au sein même des « vainqueurs de la guerre froide », c'est-à-dire entre Etats centraux du défunt bloc de l'Ouest ([5] [39]).
Mais dans la foire d'empoigne de l'impérialisme, la disparition d'un système de blocs engendre organiquement une tendance à la constitution de nouveaux blocs, chaque Etat ayant besoin d'alliés pour mener une lutte par définition mondiale. En effet, les blocs sont «la structure classique que se donnent les principaux Etats dans la période de décadence pour "organiser" leurs affrontements armés, ([6] [40])
Vers de nouveaux blocs ?
L'accroissement actuel des tensions impérialistes contient la tendance vers la reconstitution de nouveaux blocs, dont l'un serait forcément dirigé contre les Etats-Unis. Cependant, l'intérêt à une telle reconstitution varie considérablement selon les Etats.
Qui?
La Grande-Bretagne n'y a, elle, aucun intérêt, puisqu'elle trouve largement son compte dans son alliance indéfectible avec la politique américaine ([7] [41]).
Pour toute une série de pays, comme, par exemple, les Pays-Bas et le Danemark, il y a l'appréhension d'être absorbés pratiquement au cas où ils se feraient les alliés d'une super-puissance allemande en Europe, ce qui serait favorisé par les liens économiques qui existent déjà et par la proximité géographique et linguistique. Suivant le vieux principe de stratégie militaire qui recommande de ne pas s'allier avec un voisin trop puissant, ils n'ont que très peu d'intérêts à remettre en cause la domination américaine.
Pour une puissance plus importante mais moyenne comme la France, contester le leadership américain et participer à un nouveau bloc n'est pas non plus très évident car, pour ce faire, elle doit suivre la politique allemande, alors que l'Allemagne est pour l'impérialisme français le rival le plus immédiat et le plus dangereux, comme les deux guerres mondiales l'ont montré. Coincée entre l'enclume allemande et le marteau américain, la politique impérialiste de la France ne peut qu'osciller entre les deux. Cependant, à l'image du mode de production dont il est le reflet, l'impérialisme n'est pas un phénomène rationnel. La France, bien qu'elle ait beaucoup à y perdre et bien que ses futurs gains éventuels soient des plus hasardeux, joue plutôt, pour le moment, la carte allemande, et tend à s'opposer à la tutelle américaine, à propos de l'OTAN et avec la constitution d'une brigade franco-allemande. Ceci, cependant, ne saurait exclure d'autres retournements.
En revanche, les choses sont beaucoup plus claires pour des puissances de premier plan comme l'Allemagne et le Japon. Pour elles, retrouver un rang impérialiste en conformité avec leur force économique, ne peut signifier qu'une remise en cause de la domination mondiale exercée par les USA. De plus, seuls ces deux Etats ont potentiellement les moyens de pouvoir prétendre jouer un rôle mondial. Mais les chances de l'un et de l'autre, dans la course au leadership d'un futur bloc antagoniste aux USA, ne sont pas les mêmes.
Il ne faut pas sous-estimer la force et l'ambition de l'impérialisme japonais. Lui aussi tend à rentrer dans la curée impérialiste. En attestent le projet de modification de la constitution en vue d'autoriser l'envoi à l'extérieur de troupes nippones, le renforcement important de sa marine de guerre, sa volonté de plus en plus fermement affichée de récupérer les îles Kouriles aux dépens de l'URSS, ou encore certaines déclarations sans ambages de ces responsables japonais disant « il est temps que le Japon se libère de ses liens avec les Etats-Unis.([8] [42]) ». Mais le Japon, par sa position géographique excentrée vis-à-vis de la plus grande concentration industrielle mondiale, qui reste le champ principal des rivalités impérialistes, c'est-à-dire l'Europe, ne peut pas véritablement rivaliser dans cette course avec l'Allemagne.
L'impérialisme japonais cherche donc à étendre son influence et à avoir les coudées plus franches en essayant pour le moment de ne pas s'opposer trop ouvertement au grand parrain nord-américain. L'Allemagne, au contraire, par sa place centrale en Europe et sa puissance économique, est de plus en plus poussée à s'opposer à la politique américaine, et se retrouve de façon croissante au centre des tensions impérialistes, comme le manifestent ses réticences devant les projets américains concernant l'OTAN, sa volonté de la mise sur pied d'un embryon de « défense européenne », et plus encore son attitude en Yougoslavie.
Le capital allemand, « pousse-au-crime » en Yougoslavie
L'impérialisme allemand a joué en Yougoslavie le rôle de véritable « pousse-au-crime » en soutenant les velléités sécessionnistes Slovènes et surtout croates, comme en témoigne la volonté répétée de l'Allemagne de reconnaître unilatéralement l'indépendance de la Croatie. Historiquement, l'Etat yougoslave avait été créé de toutes pièces pour contrer l'expansionnisme impérialiste allemand en lui interdisant l'accès à la Méditerranée ([9] [43]). On comprend dès lors que la volonté d'indépendance croate ait représenté une véritable aubaine pour la bourgeoisie allemande qui a cherché à en tirer un maximum de profit. Vu ses liens étroits avec les dirigeants de Zagreb, l'Allemagne espérait bien pouvoir, en cas d'indépendance, utiliser les précieux ports croates sur l'Adriatique. Elle aurait pu ainsi réaliser un objectif stratégique vital : l'accès à la Méditerranée. C'est pourquoi l'Allemagne, avec l'aide de l'Autriche,([10] [44]) n'a cessé d'attiser les braises en soutenant ouvertement ou en coulisses le sécessionnisme croate, ce qui ne pouvait qu'accélérer la dislocation de la Yougoslavie.([11] [45])
Les Etats-Unis font échec à l'Allemagne
Consciente de la gravité de l'enjeu, la bourgeoisie américaine a tout fait, au delà de son apparente discrétion, pour contrer et briser, avec l'aide de l'Angleterre et des Pays-Bas, cette tentative de percée de l'impérialisme allemand. Son Cheval de Troie au sein de la CEE, la Grande-Bretagne, s'est systématiquement opposée à tout envoi d'une force militaire européenne d'intervention. L'appareil militaro-stalinien serbe, signant et violant autant de cessez-le-feu organisés par l'impuissante et pleurnicharde CEE, a pu méthodiquement mener en Croatie une véritable guerre de reconquête, avec le silence consentant des Etats-Unis.
D'ores et déjà, l'échec allemand en Yougoslavie est patent, comme sont patentes la division et l'impuissance totale de la CEE. Cet échec exprime bien toute la force, tous les atouts que conserve la première puissance mondiale dans la lutte pour le maintien de son hégémonie, et souligne les énormes difficultés qu'aura l'impérialisme allemand pour pouvoir être en mesure de disputer réellement la domination mondiale des Etats-Unis.
Cependant, cela ne signifie, ni le retour à une certaine stabilité en Yougoslavie, car la dynamique enclenchée condamne ce pays à s'enfoncer toujours plus dans une situation à la libanaise, ni que désormais l'Allemagne va renoncer et se plier docilement aux diktats de l’ « Oncle SAM». L'impérialisme allemand a perdu une bataille, mais il ne peut renoncer à chercher à soulever la tutelle américaine, ce dont témoigne déjà sa décision de mettre sur pied un corps d'armée, conjointement avec la France, marquant clairement une volonté de plus grande autonomie vis-à-vis de l'OTAN et donc des USA.
Le chaos entrave la constitution de nouveaux blocs
Si on doit reconnaître l'existence, dès à présent, d'une tendance à la reconstitution de nouveaux blocs impérialistes, processus au sein duquel l'Allemagne occupe, et occupera de plus en plus, une place centrale, rien ne permet d'affirmer que cette tendance pourra réellement aboutir, parce qu'elle se heurte, du fait de la décomposition, à toute une série d'obstacles et de contradictions particulièrement importants et pour une large part totalement inédits.
Tout d'abord l'Allemagne n'a pas pour le moment, et c'est une différence fondamentale avec la situation qui précède la première comme la deuxième guerre mondiale, les moyens militaires de ses ambitions impérialistes. Elle est largement démunie face à la formidable surpuissance américaine ([12] [46]). Pour réunir des moyens conformes à ses ambitions, il lui faudrait du temps, au minimum 10 à 15 ans, alors même que les USA font tout pour empêcher le développement de tels moyens. Mais plus encore, pour parvenir à instaurer l'économie de guerre nécessaire à un tel effort d'armement, la bourgeoisie doit arriver à imposer au prolétariat en Allemagne une véritable militarisation du travail. Et cela elle ne peut l'obtenir qu'en infligeant une totale défaite à la classe ouvrière, défaite dont les conditions sont pour le moment loin d'être réunies. Ainsi, même si l'on s'en tient là, les obstacles à franchir sont déjà de taille.
Mais, par ailleurs, il existe un autre facteur, tout aussi essentiel, qui contrarie l'évolution vers la reconstitution d'un « bloc » sous leadership allemand : le chaos qui envahit un nombre toujours plus grand de pays. Non seulement celui-ci rend beaucoup plus difficile l'obtention de la discipline nécessaire à la mise sur pied d'un «bloc» d'alliances impérialistes, mais la bourgeoisie allemande, comme toutes les autres bourgeoisies des pays les plus développés, et avec encore beaucoup plus d'acuité étant donnée sa position géographique, redoute l'avancée de ce chaos. C'est d'ailleurs cette crainte, à laquelle se sont ajoutées les pressions des USA, qui ont fait que l'Allemagne, malgré toutes ses réticences, a finalement soutenu Bush, comme l'ont fait le Japon et la France, dans sa guerre du Golfe. Malgré son désir d'échapper à la tutelle américaine, la bourgeoisie allemande sait que, pour le moment, seuls les Etats-Unis ont les moyens de freiner quelque peu le chaos.
Aucune grande puissance impérialiste n'a intérêt à la propagation du chaos : arrivée massive d'immigrés, immigrés qui ne peuvent pas être intégrés dans la production alors qu'on procède déjà à des licenciements massifs ; dissémination incontrôlée des armements, y compris d'énormes stocks d'armes atomiques ; risques de catastrophes industrielles majeures, en particulier nucléaires ; etc. Tout ceci ne peut que déstabiliser les Etats qui y sont exposés, et rendre beaucoup plus difficile la gestion de leur capital national. Si le pourrissement sur pied du système est, dans les conditions actuelles, profondément négatif pour l'ensemble de la classe ouvrière, il menace également la bourgeoisie et la conduite de son système d'exploitation. En première ligne face aux conséquences les plus dangereuses de l'effondrement du bloc de l'Est, face à l'implosion de l'URSS, l'Allemagne est contrainte de rallier, au moins en partie, les injonctions des seuls qui ont la capacité de faire le «gendarme» au niveau international : les USA.
Ainsi, dans cette période de décomposition, chaque bourgeoisie nationale des pays les plus développés est placée devant une nouvelle contradiction :
- assumer la défense de ses propres intérêts impérialistes, et affronter ses principaux concurrents de même rang, au risque d'accélérer le développement d'une situation de chaos ;
- se défendre contre l'instabilité et les manifestations dangereuses de cette décomposition, en préservant l’« ordre » mondial qui lui a permis de garder son rang de puissance capitaliste, au détriment de ses propres intérêts impérialistes face à ses plus grands rivaux.
La tendance à la constitution de nouveaux blocs impérialistes, inscrite dans la tendance générale de l'impérialisme à l'affrontement entre les plus grandes puissances, face à cette contradiction, ne pourra probablement jamais arriver jusqu'à son terme.
Même le «gendarme du monde», les USA, pour qui la lutte contre le chaos s'identifie le plus complètement et immédiatement à la lutte pour le maintien du statu quo dominant, celui de sa position hégémonique, n'échappe pas à ce dilemme. En déclenchant la guerre du Golfe, les Etats-Unis voulaient faire un exemple de leur capacité de «maintien de l’ordre» et obliger à rentrer dans le rang ceux qui pourraient contester leur leadership mondial. Le résultat de cette guerre n'a été qu'une instabilité plus grande dans toute la région de la Turquie à la Syrie, avec notamment la continuation des massacres des populations au Kurdistan, non seulement par la soldatesque irakienne, mais aussi .par l'armée turque ! En Yougoslavie, le soutien implicite des Etats-Unis au camp serbe a permis de barrer la route à la tentative de l'Allemagne d'accéder à la Méditerranée, mais il a aussi mis de l'huile sur le feu, contribuant à ce que la barbarie s'étende à tout le territoire yougoslave, poussant à l'instabilité de toute la région des « Balkans». Le seul moyen, en dernier ressort, dont dispose le « gendarme mondial », le militarisme et la guerre, ne peut qu'aggraver le développement de cette barbarie et la pousser à son paroxysme.
La dislocation de l'URSS aiguise la contradiction entre le « chacun pour soi » et la confrontation au chaos
La dislocation de l'URSS, par ses dimensions, sa profondeur (c'est la Russie qui est maintenant menacée de désintégration), est un facteur d'aggravation considérable du chaos à l'échelle mondiale : risque des plus grands exodes de populations de l'histoire, de dérapages nucléaires majeurs ([13] [47]). Face à un tel cataclysme, la contradiction dans laquelle se trouvent placées les grandes puissances, ne peut qu'être portée à incandescence. D'un côté, un minimum d'unité est nécessaire pour faire face à la situation, de l'autre l'effondrement de l'ex-empire soviétique ne fait qu'aiguiser les appétits impérialistes.
Là encore l'Allemagne se retrouve dans une position particulièrement délicate. L'est de l'Europe, y compris la Russie, représente pour l'impérialisme allemand une zone d'influence et d'expansion privilégiée. Alliances et affrontements avec la Russie ont toujours été au centre de l'histoire du capitalisme allemand. L'histoire comme la géographie poussent le capital allemand à étendre son influence à l'est, et il ne peut que chercher à tirer profit de l'effondrement du bloc de l'Est et de son leader. Depuis l'effondrement du mur de Berlin, c'est évidemment le capital allemand qui est le plus présent, tant au niveau économique que diplomatique, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, et plus généralement partout à l'est, à l'exception de la Pologne qui, quels que soient ses liens économiques, s'efforce de résister, pour des raisons historiques.
Mais face à la dislocation totale de l'URSS, la situation devient beaucoup plus complexe et difficile pour la première puissance économique européenne. L'Allemagne peut essayer de profiter de la situation pour défendre ses intérêts, en particulier tenter de constituer une véritable «Mittel Europa», une «Europe centrale» sous son influence prépondérante, mais la dislocation soviétique, avec l'effondrement de tous les pays de l'Est, est en même temps une menace directe, plus dangereuse pour l'Allemagne que pour tout autre pays du coeur du système capitaliste international.
« L'unification », l'intégration de l'ex-RDA, est déjà un lourd fardeau qui entrave, et entravera de plus en plus, la compétitivité du capital allemand. L'arrivée massive d'immigrants pour qui l'Allemagne reste la « terre promise », conjuguée aux risques nucléaires mentionnés plus haut, provoquent une grave inquiétude dans la classe dominante allemande.
Contrairement à la situation en Yougoslavie, qui, malgré sa gravité, touche un pays de 22 millions d'habitants, la situation dans l'ex-URSS pousse la bourgeoisie allemande à la plus grande prudence. C'est pourquoi, tout en cherchant à étendre son influence, elle s'efforce par tous les moyens de stabiliser un minimum la situation, et évite soigneusement pour le moment de jeter de l'huile sur le feu ([14] [48]). C'est pourquoi elle continue à être le plus ferme appui à Gorbatchev et le principal soutien économique de l'ex-empire. Elle suit globalement la politique menée par les Etats- Unis vis-à-vis de l'ex-URSS. Elle n'a pu que soutenir la récente initiative en matière de « désarmement » du nucléaire tac tique, dans la mesure où celle-ci vise à aider et contraindre ce qui reste de pouvoir central dans l'ex- URSS à se débarrasser d'armes, dont la dissémination fait peser une véritable épée de Damoclès nucléaire sur l'URSS, mais aussi sur une bonne partie de l'Europe. ([15] [49])
L'ampleur des dangers du chaos contraint les Etats les plus développés à une certaine unité pour y faire face, et aucun d'entre eux ne joue, pour le moment, la carte du pire dans l'ex-URSS. Cependant cette unité est tout à fait ponctuelle et limitée. En aucun cas le chaos et sa menace ne permettent aux grandes puissances d'étouffer leurs rivalités impérialistes. Cela signifie que le capitalisme allemand ne peut pas et ne va pas renoncer à tout appétit impérialiste, pas plus d'ailleurs que n'importe quelle autre puissance centrale.
Même confronté aux graves dangers induits par la désintégration du bloc de l'Est et de l'URSS, chaque impérialisme va essayer de préserver au mieux ses propres intérêts. Ainsi, lors de la rencontre de Bangkok, à propos de l'aide économique à apporter au leader déchu de l’ex-bloc de l'Est, tous les gouvernements présents étaient conscients de la nécessité de renforcer cette aide, afin de prévenir l'explosion de catastrophes majeures dans un futur proche. Mais chacun a essayé que ça lui coûte le moins cher possible, et que ce soit l'autre, le rival et concurrent, qui en supporte la plus lourde charge. Les USA ont « généreusement » proposé d'annuler une partie de la dette soviétique, ce qu'a fermement refusé l'Allemagne, pour la bonne raison qu'elle supporte déjà à elle seule près de 40 % de cette dette.
Cette contradiction entre le besoin des principales puissances de freiner le chaos, de limiter au maximum son extension, et celui tout aussi vital de défendre leurs propres intérêts impérialistes, est portée à son paroxysme au fur et à mesure que ce qui reste de l'Union Soviétique se délite et se désagrège.
Le chaos l'emporte
La décomposition, en aiguisant tous les traits de la décadence, et notamment ceux de l'impérialisme, bouleverse de façon qualitative la situation mondiale, en particulier les rapports inter-impérialistes.
Dans un contexte de barbarie toujours plus sanguinaire, où l'horreur côtoie de plus en plus l'absurdité absolue, absurdité à l'image d'un mode de production qui est devenu totalement caduc du point de vue historique, le seul avenir que la classe exploiteuse puisse désormais offrir à l'humanité, c'est celui du plus grand chaos de toute l'histoire.
Les rivalités impérialistes entre les Etats les plus développés du défunt bloc de l'Ouest se déchaînent dans le contexte du pourrissement sur pied, généralisé, du système capitaliste. Les tensions entre les a grandes démocraties» ne peuvent que s'aviver, en particulier entre les États-Unis et la puissance dominante du continent européen, l'Allemagne. Le fait que, jusqu'à présent, cet antagonisme se soit exprimé de façon feutrée, n'enlève rien à sa réalité.
Même si les fractions nationales les plus puissantes de la bourgeoisie mondiale peuvent avoir un intérêt commun face au chaos, cette communauté d'intérêts ne peut être que circonstancielle et limitée. Elle ne peut annuler la tendance naturelle et organique de l'impérialisme au déchaînement de la concurrence, des rivalités et des tensions guerrières. Aujourd'hui elle participe pleinement du chaos et de son aggravation. La foire d'empoigne à laquelle se livrent, et se livreront de plus en plus les grandes puissances impérialistes, ne peut avoir comme résultat que l'avancée de ce chaos au coeur de l'Europe, comme l'illustre tragiquement la barbarie guerrière en Yougoslavie.
La politique oscillante et incohérente de la part des Etats les plus solides du monde capitaliste se traduit par une instabilité croissante des alliances. Celles-ci sont et seront de plus en plus circonstancielles et sujettes à de multiples retournements. Ainsi la France, après avoir plutôt joué la carte allemande, peut très bien jouer demain la carte américaine, pour plus tard effectuer un nouveau virage. L'Allemagne, soutenant aujourd'hui le «centre» en Russie, peut choisir demain les républiques sécessionnistes. Le caractère contradictoire et incohérent de la politique impérialiste des grandes puissances exprime en dernière instance la tendance de la classe dominante à perdre le contrôle d'un système ravagé par sa décadence avancée : la décomposition.
Putréfaction, dislocation grandissante de l'ensemble de la société, voilà la perspective « radieuse» qu'offre à l'humanité ce système à l'agonie. Cela ne fait que souligner l'importance et l'extrême gravité des enjeux de la période historique actuelle, en même temps que l'immense responsabilité de la seule classe porteuse d'un réel avenir : le prolétariat.
RN, 18/11/91.
[1] [50] Rosa Luxemburg, La crise de la Social-démocratie, "Brochure de Junius ".
[2] [51] Plateforme du Courant Communiste International.
[3] [52] Sur la fausse
unité des pays industrialisés pendant la guerre du Golfe, voir l'article éditorial
de la Revue Internationale n° 64, 1er trimestre 1991.
[4] [53] "Résolution sur la situation internationale", point 5, idem.
[5] [54] Voir les articles "L'URSS en miettes", "Ex-URSS : Ce n'est pas le communisme qui s'effondre" (Revue Internationale) n° 66 et n° 67, 3e et 4e trimestres 1991).
[6] [55] "Résolution sur la situation internationale", point 4, juillet 1991, 9e congrès du CCI, Revue Internationale n° 67.
[7] [56] Sur l'attitude
respective de la Grande-Bretagne et de la France vis-à-vis des USA, voir
"Rapport sur la situation internationale" extraits", note
1, page 23 de la Revue Internationale
N° 67.
[8] [57] T. Kunugi, ex-secrétaire adjoint de l'ONU. Libération, 27/9/91.
[9] [58] Voir l'article "Bilan de 70 années de 'libération nationale'", dans ce numéro.
[10] [59] La France et l'Italie, avec d'interminables oscillations, ont aussi contribué à cette entreprise de déstabilisation meurtrière.
[11] [60] L'Allemagne, pas plus que n'importe quel autre Etat
capitaliste, ne saurait échapper aux lois de l'impérialisme régissant toute la
vie du capitalisme dans sa décadence. Le problème face aux poussées de
impérialisme allemand n'est pas, en soi, le désir ou la volonté de la
bourgeoisie allemande. Nul doute que cette bourgeoisie, ou du moins certaines
de ses fractions, sont inquiètes face à cette plongée dans la curée
impérialiste. Mais quelles que soient ces inquiétudes, elle sera contrainte
(ne serait-ce que pour empêcher qu'un concurrent prenne la place), d'affirmer
de plus en plus ses visées impérialistes. Comme dans le cas de la bourgeoisie
japonaise en 1940, où beaucoup de ses fractions étaient réticentes à entrer en
guerre, ce qui compte ce n'est pas la volonté, mais ce que la bourgeoisie est contrainte de faire.
[12] [61] L'Allemagne est encore occupée militairement par les USA et, pour l'essentiel, le contrôle sur l'ensemble des munitions de l'armée allemande est encore exercé par l'état-major américain. Les troupes allemandes n'ont pas d'autonomie au-delà de quelques jours. La brigade franco-allemande a notamment pour but de permettre une plus grande autonomie à l'armée allemande.
[13] [62] Récemment, les nationalistes « tchétchènes » menaçaient d'attentats les centrales nucléaires ; des trains de blindés, pouvant contenir des armes nucléaires tactiques, circulaient aux frontières de l'URSS en échappant à tout contrôle.
[14] [63] Voir d'un côté l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis des « Pays baltes » et ses velléités de pousser à la création d'une « République allemande de la Volga m, et de l'autre son soutien à ce qui reste de « centre » en URSS.
[15] [64] Ceci au delà du mensonge du « désarmement » qui ne supprime que les armes devenues obsolètes qui devaient de toute façon être mises à la casse et être remplacées par des armes plus modernes et sophistiquées.
Questions théoriques:
- Décomposition [29]
- Impérialisme [30]
Bilan de 70 années de luttes de « libération nationale » 2eme partie
- 6613 reads
II. Au 20e siècle, la « libération nationale », maillon fort de la chaîne impérialiste
Marx disait que la validité d'une théorie se démontre dans la pratique.
Soixante dix ans d'expériences tragiques pour le prolétariat ont tranché
clairement le débat sur la question nationale en faveur de la position de Rosa
Luxemburg, développée par la suite par les groupes de la Gauche Communiste et
surtout par Bilan, Internationalisme et notre Courant. Dans la première partie
de cet article, nous avons vu comment l'appui à la « libération nationale des peuples » a joué un rôle clé dans la
défaite de la première tentative révolutionnaire internationale du prolétariat
dans les années 1917-1923 (Revue
Internationale, n° 66). Dans cette seconde partie, nous allons voir comment
les luttes de libération nationale ont été un instrument des guerres et des
affrontements impérialistes qui ont dévasté la planète au cours des 70
dernières années.
1919-1945 derrière la « libération nationale » les manœuvres impérialistes
Pour le capitalisme, la première guerre mondiale marque la fin de sa période ascendante, et le début de son enfoncement dans le marasme de la lutte entre Etats nationaux pour le repartage d'un marché mondial fondamentalement saturé. Dans ce cadre, la formation de nouvelles nations et les luttes de libération nationale ont cessé d'être un instrument de l'expansion des rapports capitalistes et du développement des forces productives, et se sont transformées en une partie de l'engrenage des tensions impérialistes généralisées entre les différents camps capitalistes. Déjà avant la première guerre mondiale, lors des guerres dans les Balkans qui avaient donné lieu à 1’indépendance de la Serbie, du Monténégro, de l'Albanie, Rosa Luxemburg avait constaté que ces nouvelles nations avaient un comportement aussi impérialiste que les vieilles puissances, et qu'elles s'intégraient clairement dans la spirale sanglante qui menait à la guerre généralisée.
« Formellement, la Serbie mène sans nul doute une guerre de défense nationale. Mais les tendances de sa monarchie et de ses classes dirigeantes vont dans le sens de l'expansion, comme les tendances des classes dirigeantes de tous les Etats actuels (...). Il en est ainsi pour la tendance de la Serbie vers la côte adriatique, où elle a vidé avec l’Italie un véritable différend impérialiste sur le dos des albanais (...) Cependant, le point capital est le suivant : derrière l’impérialisme serbe, on trouve l’impérialisme russe. » ([1] [65])
Le monde tel qu'il est sorti de la première guerre mondiale, stoppée par l'affirmation révolutionnaire du prolétariat, était marqué par deux perspectives historiques opposées : l'extension de la révolution mondiale ou la survie du capitalisme englué dans une spirale de crises et de guerres. L'écrasement de la vague prolétarienne mondiale a signifié l'aiguisement des tensions entre le bloc vainqueur (Grande-Bretagne et France) et le grand vaincu (Allemagne), le tout aggravé par l'expansion des Etats-Unis qui constituait une menace pour tous.
Dans ce contexte historico-mondial, la « libération nationale » ne peut pas être considérée du point
de vue de la situation d'un pays particulier, puisque «Du point de vue marxiste il serait absurde d'examiner la situation d'un
seul pays pour parler d'impérialisme, parce que les différents pays capitalistes
sont rattachés par des liens très étroits. Et aujourd'hui, en pleine guerre,
ces liens sont incommensurablement plus forts. Toute l'humanité s'est convertie
en champ de bataille sanguinolent, et il n'est pas possible d'en sortir
isolément. Il y a des pays plus développés et d'autres moins développés, mais
la guerre actuelle les a tous frappés de telle manière qu'il est impossible
qu'aucun pays ne puisse sortir de lui-même de la conflagration. » ([2] [66]) Avec
cette méthode nous pouvons comprendre comment la « libération nationale » s'est transformée en mot d'ordre de
la politique impérialiste de tous les Etats : les vainqueurs directs de la première
guerre mondiale, la Grande-Bretagne et la France, l'ont employée pour
justifier le démembrement des empires vaincus (les empires austro-hongrois,
Ottoman et tsariste) et créer un cordon sanitaire autour de la Révolution
d'Octobre. Les USA l'ont élevée au rang de doctrine universelle, «principe» de la Société des Nations,
pour, d'un côté, combattre la révolution prolétarienne, et de l'autre, miner
les empires coloniaux de la Grande-Bretagne et de la France qui constituaient
l'obstacle principal à son expansion impérialiste. L'Allemagne, dès le début
des années 1920 avait fait de son « indépendance
nationale », contre le Traité de Versailles, le drapeau de son combat pour
redevenir une puissance impérialiste. Le principe «juste et progressiste» de la
« libération nationale de l'Allemagne » défendue en 1923 par le Parti communiste d'Allemagne (KPD) et l'Internationale Communiste (IC) à partir du second congrès s'est
transformé dans les mains du parti nazi en « droit pour l'Allemagne d'avoir un espace vital». Pour sa part,
l'Italie de Mussolini se considérait comme une «nation
prolétarienne» ([3] [67]) qui
revendiquait ses «droits naturels» en Afrique, dans les Balkans, etc.
L'oeuvre du Traité de Versailles
Au début des années 1920, les puissances victorieuses ont tenté d'implanter un «nouvel ordre mondial » qui corresponde à leurs intérêts. Leur principal instrument en fut le Traité de Versailles (1919), basé officiellement sur la «paix démocratique » et le « droit à l'autodétermination des peuples », qui octroyait l'indépendance à un ensemble de nations en Europe orientale et centrale : Finlande, Pays Baltes, Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie, Pologne.
L'indépendance de ces nations répondait à deux objectifs des impérialismes britannique et français : d'un côté, comme nous l'avons analysé dans la première partie de cette série d'arl’I.C.les (Revue internationale, n° 66), affronter la révolution prolétarienne, et de l'autre, créer autour de l'impérialisme allemand vaincu, une chaîne de nations hostiles qui bloqueraient son expansion dans cette zone qui, pour des raisons d'ordre stratégique, économique et historique, est son terrain d'influence naturel.
Le machiavélisme le plus retors n'aurait pu concevoir Etats plus instables, plus exposés dès le départ à de violents conflits internes, plus contraints à se mettre sous la tutelle de puissances supérieures pour servir leurs visées guerrières. La Tchécoslovaquie contenait deux nationalités historiquement rivales, tchèque et slovaque, et une importante minorité allemande dans les Sudètes. Les Etats Baltes incluaient de fortes minorités polonaises, russes et allemandes. En Roumanie, des minorités hongroises. En Bulgarie des minorités turques. En Pologne, des minorités allemandes. Mais le chef d'oeuvre fut sans nul doute, la Yougoslavie (aujourd'hui de triste actualité à cause des horribles bains de sang qui la meurtrissent). La «nouvelle» nation contenait six nationalités avec les niveaux de développement économique les plus disparates qu'on puisse imaginer (allant du développement économique de haut niveau de la Croatie ou de la Slovénie, au niveau semi-féodal du Monténégro). De plus, les zones d'intégration économique de ces différentes régions étaient situées dans les pays frontaliers : la Slovénie est un complément de l'Autriche, la Voïvodine, qui appartient à la Serbie, est une prolongation naturelle de la plaine hongroise. La Macédoine est séparée es autres par une barrière montagneuse qui l'unit à la Grèce et à la Bulgarie. Enfin, ces différentes nationalités se réclamaient de trois religions classiquement opposées dans l'histoire : catholiques, orthodoxes et musulmans. Pour comble, chacune de ces « nationalités » contenait elle-même des minorités de la nationalité voisine, et, pire encore, des Etats voisins : des minorités albanaise et hongroise en Serbie ; des minorités italienne et serbe en Croatie ; des minorités serbe, musulmane et croate en Bosnie-Herzégovine.
« Les petits Etats bourgeois récemment crées ne sont que les sous-produits de l'impérialisme. En créant, pour y trouver un appui provisoire, toute une série de petites nations, ouvertement opprimées ou officiellement protégées, mais en réalité vassales -l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Yougoslavie, la Bohème, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Arménie, la Géorgie, etc.- en les dominant au moyen des banques, des chemins de fer, du monopole des charbons, l’impérialisme les condamne à souffrir de difficultés économiques et nationales intolérables, de conflits interminables, de querelles sanglantes. » ([4] [68])
Les nouvelles nations ont adopté dès le début un comportement impérialiste clair, comme le disait l’I.C. : « Les petits Etats créés par des moyens artificiels, morcelés, étouffant au point de vue économique dans les bornes qui leur ont été prescrites, se prennent à la gorge et combattent pour s'arracher des ports, des provinces, de petites villes de rien au tout. Ils cherchent la protection des Etats plus forts, dont l'antagonisme s’accroît de jour en jour » ([5] [69]) Ainsi la Pologne manifeste ses ambitions sur l'Ukraine, provoquant une guerre contre le bastion prolétarien en 1920. Elle exerçait aussi une pression sur la Lituanie, appelant à la défense de la minorité polonaise dans ce pays. Pour contrecarrer l'Allemagne, elle s'est alliée à la France, se soumettant fidèlement aux desseins impérialistes de cette dernière.
La Pologne « libérée » tomba sous la dictature féroce de Pildsuski. Cette tendance à annuler rapidement les formalités de la démocratie parlementaire qui se développait dans la plupart des nouveaux pays (à l'exception de la Finlande et de la Tchécoslovaquie) contredisait l'illusion, sur laquelle L’I.C. en dégénérescence avait spéculé, selon laquelle la « libération nationale » devait s'accompagner d'une «plus grande démocratie». Au contraire, ce contexte impérialiste mondial, leurs propres tendances impérialistes, la crise économique chronique et leur instabilité congénitale, ont fait que ces nouvelles nations ont exprimé d'une façon extrême et caricaturale, les dictatures militaires, la tendance générale du capitalisme décadent au capitalisme d'Etat.
Les années 1930 ont fait tourner la tension impérialiste au rouge vif, démontrant que le Traité de Versailles n'était pas un instrument de la «paix démocratique» mais le combustible pour de nouveaux incendies impérialistes, plus importants encore. L'impérialisme allemand reconstruit entreprenait une lutte ouverte contre « l’ordre de Versailles », tentant de reconquérir l'Europe centrale et orientale. Sa principale arme idéologique était la « libération nationale » : il invoquait le « droit des minorités nationales » pour s'allier avec les sudètes en Tchécoslovaquie, impulsait la « libération nationale » de la Croatie pour vaincre l'hostilité serbe et mettre un pied en Méditerranée ; en Autriche, le discours était « union avec l’Allemagne », et dans les Etats baltes il offrait une «protection» contre la Russie.
L’« ordre de Versailles » se démantelait à grande vitesse. Le prétexte selon lequel ces nouveaux Etats auraient pu être une garantie de « paix et de stabilité», sur lequel avaient tant insisté les Kautskystes et les Social-démocrates quand ils ont donné leur aval à la «paix de Versailles », était totalement démenti. Pris dans le tourbillon impérialiste mondial, ils n'avaient d'autre choix que de s'y engloutir, contribuant ainsi à l'amplifier et l'aggraver.
Chine : le massacre du prolétariat donne le feu vert aux antagonismes impérialistes
Avec l'Europe centrale et orientale, la Chine allait constituer un des points chauds de la tension impérialiste mondiale. La bourgeoisie chinoise avait tenté en 1911 une révolution démocratique tardive, faible et rapidement condamnée à l'échec. L'effondrement de l'Etat impérial ouvrit la porte à la désintégration générale du pays en mille royaumes dominés par des Seigneurs de la Guerre qui s'affrontaient entre eux, lesquels, à leur tour, étaient manipulés par la Grande-Bretagne, le Japon, les USA et la Russie, dans la bataille sanglante que tous se livraient pour la domination de la position stratégique que représentait le sous-continent chinois.
Pour, l'impérialisme japonais, la Chine était une clé pour dominer tout l'Extrême-Orient. C'est avec ce but qu'il a soutenu « de façon désintéressée» la cause de l'indépendance de la Mandchourie, une des zones les plus industrielles de Chine, centre névralgique pour le contrôle de la Sibérie, de la Mongolie, et de tout le centre de la Chine. Après avoir utilisé entre 1924 et 1928 les services de Chang Tso Line, un ancien bandit converti en Maréchal et ensuite en Vice-roi de Mandchourie, le Japon s'en est débarrassé (par un attentat) pour pouvoir en 1931, envahir et occuper la Mandchourie, la transformer en un Etat souverain et l'élever au niveau d'un « empire » à la tête duquel on plaça Pou-Yi, le dernier descendant de la dynastie mandchoue.
L'expansion japonaise se heurtait à la Russie stalinienne dont la Chine était le champ d'expansion naturel. Pour faire valoir ses intérêts, Staline utilisa la trahison ouverte contre le prolétariat chinois dans les événements qui devaient mettre en évidence l'antagonisme irréconciliable qui existe entre « libération nationale» et révolution prolétarienne, et à l'inverse, la solidarité totale qui est établie entre «libération nationale» et impérialisme : « En Chine où se développait une lutte révolutionnaire prolétarienne, la Russie stalinienne chercha ses alliances dans le Kuomintang de Tchang Kai Tchek, obligeant le jeune parti communiste chinois à renoncer à son autonomie organisationnelle, le forçant à adhérer au Kuomintang, proclamant pour l’occasion le "Front des quatre classes"... Malgré cela, la situation économique désespérée et la poussée de millions de travailleurs ont provoqué l'insurrection des ouvriers de Shanghai : ils ont pris la ville contre les impérialistes et le Kuomintang en même temps. Les ouvriers insurgés, organisés par la base du Parti Communiste Chinois, ont décidé d'affronter l'armée de Libération de Tchang kai Tchek appuyée par Staline. Cela a contraint les cadres de l'Internationale à l'ignominie d'appeler une nouvelle fois les ouvriers à se soumettre aux ordres de Tchang Kai Tchek, ce qui fut lourd de conséquences. » ([6] [70])
Ce feu croisé d'intérêts impérialistes, auquel se joignaient activement les manoeuvres des impérialismes yankee et britannique, a provoqué une longue guerre de plus de trente ans, qui sema la mort, la destruction, la désolation aux dépens des ouvriers et des paysans chinois.
La guerre d'Ethiopie : un moment crucial dans le cours à la seconde guerre mondiale
L'impérialisme italien qui avait occupé la Libye et ensuite la Somalie tenta d'envahir l'Ethiopie, menaçant l'Egypte et la domination de l'impérialisme britannique sur la Méditerranée, sur l'Afrique et sur les communications avec l'Inde.
La guerre d'Ethiopie marqua un pas décisif, avec celle d'Espagne de 1936 ([7] [71]), dans le cours à la seconde guerre mondiale. Un aspect important de ce massacre fut les énormes efforts de propagande et de mobilisation idéologique de la population assaillie par les deux camps adverses, et surtout par le camp « démocratique » (France et Grande-Bretagne). Ces derniers, qui avaient intérêt à 1’« indépendance » de l'Ethiopie, levèrent l'étendard de sa « libération nationale», pendant que l'impérialisme italien invoquait une mission « humanitaire » et « libératrice » pour justifier l’invasion : le Negus n'avait pas aboli l'esclavage comme il l'avait promis.
La guerre éthiopienne a mis en évidence le fait que la « libération nationale» n'est qu'un cheval de bataille idéologique pour la guerre impérialiste, une préparation à l'orgie de nationalisme et de chauvinisme qu'allaient déployer les deux camps impérialistes, un moyen de mobilisation pour les boucheries de la seconde guerre mondiale. Comme le dénonçait Rosa Luxemburg :«(...) La phrase nationale (...) ne sert plus qu'à masquer tant Bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elles ne soient utilisées comme cri de guerre, dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de leur faire jouer leur rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes. »([8] [72])
1945 -1989 : La « libération nationale » instrument des blocs impérialistes
L'achèvement de la seconde guerre mondiale avec la victoire des impérialismes alliés s'est accompagné d'une aggravation qualitative des tendances du capitalisme décadent au militarisme et à l'économie de guerre permanente. Le bloc vainqueur se divisa en deux blocs impérialistes rivaux, les USA et l'URSS, qui délimitèrent leurs zones a'influence avec des réseaux serrés d'alliances militaires, l'OTAN et la Pacte de Varsovie, en soumettant ces pays sous influence au contrôle d'une myriade d'organisations de « coopération économique », de régulations monétaires, etc. Tout cela accompagné par un développement hallucinant des arsenaux nucléaires dont la puissance aurait déjà permis, dès le début des années 1960, de détruire le monde entier.
Dans de telles conditions, parler de « libération nationale » est une farce macabre : « (...) L’indépendance nationale est concrètement impossible, irréalisable dans le monde capitaliste actuel. Les grands blocs impérialistes dirigent la vie de tout le capitalisme, aucun pays ne peut s'échapper hors d'un bloc impérialiste sans aussitôt retomber sous la coupe d'un autre. (...) Il est absolument évident que les mouvements de libération nationale ne sont pas des pions que Staline ou Truman déplacent à leur guise l'un contre l'autre. Il n'en reste pas moins vrai que le résultat est le même. Ho Chi Minh, expression de la misère annamite, s il veut asseoir sont pouvoir de misère, devra, tout en faisant lutter ses hommes avec l'acharnement du désespoir, être à la merci de compétitions impérialistes, et se résigner à embrasser la cause d'un quelconque d'entre eux (...). » ([9] [73])
Dans cette période historique, les guerres régionales, présentées systématiquement comme «mouvements de libération nationale» n'ont été que différents épisodes de la concurrence sanglante entre les impérialismes des deux blocs.
La décolonisation
La vague d’ « indépendances nationales» en Afrique, en Asie, en Océanie, etc., qui a submergé le monde entre 1945 et 1960 s'inscrit dans une longue lutte de l'impérialisme américain pour évincer les vieux impérialismes coloniaux de leurs positions, et principalement leur rival le plus direct à cause de sa richesse économique, de la position stratégique de ses possessions, et de sa puissance navale : l'impérialisme britannique.
En même temps, les vieux empires coloniaux s'étaient transformes en fardeau pour les métropoles : avec la saturation du marche et le développement de la concurrence à l’échelle mondiale, avec les coûts chaque fois plus élevés de l'entretien des armées et des administrations coloniales, ils s'étaient transformés, de source de bénéfices en poids chaque jour plus lourd.
Certainement, les bourgeoisies locales avaient intérêt à ôter le pouvoir aux vieilles puissances, et leur organisation en mouvement de guérilla, ou en partis de « désobéissance civile», tous sous le drapeau de l'Union Nationale qui préconisait la soumission du prolétariat local à la « libération nationale », a joué un rôle dans ce processus. Mais ce rôle fut essentiellement secondaire et toujours dépendant des visées du bloc américain ou des tentatives du bloc russe de mettre à profit la « décolonisation » pour conquérir des positions stratégiques au delà de sa zone d'influence eurasiatique.
La décolonisation de l'empire britannique a illustré cela de la façon la plus claire possible : « Les retraits britanniques en Inde et en Palestine ont été les moments les plus spectaculaires de la démolition de l'empire, et le "fiasco" du canal de Suez en 1956 a mis fin à toute illusion que la Grande Bretagne était encore une "puissance mondiale de premier ordre ". » ([10] [74])
Les nouveaux Etats « décolonisés » naquirent avec des tares encore pires que ceux de la fournée de Versailles en 1919. Des frontières totalement artificielles tracées à la règle ; des divisions ethniques, tribales, religieuses ; des économies de monoculture agricole ou basées sur un type d'extraction minière ; des bourgeoisies faibles voire inexistantes ; des élites administratives et techniques peu préparées et dépendantes des vieilles puissances coloniales. Un exemple de cette situation catastrophique nous est donné par l'Inde : l'Etat récemment créé a subi en 1947 une guerre apocalyptique entre musulmans et hindous qui s'acheva par la sécession du Pakistan où se regroupa la grande majorité des musulmans. Les deux Etats ont livré depuis bien des guerres dévastatrices, et aujourd'hui la tension impérialiste qui y croît est un des plus grands facteurs d'instabilité mondiale. Ces deux pays, où le niveau de vie des populations est un des plus bas du monde, maintiennent cependant de coûteux investissements dans des installations nucléaires qui leur permettent de posséder la bombe atomique.
En 1971, dans le cadre de cette confrontation impérialiste permanente, l'Inde a patronné une «libération nationale» de la partie orientale du Pakistan, le Bengladesh, laquelle, entre autres absurdités de l'impérialisme, se trouve à plus de 2 000 kilomètres du Pakistan ! Cette guerre qui a coûté des centaines de milliers de morts, a donné lieu à un nouvel Etat, «indépendant», qui n'a rien connu d'autre que des coups d'Etat, des massacres, des dictatures, alors que la population meurt de faim ou 'inondations dévastatrices.
Les guerres israélo-arabes
Depuis 40 ans, le Moyen-Orient n'a pas cessé d'être un foyer de tension impérialiste à l'échelle mondiale à cause des énormes réserves de pétrole et de son rôle stratégique vital. Quand, avant la guerre de 1914, il était encore aux mains de l'Empire Ottoman moribond, il avait été la proie des ambitions expansionnistes de l'Allemagne, de la Russie, de la France, de la Grande Bretagne. Après la guerre mondiale, ce fut l'impérialisme britannique qui emporta le morceau avec quelques miettes pour le français (la Syrie et le Liban).
A cette époque les bourgeoisies locales de la zone commençaient à pousser vers l'indépendance. Mais ce qui a été fondamentalement déterminant pour la configuration de cette région, ce sont les manoeuvres de l'impérialisme britannique qui, au lieu d'atténuer les tensions et les rivalités existantes, les a multipliées et portées à une échelle plus vaste. «L'impérialisme anglais comme on le sait, en poussant ces latifundistes et la bourgeoisie arabe à entrer en lutte à ses côtés pendant la guerre mondiale, leur avait promis la constitution d'un Etat national arabe. La révolte arabe fut, en effet, d'une importance décisive dans l'écroulement du front turco-allemand au Proche-Orient. » ([11] [75]) Comme « récompense », la Grande-Bretagne a crée une série d'Etats «souverains» en Irak, en TransJordanie, en Arabie, au Yémen, opposés entre eux, avec des territoires économiquement incohérents, minés par les divisions ethniques et religieuses. Une manipulation savante et typique de l'impérialisme britannique qui, en les tenant tous divisés et avec des contentieux permanents, soumettait l'ensemble de la zone à ses projets. Mais il ne se contenta pas de cela, en plus « il ne tarda pas, pour la défense de ses intérêts propres, à solliciter, comme contrepartie, l’appui des sionistes juifs en leur disant que la Palestine leur serait remise tant au point de vue de l’administration que de la colonisation. » ([12] [76])
Si les juifs avaient été expulsés de beaucoup de pays durant le bas Moyen-âge, au 19e siècle nous assistons à leur intégration, tant des hautes couches, la bourgeoisie, comme des basses couches, le prolétariat, au sein des nations dans lesquelles ils vivaient. Cela révèle la dynamique d'intégration et de dépassement relatif des différences raciales et religieuses que développaient les nations capitalistes dans leur époque progressive. C'est seulement à la fin du siècle, c'est à dire, avec l'épuisement croissant de la dynamique d'expansion capitaliste, que des secteurs de la bourgeoisie juive lancèrent l'idéologie du sionisme (création d'un Etat sur la « terre promise »). Sa création en 1948 ne constitue pas seulement une manoeuvre de l'impérialisme américain pour déloger le britannique de la zone et pour entraver les tentatives russes de s'y immiscer, mais elle révèle aussi, en lien avec cet objectif impérialiste, le caractère réactionnaire de la formation de nouvelles nations : ce n'est pas une manifestation d'une dynamique d'intégration de populations comme au siècle passé, mais de séparation et d'isolement d'une ethnie pour l'utiliser comme moyen d'exclusion d'une autre, l'arabe.
Depuis le début, l'Etat israélien est une immense caserne en permanence sur pied de guerre qui utilise la colonisation des terres désertiques comme une arme militaire : les colons sont encadrés par l'armée et reçoivent une instruction militaire. En réalité, l'Etat d'Israël est dans son ensemble une entreprise économiquement ruineuse soutenue par d'énormes crédits des USA et basée sur une exploitation draconienne des ouvriers, aussi bien juifs que palestiniens. ([13] [77])
L'option américaine pour Israël, a rendu les Etats arabes plus instables, avec de plus grandes contradictions internes et externes, et a conduit ces derniers à l'alliance avec l'impérialisme russe. Leur drapeau idéologique a été depuis le début la « cause arabe » et la « libération nationale du peuple palestinien » qui est devenue le thème préféré de la propagande du bloc russe.
Comme dans beaucoup d'autres cas, ce qui leur importait le moins, c'était les palestiniens. Ces derniers furent entassés dans des camps de réfugiés en Egypte, en Syrie, etc., dans des conditions épouvantables, et utilisés comme main d'oeuvre bon marché au Koweït, en Arabie, en Egypte, au Liban, en Syrie, en Jordanie, etc., tout comme le faisait Israël. L'OLP, créée en 1963 comme mouvement de «libération nationale », s'est constituée depuis le début comme une bande de gangsters qui vole les ouvriers palestiniens les obligeant à déduire un impôt de leurs misérables salaires ; en Israël, au Liban, etc., l'OLP est un vulgaire fournisseur de main d'oeuvre palestinienne de laquelle elle extorque jusqu'à la moitié du salaire que paient les patrons. Ses méthodes de discipline dans les camps de réfugiés et dans les communautés palestiniennes n'ont rien à envier à celles de l'armée et de la police israélienne.
Nous devons nous rappeler finalement que les pires massacres de palestiniens ont été perpétrés par les gouvernements «frères » arabes : au Liban, en Syrie, en Egypte et, surtout, en Jordanie, où « ami » Hussein a bombardé brutalement les camps palestiniens causant des milliers de victimes en septembre 1970.
Il est important de souligner l'utilisation systématique des divisions ethniques, religieuses, etc., particulièrement importantes dans les zones les plus attardées de la planète, faite par l'impérialisme, tant de la part des grandes puissances comme des petites : « Que les populations juives et arabes de Palestine servent de pions aux intrigues impérialistes internationales, cela ne fait de doute pour personne. Que pour cela les meneurs du jeu suscitent et exploitent à fond les sentiments et préjugés nationaux, arriérés et anachroniques, grandement renforcés dans les masses par les persécutions dont elles furent l’objet, cela non plus n'est pas fait pour étonner. C est sur ce terrain que vient d'être ranimé un de ces incendies locaux : la guerre en Palestine, où les populations juives et arabes s'entretuent avec une frénésie chaque jour croissante et plus sanglante. » ([14] [78]) Avec ces manipulations, l'impérialisme joue à l'apprenti sorcier : il les exalte, les radicalise, les rend insolubles, car la crise historique du système n'offre aucun terrain pour pouvoir les absorber, jusqu'au point où, en certaines occasions, elles finissent par acquérir « une autonomie propre » aggravant et rendant plus contradictoires et chaotiques les tensions impérialistes.
Les guerres du Moyen-Orient n'ont pas eu comme objectif réel les « droits palestiniens », ni la « libération nationale » du peuple arabe. Celle de 1948 a servi à déloger l'impérialisme britannique de la zone. Celle de 1956 marque le renforcement du contrôle américain. Celles de 1967, 1973 et 1982 ont marqué la contre-offensive de l'impérialisme américain contre la pénétration croissante de l'impérialisme russe qui avait noué des alliances, plus ou moins stable, avec la Syrie, l'Egypte et l'Irak.
De toutes ces guerres, les Etats arabes sortirent affaiblis et l'Etat juif militairement renforcé. Mais le vrai vainqueur était le capital américain.
La guerre de Corée (1950-53)
Dans cette guerre ouverte en Extrême-Orient, entre le bloc impérialiste russe et l'américain, était en jeu l'arrêt de l'expansion russe, objectif qui fut atteint par le camp américain.
Le camp russe présentait son entreprise comme un « mouvement de libération nationale » : «La propagande stalinienne s'est particulièrement attachée à mettre en valeur ce fait que les "démocrates" auraient lutté pour l'émancipation nationale et dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'extraordinaire corruption régnant à l'intérieur de la clique dirigeante en Corée du Sud, ses méthodes "japonaises" en matière de police, son incapacité de féodaux à résoudre la question agraire (...) lui fournissaient des arguments indiscutables. Et Kim Ir Sen, de faire figure d'un nouveau Garibaldi. » ([15] [79])
L'autre élément mis en lumière par la guerre de Corée, est la formation, comme résultat direct de la confrontation inter-impérialiste, de deux Etats nationaux sur le sol d'une même nation : la Corée du Nord et du Sud, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, le Vietnam du Nord et du Sud. Cela, du point de vue du développement historique du capitalisme, est une aberration complète qui met encore plus en évidence la farce sanglante et ruineuse qu'est la « libération nationale ». L'existence de ces Etats a été directement liée non à un fait « national » mais à un fait impérialiste de la lutte d'un bloc contre l'autre. Dans la majorité des cas, ces «nations» se sont maintenues comme telles, au moyen d'une répression barbare, et leur caractère artificiel et contre-productif a pu être vérifié par l'écroulement retentissant, dans le cadre général de l'effondrement historique du stalinisme, de l'Etat d'Allemagne Orientale.
Vietnam
La lutte de « libération nationale » du Vietnam, commencée dans les années 1920, est toujours tombée dans l'orbite d'un camp impérialiste contre l'autre. Durant la 2e Guerre Mondiale, Ho Chi Minh et son Viet-Minh ont été approvisionnés en armes par les américains et les anglais, car ils jouaient un rôle contre l'impérialisme japonais. Après la 2e Guerre Mondiale, les américains et les anglais appuyèrent la France, puissance coloniale en Indochine, vu l'alignement prorusse des dirigeants vietnamiens. Même ainsi, les deux parties arrivent à un « compromis » en 1946 car, entre-temps, une série de révoltes ouvrières a éclaté à Hanoï et, pour les écraser, «(...) La bourgeoisie vietnamienne a dans le fond tout de même besoin des troupes françaises pour maintenir l'ordre dans ses affaires. » ([16] [80])
Cependant, à partir de 1952-53, avec la défaite de la guerre de Corée, l'impérialisme russe se tourne de manière décidée vers le Vietnam. Durant 20 ans, le Vietcong s'affrontera d'abord à la France, et ensuite aux Etats-Unis, dans une guerre sauvage où les deux camps commettront toutes les atrocités imaginables. Cela laissera comme résultat un pays ruiné qui, aujourd'hui, 16 ans après la « libération » non seulement ne s'est pas reconstruit, mais s'est effondré encore plus dans une situation catastrophique. Le caractère absurde et dégénéré de cette guerre se vérifie lorsque l'on voit que le Vietnam a pu être « libre » et « uni » seulement parce que les Etats-Unis, entre-temps, avaient gagné à leur bloc impérialiste l'énorme pièce constituée par la Chine stalinienne et parce que, en conséquence, le pygmée vietnamien devenait secondaire pour leurs visées.
Il faut souligner que le «nouveau Vietnam anti-impérialiste » agit, même avant 1975, comme puissance impérialiste régionale dans l'ensemble de l'Indochine : soumettant à son influence le Laos et le Cambodge où, sous prétexte de « libérer » le pays de la barbarie des Khmers Rouges, attachés à Pékin déjà lié au bloc américain, il a envahi le pays et a installé un régime basé sur une armée d'occupation.
La guerre du Vietnam, spécialement dans les années 1960, a suscité une formidable campagne des staliniens, des trotskistes, en compagnie d'autres secteurs bourgeois aux couleurs « libérales », présentant cette barbarie comme un facteur du réveil du prolétariat des pays industrialisés. De manière grotesque, les trotskistes prétendaient ressusciter les erreurs de l'Internationale Communiste sur la question nationale et coloniale sur «l'union entre les luttes ouvrières dans les métropoles et les luttes d'émancipation nationale dans le Tiers-Monde. » ([17] [81])
Un des « arguments » employé pour faire avaler cette mystification, était que la multiplication de manifestations contre la guerre du Vietnam aux USA et en Europe, était un facteur du réveil historique des luttes ouvrières depuis 1968. En réalité, la défense des luttes de « libération nationale », avec la défense des «pays socialistes », à la mode surtout dans les milieux étudiants, ont joué au contraire un rôle mystificateur et ont plutôt constitué une barrière de premier ordre contre la reprise de la lutte prolétarienne.
Cuba
Au cours des années 1960, Cuba a constitué un maillon fort de toute la propagande « anti-impérialiste ». Chaque étudiant politisé se devait d'avoir dans sa chambre des posters de 1' « héroïque guérillero » : Che Guevara. Aujourd'hui, la situation désastreuse que nous voyons à Cuba (émigrations massives, totale pénurie, même de pain), illustre parfaitement l'impossibilité totale d'une «indépendance nationale». Au début, les barbus de la Sierra Maestra n'avaient pas de sympathie spéciale pro-russe. Mais simplement, leur volonté de mener une politique un minimum « autonome » par rapport aux Etats-Unis, les a fatalement et inévitablement poussés dans les bras du capital russe.
En réalité, Fidel Castro était à la tête d'une fraction nationaliste de la bourgeoisie cubaine qui a adopté le «socialisme scientifique», éliminant nombre de ses « camarades » de la première heure, qui ont fini à Miami, c'est à dire, du côté du bloc américain, car sa seule chance de survie était dans le bloc russe. Celui-ci s'est payé avec intérêts de son « aide », entre autres manières, en se servant de Cuba comme sergent impérialiste en Ethiopie, en appui du régime pro-russe, au Yémen du Sud et, surtout, en Angola, où Cuba est arrivé à détacher 60 000 soldats. Ce rôle impérialiste de fournisseur de chair à canon dans les guerres africaines a coûté la vie à beaucoup d'ouvriers cubains, à ajouter aux africains morts pour leur «libération», et a influé tout autant que les manoeuvres du bloc yankee dans la misère atroce à laquelle ont été soumis le prolétariat et la population cubaine.
Les années 1980 : les « combattants de la liberté »
Après avoir arraché les unes après les autres les positions russes au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, le bloc américain a continué son offensive d'encerclement complet de l'URSS. C'est dans ce cadre que se situe la guerre d'Afghanistan où les USA répondent au coup de patte soviétique envahissant ce pays en 1979, par le parrainage d'une coalition de 7 groupes de guérilleros afghans. Ils les dotent des armes les plus sophistiquées avec lesquelles ils finissent par engluer les troupes russes dans une impasse. Ceci va accentuer l'énorme mécontentement existant dans toute l'URSS et va contribuer à l'écroulement spectaculaire du bloc russe en 1989.
Comme illustration de ce renforcement important du bloc américain, celui-ci pourra arracher le drapeau idéologique de la « libération nationale » au bloc russe que ce dernier avait pratiquement monopolisé durant les 30 dernières années.
Comme nous l'ayons montré tout au long de cet article, la « libération nationale » a été une arme que peuvent utiliser à leur guise les différents impérialismes : le camp fasciste l'a employée à toutes les sauces imaginables, tout comme le camp « démocratique». Cependant, depuis les années 1950, le stalinisme avait réussi à se présenter comme le bloc «progressiste» et « anti-impérialiste », habillant ses desseins du voile idéologique de la représentation des « pays socialistes» qui ne seraient pas « impérialistes » mais au contraire des «militants anti-impérialistes». Au comble du délire, il arrivait ainsi à présenter la « libération nationale» comme le passage direct au « socialisme », supercherie contre laquelle les Thèses sur la question nationale et coloniale, de 1’I.C. en 1920, malgré leurs erreurs, avaient insisté clairement sur la nécessité « de combattre énergiquement les tentatives faites par des mouvements émancipateurs qui ne sont en réalité ni communistes, ni révolutionnaires, pour arborer les couleurs communistes. »([18] [82])
Tout ce stratagème a été mis à bas dans les années 1980. Avec comme facteur principal le développement des luttes et de la conscience ouvrière, les innombrables virages et volte-face dictés par les nécessités impérialistes de la Russie, provoquèrent son usure : rappelons-nous, entre autres, le cas éthiopien. Jusqu'en 1974, le régime du Négus était dans le camp occidental, la Russie appuyait le Front de Libération Nationale de l'Erythrée converti en paladin du « socialisme ». Avec la chute du Négus, remplacé par les militaires «nationalistes» qui s'orientaient vers la Russie, les choses changèrent : alors l'Ethiopie s'est convertie en un régime «socialiste marxiste-léniniste » et le Front Erythréen s'est transformé du jour au lendemain en un « agent de l'impérialisme » en s'alignant derrière le bloc américain.
Apres 1989, la « libération nationale » fer de lance du chaos
Les événements de 1989, la chute retentissante du bloc de l'Est et l'effondrement des régimes staliniens, ont donné lieu a la disparition de la configuration impérialiste antérieure du monde, caractérisée par la division en deux grands blocs ennemis et par conséquent, à une explosion de conflits nationalistes.
L'analyse marxiste de cette nouvelle situation, déterminée par la compréhension du processus de décomposition du capitalisme ([19] [83]), permet de vérifier de manière concluante les positions de la Gauche Communiste contre la « libération nationale ».
Par rapport au premier aspect de la question, l'explosion nationaliste, nous voyons comment le tourbillon de l'effondrement du stalinisme crée une spirale sanglante de conflits inter-ethniques, des massacres, des pogromes ([20] [84]). Ce phénomène n'est pas spécifique aux anciens régimes staliniens. La majorité des pays africains a de vieux contentieux tribaux et ethniques qui, dans le cadre du processus de décomposition, se sont accélérés dans les dernières années conduisant à des massacres et des guerres interminables. De la même manière, l'Inde souffre de tensions nationalistes, religieuses et ethniques identiques, qui causent des milliers de victimes.
« Les conflits ethniques absurdes où les populations s'entre-massacrent parce qu'elles n'ont pas la même religion ou la même langue, parce qu'elles perpétuent des traditions folkloriques différentes, semblaient réservés, depuis des décennies, aux pays du "tiers-monde", l'Afrique, l'Inde ou le Moyen-Orient. Maintenant, c'est en Yougoslavie, à quelques centaines de kilomètres des métropoles industrielles d'Italie du Nord et d'Autriche, que se déchaînent de telles absurdités.
L'ensemble de ces mouvements révèle une absurdité encore plus grande : à l'heure où l'économie a atteint un degré de mondialisation inconnu dans l'histoire, où la bourgeoisie des pays avancés essaye, sans y parvenir, de se donner un cadre plus vaste que celui de la nation, comme celui de la CEE, pour gérer son économie, la dislocation des Etats qui nous avaient été légués par la seconde guerre mondiale en une multitude de petits Etats est une pure aberration, même du point de vue des intérêts capitalistes.
Quant aux populations de ces régions, leur sort ne sera pas meilleur qu'avant mais pire encore : désordre économique accru, soumission à des démagogues chauvins et xénophobes, règlements de comptes et pogroms entre communautés qui avaient cohabité jusqu'à présent et, surtout, division tragique entre les différents secteurs de la classe ouvrière. Encore plus de misère, d'oppression, de terreur, destruction de la solidarité de classe entre prolétaires face à leurs exploiteurs : voila ce que signifie le nationalisme aujourd'hui. »([21] [85])
Cette explosion nationaliste est la conséquence extrême, l'aggravation à leur plus haut niveau des contradictions, de la politique de l'impérialisme durant les 70 dernières années. Les tendances destructrices et chaotiques de la « libération nationale » occultées par les mystifications de « l’antiimpérialisme », du « développement économique », etc., et qui ont été clairement dénoncées par la Gauche Communiste, apparaissent aujourd'hui de manière brutale et extrême, dépassant les prévisions les plus pessimistes dans leur furie dévastatrice. La «libération nationale » dans la phase de décomposition se présente comme le fruit mûr de toute l'oeuvre aberrante, destructrice, développée par l'impérialisme.
« La phase de décomposition apparaît comme celle résultant de l'accumulation de toutes ces caractéristiques d'un système moribond, celle qui parachève et chapeaute trois quarts de siècle d'agonie d'un mode de production condamné par l'histoire. Concrètement, non seulement la nature impérialiste de tous les Etats, la menace de guerre mondiale, l'absorption de la société civile par le Moloch étatique, la crise permanente de l'économie capitaliste, se maintiennent dans la phase de décomposition, mais cette dernière se présente encore comme la conséquence ultime, la synthèse achevée de tous ces éléments. » ([22] [86])
Les mini-Etats qui émergent de la dislocation de l'ex-URSS ou de la Yougoslavie font preuve d'emblée de l'impérialisme le plus brutal. La Fédération Russe du « héros démocratique » Eltsine menace ses voisins et réprime l'indépendantisme de la République autonome tchétchène ; la Lituanie réprime sa minorité polonaise ; la Moldavie, sa minorité russe ; l'Azerbaïdjan s'affronte ouvertement à l'Arménie. L'immense sous-continent ex-soviétique donne lieu à 16 mini-Etats impérialistes qui peuvent très bien s'empêtrer dans des conflits mutuels qui feraient apparaître en comparaison la boucherie yougoslave insignifiante car, entre autres dangers, ils pourraient mettre en jeu les arsenaux atomiques dispersés dans l'ex-URSS.
Les grandes puissances utilisent, de manière relative vu le chaos existant, ces tensions nationalistes et toutes les poussées indépendantistes des nouveaux mini-Etats. Cette énième utilisation de la « libération nationale » ne peut avoir que des conséquences encore plus catastrophiques et chaotiques que par le passé. ([23] [87])
Plus que jamais, le prolétariat doit reconnaître la «libération nationale », l’« indépendance » ou l’« autonomie » nationales, comme une politique, des mots d'ordre, des drapeaux, partie intégrante à cent pour cent de l'ordre réactionnaire et destructeur du capitalisme décadent. Contre celle-ci, il doit développer sa propre politique : l'internationalisme, la lutte pour la révolution mondiale.
Adalen, 18 novembre 1991
[1] [88] La crise de la social-démocratie, Rosa Luxemburg, chapitre 7.
[2] [89] Lénine : intervention à la 7e conférence du POSDR en mai 1917, « Rapport sur la situation actuelle».
[3] [90] Concept qui sera repris plus tard par le « marxiste-léniniste » Mao-Tsé-Toung.
[4] [91] 2e congrès de l’I.C. : « Le monde capitaliste et l'Internationale Communiste », 1e partie, « Les relations internationales après Versailles. »
[5] [92] 2e congrès de l’I.C., op.cité, idem.
[6] [93] Internacionalismo, n° 1 : « Paix démocratique, lutte armée et marxisme ».
[7] [94] Nous n'analyserons pas la guerre d'Espagne dans cet article, étant donné que nous avons publié de nombreux articles sur cette question dans notre Revue Internationale (n° 7, 25, 47) ainsi qu'une brochure qui rassemble tous les textes de Bilan sur ce sujet. Les mystifications antifasciste et nationaliste qui ont inondé en masse le prolétariat local et international ont caché la réalité,: la guerre espagnole fut une épisode clé, avec l'Ethiopie, dans la maturation de la seconde guerre mondiale.
[8] [95] La crise de la social-démocratie, ch.7.
[9] [96] Internationalisme, n°21, p. 25, mai 1947, « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ».
[10] [97] Revue Internationale, n° 17, p. 33, «La Grande Bretagne depuis la seconde guerre mondiale ».
[11] [98] Bilan, n° 32, « Le conflit Arabo-Juif en Palestine », juin-juillet 1936. M. Idem.
[12] [99] Idem.
[13] [100] «Les derniers événements nous ont gratifiés d'un nouvel Etat : l'Etat d'Israël. Nous n'avons pas l'intention, dans le cadre de cet article, de nous étendre sur le problème juif. (...) Le devenir du "peuple" juif, ne consiste pas dans la réinstallation de son autonomie et de son droit national, mais dans la disparition de toute frontière et de toute notion d'autonomie et d'existence nationale. Les persécutions sanglantes des dernières années et de la dernière guerre contre les juifs pour aussi tragiques qu'elles furent, signifient cependant moins un fait particulier que la barbarie de la société décadente, se débattant dans les convulsions de son agonie, et d'une humanité ne parvenant pas à trouver la voie de son salut : le Socialisme. »
[14] [101] « Sur les cas particuliers », Internationalisme, n°35, juin 1948, p.18, organe de la Gauche Communiste de France.
[15] [102] Internationalisme, n°45, p. 23 : «La guerre en Corée », 1950.
[16] [103] Internationalisme, n° 13, «La question nationale et coloniale », septembre 1946.
[17] [104] Voir la critique de cette position dans la première partie de cet article, Revue Internationale, n° 66.
[18] [105] « Thèses sur la question nationale et coloniale», point 11/5, 2 Congrès de L’I.C., mars 1920.
[19] [106] Voir Revue Internationale, n° 57 et n° 62.
[20] [107] Pour une analyse de ces événements, voir « La barbarie nationaliste » dans Revue Internationale n° 62.
[21] [108] Révolution communiste ou destruction de l’humanité, Manifeste du 9e congrès du C.C.I.
[22] [109] Revue Internationale, n° 62, « La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme », mai 1990.
[23] [110] Voir l'article « Vers le plus grand chaos de l'histoire », dans ce n°.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [111]
Approfondir:
- La question nationale [112]
Questions théoriques:
- Impérialisme [30]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question nationale [113]
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [1° partie]
- 5156 reads
Du communisme primitif au socialisme de l'utopie
Introduction
Depuis sa fondation, et encore plus depuis les événements considérables qui ont provoqué l'effondrement du bloc de l'Est et de l'URSS elle-même, le CCI a publié de nombreux articles combattant le mensonge selon lequel les régimes staliniens seraient un exemple de « communisme », et donc la mort du stalinisme signifierait la mort du communisme.
Nous avons démontré l'énormité d'un tel mensonge en confrontant la réalité du stalinisme aux buts et aux principes véritables du communisme. Le communisme est international et internationaliste, et vise à un monde sans nations. Le stalinisme est férocement nationaliste et impérialiste. Le communisme veut dire l'abolition du salariat et de toutes les formes d'exploitation. Le stalinisme a imposé un niveau d'exploitation des plus cruels précisément à travers le système salarial. Le communisme signifie une société sans État et sans classe dans laquelle les être humains contrôlent librement leur propre pouvoir social. Le stalinisme, c'est l'omniprésence d'un État totalitaire, d'une discipline militariste et hiérarchique imposée sur la majorité par une minorité privilégiée de bureaucrates. Et ainsi de suite ([1] [114]). Bref, le stalinisme n'est qu'une expression brutale, aberrante du capitalisme décadent.
Nous avons également montré comment cette campagne de mensonges a été utilisée pour désorienter et déboussoler la seule force sociale capable de construire une société communiste authentique : la classe ouvrière. A l'Est, la classe ouvrière a vécu directement à l'ombre du mensonge stalinien, ce qui a eu sur elle un effet désastreux, la remplissant pour sa grande majorité, d'une haine totale envers tout ce qui a à voir avec le marxisme, le communisme et la Révolution prolétarienne d'Octobre 1917. Le résultat, c'est qu'avec la chute de la prison stalinienne, elle est tombée sous l'emprise des idéologies les plus réactionnaires, le nationalisme, le racisme, la religion, et de la croyance pernicieuse dans le fait que le salut réside dans la voie de « l'occident démocratique ». A l'Ouest, cette campagne a eu pour but principal de bloquer la maturation de la conscience qui s'est développée dans la classe ouvrière au cours des années 1980. Là où réside l'essentiel du piège, c'est qu'il ôte à la classe ouvrière toute perspective à ses combats. Dans le sillage des événements catastrophiques des deux dernières années (la guerre du Golfe, la guerre en Yougoslavie, la famine, la récession), tout le blabla triomphant sur la victoire du capitalisme, le « nouvel ordre » de paix et d'harmonie que devait engendrer la fin de la « guerre froide » résonne déjà bien creux. Mais ce qui intéresse vraiment le capitalisme, c'est que la partie négative du message passe : la fin du communisme signifie la mort de tout espoir de changer l'ordre existant ; les révolutions ne peuvent aboutir qu'à créer des choses bien pires que celles qu'elles ont combattues ; il n'y a rien d'autre à faire sinon se soumettre à l'idéologie des loups qui se mangent entre eux, du capitalisme en décomposition. Dans cette « philosophie » bourgeoise du désespoir, non seulement le communisme mais aussi la lutte de classe deviennent des utopies démodées et discréditées.
La force de l'idéologie bourgeoise réside essentiellement dans le fait que c'est la bourgeoisie qui a le monopole des moyens de propagande de masse ; elle répète sans fin les mêmes mensonges et ne laisse aucune place à l'expression de réels points de vue alternatifs. Dans ce sens, Goebbels est vraiment le « théoricien » de la propagande bourgeoise : un mensonge suffisamment répété devient une vérité, et plus le mensonge est énorme, plus il marche. Et le mensonge selon lequel le stalinisme c'est le communisme est certainement énorme, un mensonge stupide, évident, ignoble mais qui, à première vue, marche.
Le mensonge est si évident pour quiconque s'y arrête quelques minutes, que la bourgeoisie ne peut se payer le luxe de le répandre tel quel. Dans tous les discours politiques qu'on nous tient, on peut entendre toutes sortes de boniments sur les régimes staliniens, des gens qui s'y réfèrent comme si c'était du communisme et les opposent au capitalisme, mais qui, dans la phrase suivante, admettent « bien sûr » que ce n'est pas du vrai communisme, que ce n'est pas ce que Karl Marx avait comme idée du communisme. Cette contradiction contient des dangers en puissance pour la classe dominante, et c'est pourquoi elle a besoin de tuer de telles idées dans l’œuf, avant qu'elles n'amènent à une réelle clarification.
Elle le fait de diverses manières. Face aux éléments politiques les plus conscients, elle offre des alternatives « marxistes » sophistiquées comme le « trotskisme » qui se spécialise dans la dénonciation du « rôle contre-révolutionnaire du stalinisme », tout en développant en même temps qu'il y aurait des « acquis ouvriers » à défendre dans les régimes staliniens, comme la propriété étatique des moyens de production, et que ceux-ci représenteraient, pour d'obscures raisons, quand même une « transition » vers le communisme authentique. En d'autres termes, le même mensonge sur l'identité du stalinisme et du communisme, mais dans un emballage « révolutionnaire ».
Mais nous vivons dans un monde où la majorité des ouvriers se désintéresse de la politique. Et c'est en grande partie dû au cauchemar stalinien lui-même qui a, des décennies durant, servi à dégoûter les ouvriers de toute activité politique. Si elle veut étayer son grand mensonge sur le stalinisme, l'idéologie bourgeoise a besoin de quelque chose qui touche plus massivement et qui soit beaucoup moins ouvertement politique que le trotskisme et ses variantes. Ce qu'elle offre, la plupart du temps, c'est le cliché banal sur lequel elle s'appuie pour réussir à piéger quand même ceux qui comprennent que le stalinisme n'est pas du communisme : nous faisons référence au refrain si souvent répété : c'est un bel idéal, mais ça ne marchera jamais.
Le premier but de la série d'articles que nous entamons ici, c'est de réaffirmer la position marxiste selon laquelle le communisme n'est pas une belle idée. Comme le dit Marx dans l'Idéologie allemande, « Le communisme n'est pas pour nous un état de choses qu'il convient d'établir, un idéal auquel la réalité devra se conformer. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses. Les conditions de ce mouvement résultent des données préalables telles qu'elles existent présentement. » ([2] [115])
Environ vingt ans plus tard, Marx exprimait la même pensée dans ses réflexions sur l'expérience de la Commune de Paris : « La classe ouvrière n'a pas d'utopies toutes faites à introduire par décret du peuple. Elle sait que pour réaliser sa propre émancipation, et avec elle cette forme de vie plus haute à laquelle tend irrésistiblement la société actuelle de par sa propre action économique, elle aura à passer par de longues luttes, par toute une série de processus historiques, qui transformeront complètement les circonstances et les hommes. Elle n'a pas d'idéal à réaliser mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s'effondre » ([3] [116]).
Contrairement à l'idée selon laquelle le communisme ne serait rien d'autre qu'une « utopie toute faite » inventée par Marx et d'autres bonnes âmes, le marxisme insiste sur le fait que la tendance au communisme est déjà contenue dans cette société. Juste avant le passage de L'idéologie allemande cité plus haut, Marx souligne « les prémisses qui existent maintenant » pour la transformation communiste :
- le développement des forces productives que le capital a lui-même créé et sans lequel il ne peut y avoir d'abondance ni de pleine satisfaction des besoins humains, sans lequel, en d'autres termes « seules l'indigence et la misère deviendraient générales et on verrait fondamentalement renaître la lutte pour le nécessaire ; ce serait le retour de toute la vieille misère » ([4] [117]) ;
- l'existence d'un marché mondial sur la base de ce développement sans lequel « le communisme ne pourrait avoir qu'une existence locale » alors que « le communisme n'est possible concrètement que comme le fait des peuples dominants, accompli d'un seul coup et simultanément, ce qui suppose le développement universel des forces productives et du commerce mondial qui s'y rattache » ([5] [118]) ;
- la création d'une grande masse non possédante, le prolétariat, qui affronte ce marché mondial comme une puissance étrangère intolérable ;
- la contradiction croissante entre la capacité du système capitaliste de produire des richesses et la misère que connaît le prolétariat.
Dans le passage de La guerre civile en France, Marx souligne une autre idée qui est plus que jamais valable aujourd'hui : le prolétariat n'a qu'à libérer le potentiel contenu dans « la vieille société qui s'effondre ». Comme on le développera ailleurs, le communisme est présenté ici à la fois comme possibilité et comme nécessité : une possibilité parce que sont créées les capacités productives qui peuvent satisfaire les besoins matériels de l'humanité, ainsi que la force sociale, le prolétariat, qui a des intérêts directs et « égoïstes » au renversement du capitalisme et à la création du communisme ; et une nécessité parce qu'à un certain degré de leur développement, ces forces productives elles-mêmes se révoltent contre les rapports capitalistes au sein desquels elles se sont développées et ont prospéré antérieurement, et que s'ouvre une période de catastrophes qui menace l'existence même de la société, l'humanité elle-même.
En 1871, Marx déclarait prématurément que la société bourgeoise s'effondrait ; aujourd'hui, dans les dernières étapes du capitalisme décadent, l'effondrement nous cerne et la nécessité de la révolution communiste n'a jamais été plus grande.
LE COMMUNISME AVANT LE PROLÉTARIAT
Le communisme est le mouvement réel, et le mouvement réel est le mouvement du prolétariat. Un mouvement qui commence sur le terrain de la défense des intérêts matériels contre les empiétements du capital, mais qui est contraint de mettre en question et en fin de compte, d'affronter les fondements mêmes de la société bourgeoise. Un mouvement qui devient conscient de lui-même à travers sa propre pratique, qui avance vers son but à travers une autocritique constante. Le communisme est donc « scientifique » (Engels) ; c'est le « communisme critique » (Labriola).
Le but principal de ces articles est de démontrer précisément que, pour le prolétariat, le communisme n'est pas une utopie toute faite, une idée statique, mais une conception en évolution, en développement, qui a grandi en âge et en sagesse avec le développement des forces productives et la maturation subjective du prolétariat au cours de l’expérience historique qu'il a accumulé. Nous examinerons donc comment la notion de communisme et les moyens de le réaliser ont gagné en profondeur et en clarté au travers des travaux de Marx et Engels, des contributions de l'aile gauche de la social-démocratie, de la réflexion sur le triomphe puis l'échec de la Révolution d'Octobre par les fractions communistes de gauche, etc. Mais le communisme est plus ancien que le prolétariat : selon Marx, nous pouvons même dire que « le mouvement de l'histoire (...) est un acte de genèse » du communisme ([6] [119]).
Pour montrer que le communisme est plus qu'un idéal, il faut montrer que le communisme surgit du mouvement prolétarien et précède donc Marx ; mais pour comprendre ce qui est spécifique au communisme prolétarien « moderne », il est également nécessaire de le comparer et de le distinguer des formes de communisme antérieures à l'existence du prolétariat, ainsi que des premières formes immatures du communisme prolétarien lui-même qui expriment un processus de transition entre le communisme pré-prolétarien et sa forme moderne, scientifique. Comme le dit Labriola, « Le communisme critique ne s'est jamais refusé, et il ne se refuse pas, à accueillir la multiple et riche suggestion idéologique, éthique, psychologique et pédagogique qui peut venir de la connaissance et de l'étude de toutes les formes de communisme, depuis Phalée de Calcédoine jusqu'à Cabet. Bien plus, c'est par l'étude et la connaissance de ces formes que se développe et se fixe la conscience de la séparation du socialisme scientifique d'avec tout le reste » ([7] [120]).
LA SOCIÉTÉ DE CLASSES, UNE ÉTAPE PASSAGÈRE DANS L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ
D'après la sagesse conventionnelle, le communisme ne peut pas marcher parce qu'il va à l'encontre de la « nature humaine ». L'esprit de compétition, l'avidité, la nécessité de faire mieux que le voisin, le désir d'accumuler des richesses, le besoin de l'État, tout cela, nous dit-on, est inhérent à la nature humaine, aussi ancré que le besoin de se nourrir et d'avoir une activité sexuelle. Rien qu'une connaissance minimale de l'histoire de l'humanité rejette cette version de la nature humaine.
Durant la plus grande part de son histoire, pendant des centaines de milliers, peut-être des millions d'années, l'humanité a vécu dans une société sans classe, formée de communautés où l'essentiel des richesses était partagé, sans que n'interviennent ni échange, ni argent ; une société organisée non par les rois ou les prêtres, les nobles ou la machine étatique mais par l'assemblée tribale. C'est à un tel type de société que se réfèrent les marxistes, lorsqu'ils parlent de « communisme primitif ». La notion de « communisme primitif » est profondément déconcertante pour la bourgeoisie et toute son idéologie ; aussi fait-elle tout ce qu'elle peut pour la nier ou la minimiser. Conscients du fait que la conception marxiste de la société primitive fut grandement influencée par les travaux de Lewis Henry Morgan sur les Iroquois et d'autres tribus d'« indiens d'Amérique », les anthropologues académiques modernes expriment beaucoup de mépris pour les recherches de Morgan, faisant ressortir telle ou telle inconsistance sur les faits, telle ou telle erreur secondaire, et ils finissent par mettre en question l'ensemble de sa contribution. Ou bien tombant dans l'empirisme le plus borné, ils nient toute possibilité de connaître quoi que ce soit de la préhistoire de l'humanité à partir de l'étude des peuples primitifs survivants. Ou bien encore ils soulignent tous les défauts et toutes les limitations des sociétés primitives en vue d'abattre un homme de paille : l'idée selon laquelle ces sociétés seraient une sorte de paradis, libéré des souffrances et de l'aliénation.
Mais le marxisme n'idéalise pas ces sociétés. Il est conscient qu'elles étaient le résultat nécessaire, non pas de quelque bonté humaine innée, mais du faible développement des forces productives qui contraignait les premières communautés humaines à adopter une structure « communiste » afin de survivre, tout simplement. L'appropriation par une partie de la société d'un quelconque surtravail, aurait signifié immédiatement la disparition de l'autre partie réduite à la misère totale. Les conditions ne permettaient pas la production d'un surplus suffisant à l'entretien d'une classe privilégiée. Le marxisme est conscient que ce communisme était restrictif et ne permettait pas le plein épanouissement de l'individu. C'est pourquoi, ayant parlé de « la dignité personnelle, la droiture, la force de caractère et la vaillance » des peuples primitifs survivants, Engels, dans ses fructueux travaux sur l'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État ([8] [121]), ajoutait l'explication suivante : dans ces communautés, « la tribu restait pour l'homme la limite, aussi bien en face de l'étranger que vis-à-vis de soi-même : la tribu, la gens et leurs institutions étaient sacrées et intangibles, constituaient un pouvoir supérieur, donné par la nature, auquel l'individu restait totalement soumis dans ses sentiments, ses pensées et ses actes. Autant les hommes de cette époque nous paraissent imposants, autant ils sont indifférenciés les uns des autres, ils tiennent encore, comme dit Marx, au cordon ombilical de la communauté primitive » ([9] [122]).
Ce communisme de petits groupes, souvent hostiles aux autres tribus ; ce communisme dans lequel l'individu était dominé par la communauté ; ce communisme de la pénurie est très différent du communisme plus avancé de demain qui sera celui de l'unification du genre humain, de la réalisation mutuelle de l'individu et de la société, le communisme de l'abondance. C'est pourquoi le marxisme n'a rien en commun avec les diverses idéologies « primitivistes » qui idéalisent l'ancienne condition de l'homme et expriment une aspiration nostalgique à y revenir ([10] [123]).
Néanmoins, le fait même que ces communautés aient existé, et existé comme produit de la nécessité matérielle, nous fournit une preuve supplémentaire que le communisme n'est ni une simple « bonne idée », ni quelque chose qui « ne marchera jamais ». C'est ce qu'a souligné Rosa Luxemburg dans son Introduction à l'économie politique :
« Morgan a fourni au socialisme scientifique un nouveau et puissant appui. Tandis que Marx et Engels avaient, par la voie de l'analyse économique du capitalisme, démontré pour le proche avenir l'inévitable passage de la société à l'économie communiste mondiale et donné ainsi aux aspirations socialistes un fondement scientifique solide, Morgan a fourni dans une certaine mesure à l’œuvre de Marx et Engels tout son puissant soubassement, en démontrant que la société démocratique communiste englobe, quoique sous des formes primitives, tout le long passé de l'histoire humaine avant la civilisation actuelle. La noble tradition du lointain passé tendait ainsi la main aux aspirations révolutionnaires de l'avenir, le cercle de la connaissance se refermait harmonieusement, et dans cette perspective, le monde actuel de la domination de classe et de l'exploitation, qui prétendait être le nec plus ultra de la civilisation, le but suprême de l'histoire universelle, n'était plus qu'une minuscule étape passagère dans la grande marche en avant de l'humanité » ([11] [124]).
LE COMMUNISME EN TANT QUE RÊVE DES OPPRIMÉS
Le communisme primitif n'était pas statique. Il est passé par diverses étapes, et, finalement, face aux contradictions insurmontables, s'est dissous et a donné naissance aux premières sociétés de classe. Mais les inégalités de la société de classe ont, a leur tour, donné naissance à des mythes et des philosophies où s'exprimait un désir plus ou moins conscient de se débarrasser des antagonismes de classe et de la propriété privée. Les classiques de la mythologie tels Hésiode et Ovide ont raconté le mythe de l'Age d'or, du temps où il n'y avait pas de différence entre « le mien » et « le tien » ; certains philosophes grecs ont ensuite « inventé » les sociétés parfaites où tout était mis en commun. Dans ces songeries, la mémoire pas si ancienne, d'une réelle communauté tribale est mélangée aux mythes bien plus anciens de la chute de l'homme d'un paradis originel.
Mais c'est dans les périodes de crise sociale et de révolte de masse contre le système de classe du moment que les idées communistes se généralisent, deviennent populaires et donnent lieu à de véritables tentatives de les mettre en pratique. Dans la grande révolte de Spartacus contre l'Empire romain décadent, les esclaves révoltés ont fait quelques tentatives désespérées et de courte durée pour établir des communautés. Mais la tendance au paradigme ([12] [125]) « communiste » à cette époque était bien sûr représentée par le christianisme qui a commencé, comme Engels et Luxemburg l'ont montré, comme une révolte des esclaves et d'autres classes écrasées sous le joug du système romain, avant d'être adopté par l'Empire romain décadent pour devenir ensuite l'idéologie officielle de l'ordre féodal. Les premières communautés chrétiennes prêchaient la fraternité humaine universelle et ont tenté d'instituer un communisme des biens. Mais comme Rosa Luxemburg le démontre dans son texte Le socialisme et les Églises, c'est là que résidait précisément la limitation du communisme chrétien : il ne posait pas l'expropriation révolutionnaire de la classe dominante, ni la mise en commun de la production comme le communisme moderne. Il demandait simplement que les riches soient charitables et partagent leurs biens avec les pauvres ; c'était une doctrine prônant le pacifisme social et la collaboration de classe qui pouvait être facilement adaptée aux besoins de la classe dominante. L'immaturité de cette vision du communisme provenait de l'immaturité des forces productives. Ceci s'applique d'une part aux capacités de production de l'époque, car dans une société mourant d'une crise de sous-production, ceux qui se révoltaient contre elle ne pouvaient rien envisager de mieux que le partage de la pauvreté ; et d'autre part au caractère des classes exploitées et opprimées qui constituaient la véritable force motrice à l'origine de la révolte chrétienne. Ces classes n'avaient ni objectif commun, ni perspective historique. « Pour tous ces éléments, il n'y avait absolument pas de voie commune vers l'émancipation. Pour tous, le paradis était perdu dans le passé : pour les hommes libres ruinés, c était tout en même temps l'ancienne « polis », la cité et l'État dont leurs ancêtres avaient été les citoyens ; pour les esclaves captifs de guerre, l'époque où ils étaient libres ; pour les petits paysans, le système social des Gentils aujourd'hui aboli et la propriété commune ». Voilà comment Engels, dans L'histoire du christianisme primitif ([13] [126]), décrit la vision essentiellement nostalgique de la révolte chrétienne, au regard tourné vers le passé. Il est vrai que le christianisme, en continuité de la religion hébraïque, avait fait un pas en avant par rapport aux diverses mythologies païennes, du fait qu'elle incarnait une rupture avec les anciennes visions cycliques du temps, et qu'elle développait une vision de l'humanité prise dans un drame historique tourné vers l'avenir. Mais les limitations internes des classes qui avaient exprimé cette révolte, faisaient que cette histoire était toujours vue en termes messianiques et mythifiés, et le salut futur qu'elle promettait était un Eschaton ([14] [127]) au-delà des frontières de ce monde.
On peut globalement dire la même chose des nombreuses révoltes paysannes contre le féodalisme, bien qu'on rapporte du fier prédicateur Lollard, John Ball, l'un des leader de la grande révolte des paysans en Angleterre en 1381, la déclaration suivante : « Rien ne pourra aller bien en Angleterre tant que tout ne sera pas géré en commun ; quand il n'y aura plus ni lords, ni vassaux… ». De telles revendications vont au-delà d'un simple communisme des biens, et nous mènent à la vision de la propriété commune de l'ensemble des richesses sociales (et ceci peut-être parce que les Lollards étaient déjà des précurseurs de mouvements ultérieurs caractéristiques de l'émergence du capitalisme). Mais de façon générale, les révoltes paysannes souffraient des mêmes limitations fondamentales que les révoltes d'esclaves. La fameuse devise de la révolte de 1381, « Quand Adam bêchait et qu'Ève filait, qui donc alors était seigneur ? », avait une merveilleuse puissance poétique, mais elle résumait aussi les limitations du communisme paysan qui, tout comme les premières révoltes chrétiennes, était condamné à regarder en arrière un passé idyllique, vers l'Eden lui-même, vers les premiers chrétiens, vers « la véritable liberté anglaise d'avant le joug normand » ([15] [128])... Ou bien s'il regardait de l'avant, c'était avec la vision des premiers chrétiens d'un millénium apocalyptique que le Christ de retour dans toute sa gloire viendrait instaurer. Les paysans n'étaient pas la classe révolutionnaire de la société féodale, même si leurs révoltes ont aidé à saper les fondements de l'ordre féodal et ont pavé le chemin de l'émergence du capitalisme. Et comme ils ne portaient aucun projet de réorganisation de la société, ils ne pouvaient voir le salut que venant de l'extérieur de Jésus, des « bons rois » mal instruits par de traîtres conseillers, de héros comme Robin des bois.
Le fait que ces rêves communistes aient pu avoir de l'emprise sur les masses, montre qu'ils correspondaient à de réels besoins matériels, de la même façon que les rêves des individus expriment de profonds désirs non réalisés. Mais comme les conditions historiques ne pouvaient permettre leur réalisation, ils étaient condamnés à ne rester que des rêves.
LES PREMIERS MOUVEMENTS DU PROLÉTARIAT
« Dès sa naissance, la bourgeoisie était grevée de son contraire : les capitalistes ne peuvent pas exister sans salariés et à mesure que le maître des corporations du Moyen-âge devenait le bourgeois moderne, dans la même mesure le compagnon des corporations et le journalier libre devenaient le prolétaire. Et même si, dans l'ensemble, la bourgeoisie pouvait prétendre représenter également, dans la lutte contre la noblesse, les intérêts des diverses classes laborieuses de ce temps, on vit cependant, à chaque grand mouvement bourgeois, se faire jour des mouvements indépendants de la classe qui était la devancière plus ou moins développée du prolétariat moderne. Ainsi, au temps de la Réforme et de la Guerre des Paysans en Allemagne, la tendance de Thomas Münzer ; dans la grande Révolution anglaise, les niveleurs ; dans la grande Révolution française, Babeuf » ([16] [129]).
Münzer et le royaume de Dieu
Dans La Guerre des Paysans en Allemagne, Engels élabore sa thèse sur Münzer et les anabaptistes. Il considérait que ceux-ci représentaient un courant prolétarien embryonnaire au sein d'un mouvement « plébéien-paysan » bien plus éclectique. Les anabaptistes étaient toujours une secte chrétienne, mais extrêmement hérétique, et les enseignements « théologiques » de Münzer s'approchaient dangereusement d'une forme d'athéisme, en continuité de tendances mystiques antérieures en Allemagne ou ailleurs (comme Meister Eckhart). Au niveau social et politique, « son programme politique frisait le communisme, et plus d'une secte communiste moderne, encore à la veille de la Révolution de mars, ne disposait pas d'un arsenal théorique plus riche que celui des sectes « münzeriennes » du XVIe siècle. Ce programme, qui était moins la synthèse des revendications des plébéiens de l'époque qu'une anticipation géniale des conditions d'émancipation des éléments prolétariens en germe parmi ces plébéiens, exigeait l'instauration immédiate sur terre du royaume de Dieu, du millénium des prophètes, par le retour de l'Église à son origine et par la suppression de toutes les institutions en contradiction avec cette Église soi-disant primitive, mais en réalité toute nouvelle. Pour Münzer, le royaume de Dieu n'était pas autre chose qu'une société où il n'y aurait plus aucune différence de classe, aucune propriété privée, aucun pouvoir d'État autonome étranger aux membres de la société. Toutes les autorités existantes, si elles refusaient de se soumettre et d'adhérer à la révolution, devaient être renversées ; tous les travaux et les biens devaient être mis en commun, et l'égalité la plus complète régner. Une ligue devait être fondée pour réaliser ce programme, non seulement dans toute l'Allemagne, mais dans l'ensemble de la chrétienté » ([17] [130]).
Il va sans dire que puisqu'on était seulement à l'aube de la société bourgeoise, les conditions matérielles pour une telle transformation radicale n'existaient pas. Sur le plan subjectif, ceci se reflétait dans l'emprise que les conceptions messianiques religieuses gardaient et qui déterminaient l'idéologie de ce mouvement. Sur le plan objectif, l'avancée inéluctable de la domination du capital faussait toutes ces revendications communistes radicales et les transformait en suggestions pratiques pour le développement de la société bourgeoise. Ceci ne fait pas l'ombre d'un doute quand on voit le parti de Münzer catapulté au pouvoir dans la ville de Mulhausen en mars 1525 : « La position de Münzer à la tête du « Conseil éternel » de Mulhausen était cependant beaucoup plus risquée encore que celle de n'importe quel gouvernement révolutionnaire moderne. Non seulement le mouvement de l'époque, mais aussi son siècle n'étaient pas encore mûrs pour la réalisation des idées qu'il avait seulement commencé lui-même à pressentir confusément. La classe qu'il représentait, bien loin d'être complètement développée et capable de dominer et transformer toute la société, ne faisait que de naître. La transformation sociale qui hantait son imagination était encore si peu fondée dans les conditions matérielles de l'époque que ces dernières préparaient même un ordre social qui était précisément le contraire de celui qu'il rêvait d'instituer. Cependant, il restait lié à ses anciens prêches sur l'égalité chrétienne et la communauté évangélique des biens. Il devait donc tout au moins essayer de les mettre en application. C’est pourquoi il proclama la communauté des biens, l'obligation au travail égale pour tous, et la suppression de toute autorité. Mais en réalité, Mulhausen resta une ville libre républicaine, avec une constitution un peu démocratisée, avec un sénat élu au suffrage universel soumis au contrôle de l'assemblée des citoyens et un système de ravitaillement des pauvres improvisé à la hâte. La révolution sociale qui épouvantait à tel point les contemporains bourgeois protestants, n'alla jamais au-delà d'une faible et inconsciente tentative pour instaurer prématurément la future société bourgeoise » ([18] [131]).
Winstanley et la véritable communauté (commonwealth)
Les fondateurs du marxisme ne connaissaient pas aussi bien la Révolution bourgeoise anglaise que la Réforme allemande ou la Révolution française. C'est dommage car, comme l'ont montré des historiens comme Christopher Hill, cette Révolution a provoqué une énorme explosion de pensée créative ainsi qu'une éblouissante profusion de partis, de sectes et de mouvements audacieusement radicaux. Les Niveleurs auxquels se réfère Engels, étaient davantage un mouvement hétérogène qu'un parti formel. Leur aile modérée n'était rien de plus qu'une tendance démocrate radicale défendant ardemment le droit de l'individu à disposer de sa propriété. Mais vue la profondeur de la mobilisation sociale qui poussait la bourgeoisie en avant, elle donna inévitablement naissance à une aile gauche de plus en plus préoccupée des besoins des masses sans propriété et qui développa un caractère clairement communiste. Cette aile était représentée par les « Véritables Niveleurs » ou « Diggers », dont le porte-parole le plus cohérent était Gerrard Winstanley.
Dans les écrits de Winstanley, en particulier son dernier travail, on s'éloigne bien plus clairement des conceptions messianiques religieuses que Münzer ne l'a jamais fait. Son important travail, La loi de la liberté en plate-forme, représente, comme le montre son titre, une évolution nette du discours sur un terrain explicitement politique : les références subsistantes à la Bible, en particulier au mythe de la chute, ont essentiellement une fonction allégorique ou symbolique. Surtout, pour Winstanley, contrairement aux Niveleurs modérés « il ne peut y avoir de liberté universelle tant que la communauté universelle ne sera pas établie » ([19] [132]).
Les droits politiques constitutionnels qui laissaient intacts les actuels rapports de propriété, étaient une imposture. Par conséquent, il développe très en détail sa vision d'une véritable communauté où tout travail salarié, tout échange ont été abolis, où à la place de l'obscurantisme religieux et de l'église sont promus l'éducation et la science et où les fonctions de l'État sont réduites au strict minimum. Il regarde même plus loin dans le temps, lorsque « la terre entière redeviendra un trésor commun comme elle le doit... alors cette hostilité de toutes les terres entre elles cessera et personne n'osera plus chercher à dominer les autres », car « défendre la propriété et les intérêts particuliers divise le peuple d'une terre et du monde entier en différentes parties, et constitue la cause de toutes les guerres, des massacres et des disputes partout » ([20] [133]).
Cependant, bien évidemment, ce qu'Engels dit de Münzer reste valable pour Winstanley : la nouvelle société qui émerge de cette grande Révolution n'a pas été la « communauté universelle » mais le capitalisme. La vision de Winstanley constituait une étape supplémentaire vers le communisme « moderne » mais restait totalement utopique. Cela s'est surtout exprimé dans l'incapacité des Véritables Niveleurs de voir comment la grande transformation pouvait se faire. Le mouvement Digger, apparu durant la guerre civile, s'est limité à quelques tentatives par de petites bandes de pauvres sans propriété, de cultiver des terrains vagues et communaux. Les communautés Diggers devaient servir d'exemple de non violence à tous les pauvres et les dépossédés, mais furent vite dispersées par les forces de l'ordre de Cromwell et, de toutes façons, leur horizon ne dépassa guère l'affirmation des anciens droits communaux à l'honneur dans le passé. C'est après la suppression de ce mouvement et du mouvement Niveleur en général que Winstanley écrivit La loi de la liberté pour tirer les leçons de la défaite. Mais l'ironie significative, c'est que tout en exprimant le plus haut niveau de la théorie communiste à cette époque, ce travail n'était pas dédié à quelqu'un d'autre qu'Oliver Cromwell qui, trois ans auparavant, en 1649, avait écrasé la révolte des Niveleurs par les armes afin de sauvegarder la propriété et l'ordre bourgeois. Ne voyant pas d'autre force capable de faire la révolution à partir d'en bas, Winstanley était réduit au vain espoir d'une révolution d'en haut.
Babeuf et la République des ÉgauxUn schéma très semblable est apparu pendant la grande Révolution française : durant le reflux du mouvement, surgit une aile d'extrême-gauche exprimant son mécontentement vis-à-vis des libertés purement politiques prétendument intégrées dans la nouvelle constitution puisque, par-dessus tout, elles favorisaient la liberté du capital d'exploiter la majorité sans propriété. Le courant de Babeuf exprimait les efforts du prolétariat des villes qui avait fait tant de sacrifices pour la révolution de la bourgeoisie, pour lutter pour ses propres intérêts de classe, et il aboutissait inéluctablement à la revendication du communisme. Dans le Manifeste des Égaux, il proclame la perspective d'une nouvelle révolution finale : « La Révolution française n'est que l'annonciatrice d'une autre Révolution, bien plus grande, bien plus solennelle, et qui sera la dernière... »
Au niveau théorique, les Égaux
étaient une expression beaucoup plus mûre de la poussée communiste que les
Véritables Niveleurs, un siècle et demi auparavant. Non seulement ils étaient
pratiquement complètement libérés de l'ancienne terminologie religieuse, mais
ils avançaient à tâtons vers une conception matérialiste de l'histoire en tant
qu'histoire de la lutte de classe. De façon peut-être encore plus
significative, ils reconnaissaient l'inévitabilité d'une insurrection armée
contre le pouvoir de la classe dominante : la « Conspiration des
Égaux » en 1796 en est la concrétisation. Se basant sur les expériences de
démocratie directe développée dans les sections de Paris et la
« Commune » de 1793, ils ont aussi
envisagé un État révolutionnaire qui aille plus loin que le
parlementarisme conventionnel en imposant le principe de la révocabilité des
officiels élus.
Cependant, une fois de plus, l'immaturité des conditions matérielles ne pouvait que trouver son expression dans l'immaturité du « parti » de Babeuf. Comme le prolétariat de Paris n'avait pas pleinement émergé en tant que force distincte parmi les « sans-culottes » et les pauvres des villes en général, les babouvistes eux-mêmes n'étaient pas clairs sur qui était le sujet révolutionnaire : le Manifeste des Égaux n'était pas adressé au prolétariat, mais au « Peuple de France ». Ne voyant pas qui était le sujet révolutionnaire, la vision babouviste de l'insurrection et de la dictature révolutionnaire était essentiellement élitiste ; quelques élus prendraient le pouvoir au nom des masses informes, et détiendraient ensuite le pouvoir ,jusqu'à ce que ces masses soient véritablement à même de se gouverner (des vues de ce genre allaient persister dans le mouvement ouvrier plusieurs décennies après la Révolution française, surtout à travers la tendance de Blanqui qui descendait à l'origine du babouvisme, en particulier à travers la personne de Buonarotti).
Mais l'immaturité de la tendance Babeuf ne s'exprimait pas seulement dans les moyens qu'elle mettait en avant (qui de toutes façons aboutirent au fiasco total du putsch de 1796), mais dans l'aspect rudimentaire de sa conception de la société communiste. Dans les Manuscrits économiques et philosophiques, Marx s'en prend aux héritiers de Babeuf comme expression de ce « communisme qui est encore tout vulgarité et instinct », qui « se manifeste comme une envie de tout ramener au même niveau » et qui « incarne cette envie et ce nivellement à partir d'un minimum chimérique. (...) L'abolition de la propriété privée n'y est point une appropriation réelle puisqu'elle implique la négation abstraite de toute la sphère de la culture et de la civilisation, le retour à une simplicité peu naturelle d'homme dépourvu et sans désir, qui non seulement ne se situe pas au-delà de la propriété privée mais qui n'y est même pas encore parvenu » ([21] [134]). Marx va même jusqu'à dire que ce communisme vulgaire serait en réalité la continuation du capitalisme : « Il s'agit là d'une simple communauté du travail où règne l'égalité du salaire payé par le capital collectif, par la communauté, en tant que capitaliste universel » ([22] [135]). Marx avait raison d'attaquer les héritiers de Babeuf dont les vues étaient entre-temps devenues complètement obsolètes, mais à l'origine, le problème était un problème objectif. A la fin du XVIIIe siècle, la France était encore une société en grande partie agricole et les communistes de l'époque ne pouvaient pas envisager facilement la possibilité d'une société d'abondance. Aussi leur communisme ne pouvait-il qu'être « ascétique, dénonçant tous les plaisirs de la vie, spartiate » ([23] [136]) un simple « nivellement à partir d'un minimum chimérique ». C'est une autre ironie de l'histoire qu'il ait fallu les immenses privations de la révolution industrielle pour éveiller la classe exploitée à la possibilité d'une société dans laquelle l'épanouissement des sens remplace la négation spartiate.
Les inventeurs de l'utopieLe reflux du grand mouvement révolutionnaire à la fin des années 1790, l'incapacité du prolétariat à agir comme force politique indépendante ne voulaient pas dire que le virus du communisme avait été éradiqué. Il prit une nouvelle forme, celle des Socialistes de l'Utopie. Les utopistes – Saint-Simon, Fourier, Owen et d'autres – étaient bien moins insurrectionnels, bien moins liés à la lutte révolutionnaire de masses que les babouvistes ne l'avaient été. A première vue, ils peuvent donc apparaître comme un pas en arrière. Il est vrai qu'ils étaient un produit caractéristique d'une époque de réaction, et représentaient un éloignement par rapport au monde du combat politique. Néanmoins, Marx et Engels ont toujours reconnu leur dette envers les utopistes et considéraient qu'ils avaient fait des avancées significatives par rapport au « communisme grossier » des Égaux, surtout dans leur critique de la civilisation capitaliste et leur élaboration d'une alternative communiste possible :
« Mais les écrits socialistes et communistes
renferment aussi des éléments critiques. Ils attaquent la société existante
dans ses bases. Ils ont fourni par
conséquent, en leur temps, des matériaux d'une grande valeur pour éclairer les ouvriers. Leurs propositions positives en vue de la société future – suppression de l'antagonisme
entre la ville et la campagne,
abolition de la famille, du gain privé
et du travail salarié, proclamation de l'harmonie sociale et transformation de
l'État en une simple administration de la production – toutes ces propositions ne font qu'annoncer la disparition de l'antagonisme des classes, antagonisme qui commence seulement à se dessiner
et dont les faiseurs de systèmes ne connaissent encore que les premières
formes indistinctes et confuses » ([24] [137]).
Dans Socialisme utopique et socialisme scientifique, Engels donne plus de détails sur les contributions spécifiques des principaux penseurs utopistes : Saint-Simon a le mérite de reconnaître la Révolution française comme une guerre de classe et de prévoir l'absorption totale de la politique par l'économie, et donc l'abolition possible de l'État. Fourier est présenté comme un critique et satire brillant de l'hypocrisie, de la misère et de l'aliénation bourgeoise, qui a su utiliser de main de maître la méthode dialectique pour comprendre les principales étapes de l'évolution historique. Il faut ajouter qu'avec Fourier en particulier, il y a une rupture définitive d'avec le communisme ascétique des Égaux, surtout à travers sa grande préoccupation de remplacer par l'activité créative et ludique le travail aliéné. La brève biographie que fait Engels de Robert Owen est centrée sur ses recherches plus pratiques, anglo-saxonnes, pour trouver une alternative à l'exploitation capitaliste, que ce soit dans les filatures de coton « idéales » de New Lanark ou ses diverses expériences de vie de coopérative et en commune. Mais Engels reconnaît aussi à Owen le courage d'avoir rompu avec sa propre classe et rejoint le prolétariat : ses derniers efforts pour monter un grand syndicat pour tous les ouvriers d'Angleterre ont marqué un pas en avant par rapport à la philanthropie bénévole, vers la participation aux premières tentatives du prolétariat de trouver sa propre identité de classe et sa propre organisation.
Mais, en dernière analyse, ce qui s'applique aux premiers mouvements du communisme prolétarien, s'applique également aux utopistes : la grossièreté de leurs théories était le résultat des conditions grossières de la production capitaliste dont elles ont surgi. Incapables de voir les contradictions économiques et sociales qui aboutiraient en dernière instance à la chute de l'exploitation capitaliste, ils ne pouvaient qu'envisager une nouvelle société à partir de plans et d'inventions développés dans leurs propres esprits. Incapables de reconnaître le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière, ils se considéraient « bien au-dessus de tout antagonisme de classes. Ils désirent améliorer les conditions matérielles de la vie pour tous les membres de la société, même les plus privilégiés. Par conséquent, ils ne cessent de faire appel à la société tout entière sans distinction, et même ils s'adressent de préférence à la classe régnante. Car, en vérité, il suffit de comprendre leur système pour reconnaître que c'est le meilleur de tous les plans possibles de la meilleure des sociétés possibles. Ils repoussent donc toute action politique et surtout toute action révolutionnaire ; ils cherchent à atteindre leur but par des moyens pacifiques et essayent de frayer un chemin à la nouvelle doctrine sociale par la force de l'exemple, par des expériences en petit qui échouent naturellement toujours » ([25] [138]).
Aussi
non seulement les utopistes ont fini en bâtissant des châteaux en Espagne, mais
encore en prêchant la collaboration de classe et le pacifisme social. Et ce
qui était compréhensible étant donné l'immaturité des conditions objectives
dans les premières décennies du XIXe siècle, n'était plus pardonnable
une fois qu'avait été écrit le
Manifeste communiste. A partir de
ce moment-là, les descendants des Utopistes constituent un obstacle majeur au
développement du communisme scientifique incarné par la fraction Marx-Engels de
la Ligue des communistes.
Dans le prochain article de cette série, nous examinerons l'émergence et la maturation de la vision marxiste de la société communiste et le chemin qui y mène.
CDW
[1] [139] Voir, par exemple, l'éditorial de la Revue Internationale, n°67. « Ce n'est pas le communisme qui s'effondre mais le chaos capitaliste qui s'accélère » ; et l'article « Le stalinisme est la négation du communisme » dans Révolution internationale, n°205 et World Revolution, n°148, ainsi que le Manifeste du 9 Congrès du CCI : Révolution communiste ou destruction de l'humanité.
[2] [140] Éditions La Pléiade, Tome III, p. 1067.
[3] [141] Ed.sociales, la Guerre civile en France.
[4] [142] Éditions La Pléiade, Tome III, p. 1066.
[5] [143] Idem.
[6] [144] Manuscrits philosophiques et économiques, Editions La Pléiade, T. II, p. 79.
[7] [145] En mémoire du Manifeste communiste, 1895, Ed. Gordon & Breach, p. 74.
[8] [146] Éditions sociales, p. 104.
[9] [147] Idem, p. 105-106.
[10] [148] Aujourd'hui, ces idéologies « primitivistes » sont le plus souvent l'expression caractéristique de la petite-bourgeoisie qui se décompose, en particulier des courants anarchistes désillusionnés non seulement par rapport à la classe ouvrière, mais par rapport à toute l'histoire depuis l'aube de la civilisation, et qui cherchent une consolation en projetant le mythe du paradis perdu sur les premières communautés primitives. Un exemple typique en est le journal américain Fifih Estate et le livre de Freddy Perlman Against Leviathan, Against History. L'ironie, que ces éléments ne voient pas, c'est que si on étudie de près les croyances des peuples primitifs, il est clair qu'eux aussi avaient leur « paradis perdu » dans un âge mythique encore bien plus ancien. Si l'on considère de tels mythes pour le reflet d'un désir irrésolu de transcender les frontières de l'aliénation, il devient alors évident que l'homme primitif subissait également une forme d'aliénation, conclusion cohérente avec la vision marxiste de ces sociétés.
[11] [149] Éditions 10-18, p. 121.
[12] [150] Du grec paradeigma : exemple, modèle.
[13] [151] Die Neue Zeit, vol. 1, 1894-95.
[14] [152] Une fin dernière.
[15] [153] La nature conservatrice de ces révoltes a été renforcée du fait que des vestiges des anciennes limites du communisme primitif ont survécu à un degré plus ou moins grand dans toutes les sociétés de classe antérieures au capitalisme. De ce fait, les révoltes des classes exploitées ont toujours été profondément influencées par un désir de défendre et de préserver les droits communaux traditionnels qu'avait usurpés l'extension de la propriété privée.
[16] [154] Engels, Socialisme utopique et socialisme
scientifique, Éditions sociales, p. 61.
[17] [155] Éditions sociales, p. 79.
[18] [156] Idem, p. 151.
[19] [157] Cité par Hill dans son introduction à La loi de la liberté et autres écrits, 1973, Penguin édition, p. 49.
[20] [158] Cité par Hill dans The world turned upside down, 1984, Peregrine edition, p. 139.
[21] [159] Éditions La Pléiade, Tome II, p. 77-78.
[22] [160] Idem.
Dans cette critique du babouvisme, on voit que Marx pressent déjà que le capitalisme ne se base pas sur la seule propriété privée individuelle, en parlant d'un « capital collectif », et combien sa conception du communisme n'a dès le début rien à voir avec le plus grand mensonge de ce 20e siècle qui nous a présenté le capitalisme d'État en URSS comme « communiste », parce que la bourgeoisie privée y avait été expropriée.
[23] [161] Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique.
[24] [162] Le Manifeste Communiste, Éditions sociales, « Le socialisme et le communisme critico-utopiques », p. 90.
[25] [163] Idem, p. 88.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [165]