Revue Int. 1978 - 12 à 15
- 3816 reads
Revue Internationale no 12 - 1e trimestre 1978
- 3138 reads
La crise en Russie et dans les pays de l'Est
- 10780 reads
A soixante années de l'éclatement de la Révolution russe qui fit tressaillir le monde au point que la bourgeoisie mondiale vit vaciller sa domination séculaire, les défilés d'ouvriers en armes sur la place Rouge se sont transformés en parades insolentes de troupes marchant au pas cadencés sous le regard satisfait de leurs maîtres. La bourgeoisie russe peut contempler d'un oeil tranquille son armement de mort, auprès du quel celui utilisé pendant les deux carnages impérialistes fait maintenant figure de jouet inoffensif. Elle peut baptiser des mots d'octobre" et de "communisme" son arsenal infernal et embellir de citations de Lénine sa hideuse domination de classe, pour conjurer le spectre du communisme. Jamais à soixante ans d'Octobre 1917, la puissance de la classe dominante russe n'a semblé si assurée à l'ombre de ses chars dernier cri et de ses missiles ultra perfectionnés.
Mais le spectre du communisme ressurgit de nouveau. Mondialement, le système capitaliste est entré en crise, posant les bases objectives de la révolution prolétarienne. Si le prolétariat russe a été broyé par la plus féroce contre-révolution engendrée par le capitalisme, sous les bottes de la classe dominante russe, le sous-sol économique de sa propre domination se fait toujours plus fragile. C'est de la crise du capitalisme et d'elle seule, que surgira de nouveau demain, après cinquante ans de silence de mort, le prolétariat russe, entraîné dans la tourmente révolutionnaire par la masse des ouvriers d'Europe de l'Est.
Nous nous proposons dans un premier article de démontrer l'existence de la crise générale du capitalisme en Europe de l'Est, en montrant quelles en sont les formes particulières au sein du bloc russe.
Parler de crise économique dans le bloc russe, c'est-à-dire montrer la similitude des contra dictions qui minent le capitalisme décadent tant à l'Est qu'à l'Ouest, semblait, il y a encore quelques années, susciter l'incrédulité ou les sarcasmes des défenseurs patentés des "pays socialistes". On pu voir aussi des représentants respectables de la bourgeoisie libérale à l'Ouest s'extasier - alors que la crise était déjà là dans le reste du monde - sur l'apparente absence de phénomènes de crise économique dans ces pays (chute du taux de croissance, inflation, chômage). Quelle merveille de trouver enfin un oasis de calme économique, avec de belles courbes régulières de croissance ! Et puis, pensez donc, la Russie semi féodale d'avant 1914 dépassait maintenant les USA par sa production d'acier! Il y avait de quoi susciter l'admiration envieuse de bien des capitalistes occidentaux et les cris de jubilation des PC et de leurs "soutiens critiques" trotskystes. Mais l'admiration et la jubilation se sont vite changées en Inquiétude : la crise économique est bien présente là aussi ! Il n'y a pas de potion magique dans le chaudron de sorcières du capitalisme pourrissant, qu'elle se nomme "planification socialiste" ou "pensée de Mao".
Aujourd'hui, dans la presse mondiale se multi plient les articles mettant en évidence les phénomènes de crise économique dans le bloc russe. Bien mieux les représentants du capital d'Europe de l'Est vont à Canossa quémander à l'Ouest, crédits sur crédits auprès des grandes banques internationales[1] [1]. Et les trotskystes qui jouaient les seconds violons sur l'air du "développement ininterrompu des forces productives" à l'Est se sont faits soudainement muets dans leur "soutien critique" de la "société de transition socialiste". On préfère maintenant faire le battage autour des slogans d'"opposition démocratique". Quelles sont donc les raisons qui ont réduit à un couac tout ce beau concert d'éloges de la "planification socialiste" ? Pour le comprendre, Il est nécessaire de remonter dans le passé, ce lui de l'apparition des plans quinquennaux au cours des années 30.
LA PRETENDUE "IMPERMEABILITE" DU BLOC RUSSE A LA CRISE
1) La "planification" de la décadence
Le grand mythe de la bourgeoisie russe depuis la période stalinienne des plans quinquennaux est celui de 1'"Imperméabilité" du monde "socialiste" à la crise. Il est repris à qui mieux mieux par tous les partis staliniens et trotskystes du mon de quand il s'agit de préconiser des mesures "radicales" de nationalisations et "d'expropriation du capital privé".
Ainsi, selon eux, les pays de l'Est comme tous les pays du tiers-monde, où l'étatisation de l'économie est plus ou moins achevée, constitueraient un "monde à part" dans le monde capitaliste. La suppression juridique des titres de propriété serait un label de socialisme "pur" ou "dé généré". Pour les trotskystes, le seul point faible de ce "nouveau système" résiderait uniquement dans le parasitisme de la "bureaucratie" qui use rait et abuserait pour son profit personnel de la "propriété socialiste". Il suffirait que les ouvriers chassent la "bureaucratie" par une révolution "politique" ne touchant pas à la base économique "socialiste" pour que la "révolution trahie" soit enfin achevée. Alors les ouvriers pourraient goûter aux bienfaits de la "propriété socialiste". Que pour les trotskystes, la Russie soit un "Etat ouvrier" se démontre dans le miracle économique des années 30. Voilà, selon Trotsky, quel est ce "miracle" du "socialisme" :
- "Le socialisme a démontré son droit à la victoire, non dans les pays du capital mais dans une arène économique qui recouvre le sixième de la surface du globe ; non dans le langage de la dialectique', mais dans celui du fer, du ciment et de I'électricité".
(La Révolution Trahie)
Une telle assertion ferait aujourd'hui sourire si l'on ne savait ce que recouvre dans la réalité ce "droit à la victoire". Plus de dix millions de morts pendant les premiers plans quinquennaux[2] [2], le prolétariat réduit à un état de misère physiologique digne des pires horreurs de l'accumulation primitive du capital au début du 19ème siècle, la marche vers la guerre Impérialiste au prix de 17 millions de victimes, voilà le bilan de ce "brillant développement" sur le quel s'enthousiasmait Trotsky. Jamais dans le capitalisme, la dialectique du fer, du ciment et de l'électricité" n'a autant recouvert la barbarie du capitalisme écrite dans la dialectique réel le du fer et du sang.
Que la croissance des indices de production n'ait jamais été un signe du socialisme est une vérité qu'il faut de nouveau répéter après cinquante années de mensonges stalinien et trotskyste. Pour le marxisme, plus s'élèvent les Indices de production, plus se développe la paupérisation relative et absolue de la classe ouvrière astreinte à vendre une force de travail toujours plus dévalorisée au fur et à mesure que s'accélère l'accumulation. Lorsque les trotskystes parlent de croissance des forces productives, ils "oublient" de dire que dans la vraie période de transition socialiste - c'est à dire quand le prolétariat exerce sa dictature à l'intérieur d'un système qui reste encore capitaliste - la croissance des indices de production (pour au tant qu'on puisse alors parler d'Indices) se traduit par le développement absolu et relatif du secteur des biens de consommation. Le secteur des biens de production au contraire est par excellence celui du capitalisme et de son cycle infernal d'accumulation. Le socialisme n'est pas proportionnel au développement de ce secteur il lui est inversement proportionnel. La condition même du communisme, c'est que toute la production soit orientée vers la satisfaction des besoins sociaux, même si on doit défalquer un fonds d'accumulation réservé à la reproduction sociale élargie. Mais plus qu'un simple rapport arithmétique entre les deux secteurs, c'est la croissance exponentielle de la consommation qui marque le chemin suivi par le prolétariat pour substituer à la valeur d'échange, la valeur d'u sage, jusqu'à disparition de toute loi de la valeur. Alors que la révolution prolétarienne d'Octobre avait tâché - avec les moyens limités légués par la guerre civile - de développer le secteur des biens de consommation, la dialectique "du fer, du ciment et de l'électricité" allait signifier l'inversion des proportions entre les deux secteurs au profit du premier, sans que les chiffres montrent en absolu une croissance des biens de consommation, bien au contraire. Ainsi, en 1927-28 (avant les plans quinquennaux), le rapport entre secteur biens de consommation et secteur moyens de production était encore en pourcentage encore de 67,2 % contre 32,8£. En 1932, après le premier plan quinquennal- on avait déjà 46,7 % et 55,3 %. A la veille de la guerre, le secteur des biens de consommation ne représentait plus que 25 % de la production globale. C'est une proportion qui est restée rigoureusement identique depuis[3] [3] (voir tableau ci-dessous).
|
Année |
Production industrielle globale |
Moyens de production |
Moyens de consommation |
|
1917 |
100 |
38,1 |
61.9 |
|
1922 |
100 |
32,0 |
68 |
|
1928 |
100 |
39,5 |
60,5 |
|
1945 |
100 |
74,9 |
25.1 |
|
1950 |
100 |
68.8 |
31,2 |
|
1960 |
100 |
72,5 |
27,5 |
|
1964 |
100 |
74.0 |
26.0 |
|
I960 |
100 |
73,8 |
26,2 |
|
1971 |
100 |
73,4 |
26.6 |
Tableau 1 : Poids respectif des moyens de production et des moyens de consommation dans le volume global de la production industrielle (en pourcentage) (FMI-[1]).
Ce droit "à la victoire" du capitalisme en Russie assumé par le triomphe de la plus féroce contre-révolution de l'histoire se traduisit dans le langage des chiffres cher à Trotsky par une chute de 50 % du salaire réel entre 1926 et 1936[4] [4] par un triplement de la productivité du travail, autrement dit du taux d'exploitation. Avec un tel rythme d'exploitation l'URSS pouvait évidemment dépasser la production industrielle de l'Angle terre et rejoindre bientôt celle de l'Allemagne à la veille de la guerre.
Les "bordiguistes"[5] [5] ont voulu voir dans la croissance démesurée des indices de production lourde la preuve du développement d'un capitalisme "juvénile", qui du fait de sa "jeunesse" ne pouvait être encore contaminé par la crise générale du capitalisme qui entraînait dans l'effondrement l'ensemble du monde. Bref, comme pour les trotskystes - l'URSS aurait constitué un "cas particulier" pour les bordiguistes. Pourtant dans un tableau reproduit dans un récent Programme Communiste (voir tableau plus loin), il apparaît très clairement que :
- le taux de croissance le plus élevé n'est pas celui de la période des plans quinquennaux mais celui de la période de reconstruction (1922-28) : + 23%,
- la baisse du taux de croissance annuel qui se manifeste pendant les plans quinquennaux - donc en pleine crise mondiale - suit le rythme du ralentissement mondial du taux d'accumulation de puis le début du siècle[6] [6] : 1929-32 : + 19,3 % ; 1933-37 : + 17,1% ; 1938-40 : + 13,2 %. Cette chute comme on le verra par la suite va se pour suivre de plus belle jusqu'à aujourd'hui.
TAUX DE CROISSANCE DE L'INDUSTRIE RUSSE
|
Périodes |
Plan |
Taux de croissance annuel moyen |
|
1922-28 |
Avant les plans |
23% |
|
1929-1932 |
1er plan |
19,3% |
|
1933-37 |
2ème plan |
17,1% |
|
1938-40 |
3ème plan |
13 ,2% |
|
1941-45 |
Guerre |
---- |
|
1946-50 |
4ème plan |
13,5% |
|
1951-55 |
5ème plan |
13% |
|
1956-60 |
6ème plan |
10,4% |
|
1961-65 |
7ème plan (plan septennal) |
8,6% |
|
1966-70 |
8ème plan |
8,4% |
|
1971-75 |
9ème plan |
7,4% |
|
1976-80 |
10ème plan |
6,5% |
Sources ; calculs effectués d'après les données de Narodnoe Khoziaistvo SSSR, années diverses.
Comment s'explique en dépit de cette baisse, l'existence d'un fort taux de croissance, qui tranche avec ceux plus faibles des grands pays industrialisés ? Les staliniens en ont fait la preuve irréfutable de la "supériorité de la planification socialiste sous le capitalisme". Ils "oublient" une petite chose : l'URSS partait d'extrêmement bas (elle ne retrouve sa production de 1913 qu'en 1928) et se trouvait dans la nécessité, sous peine de stagnation, de renforcer ou du moins de maintenir sa production par rapport à la production mondiale : le ralentissement immédiat et rapide du taux d'accumulation ne signifie pas que la Russie aurait réussi, par une "accumulation primitive", à atteindre une vitesse de "croisière" comme les grands pays capitalistes à la fin du 19ème siècle. A la différence de ces pays qui connurent une période d'accumulation assez longue avec une croissance régulière de leur taux d'accumulation, pour la Russie, le chiffre le plus élevé atteint s'étend - d'après les statistiques officielles.- sur une période de 4 ans. Et si l'on ne tient pas compte de ces chiffres, on doit les réduire d'au moins 30 ou 40%.[7] [7]
L'URSS en dépit de toutes les mesures de capitalisme d'Etat qui sont prises à une vitesse accélérée n'échappe pas à la crise générale qui suit le krach de 1929. Ces chiffres officiels qui sont bien évidemment "gonflés" par les économistes russes traduisent mal la réalité de la chute de la production, ils montrent que la crise en Russie est bien présente et suit un rythme identique au reste du monde capitaliste. Pourquoi alors l'autarcie ? La Russie aurait-elle pu échapper à la banqueroute de 1929 ? Or la Russie se trouve dans la même situation que les autres pays : dans l'impossibilité d'exporter et d'importer en raison de son insolvabilité, le commerce extérieur russe est tombé à la fin des années 30 au tiers du chiffre de 1913 (tableau ci-dessous) :
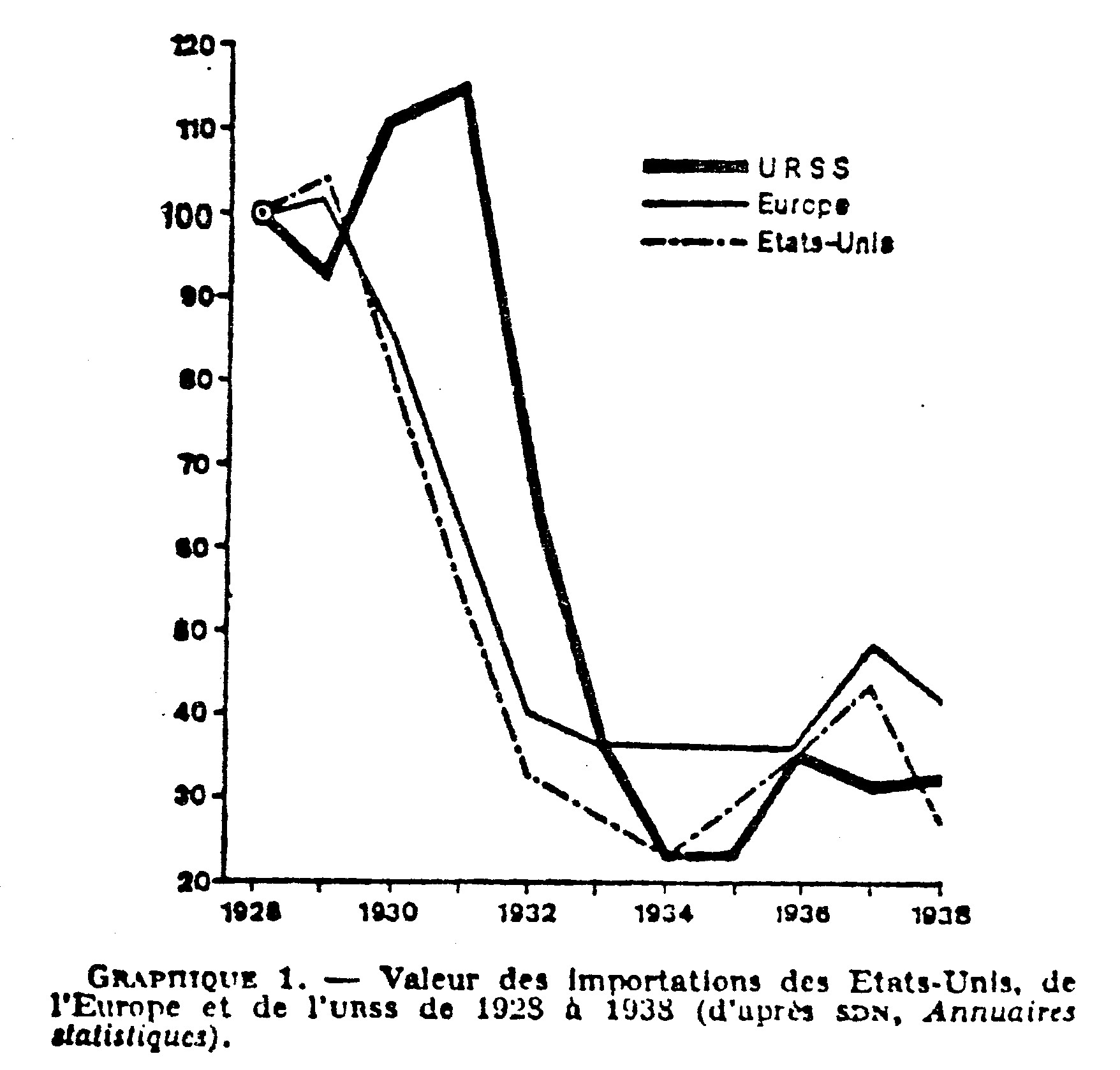
Pour financer les plans quinquennaux, l'inflation fait ravage : de 1928 à 1933 la masse monétaire passera de 1,7 milliards de roubles à 8 milliards. En 1935, le rouble du être dévalué de 80%.(cf. : Bordiga : Structure économique et sociale de la Russie). La relative imperméabilité des frontières russes au commerce mondial se traduisait donc par une banqueroute totale au même titre que celle de l'économie hitlérienne à la veille de la guerre. Mais, diront les trotskystes et les staliniens, la part de la Russie dans la production mondiale s'est élevée entre 1913 et 1938 de 4% à 12%, les indices de production se sont multipliés par 3 ou 4 en quelques années. La raison de ce "miracle" ? Au même titre que l'Allemagne, qui elle aussi accomplissait de tels miracles, la Russie "socialiste" se lançait à corps perdu dans l'économie de guerre. Au "des canons, pas de beurre" de Göring, correspondait la prosaïque constatation de Staline : "On ne peut à la fois fabriquer des casseroles et des canons".
Point culminant de la crise générale du capitalisme ne trouvant plus d'autre solution que la guerre de brigandage impérialiste, l'économie de guerre fut le seul secteur qui pouvait être planifié. Grâce aux plans quinquennaux et sur tout à la mobilisation permanente par la terreur de toute la population, dès 1935-39 les dépenses militaires soviétiques atteignaient les deux tiers de l'effort allemand ; en 1940, elles correspondaient aux 5/6 de ce dernier; en 1941, l'URSS produisait déjà pour 8,5 milliards de dollars d'armements contre 6 à l'Allemagne, (cf. : Le Conflit du Siècle de Fritz Sternberg). Le développement de la Sibérie où se trouvaient toutes les matières premières nécessaires à la guerre, par la constitution de gigantesques camps de travaux forcés, la mise en place de toute une infrastructure routière, l'accroisse ment de la productivité par le stakhanovisme furent autant de jalons dans la transformation de toute l'économie russe en économie de guerre.
La supériorité de l'économie de guerre russe sur celle de l'Allemagne tient surtout au facteur "nombre" (170 millions d'habitants contre 70 en Allemagne) mais aussi à une mobilisation de la force de travail plus intense, une réduction plus draconienne encore du secteur des biens de consommation mais surtout la destruction du secteur précapitaliste des campagnes russes sera un facteur décisif dans la mise en place de cette économie de guerre : par la collectivisation,les campagnes cessent de vivre en unités closes auto consommant les valeurs d'usage, elles fournissent, par un fantastique pillage de l'Etat capitaliste, des débouchés à l'industrie russe (bâtiments et machines agricoles). Elles fournissent un marché extra capitaliste et une avance de plusieurs millions de tonnes de vivres prêtes à nourrir les millions d'hommes mobilisés dans l'Armée Rouge [8] [8]. On sait comment, après 1945, l'URSS devait se rembourser des faux frais que constituent pour le capital les industries d'armement par le pillage systématiquement organisé des nouveaux "pays frères" tombés sous sa domination : démontage d'usines allemandes transportées en Russie avec leurs ouvriers, réquisitions forcées, échange inégal au dessous de leur va leur pour les achats russes, au dessus de leur valeur pour les ventes de marchandises produites par le "grand frère socialiste". C'est cette politique typiquement impérialiste qui permît à la Russie dès 1949 de retrouver son niveau de production de 1940. La planification de l'économie de guerre se continuerait par la planification du pillage des pays du C0MEC0N, mis en place pendant la "guerre froide".
2) La crise permanente du bloc russe
Aujourd'hui, les trotskystes continuent è argumenter que l'URSS échappe à la crise du capitalisme ; la preuve : entre 1950 et 1973, la production industrielle russe passe de 30% à 75% de celle des USA; dans la même période son rêve nu national est passé de 31% à 66% de celui de "l'oncle Sam". L'URSS, sauf de façon indirecte au travers de ses échanges internationaux, se rait donc condamnée à se situer en dehors de toute crise générale. Pour les "bordiguistes", c'est seulement maintenant que les capitalismes "juvéniles" de l'Est connaîtraient la crise en entrant dans un cycle "classique" de vieillissement.
La période d'après-guerre aurait-elle signifié pour le capitalisme d'Etat dans le bloc russe une résolution de sa crise ? Pour répondre, on ne peut séparer le cas "russe" du "cas" capitalisme mondial. Plus que toute autre économie, à l'exception du tiers-monde, celle du bloc russe vérifie pleinement la crise permanente du capitalisme depuis 1914, la crise ouverte en étant le point culminant. Tout d'abord, l'Etat prend de plus en plus en charge l'ensemble d'une économie dans l'impossibilité de trouver des débouchés extérieurs sur un marché déjà con contrôlé par quelques capitaux. Dans l'impossibilité d'accumuler de façon organique du capital productif, l'économie russe a converti toute son économie en économie de guerre. Mais l'économie d'armements est absolument improductive pour le capital national. Elle n'est une "solution" provisoire que pour autant que le capital national reporte le prix de ces "faux frais" du capital sur les pays voisins ou de son bloc. L'industrie d'armements ne produit pas un capital additionnel mais une destruction du capital accumulé. C'est la main mise impérialiste sur les pays du C0MEC0N qui lui a permis de trouver des débouchés à sa production marchande. C'est une telle politique qui a permis pendant la reconstruction du second après-guerre à la Russie d'échapper dans une certaine me sure aux convulsions du tiers-monde. Mais, loin de s'arrêter à la faveur d'un traité de"paix", l'effort de guerre russe n'a fait que se pour suivre de façon permanente au lendemain de la guerre alimenté en cela non seulement par les luttes de "libération nationale" et par la guerre de Corée mais par le maintien de "l'équilibre de la terreur" avec le bloc américain. La cri se permanente n'a pas été résolue, elle a été reportée à une échelle toujours plus élargie sur l'arène mondiale.
Dans le bloc russe de même que l'Etat totalitaire a absorbé l'ensemble de la vie civile, l'économie de guerre a absorbé l'ensemble de l'économie, créant une véritable symbiose entre secteur "civil" et secteur"militaire"de la production. A aucun moment depuis la guerre de Corée, la place des dépenses d'armements n'est tombée au dessous de 10-15% de son PNB (6% aux USA)[9] [9]. L'intégration des pays "frères" dans le grand sabbat d'armements, va signifier un poids accru dans leur économie de ce secteur purement improductif : entre 4 et 6% selon les pays, qui ont en prime l'entretien des troupes russes présentes sur leur sol, le plus défavorisé étant la RDA.
Deuxième puissance impérialiste mais puissance économique de 3ème ou 4ème rang, l'URSS a dû toujours plus rouler son capital accumulé dans le tonneau sans fond de l'industrie d'armements. A la différence du Japon où -le secteur d'armements est bien plus réduit et qui a donc pu développer son capital productif avec de prodigieux chiffres de croissance, la caractéristique de l'URSS est de nouveau après la guerre une diminution de son taux de croissance mais plus rapide encore : le taux de croissance a voisine 13% de 1945 a 1955 (reconstruction et guerre de Corée qui fournit un débouché momentané à la production d'armements); ensuite chute continuelle de 1956 à aujourd'hui avec une pointe d'accélération depuis 1960-64 puis 1971 : 8% seulement. Les chiffres donnés sont ce qu'il y a d'officiel. Si nous prenons les chiffres officieux, tels qu'ils apparaissent dans les travaux à diffusion restreinte des économistes russes[10] [10], la décroissance du taux de "croissance" est encore plus prononcée : de 1950 à 1960 = 10% environ ; 7% seulement de 1960 à 70. Les résultats du dernier plan quinquennal (1971-76) ne donneraient plus que 4,5%, donc chiffre identique peu ou prou à ceux des pays de l'OCDE.
Parallèlement, on constate des récessions de plus en plus fortes en URSS en 1953, en 1957, en 1963, qui ont pour effet d'entraîner un changement immédiat de personnel dirigeant. La situation est encore plus grave dans les pays satellites. Sauf en Bulgarie et RDA qui servent de "vitrine" du "bien-être socialiste", pour les autres pays, l'indice du revenu national par habitant ne cesse de baisser de 1950 à 1970; pour la Tchécoslovaquie, l'indice passe de 172 à 109 an prenant le chiffre de base 100 pour l'URSS); (cf. tableau ci-dessous) :
|
INDICES DU REVENU NATIONAL PAR HABITANT (URSS=100) |
||
|
|
1950 |
1970 |
|
Bulgarie |
60 |
96 |
|
Roumanie |
55 |
70 |
|
Hongrie |
119 |
81 |
|
Pologne |
114 |
81 |
|
RDA |
131 |
135 |
|
Tchécoslovaquie |
172 |
109 |
Source : Problème de l’intégration socialiste (I. Polejnik et V.P Sergeev, Moscou 1974, p.53)
Ces chiffres ne peuvent traduire plus clairement comment la Russie n'a cessé en permanence de reporter sa crise sur son bloc grâce à cet instrument privilégié que constitue le C0MEC0N. On comprend alors que dans les années 1950 la croissance de certains pays "frères" ait été purement et simplement négative dans leur revenu national : - 2% en 1952, - 4% en 1954 et 10% (!) en 1956 pour la Hongrie. Point n'est besoin de chercher plus loin la cause des explosions sociales qui embrasèrent l'Europe de l'Est entre 1953 et 56. Seule la crainte de la désagrégation de son bloc devait pousser la Russie à limiter le pillage de ces pays, au prix d'un relâchement de son contrôle économique jusqu'à ces dernières années.
Si la crise ouverte du capitalisme d'Etat a pu connaître un répit dans les pays comme la Pologne et la Hongrie au prix de l'endettement, l'URSS y est entrée de plein pied depuis les années 60. En dépit des réformes Libermann, en dépit de la hausse de son pétrole après 1973, l'URSS va connaître maintenant au travers des chiffres de son plan quinquennal 1976-80, les chiffres les plus faibles enregistrés depuis 1928 pour la croissance du fonds d'accumulation : moitié que celle enregistrée entre 1970 et 75. La crise permanente se développe donc mainte nant de plus en plus comme crise ouverte.
Deux constatations peuvent être tirées de cet te analyse de la crise en URSS et dans ses pays sate11ites :
- ni l'économie de guerre, ni les plans quinquennaux, ni la main mise économique sur les "démocraties populaires" n'ont pu tirer l'URSS de la crise permanente. En cela l'URSS ne fait que suivre et même précéder la crise générale ouverte des pays capitalistes développés depuis la fin des années 60.
- pour que surgisse la crise ouverte du capitalisme, il n'est point nécessaire qu'elle se manifeste par une chute brutale de la production donc par un effondrement. Il y a crise ouverte quand brutalement se manifeste la tendance observable depuis la période impérialiste à la chute du taux de croissance, qui traduit en fait le freinage subi dans l'accumulation du capital. La rapidité de la période de reconstruction à l'Est et son isolement relatif du marché mondial ont confronté le bloc russe plus rapidement au problème de la crise. Celle-ci a été en quelque sorte plus "planifiée" qu'à l'Ouest, restant relative et non encore absolue comme dans l'ensemble du tiers-monde.
Il faut voir maintenant comment se manifeste spécifiquement la crise à l'Est à travers trois phénomènes caractéristiques : endettement, inflation et chômage.
3) Endettement, inflation, chômage
L'endettement d'un pays capitaliste depuis 1914 traduit une tendance à la banqueroute momentanément freinée par la survie à crédit. Ce n'est plus un crédit qui anticipe un surplus social réel mais une anticipation du manque croissant à accumuler et valoriser le capital national.
Le déficit des pays du C0MEC0N depuis 1971 est lié à la faiblesse de leur production[11] [11] alors que la nécessité se fait sentir pour eux tant de jeter leurs marchandises sur le marché mondial que de perfectionner leur appareil d'économie de guerre. Ce déficit traduit leur insertion réelle dans la crise générale. Selon le Bulletin mensuel de l'ONU (juillet 1976), le déficit des balances commerciales des pays du bloc russe est passé de 700 millions de dollars en 1972 à 10 milliards en 75, avec une accélération brutale entre 74 et 75. Il apparaît à travers cette étude qu'après avoir reporté la crise sur ses "alliés", l'URSS tend à augmenter démesurément son endettement : 3,6 milliards de dollars. La situation a pris une tournure catastrophique ; selon une étude de la Chase Manhattan Bank (1977), le déficit commercial cumulé des pays de l'Est entre 1961 et 76 serait de l'ordre de 42,5 milliards de dollars, plus de la moitié du déficit relève des années 75 et 76. Fin 76 l'endettement atteignait 47 milliards de dollars, certains économistes n'hésitaient pas à prédire un chiffre compris entre 80 et 90 milliards pour 1980. Si l'endettement des pays du C0MEC0N représente 4% de leur PSB (Produit Social Brut), pour certains pays (Hongrie, Pologne) il représente jusqu'à 10-15% du PSB. Un tel endettement n'est pas s'en rappeler celui qui affecte les "hommes malades" de l'Europe : Grande-Bretagne, Italie, Portugal, Espagne, à la seule différence que te pays dominant du bloc russe, l'URSS, n'a pas d'organismes internationaux (FMI, banque mondiale) lut permettant de transférer sa dette sur ses alliés.
Les staliniens et leurs"théoriciens" trotskystes sont bien contraints de reconnaître de telles données brutes. Ils prétendent néanmoins que la crise à l'Est découle de la pression pernicieuse du capitalisme occidental qui vend plus cher ses produits au COMECON, lequel ne pourrait ex porter les précieuses marchandises "socialistes" à l'Ouest protégé par toutes sortes de barrières protectionnistes. Ce que E. Mandel appelle "contrecoup de la récession capitaliste" (Critique de l'Economie Politique, n°24-25) est l'aveu naïf que cette prétendue "récession" est bien une crise mondiale auquel aucun pays ne peut se soustraire quelque soit le soin apporté par le même Mandel à disserter sur la "nature sociale ment différente de l'économie des Etats ouvriers bureaucratisés".
Toutes les autres théories qui faisaient de : l'URSS un troisième système pouvant se soustraire au marché mondial et aux lois d'airain de la division internationale du travail, s'écroulent. Quel que soit le degré d'autarcie adopté par un pays capitaliste depuis la décadence du système, il ne peut se soustraire à la nécessité d'échanger sa production afin de la réaliser sur le marché mondial. La contradiction du système capitaliste devient telle sous la décadence qu'en même temps que s'accélère la tendance à l'autarcie se renforcent les liens internationaux entre les économies capitalistes soumises à l’impérieuse nécessités "d'exporter ou mourir". Le COMECON n'échappe pas à cette réalité, bien qu'en lui-même il représente pour les huit pays membres du COMECON une fraction du marché mondial où je réalise leur capital. Mais il n'y a pas deux marchés mondiaux : l'un "classique" dominé par les USA et l'autre externe avec ses lois propres. L'assertion de Mattick (Marx et Keynes) que tes "nations capitalistes d'Etat forment un bloc qui, sur le plan des relations économiques, se présente un peu comme un second marché mondial" se révèle totalement démentie par la réalité de la crise actuelle. Plus que jamais il se vérifie que l'unicité du marché mondial est la contra diction du capitalisme qui jette chaque Etat dans la crise. Mais, et l'inflation ? Ajoutent ceux pour qui l'apparence tient lieu de réalité "l'inflation c'est la crise, où voit-on trace d'inflation à l'Est" ?
Si l'inflation exprime depuis la première guerre mondiale la crise historique du système capitaliste, la déflation ne l'exprime pas moins, par une diminution artificielle de la masse monétaire et par la restriction du crédit. Dans les années 30 de telles mesures déflationnistes (Grande-Bretagne, France...) ne firent qu'aggraver la crise, s'accompagnant de restrictions draconiennes des salaires nominaux et d'un hyper chômage. Le monde capitaliste ne tarda pas à adopter les mesures suggérées par Keynes basées sur le plein emploi et l'inflation. On sait aujourd'hui à quelle faillite ont abouti de telles mesures à l'Ouest.
Dans le bloc russe, les indices économiques indiquent une absence d'inflation. Pourtant en 1975, les statistiques fournies par les banques de Pologne et de Hongrie admettaient depuis 70 une hausse des prix respectivement de 13,252 et de 14,6%. En Hongrie (à la différence du gouvernement polonais qui a dû reculer devant les émeutes ouvrières), en juillet 76, le prix de la viande a été relevé de 33%. En réalité, même dans les autres pays de l'Est qui n'acceptent pas la "vérité des prix", au point de décréter des baisses autoritaires (cas de la Tchécoslovaquie, de la RDA), l'inflation se manifeste de façon détournée. Par le biais du "marché libre" et du "marché noir" qui constituent le véritable marché des produits de consommation courants. C'est sur ce marché quasi institutionnalisé que la population trouve les produits de base nécessaires à la reproduction de sa force de travail ; là, les prix sont fréquemment le double, le triple des prix officiels. Les marchandises vendues au prix officiel sont bien entendu extrêmement rares et de qualité médiocre, quand elles ne sont pas détournées simple ment vers le marché noir... C'est donc une autre façon de s'attaquer à la classe ouvrière : à l'Ouest par une inflation franche et ouverte ("vérité des prix"); à l'Est par la méthode hypocrite du marché noir. D'un côté on diminue le salaire réel par la hausse accélérée des prix, de l'autre par la raréfaction des marchandises vendues dans les magasins d'Etat et par, le marché noir. Le résultat est identique : dans les deux cas le salaire réel se trouve diminué.
Ainsi le prix de chaque marchandise ne se trouve pas être le fruit d'une politique purement arbitraire de la bourgeoisie des pays de l'Est. Comme à l'Ouest, la hausse des prix exprime la loi de la valeur : valorisation et dévalorisation du capital accumulé. Il en est de même des prix à la production qui traduisent tout autant la valorisation du capital. Si des "marxistes" bien intentionnés comme le GLAT[12] [12] ou Mattick reconnaissent cette attaque permanente de la classe ouvrière par cette inflation camouflée, ils ne veulent pas reconnaître par contre que les prix de production subissent l'influence du marché mondial. Selon le GLAT "les prix imposés aux entreprises ne sont que des instruments comptables qui tentent de refléter la nécessité pour les entre prises de participer à l'extraction générale de la plus-value et à la rentabilisation du capital social". Si cela était un phénomène purement interne de comptabilité, on comprend mal pourquoi l'URSS a relevé de 100% le prix de son pétrole en 1974, on ne comprend pas plus pourquoi en Hongrie - par exemple - des relèvements des prix de l'énergie, des produits chimiques et sidérurgiques ont été effectués en 1976-77[13] [13], traduisant le relèvement général des prix mondiaux. On pourrait multiplier les exemples qui montrent que les prix ne sont pas de purs "instruments comptables" mais le pro duit d'un marché mondial sur lequel s'échangent des marchandises vendues à un prix moyen. Pas plus qu'à l'Ouest, le bloc russe n'échappe à ce déterminisme qui est la négation de tout volontarisme économique.
Cependant, la crise du capitalisme dont nous avons retrouvé les phénomènes classiques, se manifeste de façon -mais non de nature- différente en ce qui concerne le chômage, expression la plus classique de la crise générale du système.
Il en est du chômage comme de l'inflation dans les pays de l'Est : officiellement, il n'existe pas. Avant de voir si les chiffres officiels traduisent bien la réalité, on doit faire observer tout d'abord que capitalisme d'Etat ne signifie pas disparition du chômage. Déjà dans la Russie stalinienne d'avant les plans quinquennaux, il y avait 800.000 chômeurs "officiels" pour environ 10 millions d'ouvriers (1928-30). Les chômeurs "disparurent" par la suite des statistiques avec la croissance quantitative de la classe ouvrière. Aujourd'hui, selon la Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest (n°1, 1977), le chômage en Yougoslavie touche près de 600 mille ouvriers, triplant par rapport à 1965, tandis qu'un million d'ouvriers recensés devaient vendre en 1972 à l'étranger leur force de travail "socialiste".
Passons maintenant dans tes pays adhérents au C0MEC0N où l'autogestion absente n'a pas la vertu miraculeuse de transformer les ouvriers en chômeurs. En 1965, en Pologne, il y avait officiellement 600.000 chômeurs recensés et d'après Trybuna Ludu du 15/2/71, le plan quinquennal mis en place prévoyait entre 500 et 600 000 chômeurs. Il est vrai que depuis l'in surrection ouvrière de 1970-71, le gouvernement polonais a choisi la voie du plein emploi au prix d'un endettement considérable tant auprès des banques russes que des organismes internationaux de l'Ouest. On peut supposer que le "cas polonais" n'est pas isolé dans les autres pays, quand on sait que les entreprises et l'Etat, s'arrogent le droit de licencier ou comme on dit plus pudiquement de "déplacer la main-d'oeuvre". Il y a quelques années, l'organe des syndicats soviétiques Trud se plaignait de licenciements abusifs dans les Républiques d'Asie Centrale.
Un chômage camouflé peut se manifester aussi par l'émigration de la main-d'oeuvre entre les différents Etats"frères". Ce phénomène s'est particulièrement développé ces dernières années. On sait qu'en RDA travaillent (chiffres officiels) 50 000 mineurs polonais et près de 10 000 ouvriers hongrois. En Tchécoslovaquie, ce sont 20 000 travailleurs polonais qui doivent y vendre leur force de travail, tandis qu'y afflue maintenant un fort contingent d'ouvriers yougoslaves en quête de travail (La Repubblica du 10/2/76).
Cependant, il ne semble pas que ces cas, qui traduisent un chômage endémique, soient généralisables d'autant plus si l'on tient compte du fait que la masse des ouvriers représente souvent plus de 50% de la population active. Pour le moment dans la majorité des pays de l'Est les ouvriers sans travail sont avant tout des "éléments asociaux", c'est à dire les ouvriers combatifs qui luttent courageusement contre l'exploitation capitaliste. Aujourd'hui, le chômage ne se dissimule plus derrière les barbelés des camps de travail staliniens, que les régimes en place durent supprimer au début des années 50, quand il se révéla qu'ils étaient non seulement des foyers de révolte mais parfaitement improductifs et non rentables d'un point de vue capitaliste.
Comme le proclamait en 1956 la revue polonaise, Polytika, organe du parti stalinien, les classes dominantes des pays du C0MECQN se trouvent placées devant le dilemme suivant :
- "Il est certain, et nous devons en prendre conscience, que la population doit choisir soit une augmentation importante de l'emploi, soit une limitation de l'emploi et une amélioration des salaires réels. Il n'y a pas d'autre solution".
Une telle déclaration sincère des capitalistes polonais pourrait s'intituler : deux manières de réduire la part de capital variable dans les marchandises produites.
A L'Ouest, entre l'inflation et le blocage des salaires, il y a en effet une manière radicale de diminuer la part du facteur V (capital variable) pour augmenter l'extraction de la plus-value : c'est d'expulser les ouvriers du processus de production. Le résultat c'est une diminution de la masse salariale globale, quand une augmentation de la productivité vient compenser (théoriquement) les frais occasionnés par l'entretien des chômeurs.
A l'Est, en général, on n'expulse pas les ouvriers du processus de production mais on diminue la part du facteur capital variable par la réduction des biens de consommation accessibles aux ouvriers. Elle prend deux aspects : inflation (marché noir) comme à l'Ouest et blocage des salaires réels. Quand la pression ouvrière devient trop forte, on lâche les augmentations nominales de salaire. A la différence ce des pays capitalistes développés, ces hausses sont essentiellement annulées par la pénurie des biens de consommation. Les ouvriers ne peuvent acheter, ils se serrent la ceinture n'ayant d'autre chois que de déposer leur part de salaire "excédentaire" dans les caisses d'Epargne[14] [14] (voir note 19, page suivante).
Ainsi, d'après l'Annuaire statistique du COMECON (1974), les dépôts en caisses d'Epargne de 1960 à 1976 se sont multipliés par 6 en URSS par 11 en Hongrie et par 13 en Pologne. De quoi fournir un crédit gratuit pour le capitalisme qui peut les investir dans l'industrie lourde ! Tous ces chiffres montrent que malgré l'accumulation capitaliste accrue, depuis plus d'une dizaine d'années les salaires réels ont eu tendance à stagner. L'emploi a donc été maintenu par une paupérisation relative colossale de l'ensemble de la classe ouvrière. Il est à noter qu'une telle "méthode" est peu efficace compte tenue de la faiblesse de la masse de plus-value obtenue en raison du faible taux de productivité. En Occident la place occupée dans la marchandise par le facteur y est compensée par une masse de plus-value obtenue par une productivité croissante, quand le chômage payé ne croît pas de façon démesurée.
Cependant tant à l'Est qu'à l'Ouest, le résultat est identique avec l'accélération de la crise : diminution du niveau de vie global de la classe ouvrière prise comme un tout, ramenée progressivement à un seuil physiologique. Pour une fraction de plus en plus importante de la classe ouvrière à l'Ouest, pour l'ensemble de la classe à l'Est vivant à la limite du SMIC officiel. La seule différence entre l'Est et l'Ouest consiste en ce que l'attaque contre la classe ouvrière à l'Est est faite beaucoup plus tôt et plus brutalement en raison de la faiblesse de l'économie. Seule la politique "keynésienne" de plein emploi permet de mystifier le degré de l'exploitation chez les ouvriers.
Nous verrons dans la deuxième partie de cet article :
- 1) La nature du capitalisme d'Etat à l'Est afin de déterminer les raisons profondes de la crise. Le capitalisme d'Etat supprime t’il les causes classiques de la crise du capitalisme : baisse tendancielle du taux de profit, saturation des marchés ? Y a t’il crise de surproduction ou de sous-production ?
- 2) L'Impossibilité pour le capitalisme dans le bloc russe de trouver des solutions : ni par le commerce mondial, ni par le développement du marché interne.
- 3) Le degré de crise politique et le caractère de la lutte de classe face au capitalisme d'Etat.
Ch.
[1] [15] Pour la première fois dans l’histoire du bloc russe, un pays comme la Hongrie s’est trouvé dans l’obligation d’ouvrir tous ses comptes bancaires et de les communiquer au FMI, pour prouver sa solvabilité et recevoir ainsi les précieux crédits de cette institution.
[2] [16] Selon Souvarine (Staline), lors d'un recensement de la population effectué en 1937, au Heu de V70 millions d'habitants escomptés, on ne trouve que 147 millions (chiffre de 1928) de "citoyens socialistes". Après avoir fait disparaître les résultats et les statisticiens "contre-révolutionnaires", un nouveau recensement en 1939 se chargea de trouver -enfin - les 170 millions d'habitants. Il est difficile de savoir comment se répartissaient les 23 millions de fantômes entre les cimetières et les camps de concentration.
[3] [17] Chiffres extraits de l'Annuaire statistique du COMECON (1971)
[4] [18] cf. : L'URSS telle qu'elle est de Yvon (1937), témoignage d'un ouvrier français ayant travaillé en Russie, qui indique que le salaire réel mensuel est passé de. 800 kgs de pain en 1927 à 170 kgs en 1935, pour remonter faiblement à 260 kgs en 1937.
[5] [19] Il s'agit de Programme Communiste en France et de II Partito Comunista, scission de ce dernier en Italie. Tous deux considèrent que c'est dans les années 60 que le capitalisme russe est entré dans une phase de "maturité", après avoir connu une phase d'expansion "juvénile" lors des plans quinquennaux Bordiga voyait même en Staline un "révolutionnaire romantique" (sic) porté par le "tumultueux développement capitaliste".
[6] [20] cf. : Le Conflit du Siècle de Fritz Sternberg.
[7] [21] Souvarine qui fait recouper les déclarations officielles contradictoires montre "qu'aucun chiffre n'a de signification précise". Par exemple : "En 1932, il a été coulé 6,2 millions de tonnes de fon te au lieu de 10 escomptées par le plan et des 17 prévues par Staline au 16ème Congrès. Il a été ex trait 62,4 millions de tonnes de houille au lieu de 7,5 (Plan), de 90 (chiffres de contrôle) et des 140 fixées par le Comité Central (décision du 15 août 1931)..".
[8] [22] L'Etat russe ira jusqu'à prélever 85% de la production agricole qu'il n'arrive pas à développer en raison de la médiocrité du matériel (sur les 147.000 tracteurs des sovkozes, 137.000 sont endommagés) et de la résistance paysanne (en 1932, la récolte de céréales est de 69,9 millions de tonnes pour 96,6 en 1913) qui refuse de produire pour le "roi de Prusse".
[9] [23] Les extraits de Military Balance (Londres) sous-estiment une réalité où s'enchevêtre inextricablement production civile et production d'armements
[10] [24] Vassil VASSILEV, dans son livre Rationalité (sic) du système soviétique (1976) cite des chiffres extraits de thèses à huis clos (dites Zakritata teza ; publié seulement après l'agrément de la censure et « où les auteurs de tels travaux ont pu accéder à des sources statistiques ne figurant sur aucun annuaire de statistique officielle ».
[11] [25] Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cet article.
[12] [26] GLAT : groupe de Liaison pour l’Autonomie des Travailleurs (Lutte de classe), groupe révolutionnaire dont Révolution Internationale a fait la critique dans le numéro RI nouvelle série.
[13] [27] Notes et études documentaires (9 septembre 1977) : l’Europe de l’Est en 1976.
[14] [28] Les ouvriers épargnent en attendant des produits disponibles sur le marché libre. Il est bien évident que seule une mince couche de la classe ouvrière peut épargner, la majorité n'ayant pas de salaire supérieur à la simple production et reproduction de sa force de travail. Si l'argent de son salaire doit être de plus en plus déposé dans les banques ou caisses d'Epargne, avant d'être touché, cela ne lui donne aucune possibilité de disposer d'un crédit à l'achat ou d'anticiper des achats au tres que ceux immédiats de la consommation mensuelle. L'Epargne reste le fait des couches moyennes ou de la bourgeoisie dont les revenus ne peuvent s'échanger contre des marchandises qui font défaut sur le marché (ou trop onéreuses pour être achetées immédiatement : une voiture représente trois années de travail d'un ouvrier moyen).
Géographique:
Questions théoriques:
- L'économie [30]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le chemin difficile du regroupement des révolutionnaires : Lettre ouverte du CCI après la Conférence d'Oslo (septembre l97
- 3301 reads
En septembre 1977 s'est tenue une conférence de discussion internationale convoquée par des groupes politiques de Norvège (dont Arbedarkamp) et de Suède (dont Arbetarmakt-Workere Power League et Internationell Révolution) à laquelle assistaient la CWO et le CCI. Nous publierons ultérieurement le texte présenté par le CCI à cette conférence, texte qui souligne la nécessité de la clarification sur la nature du capitalisme d'Etat et sur le rejet des luttes de libération nationale, deux questions au coeur du débat en Scandinavie, pour pouvoir dégager la perspective d'un regroupement international.
Il y a à l'heure actuelle trois choses que tout groupe se voulant révolutionnaire doit comprendre : premièrement, qu'il existe d'autres groupes, qu'il n'est pas le seul, "l'unique"', qui évoluerait en va se clos ; deuxièmement, que le développement de la conscience de classe passe nécessairement par la confrontation des positions politiques partout dans le monde dans le milieu révolutionnaire ; troisièmement, que cette discussion essentielle doit être organisée, qu'elle ne peut pas se poursuivre par "ouï-dire" mais seulement dans un cadre approprié, déterminé par le besoin d'un regroupement des énergies révolutionnaires.
Il faut donc dégager les accords politiques mais aussi cerner les points de désaccord entre les groupes. Les révolutionnaires doivent avoir des critères pour déterminer quels désaccords sont compatibles dans une même organisation. Le CCI est toujours convaincu qu'il faut rejeter le monolithisme. Cette notion qui exige un accord total sur tout et à chaque instant pour pouvoir constituer une organisation révolutionnaire vient de l'aberration des petites sectes ; elle n'a jamais fait partie du mouvement ouvrier. Cependant, il faut reconnaître des limites aux divergences possibles dans un groupe prolétarien. C'est pour toutes ces raisons que la discussion doit être organisée de façon efficace. C'est pour défendre ce point de vue qui nous semble franchement UNE EVIDENCE, que le CCI s'acharne à pousser dans le sens d'une plus ample discussion internationale. Que cet acharnement ne soit pas toujours compris, les textes de ce numéro en témoignent. Nous ne faisons pourtant que poursuivre, à notre niveau, l'effort des révolutionnaires depuis Zimmerwald, les premières années de l'Internationale Communiste, la Gauche Communiste, la Gauche Italienne qui, en 1923, lançait un appel à la discussion et au travail de recherche en commun, dans le n°1 de Bilan, appel adressé aux différents groupes révolutionnaires qu'elle estimait proche, tout en gardant une fermeté exemplaire sur les positions programmatiques. La Gauche Italien ne à l'époque était loin de ce pâle fantôme qu'est le PCI (Programme Communiste) aujourd'hui dont la mégalomanie sur le parti cache mal la dégénérescence des positions politiques. L'esprit d'ouverture, le besoin de rapprochement des révolutionnaires dominaient le travail d'Internationalisme des années 40, pour ne citer que cet exemple du groupe qui est le prédécesseur direct du CCI. Cette préoccupation anime notre courant depuis ses débuts d'autant plus que s'ouvre aujourd'hui une nouvelle période de crise et de luttes ouvrières.
C'est avec le souci de la confrontation des positions politiques que le PC Internationaliste ("Battaglia Comunista") a convoqué la Conférence de Milan, et c'est dans cet esprit que le CCI y est allé et a invité d'autres groupes à se rendre à ses Congrès. Quand nous sommes allés à Milan, c'était en insistant pour que "Battaglia Comunista" invite d'autres groupes y inclus tous ceux issus de la Gauche Italienne. Avons-nous demandé un "rassemblement" sans principes ? Absolument pas. Le CCI a rejeté l'idée d'inviter des groupes trotskystes (dont Combat Communiste) et a insisté sur la définition de critères politiques clairs pour une telle conférence[1]. De même nous rejetons la méthode qui consiste à courir derrière les petits groupes soi-disant "autonomes" dont on ne sait pas où ils vont ni ce qu'ils représentent politiquement, dans le style racolage dans lequel tombe le PIC (Pour une Intervention Communiste). Au contraire, c'est avec le souci de rencontrer des groupes politiques sérieux que le CCI est allé à Oslo en septembre. La lettre que nous publions ci-dessous constitue un bilan de cette expérience qui s'efforce de clarifier le fait que les révolutionnaires ne discutent pas "pour discuter", ni pour "se clarifier" dans l'abstrait, mais pour oeuvrer concrètement et consciemment vers un regroupement. Tout ce qui va dans ce sens est positif malgré les obstacles. Tout ce qui tourne le dos à ce souci est négatif et accentue encore davantage l'isolement et la faiblesse du mouvement révolutionnaire ressurgissant aujourd'hui.
Lettre ouverte du CCI après la Conférence d'Oslo (septembre l977)
Chers camarades,
Nous vous écrivons cette lettre afin de pour suivre la discussion politique entamée par les différents groupes à" la Conférence d'Oslo, pour préciser les interventions du CCI et pour tirer le bilan de cette expérience.
Dès le départ, le processus de clarification politique en Scandinavie a préoccupé le CCI (cf. la "Lettre ouverte à Arbetarmakt" en 1975[2], les visites à différents groupes durant ces deux dernières années, la correspondance engagée), car un tel processus concerne tous les révolutionnaires et ses répercussions sont loin d'être simplement locales.
L'internationalisme est le fondement du mouvement ouvrier ; il est l'expression même de la lutte du prolétariat mondial contre le capital, contre l'exploitation et contre l'aliénation. Il n'est pas une simple addition des luttes des différents prolétariats nationaux, et ne se ré duit pas seulement à une question de solidarité ou d'aide mutuelle. C'est l'unité fondamentale de la classe ouvrière, l'unité des problèmes qu'elle rencontre dans sa lutte qu'exprime l'internationalisme, l'unité de ses expériences et des leçons qu'elle en tire. L'Internationalisme est une expression des buts du programme communiste qui, dans cette période de décadence du capitalisme, constitue la seule base pour un mouvement révolutionnaire dans n'importe quel coin du globe.
Ce qui est vrai pour la classe ouvrière dans son ensemble l’est encore plus pour ses éléments révolutionnaires. Contrairement à la bourgeoisie et à son principe de "non-ingérence dans les affaires intérieures" propre à son cadre nationaliste, pour le prolétariat il n'y a pas de questions politiques "scandinaves" qui seraient distinctes de l'ensemble du programme communiste. Il n'y a pas d'affaires spécifiquement "scandinaves" qui devraient être résolues en Scandinavie "avant" de porter le débat à 1'"extérieur". C'est la compréhension de ce fait fondamental qui a déterminé la convocation de la récente Conférence d'Oslo.
Le mouvement révolutionnaire ne produit pas des organisations qui sont circonscrites à la nationalité ou à la région où elles surgissent, mais des organisations qui se délimitent en fonction plutôt de différents courants de pensée politique au sein du prolétariat. Le but d'une organisation révolutionnaire est de contribuer au développement de la conscience de classe au sein du prolétariat par une intervention basée sur des analyses politiques claires. Ce but ne peut en aucun cas être favorisé en flattant une soi-disant exclusivité nationale ni un "auto développement". Les courants politiques ne se développent pas nécessairement de façon homogène dans une "patrie" et le processus de regroupement des révolutionnaires en Scandinavie par exemple ne peut se réaliser dans l'isolement. Il doit bénéficier de la réflexion et des expériences (et des erreurs afin de ne pas les répéter) des autres courants révolutionnaires d'hier et d'aujourd'hui ; il faut rechercher des contacts et des discussions à l'échelle internationale, pas seulement avec le CCI, mais avec la CWO, le PIC, "Battaglia Comunista", Fomento Obrero Revolucionario, c'est-à-dire les principaux courants du milieu révolutionnaire international aujourd'hui. C'est dans cet esprit qu'a été lancée l'invitation à la Conférence d'Oslo et que le CCI ressent pour lui-même la nécessité de participer à de tels efforts ; (il en fut de même pour la Conférence convoquée par "Battaglia" en mai 1977). Nous ne pouvons que souhaiter que de telles tentatives se poursuivent et se multiplient. C'est dans ce cadre que nous voudrions apporter notre point de vue sur la Conférence d'Oslo et ses discussions.
Avant toute chose, la Conférence d'Oslo a marqué un pas important vers une meilleure compréhension politique des questions fondamentales qu'elle a abordées. L'ordre du jour comprenait des discussions sur le capitalisme d'Etat et sur la nature des luttes de libération nationale dans la période actuelle. Les participants à la Conférence ne se limitaient pas seulement aux représentants des différents groupes et cercles en Norvège et en Suède (Arbetarmakt, Arbedarkamp, Groupe d'Etude Marxiste, För Komunismen, Internationell Révolution, cercle de Trondheim, etc.) mais comprenaient également des délégations de la CWO et du CCI. Dans ses buts et ses grandes lignes, on peut vraiment considérer que cette conférence (ainsi que les deux précédentes tenues en Scandinavie) est une manifestation du resurgissement et de la recherche de la classe ouvrière aujourd'hui.
Cependant, nous avons pu constater pendant la Conférence des préoccupations disparates et par fois contradictoires que nous définirons en gros comme suit :
-
une volonté militante de clarifier les perspectives politiques afin de devenir un facteur actif dans la lutte de classe ; cette préoccupation animait la majorité des camarades à la Conférence ;
-
une certaine approche académique qui considérait le marxisme comme un objet de colloques universitaires ;
-
une préoccupation diffuse de "se réaliser individuellement" marquée des vestiges de l'idéologie de la "révolution totale" de 1968.
Par exemple, on a retrouvé cette dernière préoccupation plutôt confuse dans le fait que pour certains, les conférences politiques étaient plus une opportunité pour se réaliser et s'exprimer individuellement qu'un lieu de confrontation collective d'analyses et de positions. La mystique de la "révolte dans la vie quotidienne" aidant, cette fixation sur l'individualité est aussi partiellement responsable du manque de cohésion et de structure collective dans certains des groupes.
Cette préoccupation diffuse caractéristique de l'idéologie libertaire est peut-être due aux origines de beaucoup de ces groupes qui viennent de scissions de la Fédération Anarchiste. En tous cas, la réalisation individuelle dans le capitalisme est une impossibilité et la quasi-totalité des efforts pour concrétiser la "révolution totale" aboutit à une caricature de "comportement libéré". En fait, on ne fait pas des conférences révolutionnaires pour sa propre expression ou réalisation individuelle mais pour préciser une orientation politique et pour permettre l'élaboration et la confrontation la plus fructueuse des idées. Dans sa forme la plus absurde, la conception individualiste mène à l'idée que si quelqu'un s'ennuie ou a sommeil, il n'a pas besoin de se présenter aux réunions : chacun pour soi c'est la fin de toute action organisée et collective.
Quant à la seconde préoccupation, l'orientation académique, elle était plus évidente et s'est exprimée ouvertement. Tout d'abord, i1 a été proposé de transformer la Conférence en une série de séminaires, en petits groupes d'études avec des chefs d'équipe, un procédé qui est typique des conférences universitaires à l'anglai se fort respectables et même un peu progressistes. Cette suggestion tombait vraiment a côté, vu le petit nombre de militants qui participaient à la Conférence. L'invitation adressée au CCI spécifiait a l'origine que le CCI et la CWO avaient chacun deux ou trois heures pour "faire une conférence suivie de questions", exactement comme si on invitait un professeur étranger à faire un cours sur la marxologie avancée ou sur la conception du néant selon Kierkegaard. Le CCI avait soulevé cette question dans sa correspondance et ce projet avait été changé. Ensuite i1 y eut une insistance inquiétante sur certains sujets ("qu'est-ce que le capital ?" ou “la baisse du taux de profit” et “la saturation des marchés”) qui étaient considérés comme bien plus dignes que d'autres points bien trop "politiques". En fin, il y avait un dédain, si ce n'est une hostilité ouverte, vis-à-vis de la polémique, vis-à-vis du débat et de la confrontation de positions politiques qui polluaient probablement l'air pur de l'étude "désintéressée". Confronter les positions était considéré comme "superficiel" ou comme "parler comme un tract".
Poussée jusqu'au bout de sa logique, cette attitude mène au rejet du but même de la discussion : tirer des conclusions politiques et arriver à une orientation générale qui détermine le cadre de l'intervention dans la lutte de classe. Le fait que les révolutionnaires souffrent aujourd'hui de la rupture organisationnelle avec le mouvement ouvrier passé due aux longues an nées de contre-révolution, le fait qu'il soit énormément difficile de retrouver les liens historiques et théoriques avec le marxisme révolutionnaire, ne peuvent en aucun cas servir de prétexte pour abdiquer de ses responsabilités poli tiques. Quel que soit le temps que peut prendre un processus de regroupement, en Scandinavie ou ailleurs, le cadre de la discussion ne peut jamais être "l'étude pour elle-même" ; le regroupe ment des révolutionnaires sur une base programmatique claire doit être le but explicite qui dé termine le contenu, la forme et le rythme de la discussion. Un cercle d'étude peut bien sûr constituer une étape dans la clarification politique dans la mesure où il ne devient pas une fin en soit "pendant dix ans", ou encore une illusion d' auto éducation qui devient complètement étrangère a tout contenu révolutionnaire.
Il ne s'agit pas seulement ici de critiquer certaines "formes" académiques d'organisation. Contre l'idée d'un fonctionnement académique en petits séminaires, il serait suffisant que les camarades sortent de leur coquille et participent à d'autres conférences de révolutionnaires ailleurs dans le monde, ou lisent comment les conférences de révolutionnaires procédaient dans le passé. Non, ce n'est pas une question de forme en soi mais une question plus large, une question de méthode.
Le marxisme est une arme de combat, une arme dans la lutte de classe. Ce n'est pas une science neutre. Si nous sommes tous d'accord pour approfondir notre compréhension du marxisme et pour l'utiliser dans la situation présente, on ne peut le faire qu'en tant que militant révolutionnaire engagé. La marxologie dont parlent les intellectuels des institutions bourgeoises, est une récupération vidée de sens et dénaturant le contenu du matérialisme historique.
En ce qui concerne le reproche aux "polémiques", dans la méthode marxiste il y a nécessairement un affrontement de forces sociales et la confrontation des positions politiques. La notion d'ex-posé "neutre" d'idées n'a rien à voir avec le marxisme qui, à travers toute l'histoire du mouvement ouvrier, s'est précisément développé comme critique et polémique. "Le Capital" de Marx qui semble être un point de fixation de certaines préoccupations, a été écrit comme une "critique de l'économie politique". La plupart des œuvres fondamentales du marxisme, les positions qui ont influencé le cours de la lutte de classe, les organisations du prolétariat et la vague révolutionnaire elle-même ont été élaborées au feu de la polémique à travers la confrontation des positions politiques, dans la pratique. Il n'y a pas d'autre marxisme.
De plus, les révolutionnaires marxistes ont toujours été conscients que la clarification est un processus qui, s'il n'a pas de "fin" a un commencement. Où commence-t-il aujourd'hui pour nous ? Est-ce qu'on doit refaire tout le chemin qu'a fait Marx et commencer avec Hegel (et pourquoi ne pas retourner à Platon pour avoir une idée encore plus claire de l'évolution de la philosophie) ? Est-ce qu'on doit commencer avec Quesnay et Smith et découvrir la loi de la valeur et l'étudier jusqu'en... 1977 ? Ou est-ce qu'on doit commencer comme l'a fait le CCI (et la CWO et le PIC), à partir de l'expérience de la plus haute et plus récente expression de la prise de conscience du prolétariat, le mouvement des communistes de gauche qui a rompu avec la dégénérescence de la 3ème Internationale ? Le critère est évidemment la situation dans la quelle se trouve la classe ouvrière aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une situation de paix sociale avec une perspective sans fin pour la maturation intellectuelle. Au contraire, la pression de la réalité impose à la classe ouvrière de résister à la crise du système capitaliste. Les surgissements sporadiques et épisodiques de révoltes rencontrent de puissants obstacles. Et dans ce contexte, il faut constater que les éléments révolutionnaires sont dispersés, et l'isolement guette même les groupes organisés. Que devons-nous penser dans ces conditions de ceux qui "n'ont pas de positions clairement délimitées" sur les principaux problèmes de la lutte de classe aujourd'hui et choisissent de passer leur temps à compter les points à propos de la baisse tendancielle du taux de profit contre la saturation des marchés ?
Bien que ces points de clarification théorique puissent avoir des conséquences sérieuses sur un plan général, ils ne sont pas et n'ont jamais été (pour Grossman, Mattick, Luxembourg ou Lénine) les facteurs déterminants du regroupement des révolutionnaires ni de leur intervention. Des camarades qui ont des positions théoriques différentes sur cette question ont travaillé dans la même organisation parce que leur accord était, d'abord et avant tout, politique, basé sur une plateforme ou un programme commun. Les racines théoriques de la crise constituent très certainement un important sujet que Marx et ses successeurs ont tenté constamment de clarifier depuis plus de cent ans dans le mouvement ouvrier. Mais ce thème n'a de sens que dans le camp du prolétariat. La bourgeoisie peut aussi trouver la confrontation des deux théories "intéressante" et même "stimulante intellectuellement". Mais sans une claire délimitation d'un terrain de classe commun, d'une perspective révolutionnaire, une telle discussion en soi équivaut à tourner le dos aux questions politiques vitales qui se posent au mouvement ouvrier aujourd'hui.
De telles fixations académiques, quel que soit leur objet, sont en fait l'expression de l'hésitation et de la résistance à l'engagement militant dans la lutte de classe de la part d'éléments qui n'ont pas encore rompu avec le milieu étudiant. Un écran de fumée, l'aveu qu'on pense que la lutte de classe est "tellement loin"... A ce sujet, les approches libertaires et académiques convergent vraiment.
Mais dans l'ensemble, en dépit de bien des difficultés, la préoccupation militante de clarification a dominé la Conférence. Les discussions ont mis en évidence la nécessité d'approfondir les questions suivantes :
-
Le capitalisme d'Etat, manifestation de la crise permanente du capitalisme décadent, une tendance qui existe dans tous les pays aujourd'hui à un degré plus ou moins grand ; cette position était défendue dans ses grandes lignes par beau coup de camarades de Scandinavie, et par la CWO et le CCI. Cette position s'opposait à la théorie du "mode de production bureaucratique d'Etat" dé fendue par des camarades d'Arbetarmakt ; leur document, sur la base des citations de Kuron et Modzelevski, considère les pays de l'Est et la Russie comme n'étant ni capitalistes ni socialistes, mais comme un "troisième système" qui serait "progressif" en l'absence de la lutte prolétarienne.
-
La question nationale aujourd'hui qui constitue l'application pratique de la compréhension de la décadence et du capitalisme d'Etat, les "luttes de libération nationale" sont le fer de lance de la préparation capitaliste à la guerre généralisée, et la formation d'un courant révolutionnaire solide en Scandinavie passe par un ferme rejet de toute ambiguïté sur la nature progressive du capitalisme d'Etat et du nationalisme.
C'est dans ce sens que le CCI tente de poursuivre le débat, et demande que les camarades d'Arbetarmakt considèrent sérieusement les ambiguïtés de leur position et les graves implications politiques de leur soutien aux luttes de libération nationale.
La discussion politique à la Conférence était très positive et les camarades Scandinaves ont fait un gros effort de traductions pour faciliter le débat. Beaucoup de décisions importantes ont été prises : publier un bulletin (en anglais aussi) avec les textes et le rapport de la Conférence pour fournir un cadre pour l'organisation d'u ne discussion ultérieure ; inviter d'autres groupes non Scandinaves à de futures conférences.
Il existe un potentiel révolutionnaire en Scandinavie mais les forces militantes doivent se libérer du poids des préoccupations académiques et libertaires. Si certains groupes ou cercles étaient plus représentatifs d'une certaine orientation, globalement, il n'y a pas d'homogénéité au sein des groupes Scandinaves. Aucun type de préoccupation n'était la caractéristique exclusive d'un groupe particulier. Certains des groupes existants ont des difficultés pour créer une cohésion organisationnelle, et pour assumer la responsabilité de publications régulières. Quand la cohérence n'est pas clairement définie politiquement, il y a peu de raisons pour qu'elle sache s'exprimer organisationnellement.
Tôt ou tard, les groupes Scandinaves doivent arriver à des conclusions dans leur définition politique. L'expérience a montré, en particulier depuis dix ans, que les groupes qui n'arrivent pas à se libérer de fixations académiques ou libertaires tombent rapidement dans le modernisme et disparaissent. La liste est trop longue : Manifestgruppen, Komunismen et Communist Basis en Scandinavie ; ICO, Mouvement Communiste en France ; For Ourselves aux Etats-Unis ; etc. Il semble toujours qu'on a "tout le temps qu'on veut"... et pourtant, c'est toujours les mêmes erreurs qui se répètent.
Les camarades se demandent souvent si le processus de clarification aujourd'hui et l'inévitable sélection qu'il entraîne, ne signifieront pas une forte réduction du nombre de militants, brisant la "fraternité" de la confusion ou de l'ambiguïté. Il faut dire que l'importance du regroupement sur la base des principes révolutionnaires va bien plus loin qu'une question de nombre dans le sens immédiat. Mais en fait, à long terme, la clarification apporte le seul résultat positif, même numériquement, parce que l'inertie et la lente décomposition (que ce soit pour retomber dans l'activisme le plus plat, ou dans des formes recherchées d'intellectualisme) démoralisent et épuisent les camarades, en particulier les nouveaux. En fin de compte, par manque d'orientations, tout le château de cartes s'écroule.
Le regroupement révolutionnaire aujourd'hui se heurte à beaucoup d'obstacles durant tout son processus. Ce n'est pas surprenant et les difficultés rencontrées en Scandinavie ressemblent beaucoup à celles rencontrées ailleurs. Néanmoins, il faut reconnaître les obstacles pour ce qu'ils sont. En ce sens, nous regrettons que la Conférence ait rejeté l'idée de mettre en place un comité de coordination (formé de membres de différents groupes et cercles en Scandinavie) qui aurait planifié les futurs efforts vers le regroupement, prenant en compte les points d'accord et les points qui doivent encore être clarifiés.
En fait, à la fin de la Conférence, certains camarades exaspérés par les aspects "trop politiques" de la discussion ou peut-être par 1'"intrusion" du CCI ou du CWO dans les débats Scandinaves, ont suggéré que la prochaine conférence en janvier ait lieu selon d'autres orientations : la limitation des groupes étrangers à deux camarades seulement (ceci est une modification à une proposition pour leur complète élimination), le re-établissement d'une forme de discussion en séminaires, un ordre du jour uniquement consacré aux théories des crises : “baisse du taux de profit” et “saturation des marchés”. Cette suggestion a été acceptée pendant la dernière heure de la Conférence malgré une autre proposition de la part d'autres camarades scandinaves qui voulaient que l'on poursuive la discussion sur les acquis de la discussion du moment dans une prochaine conférence, en approfondissant la question nationale et en discutant du rôle des révolutionnaires dans la lutte de classe.
Cette décision de ne discuter que de la théorie économique (Kapital Logik) à la prochaine conférence et donc durant les six mois de sa préparation équivaut à tourner le dos à la question vitale d'une définition politique et à refuser les implications de la discussion qui a eu lieu en septembre. La conférence de janvier telle qu'elle est maintenant envisagée, ne constitue pas une étape ou un pas en avant sur la voie de la clarification mais un détour, une manifestation de la résistance à voir la signification d'une plateforme politique et son importance cruciale.
La seule limitation du nombre des "étrangers" n'est-elle pas symptomatique d'une peur de confronter ses idées à celles des autres, d'une peur d'être "englouti" par ce qui est considéré comme des organisations "rivales", d'un désir de préserver son identité Scandinave et son individualité ?
Le CCI considère ce qui est actuellement prévu pour la conférence de janvier comme une dispersion des efforts révolutionnaires et un détour qui éparpille les énergies potentielles.
Considérant que c'est pour nous un énorme effort de voyager si loin pour ce que nous considérons sincèrement être une voie de garage : des séminaires sur "L'accumulation du capital" de Rosa Luxembourg ;
-
considérant qu'il nous est impossible d'intervenir en suédois ou en norvégien ni de comprendre ces langues sans traduction -ce qui serait pratiquement Impossible à réaliser en petits groupes ;
-
considérant que l'effort Indispensable de porter le débat sur un plan clairement politique se heurtera à une exaspération encore plus virulente de la part des éléments qui refusent cette orientation, il nous semble que la présence du CCI à cette Conférence est inutile et pour vous et pour nous.
En ce qui concerne l'ordre du jour de cette conférence, nous vous renvoyons aux textes que le CCI a écrit à ce sujet et à ceux de bien d'autres groupes aujourd'hui comme aux classiques du marxisme.
En ce qui concerne la question cruciale du regroupement des révolutionnaires en Scandinavie, une tâche qui touche profondément les révolutionnaires où qu'ils vivent, nous vous demandons de reconsidérer votre orientation actuelle et de prendre en compte la suggestion d'une conférence bien plus utile avec un ordre du jour tel qu'il avait été proposé au départ : la question nationale et le rôle des révolutionnaires dans le but explicite de s'orienter vers le regroupement des forces avant que l'élan de départ n'ait complètement disparu.
Camarades, c'est une illusion qui relève de l'idéologie bourgeoise que de penser que les problèmes du monde sont "si loin" de la Scandinavie. L'approfondissement de la crise économique, l'accélération de l'économie de guerre, le surgissement de la lutte de classe, la faiblesse du mouvement révolutionnaire due à la contre-révolution, tous ces facteurs rendent urgente, la formation d'un courant révolutionnaire en Scandinavie, dans ces pays qui vont être de plus en plus fortement touchés par la crise mondiale. Malgré les difficultés rencontrées par les groupes Scandinaves, l'organisation de la Conférence de septembre a commencé à répondre à une nécessité objective. Et dans ce sens, nous espérons que cette initiative sera un encouragement pour tous les révolutionnaires, Le CCI est intervenu avec l'intention d'aider le processus de clarification, et ceci non par la flatterie, par une "diplomatie secrète" ou par des "tactiques" subtiles, mais en établissant clairement quel est son point de vue et en critiquant les conceptions qu'il ne partage pas. La décision est entre vos mains tout comme la responsabilité ultime.
Cette lettre est une contribution au bulletin que vous avez créé. Nous espérons poursuivre la correspondance et les contacts avec tous les groupes et nous espérons vous voir dans de prochaines conférences. Nous réitérons notre invitation à tous les camarades à venir discuter avec nos sections quand ils le voudront et nous vous remercions par la même occasion de votre hospitalité lors de notre passage.
Fraternellement et salutations communistes,
le CCI.
Extraits de "BILAN" N°1 (novembre 1933) : introduction
-
Tirer le bilan des événements de l'après-guerre, c'est donc établir les conditions pour la victoire du prolétariat dans tous les pays. Notre fraction aurait préféré qu'une telle oeuvre se fît par un organisme international, persuadée comme elle l'est de la nécessité de la confrontation politique entre ces groupes capables de représenter la classe prolétarienne de plusieurs pays. Aussi serons-nous très heureux de pouvoir céder ce bulletin à une initiative internationale garantie par l'application de méthodes sérieuses de travail et par le souci de déterminer une saine polémique politique.
Notre fraction, en abordant la publication du présent bulletin, ne croit pas pouvoir présenter de solutions définitives aux problèmes terribles qui se posent au prolétariat de tous les pays. ...Elle n'entend pas se prévaloir de ses précédents politiques pour demander des adhésions aux solutions qu'elle préconise pour la situation actuelle. Bien au contraire, elle convie les révolutionnaires à soumettre à la vérification des événements les positions qu'elle défend aussi bien que les positions politiques contenues dans ses documents de base.
Ce n'est pas un changement dans la situation historique qui a permis au capitalisme de traverser la tourmente des évènements d'après-guerre : en 1933, d'une façon analogue, et bien plus qu'en 1917, le capitalisme se trouve être définitivement condamné comme système d'organisation sociale.
Nous sommes aujourd'hui à un terme extrême de cette période : le prolétariat n'est peut-être plus en mesure d'opposer le triomphe de la révolution au déclenchement d'une nouvelle guerre impérialiste. Cependant, s'il reste des chances de reprise révolutionnaire immédiate, elles consistent uniquement dans la compréhension des défaites passées. Ceux qui opposent à ce travail indispensable d'analyse historique le cliché de la mobilisation immédiate des ouvriers, ne font que jeter de la confusion, qu'empêcher la reprise réelle des lut tes prolétariennes.
Vie du CCI:
- Interventions [33]
Conscience et organisation:
Approfondir:
Quelques questions au CCI
- 3119 reads
Le
texte qui suit est une réponse de la "Communist Workers' Organisation" à l'article
"Les confusions politiques de la CWO" paru dans La Revue
Internationale n°10. Nous le saluons comme une contribution à la discussion
internationale parmi les révolutionnaires et, plus spécifiquement, comme
l'expression d'un nouvel intérêt de la CWO pour reprendre un dialogue politique
avec le CCI, ceci bien que la CWO n'ait pas changé l'évaluation qu'elle fait du
CCI : un groupe "contre-révolutionnaire". Nous publions également
une réponse aux points spécifiques et aux critiques que la CWO met en avant
dans ce texte.
L'article "Les confusions politiques de la CWO" fait la preuve une fois de plus de l'impasse dans laquelle se trouve le CCI. D'une part on nous dit que la CWO et le CCI partagent les mêmes positions de classe, d'autre part une cri tique de nos "confusions" révèle que nous sommes tout à la fois "près des" ou "virtuellement" substitutionnistes, staliniens et autogestionnaires. Est-ce que ce ne sont pas là des frontières de classe plutôt que des "confusions" compatibles avec les positions du CCI ? C'est seulement en prenant ses désirs pour des réalités ou par opportunisme qu'on peut faire un lien entre affirmer d'une part que nous partageons les mêmes positions de classe et d'autre part que nos confusions nous mènent à frôler les positions contre-révolutionnaires[1] [36]. Comme peu de vos membres hors du Royaume-Uni ou des États-Unis ont pu étudier soit nos positions, soit notre critique de celles du CCI, nous avons pensé qu'il peut s'avérer utile de reprendre quelques uns des points soulevés dans l'article cité ci-dessus et de démontrer les inconsistances du CCI. Une fois établies avec sérieux nos différences avec vous, nous espérons vous inciter à les traiter plus sérieusement que cela n'a été fait dans le passé.
1. L'analyse économique
L'analyse du CCI des contradictions du capitalisme s'oppose à celle présentée par Marx dans "Le Capital". Bien que cette dernière soit incomplète et consacrée inévitablement au capitalisme du 19ème siècle, le contenu fondamental et la méthode de la théorie de Marx peuvent être utilisés pour expliquer tous les phénomènes de la décadence du capitalisme[2] [37]. La CWO reconnaît que l'abandon des idées de Marx mène à diverses erreurs théoriques et pratiques qui peuvent pousser un groupe â la confusion ou même l'amener sur les traces de la contre-révolution[3] [38]. Ainsi, pour la CWO, i n'y a aucun problème sur comment mener l'analyse économique, établir une base de granit pour nos positions et élaborer une perspective politique. Mais qu'en est-i1 dans le CCI ?
"Nous reconnaissons pleinement l'importance de discuter de cette question (à savoir l'analyse économique de la CWO) au sein du mouvement ouvrier". (Revue Internationale n°10 [39]) On ne peut pas prendre au sérieux une telle affirmation puisqu'en neuf ans, depuis la fondation du groupe-père du CCI (Révolution Internationale), l'organisation n'a jamais fourni d'explications publiques et de défense de ses bases économiques qui aillent au-delà d'affirmations journalistiques. Le SEUL texte relativement soli de ("La décadence du capitalisme") ne fait mention de Rosa Luxembourg, dont le CCI prétend se réclamer pour les fondements de son analyse, qu'une seule fois. Malgré son "importance", l'analyse économique est beaucoup plus une addition décorative au marxisme et ne peut pas en elle-même mener a des confusions ou à la contre-révolution ; cette attitude est en effet tout à fait logique. Pourquoi perdre du temps a défendre l'analyse de Luxembourg, si on laisse de côté pour le moment le fait qu'elle est indéfendable[4] [40], puisque celle-ci ou toute autre théorie économique n'a pas d'implications ? Si le CCI reconnaît 1'"importance" de discuter des questions économiques, pourquoi ne l'a-t-i1 jamais fait de façon conséquente ? Plus sérieusement, pourquoi est-i1 "important" de discuter cette "question", si ses implications politiques sont peu importantes ? Ce que vous semblez réellement reconnaître (pour éviter d'être accusés de vulgariser le marxisme), c'est le besoin de dire que vous reconnaissez l'importance de l'analyse économique. Nous ouvrons au CCI notre revue Revolutionary Perspectives pour répondre au texte paru dans le n°6, "The Accumulation of Contradictions, or The Economic Conséquences of Rosa Luxembourg". De plus, nous vous invitons à expliquer pourquoi il est important selon vous de discuter l'analyse économique.
2. La Russie
Ce n'est pas seulement avec les théories économiques de Rosa Luxembourg que le CCI défend l'in défendable ; la même chose s'applique à son analyse du déclin de la vague révolutionnaire et de la fin du pouvoir prolétarien en Russie. Le CCI doit probablement être d'accord qu'en 1919 la classe ouvrière détenait réellement le pouvoir politique en Russie ; i1 est inconcevable autrement qu'ait pu se produire une révolution prolétarienne. Mais derrière un écran de fumée de "fantaisies", le CCI n'a jamais dit quand la classe ouvrière a finalement PERDU ce pouvoir. En effet, si nous sommes d'accord qu'en 1917 la classe détenait ce pouvoir, mais qu'en 1977 il n'en est plus ainsi, il s'en suit logiquement qu'à un moment donné elle a perdu ce pouvoir. Nous avons expliqué maintes fois que mars 1921 a été le Thermidor[5] [41]. (NEP, Kronstadt, le Front Unique) après lequel i1 n'est rien resté de prolétarien dans l'État russe, le Parti Bolchevik et l'Internationale Communiste. La défaite de la révolution mondiale a signifié l'impossibilité de toute autre issue à l'expérience héroïque russe. Le CCI, désireux d'éviter cette conclusion, se voit contraint à une série de convulsions à vous couper le souffle. Pour ne donner qu'un seul exemple, Kronstadt, frontière de classe autrefois, est maintenant excuse puisque les "principes" pour résoudre une telle situation n'avaient pas été essayés et expérimentés. Le prolétariat a-t-il besoin d'établir comme principe que son propre massacre est contre-révolutionnaire ? D'autres problèmes se posent au CCI lorsqu'il s'agit de traiter de la nature de classe des tendances en Russie liées au boucher de Kronstadt, Trotsky. Pourquoi la soi-disant opposition de gauche a-t-elle été une expression (quoique dégénérée) du prolétariat ? A cela aucune réponse n'a été donnée ni n'aurait pu l'être parce que le CCI n'a pas fait d'examen sérieux du programme de l'opposition et de Trotsky. Il est incroyable que le seul argument avancé a été que l'opposition a combattu l'idée d'un socialisme en un seul pays. En fait, le CCI se révèle n'être qu'un pauvre légataire. Comment l'opposition, qui est morte comme mouvement organisé en 1923, a-t-elle pu combattre une théorie qui n'allait apparaître que plus d'un an après ? Peut-être qu'une fois encore le CCI est simplement victime de son manque de clarté sur les faits. Est-ce réellement l'Opposition Unifiée de 1927 (Kamenev et autres) que nous saluerions puisqu'elle s'opposait nommément à la thèse du "socialisme en un seul pays" de Staline ?
Mais quoi qu'il en soit, l'idée que la proclamation du "socialisme en un seul pays" ait signifié que quelque chose avait changé en ce qui concerne la Russie ou le Parti Bolchevik est doublement absurde. En premier lieu, l'adoption de cette théorie n'a rien changé dans la politique des bolcheviks, du Kominterm ou de la Russie, qui étaient aussi contre-révolutionnaires avant qu'après son adoption ; de même elle n'a rien changé en ce qui concerne la position de la classe ouvrière russe. En second lieu, votre propre "méthode" dénonce la théorie de Staline comme une frontière de classe. Le rejet du "socialisme en un seul pays" n'était pas un "principe déjà établi". Comme vous le dites, même le pauvre vieux Marx avait des défaillances dans ce sens (cf."La Guerre Civile en France"), alors que Lénine défendait spécifiquement la possibilité d'une telle réalisation en 1915 (cf."Le Slogan des États-Unis d'Europe"). Ainsi, au mieux vous pouvez dire que le "socialisme en un seul pays", après la tentative qui a été faite et son échec, est devenu une frontière de classe, c'est-à-dire à la fin des années 30 ; en aucune manière, i1 ne pouvait le devenir instantanément lorsqu'il fut proposé par Staline (qui, quoi qu'il en soit, le considérait exactement de la même façon que Lénine considérait la NEP : une opération pour tenir jusqu'à la prochaine vague de la révolution en Occident. Voir Deutscher sur cette question). Vous ne pouvez guère laisser de côté la NEP de cette façon et mettre en avant le "socialisme en un seul pays" qui en fut l'aboutissement. Le CCI coupe en petits morceaux et change sa méthode selon les conclusions auxquelles il veut arriver. Les innovations de Staline ou les trahisons de la Social-démocratie sont instantanément des frontières de classe tandis que Kronstadt, le Front Unique, etc. ne le deviennent qu'après avoir été expérimentés et avoir échoué.
Si vous abandonnez l'idée de 1921 comme Thermidor, il n'y a aucune possibilité d'abandonner une position défaitiste sur la Russie jusqu'en 1940 lorsque celle-ci entre dans la guerre. Qui plus est, si la Russie avait quelque chose de prolétarien, entrer dans la guerre lorsqu'elle était attaquée par l'Allemagne nazie ne pouvait rien y changer, et nous serions forcés de repousser jusqu'en 1944-45, lorsque la Russie devient clairement impérialiste, pour rejeter toute défense de celle-ci. Les dernières publications du CCI montrent en effet clairement des signes dans ce sens et proclament que la défense de la Russie était une question ouverte jusqu'en 1940 (Revue Internationale n°10). Les leçons que nous tirons de 1'expérience russe influencent de façon cruciale ce que nous défendons comme la politique du prolétariat dans la prochaine vague révolutionnaire. Comme le CCI ne comprend pas les premières, i1 est incapable de comprendre la seconde.
3. L'État
Le CCI moralise de façon a-historique sur la question de l'État, ce qui l'amène parfois au bord de l'anarchisme et du libéralisme. Ce premier aspect s'illustre dans sa vision de l'État comme "essentiellement conservateur" et opposé à la "liberté" tandis que le second apparaît dans sa vision de l'État comme un "mal nécessaire" qui existe pour concilier ou servir de "médiation" entre les classes. Les fantômes de Kropotkine et de John Stuart Mill hantent les publications du CCI. Une analyse marxiste de l'État au con traire -tout en reconnaissant les traits communs à toutes les formes d'État- est une rupture avec de telles généralités comme celles qui obsèdent le CCI et voit chaque forme étatique historique comme porteuse de traits spécifiques. "Pour un marxiste, il n'existe pas d'"État" en général". (Karl Korsch, "Pourquoi je suis marxiste").
Si l'on prend comme exemple l'État asiatique ou despotique, on se rend compte qu'il était au début une force révolutionnaire organisant l'expansion des forces productives, regroupant par la force les producteurs dispersés en tribus dans des travaux publics à grande échelle. De même, l'État de la période absolutiste en Europe, était une alliance progressiste entre le monarque et la bourgeoisie pour jeter bas la nobles se féodale guerrière (le règne des Tudor en Grande-Bretagne par exemple). Les généralités a-historiques du CCI, qui refuse de voir ce qu'il y a de spécifique dans chaque forme étatique, se retrouvent dans l'approche qu'ils ont de l'État absolutiste. Dans la brochure sur "La décadence du capitalisme", on nous dit que c'était un organe conservateur destiné a soutenir la société féodale en déclin, un phénomène réactionnaire analogue au renforcement actuel de l'État bourgeois. En suivant la méthodologie de Luxembourg qui con fondait toutes les époques du capitalisme dans le capitalisme "en soi", le CCI confond toutes les formes étatiques dans l'État éternellement conservateur "en soi". Nous sommes ici en présence de l'idéalisme, l'idéalisme des "formes" platoniques.
En fait, l'État ouvrier n'est pas une expression de l'essence éternelle de l'État, mais une arme spécifique de la domination de classe destinée S détruire politiquement les ennemis du prolétariat. Hors de l'État-Conseils de classe, il ne peut y avoir aucun organe de nature politique exprimant les intérêts des classes ennemies. Il peut exister des associations à un niveau technique/économique sous le contrôle des soviets, il peut se créer des appendices de l'État ouvrier au travers desquels il communique avec les autres couches, mais l'idée d'un "État"extérieur aux Conseils Ouvriers est un anathème réactionnaire. Evidemment, dans le passé de tels organes se sont développés et c'était la tâche des communistes et de la classe de les détruire. Ainsi l'Assemblée Constituante en Russie était une expression de toutes les "classes non bourgeoises" particulièrement de la paysannerie. Le CCI critique-t-il maintenant les bolcheviks, comme Rosa Luxembourg, pour avoir dissout la Constituante qui aurait pu être une force de médiation pour éviter les "excès" du communisme de guerre ? Lorsqu'il tente de s'opposer à l'idée de la CWO qu'il peut y avoir un État ouvrier, le texte de la Revue Internationale n°10 nous accuse de faire le silence sur des institutions telles que le Sovnarkom, la Vesenkahn, l'Armée Rouge, de ne pas dire s'ils étaient des "organes de classe" de l'État ouvrier russe. Nous n'avons jamais fait le silence et nous ne le faisons pas : jusqu'au triomphe de la contre-révolution, ils l’étaient certainement. L'arme essentiel le pour détruire la contre-révolution ne sera pas des médiations mais la violence et la terreur.
Dans "L'Accumulation du Capital", Luxembourg verse beaucoup de larmes sur le destin des tribus, des artisans et des paysans précapitalistes. Cependant (malgré les affirmations réitérées du CCI sur le fait que son travail se base sur la loi de la valeur), le prolétariat, dont la plus-value qui lui est extraite assure la reproduction du capitalisme, mérite a peine une mention dans ce travail, encore moins une larme. Derrière la vision du CCI sur l'État dans la période de transition se cache un souci humaniste libéral semblable, pour les couches non-prolétariennes et leur destin. Ceci amène à la défense (au niveau des principes) de concessions politiques et économiques aux masses non-prolétariennes et aux aires économiquement arriérées du globe. Le prolétariat est certainement une minorité de la population mondiale, mais ce n'est pas un argument pour des médiations et pour la nécessité de concessions. Dans les pays où la grande majorité de la.production mondiale industrielle et agricole est concentrée, le prolétariat est une majorité de la population et peut traiter avec les autres couches par la force, la répression ou la dispersion selon le cas. Avec qui y a-t-il besoin d'intermédiaire au coeur du capitalisme ? La petite-bourgeoisie comme les commerçants ? Les couches professionnelles desquelles on peut tout juste s'attendre à ce qu'elles agissent de façon atomisée ? Une analyse de classe erronée, comme celle qui amène invariablement le CCI à ranger les "cols blancs" dans les "classes moyennes" ou même dans la petite bourgeoisie, mène à la vision que ces éléments douteux devront être maintenus dans leurs propres organisations distinctes de celle des ouvriers. Au contraire, l'intégration la plus rapide possible de tels groupes dans le travail productif sera la plus sure garantie contre la contre-révolution qui trouve sa base dans leurs rangs. Comme pour les millions d'êtres humains lumpenisés hors des pays capitalistes avancés, leur seul espoir est de suivre leur propre prolétariat et le prolétariat mondial vers le communisme. Au contraire de la paysannerie du passé, ils ne peuvent même pas se nourrir eux-mêmes et ne constituent certainement pas un grand obstacle au pouvoir prolétarien. Mais si un "État" surgissait réellement tel que le CCI le prévoit, baptisé dans l'eau bénite des groupes vraiment communistes, il servirait certainement de foyer pour la contre-révolution, ouvertement des couches non-prolétariennes, souterrainement du capital lui-même[6] [42].
C'est un argument fallacieux de dire que depuis Bilan qui défendait cette position dans les années 30, elle ne peut pas être une frontière de classe puisque le CCI et la CWO reconnaissent Bilan comme un groupe prolétarien. Si cette position sur l'État est une frontière de classe, demandons au CCI pourquoi Bilan n'est pas contre-révolutionnaire ? Bilan a aussi défendu le caractère prolétarien des syndicats, ce qui pour le CCI est une frontière de classe. On ne peut pas dire que ce fut seulement au cours de la 2ème Guerre Mondiale que cette question a été clarifiée ; comme pour la question de l'État qui a été posée au cours de la révolution et de la contre-révolution des années 1917-23. Ce que nous pouvons étendre aux groupes dans les profondeurs de la contre-révolution ne peut pas être étendu aux groupes émergeant dans une nouvelle situation pré-révolutionnaire. Nous pouvons défendre Bilan et dire que la question de l'État est une frontière de classe, tout comme le CCI peut le défendre bien que la question syndicale soit une "frontière de classe". Ou les syndicats deviendront-ils la prochaine "question ouverte" du CCI ?
4. Le Parti
Le CCI trouve impossible de comprendre les positions de la CWO sur cette question et est horrifié par ce qu'il voit comme nos "tendances substitutionnistes". Ce que le CCI ne saisit pas est que le substitutionnisme, comme 1'"autonomie", est un mot auquel il est impossible d'attribuer un conte nu qui ait un sens. Essayons de démêler le noeud gordien entourant cette question qui n'en est pas une. "Substitutionnisme" est sensé vouloir dire qu'une minorité de la classe tente de prendre en charge les tâches de l'ensemble de la classe. Le terme ne peut pas s'appliquer aux groupes bourgeois ; la domination minoritaire de la bourgeoisie sur les ouvriers n'est pas du substitutionnisme de l’une sur les autres, mais simplement la forme de domination de classe. Aussi, la question ne peut avoir de sens que par rapport aux groupes prolétariens, et en effet le CCI pense que des groupes communistes peuvent franchir les frontières de classe sur la question du "substitutionnisme". Nous devons clairement distinguer deux questions bien séparées.
D'un côté, il y a la position formulée au départ par Blanqui, reprise d'une certaine manière par Lénine et Bordiga ensuite, qu'une minorité communiste bien organisée peut s'emparer du pouvoir au nom de la classe ouvrière et garder le pou voir pour eux. Ceci est certainement une confusion mais ne peut être en aucun cas une frontière de classe. Nous voulons que le communisme évite l'anéantissement de l'humanité, là est le but, peu importe les moyens. Pourrait-i1 se réaliser par des coups de main blanquistes ou pour quoi pas par lévitation, tel serait alors notre programme. La question n'est pas morale. Au contraire, puisque la conscience et la participation active de la classe sont nécessaires pour battre les ennemis de la révolution et construire une nouvelle société, une telle vision de tactiques minoritaires est simplement une lamentable confusion.
L'autre côté de la même pièce sur la question substitutionnistes se situe à un niveau plus sérieux. Selon le CCI, une des "frontières de classe" sur la question de l'État est que le parti politique ne vise pas à prendre le pouvoir. Au lieu de cela, il se contente d'être une"facteur actif de 1'auto-organisation et de 1'auto-démystification de la classe ouvrière", quel que soit le véritable sens de cette phrase creuse. Si la majorité de la classe au travers de ses expériences devient consciente de la nécessité du communisme et est préparée à combattre dans ce but, elle mandate alors les communistes à des postes de responsabilité au sein des organisations générales de la classe. On peut au mieux parler d'une insurrection, pas d'une révolution tant qu'il n'y a pas de majorité communiste dans les organisations de classe. Et ces communistes mandatés ne viennent pas de l'air, ils sont membres du parti communiste (quoi d'autre ?). Par conséquent à son point victorieux, l'insurrection sera transformée en révolution, et le soutien de la majorité pour le communisme s'exprimera par la classe -via le parti dans les conseils- prenant le pouvoir. L'idée que la révolution pourrait réussir alors que la majorité de la classe n'est pas consciente de la nécessité du communisme, ou alors que la majorité des délégués aux conseils ne sont pas communistes, est absurde. Une telle conception ôte à la révolution son aspect vital -la conscience- et la réduit à un acte spontanéiste, conseilliste. Au mieux c'est une insurrection condamnée, pas une révolution. Aussi, si le "substitutionnisme", c'est-à-dire le parti cherchant â s'emparer du pouvoir, est une frontière de classe, alors le CWO a franchi ce Rubicon là depuis longtemps.
5. La théorie
Comme le parti a un rôle vital à jouer, il a besoin de savoir ce qu'il fait. Aussi, son programme et comment il est construit (la théorie) est vital. La théorie n'est pas un hobby ou un ornement des positions que nous connaissons déjà intuitivement, mais le chemin difficile qui nous fait parvenir réellement à ces positions. Nulle part ailleurs le déclin du CCI n'est plus marqué que dans la dégradation de la théorie et la tendance de son travail à devenir de plus en plus journalistique. Comme de plus en plus de problèmes sont considérés comme des "questions ouvertes" (et parallèlement de plus en plus de pourvoyeurs de contre-révolution considérés comme groupes prolétariens "confus"[7] [43], nous sommes sûrs que les tâches auxquelles nous faisons face sont "fondamentalement concrètes" (WR n°5, p.27) ou que les "questions d'interprétation historique" comme la mort du Komintern sont "entièrement hors de propos ?
Les tâches "pratiques" comme l'intervention et le regroupement ne peuvent être séparées de la théorie, de l'élaboration d'un proqramme communiste cohérent. Nous n'écrivons pas des textes théoriques ou des polémiques pour le plaisir de poser des questions, mais pour les résoudre ; c'est ainsi que le regroupement peut se faire, et avec lui l'intervention à une échelle plus large. La question du regroupement ne peut pas être posée dans l'abstrait, séparée des polémiques politiques ; c'est seulement si la discussion résout les points en question que l'existence d'organisations séparées devient injustifiée. C'est dans cet esprit que la CWO a été dans le passé et est aujourd'hui préparée à débattre avec le CCI duquel nous attendons des réponses aux questions soulevées dans cette lettre.
CWO. Octobre 1977[1] [44] Selon le CCI, la CWO s'oriente vers le "substitutionnisme". Or, ceci est une "frontière de classe" ou pour appeler un chat un chat, contre-révolutionnaire. Bien sûr, de telles conclusions sectaires ne sont jamais directement tirées de ces prémisses.
[2] [45] "Economics of Capitalist décadence" dans Revolutionary Perspectives n°2.
[3] [46] "On implications of luxembourgism" dans RP n°8.
[4] [47] Cette affirmation est démontrée dans "Economic conséquences of Rosa Luxembourg" dans RP n°6.
[5] [48] "Révolution and counter-revolution in Russia" dans RP n°4.
[6] [49] Sur notre position sur la période de
transition, voir les textes sous ce titre dans Workers'Voice n° 14 et 15.
[7] [50]
Les frontières de classe sont
tracées pour délimiter les groupes bourgeois des groupes prolétariens. Toute
autre conception les abaisse et les avilit. Aussi, nous ne pouvons que nous
opposer à la "nouvelle ligne" du CCI qui baptise toutes sortes de confusionnistes
et de contre-révolutionnaires, prolétariens, selon le critère le plus vague. Un
cadre qui inclut Programme Communiste (PCI) au sein du camp ouvrier est incapable
d'exclure de ce camp le SWP en Grande-Bretagne. En effet, si les frontières de
classe ne définissent pas un groupe prolétarien, alors toute la gauche est
prolétarienne. Toute cette question sera traitée dans un prochain numéro de
Revolutionary Perspectives ; en attendant, nos positions sont tracées dans RP
n°8 : "Une réponse de la majorité".
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [51]
Courants politiques:
Approfondir:
Quelques réponses du CCI à la CWO
- 2852 reads
Comme le texte des camarades d'Aberdeen/Edimbourg le montre (voir dans ce numéro), le fait que la CWO ressente le besoin de "s'ouvrir" au monde extérieur (qui implique non seulement discussion avec le CCI, mais aussi la volonté de participer à des conférences internationales, d'ouvrir les pages des publications à des points de vue minoritaires, de faire une analyse de sa propre histoire - cf. RP n°8) est une preuve marquante du fait que, dans cette période, il est impossible pour des révolutionnaires sérieux de se retrancher dans l'isolement et d'éviter la question du regroupement.
Le texte d'Aberdeen/Edimbourg pénètre plus profondément les contradictions de la nouvelle orientation de la CWO, dans une évaluation de sa perspective présente et future ; aussi nous ne développerons pas plus ces points ici. Nous allons principalement nous concentrer sur les critiques politiques générales que la CWO fait au CCI. Bien que nous ne puissions pas répondre dans tous les détails, nous pouvons au moins faire quelques observations qui définiront les points qui nécessitent une plus grande discussion et une clarification. Pris en lui-même le texte de la CWO nous montre que le groupe souffre toujours des mêmes conceptions fausses et des mêmes confusions que nous avons examinées dans les articles précédents et qu'il a toujours une tendance marquée à présenter une image entièrement distordue des positions du CCI. Mais l'aspect le plus sain de ce texte est qu'il peut et doit servir de stimulant à de futures discussions publiques entre nos organisations.
Nous allons traiter les points spécifiques de la critique que la CWO met en avant :
1. L'économie
Pour la CWO, l'explication économique sert comme arme dans son arsenal sectaire. Ceci s'applique à la fois à la manière dont la CWO aborde le problème des fondements économiques de la décadence capitaliste et à la manière dont il applique l'explication économique à sa perspective politique générale.
Par rapport au premier aspect, nous rejetons l'assertion de la CWO selon laquelle notre analyse de la décadence, qui doit beaucoup à la théorie des crises de Rosa Luxembourg, est "en contradiction avec celle présentée par Marx dans Le Capital". Selon la CWO, les écrits de Marx sur la baisse du taux de profit sont suffisants pour expliquer la crise historique du capitalisme et il n'y a rien de plus à ajouter. Comme sur beaucoup d'autres questions, la CWO possède déjà une vision achevée. Elle est si acharnée à vouloir ignorer les autres aspects du problème qu'elle a commencé à dire que le problème de la saturation des marchés et de la surproduction n'a rien à voir avec Marx, mais est une invention de Sismondi et de Malthus (cf. l'article sur le crédit dans RP n°8). Les préoccupations de Luxembourg sur le problème de la surproduction de marchandises seraient, selon la CWO, une variante des théories non marxistes sur la sous-consommation (cf. RP n°6). Mais si nous retournons à Marx et Engels, nous voyons qu'ils considèrent le problème de la surproduction comme absolument crucial dans la compréhension des crises capitalistes. Dans "L'Anti-Dühring". Engels insiste sur la nécessité de voir la surproduction de marchandises comme un trait fondamental et qui distingue le mode de production capitaliste, et il critique sévèrement Herr Dühring pour ses confusions entre sous-consommation et surproduction :
- "Si donc la sous-consommation est un phénomène historique permanent depuis des millénaires, alors que la stagnation générale du marché qui éclate dans les crises par suite de l'excédent de la production, n'est devenue sensible que de puis 50 ans, il faut toute la platitude de l'économie vulgaire de M. Dühring pour expliquer la collision nouvelle non pas par le phénomène nouveau de surproduction mais celui de sous-consommation qui est vieux de milliers d'années".
De manière similaire, dans les théories de la plus-value, Marx attaque Say et Ricardo précisé ment parce qu'ils affirment que, bien qu'il puis se y avoir surproduction du capital, la surproduction de marchandises et l'engorgement général du marché ne sont pas des tendances inhérentes au procès d'accumulation capitaliste :
- "La surproduction est conditionnée spécifique ment par la loi générale de la production de capital : produire jusqu'à la limite imposée par les forces productives, c'est-à-dire, exploiter le maximum de travail pour un montant donné de capital, sans prendre en considération les limites réelles du marché ou les nécessités de solvabilité ; et ceci est mené à bien par l'expansion continue de la reproduction et de l'accumulation, et par conséquent la reconversion constante du revenu en capital, alors que d'un autre côté, la masse des producteurs reste liée au niveau moyen des besoins, et doit le rester selon la nature de la production capitaliste."
Nous développerons ces points dans des textes ultérieurs, avec une fois de plus une réponse à la critique de la CWO sur la théorie des crises de Rosa Luxembourg que la CWO a offert de publier dans RP. Mais pour le moment, il suffit de dire que la CWO ne fait pas de contribution constructive au débat sur la décadence si elle continue à proclamer ses prétentions à défendre la totalité de l'orthodoxie marxiste sur ce sujet tout en fermant les yeux sur un aspect crucial de la pensée de Marx et Engels. Puisque Marx a situé deux contradictions fondamentales dans l'accumulation capitaliste -la tendance du taux de profit à baisser et le problème de la réalisation de la plus-value-, il y a, d'une manière générale, deux théories des crises qui existent au sein de la tradition marxiste : celle défendue par Grossman, Mattick et la CWO qui souligne la baisse du taux de profit d'une part, et la théorie de Luxembourg qui insiste sur les problèmes du marché d'autre part. Le CCI a toujours considéré que le cadre élaboré par Luxembourg est plus cohérent et permet de voir comment ces deux contradictions fondamentales opèrent comme deux aspects d'une totalité, tout en considérant que ni Luxembourg ni le CCI n'ont fourni une réponse achevée. Nous pensons que c'est un débat qui peut et doit se développer au sein du mouvement révolutionnaire aujourd'hui et qui ne doit pas constituer un obstacle au regroupement, surtout dans la mesure où il n'y a pas de réponse toute faite, immédiate à cette question.
La lutte de classe actuelle ne jette pas une lumière directe sur ce problème qui reste une des questions théoriques les plus complexes pour les révolutionnaires. En affrontant la réalité de la crise, le mouvement prolétarien est obligé de comprendre le mécanisme interne du capitalisme qui mène inéluctablement aux crises. Mais une orientation politique claire basée sur la décadence du système est un préalable à l'approfondissement de cette question dans la pratique du mouvement ouvrier. C'est sur ce point que le mouvement risque de s'écarter du chemin en tombant soit dans l'académisme sectaire soit dans un activisme immédiatiste qui considère les questions théoriques comme étant des affirmations dogmatiques inutiles dans la "pratique". Le CCI est profondément convaincu que l'explication économique est une question fondamentale pour le prolétariat, mais cette question n'a de sens qu'au sein d'une intervention internationale cohérente basée sur le regroupement des forces révolutionnaires.
De même, nous n'avons jamais dit qu'aucune conséquence politique ne découlait des différentes théories. En juin 1974, lors du débat sur cette question avec Revolutionary Perspectives, nous avons présenté ce que nous pensions être les faiblesses de la théorie Grossman-Mattick comme explication de la décadence et les implications politiques possibles de ces faiblesses. En même temps nous avons encouragé RP à essayer de démontrer que le concept de décadence et les conclusions politiques qu'il implique n'étaient pas incompatibles avec la théorie de Grossman-Mattick.
Il n'y a pas de contradiction dans ce que nous avons dit alors car, bien que nous pensions que des explications différentes de la crise ont réellement des conséquences politiques, ces conséquences sont rarement directes et jamais mécaniques. Puisque le marxisme est une critique de l'économie bourgeoise, du point de vue de la classe ouvrière, la clarté politique provient d'abord et avant tout de la capacité à assimiler les leçons de l'expérience de la classe ouvrière. En dernière analyse, une compréhension de "l'économie" vient d'une perspective prolétarienne et non l'inverse. Marx fut capable d'écrire "Le Capital", non parce qu'il était un homme doué, mais parce qu'il était communiste, pro duit du mouvement prolétarien, de la conscience de la classe prolétarienne qui est seule capable de saisir la finalité historique du mode de production capitaliste. Sans aucun doute, une compréhension claire du fonctionnement du capital est cruciale pour atteindre une clarté politique d'ensemble mais nous rejetons la tentative stérile de la CWO de faire dériver v1rtuellement toutes les positions politiques de l'accord ou du désaccord avec l'analyse de la crise selon la baisse du taux de profit. Ainsi, dans le texte présenté à la Conférence de Milan, nous découvrons que, du "volontarisme" au "fétichisme organisationnel", de la prétendue fixation du CCI sur l'intervention en milieu gauchiste aux erreurs sur la période de transition, etc., tout peut être directement imputé à notre "luxembourgisme". Cette méthode pour critiquer des positions politiques se fonde sur une conception complètement fausse de la compréhension politique : la compréhension est le fruit de l'expérience de la classe et non d'une contemplation de l'économie in abstracto. Cette méthode est aussi illogique qu'inconsistante et n'explique pas pourquoi des groupes (le PIC et le CCI par exemple) peuvent avoir la même analyse économique et diverger sur les perspectives politiques, et vice-versa. Il est particulièrement ironique de voir la CWO utiliser une méthodologie similaire à celle de Boukharine qui, en 1924, attaqua les théories économiques de Luxembourg pour liquider le "virus du Luxembourgisme" de l'Internationale Communiste et pour montrer comment l'explication économique de Luxembourg mène à des "positions politiques erronées" selon lui, telles que le rejet des luttes de libération nationale, la sous-estimation du problème paysan et, par implication, le refus de la possibilité du "socialisme en un seul pays" dé fendue par Staline !
2. Dégénérescence de la Révolution russe
La CWO ne comprend pas la signification de la discussion lancée par le CCI sur comment évaluer la dégénérescence de groupes politiques prolétariens. Selon elle, le CCI a bâti une "nouvelle ligne" qui n'est rien d'autre qu'une tentative pour développer le "recrutement" dans le marécage du gauchisme. En fait, la discussion qui a abouti à la "Résolution sur les groupes politiques prolétariens" adoptée au 2ème Congrès du CCI (Revue Internationale n°11), n'a pas donné naissance à une "nouvelle ligne" mais à la clarification d'une position qui était implicite auparavant. La CWO n'a pas compris les motifs du débat et la méthode utilisée. Parce que nous disons que seuls des événements cruciaux, comme les guerres ou les révolutions, peuvent trancher définitivement la question de la nature de classe d'anciens groupes prolétariens, la CWO nous accuse de "faire l'apologie" de l'attaque contre Kronstadt et d'entre tenir l'idée que l'Etat russe a quelque chose de prolétarien jusqu'à la 2ème Guerre Mondiale. Même une lecture superficielle d'un seul de nos textes peut démentir cette assertion. Ce que nous avons essayé de montrer, c'est le chemin complexe et souvent difficile par lequel passe le mouvement ouvrier pour assimiler de nouvelles leçons, comme la dégénérescence de la révolution russe. Le décalage inévitable entre la réalité et la conscience signifie que des révolutionnaires sont devenus pleinement conscients de la nature capitaliste de l'Etat et de l'économie russes bien après que le prolétariat ait perdu son pou voir politique et que la contre-révolution ait triomphé. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que seuls les évènements majeurs dans l'histoire -même s'ils sont "symboliques", comme le vote des crédits de guerre ou la proclamation du "socialisme en un seul pays"- peuvent rendre clair pour les révolutionnaires de l'époque que d'anciennes organisations prolétariennes sont désormais devenues des ennemis de classe. Il est important de voir la différence entre ce qui peut être vu et compris aujourd'hui avec le recul historique, et ce qui a pu être compris par les révolutionnaires dans le passé. Par exemple, la Russie n'est pas soudainement devenue une puissance impérialiste en 1940 ; aujourd'hui, il est possible de tracer les tendances impérialistes de l'Etat russe à partir de 1921-22. Mais pour les révolutionnaires des années 30 et 40, ce point a été l'objet d'un grand nombre de polémiques et de débats dans le mouvement ouvrier et fut tranché de manière décisive par des événements tels que l'entrée en guerre de la Russie dans la 2ème Guerre Mondiale. Ces événements montrent, sans l'ombre d'un doute, que la Russie était intégrée entièrement dans le système impérialiste mondial, et que toute défense de la Russie signifiait participation à la guerre impérialiste et abandon de l'internationalisme. Avec les trotskystes et leur défense de "l'Etat ouvrier dégénéré", ce qui fut une grave confusion théorique culmina dans le franchissement définitif des frontières de classe.
Pourquoi est-il important de faire la distinction entre une grave confusion qui peut mener à la désertion du camp prolétarien et le franchisse ment définitif de la frontière de classe ? Pour quoi est-il important d'utiliser des critères extrêmement stricts pour déclarer la mort d'une organisation prolétarienne ? C'est parce que tout jugement précipité diminue la possibilité de con vaincre des révolutionnaires confus des erreurs de leur raisonnement ; cela signifie les abandonner à la bourgeoisie sans avoir lutté. Ceci est une leçon que la CWO a grand besoin d'apprendre. Selon elle, le CCI est contre-révolutionnaire aujourd'hui parce que ses confusions sur la période de transition le mèneront à agir contre la classe demain. En admettant que le CCI ait de réelles confusions sur cette question, la tâche de tout groupe communiste responsable n'est sûre ment pas de nous rejeter comme des contre-révolutionnaires sans espoir, mais d'essayer de lutter contre les erreurs dans l'espoir qu'elles ne nous mènent pas dans le camp capitaliste dans le futur. Où la CWO trouve-t-elle la prescience qui ferait de cet effort une perte de temps ? Quoi qu'il en soit, nous espérons que la reprise de la discussion de la part de la CWO signifie une réévaluation de son sens des responsabilités.
3. L'ETAT
Nous ne répondrons pas à l'affirmation de la CWO prétendant que "le CCI moralise de façon a-historique sur la question de l'Etat". A cette accusation, une réponse a déjà été faite dans "Etat et dictature du prolétariat" (Revue Internationale n°11). Nous voulons simplement souligner une inconsistance flagrante dans l'approche de la CWO sur la question. D'un côté, il est dit que "l'idée d'un Etat extérieur aux Conseils ouvriers est un anathème réactionnaire", c'est-à-dire que l'Etat, c'est les Conseils ouvriers et rien de plus, et de l'autre côté, il est affirmé cruement que le Sovnarkom, la Vesenkahn, l'Armée Rouge et la Tcheka étaient des organes de classe de l'Etat ouvrier russe. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Les communistes de conseils étaient au moins cohérents à ce sujet. Pour eux, les seuls organes prolétariens dans la révolution russe étaient les Conseils ouvriers, les Comités d'usine et les Gardes Rouges ; l'Armée Rouge, la Tcheka, etc. étaient des institutions bourgeoises des bureaucrates bolcheviks. La CWO, quant à elle, veut défendre un Etat qui n'est rien d'autre que les Conseils ouvriers alors qu'elle est prête à qualifier d'Etat ouvrier l'Etat soviétique de 1917-21. Mais l'Etat soviétique était évidemment constitué non seule ment de Conseils ouvriers mais aussi d'Assemblées non prolétariennes comme les soviets de paysans et de soldats, d'organes administratifs (Vesenkahn) et d'organes répressifs (Tcheka et Armée Rouge) qui étaient manifestement distincts des Conseils ouvriers. En fait, tout le drame de la révolution russe et de sa dégénérescence "de l'intérieur" s'est exprimé dans l'absorption progressive des Conseils ouvriers par ces autres corps de l'Etat. Là-dessus, la CWO garde le silence quant aux questions posées dans la Revue Internationale n°1O. Les ouvriers devaient-ils, dans les Comités d'usine et les Conseils ouvriers, accepter la discipline du travail qu'imposaient diverses institutions de l'Etat, "un mal nécessaire", afin de préserver l'ordre social dans la période post-révolutionnaire, ou les Conseils ouvriers devaient-ils assurer un contrôle sur tous ces organes ?
La contribution fondamentale de la Gauche italienne à l'approfondissement de l'analyse marxiste de l'Etat fut de montrer comment les intuitions de Marx et Engels à propos de l'Etat, vu comme une "trique", furent confirmées par l'expérience pratique de la révolution russe. Ainsi, Octobre écrivait en 1938 :
- "... l'Etat, même en y accolant l'adjectif "prolétarien", reste un organe de coercition, en opposition aiguë et permanente avec la réalisation du programme communiste. En ce sens, il est une expression du danger capitaliste tout au long du développement de la période de transition."
- “L'Etat, loin d'être une expression du prolétariat, est une antithèse permanente de la classe... Il y a une opposition entre la dictature de l'Etat prolétarien et la dictature du prolétariat”.
Comme on peut le voir dans les textes de la Revue Internationale n°11, il y a discussion aujourd’hui au sein du CCI sur des questions telles que : peut-on appeler l'Etat de la période de transition un Etat ouvrier, mais il est clair que les deux ré solutions présentées au 2ème Congrès du CCI ont assimilé cette compréhension cruciale développée par la Gauche italienne sur les caractéristiques négatives de l'Etat de transition. Ceci est quelque chose qui se confirmera être une question de vie ou de mort dans la période révolutionnaire qui vient, mais qui n'a même pas été entraperçu par la CWO. Avant de faire de grandes déclarations sur les "erreurs" de la Gauche italienne sur cette question, nous voudrions demander à la CWO de réfléchir sérieusement à la contribution faite par des groupes comme Bilan, Octobre et Internationalisme à notre compréhension présente de l’Etat.
4. Le Parti
Dans la Revue Internationale n°10, nous avons sou ligné que la CWO n'a pas saisi les leçons sur l'Etat et le parti tirées de l'expérience russe. Le dernier texte de la CWO a le mérite de dire claire ment ce qui, auparavant, était seulement implicite dans ses textes : à savoir que le rôle du parti communiste est de prendre et d'assurer le pouvoir, d'Etat. Bien que nous soyons en profond désaccord avec cette idée, nous saluons au moins le fait que le débat peut maintenant se développer sur une base sans ambiguïté. Dans de nombreux textes, nous avons essayé de démontrer pourquoi le fait d'assumer le pouvoir d'Etat par le parti bolchevik fut un facteur déterminant de la dégénérescence du parti et de la révolution comme un tout, et pourquoi ce n'est pas la tâche de l'organisation politique de la classe de prendre le pou voir. La CWO, ne comprenant rien à cela, pense que pour le CCI "la révolution pourrait réussir alors que la majorité de la classe n'est pas consciente de la nécessité du communisme". Sa position sur le parti révèle une grande incompréhension de la manière dont la conscience se développe au sein de la classe. Non seulement, la CWO rejoint la conception parlementaire selon laquelle la conscience communiste peut être mesurée par la volonté des travailleurs de voter pour un parti pour gouverner l'Etat mais elle est aussi entrain d'évoluer très fortement vers la position léniniste classique selon laquelle les Conseils ouvriers ne sont qu'une "forme" au sein de laquelle la masse "incohérente" de la classe est organisée et dans laquelle le parti -qui est la conscience communiste de la classe- a la tâche d'injecter un contenu communiste. La CWO ne voit pas que la conscience de classe -c'est-à-dire la conscience communiste- se développe dans l'ensemble de la classe et que les Conseils sont aussi un aspect de ce développement de la conscience communiste. Le parti est la fraction la plus consciente de la classe, il est une arme indispensable dans la généralisation de la conscience révolutionnaire mais sa clarté est toujours relative et il ne peut jamais représenter la totalité de la conscience de classe. Une fois de plus, la CWO ne peut soutenir deux thèses. D'un côté, il est affirmé correctement qu'une minorité ne peut se substituer à la classe dans la prise du pouvoir ; de l'autre, on appelle les ouvriers à déléguer le pouvoir d'Etat au parti. Mais, comme l'a montré la révolution russe, de la conception qui dit que le parti représente le pouvoir de la classe à celle du parti se substituant à la classe, il y a une marge étroite. Un signe certain que la conscience révolutionnaire se développe dans la classe demain sera son refus de laisser le pouvoir politique qu'elle seule peut assumer dans sa totalité, entre les mains d'une minorité.
Le cheminement de la CWO vers l'idée que le par ti "détient" ou "représente" la totalité de la conscience communiste est en harmonie avec l'idée qu'elle-même représente l'ensemble du mouvement communiste aujourd'hui, qu'elle possède la seule plateforme communiste du monde. Les conséquences désastreuses de cette théorie sectaire sont bien montrées dans le texte d'Aberdeen/Edimbourg.
5. La théorie
Nous avons souligné qu'étant donné le développe ment lent et inégal de la crise et de la lutte de classe aujourd'hui, les deux dangers auxquels font face les groupes révolutionnaires dans cette période sont l'immédiatisme -une tendance à surestimer chaque lutte partielle de la classe- et l'académisme -une tendance à répondre aux inévitables creux de la lutte de classe en se retranchant dans la recherche pour "la recherche". Le deuxième danger semble celui auquel se confronte la CWO aujourd'hui. Nous ne sommes pas impressionnés par sa déclaration selon laquelle le CCI glisse aujourd'hui vers une approche "journalistique" des questions théoriques, vers "un dénigrement de la nécessité de réflexion théorique et historique". Nous ne prétendons pas avoir épuisé toutes les aires de recherche -en fait, beaucoup ne font que commencer, ce qui n'est guère surprenant si l'on considère l'extrême jeunesse du CCI et du mouvement révolutionnaire dans son ensemble. Mais les déclarations de la CWO selon lesquelles nous avons perdu tout intérêt è la clarification théorique ne résistent pas à un examen de l'énorme effort exprimé par nos publications durant ces deux dernières années. C'est plutôt le reflet du retranchement de la CWO dans un rôle autoproclamé de seul gardien de la théorie communiste et en parti culier d'"économistes politiques" du mouvement révolutionnaire. La CWO a commencé à justifier cet te position -et à expliquer sa propre décomposition interne- en réagissant démesurément è la relative lenteur de la crise et au creux de la lutte de classe après 1974 (creux qui s'est en grande partie limité aux pays avancés). Pour la CWO, cela signifie qu'à la fois le regroupement des révolutionnaires et l'intervention dans la lutte de classe sont des perspectives très lointaines pour les révolutionnaires. Mais en faisant une séparation rigide entre aujourd'hui et demain à peu près comme si nous vivions maintenant dans une période de contre-révolution -la CWO renforce le fait qu'elle ne pourra être organisationnellement et politiquement préparée aux affrontements massifs et aux conflits de classe qui mûrissent partout aujourd'hui. La nécessité de réaliser une synthèse active entre la réflexion théorique, les considérations organisationnelles et l'intervention dans le mouvement de la classe est plus que jamais la tâche de l'heure. C'est la tâche que le CCI s'est donnée.
La CWO prétend que le CCI dit des choses contradictoires quand il affirme d'un côté que le CCI et la CWO défendent les mêmes positions de classe et devraient oeuvrer vers le regroupement et de l'autre côté souligne les confusions de la CWO. Pour nous, il n'y a pas de contradiction. Nous insistons sur la nécessité pour tous les groupes communistes de discuter ensemble et d'oeuvrer vers le regroupement. Mais ceci ne signifie pas qu'il faut masquer les divergences en s'engageant dans une fusion prématurée (à la manière de RP et WV comme l'explique le texte d'Aberdeen/Edimbourg). Cela veut dire discuter à fond des divergences de manière à voir lesquelles sont compatibles au sein d'une seule organisation et lesquelles sont des obstacles sérieux au regroupement. En même temps, un regroupement ne peut être basé que sur un accord sur les positions de classe, il demande aussi une perspective d'activité commune, une volonté de travail1er et de clarifier ensemble, une conviction profonde de la nécessité de l'unité au sein du mouvement révolutionnaire. Le CCI oriente ses discussions sur le regroupement avec les camarades d'Aberdeen/Edimbourg avec cette idée claire à l'esprit. Et nous espérons que le temps viendra où nous pourrons nous engager dans un processus similaire avec ceux qui restent dans la CWO. Notre seul futur est un futur commun.
Le CCI.Courants politiques:
Approfondir:
Questions théoriques:
- L'économie [30]
Revue Internationale no 13 - 2e trimestre 1978
- 2936 reads
Rapport sur la situation mondiale
- 2539 reads
1) L'approfondissement de la crise aiguë du capitalisme se poursuit de façon inexorable. On avait pu assister en 1975-76 à un semblant de reprise après l'aggravation très sensible de 1974, mais 77 a vu partout revenir une profonde "morosité". Si quelques pays réussissent à s'en sortir un peu mieux sur le plan des échanges commerciaux, comme l'Allemagne et le Japon, ils ne peuvent éviter une stagnation de la production ni une élévation du chômage. D'autres pays, comme les Etats-Unis réussissent mieux à faire face à une baisse de la production et sont momentanément parvenus à stopper une augmentation du chômage, mais en même temps ils connaissent un déficit commercial catastrophique et un effondrement de leur monnaie. Et ce tableau ne concerne que les pays les plus développés et puissants; donc les mieux armés face à la crise. La situation des autres est désespérée : inflation de plus de 20 %, chômage de plus en plus écrasant, endettement extérieur insurmontable et qui va en s'aggravant. On peut donc conclure à la faillite totale de toutes les politiques économiques tentées par la bourgeoisie : qu'elles soient néo-keynésiennes ou "monétaristes", inspirées de Harvard ou de "l'école de Chicago".
Et il ne reste plus qu'à essayer de s'en consoler en attribuant des prix Nobel aux économistes qui se sont trompés le plus : le sommet étant atteint évidemment quand on récompense un économiste de ses échecs professionnels en le nommant chef de gouvernement. En fait, la seule "perspective" que la bourgeoisie puisse présenter face à la crise est celle d'une nouvelle guerre impérialiste généralisée.
2) Une telle perspective, les secteurs "optimistes" de la classe dominante essaient évidemment d'en écarter la possibilité ou bien d'en rejeter la "responsabilité" sur les "forces du mal et du bellicisme". Dans la vision pacifiste, une entente entre belligérants et même entre blocs impérialistes est possible et mérite donc qu'on se mobilise pour elle. En fait, une telle vision est une expression typique de l'humanisme petit- bourgeois. Le plus grand reproche qu'on peut lui faire n'est pas qu'elle tourne le dos à la réalité mais qu'elle tende à maintenir des illusions extrêmement dangereuses dans la classe ouvrière :
- possibilité de réforme et d'harmonisation du capitalisme,
- non nécessité de sa destruction pour mettre fin aux catastrophes qu'il engendre.
De plus, une telle conception qui oppose un capitalisme "pacifique" à un capitalisme "belliqueux" constitue une excellente base pour une mobilisation guerrière des pays "pacifiques" contre les pays "militaristes". A l'heure actuelle, on peut assister à une forte offensive de la bourgeoisie sur ce terrain. C'est tout particulièrement le cas au Moyen-Orient où les négociations entre l'Egypte et Israël ne constituent absolument pas une "victoire de la paix", comme dirait le Pape, mais un simple renforcement des positions américaines en vue de mieux préparer les affrontements futurs avec l'autre bloc. Plus généralement, tout le battage sur la "sécurité européenne", la "défense des droits de l'homme" et autres "croisades de paix" de Carter ne constituent que les préparatifs idéologiques de ces affrontements au même titre que les grandes déclarations de soutien au "socialisme", à "l'Indépendance nationale" et à "l’anti-impérialisme" de la part de l'URSS.
3) Une version "moderne" de la conception pacifiste consiste à considérer qu'un affrontement généralisé entre puissances impérialistes n'est plus possible de par l'évolution de leurs armements et particulièrement la possession d'armes thermonucléaires qui, pour la première fois de l’'histoire "favoriseraient l'offensive au détriment de la défensive" et dont l'utilisation se traduirait par des destructions insurmontables pour toutes les bourgeoisies. Ce qu'il faut répondre à une telle conception c'est que :
- elle n'est pas nouvelle ayant déjà été utilisée à l'égard des gaz asphyxiants et des bombardements et ayant "prédit" la fin de toutes les guerres à la veille de 1914 et de 1939,
- elle suppose une "rationalité" du capitalisme et de sa classe dominante, chose qu'ils n'ont pas,
- elle induit l'idée que les guerres sont le résultat du vouloir des gouvernements et non le résultat nécessaire des contradictions propres du système,
- elle débouche sur la possibilité d'une 3ème alternative autre que guerre ou révolution. Outre qu'elle peut démobiliser la classe ouvrière en atténuant les dangers qui menacent l'humanité en l'absence de sa propre action, une telle vision a enfin le tort très grave d'apporter de l'eau au moulin de toute la mystification bourgeoise qui dit "si tu veux la paix, prépare la guerre".
4) En fait, l'expérience de plus d'un demi-siècle a démontré que le seul obstacle qui puisse s'opposer à la "solution " bourgeoise de la crise, la guerre impérialiste, n'est autre que la lutte de classe du prolétariat qui culmine dans la révolution. Si la guerre, par les sacrifices quelle impose aux classes exploitées et le traumatisme qu'elle provoque dans l'ensemble du corps social a pu déboucher sur la révolution, on ne peut pas en conclure qu'il y ait une marche simultanée ou parallèle vers chacune des deux alternatives. Bien au contraire : l'une s'oppose à l'autre. C'est parce que la classe ouvrière est embrigadée par la social-démocratie belliciste et donc battue idéologiquement que la bourgeoisie peut aller à la guerre en 14.
De même, la victoire du fascisme et de ses "alter-ego", les "Fronts populaires" constitue le préalable nécessaire à la guerre de 1939. Réciproquement c'est la lutte de classe et la révolution qui, en 1917 en Russie et 1918 en Allemagne, mettent fin à la guerre. A tous moments, la tendance dominante entre cours vers la guerre et cours vers la révolution est fondamentalement la traduction du rapport de forces entre les deux principales classes de la société : bourgeoisie et prolétariat. C'est pour cela que la perspective sur laquelle débouche la crise actuelle est déterminée par la nature de ce rapport de forces : la capacité pour le capitalisme de mettre en place sa propre "solution" à la crise est Inversement proportionnelle à la capacité de la classe ouvrière de résister et de répondre sur son terrain aux empiétements de la crise.
LE RAPPORT DE FORCES ENTRE CLASSES SOCIALES
5) Le niveau des luttes de la classe connaît à l'heure actuelle, à son détriment, un décalage très net par rapport au niveau atteint par la crise économique. Ce décalage ne peut pas s'exprimer dans l'absolu par rapport à un schéma idéal qui, à une valeur X de la crise, ferait correspondre une valeur Y de la lutte de classe. Par contre, il peut être mis en évidence en termes relatifs par une comparaison entre le niveau dos luttes actuelles et celui des luttes à la fin des années 60, début des années 70, alors que la crise frappait de façon beaucoup moins violente que maintenant.
Une telle comparaison peut et doit se faire tant sur un plan "quantitatif" du nombre de luttes et dont les statistiques peuvent donner une image, que sur un plan "qualitatif" de la capacité de ces luttes à remettre en cause l'encadrement syndical et rejeter les mystifications capitalistes. Ces deux plans sont nécessaires dans la mesure où il n'existe pas un lien mécanique entre la combativité et la conscience de la classe mais où également le nombre des luttes constitue en soi une donnée traduisant un certain niveau de conscience ou étant apte à favoriser celle-ci. Sur le plan "quantitatif", la comparaison fait apparaître depuis quelques années et particulièrement pour 1977, une diminution du nombre de grèves et de travailleurs impliqués dans celles-ci. On peut citer en exemple un grand nombre de pays mais certains sont particulièrement significatifs, comme la France entre 1968 et maintenant ou bien l'Italie entre 1969 et aujourd'hui. Sur le plan "qualitatif'', la comparaison entre le "mai rampant" italien, qui a connu le rejet explicite des syndicats de la part d'un nombre élevé de travailleurs et la situation présente où les syndicats contrôlent, malgré quelques ratés, l'ensemble de la classe ouvrière, parle d'elle-même. Une évolution semblable, bien que plus récente, s'est manifestée en Espagne où une période combats très durs pendant lesquels la classe ouvrière s'est donnée des formes de lutte comme les assemblées, a débordé fréquemment y compris les syndicats non-officiels et a manifesté des tendances à la généralisation dans une ville ou une région, est suivie par une période beaucoup plus "calme" où la signature d'un plan d'austérité n'a pas provoqué de réactions majeures et où les seules mobilisations massives se font sur des thèmes aussi mystificateurs que "l'autonomie nationale" y compris dans des provinces encore peu touchées jusqu'Ici par un tel virus.
6) A l'heure actuelle, les seuls pays qui connaissent des luttes importantes appartiennent à des zones excentrées par rapport au cœur du capitalisme. Il s'agit essentiellement de pays sous-développés ou à mi-chemin entre développement et sous-développement comme l'Amérique Latine (Argentine, Equateur, Bolivie), le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord (Algérie et Tunisie). De telles luttes sont une confirmation du fait qu'il existe dans ces pays, contrairement aux théories prétendant qu'ils doivent encore connaître un développement capitaliste pour qu'il s'y développe une classe ouvrière, un prolétariat capable de lutter pour ses propres Intérêts de classe au point même, dans certains cas, de faire reculer partiellement les menaces de guerre sur un plan local. Mais, en même temps, le fait qu'il faille chercher des luttes Importantes de la classe dans des pays où justement elle est moins concentrée, Illustre d'une façon frappante le fait que globalement la lutte de classe se trouve actuellement dans un creux,
7) Quand II s'agit d'expliquer les causes du décalage entre niveau de la crise et niveau de la lutte de classe, certains courants comme le FOR, par exemple, ont une Interprétation toute prête. Pour eux, la crise, l'insécurité, le chômage pèsent sur la combativité et la conscience de la classe ouvrière au point, de plus en plus, de la paralyser et de la jeter dans les bras des forces politiques bourgeoises. Dans cette conception, il ne peut y avoir de révolution contre le système que quand celui-ci fonctionne "normalement", en dehors des périodes de crise. A une telle analyse, on peut apporter les réfutations suivantes :
La crise ne constitue pas une "anomalie" du fonctionnement du capitalisme; bien au contraire, elle est une expression, la plus véridique et significative de son fonctionnement normal et ce qui était déjà valable dans la phase ascendante de ce mode de production prend une ampleur toute particulière dans la phase de décadence, si on estime que la classe ouvrière ne se révolte que quand "tout va bien" alors on rejette la vision historique du socialisme comme nécessité objective, on en revient aux théories de Bernstein et en niant l'existence d'une relation entre effondrement du système et lutte révolutionnaire, on est obligé de chercher pour cette dernière d'autres facteurs capables de la provoquer - tels que la conscience "fruit de l'éducation" ou la "révolte morale" toute l'histoire du mouvement ouvrier nous enseigne que les révolutions ne viennent qu'après des crises (1846) ou des guerres (1871, 1905, 1917), c'est-à-dire des formes aigues de crise de la société.
Il est vrai que dans certaines circonstances historiques, la crise a pu aggraver la démoralisation et la sujétion Idéologique de la classe (comme ce fut le cas au cours des années 30), mais c'était dans les moments où celle-ci était déjà battue, les difficultés qu'elle rencontrait venant alors Intensifier sa détresse au lieu de radicaliser ses luttes. Il se peut également que certaines manifestations de la crise comme le chômage puissent momentanément désorienter les travailleurs mais, ici encore, l'histoire enseigne que le chômage constitue lui aussi un facteur puissant de prise de conscience de la faillite du système.
En fin de compte, cette conception n'a pas pour seul inconvénient d'être fausse et Incapable de rendre compte ce la réalité historique maïs, de plus, elle conduit è la démoralisation de la classe ouvrière et à son apathie dans la mesure où elle aboutit logiquement à l'idée :
- qu'elle doit attendre patiemment que le système soit sorti de la crise avant d'espérer pouvoir le combattre victorieusement,
- qu'elle doit, pendant ce temps, modérer ses luttes qui ne sont promises qu'à des défaites.
Avec une telle conception, on est donc amené, et pire on incite la classe; à renoncer à la révolution au moment même où elle devient possible et donc à toute perspective révolutionnaire,
8) Pour rendre compte des périodes de creux dans la lutte prolétarienne et donc d'un décalage pouvant apparaître entre niveau d'une crise et le niveau des luttes, le marxisme a déjà mis en évidence le cours sinueux et en dents de scie du mouvement de la classe, différent en cela de celui de la bourgeoisie par exemple et l'explique par le fait que le prolétariat est la première classe révolutionnaire de l'histoire n'ayant dans la vieille société aucune assise économique, marchepied de sa future domination politique, que par suite sa seule force réside dans son organisation et sa conscience acquises dans la lutte et qui sont constamment menacées par les aléas de cette lutte et l'énorme pression exercée par l'ensemble de la société bourgeoise. Ces caractéristiques permettent d'expliquer le caractère convulsif et explosif des luttes prolétariennes, y compris quand le développement de la crise revêt une forme beaucoup plus progressive. Maïs ces traits de la lutte de classe déjà valables au siècle dernier sont encore bien plus nets dans la période de décadence du capitalisme avec la perte pour le prolétariat de ses organisations de masse : parti et syndicats. Et ce phénomène est encore amplifié par le poids de la contre-révolution qui suit la vague révolutionnaire de 1917-23 et qui conduit à une disparition presque totale des organisations politiques de la classe et à la perte de tout un capital d'expérience transmis entre les générations ouvrières.
A ces causes générales et historiques motivant un cours en dents de scie il faut ajouter les conditions particulières de la reprise prolétarienne de la fin des années 60 pour comprendre les caractéristiques présentes de la lutte de classe.
Les débuts du mouvement entre 1968 et 1972 sont marqués par une très forte poussée prolétarienne qui surprend compte-tenu des effets encore peu sensibles de la crise mais qui s'explique par :
Les faibles préparatifs de la classe bourgeoise à qui des décennies de "calme social" avaient fait penser que la révolte ouvrière appartenait désormais à l'imagerie d'Epinal, l'impétuosité des nouvelles générations ouvrières qui s'éveillaient à la lutte sans avoir été brisées comme les précédentes.
On assiste ensuite à une "prise de conscience" et à une contre-offensive de la classe bourgeoise favorisée par :
La lenteur de la crise dont l'approfondissement n'est pas venu immédiatement "soutenir" et "alimenter" la première vague de luttes et grâce à laquelle les gouvernements ont pu faire croire à une possibilité de "bout du tunnel", la jeunesse et l'inexpérience des générations ouvrières qui ont animé cette vague et qui les rend plus vulnérables à des fluctuations et aux pièges tendus par la bourgeoisie.
Pour l'ensemble de ces raisons, la forte aggravation de la crise à partir de 1974 essentiellement marquée par l'explosion du chômage, n'a pas provoqué Immédiatement une réponse de la classe. Au contraire, dans la mesure où elle a frappé celle-ci au moment du ressac de la vague précédente, elle a plutôt eu tendance à engendrer momentanément un plus grand désarroi et une plus grande apathie.
9) La contre-offensive de la bourgeoisie commence à se dessiner avec netteté dès le lendemain des premiers soubresauts de la classe et a pour fer de lance les fractions "de gauche" du capital, celles qui sont les plus "crédibles" pour les travailleurs. Elle consiste dans la mise en avant d'une "alternative de gauche" ou "démocratique", qui a pour but de canaliser le mécontentement ouvrier derrière la lutte contre "la réaction", "les monopoles", "la corruption" ou le "fascisme" dans le "respect des Institutions existantes". C'est ainsi que dans un grand nombre de pays, particulièrement là où la classe ouvrière a manifesté le plus de combativité, est mise en place toute une mystification tendant à "démontrer" :
Que "la latte ne pale pas,
Qu’il faut un "changement" pour faire face à la crise.
Suivant les pays, ce changement prend la forme :
En Grande-Bretagne de l'accession des travaillistes au pouvoir à la suite des grandes grèves de l'hiver 1972-73,
En Italie du "compromis historique" destiné, avec la venue du PCI au gouvernement à "moraliser" la vie politique,
En Espagne, de la "rupture démocratique" avec le régime franquiste,
Au Portugal, de la "démocratie" d'abord, du "pouvoir populaire" ensuite,
En France, du "programme commun" et de "l'union de la gauche" qui doivent mettre fin à 20 ans de politique du "grand capital".
Dans le travail de mobilisation de la classe ouvrière vers des objectifs capitalistes et donc la démobilisation de ses propres luttes, la gauche officielle (PC-PS) a reçu une aide fidèle de la part des courants gauchistes qui sont venus apporter une caution "radicale" à cette politique (particulièrement en Italie et en Espagne) quand ils n'en ont pas été les promoteurs directs.
10) Après cette première étape de mobilisation de la classe ouvrière derrière des objectifs illusoires, l'offensive bourgeoise a comporté en général une autre étape débouchant sur la démoralisation et l'apathie des travailleurs, soit par la réalisation de l'objectif mis en avant, soit par l'échec de sa perspective.
Dans le premier cas, la bourgeoisie poursuit sa mystification en décourageant toute lutte qui risquerait de "compromettre" ou "saboter" l'objectif enfin atteint :
En Espagne, Il ne faut pas faire "le jeu du fascisme", il faut se garder de tout ce qui pourrait affaiblir la "jeune démocratie" et donc favoriser le retour du régime honni,
En Grande-Bretagne, il ne faut pas créer de difficultés au gouvernement "du travail", ce qui favoriserait le retour des "Tories réactionnaires" avec qui "ce serait pire".
Dans le second cas, l'apathie de la classe est le résultat du fait que l'échec de la perspective mise en avant est ressenti comme une défaite, ce qui provoque dans un premier temps désenchantement et démoralisation. Cette démoralisation pèse d'autant plus que, contrairement aux défaites essuyées au cours des véritables luttes du prolétariat, qui sont source d'apprentissage et d'expérience de son unité et de sa conscience, ce type de défaite sur un terrain qui n'est pas le sien (la véritable défaite étant de s'y être laissé entraîner), laisse surtout du désarroi et un sentiment d'Impuissance et non la volonté de reprendre la combat avec de meilleures forces. Les exemples les plus nets d'un tel phénomène sont probablement celui du 25 novembre 1975 au Portugal qui est venu 'ruiner les espoirs de "pouvoir populaire" qui avaient pendant un an dévoyé les luttes prolétariennes, et plus récemment celui de la France où la rupture de l'Union de la Gauche est venue mettre fin à plus de cinq années de mirage du "programme commun" qui d'élection en élection avait réussi à anesthésier totalement la combativité ouvrière.
11) Le fait que la disparition d'une perspective pour laquelle la classe s'est mobilisée, plonge celle-ci dans le désarroi et l'apathie, ne signifie pas que l'ensemble du scénario soit planifié de façon machiavélique et délibérée entre les différentes forces de la bourgeoisie. En réalité, si elle laisse un certain temps le prolétariat désemparé, l'absence de perspectives conformes à l'intérêt bourgeois, risque de déboucher sur des explosions "incontrôlées" dans la mesure où l'encadrement capitaliste, et particulièrement syndical, ne peut se passer de telles perspectives. Et la bourgeoisie n'a aucun intérêt à ce que de telles explosions aient lieu car elles constituent autant d'expériences vivantes qui restent un acquis pour la classe. En fait, la faillite des objectifs qui ont réussi à démobiliser la lutte de classe, est fondamentalement le résultat des conflits entre différents secteurs de la classe dominante, qu'ils touchent des problèmes de politique intérieure (politique à l'égard des couches moyennes, rythme du cours vers le capitalisme d'Etat, ampleur des mesures en ce sens, etc.) ou de politique extérieure (plus ou moins grande intégration dans le bloc de tutelle). Au Portugal, l'élimination de la fraction Carvalho après celle de la fraction Gonçalves des sphères du pouvoir, est le résultat de la conjonction des résistances aux mesures de capitalisme d'Etat préconisées par ces deux fractions et des impératifs de fidélité au bloc américain et dont le PS s'est fait le porte-parole le plus dynamique et efficace.
En France, les motifs de la rupture entre PC et PS résident dans des divergences très importantes sur les mesures de capitalisme d'Etat (rôle et place des nationalisations, etc.) mais encore plus sur la politique extérieure (degré d'intégration dans le bloc américain) et qui pouvaient difficilement s'envisager dans un gouvernement. Mais dans un cas comme dans l'autre, les autres facteurs de la politique bourgeoise ont pu jouer et s'imposer dans la mesure où le facteur lutte de classe était passé au second plan de par la réussite de la mystification mise en avant. Paradoxalement, c'est la réussite du "pouvoir populaire" et du "programme commun" en tant que moyens de dévoyer la lutte prolétarienne qui les rend inutiles comme formules de gouvernement. Pour le moment donc, que les perspectives mises en avant aient été réalisées ou non, la contre-offensive de la bourgeoisie a globalement porté ses fruits en faisant taire presque totalement les réactions de la classe à l'aggravation de la crise, ce qui lui laisse les mains d'autant plus libres pour développer sa propre politique de renforcement de l'Etat et d'intensification de l'économie de guerre.
LE RENFORCEMENT DE L'ETAT
12) Le renforcement de l'Etat capitaliste est un processus constant depuis l'entrée du système dans sa phase de décadence. Il s'exerce dans tous les domaines : économique, politique et social par une absorption croissante de la société civile par le Léviathan étatique. Ce processus s'accélère encore lors des périodes de crise aiguë, telles les guerres et l'effondrement économique qui suit les périodes de reconstruction, comme celui qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais l'élément marquant de ces derniers mois consiste dans le renforcement de l'Etat en tant que gardien de l'ordre social, en tant que gendarme de la lutte de classe : c'est ainsi qu'il faut Interpréter le dispositif policier et idéologique promu par le gouvernement allemand et ses confrères européens durant l'Affaire Baader. Ici semble surgir un paradoxe :
D’une part on constate que le renforcement de l'Etat est rendu possible par l'affaiblissement de la lutte de classe, d'autre part, on considère que c'est pour faire face à la lutte de classe que l'Etat se renforce.
Faut-il en conclure que l'Etat se renforce en même temps que la lutte de classe ? Ou bien faut-il dire que sa force est en raison inverse de la lutte de classe ?
Pour répondre correctement à ces questions, il faut prendre en considération l'ensemble des moyens qui constituent la force de l'Etat en tant que gardien de l'ordre (à l'exclusion de sa force économique donc). Ces moyens sont d'ordre :
Répressif, juridique, politique, idéologique. Il est clair qu'on ne peut séparer arbitrairement ces différents moyens dont les champs d'action s'interpénètrent mutuellement pour constituer le tissu superstructurel de la société, mais il est nécessaire de connaître leur spécificité pour comprendre comment Ils sont utilisés par la classe ennemie. En fait, au fur et à mesure que se développe la lutte de classe, les moyens "techniques" de la puissance étatique tendent à se renforcer:
Armement et nombre des forces de répression, mesures policières, arsenal juridique, mais en même temps les moyens politiques et idéologiques, quant à eux, tendent à s'affaiblir crise politique au sein de la classe bourgeoise ("ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner comme avant"), rupture idéologique de la classe ouvrière à l'égard de l'emprise bourgeoise ("ceux d'en bas ne veulent plus vivre comme avant"). L'insurrection est le point culminant de ce processus quand l'Etat a été dépouillé de l'ensemble de ses moyens et qu'il ne lui reste plus, face à la lutte de classe, que la force physique, elle-même partiellement paralysée par la décomposition idéologique qui règne dans ses rangs. Quand on considère la puissance de l'Etat, il faut donc distinguer les aspects formels, qui évoluent dans le même sens quo la lutte de classe, de sa force réelle qui, elle, évolue en sens inverse.
13) Les derniers événements entourant l'affaire Baader manifestent un renforcement de l'Etat sur tous les plans, non seulement formel mais réel. Ou point de vue des moyens techniques de la répression, on a assisté ces derniers mois à un déploiement spectaculaire : utilisation des sections spéciales d'intervention de l'Etat allemand systématisation des contrôles frontaliers, quadrillage policier massif, collaboration étroite des différentes polices, proposition d'un "espace judiciaire européen", etc.
Sous l'angle politique, la bourgeoisie allemande a donné l'exemple à ses consœurs européennes en constituant un "Etat major de crise", regroupant les différentes forces politiques rivales surmontant "face au danger" leurs dissections. Mais c'est sur le plan idéologique que l'offensive capitaliste a été la plus importante. Profitant d'un rapport de forces qui lui est pour l'instant favorable, la bourgeoisie a organisé tout un battage sur le terrorisme destiné à :
Justifier les déploiements policiers et les mesures juridiques diverses,
habituer l'opinion à un usage de plus en plus massif de la violence étatique contre la violence des "terroristes", substituer à la vieille mystification "démocratie contre fascisme" quelque peu usée, une nouvelle mystification "démocratie contre terrorisme" qui serait sensé la menacer.
14) Dans cette offensive en vue de renforcer l'emprise policière et idéologique de son Etat, la bourgeoisie a utilisé d’une façon très adroite le prétexte que lui a donné le comportement désespéré d'éléments de la petite bourgeoisie en décomposition, vestiges du mouvement étudiant du milieu des années 60. Mais cela ne signifie pas que ce renforcement trouve sa cause dans les agissements d'une poignée de "terroristes" ou même que ce renforcement n'aurait pu se faire sans ces agissements. En fait, c'est essentiellement de façon préventive contre la classe ouvrière, et non contre les piqûres de moustiques terroristes, que la bourgeoisie déploie dès aujourd'hui son arsenal. Et ce n'est pas un hasard si c'est la bourgeoisie allemande et particulièrement son parti social-démocrate qui se trouve à l'avant-garde de cette offensive :
L’Allemagne occupe au cœur de l'Europe, tant sur le plan économique que géographique, une position clé du point de vue de l'évolution des futures luttes de classe,
Ce pays jusqu'à présent relativement épargné, entre de plein pied dans des convulsions économiques particulièrement sous la forme d'une poussée très forte du chômage, le SPD dispose d'une expérience incomparable en matière de répression de la classe ouvrière; c'est lui qui a joué le rôle de "chien sanglant" contre les insurrections ouvrières à la fin de la première guerre mondiale et qui a provoqué l'assassinat des "terroristes" Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht.
Les leçons essentielles que nous enseignent ou nous rappellent les événements liés à l'affaire Baader, sont :
- Avant même que la classe ouvrière, à l'exception d'une toute petite minorité, ait compris l'inéluctabilité d'affrontements de classe violents avec la bourgeoisie, celle-ci a déjà mis en branle tout un dispositif pour y faire face,
- dans ce dispositif, les partis socio-démocrates joueront en Europe occidentale un rôle majeur, malgré leurs bavardages "humanistes" et "sociaux", et grâce à eux, contrairement à ce qui pouvait se passer dans la période ascendante du capitalisme, le langage "démocratique" ne fait que recouvrir une terreur d'Etat systématique qui ne s'embarrasse des "garanties démocratiques" que quand elles lui conviennent, dans sa lutte à mort contre la classe ouvrière, le capitalisme est ' prêt à utiliser pour survivre, tous les moyens qui seront à sa disposition, y compris les plus terrifiants, la période où le "droit d'asile" avait un sens, est bien terminée; désormais l'ensemble des nations capitalistes, y compris les plus "libérales", deviendra pour les éléments de la classe pourchassés dans leur pays une Immense "planète sans visa".
LE RENFORCEMENT DE L'ECONOMIE DE GUERRE
15) L'économie de guerre n'est pas un phénomène nouveau : elle s'est imposée au capitalisme depuis l’entrée de ce système dans sa phase de décadence marquée par la succession des cycles : crise-guerre-reconstruction- nouvelle crise etc. La guerre constitue le point culminant de la crise de la société ainsi que son expression la plus significative puisqu'elle signe le fait que le capitalisme ne peut se survivre qu'à travers des autodestructions et des mutilations successives. Et, de ce fait, toute la vie sociale et particulièrement l'infrastructure économique est dominée par la guerre, ses effets ou ses préparatifs. Le phénomène de l'économie de guerre apparaît donc de façon généralisée en 1914 par une mobilisation de toutes les ressources de la nation, sous l'égide de l'Etat, en vue de la production d'armements. Après 1918, on assiste cependant à un certain recul de ce phénomène Hé, d'une part aux convulsions sociales de cette période et qui font passer les rivalités inter-impérialistes au second plan dans la vie du capitalisme, et d'autre part aux propres illusions de la bourgeoisie qui avait cru à la véracité de sa propre propagande sur "la der des der". Mais le phénomène apparaît avec encore plus d'Intensité qu'auparavant dans les années 30, suite à la nouvelle crise aiguë qui frappe le système. Il revêt des formes politiques variées (fascisme, national-socialisme, new-deal, fronts populaires, plan De Man) mais qui sont toutes orientées vers les prépara "-tifs pour Ha guerre impérialiste et qui s'accompagnent d'une emprise de plus en plus totalitaire de l'Etat sur l'ensemble de la vie sociale. Un tel phénomène atteint évidemment ses plus grands sommets au cours de la deuxième guerre mondiale mais, au lendemain de celle-ci, contrairement au premier après-guerre, il ne se résorbe pas de façon totale. Avant même que l'Axe ne soit écrasé, les rivalités Inter-impérialistes se manifestent avec force au sein du camp des vainqueurs pour culminer dans la "guerre froide". De ce fait, on note la poursuite d’une production d'armements dans les proportions massives, phénomène qui ne s'est pas démenti jusqu'à aujourd'hui.
16) L'existence permanente d'une économie de guerre ne saurait être interprétée comme une "solution" aux contradictions du capitalisme, qui passerait par une modification radicale du but de la production. Celui-ci, en effet, reste toujours la production de plus-value et contrairement à ce qu'ont pu penser certaines tendances, y compris au sein du mouvement ouvrier- pour qui l'économie de guerre aurait constitué une "politique économique en sol", capable d'éviter au système les crises et de lui assurer une nouvelle ère d'essor et de prospérité, repoussant tout danger de guerre impérialiste, ce type d'économie n'a d'autre signification que la préparation directe de la guerre et ne permet de faire face à aucune des impasses économiques. Certes, on a pu voir que la production d'armes (et plus généralement les dépenses improductives) ont permis une certaine relance de l'activité économique à certains moments de l'histoire (politiques de Hitler et de Roosevelt, par exemple), mais cela n'a pu se faire que :
- par une intensification considérable de l'exploitation de la classe ouvrière,
- par un endettement massif de l'Etat qui doit bien se faire rembourser les dépenses qu'il a engagées et pour qui une nouvelle guerre apparaît comme un moyen (entre autres) de faire payer les pays vaincus.
En ce sens, non seulement l'économie de guerre ne constitue pas une "solution" permettant au capitalisme de surmonter la crise (et donc la guerre elle-même) mais de plus elle vient aggraver encore la situation économique et renforce d'autant la nécessité de la guerre. Ainsi, le fait que l'économie de guerre n'ait cessé d'exister de façon massive depuis 1945, laisse aujourd'hui au capitalisme une marge de manœuvre bien plus étroite qu'en 1929 face à la crise. En 1929, le poids relativement faible de l'économie de guerre et les réserves financières des Etats à l'issue de la période de reconstruction donnaient la possibilité momentanée d'une relance. Par contre aujourd'hui, après 30 années où l'économie de guerre n'a cessé de peser (sans compter la guerre elle-même évidemment), et bien qu'elle ait permis de prolonger la période de reconstruction jusque vers 1965, une telle politique ou son renforcement n'est plus en mesure de permettre un quelconque sursis dans la mesure où les Etats sont déjà endettés de façon généralisée. En particulier, le fait que l'inflation, qui s'était maintenue de façon endémique au lendemain de la guerre comme résultat du poids des dépenses improductives (dont l'armement), ait pris depuis le début de la crise ouverte une forme violente, traduit bien cette réalité que la crise du capitalisme se manifeste aujourd'hui comme crise et faillite des mécanismes basés sur l'économie de guerre elle-même.
17) Mais le fait que l'économie de guerre soit elle-même devenue facteur aggravant de la crise, ne peut empêcher son renforcement croissant de la part de chaque Etat et plus généralement de la part de chaque bloc. Dans la mesure où la guerre constitue le seul aboutissement que le capitalisme puisse donner à sa crise, oblige chaque jour plus chaque bloc à accentuer ses préparatifs de tous ordres et particulièrement sur le plan d'une soumission toujours plus grande de l'économie aux besoins d'armements qui suppose :
- un contrôle de plus en plus absolu et totalitaire de l'appareil productif par l'Etat,
- une réduction massive de la consommation de toutes les classes et catégories sociales,
- une augmentation massive de l'exploitation de la classe produisant l'essentiel des richesses sociales, le prolétariat.
En ce sens, le repli constaté à l'heure actuelle dans la lutte de classe, a permis une nouvelle offensive contre son niveau de vie, correspondant à une tentative pour chaque capital national d'améliorer sa position sur le marché mondial mais aussi à un nouveau renforcement de l'économie de guerre et donc à une accélération du cours vers la guerre elle-même.
VERS LA GUERRE IMPERIALISTE OU LA GUERRE DE CLASSE ?
18) La constatation de l'évolution présente du rapport de forces au détriment du prolétariat et de l'aggravation du cours vers la guerre Impérialiste qui en résulte, peut conduire à 1’idée que désormais ce cours est devenu dominant et que la classe bourgeoise peut, sans entrave notable, déchaîner une nouvelle boucherie impérialiste. En d'autres termes, le prolétariat serait déjà vaincu et incapable de perturber le libre jeu des nécessités capitalistes. Avec une telle analyse, nous serions déjà à la veille de 14 ou 39. Peut-on faire un tel rapprochement Cela supposerait que le degré de soumission du prolétariat au capitalisme soit aujourd'hui au moins égal à ce qu'il était à ces deux dates. Qu’en est-il ?
En 1914, malgré l'influence de la social-démocratie sur les travailleurs, ses succès électoraux, la puissance de ses syndicats, toutes choses qui font l'orgueil de ses dirigeants et d'un grand nombre de ses membres, et à cause de ces faits eux-mêmes, la classe ouvrière est battue, non pas physiquement mais idéologiquement. L'opportunisme a déjà fait ses plus grands ravages : croyance en un passage graduel au socialisme et en une amélioration constante des conditions de vie de la classe ouvrière, abandon de toute perspective d'un affrontement violent avec l'Etat capitaliste, adhésion aux Idéaux de la démocratie bourgeoise, à l'idée d'une convergence des intérêts des travailleurs et de ceux de leur propre bourgeoisie, par exemple dans la politique coloniale, etc. Malgré la résistance de ses éléments de gauche, cette dégénérescence frappe l'ensemble de la social-démocratie qui se fait un agent d'encadrement du prolétariat au service du capitalisme en freinant ses luttes, en les dévoyant vers des impasses, et, enfin, en prenant la tête de l'hystérie guerrière et chauvine. Et, malgré des manifestations locales de combativité ouvrière comme en Russie en 1913, malgré le maintien de certains partis socialistes sur un terrain de classe (comme en Serbie, etc), c'est globalement que la classe ouvrière est battue et plus particulièrement dans les pays les plus Ira- portants comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre et la Belgique où différentes manifestations d'opportunisme (le "révisionnisme" de Bernstein et le réformisme "orthodoxe" de Kautsky le ministérialisme de Millerand et l'humanisme pacifiste de Jaurès, le trade-unionisme, le réformisme de Vandervelde) l'ont complètement démobilisée et livrée pieds et poings liés à ses différentes bourgeoisies. En fin de compte, contrairement aux apparences, ce n'est pas l'éclatement de la guerre en août 1914 qui provoque l'effondrement de la Même Internationale mais bien la dégénérescence opportuniste du mouvement ouvrier qui rend possible l'éclatement de la guerre, la- quelle ne fait que mettre en pleine évidence et achever un processus depuis longtemps en cours.
En 1939, lorsque la seconde guerre mondiale est déclenchée, la classe ouvrière se prouve dans une détresse beaucoup plus profonde qu'en 14. C'est à la fois physiquement et idéologiquement qu'elle a été battue. A la suite de la grande vague révolutionnaire du premier après-guerre, la bourgeoisie a mené une contre-offensive massive qui s’est étendue sur près de deux décennies et a comporté trois étapes :
- épuisement de la vague révolutionnaire par une série de défaites dans différents pays, défaite de la Gauche Communiste exclue de l'IC dégénérescente, construction du "socialisme dans un seul pays" (lire le capitalisme d'Etat) en URSS,
- liquidation des convulsions sociales dans le centre décisif où se joue l'alternative historique : l'Allemagne, par l'écrasement physique du prolétariat et l'Instauration du régime hitlérien; simultanément mort définitive de l'IC et faillite de l'opposition de gauche de Trotski sombrant dans le manoeuvriérisme et l'aventurisme.
- dévoiement total du mouvement ouvrier dans les pays "démocratiques" sous couvert de "défense des conquêtes" et "d'antifascisme", enveloppe moderne de la "défense nationale"; en même temps intégration complète des partis "communistes" dans l'appareil politique de leur capital national et de l'URSS dans un bloc impérialiste ainsi que liquidation de nombreux groupes révolutionnaires et communistes de gauche qui, au travers de l'adhésion à l'idéologie antifasciste (particulièrement lors de la guerre d'Espagne) et à la "défense de l'URSS", sont happés dans l'engrenage du capitalisme ou disparaissent. En fin de compte, à la veille de la guerre, la classe ouvrière est soit soumise à ta terreur stalinienne ou hitlérienne, soit complètement dévoyés dans l’antifascisme et les rares groupes communistes qui tentent d'exprimer avec les pires difficultés sa vie politique, sont dans un état absolu d'Isolement et réduits quantitativement à de petits ilots négligeables. Bien moins encore qu'en 1914, elle ne peut apposer la moindre résistance au déclenchement de la deuxième boucherie impérialiste.
19) Aujourd'hui, on peut constater, comme on l'a vu, la persistance de beaucoup d'Illusions - en particulier électoralistes - dans la classe ouvrière; il faut relever également une certaine confiance de sa part à l'égard des partis "ouvriers" (PC et PS) mais on n'est pas autorisé à en conclure qu'elle est déjà battue, ni physiquement, ni idéologiquement. Certes, elle a pu subir ces derniers temps, des défaites physiques comme au Chili en 1973, mais uniquement dans des zones excentrées par rapport au cœur du capitalisme. Sur le plan idéologique, l'influence présente des partis de gauche ne peut pas être comparée à l'influence de la social-démocratie en 1914 ni à celle qu'ils avaient à la fin des années 30 : ils sont passés depuis trop longtemps au service du capitalisme, ils ont à leur actif trop de participations gouvernementales pour qu'ils puissent provoquer parmi les travailleurs les mêmes illusions et le même enthousiasme que par le passé. Par ailleurs, 1'idéologie "antifasciste" est aujourd'hui bien usée pour avoir trop servi déjà et ses "produits de remplacement" comme "l'anti-terrorisme", malgré leur succès présent, ne sont pas promis à une aussi grande carrière: la "bande à Baader" aurait bien du mal à provoquer la même peur que les SS de Hitler. Enfin, le bellicisme, l'envie d'en découdre avec "l'ennemi héréditaire" est bien peu répandue à l'heure actuelle et il est bien difficile pour le moment de mobiliser les jeunes générations ouvrières pour une telle cause (voir par exemple la décomposition du corps expéditionnaire américain au Vietnam au début des années 70).
Globalement, les conditions pour l'engagement d'une nouvelle guerre 4mpériallste sont aujourd'hui bien moins favorables è la bourgeoisie qu'en 1939 et môme qu'en 1914. Et même si elles étaient semblables à celles qui existaient à cette dernière date, on peut considérer que cela ne suffirait pas pour que la bourgeoisie -qui est capable de tirer les leçons de l'histoire - s'engage dans une nouvelle guerre qui risquerait d'aboutir au même résultat qu'en 1917. Les longs préparatifs de la seconde guerre mondiale, l'écrasement systématique avant son déclenchement, démontrent qu'après cette expérience où elle a senti menacée sa survie même, la bourgeoisie désormais ne se laissera entraîner dans une guerre généralisée qu'après avoir acquis la certitude absolue que la classe ouvrière a été dépouillée de toute possibilité de riposte.
Aujourd'hui, une telle certitude de la bourgeoisie passe par un écrasement préalable physique et idéologique du prolétariat. La perspective reste donc : non pas guerre Impérialiste mais guerre de classe, telle qu'elle a été analysée par le CCI à partir des premiers affrontement de classe à la fin des années 60.
20) Si malgré le creux présent, la perspective historique d'aujourd'hui reste à l'affrontement de classes, Il faut donc s'attendre à une reprise, à terme, des luttes prolétariennes. Et bien qu'il soit Impossible de prévoir le moment précis de cette reprise, on peut néanmoins en dégager certaines conditions et caractéristiques. La condition majeure de la reprise est l'abandon par la classe d'une bonne partie des illusions sur les "solutions" mises en avant par la gauche du capital. Un tel processus semble à l'heure actuelle engagé : soit que la gauche au pouvoir ait tendance de plus en plus à se déconsidérer, soit que l'échec des perspectives mises en avant commence à provoquer une certaine perplexité à leur égard. Comme on l'a vu, la perte d'illusions ne permet pas nécessairement et immédiatement un regain de combativité des travailleurs, mais, en général, provoque une certaine apathie. Il n'est pas exclu également, qu'aux illusions perdues II ne puisse s'en substituer de nouvelles mises en œuvre, en particulier, par des secteurs plus "à gauche" de la bourgeoisie. C'est pour cela qu'il serait Imprudent de prévoir une reprise Immédiate et générale des luttes. Cependant, ces nouvelles Illusions ou l'éventuelle démoralisation de la classe ne peuvent elles-mêmes résister à la progression inexorable de la crise, à l'aggravation des souffrances qu'elle représente pour le prolétariat et donc au développement de son mécontentement. En particulier, l'extension massive et persistante du chômage constituera un cinglant démenti des bavardages sur "l'efficacité" des diverses "solutions de rechange" proposées pour "résoudre la crise". Tôt ou tard, c'est cette pression économique elle-même qui jettera de nouveau les ouvriers dans la lutte. Et s'il est difficile d'évaluer le seuil de la crise à partir duquel se réamorcera un nouveau cycle de luttes de classe, il semble possible, par contre, d'établir que ce prochain cycle - et ce sera un des critères qui permettront de le reconnaître et de ne pas le confondre avec des explosions sans lendemain - devra aller au delà du cycle précédent notamment dans deux domaines : l'autonomie des luttes et la reconnaissance de leur caractère International., dans la mesure où c'est par l'encadrement syndical et la mystification sur la défense de "l'économie nationale" que la bourgeoisie a repris les choses en main jusqu'Ici. La prochaine reprise devrait donc se traduire par : un débordement beaucoup plus net que par le passé des syndicats et son corollaire : la tendance à une plus grande auto-organisation (assemblées générales souveraines, constitution de comités de grèves élus et révocables, coordination de ceux-ci entre les entreprises d'une même ville, d'une même région, etc.), une plus grande conscience du caractère international de la lutte qui pourra se traduire dans la pratique par des mouvements de solidarité Internationale, l'envol de délégations d'ouvriers en lutte (et non syndicales) d'un pays à l’autre, etc..
En résumé, la situation d'aujourd'hui se présente comme une veillée d'armes, qui peut encore se prolonger, qui peut être troublée par des éclats violents mais ponctuels, et pendant laquelle se poursuit tout un travail souterrain de maturation, s'accumulent toute une série de tensions et de charges qui vont nécessairement exploser dans de nouveaux et formidables combats de classe, qui ne constitueront probablement pas encore le surgissement révolutionnaire décisif (et II faut s'attendre à de nouvelles contre-offensives bourgeoises et à de nouvelles périodes de recul temporaire), mais à côté desquels ceux de la fin-des années 60 et début des années 70, risquent d'apparaître comme de simples escarmouches.
Janvier 1978
Récent et en cours:
- Crise économique [53]
- Luttes de classe [54]
Questions théoriques:
- Impérialisme [55]
Marxisme et théories des crises
- 3987 reads
Ce texte n'a pas la prétention de traiter tous les problèmes que soulève la théorie marxiste des crises. Son but est simplement de fournir un cadre au débat qui s'ouvre dans le mouvement révolutionnaire international; il ne prétend pas donner un point de vue "objectif" sur le débat dans la mesure où il défend une interprétation spécifique des origines de la décadence du système capitaliste, mais nous espérons qu'il pourra donner certains axes qui permettent à la discussion de se poursuivre de manière constructive.
Le contexte du débat
De façon générale, nous pouvons dire que le renouveau de la discussion sur la crise du capitalisme vient répondre à la réalité matérielle que nous vivons depuis la fin des années 60 : le plongeon irrémédiable du système capitaliste mondial dans un état de crise économique chronique. Les symptômes avant-coureurs du milieu des années 60 qui avaient pris la forme d'une dislocation du système monétaire international, ont cédé la place aux manifestations d'un désastre plus grand touchant le cœur même de la production capitaliste : chômage, inflation, chute des taux de profit, ralentissement de la production et du commerce. Aucun pays du monde -y compris les soi-disant pays "socialistes"- n'a échappé aux effets dévastateurs de cette crise. Au cours des années (19)50 et 60, l'apparent "succès" de l'économie capitaliste de l'après-guerre a ébloui bien des éléments d'un mouvement révolutionnaire extrêmement restreint qui parvenait à maintenir une existence précaire durant ces années de calme de la lutte de classe et de croissance économique. Socialisme ou Barbarie, l'Internationale Situationniste et d'autres ont pris cette phase de relative prospérité pour argent comptant et déclaré que le capitalisme avait résolu ses contradictions économiques et donc que ce n'était plus dans les limites objectives du système que se trouvaient les conditions d'un soulèvement révolutionnaire mais dans le refus "subjectif" de la classe exploitée. Les prémisses mêmes du marxisme étaient remis en question et l'on relégua les groupes qui continuaient à maintenir que le système capitaliste ne pouvait pas échapper et n'échapperait pas à un nouveau cycle de crises économiques, au rang des "reliques" d'une Gauche Communiste maintenant dépassée et se cramponnant vainement à une orthodoxie marxiste fossilisée.
Néanmoins, quelques petits groupes héritiers de la Gauche Communiste comme Internationalisme en France dans les années 40 et 50, celui de Mattick aux Etats-Unis, Internacionalismo au Venezuela dans les années 60 se sont accrochés avec ténacité à leurs positions. Ils ont compris ce qu'était exactement le boom d'après-guerre : un moment du cycle de crise-guerre et reconstruction qui caractérise le capitalisme dans sa période de décadence. Ils ont reconnu les premiers hoquets de l'économie au milieu des années 60 pour ce qu'ils étaient : les premiers chocs d'un nouvel effondrement économique; et ils ont compris que la résurgence des luttes ouvrières à partir de 68 n'était pas l'expression d'un refus des "dirigés" d'être "dirigés", mais la réponse du prolétariat à la crise économique et à la détérioration de son niveau de vie. Quelques années après 68, c'est devenu impossible de nier la réalité d'une nouvelle crise économique mondiale. Les débats qui ont donc eu lieu alors, ne portent évidemment pas sur l'existence ou non de la crise, mais sur ce qu'elle signifiait : était-elle, comme le prétendaient certains, l'expression d'un déséquilibre purement temporaire, de la nécessité de "restructurer" l'appareil productif, de l'augmentation du prix du pétrole ou des revendications des ouvriers pour l'augmentation des salaires ; ou était-elle, comme l'ont défendu les précurseurs du CCI, une expression du déclin historique irréversible du capitalisme, un nouveau moment de l'agonie du capital qui ne pouvait mener le monde qu'à la guerre ou à la révolution mondiale ?
L'approfondissement inexorable de la crise, la reconnaissance par la bourgeoisie elle-même du fait qu'il ne s'agissait pas d'une simple fluctuation temporaire mais de quelque chose de plus profond et bien plus grave, ont tranché le débat pour les éléments les plus avancés du mouvement révolutionnaire. Un processus de décantation a eu lieu qui laissa de côté les groupes qui niaient la nature de la crise actuelle comme une expression de la décadence du système capitaliste -comme le GLAT en France qui est tombé dans la forme la plus raffinée d'académisme, cependant pas avant d'avoir abandonné silencieusement l'idée que la crise était due à la lutte de classe. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si la crise est une manifestation de la décadence du capitalisme, le débat porte sur les fondements économiques de la décadence elle-même, et en ce sens, il est déjà l'expression de tout un processus de clarification qui a eu lieu durant ces quelques années passées. Le seul fait que le débat se situe à ce niveau est le produit des progrès qu'a effectué le mouvement révolutionnaire.
L'importance du débat
Comprendre que le capitalisme est un système en décadence, est absolument crucial pour toute pratique révolutionnaire aujourd'hui. L'impossibilité des réformes et de la libération nationale, l'intégration des syndicats à l'Etat, la signification du capitalisme d'Etat, la perspective qu'affronte la classe ouvrière aujourd'hui, aucun de ces points fondamentaux ne peut être compris sans les situer dans le contexte de la période historique dans laquelle nous vivons. Mais si aucun groupe révolutionnaire cohérent ne peut travailler sans comprendre la période de décadence, l'importance immédiate du débat sur les fondements économiques de celle-ci est moins claire. Nous tâcherons de traiter cette question dans ce texte, mais pour le moment, nous voudrions revenir sur quelques erreurs qui pourraient être faites. En gros, il est possible de tomber dans trois erreurs:
1) Nier l'importance de la
question sous prétexte qu'elle serait "académique" ou
"abstraite". Le groupe Workers' Voice
de Liverpool qui s'est regroupé avec Revolutionary Perspectives en 75 puis a rompu un an après, est un exemple de cette
attitude. L'une des faiblesses de ce groupe -même si ce n'était pas la plus
importante- c'était son absence de préoccupation et même son incompréhension
vis-à-vis de la décadence.
Il n'allait pas au-delà
d'une vague affirmation que le capitalisme était en déclin, ce qui a amené le
groupe à de graves confusions. Certains membres de Liverpool, quand ils étaient
encore dans la CWO, ont commencé à développer une vision complètement idéaliste
et morale de la lutte de classe, pendant que d'autres succombaient aux
illusions immédiatistes parce que des grèves locales venaient d'avoir lieu. En
règle générale, de telles attitudes de mépris de la "théorie"
s'accompagnent d'une vision activiste du travail politique.
2) Exagérer l'importance du débat. C'est actuellement une tendance répandue dans le milieu révolutionnaire; aussi allons-nous nous étendre un peu plus dessus. Un exemple typique de ce genre, c'est la CWO qui non seulement considère que la seule explication économique de la décadence du capitalisme est la baisse tendancielle du taux de profit, mais encore voit derrière chaque prétendue erreur des groupes politiques leur "fausse" explication de la décadence. Par exemple, la CWO estime que le PIC est activiste parce qu'il a une analyse "luxemburgiste" de la décadence (Revolutlonary Perspectives n°8) et que les insuffisances politiques du CCI (qui vont de son analyse et de ses rapports de la gauche jusqu'à ses erreurs sur la période de transition), plongent aussi leurs racines dans son analyse "luxemburgiste" de la crise. Puisque la CWO juge que les positions politiques ne découlent pas, fondamentalement, d'une compréhension de la période de décadence mais plus encore, de l'analyse économique spécifique faite de celle-ci, elle en conclut qu'il est impossible de se regrouper avec des organisations qui ont une analyse différente des causes de la décadence. En même temps, la CWO insiste énormément sur la nécessité d'écrire des articles sur "l'économie", et ce au détriment d'autres préoccupations qui sont aussi la tâche des révolutionnaires.
On trouve le même genre de tendance académique dans des cercles d'études en Scandinavie, en particulier. Pour beaucoup de camarades là-bas, mener une activité politique régulière et créer une organisation sont des choses impossibles tant qu'on n'a pas compris dans les moindres détails l'ensemble de la critique de l'économie politique qu'a faite Marx. Et puisqu'une telle tâche est pratiquement irréalisable, on repousse indéfiniment l'engagement dans une activité politique au profit de sessions d'études du Capital ou de débats sur les dernières productions du "marxisme" académique dont les universités de Scandinavie ou d'Allemagne nous submergent.
Les camarades qui surestiment ainsi la signification de l'analyse économique, ne comprennent pas en réalité de qu'est le marxisme. Il n'est pas un nouveau système économique" mais la critique de l'économie politique bourgeoise du point de vue de la classe ouvrière. Et en fin de compte, c'est de ce point de vue de classe qui permet d'atteindre une claire compréhension du processus économique de la société capitaliste il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Penser que la clarté politique et la défense d'un point de vue prolétarien peuvent découler d'une étude abstraite et contemplative de l'économie ou qu'il est possible de séparer la critique marxiste de l'économie politique et le point de vue partisan de la classe ouvrière, c'est laisser tomber les prémisses mêmes du marxisme qui est basé sur l'idée que l'existence précède la conscience et que de sont les intérêts des classes qui déterminent leur vision de l'économie et de la société. C'est tomber dans une caricature idéaliste du marxisme qui est alors considéré comme une science "pure" ou une discipline académique qui existerait dans le royaume des abstractions et bien loin de la réalité sordide et vulgaire de la politique et de la lutte de classe.
La critique de l'économie politique bourgeoise qu'a faîte Marx, montre qu'en dernière instance, les théories économiques bourgeoises sont une apologie des Intérêts de classe de la bourgeoisie; et la critique de Marx est l'expression des intérêts du prolétariat. L'analyse de la tendance inhérente du capital à l'effondrement qui s'exprime dans le Capital et dans d'autres œuvres, constitue l'élaboration théorique de la conscience pratique que le prolétariat développe en tant que sujet historique, dernière classe exploitée dans l'histoire et porteuse d'un mode de production supérieur et sans classe. C'est seulement du point de vue de cette classe qu'on peut comprendre la nature transitoire du capitalisme et que le communisme constitue la résolution des contradictions du capital. Aussi, l'existence du prolétariat précède-t-elle Marx, et les théories élaborées par Marx, le marxisme, sont le produit du prolétariat. Les conceptions générales développées dans le Manifeste Communiste -avec ses positions et ses polémiques "vulgairement politiques" par nos académiciens- ont précédé et jeté les bases de la réflexion la plus développée qui s'exprime dans le Capital. Et le Capital lui-même, cette "merde d'économie" comme le disait Marx, était conçu seulement comme la première partie d'une œuvre beaucoup plus vaste qui devait traiter chaque aspect de la vie politique et sociale dans le capitalisme. Ceux qui pensent qu'on doit comprendre chaque point et chaque virgule du Capital avant de pouvoir aborder les positions de classe du prolétariat et de la défendre activement, mettent simplement le marxisme et l'histoire sur la tête.
Chez Marx, il n'y a pas de distinction entre l'analyse "politique" et l'analyse "économique", l'une qui serait la compréhension pratique du monde d'un point de vue de classe, l'autre qui serait "objective" et "scientifique" et que n'importe quel professeur d'université ou autre gourou gauchiste assez intelligents pour être capables de lire les volumes du Capital, pourrait l'appliquer. C'est la conception de Kautsky et d'autres théoriciens de la Seconde Internationale sur le marxisme -une science neutre élaborée par des intellectuels bourgeois et apportée de "l'extérieur" au prolétariat. Mais pour Marx, la théorie communiste est une expression du prolétariat lui-même :
- "De même que les économistes sont les représentant scientifiques de la classe bourgeoise, de même les socialistes et les communistes sont des théoriciens de la classe prolétaire". (Misère de la Philosophie)
Le Capital, comme toutes les œuvres de Marx, est le produit militant et polémique d'un communiste, d'un combattant du prolétariat. On ne peut le concevoir autrement que comme une arme du prolétariat, une contribution à sa prise de conscience et à son émancipation. Et comment Marx qui critiquait la philosophie bourgeoise radicale comme toute la philosophie, pour n'avoir fait qu'interpréter le monde, aurait-il pu écrire un autre ouvrage ?
Marx s'est penché sur l'étude de l'économie politique parce qu'il voulait donner une base plus ferme, un cadre plus cohérent aux perspectives politiques qui découlaient de la lutte de classe et de ses expériences. Jamais il ne l'a considérée comme une alternative à une activité politique (et d'ailleurs, Marx interrompait sans cesse ses travaux pour participer à l'organisation de l'Internationale), ni comme l'unique source des positions révolutionnaires; elle ne pouvait, en aucun cas, remplacer ce qui était sa substance réelle : la conscience historique du prolétariat.
Tout comme la clarté politique se base en tout premier lieu sur la capacité à assimiler le contenu de l'expérience de la classe ouvrière, les confusions politiques expriment essentiellement l'incapacité de le faire, et plus encore, la pénétration de l'Idéologie bourgeoise. Ainsi, les confusions d'un Bernstein sur les possibilités offertes au capitalisme de surmonter ses crises, n'étaient pas le simple résultat de son incapacité à comprendre comment fonctionne la loi de la valeur, mais reflétaient la subordination idéologique croissante de la social-démocratie aux intérêts du capital. Et la critique révolutionnaire par Rosa Luxemburg et d'autres du réformisme, ne venait pas du fait qu'ils étaient de "meilleurs économistes" mais de leur capacité à défendre une perspective de classe contre les pénétrations de l'Idéologie bourgeoise.
3) Une autre Idée étroitement liée à cette seconde attitude, c'est de croire que le débat a été ou sera finalement résolu. Ceci implique à nouveau que les processus économiques peuvent tous être compris si on est assez intelligent ou scientifique, ou si on a assez de temps pour s'attacher à leur étude. En fait, au delà de certaines idées fondamentales et en particulier celles qui surgissent directement de la nature et de l'expérience du prolétariat -comme la réalité de l'exploitation, l'inévitabilité de la crise, la signification concrète de la décadence, bien des problèmes "économiques" soulevés par le marxisme ne peuvent jamais être tranchés de façon décisive, précisément parce qu'ils ne relèvent pas tous de l'expérience de la classe dans sa lutte. Ceci s'applique à la question de la force qui détermine le déclin du système capitaliste : l'expérience future de la classe ouvrière ne sera pas suffisante pour déterminer si la décadence a commencé en premier lieu comme résultat de la baisse tendancielle du taux de profit ou bien de la saturation du marché mondial, à la différence d'autres questions aujourd'hui "ouvertes" comme la nature exacte de l'Etat dans la période de transition qui sera résolue dans la prochaine vague révolutionnaire.
Ceci est déjà suffisant pour confirmer que les débats sur les "causes" réelles de la décadence ne peuvent être déclarés achevés, mais il est aussi important de noter que Marx lui-même n'a jamais élaboré une théorie complète de la crise historique du capitalisme et ce serait a-historique de s'attendre à ce qu'il l'ait fait puis qu'il ne pouvait saisir tout le phénomène de la décadence du capitalisme dans une période où le système était encore en train de se développer sur la planète. Marx a dégagé des indications générales, des conceptions fondamentales et par dessus tout une méthode pour aborder le problème. Les révolutionnaires d'aujourd'hui doivent reprendre cette méthode mais, justement parce que le marxisme n'est pas une doctrine figée mais une analyse dynamique d'une réalité en mouvement, Ils ne peuvent pas le faire en se réclamant faussement d'un "marxisme orthodoxe" qui aurait eu depuis longtemps le dernier mot sur tous les aspects de la théorie révolutionnaire. Cette attitude ne conduit en fin de compte qu'à une distorsion de ce que Marx disait en réalité. La CWO, par exemple, qui cherche à montrer que l'explication de la décadence par la baisse tendancielle du taux de profit est la seule explication marxiste, est tombée dans le piège de rabaisser en réalité toute préoccupation concernant la surproduction de marchandises comme si elle n'avait rien à voir avec Marx et comme si c'était seulement une variante de la théorie de la sous-consommation et autres confusions défendues par Malthus et Sismondi. Comme nous le verrons, le problème de la surproduction est central dans la théorie de la crise de Marx. Si le débat sur la décadence veut être fructueux, il doit laisser tomber les appels sectaires à l'orthodoxie et rechercher avant tout à définir le cadre général dans lequel peut avoir lieu une approche marxiste de la discussion.
Les deux théories des crises
Il n'y a pas mille et une théories des crises dans la tradition marxiste. Le déclin du capitalisme ne provient pas de l'avidité capitaliste, ni du triomphe "du socialisme sur un sixième de la planète", ni de l'épuisement des ressources naturelles. Fondamentalement, il y a deux explications de la crise historique du capitalisme durant ce siècle parce que Marx a mis en évidence deux contradictions fondamentales qui se trouvaient à la base des crises de croissance que le capitalisme a traversées au 19ème siècle, et qui allaient, à un moment donné, pousser le capitalisme dans une phase de déclin historique, le plonger dans une crise mortelle qui mettrait la révolution communiste à l'ordre du jour. Ces deux contradictions sont : l) la tendance du taux de profit à baisser avec l'inévitabilité de l'élévation constante de la composition organique du capital et 2) le problème de la surproduction, une maladie innée du système capitaliste qui produit plus que le marché ne peut absorber. Bien que Marx ait élaboré un cadre dans lequel ces deux phénomènes sont intimement liés, il n'a jamais terminé son examen du système capitaliste de sorte que selon ses différents écrits, il donne plus ou moins d'importance à l'un ou à l'autre phénomène comme cause fondamentale de la crise. Dans le Capital (livre troisième, 3ème section), la baisse tendancielle du taux de profit est présentée comme l'entrave fondamentale à l'accumulation, bien qu'il y soit aussi traité du problème du marché (voir plus loin). Dans la polémique avec Ricardo, dans les "Théories sur la Plus-value" (Livre quatre du Capital) Marx considère la surproduction de marchandises comme le "phénomène fondamental des crises (p.90). C'est le caractère inachevé de la pensée de Marx sur ce problème crucial -qui n'est pas déterminé par l'incapacité personnelle de Marx à achever le Capital- mais comme nous l'avons dit, par les limites de la période historique dans laquelle il écrivait, qui a amené la controverse au sein du mouvement ouvrier sur les fondements économiques du déclin du capitalisme.
La période qui a suivi la mort de Marx et d'Engels a été caractérisée par une stabilité économique relative dans les métropoles capitalistes et par la course finale et décisive des puissances capitalistes pour s'annexer les parties du globe non encore conquises. Le débat sur les origines spécifiques des crises capitalistes tendait à cette époque à se situer dans le contexte des houleux débats au sein de la Seconde Internationale entre les réformistes et les révolutionnaires, les premiers niant que le capitalisme puisse rencontrer des entraves fondamentales à son expansion tandis que les seconds commençaient à comprendre que l'impérialisme était un symptôme de la fin de la phase ascendante du capitalisme. A cette époque, la théorie "orthodoxe" de la crise dans le marxisme, comme la défendait Kautsky entre autres, tendait à se concentrer sur la question du marché mais elle n'avait pas été systématisée ni reliée à la décadence du système jusqu'à ce que Rosa Luxemburg fasse paraître "L'Accumulation du Capital" en 1913. Ce texte constitue l'exposé le plus cohérent de la thèse selon laquelle la décadence du capitalisme a lieu d'abord et avant tout à cause de l'impossibilité de développer le marché de façon continue. Luxemburg développait l'idée que puisque la totalité de la plus-value du capital social global ne pouvait être réalisée de par sa nature même ou sein des rapports sociaux capitalistes, la croissance du capitalisme était dépendante de ses continuelles conquêtes de marchés précapitalistes; l'épuisement relatif de ces marchés vers la fin du 19ème siècle et le début du 20ème a précipité l'ensemble du système capitaliste dans une nouvelle époque de barbarie et de guerres impérialistes.
La première guerre mondiale a apporté la confirmation de la réalité de cette nouvelle époque; la compréhension que le capitalisme venait d'entrer dans une nouvelle étape, "la période de décomposition et d'effondrement de tout le système capitaliste mondial" (Invitation au 1er congrès de l'IC, Janvier 1919) devenait un axiome pour l'ensemble du mouvement révolutionnaire de l'époque, mais l'Internationale n'avait pas pour autant une position unanime sur les causes spécifiques de la décomposition du capitalisme. Les principaux théoriciens de l'Internationale comme Lénine et Boukharine n'étaient pas d'accord avec Rosa Luxemburg et ils mettaient en avant la baisse tendancielle du taux de profit; Lénine, en particulier, était aussi influencé par les lubies d'Hilferding sur la théorie de la concentration qui est une impasse dans la pensée marxiste. L'Internationale n'a jamais élaboré une analyse complète de la décadence. Au contraire, son analyse était marquée par son incapacité à voir que l'ensemble du monde capitaliste était en décadence, de sorte qu'il n'y avait plus de révolutions bourgeoises ou de libérations nationales possibles dans les colonies.
Les minorités révolutionnaires les plus cohérentes de cette période et durant la période de défaite qui a suivi, les communistes de gauche d'Allemagne et d'Italie étaient plutôt d'accord avec la théorie de Rosa Luxemburg. Cette tradition relie le KAPD, Bilan, Internationalisme et le CCI aujourd'hui. A la même époque, durant les années 30, Paul Mattick, qui appartenait au mouvement des Communistes de Conseils, reprenait la critique d'Henryk Grossman à Rosa Luxemburg et l'idée que la crise permanente du capitalisme a lieu lorsque la composition organique du capital atteint une telle ampleur qu'il y a de moins en moins de plus-value pour relancer l'accumulation. Cette idée de base - tout en étant davantage élaborée sur de nombreux points, est aujourd'hui défendue par des groupes révolutionnaires comme la CWO, Battaglia Comunista et certains des groupes qui surgissent en Scandinavie (et des éléments du CCI partagent aussi ce point de vue). Il faut donc voir que le débat qui a lieu aujourd'hui, trouve ses racines historiques tout le long du chemin qui nous ramène à Marx.
Marx : la question des marchés et la Baisse Tendancielle du Taux de Profit
Le débat sur les racines économiques de la décadence soulève deux premières questions : les deux explications s'excluent-elles mutuellement ? Amènent-elles à des conclusions politiques différentes ? Voyons d'abord un aspect de la première question : ceux qui défendent aujourd'hui la théorie de Mattick affirment que l'analyse de Rosa Luxemburg n'a rien à voir avec Marx. Si cela est vrai, alors on ne peut pas parler d'un débat entre ces deux positions.
Durant ces dernières années, un certain nombre de révolutionnaires qui ont surgi de la reprise de la lutte de classe, a défendu la position de Mattick, entre autres parce qu'à première vue, les explications liées à la baisse tendancielle du taux de profit semblent s'inscrire mieux dans l'analyse que Marx a développée dans le Capital. Marx a situé l'explication de la crise dans la Sphère de la production" disent-ils, et non dans celle de la "circulation". Et c'est la bourgeoisie qui s'occupe des "problèmes de marché". Et la plupart des camarades qui nous disent ça, ne manquent pas de reprendre le vieux cri de guerre des "critiques" qui ont attaqué Rosa en 1913 : toute la théorie de Luxemburg est basée sur une incompréhension du schéma de Marx sur la reproduction élargie dans le 2ème livre du Capital. Le problème que pose Rosa sur la réalisation de la plus-value n'existe pas. On trouve dans R.P. n°6 un texte particulièrement virulent de ce genre, dans lequel la CWO, avec son sectarisme coutumier, accuse Luxemburg d'abandonner totalement le marxisme.
Le CCI ne répondra pas ici à ce texte, mais nous voudrions, pour le moment, montrer pourquoi nous considérons que la théorie de Luxemburg se situe entièrement d'un point de vue marxiste et que l'explication de la décadence du capitalisme par le phénomène de la baisse tendancielle du taux de profit obscurcît certains points cruciaux de l'analyse de Marx. Voyons tout d'abord une citation de la CWO dans RP n°6 :
- "Marx n'a pas dit que la disproportionnalité entre les secteurs ne pouvaient pas provoquer de crise... mais il a clairement montré que la contradiction fondamentale du mode de production capitaliste, sa contradiction historique, ne se trouvait pas au niveau du processus de la circulation".
Cette affirmation tombe complètement à côté de ce que Marx a montré à propos des crises. L'idée que les crises de surproduction sont dues à une "disproportion" entre les secteurs -c'est-à-dire qu'elles ne trouvent pas leurs causes dans les rapports sociaux capitalistes mais qu'elles sont simplement des inadéquations temporaires et contingentes entre l'offre et la demande- c'est précisément l'idée de Say et de Ricardo que Marx attaque dans les Théories sur la plus-value :
- "Lorsque Ricardo, Mill et Say disent qu'il ne peut y avoir surproduction ou du moins encombrement général du marché, c'est que, d'après eux, des produits s'échangent contre des produits par suite de l'égalité métaphysique entre l'acheteur et le vendeur, de l'identité entre l'offre et la demande". (Théories sur les Crises)
Ou encore, comme Marx le dit plus loin, selon les disciples de Ricardo :
- "Expliquer la surproduction d'une part par la sous-production d'autre part revient donc à dire : s'il y avait production proportionnelle, il n'y aurait pas de surproduction" (ibid., p.96)
Marx dénonce ces enfantillages et montre que "toutes les objections faites par Ricardo etc., à la surproduction ont la même base : ces économistes regardent la production bourgeoise comme un mode de production où il n'y a pas de distinction entre l'achat et la vente" (p.91) ; ce sont des apologistes de cette production, pour Marx, le phénomène de la surproduction n'est pas une interruption temporaire dans un processus d'accumulation par ailleurs régulier et constant. Une telle harmonie entre l'offre et la demande est, peut-être, théoriquement possible dans une société de simple production marchande, mais pas dans une société fondée sur les rapports de classe capitalistes, dans une société basée sur la production de plus-value. En réalité :
- "La surproduction tout spécialement a comme condition la loi de production générale du capitalisme, la loi de produire suivant les forces productives, c'est-à-dire dans la mesure du possible, d'exploiter, avec un capital donné le maximum de travail sans tenir compte de la limitation du marché ni des besoins capables de payer; le tout par l'extension incessante de la reproduction et de l'accumulation, par la retransformation constante du revenu en capital, tandis que d'autre part, la masse des producteurs reste limitée et doit, d'après le système de la production capitaliste, rester limitée à la quantité moyenne des besoins" (ibid., p.101).
Marx développe aussi l'analyse des limites inhérentes au marché capitaliste lorsqu'il met en évidence:
"Le simple rapport du salarié et du capitaliste implique deux choses :
- 1) la majeure partie des producteurs (les ouvriers) ne participe pas à la consommation (l'achat) d'une notable fraction de son produit, les moyens et les matières de travail ;
- 2) la majeure partie des producteurs (les ouvriers) ne peut consommer d'équivalent de son produit qu'autant qu'elle fournit au delà de cet équivalent, c'est-à-dire la plus-value ou le surproduit. Les ouvriers doivent toujours être surproducteurs et produire au delà de leurs besoins pour pouvoir être consommateurs ou acheteurs dans les limites de leurs besoins ". (ibid., p.77)
Le capitalisme doit s'étendre continuellement vers des "marchés extérieurs" s'il veut éviter la surproduction à cause de ces limites "internes" au marché capitaliste :
- "Mais en admettant que le marché doit s'étendre avec la production, on admet également la possibilité d'une surproduction : géographiquement, le marché est limité, le marché intérieur est plus restreint que le marché intérieur et extérieur a la fois, et celui-ci est plus restreint que le marché mondial qui, tout en ayant des limites, peut néanmoins s'étendre. En admettant que le marché doit s'étendre pour éviter la surproduction, on admet la possibilité de la surproduction. Il peut en effet arriver que l'agrandissement du marché ne corresponde pas à l'accroissement de la production, que les limites du marché ne reculent pas aussi vite que l'exige la production et que le marché redevienne trop étroit. Ricardo, conséquent avec lui-même, nie donc la nécessité d'une extension du marché liée à l'augmentation du capital et à l'accroissement de la production"(ibid., p.84-85)
Marx revient aussi sur ce point dans la partie qui traite du taux de profit dans le Capital, livre 3 :
- "La création de cette plus-value constitue le processus de production immédiat qui comme nous l'avons dit, n'a d'autres limites que celles que nous venons d'indiquer. Dès que toute la quantité de surtravail que l'on peut extorquer est matérialisée en marchandises, la plus-value est produite. Mais cette production de plus-value n'achève que le premier acte du processus de production capitaliste, le processus immédiat. Le capital a absorbé une quantité déterminée de travail non payé. A mesure que le processus se développe, qui s'exprime dans la baisse du taux de profit, la masse de plus-value ainsi produite s'accroît immensément. Vient alors le second acte du processus. Il faut que toute la masse de marchandises, le produit total, aussi bien la partie qui représente le capital constant et le capital variable que celle qui représente la plus-value, se vende. Si la vente ne s'opère ou bien qu'elle ne s'opère que partiellement ou à des prix inférieurs au prix de production, il y a bien eu exploitation de l'ouvrier mais elle n'est pas réalisée comme telle par le capitaliste (...). Les conditions de l'exploitation directe et celles de sa réalisation ne sont pas les mêmes; elles diffèrent non seulement de temps et de lieu, mais même de nature. Les unes n'ont d'autre limite que les forces productives de la société, les autres la proportionnalité des différentes branches de production et le pouvoir de consommation de la société. Mais celui-ci n'est déterminé ni par la force productive absolue ni par le pouvoir de consommation absolu; il l'est par le pouvoir de consommation, qui a pour base des conditions de répartition antagoniques qui réduisent la consommation de la grande masse de la société à un minimum variable dans des limites plus ou moins étroites. Il est, en outre, restreint par le désir d'accumuler, la tendance à augmenter le capital et à produire de la plus-value sur une échelle plus étendue. C'est une loi de la production capitaliste qu'impose le bouleversement continuel des méthodes de production par la dépréciation concomitante du capital existant, la concurrence générale et la nécessité d'améliorer la production et d'en étendre l'échelle, ne fût-ce que pour la maintenir et sous peine de courir à la ruine. Il faut, par conséquent constamment élargir le marché, si bien que les interrelations et les conditions qui les règlent prennent de plus en plus la forme d'une loi naturelle indépendante des producteurs et deviennent de plus en plus incontrôlables. Cette contradiction interne tend à être compensée par 1'extension du champ extérieur de la production. Mais, plus les forces productives se développent, plus elles entrent en conflit avec les fondements étroits sur lesquels reposent les rapports de consommation. Il n'est nullement contradictoire sur cette base remplie de contradictions, qu'un excès de capital soit lié à un excès croissant de population. Bien que la combinaison des deux puisse accroître la masse de plus-value produite, la contradiction entre les conditions où cette plus-value est produite et les conditions où elle est réalisée s'en trouveraient accrues." (Ed. La Pléiade, tome 2, p.l026-27) souligné par nous.
Ici, comme l'explique Rosa dans l'Accumulation du capital, quand Marx parle de "l'extension du champ extérieur de la production" ou "du commerce extérieur", il veut dire l'extension vers des aires non-capitalistes et le commerce avec elles, puisque c'est simplement pour les besoins de son modèle abstrait de l'accumulation qu'il a traité l'ensemble du monde capitaliste comme une nation unique exclusivement composée d'ouvriers et de capitalistes. Contrairement aux affirmations de la CWO, qui ne voit pas comment la plus-value pourrait être réalisée par un tel commerce (R.P N°6), Marx lui a clairement reconnu cette possibilité :
- "Au contraire : dans les sections de son procès de circulation où le capital industriel fonctionne soit comme argent, soit comme marchandise, son cycle s'entrecroise avec la circulation marchande des modes de production sociaux les plus différents, sous la seule réserve qu'il s'agisse de production marchande. Peu importe que les marchandises soient le produit d'un système fondé sur l'esclavage, ou le produit des paysans (Chinois, Ryots des Indes), ou de communautés (Indes Hollandaises), ou d'une production d'Etat (telle qu'on l'a rencontrée, fondée sur le servage, aux époques anciennes de l'histoire russe) ou de peuples chasseurs demi-sauvages, etc. : c'est comme marchandise et argent qu'elles affrontent l'argent et les marchandises représentant le capital industriel, qu'elles entrent à la fois dans son cycle et dans le cycle de la plus-value supportée par le capital marchandise lorsque celle-ci est dépensée comme revenu, bref qu'elles entrent dans les deux branches de circulation du capital-marchandise, le caractère du procès de production dont elles sont issues n'a aucune importance".(Le Capital, livre 2, trad. éd. Sociales, p.101-102).
Marx ne fait pas qu'accepter ta possibilité d'un tel commerce. Il entrevoit aussi sa nécessité puisque le processus du commerce qui s'accompagne de la destruction et de l'absorption des marchés précapitalistes, n'est autre que la façon dont le capitalisme "étend constamment son marché" durant la phase ascendante :
- "En premier lieu, dès que l'acte A-Mp est achevé, les marchandises (Mp) cessent d'être des marchandises et deviennent un des modes d'existence du capital industriel sous sa forme fonctionnelle de P, capital productif. Par là-même, leur origine se trouve effacée; elles n'existent plus que comme formes du capital industriel, elles lui sont incorporées. Il n'en reste pas moins que la nécessité de les remplacer impose leur reproduction et qu'en ce sens, le mode de production capitaliste dépend d'autres modes de production restés étrangers à son degré de développement. Mais il tend à convertir autant que possible toute production en production marchande; le principal moyen d'y arriver, c'est justement d'entraîner ainsi toute production dans son procès de circulation; une production marchande développée ne peut qu'être production capitaliste de marchandises. L'intervention du capital industriel fait avancer partout cette transformation et avec elle la conversion de tous les producteurs directs en salariés"(ibid., p. 102) souligné par nous.
En fait, Marx a déjà montré dans le Manifeste Communiste comment l'extension du marché capitaliste, tout en résolvant les crises à court terme, ne fait qu'accentuer le problème de la surproduction à long terme :
- "Les institutions bourgeoises sont devenues
trop étroites pour contenir les richesses qu'elles ont créées".
Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'une part, en imposant la destruction d'une masse de forces productives; d'autre part, en s'emparant de marchés nouveaux et en exploitant mieux les anciens. Qu'est-ce-à-dire ? Elle prépare des crises plus générales et plus profondes, tout en réduisant les moyens de les prévenir". (Ed. La Pléiade, tome 1, p.167)
On peut donc voir que le problème de la réalisation que Luxemburg a analysé dans L'Accumulation du Capital, n'était pas un "faux problème", dû à une mauvaise lecture de Marx. Au contraire, la thèse de Rosa s'inscrit en complète continuité avec le thème centrai de la théorie des crises de Marx : à savoir que la production capitaliste rencontre des limites inhérentes à son propre marché et doit donc s'étendre continuellement à de nouveaux marchés s'il veut éviter une crise générale de surproduction. Luxemburg a démontré que le schéma de la reproduction élargie du livre 2 du Capital est en contradiction avec cette vision dans la mesure où il se base sur la possibilité que l'accumulation crée son propre marché. Mais Luxemburg montre aussi que ce schéma est valable en tant qu'abstraction théorique permettant d'illustrer certains aspects du processus de la circulation. Il n'avait pas pour but de se présenter comme le schéma de l'accumulation historique réelle, ni comme une explication des crises et sûrement pas de "résoudre" le problème de la surproduction. Néanmoins, Marx tombe dans certaines contradictions dans l'utilisation qu'il fait du schéma et Luxemburg les met en lumière. Mais ce qui est fondamental, c'est que Marx et Luxemburg étaient tous deux conscients de la différence qui existe entre des modèles abstraits et le processus réel de l'accumulation. Rien n'est plus étranger à l'esprit de Marx que la tentative stérile d'Otto Bauer de prouver "mathématiquement" que l'accumulation peut avoir lieu sans rencontrer de limites intrinsèques sur le plan du marché et que Rosa s'était trompé parce qu'elle n'avait pas fait correctement ses calculs. Si on veut parler d'une incompréhension à propos du schéma de Marx sur la reproduction élargie, ce devrait être de l'incompréhension de ceux qui le prennent à la lettre et "liquident" le problème de la réalisation; ce sont eux qui s'éloignent de la préoccupation sous-jacente de Marx, et non pas Rosa Luxemburg. Il n'y a pas de moyen de se sortir du fait que ce schéma implique que le capitalisme peut créer indéfiniment son propre marché; ce que Marx a spécifiquement nié. Et ceci met bien des critiques de Rosa dans une position contradictoire. Mattick, par exemple, va plus loin sur le problème de la réalisation que ne le fait la CWO. dans son livre "Crises et Théories des Crises". Il met en évidence que :
- "... en système capitaliste, il ne peut exister ni de proportionnalité des divers secteurs de la production, ni concordance parfaite de la production et de la consommation". (p.97, Ed. Champ Libre)
Mais en fin de compte, Mattick nie ce point de vue en disant que le capitalisme ne rencontre pas de problème fondamental de réalisation parce que l'accumulation crée son propre marché :
- "La production marchande crée son propre marché dans la mesure où elle est capable de convertir la plus -value en capital additionnel. La demande du marché concerne tant les biens de consommation que les biens capitaux. Mais, seuls ces derniers sont accumula blés, le produit consommé étant par définition appelé à disparaître. Et seule la croissance du capital sous sa forme matérielle permet de réaliser la plus-value en dehors des rapports d'échange capital-travail. Tant qu'il existe une demande convenable et continue de biens capitaux, rien ne s'oppose à ce que soient vendues les marchandises offertes au marché". (Marx et Keynes, p.97, ED.Gallimard)
Ici, Mattick évite clairement le problème : "Dans la mesure où elle est capable de convertir la plus-value en capital additionnel", "tant qu'il existe une demande convenable et continue"... on ne répond pas du tout à la question de savoir d'où va venir cette demande "convenable" et Mattick se retrouve dans le "cercle vicieux" de la "production pour la production" que Rosa met en évidence dans l'Accumulation. Les critiques de Luxemburg citent souvent Marx quand il dit que la production capitaliste est la production pour elle-même, mais ce passage doit être remis dans son contexte. Marx n'a pas voulu dire que la production capitaliste pouvait résoudre ses problèmes en investissant dans une énorme quantité de biens capitaux sans se préoccuper de la capacité de la société à consommer les biens qu'elle produirait :
- "En outre, comme nous l'avons vu au Livre 2, section 3 (trad. Ed. Sociales, t.5, p73-76), une circulation continuelle se fait entre capital constant et capital variable (même si l'on ne tient pas compte de l'accumulation accélérée); cette circulation est d'abord indépendante de la consommation individuelle dans la mesure ou elle n'y entre pas; néanmoins, elle est définitivement limitée par cette dernière parce que la production de capital constant ne se fait jamais pour elle-même, mais uniquement parce qu'il s'en utilise davantage dans les sphères de production qui produisent pour la consommation individuelle"(Le Capital, Ed. Sociales, t.6, p.314, Livre 3) souligné par nous.
Selon Mattick, le problème qu'une fraction de la plus-value resterait non réalisée n'existe pas puisque "l'investissement" pour une accumulation ultérieure de capital constant absorbe tout ce qui est en circulation. La crise ne résulte que d'une suraccumulation de capital constant par rapport au capital variable, c'est-à-dire de la baisse tendancielle du taux de profit. Mais comme Rosa l'a déjà démontré dans L'Accumulation :
- "La consommation des ouvriers est une conséquence de l'accumulation, elle n'en est jamais le but ni la condition (...). D'ailleurs, les ouvriers ne peuvent jamais consommer que la partie du produit correspondant au capital variable, et pas un sou de plus. Qui donc réalise la plus-value toujours croissante ? Le schéma répond : les capitalistes eux-mêmes et eux seuls. Et à quoi emploient-ils leur plus-value croissante ? Le schéma répond : ils l'emploient à élargir de plus en plus leur production. Ces capitalistes seraient donc des fanatiques de la production pour l'amour de la production. (...) Mais ce que nous obtenons ainsi, ce n'est pas une accumulation de capital, mais une production croissante de moyens de production sans aucun but". (Rosa Luxemburg, p.2, T.2, petite col. Maspéro)
Ce "but" de la production de moyens de production doit se traduire par une expansion constante du marché pour tous les produits du capital. Sinon, en disant que "l'investissement" par lui-même résous le problème du marché, on retourne aux fausses solutions que Marx a critiquées dans le Capital :
- "Dire enfin que les capitaliste n'ont en somme qu'à échanger et consommer les marchandises entre eux, c'est oublier tout le caractère de la production capitaliste et oublier qu'il s'agit de mettre le capital en valeur, non de le consommer. Bref, toutes les objections qu'on fait au phénomène palpable de la surproduction... tendent à affirmer que les limites de la production capitaliste ne sont pas des limites de la production en soi, et partant qu'elles ne peuvent non plus constituer des limites pour ce mode de production spécifique, la production capitaliste" Capital livre 3, Ed. Sociales, t.1, p.270)
Ceux qui disent que l'accumulation du capital constant résout le problème de l'accumulation ne font que reprendre l'idée que les capitalistes peuvent simplement échanger leurs produits entre eux même s'ils le font pour le "futur" comme c'est dit et non pour la consommation immédiate. Tôt ou tard cependant, le capital constant dans lequel ils investissent, devra trouver un véritable marché pour les marchandises qu'il aura produites; ou bien le cycle de l'accumulation s'arrêtera. Et puisqu'il n'y a pas moyen d'éviter ce problème, nous répéterons que la position de Luxemburg disant que toute la plus-value ne peut pas être réalisée au sein des rapports de production capitalistes, est la seule conclusion qu'on peut tirer de l'idée de Marx disant que la production capitaliste ne crée pas son propre marché; c'est la seule alternative à la théorie de Ricardo selon laquelle les crises de surproduction sont seulement des interruptions accidentelles dans un cycle de reproduction fondamentalement harmonieux. Les défenseurs de la théorie de Mattick sur la "baisse du taux de profit" sont avec Marx lorsqu'ils insistent sur l'importance de la baisse du taux de profit en tant que facteur de la crise capitaliste, mais ils sont avec Say et Ricardo lorsqu'ils nient que le problème de la réalisation est fondamental dans le processus d'accumulation capitaliste.
Deux théories ou bien une seule ?
A partir de ce que nous venons de dire, il est évident qu'il ne peut y avoir d'analyse marxiste de la crise qui ignore le problème du marché en tant que facteur fondamental de la crise capitaliste. Même l'argument mis en avant par Mattick et d'autres, selon quoi la surproduction de marchandises est un problème réel mais secondaire parce qu'il découle de la baisse tendancielle du taux de profit, évite la véritable question posée par Marx et Luxemburg : le marché de la production capitaliste est limité par le rapport même entre le capital et le travail salarié. La baisse du taux de profit comme le problème du marché sont des contradictions fondamentales du capitalisme. En même temps, les deux contradictions sont étroitement liées et se déterminent réciproquement de différentes façons. La question qui se pose est alors : quel est le meilleur cadre pour comprendre comment ces deux phénomènes agissent l'un sur l'autre ?
Nous dirons que l'analyse de Mattick ne fournit pas un tel cadre dans la mesure où elle nie qu'il existe un problème de marché ; celle de Luxemburg, elle, ne rejette pas l'existence de la baisse du taux de profit. C'est vrai que dans L'Accumulation, Rosa développe un modèle abstrait, il faut le dire -"qui permettrait à la baisse tendancielle du taux de profit d'être totalement stoppée" (p.14) et que dans "Critique des Critiques", elle dit : "I1 coulera encore de l'eau sous les ponts avant que la baisse du taux de profit ne provoque l'effondrement du capitalisme" (p.158).
On pourrait dire que c'est l'expression de la sous-estimation du problème par Rosa, mais il n'y a rien, à la base de son analyse, qui rejette ce problème; et L'Accumulation donne plusieurs exemples de la façon dont la baisse tendancielle du taux de profit agit réciproquement sur le problème de la réalisation.
La raison pour laquelle Luxemburg insiste sur la question du marché comme étant à la racine de la décadence, n'est pas difficile à trouver. Comme Marx l'a montré, la baisse tendancielle du taux de profit en tant que facteur des crises capitalistes est une tendance générale qui s'exprime durant de longues périodes et rencontre des influences contraires ; par contre, le problème de la réalisation peut entraver le processus d'accumulation de façon bien plus directe et immédiate. Ceci s'applique à la fois aux crises conjoncturelles du siècle dernier et à la crise historique du capitalisme puisque l'absorption des aires précapitalistes qui avaient fourni le terrain d'une expansion continuelle du marché, constituait une entrave à laquelle s'est heurté le capital bien avant que sa composition organique ne se soit développée dans des proportions telles qu'une production rentable ne puisse se poursuivre. Mais comme le met en évidence la plate-forme du CCI :
- "... la difficulté croissante pour le capital de trouver des marchés où réaliser sa plus-value, accentue la pression à la baisse qu'exerce sur son taux de profit l'accroissement constant de la proportion entre la valeur des moyens de production et celle de la force de travail. De tendancielle, cette baisse du taux de profit devient de plus en plus effective, ce qui entrave d'autant le procès d'accumulation du capital et donc le fonctionnement de l'ensemble des rouages du système". (Revue Internationale n°5, p.9).
La saturation des marchés d'une part aggrave la baisse du taux de profit (parce que la concurrence croissante sur un marché allant se rétrécissant force les capitalistes à renouveler les machines avant que toute leur valeur ait été utilisée); d'autre part, elle supprime l'une de ses principales contre-influences : compenser la baisse dans le taux de profit en accroissant sa masse, c'est-à-dire en développant le volume des marchandises produites. Ceci ne peut servir de compensation à la baisse du taux de profit que tant que l'expansion du marché accompagne cette production croissante du volume des marchandises. Quand le marché ne peut plus s'étendre, cette compensation ne fait qu'empirer les choses puisqu'elle aggrave à la fois le problème de la baisse du taux de profit et celui de la réalisation. Il est nécessaire d'étudier de beaucoup plus près cette question, mais si Rosa n'a certainement pas répondu à ce problème, le cadre qu'elle a élaboré, permet de saisir mieux le rôle de la baisse tendancielle du taux de profit.
Mais peut-être le problème va-t-iI plus loin ? Peut-être qu'en fin de compte, les deux phénomènes ne peuvent être véritablement "réconciliés" parce qu'il y a une contradiction à la base de la pensée de Marx ? A première vue, évidemment, il apparaît que l'idée que la crise provient d'une trop grande quantité de plus-value non réalisée ne peut être "réconciliée" avec celle selon laquelle la crise résulte d'un manque de plus-value.
Bien que Marx n'ait jamais résolu le problème, Il existe dans son œuvre des éléments qui nous permettent de dire que les deux contradictions s'inscrivent cependant dans un tout dialectique.
Pour commencer :
- "Du reste, on sait que le capital se compose de marchandises et par suite la surproduction de capital inclut celle des marchandises. D'où la bizarrerie du fait que les mêmes économistes qui nient toute surproduction de marchandises reconnaissent la surproduction de capital" (Le Capital, Ed.Sociales, t.1, p.269).
Une fois qu'on a compris cela, on peut voir que les deux contradictions agissent nécessairement ensemble dans les crises capitalistes : d'un côté, la surproduction de capital amène une baisse plus poussée du taux de profit parce qu'elle implique une augmentation de la proportion entre le capital constant et le capital variable; d'un autre côté, cette énorme masse de capital constant produit une pléthore de marchandises qui dépasse de plus en plus le pouvoir de consommation de ce capital variable relativement diminuant (c'est-à-dire la classe ouvrière). Poussé par la concurrence sur un marché restreint, le capital avec sa capacité à produire sans fin des marchandises, s'accroît et s'enfle démesuré ment pendant que les masses s'appauvrissent par rapport à lui; de moins en moins de profit est représenté dans chaque marchandise, de moins en moins de marchandises peuvent être vendues. Le taux de profit et la capacité de réalisation diminuent ensemble, et l'un aggrave l'autre. La contradiction apparente entre "avoir trop" et "pas assez" de plus-value disparaît une fois qu'on voit clairement que nous parlons du capital en tant que tout, et que nous parlons en termes relatifs et non absolus. Pour le capital dans son ensemble. Il n'y a jamais de saturation absolue du marché, pas plus que le taux de profit ne tombe jusqu'à un zéro absolu qui supprimerait toute plus-value. En fait, comme Luxemburg l'a montré, à un certain stade de concentration du capital, "l'excès" et le "manque" de plus-value sont la même chose, vue de points de vue différents :
- "Si la capitalisation de la plus-value est le but proprement dit et le mobile de la production, par ailleurs le renouvellement du capital constant et du capital variable (ainsi que la partie consommée de plus-value) est la base large et la condition préalable de la capitalisation. Et si le développement international du capitalisme rend la capitalisation de la plus-value de plus en plus précaire, il élargit d'autre part la base du capital constant et du capital variable en tant que masse, aussi bien dans l'absolu que par rapport à la plus-value. De là le phénomène contradictoire que les anciens pays capitalistes, tout en constituant les uns pour les autres, un marché toujours plus large et en pouvant de moins en moins se passer les uns des autres, entrent en même temps dans une concurrence toujours plus acharnée pour les relations avec les pays non capitalistes. Les conditions de la capitalisation de la plus-value et les conditions du renouvellement du capital total se contredisent donc de plus en plus. Cette contradiction ne fait du reste que refléter la loi contradictoire de la baisse du taux de profit". (L'Accumulation, p.39, même Ed.)
En d'autres termes, c'est une masse de plus-value relativement de plus en plus réduite qui est destinée à la capitalisation, mais elle est encore "en excès" par rapport à la demande effective. Et cette plus-value de plus en plus "réduite" (à côté de la valeur qui remplace simplement la mise de tonds Initiale) est le résultat d'une composition organique du capital toujours plus grande.
Il devient donc plus clair que les deux contradictions mises en évidence par Marx ne s'excluent pas réciproquement mais sont les deux facettes d'un processus global de production de valeur. En dernière Instance, ceci fait que les "deux" théories de la crise reviennent à n'être qu'une seule.
Les conséquences politiques
Nous avons tenté de montrer qu'en dernière analyse, le problème du "taux de profit" et celui du "marché" sont théoriquement conciliables, bien que dans l'analyse de Grossman-Mattick, la question de la réalisation de la plus-value ne soit pas posée ou sous-estimée. Les faiblesses de l'analyse de Mattick sur le plan économique amènent aussi à des erreurs sur le plan des conclusions politiques qui en découlent. Bien que nous ayons l'intention ici de simplement mentionner ces faiblesses et non de les analyser de près et que, de plus, il faille être extrêmement prudent car il ne s'agit pas de voir un lien mécanique et unilatéral entre une analyse économique et des positions politiques, nous ne devons pas tomber dans l'attitude contraire et nier qu'aucune iplication politique ne soit liée à l'analyse économique. Ces conséquences prennent plus la forme de tendance, d'orientation plutôt que celle d'une loi d'airain; elles sont plus prononcées chez certains que chez d'autres, néanmoins il apparaît certaines caractéristiques communes aux différents courants qui défendent la théorie économique de Mattick.
Si l'on part uniquement de l'analyse de la baisse tendancielle du taux de profit. Il est extrêmement difficile de définir le cours historique de la crise capitaliste. Ceci concerne à la fois la compréhension rétrospective de l'aube de la décadence du capitalisme et l'analyse des perspectives de développement de la crise aujourd'hui, et c'est dû au fait que la théorie de Mattick laisse un certain nombre de questions sans réponses, ou y répond de façon inadéquate. Par exemple, si la baisse tendancielle du taux de profit est l'unique problème auquel le capital doit faire face, pourquoi la division du monde entre puissances impérialistes et la création du marché mondial capitaliste ont-elles plongé le capital dans sa crise historique ? Quand la composition organique du capital sur une échelle globale atteint-elle un point où ses contre-tendances ne peuvent plus être effectives ? Et dans l'avenir, quand donc le taux de profit sera-t-il trop bas au point d'empêcher le capital d'accumuler sans qu'il déclenche une nouvelle guerre ? Et de plus, pourquoi la guerre est-elle devenue le mode de survie du capital à notre époque ? On ne peut répondre à aucune de ces questions si l'on ne voit pas le problème du marché. Et comme Mattick ne le voit pas, il ne peut que donner des réponses vagues à ces questions. Sa compréhension de l'époque actuelle est plutôt inconsistante. Dans les années 30, ses écrits montrent qu'il voyait la crise permanente du capital comme une réalité immédiate qui ne pouvait être "résolue" que par la guerre. Mais dans ses écrits d'après-guerre, il semble mettre en question le fait que le capitalisme soit véritablement entré dans sa crise historique à l'époque de la révolution russe; tantôt, il sous-entend que la crise n'a commencé qu'en 29, tantôt que la baisse tendancielle du taux de profit ne provoquera des problèmes cruciaux pour le capital que vers l'an 2000, et que peut-être le capitalisme n'est pas décadent ! En bref, avec la théorie de Mattick, on n'a pas une compréhension consistante de la décadence comme une époque de crise-guerre-reconstruction qui a commencé de façon décisive avec la première guerre mondiale; ni de la crise d'aujourd'hui en tant que manifestation directe de ce cycle historique et que Mattick voit plutôt comme un hoquet temporaire dans une période de croissance. Ce manque de clarté sur ce qu'est en réalité la décadence, l'amène à sous-estimer la gravité de la crise actuelle et renforce sa tendance à l'académisme, qu'on retrouve le long de tout son chemin depuis les années 40. Puisque de son point de vue la "vraie" crise est bien loin devant nous, les perspectives de surgissements importants de la lutte de classe aujourd'hui ne sont pas très brillantes. Et donc, il y a peu de raison de s'engager aujourd'hui dans une activité politique militante.
Bien que la CWO se rattache à la théorie de Mattick, elle a une compréhension bien plus claire de la période de décadence, de la crise actuelle et des conclusions politiques qui en découlent. Elle a tenté de montrer que la baisse tendancielle du taux de profit peut expliquer la période ouverte par la première guerre mondiale (en particulier dans l'article "les fondements économiques de la décadence", R.P n°2). Ceci constitue un effort sérieux et qui requiert une critique plus détaillée que ce que nous pouvons faire dans le présent article. Une telle critique devrait se centrer sur certaines questions cruciales comme : l'application de la théorie économique de Mattick au cadre de la décadence est-elle cohérente ? Jusqu'à quel point peut-on analyser la période de décadence sur la base de la baisse tendancielle du taux de profit sans se référer au problème des marchés ? Et jusqu'à quel point la vision de la décadence qu'a la CWO serait-elle cohérente, si elle n'avait pas été influencée par d'autres courants, et en particulier le CCI, qui considèrent le problème des marchés comme fondamental dans l'explication de la décadence ? En d'autres termes, jusqu'à quel point l'analyse de la décadence que fait la CWO est-elle une continuation cohérente de la théorie de Mattick et jusqu'à quel point est-elle implicitement ou explicitement liée à une théorie plus globale de la décadence ? Ce que nous avons écrit plus haut sur l'impossibilité d'ignorer le problème de la réalisation indique déjà quelle doit être notre réponse à ces questions.
Ce qui est plus important peut-être encore, c'est de montrer que tout en ne suivant pas nécessairement Mattick jusqu'à l'extrême dans sa démission académique de l'engagement politique militant, "l'école de la baisse tendancielle du taux de profit" partage une tendance à voir la "vraie" crise bien loin devant nous. Et puisque de plus, certains de ces camarades défendent aussi une conception plutôt mécaniste du lien entre le niveau de la crise et le niveau de la lutte de classe, ils concluent en général que les perspectives de lutte de classe et de regroupement des révolutionnaires sont quelque peu lointaines. Ainsi, Battaglia Comunista ne voit la crise actuelle ressurgir qu'en 1971. Et pour elle le resurgissement d'une organisation internationale des révolutionnaires ne pourra avoir lieu que dans le futur; la CWO, elle, considère à la fois les préparatifs du capital pour la guerre impérialiste et la préparation de la classe ouvrière pour la guerre de classe comme quelque chose qui relève de "demain", lorsque la crise aura atteint une nouvelle étape. Le regroupement des révolutionnaires est repoussé de la même façon. Bien des camarades de Scandinavie, plus proches de Mattick et qui se situent encore dans une certaine mesure, dans le cocon de la prospérité Scandinave, continuent à voir les tâches des révolutionnaires comme une "étude" et une réflexion sans lien avec une activité militante. Nous ne pensons pas que ces attitudes "attentistes" sont accidentelles. Elles sont liées aux insuffisances de la théorie de Mattick qui ne montre pas que la décadence est une crise permanente, le produit de la disparition des conditions qui ont permis une saine expansion du capital au 19ème siècle. La théorie de Luxemburg en montrant le caractère maladif de l'accumulation à notre époque, permet de montrer les limités de la reconstruction et de comprendre que la crise, l'économie de guerre et la lutte de classe sont vraiment des réalités d'aujourd'hui. En fait, nous dirons même que la réponse de la classe est déjà en retard par rapport au développement de la crise et aux préparatifs de la bourgeoisie pour la guerre. Ceci ne veut pas dire que la crise a déjà atteint le fond ni que la guerre ou la révolution sont à l'ordre du jour de façon Immédiate et que donc nous devrions nous engager dans un activisme frénétique (comme le PIC dont l'activisme inné est renforcé par une mauvaise application de la théorie de Luxemburg sur la crise). Le capital dispose encore de mécanismes pour pailler à la crise et toute une série de processus économiques doivent encore se dérouler avant que la crise ne trouve une issue dans la guerre ou dans la révolution. Néanmoins, il est important de voir que ces processus sont déjà en route et que les tâches des révolutionnaires sont urgentes et ne peuvent être repoussées à demain. Comme l'a écrit Bilan "est-ce que demain peut-être autre chose que le développement de ce qui arrive aujourd'hui ?" (Bilan n°36)
Comme Lukacs l'a mis en évidence dans son essai "Rosa Luxemburg, marxiste", la validité de la théorie de l'accumulation de Luxemburg en tant que contribution au point de vue mondial du prolétariat, réside dans le fait qu'elle se base sur la "catégorie de la totalité", la catégorie de la perception spécifiquement prolétarienne. Le problème de l'accumulation que Rosa Luxemburg a développé, n'est qu'un problème au niveau du capital global ou total; les économistes vulgaires qui partent du point de vue du capital individuel étaient incapables de voir qu'il y avait même un problème. Dans une certaine mesure, Mattick exprime la même "vulgarité" puisqu'il a une forte tendance à voir chaque capital national isolément. Cette fausse perspective mène à un certain nombre d'erreurs :
- des ambiguïtés sur la possibilité de libération nationale puisque les petites nations, selon Mattick, peuvent sortir du marché mondial et vivre en autarcie ou sous la protection du soi-disant "bloc capitaliste d'Etat".
- parallèlement à cela, Mattick a affirmé que la Russie, la Chine etc. ne sont pas complètement régulées par la loi de la valeur et ne sont pas vraiment impérialistes, n'ayant pas de tendance inhérente à étendre le marché mondial. Il les a même appelées des sociétés "socialistes d'Etat".
Ces erreurs découlent en grande partie d'une incapacité à voir ces nations comme une partie de l'ensemble du marché capitaliste. Sur cette question à nouveau, la CWO est allée bien au-delà de Mattick et considère que les luttes de libération nationale sont impossibles et que la Russie et la Chine sont régulées par la loi de la valeur. Mais même dans ce cas, son analyse contient un certain nombre de faiblesses qu'on peut rattacher à sa théorie économique. La CWO trouve que c'est difficile d'analyser des phénomènes particuliers du point de vue de l'ensemble et montre une certaine incapacité à voir que le capitalisme d'Etat et l'économie de guerre sont fondamentalement déterminés par la nécessité pour les capitaux nationaux d'être compétitifs sur le marché mondial. Pour la CWO, les mesures capitalistes d'Etat sont en premier lieu une réponse à la baisse tendancielle du taux de profit dans certaines industries dont la haute composition organique rend l'intervention de l'Etat nécessaire pour les soutenir. Mais c'est seulement une explication partielle puisque l'Etat le fait précisément pour accroître la compétitivité de l'ensemble du capital national. Et l'idée de la CWO selon laquelle la Russie, la Chine, etc. peuvent être considérés comme des capitalismes d'Etat "intégraux" dont le développement prouve que "l'accumulation capitaliste est possible dans un système fermé" (R.P n°1), est du même ordre. Ce "fait" prétend être une réfutation de la théorie économique de Luxemburg alors que la notion de capitalisme d'Etat intégral ouvre la porte à l'idée que ces économies sont en quelque sorte "différentes" et doivent être expliquées d'une façon particulière. Et la notion implicite ou explicite selon laquelle un développement autarcique est possible, peut avoir diverses conséquences politiques. Sur la question nationale, par exemple, la CWO défend des conclusions politiques justes mais on pourrait se demander si ses conclusions sont très consistantes et cohérentes avec son analyse économique. Est-ce que l'idée de Mattick selon laquelle les nations sous-développées peuvent se développer sur la base de leur marché intérieur n'est pas une conséquence plus logique de sa théorie économique ?
Nous ne sommes pas en train de dire que la CWO a des confusions fondamentales sur la question nationale ni que son explication de l'impossibilité des luttes de libération nationale n'a pas sa cohérence propre. Mais toute contradiction aujourd'hui peut ouvrir la porte à des erreurs véritables demain. Et nous voudrions ajouter qu'il y a déjà des faiblesses notables dans l'approche que fait la CWO sur la question nationale : une difficulté à voir la voracité des appétits impérialistes dans toutes les nations aujourd'hui, y compris les plus petites; et un pessimisme prononcé sur la lutte de classe dans le tiers-monde. Sur le premier point, la CWO affirme que seules la Russie et l'Amérique peuvent "vraiment" agir en tant qu'impérialismes aujourd'hui, et que les autres capitaux nationaux ne sont que potentiellement ou tendanciellement impérialistes. Ceci cache la réalité des rivalités inter impérialistes locales qui ont un rôle à jouer dans la confrontation globale entre les blocs, une réalité qui est confirmée avec éclat par les récents événements dans la corne de l'Afrique et en Asie du Sud-est. Sur la lutte de classe dans les pays du tiers-monde, la CWO affirme régulièrement que "nous ne pouvons attendre des développements positifs... que lorsque les ouvriers des pays avancés auront pris le chemin de la révolution et donné une direction claire" (R.P n°6). Une telle vision rapetisse l'importance des luttes actuelles des ouvriers du tiers-monde dans le développement international de la conscience de classe et fait une séparation rigide entre aujourd'hui et demain, les capitaux avancés et arriérés, ce qui ne peut qu'obscurcir notre compréhension. Ces analyses inadéquates de l'impérialisme et de la lutte de classe trouvent toutes deux leur racine dans l'analyse économique qui défend l'idée que seules les nations dont la composition organique du capital est haute, sont purement impérialistes, et que seul le prolétariat de ces nations a de l'importance. Sur les deux terrains, il y a tendance à fragmenter le capital mondial et le prolétariat mondial.
Cette tendance de la part des théoriciens de la "baisse du taux de profit" à n'envisager que les choses que du point de vue du capital individuel et non global peut avoir des implications dans la discussion sur la période de transition. En effet, si l'accumulation du capital peut avoir lieu dans un seul pays, pourquoi ne pas envisager aussi des économies "communistes" autarciques ? Et la CWO pense d'ailleurs que des bastions prolétariens, qui sont sortis du marché mondial, peuvent, temporairement du moins, commencer à construire un mode de production communiste. Cette incompréhension ne peut être critiquée de façon cohérente qu'à partir d'une perspective qui comprend le capital et le marché mondial comme une totalité; à nouveau, nous dirons que l'analyse de Luxemburg fournit les armes théoriques pour comprendre comment de tels bastions isolés ne pourraient pas échapper aux effets du marché mondial.
Une fois que nous avons mis cela en évidence, nous tenons à souligner deux choses importantes :
- que ces positions erronées sont en grande partie dues à la théorie unilatérale de Mattick et de la CWO sur la baisse du taux de profit,
- et que pour autant, elles ne proviennent pas directement et inexorablement d'un cadre économique erroné.
Lorsque nous voulons analyser les erreurs d'un groupe politique. Il est important d'examiner l'ensemble de son histoire et de ses positions politiques.
Bien des erreurs mentionnées ci-dessus trouvent leur origine dans des expériences et des incompréhensions plus fondamentales : l'académisme de Mattick, par exemple, est basé sur l'expérience globale de la contre-révolution qui l'a amené à un pessimisme profond sur la lutte de classe et à une sérieuse sous-estimation de la nécessité d'une organisation des révolutionnaires. Les erreurs de la CWO sur le regroupement et la période actuelle sont aussi dans une grande mesure le produit de ses difficultés à comprendre la question de l'organisation, alors que ses erreurs sur la période de transition sont largement dues à son incapacité à tirer des leçons de la révolution russe. De même dans le "contexte luxemburgiste", l'activisme du PIC est bien plus dû dirions-nous à de profondes confusions sur le rôle des révolutionnaires qu'à son analyse économique. Les erreurs sur le plan économique tendent à renforcer les erreurs qui viennent de l'ensemble de la politique menée par ces groupes. Toute incohérence dans l'analyse faite par un groupe, ouvre la porte à des confusions plus générales; mais nous ne traitons pas de fatalités irrévocables. Les camarades qui défendent la "baisse du taux de profit" ne doivent pas nécessairement tomber dans les confusions organisationnelles de Mattick, de la CWO, de Battaglia Comunista et dans leurs incompréhensions sur la révolution russe. En même temps, les confusions organisationnelles et autres -comme le sectarisme de la CWO- peuvent accentuer les faiblesses de leur analyse économique. Ce n'est vraiment pas difficile de voir, par exemple, que les grands efforts de la CWO pour nier le problème de la surproduction sont liés au besoin de se distinguer d'autres groupes qui ont une autre vision de la décadence. Les camarades qui partent de la "baisse tendancielle du taux de profit " peuvent et doivent développer une vision plus globale qui ne nie pas la question du marché. Bien sûr, nous posons qu'en dernière instance, cela les conduira à devenir "luxemburgistes", mais seul un débat ouvert et constructif peut clarifier cela.
Ceci nous permet d'arriver à une conclusion générale sur l'importance du débat. Il est d'une importance extrême parce que, de la même façon que les faiblesses d'une analyse économique peuvent semer le chemin d'erreurs politiques plus générales ou bien les renforcer, de la même façon une analyse cohérente des fondements de la décadence rendra notre compréhension de la décadence et de ses implications politiques plus solides. Cette question doit donc être discutée comme une partie de l'ensemble des positions communistes,
Une fois comprise son importance en tant que partie d'une cohérence plus globale, le débat peut être entamé dans une perspective correcte. Puisque l'analyse des fondements économiques de la décadence est une partie d'un point de vue prolétarien plus global, un point de vue qui réclame un engagement actif pour "transformer le monde", la discussion ne peut jamais entraver l'activité révolutionnaire. Et puisque les conclusions politiques défendues par les révolutionnaires ne découlent pas de façon mécanique d'une analyse économique particulière, la discussion ne peut, en aucun cas, être une entrave au regroupement. Comme le CCI l'a toujours dit, le débat peut et doit avoir lieu dans une organisation politique unie. Les révolutionnaires du passé ne se sont jamais sentis incapables de se regrouper à cause d'analyses économiques différentes, et pas plus aujourd'hui que demain une telle nécessité ne peut être entravée pour cette raison. En réalité, c'est une des questions que nous serons probablement encore en train de discuter après que le prolétariat aura chassé le capitalisme de la surface de la terre...
C.D WARD
Questions théoriques:
- L'économie [30]
Heritage de la Gauche Communiste:
Réponse au P.C. Internazionalista "Battaglia Comunista"
- 3572 reads
Depuis plus d'un an, le CCI et le Parti Communiste Internationa1iste ont engagé un débat dans le but de dépasser le sectarisme qui pèse encore sur le mouvement révolutionnaire renaissant. C'est dans la poursuite de cet effort commun que le CCI a envoyé une importante délégation à la Conférence Internationale convoquée par Battaglia Communista en mal 1977 à Milan ([1] [58]) et qu'il a invité une délégation de Battaglia à assister aux travaux de son second Congrès en Juillet de la même année. Nous avons donc été plutôt surpris par la publication, immédiatement après, de deux articles dans Battaglia intitulés : "Le Second Congrès du CCI : déboussolement et confusion", dans lesquels nous sommes violemment attaqués parce que nous serions la proie d'un "processus d'involution et d’un éloignement conséquent du marxisme révolutionnaire"([2] [59]).
Nous avons déjà souligné dans notre presse ([3] [60]) la méprise bruyante des camarades de Battaglia qui ont pris pour des grandes "nouveautés de nature politique", des Innovations, les projets de résolution qui synthétisaient les positions constamment apparues dans notre presse (en particulier le projet sur les groupes politiques prolétariens qui est une nouvelle version de l'article "Groupes Révolutionnaires et Groupes Confus" paru entre autres dans Rivoluzione Internazionale n°8).
Battaglia n'a pas pu nier l'évidence et a cherché à échapper à la question en soutenant que ces textes-là n'étalent pas "officiels". Voilà, en vérité, une bien étrange conception que celle qui considère comme non officiels des ébauches de documents qui circulent à usage interne. Mais, toute autre considération mise à part, les positions qui sont à la base du projet de résolution sur la période de transition sont exprimées non seulement dans un tas d'articles, mais dans une résolution adoptée au second Congrès de notre section en France et publiée comme telle dans la Revue Internationale n°8. Et cela aussi, ce n'est pas officiel ?
Et en fait, ces grandes "nouveautés" apparues dans le congrès dont depuis des années au centre du débat international entre organisations communistes, un débat qui a été mené à travers les différentes publications et au cours de nombreuse conférences internationales. En plus certains groupes se sont précisément basés sur ces positions pour rompre tout contact avec notre organisation en la condamnant comme "contre-révolutionnaire". Mais, pour Battaglia tout ce travail, ces progrès, ces erreurs n'existent pas ou bien sont des bavardages sans signification : la discussion commence avec ses articles - qui sont en grande partie la répétition d'une attaque analogue fait par Programme Communiste il y a deux ans ([4] [61]).
Si nous insistons sur cette méprise, ce n'est pas pour le plaisir de coincer Battaglia, mais pour mettre en évidence les difficultés que les groupes, ayant survécues aux anciennes Gauches Communistes du passé, rencontrent pour participer au débat sur le même plan que les groupes révolutionnaires produits par la récente reprise de la lutte de classe. Mais si certains de ces groupes ont choisi la vole du silence, d'au-plus capable de réagir, ressentent à toute occasion la nécessité de défendre leurs conceptions vis-à-vis de ces minorités en adoptant un une attitude "supérieure" et inadéquate ([5] [62]).
Ainsi, pour autant que l'attaque lancée par Battaglia est violente et superficielle, elle est aussi un symptôme du fait que "le camp révolutionnaire International est en perpétuel mouvement, unifications et ruptures, croisement de polémiques, rencontres et heurts qui montrent que quelque chose bouge"([6] [63]) et comme telle, nous la saluons.. Pour cette raison, nous ne considérons pas notre réponse comme une des éternelles "mises au point" qui ont pour but de "liquider" l'adversaire. Au contraire, c'est une réaffirmation de nos positions là où elles ont été déformées, et une contribution pour redéfinir le cadre dans lequel doit se situer ta poursuite du débat - qui ne peut que mettre au centre les thèmes qui sont effectivement-à la base de nos divergences et en premier lieu celui de la nature et de la fonction du parti prolétarien.
REPRISE DE LA LUTTE DE CLASSE ET REEMERGENCE DES POSITIONS REVOLUTIONNAIRES
"Il est Inutile de se référer aux groupes affiliés au "Courant", à leur histoire pas toujours révolutionnaire de façon conséquente... En 1968, Il y a ceux qui se sont confondus avec les gauchistes; de toute façon, pour ne pas perdre sa réputation, on se cache encore aujourd'hui derrière des analyses fictives selon lesquelles mai 1968 a été le moment d'ouverture de la crise actuelle, un moment d'explosions de grandes luttes ouvrières, une première grande réponse de la classe Contre le capital" (Battaglia Communista n°10-11).
Pour commencer, nous voulons dire que si Battaglia a des accusations à faire, qu'il le fasse ouvertement les accusés et surtout en les documentant. Les communistes n'ont rien à cacher y compris leurs propres erreurs. Ceci dit, nous rappelons à l'imprudent auteur de l'article que pendant les événements de mai-juin 68, notre section française actuelle. Révolution Internationale, n'existait pas (le premier numéro ronéotypé sort en décembre 68) et avait par la même occasion peu de chances de se confondre avec les gauchistes. A l'époque, il existait seulement un petit groupe de camarades au Venezuela qui publiait la revue Internacionalismo et collaborait au bulletin ouvrier Proletario avec d'autres camarades non organisés et un autre groupe de la gauche communiste "Proletario Internacional".
Lors des événements de mal, Proletario Internacional s'est laissé entraîner, à leur annonce, dans l'euphorie générale et a proclamé, derrière les Situationnistes, la nécessité de constituer immédiatement les Conseils ouvriers :
"Et pour donner l'exemple, Proletario Internacional a proposé que les différents groupes constituant Proletario (considéré pour l'occasion comme une sorte de conseil ouvrier) se dissolvent en son sein. Tous les participants à Proletario ont suivi Proletario Internacional sur cette voie glorieuse à l'exception d'Internacionalismo. Proletario et ses participants auto-dissous n'ont pas survécu à ce qu'ils avaient pris pour la révolution. Les retombées du mouvement de mai les ont entraînés dans le néant"([7] [64]).
Ainsi les quelques militants qui défendaient alors les positions qui sont aujourd'hui celles du Courant, isolés géographiquement et entourés par la débandade et les illusions, ont su rester solidement attachés au fil de l'histoire, même au prix de leur isolement local. Mais le "coup d'épaule" de mai 68 a aussi permis le surgissement en France et aux Etats-Unis de petits groupes de camarades capables de se rattacher aux positions de la Gauche Communiste défendues par Internacionalismo, jetant ainsi les bases de notre regroupement International. Quant à Mai 68, nous y reconnaissons effectivement la première manifestation ouverte de la crise qui a ébranlé le monde capitaliste après les années "d'abondance". Mais les marxistes n'ont pas besoin de voir exploser la crise de façon ouverte et tangible pour la prévoir :
"L'année 1967 a vu la chute de la Livre-sterling et 68 nous amène les mesures de Johnson... Nous ne sommes pas des prophètes et nous ne prétendons pas savoir comment et quand auront lieu les événements. Par contre, nous sommes certains qu'il est impossible d'arrêter le processus que subit actuellement le système capitaliste avec ses réformes, ses mesures de sauvetage et autres mesures économiques capitalistes et que ce processus les porte irrémédiablement à la crise". (Internaclonalismo - janvier 1968).
Nous étions bien préparés pour reconnaître la crise qui allait commencer à se manifester et nous l'avons reconnue ([8] [65]), au milieu des grands rires de tous ceux qui parlaient de "révolte étudiante contre l'ennui de la vie". Aujourd'hui, ils ont cessé de rire.
Turin, Cordoba, Dantzig, Szczecin ont rendu impossible par la suite de nier l'évidence et Battaglia reconnaît que le capitalisme est entré en crise en...1971. Pour rejeter la nature de classe des événements de 68 en France et de 69 en Italie, Battaglia rappelle comment ils se sont terminés et quelle sorte de groupuscules les ont dominés. C'est avec cette même méthode que depuis cinquante ans, les conseillistes démontrent que la révolution d'Octobre était une révolution bourgeoise,... vu comment elle s'est terminée... Nier la nature de classe de la vague de grèves de ces années en se référant à la nature "opportuniste" des groupes qui l'ont dirigée, cela revient à nier la nature prolétarienne des révolutions de 1905 et de février 1917 puisque la majorité des soviets était contre les bolcheviks. Battaglia soutient avec raison que la présence physique des ouvriers ne garantit pas la nature prolétarienne d'un mouvement et donne l'exemple des manifestations pour l'anniversaire de la Libération en Italie. Mais il y a une grande différence entre une manifestation politique qui célèbre le triomphe de l'Etat républicain sur la lutte de classe et une grève sauvage, c'est-à-dire une manifestation de la lutte de classe. Si la Gauche Italienne ne nous avait enseigné qu'une seule chose, c'est bien que les communistes soutiennent et participent à toutes les luttes prolétariennes qui se situent sur le terrain de la défense des intérêts spécifiques de la classe ouvrière Indépendamment de la nature politique de ceux qui dominent les grèves ([9] [66]). Il est plutôt drôle de noter que dans le feu de la justification de l'absence du parti dans les luttes de 69, les camarades de Battaglia se font du tort à eux-mêmes. En effet, dans les polémiques qui ont précédé la scission du Parti Communiste Internationaliste avec les prédécesseurs de l'actuel Programme Communiste en 1952, c'étaient ces derniers qui proclamaient la nécessité de ne pas participer aux grèves politiques générales contre l'impérialisme américain vue la totale hégémonie des staliniens sur ces mouvements. Et les camarades de la tendance Damen répondaient :
"Les groupes d'usines et de chantiers doivent acquérir la capacité (qu'ils n'ont pas encore) de changer le cours de l'agitation contre l'esprit et l'orientation de cette agitation... Après avoir ouvertement pris leurs responsabilités et exprimé leurs positions politiques, ils doivent sortir de l'usine avec la majorité des travailleurs qui sortent, rester là où la majorité reste. Il ne s'agit pas d'un critère de conformité à la majorité ou à la minorité, mais d'une méthode communiste, d'une évaluation de principe : celle d'être présents là où se trouvent les masses ouvrières, là où elles bougent, discutent et ex» priment leurs désirs qui, nous le savons, ne sont pas toujours en accord avec leurs intérêts de classe... Les soi-disant camarades d'Asti (qui n'avaient pas participé aux grèves) sont et restent des jaunes; j'ajoute que, s'ils s'étaient trouvés là, leur geste aurait reçu la leçon qui lui est due; cela aurait été beau de voir des Internationalistes attaquer d'autres Internationalistes", (extrait des interventions de Lecchi et Mazenchelli, rapportées dans un bulletin interne fin 1951 de la tendance Damen). Que devons-nous en déduire ? Que la participation de la classe à des manifestations qui se déroulent EN DEHORS du terrain de classe ne constituent pas un empêchement suffisant pour être présents "là où se trouvent les ouvriers", alors que l'Inévitable immaturité et confusion qui accompagne le retour de la classe sur son PROPRE TERRAIN DE LUTTE suffit par contre pour s'interdire de participer à cette reprise de la lutte ? Cette spectaculaire contradiction n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des conséquences auxquelles mène la tentative de concilier le mythe de l'infaillibilité du parti avec la prosaïque réalité de l'absence du parti au rendez-vous qu'il avait pourtant su attendre durant de longues années de "paix sociale". Il serait absurde aujourd'hui de proclamer notre supériorité parce que nous aurions su "comprendre Mai". Mais c'est encore plus absurde que ceux qui ont pris les événements de 1968-69 pour une restructuration du capitalisme menée par la révolte des petit-bourgeois, se permettant aujourd’hui de proclamer :
"La portée réelle de cette crise que SEUL le parti et LE PREMIER (!) a su voir et énoncer" (Battaglla CommunIsta n°l3).
INVARIANCE DOGMATIQUE ET REFLEXION REVOLUTIONNAIRE
"Le marxisme révolutionnaire, le léninisme (comme continuité rigide de cette tradition de laquelle nous nous réclamons)... contre ceux qui pour ne pas se "scléroser", ont besoin de se "renouveler" par de continuelles élucubrations sur ces manques ou "erreurs" présumés du marxisme ou du léninisme" (B.C n°10-11);
Dans l'enthousiasme de la polémique contre nous, Battaglia semble accepter le fameux acte d'adhésion du militant communiste qui s'engage à : "ne pas revoir, ne pas ajouter, ne pas laisser de côté - tout soutenir, tout défendre, tout confirmer et tout répandre comme un bloc monolithique et de toutes ses forces" (Bordiga, février 1953).
Mais, par chance et surtout pour eux, nos "léninistes d'acier" se sont permis quelque "révision" et c'est vraiment ce qui leur a permis de maintenir une position entièrement Internationaliste et défaitiste pendant la seconde guerre mondiale :
"... ces thèses (de Lénine), tout en arrivant à des conclusions franchement révolutionnaires, contiennent dans leurs prémisses certaines idées qui, si elles sont mal comprises et encore plus mal appliquées devaient mener à de dangereuses déviations et donc par là-même, à de graves défaites prolétariennes.... la notion de classe a un caractère essentiellement international : ce point fondamental de la conception marxiste a été examiné de façon plus approfondie par Rosa Luxembourg qui, à peu près en même temps que Lénine, est arrivée par d'autres voies à des conclusions différentes et à les dépasser... Brièvement, le problème que Rosa soulevait et qui se heurtait aux thèses de Lénine est le suivant : le capitalisme, dans son ensemble mondial suit une voie essentiellement unitaire : les désaccords qui le troublent ne sont jamais tels qu'ils brisent la solidarité de classe qui préside à la défense de ses Intérêts fondamentaux... A faire abstraction de la considération très importante que déjà, en 1914, Rosa avait raison contre Lénine lorsqu'elle affirmait que l'époque des luttes de libération nationale était terminée avec la constitution des grands Etats européens et que dans la phase de décadence du capitalisme, toutes les guerres avalent nettement un caractère impérialiste (alors que, selon Lénine, les guerre nationales étaient encore possibles et les tâches des révolutionnaires vis-à-vis de celles-ci étaient différentes de celles à assumer face aux autres), il n'en reste pas moins le fait que le cours de la situation qui s'est ouvert avec la guerre d'Afrique, confirme de façon lumineuse la vérité des thèses de Luxembourg". (Prometeo, clandestin 1er novembre 1943)
Aujourd'hui encore Battaglia défend la position révolutionnaire sur les soi-disant "luttes de libération nationale", mais pour la défendre contre Programma à qui se réfère-t-il ? à Lénine ! :
"Il faudrait rappeler aux prétendus Internationalistes en question comment Lénine écrit vis-à-vis des soi-disant "guerres nationales" en réalité des guerres impérialistes... Lénine explique que dans toutes les guerres, le seul vaincu, c'est le prolétariat", (B.C n°18-décembre 1976)
Pour ménager la chèvre et le chou, positions révolutionnaires et "autorité léninienne", Battaglia est contraint de faire dire à Lénine le contraire de ce qu'il a dit historiquement et entre autre en se démentant lui-même comme l'a montré la citation de Prometeo. Ainsi, l'incapacité de faire une critique complète des erreurs de la IIIème Internationale (ceci vaut en particulier pour le parti) comporte le fait que même sur les questions dans lesquelles les erreurs ont été dépassées on ne parvient pourtant jamais à une véritable clarté. Par exemple, dans la question syndicale, Battaglia reconnaît que dans la vague révolutionnaire, la classe détruira les syndicats et que c'est la tâche des communistes d'en dénoncer dès maintenant la nature bourgeoise. Mais on écrit que :
"(En ce qui concerne les syndicats), s'éloigner de la ligne tracée par l'œuvre de Lénine, c'est de toute façon une chute verticale dans le vide... Le cadre de toujours reste fondamental, tout comme cela a été pour Marx, puis Lénine et tout comme nous le connaissons aujourd'hui". (Prometeo n°18, p.9, 1972)
Alors, si rien n'est changé, pourquoi le prolétariat devrait-il détruire ses anciens instruments, les syndicats. Si le syndicat est celui "de toujours", pourquoi écrire dans la plateforme :
"Catégoriquement, le Parti affirme que, dans la phase actuel le de domination totalitaire de l'impérialisme (souligné par nous), les organisations syndicales sont indispensables à l'exercice de cette domination". (Plate-forme 1952, P.C Int.).
Les camarades de Battaglia nous accusent de fossiliser leur position sur les groupes Internationalistes d'usine, qui dans la réalité sont des organes du parti, de véritables courroies de transmission entre le parti et la classe. Dans un article sur la récente Rencontre d'Oslo (B.C n°13), ils constatent que même la Comunist Workers' Organisation n'arrive pas à comprendre le rôle de ces groupes. Nous pensons qu'une incompréhension aussi largement diffusée, est due surtout à la réelle ambiguïté de leur rôle. On nous dit qu'ils sont des organes de parti, mais comment un organe de parti peut-II se baser sur des éléments qui, dans leur grand nombre, ne militent pas dans le parti ? On nous dit que les courroies de transmission du parti dans la classe sont ces groupes et non ceux des coordinations ouvrières qui surgissent spontanément. Bien. Mais, si les mots ont un sens, la courroie de transmission dans un moteur est l'élément qui assure la médiation entre deux autres éléments (et en effet les camarades de Battaglia parient "d'organismes intermédiaires"). Mais si un organisme est intermédiaire, c'est-à-dire est à moitié chemin entre le parti et la classe, comment peut-il être "un organisme de parti" ? La Gauche Italienne a toujours refusé la ligne de l'Internationale visant à l'organisation du parti sur la base des cellules d'usine et avec l'argumentation que les ouvriers étaient des militants du parti comme n'importe quel autre et que seule une organisation basée sur des sections territoriales pouvaient garantir une militance politique de tous ses membres. Battaglia semble résoudre la question en prévoyant à côté de la structure territoriale pour tous les militants une sous-structure "intermédiaire" réservée seulement aux militants ouvriers. Nous ne pensons pas qu'il s'agit d'un pas en avant. Pour la même raison, nous ne pensons pas que c'est "un souci d'ordre intellectuel" que de voir une contradiction entre la dénonciation des syndicats comme contre-révolutionnaires et la présence en leur sein comme délégués syndicaux. Plus ces délégués seront combatifs et dévoués aux intérêts de la classe, plus seront renforcées chez les ouvriers la possibilité "d'utiliser les syndicats". Il ne s'agit pas de simples plaintes de pessimistes mais d'un danger réel comme le montre le fait que Battaglia, qui soutient néanmoins qu'il a les idées claires sur les Conseils d'Usine (Documents de la Gauche Italienne n°1, p.7, Janvier 1974) arrive à déclarer :
"Il y a des données de toute autre nature à la I.B Mec. d'Asti où la participation ouvrière est très grande, pourquoi ? Parce qu'à la I .B Mec. d'Asti le Conseil d'Usine agit indépendamment ou mieux sur la base des Intérêts ouvriers et non sur les directives "pompiéristes" de Lama et Cie". (Battaglia Comunista n°l Janvier 1977)
On finit donc par participer au chorus que depuis des mois la gauche extra-parlementaire a commencé à chanter : redonner du souffle aux structures de base du syndicat, les conseils d'usine en les opposant aux "méchants sommets", c'est à dire Lama et Cie (Voir à ce propos l'assemblée du Théâtre Lyrique "pour un syndicat de Conseil"). Si on voulait suivre les méthodes polémiques de Battaglia, on pourrait sans difficulté déclarer que sa seule préoccupation est la chasse aux fauteuils des bureaucrates syndicaux. Mais ce n'est pas vrai et nous le savons bien. Nous pensons au contraire que ces erreurs-là sont une réponse fausse à une exigence juste et fondamentale : la défense militante des positions révolutionnaires dans la classe et dans ses luttes. Nous n'avons pas non plus la présomption de détenir toute la vérité. Mais les positions que nous défendons ne sont pas de "simples abstractions géométriques" développées dans l'atmosphère raréfiée des bibliothèques. Passées à l'épreuve des faits dans les cercles ouvriers qui ont surgi de la lutte de classe en Espagne, en Belgique, en France et ailleurs, elles se sont bien révélées autre chose que de "l'intellectualisme".
GROUPES POLITIQUES PROLETARIENS
"Enoncé de façon présomptueuse (puisque nous ne savons pas de quel droit le CCI s'empare du rôle d'eau pure opposée au marais de la confusion entre les groupes de la Gauche Communiste), le premier document théorise en partant d'une position au-dessus des partis : nous sommes la vérité, tous les autres le chaos".(B.C n°10-11)
Un groupe qui imagine être le seul dépositaire de la vérité révolutionnaire, "l'imaginerait" justement. Mais si nous relisons notre résolution sur les "groupes politiques prolétariens ([10] [67]), nous ne trouvons pas de telles bêtises; la résolution se conclue justement en soulignant la nécessité absolue de "nous garder de considérer que nous sommes le seul et unique groupe révolutionnaire existant aujourd'hui (Revue Internationale n°11, p.22). Loin de vanter notre incapacité innée à commettre une erreur quelconque, nous affirmons :
"Le CCI doit... se garder de recommencer ses erreurs passées qui ont conduit Révolution Internationale par exempte à écrire "nous doutons de l'évolution positive d'un groupe venant de l'anarchisme" dans une lettre adressée au "Journal Lutte de classe" dont les membres allaient un an plus tard avec ceux du RRS et du VRS fonder la section du CCI en Belgique" (Revue lnt.n°11, p.20). Et pourtant, on aurait beaucoup à citer sur les erreurs des autres.il existe par exemple des groupes qui prétendent être déjà parvenus à une clarté parfaite alors que les autres commenceraient tout juste maintenant à éclaircir leurs idées :
"La tâche propre aux révolutionnaires de tous les pays, là où Ils sont organisés en Parti (Italie) ou là où Ils agissent comme petits groupes ou simplement des individus isolés, se précise de plus en plus". (Prometeo, n°26/27, p.16, 1976)
Mis à part le ton d'auto-exaltation mythologique et la réduction à de petits groupes en phase d'orientation pour le CCI, le PIC et la CWO qui ont une plate-forme, on peut penser que, pour Battaglia, les trois autres groupes qui en Italie se réclament de la Gauche Italienne (Programma Comunista, Rivoluzione Comunista et Partito Comunista) ne sont pas révolutionnaires ou ne sont pas des partis! Mais la chose la plus amusante est le fait, qu'après avoir d'une façon désinvolte annulé d'un simple trait l'existence même de Programma Comunista, Battaglia trouve "absurdes et ridicules" nos critiques à cette organisation dans notre résolution sur les groupes politiques prolétariens. Quelle est notre position ? :
"Concernant ce dernier groupe, quel que soit le degré atteint par sa régression, Il n'existe pas à 1'heure actuelle d'é1ément décisif permettant d'établir qu'elle est passée comme corps dans le camp de la bourgeoisie. Il faut mettre en garde contre une appréciation hâtive sur ce sujet qui risque non pas de favoriser, mais d'entraver le travail d'éléments ou tendances qui peuvent tenter; au sein de ces groupes, de résister contre ce cours de dégénérescence, ou de s'en dégager" (Revue Internationale n°11, p.21).
Nous considérons Programma Comunista comme un groupe qui se situe encore dans le camp prolétarien, donc nous sommes ouverts à la discussion et à la polémique politique. Ce n'est pas par hasard que dans notre presse "nous avons déploré son mépris manifeste pour la Conférence Internationale convoquée par Battaglia. Mais quelle ne fut pas notre surprise quand, ayant reçu (après avoir beaucoup Insisté) la liste des organisations auxquelles Battaglia avait expédié 1'Appel, aux groupes internationaux de la Gauche Communiste pour la Conférence de Milan, nous n'avons trouvé ni Programma ni les autres organisations qui se réclament de la Gauche Italienne. Il y a donc deux possibilités : soit Battaglia n'a pas expédié l'Appel à ces organisations et dans ce cas, elle a essayé de se faire passer au niveau International comme le seul groupe héritier de la Gauche Italienne, soit elle les a Invités, et, face à leur refus, n'a pas daigné les nommer. Quel que soit le cas ([11] [68]), elle a démontré dans les faits son incompréhension que face aux groupes politiques qui sont sur un terrain de classe, quelles que soient leurs erreurs, Il est nécessaire : "de conserver une attitude ouverte à la discussion, discussion qui doit se mener pu publiquement et non à travers des échanges confidentiels" (Revue lnt. n°11.p.22) Et surtout, il faut savoir ne pas se laisser aller à des réactions émotives, à des représailles polémiques et à des obstinations sur des problèmes formels; c'est pour cette raison que notre attitude envers Programma Comunista ne change pas par le simple fait qu'il nous a qualifiés d’imbéciles" ([12] [69]) .
BATTAGLIA COMUNISTA, LE CCI ET LA CWO
"SI la CWO, avec plus de sérieux, se montre ou vert à l'approfondissement critique et ne s'érige pas en maître du communisme, les confusionnistes du CCI prétendent donner des sentences sur les confusions des autres en rangeant parmi les groupes confus la fleur des réactionnaires gauchistes, comme les trotskystes" (B.C n°l3).
Pour que notre nature de "marxistes du dernier moment" soit plus claire, Battaglia a pensé à nous opposer à un groupe "sérieux", la CWO. Mais pour arriver à son but, elle doit nous attribuer les positions erronées des autres et vice-versa. Battaglia fait semblant de ne pas savoir (ou probablement, elle ne le sait pas vraiment) que la CWO a rompu tout rapport avec nous en 1976 après nous avoir défini non pas comme confus mais comme "contre-révolutionnaires"([13] [70]). Les camarades de la CWO ont maintenu cette position absurde pendant presque deux ans, refusant toute discussion avec nous malgré nos propositions publiques en ce sens (W.R n°6, Revue Internationale n°9 et 10). Cette attitude ultra-sectaire l'a amenée à un isolement croissant et à la désagrégation : d'abord la scission de Liverpool (l'ancien Workers' Voice) après la scission des sections d'Edimbourg et d'Aberdeen, qui réclamaient l'ouverture de discussions avec le CCI en vue de leur Intégration dans le Courant.
Les camarades restés dans la CWO, même s'ils continuent à nous qualifier de "contre-révolutionnaires" ont enfin annoncé "que l'article dans la Revue Internationale n°l0 était politiquement assez sérieux pour pouvoir constituer la base d'une reprise de débat et donc nous sommes obligés d'essayer de faire comprendre encore une fois au CCI les conséquences de ses théories"([14] [71]) et Ils ont maintenu une attitude fraternelle lors de la Conférence "non-léniniste d'Oslo" où nous avons défendu en commun les positions révolutionnaires. En ce qui concerne les trotskystes, notre Résolution parle clair : "Parmi les parti passés à la bourgeoisie, on peut nommer principalement les partis socialistes issus de la 2ème Internationale, les partis communistes Issus de la 3ème Internationale de même que les organisations appartenant au monarchisme officiel et également les courants trotskystes...En ce sens, on ne doit rien attendre des différentes scissions trotskystes qui régulièrement se proposent de sauvegarder ou revenir à "un trotskysme pur" ([15] [72]). Mais si nous n'avons jamais pris les trotskystes pour des confus, il y en a qui, malheureusement, les ont pris pour des révolutionnaires : Battaglia Comunista a invité à la Conférence de Milan deux organisations trotskystes françaises, Union Ouvrière et Combat Communiste, et elle a défendu longuement cette invitation contre nos protestations et notre ferme opposition à n'lm-porte quelle discussion avec des organisations contre-révolutionnaires. Cette opposition n'a pas été simplement exprimée de vive voix dans une rencontre avec la CE de Battaglia mais a été publiée dans notre presse :
"... tout en mettant en garde contre l'absence de critères politiques, ce qui permet l'invitation de groupes tels que les trotskystes-modernistes d'Union Ouvrière ou les mao-trotskystes de Combat Communiste, dont nous ne voyons pas la place dans une conférence de communistes..."([16] [73]). Après tout cela. Il faut pas mal d'inconscience pour écrire que c'est nous qui n'avons pas les idées claires sur la nature réactionnaire du trotskysme.
L'ETAT DANS LA PERIODE DE TRANSITION
Nous n'avons pas l'intention, ici, de nous étendre sur ce sujet aussi complexe que vital pour les révolutionnaires, ni même de réfuter les simplifications désinvoltes que Battaglia énumère à ce propos (ceci trouvera sa place dans le développement ultérieur de la discussion). Nous nous contenterons de souligner les bourdes les plus retentissantes et mettre au clair le cadre dans lequel cette discussion doit se situer.
Pour les camarades de Battaglia, le projet de résolution présenté par le Bureau International du CCI n'est rien d'autre que la négation de la dictature du prolétariat au profit d'un "organe au-dessus des classes, ce qui se rattache, comme une conséquence logique à la défense que les partis de gauche font de "l'Etat de tous". Il est bon de rappeler ici que des accusations analogues avaient été faites par la CWO, pour ne nommer qu'elle. Quel est aujourd'hui le bilan de toutes ces accusations ? Voici ce qu'une importante minorité de la CWO a été conduite à admettre :
"La CWO soutient que le CCI serait partisan d'une soumission de la classe ouvrière à un quelconque "Etat Interclassiste". S'il en était ainsi, le CCI aurait effectivement franchi les frontières de classe. Mais en réalité, si on se prend la peine de suivre les textes du CCI sur la période de transition, on y trouve défendues les mêmes positions de classe que la CWO... Le CCI met clairement en relief que SEULE la classe ouvrière peut disposer du pouvoir politique... Il y est clair que SEULE la classe ouvrière peut s'organiser en tant que classe; la seule concession faite à cet égard concerne les paysans qui peuvent s'organiser sur une base géographique pour faire connaître leurs besoins au prolétariat"([17] [74]).
La thèse défendue dans le projet de résolution et dans maints autres textes précédents, exprime l'idée que l'expérience de la révolution russe a démontré de façon tragique que la dictature du prolétariat, la dictature des conseils ouvriers ne peut s'identifier avec cet Etat engendré par la subsistance de la division de la société en classes au lendemain même de la révolution, il en découle que la dictature du prolétariat ne s'exerce pas dans l'Etat ni à travers l'Etat mais sur l'Etat, qu'en conséquence celui-ci ne pourra être -comme l'a toujours dit le marxisme- qu'un "demi-Etat" destiné à s'éteindre progressivement et pour cela privé de toute une série de caractéristiques particulières, tel par exemple le monopole des armes.
Battaglia joue de l'équivoque et s'indigne :
"Mais alors l'Etat bourgeois a, lui, le monopole des armes, par contre celui qui surgira de la révolution prolétarienne, non!" (B.C n°12) laissant ainsi entendre au lecteur que, d'après nous, le prolétariat devrait se partager fraternellement les armes disponibles avec les anciennes classes possédantes, au nom d'une soi-disant très démocratique "lutte pour le monopole". En réalité, dans la résolution, l'Etat n'a pas le monopole des armes pour la simple raison que la classe, en ne s'identifiant pas à lui, ne le lui délègue pas :
"La domination de la dictature du prolétariat sur l'Etat et l'ensemble de la société se base essentiellement :
- sur l'interdiction de toute organisation propre aux autres classes en tant que classes,
- par sa participation hégémonique au sein de l'organisation d'où émane l'Etat,
- sur le fait qu'elle s'impose comme seule classe armée".(Revue Internationale n°11, p.26)
Puis Battaglia entreprend de nous présenter comme des gens aveuglés par une sorte de phobie de l'Etat due à des "amours libertaires non encore assoupies" :
"Faire de tous les effets négatifs de l'Etat la cause principale de la dégénérescence de la révolution d'Octobre - comme le théorise de façon explicite le document - c'est avoir compris bien peu de l'expérience de la révolution russe, c'est prendre des vessies pour des lanternes, les effets pour les causes". (B.C n°l2).
Et Battaglia d'assumer la tâche aisée de rappeler le poids sur la révolution, de l'encerclement, le reflux de la vague révolutionnaire, etc. Mais le rappeler à qui ? Le CCI a toujours défendu que "de même que la révolution russe fut le premier bastion de la révolution Internationale en 1917, le premier d'une série de soulèvements prolétariens internationaux, de même sa dégénérescence en contre-révolution fut l'expression d'un phénomène international, le résultat de l'échec de l'action d’une classe internationale, le prolétariat" ([18] [75]), menant de dures polémiques contre ceux qui ne volent comme cause de la dégénérescence que les erreurs du parti bolchevik et son identification avec l'Etat. La résolution affirme que l'Etat fut "le principal agent", c'est-à-dire l'Instrument de la contre-révolution, contrairement aux prévisions des bolcheviks, pour qui la contre-révolution ne pouvait s'affirmer qu'au travers de la destruction de l'Etat soviétique par les généraux blancs et les armées d'Invasion du capital mondial. Il revint cependant à l'Etat soviétique, renforcé au maximum pour mieux "défendre la révolution", de prendre en charge son étranglement ainsi que celui du parti bolchevik, en tant que parti prolétarien.
Bref, le projet de résolution sur la période de transition constitue un "brusque détour des voies de la science révolutionnaire", détour qui est d'autant plus grave qu9II n'a d'autre justification que celle de l’originalité à tout prix" (souligné par nous). Battaglia tombe ici vraiment mal. Notre débat sur la période de transition, les contributions élaborées au cours des années, se situent dans une continuité directe des recherches menées par les minorités révolutionnaires des années 30. Ceci est particulièrement vrai pour la Gauche Italienne qui énonçait comme tâche des révolutionnaires la résolution des "NOUVEAUX PROBLEMES POSES PAR L'EXERCICE DU POUVOIR PROLETARIEN EN RUSSIE" (Bilan, nov.1933), et qui parvint à fournir une contribution, qui pour ne pas avoir été définitive, n'en fut pas moins fondamentale :
"Mais l'Etat soviétique ne fut pas considéré essentiellement par les bolcheviks, au travers des terribles difficultés contingentes, comme un "fléau dont le prolétariat hérite et dont il devra atténuer les effets les plus fâcheux" (Engels), mais comme un organe qui pouvait être totalement identifié avec la dictature du prolétariat et donc avec le Parti... Bien que Marx, Engels, et surtout Lénine, aient, plus d'une fois, souligné la nécessité d'opposer à l'Etat son antidote prolétarien, capable d'empêcher sa dégénérescence, la révolution russe, loin de garantir le maintien et la vitalité des organisations de classe du prolétariat, les a stérilisées en les intégrant dans l'appareil étatique et en a ainsi dévoré la substance même" ([19] [76])
On peut certes être en divergence avec ces positions et/ou avec les conclusions qui en ont été tirées par la Gauche Communiste de France (Internationalisme) pendant les années 40 et par nous aujourd'hui : l'existence d'un débat ouvert sur ces thèmes au sein de notre organisation en est la meilleure preuve ([20] [77]). Mais présenter tout ce travail comme un ridicule souci "d'originalité", c'est au contraire fournir la meilleure preuve du processus de sclérose auquel Battaglia se trouve confrontée.
Mais à peine a-t-on prononcé ce terme de sclérose que les camarades de Battaglia sentent le sang leur monter à la tête, l'interprétant comme une tentative de les définir comme une bande de vieillards artérioscléroses et recroquevillés. Ce n'est pourtant pas en termes d'Insultes que nous parlons de sclérose à l'égard des groupes qui ont survécu des anciens courants révolutionnaires, tout comme ce n'est pas sur un ton d'éloge que nous constatons "l'agilité" de tous ceux (Togliatti, etc.) qui ont, avec la plus grande désinvolture, sauté de l'autre côté de la barricade. Il n'en demeure pas moins qu'un groupe révolutionnaire ne peut pas subir pendant près de 50 ans l'influence du poids de la contre-révolution triomphante, au sein même des rangs de la classe ouvrière, sans qu'il s'en dégage la moindre conséquence :
"En règle générale, d'ailleurs, leur sclérose est, en partie la rançon qu'ils paient à leur attachement et à leur fidélité aux principes révolutionnaires, à leur méfiance à l'égard de toute Innovation qui a constitué, pour d'autres groupes, le cheval de Troie de la dégénérescence ([21] [78]), méfiance qui les a conduits à rejeter les actualisations de leur programme, rendues nécessaires par l'expérience historique"([22] [79]).
Dans la réalité, la capacité de dépasser et de dénoncer les faiblesses de la position de Lénine sur la question nationale (positions que le Parti Communiste d'Italie avait, en son temps, entièrement fait siennes) a constitué un facteur Important dans la défense du défaitisme révolutionnaire, menée par le Parti Communiste International pendant la IIème guerre mondiale. Mais au cours de la longue période de paix sociale qui s'est ouverte avec l'après-guerre, le processus de sclérose a pris, en grande partie, le dessus sur le travail d'enrichissement des positions de classe. Si Programma Comunista a cru résoudre tous les problèmes et, proclamant le retour à toutes les vieilles erreurs de la IIIème Internationale, Battaglia - comme nous l’avons vu -tente elle de concilier la défense de positions de classe et une adhésion "rigide" au "léninisme". Ainsi, par exemple, dans un article sur le parti bolchevik paru dans Prometeo ([23] [80]). L’auteur des articles sur le second congrès du CCI, à côté d'une polémique juste "contre ces conceptions qui Identifient l'exercice de la dictature - qui doit être le fait de la classe et d'elle seule - avec la dictature du parti", attaque surtout "ces conceptions débordantes de préjugés bourgeois, telles celles de Rosa Luxembourg, suivant lesquelles la dictature consiste dans l'application de la démocratie et non dans son abolition". Nous ne pensons pas que ce soit ici le lieu pour répondre à ces simplifications et déformations des critiques adressées par la grande révolutionnaire à l'expérience bolchevique. D'ailleurs, il y a quelques années, Battaglia s'est, elle-même chargée de le faire en publiant, en italien la brochure "La Révolution Russe" de Rosa et en affirmant, par la plume autorisée d'Onorato Damen, que :
"La dictature du prolétariat de demain, quelque soit le pays où elle agira, constituera une expérience nouvelle, en ce sens qu'elle synthétise ra l'intuition et l'optimisme révolutionnaires de Luxembourg et l'irremplaçable enseignement de Lénine" ([24] [81]).
Mais peut-être l'auteur de l'article ne le savait pas et peut-être s'est-ll laissé aller au plaisir de "l'originalité à tout prix" à l'égard de son propre parti. Nous ne pouvons que constater : Il s'agit encore une fois des zigzags typiques de cette prétendue "Invariance" rigide.
LE DEBAT ENTRE LES REVOLUTIONNAIRES ET LES QUESTIONS OUVERTES
"Ainsi, d'après les auteurs de l'article (peut-être d'après tous les camarades du CCI ? Nous en doutons ...), l'Etat au cours de la période de transition est une question sur laquelle II est permis et même nécessaire de discuter au sein d'une organisation révolutionnaire aux aspirations vraiment internationales... Ce qui est tout à fait Inacceptable, c'est la prétention du CCI d'être une organisation Internationale de révolutionnaires. Il serait plus juste de l'appeler "groupe international d'études", groupe avec lequel, bien entendu, nous sommes toujours prêts à collaborer en donnant le meilleur de nous-mêmes". (B.C. n°14).
Contrairement à ce que semble penser aujourd'hui Battaglia Comunista, les frontières de classe qui déterminent l'appartenance au camp prolétarien, n'ont pas été toutes codifiées dans le Manifeste de 1848. La Commune de Paris a démontré que "l'Etat bourgeois se détruit mais ne sa conquiert pas", et l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, marquée par l'éclatement de la première guerre mondiale a rendu inutilisables pour la classé toutes les vieilles tactiques réformistes. De façon spécifique, dans ce dernier cas, il est parfaitement compréhensible que les révolutionnaires n'aient pas été capables, sur le moment, de mesurer l'ampleur du changement qualitatif. Mais aujourd'hui, après 50 ans de démenti historique, les refus de 669 tactiques est devenu une frontière de classe, dont la défense est la base de toute organisation révolutionnaire. La plate-forme du CCI, base d'adhésion unique dans tous les pays, assume cette fonction et c'est à faire sa critique que nous invitons quiconque voudrait sérieuse ment démontrer notre inexistence comme organisation Internationale des révolutionnaires. C'est au sein de ce cadre programmatique cohérent qu'il est permis, même nécessaire de discuter sur tous les problèmes que l'expérience historique de la classe n'a pas encore résolus. Avec Bilan, nous pensons que le court exercice du pouvoir par le prolétariat en Russie, loin de confirmer toutes les vieilles convictions du mouvement ouvrier, a soulevé de "nouveaux problèmes" auxquels II faut donner une solution dans la perspective révolutionnaire. Contribuer à la préparation de cette solution, telle est la tâche qui anime tous les militants du CCI dans cette discussion, qui se situe fermement à l'intérieur du cadre tracé par l'expérience russe (la dictature du prolétariat n'est pas la dictature du parti, etc.). Mais ce problème ne concerne pas uniquement le CCI; Il est l'affaire de tout le mouvement révolutionnaire. C'est pourquoi le débat est mené de façon ouverte, face à l'ensemble de la classe, Invitant les autres groupes à participer au débat.
C'est cette attitude qui nous a aidés è assumer dans les faits l'effort de regroupement des révolutionnaires au niveau International, cette tâche que nous avons "la prétention" de faire nôtre. C'est pour cela que nous pouvons entreprendre une discussion avec d'autres groupes sans besoin de "nous donner du courage" en affirmant qu'il s'agit uniquement de fournir une aide maximum de notre part à d'inoffensifs studieux, privés de toute cohérence Interne.
Si nous avons publié dans notre presse un texte de Battaglia fortement critique à notre égard ([25] [82]) ce n'est ni par éclectisme, ni par faiblesse : "Loin de s'exclure, fermeté sur les principes et ouverture dans l'attitude vont de pair : nous n'avons pas peur de discuter précisément parce que nous sommes-convaincus de la validité de nos positions" ([26] [83]). En fait, nous soutenons fermement que la discussion publique au sein et entre les organisations prolétariennes soit le patrimoine du mouvement ouvrier et non de quelque Institut International des Hautes Etudes Sociales. C'est ainsi que Bilan publia - à propos de la guerre d'Espagne - les textes de la minorité scissionniste et nous- mêmes les avons reproduits en publiant aujourd'hui les textes de Bilan sur cette question ;
"Ce n'est certes pas un scrupule moral qui a motivé ce choix, c'est encore moins une volonté de se tenir au-dessus de la mêlée (étant donné notre prise de position sans équivoque) qui nous a conduits à publier les textes des deux tendances. La politesse n'a rien à faire ici. Nous laissons volontiers aux héros des guerres Impérialistes la haute satisfaction de porter des fleurs à l’ennemi vaincu. Le débat politique n'est pas pour nous un beau geste, une "touche de classe", quelque chose qui nous distingue et nous fait remarquer, mais au contraire, UNE NECESSITE ELEMENTAIRE VITALE A LAQUELLE IL NE SAURAIT ETRE QUESTION DE RENONCER". ([27] [84])
[1] [85] Les documents et les procès-verbaux de la Conférence sont publiés sous la forme d'une brochure ronéotée en français et anglais et comme numéro spécial de Prometeo en Italien. On peut se procurer ces textes au PCInt. Casella Postale 1753 -Milano-Italie-
[2] [86] Voir Battaglia Comunista nô 10-11 et 12 -Août-septembre 1977.
[3] [87] Rivoluzione Internazionale n°10, p.4, sept.77.
[4] [88] "L'insondable profondeur du marxisme occidental" dans 'Le Prolétaire n°203-204-octobre 1975.
[5] [89] C'est le cas de Battaglia pour les groupes qui viennent de la Gauche Italienne, de Spartacus-Bond pour la Gauche Hollandaise (voir "Spartacus-Bond terrorisé par les fantasmes bolcheviks, Revue Internationale n:2).
[6] [90] Battaglia Comunista n°l3-octobre 1977.
[7] [91] Bulletin d'Etude et de Discussion de RI n°!0, p.3l.
[8] [92] Voir par exemple "La crise monétaire" dans RI ancienne série n°2, février 1969.
[9] [93] Ainsi nous nous sommes solidarisés avec les grèves d'août 1975 des cheminots Italiens malgré l'Intervention démagogique des syndicats autonomes (Rivoluzione Internazionale n°3).
[10] [94] Rivoluzione Internazionale n°7, p.23
[11] [95] Probablement le deuxième, étant donné les "allusions" de Programma : "Toutefois, de temps en temps, nous recevons des appels, pas très convaincus, certainement peu convaincants, pour une rencontre sur la base d'un programme très général de lutte contre l'opportunisme" (Programma Comunista, n°l2, Juin 1976).
[12] [96] Voir article de Programma Comunista n°2l, nov.1977, auquel nous répondrons dans notre prochain numéro de Rivoluzione Internazionale.
[13] [97] Voir "Les convulsions du CCI" dans Revolutionary Perspectives n°4. Selon ces camarades, en en effet, notre refus de considérer le parti bolchevik et l'IC dans son ensemble comme totalement réactionnaires à partir de 1921, fait de nous "un de ces nombreux groupes qui font partir la contre-révolution après 1921". Les camarades de Battaglia qui se réclament explicitement du Parti de Livourne (1921) et des Thèses de Rome savent désormais ce que la CWO pense d'eux.
[14] [98] Revolutionary Perspectives n°8, p.38.
[15] [99] Revue Internationale n°11, p.19-20.
[16] [100] Revue Internationale n°8, p.46, déc.1976.
[17] [101] "Frontières de classe et organisation", texte de la section d'Aberdeen et d'Edimbourg, publié maintenant dans Revolutionary Perspectives n°8
[18] [102] "La dégénérescence do la révolution russe", p.l8 dans la Revue Internationale n°3.
[19] [103] Bilan n°28, mars-avril 1936. Pour une Histoire de la Gauche Italienne dans l'exil, voir Revue Internationale n°9. p.10.
[20] [104] Voir à ce propos le contre-projet de résolution écrit par quelques camarades dans la Revue Internationale n°11, p.27. Voir encore dans le même numéro la lettre critique envoyée par le camarade E. et la réponse de R.Victor, p.31.
[21] [105] C'est pour cela que nous avons toujours condamné le mépris "juvénile" de groupes qui tels, Union Ouvrière à qui II a suffi d'une année pour Juger théoriquement et expérimenter pratiquement la formidable pauvreté de tous les "bordigo-pannekoeko-révisionnistes et de leurs sous-produits critiques" (U.O de décembre 1975); leur mépris pour les vieilles "momies" de la Gauche Communiste n'est en réalité qu'un mépris vis-à-vis des difficultés que rencontre le prolétariat pour se hausser à la hauteur de ses tâches historiques. Le naufrage d'Union Ouvrière dans la confusion après "une année" en est la meilleure preuve.
[22] [106] Revue Internationale n°11, p.21
[23] [107] Prometeo n°24-25, p.35, 1975.
[24] [108] "La Révolution Russe" de Rosa Luxembourg, Edizione Battaglia Comunista, sans date.
[25] [109] Introduction aux textes sur la divergence dans la Rivoluzione Internazionale n°1.
[26] [110] "Lettre de Battaglia Comunista" publiée dans la Revue Internationale n°8 (Eds française, anglaise et espagnole) avec une réponse approfondie et documentée de notre part. Depuis, près d'un an s'est écoulé et nous attendons toujours une réponse.
[27] [111] Revue Internationale n°11, p.22.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [112]
- Battaglia Comunista [113]
Revue Internationale no 14 - 3e trimestre 1978
- 2891 reads
Afrique, contre la marche vers la guerre mondiale : Riposte internationale de la classe ouvrière ! (tract)
- 3442 reads
Le capitalisme décadent porte la guerre en ses flancs comme seul aboutissement aux contradictions et déchirements internes du système. Aucun mystère ne voile la nature de la guerre impérialiste à notre époque. L'absence de nouveaux débouchés pour réaliser la plus-value incluse dans les marchandises produites au cours du processus de production, ouvre une crise permanente du système : une lutte acharnée pour la possession des matières première, pour la maîtrise du marché mondial, pour le contrôle des zones militaires stratégiques du globe. Plus l'antagonisme inter-impérialiste s'aggrave avec la crise économique, plus les Etats capitalistes sont amenés à renforcer leur appareil militaire défensif et offensif. Depuis la fin du siècle dernier, le capitalisme est définitivement rentré dans le stade de l'impérialisme et tous les Etats du monde, pour défendre leurs intérêts propres, sont obligés de se mettre sous la tutelle de l'une ou l'autre des deux grandes puissances : les USA et la Russie.
Les guerres restent actuellement localisées mais le théâtre des opérations s'est étendu ces derniers temps depuis l'Indochine, proie entre la Russie et la Chine, elle-même devenue l'interlocuteur privilégié du bloc occidental en Asie, jusqu'au Moyen-Orient, abcès de fixation quasi permanent et maintenant en Afrique qui se déchire en foyers de guerre effectifs ou potentiels : Zaïre, Tchad, Rhodésie, Afrique du Sud, Angola, Ethiopie, Erythrée, Somalie.
Les récents événements au Zaïre constituent le signe le plus marquant du réchauffement des conflits inter impérialistes à l'heure actuelle. Les interventions militaires directes de la France et la Belgique sont motivées par les intérêts économiques et politiques que gardent ces pays face à leurs anciens empires coloniaux, tout comme, les "casques bleus" français au Liban ne sont que l'ancienne armée coloniale déguisée. On serait tenté, si l'on reste à ce niveau seulement de comparer le Zaïre avec des aventures impérialistes des années 60 telles que le Vietnam et d'en conclure que les événements d'aujourd'hui sont moins graves, moins âpres, moins dangereux. Mais on se tromperait lourdement.
En fait, l'intervention au Zaïre comme celle au Tchad fait partie d'une concertation des efforts de tous les pays de l'OTAN pour affronter les poussées du bloc russe. Ce ne sont pas un ou deux pays qui sont en cause mais directement toute la politique des blocs impérialistes. L'impérialisme russe s'acharne à vouloir briser l'emprise du bloc américain sur l'Afrique, après avoir subi l'étau de la "pax americana" au Moyen-Orient. L'impérialisme américain vient de faire une démonstration importante de la rapidité de ses réactions ainsi que de la collaboration au sein de son bloc face aux conflits.
Au moment des événements, tous les pays d'Europe ont donné leur appui à l'intervention au Zaïre et Washington a même prêté certains de ses avions. Le 5 juin, les six pays de l'OTAN se sont réunis à Bruxelles pour étudier la situation en Afrique et plus tard, le 11 juin, les "onze" du bloc américain (y inclus l'Iran, l'Arabie Saoudite, le FMI (Fonds Monétaire International), la Banque mondiale et une commission de la CEE) ont étudié les modalités d'une aide financière pour maintenir à flot l'économie zaïroise, criblée de dettes étrangères de 2,3 milliards de dollars et dont le PNB diminue de 5 % chaque année depuis 1976. Sept pays africains participent à la force chargée de la défense du Shaba; le Maroc fournira l'essentiel des troupes de cette force sans précédent. Même l'Egypte donne son soutien militaire au Zaïre comme au Tchad.
Le renforcement des blocs impérialistes s'accentue de conflit en conflit. Nous voyons aujourd'hui clairement la véracité de notre analyse : "L'économie de guerre à l'époque actuelle n'est pas seule ment mise en place à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle d'un bloc impérialiste. L'incorporation dans un des deux blocs impérialistes -chacun dominé par un capitalisme d'Etat continental et colossal, les USA et la Russie est une nécessité à laquelle même les "grandes puissances anciennement impérialistes comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et le Japon ne peuvent résister. La tendance dominante de la part des USA et de la Russie est de coordonner, organiser et diriger le potentiel de guerre de leur bloc ("Rapport sur la situation Internationale [114]", Revue Internationale n°11). La bourgeoisie a présenté ce nouveau pas vers la guerre "franche" comme un acte humanitaire" pour "sauver les blancs", tout comme elle a lancé une campagne anti-terroriste pour mieux cacher le renforcement de l'appareil répressif de l'Etat. Les révolutionnaires ont le devoir de prendre une position intransigeante, internationaliste face à toutes les menaces de guerre, à toutes les campagnes idéologiques de la guerre. Et c'est cela que le CCI a fait à travers la déclaration que nous publions ci-dessous, dénonçant les deux camps en présence, dénonçant toute tentative de couvrir la vérité des événements par la mystification des soi-disant "luttes de libération nationale" ou par un appui au bloc russe, supposé "progressiste". Contrairement au PCI (bordiguiste) qui écrit : "les combattants palestiniens, libanais, tchadiens, sahraouis, qui se dressent les armes à la main contre "notre" impérialisme, sont les frères des prolétaires de la métropole dans la lutte contre l'ennemi commun : l'Etat impérialiste français" (Tract du 21 mai 1978, France), le CCI affirme "qu'on ne lutte pas contre l'impérialisme en choisissant l'une ou l'autre des puissances antagonistes. Tous ceux qui tiennent ce langage se font, consciemment ou inconsciemment les rabatteurs de la guerre impérialiste". Les armées palestiniennes, tchadiennes ou katangaises sont des proies de l'impérialisme russe tout en dépendant des intérêts d'une partie de la bourgeoisie locale de la même manière que le corps expéditionnaire du bloc occidental (les légionnaires français, les troupes marocaines et autres) servent l'impérialisme américain tout en défendant les intérêts d'une partie de la bourgeoisie locale. Le prolétariat n'a pas de patrie. Il n'a pas à soutenir de mouvement nationaliste d'aucune sorte, ni au « tiers-monde », ni dans les métropoles. La classe ouvrière vit et agit dans les pays sous-développés ; c'est elle, on effet, qui s'est fait massacrer dans la ville minière de Kolwezi par les armées adverses. La classe ouvrière n'a que faire des alliances avec des mouvements nationalistes. Son seul ennemi, c'est le système capitaliste partout dans le monde.
La situation internationale s'aggrave mais seul le prolétariat peut porter un coup d'arrêt aux forces impérialistes. Au mois de juin 1978, alors que les corps expéditionnaire français et occidentaux font leur sale besogne au Zaïre et au Tchad, 50.000 ouvriers des arsenaux de l'Etat français se sont mis en grève contre leurs conditions d'exploitation. C'est cette voie, cette capacité d'arrêter le bras destructeur du capital qui constitue la seule réponse possible à la crise, à l'OTAN couru ; au C0MEC0N. Il devient chaque jour plus clair que la lutte contre la guerre, c'est la lutte décisive entre le capital et le travail.
La déclaration suivante est publiée dans toute la presse du CCI, dans toutes les langues. Elle a été diffusée en tant que tract au cours des évènements du Zaïre en France et en Belgique.
Ils disent intervenir pour "raisons humanitaires". Ils mentent.
- Toutes les guerres débutent avec ce prétexte. Les atrocités ? Ils les "oublient" quand elles ne peuvent serviteurs mauvais coups : qu'ont-ils dit du massacre par l'Afrique du Sud de 600 réfugiés en Angola ?
- "Chevaliers de la civilisation", ces paras, ces légionnaires? Ce sont les troupes les plus brutales et sanguinaires. Eux-mêmes s'en vantent : "On est ici pour casser du katangais".
- La presse, la télévision, la radio en font trop; elles ne feraient pas tant de bruit si elles n'avaient du mal à remplir leur rôle : tenter de masquer l'évidence ; la seule vraie raison de l'opération Kolwezi : son caractère impérialiste. Et l'ampleur du battage est à la hauteur du l'enjeu en cause, qui n'est pas des moindres : L'INTERVENTION AU ZAÏRE MARQUE UN NOUVEAU PAS DANS L'ESCALADE VERS UNE TROISIEME GUERRE MONDIALE.
Certes, le fait n'est pas nouveau. Depuis la fin de la seconde guerre, les deux blocs impérialistes : USA et ses valets, URSS et ses "frères" n'ont cessé de s'affronter sous couvert de "dé colonisation", "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes", "défense de l'intégrité nationale", "lutte pour la démocratie", "lutte pour le socialisme", faisant des zones en conflit des enfers pour les peuples victimes de leur" sollicitude". Et ce fut, par l'envoi massif d'armements les plus meurtriers, ou par l'intervention directe, le quadrillage de la terre saignant de ces massacres : Indochine, Corée, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Vietnam, Biafra, Bengale, Cambodge. Aujourd'hui, l'Afrique est une zone privilégiée de l'échiquier où se joue leur jeu infernal : chacun avance ses pions. Les deux camps sont pour l'heure ainsi tracés : aux couleurs de l'URSS : Angola, Mozambique, Algérie, Libye et Ethiopie. En face, les pièces maîtresses des USA et de ses acolytes anglais, français et belges : Afrique du Sud et Zaïre. Plus le capitalisme mondial s'enfonce dans sa crise économique plus les conflits deviennent nombreux et violents : Rhodésie, Sahara, Ogaden, Erythrée, Tchad, la liste des massacres s'allonge.
Aujourd'hui, l'intervention au Zaïre.
- Et, parce qu'elle illustre la tendance des conflits à se rapprocher d'un centre vital du capitalisme, l'Europe, dont le Zaïre est le principal réservoir de matières premières et un territoire de pénétration capitaliste de premier ordre.
- Et, parce qu'elle constitue, malgré les disputes entre les complices français et beiges la réponse d'ensemble du bloc américain au défi lancé par le bloc russe avec sa mainmise sur l'Angola.
- Et, parce que jamais, ces dernières années, une expédition de ce genre n'a connu une telle ampleur, une telle collaboration des brigands occidentaux dans sa préparation, son exécution, sa justification : avions américains, matériel anglais, troupes belges et françaises, absolution de l'Europe des Neuf et de la Chine dite communiste.
- Et, parce que la campagne idéologique qui soutient l'offensive militaire est elle aussi sans précédent
par l'ampleur des moyens et l'hystérie des propos. Pour tout cela, l'intervention au Zaïre est une étape fondamentale de cette escalade.
Les autres mensonges de la bourgeoisie
A côté de ceux qui ont patronné cette expédition, certains ne sont pas moins hypocrites :
- CEUX QUI protestent contre l'intervention, non sur le principe, mois parce qu'elle n'a pas respecté les règles diplomatiques et constitutionnelles : fondamentalement, lis défendent les mêmes intérêts impérialistes de leur capital national.
- CEUX QUI prônent le simple pacifisme, la pression morale, les conférences internationales l'action de I'ONU et autres sornettes pour que "cessent les guerres".
La guerre n'est pas le fait de quelques gouvernements bellicistes ou mal intentionnés. Elle fait partie du mode de vie même du capitalisme, et particulièrement depuis le début du 20ème siècle. A partir de la première guerre mondiale, ce système ne se survit plus qu'à travers des mutilations successives, qu'à travers un cycle infernal où chaque reconstruction ne fait que préparer une crise encore plus grave que la précédente à laquelle la bourgeoisie no sait apporter qu'une issue guerrière chaque fois plus dévastatrice et meurtrière.
Et, pas plus que celle de 1929, le capitalisme ne peut la foire aboutir qu'à une nouvelle boucherie mondiale.
C'est ce que nous démontre jour après jour la dégradation de la situation économique dans tous les pays du monde, y compris ceux qui se disent socialistes.
C'est ce que "nous démontre l'aggravation constante des conflits sur toute la planète. C'est ce que nous démontre aujourd'hui l'intervention au Zaïre.
Prôner le pacifisme, c'est prôner la passivité et la soumission à cet engrenage. C'est ouvrir la voie à la guerre.
- CEUX QUI parlant "au nom de la classe ouvrière" ne présentent d'autre alternative aux travail leurs que de soutenir l'autre bloc impérialiste. On ne lutte pas contre l'impérialisme qui, aujourd'hui, est le fait de toutes les nations du mon de, en choisissant l'une ou l'autre des puissances antagonistes. Tous ceux qui tiennent ce langage se font, consciemment ou inconsciemment, les rabatteurs de la guerre impérialiste au même titre que les précédents.
Il n'y a pas d'issue au sein du capitalisme.
Il faut détruire ce système avant qu’il ne détruise l’HUMANITÉ
Une seule force dans la société peut le faire : la classe ouvrière. Elle l'a déjà montré en 1917 en Russie et en 1918 en Allemagne, elle seule petit enrayer et paralyser l'engrenage vers le nouvel holocauste; elle seule a le pouvoir d'abolir l'exploitation, l'oppression, les classes et les nations et d'instaurer une société nouvel le : le socialisme.
Pour cela, elle doit partout engager ou poursuivre l'offensive contre le capitalisme.
Dans les pays où on l'enrôle directement dans le massacre, elle doit dénoncer l'abrutissement du chauvinisme qu'on lui fait subir sous couvert de "libération nationale" et autres mensongeries. La seule réponse possible est celle des ouvriers russes de 1917, des ouvriers allemands de 1918.
- fraterniser avec les prolétaires en uniforme de l'autre camp,
- retourner les armes contre ses propres exploiteurs et gouvernements,
- transformer la guerre impérialiste en guerre civile.
Dans les pays du tiers-monde, terre d'élection des guerres actuelles, le prolétariat a commencé à lutter sur son terrain de classe : pour lui, pas d'autre issue que de poursuivre dans cette voie.
Dans les métropoles du capitalisme et particulièrement en France et on Belgique, celles dont l'impérialisme est aujourd'hui en première ligne, il n'y a pas non plus d'autre voie pour les travailleurs que la reprise des luttes contre l’austérité et les licenciements :
- parce que l'intervention au Zaïre contre leur niveau de vie font partie d'une même offensive du capital;
- parce que, qu'ils le veuillent ou non, ils sont déjà obligés dans l'effort de guerre ; c'est leur exploitation qui paie les dépenses militaires croissantes ;
- parce que leur seule façon de manifester leur internationalisme, leur solidarité avec leurs frères de classe directement touchés par la guerre, c'est de combattre l'ennemi commun qu'ils ont en face d'eux : leur capital national ;
- parce qu'après les troupes professionnelles, les appelés eux-mêmes seront envoyés à la tuerie; la bourgeoisie ne s'arrêtera pas là : chaque étape franchie dans la préparation de la guerre généralisée ouvre le chemin de la suivante.
Prolétaires de tous les pays,
Votre réponse de classe ne peut attendre. Renouez avec les combats engagés à partir de 1968 et que la bourgeoisie a réussi à épuiser dans les impasses "démocratiques", électorales et syndicales, "de gauche". Faites vôtres les mots d'ordre de votre classe ;
LES PROLETAIRES N'ONT PAS DE PATRIE, PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !
20 mai 1978Courant Communiste International
Tract diffusé en France et en Belgique et publié dans toutes les revues du CCI.
"Les cadres pour les nouveaux partis du prolétariat ne peuvent sortir que de la connaissance profonde des causes des défaites. Et cette connaissance ne peut supporter aucun interdit non plus qu'aucun ostracisme.
Tirer le bilan des événements de l’après guerre, c'est donc établir les conditions pour la victoire du prolétariat dans tous les pays."
BILAN n°1 (novembre 1933)
Vie du CCI:
- Interventions [33]
Géographique:
- Afrique [115]
Questions théoriques:
- Guerre [116]
Terreur, terrorisme et violence de classe
- 4693 reads
Les formidables campagnes idéologiques de la bourgeoisie européenne sur le terrorisme l’affaire Schlayer en Allemagne, affaire Moro en Italie), feuilles de vigne d’un renforcement massif de la terreur et de l’État bourgeois a mis pour un temps au premier plan des préoccupations des révolutionnaires les problèmes de la violence, de la terreur et du terrorisme. Ces question ne son pas nouvelles pour les communistes : depuis des décennies ils ont stigmatisé la barbarie avec laquelle la classe dominante maintient son pouvoir sur la société, avec quelle sauvagerie même les régimes les plus démocratiques se déchaînent à la moindre remise en cause de l’ordre existant. Ils ont su mettre en évidence que ce ne sont pas les piqûres de moustique de quelques éléments désespérés issus de la décomposition des couches petites bourgeoises qui sont visées par les campagnes officielles actuelles mais bien la classe ouvrière dont la révolte nécessairement lente va constituer, lors de son réveil, la seule menace sérieuse pour le capitalisme.
Leur rôle était donc de dénoncer ces campagnes pour ce qu’elles étaient et également mettre en évidence la stupide servilité de groupes gauchistes, comme par exemple certains trotskistes passant leur temps à dénoncer les “Brigades Rouges” parce qu’elles avaient condamné Moro “sans preuves suffisantes” et “sans l’accord de la classe ouvrière”. Mais en même temps qu’ils dénonçaient la terreur bourgeoise, qu’ils affirmaient la nécessité pour la classe ouvrière d’utiliser la violence pour détruire le capitalisme, les révolutionnaires se devaient d’être particulièrement clairs
- sur la signification réelle du terrorisme;
- sur la forme que prend la violence de la classe ouvrière dans sa lutte contre la bourgeoisie.
Et c’est ici qu’il faut constater l’existence, au sein même d’organisations défendant des positions de classe, d’un certain nombre de conceptions erronées pour lesquelles violence, terreur et terrorisme sont synonymes et qui considèrent
- qu’il peut exister un “terrorisme ouvrier”;
- que face à la terreur blanche de la bourgeoisie, la classe ouvrière doit opposer sa propre “terreur révolutionnaire” qui en constituerait en quelque sorte le symétrique.
C’est probablement le P.C.I. (Parti Communiste International) bordiguiste qui s’est fait l’interprète le plus explicite de ce type de confusion en écrivant, par exemple
“Du stalinisme, ils (les Marchais et les Pelikan) ne rejettent que les aspects révolutionnaires, le parti unique, la dictature, la terreur, qu’il avait hérités de la révolution prolétarienne... “(Programme Communiste N°76, p.87)
Ainsi, pour cette organisation, la terreur, même quand elle est mise en œuvre par le stalinisme, est d’essence révolutionnaire et il existerait une identité entre les méthodes de la révolution prolétarienne et celle de la pire contre-révolution qui se soit abattue sur la classe ouvrière.
Par ailleurs, le P.C.I. a eu tendance, au moment de l’affaire Baader, à présenter les actes terroristes de celui-ci et de ses compagnons, malgré des réserves sur l’impasse que constituent ces actes, comme annonciateurs et exemple de la future violence de la classe ouvrière. C’est ainsi qu’on peut lire dans “ Prolétaire n° 254 :
- “C’est avec cet esprit anxieux que nous avons suivi la tragique épopée d’Andréas Baader et de ses compagnons, qui ont participé à ce mouvement, celui de la lente accumulation des pré misses de la reprise prolétarienne...”, et, plus loin : “La lutte prolétarienne devra connaître d’autres martyrs...”
Enfin, l’idée d’un “terrorisme ouvrier” apparaît nettement dans des passage comme : “ Bref, pour être révolutionnaire, il ne suffit pas de dénoncer la violence et la terreur de l’État bourgeois, il faut encore revendiquer la violence et le terrorisme comme armes indispensables de l’émancipation du prolétariat.” (Prolétaire n°253)
Face à ce type de confusion, le texte qui suit se propose donc d’établir, au delà de simples définitions du dictionnaire et des abus de langage qu’ont pu commettre de façon accidentelle certains révolutionnaires du passé, les différences qui existent, en particulier du point de vue de leur contenu de classe, entre le terrorisme, la terreur cf. la violence, notamment celle que la classe ouvrière sera obligée de mettre en oeuvre pour pouvoir réaliser son émancipation.
VIOLENCE DE CLASSE ET PACIFISME
Reconnaître la lutte de classes c’est accepter d’emblée la violence comme un de ses éléments fondamentaux et inhérents à elle. L’existence de classes signifie que la société se trouve déchirée par des antagonismes d’intérêts, des intérêts irréconciliables. C’est sur la base de ces antagonismes que se constituent les classes. Les rapports sociaux qui s’établissent entre les classes sont donc forcément d’opposition et d’antagonismes, c’est-à-dire, de lutte.
Prétendre le contraire, prétendre qu’on puisse surmonter cet état de fait par la bonne volonté des uns et des autres, par la collaboration et l’harmonie entre les classes, c’est être hors de la réalité, en plein dans l’utopie.
Que les classes exploiteuses professent et diffusent de telles illusions n’a rien de surprenant. Elles sont “naturellement” convaincues qu’il ne peut exister d’autre société, de meilleure société, que celle où elles sont la classe dominante. Cette conviction aveugle et absolue leur est dictée par leurs intérêts et privilèges. Leurs intérêts et privilèges de classe se confondant avec le type de société qu’elles dominent, elles sont donc intéressées à prêcher aux classes dominées et exploitées à renoncer à la lutte, à accepter l’ordre existant; à soumettre à des “lois historiques” qu’elles prétendent être immuable. Ces classes dominantes sont donc à la fois, objectivement bornées et incapables de comprendre le dynamisme de la lutte de classes (des classes opprimées) et subjectivement intéressées, au plus haut degré, à faire renoncer les classes opprimées à toute velléité de lutte, en annihilant leur volonté par toutes sortes de mystifications.
Mais les classes exploiteuses dominantes ne sont pas les seules à avoir une telle attitude vis-à-vis de la lutte de classe. Certains courants ont cru possible d’éviter la lutte de classes en faisant appel à l’intelligence, à la meilleure compréhension, aux hommes de bonne volonté, afin de créer une société harmonieuse, fraternelle et égalitaire. Tels étaient par exemple les utopistes au début du capitalisme. Ces derniers, contrairement à la bourgeoisie et ses idéologues, n’étaient absolument pas intéressés à escamoter la lutte de classes dans l’intérêt du maintien des privilèges des classes dominantes. S’ils passaient à côté de la lutte de classes c’est parce qu’ils ne comprenaient pas les raisons historiques de l’existence de classes. Ils manifestent ainsi une immaturité de la compréhension par rapport à la réalité, de cette réalité où l’existence de la lutte de classes, de la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie est déjà dans les faits. Tout en manifestant le retard inévitable de la conscience sur l’existence, ils sont une expression de cet effort de prise de conscience, des éléments de ce balbutiement théorique de la classe. C’est pourquoi ils sont, à juste titre, considérés comme les précurseurs du mouvement socialiste, un apport considérable à ce mouvement qui dans son développement trouvera avec le marxisme un fondement scientifique et historique à la lutte de classe du prolétariat.
Il n’en est pas de même en ce qui concerne tous les mouvements humanistes, pacifistes, etc. qui fleurissent depuis la seconde moitié du siècle dernier et qui prétendent ignorer la lutte de classes. Ceux-là ne présentent en rien le moindre apport à l’émancipation de l’humanité. Ils ne sont que l’expression de classes et de couches sociales petites bourgeoises historiquement anachroniques, impuissantes, qui survivent écrasées dans la société moderne, dans la lutte entre le capitalisme et le prolétariat. Leur idéologie a-classiste, inter-classiste, anti-lutte de classes, sont autant de lamentations d’une classe impuissante, condamnée, n’ayant aucun avenir ni dans le capitalisme ni, et encore moins, dans la société que le prolétariat est appelé à instaurer: le socialisme. Minables et ridicules, leurs idées et comportement politiques, faits de lamentations, de prières et d’illusions absurdes, ne peuvent qu’entraver la marche et la volonté du prolétariat; par contre et pour cette même raison, elles sont grandement utilisables et effectivement utilisées par le capitalisme intéressé à entretenir tout ce qui peut servir d’armes à la mystification.
L’existence de classes, de la lutte de classe implique nécessairement violence de classe. Vouloir rejeter cette implication, seuls peuvent le faire de lamentables pleurnicheurs ou de fieffés charlatans (c’est nommer la social-démocratie). Sur un plan général, la violence est une caractéristique de la vie et l’accompagne le long de son déroulement. Toute action comporte un certain degré de violence. Le mouvement lui-même est fait de violence puisqu’il est le résultat rupture constante d’équilibre, laquelle découle du choc entre des forces contradictoires. Elle est présente dans le rapport entre les premiers groupements d’hommes ; elle ne s’exprime d’ailleurs pas nécessairement sous forme de violence physique ouverte : fait partie de la violence tout ce qui est imposition, coercition, établissement d’un rapport de force, menace. Est violent ce qui fait appel une agression physique ou physiologique contre d’autres êtres, mais également ce qui impose telle ou telle situation ou décision par le seul fait de disposer des moyens d’une telle agression sans les utiliser effectivement. Mais si la violence sous l’une ou l’autre de ces formes se manifeste dès qu’existe mouvement ou vie, la division de la société en classes en fait un des fondements principaux des rapports sociaux atteignant avec le capitalisme des abîmes infernaux.
Toute exploitation de classe fonde son pouvoir sur la violence et une violence toujours croissante au point de devenir la principale institution de la société. La violence sert de principal pilier, soutenant et assurant tout l’édifice social sans lequel la société s’effondrerait immédiatement. Produit nécessaire de l’exploitation d’une classe par une autre, la violence, organisée, concentrée, institutionnalisée sous sa forme achevée de l’État, devient dialectiquement un facteur, une condition fondamentale de l’existence et de la perpétuation de la société d’exploitation. Face à cette violence de plus en plus sanglante et meurtrière des classes exploiteuses, les classes exploitées et opprimées ne pouvant opposer que leur propre violence si elles veulent se libérer. Faire appel aux sentiments “humanistes” des classes exploiteuses, comme le font les religieux à la Tolstoï et les Gandhi, ou les socialistes en peau de lapin, c’est croire au miracle, c’est demander aux loups de cesser d’être des loups pour se convertir en agneaux, c’est demander à la classe capitaliste de ne plus être une classe capitaliste pour se métamorphoser en classe ouvrière.
La violence de la classe exploiteuse, inhérente à son être ne peut être arrêtée qu’en la brisant par la violence révolutionnaire des classes opprimées. Le comprendre, le prévoir, s’y préparer, l’organiser, c’est non seulement une condition décisive pour la victoire des classes opprimées, mais encore assure cette victoire à moindre frais de souffrance et de durée. N’est par un révolutionnaire celui qui émet le moindre doute, la moindre hésitation à ce sujet.
LA VIOLENCE DES CLASSES EXPLOITEUSES ET DOMINANTES : LA TERREUR
Nous avons vu qu’exploitation est inconcevable sans violence, organiquement inséparables l’une de l’autre. Autant la violence peut être conçue hors des rapports d’exploitation, cette dernière (l’exploitation), par contre, n’est réalisable qu’avec et par la violence. Elles sont l’une par rapport à l’autre comme les poumons et l’air, les poumons ne pouvant fonctionner sans oxygène.
Tout comme lors du passage du capitalisme à la phase de l’impérialisme, la violence, combinée à l’exploitation, acquiert une qualité toute nouvelle et particulière. Elle n’est plus un fait accidentel ou secondaire, mais sa présence est devenue un état constant à tous les niveaux de la vie sociale. Elle imprègne tous les rapports, pénètre dans tous les pores du corps social, tant sur le plan général que sur celui dit personnel. Partant de l’exploitation et des besoins de soumettre la classe travailleuse, la violence s’impose de façon massive dans toutes les relations entre les différentes classes et couches de la société, entre les pays industrialisés et les pays sous-développés, entre les pays industrialisés eux-mêmes, entre l’homme et la femme, entre les parents et les enfants, entre les maîtres et les élèves, entre les individus, entre les gouvernants et les gouvernés ; elle se spécialise, se structure, se concentre en un corps distinct : I’État, avec ses armées permanentes, sa police, ses prisons, ses lois, ses fonctionnaires et tortionnaires et tend à s’élever au-dessus de la société et la dominer.
Pour les besoins d’assurer l’exploitation de l’homme par l’homme, la violence devient la première activité de la société pour laquelle la société dépense une partie chaque fois plus grande de ses ressources économiques et culturelles. La violence est élevée à l’état de culte, à l’état d’art, à l’état de science. Une science appliquée, non seulement à l’art militaire, à la technique des armements, mais à tous les domaines, à tous les niveaux, à l’organisation des camps de concentration, aux installations de chambres à gaz, à l’art de l’extermination rapide et massive de populations entières, à la création de véritables universités de la torture scientifique, psychologique, où se qualifient une pléiade de tortionnaires diplômés et patentés. Une société qui, non seulement “dégouline de boue et de sang par tous ses pores” corne le constatait Marx, mais qui ne peut plus vivre ni respirer un seul instant hors d’une atmosphère empoisonnée et empestée de cadavres, de mort, de destruction, de massacre, de souffrance et de torture. Dans une telle société, la violence ayant atteint cette Nième puissance, change de qualité, elle devient la Terreur.
Parler de la violence en général, en termes généraux sans se référer aux conditions concrètes, aux périodes historiques, aux classes qui l’exercent, c’est ne rien comprendre à son contenu réel, à ce qui fait d’elle une qualité distincte, spécifique dans les sociétés d’exploitation et le pourquoi de cette modification fondamentale de la violence en terreur, qui ne peut pas être réduite à une simple question de quantité. Ne pas voir cette différence qualitative entre violence et terreur précède de la même démarche que celle qui, traitant de la marchandise, se contenterait de ne voir entre l’antiquité et le capitalisme qu’une simple différence quantitative sans s’apercevoir de la différence essentielle qualitative des deux modes de production fondamentalement distincts qui s’est opérée et qu’elle recouvre.
Au fur et à mesure que la société divisée en classes antagonistes va en se développant, la violence entre les mains de la classe exploiteuse et dominante va aller en prenant de plus en plus un caractère nouveau celui de la terreur. La terreur n'est pas un attribut des classes révolutionnaires au moment d’accomplir leur révolution et pour cet accomplissement. C’est là une vision purement formelle, très superficielle et qui revient à glorifier dans la terreur l’action révolutionnaire par excellence. A ce compte on finit par établir con un axiome “Plus forte est la terreur, plus profonde, plus radicale est la révolution”. Or, ceci est absolument démenti par l’histoire. La bourgeoisie n'a le plus perfectionné et utilisé la terreur le long de son existence qu’au moment de sa révolution (voir l848 et lors de la Commune de Paris en 1871) et la terreur atteint ses sommets au moment justement où le capitalisme entre en décadence. La terreur n’est pas l’expression de la nature et de l’action révolutionnaires de la bourgeoisie au moment de sa révolution, c’est-à-dire liée au fait révolutionnaire, même si dans ces moments elle prend des manifestations spectaculaires ; elle est bien plus l’expression de sa nature de classe exploiteuse qui, comme toutes les classes exploiteuses, ne peut fonder son pouvoir que sur la terreur. Les révolutions qui ont assuré la succession des différentes sociétés d’exploitation de classe, ne sont nullement les progéniteurs de la terreur mais ne font que la transférer en la continuant d’une classe à une autre classe exploiteuse. Ce n’est pas tant contre l’ancienne classe dominante, pour en finir avec elle, mais surtout pour affirmer sa domination sur la société en général contre la classe ouvrière en particulier que la bourgeoisie perfectionne et renforce la terreur. La terreur dans la révolution bourgeoise n’est donc pas une fin mais une continuité parce que la nouvelle société est une continuité de sociétés d’exploitation de l’homme par l’homme. La violence dans les révolutions bourgeoises n’est pas une fin de l’oppression mais la continuité de l’oppression sans fin. C’est pourquoi elle ne peut être que de la terreur.
En résumé, on peut définir la terreur comme la violence spécifique et particulière aux classes exploiteuses et dominantes dans l’histoire qui ne disparaîtra qu’avec elles.
Ses caractéristiques spécifiques sont :
- 1) être liée organiquement à l’exploitation pour l’imposer ;
- 2) être le fait d’une classe privilégiée ;
- 3) être le fait d’une classe minoritaire de la société ;
- 4) être le fait d’un corps spécialisé, sélectionné étroitement, fermé sur lui-même, tendant à se dégager de tout contrôle de la société ;
- 5) se reproduire et se perfectionner sans fin et s’étendre à tous les niveaux, à tous les rapports existants dans la société ;
- 6) n’avoir d’autre raison d’être que la soumission et l’écrasement de la communauté humaine ;
- 7) développer des sentiments d’hostilité et de violence entre des groupes sociaux : nationalisme, chauvinisme, racisme et autres monstruosités.
- 8) développer des sentiments et des comportements d’égoïsmes, d’agressivité sadique, l’esprit de vengeance, une guerre incessante et quotidienne de tous contre tous, plongeant toute la société dans un état de terreur sans fin.
LE TERRORISME DES CLASSES ET COUCHES PETITE-BOURGEOISE
Les classes petites-bourgeoises (paysans, artisans, petits commerçants, professions libérales, intellectuels) ne constituent pas des classes fondamentales dans la société. Elles n’ont pas de mode de production particulier à présenter ni aucun projet de société à offrir. Elles ne sont pas des classes historiques dans le sens marxiste du terme. Elles sont par excellence les moins homogènes des classes sociales. Sociales dans leurs couches supérieures elles tirent leurs revenus de l’exploitation du travail des autres, et, à ce titre, font partie des privilégiés, elles sont dans leur ensemble soumises à la domination de la classe capitaliste dont elles subissent la rigueur des lois et de l’oppression. Aucun devenir ne se présente à elles comme classes. Dans leurs couches supérieures, le maximum de leurs aspirations est de parvenir à s’intégrer individuellement dans la classe capitaliste. Dans leurs couches inférieures, elles sont destinées implacablement à perdre toute propriété et “indépendance” des moyens de subsistance et à se prolétariser. Dans leur immense masse moyenne, elles sont condamnées à végéter, économiquement et politiquement écrasées par la domination de la classe capitaliste. Leur comportement politique est déterminé par le rapport de force entre les deux classes fondamentales de la société : le capitalisme et le prolétariat. Leur résistance sans espoir aux lois impitoyables du Capital les amène à une vision et un comportement fatalistes et passifs. Leur idéologie est le “sauve-qui-peut” individualiste et, collectivement, les multiples variétés de lamentations plaintives, la recherche de consolations misérables, les impuissants et ridicules sermons pacifistes, humanistes de toutes sortes.
Écrasées matériellement, sans aucun avenir devant elles, végétant dans un présent aux horizons complètement bouchés, piétinant dans une médiocrité quotidienne sans bornes, elles sont dans leur désespoir la proie facile à toutes les mystifications, des plus pacifiques (sectes religieuses, naturistes, anti-violence, anti-bombe atomique, hippies, écologistes, anti-nucléaires, etc.) aux plus sanglants (Cent-noirs, pogromistes, racistes, Ku-Klux-Klan, bandes fascistes, gangsters et mercenaires de tout acabit, etc.). C’est surtout dans ces dernières, les plus sanglantes, qu’elles trouvent la compensation d’une dignité illusoire à leur déchéance réelle que le développement du capitalisme accroît de jour en jour. C’est l’héroïsme de la lâcheté, le courage des poltrons, la gloire de la médiocrité sordide. C’est dans ces rangs que le capitalisme, après les avoir réduites à la déchéance extrême, trouve une réserve inépuisable pour le recrutement de ses héros de la terreur.
S’il est arrivé parfois tout au long de l’histoire des explosions de colère et de violence de la part de ces classes, ces explosions restaient sporadiques et ne sont jamais allées au delà de jacqueries et révoltes car aucune autre perspective ne s’ouvrait à elles sinon celle d’être écrasées. Dans le capitalisme, ces classes perdent complètement leur indépendance et ne servent que de masse de manoeuvre et d’appui aux affrontements que se livrent les différentes fractions de la classe dominante tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières nationales. Dans des moments de crise révolutionnaire et dans certaines circonstances favorables, le mécontentement profond d’une partie de ces classes pourrait servir de force d’appoint à la lutte du prolétariat.
L’inévitable processus de paupérisation et de prolétarisation des couches inférieures de ces classes, est un chemin extrêmement difficile et douloureux à parcourir et donna naissance à un courant de révolte particulièrement exacerbée. La combativité de ces éléments provenant plus spécialement des artisans et de l’intelligentsia déclassée, repose plus sur leur état d’individus désespérés que sur la lutte classe du prolétariat qu’ils ont beaucoup de mal à intégrer. Ce qui les caractérise fondamentalement c’est : l’individualisme, l’impatience, le scepticisme, la démoralisation, leurs actions qui relèvent plus du suicide spectaculaire que d’un but à atteindre. Ayant perdu “leur passé”, n’ayant aucun avenir devant eux, ils vivent un présent de misère et la révolte exaspérée contre la misère de ce présent ressenti dans l’immédiat et comme un immédiat. Même si en contact avec la classe ouvrière et son devenir historique ils parviennent à s’inspirer d’une façon généralement déformée de ses idéaux, cela dépasse rarement le niveau de la fantaisie et du rêve. Leur véritable vision de la réalité reste le champ réduit et borné de la contingence. L’expression politique de ce courant prend des formes extrêmement variées qui va de la stricte actuation individuelle aux différentes formations de sectes fermées, de conspiration, de complot, de préparation de “coup d’État” minoritaire, d’actions exemplaires et, à l’extrême, le terrorisme.
Ce qui constitue leur unité dans cette diversité c’est leur méconnaissance du déterminisme objectif et historique du mouvement de la lutte de classes, leur méconnaissance du sujet historique de la société moderne, seul capable d’assurer la transformation sociale : le prolétariat.
La persistance des manifestations de ce courant est donnée par la permanence du processus de prolétarisation de ces couches tout le tong de l’histoire du capitalisme. Leurs variétés et diversités sont le produit des situations locales et contingentes. Ce phénomène social accompagne tout au long l’histoire de la formation de la classe prolétarienne et se trouve ainsi mêlé à des degrés divers au mouvement du prolétariat dans lequel ce courant importe des idées et des comportements qu’il charrie et qui sont étrangers à la classe. Cela est vrai tout particulièrement en ce qui concerne le terrorisme.
Il faut absolument insister sur ce point essentiel et ne laisser aucune ambiguïté à ce sujet. Si, à l’aube de sa formation de classe, le prolétariat dans sa tendance à s’organiser ne trouve pas encore sa forme appropriée et utilise le type d’organisation de sociétés conspiratives, secrètes, héritage de la révolution bourgeoise, cela ne change en rien la nature de classe de ces formes, leur inadéquation au contenu nouveau, celui de la lutte de classe du prolétariat. Rapidement le prolétariat sera amené à se dégager de ces formes d’organisations et méthodes d’action et à les rejeter définitivement.
Tout comme pour ce qui concerne l’élaboration théorique et sa phase utopiste, la formation d’organisations politiques de la classe passait inévitablement par la phase de sectes conspiratives. Mais il importe de ne pas alimenter la confusion, ne pas faire de nécessité vertu, ne pas confondre les divers stades du mouvement et savoir distinguer la signification différente et opposé de leur eau manifestation dans des stades différents.
De même que le socialisme utopique se transformera, à un certain stade atteint par le mouvement du prolétariat, d’une grande contribution positive en une entrave au développement ultérieur de ce mouvement, de même et à ce même stade, les sectes conspiratives seront désormais frappées du signe négatif et stérilisant pour le développement ultérieur du mouvement.
Le courant représentant les couches en voie d’une difficile prolétarisation ne saurait désormais être la moindre contribution à un mouvement de classe déjà développé. Non seulement ce courant doit revendiquer le type d’organisation de sectes et de méthodes de conspiration, mais, arrivant avec un retard toujours plus accentué sur le mouvement réel, il est amené dans son exacerbation à pousser cette revendication à outrance, à en faire une caricature, trouvant son expression extrême en préconisant l’action terroriste.
Le terrorisme n’est pas simplement l’action de terreur. C’est là se placer sur un terrain terminologique. Ce que nous voulons faire ressortir et mettre en relief c’est le sens social et la différence que ces termes recouvrent. La terreur est un système de domination, structuré, permanant, des classes exploiteuses. Le terrorisme par contre est une réaction de classe opprimée, mais sans devenir, contre la terreur de la classe opprimante. Ce sont des réactions momentanées, sans continuité, des réactions de vengeance et sans lendemain.
Nous trouvons la description émouvante de ce genre de mouvement dans Panaït Istrati et ses Haïdoucs dans le contexte historique de la Roumanie de la fin du siècle dernier. Nous les retrouvons dans le terrorisme des narodnikis russes et, aussi différentes qu’elles se présentent, chez les anarchistes et la bande à Bonnot; elles relèvent toujours de la même nature : vengeance des impuissants parce qu’impuissants. Elles ne sont jamais l’annonce d’un nouveau, mais l’expression désespérée d’une fin, de sa propre fin
Réaction impuissante d’une impuissance, le terrorisme n’ébranle pas et ne peut ébranler la terreur de la classe dominante. C’est une piqûre de moustique sur la peau d’éléphant. Par contre, il peut être et est souvent exploité par l’État pour justifier et renforcer sa terreur.
Il faut absolument dénoncer le mythe qui veut que le terrorisme serve ou puisse servir de détonateur pour déclencher le mouvement de la lutte du prolétariat. Cela serait pour le moins très singulier qu’une classe au devenir historique ait besoin de chercher dans une classe sans devenir l’élément détonateur de sa propre lutte.
Il est absolument absurde de prétendre que le terrorisme des couches les plus radicalisées de la petite-bourgeoisie a le mérite de détruire dans la classe ouvrière les effets de la mystification démocratique, de la légalité bourgeoise, et de lui enseigner la voie indispensable de la violence. Le prolétariat n’a aucune leçon à tirer du terrorisme radical, sinon celle de s’en écarter et de le rejeter, car la violence contenue dans le terrorisme se situe fondamentalement sur le terrain bourgeois de la lutte. La compréhension de la violence nécessaire et indispensable, le prolétariat la tire de son existence propre, de sa lutte, de ses expériences, de ses affrontements avec la classe dominante. C’est une violence de classe qui diffère de nature, de contenu, de forme et de méthodes aussi catégoriquement du terrorisme petit-bourgeois que de la terreur de la classe exploiteuse dominante.
Il est absolument certain que la classe ouvrière manifeste généralement une attitude de solidarité et de sympathie, non pas à l’égard du terrorisme qu’elle condamne en tant qu’idéologie, organisation et méthodes, mais à l’égard des éléments qui s’y livrent. Cela pour des raisons évidentes :
- 1) parce qu’ils sont en révolte contre l’ordre de terreur existant que le prolétariat se propose de détruire de fond en comble ;
- 2) parce que comme la classe ouvrière, Ils sont également des victimes de la cruelle exploitation et oppression de la part de l’ennemie mortelle du prolétariat ; la classe capitaliste et son État. Le prolétariat ne peut pas ne pas manifester sa solidarité à ces victimes en essayant de les sauver des mains des bourreaux, de la terreur d’État existante et en s’efforçant de les dégager de l’impasse mortellement dangereuse : le terrorisme, dans lequel ils se sont fourvoyés.
LA VIOLENCE DE CLASSE DU PROLETARIAT
• Nous n’avons pas à insister ici sur la nécessaire violence de la lutte de classe du prolétariat. Le faire serait enfoncer des portes ouvertes, car, voilà bientôt deux siècles depuis les Égaux de Babeuf, que la démonstration théorique et dans les faits de sa nécessité et inévitabilité a été apportée. II est aussi vain de répéter à n’en plus pouvoir, en la présentant comme une découverte, cette vérité que toutes les classes sont amenées à user de la violence et aussi le prolétariat. En se contentant d’énoncer ces vérités devenues des banalités, on finit par établir une sorte d’équation vide de tout sens “violence = violence”. On établit ainsi une équivalence, une identité aussi simpliste qu’absurde entre la violence du capital et la violence du prolétariat, et on passe à côté, on escamote leur différence essentielle, l’une étant oppressive et l’autre libératrice.
Dire et redire cette tautologie “violence = violence” et se contenter de démontrer que toutes les classes en usent, pour établir sa nature identique, est aussi intelligent, génial, que de voir une identité entre l’acte du chirurgien faisant une césarienne pour donner naissance à la vie et l’acte de l’assassin éventrant sa victime pour lui donner la mort, par le fait que l’un et l’autre se servent d’instrument qui se ressemblent : le couteau exerçant sur un même objet : le ventre, et une même technique apparemment fort semblable : celle d’ouvrir le ventre.
Ce qui importe au plus haut point ce n’est pas de répéter : violence, violence, mais de souligner fortement leur différence essentielle et dégager le plus clairement possible ce en quoi, pourquoi et comment la violence du prolétariat se distingue et diffère de la terreur et du terrorisme des autres classes.
En établissant une différence entre terrorisme et violence de classe, ce n’est pas pour des raisons de querelles, de terminologie, de répugnance affective au mot de terreur, ni pour des raisons de pudeur de vierges intimidées, mais pour faire ressortir plus clairement la nature de classe différente, le contenu et les formes différentes que le même mot recouvre et estompe. Le vocabulaire retarde sur les faits et souvent aussi le manque de la distinction dans les mots témoigne d’une pensée insuffisamment élaborée et entretient une ambiguïté toujours nocive. Comme exemple on peut citer le mot de “social-démocratie” qui ne correspond en rien à l’essence révolutionnaire et au but d’une société communiste que se propose l’organisation politique du prolétariat. Il en est de même pour le mot “terreur” qu’on trouve parfois dans la littérature socialiste, même chez nos classiques, accolé aux mots “révolutionnaire” et “du prolétariat”. Il faut instamment mettre en garde contre les abus qui consistent à recourir à des citations littérales de phrases, sans les rétablir dans leur contexte, les circonstances dans lesquelles elles étaient écrites, l’adversaire qu’elles visaient au risque de déformer et de trahir la véritable pensée de leurs auteurs, Il faut encore souligner que la plupart du temps ces auteurs, tout en utilisant le mot de terreur prenaient de grandes précautions pour établir la différence de fond et de forme entre celle du prolétariat et celle de la bourgeoisie, entre la Commune de Paris et Versailles, entre la révolution et la contre-révolution dans la guerre civile en Russie. Si nous pensons qu’il est temps de distinguer ces deux termes, c’est pour lever les ambiguïtés que leur identification entretient et surtout, cette ambiguïté qui ne veut voir là qu’une différence de quantité, d’intensité et non de nature de classe.
Et même s’il ne s’agissait strictement que d’un changement de quantité, cela entraînerait pour les marxistes qui se réclament de la méthode dialectique, un changement de qualité.
En répudiant la terreur en faveur de la violence de classe du prolétariat, nous entendons, non seulement exprimer notre répugnance de classe à l’égard du contenu réel d’exploitation et d’oppression qu’est la terreur, mais également en finir avec les finasseries casuistiques et hypocrites sur “la fin justifie les moyens”.
Les apologistes inconditionnels de la terreur, ces calvinistes de la révolution que sont les bordiguistes, dédaignent les questions de formes d’organisation et de moyens. Seul existe pour eux le “but” pour lequel toutes les formes et tous les moyens peuvent être indifféremment utilisés. “La révolution est une question de contenu et non de formes d’organisation”, répètent-ils inlassablement, sauf... sauf... pour ce qui est de la terreur. Sur ce point, on est catégorique “pas de révolution sans terreur”, et n’est pas un révolutionnaire celui qui n’est pas capable de tuer quelques enfants; ici, la terreur, considérée comme moyen devient une condition absolue, un impératif catégorique de la révolution et de son contenue Pourquoi cette exception ? On pourrait aussi à l’inverse, se poser d’autres questions. Si vraiment les questions de moyens et de formes d’organisation sont si importantes pour la révolution prolétarienne, ne serait-il pas possible qu’elle s’accomplisse avec la forme monarchiste ou parlementaire par exemple ? Pourquoi pas ?
La vérité est que vouloir séparer le contenu et les formes, la fin et les moyens, est une pure absurdité. Dans la réalité, contenu et formes sont intrinsèquement liés. Une fin ne contient pas n’importe quels moyens, mais “ moyens propres et les moyens déterminés ne sont valable que pour des fins déterminées. Toute autre approche n’est que de la spéculation sophistique.
Quand nous rejetons la terreur comme mode d’existence de la violence du prolétariat, ce n’est pas pour on ne sait quelle raison morale mais parce que la terreur, comme contenu et méthode, s’oppose par nature au but que se propose et poursuit le prolétariat. Les calvinistes de la révolution croient-Ils vraiment et peuvent-ils nous convaincre que pour atteindre notre but, le communisme, le prolétariat pourrait et devrait recourir aux moyens d’immenses camps de concentration et d’extermination systématique des populations par millions et millions, ou par l’installation d’un immense réseau de chambres à gaz, scientifiquement encore plus perfectionnées que celles de Hitler ? Le génocide fait-il partie du Programme et de la “voie calviniste” du socialisme ? !
Il suffit de rappeler l’énumération que nous avons faite des principales caractéristiques du contenu et des méthodes de la terreur, pour voir au premier coup d’oeil tout l’abîme qui sépare et oppose le prolétariat de celle-là.
- 1) “être liée organiquement à l’exploitation et pour l’imposer”.
Le prolétariat est une classe exploitée et lutte pour la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme.
- 2) “être le fait d’une classe privilégiée.”
Le prolétariat n’a aucun privilège et lutte pour la suppression de tout privilège.
- 3) “être le fait d’une classe minoritaire”.
Le prolétariat représente avec les travailleurs l’immense majorité de la société. D’aucuns voudraient peut-être voir dans cette référence notre “indécrottable penchant pour les principes de la démocratie”, de majorité et minorité, sans prendre garde que ce sont eux qui sont obnubilés par ce problème, en faisant de plus, de la minorité, par horreur viscérale de la majorité, le critère de la vérité révolutionnaire. Le socialisme est irréalisable s’il ne repose pas sur la possibilité historique et ne correspond pas aux intérêts fondamentaux et à la volonté de l’immense majorité de la société. C’est là un des arguments clé de Lénine de “L’État et la Révolution”, et également de Marx affirmant que le prolétariat ne saurait s’émanciper sans émanciper l’humanité toute entière.
- 4) “être le fait d’un corps spécialisé”...
Le prolétariat a écrit sur son drapeau la destruction de l’armée permanente, de la police, pour l’armement général du peuple et avant tout du prolétariat.
- “tendant à se dégager de tout contrôle de la société.”
Le prolétariat rejette, comme objectif toute spécialisation, et dans la mesure de l’impossibilité de sa totale réalisation immédiate, l’exigence de sa soumission totale au contrôle de la société.
- 5) “se reproduire et se perfectionner sans fin”.
Le prolétariat entend, lui, mettre fin à cette reproduction et à ce perfectionnement et s’engage dans cette vole dès le premier jour de sa prise du pouvoir.
- 6) “n’avoir d’autre raison que dans la soumission et l’écrasement de la communauté humaine”.
Les buts du prolétariat sont diamétralement opposés. Sa raison d’être est celle de la libération et l’épanouissement de la société humaine.
- 7) “développer les sentiments d’hostilité et de violence entre les groupes sociaux nationalisme, chauvinisme, racisme, etc.”
Le prolétariat supprime tous ces anachronismes historiques devenus des monstruosités et des entraves à l’unification harmonieuse, possible et nécessaire de toute l’humanIté.
- 8) “développer des sentiments et des comportements d’égoïsme, d’agressivité sadique, d’esprit de vengeance, de guerre incessante et quotidienne de tous contre tous, etc..”
Le prolétariat au contraire développe des sentiments tout nouveaux de solidarité, de vie collective, de fraternité de “tous pour un et un pour tous”, d’une libre association de producteurs, d’une production et consommation socialisées.
Et si l’essence des classes exploiteuses est de : “plonger toute la société dans un état de terreur sans fin”, le prolétariat, lui, fait appel à l’initiative et à la créativité de tous qui dans un enthousiasme général prennent leur vie et leur sort dans leurs propres mains.
La violence de classe du prolétariat ne saurait être la terreur puisque que sa raison d’être est précisément de briser la terreur. C’est jouer sur les mots que de considérer comme la même chose et les confondre en les désignant par les mêmes mots : violence ou terreur, le comportement de l’assassin exhibant son couteau et la main qui l’immobilise et l’empêche de commettre le meurtre. Le prolétariat ne saurait recourir à l’organisation de pogroms, au lynchage, à la création d’École de Torture, aux viols, aux procès de Moscou, comme moyens et méthodes pour la réalisation du socialisme. Ces méthodes, ils les laisse au capitalisme, parce qu’elles font partie de lui, lui sont propres, adaptées à ses buts, et qui portent le nom générique de TERREUR.
- Ni le terrorisme avant, ni la terreur après la révolution ne sauraient être des armes du prolétariat pour l’émancipation de l’humanité.
M.C.
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Personnages:
Evènements historiques:
- Terrorisme [120]
Questions théoriques:
- Terrorisme [121]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [122]
Rubrique:
Chômage et lutte de classe
- 2809 reads
L'accroissement sans précédant du chômage depuis une dizaine d'années pose et posera de plus en plus directement dans l'organisation de sa lutte, le problème que toute une partie de la classe ouvrière ne se trouve pas ou plus sur les lieux de production. Ainsi privés d'un des moyens fondamentaux de lutte que constitue la grève, les chômeurs n'en sont pas pour autant privés de toute possibilité de lutter. Au contraire. Le chômage, s'il a d'abord frappé les secteurs faibles, les petites entreprises et les secteurs marginaux de l'économie capitaliste, commence à toucher des pans entiers de la classe ouvrière dans les secteurs les plus concentrés : textile, métallurgie, construction navale, etc. Le chômage a commencé par frapper "sélectivement" la classe ouvrière et a permis à la bourgeoisie de mener son attaque contre les conditions de vie en présentant le chômage comme un problème individuel, et la rigueur catégoriel ou régional. En imprégnant de plus en plus la vie sociale, par l'accroissement de sa durée, par la présence de plus en plus fréquente de chômeurs de plus en plus nombreux dans chaque famille ouvrière -amputant ainsi le salaire qui entretient un nombre croissant de personnes-, par la mobilité qu'il provoque, le chômage, en s'étendant, fournit un potentiel d'accroissement de la capacité de la classe ouvrière à appréhender les moyens et les objectifs de la lutte au-delà des divisions entretenues par le capital. Dans la période actuelle de montée générale des luttes ouvrières, pour la première fois dans l'histoire - si l'on excepte 1848-, la perspective d’une vague révolutionnaire telle que Marx l'avait envisagée s'est ouverte : l'assaut de l'Etat bourgeois par le prolétariat se prépare dans une phase de crise économique et d'effondrement relativement lent du système capitaliste. La bourgeoisie n'a pas réuni les conditions d'embrigadement et de défaite pour aller directement à sa "solution" à la crise : la guerre généralisée. Une des conséquences d'une telle situation est l'importance prise par la lutte contre le chômage, la perte directe des moyens de subsistance, qui devient un facteur moteur des affrontements décisifs qui se préparent. En quelque sorte, les chômeurs vont être appelés à agir dans ces combats d'une manière analogue à l'action des soldats dans la vague révolutionnaire qui a suivi la guerre de 1914, dans le sens de la décision, de l'unité et de la généralisation dans l'affrontement avec l'Etat capitaliste. C'est pourquoi, il est fondamental pour la classe ouvrière de ne pas prêter le flanc aux multiples pièges que la bourgeoisie dresse pour maintenir les chômeurs comme une catégorie distincte et séparés de l'ensemble des ouvriers. Le texte qui suit s'efforce de répondre aux objections couramment mises on avant pour amputer cette unité indispensable de la classe ouvrière d'une partie de ses membres, d'une partie de ses moyens de lutter.
La surproduction générale dans le monde entier qui accompagna les crises du capitalisme, et particulièrement celles de sa phase de décadence, rejette une partie toujours croissante de la classe ouvrière en dehors du processus productif. Le chômage, dans les moments de crise aigue tels que nous les traversons actuellement est déterminé à prendre de plus en plus d'ampleur et à devenir une préoccupation centrale de la classe ouvrière. Il est donc primordial pour une organisation révolutionnaire qui se propose d'intervenir au sein de la classe ouvrière afin de clarifier les problèmes qui se posent à celle-ci, d'avoir une compréhension claire du problème du chômage au sein de la lutte de classe.
1 - La situation de chômage est Inscrite nécessairement dans la condition d'existence de la classe ouvrière. Celle-ci est, en effet, une classe de travailleurs "libres", c'est-à-dire libres de tout lien avec les moyens de production dont ils sont séparés et qui leur font face comme capital. Cette "liberté" est en fait la périodes servitudes car les ouvriers ne peuvent compter, pour à peine survivre, que sur la vente de leur force de travail. La forme spécifique que prend, dans le capitalisme, l'association du travail avec les moyens de production - le salariat - fait de la force de travail une simple marchandise comme les autres, et même la seule marchandise que possèdent les travailleurs en propre. Comme toutes les marchandises, la marchandise force de travail ne trouve à se vendre que lorsque le marché est assez large, et puisque la surproduction par rapport aux besoins du marché est contenue dans le rapport de production capitaliste lui-même, l'emploi temporaire ou définitif d'une partie des forces de travail - c'est-à-dire - le chômage - fait partie intégrante de la condition que le capital impose à la classe ouvrière. En raison du caractère particulier de la marchandise force de travail - créatrice de valeur - le chômage a même toujours été une condition indispensable au bon fonctionnement de l'économie capitaliste, en créant d'une part une masse de forces de travail disponibles pour pouvoir assumer l'élargissement de la production, et en constituant d'autre part une pression constante sur les salaires. Dans la période de décadence du capitalisme, le chômage, sous toutes ses formes, prend une ampleur considérable et devient alors une expression de la faillite historique du capital, de l’incapacité de celui-ci à poursuivre le développement des forces productives.
2 - Puisque le chômage est un aspect de la condition ouvrière, les ouvriers chômeurs font tout autant partie de la classe ouvrière que les ouvriers au travail. Si un ouvrier est au chômage, il est potentiellement au travail; s'il travaille, il est potentiellement un chômeur. La définition de la classe ouvrière comme productrice de plus-value n'est pas une question individuelle, mais ne peut-être considérée que corme une définition sociale, collective, La classe ouvrière n'est pas une simple somme d’individus, même si, au départ, le capital la crée en individus concurrents. Le prolétariat s'exprime bien plutôt dans le dépassement des divisions et de la concurrence entre les individus, pour former une seule collectivité aux intérêts distincts de ceux du reste de la société. La division des ouvriers en chômeurs et ouvriers au travail ne fait d'eux, pas plus que les autres divisions existant entre diverses catégories d'ouvriers, des classes différentes. Au contraire : ouvriers au chômage et ouvriers au travail possèdent strictement les mêmes intérêts face au capital. De même, la conscience de classe du prolétariat n'est pas une somme de consciences individuelles et, si elle tire son origine dans la façon dont les ouvriers sont intégrés à la production capitaliste, elle n'est pas liée de manière immédiate à l'activité de tel ou tel ouvrier et à sa présence ou non sur un lieu de production. La conscience de classe mûrit dans la classe ouvrière, et aussi bien parmi les chômeurs que parmi les ouvriers au travail. Cela est tellement vrai que, bien souvent, les chômeurs constituent une des parties les plus décidées du prolétariat dans une lutte frontale contre le capital, car la situation du chômeur concentre toute la misère de la condition ouvrière,
3 - Il est faux de considérer les chômeurs comme une catégorie sociale distincte : les seules divisions fondamentales que connaît la société sont les divisions en classes et celles-ci sont de déterminées par la position occupée dans la production. La situation de chômage est liée au travail salarié. Or, la société capitaliste, dans son développement et notamment dans sa tendance au capitalisme d'Etat, a salarié une partie de plus en plus grande de la population, jusqu'à salarier parfois l'ensemble de la classe bourgeoise elle-même. Une des expressions les plus pures de la décadence du capitalisme consiste en ce que les gestionnaires du capital eux-mêmes, les fonctionnaires d'Etat, les cadres, sont aussi frappés par le chômage. La situation du chômeur n’est donc plus exclusive à l’ouvrier, et c’est pourquoi le groupe de chômeurs ne représente rien en tant que tel; il englobe des ouvriers comme des membres de la bourgeoisie et des couches intermédiaires. C'est pourquoi aussi, en plus du facteur de démoralisation qui pèse sur 'e chômeur du fait de son isolement-, une partie de la masse des chômeurs peut, dans certaines circonstances, être utilisée par la bourgeoise à des fins contre-révolutionnaires et plus particulièrement dans les périodes où la classe n’offre pas de perspective prolétarienne à la crise du capital.
4 - Partie intégrante de la classe ouvrière, les ouvriers chômeurs doivent s'intégrer à la lutte de leur classe. Cependant, les possibilités de lutte qui leur sont offertes sont-, dans un premier temps restreintes. Car, d'une part, ils se retrouvent fortement isolés les uns des autres et, d'autre part, ils ne disposent- pas de moyen d'action pratique, tels que peuvent en disposer les ouvriers dans la production (grève,…). C'est pourquoi les ouvriers chômeurs entrent généralement et massivement en lutte aux moments où la lutte de classe devient assez générale. L'Intégration des chômeurs à la lutte sera alors un facteur important de radicalisation de celle-ci dans la mesure où, plus que tout autre, ils n'ont pas de revendication. immédiate, de réformes à faire valoir et où ils tendront à mener la lutte centre l'ensemble de le société capitaliste. Les modalités pratiques de cette intégration à la lutte générale de la classe et aux conseils ouvriers, nous n'avons pas à les envisager précisément ; l'expérience les donnera et ce n'est pas aux révolutionnaires de planifier les formes d'organisation de la classe. Quand celles-ci naissent, ils doivent les comprendre dans leur liaison avec le contenu de la lutte, mais ils ne peuvent pas les inventer à I'avance.
5 - La mise au chômage toujours plus massive de la classe ouvrière, sans perspective réelle de sa réintégration dans la production, a des effets multiples et contradictoires sur l'évolution de la lutte de classe. Dans un premier temps, elle affaiblit la cohésion de la classe, la divisant en ouvriers dans l'usine et hors de l'usine. En plus d'utiliser la menace de chômage et des ouvriers en chômage, comme pression sur les salaires suscitant artificiellement une hostilité opposant les ouvriers au travail et ceux au chômage, le capital s'emploie de toutes ses forces à disperser cette fraction de la classe, à les atomiser, à en faire de simples individus et à les noyer dans"une masse de nécessiteux". Dans un deuxième temps, devant l'impossibilité de réussir pleinement cet ha opération et devant le mécontentement grandissant dos ouvriers au chômage, rendant nécessaire un meilleur contrôle sur eux, le capital avec tous ses organismes, partis et syndicats, et aidé volontiers par les gauchistes, recherchent les moyens de mieux les encadrer, créant pour cela des. organismes spécialisés, les cloisonnant corme une "classe à part" de déclassés. A cette double opération du capital, de dispersion et d'encadrement, la classe ouvrière ne peut répondre que par l'affirmation de son UNITE", du fait de ses intérêts unitaires historiques or Immédiats, et par son effort constant et inlassable vers son auto-organisation.
6 - La période de décadence, de crise historique générale du système social capitaliste, mettant fin à la possibilité d'un mouvement d'amélioration réelle et durable de la condition ouvrière et posant à la classe et sa lutte des objectifs globaux et d'action révolutionnaire, rend inadéquate l'existence de cette organisation spécifique de défense de la condition économique des ouvriers a u sein du capitalisme qu'étalent autrefois les syndicats, et qui de ce fait, ne peuvent être désormais que des entraves à la lutte de classe, c'est-à-dire au profit du capitalisme. Cela ne signifie nullement que la classe n'a plus aucune défense à faire valoir pour ses intérêts immédiats, et le besoin de s'organiser pour lutter, cela signifie seulement un changement radical de la forme de lutte et de son organisation que la classe se donne nécessairement : les grèves sauvages, les comités élus par l'ensemble des ouvriers en lutte, les assemblées générales dans les usines, autant de préfigurations et d'annonciations de l'organisation générale unitaire de la classe de demain, les conseils ouvriers, vers laquelle tend la lutte de classe du prolétariat. Ce qui est vrai pour l'ensemble de la classe l'est également pour cette fraction qui se trouve au chômage, c'est-à-dire hors des usines. Comme l'ensemble de la classe, ces masses de millions de chômeurs ont à lutter contre les conditions les plus misérables que le capitalisme leur fait subir. De même que ces conditions de misère ne sont pas un fait d'individus, de chômeurs (même si cette misère est plus directement ressentie par des individus), mais fait partie intégrante de la condition imposée à la classe dans son ensemble, de même la lutte des chômeurs est une partie intégrante de la lutte générale de la classe. La lutte de classe pour les salaires n'est pas une somme de luttes de chaque ouvrier contre son exploitation individuelle mais une lutte générale contre l'exploitation par le capital de la force de travail de la classe ouvrière globale. La lutte des chômeurs contre les misérables allocations de chômage ou contre les loyers, le paiement de services sociaux (gaz, électricité, transport, etc) relève de la même nature que la lutte pour les salaires. S'il est vrai qu'elle n'a pas immédiatement un visage net, elle ne relève pas moins de la lutte globale contre l'extraction de la plus-value immédiate ou passée, directe ou indirecte à laquelle est et a été soumise la classe ouvrière.
7 - Il n'est pas exact que les ouvriers au chômage ne peuvent participer à la lutte de classe qu'uniquement au travers de leur participation au soutien des ouvriers au travail (solidarité et soutien de grèves). C'est directement en se défendant pied à pied contre les conditions que le capital leur impose et à la place qu'il leur fait occuper que le lutte des chômeurs est une partie Intégrante de la lutte générale de la classe ouvrière contre le capital et comme telle doit être soutenue par l'ensemble de la classe.
8 - Il est vrai que la situation où se trouvent les ouvriers au chômage d'être hors des usines, les prive d'une des armes importantes et classiques de la lutte de classe - la grève - mais cela ne signifie pas qu'ils sont privés de tout moyen de lutte. En perdant l'usine, les ouvriers au chômage gagnent la rue. C'est par des rassemblements dans la rue, des manifestations, des occupations de mairies, bureaux de chômage et autres Institutions publiques que les chômeurs peuvent lutter et ont lutté. Ces luttes ont pris parfois le caractère de véritables émeutes et peuvent devenir le signal et le stimulant d'une lutte généralisée. On commettrait une erreur grave on négligeant de telles possibilités. Dans une certaine mesure, les luttes radicales, éventuelles, des chômeurs peuvent prendre plus facilement et plus rapidement qu'une grève d'ouvriers dans l'usine, le caractère de lutte sociale.
9 - Pour mener la lutte que les conditions leur imposent, les ouvriers au chômage, à l'instar de toute la classe, tendent à se grouper. De par leur situation de dispersement, ce besoin de se grouper leur est rendu relativement plus difficile qu'aux ouvriers concentrés sur leur lieu de travail, les usines. Partant des bureaux de chômage où ils. pointent et se retrouvent, de leur quartier où ils se rencontrent, ils finissent par trouver les moyens de se rassembler et de se grouper. Disposant largement de "temps libre", chassés de leur habitat par l'ennui, la misère, le froid souvent, ils recherchent le contact avec les autres, Ils finissent par réclamer et obtenir des locaux publics pour se réunir. Ainsi se créent des lieux permanents de rassemble ment où les conversations, réflexions et discussions se transforment en réunions permanentes. Cela constitue un énorme avantage pour l'agitation et la politisation de ces importantes masses ouvrières. Il est de la plus haute importance de contrecarrer les manoeuvres des partis et surtout des syndicats visant à les inféoder et à en faire des appendices des syndicats. Ces rassemblements, quel que soit leur nom : groupe, comité, foyer, etc..., ne sont pas des syndicats ne serait-ce que pour la raison qu'ils ne sont pas structurés sur le même modèle; ils ne connaissent pas de statuts, d'adhésion, de sélection, de carte et de cotisations. Même quand ils se donnent des comités, ceux-ci ne sont pas permanents et sont constamment sous le contrôle de tous les participants toujours présents, quotidiennement rassemblés. A bien des égards, ils sont l'équivalent de ce que sont les assemblées générales des ouvriers des usines en lutte, tout comme ses dernières, ils sont menacés et ont à faire face aux manoeuvres des syndicats cherchant à les contrôler, chapeauter, inféoder afin de mieux les stériliser.
10 - Le fait que le mode d'existence de ces groupements . d'ouvriers au chômage ne soit pas le lieu de travail, mais leur habitat, leur quartier, leur commune, ne change rien à leur nature de classe, ni à leur lien social avec l'ensemble des autres membres de la classe. Ces liens indestructibles sont donnés par le fait que ces ouvriers au chômage ont été des ouvriers au travail hier et sont susceptibles de retourner individuellement au travail demain et par le mouvement constant d'ouvrier au travail rejoignant les sans-travail. Si le chômage est un phénomène fixe et Irréversible de la crise, cela ne se rapporte pas à chaque chômeur pris individuellement, mais à la classe dans son ensemble. Ces liens sont encore donnés par la vie commune, de parenté ou d'amitié des ouvriers au travail et au chômage partageant en commun les revenus des uns et des autres.
Et enfin ces liens existent entre les ouvriers habitant le quartier et les ouvriers travaillant dans les usines dans le quartier. La diversité des conditions particulières et circonstancielles à l'intérieur de la condition unitaire générale de la classe peut donner naissance a des formes momentanées diversifiées do regroupement des ouvriers sans mettre pour cela en cause leur caractère de classe.
11 - Dans l'organisation unitaire de la classe, qui sera dans la période révolutionnaire l'organisation centralisée des Conseils Ouvriers, Il est impensable l'exclusion de millions d'ouvriers parce qu'ils sont au chômage. D'une façon ou d'une autre, ils seront nécessairement présents dans cotte organisation unitaire de la classe comme dans ses combats. Rien ne nous permet, même pas l'expérience du passé, de stipuler d'avance la forme que doit prendre ou prendra cette participation, et à priori proclamer que ce ne sera pas par des groupements focaux de chômeurs. Il en est exactement de même pour les ouvriers au chômage que pour les ouvriers et employés dans de petites entreprises qui, le plus probablement seront appelés à se grouper sur la base des localités de leur lieu de travail pour envoyer leurs délégués au Conseil Central des conseils de la ville. De toute façon, il serait artificiel et présomptueux de dicter arbitrairement et au préalable les formes particulières que peuvent prendre les groupements des ouvriers. Il appartient aux révolutionnaires de rester toujours attentifs et vigilants afin que toutes ces formations, qui peuvent apparaître, puissent s'intégrer le mieux possible dans l'organisation unitaire et le combat unitaire de la classe.
12 - Le fait que d'autres éléments provenant de la petite-bourgeoisie et d’autres couches fassent partie également de l'état de chômage, ne modifie pas substantiellement le problème du chômage et des chômeurs. Ces éléments sont largement minoritaires dans la masse des chômeurs. Dans un certain sens, la chute de ces éléments ou une partie d'entre eux dans la masse des ouvriers au chômage est en quelque sorte un mode paradoxal de leur prolétarisation. Ce d'où ils viennent sociologiquement et ce qu'ils sont en train de devenir diffère grandement. La mentalité petite-bourgeoise qu'ils apportent avec eux au sein de la masse ouvrière au chômage peut certes avoir une influence néfaste, mais cette influence est largement limitée et minimisée par des facteurs autrement plus importants que sont la lutte classe et les rapports de force entre prolétariat et bourgeoisie. Il n'y a pas lieu de lui accorder une importance outre mesure. Après tout, nous trouvons un problème similaire quand ces éléments chutent parmi les ouvriers au travail. Tout dépend de l'état de la classe, de sa conscience et de sa combativité, la rendant fort capable de les diriger et de les assimiler. Il en est également ainsi dans une période de guerre où de grandes masses d'ouvriers, au lieu d'être en chômage, se trouvent métamorphosés en soldats et également mélangés avec des éléments provenant d'autres couches. Il serait vain et par ailleurs impossible de perdre son temps à vouloir passer un à un par le crible de leur origine sociale. Le chômage est et demeure fondamentalement un état imposé à la classe ouvrière et comme tel c'est un problème de la classe ouvrière.
Récent et en cours:
- Crise économique [53]
Questions théoriques:
- Décadence [123]
La crise en Russie et en Europe de l’Est (2e Partie)
- 2789 reads
Faiblesse et sénilité du capitalisme d’État à l’Est
A sa différence des
trotskystes qui recouvrent d'une chasuble d'or le corps nu de l'économie
capitaliste à l'Est, des militants de la gauche communiste comme Mattick ou du
GLAT[1] [124]
reconnaissent la nature réactionnaire du capitalisme d'Etat et ne lui donnent
pas un label "progressif" au nom d'une théorie du "troisième
système" si chère à SouB et à ses rejetons actuels de Solidarity.
Nous ne pouvons par exemple
que souscrire à l'article du GLAT paru dans Lutte de Classe de janvier 1977
qui affirme clairement "les contra dictions qui précipitent le capitalisme
dans la crise ne sont pas le privilège des pays les plus avancés ou des pays
sous-développés de la planète. Elles sont inhérentes au capitalisme d'Etat
comme le montre l'exemple de l'URSS". Cette prise de position est
certainement plus claire que l'assertion gratuite, en contradiction avec la
réalité de toujours du capitalisme d'Etat russe, celle de Paul Mattick prétendant
que le "capitalisme d'Etat n'est pas "réglé" par la concurrence
et les crises". Non seulement en ne
voyant pas le rôle destructeur de la concurrence et des crises à l'intérieur du
capitalisme en général mois en niant leurs effets à l'Est en particulier,
Mattick ne peut que rejeter toute possibilité objective d'une révolution
prolétarienne. C'est pourquoi alors que la bourgeoisie de par le mon de prend
de plus en plus des mesures de capitalisme d'Etat en nationalisant des secteurs
clefs de l'économie, il est nécessaire d'en définir la nature afin de montrer
qu'il ne constitue qu'un palliatif et non une "solution" à la crise
générale du capitalisme.
a) Qu'est-ce que le capitalisme d'Etat ?
Le fait que le capitalisme d'Etat ait été souvent assimilé à la Russie et à son bloc, ou à sa variante chinoise, a entretenu longtemps l'Idée que la prise en charge plus ou moins achevée dans l'ensemble de l'économie par l'Etat, était une particularité de ces pays. L'absence apparente, pendant longtemps, des manifestations classiques de la crise : chômage, crise de surproduction, baisse brutale de la production, ont semblé confirmer dette vision fausse "d'un monde à part".
En fait, loin d'être une énigme historique, un tel phénomène s'inscrivait dans l'évolution "naturelle"[2] [125] du capitalisme : "naturelle" dans la sens que ce mode de production était amené à dominer de façon toujours plus violente et totalitaire l'ensemble des rapports sociaux, "naturel le", cette évolution au 19ème siècle qui fait que certaines nations capitalistes, pour des raisons tant historiques que géographiques, avalant depuis des siècles commencé à accumuler le capital, forcé la nature à se plier aux lois qui l'engendraient et qui le dominaient. Cependant, dès la fin du siècle dernier, l'existence de nations capitalistes toujours plus nombreuses allait donner une place grandissante à l'intervention de l'Etat dans les lois "naturelles" du capitalisme. Que l'ère du libéralisme et de la lutte contre le "moloch-Etat", chère aux théoriciens libéraux du I9ème siècle avait sonné. Engels en était parfaitement conscient lorsqu'il écrivait :
"L'Etat moderne, quelle que soit sa forme, est une machine essentiellement capitaliste, un Etat des capitalistes, le capitaliste collectif idéal. Plus il s'approprie de forces productives, plus il devient un capitaliste collectif, plus grand est le nombre de citoyens qu'il exploite. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble". (Anti-Dühring)
Cette analyse d'Engels que les trotskystes prennent soin "d'ignorer", est une gifle posthume à leur théorie de "l'Etat ouvrier". Elle est une condamnation sans équivoque de tout "Programme de transition" avec son chapelet de nationalisations et d'expropriation du capital privé. L'Etat est la machine d'exploitation par excellence; quand les "Dühring" modernes, les gauchistes surenchérissent sur les nationalisations de la gauche, ils ne font qu'appeler au renforcement de la machine capitaliste.
Les bordiguistes participent inconsciemment d'une telle vision, lorsqu'ils volent dans l'Etat surgi des luttes de "libération nationale" un facteur de progrès, celui de la révolution bourgeoise. Ils ne comprennent pas que l'Etat bourgeois surgi des révolutions bourgeoises du passé, ne traduisait un progrès historique que pour au tant qu'il laissait place au libre développement des forces productives, qu'il s'effaçait devant cette nouvelle force historique. Au contraire, l'hypocrisie grandissante de l'Etat capitaliste dès la fin du siècle dernier, loin de traduire un nouvel essor qualitatif des forces productives, reflétait leur compression grandissante dans le cadre national. Deux guerres mondiales ont prouvé que le gonflement de l'Etat était directement proportionnel aux destructions croissantes des forces productives accumulées. Les nouveaux Etats "libérés" qui prennent en charge l'ensemble de la vie sociale, sont non seulement l'aveu de la faiblesse des forces productives qu'ils enserrent dans leur étau mais poussent à son comble l'exploitation et la démoralisation du prolétariat écrasé par une féroce ré pression.
b) Faiblesse du capitalisme d'Etat russe
On commettrait une erreur en limitant aux seuls soi-disant Etats "socialistes" le phénomène du capitalisme d'Etat. D'Internationalisme[3] [126] au CCI, les révolutionnaires n'ont cessé de dé montrer qu'il s'agissait d'un phénomène généralisé au monde entier, se manifestant comme une tendance, mais une tendance jamais achevée compte tenu de l'impossibilité d'absorber totalement les secteurs non capitalistes. C'est pourquoi, il est aussi faux de parler d'un capitalisme d'Etat achevé, économiquement "pur" à l'Est, où pèse encore de tout son poids un secteur agricole faiblement centralisé (kolkhozes, petits lopins de terre) et artisanal que de capitalisme privé "pur" à l'Ouest en raison de la faiblesse relative du secteur étatique. La tendance au capitalisme d'Etat ne dépend pas du pourcentage -qui serait la barre fatidique des 50 %- du secteur économique contrôlé par l'Etat. En définissant l'économie américaine comme "économie mixte" dans Marx et Keynes -diamétralement opposée au système capitaliste d'Etat russe, Mattick perd de vue l'existence de cette tendance générale.
Si certains, comme Mattick, se laissant prendre au piège des apparences, en définissant le capitalisme sous l'aspect de deux forces antagoniques ("d'Etat" et "privé"), c'est qu'ils ne veulent voir que la forme juridique revêtue par le capital. Le capitalisme d'Etat est fondamentalement le résultat de la fusion croissante entre capital et Etat. Cette fusion ne peut être confondue avec la forme juridique qui vient la recouvrir et qui bien souvent n'est que la forme mystifiée de son contenu réel. C'est le degré de concentration et de centralisation du capital au niveau de l'Etat qui détermina la réalité d'une telle fusion. Le capitalisme classique tendait au 19ème siècle à se concentrer de plus en plus internationalement au delà des frontières d'origine. Mais le capitalisme, bien que mondial, ne peut se développer et exister que dans le cadre de la concurrence entre nations capitalistes. C'est pourquoi cette tendance, lorsque se développe l'impérialisme à 1a fin du 19ème siècle, se trouve freinée : la concentration et la centralisation toujours plus grandes du capital, trouvaient comme base l'Etat national, seul en mesure de les soutenir et d'en maintenir l'existence face à d'autres concurrents dans la guerre économique permanente de tous contre tous. La manifestation du capitalisme d'Etat comme tendance, se manifesta pleinement pendant la première guerre mondiale chez tous les belligérants, faibles ou puissants. Bien que faible jusqu'à la crise de 29, la manifestation de cette tendance fut particulièrement frappante dans les grands Etats impérialistes où le capital était déjà parvenu à un haut degré de concentration et centralisation : les USA et l'Allemagne de la première guerre mondiale; cette Allemagne dont Lénine verra le modèle du capitalisme d'Etat pour la Russie. La capacité du capital américain à transformer tout l'appareil productif en économie de guerre lors de la seconde guerre mondiale, a démontré dans les faits combien la puissance même du capitalisme d'Etat était directement conditionnée par la puissance même des soubresauts de l'économie.
Cela ne signifie nullement que le capitalisme d'Etat serait une force supérieure du capitalisme, une "rationalisation du processus de production" (Boukharine, Economique de la Période de Transition). La crise permanente depuis 1914 a montré qu'on ne peut "rationaliser" un système dont le fonctionnement à travers le cycle de guerre crise reconstruction est devenu totalement irrationnel. La "rationalisation" du capitalisme est une contradiction dans les termes. De même, la planification de l'économie par le capitalisme d'Etat ne peut être rien d'autre qu'une planification de l'anarchie croissante, caractéristique même du capitalisme dès ses origines.
Précisément la force du capitalisme d'Etat américain tient dans sa propre capacité de la reporter sur le marché mondial à travers tous ses organismes étatiques (FMI, GATT, BIRD, etc.).
Qu'en est-il du capitalisme d'Etat russe ? En quoi diffère-t-il du capitalisme d'Etat américain ? Comme nous l'avons vu, l'existence du capitalisme privé n'est pas contradictoire avec celle du capital d'Etat et vice-versa. Seuls les staliniens et les trotskystes peuvent aujourd'hui voir dans l'Etat capitaliste américain "un prisonnier des monopoles" affaibli par leur pouvoir occulte. Ces apologistes de la dictature de l'Etat russe ne peuvent comprendre évidemment que la force politique d'un Etat est d'autant plus grande que la base économique qui la sous-tend est large. Comme l'ont montré les marxistes dans le passé, et Engels le premier, le développement des sociétés par actions, puis des cartels et des trusts ne conduisent pas à un affaiblissement de l'Etat mais au contraire aboutît au monopole de l'Etat qui exclue tous les autres qui lui sont alors directement subordonnés.
Si ce processus s'est en quelque sorte accompli progressivement pour les grandes puissances capitalistes (Allemagne, Etats-Unis, Japon), il n'en est pas de même pour la Russie et les pays de l'Est. Ce processus s'est au contraire réalisé par la dépossession violente de la plupart des propriétaires privés, l'Etat devenant seul propriétaire exclusif des moyens de production. L'Etat a pallié la faiblesse congénitale d'une bourgeoisie faible incapable d'opérer la concentration et la centralisation du capital par son incursion despotique dans l'économie. L'Etat s'est alors gonflé démesurément sur une assise économique faible, absorbant la société civile sans vraiment la dominer réellement.
Si, d'une certaine façon, le capitalisme d'Etat prend sa forme la plus achevée en Russie par cette absorption totale de la société civile, par la fusion totale de l'économique et du poli tique, ce n'est qu'au prix d'une anarchie toujours plus grande dans les rapports de production qu'il ne réussit a dominer que formellement. Le gigantesque gaspillage d'une planification anarchique incapable de centraliser et concentrer réellement le capital accumulé, montre que cette fusion du capital et de l'Etat s'est plus réalisée dans le domaine du droit que dans celui des faits.
c) Le mythe de la planification "scientifique"
Les pays de l'Est sont l'illustration de l'irrationalité croissante du système capitaliste dans sa totalité. Le capitalisme, surtout depuis les années 30, a cru qu'il serait possible de développer la production et la consommation de façon régulière et harmonieuse en "décidant" à l'avance les quotas de production. Des méthodes statistiques précises et des bureaux spécialisés de planificateurs permettraient de prévoir l'avenir et d'éviter ainsi les catastrophes brusques comme celle de 29. Tous les plans capitalistes, du plan De Man aux plans staliniens se sont nourris de cette illusion. La guerre devait détruire cette illusion, après qu'en 38 l'ensemble des pays capitalistes des USA à l'URSS, qui avait adopté des méthodes de planification, soit retombé dans la crise. Si l'après-guerre a fait ressurgir à nouveau ce rêve du capitalisme de trouver enfin la pierre philosophale anti-crises, sous la forme des théories "économétriques" à l'ouest et de "calculs scientifiques" à l'est, c'est qu'en réalité l'expansion des marchés reconstruits "planifiait" l'économie. C'est aujourd'hui la crise qui "planifie" l'économie. Nous avons pu le constater dans le précédent article en montrant la chute continuelle des indices de production, reflétant la contradiction grandissante de l'accumulation. La chute du taux de croissance à 3-4% annuel prévue dans les plans annuels des pays du COMECON jusqu'en 1980, montre à l'évidence que les plans sont le reflet passif de la situation. Les planificateurs russes et autres ne peuvent être des agents conscients de la production; ils ne fixent pas la production mais des indices déterminés par la tendance antérieure.
Quel est alors le sens de cette "planification" si elle ne semble avoir aucune réalité apparente ? Le titre de la brochure publiée par l'agence de presse Novosti ("Les grandes options de l'économie nationale de l'URSS pour 1976-80"), nous le donne. Planifier dans le capitalisme d'Etat ne signifie pas atteindre des objectifs certains, mais présenter...des options. Cela signifie que la planification ne trouve son sens non dans des grandeurs mathématiques croissantes mais dans les proportions existant entre secteur des biens de production et secteur des biens de consommation, compte tenu :
- de la lutte de classe qui empêche de freiner trop brutalement la proportion de ce secteur dans l'ensemble de l'économie ;
- de la nécessité de renforcer toujours le secteur d'armements et donc le secteur des moyens de production. Ce que le capitalisme d'Etat ne peut obtenir par l'expansion, il l'obtient par les fluctuations de proportion entre les deux secteurs en fixant quelle quantité de capital sera investie prioritairement dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle branche d'industrie.
Cela ne signifie en aucun cas que l'anarchie capitaliste est supprimée dans ces secteurs "prioritaires". Bien au contraire, la réalisation des objectifs du plan dans une branche déterminée se fait au prix d'un gaspillage permanent du matériel et des matières premières. Les marchandises produites de qualité médiocre n'ont alors qu'une valeur marchande des plus basses, faute d'être utilisables. Qu'on en juge :
"Dans les autres pays (que l'URSS), la production normalement s'étale sur toute la durée du mois, mais ici elle ne peut commencer que le 15 ou le 20, quand tout le matériel est arrivé. Les usines doivent donc remplir 80 % des exigences du Plan (les quotas) pendant les 10 ou derniers 15 jours. Personne ne se soucie plus de la qualité. Il n'y a plus que la quantité qui compte "L'économie russe se trouve être le domaine par excellence de l'irrationalité du point de vue des lois capitalistes de la division du travail, de la productivité et de la rentabilité. Une telle situation se reflète dans les déclarations des dirigeants capitalistes russes, qui rituellement préconisent que "dans les entreprises existantes, la production doit s'accroître en règle générale, sans augmentation de la main-d'oeuvre et même en la réduisant. Mais il n'est pas moins important d'améliorer l'organisation du travail, d'éliminer les pertes de temps de travail et d'élever la discipline à la production". (Kossyguine, XXVème congrès du PCUS).
Il faut être M. Mandel pour voir dans l'anarchie permanente des économies d'Europe de l'Est une quelconque "rationalité". Selon lui, à la différence des planifications "occidentales", "la planification soviétique est par contre une planification réelle" (Traité d'Economie Marxiste). Il est vrai que tous les mensonges trotskystes sont permis pour la défense du caractère "socialiste" des "Etats ouvriers".
d) Faiblesse de l'économie capitaliste d'Etat à l'Est
Le seul secteur de l'économie qui garde aujourd'hui un semblant de vitalité reste en Europe de l'Est et plus encore en URSS, celui de l'industrie d'armements, "il est plus facile de produire une bombe atomique ou des isotopes que de produire des transistors ou des médicaments bio chimiques" constatait un physicien russe (cité par Hedrick Smith : les Russes); il est vrai que c'est le seul secteur où la production soit réellement contrôlée; meilleur matériel, plus grande productivité, meilleurs salaires pour stimuler la recherche de la qualité. C'est le seul secteur où la concentration et la centralisation du capital par l'Etat soit une réalité, car elle est une question vitale pour l'existence même du bloc impérialiste russe. Cela est si vrai, que dans les usines travaillant pour le secteur civil, certaines chaînes de montage travaillent pour l'armée avec des pièces de première qualité rigoureusement testées dès leur arrivée dans l'usine à leur transformation par les autorités militaires. Par exemple à la médiocrité proverbiale des automobiles livrées aux particuliers, s'oppose la robustesse des véhicules utilitaires livrés au personnel de l'armée et du parti (cf. Smith, les Russes).
Cette force de l'économie de guerre russe, qu'on put voir s'exercer pendant la seconde guerre mondiale face au capital allemand, ne reflète nullement celle de l'économie globale; elle lui est inversement proportionnelle. Mais pour que l'économie" de guerre soit réelle ment efficace et puisse affronter celle des Etats-Unis, il ne suffit pas que la production d'armements du bloc russe vienne équilibrer celle de l'autre bloc. Le fait que le secteur d'armements russe représente (officiellement) 20 % du PNB de l'URSS contre 10 % de celui des Etats-Unis, montre clairement la faiblesse de l'économie soviétique.
Contrairement à une idée reçue, et qui fut en vogue à l'époque de la "réforme Liberman", le capitalisme d'Etat russe ne souffre pas d'hypercentralisation et d'hyper concentration des unités de production. C'est exactement le contraire, l'hypertrophie croissante des bureaux du plan des pays du COMECON,- est précisément le résultat de la faiblesse du soubassement économique ; elle ne peut en aucun cas aller dans le sens d'une plus grande centralisation du capital, car celle ci est fondamentalement "la concentration de capitaux déjà formés, le dépassement de leur autonomie individuelle, l'expropriation du capitaliste par le capitaliste, la transformation de beaucoup de petits capitaux en peu de capitaux déjà existants et fonctionnant" (Marx, Capital volume 1), Les statistiques russes montrent précisément (et cela est valable pour les autres pays du bloc à l'exception de la RDA qui hérite du haut degré de concentration de l'économie d'avant-guerre) que le capitalisme d'Etat est bien sou vent théorique : - au premier janvier 74, l'industrie russe comptait 48 578 entreprises auto nomes étatisées, mais fonctionnant chacune comme un centre d'accumulation propre, avec sa comptabilité propre, son autonomie financière. La part des grosses entreprises demeure faible en dehors des réalisations pilotes comme la pétrochimie et 1'électrométallurgie (Elektrostal à Moscou regroupant 20.000 ouvriers). En 1973, 31 % de la production industrielle était assurée par 1,4 % entreprises, soit 660 ; aux Etats-Unis pour obtenir le même pourcentage, il suffisait de 50 entreprises seulement (Fortune, mai 1974). En dépit de la fameuse constitution des "unions industrielles" censées regrouper les petites entreprises dans des unités plus grandes, dans une branche d'industrie donnée, en 74-75, selon Fortune, 500 entreprises américaines produisaient autant que 5000 entreprises russes !
Mais plus que d'une simple concentration, qui est plus le produit que la condition d'une accumulation élargie, c'est d'une domination purement formelle du travail dont souffrent tous les pays de capitalisme d'Etat à la russe. Il s'agit plus en effet d'une utilisation extensive (en dehors des usines pilotes) de la force de travail reposant sur la quantité de main-d'oeuvre utilisée (ou gaspillée par l'anarchie générale) que d'un essor intensif de la productivité du travail, base même du capitalisme moderne depuis la fin du siècle dernier. Si l'exploitation du prolétariat est tout aussi féroce à l'Est qu'à l'Ouest, elle ne prend pas la même forme. Ce que l'exploitation capitaliste gagne en extension en URSS et dans le C0MEC0N par l'allongement du temps de travail (de 10 à 12 heures de travail par jour), par la mobilisation quantitative de la force de travail, elle le perd en intensité et donc en efficacité du point de vue capitaliste. La forme de salariat existant, le salaire aux pièces (2/3 des ouvriers d'URSS) dominant au 19ème siècle au départ du capitalisme industriel, est typique d'un capital faible et traduit la faiblesse de la productivité du travail. En effet, c'est fondamentalement l'orientation du capital vers l'extraction de la plus-value relative qui a entraîné au siècle dernier le capitalisme sur la voie de sa domination toujours plus totalitaire sur le travail vivant. Ce que le capital russe obtient sur le terrain de la violence terroriste d'Etat au niveau politique, la dictature du capital sur le travail, se situe au niveau formel au ni veau économique. Tel est le cas des sempiternel les mises en garde des capitalistes russes, est-allemands, etc… contre le "laisser-al1er dans le travail". (Comme le remarquait déjà Marx au siècle dernier "la production de la plus-value absolue correspond à la soumission formelle du travail au capital, celle de la plus-value relative correspond à la soumission réelle du travail au capital"(Vlème chapitre du Capital). Reflet de la crise générale du capitalisme de puis 1914, le capitalisme d'Etat russe affronte la crise ouverte dans un état de faiblesse et d'archaïsme qui accroît le décalage existant sur le terrain économique entre les deux blocs antagonistes. Ainsi, le rendement en 75 par habitant en URSS était presque celui d'un pays sous-développé : 25ème rang mondial L'URSS ne participe que pour 4% aux échanges internationaux, soit autant que les Pays-Bas. Alors que la place croissante sur le marché mondial est une question de vie ou de mort pour chaque capital national plongé dans la crise, le COMECON depuis 20 ans ne participe que pour 10 % du commerce mondial, soit moins même que la RFA. Si l'on ajoute que le secteur agricole mobilise encore entre 20 et 40 % de la population active selon les pays du COMECON, on aura une idée du degré de faillite du capitalisme d'Etat. La faillite générale aujourd'hui du capitalisme est aussi et surtout celle du capitalisme d'Etat, réponse sans issue à la décadence générale, qui fait de l'irrationalité de son fonctionnement la base de son existence.
La fin des illusions
a) L'illusion mercantile
A la fin des années 60, le bloc russe a tenté de "résoudre" sa crise en cherchant à moderniser son appareil de production, de façon à accroître ses possibilités d'exportation sur le marché mondial, compte tenu du caractère limité du marché du C0MEC0N. Les réformes du style Liberman n'avaient pas permis en effet d'enrayer la chute continuelle du taux de profit accumulé dans les entreprises, se manifestant par une baisse continuelle de la rentabilité : celle-ci "passe pour les accumulations monétaires de 45, de 1% en i960 à 71, 7% en 1973", la baisse tendancielle du taux de profit reprenant en 71 (V. Vassilov, "Rationalité du système économique soviétique").
Au prix d'un endettement considérable, les pays du COMEC0N ont cherché à importer de la technologie et incité les pays industrialisés à installer des usines ultramodernes "clefs en main". Les pays de l'Est avaient l'illusion qu'il suffisait de moderniser pour transformer cette "ruée vers l'Est" du capital occidental en "ruée vers l'Ouest" de leurs marchandises. Dès 75, le monde capitaliste a du déchanter : non seulement l'Ouest a diminué ses exportations de capital vers l'Est pour des raison économiques (insolvabilité grandissante du COMECON) et stratégiques (relance de la guerre froide), mais l'Est a du se résigner à diminuer à son tour ses exportations de marchandises sur les marchés occidentaux. En dépit de l'utilisation du palliatif du dumping, la contraction des échanges et du commerce international est un phénomène irréversible qu'aucune "importation de technologie" ne saurait surmonter. Même des pays orientés pour leurs exportations (Pologne, Hongrie) vers l'Ouest ont dû modifier leurs politiques d'échanges commerciaux en les réorientant vers l'Est. Contrairement à ce qu'affirme le GLAT (Lutte de classe, février 77), la crise actuelle se manifeste bien à l'Est comme le produit de la saturation des marchés, même si celle-ci se concrétise dans ses effets par la chute tendancielle du taux de profit. Il faut être totalement en dehors de la réalité pour affirmer que"l'URSS constitue une preuve expérimentale de l'absurdité (!) de toutes les théories qui cherchent l'origine "de la crise du capitalisme dans une insuffisance de la demande ou toute autre[4] [127] forme de manque de débouchés". Le capitalisme d'Etat dans le bloc russe n'est pas en crise parce qu'il ne produit pas assez de capital accumulé : le capitalisme d'Etat est une gigantesque accumulation de capital constant et de capital variable dévalorisés non seulement par l'anarchie endémique de la production mais par la faiblesse des marchés existants, capables de le réaliser en le valorisant. Le capitalisme à l'Est a eu l'illusion - comme le GLAT - qu'il stagnait parce qu'il ne produisait pas assez de capital (cf. par exemple, le complexe d'usines de camions de la Kama, gigantesque accumulation de capital importé d'occident et gigantesque fiasco après plusieurs années de travaux (routes, bâtiments, etc.). En 75, des 100 000 camions prévus, on ne vit jamais la couleur. Mais la sous-production de capital, c'est-à-dire de marchandises n'est globalement que le corollaire de la surproduction. La sous-production d'un capital national donné est le résultat de la tendance à la surproduction des capitaux plus développés face à la contraction des marchés. Le capital polonais, par exemple, surproduit trop de bateaux par rapport aux capacités d'absorption du marché mondial; il se trouve donc obligé de sous produire par rapport à ses capacités de production. La planification dans les pays de l'Est n'a pas d'autre sens : le capital évite la brutalité de l'effondrement dû à la contraction du marché mondial en adaptant à chaque moment de cet effondrement son appareil produc tif. Seul le socialisme sera en mesure de mettre fin à cette dialectique infernale de la sous et surproduction comme croissance infinie des besoins de l'humanité et donc de la production de biens d'usage capables d'y répondre. Lui seul mettra fin à l'illusion mercantile qui enfonce toujours plus l'humanité dans la barba rie
b) Le renforcement du bloc russe
Si l'accélération brutale de la crise a augmenté
- comme ailleurs la tendance à l'autarcie des pays du COMECON, elle a entraîné l'essor des échanges au sein du COMECON. Ce que les planificateurs du COMECON appellent pudiquement développement "de la division socialiste internationale du travail" et développement de la "spécialisation", recouvre le renforcement de la domination économique, politique et stratégique du capital russe. Afin de développer et renforcer son économie de guerre face au bloc américain, la Russie a adopté des mesures symétriques.
- en juillet 1975 à Bucarest, les pays du CAEM (COMECON) ont décidé (sic) que 9 milliards de roubles seraient dépensés en commun de 1976 à 1980 pour mettre en valeur les ressources soviétiques en matières premières" (L'intégration économique à l'Est, Notes et Etudes documentaires, 8 mars 1976). Pour donner une idée de cette exploitation des "pays frères" par la Russie, une telle mesure signifiera que la Tchécoslovaquie devra y consacrer au moins 4% de ses investissements globaux. Ces mesures ratifiées par les différents PC, comme le IXième congrès du SED est-allemand, signifient en clair que la Russie va imposer le rationnement de ses satellites. Alors que les pays du COMECON, telle la Pologne et la Hongrie, avaient réussi à diversifier leurs échanges et donc leur production dans les années 60, chacun se trouve contraint de plus en plus d'accepter la main mise du capital russe sur ses branches d'industrie (multinationales de la chimie en Pologne, etc.) dont le chantage est grand en raison de son monopole des matières premières, pour cela, elle dispose de son FMI, la banque internationale d'investissement qui lui permet à travers le rouble transférable d'être le véritable bailleur de fonds d'au tant plus que le renchérissement de l'énergie russe (moins chère qu'à l'Ouest ; a considérablement augmenté l'endettement- des pays satellites vis-à-vis de l'URSS.
Ainsi ce que le capitalisme d'Etat russe n'a pu obtenir par une politique de détente avec l'ouest, la modernisation de son appareil productif, il tente de le mettre maintenant en place par la force en faisant reporter sur ses alliés tout le poids de la crise. C'est non seulement la politique Dubcek de pratiquer une politique économique "tous azimuts" qui agonise définitivement avec le retour au bercail des enfants turbulents, Pologne et Hongrie, mais toute l'illusion de la détente et de la "coexistence pacifique" entre les blocs, théorisée jadis par Krhrrouchtchev.
c) La fin de l'illusion du "socialisme à la goulasch" :
Le resurgissement de la lutte de classe dans les années 70 en Pologne, la peur de la contamination de l'insurrection des ouvriers de la Baltique sur le reste des pays du COMECON, avaient poussé la bourgeoisie de ces pays à augmenter le secteur des biens consommés, il est vrai au prix d'un endettement de l'économie par l'importation de biens courants ou par le blocage des prix des produits de base de l'alimentation. La bourgeoisie dans tous ces pays avait alors laissé espérer aux ouvriers que la pénurie des années 50 n'était plus qu'un mauvais souvenir et que l'alliance du coca-cola importé puis fa briqué en Russie avec la goulasch locale allaient amener une élévation sensible du niveau de vie.
La crise, le
renforcement du bloc russe par le report de la crise dans tous les pays du
COMECON, la place croissante consacrée de nouveau aux investissements dans
l'industrie lourde ont modifié la situation. Malgré la crainte éprouvée par la
bourgeoisie d'émeutes ouvrières, tous les plans mis en place jusqu'en 1980
prévoient une nette diminution du salaire réel :
|
|
Pologne |
Hongrie |
RDA |
Tchécoslovaquie |
|
1971-1975 |
7,2% |
3,4% |
3,7% |
3,4% |
|
1976-1980 |
3-3,4% |
2,7-3% |
? |
2,5-2,8% |
(% d'accroissement annuel, source : L'Europe de l'Est en 1976, Notes et Etudes documentaires, 9 septembre 1977).
On sait comment la Pologne a du après les émeutes de Radom et Ursus, revoir sa politique d'attaque du niveau de "vie" des ouvriers en reportant les hausses des produits alimentaires. Il n'en reste pas moins que les deux dernières années ont été des années où l'attaque du capital contre la classe ouvrière s'est fait durement sentir par des hausses répétées des prix. Le poids des sacrifices va désormais se faire plus pesant et particulièrement dans les "démocraties populaires" où la Russie a commencé à exporter les effets de la crise. Cela ne signifie nullement que le capital russe cherche à reporter sa politique d'attaque directe contre "sa" classe ouvrière. Bien au contraire : le développement prodigieux des frais militaires en Russie pour équilibrer l'avance stratégique du bloc américain, de développement d'une politique mondiale agressive vers le Moyen-Orient et l'Afrique en particulier, la nécessité de payer au prix fort le maintien dans son camp de ses lointains alliés (Cuba, Vietnam) pèse de plus en plus lourdement non seulement sur l'ensemble de l'économie du bloc mais sur les épaules de tous les prolétaires du COMECON. La théorie de "l'aristocratie ouvrière" des grands pays impérialistes achetés par leur bourgeoisie, se révèle dans le cas du prolétariat russe comme une sinistre plaisanterie, que seuls de fanatiques tiers-mondistes défenseurs des "petits peuples" pourraient prendre au sérieux.
c) Les contradictions explosives du bloc russe
Le prolétariat des pays de l'Est est peut-être moins que tout autre susceptible d'être embrigadé dans des préparatifs de guerre impérialiste et d'accepter de se sacrifier sur l'autel du "socialisme". Non seulement le prolétariat a connu les réactions les plus féroces d'une bourgeoisie impitoyable quand il s'agit de maintenir en place son système (Hongrie en 1956, Pologne en 1970), mais aussi les attaques du capital contre son niveau de"vie" signifient l'abaisser au-dessous du SMIC dans lequel le capitalisme d'Etat le maintient. Même si le capitalisme d'Etat tente maintenant de constituer des stocks alimentaires en investissant massivement dans l'agriculture (complexes agro-alimentaires), cela ne peut être compris non comme des mesures préventives de famines mais comme la constitution de stocks de réserve pour nourrir les armées qui seraient un jour jetées dans la guerre impérialiste.
D'autre part, pour pouvoir affronter le marché mondial et le bloc américain, le bloc russe devrait :
- augmenter ses capacités de production et donc accroître le taux d'exploitation des ouvriers (productivité). On "constate en 76 un ralentissement des taux de croissance de la productivité des importations et des investissements" (N.E.D, 9 septembre 77). Cela veut dire que le capital des pays du COMECON est dans l'incapacité de moderniser son appareil productif. Fini le temps de l'importation du capital occidental à haute dose. Pour "rentabiliser" le capital existant -particulièrement vétusté comme le montre la faible rotation du capital fixe - il faudrait en plus de la diminution du salaire réel des ouvriers par la pénurie contrôlée, diminuer le nombre d'ouvriers, ouvrir la voie au chômage. C'est une solution tentante pour le capitalisme des pays de l'Est; mais céder à cette tentation signifierait ouvrir en même temps la vanne des explosions sociales en chaîne, alors que la stabilité fragile de ces pays a reposé depuis la guerre sur leur politique de "plein emploi". La combativité intacte du prolétariat, les réactions de classe qui se sont fait jour en Europe de l'Est, même de façon dispersée, de Radom jusqu'à Karl-Marx-Stadt et au bassin houiller roumain, montrent la fragilité des préparatifs idéologiques à la guerre impérialiste dans le bloc russe. Autrement plus efficace et pernicieuse que la "patrie socialiste", est la campagne Carter des "droits de l'homme" comme instrument de préparation idéologique.
Enfin, le renforcement de la main mise économique sur les pays du bloc n'a renforcé que formellement la cohésion du COMECON. La note à payer présentée par l'impérialisme russe à ses alliés reste trop lourde, les avantages économiques et politiques trop faibles à côté de ceux du bloc américain, pour que soit assurée la stabilité et la solidité du bloc. Comme la montre l'écho rencontré par la campagne Carter dans les "démocraties populaires" (Charte des 77, opposition interne jusque dans le SlD, opposition "démocratique" en Pologne), le renforcement du bloc s'est accompagné aussi du renforcement des for ces centrifuges qui viennent affaiblir la cohésion du bloc.
Alors que les contradictions s'accumulent dans le bloc russe, il appartient aux révolutionnaires d'évaluer le rapport de forces entre les classes, c'est-à-dire les conditions objectives d'éclatement de la révolution mondiale en Europe de l'Est.
IV) CRISE POLITIQUE ET LUTTE DE CLASSE
La mise en place du capitalisme d'Etat en Europe de l'Est a simplifié le cadre politique dans le quel se déroule la vie même du capital. La victoire de l'URSS dans cette partie de l'Europe a entraîné des changements politiques profonds : instauration du parti unique, élimination des partis proaméricains socio-démocrates, libéraux ou paysans. S'il subsiste encore aujourd'hui officiellement d'autres partis à côté du parti étatique, tels le parti paysan polonais ou les partis chrétiens démocrate et libéral démocrate en RDA, c'est uniquement comme succursale du parti Etat; leur existence anachronique reflète en fait non un pluralisme de type occidental, mais la subsistance d'un important secteur paysan, voir confessionnel, sans qu'ils représentent une force d'opposition. Le même phénomène se retrouve en URSS où le parti stalinien russe coexiste avec d'autres partis "communistes" ou "nationaux" (ukrainien, etc.), censés représenter spécifiquement non des groupes sociaux particuliers mais des "nationalités" (géorgiens, arméniens, etc.).
Malgré ces particularités, la mise en place du capitalisme d'Etat sous forme violente dans ces pays, a abouti au parti unique. Ce qui n'a pu être réellement réalisé sur le plan économique, la fusion du capital avec l'Etat, l'a été sur le plan politique. L'existence de tels partis expriment, sous la forme la plus pure, la décadence du mode démocratique de la dictature bourgeoise. Au siècle dernier, la subsistance de classes représentant d'anciens modes de production (noblesse, paysannerie) obligeait la bourgeoisie à coexister, à s'accommoder de ces forces archaïques au sein de l'Etat. La domination progressive de la bourgeoisie sur l'Etat devait éliminer de telles forces ; l'instabilité de la base économique de sa domination avec le déclin de son propre système devait l'amener de plus en plus à enlever le voile des "libertés" recouvrant sa dictature de classe ; le déclin du capitalisme a contraint la bourgeoisie à fusionner totalement avec l'Etat, dernier rempart de sa domination. Cette tendance à la disparition de tout le con tenu formel de la démocratie s'est réalisé là où la classe capitaliste est la plus faible, la moins assise économiquement : dans le tiers-monde et en Europe de l'Est. Le renforcement du totalitarisme de l'Etat à l'Ouest montre qu'une telle tendance est non seulement universelle mais irréversible. Seule la force relative du capitalisme a laissé subsister des partis représentant les couches archaïques du capitalisme dans les pays les plus développés, la démocratie cessant d'être un mécanisme de fonctionnement du capital pour ne plus avoir qu'une simple fonction de mystification, ("libertés démocratiques", élections "libres", etc.). La faiblesse même du capitalisme à l'Est, la faiblesse de la classe bourgeoise constituée inorganiquement dans l'Etat ne lui donne pas les moyens de se payer le luxe de cet opium inefficace pour calmer les souffrances de prolétaires totalement démunis. La classe capitaliste fusionne directement avec la police et l'armée dans l'Etat à travers le parti unique qui apparaît comme son état-major. On ferait une lourde erreur si l'on croyait que la concentration en un tout de la classe capitaliste, sa totale fusion avec l'Etat ont supprimé les contradictions internes de la classe bourgeoise et éliminé toute espèce de crise politique en son sein. Les purges sanglantes au sein des partis staliniens au pouvoir depuis plus de quarante ans, ont montré que le capitalisme d'Etat n'apportait pas une consolidation de la classe dominante. Les épurations, les coups d'Etat, les règlements de compte forment la toile de fond de la vie politique de la bourgeoisie. Les scissions de la classe bourgeoise, ses déchirements en intérêts divergents ne se manifestent plus au travers de partis multiples mais au sein même du parti unique, ce qui a pour effet d'accroître l'instabilité et la fragilité de l'Etat, les événements de 56 en Hongrie en sont l'exemple le plus frappant lors de la scissions du parti en deux, entre la fraction Ralosi et la fraction Nagy. De fait, la crise permanente auquel correspond le capitalisme d'Etat en traîne une crise permanente de la bourgeoisie prisonnière du cadre totalitaire et étouffant qu'elle s'est donnée, le parti unique, pour main tenir sa domination.
La crise ouverte du capitalisme, ses manifestations, n'ont pu que mettre à nu une telle réalité ; élimination de Khroutchev, printemps de Prague, remplacement de Gomulka par Gierek. Si la crise politique tend de plus en plus à s'affirmer au grand jour, sortant du champ clos des affrontements de cliques au sein du parti étatique pour s'étaler sur la place publique, cela tient à l'accumulation grandissante des contradictions au sein de chaque capital national du bloc. L'austérité imposée par le capital russe, non seulement menace la cohésion sociale dans les "démocraties populaires", mais son poids est trop lourd à supporter pour des bourgeoisies congénitalement faibles, qui sans espoir de pou voir trouver des débouchés nécessaires à l'Ouest 53 trouvent néanmoins ramenées vers le bercail du COMECON.
Depuis quelques années, depuis surtout la campagne Carter sur les "droits de l'homme" et à la suite des espoirs nés dans certains cénacles intellectuels des accords d'Helsinki, on a vu apparaître de l'URSS jusqu'en Pologne, RDA, Tchécoslovaquie des groupes d'opposition dans ou en dehors des partis uniques réclamant l'instauration de "libertés démocratiques" et le pluralisme politique. Si en URSS, cette opposition est essentiellement limitée aux cercles intellectuels qui réclament une plus grande liberté de pensée dans leurs travaux, elle se teinte d'opposition nationaliste anti "grand-russien" dans les républiques non russes. Ces deux formes viennent se combiner dans les "démocraties populaires" : les intellectuels réclament des "libertés" soutenus cette fois plus ou moins ouvertement par des fractions de la bourgeoisie souhaitant prendre des distances économiquement et politiquement avec la ruineuse "amitié" de l'ours rus se. Dans un pays comme la Pologne, l'essor de la lutte de classe, l'impossibilité de briser par la force totalitaire de l'Etat le farouche prolétariat polonais, a fait naître une armée de cercles ou groupes d'opposition se proclamant les "défenseurs des ouvriers" tel le KOR de Kuron. Ce sont ces éléments qui font pleurer de joie les trotskystes et autres défenseurs du rétablissement de la "démocratie ouvrière''. Ces bons pèlerins de la "liberté démocratique" vont même jusqu'à affirmer (staliniens et Libertés en Europe de l'Est, Cahier Rouge n°2 "série Pays de l'Est") : "le caractère extraordinairement subversif de la revendication des libertés démocratiques en Europe de l'Est". Subversif ? Laissons parler l'un des représentants du courant "démocratique" Lipinski : "Un système dé pourvu d'un mécanisme d'adaptation continu, un système rigide qui détruit les critiques, qui n'est pas soumis à un contrôle social, qui ne respecte pas les libertés critiques fondamentales, un tel système n'est pas efficace". (Interview du Nouvel Observateur, 15 mai 1976). Main tenir la cohésion, assurer la survie, l'efficacité" du système capitaliste, voilà le programme" subversif" qu'une fois de plus les trotskystes découvrent dans de tels organismes bourgeois. Il est difficile de connaître l'écho de tels groupes chez les ouvriers : inexistant en URSS où l'activité de l'intelligentsia ne rencontre que méfiance, il semble avoir été plus grand spécifiquement en Pologne dans le milieu ouvrier[5] [128]. Cependant de telles tentatives de constituer une opposition ne signifient pas que des "régimes démocratiques" soient à l'ordre du jour en Europe de l'Est. La crise du capitalisme signifie l'accentuation du caractère totalitaire de l'Etat, la mise au pas de l'ensemble de la société. Cette emprise renforcée du capital sur le corps social ne peut se relâcher que momentanément avec l'explosion de conflits sociaux; un tel relâchement n'est alors que temporaire et prépare des mesures totalitaires nouvelles pour briser la résistance du prolétariat. L'opposition "démocratique" en Pologne n'est que le corollaire exact, le complément du renforcement de la dictature de l'Etat capitaliste, concentrée dans le parti unique. Adam Michnik, représentant du KOR, l'avouait cyniquement il y a peu de temps (Esprit, janvier 1977) : "Postuler un renversement révolutionnaire de la dictature du parti, organiser des tentatives dans ce but, serait aussi irréaliste que dangereux". L'emprise grandissante de l'URSS sur ses alliés ne laisse à cette "opposition" pas d'autre choix que d'être l'opposition officieuse du capital d'Etat, dans une acceptation tacite ou résignée du bloc russe constitué.
En dehors de sa fonction de canaliser localement le mécontentement des ouvriers dans des campagnes de signatures contre la répression, les "oppositions démocratiques" ont peu de chance de rencontrer un écho quand elles menacent la domination de l'impérialisme russe et proposent une rupture avec le bloc (Charte des 77 en Tchécoslovaquie). En aucun cas, elles ne pourront se transformer en partis d'opposition ; elles ne pourront que coexister à côté du parti unique aussi longtemps que le capital national et l'URSS le jugeront bon. C'est cette politique que le capital polonais avait mené en 56 ; une fois épuisé le mécontentement ouvrier et stabilisé le pou voir, les groupes d'opposition surgis, disparaissaient avec ou sans répression ouverte. A l'Est pas plus qu'à l'Ouest, le prolétariat n'a de "libertés" à défendre, ni d'amis sur qui compter. La seule liberté que revendique le prolétariat, c'est celle de détruire le capitalisme pourrissant qui l'écrase toujours plus. Le prolétariat prendra les armes à la main la liberté de s'organiser et de lutter pour la destruction du système. Il prendra la liberté d'enlever toute liberté de la classe bourgeoise de l'exploiter Cette vérité du marxisme, martelée incessamment par Lénine face à tous les "démocrates" du prolétariat, est plus que jamais vraie en Europe de l'Est.
De l'insurrection en Saxe et à Berlin en 53, de l’explosion de 56 en Hongrie jusqu'aux chantiers de la Baltique en 71, le prolétariat do l'Europe de l'Est a montré qu'il n'était pas une fraction séparée du prolétariat mondial, mais un de ses détachements. Il a montré par sa combativité et son héroïsme que la possibilité da la révolution prolétarienne n'est plus une utopie cultivée par quelques "archéo-marxistes".
Certes, le prolétariat des pays de l'Est devra franchir de durs obstacles pour retrouver la voie d'Octobre 17 :
- l'encadrement impitoyable et totalitaire de l'Etat, du capitalisme d'Etat, qui atomise plus qu’ailleurs la classe ouvrière,
- l'écrasement inouï du prolétariat russe qui a détruit toute continuité organisationnelle avec la vague révolutionnaire des années 20,
- la difficulté à tirer les leçons de son combat, une fois la lutte retombée en l'absence d'organisations politiques révolutionnaires.
Les surgissements du prolétariat en Europe de l'Est montrent que le prolétariat y a moins de peine à manifester sa combativité et à étendre la lutte de classe qu'en Russie où le degré des affrontements reste beaucoup plus faible et dispersé dans le temps et l'espace (explosions locales totalement isolées), parce que le capitalisme d'Etat dans ces pays seront de plus en plus des zones de faiblesse du capital mondial face au prolétariat mondial.
Cependant, le rôle central du prolétariat ouest-européen dans la lutte de classe internationale, sa concentration, le surgissement depuis le réveil de la lutte de classe en 66 d'organisations politiques sécrétées pour tirer les leçons de son combat, son niveau de conscience historique de classe plus développé, vont être un catalyseur décisif en Europe de l'Est pour transformer cette combativité accumulée depuis 71 en énergie révolutionnaire consciente capable de renverser la dictature de fer du capitalisme au niveau mondial.[1] [129] GLAT : adresse : Renée TOGNY, B.P 620 09 75421 PARIS CEDEX 09.
[2] [130] Il va de soi qu'aucune isolation d'un
phénomène historique n'est "fatale", dans le sens que ce sont les
hommes qui font leur propre histoire. C'est
plutôt la survie du capitalisme avec l'échec de la vague révolutionnaire de
17-21 qui a donné une réalité à un tel phénomène.
[3] [131]
Organe de la Gauche Communiste en
France. Voir Bulletin d'Etudes et de Discussions n°9.
[4] [132]
Celle-ci ne peut être d'aucun
secours pour les pays les plus endettés (Pologne, Hongrie). Cela est si vrai
que ces deux derniers, plus la Tchécoslovaquie, ont récemment laissé entendre,
officieusement, qu'ils tenaient à recevoir des prêts du FMI, voire à y adhérer.
Le FMI l'invention du capital américain, il est inutile de préciser que cela ne
serait possible que si ces pays passaient dans ce bloc. Le renforcement du bloc
russe sur ses satellites montre qu'un tel projet est une illusion.
[5] [133] Signatures des pétitions du KOR par des milliers d'ouvriers polonais, etc.
Géographique:
Récent et en cours:
- Crise économique [53]
Massacre des ouvriers en inde
- 2896 reads
Le tract qui suit a été récemment envoyé au CCI d'Inde; il est non signé et de source inconnue. Nous le publions parce qu'il relate un épisode important et tragique de la lutte de classe en Inde, épisode qui apporte des leçons à l'ensemble de la classe ouvrière internationale. Le massacre des ouvriers de l'usine textile de Swadeshl à Kanpur restera pour longtemps un témoignage brutal de la barbarie capitaliste et iI rappellera à tous les ouvriers que c'est la seule réponse que peut offrir le capitalisme à l'humanité dans cette époque de déclin de la "civilisation" capitaliste. Le massacre de Kanpur n'est qu'un événement parmi tant d'autres d'une série d'actes brutaux de répression de la part du régime "démocratique" Desai. Ces derniers mois, des ouvriers, des étudiants et des paysans ont été tués lors de manifestations par la police Janata dans toute l'Inde : Utar Pradesh, Madya Pradesh, Tamil, Binar, Punjab etc. Le massacre de Kanpur a aussi bien des ressemblances avec celui des 200 ouvriers de l'usine de sucre "Aztra" en Equateur en octobre dernier. Là, tout comme à Kanpur, l'armée, à défaut de la police, a utilisé la seule politique consistante pour le capital aujourd'hui face à des ouvriers en lutte : la répression cynique et sanglante. Les récents événements du Pérou, du Nicaragua, etc. confirment cette tendance qui accompagne le resurgissement du prolétariat au Tiers-Monde. En Inde, le resurgissement de la classe ouvrière a été annoncé par la grande grève des chemins de fer en 1974 qui n'a pu être écrasée par le régime de Gandhi qu'au prix de la répression la plus massive (25000 ouvriers jetés en prison) et de la collaboration la plus éhontée entre les syndicats et le gouvernement. Le régime Janata a été mis en place en 1976 pour remplacer la "dictature" de Gandhi et contrôler mieux les ouvriers grâce à la promesse de "démocratie" et de "droits humains"; mais à peine le gouvernement Dosai était-!I au pouvoir qu'il se trouvait confronté à une vague de grèves sauvages dans la classe : les dockers do Bombay, les mineurs dé Rajhara, les fonctionnaires du gouvernement et bien d'autres ont mené des luttes très dures, souvent en dehors du contrôle syndical ; et la plupart du temps elles ont reçu la même réponse sanglante que la grève de Kampour décrite dans le tract. . Les ouvriers Indiens ont payé avec bien des vies le privilège d'apprendre ce qu'est la réalité cachée derrière la façade de la démocratie Janata : la terreur de l'Etat bourgeois.
Mais le tract contient certaines faiblesses. Inévitables dans un mouvement prolétarien International qui renaît depuis peu. On les trouve quand le tract critique les leaders "révolutionnaires" du mouvement ouvrier pour leur légalisme et leur collaboration de classé avec le régime Janata. De même, Il ne reconnaît pas que le rôle de division des syndicats est produit du fait qu'ils sont eux-mêmes des organes de répression de l'Etat au sein de la classe ouvrière. En fait, le PC (M) soi-disant "ouvrier" et les autres organisations de gauche du même type sont des partis capitalistes qui soutiennent pleinement les besoins du capitalisme d'Etat et de l'austérité économique. Ils ne"trahissent" personne, pas plus qu'ils no "collaborent" avec le capitalisme, lis sont une partie do l'appareil politique du capitalisme, tout comme les syndicats. S'ils parlent de "la classe ouvrière", c'est pour mieux la mystifier. Mais dans la vie réelle, lis contribuent à la répression physique du prolétariat en le dupant, en le divisant et en l'Isolant, le tout au nom de "l'Intérêt national". La force du tract se trouve assurément ailleurs, dans sa claire dénonciation du massacre et son Internationalisme : "Ouvriers du monde entier, unissez-vous !". C'est pourquoi ce tract apporte avec lui un souffle d'air frais depuis le sous-continent Indien, pour servir d'inspiration aux révolutionnaires et à leur classe partout ailleurs.
A une époque où le monde est plus que jamais ravagé par des bains de sang Inter impérialistes travestis dans des "luttes de libération nationale", à une époque où l'on dit aux révolutionnaires dans les pays avancés qu'ils doivent soutenir ces guerres nationales parce que le prolétariat "n'existe pas" dans le tiers-monde, parce quo ces guerres peuvent préparer la voie à un "développement capitaliste progressif", ce tract nous dit très clairement qu'il y a une classe ouvrière dans le tiers-monde, qu'elle a déjà engagé sa lutte autonome et que dans cette lutte, elle s'affronte aux mêmes ennemis que les ouvriers des métropoles : la démocratie, les partis de gauche, les syndicats et, par dessus tout, l'Etat national dont la banqueroute historique dans toutes les parties du monde est clairement mise en relief par son recours à la terreur et au massacre contre le prolétariat.
MASSACRE DES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE QUE S'EST-IL EXACTEMENT PASSE A SWAPESHI ? SWADESHI (KANPUR)
- 6 décembre 1977 : Environ mille ouvriers de l'entreprise de coton SwadeshI à Kanpur, encercle deux cadres pour exiger le paiement de leurs salaires, impayé depuis 51 jours; ceci se passe à 13h30;
15h30 : d'importants effectifs de la police armée et de la Provencial Armed Constabulary (PAC) entourent l'entreprise de toutes parts;
15h50 : la police ouvre le feu sans sommation;
Vers 17h30 : plus de 150 ouvriers sont morts, des centaines sont blessés et 237 sont arrêtés.
Le 6 décembre 1977, restera dans l'histoire de 13 classe ouvrière comme le MARDI NOIR, le jour où le capital lança une guerre ouverte et armée contre la classe ouvrière, le jour du massacre de sang froid le jour du "Jalianwala Bagh" ouvrier.
On se souviendra du bain de sang; l'entreprise Swadeshi, une des plus grandes entreprises textiles de l'Inde, où les 8000 ouvriers doivent payer les frais d'une crise dont Ils ne sont pas responsables, étant contraints d'attendre le paiement de leurs salaires.
On retiendra le nombre, sinon les noms des ouvriers tués par les balles de la police. Et on se souviendra aussi des noms des meurtriers et avant tout ceux des leaders et ministres du Parti Janata qui ont décidé et justifié la fusillade.
Rien de tout cela ne sera oublié, parce que le 6 décembre fut le jour du massacre le plus barbare et prémédité d'ouvriers Indiens, depuis l'indépendance. Le nombre exact d'ouvriers tués ne sera probablement Jamais connu, dans la mesure où les cadavres précipités dans le Gange ou la rivière Betwa ne seront jamais retrouvés et identifiés, non plus que ceux réduits en cendres dans les fours de l'entreprise. Leur nombre parait être facilement de 200. Tandis que la bureaucratie censurait complètement l'Information, la presse "Iibre" gardait le silence.
Nous donnons ci-dessous la version de la police et les faits rapportés par ces centaines d'ouvriers, des témoins visibles et quelques journalistes Indépendants.
Le rapport de police : Il a été nécessaire d'ouvrir le feu parce que les ouvriers étalent en train de tuer deux cadres - le directeur de production Sharma et le chef comptable lyenger -et qu'ils ont attaqué rageusement les policiers qui essayaient d'intervenir. On suppose que le surintendant de police Rei a été assommé.
Les faits : Les cadres ont été encerclés au sein de l'entreprise à côté d'une fontaine, cependant leurs cadavres ont été trouvés dans une petite pièce à l'étage. Les trois ou quatre per sonnes qui ont été vues en train de porter les corps des deux cadres dans les escaliers n'avaient jamais été vus dans l'usine auparavant. Un journal de Kanpur rapporte que l'on a entendu Sharma crier à la police d'arrêter de tirer et que les cadres étaient vivants quand le feu a commencé. Un hebdomadaire a déclaré que les cadres ont été tués par la police après coup pour donner un bon prétexte à leurs orgies de meurtres. Le CID est jusqu'à aujourd'hui Incapable de fournir la moindre preuve de la culpabilité d'ouvriers dans le meurtre des deux cadres. On croit généralement que les deux cadres en savaient trop à propos des méfaits de la direction qui avait engagé quelques éléments (les trois ou quatre personnes dont on parlait ci-dessus), et qu'il fallait s'en débarrasser.
D'après le reportage d'un certain nombre de journaux, le surintendant de police Rei n'était pas sérieusement blessé. Sarin, l'officier de sécurité de l'entreprise a déclaré à un magazine que Rei ‘’est sorti de l'usine sur ses deux jambes et n'était pas porté’’.
Le rapport de police : Le tir a duré "au plus cinq ou dix minutes". Douze ouvriers"seulement" ont été tués et une vingtaine blessés.
Les faits : Les tirs ont commencé à 16h50 et se sont arrêtés aux alentours de 17h30. Au moins 15 ouvriers ont été tués et largement plus de cent blessés. Des propriétaires de petites échoppes en face des portes de l'entreprise, certifient que le tir de la police a duré sans discontinuer jusqu'à 17h30. Les ouvriers qui ont survécu, déclarent qu'ils ont été obligés de porter les cadavres de leurs camarades dans des camions. Ils disent qu'ils ont porté des "quantités de corps".
Cinq semaines après le 6 décembre, les autorités ont enfin commencé 5 verser les payes dues aux ouvriers. 238 ouvriers ne sont jamais venus pour recevoir leurs salaires. Où sont les 220 ouvriers qui manquent, si l'on admet la version officielle de 12 morts ?).
La police a tiré a l'intérieur de l'entreprise et aussi dehors, sans distinction et en toutes directions. Un jeune garçon de huit ans nommé Pappu et un autre de douze ans ont. été tués. Ils étalent tous deux à une bonne centaine de mètres de la porte de l'usine. Des enseignes de magasins et des maisons portent des traces de balles. Une longueur de un kilomètre de route a été complètement bloquée par la police durant trois jours pour effacer les traces de leur sauvagerie. De toute façon, les stores de Arvind Cloth Stores (magasin de vêtements), portent encore des traces de balles. Un correspondant de "Aaj", un quotidien de Kanpur a été battu et sa caméra a été détruite alors qu'il essayait de prendre des photos à l'extérieur de l'entreprise, le 6 décembre au soir.
Tout nous amène à la conclusion que les déclarations de police sont fausses et sans fondements et que les tirs n'ont pas été provoqués par les "violences ouvrières". Le feu était aussi "illégal" d'après le India To-Day, un prestigieux magazine peu suspect de sympathies de gauche.
La police n'a jamais envisagé des étapes intermédiaires telles des gaz lacrymogènes, des balles de caoutchouc avant d'ouvrir le feu. Dans le manuel de la barbarie, il n'y a pas de place pour les "détails de procédure".
POURQUOI CE MASSACRE DE SANG FROID DES OUVRIERS A SWADESHI ?
La toile de fond du massacre est la crise présente de l'industrie textile en Inde en général, la "solution" particulière recherchée par la direction Jaipuria de Swadeshi avec la sympathie et le soutien à la fois du Congrès et du régime Janata, l'expérience des ouvriers de Kanpur (qui n'est pas unique aux Indes) face aux syndicats, et la tendance récente des ouvriers à l'esprit militant et à l'auto organisation. La période de l'état "d'urgence" fut bien sûr le feu vert des capitalistes pour "discipliner" les ouvriers et augmenter le taux d'exploitation du travail. Le Jaipuria a fait un pas de plus; depuis août 1975, il verse les salaires des ouvriers avec 45 ou 60 jours de retard. Tandis que les salaires des ouvriers devenaient ainsi un apport additionnel de capital libre et intéressant pour l'entreprise, atteignant 500 000 ou 600 000 roupies, les ouvriers, eux, étalent obligés de vivre d'emprunt, dont le taux d'Intérêt montait jusqu'à 120 % par an dans la plupart des cas.
Depuis septembre Î975, les ouvriers ont dû entourer la direction, pas moins de six fois, rien que pour obtenir le paiement de leurs salaires longtemps après la date normale de paie. On peut signaler au passage qu'en aucun des cas antérieurs, les ouvriers n'ont tenté de tuer les cadres, même dans les cas où les occupations ont duré 48 ou 50 heures. Au cours de ces tortueuses batailles pour leur simple survie, les ouvriers en sont arrivés à perdre foi dans les appareils de conciliation de l'Etat d'un côté et dans ceux de "leurs" syndicats qui ont prouvé leur incapacité à sortir du cadre de la "légalité bourgeoise et à porter le mouvement plus loin".
Le plus Important de ces mouvements, fut celui du 26 octobre, avec l'encerclement du secrétaire de l'entreprise, Agarwal. L'occupation a duré 53 heures et ne s'acheva que lorsque les ouvriers eurent obtenu satisfaction pour leurs revendications. Si l'aspect explicite est la lutte pour des salaires dus, la signification réelle de ces occupations réside dans l'exemple de l'unité de classe des ouvriers et leur combativité militante. Les jours d'occupations, les ouvriers s'armaient de pierres, de briquetons, de barres de fer et surtout de tubes de gaz chlorhydrique. L'entreprise était entourée de toutes parts par les ouvriers empêchant ainsi les forces armées de faire leur travail habituel, de briser l'encerclement. Les ouvriers menaçaient de faire exploser les tubes de gaz si la police faisait la moindre tentative pour briser l'encerclement. Pendant 53 heures, les forces armées de l'Etat restèrent sans ressources, humiliées et paralysées.
La réponse des syndicats (la plupart des syndicats nationaux en Inde ont une "section" à Swadeshi) à ce degré de combativité de la classe, a été d'appeler les ouvriers à "dénoncer l'occupation". Les ouvriers de Swadeshi avaient eu plus que leur part de déclarations pathétiques sur les négociations, l'arbitrage, les compromis, les résolutions et les délégations. Pendant ces événements d'octobre, ils rossèrent les leaders syndicaux et les chassèrent. Il est notable que les ouvriers, pendant l'occupation, prirent la production en main, de même que l'organisation de la nourriture, etc. aux occupants de l'entreprise. Cette victoire des ouvriers de Swadeshi en octobre a constitué un précédent dans le Kanpur. En une seule poussée d'activité militante, les ouvriers avaient défié en même temps les capitalistes, l'Etat et leurs "propres" institutions du passé, irrémédiablement responsables du "syndicalisme responsable" et de la "légalité bourgeoise".
C’est dans cette démonstration de leur capacité d’auto organisation et leur combativité militante que se trouvent les racines réelles du massacre du 6 DECEMBRE.
Le défi de la classe ouvrière avait mis en mouvement l'appareil répressif de l'Etat. Quelques jours après le 26 octobre, le ministre de l'Intérieur et le DIG, police de l'Uttar Pradesh, dans une interview à la télévision, déclaraient que le gouvernement était prêt à prendre des "mesures définitives" pour éviter les incidents à Swadeshi et ceci "à tout prix". Le 29 novembre, un agent provocateur tenta de transformer une querelle mineure entre deux ouvriers en une émeute communale, afin de briser l'unité ouvrière. L'occasion de prendre ces "mesures définitives" se présenta enfin qui leur permit de faire une "contre démonstration" pour I’ exemple d'octobre. Certains pensent même que, bien qu'il y ait eu une réelle colère ouvrière qui ait poussé à l'occupation’’ du 6 décembre, cette occupation elle-même pourra bien avoir été échafaudée pour diviser les ouvriers impréparés. A cause d'une panne d'électricité à Kanpur, seulement mille ouvriers étalent à l'entreprise cet après-midi là sur un total de quatre vingt mille.
Depuis le massacre du 6 décembre, l'usine a subi un "lock-out" illégal qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui le 3 mars. Même le ministre "socialiste" Georges Fernandes aurait dit qu'il faudrait encore au moins un ou deux mois avant que l'entreprise ne rouvre. Apres le 15 janvier, le versement des salaires commença en présence de centaine de policiers, armés de mitraillettes, à l’Intérieur de l'entreprise et sur la route principale à l'extérieur. Les salaires payés 90 jours après échéance disparurent dans le gouffre des emprunts passés. La situation des ouvriers et de leurs familles est des plus précaires. Comme on l'a signalé plus haut, 238 ouvriers n'ont pas reparu pour récupérer leurs salaires pour des raisons évidentes. Une commission d'une seule personne nommée par le gouvernement pour enquêter sur les causes du tir, a abouti à la conclusion que celui-ci était justifié. Il y a même une critique au "Dy Magistrate" pour "n'avoir pas ordonné le tir plus tôt". Au même moment, un comité des Droits Civiques a vu le jour à Delhi défiant une fois de plus les affirmations de la bureaucratie. Le premier ministre de l'UP continue à refuser catégoriquement la tenue d'une enquête judiciaire.
LA "DEMOCRATIE" JANATA ET LA CLASSE OUVRIERE
Sans aucun doute, le massacre de Swadeshi n'a pas de parallèle dans l'histoire de la classe ouvrière aux Indes. Mais cette répression sanglante ne doit pas être prise comme un cas unique au Swadeshi. Ce n'est pas non plus l'acte d'un "District Magistrate" à la gâchette facile. Ce n'est que la manifestation la plus crue de l’attitude de plus en plus répressive du régime de Janata à l'égard de la classe ouvrière. Dès qu'il fut installé au pouvoir, il dit explicitement que les occupations ne seraient pas tolérées, que des accords signés pendant des occupations ne seraient pas reconnus, que des mesures énergiques seraient prises pour prévenir de telles actions. Non seulement cela, mais, durant ces onze derniers mois, la police sous les ordres du régime Janata a ouvert le feu, y compris sur des grèves ordinaires et "légales" dans'-la logique de la "légalité bourgeoise". Dilli-Rajharmin (MP), llsccket Bojaro % (Bihar), Sahibabad et Lucknow (UP), Mulund (Maharashtra) en sont quelques exemples. Des tas d'ouvriers y ont perdu la vie et des centaines ont été gravement blessés. Dans les campagnes où le travail agricole est plus ou moins organisé, la machine répressive a été peut-être plus dure. D'après les versions officiellement reconnues, dans le seul Etat de Bihar, la police a ouvert le feu huit fois sur des agriculteurs et onze y ont perdu la vie. Armés jusqu'aux dents, les propriétaires terriens qui défendent leurs intérêts dans la région ont déclaré une guerre ouverte aux salariés.
C'est une manifestation toujours plus évidente du caractère "démocratique" du régime Janata dont la répression est au maximum, précisément la où le Janata détient le pouvoir. Dans la grève des quatre vingt mille enseignants du secondaire en UP, vingt trois mille ont été emprisonnés alors que quelques cinq mille y perdaient leur emploi. Une loi visant à réprimer le mouvement, "déguisée" en loi s'attaquent aux criminels, est sur le point de passer au Dihar.
Dévoyant la vague de mécontentement do nasse contre le régime du parti "garlbi hatao" ("lutte contre la pauvreté"), le parti Janata se catapulta au pouvoir, se posant on "Parti de la Démocratie". Il fallait donner un sens aux slogans. Le Janata restaura le droit de grève formellement, élimina le "Compulsory Deposit Scheme" et restaura le bonus minimum de 8 1/3 % par an. On pouvait croire que le régime Janata avait des sympathies pour la classe ouvrière aussi longtemps qu'il croyait que les luttes ouvrières pouvaient être réduites à une lutte pour la "démocratie" et se dérouler dans une "ambiance libre" pour son exploitation; aussi longtemps qu'il croyait que la lutte de classe se déroulerait dans le même cadre salarié que pendant "l'état d'urgence". Mais il est de plus en plus clair aujourd'hui que les luttes des ouvriers ne sont pas basées sur tel ou tel aspect de l'esclavage salarié mais contre les fondements mêmes du système salarié. La lutte révolutionnaire de la classe ouvrière ne se fait pas pour la démocratie capitaliste mais pour la fin du capitalisme et de sa forme démocratique, basée sur l'exploitation.
Au fur et à mesure que le caractère de classe du mouvement ouvrier et son fondement révolutionnaire devint explicite, le caractère du régime Janata se révéla; son caractère de classe devint clair aussi. Aussi opposé que le régime Janata ait pu être au "Congress", avec ses slogans sur la démocratie, dans les récentes grèves des employés du gouvernement dans l'Etat du Maharastra, le premier ministre du Janata et le premier ministre du "Congress" ont affronté la lutte du même point de vue et avec une plateforme identique. Tandis que le Janata du Maharastra, les yeux fixés sur les élections à venir, soutenait la grève, son président demandait ouvertement que les ouvriers ayant de "bons" salaires n'aient pas le droit de faire grève. Pour autant que le salaire puisse être bon pour l'esclave du capital.
Aujourd'hui le langage et la politique du Janata changent très rapidement. Aujourd'hui, on entend des discours sur la condamnation des grèves, le maintien de la loi sur la détention préventive, les limitations de salaires, etc.
Pour les "champions de la démocratie", la constitution, la législation et les tribunaux industriels sont les seuls juges valables de la "légitimité" des revendications et des formes des luttes des ouvriers.
Pour la classe ouvrière, toute forme de lutte est "légitime" y compris et en particulier celles qui tendent à mettre fin à la "légitimité" de la société bourgeoise, il est clair aussi, pour la classe ouvrière, que quand elle défend ses intérêts, les champions du capital n'ont pas grand effort à faire pour laisser tomber le masque de la légalité et de la démocratie. Que coûte-t'il aux défenseurs du capital, après tout de refaire des lois dans le "parlement du peuple" ? L'imposition de l'Etat d'urgence, les justifications du maintien de la détention préventive par le Ministère de l'Intérieur, le massacre des ouvriers de Kanpur, l'introduction du "mini-Misa" en MP, ne sont que quelques exemples des plus récents.
LA "GAUCHE: SOCIALISTE" DU PARTI JANATA
Il est utile de se demander pourquoi la "gauche" du Janata reste aussi silencieuse que les hommes de paille de Gandhi, à propos de la tuerie des ouvriers de Swadeshi. La répression de la classe ouvrière et des travailleurs agricoles va sans cesse croissant et les "socialistes-Gandhiens" resteraient silencieux ? Il devient clair aujourd'hui que la gauche du Janata est forcée de jouer le même rôle vis-à-vis des mouvements de la classe ouvrière que les courants "progressistes" et "socialistes" du Congress jouaient hier, agitant les plans de "gauche"pour l'exploitation du travail tandis que la "droite" continue ses manœuvres.
LA GAUCHE "COMMUNISTE"ET LA CLASSE OUVRIERE :
De plus, les choses ne s'arrêtent pas là. Il est des questions qu'il faut adresser aux partis "communistes" officiels eux aussi. En intervenant dans le débat au parlement sur l'incident de Swadeshi, Jyotirmoy Bosu, le PCM a proclamé que cet incident était le résultat d'une conspiration, préparée par les agents provocateurs d'un certain parti politique pour rendre impopulaire le ministre de l'Intérieur et pour battre le premier ministre de l'UP dans les prochaines élections (Times of India du 8/12/1977). Selon un ouvrier de Swadeshi, un chef du PCI, Harbans Singh, dans un discours public à Kanpur, a traité les ouvriers de Swadeshi "d'ingrats" (en référence claire aux occupations d'octobre et à la bagarre entre ouvriers et dirigeants syndicaux).
Bien sûr, la bourgeoisie voit toujours la combativité ouvrière comme le résultat d'une conspiration d’éléments « anti sociaux ». Ce chef « révolutionnaire » du mouvement ouvrier défend t-il le même point de vue ? Si les revendications imposées par sa situation et par son expérience de classe, dans le contexte de crise nationale et internationale du capital, requière que la classe ouvrière brise les barrières des formes légales de lutte, pour pouvoir porter la lutte sur son propre terrain de classe, et si les chefs restent enfermés dans la politique du passé, qu'attendent-ils des ouvriers ? Naturellement, aux yeux des chefs réactionnaires, les initiatives de la classe vers son unité de classe apparaissent comme "déloyales".
Apparemment, les journaux de ces partis ont dénoncé le massacre de Swadeshi. Mais la question est de savoir ce que valent ces dénonciations et résolutions. N'est-il pas clair que si le traitement odieux que!'Etat a fait subir à une fraction de la classe ouvrière reste sans réponse de la part des ouvriers de Kanpur et du mouvement ouvrier indien, cela ne peut finir qu'en laissant au capital et à ses représentants le rapport de forces décisif ? Combien de temps faudra t’il encore pour comprendre que la plus petite illusion vis-à-vis de n'importe que représentant du capital ne peut avoir que les conséquences les plus désastreuses sur le mouvement de la classe ouvrière ? Dans quel but et pour combien de temps encore parlera-t-on des alliances avec tel ou tel secteur de la bourgeoisie ?
Il n’y a qu'une voie pour la classe ouvrière aujourd'hui. Contre sa division dans des dizaines de syndicats, la constitution de son unité de classe passe par un défi militant au parti du Congres, au régime Janata et à tous les autres représentants de la bourgeoisie. Il est devenu clair, ces derniers mois, mémo si c'est de façon sporadique, que des fractions de la classe commencent à surgir, conscientes de la tache historique qui Incombe au mouvement ouvrier. La lutte des ouvriers" de Swadeshi à Kanpur n'était pas le résultat d'une "conspiration" maïs le début de la préparation historique du défi révolutionnaire à tout l'ordre bourgeois. Dans ce sens, il fait partie Intégrante de la nouvelle phase du mouvement International de la classe ouvrière. Dans la période à venir, seuls pourront jouer un rôle révolutionnaire, ceux qui sauront saisir la dynamique interne et le contenu révolutionnaire des aspirations de la classe ouvrière.
PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !
Géographique:
- Inde [134]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [54]
MAI 68, La reprise de la lutte prolétarienne.
- 4918 reads
"Mai 68, premiers signes de la crise et du réveil prolétarien, Mai 78, approfondissement de la crise et montée de la lutte de classe".
Cette formule lapidaire, qui résume à elle seule toute l'évolution de ces dix dernières années, nous permet à la fois d'affirmer notre position et d'infirmer toutes les interprétations, les bavardages de la gauche et des gauchistes sur la signification réelle qu'a recouvert Mai 68. Car Mai 68, loin d'être un accident de l'histoire, une révolte fortuite, est en fait une des premières réactions de la classe ouvrière face à l'apparition de la crise du capitalisme.
LES EVENEMENTS DE MAI 68
Il va 10 ans, le 3 mai, un meeting rassemblant quelques centaines d'étudiants, était organisé dans la cour intérieure de la Sorbonne, à Paris, par l'UNEF (Syndicat étudiant) et le "Mouvement du 22 Mars" (formé à la Faculté de Nanterre quelques semaines avant). Rien de très exaltant dans les discours théorisateurs des "leaders" gauchistes, mais une rumeur persistante : "Occident va attaquer". Le mouvement d'extrême droite donnait ainsi le prétexte aux forces de police de "s'interposer" officiellement entre les manifestants. Il s'agissait surtout de briser l'agitation étudiante, qui, depuis quelques semaines se poursuivait à Nanterre. Simple fait divers du ras-le-bol des étudiants, constitue par des mobiles aussi divers que la contestation du mandarinat universitaire, de la revendication d'une plus grande liberté individuelle et sexuelle dans la vie interne de l'université.
Et pourtant, "l'Impensable est advenu" : pendant plusieurs jours, l'agitation va se poursuivre au Quartier Latin. Elle va monter d'un cran tous les soirs : chaque manifestation, chaque meeting rassemblera un peu plus de monde que la veille : dix mille, trente mille, cinquante mille personnes. Les heurts avec les forces do l'ordre sont aussi de plus en plus violents. Dans la rue, de jeunes ouvriers se joignent au combat, et, malgré l'hostilité déclarée ouvertement du PCF qui traîna dans la boue les "enragés" et "l'anarchiste allemand" Daniel Cohn-Bendit, la CGT se verra contrainte pour ne pas être débordée complètement de "reconnaître" la grève déclarée spontanément et qui se généralise : dix millions de grévistes secouent la torpeur de la Ve République et marquent d'une manière exceptionnelle le réveil du prolétariat.
En effet, la grève déclenchée le 14 mai à Sud-Aviation et qui s'est étendue spontanément, a pris dès le départ un caractère radical par rapport à ce qu'avaient été jusque là les "actions" orchestrées par les syndicats. Dans les secteurs essentiels de la métallurgie et des transports, la grève est quasi générale. Les syndicats sont dépassés par une agitation qui se démarque de leur politique traditionnelle et sont débordés par un mouvement qui prend d'emblée un caractère illimité et souvent peu précis comme le fait remarquer ICO (Informations et Correspondance Ouvrières) : "A la base, il n'existe en fait aucune revendication précise. Tout le monde, c'est évident, est pour une augmentation de salaire, le raccourcissement de la semaine de travail. Mais les grévistes, ou du moins la majorité d'entre eux, n'ignorent pas que ces avantages seront précaires, la meilleure preuve c'est qu'ils ne se sont jamais résolus à une action pareille. La vraie raison, toute simple, les panneaux accrochés aux portes de petites usines de la banlieue parisienne la donnent clairement : "Nous en avons assez !" (La grève généralisée en France : mai -Juin 63. N° 72 - juillet 78). Dans les affrontements qui ont eu lieu, un rôle important a été joué par les chômeurs. Ce que la presse bourgeoise appelait les "déclassés". Or, ces "déclassés", ces "dévoyés" sont de purs prolétaires. En effet, ne sont pas seulement prolétaires les ouvriers et les chômeurs ayant déjà travaillé, mais aussi ceux qui n'ont pas encore pu travailler et sont déjà au chômage. Ils sont les purs produits de l'époque de décadence du capitalisme : nous voyons dans le chômage massif des jeunes une des limites historiques du capitalisme, qui, de par la surproduction généralisée, est devenu Incapable d'intégrer la génération montante dans le procès de production. Mais ce mouvement déclenché en dehors des syndicats, et dans une certaine mesure contre eux, puisqu'il rompt avec les méthodes de lutte qu'ils préconisent en toute occasion, les syndicats ne vont pas tarder à le reprendre en mains. Dès le vendredi 17 mai, la CGT diffuse partout un tract qui précise bien les limites qu'elle entend donner à son action,: d'une part, revendications traditionnelles couplées à la conclusion d'accords de type Matignon garantissant l'existence de la section syndicale d'entreprise, d'autre part, changement de gouvernement, c'est-à-dire, les élections. Méfiants à l'égard du syndicat avant la grève, la déclenchant par dessus sa tête, l'étendant de leur propre initiative, les ouvriers ont pourtant agi pondant la grève comme s'ils trouvaient normal que le syndicat reste charge de la conduire à son terme.
Pourtant, la grève générale, malgré ses limites, a contribué avec un immense élan à la reprise mondiale de la lutte de classe. Apres une suite ininterrompue de reculs, depuis son écrasement après les événements révolutionnaires des années 1917-23, les émeutes de mai-juin 68 constituent un tournant décisif, non seulement en France, mais encore en Europe et dans le monde entier où les grèves ont non seulement ébranlé le pouvoir on place mais aussi ce qui représente son rempart le plus efficace et le plus difficile à abattre : la gauche et les syndicats,
UNE CRISE DE LA JEUNESSE ?
La première surprise passée, la première panique écartée, la bourgeoisie a pu s'atteler à trouver les explications aux événements qui remettaient en cause sa quiétude. Il n'est donc pas étonnant que la gauche ait utilisé le phénomène de l'agitation étudiante pour exorciser le spectre réel qui se lève devant les yeux de la bourgeoisie apeurée - le prolétariat - et que les événements sociaux aient été limités à leur aspect de querelle idéologique entre générations. Mai 68 nous est présenté comme étant le résultat du désoeuvrement d'une jeunesse face aux inadaptations créées par le monde moderne. Ainsi, le sociologue français Edgar Morin déclarait dans un article publié dans "Le Monde"du 5 juin 68 : "Tout d'abord, c'est un tourbillon où une lutte de classes d'âge a fait rage (jeunes contre gérontes, jeunes contre société adulte), mais a déclenché en même temps une lutte de classes, c'est à dire une révolte des dominés, les travailleurs. En fait, la lutte jeunes-vieux a déclenché par résonance la lutte travaiIleurs-autorité (patronale-étatique)". Le même type d'explication nous est donné par le journal anarchiste de Liège "Le Libertaire" qui affirme que : "S'ils refusent les structures et les responsables, c'est qu'ils se méfient d'un monde adulte où la démocratie a été bafouée, la révolution trahie. Avec eux, nous assistons à un retour extraordinaire du socialisme utopique du XIXème siècle." (n°6, juin 68). Quant au Parti Communiste International, dans son organe "Le Prolétaire" de mai 68, il mettait en évidence les causes du mouvement : "Dans ces agitations, se mêlent divers motifs, parmi lesquels émergent la guerre du Vietnam et la revendication pour le moins ingénue d'une participation directe des étudiants à la "direction de 1'université, c'est à dire aux réformes de sa structure."
Parmi les innombrables analyses qui ont été publiées sur les événements de mai 68, certaines expliquent que les occupations d'usines qui se sont soudain multipliées à travers le pays répondaient à l'occupation de la Sorbonne par les étudiants. Il y aurait eu de la part des travailleurs en grève une sorte de phénomène de mimétisme à l'égard des étudiants parisiens, alors que d'autres comme ICO, mettaient en évidence 1’incompréhension politique de la Vieme République à l'égard de la jeunesse : ".., le maillon le plus faible du capitalisme français, c'est bien en définitive la Jeunesse et les problèmes qu'elle se pose et pose à des classes dirigeantes incapables même de les apercevoir, enfermées qu'elles sont dans une politique où les promesses tiennent lieu d'actes et où l’immobilisme et le respect des puissances d'argent se parent de formules dynamiques."
L'INTEGRATION DE LA CLASSE OUVRIERE
Toutes ces "analyses" ou explications mettent l'accent sur le rôle spectaculaire du mouvement étudiant et tentent de minimiser le rôle de la classe ouvrière, allant jusqu'à nier tout rôle révolutionnaire à la classe ouvrière : "Il est de première importance de dire bien haut et avec calme qu'en mai 68, le prolétariat n'était pas 1'avant-garde révolutionnaire de la société, qu'il n'était que l'arrière-garde muette." (Coudray, alias Cardan -Castoriadis- dans "La Brèche"). Ce n'est pas un hasard. La bourgeoisie, avec ses idéologues attitrés d'une part et avec l'appui des utopistes marginaux d'autre part, a toujours cherché à occulter la réalité de l'exploitation capitaliste. Elle a toujours tout mis en oeuvre pour dévier la classe ouvrière de sa prise de conscience en distillant diverses mystifications qui démobilisent ou démoralisent le prolétariat. Les sources de ces attitudes et de ces explications qui cherchent à mettre en évidence la négation du caractère révolutionnaire du prolétariat viennent de l'intelligentsia gauchiste en retraite, pulvérisée par le déclin du capitalisme mondial. Dans les années 30 et 40, les sympathisants staliniens de "L'Institut de Recherche Sociale" de Francfort (Marcuse, Horkheimer, Adorno) ont commencé à édifier l'ossature qu'utilisent aujourd'hui les théoriciens "radicaux" récupérés par la bourgeoisie : ces idéologues prétendaient que le capitalisme "avancé" ou "moderne" a éliminé les différences entre la base économique de la société et sa superstructure. Implicitement, cette notion signifie que la classe ouvrière s'est fait "acheter" par un capitalisme qui ne souffre lui-même d'aucune contradiction économique fondamentale. Il s'ensuit alors que les contradictions du capitalisme se sont déplacées de la base vers la superstructure. Ainsi, la critique de la vie quotidienne a pris une importance prépondérante pour ses idéologues. Marcuse analyse les divers aspects du phénomène des sociétés de consommation en expliquant que si le citoyen est désormais assuré du confort, il se voit dénié tout droit à l'exercice de sa liberté et de ses responsabilités, toute possibilité de contestation, en un mot, la quasi totalité de ses dimensions humaines, d'où le titre de son livre : "L'Homme Unidimensionnel". La révolte étudiante aux yeux de Marcuse est l'un des premiers signes d'une révolte de l'homme contre ce mécanisme qui le nie puisqu'il lui refuse toute liberté et tout contrôle de ses actes; "cette révolte, souligne-t’i1, n'est pas dirigée contre les malheurs que provoque cette société mais contre ses bénéfices." C'est un phénomène nouveau propre à ce qu'on appelle la civilisation de l'opulence. Il ne faut pas avoir d'illusions mais on ne doit pas être défaitiste non plus. Il est inutile d'attendre dans un tel débat, que les masses viennent se joindre au mouvement, participent au processus. Tout a toujours commencé par une poignée d'intellectuels en révolte." Marcuse constate que la société do consommation se montre particulièrement habille dans l'art d'intégrer les révoltes. Elle produit des "esclaves" qui sont d'autant plus asservis qu'ils n'ont pas conscience d'être opprimés. La classe ouvrière, en particulier, n'est plus dans cette optique une force révolutionnaire puisque toutes ses revendications sont acceptées et assimilées par la société. Seuls restent révolutionnaires les intellectuels possédant un esprit critique suffisant pour déceler les pièges de la société de 1'opulence et les marginaux qui ne bénéficient pas de ses"bienfaits".
LA REAFFIRMAT ION DE LA NATURE REVOLUTIONNAIRE DU PROLETARIAT
"Le prolétariat est mort. Vive le prolétariat !" scandaient les jeunes marginaux d'Amsterdam. Funérailles prématurées, le mouvement de mai 68 a remis les choses en place rappelant la nature réelle du prolétariat : à la conception d'une humanité agissant sous la conduite d'idéaux éternels et inexplicables, le prolétariat oppose celle des sociétés divisées en classes économiques et évoluant sous la pression dos luttes économiques qui les opposent. Le projet révolutionnaire ne peut être défini que par une classe, c'est-à-dire une partie de la société définie par sa position spécifique au sein des rapports de production, cette classe, c'est la classe ouvrière. "L'antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie est une lutte de classe à classe, lutte qui portée à sa plus haute expression, est une révolution totale" écrira Marx dans "Misère de la Philosophie". La spécificité du prolétariat par rapport aux autres classes de la société réside dans le fait qu'elle constitue la force vivante du travail associé. C'est face aux crises économiques de la société que les classes révèlent leur véritable nature historique. De par sa situation de producteur collectif, le prolétariat ne peut envisager, face à une crise économique, de solution individuelle. Situé au coeur même de la production de l'essentiel des richesses de la société, travaillant de façon associée, n'ayant de rapport avec les moyens de production que de façon collective, le prolétariat industriel est bien la seule classe de la société à pouvoir comprendre, désirer et réaliser la collectivisation effective de la production. L'essence de la vie sociale capitaliste se résume en fait dans la lutte pour la plus-value entre ceux qui la créent et ceux qui la consomment et l'utilisent. Le moteur de l'action du prolétariat est ce combat contre l'extraction de la plus-value, contre le salariat. Tant que le capital existe, toute l'action du prolétariat est et reste déterminée par l'antagonisme fondamental qui le lie à celui-ci. C'est donc à cause des contradictions objectives existant au sein du système capitaliste et parce qu'elles correspondent au mouvement du prolétariat que le communisme est une possibilité. Ce sont les conditions historiques concrètes qui déterminent quelles sont les possibilités réelles dans une période déterminée, bien que la décision entre les diverses possibilités objectives dépend toujours de la conscience, de la volonté et de l'action des travailleurs.
LE MOUVEMENT ETUDIANT
Il est plus qu'évident que Mai 68 a pu être marqué par une décomposition certaine des valeurs de l'idéologie dominante, mais cette révolte "culturelle" n'est pas la cause du conflit : Marx nous a montré, en effet, dans son avant-propos à "La critique de l’économie politique" que "le changement dans les fondations économiques s'accompagne d'un bouleversement plus ou moins rapide dans tout cet énorme édifice. Quand on considère ces bouleversements. Il faut toujours distinguer deux ordres de choses. Il y a bouleversement matériel des conditions de production économiques. On doit le constater dans l'esprit de rigueur des sciences naturelles. Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, bref les formes idéologiques dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout."
Toutes les manifestations de crise idéologique trouvent leurs racines dans la crise économique et non le contraire. C'est l'état de crise qui peut nous indiquer le cours actuel des choses. Le mouvement étudiant fut donc bien une expression de la décomposition générale de l'idéologie bourgeoise, il fut l'annonciateur d'un mouvement social plus fondamental, mais en raison même de la place de l'université dans un système de production et des éléments qui la composent, celle-ci n'a qu'exceptionnellement un lien avec la lutte de classe. Croire que les émeutes, avec barricades et affrontements entre étudiants et policiers sont une découverte récente, serait faux. L'histoire de toutes les grandes universités européennes est marquée depuis le Moyen-Âge par des incidents violents et une activité politique intense. La grève des cours a été "inventée" il y a huit cents ans. Au XII ième siècle, les étudiants reprochaient à l'enseignement de ne pas avoir évolué depuis Charlemagne, comme les révoltés de 68 dénonçaient une université encore construite sur le modèle arrêté par Napoléon. Un campus avant la lettre, la cité étudiante de Corbell, qui regroupait hors de Paris 3000 étudiants, a été à l'origine d'un phénomène de contestation en 1104. D'ailleurs quand on regarde ainsi en arrière, on constate que les étudiants contemporains sont allés moins loin que certains de leurs prédécesseurs. En 1893, ceux-ci avaient par exemple, donné l'assaut à la Préfecture de Police. Les étudiants, cependant, ne sont pas une classe, pas même une couche sociale, leur mouvement n'est pas un mouvement de classe. Les revendications que posent les étudiants, sont liées à l'existence de la division bourgeoise du travail et de la société capitaliste en général. En outre, ce mouvement n'a nullement une vision historique et économique du développement objectif des contradictions au sein de la société. Pourtant, des étudiants allemands ou français, ont cru ouvrir la voie des révolutions du XXIème siècle en minant les communes et les barricades du XIXème. La révolte étudiante s'est épuisée à reporter ses espoirs sur les modèles "radicaux" du capitalisme d'Etat, de Cuba au Chili, de Chine au Portugal, en une longue marche désespérée. Les sectes gauchistes préexistantes, trotskystes, maoïstes ou anarchistes, se sont un temps regonflées de militants généreux hier encore anti-autoritaires, mystifiés ou insécurisés par leur impuissance à assumer un quelconque débouché à leurs rêves petit-bourgeois. Au bout de l'isolement, au bout du désespoir, les plus marginaux d'entre eux auront été jusqu'au terrorisme.
Mal 68 ne fait que montrer l'étroite relation existant entre les conflits sociaux et la dégradation économique, entre les décompositions de l'idéologie dominante et cette morne crise économique. En ce sens, mal 68 n'est pas un moment inattendu, une sorte d'accident de l'histoire : les grèves et les émeutes n'ont fait que répondre aux premiers symptômes de la nouvelle phase de la crise mondiale du capitalisme.
LA CRISE OU CAPITALISME
Marx a déjà expliqué que le capitalisme ne pouvait survivre qu'en détruisant périodiquement l'excès de capital des périodes de surproduction, afin de rajeunir et de connaître de nouveau des taux d'expansion élevés : "Cependant, ces catastrophes qui le régénèrent régulièrement, se répètent à une échelle toujours plus grande et finiront par provoquer son renversement violent," Dans la destruction massive en vue de la reconstruction, le capitalisme découvre une issue dangereuse et provisoire, mais momentanément efficace pour ses nouveaux problèmes de débouchés. Ainsi, au cours de la première guerre, les destructions n'ont pas été "suffisantes" : les opérations militaires n'affectèrent directement qu'un secteur Industriel représentant moins d'un dixième de la production mondiale. L'autodestruction de l'Europe au cours de la première guerre mondiale s'est accompagnée d'une croissance de 15 % de la production américaine. Mais dès 1929, le capitalisme mondial se heurte de nouveau à la crise. Tout comme si la leçon avait été retenue, les destructions de la seconde guerre sont beaucoup plus importantes en étendue et en intensité. Et lorsque s'ouvre la période de reconstruction de la deuxième guerre, il y a donc déjà longtemps que le capitalisme "ne peut plus s'agrandir au moyen de brusques poussées expansionnistes". Depuis des décennies, la productivité du travail s'accroît trop vite pour être contenue dans les rapports de production capitaliste, il y a déjà trente ans que les assauts répétés et de plus en plus violents des forces productives contre les "barrières qui endiguent leur développement" ravagent sauvagement la société entière, il n'y a que la misère et la barbarie de ces années de dépression croissante qui peuvent expliquer I'éblouissement général par le développement économique qui s'annonce avec la reconstruction.
Cet éblouissement n'a d'ailleurs pas épargné ceux qui se "proposaient d'être le plus haut degré do la conscience révolutionnaire", l'Internationale Situationniste : dans un ouvrage publié on 1969, "Enragés et Situationnistes dans le mouvement des occupations", l'I.S. écrivait qu'"on ne pouvait observer aucune tendance à la crise économique... L'éruption révolutionnaire n'est pas venue d'une crise économique... ce qui a été attaqué de front en mai, c'est l'économie capitaliste fonctionnant bien."
Après 1945, l'aide des USA va permettre la relance de la production de l'Europe qui paie en partie ses dettes en cédant ses entreprises aux compagnies américaines. Mais après 1955 ? Les USA cessent leur aide "gratuite", la balance commerciale des USA est excédentaire alors que celle de la majorité des autres pays est déficitaire. Les capitaux américains continuent de s'investir plus rapidement en Europe que dans le reste du monde, ce qui équilibre la balance des paiements de ces pays, mais va bientôt déséquilibrer celle des USA. Cette situation conduit à un endettement croissant du trésor américain, puisque les dollars émis et investis en Europe ou dans le reste du monde constituent une dette de celui-ci à l'égard des détenteurs de cette monnaie. A partir des années 60, cette dette extérieure dépasse les réserves d'or du trésor américain, mais cette non couverture du dollar ne suffit pas encore à mettre les USA en difficulté tant que les autres pays sont endettés vis-à-vis dos USA. Les USA peuvent donc continuer à s'approprier le capital du reste du monde en payant avec du papier. Cette situation se renverse avec la fin de la reconstruction dans les pays européens. Celle-ci se manifeste par la capacité acquise par les économies européennes de lancer sur le marché international des produits concurrents aux produits américains : vers le milieu des années 60, les balances commerciales de la plupart des anciens pays assistés deviennent positives alors que, après 1964, celle des USA ne cesse de se détériorer. Dès lors que la reconstruction des pays européens est achevée l'appareil productif s'avère pléthorique et trouve en face d'elle un marché sursaturé obligeant les bourgeoisies nationales à accroître les conditions d'exploitation de leur prolétariat pour faire face à I'exacerbation de la concurrence internationale.
La France n'échappe pas à cette situation et dans le courant, de l'année 67, la situation économique de la France doit faire face à l'inévitable restructuration capitaliste : rationalisation, productivité améliorée ne peuvent que provoquer un accroissement du chômage. Ainsi, au début de 1968, le nombre de chômeurs complets dépasse les 500 000. Le chômage partiel s'installe dans de nombreuses usines et provoque des réactions parmi les ouvriers. De nombreuses grèves éclatent, grèves limitées et encore encadrées par les syndicats mais qui manifestent un malaise certain (voir ICO). Car la récession dans l'emploi tombe d'autant plus mal que se présente sur le marché de l'emploi cette génération de l'explosion démographique qui a suivi la fin de la seconde guerre mondiale.
En liaison avec cette situation de chômage, le patronat s'efforce d'abaisser le niveau de vie des ouvriers. Une attaque en règle contre les conditions de vie et de travail est menée par la bourgeoisie et son gouvernement. Et pourtant, la France, avec ses réserves d'or, occupe encore une place sur l'échiquier mondial, place qui sera, compte tenu du contexte d'essoufflement à l'échelle mondiale, rapidement abandonnée, obligeant la bourgeoisie française à opérer un revirement politique spectaculaire. Ainsi, dans tous les pays industriels, le chômage se développe insensiblement, les perspectives économiques s'assombrissent, la concurrence internationale se fait plus acharnée. La Grande-Bretagne devra procéder, fin 67, à une première dévaluation de la livre afin de rendre ses produits plus compétitifs. Mais cette mesure sera annulée par la dévaluation successive des monnaies de toute une série d'autres pays. La politique d'austérité imposée par le gouvernement travailliste de l'époque fut particulièrement sévère : réduction massive des dépenses publiques, retrait des troupes britanniques de l'Asie, blocage des salaires, premières mesures protectionnistes. Les USA, principale victime de l'offensive européenne ne manque pas de réagir sévèrement et, dès le début de janvier 68, des mesures économiques sont annoncées par Johnson, alors qu'en mars 68, en réponse aux dévaluations de monnaies concurrentes, le dollar chute à son tour. Telle est la toile de fond de la situation économique d'avant mai 68. Il ne s'agit pas encore d'une crise économique ouverte, mais seulement des prémisses certaines qu'il fallait entrevoir pour comprendre la situation exacte.
LES LEÇONS DE MAI 68
Ainsi, nous pouvons réaffirmer que les événements de mai 68, résultaient de la crise économique du capitalisme. Loin de vouloir faire l'apologie de mai 68, les révolutionnaires doivent pouvoir en tirer les leçons et mettre on évidence les points forts et les points faibles. Premier sursaut du prolétariat face au surgissement de la crise, mai 68 ne peut être caractérisé comme moment révolutionnaire; bien des faiblesses subsistaient. Une faiblesse de taille fut I'inexpérience totale du prolétariat. Si la bourgeoisie a trouvé devant elle une détermination certaine dans la lutte, due essentiellement à un prolétariat qui n’avait pas connu les défaites de la contre-révolution et I'écrasement de la seconde guerre mondiale, la victoire de la bourgeoisie fut facilitée par l'inexpérience des ouvriers. Le mouvement spontané de la classe semble s'être Immobilisé laissant le temps aux syndicats de reprendre les choses en main, laissant le temps à la bourgeoisie, une fois sa peur passée, de passer à l'offensive.
Paradoxalement, en apparence du moins, le moyen de cette reprise en main, ce sont les grévistes eux-mêmes qui l'ont offert en occupant les usines. De l'expression maladroite et incomplète d'une radicalisation du mouvement ouvrier, les syndicats ont réussi à faire une arme pour la défense pour la défense de l'ordre. Que voulaient les grévistes en occupant les usines ? Obtenir d'abord que la grève soit totale, manifester leur détermination en agissant massivement et donc éviter la dispersion. Utilisant habilement une limitation corporative du mouvement, se manifestant justement par le repli sur l'entreprise, les syndicats ont délibérément emprisonné les ouvriers dans l'usine, obtenant ainsi qu'un mouvement quasi-général reste finalement cloisonné. Ainsi, la rue demeurait interdite à l'ouvrier de même que le contact avec d'autres entreprises.
Cinquante ans de rupture organique avec la vague do luttes des années 20 et l'absence d'un pole révolutionnaire clair et cohérent synthétisant les acquis du passé, ont pesé très lourdement dans la balance du rapport de force.
Malgré toutes les limites de l'action du prolétariat en mai 68, cette manifestation de la vie prolétarienne a suffi à rendre caduques toutes les théories d'inspiration marcusienne. L'après-mai 68 a vu l'effritement de l'école moderniste en de multiples sectes qui ont rejoint aujourd'hui le néant de leurs élucubrations passées. Cependant les idées réactionnaires meurent difficilement et la bourgeoisie s'est efforcée, par l'intermédiaire d'une idéologie plus appropriée, de poursuivre son oeuvre de mystification. Affirmer froidement que le prolétariat était intégré au capitalisme devant des ouvriers en grève, n'avait pas beaucoup de portée. Par contre, il fallait poursuivre la tâche de démoralisation, dénaturer le cours historique do l'activité prolétarienne, rendre incompréhensible le rapport existant entre la classe ouvrière et son avant-garde.
LES CONFUSIONS D’APRES MAI
Alors que les armes fondamentales du prolétariat dans, sa lutte contre le capitalisme sont sa conscience et son organisation, alors que dans l'affrontement décisif contre le capital, la classe ouvrière se dote, comme traduction de cette double nécessité, d'une part d'une organisation générale et unitaire, les conseils ouvriers et, d'autre part, d'organisations politiques, les partis prolétariens, regroupant les éléments les plus avancés de la classe et dont la tache est de généraliser et d'approfondir le processus de prise de conscience dont ils sont une expression, on a vu apparaître et refleurir les théories de la méfiance en l'action révolutionnaire du prolétariat : le léninisme et l’autonomistes Pour ces conceptions, l'organisation politique et la classe sont deux entités indépendantes, extérieures l'une à l'autre. Le léninisme déclarant la classe "trade-unioniste" accorde la primauté au parti qui aurait pour fonction essentielle de lutter contre cette autonomie ou cette spontanéité et donc de diriger la classe. Pour les autonomistes, toute tentative d'organisation des éléments les plus conscients distincte de l'organisation unitaire de la classe, aboutit nécessairement à la constitution d'un organe extérieur à celle-ci et à ses intérêts. Henri Simon, ancien animateur d'ICO, exprimait clairement cette position dans une brochure intitulée "Le nouveau mouvement" : "L'apparition du nouveau mouvement autonome a fait évoluer la notion de parti» Le parti "dirigeant" d'hier, se définissant lui-même comme "avant-garde révolutionnaire", s'identifiait au prolétariat ; cette "fraction consciente du prolétariat" devait jouer un rôle déterminant pour élever la "conscience de classe", marque essentielle des prolétaires constitués en classe. Les héritiers modernes du parti se rendent bien compte de la difficulté de maintenir une telle position ; aussi, chargent-ils le parti ou le groupe d'une "mission" bien précise pour suppléer à ce qu'ils considèrent comme des carences des travailleurs ; d'où le développement des groupes spécialisés dans l'intervention, les liaisons, I'action exemplaire, l'explication théorique, etc. Mais même ces groupes ne peuvent plus exercer cotte fonction hiérarchique de spécialistes dans le mouvement de lutte. Le nouveau mouvement, celui des travailleurs en lutte, considère tous ces éléments, les anciens groupes comme les nouveaux, en parfaite égalité avec ses propres actions. Il prend ce qu'il peut emprunter à ce qui se présente et rejette ce qui ne lui convient pas. Théorie et pratique n'apparaissent plus qu'un seul et même élément du processus révolutionnaire ; aucune ne précède ou ne domine l'autre. Aucun groupe politique n'a donc un rôle essentiel à jouer." (Liaisons N° 26, déc. 1974).
L'autonomie de la classe ouvrière n’a rien à voir avec le rejet de la part des travailleurs des partis et organisations politiques. Elle n'a rien à voir non plus avec l'autonomie de chaque fraction de la classe ouvrière (usines, régions, quartiers, nations...) par rapport aux autres, en un mot, le fédéralisme. Contre ces conceptions, nous affirmons le caractère nécessairement unitaire, mondial et centralisé du mouvement de la classe ouvrière. De même l'effort incessant de prise do conscience de la classe ouvrière secrète des organisations politiques regroupant ses éléments les plus avancés, lesquelles sont un facteur actif dans l'approfondissement, la généralisation et l'homogénéisation de la conscience au soin de la classe. Si l'autonomie du prolétariat, c'est-à-dire son indépendance vis-à-vis dos autres classes de la société, se manifeste par son organisation propre, générale et unitaire -les conseils ouvriers- elle se manifeste également sur le plan politique et programmatique par la lutte contre les Influences idéologiques des autres classes. Les leçons d'un demi siècle d'expériences depuis la vague révolutionnaire des années 1917-23 sont claires. L'organisation unitaire de la classe ne peut exister de façon permanente qu'aux moments des luttes révolutionnaires. Elle regroupe alors l'ensemble des travailleurs et constitue l'organe de la prise du pouvoir par le prolétariat. En dehors de telles périodes, dans ses différentes luttes de résistance contre l'exploitation, les organes unitaires que se donne la classe ouvrière, les comités de grèves basés sur les assemblées générales, ne peuvent exister qu'aux moments des luttes elles-mêmes. Par contre, les organisations politiques de la classe peuvent, comme expression d'un effort constant de celle-ci vers sa prise de conscience, exister dans les différentes phases de la lutte. Leur base d'existence est nécessairement un programme élaboré et cohérent, fruit de l'ensemble de l'expérience de la classe. Cette problématique est complètement escamotée par le léninisme qui dans l'action du prolétariat ne volt qu'un moteur : le parti. Parti qui d'ailleurs, indépendamment des circonstances pourrait mettre le prolétariat en mouvement, Krivine, le leader trotskyste, résume assez bien cette vision lorsqu'il écrit : "Pour en rester l'explosion révolutionnaire de mai 68, il ne lui manqua pour réussir que l'existence d'une organisation révolutionnaire bien implantée, reconnue par la masse des travailleurs et en quoi Lénine voyait la condition subjective indispensable de la crise révolutionnaire. Une telle organisation aurait fait en sorte que toutes les luttes convergent et s'étendent. Elle aurait avancé des mots d'ordre capables de faire progresser les luttes, comme celui de la grève générale illimitée, entraînant inéluctablement des mots d'ordre de combat pour la prise du pouvoir politique. Si mai 68 n'a pas abouti, n'a été qu'un "répétition générale", c'est précisément parce qu'un tel parti n'existait pas...".
La méme idée se retrouve chez les bordiguistes du PCI qui, dans leur manifeste sur la grève générale diffusé en Juin 68, appellent le prolétariat à s'organiser sous la bannière du parti et à créer des syndicats rouges : "Il les préparera, sous la direction du parti communiste mondial, en chassant de ses propres rangs les divers prophètes du pacifisme, du réformisme, du démocratisme, en imprégnant les organisations syndicales de l'idéologie communiste pour en faire sa courroie de transmission de l'organe de direction politique, le parti..". Ces idées introduisent au niveau de la lutte du prolétariat une séparation qualitative : la lutte de classe "politique" d'une partie extérieure à la lutte "économique" d'autre part. Le passage de l'économique au politique ne pouvant s'opérer que par la médiation du parti. La lutte du prolétariat ne peut donc relever dans cette optique de l'idéologie et de l'initiative du parti. Il est donc logique pour les défenseurs de cette position que le prolétariat ne se manifeste que lorsque existe le parti : ainsi Battaglia Comunista nie le caractère prolétarien des grèves en mai-juin parce que le parti n'était pas à leur tête ! (Voir compte-rendu de la Conférence Internationale de Milan en mai 1977, p.59).
Ainsi, entre lutte de classe "économique " et "politique", entre la défense de l'intérêt de classe et la révolution, il n'y a pas de continuité, un même mouvement qui se transforme en se radicalisant, mais intermédiaire obligé du parti. Loin d'envisager le mouvement révolutionnaire comme un processus de rupture des formes de l'économie capitaliste, le léninisme les considère comme la base matérielle historique du socialisme, celui-ci est dès lors projette comme leur continuité.
Opposés à cette conception, nous réaffirmons que le prolétariat fait son histoire dans les limites imposées par le développement économique et social, dans une situation donnée, dans des conditions déterminées, mais que c'est lui qui le fait, qui la décide par sa praxis qui est le lien dialectique entre le passé et l'avenir, en même temps cause et conséquence du processus historique. Il existe donc une objectivité et une obligation d'agir pour la classe et non un quelconque mouvement idéal. La lutte pour de meilleurs conditions de travail (salaires et durée) est une nécessité immédiate pour la classe ouvrière. La lutte du prolétariat, telle que nous la comprenons, est d'abord une lutte de résistance aux effets de l'accumulation du capital, une tentative d'empêcher la dépréciation de la force de travail que le développement capitaliste entraîne avec lui. L'action de résistance contre l'exploitation du capital est bien le soutien et le moteur de l'action révolutionnaire de la classe révolutionnaire. Mais ce qui donne toute son importance à la lutte au delà de la revendication, c'est la réalité nouvelle qu'elle eut inaugurer : la résistance à l'exploitation favorisant au sein du combat de l'association qui met fin momentanément à la division, à l'atomisation, qui annule les effets de la concurrence. C'est la poursuite de cette dynamique propre à la lutte qui ouvre la voie au véritable terrain de l'affrontement qui oppose le prolétariat à la bourgeoisie et laisse apparaître le fait politique. Il convient donc de prolonger, d'étendre, d'organiser ce mouvement réel de résistance afin qu'il devienne un véritable mouvement continu vers le communisme. C'est à cela que s'attachent les organes qui naissent au sein de la classe, agissant de manière collective, provoquant l'association des travailleurs, renforçant la solidarité, élément combien important de la conscience de classe prolétarienne.
C'est dans ce processus que les révolutionnaires interviennent en clarifiant le sens de la lutte, en indiquant les buts généraux du mouvement, dépassant par là la revendication parcellaire, en participant dans la lutte à l'organisation de la classe, sous la direction des organes que celle-ci se donne, en défendant les formes d'action les plus adéquates pour étendre le mouvement. En ce sens, si les communistes sont parmi les plus décidés comme le rappelle le Manifeste Communiste, Ils remplissent aussi un rôle décisif dans la clarification qu'ils apportent au mouvement, ce qui par contre n'a rien à voir avec le pouvoir de décision, qui pour nous reste aux mains des organe unitaires de la classe. Les révolutionnaires, produits du mouvement de la classe, on tant qu'éléments les plus conscients -renforçant d'ailleurs leur conscience par le mouvement de la classe- accélère la maturation de ce mouvement par la clarification théorique.
Si de la défaite des mouvements prolétariens de la fin des années 60 et du début des années 70 la bourgeoisie a pu reprendre l’initiative au travers des syndicats et des partis de gauche et gauchistes, portant ainsi l’attention sur la "solution" de la bourgeoisie à la crise : une nouvelle guerre mondiale, il n'en reste pas moins que la classe ouvrière n'est pas battue et les mouvements de lutte qui se sont développés ces derniers temps un peu partout dans le monde, sont la résultante des perspectives ouvertes par mai 68 : la réponse de la classe ouvrière contre la crise de plus en plus aiguë du capitalisme dont l'approfondissement inéluctable conduira, au travers des périodes de flux et de reflux à la radicalisation des combats prolétariens qui déboucheront sur l'embrasement révolutionnaire.
F.D.
Géographique:
- France [135]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [136]
Approfondir:
- Mai 1968 [137]
Heritage de la Gauche Communiste:
- La lutte Proletarienne [122]
Une caricature de parti : le parti bordiguiste (réponse à "Programme Communiste")
- 4785 reads
La prise de conscience absolument indispensable à son émancipation, est un processus constant, incessant du prolétariat. Cette prise de conscience lui est dictée par son être social en tant que classe conditionnée historiquement et contenant seule la solution aux contradictions insolubles auxquelles aboutit la société capitaliste, dernière expression des sociétés divisées en classes. De même que la tâche historique d'en finir à tout jamais avec l'existence et l'antagonisme de classe qui déchirent la société humaine sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, de même la conscience de cette tâche ne saurait être "importée et inculquée" au prolétariat de l'extérieur, mais elle est le produit de son propre être, de sa propre existence, de par sa situation économique, sociale et politique dans la société qui détermine son action pratique et sa lutte historique.
La manifestation de son incessant mouvement vers la prise de conscience est donnée par son effort à s'organiser, et par la formation de groupes politiques en son sein, culminant dans la constitution du parti.
C'est à cette question, la constitution du parti que le n° 76 de mars 78 de Programme Communiste, revue théorique du PC International consacre un très long article : "Sur la voie du Parti commet et puissant de demain". On doit commencer par constater qu'avec l'emphase coutumière du langage bordiguiste, les tours et les détours à longueur de pages pour se retrouver au point de départ, l'enfoncement des portes ouvertes et les répétitions d'affirmations qui tiennent lieu d'argumentation, rendent malaisés et plus difficiles à cerner les vrais problèmes en débat. Le procédé qui consiste à démontrer une affirmation en citant ses propres affirmations de la veille, elles-mêmes fondées sur des affirmations antérieures - au point de donner le vertige - peut, à ra rigueur, prouver une continuité dans l'affirmation, mais ne jamais être la démonstration qui fonde sa validité. Dans ces conditions et malgré notre ferme désir de nous en tenir aux affirmations exprimant les positions bordiguistes concernant le parti que nous considérons erronées et à combattre, il nous serait Impossible d'éviter complètement de nous laisser entraîner, suite aux affirmations de l'article, sur bien d'autres considérations.
A PROPOS DE LA FRACTION ITALIENNE DE LA GAUCHE COMMUNISTE
Ce ne serait certainement pas le moins surprenant pour la majorité des lecteurs de Programma et probablement aussi pour la majorité des propres membres du PCI, d'apprendre brusquement que "malgré ses limites objectives (?), la "Fraction de Gauche à l'étranger" fait partie de l'histoire" ([1] [138]) de la Gauche Italienne et à ce titre devient même "notre Fraction à l'étranger entre 1928 et 1940". Sur ce point, Programma nous avait habitués plutôt à une grande réserve, un lourd silence, sinon carrément à une réprobation de ce que fut la Fraction. Comment autrement comprendre, qu'en 30 ans d'existence, le PCI, qui n'épargne ses efforts de reproduire et republier dans ses journaux, revues théoriques, brochures et livres, les textes de la Gauche de 1920-26, n'a jamais trouvé le temps, le moyen, la place de publier un seul texte de la Fraction qui avait publié le "Bulletin d'Information", la revue "Bilan", le journal "Prometeo" les bulletins "Il Semé" et tant d'autres textes ? Ce n'est tout de même pas par simple hasard qu'on ne trouvera jamais dans Programma ni référence, ni mention de positions politiques défendues par "notre" Fraction, ni jamais citation de Bilan. C'est à ce point, que certains camarades du PCI en ayant vaguement entendu parler, soutenaient que le Parti ne se revendiquait pas plus de l'activité politique de la Fraction que des écrits de Bilan, et que d'autres camarades du même Parti ignoraient jusqu'à leur nom et existence.
Aujourd'hui, on découvre "le mérite de notre Fraction", un mérite II est vrai très limité, tout juste pour lui donner un coup de chapeau. Pourquoi aujourd'hui ? Est-ce parce que le trou % dans la continuité organique (un mot si apprécié par le PCI) qui va de 1926 à… 1952, est devenu un peu gênant et qu'il fallait tenter de le boucher tant bien que mal, ou est-ce parce que le CCI en a assez parlé au point qu'il est devenu Impossible de garder plus longtemps le silence ? Et pourquoi situer la Fraction entre 1928 et 1940 alors qu'elle ne s'est dissoute -à tort - qu'en juillet 1945 pour s'intégrer dans le "Parti" enfin reconstitué en Italie, après avoir entre temps dénoncé le Comité Anti-Fasciste italien de Bruxelles et exclu son promoteur Vercesi, ce même Vercesi qui, sans discussion, sera admis dans le PCI et même dans sa direction ? Est-ce par ignorance ou parce que pendant la guerre, la Fraction est allée encore plus loin dans l'orientation dans laquelle Bilan s'était engagé avant la guerre, notamment sur la question russe, sur la question de l'Etat et du parti, ce qui forait apparaître encore plus la distance qui sépare Programma des positions défendues par la Fraction ? D'ailleurs, le "mérite" accordé à la Fraction du bout des lèvres est rapidement recouvert par des critiquées d'autant plus sévères. "L'impossibilité - écrit Programme - de briser pour ainsi dire le cercle subjectif (?!) de la contre-révolution, a conduit la Fraction à certains tâchâmes, comme par exemple dans la question nationale et coloniale, ou encore à propos do la Russie, non tant dans l'appréciation do ce qu'elle était devenue, que dans la recherche d'une vole différente de colle des bolcheviks dans l'exercice do la dictature... une vole qui empêcherait a l'avenir une répétition de la catastrophe do 1926-27; et aussi on un certain sens, dans la question du parti ou de l'Internationale... (la Fraction) attendait elle aussi cette reconstitution (du Parti) du retour en force de grandes masses sur le terrain de l'affrontement direct avec l'ennemi".
Si le fait de rester fidèles aux fondements révolutionnaires du marxisme dans une période de recul est incontestablement méritoire, le grand mérite de la Fraction, ce qui la distingue particulièrement des autres groupes de l'époque, consiste précisément dans ce que l'article de Programme appelle "les lâchages". La Fraction soutenait : "les cadres pour les nouveaux partis du Prolétariat ne peuvent sortir que de la connaissance profonde des causes des défaites. Et cette connaissance ne peut supporter aucun interdit non plus qu'aucun ostracisme." ([2] [139])
Pour des gens pour qui le programme est une donnée "achevée et invariante", qui ont transformé le marxisme en un dogme et Lénine en un prophète intouchable, le fait que la Fraction ait osé (Brrr, à vous donner froid dans le dos !) vouloir soumettre à l'examen de la réalité, non pas les fondements du marxisme, mais les positions politiques et programmatiques du parti bolchevik et de l'IC, frise les limites du tolérable. Poser dans le cadre de la théorie et du mouvement communiste que le réexamen des positions politiques qui ont présidé à des défaites "ne peut supporter aucun interdit non plus qu'aucun ostracisme", n'est-ce pas la pire hérésie, un "lâchage" di rait Programme !
Le grand mérite de la Fraction, en plus de sa fidélité au marxisme et de ses prises de position sur des questions de première importance, contre le front unique réclamé par Trotski, contre les fronts populaires, contre l'infâme mystification de l'anti-fascisme, contre la collaboration et le soutien de la guerre d'Espagne; son grand mérite est d'avoir osé rompre avec cette méthode qui avait triomphé dans le mouvement où la théorie s'est transformée en dogme et les principes en tabous étouffant toute vie politique. Son mérite est d'avoir convié les révolutionnaires aux débats, ce qui l'a menée non à des "lâchages", mais à être apte à apporter une riche et valeureuse contribution à l'oeuvre révolutionnaire.
La Fraction, avec toute sa fermeté dans ses convictions, avait cette modestie de ne pas prétendre avoir résolu tous les problèmes et répondu à toutes les questions : "Notre Fraction en abordant la publication du présent bulletin, ne croît pas pouvoir présenter des solutions définitives aux problèmes terribles qui se posent aux prolétariats de tous les pays"([3] [140]).Et même là où elle était convaincue d'avoir apporté des réponses, ni le n'exigeait pas des autres la reconnaissance, mais les soumettait à leur examen, à la confrontation, à la discussion : "Elle (la Fraction) n'entend pas se prévaloir de ses précédents politiques pour demander des adhésions aux solutions qu'elle préconise pour la situation actuelle. Bien au contraire, elle convie les révolutionnaires à soumettre à la vérification des événements, les positions qu'elle défend actuellement aussi bien que les positions politiques contenues dans ses documents de base" ([4] [141]). Et suivant le même esprit elle écrira : "Notre Fraction aurait proféré qu'une telle oeuvre (publication de Bilan) se fît par un organisme international, persuadée comme elle l'est de la nécessité de la confrontation politique entre ces groupes capables de représenter la classe prolétarienne de plusieurs pays" ([5] [142]).
Pour faire ressortir pleinement toute la distance qui sépare la vision de la Fraction en ce qui concerne les rapports devant exister entre les groupes communistes et celle du parti bordiguiste, Il suffit de mettre en parallèle la citation ci-dessus de Bilan avec cette autre de Programme Communiste, de la comparer. Ainsi, parlant de leur propre groupe bombardé du titre Parti, Programme Communiste écrit : "C'est un "noyau de Parti" ? Certainement si on le compare au parti "compact et puissant de demain". Mais c'est un parti. Il ne pourra grandir que sur ses propres bases, non pas à travers la "confrontation" (souligné igné par Programme) des points de vue, mais à travers le heurt contre ceux-là mêmes qui paraissent "proches"" ([6] [143]). Comme disait un porte-parole du PCI récemment dans une réunion publique de RI à Paris : "Nous ne venons pas pour discuter ni confronter nos points de vue avec vous mais uniquement pour exposer le notre. Nous venons à votre réunion comme nous allons dans celles du parti stalinien". Une telle attitude, une telle vision ne tient pas de la fermeté des convictions mais de la simple suffisance et de" l'arrogance. Le prétendu "programme achevé et invariant" dont les bordiguistes se disent être les héritiers et les gardiens, ne recouvre rien d'autre qu'une profonde mégalomanie.
Plus un bordiguiste est ébranlé par des doutes et des incompréhensions, moins fermes sont ses convictions et plus II lui est demandé, au sortir chaque matin du lit, de s'agenouiller la tête sur le sol, et se frappant la poitrine d'entamer la litanie à l'instar des musulmans : "Dieu, mon dieu est le seul dieu et Mohamed est son prophète" ou encore comme dirait quelque part Bordiga : "Pour être membre du Parti, il n'est pas nécessaire que chacun comprenne et soit convaincu, il suffit qu'il croit et obéisse au Parti".
Il n'est pas question de dire Ici l'histoire de ce que fut la Fraction, ses mérites et ses défauts, la validité de ses positions et de ses erreurs. Comme elle disait elle-même, elle n'a fait souvent que balbutier, maïs sa contribution était d'autant plus énorme, parce qu'elle était un corps politique vivant, osant ouvrir un débat, confronter ses positions, affrontant celles des autres et non cette secte sclérosée et mégalomane qu'est le "Parti" bordiguiste. Ce qui fait, comme on vient de le voir, que la Fraction pouvait se réclamer de la Gauche Italienne, alors que c'est un abus grossier que commet le parti bordiguiste en parlant de "notre Fraction à l'étranger".
LA CONSTITUTION OU PARTI
Le parti indispensable au prolétariat se construit sur le fondement solide d'un programme cohérent, des principes clairs, lui donnant une orientation générale, contenant les réponses les plus élaborées possibles aux problèmes politiques qui se posent à la lutte de classe. Cela n'a rien de commun avec le mythique "Programme achevé, Immuable et Invariant" des bordiguistes. "A chaque période, nous verrons que la possibilité de la constitution du parti se détermine sur la base de l'expérience précédente et des nouveaux problèmes apparus au prolétariat". ([7] [144])
Ce qui est vrai pour le programme l'est également pour les forces politiques vivantes qui constituent physiquement le parti. Le parti n'est certes pas un conglomérat de toutes sortes de groupes et de tendances politiques hétéroclites. Maïs II n'est pas non plus ce "bloc monolithique" dont se réclament les bordiguistes et qui d'ailleurs n'a jamais existé que dans leurs fantasmes. "A chaque période où les conditions sont données pour la constitution du parti, le prolétariat peut s'organiser en classe, le parti se fondera sur les deux éléments suivants : 1) la conscience de la position plus avancée que le prolétariat doit occuper, l'intelligence des nouvel les voles à emprunter) la croissante délimitation des forces pouvant agir pour la révolution prolétarienne" ([8] [145]). Ne vouloir reconnaître, par principe et a priori comme seule force agissant pour la révolution que soi, et rien que sol, relève non pas de la fermeté révolutionnaire maïs d'un esprit de secte.
Relatant les conditions dans lesquelles s'est constituée la 1ère Internationale, Engels écrit : "Après les expériences et les vicissitudes de la lutte contre le capital, après les succès et surtout après les défaites, chacun pouvait se rendre compte qu'il ne suffisait plus de vanter sa médecine favorite et qu'il convenait de rechercher une meilleure Intelligence des conditions réelles de l'émancipation ouvrière". ([9] [146])
La réalité n'a rien à voir avec ce miroir devant lequel le "Parti" bordiguiste passe le meilleur de son temps et qui ne lui renvoie que sa propre image. La réalité de la constitution du parti tout au long de l'histoire du mouvement ouvrier, se présente à la fois comme une convergence et une délimitation croissante des forces pouvant agir pour la révolution, à moins de croire qu'il n'avait jamais existé de parti autre que le parti bordiguiste. Quelques exemples : La Ligue Communiste à laquelle se joignent Marx et Engels et leurs amis est l'ancienne Ligue des Justes constituée par plusieurs groupes d'Allemagne, Suisse et France, Belgique et Angleterre avec l'élimination du courant de Weltling. La 1ère Internationale est à la fols l'élimination des socialistes à la Louis Blanc et Mazzinl et la convergence d'autres courants ; la 2ème Internationale est I'élimination dos anarchistes et le regroupement des partis marxistes sociaux-démocrates; la 3ème Internationale est l'élimination des sociaux-démocrates et regroupe les courants révolutionnaires communistes ; il en est de même pour la constitution du parti social-démocrate en Allemagne Issu du parti d'Eisenach et de celui de Lassale, de même pour le parti socialiste en France provenant du parti de Guesde et Lafargue et de celui de Jaurès; de même pour la constitution du parti social-démocrate en Russie, provenant de la convergence de groupes isolés et dispersés à travers toutes les villes et régions de Russie, et l'élimination de la tendance de Struve. On peut continuer ainsi les exemples de constitution du parti dans l'histoire, on trouvera toujours ce même mouvement, opérant à la fois sur la base de l'élimination et de la convergence. Le Parti Communiste d'Italie lui-même se constitua à partir de la Fraction Abstentionniste de Bordiga et le groupe de Gramsci après l'élimination des maximalistes de Serati.
Il n'y a pas de critères valables dans l'absolu et Identiques à toutes les périodes. Toute la question est de savoir dans chaque période distinguer clairement quels sont les critères politiques pour la convergence des forces et quels sont les critères pour la délimitation. C'est précisément cela que le "Parti" bordiguiste ne sait pas, lui qui s'est constitué sans critères , par l'amalgame des forces : du parti constitué dans le nord, des groupes du sud avec des relents de partisans, de la tendance de Vercesi au Comité Anti-Fasciste de Bruxelles, de la minorité exclue de la Fraction en 1936 pour sa participation dans les milices républicaines pendant la guerre d'Espagne et de la Fraction dissoute prématurément en 1945. Comme on volt, Programme Communiste (PC) est particulièrement bien placé pour parler d'Intransigeance, de continuité organique et donner des leçons de ferme té et de pureté révolutionnaires. Dans le dénigrement de tout effort de confrontation et de débats entre les groupes révolutionnaires communistes, il ne s'agit nullement de fermeté de principes ni même de myopie politique, mais tout simplement du souci de défense et de sauvegarde de sa petite chapelle.
D'ailleurs, cette "terrible" Intransigeance purement verbale des bordigulstes contre toute "confrontation" et à fortiori regroupement, déclaré d'avance et hors de tout critère comme une entreprise de confusion, varie (excusez pour l'Invariance) selon le jour et leurs propres convenances. C'est ainsi qu'en 1949, Ils lancent un "appel pour la réorganisation internationale du mouvement révolutionnaire marxiste", appel repris en 1952 et Î957, où on peut lire : "En accord avec la position marxiste… les communistes de la Gauche Italienne adressent aujourd'hui un appel aux groupes ouvriers révolutionnaires de tous les pays pour les Inviter, en reprenant un long et difficile chemin, à accomplir un grand effort en vue de se rassembler Internationalement sur une stricte base de classe..." ([10] [147]).
Mais il est Indispensable de savoir distinguer entre le parti bordiguiste et toute autre organisation; on commettrait la plus grande erreur en croyant que ce qui est convenable pour le Parti, qui garde en exclusivité un programme achevé et Immuable, puisse être admissible pour une simple organisation mortelle de révolutionnaires. Le Parti a des raisons que la raison ne connaît pas et ne peut pas connaître. Quand les bordiguistes appellent à un "rassemblement International", c'est de l'or pur, mais quand d'autres organisations révolutionnaires appellent à une simple conférence de prise de contact et de discussion, c'est évidemment de la pire m..., du "marchandage de principes" et autre entreprise de confusion. N'est-ce pas plutôt parce que les bordiguistes se sont enfoncés aujourd'hui plus que jamais dans leur sclérose et qu'ils craignent de confronter leurs positions incertaines avec des courants révolutionnaires vivants qui existent et se développent, qu'ils préfèrent se replier sur eux-mêmes et s'Isoler ?
Il n'est pas sans Intérêt de rappeler les critères avancés dans cet appel pour le rassemblement et revendiqués à nouveau dans l'article d'aujourd’hui : "Le Parti Communiste Internationaliste propose aux camarades de tous les pays les lignes directrices suivantes :
- 1) Revendication des armes de la révolution : violence, dictature, terreur,
.- 2) Rupture complète avec la tradition des alliances de guerre, des fronts de partisans et des "libérations nationales",
- 3) Négation historique du pacifisme, du fédéralisme entre les Etats et de la "défense nationale",
- 4) Condamnation des programmes sociaux communs et des fronts politiques avec les classes non salariées,
- 5) Proclamation du caractère capitaliste de la structure sociale russe. ("Le pouvoir - l'Etat en Russie - est exercé par une coalition, hybride et complexe, des intérêts internes des classes petites-bourgeoises, semi bourgeoises et des entrepreneurs dissimulés, ainsi que des intérêts des classes capitalistes internationales" (???).
- 6) Conclusion : désaveu de tout appui au militarisme impérial russe, défaitisme catégorique contre celui de I'Amérique."
Nous venons de citer les six têtes de chapitres eux-mêmes accompagnes de commentaires les développant, qu'il serait trop long de reproduire ici. Il n'est pas question non plus de discuter ici en détails ces points et leur formulation qui peuvent laisser à désirer, notamment sur la terreur prise comme principe et arme fondamentale de la révolution ([11] [148]) ou cette subtile nuance dans la conclusion entre l'attitude à avoir face l'Amérique (défaitisme) et la Russie (désaveu) ou encore cette curieuse (c'est le moins qu'on puisse dire définition du Pouvoir en Russie qui ne serait pas tout bonnement du capitalisme d'Etat mais une "coalition hybride de classes petites-bourgeoises... et des intérêts capitalistes internationaux". On pourrait également signaler l'absence explicite d'autres points parmi ces critères, notamment la revendication du caractère prolétarien d'Octobre ou encore la nécessité du Parti de classe. Ce qui nous intéresse ici, c'est de souligner que ces critères constituent effectivement une base sérieuse sinon pour un "rassemblement" immédiat, du moins pour une prise de contact et de discussion entre des groupes révolutionnaires existants. Cette démarche est celle qu'a poursuivie la Fraction autrefois, celle que nous poursuivons aujourd'hui, celle qui a présidé à la Rencontre Internationale de Milan, l'année dernière. Mais les bordiguistes dans les éclipses de leur invariance, n'ont plus besoin aujourd'hui parce qu'ils ont constitué déjà le Parti ("minuscule mais un Parti" quand même !).
Mais cet appel a été déjà signé en son temps par le PCI, demanderont les lecteurs naïfs ? Oui mais, ce n'était encore que le Parti Communiste Internationaliste et pas encore le P.C International, nuance !. Mais ce P.C International faisait partie intégrante du P.C internationaliste d'alors, et il prétend même avoir été sa majorité ? "Oui mais", nous répond-on, il était en train de parachever sa constitution, nuance ! Mais il revendique cet Appel comme texte du Parti d'aujourd'hui ? "Oui... mais", mals-mêe-mêe-mêê-mêe….
A propos, et en passant, peut-on savoir une bonne fois pour toutes, depuis quand existe ce "vaillant minuscule parti" ? Il est de mode aujourd'hui - on ne sait pas trop pourquoi - d'affirmer que le Parti a été constitué seulement en 1952 et l'article cité plus haut, Insiste sur cette date ([12] [149]). Cependant, on cite dans l'article cité plus haut des "textes fondamentaux" de 1946 - la plate-forme date, elle, de 1945, d'autres textes aussi fondamentaux de 1948-49-51. Ces textes en question, aussi "fondamentaux" les uns que les autres, émanaient de qui au juste ? D'un Parti, d'un groupe, d'une fraction, d'un noyau, d'un embryon ?
En réalité, le PCI se constitue en 1943 après la chute de Mussolini dans le nord de l'Italie. Il se "reconstitue" une deuxième fois en 1945, à la suite de la "libération" du nord de l'occupation allemande, permettant aux groupes qui se sont constitués entre temps dans le sud de s'intégrer, s'unifier avec l'organisation existante dans le nord. C'est pour s'intégrer à ce Parti que la Fraction Italienne de la Gauche Communiste se prononce dans sa quasi unanimité pour sa propre dissolution. Cette dissolution ainsi que la proclamation de la constitution du Parti provoqueront des discussions et polémiques acharnées dans la GCI, ce qui conduira en France à une scission dans la Fraction Française de la Gauche Communiste où seule une minorité adhérera à cette politique et se séparera de la majorité. Celle-ci se prononcera contre la dissolution précipitée de la Fraction Italienne, condamnera catégoriquement et publiquement comme artificielle et volontariste la proclamation du Parti en Italie et elle mettra en relief l'opportunisme qui a servi de base politique à ce nouveau Parti ([13] [150]). Fin 1945 se tient le 1er Congrès de ce Parti (PCI) qui publie une plate-forme politique et nomme une direction centrale du Parti et un Bureau International composé des représentants du PCI et des Fractions française et belge. L'article de Programma se réfère lui-même à "Eléments d'orientation marxiste, notre texte de 1946". En 1948, nous avons de nouveau des textes programmatiques du Parti et ainsi de suite. En 1951, éclate la première crise au sein de ce Parti, qui va se terminer en une scission en deux PCI, chacun revendiquant être la continuité de l'ancien Parti, ce à quoi Programa n'a jamais renoncé.
Aujourd'hui, on Invente une nouvelle date de la constitution du Parti bordiguiste. Pourquoi ? Est-ce parce que ce n'est qu'en 1951 que "notre courant a pu atteindre cette conscience critique, grâce à la continuité de sa bataille pour défendre une "ligne vraiment générale et non occasionnelle", ce qui lui a permis de se "constituer en conscience critique organisée, en corps militant agissant en Parti" ([14] [151]) Mais où étaient donc les bordiguistes avec Bordiga entre 1943/45 et 1951 ? Que devient dans tout ceci le Programme qui reste toujours invariable depuis 1848, l'avalent-ils égaré durant ces années et n'avaient-ils "pu (ainsi) atteindre cette conscience critique" qui leur a permis de constituer le Parti en 1951 ? Mais, n'étaient-ils pas organisés depuis 1943/45 en tant que membres et membres dirigeants du PCI ? Difficile, très difficile de discuter sur une question aussi grave avec des gens qui confondent tous les termes, qui ne savent distinguer et faire la différence entre le moment de la gestation et celui de la naissance - qui ne savent pas ce qu'ils sont eux-mêmes et à quel stade ils sont, qui se disent le "Parti" tout en clamant la nécessité de la constitution du Parti, comment prendre au sérieux dos gens qui, selon les convenances du jour exhibent des actes de naissance datant de 1943, de 1945 ou en encore de 1952 ou bien à une date encore moins déterminée, dans le futur !
Il en est de la date de la constitution du PCI comme il en est pour la "Fraction’’ Gauche à l'étranger, on s'en revendique ou on les rejette selon les convenances du jour. Mais quoiqu'il en soit de la date, pour ce qui est la constitution du Parti "nous pouvons dire d'emblée que ce n'est pas porté par un mouvement ascendant mais au contraire en le précédant de loin". Voilà qui semble clair. La constitution du Parti n'est en rien conditionnée par un mouvement ascendant de la lutte de classe "mais, au contraire le précède de loin". Maïs, à quoi rime cet empressement d’ajouter aussitôt qu'il s'agit de "préparer le véritable Parti... préparer le Parti compact et puissant que nous ne sommes pas encore". En somme un Parti qui.... prépare le Parti ! En d'autres mots, un Parti qui n'en est pas un ! Mais pourquoi ce parti qui possède un programme achevé et invariant, qui a aussi atteint la conscience critique nécessaire et organisée, pourquoi n'est-il pas le "véritable parti" ? Que lui manque t'il donc pour l'être ? Certes, ce n'est pas une question de nombre de militants, mais en écrivant que le "Parti en construction" reconnaissait qu'il était "en train de naître" et non pas achevé justement (parce que) le Parti de classe est toujours en construction depuis son apparition jusqu'à sa disparition" (souligné dans le texte) ([15] [152]), on ne fait visiblement que jongler avec des mots pour mieux esquiver la réponse demandée en même temps qu'on escamote la question elle-même. Une chose est de dire que l'ovulation est une condition d'une future naissance, autre chose est de prétendre que l'ovulation est l'acte de naissance, le fait même de donner le jour à un être vivant. L'originalité géniale de "Programme" consiste à les identifier à faire de deux choses, une seule et même chose. Avec un tel raisonnement spécieux, on peut démontrer n'Importe quoi et mettre facilement Paris en bouteille. Le besoin d'un développement et d'un renforcement constant d'un parti vraiment existant, ne prouve pas son existence déjà comme le besoin de développement et renforcement de l'enfant ne prouve pas que l'ovule est déjà un enfant, mais seulement que dans certaines conditions précises, il peut le devenir. Les problèmes qui se posent à 'un diffèrent grandement de ceux qui se posent à l'autre.
Toute cette sophistique sur le Parti existant par sa construction constante, et la construction constante par le Parti déjà existant est là pour introduire subrepticement cette autre théorie bordiguiste du Parti réel et du Parti formel. Autre sophisme où le Parti réel est un pur fantôme "historique" qui n'a pas nécessairement d'existence dans la réalité et le Parti formel qui existe lui effectivement dans la réalité mais qui ne l'exprime pas forcément. Dans la dialectique bordiguiste, le mouvement n'est pas un état de la matière et donc une chose matérielle mais une force métaphysique qui crée la matière. Ainsi, la phrase du Manifeste Communiste "la constitution du prolétariat en classe, donc en Parti" devient dans la démarche bordiguiste "la constitution du Parti fait du prolétariat une classe", ce qui mène à ces conclusions doubles et contradictoires mais relevant également de la scolastique : ou l'affirmation - contrairement à toute évidence -d'un Parti qui n'aurait jamais cessé d'exister depuis son apparition (disons depuis Babeuf et les chartistes) ou partant de la constatation évidente de non existence du Parti pendant de longues périodes dans l'histoire, conclure à la disparition momentanée ou définitive de la classe (Vercesi, Camatte). La seule, constance du bordiguisme est de se mouvoir constamment d'un bout à l'autre dans ce cadre de la démarche scolastique.
On pourrait peut-être pour plus de clarté poser la question d'une autre façon. Les bordiguistes définissent le Parti comme une doctrine, un programme et une capacité d'intervention pratique, une volonté d'action. Cette définition quelque peu sommaire du Parti est aujourd'hui complétée par cet autre postulat : l'existence du Parti n'est pas liée mais doit au contraire être absolument indépendante des conditions d'une période donnée. Or de ces deux bases qui fondent le Parti : programme et volonté d'action, le premier, le programme, nous dit-on, est achevé et invariant depuis le Manifeste Communiste de 1848. Nous nous trouvons ici devant une contradiction évidente : le Programme en tant qu'essence du Parti, lui, est achevé mais le Parti en tant que matérialisation du Programme, lui, est en perpétuelle constitution ! Plus que cela, même, Il disparaît purement et simplement. Comment cela et pourquoi ?
La Ligue Communiste se dissout et disparaît en 1852. Pourquoi ? Les fondateurs du Programme, Marx et Engels, ont-ils perdu le Programme ? On pourrait peut-être invoquer contre eux la perte d'une volonté d'action, en se référant à la scission opérée par eux contre la minorité (Willitch-Schapper} de la Ligue et leur dénonciation de l'activisme volontariste de cette minorité. Mais ce se serait aller ainsi d'une absurdité à une absurdité encore plus grande ? Que reste t'il alors d'autre pour expliquer cette dissolution qui - n'en déplaise aux bordiguistes - provient d'un profond changement intervenu dans la situation ? Engels, qui sait de quoi il parle, explique, en ces termes, la disparition de la Ligue : "L'écrasement de l'insurrection parisienne de Juin 1848 - la première grande bataille entre le prolétariat et la bourgeoisie - fit passer à l'arrière plan, de nouveau, et pour un temps, les aspirations sociales et politiques de la classe ouvrière européenne.... La classe ouvrière fut réduite à lutter pour avoir, politiquement les coudées franches et à occuper une position à l'extrême gauche de la bourgeoisie radicale. Là où les mouvements prolétariens indépendants ont continué à se manifester, ils ont été impitoyablement écrasés... Sitôt la sentence (du procès des communistes de Cologne - octobre 1852) prononcée, la Ligue fut formellement dissoute par les membres qui subsistaient". ([16] [153]).
Cette explication ne semble pas convaincre nos bordiguistes qui d'ailleurs doivent la trouver complètement superflue, étant donné que pour eux le Parti ne s'est jamais dissout réellement puisqu'il continuait à exister en la personne de Marx et Engels. Pour l'affirmer, ils citent par référence une boutade extraite d'une lettre de Marx à Engels, et comme chaque fois que cola leur convient, ils transforment un mot, un bout de phrase et même une boutade dans une lettre, en vérité absolue, en un principe Invariant et Immuable. ([17] [154]). S’est-il passé quelque chose du point de vue de I'existence du Parti entre la dissolution de la Ligue en 1352 et la naissance de l'Internationale on 1864 ? Pour les bordiguistes, absolument rien; le programme restait Invariant, la volonté d'action était présente, Marx et Engels étaient là et le Parti avec eux. Rien, rien de trop important ne s'était passé, mais telle ne semble pas être l'opinion d'Engels qui écrit : "Lorsque la classe ouvrière européenne eut recouvré assez de forces pour une nouvelle attaque contre la classe dominante, naquit l'Association Internationale des TravaiIleurs".([18] [155]).
Quand Programme écrit dans son article : "Le parti révolutionnaire marxiste n'est pas le produit du mouvement sous son aspect immédiat, c'est-a-dire des phases de montée et de reflux", il ne fait, par incompréhension ou intentionnellement, que fausser le débat en introduisant ce petit mot de produit - souligné dans le texte - . Certes, le besoin d'un parti ne résulte pas de situations particulières mais de la situation générale historique de la classe (ceci s'apprend dans le cours élémentaire du marxisme et II n'y a vraiment pas de quoi se vanter de ces hautes connaissances). La controverse ne porte pas là-dessus mais si son existence effective est liée ou non aux vicissitudes de la lutte de classe, si des conditions spécifiques sont encore nécessaires pour que les révolutionnaires puissent effectivement - et non en paroles - assumer les fonctions qu'il incombe au Parti d'effectuer. Il ne suffit pas de dire qu'un enfant est un produit humain pour conclure que, de ce fait, les conditions nécessaires à sa vie - air pour respirer, alimentation pour se nourrir, soins en général - lui sont automatiquement donnés, et sans ces conditions, l'enfant est irrémédiablement condamné à dépérir. Le parti est une intervention efficace, un impact grandissant, une influence effective dans la lutte de classe et cela n'est possible que sous la condition que les luttes de la classe suivent une courbe ascendante. C'est là ce qui différencie le Parti et son existence réelle de la Fraction ou du groupe. C'est aussi ce que le PCI n'a pas encore compris et ne veut pas comprendre.
La Ligue des Communistes se constitue avec la montée de la lutte de classe annonçant la vague de luttes révolutionnaires de 1848, de même, comme nous l'avons vu avec Engels, cette même Ligue disparaît avec les défaites et les reflux de la lutte Ceci est un fait non épisodique mais général, vérifiable tout au long du mouvement ouvrier et II ne saurait en être autrement. La 1ère Internationale "naquit lorsque la classe ouvrière eut recouvre assez de force pour une nouvelle attaque contre la classe dominante" (Engels). Et nous pouvons pleinement souscrire aux paroles du Rapporteur du Conseil Général au premier Congrès de l'Internationale répondant aux attaques de la presse bourgeoise : "Ce n'est pas l'Internationale qui déclenche les grèves des ouvriers, mais ce sont les grèves des ouvriers qui donnent cette force à l'Internationale". A son tour, tout comme ce fut le cas pour la Ligue des Communistes, l'Internationale ne survivra pas longtemps à la défaite sanglante de la Commune de Paris et succombera peu après, et cela en dépit de la présence en son coin de Marx et Engels et du "programme achevé et invariant".
C'est en vain que l'article, pour démontrer le contraire de ce que nous venons de constater, recourt à la "vérification pratique. .. qu'il existe des aires entières où se sont déroulées des luttes sociales d'une extraordinaire vigueur (telle l'Angleterre ou l'Amérique du Nord) où le Parti n'a même pas existé". Voilà un argument qui ne prouve rien, sinon qu'il fait le constat qu'il n'y a pas un lien mécanique entre les luttes de la classe et la sécrétion d'un parti en son sein, ou encore qu'il existe d'autres facteurs qui contrecarrent le processus de la constitution du parti; qu'il existe en général un décalage entre les conditions objectives et les conditions subjectives entre l'être existant et sa prise de conscience. Pour que l'argument ait quelque validité, il aurait fallu nous citer le contraire, à savoir des exemples où le parti s'est constitué en dehors de pays et de périodes de montée de la lutte de classe du prolétariat. Il n'en existe pas. A moins de nous citer pour unique exemple (ne parlons pas de la IVème Internationale des trotskystes) celui du PCI. Mais là c'est une autre histoire, l'histoire de la grenouille qui voulait être aussi grosse que le boeuf. Le PCI n'a jamais été un parti autrement qu'en paroles.
Avec les exemples de la Ligue Communiste et de la 1ère Internationale, les exemples de la naissance de la 2ème Internationale et sa mort Infâme, et encore plus la constitution de la 3ème Internationale et sa fin ignoble, devenue stalinienne, sont là pour nous convaincre définitivement de la validité de la thèse défendue par la Fraction Italienne et dont nous nous revendiquons intégralement, à savoir de l'impossibilité de la constitution du parti dans une période de reflux de la lutte de classe ([19] [156]). Toute autre, naturellement, est la vision de Programme : la reconstitution du parti de classe devait se faire "avant que le prolétariat ne remonte de l'abîme où il était lui aussi tombé. Il faut ajouter que cette renaissance devait nécessairement comme c'est toujours le cas, précéder cette remontée du prolétariat ([20] [157])."
On comprend que l'article se réfère avec insistance au "Que Faire" de Lénine, surtout à la partie traitant de la conscience trade-unioniste de la classe ouvrière. Car, à bien regarder ce que sous-entend tout le raisonnement de l'article, n'est pas tant dans la surestimation du rôle du parti et leur propre tendance à la mégalomanie maïs est donné surtout par une criante sous-estimation de la capacité de prise de conscience de la classe, une profonde méfiance à son égard et pour tout dire un mépris à peine voilé de la classe ouvrière et de sa capacité de compréhension.: "S'il ("le futur scientifiquement prévu par le Parti") est certain et inéluctable pour nous matérialistes, ce n'est pas en fonction d'un "mûrissement" au sein de la classe de la conscience de sa mission historique, mais parce qu'elle sera poussée par des déterminations objectives, avant de le savoir, sans le savoir à lutter pour le communisme...([21] [158])".
C'est tout au long de l'article qu'on trouve ces compliments méprisants pour la classé ouvrière : une masse brute et abrutie qui agit sans savoir ni comprendre, mais heureusement dirigée par un parti qui comprend tout et est toute compréhension. Qu'il nous soit permis de juxtaposer à cet étouffant mépris le jugement, Ô combien aéré du vieux Engels : "Pour la victoire ultime des principes énonces dans le Manifeste, Marx se fiait uniquement au développement Intellectuel de la classe ouvrière, tel qu'il devait résulter nécessairement de l'action et de la discussion communes ([22] [159])".
Tout commentaire serait superflu. Poursuivons. Dans la vision bordiguiste, la reconstitution du Parti - complètement détachée des conditions concrètes - exige la maturité théorique et la volonté d'action. Aussi I'article porte le jugement suivant sur la Fraction : "Si elle (la Fraction) n'a pas encore été le Parti mais seulement son prélude, ce n’est pas faute d'activité pratique mais plutôt à cause de l'insuffisance du travail théorique." C'est un jugement et il vaut ce qu'il vaut. Mais qu'entend l'article au juste par suffisance du travail théorique ? La restauration, la réappropriation, la conservation du programme achevé et invariant ? Surtout sans remise en examen des positions du passé, sans recherche de réponses à des problèmes nouveaux. C'est surtout ce travail que 'article reproche à la Fraction et qu'il considère comme des lâchages graves. Ces conservateurs de musée qui ont hissé à hauteur d'idéal leur propre stérilité, voudraient faire croire que Lénine, tout comme eux, n'a jamais rien fait d'autre que "restaurer" la théorie achevée de Marx. Peut-être voudraient-ils méditer sur ce que Lénine a dit à propos de la théorie ? "Nous autres, nous ne considérons absolument pas !a théorie de Marx comme quelque chose d'achevé et d'intouchable. Nous sommes convaincus, au contraire, que cette théorie ne fait que placer les pierres angulaires de la science que les socialistes doivent (souligné par Lénine) impulser dans tous les sens, s'ils ne veulent pas rester en dehors de la vie ([23] [160])". L'article d'où est tirée cette citation s'intitule précisément "Notre Programme".
Et comment nos pontifes en marxisme mesurent-ils le degré de maturité théorique ? Existe-t-il de telles mesures fixes ? Les mesures, pour ne pas être arbitraires doivent aussi être mesurées et il n'y a pas de meilleure façon de le faire que de vérifier cette maturité théorique dans sa traduction en des positions politiques qu'on défend.
Si c'est là le moyen de mesurer la maturité et si celle-ci est le principal critère pour la constitution du Parti, nous pouvons calmement mais avec toute la conviction nécessaire dire que ce n'est pas en 1943, ni en 45 ni surtout en 52 que les bordiguistes auraient dû construire le Parti, mais ils auraient avantageusement dû attendre l'an 2000. Tout le monde y aurait gagné et eux les premiers.
Comment se constituera le Parti compact et puissant de demain, on ne peut pas encore le dire mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le PCI ne l'est pas. Le drame du bordiguisme est de vouloir être ce qu'il n'est pas : le Parti et de ne pas vouloir être ce qu'il est : un groupe politique. Ainsi, il n'accomplit pas -sauf en paroles les fonctions du parti qu'il ne peut accomplir et n'assume pas les tâches, mesquines à ces yeux, d'un vrai groupe politique. Quant à sa maturité politique, à en juger par ses positions, et au rythme où vont les choses, il risque fort de ne jamais y arriver car à chaque pas en avant, il fait deux ou trois pas en arrière.
MX
[1] [161] Programme Communiste n°76, p.5.
[2] [162] Bilan n°1, Introduction p.3.
[3] [163] Idem
[4] [164] Idem
[5] [165] Idem
[6] [166] Programme Communiste n°76, p.14.
[7] [167] Bilan n°1, p.15.
[8] [168] Idem
[9] [169] Engels : "Préface à l'édition anglaise du Manifeste Communiste" 1888.
[10] [170] Programme Communiste n°18 et 19 de l'édition française.
[11] [171] Voir notre article "Terreur, terrorisme et Violence de classe" dans ce même numéro de la Revue où ce sujet est amplement développé.
[12] [172] "Le Prolétaire" n°264 du 8/21 avril est plus explicite encore quand il écrit "...ses thèses caractéristiques de 1951 qui constituent son acte de naissance et ses bases d'adhésion".
[13] [173] Voir "L'Etincelle" et "Internationalisme", publications de la Gauche Communiste en France jusqu'à 1952.
[14] [174] "Sur la Vole du Parti Compact et Puissant de Demain".
[15] [175] Idem
[16] [176] Engels : "Préface à l'édition anglaise du Manifeste Communiste".
[17] [177] Il est largement temps de mettre fin à cet incroyable abus que certains font de citations, leur faisant dire n’importe quoi. Ceci est particulièrement vrai pour les bordiguistes en ce qui concerne l'idée du Parti chez Marx. Peut-être ne serait-ce pas inutile de citer à leur attention et soumettre à leur réflexion en vue d'expliquer cette phrase quelque peu surprenante et énigmatique du Manifeste Communiste : "Les communistes ne forment pas un parti distinct en face des autres partis ouvriers".
[18] [178] Engels : "Préface à l'édition anglaise du Manifeste Communiste".
[19] [179] On sait d'ailleurs que Bordlga était plus que récalcitrant à la proclamation de la constitution du Parti et qu'il a cédé à contrecœur à la pression exercée sur lui de tous côtés, pour s'y associer. Vercesi, à son tour, ne tardera pas longtemps pour remettre publiquement en question la constitution du Parti. Mais le vin était tiré, il ne restait plus qu'à le. boire. On trouvera l'écho de ses réticences dans "l'avant-projet de déclaration de principe pour le Bureau International de la (nouvelle) Gauche Communiste Internationale" qu'il rédige et publie en Belgique à la fin de l'année 1946; on peut y lire : "Le processus de transformation de Fractions en Partis a été déterminé dans ses grandes lignes par la Gauche Communiste selon le schéma qui affirme que le parti ne peut apparaître que lorsque les ouvriers ont commencé des mouvements de lutte qui livrent la matière première pour la prise du pouvoir", (naître que lorsque les ouvriers ont commence des mouvements de lutte qui livrent la matière première pour la prise du pouvoir", (cité dans Programa).
[20] [180] Même article et souligné dans l'original.
[21] [181] Idem, p.17
[22] [182] Engels : "Préface à la réédition allemande du Manifeste Communiste", 1er mai 1890.
[23] [183] Lénine. Article écrit en 1894 pub Mo-en 1925. Œuvres complètes p.190. Traduit de l'édition en espagnol.
Courants politiques:
- Bordiguisme [184]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 15 - 4e trimestre 1978
- 3031 reads
Le cours historique (1978)
- 3124 reads
Comment le CCI peut-il parler d'intensification des antagonismes inter-impérialistes aujourd'hui, tout en affirmant par ailleurs que la société bourgeoise est entrée dans une période de montée des luttes de classe depuis la fin des années 60 ? N'y a-t-il pas une contradiction entre les mises en garde contre un danger de guerre en Afrique, au Moyen-Orient, et l'analyse selon laquelle un nouveau cours vers la lutte prolétarienne et vers une confrontation décisive entre les classes s'est ouvert avec la crise économique ? Vivons-nous une nouvelle version des années 30 avec à l'horizon inéluctablement la guerre généralisée, ou sommes-nous devant la perspective révolutionnaire ?
Cette question revêt une importance capitale. Tout au contraire de la pensée paresseuse, molle, des spectateurs sociaux, la pensée révolutionnaire, dynamique, ne peut pas se contenter d'"un peu de ceci" et "un peu de cela" mélangés dans une sauce sociologique sans lignes directrices. Si le marxisme ne nous apportait qu'une analyse du passé pour nous offrir pour aujourd'hui un simple "on verra bien", nous n'en aurions pas besoin.
L'action sociale, la lutte, exige la compréhension des forces en présence, exige une perspective. L'action du prolétariat diffère selon sa conscience de la réalité sociale à laquelle il s'affronte et selon les possibilités offertes par le rapport des forces. L'intervention organisée des révolutionnaires dans ce processus de prise de conscience de la classe s'oriente différemment également, sinon dans son contenu profond, du moins dans son expression, selon la réponse donnée à la question "allons-nous vers la guerre, ou allons-nous vers une confrontation révolutionnaire ?".
La théorie marxiste n'est pas la lettre morte des bourreaux staliniens ou des académiciens mais reste l'effort le plus cohérent d'exprimer théoriquement l'existence et l'expérience du prolétariat dans la société bourgeoise. C'est dans le cadre du marxisme, et non seulement de sa réappropriation mais aussi de son actualisation, que les révolutionnaires peuvent et doivent répondre à la question du rapport de forces entre la bourgeoisie et le prolétariat aujourd'hui, entre la guerre et la révolution.
La Période Historique de la Société Bourgeoise
En premier lieu, la perspective pour les luttes n'est pas une simple question immédiate de jours ou d'années, mais suppose tout un développement historique. Le mode de production capitaliste, au cours de son développement, en détruisant les bases matérielles, économiques du féodalisme et d'autres sociétés précapitalistes, a étendu ses rapports de production et le marché capitaliste à toute la planète. Bien que le capitalisme aspire à être un système universel, il se heurte à des contradictions économiques internes à son propre fonctionnement basé sur l'exploitation et la concurrence. A partir de la création effective du marché mondial et du développement des forces productives, le capitalisme ne peut plus surmonter ses crises cycliques par une extension de son champ d'accumulation, il entre dans une période de déchirement interne, une période de déclin en tant que système historique, ne répondant plus aux besoins de la reproduction sociale. Le système le plus dynamique de l'histoire jusqu'à nos jours déchaîne dans sa décadence un véritable cannibalisme.
La décadence du capitalisme est marquée par l'épanouissement des contradictions inhérentes à sa nature, par une crise permanente. La crise trouve deux forces sociales antagoniques en présence, la bourgeoisie, classe du capital, vivant de la plus-value, et le prolétariat dont les intérêts de classe exploitée, en le poussant à s'opposer à son exploitation, mènent à la seule possibilité historique de dépassement de l'exploitation, de la concurrence, de la production de marchandises : une société de producteurs librement associés.
La crise agit sur ces deux forces historiquement antagoniques de façon différente : elle pousse la bourgeoisie vers la guerre et le prolétariat vers la lutte contre la dégradation de ses conditions d'existence. Avec la crise, la bourgeoisie est obligée de se retrancher derrière la force concertée des Etats nationaux pour pouvoir se défendre dans la concurrence effrénée d'un marché mondial déjà divisé entre puissances impérialistes et qui ne peut s'étendre davantage. La guerre impérialiste mondiale est le seul aboutissement de la concurrence reportée au niveau international. Pour pouvoir survivre, le capitalisme subit les déformations de son dernier stade : l'impérialisme généralisé. La tendance universelle du capitalisme décadent vers le capitalisme d'Etat n'est rien d'autre que l'expression "organisationnelle" des exigences des antagonismes impérialistes. Le mouvement vers la concentration du capital qui s'exprime déjà à la fin du XIXème siècle par des trusts, cartels et ensuite des multinationales se voit contrecarré et dépassé par la tendance vers l'étatisation qui ne répond pas à une "rationalisation" du capital mais aux besoins de renforcer et mobiliser le capital national dans une économie de guerre quasi permanente, un totalitarisme étatique dans tous les domaines de la société. La décadence du capitalisme, c'est la guerre, le massacre constant, la guerre de tous contre tous.
Contrairement au siècle passé où la bourgeoisie se renforçait en développant sa domination sur la société, elle est aujourd'hui une classe déclinante, affaiblie par la crise de son système, assurant seulement guerres et destructions comme conséquences de ses contradictions économiques.
A défaut d'une intervention prolétarienne victorieuse dans une révolution mondiale, la bourgeoisie n'a pas une "stabilité", une attente patiente à nous offrir mais au contraire un cycle de destructions chaque fois plus étendu. La classe capitaliste n'a pas d'unité ni de paix en son sein, mais l'antagonisme et la concurrence issus des rapports marchands d'une société d'exploitation. Déjà, dans la période ascendante du développement capitaliste, les révolutionnaires se sont opposés à l'idée réformiste de Kautsky, de Hilferding, selon laquelle le capitalisme pourrait évoluer vers une unité supra-nationale. La gauche socialiste et Lénine dans "L'impérialisme, Stade Suprême du Capitalisme", ont dénoncé cette chimère d'une unification mondiale du capital. Bien que les forces productives tendent à pousser dans le sens d'un dépassement du cadre national étriqué, elles n'y parviennent jamais parce que soumises au carcan des rapports capitalistes.
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, une nouvelle variante de cette théorie de supra-nationalité a été développée par Socialisme ou Barbarie pour qui une "nouvelle société bureaucratique" tendrait à créer cette unification mondiale. Mais la "société bureaucratique" n'existe pas ; la tendance générale vers l'étatisation du capital n'est ni un nouveau mode de production, ni un pas progressif vers le socialisme comme ont pu le croire certains éléments du mouvement ouvrier en la voyant se développer dans la première guerre mondiale. Etant l'expression de 1'exacerbation des rivalités entre fractions nationales du capital, le capitalisme d'Etat ne réalise aucune unité, au contraire. Le capital national est obligé de se regrouper autour des grandes puissances dans des blocs impérialistes mais ceci non seulement n'élimine pas les rivalités au sein d'un bloc, mais surtout reporte et accentue davantage les antagonismes au niveau international dans la confrontation et la guerre entre les blocs. Ce n'est que pour faire face à son ennemi mortel, le prolétariat en lutte, que la classe capitaliste peut réaliser une quelconque unité internationale provisoire.
Face à la menace du prolétariat, dans l'incapacité de répondre aux exploités par une réelle amélioration de leurs conditions de vie, mais au contraire contrainte d'exiger une exploitation plus féroce et une mobilisation pour la guerre économique et ensuite militaire, face à l'usure de ses capacités de mystification, la bourgeoisie développe un Etat policier hypertrophié, met en place tout un appareil de répression allant des syndicats jusqu'aux camps de concentration, pour pouvoir dominer une société en décomposition. Mais tout comme les guerres mondiales expriment la décomposition du système économique, le renforcement de l'appareil répressif de l'Etat montre la faiblesse réelle de la bourgeoisie face aux échéances de l'histoire. La crise du système sape les bases matérielles et idéologiques du pouvoir de la classe dominante et ne lui laisse que l'acharnement du massacre.
Contrairement à l'effondrement de la bourgeoisie dans la barbarie sanglante de son déclin, le prolétariat à l'époque de la décadence, représente la seule force dynamique de la société. L'initiative historique est avec le prolétariat; c'est lui seul qui porte la solution historique qui peut faire avancer la société. Par sa lutte de classe, il peut freiner et enfin arrêter la barbarie constante de la décadence capitaliste. En posant la question de la révolution, en "transformant la guerre impérialiste en guerre civile", le prolétariat oblige la bourgeoisie à répondre sur le terrain de la guerre des classes.
Quelle Perspective aujourd'hui?
Si nous avons posé la question de savoir si au cours d'une période de montée des luttes il peut y avoir l'expression et même l'aggravation des antagonismes impérialistes, nous sommes alors en mesure de répondre. Le propre de la bourgeoisie est la tendance vers la guerre, qu'elle en soit consciente ou non. Même quand elle se prépare pour affronter le prolétariat, les antagonismes impérialistes existent toujours; ils dépendent de l'approfondissement de la crise et ne trouvent pas leur source dans l'action de 1a classe ouvrière. Mais le capitalisme ne peut aller jusqu'au bout, à la guerre généralisée, qu'à la condition d'avoir au préalable maté le prolétariat et l'avoir embrigadé dans la mobilisation. Sans cela, l'impérialisme ne peut pas aboutir à sa fin logique.
En effet, entre l'éclatement de la crise en 29 et la seconde guerre mondiale, il a fallu dix ans, non seulement pour remettre en place une économie de guerre suffisante pour les besoins de destruction, mais pour achever l'écrasement physique et le désarmement idéologique de la classe ouvrière embrigadée dans les partis "ouvriers", staliniens et social-démocrates, derrière la bannière de 1'antifascisme ou dans les rangs du fascisme, dans l'union sacrée. De même, avant août 14, c'est tout un processus de dégénérescence de la deuxième Internationale et de collaboration des classes qui a préparé le terrain de la trahison des organisations ouvrières. La guerre mondiale n'éclate pas tel l'éclair dans un ciel bleu, mais à la suite de l'élimination effective de la résistance prolétarienne.
Si la lutte de classe est suffisamment forte, l'aboutissement dans la guerre généralisée n'est pas possible; si la lutte s'affaiblit à travers1a défaite physique ou idéologique du prolétariat, alors la voie est ouverte à l'expression de la tendance inhérente au capitalisme décadent : la guerre mondiale. Par la suite, ce n'est qu'au cours même de la guerre, comme réponse aux conditions de vie insoutenables, que le prolétariat peut reprendre le chemin de sa conscience et resurgir dans la lutte. Il ne faut pas se leurrer: on ne peut pas prétendre "faire la révolution contre la guerre", faire la grève générale au jour "J", face à l'ordre de mobilisation. Si la guerre est sur le point d'éclater, c'est justement parce que la lutte de classe a été trop faible pour freiner la bourgeoisie, et alors il ne s'agit pas de bercer le prolétariat d'illusions.
Aujourd'hui, les ouvriers ne sauraient négliger la gravité des manifestations des rivalités impérialistes et de l'enjeu du rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat. Si la deuxième guerre mondiale n'est qu'une continuité de la première et si la troisième est la continuité de la deuxième, si le capitalisme, tel un match de boxe, ne vit les périodes de "reconstruction" que comme intervalles entre les guerres, la capacité destructive actuelle nous laisse peu d'espoir d'une quelconque possibilité de surgissement du prolétariat au cours d'un troisièime holocauste. Il est fort probable que la destruction serait telle que la nécessité et la possibilité du socialisme seraient écartées avec la destruction de la majeure partie du globe. L'enjeu se joue donc aujourd'hui et non pas demain ; c'est face à une période de crise économique que surgira la classe ouvrière et non face à une guerre. Seul le prolétariat peut freiner, par sa lutte sur son terrain de classe contre la crise et la dégradation de ses conditions de vie, la tendance constante de la bourgeoisie vers la guerre. C'est aujourd'hui seulement que le rapport prolétariat/bourgeoisie décidera entre le socialisme ou la chute définitive dans la barbarie.
Si nous signalons donc la gravité des affrontements entre les blocs aujourd'hui, c'est pour mieux démasquer la réalité hideuse du système capitaliste que 60 années de souffrances nous ont enseignées. Mais cette mise en garde générale et nécessaire ne signifie nullement qu'aujourd'hui la perspective est vers la guerre mondiale ou que nous vivions une période de contre-révolution triomphante. Au contraire, les rapports de forces ont basculé en faveur du prolétariat. Les nouvelles générations ouvrières n'ont pas subi les défaites des précédentes. La dislocation du bloc "socialiste" ainsi que les insurrections ouvrières dans le bloc de l'Est ont énormément affaibli le pouvoir mystificateur de l'idéologie bourgeoise stalinienne. Fascisme et anti-fascisme sont bien trop usés pour servir et l'idéologie des "droits de l'homme" sous le capitalisme, démentie du Nicaragua à l'Iran, ne suffit pas pour les remplacer. La crise, fin de la prospérité trompeuse de la reconstruction d'après-guerre, a provoqué un réveil général du prolétariat. La vague de 1968 à 1974 a été une puissante riposte aux débuts de la crise et la combativité ouvrière n'a épargné aucun pays. C'est cette renaissance de la combativité ouvrière qui marque la fin de la contre-révolution et qui constitue la pierre angulaire de la perspective révolutionnaire aujourd'hui.
Il n'y a jamais de situation sociale unilatérale simpliste ; les antagonismes inter-impérialistes ne disparaissent pas tant que le système capitaliste est en vie. Mais la combativité ouvrière est un obstacle, le seul aujourd'hui, à la tendance vers la guerre. Quand il y a un creux dans les luttes, le frein n'agit pas suffisamment sur la vitesse et les antagonismes inter-impérialistes s'aggravent. C'est pour cela que les révolutionnaires insistent tant sur les développements de la lutte autonome de la classe ouvrière, sur les grèves sauvages qui tendent à dépasser le carcan syndical, sur la tendance vers l'auto-organisation de la classe, sur la combativité face à l'austérité et contre les sacrifices qu'exige la bourgeoisie.
La crise, en une ligne droite toujours descendante, amène la classe capitaliste en décomposition à la guerre. Par contre, elle pousse en des explosions sporadiques, en dents de scie, la classe révolutionnaire à la lutte. Le cours historique est la résultante de ces deux tendances antagoniques : guerre ou révolution.
Bien que le socialisme soit une nécessité historique face à la décadence de la société bourgeoise, la révolution socialiste n'est pas à chaque moment une possibilité concrète. Pendant les longues années de la contre-révolution, le prolétariat était défait, sa conscience et son organisation trop faibles pour être une force autonome dans la société en face de la destruction.
Aujourd'hui, par contre, le cours historique est à la montée des luttes prolétariennes. Mais le temps joue ; il n'y a jamais de fatalité dans l'histoire. Un cours historique n'est pas "stable", acquis pour toujours ; le cours vers la révolution prolétarienne est une possibilité qui s'ouvre, un mûrissement des conditions qui mène à la confrontation des classes. Mais si le prolétariat ne développe pas sa combativité, ne s'arme pas à travers la conscience forgée dans les luttes et par la contribution des révolutionnaires en son sein, il ne pourra pas répondre à ce mûrissement par son activité créatrice et révolutionnaire. Si le prolétariat est battu, s'il retombe dans la passivité à la suite d'un écrasement, alors le cours sera renversé et le potentiel de guerre généralisée toujours présent se réalisera.
Aujourd'hui le cours est vers la montée. Parce que la classe ouvrière n'est pas battue, parce qu'elle résiste à la dégradation de ses conditions de vie partout dans le monde, parce que la crise économique internationale aggrave l'usure de l'idéologie bourgeoise et donc son poids sur la classe, parce que la classe ouvrière est la force de la vie contre le "viva la muerte" de la contre-révolution sanglante, pour toutes ces raisons, nous faisons un "salut à la crise" qui ouvre pour une deuxième fois dans la période de décadence la porte de l'histoire.
J.A.
« Les contradictions du régime capitaliste se sont transformées pour l'humanité, par suite de la guerre, en souffrances inhumaines : faim, froid, épidémies, barbarie morale. La vieille querelle académique des socialistes sur la théorie de la paupérisation et le passage progressif du capitalisme au socialisme a été ainsi définitivement tranchée. Les statisticiens et les pédants de la théorie de l'aplanissement des contradictions se sont efforcés pendant des années de rechercher dans tous les coins du monde, des faits réels ou imaginaires permettant de prouver l'amélioration de certains groupes ou catégories de la classe ouvrière. On admit que la théorie de la paupérisation était enterrée sous les sifflements méprisants des eunuques qui occupent les chaires universitaires bourgeoises et des bonzes de l'opportunisme socialiste. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la paupérisation sociale, mais aussi la paupérisation physiologique, biologique dans toute sa réalité hideuse, qui se présente à nous.
La catastrophe de la guerre impérialiste a balayé toutes les conquêtes de la lutte syndicale et parlementaire. Et pourtant, cette guerre est née des tendances internes du capitalisme tout comme ces marchandages économiques et ces compromis parlementaires qu'elle a noyés dans le sang et la boue.
Le capital financier, qui a précipité l'humanité dans l'abîme de la guerre, a lui-même subi des modifications catastrophiques au cours de la guerre. Les liens de dépendance où se trouvait le papier-monnaie par rapport aux fondements matériels de la production ont été complètement rompus. (...) Si la subordination totale du pouvoir d'Etat à la puissance du capital financier a conduit l'humanité à la boucherie impérialiste, cette boucherie a permis au capital financier, non seulement de militariser complètement l'Etat, mais aussi de se militariser lui-même, si bien qu'il ne peut plus remplir ses fonctions économiques essentielles que par le fer et le sang. Les opportunistes qui, avant la guerre, incitaient les ouvriers à modérer leurs revendications au nom du passage progressif au socialisme, qui exigèrent pendant la guerre l'humiliation de classe et la soumission de classe du prolétariat au nom de l'union sacrée et de la défense de la patrie, demandent encore au prolétariat de nouveaux sacrifices et abnégations afin de surmonter les effroyables conséquences de la guerre. Si de tels prêches trouvaient audience au sein de la classe ouvrière, le développement capitaliste poursuivrait son redressement sur les cadavres de plusieurs générations avec des formes nouvelles encore plus concentrées et plus monstrueuses, avec la perspective d'une nouvelle et inévitable guerre mondiale. »
Manifeste de l'Internationale Communiste aux prolétaires du monde entier
Premier Congrès : 6 mars 1919
Courants politiques:
- Gauche Communiste [112]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Le cours historique [187]
Heritage de la Gauche Communiste:
L'État dans la période de transition
- 3136 reads
La "Revue Internationale" du CCI a abordé à plusieurs reprises la question de la période de transition du capitalisme au communisme. Elle a publié plus d'une dizaine de textes dans lesquels est évoqué en particulier le problème posé par les rapports entre la dictature du prolétariat et l'Etat dans la période de transition. L'idée d'une non-identité entre ces deux notions, telle qu'elle apparaît dans les textes suivants : "Problèmes de la période de transition" et "La révolution prolétarienne" (n°1), "La période de transition" et "Contribution à l'étude de la question de l'Etat" (n°6), "Présentation des projets de résolution du 2ème Congrès de R.I." et "La Gauche Communiste en Russie" (n°8) "Les confusions politiques de la C.W.O." (n°10) "Projet de résolution sur la période de transition au 2ème Congrès du CCI." et "L'Etat et la dictature du prolétariat" (n°11) y cette idée donc a souvent été considérée comme scandaleuse et "absolument étrangère au marxisme" par nombre d'éléments révolutionnaires qui s'empressent de brandir la citation célèbre de Marx, tirée de sa "Critique du Programme de Gotha", suivant laquelle, durant la période de transition "l'Etat ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat".
Le texte qui suit est une nouvelle contribution sur cette question. Il se propose en particulier d'établir que cette non-identité entre Etat et dictature du prolétariat n'est en rien "anti-marxiste" mais qu'au contraire, au delà de sa réfutation de certaines formules de Marx et Engels, elle s'inscrit parfaitement dans toute la démarche du marxisme.
NATURE ET FONCTION DE L'ETAT
Au cœur de la théorie de l'Etat de Marx, se trouve la notion du dépérissement de l'Etat.
Dans sa critique de la philosophie de l'Etat de Hegel, avec laquelle débute sa vie de penseur et militant révolutionnaire, Marx combat non seulement l'idéalisme de Hegel selon lequel le point de départ de tout le mouvement serait l'Idée (faisant partout "de l'Idée le sujet, et du sujet réel proprement dit, le prédicat") (), mais dénonce avec véhémence les conclusions de cette philosophie, qui fait de l'Etat le médiateur entre l'homme social et l'homme universel politique, le réconciliateur du déchirement entre l'homme privé et l'homme universel. Hegel constatant l'opposition conflictuelle croissante entre la société civile et l'Etat, veut que la solution à cette contradiction soit trouvée dans l'auto limitation de la société civile et son intégration volontaire dans l'Etat, car disait-il "c'est seulement dans l'Etat que l'homme a une existence conforme à la raison" et "tout ce que l'homme est, il le doit à l'Etat, c'est là que son être réside. Toute sa valeur, toute sa réalité spirituelle, il ne les a que par l'Etat". () A cette délirante valorisation de l'Etat qui fait de Hegel son plus grand apologiste, Marx oppose : "L'émancipation humaine n'est réalisée que lorsque l'homme a reconnu et organisé ses forces propres comme force sociale et ne sépare donc plus de lui la force sociale sous la forme de la force politique" (), c'est à dire de l'Etat.
D'emblée, la finalité, c'est-à-dire la prise de position face et contre l'Etat, produit, manifestation et facteur actif de l'aliénation de l'humanité sera présente dans l'oeuvre d'élaboration théorique de Marx. Au renforcement de l'Etat et de son absorption de la société civile de Hegel, Marx opposera résolument le dépérissement de l'Etat comme synonyme de la marche vers l'émancipation de l'humanité, et cette notion fondamentale sera reprise, enrichie, développée tout au long de sa vie et de son oeuvre.
Cette opposition radicale à l'Etat et l'annonce de son dépérissement possible et inévitable ne sont pas un produit du génie personnel de Marx, encore qu'elles trouvent chez lui une analyse rigoureuse et une démonstration des plus cohérentes. C'est dans la réalité de l'époque que ces problématiques sont présentes et c'est dans cette même réalité que les premiers germes de la réponse commencent à s'ébaucher dans l'apparition et la lutte d'une classe historique nouvelle : le prolétariat. Aussi grands qu'aient pu être sa contribution et son mérite, Marx ne faisait que rendre théoriquement saisissable le mouvement du prolétariat qui se déroulait dans la réalité.
En même temps qu'il combattait l'idéalisme et l'apologie de l'Etat de Hegel, Marx rejetait également toutes les théories "rationalistes" qui cherchaient à fonder l'Etat sur la "raison critique" ou encore celles qui, de Stirner à Bakounine, le condamnaient au nom d'un principe moral.
Produit historique du développement des forces productives et de la division du travail -qui font éclater l'ancienne société communiste primitive- la nouvelle société fondée sur la propriété privée et sa division en classes antagoniques fait nécessairement surgir cette institution super-structurelle qu'est l'Etat.
Manifestation d'une situation historique où la société est entrée dans un état de contradictions et d'antagonismes irréductibles (), l'Etat est en même temps l'institution indispensable pour maintenir une certaine cohésion, un ordre social, pour empêcher la société de se détruire complètement dans des luttes stériles et pour imposer par la force aux classes exploitées la soumission à cet ordre. Cet ordre, c'est la domination économique d'une classe exploiteuse dans la société dont l'Etat est le gardien, et c'est à travers lui que la classe exploiteuse économiquement dominante accède à la domination politique de la société. L'Etat, est donc toujours l'émanation des classes exploiteuses et, en règle générale, de la classe économiquement et immédiatement prédominante, dont il tire son origine et dont une fraction se spécialise dans la fonction étatique.
De ce que nous venons de dire découle que la fonction fondamentale de L’Etat est d'être le gardien de l'ordre économique établi.
Quand de nouvelles classes exploiteuses surgissent représentant les nouvelles forces productives qui se sont développées au sein de la société au point d'entrer en contradiction avec les rapports de production existants et exigent leur changement, c'est à l'Etat qu'elles se heurtent, à l'Etat représentant le dernier rempart de l'ancienne société. La dynamique révolutionnaire se trouve toujours dans la société civile, dans les nouvelles classes qui ont surgi, mais jamais dans l'Etat comme tel. Il est donc principalement un instrument de conservation sociale. Dire que l'Etat est tantôt conservateur, tantôt révolutionnaire selon l'état de la classe qui le domine, mettre sur le même plan ces deux moments, en faire un parallèle, c'est escamoter le problème de ce qui constitue le caractère fondamental de l'Etat, sa fonction essentielle. Même quand la classe révolutionnaire a conquis par la force l'Etat et, en le reconstruisant, l'adapte à ses besoins et intérêts, cela ne change pas la nature essentiellement conservatrice de L’Etat, ni ne lui donne une nouvelle nature révolutionnaire. Et cela pour la double raison :
- que le nouvel Etat n'est que le résultat, l'aboutissement d'un bouleversement qui a déjà eu lieu ailleurs dans la structure économique de la société et dont le nouvel Etat ne fait qu'enregistrer et consacrer le fait ;
- que, sitôt surgi, le nouvel Etat a pour fonction fondamentale, non pas tant de se débarrasser des vestiges des anciennes classes déjà défaites, mais surtout de défendre le nouvel ordre social contre la menace des nouvelles classes exploitées, et pour leur sujétion. Il importe de ne pas prendre les lueurs apparentes de L’Etat pour la réalité de sa nature profonde.
D'aucuns, se référant à tel ou tel acte ou évènement sporadique, qui s'est produit surtout durant les moments de crises sociales et de révolutions, croient pouvoir affirmer une double nature de L’Etat, conservatrice et révolutionnaire à la fois. On a cité ainsi en exemple les actes de la Convention et la Terreur dirigés contre l'aristocratie féodale, la guerre intérieure et extérieure durant les années de la Révolution Française, l'appui apporté à certains moments à la bourgeoisie par la monarchie en France et également la politique de Pierre le Grand en Russie, etc. A ces objections, on veut opposer plusieurs remarques :
1) "Les exceptions ne font que confirmer la règle".
2) On ne peut voir et comprendre le cours de l'histoire et ses lois fondamentales avec des lunettes événementielles - comme on ne mesure pas les distances entre les galaxies avec un centimètre.
3) Il n'est pas dans notre propos d'étudier et de donner une explication détaillée de chaque événement pris à part, (cela serait de la phénoménologie) mais d'expliquer leur enchaînement global, de dégager de celui-ci les lois et le sens général.
4) Nous étudions ici l’Etat dans l'histoire, et non l'histoire de l’Etat. Nous n'étudions pas chaque moment, chaque jour de son existence, mais son existence même qui correspond à une ère historique bien déterminée et limitée : l'ère de la société divisée en classes. Pendant toute cette ère historique, L’Etat a pour fonction fondamentale de maintenir l’ordre social existant. Maintenir, entretenir, garder sont autant d'ex-pressions pour dire conserver en opposition à celle de créer. C'est le sens passif opposé au sens actif, le statique opposé au dynamique.
5) Contre qui L’Etat doit-il assurer la défense de l'ordre existant ? Qui, quelles forces menacent cet ordre social ? () Réponse possible : les anciennes classes dominantes.
Ces anciennes classes ont été déchues et vaincues avant tout dans le domaine économique. La révolution ne fait que consacrer et non déterminer cette déchéance. C'est pourquoi les marxistes pouvaient parler des révolutions politiques dans cette ère, comme des "révolutions de palais", la véritable transformation s'étant déjà opérée dans les entrailles de la société, dans sa profonde réalité et structure économique.
Autre constatation importante : ce n'est jamais à partir de L’Etat existant que se déclenche le mouvement de la révolution, mais la révolution, même politique, se déclenche de la société civile contre L’Etat. Et cela, parce que ce n'est pas L’Etat qui révolutionne la société mais la société révolutionnée qui modifie et adapte l'Etat.
Le nouvel Etat surgi après l'événement qu'est la révolution, peut se livrer à quelques actes spectaculaires contre les membres de l'ancienne classe dominante, mais cela ne va jamais très loin, ni longtemps. L'ancienne classe continue à subsister et ses membres continuent I occuper longtemps une place importante dans l'appareil de L’Etat et souvent une place prépondérante. C'est la preuve que l'ancienne classe dominante ne présente pas cette menace que l’on prétend décisive et contre laquelle s'opérerait le renforcement du nouvel Etat, ce qui ferait de lui une nature révolutionnaire. Ceci est une énorme surestimation largement démentie par l'histoire.
La menace fondamentale de l'ordre existant ne vient pas des classes déchues mais des classes opprimées et des nouvelles classes historiques montantes. Ce sont elles qui, les premières de façon constante, les secondes potentiellement, présentent cette menace mortelle contre laquelle l'ordre existant a besoin de L’Etat, cette force concentrée de coercition et de répression pour sa défense.
L'Etat n'est pas tant un barrage contre le passé qu'un barrage contre l'avenir. C'est cela qui fait de sa défense du présent (conservatisme) un parent plus proche du passé (réactionnaire) que de l'avenir (révolutionnaire). Dans ce sens, on peut dire que si les classes sont représentantes des forces productives en développement, L’Etat, lui, est le défenseur des rapports de production. La dynamique historique vient toujours des premières, les entraves des seconds.
6) Pour ce qui est des exemples du rôle prétendument progressif, voire révolutionnaire, joué par la Monarchie française, Pierre le Grand, etc., il est évident que l'Etat est amené à accomplir des actes progressifs, non parce que c'est inhérent à sa nature progressive, mais malgré sa nature conservatrice, sous la pression des nouvelles forces progressives, car il ne peut se soustraire complètement aux pressions venues des la société civile.
C'est un fait que la suppression du servage et le développement de l'industrialisation capitaliste en Russie se sont faits sous le régime des tsars, de même que l'industrialisation en Allemagne sous celui des Junkers prussiens et en France sous le Bonapartisme. Cela ne fait pas de ces régimes et Etats des forces révolutionnaires ; les deux derniers, celui d'Allemagne et de France, étaient même directement issus de la contre-révolution de 1848-52.
7) Quant à l'argument de la double nature de l'Etat -contre-révolutionnaire et révolutionnaire à la fois- il n'est guère plus sérieux que celui avancé pour la défense des syndicats qui, à côté de leur nature bourgeoise auraient aussi une nature ouvrière du fait qu'en telle ou telle occasion ils prennent la défense de tel ou tel ouvrier. A ce titre, on pourrait aussi bien parler de la double nature des CRS, puisque de temps en temps, ils sauvent quelques personnes de la noyade. A croire que chaque fois que l'on essaie de raisonner et qu'on ne sait pas raisonner, on a naturellement recours à l'argument de la "double nature".
Ces quelques remarques n'ajoutent rien de substantiel , mais s'imposent pour montrer l'inanité des objections et rendent peut-être plus précise notre pensée sur la nature et fonction conservatrice de l'Etat.
Il importe ici de prendre garde et de ne pas -en se complaisant dans la confusion et l'éclectisme : l'Etat est aussi conservateur que révolutionnaire- renverser les données et ouvrir la porte qui mène directement à l'erreur de Hegel faisant de l'Etat le Sujet du mouvement de la société.
La thèse de la nature conservatrice de l'Etat, et avant tout de sa propre conservation, est dialectiquement et étroitement liée à cette autre thèse qui lui fait face, celle que l'émancipation de l'humanité s'identifie au dépérissement de l'Etat. L'une met en lumière l'autre. En escamotant ou en mettant en sourdine la première, c'est la théorie et la réalisation du nécessaire dépérissement de l'Etat que l'on obscurcit et que l'on atteint gravement.
La non-compréhension de la notion de la nature conservatrice de l'Etat doit inévitablement trouver son pendant dans la non-insistance sur la notion marxiste fondamentale du dépérissement de l'Etat. Ses implications ne manqueront pas de s'avérer d'autant plus dangereuses.
Ce qui est encore plus important et qui nous intéresse au premier chef est de faire ressortir que l'Etat -pas plus le nouveau que l'ancien n'est jamais et ne peut jamais être par définition le porteur du mouvement de dépérissement de l'Etat. Or nous avons vu que la théorie de l'Etat de Marx identifie les mouvements de dépérissement de l'Etat à celui de l'émancipation de l'humanité et, puisque l'Etat ne porte pas en lui son propre dépérissement, il s'ensuit que de par sa nature même, il ne saurait jamais être le moteur ni même l'instrument de l'émancipation humaine.
La théorie de l'Etat de Marx met encore en évidence la tendance inhérente de l'Etat et "de la fraction de la classe dominante qu'il groupe et qui se constitue en un corps à part de se "libérer" (Je la société civile, de s'en séparer, de se hisser au-dessus de la société" (Engels). Sans jamais y parvenir complètement et tout en continuant de défendre les intérêts généraux de la classe dominante, cette tendance est cependant une réalité et ouvre la voie à de nouvelles contradictions, antagonismes et aliénations que Hegel avait déjà vus et signalés et que Marx a repris : avant tout l'opposition croissante entre l'Etat et la société civile avec toutes ses implications. Cette tendance explique à son tour les multiples perturbations sociales, les convulsions dans la classe dominante elle-même, les différentes variétés de formes d'Etat existant dans une même société donnée et leurs rapports particuliers avec l'ensemble de la société. Cette tendance à se rendre indépendant de la société fait de l'autoconservation une préoccupation majeure de l'Etat et vient renforcer encore sa nature conservatrice.
Avec le développement, au travers de la succession des sociétés, de la division de la société en classes, se renforce et se développe l'Etat, poussant ses tentacules dans toutes les sphères de la vie sociale. Sa masse numérique croît proportionnellement. L'entretien de cette énorme masse parasitaire se fait par un prélèvement croissant sur la production sociale. Par le truchement des impôts directs ou indirects -qu'il prélève non seulement des revenus des masses travailleuses mais également sur les profits des capitalistes- l'Etat entre en conflit d'intérêt même avec sa propre classe qui réclame bien un Etat fort, mais qui soit en même temps bon marché. Pour les hommes de l'appareil d'Etat, cette hostilité extérieure et leurs intérêts aidant déterminent un réflexe de défense et de solidarité, un esprit de corps qui les soudent en une véritable caste à part.
De tous les champs d'activité de l'Etat, la coercition et l'oppression lui appartiennent en propre. Il dispose pour cela en exclusivité de la force armée. La coercition et l'oppression sont la raison d'être de l'Etat, son être même. Il en est le produit spécifique et les reproduit sans cesse en les amplifiant et en les perfectionnant. La complicité dans les massacres et la terreur constituent ainsi le plus solide ciment de son unité.
Avec le capitalisme est atteint le point culminant de toute la longue histoire des sociétés divisées en classes. Si ce long parcours historique imprégné de sang et de souffrances fut le tribut inévitable que l'humanité eut à payer pour développer ses forces productives, ces dernières ont atteint aujourd'hui un développement tel qu'elles rendent caduque ce type de société mais que sa survivance même est devenue la plus grande entrave à leur développement ultérieur et va jusqu'à mettre en danger l'existence même de l'humanité.
Avec le capitalisme, l'exploitation et l'oppression ont été poussées au paroxysme car le capitalisme est le résumé condensé de toutes les sociétés d'exploitation de l'homme par l'homme qui se sont succédées. L'Etat, dans le capitalisme a enfin achevé sa destinée en devenant ce monstre hideux et sanglant que nous connaissons aujourd'hui. Avec le capitalisme d'Etat, il a réalisé l'absorption de la société civile, il est devenu le gérant de l'économie, le patron de la production, le maître absolu et incontesté de tous les membres de la société, de leur vie et de leurs activités déchaînant la terreur, semant la mort et présidant à la barbarie généralisée.
LA REVOLUTION PROLETARIENNE
La révolution prolétarienne diffère radicalement de toutes les révolutions antérieures dans l'histoire. Si toutes les révolutions ont eu en commun d'être déterminées et d'exprimer la révolte des forces productives contre les rapports de production de l'ordre existant, celles qui sous-tendent la révolution prolétarienne expriment non simplement un développement quantitatif, mais posent la nécessité d'un changement qualitatif fondamental du cours de l'histoire. Toutes les anciennes modifications intervenues dans le développement des forces productives demeurent contenues dans l'ère historique de la pénurie qui pose l'inéluctabilité de l'exploitation de la force de travail. Les changements qu'elles opèrent ne sont pas en vue d'une diminution mais au contraire en vue d'une plus grande exploitation, d'une exploitation plus rationnelle, plus efficace des masses toujours plus nombreuses de la population. Elles assurent une expropriation plus poussée de celles-ci d'avec les instruments de travail et du produit de leur travail.
Dans le mouvement dialectique de l'histoire humaine, ces modifications appartiennent ensemble à une seule et même période, celle de la négation de la communauté humaine, celle de l'anti-thèse. Cette unité fondamentale fait que les différentes sociétés qui se succèdent dans cette ère, se présentent quelles que puissent être leurs différences, comme une progression dans la continuité. Sans cette continuité on ne saurait comprendre ni expliquer des événements aussi contradictoires qu'incompréhensibles à première vue comme :
- la longue survivance sociale des anciennes classes et le rôle actif qu'elles continuent à jouer dans la nouvelle société.
- la possibilité qu'a la nouvelle classe triomphante d'incorporer l'ancienne classe vaincue et de collaborer avec elle.
- la possibilité pour les nouvelles classes dominantes de maintenir ou de reprendre des modes d'exploitation contre lesquels elles ont depuis longtemps combattu et triomphé : par exemple, le trafic d'esclaves assuré et défendu par l'Angleterre capitaliste jusque dans la deuxième moitié du I9ème siècle.
- les alliances de fractions de la bourgeoisie avec la noblesse et contre sa propre classe.
- le soutien militaire de l'Angleterre bourgeoise à la Vendée féodale contre la révolution bourgeoise en France. L'alliance militaire de l'Angleterre bourgeoise avec tous les pays féodaux contre la bourgeoisie dominante en France. La longue alliance de la même Angleterre avec le régime ultraréactionnaire du tsarisme et le soutien à ce régime. L’appui apporté par ce premier et plus développé pays capitaliste au Sud esclavagiste dans la guerre de Sécession aux USA contre le Nord de la bourgeoisie industrielle et progressiste.
C'est ce qui explique que les révolutions dans cette ère se présentent comme de simples transferts de la machine d'Etat d'une classe exploiteuse à une autre classe exploiteuse et que très souvent les transformations sociales s'opèrent même sans révolution politique.
Il en est tout autrement en ce qui concerne la révolution prolétarienne. En effet, elle n'est pas en continuité des solutions aux problèmes posés par la pénurie, mais la fin de la pénurie des forces productives : à elle ne se pose pas le problème de comment rendre plus efficaces l'exploitation mais celui de la supprimer, non pas de comment assurer le renforcement de l'oppression mais de la détruire à jamais. Elle n'est pas la continuité de la Négation mais la négation de la négation et la restauration de la communauté humaine sur un nouveau plan plus élevé. La révolution prolétarienne ne saurait reproduire les caractéristiques des révolutions antérieures comme celles dont nous venons de citer quelques exemples, parce qu'elle est en rupture totale, en opposition radicale avec elles et cela aussi bien dans son contenu que dans ses formes et moyens.
Une des caractéristiques fondamentales de la révolution prolétarienne est - en opposition avec les révolutions antérieures et compte-tenu du degré atteint par le développement des forces productives - que les transformations nécessaires ne peuvent plus s'opérer avec un long décalage de pays à pays mais exigent d'emblée comme théâtre d'opération le monde entier. La révolution prolétarienne est internationale ou n'est pas. Commencée dans un pays, elle n'a de cesse que de s'étendre à tous les pays ou de succomber à plus ou moins brève échéance. Les autres révolutions étaient l'oeuvre des classes minoritaires et exploiteuses contre la majorité des classes travailleuses, la révolution prolétarienne est celle de l'immense majorité des exploités contre une minorité. Etant l'émancipation de l'immense majorité dans l'intérêt de l'immense majorité, elle ne peut se réaliser que par la participation active et constante de l'immense majorité. Elle ne peut en aucune façon prendre les anciennes révolutions pour modèle puisqu'elle est en tout point l'opposé.
Elle est appelée à bouleverser de fond en comble toutes les structures, tous les rapports existants en commençant par la destruction totale des superstructures de l'Etat. A l'encontre des révolutions antérieures qui ne viennent qu' achever la domination économique de la nouvelle classe, la Révolution du prolétariat - une classe qui n'a aucune assise économique - est le premier acte politique ouvrant et assurant par la violence révolutionnaire, le processus de la totale transformation sociale.
LA DICTATURE du PROLETARIAT
Comme il est mis en évidence dans le "Manifeste Communiste", la bourgeoisie n'a pas seulement créé les conditions matérielles de la révolution mais elle a également engendré la classe qui sera son fossoyeur, le sujet de la révolution : le prolétariat. Le prolétariat est le porteur de cette révolution radicale, parce qu'il constitue "une classe avec des chaînes radicales", une classe qui est "la négation de la société", qui selon les termes de Marx, incarne toutes les souffrances de la société, à qui on n'a pas fait un tort particulier mais "un tort en soi", une classe qui n'a rien à perdre que ses chaînes et qui ne saurait s'émanciper sans émanciper l'humanité entière. C'est la classe productive et du travail associé par excellence. C'est pourquoi le prolétariat est la seule classe porteuse de la solution aux contradictions désormais insurmontables et insupportables des sociétés divisées en classes. La solution historique que porte le prolétariat est le communisme. La profondeur de ce changement historique et l'impossibilité de toute mesure dans ce sens au sein du capitalisme qui font de la révolution sa première condition, rendent également indispensable la substitution de la domination de classe capitaliste par celle du prolétariat pour assurer la marche vers le communisme. La dictature est incontestablement liée au fait de la domination mais elle est bien plus que cela. "La dictature, écrit Lénine, signifie un pouvoir illimité s'appuyant non pas sur la loi mais sur la force" (). L'idée de la force liée à la dictature n'est pas nouvelle, ce qui nous paraît plus intéressant est la première partie de cette phrase qui contient l'idée d'un "pouvoir illimité". Lénine insistera beaucoup.".Ce pouvoir ne reconnaît aucun autre pouvoir, aucune loi, aucune norme d'où qu'ils viennent".() Particulièrement intéressant est cet autre passage où il fait ressortir l'idée de la dictature du prolétariat, dans un sens plus large que la simple force -."Cette question est posée habituellement par ceux qui rencontrent pour la première fois le mot dictature dans une acceptation nouvelle pour eux. Les gens sont habitués à ne voir que le pouvoir policier et la dictature policière. Il leur semble étrange qu'il puisse exister un pouvoir sans aucune police, qu'il puisse y avoir une dictature qui ne soit pas policière".() C'est le pouvoir des soviets tant exalté par Lénine et qui a créé "... de nouveaux organes du pouvoir révolutionnaire : soviets d'ouvriers, de soldats, de cheminots, de paysans; nouvelles autorités à la ville et à la campagne, "et qui ne s'appuyaient ni sur la "force des baïonnettes" ni sur celle du "commissariat de police" et n'avait rien de commun avec les vieux instruments de la force."() Cette dictature n'est-elle pas également fondée sur la force et la coercition ? Bien sûr que oui, mais ce qui importe est de savoir distinguer sa qualité nouvelle. Alors que la dictature des anciennes classes est essentiellement dirigée contre l'avenir, contre l'émancipation humaine, la dictature du prolétariat est "celle du peuple à l'égard de l'oppression exercée par les organes policiers et autres de l'ancien pouvoir". C'est pourquoi elle peut et doit s'appuyer sur autre chose que la simple force :
"Le nouveau pouvoir, dictature de l'immense majorité, pouvait se maintenir et se maintient exclusivement à l'aide de la confiance des larges masses, exclusivement en invitant de la façon la plus libre, la plus large et la plus forte toute la masse à participer au pouvoir. Rien de caché, rien de secret, aucun règlement, aucune formalité... c'est un pouvoir qui s'offre à la vue de tous, qui fait tout sous les yeux des masses, accessible à la masse, issu directement de la masse, c'est l'organe direct et sans intermédiaire de la masse populaire et de sa volonté". ()
Nous avons ici, non pas la description de la société communiste, dans laquelle n'existe plus aucun problème de pouvoir, mais de la période révolutionnaire où la question du pouvoir occupe une place centrale. C'est de ce pouvoir de la dictature du prolétariat dont il est question. Nous trouvons là, sous la plume de Lénine ce qu'est et doit être la dictature du prolétariat et nous retrouvons là l'essence même de la notion marxiste du dépérissement de l'Etat. C'est dans le même sens qu'Engels pouvait écrire : "Vous voulez savoir, Messieurs ce qu'est la dictature du prolétariat, regardez la Commune".
La dictature du prolétariat c'est le pouvoir illimité de la classe d'exercer librement et pleinement ses activités créatrices, c'est sa prise en charge "sans intermédiaire" de sa destinée et ce celle de la société toute entière, entraînant derrière lui les autres classes et couches travailleuses. Ce pouvoir, le prolétariat ne peut le déléguer â aucune formation particulière sans se saborder et renoncer à son émancipation car "l'émancipation du prolétariat ne peut être que l'oeuvre du prolétariat lui-même".
La classe capitaliste ainsi que les autres classes exploiteuses dans l'histoire, unies dans le but de l'exploitation, sont elles-mêmes divisées en fractions hostiles les unes aux autres, avec des intérêts divergents, et ne peuvent trouver leur unité que dans le règne d'une fraction particulière, celle qui assume la fonction de l'Etat. Le prolétariat ne connait pas en son sein d'intérêts divergents et hostiles. Son unité, il la trouve dans son but : le communisme et dans son organisation unitaire de classe : les conseils ouvriers. C'est de lui-même et en lui-même qu'il tire son unité et sa force. Sa conscience lui est dictée par son existence. Il n'y a aucune médiation entre son être et sa conscience. Le processus de sa prise de conscience se manifeste par l'apparition, en son sein, de courants de pensées et d'organisations politiques. Ceux-ci peuvent être parfois les porteurs d'idéologie de classes étrangères à lui ou bien les manifestations extrêmement importantes et précieuses d'une véritable prise de conscience de ses intérêts historiques. Le Parti communiste représente assurément la fraction la plus consciente de la classe, mais ne peut jamais prétendre être la classe elle-même, ni la remplacer dans l'accomplissement de ses tâches historiques. Aucun parti, ni même le Parti communiste ne peut réclamer un "droit" de direction, ni un pouvoir particulier de décision dans la classe. Le pouvoir de décision est l'attribut exclusif de l'organisation unitaire de la classe et de ses organes élus et révocables, un pouvoir qui ne peut jamais être aliéné à aucun autre organisme, sous le risque d'altérer gravement le fonctionnement de l'organisation de la classe et l'accomplissement de ses tâches. C'est pourquoi, il est inconcevable que les organes de direction soient confiés, même par un vote à tel ou tel groupement particulier. Cela serait reproduire au sein du prolétariat le mode de fonctionnement et de pratique propre aux classes non prolétariennes.
Toutes les formations politiques qui se situent dans le cadre de la reconnaissance de l'autonomie de la classe par rapport aux autres classes et son pouvoir illimité à l'hégémonie dans la société, doivent avoir la pleine liberté d'action et de propagande au sein de la classe et de la société, car "une des conditions de la prise de conscience de la classe est la libre circulation et confrontation des idées en son sein." (Marx)
Des esprits chagrins croient déceler dans cette conception de la dictature du prolétariat, un relent de "démocratisme". De même qu'ils prennent la révolution bourgeoise comme modèle de la révolution prolétarienne, ils prennent la dictature de la bourgeoisie pour modèle de la dictature du prolétariat. Parce que la dictature de la bourgeoisie, c'est l'Etat et rien que l'Etat, ils prennent l'Etat qui surgit inévitablement dans la période de transition, après la victoire de la révolution prolétarienne pour la dictature du prolétariat, ne faisant aucune distinction entre l'un et l'autre. Leur attention ne s'arrête pas un instant sur le simple fait suivant : alors que la bourgeoisie n'a pas d'autre organisation unitaire de sa classe que l'Etat, le prolétariat, lui, crée cette organisation unitaire groupant l'ensemble de sa classe : les Conseils, pour faire sa révolution et la maintenir après, sans la dissoudre dans l'Etat. Le pouvoir illimité de ces Conseils, voilà la Dictature du Prolétariat qui s'exerce sur toute la vie de la société y compris sur le semi Etat de la période de transition. La notion marxiste de semi-Etat ou d'Etat-Commune leur échappe complètement et ils ne retiennent, de la dictature du prolétariat, que le mot générique de Dictature, qu'ils identifient à l'Etat fort, à l'Etat terreur. Par ailleurs, ils identifient la Dictature de la classe à la dictature du Parti, ce dernier dictant sa loi, par la force, à la première. Cette vision peut se résumer ainsi: un parti unique s'emparant de l'Etat, exerçant la terreur pour soumettre l'organisation unitaire du prolétariat : les Conseils et tout le système soviétique de la société de la période de transition. Une telle dictature du prolétariat ressemble comme deux gouttes d'eau au type achevé de l'Etat capitaliste totalitaire : l'Etat stalinien et l'Etat fasciste.
Les prétendus arguments sur le rejet de toute référence à majorité-minorité, ramenés à une ridicule question de 49 et 51%, sont des jongleries sophistiques, une phraséologie creuse, un radicalisme de façade qui estompent le vrai problème. La question n'est pas que la majorité ne porte pas forcément la vérité, parce que majorité, mais de comprendre que la Révolution prolétarienne ne peut être l'oeuvre d'une minorité de la classe. Ce n'est pas ici une question de formalisme, mais de l'essence, du contenu même de la Révolution, à savoir que la classe "organise ses propres forces comme force sociale" (Marx) et ne les sépare plus comme force extérieure, indépendante d'elle. L'accomplissement de la révolution est donc inséparable de la participation effective et illimitée des immenses masses de la classe, de leur activité et organisation. C'est en cela que consiste avant tout la dictature du prolétariat. Ceci ne s'accorde donc pas avec le renforcement d'un Etat tout puissant, mais avec son affaiblissement, un Etat amputé dès sa naissance par la volonté et le pouvoir illimité du prolétariat.
La dictature du prolétariat est corrélative avec le concept du dépérissement de l'Etat, tel que le marxisme, de Marx à Lénine de 'l'Etat et la Révolution" l'ont toujours défendu. Ce n'est pas l'Etat qui fait et exerce la dictature, mais c'est la Dictature du Prolétariat qui supporte l'existence encore inévitable d'un semi-Etat et assure le processus de son dépérissement.
L'ETAT DANS LA PERIODE DE TRANSITION
La différence entre les marxistes et les anarchistes ne réside pas dans ce que les premiers concevraient un socialisme avec un Etat et les seconds une société sans Etat. Sur ce point, il y accord total. C'est plutôt avec les pseudo marxistes de la Social-démocratie, héritiers de Lassai le qui conjuguaient le Socialisme avec l'Etat, que cette différence existe, et elle est fondamentale, (cf. La "Critique du Programme de Gotha" de Marx et l'"Etat et la Révolution" de Lénine). Le débat avec les anarchistes portait sur leur méconnaissance totale d'une période de transition inévitable et sur le fait qu'en bons idéologues, ils dictaient à l'histoire un saut à pieds joints, immédiat et direct, du Capitalisme à la société communiste. ()
Il est absolument impossible d'aborder le problème de l'Etat après la Révolution si on n'a pas compris auparavant qu"entre la société capitaliste et la société communiste se place la période de transformation révolutionnaire de la première en la seconde" (), si on n'a pas compris pourquoi cette période se situe non avant mais après la révolution victorieuse, ni en quoi consiste son caractère radical par rapport aux périodes analogues dans le passé, ni le fait qu'après avoir détruit la domination de la classe capitaliste, subsistent dans la société des classes avec d'immenses masses travailleuses qui sont profondément anti-capitalistes sans être pour autant pro-communistes et qu'il ne saurait être question de les tenir à l'écart de la vie politique et de la participation active à l'organisation de la société.
Ce n'est qu'en partant de ces données objectives des exigences de la réalité historique et non en partant de l'Etat en soi qu'on peut comprendre :
1) son resurgissement inévitable
2) sa différence fondamentale avec les autres types d'Etat
3) la nécessité d'une attitude active de la part du prolétariat pour la limitation progressive de ses fonctions et en vue de son dépérissement.
Examinons de plus près ces points :
)1 son surgissement inévitable
a) Plus que dans les autres révolutions, le prolétariat se heurtera à la plus féroce et opiniâtre résistance de la part de la classe capitaliste vaincue. Il est à souligner que pour l'acte de la révolution, c'est-à-dire chasser la classe capitaliste de sa position dominante et brise son appareil d'Etat, le prolétariat y parvient en s'appuyant strictement sur son pouvoir de classe, c'est-à-dire ses organisations, sans avoir besoin d'aucun type d'Etat. Le souffle brûlant de la révolution démoralise et désorganise l'armée permanente composée en majorité d'ouvriers et de paysans dont une grande partie passe du côté de la révolution. Mais une fois vaincue, la bourgeoisie dans sa rage effrénée de revanche, décuple sa résistance, regroupe ses forces, reconstitue une armée sélectionnée de volontaires forcenés et de mercenaires, et dans la terreur déchaîne une guerre contre-révolutionnaire sans merci. Face à une telle guerre rangée menée selon toutes les règles de l'art militaire, le prolétariat ne peut se contenter d'opposer ses masses en armes mais se trouve obligé de construire à son tour une armée régulière, avec une incorporation non seulement des ouvriers mais de l'ensemble de la population. Guerre, représailles, coercition systématique contre les menées de la contre-révolution, voilà les premières déterminations du surgissement de l'institution étatique.
Pour si importantes que soient les raisons de la lutte militaire et les nécessités de la coercition contre les menées contre-révolutionnaires de la classe capitaliste, même au point d'occuper pendant la guerre civile une place de premier plan, ce serait cependant une erreur simpliste de les prendre pour la raison essentielle, encore moins unique, du surgissement de l'Etat. Le simple fait que l'Etat se maintienne et dure bien au-delà de la période de guerre civile en est une preuve suffisante.
Dans le même sens, il est important de retenir cette différence existant entre les autres Etats dans le passé, pour lesquels la coercition était essentiellement dirigée contre les classes montantes -donc durables- alors qu'ils s'accommodaient avec les anciennes classes dominantes, et l'Etat de la période de transition pour lequel c'est exactement le contraire : aucune coercition ne s'impose contre des classes montantes qui n'existent pas, mais uniquement contre les anciennes classes avec qui aucune collaboration ne saurait exister.
b) La société dans la période de transition est encore une société divisée en classes. Le marxisme et l'histoire enseignent qu'aucune société divisée en classes ne saurait subsister sans un Etat, non pas comme médiateur mais comme institution indispensable pour maintenir la cohésion nécessaire, pour empêcher la société de succomber et de se détruire.
De plus, il est indispensable et possible pour le prolétariat d'enlever tout droit politique aux membres de l'ancienne classe -classe très minoritaire-, il serait un pur non sens et hautement préjudiciable et d'ailleurs impossible d'exclure les grandes masses des classes non prolétariennes mais non exploiteuses de la vie politique et sociale. Ces masses sont vivement intéressées et concernées par tous les problèmes économiques, politiques, culturels de la vie immédiate de la société. Le prolétariat ne peut ignorer leur existence ni exercer à leur égard, dans ses transformations révolutionnaires, une coercition systématique. A l'égard de ces masses, le prolétariat ne peut mener qu'une politique de réformes, de propagande et d'incorporation à la vie sociale, sans pour autant se dissoudre lui-même ni abdiquer à l'égard de sa mission et de son hégémonie qu'est la dictature du prolétariat.
Cette incorporation nécessaire de ces masses prend la forme de cette institution particulière qu'est l'Etat-Commune et qui est encore un Etat. C'est essentiellement l'existence de ces classes, leur lente dissolution et la nécessité impérieuse de leur incorporation qui rendent inévitable le surgissement de l'Etat dans la période de transition au socialisme.
c) Aux deux raisons citées plus haut s'ajoutent les besoins de centralisation et d'organisation de la production, de la distribution, des rapports avec le monde environnant etc., en un mot toute l'administration des choses et de la vie publique complètement bouleversée par la révolution et que la société n'a pas encore appris et n'est pas encore à même de séparer du gouvernement des hommes.
Ces trois raisons se conjuguent pour agir puissamment comme facteurs déterminants pour le surgissement de l'Etat après la révolution.
2) La différence fondamentale de cet Etat avec les autres types d'Etat
Engels disait, analysant la Commune de Paris, que ce n'était plus proprement un Etat. Voulant mettre en évidence les différences profondes avec l'Etat classique, Marx, Engels, Lénine lui ont donné des noms différents: Etat-Commune, semi-Etat, Etat populaire, Dictature démocratique, Dictature révolutionnaire, etc. Tous ces noms se réfèrent, en les mettant en relief, aux caractères spécifiques qui le différencient avec 1'Etat dans le passé.
- Cet Etat se distingue avant tout par le fait que pour la première fois, c'est celui des classes exploitées et non des classes exploiteuses. Il est l'Etat d'une majorité dans l'intérêt de la majorité contre une minorité. Il existe non en vue de la défense de nouveaux privilèges mais pour détruire les privilèges. Il exerce la violence non pour l'oppression mais pour empêcher l'oppression. Il n'est pas un corps s'élevant au-dessus de la société mais à son service. Ses membres et ses fonctionnaires ne sont pas nommés mais élus et révocables, son armée permanente est remplacée par l'armement général du peuple, il remplace l'oppression par un maximum de démocratie, c'est-à-dire de libertés d'opinion, de critique et d'expression, et par-dessus tout, il est un Etat en dépérissement. Mais il reste un Etat, c'est-à-dire un gouvernement des hommes parce que c'est une institution d'une société encore divisée en classes même s'il est sa dernière forme.
- Cet Etat de la période de transition ne sera pas, selon Lénine, un Etat comme un autre "tel que l'a créé partout la bourgeoisie, depuis les monarchies constitutionnelles jusqu'aux républiques les plus démocratiques" mais conforme aux "enseignements de la Commune de Paris et l'analyse qu'en ont donnée Marx et Engels". "Voilà le type d'Etat dont nous avons besoin voilà le chemin que nous devons suivre pour qu'il soit impossible de rétablir une police ou une armée séparée du peuple".
Lénine ne confond pas cet Etat avec la Dictature du prolétariat car cet Etat est seulement "la dictature démocratique révolutionnaire du prolétariat et des paysans pauvres". "Certes, disait Lénine, la démocratie est aussi une forme d'Etat qui devra disparaître quand celui-ci disparaîtra lui-même, mais cela n'arrivera que lors du passage au socialisme définitivement victorieux et affermi, au communisme intégral".
Et Lénine de préciser le rôle du prolétariat après qu'il ait "démoli" l'Etat bourgeois : "le prolétariat doit organiser tous les éléments exploités de la population afin qu'eux-mêmes prennent directement en mains les organes du pouvoir d'Etat en formant eux-mêmes les institutions de ce pouvoir".
Ces lignes furent écrites au début mars 1917, un mois à peine après la révolution de Février. Ce thème, de la prise de l'Etat "aux mains de tous les éléments exploités de la population", nous le trouverons développe dans des dizaines d'articles de Lénine, et particulièrement dans "L'Etat et la Révolution". Et nous pouvons répéter avec lui "voilà le type d'Etat dont nous avons besoin" et que la révolution fait surgir.
3) La nécessité d'une attitude active de la part du prolétariat pour la limitation progressive des fonctions et en vue du dépérissement de l'Etat
Nous venons de voir l'énorme distance qui sépare l'Etat de la période de transition -qui n'est plus d'après Engels, à proprement parler un Etat-de tous les autres. Et pourtant d'après le même Engels "il est un fléau" dont hérite le prolétariat et Engels se charge de mettre en garde ce dernier contre ce "fléau". Comment le comprendre ?
Marx et Engels ont mis en relief les mesures que la Commune de Paris a immédiatement ressenti le besoin de prendre contre ce semi-Etat, notamment en rendant révocable à tout moment toute élection et en limitant la rémunération de ses élus et fonctionnaires au salaire moyen d'un ouvrier, afin de limiter ses tendances nocives. Lénine ne cessait de rappeler et de se référer à ces mesures, montrant ainsi l'importance qu'il accordait aux graves dangers de bureaucratisation que comportait même ce type d'Etat-Commune.
La Commune de Paris, limitée à une seule ville, et d'une courte durée de deux mois, avait eu à peine l'occasion de manifester les côtés dangereux de ce semi-Etat. On ne peut que rester encore plus admiratif devant l'étonnante perspicacité politique d'Engels, parvenant dans ces conditions à déceler et mettre en garde contre ce caractère de fléau de l'Etat post-révolutionnaire.
La révolution d'Octobre dans un pays immense, avec une population de plus de cent millions d'habitants et une durée de plusieurs années, devait servir autrement comme terrain d'expérience. Cette expérience devait confirmer tragiquement et au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer même dans le pire des cauchemars, les mises en garde d'Engels contre ce fléau.
Quand nous énumérions, après Marx, Engels et Lénine les caractères distinctifs de cet Etat, c'est plutôt ce qu'il devrait être que ce qu'il est de lui-même. De lui-même, il porte une lourde charge de toutes les tares héritées de tous les Etats qui l'on précédé. Il appartient au prolétariat d'être extrêmement vigilant à son égard. Le prolétariat ne peut éviter son surgissement, ni se soustraire à l'obligation de son utilisation, mais pour cela il devra , dès l'apparition de cet Etat, amputer ses aspects les plus nocifs afin de pouvoir le rendre utilisable pour ses propres fins.
L'Etat n'est pas le porteur ni l'agent actif du communisme. Il est plutôt son entrave. Il reflète l'état présent de la société et comme tout Etat, il a tendance à maintenir, conserver le statu quo. Le prolétariat, porteur du mouvement de la transformation sociale, oblige l'Etat à agir dans ce sens. Il ne peut l'obliger à cela qu'en le contrôlant de l'intérieur et en le dominant de l'extérieur, en lui ôtant, en le dépouillant, autant que les conditions le permettent, de ses fonctions, assurant ainsi activement le processus de son dépérissement.
L'Etat tend toujours à s'accroître démesurément. Il offre pour cela un terrain de prédilection à toute la fange d'arrivistes et autres parasites et recrute facilement ses cadres parmi les éléments résidus et vestiges de l'ancienne classe dominante en décomposition. C'est ce qu'a pu constater Lénine quand il parle de l'Etat comme la reconstitution de l'ancien appareil d'Etat tsariste. Cette machine d'Etat, comme le constatait encore Lénine, "tend à échapper à notre contrôle et tourne dans le sens contraire à ce que nous voulons". C'est encore Lénine qui, indigné, ne trouvait pas de mots assez durs pour stigmatiser les énormes abus et vexations de toutes sortes auxquels se livraient les représentants de l'Etat contre la population. Cela n'était pas seulement le fait de la vieille canaille tsariste qui Infestait l'appareil de l'Etat, mais également le personnel recruté parmi les communistes pour qui Lénine avait créé le nom de komtchvanstva (voyous communistes).
On ne peut combattre de telles manifestations si on les considère simplement comme accidentelles. Pour les combattre .efficacement, il faut aller au fond des choses, reconnaître qu'elles plongent leurs racines dans ce fléau qu'est l'inévitable survivance de cette superstructure qu'est l'Etat. Il ne s'agit pas de se lamenter, de lever les bras au ciel et de s'incliner impuissants devant une "fatalité". Le déterminisme n'est pas une philosophie du fatalisme; il ne s'agit pas davantage de prétendre que, par notre simple volonté, la société peut échapper à la nécessité du surgissement de l'Etat. Cela serait tomber dans l'idéalisme. Mais, si nous devons reconnaître que l'Etat s'impose à nous comme une "exigence de la situation" (Lénine), comme une nécessité, il importe de ne pas faire ce cette nécessité vertu, de se mettre à faire l'apologie de l'Etat et de chanter ses louanges. Le marxisme reconnait l'Etat comme une nécessité mais aussi comme un fléau et pose devant le prolétariat le problème des mesures à prendre pour assurer son dépérissement.
Il ne sert à rien d'accoupler de trente-six façons les mots Etat et prolétariat et ouvrier. On ne résout pas le problème en changeant de nom, on ne fait que l'esquiver en l'aggravant encore par la confusion. L'Etat prolétarien est un mythe. Lénine le rejetait, rappelant que c'était "un gouvernement des ouvriers et des paysans avec une déformation bureaucratique". C'est une contradiction dans les termes et c'est une contradiction dans la réalité. La grande expérience de la révolution russe est là pour en témoigner. Chaque fatigue, chaque défaillance, chaque erreur du prolétariat a Immédiatement pour conséquence le renforcement de l'Etat, et inversement, chaque victoire, chaque renforcement de l'Etat se fait en évinçant un peu plus le prolétariat. L'Etat se nourrit de l'affaiblissement du prolétariat et de sa dictature de classe. La victoire de l'un est la défaite de l'autre.
Il ne sert à rien de vouloir faire de l'organisation unitaire du prolétariat : les conseils ouvriers, l'Etat. Proclamer le Comité Central des conseils ouvriers, l'Etat, tient chez les promoteurs d'une telle idée autant de l'astuce que de l'ignorance des vrais problèmes posés par la réalité. A quoi bon affubler le conseil du nom d'Etat, s'ils sont synonymes et recouvrent la même chose ? Est-ce par amour du joli nom d'Etat ? Ces malins, à la phrase radicale, ont-ils jamais entendu parler des conseils ouvriers comme d'un fléau ou de la nécessité de leur dépérissement ? En proclamant que le conseil est l'Etat, ils excluent et interdisent toute participation des classes travailleuses non prolétariennes à la vie de la société, participation qui est comme nous l'avons vu, la principale raison du surgissement de l'Etat, ce qui est une impossibilité et une absurdité à la fois (). Et si, pour échapper à cette absurdité, on entend faire participer ces classes et ces couches dans les conseils ouvriers, ce sont ces derniers qu'on altère et on leur fait perdre leur nature d'organisation unitaire autonome du prolétariat.
On doit rejeter également une structuration de l'Etat sur la base d'une composition des différents corps sociaux (ouvriers, paysans, professions libérales, artisans, etc.) organisés séparément. Cela serait institutionnaliser leur existence et prendre pour modèle l'Etat corporatiste de Mussolini. C'est perdre de vue que nous ne sommes pas devant une société à mode d'existence fixe, mais dans une période de transition. C'est en tant que membres de la société que toute la population non exploiteuse participe à la vie sociale dans les soviets territoriaux et c'est seulement le prolétariat, parce que porteur du devenir communiste, qui, en plus, participe hégémoniquement à la vie sociale et la dirige, organisé en tant que classe dans ses conseils ouvriers.
Sans entrer dans des détails de modalité, nous pouvons retenir pour principes la structure suivante de la société de la période de transition :
1) Toute la population non exploiteuse est organisée sur la base des soviets-Communes territoriaux, se centralisant de la base au sommet, donnant naissance à cet organe qu'est l'Etat-Commune.
2) Les ouvriers participent à cette organisation soviétique, individuellement comme tous les autres membres de la société, et collectivement par leur organisation de classe autonome, à tous les échelons de cette organisation soviétique.
3) Le prolétariat s'assure une prépondérance dans la représentation, à tous les échelons, mais surtout dans les échelons supérieurs.
4) Le prolétariat garde sa pleine et entière liberté par rapport à l'Etat. Sous aucun prétexte, le prolétariat ne saurait reconnaître la primauté de décision des organes de l'Etat sur celle de son organisation de classe : les conseils ouvriers, et devrait imposer le contraire.
5) En particulier, il ne saurait tolérer l'immixtion et la pression d'aucune sorte de l'Etat dans la vie et l'activité de la classe organisée excluant tout droit et possibilité de répression de l'Etat &' l'égard de la classe ouvrière.
6) Le prolétariat conserve son armement en dehors de tout contrôle de l'Etat.
Il nous reste encore à affirmer que le Parti politique n'est pas un organe d'Etat. Longtemps, les révolutionnaires ont vécu dans cette optique, marquant ainsi l'immaturité de la situation objective et leur propre manque d'expérience. L'expérience de la révolution russe a montré la caducité de cette vision. La structure de l'Etat basée sur les partis politiques, est propre à l'Etat bourgeois et plus spécifiquement à la démocratie bourgeoise. La société de la période de transition ne délègue pas son pouvoir à des partis, c'est-à-dire à des corps spécialisés. Le semi-Etat de cette période a pour structure le système des soviets, c'est-à-dire une participation constante et directe des masses à la vie et au fonctionnement de la société. C'est à cette condition que ces masses peuvent, à chaque moment, révoquer leurs représentants, les remplacer et exercer un contrôle permanent sur eux. La délégation du pouvoir à des partis quels qu'ils soient, revient à réintroduire la division entre le pouvoir et la société, et par conséquent, s'avère la plus grande entrave à son émancipation.
Par ailleurs, comme l'a montré l'expérience de la révolution d'Octobre, la prise en mains ou la participation du parti du prolétariat à l'Etat altère profondément ses fonctions. Sans entrer dans la discussion sur la fonction du parti et ses rapports avec la classe qui relève d'un autre débat- il suffit ici de mentionner simplement que les raisons contingentes et les raisons d'Etat finissent par prévaloir pour le parti, par l'identifier à l'Etat et le séparer de la classe, jusqu'à l'opposer à celle-ci.
En conclusion, une chose doit être claire une fois pour toutes. Quand nous parlons d'autonomie, il s'agit de l'autonomie de la classe à 1'égard de l'Etat et non de celle de l'Etat. L'Etat, lui doit être subordonné à la classe. La tâche du prolétariat est de veiller au dépérissement de l'Etat. La condition première en est la non-identification de la classe avec l'Etat.
M.C
Marx, "Critique de la Philosophie de l'Etat de Hegel" p.29
Hegel, "La Raison dans l'Histoire", p.136
Marx, "La Question Juive"
"... le pouvoir politique est précisément le résumé officiel de l'antagonisme dans la société civile" (Marx, "Misère de la Philosophie" Edts Pléiade, p.136)
Nous excluons volontairement les menaces extérieures, c'est-à-dire de pays à pays qui est un problème qui existe mais qui, en l'occurrence ne ferait qu'encombrer et entraver la clarté du texte et ce que nous voulons élucider ici : le rôle de l'Etat dans l'évolution des sociétés.
Lénine "La victoire des cadets et les tâches du parti ouvrier" (28/3/1906)
idem, p.250 - 251
idem, p.250 - 251
idem, p.250 - 251
idem, p.250 - 251
Comme il arrive souvent avec l'idéalisme, il n'est radical dans la spéculation abstraite que pour mieux tomber dans la pratique concrète aux pires opportunismes, ce qui n'a pas manqué d'arriver aux anarchistes. Leur farouche "anti-tout-étatisme" postrévolutionnaire, fondé sur une volontaire ignorance des exigences de la situation historique les a directement menés à s'intégrer et à défendre encore plus farouchement l'Etat bourgeois "républicain" dans la guerre d'Espagne de 1936-39.
Marx, "Critique du Programme de Gotha".
C'est dans une erreur semblable qu'est tombée l'Opposition Ouvrière, quand elle réclamait la remise de l'Etat aux mains des syndicats, et c'est avec raison que Lénine la taxait de conception anarcho-syndicaliste.
Heritage de la Gauche Communiste:
Résolution sur : TERRORISME, TERREUR et VIOLENCE de CLASSE
- 3143 reads
Dans le numéro précédent de la “Revue Internationale”, nous avons déjà publié un texte sur la question du terrorisme, de la terreur et de la violence de classe, dégageant les fondements de1’intervention du CCI au travers de ses divers organes de presse, répondant globalement d’une part à la grande offensive idéologique et policière de la bourgeoisie et d’autre part aux différentes conceptions courantes admises dans l’ensemble du milieu révolutionnaire face aux récentes actions terroristes. Le texte que nous publions ici sous forme de résolution souligne, prolonge et approfondit les différents points développés dans le texte précédent avec la préoccupation constante de toujours mieux cerner la nature de classe de la violence libératrice et émancipatrice du prolétariat.
La résolution n’a pas pour but de donner une réponse précise et détaillée à toutes les questions et problèmes concrets qui se posent et se poseront à la classe ouvrière dans son activité révolutionnaire, activité qui part de la reprise des luttes vers la période de transformation révolutionnaire de la société, en passant par la phase insurrectionnelle et la prise du pouvoir. La résolution ne traite pas non plus de l’utilisation directe que la bourgeoisie peut faire du terrorisme. Son but est de donner un cadre, une conception d’ensemble qui permette d’aborder ces problèmes d’un point de vue prolétarien autrement qu’au travers d’affirmations simplistes telles que : “la violence, c’est la violence”, “la violence, c’est la terreur”, “dire que la violence n’est pas la terreur, c’est du pacifisme”, etc., cette casuistique de “la fin justifie les moyens” comme disait le texte précédent.
- Montrer que le pacifisme ne correspond à aucune réalité et ne peut être qu’une idéologie dans le meilleur des cas 1’expression des couches moyennes théorisant leur propre impuissance à opposer une force réelle à la bourgeoisie et son État toujours au service de la bourgeoisie dans l’exercice de sa domination sur la classe ouvrière et sur 1’ensemble de la société ;
- Montrer comment la terreur est 1’expression des classes dominantes et exploiteuses, la nature profonde de leur violence de classe devenant, quand les bases matérielles de leur domination sont sapées, le centre de la vie sociale ;
- Montrer pourquoi et comment le terrorisme est typiquement la manifestation impuissante de la révolte des couches moyennes et jamais un moyen ni un détonateur de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
- Montrer que la forme et le contenu de la violence émancipatrice de la classe ouvrière ne peut en aucun cas s’apparenter à la “terreur” ;
- Montrer enfin où se trouvent les véritables forces de la classe ouvrière ; dans la force collective, consciente et organisée de 1’immense majorité et dans sa capacité de transformation révolutionnaire des rapports sociaux ;
Tels sont les buts que se fixe la résolution publiée ci-dessous.
De plus, le texte montre que s’il y a une question où les rapports entre “buts et moyens” se trouvent particulièrement liés en se conditionnant mutuellement, c’est bien celle de la violence révolutionnaire du prolétariat. Cela implique que dans les discussions actuelles sur le terrorisme, la terreur et la violence de classe, c’est le coeur même de la conception de la révolution prolétarienne qui est abordé.
1) Il est absolument faux de présenter ce problème en
termes d’un dilemme : terreur ou pacifisme. Le pacifisme n’a jamais existé
dans la réalité d’une société divisée en classes, aux intérêts antagoniques.
Dans une telle société, ce qui régit les rapports entre les classes ne peut
être que la lutte. Aussi, le pacifisme n’a jamais été autre chose qu’une idéologie;
dans le meilleur des cas, un mirage des couches impuissantes et veules d’une
petite bourgeoisie sans devenir, dans le pire des cas, une mystification, un
mensonge éhonté des classes dominantes pour détourner les classes exploitées de
la lutte et leur faire accepter le joug de l’oppression. Raisonner en termes de
terreur ou pacifisme, opposer l’un comme une alternative de l’autre, c’est se
laisser prendre soi-même dans les filets d’un piège et finalement accréditer ce
faux dilemme, tout couine c’est le cas d’un autre piège construit également sur
un faux dilemme : guerre ou paix.
Il est indispensable de bannir des débats toute utilisation de
ce faux dilemme car en ne faisant qu’opposer la fantaisie à une réalité, on ne
fait que tourner le dos et escamoter le vrai problème qui se pose, celui de la
nature de classe de la terreur, du terrorisme et de la violence de classe.
2) De même qu’on escamote le vrai problème de la
terreur et de la violence de classe en lui substituant un faux dilemme de
terreur et pacifisme, de même on escamote complètement ce problème en
établissant une identification entre ces termes. Dans le premier cas, on l’escamote
en lui substituant un faux dilemme, dans le deuxième cas, le problème lui-même
s’évanouit et, nié, disparaît complètement. Or, il est pour le moins
stupéfiant, pour des marxistes, de concevoir que des classes aussi différentes
de nature que sont la bourgeoisie et le prolétariat, l’une porteuse de
l’exploitation, l’autre de l’émancipation, l’une porteuse de la répression,
l’autre de la libération, l’une porteuse du maintien et de la perpétuation de
la division de l’humanité, l’autre de son unification dans une communauté
humaine, que ces deux classes, l’une représentant le règne de la nécessité, de
la pénurie et de la misère, l’autre le règne de la liberté, de l’abondance et
de l’épanouissement de l’homme, que ces deux classes puissent avoir comme expression
les mêmes moeurs, le même comportement, les mêmes moyens et modes d’action.
En établissant cette identification, on escamote tout ce qui
distingue et oppose ces deux classes, non pas dans les nuées de la spéculation,
dans l’abstrait, mais dans la réalité de leur pratique. A force
d’identification de leurs pratiques, on finit par établir une identité entre
les sujets eux-mêmes, entre la bourgeoisie et le prolétariat, car il est
aberrant d’affirmer d’une part que nous sommes en présence de deux classes
d’essence diamétralement opposée et de soutenir d’autre part que ces deux
classes ont dans la réalité une pratique identique.
3) Pour cerner le fond du problème concernant la terreur, il nous faut mettre de côté ce qui n’apparaît que comme une querelle de mots, pour mettre a nu ce que les mots recouvrent. Autrement dit, le contenu et la pratique de la terreur et sa signification. Il faut commencer par rejeter la vision d’une séparation possible entre le contenu et la pratique. Le marxisme renvoie dos à dos la vision idéaliste d’un contenu éthéré existant hors de la matérialité réelle qu’est sa pratique et la vision pragmatique d’une pratique vide de contenu. Contenu et pratique, but et moyens, sans être des identités, constituent néanmoins des moments d’une unité indissoluble. Il ne saurait y avoir une pratique distincte et opposée à son contenu et on ne saurait mettre en question un contenu sans mettre en question ipso facto sa pratique. La pratique révèle nécessairement son contenu, tout comme ce dernier ne peut s’affirmer que dans sa pratique. Ceci est particulièrement évident au niveau de la vie sociale.
4) Le capitalisme est la dernière société divisée en
classes de l’histoire. La classe capitaliste fonde sa domination sur
l’exploitation économique de la classe ouvrière. Pour assurer cette
exploitation et l’accentuer au maximum, la classe capitaliste, comme toutes les
classes exploiteuses dans l’histoire recours à tous les moyens de coercition,
d’oppression et de répression dont elle peut disposer. Aucun des moyens les
plus inhumains, les plus sauvages, les plus sanglants ne saurait être exclu par
elle pour assurer et perpétuer l’exploitation. Plus se manifestent des difficultés
internes, plus se manifeste la résistance des ouvriers et plus sanglant est
l’exercice de la répression. A cette fin, elle a développé tout un arsenal de
moyens de répression les prisons, les déportations, les assassinats, les camps
de concentration, les guerres génocides, la torture la plus raffinée et
nécessairement aussi tout un corps social spécialisé dans leur mise en oeuvre -la
police, la gendarmerie, l’armée, le corps juridique, les tortionnaires
qualifiés, les commandos et les bandes para militaires. La classe capitaliste
dépense une part de plus en plus grande de la plus-value extraite de
l’exploitation de la classe ouvrière à l’entretien de cet appareil de répression,
au point que ce secteur est devenu aujourd’hui le plus important et le plus
florissant champ de l’activité sociale. Dans le but de maintenir sa domination,
la classe capitaliste est entrain de mener la société à la pire des ruines et
vouer toute l’humanité aux pires souffrances et à la mort.
Ce n’est pas là une description émotive de la barbarie
capitaliste que nous entendons faire mais plus prosaïquement la description de
ce qui constitue sa pratique.
Cette pratique qui imprègne toute la vie sociale, toutes les
relations entre les hommes et qui pénètre dans tous les pores de la société,
cette pratique, ce système de domination, nous l’appelons la terreur. La
terreur n’est pas tel ou tel acte de violence épisodique et circonstanciel. La
terreur est un mode particulier de la violence, inhérent aux classes
exploiteuses. C’est une violence concentrée, organisée, spécialisée, entretenue
et en constant développement et perfectionnement, en vue de perpétuer
l’exploitation.
Ses caractères principaux sont :
- d’être la violence d’une classe minoritaire contre la grande majorité de la société;
- de se perpétuer et de se perfectionner au point de trouver sa raison d’être en elle-même;
- de nécessiter un corps spécialisé et toujours plus spécialisé, toujours plus détaché de la société, fermé sur lui-même, échappant à tout contrôle, imposant avec la dernière brutalité sa férule sur l’ensemble de la population et étouffant dans un silence de mort toute velléité de critique et de contestation.
5) Le prolétariat n’est plus la seule classe à subir
les rigueurs de la terreur de l’État sur la société. La terreur s’exerce
également sur toutes les classes et couches petites-bourgeoises, paysans,
artisans, petits producteurs et commerçants, intellectuels et professions libérales,
scientifiques et jeunesse étudiante, et se prolonge jusque dans les rangs mêmes
de la classe bourgeoise. Ces couches et classes n’offrant aucune alternative
historique au capitalisme, excédées et exaspérées par la barbarie du système et
de sa terreur, ne peuvent lui opposer que des actes de désespoir : le
terrorisme.
Bien qu’il puisse être également utilisé par certains secteurs
de la bourgeoisie, le terrorisme est essentiellement le mode d’action, la pratique
des couches et classes désespérées et sans devenir. C’est pourquoi cette pratique
qui se veut “héroïque et exemplaire” n’est en fait qu’une action de suicide.
Elle n’offre aucune issue et n’a d’autre effet que de fournir des victimes à la
terreur de l’État. Elle n’a aucun effet positif sur la lutte de classe du prolétariat
et ne sert souvent qu’à entraver cette lutte dans la mesure où elle fait naître
des illusions parmi les ouvriers sur la possibilité d’une autre voie que celle
de la lutte de classe. C’est pour cela aussi que le terrorisme, pratique de
la petite-bourgeoisie peut être et est souvent judicieusement exploité par
l’État comme moyen de détourner les ouvriers du terrain de la lutte de classe
et sert également de prétexte pour renforcer sa terreur.
Ce qui caractérise le terrorisme, pratique de la
petite-bourgeoisie, c’est de rester une action de petites minorités ou
d’individus isolés, de ne jamais s’élever à des actions de masses, d’être mené
dans l’ombre de la petite conspiration, offrant ainsi un terrain de prédilection
aux manigances des agents de la police et de l’État, et en général à toutes
sortes de manipulations et d’intrigues les plus insolites. Si au départ le terrorisme
est l’émanation de volontés individualistes et non de l’action généralisée
d’une classe révolutionnaire, il reste également, dans son aboutissement, sur
un plan individualiste. Son action n’est plus dirigée contre la société
capitaliste et ses institutions, mais seulement contre des individualités représentatives
de cette société. Il prend donc inévitablement l’aspect d’un règlement de comptes,
d’une vengeance, d’une vendetta, de personne à personne et non celui d’un
affrontement révolutionnaire de classe contre classe. D’une façon générale, le
terrorisme tourne le dos à la révolution qui ne peut être que l’oeuvre d’une
classe déterminée, engageant de larges masses dans une lutte ouverte et
frontale contre l’ordre existant et pour la transformation sociale. Il est en outre
fondamentalement substitutionniste, ne plaçant sa confiance que dans l’action
volontariste des petites minorités agissantes.
En ce sens, l’idée est à proscrire d’un “terrorisme ouvrier”
qui se voudrait l’oeuvre de détachements du prolétariat, “spécialistes” de
l’action armée, ou bien destinés à préparer les futurs combats en donnant
l’exemple de la lutte violente au reste de la classe, ou en “affaiblissant” l’État
capitaliste par des”attaques préliminaires” Le prolétariat peut déléguer
certains détachements pour telle ou telle action ponctuelle (piquets,
patrouilles, etc.), mais sous son contrôle et dans le cadre de son mouvement
d’ensemble et, si, dans ce cadre, l’action plus décidée des secteurs
d’avant-garde peut servir de catalyseur à la lutte des larges masses, ce ne
peut jamais être à travers les méthodes conspiratives et individualistes
propres au terrorisme. Celui-ci, même s’il est pratiqué par des ouvriers ou des
groupes d’ouvriers, ne peut acquérir un caractère prolétarien, de la même façon
que la composition ouvrière des syndicats n’en fait pas des organes de la
classe ouvrière. Cependant, il ne faut pas le confondre avec des actes de
sabotage ou de violence individuelle perpétrés par des travailleurs sur des
lieux de production. De tels actes sont fondamentalement des expressions du
mécontentement et du désespoir surtout fréquents dans les périodes de reflux
pendant lesquelles ils ne peuvent en aucune façon servir de détonateur et qui
tendent, dans un moment de reprise, à s’intégrer et à être dépassés dans un
mouvement collectif et plus conscient.
Si pour toutes ces raisons, le terrorisme dans le meilleur
sens du terme (dans le pire, il peut être dirigé carrément contre les
travailleurs), ne saurait jamais être le mode d’action du prolétariat; ce
dernier ne le met jamais sur le même plan que la terreur, car il n’oublie pas
que le terrorisme, aussi futile que soit son action, est une réaction, une
conséquence provoquée par la terreur de son ennemi mortel, l’État capitaliste,
et il en est également la victime.
Le terrorisme comme pratique reflète parfaitement son
contenu : les classes petites bourgeoises dont il émane. Il est la pratique
stérile des classes impuissantes et sans devenir.
6) Dernière classe exploitée dans l’histoire, le
prolétariat porte avec lui la solution à tous le les déchirements, à toutes les
contradictions et impasses dans lesquelles la société s’est embourbée Cette
solution n’est pas seulement une réponse à son exploitation mais se rapporte à
toute la société, car le prolétariat ne peut se libérer sans libérer l’humanité
toute entière de la division de la société en classes et de l’exploitation de
l’homme par l’homme. Cette solution, d’une communauté humaine librement
associée et unifiée, c’est le communisme. Dès sa naissance, le prolétariat
porte en lui les germes et certains caractères de cette humanité renaissante :
classe démunie de toute propriété privée, classe la plus exploitée de la
société, elle s’oppose à toute exploitation; classe unifiée par le capital dans
le travail productif associé, elle est la classe la plus homogène, la plus
unitaire de la société; la solidarité est une des premières de ses qualités et
est ressentie comme le plus profond de ses besoins; classe la plus opprimée,
elle combat toutes les oppressions; classe la plus aliénée, elle porte avec
elle le mouvement de la désaliénation car sa conscience de la réalité n’est
plus sujette à l’automystifi-cation dictée par les intérêts des classes exploiteuses;
les autres classes sont soumises aux lois aveugles de l’économie, le prolétariat,
lui, agissant consciemment, se rend maître de la production, supprime l’échange
marchand et organise consciemment la vie sociale.
Portant encore les stigmates de l’ancienne société d’où il
émerge, le prolétariat est appelé néanmoins à agir en fonction de son devenir.
Pour son action il ne prend pas pour modèle les agissements des anciennes classes
dominantes car dans sa pratique comme dans son être il est en tous points leur
antithèse catégorique. Les anciennes classes dominaient, motivées qu’elles
étaient pour la défense de leurs privilèges, le prolétariat n’a, lui, aucun
privilège et sa domination est pour la suppression de tout privilège. Pour les
mêmes raisons, les anciennes classes dominantes s’enfermaient dans des
barrières sociales infranchissables de caste, le prolétariat, lui, est ouvert à
l’incorporation de tous les autres membres de la société en son sein afin de
créer une seule communauté humaine.
La lutte du prolétariat, comme toute lutte sociale, est
nécessairement violence mais la pratique de sa violence est aussi distincte de
la violence des autres classes corne sont distincts leurs pro jets et leurs
buts. Sa pratique, y compris la violence, est l’action d’immenses masses et non
de minorités; elle est libératrice, l’acte d’accouchement d’une société
nouvelle harmonieuse, et non la perpétuation d’un état de guerre permanent, chacun
contre tous et tous contre chacun. Sa pratique ne vise pas à perfectionner et
perpétuer la violence mais à bannir de la société les criminels agissements de
la classe capitaliste et l’immobiliser. C’est pourquoi la violence
révolutionnaire du prolétariat ne pourra jamais prendre la forme monstrueuse de
la terreur propre à la domination capitaliste, ou la forme du terrorisme
impuissant de la petite bourgeoisie. Sa force invincible ne réside pas tant
dans sa force physique et militaire et encore moins dans la répression, que
dans sa capacité de mobiliser ses larges masses, d’associer la majorité des
couches et classes travailleuses non prolétariennes à la lutte contre la
barbarie capitaliste. Elle réside dans sa prise de conscience et dans sa
capacité de s’organiser de façon autonome et unitaire, dans la fermeté de ses
convictions et dans la vigueur de ses décisions. Telles sont les armes
fondamentales de la pratique et de la violence de classe du prolétariat.
La littérature marxiste emploie parfois le terme de terreur à
la place de violence de classe. Mais il suffit de se référer à l’ensemble de
toute l’oeuvre de Marx, pour comprendre qu’il s’agit plutôt d’une imprécision
de formulation que d’une véritable identification dans la pensée. Cette imprécision
lui vient en outre de la profonde impression qu’a laissée sur elle l’exemple de
la grande révolution bourgeoise de 1789. Quoi qu’il en soit, il est largement
temps de lever ces ambiguïtés qui amènent certains groupes, corne les
bordiguistes, à pousser à l’extrême caricature l’exaltation de la terreur et à
faire de cette monstruosité un nouvel idéal du prolétariat.
- La plus grande fermeté et la plus stricte vigilance ne veulent pas dire l’instauration d’un régime policier. Si la répression physique contre les menées contre-révolutionnaires de la bourgeoisie aux abois peut s’avérer indispensable, et même si le danger existe d’une trop grande mansuétude ou faiblesse à son égard, le prolétariat veillera, comme ce fut la préoccupation des bolcheviks dans les premières années de la révolution, à se prévenir contre tout excès et abus qui risqueraient de défigurer et dénaturer sa propre lutte en lui faisant perdre la vision de son but. C’est avant tout sur, la participation de plus en plus active de larges masses, sur leur initiative créatrice qu’il fonde son pouvoir et la garantie du triomphe final du socialisme.
Questions théoriques:
- Terrorisme [121]
Allemagne de l'Est : l'insurrection ouvrière de juin 1953
- 3904 reads
Le texte que nous publions sur le 17 juin 1953 n'a pas pour but de céder au goût des commémorations funèbres. Depuis bien longtemps, la bourgeoisie tente de conjurer les fantômes qui viennent la hanter au déclin de son existence. Ces fantômes, ce sont ceux des révolutions prolétariennes, des mouvements révolutionnaires qu'elle a écrasés et dont elle craint le retour fatidique sinon dans la réalité immédiate, du moins dans ses pensées paisibles de classe dominante. Elle tente alors de conjurer sa terreur superstitieuse devant les "dates fatidiques" en commémorant l'événement à sa façon, en l'enterrant une seconde fois. La 1ère fois, elle déchaîne toutes ses forces militaires et idéologiques contre la classe ouvrière qui menace les bases de sa domination, la 2ème fois, elle falsifie le contenu de classe de la lutte en la transformant en vulgaire lutte pour la "patrie", la "démocratie", la "liberté".
C'est ce qu'a tenté une fois de plus la bourgeoisie à l'Est comme à l'Ouest ; les uns en transformant la lutte des ouvriers est-allemands en lutte contre les "exactions staliniennes", les autres en lutte pour la "démocratie parlementaire et pluraliste". Chaque fraction de la bourgeoisie mondiale tente une fois de plus d'assassiner le prolétariat de Berlin-Est et de Saxe en dénaturant, en calomniant, en transformant son combat en son contraire, en le niant purement et simplement.
Les révolutionnaires ne font pas de la lutte du prolétariat un objet d'étude ou de culte. Pour eux, cette lutte du passé est toujours présente. C'est pourquoi elle n'est pas un objet de commémoration de leur part, mais une arme pour le combat futur, une incitation à l'action révolutionnaire. Les événements de 1953 sont nôtres, car ils sont un moment de la lutte historique du prolétariat pour son émancipation. Ils sont une preuve éclatante de la nature capitaliste des pays de l'Est, présentés par les trotskystes comme "socialistes". Ils sont la preuve que la dictature la plus impitoyable du capital à travers son Etat totalitaire ne met pas fin à la lutte de classe. Celle-ci se poursuivra tant qu'il y aura division de la société en classes et donc exploitation. Le prolétariat à réagi aux mesures d'intensification de l'exploitation et donné une réponse cinglante au mensonge trotskyste et stalinien d'un Etat "ouvrier et socialiste". Les ouvriers d'Allemagne de l'Est, avant ceux de Hongrie en 1956, de Pologne en 1970, ont pu constater que la mitraille de la police et de l'armée était de même nature que celle qui les faucha dans les années 1918-20 de Berlin à Budapest. Avec l'insurrection des ouvriers est-allemands a commencé à s'effondrer avec fracas dans la conscience du prolétariat mondial le mythe des "Etats socialistes".
Mais surtout, les ouvriers d'Allemagne orientale ont montré -malgré leur écrasement- qu'ils sont la seule force capable d'abattre l'exploitation capitaliste. En dépit de leurs illusions sur l'Occident "démocratique", pendant mystificateur de la dictature de fer de l'Etat capitaliste à l'Est, ils ont prouvé la possibilité future d'une révolution prolétarienne dans le bloc russe, par le surgissement en quelques jours de comités de grève et d’usine couvrant tout le pays. Seul le poids de la contre-révolution triomphante a pu permettre l'intervention de l'armée russe et l'isolement du prolétariat est-allemand de la partie occidentale de l'Allemagne et des autres pays d'Europe.
Aujourd'hui la période de contre-révolution qui a isolé, affaibli, détourné la lutte prolétarienne est close. Mai 68 a prouvé que le prolétariat d'Europe occidentale n'était pas "intégré" ; les émeutes ouvrières en Pologne de décembre 1970 et janvier 1971 ont montré que la lutte de classe se poursuivait et que les événements de 1953 n'étaient pas accidentels ou le produit de la seule "stalinisation" de ces pays. C'est la crise générale du capitalisme qui parallèlement à l'Est et à l'Ouest met en branle les ouvriers de tous les pays dans leur résistance à l'exploitation.
En dépit de toutes les sirènes qui en Pologne (KOR, comité de défense des ouvriers emprisonnés), en Tchécoslovaquie (Charte des 77), tentent de montrer aux ouvriers qu'ils doivent lutter pour la "nation libre", se fondre dans le "peuple", les ouvriers des pays de l'Est ne peuvent que s'intégrer dans la lutte internationale du prolétariat. Hier isolés, c'est unis dans la lutte révolutionnaire que les ouvriers de tous les pays, en dépit de tous les "rideaux de fer", monteront demain à l'assaut du ciel.
25 Ans après le sursaut du 17 juin 1953
A la fin de la seconde guerre mondiale, les gouvernements de tous les pays ont promis aux travailleurs la paix et une prospérité durable. Aujourd'hui, plus de trente ans après, nous sommes une fois de plus plongés en plein coeur d'une crise économique internationale qui, d'Est en Ouest attaque massivement le niveau de vie de la classe ouvrière. Face à la difficulté croissante à trouver des débouchés pour la production, face à l'inflation galopante, au chômage grandissant, aux faillites de plus en plus nombreuses des secteurs industriels, le capitalisme aujourd'hui suit le chemin tracé par ses contradictions internes; ce chemin mène à terme et pour la troisième fois dans notre siècle, à la lutte inter-impérialiste généralisée, au massacre.
En Allemagne de l'Ouest, la bourgeoisie, et spécialement ses fractions extrêmes tels les maoïstes, les trotskystes et les néo-fascistes met en avant le but d'une Allemagne unifiée, indépendante, démocratique et même"socialiste", comme solution à l'aspect allemand de la crise mondiale. Nous comprendrons le sens de"cette indépendance nationale et unité" quand nous nous souviendrons que le gouvernement de Bonn a fait du 17 juin et de la défaite des travailleurs est-allemands, le jour de la célébration de l'unité allemande. En réalité, il n'y a pas de solution à la crise du capitalisme, enfermé dans le cercle vicieux de crise-guerre-reconstruction- nouvelle crise, et qui laissé à lui-même, continuera de la sorte jusqu'à ce que l'humanité soit finalement détruite. C'est précisément parce que la seule manière de sortir de cette barbarie est la révolution prolétarienne mondiale, que la tâche vitale des révolutionnaires est d'analyser les expériences passées et les luttes de notre classe, de sorte que les défaites d'hier deviennent les victoires de demain.
Les pays soi-disant socialistes de l'Europe de l'Est sont le résultat de la redivision du monde après la seconde guerre mondiale. Le mot d'ordre de la"guerre sainte" contre le fascisme n'était rien d'autre que le mensonge que les bourgeoisies de l'Ouest et de Russie ont utilisé pour mobiliser les travailleurs dans la lutte pour le profit, la recherche de marchés, de matières premières pour leurs maîtres capitalistes. L'amour de la démocratie qui était censé animer les alliés n'empêcha pas Staline de pactiser avec Hitler au début de la guerre, et ainsi la Russie put s'emparer de larges zones en Europe de 1'Est.
Au fur et à mesure que la victoire des "alliés" devenait imminente, le conflit d'intérêts au sein du camp "démocratique" lui-même et en particulier entre la Russie d'un côté et les anglais et les américains de l'autre, se faisait plus intense. La Russie ne reçut que le minimum d'aide de la part de l'Ouest et la Grande-Bretagne voulut même ouvrir un deuxième front dans les Balkans, plutôt qu'en France, afin d'empêcher les Russes d'occuper l'Europe de l'Est.
Ce qui maintint l'unité de ces gangsters, ce fut la peur que la guerre, particulièrement dans les pays vaincus, puisse, comme pour la première guerre mondiale, se terminer par une éruption de luttes de classe. Les bombardements féroces des "alliés" sur les villes allemandes avaient pour but d'écraser la classe ouvrière allemande. Dans la plupart des villes, des quartiers ouvriers ont été rasés, tandis que 10 % seulement des équipements industriels furent détruits.
La résistance croissante des ouvriers qui, dans quelques cas, entraîna des soulèvements dans les camps de concentration et dans les usines, et le mécontentement des soldats (comme les désertions sur le front Est, qui furent réprimées par des pendaisons massives) fut rapidement écrasée par les forces d'occupation. Cet exemple fut suivi partout. A l'Est, l'armée russe laissait agir les forces allemandes, qui écrasaient le soulèvement de Varsovie, qui dura 63 jours et fit 240 000 morts. De la même façon, l'armée russe se rendit responsable du maintien de l'ordre et de la paix sociale en Bulgarie ainsi qu1 ailleurs dans les Balkans. A l'Ouest, les PC participaient aux gouvernements d'après-guerre en France et en Italie afin de briser les mouvements de grèves perlées et l'agitation sociale. Le PC italien au pouvoir soutenait les mêmes "alliés" démocratiques qui bombardèrent sans merci les ouvriers italiens qui occupaient les usines vers la fin de la guerre.
Les occupants "soviétiques" commencèrent à exercer un pillage organisé des territoires de l'Europe de l'Est sous leur contrôle. Dans la zone d'occupation soviétique (ZOS), de l'Allemagne de l'Est, le démantèlement de l'équipement industriel et son transport en Union Soviétique atteignit 40 % des capacités industrielles de la Z0S. la Sowjetischen Aktiengesellschaften (SAG, société soviétique par actions), qui fut fondée en 1946 emporta en Russie 200 usines clé en mains, incluant, par exemple la grande entreprise de Leuna. Dans certaines zones, à la fin de la guerre, les ouvriers réparèrent et remirent en marche les usines, et ce sont celles-là que les Russes prirent avec un empressement particulier. En 1950 le SAG constituait les proportions suivantes de l'économie de l'Allemagne de l'Est : "plus de la moitié d'industries chimiques, un tiers de produits métallurgiques et environ un quart de machines-outils". (Staritz Sozialismus in einetw halben Land, p. 103).
Une grande partie de ces profits allait en Russie, directement comme réparation. La RDA était condamnée à payer une réparation à l'URSS jusque vers 1953-54, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il devienne clair que ces réparations étaient néfastes pour l'économie russe elle-même. L'économie ravagée de l'Allemagne de l'Est paya la note par une augmentation brutale de l'exploitation de la classe ouvrière. Le prolétariat y était forcé afin de participer au financement de la reconstruction et de l'expansion de l'économie de guerre soviétique. Staline n'a jamais expliqué pourquoi la classe ouvrière et l'Etat ouvrier" en Allemagne de l'Est devrait payer pour les crimes de ses exploiteurs. Le renforcement du pouvoir économique de l'impérialisme russe en RDA et en Europe de l'Est, était accompagné de l'émergence de fractions bourgeoises pro-russes au pouvoir. Dans la Z0S, les staliniens du KPD en arrivèrent à former avec les assassins sociaux-démocrates de la révolution allemande, la "Sozialistiche Einheits Partei" Ses buts pour l'immédiat après-guerre avaient été déjà clairement exprimés peu avant la guerre : "La nouvelle république démocratique dépossédera le fascisme de ses bases Matérielles en expropriant les trusts capitalistes fascistes et placera de réels défenseurs des libertés démocratiques et des droits des peuples dans l'armée, dans /les forces de police et dans la bureaucratie". (Staritz, p.49).
Renforcement et "démocratisation" de l'armée, de la police, de la bureaucratie telles sont les leçons que ces bons bourgeois "marxistes" ont tirées de Marx, de Lénine et de la Commune de Paris.
Et puis, les années de l'après-guerre étant finies, vint le temps de l'annonciation du début de la construction du socialisme. Un socialisme miraculeux qui pouvait être construit sur le corps d'un prolétariat défait et écrasé. Il est intéressant dénoter que, entre 1945 et 48, même le SED ne prétendait pas que les mesures de capitalisme d'Etat qu'il mettait en avant avait quelque chose à voir avec le socialisme. Mais, aujourd'hui les gauchistes de toutes tendances, qui prétendent que les nationalisations, c'est le socialisme, préfèrent oublier le haut degré d'étatisation dans les pays d'Europe de l'Est, même avant la guerre, et spécialement dans ces pays renommés pour leurs gouvernements "réactionnaires", tels que la Pologne ou la Yougoslavie. Cette centralisation de l'économie sous la direction de l'Etat s'est poursuivie pendant l'occupation allemande ([1] [189]).
En fait, la fameuse déclaration de "construction du socialisme" alla de paire avec le resserrement économique, politique et militaire dans l'Europe de l'Est parés 1948. Ce fut le résultat direct d'un renforcement global des conflits entre les blocs américain et russe. Le plan de deux ans (à dater de 1949) prévoyait une augmentation de la production de 35 %, reposant sur un accroissement de la productivité de 30 %, 15% d'augmentation de la masse salariale, et une baisse de 7% des tarifs publics. Le but du SED était, par ce moyen d'augmenter la productivité du travail deux fois plus que les salaires. Les moyens pour arriver à ces fins reposaient sur l'amélioration dans l'organisation du travail, l'introduction de "normes strictes", la lutte contre l'absentéisme et le manque d'attention au travail. ([2] [190])
L'augmentation des salaires en 1948, pour autant qu'elle ait eu lieu, était purement et simplement le résultat de l'accroissement des cadences et de "l'émulation" en d'autres termes, elles furent le résultat de l'augmentation de l'exploitation. C'était la période du mouvement Hennecke (équivalent du stakhanovisme) et de la discipline de fer imposée dans les usines par les syndicats. Mais, même de si petites augmentations de salaire devinrent insupportables pour l'économie et durent être supprimées de diverses façons. Le bloc de l'Est moins fort économiquement, de moins en moins capable de concurrencer son rival américain fut contraint pour survivre d'extraire des superprofits sur le dos du prolétariat et de les réinvestir dans l'industrie lourde (et plus précisément dans les industries en rapport avec l'économie de guerre) et au détriment de l'infrastructure et de la production de biens de consommation... Cette situation qui requérait un contrôle immédiat et centralisé de la part de l'Etat contraint la bourgeoisie à attaquer de front le niveau de vie de la classe ouvrière.
La réponse du prolétariat se manifesta par des vagues de lutte de classe qui secouèrent l'Europe de l'Est des années 53 à 56. Le mouvement commença au début de Juin 53 avec la manifestation des ouvriers de Pilsen (Tchécoslovaque) qui entraîna un affrontement avec l'armée et qui fut suivie immédiatement par une montée de luttes en RDA et par des révoltes dans les énormes camps de travail de Vorkuta (URSS) en Juin de la même année. Ce mouvement atteignit son apogée en 56 avec les événements en Pologne, en Hongrie où des conseils ouvriers furent formés.
On estima que les salaires réels en RDA en 1950 étaient deux fois moins élevés qu'en 1936 (Bureaucratie et Révolution p.80). En Juillet 1952, le SED annonça l'ouverture d'une nouvelle période de "construction accélérée du socialisme", par quoi il faut entendre une nouvelle augmentation des investissements dans l'industrie lourde, un grand accroissement de la productivité et un plus grand accroissement encore des normes de productivité. Il était clair que l'on tentait d'accélérer la reconstruction d'après-guerre. Au printemps 53, au moment où les syndicats de Berlin Ouest avaient des difficultés à contrôler la combativité des ouvriers du bâtiment, le gouvernement de Berlin Est mettait sur pied une campagne énorme pour l'accroissement des normes de production en général, et de celles du bâtiment en particulier. Le 28 Mai, il fut annoncé que 60% des ouvriers du gigantesque site de construction de Stalinallee avaient "volontairement" augmenté leurs normes (il s'agit là du langage du réalisme socialiste !). Les effets de la campagne nationale de la production se faisaient déjà sentir. Le même mois, des grèves eurent lieu à Magdebourg et Karl Marx Stadt. En réponse, le gouvernement annonça une augmentation générale de 10% des normes de production pour le 5 Juin.
Effrayé par l'esprit prévalant au sein de la classe ouvrière, un groupement anti-Ulbricht au sein de la direction du SED, et apparemment avec le soutien du Kremlin, mit en avant un train de réformes destiné à obtenir le soutien des classes moyennes. Ce groupe commença même à suggérer une politique plus souple en ce qui con cerne les normes de production ([3] [191]).
Mais il était trop tard pour éviter une éruption prolétarienne par de telles manoeuvres. Le 16 Juin, les ouvriers du bâtiment prirent la rue et appelèrent les autres ouvriers à s'unir à eux. La manifestation se dirigea vers les bâtiments gouvernementaux. La grève générale fut appelée pour le lendemain et paralysa Berlin-Est; elle fut suivie dans toutes les autres villes importantes. La lutte était organisée par des comités de grève élus par les ouvriers dans les assemblées ouvertes et contrôlées par eux -indépendamment des partis et des syndicats. En effet, la dissolution des cellules du Parti dans les usines étaient souvent la première revendication des ouvriers. A Halle, Bitterfeld et Merseburg, coeur industriel de l'Allemagne de l'Est, des comités de grève pour toute la ville furent élus qui essayaient ensemble de coordonner et de diriger la lutte. Ces comités assumaient la tâche de centraliser la lutte et aussi d'organiser temporairement les affaires courantes de la ville :
" A Bitterfeld, le comité de grève central, demanda que les pompiers lavent la propagande officielle. La police continuait à procéder à des arrestations, là-dessus, le comité forma des unités de combat et organisa l'occupation systématique des quartiers de la ville. Les prisonniers politiques de Bitterfeld furent relâchés sur ordre du comité de grève. Par contre, le comité ordonna l'arrestation du maire. (Sarel. "Arbeiter gegen den Kormiunismus"!).
Dans tout le pays, les quartiers généraux du parti furent occupés ou brûlés, les prisons ouvertes et les prisonniers libérés. L'appareil répressif de l'Etat fut paralysé. Seuls, les chars russes pouvaient à présent aider le gouvernement. A Berlin Est, 25 000 soldats russes et 300 chars écrasèrent la résistance des ouvriers armés de bâtons et de bouteilles. A Leipzig, Magdeburg et Dresde, l'ordre fut ramené au bout de quelques heures. En d'autres endroits, cela prit plus de temps. A Berlin, des grèves avaient encore lieu trois semaines plus tard.
A cause de la vitesse avec laquelle ils prirent la rue, généralisant la lutte et l'amenant au niveau politique immédiatement mais surtout à cause de la compréhension de la nécessité d'affronter directement l'Etat, les ouvriers furent capables de paralyser l'appareil répressif de la bourgeoisie Est-allemande, Cependant, de la même façon que l'extension rapide de la grève à travers le pays permit d'empêcher l'utilisation effective de la police contre les ouvriers, une extension INTERNATIONALE de la guerre civile aurait été nécessaire pour contrer la menace de 1'"armée rouge". En ce sens, nous pouvons dire que, prenant place, comme elle le fit, au plus profond de la contre-révolution qui suivit la vague révolutionnaire des années 17-23, la défaite des ouvriers est-allemands eut pour cause l'isolement d'avec leurs frères de classe des autres pays à l'Est comme à l'Ouest. En fait, le poids de la contre-révolution mit des barrières plus importantes que les baïonnettes de l'impérialisme russe au passage de la révolte à la révolution. Les liens de la classe à son propre passé, à ses expériences et à ses luttes ont été rompus depuis longtemps par les héros sanglants de la réaction que sont les Noske, Hitler et Staline -rompus par les camps de concentration, les bombardements de population-par la démoralisation et la destruction de ses partis révolutionnaires (meurtre de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht et dispersion politique du KAPD). Ayant souffert longtemps de la domination des Etats à parti unique, les ouvriers pensaient que la démocratie parlementaire pouvait les protéger de l'exploitation brutale. Ils réclamèrent des élections libres et un parlement. Ils envoyèrent des délégués à Berlin-Ouest pour obtenir l'aide de l'Etat et des syndicats, mais en vain. La police de Berlin-Ouest et les troupes françaises et britanniques furent postées le long de la frontière avec Berlin-Est pour empêcher tout mouvement de solidarité entre les ouvriers de l'Est et de l'Ouest. Les syndicats de l'Ouest rejetèrent la suggestion d'appeler à une grève de solidarité et mirent les ouvriers de l'Est en garde contre les actions illégales et l'aventurisme. Les ouvriers appelèrent l'armée russe à rester neutre (à ne pas intervenir dans les affaires intérieures allemandes d'après le comité de grève de Halle et Bitterfeld). Mais ils en apprirent une dure leçon : dans la guerre de classes, il n'y a pas de neutralité. Les ouvriers voulaient être débarrassés de Ulbricht et Cie, sans réaliser qu'il serait remplacé par un autre et que la question n'est pas de renverser tel ou tel gouvernement mais de détruire le système capitaliste mondial qui est une corde à notre cou. Ils ne comprenaient pas le besoin de centraliser politiquement la lutte au niveau des conseils ouvriers afin de balayer l'Etat bourgeois.
Les staliniens du DKP et les maoïstes d'Allemagne de l'ouest sont d'avis que les événements du 17 juin étaient un complot fasciste organisé par Bonn et Washington. Ils montraient par là-même leur nature anti-prolétarienne une fois de plus. La classe ouvrière aura à rejeter de tels courants (ou d'autres comme le "camarade" Bahro qui est si ardent à vouloir démocratiser l'Etat de l'Allemagne de l'Est et son Etat ouvrier" bien-aimé afin de préserver la loi et l'ordre) aux poubelles de l'histoire.
La logique de tels courants est illustrée par un tract Que le groupe maoïste KBW sortit pour le 25ème anniversaire des événements du 17 juin. Ces chiens de garde autoproclamés de la pureté stalinienne disaient ceci : "Le fait que le soulèvement fut "soutenu" par le gouvernement ouest-allemand prouve qu'il ne peut s'agir que d'une tentative de putsch fasciste. En fait, la bourgeoisie occidentale soutînt ce soulèvement exactement de la même manière que les syndicats, par exemple, "soutiennent" un mouvement de grève : dans le but de le diriger dans une impasse et à la défaite. Les faits montrent que les gens qui préparaient le leur sale besogne pour le 17 juin étaient en fait sans pouvoir, précisément parce qu'ils n'étaient pas des "ouvriers courageux" mais des provocateurs, des valets de l'impérialisme, sans le soutien de la classe ouvrière et qui détalèrent comme des lapins quand l'"Armée rouge',' à cette époque une armée de la classe ouvrière s'opposa à cette tentative contre ^révolutionnaire".
Tract du KBW, 15 juin 1978
Voilà qui est bien, c'est si facile d'expliquer ainsi le problème ! Mais même ainsi, ces perroquets de la contre-révolution jugent encore nécessaire de radoter sur les erreurs de l'Oncle Walter (Ulbricht) et les confusions des ouvriers. Mais comment se fait-il que trois ans après cette première aventure fasciste, les cocktails des masses ouvrières hongroises aient eu à combattre les chars de Staline ? Et pourquoi les ouvriers attaquèrent-ils leur "propre" armée si souvent et si violemment ? Et pourquoi encore les "bons ouvriers" ne remuèrent-ils pas le petit doigt pour sauver leur "Etat" et"leur révolution" pendant la fameuse contre-révolution Kroutchévienne dont on parle tant dans les milieux maoïstes ?
Les conditions de la lutte de classe dans le système capitaliste décadent firent que les ouvriers d'Allemagne en 1953 et de Hongrie en 1956, dans leur lutte contre le système, furent immédiatement confrontés aux forces et à l'hostilité de la bourgeoisie mondiale. Les buts frauduleux de la "démocratie" et de "l'unité allemande" mis en avant par la propagande de l'Ouest, achevèrent l'oeuvre de l'armée rouge dans la défaite de la classe ouvrière. Par sa manipulation de mensonges, la bourgeoisie des plus vieux pays capitalistes prouva une fois de plus sa maîtrise en la matière. Leur stratégie consista à :
- mener les luttes ouvrières à leur fin aussi vite que possible, principalement en empêchant l'extension au-delà des frontières;
- en déviant le mouvement sur le terrain bourgeois (démocratie, liberté...), l'Occident espérait étendre son influence au sein du bloc russe.
De toute façon l'idéologie de la bourgeoisie de l'Ouest était dirigée en premier lieu et surtout contre le prolétariat lui-même. Tous les discours sur les bas salaires et le manque de liberté du "peuple" à l'Est est utilisé surtout aujourd'hui pour briser la résistance ouvrière à l'austérité et à l'économie de guerre intensive. L'intervention idéologique du bloc de l'Ouest en 1953 était particulièrement importante à tel point que, contribuant au désarmement politique du prolétariat, elle aida les staliniens à rester au pouvoir.
En 1956 en Pologne et en Hongrie, le nationalisme fut l'arme la plus efficace pour réduire puis dissoudre la résistance ouvrière. Quelques mois seulement après le massacre des ouvriers à Pozna’n, le PC polonais pouvait armer la population de Varsovie pour défendre la patrie contre les russes. Par contre le gouvernement de Berlin-Est fut lui-même menacé par le nationalisme allemand dans la mesure où ce nationalisme incarnait la menace de l'Ouest, la grande peur d'être dévoré par Bonn* Précisément pour ces raisons, l'unification de toutes les classes contre les russes et était exclue depuis le début, l'existence même de la RDA dépendant du pouvoir des russes. Incapable d'utiliser des moyens de mystification, le SED dut être secouru par les chars étrangers et par le baratin démocratique.
La classe ouvrière en menant ses luttes, n'a jamais été et ne peut pas être une"classe pour le capital". Face aux mensonges de la bourgeoisie et de ses fractions de gauche - qui reprochent sans cesse à la classe le militarisme, l’aristocratie ouvrière, le racisme - face à cette conception qui voit la classe ouvrière résignée et défaite, les révolutionnaires mettent en avant le fait que le coeur de la société de classe réside dans la contradiction entre travail salarié et capital. Ceux-ci s'opposent sans cesse, dans une situation d'hostilité permanente, déterminée par les conditions objectives. Parce que le prolétariat n'a pas de pouvoir économique dans la société, la destruction du capitalisme ne peut être qu'un acte politique, le résultat d'une conscience et d'une volonté révolutionnaire de la part des travailleurs. Ce fut en grande partie à cause d'un manque d'expérience et de conscience de la part de la classe et de ses minorités révolutionnaires que la révolution d'octobre échoua. De la même façon, toutes les tentatives des années 40 et 50 pour résister au capitalisme n'ont pu éviter l'échec à cause de la profonde confusion et de la démoralisation qui suivirent la défaite de la Révolution d'Octobre.
Les Communistes de Conseils, comme "Daad en Gedachte" par exemple atteignent le sommet de l'idéalisme quand ils affirment que les évènements du 17 juin 1953 prouvent le pouvoir illimité de la spontanéité de masse du prolétariat, concept qu'ils opposent à la nécessité du Parti de classe. Toute aussi étrangère au marxisme e est la conception typique des bordiguistes qui expliquent toute défaite par l'absence du parti révolutionnaire. Parce que la nature profonde du prolétariat est celle d'une classe exploitée et révolutionnaire, il entre en lutte spontanément. Cependant, afin d'être capable de mener ses luttes à bien et de s'attaquer au capital, il est essentiel pour le prolétariat d'organiser et de diriger ses luttes aussi consciemment que possible. La classe forge ses armes, ses organes au feu même de la lutte de classe. Grâce à ses organes elle fait passer ses luttes immédiates sur le terrain de ses propres intérêts de classe, c'est-à-dire la lutte pour le communisme. Dans les affrontements révolutionnaires, les masses ouvrières s'organisent en conseils qui lancent et coordonnent les attaques et les retraites temporaires et qui préparent l'insurrection. De cette façon, la classe dépasse sa propre spontanéité et devient un pouvoir révolutionnaire autonome, unifié et indivisible.
En fait, les Communistes de Conseils et les Bordiguistes posent la question de travers. Ce ne sont ni les Conseils seuls, ni le Parti seul qui soient indispensables pour la victoire de la révolution mais c'est L'AUTO-ORGANISATION CONSCIENTE DE LA CLASSE !
La formation du parti et des conseils sont deux moments séparés et fondamentaux dans le p processus d'auto-organisation de la classe. Aucune lutte ouvrière et encore moins au plus profonde de la contre-révolution ne sera victorieuse simplement parce que le "parti mondial" existera. Le parti mondial n'est pas simplement une collection de principes ; il est encore mo moins le produit de quelques sectes malade prenant ses propres rêves pour la réalité. Le parti mondial de demain signifie 1'auto-organisation militante et disciplinée des éléments les plus combatifs et les plus conscients de la classe qui, durant les luttes, jouent un rôle vital et dynamique dans l'effort de la classe pour s'organiser et remplir les tâches qui se présentent à elle. Le parti, produit de la lutte de classe, n'en émerge pas pour autant spontanément, au contraire son existence est préparée par de longues années de travail théorique et pratique. Nous devons, dès à présent nous engager dans ce travail préparatoire.
Bien que l'absence de minorités révolutionnaires dans les luttes des années 53 et 56 soit un symptôme de la faiblesse de la classe dans cette période, l'apparition et le renforcement de telles minorités depuis 1968 nous montre qu'une nouvelle période de lutte de classe est ouverte devant nous. Les grèves à Berlin-Est et Karl Marx Stadt, ainsi que les émeutes à Wittenberg et Erfurt qui eurent lieu récemment, annoncent qu'une nouvelle ère de luttes de classe et de crise sociale s'est ouverte en RDA. En Europe de l’Est, nous avons vu les premières tentatives courageuses du prolétariat pour résister à la crise (Pologne et Roumanie). Sans avoir atteint un haut degré de politisation ces luttes ont tracé des leçons essentielles pour la classe ouvrière mondiale : donner un démenti aux théories qui proclament "l'intégration" du prolétariat dans le capitalisme d'Etat à l'Est prétendument "paradis ouvrier", la preuve de l'unité internationale du combat ouvrier contre le capital sous toutes ses formes. 25 ans après la révolte des ouvriers d'Allemagne de l'Est, nous opposons à l'unité des brigands de la bourgeoisie, l'unité et la solidarité des ouvriers et révolutionnaires de tous les pays.
Krespel
[1] [192] La situation de Tchécoslovaquie en 1945 nous montre la réalité de ce développement capitaliste d'Etat qui a été mis en place sans les staliniens et les "partis ouvriers". D'après Benes, le chef d'Etat conservateur à l'époque : "Les allemands prirent simplement le contrôle de toutes les banques. S'ils ne les ont pas nationalisées directement, ils les mirent en fin de compte entre les mains de grands trusts allemands. Dans ce sens, ils ont préparé automatiquement le capital financier et l'économie de notre pays pour les nationalisations...Remettre ces propriétés et les banques entre les mains des propriétaires tchèques ou les renforcer sans une aide considérable de l'Etat et sans de nouvelles garanties financières, était tout simplement impossible. L'Etat devait aller de l'avant." ("Bureaucracy and Révolution", p.27).
[2] [193] Staritz p.107. L'auteur oublie ici qu'un accroissement de la masse salariale de 15% ne signifie pas une augmentation de 15% du salaire individuel mais d'abord et surtout un accroissement du nombre d'ouvriers.
[3] [194] Il s'agit du groupe constitué autour de Franz Dahlem. Chaque crise politique dans l'Europe de l'Est fait naître une fraction voulant "démocratiser" ou changer ceci ou cela, afin d'éviter l'affrontement avec le prolétariat. En 1956, c'était Gomulka en Pologne et Nagy en Hongrie. En 1968, c'était Dubcek en Tchécoslovaquie. Aujourd'hui c'est exactement la même chose avec l'Opposition en Pologne, les "droits de l'homme" en Russie, la "Charte 77" en Tchécoslovaquie et Bahro, Havemann, Biermann et leurs amis en RDA.
Géographique:
- Allemagne [195]
Heritage de la Gauche Communiste:
Espagne 1936 : le mythe des collectivités anarchistes
- 8177 reads
Les collectivités espagnoles de 1936 ont été présentées par les anarchistes comme le modèle parfait de la révolution. Selon eux, elles permettent l'autogestion ouvrière de l'économie, elles signifient l'élimination de la bureaucratie, elles augmentent le rendement du travail et "merveille des merveilles" sont "l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes"..."dirigés et orientés à tout moment par les libertaires", (selon les paroles de Gaston Levai, défenseur intransigeant de l'anarchisme et de la CNT).
Mais les anarchistes ne sont pas seuls à nous offrir le "paradis" des collectivités. Heribert Barrera -républicain catalaniste en 1936, aujourd'hui député aux Cortes- en fait l'éloge comme un "exemple d'économie mixte respectueuse de la liberté et de l'initiative humaine" (!!!) tandis que les trotskystes du POUM nous apprennent que "l'oeuvre des collectivités a donné un caractère plus profond à la révolution espagnole qu'à la révolution russe". G.Munis et les camarades du FOR (Fomento Obrero Revolucionario) se font des illusions sur le caractère "révolutionnaire" et "profond" des collectivités.
Pour notre part, nous nous voyons obligés de jouer une fois de plus les rabat-joie : les collectivités de 36 n'ont pas été un instrument de la révolution prolétarienne mais un instrument de la contre-révolution bourgeoise; elles ne furent pas "l'organisation de la nouvelle société" mais la planche de salut de l'ancienne qui s'est maintenue avec toute sa sauvagerie.
En disant cela, nous ne voulons pas démoraliser notre classe. Au contraire : la meilleure manière de la démoraliser est de la faire lutter pour de faux modèles de révolution. La condition môme pour la victoire de ses aspirations révolutionnaires est de se libérer complètement de tout faux modèle, de tout faux paradis.
Qu'ont été les collectivités
En 1936, l'Espagne, touchée de plein fouet par la crise économique qui, depuis 1929 secoue le capitalisme mondial, vit des convulsions particulièrement graves.
Tout capital national souffre de trois types de convulsions sociales :
- celui issu de la contradiction fondamentale bourgeoisie-prolétariat;
- celui provenant des conflits internes entre les différentes fractions de la bourgeoisie elle-même;
- celui qu'occasionne l'affrontement entre blocs impérialistes qui prennent chaque pays comme scène pour leurs luttes d'influence et comme marché.
Dans l'Espagne de 1936, ces trois convulsions confluèrent avec une intensité brutale, amenant le capitalisme espagnol à une situation extrême.
En premier lieu, le prolétariat espagnol -pas encore écrasé comme le furent ses frères européens mena une bataille énergique contre l'exploitation, jalonnée par une extraordinaire escalade de grèves générales, de révoltes et d'insurrection qui ont causé la plus grande alarme au sein de la classe dominante.
En second lieu, les conflits internes de celle-ci vont en s'aggravant. Une économie retardataire, déchirée par de formidables déséquilibres et dévorée pour cela avec plus d'intensité par la crise mondiale, est le meilleur bouillon de culture pour l'éclatement de conflits entre la bourgeoisie de droite (propriétaires terriens, financiers, militaires, clergé, commandés par Franco) et la bourgeoisie de gauche (industriels, classes moyennes urbaines, syndicats, etc dirigés par la République et le Front Populaire). Finalement, l'instabilité du capitalisme espagnol en fait une proie facile des convoitises impérialistes du moment, qui, éperonnés par la crise, ont besoin de nouveaux marchés et de nouvelles positions stratégiques. L'Allemagne et l'Italie tiennent leur pion avec Franco, dissimulé derrière le masque de la "tradition" et de "la croisade contre le communisme athée", tandis que la Russie et les puissances occidentales -alors amies- trouvent dans la République et le Front Populaire, leur bastion, dissimulés derrière le voile mystificateur de "l'anti-fascisme" et de la"lutte pour la révolution". Dans ce contexte, surgit le soulèvement de Franco, le fameux 18 juillet 1936 qui signifie pour la classe ouvrière l'apogée de la surexploitation et de la répression commencée par la République dès 1931. La réponse de la classe ouvrière est immédiate et foudroyante : grève générale, insurrection, armement des masses, expropriation et occupation des entreprises. Dès les premiers instants, toutes les forces de la bourgeoisie de gauche qui vont des partis républicains jusqu'à la CNT, essaient d'enfermer les ouvriers dans le piège de la lutte "antifasciste" et de transformer les expropriations d'entreprises en une fin en soi, pour faire retourner les ouvriers au travail avec l'illusion que les entreprises sont leurs, qu'elles sont "collectivisées".
Mais les journées insurrectionnelles de Juillet démontrent à satiété que la lutte ouvrière ne se développe pas seulement contre Franco mais aussi, à la fois, contre l'Etat républicain : les ouvriers font grève, exproprient les entreprises, s'arment comme classe autonome pour entamer une offensive contre l'ensemble de l'Etat capitaliste, aussi bien le Franquiste que le Républicain. Pour réussir la grève insurrectionnelle, les ouvriers ne pouvaient se satisfaire des expropriations et de la formation de milices, mais devaient détruire en même temps que l'armée franquiste toutes les forces républicaines (les Azana, Companys, le PC, la CNT, etc.) et, ensuite, détruire totalement l'Etat capitaliste, érigeant sug ses décombres le pouvoir des conseils ouvriers.
Cependant, la clé de l'échec du prolétariat et de son enrôlement dans la barbarie de la guerre civile, réside dans le fait que les forces républicaines -et par-dessus tous la CNT et le POUM- parvinrent à empêcher les ouvriers de franchir le pas décisif -détruire l'Etat capitaliste- et ils enfermèrent les ouvriers dans la "collectivisation de l'économie" et de la "lutte anti-fasciste".
Les nationalistes catalans, le Front Populaire, le POUM et surtout la CNT réduisirent la lutte des ouvriers à la simple expropriation des entreprises, les transformant en "COLLECTIVITES REVOLUTIONNAIRES", lesquelles en se maintenant au sein de 1'Etat capitaliste, le laissant intact, non seulement devinrent inutiles pour les ouvriers mais aussi se convertirent en un instrument de sa sur-exploitation et de contrôle du capital.
"Parce que le pouvoir de l'Etat restait en place, la Généralité de Catalogne pouvait légaliser tranquillement les expropriations ouvrières et faire choeur avec tous les courants "ouvriers" qui trompaient les ouvriers avec les expropriations, le contrôle ouvrier, la répartition des terres, les épurations, mais qui gardaient un silence criminel sur la réalité terriblement effective et peu apparente de l'existence de l'Etat capitaliste. Pour cette raison, les expropriations ouvrières sont restées intégrées dans le marché du capitalisme d'Etat".
BILAN
Ainsi, nous voyons que la CNT qui, à aucun moment, n'a appelé à la grève spontanée du 19 juillet, à prendre les armes, appelle ensuite à REPRENDRE LE TRAVAIL, A TERMINER LA GREVE, ou même s'oppose à l'assaut contre l'Etat capitaliste avec l'excuse que les entreprises sont collectivisées". Gaston Levai dans son livre "Collectivités Libertaires en Espagne" nous "raisonne" ainsi : "Quand se produisit l'attaque fasciste, la lutte et l'état d'alerte mobilisèrent la population durant cinq ou six jours, à la fin desquels la CNT donna l'ordre de reprendre le travail. Prolonger la grève aurait été contre les intérêts des travailleurs eux-mêmes qui assumaient la responsabilité de la situation".
Les belles collectivités "libertaires" qui étalent "une révolution plus profonde que la révolution russe" - toujours selon le POUM- justifièrent le RETOUR AU TRAVAIL, LA FIN DE LA TENTATIVE REVOLUTIONNAIRE, LA SOUMISSION DES OUVRIERS A LA PRODUCTION POUR LA GUERRE. Dans les conditions d'alors de convulsions et de désagrégation extrêmes de l'édifice capitaliste, la façade radicale des collectivités fut l'ultime recours pour faire travailler les ouvriers et sauver l’ordre exploiteur comme le reconnaît franchement Osorio Gallardo, politicien monarchiste et de droite :"Jugeons impartialement. Les collectivités ont été une nécessité. Le capitalisme avait perdu toute son autorité morale et les maîtres ne pouvaient plus ordonner et les ouvriers ne voulaient plus obéir. Dans une situation aussi angoissante, ou l'industrie restait abandonnée, ou bien la Généralité s'en chargeait, établissant un communisme soviétique".
AU SERVICE DE L'ECONOMIE DE GUERRE
Quand on nous dit que les collectivités furent un modèle de "communisme", de "pouvoir ouvrier", qu'elles furent "une révolution plus profonde que celle en Russie", il y a de quoi éclater de rire : la quantité de renseignements, de faits et de témoignages qui montrent le contraire sont accablants Voyons donc :
Premièrement : un grand nombre de collectivisations se fit avec l'accord des patrons eux-mêmes. A propos de la collectivisation de l'industrie chocolatière de Torrente (Valence), Gaston Levai, dans le livre précédemment cité, écrit :
"Motivés par le désir de moderniser la production (?) Comme de supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme (sic), il y eut une assemblée le 1er septembre 1936. Les patrons furent invités à participer à la collectivité tout comme les ouvriers. Et tous acceptèrent de s'associer pour organiser la production et la vie sur des bases inédites".
Les, "bases inédites" de la vie se construisaient en respectant tous les piliers du régime capitaliste ! Ainsi, la collectivité des tramways de Barcelone "non seulement accepta de payer aux créditeurs de la Compagnie les dettes contractées, mais aussi traita avec les actionnaires qui furent convoqués à une assemblée générale"(idem). Quelle profonde révolution que celle qui respecte les dettes antérieures et respecte les intérêts des actionnaires ! Quelle étrange manière d'organiser la production et la vie sur des bases inédites !
Deuxièmement : les collectivités servirent aux syndicats et partis politiques bourgeois à reconstruire l'économie capitaliste : - en concentrant les entreprises :
"Nous nous sommes chargés des ateliers avec un nombre insignifiant de travailleurs sans embryons syndicaux dont l'inactivité portait préjudice à l'économie".
Rapport du syndicat du bois de la CNT de Barcelone (1937)
- en rationalisant l'économie
"En premier, nous avons établi la solidarité financière des industries, organisant un Conseil général de l'économie* où chaque branche envoyait deux délégués. Les ressources excédentaires serviront pour aider les industries déficitaires afin qu'elles reçoivent les matières premières et autres éléments de production".
CNT de Barcelone 1936
- en centralisant la plus-value et le crédit pour les canaliser selon les besoins de l'économie de guerre.
"Dans toutes les entreprises collectivisées, 50 % des bénéfices seront destinés à la conservation des ressources propres et les 50 % restants seront mis à la disposition du Conseil économique local ou régional correspondant"
Rapport de la CNT sur les collectivités Décembre 1936
Comme on le voit, pas un centime de bénéfice pour les travailleurs, mais cela ne fait rien ! Gaston Levai le justifie avec le plus grand cynisme: "On peut avec raison se demander pourquoi les bénéfices ne sont pas répartis entre les travailleurs dont les efforts fournissent ces bénéfices; à cela nous répondons : parce qu'ils sont réservés à des fins de solidarité sociale".
En fait de solidarité "sociale" avec l'exploitation, avec l'économie de guerre, avec la misère la plus terrible !
Troisièmement : les collectivités ne touchent pas au capital étranger, "pour ne pas incommoder les pays amis"selon le POUM, ce que nous traduisons par : afin de s'assujettir aux puissances impérialistes qui soutiennent le gang républicain. Merveilleuse et profonde révolution que voilà !
Quatrièmement : les organismes qui géraient et dirigeaient les collectivités (syndicats, partis politiques, comités) étaient pleinement intégrés à l'Etat capitaliste :
"Les comités de fabrique et les comités de contrôle des entreprises expropriées se transformèrent en organes pour activer la production et pour cette raison, ils furent défigurés quant à leur signification de classe. Il ne s'agissait plus là d'organismes créés dans le cours d'une grève insurrectionnelle pour démolir l'Etat, mais d'organes orientés vers la production de guerre, condition essentielle pour permettre la survivance et le renforcement de cet Etat".
BILAN
Et quant aux partis et syndicats, ce sont non seulement les forces du Front Populaire mais aussi les organisations plus "ouvrières" et plus "radicales" qui sont intégrées à l'Etat : la CNT participa au Conseil Economique de Catalogne avec quatre délégués, au gouvernement de la Généralité de Catalogne avec trois ministres et au gouvernement central de Madrid avec trois autres. Mais ce n'est pas seulement au sommet de l'Etat qu'ils participèrent pleinement mais aussi à la base de cet Etat, village par village, entreprises par entreprises, quartiers par quartiers. L'Espagne républicaine a vu des centaines de maires, de conseillers, d'administrateurs, de chefs de police, d'officiers militaires, etc., "libertaires"...
Mais ces forces ne sont pas seulement partie intégrante de l'Etat par leur participation directe en son sein. C'est toute la politique qu'elles défendaient qui faisaient d'elles la chair et le sang de l'ordre capitaliste. Cette politique qui entravait à tout moment l'action des collectivités était l'unité anti-fasciste, qui justifia le sacrifice des ouvriers sur le front militaire et la sur-exploitation de l'arrière-garde. Gaston Levai nous explique clairement cette politique qui, parmi d'autres, mena la CNT :"il fallait défendre les libertés si relatives et pourtant si appréciables représentées par la République". Gaston Levai "oublie" "l'appréciable" "liberté ouvrière" qui signifie la répression de la République contre les grèves ouvrières (rappelons nous Casas Viejas, Alto Llobregart, Asturias...) "Il ne s'agissait pas de faire une révolution sociale, ni d'implanter le communisme libertaire, ni d'une offensive contre le capitalisme, l'Etat ou les partis politiques-: il fallait empêcher le triomphe du fascisme" (G.L). Pourquoi diable la CNT, les anarchistes et compagnie critiquent-ils donc le PCE s'ils défendaient la même chose ! si leur programme était le même : la défense du capitalisme sous le masque de 1'anti-fascisme !
Cinquièmement : le caractère "révolutionnaire", "anti-capitaliste", "libertaire" des collectivités fut convenablement canalisé par l'Etat capitaliste qui les reconnut au travers du Décret de collectivisation (24/10/36) et les coordonna par la constitution du Conseil de l'Economie. Et savez-vous qui signa ces deux décrets ? Mr Tarradellas aujourd'hui brillant président de la Généralité de Catalogne !
Nous sommes obligés de conclure que les collectivités ne signifièrent pas la plus petite attaque contre l’ordre bourgeois mais furent une forme que celui-ci adopta pour réorganiser l'économie et maintenir l'exploitation à un moment d'extrême tension sociale et d'énorme radicalisation ouvrière qui ne permettait pas d'utiliser les méthodes traditionnelles :
"Face à un incendie de classe, le capitalisme ne peut même pas penser à recourir aux méthodes classiques de la légalité. Ce qui le menace est l'INDÉPENDANCE de la lutte ouvrière qui conditionne la prochaine étape révolutionnaire jusqu'à l'abolition de la domination bourgeoise. Par conséquent, le capitalisme doit retisser la maille de son contrôle sur les exploités. Les fils de cette maille qui avant étaient la magistrature, la police, les prisons se transforment dans la situation extrême de Barcelone en Comités de milice, en industries socialisées, en syndicats ouvriers, en patrouilles de vigilance, etc.".
L'IMPLANTATION DE L'ECONOMIE DE GUERRE
Une fois vue la nature d'instrument capitaliste des collectivités, nous allons voir le rôle qu'elles ont joué, et celui-ci fut d'implanter au sein du prolétariat une économie de guerre draconienne, qui permit d'affronter le énormes frais et la gigantesque saignée de ressources que supposait la guerre impérialiste qui se déroulait en Espagne en 1936-39.
En peu de mots, l'économie de guerre suppose trois choses :
1) La militarisation du travail
2) Le rationnement
3) Canaliser toute la production vers une fin exclusive, totalitaire et monolithique : la GUERRE.
Le cache-sexe des collectivités servit à la bourgeoisie pour imposer aux ouvriers une discipline militaire dans le travail, l'allongement de la journée de travail, la réalisation d'heures supplémentaires non payées...
Un journal bourgeois chantait joyeusement "l'ambiance" régnant à l'usine Ford de Barcelone : "Il n'y avait ni commentaires ni controverses. D'abord la guerre et pour elle travailler et travailler sans cesse... Optimistes et satisfaits, cela ne leur faisait rien que leur comité -constitué de camarades travailleurs comme eux- établisse des consignes rigides et détermine plus d'heures de travail. Ce qui était important était de vaincre le fascisme »1. Le statut des collectivités définissait clairement l'implantation de la militarisation du travail : "Article 24 : tous travailleront obligatoirement sans limite de temps pour ce qui est nécessaire au bien de la collectivité"'. "Article 25 : tout collectiviste est obligé* en plus du travail qui lui est normalement assigné, de donner son aide où que ce soit pour tous les travaux urgents ou imprévus "(Collectivité de Jatina-Valence).
Dans les "assemblées" des collectivités s'imposaient "démocratiquement" de plus en plus de mesures de militarisation : "On décida d'organiser un atelier où les femmes iraient travailler au lieu de perdre leur temps dans la rue... On finit par décider que chaque atelier aurait une déléguée qui se chargerait de contrôler les apprenties, lesquelles si elles manquaient deux fois sans motif seraient renvoyées sans appel". (Collectivité de Tamarite-Huesca).
Quant aux rationnements, une revue catalaniste de l'époque nous explique très clairement la méthode "démocratique" de les imposer au prolétariat :"Dans tous les pays, on oblige les citoyens à tout économiser, depuis les métaux précieux jusqu'aux pelures de pommes de terre. Le pouvoir public exige d'eux ce régime de rigueur. Mais ici, en Catalogne, c'est le peuple qui spontanément complète son oeuvre, s'imposant volontairement, consciemment un rationnement rigoureux".
La première loi de 1'"ultra-révolutionnaire" Conseil d'Aragon de Durruti et autres satrapes fut :"Pour les fournitures des collectivités, on établira une carte de rationnement". Ces rationnements imposés comme des "mesures révolutionnaires" et "consciemment acceptés par les citoyens" signifièrent une misère indescriptible pour les ouvriers et pour toute la population. Gaston Levai reconnaît sans vergogne :
"Dans la majorité des collectivités, la viande manquait presque toujours et peu à peu il manqua jusqu'aux pommes de terre"(opus cité).
Finalement, la discipline militaire, les rationnements que la bourgeoisie impose derrière le masque des collectivités, avait une fin unique : sacrifier toutes les ressources économiques et humaines aux dieux sanguinaires de la guerre impérialiste :
- Dans la collectivité de Mas de las Matas (Barcelone) et suivant proposition de la CNT :
"On adapta les installations du cellier à la fabrication d'alcool à 96 ° indispensable aux médecins du front. On limita également l'achat de vêtements, de machines, etc., destinés à la consommation des gens de la collectivité car ces ressources ne devaient pas servir au luxe mais au front".
- Dans les collectivités d'Alicante :"Le gouvernement reconnaissant les progrès de la collectivisation dans la province, commanda des armes aux ateliers syndicaux d'Alcoy, du tissu à l'industrie textile socialisée et des chaussures à l'industrie d'Elda également aux mains des libertaires, avec pour but d'armer, de vêtir et de chausser les soldats". (Gaston Levai)
LES COLLECTIVITES: INSTRUMENTS DE SUREXPLOITATION
La démonstration la plus palpable du caractère anti-ouvrier des sinistres "collectivités" anarchistes est, que grâce à elles, la bourgeoisie républicaine réduisit jusqu'à une limite intolérable les conditions de travail et de vie des ouvriers :
- Les salaires : ceux-ci, de juillet 1936 à décembre 1938 diminuèrent nominalement de 30 %, tandis que la chute du niveau de vie fut pire encore : plus de 200 %\
- les prix : Ils passèrent de l'indice 168,8 en 1936 (indice 100 en 1913) à celui de 564 en novembre 1937 et 687,8 en février 1938.
- Le chômage : malgré l'énorme saignée de gens envoyés au front, laquelle diminua le chiffre des chômeurs, celui-ci grimpa de 39 % entre janvier 1936 et novembre 1937.
- La durée du travail : elle monta à 48 H (en 1931, elle était de 44H, en juillet 36, la Généralité, pour calmer la lutte ouvrière, décréta la semaine de 40H, mais quelques mois plus tard, cette mesure disparut du plan avec l'excuse de l'effort de guerre et de la "collectivisation". Le nombre d'heures supplémentaires augmenta la durée du travail de30%. Ce furent précisément les organisations "ouvrières" (PCE, UGT, P0UM et surtout la CNT) qui réclamèrent avec plus de véhémence la surexploitation et la dégradation de la situation des ouvriers.
Peiro, bonze de la CNT écrivit en août 1936 : "Four les besoins nationaux, la semaine de 40h n'est pas assez, celle-ci ne peut certainement pas être plus inopportune".
Les consignes syndicales de la CNT sont des plus "favorables" aux ouvriers : "Travailler, produire et vendre. Aucune revendication salariale ou autre. Tout doit rester subordonné à la guerre. Dans toute la production qui a un lien direct ou indirect avec la guerre anti-fasciste, on ne pourra exiger que soient respectées les bases le travail, que ce soit pour les salaires ou la durée du travail. Les ouvriers ne pourront demander des rémunérations spéciales pour les heures extra effectuées pour la guerre anti-fasciste et devront augmenter la production par rapport à la période antérieure au 9 juillet."
Le PCE quant à lui crie :"Non aux grèves dans l Espagne démocratique ! Pas un ouvrier oisif à l'arrière. !".
Naturellement, les collectivités, comme instrument de "pouvoir ouvrier" et de "socialisation" aux mains de l'Etat furent l'excuse qui fit avaler aux ouvriers cette brutale réduction de leurs conditions de vie.
Ainsi, dans la collectivité de Graus (Huesca) :"aux femmes on ne paiera pas de salaire pour leur travail étant donné que leurs besoins sont couverts par le salaire familial!. Dans la collectivité d'Hospitalet (Barcelone) "comprenant la nécessité d'un effort exceptionnel, on repoussa l'augmentation de S % des salaires et la diminution de la journée de travail décrétée par le gouvernement". Encore plus royaliste que le gouvernement !
CONCLUSIONS
Rappeler la douloureuse expérience historique dont souffrit le prolétariat espagnol, dénoncer la grande escroquerie des collectivités, par laquelle la bourgeoisie parvint à le tromper, ce n'est pas là une question pour intellectuels ou érudits, c'est une nécessité vitale pour ne pas retomber dans le même piège. Pour nous vaincre et pour nous faire avaler des mesures de surexploitation, de chômage, de sacrifice, la bourgeoisie recourt au mensonge; elle se déguise en "ouvrière" et "populaire" (en 1936, les bourgeois se faisaient des cals aux mains et s'habillaient en "ouvriers"); elle"socialise" et fait autogérer les usines, elle appelle à toutes les formes de solidarité inter-classiste, derrière les drapeaux de "l'anti-fascisme", de la "défense de la démocratie", de la "lutte anti-terroriste".., Elle donne aux ouvriers la fausse impression qu'ils sont "libres", qu'ils "contrôlent" l'économie, etc.. Mais derrière tant de"démocratie", "participation" et "autogestion", se cache intact, plus puissant et renforcé que jamais, 1'APPAREIL D'ETAT BOURGEOIS autour duquel les RELATIONS CAPITALISTES DE PRODUCTION se maintiennent et s'aggravent dans toute leur sauvagerie.
Aujourd'hui, alors que les lois fatales du capitalisme sénile, le conduise vers la guerre, ce sont le "sourire", la "confiance dans les citoyens", la "plus grande démocratie", l’"autogestion", qui sont le grand théâtre par lequel le capitalisme demande de plus en plus de sacrifices, de plus en plus de chômage, de plus en plus de misère, de plus en plus de sang sur les champs de bataille. Les "collectivités" de 1936 furent un des faux modèles, un des paradis, une des belles illusions de plus au travers desquelles le capitalisme amena les ouvriers à la défaite et au massacre. La leçon de ces événements doit être tirée et servir aux prolétaires d'aujourd'hui pour déjouer les pièges que le capital leur tend, afin d'avancer vers leur libération définitive.
E.F. (Traduit de A.P n° 20)
Géographique:
- Espagne [196]
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [197]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [112]
- Anarchisme officiel [198]
Approfondir:
- Espagne 1936 [199]
Sur la question nationale : (réponse a «Solidarity »)
- 3443 reads
Ce texte a été rédigé pour être publié dans le milieu révolutionnaire en Scandinavie. En effet, des camarades d'Oslo (Norvège) avaient l'intention de publier un texte de Solidarity qui s'intitule "Le Tiers-mondisme et le Socialisme" et ils nous ont demandé une réponse critique à ce texte. Puisque vraisemblablement, ce projet ne s'est pas réalisé jusqu'à présent, nous jugeons utile de publier ce texte nous-mêmes dans notre presse.
On constate que des éléments révolutionnaires en Scandinavie -comme d'autres qui surgissent en Amérique, en Inde ou à Hong-Kong- tombent souvent sous l'influence des idées anarchistes, "libertaires", telles qu'elles sont véhiculées par le groupe Solidarity. Les thèmes traités dans cette critique -signification de la décadence capitaliste, des "luttes de libération nationale"; nature de classe de la révolution russe- sont particulièrement difficiles à comprendre pour les éléments révolutionnaires d'aujourd'hui coupés des acquis théoriques des fractions communistes du passé. Chaque fois, on en revient aux mêmes questions comme si elles n'avaient jamais été posées dans le passé. "Oui, Cuba ou la Chine sont des pays capitalistes mais... il doit y avoir quand même quelque chose de progressiste dans le développement de ces régimes..." ou bien "La Russie est un pays capitaliste aujourd'hui et par conséquent... la révolution d'Octobre 17 est une révolution bourgeoise...". Bien que débattre de ces questions soit nécessaire à la clarification politique, celle-ci est souvent bloquée par l'intervention de courants qui cherchent à donner un cadre plus élaboré à ces confusions inextricables. Tel est le rôle de Solidarity avec sa théorie du "nouveau capitalisme bureaucratique"; tel est le râle des bordiguistes avec leurs fantaisies sur les "jeunes capitalismes" du tiers-monde ou la "révolution double" (c'est-à-dire bourgeoise et prolétarienne) d'Octobre 17. Dans le texte qui suit, nous nous efforçons de confronter ces aberrations théoriques avec la vision historique claire défendue par Rosa Luxembourg à l'époque de la première guerre mondiale et par Bilan dans les années 30 : à l'époque de la décadence capitaliste, il ne peut plus y avoir de révolution bourgeoise nulle part dans le monde; c'est la révolution prolétarienne qui est à l'ordre du jour partout, dans tous les pays.
Le texte traite brièvement des origines de Solidarity et des idées de Cardan telies qu'elles sont présentées dans "Modem Capitalism" et "The Cnsis of Modem Society". Rupture positive avec le trotskisme à l'origine, Socialisme ou Barbarie, le groupe de Cardan/Chaulieu et Solidarity plus tard, tous deux imprégnés de conceptions héritées du trotskysme, ont été incapables de répondre aux événements. Socialisme ou Barbarie a eu le bon goût de disparaître avant que le resurgissement de la crise capitaliste mondiale n'ait démystifié sa théorie d'un soi-disant capitalisme "sans crises", et avant que le groupe n'ait abandonné toute prétention à une position prolétarienne. Par contre, l'existence actuelle de Solidarity ne fait que souligner les contradictions, les absurdités de ses idées. Ecrit avant la fusion de Solidarity avec un autre groupe libertaire, Social Révolution (scission du groupe fossilisé The Socialist Party of Great Britain), le texte note déjà une tendance qui semble s'accélérer depuis la fusion : l'abandon progressif des positions de classe en faveur du point de vue de "l'individu autonome". Cette évolution vers l'individualisme ([1] [200]) et l'"alternate life-styles" (la vie quotidienne "désaliénée") s'accompagne d'une évolution rapide vers des positions purement et simplement gauchistes sur des questions cruciales telles que les syndicats et l'anti-fascisme. L'incohérence théorique mène toujours à l'opportunisme en pratique, vers la trahison des principes fondamentaux.
En publiant ce texte donc, nous espérons contribuer à l'évolution politique des courants qui surgissent actuellement -de la Californie à Bombay, d'Oslo à Hong-Kong. Contrairement à Socialisme ou Barbarie et Solidarity, la majorité de ces courants ne vient pas du marasme contre-révolutionnaire du trotskysme, mats a surgi dans une période plus favorable au développement des groupes communistes que ne liétaient les années 50 ou le début des années 60. Il y a ainsi plus de chances d'éviter de répéter les erreurs du passé et de devenir partie prenante de l'avenir révolutionnaire.
La brochure de Solidarity : "Ceylan : la montée du JVP en avril 1971", contient un appendice qui s'appelle "tiers-mondisme ou socialisme ?" (paru par ailleurs dans une autre brochure de Solidarity : "Viêt-Nam : quelle victoire ?".) Le point de vue de Solidarity sur les soi-disant luttes de libération nationale apparaît particulièrement clairement dans cet appendice, qui contient aussi quelques brefs commentaires sur la révolution russe. Nous tenterons de traiter ici des positions de Solidarity sur ces deux questions d'importance vitale, dans 1'espoir d'ouvrir une discussion dans le mouvement révolutionnaire actuel.
La Question des Révolutions bourgeoises dans les Sphères Arriérées du Capitalisme Mondial
L'appendice établit que "dans des conditions favorables, toute bureaucratie peut "résoudre" le problème des tâches bourgeoises dans le tiers-monde". Il parle aussi "des nouvelles classes dominantes" dans le tiers-monde qui prennent en charge la réalisation de "l'accumulation primitive" du capital dans le cadre de leurs frontières nationales". Les "révolutions bourgeoises tardives" dit aussi Solidarity, permettent d'"élever le niveau de consommation des masses"et de mettre en place des "programmes sociaux" pour elles.
En 1919, l'Internationale Communiste (IC) a affirmé que le capitalisme était entré dans sa phase de décadence, l'ère de la révolution prolétarienne ou de la guerre inter-impérialiste. Mais pour Solidarity, nous sommes à l'époque du "capitalisme moderne" où tout est possible, y compris "des révolutions bourgeoises tardives" ainsi qu'un progrès économique sans fin pour l'ensemble du capitalisme. Le CCI défend aujourd'hui l'analyse de TIC ([2] [201]). A la lumière des 50 dernières années de contre -révolution et de guerres inter-impérialistes, il devrait être évident que la classe capitaliste, existant à l'échelle mondiale, est devenue une classe complètement réactionnaire, en même temps qu'avec la première guerre mondiale, le capitalisme entrait dans sa période de décadence. L'époque des révolutions bourgeoises, l'époque de l'ascendance du capitalisme en tant que système progressif de reproduction humaine a pris fin avec la première guerre mondiale. Les guerres de "libération nationale" de ce siècle sont devenues des arènes pour la confrontation impérialiste mondiale, des bancs d'essai pour d'autres guerres impérialistes mondiales et des charniers pour les ouvriers et les paysans sans terres. Aujourd'hui, il n'y a plus de révolutions bourgeoises possibles et seule la révolution communiste peut ouvrir à l'humanité une nouvelle ère de progrès et de développement.
Aux 18ème et 19ème siècles, la révolution bourgeoise était une possibilité historique. De telles révolutions, comme Marx fut capable de l'analyser, étaient des mouvements politiques progressistes qui permettaient de libérer les énormes forces productives du capitalisme ascendant. Ces révolutions ont irrésistiblement arraché les entraves précapitalistes et féodales pour pouvoir développer le progrès social. A partir des marchés locaux, régionaux, nationaux, la bourgeoisie a étendu son système jusqu'à créer le marché mondial et le prolétariat mondial. La fonction la plus progressive qu'a en fin de compte remplie le jeune ordre bourgeois, c'est la création et la consolidation du marché mondial. Mais en 1914, ce marché était devenu complètement saturé par rapport à la capacité progressive croissante du système dans son ensemble. Dès lors, le système est entré dans sa phase de déclin, une période de crise permanente et de guerre impérialiste cyclique, une période caractérisée par la croissance incessante de la production de gaspillage et les préparatifs de guerre.
Il est tout aussi faux de parler d'"accumulation primitive" dans les aires arriérées du capitalisme aujourd'hui. Cette étape du développement du capitalisme constituait un moment progressif dans la destruction du féodalisme et la création du prolétariat à l'échelle mondiale. L'accumulation primitive est donc une composante historique du capitalisme ascendant. Elle ne peut avoir à nouveau lieu pendant sa phase de décadence. C'est un non-sens que de parler à la fois d'impérialisme et d'accumulation primitive qui auraient lieu au même moment, dans un système qui a créé le marché capitaliste mondial. Non seulement les conditions objectives du socialisme existent à l'échelle mondiale, mais encore elles existent depuis 50 ans. Seule la défaite de la vague de luttes prolétariennes en 1917-23 a permis qu'ait lieu la contre-révolution bestiale du stalinisme et autres variantes capitalistes d'Etat comme le maoïsme, ou le castrisme. Ces mouvements contre-révolutionnaires n'ont pas libéré les forces productives, nationalement ou internationalement. Ils n'ont pas ouvert à l'humanité des horizons nouveaux comme le firent la révolution française de 1789 ou les révolutions européennes de 1848. Ils sont bien plutôt apparus comme des expressions de la victoire de la contre-révolution sur le prolétariat. Les plans quinquennaux de Staline et les collectivisations de Mao n'étaient pas historiquement progressifs ; ils furent inévitables une fois que l'alternative prolétarienne à la décadence capitaliste - la révolution mondiale - fut écrasée par la bourgeoisie, y compris et surtout par ses fractions de gauche comme les staliniens. Seule la révolution prolétarienne est aujourd'hui progressive pour l'humanité. Toute autre sorte de "révolution" n'est qu'une convulsion d'une fraction de la bourgeoisie qui répond à la crise, à la guerre impérialiste, et à la nécessité d'étatiser l'économie. Et puisque l'ensemble de l'économie mondiale est aujourd'hui déterminé par des rapports de production complètement décadents, toute étatisation de l'économie nationale (ou ce que Solidarity appelle "l'accumulation primitive") ne constitue qu'un renforcement de ces rapports de production dépassés, sur une échelle nationale. Pour toutes ces raisons, la République de Weimar par exemple n'était pas une révolution bourgeoise allemande "tardive". Au contraire, elle représentait la destruction de la révolution prolétarienne en Allemagne, le massacre de plus de 20000 militants prolétariens entre 1918 et 1919. Les révolutionnaires ne peuvent pas confondre la victoire de la contre-révolution mondiale avec la période, à jamais finie, d'ascendance du capitalisme.
En dépit des banalités répandues par les "experts" en économie, le progrès matériel ne se mesure pas par des augmentations de rendement, par la création de nouvelles usines, par le plein emploi ni par la croissance numérique apparente de la classe ouvrière. Aujourd'hui, de tels mythes de technocrates ne servent qu'à cacher le gonflement de production de gaspillage. En d'autres termes, le développement de moyens de destruction ne représente pas un accroissement des valeurs d'usage qui peuvent être consommées de façon productive dans le processus d'accumulation capitaliste. Pour le capital global, y inclus les secteurs arriérés de l'économie mondiale, la production de gaspillage et les dépenses militaires constituent une stérilisation de la plus-value. Un bref examen du "progrès économique" réalisé par les "révolutions bourgeoises tardives" de Solidarity montrera qu'il n'y a pas eu de progrès matériel dans ces pays. Le déclin économique s'est poursuivi là comme ailleurs, et s'il s'est produit quelque chose c'est que les contradictions dans ces pays sont devenues plus brutales et plus intolérables. La Chine, Cuba, le Vietnam, etc. ont des dépenses d'Etat énormes, orientées vers la production de gaspillage et une économie de guerre ; la Chine dépense plus de 30% de son produit national en armements. Ces pays ne peuvent pas échapper aux lois du système, pas plus que ne le peuvent les pays européens, la Russie et les Etats-Unis.
Partout le prolétariat se trouve confronté à l'austérité, au chômage - masqué ou non -, à une exploitation croissante, à une répression policière plus grande, à l'inflation et à des réductions de salaires brutales. Partout le prolétariat se trouve face aux diktats d'un système qui s'oriente de plus en plus vers la guerre impérialiste, vers une barbarie complète. Où sont donc les "plus hauts niveaux de consommation" et les "programmes sociaux" de Solidarity ?
La Première Internationale a pu soutenir Lincoln et le Nord contre les esclavagistes du Sud, durant la guerre civile mexicaine ; de même, le mouvement ouvrier du siècle dernier a soutenu la petite-bourgeoise "jacobine" d'Italie, de Pologne et d'Irlande dans sa lutte contre le féodalisme et la réaction absolutiste. Comment était-ce possible ? Solidarity ne le voit pas du tout. A cette époque, le prolétariat luttait encore dans un contexte social où le système était économiquement progressif. Aussi la classe ouvrière pouvait-elle soutenir certaines tendances capitalistes spécifiques sans perdre pour autant sa propre autonomie de classe. La lutte contre le féodalisme que menait la bourgeoisie et que soutenait le prolétariat, libérait les rapports de production capitalistes et dans ce sens, renforçait le prolétariat dans la préparation de sa propre révolution, lorsque le capitalisme aurait achevé son rôle historiquement progressif. Dans les conditions d'aujourd'hui, une telle stratégie ne fait que mener le prolétariat au massacre puisque partout la bourgeoisie s'affronte directement au prolétariat. Aujourd'hui le capitalisme est un système mondial. Le féodalisme a été vaincu par le développement du capitalisme dans sa période ascendante. Dans une époque d'impérialisme mondial, il ne peut plus y avoir de révolution bourgeoise contre le féodalisme. La libération nationale dans le tiers-monde aujourd'hui ne veut pas dire la lutte d'un capitalisme montant contre des modes de production précapitalistes ou féodaux mais veut dire lutte inter-impérialiste menée à l'échelle d'un capital national particulier. Dire, comme le fait Solidarity, que des "révolutions bourgeoises" peuvent se produite aujourd'hui mais que le prolétariat ne doit pas soutenir la bourgeoisie dans sa "lutte", est complètement absurde. Quand les révolutions bourgeoises contre le féodalisme étaient possibles, le prolétariat les soutenait. Aujourd'hui, si le prolétariat ne peut pas soutenir une quelconque fraction de la bourgeoisie, c'est parce que le capitalisme a termine sa mission historique. Ce qui est aujourd'hui historiquement à Tordre du jour, c'est la révolution communiste.
Cependant, puisque Solidarity défend l'idée que des "révolutions bourgeoises" sont possibles aujourd'hui dans les pays sous-développés, sur quoi se base-t-il donc pour s'opposer aux régimes qui surgissent de ces "révolutions" ? Après tout, Solidarity est d'accord avec les proclamations de ces gouvernements selon lesquels la "révolution" a pour résultat le développement économique. Solidarity veut même flatter ces gouvernements en les traitant de "jacobins" ou de révolutionnaires bourgeois. Mais en abandonnant ainsi l'analyse matérialiste du développement historique du capitalisme, Solidarity n'en reste qu'au moralisme lorsqu'il établit son opposition à ces régimes. C'est une opposition purement idéaliste et utopique. Voila Solidarity qui déverse son mépris quand il parle des ""Révolutionnaires bourgeois tardifs" de Ceylan, de la Chine ou du Vietnam, tout en admettant en même temps qu'ils remplissent une tâche historique progressiste et inévitable en développant les forces productives du capitalisme. Mais si c'était vrai, il n^ aurait alors rien de "tardif" à la montée de Mao, Castro ou Allende. En fait, leur montée au pouvoir serait tout à fait à propos pour le capital. De plus, toute cette période pourrait être caractérisée, de façon tout à fait justifiée, comme celle des "révolutions bourgeoises tardives", promettant au capitalisme un développement éternel jusqu'au moment où le dernier village de Patagonie se sera engagé dans la "reproduction élargie", après avoir terminé sa "propre" "accumulation primitive".
Dans le point de vue de Solidarity, il y a donc une étrange séparation entre la réalité économique et la lutte de classe. Pour les marxistes, le capitalisme doit entrer dans sa phase de décadence en tant que système social avant que le prolétariat mondial puisse directement lutter pour le communisme. Si le capitalisme peut continuer à se développer économiquement, si des "révolutions bourgeoises", "tardives" ou autres, peuvent se produire aujourd'hui,alors la révolution communiste n'est pas seulement une impossibilité objective, mais est subjectivement impossible jusqu'au moment où le capital aura terminé son évolution progressiste. Mais pour Solidarity, cela n'a aucune importance de savoir si oui ou non le capitalisme est décadent en tant que système de reproduction économique. Ce qui est important, c'est la conscience subjective des "dirigés" et c'est tout. Si les "dirigés" veulent la révolution, alors la révolution aura lieu, même si cela veut dire que la révolution prolétarienne est simultanée à une révolution bourgeoise dans un autre coin du globe. Si Solidarity était logique, alors il défendrait la position que la révolution était possible n'importe quand, même au 19ème siècle. Si les conditions objectives de la décadence capitaliste n'ont aucune importance aujourd'hui, pourquoi les conditions objectives du développement capitaliste dans sa phase d'ascendance en auraient-elles ?
Aux yeux du mouvement marxiste cependant, la révolution prolétarienne obéit à une nécessité historique. La révolution prolétarienne n'est historiquement à Tordre du jour que lorsque le capitalisme est entré mondialement dans une ère de déclin. D'après Solidarity, le capitalisme aurait une superstructure politique complètement autonome, indépendante des fondements économiques. Cuba, la Chine, la Russie se sont tous développés "économiquement", mais"politiquement" les répercussions de ces "révolutions bourgeoises tardives" sont négatives et réactionnaires. La vérité, c'est qu'il existe une interconnexion réelle entre le déclin économique du système capitaliste mondial et son déclin politique. Le "progrès économique" de bien des nations arriérées "libérées" comme la Chine, la Corée du Nord ou le Vietnam peut bien impressionner des scribes tels que Myrdal ou Cajo Brendel, mais les révolutionnaires doivent comprendre le contenu réel de ce "progrès". Nous avons déjà mentionné la production de gaspillage chronique de ces économies et le fait que ce sont des Etats policiers. La nécessité pour la bourgeoisie à notre époque et dans ces régimes en particulier, de réprimer brutalement le prolétariat exprime la profonde faiblesse de tels régimes, à la fois au niveau économique et politique. De tels régimes doivent se lancer dans la concurrence de façon militaire s'ils veulent survivre sur le marché mondial.
A l'exception de la Russie (qui est elle-même une puissance impérialiste dominante même si elle est plus faible que les Etats-Unis), de tels régimes ne peuvent qu'avoir une existence fragile et précaire, passant d'un bloc impérialiste à l'autre. Il est complètement impossible pour ces régimes de conquérir une quelconque indépendance nationale. Chaque fois que ces aires ont servi comme arènes de la lutte inter impérialiste (comme l’héroïque" Vietnam), elles n'ont fait que renforcer la puissance impérialiste de l'un ou 1'autre des deux grands blocs impérialistes. Les luttes de libération nationale (sic) n'"affaiblissent" jamais l'impérialisme comme les gauchistes (et Solidarity dans sa brochure sur le Vietnam) le prétendent. La bourgeoisie américaine est tout autant assurée de sa puissance impérialiste qu'elle ne l'était avant la guerre du Vietnam. C'est tout autant absurde de parler de "révolutions bourgeoises" dans le tiers-monde qui développeraient des forces productives dans ces pays. Aucun de ces capitaux nationaux "libérés" n'a atteint un niveau de productivité du travail qui soit comparable à celui des pays développés. Au lieu de faire des comparaisons arbitraires au niveau local comme le font les apologistes de ces régimes, une comparaison véritable doit être faite entre la productivité économique des pays avancés par rapport à celle qu'accomplissent aujourd'hui les régimes de "libération nationale". Plutôt que de comparer la Chine de Mao à celle du Kuomintang, une vraie comparaison serait de la mesurer aux niveaux économiques des secteurs avancés du capitalisme. La crise des rapports de production capitalistes que subissent les économies occidentales avancées (avec leurs 22 millions de chômeurs, leurs usines inutilisées et l'inflation galopante) est la même contradiction qui étrangle aujourd'hui l'économie chinoise. C'est d'ailleurs cette caractéristique même qui fait que la productivité du travail reste extrêmement basse en Chine en comparaison avec les pays développés, tout comme la Russie stalinienne n'a pas réussi en cinquante ans à atteindre le niveau de productivité du travail des pays capitalistes avancés de l'Ouest. De ce point de vue concret, on peut voir que le décalage entre le les secteurs plus développés et les secteurs arriérés du capital mondial s’accroît favorablement chaque année, en progression géométrique. Et les pays avancés confrontés à la décadence de l'ensemble du système s'orientent vers une autre guerre impérialiste généralisée et entraînent toutes les nations "libérées" derrière eux dans la barbarie.
La question des aires arriérées du capitalisme ne peut être posée qu'à l'échelle globale. Solidarity, comme les mencheviks et des tendances similaires dans la Social Démocratie avant eux, base toute sa perspective sur l'exemple isolé d'une économie nationale. Selon l'analyse que fit Rosa Luxembourg au début de notre époque, l'avenir des aires arriérées du capitalisme mondial est indissolublement lié à la décadence de l'ensemble du système. Aujourd'hui, après deux guerres mondiales, après l'établissement d'une économie de guerre permanente, après plus de 50 années de déclin économique et social prolongé dans le sillage d'une révolution internationale défaite, il est impossible de prendre au sérieux les fantaisies de Paul Cardan et de son "capitalisme moderne", et la proclamation du développement éternel du capitalisme. Pour le prolétariat, la question de savoir si le système se développe ou décline a été tranchée pour toujours par le cycle barbare de crise, guerre et reconstruction de ce siècle. Et alors que le prolétariat international ressurgit sur l'arène politique après avoir subi la pire période contre-révolutionnaire de son histoire, seuls les aveugles continuent à parler de "révolutions bourgeoises tardives" au moment où se font entendre les premiers bruits de la seconde vague révolutionnaire de ce siècle.
LA REVOLUTION RUSSE
L'autre confusion principale dans l'appendice publié par Solidarity réside dans les remarques que fait le groupe sur la révolution russe. Ces remarques révèlent les profondes confusions de Solidarity sur cet épisode vital du mouvement ouvrier. Nous pouvons lire :
"...la "révolution permanente" en Russie à la fois débuta et finit comme une révolution bourgeoise (malgré le fait que le prolétariat ait assumé le "rôle dirigeant" dans le déroulement du processus)".
Il est ahurissant que cette vieille thèse menchevik soit présentée par Solidarity comme une grande découverte. Malheureusement pour Solidarity, cette grande "innovation" n'avait déjà aucune base dans la réalité à l'époque où les mencheviks l'ont défendue. Elle n'en a pas plus aujourd'hui.
Beaucoup de tendances anarchistes, de même que les Sociaux-Démocrates, ont rejeté la révolution russe. Ce n'est pas surprenant puisqu'elles rejettent le marxisme. En ce qui concerne Solidarity, bien qu'il ne se soit jamais prétendu marxiste, il a néanmoins ressenti le besoin de rejeter l'expérience de la révolution prolétarienne d'octobre 17 pour se joindre au choeur des libertaires. Le refrain de ce choeur, c'est l'affirmation que le stalinisme égale le léninisme égale le marxisme. Avec cette formule, les libertaires commencent avec la contre-révolution et l'identifient à la pensée et à l'action de la classe ouvrière. En commençant par le rejet de la contre-révolution et ce qu'il en comprend, Solidarity finit par rejeter à la fois l'expérience pratique de l’outil théorique de la lutte de classe,. Il rejette non seulement les expériences ouvrières de la révolution russe mais encore la totalité de la période de luttes révolutionnaires qui va de 1917 à 1923 : le développement du mouvement ouvrier en Europe, les surgissements ouvriers, le regroupement des révolutionnaires dans la Troisième Internationale et la clarification qui s'est faite dans ses premiers Congrès, et enfin la compréhension qui se fit à travers les luttes et que l'aile gauche de TIC défendit contre la dégénérescence de celle-ci alors que la révolution mondiale commençait à refluer. Est-ce que tout cela n'était que de l'aventurisme, simplement la conséquence de la "révolution bourgeoise" russe comme les mencheviks le proclamaient ? Est-ce que c'était une"révolution bourgeoise"russe qui était à l'ordre du jour durant cette époque de déclin impérialiste, cette époque de guerres et de révolutions, durant cette époque de lutte à mort entre le capitalisme mondial et le prolétariat international ? Les révolutionnaires qui s'étaient regroupés autour du slogan "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile", étaient-ils des utopistes dans l'erreur ou même des machiavéliques rusés qui voulaient prendre le pouvoir pour eux-mêmes aux dépens de l'effort de guerre impérialiste ? Toute l'expérience russe de la dictature du prolétariat - ce qu'elle fut historiquement, c'est-à-dire une tentative -, les conseils ouvriers, l'activité autonome de la classe ouvrière, tout cela était-ce simplement une illusion, quelque chose que le prolétariat d'aujourd'hui ferait mieux d'oublier ?
Est-ce que l'échec final de la révolution russe était identique à l'évolution de la conscience du prolétariat en 1917, quand il devint conscient de la nécessité de détruire l'Etat bourgeois de Kerensky - un événement qui a fait de la dictature du prolétariat une réalité vivante de cette époque révolutionnaire ? Que la classe ouvrière n'ait pas été capable d'étendre son pouvoir à l'échelle internationale, est évident. Il est tout aussi évident quand on lit les documents des premières années de l'IC et les écrits des révolutionnaires russes de cette époque, que le camp prolétarien comprenait qu'un isolement continu de la révolution russe se terminerait en une défaite du bastion prolétarien. Sur le plan subjectif, les confusions du prolétariat que ses minorités politiques, y compris les bolcheviks, reflétaient, ont finalement condamné la révolution russe et l'ensemble du mouvement révolutionnaire à l'échec. Mais ce serait d'une pensée stérile et d'un curieux fatalisme de dire que février et octobre 17 ont été condamnés à l'échec (en Russie et internationalement) depuis le début. Et c'est ce que dit Solidarity dans son appendice sur la révolution russe. On peut déjà voir la mort dans un bébé nouveau-né, et peut-être que sur ce plan Kierkegaard est plus profond que Marx. Mais les processus historiques dépendent de l'intervention active et consciente des forces de classe qui ne peuvent être analysées comme un jeu de mystères médiéval. Ce qui a manqué au prolétariat en 17, c'était une expérience et une clarté suffisantes sur les besoins qui surgissaient devant lui avec l'avènement d'une nouvelle époque. Il a été catapulté dans une nouvelle phase historique au moment où il sortait juste du carnage de la première guerre impérialiste mondiale. Il a tenté de détruire le capitalisme mais il a échoué. Mais aucun révolutionnaire de l'époque n'aurait affirmé que tout était perdu d'avance! Ceux qui proclamaient alors que seule une "révolution bourgeoise" était à l'ordre du jour, c'étaient Plekhanov en Russie, Ebert et Noske en Allemagne qui, soit cherchaient à excuser l'exécution du prolétariat révolutionnaire, soit en devinrent eux-mêmes les bourreaux.
Solidarity va rapidement atteindre la fin de sa longue et négative évolution, et disparaître comme beaucoup d'autres groupes. Les positions incohérentes de Solidarity sont le résultat de son incapacité à rompre pleinement avec son passé gauchiste. Tout comme le groupe français Socialisme ou Barbarie qui défendait des idées similaires et s'est dissout en 1967, Solidarity vient d'une scission du trotskysme après la guerre. Se prenant pour des "innovateurs", ces tendances n'ont jamais tenté d'établir une continuité avec les traditions et les leçons défendues par les fractions communistes de gauche (les Gauches Italienne, Allemande et Hollandaise). Elles n'ont donc jamais rompu complètement avec la contre-révolution. Elles n'ont pas vu, par exemple, que leurs "innovations" étaient des conceptions usées ou des incompréhensions qui furent réfutées il y a longtemps par le mouvement révolutionnaire. Toute leur vision se basait sur une critique individualiste et fragmentaire de la contre-révolution. Ainsi, Socialisme ou Barbarie pouvait encore défendre 1'idë d'un parti léniniste et défendre les luttes de libération nationale et le "travail syndical de boîte". Graduellement, les conceptions anarchistes de Stirner, de Proudhon ont commencé à pénétrer ses activités. Solidarity et d'autres groupes similaires ont commence a défendre ce qu'ils appellent "l'autogestion", et de plus en plus on ne savait pas si la classe ouvrière était la classe communiste de notre époque. Ces confusions étaient rationnaiisées par la forte influence de la sociologie bourgeoise et bien vite nos "innovateurs" de S ou B et de Solidarity se sont mis à défendre les idées des renégats comme Burn-ham, Rizzi et autres académiciens bourgeois comme Marcuse et Bell qui proclamaient la mort du prolétariat et que la "bureaucratie" était une nouvelle classe sociale qui mettait en question le marxisme.
Bien que la rupture initiale de Solidarity avec le trotskysme révélait un véritable effort de clarification, elle a aussi montré la quasi-impossibilité d'un développement sain de la part d'une tendance qui vient de l'appareil politique capitaliste. Aujourd'hui, alors que le prolétariat surgit à nouveau à l'échelle mondiale, les idées de Solidarity apparaîtront de plus en plus cyniques et anachroniques. A côté de ce resurgissement et avec lui, le mouvement révolutionnaire actuel contribuera aussi à la mort des idées de Solidarity. En fait, le mouvement actuel doit critiquer sans merci toutes les confusions qui restent de la contre-révolution. Et il est forcé de la faire par les nécessités mêmes de la révolution communiste qui requiert la plus grande clarté et cohérence comme condition première à la pratique révolutionnaire. L'incapacité de dire ce qui est et ce qui n'est pas, l'incapacité de tirer les leçons du passé, la mollesse et l'impuissance politiques, toutes ces caractéristiques sont celles d'une tendance politique mourante. Solidarity est perclus de tous ces défauts majeurs. Si le mouvement révolutionnaire actuel peut bénéficier d'une dernière contribution de la part de Solidarity, ce serait la disparition rapide de sa stérile existence.
J.McIver août 77
L'auteur de cette critique a participé à la rédaction du texte de Solidarity "Tiers-mondisme ou socialisme", il y a plusieurs années. Aujourd'hui, dans le Courant Communiste International ce camarade peut apprécier l'attraction que les idées de Solidarity ont dans le mouvement révolutionnaire actuel L'espoir est donc non seulement que s'ouvre et se poursuive une discussion sur ces sujets, mais que les nouveaux révolutionnaires acquièrent la clarté nécessaire pour confronter ces conceptions usées qui ne peuvent être que des obstacles à l'activité révolutionnaire. Sans cette clarté nécessaire, le but qu'ils défendent ne deviendra jamais "dur comme l'acier, clair comme le cristal" (Gorter).
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question nationale [205]