Revue Internationale n° 144 - 1er trimestre 2011
- 1936 reads
Mobilisation sur les retraites en France, riposte étudiante en Grande-Bretagne, révolte ouvrière en Tunisie.
L'avenir est au développement international et à la prise en main de la lutte de classe
Les grèves et les manifestations de septembre, octobre et novembre en France qui se sont déroulées à l’occasion de la réforme des retraites ont témoigné d’une forte combativité dans les rangs des prolétaires, même si elles n’ont pas réussi à faire reculer la bourgeoisie.
Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique internationale de notre classe qui retrouve progressivement le chemin de la lutte, chemin jalonné en 2009 et 2010 par la révolte des jeunes générations de prolétaires contre la misère en Grèce et par la volonté d'étendre leur lutte des ouvriers de Tekel en Turquie en s'opposant de façon déterminée au sabotage des syndicats.
Ainsi, les étudiants se sont largement mobilisés contre le chômage et la précarité que leur réserve le monde capitaliste comme en Grande-Bretagne, en Italie ou aux Pays-Bas. Aux États-Unis, bien que restant enfermées dans le carcan syndical, plusieurs grèves d'envergure se sont succédées en divers points du pays depuis le printemps 2010 pour résister aux attaques : dans le secteur de l'éducation en Californie, infirmiers à Philadelphie et Minneapolis-Saint-Louis, ouvriers du bâtiment à Chicago, secteur agro-alimentaire dans l'État de New York, enseignants dans l'Illinois, ouvriers de Boeing et d'une usine Coca-Cola à Bellevue (État de Washington), dockers dans le New Jersey et à Philadelphie.
A l'heure où nous mettons sous presse, au Maghreb, en particulier en Tunisie, la colère ouvrière accumulée depuis des décennies s'est propagée comme une traînée de poudre après l'immolation publique, le 17 décembre, d'un jeune chômeur diplômé qui s'était vu confisquer par la police municipale de Sidi Bouzid, au centre du pays, son étal de fruits et légumes, son unique gagne-pain. Des manifestations spontanées de solidarité se sont propagées à travers tout le pays face à l'ampleur du chômage et à la hausse brutale des produits alimentaires de première nécessité. La répression brutale et féroce de ce mouvement social a fait plusieurs dizaines de morts, la police tirant à balles réelles sur les manifestants désarmés. Cela n'a fait que renforcer l'indignation et la détermination des prolétaires pour réclamer d'abord du travail, du pain et un peu de dignité, puis le départ de Ben Ali. "On n'a plus peur", scandaient les manifestants en Tunisie. Les enfants de prolétaires en tête ont utilisé les réseaux d'Internet ou leur téléphone portable comme armes de combat, pour montrer et dénoncer la répression, et comme moyens de communication et d'échange assurant ainsi un lien entre eux mais aussi avec leurs famille ou amis en dehors du pays, notamment en Europe, brisant ainsi partiellement la conspiration du silence de toutes les bourgeoisies et de leurs médias. Partout, nos exploiteurs se sont efforcés de masquer la nature de classe de ce mouvement social, cherchant à le dénaturer tantôt en le présentant comme des émeutes comme celles de 2005 en France ou comme l'œuvre de casseurs et de pillards, tantôt en le faisant passer pour une "lutte héroïque et patriotique du peuple tunisien" pour la "démocratie" animée par des intellectuels diplômés et les "classes moyennes".
La crise économique et la bourgeoisie portent leurs coups de boutoir partout dans le monde. En Algérie, en Jordanie, en Chine, d'autres mouvements sociaux similaires face à l'enfoncement dans la misère ont été durement réprimés. Cette situation doit pousser les prolétaires des pays centraux, plus expérimentés, à prendre conscience de l'impasse et de la faillite dans laquelle le système capitaliste entraîne partout l'humanité et à apporter leur solidarité à leurs frères de classe en développant leurs luttes. D'ailleurs les travailleurs commencent peu à peu à réagir et à refuser l’austérité, la paupérisation et les "sacrifices" imposés.
Pour l’instant, cette riposte est nettement en deçà des attaques que nous subissons. C’est incontestable. Mais une dynamique est enclenchée, la réflexion ouvrière et la combativité vont continuer de se développer. Pour preuve, ce fait nouveau : des minorités cherchent aujourd’hui à s’auto-organiser, à contribuer activement au développement de luttes massives et à se dégager de l’emprise syndicale.
La mobilisation contre la réforme des retraites en France
Le mouvement social de l'automne dernier en France est pleinement révélateur de cette dynamique enclenchée par le précédent mouvement contre le CPE 1.
C’est par millions que les ouvriers et employés de tous les secteurs sont descendus régulièrement dans la rue en France. Parallèlement, depuis la rentrée de septembre, des mouvements de grève plus ou moins radicaux sont apparus ici et là, exprimant un mécontentement profond et grandissant. Cette mobilisation constitue le premier combat d’envergure en France depuis la crise qui a secoué le système financier mondial en 2007-2008. Elle n’est pas seulement une réponse à la réforme des retraites elle-même mais, par son ampleur et sa profondeur, elle est une réponse claire à la violence des attaques subies ces dernières années. Derrière cette réforme et les autres attaques simultanées ou en préparation, se manifeste le refus grandissant d'un enfoncement aggravé de tous les prolétaires et d‘autres couches de la population dans la pauvreté, la précarité et la misère la plus sombre. Et avec l’approfondissement inexorable de la crise économique, ces attaques ne sont pas près de s’arrêter. Il est clair que cette lutte en annonce d’autres et qu’elle s’inscrit en droite ligne de celles qui se sont développées en Grèce et en Espagne face aux mesures drastiques d’austérité.
Cependant, malgré la massivité de la riposte, le gouvernement en France n’a pas cédé. Au contraire, il est resté intraitable, affirmant sans relâche et malgré la pression de la rue sa ferme détermination à faire passer son attaque sur les retraites, se permettant de surcroît de répéter avec cynisme qu’elle était "nécessaire", au nom de la "solidarité" entre les générations.
Pourquoi cette mesure qui frappe au cœur toutes nos conditions de vie et de travail, et alors que l’ensemble de la population a exprimé amplement et puissamment son indignation et son opposition, est-elle passée malgré tout ? Pourquoi cette mobilisation massive n’a-t-elle pas réussi à faire reculer le gouvernement ? Parce que le gouvernement avait la certitude du contrôle de la situation par les syndicats, lesquels ont toujours accepté, comme également les partis de gauche, le principe d’une "réforme nécessaire" des retraites ! On peut faire la comparaison avec le mouvement de 2006 contre le CPE. Ce mouvement, que les médias avaient traité au début avec le plus grand mépris comme une "révolte étudiante" sans lendemain, a fini par faire reculer le gouvernement qui n’a eu d’autre recours que de retirer le CPE.
Où est la différence ? Elle réside d’abord en ceci que les étudiants s’étaient organisés en assemblées générales ouvertes à tous, sans distinction de catégories ou de secteurs, du public ou du privé, au travail ou au chômage, travailleurs précaires, etc. Cet élan de confiance dans les capacités de la classe ouvrière et dans sa force, de profonde solidarité dans la lutte, avait créé une dynamique d’extension du mouvement imprimant à celui-ci une massivité impliquant toutes les générations. Car, tandis que, d’un côté, les assemblées générales voyaient se dérouler des débats et des discussions les plus larges, ne restant pas cantonnées au seul problème des étudiants, de l’autre côté, on voyait au fil des manifestations les travailleurs eux-mêmes se mobiliser de plus en plus avec les étudiants et de nombreux lycéens.
Mais c’est aussi parce que la détermination et l’esprit d’ouverture des étudiants, tout en entraînant des fractions de la classe ouvrière vers la lutte ouverte, n’arrivaient pas à être battus en brèche par les manœuvres des syndicats. Au contraire, alors que ces derniers, notamment la CGT, s’efforçaient de se placer en tête des manifestations pour en prendre le contrôle, c’est à plusieurs reprises que les étudiants et les lycéens ont débordé les banderoles syndicales pour affirmer clairement qu’ils ne voulaient pas se voir ravaler en arrière-plan d’un mouvement dont ils étaient à l’initiative. Mais surtout ils affirmaient leur volonté de garder le contrôle eux-mêmes de la lutte, avec la classe ouvrière, et de ne pas se laisser avoir par les centrales syndicales.
En fait, un des aspects qui inquiétait le plus la bourgeoisie, c’est que les formes d’organisation que s’étaient données les étudiants en lutte, ces assemblées générales souveraines, élisant leurs comités de coordination et ouvertes à tous, dans lesquelles les syndicats étudiants faisaient souvent profil bas, ne fassent tâche d’huile parmi les salariés si ces derniers entraient en grève. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, au cours de ce mouvement, Thibault 2 a affirmé à plusieurs reprises que les salariés n’avaient pas de leçons à recevoir des étudiants sur comment s’organiser. D'après lui, si ces derniers avaient leurs assemblées générales et leurs coordinations, les salariés avaient leurs syndicats en qui ils avaient confiance. Dans un tel contexte de détermination chaque fois réaffirmée et de danger d’un débordement des syndicats, il fallait que l'État français lâche du lest car c’est le dernier rempart de protection de la bourgeoisie contre l’explosion de luttes massives qui risquait d’être battu en brèche.
Avec le mouvement contre la réforme des retraites, les syndicats, soutenus activement par la police et les médias, ont fait les efforts nécessaires pour tenir le haut du pavé, en sentant venir le vent et s’organiser en conséquence.
D'ailleurs le mot d'ordre des syndicats n'était pas "retrait de l'attaque sur les retraites" mais "aménagement de la réforme". Ils appelaient à se battre pour une meilleure négociation État-Syndicats et pour une réforme plus "juste", plus "humaine". On les a vus jouer dès le début la division malgré l'apparente unité de l'intersyndicale clairement constituée pour faire barrage aux "risques" de débordements ; le syndicat FO 3 organisait au début ses manifestations dans son coin, tandis que l’intersyndicale qui organisait la journée d’action du 23 mars préparait le "ficelage" de la réforme, après tractations avec le gouvernement, en programmant deux autres journées d’action le 26 mai, et surtout le 24 juin, à la veille des vacances d’été. On sait qu’habituellement une journée d’action, à cette époque de l’année, signe le coup de grâce pour la classe ouvrière lorsqu’il s’agit de faire passer une attaque majeure. Pourtant, cette dernière journée d’action a montré une mobilisation inattendue, avec plus du double d’ouvriers, de chômeurs, de précaires, etc., dans les rues. Et, alors qu’une morosité, largement soulignée par la presse, avait marqué les deux premières journées d’action, la colère et le ras-le-bol étaient au rendez-vous du 24 juin où le succès de la mobilisation a regonflé le moral du prolétariat. L'idée qu'une lutte d'ampleur est possible gagne du terrain. Les syndicats sentent évidemment eux aussi le vent tourner, ils savent que la question "Comment lutter ?" trotte dans les têtes. Ils décident donc d'occuper immédiatement le terrain et les esprits, il n'est pas question pour eux que les prolétaires se mettent à penser et à agir par eux-mêmes, en dehors de leur contrôle. Ils décident donc d'appeler à une nouvelle journée d'action pour le 7 septembre, dès le retour des congés d'été. Et pour être bien sûrs d'endiguer le mouvement de réflexion, ils vont jusqu'à faire passer en pleines vacances d'été des avions au-dessus des plages tirant des banderoles publicitaires appelant à la manifestation du 7 !
Pour leur part, les partis de gauche, qui étaient pourtant bien d’accord eux aussi sur l’impérieuse nécessité d’attaquer la classe ouvrière sur la question des retraites, sont venus se greffer à la mobilisation afin de ne pas se discréditer totalement.
Mais un autre événement, un fait divers, vient durant l'été alimenter la colère ouvrière : "l’affaire Woerth" (il s'agit d'une connivence entre les hommes politiques actuellement au pouvoir et la plus riche héritière du capital français, Madame Bettencourt, patronne du groupe L'Oréal, sur fond de fraudes fiscales et arrangements illégaux en tous genres). Or, Éric Woerth n'est autre que le ministre chargé de la réforme des retraites. Le sentiment d'injustice est total : la classe ouvrière doit se serrer la ceinture pendant que les riches et les puissants mènent "leurs petites affaires". C’est donc sous la pression de ce mécontentement ouvert et de la prise de conscience grandissante des implications de cette réforme sur nos conditions de vie que se présente la journée d’action du 7 septembre, obligeant cette fois-ci les syndicats à entonner le credo de l’unité d'action. Depuis, pas un syndicat n’a manqué à l’appel des journées d’action qui ont regroupé dans les manifestations environ trois millions de travailleurs à plusieurs reprises. La réforme des retraites devient le symbole de la dégradation brutale des conditions de vie.
Mais cette unité de "l’intersyndicale" a constitué un leurre pour la classe ouvrière. Elle visait en fait à lui faire croire que les syndicats étaient déterminés à organiser une offensive d’ampleur contre la réforme et qu’ils s’en donnaient les moyens avec des journées d’action à répétition dans lesquelles on pouvait voir et entendre à satiété leurs leaders, bras dessus, bras dessous, égrener leurs discours sur la "poursuite" du mouvement et autres mensonges. Ce qu’ils redoutaient par-dessus tout, c’est que les travailleurs sortent du carcan syndical et qu’ils s’organisent par eux-mêmes. C’est ce que disait Thibault, le secrétaire général de la CGT, qui faisait "passer un message" au gouvernement dans une interview au journal le Monde du 10 septembre : "On peut aller vers un blocage, vers une crise sociale d’ampleur. C’est possible. Mais ce n’est pas nous qui avons pris ce risque", donnant l’exemple suivant pour mieux affirmer où se trouvait l’enjeu auquel étaient confrontés les syndicats : "On a même trouvé une PME sans syndicat où 40 salariés sur 44 ont fait grève. C’est un signe. Plus l’intransigeance dominera, plus l’idée de grèves reconductibles gagnera les esprits."
En clair, si les syndicats ne sont pas là, les ouvriers s’organisent eux-mêmes et non seulement décident réellement de ce qu’ils veulent faire mais risquent de le faire massivement. Et c’est contre quoi les centrales syndicales, et particulièrement la CGT et SUD 4, se sont attelées avec un zèle exemplaire : occuper le terrain sur la scène sociale et dans les médias, tout en empêchant avec la même résolution sur le terrain toute réelle expression de solidarité ouvrière. En bref, un battage à tout crin d’une part, et de l’autre une activité visant à stériliser et entraîner le mouvement dans de fausses alternatives, afin de créer la division, la confusion, et mieux le mener à la défaite.
Le blocage des raffineries de pétrole en est un exemple des plus évidents. Alors que les ouvriers de ce secteur, dont la combativité était déjà très vive, avaient la volonté grandissante de manifester leur solidarité envers l’ensemble de la classe ouvrière contre la réforme des retraites, ouvriers par ailleurs particulièrement confrontés à des mesures drastiques de réductions de personnels, la CGT a fait en sorte de transformer cet élan de solidarité en grève-repoussoir. Ainsi, le blocage des raffineries n’a jamais été décidé dans de véritables assemblées générales, où les travailleurs pouvaient exprimer réellement leur point de vue, mais il a été décidé suite à des manœuvres dont les leaders syndicaux sont spécialistes et qui ont fait adopter, en pourrissant la discussion, des actions stérilisantes. Cependant, malgré cet enfermement verrouillé par les syndicats, certains ouvriers de ce secteur ont cherché à créer des contacts et des liens avec des ouvriers d’autres secteurs. Mais, globalement pris dans l’engrenage du "blocage jusqu’au bout", la plupart des ouvriers des raffineries se sont vu piégés dans une logique syndicale d’enfermement dans l’usine, véritable poison utilisé contre l’élargissement du combat. En effet, bien que les ouvriers des raffineries avaient pour objectif de renforcer le mouvement, d’en être un des bras armés, afin de faire reculer le gouvernement, le blocage des dépôts, tel qu’il s’est déroulé sous la houlette syndicale, s’est surtout révélé être une arme de la bourgeoisie et de ses syndicats contre les ouvriers. Non seulement pour isoler ceux des raffineries, mais pour rendre leur grève impopulaire, en créant un vent de panique et en agitant la menace d’une pénurie de carburant généralisée ; la presse a abondamment déversé son fiel contre ces "preneurs d’otages empêchant les gens de se rendre à leur travail ou de partir en congés". Mais c’est aussi physiquement que les travailleurs de ce secteur se sont trouvés isolés ; alors même qu’ils voulaient contribuer par la lutte solidaire à la construction d’un rapport de forces favorable au retrait de la réforme, ce blocage particulier s’est en fait retourné contre eux et contre l’objectif qu’ils s’étaient donné initialement.
Il y a eu de nombreuses actions syndicales similaires, dans certains secteurs comme les transports, et de préférence dans des régions peu ouvrières, car il fallait à tout prix pour les syndicats prendre le moins de risques possibles d’extension et de mise en œuvre active de la solidarité. Il leur fallait faire semblant, pour la galerie, d’orchestrer les luttes les plus radicales et de jouer la partition de l’unité syndicale dans les manifestations, tout en pourrissant en réalité la situation.
Partout, on a donc vu les syndicats, réunis dans une "intersyndicale" pour mieux promouvoir le simulacre de l’unité, mettre en œuvre des semblants d’assemblées générales, sans véritable débat, enfermées dans les préoccupations les plus corporatistes, tout en affichant publiquement la prétendue volonté de se battre "pour tous" et "tous ensemble"… mais organisées chacun dans son coin, derrière son petit chef syndicaliste, en faisant tout pour empêcher la mise en œuvre de délégations massives en recherche de solidarité vers les entreprises les plus proches géographiquement.
Les syndicats n’ont d’ailleurs pas été les seuls à entraver la possibilité d’une telle mobilisation, car la police de Sarkozy, réputée pour sa prétendue débilité et son esprit anti-gauche, a su se faire l’auxiliaire indispensable des syndicats à plusieurs reprises par ses provocations. Exemple : les incidents de la place Bellecour à Lyon, où la présence d’une poignée de "casseurs" (probablement manipulés par les flics) a servi de prétexte à une violente répression policière contre des centaines de jeunes lycéens dont la plupart ne cherchaient qu’à venir discuter à la fin d’une manifestation avec les travailleurs.
Un mouvement riche de perspectives
En revanche, il n’a pas du tout été question dans les médias des nombreux Comités ou Assemblées générales interprofessionnels (AG interpros), qui se sont formés durant cette période, comités et AG dont le but affiché était et reste de s’organiser en-dehors des syndicats et de développer des discussions réellement ouvertes à tous les prolétaires, ainsi que des actions dans lesquelles c’est toute la classe ouvrière qui pourrait, non seulement se reconnaître, mais aussi et surtout s’impliquer massivement.
On voit ici ce que la bourgeoisie a craint particulièrement : que des contacts se nouent et se multiplient le plus largement possible dans les rangs de la classe ouvrière, jeunes, vieux, au travail ou au chômage.
Il faut tirer les leçons de l'échec du mouvement.
Le premier constat après l'échec du mouvement est que ce sont les appareils syndicaux qui ont permis de faire passer l’attaque auprès des prolétaires et qu’il ne s’agit nullement de quelque chose de conjoncturel. C’est qu’ils ont fait leur sale boulot, pour lequel tous les spécialistes et autres sociologues, ainsi que le gouvernement et Sarkozy en personne, les saluent pour leur "sens des responsabilités". Oui, sans hésitation, la bourgeoisie peut se féliciter d’avoir des "responsables" syndicaux capables de briser un mouvement d’une telle ampleur en faisant en même temps croire qu’ils ont pourtant fait tout leur possible pour lui permettre de se développer. Ce sont encore ces mêmes appareils syndicaux qui sont parvenus à étouffer et marginaliser les véritables expressions de lutte autonome de la classe ouvrière et de tous les travailleurs.
Cependant, cet échec est porteur de nombreux fruits car tous les efforts déployés par l’ensemble des forces de la bourgeoisie n’ont pas réussi à entraîner le mouvement dans une défaite cuisante de tout un secteur, comme ce fut le cas en 2003 avec la lutte contre la réforme des retraites du secteur public qui avait donné lieu à un cinglant recul parmi les travailleurs de l’Éducation nationale après plusieurs semaines de grève.
Ensuite, ce mouvement a permis le surgissement convergent en plusieurs endroits de minorités exprimant une vision claire des besoins réels de la lutte pour l'ensemble du prolétariat : la nécessité d'une prise en mains de la lutte pour pouvoir l'étendre et la développer, traduisant un réel mûrissement de la réflexion, tout en exprimant l'idée que le développement de la lutte n'en est qu'à son début et manifestant une volonté de tirer les leçons de ce qui s'est passé et de rester mobilisées pour l'avenir.
Comme le dit un tract de "l’AG interpro" parisienne de la Gare de l’Est daté du 6 novembre : "Il aurait fallu, dès le départ, s’appuyer sur les secteurs en grève, ne pas limiter le mouvement à la seule revendication sur les retraites alors que les licenciements, les suppressions de postes, la casse des services publics, les bas salaires continuent dans le même temps. C'est cela qui aurait pu permettre d’entraîner d’autres travailleurs dans la lutte et d’étendre le mouvement gréviste et de l’unifier. Seule une grève de masse qui s'organise à l'échelle locale et se coordonne nationalement, au travers de comités de grève, d'assemblées générales interprofessionnelles, de comités de lutte, pour que nous décidions nous-mêmes des revendications et des moyens d'action tout en contrôlant le mouvement, peut avoir une chance de gagner."
"La force des travailleurs n'est pas seulement de bloquer, ici ou là, un dépôt pétrolier ou même une usine. La force des travailleurs, c'est de se réunir sur leurs lieux de travail, par-delà les professions, les sites, les entreprises, les catégories et de décider ensemble" Car "l'attaque ne fait que commencer. Nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. C'est la guerre de classe que la bourgeoisie nous déclare et nous avons encore les moyens de la mener" (tract intitulé "Personne ne peut lutter, décider et gagner à notre place", signé par des travailleurs et précaires de "l’AG interpro" de la Gare de l’Est et d’Île-de-France, déjà cité plus haut). Nous n’avons pas d’autre choix pour nous défendre que d’étendre et de développer massivement nos luttes et pour cela de les prendre dans nos propres mains.
Cette volonté s'est donc clairement affirmée à travers en particulier :
- des véritables AG interpros qui ont émergé, même de façon très minoritaire, dans le développement de la lutte en affichant leur détermination à rester mobilisées en vue de préparer de futurs combats ;
- la tenue ou les tentatives de former des assemblées de rues ou des assemblées populaires en fin de manifestations s'est également affirmée, en particulier à Toulouse.
Cette volonté de s'auto-organiser exprimée par des minorités révèle que l'ensemble de la classe commence à se poser des questions sur la stratégie syndicale, sans oser tirer encore toutes les conséquences de ses doutes et questionnements. Dans toutes les AG (syndicales ou non), la plupart des débats sous diverses formes ont tourné autour de questions essentielles sur "comment lutter ?", "comment aider les autres travailleurs ?", "comment exprimer notre solidarité ?", "quelle autre AG interpro pouvons-nous rencontrer ?", "comment briser l'isolement et toucher le maximum d'ouvriers pour discuter avec eux des moyens de lutter ?"… Et dans les faits, quelques dizaines de travailleurs de tous secteurs, de chômeurs, de précaires, de retraités se sont rendues effectivement chaque jour devant les portes des 12 raffineries paralysées, pour "faire nombre" face aux CRS, apporter des paniers-repas aux grévistes, un peu de chaleur morale.
Cet élan de solidarité est un élément important, il révèle une nouvelle fois la nature profonde de la classe ouvrière.
"Prendre confiance en nos propres forces" devra être le mot d’ordre de demain.
Cette lutte est en apparence une défaite, le gouvernement n'a pas reculé. Mais en fait, elle constitue un pas en avant supplémentaire pour notre classe. Les minorités qui ont émergé et qui ont essayé de se regrouper, de discuter en AG interpro ou en assemblée populaire de rue, ces minorités qui ont essayé de prendre en main leurs luttes en se méfiant comme de la peste des syndicats, révèlent le questionnement qui mûrit en profondeur dans toutes les têtes ouvrières. Cette réflexion va continuer de faire son chemin et elle portera, à terme, ses fruits. Il ne s'agit pas là d'un appel à attendre, les bras croisés, que le fruit mûr tombe de l'arbre. Tous ceux qui ont conscience que l'avenir va être fait d'attaques ignobles du capital, d'une paupérisation croissante et de luttes nécessaires, doivent œuvrer à préparer les futurs combats. Nous devons continuer à débattre, à discuter, à tirer les leçons de ce mouvement et à les diffuser le plus largement possible. Ceux qui ont commencé à tisser des liens de confiance et de fraternité dans ce mouvement, au sein des cortèges et des AG, doivent essayer de continuer de se voir (en Cercles de discussion, Comités de lutte, Assemblées populaires ou "lieux de parole") car des questions restent entières, telles que :
- Quelle est la place du "blocage économique" dans la lutte de classe ?
- Quelle est la différence entre la violence de l'État et celle des travailleurs en lutte ?
- Comment faire face à la répression ?
- Comment prendre en main nos luttes ? Comment nous organiser ?
- Quelles différences entre une AG syndicale et une AG souveraine ? etc.
Ce mouvement est déjà riche en enseignements pour le prolétariat mondial. Sous une forme différente, les mobilisations étudiantes en Grande-Bretagne sont également porteuses de promesses pour le développement des luttes à venir.
Grande-Bretagne : la jeune génération renoue avec la lutte
Le premier samedi après l’annonce du plan de rigueur gouvernemental de réduction drastique des dépenses publiques, le 23 octobre, se sont déroulées de nombreuses manifestations contre les coupes budgétaires, partout dans le pays, appelées par divers syndicats. Le nombre de participants, très variable (allant jusqu'à 15 000 à Belfast ou 25 000 à Edimbourg) révèle la profondeur de la colère. Une autre démonstration de ce ras-le-bol généralisé est la rébellion des étudiants contre la hausse de 300 % des frais d’inscription dans les universités.
Déjà ces frais les contraignaient à s’endetter lourdement pour rembourser après leurs études des sommes astronomiques (pouvant aller jusqu’à 95 000 euros !). Ces nouvelles hausses ont donc provoqué toute une série de manifestations du Nord au Sud du pays (5 mobilisations en moins d’un mois : les 10, 24 et 30 novembre, les 4 et 9 décembre). Cette hausse a tout de même été définitivement votée à la chambre des Communes le 8 décembre.
Les foyers de lutte se sont multipliés : dans la formation continue, dans les écoles supérieures et les lycées, occupations d’une longue liste d’universités, de nombreuses réunions sur les campus ou dans la rue pour discuter de la voie à suivre... les étudiants ont reçu le soutien et la solidarité de la part de nombreux enseignants, notamment en fermant les yeux devant les absences des grévistes en classe (l’assiduité au cours est ici strictement réglementée) ou en allant rendre visite aux étudiants et en discutant avec eux. Les grèves, manifestations et occupations ont été tout sauf ces sages événements que les syndicats et les "officiels" de la gauche ont habituellement pour mission d’organiser. Cet élan de résistance à peine contrôlé a inquiété les gouvernants. Un signe clair de cette inquiétude est le niveau de la répression policière utilisée contre les manifestations. La plupart des rassemblements se sont terminés par des affrontements violents avec la police anti-émeutes pratiquant une stratégie d’encerclement, n’hésitant pas à matraquer les manifestants, ce qui s’est traduit par de nombreux blessés et de nombreuses arrestations, surtout à Londres, alors que des occupations se déroulaient dans une quinzaine d’universités avec le soutien d’enseignants. Le 10 novembre, les étudiants avaient envahi le siège du Parti conservateur et le 8 décembre, ils ont tenté de pénétrer dans le ministère des finances et à la Cour suprême, tandis que des manifestants s’en sont pris à la Rolls-Royce transportant le prince Charles et son épouse Camilla. Les étudiants et ceux qui les soutiennent étaient venus aux manifestations de bonne humeur, fabriquant leurs propres bannières et leurs propres slogans, certains d’entre eux rejoignant pour la première fois un mouvement de protestation. Les débrayages spontanés, l’investissement du QG du Parti conservateur à Millbank, le défi face aux barrages de police, ou leur contournement inventif, l’occupation des mairies et autres lieux publics, ne sont que quelques expressions de cette attitude ouvertement rebelle. Les étudiants ont été écœurés et révoltés par l'attitude de Porter Aaron, le président du NUS (le syndicat national des étudiants) qui avait condamné l'occupation du siège du Parti conservateur, l'attribuant à la violence pratiquée par une infime minorité. Le 24 novembre à Londres, des milliers de manifestants ont été encerclés par la police quelques minutes après leur départ de Trafalgar Square, et malgré quelques tentatives réussies pour percer les lignes de police, les forces de l’ordre ont bloqué des milliers d’entre eux pendant des heures dans le froid. A un moment, la police montée est passée directement à travers la foule. A Manchester, à Lewisham Town Hall et ailleurs, mêmes scènes de déploiement de la force brutale. Après l’irruption au siège du parti conservateur à Millbank, les journaux ont tenu leur partition habituelle en affichant des photos de présumés "casseurs", faisant courir des histoires effrayantes sur les groupes révolutionnaires qui prennent pour cible les jeunes de la nation avec leur propagande maléfique. Tout cela montre la vraie nature de la "démocratie" sous laquelle nous vivons.
La révolte étudiante au Royaume-Uni est la meilleure réponse à l’idée que la classe ouvrière dans ce pays reste passive devant le torrent d’attaques lancées par le gouvernement sur tous les aspects de notre niveau de vie : emplois, salaires, santé, chômage, prestations d’invalidité ainsi que l’éducation. Toute une nouvelle génération de la classe exploitée n’accepte pas la logique de sacrifices et d’austérité qu'imposent la bourgeoisie et ses syndicats. Ce n'est qu'en prenant en main ses luttes, en développant sa solidarité et son unité internationales que la classe ouvrière, notamment dans les pays "démocratiques" les plus industrialisés, pourra offrir une perspective d'avenir à la société. Ce n'est qu'en refusant de faire les frais de la faillite du capitalisme partout dans le monde, que la classe exploitée pourra mettre un terme à la misère et à la terreur de la classe exploiteuse en renversant le capitalisme et en construisant une autre société basée sur la satisfaction des besoins de toute l'humanité et non sur le profit et l'exploitation.
W. (14 janvier)
1. Lire notre article de la Revue internationale n° 125, "Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [2]".
2. Secrétaire général de la CGT, principale centrale syndicale du pays et proche du Parti "communiste".
3 FO : "Force ouvrière". Syndicat issu d'une scission de la CGT en 1947, au début de la Guerre froide, appuyée et financée par l'AFL-CIO des États-Unis. Jusqu'aux années 1990, cette centrale se distingue par sa "modération" mais, depuis, elle a "radicalisé" ses postures en essayant de "tourner" la CGT sur sa gauche.
4 SUD : "Solidaires Unitaires Démocratiques". Syndicat minoritaire se situant à l'extrême gauche de l'éventail des forces d'encadrement de la classe ouvrière et animé principalement par des groupes gauchistes.
Face à la crise capitaliste, il n'existe aucune voie de sortie
- 2991 reads
Économies nationales surendettées, les plus faibles devant être secourues pour leur éviter la banqueroute et celle de leurs créanciers ; plans de rigueur pour tenter de contenir l'endettement qui ne fait qu'accroître les risques de récession et, ce faisant, les risques de faillites en série ; tentatives de relance au moyen de la planche à billets… qui relancent l'inflation. C'est l'impasse au niveau économique et la bourgeoisie s'avère dans l'incapacité totale de proposer des politiques économiques un tant soit peu cohérentes.
Le "sauvetage" d'États en Europe
Au moment même où l'Irlande négociait son plan de "sauvetage", les autorités du FMI admettaient que la Grèce ne pourrait pas rembourser le plan qu'elles-mêmes et l'Union Européenne avaient mis en place en avril 2010 et que, de fait, la dette de ce dernier pays devait être restructurée, même si le mot n'a pas été employé par les autorités financières. D'après D. Strauss Khan, le chef du FMI, il devrait être permis à la Grèce de finir de rembourser la dette résultant de son plan de sauvetage, non pas en 2015 mais en 2024 ; c'est-à-dire, au train où va la crise des États en Europe, dans une éternité. C'est là un véritable symbole de la fragilité d'un certain nombre de pays européens minés par la dette, pour ne pas dire la plupart d'entre eux.
Bien sûr, ce nouveau "cadeau" à la Grèce doit s'accompagner de mesures d'austérité supplémentaires. Après le plan d'austérité d'avril 2010 qui s'était soldé par la suppression du paiement de deux mois de retraites, de la baisse des indemnités dans le secteur public, d'une augmentation des prix, elle-même conséquence d'une augmentation des taxes sur l'électricité, les carburants, les alcools, le tabac, etc., des décisions sont en cours de préparation pour supprimer des emplois publics.
C'est un scénario analogue qui se déroule en Irlande où les ouvriers subissent leur quatrième plan d'austérité : en 2009, les salaires des fonctionnaires avaient subi une baisse comprise entre 5 et 15%, des allocations sociales avaient été supprimées et les départs à la retraite n'étaient plus remplacés. Le nouveau plan d'austérité négocié en échange du plan de "sauvetage" du pays contient la baisse du salaire minimum de 11,5%, la diminution des allocations sociales et familiales, la suppression de 24 750 postes de fonctionnaire et l'augmentation de la TVA de 21% à 23%. Et, comme pour la Grèce, il est évident qu'un pays de 4,5 millions d'habitants, dont le PIB était en 2009 de 164 milliards d'euros, ne parviendra pas à rembourser un prêt de 85 milliards d'euros. Pour ces deux pays, il ne fait pas de doute non plus que ces plans d'austérité particulièrement violents appellent l'adoption de futures mesures enfonçant la classe ouvrière et la majeure partie de la population dans une misère telle que, faire face aux fins de mois, va devenir impossible.
L'incapacité de nouveaux pays (Portugal, Espagne, etc.) à faire face à leur dette est déjà annoncée alors que, pour éviter une telle issue, ces pays avaient déjà adopté des mesures d'austérité particulièrement draconiennes qui, comme en Grèce et en Irlande, en annoncent d'autres.
Que cherchent à sauver les différents plans d'austérité ?
La question est d'autant plus légitime que la réponse ne s'impose pas d'elle-même. Une chose est certaine, c'est qu'ils n'ont pas pour objet de sauver de la misère les millions de personnes qui sont les premières à en subir les conséquences. Une indication concernant la réponse recherchée est fournie par l'angoisse qui étreint les autorités politiques et financières devant le risque que de nouveaux pays soient à leur tour exposés à un défaut de paiement sur leur dette publique. C'est en fait plus qu'un risque dans la mesure où l’on ne voit guère comment ce scénario ne se produirait pas.
A l'origine de la faillite de la l'État grec se trouve un déficit budgétaire considérable dû à une masse exorbitante de dépenses publiques (en particulier d'armements) que les ressources fiscales du pays, affaiblies par l'aggravation de la crise en 2008, ne permettent pas de financer. Quant à l'État irlandais, son système bancaire avait accumulé une quantité de créances de 1 432 milliards d'euros (à comparer avec le montant du PIB de 164 milliards d'euros - déjà mentionné précédemment - pour mesurer l'absurdité de la situation économique présente !) que l'aggravation de la crise a rendu impossible à recouvrir. En conséquence de quoi, le système bancaire en question a dû être en grande partie nationalisé, les créances étant ainsi transférées à l'État. Après avoir payé une partie, pourtant relativement faible, des dettes du système bancaire, l'État irlandais s'est retrouvé en 2010 avec un déficit public correspondant à 32% du PIB ! Au-delà du caractère délirant de tels chiffres, il faut souligner que, même si les déboires de ces deux économies nationales ont des histoires différentes, le résultat est le même. En effet, dans un cas comme dans l'autre, face à l'endettement démentiel de l'État ou des institution privées, c'est l'État qui doit assumer la fiabilité du capital national en montrant sa capacité à rembourser la dette et payer les intérêts de celle-ci.
La gravité de ce qu'impliquerait une incapacité des économies grecque et irlandaise à assumer leur dette déborde largement le périmètre des frontières de ces deux pays. C'est d'ailleurs bien ce dernier aspect qui explique la panique qui, à cette occasion, s'est emparée des hautes instances de la bourgeoisie mondiale. De la même manière que les banques irlandaises possédaient des créances considérables sur toute une série d'États du monde, les banques des grands pays développés possèdent des créances colossales sur les États grec et irlandais. Concernant le montant des créances des grandes banques mondiales sur l'État irlandais, les différentes sources ne concordent pas. Parmi celles-ci, retenons, à titre indicatif, des évaluations qui apparaissent "moyennes" : "Selon le quotidien économique les Échos de lundi, les banques françaises seraient exposées à hauteur de 21,1 milliards en Irlande, derrière les banques allemande (46 milliards), britanniques (42,3) et américaines (24,6)" 1. Et concernant l'engagement des banques à l'égard de la Grèce : "Les établissements français sont les plus exposés, avec 75 milliards de dollars (55 milliards d'euros) d'encours. Les établissements suisses ont investi 63 milliards de dollars (46 milliards d'euros), les Allemands 43 milliards (31 milliards d'euros)" 2. Le non-renflouement de la Grèce et de l'Irlande aurait mis dans une situation très difficile les banques créditrices, et donc les États dont elles dépendent. C'est tout particulièrement le cas pour des pays dont la situation financière est très critique (Portugal, Espagne), qui sont, eux aussi, engagés en Grèce et en Irlande, et pour qui une telle situation aurait été fatale.
Ce n'est pas tout. Le non-renflouement de la Grèce et de l'Irlande aurait signifié que les autorités financières de l'UE et du FMI ne garantissaient pas les finances des pays en difficulté, qu'il s'agisse de la Grèce, de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne, etc. Il en aurait résulté un véritable sauve-qui-peut des créanciers de ces États, la faillite garantie des plus faibles parmi ces derniers, l'effondrement de l'euro et une tempête financière, en comparaison de laquelle les conséquences de la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008 auraient fait figure de légère brise de mer. En d'autres termes, en venant au secours de la Grèce et de l'Irlande, les autorités financières de l'UE et du FMI n'ont pas eu comme préoccupation de sauver ces deux États, encore moins les populations de ces deux pays, mais bien d'éviter la déroute du système financier mondial.
Dans la réalité, ce ne sont pas que la Grèce, l'Irlande et quelques autres pays du sud de l'Europe dont la situation financière est fortement détériorée, comme le traduisent les chiffres suivants : "On obtient les statistiques suivantes (janvier 2010) [montant de la dette totale en pourcentage du PIB] : 470% pour le Royaume-Uni et le Japon, médailles d’or de l’endettement total ; 360% pour l’Espagne ; 320% pour la France, l’Italie et la Suisse ; 300% pour les États-Unis et 280% pour l’Allemagne" 3. En fait, l'ensemble des pays, qu'ils soient situés dans la zone euro ou hors de celle-ci, ont un endettement considérable qui, de manière évidente, ne permet pas qu'il puisse être remboursé. Néanmoins, les pays de la zone euro ont sur ce plan à faire face à une difficulté supplémentaire dans la mesure où un État qui s'endette n'a pas la possibilité de créer lui-même les moyens monétaires pour "financer" ses déficits puisqu’une telle possibilité est exclusivement du ressort d'une institution qui lui est extérieure, à savoir la Banque Centrale Européenne. D'autres pays, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, également très endettés, n'ont pas ce problème puisqu'ils ont toute autorité pour créer leur propre monnaie.
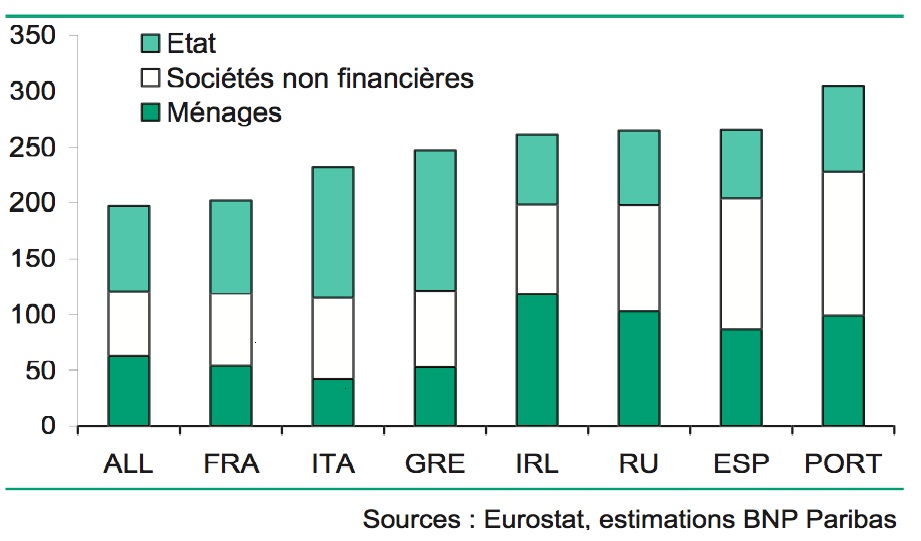
Endettement public et privé (en % du PIB) hors institutions financières, en 2009
Quoi qu'il en soit, les niveaux d'endettement de tous ces États montre que leurs engagements dépassent leurs possibilités de remboursement, et ce jusqu'à l'absurde. Des calculs ont été faits qui montrent que la Grèce devrait – au bas mot - parvenir à un excédent budgétaire de 16 ou 17% pour stabiliser sa dette publique. En fait, ce sont tous les pays du monde qui se sont endettés à un point tel que leur production nationale ne permet pas le remboursement de leur dette. En d'autres termes, cela signifie que des États et institutions privées possèdent des créances qui ne pourront jamais être honorées 4. Le tableau ci-dessous, qui indique l'endettement de chaque pays européen (hors institutions financières, contrairement aux chiffres mentionnés plus haut), permet de se faire une bonne idée de l'immensité des dettes contractées de même que de la fragilité des pays les plus endettés.
Les plans de sauvetage n'ayant aucune chance d'aboutir, leur existence a-t-elle une autre signification ?
Le capitalisme ne peut survivre que grâce à des plans de soutien économique permanents
Le plan de "sauvetage" de la Grèce a coûté 110 milliards d'euros et celui de l'Irlande 85 milliards. Ces masses financières apportées par le FMI, la zone euro et le Royaume-Uni (pour 8,5 milliards d'euros alors que le gouvernement Cameron a par ailleurs mis en œuvre son propre plan d'austérité visant à diminuer les dépenses publiques de 25% en 2015 5) ne sont autres que de la monnaie émise sur la base de la richesse des différents États.
En d'autres termes, l'argent dépensé dans le plan de sauvetage n'est pas basé sur de nouvelles richesses créées mais il est bel et bien le produit de la planche à billets, ce qui en fait de la "monnaie de singe".
Un tel soutien au secteur financier, lequel finance l'économie réelle, est en fait un soutien à l'activité économique réelle. Ainsi, alors que d'un côté se mettent en place des plans d'austérité draconiens, qui annoncent d'autres plans d'austérité encore plus draconiens, on voit les États être obligés, sous peine d'effondrement du système financier et de blocage de l'économie mondiale, d'adopter ce qu'il faut bien appeler des plans de soutien – dont le contenu est très proche de ce qui s'appelle des "plans de relance".
En fait, ce sont les États-Unis qui sont allés le plus loin dans cette direction : le Quantitative Easing n° 2 de 900 milliards de dollars 6 n'a pas d'autre sens que de tenter de sauver un système financier américain dont les livres de compte demeurent remplis de mauvaises créances, et de soutenir la croissance économique des États-Unis dont le caractère poussif montre qu'elle ne peut pas se passer d'un déficit budgétaire important.
Les États-Unis, bénéficiant toujours de l'avantage que leur confère le statut du dollar comme monnaie d'échange mondiale, ne subissent pas les même contraintes que la Grèce, l'Irlande ou d'autres pays européens et, de ce fait, il n'est pas exclu, comme beaucoup le pensent, que devra être adopté un Quantitative Easing n° 3.
Ainsi, le soutien de l'activité économique par les mesures budgétaires est beaucoup plus fort aux États-Unis qu'il ne l'est dans les pays européens. Mais cela n'empêche pas les États-Unis de chercher aussi à diminuer de manière drastique le déficit budgétaire, comme l'illustre le fait que B. Obama lui-même a proposé de bloquer le salaire des fonctionnaires fédéraux. En fait, c'est dans tous les pays du monde que l'on trouve de telles contradictions dans les politiques mises en œuvre
La bourgeoisie a dépassé les limites de l'endettement que le capitalisme peut supporter
Nous avons donc des plans d'austérité et des plans de relance menés en même temps ! Quelle est la raison de telles contradictions ?
Comme l'avait montré Marx, le capitalisme souffre par nature d'un manque de débouchés car l'exploitation de la force de travail de la classe ouvrière aboutit forcément à la création d'une valeur plus grande que la somme des salaires versés, vu que la classe ouvrière consomme beaucoup moins que ce qu'elle a produit. Pendant toute une période qui va jusqu'à la fin du XIXe siècle, la bourgeoisie a pu réellement faire face à ce problème par la colonisation de territoires qui n'étaient pas capitalistes, territoires sur lesquels elle forçait, par de multiples moyens, la population à acheter les marchandises produites par son capital. Les crises et les guerres du XXe siècle ont illustré que cette manière de faire face au problème de la surproduction, inhérent à l'exploitation capitaliste des forces productives, atteignait ses limites. En d'autres termes, les territoires non capitalistes de la planète n'étaient plus suffisants pour permettre à la bourgeoisie d'écouler ce surplus de marchandises qui permet l'accumulation élargie et résulte de l'exploitation de la classe ouvrière. Le dérèglement de l'économie qui s'est produit à la fin des années 1960 et qui s'est manifesté par des crises monétaires et par des récessions signait la quasi absence des marchés extra-capitalistes comme moyen d'absorber le surproduit de la production capitaliste. La seule solution qui se soit alors imposée a été la création d'un marché artificiel alimenté par la dette. Il permettait à la bourgeoisie de vendre à des États, des ménages ou des entreprises des marchandises sans que ces derniers disposent des moyens réels pour les acheter.
Nous avons souvent abordé ce problème en soulignant que le capitalisme avait utilisé l'endettement comme un palliatif à la crise de surproduction dans laquelle il est enfoncé depuis la fin des années 1960. Mais il ne faut pas confondre endettement et miracle. En effet, la dette doit être progressivement remboursée et ses intérêts payés systématiquement sinon le créancier, non seulement n'y trouve pas son intérêt, mais encore il risque lui-même de faire faillite.
Or, la situation d'un nombre croissant de pays européens montre qu'ils ne peuvent plus s'acquitter de la partie de leur dette exigée par leurs créanciers. En d'autres termes, ces pays se retrouvent devant l'exigence de devoir diminuer leur dette, notamment en réduisant leurs dépenses, alors que quarante années de crise ont montré que l'augmentation de celle-ci était une condition absolument nécessaire à ce que l'économie mondiale n'entre pas en récession. C'est là une même contradiction insoluble à laquelle sont confrontés, de façon plus ou moins aigüe, tous les États.
Les secousses financières qui se manifestent en ce moment en Europe sont ainsi le produit des contradictions fondamentales du capitalisme et illustrent l'impasse absolue de ce mode de production. D'autres caractéristiques de la situation actuelle, que nous n'avons pas encore évoquées dans cet article, entrent également en jeu.
L'inflation se développe
Au moment même où beaucoup de pays du monde mettent en place des politiques d'austérité plus ou moins violentes, ayant pour effet de réduire la demande intérieure, y inclus les produits de première nécessité, le prix des matières premières agricoles connait de très fortes augmentations : plus de 100 % pour le coton en un an 7, plus de 20% pour le blé et le maïs entre juillet 2009 et juillet 2010 8 et 16% pour le riz entre la période avril-juin 2010 et fin octobre 2010 9 ; une tendance analogue concerne les métaux et le pétrole. Bien sûr, les facteurs climatiques ont un rôle dans l'évolution du prix des produits alimentaires, mais l’augmentation est tellement généralisée qu'elle a nécessairement des causes qui sont autres. Plus généralement, l'ensemble des États sont préoccupés par le niveau de l'inflation qui affecte de plus en plus leur économie. Quelques exemples concernant les pays "émergents" :
- Officiellement l'inflation en Chine atteignait, au mois de novembre 2010, le rythme annuel de 5,1% (en fait tous les spécialistes s'accordent à dire que les chiffres réels de l'inflation dans ce pays se situent entre 8 et 10%) ;
- En Inde, l'inflation était de 8,6% au mois d'octobre ;
- En Russie, où l'inflation a été de 8,5% en 2010 10.
Le développement de l’inflation n'est pas un phénomène exotique réservé aux pays émergents puisque les pays développés sont aussi de plus en plus concernés : les 3,3% en novembre au Royaume-Uni ont été qualifiés de dérapage par le gouvernement ; le 1,9% dans la vertueuse Allemagne est qualifié de préoccupant parce qu'il s'insère au sein d'une croissance rapide.
Quelle est donc la cause de ce retour de l'inflation ?
L'inflation n'a pas toujours pour cause une demande excédentaire par rapport à l'offre permettant aux vendeurs d'augmenter les prix sans craindre de ne pas vendre toutes leurs marchandises. Un autre facteur tout à fait différent peut être à l'origine de ce phénomène : il s'agit de l'augmentation de la masse monétaire qui se produit effectivement depuis trois décennies. En effet, l'utilisation de la planche à billets, c'est-à-dire l'émission de nouvelle monnaie sans que la richesse nationale lui correspondant augmente dans les mêmes proportions, aboutit inévitablement à une dépréciation de la valeur de la monnaie en service, ce qui se traduit par une hausse des prix. Or, toutes les données communiquées par les organismes officiels font apparaître, depuis 2008, de fortes augmentations de la masse monétaire dans les grandes zones économiques de la planète.
Ces augmentations encouragent le développement de la spéculation, avec des conséquences désastreuses pour la vie de la classe ouvrière. La demande étant trop faible, notamment du fait de la stagnation ou de la baisse des salaires, les entreprises ne peuvent pas augmenter le prix des marchandises sur le marché sous peine de ne pouvoir les écouler et d'enregistrer des pertes. Ces mêmes entreprises, ou les investisseurs, se détournent ainsi de l'activité productive, trop peu rentable et donc trop risquée, et orientent les quantités de monnaie créées par les banques centrales vers la spéculation : concrètement, cela signifie achat de produits financiers, de matières premières ou de monnaies avec l'espoir qu'ils pourront être revendus avec un profit substantiel. Ce faisant, ces "produits de consommation" vont se trouver transformés en actifs. Le problème, c'est qu'une bonne partie de ces produits, en particulier les matières premières agricoles, sont aussi des marchandises qui entrent dans la consommation du plus grand nombre d'ouvriers, de paysans, de chômeurs, etc. Finalement, en plus de la baisse de ses revenus, une grande partie de la population mondiale va aussi se trouver aux prises avec l'augmentation du prix du riz, du pain, des vêtements, etc.
Ainsi, la crise qui oblige la bourgeoisie à sauver ses banques au moyen de la création de monnaie aboutit à ce que les ouvriers subissent deux attaques :
-
la baisse du niveau de leur salaire,
l'augmentation du prix des produits de première nécessité.
C'est pour ces raisons que l'on a connu une augmentation du prix des produits de première nécessité depuis le début des années 2000 et les mêmes causes ont, aujourd'hui, les mêmes effets. En 2007-2008 (juste avant la crise financière), de grandes masses de la population mondiale se retrouvant dans une situation de disette avaient été à l'origine d'émeutes de la faim. Les conséquences de l'actuelle flambée des prix ne se sont pas fait attendre comme l'illustrent les révoltes actuelles en Tunisie et en Algérie.
Le niveau actuel de l'inflation ne cesse de s'élever. D’après le Cercle Finance du 7 décembre, le taux des T bonds 11 à 10 ans est passé de 2,94% à 3,17% et le taux des T bonds à trente ans est passé 4,25% à 4,425%. Cela signifie clairement que les capitalistes anticipent une perte de valeur de l'argent qu’ils placent en exigeant un taux plus élevé pour leurs placements.
Les tensions entre capitaux nationaux
Lors de la crise des années 1930, le protectionnisme, moyen de la guerre commerciale, s’était développé massivement à tel point qu’on avait pu alors parler de "régionalisation" des échanges : chacun des grands pays impérialistes se réservant une zone planétaire qu’il dominait et qui lui permettait de trouver un minimum de débouchés. Contrairement aux pieuses intentions publiées par le récent G20 de Séoul, et selon lesquelles les différents pays participant ont déclaré vouloir bannir le protectionnisme, la réalité n'est pas celle-là. Des tendances protectionnistes sont clairement à l’œuvre actuellement et on préfère chastement parler, à leur propos, de "patriotisme économique". La liste des mesures protectionnistes adoptées par les différents pays serait trop fastidieuse pour être rapportée. Mentionnons simplement le fait que les États-Unis en étaient, en septembre 2010, à 245 mesures anti-dumping ; que le Mexique avait pris, dès mars 2009, 89 mesures de rétorsion commerciale contre les États-Unis et que la Chine a récemment décidé la limitation drastique de l’exportation de ses "terres rares" qui rentrent dans la production d’une grande partie des produits de haute technologie.
Mais, dans la période actuelle, c'est la guerre des monnaies qui se trouve constituer la manifestation majeure de la guerre commerciale. Nous avons vu plus haut que le Quantitative Easing n° 2 était une nécessité pour le capital américain, mais en même temps, dans la mesure où la création de monnaie qui l'accompagne ne peut que se traduire par la baisse de la valeur de celle-ci, et donc aussi du prix des produits "made in USA" sur le marché mondial (relativement aux produits des autres pays), il constitue une mesure protectionniste particulièrement agressive. De même, la sous-évaluation du yuan chinois poursuit des objectifs similaires.
Et pourtant, malgré la guerre économique, les différents États ont été obligés de s’entendre pour permettre à la Grèce et à l’Irlande de ne pas faire défaut sur leur dette. Cela signifie que dans ce domaine aussi, la bourgeoisie ne peut pas faire autrement que de prendre des mesures très contradictoires, dictées par l’impasse totale dans laquelle se trouve son système.
La bourgeoisie a-t-elle des solutions à proposer ?
Pourquoi, dans le contexte de la situation catastrophique actuelle de l'économie mondiale, voit-on apparaître des articles comme ceux de La Tribune ou du Monde titrant respectivement "Pourquoi la croissance sera au rendez-vous" 12 et "Les États-Unis veulent croire à la reprise économique" 13 ? De tels titres, qui ne relèvent que de la propagande, visent à nous endormir et, surtout, à nous faire croire que les autorités économiques et politiques de la bourgeoisie ont encore une certaine maîtrise de la situation. En fait, la bourgeoisie n’a le choix qu’entre deux politiques qui sont comme la peste et le choléra :
- Soit elle procède comme elle l’a fait pour la Grèce et l’Irlande à de la création de monnaie, car tant les fonds de l'UE que ceux du FMI proviennent de la planche à billets des divers États membres ; mais alors on se dirige vers une dévalorisation des monnaies et une tendance inflationniste qui ne peut que devenir de plus en plus galopante ;
- Soit elle pratique une politique d'austérité particulièrement draconienne visant à une stabilisation de la dette. C'est la solution qui est préconisée par l'Allemagne pour la zone euro, les particularités de cette zone faisant que, en fin de compte, c'est le capital allemand qui supporte le plus gros du coût du soutien aux pays en difficulté. L'aboutissement d'une telle politique ne peut être que la chute vertigineuse dans la dépression, à l’image de la chute de la production que l’on a vu en 2010 en Grèce, en Irlande et en Espagne suite aux plans "de rigueur" qui ont été adoptés.
Un certains nombre d'économistes dans toute une série d'ouvrages publiés récemment proposent tous leur solution à l'impasse actuelle, mais toutes procèdent soit de la méthode Coué, soit de la plus pure propagande pour faire croire que cette société a, malgré tout, un avenir. Pour ne prendre qu'un exemple, selon le professeur M. Aglietta 14, les plans d’austérité adoptés en Europe vont coûter un pour cent de croissance dans l’Union Européenne ramenant celle-ci à un niveau d'environ 1% en 2011. Sa solution alternative est révélatrice du fait que les plus grands économistes n'ont plus rien de réaliste à proposer : il n’a pas peur d’affirmer qu’une nouvelle "régulation" basée sur "l’économie verte" serait la solution. Il "oublie" seulement une chose : une telle "régulation" impliquerait des dépenses considérables et donc une création monétaire bien plus gigantesque que l'actuelle, et ce alors que l’inflation redémarre de façon particulièrement préoccupante pour la bourgeoisie.
La seule vraie solution à l'impasse capitaliste est celle qui se dégagera des luttes, de plus en plus nombreuses, massives et conscientes que la classe ouvrière est contrainte de mener de par le monde, pour résister aux attaques économiques de la bourgeoisie. Elle passe naturellement par le renversement de ce système dont la principale contradiction est celle de produire pour le profit et l'accumulation et non pour la satisfaction des besoins humains.
Vitaz - 2 janvier 2011
1. lexpansion.lexpress.fr/entreprises/que-risquent-les-banques-francaises_1341874.html [3]
2. https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/02/12/04016-20100212ARTFIG00395-grece-ce-que-risquent-les-banques-.php [4]
3. Bernard Marois, professeur émérite à HEC : www.abcbourse.com/analyses/chronique-l_economie_shadock_analyse_des_dettes_totales_des_pays-456 [5]
4. J. Sapir "L'euro peut-il survivre à la crise", Marianne, 31 décembre 2010
5. Mais il est révélateur que M. Cameron commence à avoir peur de l'effet dépressif sur l'économie anglaise du plan qu'il a concocté.
6. Le QE n° 2 a été fixé à 600 milliards de dollars, mais il faut ajouter le droit qu'a la FED depuis cet été de renouveler l'achat de créances arrivées à échéance pour 35 milliards de dollars par mois.
7. blog-oscar.com/2010/11/la-flambee-du-cours-du-coton (les chiffres rapportés sur ce site datent de début novembre ; aujourd'hui ces chiffres sont largement dépassés).
8. C. Chevré, MoneyWeek, 17 novembre 2010
9. Observatoire du riz de Madagascar ; iarivo.cirad.fr/doc/dr/hoRIZon391.pdf
10. Le Figaro du 16 décembre 2010, https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/12/16/97002-20101216FILWWW00522-russie-l-inflation-a-85-en-2010.php [6]
11. Bons du Trésor américains.
12. La Tribune, 17 décembre 2010
13. Le Monde, 30 décembre 2010
14. M. Aglietta dans l'émission "L'esprit public" sur la chaine radio "France Culture", 26 décembre 2010.
Récent et en cours:
- Crise économique [7]
La crise en Grande-Bretagne
- 4620 reads
Le texte ci-dessous est, à quelques modifications mineures près, la partie économique du rapport sur la situation en Grande-Bretagne réalisé pour le 19e congrès de World Revolution (section du CCI en Grande-Bretagne). Nous avons jugé utile sa publication à l'extérieur de notre organisation dans la mesure où ce document fournit un ensemble de données et analyses permettant de saisir la manière dont la crise économique mondiale se manifeste dans la plus ancienne puissance économique du capitalisme.
Le contexte international
En 2010, la bourgeoisie a annoncé la fin de la récession et prédit que l'économie mondiale repartira dans les deux années à venir grâce aux économies émergentes. Cependant, il existe de grandes incertitudes sur la situation globale qui se reflètent dans des projections de croissance contradictoires. Le FMI, dans sa World Outlook Update de juillet 2010, prévoit une croissance globale de 4,5% pour l'année en cours et de 4,25% pour l'année suivante. Le rapport sur les Global Economic Prospects de la Banque mondiale de l'été 2010 envisage une croissance de 3,3% pour 2010 et 2011, et de 3,5% pour 2012, si les choses vont bien. Si elles ne vont pas bien, 3,1% pour 2010, 2,9% l'année suivante et 3,2% en 2012. Leurs préoccupations concernent particulièrement l'Europe pour laquelle la Banque mondiale fait dépendre son estimation la moins pessimiste d'hypothèses qui sont loin d'être réalisées : "les mesures prises empêchent le marché, du fait de sa nervosité actuelle, de ralentir les prêts des banques" et "on parvient à éviter un défaut de paiement ou une restructuration de la dette souveraine européenne". 1 Si ces conditions ne sont pas réalisées, alors l'Europe connaîtra un taux de croissance inférieur, estimé à 2,1, 1,9 et 2,2 pour cent respectivement entre 2010 et 2012.
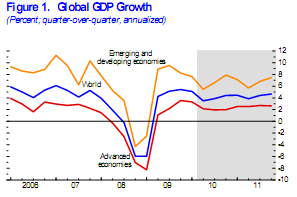
Légende : Orange : Economies émergentes ou en développement ; Rouge : Economies développées ; Bleu : Economie mondiale
Croissance globale du PIB
(Source: FMI, World Economic Outlook Update, Juillet 2010)
La situation reste fragile du fait du haut niveau de dettes et du bas niveau de prêts bancaires, et de la possibilité de nouveaux chocs financiers comme celui qu'on a connu en mai de cette année (2010) où les marchés boursiers ont globalement perdu entre 8 et 17% de leur valeur. L'échelle du renflouage est en elle-même l'une des causes des préoccupations : "La dimension du plan de sauvetage de l'Union européenne et du FMI (près de 1 trillion de dollars) ; l'ampleur de la réaction initiale du marché à la possibilité de défaut de paiement de la Grèce et au danger de contagion ; et la poursuite de la volatilité sont des indicateurs de la fragilité de la situation financière... un nouvel épisode d'incertitude du marché pourrait avoir des conséquences sérieuses pour la croissance à la fois sur les pays de haut revenu et sur les pays en développement." 2 Comme on pouvait s'y attendre, le FMI prescrit une réduction des dépenses étatiques, avec le résultat inévitable d'imposer l'austérité à la classe ouvrière : "Les pays à haut revenu devront faire des coupes dans les dépenses gouvernementales (ou augmenter leur revenu) de 8,8% du PIB pendant une période de 20 ans afin de ramener le niveau de la dette à 60% du PIB d'ici 2030."
Malgré leur objectivité apparente et la sobriété de leurs analyses, les rapports du FMI et de la Banque mondiale laissent à penser qu'il existe une profonde incertitude et une grande peur au sein de la classe dominante concernant sa capacité à surmonter la crise. Il est prévisible que d'autres pays suivront l'Irlande dans sa chute dans la récession.
L'évolution de la situation économique en Grande-Bretagne
Cette partie, basée sur des données officielles, est destinée à donner une vue d'ensemble du cours de la récession. Cependant, il est important de rappeler que la crise a commencé dans le secteur financier, à la suite de la crise du marché immobilier aux Etats-Unis, et qu'elle a affecté les grandes banques et les instituts financiers impliqués dans des prêts à risques sur toute la planète. Elle a été la plus forte sur le marché des subprimes aux Etats-Unis et s'est répandue à travers le système financier du fait que le commerce est basé sur des produits financiers dérivés de ces prêts. Cependant d'autres pays, en particulier la Grande-Bretagne et l'Irlande, ont trouvé le moyen de développer leur propre bulle immobilière ce qui a contribué, de pair avec une augmentation massive de l'endettement non sécurisé des particuliers, à créer un niveau de dette tel qu'en fin de compte, en Grande-Bretagne, il a dépassé le PIB annuel du pays. La crise qui se développait submergeait l'économie "réelle" et préparait la récession. Cette situation a suscité une réponse très forte de la classe dominante britannique qui a injecté des sommes d'argent sans précédent dans le système financier et a baissé les taux d'intérêt à un niveau jamais vu.
Les chiffres officiels montrent que la Grande-Bretagne est entrée en récession au cours du 2e trimestre 2008 et en est sortie au 4e trimestre 2009 avec un pic de recul du PIB de 6,4%. 3 Ce chiffre qui vient d'être révisé à la baisse, fait de cette récession la pire depuis la Seconde Guerre mondiale (les récessions du début des années 1990 et des années 1980 ont respectivement été accompagnées de taux négatifs de croissance de 2,5% et de 5,9%). La croissance du 2e trimestre 2010 a été de 1,2%, une augmentation significative par rapport au 0,4% du 4e trimestre 2009 et au 0,3% du premier trimestre 2010. Cependant, elle est toujours en dessous des 4,7% de la période précédant la récession.
Le secteur manufacturier a été le plus affecté par la récession, enregistrant une chute maximale de 13,8% entre le 4e trimestre 2008 et le 3e trimestre 2009. Depuis, ce secteur a enregistré une croissance de 1,1% au dernier trimestre 2009 et de 1,4% et 1,6% au cours des deux trimestres suivants.
L'industrie du bâtiment a connu un fort rebond de croissance, de 6,6%, au cours du 2e trimestre 2010 et contribué de 0,4% au taux de croissance global de ce trimestre. Mais ceci fait suite à un déclin très substantiel tant dans la construction (tombée de 37,2% entre 2007 et 2009) que dans l'activité industrielle et commerciale (tombé de 33,9% entre 2008 et 2009).
Le secteur des services a enregistré une chute de 4,6%, les services financiers et d'affaires chutant de 7,6% "bien plus que lors des précédents reculs et contribuant le plus à la chute". 4 Au cours du dernier trimestre de 2009, ce secteur a retrouvé une croissance de 0,5% mais au cours du premier trimestre 2010, celle-ci est tombée à 0,3%. Bien que le déclin de ce secteur soit moindre que celui des autres, sa position dominante dans l'économie signifie que c'est lui qui a le plus contribué au déclin global du PIB au cours de cette récession. Au cours de celle-ci, le déclin du secteur des services a été également supérieur à ce qu'il avait été dans les récessions du début des années 1980 et du début des années 1990 où les chutes ont été respectivement de 2,4% et de 1%. Plus récemment, le secteur de la finance et des affaires a connu une plus forte croissance et a contribué de 0,4 point au chiffre du PIB global.
Comme on pouvait s'y attendre, les exportations comme les importations ont diminué au cours de la récession. Cela a été le plus marqué dans le commerce de marchandises (bien que la balance se soit légèrement améliorée dernièrement) : "En 2009, le déficit est passé de 11,2 milliards de £ à 81,9 milliards. Il y a eu une chute des exportations de 9,7% - de 252,1 milliards de £ à 227,5 milliards. Cependant cela s'est accompagné d'une chute des importations de 10,4%, la plus grande chute annuelle depuis 1952, qui a eu un impact bien plus grand puisque le total des importations est significativement supérieur à celui des exportations. Les importations sont tombées de 345,2 milliards de £ en 2008 à 309,4 milliards de £ en 2009. Ces chutes importantes, tant dans les exportations que dans les importations, sont le résultat d'une contraction générale du commerce en plus de la crise financière mondiale qui a commencé fin 2008". 5
Le déclin dans les services a été plus réduit, les importations chutant de 5,4% et les exportations de 6,9%, la balance commerciale restant toutefois positive de 55,4 milliards de £ en 2008 et 49,9 milliards de £ en 2009. Le total du commerce dans les services était en 2009 de 159,1 milliards de £ d'exportations et de 109,2 milliards d'importations, ce qui est significativement moins que celui du commerce de marchandises.
Entre 2008-09 et 2009-10, le déficit des comptes courants a doublé, de 3,5% du PIB à 7,08%. Les demandes d'emprunt du secteur public qui incluent l'emprunt pour des dépenses en investissements sont passées de 2,35% du PIB en 2007- 08, à 6,04% en 2008 - 09 et 10,25% en 2009 - 10. En 2008, elles se montaient à 61,3 milliards de £ et en 2009 à 140,5 milliards. Il était prévu que la dette nette totale du gouvernement se monte à 926,9 milliards de £ en juillet de cette année soit 56,1% du PIB, alors qu'elle avait été de 865,5 milliards en 2009 et de 634,4 milliards en 2007. En mai 2009, Standard and Poor’s (organisme de notation) a soulevé la question de rétrograder la notation de la dette britannique en dessous du niveau AAA (le plus élevé). Une telle baisse aurait renchéri de façon significative le coût des emprunts.
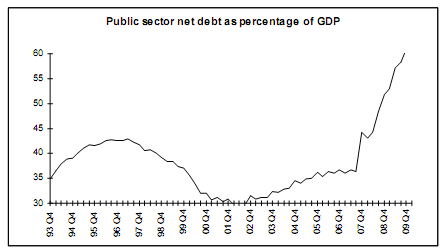
Dette nette du secteur public en pourcentage du PIB
Le nombre de faillites a augmenté pendant la récession, de 12 507 en 2007 (ce qui était un des chiffres les plus bas de la décennie) à 15 535 en 2008 et 19 077 en 2009. Le nombre de rachats et de fusions a augmenté au cours de la deuxième moitié de la décennie pour atteindre 869 en 2007 avant de tomber au cours des deux années suivantes respectivement à 558 et 286. Les chiffres du premier trimestre 2010 n'indiquent pas une quelconque augmentation. Ceci semble signifier que l'insolvabilité des entreprises et la destruction de capital n'ont pas engendré le processus général de consolidation qui intervient en général en sortie d'une crise, ce qui, en soi, peut indiquer que la vraie crise est toujours là.
Pendant la crise, la livre sterling a beaucoup chuté par rapport aux autres devises, perdant plus d'un quart de sa valeur entre 2007 et début 2009, ce qui a suscité le commentaire suivant de la banque d'Angleterre : "Cette chute de plus de 25% est la plus forte sur une période comparable depuis la fin des Accords de Bretton Woods au début des années 1970." 6 Il y a eu une reprise depuis mais la livre reste environ 20% en dessous de son taux de change de 2007.
Le prix du logement a beaucoup chuté après l'éclatement de la bulle immobilière et bien que les prix recommencent à augmenter cette année, ils sont nettement en-dessous de leur maximum et ont à nouveau chuté de 3,6% en septembre dernier. Le nombre de ventes reste à un niveau historiquement bas.
La Bourse a connu de fortes chutes depuis mi-2007 et bien qu'elle ait remonté depuis, l'incertitude existe toujours. Les préoccupations liées à la dette de la Grèce et d'autres pays avant l'intervention de l'Union européenne et du FMI ont provoqué une chute significative en mai cette année comme le montre le graphique ci-après.
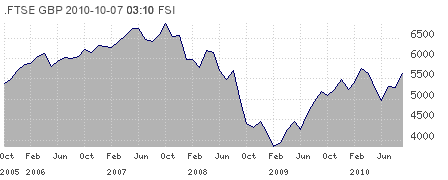
Evolution des valeurs boursières
L'inflation a atteint presque 5% en septembre 2008 avant de retomber à 2% l'année suivante. Elle est depuis passée à plus de 3% en 2010, au-dessus de l'objectif de 2% établi par la Banque d'Angleterre.
L'augmentation du chômage est estimée à 900 000 pendant la récession, ce qui est bien plus bas qu'au cours des précédentes récessions. En juillet 2010, les chiffres officiels étaient de 7,8% de la force de travail, un total d'environ 2,47 millions de personnes.
L'intervention de l'Etat
Le gouvernement britannique est intervenu avec force pour limiter la crise, mettant en oeuvre une série de mesures qui ont également été prises dans beaucoup d'autres pays. Gordon Brown a eu son heure de gloire pendant quelques mois ; son lapsus au cours d'un débat à la Chambre des Communes comme quoi il avait sauvé le monde, est célèbre. L'intervention de l'Etat a comporté plusieurs volets :
- des baisses des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Entre 2007 et mars 2009, le taux a été progressivement abaissé de 5,5% à 0,5%, l'amenant au niveau le plus bas jamais enregistré et au-dessous du taux d'inflation ;
- une intervention de soutien direct aux banques, conduisant à des nationalisations totales ou partielles, à commencer par Northern Rock en février 2008, suivie ensuite par Bradford and Bingley. En septembre, le gouvernement négociait le rachat de HBOS par la Lloyds TSB. En octobre, 50 milliards de livres étaient mises à la disposition des banques pour leur recapitalisation. En novembre 2009, une nouvelle injection de 73 nouveaux milliards de livres a abouti à la nationalisation de fait de RBS/NatWest et à la nationalisation partielle de Lloyds TSB/HBOS ;
- une politique de détente du crédit par l'augmentation de la masse monétaire et par l'octroi de subventions au secteur bancaire, connue sous le nom de l'Asset purchase facility. En mars 2009, un plan d'injection de 75 milliards de livres sur trois mois a été annoncé. Le montant s'est élevé jusqu'à atteindre aujourd'hui un total de 200 milliards. La Banque d'Angleterre explique que le but de la détente du crédit est d'injecter plus d'argent dans l'économie sans pour autant devoir réduire le taux de base de 0,5%, déjà au plancher, en vue de maintenir l'objectif d'une inflation à 2%. Cela se fait par l'achat d'avoirs par la Banque d'Angleterre (principalement des gilts 7) aux institutions du secteur privé, ce qui procure des liquidités aux vendeurs. C'est simple en apparence mais, selon le Financial Times, "Personne ne sait très bien si la politique de détente du crédit ou d'autres politiques monétaires non orthodoxes marchent, ni comment elles marchent." 8
- un encouragement à la consommation. En janvier 2009, la TVA a été abaissée de 17,5% à 15% et, en mai 2009, un système de rabais sur les ventes d'automobiles a été introduit. L'augmentation des garanties sur les dépôts de banque à 50 000 £ en octobre 2008 peut être vue comme un élément de cette politique puisque son but est de rassurer les consommateurs sur le fait que leur argent ne disparaîtra pas purement et simplement en cas d'effondrement de la banque.
Cette politique a permis de contenir la crise dans l'immédiat et d'éviter de nouveaux effondrements bancaires. Le prix en a été une augmentation substantielle de la dette comme on l'a indiqué plus haut. Les chiffres officiels donnent le coût de l'intervention du gouvernement, de 99,8 milliards de £ en 2007, 121,5 milliards de £ en 2009 et 113,2 en juillet cette année. Ces chiffres n'incluent ni les coûts de la détente du crédit (ce qui ajouterait environ 250 milliards de £ au total) ni le coût de l'achat d'avoirs comme la participation dans les banques sous le prétexte que ces avoirs ne seront détenus que provisoirement par le gouvernement avant d'être revendus. Cela reste à voir, même si Lloyds TSB a déjà remboursé une partie des sommes reçues. Selon certains commentateurs, l'action du gouvernement a par ailleurs contribué au fait que l'augmentation du chômage a été plus faible que prévu, pendant la récession. Nous y reviendrons plus en détail plus loin.
Cependant, les prospectives à long terme semblent plus contestables :
- les interventions pour prévenir l'inflation et, en théorie, encourager les dépenses n'ont pas permis d'atteindre leur but bien qu'il semble que les tendances de fond soient meilleures que ce qui était prévu. Cependant, le coût des aliments augmente globalement ce qui ne pourra que pousser l'inflation à la hausse et les ventes à la baisse ;
- les tentatives d'injecter des liquidités dans le système en réduisant le coût de l'emprunt et en augmentant l'argent disponible n'ont pas eu la conséquence attendue, amenant les politiciens à réitérer leurs appels pour que "les banques en fassent plus" ;
- l'impact de la baisse de la TVA et du système de rabais sur les automobiles a contribué à un début de reprise fin 2009, mais à présent cette mesure n'est plus en vigueur. Il y a eu une légère baisse des ventes d'automobiles au premier trimestre 2010 alors que le système de rabais existait encore. En fin de compte, il y a eu des réductions concernant la plupart des domaines de consommation des ménages, mais cela s'est traduit par le ralentissement de l'endettement individuel et l'augmentation du taux d'épargne. Etant donné le rôle central joué par la consommation des ménages, basée sur l'endettement, au sein du boom économique, il est clair que sa baisse a des implications négatives, dans cette reprise comme dans toute reprise.
Les prévisions pour la croissance du PIB en 2010 et 2011 en Grande-Bretagne se montent respectivement à 1,5% et 2%. C'est au dessus des 0,9% et 1,7% prévus dans la zone euro, mais en dessous des 1,9% et 2,5% prévus pour l'ensemble de l'OCDE 9 et en dessous des prévisions du FMI pour l'Europe citées au début de ce rapport.
Cependant, pour saisir la signification réelle de la crise, il est nécessaire d'aller au-delà de la surface des phénomènes et d'examiner des aspects de la structure et du fonctionnement de l'économie britannique.
Les questions économiques et structurelles
Changement dans la composition de l'économie britannique : de la production aux services
Pour comprendre la situation du capitalisme britannique et la signification de la récession, il est nécessaire d'examiner les principaux changements structurels intervenus dans l'économie au cours des récentes décennies. Un article publié par Bilan en 1934/1935 (numéros 13 et 14) notait qu'en 1851, 24% des hommes étaient employés dans l'agriculture alors qu'ils n'étaient plus que 7% en 1931, et qu'au cours de la même période, la proportion d'hommes employés dans l'industrie a décliné de 51% à 42%. Aujourd'hui, on est clairement bien en deçà. Dans les années 1930, la Grande-Bretagne avait encore un empire, même sur le déclin, sur lequel elle pouvait s'appuyer. C'est fini depuis la Seconde Guerre mondiale. La tendance historique s'est modifiée passant du secteur de la production vers celui des services et, au sein de ce dernier, vers la finance en particulier comme le montrent les deux tableaux ci-dessous.
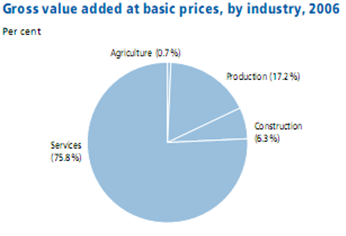
Valeur ajoutée brute totale par secteur en 2006, aux prix de base
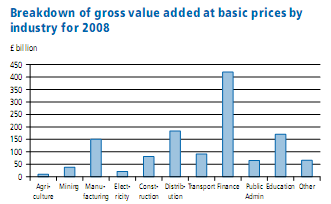
Répartition de la valeur ajoutée brute totale par secteur en 2008,
aux prix de base
Ces deux tableaux proviennent du Blue Book de 2010 qui établit les comptes de la nation. Il fait le commentaire suivant : "En 2006, dernière année de référence, un peu plus de 75% de la valeur ajoutée brute totale provenait du secteur des services, alors que celle issue de la production était de 17%. La partie restante venait majoritairement du secteur de la construction". 10 En 1985, le secteur des services ne constituait que 58% de la valeur ajoutée brute. "Une analyse des 11 grands secteurs industriels montre qu'en 2008, l'intermédiation financière et autres secteurs des services fournissaient la plus grande contribution à la valeur ajoutée brute aux prix de base courants, à 420 milliards de livres sur un total de 1 295,7 milliards (32,4%). Les secteurs de la distribution et de l'hôtellerie ont contribué à hauteur de 14,2% ; ceux de l'éducation, de la santé et du social se montaient à 13,1% ; et celui de la manufacture à 11,6%." 11 Il faut noter qu'en l'espace de deux ans (de 2006 à 2008, le secteur manufacturier a chuté d'environ un tiers (de 17% à 11,6%).
Le tableau ci-dessous intitulé "Changements structurels dans les services au Royaume-Uni" donne une idée de cette évolution au cours des trente dernières années en cherchant à quantifier le développement des différents secteurs qui constituent le secteur des services. "Le rendement total des services a plus que doublé au cours de cette période alors que, dans le secteur des affaires et de la finance, il a été multiplié quasiment par cinq." 12 En comparaison, le même tableau concernant la manufacture montre que ce secteur n'a augmenté que de 18,1% au cours de la même période avec de grandes variations selon les industries.
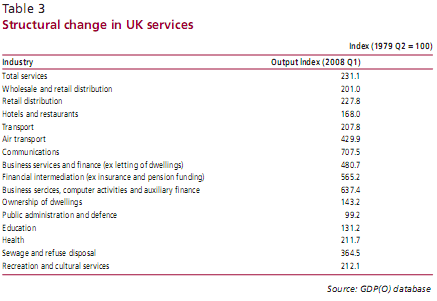
Changements structuraux dans les services au Royaume-Uni.
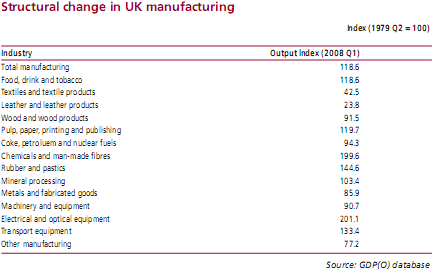
Changements structuraux dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni
Le secteur des services dans son ensemble est plus rentable que celui de la manufacture comme le montre le tableau ci-dessous. Au cours du premier trimestre 2010, le taux net de rendement dans la manufacture était de 6,4% et dans les services de 14,4%. Cependant, ce sont les taux de rendement les plus bas respectivement depuis 1991 et 1995.
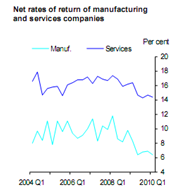
Taux net de rendement dans le secteur manufacturier et dans les services
La montée du secteur financier
Les chiffres publiés sur la profitabilité du secteur des services cités plus haut concernent les compagnies privées non financières et une caractéristique particulière de la situation en Grande-Bretagne est l'importance du secteur de la finance. Celui-ci nécessite donc un examen plus détaillé. Cinq des dix premières banques en tête par capitalisation en Europe en 2004, dont les deux premières, étaient basées en Grande-Bretagne. Globalement, les quatre plus grandes banques britanniques sont dans les sept premières mondiales (les banques américaines Citicorp et UBS sont les deux premières). Selon le directeur de la Stabilité financière à la Banque d'Angleterre : "La part du secteur financier du Royaume uni dans la production total a augmenté de 9% au dernier trimestre 2008. L'excédent brut d'exploitation des entreprises financières (la valeur ajoutée brute moins la compensation pour les employés et d'autres taxes sur la production) a augmenté de 5 milliards de livres à 20 milliards, ce qui est aussi la plus grande augmentation jamais enregistrée". 13 Ceci reflète la tendance en Grande-Bretagne depuis un siècle et demi : "Au cours des 160 dernières années, la croissance de l'intermédiation financière a dépassé l'ensemble de la croissance économique de plus de 2 points de pourcentage par an. Ou, dit autrement, la croissance de la valeur ajoutée du secteur financier a été plus du double de celle de l'ensemble de l'économie nationale au cours de la même période." 14 Alors qu'il représentait environ 1,5% des profits de l'économie entre 1948 et 1970, le secteur représente maintenant 15%. C'est un phénomène global avec des profits avant impôts sur les 1000 principales banques mondiales atteignant 800 milliards de livres en 2007-08, une augmentation de 150% depuis 2000-01. De façon cruciale, le rendement du capital dans le secteur bancaire a largement dépassé celui du reste de l'économie comme le montre le tableau ci-dessous.
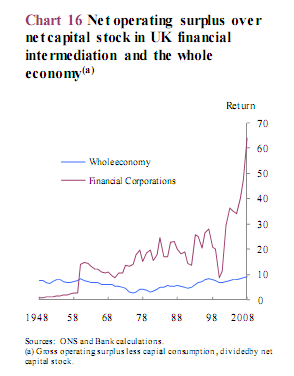
Le ratio de l'excédent net d'exploitation par rapport au capital net dans le secteur d'intermédiation financière et pour l'économie dans son ensemble au Royaume-Uni
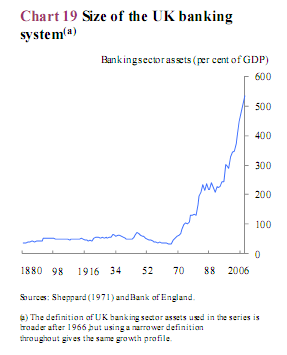
Taille du système bancaire au Royaume-Uni
Le poids du secteur bancaire au sein de l'économie peut se mesurer en comparant ses avoirs par rapport à l'ensemble du PIB du pays. On peut le voir dans le tableau ci-dessus. En 2006, les avoirs de la banque d'Angleterre dépassaient 500% du PIB. Aux Etats-Unis au cours de la même période, les avoirs sont passés de 20% à 100% du PIB, le poids du secteur bancaire en Grande-Bretagne est donc bien supérieur. Cependant son ratio de capital (c'est-à-dire le capital détenu par la banque relativement à celui qui est prêté) ne s'est pas maintenu, tombant de 15-25% au début du 20e siècle à 5% à la fin de celui-ci. Ceci s'est considérablement amplifié au cours de la dernière décennie. Juste avant le krach, le taux de couverture des principales banques était environ de 1 pour 50. Ceci souligne que l'économie globale s'est construite sur une tour de capital fictif au cours des dernières décennies. La crise de 2007 a menacé de faire basculer l'ensemble de l'édifice et cela aurait été catastrophique pour la Grande-Bretagne vu sa dépendance envers ce secteur. C'est pourquoi la bourgeoisie britannique a dû répondre comme elle l'a fait.
La nature du secteur des services
Cela vaut aussi la peine d'examiner de plus près le secteur des services. Il est réparti de différentes façons dans les publications officielles qui fournissent des informations plus ou moins détaillées. Ici, nous nous référerons à la liste des services qui sont cités dans le tableau présenté plus haut ("Changement structurel dans les services au Royaume-Uni"). Il faut toutefois noter à ce sujet que, parfois, la construction qui est une activité productive est incluse dans le secteur des services. La bourgeoisie enregistre la valeur que chaque industrie est supposée ajouter à l'économie, mais ça ne nous dit pas si elles produisent vraiment de la plus-value ou si, tout en remplissant une fonction nécessaire, elles n'ajoutent pas de valeur.
Certains de ces secteurs sont ce que Marx décrivait comme "les frais de circulation". 15 Il y distingue ceux qui sont liés à la transformation de la marchandise d'une forme en une autre, c'est-à-dire de la forme marchandise en monnaie ou vice-versa, et ceux qui sont la continuation du processus de production.
Les changements de forme de la marchandise, bien qu'ils fassent partie du processus global de la production n'ajoutent pas de valeur et constituent un coût sur la plus-value extraite. Dans la liste que nous examinons, sont inclus la distribution de détail et de gros (quand elle ne comprend pas le transport des marchandises – voir plus loin), les hôtels et les restaurants (dans la mesure où ils sont le point de vente de marchandises finies – la préparation des repas peut être considérée comme un processus productif produisant de la plus-value), une grande partie des télécommunications (quand elles sont concernées par l'achat de matières premières ou la vente de produits finis), les ordinateurs et services d’affaires (quand ils sont concernés par des activités telles que la commande et le contrôle des stocks et la stratégie de marché). Toute l'industrie du marketing et de la publicité, qui n'est pas signalée de façon distincte ici, tombe dans cette catégorie puisque son rôle est de maximaliser les ventes.
Marx défend que ces activités qui sont la continuation du processus productif incluent des activités comme le transport qui achemine la marchandise à son point de consommation, ou comme le stockage qui préserve la valeur de la marchandise. Ces activités tendent à augmenter le coût de la marchandise sans ajouter à sa valeur d'usage ; ce sont des coûts improductifs pour la société mais elles peuvent produire de la plus-value pour les capitalistes individuels. Dans notre liste, cette catégorie inclut le transport, la distribution de détail et en gros quand elles impliquent le transport ou le stockage des marchandises.
Un troisième domaine concerne les activités liées à l'appropriation d'une part de la plus-value grâce aux intérêts ou à la rente. Une grande part des activités dans les services d’affaires, la finance, l'intermédiation et les services financiers d’affaires, l'informatique (…) sont des aspects de l'administration de la Bourse et des banques où des honoraires et des commissions sont perçus ainsi que des intérêts. Les organismes financiers investissent aussi de l'argent et spéculent pour leur compte. La propriété des logements est probablement reliée à la location d'où l'enregistrement de plus-value sous forme de rente.
Un quatrième domaine est l'activité de l'Etat qui couvre la plus grande part des cinq derniers éléments de notre liste. Puisqu'ils se fondent sur la plus-value issue de la taxation de l'industrie, aucun ne produit de plus-value, bien que les commandes de l'Etat puissent produire des profits pour les entreprises individuelles. Dans la Revue internationale n° 114, nous soulignions que la façon dont "la bourgeoisie produit ses comptes nationaux [tend] à surestimer le PIB parce que la comptabilité nationale prend partiellement en compte deux fois la même chose. En effet, le prix de vente des produits marchands incorpore les impôts dont le montant sert à payer les dépenses de l'Etat, à savoir le coût des services non marchands (enseignement, sécurité sociale, personnel des services publics). L'économie bourgeoise évalue la valeur de ces services non marchands comme étant égale à la somme des salaires versés au personnel qui est chargé de les produire. Or, dans la comptabilité nationale, cette somme est rajoutée à la valeur ajoutée produite dans le secteur marchand (le seul secteur productif) alors qu'elle est déjà incluse dans le prix de vente des produits marchands (répercussion des impôts et des cotisations sociales dans le prix des produits)." 16
Si on prend l'ensemble du secteur des services, il est clair qu'il n'apporte pas à l'économie la valeur qu'on prétend. Certains services participent à réduire le total de plus-value produite, et les autres, ceux de la finance et des affaires en particulier, prennent leur part de la plus-value produite, y compris lorsqu'elle est produite dans d'autres pays.
Quelles sont les raisons du changement de structure de l'économie britannique ? D'abord, une augmentation de la productivité signifie qu'une masse croissante de marchandises est produite par un nombre de plus en plus faible d'ouvriers. C'est la réalité que montrent les chiffres de Bilan cités plus haut. Deuxièmement, l'augmentation de la composition organique et la chute du taux de profit ont pour résultat que la production se déplace vers des régions où les coûts du travail et du capital constant sont plus bas. 17 Troisièmement, les mêmes facteurs poussent le capital à orienter ses activités là où les rendements sont plus forts, notamment le secteur financier et bancaire dans lequel la domination de longue date de la Grande-Bretagne (Bilan parlait de la Grande-Bretagne comme du "banquier mondial") lui permettait d'extraire plus de plus-value. La dérégulation de ce secteur dans les années 1980 n'a pas réduit les coûts mais a renforcé la domination des principales banques et des compagnies financières, et la dépendance de la bourgeoisie vis-à-vis des profits qu'elles produisent. Quatrièmement, avec l'augmentation de la masse de marchandises, augmente aussi la contradiction entre l'échelle de la production et la capacité des marchés, ce qui mobilise davantage de ressources pour transformer le capital de sa forme de marchandise en sa forme d'argent. Cinquièmement, la complexité croissante de l'économie et des contraintes sociales a pour conséquence le développement de l'Etat qui doit gérer l'ensemble de la société dans l'intérêt du capital national. Ceci inclut les forces de contrôle direct, mais aussi les secteurs de l'Etat qui ont pour tâche de produire des ouvriers qualifiés, de les maintenir à peu près en bonne santé et de gérer les différents problèmes sociaux qui surgissent dans une société d'exploitation.
Conclusion
Deux conclusions quelque peu contradictoires peuvent être tirées de cette partie du rapport. La première et la plus importante est que l'évolution du capitalisme britannique l'a exposé de plein fouet à la crise lorsqu'elle a éclaté et il y a eu un vrai danger que l'effondrement du secteur financier paralyse l'économie. La perspective était à une accélération aiguë du déclin du capitalisme britannique avec toutes ses conséquences au niveau économique, impérialiste et social. Dire que la bourgeoisie britannique était au bord de l'abîme en 2007 et 2008 n'est pas une exagération. La réponse que la classe dominante a apportée confirme qu'elle est toujours capable et déterminée ; elle a uni toutes ses forces pour faire face au danger immédiat ; pour les conséquences à plus long terme c'est autre chose.
La seconde conclusion est que ce serait une erreur de négliger les secteurs manufacturiers et de penser que la Grande-Bretagne n'a quasiment plus d'industrie. Deux raisons à cela. D'abord, le secteur industriel participe toujours de façon importante à l'économie dans son ensemble, même si le taux de profit y est plus bas. La contribution de 17% ou même 11,6% à l'économie totale n'est pas insignifiante (et est en réalité probablement plus grande une fois que les composantes non productives des services sont prises en compte). De plus, même si dans ce secteur la balance commerciale est négative depuis des décennies, la production constitue une composante importante des exportations de la Grande-Bretagne. Deuxièmement, la crise actuelle met à nu le danger de ne s'appuyer que sur une partie de l'économie. Cela explique pourquoi le gouvernement de Cameron met en avant le rôle que la manufacture peut jouer dans une reprise économique et pourquoi la promotion du commerce britannique est devenue récemment une priorité de la politique étrangère de la Grande-Bretagne. Que celle-ci soit réaliste est une autre question car elle requiert une attaque sur les coûts de production plus importante que tout ce qui a été fait par Thatcher et ira contre les tendances historique et immédiate de l'économie globale. La Grande-Bretagne ne peut entrer directement en compétition avec la Chine et ses semblables, aussi devra-t-elle trouver des créneaux particuliers.
Tout cela nous amène à la question : "quel espoir de reprise économique ?"
IV. Quel espoir de reprise économique ?
Le contexte global
"... des données récentes indiquent que la reprise globale ralentit après une reprise initiale relativement rapide. La production occidentale est toujours bien en dessous des tendances d'avant 2008. Le chômage obstinément haut aux Etats-Unis gâche des vies et aigrit la politique. L'Europe a frôlé la déroute d'une seconde crise mondiale en mai lorsque ses principales économies ont accepté de renflouer la Grèce et d'autres pays très endettés risquant le défaut de leur dette souveraine. Le Japon est intervenu sur le marché des monnaies pour la première fois en six ans pour arrêter une montée du yen mettant en péril ses exportations." Cette citation du Financial Times 18 à la veille de la réunion biannuelle du FMI et de la Banque mondiale début octobre reflète les préoccupations de la bourgeoisie.
On peut constater que les plans de reprise en Europe ont jusqu'à présent échoué à produire de forts taux de croissance et on doit souligner avant tout l'augmentation de la dette publique qui, dans certains pays, a amené à mettre en question la capacité de l'Etat à rembourser ses dettes. La Grèce est aux avant-postes de ce groupe de pays, mais la Grande-Bretagne fait aussi partie de ceux dont le niveau d'endettement présente un risque. Le graphique ci-dessous, malgré son intitulé rassurant, montre qu'aux Etats-Unis et dans beaucoup de pays d'Europe, le niveau d'endettement présente un risque. La Grande-Bretagne n'a peut-être pas un niveau de dette aussi considérable que d'autres (axe horizontal), mais son déficit courant est le plus élevé (axe vertical), indiquant à quelle rapidité elle a récemment accumulé de la dette.
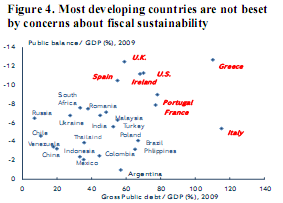
La plupart des pays en voie de développement n'ont pas de problème de viabilité fiscale
Deux stratégies distinctes ont été adoptées pour faire face à la récession : celle qui a les faveurs des Etats-Unis et consiste à poursuivre l'endettement et celle qui est de plus en plus adoptée en Europe consistant à diminuer les déficits en imposant des programmes d'austérité. Les Etats-Unis sont en position de mener cette politique parce que le dollar continue à être la monnaie de référence, ce qui leur permet de financer leur déficit en imprimant des billets, une option à laquelle leurs rivaux ne peuvent recourir. Les autres pays sont plus contraints par leur dette et ce fait en lui-même apporte des éléments de réponse à la question qui se pose concernant les limites de l'endettement. Une évolution récente au niveau international a été l'augmentation des efforts pour utiliser les taux de change afin d'être plus compétitif, ce qui est crucial pour utiliser les exportations en vue de restaurer la situation économique d'un pays. Une deuxième cause est la lutte qui oppose les pays excédentaires aux pays déficitaires sur la question des taux de change. Elle s'exerce entre la Chine et les Etats-Unis où la dévaluation du dollar par rapport au yuan non seulement réduirait la compétitivité des marchandises chinoises mais dévaluerait également ses énormes avoirs en dollars américains (c'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine a utilisé une partie de ses réserves pour acheter des avoirs dans différents pays, y compris en GB). La politique d'assouplissement monétaire ("quantitative easing", QE) joue un rôle dans la dévaluation des monnaies puisqu'elle participe d'augmenter la création de monnaie, ce qui donne un nouvel éclairage à l'annonce récente par le Japon d'un nouveau round sur le QE. Les Etats-Unis et la GB envisagent la même chose. Ce que cela implique, c'est une perte de l'unité qu'on a connue en pleine crise et son remplacement par l'attitude du chacun pour soi. Un journaliste du Financial Times commentant ces événements écrivait récemment : "Comme dans les années 1930, tout le monde cherche à sortir de la crise grâce aux exportations ce que, par définition, tous ne peuvent faire. Aussi des déséquilibres globaux se développent à nouveau, comme le risque de protectionnisme." 19 Les pressions grandissent mais nous ne pouvons pas encore dire si la bourgeoisie y succombera.
Ce que cela signifie, c'est que toutes les options sont porteuses de véritables dangers et qu'il n'existe pas de sortie évidente de la crise. Le manque de demande solvable va renouveler la pression qui a mené à l'escalade de l'endettement et va réanimer les réflexes protectionnistes qui avaient été depuis longtemps contenus, tandis que les politiques d'austérité risquent de réduire encore la demande et de provoquer une nouvelle récession, un plus grand protectionnisme et de renforcer la pression pour un retour à l'utilisation de l'endettement. Dans cette perspective, le recours à de nouvelles dettes semble le plus évident dans l’immédiat puisque ce sera la poursuite des politiques des dernières décennies mais cela pose la question des limites de l'endettement et, si de telles limites existent, ce qu’elles sont et si nous les avons atteintes. Pour ce rapport, nous pouvons conclure des récents développements et de la crise qui a éclaté en Grèce qu'il existe des limites à l'endettement – ou, plutôt, un point où les conséquences d'une dette accrue se mettent à saper son efficacité et déstabiliser l'économie mondiale. Si la Grèce s'avérait incapable de rembourser, il y aurait non seulement une dépression sérieuse dans le pays, mais il y aurait également des perturbations sérieuses de tout le système financier international. La chute de la Bourse avant le renflouage de l'Europe et du FMI a montré la sensibilité de la bourgeoisie à cette question.
Les options du capitalisme britannique
La bourgeoisie britannique est aux avant-postes de celles qui ont choisi l'austérité avec son plan pour éliminer le déficit en quatre ans, ce qui requiert une coupe d'environ ¼ des dépenses de l'Etat. Au-delà du secteur étatique, son plan de suppression des allocations pour rendre le travail plus attractif a clairement pour objectif de baisser le coût du travail dans toute l'économie afin d'augmenter la compétitivité et la profitabilité du capitalisme britannique. Elle présente cela sous le drapeau de l'intérêt national et cherche à suggérer que la crise est la faute du gouvernement travailliste et pas du capitalisme.
Nous avons analysé, dans des rapports antérieurs, que le capitalisme britannique avait récemment produit de la plus-value en augmentant le taux d'exploitation absolue de la classe ouvrière et avait réalisé cela au moyen d'une augmentation de la dette, en particulier de la dette privée alimentée par le boom immobilier et l'explosion des prêts non sécurisés. Sur cette base, le rapport du dernier congrès de la section en Grande-Bretagne soulignait l'importance du secteur des services et le présent rapport le confirme tout en précisant que ce n'est pas l'ensemble du secteur qui est concerné mais celui des finances. Dans ce cadre, cela vaut la peine d'examiner comment les trois éléments de réponse à la crise – l'endettement, l'austérité et les exportations – se présentent dans la situation rencontrée par la Grande-Bretagne.
Avant la crise, l'endettement des ménages a été à la base de la croissance économique pendant plusieurs années, à la fois directement à travers la dette accumulée par les ménages britanniques et indirectement à travers le rôle des institutions financières dans le marché global de la dette. Avec l'éclatement de la crise, l'Etat s'est endetté pour protéger les institutions financières et, dans une bien moindre mesure, pour protéger les ménages (l'augmentation de la protection de l'épargne jusqu'à 50 000 £), tandis que la croissance de l'endettement des ménages déclinait et que certaines personnes se trouvaient insolvables. A présent, le niveau de l'endettement privé diminue légèrement tandis que l'épargne augmente et que le gouvernement a annoncé qu'il était déterminé à diminuer le déficit de moitié. A moins qu'il n'y ait un renversement, il semble peu probable que l'endettement puisse contribuer en quoi que ce soit à la reprise. L'austérité qui se profile peut avoir deux effets sur la classe ouvrière. D'une part, elle peut amener beaucoup de travailleurs à limiter leurs dépenses et à chercher à rembourser leurs dettes afin de se protéger. D'autre part, elle peut en amener d'autres à s'endetter pour boucler les fins de mois. Cependant, ce dernier cas de figure serait certainement limité par la réticence des banques à prêter. Le secteur financier était dépendant du développement de la dette globale pour la plus grande part de sa croissance avant le krach et, à présent, il y a des tentatives de trouver des alternatives, qui se concrétisent par exemple par l'activité accrue dans le marché alimentaire. Cependant ce type d'activités continue à dépendre en dernière instance de la présence d'une demande solvable, ce qui nous ramène au point de départ. Si les Etats-Unis continuent sur le chemin d'une augmentation de l'endettement, le capital britannique pourrait en bénéficier étant donné sa position au sein du système financier global, ce qui semble indiquer que, malgré toute la rhétorique d'un Vince Cable 20 et ses semblables, aucune action ne sera entreprise pour freiner les banquiers et que la stratégie de dérégulation initiée sous Thatcher continuera.
L'austérité semble être actuellement la stratégie principale. Le but avoué est de réduire le déficit, avec la promesse implicite qu'après, les choses reviendront à la normale. Mais pour avoir un quelconque impact durable sur la compétitivité du capital britannique, des changements durables devront avoir lieu. Les espoirs peuvent être placés dans une grande augmentation de la productivité mais cela ne s'est pas concrétisé depuis des décennies. Cela n'arrivera probablement pas, à moins qu'il y ait un investissement substantiel dans les domaines liés à une productivité croissante, comme la recherche et le développement, l'éducation et l'infrastructure. Ce qui est déjà évident, c'est qu'il y a des coupes dans ces domaines, aussi l'effort le plus probable sera de réduire en permanence la proportion de plus-value engrangée par l'Etat et la proportion de la valeur totale assignée à la classe ouvrière. Bref, une réduction de la taille de l'Etat et des salaires plus bas. Cependant, pour être efficace, les attaques contre la classe ouvrière devront être massives et la réduction de la taille de l'Etat va à l'encontre de la tendance que nous avons connu au cours de la période de décadence au sein de laquelle l'Etat doit accroître sa domination sur la société afin de défendre ses intérêts économiques et impérialistes et d'empêcher les contradictions au cœur de la société bourgeoisie de la faire éclater.
Les exportations ne peuvent jouer un rôle que si la bourgeoisie réussit à rendre le capital britannique plus compétitif. Tous ses rivaux font de même. Le secteur des services en Grande-Bretagne rapporte et il serait possible d'augmenter son niveau relativement bas d'exportations. Mais l'ennui c'est que les parties les plus rentables de ce secteur semblent être celles qui sont liées au système financier ce qui rend son développement dépendant d'une reprise globale.
Pour résumer, il n'y a pas de voie facile pour le capitalisme britannique. La direction la plus probable semble être de continuer à s'appuyer sur sa position au sein du système financier global en même temps qu'un programme d'austérité pour soutenir les profits. A long terme cependant, il ne peut que se trouver face à une détérioration continue de sa position.
V. Les conséquences de la crise sur la classe ouvrière
L'impact de la crise sur la classe ouvrière fournit la base objective pour notre analyse de la lutte de classe. Cette partie se concentrera sur la situation matérielle de la classe ouvrière. Les questions de l'offensive idéologique de la classe dominante et du développement de la conscience de classe seront traitées dans d'autres parties du rapport (...)
L'un des impacts immédiats de la crise sur la classe ouvrière a été une augmentation du chômage. Le taux a augmenté sans interruption durant la plus grande partie de 2008 et 2009, augmentant de 842 000 et atteignant 2,46 millions ou 7,8% de la population active. Cependant, c'est en-dessous des augmentations connues au cours des récessions des années 1980 et 90, quand les taux ont augmenté respectivement jusqu'à 8,9% (une augmentation de 932 000) et 9,2% (une augmentation de 622 000), ceci en dépit du fait que la chute du PIB ait été supérieure dans la récession actuelle à celle des précédentes.
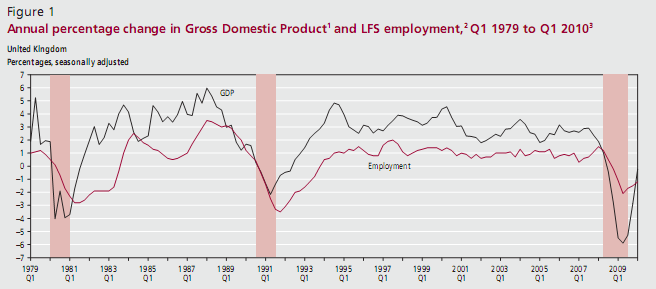
Variation annuelle du PIB et de l'emploi (chiffres 'Labour Force Survey') du premier trimestre 1979 au premier trimestre 2010
Une étude récente indique que la chute du PIB pendant cette récession aurait pu donner lieu à une augmentation supplémentaire du chômage de l’ordre d’un million 21 ; on peut se demander pourquoi cela n'est pas arrivé. L'étude citée avance que c'est dû au fait de "la forte position financière des entreprises au début de la récession et du resserrement financier plus modéré sur les entreprises au cours de cette récession" ce qui à son tour est dû à trois facteurs : "Premièrement, les politiques d'assistance du système bancaire, la baisse des taux d'intérêt et le grand déficit gouvernemental, créant un fort stimulant. Deuxièmement, la flexibilité des ouvriers qui a permis une véritable diminution des coûts salariaux pour les entreprises, accompagnée par des taux d'intérêt bas qui ont soutenu la croissance du salaire réel des consommateurs. Enfin, le fait que les entreprises se sont abstenues de licencier la main d'œuvre qualifiée tout en faisant face à la pression sur les profits et à la sévérité de la crise financière."
La baisse des coûts salariaux est attestée par les faits et elle a été réalisée grâce à la réduction des heures travaillées (et donc payées) et à une augmentation des salaires inférieure à l'inflation. Le travail à temps partiel a augmenté depuis la fin des années 1970 où il constituait un peu plus de 16% de la force de travail, et a atteint 22% en 1995. Au cours de cette récession il s'est encore accru et la majorité des travailleurs à temps partiel le sont parce qu'ils n'ont aucune autre alternative. 22 Le nombre de personnes sous-employées dépasse le million. Il y a eu une légère chute de la moyenne des heures de travail par semaine, de 32,2 à 31,7 mais sur l'ensemble de la force de travail, cela équivaut à 450 000 emplois basés chacun sur la moyenne de la durée du travail dans le pays.
La réduction des salaires réels provient à la fois d'accords sur les salaires défavorables aux salariés et de la montée de l'inflation. Le résultat est que les entreprises ont économisé 1% des coûts salariaux réels.
Mais ce n'est pas tout. Alors qu'on a vu dans les dernières années des efforts pour radier les gens du système d'allocations, cette tendance ne s'est pas accentuée au cours de la récession. En fait, l'utilisation de l'allocation d'incapacité ou autre continue à permettre de masquer le chômage comme le montre le graphique ci-dessous.
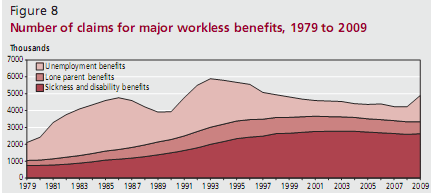
Evolution du nombre de demandes des principales allocations chômage
De plus, au cours des deux dernières récessions, le chômage a continué à augmenter longtemps après que, formellement, la récession fut terminée. Dans les années 1980, il a fallu 8 ans pour que les niveaux de chômage retrouvent ceux qui avaient précédé la récession, et dans les années 1990, presque 9. Alors que le taux d'augmentation du chômage dans la présente récession pourrait se stabiliser plus rapidement que dans les deux précédentes, il y a de bonnes raisons de penser que ce ne pourrait être qu’un interlude temporaire. En effet, non seulement les mesures d'austérité prévoient le licenciement de centaines de milliers de fonctionnaires, mais aussi la récession en W (double plongée) que ces mesures pourraient provoquer, en plus de l'incertitude de la situation générale, signifie que le chômage pourrait bien recommencer à augmenter. On considère qu'il faudrait des taux de croissance annuels de 2% pour que l'emploi augmente et de 2,5% en cas d'une modeste augmentation de la population. Or de tels taux ne font pas partie des projections pour le futur.
Ceux qui se retrouvent au chômage y restent plus longtemps puisque le nombre d'emplois vacants est substantiellement inférieur au nombre de ceux qui cherchent du travail. Plus la période de chômage dure, plus la probabilité est grande qu'un chômeur qui a trouvé du travail connaîtra de nouveau le chômage dans le futur. Début 2010, 700 000 personnes étaient dans la catégorie chômeur de longue durée, n'ayant pas travaillé depuis 12 mois ou plus. Il vaut la peine de souligner ici l'impact du chômage sur la population : "Une indication des coûts réels de cette flexibilité a été fournie par une étude récente de l'impact de la récession sur la santé mentale. Elle montrait que 71% des personnes ayant perdu leur emploi l'an dernier ont connu des symptômes de dépression, les plus affectés ayant entre 18 et 30 ans. La moitié d'entre eux dit avoir connu le stress et l'anxiété." 23
Un aspect de la réduction des salaires et de l'aggravation générale des conditions de vie est une chute de la consommation. Bien que certaines des études citées avancent que celle-ci s’est réduite faiblement, d'autres affirment qu'il y a eu une chute de 5% au cours de 2008 et 2009. Evidemment, pour la plupart des gens, ce n'est pas une question de choix mais la simple conséquence de la perte d’emploi, d'une diminution des heures de travail ou d'une baisse directe du salaire.
Les chiffres officiels montrent une chute de la pauvreté chez les enfants et les retraités au cours de la période du gouvernement travailliste, le niveau de vie moyen augmentant par ailleurs de 2% par an. Cependant, il y a eu un ralentissement ces dernières années. En même temps l'inégalité a augmenté et la pauvreté chez les adultes en âge de travailler est à son plus haut niveau depuis 1961. 24 Globalement, la pauvreté relative s'est accrue entre 1% et 1,8% (ce qui représente entre 0,9 et 1,4 million de personnes) pour atteindre 18,1% ou 22,3% (la différence des estimations résulte de l'inclusion ou non des coûts du logement).
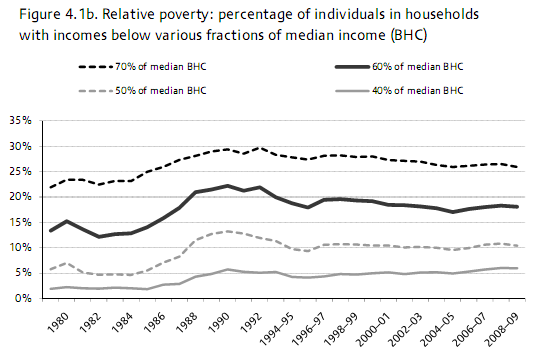
La pauvreté relative: pourcentage d'individus dans des ménages dont le revenu se situe en-deça de diverses fractions du revenu médian
Bien qu'il y ait eu récemment un léger déclin du niveau d'endettement personnel (au rythme de 19 pence par jour), en juillet de cette année le taux de croissance annuel était toujours de 8% et le total de la dette de 1 456 milliards de livres 25, ce qui, comme nous l'avons souligné auparavant, est supérieur à la production annuelle totale du pays. Cette somme inclut 1 239 milliards de livres de prêts sécurisés pour le logement et 217 milliards de crédit à la consommation. On estime qu'une famille moyenne doit dépenser 15% de son revenu net à rembourser ses dettes.
Ceci a eu pour résultat l'augmentation des banqueroutes personnelles et des Arrangements Volontaires Individuels (IVA). Ces derniers sont passés, de façon significative, de 67 000 en 2005, à 106 000 en 2006 et 107 000 en 2008 avant de monter à nouveau pour atteindre 134 000 en 2009. Le premier trimestre de cette année a vu 36 500 IVA supplémentaires, ce qui, si cela devait continuer ainsi, signifierait une nouvelle augmentation. 26 Cette augmentation est très substantiellement supérieure à celle que nous avons vue au cours des précédentes récessions, bien que les changements légaux rendent difficiles les comparaisons directes. 27
A côté de la diminution de la croissance de la dette personnelle, l'ONS rapporte une évolution du taux d'épargne des ménages, passant de – 0,9% début 2008 à + 8,5% à la fin 2009. 28 Il semble que beaucoup d'ouvriers cherchent à se préparer pour les jours difficiles à venir.
Perspectives
Bien que l'impact de la crise sur la classe ouvrière soit plus important que les publications de la bourgeoisie tendent à la présenter, il a néanmoins été relativement contenu à la fois au niveau de l'emploi et du revenu. C'est dû en partie aux circonstances, en partie à la stratégie adoptée par la bourgeoisie - y compris à travers l'utilisation de l'endettement - et, en partie, à la réponse de la classe ouvrière qui semble s'être plus focalisée sur la façon de survivre à la récession que sur la nécessité de la combattre. Mais il est peu probable que cette situation continue. Premièrement, la situation économique globale va rester très difficile puisque la bourgeoisie est incapable de résoudre les contradictions fondamentales qui minent les fondements de son économie. Deuxièmement, la stratégie de la classe dominante britannique a maintenant évolué vers l'instauration de l'austérité, du fait, en partie, de la situation globale. Elle pourrait revenir à l'utilisation de la dette à court terme mais cela ne ferait qu'empirer les problèmes à plus long terme. Troisièmement, l'impact sur la classe ouvrière va s'accroitre dans la période à venir et contribuera à développer les conditions objectives pour l'essor de la lutte de classe.
10/10/2010
1 World Bank, Global Economic Prospects, été 2010, Key Messages.
2 Ibid.
3 La plupart des données de cette partie sont tirées de la Economic and Labour Market Review d'août 2010, publiée par le Bureau national des Statistiques (Office for National Statistics, ONS). D'autres chiffres proviennent du Blue Book qui traite des comptes nationaux de la Grande-bretagne, du Pink Book qui traite de la balance des paiements et de Financial Statistics ; tous sont publiés par L'ONS.
4 Economic and Labour Market Review, août 2010.
5 ONS, Pink Book, Edition 2010
6 Banque d’Angleterre, Inflation Report, février 2009.
7 "Les gilts, abréviation de gilt-edged securities, soit littéralement "valeurs mobilières dorées sur tranche", sont les emprunts d'État émis par le Royaume-Uni." (Wikipedia)
8 Financial Times, "That elusive spark" ("Cette étincelle insaisissable"), 06/10/2010
9 Ces chiffres sont tirés du Economic and Labour Market Review, septembre 2010. La revue reprend les prévisions pour la zone euro et l'OCDE de l'Economic Outlook de l'OCDE de novembre 2009.
10 Blue Book 2010
11 Ibid.
12 Economic and Labour Market Review, août 2010
13 Andrew Haldane, "The Contribution of the Financial Sector Miracle or Mirage", Banque d'Angleterre, juillet 2010.
14 Ibid.
15 Voir Le Capital, livre II, chapitre IV, "Les frais de circulation"
16 Revue internationale n° 114, "Crise économique : Les oripeaux de la "prospérité économique" arrachés par la crise".
17 On attribue au développement de la production en Chine et à d'autres producteurs à bas coût le maintien de la stabilité relative du taux de l'inflation globale au cours des dernières décennies ainsi que la réduction des coûts du travail dans le monde entier, y compris dans les pays développés, puisque le nombre d'ouvriers s'est massivement accru (il a été indiqué que l'entrée de la Chine dans l'économie mondiale a doublé la main d'œuvre à disposition). Par conséquent, non seulement le taux de profit peut être plus élevé dans les pays à bas coût eux-mêmes, mais on peut également faire baisser le coût du travail et remonter le taux de profit dans les pays développés, ce qui résulte dans l'augmentation du taux de profit moyen que nous avons noté dans plusieurs numéros de la Revue internationale. Mais que cela suffise à créer la masse nécessaire de profit est une autre question.
18 "That elusive spark", 06/10/2010
19 John Plender, "Currency demands make a common ground elusive", 06/10/2010
20 Membre du Parti Libéral-Démocrate et actuellement secrétaire d'Etat pour l'Entreprise et l'Innovation ("Secretary of State for Business, Innovation and Skills") au sein du gouvernement de coalition Cameron-Clegg.
21 "Employment in the 2008-2009 recession", Economic and Labour Market Review, août 2010
22 Voir Economic and Labour Market Review, septembre 2010
23 Rapport original dans The Guardian, 01/04/2010
24 Institute for Fiscal Studies, Poverty and Inequality in UK, 2010.
25 Les chiffres de ce paragraphe proviennent de Debt Facts and Figures de septembre 2010 compilés par Credit Action.
26 Source : ONS, Financial Statistics, août 2010
27 Economic and Labour Market Review, août 2010. Entre 1979 et 1984, la hausse a été de 3 500 à 8 229, et entre 1989 et 1993, de 9 365 à 36 703.
28 Ibid.
Géographique:
- Grande-Bretagne [8]
Récent et en cours:
- Crise économique [7]
La révolution hongroise de 1919 : l'exemple de la Russie inspire des ouvriers hongrois (II)
- 5144 reads
Dans ce second article nous verrons comment cette manœuvre échoua, et comment la situation révolutionnaire continuant de mûrir, le Parti social-démocrate lança une autre manœuvre aussi risquée mais qui finalement fut un succès pour le capitalisme : fusionner avec le Parti communiste, "prendre le pouvoir" et organiser "la dictature du prolétariat", ce qui bloqua le processus ascendant de lutte et d’organisation du prolétariat et le conduisit dans une impasse qui permit sa défaite totale.
Mars 1919 : crise de la République bourgeoise
La vérité sur l’affaire de l’assaut du journal finit bientôt par éclater. Les ouvriers se sentirent trompés et leur indignation grandit quand ils apprirent les tortures infligées aux communistes. La crédibilité du Parti social-démocrate en prit un sérieux coup. Tout ceci favorisait la popularité des communistes. Les luttes revendicatives se multipliaient depuis fin février, les paysans prenaient les terres sans attendre la sempiternelle promesse de "réforme agraire"2, l’affluence aux réunions du Conseil ouvrier de Budapest grandissait et des discussions tumultueuses portaient des critiques acerbes aux dirigeants sociaux-démocrates et syndicaux. La République bourgeoise, qui avait suscité tant d’illusions en octobre 1918, décevait à présent. Les 25 000 soldats rapatriés des champs de bataille étaient enfermés dans leurs casernes et organisés en conseils ; la première semaine de mars, non seulement les assemblées de casernes renouvelaient leurs représentants – avec une augmentation significative de délégués communistes – mais, en outre, votaient des motions par lesquelles il était affirmé qu’"il ne sera obéi aux ordres du gouvernement que s’ils ont préalablement été ratifiés par le Conseil de soldats de Budapest".
Le 7 mars, une session extraordinaire du Conseil ouvrier de Budapest adopta une résolution qui "exigeait la socialisation de tous les moyens de production et le passage de leur direction aux conseils". Même si la socialisation sans destruction de l’appareil d’État bourgeois ne peut être qu'une mesure boiteuse, cet accord exprimait cependant la grande confiance en soi des conseils et était une réponse à deux questions pressantes : 1) le sabotage effectué par le patronat sur une production totalement désorganisée par l’effort de guerre ; 2) la terrible pénurie de vivres et de produits de première nécessité.
Les événements se radicalisent. Le Conseil ouvrier des métallos lance un ultimatum au gouvernement : il lui accorde cinq jours pour céder le pouvoir aux partis du prolétariat 3. Le 19 mars se déroule la plus grande manifestation ayant eu lieu jusqu’alors, convoquée par le Conseil ouvrier de Budapest ; les chômeurs revendiquent une allocation et une carte de ravitaillement, ainsi que la suppression des loyers. Le 20, les typographes partent en grève, et celle-ci se généralise dès le lendemain avec deux revendications : libération des dirigeants communistes et "gouvernement ouvrier".
Si ces faits démontrent la maturation d’une situation révolutionnaire, ils mettent aussi en évidence que celle-ci était encore loin du niveau politique qui permet au prolétariat de se lancer à l’assaut du pouvoir. Pour le prendre et le conserver, le prolétariat doit compter sur deux forces indispensables : les conseils ouvriers et le parti communiste. En mars 1919, les conseils ouvriers en Hongrie n'en étaient qu'à leurs premiers pas, ils commençaient à peine à sentir leur force et leur autonomie et ils en étaient encore à tenter de se libérer de la tutelle étouffante de la social-démocratie et des syndicats. Leurs deux principales faiblesses étaient :
– leurs illusions sur la possibilité d’un "gouvernement ouvrier" qui unirait les sociaux-démocrates et les communistes, ce qui, comme nous le verrons, sera le tombeau du développement révolutionnaire ;
– leur organisation était encore celle des secteurs économiques : conseils de métallos, de typographes, d’ouvriers du textile, etc. En Russie, depuis 1905, l’organisation des conseils était totalement horizontale, organisant les ouvriers comme un tout par-dessus les divisions par secteur, région, nationalité, etc. ; en Hongrie coexistent les conseils sectoriels et les conseils horizontaux par villes, avec les dangers que cela représente au niveau du corporatisme et de la dispersion.
Nous soulignions dans le premier article de cette série que le Parti communiste était encore très faible et hétérogène, que le débat commençait à peine à se développer en son sein. Il souffrait de l’absence d’une structure internationale solide pour le guider – l’Internationale communiste célébrait à peine son Premier Congrès. Pour ces raisons, comme nous allons le voir, il manifesta une énorme faiblesse et une absence de clarté qui fera de lui une victime facile du piège que lui tendra la social-démocratie.
La fusion avec le Parti social-démocrate et la proclamation de la République soviétique
Le colonel Vix, représentant l’Entente4, remet un ultimatum dans lequel il est stipulé la création d’une zone démilitarisée dans le territoire hongrois directement gouvernée par le commandement allié, d’une profondeur de 200 kilomètres, ce qui revient à occuper la moitié du pays.
La bourgeoisie n’affronte jamais le prolétariat à visage découvert ; l’histoire nous enseigne qu’elle tente de le prendre entre deux feux, la gauche et la droite. Nous voyons là comment la droite ouvre le feu avec la menace de l’occupation militaire, qui se concrétisera par l’invasion en bonne et due forme dès le mois d’avril. De son côté, la gauche entre en action dès le lendemain à partir d’une déclaration pathétique du Président Karolyi : "La patrie est en danger. L'heure la plus grave de notre histoire a sonné. (…) Le moment est venu où la classe ouvrière hongroise, avec sa force, la seule force organisée du pays, et avec ses relations internationales, doit sauver la patrie de l'anarchie et de la mutilation. Je vous propose donc un gouvernement social-démocrate homogène qui fera face aux impérialistes. Il s'agira d'une lutte dont l'enjeu est le sort de notre pays. Pour mener à bien cette lutte, il est indispensable que la classe ouvrière retrouve son unité, et que l'agitation et le désordre provoqués par les extrémistes cessent. A cette fin les sociaux-démocrates doivent trouver un terrain d'entente avec les communistes" 5.
Le feu croisé contre la lutte de classe de la droite, avec l’occupation militaire, et de la gauche, avec la défense nationale, convergent vers le même objectif : sauver la domination capitaliste. L’occupation militaire – le pire affront que puisse souffrir un État national – a comme objectif réel l’écrasement des tendances révolutionnaires du prolétariat hongrois. En outre, elle offre la possibilité à la gauche d’encadrer les ouvriers vers la défense de la patrie. C’est un piège qui s’était déjà présenté en octobre 1917 en Russie quand, confrontée à son incapacité à écraser le prolétariat, la bourgeoisie russe avait préféré que les troupes allemandes occupent Petrograd. La classe ouvrière déjoua alors habilement cette manœuvre en s'engageant dans la prise de pouvoir. Dans le sillage du comte Karolyi, le social-démocrate de droite Garami expose la stratégie à suivre : "confier le gouvernement aux communistes, attendre leur faillite totale et alors, alors seulement, dans une situation libérée de ces déchets de la société, nous pourrons former un gouvernement homogène" 6. L’aile centriste du Parti 7 précisait cette politique : "Constatant en effet que la Hongrie se trouve être sacrifiée par l'Entente, qui manifestement a décidé de liquider la Révolution, il en résulte que les seuls atouts dont celle-ci dispose sont la Russie soviétique et l'Armée rouge. Pour obtenir l'appui de ces dernières, il faut que la classe ouvrière hongroise soit effectivement maîtresse du pouvoir et que la Hongrie soit une véritable république populaire et soviétique." Et elle ajoutait "pour éviter que les communistes n'abusent du pouvoir, il vaut mieux le prendre avec eux !" 8.
L’aile gauche du Parti social-démocrate défend une position prolétarienne et tend à converger vers les communistes. Face à elle, les droitiers de Garami et les centristes de Garbai manœuvrent avec habileté. Garami démissionne de toutes ses responsabilités. L’aile droite se sacrifie en faveur de l’aile centriste qui "se déclarant favorable au programme communiste" parvient à séduire la gauche 9.
Après ce virage, la nouvelle direction centriste propose la fusion immédiate avec le Parti communiste et rien de moins que la prise de pouvoir ! Une délégation du Parti social-démocrate se rend à la prison erncontrer Bela Kun et lui propose la fusion des deux partis, la formation d’un "parti ouvrier", l’exclusion de tous les "partis bourgeois" et l’alliance avec la Russie. Les conversations durent à peine une journée au terme de laquelle Bela Kun rédige un protocole en six points parmi lesquels sont soulignés "Les comités directeurs du Parti social-démocrate Hongrois et du Parti Communiste Hongrois ont décidé l'unification totale et immédiate de leurs organisation respectives. Le nom de la nouvelle organisation sera Parti Socialiste Unifié de Hongrie (PSUH). (…) Le P.S.U.H. prend immédiatement le pouvoir au nom de la dictature du prolétariat. Cette dictature est exercée par les conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats. Il n'y aura plus d'Assemblée Nationale (…) Une alliance militaire et politique la plus complète possible sera conclue avec la Russie" 10.
Le Président Karolyi, qui suit de près les négociations, présente sa démission et fait une déclaration adressée "au prolétariat du monde pour obtenir aide et justice. Je démissionne et je remets le pouvoir au prolétariat du peuple de Hongrie" 11.
Lors de la manifestation du 22 mars, "l’ex-homo-regius, le ci-devant archiduc François-Joseph, tel Philippe Egalité, lui aussi viendra se ranger aux côtés des ouvriers, au cours de la manifestation" 12. Le nouveau gouvernement, formé dès le lendemain, avec Bela Kun et d'autres dirigeants communistes récemment libérés, est présidé par le social-démocrate centriste Garbai 13. Il dispose d’une majorité centriste avec deux postes réservés à l’aile gauche et deux autres aux communistes, parmi lesquels Bela Kun. Alors commence une opération à haut risque qui consiste à prendre les communistes en otages de la politique social-démocrate et à saboter les conseils ouvriers à peine naissants avec le cadeau empoisonné de la "prise de pouvoir". Les sociaux-démocrates laisseront le rôle principal à Bela Kun qui – totalement pris au piège – deviendra le porte-voix et la caution de toute une série de mesures qui ne feront que le décrédibiliser 14.
"L’unité" crée la division des forces révolutionnaires
La proclamation du parti "unifié" parvint en premier lieu à stopper le rapprochement des sociaux-démocrates de gauche et des communistes, habilement séduits par la radicalisation des centristes. Mais le pire fut l’ouverture d’une boîte de Pandore parmi les communistes qui se divisèrent en plusieurs tendances. La majorité, autour de Bela Kun, se transforma en otage des sociaux-démocrates ; une autre tendance se forma autour de Szamuelly, demeurant dans le parti mais tentant de mener une politique indépendante ; la majorité des anarchistes se séparèrent, formant l’Union anarchiste qui soutiendra cependant le gouvernement avec une posture d’opposition 15.
Le Parti, formé quelques mois auparavant et qui commençait à peine à développer une organisation et une intervention, se volatilisa complètement. Le débat devint impossible et une confrontation permanente opposait ses anciens membres. Celle-ci ne se basait pas sur des principes ou une analyse indépendante de la situation, mais était toujours à la remorque de l’évolution des événements et des subtiles manœuvres auxquelles se livraient les centristes sociaux-démocrates.
La désorientation sur la réalité de la situation en Hongrie affecta même un militant aussi expérimenté et lucide que Lénine. Dans ses œuvres complètes apparaît la transcription des discussions avec Bela Kun des 22 et 23 mars 1919 (16). Lénine demande à Bela Kun : "Ayez la bonté de communiquer quelles garanties réelles avez-vous pour que le nouveau Gouvernement hongrois soit effectivement communiste et non pas seulement socialiste, c’est-à-dire social-traître. Les communistes ont-ils la majorité dans le Gouvernement ? Quand se tiendra le Congrès des conseils ? En quoi consiste réellement la reconnaissance de la dictature du prolétariat par les socialistes ?". Lénine pose les questions élémentaires correctes. Cependant, comme tout repose sur des contacts personnels et non sur un débat collectif international, Lénine conclut : "Les réponses de Bela Kun furent pleinement satisfaisantes et dissipèrent nos doutes. Il en ressortait que les socialistes de gauche avaient rendu visite à Bela Kun en prison et eux seuls, sympathisants des communistes, ainsi que des personnes du centre, furent ceux qui formèrent le nouveau gouvernement, pensant que les socialistes de droite, les sociaux-traîtres pour ainsi dire, incorrigibles et intransigeants, abandonnèrent le parti sans être suivis par aucun ouvrier". On voit ici que Lénine était pour le moins mal informé ou n’évaluait pas correctement la situation, car le centre de la social-démocratie était majoritaire au gouvernement et les sociaux-démocrates de gauche étaient entre les mains de leurs "amis" du centre.
Emporté par un optimisme démobilisateur, Lénine conclut : "La propre bourgeoisie a donné le pouvoir aux communistes de Hongrie. La bourgeoisie a démontré au monde entier que lorsque survient une crise grave, quand la nation est en danger, elle est incapable de gouverner. Et le seul pouvoir réellement souhaité par le peuple est le pouvoir des Conseils de députés ouvriers, soldats et paysans".
Hissés au "pouvoir", les conseils ouvriers sont sabotés
Ce pouvoir n’existait réellement que sur le papier. En premier lieu, c’est le Parti socialiste unifié qui prend le pouvoir sans que le Conseil de Budapest ou aucun autre conseil du pays n’y participe en aucune façon (17). Même si le Gouvernement se déclare formellement "subordonné" au Conseil ouvrier de Budapest, dans la pratique, c’est lui qui présente les décrets, ordres et décisions de toutes sortes comme des faits avérés, par rapport auxquels le Conseil ne dispose que d’un relatif droit de veto. Les conseils ouvriers sont pris dans le corset faisandé de la pratique parlementaire. "Les affaires du prolétariat continuèrent à être administrées – ou pour mieux dire sabotées – par l’ancienne bureaucratie et non par les conseils ouvriers eux-mêmes, qui ne parvinrent donc jamais à devenir des organismes actifs" 18.
Le coup le plus violent porté aux conseils est la convocation par le Gouvernement à des élections afin de constituer une "Assemblée nationale des Conseils ouvriers". Le système d’élections qu’impose alors le Gouvernement consiste à concentrer les élections sur deux dates (7 et 14 avril 1919), "suivant les modalités de la démocratie formelle (vote au scrutin de listes, avec isoloirs, etc.)" 19. C’est là la reproduction du mécanisme typique des élections bourgeoises, qui ne fait que saboter l’essence même des conseils ouvriers. Alors que dans la démocratie bourgeoise les organes élus sont le résultat d’un vote effectué par une somme d’individus atomisés et totalement séparés entre eux, les Conseils ouvriers supposent un concept radicalement nouveau et différent de l’action politique : les décisions, les actions à mener, sont pensées et discutées lors de débats auxquels participent d’énormes masses organisées, et celles-ci ne se contentent pas de prendre des décisions mais les mettent elles-mêmes en pratique.
Le triomphe de la manœuvre électorale n’est pas que le produit de l’habileté manœuvrière des sociaux-démocrates ; ceux-ci ne font qu’exploiter les confusions existantes non seulement parmi les masses mais aussi dans la propre majorité des militants communistes et particulièrement dans le groupe de Bela Kun. Des années de participation à des élections et au Parlement – activité nécessaire pour les progrès du prolétariat durant la période ascendante du capitalisme – avaient provoqué des habitudes et des visions liées à un passé définitivement révolu qui entravaient une riposte claire face à la nouvelle situation, laquelle exigeait la rupture complète avec le parlementarisme et l’électoralisme.
Le mécanisme électoral et la discipline du parti "unifié" font que "dans la présentation des candidats aux élections des conseils, les communistes durent défendre la cause des sociaux-démocrates et même ainsi, plusieurs ne furent pas élus", constate Szantó, qui ajoute que ceci permettait aux sociaux-démocrates de se livrer "au verbalisme révolutionnaire et communiste, afin d’apparaître plus révolutionnaires que les communistes !" 20.
Ces politiques provoquèrent une vive résistance. Les élections d’avril furent contestées dans le 8e district de Budapest, Szamuelly parvenant à faire annuler la liste officielle de son propre parti (!) et à imposer des élections se basant sur les débats lors d’assemblées massives, lesquelles donnèrent la victoire à une coalition de dissidents du propre PSUH et à des anarchistes, regroupés autour de Szamuelly.
D’autres tentatives de donner vie à d’authentiques conseils ouvriers eurent lieu à la mi-avril. Un mouvement de conseils de quartiers parvint à tenir une Conférence de ces derniers à Budapest qui critiqua sévèrement le "gouvernement soviétique" et avança toute une série de propositions quant à l’approvisionnement, la répression des contre-révolutionnaires, les rapports avec la paysannerie, la poursuite de la guerre et proposa – à peine un mois après les élections ! – une nouvelle élection des Conseils. Otage des sociaux-démocrates, Bela Kun apparût lors de la dernière session de la Conférence dans le rôle du pompier de service, son discours frisant la démagogie : "Nous sommes déjà tellement à gauche qu’il est impossible d’aller plus loin. Un tournant encore plus à gauche ne pourrait être qu'une contre-révolution" 21.
La réorganisation économique s’appuie sur les syndicats contre les conseils
La tentative révolutionnaire se heurtait au chaos économique, à la pénurie et au sabotage patronal. S’il est vrai que le centre de gravité de toute révolution prolétarienne est le pouvoir politique des conseils, ceci ne veut pas pour autant dire qu’ils doivent négliger le contrôle de la production. Même s’il est impossible de commencer une transformation révolutionnaire de la production vers le communisme tant que la révolution n'est pas victorieuse au niveau mondial, il ne faut pas en déduire que le prolétariat n’ait pas à mener une politique économique dès le début de la révolution. Celle-ci doit en particulier aborder deux questions prioritaires : la première est d’adopter toutes les mesures possibles en vue de diminuer l’exploitation des travailleurs et de garantir qu’ils disposent du maximum de temps libre pour pouvoir consacrer leur énergie à la participation active dans les conseils ouvriers. Sur ce plan, et sous la pression du Conseil ouvrier de Budapest, le Gouvernement adopta des mesures telles que la suppression du travail à la tâche et la réduction de la journée de travail, avec comme objectif de "permettre aux ouvriers de participer à la vie politique et culturelle de la révolution" 22. La seconde est la lutte pour l’approvisionnement et contre le sabotage, de sorte que la faim et le chaos économique inévitables ne sonnent le glas de la révolution. Confrontés à ce problème, les ouvriers créèrent dès janvier 1919 des conseils d’usine, des conseils sectoriaux et, comme nous l’avons vu dans le premier article de cette série, le Conseil de Budapest adopta un plan audacieux de contrôle de l’approvisionnement des produits de première nécessité. Mais le Gouvernement, qui devait s’appuyer sur eux, mena une politique systématique pour leur enlever le contrôle de la production et de l’approvisionnement, le confiant de plus en plus aux syndicats. Bela Kun commit alors de graves erreurs. Il déclara ainsi en mai 1919 : "L'appareil de notre industrie repose sur les syndicats. Ces derniers doivent s'émanciper davantage et se transformer en puissantes entreprises qui comprendront la majorité, puis l'ensemble des individus d'une même branche industrielle. Les syndicats prenant part à la direction technique, leur effort, tend à saisir lentement tout le travail de direction. Ainsi ils garantissent que les organes économiques centraux du régime et la population laborieuse travaillent en accord et que les ouvriers s'habituent à la conduite de la vie économique." 23. Roland Bardy commente cette analyse de façon critique : "Prisonnier d’un schéma abstrait, Bela Kun ne pouvait se rendre compte que la logique de sa position conduisait à redonner aux socialistes un pouvoir dont ils avaient été progressivement dépossédés (…) Durant toute une période, les syndicats seront le bastion de la social-démocratie réformiste et se trouveront constamment en concurrence directe avec les soviets" 24.
Le Gouvernement parvint à imposer que seuls les ouvriers et les paysans syndiqués auraient accès aux coopératives et aux économats de consommation. Ceci donnait aux syndicats un levier essentiel de contrôle. Bela Kun le théorisa : "le régime communiste est celui de la société organisée. Celui qui veut vivre et réussir doit adhérer à une organisation, aussi les syndicats ne doivent-ils pas faire des difficultés aux admissions" 25. Comme Bardy le signale : "Ouvrir le syndicat à tous était le meilleur moyen pour liquider la prépondérance du prolétariat en son sein et à long terme permettre le rétablissement "démocratique" de la société de classe" ; de fait, "les anciens patrons, rentier et, leurs grands valets ne participaient pas dans la production active (industrie et agriculture,) mais dans les services administratifs ou juridiques. Le gonflement de ce secteur permit à l’ancienne bourgeoisie de survivre en tant que classe parasite, et d’avoir accès à la répartition des produits, sans être intégrée cependant dans le processus productif, actif" 26. Ce système favorisa la spéculation et le marché noir, sans jamais parvenir à résoudre les problèmes de famine et de pénurie qui torturaient les ouvriers des grandes villes.
Le Gouvernement impulsa la formation de grandes exploitations agricoles régies par un système de "collectivisation". Ce fut une grande escroquerie. Des "Commissaires de production" furent placés à la tête des fermes collectives et ceux-là, quand ils n’étaient pas d’arrogants bureaucrates, étaient… les anciens propriétaires terriens ! Ces derniers occupaient d’ailleurs toujours leurs demeures et exigeaient des paysans qu’ils continuent à les appeler "maître".
Les Fermes collectives étaient supposées étendre la révolution dans les campagnes et garantir l’approvisionnement, mais elles ne firent ni l’un ni l’autre. Les travailleurs journaliers et les paysans pauvres, profondément déçus par la réalité des Fermes collectives, s’éloignaient de plus en plus du régime ; par ailleurs, leurs dirigeants exigèrent un troc que le gouvernement était incapable de tenir : fournir des produits agricoles en échange d’engrais, de tracteurs et de machines. Ils vendaient donc à des spéculateurs et à des accapareurs, ce qui eut pour conséquence que la faim et la pénurie parvinrent à de tels niveaux que le Conseil ouvrier de Budapest organisa désespérément la transformation des parcs et jardins en zones de culture agraires.
L’évolution de la lutte révolutionnaire mondiale et la situation en Hongrie
La seule possibilité permettant au prolétariat hongrois de briser le piège dans lequel il était tombé résidait dans l’avancée de la lutte du prolétariat mondial. La période qui va de mars à juin 1919 était porteuse de grands espoirs malgré le coup de massue qu’avait provoqué l’écrasement de l’insurrection de Berlin en janvier 27. En mars 1919 se constitue l’Internationale communiste, en avril est proclamée la République des conseils de Bavière qui finit tragiquement écrasée par le gouvernement social-démocrate. L’agitation révolutionnaire en Autriche, où se consolidaient les conseils ouvriers, fut aussi avortée par la manœuvre d’un provocateur, Bettenheim, qui incita le jeune parti communiste à une insurrection prématurée qui fut facilement écrasée (mai 1919). En Grande-Bretagne éclata la grande grève des chantiers navals de la Clyde, au cours de laquelle apparurent des conseils ouvriers et qui provoqua des mutineries dans l’armée. Des mouvements de grève apparurent en Hollande, Norvège, Suède, Yougoslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Pologne, Italie et même aux États-Unis. Mais ces mouvements étaient encore trop embryonnaires. Cette situation conférait ainsi une marge de manœuvre importante aux armées de France et de Grande-Bretagne qui étaient restées mobilisées après la fin de la guerre mondiale et se chargeaient maintenant de la sale besogne de gendarmes et écrasaient les foyers révolutionnaires. Leur intervention se concentra sur la Russie (1918-20) et la Hongrie (dès avril 1919). Quand éclatèrent les premières mutineries dans l’armée et, confrontées aux campagnes qui se faisaient jour contre la guerre livrée à la Russie révolutionnaire, les troupes d’appelés furent rapidement remplacées par des troupes coloniales, bien plus résistantes face au prolétariat.
Contre la Hongrie, le commandement français tira les leçons du refus des soldats de réprimer l’insurrection de Szeged. La France resta au second plan et attisa les États voisins contre la Hongrie : la Roumanie et la Tchécoslovaquie seront le fer de lance de ces opérations. Ces États combinaient le travail de gendarme avec la conquête de territoires au détriment de l’État hongrois.
La Russie soviétique, assiégée, ne put accorder le moindre soutien militaire. La tentative de l’Armée rouge et des guérilléros de Nestor Makhno de lancer en juin 1919 une offensive par l’ouest afin d’ouvrir une voie de communication vers la Hongrie, fut réduite à néant par la violente contre-attaque du général Denikine.
Mais le problème central était que le prolétariat avait son ennemi dans sa propre maison 28. Le 30 mars, le Gouvernement de la "dictature du prolétariat" créait pompeusement l’Armée rouge. C’était la même vieille armée rebaptisée. Tous ses postes de commandement restaient aux mains des anciens généraux, supervisés par un corps de commissaires politiques dominé par les sociaux-démocrates, dont les communistes étaient exclus.
Le gouvernement rejeta une proposition des communistes de dissoudre les forces policières. Les ouvriers, cependant, désarmèrent par eux-mêmes les gardes et plusieurs usines de Budapest adoptèrent des résolutions sur ce sujet qui furent immédiatement appliquées : "Alors seulement les sociaux-démocrates donnèrent la permission. Mais ils n’autorisèrent pas que s’effectuent leur désarmement, ce n’est qu’après une longue résistance qu’ils consentirent à approuver le licenciement de la police, de la gendarmerie et de la garde de sécurité" 29. La formation de l’Armée rouge fut décrétée, intégrant dans ses rangs les policiers licenciés !
L’Armée et la police, colonne vertébrale de l’État bourgeois, restèrent donc intactes grâce à ces tours de passe-passe. Il n’est donc pas surprenant que l’Armée rouge se décomposât si facilement lors de l’offensive d’avril lancée par les troupes roumaines et tchèques. Plusieurs régiments passèrent même à l’ennemi.
Contre les troupes d’envahisseurs aux portes de Budapest, le 30 avril, la mobilisation ouvrière parvint à retourner la situation. Les anarchistes et le groupe de Szamuelly menèrent une forte agitation. La manifestation du Premier Mai connut un succès massif, les slogans demandant "l’armement du peuple" furent lancés et le groupe de Szamuelly réclama "tout le pouvoir aux conseils ouvriers". Le 2 mai se tint un meeting gigantesque qui demanda la mobilisation volontaire des travailleurs. En quelques jours, rien qu’à Budapest, 40 000 d’entre eux s’engagent dans l’Armée rouge.
L’Armée rouge, renforcée par l’incorporation massive des ouvriers et par l’arrivée de Brigades internationales de volontaires français et russes, lança alors une grande offensive qui obtint toute une série de victoires sur les troupes roumaines, serbes et particulièrement sur les tchèques qui subirent une grande défaite et dont les soldats désertèrent massivement. En Slovaquie, l’action des ouvriers et des soldats rebelles conduisit à la formation d’un Conseil ouvrier qui, appuyé par l’Armée rouge, proclama la République slovaque des Conseils (16 juin). Le Conseil conclut une alliance avec la République hongroise et lança un manifeste dirigé à tous les ouvriers tchèques.
Ce succès alerta la bourgeoisie mondiale : "La Conférence de la Paix à Paris, alarmée par les succès de l’Armée rouge, lança le 8 juin un nouvel ultimatum à Budapest, dans lequel elle exigeait que l’Armée rouge interrompe son avancée, invitant le gouvernement hongrois à Paris pour "discuter des frontières de la Hongrie". Il y eut ensuite un second ultimatum, dans lequel l’usage de la force était évoqué si l’ultimatum n’était pas respecté" 30.
Le social-démocrate Bohm, soutenu par Bela Kun, ouvrit "à n’importe quel prix" des négociations avec l’État français, qui exigea comme premier pas l’abandon de la République des Conseils de Slovaquie, ce qui fut accepté le 24 juin. Cette République fut alors écrasée le 28 du même mois et tous ses militants connus pendus dès le lendemain.
L’Entente opèra alors un changement de tactique. Les exactions des troupes roumaines et leurs prétentions territoriales avaient été à l’origine d’un resserrement des rangs autour de l’Armée rouge, ce qui avait en mai favorisé ses victoires. Un Gouvernement provisoire hongrois fut formé à la hâte autour de deux frères de l’ancien Président Karolyi, qui s’installa dans la zone occupée par les roumains mais dut cependant se retirer en maugréant pour donner l’apparence d’un "gouvernement indépendant". L’aile droite de la social-démocratie réapparut alors, soutenant ouvertement ce gouvernement.
Le 24 janvier eut lieu une tentative de soulèvement à Budapest, organisé par la social-démocratie de droite. Le Gouvernement négocia avec les insurgés et cèda à sa revendication d’interdire les Gars de Lénine, les Brigades internationales et les régiments contrôlés par les anarchistes. Cette répression précipita la décomposition de l’Armée rouge : de violents affrontements éclatèrent en son sein, les désertions et les mutineries se multiplièrent.
La défaite finale et la répression brutale
La démoralisation atteint son comble parmi la population ouvrière de Budapest. Beaucoup d’ouvriers et leur famille fuient la ville. Les révoltes paysannes contre le Gouvernement se multiplient dans les campagnes. La Roumanie reprend son offensive militaire. Dès la mi-juin, retrouvant leur unité, les sociaux-démocrates réclament la démission de Bela Kun et la formation d’un nouveau gouvernement sans la présence des communistes. Le 20 juillet, Bela Kun lance une offensive militaire désespérée contre les troupes roumaines avec ce qui reste de l’Armée rouge, qui se rend le 23. Le 31 juillet, finalement, Bela Kun démissionne et un nouveau gouvernement avec les sociaux-démocrates et les syndicats est formé, qui déchaîne une violente répression contre les communistes, les anarchistes et tout militant ouvrier qui n’a pu prendre la fuite. Szamuelly est assassiné le 2 août.
Le 6 août, ce gouvernement est à son tour renversé par une poignée de militaires qui ne rencontrent aucune résistance. Les troupes roumaines entrent à Budapest. Les prisonniers sont soumis à des tortures moyenâgeuses avant d’être assassinés. Les soldats blessés ou malades sont arrachés des hôpitaux et traînés dans les rues où ils sont soumis à tout type d’humiliations avant d’être tués. Dans les villages, les troupes obligent les paysans à organiser des procès contre leurs propres voisins considérés comme suspects, à les torturer pour ensuite les assassiner. Les refus sont châtiés par l’incendie des maisons avec leurs occupants à l’intérieur.
Alors que 129 contre-révolutionnaires furent exécutés pendant les 133 jours que dura la République soviétique, plus de 5 000 personnes furent assassinées entre le 15 et le 31 août. Il y eut 75 000 arrestations. Les procès de masse commencèrent en octobre.15 000 ouvriers furent jugés par les tribunaux militaires qui infligeaient les peines de mort et les travaux forcés.
Entre 1920 et 1944, la féroce dictature de l’amiral Horty bénéficia du soutien des démocraties occidentales malgré ses sympathies pour le fascisme, en remerciement de ses services rendus contre le prolétariat.
C. Mir, 4-9-2010
1 Cf. Revue internationale no 139, https://fr.internationalism.org/rint139/1914_23_dix_annees_qui_ebranlerent_le_monde_la_revolution_hongroise_de_1929.html [9]
2 Par une action coordonnée, les comités de paysans prirent les terres du principal aristocrate du pays, le comte Esterhazy.
3 Ceci révèle la politisation croissante des ouvriers mais aussi les insuffisances de leur prise de conscience, puisqu’ils demandent un gouvernement où seraient ensemble les traîtres sociaux-démocrates et les communistes, qui avaient été incarcérés au moyen des manœuvres de premiers.
4 Pendant la Première Guerre mondiale, l’Entente regroupait le camp impérialiste formé par la Grande-Bretagne, la France et la Russie, du moins jusqu’à la Révolution d’Octobre.
5 Roland Bardy, 1919, la Commune de Budapest, p. 83. La majeure partie des informations utilisées dans cet article est extraite de l’édition française de cet ouvrage, qui contient une abondante documentation.
6 Ibidem.
7 L’aile centriste du parti hongrois était formée par des cadres aussi réactionnaires que ceux de l’aile droite, mais beaucoup plus rusés et capables de s’adapter à la situation.
8 Roland Bardy, op. cit., p. 84.
9 Bela Szanto, dans son livre la Révolution hongroise de 1919, page 88 de l’édition espagnole, chapitre "Avec qui auraient dû s’unir les communistes ?", cite un social-démocrate, Buchinger, qui reconnaît que "l’union avec les communistes sur la base de leur programme intégral fut réalisée sans la moindre conviction".
10 Roland Bardy, op. cit., p. 85.
11 Idem, p. 86.
12 Idem, p. 99.
13 Cet individu avait crié, en février 1919 : "les communistes doivent être mis face aux canons des fusils", et il déclarera en juillet 1919 : "je suis incapable de m’intégrer à l’univers mental sur lequel se base la dictature du prolétariat" (Szanto, op. cit., p. 99).
14 Bela Szanto, op. cit., p. 82 de l’édition espagnole, rapporte que dès le lendemain, Bela Kun confessa à ses camarades du Parti : "Les choses vont trop bien. Je n’ai pu dormir, je n’ai cessé de penser toute la nuit où nous avons pu nous tromper", chapitre "Au pas de charge vers la dictature du prolétariat".
15 Au sein de l’Union anarchiste se distingue une tendance organisée de façon autonome, qui se fait appeler Les Gars de Lénine et qui proclame "la défense du pouvoir des conseils ouvriers". Elle jouera un rôle significatif au cours des actions militaires en défense de la révolution.
16 Tome 38 de l’édition espagnole, pages 228, 229 et 246. Les documents s’intitulent "Salut par radio au gouvernement de la République des conseils hongroise", radiogramme envoyé à Bela Kun, et "Communiqué sur les conversations radio avec Bela Kun".
17 Le Conseil ouvrier de Szeged – ville de la zone "démilitarisée" mais occupée en réalité par 16 000 soldats français – agit de façon révolutionnaire. Le 21 mars, le Conseil organisa l’insurrection, occupant tous les points stratégiques. Les soldats français refusèrent de les combattre et le commandement décida alors la retraite. Le 23, le Conseil élit un Conseil de gouvernement formé par un ouvrier du verre, un autre du bâtiment et un avocat. Il prend contact dès le 24 avec le nouveau Gouvernement de Budapest.
18 Szantó, op. cit., p. 106, chapitre "Contradictions théorique et de principe et leurs conséquences".
19 Roland Bardy, op. cit., p. 101.
20 Bela Szanto, op. cit., page 91, chapitre "Avec qui auraient dû s’unir les communistes ?".
21 Roland Bardy, op. cit., p. 105.
22 Idem, p. 117.
23 Idem, p. 111.
24 Idem, p. 112.
25 Idem, p. 127.
26 Idem, p. 126
27 Cf. le quatrième chapitre [10] de notre série sur la Révolution en Allemagne, Revue internationale, no 136.
28 Bela Szanto, op. cit., page 146 : "La contre-révolution se sentit si forte qu’elle pouvait dans ses brochures et opuscules présenter comme siens des hommes qui étaient à la tête du mouvement ouvrier ou qui occupaient des postes importants dans la dictature des Conseils."
29 Idem, p. 104, chapitre "Contradictions théorique et de principe et leurs conséquences".
30 Alan Woods, La République soviétique hongroise de 1919, la révolution oubliée. En espagnol : https://marxist.com/republica-sovietica-hungara-1919.htm [11].; en anglais : https://marxist.com/hungarian-soviet-republic-1919.htm [12]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (3e partie)
- 1820 reads
Nous avons vu dans la partie précédente [14] du Manifeste (publiée dans la Revue internationale n° 143) comment celui-ci s'opposait violemment à tout front unique avec les sociaux-démocrates. En contrepartie, il appelait à un front unique de tous les éléments véritablement révolutionnaires, parmi lesquels il incluait les partis de la Troisième Internationale au même titre que les partis communistes ouvriers (KAPD en Allemagne). Face à la question nationale qui se pose dans les républiques soviétiques, traitée dans la troisième publication que nous faisons de ce document, celui-ci préconise la réalisation du Front unique avec les PC des ces républiques qui, dans l'IC, "auraient les mêmes droits que le parti bolchevique".
Toutefois, le point le plus important abordé dans cette avant-dernière partie du Manifeste est celui consacré à la NEP.
La position du Manifeste sur cette question est la suivante : "La NEP est le résultat direct de la situation des forces productives dans notre pays (…) Ce qu’a fait le capitalisme des petites productions et propriétés dans l’agriculture et l’industrie des pays capitalistes avancés (en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne), le pouvoir du prolétariat doit le faire en Russie." En fait, ce point de vue n'est pas très éloigné de celui de Lénine pour qui la NEP était une forme de capitalisme d'État. En 1918, Lénine défendait déjà que le capitalisme d'État constituait un pas en avant, un pas vers le socialisme pour l'économie arriérée de la Russie. Dans le discours au Congrès du parti bolchevique de 1922, il reprend ce thème, en insistant sur la différence fondamentale à faire entre le capitalisme d'État sous la direction de la bourgeoisie réactionnaire, et le capitalisme d'État administré par l'État prolétarien. Le Manifeste énonce une série de suggestions pour "l'amélioration" de la NEP, dont l'indépendance vis-à-vis des capitaux étrangers.
Là où le Manifeste diverge de Lénine et de la position officielle du parti bolchevique c'est lorsqu'il souligne que "Le plus grand péril lié à la Nouvelle Politique économique, c’est que le niveau de vie d’une très grande partie de ses cadres dirigeants a commencé à changer rapidement". Les mesures qu'il préconise sont la régénérescence du système des soviets : "Pour prévenir le risque de dégénérescence de la Nouvelle Politique économique en Nouvelle politique d’exploitation du prolétariat, il faut conduire le prolétariat vers l’accomplissement des grandes tâches qui sont devant lui par une réalisation cohérente des principes de la démocratie prolétarienne, ce qui donnera les moyens à la classe ouvrière de défendre les conquêtes de la Révolution d’octobre contre tous les périls d’où qu’ils viennent. Le régime interne du parti et les rapports du parti avec le prolétariat doivent être radicalement transformés dans ce sens."
La question nationale
La réalisation de la tactique du front uni fut surtout difficile à cause de la variété nationale et culturelle des peuples en URSS.
L’influence pernicieuse de la politique du groupe dirigeant du PCR (bolchevique) se révéla en particulier sur la question nationale. À toute critique et à toute protestation, des proscriptions sans fin ("division méthodique du parti ouvrier") ; des nominations qui parfois ont un caractère autocratique (personnes impopulaires qui n’ont pas la confiance des camarades locaux du parti) ; des ordres donnés aux républiques (aux mêmes populations demeurées pendant des décennies et des siècles sous le joug ininterrompu des Romanov personnifiant la domination de la nation grand-russe), qui peuvent finir par donner une nouvelle vigueur aux tendances chauvines dans les larges masses travailleuses, pénétrant même les organisations nationales du parti communiste.
La Révolution russe, dans ces républiques soviétiques, fut indubitablement accomplie par les forces locales, par le prolétariat local avec l’appui actif des paysans. Et si tel ou tel parti communiste national développa un travail nécessaire et important, celui-ci consista essentiellement à appuyer les organisations locales du prolétariat contre la bourgeoisie locale et ses soutiens. Mais une fois accomplie la révolution, la praxis du parti, du groupe dirigeant du PCR (bolchevique), inspirée par la défiance vis-à-vis des revendications locales, ignore les expériences locales et impose aux partis communistes nationaux divers contrôleurs, souvent de nationalité différente, ce qui exaspère les tendances chauvines et donne aux masses ouvrières l’impression que ces territoires sont soumis à un régime d’occupation. La réalisation des principes de la démocratie prolétarienne, avec l’institution des organisations locales étatiques et de parti, éliminera dans toutes les nationalités les racines de la différence entre ouvriers et paysans. Réaliser ce "front unique" dans les républiques qui ont accompli la révolution socialiste, réaliser la démocratie prolétarienne, signifie instituer l’organisation nationale avec des partis communistes ayant dans l’Internationale les mêmes droits que le PCR (bolchevique) et constituant une section particulière de l’Internationale. Mais puisque toutes les républiques socialistes ont certaines tâches communes et que le parti communiste développe dans toutes un rôle dirigeant, on doit convoquer – pour les discussions et les décisions sur les problèmes communs à toutes les nationalités de l’Union des républiques socialistes soviétiques – des congrès généraux de parti qui élisent, en vue d’une activité stable, un exécutif des partis communistes de l’URSS. Une telle structure organisationnelle des partis communistes de l’URSS peut déraciner et déracinera indubitablement la méfiance au sein du prolétariat et elle présentera en outre une énorme importance pour l’agitation du mouvement communiste dans tous les pays.
La NEP (Nouvelle Politique économique)
La NEP est le résultat direct de la situation des forces productives dans notre pays.
Et vraiment, supposons que notre pays soit couvert d’une épaisse forêt de tuyaux d’usine, la terre cultivée par des tracteurs et non par des charrues, que le blé soit moissonné à l’aide de moissonneuses et non d’une faucille et d’une faux, battu par une batteuse et non par un fléau, vanné par un tarare et non par une pelle aux quatre vents ; de plus toutes ces machines mises en marche par un tracteur – est-ce que dans ces conditions nous aurions besoin d’une Nouvelle Politique économique ? Pas du tout.
Et imaginez-vous maintenant que l’année dernière, en Allemagne, en France et en Angleterre il y ait eut une révolution sociale et que chez nous, en Russie, la massue et l’araire n’aient pas pris leur retraite, remplacés par la reine machine, mais règnent sans rivaux. Tout comme ils règnent aujourd’hui (surtout l’araire, et le manque de bêtes oblige l’homme à s’y atteler lui-même avec ses enfants, sa femme suivant l’araire). Aurait-on alors besoin d’une Nouvelle Politique économique ? Oui.
Et pour quoi ? Pour la même chose, pour s’appuyer sur une culture familiale paysanne avec son araire et, par là, pour passer de l’araire au tracteur, donc pour changer la base matérielle d’une économie petite-bourgeoise de la campagne en vue d’élargir la base économique de la révolution sociale.
Ce qu’a fait le capitalisme des petites productions et propriétés dans l’agriculture et l’industrie des pays capitalistes avancés (en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne), le pouvoir du prolétariat doit le faire en Russie.
Mais comment accomplir cette tâche ? En décrétant, en criant : "eh vous, petit-bourgeois, disparaissez !" ? On pourrait prendre de pareils décrets réprimandant un élément petit-bourgeois autant qu’on voudrait, la petite-bourgeoisie vivrait quand même comme un coq en pâte. Et qu’est-ce que les purs prolétaires feraient sans elle dans un pays comme la Russie ? Ils mourraient de faim ! Pourrait-on rassembler tous les petit-bourgeois dans une commune collective ? Impossible. Ce ne sera donc pas par décrets que l’on combattra l’élément petit-bourgeois, mais en le soumettant aux nécessités d’une économie rationnelle, mécanisée, homogène. Par la lutte libre des économies basées sur l’utilisation des machines et des nouveaux perfectionnements techniques contre tous les autres modes de production archaïques qui dominent encore dans une petite économie artisanale. On ne peut pas construire le communisme avec un araire.
Mais imaginez que la révolution socialiste ait eu lieu en Allemagne ou en Angleterre. Est-ce qu’une Nouvelle Politique économique y serait possible à un quelconque moment du processus révolutionnaire ?
Ça dépend totalement de l’importance et de l’échelle de la production petite-bourgeoise. Si son rôle dans la vie du pays est insignifiant, on pourra se passer de Nouvelle Politique économique et, en accélérant l’activité législative de la dictature prolétarienne, introduire de nouvelles méthodes de travail.
Donc là où la production petite-bourgeoise exerce une influence considérable sur la vie économique du pays et où l’industrie de la ville et de la campagne ne peut pas s’en passer, la Nouvelle Politique économique aura lieu. Plus la grande industrie dépendra de la petite production, plus l’échelle de la NEP sera grande et sa durée conditionnée à la vitesse de la marche triomphante d’une industrie socialiste nationale.
En Russie, la Nouvelle Politique économique durera longtemps – non parce que quelqu’un le veut, mais parce que personne ne peut agir autrement. Jusqu’au moment où notre industrie socialiste cessera de dépendre de la production et de la propriété petites-bourgeoises, il n’y sera pas question de suspendre la NEP.
La NEP et la campagne
La question du changement de politique économique, de la suspension de la NEP, sera posée à l’ordre du jour après la disparition de la domination petite-bourgeoise dans l’agriculture.
Actuellement, la force et la puissance de la révolution socialiste sont totalement conditionnées par la lutte pour l’industrialisation, du tracteur contre l’araire. Si le tracteur arrache la terre russe à l’araire, alors le socialisme vaincra, mais si l’araire chasse le tracteur, le capitalisme l’emportera. La Nouvelle Politique économique ne disparaîtra qu’avec l’araire.
Mais avant que le soleil ne se lève, la rosée peut crever les yeux 1 ; et pour que nos yeux, ceux de la révolution socialiste, restent sains et saufs, il nous faut suivre une ligne juste envers le prolétariat et la paysannerie.
Notre pays est agraire. Nous ne devons pas oublier que le paysan y est le plus fort, il faut l’attirer de notre côté. Nous ne pouvons pas l’abandonner à une idéologie bourgeoise, car ce serait la mort de la Russie soviétique et la paralysie pour longtemps de la révolution mondiale. La question des formes d’une organisation de paysans est une question de vie et de mort pour la Révolution russe et internationale.
La Russie est entrée dans la voie de la révolution socialiste alors que 80 % de sa population vivait encore dans des exploitations individuelles. Nous avons poussé le paysan à exproprier les expropriateurs, à s’emparer des terres. Mais lui ne comprenait pas cette expropriation comme l’ouvrier industriel la comprend. Son être à la campagne déterminait sa conscience. Chaque paysan, ayant son exploitation individuelle, rêvait de l’accroître. Les propriétés foncières n’avaient pas la même organisation interne que les entreprises industrielles des villes, c’est pourquoi il fallut "socialiser la terre" bien que ce fût une régression, un recul des forces productives, un pas en arrière. En expropriant peu ou prou les expropriateurs, nous n’avons pas pu penser à changer tout de suite un mode de production avec les forces productives existantes, le paysan ayant son exploitation individuelle. Il ne faut jamais oublier que la forme de l’économie est entièrement déterminée par le degré de développement des forces productives, et notre charrue araire ne peut en rien prédisposer au mode de production socialiste.
Il n’y a pas lieu de penser que nous puissions influencer un propriétaire par notre propagande communiste et qu'il se retrouve dans une commune ou une collectivité.
Pendant trois ans, prolétariat et bourgeoisie se sont affrontés pour récupérer la paysannerie. Celui qui gagna l’ascendant sur cette dernière gagna la lutte. Nous avons vaincu parce que nous étions les plus forts, les plus puissants. Il faut affermir cette puissance, mais en même temps réaliser une chose : elle ne sera pas consolidée par la qualité ou la quantité de discours de nos bavards, mais au fur et à mesure de la croissance des forces productives, au fur et à mesure que triomphera le tarare sur la pelle, la faucheuse sur la faux, la moissonneuse sur la faucille, le tracteur sur la charrue. Au fur et à mesure que triomphera l’économie socialisée de la production et de la propriété petite-bourgeoise.
Qui peut prouver que le paysan soit opposé aux faucheuses, aux tarares, aux moissonneuses, aux lieuses et aux tracteurs ? Personne. Personne ne peut donc prouver que le paysan n’arrivera jamais aux formes socialisées de l’économie, mais nous savons qu’il y arrivera en tracteur et non en s’attelant lui-même à l’araire.
G.V. Plekhanov raconte qu’une tribu africaine sauvage en voulait aux Européens et considérait abominable tout ce qu’ils faisaient. L’imitation des mœurs, des coutumes et des façons européennes de travailler était considérée comme péché capital. Mais les mêmes sauvages, qui utilisaient des haches de pierre, ayant vu les Européens manier les haches d’acier, ont bientôt commencé à se procurer ces dernières, quoiqu'en récitant des formules magiques et en se cachant.
Certes, pour le paysan, tout ce que les communistes font et qui sent la commune est abominable. Mais il faut le forcer à substituer le tracteur à la charrue, tout comme les sauvages ont substitué la hache d’acier à celle de pierre. C’est beaucoup plus facile à faire pour nous que pour les Européens en Afrique.
Si on veut développer l’influence du prolétariat en milieu paysan, il ne faut pas rappeler trop souvent au cultivateur que c’est la classe ouvrière qui lui a donné la terre, car il peut bien répondre : "Merci, mon brave, et maintenant, pourquoi es-tu venu ? Pour prélever un impôt en nature ? Cet impôt, tu l’auras, mais ne dis surtout pas qu’hier tu étais très bien, dis si aujourd’hui tu veux faire du bien. Sinon, mon colon, va te faire voir !"
Tous les partis contre-révolutionnaires, des mencheviks aux SR et aux monarchistes inclus, basent leurs théories pseudo-scientifiques de l’avènement inévitable d’un paradis bourgeois sur la thèse qu’en Russie le capitalisme n’a pas encore épuisé tout son potentiel, qu’il y reste de grandes possibilités de développement et de prospérité, qu’il va embrasser peu à peu toute l’agriculture en y introduisant des méthodes industrielles de travail. C’est pourquoi, concluent-ils, si les bolcheviks ont fait un coup d’État, s’ils ont pris le pouvoir pour construire le socialisme sans attendre les conditions matérielles nécessaires, ils devront soit se transformer eux-mêmes en vraie démocratie bourgeoise, soit les forces développées à l’intérieur exploseront politiquement, renverseront les communistes résistant aux lois économiques et mettront à leur place une coalition des Martov, Tchernov, Milioukov, dont le régime donnera libre champ au développement des forces productives du pays.
Certes, chacun sait que la Russie est un pays plus arriéré que l’Angleterre, les États-Unis, l’Allemagne, la France etc. Mais tous doivent comprendre : si le prolétariat dans ce pays a eu assez de force pour prendre le pouvoir, pour exproprier les expropriateurs, supprimer la résistance acharnée des oppresseurs soutenue par la bourgeoisie du monde entier, ce prolétariat aura d’avantage encore de force pour suppléer le processus anarchique de mécanisation de l’agriculture du capitalisme par une mécanisation conséquente et planifiée grâce à l’industrie et au pouvoir prolétarien, soutenue par les aspirations conscientes des paysans à voir facilité leur travail.
Qui dit que c’est facile à faire ? Personne. Surtout après les ravages immenses que les SR, les mencheviks, la bourgeoisie et les propriétaires fonciers ont fait en déclenchant la guerre civile. C’est difficile à faire mais ce sera fait, même si les mencheviks et les SR, alliés aux Cadets et aux monarchistes, feront flèche de tout bois en vociférant en faveur du retour de la bourgeoisie.
Il nous faut poser cette question dans un cadre pratique. Il n’y a pas longtemps, le camarade Lénine a écrit une lettre aux camarades émigrés américains en les remerciant de l’aide technique qu’ils nous prêtent en organisant des sovkhozes et des kolkhozes exemplaires, où sont utilisés des tracteurs américains pour le labour et la moisson. Ainsi, la Pravda a publié un rapport du travail d’une telle commune à Pierm.
Comme tout communiste, nous sommes ravis que les prolétaires d’Amérique viennent à notre secours, là où on le nécessite le plus. Mais notre attention fut involontairement attirée par un fragment de ce rapport disant que les tracteurs avaient chômé pendant longtemps parce que : 1) l’essence s’était révélée impure ; 2) on avait été obligé de l’importer de loin, avec retard ; 3) les chauffeurs du village avaient mis beaucoup de temps à étudier le maniement des tracteurs ; 4) les routes et surtout les ponts n’étaient pas bons pour les tracteurs.
Si la mécanisation de l’agriculture détermine le sort de notre révolution et n’est de ce fait pas étrangère au prolétariat du monde entier, il faut la développer sur une base plus solide. Sans renoncer à une aide d’une telle ampleur (que nous accordent les camarades d’outre-mer) ni diminuer son importance, nous avons pourtant à penser les résultats qu’elle nous permettra d’obtenir.
Il nous faut avant tout attirer l’attention sur le fait que ces tracteurs ne sont pas produits dans nos usines. Peut-être n’a-t-on pas besoin de les produire en Russie, mais si cette aide prend de l’envergure, notre agriculture sera liée à l’industrie des États-Unis.
Maintenant il faut déterminer quel type de tracteur, quel moteur est applicable aux conditions russes. 1) il doit utiliser le pétrole comme combustible et ne pas faire de caprices à cause de la mauvaise qualité de l’essence ; 2) il doit être simple d’utilisation pour que non seulement les chauffeurs professionnels sachent le conduire, mais pour qu’on puisse former ces chauffeurs facilement et autant qu’il en faudra ; 3) il faut avoir des niveaux de force : 100, 80, 60, 40, 30, 25, selon le type de terre : à labourer, vierge ou déjà cultivée ; 4) il faut que ce soit un moteur universel pour le labour, le battage, le fauchage, le transport du blé ; 5) il faut qu’on le fabrique dans les usines russes et non qu’on aille le chercher quelque part outre-mer ; sinon, au lieu de l’alliance de la ville et de la campagne, ce serait l’alliance de la campagne et des négociants étrangers ; 6) il doit utiliser un combustible local.
Après les horreurs de la guerre et de la famine, notre pays promet à la machine dans l’agriculture un triomphe plus grand et plus proche que jamais dans le monde. Car actuellement, même la simple charrue araire, l’instrument principal de travail dans notre campagne, commence à manquer et lorsqu’il y en a, on n’a pas de bêtes à y atteler. Les machines pourraient faire des choses impossibles à imaginer.
Nos spécialistes estiment que l’imitation aveugle des États-Unis serait nuisible à notre économie ; ils pensent aussi que malgré tout, la production en série des moteurs indispensables à notre agriculture est possible avec nos moyens techniques. Cette tâche est d’autant plus facile à résoudre que notre industrie métallurgique se plaint toujours de l’absence de commandes, que les usines fonctionnent à la moitié de leur potentiel, donc à perte ; on leur passerait des commandes.
La production en série d’une machine universelle agricole simple, que des mécaniciens préparés rapidement pourraient conduire, qui fonctionnerait au pétrole et ne ferait donc pas de caprices à cause d’une essence de qualité médiocre, doit être organisée dans les régions de Russie où il est facile de transporter le pétrole soit par train, soit par bateau. On pourra utiliser le moteur à pétrole au sud de la Russie, en Ukraine, au centre de la Russie, dans les régions de la Volga et de la Kama ; ça ne marcherait pas en Sibérie, car le transport du pétrole y reviendrait très cher. L’immense espace de la Sibérie est un problème pour notre industrie. Mais il y a d’autres types de combustible en Sibérie, notamment du bois ; c’est pourquoi les moteurs à vapeur pourront y occuper une place importante. Si nous réussissons à résoudre le problème de la distillation du bois, de l’extraction de l’esprit de bois en Sibérie, on pourra utiliser des moteurs à bois. Lequel des deux moteurs sera le plus rentable, les spécialistes techniques devront le décider d’après les résultats pratiques.
Le 10 novembre 1920, la Pravda, sous le titre "Entreprise gigantesque", rapportait la nouvelle de la constitution de la Société internationale de secours pour la renaissance de l’industrie dans l’Oural. De très importants trusts d’État et le Secours ouvrier international contrôlent cette société qui dispose d’ores et déjà d’un capital de deux millions de roubles-or et est entrée en rapport d’affaires avec l’entreprise américaine Keith en acquérant une grande quantité de tracteurs, affaire jugée évidemment avantageuse.
La participation du capital étranger est nécessaire, mais dans quel domaine ? Nous voulons, ici, soumettre à tous les questions suivantes : si le Secours ouvrier international peut nous aider grâce à ses rapports avec l’entreprise Keith, pourquoi ne pourrait-il pas, avec une quelconque autre entreprise, organiser chez nous, en Russie, la production des machines nécessaires à l’agriculture ? Ne serait-il pas préférable d’employer les deux millions de roubles-or que la société possède dans la production de tracteurs, ici, chez nous ? A-t-on justement envisagé toutes les possibilités ? Est-il réellement nécessaire d’enrichir de notre or l’entreprise Keith et de lier à elle le sort de notre économie agricole ?
Dans un livre technique, nous avons lu qu’en voulant soumettre les régions agricoles des pays occupés à leur domination économique certaine, les firmes allemandes étaient venues avec leurs tracteurs, avaient labouré les terres et puis avaient vendu les machines aux laboureurs pour un sou. Il va de soi que par la suite, ces firmes ont demandé un haut prix, mais les tracteurs se vendaient déjà. C’était la conquête sans verser une goutte de sang.
La volonté de la firme Keith de nous aider et de nous accorder un crédit semble être du même genre et il faut y être très prudent.
Certes, il est relativement douteux que la firme Keith puisse nous fournir des tracteurs adaptés aux conditions russes, mais même les tracteurs qui y sont peu accommodés remporteront un succès assuré au vu des conditions lamentables de notre agriculture, car n’importe quoi aurait du succès dans une pareille situation. Si la production des moteurs nécessaires et adaptés aux conditions russes est possible de toute façon, pourquoi a-t-on besoin de la firme Keith ? Car, autant qu’on sache, il n’est pas définitif que nous ne puissions pas organiser nous-mêmes la production des machines nécessaires.
Si les idées et les calculs des ingénieurs de Petrograd sont réellement justes, les deux millions de roubles-or accordés par cette Société seraient un investissement bien plus solide pour un redressement de l’économie dans l’Oural que l’aide de la firme Keith.
En tout cas, il faut discuter sérieusement cette question, parce qu’elle a une portée non seulement économique, mais aussi politique, non seulement pour la Russie soviétique mais pour toute la révolution mondiale. Et on ne peut pas la résoudre d’un seul coup. Il faut savoir ce que nous pourrions faire de cet or, et réfléchir : si les personnes compétentes et les autorités décident que ça ne vaut même pas la peine d’essayer et qu’il vaut mieux s’adresser directement outre-mer, soit.
Nous avons peur d’avoir l’esprit d’escalier : d’abord nous donnerons de l’or à monsieur Keith, puis nous ferons publiquement notre mea-culpa, tout en nous vantant de ne pas avoir peur de reconnaître nos fautes.
Si on mécanise l’agriculture en Russie, par la production des machines nécessaires par nos usines et non par l’achat à la bonne firme d’outre-mer Keith, la ville et la campagne seront indissolublement liées par la croissance des forces productives, rapprochées l’une de l’autre ; il faudra alors consolider ce rapprochement idéologique en organisant "des syndicats de type particulier" (d’après le programme du PCR). Ce sont des conditions indispensables pour l’abolition paisible des rapports capitalistes, l’élargissement d’une base de la révolution socialiste à l’aide d’une nouvelle politique économique 2.
Notre révolution socialiste détruira la production et la propriété petite-bourgeoise non en décrétant la socialisation, la municipalisation, la nationalisation, mais par la lutte consciente et conséquente des modes modernes de production au détriment des modes dépassés, désavantageux, par l’instauration évolutive du socialisme. C’est exactement l’essence du saut de la nécessité capitaliste à la liberté socialiste.
La Nouvelle Politique économique et la politique tout simplement
Et quoi qu’en disent les gens "bien-pensants", c’est en premier lieu la classe ouvrière active et en second la paysannerie (et non les fonctionnaires communistes, même les meilleurs et les plus intelligents) qui sont en mesure de mener cette politique.
La Nouvelle Politique économique déterminée par l’état des forces productives de notre pays cache en elle des dangers pour le prolétariat. Nous ne devons pas seulement montrer que la révolution sait affronter un examen pratique sur le plan de l’économie et que les formes économiques socialistes sont en fait meilleures que les capitalistes, mais nous devons aussi affirmer notre position socialiste sans engendrer pour autant une caste oligarchique qui détienne le pouvoir économique et politique, qui finisse par craindre par-dessus tout la classe ouvrière. Pour prévenir le risque de dégénérescence de la Nouvelle Politique économique en Nouvelle politique d’exploitation du prolétariat, il faut conduire le prolétariat vers l’accomplissement des grandes tâches qui sont devant lui par une réalisation cohérente des principes de la démocratie prolétarienne, ce qui donnera les moyens à la classe ouvrière de défendre les conquêtes de la Révolution d’octobre contre tous les périls d’où qu’ils viennent. Le régime interne du parti et les rapports du parti avec le prolétariat doivent être radicalement transformés dans ce sens.
Le plus grand péril lié à la Nouvelle Politique économique, c’est que le niveau de vie d’une très grande partie de ses cadres dirigeants a commencé à changer rapidement. Les membres de l’administration de certains trusts, par exemple celui du sucre, reçoivent un salaire mensuel de 200 roubles-or, jouissent gratuitement ou pour un prix modique d’un bel appartement, possèdent une automobile pour leurs déplacements et ont bien d’autres avantages pour satisfaire leurs besoins à prix moindre que celui payé par les ouvriers adonnés à la culture de la betterave à sucre, alors même que ces ouvriers, bien qu’ils soient communistes, ne reçoivent (outre les modestes rations alimentaires qui leurs sont accordées par l’État), que 4 ou 5 roubles par mois en moyenne (et avec ce salaire ils doivent également payer le loyer et l’éclairage) ; il est bien évident qu’on entretient vraiment une différence profonde dans le mode de vie des uns et des autres. Si cet état de chose ne change pas au plus vite mais se maintient encore dix ou vingt ans, la condition économique des uns comme des autres déterminera leur conscience et ils se heurteront en deux camps opposés. Nous devons considérer que les postes dirigeants, souvent renouvelés, sont occupés par des personnes de très basse extraction sociale mais qu’il s’agit toujours d’éléments non prolétariens. Ils forment une très mince couche sociale. Déterminés par leur condition, ils se considèrent comme étant les seuls aptes à certaines tâches réservées, les seuls capables de transformer l’économie du pays, de satisfaire le programme revendicatif de la dictature du prolétariat, des conseils d’usine, des délégués ouvriers, à l’aide du verset : "Ne nous exposez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal".
Ils considèrent en réalité ces revendications comme les expressions de l’influence d’éléments petits-bourgeois contre-révolutionnaires. Il y a donc ici sans le moindre doute un danger qui couve sur les conquêtes du prolétariat, qui vient du côté où l’on pouvait le moins s’y attendre. Pour nous, le danger est que le pouvoir prolétarien dégénère en hégémonie d’un groupe puissant décidé à tenir dans ses propres mains le pouvoir politique et économique, sous le voile de très nobles intentions, naturellement, "dans l’intérêt du prolétariat, de la révolution mondiale et autres idéaux très élevés". Oui, le danger existe vraiment d’une dégénérescence oligarchique.
Mais dans le pays où la production petite-bourgeoise exerce une influence décisive, où de plus la politique économique permet d’accélérer, de renforcer au maximum les vues individualistes d’un petit propriétaire, il faut exercer une pression permanente sur la base même de l’élément petit-bourgeois. Et qui l’exercera ? Seront-ce les mêmes fonctionnaires, ces sauveurs de l’humanité affligée ? Qu’ils aient tous la sagesse de Salomon – ou de Lénine – ils ne pourront quand même pas le faire. Seule la classe ouvrière en est capable, dirigée par le parti qui vit sa vie, souffre de ses souffrances, de ses maladies, un parti qui n’ait pas peur de la participation active du prolétariat à la vie du pays.
Il ne faut pas, il est nuisible et contre-révolutionnaire de raconter des fables au prolétariat pour endormir sa conscience. Mais qu’est-ce qu’on nous dit ? "Tiens-toi coi, va aux manifestations lorsqu’on t’y invite, chante l’Internationale quand il le faut, le reste sera fait sans toi par de braves garçons, presque des ouvriers comme toi, mais qui sont plus intelligents que toi et connaissent tout sur le communisme, reste donc tranquille et tu entreras bientôt au royaume socialiste". C’est du pur socialisme-révolutionnaire. Ce sont eux qui défendent que des individus brillants, pleins de dynamisme et armés de talents variés, issus de toutes les classes de la société (et ce semble être le cas) font de cette masse de couleur grise (la classe ouvrière) un royaume élevé et parfait où il n’y aura ni maladies, ni peines, ni soupirs, mais la vie éternelle. C’est tout à fait le style des "saints pères" socialistes-révolutionnaires.
Il faut substituer à la pratique existante une pratique nouvelle qui se baserait sur l’activité autonome de la classe ouvrière et non sur l’intimidation du parti.
En 1917, on avait besoin d’une démocratie développée et en 1918, 1919 et 1920, il fallut réduire tous les appareils dirigeants en les suppléant partout par le pouvoir autocratique de fonctionnaires nommés par en haut qui décrétaient tout ; en 1922, face aux tâches bien différentes qu’auparavant, il est hors de doute qu’on ait besoin d’autres formes d’organisation et méthodes de travail. Dans les fabriques et les usines (nationales) il faut organiser des conseils de députés ouvriers servant de noyaux principaux du pouvoir d’État ; il faut mettre en pratique le point du programme du PCR qui dit : "L’État soviétique rapproche l’appareil étatique et les masses, y compris par le fait que l’unité de production (l’usine, la fabrique) devient le noyau principal de l’État au lieu du district" (cf. le Programme du PCR, division politique, point 5). C’est ce noyau principal du pouvoir d’État aux fabriques et usines qu’il faut restaurer en Conseils de députés ouvriers qui prendront la place de nos sages camarades qui dirigent actuellement l’économie et le pays.
Peut-être certains lecteurs lucides vont-ils nous accuser de faction (article 102 du Code pénal), d’ébranler les bases sacrées du pouvoir prolétarien. Il n’y a rien à dire à de pareils lecteurs.
Mais d’autres diront : "Montrez-nous un pays où les ouvriers jouissent de mêmes droits et libertés qu’en Russie". Ceci dit, ils penseront mériter l’ordre du Drapeau rouge pour avoir écrasé une faction, sans peine et sans verser le sang qui plus est. Et à ceux-là, on peut dire quelque chose. Montrez donc, chers amis, encore un pays où le pouvoir appartient à la classe ouvrière ? Un tel pays n’existe pas, donc la question est absurde. Le problème, ce n’est pas d’être plus libéral, plus démocratique qu’une puissance impérialiste (d’ailleurs ce ne serait pas un grand mérite) ; le problème consiste à résoudre les tâches qui se posent au seul pays au monde qui ait fait le coup d’État d’Octobre, faire en sorte que la NEP (Nouvelle Politique économique) ne devienne une "NEP" (Nouvelle exploitation du prolétariat) et que, dans dix ans, ce prolétariat ne soit pas, Gros-Jean comme devant, forcé de recommencer sa lutte, peut-être sanglante, pour renverser l’oligarchie et garantir ses conquêtes principales. Le prolétariat peut le garantir en participant directement à la résolution de ces tâches, en instaurant une démocratie ouvrière, en mettant en pratique un des points principaux du programme du PCR qui dit : "La démocratie bourgeoise s’est bornée à proclamer formellement les droits et libertés politiques", à savoir les libertés d’association, de presse, égales pour tous les citoyens. Mais en réalité, la pratique administrative et surtout l’esclavage économique des travailleurs ne permettent pas à ces derniers de jouir pleinement de ces droits et libertés.
Au lieu de les proclamer formellement, la démocratie prolétarienne les accorde en pratique avant tout aux classes de la population opprimées jadis par le capitalisme, c’est-à-dire au prolétariat et à la paysannerie. Pour cela, le pouvoir soviétique exproprie les locaux, les imprimeries, les dépôts de papier de la bourgeoisie en les mettant à la disposition des travailleurs et de leurs organisations.
La tâche du PCR (bolchevique) consiste à permettre aux grandes masses de la population laborieuse de jouir des droits et libertés démocratiques sur une base matérielle de plus en plus développée (cf. le Programme du PCR, division politique, point 3).
Il aurait été absurde et contre-révolutionnaire de revendiquer la réalisation de ces thèses programmatiques en 1918, 1919 ou 1920 ; mais il est encore plus absurde et contre-révolutionnaire de se prononcer contre leur réalisation en 1922.
Veut-on améliorer la position de la Russie soviétique dans le monde, ou restaurer notre industrie, ou élargir la base matérielle de notre révolution socialiste en mécanisant l’agriculture, ou faire face aux effets dangereux d’une Nouvelle Politique économique, on en revient inévitablement à la classe ouvrière qui seule est capable de faire tout ça. Moins elle est forte, plus fermement doit-elle s’organiser.
Et les bons garçons qui occupent les bureaux ne peuvent résoudre de pareilles tâches grandioses, n’est-ce pas ?
Malheureusement, la majorité des chefs du PCR ne pense pas de la même façon. À toutes les questions sur la démocratie ouvrière, Lénine, dans un discours prononcé au IXe congrès panrusse des soviets, répondit ainsi : "A tout syndicat qui pose, en général, la question de savoir si les syndicats doivent participer à la production, je dirai : mais cessez donc de bavarder (applaudissements), répondez-moi plutôt pratiquement et dites-moi (si vous occupez un poste responsable, si vous avez de l’autorité, si vous êtes un militant du Parti communiste ou d’un syndicat) : où avez-vous bien organisé la production, en combien d’années, combien de personnes vous sont subordonnées, un millier ou une dizaine de milliers ? Donnez-moi la liste de ceux à qui vous confiez un travail économique que vous avez mené à bonne fin, au lieu de vous attaquer à vingt affaires à la fois pour ne faire aboutir aucune d’elles, faute de temps. Chez nous, avec nos mœurs soviétiques, il est rare qu’on mène une affaire à terme, qu’on puisse parler d’un succès durant quelques années ; on craint de s’instruire auprès du marchand qui empoche 100 % de bénéfices et plus encore, on préfère écrire une belle résolution sur les matières premières et se targuer du titre de représentants du Parti communiste, d’un syndicat, du prolétariat. Je vous demande bien pardon. Qu’est-ce qu’on appelle prolétariat ? C’est la classe qui travaille dans la grande industrie. Mais où est-elle, la grande industrie ? Quel est donc ce prolétariat ? Où est votre grande industrie ? Pourquoi est-elle paralysée ? Parce qu’il n’y a plus de matières premières ? Est-ce que vous avez su vous en procurer ? Non. Vous écrirez une résolution ordonnant de les collecter, et vous serez dans le pétrin ; et les gens diront que c’est absurde ; vous ressemblez à ces oies dont les ancêtres ont sauvé Rome", et qui, pour continuer le discours de Lénine (selon la morale de la fable bien connue de Krylov) doivent être guidées avec une longue baguette au marché pour y être vendues.
Supposons que le point de vue de l’ancienne Opposition ouvrière sur le rôle et les tâches des syndicats soit erroné. Que ce ne soit pas la position de la classe ouvrière au pouvoir, mais celle d’un ministère professionnel. Ces camarades veulent récupérer la gestion de l’économie en l’arrachant des mains des fonctionnaires soviétiques, sans pour autant impliquer la classe ouvrière dans cette gestion, à travers la démocratie prolétarienne et l’organisation des Conseils de députés ouvriers des entreprises conçus comme noyaux principaux du pouvoir étatique, à travers la prolétarisation de ces nids bureaucratiques. Et ils ont tort.
On ne peut pas parler à la façon de Lénine de la démocratie prolétarienne et de la participation du prolétariat à l’économie populaire ! La très grande découverte faite par le camarade Lénine est que nous n’avons plus de prolétariat. Nous nous réjouissons avec toi, camarade Lénine ! Tu es donc le chef d’un prolétariat qui n’existe même pas ! Tu es le chef du gouvernement d’une dictature prolétarienne sans prolétariat ! Tu es le chef du Parti communiste mais non du prolétariat !
à l’inverse du camarade Lénine, son collègue du Comité central et du Bureau politique Kamenev voit le prolétariat partout. Il dit : "1) Le bilan de la conquête d’Octobre consiste en ce que la classe ouvrière organisée en bloc dispose des richesses immenses de toute l’industrie nationale, du transport, du bois, des mines, sans parler du pouvoir politique. 2) L’industrie socialisée est le bien principal du prolétariat", etc., etc. On peut citer beaucoup d’autres exemples. Kamenev voit le prolétariat chez tous les fonctionnaires qui, depuis Moscou, se sont installés par voie bureaucratique et lui-même est, selon ses propres dires, encore plus prolétaire que n’importe quel ouvrier. Il ne dit pas, en parlant du prolétariat : "LUI, le prolétariat..." mais "NOUS, le prolétariat...". Trop de prolétaires du type de Kamenev participent à la gestion de l’économie populaire ; c’est pourquoi il arrive que de semblables prolétaires tiennent d’étranges discours sur la démocratie prolétarienne et sur la participation du prolétariat à la gestion économique ! "S’il vous plaît, dit Kamenev, de quoi parlez-vous ? Ne sommes-nous pas le prolétariat, un prolétariat organisé en tant qu’unité compacte, en tant que classe ?".
Le camarade Lénine considère tout discours sur la participation du prolétariat à la gestion de l’économie populaire comme un bavardage inutile parce qu’il n’y a pas de prolétariat ; Kamenev est du même avis, mais parce que le prolétariat "en tant qu’unité compacte, en tant que classe" gouverne déjà le pays et l’économie, dans la mesure où tous les bureaucrates sont considérés par lui comme prolétaires. Eux, naturellement, se mettent d’accord et s’entendent particulièrement bien, déjà sur quelques points, parce que depuis la Révolution d’octobre Kamenev a pris l’engagement de ne pas prendre position contre le camarade Lénine, de ne pas le contredire. Ils se mettront d’accord sur le fait que le prolétariat existe – naturellement pas seulement celui de Kamenev – mais aussi sur le fait que son bas niveau de préparation, sa condition matérielle, son ignorance politique imposent que "les oies soient tenues loin de l’économie avec une longue baguette". C’est ainsi que cela se passe en réalité !
Le camarade Lénine a appliqué ici la fable de façon plutôt impropre. Les oies de Krylov crient que leurs ancêtres sauvèrent Rome (leurs ancêtres, camarade Lénine) tandis que la classe ouvrière ne parle pas de ses ancêtres, mais d’elle-même, parce qu’elle (la classe ouvrière, camarade Lénine) a accompli la révolution sociale et de ce fait veut diriger elle-même le pays et son économie ! Mais le camarade Lénine a pris la classe ouvrière pour les oies de Krylov et, la poussant avec sa baguette, lui dit : "Laissez vos aïeux en paix ! Vous, qu’avez-vous fait ?". Que peut répondre le prolétariat au camarade Lénine ?
On peut nous menacer avec une baguette et cependant nous déclarerons à haute voix que la réalisation cohérente et sans hésitation de la démocratie prolétarienne est aujourd’hui une nécessité que la classe prolétarienne russe ressent jusqu’à la moelle ; car elle est une force. Advienne que pourra, mais le diable ne sera pas toujours à la porte du pauvre ouvrier. (A suivre)
1. Proverbe russe.
2. Il va de soi que dans la période transitoire les formes existantes d’organisation de la paysannerie sont historiquement inévitables.
Géographique:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [16]
