Revue Internationale no 11 - 4e trimestre 1977
- 2758 reads
TEXTES DU IIème CONGRES DU COURANT COMMUNISTE INTERNATIONAL
- 2464 reads
Présentation
Nous publions dans ce numéro les principaux textes du second Congrès du Courant Communiste International. Ce Congrès a essentiellement été consacré au réexamen et à la vérification de l'orientation du CCI. Il a été un moment où l'organisation internationale toute entière, tire le bilan et trace les perspectives pour la période à venir.
Ce second Congrès a ainsi réaffirmé avec force, à la lumière de l'expérience, la validité des bases principielles sur lesquelles s'est fondé le CCI, il y a un an et demi :
- la plateforme politique[1] [1],
- les statuts d'une organisation révolutionnaire unie et centralisée internationalement,
- le manifeste du premier Congrès appelant les révolutionnaires à prendre conscience de leurs tâches, par rapport à l'enjeu décisif de notre époque de crise et de lutte de classe[2] [2].
Seule cette basé de principes cohérents donne un sens global à l'activité révolutionnaire et le second Congrès du CCI s'est donné comme tâche la mise en application de ces principes à l'analyse de la situation politique actuelle.
es textes du Congrès parlent d'eux-mêmes, mais on ne peut en saisir toute la portée qu'en les comprenant comme le résultat du travail collectif d'une organisation révolutionnaire. L'élaboration méthodique des perspectives tout comice sa traduction en interventions actives nécessitent la création d'un cadre collectif et organisé. Ce Congrès a donc, considéré l'élargissement général de l'organisation dans ses huit sections territoriales et surtout le développement du travail du CCI en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Hollande comme une vérification de l'orientation défendue et suivie depuis longtemps. Plus que le simple accroissement numérique, l'important a été la capacité du CCI depuis dix-huit mois à diffuser régulièrement ses analyses dans 95 numéros de ses publications, en 7 langues, distribuées un peu partout dans le monde.
Les textes ci-dessous sont aussi le fruit d'une recherche politique et théorique constante du CCI pour pouvoir aller plus loin vers les problèmes que la lutte de classe pose pour l'avenir et notamment sur la période de transition au socialisme. En ce sens, ces textes cristallisent un an et demi d'efforts de discussions aussi bien avec d'autres courants politiques qu'au sein du CCI. La capacité d'élever constamment le niveau politique du CCI et ceci de façon homogène dans toute l'organisation en comptant sur l'apport de tous les militants, a été et reste un axe fondamental du travail, seule façon d'assurer que les révolutionnaires puissent contribuer à l'approfondissement théorique dans le mouvement ouvrier.Expression d'un effort organisationnel et d'une recherche théorique, les travaux du second Congrès expriment aussi la volonté de mieux com-prenùre le milieu révolutionnaire aujourd'hui afin d'oeuvrer vers le regroupement. Nous pré-, sentons donc ces documents à la lumière des récentes tentatives importantes de confrontation entre groupes politiques prolétariens. En mai 1977, le Partito Comunista Internazionalista ("Battaglia Comunista") a convoqué une Conférence Internationale[3] [3] de discussions à laquelle a participé le CCI. D'autres groupes invités (dont la Communist Workers Organisation et Fomento Obrero Revolucionario) n'ont malheureusement pas pu être présents et d'autres comme Pour Une Intervention Communiste ont refusé; mais les débats sur la période actuelle et les implications pour la lutte de classe, sur le rôle des syndicats et sur l'organisation des révolutionnaires ont aidé à dissiper des malentendus, à mieux cerner les points d'accord et les raisons des désaccords. Suite à cette tentative, limitée mais fructueuse de clarification, le CCI a accueilli une délégation du PCI-Battaglia Comunista au second Congrès où ces camarades ont pu porter le débat devant l'ensemble de l'organisation. Les impératifs imposés par le développement de la résistance ouvrière sont aujourd'hui ressentis de façon beaucoup plus forte dans le milieu révolutionnaire en tant qu'impulsion vers les contacts internationaux. En septembre 1977, plusieurs groupes suédois et norvégiens organisent une conférence, de discussions à laquelle le CCI participe.
Un autre élément de la situation actuelle prouvé par l'expérience de ces dernières années, est la' faillite de la théorisation de l'isolement. Ceux qui, en 1975, ont rejeté le regroupement et même tout contact avec le CCI - PIC en France, la CWO en Grande-Bretagne, le Revolutionary Workers 'group aux USA - se sont depuis longtemps disloqués entre eux, condamnant la tentative d'association anti-CCI à la stérilité. La RWC s'est dissoute il y a un an après avoir subi les métamorphoses du modernisme. La CWO, pour sa part avait déjà recueilli l'an passé les premiers fruits amers de l'unification confuse et sectaire entre Revolutionary Perspectives et Workers 'Voice : l'éclatement de leur "regroupement" national en deux morceaux. Tout récemment, au cours de l'été 77, le reste de la CWO a subi une seconde scission et ceux qui quittent la CWO défendent, cette fois-ci la nécessité du regroupement et plus particulièrement expriment la volonté d'entamer une discussion avec le CCI dans ce sens[4] [4].
C'est dans ce contexte général que nous présentons les textes du Congrès qui portent sur trois thèmes principaux :
- Un rapport sur la situation internationale dans lequel est tracés l'évolution actuelle du renforcement de la tendance vers le capitalisme d'Etat dans le bloc de l'Ouest et dans le bloc de l'Est, mettent en relief le développement de l'économie de guerre, réponse du Capital à la crise et les antagonismes inter-impérialistes évoluant, de guerres locales vers une généralisation. Nous tentons d'approfondir à la lumière des événements actuels les analyses de l'économie de guerre faites par la Gauche Communiste dans les années 30.
- Une résolution sur les groupes politiques prolétariens, marquant l'effort de cerner les différents éléments qui constituent le milieu révolutionnaire de notre période, éléments différents de ceux des Partis de masse d'autrefois. Ce texte situe le CCI dans un contexte plus général du développement de la conscience de classe en soulignant la volonté de rejeter le sectarisme et toute prétention à l'exclusivité, chère aux bordiguistes. Cette résolution aborde les groupes politiques et non les cercles de discussion qui peuvent surgir en milieu ouvrier : ces surgissements éphémères, expressions historiques et actuelles de la faiblesse de la présence des organisations révolutionnaires, seront traités spécifiquement dans d'autres textes.
- Sur la période de transition du capitalisme au communisme, le lecteur trouvera deux projets synthétisant le niveau atteint par la discussion dans le CCI. Bien que l'orientation du premier texte ait suscité l'accord de la plupart des membres de l'organisation, le Congrès a préféré ne pas se contenter d'un vote formel sur cette question, considérant qu'il est plus important actuellement de poursuivre plus avant cette discussion et ceci publiquement. Notre principal souci reste en effet la clarification théorique, non seulement dans le CCI mais en stimulant les contributions d'autres courants et éléments révolutionnaires à ce débat complexe.
[1] [5] Revue Internationale n°5
[2] [6] Révolution Internationale n°22
[3] [7] Revue Internationale n°10 et textes de la Conférence Internationale (brochures) (ronéoté en Français et Anglais, n° spécial de "Prométéo" bilingue français-italien)
[4] [8] Les textes de cette scission et une mise au point sur les discussions seront publiés dans le prochain numéro de la Revue Internationale ainsi que dans "Revolutionary Perspectives" (organe de la CWO à notre critique parue clans les n°s 9 et 10 de la Revue Internationale)
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
De la crise à l’économie de guerre
- 2683 reads
Ce rapport sur la situation internationale tente de tracer les perspectives politiques et économiques fondamentales que au cours de l'année à venir. Plus qu'une analyse détaillée de la conjoncture économique et politique actuelle même dans les principaux pays capitalistes -analyses qui se poursuivent aujourd'hui de façon régulière dans les publications des différentes sections territoriales du Courant Communiste International-, nous nous efforcerons de donner les lignes essentielles, les axes fondamentaux qui vont déterminer le cours de l'économie capitaliste pour l'année prochaine et qui vont dessiner l'orientation politique des diverses bourgeoisies nationales et les actions des deux blocs impérialistes. Nous espérons ainsi élaborer une perspective cohérente pour guider l'intervention du CCI dans les batailles de classe décisives qui se préparent de plus en plus : perspective qui sera un des éléments pour que le CCI devienne de plus en plus un facteur actif du développement de la conscience du prolétariat, pour que le CCI puisse devenir un élément vital de l'orage prolétarien qui déracinera et détruira l'Etat capitaliste dans le monde entier et ouvrira la transition au Communisme.
Malgré les proclamations triomphales de "reprise" avec lesquelles politiciens et hommes d'Etat bourgeois ont tenté de calmer leur faim croissante et ont appauvri le monde, ces deux dernières années, la crise économique capitaliste globale s'est approfondie sans relâche. Dans les pays industrialisés du bloc américain (OCDE), la croissance du PNB réel et des exportations a décliné depuis le début de 1977 (voir tableau ci-dessous). Cependant, même ces sombres tableaux n'arrivent pas à traduire la situation catastrophique dans laquelle les pays européens les plus faibles économiquement, comme la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et le Portugal se trouvent aujourd'hui. Des PNB quasiment stagnants, un effondrement des investissements dans des nouvelles branches et des déficits énormes du commerce et des balances de paiements, ont mené â une dévaluation de fait de leurs monnaies, une chute vertigineuse des réserves d'échange et une poussée des dettes extérieures.
Il en est résulté une hyper-inflation (Grande-Bretagne, 16-17% ; Italie, 21% ; Espagne, 30% ; Portugal, plus de 30%) et un chômage massif (Grande-Bretagne, 1,5 million ; Italie, 1,5 million ; Espagne, 1 million ; Portugal, 500.000 soit 18% de la population officiellement).
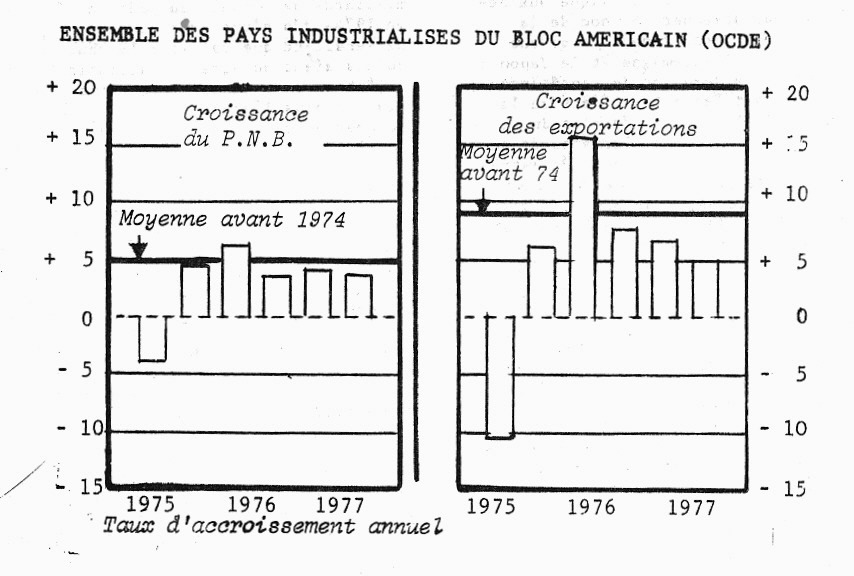
Ces quatre pays sont réellement en faillite et ne sont maintenus à flot que par les prêts et les crédits qui dépendent en dernier ressort du bon vouloir des Etats-Unis. La bourgeoisie de ces hommes malades de l'Europe ne parle même plus de "reprise" ou de "croissance" ; le nouveau mot d'ordre est "stabilisation", euphémisme pour l'austérité draconienne, la déflation et la stagnation auxquelles ils sont condamnés par leur faiblesse économique et les dictats de leurs créanciers. Qui plus est, les rangs de ces hommes malades commencent à être rejoints par la France, la Belgique, le Danemark, la Suède et le Canada, pays dont la puissance économique n'était pas mise en question dans les cercles bourgeois il y a quelques années, mais qui s'enfoncent maintenant rapidement dans le marécage des déficits incontrôlables du commerce et des paiements, des dévaluations, des dettes accrues, de l'hyper-inflation et du chômage montant en flèche, auxquels ont déjà droit leurs proches voisins.
Un coup d'oeil sur les économies puissantes du bloc américain -Etats-Unis, Allemagne, Japon- révèle rapidement une extrême fragilité et de sombres perspectives pour ces mêmes économies qui semblent fortes. La santé apparente de l'Allemagne et du Japon -avec leurs importants surplus commerciaux et leurs monnaies robustes- repose presque exclusivement sur de gros efforts d'exportation massive et un dumping systématique. Parallèlement, les Etats-Unis ont bénéficié d'une série de mesures inflationnistes qui sont arrivées maintenant à leur terme et du fait que le déficit de leur commerce a largement été compensé par d'énormes bénéfices invisibles (paiements d'intérêts, profits d'investissements à l'étranger, transfert de capitaux, etc.) qui échoient au chef de file d'un bloc impérialiste. En effet, bien qu'ils se défendent de s'adonner à une politique aux dépens du voisin pour atténuer le choc de la crise mondiale, c'est précisément ce qu'ont fait les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon ; ils n'ont présenté un semblant de santé économique qu'en reportant les pires effets de la crise sur les nations les plus faibles du bloc. Cependant avec la chute alarmante de nouveaux investissements, avec les mesures extrêmes que prennent les pays au commerce en déficit pour réduire leurs importations, les possibilités pour les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon d'atteindre leurs objectifs de croissance prévus pour 1977 (Etats-Unis, 5,8% ; Allemagne, 5% ; Japon, 6,7%) et de réduire par là leur chômage déjà dangereusement élevé (Etats-Unis, 6,7 millions ; Allemagne, 1,4 million ; Japon, 1,4 million) sans même parler de fournir un quelconque stimulant à leurs "partenaires" plus faibles, apparaissent de plus en plus hypothétiques. Et aucun des trois grands ne se mettra ardemment à relâcher cette pression par de nouveaux budgets inflationnistes, confrontés qu'ils sont au spectre de l'inflation galopante qui se rapproche à nouveau d'un taux à deux chiffres aux Etats-Unis (6,4%) et au Japon (9,4%).
Dans le bloc russe (COMECON), même les bureaux de planification étatiques doivent maintenant reconnaître la présence et l'accroissement du chômage et de l'inflation - effets sans équivoque d'une production capitaliste et de sa crise permanente. L'activité économique du bloc russe a été soutenue par 35 à 40 milliards de dollars en prêts des banques occidentales au cours de ces dernières années (en partie de l'explosion du crédit du bloc américain dans un effort vain de compenser la saturation du marché mondial). Le bloc russe s'est maintenant lancé dans une course à 1'exportation massive, une quête frénétique de marchés du résultat de laquelle dépend le remboursement de ses énormes prêts. Mais cette offensive à l'exportation massive arrive au moment où les pays du bloc américain s'orientent désespérément vers un freinage de la pénétration des importations et où les pays du tiers-monde sont à deux doigts de la banqueroute, mais encore tombe sur les barrières mises à l'octroi de nouveaux prêts (résultant à la fois de considérations financières et politiques) sans lesquels le bloc russe ne peut acquérir la nouvelle technologie qui seule -conjointement avec les attaques planifiées contre la classe ouvrière- pourrait rendre ses marchandises compétitives sur le marché mondial. Ainsi, pares la flambée du commerce et des échanges avec le bloc américain entre 1971 et 1976, le bloc russe se retrouve dans un cul-de-sac économique.
Le "tiers-monde" -y compris les quelques puissances industrielles de second ordre comme l'Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, etc.- s'enfonce chaque jour de plus en plus profondément dans une barbarie croissante. Le monde de cauchemar, de faim, de misère, de camps de travail et de mendicité auquel le capitalisme décadent condamne l'humanité, est déjà une réalité dans des pays constituant les deux tiers de la population mondiale. Les 78 milliards de dollars en prêts au "tiers-monde" en 1974-1976 n'ont pratiquement rien fait pour ne serait-ce que ralentir la chute totale (bien qu'ils aient pu être un palliatif temporaire à l'absence de demande effective condamnant de plus en plus l'appareil industriel du monde à tourner au ralenti). Etant donné la banqueroute complète du "tiers-monde", les nouveaux fonds à venir -à une échelle nettement moindre- ne serviront qu'à reculer l'impossible remboursement des dettes et la faillite qui en découlerait pour les principales banques occidentales. L'austérité brutale que les régimes du "tiers-monde" -"socialistes", "marxistes-léninistes", "nationalistes" et "démocratique”- imposent de plus en plus dans un effort désespéré pour réduire les invraisemblables déficits commerciaux (22 milliards de dollars en 1976 pour les pays importateurs de pétrole avec les seuls pays de l'OCDE) nés de leur dépendance des exportations agricoles et de matières premières, sera le verdict pour les masses.
Nous pouvons mieux comprendre pourquoi la perspective qu'affronte le capital mondial aujourd'hui est une chute inévitable de la production et du commerce, si nous regardons la nature,les fondements et les limites de l'apparent tournant dans la production et le commerce pendant l'hiver 1975-1976 qui a suivi la chute exceptionnelle de 1975 et l'accélération de la production (mais non du commerce) qui a eu lieu l'hiver passé après l'accalmie de l'été dernier. La chute de 1975 a été enrayée en premier lieu par l'intervention hâtive de budgets réflationnistes et une nouvelle explosion massive du crédit, la création de capital fictif, qui peut, pour un court moment, une fois encore compenser la saturation des marchés sous-jacente à la crise mortelle du capitalisme. Il faut ajouter à ces deux facteurs, d'une part le bond dans l'armement dû au re-stockage qui a suivi la chute des stocks alors que la production coulait, d'autre part, la chute de l'épargne des classes moyennes qui a provoqué un mini-boom dans les biens de consommation (voitures, etc.), moins due à une quelconque confiance dans la reprise qu'à une conviction assurée du caractère permanent de l'inflation. Ces deux derniers facteurs ont servi à ce que la croissance des pays de l'OCDE atteigne 7-8% en PNB réel au cours de l'hiver 1975-76, tandis que seule l'explosion du crédit et les mesures fiscales gouvernementales soutiennent le beaucoup plus fragile "bout du tunnel" entrevu cet hiver.
Aujourd'hui, ce qui empêche la poursuite de l'explosion du crédit - sans lequel le commerce mondial se réduirait - apparaît dans ce qui menace de plus en plus les gros emprunteurs comme le Zaïre, le Pérou, le Mexique et le Brésil, les gigantesques déficits du commerce et des paiements qui harcèlent les "tiers-monde", le bloc russe et les pays les plus faibles du bloc américain ? Les sources du crédit se tarissent comme la capacité des pays débiteurs à rembourser leurs dernières dettes. Les nouveaux prêts aux pays du "tiers-monde" -fournis sans enthousiasme par le FMI (Fonds Monétaire International) plutôt que par les banques privées à sec- serviront à assurer le remboursement des prêts précédents avec les intérêts, et non à financer un flux continu de marchandises ; de plus, de tels prêts dépendront du strict contrôle sur les économies des pays débiteurs et l'exigence qu'ils réduisent ou éliminent leurs dettes en diminuant de façon drastique leurs importations. A cette pression considérable qui va contracter le commerce mondial, viennent s'ajouter les limitations politico-financières d'un nouveau bond des prêts massifs au bloc russe sans lesquels le commerce entre les deux blocs déclinera. Finalement, les pays en déficit du bloc américain ont été conduits à la limite de la faillite par leurs énormes dettes et le déficit de leurs balances de paiements. Ayant atteint les limites de leur solvabilité, confrontés â la crise économique, ces pays doivent, soit opter pour le protectionnisme et l'autarcie, soit accepter les ordres et la discipline - ce qui signifie encore des limitations strictes aux importations et une contraction plus avancée du commerce mondial.
Le rétrécissement du commerce mondial ne peut être compensé par une forte hausse de la demande dans les centres industriels vitaux du capitalisme. Les obstacles 2 la poursuite (sans parler d'accélération) des stimulants fiscaux qui ont été pratiquement la seule base de la plus haute demande dans les pays industrialisés du bloc américain, empêchent le lancement de quelconques "programmes de reprise" ambitieux et l'introduction de budgets inflationnistes ou de politiques aptes à permettre un nouveau bond de la production.
Dans ces pays frappés par l'hyper-inflation, tant que les conditions politiques (le niveau de la lutte de classe) le permettent, les coupes sombres dans les "dépenses publiques", la restriction du crédit, en d'autres termes, la politique déflationniste est une nécessité. Dans les économies 'fortes" (Etats-Unis, Allemagne, Japon), la bourgeoisie est très hésitante de peur de laisser libre court à l'hyperinflation que le déploiement de mesures d'austérité a pour le moment tenue en échec. Si les stimulants fiscaux gouvernementaux ne peuvent plus être utilisés comme avant pour empêcher une chute de la production, le plongeon n'en sera que plus dévastateur du fait du déclin catastrophique actuel de nouveaux investissements industriels. Le refus d'investir de la part de la bourgeoisie est lié â la chute prodigieuse et continue du taux de profit depuis que le capital mondial a replongé dans la crise ouverte en 1967 environ. Ce phénomène est illustré par la situation du capital allemand (qui a indiscutablement étalé les premiers assauts de la crise ouverte mieux qu'aucun autre pratiquement) où le taux de profit, après taxes, était de 6 7, pour la période 1960-67, 5,3% pour 1967-71 et 4,1% en 1972-75. La baisse du taux de profit s'est accélérée du fait de l'accroissement des dépenses improductives de l'Etat au fur et à mesure des tentatives de contrebalancer les effets de la saturation du marché mondial, et du fait de contenir les antagonismes de classe portés au rouge par l'approfondissement de la crise. Ceci, et les taux d'intérêts élevés avec lesquels la bourgeoisie tente désespérément de combattre l'hyper-inflation que ces dépenses improductives -mais nécessaires- ont engendrée, réduisent les investissements (particulièrement dans le secteur 1, la production des moyens de production), à tel point qu'une chute de la production se profile menaçante à l'horizon.
L'échec des efforts des différents gouvernements pour stimuler leurs économies et surmonter le les effets de la crise en alternant plans et budgets de "reprise" et d'austérité, inflation galopante et simultanément récession, la persistance et l'aggravation d'une explosion du crédit et simultanément de la chute ravageuse des investissements, la persistance et l'aggravation de la diminution des taux de profit et parallèlement de dépenses "publiques" sans précédent, le chômage massif et d'énormes déficits budgétaires, tout cela montre la faillite totale du Keynésianisme, de la confiance dans la politique fiscale et monétaire, qui a été la pierre angulaire de la politique économique bourgeoise depuis le resurgissement de la crise ouverte en 1967. L'impossibilité de stimuler l'économie sans relancer l'hyper-inflation , l'impossibilité de contrôler l'inflation sans une chute vertigineuse de la production et des profits, les moments toujours plus courts d'oscillations entre récession et inflation galopante, en fait, le caractère permanent et simultané de la récession et de l'inflation, ont démoli les théories économiques (sic) sur lesquelles la bourgeoisie a fondé sa politique.
L'impuissance d'une politique fiscale et monétaire devant un nouveau plongeon du commerce mondial et de la production, impose à la bourgeoisie une nouvelle politique économique pour affronter sa crise mortelle.
La bourgeoisie doit tenter d'échapper à l'effondrement des politiques keynésiennes en recourant de plus en plus à un contrôle totalitaire et direct sur l'ensemble de l'économie par l'appareil d'Etat. Et si d'importantes fractions de la bourgeoisie hésitent encore à admettre que le Keynésianisme a fait son temps, ses représentants les plus éclairés n'ont aucun doute sur le choix à faire. Les porte-parole des groupes financiers et industriels dominants des Etats-Unis l'expriment ainsi :
"Si la politique monétaire et fiscale peut ramener l'équilibre dans l'économie, c'est tout ce dont on a besoin. Toutefois, si les plans échouent, le gouvernement, les syndicats et le patronat peuvent tous s’attendre à une intervention (de l'Etat) à une échelle qui_ ne connaît pas de précédent dans l'histoire". (Business Week, 4.4.77)
Les révolutionnaires doivent être absolument clairs sur la nature des pas que la crise permanente du capitalisme impose à chaque fraction de la bourgeoisie, dans le sens du renforcement du capitalisme d'Etat, nouvelle phase dans l'évolution qu'affronte notre classe :
"Le capitalisme d'Etat n'est pas une tentative de résoudre les contradictions 'essentielles du capitalisme en tant que système d'exploitation de la force de travail mais la manifestation de ces contradictions. Chaque groupe d'intérêts capitaliste essaie de rejeter les effets de la crise du système sur un groupe voisin, en se l'appropriant comme marché et champ d'exploitation. Le capitalisme d'Etat est né de la nécessité pour ce groupe d'opérer sa concentration et de mettre sous sa coupe les marchés qui lui sont extérieurs. L'économie se transforme donc en une économie de guerre". ("'L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective", Internationalisme 1952, republié dans le Bulletin d'Etudes et de Discussion n°8 de RI, p.8/9).
L'économie de guerre qui surgit sur les décombres du keynésianisme n'est en rien une sortie pour la crise mondiale ; ce n'est pas une * politique économique qui peut résoudre les contradictions du capitalisme ou créer les fondements d'une nouvelle étape du développement capitaliste. L'économie de guerre ne peut être comprise qu'en termes d'inévitabilité d'une autre guerre mondiale impérialiste si le prolétariat ne met pas fin au règne de la, bourgeoisie : elle est le cadre indispensable pour les préparatifs de la bourgeoisie à la conflagration mondiale que les lois aveugles du capitalisme et l'approfondissement inexorable de la crise lui imposent. La seule fonction de l'économie de guerre est... la GUERRE ! Sa raison d'être est la destruction effective et systématique des moyens de production et des forces productives et la production des moyens dé destruction - la véritable logique de la barbarie capitaliste.
Seule la mise en place d'une économie de guerre peut maintenant empêcher l'appareil productif capitaliste de s'enrayer. Pour établir pleinement une économie de guerre, cependant, chaque fraction nationale du capital doit :
- soumettre tout l'appareil de production et de distribution au contrôle totalitaire de l'Etat et orienter l'économie vers un seul but : la guerre ;
- réduire férocement la consommation de toutes les classes et couches sociales ;
- accroître massivement le rendement et le degré d'exploitation de la seule classe source de valeur, de toute richesse : le prolétariat.
L'énormité et la difficulté d'une telle entreprise sont la cause de la crise politique croissante dans laquelle se trouve empêtrée la bourgeoisie de chaque pays. L'organisation totalitaire de l'économie et son orientation vers un seul but fait souvent surgir d'âpres luttes entre fractions de la bourgeoisie, du fait que ces fractions aux intérêts particuliers qui seront sacrifiés, combattent contre l'immolation sur l'autel de l'étatisation. La réduction de l'ensemble de la consommation que l'économie de guerre nécessite, provoque d'incessants remous et une âpre opposition dans les rangs des couches moyennes, de la petite-bourgeoisie et des paysans. Mais c'est l'assaut contre le prolétariat -parce qu'il risque d'ouvrir la porte à une guerre de classe généralisée- qui n'est pas seulement la tâche la plus difficile à accomplir par la bourgeoisie dans la situation présente mais encore est la véritable clé de la constitution de l'économie de guerre. L'économie de guerre dépend de façon absolue de la soumission physique et/ou idéologique du prolétariat à l'Etat, du degré de contrôle que l'Etat a sur la classe ouvrière.
Toutefois, l'économie de guerre à l'époque actuelle, n'est pas seulement mise en place à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle d'un bloc impérialiste. L'incorporation dans un des deux blocs impérialistes -chacun dominé par un capitalisme d'Etat continental et colossal, les Etats-Unis et l'URSS- est une nécessité â laquelle même les grandes puissances anciennement impérialistes comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et le Japon, ne peuvent résister. La tendance puissante de la part des Etats-Unis et de la Russie à coordonner, organiser et diriger le potentiel de guerre de leur bloc, intensifie la crise politique de chaque bourgeoisie nationale du fait, d'une part, de la pression à se soumettre aux exigences de consolidation du bloc impérialiste, d'autre part, du besoin de défendre l'intérêt du capital national et engendre des tensions accrues et irrésistibles.
Nous allons voir maintenant les problèmes spécifiques auxquels s'affronte la bourgeoisie aux Etats-Unis et dans le bloc américain et dans le bloc russe, dans l'organisation de leur économie de guerre pour surmonter les différentes résistances qu'elle suscite et pour résoudre leurs crises politiques. Nous verrons ensuite l'accroissement des oppositions inter-impérialistes dans le monde qui mènent inexorablement, quoique graduellement les deux blocs impérialistes vers la guerre mondiale. Finalement, nous tracerons les perspectives d'intensification de la lutte de classe du prolétariat, les obstacles et les tendances à la guerre de classe généralisée.
Les Etats-Unis et le bloc américain
Au cours de ses premiers mois, comme président des Etats-Unis, Jimmy Carter a infligé des coups sévères aux Keynésiens orthodoxes de son administration en combattant le budget initial inflationniste (par l'élimination des réductions de taxes, proposées et des crédits aux nouveaux investissements), Carter a présenté un budget moins large que celui proposé par son prédécesseur Républicain, Gérald Ford. Mais si Carter et son équipe ont vu les limites du Keynésianisme, ils n'ont certainement pas fait battre en retraite le "conservatisme fiscal" et le monétarisme que beaucoup de Républicains tiennent pour la seule réponse gouvernementale à la crise et au spectre de l'inflation galopante. L'administration Carter a vu la totale futilité des tentatives d'arrêter la crise en comptant sur une politique monétaire et fiscale (stimulante ou restrictive) et commence à engager les Etats-Unis vers une nouvelle phase d'économie de guerre et de totalitarisme étatique.
Le seul poste du budget américain â s'accroître à un taux prodigieux est la recherche et la production d'armements. Le boni en avant probable -qui dépend du résultat des pourparlers SALT- des têtes nucléaires Mk-12a ("silo-buster") et des bombardiers B-1 n'est que le commencement d'une nouvelle explosion des armements qui deviendra l'axe de l'activité économique. Qui plus est, les initiatives récentes de l'administration Carter pour soumettre les exportations d'armes plus directement aux intérêts stratégiques américains, et pour limiter l'extension de la technologie nucléaire qui fournit le plutonium sous une forme utilisable pour la fabrication de bombes, ne sont pas des pas vers la limitation des armements, mais beaucoup plus une partie d’une politique d'ensemble pour consolider le bloc américain autour de la domination exclusive des Etats-Unis et pour soumettre l'armement et son développement exclusive, au contrôle, à la volonté et aux visées de l'impérialisme américain.
L'orientation résolue de l'administration Carter vers une économie de guerre et son accélération vers le capitalisme d'Etat apparaît clairement dans sa politique de l'énergie, ses propositions pour l'extension de l'importance et l'échelle du stockage, et ses pas vers la cartellisation du commerce mondial. Les nécessités d'une économie de guerre ont amené le gouvernement à commencer une politique nationale de l'énergie par la mise en place d'agences d'Etat et la proposition de créer une super agence dirigée par un responsable de l'énergie. L'État américain entend dicter le prix de l'énergie, les sortes d'énergie à utiliser et les quantités d'énergie â allouer aux différentes régions et aux divers types de production et de consommation. L'insistance de la politique d'énergie sur les économies est le fer de lance de l'effort de restreindre la consommation de toutes les classes et couches sociales (bien qu'en premier lieu, ce soit pour la classe ouvrière), l'austérité brutale qui est la base d'une économie de guerre. Le développement de nouvelles sources d'énergie pour à la fois assurer "l'indépendance" de l'Amérique en matière d'énergie en temps de guerre, et rendre les autres pays de bloc totalement dépendants des Etats-Unis, va se faire au travers de l'étatisation de l'industrie de l'énergie. L'étatisation complète de l'énergie se produit de deux façons. D'abord, l'Etat américain possède directement la plupart des ressources énergétiques restantes du pays :
"Les meilleures possibilités pour le pétrole et le gaz naturel se trouvent dans les gisements offshore des eaux fédérales. La production de charbon se déplace vers l'ouest où le gouvernement contrôle la plupart des concessions minières même l'uranium de la nation se trouve en grande partie dans le domaine public". (Business Week, 4.4.77)
Ensuite, le développement de la technologie nucléaire et de l'infrastructure nécessaire au traitement du charbon exigent un plan d'Etat et un capital d'Etat, comme le reconnaissent en personne les porte-parole des monopoles des Etats-Unis :
"Développer et mettre en oeuvre une telle technologie nécessaire à grande échelle, dicte des ajustements économiques importants - par exemple, des prix du pétrole plus élevés et la formation massive de capital. Seul, le gouvernement semble capable de diriger un tel effort aussi titanesque". (Ibid)
L'équipe Carter envisage aussi une expansion massive des stocks du gouvernement américain, en ajoutant des stocks "économiques" aux 7,6 milliards de dollars de réserve militaire stratégique de 93 marchandises. Les réserves stratégiques sont faites en vue d'assurer le ravitaillement en cas de guerre. Les stocks économiques de matières premières clés permettent à l'Etat américain de contrôler les prix S la consommation et de faire pression sur les produits étrangers pour casser les prix, à travers sa capacité de mettre en circulation les marchandises stockées sur le marché.
Finalement, l'Etat américain est à l'avant-garde du mouvement de cartellisation du commerce mondial. Par opposition aux cartels Internationaux qui ont dominé le marché mondial à l'époque du capitalisme monopoliste, et qui ont été établis par des trusts "privés", un nouveau type de cartellisation appropriée à l'époque du capitalisme d'Etat et de l'économie de guerre, apparaît. Les cartels organisés aujourd'hui pour fixer et régulariser les prix des matières premières importantes, et pour déterminer le partage des marchés clés à répartir aux différents capitaux nationaux, sont négociés et dirigés directement par les divers appareils de l'Etat.
Deux types de cartels ont été impulsés par l'administration Carter. Les premiers sont les cartels de marchandises qui englobent à la fois pays importateurs et exportateurs, et qui déterminent la marge des prix acceptable et régularisent le mouvement des prix par l'utilisation de stocks-tampons dans les mains soit des gouvernements, soit du cartel. Les Etats-Unis sont maintenant en voie d'organiser de tels cartels pour le sucre et le blé, qui peuvent être lés premiers venus de cartels pour d'autres matières premières et produits agricoles. De tels cartels de marchandises organisés par l'Etat vont tenter de stabiliser les prix des matières premières, élément â la base de toute planification économique d'ensemble, contrebalançant la baisse du taux de profit, tout autant que facilitant une stratégie de "nourriture bon marché", qui abaisserait la valeur de la force de travail et par là-même atténuerait la voie vers une compression des salaires de la classe ouvrière -tout ce qui forme les ingrédients nécessaires â l'économie de guerre.
Le second type de cartels est une réponse directe au rétrécissement du marché mondial et implique une planification étatique non pour l'expansion mais pour la contraction du commerce mondial. Ce qui est mis en place, ce sont des accords entre Etats exportateurs et importateurs pour fixer quotas ou partages d'un marché national pour des marchandises spécifiques pour de nombreux capitaux nationaux en compétition. Les Etats-Unis ont récemment arrangé ce qu’ils nomment avec euphémisme des "accords de discipline de marché" avec le Japon sur les aciers spéciaux et les appareils de TV (ce dernier réduira les importations japonaises aux Etats-Unis de 40%), et sont maintenant en voie de négocier des accords pour diviser les marchés mondiaux pour les textiles, les vêtements, les chaussures et l'acier. Ces cartels représentent l'alternative de Washington à une orgie de protectionnisme et d'autarcie de la part de chaque capital national au sein du bloc américain, un rétrécissement organisé et coordonné des marchés, pour tenter de préserver la cohésion du bloc de l'impact de la crise mondiale.
Parallèlement à ces étapes pour consolider une économie de guerre, l'administration Carter a brandi une nouvelle idéologie de guerre -la croisade pour les "droits de l'homme". A l'époque des guerres mondiales impérialistes, quand la victoire dépend avant tout de la production, quand chaque ouvrier est un "soldat", une idéologie capable de plier l'ensemble de la population à l'Etat et inculquant une volonté de produire et dé se sacrifier est une nécessité pour le capitalisme. Gui plus est, à l'époque où les guerres ne sont pas des combats entre nations mais entre blocs impérialistes, le chauvinisme national seul n'est plus une idéologie suffisante. Comme la bourgeoisie prépare une nouvelle le boucherie mondiale, la lutte pour les "droits de l'homme" remplace l'anti-communisme dans l'arsenal idéologique des impérialismes "démocratiques" du bloc américain, comme ils commencent à mobiliser leurs populations pour la guerre avec les "dictatures totalitaires" du bloc russe (d'autant plus que les pays comme la Chine qui sont incorporés au bloc américain ont des régimes "communistes" et que la participation dans les gouvernements de plusieurs pays d'Europe de l'Ouest des partis "communistes" est prévisible. Derrière les appels moralisateurs de Jimmy Carter à la reconnaissance universelle des droits de l'homme, s'aiguisent les sabres américains.
L'organisation d'une économie de guerre pleinement développée aux Etats-Unis ne se met toutefois pas en place sans une furieuse résistance de la part de beaucoup d'intérêts bourgeois puissants. En particulier, les milieux d'affaires agricoles du "Middle West" s'opposent â ce qu'ils perçoivent comme une stratégie de "nourriture bon marché" ; l'acier, le textile, la chaussure et beaucoup d'autres industries se battent pour un protectionnisme, considérant le souci du gouvernement de la cohésion et de la stabilité du bloc impérialiste mondial comme une trahison de l'industrie américaine ; les intérêts pétroliers du sud-ouest s'opposent violemment à la politique d'énergie de Carter. Tous ces groupes s'organisent pour défendre des intérêts particularistes en résistant à l'étranglement par l'Etat-léviathan de l'ensemble de l'économie. Plus encore, ils essaient de mobiliser des légions de petits et moyens capitalistes (pour qui le capitalisme d'Etat est la sentence de mort) tout comme les classes moyennes désenchantées pour résister au courant d'étatisation, Néanmoins, ce sont les intérêts du capital national global - qui exigent absolument une économie de guerre - qui vaincront dans toute lutte au sein de la bourgeoisie, et ce sont ces fractions de la bourgeoisie qui reflètent au plus près ces intérêts qui dicteront en dernière instance l'orientation de l'Etat capitaliste et détermineront sa politique.
Du fait du décalage qui ne cesse d'augmenter entre le poids économique relativement croissant des Etats-Unis et l'économie affaiblie de l'Europe et du Japon, les Etats-Unis ont la capacité de déterminer, de dicter les priorités économiques et l'orientation des autres pays de son bloc. Oui plus est, avec l'intensification de la crise au sein même de l'Amérique, les Etats-Unis vont avoir de plus en plus à détourner les pires effets de la crise sur l'Europe et le Japon (dans les limites qui ne détruisent pas la cohésion d'ensemble du bloc). Les Etats-Unis mettent maintenant en place une politique visant au rationnement de l'Europe. La manière par laquelle le capital américain impose l'austérité sur les pays en faillite de l'Europe, se trouve dans sa capacité à accorder ou refuser les crédits sans lesquels l'Europe se trouve confrontée à la ruine économique, et par conséquent à contraindre les "hommes malades" du continent à placer le contrôle de leurs économies dans les mains de leur créditeur américain. A la différence des années 20, lorsque les prêts désespérément demandés étaient largement fournis par les banques privées, aujourd'hui -dans des conditions dominantes de capitalisme d'Etat- la masse des crédits est canalisée par des institutions d'Etat ou semi-publiques comme le Trésor, le Système Fédéral de Réserve ou le Fonds Monétaire International, contrôlés par Washington. On a pu voir les plans du capital américain, pour d'un côté réduire énergiquement la consommation en Europe, et d'un autre côté imposer plus fermement à l'Europe les impératifs d'une économie de guerre construite à l'échelle de l'ensemble du bloc impérialiste, dans les négociations récentes du FMI sur les prêts à la Grande-Bretagne, l'Italie et le Portugal. Comme condition du prêt de 3,9 milliards de dollars, le FMI a tenu à ce que la Grande-Bretagne garantisse de ne pas imposer de contrôles permanents de l'ensemble des importations et de ne pas instituer de restrictions monétaires, garanties qui éliminent la possibilité de mesures protectionnistes ou autarciques qui pourraient briser le bloc ou mettre en danger les intérêts américains. Dans le cas de l'Italie, les conditions du FMI au prêt de 530 millions de dollars ont été un début de démantèlement du système d'indexation qui fait automatiquement les ajustements de salaires quand les prix montent, des limites et des contrôles sur les dépenses publiques locales et nationales, et un veto du FMI à l'expansion du crédit. La demande du Portugal d'un prêt d'1,5 milliard de dollars au FMI a rencontré une exigence de dévaluation de 25% de l'escudo pour attaquer les salaires réels et réduire les importations (dont 20% sont de l'alimentation) ; et dans ce cas, les portugais ont dévalué de 15% et les coffres américains ont commencé à s'ouvrir.
Comme partie intégrante de cette politique pour assurer la stabilité de l'ensemble du bloc américain, les Etats-Unis se sont efforcés de répartir l'impact de la crise mondiale plus régulièrement dans son bloc (Amérique mise â part), en imposant à l'Allemagne de l'Ouest et au Japon une politique d'assistance et de soutien aux économies de ces pays d'Europe qui sont prêts de 1'effrondement. Ainsi, les Etats-Unis pressent l'Allemagne et le Japon de réévaluer pour fournir aux pays plus faibles des marchés et réduire de façon significative leurs exportations -ce qui a été en partie accompli au travers d'une réévaluation du mark et du yen. La hausse de la valeur des monnaies allemande et japonaise va ainsi aider à contenir l'offensive des exportations vers l'Amérique, et â réduire la compétitivité des deux principaux rivaux commerciaux des Etats-Unis. Cette politique a commencé à porter ses premiers fruits, puisque le gouvernement Fukuda du japon a laissé le yen s'élever de plus de 7% par rapport au dollar entre janvier et avril 1977.
Si l'une des bases de l'étranglement de l'ensemble des économies des son bloc par l'Amérique est la suprématie de sa puissance financière, son contrôle des ressources d'énergie vitales en est une autre. C'est la "Pax americana" de Washington au Moyen-Orient qui assure à l'Europe et au Japon le pétrole dont dépend maintenant le fonctionnement de leur appareil productif. La ferme opposition des Etats-Unis au développement et à l'extension des réacteurs nucléaires à haut rendement qui produisent leur propre plutonium comme source d'énergie, est en partie due au fait qu'une telle technologie pourrait potentiellement rendre les économies de l'Europe et du Japon indépendantes de l'Amérique en ce qui concerne l'énergie. En abandonnant le développement des réacteurs à haut rendement, les Etats-Unis ne se sacrifient en rien, puisque leurs réserves d'uranium sont là pour faire de l'utilisation de la puissance nucléaire quelque chose de compatible avec le but américain d'indépendance en matière d'énergie. Pour l'Europe et le Japon cependant, l'énergie nucléaire qui dépend de l'uranium et du pétrole les condamne à une dépendance absolue des Etats-Unis en matière d'énergie.
Tout en mettant l'Europe sous rationnement et en dictant l'austérité aux pays de son bloc, il est un domaine ou l'Amérique exige une augmentation massive des dépenses et de la production : l'armement. L'exacerbation des tensions inter-impérialistes et les nécessités d'une économie de guerre ont déjà amené les Etats-Unis à presser ses alliés de l'OTAN â accroître leurs budgets militaires. Les économies européenne et japonaise seront désormais de plus en plus organisées pour la production de canons et non de beurre !
Le besoin d'imposer une austérité draconienne, d'accélérer la tendance qu capitalisme d'Etat, de lancer une attaque contre le prolétariat (dans des conditions d'accroissement de la lutte de classe), et d'ajuster leurs politiques aux diktats américains, a amené les bourgeoisies de l'Europe et du Japon dans les filets d'une crise politique grave. La nature des tâches que ces bourgeoisies doivent essayer d'accomplir, dicte entièrement un cours qui, graduellement ou brutalement (en fonction de la vitesse avec laquelle une économie donnée s'effondre ou de l'acuité de la lutte de classe), amènera la gauche au pouvoir. Dans la conjoncture présente, ce sont des gouvernements de gauche dominés par les partis socialistes et basés sur les organisations syndicales, ou des fronts populaires qui comprennent les partis staliniens, qui sont le mieux adaptés aux besoins de la bourgeoisie.
Parce qu'elle n'est pas liée au capital "privé" aux intérêts particuliers au sein du capital national et aux fractions anachroniques de la bourgeoisie (caractéristique de la droite), la gauche peut mieux imposer le contrôle totalitaire et centralisé de l'Etat sur l'ensemble de l'économie et la réduction draconienne de la consommation de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie, marques de l'économie de guerre. Du fait du soutien électoral de la classe ouvrière, de son encadrement à la base et de son idéologie "socialiste", seule la gauche -confrontée à un prolétariat combatif qui devient l'axe de la vie politique- a une chance de dévoyer la lutte de classe et de mettre en place la réduction féroce du niveau de vie du prolétariat, l'intensification de son exploitation et sa soumission idéologique à l'Etat - tout ce dont dépend le succès mortel de l'économie de guerre. Du fait de son atlantisme, son "internationalisme", la gauche (tout au moins les partis socialistes et les syndicats) est la mieux placée pour poursuivre la consolidation d'une économie de guerre à l'échelle de l'ensemble du bloc américain.
On peut, par exemple, voir cette convergence entre gouvernement de gauche et intérêts de. L’impérialisme américain dans les efforts des Etats-Unis d'imposer des politiques économiques différentes selon la force ou la faiblesse des économies de son bloc. Dans les économies plus faibles (Grande-Bretagne, France, Italie, Espagne, Portugal), les Etats-Unis poussent à l'austérité et à la déflation, ce qui cristallise une résistance autour des partis de droite liés au capital "privé" et aux secteurs anachroniques et rétrogrades de la bourgeoisie qui a besoin de subventions massives du gouvernement, de crédit facile et d'une inflation pour maintenir à flot le marché national. Au contraire, c'est le centre-gauche et la gauche qui sont prêts à accepter les "recommandations" du FMI et â imposer les diktats américains. Même la politique de gauche, de nationalisation, qui fait partie intégrante d'une économie de guerre (comme la nationalisation de l'aéronautique et de la construction navale en Grande-Bretagne, ou la nationalisation de Dassault et des monopoles de l'électronique, proposée par le Programme Commun en France), ne mettra pas en péril les intérêts américains et pourra certainement faciliter, le contrôle américain directement au niveau étatique. En Allemagne et au Japon, les Etats-Unis exigent la réévaluation des monnaies et les limitations des exportations, ce qui engendre une opposition considérable de la part de fractions de la bourgeoisie, coalisées autour des partis de droite qui répugnent extrêmement â prendre des mesures de limitation de la compétitivité nationale sur le marché mondial et à ajuster les intérêts du capital national aux intérêts du bloc. C'est au contraire la gauche modérée (SPD en Allemagne, Sociaux-démocrates et aile EDA du parti socialiste au Japon) qui est la plus à même de coordonner les intérêts du capital national et les exigences de l'Amérique.
Le capital américain préfère clairement les Travaillistes, aux Conservateurs en Grande-Bretagne, les. Sociaux-démocrates au Chrétiens-démocrates en Allemagne, au Portugal, Soares et les Socialistes sont mieux adaptés aux intérêts américains que Sa Carneiro et Jaime Neves. En Espagne, Washington veut un gouvernement mené par Suarez avec, participation directe ou indirecte de Felipe Gonzalez et du PSOE et ne tolérerait pas un gouvernement mené par Fraga Iri-barne et l'Alianza Popular. En France, un gouvernement mené par Mitterrand et le parti socialiste a la faveur des américains, plutôt qu'un gouvernement mené par Chirac. Même en Italie, une combinaison Andreotti-Berlinguer est mieux adaptée aux besoins américains qu'un gouvernement mené par Fanfani et l'aile droite des Chrétiens-démocrates.
Et puis, la droite est de plus en plus incapable d'adopter les mesures économiques nécessaires imposées par l'approfondissement de la crise, aussi bien qu'inadéquate à faire face à la menace prolétarienne ; elle est de plus en plus hostile aux intérêts américains, alors que la gauche est le seul véhicule par lequel la bourgeoisie peut de façon réaliste essayer d'établir une économie de guerre dans la conjoncture actuelle. L'inéluctable mouvement de la bourgeoisie vers la gauche semble cependant contredit par .le résultat de récentes élections dans certains pays du bloc américain. Dans nombre de pays, il y a eu une tendance électorale prononcée vers la droite ; victoires de la droite aux élections générales en Australie, Nouvelle Zélande et Suède en 1976 ; gains appréciables du CDU/CSU en Allemagne, la même année ; déplacement considérable vers la droite au Portugal entre les élections d'avril 1975 pour l'Assemblée Constituante et les élections au parlement de l'année suivante ; victoires totales des- conservateurs au parlement et aux élections locales en Grande-Bretagne, cette année ; triomphe des sociaux-chrétiens aux élections générales en Belgique, en avril.
Cette tendance électorale vers la droite se nourrit d'une vague de frustration et de mécontentement de la part des petits et moyens capitalistes, de la petite-bourgeoisie et des classes moyennes, tous ceux qui ont vu leur niveau de vie tomber fortement ces dernières années. Parce que l'Etat capitaliste a hésité à s'attaquer trop directement au prolétariat de peur de provoquer prématurément l'étincelle d'une guerre de classe généralisée ou même d'une vague de grèves massive à laquelle il n'est pas préparé, les classes moyennes -plus fragmentées et qui ne menacent pas directement l'ordre bourgeois- ont été l'objet de beaucoup des premières mesures d'austérité. Il en est résulté que les couches moyennes et leurs frustrations sont devenues momentanément l'axe de la politique dans beaucoup de pays et ceci a provoqué la renaissance électorale actuelle de la droite. Cependant, pour empêcher le krach économique imminent et établir une véritable économie de guerre, la bourgeoisie -malgré ses hésitations- doit rapidement axer son attaque directement contre le prolétariat et tenter d'enrayer la lutte de classe montante qu'elle va provoquer. Et comme la classe ouvrière devient l'axe de la politique. La tendance électorale va bientôt refléter le cours fondamental de la bourgeoisies : un tournant à gauche.
Cependant, même si le déplacement électoral à court terme vers la droite n'a pas altéré ou même ralenti l'évolution résolue de la bourgeoisie vers la gauche dans la constitution des gouvernements (ce qui démontre une fois encore la nature purement décorative des parlements et le caractère seulement mystificateur à l'époque de la décadence capitaliste), si la bourgeoisie avait recherché une ouverture pour effectuer un tournant gouvernemental vers la droite (comme le prétendent les gauchistes), le tournant électoral récent la lui aurait fourni. Au lieu de cela, la bourgeoisie s'est grandement désintéressée des résultats des élections en constituant ou perpétuant une équipe gouvernementale qui exprime le besoin actuel de se baser sur les partis de gauche et les syndicats. Ainsi, en Grande-Bretagne, où une élection générale aurait presque certainement amené le retour d'un gouvernement conservateur, la bourgeoisie tient bon jusqu'à ce que la tendance électorale revienne à la gauche et pour éviter une élection prématurée soutient le gouvernement travailliste avec les votes du parti Libéral. Au Portugal, malgré le Parlement, la bourgeoisie tient à un gouvernement purement socialiste. En Belgique, où les résultats électoraux ont rendu possible un gouvernement Social-Chrétien-Libéral de centre-droit, la bourgeoisie au lieu de cela, est déterminée à constituer un gouvernement Social-Chrétien-Socialiste de centre-gauche avec une base syndicale puissante.
Avec la perspective claire d'une évolution vers la gauche de la bourgeoisie, nous devons maintenant voir la nature des partis staliniens aujourd'hui. La participation des staliniens au gouvernement va devenir de plus en plus, une nécessité pour les bourgeoisies de quelques-uns des pays européens les plus faibles (Italie, France, Espagne), d'autant plus que les staliniens sont les mieux pourvus pour imposer les mesures d'austérité essentielles à la classe ouvrière et dévoyer la lutte de classe. Cependant, la participation stalinienne dans le gouvernement provoque une opposition furieuse -souvent violente- de la part de fractions plus puissantes de la bourgeoisie nationale et une résistance et une méfiance de la part des Etats-Unis. Nous devons être clairs sur le véritable caractère du stalinisme, ses traits distinctifs comme parti bourgeois, pour comprendre ce que sont les sources de cette opposition et de cette méfiance et jusqu'à quel point celles-ci peuvent empêcher que les staliniens n'accèdent au pouvoir.
D'abord, les partis staliniens ne sont pas des partis anti-nationaux ou des agents de Moscou. Tous les partis bourgeois (de droite comme de gauche), quelle que soit leur orientation dans l'arène internationale sont des partis nationalistes :
"A l'époque de l'impérialisme, la défense de l'intérêt national ne peut prendre place qu'au sein du cadre élargi du bloc impérialiste. Ce n'est pas comme une cinquième colonne, comme agent de l'étranger, mais en fonction de son intérêt immédiat ou à long terme, à strictement parler, qu'une bourgeoisie nationale opte pour et adhère à un des blocs qui existe. C'est autour de ce choix pour l'un ou l'autre bloc que la division et la lutte interne au sein de la bourgeoisie prennent place ; mais cette division prend toujours place sur la base d'un seul souci et d'un seul but commun : l'intérêt national, l'intérêt de la bourgeoisie nationale". (Internationalisme, n°30, 1948).
Le nationalisme est et a toujours été la base des partis staliniens, et lorsqu'ils optèrent en 194K) pour le bloc russe, quand se met en place la division de l'Europe entre les deux blocs impérialistes mondiaux, ils n'étaient pas plus une cinquième colonne de Moscou que les sociaux-démocrates ou les chrétiens-démocrates, une cinquième colonne de Washington : ce qui a divisé ces partis bourgeois, était la question de savoir dans quel bloc impérialiste, les intérêts vitaux du capital national seraient les mieux défendus.
Cependant, dans la conjoncture actuelle, alors qu'un changement de bloc de la part d'un des pays d'Europe de l'ouest et du Japon est difficilement possible, sauf à travers la guerre ou -à la dernière limite- par un changement dramatique et fondamental dans l'équilibre mondial entre les deux camps impérialistes, aucune fraction de la bourgeoisie, qui espère avec réalisme venir au pouvoir, ne peut rechercher l'incorporation dans le bloc russe. En ce sens, "l'Eurocommunisme" est la reconnaissance par les staliniens que les intérêts de leurs capitaux nationaux excluent aujourd'hui un changement de bloc. Le nationalisme des partis staliniens dans ces pays prend maintenant la forme d'un soutien aux réponses protectionnistes à l'approfondissement de la crise économique, et d'un engagement vers ce qui n'est encore qu'une tendance embryonnaire à l'autarcie. Si cette orientation de la part des staliniens ne remet pas en question l'incorporation de leur pays dans le bloc américain, elle va néanmoins à 1'encontre des plans du capital américain, qui visent à intégrer plus fortement les différents pays du bloc dans une gigantesque économie de guerre sous le contrôle absolu de Washington. On trouve là une des bases de l'éternelle méfiance des Etats-Unis vis-à-vis des staliniens et sa préférence pour les partis socialistes, pour lesquels les intérêts vitaux du capital national exigent l'ajustement le plus complet des politiques nationales aux besoins de l'ensemble du bloc.
Mais ce n'est pas son soutien à des politiques autarciques -qu'il partage de toute manière avec l'extrême-droite- qui est la caractéristique la plus distinctive du stalinisme, et qui explique la férocité qu'il met à s'opposer aux autres fractions de la bourgeoisie nationale. Les partis staliniens, quelle que soit leur phraséologie actuelle démocratique et pluraliste, sont les défenseurs de la forme la plus totale et la plus extrême du capitalisme d'Etat, du contrôle totalitaire et direct par l'Etat de tous les aspects de la production et de la distribution, du parti unique d'Etat et de la militarisation totale de la société. A l'inverse des autres partis bourgeois (y compris les socialistes), les staliniens n'ont pas d'attaches à un quelconque capital "privé". Tandis que d' d'autres fractions de la bourgeoisie soutiennent une fusion plus ou moins grande entre capital d'Etat et capital "privé", les staliniens au pouvoir veut dire élimination du capital privé et avec lui de tous les autres partis bourgeois. C'est la base de la peur permanente et de l'hostilité des autres fractions bourgeoises envers les staliniens ; et cela explique les nombreuses réserves de l'impérialisme américain, qui exerce encore le plus gros de son contrôle sur ses "alliés", pas encore directement sur l'Etat ou sur une base étatique, mais à travers les liens du capital privé -liens que le stalinisme remettrait en cause.
C'est pour ces raisons qu'à la fois les Etats-Unis et les autres partis de la bourgeoisie en Europe et au Japon sont décidés à maintenir un strict contrôle sur les staliniens même si l'aggravation de la situation économique et politique les amène peu à peu à une participation directe dans le gouvernement, dans un effort pour stabiliser l'ordre bourgeois chancelant. Cependant, comme la situation économique et politique continue à se détériorer et comme s'affirme le besoin d'aller le plus loin possible vers une économie de guerre, il y aura de plus en plus convergence totale entre les besoins vitaux du capital national et programme draconien du stalinisme.
Le bloc russe
La crise permanente du capitalisme mondial pose au bloc russe des problèmes particulièrement aigus : son extrême faiblesse et ses énormes handicaps matériels face à l'intensification de la guerre commerciale contre le bloc américain, et en arrière fond, la préparation aux affrontements militaires pour le repartage du marché.
Les pays du bloc russe doivent essayer de compenser le faible taux productif de la force de travail, l'archaïsme de leur appareil productif par une plus grande extraction de plus-value absolue que leurs rivaux du bloc US." Même la plus drastique baisse de salaire, l'accroissement énorme des cadences et l'allongement de la journée de travail dont la limite est évidente dans la renaissance de combativité ouvrière, ne parviendraient pas à rendre le capital russe compétitif sur un marché rétréci. S'il est vrai que la plus-value n'est le produit que du travail vivant nouvellement ajouté dans le procès de production du capital variable, aussi bien la masse que le taux de plus-value dépendent étroitement du niveau de mécanisation et de technologie du capital que les ouvriers mettent en mouvement, du capital engagé dans le procès productif. C'est pour cette raison que la compétitivité du bloc russe est étroitement liée à l'acquisition de technologie de pointe, qui de toute façon ne peut venir que du bloc US, par achat ou par conquête. Une des différences entre le "socialisme" autarcique de Staline et le "socialisme" mercantile de Brejnev est que, dans le cadre d'une re-division en cours du marché mondial, et l'établissement de nouvelles constellations impérialistes, Staline voyait le dépassement des faiblesses de la Russie d'abord dans les conquêtes militaires (pillage et transport en Russie des industries les plus avancées d'Allemagne, de pays danubiens et de Mandchourie, et ainsi, à travers l'incorporation directe de ces aires dans l'orbite de l'impérialisme russe) alors que dans le cadre d'une stabilisation relative entre les blocs impérialistes (au moins en ce qui concerne les aires les plus industrielles), Brejnev a essayé de compenser le retard russe par le commerce et l'achat massif de technologie à l'Ouest.
Les déficits commerciaux croissants qui sont la preuve inexorable de la même non-compétitivité du capital russe sur le marché mondial, ont rendu l'achat de technologie au bloc US complètement dépendant des emprunts et crédits... Mais la dette étrangère croissante du bloc russe ajouté à son déficit commercial produit un nouveau cycle d'emprunts, financièrement trop risqués pour être entrepris par les banques de l'Ouest. A ceci, s'ajoutent les facteurs politico-militaires qui de plus en plus jouent contre la continuation du déversement de marchandises et de technologie du bloc US dans le COMECON. L'approfondissement de la crise économique intensifie la compétition entre les blocs (particulièrement dans le tiers-monde, où la Russie a une balance positive et où les machines et la technologie de l'Ouest deviennent indispensables à son offensive économique) et développe les contrastes inter-impérialistes. En réponse, l'impérialisme américain, en tant que moment de la consolidation de l'économie de guerre pour le compte de son bloc, n'hésitera pas à subordonner les considérations du commerce à court terme aux objectifs politiques et stratégiques à plus long terme, qui conduiront à un tassement des échanges commerciaux entre les blocs. En fin de compte, conquêtes et guerres seront le seul moyen de l'impérialisme russe pour essayer de dépasser l'archaïsme technique de son appareil productif et des carnages du "socialisme" mercantile avec sa politique de détente, naîtra sur le sol russe une version "revue et corrigée" du "socialisme" autarcique d'hier.
La supériorité stratégique et tactique actuelle du Pacte de Varsovie sur l'OTAN, sur la ligne de partage des deux impérialismes en Europe centrale, ne doit pas masquer l'infériorité matérielle écrasante du bloc russe dans sa tentative de rejoindre les pays industriels du coeur de l'Europe. Le marxisme montre la primauté du facteur économique sur le facteur politico-économique dans tous les heurts entre Etats capitalistes. En dernière analyse, la supériorité économique se traduit en supériorité militaire comme le démontrent les deux guerres inter-impérialistes. L'énorme supériorité de l'appareil productif du bloc US qui ne laisse aucun choix a l'impérialisme russe, sinon une guerre de conquête s'il ne veut pas être étouffé par l'hippopotame US, est ainsi la raison pour laquelle l'impérialisme US possède toutes les cartes maîtresses dans ce jeu de mort avec le rival russe. La bourgeoisie russe est confrontée au dilemme que, pour faire la guerre avec succès, il faut d'abord être économiquement le plus fort, alors que pour asseoir sa supériorité économique dans l'époque de la décadence, il faut d'abord faire la guerre. La seule issue que peut espérer le bloc russe pour faire pencher la balance dans son sens, dans la mesure où il est contraint de préparer la guerre et de compenser son infériorité économique par une meilleure organisation de son économie de guerre, une plus totale intégration de toutes ses ressources -humaines et matérielles- aux nécessités de la production de guerre.
Les formes extrêmes de capitalisme d'Etat dans les pays du bloc russe -résultat de leur faiblesse économique- ne doivent pas nous faire conclure qu'une économie de guerre bien organisée existait déjà. La situation chaotique de la production et de la distribution de denrées alimentaires, dont une bonne organisation est vitale dans une économie de guerre afin de nourrir les producteurs et les utilisateurs d'armes à meilleur marché possible, et ainsi destiner la masse de travail disponible, des machines et des matières premières à la production de matériel de guerre, indique l'ampleur du problème rencontré par la bourgeoisie du bloc russe.
La prédominance de fermes "privées" petites et inefficaces (85% de la production agricole en Pologne) et les parcelles "privées" dans les fermes collectives (au point que 50% du revenu des Kolkhozes russes vient de la vente du produit des lopins privés) aussi bien que les florissants marchés "noirs" ou "libres" pour les denrées alimentaires, montrent que l'Etat n'a pas encore un contrôle totalitaire du secteur II, la production de biens de consommation, une bonne distribution, qui sont essentielles à une économie de guerre. La sujétion de la paysannerie et le contrôle complet de l'agriculture par l'Etat' Léviathan aussi bien que l'élimination des marchés noirs et libres, sont des tâches formidables que la bourgeoisie du bloc russe devra affronter dans les années à venir.
Même dans l'industrie, dont la quasi totalité est nationalisée dans le bloc russe, il y a des obstacles d'importance à la consolidation de l'économie de guerre.
La décentralisation de l'industrie et l'autonomie de l'entreprise qui était un aspect du "socialisme" mercantile,doit d'abord être éliminé si le secteur 1 doit être organisé de manière centralisée autour du but de la production d'armements.
Déjà, une telle entreprise produira des heurts au sein de la bourgeoisie elle-même tels que les directeurs et chefs d'entreprises d'usines particulières et de trusts, essaieront de préserver leurs prérogatives.
La nécessité d'un ordre économique plus unifié et autarcique (dirigé par Moscou) qui pèse sur l'ensemble du bloc, exacerbe aussi les tensions au sein de la bourgeoisie de chaque pays sur la manière d'appliquer les décisions de l'impérialisme russe.
Etant donné la prédominance du facteur politico-militaire, aucune fraction significative de la bourgeoisie d'aucun pays du COMECON ne peut sérieusement remettre en cause l'appartenance au bloc russe. Cependant, il y a de sérieuses divergences entre ces fractions de la bourgeoisie dans chaque pays, qui cherchent à étendre leur commerce avec l'Ouest et à encourager les investissements du capital de l'Ouest afin de stimuler le développement d'industries purement nationales, et d'autres fractions pont qui l'intérêt du capital national implique l'orientation de la vie économique exclusivement autour du bloc et de la construction d'une économie de guerre unifiée.
Le poids politico-militaire écrasant de l'impérialisme russe dans le bloc de l'Est fera en sorte que ce soit cette dernière fraction qui l'emporte dans les heurts au sein de la bourgeoisie.
La profondeur de la crise politique de la bourgeoisie dans le bloc russe de toutes façons, se manifeste crûment par les efforts croissants pour contenir un prolétariat combatif. La profondeur de la crise économique et la nécessité de l'économie de guerre réclament une attaque drastique au niveau de vie et aux conditions de travail déjà abyssaux du prolétariat. Déjà, l'appareil politique de la bourgeoisie, perfectionné pendant le creux de la contre-révolution, quand la classe était écrasée, est mal adapté à la tâche de tromper un prolétariat déclenchant des luttes toujours plus dures et militantes.
La faiblesse économique de toutes les fractions du capital national les a conduit à une dépendance quasi-totale à l'égard de leur appareil militaire et policier pour maintenir l'ordre. De plus, la domination de l'impérialisme russe sur son bloc (à la différence de la situation de l'impérialisme US) dépend presque exclusivement de facteurs militaires. Ainsi, dans une situation historique dans laquelle le recours à la répression physique directe du prolétariat risque de provoquer la guerre de classe généralisée, quand le capital doit d'abord essayer de contrôler le prolétariat économiquement, condition préalable à son écrasement physique, la bourgeoisie du bloc russe a été incapable d'ajuster les formes de sa dictature aux nécessités du nouveau rapport de force entre classes. Chaque relâchement de l'appareil de répression directe risque d'affaiblir l'Etat ; une trop grande utilisation de l'appareil répressif risque d'allumer la flamme prolétarienne. Aussi, la bourgeoisie dans le bloc russe est paralysée face à la tâche urgente de l'attaque du prolétariat.
Les antagonismes inter-impérialistes
Si la production d'armements et la mise en place de l'économie de guerre sont la seule manière d'éviter la chute de l'appareil productif capitaliste, ce n'est en aucune façon une politique économique en soi (quoiqu'en pensent encore de larges secteurs de la bourgeoisie) mais la préparation à une conflagration mondiale, une expression des antagonismes inter-impérialistes que la crise mortelle du capitalisme mène au point de rupture. L'approfondissement inexorable de la crise mondiale n'a pas seulement porté à un point extraordinairement haut les tensions entre les doux blocs impérialistes, mais a aussi clairement révélé les différentes manières pour les impérialismes américains et russes de dominer les autres pays de leurs blocs, et de contrôler les marchés extérieurs, sources de matières premières et réservoir de main-d'oeuvre bon marché. A cause de sa faiblesse économique, la domination de la Russie sur d'autres pays dépend presque exclusivement de l'occupation militaire directe, ou au moins, de l'intervention rapide de ses forces armées. De plus, du fait de la supériorité navale américaine toujours écrasante, les régions sujettes au contrôle militaire de l'impérialisme russe, sont effectivement limitées aux régions d'Eurasie, et à des aires aisément accessibles à l'armée de terre russe.
C'est la clé de la domination russe en Europe de l'Est et en Mongolie, de même que l'incapacité de l'impérialisme russe à avoir un contrôle sur les pays hors d'atteinte de ses tanks. Au contraire, la suprématie de l'appareil productif de l'impérialisme "américain est telle qu'il peut économiquement dominer n'importe quelle partie du monde. La seule barrière à la domination économique américaine est l'hégémonie militaire de l'impérialisme russe dans une aire donnée qui, nous l'avons vu, est, pour des raisons stratégiques (l'infériorité navale) encore limité aujourd'hui à des aires contiguës à la Russie elle-même. L'infériorité économique de la Russie et les limites à ses ambitions militaires sont telles que même quand les fractions bourgeoises, armées et soutenues par elles triomphent dans un conflit inter-impérialistes localisé (Viêt-Nam, Mozambique, Angola…), cela ne signifie pas que le pays en question passe sans équivoque dans le bloc russe. Plutôt, la combinaison du poids économique du bloc US qui va croissant au fur et à mesure que la crise frappe les économies les plus faibles de plus en plus durement, et les limitations stratégiques de l'impérialisme russe produisent souvent une période d'oscillations entre les blocs. La recherche de la part du Viêt-Nam d'investissements du bloc US, de crédit et de commerce, dans un vain effort pour reconstruire une économie délabrée, prouve l'incapacité de la Russie à incorporer fermement dans son bloc, même un régime dont l'existence dépend de son aide militaire. La continuation de la dépendance à l'égard de l'Afrique du Sud par le Mozambique, l'appel au bloc US pour l'extraction et la vente de son pétrole et de ses minerais qui sont, la base de la vie économique de l'Angola, indiquent tous les deux les énormes difficultés que rencontre la Russie à essayer de supplanter l'impérialisme américain dans les points forts d'Afrique.
A cause de sa supériorité économique, môme les défaites militaires des fractions bourgeoises qu'il soutient ne sont suffisantes pour briser la mainmise de l'impérialisme US sur un pays, vu que, en raison de faiblesse économique, aucune sorte d'occupation militaire ne suffit a l'impérialisme russe pour s'assurer le contrôle d'un pays.
C'est la supériorité économique et stratégique qui est la base du continuel déséquilibre entre les deux camps impérialistes en faveur du bloc américain. Les USA sont en train d'éliminer la plus importante tète rie pont que l'impérialisme russe a établie dans l'effort pour s'étendre au coeur de l'Eurasie, son fief. Ainsi, au Moyen-Orient, l'Egypte et le Soudan sont réincorporés politiquement, économiquement et même militairement dans le bloc US, tandis que la Syrie a déjà fait les premiers pas dans ce sens. Le récent effort de l'impérialisme russe pour gagner une place dominante au Liban, via les Palestiniens et le front des gauchistes musulmans (qu’il armait et soutenait diplomatiquement); a été balayé par la seule armée syrienne (soutenue par Washington), que Moscou avait si bien équipée. La défaite militaire au Liban et l'affaiblissement de l'impérialisme russe au Moyen-Orient, ont maintenant conduit la plus influente fraction de l'OLP à reconsidérer son orientation pro-russe. De plus, les USA commencent à remettre en cause jusqu'à l'hégémonie russe en Irak.
Avec le rétablissement de la domination quasi-totale des USA sur le monde arabe, une domination qui embrasse aussi bien les régimes "socialistes" que les “royaumes", l'administration Carter dirige maintenant ses efforts pour imposer un statu quo israélo-arabe, qui impliquerait la formation d'un Etat croupion sur la rive ouest et dans la bande de Gaza.
L'impérialisme US espère établir une "Pax americacana" durable sur la région et faire du Moyen-Orient une solide barrière à l'expansion de l'impérialisme russe, plutôt qu'un passage pour la Russie vers l'Afrique et l'Asie du Sud comme cela se passait précédemment.
La lutte intense entre les deux blocs pour le contrôle de la corne africaine et de la ligne vitale de Babed-el-Mameb, qui commande les routes entre l'Europe et l'Asie, entre maintenant dans une phase décisive. L'apparent triomphe de la Russie en Ethiopie où le régime du colonel Mengistus a opté pour Moscou et où les armes russes permettent une escalade de la guerre barbare en Erythrée ainsi que le fait de mettre le front de libération de l'Erythrée dans la dépendance de l'impérialisme américain, a sa contre-partie dans la réorientation de la Somalie vers le bloc US.
Ceci et l'influence croissante du client américain, l'Arabie Saoudite sur le Sud-Yemen conduisent à un changement du rapport de force interimpérialiste dans la corne orientale, qui pourrait bien laisser l'impérialisme russe avec seulement le bastion éthiopien, dont les parties importantes (Erythrée, Ogaden) seraient détachées par des voisins envieux et des fronts de libération soutenus par les USA. Un régime indépendant en Erythrée soutenu par les USA, un à Djibouti occupé par la France, le Yémen, la Somalie tirés dans le bloc US par l'Arabie Saoudite, feraient (avec l'Egypte et le Soudan, maintenant intégrés dans le camp US) de la Mer Rouge, un lac américain.
En Inde, la défaite d'Indira Gandhi et la victoire de la coalition pro-américaine Janata, la formation d'un gouvernement dirigé par Morarji Desai forgent de nouvelles chaînes économiques liant New-Delhi à Washington en même temps que cela signifie l'élimination des politico-militaires de Moscou (établis au cours de la guerre indo-pakistanaise) dans l'Asie du Sud et l'Océan Indien.
Ce n'est pas l'expansion de l'impérialisme russe nais la consolidation de la mainmise du bloc US sur le sous-continent indien qui s'opère'. Cependant, en Extrême-Orient, l'incroyable croissance des antagonismes inter-impérialistes entre Chine et Russie et les tensions croissantes sur leurs frontières communes font pencher la Chine vers le bloc US, processus qui est accéléré par l'état de son économie. Alors que l'administration Carter se pose déjà la question de la nature de son aide à la Chine dans l'éventualité d'une guerre russo-japonaise et que l'amorce d'un rapprochement sino-indien se fait jour (rapprochement désiré par Washington), tous ces faits sont des signes incontestables de l'affaiblissement du bloc russe dans le continent asiatique.
Les initiatives de Washington au Moyen-Orient et dans la corne orientale, dans le sous-continent indien et en Extrême-Orient ont pour but d'enfermer ces régions dans un cercle de fer, que les Etats-Unis essayent de construire afin de confirmer l'impérialisme russe dans le centre Eurasien. Le succès de la politique de l'impérialisme US dépend en grande partie de sa capacité a stabiliser ces régions et à atténuer les rivalités inter-impérialistes entre les différents Etats - stabilisation de la barbarie, dans laquelle la crise permanente du capitalisme a déjà poussé l'humanité. La seule issue laissée à l'impérialisme russe, s'il a une chance de concurrencer l'impérialisme américain, est de mettre tous ses efforts pour déstabiliser ces régions par son soutien politique et: militaire aux luttes de libération nationale et à certaines fractions de la bourgeoisie dans chacun de ces pays, pour qui le statu-quo imposé par les USA est intolérable. Ainsi, au Moyen-Orient, le seul espoir pour les russes de reprendre du terrain est une nouvelle guerre israélo-arabe.
Dans le sous-continent indien, 1'expansion de l'impérialisme russe ne peut se faire que par une nouvelle guerre indo-pakistanaise -même, si cette fois, la Russie soutient Islamabad et essaie de forger un bloc musulman composé du Pakistan- du BanglaDesh et de l'Afghanistan afin de lutter contre l'Inde soutenue par les USA.
C'est exactement cette politique de déstabilisation que le capital russe a entrepris en Afrique du Sud, où les armes et les fonds vont au front patriotique en Rhodésie, au Swapo en Afrique du Sud-est et à la récente guérilla cubaine en Afrique du Sud même. Les USA voyant: le danger d'une telle déstabilisation pour sa propre domination, essaient d'imposer la règle de la majorité noire en Rhodésie et en Afrique du Sud afin d'asseoir sa domination sur des bases plus solides en soutenant une fraction noire do la bourgeoisie. Dans toutes ces régions, de toute façon, les limites stratégiques de la Russie, même si une politique de déstabilisation ne peut être, évitée, rendent l'occupation militaire directe de la Russie extrêmement difficile.
Il existe une région où la tentative de l'impérialisme russe pour s'étendre à partir de son aire géo-politique offre des possibilités de technologie avancée et n'a pas de limites stratégiques écrasantes, cette région c'est : l'Europe. Le seul pays en Europe où une extension russe serait bénéfique, et qui ne provoquerait pas automatiquement une guerre importante entre les deux blocs impérialistes, c'est : la Yougoslavie.
La mort de Tito va exacerber les contradictions au sein de la bourgeoisie yougoslave : d'un côté les fractions favorables à une orientation pro-russe et de l'autre celles favorables à une orientation pro-américaine. Entre la fraction Serbe, qui domine la bourgeoisie et le nationalisme croissant des fractions Croates et Slovènes, l'impérialisme russe peut, soit provoquer un changement de pouvoir à Belgrade, soit essayer de démembrer la Yougoslavie en fournissant une aide matérielle décisive à l'établissement d'Etats nationaux Serbe et Croates liés à Moscou. Avec sa supériorité matérielle et stratégique en Europe du Sud-est, le spectre de la Russie se dessine dans l'Adriatique.
L'effet d'une telle progression, si elle devait être couronnée de succès, modifierait de manière significative le rapport de force entre les blocs dans l'Europe du Sud et soumettrait l'Italie et la Grèce à une pression croissante de la Russie. A cela il faut ajouter la tension croissante entre la Grèce et la Turquie à propos de Chypre et des droits d'exploitation dans la mer Egée, qui peuvent donner au bloc russe l'occasion de prendre l'impérialisme US de flanc dans la Méditerranée, s'il ne parvient pas à une solution stable pour la région. La concentration de la pression russe dans l'Europe du Sud-est et en Asie Mineure indique le lieu où le prochain conflit impérialiste peut éclater.
La lutte de classe
L'approfondissement de la crise économique, menaçant de paralyser l'appareil productif du capitalisme, et ses manifestations dans l'exacerbation des antagonismes inter-impérialistes, conduisent la bourgeoisie à l'établissement de l'économie de guerre et, en fin de compte, aux préparatifs pour un nouveau massacre mondial. Cependant, le prolétariat partout barre le chemin à l'économie de guerre et à la conflagration mondiale dont elle est la préparation indispensable. La soumission idéologique et physique de la classe ouvrière à l'Etat capitaliste est la condition préalable nécessaire pour installer définitivement une économie de guerre. Mais aujourd'hui, la bourgeoisie s’affronte à un prolétariat combatif et de plus en plus conscient de ses intérêts.
En effet, la classe ouvrière a réagi de façon combative aux premiers coups de la crise qui a marqué la fin définitive de la période de reconstruction après la seconde guerre mondiale: la vague d'occupations d'usines qui a débouché sur la grève générale de 10 millions d'ouvriers en France en 1968 ; "l'automne chaud" de 1969 en Italie pendant lequel l'industrie a été paralysée par des grèves de masse et des occupations d'usines ; la grève anti-syndicale des mineurs de KIRUNA cette même année, qui a brisé plus de trois décennies de "paix sociale", qui avait valu h la Suède la renommée de "paradis pour le capital" sous le régime social-démocrate; les dures luttes des mineurs de Limbourg en Belgique en 1970 ; les grèves et combats violents de milliers d'ouvriers contre la police qui ont foudroyé les centres industriels de la Pologne pendant l'hiver 1970-71 ; la vague des grèves en Grande-Bretagne qui a culminé dans la grève générale de solidarité avec les dockers en 1972 ; les luttes des ouvriers à SEAT (Barcelone) en 1971 et à Vigo et Ferrol en 1972 qui -élevant des barricades et se battant dans la rue Cintre la police ainsi que les assemblées générales dans les usines- ont marqué la remontée du prolétariat en Espagne ; toutes ces luttes étaient autant de coups portés à la bourgeoisie des métropoles capitalistes, elles ont mis en évidence que l'approfondissement de la crise économique produit un durcissement de la lutte de classe. Par conséquent, si d'un côté, les nécessités économiques obligent la bourgeoisie à faire face au prolétariat rapidement et de façon décidée pour l'écraser, les réalités politiques, d'un autre côté, le rapport de force entre les classes, font que la bourgeoisie essaie d'éviter l'affrontement direct avec la classe ouvrière aussi longtemps que possible.
Par rapport aux années 1968-72, les années qui ont suivi la vague de luttes 1968-72, donnent l'impression d'un recul et d'un creux dans la lutte de classe. En réalité, après avoir encaissé les premiers coups de la crise, la bourgeoisie des métropoles a cherché désespérément à reporter les effets les plus désastreux de la crise sur les pays capitalistes plus faibles ; ainsi, les plus durs affrontements entre prolétariat et bourgeoisie se sont déplacés vers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique Latine et la Chine. L'Egypte est la proie de vagues de grèves sauvages depuis 1974 : les usines de textile à Kelvan en 1975, les grèves qui ont paralysé les trois grands centres industriels du pays, Alexandrie, Helwan et Le Caire, en avril 1976, et les grèves et émeutes contre les hausses des prix des produits de première nécessité en janvier de cette année. En Israël, les ouvriers ont répondu à la hausse des prix gigantesque de 1975 par des protestations violentes, et en novembre-décembre 1976, une vague de grèves -touchant 35 7, des travailleurs du pays, s'est attaquée au contrat social imposé par le gouvernement des travaillistes et par les syndicats. En Afrique, en 1976, le prolétariat s'est lancé dans des grèves de; masse aussi bien contre les régimes du capital " noir" que du capital "blanc" : en juillet, les ports de l'Angola ont été paralysés par des grèves que le MFLA a réprimées dans le sang ; en septembre, les mesures d'austérité de la junte "marxiste-léniniste" d'Ethiopie' ont provoqué une grève générale dans les banques, les assurances, dans les secteurs de l'eau, du gaz et de l'électricité, grève générale qui a abouti à un affrontement violent avec l'armé ; en Afrique du Sud, aussi bien dans l'industrie automobile que dans les mines, des grèves dures ont éclaté, tandis qu'en Rhodésie, les chauffeurs d'autobus de Salisbury ont paralysé les transports de la ville pendant plus de quarante jours malgré la répression brutale de la police. En Amérique Latine, le prolétariat a répondu à la crise avec des luttes de plus en plus massives, violentes et unifiées : en Argentine, les ouvriers de l'électricité ont coupé le. courant dans les principales villes, en automne 1976 ; à Cordoba, les ouvriers de l'automobile se sont affrontés aux forces de police ; au Pérou, des luttes semi-insurrectionnelles ont transformé Lima en un champ de bataille, en 1975 et 1976 ; dans les mines d'étain de Bolivie, dans les plantations et usines de textile de Colombie, dans les centres de textile et la zone de fer au Venezuela, le prolétariat a engagé des luttes violentes. En Chine, les années 1975 et 76 ont vu des grèves se généraliser d'usine en usine, saisissant des provinces entières et atteignant des proportions semi-insurrectionnelles ; comme à Kang-Show, lors d'une grève générale qui a duré trois mois, les ouvriers ont attaqué les sièges du Parti et du gouvernement, des barricades ont été dressées dans des quartiers ouvriers et il a fallu dix mille soldats pour ramener l'ordre. Entre 1973 fit 1977, on n'assiste pas à un ralentissement de l'intensité de la résistance du prolétariat aux effets de la crise mais à un déplacement momentané de l'épicentre de la lutte de classe vers la périphérie du monde capitaliste.
Par ailleurs, en ce qui concerne les métropoles capitalistes, même si on dit qu'il y a un décalage entre la profondeur de la crise et la réaction du prolétariat, que la lutte de classe a baissé après 1972, on ne doit pas oublier le fait qu'il n'y a pas eu de défaite politique du prolétariat, que dans aucun des centre du capitalisme mondial, la bourgeoisie n'a écrasé physiquement ou idéologiquement la classe ouvrière. En fait le calme apparent dans la lutte de classe ne signifie pas une diminution de combativité de la classe -même provisoirement- mais une conscience croissante chez les ouvriers du caractère futile en dernière instance des luttes purement économiques. C'est par l'impossibilité de défendre, avec leurs luttes, ne fussent que leurs intérêts"immédiats", que le prolétariat est entrain d'apprendre qu'il doit s'affronter au capital et son Etat avec des luttes directement politiques ; c'est par cette impossibilité qu'il apprend la nécessité de généraliser et politiser ses luttes. La vague de grèves qui s'est répandue à travers l'Espagne comme une traînée de poudre en janvier mars 1976, et les grèves violentes qui ont embrassé la Pologne en juin 1976, ont donné le signe de départ d'une nouvelle phase de généralisation et de radicalisation des luttes prolétariennes dans les métropoles capitalistes. La vitesse avec laquelle se sont généralisées les luttes à Radom (Pologne) et à Vitoria (Espagne), prenant une usine après l'autre, revêtant souvent un caractère insurrectionnel, est un signe indicateur de l'expérience que le prolétariat a déjà acquise et de l'orage prolétarien qui se prépare. Au cours de 1'année dernière, les bourgeoisies d'Italie, de Grande-Bretagne, du Portugal, du Danemark et de Hollande ont dû faire face aux premiers assauts de cette nouvelle vague de luttes ouvrières. Mais ce n'est pas une simple énumération de grèves ni de pays touchés par les luttes qui peut exprimer quelle est la situation réelle du moment présent alors que c'est au niveau mondial que le prolétariat est l'élément déterminant :
- "Les conditions pour l'unité Internationale de la classe sont entrain de se créer lentement ; pour la première fois dans l'histoire, le surgissement de luttes ouvrières est simultanée dans tous les pays du monde autant dans la périphérie (Afrique, Asie, Amérique Latine) que dans le centre (Amérique du Nord, Europe)”. (Accion Proletaria, avril-mai 77).
De même que la réapparition d'une crise ouverte en 1967 a provoqué une vague de luttes combatives du prolétariat dans les années qui ont suivi, de même, la nouvelle phase de la crise, qui oblige la bourgeoisie à mettre en place une économie de guerre et l'amène vers une guerre inter-impérialiste généralisée, deviendra un facteur qui engendrera dans la classa ouvrière la conscience de plus en plus claire de la nécessité d'engager des luttes directement politiques.
Ainsi, la nécessité impérieuse pour la bourgeoisie de mettre Dur pied une économie de guerre deviendra un facteur de poids dans l'accélération du cours vers une guerre de classe généralisée.
La bourgeoisie est amenée il instaurer son économie de guerre conformément aux lois aveugles qui déterminent ses actions ; alors que la classe bourgeoise est incapable de comprendre les forces qui la poussent vers la guerre, les marxistes révolutionnaires peuvent voir clairement quel est le cours que la bourgeoisie sera obligée de suivre et comprendre les tendances de base de l'économie et de la politique capitalistes que la bourgeoisie ne peut voir que confusément.
C'est pour cette raison que le CCI peut tracer les perspectives politiques et économiques fondamentales du capitalisme dans les années à venir. Cependant, la lutte de classe du prolétariat, en devenant directement une lutte politique, n'est pas un produit des lois aveugles, c'est une lutte consciente. Aussi, si les révolutionnaires ne peuvent pas prédire quand les luttes vont surgir -justement à cause du facteur conscient qui en est la clé- ils peuvent et doivent, par leur intervention politique dans la lutte de classe, par l'accomplissement de leur tâche vitale de contribution à la généralisation de la conscience révolutionnaire dans la classe, devenir un facteur actif et décisif dans le surgissement et le développement des luttes politiques qui mèneront vers une guerre de classe généralisée du prolétariat contre la bourgeoisie. C'est cela qui est à l'ordre du jour maintenant.
CCI
Vie du CCI:
Récent et en cours:
- Crise économique [11]
Les groupes politiques prolétariens
- 2560 reads
La caractérisation des différentes organisations qui se réclament du socialisme et de la classe ouvrière est de la plus haute importance pour le CCI. Ce n'est nullement une question abstraite ou de simple théorie mais au contraire qui oriente de façon directe l'attitude du Courant à l'égard de ces organisations et donc son intervention face à elles : soit dénonciation en tant qu'organe et émanation du Capital, soit polémique et discussion en vue de tenter de favoriser leur évolution vers une plus grande clarté et rigueur programmatique ou de permettre et impulser en leur sein l'apparition de tendances à la recherche d'une telle clarté. C'est pour cela qu'il faut se garder de toute appréciation hâtive ou subjective des organisations auxquelles le CCI est confronté et qu'il est nécessaire, tout en se gardant d'un étiquetage formel et rigide, de définir les critères les plus exacts possible d'une telle appréciation. Toute erreur ou précipitation en ce domaine met en cause l'accomplissement de la tâche fondamentale de constitution d'un pôle de regroupement des révolutionnaires et porte en germe des déviations de caractère soit opportuniste, soit sectaire qui seraient des menaces pour la vie même du Courant.
1) Le mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière s'exprime en un processus de maturation de sa conscience, processus difficile, en dents de scie, jamais linéaire, connaissant de multiples tâtonnements, remises en question, et qui se manifeste nécessairement dans l'apparition et l'existence simultanée de plusieurs organisations plus ou moins formées et avancées. Ce processus s'appuie sur l'expérience à la fois immédiate et historique de la classe, a besoin des deux pour pouvoir se développer et s'enrichir. Il doit s'approprier les acquis passés de la classe mais, en même temps, il doit être capable de critiquer et dépasser les limites de ces acquis, activité qui n'est à son tour possible qu'à partir d'une réelle assimilation de ces acquis ; et, de fait, les différents courants qui se manifestent dans la classe se distinguent par une plus ou moins grande aptitude à assumer ces différentes tâches. Si la prise de conscience de la classe s'inscrit en rupture avec l'idéologie bourgeoise ambiante, les groupes qui l'expriment et y participent sont eux-mêmes soumis à la pression de cette idéologie ce qui fait constamment peser sur eux une menace de disparition ou d'absorption par la classe ennemie.
Ces caractéristiques générales du processus de développement de la conscience révolutionnaire sont encore plus marquées dans la période de décadence du capitalisme. En effet, cette décadence, tout en jetant les bases pour la destruction du système aussi bien du point de vue objectif (crise mortelle du mode de production) que subjectif (décomposition et déliquescence qui en résultent pour l'idéologie bourgeoise et affaiblissement de son emprise sur la classe ouvrière), a suscité l'apparition d'entraves et difficultés nouvelles à cette prise de conscience. A ce titre, on peut citer :
- l'atomisation que subit la classe en dehors des périodes de lutte intense,
- l'emprise de plus en plus totalitaire de l'Etat sur l'ensemble de la vie sociale,
- l'intégration dans celui-ci de toutes les organisations de masse -partis et syndicats- qui, au siècle dernier, constituaient un lieu de développement de la conscience de classe,
- enfin, le facteur supplémentaire de confusion constitué par les tendances radicales résultant de la décomposition de l'idéologie bourgeoise officielle .
Mais à l'heure actuelle, à l'ensemble de ces conditions, il vient s'ajouter :
- le poids de la plus profonde contre-révolution subie par le mouvement ouvrier, ayant conduit à la disparition ou à la sclérose des courants communistes du passé,
- le fait que la crise aiguë du système qui est à la base de la reprise historique de la classe, ait produit une accentuation violente de la décomposition des divers secteurs des couches moyennes, et particulièrement les milieux intellectuels et étudiants, et dont la radicalisation a produit de multiples écrans de fumée venant compliquer l'effort de la classe révolutionnaire vers une prise de conscience.
2) Dans un tel cadre général du mouvement de la classe vers une prise de conscience de ses tâches historiques, on peut observer l'existence de trois types fondamentaux d'organisations.
En premier lieu, les partis qui, après avoir été des organes de la classe, ont succombé à la pression du capitalisme et ont pris place comme défenseurs du système en assumant une fonction plus ou moins directe de gestion du capital national. Pour de tels partis, l'histoire enseigne :
- que tout retour en arrière vers une activité prolétarienne est impossible,
- qu'à partir du moment de leur changement de camp, leur dynamique n'est plus déterminée que par des besoins du capital ou comme manifestations de la vie de celui-ci ;
- que s'il subsiste dans leur langage et leur programme des références à la classe ouvrière, au socialisme ou à des positions révolutionnaires, c'est uniquement à usage de mystification. En fait, même si les positions de tels partis ne sont, pas toujours cohérentes entre elles, elles sont soutenues par une cohérence générale dans la défense des intérêts capitalistes.
Parmi ces partis, on peut nommer principalement les partis socialistes issus de la 2ème Internationale, les partis communistes issus de la 3ème, de même que les organisations appartenant à l'anarchisme officiel, et également les courants trotskystes. Tous ces partis ont été conduits à tenir une place dans la défense du capital national comme agents du maintien de l'ordre ou rabatteurs pour la guerre impérialiste.
En second lieu, les organisations dont l'appartenance à la classe ouvrière est indiscutable de par leur capacité à tirer les leçons des expériences passées de la classe, à comprendre les données historiques nouvelles, à rejeter toutes les conceptions qui se sont révélées étrangères à la classe ouvrière et dont l'ensemble des positions atteint un haut niveau de cohérence. Même si le processus de prise de conscience n'est jamais achevé, si la cohérence ne peut jamais être parfaite, si les positions de classe demandent un constant enrichissement, on a pu constater à travers l'histoire l'existence de courants qui, à un moment donné, ont représentés les manifestations non exclusives, mais les plus avancées et complètes de la conscience de classe et ont assumé un rôle central dans ce processus.
Dans nos rapports avec de tels groupes, proches du CCI mais extérieurs, notre but est clair. Nous essayons d'établir une discussion fraternelle et approfondie des différentes questions affrontées par la classe ouvrière, afin:
- d'atteindre un maximum de clarté pour le mouvement dans son ensemble,
- d'explorer les possibilités d'un renforcement de l'accord politique et de progression vers le regroupement.
En troisième lieu, des groupements dont, à l'inverse des précédents, la nature de classe n'est pas tranchée de façon nette et qui, manifestation du caractère complexe et difficile du processus de prise de conscience du prolétariat, se distinguent des organisations du second type par le. fait :
- qu'ils sont moins dégagés du poids de l'idéologie capitaliste et plus vulnérables, face à celle-ci,
- qu'ils sont moins capables d'intégrer ou les acquis anciens ou les données nouvelles de la lutte,
- que coexistent dans leur programme, au détriment d'une cohérence solide, des positions prolétariennes et des positions de la classe ennemie,
- qu'ils sont traversés à une échelle bien plus grande, par des tendances contradictoires, d'une part vers l'absorption ou la destruction par le capital, et d'autre part vers un ressaisissement.
Dans le cas de ces groupes, dans la mesure où ils sont plongés dans la confusion, la démarcation qui sépare le camp prolétarien du camp capitaliste, bien qu'elle existe effectivement, est extrêmement difficile à établir de façon formelle. Pour ces mêmes raisons, il est difficile d'en définir une classification précise, on peut cependant les distinguer en trois grandes catégories :
I) Les courants plus ou moins formels qui peuvent se dégager de mouvements embryonnaires et encore confus de la classe,
II) Les courants issus d'organisations passées dans le camp ennemi et rompant avec elles, qui, tous deux, sont une manifestation du processus général de rupture avec l'idéologie bourgeoise.
III) Les courants communistes en voie de dégénérescence, en général comme résultat d'une sclérose et d'un épuisement suite à une incapacité à actualiser leurs positions d'origine.
3) Parmi les groupes du premier type on peut ranger divers courants informels comme le "Mouvement du 22 mars" en 1968, des "groupes autonomes", etc., toutes organisations surgies du mouvement immédiat lui-même et donc sans racine historique, sans programme élaboré, puisqu'établi sur quelques points partiels et vagues, dépourvus d'une cohérence globale et ignorant l'ensemble des acquis historiques de la classe. Ces caractéristiques rendent ces courants très vulnérables, ce qui se manifeste dans la plupart des cas par leur disparition à bref délai ou leur transformation rapide en simple queue des groupes gauchistes. Cependant, de tels courants peuvent également s'engager dans un processus de clarification et d'approfondissement de leurs positions, ce qui les amène à évoluer vers une disparition comme tels et une intégration de leurs membres dans l'organisation politique de la classe.
Face à chacun de ces mouvements, le CCI doit intervenir afin de favoriser et de stimuler une telle évolution positive et tenter de leur éviter une dislocation dans la confusion ou leur récupération par le capitalisme.
4) Concernant les groupes du deuxième type, seuls en font partie les courants qui se séparent de leur organisation d'origine sur la base d'une rupture avec certains points de son programme et non sur la base d'une "sauvegarde" de principes prétendument révolutionnaires en cours de liquidation. En ce sens, on ne doit rien attendre des différentes scissions trotskystes qui régulièrement se proposent de sauvegarder ou revenir à un "trotskysme pur".
Apparus sur la base, d'une rupture programmatique avec leur organisation d'origine, ces groupes se distinguent fondamentalement des fractions communistes qui peuvent apparaître comme réaction à un processus de dégénérescence des organisations prolétariennes. En effet, celles-ci se basent non sur une rupture mais sur une continuité du programme révolutionnaire précisément menacé par le cours opportuniste de l'organisation, même si par la suite elles lui apportent les rectifications et enrichissements imposés par l'expérience. De ce fait, alors que les fractions apparaissent avec un programme révolutionnaire cohérent et élaboré, les courants qui rompent avec la contre-révolution se présentent avec des positions essentiellement négatives, opposées, généralement de façon partielle, à celles de leur organisation d'origine, ce qui ne suffit pas à constituer un programme communiste solide. Leur rupture avec une cohérence contre-révolutionnaire ne peut suffire à leur conférer une cohérence révolutionnaire. De plus, l'aspect nécessairement parcellaire de leur rupture se traduit par la conservation d'un certain nombre de pratiques du groupe d'origine (activisme, carriérisme, manoeuvriérisme, etc.) ou par l'adoption de pratiques symétriques, mais non moins erronées (attentisme, refus de l'organisation, sectarisme, etc.).
Pour l'ensemble de ces raisons, de tels groupes ont en général des probabilités très faibles d'évolution positive comme corps. Leurs déformations d'origine pèsent la plupart du temps trop fortement pour qu'ils puissent se dégager véritablement de la contre-révolution, quand ils ne disparaissent pas purement et simplement. Une telle dissolution est en fin de compte la meilleure issue puisqu'elle peut permettre à leurs militants de se dégager des tares organiques originelles et donc de s'orienter vers une cohérence révolutionnaire.
Cependant, ce qui existe à l'état d'une forte probabilité ne peut jamais être considéré comme une absolue certitude et, en ce sens, le CCI doit se garder de toute prise de position les rejetant de façon irrémédiable dans la contre-révolution, ce qui ne peut que bloquer une évolution positive de tel groupe ou de ses militants. Il peut en effet exister de grandes différences dans la dynamique de tels groupes suivant leur organisation d'origine : si les scissions provenant d'organisations au programme et à la pratique contre-révolutionnaires bien cohérents et affirmés (comme les organisations trotskystes par exemple) sont en général les plus handicapés, par contre, les courants qui se dégagent d'organisations plus informelles et au programme moins élaboré (comme celles venant de l'anarchisme par exemple) ou ayant trahi de façon plus récente, ont de meilleures chances d'évoluer vers des positions révolutionnaires y compris comme corps.
Par ailleurs, le caractère de plus en plus évident, à mesure que s'approfondit la crise du capitalisme, du décalage existant entre la phraséologie radicale des organisations gauchistes et leur politique bourgeoise provoque et va encore provoquer en leur sein la réaction de leurs éléments les plus sains, abusés dans un premier temps par cette phraséologie, et qui viendra alimenter ce genre de scissions.
Dans tous les cas, tout en faisant preuve d'une plus grande prudence qu'à l'égard des groupements du premier type et tout en se gardant de toute tentative de création de "comités" communs avec eux, comme a pu le préconiser le PIC par exemple, le CCI doit intervenir activement dans l'évolution de tels courants, favoriser par ses critiques non pas sectaires mais ouvertes la discussion et la clarification en leur sein et se garder de recommencer ses erreurs passées qui ont conduit par exemple "Révolution Internationale" à écrire "nous doutons de l'évolution positive d'un groupe venant de l'anarchisme" dans une lettre adressée au "Journal des Luttes de Classe" dont les membres allaient, un an plus tard, en compagnie de ceux du RRS et du VRS, fonder la section du CCI en Belgique.
5) Le problème posé par les groupes communistes en cours de dégénérescence est probablement un des plus difficiles à résoudre et demande à être examiné avec un maximum de soins. Le fait que tout franchissement de la frontière entre le camp prolétarien et le camp capitaliste ne puisse se faire qu'à sens unique, qu'une organisation prolétarienne qui passe sur le terrain bourgeois le fasse de façon définitive sans espoir de retour, doit inciter à la plus grande prudence dans la détermination du moment de ce passage et dans le choix des critères permettant une telle détermination.
Il ne faut pas considérer par exemple qu'une organisation est bourgeoise parce qu'elle agit dans les faits comme facteur non de clarification de la conscience de classe mais comme facteur de confusion : toute erreur d'une organisation prolétarienne, et du prolétariat en général, profite évidemment à l'ennemi de classe mais on ne peut pas dire que parce qu'une organisation commet des erreurs même très graves elle est l'émanation de la classe ennemie. Dans une armée, l'existence de mauvaises troupes est incontestablement une faiblesse qui favorise l'autre camp. Doit-on pour cela considérer que de telles troupes trahissent ?
En second lieu, on ne peut considérer que le franchissement d'une frontière de classe par une organisation signifie obligatoirement sa mort comme organe du prolétariat. Parmi les frontières de classe, il en est effectivement qui influent tout particulièrement sur la cohérence globale du programme et dont le franchissement peut constituer un critère décisif : ainsi le soutien de la "défense nationale" place d'emblée une organisation dans le camp de la bourgeoisie. Cependant, si une position erronée, même sur un seul point, éclaire d'une manière ambiguë tout l'ensemble du programme d'un groupe, certaines positions tout en se situant en dehors d'une cohérence communiste, ne l'empêchent pas forcément de maintenir un ensemble de positions authentiquement révolutionnaires. Ainsi, certains courants communistes ont pu apporter des contributions fondamentales à la clarification du programme révolutionnaire tout en conservant des positions nettement fausses sur des points importants (ainsi, la Gauche Italienne qui, sur les questions du substitutionisme, des syndicats et même de la nature de l'URSS, a maintenu des positions et analyses fortement, erronées).
Enfin, un des éléments fondamentaux à prendre en compte est l'évolution du groupe considéré. Un jugement ne doit pas être formulé à partir d'une analyse statique, mais dynamique. Par exemple, à toutes positions identiques, il existe une différence entre un groupe qui surgit aujourd'hui et qui appuie les luttes de libérations nationales,et un groupe qui s'est formé sur la base de la lutte contre la guerre impérialiste et qui, ne comprenant pas de lien entre ces deux positions, capitule sur le premier point.
Alors que pour un groupe récent, toute position contre-révolutionnaire risque de l'entraîner rapidement en bloc sur le terrain de la bourgeoisie, les courants communistes qui se sont trempés dans les grandes épreuves historiques, même s'ils portent en eux des éléments très importants de dégénérescence, n'évoluent pas d'une façon aussi rapide. Les conditions très difficiles dans lesquelles ils ont surgi les ont obligé à se doter d'une armure programmatique et organisationnelle beaucoup plus résistante contre les assauts de la classe dominante. En règle générale, d'ailleurs, leur sclérose est en partie la rançon qu'ils payent à leur attachement et à leur fidélité aux principes révolutionnaires, à leur méfiance à l'égard de toute innovation qui a constitué pour d'autres groupes le cheval de Troie de la dégénérescence, méfiance qui les a conduit à rejeter les actualisations de leur programme rendues nécessaires par l'expérience historique. C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'en général seuls les événements majeurs de l'évolution de la société, guerre impérialiste ou révolution, qui constituent des phases essentielles de la vie des organisations politiques, permettent de trancher de façon définitive sur le passage comme corps d'un organisme dans le camp ennemi. Souvent, seules de telles situations sont en mesure de clarifier suffisamment les problèmes pour permettre de déchirer le voile empêchant de comprendre certaines aberrations qui relèvent plus d'un aveuglement d'éléments prolétariens que d'une cohérence dans la contre-révolution. C'est généralement dans ces moments où il n'existe plus de place pour les ambiguïtés que les organes en dégénérescence font la preuve soit de leur passage définitif dans l'autre camp, par une collaboration ouverte avec la bourgeoisie, soit de leur maintien dans le camp ouvrier, par une réaction salutaire démontrant qu'ils constituent encore un terrain fertile pour l'apparition d'une pensée communiste. Mais ce qui est valable pour les grandes organisations de la classe en dégénérescence, l'est beaucoup moins pour les petits groupes communistes, à l'impact limité. Si les premiers sont reçus à tambour battant par la bourgeoisie auprès de laquelle ils sont appelés à jouer un rôle de premier ordre, les seconds, quand ils sont happés dans l'engrenage, pour n'avoir pas de possibilité réelle d'assumer une fonction capitaliste, sont broyés impitoyablement et meurent dans une longue et douloureuse agonie de secte.
6) À l'heure actuelle, on peut distinguer deux grands courants qui entrent dans la caractérisation qui vient d'être faite et qui se trouvent dans un processus semblable de sclérose et de dégénérescence. Il s'agit de groupes venant des Gauches Hollandaises et Allemande, d'une part, et Italienne d'autre part. Parmi eux, certains ont mieux résisté que les autres à cette dégénérescence, notamment "Spartacusbond" pour le premier courant et "Battaglia Communista" pour le second, au point de pouvoir se dégager en bonne partie des positions sclérosées, Par contre, d'autres groupes sont engagés beaucoup plus avant dans une telle involution : par exemple "Programme Communiste". Concernant cette dernière organisation, quel que soit le degré atteint par sa régression, il n'existe cependant pas, à l'heure actuelle, d'élément décisif permettant d'établir qu'elle est passée comme corps dans le camp bourgeois. Il faut mettre en garde contre une appréciation hâtive sur ce sujet qui risque non pas de favoriser, mais d'entraver l'évolution et le travail des éléments ou tendances qui peuvent tenter au sein de ce groupe de résister contre ce cours de dégénérescence, ou de s'en dégager.
A l'égard de l'ensemble de ces groupes, il s'agit de maintenir une attitude sereine alliant l'intransigeance dans la défense de nos positions et la dénonciation de leurs erreurs, à la manifestation de notre volonté de discuter avec eux. Ne pas faire cela traduirait une incompréhension fondamentale de nos responsabilités et du fait que la dégénérescence complète de ces groupes constitue une perte et un affaiblissement pour le prolétariat.
7) Dans la définition de l'attitude générale du CCI à l'égard des différents groupes et éléments pouvant exister ou apparaître autour de lui avec des positions plus ou moins confuses, il faut prendre en considération le fait que nous nous situons aujourd'hui dans une période de reprise historique de la lutte de classe.
Dans les périodes de recul ou de creux prolétarien, comme celle dont nous sommes sortis au milieu des années 60, la préoccupation majeure des noyaux communistes est de sauvegarder la rigueur des principes, ce qui les conduit plutôt à s'isoler à l'égard de la situation ambiante pour ne pas se laisser entraîner par elle. Dans de telles circonstances, il est vain de miser sur l'apparition de nouveaux éléments ou forces révolutionnaires : la tâche difficile de défense des principes communistes menacés par la contre-révolution revient essentiellement aux quelques éléments issus des anciens partis qu'elle n'a pas entraînés et qui sont restés fidèles à ces principes.
Par contre, dans la période de reprise actuelle, tout en portant la plus grande attention à l'évolution des courants communistes venant de la vague révolutionnaire précédente et à la discussion avec eux, nous devons avoir comme préoccupation principale de ne pas nous couper des éléments et groupes qui surgissent nécessairement dans la classe comme manifestation de cette reprise. Nous ne pourrons réellement assumer notre fonction comme pôle de regroupement à leur égard que si nous sommes en même temps capables :
- de nous garder de considérer que nous sommes le seul et unique groupement révolutionnaire existant aujourd'hui ;
- de défendre face à eux nos positions avec fermeté ;
- de conserver à leur égard une attitude ouverte à la discussion, laquelle doit se mener publiquement et non à travers des échanges confidentiels.
Loin de s'exclure, fermeté sur les principes et ouverture dans l'attitude vont de pair : nous n'avons pas peur de discuter précisément parce que nous sommes convaincus de la validité de nos positions.
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Période de transition – Projet de résolution
- 2618 reads
La plate-forme du CCI énonce les acquis essentiels du mouvement ouvrier sur les conditions et le contenu de la révolution communiste. Ces acquis peuvent être résumés ainsi :
a) Toutes les sociétés jusqu'à aujourd'hui ont été fondées sur l'insuffisance du développement des forces productives par rapport aux besoins des hommes. De ce fait, à l'exception du communisme primitif, elles ont toutes été divisées en classes sociales aux intérêts antagoniques. Cette division a provoqué l'apparition d'un organe, l'Etat, dont la fonction spécifique a été d'empêcher que ces antagonismes ne conduisent à un déchirement et à une destruction de la société elle-même.
b) Par le progrès que le capitalisme a impulsé au développement des forces productives, il a rendu nécessaire et possible son remplacement et son dépassement par une société fondée sur le plein développement des forces productives, l'abondance, la satisfaction de tous les besoins humains : le communisme. Une telle société n'est plus divisée en classes sociales et de ce fait ne connaît ni ne peut supporter l'existence d'un Etat.
c) Comme par le passé, il existe entre les deux sociétés stables que sont le capitalisme et le communisme, une période de transition pendant laquelle disparaissent les anciens rapports sociaux et se mettent en place les nouveaux. Pendant cette période, subsistent des classes sociales, des conflits entre elles et donc un organe ayant pour fonction d'empêcher que les conflits ne menacent la société : l'Etat.
d) L'expérience de la classe ouvrière a démontré que cet Etat ne peut en aucune façon constituer une continuité organique de l'Etat de la société capitaliste. C'est de fond en comble et à l'échelle mondiale que celui-ci doit être détruit pour que puisse s'ouvrir la période de transition du capitalisme au communisme.
e) La destruction mondiale du pouvoir politique de la bourgeoisie s'accompagne de la prise, du pouvoir à cette échelle par le prolétariat, seule classe qui soit porteuse du communisme. La dictature du prolétariat qui s'instaure sur la société, est basée sur l'organisation générale de la classe : les Conseils Ouvriers. C'est la classe ouvrière dans son ensemble qui seule peut exercer le pouvoir dans le sens de la transformation communiste de la société : contrairement aux classes révolutionnaires du passé, elle ne peut déléguer son pouvoir à une quelconque institution particulière, à aucun parti politique, y compris les partis ouvriers eux-mêmes.
f) Le plein exercice par le prolétariat de sa dictature de classe suppose :
- son armement général, son absolue soustraction à toute soumission à des forces extérieures, le rejet de tous rapports de violence en son sein.
g) La dictature du prolétariat exerce sa fonction de levier de la transformation sociale :
- en expropriant les anciennes classes exploiteuses,
- en socialisant progressivement les moyens de production,
- en menant une politique économique dans le sens
de l'abolition du salariat et de la production marchande, dans celui de la satisfaction croissante des besoins humains.
La plate-forme du CCI, se basant sur l'expérience de la révolution, souligne la"complexité et la gravité du problème posé par les rapports entre la classe ouvrière organisée et l'Etat de la période de transition". Elle estime que "dans la période qui vient, le prolétariat et les révolutionnaires ne pourront pas esquiver ce problème, mais se devront d'y consacrer tous les efforts nécessaires pour le résoudre". C'est dans un tel effort que s'inscrit la présente résolution.
I- SPECIFICITE DE LA PERIODE DE TRANSITION DU CAPITALISME AU COMMUNISME
La période de transition du capitalisme au communisme comporte un certain nombre de points communs avec les autres périodes de transition antérieures. C'est ainsi que, comme par le passé :
La période de transition du capitalisme au communisme ne connaît pas de mode de production propre, mais un enchevêtrement de deux modes de production;
Pendant cette période se développent lentement, au détriment de l'ancien, les germes du nouveau mode de production jusqu'au point de le supplanter;
- le dépérissement de l'ancienne société n'est pas automatiquement maturation de la nouvelle, mais seulement condition de cette maturation :
en particulier, si la décadence du capitalisme exprime le fait que les forces productives ont atteint leur limite de développement dans le cadre de cette société, ces forces productives sont encore insuffisantes pour permettre le communisme et devront donc poursuivre leur développement pendant la période de transition.
Le dernier point commun, qu'il est utile de mettre en évidence, entre toutes les périodes de transition, c'est qu'elles relèvent de la société qui va surgir. Dans la mesure où le communisme se distingue fondamentalement de toutes les autres sociétés, la transition qui y conduit comporte donc toute une série de caractéristiques inédites :
Elle ne marque plus le passage d'une société d'exploitation à une autre société d'exploitation, d'une forme de propriété à une autre forme de propriété mais conduit à la fin de toute exploitation et de toute propriété ;
Elle n'est plus l'oeuvre d'une classe exploiteuse et propriétaire des moyens de production, mais d'une classe exploitée qui n'a jamais possédé et ne possédera jamais, même collectivement, de moyens de production, d'économie propre ;
Elle n'aboutit pas à la conquête du pouvoir politique par la classe révolutionnaire ayant au préalable établi sa domination économique sur la société, mais au contraire, commence et est conditionnée par cette prise du pouvoir. La seule domination que le prolétariat ne pourra jamais exercer sur la société sera de nature politique et non économique ;
Le pouvoir politique du prolétariat n'aura pas pour fonction de stabiliser un état de choses existant, préserver des privilèges particuliers ou l'existence d'une division en classes, mais au contraire de bouleverser continuellement cet état de choses, d'abolir tous les privilèges et toute division en classes.
II - L'État et son rôle dans l’histoire
Suivant les propres termes d'Engels :
- l'Etat n'est pas un pouvoir imposé du dehors de la société, il est un produit de la société à un stade donné de son développement,
- il est l'aveu que cette société s'est engagée dans d'insolubles contradictions, s'étant scindée en oppositions inconciliables entre classes aux intérêts économiques antagonistes,
- il a pour fonction de modérer ce conflit, de le maintenir dans les "limites de l'ordre" afin que les classes antagonistes et avec elles la société ne se consument pas en luttes stériles,
- issu de la société, il se place au-dessus d'elle et tend constamment à lui devenir étranger et à se conserver lui-même,
- sa fonction de préservation de "l'ordre" identifie l'Etat aux rapports de production dominants et donc à la classe qui les incarne, la classe économiquement dominante, et qui, par l'intermédiaire de l'Etat, s'assure la domination politique.
Le marxisme n'a jamais donc considéré l'Etat comme une création ex-nihilo de la classe dominante mais bien comme un produit, une sécrétion organique de l'ensemble de la société. L'identification entre la classe économiquement dominante et l'Etat est fondamentalement le résultat de l'identité de leurs intérêts communs de préservation des rapports de production existants. De même, à partir de la conception marxiste, on ne peut en aucune façon considérer l'Etat comme un agent révolutionnaire, un instrument de progrès historique. En effet, pour le marxisme :
- 1°) La lutte de classe est le moteur de l'histoire ;
- 2°) L'État a pour fonction de modérer la lutte de classe et tout particulièrement au détriment de la classe exploitée.
La seule conclusion découlant logiquement de ces prémices est que dans toute société l'Etat ne peut être autre chose qu'une institution conservatrice par essence et par excellence. Aussi, si l'Etat est dans les sociétés de classe un instrument indispensable au processus productif en ce qu'il assure la stabilité nécessaire à sa continuation, il ne peut jouer ce rôle que par sa fonction d'agent de l'ordre social. Au cours de l'histoire, l'Etat apparaît donc comme un facteur conservateur et réactionnaire de premier ordre, comme une entrave à laquelle se heurtent constamment l'évolution et le développement des forces productives.
Afin de pouvoir assurer son rôle d'agent de sécurité et de conservation, l'Etat s'appuie sur une force matérielle, sur la violence. Dans les sociétés passées, il possède en monopole exclusif toutes les forces de violence existantes : la police, l'armée, les prisons.
Ayant son origine dans la nécessité historique de la violence, trouvant dans l'exercice de la coercition la condition de son épanouissement, l'Etat tend à devenir un facteur indépendant et supplémentaire de violence dans l'intérêt de son auto-conservation, de sa propre existence. La violence, en tant que moyen devient un but en soi, entretenu et cultivé par l'Etat, répugnant de par sa nature même à toute forme de société tendant à se passer de violence en tant que régulateur des rapports entre les hommes.
III- L'État dans la période de transition au communisme
L'existence, dans la période de transition, d'une division de la société en classes aux intérêts antagoniques fait surgir au sein de celle-ci, un Etat. Cet état a pour tâche de garantir les bases de la société transitoire à la fois contre toute tentative de restauration du pouvoir des anciennes classes exploiteuses et contre tout déchirement résultant des oppositions entre les différentes classes non exploitées qui subsistent en son sein.
L'État de la période de transition comporte un certain nombre de différences d'avec celui des sociétés antérieures :
- pour la première fois de l'histoire, ce n'est pas l'Etat d'une minorité exploiteuse pour l'oppression de la majorité mais au contraire celui de la majorité des classes exploitées et non exploiteuses contre la minorité des anciennes classes dominantes déchues ;
- il n'est pas l'émanation d'une société et de rapports de production stables mais au contraire d'une société dont la caractéristique permanente est le constant bouleversement dans lequel s'opèrent les plus grandes transformations que l'histoire ait connues ;
- il ne peut s'identifier à aucune classe économiquement dominante dans la mesure où il n'existe aucune classe de ce type dans la période de transition ;
- contrairement à l'Etat des sociétés passées, celui de la société transitoire n'a plus le monopole des armes. C'est pour l'ensemble de ces raisons et de leurs implications que les marxistes ont pu parler de "demi-État" au sujet de l'organe surgissant dans la période de transition.
Par contre, cet État conserve un certain nombre de caractéristiques de ceux du passé. Il reste en particulier l'organe gardien du statu-quo, chargé de codifier, légaliser un état économique déjà existant, de le sanctionner, de lui donner force de loi dont l'acceptation est obligatoire pour tous les membres de la société. En ce sens, l'Etat reste un organe fondamentalement conservateur tendant :
- non à favoriser la transformation sociale mais s'opposer à celle-ci,
- à maintenir en vie les conditions qui le font vivre : la division de la société en classes,
- à se détacher de la société, à s'imposer à elle et perpétuer sa propre existence et ses propres privilèges,
- à lier son existence à la coercition, à la violence qu'il utilise nécessairement pendant la période de transition et à tenter de maintenir ce type de régulation des rapports sociaux.
C'est pour cela que l'Etat de la période de transition a été depuis le début considéré par les marxistes comme un "fléau", "un mal nécessaire" dont il s'agit de"limiter les effets les plus fâcheux". Pour l'ensemble de ces raisons, et contrairement à ce qui s'est produit dans le passé, la classe révolutionnaire ne peut s'identifier avec l'Etat de la période de transition.
D'une part, le prolétariat n'est pas une classe économiquement dominante. Il ne l'est ni dans la société capitaliste ni dans la société transitoire. Dans celle-ci, il ne possède aucune économie, aucune propriété même collective mais lutte pour la disparition de l'économie, de la propriété. D'autre part, le prolétariat, classe porteuse du communisme, agent du bouleversement des conditions économiques et sociales de la société transitoire, se heurte nécessairement à l'organe tendant à perpétuer ces conditions. C'est pour cela qu'on ne peut parler ni "d'Etat socialiste", ni "d'Etat ouvrier", ni "d'Etat du prolétariat" durant la période de de transition.
Cet antagonisme entre prolétariat et Etat Se manifeste tant sur le plan immédiat que sur le plan historique.
Sur le terrain immédiat, le prolétariat devra s'opposer aux empiétements et à la pression de l'Etat en tant que représentant d'une société dans laquelle subsistent des classes aux intérêts antagoniques aux siens.
Sur le terrain historique, la nécessaire extinction de l'Etat dans le Communisme, déjà mise en évidence par le marxisme, ne sera pas le résultat de sa dynamique propre mais le fruit d'une pression soutenue de la part du prolétariat qui le dépouillera progressivement de tous ses attributs au fur et à mesure de l'évolution vers la société sans classe.
Pour ces raisons, si le prolétariat doit se servir de l'Etat de la période de transition, il doit conserver sa complète indépendance à l'égard de cet organe. En ce sens, la dictature du prolétariat ne se confond pas avec l'Etat. Entre les deux, existe un rapport de forces constant que le prolétariat devra maintenir en sa faveur : la dictature du prolétariat ne s'exerce pas dans l'Etat ni à travers l'Etat mais sur l'Etat.
Moyens concrets des rapports entre dictature du prolétariat et État de la période de transition
L'expérience de la Commune d'une part, et celle de la révolution en Russie d'autre part, au cours de laquelle l'Etat a constitué l'agent majeur de la contre-révolution en Russie même, ont mis en évidence la nécessité d'un certain nombre de moyens permettant :
- de limiter les aspects "les plus fâcheux de l'Etat",
- d'assurer la pleine indépendance de la classe révolutionnaire,
- de permettre la dictature du prolétariat sur l'Etat.
a) la limitation des caractéristiques les plus néfastes de l'Etat de la société transitoire passe par :
- le fait qu'il ne se constitue pas sur une couche spécialisée, les partis politiques, mais sur la base de délégués élus par les organisations territoriales, les Conseils Locaux et révocables par elle ;
- que toute cette organisation étatique exclue catégoriquement toute participation des couches et classes exploiteuses qui sont privées de tout droit politique ;
- que la rémunération de ses membres, des fonctionnaires,ne peut jamais être supérieure à celle des ouvriers.
b) l'indépendance de la classe ouvrière se manifeste par :
- le programme,
- l'existence de ses partis de classe qui, contrairement aux partis bourgeois, ne peuvent, comme tels, ni s'intégrer à l'Etat, ni assumer de fonction étatique sous peine de dégénérer et de perdre complètement leurs fonctions spécifiques dans la classe, sa propre organisation de classe : les Conseils ouvriers, distincts de toute institution étatique, son armement propre.
Elle s'exerce contre l'Etat et les autres classes de la société :
- en ce qu'elle interdit toute intervention de leur part dans l'activité et l'organisation propre du prolétariat,
- en ce qu'elle se réserve toute possibilité,
- de défendre ses intérêts immédiats par l'utilisation de divers moyens de pression dont la grève.
c) la domination de la dictature du prolétariat sur l'Etat et l'ensemble de la société se base essentiellement :
- sur l'interdiction de toute organisation propre aux autres classes en tant que classes,
- par sa participation hégémonique au sein de l'organisation d'où émane l'Etat,
- sur le fait qu'elle s'impose comme seule classe armée.
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Communisme [12]
Période de transition - Contre-projet de résolution
- 2799 reads
-
"Il faut tenir compte de l'impossibilité d'arriver en une phase qui s'appelle de transition à des notions fixes, complètes, ne souffrant aucune contradiction logique et exempte de toute idée de transition" (Bilan)
A – La période de transition du capitalisme au communisme.
1) La succession des modes de production esclavagiste, féodal, capitaliste ne connaissait pas à proprement parler de périodes de transition. Les nouveaux rapports, sur la base desquels s'édifiait la forme sociale progressive, étaient créés à l'intérieur de l'ancienne société. Le vieux système et le nouveau coexistaient (jusqu'à ce que le second supplante le premier) et cette cohabitation était possible parce qu'entre ces diverses sociétés n'existait qu'un antagonisme de forme alors qu'elles restaient par essence des sociétés d'exploitation. La succession du communisme au capitalisme diffère fondamentalement de celles du passé. Le communisme ne peut émerger au sein du capitalisme parce qu'entre ces deux sociétés, il y a non seulement différence de forme mais également différence de contenu. Le communisme n'est plus une société d'exploitation et le mobile de la production n'est plus la satisfaction des besoins d'une minorité. Cette différence de contenu exclut la coexistence de l'un et de l'autre et crée la nécessité d'une phase transitoire au cours de laquelle les nouveaux rapports et la nouvelle société se développent à l'extérieur du capitalisme.
2) Entre la société capitaliste et la société communiste se place donc une phase de transformation révolutionnaire de celle-ci en celle-là. Cette phase transitoire est non seulement inévitable, mais encore nécessaire, pour combler l'immaturité des conditions matérielles et spirituelles léguées par le capitalisme au prolétariat (immaturité qui interdit le règne immédiat du communisme au sortir de la révolution). Cette période se caractérise par la fusion de deux processus sociaux : l'un de décroissance des rapports et catégories appartenant au système en déclin, l'autre de croissance des rapports et catégories qui relèvent du système nouveau. La spécificité de l'époque de transition réside en ceci : le prolétariat qui a conquis le pouvoir politique (par la révolution) et garanti sa domination (par la dictature) s'engage dans le bouleversement ininterrompu et systématique des rapports de production et des formes de conscience et d'organisation qui en dépendent. Pendant la phase intermédiaire, par des mesures politiques et économiques, la classe ouvrière développe les forces productives laissées en héritage par le capitalisme, en sapant les bases de l'ancien système et en dégageant les bases de nouveaux rapports sociaux fondés sur une répartition de la masse des produits (et des conditions de la production) permettant à tous les producteurs de réaliser la pleine satisfaction, la libre expansion de leurs besoins.
B – Le régime politique de la période de transition.
3) Pour le capitalisme, la substitution de son privilège au privilège féodal, l'époque des révolutions bourgeoises pouvaient s'accommoder d'une coexistence durable entre États capitalistes et États féodaux, voire même pré-féodaux, sans altérer ou supprimer les assises du nouveau système. La bourgeoisie, sur la base de positions économiques conquises graduellement n'avait pas non plus à détruire l'appareil d'État de l'ancienne classe dominante dont elle s'était progressivement emparé. Elle n'eut à supprimer ni la bureaucratie, ni la police, ni la force armée permanente, mais à subordonner ces instruments d'oppression à ses fins propres, parce que la révolution politique (qui n'était pas toujours indispensable) concrétisait une hégémonie économique et ne faisait que substituer juridiquement une forme d'exploitation à une autre. Il en va tout autrement pour le prolétariat qui, n'ayant aucune assise économique et aucun intérêt particulier, ne peut se contenter de prendre tel quel l'ancien appareil d'État. La période de transition ne peut débuter qu'après la révolution prolétarienne dont l'essence consiste en la destruction mondiale de la domination politique du capitalisme et, en premier lieu, des États bourgeois nationaux. La prise du pouvoir politique général dans la société par la classe ouvrière, l'instauration mondiale de la dictature du prolétariat précédent, conditionnent et garantissent la marche de la transformation économique et sociale.
4) Le communisme est une société sans classes et, partant, sans État. La période de transition qui ne se développe réellement qu'après le triomphe de la révolution à l'échelle internationale, est une période dynamique qui tend vers la disparition des classes, mais qui connaît encore la division en classes et la persistance d'intérêts divergents et antagoniques dans la société. Comme telle, elle fait surgir inévitablement une dictature et une forme d'État politique. Le prolétariat ne peut parer à l'insuffisance temporaire des forces productives que lui lègue le capitalisme sans recourir à la contrainte. En effet, l'époque de transition est caractérisée par la nécessité de discipliner et de réglementer l'évolution de la production, de l'orienter vers un épanouissement qui permettra l'établissement de la société communiste. Les menaces de restauration bourgeoise sont également en fonction de cette insuffisance de la production et des forces de production. La dictature et l'utilisation de l'État sont indispensables au prolétariat placé devant la nécessité de diriger 1'emploi de la violence pour extirper les privilèges de la bourgeoisie, dominer celle-ci politiquement et organiser de manière nouvelle les forces de production libérées progressivement des entraves capitalistes.
C – Conditions d’apparition et rôle de l’État dans l’histoire.
5) Dans toute société divisée en classes, afin d'empêcher que les classes aux intérêts opposés et inconciliables ne se détruisent mutuellement, et par là même consument la société, surgissent des superstructures, des institutions, dont le couronnement est l'État. L'État naît pour maintenir les conflits de classes dans des limites déterminées. Cela ne signifie nullement qu'il parvient à concilier les intérêts antagoniques sur un terrain d'entente "démocratique", ni qu'il fasse office de "médiateur" entre les classes. Comme l'État surgit du besoin de discipliner les antagonismes de classes, mais comme en même temps il surgit au milieu du conflit entre les classes, il est en général l'État de la classe la plus puissante, de celle qui s'est imposée politiquement et militairement dans le rapport de force historique, et qui, par l'intermédiaire de l'État, impose et garantit sa domination.
L'État est l'organisation spéciale d'un pouvoir (Engels), c'est l'exercice centralisé de la violence par une classe contre les autres, destinée à fournir à la société un cadre conforme aux intérêts de la classe dominante. L'État est l'organisme qui maintient la cohésion de la société, non en réalisant un soi-disant "bien commun" (parfaitement inexistant), mais en assurant l'ensemble des tâches de domination d'une classe aux divers niveaux économique, juridique, politique et idéologique. Son rôle propre est non seulement de type administratif, mais surtout de maintenir par la violence les conditions de domination de la classe dominante contre les classes dominées, pour assurer 1'extension, le développement, la conservation de rapports de production spécifiques contre les dangers de restauration ou de destruction.
6) Quelles que soient les formes que prennent la société, les classes et l'État, le rôle de celui-ci reste toujours fondamentalement : assurer la domination d'une classe sur les autres. L'État n'est donc pas "par essence une entité conservatrice". Il est révolutionnaire à certaines époques, conservateur ou contre-révolutionnaire à d'autres, parce que loin d'être un facteur autonome dans l'histoire, il est l'instrument, le prolongement, la forme d'organisation de classes sociales qui prennent naissance, mûrissent et disparaissent. L'État est étroitement lié au cycle de la classe et s'avère donc progressif ou réactionnaire selon l'action historique de la classe sur le développement des forces productives de la société (selon qu'elle concourt à favoriser ou à freiner leur développement).
Il faut se garder cependant d'une vision strictement "instrumentaliste" de l'État. Par définition arme de classe dans les conflits immédiats et de sociétés, l'État est affecté en retour par ces mêmes conflits. Loin d'être simplement tributaires de la volonté (traduction de la nécessité) d'une classe d'assurer sa domination, les appareils d'État subissent les pressions des diverses classes et des divers intérêts. Interviennent dans les déterminations d'action de l'État (et les possibilités de son évolution) aussi bien le cadre économique, le niveau du droit, que les rapports de force politiques et militaires. C'est en ce sens que l'État "n'est jamais en avance sur l'état de chose existant". En effet, si l'État permet, à certaines époques, aux classes progressives d'exercer le pouvoir politique, en vue de l'extension de rapports de production déterminés, il est contraint -à ces mêmes époques et pour poursuivre ce même but- de défendre la société nouvelle contre les menaces internes et externes, de relier les aspects épars de la production, de la distribution, de la vie sociale, culturelle, idéologique, et ce, avec des moyens (ceux qui existent et dont il peut disposer) qui ne relèvent pas toujours et forcément du programme de la classe révolutionnaire, d'une tendance de la nouvelle société en train de naître. "Ainsi, il faut considérer que la formule “l'État” est l'organe d'une classe n'est pas d'un point de vue formel, une réponse en soi aux phénomènes qui se déterminent, la pierre philosophale qui doit être recherchée au travers des faits, mais qu'elle signifie qu'entre la classe et l'État se déterminent des rapports qui dépendent de la fonction d'une classe donnée". (Bilan)
D – Nécessité des soviets comme pouvoir d’État du prolétariat.
7) L'État qui succède à l'État bourgeois est une forme nouvelle d'organisation du prolétariat, grâce à laquelle celui-ci se transforme, de classe opprimée, en classe dominante et exerce sa dictature révolutionnaire sur la société. Les Soviets territoriaux (des ouvriers, des paysans pauvres, des soldats...) en tant que puissance étatique du prolétariat signifient :
-
la tentative par le prolétariat en tant que seule classe porteuse du communisme, de lutter pour l'organisation de l'ensemble des classes et couches exploitées ;
-
la continuation à l'aide du système soviétique, de la lutte de classe contre la bourgeoisie qui reste encore la classe la plus puissante même au début de la dictature du prolétariat, même après son expropriation et sa subordination politique.
Le prolétariat a encore besoin d'un appareil d'État, aussi bien pour réprimer la résistance désespérée de la bourgeoisie que pour diriger la grande masse de la population dans la lutte contre la classe capitaliste et la mise en place du communisme. Cette situation n'a nullement besoin d'être idéalisée : "L'État n'étant qu'une, institution temporaire dont on est obligé de se servir dans la lutte, dans la révolution, pour organiser la répression par la force contre ses adversaires, il est parfaitement absurde de parler d'un État populaire libre ; tant que le prolétariat fait encore usage de l'État, ce n'est point dans l'intérêt de la liberté, mais pour réprimer ses adversaires". (Engels)
8) Produit de la division en classes de la société, de la nature inconciliable des antagonismes de classes, la dictature du prolétariat se distingue cependant (et avec elle son État) du pouvoir des classes dominantes dans le passé par les caractéristiques suivantes :
-
le prolétariat n'exerce pas sa dictature en vue de bâtir une nouvelle société d'oppression et d'exploitation. Par conséquent, il n'a nullement besoin, comme les anciennes classes dominantes, de cacher ses buts, de mystifier les autres classes en présentant sa dictature comme le règne de "la liberté, de l'égalité, de la fraternité". Le prolétariat affirme hautement que sa dictature est une dictature de classe ;
-
que les organes de son pouvoir politique sont des organismes qui servent, par leur action, le programme prolétarien, à l'exclusion du programme et des intérêts de toutes les autres classes.
C'est ainsi que Marx, Engels, Lénine, la Fraction parlaient -pouvaient et devaient parler- non d'un État "de la majorité des classes exploitées et non-exploiteuses" (l'encadrement des formations intermédiaires dans l'État n'étant pas synonyme de partage du pouvoir), non d'un État "a-classiste" ou "multiclassiste" (notions idéologiques et aberrantes par définition), mais d'un État prolétarien, d'un État de la classe ouvrière, ce dernier étant l'une des formes indispensables de la dictature du prolétariat.
La domination de la majorité, organisée et dirigée par le prolétariat sur la minorité dépossédée de ses prérogatives, rend inutile le maintien d'une machine bureaucratique et militaire, à laquelle le prolétariat substitue, et son propre armement -pour briser toute résistance bourgeoise- et une forme politique lui permettant d'accéder progressivement (et par devers lui l'ensemble de l'humanité) à la gestion sociale. Il supprime tous les privilèges inhérents au fonctionnement des anciens États (nivellement des traitements, contrôle rigoureux des fonctionnaires : électivité complète et révocabilité à tous moments) ainsi que la séparation réalisée par le parlementarisme entre organismes législatifs et exécutifs. Dès sa formation, l'État de la dictature du prolétariat cesse de la sorte d'être un "État" au vieux sens du terme. A l'État bourgeois se substituent les Soviets, un demi-État, un État-Commune ; l'organe de domination de l'ancienne classe est remplacé par des institutions de principe essentiellement différent.
E – Dépérissement ou renforcement de l’État.
9) Tenant compte des considérations que nous avons évoquées quant aux conditions et à l'ambiance historiques dans lesquelles naît l'État prolétarien, il est évident que le dépérissement de celui-ci ne peut se concevoir que comme le signe du développement de la révolution mondiale et, plus profondément, de la transformation économique et sociale. Dans des conditions de combat défavorables (sur le triple plan politique, militaire, économique), l'État ouvrier peut se trouver contraint de se renforcer, à la fois pour empêcher la désagrégation de la société et pour assurer les tâches de défense de la dictature prolétarienne érigée dans un ou plusieurs pays. Cette obligation réagit à son tour sur sa nature même : l'État acquiert un caractère contradictoire : instrument de classe, il est cependant forcé de répartir les biens -les conditions de la production- et les responsabilités sociales selon des normes qui ne relèvent pas toujours et forcément d'une tendance immédiate vers le communisme. En cohérence avec la conception développée par Lénine, Trotsky, et surtout par Bilan, nous devons donc admettre -au-delà de préoccupations métaphysiques- que l'État ouvrier, bien qu'assurant la domination du prolétariat sur la bourgeoisie, exprime toujours l'impuissance temporaire à supprimer le droit bourgeois. Ce dernier continue à exister, non seulement dans le déroulement économique et social mais dans le cerveau de millions de prolétaires, de milliards d'individus. L'État menace continuellement, même après la victoire politique du prolétariat, de donner vie à des stratifications sociales s’opposant sans cesse davantage à la mission libératrice de la classe ouvrière. Aussi, a certaines époques, "si l'État, au lieu de dépérir, devient de plus en plus despotique, si les mandataires de la classe ouvrière se bureaucratisent, tandis que la bureaucratie s'érige au-dessus de la société, ce n'est pas seulement pour des raisons secondaires, telles que les survivances idéologiques du passé, etc., c'est en vertu de l'inflexible nécessité de former et d'entretenir une minorité privilégiée, tant qu'il n'est pas possible d'assurer l'égalité réelle". (Trotsky). Jusqu'à la disparition de l'État, jusqu'à sa résorption dans une société s'administrant elle-même, celui-ci continue à receler cet aspect négatif : instrument nécessaire de 1'évolution historique, il menace constamment de diriger cette évolution non à l'avantage des producteurs, mais contre eux et vers leur massacre.
F – Le prolétariat et l’État
10) La physionomie spécifique de l'État ouvrier se dévoile en ceci :
-
d'une part, comme arme dirigée contre la classe expropriée, il révèle son côté "fort" ;
-
d'autre part, comme organisme appelé non pas à consolider un nouveau système d'exploitation mais à les abolir tous, il découvre son côté "faible" (parce que dans des conditions défavorables, il tend à devenir le pôle d'attraction des privilèges capitalistes). C'est pourquoi, alors qu'entre la bourgeoisie et l'État bourgeois, il ne pouvait y avoir d'antagonismes, il peut en surgir entre le prolétariat et 1' État transitoire. Avec la fondation de l'État prolétarien, le rapport historique entre la classe dominante et l'État se trouve modifié.
Il faut considérer que :
a) la conquête de la dictature du prolétariat, l'existence de l'État ouvrier sont des conditions nouvelles à l’avantage du prolétariat mondial, non une garantie irrévocable contre toute entreprise de dégénérescence ;
b) si l'État est ouvrier, cela ne signifie nullement qu'il n'y ait aucun besoin ou possibilité pour le prolétariat d'entrer en conflit avec lui, de telle sorte qu'il ne faille tolérer aucune opposition à la politique étatique ;
c) à l'inverse des États du passé, l'État prolétarien ne peut synthétiser, concentrer dans ses appareils, tous les aspects de la dictature. L'État ouvrier se différencie profondément de l'organisme unitaire de classe et de l'organisation qui regroupe l'avant-garde du prolétariat, cette différenciation s'opérant parce que l'État, malgré l'apparence de sa plus grande puissance matérielle, possède, au point de vue politique de moindres possibilités d'action. Il est mille fois plus vulnérable par l'ennemi que les autres organismes ouvriers. Le prolétariat ne peut compenser cette faiblesse que par la politique de classe de son Parti et de Conseils Ouvriers, au moyen desquels il exerce un contrôle indispensable sur l'activité étatique, développera sa conscience de classe et préservera la défense de ses intérêts. La présence agissante de ces organismes est la condition pour que l'État reste prolétarien. Le fondement de la dictature réside non seulement dans le fait que nulle inter diction ne s'oppose au fonctionnement des Conseils Ouvriers et du Parti (proscription de la violence au sein du prolétariat, permanence du droit de grève, autonomie des Conseils et du Parti, liberté de tendance dans ces organes), mais aussi que les moyens leur soient octroyés pour résister à une métamorphose éventuelle de l'État, non vers le dépérissement, mais vers le triomphe de son despotisme.
G – Sur la dictature et les tâches de l’État ouvrier
12) Le rôle du capitalisme, son but, suffisaient à indiquer le rôle de ses différentes formes d'État : maintenir l'oppression au profit de la bourgeoisie. Pour ce qui est du prolétariat, c'est encore une fois, le rôle et le but de la
classe ouvrière qui détermineront le rôle et le but de l'État prolétarien. Mais ici, le critère de la politique menée par l'État n'est plus un élément indifférent pour déterminer son rôle (comme c'était le cas pour la bourgeoisie et pour toutes les classes précédentes), mais un élément d'ordre capital dont va dépendre sa fonction d'appui à la révolution mondiale, et, en définitive, la conservation de son caractère prolétarien.
13) Une politique prolétarienne dirigera l'évolution économique vers le communisme seulement si celle-ci reçoit une orientation diamétralement opposée à celle du capitalisme, si donc elle se dirige vers une élévation progressive et constante des conditions de vie des masses et non vers leur abaissement. Dans la mesure où le permet le contexte politique, le prolétariat doit agir dans le sens d'une diminution constante du travail non payé, ce qui amené inévitablement comme conséquence un rythme de l'accumulation suivant un cours extrêmement ralenti par rapport à celui de l'économie capitaliste. Toute autre politique entraînerait inéluctablement la conversion de l'Etat prolétarien en un nouvel Etat bourgeois à l'image de ce qui s'est passé en Russie.
14) En aucun cas, l'accumulation ne peut se baser sur la nécessité de l'accumulation pour battre la puissance économique et militaire des Etats capitalistes. La révolution mondiale ne peut résulter que de la capacité du prolétariat de chaque pays à s'acquitter de sa mission, de la maturation mondiale des conditions politiques pour l'insurrection. La classe ouvrière ne peut reprendre à la bourgeoisie sa vision de la "guerre révolutionnaire". Dans la période de guerre civile, le contraste ne passe pas entre État(s) prolétarien(s) et Etats capitalistes, mais entre prolétariat mondial et bourgeoisie mondiale. Dans l'activité de l'Etat prolétarien, les domaines économiques et militaires sont forcément d'ordre secondaire.
15) L'État transitoire est essentiellement un instrument de domination politique qui ne peut suppléer à la lutte de classe internationale. L'État ouvrier doit être considéré comme un outil de la révolution mondiale et au grand jamais comme le pôle de concentration de cette dernière. Si le prolétariat obéissait au second des deux critères, il serait forcé de passer à des compromis avec les classes ennemies alors que les nécessités révolutionnaires réclament impérieusement une lutte sans merci contre toutes les formations anti-prolétariennes même au risque d'aggraver la désorganisation économique résultant de la révolution. Toute autre perspective qui partirait de soucis soi-disant "réalistes" ou d'une prétendue "loi du développement inégal" ne pourrait que vicier les fondements de l'État prolétarien et conduire à sa transformation en État bourgeois sous le couvert fallacieux du "socialisme en un seul pays".
16) La dictature du prolétariat doit veiller à ce que les formes et les procédés de contrôle des masses soient multiples et variés afin de parer à toute ombre de dégénérescence et de déformation du pouvoir des Soviets, dans le but également d'arracher sans cesse "l'ivraie bureaucratique", excroissance qui accompagne inévitablement la période transitoire. La sauvegarde de la révolution est conditionnée par l'activité consciente des masses ouvrières. La véritable tâche politique du prolétariat consiste à élever sa propre conscience de classe comme à transformer la conscience de l'ensemble des couches travailleuses, tâche à côté de laquelle l'exercice de la contrainte se manifestant au travers des organismes administratifs et policiers de l'État ouvrier est secondaire (et le prolétariat doit veiller à en limiter les plus fâcheux effets). Le prolétariat ne doit pas perdre de vue ceci : que "tant qu'il fait encore usage de l'État, il ne le fait pas dans l'intérêt de la liberté, mais pour avoir raison de son adversaire".
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Communisme [12]
DEBAT : L’État et la dictature du prolétariat
- 2674 reads
Présentation
Avant l'expérience de la Révolution en Russie, les marxistes avaient une conception du rapport entre le prolétariat et l’État au cours de la période de transition du capitalisme au communisme, qui était relativement simple dans son essence.
On savait que cette transition devrait commencer par la destruction du pouvoir politique de la bourgeoisie et que cette phase ne faisait que précéder, en la préparant, la société communiste qui ne connaîtrait, elle, ni classes, ni pouvoir politique, ni État. On savait qu'au cours de ce mouvement la classe ouvrière devrait instaurer sur le reste de la société sa dictature. On savait aussi qu'au cours de cette période qui porte encore tous les stigmates du capitalisme, en particulier par la subsistance de la pénurie matérielle et des divisions de la société en classes, il subsisterait inévitablement un appareil de type étatique ; on savait enfin, surtout grâce à l'expérience de la Commune de Paris en 1871, que cet appareil ne pourrait pas être l' État bourgeois "conquis" par les ouvriers, mais qu'il serait dans ses formes et dans son contenu une institution transitoire essentiellement différente de tous les États ayant existé jusqu'alors. Mais, en ce qui concerne le problème du rapport entre la dictature du prolétariat et cet État, entre la classe ouvrière et cette institution produit des héritages du passé, on croyait pouvoir résoudre la question par une idée simple : dictature du prolétariat et État de la période de transition sont une et même chose, classe ouvrière armée et État sont identiques. En quelque sorte, au cours de la période de sa dictature, le prolétariat, croyait-on, pourrait reprendre à son compte la célèbre formule de Louis XIV : "L'État c'est moi".
Ainsi, dans le Manifeste Communiste, cet État est décrit comme "Le prolétariat organisé en classe dominante" ; de même, dans la Critique du Programme de Gotha, Marx écrivait :
-
"Entre la société capitaliste et la société communiste se situe la période de transformation révolutionnaire de l'une en l'autre. A cette période correspond également une phase de transition politique où l’État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat".
Plus tard, à la veille d'Octobre 17, Lénine, en plein combat contre la Social-démocratie qui se vautrait dans le bourbier du premier massacre mondial en participant aux gouvernements des États bourgeois belligérants, reprenait avec force cette idée dans l' État et la Révolution :
-
"... (les marxistes) proclament la nécessité pour le prolétariat, après qu'il aura conquis le pouvoir politique, de détruire entièrement la vieille machine d'État et de la remplacer par une nouvelle, qui consiste dans l'organisation des ouvriers armés ..." ;
ou encore :
-
"La Révolution consiste en ceci : le prolétariat détruit l'"appareil administratif" et l'appareil d’État tout entier pour le remplacer par un nouveau, qui est constitué par les ouvriers armés".
Il découlait tout naturellement de cette vision que l’État de la Période de Transition ne pour rait être autre chose que l'expression la plus achevée, la plus efficace de la classe ouvrière et de son pouvoir. Tout paraissait assez simple dans le rapport entre État et prolétariat puisqu'ils devaient être une seule et même chose. La bureaucratie étatique ? Elle n'existe rait pas ou constituerait un problème sans importance majeure puisque les ouvriers eux-mêmes (même une cuisinière, disait Lénine) assumeraient sa fonction. Envisager sérieusement la possibilité d'un antagonisme, d'une opposition entre classe ouvrière et État sur le terrain économique ? Impossible ! Comment le prolétariat pourrait-il faire grève contre l’État puisque l’État ce serait lui ? Comment l’État pourrait-il, de son côté, chercher à imposer quoi que ce soit de contraire aux intérêts économiques de la classe ouvrière puisqu'il en serait l'émanation directe ? Envisager un antagonisme sur le terrain politique semblait encore plus invraisemblable : l’État ne devait-il pas être l'instrument le plus achevé de la dictature du prolétariat ? Comment pourrait-il exprimer des forces contre-révolutionnaires puisqu'il devait être par définition le fer de lance du combat du prolétariat contre la contre-révolution ?
La Révolution Russe apporta un démenti cinglant à cette vision trop simple, mais qui prédominait inévitablement dans le mouvement ouvrier international qui, à l'exception de l'expérience des deux mois de la Commune de Paris, ne s'était jamais affronté réellement aux problèmes de la Période de Transition dans toute leur complexité.
Ainsi, au lendemain de la prise du pouvoir d'Octobre 17, l'on proclama l'État, "État Prolétarien" ; les meilleurs des ouvriers, les combattants les plus expérimentés furent placés à la tête des principaux organes de l' État ; on interdit les grèves ; on se promit d'accepter toute décision des organes de l'État comme expression des nécessités globales du combat révolutionnaire ; bref, on inscrivit dans les lois et dans la chair de la révolution naissante l'identité tant proclamée entre État et classe ouvrière.
Mais, dès les premiers moments, les impératifs de la subsistance sociale entreprirent de contredire systématiquement le fondé d'une telle identification. Devant les difficultés auxquelles devait faire face la Révolution Russe étouffée progressivement par son isolement international, l'appareil de l'État s'avéra constituer non pas un corps identique aux "ouvriers armés", ni l'incarnation la plus globale de la dictature du prolétariat, mais au contraire un corps de fonctionnaires bien distinct du prolétariat et une force dont les tendances innées n'étaient pas à la révolution communiste, mais au contraire au conservatisme. La bureaucratisation des fonctionnaires chargés de l'organisation de la production, la distribution, le maintien de l'ordre, etc., se développa dès les premiers mois sans que personne, ni même les premiers responsables du Parti Bolchevik à la tête de l'État -qui ne manquèrent pourtant pas de la combattre- n'y puissent rien, et surtout, sans que l'on pût reconnaître dans cette bureaucratie étatique une force contre-révolutionnaire, puisqu'elle était "l'État Prolétarien".
Sur le terrain économique comme sur le terrain politique, un fossé se creusa progressivement entre la classe ouvrière et ce qui était supposé être "son" État. Dès la fin de 1917, des grèves économiques éclataient à Petrograd ; dès 1919, des courants communistes de gauche ouvriers dénonçaient la bureaucratie étatique et son opposition aux intérêts de la classe ouvrière ; en 1920-21, à la fin de la guerre civile, ces antagonismes explosaient ouvertement dans les grèves de Petrograd de 1920 et l'insurrection de Kronstadt de 1921 réprimée par l'Armée Rouge. Bref, dans le combat pour le maintien de son pouvoir, le prolétariat en Russie ne trouve pas dans l'État l'instrument auquel il s'attendait, mais au contraire une force de résistance qui bientôt se transforma en principal protagoniste de la contre-révolution.
La défaite de la Révolution Russe fut certes, en dernière instance, le produit de la défaite de la révolution mondiale et non de l'action de l’État. Mais dans ce combat contre la contre-révolution, l'expérience mit en évidence que l'appareil d’État et sa bureaucratie n'étaient ni le prolétariat, ni même le fer de lance de sa dictature, encore moins une institution à laquelle la classe révolutionnaire en armes devrait se soumettre au nom d'une soi-disant "nature prolétarienne".
Il est vrai que l'expérience du prolétariat en Russie était condamnée à l'échec du moment qu’elle n'était pas parvenue à s'étendre mondialement. Il est certain que la puissance de l'antagonisme État-prolétariat fut une manifestation de la faiblesse du prolétariat mondial et de l'inexistence des conditions matérielles pour un véritable épanouissement de la dictature du prolétariat. Mais ce serait se bercer à nouveau d'illusions que de croire que seule l'ampleur de ces difficultés expliquent cet antagonisme, et que, dans des conditions meilleures, l'identification dictature du prolétariat-État de la Période de Transition resterait valable. La Période de Transition est une phase où le prolétariat affronte une difficulté fondamentale : celle d'établir de nouveaux rapports sociaux alors que par définition, les conditions matérielles de leur épanouissement ne font alors que s'instaurer sous l'action révolutionnaire des ouvriers en armes. Cette difficulté s'est développée en Russie sous ses formes les plus extrêmes, mais elle n'en était pas moins dans son essence la même que le prolétariat retrouvera demain. L'importance des entraves rencontrées par la dictature du prolétariat en Russie ne fait pas de cette expérience une exception qui infirmerait la règle de l'identité Prolétariat-État de la Période de Transition, mais au contraire un facteur qui a permis de mettre en lumière, sous ses formes les plus aiguës, l'inévitabilité et la nature de l'antagonisme qui oppose la force révolutionnaire prolétarienne et l'institution du maintien de l'ordre pendant la Période de Transition.
Depuis sa constitution, le CCI, à la suite des travaux de la Gauche Italienne (Bilan) pendant l'entre-deux-guerres et ceux du groupe Internationalisme, dans les années 40, a entrepris la complexe et indispensable tâche de reprendre, revoir et compléter la compréhension révolutionnaire du rapport entre État et Prolétariat au cours de la Période de Transition à la lumière de l'expérience russe (voir n°s 1, 3 et 6 de la Revue Internationale).
Dans le cadre de cet effort, nous publions ici, d'une part, la lettre d'un camarade qui réagit critiquement aux thèses développées à ce sujet dans la Résolution adoptée par le IIème Congrès de Révolution Internationale, section en France du C.C.I. (voir Revue Internationale n° 6) et d'autre part, une réponse à cette critique.
CCIConscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
DEBAT : Lettre de E.
- 2583 reads
Le marxisme, dans la mesure où il est une connaissance scientifique de la succession des modes et des formes sociales de la production dans le passé, est aussi la prévision des étapes et des caractéristiques fondamentales et indissociables de la succession de l'ultime forme sociale, le communisme à partir de celle où nous vivons. Les formes économiques se transforment selon un processus ininterrompu dans l'histoire de la société humaine. Mais ce processus se traduit sous la forme de périodes de convulsions, de luttes pendant lesquelles l'affrontement politique et armé des classes brise les entraves qui empêchent l'accouchement et le développement accéléré de la nouvelle forme, c'est la période de la lutte pour le pouvoir, dont l'aboutissement est une dictature de la force de demain sur celle d'hier (ou l'inverse jusqu'à une nouvelle crise). Le révisionnisme socialiste de l'avant-dernière guerre avait prétendu effacer la théorie de Marx et d'Engels sur la dictature, et c'est à Lénine que revient le mérite de l'avoir remise sur ses pieds, dans "L'État et la Révolution", où, restaurant complètement le marxisme, il pousse à son terme le devoir théorique de destruction de l'État bourgeois. Lénine, en accord parfait avec la doctrine marxiste, pose ainsi le cadre permettant de distinguer les phases successives de la transition du capitalisme au communisme.
Stade intermédiaire
Le prolétariat a conquis le pouvoir politique et comme toutes les autres classes dans le passé impose sa propre dictature. Ne pouvant abolir d'un seul coup les autres classes, le prolétariat les met hors-la-loi. Ce qui veut dire que l'État prolétarien contrôle une économie, qui dans un secteur toujours plus restreint, non seulement comporte une distribution marchande, mais aussi des formes d'appropriation privée de ses produits et de ses moyens de production, tant individuels qu'associés ; en même temps, par ses interventions despotiques, il ouvre la voie qui mène au stade inférieur du communisme. Comme on voit, contrairement aux assertions de R. sur une prétendue complexité de la conception de l'État et de son rôle chez Lénine, l'essence de celle-ci est très simple : le prolétariat s'érigeant en classe dominante crée son propre organe d'État différent des précédents par la forme, mais gardant par essence la même fonction : oppression des autres classes, violence concentrée contre elles pour le triomphe de ses intérêts historiques comme classe dominante même si ceux-ci coïncident à long terme avec ceux de l'humanité.
Communisme inférieur
Dans cette phase, la société a déjà la disposition des produits en général et en fait la répartition à ses membres, selon un plan de contingentement. Pour une telle tache, il n'y a plus besoin d'échange marchand ni de monnaie : la distribution s'effectue centralement sans échange d'équivalents. A un tel stade, il y a non seulement obligation au travail, mais comptabilisation du temps de travail "effectué" et un certificat qui en atteste : les fameux bons de travail tant discutés, qui ont la caractéristique de ne pouvoir être accumulés, de telle sorte que toute tentative d'accumulation se fasse en pure perte, avec une quote-part de travail ne recevant aucun équivalent. La loi de la valeur est détruite parce que la société "n'accorde aucune valeur aux produits" (Engels). A ce second stade, succède le communisme supérieur, sur lequel nous ne nous attarderons pas.
Comme nous l'avons vu, le marxisme met au début de la phase de transition et comme prémisse nécessaire, la révolution politique violente dont l'issue est l'inévitable dictature de classe. Ce sera par l'exercice de cette dictature qu'avec des interventions despotiques et soutenues par le monopole de la force année que le prolétariat actualisera les profondes "réformes" qui détruiront jusqu'au dernier vestige de la forme capitaliste.
Jusqu'ici, il me semble qu'il n'y a aucune divergence. Les difficultés commencent quand on affirme que "L'État a une nature historique anti-communiste et anti-prolétarienne" et "essentiellement conservatrice" et que donc sa dictature (celle du prolétariat) ne "peut trouver dans une institution conservatrice par excellence sa propre expression authentique et totale". Ici l'anarchisme (pardonnez-moi la brutalité des mots) chassé par la porte rentre par la fenêtre. En fait, on accepte la dictature du prolétariat, mais on oublie qu'État et dictature ou pouvoir exclusif d'une classe sont synonymes.
Avant de critiquer plus spécifiquement quelques affirmations contenues dans le texte pris en exemple, Je veux rappeler les lignes fondamentales de la théorie marxiste de l'État. Chaque État se définit, dans Engels, par un territoire précis et par la nature de la classe dominante, il se définit donc par un lieu, la capitale où se réunit le gouvernement, qui pour le marxisme est le "comité d'administration des intérêts de la classe dominante". Dans la phase du pouvoir féodal au pouvoir bourgeois, se forme la théorie politique -typique de la mystification bourgeoise- qui dans toutes les révolutions historiques a dissimulé le caractère du passage du féodalisme au capitalisme. La bourgeoisie dans sa conscience mystifiée affirme détruire le pouvoir d'une classe non pour y substituer celui d'une autre, mais pour construire un État qui fonde son propre pouvoir sur l'accord et l'harmonisation des exigences de "tout un peuple". Mais dans toutes les révolutions, une série de faits mirent en lumière la robustesse de la dynamique révolutionnaire marxiste fondée sur les classes, la dictature de l'une s'accompagnant de l'a violation de la liberté des autres, et de violence exacerbées contre leurs partis, jusqu'à la terreur, fait aussi inséparable des révolutions purement bourgeoises.
Un des premiers actes à accomplir est la démolition du vieil appareil d'État que la classe arrivée au pouvoir doit entreprendre sans hésitation. Les leçons, déjà tirées par Marx de la Commune de Paris, qui, s'installant à l'Hôtel de Ville, opposa l'État à l'État armé, étouffa dans la terreur (avant d'être étouffée à son tour) même les individus de la classe ennemie, sont celles-là. Et "s'il y eut une faute, ce ne fut pas celle d'avoir été trop féroce mais de ne pas l'avoir été assez".
De cette importante expérience du prolétariat, Marx tira l'enseignement fondamental auquel nous ne pouvons renoncer, que les classes exploiteuses ont besoin de la domination politique pour le maintien de l'exploitation et que le prolétariat en a besoin pour la supprimer complètement. La destruction de la bourgeoisie n'est réalisable qu'à travers la transformation du prolétariat en classe dominante. Cela veut dire que l'émancipation de la classe travailleuse est impossible dans les limites de l'État bourgeois. Celui-ci doit être défait dans la guerre civile et son mécanisme démoli. Après la victoire révolutionnaire, il faut que surgisse une autre forme historique pendant laquelle surgit la société socialiste et s'éteint l'État.
Après cette brève réaffirmation de ce que sont pour moi les piliers de la doctrine marxiste de l'État et du passage d'un système social à un autre, et plus spécifiquement du capitalisme au communisme, je vais m'arrêter sur le texte de la résolution relative à la période de transition. Ce qui saute aux yeux dans un tel document est avant tout le caractère contradictoire de certaines affirmations.
Si, d'un côté on affirme "que la prise du pouvoir politique général. dans la société par le prolétariat précède, conditionne et garantit la poursuite de la transformation économique et sociale", on ne se rend pas compte que prendre le pouvoir politique général, signifie instaurer une dictature sur les autres classes et que l'État est et fut toujours l'organe(différent dans ses caractéristiques : fonctionnement, division des pouvoirs, représentation, selon le mode de production et les classes dont il représentait la domination) de la dictature d'une classe sur les autres.
En outre, quand on affirme que "toute cette organisation exclut catégoriquement toute participation des classes et couches sociales exploiteuses qui pont privées de tout, droit politique et civique", on ne se rend pas compte que toutes les justes caractéristiques de cet État exprimées dans d'autres points du même paragraphe et surtout celle déjà citée de la représentation politique d'une seule classe, ne sont pas de simples différences formelles mais détruisent toutes les assertions qui servent à identifier l'État de la bourgeoisie et de ce fait donnent une base à l'identité tant combattue entre État et dictature du prolétariat.
Mais sur quelles bases arrive-t-on à affirmer la nécessité absolue pour le prolétariat de ne pas identifier sa propre dictature et l'État de la période de transition ? Avant tout parce qu'on affirme que l'État est une institution conservatrice par excellence. On rejoint par là l'anti-historicisme de l'anarchisme et ses oppositions de principe à l'État. Les anarchistes tirent leur conviction de la nécessité de l'affranchissement de sa seigneurie "l'Autorité". R.I. ne va pas jusque là, évidemment, mais exactement comme les anarchistes, juge l'État conservateur et réactionnaire dans toute époque sociale, n'importe quelle aire géographique, quelle que soit la direction vers laquelle il s'oriente, et donc quelle que soit la domination de classe dont il est l'expression, indépendamment de la période historique au cours de laquelle cette domination s'exerce.
Rien de tel pour le marxisme. Pour le marxisme, l'État est avant tout une institution différente selon les époques historiques, tant par ses caractéristiques formelles que par ses fonctions propres. En fait, le matérialisme du marxisme nous enseigne, si on se réfère à l'histoire, que dans le passé et les phases révolutionnaires, à peine une classe a-t-elle conquis le pouvoir qu'elle stabilise le type d'organisation étatique répondant le mieux à la poursuite de ses intérêts de classe. L'État assumait alors la fonction révolutionnaire qu'avait la classe -alors révolutionnaire- qui l'avait institué. C'est à dire : faciliter par ses interventions despotiques -après avoir brisé par la terreur la résistance des anciennes classes- le développement des forces productives, en balayant les obstacles qui barrent ce chemin, en stabilisant et en imposant par le monopole des forces armées un cadre de lois et rapports de production qui favorisent ce développement et répondent aux intérêts de la nouvelle classe ou pouvoir. Par exemple, pour n'en citer qu'un, l'État français de 1793 assuma une fonction éminemment révolutionnaire.
Une autre raison est exprimée au même paragraphe du point C : "l'État de la période de transition porte encore tous les stigmates d'une société divisée en classes". C'est une bien étrange raison, puisque tout ce qui sort de la société capitaliste en porte les stigmates. Donc, pas seulement l'État, mais aussi le prolétariat organisé dans les soviets, puisqu'il a grandi et a été éduqué sous l'influence pesante de l'idéologie conservatrice du système capitaliste. Seul, le parti, même s'il ne constitue pas un îlot de communisme au sein du capitalisme, est moins marqué par ces stigmates puisqu'en lui se fondent "volonté et conscience qui deviennent prémisses de l'action, comme résultat d'une élaboration générale historique" (Bordiga). (Ces affirmations peuvent sembler sommaires mais je les éclaircirai par la suite) (* [14]).
Pour conclure, je veux n'arrêter sur la profonde contradiction à laquelle votre vision mène. Vous affirmez en fait :"sa domination (du prolétariat) sur la société est aussi dominante sur l'État et il ne peut l'assurer qu'à travers sa dictature de classe". Je veux répondre avec les paroles classiques de Lénine qui, dans"l'État et la Révolution" souligne encore une fois l'essence de la doctrine marxiste de l'État : 'L' essence de la doctrine de l'État de Marx peut être comprise en profondeur seulement par celui qui comprend que la dictature d'une seul la classe est nécessaire, non seulement pour toutes sociétés de classes en général, non seulement pour le prolétariat après avoir abattu la bourgeoisie mais pour toute la période historique qui sépare le capitalisme de "la société sans classes", du communisme. Les formes de l'État bourgeois sont extraordinairement variées, mais leur substance est unique : tour car. État cent, d'une façon ou d'une autre, et en dernière instance, nécessairement une dictature de la bourgeoisie. Le passage au communisme ne peut naturellement pas produire une énorme abondance et diversité de formes politiques mais sa substance est nécessairement une: la dictature du prolétariat".
Donc, du point de vue marxiste, l'État se définit comme un organe (différent dans la forme et les structures selon les époques historiques, les sociétés de classes et la direction de classe dans laquelle il travaille) au moyen duquel s'exerce la dictature du prolétariat, disposant du monopole de la force armée.
C'est donc un non sens de parler d'un État qui soit soumis à une dictature qui lui est extérieure et qui ne peut alors intervenir despotiquement dans la réalité économique, et sociale pour l'orienter vers une certaine direction de classe.
E.* [15] Dans un prochain numéro de la REVUE INTERNATIONALE, nous publierons la seconde partie de cette lettre, avec notre réponse, sur la question du parti.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
DEBAT : Réponse à E.
- 2506 reads
Deux idées sous-tendent essentiellement la
critique formulée par le camarade E. : la première consiste dans le rejet de
l'affirmation que "l'État est une institution conservatrice par
excellence" ; la seconde, dans la réaffirmation de l'identité État et
dictature du prolétariat au cours de la période de transition, car l'État est
toujours l'État de la classe dominante. Voyons donc de plus près le contenu de
ces deux arguments.
E. écrit : ..."on affirme (dans la résolution de R.I.) que l'État est une institution conservatrice par excellence. On rejoint là l'anti-historicisme de l'anarchisme et ses oppositions de principe à l'État. Les anarchistes tirent leurs convictions de la nécessité de l'affranchissement de sa seigneurie "l'autorité".
R.I. ne va pas jusque là, évidemment, mais exactement corme les anarchistes, juge l'État conservateur et réactionnaire dans toute époque sociale, n'importe quelle aire géographique, cruelle que soit la direction vers laquelle il s'oriente et donc quelle que soit la domination de classe dont il est l'expression, indépendamment de la période historique au cours de laquelle cette domination s'exerce."
Avant de voir pourquoi l'État est effectivement "une institution conservatrice par excellence", répondons à cet argument polémique qui consiste à assimiler notre position à celle des anarchistes.
Notre conception relèverait de l'"anti-historicisme anarchiste" parce qu'elle dégage une caractéristique de l'institution étatique (son caractère conservateur) indépendamment de "l'aire géographique", de la "domination de classe dont il est l'expression" et "de la période historique au cours de laquelle cette domination s'exerce". Mais en quoi dégager les caractéristiques générales d'une institution ou d'un phénomène au travers de l'histoire, indépendamment des formes spécifiques que celle-ci peut connaître suivant la période, relèverait-il d'une conception "a-historique" ? Qu'est ce donc que savoir se servir de l'histoire pour comprendre la réalité ni ce n'est d'abord et avant tout savoir dégager les lois générales qui se vérifient au travers de différentes périodes et conditions spécifiques. Le marxisme est-il "a-historique" lorsqu'il dit que depuis que la société est divisée en classes "la lutte de classes est le moteur de l'histoire" quelle que soit la période historique et quelles que soient les classes ?
On peut mettre en avant la nécessité de distinguer dans chaque État de l'histoire (État féodal, État bourgeois, État de la période de transition, etc.) ce qui lui est particulier, spécifique. Mais comment pourrait-on saisir ces particularités sans savoir par rapport à quelles généralités elles se définissent? Le fait de dégager les caractéristiques générales d'un phénomène au cours de l'histoire, à travers toutes les tonnes particulières aussi différentes soient-elles qu'il ait pu prendre suivant les périodes, est non seulement le fondement même d'une analyse historique mais aussi la condition première pour pouvoir comprendre en quoi consistent les spécificités de chaque expression particulière du phénomène.
Du point de vue marxiste, on peut être tenté de mettre en question la véracité de la loi générale que nous dégageons sur la nature conservatrice de l'État, mais en aucun cas s'attaquer au fait en soi de vouloir reconnaître la caractéristique historique générale d'une institution. Autrement, c'est nier la possibilité de toute analyse historique.
Il nous est ensuite dit que notre position relève encore de l'anarchiste par le fait qu'elle constituerait "une opposition de principe à l'État". Rappelons en quoi consiste cette opposition de principe des anarchistes à l'État : rejetant l'analyse de l'histoire en termes de classe et le déterminisme économique, les anarchistes n'ont jamais compris l'État comme le produit des besoins d'une société divisée en classes, mais comme un mal en soi qui, avec la religion et l'autoritarisme, serait à la base de tous les maux de la société ("je suis contre l'État parce que l'État est maudit", disait Louise Michel). Pour les mêmes raisons ils considèrent qu'entre le capitalisme et le communisme, il n'y a aucun besoin d'une période ce transition et encore moins d'État : l'État ouvra et devra être "aboli","interdit" par décret au lendemain même de l'Insurrection générale.
Qu'y a-t-il de commun entre cette vision et celle qui affirme que l'État, produit de la division de la société en classes, à une essence conservatrice car il a pour fonction de réfréner et de maintenir ce conflit dans l'ordre et la stabilité sociale ? Si nous soulignons le caractère conservateur de cette institution ce n'est pas pour préconiser une indifférence "apolitique" du prolétariat à son égard, ou pour colporter des illusions sur la possibilité de faire disparaître l'institution étatique par quelque interdiction que ce soit tant que la division de la société en classes subsistera, mais pour mettre en lumière pourquoi le prolétariat, loin de se soumettre inconditionnellement à l'autorité de cet État au cours de la période de transition -comme le préconise l'idée qui voit dans l'État l'incarnation de la dictature du prolétariat- doit, au contraire, soumettre cet appareil par un rapport de force permanent à sa propre dictature de classe. Qu'y a-t-il de commun entre cette vision et celle des anarchistes qui rejettent en bloc État, période de transition et surtout la nécessité de la dictature du prolétariat ?
Assimiler cette analyse à la vision anarchiste c'est se payer de mots avec des arguments de polémique dérisoire.
Mais venons-en au problème de fond : pourquoi l'État est-il une institution conservatrice par excellence ?
Le mot conservateur désigne par définition ce ou celui qui s'oppose à toute innovation, ce ou celui qui résiste au bouleversement de l'état de chose existant. Or, l'État, quel qu'il soit, est une institution dont la fonction essentielle n'est autre que celle du maintien de l'ordre, le maintien de l'ordre existant. Il est le produit du besoin de toute société divisée en classes de se doter d'un organe capable de maintenir par la force un ordre qu'elle n'est pas capable de maintenir de façon spontanée, harmonieuse, du fait même de son déchirement en groupes sociaux aux intérêts économiques antagonistes. Il constitue par là même la force à laquelle doit s'opposer toute action visant à bouleverser l'ordre social, et donc, toute action révolutionnaire.
- "L'État n'eut donc pas un pouvoir imposé du dehors de la société ; il n'est pas davantage "la réalité de l'idée morale", "l'image de la réalité de la raison”, comme le prétend Hegel. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement ; il est l'aveu que cette société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s'étant scindée en oppositions inconciliables qu'elle est impuissante à conjurer, Mais pour que les antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés, ne se consument pas, elles et la société, en une lutte stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de l'"ordre"; et "ce pouvoir, né de la société, mais qui se place au-dessus d'elle et lui devient de plus en plus étranger, c'est l'État". (Souligné par nous)
Dans la fameuse formulation d'Engels dans "L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État", expliquant le besoin auquel correspond l'État et la fonction qui en découle pour celui-ci se trouve clairement énoncé cet aspect essentiel du rôle de cette institution : estomper le conflit entre classes, le maintenir dans les limites de l'ordre. Et quelques pages plus loin, …"l'État est né du besoin de réfréner des oppositions de classes".
Quand on sait que la force qui crée les bouleversements révolutionnaires n'est autre que la lutte des classes, c'est-à-dire, ce "conflit", cette "opposition" que l'État a pour tâche d'estomper" et de "réfréner", il est aisé de comprendre pourquoi l'État est une institution essentiellement conservatrice.
Dans les sociétés d'exploitation où l'État est ouvertement le gardien des intérêts de la classe économiquement dominante, le rôle conservateur de l'État face à tout mouvement tendant à mettre en question l'ordre économique existant et dont l'État est toujours, avec la classe dominante, Je bénéficiaire, apparaît assez clairement. Cependant, cette caractéristique conservatrice n'est pas moins présente dans l'État de la période de transition au communisme.
A chaque pas franchi par la révolution communiste (destruction du pouvoir politique de la bourgeoisie dans un ou plusieurs pays, puis dans le monde entier ; collectivisation de nouveaux secteurs de la production, développements de la collectivisation de la distribution dans les centres industriels, puis dans des régions agricoles avancées, puis arriérées, etc.) à chacune de ces étapes, et tant que le développement des forces productives n'aura pas atteint un degré suffisant permettant que chaque être humain suisse participer réellement à une production collectivisée à l'échelle mondiale et recevoir de la société "selon ses besoins", tant que l'humanité ne sera pas parvenue à ce stade de richesse qui lui permettra de se débarrasser enfin de tous les systèmes de rationnement de la distribution des produits et de s'unifier dans une communauté humaine sans divisions, à chaque pas franchi dans ces conditions, donc, la société devra se doter de règles de vie, de lois sociales stables et uniformes qui lui permettent de vivre en accord avec les conditions de production existantes, sans être pour autant déchirée par les conflits internes entre les classes qui subsistent, en attendant de pouvoir franchir de nouvelles étapes en avant.
Du fait qu'il s'agit de lois qui expriment encore un stade de pénurie, c'est-à-dire, un stade où le bien-être des uns tend à se faire toujours aux dépens du bien-être des autres, il s'agit de lois qui -même en instaurant "l'égalité dans la pénurie"- exigent pour être appliquées un appareil de contrainte et d'administration qui les impose et les fait respecter à l'ensemble de la société. Cet appareil n'est autre que l'État.
Si au cours de la période de transition nous décidions par exemple de distribuer gratuitement les biens de consommation dans ce qui seraient des centres de distribution, alors que la pénurie sévit encore dans la société, nous aurions peut-être quelques milliers ou milliards de personnes qui pourraient, le premier jour, se servir a leur faim -les premiers arrivés aux centres- mais au moins autant d'autres personnes se trouveraient réduites à la famine. Dans le manque, distribuer, même équitablement, impose d'instaurer des règle de rationnement et avec elles, des "fonctionnaires" : l'État des "surveillants et des comptables" dont parlait Lénine.
La fonction de cet État n'est pas une fonction révolutionnaire, même si l'ordre politique existant est celui de la dictature du prolétariat. Sa fonction intrinsèque est dans le meilleur des cas celle de stabiliser, régulariser, institutionnaliser les rapports sociaux existants. La mentalité du bureaucrate de la période de transition (et il n'y a pas d'État sans bureaucrates) n'est pas caractérisée par sa hardiesse révolutionnaire, loin de là. Elle tend invinciblement à être celle de tous les fonctionnaires : le maintien de l'ordre, la stabilité des lois qu'il est chargé de faire appliquer... et autant que possible, la défense de ses intérêts de privilégié. Plus la pénurie qui rend indispensable cet État se prolonge et plus s'accroît la force conservatrice de cet appareil et donc, avec elle, la tendance au resurgissement de toutes les caractéristiques de la vieille société.
Dans le Manifeste Communiste, Marx écrivait :
- "le développement des forces productives cet pratiquement la condition première condition nécessaire (du communisme) pour cette raison encore que l'on socialiserait sans lui l'indigence et que l'indigence ferait recommencer la lutte pour le nécessaire et par conséquent ressusciter tout le vieux fatras..."
La révolution russe où le pouvoir du prolétariat doit rester isolé, condamné à la pire pénurie fut la tragique démonstration par la pratique de cette vision. Mais elle montra du même coup que "le vieux fatras" ressuscitait d'abord et avant tout, là où on croyait que se trouvait l'incarnation de la dictature du prolétariat : dans l'État et sa bureaucratie.
Citons un témoin d'autant plus significatif qu'il fut un des principaux défenseurs de l'identité entre dictature révolutionnaire du prolétariat et État de la période de transition : Léon Trotsky :
- "L'autorité bureaucratique a pour base la pauvreté en articles de consommation et la lutte contre tous qui en résulte. Quand il y a assez de marchandises au magasin, les chalands peuvent venir à tout moment. Quand il y a peu de marchandises, les acheteurs sont obligés de faire la queue à la porte. Sitôt que la queue devient très longue, la présence d'un agent de police s'impose pour le maintien de l'ordre. Tel est le point de départ de la bureaucratie soviétique. Elle "sait" à qui donner et qui doit patienter "...
- ..."(La bureaucratie) surgit tout au début comme l'organe bourgeois de la classe ouvrière, établissant et maintenant les privilèges de la minorité, elle s'attribue naturellement la meilleure part : celui qui distribue les biens ne s'est encore jamais lésé. Ainsi naît de la société un organe qui, dépassant de beaucoup sa fonction sociale nécessaire, dévient un facteur autonome et en même temps la source de prends dangers pour tout l'organisme social". ("La Révolution Trahie")
Certes, le prochain mouvement révolutionnaire ne connaîtra certainement pas des conditions matérielles aussi désastreuses que le furent celles de la Russie. Mais la nécessité d'une période de transition, une période de lutte contre l'indigence et la pénurie à l'échelle de la planète ne sera pas moins inévitable que la subsistance d'une structure étatique. Le fait de disposer d'un potentiel plus grand de forces productives pour entreprendre la création des conditions matérielles de la société communiste constitue un éléments fondamental de l'affaiblissement de l'État et donc de sa force conservatrice sous la dictature du prolétariat. Mais il n'élimine pas pour autant cette caractéristique. Aussi reste-t-il de la première importance que le prolétariat ait su assimiler les leçons de l'expérience russe et sache voir dans l'État de cette période non pas l'incarnation suprême de sa dictature mais un organe qu'il devra soumettre à sa dictature et par rapport auquel il devra maintenir son autonomie organisationnelle.
Une force de stabilisation, non de bouleversement
Mais, nous dit-on, l'histoire montre que l'État assume une fonction révolutionnaire lorsque la classe qui l'instaure est elle-même révolutionnaire :
- "Dans le passé et dans les phases révolutionnaires, à peine une classe a t’elle conquis le pouvoir qu'elle stabilise le type d'organisation étatique répondant le mieux à la poursuite de ses intérêts de classe. L'État assumait alors la fonction révolutionnaire qu'avait alors la classe révolutionnaire qui l'avait institué. C'est à dire : faciliter par ses interventions despotiques -après avoir brisé par la terreur la résistance des anciennes classes- le développement des forces productives en balayant les obstacles qui barrent ce chemin, en stabilisant et imposant par le monopole des forces armées un cadre de lois et de rapports de production qui favorisent ce développement et répondent aux intérêts de la nouvelle classe au pouvoir. Par exemple, pour n'en citer qu'un, l'État français de 1793 assuma une fonction éminemment révolutionnaire".
Il ne s'agit pas ici de jouer avec les mots. "Assumer une fonction révolutionnaire" d'une part, "stabiliser un cadre de lois et de rapports qui répondent aux intérêts de la nouvelle classe au pouvoir" d'autre part, ne décrivent pas la même chose. A partit du moment où la lutte d'une classe révolutionnaire aboutit à établir un rapport de forces dans la société en sa faveur, il est évident que le cadre légal, l'institution étatique qui a pour fonction de stabiliser les rapports de force existants dans la société est amené à traduire ce nouvel état de fait dans les lois et des interventions de l'exécutif pour les faire appliquer. Toute action politique d'envergure dans une société divisée en classes et donc chapeautée par une structure étatique, ne peut atteindre son but sans se traduire, tôt ou tard, par une concrétisation au niveau des lois et de l'action de l'État. C'est ainsi que l'État de 1793 en France, par exemple, fut amené à légaliser des mesures révolutionnaires imposées dans les faits par les forces révolutionnaires : exécution du roi, loi des suspects et instauration de la Terreur contre les éléments réactionnaires, réquisitions et rationnements, confiscation et vente des biens des immigrés, impôt sur les riches, "déchristianisation" et fermeture des églises, etc.. De même l'État des soviets en Russie prit des mesures révolutionnaires, telles la consécration du pouvoir des soviets et la destruction du pouvoir politique de l'ancienne classe, l'organisation de la guerre civile contre les armées blanches, etc…
Mais peut-on dire que l'État ait assumé pour autant la fonction révolutionnaire des classes qui l'ont instauré ?
La question qui se pose est de savoir si ces faits montrent que l'État n'est conservateur que dans la mesure où la classe dominante l'est elle-même, et inversement, révolutionnaire lorsque cette dernière est elle-même révolutionnaire. En d'autres termes, l'État n'aurait aucune tendance conservatrice ou révolutionnaire intrinsèque par lui-même. Il serait tout simplement l'incarnation institutionnelle de la volonté de la classe dominante politiquement, ou, pour reprendre une formulation de Boukharine sur l'État et le prolétariat pendant la période de transition :
- "La raison collective de la classe ouvrière (...) trouve son incarnation matérielle dans l'organisation suprême et universelle, celle de l'appareil d'État", (Questions économiques de la Période de transition -Edts EDI, page 110).
Regardons donc ces événements de plus près, et commençons par :
- "L'État français de 93 fut le plus radical par ses mesures de tous les États bourgeois de l'histoire" (nous traiterons de la révolution russe dans le point suivant).
L'État de 93 est celui de la Convention Nationale, instaurée à la fin de 92 après la destitution de la Monarchie par la Commune Insurrectionnelle de Paris et la terreur imposée par celle-ci la Convention succédait à l'État de l'Assemblée Législative qui avait "organisé" les guerres révolutionnaires, mais dont l'existence se trouve mise en question par la chute du trône et par le pouvoir réel de la Commune Insurrectionnelle dont elle tenta, en vain, de déclarer la dissolution (le 1er septembre, la Législative proclama la dissolution de la Commune mais dut revenir sur sa décision le soir même).
La Législative succédait elle-même à la Constituante qui, après avoir déclaré abolis les droits seigneuriaux et adopté la déclaration universelle des droits de l'homme, avait refusé de prononcer la déchéance du roi.
Avant de voir comment ont été prises les fameuses mesures radicales de 1793, constatons donc déjà que les évènements qui vont de la conquête du pouvoir par la bourgeoisie en 89 à l'avènement de la Convention, trois ans plus tard (septembre 92), n'ont rien à voir avec la description simpliste que nous offre le camarade E. : "Dans le passé et dans les phases révolutionnaires, à peine une classe a t’elle conquis le pouvoir qu'elle stabilise (sic) le type d'organisation étatique répondant le mieux à la poursuite de ses intérêts de classe".
Dans la réalité, à peine la bourgeoisie a t’elle conquis le pouvoir politique en 89 que commence un processus long et complexe au cours duquel la classe révolutionnaire, au lieu de stabiliser l'État qu'elle vient d'instaurer, se voit contrainte de le mettre, systématiquement en question pour pouvoir mener à bien sa mission révolutionnaire.
A peine l'État a t’il consacré un nouveau rapport de forces instauré par les forces vives de la société (l'abolition des droits seigneuriaux par la Constituante après les événements de Juillet 89 à Paris, par exemple) que déjà le cadre institutionnel, qui se trouve par cet acte stabilisé, s'avère insuffisant et se transforme en entrave aux nouveaux développements du bouleversement révolutionnaire (refus de la Constituante de prononcer la déchéance du roi et répression par celle-ci des mouvements populaires en ce sens).
Si de 89 a 93, il a déjà fallu à la révolution trois forces étatiques (chacune ayant connu elle-même divers gouvernements), c'est justement parce qu'aucun de ces États ne parvient à "assumer la fonction révolutionnaire de la classe qui l'a institué". Chaque nouveau pas en avant de la révolution prend ainsi la forme d'une lutte, non seulement contre les classes de l'ancien régime, mais aussi contre l'État "révolutionnaire" et son inertie légaliste et conservatrice.
L'année 93 elle-même ne marque pas une "stabilisation du type d'organisation étatique répondant le mieux à la poursuite des intérêts de la bourgeoisie". Elle correspond au contraire à l'apogée de la déstabilisation de l'institution étatique. Il faut attendre Napoléon, ses codes juridiques, sa réorganisation de l'administration et son "Citoyens ! La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencés, elle est finie !" pour que véritablement on puisse commencer à parler de stabilisation[1] [16].
Et comment pourrait-il en être autrement ? Comment une classe véritablement révolutionnaire pourrait-elle traiter, au moment même du combat le représentant du maintien de l'ordre" (même du sien) autrement qu'à coups de pieds pour le faire sortir de ses préoccupations administratives et ses formalités juridiques où il s'attache, suivant le mot d'Engels, à "estomper le conflit (entre classes), à le maintenir dans les limites de ‘l'ordre’".
Croire que l'institution étatique puisse être "l'incarnation matérielle" de la volonté révolutionnaire d'une classe est aussi absurde qu'imaginer qu'une révolution puisse se dérouler dans l'ordre ! ; C’est demander à un organe dont la fonction essentielle est d'assurer la stabilité de la vie sociale, d'incarner l'esprit de subversion qu'il a précisément pour tâche d'étouffer dans les forces vives de la société ; c'est demander à un corps de bureaucrates d'avoir l'esprit d'une classe révolutionnaire.
Une révolution est la formidable explosion des forces vives de la société qui prennent directement en mains la destinée du corps social, bouleversement sans respect ni atermoiements sur toute institution (même créée par elle) qui entrave leur mouvement. La puissance d'une révolution se mesure ainsi en premier lieu dans la capacité de la classe révolutionnaire à ne pas se laisser enfermer dans le carcan légal de ses premières conquêtes, à savoir être aussi impitoyable avec les insuffisances de ses propres premiers pas qu'avec les forces de l'ancien régime. La supériorité politique de la révolution bourgeoise en France par rapport à celle de la bourgeoisie anglaise résida précisément dans sa capacité à ne pas être paralysée par le fétichisme de l'État et d'être parvenue à bouleverser sans cesse et sans pitié sa propre institution étatique jusqu'aux dernières conséquences.
Mais, venons-en donc au fameux État de 93 et à ses mesures, puisqu'il constitue précisément d'une part l'exemple proposé par le camarade E. pour démontrer les soi-disant capacités révolutionnaires de l'institution étatique, et d'autre part, une des plus éclatantes illustrations de l'impuissance de cette institution dans ce domaine.
En fait, les grandes mesures révolutionnaires de la période de 93 n'ont pas été prises par l'initiative de l'État mais contre celui-ci. C'est à l'action directe des fractions les plus radicales de la bourgeoisie parisienne, appuyées et souvent emportées par l'énorme pression du prolétariat des faubourgs de la capitale, qu'elles doivent leur réalisation.
La Commune Insurrectionnelle de Paris, ce corps constitué avec les événements des 9-10 août 92, par les éléments les plus radicaux de la bourgeoisie disposant de la force des bourgeois armés, la Garde Nationale et les Sectionnaires armés des faubourgs reposant essentiellement sur l'élan des masses populaires, c'est ce corps, expression organique directe du mouvement révolutionnaire, qui impose d'abord à la Législative, puis à la Convention -dont elle provoque l'instauration par les élections au suffrage universel indirect et 90% d'abstentions d'électeurs terrorisés- les mesures les plus radicales de la révolution. C'est elle qui provoque la chute du roi le 10 août 92, qui emprisonne la famille royale au Temple le 13, c'est elle qui empêcha sa propre dissolution par l'État de la Législative, elle qui instaura directement les tribunaux révolutionnaires et la terreur des journées de septembre 92 ; c'est elle qui, en 93, impose à la Convention l'exécution du roi, la loi sur les suspects, la proscription des Girondins, la fermeture des églises, l'instauration officielle de la Terreur, etc. Et, comme pour mettre en évidence son caractère de force vive distincte de l'État, elle impose encore à la Convention la prééminence de Paris comme "guide la Nation et tuteur de l'Assemblée", le droit d'intervention directe du "peuple" au besoin contre "ses représentants" et enfin "le droit à l'insurrection" !
L'exemple de Cromwell en Angleterre dissolvant par la force l'Assemblée et faisant apposer sur la porte d'entrée une affiche : "A LOUER", traduit la même nécessité.
Si les événements de 92-93 montrent quelque chose, ce n'est donc pas que l'institution étatique est d'autant plus révolutionnaire que l'est la classe qui la domine, mais au contraire que :
- plus cette classe est révolutionnaire et plus elle est amenée à se heurter au caractère conservateur de l'État ;
- plus elle a besoin de prendre des mesures radicales et plus elle est contrainte de refuser de se soumettre à l'autorité étatique pour soumettre au contraire cette institution à sa dictature.
Nous avons dit au début de ce point : "assumer une fonction révolutionnaire" et "stabiliser un cadre de lois et de rapports qui répondent aux intérêts de la nouvelle classe au pouvoir" ne veut pas dire la même chose. La différence entre les deux dans les phases révolutionnaires, l'histoire La résout par un rapport de forces entre la vraie force révolutionnaire, la classe réelle elle-même, et son expression juridique, l'État.
S'identifier à un organe stabilisateur
Nous avons jusqu'à présent traité de la nature conservatrice de l'État en restant sur un terrain historique général. En revenant au domaine de la période de transition au communisme, nous sommes amenés à voir à quel point cet antagonisme entre révolution et institution étatique, larvé ou ponctuel dans les révolutions du passé, prend dans la révolution communiste un caractère plus profond et irréconciliable.
Le camarade E. nous dit :
- "Les difficultés commencent quand on affirme que l'État a une nature historique anti-communiste et anti-prolétarienne et essentiellement conservatrice et que donc "sa dictature" (celle du prolétariat) ne peut trouver dans une institution conservatrice par excellence sa propre expression "authentique et totale" et l'anarchisme (pardonnes-moi la brutalité des mots) chassé par la porte revient par la fenêtre".
Laissons de côté l'argument polémique qui consiste à traiter notre position d'anarchiste : nous en avons déjà parlé. Et voyons pourquoi le prolétariat ne peut trouver dans une institution conservatrice son "expression authentique et totale".
Nous avons vu comment au cours de la révolution bourgeoise, il se produit des moments où, du fait de la tendance conservatrice qui s'exprimait dans les premières formes de son propre État, la bourgeoisie s'est vue contrainte, à travers ses fractions les plus radicales de prendre une distance réelle par rapport à cette institution et d'imposer sa dictature "despotique" non seulement sur les autres classes de la société, mais aussi sur l'État qu'elle venait d'instaurer.
Cependant, cette opposition entre bourgeoisie et État ne pouvait être que momentanée. Le but des révolutions bourgeoises, aussi radicales et populaires soient-elles, ne peut jamais être autre que l'affermissement et la stabilisation d'un ordre social dont elle est bénéficiaire. Aussi grande que puisse être son opposition à l'ancienne classe dominante, elle ne déstabilise la société et l'institution étatique que pour mieux la figer par la suite, une fois affirmé son pouvoir politique dans un nouvel ordre stable où elle peut, sans entrave, épanouir sa force de classe exploiteuse.
C'est ainsi que l'ouragan révolutionnaire de 93 fut suivi de la soumission de la Commune Insurrectionnelle de Paris au gouvernement du Comité de Salut Public de Robespierre, puis de l'exécution de Robespierre lui-même par la "réaction" de Thermidor, pour aboutir à l'État fort de Napoléon, où État et bourgeoisie se retrouveront fraternellement enlacés dans un désir absolu d'ordre et de stabilité.
En fait, plus se consolide et se développe le système de la bourgeoisie et plus cette dernière se reconnaît entièrement dans son État, garant absolu et conservateur de ses privilèges. Plus la bourgeoisie devient conservatrice et plus elle s'identifie à son gendarme et administrateur.
Il en est tout autrement pour le prolétariat. Le but de la classe ouvrière au pouvoir n'est ni de maintenir son existence comme classe ni de conserver l'État, produit de la société divisée en classes. Son objectif déclaré, c'est la disparition des classes et en conséquence de l'État. La période de transition au communisme n'est pas un mouvement vers la stabilisation du pouvoir prolétarien mais au contraire vers sa disparition. Il en découle, non pas que le prolétariat ne doive pas affirmer sa dictature sur l'ensemble de la société mais qu'il se sert de cette dictature pour bouleverser en permanence l'état de choses existant. Ce mouvement de bouleversement est permanent jusqu'au communisme : toute stabilisation de la révolution prolétarienne constitue pour elle un recul et une menace de mort. La fameuse sentence de Saint-Just : "Ceux qui font une révolution à moitié creusent leur propre tombe" s'applique au prolétariat du fait de sa nature de classe exploitée plus qu'à toute classe révolutionnaire dans l'histoire.
Contrairement à l'idée de Trotsky qui -incapable de reconnaître dans le développement de la bureaucratie après 17 la force de la contre-révolution- parlait d'un "Thermidor prolétarien", il n'y a pas de "thermidor" pour la révolution prolétarienne. Thermidor fut pour la bourgeoisie une nécessité correspondant à la recherche d'une stabilisation de son pouvoir. Pour le prolétariat, toute stabilisation constitue non pas un aboutissement, une réussite, mais une faiblesse, et à moyen terme, un recul de son oeuvre révolutionnaire.
Le seul moment où la stabilisation des rapports sociaux pourrait correspondre aux intérêts du prolétariat serait celui d'une société sans classe, le communisme. Mais alors, il n'y aura plus ni prolétariat, ni dictature du prolétariat, ni État. C'est pourquoi le prolétariat ne peut jamais trouver dans cette institution dont la fonction est"d'estomper le conflit entre les classes" et de stabiliser l'état de choses existant, "son expression authentique et totale".
Contrairement à ce qui se produisait pour la bourgeoisie, le développement de la révolution prolétarienne ne se mesure pas au renforcement de l'institution étatique, mais au contraire à la dissolution de celle-ci dans la société civile, la société des producteurs.
Mais l'attitude du prolétariat au cours de sa dictature à l'égard de l'État -non identification, organisation autonome par rapport à lui et exercice de sa dictature sur lui- se distingue de celle de la bourgeoisie installée, non seulement parce que pour la première, la dissolution de l'appareil étatique est une nécessité, mais aussi -et sans cela cette nécessité ne serait qu'un voeu pieux- parce qu'elle est une possibilité.
Divisée par la propriété privée et la concurrence sur lesquelles elle fonde sa domination économique, la bourgeoisie ne peut engendrer longtemps de corps organisé qui incarne ses intérêts de classe en dehors de l'État. L'État est pour la bourgeoisie non seulement le défenseur de sa domination à l'égard des autres classes, il est aussi le seul lien d'unification de ses intérêts. Dans la division en mille intérêts privés et antagonistes de la bourgeoisie, seul l'État constitue une force capable d'exprimer les intérêts de l'ensemble de la classe. C'est pourquoi, si elle ne pouvait se passer, à un moment donné, ni en France ni en Angleterre, de l'action autonome de ses fractions les plus radicales contre l'État qu'elle avait instauré pour mener à bout sa révolution, elle ne pouvait pas plus prolonger longtemps cet état de choses, sous peine de perdre toute unité politique et donc toute force (voir le sort réservé à la Commune Insurrectionnelle de Paris et à ses dirigeants une fois leur fulgurante action révolutionnaire accomplie).
Le prolétariat ne connaît pas cette impuissance. N'ayant pas d'intérêts antagonistes en son sein et trouvant dans son unité autonome la principale force de son action, le prolétariat peut exister unifié et puissant sans recours à un arbitre armé au-dessus de lui. Sa représentation comme classe, il la trouve en lui-même, dans ses propres organes unitaires : les Conseils Ouvriers.
Ce sont ces Conseils qui doivent et peuvent constituer le seul et véritable organe de la dictature du prolétariat. C'est en eux et en eux seuls que la classe ouvrière trouve son "expression authentique et totale".
Le prolétariat comme classe dominante
Le camarade E. reprend à son compte les positions de Lénine dans "l'État et la Révolution", basées elles-mêmes sur les écrits et l'expérience pratique passée du mouvement prolétarien. Mais il le fait en simplifiant à l'extrême cette position, en oubliant le contexte politique où elle fut définie et évidemment en laissant de côté la plus importante expérience de la dictature du prolétariat : la révolution russe.
Le plus grand et le plus riche moment de l'histoire du combat prolétarien n'aurait d'après E., rien, strictement rien modifié aux formulations des révolutionnaires avant Octobre. Le résultat est une grossière simplification des inévitables insuffisances de la théorie révolutionnaire avant 1917, dans un domaine où la seule expérience existante alors était celle de la Commune de Paris.
E. écrit :
- "L'essence de celle-ci (la conception de l'État et de son rôle chez Lénine) est très simple : le prolétariat s’érigeant en classe dominante crée son propre organe d'État différent des autres par la forme, mais jouant par essence la même fonction : oppression des autres classes, violence concentrée contre elles pour le triomphe de ses intérêts historiques comme classe dominante, même si ceux-ci coïncident à long terme avec ceux de l'humanité".
Il est vrai que l'essence de la fonction de l'État a toujours été le maintien de l'oppression des classes exploitées par la classe exploiteuse. Mais au moment de transporter cette idée à l'analyse de la période de transition au communisme, cette simplicité est plus qu'insuffisante. Et cela pour deux raisons principales :
- premièrement parce que la classe exerçant la dictature n'est pas une classe exploiteuse mais exploitée ;
- deuxièmement, parce que, de ce fait, ainsi que pour les raisons que nous avons vues, le rapport entre prolétariat et État ne peut être celui qui caractérisait la domination des classes exploiteuses.
Dans "l'État et la Révolution", Lénine fut amené à mettre au premier plan cette conception simple de l'État, du fait même de la polémique qu'il y développait contre la social-démocratie. Cette dernière, pour justifier sa participation au gouvernement de l'État bourgeois, prétendait ne voir dans l'État (et l'État bourgeois en particulier) qu'un organe de conciliation entre les classes : elle en déduisait qu'en y participant et développant l'influence électorale des partis ouvriers, on pourrait le transformer en outil du prolétariat pour l'avènement du socialisme. Lénine rappela avec force que dans une société divisée en classes l'État avait toujours été l'État de la classe dominante, l'appareil du maintien du pouvoir de cette dernière, sa force armée contre les autres classes.
La pensée d'une classe révolutionnaire et à fortiori celle d'une classe révolutionnaire exploitée ne peut jamais se développer dans un univers de paisible recherche scientifique. Arme d'un combat global, elle ne peut s'exprimer qu'en opposition violente à l'idéologie dominante dont elle s'attache en permanence à démontrer la fausseté. C'est pourquoi, on ne trouvera jamais un texte révolutionnaire qui ne prenne, d'une façon ou d'une autre, la forme de critique ou de polémique. Même les morceaux les plus "scientifiques" du Capital sont rédigés dans un esprit de combat critique contre les théories économiques de la classe dominante. Aussi faut-il savoir, quand on reprend les écrits révolutionnaires, les replacer en permanence dans le combat auquel ils s'intègrent. La polémique, si elle est vivante, conduit inévitablement à polariser la pensée sur des aspects particuliers de la réalité parce qu'étant les plus importants dans tel combat particulier. Mais ce qui est essentiel dans une discussion ne l'est pas automatiquement dans une autre. Reprendre mot pour mot les formulations et les préoccupations exprimées dans des textes traitant d'un problème particulier pour les appliquer telles quelles, sans les replacer dans leur contexte, à d'autres problèmes fondamentalement différents, conduit la plupart du temps à des aberrations où ce qui pouvait être une simplification nécessaire dans une polémique se transforme, transposé ailleurs, en une absurdité théorique. C'est pourquoi l'exégèse est toujours une entrave pour la théorie révolutionnaire.
Transposer telles quelles les insistances dégagées du combat contre la participation de la social-démocratie dans l'État bourgeois et son rejet de la dictature du prolétariat, aux problèmes posés par le rapport entre la classe ouvrière et l'État de la période de transition au communisme est un exemple de ce type d'erreur. Erreur qui fut souvent commise aussi bien par Marx et Engels que par Lénine et tous les révolutionnaires dont l'union fut forgée au feu du combat contre la social-démocratie pendant la première guerre. Compréhensible peu avant Octobre 17, elle ne l'est cependant plus aujourd'hui.
L'expérience de la révolution russe a mis en évidence à quel point le rapport entre le prolétariat au pouvoir et l'État était différent de celui qu'entretenaient les classes exploiteuses.
Le prolétariat exerçant sa dictature s'affirme comme classe dominante dans la société. Mais dominante n'a rien à voir ici avec le contenu de ce terme dans les sociétés passées. Le prolétariat est classe dominante politiquement, mais non économiquement. Non seulement la classe ouvrière ne peut exploiter aucune autre classe de la société, mais, qui plus est, elle demeure dans une certaine mesure classe exploitée.
Exploiter économiquement une classe, c'est tirer profit de son travail au détriment de sa propre satisfaction, c'est amputer une classe d'une partie du fruit de son travail en la privant par cela de la possibilité d'en jouir. Or, au lendemain de la prise du pouvoir par le prolétariat, la situation économique de la société connaît les deux caractéristiques suivantes :
- Par rapport aux besoins humains (mêmes considérés dans leur définition minimum de ne souffrir ni de faim, ni de froid ni de maladies curables), la pénurie règne en maître absolu pour près de doux tiers de l'humanité ;
- L'essentiel de la production mondiale est réalisée dans les régions industrialisées par une fraction largement minoritaire de la population : le prolétariat.
Dans ces conditions, la marche vers le Communisme implique un énorme effort de production visant à permettre d'une part la plus grande satisfaction des besoins humains et, d'autre part (liée à cette première nécessité) l'intégration au processus productif (à ses niveaux de technicité les plus élevés) de l'immense masse de la population qui est improductive, soit (dans les pays développés) parce qu'elle remplissait des fonctions improductives dans le capitalisme, soit (et c'est le cas pour la majorité dans le tiers-monde) parce que le capitalisme n'avait pu les intégrer à la production sociale. Or, qu'il s'agisse d'augmenter la production de biens de consommation ou qu'il s'agisse de produire les moyens de production qui permettront d'intégrer les masses improductives (le paysannat indigent du tiers-monde ne sera pas intégré à la production socialisée avec des charrues de bois ou d'acier, mais avec les moyens industriels les plus avancés... qu'il faudra créer), cet effort donc repose essentiellement sur le prolétariat.
Tant que subsiste la pénurie dans le monde et tant que le prolétariat reste une fraction de la société (c'est à dire tant que sa condition ne s'est pas étendue à toute la population du globe), il se trouvera à produire un surplus de biens (de consommation et de production) dont il ne bénéficiera qu'à long terme. De ce point de vue, donc, le prolétariat non seulement n'est pas classe exploiteuse mais demeure encore classe exploitée.
Dans les sociétés passées, l'État tendait à s'identifier à la classe dominante et à la défense de ses privilèges dans la mesure où cette classe était économiquement dominante, c'est à dire bénéficiant du maintien des rapports production existants. La tâche de "l'État de maintien de l'ordre est dans une société d'exploitation inévitablement le maintien de l'exploitation et donc des privilèges de l'exploiteur.
Mais au cours de la période de transition au communisme, le maintien des rapports économiques existants, s'il peut constituer, par certains aspects et à court terme, un moyen d'empêcher un recul en deçà des pas franchis par le prolétariat (et c'est en cela que l'État est inévitable au cours de la période de transition), il représente par ailleurs le maintien d'une situation économique où le prolétariat supporte le poids de la subsistance et du développement de l'ensemble de la société. Contrairement à ce qui passait dans les sociétés où la classe politiquement dominante était une classe bénéficiant directement de l'ordre économique existant, au cours de la dictature du prolétariat, la convergence entre État et classe politiquement dominante perd tout fondement économique. Qui plus est, comme organe exprimant les besoins de cohérence de la société et la nécessité d'empêcher que les antagonismes entre classes se développent, l'État tend inévitablement à s'opposer, sur le terrain économique, aux intérêts immédiats de la classe ouvrière. L'expérience russe au cours de laquelle, on vit l'État exiger du prolétariat un effort de production toujours plus grand au nom de la nécessité de pouvoir satisfaire aux exigences de l'échange avec les paysans ou avec les puissances étrangères, mit en évidence, à travers la répression des grèves ouvrières (dès les premiers mois de la révolution) à quel point cet antagonisme pouvait être déterminant dans les rapports entre prolétariat et État.
C'est pourquoi encore le prolétariat au pouvoir ne peut reconnaître dans l'État, comme le voulait Boukharine, "l'incarnation matérielle de sa raison collective", mais un instrument de la société qui ne se soumettra pas à son pouvoir "automatiquement" -comme c'était le cas pour les classes exploiteuses, une fois leur domination politique définitivement assurée- mais qu'il devra au contraire soumettre sans relâche à son contrôle et à sa dictature, s'il ne veut le voir se retourner contre lui, comme en Russie.
Une dictature sur l'État
Mais, dernier argument du camarade E., on nous dit qu'un État qui serait soumis à une dictature qui lui est extérieure, n'aurait pas les moyens de jouer son rôle. Nous oublierons que, si État et dictature d'une classe ne sont pas identiques, il n'y a pas de dictature réelle.
- "En fait, on accepte la dictature du prolétariat, mais on oublie qu'État et dictature, ou pouvoir exécutif d'une classe sont synonymes (...) C'est donc un non-sens de parler d'un État qui soit soumis à une dictature qui lui est extérieure et qui ne peut alors intervenir despotiquement dans la réalité économique et sociale pour l'orienter dans une certaine direction de classe".
Il est vrai qu'il ne peut y avoir de dictature d'une classe quelle qu'elle soit sans qu'existe dans la société une institution de type étatique : d'une part, parce que division de la société en classes implique existence d'un État, d'autre part, parce que tout pouvoir de classe nécessite l'existence d'un appareil qui traduise dans un cadre de lois et de moyens de contraintes son pouvoir dans, la société: l'État. Il est vrai aussi qu'un État qui ne disposerait pas d'un pouvoir réel ne serait pas un État. Mais il est faux de dire que dictature de classe est identique à État et "qu'un État qui soit soumis à une dictature qui lui est extérieure est un non-sens".
La situation de dualité de pouvoir (celui d'une classe d'une part, celui de l'État d'autre part le premier s'exerçant sur le second) s'est déjà produite dans l'histoire, en particulier au cours des grandes révolutions bourgeoises. Et, pour toutes les raisons que nous avons vues, elle s'imposera comme une nécessité au cours de la période de dictature du prolétariat.
Ce qui est réel, c'est qu'une telle situation ne peut s'éterniser sans entraîner la société dans une contradiction inextricable dans laquelle elle se consommerait elle-même. Elle constitue une contradiction vivante qui doit se résoudre inévitablement. Mais la façon dont elle se résout diffère fondamentalement suivant qu'il s'agisse de la révolution bourgeoise ou de la révolution prolétarienne.
Dans le premier cas, cette dualité du pouvoir se résout rapidement par une identification du pouvoir de la classe dominante avec le pouvoir d'État qui sort du processus révolutionnaire renforcé et investi du pouvoir suprême sur l'ensemble de la société, la classe dominante incluse.
Dans le cas de la révolution prolétarienne au contraire, elle se résout dans la dissolution de l'État et la prise en mains de toutes les destinées dé la vie sociale par la société elle-même.
C'est là une opposition fondamentale qui se traduit par des caractéristiques dans le rapport entre classe dominante et État dans la révolution prolétarienne différentes de celles de la révolution bourgeoise, non seulement par la forme mais aussi par le contenu.
Pour mieux cerner ces différences, il est nécessaire de tenter de se représenter les lignes générales des formes du pouvoir du prolétariat au cours de la période de transition telles qu'elles peuvent être esquissées à partir de l'expérience historique du prolétariat. Sans vouloir s'attacher à définir les détails institutionnels d'une telle période, car s'il est une caractéristique majeure des périodes révolutionnaires, c'est que toutes les formes institutionnelles tendent à apparaître comme des coquilles vides que les forces vives de la société remplissent et bouleversent au gré du besoin de leurs affrontements, il est cependant possible de dégager les axes très généraux suivants :
- L'organe du pouvoir direct du prolétariat sera constitué par les organisations unitaires de cette classe, les conseils ouvriers, assemblées de délégués élus et révocables par l'ensemble des prolétaires, c'est à dire l'ensemble des travailleurs produisant de façon collective dans le secteur socialisé (ouvriers de l'ancienne société et travailleurs intégrés au fur et à mesure du développement de la révolution dans le secteur collectivisé). Armés de façon autonome, tels sont les instruments authentiques de la dictature du prolétariat ;
- L'institution étatique est constituée à sa base par les conseils existant sur une base non pas de classe, c'est à dire non pas en fonction de la place occupée dans la production (le prolétariat se doit empêcher toute organisation de classe autre que la sienne) mais géographique : assemblées et conseils de délégués de la population par quartiers, villes, régions, etc. culminant dans un conseil central (qui constitue l'organe central de l'État).
Emanation de ces institutions, se dresse tout l'appareil d'État avec d'une part, ceux chargés du maintien de l'ordre : "surveillants" et armée pendant la guerre civile et, d'autre part le corps des fonctionnaires chargés de l'administration et de la gestion de la production et de la distribution.
Cet appareil de gendarmes et de fonctionnaires pourra être plus ou moins important, plus ou moins dissout dans la population elle-même suivant le cours du processus révolutionnaire, mais il serait illusoire d'ignorer l'inévitabilité de leur existence dans une société qui connaît encore les classes et la pénurie.
La dictature du prolétariat sur l'État de la période de transition, c'est la capacité de la classe ouvrière à maintenir l'armement et l'autonomie de ses conseils par rapport à l'État et à imposer à celui-ci (à ses organes centraux comme à ses fonctionnaires) sa volonté.
La dualité de pouvoir qui en résulte tendra à se résoudre au fur et à mesure que l'ensemble de la population sera intégrée dans le prolétariat et ses conseils et que l'abondance se développant, la fonction des gendarmes et autres fonctionnaires disparaîtra, "le gouvernement des hommes cédant la place à l'administration des choses" par les producteurs eux-mêmes. Le développement du pouvoir du prolétariat se fait dans le même mouvement que la diminution de celui des fonctionnaires de l'État et l'absorption par le prolétariat de l'ensemble de l'humanité transforme son pouvoir de classe en action consciente de la communauté humaine.
Mais, pour qu'un tel processus ait cours, il est nécessaire non seulement que les conditions matérielles de son épanouissement se trouvent réunies (en particulier extension mondiale de la révolution, développement des forces productives) main encore que le prolétariat, force motrice essentielle de ce processus, sache conserver et développer l'autonomie et la force de son pouvoir sur l'État.
Loin de constituer un non-sens, cette dictature de conseils ouvriers à laquelle est soumis l'État et qui lui est "extérieure", représente le mouvement même du dépérissement de l'État.
La révolution russe ne connut pas les conditions matérielles d'un tel épanouissement, mais par les difficultés énormes auxquelles elle se heurta, mit en relief le contenu des tendances intrinsèques de l'appareil étatique, le rôle de ce dernier s'étant trouvé du fait même de ces difficultés amplifié jusqu'aux dernières limites.
Au lendemain d'Octobre 17, existaient en Russie aussi bien les conseils ouvriers, protagonistes d'Octobre, que les conseils d'État, les soviets et leur appareil étatique en développement. Mais, reposant sur la conviction que l'État ne pouvait être distinct de la dictature du prolétariat, les conseils ouvriers se transformèrent en institution étatique s'intégrant dans l'appareil d'État. Avec le développement du pouvoir de la bureaucratie, provoquée par l'absence de toutes les conditions matérielles du développement de la révolution, l'opposition entre État et prolétariat ne tarda pas à apparaître au grand jour, on crut pouvoir résoudre l'antagonisme en plaçant partout où l'on pouvait dans l'appareil étatique, à la place ces fonctionnaires, les ouvriers les plus résolus et les plus expérimentés, les membres du Parti. Le résultat ne fut pas une prolétarisation de l'État, mais une bureaucratisation des révolutionnaires. A la fin de la guerre civile, le développement de l'antagonisme entre classe ouvrière et État aboutit à la répression par l'État des grèves de Petrograd en 1920 puis de l'insurrection des ouvriers de Kronstadt qui revendiquaient entre autres, des mesures contre la bureaucratie et la révocation des délégués aux Soviets.
Il ne s'agit pas d'en déduire ici que si le prolétariat avait gardé l'autonomie de ses conseils à l'égard de l'État et su imposer sa dictature à l'État au lieu de voir dans ce dernier son "incarnation matérielle", la révolution aurait définitivement triomphé en Russie.
La dictature du prolétariat en Russie ne fut pas étouffée par son incapacité à résoudre les problèmes de ses rapports avec l'État mais par l'échec de la révolution dans les autres pays, qui la condamnait à l'isolement. Cependant, son expérience à l'égard de ce problème crucial ne fut ni inutile ni "un cas particulier" sans signification pour l'ensemble du mouvement historique. L'expérience russe jeta une lumière fondamentale sur cette question complexe qui demeurait dans la théorie révolutionnaire encore particulièrement confuse. Non seulement, elle apporta avec les conseils ouvriers et l'organisation Soviétique, une réponse pratique au problème des formes du pouvoir prolétarien, mais elle permit de mieux résoudre ce qui se présentait dans les théories dégagées de l'expérience de la Commune de Paris comme une contradiction : de Marx et Engels à Lénine d'une part, on affirmait que l'État était l'incarnation de la dictature du prolétariat et d'autre part, on tirait de l'expérience de la Commune la leçon que le prolétariat devrait se prémunir contre les "effets nuisibles" (Engels) de cet État en soumettant tous ses fonctionnaires à un contrôle du prolétariat : réduction du revenu à celui d'un ouvrier et révocabilité à tout instant des fonctionnaires d'État par le prolétariat. Si l'État est identique à la dictature du prolétariat, pourquoi celui-ci devrait-il se méfier de ses effets nuisibles ? Comment la dictature d'une classe pourrait-elle avoir des effets contraires à ses propres intérêts ?
En fait, la nécessité d'une distinction nette entre dictature du prolétariat et État ainsi que d'un pouvoir dictatorial de la première sur le second se trouve en germe, sinon comme intuition du moins comme nécessité théorique dans les écrits des révolutionnaires sur cette question avant 17. Ainsi, par exemple, dans "l'État et la Révolution", Lénine est amené à parler d'une distinction entre quelque chose qui serait "l'État des fonctionnaires" et une autre qui serait "l'État des ouvriers armés": "en attendant l'avènement de la phase supérieure du communisme, les socialistes réclament de la société et de l'État qu'ils exercent le contrôle le plus rigoureux sur la mesure de travail et la mesure de consommation ; mais ce contrôle doit commencer par l'expropriation des capitalistes, par le contrôle des ouvriers sur les capitalistes, et il doit être exercé non par l'État des fonctionnaires mais par l'État des ouvriers armés" (souligné dans le texte).
Et dans un autre passage du même ouvrage où il tente de faire une comparaison entre l'économie de la période de transition et l'organisation de la poste dans le capitalisme, il affirme la nécessité du contrôle de ce corps de fonctionnaires par le corps des ouvriers armés :
- "Toute l'économie nationale organisée comme la poste, de façon que les techniciens, les surveillants, les comptables reçoivent, comme tous les fonctionnaires, un traitement n'excédant pas des "salaires d'ouvriers", sous le contrôle et la direction du prolétariat armé : tel est notre but immédiat", (souligné par nous).
La révolution russe montre tragiquement à quel point ce qui pouvait paraître comme une contradiction théorique dans la pensée révolutionnaire exprimait en fait une contradiction réelle entre la dictature du prolétariat et l'État de la période de transition ; elle mit en lumière à quel point "le contrôle et la direction du prolétariat armé" sur l'État constitue une condition sine qua non de l'affirmation de la dictature du prolétariat.
Le camarade E. croit certainement rester fidèle à l'effort théorique du prolétariat tel qu'il se concrétise avant Octobre 17 et en particulier dans "l'État et la Révolution" de Lénine dont il prend ici une défense intransigeante. Mais c'est trahir l'esprit de cet effort que de se camper sur une position qui presque par principe se refuse de mettre en question ces acquis théoriques à la lumière de la plus grande expérience de dictature du prolétariat. Pour conclure, nous ne pouvons que rappeler ce que Lénine écrivait justement dans "l'État et la Révolution" à propos de ce que doit être l'attitude des révolutionnaires dans ce domaine :
- "Marx ne se contenta pas d'admirer l'héroïsme des communards "montant à l'assaut du ciel", selon son expression. Dans le mouvement révolutionnaire des masses bien que celui-ci n’eut pas atteint son but, il voyait une expérience historique d'une portée immense, un certain pas en avant de la révolution prolétarienne universelle, un pas réel bien plus important que des centaines de programmes et de raisonnements. Analyser cette expérience, y puiser des leçons de tactique, s’en servir pour passer au crible sa théorie : telle est la tâche que Marx se fixe".
"Etant donné qu'il ne nous appartient pas de forger un plan qui vaille pour tous les temps à venir, il est d'autant plus certain que ce que nous devons faire pour le présent, c'est une évaluation critique impitoyable de tout ce qui est, impitoyable au sens où notre critique ne doit craindre ni ses propres résultats ni le conflit avec les pouvoirs établis."
(Karl Marx)
[1] [17]Et encore : l'État
français connaîtra les forte suivit l'Empire Napoléonien et celles de 1848.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Livres - Sur « La Gauche Communisme en Allemagne (1918-21) » de D. Authier et J. Barrot (notes de lecture)
- 3720 reads
Nous saluons d'abord la parution récente de
l'ouvrage de Denis Authier et Jean Barrot, qui manifeste incontestablement un
souci d'analyse d'un point de vue marxiste révolutionnaire et qui met à la
disposition de nombreux camarades, des textes de la Gauche jusqu'alors
introuvables. Il va de soi que l'on ne saurait trop insister sur la nécessité
de telles études qui déchirent un petit bout du voile diffamatoire recouvrant
la richesse des positions de la Gauche Communiste. Le livre est un des seuls[1] [18]
à mettre en avant la perspective communiste ouverte par la révolution en Russie
et ce, dans la période historique des révolutions prolétariennes. Ce travail a
de grandes qualités, mais également des faiblesses que nous allons essayer de
développer ici.
LES RELENTS MODERNISTES
Le livre se présente en deux parties, l'une d'analyse de la situation historique générale et de l'évolution des groupes de la Gauche Communiste, et l'autre en un recueil de textes. De manière générale dans leur analyse, les auteurs ne perçoivent pas nettement le changement de période ouvert par la première guerre mondiale et ne l'analysent pas comme la fin de la période où le mode de production capitaliste développait effectivement les forces productives et où, de plus en plus, ce même mode de production devient une entrave à tout développement ultérieur, entrave concrétisée par la nécessité périodique de détruire massivement une partie de ces forces productives dans des guerres mondiales. Ces camarades n'expriment jamais clairement la cause matérielle qui fait basculer l'ensemble de la social-démocratie et ses organes, partis de masse et syndicats, dans le camp de la bourgeoisie : la fin de la période ascendante et l'ouverture de la période de décadence, où les seules tâches du prolétariat sont la destruction de l'État bourgeois et la constitution mondiale de la dictature des Conseils Ouvriers.
Noyant le phénomène fondamental du changement de période dans des épiphénomènes tels que l'augmentation massive de la productivité du travail permettant l'extraction de plus-value relative, ce que Marx appelle alors la domination réelle du capital, les auteurs tombent dans les sophismes modernistes d'une soi-disant dichotomie entre "l'ancien mouvement ouvrier" (correspondant à la période ascendante) qui serait réformiste et le "nouveau" qui serait lui "pur et dur". De là à parler de "prolétariat allemand (qui) reste globalement réformiste ..." (p.28) ou de "la majorité réformiste de la classe ouvrière ..." (p.89) ..., il n'y a qu'un pas, qu'ils franchissent en assimilant le poids de l'idéologie bourgeoise : le réformisme, à la nature même de la classe ouvrière qui elle ne peut pas, qu'elle le veuille ou non, être "réformiste", "pour le capital" ou autres nouveautés. La classe ouvrière est strictement déterminée par la place socio-économique qu'elle occupe dans la production, qui la contraint à toujours lutter contre le capital ; c'est la lutte de classe. Le changement de période ne fait, lui, "que" changer les conditions de cette lutte qui a toujours été révolutionnaire (cf. La Commune de Paris), mais qui, dans le cadre progressif du système, pouvait arracher des réformes, c'est-à-dire des améliorations réelles de sa condition d'exploitée. Le changement des conditions dans lesquelles la lutte de classe se développe, est donc étroitement lié au changement de période qui marque le passage du système capitaliste dans sa phase de déclin historique. En assimilant la maladie bourgeoise du réformisme, à la nature révolutionnaire du prolétariat, l'on ne comprend plus pourquoi la classe ouvrière est la classe révolutionnaire, porteuse du communisme, l'on ne comprend plus ce qui ferait changer la nature "réformiste" du prolétariat en révolutionnaire, sinon un coup de baguette magique... Non, "le prolétariat est révolutionnaire ou n'est rien" (lettre de Marx à Schweitzer - 1865) signifie que sa lutte a toujours été une lutte contre le capital, une lutte révolutionnaire, une lutte qui d'emblée est politique car elle vise, consciemment ou non, à la destruction de l'État bourgeois. C'est donc bien ce changement des conditions de la lutte prolétarienne qui obligé la classe ouvrière, dans la période de décadence, à s'organiser uniquement dans les organes de la prise du pouvoir, les Conseils Ouvriers, et qui l'oblige à secréter le parti de classe, comme minorité, expression visible de sa conscience de classe. Nous voyons ici très clairement en quoi les Conseils Ouvriers ne sont pas la "découverte d'une forme d'un nouveau mouvement ouvrier", mais correspondent à la matérialisation du contenu invariant qui gît dans les entrailles du prolétariat, contenu que la période historique imposera comme nécessité à l'humanité : le communisme, la société sans classe.
La légende de la Gauche Italienne opposée à la Gauche Allemande
Cette légende, entretenue notamment par les bordiguistes “orthodoxes" du PCI[2] [19] vise à présenter la Gauche Allemande "anarchiste", antagoniquement à la Gauche Italienne "marxiste". Or, s'il est vrai que la Gauche Italienne a développé ses positions par des analyses plus vigoureuses, l'ensemble de la Gauche Internationale est le produit du même mouvement, affirmant, par delà les frontières, les mêmes constantes fondamentalement correctes : l'anti-parlementarisme marxiste, la défiance envers les syndicats, le rejet du frontisme, la nécessité de partis minoritaires, mais forgés par des principes communistes stricts rejetant toutes les anciennes tactiques opportunistes. La démystification de cette légende est particulièrement bienvenue dans cet ouvrage. Barrot et Authier démontrent, même s'il n'y a pas eu la constitution d'une fraction communiste de gauche au niveau international, la présence de cette gauche dans tous les pays (la Belgique avec Van Overstraeten et l'Ouvrier Communiste ne faisant pas exception), et, en particulier, l'existence de liens programmatiques entre la fraction communiste abstentionniste du Parti Socialiste Italien ("Il Soviet") et la Gauche Communiste Allemande (Pannekoek, Gorter). En effet, c'est cette fraction qui chargea, lors de sa conférence en mai 1920 à Florence, ses délégués à l'Internationale Communiste, "de constituer une fraction antiparlementaire conséquente à l'intérieur de la IIIème Internationale ..." et insiste "sur l'incompatibilité des principes et des méthodes communistes avec une participation aux instances représentatives bourgeoises"(* [20]). C'est dans ce même but qu'un an plus tard furent délégués des membres du KAPD (Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne) au 3ème Congrès de l'I.C. Et, de fait, Terraccini, délégué du PC d'Italie à ce même congrès, a soutenu l'intervention du KAPD contre la "tactique" frontiste de la "Lettre ouverte". L'on pourrait encore citer longuement les faits et prises de positions démontrant ce lien programmatique évident entre les différentes Gauches, lien certainement existant du seul fait que toutes les Gauches étaient produites par le même mouvement, celui de la compréhension que la révolution communiste mondiale est à l'ordre du jour et est, la seule solution pour la classe ouvrière. La faiblesse des Gauches s'exprime également clairement dans leur impossibilité de créer une réelle fraction internationale, pouvant lutter efficacement contre la dégénérescence de l'IC, entraînée de plus en plus, du fait de l'écrasement de la révolution mondiale, vers la bourgeoisie. L'on peut citer, outre la Gauche Allemande et Hollandaise, la Gauche Italienne, l'Hongroise avec B. Kun, Varga et Lukàcs, la Bulgare avec I. Gancher, l'Américaine avec J. Reed, l'Anglaise avec Pankhurst, la Française avec Lepetit et Sigrand, la Russe avec l'Opposition Ouvrière et le groupe de Miasnikov... Mais, comme le dit très bien cet extrait du texte "La Gauche Allemande et la question syndicale dans la IIIème Internationale"[3] [21] (cité p. 189) :
- "De même que la Commune fut "fille" (Engels) de l'A.I.T., de même la révolution allemande fut celle de cette Gauche Internationale qui n'eut jamais la force de se donner une organisation unitaire finale, mais dont les grands courants furent la Gauche Allemande, qui dans sa lutte même osa soutenir la direction programmatique donnée par le mouvement révolutionnaire lui-même, et la Gauche Italienne, qui eut la tâche historique de continuer le travail de la Gauche Internationale, le complétant et le formulant dans ses attaques contre la contre-révolution victorieuse ; elle nous a transmis ces armes théoriques... qui formeront la base du mouvement révolutionnaire futur qui, dans la pratique de la Gauche Allemande... trouve un grand exemple historique. La révolution future ne sera pas une question de banale "imitation", il s'agira de suivre "le fil du temps" tiré par la Gauche Communiste Internationale".
La Gauche Allemande et la question du “Parti”
Un élément important encore mis en avant par ce livre est, parmi l'ensemble des faiblesses des communistes en Allemagne, celle qui matérialise le plus toutes les autres, l'incompréhension du caractère indispensable pour le prolétariat d'avoir une avant-garde solide, constituée avant les combats décisifs, et ayant fermement rompu avec tout l'opportunisme et les positions bourgeoises véhiculées par la social-démocratie. Relever les erreurs du passé ne signifie pas qu'il faille rejeter la lutte héroïque de la Gauche Communiste, au contraire, cela permet aux révolutionnaires de tirer du mouvement prolétarien des indications utiles concernant la fonction et le rôle de l'avant-garde communiste. En cela, l'expérience allemande est riche en tâtonnements, en incompréhensions, mais aussi en ruptures lucides avec le substitutionnisme et le carriérisme, caractérisant de plus en plus les PC centristes comme étant amenés, avec le reflux du mouvement, dans le camp de la bourgeoisie par l'adoption du "socialisme dans un seul pays", négation même du programme communiste. D'autre part, il ne faudrait pas voir la Gauche Allemande comme homogène, et entièrement ravagée par l'attentisme, hérité des tergiversations de Rosa Luxembourg à rompre avec la social-démocratie et le refus de la nécessité des minorités révolutionnaires, théorisé, par la suite, par la tendance Essen et l'AAUD-E (Union Générale Ouvrière d'Allemagne Unitaire.) avec 0tto Rhule et "Die Aktion". En effet, les thèses du KAPD sur le rôle du Parti dans la révolution prolétarienne développent largement le besoin pour le prolétariat de se doter de "la forme historique convenable pour le rassemblement des combattants prolétariens les plus conscients, les plus éclairés, les plus disposés à l'action, (qui) est le parti" :
- "Le parti communiste doit donc tout d'abord, de façon absolument tranchante tenir à l'écart de lui tout réformisme et tout opportunisme ; il en est de même pour son programme, sa tactique, sa presse, ses mots d'ordre particuliers et ses actions. En particulier, il ne devra jamais accroître l'effectif de ses membres plus rapidement que ne le permet la force d'absorption du noyau communiste solide"[4] [22]
Dans le même sens, les interventions de Jan Appel au 3ème Congrès de l'IC sont aussi significatives[5] [23] :
- "Le prolétariat a besoin d'un parti -noyau- ultra formé. Il doit en être ainsi. Chaque communiste doit être individuellement un communiste irrécusable -que cela soit notre but- et il doit pouvoir être un dirigeant sur place, dans ses rapports, dans les luttes où il est plongé, il doit pouvoir tenir bon, et ce qui le tient, ce qui l'attache, c'est son programme. Ce qui le contraint à agir, ce sont les décisions que les communistes ont prises. Et là, règne la plus stricte discipline. Là, on ne peut rien changer, ou bien on sera exclu ou sanctionné. Il s'agit donc d'un parti qui est un noyau sachant ce qu'il veut, qui est solidement établi et a fait ses preuves au combat, qui ne négocie plus, mais se trouve continuellement en lutte. Un tel parti ne peut naître que lorsqu'il s'est réellement jeté dans la lutte, quand il a rompu avec les vieilles traditions du mouvement des syndicats et des partis, avec les méthodes réformistes dont fait partie le mouvement syndical, avec le parlementarisme."
Un texte aussi clair ne peut laisser aucun doute sur la nature profondément marxiste du KAPD, et nous permet de comprendre la dynamique qui fait surgir le parti de classe comme continuellement à la tête des luttes. Ce qui signifie qu'en période de contre-révolution, toute constitution de parti n'est qu'un artifice organisationnel qui ne sert que la confusion. Il ne peut rester que de petits groupes préservant les acquis programmatiques et les positions de classe. Mais lorsque la vague ouvrière remonte :
- "Il ne s'agit plus alors de défendre les positions, mais, sur la base de ces positions en constante élaboration, sur la base du programme de classe, d'être capables de cimenter la spontanéité de la classe, d'exprimer la conscience de classe, d'unifier ses forces en vue de l'assaut décisif, en d'autres termes, de construire le parti, moment essentiel de la victoire prolétarienne." (Leçons de la Révolution Allemande in Revue Internationale du C.C.I. n°2).
Pour terminer ces quelques remarques, il nous faut encore signaler que le choix des textes est relativement peu significatif et ne correspond pas aux meilleures productions de la Gauche Allemande, mais les auteurs s’en expliquent eux-mêmes et de toute manière leur publication en français ne peut que contribuer à la reconnaissance de ce courant comme l’un des plus important de la Gauche Communiste Internationale.
Ainsi ce livre vient à point pour satisfaire le besoin pressant du mouvement révolutionnaire renaissant de :
- "Connaître son propre passé pour mieux en faire la critique".
[1] [24] Avec également l'autre excellent ouvrage de D. Authier sur ce sujet, qui regroupe des textes beaucoup plus fondamentaux de la Gauche Allemande : "La Gauche Allemande", textes du KAPD, de l'AAUD... Edition : "Invariance" -Brignoles- voir la critique de ce livre dans "Révolution Internationale" n°6. Pour un aperçu général de cette question, il existe un article paru dans la Revue Internationale du CCI n°2 : "Les leçons de la Révolution Allemande".
[2] [25] Il est d'ailleurs compréhensible pour ces vestales dégénérées du "Parti Communiste International", de camoufler leur vertu léniniste derrière de calomnieuses insinuations, car c'est notamment deux scissions de ce même P.C.I., "Invariance" et le groupe danois "Kommunismen" qui remirent des textes de la Gauche Allemande en circulation.
* [26] (p. 313-314)
[3] [27] Ce texte est justement écrit par la scission du P.C.I. en 1972, "Kommunismen".
[4] [28] Extrait d'"Invariance" n° 8.
[5] [29] Extrait de la "Gauche Allemande".
Géographique:
- Allemagne [30]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [31]