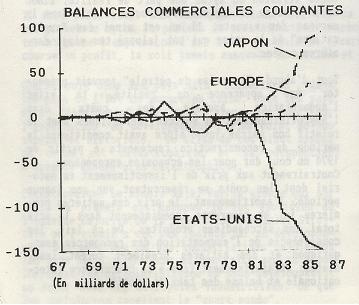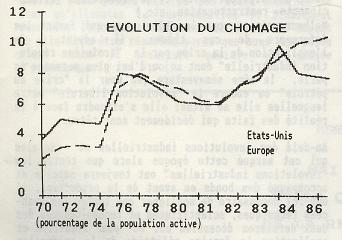Revue Internationale no 53 - 2e trimestre 1988
- 2609 reads
Editorial : luttes ouvrières en Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, émeutes et répression en Palestine
- 2702 reads
SEUL LE PROLETARIAT PEUT METTRE FIN A LA BARBARIE
Les médias, les journaux télévisés, la presse sont pleins de nouvelles. Depuis un an, petit à petit on apprend tout, et même beaucoup plus, sur le passé nazi du président autrichien K.Naldheim, sur l'insulte de "couille" que Chirac aurait adressée à Thatcher , pour ne citer que deux des innombrables "nouvelles d'importance" qui font couler tant d'encre.
Par contre, il faut être un lecteur assidu, et sacrement fouineur, de plusieurs journaux par jour pour découvrir les rares nouvelles ayant trait aux Misères quotidiennes et aux luttes de millions d'hommes. Parfois dans un entrefilet, on apprend la fin d'une grève... dont personne n'avait parlé à son début. Ou bien à l'occasion d'un article sur le PS portugais, on apprend que le pays est secoué par une vague de mécontentement social (février 88). Et quand la nouvelle d'une lutte ou d'une révolte ouvrière ne peut être censurée à cause de son ampleur, de ses répercussions et de son écho dans la société, alors c'est le mensonge et la désinformation la plus complète. Quand ce ne sont pas les insultes sur les ouvriers en lutte.
LA BOURGEOISIE CONTRE LA PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX DE LA SITUATION
La bourgeoisie fait le maximum pour occulter la réalité des luttes ouvrières. Aujourd'hui la faillite économique du capitalisme ne peut plus être cachée. La bourgeoisie internationale se prépare à accentuer encore plus dramatiquement ses attaques contre les conditions d'existence de l'humanité entière, et en premier lieu du prolétariat mondial. La censure des médias sur les luttes vise à limiter, si elle ne peut l'empêcher, le développement de la confiance en soi, dans sa force, dans son combat, du prolétariat.
Mais il n'y a pas que les luttes ouvrières que la bourgeoisie essaye de masquer. Alors qu'une véritable armada des principaux pays du bloc occidental se trouve sur le pied de guerre dans le golfe Persique face au bloc russe, avec pour prétexte de mettre au pas l'Iran de Khomeiny, c'est plutôt la discrétion qui règne dans les médias. Sauf campagne de propagande précise. Et pourtant il ne se passe pas de jour sans opérations militaires. Sans parler évidemment de la poursuite de la guerre Iran-Irak. Les grandes puissances se livrent en ce moment à un renforcement considérable de l'armement qu'elles essaient de masquer derrière les campagnes sur le "désarmement" est-ouest (sommet Reagan-Gorbatchev, sommet de l'OTAN). Partout, il s'agit de limiter autant que faire se peut la prise de conscience que le capitalisme c'est la guerre. S'il n'est pas détruit de fond en comble, il n'a rien d'autre à offrir à l'humanité qu'une 3ème guerre mondiale.
LA DECOMPOSITION DU CAPITALISME
L'avenir que nous prépare le capitalisme se manifeste dans toute son horreur au Moyen-Orient: la guerre Iran-Irak; non contents d'avoir déjà envoyé plus d'un million d'hommes à la mort sur le front, les Etats se livrent à la "guerre des villes" : la population civile massacrée à coups de missiles lancés à l'aveuglette, en plein coeur des villes. Pour "faire pression sur l'ennemi". Le Liban, dont on connaît l'horreur devenue endémique. Et maintenant les "territoires occupés" par Israël.
Nous dénonçons ici la répression sauvage que l'Etat bourgeois israélien exerce contre les populations en révolte des territoires occupés. En révolte contre la misère, le chômage massif, les famines, et contre la répression systématique et sauvage qu'elles subissent en permanence. Presque une centaine de morts. Tués par balles. Des blessés par milliers. Blessés par les sévices imposés: tortures, "passages à tabac", bastonnades. Et tout particulièrement des fractures des bras et des phalanges des mains à coup de pierre, de casque, infligés à froid et systématiquement par les soldats. Certains resteront infirmes à vie. Bref la terreur. La terreur capitaliste, banale et courante, telle qu'elle existe quotidiennement dans le monde. Rien qui soit exceptionnel à vrai dire.
Mais il ne suffit pas de dénoncer la répression. Il faut aussi dénoncer, et sans équivoque, toutes les forces qui agissent pour dévoyer cette colère, cette révolte, dans l'impasse du nationalisme. L'OLP certes. Mais aussi et surtout l'ensemble du bloc occidental, USA en tête évidemment, qui pousse l'OLP, qui pousse à son implantation dans les territoires occupés -jusque là relativement faible-, qui pousse, sinon à la constitution d'un Etat palestinien, du moins au contrôle de la population par l'OLP. Et qu'Israël, malgré sa bonne volonté, n'arrive plus à garantir. Il n'y a rien à attendre de l'OLP sinon l'exercice de la même terreur étatique que celle d'Israël. L'OLP a déjà largement fait ses preuves dans la répression et le maintien de l'ordre capitaliste dans les camps palestiniens du Liban.
Disons-le clairement. Que ce soit avec Israël ou avec un Etat palestinien, les populations des territoires occupés et en exil dans les camps palestiniens du Liban ou d'ailleurs vont souffrir encore plus de la misère, de la répression et de la guerre permanente qui existent et se développent en particulier dans cette région du monde. Tout comme pour l'ensemble des populations voisines. La seule façon de limiter les effets de cette barbarie croissante réside dans la capacité de la classe ouvrière de ces pays à entraîner les populations dans le refus de la logique guerrière et de la misère. Et c'est possible: les manifestations de rue au Liban contre les hausses de prix; la réalité du mécontentement ouvrier en Israël déjà exprimé par des grèves et des manifestations.
En troisième lieu, nous voulons aussi dénoncer le choeur des pleureuses, des démocrates de gauche, et autres humanistes, qui recommandent de "tout leur coeur" un traitement humain dans la répression. Une répression qui serait "humaine". Non violente sans doute. Et pourquoi pas rêver de guerre sans morts et sans souffrance. Guerre humaine quoi. Ces gens ne sont pas aussi idiots que cela. En fait, ce sont des hypocrites qui participent de toutes leurs larmes à la campagne médiatique et idéologique du bloc occidental visant à rendre la population otage de la fausse alternative: ou Israël ou l'OLP.
La publicité des médias faite autour des exactions de l'armée israélienne est le fait conscient du bloc US: il utilise la violence de la répression tout comme les massacres des camps palestiniens de Sabra et Chat Ila à Beyrouth en septembre 1982. Massacres accomplis sous les yeux complices des soldats israéliens. Massacres qui avaient servi à justifier aux yeux des populations occidentales l'envoi au Liban des armées US, britannique, française et italienne en 1982.
La situation dans les territoires occupés signifie que l'Etat d'Israël, à son tour, est en train de se "libaniser". C'est toute la région, tout le Moyen-Orient qui se "libanaise". C'est toute la société qui se décompose et pourrit. Cette décomposition est le produit du déclin, de la putréfaction du capitalisme. Il pourrit sur pied. Partout dans le monde.
SEUL LE PROLETARIAT PEUT EN FINIR AVEC LA BARBARIE DU CAPITALISME
Faillite économique, misère croissante et la guerre. Voilà dans toute son horreur ce que le capitalisme nous offre. Et cela alors qu'il existe potentiellement dans le monde un développement des forces productives suffisant amplement à mettre fin à la misère de la planète. C'est la réalité de ces contradictions qui forge la prise de conscience de la classe ouvrière
- du futur que nous prépare la bourgeoisie si on ne lui enlève pas le pouvoir;
- qu'elle seule, classe ouvrière, est en mesure d'enlever le pouvoir à la bourgeoisie parce que c'est elle qui produit tout, que c'est grâce à elle que tout fonctionne. Et qu'une classe dominante qui n'est plus obéie n'est plus une classe dominante.
La prise de conscience révolutionnaire qui passe obligatoirement par l'unification des prolétaires. Unification qui ne peut se faire que dans la lutte commune, sur des intérêts communs, contre un ennemi commun.
LE PROLETARIAT CONTINUE A LUTTER
A l'heure où nous écrivons, et malgré la censure de fait établie par l'ensemble de la presse internationale, le mouvement de lutte en Grande-Bretagne continue: grèves dans l'automobile, mécontentement constant et luttes parmi les infirmières et dans les services publics, dans l'enseignement. Malgré cela, au vu des informations fournies par les camarades de notre section en Grande-Bretagne, nous pouvons dire aujourd'hui que le mouvement semble marquer une pause.
Les premiers jours de février, les infirmières, 15 000 mineurs, 7 000 marins, 32 000 ouvriers de Ford et ceux de General Motors (Vauxhall), de Renault Truck industries (RVI), les enseignants, se mobilisent malgré l'opposition et les sabotages syndicaux ([1] [1]) . D'abord débordés, les syndicats vont vite obtenir une première victoire: en réussissant à retarder le déclenchement de la grève à Ford pour après la grève nationale des infirmières du 3 février. Malgré la simultanéité des luttes, malgré diverses manifestations de solidarité avec les mineurs et les infirmières, malgré l'éclatement d'une grève sauvage dès le 4, aux usines Ford de Londres,, les syndicats vont reprendre le contrôle de la situation en évitant toute tentative d'extension et d'unification à partir de Ford, véritable coeur du mouvement. L'isolement des ouvriers de Ford réussi, leur retour au travail obtenu au prix d'une promesse d'augmentation salariale de 14% sur 2 ans, la possibilité d'une première unification des différentes luttes ne s'est pas réalisée. Aujourd'hui les syndicats, pour le moment maîtres de la situation, préparent toute une série de journées d'action par secteur en vue d'épuiser la forte combativité dans des actions cloisonnées et sans perspective.
LES OUVRIERS BRITANNIQUES NE SONT PAS SEULS
Malgré la propagande bourgeoise selon laquelle les ouvriers sont passifs, résignés et sans combativité, ce mouvement de lutte en Grande-Bretagne vient confirmer l'existence d'une vague internationale de luttes. Ce mouvement succède à celui des ouvriers en Belgique au printemps 86, à la grève dans les chemins de fer français de l'hiver dernier, aux luttes ouvrières du printemps 87 en Espagne, à celles, massives, en Italie au cours de l'année 87 et au mouvement de colère et de lutte en Allemagne à la fin de cette même année. Sans parler des myriades de petits conflits qui ne font pas parler d'eux mais n'en représentent pas moins une immense acquisition d'expérience pour le prolétariat sur ce qu'est le capitalisme. Et ces luttes au coeur de la vieille Europe ne sont pas isolées: luttes en Yougoslavie, en URSS, en Roumanie, en Pologne pour les pays de l'Est; en Corée, à Taiwan, au Japon; en Suède, au Portugal, en Grèce; en Amérique Latine... Tout cela depuis le début 87. Même dans les pays où la bourgeoisie réussissait encore à empêcher l'éclatement de luttes ouvrières malgré le mécontentement, l'accélération brutale de la crise rompt l'équilibre fragile qui existait tant bien que mal.
Ce sont tous les continents qui sont touchés par le développement des luttes ouvrières. Outre la simultanéité dans le temps, ces mouvements manifestent les mêmes grandes caractéristiques: ils sont massifs; ils touchent plusieurs secteurs à la fois parmi les plus concentrés et les plus nombreux, et en particulier la fonction publique; ils posent tous la nécessité de briser le corporatisme et de réaliser l'unification entre les différents secteurs en lutte; ils manifestent une méfiance chaque fois plus grande à l'égard des syndicats en les débordant tout au moins au début; et en tentant de leur disputer le contrôle et l'organisation des luttes.
LES LUTTES ACTUELLES NE SUFFISENT PAS: IL FAUT ALLER PLUS LOIN
La situation actuelle est marquée par une accélération terrible de l'histoire sur tous les plans: économique par la chute dans la crise; guerrier par l'accentuation des antagonismes impérialistes; social par l'existence des luttes ouvrières de défense face aux attaques économiques. Cette accélération sur tous les plans signifie pour le prolétariat l'annonce d'attaques encore plus dramatiques sur ses conditions d'existence. Ces attaques vont nécessiter de sa part un effort important pour pouvoir développer à un niveau plus haut ses luttes. Il devra de plus en plus assumer l'aspect politique de ses luttes économiques:
"Dans les combats à venir de la classe ouvrière, une compréhension claire de leur enjeu véritable, du fait qu'ils ne constituent pas une simple résistance au coup par coup contre les agressions croissantes du capital nais qu'ils sont les préparatifs indispensables en vue de la seule issue pour l’humanité: la révolution communiste, une telle compréhension de l'enjeu sera la condition tant de leur efficacité immédiate que de leur aptitude à servir réellement de préparatifs pour les affrontements à venir.
Par contre, toute lutte qui se cantonne sur le terrain strictement économique, défensif contre l'austérité sera plus facilement défaite, tant au niveau immédiat que comme partie d'une lutte beaucoup plus vaste, fin effet, elle sera privée du ressort de cette arme, aujourd'hui si importante pour les travailleurs qu'est la généralisation et qui s'appuie sur la conscience du caractère social et non pas professionnel du combat de la classe. De même, par manque de perspectives, les défaites immédiates seront surtout un facteur de démoralisation au lieu d'agir comme éléments d'une expérience et d'une prise de conscience." (Revue Internationale n°21, 2è trimestre 1980)
Se limiter à combattre les conséquences économiques de la crise du capitalisme sans lutter contre la cause elle-même, c'est, à terme, rendre inefficaces les luttes même au plan économique. Lutter contre la cause des malheurs qui assaillent l'humanité, c'est non seulement lutter contre le mode de production capitaliste, mais aussi le détruire de fond en comble et en finir avec la misère et les guerres. Et cela seul le prolétariat peut le réaliser. Pour aller plus loin, la classe ouvrière doit tirer les leçons de ses luttes passées. Les travailleurs britanniques viennent de nous montrer qu'ils s'étaient remis de la défaite cuisante subie lors de la grève des mineurs. En particulier en en tirant la principale leçon: les luttes isolées, même si elles sont longues, sont vouées à l'échec.
EN ITALIE: L'OBSTACLE DU SYNDICALISME DE BASE
Déjà durant le "mai rampant" italien en 1969, les ouvriers s'étaient affrontés durement aux syndicats. La forte méfiance à leur égard est sans doute une des principales caractéristiques du prolétariat dans ce pays. En 1984, les ouvriers en lutte contre la remise en cause de l'échelle mobile des salaires avaient refusé d'obéir aux syndicats officiels. Et le mouvement était parti derrière les "conseils d'usines" qui en fait étaient de véritables organes syndicalistes de base. Son apogée, et en même temps son enterrement, fut la participation d'un million d'ouvriers à la manifestation de Rome en avril 84.
L'échec de cette lutte a nécessité trois ans de "digestion", de réflexion, de mûrissement de la conscience ouvrière. Le mouvement de 87 qui démarre dans les écoles au printemps rejette les syndicats officiels. Il s'organise en assemblées et en comités de délégués -les COBAS- pour s'étendre dans tout le pays. Quarante mille personnes manifesteront à Rome au mois de mai à l'appel des seuls COBAS. Mais il ne réussira pas à s'étendre à d'autres secteurs malgré la mobilisation existante. Après les vacances de l'été le mouvement dans l'école s'essouffle, et les autres mobilisations ouvrières -surtout dans les transports- restent isolées et dispersées sans réussir à prendre véritablement le relais de l'école. Et cela en particulier à cause de la mainmise de plus en plus forte du syndicalisme de base sur les COBAS qui se sont développés un peu dans tous les secteurs en lutte.
Quand la mobilisation retombe, quand le mouvement recule, ces comités de délégués deviennent une proie facile pour le syndicalisme. Celui-ci fait dévier l'indispensable recherche de la solidarité et de l'extension entre les différents secteurs en lutte vers de faux problèmes, en vérité des pièges, pour étouffer la combativité ouvrière:
- d'abord dans la question de l'institutionnalisation ou de la légalisation des COBAS en vue d'en faire de nouvelles formes syndicales qui ne veulent pas dire leur nom et ayant la confiance des ouvriers;
- dans le cadre du corporatisme (spécialement dans les chemins de fer parmi les conducteurs);
- dans la centralisation trop précipitée, hâtive des comités dans des assemblées au plan régional et surtout national où les syndicalistes de base gauchistes peuvent utiliser toute leur science de la manoeuvre bureaucratique et... syndicale.
Au nom de l'extension, les syndicalistes de base, qui y sont dans les faits opposés, n'hésitent pas à provoquer un contre-feu qui s'avère bien souvent efficace en provoquant, soit trop tôt, soit artificiellement, la "centralisation" des premières et immatures tentatives de prise en main de leur lutte par les ouvriers, pour mieux les étouffer dans les assemblées de base. Un peu comme les bourgeons se développant trop tôt et détruits par les dernières gelées de l'hiver. C'est le mouvement et la vitalité des luttes, l'existence des assemblées ouvrières, la recherche de l'extension, le processus vers l'unification par la prise en main des luttes par les ouvriers eux-mêmes, qui peuvent mener à la centralisation indispensable et effective des combats ouvriers.
LE GEANT PROLETARIEN ALLEMAND SE REVEILLE ET ANNONCE L'UNIFICATION DES LUTTES
Le mouvement de décembre 87 autour de l'opposition aux 5 000 licenciements à une usine Krupp à Duisburg a été la lutte la plus importante en Allemagne depuis les années 20. Le prolétariat allemand est appelé à jouer un rôle central dans le processus révolutionnaire de par sa concentration, sa puissance, son expérience historique particulièrement riche, ses liens avec le prolétariat de RDA et des pays de l'Est. Les luttes de décembre portent un coup au mythe de la prospérité allemande, de la discipline et de la docilité des ouvriers de ce pays. Nous sommes au début de luttes massives en RFA.
L'importance de cette lutte fut qu'elle provoqua la participation d'ouvriers de différentes villes et de différents secteurs dans un mouvement classiste de solidarité. Non dans la grève, mais dans les manifestations de rue, dans les meetings de masse et dans les délégations de masse. Alors que dans la grève des cheminots français (SNCF), la question centrale était encore l'extension d'un secteur isolé au reste de la classe, en Allemagne la question de l'unification autour des ouvriers de Krupp fut posée dès le début.
Nais surtout l'importance de cette lutte réside en ce qu'elle annonce. Malgré son manque d'expérience, d'affrontements aux syndicats et à leurs manoeuvres, aux partis de gauche et au gauchisme du syndicalisme de base, dès son entrée sur la scène sociale, le prolétariat allemand indique clairement la caractéristique principale et la perspective des mouvements à venir: ce sont les secteurs centraux, le coeur du prolétariat européen, qui vont être touchés par les attaques. Les principales concentrations ouvrières: la Ruhr, le Benelux, les régions de Londres et de Paris, et le nord de l'Italie. Ce sont ces fractions centrales qui vont entrer en lutte et ouvrir, "offrir" à l'ensemble de la classe ouvrière, la perspective concrète de l'unification des combats ouvriers dans chaque pays. Et la perspective de la généralisation internationale de la lutte ouvrière.
Les mouvements en Italie et en Allemagne synthétisent et cristallisent les principales nécessités de TOUTES les luttes actuelles dans le monde au-delà des particularités politiques locales et nationales:
- ne pas rester isolés dans le corporatisme;
- étendre les luttes;
- les organiser en assemblées générales en ne laissant pas le syndicalisme -officiel ou "masqué", "radical", de base- les étouffer par ses sabotages et ses manoeuvres;
- assumer le caractère général et politique des luttes: toute la classe ouvrière est attaquée, unifier les luttes en une seule lutte contre les différents Etats.
IL FAUT SE PREPARER AUX COMBATS A VENIR
Les luttes qui vont se produire ne sont pas gagnées d'avance. Automatiquement. Il faut que la classe ouvrière les prépare et s'y prépare. C'est ce qu'elle a fait et continue de faire par ses luttes mêmes. Par sa propre pratique. En développant son expérience. En en tirant les leçons. En prenant confiance dans sa propre force. C'est l'ensemble de la classe ouvrière qui renforce sa prise de conscience de manière massive et collective. Dans les luttes ou bien en dehors de celles-ci de manière "invisible", souterraine telle la taupe comme disait K. Marx.
Dans cette tâche, un rôle particulier est dévolu aux minorités d'ouvriers -organisées ou non- les plus combatives et les plus conscientes. Celles-ci doivent se préparer aux combats à venir si elles veulent remplir le rôle pour lequel le prolétariat les a produites. Parmi celles-ci, les groupes révolutionnaires sont irremplaçables et se doivent d'être à la hauteur de la situation. Etre à la hauteur de la situation signifie en premier lieu reconnaître celle-ci. Reconnaître la vague internationale de luttes actuelles et sa signification. Cette reconnaissance doit servir aux groupes communistes pour assurer une présence, une intervention politique sur le terrain, dans les luttes. Une intervention qui soit juste et efficace immédiatement et à plus long terme. Pour cela, il faut que les révolutionnaires ne tombent pas dans les pièges tendus par le syndicalisme de base. Et surtout n'en restent pas prisonniers. Prisonniers en particulier, comme nous l'avons vu ces dernières années:
- de la "fétichisation" de 1'auto-organisation au travers des coordinations et autres "assemblées nationales" centralisatrices mises en place par les syndicalistes gauchistes;
- du corporatisme et du localisme même au travers du radicalisme violent et du jusqu'au-boutisme véhiculés par les PC et les gauchistes.
Enfin, les révolutionnaires doivent pousser et participer aux regroupements ouvriers. En particulier, favoriser toutes les formations de comités de lutte. Car les ouvriers les plus combatifs ne doivent pas attendre l'éclatement de mouvements pour tisser des contacts entre eux, pour discuter, réfléchir ensemble, se préparer aux luttes afin d'en faire la propagande, l'agitation. Et par la suite, malgré les magouilles, les obstacles, voire l'opposition violente des syndicalistes, intervenir et prendre la parole dans les grèves, les assemblées, les manifestations de rue pour défendre les besoins des luttes et entraîner l'ensemble des ouvriers.
Il en va de la défense immédiate des conditions d'existence de la classe ouvrière. Il en va de l'avenir de l'humanité gravement menacée par l'absurdité aveugle et suicidaire du capitalisme. Seul le prolétariat international peut aujourd'hui limiter le développement de la misère. Et surtout, seul le prolétariat peut en finir à jamais avec la barbarie capitaliste.
R.L. 7/3/88.
[1] [2] Pour le suivi plus précis de ce mouvement, nous renvoyons nos lecteurs à nos différentes publications territoriales.
Géographique:
- Europe [3]
- Moyen Orient [4]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [5]
20 ANS depuis MAI 1968 : le mûrissement des conditions de la révolution prolétarienne
- 5094 reads
Les commentateurs "officiels" de l'histoire et les nostalgiques déçus des années de gloire du "mouvement étudiant" fêtent l'anniversaire des 20 ans de Mai 1968 en étant d'accord sur un point: les "rêves révolutionnaires de 68" n'étaient que des rêves. La réalité des 20 années qui nous séparent de l'explosion sociale de Mai 68 n'aurait fait que confirmer le caractère utopique de l'idée de la révolution communiste. Les conditions d'une telle révolution loin d'avoir mûri, se seraient au contraire éloignées. Il suffit pourtant de ne pas chausser les lunettes opaques de 1'idéologie de la classe dominante pour percevoir que la dynamique profonde qui traverse ces deux décennies traduit un mûrissement, sans précédent dans l'histoire, des conditions d'une révolution communiste mondiale.
Il est impossible de traiter ici en détail ces 20 années de lutte de classe particulièrement riches en enseignements. Mous nous attacherons uniquement à répondre à deux questions : quelle fut la signification de Mai 68? Les conditions d'une révolution communiste mondiale se sont-elles développées depuis lors?
LA RUPTURE DE MAI 1968
Mène s'ils se sont déroulés en France, les événements du printemps 68 étaient par leurs racines comme par leurs conséquences d'une dimension internationale. C'est dans le monde entier que les relations entre les classes commençaient à connaître un changement profond. Ces événements ne faisaient que concrétiser de façon éclatante un processus qui se déroulait à l'échelle de la planète et c'est comme tel qu'ils doivent être envisagés.
La grève de nasses de 1968 en France, comme la quasi-totalité des grèves ouvrières importantes de ce siècle, fut au départ totalement spontanée: ce ne sont pas les syndicats qui ont déclenché le mouvement, au contraire. Ceux-ci tentèrent au début, en vain, d'arrêter par tous les moyens la mobilisation naissante.
Sur le plan immédiat, cette mobilisation trouva au départ un amplificateur gigantesque, dans la volonté de répondre la brutale répression à laquelle se livrait l'Etat contre des manifestations d'étudiants. Contre cette répression, le 13 mai, Paris connaissait une des plus grandes manifestions de son histoire. Puis, en quelques jours par centaines de milliers, dans toutes les villes de France, tous les secteurs de la classe ouvrière sont entrés en lutte. Tout aussi rapidement le mouvement de grève se faisait l'expression du profond mécontentement qui mûrissait dans l'ensemble de la classe travailleuse. 10 millions de travailleurs paralysaient l'essentiel de l'appareil productif du capital français.
L'arrogance coutumière de la classe dominante laissait la place à la surprise et au désarroi devant le déploiement de force de ce prolétariat qu'elle croyait définitivement soumis et vaincu. Après avoir subi la défaite sanglante des insurrections ouvrières qui ont marqué la fin de la 1ère guerre mondiale, après avoir subi le triomphe de la contre-révolution stalinienne en Russie, après avoir subi dans les années 30 les effets d'une dépression économique sans avoir les moyens de répondre, après avoir subi une deuxième guerre mondiale dont les horreurs et la barbarie étaient à peine prévisibles, après avoir subi 20 ans de reconstruction économique avec la robotisation et l'atomisation la plus effroyable de la vie sociale, après avoir vécu près de 40 ans sous le contrôle quasi militaire des partis politiques staliniens, fascistes ou démocratiques , après avoir entendu pendant des années qu'elle s'embourgeoisait, bref après des décennies d'écrasement, de soumission et de désorientation, en mai 1968 la classe ouvrière revenait par la grande porte sur la scène de l'histoire. Si l'agitation estudiantine qui se développait en France, depuis le début du printemps avait déjà bouleversé l'ambiance sociale du pays: affrontements répétés avec les forces de l'Etat sur des barricades où il n'y avait pas que des étudiants; s'il y avait déjà eu des premières grèves qui pouvaient annoncer un prochain orage (Sud-Aviation, Renault-Cléon), l'entrée massive en lutte de la classe ouvrière bouleversa tout. La classe exploitée relevait la tête et cela entraînait une secousse dans l'ordre social jusque dans ses fondements les plus profonds. Des "comités d'action", d'usine ou de quartier, des "comités de lutte", des "groupes ouvriers" se formaient partout rassemblant les éléments les plus combatifs qui cherchaient à comprendre et à se regrouper pour agir indépendamment des structures syndicales. Les véritables idées communistes y retrouvaient un droit de citer.
Cependant la classe ouvrière, qui fut certainement la première surprise par l'ampleur de sa propre force, n'en était pas, dans son ensemble, à se poser la question de jouer le tout pour le tout dans une tentative révolutionnaire. Loin de là. Elle en était à ses premiers nouveaux pas, sans expérience et encore pleine d'illusions.
La bourgeoisie, passé l'effet de surprise ne resta pas les bras croisés. Déployant une coopération sans faille entre tous ses secteurs politiques, de la droite à l'extrême gauche et des forces de répression policière aux structures syndicales, elle parvint à reprendre le contrôle de la situation. Il y eut les concessions économiques accordées à grand renfort d'appels à la reprise du travail après la "victoire des accords de Grenelle". Il y eut l'annonce d'élections dans le but a peine voilé de dévoyer les luttes du terrain de la rue vers celui des urnes. Mais il y eut surtout l'habituelle combinaison de la répression policière et du sabotage des luttes de l'intérieur par les syndicats et les forces de la gauche du capital. Dés le départ les syndicats orientèrent les travailleurs vers l'occupation des usines, nais une occupation qui devait s'avérer rapidement un moyen d'emprisonner les travailleurs et de les isoler les uns des autres, sous prétexte de "protéger l'outil de travail contre les étudiants provocateurs". Tout au long du mouvement, les syndicats se sont appliqués à entretenir cet éparpillaient et enfermement des forces. Les heurts directs sont fréquents entre ouvriers et responsables syndicaux, pourtant prêts à tout faire pour ne pas perdre toute crédibilité. Après la signature des dits "accords de Grenelle", le responsable du principal syndicat, Georges Séguy (secrétaire général de la CGT et membre du bureau politique du PCF), venu à Renault-Billancourt pour faire voter leur acceptation et la reprise du travail, se voit désavoué par l'assemblée générale. Il faudra toute la capacité manoeuvrière des syndicats pour parvenir enfin à faire reprendre le travail. Deux exemples concrets résument bien ce que fut le travail final de "rétablissement de l'ordre": le premier, les syndicats appelant à la reprise du travail dans les différents dépôts des chemins de fer et des transports de la capitale en affirmant mensongèrement que d'autres dépôts l'avaient déjà fait; le second, à Sochaux, dans la plus grande usine d'automobiles de France, relativement isolée à l'est du pays, au moment des très violents affrontements provoqués par les charges de police pour faire évacuer l'usine -DEUX OUVRIERS SONT TUES PAR LA POLICE- la CGT sabote matériellement l'organisation de la résistance dans l'usine, toujours pour "ne pas céder à la provocation".
Beaucoup d'ouvriers rentrèrent la rage au ventre. Beaucoup de cartes Syndicales furent déchirées. La presse "bien pensante" parlait élogieuse du sens des responsabi1ités des syndicats. La bourgeoisie parvint à rétablir l'ordre, son ordre.
Mais les événements de 1968 avaient bouleversé irréversiblement la situation historique. 10 millions d'ouvriers, au coeur de la zone la plus industrialisée du monde, avaient fermé avec fracas une porte de l'histoire: celle de près de 40 ans d'écrasement idéologique du prolétariat, de 40 ans de contre-révolution triomphante. Une nouvelle période historique commençait.
Mai 68 pose la question de la perspective révolutionnaire
Aujourd'hui la bourgeoisie ne parle plus de 68 avec la haine qu'elle inculquait à ses forces de police au moment des barricades ou de Sochaux. A travers ses médias elle prend même parfois un ton d'attendrissement pour parler des UTOPIES des jeunes de ce temps là. Mai 68 c'était un beau rêve, mais irréalisable. Car, sous-entendu, le capitalisme est éternel.
Il est vrai qu'en Mai 68 la question de la révolution devint à nouveau pour des millions de personnes un objet de débats et de réflexion. Il est vrai que pour une partie des étudiants "la révolution" était à l'ordre du jour, immédiatement. On voulait TOUT, TOUT DE SUITE! Et il est vrai aussi que c'était là une utopie.
Mais l'utopie n'était pas dans l'idée générale de la nécessité et la possibilité de la révolution -comme le dit la bourgeoisie- mais dans l'illusion de croire que celle-ci était, il y a 20 ans, immédiatement réalisable.
Tout d'abord une remarque. Pour la partie des étudiants qui se réclamait de "la révolution" (une petite minorité, contrairement à ce que certaines légendes laissent penser) le mot de révolution ne voulait souvent pas dire grand chose. Avant 1968 en France, comme dans la plupart des pays, il y avait déjà une agitation estudiantine. Beaucoup de jeunes étudiants s'intéressaient aux luttes de libération nationale des pays moins développés (car pensaient-ils, il n'y avait rien à attendre du prolétariat trop embourgeoisé des pays industrialisés); Che Guevara était la nouvelle idole; ils croyaient souvent au "socialisme" ou à "la nature ouvrière" des régimes des pays de l'Est... avec des préférences suivant les courants pour la Chine, Cuba, l'Albanie...; et quand l'idée de révolution n'était pas identifiée avec celle d'un capitalisme d'Etat à la stalinienne elle se perdait dans un flou artistique qui allait des élucubrations autogestionnaires aux utopies dépassées des socialistes pré-marxistes; les stupidités d'un Marcuse sur la disparition de la classe ouvrière et sur la nature révolutionnaire de couches comme les étudiants trouvaient un franc succès. Il n'en demeure pas moins que, indépendamment des confusions universitaires, la réalité posait la question de la perspective révolutionnaire. Le retour de la force du prolétariat sur la scène sociale, le fait que celui-ci démontrait dans la pratique sa capacité à se saisir de l'ensemble de l'appareil productif social, le fait que la chape de plomb du pouvoir des classes dominantes perdait soudain son apparence éternelle, immuable, inévitable, tout cela faisait que -même si ce n'était pas en termes de réalisation immédiate- la question de la révolution revenait hanter les esprits.
"A mieux considérer les choses, on verra toujours que la tache surgit là où les conditions matérielles de sa réalisation sont déjà formées, où sont en train de se créer".
Marx, Avant-propos à la Critique de l'économie politique.
Un nouveau développement des conditions de la révolution était "en train de se créer" en 1968. Ce même prolétariat qui avait été capable de se lancer à plusieurs reprises dans l'histoire à l'assaut révolutionnaire contre la société d'exploitation, était de retour et il se préparait encore une fois à recommencer. Mais on n'était qu'au début d'un processus.
* Quelles sont les conditions d'une situation révolutionnaire?
Lénine définissait les conditions d'une telle situation en disant en substance qu'il fallait "que ceux d'en haut ne puissent plus gouverner comme auparavant" et que "ceux d'en bas ne veuillent plus vivre comme auparavant". En effet, une révolution sociale implique un bouleversement de fond en comble des rapports sociaux existants pour tenter d'en établir de nouveaux. Cela exige la volonté révolutionnaire des lasses lais aussi un affaiblissement "objectif des conditions de pouvoir de la classe dominante. Or le pouvoir de cette classe ne repose pas uniquement sur les armes et la répression. (Contrairement à ce que prétend l'anarchisme). Ce pouvoir trouve ses fondements, en dernière instance, dans la capacité de la classe dominante à assurer le fonctionnement d'un mode de production permettant la subsistance matérielle de la société. Aussi n'y a-t-il pas de véritable affaiblissement de l'ordre établi sans crise économique, que cette crise prenne la forme "pure" ou celle "déguisée" d'une guerre. Cette crise économique est aussi une condition nécessaire, même si non suffisante, pour le développement de la volonté révolutionnaire de la classe ouvrière. C'est cette crise qui par l'aggravation des conditions d'existence qu'elle entraîne, pousse la classe exploitée à réagir et à s'unifier au niveau mondial.
A ces conditions "objectives", c'est-à-dire indépendantes de l'action de la classe révolutionnaire, doivent s'ajouter évidemment celles qui mesurent l'extension et la profondeur de la conscience et la volonté révolutionnaires dans cette classe: dégagement de l'emprise de l'idéologie dominante, assimilation de sa propre expérience historique, confiance en soi, réappropriation de son programme historique.
En 1968 ces conditions commençaient à se former, mais, ce développement était encore loin d'être parvenu à son terme.
Sur le plan économique, le capitalisme sortait à peine de la période de relative prospérité de la reconstruction. La récession de 67, si elle traduisait la fin de quelque chose et l'ouverture d'une nouvelle période de crise économique, restait encore fort modérée. La marge de manoeuvre de la bourgeoisie commençait de nouveau à se rétrécir de façon accélérée, mais elle avait encore les moyens de faire face aux secousses de la machine économique, même si c'était au prix de manipulations économiques des Etats qui ne faisaient que préparer de nouvelles et plus grandes difficultés pour l'avenir. Pour la classe ouvrière mondiale cette situation se traduisait encore par des illusions quant à la possibilité d'une nouvelle prospérité. Le caractère mondial de la crise économique, qui aujourd'hui semble si évident, ne l'était pas à l'époque. On croyait encore souvent que les difficultés économiques étaient d'ordre national et qu'une meilleure gestion des affaires publiques suffirait à rétablir la situation. Dans les pays les moins développés c'était les illusions sur les dites" luttes de libération nationale".
Le chômage recommençait à se développer, d'où une certaine inquiétude, mais son niveau restait encore proche de celui du "plein-emploi" (un terme employé à l'époque et tombé depuis quasiment en désuétude). De façon générale, le niveau de vie s'il se dégradait déjà, était encore loin de connaître les chutes violentes qu'il connaîtrait dans les deux décennies suivantes. (Voir l'article consacré à 20 ans de crise économique).
Cette immaturité générale se concrétisait aussi au niveau de l'autonomie du prolétariat à l'égard des forces syndicales du capital. Mai 68, comme toutes les luttes de notre époque, s'est caractérisé par l'intensification de l'opposition ouverte entre ouvriers et organisations syndicales. En Mai 68 comme en 69 en Italie, la lutte ouvrière devait se heurter souvent violemment à celles-ci. Mais ici encore ce n'était que le début d'un processus. Malgré la méfiance croissante, les illusions sur la nature des syndicats qu'on considérait "malgré tout ouvrière", restait importante.
Mais ce qui manquait le plus à la génération de prolétaires de 1968 c'était l'expérience des combats. Pour gigantesque qu'ait été le déploiement de forces de Mai 68, la classe ouvrière dans son ensemble était loin de comprendre ce qu'elle était en train de faire et encore moins de le maîtriser. De façon générale son expérience immédiate se résumait encore trop souvent aux ballades syndicales, aux enterrements des Premier Mai, aux grèves longues et isolées.
Mai 68 était très loin de constituer une véritable situation révolutionnaire. L'ensemble de la classe ouvrière le savait ou le sentait. Et toute l'impatience de la petite-bourgeoisie intellectuelle en révolte qui voulait "Tout, tout de suite" n'y pouvait rien. ([1] [6])
CE QUE LE PROLETARIAT A APPRIS EN 20 ANS
20 années de décomposition capitaliste
Cependant, les conditions d'une situation révolutionnaire au niveau mondial n'ont cessé de se développer et de s'approfondir pendant les dernières 20 années. Ceux qui le nient aujourd'hui sont souvent les mêmes qui croyaient la révolution immédiatement réalisable en 1968. Et ce n'est pas par hasard, car dans les deux cas le lien entre crise économique et lutte de classe est ignoré ou nié. L'évolution objective de la société capitaliste au cours de ces 20 dernières années peut se résumer en un bilan aussi catastrophique que menaçant. La misère la plus effroyable que l'humanité ait jamais connue s'est étendue comme tâche d'huile dans les zones les moins développées de la planète nais aussi de plus en plus dans les pays centraux; la destruction de tout avenir pour un nombre toujours croissant de chômeurs et une intensification impitoyable des conditions d'exploitation pour ceux qui travaillent encore; développement permanent de l'économie de guerre et exacerbation des rivalités commerciales et militaires entre nations: l'évolution de la vie économique et politique du capitalisme au cours des 20 dernières années a mis en évidence, encore une fois que la seule "issue" à la quelle conduit ce système social décadent est celle d'une nouvelle guerre mondiale.. De la guerre du Viêt-nam à la guerre Irak-Iran, en passant par la destruction du Liban et la guerre d'Afghanistan, le capitalisme menace toujours plus de transformer la planète en un bain de sang. (Voir dans ce numéro et le précédent l'article consacré à l'évolution des conflits impérialistes). L'évolution du capitalisme ruine elle même les bases sur lesquelles repose le pouvoir de la classe dominante.
Ces années ont détruit beaucoup d'illusions dans la conscience des ouvriers et développé quelques convictions importantes:
- caractère irréversible et mondial de la crise économique capitaliste;
- impossibilité de toute issue "nationale" et l'impasse que constituent "les guerres de libération nationale".
- impossibilité de réformer un système social qui est de plus en décomposé dans ses fondements mêmes.
- nature capitaliste des pays dits "communistes".
Mais ce n'est pas tant le développement de la NECESSITE de la révolution et de la conscience qu'en acquiert le prolétariat qu'il est difficile de percevoir. C'est plutôt le développement de la POSSIBILITE de celle-ci, à travers l'accumulation d'expériences au cours de 20 années de combats ouvriers, qui n'apparaît pas toujours au regard superficiel.
20 années de luttes
La lutte de classe pendant ces années ne s'est pas développée de manière linéaire. Son développement s'est fait au contraire de façon heurtée, complexe, connaissant des avancées et des reculs, à travers des vagues successives entrecoupées de périodes d'accalmie et de contre-offensive de la bourgeoisie. Si l'on regarde globalement ces 20 années de luttes sur le plan mondial -le seul plan qui soit valable pour comprendre la dynamique de la lutte prolétarienne- on peut distinguer trois vagues majeures de montée des luttes ouvrières. La première vague ouverte par mai 68 s'étend jusqu'en 1974. Pendant près de 5 ans dans la quasi-totalité des pays, industrialisés ou moins développés, de l'Est ou de l'Ouest, les luttes ouvrières connaissent un nouveau développement. Dès 1969 en Italie ("l'Automne chaud") une puissante vague de grèves, au cours de laquelle les heurts entre ouvriers et syndicats se sont multipliés, confirmait que 1968 avait bien été l'ouverture d'une nouvelle dynamique internationale de la lutte ouvrière; la même année en Argentine (Cordoba, Rosario), la classe ouvrière se lançait dans des combats massifs. En 1970 en Pologne la lutte ouvrière atteint de nouveaux sommets: affrontements généralisés dans la rue avec la milice; la classe ouvrière contraint le gouvernement à reculer. Pour les ouvriers des pays de l'Est c'est la confirmation qu'on peut se battre contre le totalitarisme étatique ; pour les ouvriers du monde entier, le mythe de la nature ouvrière des pays de l’Est subit un nouveau choc. Puis, dans un contexte international de combativité, des luttes particulièrement significatives se développent en Espagne (Barcelone en 1971), en Belgique et Grande-Bretagne (1972). Cependant dès 1973 la mobilisation ouvrière va se ralentir sur le plan international. Malgré les luttes importantes que développe la classe ouvrière au Portugal et en Espagne à l'occasion de la démocratisation des régimes politiques (1974-1977), malgré une nouvelle vague de grèves en Pologne en 1976, au niveau global -en particulier en Europe occidentale- la mobilisation ouvrière se réduit fortement.
Mais en 1978, une nouvelle vague de luttes ouvrières explose au niveau international. Plus courte dans le temps que la précédente, on y voit de 1978 à 1980, un nouveau déploiement des forces prolétariennes qui frappe par sa simultanéité internationale. Les grèves massives du secteur pétrolier en Iran en 1978, celles des métallurgistes allemands et brésiliens de 1978 à 1980; la lutte des mineurs aux USA en 1979 puis des transports de New-York en 1980; les violentes luttes des sidérurgistes français en 79 ou celles des dockers de Rotterdam la mène année; "l'hiver de mécontentement", 1979-80 en Grande-Bretagne qui aboutit à la grande grève des sidérurgistes et à la chute du gouvernement travailliste; les grèves de Togliattigrad en URSS en 1980 comme celles de Corée du Sud au même moment... Tous ces combats confirment que l'accalmie sociale du milieu des années 70 n'avait été que provisoire. Puis, en août 1980, en Pologne éclatait la plus importante lutte ouvrière depuis les années 20. Tirant les leçons des expériences de 1970 et 76, la classe ouvrière déploie un degré de combativité, d'organisation et de maîtrise de sa force, extraordinaires. Hais sa dynamique va échouer sur deux écueils meurtriers: les illusions des travailleurs des pays de l'Est sur la "démocratie occidentale" en particulier sur le syndicalisme; et deuxièmement le cadre national. Solidarnosc, le nouveau syndicat "démocratique", formé sous l'oeil attentif des forces "démocratiques" des pays occidentaux, imbibé et propagateur zélé de la plus insidieuse idéologie nationaliste, sut distiller et cultiver systématiquement ce poison. Dans les faits, l'échec de la grève de masse en Pologne qui aboutit au coup de force de Jaruzelski en décembre 1981, a posé ouvertement la question de la responsabilité du prolétariat des pays les plus centraux et disposant de la plus grande expérience historique: non seulement au niveau de l'internationalisation de la lutte ouvrière, mais aussi au niveau de sa contribution pour le dépassement des illusions sur les "démocraties occidentales" qui pèsent encore sur le prolétariat des pays de l'est.
Après la période de reflux qui au niveau international accompagne la lutte ouvrière à la fin du mouvement en Pologne, une troisième vague de combats commence à la fin 1983 avec la grève du secteur public en Belgique. En Allemagne occidentale, à Hambourg c'est l'occupation des chantiers navals. En 1984 l'Italie connaît une puissante vague de grèves contre l'élimination de l'échelle mobile qui aboutit à une manifestation de près d'un million de travailleurs à Rome. En Grande-Bretagne c'est la grande grève des mineurs qui dura un an et qui, malgré le caractère exemplaire de son courage et de sa combativité, mit en évidence, plus que tout autre, l'inefficacité à notre époque des grèves longues et isolées. Cette même année des luttes importantes se déroulent en Inde, aux USA, en Tunisie et au Maroc. En 1985 c'est la grève massive au Danemark; plusieurs vagues de grèves sauvages secouent cet autre "paradis socialiste" qu'est la Suède; les premières grandes grèves au Japon (chemins de fer), les grèves de la banlieue de Sao Paolo au Brésil en pleine transition "démocratique"; l'Argentine, la Bolivie, l'Afrique du Sud, la Grèce, la Yougoslavie connaissent aussi des luttes importantes. L'année 1986 est marquée par la grève massive du printemps en Belgique qui paralyse le pays en s'étendant par elle-même malgré les syndicats. Fin 1986, début 87 les travailleurs des chemins de fer en France développent une lutte caractérisée par les tentatives des ouvriers de s'organiser indépendamment des syndicats. Au printemps 87, 1’Espagne connaît une série de grèves qui s'opposent directement aux plans du gouvernement socialiste. Puis ce sont les luttes des mineurs d'Afrique du Sud, celles des travailleurs de l'électricité au Mexique et une grande vague de grèves en Corée du Sud. L'année restera marquée par les luttes des travailleurs de l'école en Italie qui parviennent à organiser leur combat en dehors et contre les syndicats. Enfin, la récente mobilisation des travailleurs de la Ruhr en Allemagne et la reprise des grèves en Grande-Bretagne en 1988 (voir l'éditorial de ce numéro) confirment que cette troisième vague internationale de luttes ouvrières, qui dure depuis maintenant plus de 4 ans est loin d'être terminée et ouvre des perspectives d'autant plus importantes que le capital mondial connaît une nouvelle aggravation de sa crise économique.
Ce que le prolétariat a appris de ses luttes
La simple comparaison des caractéristiques des luttes d'il y a 20 ans avec celles d'aujourd'hui permet de percevoir rapidement l'ampleur de l'évolution qui s'est lentement réalisée dans la classe ouvrière. Sa propre expérience, ajoutée à l'évolution catastrophique du système capitaliste, lui a permis d'acquérir une vision beaucoup plus lucide de la réalité de son combat. Cela s'est traduit par ;
- une perte des illusions sur les forces politiques de la gauche du capital et en premier lieu sur les syndicats à l'égard desquels les illusions ont laissé la place à la méfiance et de plus en plus à l'hostilité ouverte;
- l'abandon de plus en plus marqué de formes de mobilisation inefficaces, impasses dans lesquelles les syndicats ont tant de fois fourvoyé la combativité ouvrière:
- journées d'action, manifestations-ballades-enterrements,
- les grèves longues et isolées...
Mais l'expérience de ces 20 années de lutte n'a pas dégagé pour la classe ouvrière que des enseignements "en négatif" (ce qu'il ne faut pas faire). Elle s'est aussi traduite par des enseignements sur comment faire:
- la recherche de l'extension de la lutte (Belgique 1986 en particulier),
- la recherche de la prise en main des combats, en s'organisant par assemblées et comités de grève élus et révocables; (France fin 86, Italie 1987 principalement).
De façon générale, les ouvriers ont moins recours à la forme de lutte de la grève: quand le combat s'engage il tend à être massif et "la rue", l'action politique, prend de plus en plus d'importance. C'est la réponse à des attaques qui sont de plus en plus massives et font éclater de plus en plus crûment l'incompatibilité totale entre les intérêts ouvriers et ceux de l'ordre social existant.
Au cours de ces 20 années, lentement, de façon toujours heurtée, le prolétariat mondial a développé sa conscience en perdant ces illusions et gagnant en expérience et détermination.
Ce que la bourgeoisie a appris
La bourgeoisie mondiale a aussi beaucoup appris de ces années. Le problème du maintien de l'ordre social est devenu une priorité. Elle a développé tous les moyens de répression: tous les gouvernements du monde ont, dans les 20 dernières années, créé ou renforcé leurs polices "anti-émeutes", inventé de nouvelles armes pour "guerres civiles", développé leurs polices politiques... Nombre d'entre eux ont utilisé le désespoir de petits bourgeois déçus et se suicidant dans le terrorisme pour renforcer un climat de répression. Dans les usines, le chantage au chômage est systématiquement utilisé comme moyen de répression.
Mais ce qu'a le plus appris la bourgeoisie c'est à utiliser les forces politiques et syndicales qui travaillent au sein de la classe ouvrière : syndicats, partis "de gauche", organisations "gauchistes". Elle a ainsi "démocratisé" les régimes de nombreux pays, (Portugal, Espagne, Amérique Latine, Philippines, Corée du Sud...) non pas pour alléger le poids de sa dictature mais pour créer des organes syndicaux et politiques capables de compléter le travail que l'armée et la police ne pouvaient plus faire seules. Dans les pays à plus vieille tradition "démocratique", face à l'usure des syndicats officiels et des partis de gauche, elle a recours au "syndicalisme de base" ou à ses forces "extra-parlementaires" pour ramener les luttes sur le terrain syndical et "démocratique".
Nous sommes loin de 1'"effet de surprise" créé par les luttes ouvrières de la fin des années 60. Mais ce "réarmement" de la bourgeoisie ne traduit en fait que la nécessité de recourir à des moyens de plus en plus extrêmes pour faire face à une situation qui devient de plus en plus difficile à contrôler. Derrière ce "renforcement" se dessine l'effondrement des hases réelles de son pouvoir.
VERS DES AFFRONTEMENTS DIFFICILES ET DECISIFS
Pour l'impatiente petite bourgeoisie des années 60 tout cela est trop long, trop difficile et ne peut conduire à rien. Tout lui semble un recul par rapport aux années 60.
Pour les marxistes l'évolution de ces années n'a fait que confirmer la vision, que Marx formulait déjà au XIXe siècle, de ce qu'est la lutte de la seule classe de l'histoire qui soit à la fois EXPLOITEE ET REVOLUTIONNAIRE.
Contrairement au combat révolutionnaire de la bourgeoisie contre la féodalité, où chaque victoire se traduisait par un développement de son pouvoir politique réel sur la société aux dépens de celui de la noblesse, le combat révolutionnaire du prolétariat ne connait pas d'acquis progressifs et cumulatifs au niveau du pouvoir. Tant que le prolétariat n'est pas parvenu à la victoire politique finale, la Révolution, il reste classe exploitée, dépossédée, réprimée. C'est pourquoi ses luttes apparaissent comme un éternel recommencement.
"Les révolutions prolétariennes, par contre, comme celles du XIXe siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n'abattre leur adversaire que pour mieux lui permettre de puiser de nouvelles forces dans la terre et se redresser à nouveau formidable en face d'elles, reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soit crée la situation gui rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles-mêmes crient: 'Hic Rhodus, hic salta"'.([2] [7]) Marx, Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte.
On parle peut être moins facilement de révolution en 1988 qu'en 1968. Mais lorsqu' aujourd'hui le mot est crie dans une manifestation qui dénonce la nature bourgeoise des syndicats à Rome ou dans une manifestation de chômeurs à Bilbao il a un sens autrement plus concret et profond que dans les assemblées enfiévrées et pleines de fausses illusions de 1968.
1968 avait affirmé le retour de l'objectif révolutionnaire. Pendant 20 années les conditions de sa réalisation n'ont cessé de mûrir. L'enfoncement du capitalisme dans sa propre impasse, la situation de plus en plus insupportable que cela crée pour l'ensemble des classes exploitées, l'expérience cumulée par la combativité ouvrière, tout cela conduit à cette situation dont parlait Marx, gui rend "tout retour en arrière impossible".
RV.
[1] [8] Pour une histoire et analyse révolutionnaires des événements de Mai 68 voir Pierre Hempel, "Mai 68 et la question de la révolution".
[2] [9] Référence à une légende grecque: un vantard qui parcourait les villes de la Méditerranée en affirmant qu'il était capable de sauter par-dessus la statue du colosse de Rhodes, se trouva un jour dans cette ville. Il lui fut alors crié: "Voici Rhodes, c'est ici que tu dois sauter!".
Géographique:
- France [10]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [11]
Approfondir:
- Mai 1968 [12]
Heritage de la Gauche Communiste:
Vingt ans depuis mai 1968 : le capitalisme dans le tourbillon de la crise
- 3055 reads
"L'année 67 nous a laissé la chute de la livre Sterling et 68 nous apporte les mesures de Johnson (...) voici que se dévoile la décomposition du système capitaliste, qui, durant quelques années, était restée cachée derrière l'ivresse du "progrès" gui avait succédé à la seconde guerre mondiale." ("Internacionalismo", Venezuela, janvier 1968)
Il y a vingt ans nous devions convaincre de l'existence de cette crise, aujourd'hui nous en sommes à l'expliquer et à en montrer les implications historiques.
"C'est en 1967 que les premiers symptômes se font sentir de façon certaine : la croissance annuelle de la production Mondiale tombe à son niveau le plus bas depuis 10 ans. Dans les pays de l'OCDE, le chômage et l'inflation connaissent des accélérations faibles, mais certaines. La croissance des investissements ralentit sans discontinuité de 65 à 67. En 1967, il y a officiellement 7 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE et le PUB croit de 3,51. Ce sont des chiffres qui aujourd'hui semblent bien négligeables comparés au niveau atteint par la crise actuellement, mais ils n'en marquaient pas moins la fin de la "prospérité" d'après-guerre (...). La deuxième récession dont le fond est touché en 1970 est beaucoup plus forte que celle de 67. Dans les pays de l'OCDE, elle est plus profonde, et dans l'ensemble du monde, elle est plus longue. Elle vient confirmer que la récession de 61 n'avait pas été un accident "allemand" mais l'annonce certaine d'une nouvelle période d'instabilité économique." (cf. notre brochure "La décadence du capitalisme", p. 4)
Il aura fallu vingt ans, une génération, pour que ce qui n'était que les premières manifestations d'une crise ouverte après la période de reconstruction consécutive à la seconde guerre mondiale apparaisse ouvertement comme l'expression d'une crise générale et insurmontable d'un mode de production aiguillonné par la course au profit, la soif jamais assouvie de marchés et fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme.
Que ce soit dans les pays dits "communistes", dans les pays de l'Est ou encore en Chine, dans les pays dits "développés" ou ceux hier désignés par l'appellation "en développement", d'un point de vue mondial et historique, le bilan de ces vingt années de crise est catastrophique et la perspective s'annonce encore plus catastrophique.
Catastrophique en absolu déjà. Par la misère qui sur toute la planète est devenue le lot quotidien de l'immense majorité de la population mondiale. Situation où l'avenir n'est pas indiqué par un développement des pays peu ou pas industrialisés rejoignant les pays développés, mais au contraire par un développement des caractéristiques du sous-développement au coeur même des métropoles industrielles, ce que les sociologues appellent le "quart monde".
Catastrophique relativement encore quand on considère l'immense gâchis comparé aux possibilités réelles en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques et de toutes les richesses matérielles produites par le travail; toutes choses qui pourraient être le puissant levier d'une émancipation de l'humanité mais qui dans le carcan de la crise mondiale sont systématiquement orientées et transformées en forces de destructions.
L'évidence de cette crise d'une profondeur et d'une gravité extrême s'impose d'autant plus fortement que toutes les politiques économiques pour y faire face ont depuis vingt ans été, sans exception aucune, des échecs cuisants et que les perspectives de sortir de l'ornière où, à l'Est comme à l'Ouest, l'économie mondiale s'enfonce chaque jour plus, apparaissent aujourd'hui comme totalement illusoires.
De fait les questions que soulève cette crise sont des questions de fond qui touchent le coeur même de l'organisation sociale, de sa structure, des rapports qui s'y nouent et conditionnent l'avenir de la société mondiale.
A la veille d'une nouvelle et puissante récession mondiale inéluctable, cette rétrospective de vingt années de crise ne peut que prendre en compte le rappel des illusions et des mythes qui pendant des années, à tel ou tel moment, furent distillés par les voies officielles du pouvoir ou de la contestation de gauche.
CE QUI A ETE DIT A PROPOS DE LA CRISE
Ces vingt dernières années, au rythme d'une crise jamais surmontée, progressant par à-coups, sont en même temps l'histoire de l'effondrement des illusions qui ont marqué son parcours. Durant toutes ces années tout ou presque tout a été invoqué pour conjurer le démon.
LA "CRISE DU PETROLE" ET LA CRISE DE SURPRODUCTION
Dans la première moitié des années 70, la "crise du pétrole", "la crise énergétique", et la "pénurie" de matières premières en général furent rendues responsables de la récession de 74 et de la crise financière jamais surmontée.
A en croire les experts et les dirigeants mondiaux de tous bords la "pénurie" des sources énergétiques "qui provoquait une augmentation de leur prix" était responsable des soubresauts économiques. L'économie mondiale était en quelque sorte victime d'un problème "naturel", indépendant et extérieur à sa nature profonde.
Pourtant quelques années après, dès 78-79, alors que les soubresauts de l'économie mondiale furent devenus convulsions, nous étions amenés à constater non pas une pénurie des sources énergétiques accompagnée d'une augmentation de leurs prix, mais une surproduction générale de celles-ci et en particulier du pétrole, et conséquemment une chute de leur cours.
L'aspect flagrant de la nature de cette crise s'exprime caricaturalement dans les secteurs de la production des matières premières et en particulier dans l'agriculture: une crise manifeste de surproduction qui engendre la pénurie. C'est ainsi qu'alors que toutes les nations se livrent la guerre agricole la plus acharnée qui ait jamais existé nous sommes amenés à constater un développement ahurissant des famines et de la sous-nutrition dans le monde. C'est ainsi que:
"La production agricole mondiale est suffisante pour assurer à chaque individu plus de 3.000 calories par jour, soit 500 de plus que ce qu'il est nécessaire à la bonne santé d'un adulte moyen et, de 1969 à 1983, la croissance de la production agricole (40 %) a été plus rapide que celle de la production mondiale (35%)."
("L'insécurité alimentaire dans le monde", octobre 87, p. 4)
Ce qui n'empêche que, comme nous l'apprend an dernier rapport de la Banque mondiale, l'insécurité alimentaire concerne 700 millions de personnes et qu'il ne s'agit en aucune façon d'une question de capacité productive puisque:
"La faim persiste même dans les pays qui ont atteint l'autarcie alimentaire. Dans ces pays les famines touchent simplement ceux qui n'ont pas de revenus suffisants pour accéder au marché." (Banque mondiale: "Rapport sur la pauvreté et la faim" -1987)
D'autre part, les bourgeoisies occidentales se sont à l'époque beaucoup plaintes de cette augmentation des coûts dans l'approvisionnement en matières premières et sources énergétiques qui les "étranglait". Par contre, il n'est jamais fait référence au sort de ces masses de dollars qui à l'époque passèrent dans les mains des pays producteurs de matières premières. En fait, ces dollars se retrouvèrent vite dans les poches de ceux qui les avaient déboursés, car ils développaient la capacité d'importation des pays producteurs de matières premières. Mieux encore, ce qui fut acheté en majorité par les pays producteurs de matières premières dans les années 70, ce ne fut pas des moyens de consommation, ou des moyens de production, mais des armes.
"Entre 1977 et 1985, le tiers monde a acheté pour 286 milliards de dollars d'armement, ce qui équivaut à 30% de la dette que les pays du Sud avaient accumulée durant la même période (...). Le Proche-Orient a absorbé près de la moitié des exportations (...). Le marché a connu, entre 1910 et 1911, une expansion moyenne de 13%."
("Le Monde diplomatique", mars 88: "le grand bazar aux canons dans le tiers monde", p. 9)
Ravagé par la guerre et la crise, l'état de barbarie avancé dans lequel se trouve aujourd'hui le Moyen-Orient est une illustration parfaite des rapports étroits qu'entretiennent crise et guerre, et l'histoire de ces dernières années nous montre ici clairement comment la crise de surproduction se transforme en destruction pure et simple.
Il y a dans tout mensonge une part de vérité, dans toute illusion ou mythe une part de réalité; sinon aucun d'entre eux ne saurait trouver d'écho dans le cerveau des vivants. Il en est ainsi des "explications" de la crise qui ont jalonné ces vingt dernières années.
Tout d'abord, "la crise du pétrole" pouvait présenter une apparence de réalité. En effet l'augmentation brutale des coûts dans l'approvisionnement en sources énergétiques dont le relatif bon marché jusqu'alors avait conditionné la période de reconstruction représenta à partir de 1974 un coup dur pour les économies européennes. Contrairement aux prix de l'investissement en matériel dont les coûts se répercutent sur une longue période, l'amortissement, le prix des matières premières lui se répercute immédiatement dans le prix total des marchandises produites. De ce fait, les conséquences de l'augmentation des ressources énergétiques et des matières premières furent immédiates: affaiblissement face à la concurrence internationale et baisse des taux de profit.
Contrairement à ce qui en a été dit, ces augmentations n'avaient pas pour cause une pénurie naturelle des matières premières, les seules "pénuries" qui sévirent à cette époque ne furent que des "pénuries" organisées pour spéculer sur une anticipation à la hausse.
La brutale augmentation des coûts des ressources énergétiques et des matières premières en général avait par contre pour raison véritable la baisse brutale du dollar depuis 1971. Dans la mesure où tous les achats étaient libellés en dollars, les pays producteurs en augmentant le prix du pétrole ne faisaient que répercuter la baisse de la valeur du dollar.
Nous touchons ici du doigt le fond de la question. La chute du dollar, résultat direct de la décision des autorités américaines prise en 1973 de laisser flotter le dollar en vue de rendre l'économie américaine plus compétitive, venait consacrer l'effondrement des accords de Brettons Wood signés en juillet 1944.
"Ces accords étaient destinés i reconstruire, une fois la paix rétablie, le système monétaire international, disloqué depuis le début des années 30...Il s'agissait précisément d'éviter au monde le retour à l'expérience désastreuse des dévaluations "compétitives" et des "changes flottants" qu'il avait connue entre les deux guerres" ("Bilan économique et social 87" - Le Monde - page 41)
De fait, la baisse "compétitive" du dollar signifiait un retour aux conditions économiques de crise d'avant guerre.
L'économie mondiale dans une nouvelle période de crise économique aiguë se retrouvait face aux mêmes problèmes qui avaient précipité la seconde guerre mondiale, mais cette fois, multipliés par cent.
Prélude à cette situation, en 1967: l'apparition du déficit commercial américain.
En lui-même, ce déficit, mineur comparé au gouffre actuel (voir courbe du déficit USA), marquait la fin de la période de reconstruction. Il signifiait que les économies européennes et asiatiques désormais reconstruites ne constituaient plus un marché et que de plus elles s'inséraient dans la concurrence mondiale face à un marché réduit d'autant. Depuis tout ce qui a été fait en matière d'économie politique n'a eu pour raison d'être que la volonté de compenser l'effondrement des possibilités économiques que représentait la période de reconstruction.
La période qui s'étend de 1967 à 1981 n'est pas autre chose du point de vue économique que l'histoire de l'emploi massif et redoublé des recettes keynésiennes de soutien artificiel de l'économie. Rappelons rapidement en quoi consistent ces recettes keynésiennes:
"Le fondement de l'apport de Keynes à l'économie politique bourgeoise peut se résumer au fait d'avoir accepté de reconnaître, en plein marasme de la crise de 1929, l'ineptie de ce principe religieux de la science économique bourgeoise, inventé par l'économiste français Jean-Baptiste Say au 19ème siècle, suivant lequel le capitalisme ne peut pas connaître de véritable crise de marchés puisque "toute production est en même temps une demande". La solution keynésienne consisterait à créer une demande artificielle par l'Etat. Si le capital ne parvient pas à créer une demande nationale suffisante pour absorber la production, et si en outre, les marchés internationaux sont saturés, Keynes préconise que l'Etat se fasse acheteur des masses de produits qu'il paiera avec de la monnaie de singe émise par lui. Comme tout le monde a besoin de cet argent, personne ne protestera sur le fait qu'il ne représente que du papier." (Voir notre brochure "La décadence du capitalisme", P. 15)
Durant cette période:
"Les USA sont devenus la locomotive de l'économie mondiale en créant un marché artificiel pour le reste de leur bloc au moyen d'énormes déficits commerciaux. Entre 1976 et 1980, les USA ont acheté des marchandises à l'étranger pour 100 milliards de dollars, plus qu'ils n'en ont vendu. Seuls les USA -parce que le dollar est la monnaie de référence et de réserve mondiale- pouvaient mettre en oeuvre une telle politique sans qu'il soit nécessaire de dévaluer massivement leur monnaie. Ensuite, les USA ont inondé le monde de dollars sous forme de prêts aux pays sous-développés et au bloc russe. Cette masse de papier-monnaie a temporairement créé une demande effective qui a permis au commerce mondial de continuer". (Revue Internationale n° 26, p.4)
Nous pouvons ici citer encore en exemple pour cette période d'illusion, la RFA:
"L'Allemagne s'est mise à jouer à la "locomotive", cédant à la pression, il faut le reconnaître des autres pays (...) L'augmentation des dépenses publiques a en gros doublé, croissant de 1,7 fois la croissance du produit national. A tel point que la moitié de celui-ci est dorénavant canalisé par les services publics. Ainsi la croissance de l'endettement public a-t-elle été explosive. Stable autour de 18i du PNB au début des années 70, cet endettement est passé brusquement à 251 en 1975, puis à 351 en 81. Elle atteint un niveau inconnu depuis les années de banqueroute de 1'entre-deux-guerres.
Les Allemands qui n'ont pas la mémoire courte voient ressurgir le spectre des brouettes remplies de billets de la république de Weimar/" (cité dans la Revue Internationale n° 31 en 1982, p.22)
C'est la crise du dollar et la menace d'une faillite financière générale qui en 79 vont donner le signal d'un changement de politique économique mondiale sous le couvert de l'idéologie libérale de la "déréglementation" qui aboutira en 82 à la plus forte récession économique qu'ait connue le monde depuis les années qui précédèrent la seconde guerre mondiale.
LA "REVOLUTION LIBERALE"
Toutes les explications tant exploitées des causes "naturelles" de la crise mondiale dans les années 70 n'expliquaient rien du tout. On les oublia vite et on n'en entendit plus parler. La crise mondiale elle, inexorablement se développait, gagnait en profondeur et étendue, touchant au coeur même des métropoles industrielles. Il fallait l'expliquer; au moins trouver une caution idéologique aux "thérapies" douloureuses que l'on commença dès 1979 à administrer aux populations laborieuses. Le chômage allait passer brutalement du simple au double, les salaires étaient bloqués, dans les entreprises, les usines, les bureaux, la mentalité garde-chiourme était à l'honneur. Partout l'on demandait aux ouvriers et employés de se transformer en soldats de "l'Entreprise", de la "Nation" pour une guerre économique où ils avaient tout à perdre et rien à gagner. Et où en effet ils perdirent beaucoup.
Quel soulagement quand les causes de la maladie pernicieuse qui rongeait d'un mal secret l'économie mondiale furent mises à jour et le mystère enfin révélé.
La "société" souffrait de trop de "dirigisme". Mollement, elle se mourait dans ses "habitudes d'assistanat", qui accompagnèrent ce qui à l'occasion fut appelé "les trente glorieuses", c'est-à-dire toute la période après-guerre des reconstructions (1945-75) (sic). Ce "trop d'Etat" avait fini par briser les ressorts productifs, par casser "la soif d'entreprendre" et créer de lourds déficits dans les caisses des Etats, déficits qui grevaient d'autant le potentiel productif.
Au fond des choses, si "fond" dans de telles conceptions simplistes il y a, cet "interventionnisme" de l'Etat empêchait les "lois naturelles" de l'économie mondiale de jouer et d'assurer leur rôle "d'autorégulation". D'un seul coup les économistes avaient mis le doigt sur les causes de la crise et leur joie était d'autant plus profonde que ces révélations indiquaient du même coup les solutions et remèdes à y apporter. L'euphorie fut d'autant plus grande, le soulagement d'autant plus intense que ces remèdes qui furent administrés à haute dose aux populations laborieuses du monde entier durant la première moitié des années 80 avaient un goût qui n'était pas pour déplaire à la bourgeoisie mondiale: licencier, réduire les salaires, casser les assurances sociales de toutes sortes, montrer du doigt et mettre au pilori le "fonctionnaire" et autres employés d'Etat, enfin étrangler et laisser crever de tiers monde.
Mais tout comme la prétendue pénurie des matières premières et des sources énergétiques qui se révéla être en fait surproduction, ce "moins d'Etat" apparut rapidement comme un plus d'Etat. Ne serait-ce que par son intervention dans tous les aspects de la vie sociale, à commencer par la répression de toutes les manifestations de révolte que cette politique provoqua. Ou encore pour orienter une part croissante de l'effort productif, technologique et scientifique vers la production d'armement et l'investissement productif vers la bourse.
Pourtant en 84-85, le mythe d'une reprise économique aux USA a fait grand bruit. Les recettes reaganiennes semblaient avoir un impact salutaire sur la santé économique. Tous les indices cités, inflation, production, emploi reprenaient de la santé. Dans le monde entier, les financiers, les industriels, les hommes d'Etat, étaient éblouis par cette "révolution" et tout le monde dorénavant voulait faire du "libéralisme", y compris en ... URSS et en Chine. L'aventure échoua comme on le sait dans le spectaculaire effondrement boursier d'octobre 87, la menace d'une récession majeure et un renouveau de l'inflation.
Les déficits budgétaires et commerciaux loin de se dégonfler avaient atteint en quelques années des sommets vertigineux, en particulier sur le sol où cette idéologie avait trouvé à la fois un tremplin et un terrain de prédilection: les USA. C'est le bilan que nous tirions dès 1986:
"La croissance américaine s'est faite a crédit. En cinq ans, les USA, qui étaient le principal créditeur de la planète, sont devenus le principal débiteur, le pays le plus endetté du monde. La dette cumulée des USA, interne et externe, atteint aujourd'hui la somme pharamineuse de 8.000 milliards de dollars, alors qu'elle n'était que de 4.600 milliards de dollars en 1980, et 1600 en 1970. C'est-à-dire que pour parvenir à jouer son rôle de locomotive, en l'espace de cinq ans, le capital américain s'est endetté autant que durant les dix années qui ont précédé." (Revue Internationale n°48)
La production industrielle, elle, au lieu de prendre un nouvel essor ne fut jamais aussi poussive ou finit par franchement reculer aux USA encore. Cette "soif d'entreprendre", de "créer" qui libérée de ses contraintes, devait se trouver des ailes et prendre un nouvel essor, après avoir fui de façon massive la sphère industrielle, ne trouva d'autre refuge que la spéculation financière et boursière, seule activité fiévreuse du capital ces dernières années et qui a connu la fin lamentable que l'on sait.
Cela vaut pour toutes les grandes puissances industrielles et particulièrement pour la plus puissante, les USA. On a cité la baisse du chômage comme un des principaux acquis de cette "révolution libérale" aux USA, alors qu'un million d'emplois était définitivement perdu dans les secteurs industriels, que plus de 30 millions de personnes se trouvaient dorénavant dans des conditions d'existence en dessous du "seuil de pauvreté", et que les seuls emplois créés étaient des emplois à temps partiel dans le secteur des services :
"Alors que, dans les années 70, un emploi supplémentaire sur cinq était rémunéré moins de 7.000 dollars par an, cela a été le cas pour 6 emplois nouveaux sur dix i partir de 1979. (...) Entre 1979 et 1984, le nombre de travailleurs qui touchaient un salaire égal ou supérieur au salaire moyen a diminué de 1,8 million... Le nombre de travailleurs qui gagnaient moins a augmenté de 9,9 millions". ("Le Monde", "Dossiers et Documents, bilan économique et social", 1987).
Quant aux nations dites du "tiers monde" qui auraient dû trouver un stimulant dans la libération des "lois naturelles" du marché et de la concurrence, elles ont dans les dernières années touchées le fond du gouffre. Loin d'être "libérées" de la tutelle hégémonique des grandes puissances industrielles, elles ne furent jamais aussi dépendantes, écrasées par le poids d'une dette et de ses intérêts qui doublaient en même temps que la valeur monétaire du dollar alors que les exportations de matières premières, leur principale source de revenus, que l'appareil productif mondial n'absorbait plus, s'effondraient. Le Mexique, pour ne citer que cet exemple, en novembre 87 dévaluait le peso de 50%.
Comme dans la question de la crise du pétrole, il y a dans la "critique libérale" du "trop d'Etat" une part de vérité. Ce qu'il y a de juste ne concerne pas l'analyse, loin s'en faut, encore moins les solutions, mais un certain constat: de soutien essentiel à une activité économique dont les forces internes poussaient à l'éclatement, l'intervention de l'Etat dans tous les domaines de la vie économique et sociale a précipité la crise de surproduction qu'il avait pour tâche de contenir.
Au début des années 80, nous analysions ce changement de situation en soulignant ses caractéristiques essentielles qui ne concernaient pas uniquement un développement quantitatif de la crise économique, mais aussi un développement qualitatif des conditions historiques de son développement. Au sein de ces caractéristiques nous distinguions comme aspect essentiel que contrairement aux années de crise d'avant-guerre où les mesures keynésiennes de "New deal" furent prises après le plus fort de la crise, ce style de mesures pour le soutien artificiel de l'économie n'est pas devant mais irrémédiablement derrière nous alors que le plus fort de la crise lui, est devant nous.
Le déroulement des faits ou plutôt méfaits économiques depuis le début des années 80 est largement venu conforter ce constat. Plus encore, la concentration accélérée des activités des différents Etats sur les domaines militaires, production d'armements, stratégie mondiale, intervention et présence militaires accentuées alors que la disparition des "aspects sociaux" de cette intervention ne servait plus de masque et ne pouvait plus faire illusion, est venu souligner la gravité de la situation historique actuelle.
LA "REVOLUTION" TECHNOLOGIQUE »
Notre bref, trop bref, rappel de ce qui a tenu lieu d'analyse de la crise durant ces vingt dernières années ne serait pas complet si l'on ne mentionnait pas ici la fameuse "troisième révolution industrielle". A cheval entre deux époques, entre deux phases historiques de développement, les "soubresauts" économiques n'étaient finalement pas autre chose que la crise obligée et nécessaire du passage d'une époque à une autre. Que n'a t’on pas dit et imposé au nom de cette fameuse "révolution technologique", à commencer par les licenciements. Le premier intérêt de cette "analyse" historique était tout entier contenu dans l'idée que la crise du capitalisme que personne ne pouvait plus nier, ce qui était ennuyeux en soi, n'était somme toute qu'une crise de croissance. Au-delà de cette mauvaise passe l'avenir était radieux. A condition, bien sûr, de se soumettre aux impératifs douloureux, mais nécessaires de l'accouchement présent. Dans la continuité, cette analyse "révolutionnaire" offrait l'avantage de présenter comme "rétrograde", voire "réactionnaire", toute révolte contre les mesures qui allaient contre cette "révolution" (licenciements, restructuration, etc.) Malheureusement pour les idéologues qui furent les défenseurs de ces thèses, il advint de l'explication de la crise par la "troisième révolution industrielle" dont aujourd'hui plus personne ne parle, la même mésaventure que pour la "crise du pétrole" ou encore la "révolution libérale" entre lesquelles elle se situa: elle s'effondra face à la réalité des faits qui décidément sont têtus.
Au-delà des involutions industrielles et sociales qui ont marqué cette époque alors que toutes les "révolutions industrielles" ont toujours suscité et accompagné des bonds en avant de la production, il est ici nécessaire de souligner que toutes les avancées techniques, scientifiques et technologiques des deux dernières décennies ont eu pour aiguillon et application le domaine militaire de la production d'armement, les retombées civiles, elles, restant extrêmement limitées.
"Le monde consacre à des fins militaires une somme de ressources supérieures i ce qu'était la production mondiale de 1900 (...). De plus, le domaine militaire absorbe les deux tiers de la défense mondiale en matière de recherche et de développement." ("Armement et désarmement à l'âge nucléaire", "La documentation française" n° 4456, p. 13)
POUR EN FINIR AVEC LES MYTHES ET ILLUSIONS SUR LA CRISE
Toute la difficulté à comprendre la crise économique tient à sa nature. C'est en effet la première fois dans son histoire que l'humanité est amenée à subir une crise de surproduction générale. Alors que toutes les crises des modes de production qui nous ont précédés, esclavagisme, féodalisme, s'exprimaient dans de larges crises de sous-production, il en va tout autrement pour le capitalisme, ce qu'exprime K. Marx dans le "Manifeste Communiste:
"Dans ces crises, une grande partie, non seulement des produits déjà créés, mis encore des forces productives existantes est livrée à la destruction. Une épidémie éclate qui, à toute époque, eût semblé absurde: l'épidémie de la surproduction."
Et encore K. Marx n'a de son vivant assisté qu'à des crises de surproduction limitées dans le temps et dans l'espace. Limitées à des secteurs particuliers et précédées par de longues et larges périodes d'expansion du capitalisme à travers le monde.
Non seulement cette caractéristique de crise de surproduction la rend de prime abord incompréhensible par l'absurdité qu'elle représente, mais de plus, le fait que la crise économique soit une crise de surproduction a permis pendant des années toutes les manipulations pour en repousser les échéances. Face à une crise de sous-production, il n'y a pas d'alternative: quand il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. La crise de surproduction, surproduction qui est une surproduction relative, non en fonction des besoins humains mais de la capacité d'absorption du marché mondial, elle, peut être repoussée, masquée par toute une série de manipulations financières, commerciales et l'histoire économique récente n'est pas autre chose que l'histoire de ces manipulations. Mais ces manipulations dans lesquelles sont passés maîtres les Etats modernes ne font qu'alimenter la surproduction et finalement exacerber la crise. Fatalement il arrive un moment où elle doit être résorbée parce que sous son poids c'est toute la structure sociale qui menace d'effondrement.
Notre époque n'est pas autre chose qu'une telle situation d'échéance et de solde. Et au-delà de ces vingt dernières années, la crise actuelle n'est que le prolongement et l'aboutissement de toute une période historique qui commence dès le début de notre siècle avec la première guerre mondiale. Période où:
"Entre 1914 et 1980, on compte 10 années de guerre généralisée (sans compter les guerres locales permanentes), 39 années de dépression (1918-22, 1929-39, 1945-50, 1967-87), soit au total 49 années de guerre et de crise, contre seulement 24 années de reconstruction (1922-29 et 1950-67). Et le cycle de la crise n’est pas encore terminé !..."(Revue Internationale, n°48)
Résorbée, la surproduction mondiale ne peut l'être de mille manières. Soit elle est résorbée par une immense destruction, c'est le cas des guerres, soit par une transformation radicale des rapports sociaux et mondiaux de production où les buts, les moyens, les conditions de l'activité productrice seront enfin libérés des carcans du marché, du profit, de l'exploitation et de la division du travail entre travail manuel et travail intellectuel.
Y a t-il plus grande ineptie face à la crise économique mondiale et à son stade avancé que les injonctions de toutes les bourgeoisies nationales à vouloir transformer la population laborieuse en soldats de l'économie, à vouloir les faire s'affronter dans une guerre économique où ce sont des générations entières qui sont sacrifiées et qui en fin de compte -la triste expérience de deux guerres mondiales nous le prouve- ne peut qu'aboutir à la guerre tout court.
Prénat
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [11]
Récent et en cours:
- Crise économique [14]
Vingt ans depuis mai1968 : évolution du milieu prolétarien (1° partie) (1968-1977)
- 3396 reads
Mai 1968: 10 millions de travailleurs en grève en France sont l'annonce du retour significatif du prolétariat sur la scène de l'histoire et ouvrent une vague de luttes qui va prendre une dimension internationale et qui jusqu'au milieu des années 1970 va manifester ses effets dans presque tous les pays de la planète.
Jamais depuis des décennies, depuis l'échec de la vague révolutionnaire commencée en 1917 et gui s'épuise à la fin des années 1920, la lutte de classe n'avait déployé une telle force, pris une telle ampleur. Après quarante longues années de contre-révolution où le triomphe de la bourgeoisie s'était exprimé par une domination idéologique sans précédent dans l'histoire, où la théorisation de l'intégration du prolétariat, de son embourgeoisement, de sa disparition comme classe révolutionnaire animait la réflexion d'intellectuels en mal de nouveautés, où le socialisme était identifié aux sombres dictatures staliniennes et à leurs caricatures "tiers-mondistes", où les jungles d'Amérique du sud et d'Indochine étaient présentées corne le centre de la révolution mondiale, le réveil du prolétariat vient remettre les pendules de l'humanité a l'heure. Un verrou vient de sauter, celui de la contre-révolution: une nouvelle période historique s'ouvre.
La lutte ouvrière renaissante va polariser le mécontentement qui s'accumule depuis des années bien au-delà du prolétariat dans de nombreuses couches de la société. La guerre du Vietnam qui s'éternise et s'intensifie, les premières attaques de la crise gui marque son retour au milieu des année 1960 après la période d'euphorie de la reconstruction d'après-guerre vont provoquer un profond malaise au sein d'une jeunesse élevée dans l'illusion d'un capitalisme triomphant, sans crise, et les promesses d'un avenir radieux. La révolte des étudiants sur tous les campus du monde va servir à la propagande bourgeoise pour masquer la reprise de la lutte de classe, mais aussi elle va répercuter l'écho déformé du regain de réflexion politique qui se développe au sein du prolétariat, ce qui se concrétise dans un intérêt renouvelé pour la classe ouvrière, son histoire et ses théories et donc pour le marxisme. Révolution devient un mot à la mode.
Brutalement, comme étonnée de sa propre force, une nouvelle génération de prolétaires s'affirme sur la scène historique et mondiale. Comme produit de cette dynamique, dans une ébullition juvénile mais aussi dans une grande confusion; sans expérience, sans liens avec les traditions révolutionnaires du passé, sans réelle connaissance de l'histoire de sa classe, fortement influencé par la contestation petite-bourgeoise, un nouveau milieu politique du prolétariat se forme. Une nouvelle génération de révolutionnaires est en train de naître dans l'enthousiasme et... l'inexpérience.
Bien sûr, lorsque nous traitons du milieu prolétarien, n'y sont pas incluses les organisations qui prétendent représenter le prolétariat et le défendre, nais qui ne sont en fait que les expressions destinées à le mystifier, à saboter ses luttes, de la "gauche" de l'appareil politique de contrôle de l'Etat capitaliste sur la classe ouvrière, quelles que soient les illusions qui existent dans la classe ouvrière à leur sujet. Ce sont non seulement les PC et PS depuis longtemps intégrés à tous les rouages de l'appareil d'Etat, nais aussi leurs émules maoïstes, qui ne sont qu'une excroissance tardive du stalinisme, les trotskystes dont l'abandon des principes de classe dans la IIème guerre impérialiste mondiale, dont la trahison par le soutien d'un camp impérialiste contre un autre, les a définitivement mis en dehors du camp prolétarien. Même si en 1968 et après, ces groupes dits "gauchistes" ont une influence déterminante et occupent le devant de la scène, leur histoire passée les situe radicalement en dehors du prolétariat et de son milieu politique. C'est d'ailleurs contre l'attitude politique de ces groupes de la "gauche" bourgeoise que se forme dans un premier temps la mouvance dont va surgir le renouveau du milieu prolétarien, et cela même si dans la confusion et le remue-ménage de l'époque, les idées gauchistes pèsent lourdement sur la naissance de ce nouveau milieu prolétarien.
Depuis les événements de mai 68, vingt ans se sont écoulés, 20 ans durant lesquels la crise économique a exercé ses ravages sur le marché mondial, a labouré le champ social, balayé les illusions de la reconstruction. 20 ans durant lesquels la lutte de classe a connu des flux et des reflux. 20 ans durant lesquels le milieu prolétarien a du retrouver ses racines et poursuivre la clarification nécessaire à l'efficacité de son intervention.
Durant ces 20 années, quelle a été l'évolution du milieu politique? Quel bilan tirer aujourd’hui? Quels fruits prolétariens a donnés la génération de 1968? Quelles perspectives tracer pour féconder le futur ?
LE MILIEU POLITIQUE PROLETARIEN AVANT 1968
Les groupes politiques qui avant le chambardement de la fin des années 60 ont pu résister à l'étouffement de la contre-révolution et maintenir contre vents et marées leur existence sur des positions révolutionnaires ne sont qu'une poignée, regroupant chacun une poignée d'individus. Ces groupes se définissent en fonction de leur filiation politique. Deux grands courants se distinguent essentiellement qui trouvent leur origine dans les fractions qui se sont opposées dans les années 20 à la dégénérescence politique de la Illème Internationale:
- la tradition des gauches dites "hollandaise" et "allemande" ([1] [15]) qui s est maintenue au travers de groupes politiques tel le "Spartacusbond" ([2] [16]) en Hollande ou de cercles plus ou moins formels comme celui regroupé autour de Paul Mattick aux USA, ICO en France ou Daad en Gedachte en Hollande apparus au début des années 60, sont le produit dégénéré de cette tradition du "communisme de conseils" incarnée principalement par le GIK dans les années 30, Ce courant, dans la continuité politique des théorisations d'Otto Riihle dans les années 20, puis d'Anton Pannekoek et de Canne Meier dans les années 30, se caractérise par une incompréhension profonde de l'échec de la révolution russe et de la dégénérescence de l'Internationale communiste, ce qui 1’amène à nier le caractère prolétarien de celles-ci et dans la foulée à rejeter la nécessité de l'organisation politique du prolétariat;
- la tradition de la gauche dite "italienne" exprimée dans sa continuité organisationnelle par le PCI ([3] [17]), fondé en 1945 autour d'Onorato Damen et d'Amadeo Bordiga, et qui publie Battaglia Comunista. * Les scissions dont la principale va se faire autour de Bordiga en 1952 qui va publier Programa Comunista ([4] [18]) vont donner lieu à de multiples avatars du PCI parmi lesquels on peut entre autre citer "Il Partito Comunista". Cependant, ces organisations, si elles ont pu maintenir une continuité organisationnelle avec les fractions communistes du passé ne se revendiquent paradoxalement pas du groupe qui dans les années 30 a représenté le plus haut niveau de clarté politique de cette tradition dont elles sont issues, et de ce point de vue, en rejetant ainsi les apports politiques de Bilan, expriment une continuité politique affaiblie. Cela va se traduire dans une rigidité dogmatique qui nie les nécessaires clarifications imposées par 60 ans de décadence du capitalisme, ainsi Bordiga et le PCI (Programa Comunista) vont caricaturalement se réclamer de l'invariance du Marxisme depuis...1848. Pour ces organisations, la critique insuffisante des positions erronées de la Illème Internationale va se traduire dans des positions politiques on ne peut plus floues et même souvent fausses sur des points aussi centraux que la question nationale ou la question syndicale. La juste volonté de défendre la nécessité du parti va pour ces groupes malheureusement s'exprimer dans une forme caricaturale, notamment chez Bordiga, où le parti est présenté et conçu de manière formelle comme la réponse à toutes les difficultés du prolétariat, comme la panacée universelle à laquelle les prolétaires doivent se soumettre. De ces groupes, seul le PCI (Programa Comunista) a une existence internationale, notamment en France et en Italie, alors que les autres n'existent qu'en Italie.
Dans cette tradition de la gauche "italienne" il faut inclure Internacionalismo au Venezuela, fondé en 1964 sous l'impulsion d'anciens membres de Bilan (1928-1939) ([5] [19]) et d'Internationalisme (1945-1953) ([6] [20]) qui, s'il n'exprime pas une réelle continuité organisationnelle, est par contre la plus claire expression de la continuité politique avec les acquis de Bilan et ensuite d'Internationalisme qui en a poursuivi le travail d'élaboration théorique. Cependant, si Internacionalismo se réclame explicitement des apports de Bilan et de la gauche "italienne", il a su aussi s'enrichir de manière critique, comme l'ont fait avant lui Bilan et Internationalisme, des apports des autres fractions de la gauche internationale du début du siècle et cela se concrétise dans la clarté de ses positions sur la question de la décadence du capitalisme, sur la question nationale, sur la question syndicale, comme sur celle du rôle du parti. Ce n'est certainement pas un hasard si Internacionalismo est le seul groupe à prévoir le retour historique de la lutte de classe.
Ce tableau du milieu politique avant 1968 ne serait pas complet s'il n'incluait également les groupes qui se sont formés au lendemain de la IIème guerre mondiale en réaction à la trahison de la IVème Internationale trotskyste et qui sont issus de ce courant. Il faut notamment citer le FOR ([7] [21]) qui se forme autour de Benjamin Perret et _G. Munis, et Socialisme ou Barbarie autour de Cardan-Chaulieu. Ces groupes issus d une tradition politique, le trotskisme, affaiblie par sa participation à la dégénérescence de la Illème Internationale et son abandon des principes de classe dans son soutien à la 2ème boucherie impérialiste mondiale, ont une originalité liée a leur filiation: leur incompréhension de la dégénérescence de la révolution en Russie et des fondements économiques du capitalisme d'Etat dans la période de décadence du capitalisme qui les mène à théoriser la fin des crises économiques du capitalisme et ainsi à se couper des bases d'une compréhension matérialiste, marxiste de l'évolution de la société. Socialisme ou Barbarie va explicitement renier le prolétariat et le marxisme pour développer «ne théorie fumeuse où la contradiction fondamentale de la société n'était plus celle entre capital et travail, entre bourgeoisie et prolétariat, mais dans le rapport idéologique entre dirigeants et dirigés! Niant la nature révolutionnaire du prolétariat, Socialisme ou Barbarie perd sa raison d'être comme organisation politique et disparaît au début des années 60. Pourtant l'influence pernicieuse de ses théories va lourdement peser non seulement sur les milieux intellectuels, nais aussi sur le milieu politique, notamment ICO, et sur sa marge l'Internationale situationniste. Le FOR quant à lui ne va jamais sombrer dans de telles extrémités, mais son refus de reconnaître la réalité de la crise économique affaiblit l'ensemble de ses positions politiques en les privant d'une cohérence indispensable.
LA FRAGILITE DU MILIEU QUI RENAIT APRES 1968
Les événements de la lutte de classe et notamment les grèves de mai 68 en France, le mai rampant italien en 1969, les émeutes de Pologne en 1970, par leur écho international, vont impulser une réflexion dans le prolétariat et même dans toute la société, et redonner ainsi une audience à la théorie révolutionnaire du marxisme. Portés par cette vague internationale de lutte de classe, une multitude de petits groupes, cercles ou comités vont naître dans la plus grande confusion mais à la recherche d'une cohérence révolutionnaire. De cette mouvance informelle va surgir le renouveau du milieu politique.
La confrontation concrète avec les manoeuvres de sabotage de la lutte de classe menées par ceux-là mêmes qui se prétendent les défenseurs les plus ardents des intérêts de la classe ouvrière, va être un facteur décisif de la prise de conscience brutale de la nature anti-ouvrière des syndicats et des partis de "gauche". La remise en cause de la nature prolétarienne des organisations syndicales, des partis socialistes naguère issus de la défunte Ilème Internationale, des partis communistes staliniens et de leurs émules "gauchistes" dans leurs différentes variantes maoïstes et trotskystes, est le produit immédiat de la lutte de classe qui sert de révélateur. Cependant l'intuition de positions politiques de base du prolétariat ne peut dissimuler la profonde fragilité politique de cette nouvelle génération qui renoue avec les positions révolutionnaires sans une réelle connaissance de l'histoire passée de sa classe, sans lien avec les organisations antérieures du prolétariat, sans expérience militante d'aucune sorte et sous l'influence pesante des illusions petite bourgeoises véhiculées par le mouvement des étudiants. Le poids de décennies de contre-révolution pèse extrêmement lourdement. "Cours camarade, le vieux monde est derrière toi!" clament les révoltés de 68. Mais si le rejet du "vieux monde" permet d'approcher certaines positions de classe telles que la nature capitaliste des syndicats, des partis dits de "gauche", des soi-disant "patries du socialisme", dans la foulée il tend allègrement à faire rejeter des acquis indispensables du prolétariat. Et en premier lieu celui de la nature révolutionnaire du prolétariat, mais aussi le marxisme, les organisations passées du prolétariat, la nécessité de l'organisation politique, etc. Immédiatement, les idées qui vont trouver le plus d'écho parmi une mouvance marquée du sceau de l'immaturité et de l'inexpérience propre à la jeunesse sont celles de courants "radicaux" telle l'Internationale Situationniste qui réactualise au goût du jour les théories de Socialisme ou Barbarie, et se fait l'expression la plus radicale du mouvement des étudiants. Diluant la lutte ouvrière dans la révolte des couches petites-bourgeoises, l'identifiant avec un réformisme radical de la vie quotidienne, tentant un savant amalgame entre Bakounine et Marx, l'Internationale Situationniste esquive le terrain marxiste pour réactualiser avec un siècle de retard les illusions utopistes.
Ainsi va le "modernisme" ([8] [22]) qui, tout dévoué à sa recherche de la nouveauté et au rejet de l'ancien, ne fait que redécouvrir des théories historiquement périmées. Mais alors que le courant "moderniste" est fondamentalement étranger à la classe ouvrière, le courant conseilliste ([9] [23]) lui, s'inscrit historiquement dans le milieu politique prolétarien. ICO en France est particulièrement représentatif de cette tendance, se réclamant des apports des gauches "allemande" et "hollandaise", il théorise, dans la continuité des errements de la gauche "hollandaise" dans les années 30, le rejet de la nécessité pour le prolétariat de se doter d'organisations politiques. Cette position va connaître un grand succès alors que, après des décennies de contre-révolution victorieuse, de trahison des organisations prolétariennes gui succombent sous la pression bourgeoise et s'intègrent à l'Etat capitaliste, et de manoeuvre anti-ouvrière des organisations qui prétendent pourtant parler en son nom, le sentiment de méfiance du prolétariat vis-à-vis des organisations quelles qu'elles soient est exacerbé. Cette tendance tend à culminer dans une peur de l'organisation en soi. Le mot même effraie.
Dans un premier temps ICO va polariser le milieu politique renaissant en France et même internationalement avec l'écho planétaire des événements de mai 68, et contribuer à la divulgation et à la réappropriation de l'expérience prolétarienne des révolutionnaires du passé (notamment du KAPD en Allemagne), bien que de manière partielle et déformée. Aux conférences qu'organise ICO participent de nombreux groupes; ainsi en France: les Cahiers du communisme de conseil de Marseille, le Groupe conseilliste de Clermont-Ferrand, Révolution Internationale de Toulouse, le GLAT, la Vieille Taupe, Noir et rouge, Archinoir; à la conférence de Bruxelles en 1969 vont participer des groupes belges et italiens ainsi que des "personnalités" telles que Daniel Cohn-Bendit et Paul Mattick. Mais cette dynamique de polarisation du milieu politique se fait plus sous la pression de la lutte de classe que grâce à la cohérence politique d'ICO ; avec la retombée de la lutte ouvrière en France au tout début des années 70, les conceptions anti-parti, anti-organisation d'ICO vont peser de plus en plus lourdement sur un milieu politique immature. Alors qu'au début ICO attire aux positions prolétariennes des groupes et éléments en rupture d'anarchisme et d'académisme intellectuel, avec le reflux des grèves c'est l'inverse qui se produit: c'est ICO qui est gagné par la gangrène anarchiste et "moderniste". Finalement ICO disparaîtra en 1971.
Cet itinéraire d'ICO est tout a fait exemplaire de la dynamique du conseillisme dans le milieu politique international, même si dans d'autres pays que la France ce phénomène a pu être décalé dans le temps. Les théorisations conseillistes en rejetant la nécessité de l'organisation, en niant la nature prolétarienne de la révolution russe, du Parti bolchevik et de la IIIème Internationale constituent un pôle de déboussolement et de décomposition au sein du milieu prolétarien en formation en le coupant de racines historiques essentielles et en le privant des moyens organisationnels et politiques de s'inscrire dans la durée. Le conseillisme est un pôle de dilution des énergies révolutionnaires de la classe.
Tous les groupes prolétariens qui surgissent dans l'enthousiasme de la jeunesse à la fin des années 60 sont peu ou prou marqués par l'influence pernicieuse du "modernisme" et du conseillisme: que de discours n'a-t-on entendu sur la fin des crises avec le capitalisme d'Etat, sur les méchants bolcheviks et la destinée inéluctable pour tout parti de trahir le prolétariat, sur l'aliénation suprême que constitue le militantisme révolutionnaire. Discours à la mode et qui vont disparaître avec elle! La décantation inévitable qui vient avec le reflux de la lutte de classe, en même temps qu'elle balaye les illusions, imposant ainsi une nécessaire clarification, va se traduire par la disparition des groupes politiquement les plus faibles. Dans la première moitié des années 70 c'est l'hécatombe: exit l'IS qui n'aura "brillé" qu'un fugace printemps, exit ICO morte sur le champ dérisoire de la critique de la vie quotidienne, exit Pouvoir Ouvrier, Noir et rouge et la Vielle Taupe en France, exit Lotta continua et Potere Operaio en Italie mal dégrossis du gauchisme maoïste, et la liste est évidemment loin d'être exhaustive. L'histoire est là, avec la lutte de classe qui reflue et la crise qui se développe, qui impose inéluctablement ses évidences et apporte sa sanction.
Les divers PCI issus de la gauche "italienne" incapables de comprendre que le réveil de la lutte de classe la fin des années 60 signifie le glas de la période de contre-révolution, sous-estimant complètement l'importance des grèves qui se déroulent sous leurs yeux vont être incapables de remplir la fonction pour laquelle ils existent: intervenir dans la classe et dans le processus de formation de son milieu politique. Ceux qui se prétendent la seule continuité organique et politique avec les organisations révolutionnaires du début du siècle, qui auraient dû renforcer le milieu politique renaissant en accélérant le nécessaire processus de réappropriation des acquis prolétariens du passé, ceux qui se prétendent le Parti de classe, ceux-là sont quasiment absents jusqu'au milieu des années 70. Ils dorment en croyant que continue la longue nuit de la contre-révolution et en serrant frileusement les "tables de la loi" du programme communiste. Le PCI (Programme Communiste), seule organisation à avoir une réelle existence internationale, traite avec un souverain mépris ces éléments à la recherche balbutiante d'une cohérence révolutionnaire et le PCI (Battaglia Comunista), plus enclin à la discussion politique, reste timidement replié sur l'Italie.
Même si les positions de ces groupes sur la question du parti, qui les distinguaient fondamentalement du conseillisme, ne pouvaient dans un premier temps polariser de la même manière le milieu politique renaissant, leur relative absence n'a pu que renforcer le poids destructeur du conseillisme sur les jeunes énergies révolutionnaires immatures.
Finalement, seule l'expression qui pouvait paraître superficiellement la plus "faible" des courants qui se rattachent à la gauche "italienne", parce qu'isolée au Venezuela, mais qui ne l'était certainement pas sur le plan politique qui nous intéresse, va parvenir à donner des fruits. A l'initiative de membres d'Internacionalismo immigrés en France va être formé le groupe Révolution Internationale à Toulouse, en plein bouillonnement de mai 68. Ce petit groupe, perdu dans la multitude de ceux qui surgissent à cette époque va être à même -parce qu'en son sein participent d'anciens militants de la gauche "italienne", de Bilan et d'Internationalisme, qui lui apportent une expérience politique irremplaçable- de jouer un rôle positif face à la tendance à la décomposition qui est à l'oeuvre dans ce nouveau milieu politique sous l'emprise dangereuse du conseillisme. Cela va notamment se concrétiser dans la dynamique de regroupement que va savoir incarner Révolution Internationale.
LA DYNAMIQUE DU REGROUPEMENT ET LE POIDS DU SECTARISME
Du sein même du nouveau milieu politique dominé par la confusion va apparaître une tendance qui va s'opposer au processus de décomposition qui se manifeste comme expression du poids des idées conseillistes. La volonté de clarification politique, le souci de réappropriation des acquis politiques du marxisme va se concrétiser dans une défense de la nécessité de l'organisation politique pour le prolétariat et une critique des erreurs conseillistes. Dès sa fondation RI va se consacrer à cette tâche: défendant des principes révolutionnaires sur la question de l'organisation, mais aussi proposant un cadre cohérent de compréhension des positions de classe et de l'évolution du capitalisme au XXème siècle au travers de la théorie de la décadence du capitalisme reprise de Rosa Luxemburg et de Bilan et des élaborations sur le capitalisme d'Etat héritées d'Internationalisme. Cela lui permet une plus grande clarté sur des questions comme celles du caractère prolétarien de la révolution russe, du parti bolchevik, de la IIIème Internationale qui sont celles qui sont posées au sein du milieu d'après 68. De plus, la cohérence plus solide des fondements politiques de RI va s'exprimer dans sa compréhension des événements de mai 68: tout en défendant l'importance et la signification historique des luttes ouvrières qui se développent internationalement RI s'oppose fermement aux surestimations délirantes de ceux qui au sein du courant conseillisto-moderniste voyaient la révolution communiste pour l'immédiat et préparaient ainsi leur démoralisation future. RI, même si dans un premier temps son audience est restreinte et noyée dans le conseillisme dominant, représente un pôle de clarté dans le milieu politique de l'époque. En France, la participation de RI aux réunions organisées par ICO va lui permettre de confronter la confusion conseilliste et de polariser l'évolution d'autres groupes. Le processus de clarification qui prend place alors permettra de développer une dynamique de regroupement qui aboutira en 1972 à la fusion du Groupe conseilliste de Clermont-Ferrand et des Cahiers du communisme de conseil au sein de RI.
La dynamique du regroupement et la formation du CCI ([10] [24])
Sur le plan international la dynamique est la même. Dans la retombée de la lutte de classe les débats s'accélèrent au sein du milieu politique prolétarien dans lesquels RI et Internacionalismo vont jouer un rôle de clarification déterminant. La lutte contre les conceptions conseillistes s'intensifie, poussant de nombreux groupes à rompre avec leurs premières amours libertaro-conseillistes. Internationalism aux USA se forme en contact étroit avec Internacionalismo, les discussions de clarification avec RI sont directement à l'origine de la formation de World Révolution et vont avoir beaucoup d'influence sur des groupes comme Worker's Voice et Revolutionary Perspective en Grande-Bretagne, c'est directement sous l'égide de RI que trois groupes fusionnent pour former Internationalisme en Belgique, de même en Espagne et en Italie c'est autour de la cohérence de RI que se forment Accion Proletaria et Rivoluzione Internazionale.
L'appel d'Internationalism (USA) à la constitution d'un réseau international de contacts entre les groupes prolétariens existants va permettre l'accélération de la clarification théorique et de la décantation politique. Dans cette dynamique sera tenue une conférence internationale en 1974 qui prépare et annonce la fondation du CCI en 1975 qui regroupe alors Internacionalismo (Venezuela), Révolution Internationale (France), Internationalism (USA), Nord Révolution (GB), Internationalisme (Belgique), Accion proletaria (Espagne), Rivoluzione Internazionale (Italie) sur la base d'une plate-forme commune. Existant ainsi dans sept pays, loin des conceptions anarcho-conseillistes qui cachent mal le poids du localisme le CCI appuiera son existence sur un fonctionnement centralisé à l'échelle internationale, à l'image de la classe ouvrière qui est une et n'a pas d'intérêt particulier suivant les pays où elle se trouve.
La décomposition du gauchisme et le développement du PCI (Programme Communiste)
La vague de lutte de classe qui a débuté de manière explosive en 1968 commence à marquer le pas dès le début des années 70, la classe dominante surprise dans un premier temps réorganise son appareil de mystification politique pour lieux confronter la classe ouvrière. Cet infléchissement de la situation qui provoque la débandade du milieu conseilliste marqué par l'immédiatisme et la déroute des conceptions qui le caractérisaient va aussi provoquer une certaine décomposition des groupes "gauchistes" trotskystes et maoïstes secoués par de nombreuses scissions dont certaines vont tendre à se rapprocher des positions révolutionnaires. Cependant ces groupes marqués par leur lourde hérédité vont être incapables de réellement s'intégrer au milieu prolétarien. Ainsi les deux scissions de Lutte ouvrière en France: Union ouvrière et Combat communiste dont la première,au début influencée par le FOR/fait une traversée météoritique du milieu prolétarien pour disparaître dans le "modernisme" alors que la seconde se révélera congénitalement incapable de rompre avec le trotskisme "radical".
La dynamique de sortie du sein des groupes de 1'extrême-gauche de nombreux éléments plus démoralisés que clarifiés va s'intensifier avec l'entrée de la lutte de classe dans une phase de recul au milieu des années 70. C'est sur cette base que va se développer le PCI (Programme communiste). Après être passé à côté de la lutte de classe à la fin des années 60 sans rien voir, le PCI bordiguiste commence à sortir de sa torpeur au début des années 70, mais ce sera pour traiter avec un souverain mépris le milieu prolétarien qui s'est constitué et développer un recrutement opportuniste vis-à-vis d'éléments au "gauchisme" mal dégrossi. Sur la base de positions erronées sur des questions cruciales telles que la question nationale ou la question syndicale, la dérive opportuniste du PCI va s'intensifier et s'accélérer tout au long des années 70. Il va ainsi successivement soutenir la lutte de libération nationale en Angola, la terreur des Khmers rouges au Cambodge et la "révolution" palestinienne. Et le PCI bordiguiste va enfler à la mesure de la gangrène "gauchiste" qui le gagne.
A la fin des années 70 le PCI (Programme Communiste) sera l'organisation la plus importante au sein du milieu politique prolétarien existant. Hais si le PCI est le pôle dominant du milieu politique durant cette période ce n'est pas seulement à son importance numérique et sa réelle existence internationale qu'il le doit. Le recul de la lutte de classe sème le doute sur la capacité révolutionnaire du prolétariat et un nouvel attrait pour les conceptions substitutionnistes du parti se développe en réaction aussi à l'évidente déroute des conceptions anti-organisationnelles du conseillisme. Le bordiguisme qui théorise le parti comme le remède souverain contre toutes les difficultés de la classe fondamentalement trade-unioniste qu'il doit diriger et organiser comme un état-major militaire dirige son armée, connaît un regain d'intérêt dont le PCI va bénéficier. Hais au-delà du PCI (Programme communiste) c'est l'ensemble du milieu politique qui va être polarisé par le nécessaire débat sur le rôle et les tâches du parti communiste.
Le poids du sectarisme
Cependant si le PCI (Programme communiste) est la principale organisation du milieu prolétarien dans la deuxième moitié des années 70, il n'est pas pour autant le produit d'une dynamique de clarification et de regroupement. Bien au contraire, son développement s'est opéré sur la base d'un opportunisme grandissant et d'un sectarisme constamment théorisé. Le PCI qui se considère comme la seule organisation prolétarienne existante refuse toute discussion avec d'autres groupes. Le développement du PCI bordiguiste n'est pas l'expression de la force de la classe mais celle de son affaiblissement momentané déterminé par le recul des grèves. Malheureusement le sectarisme n'est pas l'apanage du seul PCI de Bordiga même s'il en fait la théorisation la plus caricaturale, il pèse sur l'ensemble du milieu prolétarien comme expression de son immaturité. Cela se concrétise notamment dans:
- la tendance de certains groupes à se croire seuls au monde et à nier la réalité de l'existence d'un milieu politique prolétarien; à l'image du PCI de nombreuses sectes se réclamant du bordiguisme vont développer cette attitude;
- une tendance à être plus soucieux de se distinguer sur des points secondaires afin de justifier sa propre existence séparée que de se confronter au milieu politique pour pousser à la clarification. Cette attitude va en général de pair avec une profonde sous-estimation de l'importance du milieu prolétarien et des débats qui l'animent; ainsi, Revolutionary Perspective qui refuse la dynamique de regroupement avec World Révolution en Grande-Bretagne en 1973 en arguant d'une divergence "fondamentale": selon ce groupe, après 1921 le parti bolchevik n'était plus prolétarien. Cette "fixation" de RP sur cette question n'étant qu'un prétexte, ce qui va se traduire quelques années plus tard par l'abandon de cette position sans en tirer les conséquences sur l'échec antérieur du regroupement en GB;
- une tendance aux scissions immatures et prématurées comme celle du PIC qui se sépare de RI en 1973 sur une base activiste et immédiatiste mâtinée de conseillisme. Cependant, toute les scissions ne sont pas infondées; ainsi celle du CCI ([11] [25]) en 1977 à partir du CCI est justifiée dans la mesure où les camarades qui vont former le CCI rompent avec la cohérence du CCI sur des positions fondamentales telles que le rôle du parti et la nature de la violence de classe, rejoignant les conceptions bordiguistes. Cependant cette scission exprime quand même le poids du sectarisme en reprenant les conceptions sectaires du PCI sur bien des points;
- paradoxalement la tendance au sectarisme va aussi se manifester dans des tentatives de regroupement qui vont singer la dynamique qui fut celle du CCI. Ainsi le PIC va se faire l'initiateur de conférences qui essaieront dans la plus grande confusion de regrouper des groupes plus marqués par l'anarchisme que par les positions révolutionnaires. La fusion de Worker's Voice et de Revolutionnary Perspective en Grande-Bretagne au sein du CWO ([12] [26]), si elle marque une volonté positive vers le regroupement, est aussi malheureusement marquée par l'attitude sectaire que cette organisation déploie vis-à-vis du CCI, alors que les positions de base sont très proches.
Ce poids du sectarisme sur le milieu politique est l'expression de la rupture occasionnée par 50 ans de contre-révolution, et l'oubli de l'expérience des révolutionnaires du passé sur la question du regroupement et de la formation du parti communiste, situation encore accentuée à la fin des années 70 par le recul de la lutte de classe. Cependant parce que le milieu politique n'est pas un reflet mécanique de la lutte de classe mais l'expression d'une volonté consciente de celle-ci de lutter contre les faiblesses qui la marquent, la volonté des différents groupes du milieu politique de s'engager résolument dans la dynamique de clarification, avec en perspective le nécessaire regroupement des forces révolutionnaires, est l'expression concrète de leur clarté politique sur leur immense responsabilité dans la période historique présente.
Dans ces conditions l'appel de Battaglia Comunista à la tenue de conférences des groupes de la Gauche communiste, après une longue période de très grande discrétion de ce groupe sur la scène internationale, marque une évolution positive pour l'ensemble du milieu qui, avec le recul momentané de la lutte ouvrière, subit fortement le poids du sectarisme et de la dispersion.
Dans la deuxième partie de cet article nous verrons comment s'est située l'évolution du milieu politique à la fin des années 70 et durant les années 80, évolution marquée par la tenue des conférences et leur échec final, la crise que cette situation ouvre au sein du milieu et la brutale décantation qui en résulte et qui se traduit notamment par l'éclatement du PCI, et comment ce milieu va réagir face au développement d'une nouvelle vague de lutte de classe à partir de 1983 et aux responsabilités que cela implique pour les révolutionnaires.
JJ. 7/3/88
[1] [27] Remarque préliminaire: Il est évident que dans le cadre de ces notes il n'est pas possible de retracer l'itinéraire et les positions de tous les groupes mentionnés dans cet article et dont beaucoup ont d'ailleurs rejoint les poubelles de l'histoire. Nous nous bornerons donc à faire référence aux groupes de la tradition de la gauche communiste et à ceux toujours existants.
[2] [28] "Spartakusbond": voir Revue Internationale n*38 et 39. Sur la •gauche hollandaise", voir Revue Internationale n*30, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52.
[3] [29] "Partito Comunista Internazionalista", fondé en 1945, qui publie Battaglia Comunista et Prometeo: voir, entre autres, Revue Internationale n*36, 40 et 41. Adresse: Prometeo, Caselia Postale 1753, 20100 Milano, Italie.
[4] [30] "Parti Communiste International", scission en 1952 du précédent, qui publie en France Le Prolétaire et Programme Communiste. Voir Revue Internationale n'32, 33, 34, 38.
[5] [31] Bilan, publication de la "gauche italienne", formée en 1928, publié de 1333 à 1938. Voir la brochure du CCI La Gauche Communiste d'Italie. Voir Revue Internationale n°47
[6] [32] Internationalisme, publication de la Gauche Communiste de France, 1945-1952. Voir les rééditions d'articles dans la Revue Internationale. Voir La Gauche communiste d’ltalie,
[7] [33] "Ferment Ouvrier Révolutionnaire", qui publie Alarme, BP329,
Ï5624 PARIS Cedex 13. Voir Revue Internationale nf52.
[8] [34] Sur le "modernisme", voir Revue Internationale n'34.
[9] [35] Sur le "conseillisme", voir Revue Internationale n#37, 40, 41.
[10] [36] Voir la Revue Internationale n°40: "10 ans de CCI". Voir les différentes publications territoriales du CCI au dos de cette revue.
[11] [37] GC1, BP 54, BXL 31 Bruxelles, Belgique. Voir Revue Internationale n°48, 49, 50, sur la décadence du capitalisme.
[12] [38] CWO, PO Box 145, Head Post Office, Glasgow, Grande-Bretagne. Voir Revue Internationale n°39, 40, 41.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [11]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [39]
Décadence du capitalisme guerre, militarisme et blocs impérialistes (2eme partie)
- 3448 reads
Dans la première partie de cet article nous mettions en évidence le caractère parfaitement irrationnel de la guerre dans la période de décadence du capitalisme. Alors qu'au siècle dernier, malgré les destructions et les Massacres qu'elles occasionnaient, les guerres constituaient un moyen de la marche en avant du mode de production capitaliste favorisant la conquête du marché mondial et stimulant le développement des forces productives de l'ensemble de la société, les guerres du 20ème siècle ne sont plus que l'expression extrême de toute la barbarie dans laquelle la décadence capitaliste plonge cette même société. Cette partie de l'article soulignait en particulier que les guerres mondiales, mais aussi les multiples guerres "locales", de même que toutes les dépenses militaires englouties dans leur préparation et leur entretien, ne sauraient nullement être considérées comme des "faux frais" du développement de l'économie capitaliste mais s'inscrivent de façon uniquement négative dans le bilan d'ensemble de celle-ci: résultat majeur des contradictions insolubles qui minent cette économie, elles constituent un facteur puissant d'aggravation et d'accélération de son effondrement. En fin de compte, la parfaite absurdité de la guerre aujourd'hui s'illustre de façon éclatante avec le fait qu'une nouvelle guerre généralisée, qui est la seule perspective que le capitalisme soit en mesure pour sa part de proposer malgré toutes les campagnes pacifistes actuelles, signifierait tout simplement la destruction de l'humanité.
Une autre illustration du caractère complètement irrationnel et absurde de la guerre dans la période de décadence du capitalisme, comme manifestation de l'absurdité même que représente pour l'ensemble de la société la survivance de ce système, est constituée par le fait que le bloc qui, en dernier ressort, déclenche la guerre mondiale est justement celui qui en sort "vaincu" (si tant est qu'on puisse considérer qu'il y a un "vainqueur"). C'est ainsi qu'en août 1914 c'est directement l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui déclarent la guerre aux pays de l'Entente. De même en septembre 1939, c'est l'invasion de la Pologne par l'Allemagne qui déclenche les hostilités en Europe alors que c'est le bombardement de la flotte américaine à Pearl Harbor en décembre 1941 par le Japon qui se trouve à l'origine immédiate de l'entrée en guerre des Etats-Unis.
LA DEMARCHE "SUICIDAIRE" DU CAPITALISME DECADENT
Cette démarche "suicidaire" des pays qui allaient en fin de compte être les principaux perdants de la conflagration mondiale ne peut évidemment pas s'expliquer par la "folie" de leurs dirigeants. En réalité, cette apparente "folie" dans la conduite des affaires de ces pays, n'est pas autre chose que la traduction de la "folie" générale du système capitaliste aujourd'hui; cette démarche "suicidaire", c'est avant tout celle du capitalisme dans son ensemble depuis qu'il est entré dans sa période de décadence, et qui ne fait que s'aggraver à mesure qu'il s'enfonce dans cette décadence. Plus précisément, la conduite "irrationnelle" des futurs "perdants" des guerres mondiales ne fait qu'exprimer deux réalités:
- le caractère inéluctable, lorsque fait dé faut l'obstacle de la lutte prolétarienne, de la guerre généralisée comme aboutissement de l'exacerbation des contradictions économiques du mode de production capitaliste;
- le fait que la grande puissance qui "pousse" le plus vers l'affrontement général soit la moins bien lotie dans le partage du butin impérialiste et qui trouve le plus grand intérêt dans la remise en cause de ce partage.
Le premier point fait partie du patrimoine "classique" du marxisme depuis le début du siècle. Il est un des fondements de toute la perspective de notre organisation pour la période actuelle et il a été amplement développé dans d'autres articles de notre presse. Ce qu'il importe de souligner plus particulièrement ici, c'est l'absence d'un réel contrôle de ce phénomène de la part de la classe dominante. De même que tous les efforts, toutes les politiques de la bourgeoisie en vue de surmonter la crise de l'économie capitaliste ne peuvent empêcher celle-ci de s'aggraver de façon inexorable, toutes les gesticulations des gouvernements, même lorsqu'elles visent "sincèrement" à préserver la paix, ne peuvent enrayer l'engrenage qui conduit le monde vers la boucherie impérialiste généralisée, le deuxième phénomène découlant d'ailleurs du premier.
En effet, devant l'impasse totale où se trouve le capitalisme et la faillite de tous les "remèdes" économiques, aussi brutaux qu'ils soient, la seule voie qui reste ouverte à la bourgeoisie pour tenter de desserrer l'étau de cette impasse est celle d'une fuite en avant avec d'autres moyens - eux aussi de plus en plus illusoires d'ailleurs - qui ne peuvent être que militaires. Depuis plusieurs siècles déjà, la force des armes est un des instruments essentiels de la défense des intérêts du capitalisme: c'est par les guerres coloniales en particulier que ce système s'est ouvert le marché mondial, que chaque puissance bourgeoise s'est constitué son "pré carré" lui permettant d'écouler ses marchandises et de se fournir en matières premières. Ce qu'exprimait l'explosion du militarisme et des armements dès la fin du siècle dernier, c'est l'achèvement de ce partage du marché mondial entre les grandes (et même les petites) puissances bourgeoises. Désormais, pour chacune d'entre elles, un accroissement (et partant la préservation) de sa part du marché passait nécessairement par un affrontement avec les autres puissances, et les moyens militaires qui suffisaient pour mettre au pas des populations indigènes munies de flèches et de lances devaient être plus que décuplés pour faire face à ceux des autres nations industrielles. Depuis cette époque, et même si la colonisation a fait place à d'autres formes de domination impérialiste, ce phénomène n'a fait que s'amplifier jusqu'à acquérir des proportions monstrueuses transformant complètement ses rapports avec l'ensemble de la société.
En effet, dans la décadence capitaliste, il en est de la guerre et du militarisme comme des autres instruments de la société bourgeoise et notamment de son Etat. A l'origine, ce dernier apparaît en tant que simple instrument de la société civile (de la société bourgeoise dans le cas de l'Etat bourgeois) pour assurer un certain "ordre" en son sein et empêcher que les antagonismes qui la divisent ne l'amènent à sa dislocation. Avec l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence, avec l'amplification des convulsions du système, se développe le phénomène du capitalisme d'Etat où ce dernier acquiert un poids sans cesse croissant jusqu'à absorber l'ensemble de la société civile, à devenir le principal, sinon le seul, patron. Même si l'Etat continue d'être un organe du capitalisme, et non l'inverse, en tant que représentant suprême de ce système, que garant de sa préservation, il tend à échapper au contrôle immédiat des différents secteurs de la classe bourgeoise dans la plupart de ses fonctions, pour imposer à celle-ci ses propres nécessités globales et sa propre logique totalitaire. Il en est de même du militarisme qui constitue une composante essentielle de l'Etat et dont le développement est justement un des facteurs majeurs de l'intensification du phénomène du capitalisme d'Etat. A l'origine simple moyen de la politique économique de la bourgeoisie, il acquiert avec l'Etat, et au sein de l'Etat, un certain niveau d'autonomie et tend de plus en plus, avec l'amplification de son rôle dans la société bourgeoise, à s'imposer à celle-ci et à l'Etat.
Cette tendance à la colonisation de l'appareil étatique par la sphère militaire s'illustre en particulier par l'importance du budget des armées dans le budget total des Etats (c'est en général le budget le plus élevé), mais pas uniquement. En fait, c'est l'ensemble de la conduite des affaires de l'Etat qui subit de façon massive l'emprise du militarisme. Dans les pays les plus faibles, cette emprise prend souvent la forme extrême de dictatures militaires, mais elle n'est pas moins effective dans les pays où c'est le personnel spécialisé des politiciens qui dirige l'Etat, de même que l'emprise du capitalisme d'Etat n'est pas moins forte là où, contrairement aux pays prétendus socialistes, il n'y a pas identification complète entre l'appareil politique et l'appareil économique du capital. D'ailleurs, même dans les pays les plus développés, les exemples ne manquent pas, depuis la première guerre mondiale, de la participation de militaires aux instances suprêmes de l'Etat: rôle éminent du Général Groener, premier quartier-maître général, comme inspirateur de la politique du chancelier social-démocrate Ebert dans la répression de la Révolution allemande en 1918-19, élection du Maréchal Hindenburg à la présidence de la République en 1925 et 1932 (c'est lui qui fera appel à Hitler dans la fonction de chancelier en 1933), nomination à la tête de l'Etat français du maréchal Péta in en 1940 et du général De Gaulle en 1944 puis en 1958, élection du général Eisenhower comme président des Etats-Unis en 1952 et 1956, etc. De plus, alors que, dans le cadre de la "Démocratie", le personnel et les partis politiques sont amenés à changer au sommet de l'Etat, 1'état-major et la hiérarchie militaire bénéficient d'une remarquable stabilité, ce qui ne peut que renforcer leur pouvoir réel.
Du fait de cette domination du militarisme dans la vie politique, à mesure que les "solutions" à la crise préconisées et mises en oeuvre par les appareils économiques et politiques de la société bourgeoises font la preuve de leur impuissance, les "solutions" spécifiques dont les appareils militaires sont les promoteurs tendent à s'imposer de façon croissante. C'est en ce sens, par exemple, qu'on peut comprendre l'accession au pouvoir du parti nazi en 1933: ce parti représentait avec le plus de détermination l'option militaire face à la catastrophe économique qui sévissait de façon particulièrement aiguë en Allemagne. Ainsi, à mesure que s'enfonce le capitalisme dans sa crise, s'impose à lui de façon croissante, irréversible et incontrôlable, la logique du militarisme, même si celui-ci n'est pas plus capable que les autres politiques de proposer (comme on l'a vu dans la première partie de cet article) la moindre solution aux contradictions économiques du système. Et cette logique du militarisme, dans un contexte mondial où tous les pays sont dominés par elle, où le pays qui ne prépare pas la guerre, qui n'emploie pas les moyens militaires lorsqu'ils "s'imposent", devient la "victime" des autres pays, ne peut conduire qu'à la guerre généralisée même si celle-ci ne saurait apporter à tous les belligérants que massacres et ruines, et même la destruction totale.
Cette pression inéluctable vers l'affrontement généralisé s'exerce d'autant plus fort sur les grandes puissances que celles-ci sont moins bien pourvues dans le partage du butin impérialiste alors que les mieux loties ont beaucoup plus intérêt à préserver le statu quo. C'est pour cela que lors de la première guerre mondiale, les deux puissances qui poussent le plus vers la guerre sont la Russie et surtout l'Allemagne et que le bloc qui engage le conflit est celui dominé par cette dernière laquelle se trouve avec un empire colonial de moindre envergure que ceux de la Belgique et du Portugal alors qu'elle est devenue la première puissance économique d'Europe. Cette situation est encore plus nette lors de la deuxième guerre mondiale où la situation de l'Allemagne s'est encore aggravée du fait des conditions du traité de Versailles de 1919 qui l'a dépouillée de ses rares possessions coloniales de même que d'une partie de "son" territoire national. De même, le Japon détruit la flotte américaine du Pacifique en 1941 dans l'espoir d'élargir dans cet océan un empire colonial qu'il estime insuffisant, compte tenu de sa nouvelle puissance économique, avec la seule Mandchourie acquise en 1937 au détriment de la Chine. Ainsi, les brigands impérialistes qui précipitent la guerre du fait de l'étroitesse de leur "espace vital" sont finalement les moins bien lotis pour la gagner:
- parce qu'ils disposent de moindres assises territoriales et économiques que leurs adversaires;
- parce que leur offensive, dans un monde entièrement partagé entre les grandes puissances bourgeoises, ne peut que souder entre elles celles qui sont déjà "installées" (comme c'est par exemple le cas de la France et de la Grande-Bretagne dont les rivalités en Afrique de la fin du 19ème siècle sont finalement surmontées face à la menace commune que représente l'Allemagne).
Par bien des côtés, l'URSS et son bloc se trouvent aujourd'hui dans une situation similaire à celle de l'Allemagne et de ses alliés en 1914 et 1939. En particulier, la cause première de la situation dont pâtissent l'une et l'autre de ces deux puissances est leur accession tardive au développement industriel et au marché mondial qui les a contraintes de se contenter des miettes laissées par les puissances industrielles plus anciennes (comme la France et la Grande-Bretagne notamment) lors de leur partage du gâteau impérialiste. Cependant, il faut noter une différence importante entre l'URSS d'aujourd'hui et l'Allemagne du passé. Si, comme l'Allemagne en 1914 et 1939, l'URSS est aujourd'hui la 2ème puissance économique du monde (bien qu'en termes de PNB elle soit passée derrière le Japon) elle se distingue de ce pays par le fait qu'elle ne dispose nullement d'une économie et d'une industrie à 1'avant-garde du développement. Bien au contraire: elle accuse dans ce domaine un retard considérable et insurmontable. C'est là on des phénomènes majeurs de la décadence capitaliste: l'impossibilité pour les capitaux nationaux nouveaux venus de se hisser au niveau de développement des puissances "installées". L'essor industriel de l'Allemagne prend place au moment (fin du 19ème siècle) où le capitalisme connaît sa plus grande prospérité ce qui permet de faire de l'économie de ce pays la plus moderne du monde au moment où le capitalisme entre en décadence. L'essor industriel de la Russie actuelle, après les terribles destructions de la première guerre mondiale et de la guerre civile qui a suivi la révolution, prend place au contraire en pleine période de décadence (la fin des années 20 et les années 30): de ce fait, ce pays n'est jamais parvenu à sortir réellement de son sous-développement et compte parmi les plus arriérés du bloc qu'il domine ([1] [40]).
Ainsi, à la moindre extension de son empire s'ajoute, pour l'URSS, une faiblesse économique et financière énorme par rapport à son rival occidental. Ce décalage économique est encore plus évident au niveau de l'ensemble des deux blocs: ainsi parmi les 8 premières puissances mondiales (en termes de PNB), 7 (l'URSS se trouvant en 2ème position) font partie de l'OTAN ou sont, comme le Japon, des alliés sûrs des Etats Unis. En revanche, les alliés de l'URSS au sein du pacte de Varsovie se situent respectivement aux 11ème, 13ème, 19ème, 32ème, 40ème et 55ème positions. Cette faiblesse se répercute sur toute une série de domaines dans la période actuelle.
Une des conséquences primordiales de la supériorité économique du bloc occidental, et notamment des Etats-Unis, consiste dans la variété des moyens dont il dispose pour asseoir et maintenir sa domination impérialiste. Ainsi, les Etats Unis peuvent établir leur domination aussi bien sur des pays gouvernés par des régimes "démocratiques", que sur des pays aux mains de l'armée, de partis uniques, et même de partis de type stalinien. L'URSS, par contre, n'arrive à contrôler que des régimes directement à son image (et encore!) ou des régimes militaires dépendant directement du soutien des troupes du bloc.
De même, le bloc occidental peut faire, à côté de la carte militaire, un large usage de la carte économique dans le contrôle de ses dépendances (aides bilatérales, intervention d'organismes comme le FMI, la Banque mondiale, etc.). Ce n'est pas le cas de l'URSS qui n'a pas, et n'a jamais eu, les moyens de jouer une telle carte. C'est uniquement à la force militaire que cette puissance doit la cohésion de son bloc.
Ainsi, la faiblesse économique d'ensemble du bloc russe explique sa situation stratégique nettement défavorable à l'échelle mondiale: le registre limité de ses moyens ne lui a jamais permis de se dégager vraiment de l'encerclement que fait peser sur lui le bloc américain. Elle explique également que même sur le terrain strictement militaire - qui est le seul qui lui reste - il n'ait pas de possibilité de s'affronter victorieusement à son rival.
En effet, alors que l'Allemagne du début du siècle ou des années 30 avait pu, grâce à son potentiel industriel moderne, prendre momentanément, avant les affrontements décisifs, une certaine avance militaire sur les pays dont elle contestait l'hégémonie, l'URSS et son bloc, du fait de leur arriération économique et technologique, ont toujours été en retard sur le bloc américain du point de vue des armements. De plus, ce retard est aggravé par le fait que, depuis la seconde guerre mondiale -comme manifestation de l'accentuation constante des grandes tendances de la décadence capitaliste- le monde entier n'a pas bénéficié d'un seul instant de répit dans le domaine des conflits locaux et des préparatifs militaires contrairement à ce qui avait prévalu à la suite de la première guerre mondiale.
Depuis la seconde guerre mondiale, l'URSS n'a pu donc que courir derrière -bien loin- la puissance militaire du bloc de l'Ouest sans jamais parvenir à l'égaler ([2] [41]). Les énormes efforts qu'elle a consacrés à ses armements, notamment dans les années 60-70, s'ils lui ont permis d'atteindre une certaine parité dans quelques domaines (notamment la puissance de feu nucléaire) ont eu comme résultat une aggravation encore plus dramatique de son retard industriel et de sa fragilité face aux convulsions de la crise économique mondiale. En revanche, ils ne lui ont pas permis de préserver les positions (à l'exception de l'Indochine) que les guerres de décolonisation (menées contre des pays du bloc de l'Ouest) lui avaient permis de conquérir en Asie (Chine) ou en Afrique (Egypte notamment).
Au tournant des années 70 et 80, se produit une modification importante du contexte général dans lequel se sont déployés les conflits impérialistes depuis la fin de la guerre froide. A la base de cette modification se situe la mise en évidence de plus en plus nette de l'impasse totale de l'économie capitaliste dont la récession de 81-83 constitue une illustration particulièrement claire. Cette impasse économique ne peut qu'accentuer de façon très importante la fuite en avant de tous les secteurs de la bourgeoisie mondiale dans une marche vers la guerre (voir en particulier l'article "Années 80, les années de vérité", in Revue Internationale n° 20, 1er trimestre 1980).
L'OFFENSIVE DU BLOC AMERICAIN
Dans ce contexte on assiste à une modification qualitative de l'évolution des conflits impérialistes. Sa caractéristique majeure consiste dans une offensive générale du bloc américain contre le bloc russe. Une offensive dont Carter, avec le lancement de sa campagne sur les "droits de l'homme" et les décisions essentielles sur le plan des armements (système de fusées nucléaires NX, construction des euromissiles, constitution de la force d'intervention rapide), avait jeté les bases et qui s'est déployée avec le mandat de Reagan notamment avec des augmentations considérables des budgets militaires, l'envoi des corps expéditionnaires US au Liban en 82, à la Grenade en 84, la décision de développer le dispositif de la "Guerre des étoiles" et, plus récemment, les bombardements de la Libye par l'US Air Force et le déploiement de l'US Navy dans le golfe persique.
Cette offensive vise à parachever l'encerclement de l'URSS par le bloc occidental, à dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct. Elle passe par une expulsion définitive de l'URSS du Moyen-Orient, d'ores et déjà réalisée avec l'insertion de la Syrie au milieu des années 80, dans les plans impérialistes occidentaux, par une lise au pas de l'Iran et la réinsertion de ce pays dans le bloc US comme pièce importante de son dispositif. Elle a pour ambition de se poursuivre par une récupération de l'Indochine. Elle vise en fin de compte à étrangler complètement l'URSS, à lui retirer son statut de puissance mondiale.
Une des caractéristiques majeures de cette offensive, c'est l'emploi de plus en plus massif par le bloc US de sa puissance militaire notamment par l'envoi de corps expéditionnaires américains ou d'autres pays centraux du bloc (France, Angleterre et Italie notamment) sur le terrain des affrontements, comme on a pu le voir en 1982 au Liban, dans le golfe persique en 1987. Cette caractéristique correspond au fait que la carte économique employée abondamment par le passé pour mettre la main sur les positions de l'adversaire ne suffit plus:
- du fait des ambitions présentes du bloc US;
- du fait de l'aggravation de la crise mondiale elle-même -qui crée une situation d'instabilité interne dans les pays du Tiers-monde sur lesquels s'appuyait auparavant le bloc US.
Sur ce point, les événements d'Iran ont été un révélateur. L'effondrement du régime du Shah et la paralysie que cela a occasionné pour le dispositif américain dans cette région ont permis à l'URSS de marquer des points en Afghanistan en installant ses troupes à quelques centaines de kilomètres des "mers chaudes" de l'océan Indien. Ils ont convaincu la bourgeoisie américaine de mettre sur pied sa force d'intervention rapide (et lui ont permis de faire "avaler" facilement cette décision à la population traumatisée par l'exploitation de l'affaire des otages de l'ambassade américaine de Téhéran en 1980) et de réorienter sa stratégie impérialiste.
Ainsi, la situation présente se différencie de celle qui a précédé la 2ème guerre mondiale par le fait que c'est maintenant»le bloc le mieux loti qui est à l'offensive:
- du fait que ce bloc dispose d'une énorme supériorité militaire et notamment d'une très grande avance technologique;
- du fait qu'en se prolongeant beaucoup plus longtemps que lors des années 30, sans qu'elle puisse déboucher sur un conflit généralisé, la crise prolonge et provoque un déploiement beaucoup plus vaste des préparatifs à un tel conflit, préparatifs pour lesquels, évidemment, le bloc économiquement le plus puissant est le mieux armé.
Cependant, cela ne veut pas dire que soit remis en cause le fait que ce soit le bloc le plus défavorisé qui déclenche en fin de compte le conflit généralisé. Pour l'URSS, les enjeux sont considérables. Pour ce pays, c'est une question de vie ou de mort qui est au bout de l'offensive actuelle du bloc US. Finalement, si le bloc américain peut poursuivre jusqu'au bout son offensive actuelle (ce qui suppose qu'il ne soit pas entravé par la lutte de classe) il ne restera à l'URSS pas d'autre alternative que de faire appel aux terribles moyens de la guerre généralisée:
- parce que, en règle générale, un bloc ne capitule jamais avant d'avoir usé de tous les moyens militaires dont il dispose (sauf s'il y est contraint par la lutte de classe);
- parce qu'une capitulation de l'URSS signifierait l'effondrement du régime et la dépossession complète de l'actuelle bourgeoisie du fait qu'elle est complètement intégrée à l'Etat (contrairement à la bourgeoisie allemande qui pouvait s*accommoder d'une victoire des Alliés et d'un changement de régime politique).
Si, en fin de compte, le schéma qui a prévalu en 1914 et en 1939 reste donc aujourd'hui valable sur l'essentiel (c'est le bloc le plus défavorisé dans le partage impérialiste qui fait le pas décisif), il faut s'attendre dans la période qui vient à une avancée progressive du bloc US qui va continuer à marquer des points (contrairement aux années 30 où c'est l'Allemagne qui a marqué des points: Anschluss en 37, Munich en 38, Tchécoslovaquie en 39...).
Face à cette avancée, il faut s'attendre à une résistance pied à pied, acharnée de la part du bloc russe partout ou il peut opposer une telle résistance, ce qui va se traduire par une poursuite et une intensification des confrontations militaires dans lesquelles le bloc US va s'engager de plus en plus directement. En ce sens, la carte diplomatique, si elle continuera à être jouée, tendra de plus en plus à être le résultat d'un rapport de forces obtenu au préalable sur le terrain militaire.
C'est bien d'ailleurs ce qui en est advenu encore récemment avec la signature, le 8 décembre 87, de l'accord de Washington entre Reagan et Gorbatchev sur les missiles "de portée intermédiaire (entre 500 et 5500 km) et des négociations qui se poursuivent à l'heure actuelle à propos d'un éventuel retrait des troupes russes de l'Afghanistan.
Dans ce dernier cas, si un tel retrait se produit, il résultera de l'impasse dans laquelle s'est lise c l'URSS dans ce pays depuis notamment que les Etats-Unis fournissent abondamment la guérilla en armements ultramodernes comme les missiles sol-air "Stinger" qui provoquent des dégâts considérables parmi les avions et les hélicoptères russes.
Pour ce qui concerne les accords de Washington sur l'élimination des "euromissiles", il faut relever qu'ils sont aussi un résultat de la pression militaire exercée par les Etats-Unis et leur bloc sur le bloc adverse, notamment l'installation des fusées "Pershing II" et des "missiles de croisière" dans différents pays d'Europe occidentale (Grande-Bretagne, RFA, Pays-Bas, Belgique et Italie) à partir de novembre 83. Le fait que cet accord résulte principalement d'une initiative russe et que le nombre de missiles et de têtes nucléaires supprimés par l'URSS soit bien plus élevé que du côté américain (857 missiles et 1667 têtes contre 429 missiles et autant de têtes) illustre que c'est bien l'URSS qui se trouve en position de faiblesse (notamment du fait que ses fusées SS20 sont bien moins précises que les Pershing II, qui peuvent frapper à moins de 40 mètres du but des cibles distantes de 1800 km, sans parler des "missiles de croisière" qui, après 3000 km de vol, sont encore bien plus précis).
Pour le chef de file du bloc de l'Ouest, l'opération est d'autant plus intéressante que le retrait de ses propres "euromissiles" n'implique ni le retrait, ni -. l'arrêt du déploiement de ceux de ses alliés: en ; fait, derrière l'accord de Washington, il y a la volonté des Etats-Unis de reporter vers les pays européens une partie du fardeau militaire. Cette plus grande implication de ces pays dans l'effort de défense de leur bloc s'est d'ailleurs illustrée durant l'été 87 de façon on ne peut plus significative par leur participation, souvent massive, à l'Armada occidentale déployée dans le golfe persique. Elle s'est confirmée clairement fin 87 avec la décision franco-britannique de construire en commun un missile nucléaire air-sol de plus de 500 km de portée de même qu'avec les manoeuvres militaires conjointes franco-allemandes préfigurant une plus grande intégration des armées des deux pays concernés et, à terme, de l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest. Elle s'est confirmée une nouvelle fois au dernier "sommet" de l'OTAN, début mars 88, où les membres de cette alliance, c'est-à-dire principalement les pays d'Europe occidentale, se sont engagés à moderniser régulièrement leurs armements (en fait à accroître encore leurs dépenses militaires).
Ainsi, les accords de Washington ne signifient nullement une remise en cause des caractéristiques générales des antagonismes inter impérialistes qui dominent le monde à l'heure actuelle. En particulier, la suppression des "euromissiles" ne constitue qu'une petite égratignure dans la phénoménale capacité de destruction dont disposent les grandes puissances. Malgré l'effroyable potentiel de destruction que représentent les 2100 bombes atomiques appelées à être éliminées (chacune plus puissante que celle qui a détruit Hiroshima en août 1945), cela ne constitue qu'une petite partie des quelques 40000 bombes qui restent prêtes à être expédiées par des missiles de toutes sortes installés à terre ou à bord d'avions, de sous-marins et de navires; sans compter tous les obus nucléaires (probablement des dizaines de milliers) que 6800 canons peuvent tirer.
LA CLASSE OUVRIERE DOIT COMBATTRE LES ILLUSIONS PACIFISTES
Si les accords de Washington n'impliquent aucune réduction sensible du formidable potentiel de destruction entre les mains des grandes puissances, ils ne signifient pas non plus l'ouverture d'une quelconque perspective de désarmement et de liquidation de la menace d'une guerre mondiale. Le "réchauffement" présent des relations entre les deux "grands", les amabilités échangées entre Reagan et Gorbatchev qui tranchent avec les échanges d'insultes d'il y a quelques années, n'indiquent nullement que la "raison" soit en train de l'emporter dans les relations internationales au détriment de la "folie" que représente l'affrontement entre puissances.
"En réalité, les discours pacifistes, les grandes manoeuvres diplomatiques, les conférences internationales de toutes sortes ont toujours fait partie des préparatifs bourgeois en vue de la guerre impérialiste (corne l’ont démontré par exemple les accords de Munich en 1938, un an avant le déchaînement de la seconde guerre mondiale). Ils interviennent en général en alternance avec les discours bellicistes et ont une fonction complémentaire. Alors que ces derniers ont pour objet de faire accepter à la population, et en particulier à la classe ouvrière, les sacrifices économiques commandés par l'explosion des armements, de la préparer à la mobilisation générale, les premiers ont pour objet de permettre à chaque Etat d'apparaître comme 'celui qui veut la paix', qui n'est pour rien dans l'aggravation des tensions, afin de pouvoir justifier par la suite la 'nécessité' de la guerre contre 'l'autre qui en porte toute la responsabilité". (Résolution sur la situation internationale du 7èrae congrès du CCI, Revue Internationale n°51, p.10) On pourrait même préciser que l'exemple de la conférence de Munich, qui avait été présentée comme un "grand pas vers la paix en Europe" après toute une période de développement des tensions diplomatiques et de déploiement des discours bellicistes, nous a enseigné que les phases "pacifistes" de la propagande bourgeoise ne signifient nullement que le danger de guerre soit moins imminent qu'au moment des phases "bellicistes". C'est tout le contraire qui est vrai: en réalité la fonction spécifique de chacun des deux types de campagnes conduit à justement utiliser les discours pacifistes à la veille même du déchaînement des conflits, afin de mieux pouvoir surprendre la classe ouvrière et paralyser toute résistance de sa part, alors que les discours pacifistes correspondaient à la phase antérieure de développement des armements.
Même si le déchaînement d'une troisième guerre mondiale n'est pas actuellement à l'ordre du jour du fait que le prolétariat d'aujourd'hui n'a pas été défait mais se trouve au contraire dans une période historique de développement de ses luttes, "c'est bien à une telle alternance entre discours bellicistes et discours pacifistes que nous avons assisté ces dernières années de la part de l'administration Reagan dont le 'jusqu'auboutisme' des premières années de son Mandat, destiné à justifier les énormes accroissements des dépenses militaires ainsi que diverses interventions à l'extérieur (envoi des corps expéditionnaires américains au Liban et à la Grenade en 82-83, etc.), a fait place à 1"ouverture' face aux initiatives soviétiques dès lors qu'était acquise et raffermie la nouvelle orientation d'accroissement des préparatifs militaires et qu'il convenait de faire preuve de 'bonne volonté'". (Ibid)
Le fait que le principal "destinataire" de ces différentes campagnes soit le prolétariat mondial est notamment illustré par le moment où chacune d'entre elles s'est développée. En effet, le point culminant de la campagne belliciste prend place au début des années 80 alors que la classe ouvrière a subi une importante défaite concrétisée et aggravée par la répression des ouvriers de Pologne en décembre 81. Ce qui momentanément domine au sein de la classe ouvrière c'est un sentiment d'impuissance et une forte désorientation. Dans ce contexte, les campagnes bellicistes promues par les gouvernements, les discours de guerre quotidiens, s'ils développent parmi les ouvriers une inquiétude justifiée face aux perspectives terribles que le système propose à toute l'humanité, ont finalement pour principal résultat d'accroître encore leur sentiment d'impuissance, leur désarroi, et d'en faire des "proies" plus faciles pour les grandes manifestations pacifistes de diversion organisées par les forces de gauche dans l'opposition. Pour sa part, la campagne pacifiste promue par les gouvernements occidentaux derrière le "chef d'orchestre" Reagan prend son essor en 84 juste après que toute une série de luttes massives en Europe aient fait la preuve que la classe ouvrière était sortie de son désarroi momentané et quelle reprenait confiance en elle-même. Dans ces conditions, l'inquiétude résultant des discours guerriers est beaucoup moins en mesure de développer un sentiment d'impuissance parmi les ouvriers. En revanche, elle risque d'accélérer parmi eux la prise de conscience du fait que leurs luttes présentes contre les attaques économiques du capitalisme constituent le seul obstacle véritable à un déchaînement de la guerre mondiale, qu'elles sont des préparatifs vers le renversement de ce système barbare. C'est justement à conjurer ce "risque" que les campagnes pacifistes visent aujourd'hui. Ne pouvant plus faire accepter avec fatalisme aux ouvriers la perspective d'un nouvel accroissement des conflits impérialistes et les effroyables implications contenues dans une telle perspective, il s'agit maintenant pour la bourgeoisie de tenter de les endormir, de leur faire croire que la "sagesse" des dirigeants du monde est en mesure de mettre un terne définitif à la menace d'une troisième guerre mondiale.
Ainsi, l'idée essentielle qu'avec des arguments différents ces deux types de campagnes se proposent d'ancrer dans la tête des ouvriers, c'est que les questions fondamentales de la vie de la société, et en particulier la question de la guerre, se jouent en dehors de toute possibilité pour le prolétariat d'y apporter sa propre réponse en tant que classe. C'est justement l'idée opposée que les révolutionnaires doivent défendre de façon permanente en intervenant dans la classe ouvrière: toutes les "conférences", tous les "accords" entre brigands impérialistes, toute la "sagesse" des hommes d'Etat n'y feront rien: seule la classe ouvrière peut empêcher que la crise actuelle du capitalisme ne débouche sur une troisième guerre mondiale et donc sur la destruction de l'humanité, seule la classe ouvrière, en renversant le capitalisme, peut libérer la société du fléau des guerres.
Aujourd'hui, alors que la bourgeoisie occidentale fait tout son possible pour masquer la véritable gravité de l'envoi de sa formidable armada dans le golfe persique -qui porte en elle la perspective d'une intensification considérable des tensions entre les grandes puissances-, alors qu'elle présente les décisions du dernier sommet de l'OTAN comme un appel à la poursuite du désarmement et à l'atténuation de ces tensions alors qu'en fait c'est un renforcement des armements et une aggravation de celles-ci qu'elles contiennent, alors que Gorbatchev se fait partout et ostensiblement le "grand champion de la paix", il appartient aux révolutionnaires de rappeler et souligner, comme se le proposait cet article, les dimensions et le caractère inéluctable, au sein du capitalisme, de la barbarie dans laquelle ce système a plongé et plongera de plus en plus la société. Il leur appartient en même temps de renforcer leur dénonciation de toutes les illusions pacifistes en poursuivant le combat engagé par leurs aînés depuis le début de ce siècle:
"Les formules du pacifisme: désarmement universel sous le régime capitaliste, tribunaux d'arbitrage, etc., apparaissent non seulement comme une utopie réactionnaire mais encore comme une véritable duperie des travailleurs, tendant à désarmer le prolétariat et à le distraire de sa tâche qui est le désarmement des exploiteurs." (Lénine, Programme du Parti Bolchevik, mars 1919)
F.M.
[1] [42] Notre revue, à plusieurs reprises (voir en particulier le "Rapport sur la situation internationale" du 3ème Congrès du CCI dans le n°18 et "A propos de la critique de la théorie du "maillon faible" dans le n°37), a mis suffisamment en évidence l'arriération considérable dont n'arrive pas à se défaire l'URSS pour qu'il soit nécessaire d'y revenir ici.
[2] [43] C'est d'ailleurs un des éléments qui expliquent que les conflits de la "guerre froide" de la fin des années 40 et du début des années 50 n'aient pu dégénérer en conflagration mondiale: les échecs de l'URSS dans ses tentatives à Berlin (blocus de Berlin-Ouest entre avril 48 et mai 49 déjoué par un pont aérien ais en place par les Occidentaux) et en Corée (invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord en juin 50 qui doit faire face à l'envoi des troupes américaines et aboutit en juillet 53 à un armistice par lequel la Corée du Nord perd une partie de son territoire) lui ont démontré, dès cette époque, qu'elle n'avait pas les moyens de ses objectifs. Les autres tentatives ultérieures de l'URSS pour améliorer ses positions se sont pour la plupart soldées aussi par des échecs. Il en fut ainsi, par exemple, en 1961, de sa tentative d'installer à Cuba des fusées nucléaires menaçant directement le sol américain et qu'elle a dû abandonner face au blocus naval des Etats-Unis. C'est pour cela que tous les discours sur la prétendue "supériorité* Militaire du Pacte de Varsovie sur l'OTAN, notamment en Europe, ne sont que pure propagande. En 82, la bataille aérienne de la Bekaa au Liban est concluante: quatre-vingt deux avions à zéro en faveur d'Israël, équipé de matériel américain, contre la Syrie équipée de Matériel russe. En Europe, l'OTAN n'a pas besoin d'avoir autant de tanks ou d'avions que le Pacte de Varsovie pour disposer d'une supériorité écrasante.
Questions théoriques:
- Internationalisme [44]
- Guerre [45]
Heritage de la Gauche Communiste:
Correspondance internationale : adresse au milieu prolétarien et à la classe ouvrière (GPI, Mexique)
- 2683 reads
Présentation
Nous publions ci-dessous le communiqué du Grupo Proletario Internacionalista du Mexique sur l'agression dont il a été victime de la part d'éléments issus de la décomposition du gauchisme. Nous partageons entièrement les positions qui y sont développées et affirmons notre totale solidarité avec le GPI. Alors que de plus en plus se développent les luttes ouvrières sur un terrain de classe, contre les attaques des conditions de vie, contre les blocages et baisses des salaires, contre les licenciements, et ceci dans tous les pays y indus les pays moins développés, alors que de plus en plus ces luttes remettent en question ouvertement l'encadrement syndical, alors que commence à se développer un milieu politique prolétarien résolument internationaliste, qui défend la nécessité des luttes massives de la classe ouvrière et dénonce comme pratiques bourgeoises toutes les formes de syndicalisme, de nationalisme et de terrorisme, le "gauchisme" issu des "guérillas" et de la "libération nationale" qui ont dominé la vie politique en Amérique Latine depuis la fin des années 60, montre son vrai visage. Mon seulement cette idéologie "radicale" de la petite bourgeoisie prônant le terrorisme n'a jamais remis en question en quoi que ce soit la domination étatique de la bourgeoisie, mais l'impuissance d'hier de ses actes terroristes contre l'Etat se convertit aujourd'hui directement en un instrument indispensable de cet Etat contre les véritables groupes communistes, contre les intérêts immédiats et généraux du prolétariat. Ainsi, à peine quelques mois se sont-ils écoulés depuis la sortie de "Révolution mundial", publication du GPI, et en particulier du n°2 dénonçant le caractère bourgeois de cette idéologie gauchiste et l'impasse que constituent pour le prolétariat les guérillas et le terrorisme radical, que la riposte s'est organisée, usant des méthodes de la violence bourgeoise et de la terreur d'Etat contre les éléments prolétariens: torture, vol, intimidation, etc.
Les groupes politiques prolétariens et avec eux toute la GPI, et ceci sans aucune réserve.
Communiqué du Grupo Proletario Internacionalista ( Mexique ) .
Au milieu communiste international,
A la classe ouvrière mondiale,
Le mardi 9 février 1988, la terreur étatique à laquelle le capital soumet la classe ouvrière et ses forces révolutionnaires dans le monde entier s'est manifestée, cette fois, dans l'action de gangsters et de répression que le GPI a vécu des mains d'une des bandes des résidus du gauchisme terroriste du pays.
L'activité contre-révolutionnaire des groupes terroristes et de guérilla a une histoire néfaste dans cette région du monde (tout comme en Amérique Latine et ailleurs):
- comme une des expressions de l'action désespérée et sans perspective de la petite bourgeoisie urbaine et rurale, elle a dominé la scène sociale du pays de la moitié des années 60 jusqu'aux premières années 70, en diffusant dans la classe ouvrière, avec des nuances diverses, l'idéologie réactionnaire du capital;
- comme instrument indirect ou direct du capital quand les premiers signes du réveil du prolétariat se sont manifestés dans cette région -autour de 1973- elle propagea dans les luttes ouvrières l'impasse de l'idéologie contre-révolutionnaire de la terreur facilitant le travail de répression de l'Etat;
- aujourd'hui, alors qu'il ne reste que des résidus caricaturaux et de simples bandes de voleurs de la majorité des groupes terroristes ou de guérilla; maintenant, alors que depuis quelques années la classe ouvrière dans le pays est en train de s'incorporer à la lutte contre le capital que réalisent ses frères de classe dans le monde entier; maintenant, quand une vraie présence politique révolutionnaire dans la région est en train de se former au milieu de grandes difficultés; maintenant, de nouveau commence à s'agiter le fantôme de la "guérilla" et de la "terreur" fournissant là une utilisation beaucoup plus directe de la part de l'Etat de ces groupes en décomposition contre la classe ouvrière et ses forces révolutionnaires.
Un de ces groupes a attaqué plusieurs militants du GPI, en les torturant et en volant au groupe du matériel d'impression, des documents politiques, de la propagande du milieu communiste et les papiers officiels de camarades. Cette bande a répondu ainsi à la dénonciation politique du rôle contre-révolutionnaire du terrorisme et de la guérilla que le GPI a faite dans sa publication Revolucion Mundial; c'est ainsi que dans le futur ces bandes continueront à agir en collaboration directe ou indirecte avec le travail de répression du capital.
Face à l'action de cette bande et aux actions qui, en rapport avec elle, viendront dans le futur, et qui en accord avec la réalité de la lutte de classe constituent une attaque contre le prolétariat, contre ses forces révolutionnaires naissantes dans le pays et contre l'ensemble du milieu communiste international, et qui s'inscrivent en plein dans la logique de l'activité terroriste étatique, le GPI manifeste:
1- La réitération de sa dénonciation du rôle contre-révolutionnaire du terrorisme et de la guérilla et son avertissement à la classe ouvrière contre l'activité de ces individus et leurs tentatives de l'amener dans l'impasse de la violence minoritaire (individuelle ou de groupe).
2- Sa dénonciation de l'usage que ces individus ou l'Etat peuvent faire des documents politiques du GPI et de l'ensemble du milieu communiste international pour accroître le climat de répression étatique contre la classe ouvrière et ses forces révolutionnaires.
3- Le GPI n'a rien à voir avec les prédicateurs apeurés du pacifisme "démocratique" ni avec la petite bourgeoisie désespérée (ou des éléments déclassés) qui font du culte de la violence minoritaire terroriste le centre de leur existence; le GPI base son activité révolutionnaire dans la conviction que l'unique force capable de s'opposer à la violence réactionnaire de l'Etat capitaliste est la classe ouvrière dans l'exercice de sa lutte et de sa propre violence révolutionnaire.
Grupo Proletario Internacionalista. Mexico, 15 février 1988.
Géographique:
- Mexique [47]