Revue Internationale no 70 - 3e trimestre 1992
- 2935 reads
Editorial : Face au chaos et aux massacres, seule la classe ouvrière peut apporter une réponse
- 2588 reads
Nous publions en page 9 une résolution sur la situation internationale adoptée par le CCI en avril 1992. Depuis que ce document a été rédigé, les événements ont amplement illustré les analyses qu'il contient. C'est ainsi que la décomposition et le chaos, particulièrement au plan des antagonismes impérialistes, n'ont fait que s'aggraver comme on peut le voir, par exemple, avec les massacres en Yougoslavie. De même, la crise économique mondiale a poursuivi son cours catastrophique, créant les conditions d'une reprise des combats de classe auxquels la bourgeoisie se prépare de façon active, comme en témoignent les grandes manoeuvres syndicales en Allemagne.
L'effondrement, dans la deuxième moitié de 1989, du bloc de l'Est n'a pas fini de faire sentir ses conséquences. Le «nouvel ordre mondial» qu'il annonçait, au dire du président Bush, se présente en réalité comme un désordre encore plus catastrophique que le précédent, un chaos sanglant accumulant, jour après jour, les ruines et les cadavres en même temps que les anciens antagonismes entre grandes puissances ont cédé la place à de nouveaux antagonismes de plus en plus explosifs.
Le déchaînement des antagonismes impérialistes
Dans le capitalisme décadent, et particulièrement lorsque la crise économique ouverte témoigne de façon décisive de l'impasse où se trouve ce système, il n'y a pas de place pour une quelconque atténuation des conflits entre les différentes bourgeoisies nationales. Alors qu'il n'existe plus aucune issue pour l'économie capitaliste, que toutes les politiques destinées à surmonter la crise n’ont eu d'autre effet que de la rendre encore plus catastrophique, que les remèdes se sont révélés n'être que des poisons venant encore aggraver l'état du malade, il ne reste d'autre alternative à toute bourgeoisie, quels que soient ses moyens et sa puissance, que la fuite en avant dans la guerre et les préparatifs en vue de celle-ci. C'est pour cela que la disparition, en 1989, d'un des deux blocs militaires qui s'étaient partagé le monde depuis le lendemain de la seconde guerre mondiale n'a nullement débouché sur la «nouvelle ère de paix» que nous annonçaient les chantres du monde bourgeois. En particulier, puisque la menace de «l'Empire du mal» ne pesait plus sur eux, les «alliés» d'hier, c'est-à-dire les principaux pays du bloc occidental, se sont senti pousser des ailes pour mettre en avant leurs intérêts spécifiques face à ceux du «grand frère» américain.
Les alliances que contractent les différentes bourgeoisies nationales ne sont jamais des mariages d'amour mais nécessairement des mariages d'intérêt. En même temps qu'on peut assister à des «réconciliations» spectaculaires, où l'on découvre que la haine réciproque que les Etats avaient inculquée pendant des décennies aux populations doivent céder la place a une « amitié sans faille », les meilleurs amis d'hier, «unis à jamais par l'histoire», par leurs «valeurs communes» et par les «épreuves partagées», n'hésitent pas à se convertir en ennemis acharnés, dès lors que leurs intérêts ont cessé de converger. Il en avait été ainsi au cours et au lendemain de la seconde guerre mondiale où l'URSS avait été présentée par les «démocraties» occidentales, tour à tour, comme un suppôt du diable hitlérien, puis comme un «héroïque compagnon de combat», puis, de nouveau, comme l'incarnation du démon.
Aujourd'hui, même si les structures de base du bloc américain (OTAN, OCDE, FMI, etc.) subsistent encore formellement, si les discours bourgeois évoquent encore l'union des grandes «démocraties», c'en est fini dans les faits de l'Alliance atlantique. L'ensemble des événements qui se sont déroulés depuis près de deux ans n'a fait que confirmer cette réalité : l'effondrement du bloc de l'Est ne pouvait aboutir qu'à la disparition du bloc militaire qui lui faisait face et qui venait de remporter la victoire dans la guerre froide qui les avait opposés depuis plus de 40 ans. De ce fait, non seulement la solidarité entre les principaux pays occidentaux a volé en éclats, mais sont déjà en oeuvre, même si c'est de façon embryonnaire, les tendances vers la reconstitution d'un nouveau bloc impérialiste où l'antagonisme principal se situerait entre les Etats-Unis et leurs alliés d'un côté et, de l'autre, une coalition dirigée par l'Allemagne. Comme la presse du CCI l'a longuement mis en évidence, la Guerre du Golfe du début 1991 avait comme principale origine la tentative américaine de bloquer le processus de désagrégation du bloc occidental et de tuer dans l'oeuf toute velléité de reconstitution d'un nouveau système d'alliances. Les événements de Yougoslavie à partir de l'été 1991 ont montré que l'énorme opération mise au point par Washington n'avait eu que des effets limités et que sitôt terminés les combats dans le Golfe, et la «solidarité» qu'ils exigeaient entre les coalisés, les antagonismes de fond resurgissaient de plus belle. La reprise actuelle des combats dans 1’ex-Yougoslavie, cette fois en Bosnie-Herzégovine, vient, au-delà des apparences, confirmer cette aggravation des tensions entre les grandes puissances qui constituaient le bloc de l'Ouest.
Massacres et discours de paix dans l'ex-Yougoslavie : la guerre au coeur de l'Europe
A l'heure où ces lignes sont écrites, la guerre fait de nouveau rage dans l'ex-Yougoslavie. Après des mois de massacres dans différentes parties de la Croatie, et alors que la situation semblait s'apaiser dans cette région, c'est maintenant la Bosnie-Herzégovine qui se retrouve à feu et à sang. En deux mois, le chiffre des tués s'élève déjà à plus de 5000. Les blessés se comptent par dizaines de milliers alors que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont obligées de quitter les zones de combat, en même temps, d'ailleurs, que la mission de l'ONU à Sarajevo et autres organismes qui pouvaient apporter un minimum de protection à ces populations.
Aujourd'hui, la Serbie est mise «au ban des nations» comme disent les journalistes. Le 30 mai, l'ONU a adopté des mesures rigoureuses d'embargo contre ce pays, comparables à celles imposées à l'Irak avant la guerre du Golfe, pour le contraindre à cesser de déchaîner, en compagnie des milices serbes, le fer et le feu en Bosnie-Herzégovine. Et c'est l'oncle Sam qui a pris la tête de cette campagne de grande ampleur contre la Serbie en même temps qu'il se proclame le défenseur de la «Bosnie démocratique».
Ainsi, Baker n'hésitait pas à évoquer, le 23 mai, la possibilité d'une intervention militaire pour faire plier la Serbie. Et, c'est sous une très forte pression américaine, que les autres membres du Conseil de Sécurité qui pouvaient avoir des réticences, comme la Russie et la France, se sont finalement ralliés à une motion «dure» contre ce pays. Au passage, les Etats-Unis n'ont pas manqué une occasion pour faire ressortir que le maintien de l'ordre dans l’ancienne Yougoslavie incombait fondamentalement aux pays d'Europe et à la CEE, et qu'ils ne se mêlaient de cette question que dans la mesure où ces derniers faisaient la preuve de leur impuissance.
Pour qui a suivi le jeu des grandes puissances depuis le début des affrontements en Yougoslavie, la position actuelle de la première d'entre elles peut apparaître comme un mystère. Pendant des mois, notamment à la suite de la proclamation de l'indépendance de ta Slovénie et de la Croatie au cours de l'été 1991, les Etats-Unis se sont comportés comme de véritables alliés de la Serbie condamnant en particulier le démantèle ment de la Yougoslavie que devait provoquer nécessairement la sécession des deux républiques du Nord. Au sein de la CEE, les pays traditionnellement les plus proches des Etats-Unis, la Grande- Bretagne et les Pays-Bas, ont tout fait pour laisser les mains libres à la Serbie dans ses opérations visant à mettre au pas la Croatie, ou tout au moins à l'amputer d'un bon tiers de son territoire. Pendant des mois, les Etats-Unis fustigé «l'impuissance européenne», qu'ils avaient grandement contribué à aggraver, pour apparaître enfin sur le devant de la scène, tel le Zorro de la légende, et obtenir, à la suite de l'action de l'émissaire de l'ONU, le diplomate américain (quel hasard !) Cyrus Vance, un arrêt des combats en Croatie alors que la Serbie avait déjà atteint 1 essentiel de ses buts de guerre dans cette région.
Cette action de la diplomatie américaine se comprenait parfaitement. En effet, si l'indépendance de la Croatie avait été fortement encouragée par l'Allemagne, c'est parce qu'elle coïncidait avec les nouvelles ambitions impérialistes de ce pays dont la puissance et la position en Europe en fait le prétendant le plus sérieux au rôle de chef de file d'une nouvelle coalition dirigée contre les Etats-Unis, maintenant qu'a disparu toute menace venant de l'Est. Pour la bourgeoisie allemande, une Croatie indépendante et «amie» était la condition de l'ouverture d'un accès sur la Méditerranée qui constitue un atout indispensable pour toute puissance prétendant jouer un rôle mondial. Et c'est bien ce que les Etats-Unis voulaient éviter à tout prix. Leur soutien à la Serbie durant les affrontements en Croatie, qui ont causé à ce dernier pays des ravages considérables, leur permettait de signifier tant à la Croatie qu'à l'Allemagne ce qu'il en coûte de vouloir mettre en oeuvre une politique qui contrarie les intérêts US. Mais justement parce que la première puissance mondiale n'a pas eu à se «mouiller» directement dans toute la seconde partie de 1991 et au début 1992, laissant la CEE afficher son impuissance, elle pouvait opérer par la suite une arrivée en force ou elle allait désigner comme bouc émissaire son allié d'hier, la Serbie.
Aujourd'hui, la soudaine passion des Etats-Unis pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine n'a évidemment rien à voir avec le fait que les autorités de ce dernier pays seraient plus «démocratiques» que celles de la Croatie. Ce sont des gangsters de la même race qui gouvernent à Sarajevo, Zagreb, Belgrade et Washington. En réalité, du point de vue des Etats-Unis, la très grande supériorité de la Bosnie-Herzégovine sur la Croatie tient au fait qu'elle peut constituer un point d'appui de première importance pour contrecarrer la présence allemande dans la région. Pour des raisons tant géographiques qu'historiques, l'Allemagne était au départ le pays le mieux placé pour rattacher une Croatie indépendante à sa zone d'influence. C'est pour cela que les Etats-Unis n'ont pas cherché immédiatement à la concurrencer auprès de la Croatie, faisant au contraire tout leur possible pour s'opposer à l'indépendance de ce pays. Mais une fois que 'Allemagne a joué sa carte en Croatie, il revenait à la bourgeoisie américaine de réaffirmer sa place de gendarme du monde et donc de revenir en force dans une région normalement du ressort des Etats européens. Le cynisme et la brutalité de l'Etat serbe et de ses milices lui en a offert une occasion rêvée. En se déclarant le grand protecteur des populations de la Bosnie-Herzégovine victimes de cette brutalité, l’oncle Sam se propose de ramasser la mise à plusieurs niveaux :
- il fait une nouvelle fois la preuve, comme lors de la guerre du Golfe et de la conférence de Madrid sur le Moyen-Orient à la fin 1991, qu'aucun problème important ans les relations internationales ne peut être réglé en dehors de l'intervention de Washington ;
- il adresse un message aux sphères dirigeantes des deux grands voisins de l'ex-Yougoslavie bénéficiant d'une importance stratégique de premier ordre, l'Italie et a Turquie, pour les convaincre de la nécessité de lui rester fidèles ;
- il ravive les plaies que la question de la Yougoslavie avait provoquées dans l'alliance privilégiée entre la France et l'Allemagne (même si ces difficultés ne sont pas en mesure de remettre en cause la convergence d'intérêts qui existe par ailleurs entre ces eux pays, comme le démontre leur décision de constituer un corps d'armée commun)1] [1] ;
- il prépare son implantation en Bosnie-Herzégovine afin de priver l'Allemagne d'une libre disposition des ports croates de Dalmatie.
Concernant ce dernier point, la simple lecture d'une carte géographique permet de constater que la Dalmatie est constituée d'une bande étroite de terre coincée entre la mer et les hauteurs tenues par l'Herzégovine. Si l'Allemagne, grâce à son alliance avec la Croatie, rêvait d'installer des bases militaires dans les ports de Zadar, Split et Dubrovnik comme points d'appui d'une flotte méditerranéenne, elle serait confrontée au fait que ces ports se trouvent respectivement a 80, 40 et 10 km de la frontière «ennemie» (Dubrovnik a même la particularité d'être coupé du reste de la Croatie par un débouché de l'Herzégovine sur la mer). En cas de crise internationale, il ne serait pas difficile, pour la puissance américaine, de faire le blocus de ces ports, comme la Serbie l'a démontré jusqu'à présent, coupant les avant-postes allemands de leurs arrières et les rendant inutilisables.
En ce qui concerne le «message» transmis à l'Italie, il prend toute son importance à un moment où, à l'image d'autres bourgeoisies européennes (par exemple la bourgeoisie française dont le parti néo-gaulliste, le RPR, est partagé entre partisans et adversaires d'une alliance plus étroite avec l'Allemagne au sein de la CEE), celle de ce pays est divisée sur les alignements impérialistes, comme le démontre notamment la paralysie actuelle de son appareil politique. Compte tenu de la position de premier plan de ce pays en Méditerranée (contrôle du passage entre l'Ouest et l'Est de cette mer, présence à Naples du commandement de la 6e flotte US), les Etats-Unis sont prêts à «mettre le paquet» pour qu'il ne soit pas tenté de rejoindre l'alliance franco-allemande.
De même, une mise en garde des Etats-Unis à la Turquie se comprend tout à fait à 1 heure où ce pays est tenté de coupler ses propres ambitions régionales en direction des républiques musulmanes de l'ex-URSS (qu'elle compte arracher à l'influence d'une Russie aujourd'hui alliée aux Etats-Unis) à une alliance avec l'Allemagne et à un soutien aux ambitions impérialistes de ce pays au Proche-Orient. La Turquie occupe, elle aussi, une position stratégique de première importance puisqu'elle contrôle le passage entre la Mer Noire et la Méditerranée. Aussi, son rapprochement en cours avec l'Allemagne (mis en évidence, notamment, par le «scandale» de la livraison de matériel militaire destiné à la répression des Kurdes, scandale dévoilé grâce aux «bons offices» de Washington) constitue une menace très sérieuse pour les Etats-Unis. Ces derniers ont déjà commencé à réagir en soutenant les nationalistes Kurdes et ils sont prêts à employer des moyens encore plus importants pour stopper un tel rapprochement. En particulier, la «protection» apportée aujourd'hui par la première puissance mondiale aux populations musulmanes de Bosnie-Herzégovine (majoritaires dans ce pays) apparaît comme un pavé dans la mare de la Turquie qui se présente comme le «grand arrière» des musulmans de la région.2] [2])
Ce que démontrent cependant les massacres de Yougoslavie, c'est que même si l'avancée de la décomposition est un phénomène qui échappe au contrôle de tous les secteurs de la bourgeoisie mondiale, y compris ceux des pays les plus avancés et puissants, ces derniers secteurs ne restent pas inactifs et passifs face à un tel phénomène. Contrairement aux équipes nouvellement promues dans les pays de l'ancien bloc de l'Est (sans parler, évidemment de la situation dans le «tiers-monde») et qui sont complètement débordées par la situation économique et politique (notamment par l'explosion des nationalismes et des conflits ethniques), les gouvernements des pays les plus développés sont encore capables de mettre à profit la décomposition pour la défense des intérêts de leur capital national. C'est notamment ce qu'ont démontré, début mai, les émeutes de Los Angeles.
L'utilisation de la décomposition par la bourgeoisie
Comme le CCI l'a mis en évidence[3] [3] la décomposition générale de la société capitaliste, telle qu'elle se développe aujourd'hui, révèle l'impasse historique totale dans laquelle se trouve maintenant cette société. Tout comme la crise et les guerres, la décomposition n'est donc pas une question de bonne ou de mauvaise volonté de la bourgeoisie ou bien de politique erronée de sa part. Elle s'impose à elle de manière insurmontable et irréversible. Le fait que la décomposition, au même titre qu'une éventuelle 3e guerre mondiale, ne puisse avoir d'autre aboutissement, au sein du capitalisme, que la disparition de l'humanité n y change rien. C'est bien ce que révèle le «Sommet» de Rio sur la protection de la Terre qui s'est tenu au début du mois de mai. Comme il était prévisible, la montagne a accouché d'une souris malgré la gravité croissante des problèmes d'environnement mise en évidence par la majorité des scientifiques. Alors que, à cause de l'effet de serre, ce sont de terribles famines qui se profilent à l'horizon, voire la disparition de l'espèce humaine, chacun se renvoie la balle pour ne rien faire (le Nord contre le Sud et réciproquement, l'Europe contre les Etats-Unis, etc.).
Mais si la bourgeoisie se révèle absolument incapable de mettre en oeuvre une quelconque politique à long terme et à l'échelle mondiale, même quand c'est sa propre survie, en même temps que celle de l'ensemble de l’humanité qui est menacée, elle reste capable de réagir contre les effets de la décomposition, sur le court terme et au niveau de la défense de ses intérêts nationaux. Ainsi, les émeutes de Los Angeles sont venues mettre en relief toutes les capacités manoeuvrières que les bourgeoisies les plus puissantes sont encore capables d'utiliser.
Los Angeles constitue une sorte de concentré de toutes les caractéristiques de la société américaine : l'opulence et la misère, la «high tech» et la violence. Symbole du «rêve américain», c'est devenu aussi celui du «cauchemar américain». Comme nous l'avons mis en évidence dans nos textes sur la décomposition, celle-ci, au même titre que la crise économique, part du coeur du capitalisme, même si elle trouve à sa périphérie ses formes les plus extrêmes et catastrophiques. Et L'A (comme on dit en langage «branché») est bien le coeur de ce coeur. Depuis de nombreuses années déjà, la décomposition y exerce des ravages tragiques et particulièrement dans les ghettos noirs. Dans la plupart des villes américaines, ces ghettos sont devenus de véritables enfers, dominés par une misère insupportable, des conditions de logement et sanitaires dignes du «tiers-monde» (par exemple, la mortalité infantile y atteint des taux comparables à ceux des pays les plus arriérés, le SIDA y frappe de façon tragique) et surtout un désespoir généralisé qui conduit une proportion considérable des jeunes, dès la première adolescence, vers la drogue, la prostitution et le banditisme. De ce fait, la violence et le meurtre font partie du quotidien de ces quartiers : la première cause de décès des hommes noirs de la tranche d'âge 15-34 ans est l'assassinat, près d'un quart des hommes noirs entre 20 et 29 ans est en prison ou en liberté surveillée, 45 % de la population carcérale est noire (les noirs représentent 12% dans la population totale). Ainsi, à Harlem, ghetto noir de New-York, pour cause d'assassinat, d'overdose, de maladie, l'espérance de vie d'un homme est plus courte que celle d'un homme du Bangladesh.
Cette situation s'est aggravée tout au long des années 1980, mais la récession actuelle, avec une montée vertigineuse du chômage, lui a donné des proportions encore bien plus considérables. De ce fait, depuis des mois, de nombreux «spécialistes» ne cessaient de prédire l'imminence d'émeutes et d'explosions de violence dans ces quartiers. Et c'est justement face à une telle menace que la bourgeoisie américaine a réagi. Plutôt que de se laisser surprendre par une succession d'explosions spontanées et incontrôlables, elle a préféré organiser un véritable contre-feu lui permettant de choisir le lieu et le moment d'un tel surgissement de violence et de prévenir du mieux possible les surgissements futurs.
Le lieu : Los Angeles, véritable paradigme de l'enfer urbain aux Etats-Unis, où plus de 10 000 jeunes vivent du commerce de la drogue, dont les ghettos sont quadrillés par des centaines de bandes armées qui se massacrent pour le contrôle d'une rue, d'un point de vente de la «poudre d'ange».
Le moment : au début de la campagne pour les présidentielles, qui s'en trouve relancée, mais à distance respectable de l'élection elle-même, afin que de tels troubles, éclatant de façon incontrôlée, ne viennent déconsidérer au dernier moment un candidat, Bush, dont les sondages sont pour l'heure peu reluisants.
Les moyens : l'organisation en plusieurs temps d'une véritable provocation. D'abord, une campagne médiatique de grande ampleur autour du procès des quatre flics blancs qui avaient été filmés en train de tabasser sauvagement un automobiliste noir : c'est à satiété que les téléspectateurs ont pu voir et revoir cette scène révoltante. Ensuite l'acquittement des flics par un tribunal installé de façon délibérée dans un quartier réputé pour son conservatisme, son «goût de l'ordre» et ses sympathies envers la police. Enfin, dès que se sont produits, de façon parfaitement prévisible, les premiers troubles et les premiers rassemblements, une véritable désertion, sur ordre supérieur, des quartiers «chaud» par les forces de police, laissant ainsi l'émeute prendre un maximum d'ampleur. Ces mêmes forces de police, en revanche, sont restées très présentes dans les quartiers bourgeois proches, tels Beverley Hills. Cette tactique avait aussi l'avantage de priver les manifestants de leur ennemi traditionnel, le flic, permettant de canaliser encore plus leur colère vers le saccage des commerces, l'incendie des maisons appartenant à d'autres communautés de même que vers les règlements de comptes entre bandes. Avec une telle tactique, les 58 morts provoqués par cette explosion ne sont pas dus aux forces de police mais essentiellement aux affrontements entre habitants des ghettos (particulièrement entre les jeunes manifestants et les petits commerçants voulant protéger par les armes leurs échoppes).
Les moyens et les conditions du retour à l'ordre faisaient aussi partie de la manoeuvre : ce sont les mêmes soldats qui, il y a un an et demi à peine défendaient le «droit» et la «démocratie» dans le Golfe qui sont venus participer à la pacification des quartiers troublés. La répression, si elle n'a pas été sanglante, a été cependant conduite à grande échelle : près de 12000 arrestations et, pendant des semaines, à la télévision, les images des centaines de procès condamnant à la prison les émeutiers interpellés. Le message était clair : même si elle ne se comporte pas comme un quelconque régime du «tiers-monde», et si elle veille à ne pas faire couler le sang de ceux qui troublent l'ordre public (et cela était d'autant plus facile que, grâce à leur provocation, les autorités n'ont été à aucun moment débordées par les événements), la «démocratie américaine» sait faire preuve de fermeté contre eux. Avis a ceux qui, dans le futur, seraient tentés de recommencer de nouvelles émeutes...
La «gestion» des émeutes de L'A a permis à l'équipe dirigeante de la bourgeoisie américaine de démontrer à tous les secteurs de celle-ci qu'elle était, malgré toutes les difficultés qui s'accumulent, malgré le développement du cancer des ghettos et de la violence urbaine, à a hauteur de ses responsabilités. Dans un monde de plus en plus soumis à des convulsions de toutes sortes, la question de l'autorité du pouvoir, tant à l'extérieur qu'à 'intérieur, de la première puissance de la planète est de la plus haute importance pour la bourgeoisie de ce pays. Avec la provocation à Saddam Hussein durant l'été 1990 suivie de la «tempête du désert» au début 1991, Bush a fait la preuve qu'il savait manifester ce type d'autorité au niveau international. Los Angeles, avec des moyens spectaculaires, notamment dans les montages médiatiques qui rappelaient ceux mis en oeuvre autour de la guerre du Golfe, a démontré que l'administration actuelle était aussi capable de réagir sur le plan «domestique» et que, pour catastrophique qu'elle soit, la situation intérieure aux Etats-Unis restait «under control».
Cependant, les émeutes provoquées de L'A ne constituaient pas seulement un moyen pour l'Etat et le gouvernement de réaffirmer leur autorité face aux différentes manifestations de la décomposition. Elles étaient aussi un instrument d'une offensive de grande ampleur contre la classe ouvrière.
La bourgeoisie se prépare à une reprise des combats de classe
Comme la résolution le met en évidence : «l'aggravation considérable de la crise capitaliste, et particulièrement dans les pays les plus développés, constitue un facteur de premier ordre de démenti de tous les mensonges sur le "triomphe" du capitalisme, même en l'absence de luttes ouvertes. De même, l'accumulation du mécontentement provoqué par la multiplication et l'intensification des attaques résultant de cette aggravation de la crise ouvrira, à terme, le chemin à des mouvements de grande ampleur qui redonneront confiance à la classe ouvrière... Dans l'immédiat, les luttes ouvrières se situent à un des niveaux les plus bas depuis la dernière guerre mondiale. Mais ce dont il faut être certain c'est que, dès à présent, se développent en profondeur les conditions de leur surgissement...» (point 16). Dans tous les pays avancés, la bourgeoisie est bien consciente de cette situation, et particulièrement la première d'entre elles. C'est pour cela que les émeutes de L.A. ont constitué également un instrument de cette bourgeoisie pour affaiblir de façon préventive les futurs combats ouvriers. En particulier, grâce aux images faisant apparaître les noirs comme de véritables sauvages (telle l'image de jeunes noirs s'attaquant à des chauffeurs de camion blancs), la classe dominante a réussi à renforcer de façon significative un des facteurs de faiblesse de la classe ouvrière des Etats-Unis : la division entre les ouvriers blancs et les ouvriers noirs ou d'autres communautés. Comme le déclarait un expert de la bourgeoisie : «le niveau de sympathie que les blancs pouvaient éprouver pour les noirs a considérablement diminué du fait de la peur ressentie par les premiers devant la montée constante de la criminalité noire» (C. Murray de l'American Entreprise Institute, le 6/5/02). En ce sens, le «rétablissement de l'ordre contre des bandes de délinquants noirs pilleurs de magasins et dealers», tel que la bourgeoisie en a voulu donner l'image, a pu être accueilli avec satisfaction par une proportion non négligeable des ouvriers blancs oui sont souvent victimes de 1 insécurité urbaine. A cette occasion, l’«efficacité» des forces dépêchées par l'Etat fédéral (qui contraste avec l’«inefficacité» supposée des forces de la police locale) n'a pu que renforcer l'autorité de celui-ci.
En outre cette montée du racisme a été exploitée par les professionnels de P anti-racisme pour lancer de nouvelles campagnes a-classistes de diversion qui, loin de favoriser l'unité de classe du prolétariat, visent au contraire à le diluer dans l'ensemble de la population et à l'attacher au char de la «démocratie». De même, les syndicats et le Parti Démocrate ont profité de la situation pour dénoncer la politique sociale des administrations républicaines depuis le début des années 1980 rendues responsables de la misère dans les quartiers pauvres des villes. En d'autres termes, pour que les choses s'améliorent, il faut aller voter pour le «bon candidat», ce qui permet au passage de relancer une campagne électorale qui, jusqu'à présent, ne mobilisait pas les roules.
Les différentes manifestations de la décomposition, comme par exemple les émeutes urbaines dans le «tiers-monde» et les pays avancés, seront utilisées par la bourgeoisie contre la classe ouvrière tant que cette dernière n'aura pas été encore en mesure de mettre en avant sa propre perspective de classe vers le renversement du capitalisme. Et cela, que de tels événements soient spontanés ou provoqués sciemment. Mais le fait que la bourgeoisie soit en mesure de choisir le moment et les circonstances de telles explosions lui permet d'en rendre plus efficace l'impact pour la défense de son ordre social. Que les émeutes de L'A soient arrivées fort à propos comme instrument contre la classe ouvrière nous est confirmé par l'ensemble des manoeuvres que la classe dominante déploie contre les exploités dans les autres pays avancés. L'exemple le plus significatif de cette politique bourgeoise nous a été donné récemment dans un des pays les plus importants du monde capitaliste, l'Allemagne.
Offensive de la bourgeoisie contre la classe ouvrière en Allemagne
L'importance de ce pays ne tient pas seulement à son poids économique et à son rôle stratégique croissant. C'est aussi dans ce pays que vit, travaille et lutte un des prolétariats les plus puissants du monde, un prolétariat qui, compte-tenu de son nombre et de sa concentration au coeur de l'Europe industrialisée de même que de son expérience historique incomparable, détient une grande partie des clés du futur mouvement de la classe ouvrière vers la révolution mondiale. C'est bien pour cette raison que l'offensive politique de la bourgeoisie contre la classe ouvrière en Allemagne, et dont la grève du secteur public, la plus importante depuis 18 ans, menée de main de maître par les syndicats, était le fer de lance, ne visait pas seulement la classe ouvrière de ce pays. L'écho considérable qu'elle a eu dans les médias des différents pays européens (alors qu'habituellement les luttes ouvrières font l'objet d'un black-out presque complet à l'étranger) a fait a démonstration que c'est tout le prolétariat européen qui était visé par cette offensive.
Les conditions spécifiques de l'Allemagne permettent de comprendre pourquoi une telle action a pris part aujourd'hui dans ce pays, n effet, outre son importance historique et économique qui sont des données permanentes, outre le fait qu'elle doit faire face, comme toutes les bourgeoisies, à une nouvelle aggravation considérable de la crise, la bourgeoisie de ce pays se trouve à l'heure actuelle confrontée au problème de la réunification (en fait de la «digestion» de l'Est par l'Ouest). Cette réunification est un véritable gouffre à milliards de DM. Le déficit de l'Etat s'est élevé vers des sommets rarement atteints dans ce pays «vertueux». Il s'agit donc pour la bourgeoisie de préparer la classe ouvrière à des attaques d'un niveau sans précédent afin de lui faire accepter le coût de la réunification, il importe de lui faire comprendre que c'en est fini des «vaches grasses» et qu'elle devra désormais faire des sacrifices très importants. C'est pour cela que les propositions salariales dans le secteur public (4,9 %), alors même que se sont déjà multipliées les taxes de toutes sortes, étaient inférieures à l'inflation. C'est le cheval de bataille qu'ont enfourché les syndicats témoignant d'une radicalité inconnue depuis des décennies, organisant des crèves tournantes massives (plus de 100 000 ouvriers par jour) qui ont provoqué certains jours un véritable chaos dans les transports et autres services publics (ce qui a eu comme conséquence d'isoler les grévistes des autres secteurs de la classe ouvrière). Après des revendications salariales de l'ordre de 9 %, les syndicats ont rabattu leurs prétentions à 5,4 %, présentant ce chiffre comme une « victoire » pour les travailleurs et une «défaite» pour Kohl. Evidemment, la majorité des ouvriers a considéré, après trois semaines de grève, que c était nettement insuffisant (plus 0,5% par rapport à la proposition d'origine, environ 20 DM par mois) et la popularité de la très médiatique Monika Mathies, présidente de l’ÖTV, y a laissé quelques plumes. Mais, pour la bourgeoisie, plusieurs objectifs importants avaient été atteints :
- mettre en évidence que, malgré une grève très massive et des actions «dures», il était impossible de faire fléchir la bourgeoisie dans sa volonté de limiter les hausses de salaire ;
- présenter les syndicats, qui avaient systématiquement organisé toutes les actions, maintenant les ouvriers dans la plus grande passivité, comme les véritables protagonistes de la lutte contre les patrons en même temps que l'assurance sociale à laquelle faut s'affilier pour que soient (payés les jours de grève (pendant a grève, les travailleurs taisaient la queue pour aller prendre leur carte syndicale qui les engage pour deux ans) ;
- renforcer encore un peu plus la division entre les ouvriers de l'Est et ceux de l'Ouest, les premiers ne comprenant pas que les seconds revendiquent des augmentations alors qu'à l'Ouest, les salaires sont nettement supérieurs et le chômage plus faible, les seconds n'ayant pas envie de payer pour les «ossies» qu'on se plaît à présenter comme des «paresseux» et des «incapables».
Dans les autres pays, l'image de l’«Allemagne modèle» a été quelque peu ternie par ces grèves. Mais la bourgeoisie s'est empressée d'enfoncer deux clous contre la conscience de la classe ouvrière :
- le mensonge que la grève des ouvriers allemands «privilégiés» vient encore aggraver la situation financière et économique de l'occident ;
- le message qu'il est illusoire de tenter de mener des luttes contre la dégradation des conditions d'existence, puisque, malgré toute leur force (et notamment celle des syndicats) et la prospérité de leur pays, les ouvriers d'Allemagne n’ont pas pu obtenir grand-chose,
Ainsi, la bourgeoisie la plus puissante d'Europe a donné le ton de l'offensive politique contre la classe ouvrière qui doit nécessairement accompagner des attaques économiques d'une brutalité sans précédent. Pour le moment, la manoeuvre a réussi mais l'ampleur qu'elle a prise est à l'image de la crainte que le prolétariat inspire à la bourgeoisie. Les événements de ces trois dernières années, et toutes les campagnes qui les ont accompagnés, ont affaibli de façon significative la combativité et la conscience au sein de la classe ouvrière. Mais celle-ci n'a pas dit son dernier mot. Avant même qu'elle n'ait renoué avec des luttes de grande envergure, sur son terrain de classe, tous les préparatifs de la classe dominante démontrent l'importance de ces combats à venir.
[1] [4] Comme le signale la résolution, l'Allemagne et la France n'attendent pas exactement la même chose de leur alliance. En particulier, ce dernier pays compte sur ses avantages militaires pour compenser son infériorité économique par rapport au premier afin de ne pas se retrouver en situation de vassal et de pouvoir revendiquer une sorte de «co-direction» d'une alliance des principaux Etats européens (à l'exception de la Grande-Bretagne, évidemment). C'est pour cela que la France n'est nullement intéressée à une présence allemande en Méditerranée qui dévaloriserait de façon très sensible l'importance de sa propre flotte dans cette mer ce qui la priverait a'un atout majeur dans les marchandages avec son «amie».
[2] [5] Il n'est pas exclu non plus que le soutien des Etats-Unis aux populations croates de Bosnie-Herzégovine actuellement victimes de la Serbie parvienne un jour à « démontrer ». La Croatie qu'elle a tout intérêt à troquer la «protection» allemande, qui s'est révélée d'une efficacité très limitée, contre une protection américaine beaucoup mieux pourvue en moyens de se faire respecter. De telles visées ne sauraient évidemment être absentes de la diplomatie américaine.
[3] [6] Voir notamment les articles dans la Revue Internationale n° 57 et 62.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [7]
Questions théoriques:
- Guerre [8]
Crise économique mondiale : une récession pas comme les autres
- 6495 reads
Sur le plan économique, le monde entier semble suspendu à une seule question : y aura-t-il une reprise aux Etats-Unis ? La locomotive qui a tiré l'économie mondiale depuis deux décennies aura-t-elle la force de redémarrer une fois encore ?
La réponse des économistes est évidemment: oui. Leur métier de gérants et porte-paroles idéologiques du système leur interdit, quoiqu il en soit, de penser autrement. La seule chose dont ils sont sûrs c'est que le capitalisme est éternel. Au-delà du royaume des marchands et de l'exploitation salariale, il ne peut y avoir que le néant. Même pour les plus cyniquement lucides d'entre eux, les pires difficultés de l'économie capitaliste mondiale ne peuvent jamais être que des contrariétés passagères, des secousses dues aux «nécessités du progrès», surmontables pour peu qu'on se donne les moyens des «changements structurels nécessaires». L'actuelle récession ouverte qui, depuis plus d'une année, a commencé a frapper les principales puissances économiques du monde, ne serait ainsi qu'un «ralentissement cyclique»; un naturel et salutaire mouvement de repli après une trop longue période d'expansion.
«Toute l'économie mondiale est en train de s'assainir après des années d'excès», déclarait Raymond Barre([1] [9]) en février 1992, au cours du Forum de l'économie mondiale de Davos.
Georges Bush et l'équipe chargée d'organiser son actuelle campagne électorale aux Etats-Unis vont plus loin : la récession toucherait, dés à présent, à sa in et une nouvelle reprise serait en cours. «Le vieil adage se vérifie : "Quand le bâtiment va, tout va "», déclarait Bush, à la mi-mai, citant des statistiques qui faisaient état d'une augmentation de la construction de logements aux Etats-Unis dans les premiers mois de 1992.
Mais la réalité historique se moque des rêves et souhaits des «responsables» de l'ordre établi. Quelques jours après cette déclaration optimiste de Bush, les statistiques officielles faisaient état d'une chute de 17 % de l'indice de construction de nouvelles maisons, la plus forte chute depuis 8 ans !
Les difficultés que connaît la bourgeoisie mondiale pour faire face a l'actuelle récession ouverte de son économie sont qualitativement nouvelles. Cette récession n'est pas comme les autres.
Des récessions de plus en plus destructrices
Il est vrai que depuis deux décennies l'économie mondiale, suivant à des degrés divers les mouvements de l'économie américaine, a connu une succession de récessions et de «reprises». Mais les récessions, depuis la fin des années 60, c'est-à-dire depuis la fin de la période de «prospérité » due à la reconstruction consécutive à la 2e guerre mondiale, ne suivent pas un mouvement cyclique analogue à la respiration d'un corps sain ; encore moins épousent-elles le rythme des crises cycliques du capitalisme dans la deuxième moitié du 19e siècle, en pleine phase ascendante du capitalisme, dont l'intensité allait en s'atténuant chaque dix ans. Les fluctuations de l'économie mondiale depuis 20 ans ne traduisent pas le mouvement cyclique d'une vie en expansion, mais les convulsions d un corps de plus en plus malade. Depuis la récession de 1967, les plongeons ont été chaque fois de plus en plus profonds et prolongés dans le temps. Le mouvement de la croissance de la production aux Etats-Unis, coeur du capitalisme mondial, est éloquent à cet égard (Voir Graphique 1 ci-contre).
Cet «électrocardiogramme» du centre du capitalisme ne traduit que partiellement la réalité. Dans les faits, après la récession de 1980-1982, il n'y a pas eu de véritable reprise de la croissance économique mondiale. Les pays du «tiers-monde» ne sont pas réellement parvenus à se relever. Les années 1980 sont, pour la plupart des pays sous-développés, synonyme du plus grand marasme économique de leur existence. Le continent africain, une grande partie de l'Asie et de l'Amérique Latine ont été économiquement dévastés au cours de cette période ; l'ex-URSS et les pays de son glacis connaissent depuis le milieu de cette décennie une plongée dans le chaos qui se concrétise par un des plus violents reculs économiques connus dans l'histoire. Ce n'est que dans la petite partie du monde, constituée par les pays les plus industrialisés de l'ancien bloc occidental, que l'économie connaît un certain développement au cours des années 1980. Et encore, ce développement ne se fait que dans certaines zones de ces pays : une véritable désertification industrielle a ravagé pendant ces années des régions qui comptaient parmi les plus anciennement industrialisées de la planète, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique ou aux Etats-Unis par exemple.
La récession qui frappe aujourd'hui les pays les plus industrialisés n'a donc rien à voir avec un répit salutaire dans un cours de croissance mondiale. Elle marque, au contraire, l'effondrement de la seule partie au monde qui avait relativement échappé au marasme général.
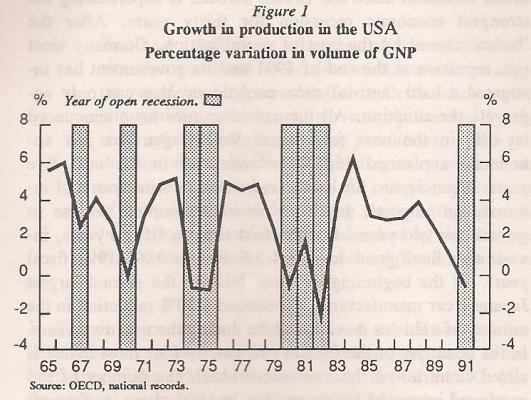
La machine à «relancer» l'économie ne répond plus
Mais, même malade, l'économie des pays les plus industrialisés peut-elle retrouver un minimum de croissance, comme ce fut le cas après les récessions précédentes ? Les gouvernements des grandes puissances peuvent-ils, encore une fois, faire redémarrer la machine en baissant les taux d'intérêt et en faisant tourner la planche à billets ? Le recours au crédit, au «produisons aujourd'hui ; on verra demain pour le paiement », peut-il encore permettre de s'en sortir en trichant, en repoussant les échéances ?
La bureaucratie de l'OCDE, grand chantre des vertus éternelles du système capitaliste et de la victoire du «libéralisme», annonçait fin 1991 l'imminence d'une «reprise modérée» ([2] [10]) Mais elle accompagnait cette «prévision» d'une réserve importante :
«Dans la plupart des grands pays, la croissance monétaire léthargique est à la fois involontaire et inhabituelle (,..)La contraction persistante de l'offre de crédits bancaires, qui paraît être à l'origine de ce ralentissement, pourrait constituer une menace pour la croissance (...) Les incertitudes dues au ralentissement actuel de la croissance monétaire posent un problème très difficile aux responsables.»
Ce qui est appelé ici «la croissance monétaire léthargique» n'est autre que la contraction du crédit bancaire, le «crédit crunch» pour employer le terme anglo-saxon devenu à la mode. La masse monétaire dont il est question est essentiellement celle constituée par les multiples formes de crédits bancaires. Sa contraction traduit essentiellement le refus, l'incapacité des banques d'ouvrir de nouveau le robinet de l'endettement pour faire redémarrer la machine productive, comme lors des récessions des deux dernières décennies.
Le recours sans limites au crédit par le passé, en particulier pendant les «années Reagan» se paie aujourd'hui en termes de banqueroutes. L'insolvabilité croissante des entreprises, et d'une grande partie des banques, interdit le remboursement d'un nombre toujours plus élevé de crédits, poussant chaque jour plus de banques au bord de la faillite. L'effondrement des caisses d'épargne américaines, à la fin des années 1980, n'était que le début de ce marasme. ([3] [11]) Dans ces conditions, les actuelles nouvelles facilités de crédit créées par l'Etat (baisse des taux d'intérêt, création monétaire) sont utilisées par les banques, non pas pour octroyer de nouveaux crédits mais pour tenter de renflouer leurs caisses et de réduire le déséquilibre de leurs bilans.
Lowell L. Bryan, un «éminent expert» américain du système bancaire et financier, affirmait en 1991, dans un livre au titre évocateur de Bankrupt (banqueroute) ([4] [12]) :
«C'est peut être 25 % du système bancaire [américain], représentant plus de 750 milliards de dollars en placements([5] [13]) qui a commencé à connaître des pertes tellement massives qu'il n'a d'autre choix que de se consacrer à se faire rembourser des crédits plutôt qu'à étendre le crédit. Qui plus est, les banques qui ne connaissent pas de problèmes de crédit deviennent évidemment à leur tour beaucoup plus prudentes »
Le Graphique 2 (voir page suivante) montre clairement la réalité de l'effondrement sans précédent de la croissance de la masse de crédits bancaires (en particulier à partir de 1990). Il met aussi en évidence la nouvelle impuissance du Gouvernement pour relancer la machine a crédit. Contrairement à ce qui se produit lors des récessions de 1967, 1970, 1974-75, 1980-82, l'augmentation de la masse monétaire créée directement par l'Etat (billets de la banque centrale et pièces de monnaie) ne provoque plus une augmentation de la masse des crédits bancaires. Le gouvernement américain a beau appuyer sur l'accélérateur, la machine bancaire ne répond plus.
«Nous avons créé un marché qui est efficace pour la destruction de notre économie. Notre système financier est sur le point de s'effondrer. La réglementation de notre système financier, et le contrat social qui le sous-tend, est en faillite», constate amèrement l'auteur de Bankrupt. Et ce constat résume bien la nouveauté qui fait que cette récession ouverte n'est pas comme les autres.
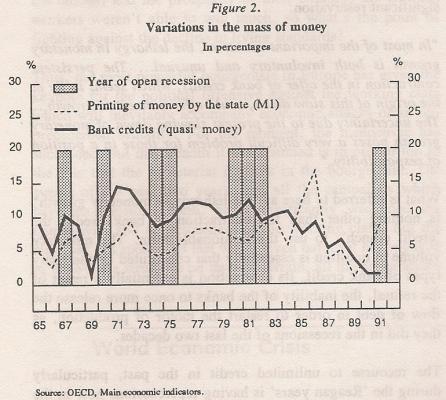
L'économie mondiale ne connaît pas un processus d' «assainissement» financier, mais le contrecoup destructeur de la plus grande période de spéculation de l'histoire du capitalisme. La machine qui a permis pendant des années de repousser les problèmes dans 'avenir est en morceaux, sans que pour autant le problème de fond, l'incapacité du capitalisme de créer ses propres débouches, soit résolu. Au contraire. Jamais le décalage entre ce que la société peut produire et ce qu'elle peut acheter n'a été aussi grand. ([6] [14])
Encore plus de chômage et de misère
Au niveau superficiel, les doses massives d'interventionnisme monétaire de l'actuelle administration Bush - perspective d'élections présidentielles oblige -peuvent provoquer des ralentissements de la chute dans des secteurs particuliers. La récente cascade de réductions du taux d'intérêt par la Fédéral Reserve (plus d'une vingtaine en quelques mois), a, par exemple, fini par enrayer momentanément la chute de la construction de logements. Mais tout cela demeure d'une fragilité extrême.
Les efforts désespérés du gouvernement américain pour limiter les dégâts, à la veille des élections, parviendront, dans le meilleur des cas, à ralentir la chute momentanément. Mais cela ne provoquera pas une véritable reprise ni un dépassement de la récession. Tout au plus cela entraînera un infléchissement momentané de la courbe descendante, une récession en «double dip», en double plongeon, comme ce fut le cas lors de la récession de 1980-1982, qui fut entrecoupée par la fausse reprise de 1981.
(Voir Graphique 1 ).
Les principales entreprises américaines, comme General Motors, IBM ou Boeing, continuent de licencier. Leurs plans de «restructuration», prévoient des dizaines de milliers de suppressions d'emplois (74 000 pour la seule General Motors) et sont prévus pour s'étaler pendant les trois ou cinq ans à venir. Cela en dit long sur la confiance qu'ont les gérants des plus grandes entreprises mondiales (et de pointe) dans es perspectives de reprise.
L'évolution de l'économie dans les autres grands pays industrialisés confirme la dynamique de recul. Le Royaume-Uni continue de s'enfoncer dans ce qui constitue déjà sa plus violente récession depuis les années 1930. La Suède connaît le plus puissant recul économique depuis 30 ans. L'Allemagne, après le «boom» provoqué par les dépenses dues à la réunification, est entrée en récession à la fin de l'année 1991 et son gouvernement met en place un puissant plan de «refroidissement anti-inflation» qui ne pourra qu'aggraver la situation. Tous les constructeurs automobiles y annoncent des suppressions d'emplois pour les années à venir : Volkswagen vient d'annoncer un plan de 15 000 licenciements pour les cinq prochaines années. Le Japon lui-même, victime du ralentissement des importations américaines et mondiales, ne cesse de voir sa croissance diminuer depuis deux ans. Pour la première fois en 15 ans, les investissements y diminuent (- 4,5 % pour l'année fiscale 1991-1992). Nissan, le deuxième constructeur automobile japonais, a annoncé début juin une réduction de 30 % du nombre de véhicules qui seront produits au cours des deux prochaines années. Dans l'ensemble de la zone de l'OCDE (les 24 pays les plus industrialisés de l'ex-bloc occidental) il y a eu 6 millions de chômeurs en plus au cours de la seule année 1991 et aucune prévision officielle ne se risque à prédire un véritable arrêt de l'hémorragie.
Pour la classe ouvrière mondiale, pour les exploités de la planète, cette récession n'est pas, non plus, comme les autres. La nouvelle aggravation du chômage et de la misère, qui frappe et frappera dans les années à venir, s'annonce elle aussi sans précédent. Elle s'abat, en outre, sur une classe qui vient de subir, au cours des années 1980, la plus violente attaque économique depuis la dernière guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est la partie centrale du prolétariat mondial, celle des pays les plus industrialisés, celle qui avait été relativement la moins frappée, qui se trouve en première ligne. La nouvelle recrudescence des difficultés du système met ainsi, une fois encore, la classe révolutionnaire devant ses responsabilités historiques.
RV, 10/6/92
[1] [15] « Le premier économiste de France » disait Giscard d'Estaing de cet ancien chef du gouvernement français.
[2] [16] Perspectives économiques n° 50, décembre 1991.
[3] [17] Voir en particulier l'article « Crise du crédit, relance impossible, une récession toujours plus profonde », dans la Revue Internationale n°68.
[4] [18] Bankrupt – Restoring the health and profitability of our banking svstem, HarperCollins Publishers.
[5] [19] Soit l'équivalent de la production totale de l'Espagne et de la Suisse en 1991.
[6] [20] Au mois de mai 1992, la presse mondiale publiait simultanément deux nouvelles : l'annonce par les Nations Unies que 60 millions d'êtres humains risquent de mourir de faim en Afrique cette année, et la notification par la CEE de sa décision de faire stériliser 15 % des terres cultivables en céréales en Europe, par manque d'acheteurs !
Récent et en cours:
- Crise économique [21]
Résolution sur la situation internationale : Le développement des conditions d'un resurgissement de la lutte de classe
- 2880 reads
Deux ans et demi après l'effondrement du bloc de l'Est et des régimes staliniens d'Europe, la situation mondiale continue d'être déterminée pour une grande part par cet événement historique considérable. En particulier, celui-ci a constitué un facteur d'aggravation sans précédent de la décomposition du capitalisme, notamment sur le plan des antagonismes impérialistes de plus en plus marqués par le chaos résultant de celle-ci. Cependant, la crise économique du mode de production capitaliste, en connaissant une très forte aggravation à l'heure actuelle, et en premier lieu dans les métropoles du capital, tend à revenir au centre de cette situation. En détruisant les illusions sur la « supériorité du capitalisme » déversées à profusion lors de la chute du stalinisme, mettant en évidence de façon croissante l'impasse dans laquelle se trouve ce système, obligeant la classe ouvrière à se mobiliser pour la défense de ses intérêts économiques face aux attaques de plus en plus brutales que la bourgeoisie est conduite à déchaîner, elle constitue un puissant facteur de dépassement des difficultés rencontrées par la classe ouvrière depuis l'effondrement du bloc de l'Est.
1) L'envahissement de l'ensemble de la vie du capitalisme par le phénomène de décomposition est un processus qui remonte au début des années 1980 et même à la fin des années 1970 (par exemple les convulsions en Iran débouchant sur la constitution d'une République «islamique» et la perte de contrôle de ce pays par son bloc de tutelle). L'agonie et la mort des régimes staliniens et l'effondrement du bloc impérialiste dominé par l'URSS sont une manifestation de ce processus. Mais, en même temps, ces faits historiques considérables ont provoqué une accélération énorme de celui-ci. C'est pour cela qu'on peut considérer qu'ils révèlent et marquent l'entrée u capitalisme dans une nouvelle phase de sa période de décadence, celle de la décomposition, de la même façon que la première guerre mondiale constituait la première convulsion de grande envergure résultant de l'entrée de ce système dans sa décadence et qui allait en amplifier de façon majeure les différentes manifestations.
Ainsi, l'effondrement des régimes staliniens d'Europe marque l'ouverture d'une période de convulsions catastrophiques dans les pays sur lesquels régnaient ces régimes. Mais c'est encore plus sur le plan des antagonismes impérialistes à l'échelle mondiale que s'expriment les caractéristiques de la nouvelle période, et notamment, au premier rang d'entre elles, le chaos. En effet, c'est bien le chaos qui permet le mieux de qualifier la situation présente des rapports impérialistes entre Etats.
2) La guerre du Golfe du début 1991 a constitué la première manifestation de grande ampleur de ce nouvel «état du monde» :
- elle résultait de la disparition du bloc de l'Est et des premières manifestations de son inéluctable conséquence, la disparition du bloc occidental lui-même ;
- elle constituait, de la part de la première puissance mondiale, une action de grande envergure afin de limiter ce dernier phénomène en contraignant les anciens alliés (en premier lieu, l'Allemagne, le Japon et la France) à manifester, sous la direction de cette puissance, leur «solidarité» face à la déstabilisation générale du monde ;
- par la barbarie sanglante qu'elle a engendrée, elle donnait un exemple de ce qui attend dorénavant l'ensemble de l'humanité ;
- malgré l'ampleur des moyens mis en oeuvre, elle n'a pu que ralentir, mais sûrement pas inverser les grandes tendances qui s'affirmaient dès la disparition du bloc russe : la dislocation du bloc occidental, les premiers pas vers la constitution d'un nouveau bloc impérialiste dirigé par l'Allemagne, l'aggravation du chaos dans les relations impérialistes.
3) La barbarie guerrière qui s'est déchaînée en Yougoslavie quelques mois à peine après la fin de la guerre du Golfe constitue une illustration particulièrement irréfutable de ce dernier point. En particulier, les événements qui se trouvent à l'origine de cette barbarie, la proclamation de l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, s'ils sont eux-mêmes une manifestation du chaos et de l'exacerbation des nationalismes qui caractérisent l'ensemble des zones dirigées auparavant par des régimes staliniens, n'ont pu avoir lieu que parce que ces nations étaient assurées du soutien de la première puissance européenne, l'Allemagne. Bien plus encore que son indiscipline lors de la crise du Golfe (voyage de Brandt à Bagdad avec la bénédiction de Kohl, l'action diplomatique de la bourgeoisie allemande dans les Balkans, qui visait à lui ouvrir un débouché stratégique sur la Méditerranée via une Croatie «indépendante» sous sa coupe, constitue le premier acte décisif de sa candidature à la direction d'un nouveau bloc impérialiste.
4) L'énorme supériorité militaire des Etats-Unis a l'heure actuelle, dont justement la guerre du Golfe a permis un étalage spectaculaire et meurtrier, contraint évidemment la bourgeoisie allemande à limiter considérablement ses ambitions pour le moment. Encore bridée sur le plan diplomatique et militaire (traités lui interdisant d'intervenir à l'extérieur de ses frontières, présence des troupes américaines sur son territoire), dépourvue notamment de l'arme atomique et d'une industrie d'armement de pointe, l'Allemagne ne se trouve qu'au tout début du chemin qui pourrait la conduire à constituer autour d'elle un nouveau bloc impérialiste. Par ailleurs, comme on l'a vu en Yougoslavie, la mise en avant par ce pays de ses nouvelles ambitions ne peut conduire qu'à accentuer la déstabilisation de la situation en Europe et donc à aggraver le chaos dans cette partie du monde ce qui, compte tenu de sa position géographique constitue, pour eux, plus encore que pour les principaux pays occidentaux, une menace de première importance (notamment sous la forme d'une immigration massive). C'est notamment pour cette raison que l'Allemagne continue de tenir sa place au sein de la structure de 'OTAN. Cette dernière, comme elle l'a annoncé elle-même à son sommet de Rome en automne 1991, n'a plus pour objectif de faire face à une puissance russe en pleine déconfiture mais de constituer un parapluie contre les convulsions en Europe de l'Est. La nécessaire fidélité de l'Allemagne envers l'OTAN ne peut que réduire de façon importante la marge de manoeuvre de ce pays à l'égard de la puissance américaine qui dirige cette structure.
5) Enfin, la nécessité pour l'Allemagne de se doter d'alliés de premier plan en Europe occidentale, et qui est une condition de son accession au rang de puissance mondiale, se heurte, pour le moment, à des difficultés importantes. Ainsi, au sein de la CEE, elle ne peut compter en aucune façon sur a Grande-Bretagne (oui est le meilleur allié des Etats-Unis) ni sur les Pays-Bas (que l'étroitesse des liens économiques avec leur grand voisin incitent justement à se tourner vers les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour ne pas devenir une simple province allemande et qui constituent, de ce fait, la tête de pont de ces puissances dans le Nord du continent européen). De tous les grands d'Europe, la France est le plus intéressé à des liens étroits avec l'Allemagne dans la mesure où elle ne peut prendre la place de lieutenant des Etats-Unis dans la sphère européenne que l'histoire, la communauté de langue et surtout la proposition géographique ont attribue de façon définitive à la Grande-Bretagne. Cependant, l'alliance franco-allemande ne saurait avoir la même solidité et stabilité que celle entre les deux puissances anglo-saxonnes dans la mesure où :
- les deux partenaires ne placent pas les mêmes espoirs dans leur alliance (l'Allemagne aspirant à une position dominante alors que la France voudrait conserver un statut d'alter ego, sa détention de l'arme atomique et de positions impérialistes en Afrique devant compenser son infériorité économique) ce qui peut aboutir à des positions diplomatiques divergentes, comme on l'a vu à propos de la Yougoslavie ;
- la puissance américaine a d'ores et déjà entrepris de faire payer très cher le manque de fidélité de la France (éviction du Liban, appui à l'entreprise de Hissen Habré au Tchad, soutien du FIS en Algérie, affaire Habache, etc.), afin de faire revenir ce pays à de «meilleurs sentiments».
6) Cependant, tant son énorme retard militaire actuel, que les embûches que la puissance américaine ne manquera pas de lui opposer, que le risque de provoquer une exacerbation du chaos, ne sauraient détourner l'Allemagne du chemin dans lequel elle s'est, dès à présent, engagée. L'inéluctable aggravation, avec la crise capitaliste elle-même, des antagonismes impérialistes, la tendance de ces antagonismes à déboucher sur le partage du monde en deux blocs impérialistes, la puissance économique et la place en Europe de ce pays, ne peuvent que le pousser toujours plus à poursuivre sa progression sur ce chemin, ce qui constitue un facteur d'instabilité supplémentaire dans le monde d'aujourd'hui.
Plus généralement, même si la menace du chaos constitue un facteur pouvant à certains moments refréner l'affirmation par les grandes puissances de leurs intérêts impérialistes propres, la tendance historique dominante du monde actuel est celle d'une exacerbation de leurs antagonismes, aussi catastrophique que puisse être cette exacerbation. En particulier, la détermination des Etats-Unis, affichée avec la guerre du Golfe, de jouer pleinement leur rôle de «gendarme du monde» ne pourra s'exprimer, en fin de compte, que par l'emploi croissant de la force militaire et le chantage au chaos, ce qui contribuera à aggraver encore ce dernier (comme l'illustre, notamment avec le problème Kurde, la situation du Moyen-Orient après cette guerre). Ainsi, quelles que soient les tentatives des grandes puissances pour y remédier, c'est bien le chaos qui dominera de plus en plus l'ensemble des rapports entre Etats dans le monde d'aujourd'hui, un chaos qui se trouve aussi bien à l'origine qu'à l'aboutissement des conflits militaires, un chaos qui ne pourra que se trouver amplifié par l'aggravation inéluctable de la crise du mode de production capitaliste.
7) La récession ouverte dans laquelle a plongé depuis deux ans la première puissance mondiale est venue sonner le glas de bien des illusions que s'était faites et avait propagées la bourgeoisie durant la majeure partie des années 1980. Les fameuses «reaganomics», qui avaient permis la plus longue période depuis les années 1960 de croissance continue des chiffres censés exprimer la richesse des pays (tel le PNB), se révèlent maintenant comme un échec cinglant qui a fait des Etats-Unis le pays le plus endetté de la terre et qui éprouve des difficultés croissantes à financer ses dettes. L'état de santé de l'économie américaine avec sa dette totale de 10 000 milliards de dollars, sa chute de 4,7 % des investissements en 1991 malgré une baisse historique des taux d'intérêt, son déficit budgétaire de 348 milliards de dollars pour 1992, constitue un indice significatif de la situation catastrophique dans laquelle se trouve 1’économie mondiale. Celle-ci, depuis la fin des années 1960, n'a réussi à faire face à la contraction inéluctable des marchés solvables que par une fuite en avant dans l'endettement généralisé. C'est ainsi que la forte récession mondiale de 1974-75 n'avait pu être surmontée que par l'injection massive de crédits dans les pays sous-développés et du bloc de l'Est, leur permettant pour une courte période, de relancer par leurs achats la production des pays industrialisés mais les conduisant rapidement à la cessation de paiements. La récession de 1981-82, qui constituait la conséquence inéluctable de cette situation, n'a pu à son tour être surmontée que par une nouvelle relance de l'endettement, non plus des pays périphériques, mais du premier d'entre eux. Le déficit commercial des Etats-Unis a servi de nouvelle «locomotive» à la production mondiale et la «croissance» interne de ce pays a été stimulée par des déficits budgétaires de plus en plus colossaux. C'est notamment pour cela que l'impasse économique dans laquelle se débat la bourgeoisie américaine revêt un tel caractère de gravité pour l'ensemble de l'économie mondiale. Désormais, le capitalisme ne peut plus compter sur la moindre «locomotive». Asphyxié par l'endettement, il pourra de moins en moins échapper, globalement et au niveau de chacun des pays, à la conséquence inéluctable de la crise de surproduction : une chute croissante de la production, la mise au rebut de secteurs de plus en plus vastes de l'appareil productif, une réduction drastique de la force de travail, des faillites en série, notamment dans le secteur financier, à côté desquelles celles de ces dernières années apparaîtront comme de petites péripéties.
8) Une telle perspective ne saurait être remise en cause par les bouleversements que vient de connaître l'économie clés pays anciennement autoproclamés «socialistes». Pour ces pays, les mesures de «libéralisation» et de privatisation n'ont fait qu'ajouter la désorganisation la plus complète et des chutes massives de la production au délabrement et à l'absence de productivité qui se trouvaient à 'origine de l'effondrement des régimes staliniens. Dès à présent, ou dans un très court terme, c'est la famine qui menace les populations d'un certain nombre d'entre eux. Ce qui attend la plupart de ces pays, et particulièrement ceux issus de la défunte URSS où les affrontements ethniques et nationalistes ne pourront encore qu'aggraver les choses, c'est une plongée dans le tiers-monde. Ainsi, il n’a pas fallu deux ans pour que se dissipent les illusions sur les «marchés» miraculeux qui étaient censés s'ouvrir à l'Est. Ces pays, déjà endettés jusqu'au cou, ne pourront pas acheter grand chose aux pays les plus développés et ces derniers, déjà confrontés à une crise des liquidités sans précédent, ne dispenseront qu'avec la plus extrême parcimonie leurs crédits à des économies qui apparaissent de plus en {dus comme des gouffres sans fond. Il n'y aura pas de « plan Marshall » pour les pays de l'Est, pas de réelle reconstruction de leur économie leur permettant de relancer un tant soit peu la production des pays les plus industrialisés.
9) L'aggravation considérable de la situation de l'ensemble de l'économie mondiale va se traduire par la poursuite et l'intensification a un niveau sans précédent des attaques capitalistes contre la classe ouvrière de tous les pays. Avec le déchaînement de la guerre commerciale, de la compétition pour des marchés de plus en plus restreints, les baisses des salaires réels et l'aggravation des conditions de travail (augmentation des cadences, économies sur la sécurité, etc.) vont côtoyer la réduction massive des prestations sociales (éducation, santé, pensions, etc.) et des effectifs au travail. Le chômage, dont la courbe a repris brutalement en 1991 un cours ascendant dans les principaux pays avancés (28 millions de chômeurs dans l'OCDE contre 24,6 millions en 1990) est destiné à dépasser de loin ses niveaux les plus élevés du début des années 1980. C'est une misère sordide, intenable, qui attend la classe ouvrière, non seule ment dans les pays moins développés mais aussi dans les plus riches d'entre eux. Le sort qui aujourd'hui accable les ouvriers des ex-pays «socialistes» indique aux ouvriers des métropoles d Occident la di rection vers où s'acheminent leurs conditions d'existence. Cependant, il serait totalement faux « de ne voir dans la misère que la misère», comme Marx le reprochait déjà à Proudhon. Malgré la somme tragique de souffrances qu'elle représente pour la classe ouvrière, et en bonne partie à cause d'elle, l'aggravation présente et à venir de la crise capitaliste porte avec elle la reprise des combats de classe et de la progression de la conscience dans les rangs ouvriers.
10) De façon paradoxale mais parfaitement explicable et prévue par le CCI depuis l'automne 1989, l'effondrement du stalinisme, c'est-à-dire du fer de lance de la contre-révolution qui a suivi la vague révolutionnaire du premier après-guerre, a provoque un recul très sensible de la conscience dans la classe ouvrière. Cet effondrement a permis un déchaînement sans précédent des campagnes sur le thème de la «mort du communisme», de la «victoire du capitalisme» et de la «démocratie» qui n'a pu qu'accentuer la désorientation de la grande majorité des ouvriers sur la perspective de leurs combats. Cependant, cet événement n'a eu qu’un impact limité, en durée et en profondeur, sur la combativité ouvrière, comme les luttes du printemps 1990 dans différents pays l'ont attesté. En revanche, à partir de l'été 1990, la crise et la guerre du Golfe, en développant un fort sentiment d'impuissance dans les rangs du prolétariat des pays les plus avancés (qui étaient tous impliqués, directement ou indirectement, dans l'action de la «coalition») ont constitué un facteur très important de paralysie de sa combativité. En même temps, ces derniers événements, en mettant à nu les mensonges sur le «nouvel ordre mondial», en dévoilant le comportement criminel des «grandes démocraties» et de tous les défenseurs patentés des «droits de l'homme», ont contribué à saper une partie de l'impact sur les consciences ouvrières des campagnes de la période précédente. C'est bien pour cette raison que les principaux secteurs de la bourgeoisie ont pris soin d'accompagner leurs «exploits» au Moyen-Orient d'un tel écran de mensonges, de campagnes médiatiques et de nouvelles opérations «humanitaires», notamment en faveur des Kurdes qu'ils avaient eux-mêmes livrés à la répression par le régime de Saddam Hussein.
11) Le dernier acte de cet ensemble d'événements affectant les conditions de développement de la conscience et de la combativité dans la classe ouvrière s'est joué à partir de l'été 1991 avec :
- le putsch manqué en URSS, la disparition de son parti dirigeant et la dislocation de ce pays ;
- la guerre civile en Yougoslavie.
Ces deux événements ont provoqué un nouveau recul de la classe ouvrière, tant au plan de sa combativité que de la conscience en son sein. S'il n'a pas eu un impact comparable à celui des faits de la seconde partie de 1989, l'effondrement du régime prétendument «communiste» en URSS et la dislocation du pays qui avait connu la première révolution prolétarienne victorieuse a attaqué plus en profondeur encore la perspective du communisme dans la conscience des masses ouvrières. En même temps, les nouvelles menaces d'affrontements militaires catastrophiques (y compris avec l'arme nucléaire) surgies de cette dislocation ont participé à accentuer le sentiment d'inquiétude impuissante en leur sein. Ce même sentiment a été amplifié par la guerre civile en Yougoslavie, à quelques centaines de kilomètres es grandes concentrations ouvrières d'Europe occidentale, dans la mesure où le prolétariat de celles-ci ne pouvait qu'assister en spectateur a des massacres absurdes et qu'il était obligé de s'en remettre au bon vouloir des gouvernements et des institutions internationales (CEE, ONU) pour qu'ils prennent fin. De plus, la conclusion (provisoire) de ce conflit, où les grandes puissances ont envoyé leurs troupes avec une «mission de paix» sous l'égide de l'ONU, n'a pu que redorer le blason, terni par la guerre du Golfe, des unes et de l'autre.
12) Les événements de Yougoslavie sont venus mettre en évidence la complexité du lien qui existe entre la guerre et la prise de conscience du prolétariat. Historiquement, la guerre a constitué un puissant facteur tant de la mobilisation que de la prise de conscience de la classe ouvrière. Ainsi, la Commune de Paris, la révolution de 1905 en Russie, celle de 1917 dans ce même pays, celle de 1918 en Allemagne étaient des résultats de la guerre. Mais en même temps, comme le CCI l'a mis en avant, la guerre ne crée pas les conditions les plus favorables à l'extension de la révolution à l'échelle mondiale. De même, la seconde guerre mondiale a démontré que, désormais, il était illusoire de miser sur un surgisse- ment du prolétariat au cours d'un conflit impérialiste généralisé et que celui-ci constituait. Au contraire, un facteur d'enfoncement de la classe dans la contre-révolution. Cependant, la guerre impérialiste n'a pas perdu pour autant sa capacité de mettre en relief aux yeux des prolétaires la nature profondément barbare du capitalisme décadent et des menaces qu'il fait courir à la survie de l'humanité, le comportement de gangsters des «hommes de bonne volonté» qui gouvernent le monde bourgeois et le fait que la classe ouvrière constitue la principale victime de ce type d'agissements. C'est pour cela que la guerre du Golfe a pu agir, partiellement, comme antidote au poison idéologique déversé au cours de l'année 989. Mais, aujourd'hui, pour que la guerre puisse avoir un tel impact positif sur la conscience des masses ouvrières, il est nécessaire que ces différents enjeux apparaissent clairement aux yeux des prolétaires, ce qui suppose :
- que ces derniers ne soient pas massivement embrigadés derrière les drapeaux nationaux (et c'est pour cette raison que les différents conflits qui déchirent les régions où régnait le stalinisme ne font qu'accentuer le désarroi des ouvriers qui s'y trouvent) ;
- que la responsabilité, dans la barbarie et les massacres, des Etats des pays avancés soit évidente et non masquée par les circonstances locales (conflits ethniques, haines ancestrales) ou des opérations «humanitaires» (comme les «missions de paix» de l'ONU).
Dans la période qui vient, ce n'est pas des affrontements comme ceux de la Yougoslavie ou du Caucase qu'il faut attendre une impulsion e la prise de conscience clans les masses ouvrières. En revanche, la nécessité pour les grandes puissances de s'impliquer de plus en plus de manière directe dans les conflits militaires va constituer un facteur important de prise de conscience dans les rangs ouvriers, particulièrement dans les secteurs décisifs du prolétariat mondial qui justement vivent dans ces pays.
13) Plus généralement, les différentes conséquences de l'impasse historique dans laquelle se trouve le mode de production capitaliste n'agissent pas dans la même direction du point de vue du processus de prise de conscience dans l'ensemble de la classe ouvrière. Ainsi, les caractéristiques spécifiques de la phase de décomposition, notamment le pourrissement sur pieds de la société et le chaos, constituent pour l'heure un facteur d'accroissement de la confusion dans la classe ouvrière. Il en est ainsi, par exemple, des convulsions dramatiques qui affectent l'appareil politique de la bourgeoisie dans les pays sortant du prétendu «socialisme réel» ou dans certain pays musulmans (montée de l’intégrisme). Dans les pays avancés également, les différents soubresauts qui secouent cet appareil politique, à une échelle bien moindre évidemment, et sans échapper au contrôle des forces bourgeoises dominantes (montée des mouvements xénophobes en France, en Belgique, dans l'Est de l'Allemagne, succès électoraux des partis régionalistes en Italie, des écologistes en France ou en Belgique), sont efficacement utilisés pour attaquer la conscience des ouvriers. En réalité, les seuls éléments qui agissent favorablement à la prise de conscience du prolétariat sont ceux qui appartiennent à la décadence dans son ensemble, et non spécifiquement à la phase de décomposition : la guerre impérialiste avec une participation directe des métropoles du capitalisme et la crise de l'économie capitaliste.
14) De même qu'il importe de sa voir distinguer la contribution des différents aspects de l'impasse tragique dans laquelle se trouve la société à la prise de conscience de l'ensemble de la classe ouvrière, il est nécessaire de discerner les diverses façons dont cette situation affecte chacun de ses secteurs. En particulier, il doit être clair, comme le CCI l'a mis en évidence depuis le début des années 1980, que le prolétariat des ex-pays «socialistes» est confronte à d'énormes difficultés dans sa prise de conscience. Malgré les terribles attaques qu'il a déjà subies et qu'il subira encore plus, malgré les combats, même de grande ampleur, qu'il va encore mener contre ces attaques, ce secteur de la classe ouvrière mondiale se distingue par sa faiblesse politique qui en fait une proie relativement facile pour les manoeuvres démagogiques des politiciens bourgeois. Ce n’est que 'expérience et l’exemple des combats des secteurs les plus avancés de la classe, notamment ceux d'Europe occidentale, contre les pièges les plus sophistiqués tendus par la bourgeoisie qui permettra aux ouvriers d'Europe de l'Est d'accomplir des pas décisifs dans le processus de prise de conscience.
15) De même, au sein de l'ensemble de la classe ouvrière mondiale, il importe d'établir également une claire distinction, pour ce qui concerne la façon dont les bouleversements depuis 1989 ont été perçus, entre les minorités d'avant-garde et les grandes masses du prolétariat. Ainsi, autant ces dernières ont subi de plein fouet la succession des différentes campagnes de la bourgeoisie, et ont été conduites de façon très sensible à se détourner de toute perspective de renversement du capitalisme, autant les mêmes événements et les mêmes campagnes ont provoqué un regain d'intérêt, une mobilisation à l'égard des positions révolutionnaires de la part des petites minorités qui ont refusé de se laisser entraîner et assourdir par les discours sur la «mort du communisme». C'est une nouvelle illustration du fait que contre le scepticisme, le désarroi et le désespoir que les différents aspects de la décomposition font peser sur l'ensemble de la société, et notamment sur la classe ouvrière, le seul antidote est constitué par l'affirmation de la perspective communiste. Cet accroissement récent de l'audience des positions révolutionnaires est également la confirmation de la nature du cours historique tel qu'il s'est développé à partir de la fin des années 1960, un cours aux affrontements de classe et non à la contre-révolution, un cours que les événements des dernières années, aussi néfastes qu'ils aient pu être en majorité pour la conscience du prolétariat, n'ont nullement pu renverser.
16) Et c'est bien parce que le cours historique n'a pas été renversé, parce que la bourgeoisie n'a pas réussi avec ses multiples campagnes et manoeuvres à infliger une défaite décisive au prolétariat des pays avancés et à l'embrigader derrière ses drapeaux, que le recul subi par ce dernier, tant au niveau de sa conscience que de sa combativité, sera nécessairement surmonté. Déjà, l'aggravation considérable de la crise capitaliste, et particulièrement dans les pays les plus développés, constitue un facteur de premier ordre de démenti de tous les mensonges sur le «triomphe» du capitalisme, même en l'absence de luttes ouvertes. De même, l'accumulation du mécontentement provoqué par la multiplication et l'intensification des attaques résultant de cette aggravation de la crise ouvrira, à terme, le chemin à des mouvements de grande ampleur qui redonneront confiance à la classe ouvrière, lui rappelleront qu'elle constitue, dès à présent, une force considérable dans la société et permettront à une masse croissante d'ouvriers de se tourner de nouveau vers la perspective du renversement du capitalisme. Il est évidemment encore trop tôt pour prévoir à quel moment prendront place de tels mouvements. Dans l'immédiat, les luttes ouvrières se situent à un des niveaux les plus bas depuis la dernière guerre mondiale. Mais ce dont il faut être certain c'est que, dès à présent, se développent en profondeur les conditions de leur surgissement ce qui doit inciter les révolutionnaires à une vigilance croissante afin qu'ils ne soient pas surpris par un tel surgissement et qu'ils soient préparés à intervenir en son sein pour y mettre en avant la perspective communiste.
CCI, 29/3/1992.
Vie du CCI:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [7]
1492 : « découverte de l'Amérique » : la bourgeoisie fête 500 ans de capitalisme
- 16012 reads
Avec un faste grandiose la classe dominante célèbre le 500éme anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. L'Exposition universelle de Séville, ville d'où est partie l'expédition qui allait atteindre pour la première fois les îles des Caraïbes, est le point d'orgue de ces réjouissances hyper médiatisées. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. La plus grande flotte de voiliers qui ait jamais traversé l'Atlantique, s'est élancée sur les traces de l'auguste découvreur ; plusieurs films ont été produits qui retracent l'épopée de Colomb ; des dizaines de livres, romans historiques et études universitaires ont été publiés pour raconter l'histoire de la découverte de l'Amérique, analyser la signification de l'événement ; sur les écrans de télévision du monde entier, des émissions sont consacrées à ce fait historique, la presse n'est pas en reste avec des centaines d'articles publiés. Rarement, un événement historique, que tous les écoliers étudient dans leurs livres d'histoire, aura polarisé autant de moyens dans sa célébration. Ce n'est pas un hasard.
L'arrivée de Christophe Colomb sur les côtes du Nouveau Monde ouvre les portes d'une période que les historiens de la classe dominante vont parer de toutes les vertus, qualifiant cette période historique, qui débute au milieu du 15éme siècle, de période des découvertes, de la Renaissance, car c'est celle qui voit le capitalisme s'imposer en Europe et commencer sa conquête du monde. Ce que fête la classe dominante, ce n'est pas seulement le 500éme anniversaire d'un fait historique particulièrement important, c'est, symboliquement, un demi millénaire de domination du capitalisme.
Une découverte rendue possible par le développement du capitalisme
Au 15e siècle, le vent qui gonfle les voiles des caravelles et les propulse vers de nouveaux horizons est celui du capitalisme mercantile à la recherche de nouvelles routes commerciales vers PInde et l'Asie, pour l'échange des épices et des soieries qui valent «plus que de l'or». Cela est tellement vrai que Colomb, jusqu'à sa mort en 1506, restera toujours persuadé que les rivages où ses navires ont accosté, sont ceux de l'Asie, de l'Inde qu'il cherchait obstinément à joindre en ouvrant une nouvelle route occidentale. Le nouveau continent dont il fit la découverte sans le savoir, ne portera jamais son nom, mais s'appellera Amérique, tiré du prénom du navigateur Amerigo Vespucci qui, le premier, établira, dans le compte-rendu de ses voyages publié en 1507, que les terres découvertes constituent un nouveau continent.
Il est aujourd'hui avéré que plusieurs siècles auparavant, les vikings ont déjà abordé les côtes de l'Amérique au nord, et il est même probable qu'à d'autres moments de l'histoire humaine, de hardis navigateurs ont déjà effectué la traversée de l'Atlantique d'Est en Ouest. Mais, ces «découvertes», parce qu'elles ne correspondaient pas, à ce moment-là, aux besoins du développement économique, sont restées méconnues, ont sombré dans l'oubli. Il n'en a pas été de même pour l'expédition de Colomb. La découverte de l'Amérique {par Christophe Colomb n'est pas le fruit du hasard, d'une simple aventure individuelle extraordinaire. Colomb n'est pas un aventurier isolé, il est un navigateur parmi bien d'autres qui s'élancent à l'assaut des océans. Elle est le produit des besoins du capitalisme qui se développe en Europe, elle s'insère dans un mouvement d'ensemble qui pousse les navigateurs à la recherche de nouvelles routes commerciales.
Ce mouvement d'ensemble trouve son origine dans les bouleversements économiques, culturels et sociaux qui secouent l'Europe avec la décadence de la féodalité et l'essor du capitalisme mercantile.
Depuis le 13e siècle, les activités de commerce, de banque et de finance se sont épanouies dans les républiques italiennes, qui ont le monopole du commerce avec l'Orient. «Dès le 15e siècle, les bourgeois des villes étaient devenus plus indispensables à la société que la noblesse féodale. (...) Les besoins de la noblesse elle-même avaient grandi et s'étaient transformés au point que, même pour que, les villes étaient devenues indispensables ; ne tirait-elle pas des villes le seul instrument de sa production, sa cuirasse et ses armes ? Les tissus, les meubles et les bijoux indigènes, les soieries d Italie, les dentelles du Brabant, les fourrures du Nord, les parfums d'Arabie, les fruits du Levant, les épices des Inaes, elle achetait tout aux citadins. Un certain commerce mondial s'était développé; les Italiens sillonnaient la Méditerranée et, au-delà, les côtes de l'Atlantique jusqu 'en Flandre ; malgré l'apparition de la concurrence hollandaise et anglaise, les marchands de la Hanse dominaient encore la mer du Nord et la Baltique. (...) Tandis que la noblesse devenait de plus en plus superflue et gênait toujours plus l'évolution, les bourgeois des villes, eux, devenaient la classe qui personnifiait la progression de la production et du commerce, de la culture et des institutions politiques et sociales »([1] [23])
Le 15e siècle est marqué par l'essor des connaissances qui signe le début de la Renaissance, caractérisée non seulement par la redécouverte des textes antiques, mais aussi par les merveilles d'Orient, comme la poudre, qu'introduisent en Europe les commerçants, et les nouvelles découvertes, comme l'imprimerie et le progrès des techniques de la métallurgie, ou du tissage, permises par le développement de l'économie. Un des secteurs qui sera le plus bouleversé par le développement des connaissances est celui de la navigation, secteur central pour le commerce dans la mesure où il en est le principal vecteur, avec l'invention de nouveaux types de navires, plus solides, plus grands, plus adaptés à la navigation océanique hauturière, et avec le développement d'une meilleure connaissance de la géographie et des techniques de navigation, «De plus, la navigation était une industrie nettement bourgeoise, qui a imprimé son caractère antiféodal même à toutes les flottes modernes.»([2] [24])
Dans le même temps, se sont créés et renforcés les grands Etats féodaux. Cependant, ce mouvement ne traduit pas le renforcement du féodalisme, mais sa régression, sa crise, sa décadence. «Il est évident que (...) la royauté était l'élément de progrès. Elle représentait l’ordre dans le désordre, la nation en formation en face de l’émiettement en Etats vassaux rivaux. Tous les éléments révolutionnaires, qui se constituaient sous la surface de la féodalité en étaient tout aussi réduits à s'appuyer sur la royauté que celle-ci en était réduite à s'appuyer sur eux.» ([3] [25])
L'extension de la domination ottomane sur le Moyen-Orient et l'est de l'Europe, concrétisée par là prise de Constantinople en 1453, débouche sur la guerre avec la République de Venise à partir de 463, et coupe aux commerçants italiens, qui en avaient le quasi-monopole, les routes du commerce fort rémunérateur avec l'Asie. La nécessité économique d'ouvrir de nouvelles routes de commerce vers les trésors des mythiques Indes, Cathay (Chine) et Cipango (Japon), et la perspective de mettre la main sur la source des richesses de Gênes et de Venise, vont constituer le stimulant qui va pousser les royaumes du Portugal et d'Espagne à financer des expéditions maritimes.
Ainsi, durant le 15e siècle, se sont réunies en Europe les conditions et les moyens qui vont permettre le développement de l'exploration maritime du monde :
- développement d'une classe mercantile et industrieuse, la bourgeoisie ;
- développement des connaissances et des techniques, concrétisées notamment sur le plan de la navigation ;
- formation des Etats qui vont soutenir les expéditions maritimes ;
- situation de blocage du commerce traditionnel avec l'Asie, qui va pousser à la recherche de nouvelles routes.
Depuis le début du 15e siècle, Henri le Navigateur, roi du Portugal, finance des expéditions le long des côtes de l'Afrique et y établit les premiers comptoirs (Ceuta en 1415). Dans la foulée, les îles au large de l'Afrique sont colonisées : Madère en 1419, les Açores en 1431, les îles du Cap-Vert en 1457. Ensuite, sous le règne de Jean II, le Congo est atteint en 1482, et le «cap des Tempêtes», futur cap de Bonne Espérance, franchi par Bartolomeo Diaz, ouvre la route des Indes et des épices que Vasco de Gama va suivre en 1498. L'expédition de Colomb est donc une parmi beaucoup d'autres. Dans un premier temps, il avait offert ses services aux Portugais, pour explorer une route occidentale d'accès aux Indes, mais ceux-ci, qui avaient vraisemblablement atteint Terre-Neuve en 1474, les avaient refusés, car ils privilégiaient la recherche d'une route qui contourne l'Afrique par le sud. De même que Colomb a profité de l'expérience des navigateurs portugais, sa propre expérience va bénéficier à John Cabot qui, au service de l'Angleterre, atteint le Labrador en 1496. Pinzon et Lope, pour le compte de l'Espagne, découvrent, en 1499, l'embouchure de l’Orénoque. Cabrai, en tentant de contourner l'Afrique, atteint, en 1500, les côtes du Brésil. En 1513, Balboa peut admirer les vagues de ce qui s'appellera l'océan Pacifique. Et, en 1519, s'élancera l'expédition de Magellan, qui réalisera le premier tour du monde.
«Mais ce besoin de partir au loin à l'aventure, malgré les formes féodales ou à demi féodales dans lesquelles il se réalise au début, était, a sa racine déjà, incompatible avec la féodalité dont la base était l'agriculture et dont les guerres de conquête avaient essentiellement pour but /'acquisition de la terre.»([4] [26])
Ce ne sont donc pas les grandes découvertes qui provoquent le développement du capitalisme, mais au contraire, le développement du capitalisme en Europe qui permet ces découvertes, que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan des techniques. Colomb, comme Gutenberg, est le produit du développement historique du capital. Cependant, ces découvertes seront un puissant facteur accélérateur du développement du capitalisme, et de la classe qu'il porte avec lui, la bourgeoisie.
«La découverte de l'Amérique, la circumnavigation de l'Afrique offrirent à la Bourgeoisie naissante un nouveau champ d'action. Les marchés des Indes orientales et de la Chine, la colonisation de l'Amérique, les échanges avec les colonies, l'accroissement des moyens d'échange et des marchandises en général donnèrent au commerce, à la navigation, à l'industrie un essor inconnu jusqu'alors ; du même coup, ils hâtèrent le développement de l'élément révolutionnaire au sein d'une société féodale en décomposition.»([5] [27])
«Les grandes découvertes géographiques ont provoqué, aux 16e et 17 siècles, de profonds bouleversements dans le commerce et accéléré le développement du capital marchand. Il est certain que le passage du mode féodal au mode capitaliste de production en fut lui aussi accéléré, et c'est précisément ce fait qui est à l'origine de certaines conceptions foncièrement erronées. La soudaine extension du marché mondial, la multiplication des marchandises en circulation, la rivalité entre les nations européennes pour s'emparer des produits d'Asie et des trésors d'Amérique, le système colonial enfin, contribuèrent largement à libérer la production de ses entraves féodales. Cependant, dans sa période manufacturière, le mode de production moderne apparaît seulement là où les conditions appropriées se sont formées pendant le moyen Age, que l'on compare la Hollande avec le Portugal, par exemple. Si, au 16e siècle, voire, en partie du moins, au 17e siècle, l'extension soudaine du commerce et la création d'un nouveau marché mondial ont joué un rôle prépondérant dans le déclin de l'ancien mode de production et dans l'essor de la production capitaliste, c'est parce que, inversement, cela s'est produit sur la base du mode de production capitaliste déjà existant. D'une part, le marché mondial constitue la base du capitalisme; de l'autre, c'est la nécessité pour celui-ci de produire à une échelle constamment élargie qui l'incite à étendre continuellement le marché mondial : ici, ce n'est pas le commerce qui révolutionne l'industrie, mais l'industrie qui révolutionne constamment le commerce »([6] [28])
«L'extension du commerce, par suite de la découverte de l'Amérique et de la route maritime des Indes orientales, donna un essor prodigieux à la manufacture et, d'une façon générale, au mouvement de la production. Les nouveaux produits importés de ces régions et, en particulier, les masses d'or et d'argent jetées dans la circulation, modifièrent radicalement la position mutuelle des classes et portèrent un rude coup à la propriété foncière féodale et aux travailleurs ; les expéditions d'aventuriers, la colonisation et, avant tout, la possibilité donnée aux marchés de s'étendre chaque jour, jusqu'à s'amplifier en marché mondial, suscitèrent une nouvelle phase de l'évolution historique.»([7] [29])
De fait, en 1492, avec la découverte de l'Amérique, symboliquement une page se tourne dans 1’histoire de l'humanité. Une nouvelle époque s'ouvre, celle où le capitalisme entame sa marche triomphale vers la domination du monde. «Le commerce mondial et le marché mondial inaugurent au 16e siècle la biographie moderne du capitalisme.» «L'histoire moderne du capital date de la création du commerce et du marché des deux mondes au 16e siècle. » « Bien que les premières ébauches de la production capitaliste aient été faites de bonne heure dans quelques villes de la Méditerranée, l'ère capitaliste ne date que du 16e siècle. » ([8] [30]) C'est l'ouverture de cette ère nouvelle, celle de sa domination, celle du début de la construction du marché mondial capitaliste, que la bourgeoisie fête avec tant de faste aujourd'hui. «La grande industrie a fait naître le marché mondial que la découverte de l'Amérique avait préparé. Le marché mondial a donné une impulsion énorme au commerce, à la navigation, aux voies de communication. En retour, ce développement a entraîné l'essor de l'industrie. A mesure que l'industrie, le commerce, la navigation, les chemins de fer prirent de l'extension, la bourgeoisie s'épanouissait, multipliant ses capitaux et refoulant à l'arrière-plan toutes les classes léguées par le Moyen Age.»([9] [31])
Avant les grandes découvertes du 15e et 16e siècle, évidemment les Incas ou les Aztèques ne sont pas connus, mais les civilisations des Indes, de la Chine, ou du Japon le sont à peine plus, le plus souvent de manière purement mythique, où l'affabulation l'emporte sur la connaissance réelle. La découverte de l'Amérique signe la fin d'une période de l'histoire marquée par le développement multipolaire de civilisations qui s'ignorent, ou communiquent à peine par un commerce relativement restreint. Ce ne sont pas seulement de nouvelles routes maritimes qui sont explorées, ce sont des voies de commerce qui s'ouvrent aux marchandises européennes. Le développement du commerce porte la fin des civilisations séculaires qui se sont développées en dehors de l'Europe, «Par suite du perfectionnement rapide des instruments de production et grâce à l'amélioration incessante des communications, la bourgeoisie précipite dans la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bas prix de ses marchandises est la grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares le plus opiniâtrement xénophobes».([10] [32]) «En exploitant le marché mondial, la bourgeoisie a donné une forme cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. (...) Les produits industriels sont consommés non seulement dans le pays même, mais dans toutes les parties du monde. Les anciens besoins, satisfaits par les produits indigènes, font place à de nouveaux lui réclament pour leur satisfaction es produits des pays et des climats les plus lointains. L'ancien isolement et l'autarcie locale et nationale font place à un trafic universel, une interdépendance universelle des nations. Et ce qui est vrai de la production matérielle ne l'est pas moins des productions de l'esprit. Les oeuvres spirituelles des diverses nations deviennent un bien commun. Les limitations et les particularismes nationaux deviennent de plus en plus impossibles, et les nombreuses littératures nationales et locales donnent naissance à une littérature universelle.» ([11] [33]) Voilà le rôle éminemment révolutionnaire qu'a joué la bourgeoisie : elle a unifié le monde. En saluant comme elle le fait aujourd'hui la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, premier pas significatif de cette unification par la création du marché mondial, elle célèbre en fait sa propre gloire.
La bourgeoisie aime à honorer ce 16e siècle qui voit son affirmation en Europe et qui annonce sa domination mondiale à venir, celui de la Renaissance, des grandes découvertes, de la floraison des Arts et des connaissances. La classe dominante aime à se reconnaître dans ces hommes de la Renaissance qui symbolisent et annoncent l'élan prodigieux de la technique qui va se concrétiser dans le développement tumultueux des forces productives que va permettre le capitalisme. Elle salue en eux la quête d'universalité qui est sa propre caractéristique qu'elle va imposer au monde en le façonnant à sa propre image. Et c'est une des plus belles images qu'elle puisse donner d'elle-même. Une de celles qui caractérise le mieux le progrès qu'elle a incarné pour l'humanité.
Mais toute médaille a son revers, et au revers de la belle aventure de Colomb qui découvre le Nouveau Monde, il y a la colonisation brutale, l'asservissement impitoyable des indiens, la réalité du capitalisme comme système d'exploitation et d'oppression. Les trésors issus des colonies qui refluent vers la mère patrie pour y fonctionner comme capital sont extorqués «par le travail forcé des indigènes réduits à l'esclavage, par la concussion, le pillage et le meurtre.» ([12] [34])
Colonisation de l'Amérique : la barbarie capitaliste à l'oeuvre
Le capitalisme n'a pas seulement créé les moyens techniques et accumulé les connaissances qui ont rendu possible le voyage de Colomb et la découverte de l'Amérique. Il a aussi fourni le nouveau Dieu, l'idéologie qui va pousser de l'avant les aventuriers qui s'élancent à la conquête des mers.
Ce n'est pas le goût de la découverte qui pousse Colomb de l'avant, c'est l'appât du gain : «L'or est la meilleure chose au monde, il peut même envoyer les âmes au paradis » déclare-t-il, tandis que Cortez surenchérit : «Nous, Espagnols, nous souffrons d'une maladie de coeur dont l'or est le seul remède »
«C'est l'or que les Portugais cherchaient sur la côte d'Afrique, aux Indes, dans tout l'Extrême-Orient ; c'est l'or le mot magique qui poussa les Espagnols à franchir l'océan Atlantique pour aller vers l'Amérique; l’or était la première chose que demandait le blanc, dès qu'il foulait un rivage nouvellement découvert. »([13] [35])
«D'après le rapport de Colomb, le Conseil de Castille résolut de prendre possession d'un pays dont les habitants étaient hors d état de se défendre. Le pieux dessein de le convertir au christianisme sanctifia l'injustice du projet. Mais l'espoir d'y puiser des trésors fut le vrai motif qui décida l'entreprise. (...) Toutes les autres entreprises des Espagnols dans le Nouveau Monde postérieures à celles de Colomb paraissent avoir eu le même motif. Ce fut la soif sacrilège de l'or (...) » ([14] [36]) La grande oeuvre civilisatrice du capitalisme européen prend d'abord la forme a'un génocide. Au nom de cette «soif sacrilège de l'or», les populations indiennes vont être soumises au pillage, au travail forcé, à l'esclavage dans les mines, décimées par les maladies importées par les Conquistadores : syphilis, tuberculose, etc. Las Casas estimait qu'entre 1495 et 1503, plus de trois millions d'hommes avaient disparu sur les îles, massacrés dans la guerre, envoyés comme esclaves en Castille ou épuisés dans les mines ou par d autres travaux : « Qui parmi les générations futures croira cela? Soi-même qui écrit ces lignes, qui j’ai vu de mes yeux et qui n’en ignore rien, je peux difficilement croire qu'une telle chose ait été possible. » En un peu plus d'un siècle, la population indienne va être réduite de 90 % au Mexique, chutant de 25 millions à 1 million et demi, et de 95 % au Pérou. Le trafic d'esclaves, à partir de l'Afrique, va se développer pour compenser le manque de main-d'oeuvre qui découle du massacre. Tout au long du 16e siècle, des centaines de milliers de nègres vont être déportés pour repeupler l'Amérique. Ce mouvement va encore s'intensifier aux siècles suivants. A cela, il faut ajouter l'envoi de milliers d'européens condamnés aux travaux forcés dans les mines et les plantations d'Amérique. «La découverte des contrées aurifères et argentifères de l'Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, la transformation de l'Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés idylliques d'accumulation primitive qui signalent l'ère capitaliste à son aurore.»([15] [37])
Les milliers de tonnes d'or et d'argent qui se déversent en Europe, en provenance des colonies américaines, et qui vont servir à financer le gigantesque essor du capitalisme européen, sont souillés du sang de millions d'esclaves. Mais cette violence qui caractérise l'entreprise coloniale capitaliste n'est pas réservée en propre à la conquête des terres lointaines, elle caractérise le capitalisme dans tous les aspects de son développement, y compris dans sa terre d'élection l'Europe.
En Europe, le capitalisme s'impose avec la même violence
Les mêmes méthodes utilisées sans retenue pour l'exploitation forcenée des indigènes dans les colonies d'Amérique, d'Afrique et d'Asie sont employées en Europe, pour arracher les paysans à la terre, et les transformer en esclaves salariés dont l'industrie manufacturière en plein essor a besoin. La période de a Renaissance, que la bourgeoisie se plaît à nous présenter sous le jour aimable de la multiplication des découvertes et de l'épanouissement artistique, est, pour des millions de paysans et de travailleurs, celle de la terreur et de la misère.
Le développement du capitalisme se caractérise en Europe par le mouvement d'expropriation des terres ; des millions de paysans vont être jetés sur les routes. «L'expropriation des producteurs immédiats s'exécute avec un vandalisme impitoyable qu'aiguillonnent les mobiles les plus infâmes, les passions les plus sordides et les plus haïssables dans leur petitesse. »([16] [38]) «Les actes de rapine, les atrocités, les souffrances...depuis le dernier tiers du 15e siècle jusqu'à la fin du 18e, forment le cortège de l'expropriation violente des cultivateurs. »([17] [39]) «La spoliation des biens d'église, l'aliénation frauduleuse des domaines de l'Etat, le pillage des terrains communaux, la transformation usurpatrice et terroriste de la propriété féodale ou même patriarcale en propriété moderne privée, la guerre aux chaumières, voilà les procédés idylliques de l'accumulation primitive. Ils ont conquis la terre à l'agriculture capitaliste, incorporé le sol au capital et livré à l'industrie des villes les bras dociles d'un prolétariat sans feu ni lieu. »([18] [40])
« Ainsi il arrive qu'un glouton avide et insatiable, un vrai fléau pour son pays natal, peut s'emparer de milliers d'arpents de terre en les entourant de pieux ou de haies, ou en tourmentant leurs propriétaires par des injustices qui les contraignent à vendre. De façon ou d'autre, de gré ou de force, il faut qu'ils déguerpissent, tous, pauvres gens, coeurs simples, hommes, femmes, époux, orphelins, veuves, mères avec leurs nourrissons et tout leur avoir ; peu de ressources, mais beaucoup de têtes, car l'agriculture a besoin de beaucoup de bras. Il faut qu'ils traînent leurs pas loin de leurs anciens foyers, sans trouver un lieu de repos. Dans d'autres circonstances, la vente de leur mobilier et de leurs ustensiles domestiques eût pu les aider, si peu qu'ils valent ; mais, jetés subitement dans le vide, ils sont forcés de les donner pour une bagatelle. Et, quand ils ont erré çà et là et mangé jusqu'au dernier liard, que peuvent-ils faire autre chose que de voler, et alors, mon Dieu ! d'être pendu avec toutes les formes légales, ou d'aller mendier ? Et alors encore on les jette en prison comme des vagabonds, parce qu'ils mènent une vie errante et ne travaillent pas, eux auxquels personne au monde ne veut donner du travail, si empressés qu'ils soient à s'offrir pour tout genre de besogne. »([19] [41])
«La création d'un prolétariat sans feu ni lieu - licenciés des grands seigneurs féodaux et cultivateurs victimes d'expropriations violentes et répétées - allait nécessairement plus vite que son absorption par les manufactures naissantes. (...) Il en sortit donc une masse de mendiants de voleurs, de vagabonds. De là vers la fin du 15e siècle et pendant tout le 16e, dans l'ouest de l'Europe, une législation sanguinaire contre le vagabondage. Les pères de la classe ouvrière actuelle furent châtiés d'avoir été réduits à l'état de vagabonds et de pauvres.»([20] [42]) Châtiés et de quelle manière ! En Angleterre, sous le règne de Henri VIII (1509-1547), les vagabonds robustes sont condamnés au fouet et à l'emprisonnement. A la première récidive, en plus du fouet de nouveau appliqué, le vagabond a la moitié de l'oreille coupée ; à la seconde récidive, il sera considéré comme félon et exécuté, comme ennemi de l'Etat. Sous le règne de ce roi, 72 000 pauvres hères furent exécutés. Sous son successeur Edouard VII, en 1547, un statut ordonne que tout individu réfractaire au travail sera adjugé comme esclave à la personne qui l'aura dénoncé comme truand. En cas d'une première «absence» de plus de quinze jours, il sera marqué d'un « S » au fer rouge sur la joue et le front, et condamné à l'esclavage à perpétuité ; la récidive, c'est la mort. «Sous le règne aussi maternel que virginal de queen Bess" (la reine Elisabeth, 1572), on pendit les vagabonds par fournées, rangés en longues files. Il ne se passait pas d'année qu'il n'y en eût 300 ou 400 d'accrochés à la potence dans un endroit ou dans un autre. » ([21] [43]) En France, à la même époque, «tout homme sain et bien constitué, âgé de 16 à 60 ans, et trouvé sans moyens d'existence et sans profession, devait être envoyé aux galères ». « Il en est de même du statut de Charles Quint pour les Pays-Bas (1537).»
«C'est ainsi que la population des campagnes, violemment expropriée et réduite au vagabondage, a été rompue à la discipline qu'exige le système du salariat par des lois d'un terrorisme grotesque, par le fouet, la marque au fer rouge, la torture et l'esclavage. »([22] [44])
«Dans tous les pays développés, jamais le nombre de vagabonds n'avait été aussi considérable que dans la première moitié du 16e siècle. De ces vagabonds, les uns s'engageaient pendant les périodes de guerre, dans les armées; d'autres parcouraient le pays en mendiant ; d'autres enfin s efforçaient, dans les villes, de gagner misérablement leur vie par des travaux à la journée ou d’autres occupations non accaparées par les corporations.»([23] [45]) Les paysans spoliés de leurs terres, jetés sur les routes ne vont donc pas seulement être réduits à la mendicité ou obligés de se soumettre à l'esclavage salarié. Ils vont aussi être abondamment employés comme chair à canon. Ces canons et escopettes infiniment plus destructeurs que les piques, épées, masses, arcs et arbalètes des guerres féodales antérieures, réclament une masse toujours plus importante de soldats à sacrifier à l’appétit sanglant du capitalisme naissant ; les progrès scientifiques et technologiques de la Renaissance vont être amplement utilisés dans le perfectionnement des armes et leur production de plus en plus massive. Le 16e siècle est un siècle de guerre : « les guerres et les dévastations étaient des phénomènes quotidiens à l'époque. »([24] [46]) Guerres de conquêtes coloniales, mais aussi et surtout guerres en Europe même : guerres « italiennes » du roi de France, François 1er; guerre des Habsbourg contre les Turcs qui font le siège de Vienne en 1529 et seront défaits par la marine espagnole à la bataille de Lépante en 1571 ; guerre d'indépendance des Pays-Bas contre la domination espagnole à partir de 1568 ; guerre entre 'Espagne et l'Angleterre qui aboutit en 1588 à l'anéantissement par la marine anglaise de la grande Armada espagnole, la plus grande flotte de guerre réunie jusque là; guerres multiples entre les princes allemands ; guerres de religion, etc. Ces guerres sont le produit des bouleversements qui secouent l'Europe avec le développement du capitalisme.
«Même dans ce que l’on appelle les guerres de religion du 16e siècle, il s'agissait avant tout de très positifs intérêts matériels de classe, et ces guerres étaient des luttes de classes, tout autant que les collisions intérieures qui se produisirent plus tard en Angleterre et en France. » ([25] [47]) L'acharnement que vont mettre les Etats nationaux, tout juste sortis du Moyen Age, les princes féodaux et les nouvelles cliques bourgeoises à s'affronter derrière l'étendard des religions, ils vont cependant savoir l'oublier lorsqu'il s agit de réprimer avec la plus extrême férocité les révoltes paysannes que la misère soulève. Face à la guerre des paysans en Allemagne, « Bourgeois et princes, noblesse et clergé, Luther et le Pape s'unirent "contre les bandes paysannes, pillardes et tueuses "([26] [48]). "Il faut les mettre en pièces, les étrangler, les égorger, en secret et publiquement, comme on abat des chiens enragés !" s'écria Luther. » «"C'est pourquoi, mes chers seigneurs, égorgez-les, abattez-les, étranglez-les, libérez ici, sauvez là ! Si vous tombez dans la lutte, vous n'aurez jamais de mort plus sainte !" »([27] [49])
Le 16e siècle n'est pas le siècle d'une liberté naissante comme aime à le faire croire la bourgeoisie. Il est celui d'une nouvelle oppression qui s'installe sur les décombres du féodalisme en déliquescence, celui des persécutions religieuses et de la répression sanglante des révoltes plébéiennes. Ce n'est certainement pas un hasard si la même année où le nouveau monde est découvert, 1492, l'Inquisition est fondée en Espagne. Dans ce pays, des millions de juifs et de musulmans seront christianisés de force et poussés vers l'exode pour fuir la mort qui menace ceux qui résistent. Mais cela n'est pas propre à une Espagne encore profondément marquée par les stigmates du féodalisme représenté par un christianisme catholique intransigeant qui constitue son pendant idéologique ; dans toute l'Europe, les massacres religieux, les pogroms sont monnaie courante, la persécution des minorités religieuses ou raciales une constante, et l'oppression des masses la règle. A l'horreur de l'Inquisition répond en écho la rage de Luther contre les paysans insurgés d'Allemagne : «Les paysans ont de la paille d'avoine dans la tête; ils n'entendent point les paroles de Dieu, ils sont stupides ; c'est pourquoi il faut leur faire entendre le fouet, l arquebuse et c'est bien fait pour eux. Prions pour eux qu'ils obéissent. Sinon, pas de pitié!». Voila comment parlait le père de la Réforme, la nouvelle idéologie religieuse derrière laquelle s'avançait la bourgeoisie dans sa lutte contre le catholicisme féodal.
C'est à ce prix, par ces moyens, que le capitalisme impose sa loi qui permet, en sapant les bases de 'ordre féodal, de libérer les forces productives, de produire des richesses comme jamais l'humanité n'en avait rêvé. Mais si le 16e est une période d'enrichissement gigantesque pour les bourgeois commerçants et les Etats, il n'en est pas de même pour les ouvriers. «Au 16e siècle, la situation des travailleurs s'était, on le sait, fort empirée. Le salaire nominal s'était élevé, mais point en proportion de la dépréciation de l'argent et de la hausse correspondante du prix des marchandises. En réalité, il avait donc baissé. »([28] [50]) En Espagne, les prix sont multipliés par trois ou quatre entre 1500 et 1600 ; en Italie le prix du blé est multiplié par 3,3 entre 1520 et 1599 ; entre le premier et le dernier quart du 16e siècle, les prix sont multipliés par 2,6 en Angleterre et par 2,2 en France. La baisse du salaire réel qui en découle durant cette période est estimée à 50 % ! La bourgeoisie mercantile et les princes régnants s'étaient vite chargés de concrétiser l'idée de Machiavel selon laquelle « Dans un gouvernement bien organisé, l'Etat doit être riche et le citoyen pauvre. » ([29] [51])
« Tantae molis erat ! (Qu'il a fallu de peines) Voilà de quel prix nous avons payé nos conquêtes ; voilà ce qu'il en a coûté pour dégager les « lois éternelles et naturelles » de la production capitaliste (...) chef-d'oeuvre de l'art, création sublime de l'histoire moderne. Si, d'après Augier, c'est "avec des taches naturelles de sang sur une de ses faces" que "l'argent est venu au monde", le capital y arrive suant le sang et la boue par tous les pores. » ([30] [52])
«Les différentes méthodes d'accumulation primitive que l'ère capitaliste fait éclore, se partagent d'abord, par ordre plus ou moins chronologique, entre le Portugal, l'Espagne, la Hollande, la France et l Angleterre, jusqu'à ce que celle-ci les combine toutes, au dernier tiers du 17é siècle, dans un ensemble systématique, embrassant à la fois le régime colonial, le crédit public, la finance moderne et le système protectionniste. Quelques unes de ces méthodes reposent sur l'emploi de la force brutale, mais toutes sans exception exploitent le pouvoir de l'Etat, la force concentrée et organisée de la société, afin de précipiter violemment le passage de l’ordre économique féodal à l’ordre économique capitaliste et d'abréger les phases de transition. Et, en effet, la force est l'accoucheuse de toute vieille société en travail. La force est un agent économique.»([31] [53]) Rosa Luxemburg, à propos des relations entre le capital et les modes de production non capitalistes qui ont «le monde entier pour théâtre », constate :
«Les méthodes employées sont la politique coloniale, le système des emprunts internationaux, la politique des sphères d'intérêts, la guerre. La violence, l'escroquerie, oppression, le pillage se déploient ouvertement, sans masque, et il est difficile de reconnaître les lois rigoureuses du processus économique dans l'enchevêtrement des violences et des brutalités politiques. La théorie libérale bourgeoise n'envisage que l'aspect unique de la "concurrence pacifique", des merveilles de la technique et de l'échange pur de marchandises ; elle sépare le domaine économique du capital de l'autre aspect, celui des coups de force considérés comme des incidents plus ou moins fortuits de la politique extérieure. En réalité, la violence politique est, elle aussi, l'instrument et le véhicule du processus économique; la dualité des aspects de l'accumulation recouvre un même phénomène organique, issu des conditions de la reproduction capitaliste. La carrière historique du capital ne peut être appréciée qu'en fonction de ces deux aspects. Le capital n 'est pas qu 'à sa naissance "dégouttant de sang et de boue par tous les pores", mais pendant toute sa marche à travers le monde; c'est ainsi qu'il prépare, dans des convulsions toujours plus violentes, son propre effondrement. »([32] [54])
Les humanistes bourgeois d'aujourd'hui qui célèbrent avec ferveur et enthousiasme la découverte de l'Amérique voudraient faire croire que la brutalité extrême de la colonisation qui a suivi ne serait qu'un excès du capitalisme naissant, marqué par sa forme mercantile et empêtré dans les rets du féodalisme brutal de l'Espagne, un péché de jeunesse en quelque sorte. Mais cette violence est loin d'avoir été seulement l'apanage des espagnols et des portugais. Ce que les conquistadores ont commencé, les hollandais, les français, les anglais, et la jeune démocratie nord- américaine qui naît de la guerre d'indépendance contre le colonialisme anglais à la fin du 18e siècle, vont le poursuivre : l'esclavagisme durera jusqu'au milieu du 19e siècle, et le massacre des indiens jusqu'à la fin de ce même siècle en Amérique du nord. Et cette violence, comme on l'a vu, n'a pas été réservée au domaine colonial, elle a été générale et marque de son empreinte indélébile toute la vie du capital. Elle s'est perpétuée au-delà de la phase mercantile du capitalisme dans le développement brutal de la grande industrie. Les méthodes expérimentées dans les colonies vont servir à intensifier l'exploitation dans les métropoles. «Dans le même temps que l'industrie cotonnière introduisait en Angleterre l'esclavage des enfants, aux Etats-Unis eue transformait le traitement plus ou moins patriarcal des noirs en un système d'exploitation mercantile. En somme, il fallait pour piédestal à l'esclavage dissimulé des salariés en Europe l esclavage sans phrase dans le Nouveau Monde. »([33] [55])
Mais ce n'est évidemment pas ces hauts faits d'armes, ce massacre impitoyable, cette rapacité criminelle que la bourgeoisie veut fêter avec le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Cette réalité barbare du capitalisme, cette empreinte de « boue et de sang » qui marque le capitalisme depuis son origine, elle préfère la rejeter dans les oubliettes de l'histoire, la gommer pour présenter l'image plus convenable des grands progrès, des découvertes géographiques, technologiques et scientifiques, de l'explosion artistique et des douces poésies de la Renaissance.
Un demi millénaire après Colomb : le capitalisme dans sa crise de décadence
Aujourd'hui, la classe dominante, en fêtant la découverte de l'Amérique, entonne donc un hymne à sa propre gloire, utilise ce fait historique pour sa propagande idéologique afin de justifier sa propre existence. Mais depuis la découverte de l'Amérique, depuis l'époque de la Renaissance, les choses ont bien changé.
La bourgeoisie n'est plus la classe révolutionnaire qui postule au remplacement du féodalisme déliquescent et décadent. Depuis longtemps elle a imposé son pouvoir au moindre recoin de la planète. Ce que la découverte de l'Amérique par Colomb annonçait, la création du marché mondial capitaliste, est achevé depuis la fin du 19e siècle. La dynamique de colonisation inaugurée dans le Nouveau Monde s'est étendue à la terre entière, les civilisations pré-capitalistes d'Asie se sont effondrées comme les civilisations précolombiennes d'Amérique sous les coups de boutoir du développement de l'échange capitaliste. Au début du 20e siècle, il n'existe plus de marché pré-capitaliste qui ne soit contrôle ou pris dans les mailles d'une puissance capitaliste ou d'une autre. La dynamique de colonisation qui a permis, par le pillage et 'exploitation forcenée des indigènes, l'enrichissement de l'Europe mercantile et qui a ouvert de nouveaux débouchés à l'industrie capitaliste, permettant ainsi son développement tumultueux, bute sur les limites mêmes de la géographie mondiale. «Du point de vue géographique, le marché est limité : le marché intérieur est restreint par rapport à un marché intérieur et extérieur, qui l'est par rapport au marché mondial, lequel - bien que susceptible d'extension- est lui-même limité dans le temps. »([34] [56]) Confronté à cette limite objective du marché depuis près d'un siècle, le capitalisme ne parvient plus à trouver des débouchés solvables à la mesure de ses capacités de production, et s'enfonce dans une crise inexorable de surproduction. «La surproduction est une conséquence particulière de la loi de la production générale du capital : produire en proportion des forces productives (c'est-à-dire selon la possibilité d'exploiter, avec une masse de capital donnée, la masse maximum de travail) sans tenir compte des limites réelles du marché ni des besoins solvables. .. » ([35] [57])
«A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. »([36] [58]) Cette réalité, qui a déterminé naguère la fin dû système féodal et nécessité le développement du capitalisme comme facteur progressiste de libération des forces productives, s'impose aujourd'hui au système capitaliste lui-même. Il n'est plus source de progrès, il est devenu une entrave au développement des forces productives, il est entré, à son tour, en décadence.
Les conséquences de cet état de fait sont dramatiques pour l'ensemble de l'humanité. A l’époque de Colomb, à l'époque de la Renaissance, et par la suite jusqu'à l'achèvement de la construction du marché mondial, malgré la barbarie, la violence qui caractérisent constamment son développement, le capitalisme est synonyme de progrès car il s'identifie avec la croissance des forces productives, avec l'incroyable explosion de découvertes qui en découlent. Aujourd'hui, tout cela est terminé, le capitalisme est devenu une entrave, un frein au développement des forces productives. Il n'est plus porteur de progrès, et il ne peut plus offrir que son visage barbare.
Le 20e siècle montre amplement cette sinistre réalité : des conflits impérialistes constants, ponctués par deux guerres mondiales, des répressions massives, des famines comme jamais l'humanité n'en avait connues, ont provoqué plus de morts en 80 ans que plusieurs siècles de développement brutal. La crise permanente qui se développe a plongé la majorité des habitants de la planète dans la pénurie alimentaire. Partout dans le monde la population subit un processus de paupérisation accéléré, une dégradation tragique de ses conditions dévie.
De manière caractéristique, alors que le 19e siècle est marqué par le développement de la médecine, le reflux des grandes épidémies, l'accroissement de l'espérance de vie, le dernier quart du 20e siècle voit les grandes épidémies faire un retour en force : choléra, paludisme et, évidemment, le SIDA. Le développement du cancer est le symbole de l'impuissance présente du capitalisme. Comme les grandes épidémies de peste du Moyen Age qui manifestaient le symptôme de la décadence du féodalisme, de la crise de ce système, ces épidémies traduisent aujourd'hui, dramatiquement, la décadence du capitalisme, son incapacité à faire face aux calamités qui plongent l'humanité dans la souffrance. Quant à l'espérance de vie, sa croissance a été freinée, elle stagne maintenant dans les pays développés et régresse depuis des années dans les pays sous-développés.
Les capacités de découvertes, d'innovation, qu'il serait nécessaire de mobiliser pour faire face à ces maux, sont de plus en plus freinées par les contradictions d'un système en crise, avec des crédits de recherche qui se réduisent comme peau de chagrin sous les coupes des budgets d austérité qui partout sont mis en place, l'essentiel du potentiel d'invention est mis au service de la recherche militaire, sacrifié sur l'autel de la course aux armements, consacré à la fabrication d'armes de destruction toujours plus perfectionnées, toujours plus barbares. Les forces de la vie sont détournées au profit de celles de la mort.
Cette réalité du capitalisme devenu décadent, devenu un frein au progrès, s'illustre sur tous les plans de la vie sociale. Cela, la classe dominante doit absolument le masquer, le dissimuler. Pendant des siècles, la démonstration spectaculaire et concrète par la bourgeoisie des progrès, clés inventions, des réalisations merveilleuses dont son système était capable était le support de sa domination idéologique sur la masse des exploités qu elle sou mettait à la loi bestiale du profit. Aujourd'hui, elle ne parvient plus à réaliser de tels exploits. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple significatif, la conquête de la Lune, présentée il y a 20 ans comme la répétition moderne de l'aventure de Colomb, est restée sans lendemain, et la conquête de l'espace, la nouvelle frontière qui devait faire rêver les générations présentes et leur faire croire dans les possibilités toujours renouvelées de l'expansion capitaliste, s'est étiolée sous le poids de la crise économique et des échecs technologiques. Elle apparaît maintenant comme une utopie impossible. L'espérance de voyage vers d'autres planètes et vers les étoiles lointaines, le grand projet, est aujourd'hui réduit à une laborieuse et routinière utilisation mercantile et militaire de la haute atmosphère terrestre. Ce bond de l'humanité hors de son jardin terrestre, le capitalisme est incapable de le réaliser car il n'y a, dans l'espace proche qui nous environne, aucun marché à conquérir, aucun indigène à réduire en esclavage. Il n'y a plus d'Amérique, plus de Christophe Colomb.
Le Nouveau Monde est devenu vieux. L'Amérique du nord qui durant des siècles a représente pour les opprimés du monde entier le monde nouveau, l'échappatoire à la misère et aux persécutions où tout paraissait possible, même si cela relevait pour une grande part de l'illusion, est devenue maintenant le symbole de la décomposition putride du monde capitaliste, de ses contradictions aberrantes. Amérique, symbole par excellence du capitalisme, aujourd'hui, le rêve est terminé, il ne reste que l'horreur.
La bourgeoisie maintenant n'a plus, nulle part dans le monde, de réalisation à présenter pour justifier sa domination scélérate. Elle ne peut, pour justifier sa barbarie présente, que communier dans la messe au temps passé. Voilà le sens de tout ce vacarme autour du voyage de Colomb il y a cinq siècles. Pour redorer son blason terni, la classe dominante n'a plus que le souvenir de sa gloire passée à offrir, et, comme ce passé n'est, malgré tout, pas si magnifique, elle ne peut que l’enjoliver, le parer de toutes les vertus. Comme un vieillard sénile qui radote, la classe dominante est tournée vers ses souvenirs, pour oublier elle-même et, faire oublier du même coup, que le présent lui fait peur car elle n'a plus d'avenir.
JJ, 1/06/1992
[1] [59] Engels, La décadence de la féodalité et l'essor de la bourgeoisie, in La guerre des paysans, Ed. Sociales.
[2] [60] Ibid.
[3] [61] Ibid
[4] [62] Ibid
[5] [63] Marx-Engels, Le Manifeste communiste.
[6] [64] Marx, Le Capital, IV-13, Ed. Sociales.
[7] [65] Marx-Engels, L'idéologie allemande, Ed. Sociales.
[8] [66] Marx, Le Capital VIII-26.
[9] [67] Marx-Engels, Le Manifeste communiste.
[10] [68] Ibid.
[11] [69] Ibid.
[12] [70] Marx, Le Capital, VIII-31.
[13] [71] Engels, La décadence de la féodalité et l'essor de la bourgeoisie.
[14] [72] Adam Smith, cité par Engels, Ibid.
[15] [73] Marx, Le Capital, VIII-31.
[16] [74] Ibid., VIII-32.
[17] [75] Ibid.,VIII-27.
[18] [76] Ibid.
[19] [77] Thomas More : L'Utopie, 1516, cité par Marx dans Le Capital VIII-28.
[20] [78] Marx, Le Capital VIII-28.
[21] [79] Ibid.
[22] [80] Ibid.
[23] [81] Engels, La guerre des paysans, I.
[24] [82] Idib., VII.
[25] [83] Ibid., II.
[26] [84] Titre d'un pamphlet de Luther publié en 1525 en pleine guerre des paysans, note d'Engels.
[27] [85] Engels, La
guerre des paysans, I.
[28] [86] Marx, Le Capital, VIII-28.
[29] [87] Machiavel, Le Prince, 1514.
[30] [88] Marx, Le Capital, VIII-31.
[31] [89] Ibid., VIII-31.
[32] [90] Rosa Luxemburg, L'accumulation du capital, Ed. Maspéro.
[33] [91] Marx, Le Capital VIII-31.
[34] [92] Marx, Matériaux pour l’« économie » "Limites du marché et accroissement de la consommation", Ed. La Pléiade, Economie Tome II.
[35] [93] Ibid.
[36] [94] Marx, Avant-propos à la critique de l'économie politique, Ed. Sociales.
Géographique:
- Etats-Unis [95]
- Amérique Centrale et du Sud [96]
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle [3e partie]
- 5593 reads
L'aliénation du travail constitue la prémisse de son émancipation
Dans les deux premiers articles de cette série (Revue Internationale n°68 et 69), nous avons commencé par réfuter l'idée que le communisme n'était qu'une invention de quelques « réformateurs du monde », en examinant le développement des idées communistes dans l'histoire, en les montrant comme le produit des forces matérielles qui travaillent en profondeur la société, et surtout comme celui de la rebellion des classes opprimées et exploitées contre les conditions de la domination de classe. Dans le second article en particulier, nous avons montré que la conception marxiste du communisme, loin d'être un schéma sorti du cerveau de Marx, est devenue possible seulement lorsque le prolétariat a gagné des hommes tels que Marx et Engels à la lutte pour son émancipation.
Les deux articles suivants traitent des premières définitions par Marx de la société communiste, et en particulier de sa vision du communisme comme le dépassement de l'aliénation de l'homme. L'article qui suit est donc consacré particulièrement au concept d'aliénation. A première vue, ceci peut paraître s'éloigner du principal argument de cette série d'articles, à savoir que le communisme est une nécessité matérielle imposée par les contradictions inhérentes au mode de production capitaliste. Superficiellement, la question de l'aliénation peut sembler être un facteur purement subjectif, quelque chose qui concerne les idées et les sentiments plus que les bases matérielles solides de la société. Mais, comme nous le développons dans cet article, ce fut le mérite et la force de la conception de Marx de l'aliénation que de faire sortir celle-ci des nuages de la spéculation brumeuse pour en situer les racines dans les rapports sociaux fondamentaux entre les êtres humains. Et, par là-même, Marx fit parfaitement la clarté sur le fait que la société communiste qui peut permettre à l'homme de surmonter son aliénation ne peut venir que d'une transformation totale de ces rapports sociaux, c'est-à-dire de la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière.
Sur les buts supérieurs du communisme
On a souvent dit que Marx ne s'est jamais intéressé à dresser des plans pour la société communiste future. C'est vrai dans la mesure où, à la différence des socialistes utopiques qui voyaient le communisme comme une pure invention d'esprits éclairés, Marx avait conscience qu'il serait infructueux de dresser des plans détaillés de la structure et du fonctionnement de la société communiste, puisque cette dernière ne pouvait être que l'oeuvre d'un mouvement social de masse qui devrait trouver les solutions pratiques à la tâche sans précédent de construire un ordre social qualitativement supérieur à tout ce qui avait existé jusqu'alors.
Mais cette opposition parfaitement valable à toute tentative de faire rentrer le mouvement réel de l'histoire dans la camisole de schémas préétablis, ne signifie pas du tout que Marx, ni la tradition marxiste en général, ne trouve aucun intérêt à définir les buts ultimes du mouvement. Au contraire : c'est l'une des fonctions distinctives de la minorité communiste d'avoir « sur le reste de la masse des prolétaires l'avantage de comprendre clairement les conditions, la marche, et les résultats généraux du mouvement prolétarien » (Le Manifeste Communiste). Ce qui distingue le communisme de toutes les sortes d'utopie, ce n'est pas l'absence de vision des « résultats généraux » ultimes, mais le fait qu'il établit les connexions réelles entre ces buts et les « conditions » et la « marche » qui y mènent. En d'autres termes, il base sa vision de la société future sur une analyse complète des conditions de la société existante ; de sorte que, par exemple, la revendication de l'abolition de l'économie de marché ne découle pas d'une objection purement morale à l'achat et à la vente, mais de la reconnaissance qu'une société fondée sur une production généralisée de marchandises est condamnée à s'écrouler sous le poids de ses contradictions internes, posant de ce fait la nécessité d'une forme d'organisation sociale supérieure, basée sur la production pour l'usage. En même temps, le marxisme fonde sa conception du chemin, de la ligne de marche vers cette forme supérieure, sur les expériences réelles de la lutte du prolétariat contre le capitalisme. Ainsi, alors que le mot d'ordre de dictature du prolétariat est apparu au tout début du mouvement marxiste, la forme que cette dictature devait prendre, a été précisée par les grands événements révolutionnaires de l'histoire de la classe ouvrière, en particulier la Commune de Paris et la Révolution d'Octobre 1917.
Sans une vision générale du type de société à laquelle il vise, le mouvement communiste serait aveugle. Au lieu d'être l'incarnation la plus haute de cette capacité humaine, unique, de prévoir, d'« ériger sa structure en imagination avant de l'ériger dans la réalité »,[1] [97] il ne serait rien de plus qu'une réaction instinctive à la misère capitaliste. Dans sa bataille permanente contre la domination de l'idéologie bourgeoise, il n'aurait aucun pouvoir de convaincre les ouvriers et toutes les autres couches opprimées de la société que leur seul espoir réside dans la révolution communiste, que les problèmes apparemment insolubles posés par la société capitaliste peuvent trouver des solutions pratiques dans une société communiste. Et une fois la transformation révolutionnaire véritablement commencée, il n'aurait aucun moyen de mesurer le progrès fait vers son but final.
Cependant, nous ne devons pas oublier qu'il y a une distinction à faire entre ces buts finaux, les « résultats généraux » ultimes, et la « marche » qui y mène. Comme on l'a déjà dit, cette dernière est sujette a une clarification constante par l'expérience pratique du mouvement de la classe : la Commune de Paris a clarifié pour Marx et Engels le fait que le prolétariat devait détruire l'ancien appareil d'Etat avant d'ériger son propre appareil de pouvoir ; le surgissement des soviets en 1905 et 917 a convaincu Lénine et Trotsky qu'ils étaient « la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat », et ainsi de suite. D'un autre côté, si l'on considère les buts suprêmes du communisme, on ne peut que s'en tenir à des conclusions très générales basées sur la critique de la société capitaliste, jusqu'au moment où le mouvement réel aura commencé à les mettre à l'ordre du jour en pratique. C'est d'autant plus vrai que la révolution prolétarienne est, par définition, d'abord une révolution politique, et ensuite une transformation économique et sociale. Comme les exemples authentiques de révolution de la classe ouvrière ne sont pas allés, jusqu'ici, au-delà de la conquête du pouvoir politique dans un pays donné, les leçons qu'ils nous ont apportées, sont fondamentalement liées aux problèmes politiques des formes et des méthodes de la dictature du prolétariat (rapports entre parti, classe et Etat, etc.) ; ce n'est que de façon limitée qu'ils nous ont donné des orientations précises sur les mesures sociales et économiques qui doivent être prises pour établir les fondements de la production et de la distribution communistes, et cela, en grande partie de façon négative (par exemple que l'étatisation n'est pas la socialisation). En ce qui concerne la société communiste pleinement développée qui n'émergera qu'après une période de transition plus ou moins longue, l'expérience historique de la classe ouvrière n'a pu et ne pouvait apporter d'éclaircissement qualitatif pour la description par les communistes d'une telle société.
Ce n'est donc pas par hasard si les descriptions les plus inspirées et les plus inspirantes des buts suprêmes du communisme apparaissent au début de la vie politique de Marx, coïncidant avec son adhésion à la cause du prolétariat, avec son identification explicite comme communiste, en 1844.([2] [98]) Ces premières descriptions de ce que pourrait être l'humanité une fois que les entraves du capitalisme et des sociétés de classe précédentes seront détruites, ont été rarement améliorées dans les écrits ultérieurs de Marx. Nous répondrons brièvement à l'argument selon lequel Marx a abandonné ces premières définitions comme de simples folies de jeunesse. Mais pour le moment nous voulons simplement dire que l'approche que Marx a eue de ce problème, est entièrement cohérente avec l'ensemble de sa méthode : sur la base d'une critique profonde de l'appauvrissement et de la déformation de l'activité humaine dans les conditions sociales existantes, il a déduit ce qui était nécessaire pour nier et dépasser cet appauvrissement. Mais une fois qu'il eût établi les buts ultimes du communisme, ce qui était essentiel était de se plonger dans le mouvement prolétarien naissant, dans la dureté et le vacarme de ses luttes économiques et politiques, qui seules avaient la capacité de transformer ces buts lointains en réalité.
Les Manuscrits économiques et philosophiques et la continuité de la pensée de Marx
Pendant l'été 1844, Marx vivait à Paris, entouré des nombreux groupes communistes qui avaient constitué un élément si important pour le gagner à la cause communiste. C'est là qu'il écrivit les Manuscrits économiques et philosophiques aujourd'hui célèbres, auxquels il s'est référé ultérieurement comme un travail de base pour les Grundrisse et Le Capital lui-même. C'est là qu'il a tenté de maîtriser l'économie politique du point de vue de la classe exploitée, faisant ses premières incursions dans des questions telles que le salaire, le profit, la rente foncière et l'accumulation du capital, questions qui devaient occuper une place si importante dans ses travaux ultérieurs ; même si, dans ses remarques introductives aux Manuscrits, il annonce le plan d'une série monumentale de brochures dont la partie économique ne constituait que le début. Dans ces mêmes carnets de notes, on trouve aussi la tentative la plus globale de Marx d'en finir avec la philosophie idéaliste hégélienne qui avait à présent perdu son utilité, ayant été « remise sur ses pieds » par l'émergence d'une théorie matérialiste de l'évolution historique. Mais les Manuscrits sont certainement mieux connus pour la façon dont ils ont traité l'aliénation du travail et quoique dans une moindre mesure pour l'effort de définir le type d'activité humaine qui le remplacerait dans la future société communiste.
Les Manuscrits économiques et philosophiques n'ont pas été publiés avant 1927: cela signifie qu'ils n'étaient pas connus pendant la période révolutionnaire la plus cruciale de l'histoire du mouvement ouvrier ; leur publication a coïncidé avec les derniers souffles de la vague révolutionnaire qui a ébranlé le monde capitaliste durant la décennie qui a suivi 1917. 1927 est l'année qui a vu à la fois la défaite de la révolution en Chine et celle de l'opposition de Gauche dans les Partis Communistes ; un an plus tard, l'Internationale Communiste signait sa propre fin en adoptant l'infamante théorie du « socialisme en un seul pays ». Le résultat de cette ironie de l'histoire est que c'est la bourgeoisie et non le mouvement prolétarien qui a eu le plus à dire sur les Manuscrits et leur signification. Il y eut en particulier une grande controverse, dans les antichambres stériles de la « théorie » académique bourgeoise de gauche, sur la rupture supposée du « jeune Marx » avec le « vieux Marx ». Comme Marx n'a jamais publié lui-même les Manuscrits et qu'il y a traité de questions qui semblaient peu développées dans ses écrits ultérieurs, certains ont supposé que les Manuscrits représentaient un Marx immature, feuerbachien, hégélien même, rejeté de façon décisive par le Marx ultérieur, plus mûr et plus scientifique. Les principaux tenants de ce point de vue sont... les staliniens, et surtout Althusser, cet obscurantiste achevé. Selon eux, ce que Marx a surtout abandonné, c'est la conception de la nature humaine qu'on trouve dans les Manuscrits, et en particulier la notion d'aliénation.
Il est évident qu'un tel point de vue ne peut être considéré séparément de la nature de classe du stalinisme. La critique du travail aliéné dans les Manuscrits est liée de façon intime à la critique du « communisme de caserne », un communisme dans lequel la communauté devient un capitaliste abstrait payant des salaires, vision du communisme qui fut défendue par d'authentiques courants prolétariens immatures comme les Blanquistes à l'époque.([3] [99]) Marx condamne franchement de telles visions du communisme dans les Manuscrits parce que, pour lui, le communisme n'avait de sens que s'il en finissait avec la suppression des capacités créatrices de l'homme et transformait la corvée du travail en activité libre et joyeuse. Pour leur part, les staliniens se définissent par la notion selon laquelle le socialisme va de pair avec un régime de dénuement et d'exploitation forcenée, personnifié par les conditions dans les usines et les camps de travail des soi-disant pays « socialistes ». Il ne s'agit plus là d'une expression immature du mouvement prolétarien, mais de la pleine apologie de la contre-révolution capitaliste. C'est clairement du travail aliéné qui existait dans le « socialisme réel » de l'Est : il n'est donc pas surprenant que les staliniens ne soient pas très à l'aise avec l'ensemble de cette notion. Dans le même sens, la vision que défend Marx, dans les Manuscrits, des rapports entre l'homme et la nature ne concorde pas du tout avec la catastrophe écologique qu'a entrainée1' « interprétation » stalinienne de cette question. Sur ces deux aspects du travail aliéné et des rapports de l'homme à la nature, la vision du communisme élaborée dans les Manuscrits sape l'imposture du « socialisme » stalinien.
A l'opposé de la gamme bourgeoise, plusieurs variétés d'humanisme libéral, y compris les théologiens protestants et la crème des sociologues, ont aussi tenté de séparer les « deux Marx ». Seulement cette fois, ils ont nettement préféré le jeune Marx romantique, idéaliste et généreux, à l'auteur froid et matérialiste du Capital. Mais au moins de telles interprétations ne se réclament pas du marxisme.
Les écrits de Bordiga dans les années 1950 sont parmi les rares tentatives du mouvement prolétarien de faire quelques commentaires sur les Manuscrits, et ils rejettent clairement cette division artificielle : « Un autre lieu commun très vulgaire est que Marx est hégélien dans les écrits de jeunesse, que c'est seulement après qu'il fut le théoricien du matérialisme historique, et que, plus vieux, il fut un vulgaire opportuniste. »[4] [100] Contre de tels clichés, Bordiga a défendu de façon juste la continuité de la pensée de Marx à partir du moment où il a clairement rejoint la cause du prolétariat. Mais ce faisant, et en réaction aux diverses théories du moment qui soit proclamaient l'obsolescence du marxisme, soit tentaient de l'épicer de divers ajouts tels que l'existentialisme, Bordiga s'est trompé sur cette continuité et l'a prise pour « le monolithisme de tout le système depuis sa naissance jusqu'à la mort de Marx et même après lui (concept fondamental de l'invariance, refus fondamental de l'évolution enrichissante de la doctrine du parti). »[5] [101] Cette conception réduit le marxisme à un dogme statique comme l'Islam ; pour le vrai musulman, le Coran est le verbe de. Dieu de façon précise, parce que pas un point, pas une virgule n'a été changé depuis qu'il fut pour la première fois « dicté ». C'est une notion dangereuse qui a fait oublier aux bordiguistes les enrichissements réels apportés par le courant même dont ils proviennent, la Fraction de Gauche italienne, et les a faits retourner aux positions rendues obsolètes par l'ouverture de l'époque du déclin capitaliste. Par rapport au sujet en cause, les Manuscrits, cela n'a pas de sens. Si l'on compare les Manuscrits aux Grundrisse, qui constituaient si on veut le second brouillon du même grand travail, la continuité est absolument claire : à l'encontre de l'idée selon laquelle Marx a abandonné le concept d'aliénation, le mot et le concept apparaissent encore et encore dans ces travaux de Marx « mûr », tout comme ils le font dans Le Capital lui-même. Mais les Grundrisse représentent sans aucun doute un enrichissement par rapport aux Manuscrits. Ils clarifient par exemple certaines questions fondamentales telles que la distinction entre le travail et la force de travail, et sont donc capables de découvrir le secret de la plus-value. Dans son analyse du phénomène de l'aliénation, Marx est capable de poser le problème de façon plus historique que dans ses travaux précédents, parce qu'il se base sur une étude approfondie des modes de production qui ont précédé le capitalisme. Pour nous, poser correctement le problème, c'est affirmer à la fois la continuité et l'enrichissement progressif de la « doctrine du parti », parce que le marxisme est tout à la fois une tradition profondément historique et une méthode vivante.
Le concept d'aliénation : du mythe à la science
L'idée que l'homme est devenu étranger ou aliéné par rapport à ses propres pouvoirs véritables, est très ancienne. Mais dans toutes les sociétés qui ont précédé le capitalisme, le concept prenait forcément des formes mythiques ou religieuses, surtout dans le mythe de la chute de l'homme d'un paradis originel, dans lequel il jouissait de pouvoirs divins.
Le mythe précède la société de classes et constitue un élément central des croyances et des pratiques des sociétés communistes primitives. Les Aborigènes australiens, par exemple, croyaient que leurs ancêtres étaient les êtres créateurs prodigieux de « l'âge d'or », et que depuis la fin de l'époque mythique les êtres humains avaient considérablement perdu de leur puissance et de leur connaissance.
Tout comme la religion qui en descend, le mythe est à la fois une protestation contre l'aliénation et une expression de celle-ci ; dans le mythe comme dans la religion, l'homme projette des pouvoirs qui sont réellement les siens sur des êtres surnaturels en dehors de lui. Mais le mythe est l'idéologie caractéristique d'avant l'émergence des divisions de classes. Au cours de cette époque historique immensément longue, l'aliénation n'existe qu'à l'état embryonnaire : les conditions brutales de la lutte pour la survie imposent la domination brutale de la tribu sur l'individu, au travers de traditions et coutumes immuables, léguées par les ancêtres mythiques. Mais ce n'est pas encore un rapport d'exploitation de classe. Ceci se reflète sur le plan idéologique dans un deuxième aspect des croyances en l'âge d'or mythique : L’âge d'or peut être périodiquement restauré par les fêtes collectives, et chaque membre de la tribu conserve une identité secrète avec les ancêtres de l'époque. Bref, l'homme ne se sent pas encore totalement étranger à ses propres pouvoirs créateurs.
Avec la dissolution de la communauté primitive par le développement de la société de classes, l'apparition de l'aliénation à proprement parler se reflète dans l'émergence d'une conception strictement religieuse. Dans des sociétés antiques telles que l'Egypte et la Mésopotamie, la forme des vieilles fêtes périodiques du renouveau est maintenue ; mais désormais les masses sont plutôt les spectateurs d'un rituel élaboré et joué par les prêtres avec pour but de glorifier un despote divinisé. Un gouffre s'est ouvert entre l'homme et les dieux, reflétant la séparation croissante de l'homme avec l'homme.
Dans les religions judéo-chrétiennes, les conceptions cycliques profondément conservatrices de la société asiatique sont remplacées par la notion révolutionnaire que le drame de la chute de l'homme et de sa rédemption est une progression historique à travers le temps. Mais avec ce développement, c'est un fossé quasiment infranchissable entre l'homme et Dieu qui s'est ouvert : Dieu ordonne à Adam de quitter l'Eden, précisément à cause du pêché d'avoir tenté de s'élever au niveau de Dieu.
Cependant, dans les traditions religieuses occidentales ont émergé beaucoup de courants ésotériques et mystiques qui virent la Chute non comme la punition de l'homme pour avoir désobéi à la figure lointaine de Dieu, mais comme un processus cosmique dynamique dans lequel l'Esprit originel s'est « oublié » lui-même et a plongé dans le monde de la division et de la réalité apparente. Dans cette conception, la séparation entre le monde créé et le fondement ultime de l'être n'était pas absolue : il restait la possibilité pour le véritable initié de recouvrer son unité sous-jacente avec l'Esprit suprême. De telles visions étaient le fait des Kabbalistes juifs par exemple et de leurs nombreuses ramifications chrétiennes, alchimistes et hermétistes. Il est significatif que de tels courants, qui sont très souvent tombés dans les hérésies du panthéisme et de l'athéisme, devinrent de plus en plus influents avec l'effondrement de l'orthodoxie catholique-féodale, et furent, comme le montre Engels dans La guerre des paysans en Allemagne, souvent associés aux mouvements sociaux subversifs dans la période du capitalisme naissant.
Il existe un lien précis, bien que rarement exploré, entre la pensée de Hegel et certaines de ces traditions ésotériques, en particulier dans les travaux du Protestant radical, artisan visionnaire auquel Marx se réfère lui-même une fois comme à « l'inspiré Jakob Boehme. »[6] [102] Mais Hegel était également le théoricien le plus avancé de la bourgeoisie révolutionnaire, et par conséquent l'héritier de la philosophie rationaliste des Grecs Anciens. Comme tel, il fit une tentative grandiose de détacher l'ensemble du problème de l'aliénation du terrain du mythe et du mysticisme, et de le poser de façon scientifique. Pour Hegel, cela signifiait que ce qui avait été ésotérique autrefois, enfermé dans les recoins mentaux secrets de quelques privilégiés, devait être appréhendé consciemment, clairement et collectivement : « Seulement ce qui est parfaitement déterminé dans sa forme, est en même temps exotérique, compréhensible et capable d'être appris et possédé par tous. L'intelligibilité est la forme sous laquelle la science s'offre à chacun et est la route qui lui est ouverte pour être évidente pour tous. »[7] [103] Avec Hegel donc, il y a une tentative de saisir la séparation de l'homme d'un point de vue historique et consciemment dialectique, et Marx reconnaît même qu'il a apporté des éclaircissements sur le rôle-clé du travail dans l'auto-génèse de l'homme. Et cependant, Marx, à la suite de Feuerbach, a souligné que le système hégélien n'a fait que quelques pas dans le sens de la science avant de retomber dans le mysticisme. On peut voir aisément que la notion hégélienne de l'histoire comme « aliénation de l'Idée Absolue » est une nouvelle forme de la version kabbalistique de la chute cosmique originelle. Pour Marx au contraire, la question n'était pas l'histoire de Dieu, mais l'histoire « du devenir de la nature pour l'homme »[8] [104] ; elle n'était pas la chute d'une conscience originelle dans le royaume vulgaire de la matière, mais l'ascension matérielle de l'être inconscient vers l'être conscient.
Pour autant que Hegel ait traité l'aliénation comme un aspect de l'expérience concrète humaine, celle-ci est là encore devenue a-temporelle et a-historique, du fait qu'elle était posée comme une catégorie absolue du rapport de l'homme au monde extérieur : selon les termes de Marx, Hegel a mélangé l'objectivation, la capacité humaine de séparer le sujet de l'objet, avec l'aliénation. En conséquence, si cette séparation entre l'homme et le monde avait une chance de pouvoir être un jour surmontée, elle ne pouvait l’être qu'à partir du monde abstrait de la pensée, le royaume propre du philosophe qui, pour Marx, n'était lui-même qu'un reflet de l'aliénation.
Mais Marx n'a pas abandonné le concept d'aliénation des Hégéliens. Au contraire, il a tenté de le restaurer dans ses fondements matériels en situant ses origines dans la société humaine. Feuerbach avait expliqué que l'Idée Absolue, comme toutes les manifestations précédentes de Dieu, était en fait la projection de l'homme incapable de réaliser sa propre puissance, de l'homme étranger a lui-même. Mais Marx est allé plus loin, en reconnaissant le fait que « si l'assise profane se détache d’elle-même et se fixe dans les nues, tel un royaume indépendant, cela ne peut s'expliquer que par le déchirement de soi et par la contradiction à soi-même de cette assise profane. »[9] [105] Le concept d'aliénation reste vital pour Marx parce qu'il est devenu une arme de son assaut contre la « base séculaire », c'est-à-dire la société bourgeoise et, par-dessus tout, l'économie politique bourgeoise.
Confronté à la marche triomphante de la société bourgeoise, à tous les « miracles du progrès » qu'elle a apportés, Marx a utilisé le concept d'aliénation pour montrer ce que tout ce progrès signifiait pour les véritables producteurs de richesse, les prolétaires. Il a montré que la richesse croissante de la société capitaliste signifiait l'appauvrissement croissant de l'ouvrier. Pas seulement son appauvrissement physique, mais aussi l'appauvrissement de sa vie intérieure : « (...) Plus l'ouvrier se dépense dans son travail, plus le monde étranger, le monde des objets qu'il crée en face de lui devient puissant, et (...) plus il s'appauvrit lui-même, plus son monde intérieur devient pauvre, moins il possède en propre. C'est exactement comme dans la religion. Plus l'homme place en Dieu, moins il conserve en lui-même. L'ouvrier met sa vie dans l'objet, et voilà qu'elle ne lui appartient plus, elle est à l'objet. Plus cette activité est grande, plus l'ouvrier est sans objet. Il n'est pas ce qu'est le produit de son travail. Plus son produit est important, moins il est lui-même. La dépossession de l'ouvrier au profit de son produit signifie non seulement que son travail devient un objet, une existence extérieure, mais que son travail existe en dehors de lui, indépendamment de lui, étranger à lui, et qu'il devient une puissance autonome face à lui. La vie qu'il a prêtée à l'objet s'oppose à lui, hostile et étrangère. »[10] [106]
Là l'approche de Marx est évidente : contre les abstractions de Hegel (qui ont pris une forme caricaturale dans le travail des Jeunes Hégéliens autour de Bruno Bauer), Marx a enraciné le concept d'aliénation dans les « faits économiques présents. »[11] [107] Il montre que l'aliénation est un élément irréductible du système de travail salarié qui n'a d'autre sens que ,plus 1’ouvrier produit, plus il enrichit non lui-même, mais le capital, cette puissance étrangère qui se dresse au-dessus de lui.
Aussi l'aliénation cesse-t-elle d'être un simple état d'esprit, un aspect inhérent du rapport de l'homme au monde (auquel cas elle ne pourrait jamais être surmontée) et devient un produit particulier de l'évolution historique de l'homme. Elle n'a pas commencé avec le capitalisme : le travail salarié, comme Marx le souligne dans les Grundrisse, est simplement la forme finale et la plus haute de l'aliénation. Mais parce qu'elle est sa forme la plus avancée, elle fournit la clé de la compréhension de l'histoire de l'aliénation en général, tout comme l'apparition de l'économie politique bourgeoise rend possible l'examen des fondements des modes de production précédents. Sous les conditions bourgeoises de production, les racines de l'aliénation sont mises à nu : elles ne résident pas dans les nuages, dans la seule tête de l'homme, mais dans le processus du travail, dans les rapports pratiques et concrets entre 1’homme et l'homme, et l'homme et la nature. Ayant fait cette percée théorique, il devient alors possible de montrer comment l'aliénation de l'homme dans l'acte de travail s'étend à toutes ses autres activités ; de même, cela ouvre la possibilité d'investigation des origines de l'aliénation et de son évolution à travers les précédentes sociétés humaines, bien qu'il faille dire que Marx et le mouvement marxiste n'ont pas fait plus qu'établir les prémisses d'une telle investigation, puisque d'autres tâches ont nécessairement eu priorité sur celle-ci.
Les quatre facettes de l'aliénation
Bien que la théorie de Marx de l'aliénation soit loin d'être complète, sa façon de la traiter dans les Manuscrits montre à quel point il était préoccupé qu'elle ne reste pas dans le vague et l'incertain. Dans le chapitre sur « le travail aliéné », il examine donc le problème de façon très précise, identifiant quatre aspects distincts mais interconnectés de l'aliénation.
Le premier aspect est celui qui est traité dans la citation précédente des Manuscrits et résumé brièvement dans un autre passage : « Le rapport de l'ouvrier au produit du travail comme à un objet étranger exerçant son pouvoir sur lui. Ce rapport est en même temps le rapport au monde extérieur des sens, aux objets de la nature, en tant que monde étranger opposé à lui de façon hostile. »[12] [108] Dans les conditions d'aliénation, les produits des mains mêmes des hommes se retournent contre eux, et bien que cela s'applique aux précédents modes d'exploitation de classe, cela atteint un sommet sous le capitalisme qui est une puissance complètement impersonnelle et inhumaine, créée par le travail des hommes mais échappant complètement à leur contrôle, et plongeant périodiquement l'ensemble de la société dans des crises catastrophiques. Cette définition s'applique évidemment à l'acte immédiat de production : le capital, sous la forme des machines et de la technologie, domine l'ouvrier, et au lieu d'augmenter ses loisirs, intensifie son épuisement. De plus, la critique du travail salarié comme étant, par définition, du travail aliéné défie toutes les tentatives de la bourgeoisie de séparer les deux : par exemple, les thèmes frauduleux, populaires dans les années 1960, qui avaient pour but de créer « la satisfaction dans le travail » en réduisant l'extrême spécialisation caractéristique du travail à l'usine, en instituant des équipes de travail, la « participation des ouvriers » et tout le reste. Du point de vue marxiste, rien de tout cela n'altère le fait que les ouvriers créent des objets sur lesquels ils n'ont aucun contrôle et qui ne servent qu'à enrichir d'autres à leurs dépens, et cela reste vrai, même si les ouvriers s'estiment « bien payés ». Mais on peut aussi faire une application bien plus large de toute cette problématique au processus immédiat de production. Il est de plus en plus clair, par exemple, en particulier dans la période de décadence du capitalisme, que tout l'appareil politique, bureaucratique et militaire du capital a développé une vie propre hypertrophiée, qu'il écrase les êtres humains comme un énorme monstre. La bombe atomique est l'exemple-type de cette tendance : dans une société réglée par des forces inhumaines, les forces du marché et de la concurrence capitaliste, ce que
l'homme produit a tellement échappé à son contrôle qu'il en est menacé d'extinction. On peut dire la même chose du rapport de l'homme et de la nature dans le capitalisme : ce dernier n'a pas en lui-même produit l'aliénation entre l'homme et la nature, qui a une histoire bien plus ancienne, mais il la porte à son point ultime. En « perfectionnant » l'hostilité entre l'homme et la nature, en réduisant l'ensemble du monde naturel au statut de marchandise, le développement de la production capitaliste menace aujourd'hui de détruire la matrice même de la vie planétaire.[13] [109]
La seconde dimension de l'aliénation décrite par Marx est le rapport de l'ouvrier à « l'acte de production, à l'intérieur de l'activité productrice elle-même. Comment l'ouvrier ne serait-il pas étranger au produit de son activité si, dans l'acte même de la production, il ne devenait étranger à lui-même ? ». Dans ce processus, « le travail n'appartient pas à l'être (de l'ouvrier) ; dans son travail, l'ouvrier ne s'affirme pas, mais se nie ; il ne s'y sent pas satisfait mais malheureux ; il n'y déploie pas une libre énergie physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. C'est pourquoi l'ouvrier n'a le sentiment d'être à soi qu'en dehors du travail ; dans le travail, il se sent extérieur à soi-même. Il est lui quand il ne travaille pas et, quand il travaille, il n'est pas lui. Son travail n'est pas volontaire, mais contraint. Travail forcé, il n'est pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. La nature aliénée du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu'il n'existe pas de contrainte physique ou autre, on fuit le travail comme la peste »[14] [110].
N'importe qui ayant un emploi « normal » dans la vie quotidienne capitaliste, mais surtout n'importe qui ayant déjà travaillé dans une usine, peut se reconnaître et reconnaître ses sentiments dans ces mots. Dans une société capitaliste qui a depuis longtemps établi sa domination sur le monde, le fait que le travail doive être une expérience détestable pour la vaste majorité de l'humanité, est présenté quasiment comme une loi de la nature. Mais pour Marx et le marxisme, il n'y avait et il n'y a rien de naturel là-dedans. Les précédentes formes de production (par exemple le travail communal primitif, le travail artisanal) n'avaient pas réalisé ce divorce entre l'acte de production et la jouissance des sens ; ceci en soi est la preuve que la séparation totale réalisée par le capital est un produit historique et non naturel. Armé de cette connaissance, Marx a été capable de dénoncer la qualité véritablement scandaleuse de la situation apportée par le travail salarié. Et cela l'a amené à l'autre aspect de l'aliénation : l'aliénation par rapport à la vie de l'espèce.
Ce troisième aspect de la théorie de l'aliénation de Marx est certainement le plus complexe, le plus profond et le moins compris. Dans cette partie du même chapitre, Marx affirme que l'homme est devenu étranger à sa nature humaine. Pour Althusser et d'autres critiques du « jeune Marx », de telles idées sont la preuve que les Manuscrits de 1844 ne représentent pas une rupture décisive avec Feuerbach et la philosophie radicale en général. C'est faux. Ce que Marx rejetait chez Feuerbach, c'était la notion d'une nature humaine fixe et immuable. Puisque la nature elle-même n'est pas fixe et immuable, c'est clairement une impasse théorique, en fait une forme d'idolâtrie. La conception de Marx de la nature humaine n'est pas celle-là. Elle est dialectique : l'homme est toujours une partie de la nature, la nature est « le corps inorganique de l'homme » comme il le dit dans un passage des Manuscrits ; l'homme est toujours une créature d'instinct, comme il le dit ailleurs dans le même ouvrage.[15] [111] Mais l'homme se distingue de toutes les autres créatures naturelles par sa capacité à transformer son corps à travers l'activité créatrice consciente, la nature la plus essentielle de l'Homme, son être générique, comme le dit Marx, qui est celle de créer, de transformer la nature.
Les critiques vulgaires du marxisme proclament parfois que Marx a réduit l'homme à 1' « homo faber », une simple bête de somme, une catégorie économique. Mais ces critiques sont aveuglés par la proximité du travail salarié, par les conditions de la production capitaliste. En définissant l'homme comme producteur conscient, Marx l'élevait en fait aux portes du paradis : car qui est Dieu sinon l'image étrangère de l'homme vraiment homme, de l'homme créateur ? Pour Marx, l'homme n'est vraiment l'homme que lorsqu'il produit dans un état de liberté. L'animal « ne produit que sous l'empire d'un besoin physique immédiat, (...) l'homme produit tandis qu'il est libéré de tout besoin physique et ne produit vraiment que lorsqu'il en est libéré. »[16] [112]
C'est certainement l'une des prises de position les plus radicales que Marx ait jamais prise. Alors que l'idéologie capitaliste voit le fait que le travail se présente sous une forme de torture mentale ou physique comme un fait éternel de la nature, Marx dit que l'homme est un homme, non seulement quand il produit, mais quand il produit pour la pure joie de produire, quand il est libre du fouet du besoin physique immédiat. Autrement, l'homme vit une existence purement animale. Engels a écrit la même chose bien des années plus tard, dans la conclusion de Socialisme utopique ou socialisme scientifique, lorsqu'il dit que l'homme ne se distinguera pas vraiment du reste du genre animal tant qu'il ne sera pas entré dans le royaume de la liberté, aux stades les plus avancés de la société communiste.
On pourrait même dire que le travail aliéné réduit l'homme à un niveau inférieur à celui des animaux : « En arrachant à l'homme l'objet de sa production, le travail aliéné lui arrache sa vie générique, sa véritable objectivité générique, et en lui dérobant son corps non organique, sa nature, il transforme en désavantage son avantage sur l'animal. De même, en dégradant au rang de moyen la libre activité créatrice de l'homme, le travail aliéné fait de sa vie générique un instrument de son existence physique »[17] [113]
En d'autres termes, la capacité de l'homme au travail conscient est ce qui le rend humain, ce qui le sépare de toutes les autres créatures. Mais sous les conditions d'aliénation, cette avance devient un recul : la capacité de l'homme de séparer le sujet de 1’objet, qui est un élément fondamental de la conscience spécifiquement humaine, est pervertie en un rapport d'hostilité à la nature, au monde « objectif » des sens. En même temps, le travail aliéné, par dessus tout le travail salarié capitaliste, a transformé la caractéristique la plus essentielle et la plus élevée de l'homme, son activité vitale consciente, libre, spontanée, en de simples moyens de subsistance, l'a transformée en fait en quelque chose qui s'achète et se vend sur le marché. En bref, la « normalité » de travailler sous le capitalisme est l'insulte la plus raffinée à 1' « être générique » de l'homme.
La quatrième facette de l'aliénation découle directement des trois précédentes :
« Par conséquent, (...) rendu étranger au produit de son travail, à son activité vitale, à son être générique, l'homme devient étranger à l'homme. Lorsqu'il se trouve face à lui-même, c'est l'autre qui est présent devant lui »[18] [114].
L'aliénation du
travail dans sa forme entière implique un rapport d'exploitation : 1
appropriation du surplus par la classe dominante. Dans les premières sociétés
de classe (dans ce chapitre, Marx mentionne l'Egypte, l'Inde, le Pérou,
exemples qu'il classa ultérieurement comme mode de production asiatique), bien que ce surplus soit
normalement consacré aux dieux, la puissance
étrangère réelle régnant sur le
travail des exploités, n'etait pas les dieux mais d'autres hommes :
« L'être "étranger"
à qui appartient le travail et le produit
du travail, qui dispose du travail et jouit du produit du travail, ne peut être
autre que l'homme lui-même. »[19] [115]Cette division profonde au coeur de la vie sociale
crée inévitablement une séparation fondamentale entre les êtres humains. Du point de vue de la classe dominante dans n'importe quelle société de classe, les
producteurs de richesses, les exploités sont autant d'objets, simples biens
qui n'existent qu'à leur bénéfice (bien qu'à nouveau il faille dire ici que ce n'est que sous le capitalisme que cette aliénation prend une forme achevée, puisque dans son mode de production les rapports d'exploitation perdent
tout caractère personnel et deviennent complètement inhumains et mécaniques).
Du point de vue de la classe
exploitée, les dirigeants de la
société sont également cachés derrière un brouillard de mystification, apparaissant
à un moment comme des dieux, à un autre comme des démons selon les circonstances ;
ce n'est que lorsque a émergé la conscience
de classe prolétarienne qui est la
négation de toutes les formes
idéologiques de perception, qu'il est
devenu possible pour une classe exploitée de voir ses exploiteurs à la lumière
du jour en tant que simples produits de rapports sociaux et historiques.[20] [116]
Mais cette division ne se réduit pas au rapport direct entre exploiteur et exploité. Pour Marx, l'être générique de l'homme ne constitue pas une essence isolée enfermée dans chaque individu ; c'est la « Gemeinwesen », un terme-clé qui implique que la nature de l'homme est sociale, que l'existence communautaire est la seule réelle forme humaine de l'existence. L'homme n'est pas isolé, producteur individuel. Il est par définition le travailleur social, le producteur collectif. Cependant, et cet élément est développé dans les pages des Grundrisse en particulier, l'histoire de l'homme depuis les temps tribaux peut être vue comme la dissolution continue des frontières communautaires originelles qui maintenaient la cohésion des premières sociétés humaines. Ce processus est intimement lié au développement des rapports marchands, puisque ceux-ci sont, avant tout, l'agent dissolvant de l'existence communautaire. On peut déjà voir cela dans la société classique où la croissance sans précédent des rapports mercantiles avait profondément miné les anciens liens « gentils » et tendait déjà à créer une société de « guerre de chacun contre tous », un fait noté par Marx dès sa Thèse de doctorat sur la philosophie grecque. Mais la domination des rapports marchands a évidemment atteint son apogée sous le capitalisme, la première société qui a généralisé les rapports marchands au coeur même de l'organisme social, le processus de production lui-même.
Cet aspect de la société capitaliste en tant que société de l'égoïsme universel, dans laquelle la concurrence et la séparation mettent tous les hommes en guerre avec les autres, a été particulièrement souligné dans son article La Question juive, dans lequel Marx fait sa première critique de la conception bourgeoise d'une émancipation purement politique : « Aucun des prétendus droits de l'homme ne dépasse donc l'homme égoïste, l'homme en tant que membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire un individu séparé de la communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant à son arbitraire privé. L'homme est loin d'y être considéré comme un être générique ; tout au contraire, la vie génerique elle-même, la société, apparaît comme un cadre extérieur à l'individu, comme une limitation de son indépendance originelle. »[21] [117]
Cette atomisation de l'homme dans la société civile, c'est-à-dire bourgeoise, est une clé indispensable pour analyser toutes les questions sociales qui existent en dehors du processus immédiat de production : les rapports entre les sexes et l'institution de la famille ; le phénomène de « solitude de masse » qui a tant intrigué les sociologues et qui semble caractéristique de la civilisation du 20e siècle ; et, en général, toute la sphère des relations interpersonnelles. Mais cela a également une signification plus directe pour la lutte du prolétariat, puisque cela se rapporte à la façon dont le capitalisme divise le prolétariat lui-même et fait de chaque ouvrier un concurrent de son camarade ouvrier, inhibant ainsi la tendance inhérente du prolétariat à s'unir en défense de ses intérêts communs contre l'exploitation capitaliste.
Le phénomène d'atomisation est particulièrement aigu aujourd'hui, dans la phase finale de la décadence capitaliste, la phase de l'effondrement généralisé et de la décomposition des rapports sociaux. Comme on l'a dit dans de nombreux textes[22] [118], cette phase est avant tout caractérisée par le développement de l'individualisme, du « chacun pour soi », par le désespoir, le suicide, la drogue et la maladie mentale à une échelle inconnue jusqu'ici dans l'histoire. C'est la phase dont le mot d'ordre pourrait être la phrase de Thatcher : « Il n'existe pas quelque chose qui serait la société, mais seulement des individus et leur famille » ; c'est une phase, comme les événements sanglants qui se déroulent dans l'ex-URSS le confirment, de cannibalisme individuel dans laquelle des masses d'êtres humains sont emportées dans les conflits les plus irrationnels et les plus meurtriers, des pogroms, des luttes fratricides et des guerres qui menacent de façon sinistre le futur même de la race humaine. Cela va sans dire que les racines d'une telle irrationalité résident dans les aliénations fondamentales au centre de la société bourgeoise et que leur solution ne peut être apportée qu'à partir de ce centre, par le changement radical des rapports sociaux de production.
L'aliénation du travail est la prémisse de son émancipation
Car il ne faut pas oublier que Marx n'a pas élaboré sa théorie de l'aliénation pour déplorer la misère qu'il voyait autour de lui, ni pour présenter, comme l'ont fait divers courants de socialisme « vrai » et féodal, l'histoire humaine comme rien d'autre qu'une chute regrettable depuis un état originel de plénitude. Pour Marx, l'aliénation de l'homme était le produit nécessaire de l'évolution humaine, et comme telle contenait les germes de son propre dépassement : « L'être humain devait être réduit à cette pauvreté absolue, afin de donner jour à sa richesse intérieure. »[23] [119] Mais la création de cette vaste richesse extérieure, cette richesse étrangère à ceux qui la créent, rend également possible que les êtres humains passent de 1’aliénation à la liberté. Comme Marx le dit dans les Grundrisse : « Il sera démontré (...) que la forme la plus extrême de l'aliénation, celle où le travail est en rapport avec le capital et le travail salarié, et le travail, l'activité productive est en rapport à ses propres contradictions et à son propre produit, est un moment de transition nécessaire - et donc contient en elle-même, sous une forme seulement encore inversée, mise sur la tête, la dissolution de tous les présupposés limités de la production et de plus crée et produit les présupposés inconditionnels de la production, et avec cela, les pleines conditions matérielles pour le développement total, universel des forces productives des individus »[24] [120].
Il y a deux aspects là dedans : d'abord, à cause de la productivité sans précédent du travail réalisée sous le mode de production capitaliste, le vieux rêve d'une société d'abondance où tous les êtres humains, et pas simplement quelques privilégiés, ont le loisir de se dédier au « développement total, universel » de leur puissance créatrice, peut cesser d'être un rêve pour devenir une réalité. Mais la possibilité du communisme n'est pas seulement une question de possibilité technologique. Elle est par-dessus tout liée à l'existence d'une classe qui a un intérêt matériel à la mettre au monde. Et là encore la théorie de l'aliénation de Marx montre comment en dépit et à cause de l'aliénation qu'il subit dans la société bourgeoise, le prolétariat sera amené à se dresser contre ses conditions d'existence : « La classe possédante et la classe du prolétariat représentent la même aliénation humaine. Mais la première se complaît et se sent confirmée dans cette aliénation de soi, elle éprouve l'aliénation comme sa propre puissance et trouve en elle l'apparence d'une existence humaine ; la seconde se sent anéantie dans l'aliénation, elle voit en elle sa propre impuissance et la réalité d'une existence inhumaine. Pour employer une expression de Hegel, elle est dans l'abjection, la révolte contre cette abjection, révolte à laquelle elle est poussée nécessairement par le conflit de sa nature humaine avec sa situation dans la vie, qui est la négation évidente, radicale et intégrale de cette nature ».[25] [121]
La théorie de l'aliénation n'est donc rien si elle n'est pas une théorie de révolte de classe, une théorie de révolution, une théorie de la lutte historique pour le communisme. Dans le prochain chapitre, nous étudierons les premières ébauches de la société communiste que Marx a « déduites » de sa critique de l'aliénation capitaliste.
CDW.
[1] [122] Le Capital. Dans ce passage de Marx « mûr », il développe une question fondamentale traitée dans les Manuscrits : la distinction entre le travail humain et « l’activité vitale » des autres animaux.
[2] [123] Voir l'article précédent de cette série : « Comment le prolétariat a gagné Marx au communisme », Revue internationale n 69.
[3] [124] Sur les critiques par Marx du « communisme vulgaire », voir le premier article de cette série, Revue internationale n° 68
[4] [125] Bordiga, « Commentaires sur les Manuscrits de 1844 », dans Bordiga et la passion du communisme, réunis par J.Camatte, Editions Spartacus, 1974.
[5] [126] Ibid.
[6] [127] Marx, dans l'article éditorial du n° 179 de la Kolnische Zeitung, publié dans la Reinische Zeitung, 1842.
[7] [128] Hegel, La phénoménologie de l'esprit, 1807, Préface.
[8] [129] Manuscrits économiques et philosophiques, Ed. La Pléiade, Tome II.
[9] [130] Thèses sur Feuerbach, Ed. La Pléiade, T.III
[10] [131] Manuscrits, Ed. La Pléiade, T. II
[11] [132] Manuscrits, Ed. La Pléiade, T. II.
[12] [133] Ibid.
[13] [134] Voir l'article « C'est le capitalisme qui empoisonne la terre », dans la Revue internationale n° 63
[14] [135] Manuscrits, Ed. La Pléiade, T.II
[15] [136] Ibid
[16] [137] Manuscrits, Ed 10-18
[17] [138] Manuscrits, Ed. La Pléiade, T.II
[18] [139] Ibid
[19] [140] Ibid
[20] [141] Sur les spécificités de la conscience prolétarienne, voir en particulier Lukacs, Histoire et Conscience de classe ; et la brochure du CCI Conscience de classe et organisations communistes.
[21] [142] La question Juive, Ed. 10-18.
[22] [143] Voir en particulier « La décomposition, phase finale de la décadence du capitalisme », dans la Revue internationale n° 62.
[23] [144] Manuscrits, Ed. La Pléiade, T.II.
[24] [145] Grundrisse (traduit de l'anglais par nous).
[25] [146] Marx et Engels, La Sainte Famille, Ed. La Pléiade, T. III.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [148]
Heritage de la Gauche Communiste:
A quoi sert la « fraction externe du CCI » ? De l'irresponsabilité politique au vide théorique
- 4194 reads
Le milieu politique prolétarien est constitué d'un certain nombre d'organisations qui, malgré des confusions et des erreurs d'analyse, quelques fois graves pour certaines, représentent un réel effort historique de la classe ouvrière dans sa prise de conscience. Cependant, en marge de ce milieu, on peut trouver toute une série de petits groupes qui ne s'inscrivent pas en véritable continuité avec l'effort des courants historiques de la classe, dont l'existence est essentiellement basée sur l'esprit de chapelle, voire sur des « questions personnelles » et autres mesquineries. De tels groupes se présentent comme des parasites des véritables organisations révolutionnaires. Non seulement leur existence est sans fondement du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, mais ils vivent aux dépends des organisations sérieuses et ils contribuent à discréditer aux yeux des prolétaires les positions et l'activité de celles-ci. La Fraction externe du CCI (fecci) constitue un exemple particulièrement significatif de groupe parasite. C'est ce qu'a illustré, sous une forme caricaturale, la façon dont ce groupe a affronté les événements historiques considérables qui ont bouleversé le monde au cours des deux dernières années. Dans les n° 44 et 45 de la Revue Internationale (RInt), nous avons évoqué les circonstances dans lesquelles s'est constituée la fecci. Nous ne reviendrons que très brièvement ici sur ces circonstances.
La FECCI a été formée par un certain nombre d'anciens militants de notre organisation qui ont volontairement quitté celle-ci en novembre 1985 lors de son 6e congrès. Ces camarades s'étaient constitués en tendance quelques mois auparavant autour d'un document qui tentait de faire une synthèse de différents points de vue contradictoires qui avaient été développés dans l'organisation contre les orientations de celle-ci. Mais au-delà de leur absence d'homogénéité et de leur incohérence, les positions exprimées à cette époque par ces camarades se distinguaient par un manque de fermeté, par des concessions à l'égard des positions conseillistes, en bref par une démarche centriste envers le conseillisme. Bien que de telles positions auraient pu avoir des conséquences néfastes si elles avaient gagné l'ensemble du CCI, elles ne motivaient en aucune façon une séparation organisationnelle. Aussi, nous avions considéré cette scission comme une véritable désertion marquée du sceau de l'irresponsabilité et du sectarisme. D'ailleurs, les scissionnistes eux-mêmes étaient bien conscients du caractère injustifiable de leur démarche puisqu'ils ont, depuis leur départ et jusqu'à aujourd'hui, colporté la fable qu'ils avaient été exclus du CCI. Nous n'avons pas la place, dans le cadre de cet article, de revenir sur ce mensonge (que nous avons déjà amplement réfuté dans la RInt n°45). Au même titre que les communautés primitives, les sectes ont en général besoin de se donner un mythe fondateur justifiant leur existence. L'exclusion du CCI constitue un des mythes fondateurs de cette secte qui a pour nom fecci.
Cependant, le mensonge n'est pas la seule caractéristique de la fecci. Il faut y ajouter également la stupidité. C'est ainsi qu'elle donne elle-même le bâton pour se faire battre en confirmant qu'elle n'a nullement été exclue du CCI mais qu'elle a quitté celui-ci de son propres chef.
« Rester dans une organisation dégénérescente comme le CCI revient à se priver de la possibilité de faire face et éventuellement de surmonter la crise du marxisme... Et tout ceci est recouvert d'un fin vernis de respectabilité par un nouveau dogme que le CCI a inventé commodément il y a six ou sept ans, à savoir que les militants sont censés rester dans une organisation jusqu'à ce que celle-ci ait franchi la frontière de classe vers la classe capitaliste ennemie. Prisonniers pour la vie. Comme des femmes battues qui proclament pathétiquement qu "il m'aime", les militants du CCI ont découvert le caractère sacré du mariage. » (Perspective Internationaliste - PI -n° 20, « Pour une pratique vivante de la théorie marxiste »). Le lecteur pourra apprécier à sa juste valeur a comparaison entre le CCI et un mari brutal. La fecci nous a habitués depuis ses origines à ce genre de qualificatifs. Ce qu'on peut constater, toutefois, c'est que la FECCI (se considère-t-elle comme une femme battue ?) revendique avec véhémence son divorce avec le CCI alors qu'elle confirme clairement que ce dernier y était opposé.
Encore une fois, la place nous manque ici pour revenir sur l'ensemble des accusations stupides et mensongères, et elles sont nombreuses, portées par la fecci contre notre organisation. En particulier, nous reviendrons dans un autre article, si c'est encore nécessaire, sur un des chevaux de bataille de la fecci : le prétendu abandon par le CCI de ses principes programmatiques. Cependant, il est une accusation dont les événements de ces dernières années ont révélé la débilité : c'est l'accusation de régression théorique.
La FECCI et l'approfondissement théorique
Outre l’accusation d'abandon des principes, la FECCI a décrété que «... le CCI, non seulement avait cessé d'être un laboratoire pour le développement de la théorie/praxis marxiste (la condition sine qua non d'une organisation révolutionnaire) mais il était même incapable de maintenir les acquis théoriques sur lesquels il s'était fondé. » ([1] [150]) . Pour sa part, la fecci s'est donnée comme objectif de sauvegarder ces acquis et de les enrichir : « pour qu'une organisation vive et se développe, il ne suffît pas qu'elle garde une plateforme dans ses archives... L'histoire avance, pose de nouveaux problèmes, pose d'anciens problèmes sous une forme nouvelle, et tous ceux qui ne parviennent pas à se placer à la hauteur de l'histoire sont condamnés à être piétines dans sa progression » ([2] [151]). De toute évidence, elle ne connaît pas l'histoire de l'arroseur arrosé. C'est ce que les bouleversements intervenus depuis l'automne 1989 ont démontré à l'évidence.
Comme l'écrivait la fecci en décembre 1989, « Les événements qui secouent l'Europe de l'Est depuis plusieurs mois requièrent l'élaboration, de la part des révolutionnaires, d'une analyse marxiste claire qui en cerne les causes et conséquences réelles sur le plan du rapport de forces inter impérialistes et de la lutte de classe...»([3] [152]) Et effectivement, la fecci a constaté que «La Russie n'a désormais plus de bloc. Pour le moment, elle a cessé d'être un protagoniste essentiel sur la scène mondiale, un concurrent de l'impérialisme US. (...) La division du monde en deux blocs rivaux, qui n'est pas seulement la caractéristique de la dernière moitié de ce siècle mais aussi une condition nécessaire pour un conflit mondial, n'existe plus aujourd'hui. ». Bravo ! C’est presque exactement ce que nous avons écrit à partir de la fin de l'été 1989, c'est-à-dire près de deux mois avant la disparition du mur de Berlin. ([4] [153]) Le petit ennui, c'est que cette analyse de la fecci ne date pas de la même période, mais qu'elle est apparue pour la première fois dans PI n° 21 («L'avenir de l'impérialisme ») daté de l'hiver 1991-92, c'est-à-dire plus de deux ans après que nous ayons adopté notre propre analyse.
Depuis Marx, nous savons que « c’est dans la pratique que l'homme doit prouver la vérité, c’est-à-dire la réalité et la puissance... de sa pensée» (Thèses sur Feuerbach). Lorsque la capacité théorique des organisations révolutionnaires a été mise à l'épreuve dans la pratique, on a pu voir à l'oeuvre la fecci qui s'était justement proposée de reprendre le flambeau de l'élaboration théorique qu'à ses dires le CCI avait laissé tomber. Voici ce qu'elle écrivait le 16 décembre 1989 (plus d'un mois après la disparition du mur de Berlin : «Les événements actuels en Europe de l'Est s'inscrivent dans le cadre de la politique de la "perestroïka" entamée en Russie il y a quatre ans lors de l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. (...) Les buts de la perestroïka sont (...) sur le plan militaire et impérialiste, arrêter l'offensive [du bloc] occidental par une contre-offensive idéologique visant à l’amener à réduire ses dépenses d'armement et le diviser, tout en cherchant à se doter du potentiel économique et technologique nécessaire pour le concurrencer militairement à moyen terme. (...) sur le plan impérialiste, la Russie n'a plus guère le choix que de déstabiliser la scène européenne en escomptant en tirer profit. L'Europe a toujours été le théâtre ultime des conflits impérialistes mondiaux, et l'est plus que jamais pour la Russie aujourd'hui... En accélérant les réformes dans les pays est-européens, la Russie entend modifier les données du problème européen, ouvrir la Communauté Européenne à l'Est pour la diviser et la neutraliser. La destruction du mur de Berlin, loin d'être un gage de paix, est une bombe à retardement placée au coeur de l'Europe. (...) Si la dissolution du stalinisme comme mode de domination du capital dans les pays d'Europe de l'Est est à terme une possibilité qui ne peut être exclue ([5] [154]) à cause de leur passé historique et de la possibilité de leur attraction dans l'orbite occidentale, il n'en va pas de même de la Russie elle-même. » ([6] [155])
Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon les membres de la FECCI seraient aujourd'hui enterrés. Nous pouvons toutefois leur accorder une qualité : le cran. Il faut effectivement avoir bien du cran pour continuer aujourd'hui à se réclamer d'une organisation qui a pu adopter des positions aussi ineptes, qui a pu se tromper à ce point dans la compréhension d'une situation historique. Dans l'ensemble, le milieu politique prolétarien a éprouvé bien des difficultés à produire une analyse correcte et lucide des événements de la seconde moitié de 1989.([7] [156]) Mais il faut bien reconnaître que la fecci détient de très loin le pompon. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas réellement la placer dans le milieu politique prolétarien à proprement parler.
En fait, une cécité comme celle de la FECCI a peu d'équivalents dans l'histoire de ce milieu politique ([8] [157]) : le seul exemple comparable est celui du Ferment Ouvrier Révolutionnaire (FOR) qui, pendant plus de vingt ans, a nié l'existence de la crise économique du capitalisme. Car même lorsqu'elle a admis (par la force des évidences) son erreur d'analyse initiale, la fecci a continué de ne rien comprendre à ce qui se passait. Ainsi, lors de sa 4e conférence, en été 1991, la FECCI n'avait pas encore reconnu la disparition du bloc de l'Est. La façon dont elle traite de cette question dans PI n°20 est d'ailleurs typique de son centrisme congénital : d'un côté, on constate « l’effondrement du Pacte de Varsovie et du COMECON » (ce qui est la moindre des choses après leur disparition formelle qui ne faisait qu’entériner un effondrement qui avait eu lieu bien auparavant), on découvre que « les événements de ces deux dernières années ont représenté une véritable révocation des accords de Yalta, » ([9] [158]) on met en évidence la perte par l'impérialisme russe de toutes les positions et de l'influence qu'il conservait (Europe centrale, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Afrique, Amérique centrale et Cuba, etc.), mais, d'un autre côté, on se refuse de parler explicitement de la «disparition» ou même de «l'effondrement du bloc de l'Est». Dans ce document, on oppose au « bloc américain » «l'impérialisme russe » ou son « adversaire potentiel russe » sans, à aucun moment, dire clairement ce qui est advenu du bloc russe.([10] [159]) Pour le centrisme, il est des mots qu'il ne faut pas prononcer, comme cela, on s’évite de devoir affirmer une position claire et tranchée. Et comme le propre d'une position centriste, c est d'être intenable, il faut bien, un jour ou l'autre, sous la pression des réalités, parce que « les faits sont têtus» (comme disait Lénine), qu'on se jette à l'eau : c'est ce qu'a fait, avec deux ans de retard, PI n° 21. Bel effort, bravo camarades !
« LA PAILLE ET LA POUTRE »
Evidemment, les exploits de la FECCI, concernant la compréhension des événements qui ont secoué le monde dans la dernière période, ne pouvaient en rester à «l'élaboration» d'une «analyse» tellement erronée qu'il fallait la remettre en cause mois après mois. Il fallait encore qu'elle fasse preuve de sa stupidité et de sa cécité dans la critique des organisations révolutionnaires, et particulièrement du CCI. Ainsi, dans PI n° 16, on trouve un article au titre explicite «Le CCI et l'Europe de l'Est, le virage à 180° d'une organisation dégénérescente » qui se propose de procéder à une «dénonciation» de a vision du CCI puisque : « Il faut bien parler de dénonciation et non de polémique devant la profondeur de la confusion que représente cette organisation face à notre classe et devant la lâcheté avec laquelle elle change de position, avec cette tactique bien connue des organisations staliniennes : sans débat ouvert et de façon monolithique. » Rien que cela, excusez du peu !
L'article se scandalise que « La vision développée par le CCI [soit] donc celle de la disparition du bloc de l'Est par ''implosion" sous l'effet de la crise économique». C'est effectivement bien (à grands traits) la conception défendue par le CCI depuis le début et que nous n'avons remise en cause à aucun moment. Mais pour la FECCI : « Il s'agit là... d'une analyse qui abandonne le cadre marxiste de la décadence. », c'est « une régression théorique fondamentale. .. car il s'agit bien de la compréhension d'un des mécanismes profonds du capitalisme et de sa crise », c'est « renier purement et simplement le cadre de l'impérialisme et la nature même de la bourgeoisie», c'est «certes accréditer le battage idéologique bourgeois mais certainement plus comprendre la réalité avec un cadre d'analyse marxiste», c'est «nier le caractère guerrier des Etats impérialistes», etc. On ne peut évidemment reproduire toutes les accusations de ce style, ce serait vraiment lassant pour le lecteur. Mais ce que témoigne l'article, fondamentalement, c'est que pour la FECCI, son « cadre d'analyse » (lequel, au fait ?) est plus important que la réalité elle-même. Et si cette dernière ne se plie pas à ses schémas, et bien, elle n'existe pas ! Et tout cela au nom du «marxisme» s'il vous plaît.
En fait, il ne suffit pas de produire des citations de Marx et de Rosa Luxemburg, comme le fait l'article, pour développer une pensée marxiste (les staliniens nous l'ont prouvé depuis des décennies). Encore faut-il comprendre ce qu'elles veulent dire et ne pas afficher une nullité théorique affligeante en confondant, par exemple, impérialisme et blocs impérialistes. C'est pourtant bien ce que fait l'article. Celui-ci rappelle l'affirmation parfaitement juste de Rosa Luxembourg : « La politique impérialiste n'est pas l'oeuvre d un pays ou d'un groupe de pays. Elle est le produit de l'évolution mondiale à un moment donné de sa maturation. C'est un phénomène international par nature... auquel aucun Etat ne saurait se soustraire. ». Et, à cette citation, la FECCI fait dire que la division du monde en deux blocs impérialistes est une donnée permanente du capitalisme depuis le début du siècle. Camarades de la fecci, il faut retourner à l'école primaire, c'est là qu'on apprend à lire. ([11] [160])
Si la rigueur théorique n'est vraiment pas le fort de la fecci, ce n'est pas finalement pour elle un problème. Le but principal de l'article, comme l'annonce son titre et son introduction, est bien le dénigrement de notre organisation.
Il faut à tout prix illustrer la thèse de la « dégénérescence du CCI » qui est un des autres mythes fondateurs de la FECCI. C'est avec insistance que la conclusion y revient : « Entraîné et balayé par l'idéologie dominante, incapable désormais d'appréhender les événements quotidiens au travers de principes de classe et d'une méthodologie marxiste, le CCI se fait le véhicule de l'idéologie de classe. (...) Nous espérons que ces articles [ceux de Pi] alimenteront le débat au sein du milieu révolutionnaire, et, qui sait, provoqueront un choc salutaire auprès des éléments restés sains dans le CCI». Les «éléments sains du CCI» disent un grand merci à la FECCI pour sa sollicitude... et pour la démonstration qu'elle a faite, tout au long de la dernière période, de l'absurdité de ses accusations contre le CCI.
Sérieusement, si on ne peut demander à la FECCI de réaliser son ambition d’ «approfondissement théorique» (de toute évidence, ses «analyses» depuis deux ans ont établi que cela dépasse de loin ses capacités), il serait temps, pour la dignité des rapports entre révolutionnaires, qu’elle arrête avec ses insultes ridicules mais répugnantes à propos des prétendues « tactiques staliniennes » du CCI. Dans la RInt n°45, nous avons déjà fait justice de ce type d'accusations concernant la façon dont le CCI avait affronté l'apparition en son sein de la minorité qui allait former la FECCI. Aujourd'hui, vouloir étayer une telle légende en relevant que le CCI n'a pas fait part dans sa presse des positions de ses membres en désaccord avec son analyse sur l'Est est une absurdité. Que les prises de position successives de la FECCI sur ce sujet aient provoqué dans ses rangs le surgissement et le maintien de nombreux désaccords, ([12] [161]) cela se comprend aisément : lorsque des positions sont tellement éloignées de la réalité, il est difficile qu elles rencontrent l'unanimité ou même qu'elles permettent un minimum l'homogénéité dans l'organisation. La FECCI sait pertinemment qu'il y a eu des débats dans le CCI tout au cours des événements de la dernière période. Mais elle sait également, parce que ses membres étaient d'accord avec un tel principe lorsqu'ils étaient militants du CCI, que ces débats, afin de permettre une réelle clarification dans la classe, ne sont répercutés vers l'extérieur que lorsqu'ils ont atteint un certain niveau de développement. Or, si l'analyse adoptée par le CCI au début octobre 1989 (et mise en discussion à la mi-septembre) sur les événements de l'Est a provoqué sur le moment des désaccords, ces derniers se sont assez rapidement résorbés du fait que, jour après jour, la réalité ne faisait que confirmer la validité de cette analyse. Est-ce une preuve de la «dégénérescence du CCI» que son cadre d'analyse et sa compréhension du marxisme lui aient permis, beaucoup plus rapidement que les autres groupes du milieu politique, d'appréhender la signification et les implications des événements de l'Est ?
Avant d'en finir avec les accusations de la fecci contre le CCI à {propos des événements de l'Est, il faut encore relever deux perles (parmi beaucoup d'autres que nous ne pouvons évoquer faute de place) : notre prétendu « virage à 180°» et la question du «super impérialisme».
Incapable de reconnaître les changements qui étaient intervenus sur a scène internationale (malgré tous les discours sur la «sclérose» du CCI), changements qui constituaient effectivement un « virage à 180° », la fecci n'a su (ou voulu) voir dans la compréhension qu'en avait le CCI qu'un reniement de son propre cadre d'analyse fondamental. Encore une fois, la critique (la « dénonciation » suivant les termes de la fecci) est imbécile et de mauvaise foi. Et cela d'autant plus que, dans notre prise de position sur les événements de l'Est publiée dans la RInt n° 60, nous nous appuyons amplement sur l'analyse des régimes staliniens et du bloc de l'Est que le CCI avait développée au début des années 1980 (et qui se basait sur les avancées de la Gauche communiste de France sur la question) à la suite de l'instauration de l'état de guerre en Pologne (cf. RInt n°34). En revanche, on ne trouve dans les «analyses» multiples et à géométrie variable (minoritaires; majoritaires; majoritaires/minoritaires ou minoritaires/majoritaires) que nous a proposées la fecci aucune référence à ce cadre (ne serait-ce que pour le remettre en cause) que pourtant les membres de la FECCI avaient fait leur à cette époque puisqu'ils étaient encore militants du CCI.([13] [162]) La prochaine fois que la FECCI aura envie d'écrire que le CCI « est incapable de maintenir ses acquis théoriques », nous lui conseillons de commencer par se regarder dans une glace.
C'est le même conseil que nous lui donnons au cas où elle serait tentée de nous attribuer encore une fois (comme elle le fait par exemple dans l'article de PI n° 19 « Un même appel contre la guerre impérialiste ») une position typiquement bourgeoise comme celle du « super impérialisme». Cette thèse élaborée par Kautsky et les réformistes à la veille et au cours de la première guerre mondiale visait à établir que les secteurs dominants du capital mondial seraient en mesure de s'unifier pour imposer leur loi sur la planète et garantir de ce fait la stabilité et la paix de celle-ci. La fecci savait pertinemment, lorsqu'elle nous a attribué une telle conception, que depuis le tout début des événements de l'Est nous l'avions clairement rejetée : « Cette disparition du bloc de l'Est signifie-t-elle que, désormais, le monde sera dominé par un seul bloc impérialiste ou que le capitalisme ne connaîtra plus d'affrontements impérialistes ? De telles hypothèses seraient tout à fait étrangères au marxisme. (...) Aujourd'hui, l'effondrement de ce bloc ne saurait remettre en selle ce genre d'analyses [celles du "super impérialisme"] : cet effondrement porte avec lui, à terme, celui du bloc occidental. (...) l'aggravation des convulsions de l'économie mondiale ne pourra qu'attiser les déchirements entre /TOUS les] Etats, y compris, et de plus en plus, sur te plan militaire. (... ) La disparition des deux constellations impérialistes qui étaient sorties de la seconde guerre mondiale porte, avec elle, la tendance à la recomposition de deux nouveaux blocs.([14] [163]) » En revanche, c'est bien une telle conception du « super-impérialisme » qui transparaît dans PI n°21 («L'avenir de l'impérialisme ») : « Un seul bloc a survécu à la crise. Il n'a pas de concurrent en ce moment. Et pourtant, contrairement aux prédictions faites par le CCI et par d'autres, pour le moment il ne montre aucun signe de désintégration. Son existence ne repose plus sur la rivalité impérialiste avec la Russie, mais sur la domination du monde selon les besoins des capitaux les plus puissants. » L'éditorial de ce numéro de notre Revue, comme celui du précédent, fait justice (après beaucoup d'autres articles) de la prétendue cohésion du bloc de l'Ouest : encore une fois, la FECCI refuse de voir la réalité. Mais ce qui est plus grave encore, c'est qu'elle remet en cause, ce faisant, un des acquis essentiels du marxisme au cours de ce siècle. Ainsi, pour étayer l'idée que des puissances comme l'Allemagne et le Japon ne peuvent faire autre chose que se maintenir fermement dans le « bloc américain »> la fecci nous affirme que : « Les Etats du bloc américain ou occidental sont devenus économiquement dépendants du fonctionnement de ces institutions [Banque mondiale, FMI, GATT, etc.] et du réseau de liens commerciaux et financiers qu’ils ont tissés. »([15] [164]) C'est là une version moderne de la conception des réformistes du début du siècle (dénoncée vigoureusement par les révolutionnaires de l'époque) qui prétendaient que le développement des liens économiques, financiers, commerciaux entre pays constituait un frein à leurs antagonismes impérialistes et devait écarter la menace de guerre entre eux. La fecci est vraiment bien placée pour parler des «reniements du marxisme» par le CCI et de sa « capitulation » devant l'idéologie bourgeoise. Quand on veut se mêler de moucher les autres, il vaut mieux vérifier d'abord si on n'est pas morveux soi-même. En fait, c'est là une des pratiques courantes de la FECCI qui, afin de masquer ses propres défauts, les attribue généreusement au CCI. C’est un procédé vieux comme la politique mais qui n'a jamais grandi ceux qui l'ont utilisé, particulièrement s'il s'agit de révolutionnaires.
A QUOI SERT LA FECCI ?
Si on considère, comme elle le dit fort justement elle-même, que « Les événements qui secouent l’Europe de l'Est... requièrent l'élaboration, de la part des révolutionnaires, d'une analyse marxiste claire qui en cerne les causes et conséquences réelles... » ce n'est pas faire preuve de la moindre volonté de dénigrement que de constater que la fecci a complètement failli a sa tâche. Elle-même le reconnaît d'ailleurs : «Cette réalité nouvelle nous a conduits à reconnaître l'insuffisance de notre ancienne analyse qui, par certains côtés, restait prisonnière de poncifs sans valeur, » ([16] [165]) même si c'est pour ajouter un peu plus loin (il faut bien crâner un peu et soutenir le moral des adhérents) : «Estimant positive notre capacité d'analyse de la situation... nous avons décidé de poursuivre dans la même voie que précédemment. »
Plus généralement, on peut constater que la FECCI a fait complètement faillite dans son objectif de préserver et développer les acquis théoriques du CCI, tâche que ce dernier aurait abandonnée à ses dires. Lorsque ses prétentions ont été confrontées à l'épreuve des faits, elles ont éclaté comme des bulles de savon. Elle voulait nous donner une leçon de clairvoyance théorique, elle a fustigé pendant deux ans, dans les termes les plus infamants nos analyses, mais, pour finir, elle a été obligée d'accepter, pour l'essentiel, sans évidemment e reconnaître, le point de vue que nous avions défendu depuis le début ([17] [166]) et qu'elle présentait comme la preuve irréfutable de la « dégénérescence » de notre organisation. La seule différence qu'elle maintient avec notre compréhension élaborée il y a déjà deux ans et demi, c'est qu'elle reprend maintenant à son compte la position bourgeoise du super-impérialisme qu'elle nous avait attribuée de façon mensongère. Ainsi, toute sa « démonstration » de la « régression du CCI » s'est retournée contre elle : ce n'est pas le CCI qui régressait, c'est la fecci qui ne comprenait rien à la situation, toute armée qu'elle fut de sa supériorité théorique auto-proclamée. Et si l'incapacité d'appréhender les enjeux des événements de l'Est était une manifestation de régression, comme elle l'a affirmé, avec raison, pendant deux ans, ce n'est certainement pas notre organisation qui a régressé mais bien la FECCI elle-même.
A la question «A quoi sert la FECCI ? », on pourrait donc être tenté de répondre : « A rien ». Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Même si l'influence de la FECCI est insignifiante, sa capacité de nuisance n’est pas nulle. Et c'est pour cette raison que nous lui consacrons cet article. En effet, dans la mesure où sa revue a un certain nombre de lecteurs, où quelques personnes assistent à ses réunions publiques, où elle intervient dans le milieu politique prolétarien, alors qu'elle se réclame de la plateforme de l'organisation aujourd'hui la plus importante de celui-ci, le CCI, elle constitue un élément de confusion supplémentaire au sein de la classe ouvrière. En particulier, ses tendances conseillistes et son manque de rigueur théorique ne peuvent que rencontrer un écho dans une partie du monde comme les Etats-Unis qui se distingue par la faiblesse de son milieu politique, par l'ignorance que manifestent beaucoup de ses membres et par la forte imprégnation des visions conseillistes et libertaires. Ce faisant, un groupe comme la fecci contribue incontestablement à maintenir et enfoncer dans son sous-développement le milieu prolétarien d'un tel pays.
Mais plus fondamentalement encore, la fecci a pour fonction de discréditer un travail révolutionnaire sérieux et, en premier lieu, le marxisme lui-même. Ainsi, que ce soit au nom du «marxisme» que, pendant deux ans, ce groupe ait proféré une telle quantité d'inepties, qu'il ait fait preuve d'une telle cécité ne peut aboutir qu'à déconsidérer le marxisme lui-même. Ce faisant, la fecci apporte sa petite contribution à la campagne actuelle sur la «mort du marxisme ». C'est vrai que PI n° 17 a publié un texte, « Le marxisme est-il mort ? » qui dénonce ces mensonges et réaffirme, à sa façon, la pleine validité du marxisme. Mais encore faut-il que les révolutionnaires fassent la preuve, dans la pratique, par la vérification de leurs analyses, de la validité du marxisme. Et cela, la fecci est vraiment mal placée pour le faire. Mais, malheureusement, la contribution de la fecci aux campagnes répugnantes contre le marxisme ne s'arrête pas à sa défense inconséquente de cette théorie. C'est de façon délibérée qu'elle y participe dans PI n°20. La première page elle-même est déjà ambiguë : « Le "communisme" doit mourir pour que vive le communisme ». Comme s'il n'y avait pas assez de confusions entre communisme et stalinisme, comme si l'agonie actuelle de ce dernier se présentait comme une «victoire» pour la classe ouvrière, alors qu'elle a été retournée contre elle par toute la bourgeoisie «démocratique ». De plus, l'éditorial se réjouit « Que tombent les statues » de Lénine. Si la classe ouvrière n'a évidemment pas besoin des statues des révolutionnaires (que la bourgeoisie a édifiées justement pour en faire des «icônes inoffensives », comme disait Lénine lui-même), il ne faut pas se méprendre sur la signification des actions des foules dans la période passée : elles correspondent à un rejet, promu et encouragé par les forces bourgeoises, de l'idée même d'une révolution du prolétariat. Ce même éditorial nous affirme que [les révolutionnaires] «doivent se débarrasser de la tendance à considérer la révolution bolchevique comme un modèle». Dans les circonstances présentes, le terme «révolution Bolchevique» est déjà pernicieux puisqu'il laisse entendre, comme le répète aujourd'hui la bourgeoisie de façon obsédante, que la révolution d'Octobre était l'affaire des seuls bolcheviks, ce qui ne peut que conforter la thèse que cette révolution n'était pas autre chose qu'un coup d'Etat de Lénine et des siens « contre la volonté de la population » ou même de la classe ouvrière. Et pour bien ancrer ce type de confusions, l'éditorial est chapeauté par un dessin représentant Lénine versant des larmes qui ont la tête de Staline : en d'autres termes, Staline est bien, d'une certaine façon l'héritier de Lénine. Encore une fois, la Gauche communiste, et le CCI en particulier, n'a jamais craint de mettre en lumière les erreurs des révolutionnaires qui ont facilité le travail de la contre-révolution. Mais elle a toujours su où étaient les priorités du moment : aujourd'hui, cette priorité n'est certainement pas de « hurler avec les loups » mais bien de revendiquer, à contre-courant des campagnes bourgeoises, l'expérience fondamentalement valable de la vague révolutionnaire du premier après guerre. Tout le reste n'est qu'opportunisme.
Enfin, ce même numéro de PI contient un article (« Pour une pratique vivante de la théorie marxiste») qui glose longuement sur la «crise du marxisme». On comprend que la fecci commence à se sentir mal dans ses souliers après la mise en évidence de son incapacité à comprendre les enjeux des événements de l'Est. Ce n'est pas une raison pour affirmer péremptoirement que «personne dans ce milieu [révolutionnaire] «n’a prédit ces événements». Une telle prévision n'a sûrement pas été le fait de la fecci, on le sait, mais elle n'est pas seule au monde et notre propre organisation ne peut se sentir concernée par ce genre d'affirmations. En ce sens, ce n'est pas le marxisme tel qu'il a été développé par la Gauche communiste et, à sa suite, par le CCI, qui porte la responsabilité de la faillite des analyses de la fecci. Il ne faut pas se tromper de cible : ce n'est pas le marxisme qui est en crise, c'est la FECCI. Ceci dit, ce genre d'article où TOUT le milieu politique est mis dans le même sac, où on attribue généreusement à tous les autres groupes sa propre nullité, ne peut encore une fois qu'apporter de l'eau au moulin de ceux qui prétendent que c'est le marxisme «en général » qui a fait faillite.
Mais la contribution de la fecci à la confusion dans les rangs de la classe ouvrière et de son milieu politique ne s'arrête pas à ces divagations sur la «crise du marxisme». On la retrouve dans son rapprochement actuel avec le Communist Bulletin Group (cbg) qui sévit en Ecosse. Ce groupe est issu de la scission, fin 1981, de la tendance secrète qui s'était formée autour de l'élément trouble Chénier (lequel, quelques mois après son exclusion, portait les banderoles du syndicat CFDT et qui est aujourd'hui un cadre du parti socialiste, dirigeant le gouvernement français). Au moment de leur départ, les membres de cette « tendance » y compris ceux qui allaient former le CBG, avaient dérobé à notre organisation du matériel et des fonds. Voici ce que le CCI écrivait à propos de ce groupe en 1983, avec le plein accord clés camarades qui, plus tard, allaient constituer la fecci:
« Dans les premiers numéros de The Bulletin, il [le CBG] se revendiquait de ce comportement en se vautrant dans le colportage de racontars aussi vils que stupides contre le CCI.([18] [167]) Maintenant, (sans doute en voyant que l'attitude précédente n'a pas mené au résultat escompté) il essaye de se blanchir les mains en défendant hypocritement "la nécessité de polémiques saines". (...) Comment oser parler de "solidarité", de "reconnaissance du milieu politique du prolétariat" quand le fondement n'existe pas? CBG a la toupet d’oser nous écrire : "L’existence de ce milieu engendre une communauté d’obligations et de responsabilité". Mais cela se traduira en vol le jour où vous serez en désaccord avec le CBG et il justifiera le vol comme "anti-petit-bourgeois". Peut-être pourrions-nous le formuler ainsi: quand on scissionne, on peut voler ce qu'on veut, mais quand on a enfin un groupe à soi... l'accession à la propriété assagit les petits voyous. Quelles sont les positions du CBG? Celles (plus ou moins) du CCI! Voila un autre groupe dont l'existence est parasitaire. Que représente-t-il face au prolétariat ? Une version provinciale de la plateforme du CCI avec la cohérence en moins et le vol en plus. (...) La plupart des petits cercles qui scissionnent sans avoir préalablement clarifié les positions commencent par suivre le chemin de la facilité en adoptant la même plate-forme que le groupe d'origine. Mais bientôt, pour Justifier une existence séparée, on découvre maintes questions secondaires divergentes et à la fin on change les principes... le CBG prend déjà le même chemin en rejetant la cohérence sur la question de l'organisation. »([19] [168])
Voici également en quels termes la fecci évoquait le CBG en 1986 : « ... les scissionnistes de 81 usèrent de la tromperie pour s'approprier du Matériel du CCI. Certains de ceux qui formèrent ultérieurement le cbg aggravèrent encore les choses en menaçant d'appeler la police contre les membres du CCI qui voulaient récupérer le matériel volé. (...) Dans les pages du Communist Bulletin n° 5, le CBG a condamné de telles menaces comme "un comportement totalement étranger à la pratique révolutionnaire". Il affirme également que "les scissionnistes devraient rendre le matériel appartenant au groupe et les fonds de l'organisation". Cette autocritique est toutefois, au mieux, timide. Pour autant que nous sachions, le CBG détient toujours des fonds dont il avait la responsabilité quand il faisait partie du CCI... )ans la pratique, le CBG en tant que groupe n'a pas répudié sans équivoque le comportement gangstériste dans le milieu.»([20] [169])
Ainsi, à ses débuts, la FECCI était plus que réticente face aux propositions d'ouverture que le cbg avait faites à son égard. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts de la Tamise, et le même CBG était l'invité d'honneur de la 4e conférence de la FECCI puisqu'entre elle et lui «s’'était dégagé, au cours de précédentes discussions et rencontres, une réelle identité principielle. »([21] [170]) C'est vrai, qu'entre temps, le CBG, après presque neuf ans, avait restitue au CCI le matériel et les fonds dérobés au CCI. La FECCI en avait fait une sorte de préalable : «Sur notre insistance et comme pré condition à la tenue de la rencontre, le cbg marqua son accord sur la restitution au CCI du matériel en sa possession.»([22] [171]) Comme on peut donc le voir, ce n'est pas parce qu'il serait devenu d'un seul coup honnête que le cbg nous a restitue ce qu'il avait volé. Il a tout simplement acheté, au sens propre et en Livres Sterling, sa respectabilité aux yeux de la fecci qui était prête, dès lors à les fermer sur son « comportement gangstériste » (comme elle l'écrivait elle-même) du passé. Ainsi, la fecci s'est comportée comme une fille de bonne famille qui, craignant de rester célibataire après plusieurs échecs sentimentaux,([23] [172]) est prête à accepter les avances d'un ancien voyou. Mais comme elle « a de l'honneur», elle exige, avant de se fiancer, que son prétendant restitue à ses victimes le produit de ses larcins. Décidément, même si la fecci estime que l'opportunisme ne peut plus exister dans la période de décadence, elle est un vivant exemple du contraire. Et cela d'autant plus que la FECCI elle-même affirmait que ce qu'elle reprochait (évidemment à tort) au CCI était la marque de la tendance de 1981 : «Beaucoup d'aspects de la dégénérescence programmatique du CCI en 1985 (la recherche d'une influence immédiate, la tendance au substitutionnisme, le flou sur la nature de classe du syndicalisme de base, etc.) sont précisément des points qui étaient défendus par Chénier et d'autres scissionnistes en 1981. »([24] [173])
En fin de compte, ce n'est évidemment pas un hasard si, aujourd'hui, la FECCI opère un regroupement parfaitement opportuniste avec un groupe que tout le CCI (y compris les camarades de la future fecci) reconnaissait comme «parasitaire». C'est que la FECCI, ne se distingue fondamentalement pas du cbg (sinon qu'elle savait qu'on ne doit pas voler le matériel des organisations révolutionnaires). Tous les deux sont fondamentalement des groupes parasites, qui ne correspondent nullement à un effort historique, aussi imparfait soit-il, du prolétariat et de ses organisations politiques vers sa prise de conscience, et dont la seule raison d'existence est justement de «parasiter» (au sens propre de tirer sa substance en prélevant celle des autres et en les affaiblissant) les véritables organisations du prolétariat.
Une des preuves que la fecci n'a pas d'existence autonome, en tant que groupe politique, vis-à-vis du CCI, c'est que sa publication est constituée pour plus d'un tiers en moyenne (et quelques fois dans sa presque totalité) d'articles attaquant et dénigrant notre organisation.([25] [174]) Cette démarche parasitaire permet également de comprendre es énormes difficultés rencontrées par la fecci pour comprendre les véritables enjeux des événements de l'Est : comme il lui fallait à tout prix se distinguer du CCI pour justifier son existence (et «démontrer » la dégénérescence du CCI), elle n'a pu raconter que des âneries dans la mesure où le CCI a été la première organisation du milieu politique à appréhender correctement ces enjeux. La seule chance (et encore) pour la fecci de dire quelque chose de sensé aurait été que nous fassions fausse route. C'était quand même trop nous demander. En fait, c'est le propre des groupes parasites que de sombrer dans l'incohérence et les analyses aberrantes et cela d'autant plus que l'organisation de référence à des positions correctes et cohérentes, l'opposition systématique contre la cohérence ne peut que donner n'importe quoi.([26] [175])
D'ailleurs, le caractère parasitaire de la fecci apparaît dans son nom même. Pour l’ouvrier qui est peu informé des arcanes du milieu politique, rencontrer une publication ou un tract signé d'une organisation qui se réfère au CCI sans être le CCI ne peut que semer le trouble. Les absurdités écrites par la fecci risquent d'être imputées à tort à notre organisation et même si la FECCI écrit des choses correctes (cela lui arrive quelquefois puisque sa plate-forme est celle du CCI), il ne peut qu'aboutir à la conclusion que les révolutionnaires sont des gens peu sérieux qui prennent un malin plaisir à semer la confusion.
Fondamentalement, la fonction de tels groupes est d'amoindrir l'action des organisations révolutionnaires dans la classe, de discréditer les idées révolutionnaires elles-mêmes. C'est pour cela que nous estimons aujourd'hui encore, comme en 1986 que : «Comme à l'égard du CBG, nous pouvons écrire à propos de la FECCI : " Voila un autre groupe dont l'existence est parasitaire. La meilleure chose que nous puissions souhaiter pour la classe ouvrière de même que pour les camarades qui la composent, c'est la disparition la plus rapide possible de la FECCI. " »([27] [176])
Et si, décidément, la fecci n'est pas résolue à rendre ce service à la classe ouvrière nous pouvons lui demander au moins de nous lâcher les basques et de cesser de faire référence à notre organisation dans son propre nom : cela éviterait au CCI de continuer d'endosser le discrédit qu'apportent à son nom les stupidités et l'opportunisme de la FECCI.
FM, mars 92.
[1] [177] « Pourquoi la Fraction », PI n° 3.
[2] [178] « Les tâches de la fraction », PI n° 1.
[3] [179] « Les bouleversements en Europe de l'Est », supplément à PI n° 15.
[4] [180] « ..quelle que soit l’évolution future de la situation dans les pays de l'Est, les événements qui les agitent actuellement signent la crise historique, l’effondrement définitif du stalinisme, cette monstruosité symbole de la plus terrible contre-révolution qu'ait subie le prolétariat. Dans ces pays s'est ouverte une période d'instabilité, de secousses, de convulsions, de chaos sans précédent dont les implications dépasseront très largement leurs frontières. En particulier, l'effondrement qui va encore s'accentuer du bloc. russe ouvre les portes à une déstabilisation du système de relations internationales, des constellations impérialistes, qui étaient sortis de la seconde guerre mondiale avec les accords de Yalta. ...) Les événements qui agitent à l'heure actuelle les pays dits "socialistes", la disparition défait au bloc russe, (...) constituent le fait historique le plus important depuis la seconde guerre mondiale avec le resurgissement international du prolétariat à la fin des années 60. » (Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est, RInt n° 60)
«La configuration géopolitique sur laquelle a vécu le monde depuis la seconde guerre mondiale est désormais complètement remise en cause par les événements qui se sont déroulés au cours de la seconde moitié de l’année 1989. Il n'existe plus aujourd'hui deux blocs impérialistes se partageant la mainmise sur la planète. (...) à l'heure actuelle, un cours vers la guerre mondiale est exclu du fait de l'inexistence de deux blocs impérialistes. » (« Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos », RInt n° 61)
[5] [181] Pour mémoire, ce texte est écrit alors que les seuls régimes staliniens d’Europe à conserver leur pouvoir passé sont ceux d’Albanie te de Hongrie.
[6] [182] Résolution de la fecci sur les bouleversements en Europe de l'Est, supplément à PIn°15.
[7] [183] Voir « Face aux bouleversements à l'Est, une avant-garde en retard », RInt n° 62.
[8] [184] Cependant, on peut dire que, d'une certaine façon, les événements de l'Est ont quand même donné raison à la fecci sur certains points : comme nous l'avions prévu depuis le début dans notre analyse, ces événements ont effectivement provoqué la division du bloc occidental et de la CEE. Mais il est fort peu probable que ce fut de cette façon-là que l'ait planifié Gorbatchev; à moins de considérer qu'il ait adopté l'attitude du mari trompé qui se suicide pour plonger sa femme dans la culpabilité et le désespoir... La fecci pourrait réfléchir à cette hypothèse dans le cadre de sa problématique de la femme battue, partie prenante de son effort pour « approfondir le marxisme».
[9] [185] «Antagonismes inter impérialistes : une orientation pour les années 90». Comme souvent, la fecci fait dans l'humour involontaire. Compte tenu du fait qu'elle avait été obligée de modifier son analyse tout au long des deux ans qui s'étaient écoulés (pratiquement à chacune de ses publications de PI, mais sans que cela lui permette de dégager une analyse correcte), proposer une orientation pour toute une décennie faisait figure d'acte de démence. Si la présomption de la fecci n'était pas aussi hypertrophiée qu'est rachitique sa capacité d'analyse, en d'autres mots, si elle avait un tout petit peu le sens du ridicule, elle aurait dû proposer «une orientation pour le prochain trimestre», c'est-à-dire jusqu'à la parution suivante de sa revue. Elle se serait évitée ainsi le désagrément de devoir invalider dès PI n°21 (sans toutefois le reconnaître) les prévisions à long terme de PI n°20.
[10] [186] Pour ne pas mentir, il faut bien dire que la fecci, dans la présentation de sa conférence, évoque tout de même le bloc de l'Est : «le COMECON a disparu en tant que système de rapport impérialiste entre la tête de bloc, l'URSS, et ses satellites qui ont cessé d'être de simples vassaux ». C'est clair, ça au moins ! C'est clair que la fecci veut noyer le poisson. Le COMECON a disparu, certes (c'est bien de constater ce que celui-ci a lui- même annoncé officiellement), mais subsiste-t-il un autre «système de rapport impérialiste entre... l'URSS et ses satellites»'} Mystère. De quel «bloc» s'agit-il? De celui qui a disparu, ou de celui qui subsisterait encore sous d'autres formes ? Au lecteur de deviner. Et que sont devenus les satellites ? Des vassaux quand même mais «pas simples» ? Quand la fecci cessera-t-elle de prendre les lecteurs de sa revue pour des simples d'esprit ?
[11] [187] Il n'y a pas de limites à la nullité et à l'ignorance théoriques de la fecci (surtout quand elle se propose d'épingler le cci). Ainsi, dans PIn° 1 / («Saisir la signification des événements en Europe de l'Est») on peut lire que : « la théorie du capitalisme d'Etat est basée sur l'existence de blocs militaires». C'est une idiotie. Les deux phénomènes ont bien une origine commune : l'impérialisme et, plus globalement, la décadence capitaliste, mais cela ne signifie pas qu'ils soient liés entre eux par un lien de cause à effet. Si la rougeole provoque à la fois des boutons et de la fièvre, faut-il en conclure que ce sont les boutons qui sont responsables de la fièvre ? Dans ce même article, la fecci ironise finement: «Il est étrange de conjecturer la fin d'un bloc impérialiste tout entier sans qu’un seul coup de feu ait été tiré. Chaque bloc serait sans aucun doute transporté de joie si l'autre devait venir à disparaître en raison des seuls effets de la crise, sans avoir à tirer un missile. Pensez au temps et à l'énergie qui pourraient ainsi être épargnés ! » Et oui, c est «étrange» ! Surtout pour ceux qui écrivent que : «L'histoire avance, pose de nouveaux problèmes, pose d'anciens problèmes sous une forme nouvelle». Mais c'est arrivé, même s'il a fallu deux ans aux auteurs de ces bonnes paroles pour s'en rendre compte. Pensons au temps et à l'énergie qui pourraient être épargnés aux organisations révolutionnaires (et à la classe ouvrière) si elles n'étaient pas encombrées de parasites stupides et prétentieux comme la fecci ! Et comme l'ironie mal à propos semble être le fort de la fecci, et particulièrement de l'auteur des lignes qui précèdent (JA), nous avons encore droit dans PI n° 20, du même auteur, a une pique du même calibre : «Certains nous chantent même que la rivalité impérialiste entre le bloc U. S. et le bloc russe est une affaire du passé. On n'arrête pas le progrès !» (« Pour une pratique vivante du marxisme») Trois mois après, c'est la fecci elle-même qui chante (mieux vaut tard que jamais !) la même chanson. Mais en comprend-elle les paroles ?
[12] [188] Voir PI n° 16, où il semble qu'il y ait autant de positions que de membres de la fecci (ce qui confirme que cette dernière reproduit la même hétérogénéité qui existait déjà dans l'ancienne "tendance").
[13] [189] Il faut noter que, dans les deux textes (celui de la fecci et celui de la minorité d'alors) de décembre 89 prenant position sur les événement de l'Est (supplément à PI n° 15), il n'est fait AUCUNE référence au document « Thèses sur Gorbatchev » publié dans PI n° 14 et qui était censé représenter le cadre de compréhension de la «perestroïka » En particulier, il n'est nullement évoqué la question du passage de la « domination formelle à la domination réelle du capital» qui constitue un nouveau dada de la fecci (voir dans la Revue n° 60 notre article de réfutation des élucubrations de la fecci et d'autres groupes sur cette question) et qui est présentée par elle comme un de ses grands « apports théoriques ». De toute évidence les « découvertes » de la fecci ne lui étaient pas d'un grand usage pour comprendre le monde d'aujourd’hui. Ce n'est qu'ultérieurement, qu'elle a essayé de recoller les morceaux en y faisant, sans trop de conviction, de nouveau référence.
[14] [190] RInt 61, « Après l'effondrement du bloc de l'Est, déstabilisation et chaos », janvier 1990.
[15] [191] «Antagonismes inter-impérialistes : une orientation pour les années 90 », PI n° 20.
[16] [192] PI n°20, Présentation de la IV^ conférence de PI.
[17] [193] Il existe évidemment une différence fondamentale entre la façon dont la fecci est parvenue à comprendre les enjeux et les implications des événements de l'Est et la façon dont le CCI l'avait fait il y a deux ans et demi. C'est de manière totalement empirique, sous la poussée massive de réalités irréfutables, que la fecci a fini par reconnaître une réalité. En revanche, si le CCI a réussi à identifier cette nouvelle réalité historique alors même que les manifestations en passaient encore pratiquement inaperçues pour la totalité des observateurs (qu'ils appartiennent au camp capitaliste ou même au camp prolétarien), ce n’est pas en faisant appel a un médium ou aux prédictions de Nostradamus. C'est en se basant sur son cadre d'analyse antérieur et en s'appuyant fermement sur la démarche marxiste lorsqu'il a fallu reconsidérer certains aspects de ce cadre. Empirisme (dans le meilleur des cas) contre méthode marxiste, voilà la véritable distinction entre la fecci et le CCI sur le plan de la réflexion théorique.
[18] [194] Pour avoir une petite idée du niveau de la kpolémique» tel que l'entendait le cbg, voici un tout petit extrait de sa prose de l'époque : «un processus de manoeuvres dans lequel X et sa compagne de lit d'alors,Y, jouèrent un rôle proéminent » [a process of manoeuvring in which X and his then bed-fellow Y played a proéminent part] (« Lettre ouverte au milieu prolétarien sur l'affaire Chénier », The Bulletin n° 1).
[19] [195] RInt n°36, "Adresse du 5e congrès du CCI aux groupes politiques prolétariens : réponse aux réponses [196]".
De façon quelque peu ironique, cet article a été écrit par JÀ, aujourd'hui membre de la fecci et principal procureur de notre organisation dans les colonnes de PI, lorsqu'elle défendait les principes du CCI. Nous lui souhaitons bien du plaisir, ainsi qu'aux « voyous » du cbg, dans les relations étroites qui se développent à l'heure actuelle entre la fecci et le cbg.
[20] [197] PI n° 3, « Les incompréhensions face à notre existence ».
[21] [198] PI n° 20.
[22] [199] PI n°15, «Compte-rendu d'une rencontre avec le cbg ».
[23] [200] Voir dans PI n° 13 (« Revue Internationale du Mouvement communiste : Les Limites d'une initiative») ses déboires dans ses tentatives de participation, en 87, à un rapprochement entre différents reliquats de groupes politiques confus et parasitaires. 4. PI n6 3, « Les incompréhensions face à notre existence».
[24] [201] PI n6 3, « Les incompréhensions face à notre existence».
[25] [202] C'est pour cela qu'on a du mal à la croire lorsqu'elle écrit : « Nous avons donc accentué notre critique de la manière dépenser et d'agir du CCI, ... non par plaisir d'assouvir des rancoeurs obsessionnelles "anti-CCI " mais par soucis révolutionnaire » (PI n° 10, « Quelle lutte pour les comités ouvriers »)
[26] [203] C'est faute de place que cet article, rédigé en mars 92, n est pas paru dans le précédent numéro de notre Revue. Depuis, la fecci a publié un nouveau numéro de PI que nous ne pouvions pas évoquer sans allonger encore notre article. Cependant, il vaut la peine de citer un texte de PI n° 22, rédigé par un ancien membre de la fecci, et qui connaît bien l'état d'esprit qui la domine : «La Fraction ne veut pas utiliser la notion de décomposition, sans doute parce que ce serait aller dans le sens du CCI (souligné par nous). On comprend mal pourquoi ta Fraction critique l'emploi du terme décomposition " et accuse le CCI de sortir du cadre au marxisme quand cette organisation utilise et développe cette notion. Tout se passe comme s'il y avait une orthodoxie de la décadence, une invariance de la décadence sur laquelle il serait malséant de revenir. De critique, la pensée devient immobilisme, passe-partout essayant péniblement d'ouvrir les énigmes... De la sorte, on prépare et on se dirige tout droit vers une situation analogue à celle causée par nos insuffisances d'analyse des événements à l'Est. On s'est rendu compte de la disparition du bloc de l'Est avec deux années de retard; on se rendra compte de la réalité de la décomposition sociale avec un retard tout aussi accablant. » (« Décadence du capitalisme, décomposition sociale et révolution»). Nous ne saurions mieux dire !
[27] [204] RInt n°45, «La Fraction externe du CCI».