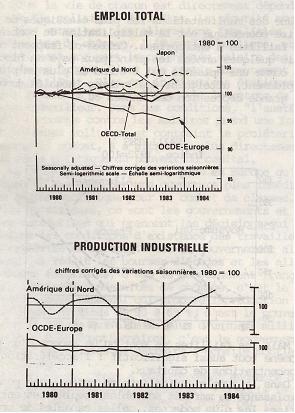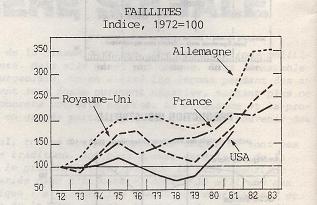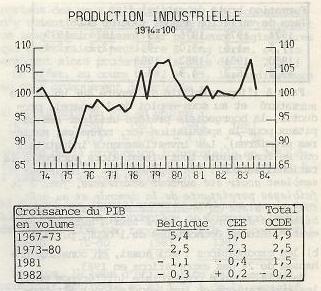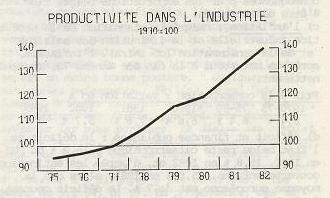Revue Internationale no 38 - 3e trimestre 1984
- 2530 reads
Lutte de classe internationale : simultanéité des grèves ouvrières : quelles perspectives ?
- 2436 reads
LE RENOUVEAU INTERNATIONAL DES LUTTES
Dans notre Revue Internationale n°37, la précédente, nous titrions sur la reprise internationale de la lutte de classe. Après la défaite du prolétariat en Pologne, et le recul des luttes qui l'avait suivie en 1981 et 82, nous avons assisté ces derniers temps au resurgissement de luttes massives dans le monde entier, et principalement en Europe occidentale.
Ce resurgissement confirme que la classe ouvrière refuse de se serrer encore plus la ceinture ; qu'elle n'accepte pas de se sacrifier pour "sauver les économies nationales" ; que la bourgeoisie ne réussit pas à obtenir la paix sociale, la discipline sociale, ni une quelconque adhésion à ses projets économiques immédiats : baisse des salaires, licenciements massifs, la misère généralisée. Cette indiscipline sociale du prolétariat signifie que la bourgeoisie n'a pas les moyens politiques pour déclencher sa 3ème guerre mondiale, malgré l'intensification des rivalités et des conflits inter impérialistes. Incapable de faire accepter l'accentuation de la misère, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne réussit pas à l'imposer en grande partie, la bourgeoisie est d'autant plus -incapable d'imposer de plus grands sacrifices, jusqu'au dernier, celui de nos vies qu'impliquerait l'ouverture de la voie à l'issue capitaliste à la crise : la guerre généralisée.
Nous continuons donc d'affirmer que le cours historique de la période ouverte à la fin des années 60 est aux affrontements de classe et non à la guerre.
Dans les années 80, "années de vérité", la bourgeoisie ne peut plus retarder l'attaque économique contre la classe ouvrière. Cette attaque n'est pas improvisée, cela fait plusieurs années que la classe dominante la prépare, et ce au niveau international : __
- au niveau politique, c'est la mise en place de la tactique de la "gauche dans l'opposition", c'est-à-dire en dehors de toute responsabilité gouvernementale ;
- au niveau économique, c'est la planification par des organismes tels que le FMI ou l'OCDE, ou par des accords entre Etats, de l'attaque économique contre la classe ouvrière.
Nous avons maintes fois développé dans cette Revue (notamment dans la Revue Internationale n° 31, sur "le machiavélisme de la bourgeoisie") et dans nos différentes presses territoriales cette question. Inutile d'y revenir ici.
C'est bien à une attaque concertée, planifiée et organisée au niveau international, contre laquelle se défend la classe ouvrière depuis la fin 83 ([1] [1]).
Le silence de la presse.
Le silence, les mensonges déversés par les médias de la bourgeoisie ne doivent pas empêcher les groupes révolutionnaires de reconnaître cette reprise. Depuis septembre dernier, c'est l'ensemble des pays européens qui sont touchés par des grèves, des réactions massives et déterminées du prolétariat. Sans négliger les révoltes de la faim en Tunisie, au Maroc, dernièrement à Saint Domingue, il est nécessaire de constater que les mouvements qui secouent les USA, fait nouveau, le Japon (22 000 dockers en grève), et surtout la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Espagne, l'Italie, etc.. se situent dans le centre historique, économique et politique du capitalisme, et à ce titre revêtent une importance particulière.
Malgré le black-out de la presse, nous savons, et une des tâches des révolutionnaires, c'est aussi de faire savoir que :
- en Espagne "les ouvriers désabusés se sont mis à se défendre contre les plans du gouvernement. Il n'y a pas un jour sans qu'une nouvelle grève ne se déclenche..." (Der Spiegel, 20/2/84) ; touchés par les grèves : SEAT, la General Motors, les secteurs du textile, Iberia (aviation), les chemins de fer, les services publics, la sidérurgie (Sagunto) et les chantiers navals ;
- le 24 mars, 700 000 ouvriers manifestaient à Rome contre la remise en cause de "l'échelle mobile" ;
- les 12 et 13 mars, 135 000 mineurs se mettent en grève en Grande-Bretagne, grève qui se poursuit depuis ;
- en France, après Talbot, les Postes, c'est la sidérurgie, les chantiers navals, les mines et l'automobile qui sont touchés par les réactions ouvrières ;
- en mai, au paradis de la paix sociale en Allemagne de l'Ouest, la grève lancée par le syndicat sur les 35 heures est la réponse de la bourgeoisie à la combativité des ouvriers qui commençait à s'exprimer dans plusieurs grèves sauvages et spontanées.
Du mouvement de grève générale dans les services publics en Belgique de septembre à la grève actuelle des métallos en Allemagne, c'est l'ensemble du prolétariat international qui reprend le chemin du combat de classe, du refus de la logique de sacrifice que nous offre le capitalisme.
LES ARMES DE LA BOURGEOISIE
1- Les campagnes de diversion.
Le silence et les mensonges des journaux ne sont pas la seule arme utilisée par la bourgeoisie. L'organisation de campagnes de diversion permet de déboussoler, de démobiliser les ouvriers : essentiellement ceux qui ne sont pas encore en lutte. C'est tout le sens de la manifestation pacifiste organisée par la gauche et les gauchistes en pleine grève de la fonction publique aux Pays-Bas, l'automne dernier. L'utilisation du scandale des "avions-renifleurs de pétrole" - il fallait l'inventer - durant la grève à Talbot en France, le bruit fait autour du scandale sur le financement de partis politiques en Allemagne - quelle soudaine honnêteté ! - au moment où débutait la grève des métallos, ne visent qu'à passer sous silence les grèves ouvrières.
Toutes ces campagnes, et il y en a bien d'autres, produisent un écran de fumée derrière lequel il est difficile d'entrevoir les réactions ouvrières, ce qui renforce ainsi leur isolement.
2- Les faux appels à l'extension.
Face aux secteurs de la classe qui, eux, sont en lutte, ces écrans de fumée ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, la bourgeoisie n'a peur que d'une chose : l'extension, la coordination réelles des grèves. Elle ne peut plus empêcher les réactions prolétariennes ; elle n'en est plus capable. Non, alors elle cherche à les étouffer dans la dispersion et l'isolement. Le prolétariat n'étant pas une masse amorphe sans réflexion, la bourgeoisie se doit d'employer des thèmes qui permettent cet isolement et cette division. Cette tâche revient en premier lieu à ses bons serviteurs du capital que sont les syndicats : enfermer les ouvriers dans des impasses, dans la défense de l'économie nationale, "produisons français, consommons français" crie la CGT, le syndicat du PCF, en opposant les ouvriers d'une région à l'autre comme en Belgique, d'un secteur à l'autre comme aux Pays-Bas où les syndicats lors de la grève du secteur public proposaient une... réduction des salaires dans le privé !
Il est de plus en plus clair pour les ouvriers qu'isolés, dispersés par région, par secteur industriel, ils courent à l'échec. Ce sentiment envers la nécessité de l'extension est chaque fois plus affirmée. Pour parer à cette volonté, pour la vider de son contenu prolétarien, la bourgeoisie n'hésite pas à prendre les devants. Elle propose de fausses extensions, de fausses généralisations, de fausses solidarités.
Nous avons déjà vu comment les syndicats avaient "généralisé" la lutte des cheminots et des postiers en Belgique aux secteurs les moins combatifs, les plus encadrés des services publics. Ainsi, ils noyaient le coeur militant de la lutte et lui étaient toute initiative d'extension réelle pour s'assurer du contrôle complet de la grève.
C'est à la recherche du même but que la CGT a organisé, appelé et fait défiler, "protégés" par son service d'ordre, les ouvriers de la sidérurgie lors de la "Marche sur Paris" du 13 avril. A la recherche du même but aussi, l'organisation de la "Marche sur Rome" du 24 mars ; de même le syndicat du PC espagnol, les "commissions ouvrières" ainsi que les gauchistes en voulant appeler pour le 6 mars à une "Marche sur Madrid" avaient la même volonté d'isolement et de dispersion que la FGT belge.
3- Le syndicalisme de base.
L'accumulation de toutes ces manoeuvres déconsidère encore plus les syndicats parmi les ouvriers. Et malgré la radicalisation de leur langage, ils ne réussissent pas à enrayer la baisse du nombre de syndiqués, à empêcher que les dirigeants se fassent de plus en plus huer et chahuter lors de leur apparition et surtout à garder le contrôle complet sur les réactions ouvrières.
C'est là qu'intervient le syndicalisme critique, à la base, "radical" qui tente de ramener dans le giron du syndicalisme, et non plus tant des syndicats eux-mêmes trop démasqués, les ouvriers qui s'en détournent. C'est le syndicalisme? De base, le Collectif 79/84 qui, à Longwy, enferme les ouvriers dans des "actions-commandos" qui no servent qu'à les isoler encore plus dans "leur" région, "leur" ville, "leur" usine. Ce sont les"coordinations de forces syndicales", les "comités de lutte et de solidarité" qui, avec le leader Camacho des "commissions ouvrières" espagnoles, promettent une "grève générale" hypothétique, à une date indéfinie que... seuls les syndicalistes décideront.
Le meilleur exemple du sale travail qu'accomplit le syndicalisme de base se trouve en Italie. Il y avait bien longtemps que les syndicats officiels n'avaient pu mobiliser tant de monde : 700 000 ouvriers sont venus à la "Marche sur Rome?" à l'appel des "assemblées nationales des conseils d'usine". Nous devons d'abord dire que ces "conseils d'usine" n'ont de conseil que le nom. Ce n'est pas la première fois que la bourgeoisie usurpe des mots et noms au prolétariat afin d'en dénaturer la signification réelle, leur contenu de classe. Ces "conseils" ne sont qu'une structure syndicaliste à la base qui existe de façon permanente depuis 69. Ils sont tout le contraire d'un organe de lutte produit, contrôlé, dirigé par les ouvriers réunis en assemblées générales. Créés à la fin du mouvement de 69 pour maintenir les luttes dans l'enceinte des usines et des ateliers, ils reviennent en scène aujourd'hui afin de constituer une organisation syndicaliste de base crédible pour les ouvriers au niveau national, et ce dès le début du mouvement ; ils suppléent ainsi à la carence des syndicats officiels. Le mot d'ordre des "conseils d'usine" gauchistes d'Italie est : "nous ne sommes pas contre le syndicat, le syndicat c'est nous". La bourgeoisie utilise le syndicalisme de base pour vider la lutte de son contenu et en prendre le contrôle en appliquant la tactique du "laisser-faire à la base", de "reconnaître toutes les actions". Un des arguments du syndicalisme de base est d'essayer de faire croire aux ouvriers que par leur lutte, leur détermination, leur combativité, ils peuvent exercer une pression sur les syndicats afin de pousser ceux-ci ou leur direction à reconnaître ou à prendre en main les luttes. Cela, c'est toujours ramener les ouvriers dans le giron du syndicalisme, en prenant argument de la radicalisation de son langage.
Ces changements de langage syndical trouvent leur véritable sens dans toutes ces grèves, telles Talbot ou Citroën en France, où l'annonce par le patronat d'un nombre de licenciements plus élevé que celui dont il a vraiment besoin permet d'abord au syndicat de se montrer très radical en refusant tout renvoi et lui permet ensuite de faire croire à sa victoire, à son efficacité, en faisant "reculer" la bourgeoisie jusqu'au nombre de licenciements... qu'elle avait planifié. Ainsi, à Talbot, on annonce d'abord 3000 licenciés, puis, "grâce" à l'action énergique du syndicat c'est "seulement" 2000 ouvriers qui sont renvoyés.
Même si elle n'est pas nouvelle, cette tactique, cette concertation préalable entre patrons et syndicats est aujourd'hui de plus en plus employée.
4- L'utilisation de la répression.
L'Etat ne peut se permettre une répression aveugle et frontale contre les luttes ouvrières qui se développent actuellement. Celle-ci aurait l'effet inverse à celui recherché : accélérer la prise de conscience chez les ouvriers que c'est à l'ensemble de la bourgeoisie, à l'Etat qu'ils doivent s'affronter. Néanmoins, l'Etat doit montrer sa présence et sa force. C'est ainsi qu'il sélectionne l'utilisation de sa répression. Il tente de créer des abcès de fixation qui puissent détourner la combativité des luttes.
C'est le sens des procès faits au syndicat des mineurs en Grande-Bretagne contre l'organisation des piquets de grève. En outre, cela crédibilise le syndicat en lui donnant une "auréole" de réprimé. La bourgeoisie anglaise n'a pas hésité à arrêter plus de 500 mineurs à ce jour. C'était le même but qui était visé en France à Talbot, en faisant intervenir la milice patronale sous les yeux de la police contre les ouvriers en grève. De même, à Longwy, avec les opérations "coup de poing", "commandos". C'est aussi ce qui s'est passé à Sagunto en Espagne avec la violente répression contre une manifestation des ouvriers.
C'est un terrain propice au syndicalisme de base, aux gauchistes, qui peuvent ainsi à l'aide de la violence étatique, au besoin avec des "victimes", crédibiliser leurs actions violentes. L'utilisation de la répression "sélective" et celle du gauchisme sont parfaitement complémentaires et forment un tout.
5- Le maintien de la gauche dans l'opposition.
Tous ces obstacles opposés par la bourgeoisie au prolétariat nécessitent, pour avoir un maximum d'efficacité, le relais, l'existence d'un semblant d'opposition aux gouvernements en place chargés d'attaquer la classe ouvrière. Le maintien de partis de gauche importants, au langage ouvrier, ayant eu la confiance des ouvriers et s'appuyant sur les illusions et les faiblesses que ces derniers conservent, permet une mise en place crédible, efficace des obstacles cités précédemment.
Le renvoi du PS dans l'opposition en Allemagne a permis l'année dernière l'organisation de puissantes manifestations pacifistes ; il permet aujourd'hui au syndicat DGB d'organiser préventivement un mouvement de grève sur les 35 heures. Celui-ci a pour but d'épuiser, de dévoyer, de déboussoler la combativité ouvrière qui commençait à s'exprimer spontanément. De même, l'appel à des manifestations pacifistes en Italie correspond à une opposition plus prononcée du PC envers le gouvernement et à une radicalisation de son langage ; tout comme pour la CGIL d'ailleurs qui, en appuyant le syndicalisme de base style "conseils d'usine", tente d'occuper le terrain social. Bien que participant au gouvernement, le PCF essaie de suivre l'exemple des PC italien et espagnol, des PS allemand ou belge afin de paraître s'opposer à l'attaque qui est faite à la classe ouvrière ; c'est le sens des critiques de plus en plus fortes que porte son syndicat, la CGT, contre Mitterrand.
Pour la bourgeoisie, l'heure n'est pas à changer le dispositif de son appareil politique face au prolétariat. Bien au contraire, il s'agit de renforcer la politique de la "gauche dans l'opposition" afin d'affronter le prolétariat.
LES CARACTERISTIQUES DES LUTTES ACTUELLES
La reprise des luttes actuelles signifie que le prolétariat - attaqué économiquement par la bourgeoisie d'une part, ayant mûri et réfléchi sa défaite en Pologne, perdant de plus en plus, et ses illusions sur une issue à la crise du capitalisme, et sa confiance dans les partis de gauche et les syndicats d'autre part - reprend le chemin du combat de classe qui passe par la défense de ses conditions de vie, par la lutte contre le capital.
La nécessité du maintien de la gauche dans l'opposition, la nécessité d'une force politique de la bourgeoisie qui soit présente dans les luttes pour les contrôler, les saboter, les dévoyer, est une tactique employée maintenant depuis les années 79-80. La reprise actuelle des luttes ouvrières manifeste l'usure progressive de cette tactique. Dans la plupart des pays d'Europe occidentale, l'existence de grands partis de gauche en "opposition" ne suffit plus à empêcher le surgissement des grèves.
En même temps que l'usure progressive de la carte de la gauche dans l'opposition, les luttes ouvrières actuelles manifestent également la fin des illusions sur un renouveau économique du capitalisme. Ces illusions entretenues par la gauche et ses syndicats sur des solutions nationales, protectionnistes, "anti-capitalistes" du style "faire payer les riches", tendent à tomber de plus en plus. C'est ce qu'exprime le refus des ouvriers de la sidérurgie tant en Espagne qu'en France, de se laisser berner par les "plans de reconversion" et de "formation". C'est ce qu'exprime encore plus le retour au combat de classe des ouvriers des USA et d'Allemagne de l'Ouest qui, il y a deux ans, acceptaient les réductions de salaire pour "sauver" leur entreprise.
Cette maturation de la conscience dans la classe ouvrière passe aujourd'hui par la reconnaissance du caractère bourgeois de la gauche dans son ensemble, de 1'inéluctabilité de l'approfondissement de la crise du capitalisme, et que seule la lutte ouvrière déterminée, massive et généralisée peut ouvrir une autre perspective à la dégradation continuelle des conditions d'existence. Cette maturation progressive s'exprime dans les caractéristiques mêmes des luttes qui se déroulent sous nos yeux aujourd'hui :
- tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant un certain débordement des syndicats ;
- tendance à des mouvements de grande ampleur ;
- simultanéité croissante des luttes au niveau international ;
- rythme lent du développement de ces luttes.
1- La tendance au surgissement de mouvements spontanés.
Que ce soit la grève du secteur public en Belgique partie sans les syndicats en septembre 83, que ce soit, en octobre 83 en Grande-Bretagne, le rejet par 65 000 ouvriers des chantiers navals de l'accord passé entre le syndicat et la direction, et le même mois, dans le même pays, la grève de 15 000 mineurs sans l'accord syndical, que ce soit les critiques et le dégoût des ouvriers envers les syndicats à Talbot en décembre 83, ou les violentes manifestations, spontanées, des ouvriers de la sidérurgie et des chantiers navals en France en mars 84, que ce soit en Espagne à la General Motors, en Allemagne où des grèves "sauvages" ont éclaté à Duisburg (Thyssen) et à Brème (Klokner), que ce soit même les "révoltes de la faim" en Tunisie, au Maroc, en République Dominicaine le 20 avril, au Brésil etc., toutes ces réactions ouvrières manifestent une tendance générale à déborder spontanément les syndicats.
Ces derniers ne réussissent plus à empêcher les réactions ouvrières, même s'ils arrivent encore à en garder en grande partie le contrôle. La prise de conscience du rôle anti-ouvrier des syndicats grandit. Les mensonges sur leur caractère ouvrier, sur la possibilité et la nécessité d'en passer par eux, sur leur indispensabilité, sont de plus en plus démasqués.
2- La tendance à des mouvements de grande ampleur.
Ce sont des millions d'ouvriers qui, dans le monde entier, et particulièrement dans les grands centres capitalistes, ont participé, et continuent de participer aux luttes actuelles. Nous l'avons vu précédemment : des mouvements d'une très grande ampleur ont touché, et touchent présentement 1'ensemble de l'Europe occidentale, les USA, l'Amérique du Sud, les pays d'Afrique du Nord tout comme l'Afrique du Sud, l'Inde etc.. De plus, ce sont tous les secteurs qui sont touchés par les réactions ouvrières : services publics, automobile, sidérurgie, chantiers navals, mines etc..
Inévitablement, les ouvriers connaissent l'existence de ces mouvements, et ce malgré le silence et les mensonges de la presse. Inévitablement, pour rompre avec leur isolement, la question de l'extension et de la coordination des luttes se pose. Un début de réponse a été donné par les cheminots à Liège et à Charleroi (Belgique) quand ils sont allés chercher les ouvriers des postes et ont réussi à les entraîner dans la grève en septembre dernier. Contre les licenciements massifs, les mineurs de Grande-Bretagne se mettent en grève. 10 000 piquets de grève appellent à l'extension et les 12 et 13 mars, 135 000 mineurs ont arrêté le travail. C'est là aussi un début de réponse à ce problème de l'extension.
L'extension d'ailleurs ne se fait pas uniquement vers les ouvriers qui ont un travail. Ceux qui sont chômeurs sont tout autant concernés par les luttes de leur classe. Nous avons vu comment les ouvriers sans travail se sont joints aux manifestations ouvrières à Longwy et à Sagunto. En République Dominicaine, les chômeurs, 40% de la population, ont participé à la révolte ouvrière contre les augmentations de 40 à 80% des produits alimentaires de base. Même chose en Tunisie et au Maroc l'hiver dernier.
3- La simultanéité des luttes.
Ni durant la première vague de luttes ouvrières de 68-74, ni durant la seconde de 78-80, une telle simultanéité n'avait existé. Et chacun d'entre nous sait le prix qu'en a payé le prolétariat en Pologne : l'incapacité à rompre avec les filets de la propagande bourgeoise sur la spécificité "de l'Est" de la grève de masse d'août 80, l'incapacité des luttes ouvrières à rompre l'isolement international du prolétariat. Aujourd'hui, cette simultanéité n'est que la juxtaposition des luttes ouvrières et non la généralisation internationale de la lutte de classe. Néanmoins l'idée de la généralisation fait déjà son chemin : en assemblées générales, les ouvriers de Charleroi, face au syndicat, au plus fort des affrontements entre les ouvriers de Longwy et la police française scandaient "à Longwy ! A Longwy !" Il ne faut pas s'y tromper, les grèves en Europe, et principalement et pour des raisons différentes, en Allemagne et en France, suscitent une grande attention et un grand intérêt parmi les ouvriers.
4- L'auto organisation.
Jusqu'à présent, le prolétariat n'a pu étendre, coordonner et encore moins généraliser son combat. Tant que les ouvriers n'arriveront pas à disputer le contrôle de leurs luttes aux syndicats, tant qu'ils ne réussiront pas à les prendre en main eux mêmes, tant qu'ils ne s'affronteront pas aux syndicats sur les buts et le contrôle des luttes, ils ne pourront organiser l'extension. C'est dire l'importance de l'auto organisation pour répondre aux besoins immédiats, premiers de chaque lutte aujourd'hui. C'est aux assemblées générales de décider et d'organiser l'extension et la coordination. Ce sont elles qui se déplacent si elles le peuvent, qui. envoient des délégations massives ou des délégués appeler à la grève dans les autres usines, ce sont elles qui nomment et révoquent à tout moment, si besoin est, les délégués. Or, jusqu'à présent, la bourgeoisie a réussi à vider de leur contenu toutes les assemblées qui ont existé.
Sans auto organisation, sans assemblées générales, il ne peut y avoir de véritable extension, et encore moins de généralisation internationale du combat de classe. Mais sans cette extension, les rares exemples d'auto organisation, d'assemblées générales en Belgique, en France, en Espagne, perdent leur fonction et leur contenu prolétariens, et laissent ainsi la bourgeoisie et ses syndicats occuper le terrain. Les ouvriers sont en train de comprendre que l'organisation de l'extension ne se fera qu'au prix du combat contre le syndicalisme.
5- Le rythme lent du développement des luttes.
La difficulté présente d'auto organisation de la classe ouvrière n'est que l'effet le plus visible du rythme lent du développement des luttes actuelles. L'attaque économique est pourtant très forte. Certains pourraient voir dans ces difficultés et la lenteur de la reprise, dans l'absence d' "un saut qualitatif" dans la grève de masse du jour au lendemain, une faiblesse extrême du prolétariat. Ce serait confondre les conditions de lutte dans lesquelles se trouve le prolétariat dans les grands pays industriels et historiques du capitalisme, avec les conditions qu'il rencontre dans les pays du "tiers-monde" et du bloc russe comme en Pologne. Avant de pouvoir déboucher sur la grève de masse et sur la généralisation internationale, le prolétariat doit affronter et dépasser les obstacles disposés par la bourgeoisie : la gauche dans l'opposition et les syndicats, et en même temps organiser le contrôle et l'extension de ses luttes. Ce processus nécessite une prise de conscience et une réflexion collective de la classe tirant les leçons du passé, et celles des luttes actuelles. Le rythme lent de la reprise des luttes, loin de constituer une faiblesse insurmontable, est le produit de la maturation lente, mais profonde de la conscience dans la classe ouvrière. Nous affirmons donc que nous n'en sommes qu'au débat de cette vague de lutte.
La raison de cette lenteur est due à la nécessité de reprendre les questions qui avaient été posées durant la vague précédente, mais qui n'avaient pas été résolues : le manque d'extension dans la grève du port de Rotterdam en 79 ; l'abscence d'assemblées générales à Longwy Denain la même année ; le sabotage du syndicalisme de base dans la grève de la sidérurgie en Grande-Bretagne; la nécessité de la généralisation internationale après la grève de masse en Pologne ; le rôle de la "gauche dans l'opposition" dans le reflux et la fin de cette vague de lutte.
Mais contrairement à 78-80, c'est à l'ensemble de ces questions que les ouvriers dans toutes les luttes d'aujourd'hui, se trouvent confrontés. Ce n'est pas une question qui est abordée dans chaque lutte, mais toutes à la fois. D'où la lenteur du rythme actuel des luttes ; d'où la difficulté mais aussi la profondeur de la maturation de la conscience dans la classe ouvrière.
6- Le rôle particulier actuellement du prolétariat en France.
Dans la prise de conscience du prolétariat international, la partie de celui-ci en France a une responsabilité particulière, temporaire et limitée. Du fait de l'arrivée accidentelle de la gauche au pouvoir suite aux élections de mai et juin 81, ce pays constitue à l'heure actuelle une brèche dans le dispositif politique international des forces de la bourgeoisie. La participation au gouvernement des partis de gauche, PS et PC, est lourde d'affaiblissement pour la bourgeoisie internationale.
Si la grève de masse d'août 80 en Pologne n'a pas peu contribué à la destruction de la mystification sur le caractère "socialiste" des pays capitalistes du bloc de l'Est, le développement des grèves actuelles en France ne peut que contribuer à démasquer les mystifications et les mensonges colportés par les partis de gauche dans les autres pays et à l'affaiblissement de ces mêmes partis en milieu ouvrier.
Le licenciement de milliers d'ouvriers par ce gouvernement, le soutien qu'il reçoit des syndicats, les grèves, tant dans les services publics (Postes, Chemins de Fer) que dans l'automobile (Talbot, Citroën), les affrontements violents avec la police de "gauche" des ouvriers de la sidérurgie et des chantiers navals (Longwy, Marseille, Dunkerque) ne peuvent qu'accélérer la reconnaissance dans l'ensemble de la classe ouvrière internationale du caractère bourgeois des partis de gauche du capital. De cette prise de conscience par le prolétariat dépend en grande partie le développement de la lutte de classe jusqu'à la révolution prolétarienne.
LE ROLE DES COMMUNISTES
Il existe une autre partie du prolétariat qui tient un rôle particulier, sans commune mesure avec la précédente. Cette partie exerce une responsabilité historique, permanente et universelle. Elle est constituée des minorités communistes, des révolutionnaires.
"Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire" écrit Lénine dans Que Faire ? Sans programme communiste, sans prise de position claire dans la lutte de classe, pas de révolution prolétarienne possible ; sans organisation politique, pas de programme, pas de position claire et donc, pas de révolution.
Les luttes de la classe ouvrière ne peuvent se développer qu'en affirmant et maintenant leur autonomie et leur indépendance face à la bourgeoisie. Cette autonomie ouvrière dépend de la clarté politique du mouvement de lutte lui-même. Partie intégrante de la classe ouvrière, ses minorités politiques ont un rôle indispensable et irremplaçable dans cette nécessaire clarification politique. Les groupes politiques du prolétariat ont pour responsabilité de participer et d'intervenir dans le processus de prise de conscience de la classe ouvrière. Ils accélèrent et poussent le plus loin possible cette réflexion collective de leur classe. C'est dans ce sens qu'il importe :
- qu'ils reconnaissent la reprise actuelle des luttes ouvrières après la défaite en Pologne ;
- qu'ils dénoncent la "gauche dans l'opposition" comme obstacle majeur opposé par la bourgeoisie aux luttes ouvrières ;
- qu'ils comprennent que l'Europe occidentale est la clef, l'épicentre du renouveau des luttes aujourd'hui et du développement de celles-ci ;
- qu'ils sachent reconnaître que le cours historique est, depuis la fin des années 60, aux affrontements de classe et non à la guerre impérialiste. Seule cette compréhension générale peut leur permettre une intervention claire :
- la dénonciation du syndicalisme sous toutes ses formes. Nous avons pu voir les effets désastreux du syndicat Solidarité en Pologne après la grève da masse d'août 80. C'est non seulement une très grande partie d'ouvriers qui fut aveuglée et abusée sur le caractère profondément syndicaliste et capitaliste de Solidarnosc, mais aussi nombre d'éléments et de groupes révolutionnaires. Le rejet et le dépassement du syndicalisme dans l'organisation de l'extension par les ouvriers eux-mêmes nécessitent la dénonciation sans concession et sans faille des syndicats, du syndicalisme de base et de ses agissements par les minorités communistes organisées pour cela. Celle-ci est indispensable et déterminante pour dépasser les pièges de la bourgeoisie ;
- la mise en avant des perspectives de lutte qui passent par l'organisation de l'extension et de la généralisation dans les assemblées générales. C'est un combat permanent que doivent livrer les ouvriers les plus combatifs, les plus avancés et, parmi eux, les petits groupes communistes dans les luttes, dans les assemblées pour l'organisation de l'extension et de la coordination contre le syndicalisme qui s'y oppose.
L'intervention, la propagande, le combat politique des révolutionnaires détermineront de plus en plus la capacité du prolétariat dans son ensemble à rejeter les pièges tendus par la bourgeoisie et ses syndicats dans les luttes. La bourgeoisie, elle, n'hésite pas à "intervenir", à être présente, à occuper le terrain afin d'enrayer le développement de la prise de conscience des ouvriers, d'obscurcir les questions politiques, de dévoyer les luttes dans des impasses. D'où la nécessité de "minorités communistes combattant en leur sein (les assemblées), exposant les manoeuvres de la bourgeoisie et de tous ses agents, et traçant une perspective claire pour le mouvement. L'organisation révolutionnaire est le meilleur défenseur de 1’autonomie ouvrière'.' ( Revue Internationale n°24, p. 12, "sur le rôle des révolutionnaires").
Ces minorités communistes, organisées théoriquement, politiquement, matériellement "sont donc la fraction la plus résolue du prolétariat" de tous les pays, la fraction qui entraîne les autres (suivant 1'idée du Manifeste Communiste). Les groupes révolutionnaires doivent marcher au premier rang du combat prolétarien. Ils doivent montrer la voie du combat de classe. Ils "dirigent", au sens où ils orientent la classe ouvrière vers le développement de ses luttes, sur le chemin de la révolution prolétarienne. Ce développement passe aujourd'hui par les nécessaires et inséparables auto organisation et extension des luttes contre les syndicats.
C'est la tâche que le CCI s'est assignée. C'est tout le sens de notre combat dans le mouvement des luttes actuelles.
R.L.
[1] [2] A ce sujet, nous voudrions corriger une formulation que nous avons souvent utilisée, en particulier dans "les thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe" parues dans la dernière Revue Internationale ; à la page 4, dans le point 2, il est dit que "c'est la classe ouvrière mondiale qui détient 1'initiative historique, qui est passée globalement à l'offensive face à la bourgeoisie..." S'il est vrai que la classe ouvrière détient la clef de la situation historique au sens où de son combat dépend l'issue dans la barbarie capitaliste ou dans la révolution prolétarienne et le communisme, par contre, il est faux de dire que la classe ouvrière est passée à l'offensive face au capitalisme. Passer à 1'offensive signifie pour le prolétariat qu'il se trouve à la veille de la révolution, dans une période de double pouvoir, organisé en conseils ouvriers, qu'il se prépare consciemment à attaquer l'Etat bourgeois et à le détruire. Nous en sommes encore loin.
Géographique:
- Europe [3]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [4]
Où en est la crise ? La crise transforme l'Europe occidentale en une poudrière sociale
- 2754 reads
Il existe une "mémoire collective" historique au sein de la classe ouvrière. Les organisations politiques révolutionnaires en sont une manifestation importante. Mais elle n'est pas unique. Dans 1'ensemble de la classe, les luttes passées, les attaques de la bourgeoisie, on en a tiré les leçons pendant des années, souvent sous forme plus ou moins consciente, souvent sous forme purement négative, sachant plus ce qu'il ne faut pas faire que dégageant une perspective concrète positive précise. La puissance et la profondeur du mouvement ouvrier en Pologne en 1980 étaient en grande partie le fruit direct du souvenir des expériences successives de 1956, 1970 et 1976.
C'est pour cela que dans l'unité du prolétariat mondial, toutes les parties de la classe ne sont pas identiques : il y a des secteurs qui ont une plus grande tradition, une plus grande expérience de la lutte de classe. La vieille Europe occidentale regroupe le prolétariat qui possède le plus important coeur industriel (il y a dans la CEE 41 millions de salariés dans 1’industrie, contre 30 millions aux USA et 20 au Japon) et la plus longue expérience historique : à travers les luttes qui vont de 1848 et la Commune de Paris à la vague révolutionnaire de la fin de la 1ère guerre, à travers la confrontation avec la contre-révolution sous toutes ses formes, stalinienne, fasciste, "démocratique" (parlementarisme, syndicalisme), à travers des centaines de milliers de grèves de toutes sorte et ampleur, s'est forgée une classe plus aguerrie qu'ailleurs [1] [5]().
L 'Europe occidentale est actuellement non seulement la zone concentrant les principaux bataillons du prolétariat mondial, mais aussi, au sein de la partie industrialisée du bloc US, celle où, à court et moyen terme, la classe révolutionnaire est appelée à connaître la plus violente attaque économique. Les capitaux d'Europe occidentale s'effondrent lentement, incapables d'affronter sur le marché mondial et sur leur propre marché la concurrence économique de leurs propres "partenaires", américains et japonais, concurrence devenue d'autant plus agressive et impitoyable que ces derniers sont eux-mêmes plongés dans la plus violente crise depuis les années 30.
Les conditions objectives s'ajoutent aux conditions subjectives pour faire de l'Europe de l'Ouest le formidable détonateur révolutionnaire que Marx a annoncé.
LE DECLIN ECONOMIQUE DE L'EUROPE
LA LOI DU PLUS FORT
Dans la décennie qui va de 1963 à 1973, les économies des Etats de la CEE croissaient en moyenne à un rythme de 4,6 I (PIB). Ce taux tombe à 2 % dans la décennie suivante. Au début des années 80, il est tout simplement nul et recule dans plusieurs pays. A la fin des années 60, le taux de chômage dans la CEE était de 2,3 % ; aujourd'hui, il dépasse 10 % et atteint 17 % dans des pays aussi divers que l'Espagne et les Pays-Bas. Entre 1975 et 1982, "la part de marché" de la CEE (mesurée par sa part dans le total des exportations de produits manufacturés de l'ensemble de l'OCDE) est tombée de57%à53% tandis que celle des USA se maintenait à 18 % et celle du Japon augmentait de 13 à 16 %.
Dans la deuxième moitié des années 70, l'économie d'Europe occidentale a commencé à perdre de plus en plus de terrain par rapport aux USA et au Japon. Cette tendance s'est accélérée avec l'entrée dans les années 80. Simultanément, la dépendance du capital en Europe à l'égard de celui de " la puissance chef de bloc - dépendance qui ne s'est jamais démentie depuis la 2ème guerre -s'est fortement aggravée.
Le déclin économique de l'Europe occidentale au sein de son bloc trouve en partie son explication dans les caractéristiques des rapports entre nations dans le capitalisme décadent et militarisé.
Les lois qui régissent les rapports entre capitaux nationaux - fussent-ils ceux d'un même bloc militaire - sont les mêmes que celles du milieu de la pègre. Lorsque la crise frappe le monde capitaliste, la concurrence économique qui lui sert de mode de vie s'exacerbe jusqu'à son paroxysme, tout comme les gangsters s'entretuent lorsque les butins à conquérir se font plus rares et difficiles à obtenir.
Dans l'époque actuelle, cela se traduit au niveau de la planète par l'aggravation des tensions entre les deux blocs militaires. Au niveau de chaque bloc, en son sein, chaque nation est militairement sous le contrôle absolu de la puissance dominante (Le Japon corn ire la Pologne ne disposent que d'un strict minimum de munitions dans leurs armées ; ce sont les chefs de bloc qui en ont la possession et les leur fournissent). Mais les antagonismes économiques n'en subsistent pas moins.
Dans le bloc le plus riche, l'occidental, une certaine liberté de concurrence - beaucoup moindre que ce que les propagandes officielles prétendent- permet à ces antagonismes économiques d'apparaître au grand jour : c'est la guerre à coup de coûts de production moindres, à coup de subventions d'Etat aux exportations, à coup de mesures protectionnistes et de marchandages de "parts de marché", etc.
Dans le bloc de l'Est, le plus pauvre, le plus ruiné par le gigantesque effort de guerre et de militarisation, les tensions économiques entre capitaux nationaux apparaissent plus difficilement tant elles sont soumises aux impératifs militaires (la PDA est proportionnellement plus industrialisée que l'URSS ; elle n'en est pas moins obligée d'acheter le pétrole de celle-ci à un cours arbitrairement fixé, toujours supérieur au cours mondial et elle doit généralement le payer en devises occidentales).
Cependant, avec l'accélération de la crise et de la décadence capitaliste mondiale, c'est le mode de vie du bloc le plus ruiné qui montre l'avenir au mieux nanti. Comme nous le disions lors de notre second Congrès International (1977) : "Les Etats-Unis vont mettre l'Europe au rationnement". Depuis le début des années 70, l'évolution en occident ne s'est pas faite vers un plus grand libéralisme dans les échanges et la vie économique, mais au contraire vers la multiplication des mesures protectionnistes et un pouvoir de plus en plus impitoyable des USA sur leurs vassaux. Le GATT, organisation chargée de défendre et stimuler le libre-échange entre nations, ne cesse dans ses derniers rapports annuels de s'arracher les cheveux et de crier au sacrilège suicidaire devant la multiplication des barrières douanières et autres mesures qui entravent le "libre-échange" entre nations.
Quant aux relations économiques des USA avec leurs partenaires industrialisés, elles se caractérisent, surtout depuis la dite crise du pétrole (1974-75), par une série de manoeuvres économiques dont le résultat concret est un "pillage". Un pillage dont les fruits sont employés par la puissance dominante essentiellement à financer ses dépenses militaires.
Tout comme l'URSS, les USA portent la plus lourde part des dépenses militaires du bloc ([2] [6]). Depuis Nixon, les USA ont mené au niveau de leur bloc des politiques économico militaires qui leur ont permis d'imposer par la force à leurs vassaux le financement d'une partie de leur politique militaire.
Les violentes augmentations du prix du pétrole (1974-75, 1979-80) dont les USA contrôlent directement ou indirectement l'essentiel de la production et de la commercialisation ont fourni :
1 - à travers le flot de Dollars qui a été déversé sur le Moyen-Orient en provenance du Japon et de l'Europe, les moyens de financer, essentiellement à travers l'Arabie Saoudite la "Pax Americana" ;
2 - à travers l'énorme demande de Dollars provoquée (le pétrole se paie en Dollars) une surévaluation du billet vert qui permettait aux USA d'acheter n'importe quoi, n'importe où, en payant d'autant moins ; c'est une sorte de réévaluation forcée du Dollar.
La politique de taux d'intérêts élevés pratiquée par les USA depuis le début des années 80 se traduit par un résultat analogue. La crise économique fait apparaître une masse de capitaux "oisifs" sous forme argent, qui ne trouvent pas de secteurs productifs rentables où s'investir, le secteur productif se réduisant comme peau de chagrin. Ces capitaux sont contraints, sous peine de disparaître au moins partiellement, de se placer dans des secteurs spéculatifs, de se transformer en capitaux fictifs. Ils se placent là où les taux d'intérêts réels sont les plus élevés. Avec leur politique, les USA attirent chez eux ainsi une masse énorme de capitaux du monde entier et qui doivent, pour se placer, commencer par être transformés en Dollars. Celui-ci devient plus demandé, plus recherché, plus cher : il est surévalué (en janvier 84, certains estimaient la surestimation du prix du Dollar à 40 %). Achetant à bas prix (il faudrait dire : à prix forcé), les USA se paient le luxe du plus grand déficit commercial de leur histoire... sans que pour cela leur monnaie, au moins pour le moment ne soit dévaluée, au contraire. Simultanément, et tout aussi impunément, ils connaissent un déficit des administrations publiques sans précédent (200 milliards de Dollars), soit l'équivalent de leurs dépenses militaires officielles ([3] [7]).
Comme nous l'avons à plusieurs reprises démontré dans des numéros précédents de cette Revue, cette politique ne peut pas être éternelle. Elle constitue une fuite en avant qui prépare de gigantesques explosions financières.
Mener une politique de taux d'intérêt réels élevés veut dire être capable de payer des revenus réels élevés aux capitaux que l'on emprunte. Or, la crise économique, qui dévaste aussi les USA, interdit à ceux-ci de trouver les moyens réels de payer ces intérêts. Quant à la production militaire, la seule qui connaît un véritable développement, elle détruit ces moyens de paiement plutôt qu'elle n'en crée. Les USA paient ces revenus en réalité avec du papier, des Dollars surévalués, qui à leur tour se placent de nouveau aux USA. Au bout c'est la banqueroute du système financier mondial ([4] [8]). Mais les USA n'ont pas véritablement le choix et ils n'en laissent aucun à leurs "alliés". L'économie américaine "soutient" celle de l'Europe occidentale comme la corde soutient le pendu. Tout comme dans le bloc rival, et comme dans l'ensemble de la vie sociale du capitalisme décadent, les rapports économiques sont de plus en plus calqués et soumis aux rapports militaires. Parlant des rapports de l'Europe avec son chef de bloc, Helmut Schmidt - représentant expérimenté du capital allemand - déclarait récemment que Washington avait tendance à "remplacer ou supplanter son leadership politique par un commandement militaire strict, exigeant de ses alliés qu'ils exécutent les ordres sans discuter et dans les deux jours qui suivent" (Newsweek, 9 avril 84).
Dans le bloc de l'Est, l'URSS pille ses vassaux directement, par la pression militaire et policière. Dans le bloc occidental, les USA pillent surtout à travers le jeu des mécanismes économiques du "marché" militairement dominé par eux. Mais le résultat est le même. Le chef de bloc se fait payer sa politique militaire par des prélèvements directs ou indirects sur ses "alliés".
Le retard croissant de l'Europe est en grande partie le résultat de la loi du monde capitaliste, celle du plus fort.
Les faiblesses intrinsèques de l'économie européenne sont celles d'un continent divisé en une multitude de nations, concurrentes entre elles, incapables de dépasser leurs divisions, de concentrer leurs forces pour tenter de résister à la concurrence économique de puissances comme les USA et le Japon.
LE MYTHE DU MARCHE COMMUN
Une des manifestations les plus classiques de la crise économique est la multiplication du nombre de faillites d'entreprises. Celles-ci frappent depuis quelques années les principaux pays du bloc US comme une épidémie qui s'étend de plus en plus rapidement, atteignant des rythmes inégalés depuis la grande dépression des années 30.
Mais les faillites ne sont qu'un aspect d'un phénomène tout aussi significatif : l'accélération des concentrations de capitaux.
Dans la jungle capitaliste en proie à une pénurie croissante de marchés solvables, seules les entreprises les plus modernes, celles capables de produire à meilleur marché peuvent survivre. Mais moderniser l'appareil de production dans la période actuelle nécessite des concentrations de capitaux de plus en plus énormes. Face aux géants américains ou même japonais, les européens divisés, incapables de se mettre d'accord sur autre chose que sur la façon d'attaquer ou de combattre le prolétariat, parviennent de moins en moins à suivre la course technologique. Il est plus facile et plus rentable pour une entreprise européenne en difficulté de s'allier avec des capitaux américains ou japonais qu'avec d'autres européens. Et c'est ce qui se produit dans la réalité, malgré les déclarations ampoulées des prêtres de "l'Europe Unie".
Le "Marché Commun" a été un marché unifié essentiellement pour les capitaux américains et japonais qui ont la puissance et les moyens militaires de contrôler des marchés de cette taille.
La CEE, après des années d'efforts, ne parvient aujourd'hui à planifier et organiser que... la destruction et le démantèlement de l'appareil productif (la sidérurgie n'étant que l'exemple le plus spectaculaire).
Du point de vue des conditions objectives, l'Europe occidentale devient une poudrière sociale parce que la crise économique s'y accélère. Mais pas uniquement à cause de cela. Deux caractéristiques du capitalisme en Europe occidentale rendent plus explosive et profonde la lutte de classe dans cette partie du monde : le poids de l'Etat dans la vie sociale ; la juxtaposition d'une somme de petits Etats-nations.
LE POIDS DE L'ETAT DANS LA VIE SOCIALE REND LA LUTTE OUVRIERE PLUS IMMEDIATEMENT POLITIQUE
Plus l'Etat est présent dans la vie économique, et plus la vie de chacun est directement dépendante de "la politique" de l'Etat. La sécurité sociale, les retraites, les allocations familiales, les indemnités de chômage, l'éducation publique, etc. constituent une part importante du salaire des ouvriers en Europe. C'est une partie directement gérée par l'Etat. Plus ces institutions étatiques sont présentes et plus l'Etat est le patron de tout travailleur. Dans ces conditions, "l'austérité", l'attaque contre les salaires prend une forme directement politique et contraint le prolétariat, lorsqu'il combat, à s'affronter plus directement au coeur politique du pouvoir du capital.
La crise se traduit ainsi, plus en Europe qu'au Japon ou aux USA, par une ouverture plus immédiate du terrain politique pour le combat de classes. Plus qu'ailleurs, ce sont les gouvernements et non les entreprises qui prennent les décisions qui modulent les conditions d'existence des travailleurs. L'austérité en Europe, c'est le gouvernement allemand qui réduit les bourses d'études et les allocations familiales, c'est le gouvernement français qui réduit les indemnités de chômage, c'est le gouvernement espagnol qui propose la réduction du taux des retraites de 90 à 65 %, c'est le gouvernement anglais qui élimine plus d'un demi million de postes de fonctionnaires, c'est le gouvernement italien qui décide de détruire l'échelle mobile des salaires.
Le poids de l'Etat a régulièrement augmenté dans tous les pays du bloc occidental, y compris le Japon et les USA. Si on mesure ce poids par les dépenses totales des administrations publiques en pourcentage du produit intérieur brut, celui-ci est passé au Japon entre 1960 et 1981 de 18 % à 34 % et aux USA de 28 % à 35 %. Mais pendant ce temps, en 1981, ce pourcentage atteignait :
47 % en Grande-Bretagne,
49 % en Allemagne et en France,
51 % en Italie,
56 % en Belgique,
62 % en Hollande,
65 % en Suède.
C'est une des raisons pour lesquelles les luttes ouvrières en Europe occidentale ont et auront tendance à assumer plus immédiatement leur contenu politique.
LA JUXTAPOSITION D'UNE SOMME D'ETATS REND PLUS EVIDENT LE CARACTERE INTERNATIONAL DE LA LUTTE PROLETARIENNE
La nation constitue une institution de base caractéristique du mode de production capitaliste, tout comme le salariat. Elle fut un important progrès historique marquant la fin de 1'endettement féodal. Mais, comme l'ensemble des rapports sociaux capitalistes, elle est devenue une entrave majeure à tout développement ultérieur. Une des contradictions fondamentales qui condamnent historiquement le capitalisme est celle entre la production qui est matériellement réalisée à échelle mondiale et l'appropriation et orientation de celle-ci de façon nationale.
Or, nulle part au monde cette contradiction ne se manifeste de façon aussi criante que dans la vieille Europe occidentale. Nulle part, l'identité d'intérêts des prolétaires de tous les pays, la possibilité et la nécessité de l'internationalisation du combat de classe face à l'absurdité de la crise économique capitaliste, n'apparaissent de façon aussi immédiate.
Cette généralisation de la lutte ouvrière à travers les frontières ne se produira pas du jour au lendemain. Elle ne peut pas être une réponse mécanique aux conditions objectives. Il faudra certainement une longue période de luttes qui se déroulent simultanément dans l'ensemble des petits Etats européens pour qu'au milieu d'une effervescence prérévolutionnaire se forge dans la classe ouvrière la conscience et la volonté d'assumer son être international et révolutionnaire.
La classe ouvrière en Europe possède pour cela l'avantage déterminant d'être la fraction historiquement la plus expérimentée, celle dont les traditions révolutionnaires sont les plus importantes. Ce n'est pas par hasard si c'est en Europe occidentale que se concentrent les principales organisations politiques révolutionnaires du prolétariat, forces qui, pour faibles qu'elles puissent être encore aujourd'hui, ont et auront un rôle déterminant à jouer dans le processus révolutionnaire.
L'effondrement de l'économie capitaliste est un phénomène mondial qui touche tous les pays, créant à l'échelle de la planète les conditions de la révolution communiste. Mais l'Europe occidentale du fait de sa place dans le processus mondial de production, du fait de sa place particulière au sein du bloc militaire américain, du fait de sa structure politique (importance de l'Etat, multiplicité de nations), ainsi que du fait des conditions subjectives d'existence du prolétariat, constitue nécessairement l'épicentre de la révolution mondiale.
RV
[1] [9] Voir "Le prolétariat d'Europe de l'Ouest au coeur de la lutte de classe" Revue Internationale n°31, 4ème trimestre 1982, ainsi que "Critique de la théorie du 'maillon le plus faible'" Revue Internationale n°37, 3ème trimestre 1984.
[2] [10] La relative arriération de 1'URSS par rapport à certains des pays de son glacis, telle la RDA, est le reflet du fardeau de ses dépenses militaires. Les seuls secteurs où l'URSS est en tête dans son bloc sont ceux directement militaires.
[3] [11] Les difficultés croissantes que connaissent actuellement les banques américaines et la multiplication des faillites dans ce secteur sont les premières manifestations du gouffre auquel doit aboutir cette politique.
[4] [12] Idem.
Récent et en cours:
- Crise économique [13]
Belgique-Hollande:crise et lutte de classe : Rapport du 5ème Congrès d'Internationalisme
- 4077 reads
Si nous avons décidé de publier dans la Revue Internationale un rapport consacré à la situation économique, politique et sociale dans ces deux pays d'Europe, c'est que justement celle-ci n'a rien de particulier ou de spécifique, mais exprime de façon exemplaire ce que subissent de façon croissante les prolétaires dans tous les pays industrialisés.
L'austérité draconienne dans ces deux pays qui, il y a quelques années encore, étaient vantés pour leur niveau de vie parmi les plus élevés d'Europe et pour leur niveau de"protection sociale" enviable, est un indice de l'évolution de la crise économique au coeur du capitalisme mondial, de la force de l'attaque des conditions de vie des ouvriers. De même, la capacité de riposte ouvrière à cette attaque et les efforts d'adaptation politique de la bourgeoisie nous fournissent des indications précieuses concernant le développement du rapport de force entre les classes,
Nous estimons donc que ce texte est une excellente illustration de notre démarche générale appliquée à des situations concrètes et qu'il démontre clairement combien l'approfondissement de notre cadre d'analyse par rapport au rôle de la gauche dans l'opposition, le syndicalisme de base, le cours historique ou le processus de généralisation de la lutte de classe, basé sur les leçons de la vague de lutte précédente, se révèle indispensable pour appréhender la situation sociale actuelle.
Le 4ème Congrès de la section du CCI en Belgique (février 1982) se déroula deux mois après le putsch de Jaruzelski en Pologne, en pleine contre-offensive de la bourgeoisie internationale, au nouent où la classe ouvrière, déboussolée, marquait le coup.
Dans ce cadre, ce n'était nullement un hasard si la bourgeoisie belge, après des années de tergiversations et sous la pression directe du bloc, venait d'aligner sa politique sur celle du bloc et engageait l'attaque directe contre la classe ouvrière. La résolution sur la situation nationale, adoptée lors du Congrès, décrivait adéquatement la stratégie mise en place par la bourgeoisie :
"Les élections du 8 novembre 81 légaliseront ce nouvel ordre de bataille de la bourgeoisie face à la lutte de classe, le pas qualitatif dans l'attaque frontale du prolétariat est franchi :
a) une droite dure et arrogante au pouvoir, bien ancrée au pouvoir dans une perspective à long terme et parlant le langage de la vérité,
b) un partage essentiel des tâches au sein de l'appareil politique de la bourgeoisie entre une droite dure au gouvernement et une gauche dans l'opposition face à la lutte de classe, ainsi que diverses sous divisions au sein du gouvernement et dans l'opposition, permettant plus de souplesse dans le développement des mystifications,
c) une gauche dans l'opposition aux accents radicaux dont les thèmes actuels ne sont plus ceux d'une, équipe responsable développant un langage d'illusions dans la perspective d'un retour au gouvernement, mais dont la seule fonction aujourd'hui est de faire dérailler les luttes, face aux réactions engendrées par l'austérité draconienne" (Résolution sur la situation en Belgique et aux Pays-Bas, février 82).
Ainsi, la résolution indiquait clairement dès février 82 les axes fondamentaux de la politique de la bourgeoisie en Belgique pour les deux années à venir. En Hollande, la situation paraissait encore moins tranchée et la gauche venait de revenir au pouvoir. Toutefois, dans le rapport sur la situation aux Pays-Bas, nous soulignions que "L'adhésion du PVDA (SD) au gouvernement n'était rien d'autre qu'une solution de secours temporaire" (Idem), ce qui se confirma bien vite dès la fin de 82. Globalement donc, pour les deux pays, la stratégie de la bourgeoisie dans la période écoulée se caractérisa par une austérité draconienne et le travail de sape de la gauche dans l'opposition.
Sous la pression inexorable de la crise et de l'austérité, l'affrontement entre les classes reprit de plus belle au sein même des pays industrialisés. La Belgique et la Hollande se retrouvèrent au premier rang dans la reprise de la lutte de classe. C'est dans cette perspective que nous évaluerons les résultats de la stratégie de la bourgeoisie, autant sur le plan économique que politique, et son impact sur le développement de la lutte prolétarienne.
BELGIQUE DEUX ANS D'AUSTERITE ET DE "SACRIFICES"
"L'économie belge connaît depuis plusieurs années une situation caractérisée par des déséquilibres multiples et accusés. Ceux-ci trouvent leur origine dans les effets de la crise internationale à laquelle la Belgique est particulièrement sensible en raison de son degré exceptionnel d'ouverture sur l'extérieur. Ils ont également des causes internes, parmi lesquelles les plus importantes tiennent d'une part, à une adaptation insuffisante de la production à l'évolution de la demande intérieure et extérieure et, d'autre part, à un système rigide de formation des revenus qui a conduit à une modification importante dans le partage du revenu national au cours des années 70," (Etudes économiques de l'OCDE, Belgique Luxembourg, mai 83, p.9).
En clair, depuis la fin des années 70, la Belgique se trouve dans une situation économique particulièrement difficile causée :
a) par l'approfondissement de la crise mondiale du capitalisme que la Belgique ressent plus directement et plus brutalement que d1autres à cause de sa dépendance des marchés internationaux, vu l'exiguïté de son marché intérieur.
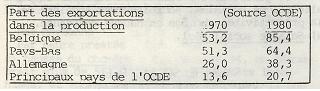
b) par les hésitations de la bourgeoisie belge à mettre en place une politique économique et sociale rigoureuse visant à rationaliser l'économie et « à réduire considérablement les salaires et les allocations sociales.
Aussi, dos son installation, l'action du gouvernement Martens-Gol sera centrée sur :
- le "transfert du revenu des ménages vers les entreprises" (sic !), réalisé par une politique des revenus avec un blocage partiel de l'indexation associé à une dévaluation de 8,5% du franc au sein du SME, et une politique budgétaire restrictive
(l'objectif étant de réduire le déficit public en 82 et 83 chaque fois d'un montant équivalent à 1,5% du PNB, de façon à diminuer le prélèvement des administrations sur les disponibilités de financement de l'économie (Etudes économiques de l'OCDE, p.9).
- Une rationalisation des secteurs non adaptés à "l'évolution de la demande intérieure et extérieure" : sidérurgie (Cockerill-Sambre), chantiers navals (Cockerill-Hoboken, Boel), mines du Limbourg, textile (Fabelta, Motte), métallurgie (Nobels-Peelman, Boomse Metaalwerken, Brugeoise et Nivelles). Comme le reconnaissait cyniquement Gardois, le "conseiller spécial" du gouvernement pour la sidérurgie, il ne s'agit, à travers des fusions, des fermetures partielles, des aides de l'Etat conditionnées par des baisses conséquentes des salaires, que d'une "liquidation socialement camouflée".
Quels sont, après deux ans d'application, les résultats de cette politique d'austérité draconienne ? Une telle observation est importante dans la mesure où, de par sa situation au début des années de vérité, la Belgique a servi de "laboratoire" à la bourgeoisie occidentale pour tester la façon d'imposer une austérité généralisée et une attaque globale contre le niveau de vie de la classe ouvrière.
La situation de l'économie belge
Malgré les deux années de restriction et de "sacrifices", les indicateurs économiques montrent clairement que la situation économique est loin d'être brillante, comme l'illustre bien la croissance du produit intérieur brut :
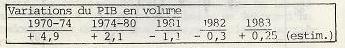
Plus explicite encore est le graphique de la production industrielle qui révèle pratiquement une stagnation permanente de celle-ci depuis 1974.
Même par rapport à l'ensemble des autres pays industrialisés, on ne peut guère dire que l'économie belge a rattrapé le terrain perdu. On pourrait tout au plus parler d'une stabilisation dans la récession.
Cette constatation générale sera étayée en examinant de plus près quatre facteurs permettant de juger plus en profondeur de la santé de l'économie belge :
a) la compétitivité : pour le gouvernement, c'est a ce niveau que se trouve la clé du problème et la solution de la crise : en rendant à l'industrie sa compétitivité, la production pourra reprendre et le chômage se résorber. Et à première vue, en effet, les résultats de la politique gouvernementale semblent spectaculaires.
Toutefois, trois constatations atténuent fortement les conséquences de ce redressement de la compétitivité :
- le redressement de la compétitivité est avant tout lié à la réduction des coûts salariaux et, d'une manière générale, à la diminution des heures travaillées, suite à l'extension du chômage et non pas vraiment au développement de la production ou des exportations (cf. infra);
- comme les autres pays industrialisés ont pris depuis lors des mesures similaires (cf. Rapport sur la Hollande), l'amélioration de la compétitivité sera rapidement annulée.
- la restauration de la position concurrentielle et de la rentabilité des entreprises n'a aucunement conduit à une reprise des investissements productifs. La chute des livraisons de biens d'équipement au marché intérieur ainsi que celle du volume de la formation brute de capital fixe le confirment : la chute des investissements continue.
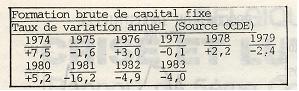
Face à l'impossibilité de vendre sur un marché sursaturé et au sous-emploi de l'appareil productif, la bourgeoisie préfère utiliser ses capitaux pour la spéculation (or, monnaies, matières premières). Les investissements industriels qui se font malgré tout visent alors surtout à la rationalisation : "En moyenne, les entreprises semblent avoir été surtout soucieuses, face à la faiblesse persistante de la demande et au coût toujours élevé du crédit, de restructurer leurs bilans et d’accroître leurs taux d’auto financement. " (Etudes économiques de l'OCDE, p. 31).
b) les exportations : ici aussi, on constate une hausse de 2% des exportations en 1983.
Mais la balance commerciale (différence entre les exportations et les importations) est toujours déficitaire. De plus, l'amélioration s'explique :
- par la baisse des importations, causée par la dévaluation et la politique d'austérité
- par la dévaluation qui a rendu les produits belges moins chers à l'exportation.
Toutefois, dans la mesure où la Belgique exporte essentiellement vers d'autres pays industrialisés (83 % vers l'OCDE dont 70 % vers la CEE contre 2 % vers le COMECON et 5 % vers l'OPEP) et que ceux-ci subissent de plus en plus l'austérité et limitent en conséquence leurs importations, les conséquences pour les exportations belges risquent d'être désastreuses.
c) 1'inflation : malgré la stagnation de la production industrielle et la diminution des salaires et de la consommation (cf. infra), l'inflation, après un net recul à la fin des années 70, reprend nettement.
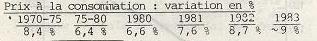
d) déficit et finances publiques : le déficit de l'Etat belge reste catastrophique : 16,2 % du PNB en 1981, 15,8 % en 1982 et,"d'après les estimations gouvernementales, 15,5 % en 1983, alors que la moyenne européenne est de 7 %. Le déficit courant de la Belgique se chiffrait en 1982 à 190 milliards de FB, tandis que la charge des intérêts de la dette représente aujourd'hui déjà 3 % du PNB et 20 % des recettes courantes des administrations.
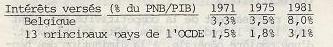
En outre, comme une grande partie de la dette (dette extérieure) est calculée en dollar, la hausse récente de la monnaie US aura des conséquences catastrophiques sur la charge des intérêts.
La "réduction de la charge sociale"
S'il fallait définir succinctement les deux années écoulées, on retiendrait sans nul doute l'attaque brutale du niveau de vie de la classe ouvrière. Certes, dés les années 70, le niveau de vie de la classe ouvrière avait été entamé, mais cela s'était fait de manière détournée, par une hausse des impôts directs et indirects, par un accroissement de la productivité (cf. tableau sur la productivité) et par l'inflation galopante. Mais depuis les "années de vérité", et plus particulièrement depuis la mise en place de la stratégie actuelle de la bourgeoisie (droite au pouvoir, gauche dans l'opposition), l'attaque est brutale, massive et généralisée : baisse des salaires et des allocations sociales, accroissement accéléré de la productivité, chômage en hausse constante, a) Salaire social réel,
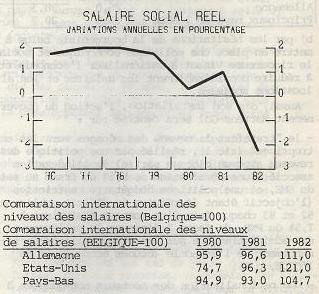
" Au total, les experts belges estiment que, sous l'hypothèse d'une augmentation des prix à la consommation de 7,5 % en 1983 (8,7 % en 1982), l'incidence des mesures de freinage des salaires serait de l'ordre de 7,5 % entre décembre 1981 et décembre 1983, dont 4,5 % au cours de 1982". (Etudes économiques de l'OCDE, p. 16).
Comme l'inflation pour 1983 se chiffrerait, non à 7,5 % mais à plus ou moins 9 %, la baisse des salaires "officielle" devrait s'établir au-delà de 8 %. Pour juger de l'importance de l'attaque, on peut encore relever que, dans l'industrie manufacturière et calculé par rapport aux 15 principaux pays de l'OCDE, l'indice des coûts unitaires relatifs de main d'oeuvre s'est situé en 1982 très en deçà de son niveau en 1970. Parallèlement on assiste à une baisse de la consommation privée, bien illustrée par l'effondrement du volume des ventes au détail :
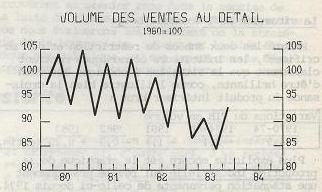
b) 1'augmentation de la productivité : l'amélioration de la compétitivité par la dévaluation et la baisse des salaires n’a nullement débouché sur une baisse du chômage, qui a continué à monter (cf. infra), mais sur une forte augmentation de la productivité à travers une rationalisation (meilleur taux d'utilisation de l'appareil productif) (cf. tableau n° 7) et une mécanisation et une automatisation intensive.
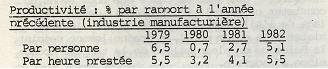
c) hausse du chômage : fin janvier 84, on dénombrait plus de 523.000 chômeurs complets indemnisés, et encore ce chiffre nous donne-t-il une idée fausse de la situation réelle. En vérité, d'après l'OCDE, le nombre de personnes sans emploi (chômeurs indemnisés et autres) s'élevait en mars 83 à environ 600.00, le rythme de progression du chômage s'étant à peine infléchi, dépassant 16 % en mars 83 (contre 20 % pour les 12 mois précédents).
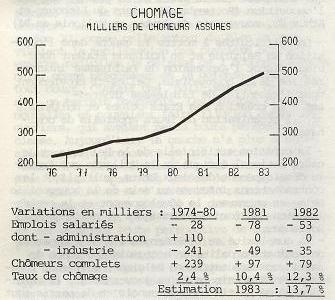
En outre, environ 180.000 personnes bénéficiaient d'un programme public d'aide à l'emploi (chômeurs mis au travail, cadre spécial temporaire, etc.) ou d'une pré pension de sorte crue, au total, près de 19 % de la population active se trouvait en dehors du circuit normal de 1'emploi.
En conclusion, l'austérité draconienne imposée par le gouvernement Martens V a représenté la première attaque directe généralisée contre l'ensemble de la classe ouvrière en Belgique sans qu'elle n'ouvre la voie à une reprise de l'économie qui "ne peut reposer que sur la demande extérieure" (OCDE, p. 46). L'amélioration relative de la compétitivité de l'industrie belge n'est qu'une donnée temporaire et passagère que les programmes d'austérité et de réduction de salaires dans les autres pays industrialisés réduira rapidement à néant. La crise générale du capitalisme ne laisse aucun répit à la bourgeoisie belge en dehors d'un redoublement des attaques contre la classe ouvrière.
HOLLANDE LE CARACTERE INELUCTABLE DE L'PIPASSE ECONOMIQUE
Il y a deux ans, dans le sillage de la locomotive allemande, les Pays-Bas passaient encore pour une des économies les plus fortes, alors qu'aujourd'hui, ils connaissent le chômage le plus étendu et, après la Belgique, le déficit le plus important des pays industrialisés. Les économistes n'y voient plus le bout du tunnel, mais prévoient un long chemin passant par plusieurs législatures qui aboutiraient peut-être à long terme, et ils avancent alors prudemment la date de ... 2005 !
En effet, au cours de 82 et 83, les indicateurs se sont brusquement détériorés :
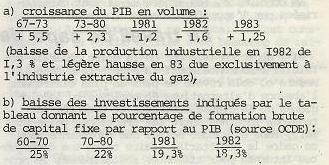
De plus, le taux d'utilisation de l'appareil productif est tombé en 83 à 77 % de la capacité totale de production, le même niveau qu'en 75.
Le taux d'utilisation était en 82 inférieur de 8 % à celui de 73 et de 6,5 % à celui de 79. Le déficit budgétaire qui augmentait de 6,7 % en 81 a augmenté de 9,4 % en 82 et en 83, on prévoit une hausse de 12,5 %. Le graphique n° 9 montre dès lors l'accroissement fulgurant de la dette de l'Etat hollandais, augmentant de 19 % en 81, de 22 % en 82, et atteignant la somme impressionnante de 144,7 milliards de florins.
Les chiffres du commerce extérieur semblent infirmer les données précédentes, puisque l'excédent de la balance des paiements courants a augmenté de 9,8 % en 82 et de 12 % en 83. Ces chiffres n'ont pourtant qu'une signification limitée parce qu'ils s'expliquent surtout par le développement des ventes de gaz naturel et par le recul des importations qui résulte de la chute de la consommation nationale. En vérité, l'industrie hollandaise est en moins bonne posture. " Quelques multinationales puissantes : Philips, Royal Dutch Schell, Unilever ont fait sa réputation. Mais sa structure est faible, peu présente dans les créneaux les plus porteurs. Le déclin est complet dans le textile, la confection, les chantiers navals. Au fil des ans, ce tissu industriel s1est effiloché. Le florin fort et la forte propension à investir à l’étranger y ont contribué." (Le Monde du 5.2.84, p. 9). En conséquence, dès la fin de 82, l'attaque directe contre la classe ouvrière s'accentua en Hollande, après la réorganisation par la bourgeoisie de ses forces politiques avec le passage de la gauche dans l'opposition et la venue de la droite au pouvoir (gouvernement Lubbers). Si la stagnation et le léger recul des salaires était déjà un fait dès le début des années 80 (1972 : 100 - 1980 : 103,9 -1981 : 101,2 - 1982 : 100,1) grâce à un premier gouvernement de droite (Van Agt et Wiegel) et aux mesures plus indirectes du gouvernement de centre-gauche (Van Agt et Den Uyl) en 82, les attaques contre le niveau de vie du prolétariat vont pleuvoir à partir de la fin 82 :
- baisse des salaires de 3,5 % pour la classe ouvrière en 83 et même de 5 % pour les fonctionnaires
- baisse de 3,5 % des salaires des fonctionnaires et des allocations en 84
- diminution des salaires et des allocations de 15 % prévue entre 84 et 86.
En parallèle, on assiste à une véritable explosion du chômage :
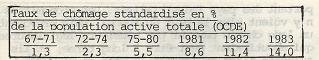
En quelques années, les Pays-Bas ont largement dépassé la moyenne de l'OCDE qui est de 10 %.
En conclusion, les années 82-84 sont caractérisées par l'approfondissement inéluctable de la crise économique qui n'épargne plus aucun pays et par le déclenchement d'une attaque sans précédent contre le niveau de vie de la classe ouvrière. C'est dans ce cadre que nous avons pu constater comment la Hollande qui, dans le sillage de l'Allemagne, semblait encore mieux résister à la crise en 81, a graduellement rejoint la Belgique en plein milieu de la tempête économique et sociale.
Si l'approfondissement de la crise générale affaiblit fondamentalement la bourgeoisie dans la mesure où cela révèle de plus en plus clairement l'absence d'alternatives économiques ou idéologiques de la classe dominante et exacerbe les tensions internes entre ses fractions, celle-ci sait face au danger mortel crue représente dans ce cadre le prolétariat, faire taire ses divergences internes pour affronter solidairement le prolétariat.
Les solutions gui lui font défaut sur le plan économique sont dès lors compensées par une remarquable habileté sur le plan politique. Chaque jour, la bourgeoisie démontre qu'elle est capable de défendre avec beaucoup de hargne et d'intelligence ses privilèges et sa domination. Dans les principaux pays industrialisés, la carte maîtresse du dispositif bourgeois visant à imposer l'austérité généralisée et à faire accepter les préparatifs de guerre est la mise en place de la gauche dans l'opposition. Cela s'est parfaitement illustré en Belgique et en Hollande.
LA NECESSITE DE IA GAUCHE DANS L'OPPOSITION EN BELGIQUE ET EN HOLLANDE
Depuis la reprise des luttes ouvrières en 1978, le CCI avait mis en avant la nécessité de la gauche dans l'opposition pour briser les luttes de l'intérieur, mais l'expérience nous a appris qu'il y a, entre la nécessité objective pour la bourgeoisie et sa capacité à faire tout ce qui est nécessaire pour la satisfaire, un monde de difficultés à franchir. Si en Belgique et en Hollande, la bourgeoisie a réussi adéquatement à adapter son dispositif de défense aux nécessités de la période, le passage de la gauche dans l'opposition s'est toutefois caractérisé par une grande difficulté à le réaliser concrètement :
- en Belgique, dès 1980, une série de gouvernements "de transition" ont essayé de réaliser les conditions nécessaires au passage de la gauche dans l'opposition (cf. Rapport au 50 Congrès), mais ce n'est qu'à la fin 81 qu'elle pourra avoir lieu;
- en Hollande, la droite était venue au pouvoir dès 78 pour mener une politique d'austérité (gouvernement chrétien-libéral Van Agt et Wiegel). Pourtant, de la mi-8I à la mi-82, la gauche revient au pouvoir, et ceci nettement à contre-courant des nécessités nationales (les socialistes ont perdu les élections, une austérité draconienne doit être imposée) et internationales (crise et austérité se généralisent à tous les pays). Ce n'est qu'après environ un an de paralysie gouvernementale accrue et de dé crédibilisation croissante de la gauche que la bourgeoisie trouva le moyen d'en revenir à la situation du début 81.
Ces atermoiements et ces hésitations n'étaient pas l'expression d'une meilleure résistance à la crise, comme certains l'affirmaient.
- Il s'agit des deux pays les plus axés sur l'exportation. Ils ressentent dès lors plus vite et plus fortement que d'autres la crise mondiale de surproduction.
- Malgré les ressources énergétiques propres (gaz naturel), la Hollande a un tissu industriel en dé clin, ce qui amène dès 78 le gouvernement à prendre des mesures d'austérité et de rationalisation (automobiles DAF, textile, chantiers navals).
- La crise provoque dès 79 des réactions ouvrières qui indiquent que la place de la gauche est dans l'opposition (Rotterdam 79, mines du Ljmbourg et Athus 80, mouvements de luttes en Wallonie en 81).
Les difficultés à mettre la gauche dans l'opposition en Belgique et en Hollande étaient donc bien plutôt l'expression de faiblesses internes réelles de la bourgeoisie. Celles-ci proviennent pour l'essentiel de faiblesses inhérentes à la création des Etats belges et hollandais et à l'organisation de leurs appareils de domination.
- La création artificielle de la Belgique et le cadre national étriqué de la Hollande ont freiné le développement des deux Etats, multipliant les contradictions internes au sein de la bourgeoisie belge et entravant le développement et la centralisation des forces économiques et politiques en Hollande.
- La complexité et l'hétérogénéité de l'appareil de domination politique bourgeois (présence de partis communautaires en Belgique, obligeant longtemps à maintenir le PS au gouvernement, la multiplicité de partis confessionnels et de partis tout court en Hollande, séquelles du développement historique de ces pays, rendait toute manoeuvre de la bourgeoisie fort délicate) a retardé ou empêché pendant un certain temps que la bourgeoisie mette la gauche là où elle pouvait lui rendre les meilleurs services.
Toutefois, malgré ces difficultés internes, les bourgeoisies belge et hollandaise ont montré qu'elles avaient une assise suffisamment solide et une expérience assez riche pour développer, sous la pression économique et face au danger de la lutte de classe, un dispositif redoutable afin d'encadrer et de mystifier les luttes.
LE ROLE DE LA CAUCHE ET LA REPRISE DES LUTTES
Alors que le développement de la crise amène souvent à identifier notre période aux années 30, la comparaison entre le travail de la gauche dans ces deux périodes en Belgique révèle le caractère fondamentalement différent des deux périodes historiques.
Dans les années 30, face à la crise et aux luttes ouvrières (grèves insurrectionnelles de 1932), la gauche (Parti Ouvrier Belge) avance le plan de travail (ou Plan De Man) pour "sortir la Belgique de la crise". De cette façon, la classe ouvrière est massivement mobilisée derrière des perspectives de capitalisme d'Etat (programmes de nationalisations) et est amenée à soutenir l'action parlementaire du P0B et du PCB "pour combattre le fascisme".
Aujourd'hui, la tactique et le travail de la gauche sont fondamentalement différents :
- son langage n'est pas celui du réalisme, de la conciliation nationale, de l'union sacrée. Au contraire, elle se veut critique, radicale, ouvriériste même. Les personnalités équivoques sont éliminées (Cools, Simonet), tandis qu'elle ne fait aucun effort pour retourner au gouvernement;
- sa tactique n'est pas offensive, mais défensive. Loin de tenter de mobiliser les ouvriers derrière la capital national, la gauche essaye aujourd'hui d'empêcher par tous les moyens que la lutte se développe.
Alors que dans les années 30, l'encadrement de la classe ouvrière était pris directement en charge par le POB lui-même, la commission syndicale n'étant qu'un appendice du parti, ce sont aujourd'hui les syndicats qui sont aux avant-postes, dans la lutte même, pour tenter de la dévoyer. Les campagnes de la gauche dans les années 30, comme celle autour du Plan De Man, visaient la mobilisation des ouvriers pour des mesures radicales de défense de l'économie nationale, comme précurseur de la défense nationale tout court. C'était une "politisation" des luttes sur un terrain bourgeois. Les mesures étaient nouvelles et pouvaient faire illusion auprès des ouvriers, qui avaient perdu toute perspective de classe. Aujourd'hui, la gauche n'a plus d'autre alternative à proposer, qu'une austérité mieux "emballée", plus "équitable". Ses plans ne font plus illusion après des années de crise, de ministres socialistes et d'austérité "raisonnable". C'est pourquoi ses efforts se concentrent sur le terrain syndical, pour diviser la classe ouvrière en lui enlevant toute perspective de lutte et pour casser ainsi sa combativité.
Ce comportement différent de la gauche trouve son explication dans la dynamique diamétralement opposée qui caractérise le rapport de force entre les classes en 1930 et aujourd'hui. A la fin des années 20, la classe ouvrière était battue au niveau international et la gauche avait pour but, dans les pays où les prolétaires n'avaient pas été écrasés physiquement, d'embrigader la classe ouvrière pour une nouvelle guerre mondiale derrière le drapeau de 1'anti-fascisme. Aujourd'hui, la lutte contre l'austérité d'un prolétariat non défait tend à l'unification sur le plan national comme sur le plan international, et la gauche essaye d'empêcher son développement et de déboussoler la classe ouvrière.
LA GAUCHE DANS L'OPPOSITION FACE AUX LUTTES
Tout au long de ces deux dernières années, la classe ouvrière, en Belgique comme en Hollande, s'est constamment heurtée à la gauche dans l'opposition et a fait souvent l'amère expérience de ses techniques raffinées de sabotage au sein des luttes. Ces dernières sont axées sur trois axes centraux :
- Occuper le terrain : la force de la gauche et des syndicats ne résulte pas de perspectives originales ou de solutions nouvelles avancées face à l'approfondissement de la crise. Leur force, c'est leur organisation au sein de la classe, leur appareil d'encadrement des ouvriers, le poids des idées reçues pesant sur le prolétariat,' en parti culier la conviction encore répandue qu'une lutte ne peut se développer, s'organiser, être gagnée qu'à travers l'organisation syndicale. C'est à travers cette occupation du terrain social qu'ils peuvent peser lourdement sur le développement et l'orientation des luttes.
- Isoler ou fractionner la réponse de la classe ouvrière : face à la généralisation de l'austérité et des attaques contre le niveau de vie de la classe ouvrière, la gauche peut désamorcer la puissance du mouvement en empêchant l'extension quantitative de la lutte (limiter à l'usine, au secteur, à la région). A ce propos, il faut constater que la gauche utilise avec beaucoup de raffinement les contradictions internes au système, de fausses oppositions ou diverses campagnes idéologiques de la .bourgeoisie pour diviser ou noyer les luttes prolétariennes :
. Les oppositions régionales (Flandres, Wallonie) sont systématiquement mises en avant pour entraver l'extension des luttes à la Belgique entière
. Le féminisme est exploité en Hollande pour diviser et opposer les travailleurs de sexes différents, tandis que le pacifisme a été directement utilisé pour briser la grève des fonctionnaires..
Toutefois, l'isolement et l'encadrement de la lutte peuvent aussi être réalisés en désamorçant la dynamique même du combat. Ainsi, pendant l'automne 83 en Belgique, c'est par le biais d'une "généralisation" formelle mais vide de la grève que les syndicats parvinrent à prendre le contrôle du mouvement et à le vider de sa substance. En réalité, le travail d'éparpillement tend avant tout à séparer l'extension du mouvement de son auto organisation, qui sont deux composantes indispensables de son développement. Pour ce faire, on peut agir sur différentes facettes de la lutte :
. Au niveau des moyens de lutte : grèves passives, occupations, autogestion, "nouveaux moyens de lutte" (grève de l'épargne, etc.);
. Au niveau de la préparation des luttes : mettre l'accent sur les préparatifs techniques (tracts, piquets de grève, etc.) et financiers;
. Au niveau de l'organisation des luttes, placées sous le contrôle des syndicats ou de comités de grève syndicaux dirigés par des permanents syndicaux et des syndicalistes de base;
. Au niveau des perspectives de la lutte : placer la lutte dans la logique du système et de sa crise : se battre "pour une véritable concertation", le sauvetage de son usine, sa région, pour des "sacrifices équitables", pour "faire payer les riches", pour la nationalisation, ...
- Enfermer le mécontentement ouvrier dans le cadre du syndicalisme : les syndicats, comme nous l'avons vu, jouent un rôle central dans la stratégie de la gauche dans l'opposition et ce rôle est encore accentué en Belgique et en Hollande par la dé crédibilisation subie par les partis socialistes à cause des difficultés internes de la bourgeoisie. Ceci provoque une "usure" accélérée des directions syndicales et explique, avec la combativité ouvrière persistante l'importance croissante du syndicalisme de base qui a joué, en Belgique comme en Hollande, pendant les deux années passées, un rôle central dans les luttes importantes qui ont éclaté (Rotterdam 79, vagues de luttes de 81 et 82 en Belgique, grève des fonctionnaires en Belgique et en Hollande en 83). La fonction essentielle du syndicalisme de base a été confirmée dans la période écoulée:
. Par la concentration de toutes les forces gauchistes sur ce travail syndical à la base,
. Par des tentatives de coordination des forces et des conceptions syndicalistes de base sur un plan national ("Vakbond en Demokratie" en Belgique, "Solidariteit" en Hollande).
Dans les luttes actuelles, le rôle du syndicalisme de base est double :
. Prendre le contrôle des luttes radicales pour empêcher quelles aillent trop loin, donc pour saboter, derrière un vocabulaire radical, derrière des actions spectaculaires (affrontements avec la police : sidérurgie en 82), leur extension et leur radicalisation;
. Ramener les "brebis galeuses" dans le giron syndical en leur faisant croire que "les syndicats, c'est nous", tandis que par leurs discours radicaux, leurs actions dures, leurs conflits continuels avec les directions syndicales, ils gagnent la confiance des ouvriers combatifs (Rotterdam, 79 et 82, lutte dans la fonction publique en Belgique et en Hollande, 83).
Dès à présent, le syndicalisme de base s'impose comme une des armes les plus pernicieuses de la bourgeoisie, maintenant que les syndicats traditionnels seront de plus en plus souvent contestés et dépassés par la lutte ouvrière. De par sa flexibilité qui peut même s'accommoder d'un antisyndicalisme de façade, il sera utilisé par la bourgeoisie jusque dans la période révolutionnaire au sein des conseils pour dévoyer le prolétariat de son combat révolutionnaire vers la logique syndicaliste et gestionnaire. Son utilisation, fréquente dès à présent, si elle permet à la bourgeoisie pour le moment de contrôler les mouvements, d'étouffer toute perspective de lutte révolutionnaire et d'entraver l'auto organisation de la classe, marque l'affaiblissement historique de la bourgeoisie et annonce, à long terme, la dé crédibilisation de ses armes mystificatrices les plus radicales.
Le prolétariat face à la gauche dans l'opposition
Les tergiversations de la bourgeoisie et le retard accumulé dans la prise de mesures draconiennes qui ont nécessité un rattrapage brutal, le rôle de "laboratoire" que la Belgique a joué durant ces années en étant la pointe la plus avancée dans l1attaque de la bourgeoisie mondiale contre les conditions de vie des ouvriers dans les pays occidentaux, ont profondément marqué les conditions de la lutte de classe. Attaquée durement et presque continuellement, la classe ouvrière a été obligée de réagir et l'a fait régulièrement (hiver 81, février-mars 82, septembre-octobre 83). De ce fait, les luttes ouvrières en Belgique et plus tard en Hollande ont exprimé d'une façon particulièrement édifiante les obstacles et les problèmes auxquels la classe ouvrière mondiale est confrontée, surtout dans les pays industrialisés, et qu'elle devra surmonter, mais aussi la dynamique et la force du mouvement.
Dès février 1981, des grèves massives éclatent dans toute une série d'usines (Caterpillar, British Leyland, FN) dans la sidérurgie et les transports publics, aussi bien en Flandres qu'en Wallonie, contre les mesures d'austérité prises par un gouvernement où des ministres socialistes occupent des postes-clés (économie, travail). Elles montrent à la bourgeoisie combien le temps presse, combien les nécessités de l'heure (austérité, attaque directe de la classe ouvrière) exigent une stratégie appropriée. En novembre 81, après des élections anticipées, la droite est au pouvoir, et la gauche dans l'opposition démontrera déjà quelques semaines plus tard sa redoutable efficacité.
LES LUTTES DE FEVRIER-MARS 1982 : LE DESARROI FACE AU REPLI DES LUTTES
Le mouvement de février-mars 82 qui mobilise plusieurs dizaines de milliers de travailleurs autour des sidérurgistes à Liège, à Charleroi et dans le Hainaut contre la réduction draconienne des salaires accompagnant la dévaluation, est sans conteste le mouvement le plus important en Belgique depuis la grève générale de 60-61.
Eclatant quelques semaines après le putsch en Pologne, il démontre, par la grande combativité, par la tendance à une lutte générale, dépassant les secteurs ou les revendications particulières face à l'attaque générale que subit le prolétariat, par la tendance à exprimer la spontanéité de la classe et à remettre en cause l'encadrement syndical, par l'affrontement avec l'Etat et en particulier avec les forces de l'ordre, que la défaite en Pologne n'a pas fondamentalement entamé le potentiel de combativité du prolétariat mondial et que le désarroi de la classe ouvrière face à la contre-offensive idéologique de la bourgeoisie n'est pas éternel et ne traduit pas de recul profond et de longue durée de la lutte de classe.
Toutefois, le désarroi général du prolétariat après la défaite en Pologne, l'inexpérience face aux manoeuvres de la gauche dans l'opposition, vont profondément- marquer les luttes de 82 et ne favorisent pas le développement des luttes et la clarté de leurs perspectives. Ainsi, il faut relever :
- tout d'abord l'isolement de la lutte en Belgique, face à un calme social plat dans les autres pays industrialisés, plongés en plein dans les campagnes idéologiques de la bourgeoisie sur la Pologne
- la limitation du mouvement qui s'est développé, autour des actions des sidérurgistes, à la Wallonie, tandis que les syndicats avaient réussi à désamorcer toute velléité de résistance en Flandres (cf. la longue lutte à Boel et Tamise)
- la facilité relative avec laquelle les syndicats entravent l'extension du mouvement par leurs tentatives de division ouvertes : entre syndicats, entre secteurs, entre régions (Liège contre Charleroi) , permettant à la bourgeoisie de contrôler fermement le mouvement et de conserver un discours particulièrement arrogant sans céder sur quoi que ce soit.
LES LUTTES DE SEPTEMBRE-NOVEMBRE 1983 : AU COEUR DE LA REPRISE DES LUTTES
La longue lutte des services publics en Belgique (septembre octobre), puis en Hollande (octobre-novembre) constitue le mouvement de luttes ouvrières le plus important depuis les combats de Pologne en 1980. Elle reprend les caractéristiques positives du mouvement précédent, mais elle profite de l'accumulation des conditions objectives permettant une reprise internationale de la lutte de classe. :
- longue période d'austérité, de chômage et d'attaques contre la classe ouvrière, qui se sont généralisés à tous les pays industrialisés sans que cela n'amène une amélioration des conditions économiques
- la classe ouvrière en Belgique a fait l'expérience de deux ans de gauche dans l'opposition et de ses mystifications tandis que cette expérience s'est étendue aux pays environnants (la gauche dans l'opposition aux Pays-Bas et en Allemagne)
- les luttes en Belgique et en Hollande s'inscrivent dans une nouvelle vague internationale de combats contre le capitalisme.
Cette maturation des conditions objectives de la reprise de la lutte de classe est confirmée par le développement des caractéristiques suivantes au sein même des combats en Belgique et en Hollande :
- Une tendance vers des mouvements unitaires et massifs impliquant un grand nombre d'ouvriers et touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays. En 1983, aussi bien en Belgique qu'en Hollande, c'est l'ensemble des services publics, soit 1/5 de la population active, qui lutte. Les travailleurs de toutes les centrales syndicales sont impliqués. En Hollande, jamais dans l'histoire de la classe ouvrière, les services publics n'avaient combattu à cette échelle, tandis qu'en Belgique, le mouvement dépassait la division entre la Flandre et la Wallonie et a même failli s'étendre au privé.
- Une tendance à un surgissement spontané des luttes exprimant, surtout à leur début, un certain débordement des syndicats. C'est spontanément et contre les directives syndicales que les conducteurs de trains en Belgique, les conducteurs de bus et de trains en Hollande, lancent la grève. C'est toujours spontanément que d'autres secteurs (postes, transports communaux) rejoignent le combat en Belgique. La puissance de l'extension peut être mesurée au fait que :
. Les syndicats sont obligés d'entériner et en même temps d'élargir la grève d'une façon formelle et d'adopter une attitude de "laisser faire" à la base pour reprendre le contrôle du mouvement;
. Les syndicats ont eu toutes les peines du monde pour arrêter le mouvement en Hollande.
- Une tendance vers une simultanéité croissante des luttes au niveau international. Les mouvements en Belgique et en Hollande éclatent dans les mêmes secteurs et environ au même moment, tandis que simultanément il y a en France la grève des postes, et ceci dans deux pays voisins à forte concentration ouvrière avec une grande expérience de la lutte, fort tournés vers l'extérieur, et au centre des pays industrialisés. Il n'en faut guère plus pour expliquer la crainte de la bourgeoisie qui s'est manifestée à travers le black-out sur ces mouvements sur le plan international et par une attitude conciliante du gouvernement en Belgique même.
Ces caractéristiques ont été confirmées par les grèves d'avril 84 qui, si elles n'ont pas eu l'ampleur des mouvements de l'automne précédent, ont incontestablement mis en évidence le renforcement des tendances suivantes :
- la simultanéité de plus en plus manifeste des luttes dans un grand nombre de pays industrialisés (luttes en Belgique, en France, en Angleterre et en Espagne en avril) et la confrontation à la fois avec les mystifications de la gauche dans l'opposition (Belgique, Angleterre) et l'austérité de la gauche au pouvoir (France, Espagne)
- l'accélération du rythme de confrontations entre les deux classes (les grèves d'avril viennent seulement cinq mois après les mouvements dans le secteur public),
- la confrontation continuelle avec la gauche dans l'opposition renforçant une tendance à la remise en cause de la stratégie syndicale et la prise en main des luttes par les travailleurs eux-mêmes.
La faiblesse centrale, commune à l'ensemble de ces luttes, est l'incapacité de la classe ouvrière à faire front aux manoeuvres de la gauche dans l'opposition -en particulier des syndicats- au sein même des luttes et d'autre part d'affirmer ses propres perspectives de classe. Si les travailleurs prennent de plus en plus conscience du rôle des syndicats dans leur attitude quotidienne de défenseurs de "l'austérité raisonnable", ils restent désarmés lorsque ces mêmes syndicats déploient toute leur astuce au sein des luttes. Cette faiblesse est liée à un manque d'expérience et de confiance en soi de la part du prolétariat, et à une capacité d'adaptation impressionnante de la bourgeoisie à travers le syndicalisme.
La principale forme que prend la gauche dans l'opposition dans la lutte est celle du syndicalisme de base qui a constitué le fer de lance de la réponse bourgeoise aux luttes. Profitant de luttes ponctuelles ou isolées dans les usines, les syndicalistes de base par leur discours combatif et dans leurs actions pseudo radicales gagnent la confiance de secteurs combatifs de la classe ouvrière et répandent l'idée qu'un type de syndicalisme différent de celui des "directions syndicales" est possible (à l'intérieur de la structure traditionnelle si possible, à l'extérieur si nécessaire). Ainsi, en Belgique, les "syndicalistes de combat" se sont mis aux avant-postes de toute une série de luttes isolées et se sont heurtés parfois durement aux leaders syndicaux (Boel et Tamise, Fabelta, Motte, ACEC, Valfil, FN, Brugeoise et Nivelles, etc.). En Hollande, une grève comme celle du port de Rotterdam en 82 a été entièrement menée par la "base syndicale" sous le slogan "Le syndicat, c'est nous !".
C'est à partir de telles luttes que le syndicalisme de base a tiré les expériences et a gagné l'autorité nécessaire pour dévoyer et saboter des luttes de plus grande envergure : en 82 par exemple, les syndicalistes de base prenaient l'initiative de constituer un comité de grève intersectoriel régional dans la province du Hainaut pour enfermer et épuiser la combativité ouvrière dans le cadre de la région. C'est encore eux qui entraînent les sidérurgistes vers l'affrontement préparé et provoqué par la bourgeoisie pour liquider le mouvement. En 83, aussi bien en Belgique qu'en Hollande, c'est aux syndicalistes de base que revient la tâche, dans le cadre de la généralisation formelle décrétée par la bourgeoisie, d'épuiser le mouvement dans des actions radicales mais dispersées, isolées et sans perspectives.
Ces éléments confirment et expliquent que le développement de la lutte dans les pays industrialisés sera lent. Toutefois, avec l'impasse économique totale du système, l'attaque croissante des conditions de vie du prolétariat et les réactions ouvrières, l'ensemble des mystifications de la bourgeoisie, même les plus radicales, tendront à s'épuiser progressivement tandis que les affrontements de classe prendront un caractère de plus en plus massif, puissant et simultané.
INTERNATIONALISME, SECTION EN BELGIQUE DU CCI, MARS 1984
Géographique:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [4]
Questions théoriques:
- L'économie [16]
Organisation des revolutionnaires - Sur les conditions du surgissement du parti
- 3086 reads
Les conditions générales de la remontée ouvrière depuis 68 et ses implications sur le processus de regroupement pour le parti.
1- Ce n'est pas comme produit d'une réaction contre la guerre, mais d'un développement lent et en dents de scie de la lutte de classe, face à une crise internationale se développant relativement lentement, que surgira le futur parti. Ceci implique
- la possibilité d'une beaucoup plus grande maturation de la conscience ouvrière avant l'assaut final, maturation s'exprimant en particulier au sein des minorités révolutionnaires ;
- qu'une lutte se développant à l'échelle mondiale jette les bases pour un processus de regroupement des forces révolutionnaires se posant directement au niveau international.
2- Le caractère "original" de la période 17-23 n'est pas tant dans la rapidité des événements à partir de 17 (nous devons nous attendre à une rapidité encore plus grande, face à une bourgeoisie beaucoup mieux avertie, une fois le processus révolutionnaire engagé) mais dans le caractère "charnière" de la période.
Aujourd'hui, 70 ans de décadence capitaliste font qu'une série de questions se pose en des termes beaucoup plus clairs qu'à l'époque : nature des syndicats, de la démocratie et du parlementarisme, question nationale. Alors que nous sommes encore loin de la période insurrectionnelle, chaque lutte ouvrière est contrainte de s'affronter aux forces de mystification et d'encadrement de la bourgeoisie. Même dans la confusion, le milieu prolétarien actuel est contraint de prendre position face aux enseignements de ces 70 ans de décadence. La tâche de clarification des conditions qu'ouvre pour la lutte de classe l'entrée en décadence du système est d'ores et déjà beaucoup plus avancée qu’en 1919.
3- Si la période présente reste caractérisée par l'absence de continuité organique avec le mouvement du passé, et si cela pèse lourdement sur l'état des forces révolutionnaires et les rapports qu'elles entretiennent entre elles aujourd'hui, nous ne devons pas oublier que la continuité organique avec la 2ème Internationale,-même si elle a fourni les forces vives de l'IC- a aussi conditionné beaucoup de ses faiblesses. C'est non seulement sur le plan programmatique que l'avant-garde ne put mener de façon suffisamment approfondie la critique des traditions social-démocrate et cerner l'ensemble des conditions nouvelles qui s'ouvraient. Sur le plan organisationnel, les différentes fractions de gauche ont eu d'énormes difficultés à comprendre ce qu'elles étaient et à dépasser le stade d'exister comme opposition chargée de redresser l'organisation SD dégénérescente. Le processus même de confrontation et de regroupement sera marqué par le modèle de la 2ème Internationale, fonctionnant comme une somme de partis nationaux, et même, à l'intérieur d'une nation comme l'Allemagne par des habitudes de fédéralisme. Ainsi :
- même sans"rupture organique", la mise en place d'un cadre de discussion fut non seulement insuffisamment international, mais fut même très difficile dans la seule Allemagne ;
- l'élaboration de la rupture avec la 2ème Internationale restera une série de processus nationaux, impliquant des décalages dans le temps, une hétérogénéité sur le plan politique.
La longue période de défaite qu'a traversée le prolétariat après l'échec de la révolution a été en même temps le creuset dans lequel la classe a mené le plus loin possible son effort pour tirer les enseignements de la vague révolutionnaire. Nous avons derrière nous, non seulement l'expérience vivante d'Octobre, mais l'effort des fractions, Bilan et Internationalisme, pour en tirer le maximum de leçons en vue de la prochaine vague.
4- Aujourd'hui la rupture organique avec le mouvement du passé fait que les groupes révolutionnaires ne sont plus confrontés à la nécessaire rupture avec les organisations passées à l'ennemi. Ils ne sont pas non plus ce qu'était Bilan, la fraction ayant la tâche essentielle, dans la contre-révolution triomphante, de faire le pont avec la prochaine ouverture d'un cours révolutionnaire, en tirant tous les enseignements de la défaite. Leur existence et leur développement aujourd'hui est avant tout conditionné par la reprise des luttes ouverte en 68.
5- Les conditions sont réunies plus que jamais pour que se réalise ce que le texte du CCI met en avant : dans la période de décadence "le parti politique peut parfaitement surgir avant ce point culminant que sont les conseils ouvriers" ([1] [17]).
Le schéma simpliste qui fait des bolcheviks un "exemple de parti", comparé à l'Allemagne où le regroupement s'avéra beaucoup plus difficile, ne voit pas que l'absence dès 1917 d'un parti international fut une grande faiblesse qui allait peser sur toute la vague révolutionnaire. C'est au niveau international et non au niveau de la seule Allemagne, qu'allait peser le retard avec lequel s'est fait le regroupement pour le parti mondial. Le pôle de clarification que fut l'IC eut lieu trop tard, trop peu de temps et. connaît aujourd'hui des conditions bien meilleures pour se constituer préalablement aux moments décisifs. De même c'est sur une base programmatique beaucoup plus claire qu'il pourra et devra se constituer, englobant comme base minimum l'ensemble des leçons de la première vague révolutionnaire.
6- Aujourd'hui, si les conditions générales montrent la possibilité pour un parti plus clair, plus mûr et plus directement international, elles rendent aussi ces caractéristiques plus nécessaires que jamais. Si la bourgeoisie n'a plus cette arme contre-révolutionnaire essentielle que furent les organisations de masses qui venaient de passer à l'ennemi, elle a par contre appris à développer les moyens d'encadrement les plus subtils et il faut s'attendre à toutes les tentatives de sa part pour tenter de récupérer les organes dont se dotera 1a classe. Et surtout, c'est une bourgeoisie beaucoup plus capable de s'unifier extrêmement rapidement au niveau international que le prolétariat trouvera en face de lui. Dans une telle situation, la clarté de l'avant-garde prolétarienne, son unité et sa capacité à développer une influence internationale seront VITALES.
Le milieu prolétarien et l'effort de regroupement aujourd’hui
1- L'échec du cycle de conférences internationales annonçant la crise que traverse le milieu révolutionnaire, et ce alors que s'ouvre une accélération qualitative de l'histoire, donne la mesure du retard et de la faiblesse des minorités communistes face à leurs responsabilités. Ainsi il ne suffit pas que les conditions objectives telles qu'elles existent aujourd'hui oeuvrent dans un sens favorable à une clarification et un processus d'unification au sein des forces révolutionnaires, pour que le processus de regroupement pour le parti s'engage automatiquement.
2- La rupture organique avec 1e mouvement du passé et les 50 années de contre-révolution impliquent des tâches qualitativement différentes aux minorités communistes. La question ne se pose plus en termes d'assurer la continuité du programme en opérant une rupture claire avec les anciennes organisations dégénérées. Cependant la tâche n'en est pas moins lourde. C'est un long travail de décantation qui incombe aux minorités communistes depuis que le prolétariat a ressurgi en 68. Décantation dans le sens, tant d'une réappropriation des leçons du passé que d'une clarification des conditions nouvelles qui s'ouvrent. Cette décantation implique une compréhension de ce qu'elles sont, ne sont pas, en lien avec l'analyse de la période actuelle. La mégalomanie -le mythe d'être aujourd'hui LE parti en rejetant toute confrontation avec le milieu-, le sectarisme, l'idée que l'histoire commence "avec soi" ou celle que le parti et son programme est une donnée invariante depuis 1848, et les confusions ambiantes sur le processus du regroupement, sont autant d'expressions des difficultés du milieu à prendre conscience de ce qu'il est et de ce que sont ses responsabilités aujourd'hui.
3- En disant que les conditions existent aujourd'hui pour que le parti surgisse avant le momment crucial, nous ne disons pas que toutes les condiions sont réunies pour que le parti se constitue demain matin. Son lien avec le développement de la lutte de classe signifie que le surgissement du parti implique que 1a classe ouvrière réponde à l'appel de l'histoire et développe sa conscience dans une dynamique d'internationalisation de sa lutte.
L'apparition de partis du prolétariat exige une telle dynamique, non seulement pour qu'il soit "entendu", non seulement parce que ce n'est que dans cette phase que les idées révolutionnaires peuvent "devenir forces matérielles", mais aussi parce que seule une telle dynamique peut apporter des éléments indispensables au regroupement des forces révolutionnaires à l'échelle mondiale, en clarifiant pratiquement des questions aussi essenielles que le problème de la généralisation internationale, l'organisation générale de la classe contre les multiples formes syndicales, le rôle de la violence ...et surtout la question du parti, de son rapport avec les conseils ouvriers.
4- Rejetant donc l'idée d'un parti créé artificiellement autour d'un regroupement "PCI + CCI +CWO" et le caractère absurde d'une telle hypothèse, le CCI ne considère pas pour autant le futur parti comme un produit mécanique de la période prérévolutionnaire. Celui-ci exige dès aujourd'hui un effort volontaire de la part des minorités communistes, mais cela sans illusion immédiatiste ou prématurée. Notre volonté de participer aux conférences initiées par le PCI (BC) s'appuyait :
- sur le rejet de toutes les pratiques de sectarisme, de refus du débat ;
- sur 1a compréhension qu'il ne pouvait être question de créer un regroupement prématuré;
- sur le besoin de mettre en place un lieu de confrontation et de décantation le plus large possible, dans le cadre des frontières de classe;
- sur la nécessité d'avoir des critères de participation suffisamment précis, rejetant entre autres les courants"anti-parti" modernistes ou conseillistes, afin que soit clair en particulier l'objet de telles conférences ;
- sur l'objectif que ces conférences constituent, face à l'extérieur, face à la classe, un pôle actif de référence, en étant capable de prendre position sur des questions essentielles;
- sur la nécessité d'ordres du jour allant dans le sens de l'approfondissement de ce qu'est l'effort d'unification des révolutionnaires aujourd'hui : l'analyse de la période actuelle et de la crise d'une part, la question du rôle des révolutionnaires d'autre part, comme une des questions les moins avancées aujourd'hui, qui rend urgente une confrontation.
Nous devions nous rendre compte que le sectarisme et le refus du débat pesaient y compris sur les groupes qui avaient participé activement aux conférences. L'immaturité du milieu s'est aussi traduite par l'idée qu'avaient finalement BC et la CWO de conférences beaucoup plus immédiates, cherchant un regroupement rapide avant que le débat n'ait eu lieu, et finalement n'attendant des premières conférences que les moyens matériels de chasser le CCI... au nom d'un désaccord qui n'a même pas été débattu.
5- Cette expérience nous montre l'étendue du chemin qui reste à parcourir. Si nous avons mis la question du parti à l'ordre du jour dans le CCI, c'est bien parce que nous pensons que cette question cristallise la compréhension des tâches des minorités révolutionnaires aujourd'hui, ainsi que l'attitude qu'elles ont les unes envers les autres. Au coeur du processus de décantation qui, de gré ou de force -et même sous la forme d'une crise ouverte se traduisant par la disparition de groupes tout entiers- est engagé au sein du milieu, se trouve la question du parti et du processus de développement de la conscience de classe.
La crise qui traverse le milieu et qui n'a pas épargné le CCI est une grave alerte. Elle montre en effet que ce sont les confusions sur le rôle des organisations politiques de la classe, la recherche d'un résultat immédiat et l'impatience vis à vis de la lutte de classe qui constituent le meilleur terrain à la destruction des organisations communistes par la pression matérielle et idéologique de la bourgeoisie.
Nous ne pouvons nous réjouir de voir un PCI décimé donner naissance à une organisation bourgeoise, de voir la CWO flirter avec des groupes nationalistes. Cela montre que, sans une claire réaction sur le plan programmatique à la pression de la bourgeoisie, sans non plus développer une capacité à intégrer les nouvelles leçons de la lutte de classe, tout l'effort de décantation au sein du milieu peut se trouver détruit du jour au lendemain.
6- Notre compréhension sur la question du parti est aujourd'hui celle qui va le plus loin dans le bilan de la 1ère vague révolutionnaire. C'est la question sur laquelle règne le plus de confusions dans le milieu, dans la mesure où l'expérience de 17-23 n'a pu l'éclairer complètement. Nous disons souvent que notre position s'inscrit plus en négatif qu'en positif, nous devons cependant comprendre que c'est seulement les prochains mouvements de la grève de masse qui pourront clarifier pleinement cette question au niveau international.
Les événements de Pologne, avec toutes leurs limites, ont constitué pour nous une confirmation éclatante de nos positions sur le développement de la conscience de classe, le rôle des minorités révolutionnaires et les formes d'organisation unitaire de la classe. Ils nous ont aussi contraints à pousser plus loin notre compréhension sur le problème de l'internationalisation, sur le rejet du "maillon faible". C'est en fait tout le milieu qui a été mis à l'épreuve devant ces événements. Devant un tel mouvement dans un pays plus central, le CWO aurait-il pu longtemps appeler à l'insurrection tout de suite ? Le PCI aurait-il pu continuer à prétendre qu'il n'y a pas de mouvement de classe sans organisation préalable des ouvriers par le parti ?
Les prochains mouvements mettront, plus encore que la phase de recul du début des années 80, les groupes révolutionnaires à l'épreuve. I1 y aura sans doute d'autres bouleversements au sein du milieu, on verra aussi surgir de nouveaux groupes. Ceux-ci ne seront pas pour autant à l'abri des confusions du passé. Pour englober les enseignements des prochaines expériences de la classe, pour constituer un point de référence afin que les nouvelles avant-gardes communistes ne refassent pas les mêmes erreurs, l'effort de clarification doit être poursuivi au sein du milieu actuel.
L'ossature du prochain parti n'est pas donnée une fois pour toutes par les courants et groupes existant aujourd'hui, pourtant c'est à eux de poursuivre l'effort de décantation indispensable au regroupement de demain, car c'est pour cela que la classe les a fait naître dès qu'elle a repris le chemin de la lutte.
JU mai 1983
[1] [18] Texte adopté comme résolution au 5ème Congrès du CCI. Cf. Revue Internationale n° 35 sur le parti et ses rapports avec la classe, P.27, point 17d.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [20]
Heritage de la Gauche Communiste:
Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire : le Communistenbond Spartacus et le courant conseilliste 1942-1948, I
- 4421 reads
Le Communistenbond Spartacus (Union communiste "Spartacus") est né en 1942 d'une scission du "Marx-Lenin-Luxemburg front" lui-même issu du RSAP. Ce dernier dont la figure dominante était Henk Sneevliet, était une organisation qui avant son interdiction en 1940 par le gouvernement hollandais, oscillait entre le trotskisme et le POUM, avec des positions antifascistes, syndicalistes, de défense des "libérations nationales" et de l'Etat russe. Le MLL Front qui lui succéda dans 1'illégalité s'engagea dans un travail internationaliste de dénonciation de tous les fronts de guerre capitaliste ; et en 1941, sa direction à l'unanimité moins une voix trotskyste, décida de ne pas soutenir l'URSS, dénonçant la guerre germano-soviétique comme un déplacement du front de la guerre impérialiste. L'arrestation de la direction du MLL Front - dont Sneevliet - et leur exécution par l'armée allemande, décapitèrent le MLL Front en 1942. Quelques mois plus tard les restes du Front se scindaient en deux : d'un côté, la petite minorité trotskyste qui choisissait le camp capitaliste ; de 1'autre côté, les militants internationalistes qui allaient former, au départ dans une grande confusion, le Communistenbond. Cette organisation évolua progressivement vers le communisme des conseils. Après avoir représenté à partir de 1945 et dans les années 50 le courant révolutionnaire internationaliste en Hollande, elle finit par dégénérer complètement dans 1'idéologie conseilliste. Elle disparut à la fin des années 70 comme groupe, pour ne laisser que des épigones, dont le groupe "Daad en Gedachte".
Si nous présentons cette histoire du"Communistenbond Spartacus" c'est d'abord que son histoire est mal connue, d'autant plus que le Bond en dégénérant considérait que cette histoire "c'est des vieilleries". Pour les révolutionnaires internationalistes, 1'histoire d'un groupe communiste n'est pas une "vieillerie", c'est notre histoire, 1 'histoire d'une fraction politique que le prolétariat a fait surgir. Faire le bilan de ce groupe et du courant conseilliste aujourd'hui, c'est tirer les leçons positives et négatives qui nous permettent de forger les armes de demain. Comme le courant conseilliste est organisationnellement un courant en décomposition en Hollande, qui n 'est plus un corps vivant pouvant tirer les leçons vivantes pour la lutte révolutionnaire, il appartient au CCI de tirer les enseignements de 1'histoire du Communistenbond Spartacus : pour montrer aux éléments qui surgissent sur la base du conseillisme que la logique de ce dernier les mène au néant.
Deux leçons fondamentales sont à tirer :
1) Le rejet d'octobre 17 comme révolution "bourgeoise" mène inévitablement au rejet de toute 1'histoire du mouvement ouvrier depuis 1848. Il s'accompagne nécessairement d'un refus de reconnaître le changement de période historique depuis 1914 : la décadence du capitalisme, et mène logiquement au soutien des "luttes de libération nationale" comme "révolutions bourgeoises progressistes". C'est cette logique qu'avait choisie le groupe suédois "Arbetarmakt" qui devait le plonger jusqu'au cou dans le magma gauchiste.
2) L'incompréhension de la nécessité de la fonction et du fonctionnement centralisé de l'organisation révolutionnaire mène inévitablement au néant ou à des conceptions anarchistes. L'anti-centralisme et l'individualisme dans la conception de l'organisation ouvrent d'abord la porte à 1'ouvriérisme et à l'immédiatisme qui coexistent joyeusement avec l'académisme et l'opportunisme. Le résultat? L'histoire du Communistenbond nous le montre : 1'abdication devant les tendances anarchistes et petites-bourgeoises. Finalement la dislocation ou la capitulation devant 1'idéologie bourgeoise (syndicalisme, luttes de libération nationale).
Puisse cette histoire du Communistenbond Spartacus contribuer à ce que les éléments qui se réclament du "communisme des conseils" comprennent la nécessité d'une activité organisée sur la base de la conception marxiste de la décadence du capitalisme. L'organisation politique des révolutionnaires sur une base internationale et centralisée est une arme indispensable que la classe fait surgir pour le triomphe de la révolution communiste mondiale.
L'évolution du MLL Front vers des positions internationalistes de non défense de l'URSS et de combat des deux blocs impérialistes, sans distinction d'étiquette - "démocratie, fascisme, communisme" - est une évolution atypique. Issu du RSAP, orienté vers le socialisme de gauche, le MLL Front évoluait vers des positions communistes de conseils. Cette orientation s'explique avant tout par la forte personnalité de Sneevliet qui - malgré son âge déjà avancé - était encore capable d'évoluer politiquement, et qui sur le plan personnel n ' avait plus rien à perdre ( [1] [22]). Une transformation politique aussi profonde ne peut être mise en parallèle qu'avec celle - tout aussi atypique - du groupe de Munis et des RKD ([2] [23]).
Cette évolution n'avait pas, cependant, été jusqu'à ses ultimes conséquences. La disparition de Sneevliet et de ses camarades -en particulier Ab Menlst - décapitait totalement la direction du Front. Celui -ci avait dû en partie sa cohésion au poids politique de Sneevliet, qui était plus un militant guidé par sa conviction révolutionnaire et son intuition qu'un théoricien.
La mort de Sneevliet et de la quasi-totalité des membres de la Centrale réduisit à néant pendant plusieurs mois l'organisation. De mars jusqu'à l'été 1942, tous les militants se cachaient et évitaient de reprendre contact, par peur de la Gestapo, dont ils soupçonnaient qu'elle avait démantelé le Front par un indicateur, exerçant son oeuvre au sein même de l'organisation. Les archives de police et du procès de Sneevliet ne laissent pourtant pas d'indice qu'il y eut un agent de la Gestapo à l'intérieur. ([3] [24])
De la direction du Front, seul Stan Poppe avait survécu. C'est sous son influence que fut fondé, au cours de l'été, le "Revolutionair-socialistische Arbeidersbeweging" (Mouvement ouvrier socialiste-révolutionnaire). Le terme de "mouvement ouvrier" laissait comprendre que l'organisation, qui poursuivait formellement le MLL Front, ne se concevait ni comme un front, ni comme un parti.
A la suite de la formation du groupe de Stan Poppe, les derniers partisans de Dolleman formaient le 22 août 1942 à La Haye leur propre groupe, avec une orientation trotskyste. Ainsi, naissait le "Comité van Revolutionaire Marxisten" (Comité de marxistes révolutionnaires), sur la base de la défense de l'URSS ([4] [25]). Ce groupe était numériquement beaucoup plus réduit que le Mouvement ouvrier socialiste-révolutionnaire. Il publiait un journal : "De Rode October" (L'Octobre rouge), tiré mensuellement à 2.000 exemplaires. Parmi les dirigeants du CRM, on retrouvait Max Perthus, qui avait été libéré de prison. L'ancienne fraction trotskyste du MLL Front se trouvait donc reconstituée. Les éléments les plus jeunes du Front, plus activistes, rejoignaient en majorité le CRM. Logiquement ce dernier se rattachait à la IV° Internationale, dont il se proclamait section aux Pays Bas en juin 1944. ([5] [26])
Cette ultime scission était la conséquence de l'affrontement entre deux positions inconciliables: l'une qui défendait les positions internationalistes prises en juillet 1941 par Sneevliet et ses camarades ; l'autre qui marchait dans la guerre en soutenant la Russie, et par conséquent le bloc militaire des Alliés.
D'autres raisons ont pu jouer dans la scission, à la fois organisationnelles et personnelles. Lors de l'été 1942, Poppe avait pris soin de former une nouvelle direction en éliminant tous les partisans de la défense de l'URSS. D'autre part Poppe, ayant été la dernière personne à voir Sneevliet avant son arrestation, apparaissait pour certains peu sûr sinon suspect ([6] [27]).
Dans les faits, l'organisation constituée autour de Stan Poppe était parfaitement préparée à la clandestinité, et put poursuivre son travail politique jusqu’à la fin de la guerre, sans arrestations. Elle trouvait en Leen Molenaar l'un des plus habiles confectionneurs de faux papiers et de cartes de ravitaillement pour les militants clandestins ([7] [28]).
A la fin de l'été, le groupe qui comptait une cinquantaine de militants commença à éditer un bulletin ronéoté, avec plus ou moins de régularité :"Spartacus". Ce dernier était l'organe du "Communistenbond Spartacus" (Union communiste Spartacus). Plusieurs brochures étaient éditées qui montraient un niveau théorique plus élevé que dans le MLL Front. Vers la fin de l'année 1944, "Spartacus" devenait un organe théorique mensuel. A côté, à partir d'octobre 1944 et jusqu'à mai 1945, était diffusée sous forme de pamphlet une feuille hebdomadaire sur l'actualité immédiate : "Spartacus - actueleberichten" (Nouvelles actuelles).
Politiquement, les membres du Bond étaient plus aguerris car plus anciens que les éléments trotskystes, et plus formés théoriquement. Beaucoup d'entre eux avaient milité dans le NAS, dont ils avaient gardé tout un esprit syndicaliste-révolutionnaire. Ainsi Anton (Toon) van den Berg, militant de l'OSP puis du RSAP, avait dirigé le NAS à Rotterdam jusqu'en 1940. Autour de lui se formait le groupe de Rotterdam du Communistenbond, qui se caractérisa toujours jusqu'au lendemain de la guerre par un esprit activiste. D'autres militants, enfin, avaient tout un passé politique, marqué moins par le syndicalisme que par le socialisme de gauche et même du MLL Eront. Tel était le cas de Stan Poppe.
Stan Poppe avait joué un rôle important dans l'OSP. Il se trouvait à la direction de ce parti, dans la fonction de secrétaire. Lors de la fusion avec le RSP, il était devenu membre du Bureau politique du RSAP. Nommé en 1936 secrétaire trésorier de ce parti, il avait été délégué -avec Menlst - en décembre à la conférence du Centre pour la IV° Internationale. Membre du Bureau politique en 1938, il était en 1940 l'un des responsables du MLL Front. Dans le Front, ccmme plus tard dans le Communistenbond Spartacus, il se faisait connaître sous le pseudonyme de Fjeerd Woudstra. Très orienté vers l'étude économique, son orientation politique était encore un mélange de léninisme et de conseillisme.
La plupart des militants venaient de l'ancien RSAP, sans être passés par le mouvement trotskyste, d'ailleurs très faible aux Pays Bas. Nombre d'entre eux continuèrent - après la guerre - à militer dans le Bond, la plupart jusqu'à la fin de leur vie : Bertus Nansink, Jaap van Otterloo, Jaap Meulenkamp, Cees van der Kull, Wlebe van der Wal, Jan Vastenhouw étaient ce type de militants.
Cependant, pendant deux ans encore, l'évolution de "Spartacus" se signala par des ambiguïtés politiques qui prouvaient que l'esprit du RSAP n'avait pas totalement disparu. Les réflexes socialistes de gauche se manifestèrent encore lors de prises de contact avec un groupe social-démocrate qui avait quitté le SDAP au début de la guerre et dont la personnalité marquante était W. Romljn. Ce dernier -à la fin de l'année 1943- avait écrit, sous le pseudonyme Soc lus, une brochure où il se prononçait pour un soutien "tactique" de la lutte militaire des Alliés. "Spartacus" attaque durement cette position ([8] [29]) et renonça aux négociations de fusion avec Romljn. Le fait moue qu'il y eut des propositions de fusion avec ce groupe montrait que le Bond n'avait aucune caractérisation de classe de la social-démocratie. En cela "Spartacus" était très éloigné des communistes de conseils qui avaient toujours dénoncé comme contre révolutionnaire et bourgeois les groupes socialistes de droite comme de gauche. Cette persistance à chercher des contacts avec des socialistes de gauche se retrouve encore en novembre 1944, lorsque pendant quelque temps un travail commun est mené avec le groupe "De Vonk" (cf. chapitre précédent), travail qui finalement échoue, compte tenu des divergences politiques.
Avec le courant trotskyste, si la rupture organisationnelle était consommée, il n'en était pas de mené idéologiquement avec ses tendances de gauche. Poppe eut au cours de l'année 1944 deux réunions avec le groupe "Contre le courant" (Tegen de Stroom de Vereekenl. Bien que celui-ci refusa la défense de l'URSS en juin 1941, il restait lié au Comité communiste Internationaliste français d'Henri Molinier ; il devait d'ailleurs s'intégrer dans la IV° Internationale, après la guerre ([9] [30]). Plus significatif était le fait que même au sein du Bond "Spartacus" les dernières hésitations sur la défense de l'URSS n'avaient pas été totalement levées. Une petite partie de l'organisation - contre la défense du camp russe dans la présente guerre - se prononçait pour cette défense en cas d'une troisième guerre mondiale entre les Alliés occidentaux et l'URSS ([10] [31]),
Aussi, pendant deux ans - jusqu'à ce que l'apport théorique de l'ex-GIC devint prépondérant - le Bond essaya de clarifier ses positions politiques. Son activité consista en grande partie à réaliser un travail théorique, sous forme de brochures, lequel reposait en grande partie sur les épaules de Bertus Nansink et surtout de Stan Poppe.
La brochure de Stan Poppe sux "Les perspectives de l'impérialisme après la guerre en Europe et la tâche des socialistes -révolutionnaires" fut écrite en décembre 1943 et parut en janvier 1944 ([11] [32]). Le texte, très influencé par le livre de Lénine L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, se réclamait du "socialisme scientifique de Marx, Engels, Lénine" et non de Rosa Luxembourg. Il essayait de définir le cours suivi par le capitalisme et les perspectives révolutionnaires pour le prolétariat.
La cause de la guerre mondiale était "la crise générale du capitalisme" depuis 1914. Dans un sens léniniste, Poppe définissait la nouvelle période de crise comme impérialiste monopoliste :
"Cette phase ultime, la plus haute, Lénine la définissait cpmme impérialiste. L'impérialisme est le côté politique de la société produisant selon un mode capitaliste-monopoliste."
Cette référence à Lénine est particulièrement intéressante, quand on sait que par la suite les "conseillistes" de "Spartacus" se définiront comme anti-léninistes.
On peut voir déjà, pourtant, une certaine réflexion théorique percer sous la référence quasi scolaire à Lénine. Poppe comprend la crise comme une crise de surproduction. Celle-ci se traduit par le capitalisme d'Etat, aboutissement de la phase du monopole, dont l'expression est l'économie d'armements. Celle-ci envahit la production et "le système (capitaliste) ne peut être secouru que par la guerre et par la production pour la guerre".Il ne parle pas, dans sa contribution,de la Russie comme capitaliste d'Etat. Au contraire, il affirme que l'URSS "est soustraite à l'emprise du monopole - production capitaliste - et à la demi-nation du marché" ; qu'elle est "le seul adversaire étatiquement organisé de l'impérialisme". Une telle position était d'autant plus surprenante que Poppe avait été l'un de ceux qui -dans le MLL Front - avait caractérisé l'URSS comme capitaliste d'Etat. Contradictoire était donc la dénonciation dans ce texte des mesures de capitalisme d'Etat dans tous les pays,"qu'ils soient démocratiques ou autocratiques, républicains ou monarchistes", sauf en URSS.
Plus lucide était l'analyse du conflit en Europe :"La guerre touche à sa fin. La défaite militaire de l'Allemagne et de ses alliés n'est pas une spéculation mais un fait..." Poppe, par un paradoxe de style, considérait que la Deuxième guerre mondiale se prolongeait par une Troisième guerre mondiale en Asie, mettant aux prises le Japon et le camp anglo-américain pour la domination des colonies.
Un peu comme Bordiga après 1945 ([12] [33]) Poppe considérait que la guerre menait à la fascisation des démocraties occidentales, sur le plan politique :
"La guerre impérialiste est - sur le plan de la politique extérieure- l'autre face de l'exploitation monopolistique de la force de travail "- tandis que - en politique intérieure - la démocratie bourgeoise, forme de vie du même ordre social, est comme le fascisme."
Les démocraties trouveront - en cas de crise révolutionnaire - dans le fascisme "leur propre futur", sinon s'imposera en économie une forme de néo-fascisme :
"Sous l'apparence de la terminologie, il n'y aura plus de fascisme, mais dans les faits nous vivrons son deuxième âge d'or. Au coeur de la politique sociale néo-fasciste il y aura la dégradation du revenu ouvrier, conséquence nécessaire de la politique de déflation."
Ayant en tête l'exemple des années 30, Poppe pensait que la crise ouverte du capitalisme se poursuivrait après la guerre : en effet, il n'y aurait pas de "conjoncture de reconstruction, sinon très courte et extrêmement modeste."
L'alternative pour le prolétariat était "entre le socialisme ou la chute dans la barbarie", c'est à dire entre la révolution prolétarienne ou la guerre. Faisant cette constatation, le texte se garde de faire des pronostics. Il souligne que la guerre "pour la reconquête et la sauvegarde de l'Indonésie et de l'Extrême-Orient" implique "la perspective d'une guerre inévitable contre l'Union soviétique elle-même", soit au cours de la "troisième" guerre en Orient soit à l'occasion d'une "quatrième" guerre mondiale.
Néanmoins, "la crise générale du capitalisme fait mûrir la crise révolutionnaire du système". Cela n'implique pas que la "révolution surgisse automatiquement" : Elle dépend de l'intervention consciente de la classe révolutionnaire au cours du processus (révolutionnaire) "
Théoriquement, Poppe définit la révolution comme la mise en place de la dictature du prolétariat et la dissolution "de cette dictature et de l'Etat lui-même". Cette dictature sera celle des conseils d'usine qui formeront "les conseils centraux du pouvoir". Il est intéressant de noter que sont exclus ici les soviets de paysans. Dans "la lutte pour le pouvoir" qui n'est autre que "la lutte pour et avec les conseils" le prolétariat d'usine est le coeur de la révolution. Il est symptomatique d'une vision usiniste gramscienne que Poppe prenne comme exemple l'occupation des usines, à l'exemple de l'Italie en 1920 ([13] [34]).
Symptomatique est la séparation faite entre la révolution des conseils dans les pays industrialisés et l'appel lancé au soutien des "luttes de libération nationale" :
"Il ne peut point y avoir de politique socialiste en Europe et en Anérique sans la proclamation de la pleine indépendance des anciens peuples coloniaux."
Dans la question coloniale, Poppe reprend à son compte les positions de Lénine sur le "droit des peuples à l'auto-détermination". Il ne semble pas que ces positions de Poppe reflétassent l'opinion de tous les militants : en 1940, Jan Vastenhouw -membre alors du MLL Front - avait fermement attaqué la conception de Lénine dans un bulletin interne.
Poppe va cependant très loin dans son analyse ; non seulement il considère que "la tâche (des révolutionnaires socialistes) est naturellement d'appeler les ouvriers de tous les pays à chasser les Japonais des territoires occupes par ceux-ci en Chine et en Indonésie", mais il proclame la nécessité de cette "libération" sous la bannière de l'URSS. Mais Poppe ne parle pas d'une URSS stalinienne, mais d'une URSS libérée -grâce à l'instauration du pouvoir des conseils en Europe - par les ouvriers et les paysans du stalinisme. Dans cette optique - mélange de fantasme et de croyance- il y aurait guerre de "libération nationale" révolutionnaire :
"Si les socialistes ne se trompent pas dans leur prévision, alors cela signifie que l'Union soviétique devient le facteur le plus important aussi dans la lutte contre l'impérialisme japonais. Une Union soviétique qui peut s'appuyer sur l'alliance du pouvoir des conseils des autres peuples au lieu des traités douteux avec les gouvernements capitalistes ; une union soviétique qui se sait soutenue sur ses arrières par un système d'Unions des conseils européens . et par la solidarité du prolétariat guidé par le socialisme révolutionnaire doit aussi - sans le secours des armes anglaises et américaines- être capable de chasser les impérialismes japonais du Mandchukuo et des autres parties de territoire de la République chinoise, de même que de l'Indonésie."
Cette idée d'une guerre de "libération révolutionnaire" s'apparentait à la théorie de la guerre révolutionnaire lancée en 1920 par le Komintern. On ne peut manquer de constater ici, cependant, que la "libération" préconisée par Poppe à la pointe des baïonnettes est plus nationale sinon nationaliste- puisqu'elle se propose de restaurer l'intégrité territoriale de la "République de Chine"- que révolutionnaire. Elle apparaît comme une guerre nationale bourgeoise, à l'image des guerres de la Révolution française, qui instaure et non détruit le cadre national. La théorie de Poppe des conseils ouvriers est une théorie nationale des conseils fédérés en Unions. Ici, la conception de la "lutte de libération nationale" est le corollaire d'une conception où la révolution ouvrière qui fait surgir les conseils ouvriers est nationale.
Les positions de Poppe et du Communistenbond sont donc encore très éloignées de celles du communisme des conseils. Elles sont encore un mélange syncrétique de léninisme, de trotskisme, voire de gramscisme. Et cela d'autant plus que jusqu'à l'été 1944, le Bond sera incapable d'avoir une position théorique sur la nature de l'URSS.
C'est finalement par des discussions menées au cours de l'été 1944 avec d'anciens membres du GIC que l'Union communiste Spartacus s'oriente définitivement vers le communisme des conseils. Quelques membres du Bond prirent contact avec Canne Meijer, B.A. Sijes, Jan Appel et Théo Massen, Bruun van Albada pour leur demander de travailler dans leur organisation. Ils acceptèrent de contribuer théoriquement par la discussion et par écrit ([14] [35]) ; mais ils ne voulaient en aucun cas ni dissoudre le propre groupement ni adhérer immédiatement au Bond Ils étaient encore très méfiants vis-à-vis de la nouvelle organisation marquée par une tradition léniniste ; ils voulaient auparavant voir dans quelle mesure le Bond s'orienterait vers le communisme des conseils. Peu à peu ils participèrent aux activités rédactionnelles et d'intervention, en avant un statut hybride d'"hôtes" ([15] [36]). Ils évitaient de prendre partie dans les questions organisationnelles du Bond et ne participaient pas aux réunions lorsque de telles questions étaient soulevées. C'est peu avant mai 1945, qu'ils devinrent membres à part entière de l'organisation, une fois constaté l'accord théorique et politique de part et d'autre.
Le fruit d'une maturation politique du Bond fut la brochure, publiée en août 1944 : "De Strijd cm de macht" (La lutte pour le pouvoir). Cette brochure se prononçait contre toute activité de type parlementaire et syndical, et préconisait la formation de nouveaux organes prolétariens, antisyndicaux, nés de la lutte spontanée : les conseils d'usine, base de la formation de conseils ouvrier La brochure constatait, en effet, .que les changements dans le mode de production capitaliste entraînaient des modifications structurelles au sein de la classe ouvrière et donc mettaient à l'ordre du jour de nouvelles formes d'organisations ouvrières correspondant au surgissement d'u "nouveau mouvement ouvrier". ([16] [37])
A la différence de l'ancien GIC, le Bond - dans cette brochure - préconisait la formation d'un parti révolutionnaire et d'une Internationale. Cependant, à la différence du trotskisme, il était souligné qu'un tel parti ne pourrait surgir qu'à la fin de la guerre, et de lui-même, lorsque seraient formés les organes de lutte du prolétariat.
Lorsque en mai 1945, le Communistenbond "Spartacus" publie légalement la revue mensuelle, Spartacus, il ne peut plus être considéré comme une continuation du MLL Front. Avec l'apport militant des membres du GIC il est devenu une organisation communiste des conseils. Comme devait le noter en 1946, Canne Meijer : "Le Spartacusbond actuel ne peut être considéré comme une continuation directe du RSAP. Sa composition est différente et dans beaucoup de questions, la prise de positions est autre... Beaucoup qui auparavant appartenaient au RSAP ne se sont pas joints à "Spartacus", alors que quelques-uns purent être attirés par les trotskystes. Mais ils ne sont pas nombreux, car les trotskystes de toute façon ne sont pas nombreux." ([17] [38])
En importance, "Spartacus" était la première organisation révolutionnaire en Hollande, et portait donc une lourde responsabilité politique au niveau international dans le regroupement des révolutionnaires en Europe, cloisonnés par l1 Occupation et de nouveau à la recherche de liens internationaux. Cette possibilité de devenir un pôle de regroupement dépendait autant de la solidité de l'organisation, de son homogénéité politique et théorique, que d'une claire volonté de sortir des frontières linguistiques de la petite Hollande.
Numériquement le Bond était relativement fort pour une organisation révolutionnaire, surtout dans un petit pays. En 1945, il comptait une centaine de militants ; il avait à la fois une revue théorique mensuelle et un journal hebdomadaire, dont le tirage était de 6.000 exemplaires ([18] [39]). Il était présent dans la plupart des grandes villes, et en particulier dans les centres ouvriers d'Amsterdam et de Rotterdam, où la tradition communiste des conseils était réelle.
Cependant, l'organisation était loin d'être homogène. Elle rassemblait d'anciens membres du MLL Front, du GIC, mais aussi d'anciens syndicalistes du NAS d'avant guerre. Au Bond s'étaient aussi adjoints des anarchistes de l'ancien "Mouvement socialiste libertaire". Beaucoup de jeunes enfin avaient rejoint "Spartacus", mais sans expérience politique ni formation théorique. Il y avait donc une union de différentes origines mais pas véritablement une fusion, condition même de la création d'un tissu organisationnel homogène. Les tendances centrifuges - comme on le verra plus loin - étaient donc fortes. Les éléments libertaires véhiculaient des conceptions anti-organisation. Les ex-syndicalistes, particulièrement actifs autour de Tbon van den Berg à Rotterdam, étaient très activistes et ouvriéristes. Leur conception était plus syndicaliste que politique. D'autre part, les jeunes avaient une propension - découlant de leur immaturité politique - à suivre l'une de ces deux tendances, et particulièrement la première.
Organisationnellement, le Bond n'avait rien à voir avec l'ancien GIC qui se concevait comme une fédération de groupes de travail. Le Bond était une organisation centralisée et le restera jusqu'en 1947. Son organisation était composée de noyaux (Kerne) ou sections locales de 6 membres, coiffées par des sections territoriales ou urbaines. Le comité exécutif de 5 membres représentait l'organisation à l'extérieur et était responsable devant le congrès du Bond, qui était l'instance suprême. Comme dans toute organisation révolutionnaire digne de ce nom, elle avait des organes de travail élus : une commission politique regroupant la rédaction et chargée des questions politiques ; une commission d'organisation pour les taches courantes ; une commission de contrôle chargée de vérifier que les décisions prises étaient appliquées ; une 'commission de contrôle financier. En tout, en 1945 il y avait entre 21 et 27 personnes dans les organes centraux.
L'adhésion à l'organisation était clairement définie par les statuts adoptés en octobre 1945 ([19] [40]). Le Bond qui avait alors une conception très haute de l'organisation ne voulait accepter de nouveaux membres qu'avec la plus grande prudence et exigeait d'eux "la discipline d'un parti centraliste démocratique" ([20] [41]). Le Bond, en effet, renouait avec la tradition du KAPD.
De cette tradition, cependant, le Communistenbond reprenait certains aspects les moins favorables à l'accomplissement de son travail. Centralisé par ses organes, le Bond était décentralisé au niveau local. Il considérait que chaque "noyau est autonome dans sa propre région" ([21] [42]). Visant à une "décentralisation du travail", il était inévitable que celle-ci entre en contradiction avec le centralisme de l'organisation.
D'autre part, le Bond véhiculait certaines conceptions de l'organisation qui s'étaient épanouies dans les grandes organisations politiques de masses du passé. L'organisation était encore conçue comme une organisation de "cadres" ; d'où la formation, décidée lors de la Conférence des 21 et 22 juillet 1945, d'une "école de cadres marxistes". Elle n'était pas totalement unitaire ; à la périphérie gravitaient les "Associations des amis de Spartacus" (V.S.V.). Le Bond trouvait dans le VSV son organisation de jeunesse autonome. Composée de jeunes entre 20 et 25 ans, cette organisation parallèle était en fait une organisation de jeunes sympathisants. Bien que n'ayant pas de devoirs vis-à-vis du Bond, ils devaient participer à la propagande et contribuer financièrement. Un tel flou entre militants et sympathisants ne contribua pas peu à renforcer les tendances centrifuges au sein de l'organisation.
Un autre exemple du poids du passé est à trouver dans la création en août 1945 d'une "Aide ouvrière" (Arbeidershulp). Il s'agissait de créer dans les entreprises un organisme, ou plutôt une caisse de secours, pour aider financièrement les ouvriers en grève. En filigrane, il y avait l'idée que le Communistenbond devait diriger la lutte des ouvriers et se substituer à leurs efforts spontanés de s'organiser. Néanmoins, l'"Aide ouvrière" n'eut qu'une brève existence. La discussion sur le parti, générale dans le Bond, permit de préciser quelle était la nature et la fonction de l'organisation politique des révolutionnaires.
"Spartacus" pensait en effet que les luttes ouvrières qui éclataient à la sortie de la guerre auguraient d'une période révolutionnaire, sinon dans l'immédiat, du moins dans le futur. Eh avril 1945 la conférence du Spartacusbond proclamait la nécessité d'un parti et le caractère provisoire de son existence comme organisation nationale :
"Le Bond est une organisation provisoire de marxistes, orientée vers la formation d'un véritable parti communiste international, lequel doit surgir de la lutte de la classe ouvrière". ([22] [43])
Il est remarquable que cette déclaration posait la question de la naissance d'un parti en période révolutionnaire. Une telle conception était à l'inverse de celle des trotskystes des années 30, puis des bordiguistes après 1945 qui faisaient du moment de ce surgissement une question secondaire et considéraient que le parti était le produit d'une simple volonté. Il suffisait de le "proclamer" pour qu'il existât. Non moins remarquable était 1'"Adresse inaugurale" - votée à la conférence de juillet- adressée aux groupes révolutionnaires internationalistes. Elle excluait le CRM trotskyste de Hollande, avec lequel la conférence rompit tout contact, en raison de leur position de "défense de l'URSS" ([23] [44]). Enfin elle était un appel au regroupement des différents groupes de la Gauche communiste, qui rejetaient la vision de la prise du pouvoir par un parti :
"C'est dans et par le mouvement même que peut naître une nouvelle Internationale communiste, à laquelle les communistes de tous les pays -débarrassés de la domination bureaucratique mais aussi de toute prétention à briguer le pouvoir pour leur propre compte - peuvent participer". ([24] [45])
On doit cependant constater que cet appel au regroupement des révolutionnaires internationalistes ne se traduisit que par des mesures limitées. La conférence décida d'établir un Secrétariat d'information à Bruxelles dont la tâche était de prendre contact avec divers groupes et d'éditer un Bulletin d'information. En même temps, le contact était repris pour un temps très bref avec le groupe de Vereeken. Il était évident que les positions de son groupe "Centre le courant" (Tegen de stroem) ([25] [46]) étaient incompatibles avec celles du Bond. Mais le fait même de reprendre contact notait une absence de critères politiques dans la délimitation des groupes cemmunistes internationalistes d'autres groupes confus ou anarchistes. Cette même absence de critères se retrouvera en 1947, lors d'une conférence internationale tenue à Bruxelles (cf. infra).
La préparation du Bond au surgissement d'un parti impliquait que la plus grande homogénéité se fasse dans l'organisation sur la conception théorique du parti. C'est pourquoi furent écrites et discutées pour le congrès des 24-26 décembre 1945 des "Thèses sur la tâche et la nature du parti" ([26] [47]). Elles furent adoptées par le congrès et publiées en brochure en janvier 1946 ([27] [48]). Il est très significatif qu'elles furent rédigées par un ancien membre du GIC : Bruun van Albada. Ce fait même montrait l'unanimité qui existait alors dans le Bond sur la question, et surtout traduisait le rejet explicite des conceptions qui avaient régné dans le GIC au cours des années 30.
La tenue de réunions publiques sur le thème du parti, au cours de l'année 1946, montre l'importance que les thèses revêtaient pour l'organisation.
Les Thèses sont centrées sur le changement de fonction du parti entre la période d'ascendance du capitalisme - appelée période du"capitalisme libéral"- et la période de décadence qui suit la première guerre mondiale - période de domination du capitalisme d'Etat. Bien que les concepts d1ascendance et de décadence du capitalisme ne soient pas utilisés, le texte souligne avec force le changement de période historique qui implique une remise en cause des vieilles conceptions du parti :
"La critique actuelle des vieux partis n’est pas seulement une critique de leur pratique politique ou des procédés des chefs, mais une critique de toute la vieille conception du parti. Elle est une conséquence directe des changements dans la structure et dans les objectifs du mouvement de masse. La tâche du parti (révolutionnaire) est dans son activité au sein du mouvement de masse du prolétariat."
Les Thèses, de façon historique, montrent que la conception d’un parti ouvrier agissant sur le modèle des partis bourgeois de la Révolution française et non distinct des autres couches sociales est devenue caduque avec la Commune de Paris. Le parti ne vise pas la conquête de l’Etat mais sa destruction :
"Dans cette période de développement de l'action de masse, le parti politique de la classe ouvrière allait jouer un rôle beaucoup plus grand. Parce que les ouvriers n’étaient pas encore devenus la majorité écrasante de la population, le parti politique apparaissait encore comme l'organisation nécessaire, qui doit oeuvrer à entraîner la majorité de la population dans l'action des ouvriers, tout à fait de la même façon que le parti de la bourgeoisie a agi dans la révolution bourgeoise ; parce que le parti prolétarien devait être à la tête de l'Etat, le prolétariat devait conquérir le pouvoir d'Etat".
Montrant l'évolution du capitalisme après 1900, "période de prospérité croissante du capitalisme", les Thèses montrent le développement du réformisme dans la social-démocratie. Elles ont tendance à rejeter les partis de la II° Internationale après 1900, étant donné leur évolution vers l'opportunisme parlementaire et syndical. Et elles ignorent la réaction des gauches communistes (Lénine, Luxembourg/ Pannekoek) en leur sein. Montrant très bien le "semblant de pleine démocratie" de la social-démocratie classique et la "complète scission entre la masse des membres et la direction du parti", les Thèses concluent négativement et ne montrent pas l'apport positif de l'organisation pour le mouvement ouvrier de l'époque :
"Le parti politique cesse d'être une formation de pouvoir de la classe ouvrière. Il devient la représentation diplomatique des ouvriers dans la société capitaliste. En opposition loyale, il participe au Parlement, participe à l'organisation de la société capitaliste." La Première guerre mondiale ouvrait une nouvelle période, celle de la Révolution prolétarienne. Les Thèses considèrent que c'est la paupérisation absolue du prolétariat et non le changement de période qui est à l'origine de la révolution. De ce fait, on voit mal en quoi la période révolutionnaire de 1917-1923 se distinguait de 1848, période de "paupérisation absolue" caractéristique de la situation du prolétariat naissant :
"L'éclatement de la guerre mondiale signifia qu'à la phase de paupérisation relative succédait celle de la paupérisation absolue. Cette nouvelle évolution doit par la force des choses pousser les ouvriers dans une opposition révolutionnaire au capital. Aussi, en même temps, les ouvriers entraient en conflit avec la social-démocratie".
Les Thèses ne manquent pas de souligner les apports positifs de la vague révolutionnaire de l'après-guerre : naissance spontanée "d'organisations d'entreprise et de conseils ouvriers comme organes de la démocratie ouvrière à l'intérieur des entreprises et organes de la démocratie politique locale". Les Thèses, cependant, minimisent la portée révolutionnaire de 1917 en Russie ; elles ne semblent retenir de 17 que la suite : la contre-révolution et le capitalisme d'Etat. Elles voient même dans la révolution l'origine la contre révolution stalinienne. Le processus de dégénérescence est nié et les ouvriers russes sont ainsi rendus responsables de l'échec de la révolution russe. Ainsi, le développement du "socialisme d'Etat" (c'est-à-dire le capitalisme d'Etat) est considéré "comme résultat de la lutte révolutionnaire des paysans et des ouvriers."
Cependant, c'est avec lucidité que les Thèses notent l'effet pernicieux de la confusion entre socialisme et capitalisme d'Etat dans les rangs ouvriers de l'époque. Cette confusion empêcha la pleine maturation de la conscience révolutionnaire:
"... par la Révolution russe, la conception socialiste d'Etat se para d'une auréole révolutionnaire et cela ne contribua pas peu à entraver la réelle prise de conscience révolutionnaire des ouvriers." ([28] [49])
Le rejet implicite de la Révolution russe et de l'apport du parti bolchevik en 1917 amène le rédacteur des Thèses à établir une identité entre le bolchevisme révolutionnaire des débuts et le stalinisme. Pour lui, il n'y a pas de différence entre bolchevisme et social-démocratie, "sinon de méthode" pour établir une"économie planifiée par l'Etat".
Plus originale est la définition du rôle du parti et des révolutionnaires dans leur intervention. Reprenant la conception du KAPD des années 1920, le Bond souligne que le rôle du parti n'est ni de guider, ni d'éduquer, ni de se substituer à la classe ouvrière :
"Le rôle du parti est maintenant restreint à celui d'une organisation de clarification et de propagande. Il n'aspire pas davantage à instaurer une domination sur la classe".
La genèse du parti dépend étroitement des changements dans le capitalisme - où la période "de capitalisme libéral est définitivement close" -et de la transformation de la conscience de classe des ouvriers. La lutte révolutionnaire qui fait surgir le parti, est avant tout une lutte contre l'Etat produite par l'action de masses, et une lutte consciente pour l'organisation :
"L'Etat est devenu clairement l'ennemi mortel de la classe ouvrière... Dans tous les cas, la lutte des ouvriers se déroule en opposition inconciliable avec cet Etat, non seulement contre les gouvernements mais contre l'ensemble de l'appareil (d'Etat), vieux partis et syndicats inclus. Il y a un lien indestructible entre les trois éléments de la lutte d'émancipation des ouvriers : l'essor de l'action de masse, l'essor de l'organisation et de la conscience."
Les Thèses établissent une interaction dialectique entre le développement de l'organisation révolutionnaire et la lutte révolutionnaire :
"Ainsi se développe dans la lutte l'organisation matériellement et spirituellement ; et avec l'organisation se développe la lutte."
L'aspect le plus significatif des Thèses est de montrer le rôle positif du parti révolutionnaire dans les mouvements de masses et de définir le type de militant révolutionnaire correspondant à la nouvelle période.
Son champ d'action est clairement défini :
a) nécessité du parti : prise de conscience
Les Thèses montrent que le parti est nécessaire, car il est un produit dialectique du développement de la conscience de classe et par conséquent un facteur actif dans ce processus de développement. On est ici très loin de la vision "conseilliste"-qui sera développée par la suite - où les révolutionnaires inorganisés se dissolvent dans la classe ([29] [50]). Est rejetée aussi la conception bordiguiste qui fait du parti un véritable état-major auquel les ouvriers sont subordonnés aveuglément. La nécessité du parti découle non d'un rapport de forces entre cette organisation et la classe, mais d'un rapport organique entre parti et classe, né du développement de la conscience de classe :
"Dans le processus de prise de conscience par la lutte, où la lutte devient consciente d'elle-même, le parti a un rôle important et nécessaire à jouer. En premier lieu il soutient cette prise de conscience. Les leçons qu'on doit tirer autant des victoires que des défaites - et dont les ouvriers, séparément, ont une conscience plus ou moins claire - sont formulées par le parti et diffusées parmi les masses par le moyen de sa propagande. C'est "l'idée", qui, dès qu'elle s'empare des masses, devient une force matérielle".
"Le parti n'est ni un état-major détaché de la classe ni le "cerveau pensant" des ouvriers ; il est le foyer où se focalise et s'exprime la conscience grandissante des ouvriers".
Si le parti et la classe sont dans un rapport organique de complémentarité dans une même unité de conscience, ils ne sont pas identiques ni confondus. Le parti est l'expression la plus élevée de la conscience de classe du prolétariat, comme conscience politique et historique, et non comme conscience reflet de la lutte immédiate (conscience immédiate dans la classe). Le parti est donc une partie de la classe.
"Partie de la classe, la plus consciente dans la lutte et la plus formée, le parti a la capacité de comprendre le premier les dangers qui menacent (la lutte des ouvriers) , de discerner le premier les potentialités des nouvelles organisations de pouvoir : il doit y lutter de façon telle que son opinion soit utilisée à fond par les ouvriers ; il doit la propager par la parole, et s'il le faut par une intervention en acte, afin que son exemple fasse avancer la classe dans sa lutte".
On notera que cette conception du parti dans sa fonction propagandiste "par les mots et par les faits" est identique à celle du KAPD dans les années 20. Le Bond a ici une conception presque volontariste du parti, où l'exemple de l'action du parti est un combat et même une incitation au combat. Cette définition du parti rejoint aussi celle de Bordiga pour lequel un parti c'est un programme plus une volonté d'action. Mais dans la Gauche hollandaise, le programme est moins un ensemble de principes théoriques et politiques que la formulation de la conscience de classe, voire d'une somme de consciences ouvrières :
"Ce que ressent chaque ouvrier, à savoir que la situation est intenable et qu'il est absolument nécessaire de détruire le capitalisme, doit être synthétisé par le parti dans des formules claires".
b) les tâches du parti : théorie et praxis Pour le Communistenbond, il est clair qu'il ne peut être fait une séparation entre travail théorique et intervention pratique. La théorie n'est pas définie comme une somme d'opinions individuelles mais comme une science. Comme le soulignait déjà le Bond en janvier 1945 ; "Le matérialisme dialectique n'est pas seulement la seule méthode exacte mais aussi la seule méthode universelle de recherche " ([30] [51]). Paradoxalement, c'est le scientifique Pannekoek qui rejette dans ses "Conseils ouvriers" l'idée de théorie matérialiste scientifique considérant qu'une organisation exprime des opinions variées sans résultat scientifique et sans méthode. Contrairement au Bond de la période 45-46, Pannekoek défend une méthode éclectique, c'est à dire rejette toute méthode d'investigation théorique, selon le principe qu'une somme d'unités donne une totalité. Il écrit en effet que " dans chacune de ces pensées diverses se trouve en fait une parcelle de la vérité, plus ou moins grande" ([31] [52]). Au contraire, les Thèses affirment :
"Les questions doivent être examinées dans leur cohérence ; les résultats doivent être exposés dans leur clarté et leur déterminisme scientifiques . "
De cette méthode découlent les tâches du parti dans le prolétariat :
- tache"d'éclaircissement" et non d'organisation, cette tâche étant celle des ouvriers dans leur lutte. La fonction d'organisation de la classe disparaît au profit d'une tâche de clarification de la lutte. Cette clarification est définie négativement comme une lutte idéologique et pratique contre "toutes les tentations fourbes de la bourgeoisie et de ses complices de contaminer par leur propre influence les organisations ouvrières".
- tâche"d'intervention pratique dans la lutte de classe". Sa réalisation découle de la compréhension par le parti qu'il ne peut"soustraire aux ouvriers leurs fonctions" :
"(Le parti) ne peut intervenir que comme partie de la classe et non en contradiction avec celle-ci. Sa position dans l'intervention est uniquement de contribuer à 1'approfondissement et à l'extension de la domination du pouvoir de la démocratie des conseils..."
Cette fonction du parti n'implique pas la passivité. A la différence des "conseillistes" des années 50 et 60 (cf. infra), le Spartacusbond n'a pas peur de s'affirmer comme un "moteur" de la lutte de classe qui prend des initiatives qui compensent les hésitations des ouvriers :
"Quand les ouvriers hésitent à prendre certaines mesures, les membres du parti peuvent, comme ouvriers d'industrie révolutionnaires, prendre l'initiative et ils sont même tenus de le faire quand l'accomplissement de ces mesures est possible et nécessaire. Quand les ouvriers veulent remettre à une instance syndicale la décision de déclencher une action, les communistes conscients doivent prendre l'initiative pour une intervention propre des ouvriers. Quand, dans une phase plus développée de la lutte, les organisations d'entreprise et les conseils ouvriers hésitent devant un problème d'organisation de l'économie les communistes conscients ne doivent pas seulement leur montrer la nécessité de cette organisation ; ils doivent aussi étudier eux-mêmes ces questions et convoquer des assemblées d'entreprise pour les discuter. Ainsi, leur activité se déroule dans la lutte et comme le moteur de la lutte, quand celle-ci stagne ou risque de s'égarer sur les voies de garage.
Qui ne manquera pas de relever, dans ce passage, une certaine interprétation ouvriériste de l'intervention dans les conseils ouvriers. Que les membres du parti interviennent comme "ouvriers d'industrie "semble exclure que des "communistes conscients" - d'extraction intellectuelle- puissent défendre comme membres du parti devant les ouvriers leur point de vue. A ce compte là, Marx, Lénine Engels seraient exclus. On sait qu'en 1918, Rosa Luxembourg fut privée du "droit" d'expression dans le Grand Conseil de Berlin sous le prétexte qu'elle était une "intellectuelle". Les défenseurs de la motion d'exclusion étaient les membres du SPD conscients du poids politique de Luxembourg. Ici, les Thèses semblent concevoir que les "intellectuels" membres du parti seraient "étrangers" au prolétariat, bien que le Parti soit défini comme "une partie de la classe".
D'autre part, il est caractéristique que l'intervention du Parti dans les conseils soit centrée d'emblée sur les problèmes économiques de la période de transition : gestion de la production et "organisation de l'économie par la démocratie des conseils ouvriers, dont la base est le calcul du temps de travail". En affirmant que "la nécessité de l'organisation d'une économie communiste planifiée doit être démontrée clairement", le Spartacusbond manifeste une tendance à sous-estimer les problèmes politiques qui se posent en premier dans la révolution prolétarienne, à savoir la prise du pouvoir par les conseils, comme préalable d'une période de transition vers le communisme.
c) le fonctionnement du parti
Les Thèses passent sous silence la question de la centralisation du Parti. Ne sont abordées ni la question des fractions et des tendances, ni la question de la démocratie interne. Le Bond manifeste une tendance à idéaliser l'homogénéité du Parti. Tout comme le PCint bordiguiste de l'après-guerre ([32] [53]), il ne conçoit pas que des divergences puissent surgir dans l'organisation. Mais alors que le parti"bordiguiste" trouve des "garanties" contre les divergences dans un idéal de "programme" immuable, le Spartacusbond croit les trouver dans l'existence de militants idéaux. Le militant, selon le Bond est celui qui est toujours capable d'autonomie de compréhension et de jugement :
"(Les membres du Parti) doivent être des travailleurs autonomes, ayant leur propre faculté de comprendre et de juger..."
Cette définition du militant apparaît comme un "impératif catégorique" et une éthique individuelle à l'intérieur du Parti. Il est à souligner que le Bond pense qu'une composition professionnelle entièrement prolétarienne et que la haute qualité de chaque militant mettent le Parti à l'abri des risques d'une dégénérescence bureaucratique. Cependant on ne peut manquer de relever que les partis composes totalement d'ouvriers, comme les PC dans les années 20 et 30 ne les a pas mis à l'abri de la bureaucratisation stalinienne et que l'organisation du Parti en cellules d'ouvriers d'usine a étouffé la capacité politique de "compréhension et de jugement" des militants ([33] [54]), fussent-ils les meilleurs. D'autre part, dans un parti révolutionnaire, il n'y a pas d'égalité formelle de capacités de tous ; l'égalité réelle est politique par le fait que le Parti est un corps politique avant tout dont la cohésion se reflète dans chacun de ses membres. C'est ce corps qui permet aux militants de tendre individuellement vers une homogénéité politique et théorique.
Plus profond est le rejet par le Bond d'une discipline jésuitique de cadavre - le fameux "perinde ac cadaver" de la Société de Jésus - qui brise les convictions profondes de chaque militant :
"Liés aux conceptions générales et principiel-les du Parti, qui sont en même temps leurs, propres conceptions, (les militants) doivent défendre et appliquer celles-ci dans toutes les circonstances. Ils ne connaissent pas la discipline de cadavre de la soumission sans volonté aux décisions ; ils ne connaissent que l'obéissance par conviction intime, issue d'une conception fondamentale et, dans un conflit au sein de l'organisation, c'est cette conviction qui tranche."
Ainsi est acceptée une discipline de l'organisation librement consentie, qui découle de la défense des positions principielles du Parti. C'est cette notion de discipline qui fut par la suite rejetée quelques années plus tard (cf. infra) par le Bond sous le prétexte qu'elle s'opposait à la libre activité de chacun comme "homme libre pensant par lui-même".
Une idée très importante se trouve exposée dans les Thèses. Le parti n'est pas seulement un programme, mais il est composé d'hommes aminés par la passion révolutionnaire. C'est cette passion, que le Bond appelle "conviction", qui prémunirait le Parti contre toute tendance dégénérescente :
"Cette auto activité des membres, cette éducation générale et cette participation consciente à la lutte des ouvriers rend impossible tout surgissement d'une bureaucratie de parti. Sur le plan organisationnel, on ne saurait trouver des mesures efficaces contre ce (danger) au cas où cette auto activité et cette éducation viendraient à manquer ; dans ce cas-là le parti ne pourrait plus être considéré comme un parti communiste : le parti vraiment communiste, pour lequel l'auto activité de la classe est l'idée de base, le parti dans lequel cette idée s'est incarnée, chair et os, jusque dans ses membres. Un parti avec un programme communiste peut finir par dégénérer, peut-être ; un parti composé de communistes, jamais."
Traumatisé par l'expérience russe, le Bond pensait que la volonté militante et la formation théorique constituaient suffisamment de garde-fous contre la menace de dégénérescence. Il tendait ainsi à édifier l'image d'un militant pur, non soumis individuellement à la pression de l'idéologie bourgeoise. Concevant que le parti est une somme d'individus ayant "les exigences les plus hautes", les Thèses traduisaient un certain volontarisme, voire un idéalisme naïf. La séparation entre programme, fruit d'une constante recherche théorique, et volonté militante aboutissaient à rejeter l'idée d1 un parti, comme corps et programmatique et organique. Si le parti était une somme de volontés militantes, il n'y avait plus d'organe irrigant l'ensemble des cellules militantes. Par la suite, le Bond allait pousser cette séparation à l'extrême, deux ans après (cf .infra).
d) le lien avec la classe
Issu de l'action de masse du prolétariat, le Parti ne trouve finalement d'ultime "garantie" qu'à travers ses liens avec le prolétariat :
"Quand ce lien est inexistant, quand le parti est un organe qui se situe en dehors de la classe, il n'a d'autre choix que de se placer - de façon défaitiste - en dehors de la classe, ou de soumettre les ouvriers à sa direction par la contrainte. Aussi, le Parti ne peut être véritablement révolutionnaire que s'il est ancré dans les masses de telle sorte que son activité n'est, en général, pas distincte de celle du prolétariat, si ce n'est dans le sens que la volonté, les aspirations et la compréhension conscientes de la classe ouvrière sont cristallisées dans le Parti".
Le lien avec la classe apparaît ici -dans sa définition - contradictoire. Le parti catalyse la conscience de la classe en lutte et simultanément fusionne avec le prolétariat. Le Bond ne voit de contradiction entre le Parti et la classe que dans un processus dégénérescent, où se perd le "lien". La cause réside dans la hantise que partageaient les révolutionnaires de cette époque de voir se répéter les horreurs de la contre-révolution en Russie On ne peut, cependant, s'abstenir de remarquer que l'adéquation des buts historiques du prolétariat avec ceux du Parti, n'est point une fusion. L'histoire du mouvement ouvrier, en particulier les révolutions russe et allemande, est l'histoire tourmentée des rapports entre le Parti et la classe. En période révolutionnaire, le Parti peut être en désaccord avec des actions de la classe ; ainsi les bolcheviks étaient en désaccord en juillet 1917 avec les masses ouvrières de Petrograd qui voulaient prendre prématurément le pouvoir. Il peut aussi, comme le Spartakus Bund de Luxembourg, être en accord avec la "volonté des masses" impatientes de prendre le pouvoir à Berlin et se faire décapiter. Dans les faits, la "fusion" entre Parti et masses est rarement accomplie. Le Parti se dirige plus même en période révolutionnaire et totalement dans une phase contre-révolutionnaire - à "contre courant" que "dans le courant". Etant "une partie de la classe" - comme le montrent les Thèses - il est distinct de la totalité de la classe lorsque ses principes et son activité ne sont pas totalement acceptés par la masse des ouvriers ou même rencontrent l'hostilité.
e)Parti et Etat dans la révolution Les Thèses de décembre 1945 n'abordaient pas les rapports entre Parti et Etat, lors de la prise du pouvoir. La question ([34] [55]) fut soulevée au sein du Bond et en mars 1946 parut une brochure consacrée -dans un de ses chapitres - à ce problème : "Van slavenmaatschappij tôt arbeidersmacht" (De la société esclavagiste au pouvoir ouvrier). Il en ressortait que le parti ne pouvait ni prendre le pouvoir ni"gouverner" les ouvriers. En effet, "quel que soit le parti qui forme le gouvernement, il doit gouverner contre les hommes, pour le capital et par une bureaucratie" ([35] [56]). C'est pourquoi le Parti, parti et partie des conseils ouvriers, est distinct de l'Etat :
"C'est un tout autre parti que ceux de la société bourgeoise. Il ne participe lui-même sous aucune forme au pouvoir...la prise du pouvoir prolétarienne n'est ni la conquête du gouvernement de l'Etat par un "parti ouvrier" ni la participation d'un tel parti à un gouvernement d'Etat... l'Etat en tant que tel est complètement étranger par essence au pouvoir des ouvriers ; ainsi les formes d'organisation du pouvoir ouvrier n'ont aucune des caractéristiques de l'exercice du pouvoir par l'Etat." ([36] [57])
Mais en 1946, à l'inverse de ce qui se produira plus tard, c'est Pannekoék qui est influencé par le Ccmmunistenbond ! Dans ces "Cinq thèses sur la lutte de classe" ([37] [58]) il affirme - en contradiction avec ses thèses antérieures- que le travail des partis (révolutionnaires) "est une partie indispensable de l'auto émancipation de la classe ouvrière". Il est vrai qu'il réduit la fonction de ces partis à une fonction uniquement théorique et propagandiste :"Aux partis incombe la deuxième fonction (la première étant "la conquête du pouvoir politique", NDR), c'est à dire diffuser les idées et les connaissance; d'étudier, discuter, formuler les idées sociales et, par la propagande éclairer l'esprit des masses ".
Les oppositions qui naquirent dans le Bond sur la conception du Parti - lors de la préparation du congrès de Noël 1945- apportaient plus des nuances aux Thèses qu'elles ne le critiquaient. Elles étaient en tout cas, un rejet de la théorie éducationniste de Pannekoek. Dans un projet de Thèses - accepté par 2 membres sur 5 de la Commission politique- il était souligné que "le nouveau parti n'est pas l'éducateur de la classe". Ce projet tenait surtout à préciser certains points qui restaient flous dans "Taak en Wszen van de nieuwe Parti ". En premier lieu- pour mieux marquer la rupture avec l'ancien RSAP de Sneevliet - la participation "tactique" aux élections était nettement rejetée :"Le parti naturellement ne participe à aucune activité parlementaire". En second lieu, le rédacteur du projet croyait voir dans les Thèses un retour aux conceptions activistes du KAPD, ou plutôt des tendances "dirigistes" dans la lutte de masses:
"Le parti ne mène aucune action et, comme parti, ne conduit aucune action de la classe. Il combat précisément toute subordination de la classe et de ses mouvements à la direction d'un groupe politique."
Dans cet esprit, le nouveau parti "ne reconnaît point de 'chefs1; il ne fait qu'exécuter les décisions de ses membres... Aussi longtemps qu'une décision subsiste, elle vaut pour tous les membres."
Chardin. (à suivre)
[1] [59] Des deux fils de Sneevliet, l'un s'était suicidé, l'autre était mort en Espagne dans les milices du POUM, sous la bannière de l'antifascisme, victime des positions propagées par le RSAP.
[2] [60] Le groupe de Munis, exilé au Mexique pendant la guerre, prit des positions internationalistes de non-défense de l'URSS. Les RKD, issus eux aussi du trotskisme, et composés de militants français et autrichiens travaillèrent à la fin de la guerre en collaboration avec la Fraction française de la Gauche communiste. Ils s'orientèrent peu à peu vers l'anarchisme pour disparaître en 1948-1949.
[3] [61] Les études de Max Perthus et de Wim Bot sur le MLL Front, qui s'appuient sur les archives allemandes en Hollande, ne donnent aucun fondement à cette hypothèse.
[4] [62] Winkel dans son livre : "De ondergrondse pers 1940-1945" (la Haye, 1954) affirme que l'ex-chef du KAPN et ami de Gorter, Barend Luteraan était rédacteur du CRM ; il semble que Luteraan ait créé pendant la guerre son propre groupe, sur des positions trotskystes. Après la guerre, il devint membre de la social-démocratie hollandaise (Parti du Travail).
[5] [63] Le "Groupe bolchevik-léniniste" constitué sur les positions de la IV° Internationale en 1938 disparut pendant la guerre, après l'arrestation de ses dirigeants. Le CRM se proclama parti en décembre 1945, bien que très faible numériquement, sous l'étiquette de "Parti communiste révolutionnaire" (RCP). Il publiait l'hebdomadaire " De Tribune" qui n'avait rien à voir avec le tribunisme du SPD de Gorter.
[6] [64] Après la guerre, les soupçons se portèrent sur Stan Poppe. Sneevliet avait été arrêté après une visite à Poppe. Dans le dossier du procès de Sneevliet il était affirmé que ce dernier avait été capturé "avec l'aide de Poppe". En décembre 1950 fut constituée une Commission d'enquête composée du RCP, du Ccrmunistenbond et du petit syndicat indépendant 0VB. Elle arriva unanimement à la conclusion que l'attitude de Poppe était irréprochable et qu'aucun blâme ne pouvait être porté contre lui.
[7] [65] 300.000 personnes sur une population de 6 millions d'habitants vivaient dans la clandestinité, avec de faux papiers et de fausses cartes de ravitaillement.
[8] [66] cf. "Spartacus, bulletin van de revolutionair-socialistische Arbeidersbeweging in Nederland", janvier 1944.
[9] [67] cf. Vereeken :"Le Guépéou dans le mouvement trotskyste", Paris, 1975, chapitre premier.
[10] [68] cf. "Spartacus n°4, octobre 1942 ; et dans la même revue de février 1944 l'article :"De Scwiet-Uhie en Wij" ("L'Union soviétique et nous").
[11] [69] "De perspectiven van het impérialisme na de oorlog in Europa en de taak van de revolutio-naire socialisten", décembre 1943. Il est remarquable que cette brochure, dont les thèses étaient très éloignées du communisme des conseils, soit donnée comme base politique du Bond en 1945, sans qu'aucune critique soit portée sur le contenu de ces thèses. Cf ; "Spartacus, maans-chrift voor de revolutionair-socialistische Arbeidersbeweging", mai 1945 : Beschouwingen over de situatie : de balans".
[12] [70] cf. "ETOrcéteo", n°3, octobre 19^6 : "Le prespettive del dopoguerra in relazione alla piatta-forma del Fartito" (Tes nerspectives de l'après-guerre en relation avec la plateforme du Parti). Bordiga , auteur de l'article, y affirme que "les démocraties occidentales évoluent progressivement vers les formes totalitaires et fascistes". Sous ces termes, Bordiga, comme la Gauche hollandaise, voulaient souligner la tendance vers le capitalisme d'Etat dans les pays d'Europe occidentale.
[13] [71] Le Bond publia dans sa revue théorique "Maandblad Spartacus"en 1945 (N°9 et 12) une étude sur les occupations d'usines en Italie :"Een bedrijfsbezetting" (Une occupation d'usines). L'article affirme que en 1920 "les usines formaient une unité qui n'était rattachée ni à un parti ni à un syndicat". "... le mouvement finit par un compromis entre les syndicats et les patrons". Il montre que l'occupation d'usines ne suffit pas et que doivent surgir des conseils ouvriers dont la "tâche première n'est pas l'ordonnancement de l'industrie mais l'organisation de la lutte. C'est alors une période de guerre : la guerre civile". Cette vision critique de l'occupation des usines en Italie est bien différente de la vision usiniste défendue par la suite dans le Bond par Pannekoek d'une "gestion de la production" par les conseils.
[14] [72] Pour l'historique de la fusion entre les ex-GIC et le Communistenbond, une lettre de Canne Meijer du 30 juin 1946 au journal "Le prolétaire" (RKD-CR) donne d'utiles précisions. Canne Meijer écrivit en 1944 pour la discussion un texte sur la démocratie ouvrière : "Arbeiders-democratie in de bedrijven". Bruun van Albada publia dans "Spartacus" n°1 de janvier 1945, une étude sur la méthode marxiste : Het marxisme als méthode van onderzoek", comme méthode dialectique scientifique d'investigation.
[15] [73] Ils étaient seulement des "hôtes" - note Canne Meijer dans la même lettre -, faisaient tout le travail… en commun avec les camarades du Bond, mais ils se gardaient de toute ingérence organisation
[16] [74] Cependant en 1943 et 1944, des membres du Bond participaient à la création du petit syndicat clandestin "Eenheidsvakbewweging" (Syndicat unitaire). Pour l'histoire de ce syndicat, cf. "De Eenheidsvakcentra-le (EVC) 1943-1948", Groningen, 1976 par P. Coomans, T. de Jonge et E. Nijhof.
[17] [75] Lettre du 30 juin 1946, déjà citée, Canne Meijer considère que le Bond s'inscrit dans le développement d'un "nouveau mouvement ouvrier qui n'est pas une 'opposition' à l'ancien ni sa 'gauche' ou son 'ultra-gauche', mais un mouvement avec d'autres fondements".
[18] [76] Lettre de Canne Meijer du 27 juin 1946 au journal "Le Prolétaire". En 1946 le tirage de "Spartacus" hebdomadaire était tombé à 4.000 exemplaires.
[19] [77] Décision de la conférence des 21-22 juillet 1945, où étaient présents 21 militants des "Kerne" de Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Hilversum-Bussum. Cf "Uit eigen Kring" (UEK) n°2, août 1945.
[20] [78] Décision de la conférence des 21-22 juillet 1945, où étaient présents 21 militants des "Kerne" de Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Hilversum-Bussum. Cf "Uit eigen Kring" (UEK) n°2, août 1945.
[21] [79] "Le noyau est autonome dans son propre cercle. Il décide de l'admission et de l'exclusion des membres. Le Comité exécutif central est d'abord consulté pour l'admission et l'exclusion des membres. Par ce point de statut, l'autonomie des noyaux restait limitée en théorie, d'autant plus qu était affirmée la discipline organisative : "Les noyaux (noyaux principaux) sont tenus d'observer les décisions prises par la Conférence du Bond et de diffuser les principes du Bond, tels que ceux-ci étaient et sont établis aux conférences du Bond."
[22] [80] "Uit eigen kring", n°1, avril 1945.
[23] [81] "Uit eigen kring", n°2 août 1945 : "La conférence se met d'accord de rejeter toute collaboration avec le CRM. Décision est prise de ne pas s'engager dans une discussion avec le CRM".
[24] [82] "Uit eigen kring", n°4 août 1945, Projet d'adresse inaugurale "aux travailleurs manuels et intellectuels de tous les pays "
[25] [83] La proposition d'établir un "Secrétariat d'informations" à Bruxelles venait de "Contre le courant" et de la Centrale du Communistenbond. La conférence donna son accord. Cf. "Vit eigen king"n°2, août 1945, point 8 de la résolution.
[26] [84] Les Thèses,-qui étaient l'un des trois projets de thèses, parurent dans "Uit eiqen kring" n°8 décembre 1945, puis sous forme brochure en janvier 1946. Les deux autres projets, sans être rejetés étaient soumis à la discussion.
[27] [85] Les Thèses ne furent remises en question qu'en 1951. Des projets d'amendements furent soumis à l'organisation par le groupe d'Amsterdam. Cf. "Uit eigen kring", 20 octobre 1951.
[28] [86] En 1943, Pannekoek lui-même, en dépit de son analyse de la révolution russe comme "bourgeoise" , montrait qu'Octobre 1917 a eu un effet positif sur la conscience de classe : "Puis, comme une étoile brillante dans un ciel sombre, la Révolution russe illumina toute la Terre. Partout les masses se remirent à espérer ; elles devinrent plus rétives aux ordres de leurs maîtres, car elles entendaient les appels venus de Russie : appels à mettre fin à la guerre, appels à la fraternité entre les travailleurs de tous les pays, appels à la Révolution mondiale contre le capitalisme." ("Les conseils ouvriers", p. 184, Balibaste)
[29] [87] Cf. Bordiga, in "Parti et classe", 1921 (republié dans Le fil du temps, n°8, octobre 1971) : "Un parti vit quand vivent une doctrine et une méthode d'action. Un parti c'est une école de pensée politique et, par conséquent, une organisation de lutte. Tout d'abord, il y a un fait de conscience ; ensuite un fait de volonté, soit plus exactement une tendance vers une finalité."
[30] [88] Cf "Spartacus, maandschrift vcor de revolutionaire-socialistische arbeidersbeweging",n°1 : "Het marxisme als méthode van onderzoek", article écrit par Van Albada, qui était astronome.
[31] [89] Cf. "Les conseils ouvriers", p. 493, Bélibaste.
[32] [90] Le PC internationaliste de Bordiga se concevait comme un parti "monolithique" où ne pouvait exister une "liberté de théorie". Les débats internes étaient rendus impossibles par le "centralisme organique" d'une direction concevant le marxisme comme une "conservation de la doctrine". Dans le Bond, existaient des débats internes, mais sans qu'il définisse dans ses statuts dans quel cadre ils devaient surgir.
[33] [91] Cf . Bordiga, l’Unita n°172, 26 juillet 1925 : « …les chefs d’origine ouvrière ce sont révélés au moins aussi capable que les intellectuels d’opportunisme et de trahison en général, plus susceptibles d’être absorbés par les influences bourgeoises… Nous affirmons que l’ouvrier, dans la cellule, aura tendance à ne discuter que les questions particulières intéressant les travailleurs de son entreprise » .
[34] [92] Un deuxième projet de thèses sur le parti abordait cette question. Il rejetait explicitement la conception que le parti prend et exerce le pouvoir. Cf ."Stellingen,taak en wezen van de Partij", thèse 9,in "Uit eigen kring",n°7, décembre 1945.
[35] [93] La brochure était l'un des fondements programmatiques du Bond. Elle examinait la question du voir à travers l'évolution des sociétés de classe de l'Antiquité jusqu'à la société capitaliste.
[36] [94] Les "Cinq thèses" de Pannékoek ont été republiées par "Informations et correspondance ouvrières" (ICO) dans le brochure : "La grève généralisée en France, mai-juin 1968", supplément à ICO, n°72.
[37] [95] Uit eigen kring", n°7, décembre 1945 : "Stellingen over begrip en wezen van de parti j" (Thèses sur le concept et l'essence du parti). Ces Thèses forment le troisième projet soumis à la discussion et non accepta par le Congrès du Bond.
Géographique:
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [20]