Révolution Internationale - les années 1960
- 212 lectures
A ses tous débuts, Révolution Internationale est une revue ronéotée, tirée à la main, et vendue en librairie, dans les marchés, les manifs, et devant les usines. C'est l'expression du groupe "Révolution Internationale", qui deviendra plus tard la section en France du CCI.
Nous publierons ici, de temps en temps et selon leur utilité pour des débats en cours dans le camp internationaliste, des articles publiés dans Révolution Internationale.
Structure du Site:
RI - 1960s
- 316 lectures
Structure du Site:
Révolution Internationale - 1968
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 339.27 Ko |
- 159 lectures
Révolution internationale n1 ancienne série - décembre 1968
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 515.71 Ko | |
| 71.18 Ko |
- 107 lectures
Révolution Internationale - 1969
- 138 lectures
Révolution internationale n°2 ancienne série - février 1969
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 853.7 Ko |
- 95 lectures
VIET-NAM,exemple de "Libération nationale"
- 16 lectures
De tous côtés aujourd'hui, nous entendons crier à la solidarité avec telle ou telle "lutte héroïque" de "libération nationale". Cependant, depuis la dernière guerre mondiale un nombre considérable de pays ont réalisé leur "libération nationale" sans que pour autant il se produise un changement radical, révolutionnaire dans leur structure interne ou dans leurs relations de soumission aux grandes puissances capitalistes.
Non seulement, aucun des mouvements de "libération nationale" n'a donné naissance à une révolution prolétarienne, mais encore les grandes puissances impérialistes (USA, URSS, Chine, etc.…) loin de s'affaiblir, n'ont fait que se renforcer.
La guerre du Viêt-Nam est-elle une exception ?
Nous nous proposons de démontrer qu'elle ne l'est pas et, à travers cet exemple, déterminer d'un point de vue révolutionnaire, la nature de classe des luttes délibération nationale" et ce qu'elles représentent pour le prolétariat mondial.
I LA BASE ECONOMIQUE DE LA " LIBERATION NATIONALE "
La colonisation a fait pénétrer le mode de production capitaliste dans les pays se trouvant à un stade inférieur de développement. "Elle (la bourgeoisie( contraint toutes les nations (...) d'adopter le mode de production bourgeois; elle les contraint d'importer chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit, elle en fait des nations de bourgeois. En un mot elle crée un monde à son image" (Marx-Engels. "Manifeste Communiste").
La puissance dominante lance sur le nouveau marché ses produits manufacturés, et bouleverse ainsi les rapports pré-capitalistes (économie naturelle primitive) pour en substituer de nouveaux: les rapports de production capitaliste qui font surgir une bourgeoisie et une classe ouvrière locale.
La première naît comme intermédiaire du capital étranger sur le plan local sous la forme d'une bourgeoisie commerciale dont l'existence dépend de la présence et du maintien du capital étranger.
Le développement des forces productives du pays s'accompagne par la suite, de la disparition progressive d'une partie des couches pré-capitalistes et de la montée d'une bourgeoisie industrielle détentrice d'une partie du capital national.
Cette couche aura rapidement des intérêts antagonistes à ceux du capital étranger. En effet:
- La bourgeoisie nationale ne ramasse que les miettes que l'exploiteur étranger laisse derrière lui.
- L'intérêt de la bourgeoisie nationale est de développer au maximum toutes les forces de production du pays, tandis que la puissance dominante ne s'intéresse qu'aux secteurs qui lui sont directement rentables (et dans une relation subordonnée aux besoins de l'industrie de la métropole), au détriment des autres (maintien de régimes de monoculture ou d'industrie extractive, etc...).
- La bourgeoisie locale pense pouvoir subsister sans la puissance en question, et qu'il est plus profitable pour elle de choisir ses partenaires commerciaux librement.
Ainsi, l'existence d'un capital national implique nécessairement celle d'un intérêt capitaliste national et c'est là la base des luttes de "libération nationale".
Les représentants de ces intérêts ont changé à travers l'histoire, se présentant tantôt sous une forme, tantôt sous une autre; les mots d'ordre de la bataille eux aussi ont changé. Cependant, la nature du combat reste la même: une NATURE BOURGEOISE.
II LES REPRESENTANTS DES INTERETS CAPITALISTES NATIONAUX BOURGEOISIE, BUREAUCRATIE
Jusqu'au début du XX° Siècle, c'est fondamentalement la bourgeoisie privée nationale détentrice d'une partie du capital local, qui a représenté les intérêts de celui-ci. C'est elle qui a entrepris les tâches de sa défense face aux puissances étrangères; c'est elle qui a réalisé les tâches d'aménagement capitaliste dans ces pays (USA, Amérique Latine, etc..). A mesure que le capitalisme à l'échelle mondiale est entré dans sa phase impérialiste de décadence, à mesure que le développement du capital devait faire face à des contradictions et des concurrences inter-capitalistes chaque fois plus grandes à cause de la saturation mondiale des marchés, ces bourgeoisies se sont avérées de plus en plus impuissantes à faire face aux puissances étrangères et à développer le capital national.
Aussi, Trotsky pouvait-il formuler sa théorie de la Révolution Permanente selon laquelle, la bourgeoisie des pays sous-développés n'étant plus capable dans le "capitalisme pourrissant" de réaliser les tâches de la révolution bourgeoise, ce serait le prolétariat qui en prendrait la charge. Il y voyait même la base d'un processus révolutionnaire -analogue à celui qui donna naissance à la Révolution Russe de 1917- qui ferait aboutir ces révolutions, originairement bourgeoises, à des révolutions prolétariennes.
La théorie de Trotsky fut démentie par les faits. Les bourgeoisies de ces pays arriérés se sont avérées incapables de réaliser leur tâche, mais ce n'est pas le prolétariat qui s'en est chargé, sinon les couches de la petite bourgeoisie intellectuelle, fonctionnaires et technocrates.
Ces couches, privilégiées et éduquées, comprenant parfaitement les intérêts du capital national quoique ne le détenant pas, sont devenues les porteuses de l'idée du capitalisme d'État, seule forme d'organisation du capital qui permette de tenter de faire face aux capitaux étrangers et de contenir ou éliminer tout mouvement qui s'opposerait à ces besoins.
En effet, le capitalisme d'État -passage de tous les moyens de production aux mains de l'appareil étatique- permet:
- de concentrer toutes les ressources économiques du pays et de renforcer ainsi dans la mesure du possible le potentiel de production, - de soumettre la principale ressource -la force de travail- à un contrôle total par l'encadrement d'un parti unique et de ses syndicats, organes de l'État (interdiction du droit de grève, interdiction de toute organisation opposée au parti au pouvoir, dictature idéologique, baisse forcée des salaires et imposition de normes de travail nécessaires aux besoins du capital national, etc...),
- de réaliser manu militari l'accumulation primitive du capital en éliminant par la force tous les secteurs de production pré-capitalistes (nationalisations des terres, élimination des petites exploitations et de l'artisanat).
Toutes ces conditions sont nécessaires pour le renforcement du capital national.
Pourquoi est-ce cette couche de la petite bourgeoisie qui devient la championne du capitalisme d'État ? D'une part, elle n'a aucun intérêt au maintien du statu quo, n'ayant aucun avenir du fait de la stagnation économique du pays. D'autre part, indispensable à la marche du pays, elle est parfaitement consciente du retard de son pays comme du degré de pourriture et corruption des dirigeants qu'elle sert; dirigeants, qui, trop liés au capital étranger, ne peuvent que négliger les intérêts de l'économie nationale.
Ces couches, condamnées à rester les serviteurs des cliques corrompues au pouvoir, voient dans le CAPITALISME D'ÉTAT le moyen de déplacer celles- ci pour se mettre à leur place. En effet, technocrates et bureaucrates par définition trouvent leur intérêt, comme couche sociale, dans l'établissement d'un système dans lequel le pouvoir politique ET économique est aux mains de l'État, c'est-à-dire d'eux-mêmes. C'est pourquoi leur lutte est toujours celle pour les nationalisations, le renforcement absolu de l'appareil étatique, et la prise du pouvoir par un parti unique, le leur, "celui qui a fait la révolution".
Les intérêts du capital national sont ainsi représentés par deux couches capitalistes, correspondant à des périodes historiques différentes:
- une fraction de la bourgeoisie privée nationale,
- la bureaucratie, une partie de la petite bourgeoisie intellectuelle, technocrate, fonctionnaire.
Ainsi, dans la Guerre du Viêt-Nam, on trouve au sein du Front National de Libération ces deux fractions alliées en lutte contre l'emprise des USA.
LE F.N.L.
Il persiste encore à l'heure actuelle des fractions de la bourgeoisie privée qui tentent d'échapper à l'emprise du capital étranger. Ainsi, on trouve au sein du FNL vietnamien une fraction luttant contre les USA sans désirer pour autant l'instauration d'un régime de capitalisme d'État, style Viêt-Nam du Nord (RDVN) qui l'exproprierait. Tran Bau Kiem, chef de la délégation du FNL aux conversations de Paris, déclarait récemment dans une interview donnée au Nouvel Observateur: "Je suis d'abord secrétaire général du Parti Démocrate dont les membres appartiennent surtout aux milieux aisés. Il comprend beaucoup de commerçants, d'intellectuels, d'industriels. Dire que vouloir libérer son pays de l'emprise colonialiste ou néo-colonialiste c'est être marxiste, c'est un abus de langage".
La présence de cette fraction ayant des intérêts privés explique le caractère bourgeois traditionnel du Programme du Front, réclamant entre autres la protection du droit de propriété privée.
Cependant, ces fractions de la bourgeoisie privée restent assez réduites et leur champ de manœuvres est étroit; à l'intérieur du pays, elles s'opposent aux "valets de l'impérialisme américain", c'est-à-dire au gouvernement en place Son seul allié reste donc le régime du Nord sous l'emprise duquel elle ne veut pas non plus tomber; c'est pourquoi cette couche est aujourd'hui de plus en plus amenée à composer avec les USA. Sa subsistance en tant que couche sociale sera déterminée non pas par les combats livrés sur le champ de bataille, mais par le règlement international du conflit qui réglera le futur statu quo du Sud-Viet-Nam.
La lutte de cette bourgeoisie est aujourd'hui désespérée dans la mesure où il n'y a aucune possibilité réelle qu'elle se libère des USA sans tomber sous les coups d'un régime bureaucratique capitaliste d'État (dit "communiste") qui l'éliminera.
LA BUREAUCRATIE
Cette couche dont l'existence comme classe n'est pas liée à la propriété privée du capital mais à la fonction qu'elle va exercer est la couche la plus dynamique. Mais seule elle ne représente aucun poids dans le jeu des forces en présence. Ainsi, elle cherchera sur le plan national aussi bien que sur le plan international tout appui susceptible de l'aider dans la réalisation de ses aspirations.
Sur le plan national:
- Tout d'abord, la bureaucratie cherchera un soutien dans la population. La mobilisation de la population contre l'impérialisme étranger est facilement réalisable car dans ces pays, l'ingérence du capital étranger apparaît comme la cause de tous les maux. Mettant de côté la lutte de classe, la mobilisation se fera sur un critère de nationalité et ainsi prolétaires et bourgeois sont appelés au combat sans distinction. Dans cette optique, sont créés de larges fronts nationaux; ainsi, le Comité Central du Parti Communiste indochinois crée en Mai 1941 le Viet-Minh ayant pour but de : "réunir TOUS LES PATRIOTES sans distinction de fortune, d'âge, de sexe, de religion ou d'opinion politique pour travailler ensemble à la libération de notre peuple, et au SALUT DE NOTRE NATION" ("Les Grandes Dates de la Classe Ouvrière"(sic)publié par Hanoï. Cité dans Ho Chi Minh de Lacouture).
- La bureaucratie s'alliera avec tous les partis susceptibles de l'aider à un moment donné, quitte à les éliminer par la suite. C'est ainsi que le Parti Communiste Indochinois a présenté des candidats en commun avec le Parti Trotskyste en 1933 et même jusqu'en 1937 aux élections du Conseil colonial pour que seulement deux ans plus tard, dans un rapport d'Ho Chi Minh, la ligne d'action soit: "vis à vis des trotskystes; point d'alliance, point de concessions. Il faut à tout prix démasquer leur rôle d'hommes de main des fascistes". "En Août 1945, Ta Tu Thau, un des dirigeants du Parti Trotskyste, lance le mot d'ordre pour l'établissement de Conseils Ouvriers et paysans à la place du règne Viet-Minh.
Il est arrêté, "jugé" devant les Comités du "peuple" et déclaré trois fois innocent. Il semblait peu utile de préparer un quatrième jugement et ainsi, il fut fusillé quelques jours après son troisième acquittement" (Raconté par Solidarity. Brochure "The rape of Viêt-Nam par Bob Potter)[1].
- Un autre exemple des alliances de la bureaucratie est donné lorsqu'au Printemps 1943, Ho Chi Minh se trouve à la tête du Dong Minh Hoi, organisation regroupant les différents partis nationalistes vietnamiens et financée à raison de 100000 $ c. par mois par la Chine de Chiang Kai Chek; un an plus tard, en Mars 1944, Ho Chi Minh obtiendra un portefeuille ministériel dans un "gouvernement provisoire" regroupant ces différents partis nationalistes et ayant pour programme l'indépendance du Viêt-Nam avec l'aide du Kuomintang. Cette alliance éphémère sera rejetée dès l'instant où la bureaucratie se sent assez forte pour créer son propre gouvernement, ce qui est fait en Août 1945 par la création du "Comité Viêt-Nam de Libération du Peuple" (sur 14 membres, 11 appartiennent ou au Viet-Minh).
Ainsi, de proche en proche, la bureaucratie éliminera ses ennemis (après en avoir tiré le maximum) pour rester seule au pouvoir.
Quelle est la nature de ce pouvoir ? De toutes parts, on nous parle de la "révolution" vietnamienne, du "combat héroïque" contre l'impérialisme américain; partout, on s'enivre d'une phraséologie révolutionnaire et on semble oublier les faits concrets: où va mener le combat ? quelle est la nature du régime du Nord Viêt-Nam ? quel est l'acquis de ce prolétariat au nom duquel la bureaucratie mène sa lutte ?
LA R.D.V.N.
La proclamation en Septembre 1945 de la République Démocratique du Viêt-Nam consacre la réalisation de l'indépendance vietnamienne vis-à-vis du colonialisme français et l'aboutissement de la "révolution" vietnamienne. Cependant, le pouvoir qui est établi n'a de révolutionnaire ou prolétarien que le nom.
L'État n'y a pas été brisé: maintien de la structure étatique bourgeoise, avec un Président de la République, un Président du Conseil, un Conseil des Ministres, 16 Ministères, etc... (Cf. Constitution Nord-Vietnamienne de 1960. Ce ne sont que les dirigeants qui ont changé: à la place de l'ancien empereur Bao Dai et de l'administration française, c'est une bureaucratie qui s'installe.
A la place de la bourgeoisie privée ou des entreprises étrangères qui étaient les exploiteurs d'autrefois, nous avons aujourd'hui la machine d'État qui "dirige les activités économiques d'après un plan unifié. L'État s'appuie sur les organismes gouvernementaux, sur les organisations syndicales, sur les coopératives et sur toutes les autres organisations de travailleurs pour édifier et réaliser le plan économique". (Constitution de la RDVN de 1960. Chap II. Art. 10).
[1] Solidarity c/o H. Russel. 53 A Westmoreland Road. Bromley. Kent. GB.
Géographique:
- Vietnam [6]
Personnages:
- Trotsky [7]
- Tran_Bau_Kiem [8]
- Lacouture [9]
- Ho Chi Minh [10]
- Ta Tu Thau [11]
- Bob Potter [12]
- Chiang Kai Chek [13]
- Bao Dai [14]
Questions théoriques:
- Impérialisme [15]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Comprendre Mai
- 43 lectures
Les événements de Mai 1968 ont eu comme conséquence de susciter une activité littéraire exceptionnellement abondante. Livres, brochures, recueils de toutes sortes se sont succédés à une cadence accélérée et à des tirages forts élevés. Les maisons d’éditions -toujours à l’affût de "gadgets" à la mode- se sont bousculées pour exploiter à fond l’immense intérêt soulevé dans les masses par tout ce qui touche à ces événements. Pour cela, ils ont trouvé, sans difficultés, journalistes, publicistes, professeurs, intellectuels, artistes, hommes de lettres, photographes de toutes sortes, qui, comme chacun sait, abondent dans ce pays et qui sont toujours à la recherche d’un bon sujet bien commercial.
On ne peut pas ne pas avoir un haut-le-cœur devant cette récupération effrénée.
Cependant dans la masse des combattants de Mai, l’intérêt éveillé au cours de la lutte même, loin de cesser avec les combats de rue, n’a fait que s’amplifier et s’approfondir. La recherche, la discussion, la confrontation se poursuivent. Pour n’avoir pas été des spectateurs ni des contestataires d’occasion, pour s’être trouvées brusquement engagées dans des combats d’une portée historique, ces masses, revenues de leur propre surprise, ne peuvent pas ne pas s’interroger sur les racines profondes de cette explosion sociale qui était leur propre ouvrage sur sa signification, sur les perspectives que cette explosion a ouverte dans un futur à la fois immédiat et lointain. Les masses essaient de comprendre, de prendre conscience de leur propre action.
De ce fait, nous croyons pouvoir dire que c’est rarement dans les livres publiés à profusion que nous pouvons trouver le reflet de cette inquiétude et des interrogations de la part des gens. Elles apparaissent plutôt dans de petites publications, les revues souvent éphémères, les papiers ronéotés de toutes sortes de groupes, de comités d’action de quartier et d’usines qui ont survécu depuis Mai, dans leurs réunions, au travers de discussions souvent et inévitablement confuses. Au travers et en dépit de cette confusion, se poursuit néanmoins un travail sérieux de clarification des problèmes soulevés par Mai.
Après plusieurs mois d’éclipse, et de silence, probablement consacrés à l’élaboration de ses travaux, vient d’intervenir dans ce débat le groupe de l’"Internationale Situationniste", en publiant un livre chez Gallimard : Enragés et Situationnistes dans le mouvement des occupations.
On était en droit d’attendre de la part d’un groupe qui a effectivement pris une part active dans les combats, une contribution approfondie à l’analyse de la signification de Mai, et cela d’autant plus que le temps de recul de plusieurs mois offrait des possibilités meilleures. On était en droit d’émettre des exigences et on doit constater que le livre ne répond pas à ses promesses. Mis à part le vocabulaire qui leur est propre : "spectacle-société de consommation critique de la vie quotidienne, etc.", on peut déplorer que pour leur livre, les situationnistes aient allègrement cédé au goût du jour, se complaisant à le farcir de photos, d’images et de bandes de comics.
On peut penser ce que l’on veut des comics comme moyen pour la propagande et l’agitation révolutionnaire. On sait que les situationnistes sont particulièrement friands de cette forme d’expression que sont les comics et les bulles. Ils prétendent même avoir découvert dans le "détournement", l’arme moderne (?) de la propagande subversive, et voient en cela le signe distinctif de leur supériorité par rapport aux autres groupes qui en sont restés aux méthodes "surannées" de la presse révolutionnaire "traditionnelle", aux articles "fastidieux" et aux tracts ronéotés.
Il y a assurément du vrai dans la constatation que les articles de la presse des groupuscules sont souvent rébarbatifs, longs et ennuyeux. Cependant, cette constatation ne saurait devenir un argument pour une activité de divertissement. Le capitalisme se charge amplement de cette besogne qui consiste sans cesse à découvrir toutes sortes d’activités culturelles (sic) pour les jeunes, les loisirs organisés et surtout les sports. Ce n’est pas seulement une question de contenu mais aussi de méthode appropriée qui correspond à un but bien précis : le détournement de la réflexion.
La classe ouvrière n’a pas besoin d’être divertie. Elle a surtout besoin de comprendre et de penser. Les comics, les mots d’esprit et les jeux de mots leur sont d’un piètre usage. On adopte d’une part pour soi un langage philosophique, une terminologie particulièrement recherchée, obscure et ésotérique, réservée aux "penseurs intellectuels", d’autre part, pour la grande masse infantile des ouvriers, quelques images accompagnées de phrases simples, cela suffit amplement.
Il faut se garder, quand on dénonce partout le spectacle, de ne pas tomber soi-même dans le spectaculaire. Malheureusement, c’est un peu par-là que pêche le livre sur Mai en question. Un autre trait caractéristique du livre est son aspect descriptif des événements au jour le jour, alors qu’une analyse les situant dans un contexte historique et dégageant leur profonde signification eût été nécessaire. Remarquons encore que c’est surtout l’action des enragés et des situationnistes qui est décrites plutôt que les événements eux-mêmes - comme d’ailleurs l’annonce le titre. En rehaussant bon mesure le rôle joué par telle personnalité des enragés, en faisant un véritable panégyrique de soi, on a l’impression que ce n’est pas eux qui étaient dans le mouvement des occupations, mais que c’est le mouvement de Mai qui était là pour mettre en relief la haute valeur révolutionnaire des enragés et des situationnistes. Une personne n’ayant pas vécu, ignorant tout de Mai et se documentant au travers de ce livre, se ferait une curieuse idée de ce que ce fut. A les en croire, les situationnistes auraient occupés une place prépondérante, et cela dès le début, dans les événements, ce qui révèle une bonne dose d’imagination et est vraiment "prendre ses désirs pour la réalité". Ramenée à ses justes proportions, la place occupée par les situationnistes a été sûrement inférieure .à celle de nombreux autres groupuscules, et en tout cas pas supérieure. Au lieu de soumettre à la critique le comportement, les idées, les positions des autres groupes - ce qui aurait été intéressant, mais qu’ils ne font pas - minimiser[1] ou encore passer sous silence l’activité et le rôle des autres est un procédé douteux pour faire ressortir sa propre grandeur, et ne mène pas à grand-chose.
* * * * *
Le livre (ou ce qu’il en reste, déduction faite des bandes dessinées, photos, chansons, inscriptions murales et autres reproductions) débute par une constatation généralement juste. Mai avait surpris un peu tout le monde et en particulier les groupes révolutionnaires ou prétendus tels. Tous les groupes et courants, sauf évidemment les situationnistes qui, eux, "savaient et montraient la possibilité et l’imminence d’un nouveau départ de la révolution". Pour le groupe de situationnistes, grâce à "la critique révolutionnaire qui ramène au mouvement pratique sa propre théorie, déduite de lui et portée à la cohérence qu’il poursuit, certainement rien n’était plus prévisible, rien n’était plus prévu, que la nouvelle époque de la lutte de classe …"
On sait depuis longtemps qu’il n’existe aucun code contre la présomption et la prétention, manie fort répandue dans le mouvement révolutionnaire -surtout depuis le "triomphe" du léninisme- et dont le bordiguisme est une manifestation exemplaire ; aussi ne disputerons-nous pas cette prétention aux situationnistes et nous contenterons-nous simplement d’en prendre acte en haussant les épaules pour seulement chercher à savoir : où et quand, et sur la base de quelles données, les situationnistes ont-ils prévus les événements de Mai ? Quand ils affirment qu’ils avaient "depuis des années très exactement prévu l’explosion actuelle et ses suites", ils confondent visiblement une affirmation générale avec une analyse précise du moment. Depuis plus de cent cinquante ans, depuis qu’existe un mouvement révolutionnaire du prolétariat, existe la "prévision" qu’un jour inévitablement surviendra l’explosion révolutionnaire. Pour un groupe qui prétend non seulement avoir une théorie cohérente, mais encore "ramener sa critique révolutionnaire au mouvement pratique", une prévision de ce genre est largement insuffisante. Pour ne pas rester une simple phrase rhétorique, "ramener sa critique au mouvement pratique" doit signifier l’analyse de la situation concrète, de ses limites et de ses possibilités réelles. Cette analyse, les situationnistes ne l’ont pas faite avant et, si nous jugeons d’après leur livre, ne la font pas encore maintenant ; car quand ils parlent d’une nouvelle période de reprise des luttes révolutionnaires, leur démonstration se réfère toujours à des généralités abstraites. Et même quand ils se réfèrent aux luttes de ces dernières années, ils ne font rien d’autre que de constater un fait empirique. Par elle seule, cette constatation ne va pas au-delà du témoignage de la continuité de la lutte des classes et n’indique pas le sens de son évolution, ni de· la possibilité de déboucher et d’inaugurer une période historique de luttes révolutionnaires surtout à l’échelle internationale, comme peut et doit l’être une révolution socialiste. Même une explosion d’une signification révolutionnaire aussi formidable que la Commune de Paris ne signifiait pas l’ouverture d’une ère révolutionnaire dans l’histoire, puisqu’au contraire elle sera suivie d’une longue période de stabilisation et d’épanouissement du capitalisme, entraînant comme conséquence, le mouvement ouvrier vers le réformisme.
A moins de considérer comme les anarchistes, que tout est toujours possible et qu’il suffit de vouloir pour pouvoir, nous sommes appelés à comprendre que le mouvement ouvrier ne suit pas une courbe continuellement ascendante mais est fait de périodes de montées et de périodes de reculs, et est déterminé objectivement et en premier lieu par l’état de développement du capitalisme et des contradictions inhérentes à ce système.
L’IS définit l’actualité comme "le retour présent de la révolution". Sur quoi fonde-t-elle cette définition ? Voici son explication :
- 1/ "La théorie critique élaborée et répandue par l’l.S. constatait aisément (...) que le prolétariat n’était pas aboli" (curieux vraiment que l’I.S. constate "aisément" ce que tous les ouvriers et tous les révolutionnaires savaient sans recours nécessaire à l’I.S.)
- 2/ " ... que le capitalisme continuait à développer ses aliénations" (qui s’en serait douté ?).
- 3/ " ... que partout où existe cet antagonisme (comme si cet antagonisme ne pouvait dans le capitalisme ne pas exister partout) la question sociale posée depuis plus d’un siècle demeure" ( en voilà une découverte !)
- 4/ "... que cet antagonisme existe sur toute la surface de la planète" (encore une découverte !)
- 5/ "L’I.S. explique l’approfondissement et la concentration des aliénations par le retard de la révolution" (évidence ...).
- 6/ "Ce retard découle manifestement de la défaite internationale de prolétariat depuis la contre-révolution russe" (voilà encore une vérité proclamée par les révolutionnaires depuis 40 ans au moins).
- 7 / En outre "l’I.S. savait bien ( ... ) que l’émancipation des travailleurs se heurtait partout et toujours aux organisations bureaucratiques".
- 8/ Les situationnistes constatent que la falsification permanente nécessaire à la survie de ces appareils bureaucratiques, était une pièce maîtresse de la falsification généralisée dans la société moderne.
- 9 / Enfin "ils avaient aussi reconnu et s’étaient employés à rejoindre les nouvelles formes (?) de subversion dont les premiers signes s’accumulaient".
- 10/ Et voilà pourquoi "ainsi les situationnistes savaient et montraient la possibilité et l’imminence d’un nouveau départ de la révolution".
Nous avons reproduit ces longs extraits afin de montrer le plus exactement possible ce que les situationnistes, d’après leur propre dire, "savaient".
Comme on peut le voir, ce savoir se réduit à des généralités que connaissent depuis longtemps des milliers et des milliers de révolutionnaires, et ces généralités si elles suffisent pour l’affirmation du projet révolutionnaire, ne contiennent rien qui puisse être considéré comme une démonstration de "l’imminence d’un nouveau départ de la révolution". La "théorie élaborée" des situationnistes se réduit donc à une simple profession de foi et rien de plus. C’est que la Révolution Socialiste et son imminence ne sauraient se déduire de quelques "découvertes" verbales comme la société de consommation, le spectacle, la vie quotidienne, qui désignent avec de nouveaux mots les notions connues de la société capitaliste d’exploitation des masses travailleuses, avec tout ce que cela comporte, dans tous les domaines de la vie sociale, de déformations et d’aliénations humaines.
En admettant que nous nous trouvions devant un nouveau départ de la révolution, comment expliquer d’après l’I.S. qu’il ait fallu attendre JUSTE LE TEMPS qui nous sépare de la victoire de la contre-révolution russe, disons : 50 ans. Pourquoi pas 30 ou 70 ? De deux choses l’une : où la reprise du cours révolutionnaire est déterminée fondamentalement par les conditions objectives, et alors il faut les expliciter -ce que l’I.S. ne fait pas- ou bien cette reprise est uniquement le fait d’une volonté subjective s’accumulant et s’affirmant un beau jour et elle ne pourrait alors être que constatable mais non prévisible puis qu’aucun critère ne saurait d’avance fixer son degré de maturation.
Dans ces conditions, la prévision dont se targue l’I.S. tiendrait davantage d’un don de devin que d’un savoir. Quand Trotsky écrivait en 1936 "La révolution a commencé en France", il se trompait assurément, néanmoins son affirmation reposait sur une analyse autrement sérieuse que celle de l’I.S. puisqu’elle se référait à des données telles que la crise économique qui secouait le monde entier. Par contre la "prévision" juste de l’I.S. s’apparenterait plutôt aux affirmations de Molotov inaugurant la fameuse troisième période de l’I.C. (Internationale Communiste) au début de 1929, annonçant la grande nouvelle que le monde était entré avec les deux pieds dans la période révolutionnaire. La parenté entre les deux consiste dans la gratuité de leurs affirmations respectives, dont l’étude est effectivement indispensable comme point de départ de toute analyse sur une période donnée, suffisent à déterminer le caractère révolutionnaire ou non des luttes de cette période : et c’est ainsi que, s’appuyant sur la crise économique mondiale de 1929, il croit pouvoir annoncer l’imminence de la révolution. L’I.S par contre croit suffisant d’ignorer et de vouloir ignorer tout ce qui se rapporte à l’idée même d’une condition objective et nécessaire, d’où son aversion profonde pour ce qui concerne les analyses économiques de la société capitaliste moderne.
Toute l’attention se trouve ainsi dirigée vers les manifestations les plus apparentes des aliénations sociales, et on néglige de voir les sources qui leur donnent naissances et les nourrissent. Nous devons réaffirmer qu’une telle critique qui porte essentiellement sur les manifestations superficielles, aussi radicale soit-elle, restera forcément circonscrite, limitée, tant en théorie qu’en pratique.
* * * * *
Le capitalisme produit nécessairement les aliénations qui lui sont propres dans son existence et pour sa survie, et ce n’est pas dans leur manifestation que se rencontre le moteur de son dépérissement. Tant que le capitalisme dans ses racines, c’est à dire comme système économique, reste viable, aucune volonté ne saurait le détruire.
"JAMAIS UNE SOCIETE N’EXPIRE AVANT QUE SOIENT DEVELOPPES TOUTES LES FORCES PRODUCTIVES QU’ELLE EST ASSEZ LARGE POUR CONTENIR" (Marx Avant-propos à la Critique de l’Économie Politique).
C’est donc dans ces racines que la critique théorique radicale doit déceler les possibilités de son dépassement révolutionnaire.
"A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapport de production... Alors commence une ère de révolution sociale." (Marx, Idem).
Cette collision dont parle Marx, se manifeste par des bouleversements économiques, comme les crises, les guerres impérialistes et les convulsions sociales. Tous les penseurs marxistes ont insisté sur le fait que pour qu’on puisse parler d’une période révolutionnaire, "il ne suffit pas que les ouvriers ne veuillent plus, il faut encore que les capitalistes ne puissent plus continuer comme auparavant". Et voilà l’I.S. qui se prétend être quasiment l’unique expression théorique organisée de la pratique révolutionnaire d’aujourd’hui, qui bataille exactement dans le sens contraire. Les rares fois où, surmontant son aversion, elle aborde dans le livre les sujets économiques, c’est pour démontrer que le nouveau départ de la révolution s’opère non seulement indépendamment des fondations économiques de la société mais encore dans un capitalisme économiquement florissant. "On ne pouvait observer aucune tendance à la crise économique (p.5) ...L’éruption révolutionnaire n’est pas venue d’une crise économique ... ce qui a été attaque de front en Mai, c’est l’économie capitaliste FONCTIONNANT BIEN" (souligné dans le texte p.209).
Ce qu’on s’acharne à démontrer évidemment ici, est que la aise révolutionnaire et la situation économique de la société sont deux choses complètement séparées, pouvant évoluer et évoluant de fait chacune dans un sens qui lui est propre, sans relation entre elles. On croit pouvoir appuyer cette "grande découverte" théorique dans les faits, et on s’écrie triomphalement : "ON NE POUVAIT OBSERVER AUCUNE TENDANCE A LA "CRISE" ECONOMIQUE" !
Aucune tendance ? Vraiment ?
Fin 1967, la situation économique en France commence à jouer des signes de détérioration. Le chômage menaçant commence à préoccuper chaque jour davantage. Au début de 1968, le nombre de chômeurs complets dépasse les 500 000. Ce n’est plus un phénomène local, il a atteint toutes les régions. A Paris, le nombre des chômeurs croît lentement mais constamment. La presse se remplit d’article traitant gravement de la hantise du dés-emploi dans divers milieux. Le chômage partiel s’installe dans beaucoup d’usines et provoque des réactions parmi les ouvriers. Plusieurs grèves sporadiques ont la question du maintien de l’emploi et du plein emploi pour cause directe. Ce sont surtout les jeunes qui sont touchés en premier lieu et qui ne parviennent pas à t’intégrer dans la production. La récession dans l’emploi tombe d’autant plus mal que se présente sur le marché du travail cette génération de l’explosion démographique qui a suivi immédiatement la fin de la IIème Guerre Mondiale. Un sentiment d’insécurité du lendemain se développe parmi les ouvriers et surtout parmi les jeunes. Ce sentiment est d’autant plus vif qu’il était pratiquement inconnu des ouvriers en France depuis la guerre.
Concurremment, avec le dés-emploi et sous sa pression directe, les salaires tendent à baisser et le niveau de vie des masses se détériore. Le gouvernement et le patronat profitent naturellement de cette situation pour attaquer et aggraver les conditions de vie et de travail des ouvriers (voir par exemple les décrets sur la Sécurité Sociale).
De plus en plus, les masses sentent que c’en est fini de la belle prospérité. L’indifférence et le je-m’en-foutisme, si caractéristiques et tant décriés des ouvriers, au long des derniers 10-15 ans, cèdent la place à une inquiétude sourde et grandissante.
Il est assurément moins aisé d’observer cette lente montée de l’inquiétude et du mécontentement chez les ouvriers, que des actions spectaculaires dans une faculté. Cependant, on ne peut continuer à l’ignorer après l’explosion de Mai, à moins de croire que 10 millions d’ouvriers aient été touchés un beau jour par l’Esprit-Saint de l’Anti-spectacle. Il faut bien admettre qu’une telle explosion massive repose sur une longue accumulation d’un mécontentement réel de leur situation économique et de travail, directement sensible dans les masses, même si un observateur superficiel n’en a rien aperçu. On ne doit pas non plus, attribuer exclusivement à la politique canaille des syndicats et autres staliniens le fait des revendications économiques.
Il est évident que les syndicats, le P.C., venant à la rescousse du gouvernement, ont joué à fond la carte revendicative comme un barrage contre un possible débordement révolutionnaire de la grève sur un plan social global. Mais ce n’est pas le rôle des organismes de l’État capitaliste que nous discutons ici. C’est là leur rôle et on ne saurait leur reprocher de le jouer à fond. Mais le fait qu’ils ont facilement réussi à contrôler la grande masse des ouvriers en grève sur un terrain uniquement revendicatif, prouve que les masses sont entrées dans la lutte essentiellement dominées et préoccupées par une situation chaque jour plus menaçante pour eux. Si la tâche des révolutionnaires est de déceler les possibilités radicales contenues dans la lutte même des masses et de participer activement à leur éclosion, il est avant tout nécessaire de ne pas ignorer les préoccupations immédiates qui font entrer les masses dans la lutte.
Malgré les fanfaronnades des milieux officiels, la situation économique préoccupe de plus en plus le monde des affaires, comme le témoigne la presse économique du début de l’année. Ce qui inquiète n’est pas tant la situation en France, qui occupe alors une place privilégiée, mais le fait que cette situation d’alourdissement s’inscrit dans un contexte d’essoufflement économique à l’échelle mondiale, qui ne manquerait pas d’avoir des répercussions en France. Dans tous les pays industriels, en Europe et aux USA, le chômage se développe et les perspectives économiques s’assombrissent. L’Angleterre, malgré une multiplication des mesures pour sauvegarder l’équilibre, est finalement réduite fin 1967 à une dévaluation de la £, entraînant derrière elle la dévaluation dans toutes une série de pays. Le gouvernement Wilson proclame un programme d’austérité exceptionnel : réduction massive des dépenses publiques, y compris l’armement -retrait des troupes britanniques de l’Asie, blocage des salaires, réduction de la consommation interne et des importations- effort pour augmenter les exportations. Le 1er janvier 1968, c’est au tour de Johnson de pousser un cri d’alarme et d’annoncer des mesures sévères indispensables pour sauvegarder l’équilibre économique. En mars, éclate la crise financière du dollar. La presse économique chaque jour plus pessimiste, évoque de plus en plus le spectre de la crise de 1929, et beaucoup craignent des conséquences encore plus graves. Le taux de crédit monte dans tous les pays, partout la bourse des valeurs accuse des bouleversements, et dans tous les pays, un seul cri : réduction des dépenses et de la consommation, augmentation des exportations à tout prix et réduction au strict nécessaire des importations. Parallèlement, la même détérioration se manifeste à l’Est dans le bloc russe, ce qui explique la tendance des pays comme la Tchécoslovaquie et la Roumanie à se détacher de l’emprise soviétique et à chercher des marchés à l’extérieur.
Tel est le fond de la situation économique d’avant Mai.
Bien sûr, ce n’est pas la crise économique ouverte, d’abord parce que ce n’est que te début, et ensuite parce que dans le capitalisme actuel, l’État dispose de tout un arsenal de moyens lui permettant d’intervenir afin de pallier et partiellement, d’atténuer momentanément les manifestations les plus frappantes de la crise. Il est nécessaire toutefois de mettre en évidence les points suivants :
- a/ Dans les 20 années qui ont suivi la IIème Guerre, l’économie capitaliste a vécu sur la base de la reconstruction des ruines résultant de la guerre, d’une spoliation éhontée des pays sous-développés, qui au travers de la fumisterie de guerres de libération et d’aides à leur reconstruction en États indépendants, ont été exploités au point d’être réduits à la misère et à la famine d’une production croissante d’armements : l’économie de guerre.
- b/ Ces trois sources de la prospérité et du plein-emploi de ces 20 dernières années, tendent vers leur point d’épuisement. L’appareil de production se trouve devant un marché d’autant plus saturé et l’économie capitaliste se retrouve exactement dans la même situation et devant les mêmes problèmes insolubles qu’en 1929, encore aggravés.
- c/ L’inter-relation entre les économies de l’ensemble des pays est plus accentuée qu’en 1929. De là une répercussion plus grande et plus immédiate de toute perturbation d’une économie nationale sur l’économie des autres pays et sa généralisation.
- d/ La crise de 1929 a éclaté après de lourdes défaites du prolétariat international, la victoire de la contre-révolution russe s’imposant complètement par sa mystification du "socialisme" en Russie, et le mythe de la lutte anti-fasciste. C’est grâce à ces circonstances historiques particulières que la crise de 1929 qui n’était pas conjoncturelle mais bien une manifestation violente de la crise chronique du capitalisme en déclin, pouvait se développer et se prolonger de longues années, pour déboucher finalement dans la guerre et la destruction généralisée. Tel n’est plus le cas aujourd’hui.
Le capitalisme dispose de moins en moins de thèmes de mystification capables de mobiliser les masses et de les jeter dans le massacre. Le mythe russe s’écroule, le faux dilemme démocratie bourgeoisie contre totalitarisme est bien usé. Dans ces conditions, la crise apparaît dès ses premières manifestations pour ce qu’elle est. Dès ses premiers symptômes, elle verra surgir dans tous les pays, des réactions de plus en plus violentes des masses. Aussi, c’est parce qu’aujourd’hui la crise économique ne saurait se développer pleinement, mais se transforme dès ses premiers indices en crise sociale, que cette dernière peut apparaître à certains comme indépendante, suspendue en quelque sorte en l’air, sans relation avec la situation économique qui cependant la conditionne.
Pour bien saisir cette réalité, il ne faut évidemment pas l’observer avec des yeux d’enfant, et surtout ne pas rechercher la relation de cause à effet d’une façon étroite, immédiate et limitée à un plan local de pays et de secteurs isolés. C’est globalement, à l’échelle mondiale, qu’apparaissent clairement les fondements de la réalité et des déterminations ultimes de son évolution. Vu ainsi, le mouvement des étudiants qui luttent dans toutes les villes du monde, apparaît dans sa signification profonde et sa limite. Si les combats des étudiants, en Mai, pouvaient servir comme détonateur du vaste mouvement des occupations des usines, c’est parce que, avec toute leur spécificité propre, ils n’étaient que les signes avant-coureurs d’une situation s’aggravant au cœur de la société, c’est à dire dans la production et les rapports de production.
Mai 1968 apparaît dans toute sa signification pour avoir été une des premières et une des plus importantes réactions de la masse des travailleurs contre une situation économique mondiale allant se détériorant. C’est par conséquent une erreur de dire comme l’auteur du livre que : "L’éruption révolutionnaire n’est pas venue d’une crise économique, mais elle a TOUT AU CONTRAIRE CONTRIBUE A CREER UNE SITUATION DE CRISE DANS L’ECONOMIE" et "cette économie une fois perturbée par les forces négatives de son dépassement historique doit FONCTIONNER MOINS BIEN" (p. 209).
Ici décidément, les choses marchent sur la tête : les crises économiques ne sont pas le produit nécessaire des contradictions inhérentes au système capitaliste de production, comme nous l’enseigne Marx, mais au contraire, ce sont seulement les ouvriers par leurs luttes qui produisent ces crises dans une économie qui "FONCTIONNE BIEN". C’est ce que ne cessent de nous répéter de tous temps, le patronat et les apologistes du capitalisme ; c’est ce que De Gaulle reprendra en novembre, expliquant la crise du Franc par la faute des enragés de Mai[2].
C’est en somme la substitution de l’économie politique de la bourgeoisie à la théorie économique du marxisme. Il n’est pas surprenant qu’avec une telle vision, l’auteur explique tout cet immense mouvement qu’était Mai comme l’œuvre d’une minorité bien décidée et en l’exaltant : "L’agitation déclenchée en janvier 1968 à Nanterre par quatre ou cinq révolutionnaires qui allaient constituer le groupe des enragés, devait entraîner, sous cinq mois, une quasi liquidation de l’État". "Et plus loin jamais une agitation entreprise par un si petit nombre n’a entraîné en si peu de temps de telles conséquences".
Là où pour les situationnistes le problème de la révolution se pose en termes "d’entraîner", ne serait-ce que par des actions exemplaires, il se pose pour nous en termes d’un mouvement spontané des masses du prolétariat, amenées forcément à se soulever contre un système économique en désarroi et en déclin, qui ne leur offre plus désormais que la misère croissante et la destruction, en plus de l’exploitation.
C’est sur cette base de granit que nous fondons la perspective révolutionnaire de classe et notre conviction de sa réalisation.
[1] Voir dans les pages 179 à 181 avec quel dédain et combien superficiellement, ils font la "critique" des autres groupes "conseillistes".
[2] Pour ceux qui voudraient voir dans la crise du franc en novembre, un simple fait de spéculation de "mauvais français", nous soumettons ces lignes de Marx extraites de "Revue de Mai à Octobre 1850" :
- "La crise elle-même éclate d’abord dans le domaine de la spéculation, et ce n’est que plus tard qu’elle s’installe dans la production. A l’observation superficielle, ce n’est pas la surproduction, mais la sur-spéculation - pourtant simple symptôme de la surproduction - qui paraît être la cause de la crise. La désorganisation ultérieure de la production n’apparaît pas comme un résultat nécessaire de sa propre exubérance antérieure, mais comme une simple réaction de la spéculation en train de s’effondrer" (Publié par M. Rubel dans Études de Marxologie - n"7 - août 1963).
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [17]
Evènements historiques:
- mai 1968 [18]
Rubrique:
Révolution internationale n°3 ancienne série - décembre 1969
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 117.34 Ko |
- 68 lectures
Rubrique:
Révolution Internationale - 1968 (ancienne série)
- 602 lectures
Révolution Internationale -anc_série n°1
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 4.18 Mo |
- 374 lectures
Le pouvoir des conseils ouvriers
- 304 lectures
AVERTISSEMENT
"Tout dernièrement, je vis une maison. Elle brûlait. "Les flammes léchaient le toit. Je m’approchai et remarquai qu'il y avait encore des gens dans la maison. "J'ouvris la porte et leur criai de sortir rapidement. "Mais les gens n'avaient pas l'air pressés. "L'un d'eux me demanda tandis que le feu lui brûlait déjà les cils, quel temps il faisait dehors, s'il ne pleuvait pas, s'il n'y avait pas de vent, s'il y avait une autre maison. Il me posa encore quelques questions de ce genre. "Sans répondre, je sortis de la maison. "Ces gens-là pensai-je, il faut qu'ils meurent brûlés vifs, avant qu'ils s'arrêtent de poser des questions. "Vraiment, mes amis, celui pour qui le plancher n'est pas encore assez chaud, qu'il ne préfère le changer pour un autre plutôt que d'y rester, à celui-là je n'ai rien à dire". Ainsi parla Goutama le Bouddha"[1].* * *
Nous ne nous adressons pas à ceux qui ont reproché au mouvement de Mai de "tout vouloir détruire sans savoir quoi mettre à la place".
* * *
En parlant des Conseils Ouvriers et de la nouvelle société, nous ne répondons pas à la question du pourquoi nous sommes révolutionnaires
Si nous parlons de ce que doivent être les buts de la révolution, ce n'est pas pour "justifier" la nécessité de détruire cette société, mais pour dénoncer tous ceux qui veulent la préserver en falsifiant ces mêmes buts.
C'est seulement en ce sens que nous tentons de répondre à la question : "qu’est-ce que nous avons à construire ?". A ceux qui ne comprennent pas encore que cette construction ne pourra se faire que "sur les ruines de cette société", nous n'avons rien à dire.
* * *
-I– QU'AVONS-NOUS A CONSTRUIRE SUR LES RUINES DE CETTE SOCIETE ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de commencer par dénoncer toutes les falsifications qui n'ont eu dans l'histoire d'autre but que celui de dévier et freiner la révolution dans le monde entier.
PAYS DITS "COMMUNISTES" - LES PAYS DITS "COMMUNISTES"
La première et la plus grande de ces falsifications est celle des pays dits "communistes". La bourgeoisie et la bureaucratie dans le monde entier s'appliquent à partager le monde en deux régimes sociaux antagonistes : capitalisme et "communisme". Il semblerait ainsi établi que l'on ne peut pas se sortir du système capitaliste occidental sans déboucher sur un régime de type russo-chinois, dit "communiste". Et vice-versa.
La dégénérescence de la Révolution Russe et le mensonge qui s'en suivit, présentant la Russie, la Chine et les pays de l'Est comme des "états ouvriers", ou même des "états ouvriers dégénérés',' ont pesé sur la conscience révolutionnaire du prolétariat comme une des plus grandes mystifications de tous les temps et la meilleure source de découragement et de désabusement.
Dans les pays dits "communistes", la classe ouvrière est aussi exploitée que dans les pays occidentaux. Les ouvriers, comme partout, y sont réduits à la besogne de vendre quotidiennement leur force de travail à un capital qui ne diffère de l'occidental que parce qu'il est entièrement dans les mains de l'Etat.
La production y est orientée selon les critères classiques de rentabilité du capital investi, de vente et de profit. La vie des travailleurs y est aussi inhumaine que celle des travailleurs occidentaux.
C'est par une différence des formes d'organisation des exploiteurs et des mensonges dont ils se servent pour justifier leur oppression, que ces deux systèmes se distinguent ;
- En régime capitaliste, classique, la majorité des capitaux est aux mains de la bourgeoisie privée. En régime "communiste", la totalité des capitaux est aux mains de l'Etat qui est le capitaliste unique, tout-puissant. Dans ce régime, l'appareil d'Etat est le maître unique et absolu de toute l'économie et donc de toute la société. Sans ambages, c'est lui qui décide du destin de chaque habitant. L'individu est pris sous son contrôle direct tout au long de sa vie et est utilisé pour telle ou telle tâche selon 1er besoins du capital d'Etat. Le travail, tout comme les distractions et toutes les activités, sont organisées par lui. Aussi, l'Etat peut-il planifier de façon très précise l'utilisation des ressources économiques pour obtenir le maximum de rentabilité du travail de chaque exploité. C'est le capitalisme dans sa forme la plus finie; le capitalisme d’Etat.
- La classe des exploiteurs dans le système capitaliste d'Etat est la bureaucratie étatique. Ce n'est pas une "nouvelle classe". C'est la forme que prend la bourgeoisie dans ce système, la "Bourgeoisie rouge" comme l'appellent les révolutionnaires polonais Kuron et Modzelewsky. Elle diffère de la bourgeoisie privée classique par ses modes de recrutement et de rémunération ;
L'institution ce l'héritage est, dans le capitalisme classique, le moyen normal de recrutement de la bourgeoisie. L’appartenance au parti et la fonction étatique en sont le moyen dans le capitalisme d'Etat. Elle est alors constituée par les hauts fonctionnaires de l'Etat, hommes politiques, grands militaires et, surtout, gérants des entreprises.[2]
Les revenus de la bureaucratie ne sont pas sous la forme de dividendes de capitaux leur appartenant personnellement, mais de salaires qu'ils s'attribuent sur les revenus de l'Etat.
- Cependant, la différence qui leurre le plus réside dans la phraséologie démagogique que chacun d'eux utilise pour imposer sa domination de classe.
Dans les vieux pays de capitalisme classique, tout le mensonge des classes au pouvoir se fonde principalement sur les expressions : "droit au travail", "droit de propriété", "démocratie'', "libre-entreprise", etc..., des formules telles que "planification socialiste", "nationalisations", "propriété collective d'Etat" comme équivalent et synonyme de socialisme ; l'absence de la forme pri-. vée du capital comme équivalent d'absence de capital tout court. - Cette différence correspond en réalité à une différence des formes que prend le système capitaliste.
Du fait que le capitalisme d'Etat implique l'expropriation des riches capitalistes privés par l'Etat, il peut se donner des airs de révolutionnaire. En effet, quand on a été habitué à assimiler l'idée d'exploitation à l'image du "riche bourgeois gras, fumant le cigare, coiffé d'un haut-de-forme...", son expropriation au profit de l'Etat peut sembler, à première vue, être un acte révolutionnaire correspondant aux intérêts de la classe ouvrière. C'est sur cette expropriation que basent toute leur propagande les tenants du capitalisme d'Etat, se disant pour cela "communistes". Mais, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en supprimant les capitalistes privés, ils n'ont pas éliminé le capitalisme mais qu'au contraire, ils lui ont donné sa forme la plus efficace dans l'oppression.[3]
Les partis de bureaucrates prennent le pouvoir en s'asseyant sur la chaise toute chaude des anciens exploiteurs privés (Chine, Cuba, Corée, etc...); ils ne détruisent en rien l'appareil d'Etat car ils en ont besoin pour exercer leur pouvoir bourgeois. Le prolétariat, lui, ne peut jamais se servir de l'appareil d'Etat bourgeois. Son action "devra consister non plus à faire passer la machine bureaucratique et militaire en d'autres mains (...) mais à la BRISER. C'est la condition première de toute révolution populaire réelle (...)" (Marx. A propos de l'expérience de la Commune de Paris. Lettre à Kugelmann citée par Lénine dans "L'Etat et La Révolution").
Lorsque ces partis se sont trouvés en présence d'organisations de pouvoir ouvrier, comme ce fut le cas en Russie, ils n'ont pu prendre le pouvoir qu'en éliminant physiquement les révolutionnaires et en dissolvant ces organisations (Exécution de la quasi-totalité des membres du Comité Central du Parti Bolchévik de 1917, dissolution des soviets).
Cependant, ces partis gouvernent toujours au nom de la "Révolution", de la "classe des travailleurs" sur qui ils exercent la plus féroce des dictatures. Au nom de l'"internationalisme prolétarien" , ils ont écrasé des insurrections prolétariennes en Chine 1927, Espagne 1936, Allemagne 1953, Hongrie et Pologne 1956.
C'est là chose courante, on n'a jamais vu la classe des exploiteurs se considérer comme telle et gouverner AU NOM du droit à l'oppression et à l'exploitation. On exploite toujours AU NOM de l'intérêt des exploités: les bureaucrates n'ont fait que pousser ce mensonge aux limites extrêmes du cynisme.
On ne juge jamais quelqu'un d'après ce qu'il dit de lui-même,comme le disait Marx. Les régimes qui se font appeler "communistes" peuvent se prétendre ennemis de l'exploitation et représentants des intérêts prolétariens, ce sont les faits eux-mêmes qui ont démontré combien depuis 40 ans, ils étaient, au contraire, les plus pernicieux défenseurs du capitalisme et les plus efficaces et sanguinaires ennemis de la Révolution prolétarienne. L'attitude de leur représentant en France, le P.C.F., en 1936, 1946 ou 1968 n'en est qu'une petite manifestation.
Seules les expressions changent, le but du mensonge est le même: mystifier la classe ouvrière.
* * *
ETATISATION - LES NATIONALISATIONS ET ETATISATIONS
Il serait absurde de concevoir le capitalisme d'Etat comme le produit du malicieux cerveau d 'un Staline.
Le capitalisme d'Etat est la forme que tend à prendre le capitalisme à partir d'un certain degré de mûrissement : celui où il commence à pourrir. La prise en charge de toute l'exploitation par l'appareil étatique est une tendance générale du système à partir du moment où il ne peut se survivre qu'en s'imposant par la force, en contrôlant toute la société, en particulier son futur fossoyeur; le prolétariat.
La nécessité d'assurer la mise en marche d'un appareil productif toujours plus complexe dans des conditions de marché de plus en plus difficiles, crée le besoin objectif d'un capitaliste de plus en plus puissant capable de remplir cette fonction. CE CAPITALISTE NE PEUT ETRE AUTRE QUE L'ETAT LUI-MEME.
Avec l'exacerbation des antagonismes inter-impérialistes qui aboutissent à la guerre de 1914, le rôle de l'Etat capitaliste devient de plus en plus indispensable à l'expansion impérialiste du capital de chaque nation, tant sur le plan de l'organisation interne de l'économie que sur le plan de la concurrence internationale.
Avant 1914, l'Etat bourgeois était simplement le gendarme au service du capitalisme ; depuis, la bourgeoisie privée a dû céder progressivement ses fonctions d'exploitation à son gendarme.
Les nationalisations et étatisations, les plans étatiques, sont la manifestation de cette tendance. Le capitalisme décadent tend irréversiblement vers le capitalisme d'Etat. Cette évolution se réalise avec plus ou moins de rapidité selon les pays, mais dans chacun d'eux, il existe des partis politiques qui en sont les représentants authentiques. C'est le cas de la plupart des partis de "gauche" ou "progressistes" et, évidemment, de tous les partis "communistes". Le plus souvent, d'ailleurs, les vraies divergences qui existent entre ces partis résident dans la cadence et les pourcentages d'étatisation de l'économie qu’ils se proposent de réaliser.
Ces partis ne peuvent offrir comme solution aux problèmes de la société capitaliste que celle du transfert de la propriété des moyens de production des mains des bourgeois privés à celles de l'Etat. Avec leurs prétentions de "gauche" et de "progrès", ils n'offrent qu'un moyen -non pour éliminer- mais pour rendre plus efficace l'exploitation.
Tous ces partis et leurs "théories" n'ont rien à voir avec la Révolution socialiste. LA REVOLUTION N'EST PAS LE CHANGEMENT D'UN PATRON PAR UN AUTRE, ELLE EST L'ELIMINATION DES PATRONS. ELLE N’EST PAS LA DELEGATION DE POUVOIR A UNE AUTRE CLIQUE QUE LA PRECEDENTE, ELLE EST LA PRISE EN MAINS DE TOUTE LA SOCIETE PAR LES TRAVAILLEURS EUX-MEMES.
Certains groupes d’"extrême-gauche", comme les trotskystes par exemple, prétendent que, bien que les nationalisations ne soient pas la révolution, elles sont cependant une étape, un pas en avant qu'on peut revendiquer dans l'époque actuelle (cf. "Programme de Transition". Trotsky. 1938).
Le capitalisme a aujourd'hui cessé de développer ses forces productives. Le bien-être apparent et instable qu'il assure pour le moment aux travailleurs des grands pays capitalistes ne peut pas cacher qu'une partie chaque jour plus grande de l'humanité est rejetée dans la misère, que la production actuelle est fondée sur l'économie de guerre et la destruction, et qu'on vit sous la menace permanente d'une III° Guerre Mondiale. La Révolution prolétarienne est non seulement à l'ordre du jour mais retarde d'un demi-siècle sur l'histoire.
Toute mesure prise à l'intérieur du cadre capitaliste s'inscrit aujourd'hui dans un courant de chute et de décadence. Aussi, les nationalisations ne constituent-elles pas un progrès mais un pas sur place qui dans le mouvement de l'histoire ne peut être qu'un pas en arrière. Seule, l'élimination des rapports de production capitaliste -sous toutes ses formes, étatiques ou privées- par la Révolution socialiste, sera objectivement un pas en avant.
D'autre part, l'expérience a démontré combien les luttes pour les nationalisations ont servi à mener le prolétariat dans les besognes du capitalisme, à dévier sa lutte et à lui cacher ses vraies tâches révolutionnaires. Qu'il suffise de se rappeler les luttes de 1936 et 1946 en France et ce qu'elles ont donné.
Il doit aujourd'hui être clair que, chaque fois que la classe ouvrière laissera dévier sa lutte vers les nationalisations et les étatisations, elle ne gagnera que le sang et les larmes d'une nouvelle défaite.
* * *
GESTION - PARTICIPATION ET CO-GESTION
Une autre idée lancée aujourd'hui comme solution des problèmes de cette société est celle de la participation et de la co-gestion.
On parle d'associer les ouvriers aux décisions prises par l'entreprise. Pour cela, les gaullistes de "gauche" préconisent "de donner aux citoyens des diverses catégories la possibilité d'acquérir une formation économique spécialisée en matière de gestion des entreprises". Et De Gaulle de proclamer "que soit attribué de par la loi à chacun, une part de ce que l'affaire gagne et de ce qu'elle investit en elle-même grâce à ses gains".
Ce n'est même pas une idée originale. Depuis des dizaines d'an-' nées, de tels systèmes ont été proposés dans divers pays et particulièrement en France. Ce sont les mesures classiques que la bourgeoisie propose pour tenter de "calmer" les ouvriers lorsque les tensions entre classes deviennent trop aiguës. Pour n'en donner que quelques exemples: dans les dernières années de la 1° Guerre Mondiale, une vague révolutionnaire ébranle le monde (Révolution russe 1917, Hongrie 1919, Allemagne 1918-1919, Italie 1920, etc..); en France, les grèves deviennent de plus en plus nombreuses et importantes. Pour "réconcilier les classes en France", on vota des lois en 1917 sur la participation. Les catholiques et les syndicats demandaient la "participation des salariés à la gestion de l'entreprise". En Allemagne, la social-démocratie, après avoir écrasé la Révolution de 1919, rend obligatoire la co-gestion dans toutes les entreprises de plus de 20 ouvriers. Aux U.S.A., à la même époques , les trusts et les entreprises privées mettent en place l'actionnariat ouvrier. En France encore, en 1945, lorsqu'une nouvelle série de grèves secoue le pays, une Ordonnance du 22 Février 1945 rend obligatoire la participation en créant les Comités d'entreprise (De Gaulle et le P.C.F.).
Est-ce étonnant que lorsqu'en Mai-Juin 1968 éclate en France la plus grande grève de l'histoire du mouvement ouvrier, le gouvernement, les partis de "gauche" et leurs syndicats aient eu comme réflexe immédiat de jeter l'os à rongé de la co-gestion et de la participation ?
Mais voyons de plus près en quoi consiste cette co-gestion.
Elle est décrite comme le droit des travailleurs à déléguer quelques-uns d'entre eux à participer à la gestion de l'entreprise (les grandes centrales syndicales voudraient que leurs délégués exercent cette fonction).
Mais qu'est-ce que la gestion d'une entreprise capitaliste sinon l'organisation de l'exploitation des travailleurs qu'elle embauche ? L'entreprise capitaliste comme son organisation et sa gestion sont conçues pour extirper le maximum de bénéfices du travail des ouvriers. A moins de détruire de fond en comble toute son organisation et celle de toute la société dont elle n'est qu'un élément, la participation à sa gestion ne peut donc être que la participation à l'organisation de l'exploitation de la classe ouvrière. On voudrait ainsi que quelques travailleurs aident leur patron à exploiter leurs camarades en leur donnant évidemment les moyens "pour qu'ils acquièrent une formation économique spécialisée en matière de gestion d'entreprise".
Les syndicats et les partis de gauche prétendent que grâce à cette participation à la gestion, les délégués ouvriers pourraient influencer la direction et obtenir quelques améliorations des conditions de travail de la classe ouvrière.
Sans compter le fait qu'il ne s'agit pas d'obtenir quelques améliorations des conditions de vie, sinon le changement de la vie elle- même, qu'il ne s'agit plus de réformer cette société pourrissante mais de la détruire pour en bâtir une nouvelle, regardons si au moins la co-gestion peut permettre d'obtenir une amélioration réelle des conditions de vie.
Il est possible qu'après de longues discussions avec la direction, les délégués puissent obtenir la construction d'un meilleur vestiaire, d'une cantine plus propre ou de waters moins sales. (C'est-à-dire ce que les syndicats obtiennent parfois aujourd'hui). Mais pourront-ils toucher aux facteurs qui déterminent REELLEMENT les conditions de vie et de travail; les cadences, les hiérarchies, les chronométreurs, les horaires, la conception des machines qui font de tout ouvrier un robot ? Il est évident que non.
La co-gestion est bien ce que son nom indique ; une CO-gestion, et non une gestion. Les cadences, la productivité, la rentabilité, etc..., sont le véritable objet de la gestion d'entreprise. Et ces problèmes, qui sont les VRAIS problèmes des conditions de travail, le patronat ne peut les laisser aux mains des travailleurs sans mettre en question la fonction même de l'entreprise et donc la société qu'il domine.
Les participations et co-gestions sont des choses parfaitement limitées ; les travailleurs ont le droit de "participer" tant qu'ils ne touchent pas aux vrais problèmes. Huvelin, président du Conseil National du Patronat Français, le disait clairement le 9 Juillet 1968 en se prononçant en faveur de la "participation":
- "Il incombe au législateur de préciser les attributions du délégué syndical désigné parmi le personnel de l'entreprise et de le mettre à même d'exercer sa mission, MAIS IL SERAIT DANGEREUX QU'UNE EXTENSION ABUSIVE DE SA MISSION VIENNE CONTRECARRER, POUR NE PAS DIRE PARALYSER L'ACTION DE LA DIRECTION ET DES CADRES...). Cela ferait éclater l'entreprise en morceaux, et ruinerait les fondements de l'autorité, en écarterait une épargne dont les droits doivent être respectés, briserait les hiérarchies et détruirait l'efficacité du travail".
Seuls des gens intéressés à maintenir la classe ouvrière dans la soumission et le mensonge capitaliste, peuvent voir dans la participation à la gestion de l'entreprise une solution quelconque.
Il en va de même pour son inévitable compagne ; la participation aux bénéfices de l'entreprise.
Il s'agit là encore d'un moyen pour tenter d'intéresser les travailleurs à leur propre exploitation. En feignant de partager les bénéfices que l'entreprise a obtenus de leur travail, ils comptent en faire des passionnés du travail, des "petits capitalistes" qui ne pensent qu'aux moyens d'obtenir plus de bénéfices pour leur boîte. Avec quelques miettes, la bourgeoisie pense faire disparaître les luttes et les antagonismes entre exploiteurs et exploités.
Comme duperie, cette méthode a déjà donné ses fruits dans divers pays et dans quelques entreprises (Sommer par exemple), mais à une époque différente. Aujourd'hui, il n'est d'ouvrier tant soit peu combatif qui n'en parle sans rire. Il n'y a que des De Gaulle pour voir dans la participation aux bénéfices "la solution aux problèmes de la société de consommation" sans même se sentir ridicule.[4](1).
Ce que la bourgeoisie sénile n'arrive pas à comprendre, c'est que le prolétariat a commencé à contester non pas des salaires TROP bas, ni des directions TROP isolées de lui, mais bien LE SALARIAT ET LES DIRIGEANTS EUX-MEMES !
Avec sa "participation", la bourgeoisie-bureaucratie ressemble à cette pauvre femme qui tentait de retenir la marée montante avec un petit balai...
- Cependant la bourgeoisie, surtout quand elle prend sa forme bureaucratique n'est pas toujours aussi rétrograde et imbécile que les gaullistes. Comprenant mieux ce qui s'annonce derrière le mouvement dont le premier pas fut Mai, les fractions "intelligentes" de la bourgeoisie, celles de "gauche", ont cherché au fond des tiroirs de l'opportunisme des formules plus adéquates à leurs besoins présents.
- Le P.S.U. et la C.F.D.T. ressortent ainsi aujourd'hui l'auto-gestion de type yougoslave.
- L'AUTO-GESTION - L'AUTO-GESTION - L'AUTO-GESTION
Il est d'autant plus nécessaire de dénoncer ce bla-bla démagogique, qu'il tente de reprendre à son compte -avec les déformations nécessaires- une idée révolutionnaire. L'auto-gestion reste en effet, dans l'expérience prolétarienne, un des traits fondamentaux de ce que sera la société bâtie par la classe ouvrière. Or, comme il arrive toujours avec les idées qui mettent en cause les bases mêmes du système existant, les tenants du régime se sont appliqués à tenter de la récupérer pour en faire quelque chose d'inoffensif ou même un moyen de renforcer les structures actuelles. Les éléments les plus opportunistes des groupes bourgeois français, les "enfants terribles du capital", devant la force des évènements de Mai, se sont mis à parler plus fort d'auto-gestion dans le but -toujours le même- de défendre les structures de base du capitalisme tout en feignant de les mettre en cause.
Dans cette soi-disant auto-gestion, dont le modèle est l'autogestion yougoslave, ni les salaires, ni la distribution, ni l'orientation de la production ne sont dans les mains des ouvriers. C'est l'Etat et ses conseillers techniques qui décident de tout cela. C'est un capitalisme d'Etat (puisque toutes les entreprises sont propriétés de l'Etat) dans lequel on laisse quelques initiatives mineures aux travailleurs, lesquelles ne leurs permettent pas d'intervenir dans les directives fondamentales de la production.
Le Plan de l'économie nationale est décidé par la bureaucratie au pouvoir qui l'impose à l'ensemble des entreprises.
On retrouve toujours la même tactique : LAISSER INTACTS LES RAPPORTS FONDAMENTAUX D'EXPLOITATION (bureaucratie, capital, salariat) en ne changeant en fait que quelques modalités SUPERFICIELLES de la production et de l'exploitation capitaliste.
Dans ces conditions, l'auto-gestion ne peut être, dans le meilleur des cas, qu'une auto-exploitation. C'est tout.
- Ce dont les défenseurs de l'auto-gestion de type yougoslave ne parlent pas, c'est des luttes des ouvriers yougoslave contre le système. Par exemple, des grèves de la fin 1967 avec occupations, descente dans les rues, et à Nis, dans une entreprise de transports, "projection" du directeur de l'usine par-dessus un mur...
Ce genre d'auto-gestion est un bon moyen pour utiliser l'enthousiasme des travailleurs à qui on présente le "mirobolant" projet d'une nouvelle patrie qui leur appartiendrait (Exemple: les kibboutzim en Israel). Le destin de toutes ces expériences, on le connaît: elles n'ont servi qu'à mettre sur pied des bases pour l'exploitation capitaliste.
Toutes ces solutions, du genre auto-gestion, coopératives, etc... exploitent la fausse idée que l'existence de centres de production non capitalistes est possible dans un monde capitaliste. On prétend voir l'entreprise non comme une partie d'un tout, mais le tout comme une somme anarchique d'entreprises; c'est là une conception petite bourgeoise, artisanale de la société. On croit qu'en transformant peu à peu chaque entreprise, on arrivera progressivement à éliminer définitivement le capitalisme, en évitant ainsi une révolution violente.
On ne voit pas, ou on cache, que l'usine, comme centre de production, dépend entièrement du reste de la société; qu'elle en dépend aussi bien pour l'approvisionnement en matières premières et énergie, que pour l'écoulement de sa production; qu'elle n'est elle-même qu'un MOMENT de la production sociale; que dans une production sociale capitaliste, elle ne peut être qu'une usine capitaliste, et les rapports sociaux existants en son intérieur, des rapports d'exploitation.
Tant qu'il existe capital, il existe salaire et donc exploitation capitaliste: que le capital appartienne à de riches bourgeois ou à l'Etat et sa bureaucratie, cela ne change rien; que ce soit une direction unique ou un groupe d'ouvriers qui décident des conditions de la réalisation de telle ou telle production, les rapports d'exploitation restent intacts: les salaires, comme la quantité à produire dans un certain délai, sont déterminés selon des critères de rentabilité du capital investi, sous peine de faillite immédiate.
Le but véritable de toutes ces théories est de cacher que l'élimination de l'exploitation capitaliste ne peut être que le produit d'une révolution violente qui s'attaque à TOUTES les institutions sociales existantes, qui bouleverse la totalité des structures, et qui ne se perd pas dans des réformes PARCELLAIRES sous prétexte de "réalisme" et de "non-violence".
- CE N'EST PAS EN CHANGEANT QUELQUES RAPPORTS DANS L'ENTREPRISE QU'ON TRANSFORMERA LES FONDEMENTS DE LA SOCIETE, C’EST EN S'ATTAQUANT AUX FONDEMENTS DE LA SOCIETE QU'ON TRANSFORMERA LES RAPPORTS DANS LES CENTRES DE PRODUCTION, ET CES CENTRES EUX-MEMES.
La société que nous aurons à construire sur les ruines de celle-ci n'a rien à voir avec celle des pays dits "communistes", ni avec celle qu'on nous propose par les nationalisations et étatisations, ni avec celle résultant des "participations" et "auto-gestions" dont on a parlé. Car elles rie sont toutes que des variantes d'une même réalité: cette réalité qu’il s'agit justement de détruire. Avec des noms divers, des modalités quelque peu différentes, sous des apparences légèrement changeantes, elles habillent toujours le même fond, la même misère, le même ennui, la même oppression.
Et les bourgeois de crier : "Vous critiquez tout! C'est trop facile ! Il faut être réaliste."
En dehors des solutions qui se rattachent à celles décrites plus haut, tous les partis et leurs syndicats crient au rêve, à l'utopie... aux provocateurs. C'est que les classes au pouvoir n'arrivent jamais à concevoir réellement la possibilité de leur disparition -de même que l'homme n'arrive jamais à imaginer parfaitement sa mort. Tout ce qui tend à éliminer les bases de la société qui fait d'eux des privilégiés, leur semble pure invention et rêverie.
Cependant, le prolétariat a déjà ébauché plus d'une fois la société qu'il bâtira sur les cadavres de ces bureaucrates. C'est à travers ses différentes tentatives pour abattre le capitalisme que la classe ouvrière a défini les traits fondamentaux de la nouvelle société. Comme classe antagoniste de la bourgeoisie, le prolétariat, chaque fois qu'il s'est opposé violemment au capitalisme, a réalisé les premiers pas constructifs de la société socialiste. Seulement, l'histoire de ces expériences, l'histoire révolutionnaire du prolétariat, est systématiquement ignorée ou défigurée par la bourgeoisie, ses écoles et ses "penseurs". (Ainsi, on a tenté de présenter la Commune de Paris comme un exemple de patriotisme contre les allemands; on a voulu faire de la Révolution russe un mouvement nationaliste, de la Révolution hongroise de 1556, un mouvement pro-impérialisme américain, etc...).
Mais on ne peut ni changer, ni éliminer l'histoire. Et en engageant de nouveau ouvertement sa lutte historique, le prolétariat reprendra ses dernières luttes au point où il les avait laissées, pour les mener enfin à leur aboutissement final.
* * *
OUVRIERS - LES CONSEILS OUVRIERS - LES CONSEILS OUVRIERS
La première tentative de prise de pouvoir par le prolétariat, la Commune de Paris (1871), a fait apparaître la nécessité absolue de détruire INTEGRALEMENT l'Etat capitaliste.
Par quoi remplacer l'appareil bourgeois ?
Les plus grands théoriciens de la classe ouvrière, à partir de l'expérience de 1871, ne parvinrent qu'à définir des traits généraux de l'organisation de la nouvelle société, sans répondre de façon pratique et concrète à cette question. Et lorsqu'en 1905, en Russie, la classe ouvrière s'organise pour la première fois en CONSEILS, le parti bolchevik, méfiant, mettra du temps à comprendre que ces organisations constituent la "forme enfin trouvée" de la nouvelle société.
Depuis cette époque, chaque fois que le prolétariat s'est attaqué au capitalisme, il s'est organisé en conseils ouvriers; ils sont réapparus en 1917 en Russie; en 1918-1919, 1921, 1923, en Allemagne; en 1920 en Italie; en 1927 en Chine; en 1936 en Espagne; en 1953 en Allemagne de l'Est; en 1956 en Pologne et en Hongrie...
Produit spontané de la classe ouvrière, les Conseils se retrouvent dans des conditions et à des moments aussi différents que ceux de la Révolution Chinoise en 1927 ou de la Révolution Espagnole en 1936.
Notre but n'est pas de faire ici une étude détaillée des différentes expériences historiques des Conseils; nous voulons montrer que les Conseils ne sont pas une "simple forme d'organisation" comme une autre, mais bien LA forme spécifique d'organisation de la classe ouvrière quand elle entreprend sa tâche révolutionnaire.
Si depuis 1905 l'histoire de la lutte de la classe ouvrière est celle des Conseils, ce n'est pas un hasard.
Les Conseils ne sont pas un schéma desséché, produit de quelque "cerveau génial" et qu'on a tenté d'appliquer par la force partout, mais la réponse spontanée aux problèmes qui se posent au prolétariat en lutte contre le capitalisme.
En période révolutionnaire, la distinction entre théorie et pratique, entre "ceux qui pensent" et "ceux qui agissent" disparaît dans la réalité. Chaque pensée commune se traduit par des actions; chaque action entraîne immédiatement des prises de position théoriques. Cette cohérence fait que chaque action, fut-elle une erreur, devient une source riche d'enseignements pour l'avenir. Dans ces journées qui "concentrent en elles vingt années", "chaque pas du mouvement REEL est plus important qu'une douzaine de programmes" (K. Marx. Lettre à Bracke. 1875), La spontanéité des masses dans ces périodes est la force même du mouvement, et c'est au cours d'un de ces "pas du mouvement réel" que le prolétariat, en formant des Conseils ouvriers, a trouvé la solution au problème fondamental de l'organisation de la nouvelle société.
Chaque fois qu'il a tenté de renverser le capitalisme, le prolétariat dans sa lutte décisive, s'est trouvé devant les mêmes besoins chaque fois, il y a répondu en organisant des Conseils. Il suffit de voir quels sont ces besoins pour comprendre que les Conseils réapparaîtront lors de la prochaine révolution.
On comprendra alors que les Conseils ne font pas partie des vieilles histoires de la classe ouvrière mais sont plus que jamais à l'ordre du jour: en tant qu'assemblées responsables de travailleurs, éligibles et révocables, détenant tous les pouvoirs, ils constituent la seule réponse possible et réelle au problème de l'organisation sociale future.
1 - L'Etat bourgeois avec son armée régulière, sa police, son corps bureaucratique, son système de "représentativité", etc..., est une institution correspondant étroitement à la société capitaliste. C'est l'organisation que se donne la bourgeoisie dans le but de protéger et de maintenir ses privilèges; c'est donc une institution destinée à assurer le contrôle et l'oppression de la majorité de la population par une minorité qui est dans ce cas la bourgeoisie (qu'elle prenne la forme de bourgeoisie classique privée, ou bureaucratique comme en Chine, U.R.S.S., Cuba, etc...).
La révolution prolétarienne à la différence des révolutions bourgeoises n'est possible que par l'action consciente de la classe ouvrière dans son immense majorité. A la différence de buts entre ces deux sortes de révolutions, correspond une différence de moyens pour leur mise en oeuvre. D'où l'impossibilité pour le prolétariat d'utiliser cet appareil d'Etat et la nécessité pour lui de le détruire.
Il s'en découlera un "vide" que la classe ouvrière devra combler par sa propre organisation: celle de "l'immense majorité au profit de l'immense majorité". C'est-à-dire, celle qui abolira la rupture bourgeoise entre dirigeants et exécutants et qui par un système de démocratie directe (délégués élus et révocables à tout moment, institués comme EXECUTANTS de la majorité) donnera à tous et à chacun le moyen de s'exprimer et agir, en prenant en charge tous les secteurs de la vie sociale.
Cette forme d'organisation n'est autre que celle des Conseils ouvriers.
2 - De même que le capitalisme a permis un immense développement des forces productives en éliminant les entraves à la production que constituaient les lois de production féodales et artisanales, la Révolution Socialiste aura comme effet de libérer et permettre leur développement en éliminant les lois de production capitaliste, devenues à leur tour un cadre trop étroit. En effet, le capitalisme a cessé d'être un facteur de progrès économique. Emprisonné dans ses lois fondamentales, il ne peut plus assurer le développement de la production des biens de consommation nécessaires à l’humanité.
Depuis les temps de la 1° Guerre Mondiale, il est de plus en plus obligé d'orienter la production vers la destruction et la guerre ; de reconstruire ce qu'il a détruit en se préparant à de nouvelles destructions pour se survivre. Depuis un demi-siècle, il n'a pu que plonger une fraction chaque fois plus grande de la population mondiale dans la misère la plus totale. Vivant de guerres en reconstructions, de reconstructions en crises et de crises en guerres, il se débat à l'intérieur de ses propres contradictions ne pouvant plus développer de nouvelles forces productives.
C'est en ce sens que la Révolution socialiste est OBJECTIVEMENT à l'ordre du jour. "Jamais une société n'expire avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir" (K. Marx. Avant-Propos à la "Critique de l'Economie Politique").
La Révolution devra donc porter les moyens de sortir l'humanité de l'impasse dans laquelle la maintient le capitalisme et, l'organisation qu'elle donnera à la société, devra répondre à cette nécessité.
Nous voulons ici montrer que pour cette tâche encore, le Prolétariat devra s'organiser en Conseils ouvriers.
Examinons d'abord quelles sont les raisons essentielles qui placent le Capitalisme dans l'impossibilité de dépasser ce stade, cette impasse. La loi fondamentale du capitalisme est celle selon laquelle toute l'activité économique doit avoir pour but "la formation et l'accroissement du capital". Or, l'accroissement du capital est l'accumulation de bénéfices qui ne sont que le sur-travail extirpé à la force de travail, à la classe ouvrière. Seulement, pour que cette accumulation du capital se réalise, il est nécessaire de vendre le produit de ce sur-travail. La production capitaliste se fait pour la vente: c'est-à-dire qu'elle est limitée par la possibilité d'achat de la société.
Produire pour la vente ne veut pas dire produire selon les besoins existants mais bien produire selon la quantité d'argent disponible dans la société. Or, les rapports de production capitaliste sont tels, que l'ensemble des travailleurs ne peut obtenir les moyens d'acquérir toute la production qu'il réalise. Le problème pour les capitalistes est donc de trouver à vendre ce surplus de production nécessaire pour réaliser l'accumulation du capital.
Lorsqu'il existait des secteurs économiques extra-capitalistes (paysannat, artisanat, pays vivant sous des rapports économiques primitifs), le problème était résolu par le marché qu'ils constituaient pour les pays d'industrie développée. Mais du moment que ces secteurs mêmes se trouvent absorbés dans la sphère capitaliste, le problème n'en devient que plus insoluble. Il se produit a- lors une saturation des marchés. C'est l'impossibilité de continuer à produire. "... La société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistances, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elle dispose ne favorisent plus le développement des conditions de la propriété bourgeoise ; au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ces CONDITIONS QUI SE TOURNENT EN ENTRAVES ; et toutes les fois que les forces productives sociales s'affranchissent de ces entraves, elles précipitent dans le désordre la société toute entière et menacent l'existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses produites en son sein."
- "Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ses crises ? D'une part, par la destruction forcée d'une masse de forces productives ; d'autre part, par la conquête de nouveaux marchés et l'exploitation plus parfaite des anciens. C'est-à-dire qu'elle prépare des crises plus générales et plus formidables et diminue les moyens de les prévenir". (Marx-Engels. Manifeste Communiste).
1914 a marqué pour ainsi dire la saturation définitive des marchés mondiaux. Il a fallu la guerre mondiale pour détruire suffisamment et pouvoir reconstruire. Puis la reconstruction ne fut pas suffisante : le capitalisme se lança dans la destruction permanente de la production sociale, de cet "excès de civilisation, de moyens de subsistances", en maintenant constamment des guerres locales, en faisant de la production inutile (armes) qui non seulement sont un gaspillage du travail mais encore sont destinées à détruire le travail déjà fait.
Tout cela pour tenter -ne fut-ce que provisoirement- de détourner sa contradiction: AVOIR TOUJOURS BESOIN D'ACCROITRE SA PRODUCTION D'UNE PART ET NE PAS POUVOIR ECOULER CETTE PRODUCTION DANS LE MARCHE D'AUTRE PART.
La misère effroyable dans laquelle le capitalisme a plongé deux tiers de l'humanité (auxquels il ne peut rien vendre parce qu'il ne peut pas leur donner les moyens d'achat); l’oppression et la barbarie qu'il impose à tous les hommes (en particulier à ceux des pays industrialisés, devenus des robots, dont toute la vie est contrôlée par l'appareil d'Etat capitaliste) sont la conséquence de l’emprisonnement de la société dans les lois de la marchandise: LES LOIS DU PROFIT ET DE LA VENTE NECESSAIRE A LA REALISATION DE CELUI-CI.
La Révolution socialiste correspond ainsi au besoin de briser ce cadre de lois, c'est-à-dire de libérer la production en éliminant les lois du profit et donc de la vente. En un mot, éliminer la marchandise et en particulier la marchandise fondamentale, celle qui permet de mesurer toutes les autres, la force de travail.
Il faut que la production ne soit plus limitée par la vente mais qu'elle puisse se développer en tenant compte SEULEMENT ET EXCLUSIVEMENT DES BESOINS DES HOMMES. Les hommes doivent se répartir la production qu’ils réalisent selon leurs besoins et non plus selon les intérêts d'une minorité capitaliste. C'est la seule façon de dépasser l'impasse dans laquelle se trouve l'humanité et qui l'amène à la barbarie.
C'est là que porte le développement objectif des techniques de production indépendamment des hommes.
Mais cette transformation aussi normale et nécessaire puisse-t-elle sembler, présuppose l'élimination des minorités exploitantes. Elle implique la prise en charge de toute la production par la majorité de la population, par les travailleurs.
Le problème est alors : comment faire pour que la production soit aux mains de tous les travailleurs, pour qu'il n'y ait pas une nouvelle minorité qui en s'emparant du contrôle des moyens de production perpétue l'exploitation capitaliste ?
C'est à cette question que seule l'organisation des conseils peut répondre. En effet, les Conseils étant des assemblées de travailleurs élus et révocables à tout instant, ayant simplement un pouvoir d'exécution des directives prises en assemblées informées, sont la forme même qui permet à tous les hommes de diriger leur activité, leur production. Ils constituent non plus un organe destiné à imposer à une majorité les directives d'une minorité mais l'organisation de l'immense majorité pour coordonner et rendre effective son action et ses désirs. Les conseils sont le moyen à travers lequel l'ensemble des travailleurs prend en charge toute la production qu'il réalise.
3 - Une autre caractéristique de la révolution rend l'organisation de la classe ouvrière en Conseils obligatoire.
Les périodes révolutionnaires se caractérisent par la prise de conscience de millions de travailleurs ; cela veut dire des millions d'initiatives et d'expériences à réaliser. Les masses, sorties de l'apathie qui caractérise les époques de réaction, sont constamment amenées à dépasser leurs éléments les plus avancés, souvent encore imprégnés d'une pensée correspondant à la période pré-révolutionnaire. Ainsi, Trotsky lui-même, qu'on ne peut pas soupçonner du moindre "spontanéisme" constatait pendant la Révolution Russe que très souvent, le Comité Central du Parti Bolchevik était en retard par rapport à la base du Parti, et que le Parti lui-même retardait sur la conscience générale des masses. Il ne peut en être autrement ; plus le processus révolutionnaire avance, plus des millions d'hommes se réveillent, cherchent et trouvent des solutions, devançant ceux qui au début du mouvement étaient effectivement une avant-garde. Une des conditions essentielles de la révolution est donc l'organisation des masses sous une forme qui puisse traduire immédiatement et directement en actes leur conscience. Les initiatives exigées pour la transformation radicale que constitue la révolution socialiste ne peuvent pas s'enfermer dans le cabinet du meilleur Comité Central.
Seuls les Conseils, parce qu'ils regroupent l'ensemble des travailleurs et parce qu'ils exercent leur pouvoir sur toute la vie de la société dans chaque usine, quartier, région, peuvent répondre à ce besoin fondamental. Eux seuls, peuvent assurer la participation (au vrai sens du terme) EFFECTIVE ET IMMEDIATE de tous les travailleurs ; eux seuls peuvent garantir la rapidité de la réalisation des initiatives de la classe révolutionnaire.
* * *
- II –
COMMENT S'ORGANISENT LES CONSEILS ENTRE- EUX?
COMMENT ASSURERONT-ILS LEUR POUVOIR FACE AUX FORCES DU SYSTEME DONT ILS SONT LA NEGATION ?
COMMENT ASSURERONT-ILS LA GESTION DE LA PRODUCTION ? (PLANIFICATION ?)
COMMENT AGIRONT LES CONSEILS DES VILLES ENVERS LES CONSEILS DES CAMPAGNES ?
COMMENT AGIRONT LES CONSEILS ENVERS LES PAYS QUI RESTENT SOUS LA DOMINATION CAPITALISTE ?
Nous pouvons difficilement prévoir positivement quel chemin précis prendra la révolution. Notre pensée est déterminée par les cadres de la société actuelle et il serait impossible de définir ce qui sera le produit d'une nouvelle pensée, dans une nouvelle société que nous ne connaissons que par opposition à celle-ci. Tout ce que nous pouvons faire, c'est définir tout au plus, négativement "ce qui ne sera pas", et à partir des expériences positives -les actions passées du prolétariat comme classe révolutionnaire- dessiner les grands traits des mesures destinées à tenter d'éviter tout retour en arrière vers le capitalisme. La révolution, disait Rosa Luxembourg, n'est pas "une recette toute prête (...) que le parti de la révolution a en poche et qu'il n'a plus besoin que d'appliquer avec énergie (...). Bien loin d'être une somme de prescriptions toutes faites qu'on n'aurait plus qu'à mettre en application la réalisation pratique du socialisme comme système économique, social et juridique est une chose qui réside dans le brouillard de l'avenir. Ce que nous possédons dans notre programme, ce ne sont que quelques grands poteaux indicateurs montrant la direction dans laquelle les mesures à prendre doivent être recherchées, indications, d'ailleurs d'un caractère surtout négatif." (Rosa Luxembourg. La Révolution Russe.).
Nous répondons donc à ces questions en nous basant sur les résultats des expériences passées et en tenant compte de la logique propre de la révolution prolétarienne dans les cadres des techniques de la société présente.
1 - COMMENT S'ORGANISENT LES CONSEILS ENTRE EUX ?
Les conseils, nous l'avons répété, sont le moyen spécifique par lequel les travailleurs prennent en mains TOUTE la société. Ils doivent donc se constituer de façon à coordonner parfaitement leur action sur tout le territoire où ils exercent leur pouvoir. Les diverses expériences ont montré que cette coordination entre les divers conseils de base (Conseils d'usines, de quartiers, de campagne) ne peut être réalisée que par un autre Conseil.
C'est le rôle des Conseils de villes formés de délégués de quartiers et d'usines, des Conseils de régions avec des délégués de villes et circonscriptions agricoles, enfin d'un Conseil central, une assemblée centrale de Conseils.
Les relations existant entre tous ces Conseils sont les mêmes qui existent entre les travailleurs et leur Conseil local d'usine, Toute décision est prise par les délégués après collecte des DIRECTIVES des Conseils locaux, élaboration d'une ou diverses solutions et RATIFICATION d'une d'elles par les intéressés. A l'égal des Conseils de base, les Conseils supérieurs restent les EXECUTANTS de la volonté de ceux dont ils sont l'émanation. Ils sont simplement le moyen que se donnent ces derniers pour la réaliser.
Les prêtres de la bureaucratie, de la technocratie y verront un "pêché mortel" contre la rapidité et l’efficacité : "Qu'est-ce que cette coordination où tout ordre est discuté, où des ouvriers sans éducation donneront des ordres à des spécialistes, où il faudra attendre la décision de millions de personnes pour faire un pas ? Ce sera le règne du désordre, de la lenteur et de l’anarchie !»
On pourrait leur répondre que même s'il fallait pour prendre une décision le double du temps qu'il faut actuellement, et frôler le désordre total constamment pour éliminer la bureaucratie et son système, l'humanité n'hésiterait pas à choisir. Une seule décision -aussi lente soit-elle- prise par les Conseils pour la construction de la nouvelle société vaut plus que mille décisions immédiates prises par les bureaucrates pour maintenir l'exploitation.
Mais de toute façon, le système des Conseils est sur le plan de la rapidité des décisions infiniment plus efficace que celui de la hiérarchie bureaucratique, car l'un est vivant et l'autre mort.
Dans les Conseils, les décisions sont le produit de ceux-là mêmes qui seront appelés à les réaliser; elles seront donc automatiquement plus exactes, car plus proches de la réalité. C'est l'élimination immédiate des cloisons bureaucratiques étanches qui enferment toute décision à prendre dans un labyrinthe dont elle ne ressort qu'après de longues et absurdes pérégrinations dans les archives de l'appareil bureaucratique où elle y devient quelque chose de purement formel, d'administratif, donc lourd, lent, émoussé, mort»
De plus, le Conseil est la réalisation même de l'unité du "législatif "et de l'"exécutif". Toute administration de classe implique la division à tous les échelons entre les appareils de "législation" et ceux d'"exécution" du fait de l'existence de classes antagonistes, de groupes bourgeois d'intérêts différents. Les Conseils au contraire, comme organes de la lutte pour l'élimination des classes à travers la prise en mains de toute la vie, de toute l'activité sociale par les travailleurs eux-mêmes, réalisent l'unité inséparable de ces deux moments. Tout Conseil est à la fois délibératif et exécutif. "La Commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, EXECUTIF ET LEGISLATIF A LA FOIS". (K. Marx. La Guerre Civile en France).
L’union de ces deux moments dans un même organisme est le facteur le plus important pour assurer la RAPIDITE réelle des décisions.
L'affirmation qu'une décision est d'autant plus rapide et efficace qu'elle est prise par peu de personnes est un mythe. Sa rapidité et son efficacité sont au contraire en proportion directe de son lien avec la réalité.
On tend souvent à concevoir les rapports d'administration de la société future comme des rapports super-bureaucratiques (Voir par exemple les livres de science-fiction : "1984" de Orwell).
Cela vient du fait que le capitalisme en entrant dans sa phase de décadence prend une forme de plus en plus bureaucratique.
En fait les rapports dans les Conseils seront exactement le contraire des rapports bureaucratiques.
Alors que la bureaucratie se définit par la fixité des charges et par des fonctions hiérarchisées, tout comme leurs revenus, les Conseils se définissent par la révocabilité de celles-là et la répartition des revenus selon les besoins de chacun.
Alors que la bureaucratie est synonyme d'irresponsabilité, le délégué au Conseil est par définition constamment responsable devant ceux qui 1'ont délégué.
Alors que dans le monde bureaucratique, la réalité est mise sous forme de documents inaccessibles, formels, coupés de la vie réelle, le Conseil doit envisager tout problème à résoudre dans sa forme la plus vivante, car tous ses effets doivent être compris et acceptés par l'ensemble des travailleurs qui le forment.
Enfin, à leur différence de buts, il correspond une différence totale de moyens. L'un est l'appareil destiné à faire de chaque travailleur un exécutant inconditionnel et discipliné de la minorité au pouvoir, l'autre est l'organisation de la majorité pour prendre ELLE- MEME en mains sa vie.
Le fait que le capitalisme évolue vers les pires rapports bureaucratiques, antithèse même du socialisme, ne peut d'ailleurs surprendre que quelque piètre réformiste qui pense encore que le socialisme sera le produit d'une lente évolution du capitalisme. C'est au contraire en prenant ses formes les plus réactionnaires, les plus autoritaires, qu'une société en décomposition se prépare au combat final.
Si la contre-révolution en Russie prend la forme de capitalisme bureaucratique d'Etat, ce n'est que parce que les rapports de domination capitaliste ne pouvaient se restaurer contre les Conseils qu'en prenant leur forme la plus contre-révolutionnaire, celle qui permet la domination et l'exploitation la plus violente.
En ce sens, rien n'est plus faux et réactionnaire que l'idée des trotskystes qui voient dans la bureaucratie et le capitalisme d'Etat une sorte de "Bonapartisme" prolétarien, une mauvaise conquête de la révolution russe (mais conquête quand même), et dans la bureaucratie un défenseur "à contre coeur" de la classe ouvrière devant le Capital.
Tout au contraire, comme négation parfaite des régimes capitalistes bureaucratiques, les Conseils se coordonneront entre eux en établissant les rapports les plus démocratiques que l'humanité ait conçus jusqu'à présent.
2 - COMMENT LES CONSEILS ASSURENT-ILS LEUR POUVOIR FACE AUX FORCES DU SYSTEME DONT ILS SONT LA NEGATION ?
L'expérience des différentes luttes révolutionnaires montre que la prise du pouvoir par le prolétariat n'est pas quelque chose d'immédiat, que les Conseils Ouvriers ne se trouvent pas avec le pouvoir en mains dès l'instant de leur formation.
Au contraire, le processus révolutionnaire est tel qu'en général les Conseils se constituent parallèlement à l'appareil d'Etat bourgeois, créant ainsi dans les faits une DUALITE DE POUVOIR. La Révolution est le produit de la victoire du pouvoir des Conseils ouvriers sur celui de l'appareil capitaliste.
Cette lutte se traduit par une série de mesures violentes : expropriations forcées, destruction de l'appareil répressif de la bourgeoisie, défense armée des institutions crées par les Conseils etc...
L'idée de la nécessité de cette violence est parfaitement acquise. Les évènements de Mai-Juin 68 en France et la répression policière à laquelle ils ont donné lieu, ont ouvertement dénoncé ceux pour qui elle était fausse dans les pays développés (Ex. P.C.F.).
Mais si l'idée soi-disant "pacifiste" est parfaitement contre- révolutionnaire, celle qui fait de cette violence la tâche de corps armés détachés, agissant "au nom des travailleurs", sous la direction d'un parti, ne l'est pas moins. De même que le pouvoir de la classe ouvrière ne peut être exercé que par elle-même, la force de son pouvoir, la violence révolutionnaire que la destruction des anciennes structures implique ne peut être que son œuvre propre[5].
Un corps armé détaché des masses tendra obligatoirement, au moindre reflux révolutionnaire, à se constituer en un pouvoir séparé qui finira par s'exercer sur les masses elles-mêmes. A partir du moment où la force de répression est déléguée à un appareil séparé, qui l'exerce, "au nom de la majorité", rien ne peut l'empêcher d'exercer cette violence contre une partie des masses, au nom des masses elles-mêmes (Voir par exemple l'écrasement des grèves de Petrograd et la Commune de Kronstadt en 1921, en Russie).
C'est pourquoi, dès ses premiers grands combats armés de la Commune de Paris, le prolétariat réalise L'ARMEMENT GENERAL DES TRAVAILLEURS. Toutes les armes doivent passer aux mains des travailleurs et ce sont leurs Conseils qui décident de toute action armée.
L'idée blanquiste d'un corps de conjurés qui exerce la violence et-fait la Révolution "au nom des ouvriers" pouvait être considérée au siècle dernier comme une erreur produit du manque de maturité du mouvement ouvrier. Aujourd'hui, elle ne peut être vue que comme la plus pure incarnation de la contre-révolution bureaucratique.
* * *
3 - COMMENT LES CONSEILS ASSURERONT-ILS LA GESTION DE LA PRODUCTION ? (PLANIFICATION ?)
La tâche des Conseils sera de mettre en marche la production en éliminant le profit et la vente, pour parvenir à donner "à chacun selon ses besoins" et à exiger "de chacun selon ses capacités".
Les Conseils se trouveront devant le problème de la nécessité de centraliser au maximum la production d'une part, et d'assurer la liberté de chacun d'autre part» Cette centralisation correspond au besoin de savoir d'une part les montants de la production réalisée, d'autre part les besoins existant dans l'ensemble de la société. Le problème de ce recensement est d'une importance capitale. En Russie, le très faible niveau d'éducation des travailleurs, souvent analphabètes, la situation économique Créée par 1'.invasion militaire du pays et la guerre civile obligeaient à laisser ce travail indispensable à des éléments "instruits" -provenant des anciennes classes exploitantes. Ces couches, ces fonctionnaires, finissaient ainsi par détenir un pouvoir illimité devant la misère et la pénurie qui sévissaient dans la population. Ces fonctions ont constitué une des bases, sinon la base, de la bureaucratie qui finit par s'emparer totalement des leviers de la révolution et par l'écraser.
Aujourd'hui, l'élévation générale du niveau culturel, ainsi que l'existence de machines modernes (ordinateurs, cerveaux électroniques) capables d'enregistrer et classer en quelques secondes des milliers de données simplifient le problème. Mais il reste à savoir qui contrôlera ces machines. Comment se réaliseront les plans ? Quels seront les rapports entre les impératifs d'une planification et les directives des Conseils d’usines ?
C'est là une question fondamentale sur laquelle aucune équivoque ne peut être permise. Il est aujourd'hui commun de considérer la planification comme une mesure "socialiste". Mais est-ce que dans une société capitaliste, la planification peut être autre chose que la planification de l'exploitation capitaliste ? Prétendre que les pays de capitalisme d'Etat, comme la Russie, la Chine, Cuba, etc..., sont des pays socialistes parce qu'ils planifient leur production, c'est se moquer du monde. On en arriverait -comme le font certains trotskystes- à définir un certain pourcentage de socialisme pour chaque pays selon la proportion de l'économie qui est soumise à la planification étatique...
Ce n'est pas parce que les Conseils se serviront de la planification que planifier veut dire être socialiste. Au contraire, plus les capitalistes planifient, plus ils perfectionnent leurs méthodes d'exploitation.
La planification à laquelle procéderont les Conseils Ouvriers n'a rien à voir avec la planification actuelle, ni par ses buts, ni par ses moyens. Aujourd'hui, la planification sert à calculer les marges de profit maximum, la rentabilité des capitaux, à organiser les moyens pour mieux extirper du travail avec des salaires minimums, à calculer la quantité de produits à détruire pour assainir le marché, etc... En un mot, elle sert à "rationaliser" l'exploitation. Elle est élaborée à travers les secrets commerciaux, les groupes de pression, le chantage économique, la collaboration des organisations syndicales[6] ...
Le but de la planification que réaliseront les Conseils sera au contraire de permettre la distribution de la production par les travailleurs eux-mêmes. Etant le moyen pour COORDONNER l'action de tous les Conseils, la planification doit être leur oeuvre. En aucun cas elle ne pourrait se concevoir comme étant élaborée à l'extérieur et donc s'imposant à eux.
Comment pourront alors s'organiser les Conseils pour réaliser cette planification ? Il semble qu'il y ait un moyen parfaitement réalisable avec les techniques présentes: c'est ce que Pierre Chau- lieu appelle "l'Usine du Plan" ("Le Contenu du Socialisme" dans la revue "Socialisme ou Barbarie"). Ce serait un centre unique pour tous les pays, équipé ordinateurs. Il aurait à enregistrer de façon permanente les données des besoins et des possibilités de production dans tout le territoire. D'une part les directives et souhaits de tous les Conseils (d'usines, de quartiers, de villes, de régions, etc...), d'autre part les données spécifiant les possibilités de chaque centre de production.
Sa tâche serait de coordonner ces deux séries d'informations, de préparer les plans de réalisation qui permettent la satisfaction des besoins en assurant la plus grande harmonie entre toutes les activités économiques.
Avec un groupe de données, l'"Usine du Plan" préparerait plusieurs plans qui seraient soumis à l'ensemble des Conseils pour qu'ils en choisissent un.
Ce centre serait organisé comme n'importe quel autre centre de production. Les personnes qui y travaillent, travailleurs comme les autres, seraient organisées en un Conseil lié à tous les autres Conseils du pays. Ce serait un centre de production comme un autre qui produirait des plans au lieu de produire des avions ou des machines à laver... La planification cesse d'être une activité "spéciale" parce qu'elle perd son caractère d'arme politique de minorité qu'elle a dans le régime capitaliste. A travers l'Usine du Plan, elle devient réellement le résultat des directives de tous Conseils pour leurs propres besoins.
"Les travailleurs ne comprendront pas les données techniques nécessaires à la planification" diront les planificateurs actuels. Le problème est posé du point de vue borné et stupide du petit technocrate de cette société. Dans l'économie capitaliste, la planification est basée sur de "savants" calculs de profits, de rentabilité, de publicité, de marchés, toutes choses qui doivent rester le patrimoine sacré des capitalistes et de leurs techniciens , car elles planifient les moyens d'exploitation de la société. Dans de nouveaux rapports de production, la planification aura comme objet les besoins réels et l'activité des producteurs eux-mêmes. Or, qui peut mieux les comprendre sinon les travailleurs. De plus, une telle planification sera du point de vue technique infiniment plus simple et rationnelle que la planification présente. En effet, elle n'aura plus à osciller entre les deux écueils auxquels se heurte tout calcul de perspectives, actuellement: ou bien les profits sont insuffisants, et c'est la crise; ou bien on produit trop, et c'est aussi la crise. La nouvelle production aura simplement à éviter des excès de travail ou des risques de sous-consommation. Elle sera donc une simple harmonisation rationnelle et non plus un casse-tête d'autant plus complexe qu'il est "aberrant".
Même si du fait du bas niveau culturel que la classe ouvrière hérite du capitalisme, certains côtés techniques de la planification devaient être laissés à des techniciens spécialisés, d'une part ceux-ci ne travailleraient que sur les ordres et les données du reste des Conseils, d'autre part l'information serait parfaitement possible au niveau des faits réels, des effets de chaque proposition de planification.
Nous n'avons pas voulu définir un projet précis de planification mais montrer qu'il est possible de réaliser aujourd'hui une planification qui soit l'oeuvre de tous.
Il ne s'agit pas non plus de nier les difficultés réelles que rencontrera le prolétariat, au début de la révolution, pour entreprendre la gestion de la vie économique.
Le prolétariat sort du capitalisme encore entaché de préjugés et de tares qui ne disparaîtront pas du jour au lendemain. De plus ce n'est pas instantanément qu'il élèvera son faible niveau d'instruction.
Au contraire de la bourgeoisie, en conquérant les pouvoirs, le prolétariat ne possède aucune préparation historique à la gestion de la société. Quand la bourgeoisie s'est emparée du pouvoir politique en éliminant les structures féodales, elle possédait déjà des siècles d'expérience économique ; elle s'était développée comme classe dirigeante à l'intérieur de la société féodale en réalisant déjà la gestion de l'économie capitaliste. La révolution bourgeoise ne fut ainsi fondamentalement que l'élimination de la super-structure politique de la féodalité. L'infra-structure économique, la forme de production capitaliste avait déjà des bases solides.
Le prolétariat au moment de sa prise du pouvoir ne possède aucune expérience préalable; il devra en plus entreprendre des transformations beaucoup plus importantes que celles qu'eut à réaliser la bourgeoisie.
Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le prolétariat ne pourra dépasser ses faiblesses, son manque d'expérience qu'à travers sa propre expérience ; qu'il ne pourra être à la hauteur de ses tâches qu'en se mettant à la pratique vivante. C'est à travers ses propres erreurs et réalisations qu'il parviendra à combler son manque de préparation historique. Personne, aucun groupe ni couche ne peut acquérir cette expérience à sa place. Pour cela, les conditions objectives fondamentales, les éléments techniques et économiques de la solution EXISTENT, et c'est cela qui est primordial.
LES PREMIERES MESURES...
Il sera vital pour le sort de la Révolution que dès les premiers moments, le prolétariat entreprenne immédiatement un premier plan provisoire. Celui-ci sera le moyen de coordonner les premières mesures économiques de la révolution.
Il est évident que de la rapidité et l'harmonie avec lesquelles ces mesures seront prises, peut dépendre le sort de la révolution. En effet, ces premières mesures auront comme but immédiat de rompre au plus vite les ponts qui constituent les fondements de l'économie capitaliste. C'est seulement en les brisant que la révolution pourra assurer sa marche en avant et son ré-affermissement. Or, ce sont des mesures aussi importantes qu'elles s'étendent à tous les secteurs de la vie sociale. Elles devront donc pour être effectives se faire dans la coordination la plus parfaite, d'où l'urgence de ce premier plan.
Quelles sont ces mesures économiques générales ?
Les expériences des luttes du prolétariat et la nature même des tâches de la révolution, font qu'elles se regroupent fondamentalement autour de deux mesures essentielles : 1°. La suppression de toute propriété sur les moyens de production, 2°. L'abolition du salariat.
C'est la lutte pour la réalisation de ces deux mesures fondamentales qui constitue ce que Marx appelait la "période de transition" du capitalisme au communisme, ou plutôt la "première phase" du communisme.
Derrière l'expression "période de transition", on a camouflé de nombreuses formes de capitalisme. On a tenté de faire passer les moindres transformations superficielles de quelques éléments du système capitaliste, pour des mesures de transition vers le socialisme. On a vu combien toutes ces mesures (nationalisations, planification, actionnariat ouvrier, co-gestion, contrôle ouvrier, etc...) n'étaient en fait que des moyens pour renforcer le système existant.
La période de "transition" vers le socialisme ne peut être que la période de destruction des anciennes structures politiques et économiques et de construction des bases de la nouvelle société.
C'est pourquoi, elle ne peut être autre que celle où le prolétariat entreprend l'élimination définitive de tout contrôle ou propriété sur les moyens de production et la suppression du salariat.
Rien n'est plus dangereux que l'affirmation selon laquelle il ne faut pas envisager ces mesures trop tôt, car ce serait vouloir "brûler les étapes" et par là plonger la société dans un désordre total. De la réalisation de ces mesures au plus vite dépend la possibilité d'émancipation réelle des travailleurs. C'est dès les premiers pas de la révolution que TOUT doit être entrepris pour leur réalisation. Elles sont la base et ont en elles le contenu même de la révolution. Les envisager comme quelque chose de lointain, de perdu dans les nuages de l'avenir, a toujours été l'attitude de ceux qui ne voulaient que défendre et maintenir les structures de la société présente.
***
1°/ L'ELIMINATION DE TOUTE PROPRIETE PRIVEE SUR LES MOYENS DE PRODUCTION.
Cela veut dire l'expropriation forcée de tous les capitalistes et principalement du plus important: l'Etat capitaliste (ce dernier devant être détruit). En aucun cas il ne s'agirait d'une "nationalisation" telle qu'elle est comprise aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire changer les moyens de production de propriétaire en donnant à un ensemble de bureaucrates les pouvoirs des bourgeois privés, mais de placer TOUS LES MOYENS DE PRODUCTION SOUS LA GESTION TOTALE ET INTEGRALE DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS CONSEILS.
Les usines, leur existence; l'orientation, la quantité et les modalités de la production doivent dépendre uniquement et exclusivement de la volonté des travailleurs. C'est à eux de tout décider.
C'est seulement en éliminant le pouvoir de toute minorité sur les moyens de production, que ceux-ci cesseront d'être un moyen d'exploitation des travailleurs. Que ces minorités s'emparent de ce contrôle sous des prétextes d'appartenance à un parti ou parce qu'elles possèdent des connaissances quelconques, cela rie change rien au problème.
Le problème des techniciens-cadres ne peut plus être envisagé aujourd'hui selon le schéma classique : technicien-cadre = allié du patron.
La décadence historique du capitalisme se traduit par une tendance au remplacement de la vieille bourgeoisie privée par une bourgeoisie technocratique salariée (tendance au capitalisme d'Etat). Ainsi, une fraction des cadres est dans les faits, ou devient une forme de la bourgeoisie ; salariés de l'Etat, ces cadres ne sont plus les "alliés du patron", mais des patrons eux-mêmes.
Mais d'un autre côté, le système capitaliste a fait atteindre un tel degré de décomposition à la vie quotidienne, qu'une plus grande fraction des classes moyennes (techniciens, cadres, etc...) tend aujourd'hui plus facilement à se rallier à la lutte contre le système. L'agitation des étudiants dans le monde entier en est une expression certaine. Il est aussi intéressant de noter l'attitude révolutionnaire des centres scientifiques comme celui de Saclay pendant les évènements de Mai-Juin 1968.
Il est donc permis de penser, que lors de la prochaine révolution, les couches de techniciens nécessaires à la mise en marche de la production moderne passeront plus facilement du côté de la révolution.
Mais là encore, ce qui reste fondamental, c'est l'action de la classe ouvrière. C'est seulement si elle entreprend des transformations réelles en rendant impossible tout retour au capitalisme, toute domination de minorités, que ces couches se rattacheront réellement à son combat.
--------------------
Quant à l'élimination de la propriété privée sur la terre, c'est là un problème plus complexe du fait de l'existence du petit propriétaire paysan. Nous en parlerons plus loin.
-------------------
***
2°/ LA SUPPRESSION, DU SALARIAT
Capital sous-entend salariat. L'élimination de toute propriété privée sur les moyens de production-implique obligatoirement l'élimination de la vente et de l'achat de la force de travail, c'est-à- dire la suppression du salariat.
Le bénéfice du capitaliste vient de la différence existant entre la VALEUR DE LA FORCE DE TRAVAIL et le TRAVAIL que cette force peut CREER. La valeur de la FORCE DE TRAVAIL est égale à la quantité de travail SOCIALEMENT nécessaire pour sa reproduction. C'est-à- dire, le travail nécessaire pour créer tous les biens de consommation nécessaires à. l'entretien et la reproduction de cette force. (Habits, logements, nourriture, etc..., déterminés selon les "habitudes sociales").
Cette force de travail a la particularité de pouvoir créer, en une journée par exemple, une quantité de valeur SUPERIEURE à la sienne. Cela veut dire qu'un ouvrier, travaillant toute une journée, peut grâce à sa force de travail, créer la valeur des biens de consommation qui lui sont nécessaires pour se maintenir (valeur de sa force de travail) PLUS UNE QUANTITE DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE.
Il y a donc à distinguer deux notions: l'une, LA FORCE DE TRAVAIL, l'autre, LE TRAVAIL que celle-ci peut réaliser. Leurs valeurs sont différentes. Le bénéfice du capitaliste qui achète la force de travail de l'ouvrier, vient justement du fait qu'il s'approprie du TRAVAIL de l'ouvrier alors qu'il ne paye que la valeur de SA FORCE DE TRAVAIL. Cette différence entre ces deux valeurs est ce que Marx appelait la PLUS-VALUE.
Le SALAIRE, est la valeur de la FORCE DE TRAVAIL: il est la somme que paye le capitaliste à l’ouvrier pour acheter la force dont il a besoin pour mettre en marche les moyens de production qu'il détient
A partir du moment où ces moyens de production cessent d'être la propriété des capitalistes (patrons privés ou Etat), à partir du moment où Capital et capitalistes sont éliminés et que la production devient l'œuvre des travailleurs LIBREMENT ASSOCIES, personne ne peut acheter, ni vendre, la force de travail.
Celle-ci perd dans les faits son caractère de MARCHANDISE. Et sa valeur comme telle -LE SALAIRE- est appelée à disparaître immédiatement.
L'élimination de la propriété sur lés moyens de production est ainsi suppression de toute possibilité d'appropriation de la force de travail d'autrui: c'est la suppression du salariat.
Comment se fait alors la distribution de la production puisque les critères de distribution capitaliste disparaissent ?
Il est évident qu'à un changement des modes d'appropriation des moyens de production correspond obligatoirement un changement radical des modes de production. La "distribution" n'est elle-même qu'un moment du processus général de la production.
Ainsi, à une appropriation des moyens de production par l'ensemble des travailleurs correspondra au début, (tant que l'abondance n'est pas encore suffisante, tant que le travail reste une activité pénible) une distribution proportionnelle au temps de travail de chacun.
Pour cela, la mesure toujours mise au premier plan par le prolétariat depuis la Commune de Paris de 1871 a été "L'EGALITE DES "SALAIRES"". C'est-à-dire que ingénieur ou ouvrier illettré ont droit à une même quantité de produits pour un même temps de travail réalisé, ou pour avoir exécuté la tâche que leur Conseil leur a donné.
Cette distribution devra se faire par l'intermédiaire de BONS individuels, valables pour une durée limitée (de façon à éviter toute possibilité d'accumulation). Chaque producteur "reçoit de la société un bon constatant qu'il a fourni tant de travail (défalcation faite du travail effectué pour les fonds collectifs[7]) et, avec ce bon, il retire des stocks sociaux d'objets de consommation autant que coûte une quantité égale de son travail. Le même quantum de travail qu'il a fourni à la société sous une forme, il le reçoit d'elle, en retour, sous une autre forme." (Marx. Critique du Programme de Gotha).
Mais ce droit, cette forme de distribution de la production reste encore grevée d'une limite bourgeoise dans la mesure où la distribution est faite PROPORTIONNELLEMENT au travail réalisé.
Marx explique que ce n'est un droit "égal" que dans la mesure où il est basé sur l'emploi d'une unité de mesure commune. Mais, les individus étant inégaux ("et ce ne serait pas des individus distincts s'ils n'étaient pas inégaux"), les uns étant plus doués ou plus forts que les autres, les uns ayant des besoins plus grands que les autres (Ex : l'un est marié, l'autre, non ; l'un a des enfants, l'autre, non...) ce droit "égal" se traduirait par des inégalités selon les individus.
"Pour éviter tous ces inconvénients, le droit devrait être non pas égal, mais inégal".
C'est seulement lorsque la distribution et la production se feront selon les critères "de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins" qu'une véritable égalité existera ; c'est seulement alors que la révolution aura atteint réellement ses buts.
Mais une telle distribution ne sera possible que lorsque "auront disparu l'asservissante subordination des individus à la division du travail et, avec elle, l'opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel; quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin vital; quand, avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles aussi et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance" (Marx. Critique du Programme de Gotha).
En sortant de la société capitaliste, toutes ces conditions sont encore à réaliser.
La soi-disant société "d'abondance" actuelle, n'est "d'abondance" que par rapport aux lois capitalistes; elle est une société "de pénurie" par rapport aux besoins économiques des hommes. Et au lendemain de la prise de pouvoir par le prolétariat, cette pénurie ne sera pas disparue instantanément; c'est au Conseil qu'il incombera de la dépasser définitivement.
D'autre part le travail, immédiatement après que la société soit sortie du capitalisme restera encore une activité pénible. C'est pourquoi dans cette phase, les Conseils devront garder un critère économique de distribution des biens. Et ce critère, produit des besoins imposés par les traces de la société capitaliste, portera encore les stigmates de la bourgeoisie.
Il serait irréel de nier la nécessité de cette première période, de cette période de "transition".
- "Le droit ne peut jamais être plus élevé que l'état économique de la société et que le degré de civilisation qui y correspond"
(Karl Marx. Critique du Programme de Gotha).
Mais rien ne serait plus dangereux que de ne pas voir cette période comme une TRANSITION, la plus courte possible.
Elle n'est qu'un début et comme tel, elle doit déjà comprendre toute une série de transformations qui correspondent à la société communiste déjà développée.
Ainsi, dès les premiers jours, il faudra que TOUT ce qui constitue des services communs à tous (transports, éducation, santé, hôpitaux, loisirs -dans la mesure où ce mot garde un sens- , presse, etc...) puisse fonctionner sans règle économique quelconque.
Ce secteur, libéré de toute loi économique devra s'accroître systématiquement dans, la mesure du possible jusqu'à englober toute la production sociale, jusqu'à la fin de l'économie, jusqu'à la "fin du règne de la nécessité" qui ouvrira les portes au "début de l'histoire" (Engels).
A entendre parler de l'égalité des salaires ou de leur élimination pure et simple, tous les défenseurs du système ont les cheveux qui se dressent et hurlent encore: "A l'utopie! Au crime! Il faut être réaliste ! Etc...".
Ainsi par exemple, Staline en parlant de l'égalité des salaires au XVIII° Congrès de 1934 disait que c'était "une absurdité réactionnaire, petite bourgeoise, digne d'une secte primitive d'ascètes, mais pas d'une société socialiste, organisée selon des principes marxistes". Il lui opposait évidemment une échelle hautement différenciée, des récompenses matérielles pour le travail, afin d'encourager l'habileté et la compétence. (Quant aux "principes marxistes", nous avons déjà vu quelle était l'opinion de Marx à ce sujet).
L'idée généralement avancée pour justifier les salaires et surtout, la différenciation de ceux-ci, est que "sans contrainte matérielle, les hommes ne travaillent pas", de plus "en éliminant la concurrence matérielle entre les hommes, et donc entre les entreprises et les nations, le progrès s'arrêtera".
Le capitalisme en donnant naissance à la société la plus inhumaine a créé les organes d'oppression et de contrainte les plus perfectionnés qu'on ait jamais connus: Etat, police, écoles, presse ou télévision, tout dans cette société est devenu un organe d'oppression. Comment demander alors à un défenseur du capitalisme de concevoir un instant un monde sans contraintes ? Réduisant tout ce qui existe, et fondamentalement la force de travail au rôle de marchandise, le capitaliste finit par ne plus pouvoir imaginer qu'un homme puisse trouver quelque bonheur à réaliser une activité sans se vendre. Pourtant, ils savent bien profiter du besoin des hommes de réaliser des activités dont ils ont, au moins, l'illusion que ce sont des activités qu'ils exercent POUR LEUR PLAISIR, simplement parce qu'il s'agit d'un travail qui n'est pas destiné à leur être volé et retourné contre eux. Ainsi par exemple, les capitalistes américains ont découvert qu'un bon "truc" pour vendre certains appareils électroniques était de les vendre en pièces détachées laissant à l'acheteur le loisir de les monter lui-même.
De même dans tous les pays industrialisés, se sont développées vertigineusement les industries produisant des outils de "bricolage", car le bricolage est, justement, une activité "gratuite", que l'on fait simplement pour le plaisir de créer et d'être maître de son activité, de sa vie, ne fut-ce que pendant quelques instants.
Que l’on songe aux réalisations extraordinaires que pourra faire l'humanité le jour où elle aura à sa disposition tous les moyens de production aujourd'hui sous le contrôle des classes exploitantes, le jour où, par la disparition des minorités dirigeantes, "le travail sera devenu non seulement le moyen de vivre mais encore le premier besoin de la vie. Alors, le soi-disant "progrès" de la société actuelle, qui est fait en fonction des profits du capital, qui mène à l'aberration permanente des "brevets" d'invention, qui -se vendent et s'achètent, surtout pour empêcher qu'une nouvelle invention ne vienne plonger dans la faillite une entreprise capitaliste qui en employait une autre plus ancienne; ce soi-disant "progrès" qui plonge chaque jour une fraction plus grande de l'humanité dans la misère, laissera place au seul progrès possible: celui où tous les hommes seront maîtres de leur existence. Les bourgeois et bureaucrates ne font que s'élever contre l'idée qu'on puisse travailler sans se vendre. Et cependant, ils n'ont fait que créer et cultiver des mythes comme "la Patrie", "la Révolution", "l'Honneur", l'adoration du chef (Führer, "Père du Peuple", "Grand Chef, grand guide, grand pilote", "Oncle Hô", etc...), pour tenter de trouver un encouragement au travail autre que celui du salaire.
Toute cette opposition à l'élimination des salaires et des revenus- différenciés se résume en réalité, simplement à ceci: ne pas supprimer les revenus des exploiteurs. La profondeur de ce soi-disant "réalisme" s'arrête là.
Le problème de "l'encouragement" au travail n'a un sens que pour les capitalistes cherchant à augmenter la productivité de la force de travail qu'ils achètent.
Le problème pour les Conseils sera au contraire de réduire immédiatement le temps de travail, de supprimer le caractère aliénant de celui-ci dans la société actuelle, tout en élargissant la production.
Toute société et tout système économique sont appelés à élargir la production. Une différence distingue cependant cet élargissement de la production dans le capitalisme et dans le socialisme et cette différence est FONDAMENTALE. Pour le premier, l'élargissement est un but en soi ayant pour mobile l'accroissement du Capital. La consommation des producteurs n'est qu'un "pis-aller", un moment désagréable, des frais inévitables du processus de la production. Ainsi, il tend à la réduire autant qu'il peut. Pour le second, la production a pour but la satisfaction des besoins des producteurs. Elle lui est entièrement subordonnée. Le rythme de l'élargissement de la production est déterminé et LIMITE par la satisfaction des besoins immédiats.
Le point de départ de tout ce processus d'élargissement n'est pas donné par la recherche du plus grand rythme mais par les degrés de satisfaction à atteindre immédiatement.
La taille de la tâche à entreprendre, la complexité des problèmes auxquels sa réalisation se heurtera, le faible nombre d'expériences réalisées, et 1'insuffisance de celle dont on dispose font du problème de l'organisation de la production par les Conseils une question extrêmement complexe.
Nous n'avons prétendu résoudre en rien, ni même soulever tous les problèmes qui se poseront sur ce plan[8], mais simplement insister sur
le fait que leur résolution est possible et nécessaire, et dénoncer (en en donnant les traits fondamentaux) tous ceux qui tentent de présenter la nouvelle société comme un capitalisme avec de meilleurs salaires et des technocrates à la place des capitalistes privés.
* * *
4 - COMMENT AGIRONT LES CONSEILS DES VILLES ENVERS LES CONSEILS DES CAMPAGNES ?
Dans la société actuelle, la séparation de la ville et de la campagne se double d'une opposition sur le plan économique (le prolétariat mène un combat contre la hausse des prix des moyens de subsistances, parmi lesquels les produits agricoles, alors que les producteurs de la campagne mènent au contraire un combat contre la chute des prix de leurs produits).
Or, la révolution ne peut atteindre ses objectifs qu'en réalisant l'union entre la ville et la campagne, entre industrie et agriculture, entre ouvriers et paysans.
Comment devront agir les Conseils des villes pour réaliser cette union ? Il faut d'abord distinguer dans la campagne les grandes propriétés utilisant le travail salarié des petites propriétés familiales.
I. LES GRANDES PROPRIETES AGRICOLES
Elles sont aux mains de grands propriétaires terriens exploitant des travailleurs salariés, des prolétaires agricoles. Le problème de la révolution se pose dans les mêmes termes qu'à l'usine de ville. A la lutte dans les villes pour la conquête des moyens de production, correspond dans la campagne la lutte des ouvriers agricoles pour la collectivisation des terres et leur mise en gestion par leur propre Conseil. Ce ne sont que deux aspects géographiques de la même lutte, de la même classe. Une fois prises en charge par les Conseils, ces terres collectivisées deviendront des centres de production comme n'importe quelle usine.
Il est ici important de noter qu'en aucun cas la répartition des grandes propriétés agricoles en petites propriétés ne constitue une mesure valable. Comme disait Rosa Luxembourg, en critiquant cette mesure entreprise par les bolcheviks en Russie 1917 : "Non seulement ce n'est pas une mesure socialiste, mais elle coup e le chemin qui y mène, elle accumule, devant la transformation des conditions de l'agriculture dans le sens socialiste des difficultés insurmontables". (La Révolution Russe). C'est une mesure qui, au lieu de créer les conditions pour la réalisation du socialisme, perpétue et ACCROIT la propriété privée sur les moyens de production, créant ainsi des milliers de nouveaux opposants à la révolution.
II. LES PETITES PROPRIETES AGRICOLES
Le problème est autrement plus ardu lorsqu'il s'agit de la collectivisation des terres qui sont aux mains des petits propriétaires, n'employent pas le travail salarié.
Ces petits propriétaires, tirant leurs revenus de la terre qu'ils possèdent, sont fermement attachés à la propriété privée et donc tendent à s'opposer à toute idée de collectivisation et par là à la révolution.
Il faut cependant distinguer nettement les petits propriétaires pauvres des petits propriétaires riches. En effet, l'expérience démontre que selon leur richesse, ces petits propriétaires ont une attitude totalement différente face à la révolution de la classe ouvrière.
Dans les pays sous-développés, par exemple, où il existait un petit paysannat pauvre, celui-ci a pu devenir, un allié du prolétariat dans la lutte. C'est le cas du paysannat russe en 1917, ou des paysans espagnols en 1936-37 qui collectivisèrent souvent spontanément leurs terres.
Aussi le prolétariat de ces pays parlait de l'alliance paysans- ouvriers pour la révolution car elle s'imposait d'elle-même dans les faits.
Mais le problème est différent lorsqu'il s'agit de petits propriétaires riches. Ceux-ci tendent à s'opposer à la révolution avant et après la prise du pouvoir par le prolétariat. Ainsi par exemple en Russie, après la répartition des terres par les bolcheviks, il se créa toute une couche de paysans riches qui s'opposèrent à toute collectivisation. La même attitude est en général celle des petits propriétaires souvent assez riches dans les pays industrialisés. C'est ce qui explique qu'on ne retrouve que très rarement envisagée l'alliance paysans-ouvriers par les révolutionnaires européens (Gauche Hollandaise, Gauche Allemande...).
Cependant, dans les pays industrialisés comme dans les pays sous- développés, la question de l'union de la ville et de la campagne est fondamentale pour l'avenir de la révolution.
Comment le prolétariat peut-il s'attaquer à ce problème ?
La mesure stalinienne de la "collectivisation" forcée est évidemment à rejeter. Staline avait "collectivisé" les terres des petits propriétaires par la force armée en envoyant des millions de paysans dans des camps de concentration en Sibérie. Mais il ne s'agissait pas d'une mesure socialiste ni d'une collectivisation des terres par les travailleurs. Ce n'était que la réalisation forcée de la tâche bourgeoise d'intégration de la campagne dans des relations purement capitalistes. Les terres ainsi "collectivisées" passèrent non pas aux mains des travailleurs agricoles organisés en Conseils, mais à celles de l'Etat capitaliste russe et de sa bureaucratie.
La "collectivisation" forcée est un moyen qui correspond étroitement aux buts d'une classe exploitante, à la réalisation de l'accumulation primitive du Capital. Elle n'a rien à voir, ni de loin ni de près, avec la révolution socialiste.
Le moyen envisagé par les révolutionnaires pour amener les petits propriétaires à collectiviser leurs terres et s'organiser en Conseils a toujours été celui de la persuasion conséquente par l'explication et l'exemple constructif des collectivisations réalisées. C'est en montrant dans les faits et en expliquant les avantages de la collectivisation, que les révolutionnaires amèneront les petits propriétaires paysans à comprendre l'intérêt qu'ils ont à se rallier à la révolution en mettant leurs terres en commun. Cette méthode reste aujourd'hui la seule valable, mais le problème se trouve simplifié pour plusieurs raisons.
- En évoluant, le capitalisme a remplacé dans la plupart des pays la petite propriété agricole par l'exploitation extensive de grandes propriétés, employant une main d'oeuvre salariée et permettant l'utilisation de machineries agricoles.
- Actuellement, le petit propriétaire agricole est beaucoup plus dépendant de la production industrielle (engrais chimiques, électricité, tracteurs, etc...), ce qui vis à vis du prolétariat lui donne une force moindre d'opposition et le pousse au contraire à la collaboration.
- Ce qui a constitué souvent la base de l'opposition présentée par le paysannat à la révolution et au prolétariat des villes, c'est le fait que ce dernier devait la plupart du temps demander à la campagne les moyens de subsistances 'sans rien apporter, ou très peu, en contrepartie (Russie 1917, 1918,...).
Dans les pays développés, avec les techniques de production actuelles, le prolétariat peut apporter non seulement une contre-partie équivalente, mais encore bien supérieure au nécessaire. La base de cette opposition se trouve ainsi rompue.
- Avec les moyens de communication et d'information actuels (radio, télévision, etc...) l'isolement de la campagne par rapport à la ville est beaucoup moins marqué qu'il ne l'était autrefois. De ce fait, la compréhension par la campagne des expériences de la ville se trouvera immensément accélérée.
Le problème de cette petite bourgeoisie paysanne est le même à grands traits, que celui de la petite bourgeoisie commerçante. Là encore, c'est seulement en présence des transformations réelles de la nouvelle société, devant la nécessité de s'adapter aux nouvelles structures que le prolétariat créera que ces couches se rattacheront à la révolution.
* * *
5 - COMMENT AGIRONT LES CONSEILS ENVERS LES PAYS QUI RESTENT SOUS LA DOMINATION CAPITALISTE?
Le capitalisme étant un système mondial, la révolution prolétarienne ne peut atteindre ses objectifs qu'à l'échelle mondiale. Elle n'a de sens réel qu'envisagée internationalement. La lutte du prolétariat contre le capitalisme en un pays ne peut être qu'un MOMENT de la lutte générale de la classe ouvrière mondiale.
L'interdépendance de tous les Etats capitalistes est telle que le prolétariat ne peut pas maintenir son pouvoir en un seul pays. La production de n'importe quel pays dépend des autres pays et pour son approvisionnement en matières premières et pour ses débouchés. Par suite, la socialisation véritable des moyens de production ne peut se réaliser dans un pays si elle né l'est pas internationalement.
Le prolétariat aura -comme classe possédante des intérêts et des buts internationaux- en éliminant toute appropriation des moyens de production par des minorités étalés plaçant sous la gestion de tous les travailleurs, à éliminer les cadres des frontières nationales devenus depuis longtemps trop étroits.
"La question des relations internationales nous paraît essentielle, non seulement parce que l'impérialisme signifie désormais l'interdépendance ferme et durable de tous les Etats du monde en un système unique -pour ne pas dire en un tas de boue et de sang- mais encore parce que la victoire socialiste ne se conçoit pas en un seul pays mais exige la collaboration la plus active de plusieurs pays avancés tout au moins..." (Lénine. 6-9 Novembre 1918. Discours au VI° Congrès des Soviets).
La dégénérescence de la révolution russe puis la contre-révolution qui s'en suivit, conséquence fondamentale de l'échec de la révolution dans les autres pays du monde, ont été la confirmation la plus sanglante de cette vérité. Sous la couverture du "socialisme en un seul pays", le capitalisme a repris tous ses droits en Russie, sous sa forme la plus opprimante: celle du capitalisme d'Etat.
C'est pourquoi, dès les premiers moments de la prise de pouvoir par les Conseils dans un pays, ils doivent orienter tous leurs efforts vers la solidarité la plus intégrale avec le prolétariat en lutte dans les autres pays. Ils possèdent pour cela le plus grand des atouts: celui de l'exemple. Ainsi à la solidarité matérielle en armes ou produits, doit s'ajouter la communication permanente de toutes les mesures qu'ils réalisent et le sens de leur contenu.
Aujourd'hui, cette tâche fondamentale sera infiniment plus simple à réaliser qu'elle ne le fut lors de la dernière grande vague révolutionnaire internationale, celle de la fin de la 1° Guerre Mondiale. En effet, le développement des moyens de communications est tel que rien d'important ne peut se produire dans le monde sans que la planète entière en soit informée. C'est aujourd'hui une banalité de constater le rôle fondamental que ces moyens peuvent jouer pour la révolution. Mais nous sommes encore trop imprégnés des images de la vague révolutionnaire d'il y a 50 ans ou de celle des révolutions qui ont éclaté isolément à des moments où, de par la situation mondiale, elles ne pouvaient rester que des îlots isolés (Chine 1927, Espagne 1936-37, Pays de l'Est 1953-56).
Un autre élément permet de dire que la prochaine révolution prolétarienne connaîtra une expansion internationale beaucoup plus forte que toutes celles auparavant. C'est l'accroissement immense de l'interdépendance des économies des différents pays.
La révolution n'éclate pas un beau jour parce que tout d'un coup les ouvriers d'un pays décident instantanément de "faire la révolution". Ce n'est pas non plus l'influence de quelques hommes organisés qui en quelques jours persuade des millions d'hommes et leur communique une "fièvre révolutionnaire". La révolution prolétarienne, qui implique la prise de conscience de millions de travailleurs en même temps est toujours le produit d'un processus long qui place L'ENSEMBLE de la classe ouvrière dans des conditions qui l'oblige à agir en classe révolutionnaire. Ce processus est en général celui d'une décomposition de ses conditions de vie, devenues plus insupportables que d'habitude, produits elles-mêmes d'une crise du système ou d'une guerre -ce qui est la même chose.
Or, une crise économique éclatant aujourd'hui dans n'importe quel pays, devient immédiatement mondiale. La crise qui a donné naissance à la guerre de 1914-18, ou la crise de 1929 qui aboutit à la II° Guerre mondiale ont montré à quel point, dans le capitalisme décadent, toute crise économique est obligatoirement internationale. Or, depuis 1914-18, depuis 1929, 1939-40, les économies des différents pays n'ont fait que s'entrelacer de plus belle. Il suffit de voir les effets mondiaux de la petite dévaluation de la Livre Sterling en 1967...
Si la crise de 1929 n'a mis que quelques mois pour s'étendre au monde entier, la prochaine ne prendra que quelques semaines et son intensité sera cent fois plus importante, car toutes les solutions artificielles que, depuis la dernière guerre, le capitalisme a tenté d'utiliser pour pallier à sa crise, arrivent aujourd'hui à leur fin, à l'Est comme à l'Ouest.
C'est dans cette internationalisation obligatoire des conditions qui poussent le prolétariat dans la prise de conscience révolutionnaire que se trouve la clé fondamentale de la possibilité de la révolution mondiale. C'est là son fondement scientifique.
La prochaine révolution sera certainement la réponse du prolétariat à la crise dans laquelle vient d'entrer à nouveau le capitalisme et dont la crise de la Livre, celle du Dollar, celle du Franc, l'accroissement général du chômage, le déficit croissant des balances commerciales, la récession que connaît la plupart des pays développés, ne sont que les premiers symptômes. Elle s'annonce déjà avec tout son caractère international par la multiplication des luttes ouvrières et étudiantes dans le monde entier (De la France à l'Uruguay, de l'Italie au Canada, de l'Inde au Brésil...).
Le premier prolétariat du monde qui prendra le pouvoir dans son pays, jouira immédiatement pour sa tâche de la plus grande effervescence révolutionnaire que l'histoire aura jamais connue.
* * *
- III - LES DEFORMATIONS BUREAUCRATIQUES DE L'IDEE DES CONSEILS.- Les courants de pensée bureaucratiques (Staliniens, Castristes, Maoïstes, et Trotskystes) ne voient et ne peuvent voir l'importance des Conseils. Pour eux, le problème n'est pas celui de la forme d'auto-organisation de la classe, mais celui de l'organisation de l'"avant-garde" qui doit la diriger.
Pour les staliniens déclarés (P.C.F., pro-chinois, castristes), le problème ne se pose pas, et ils ne savent, pour la plupart, môme pas de quoi il s'agit. C'est normal : dans tous ces pays du bloc soi- disant socialiste, il n'y a pas de Conseils Ouvriers ni quelque chose qui leur ressemble (Dans quelques pays de l'Europe de l'Est, on donne ce nom à des organisations de participation). Si les bureaucraties qui y exercent leur dictature ont eu quelques contacts avec des Conseils Ouvriers, ce fut lors des insurrections ouvrières qu'ils ont écrasées en Russie 1921, Chine 1927, Espagne 1936, Allemagne de l'Est 1953, Pologne, et Hongrie 1956.
Avec eux, comme avec les démagogues du P.S.U., qui se réclament des expériences de ces pays (du moins lorsque le vent dans la salle où ils parlent souffle de ce côté-là), il n'y a donc pas de discussion possible.
Les trotskystes sont plus nuancés : tout en se disant "anti-stalinien", ils défendent le "caractère ouvrier" de ces Etats qu'ils appellent "Etats ouvriers dégénérés" ; (suivant les fractions trotskystes, le nombre de ces Etats serait plus ou moins grand ; les plus "radicaux" arrivent à considérer qu'un seul de ces Etats, la Russie, est un Etat ouvrier dégénéré).
Les trotskystes accusent constamment les partis staliniens d'être des partis bureaucratiques, mais à quelques nuances près, ils maintiennent les mêmes raisonnements lorsqu'il s'agit du problème des Conseils Ouvriers et de la prise du pouvoir par le prolétariat. Derrière des différences apparentes, ils défendent la même conception bureaucratique de la révolution.
Ce n'est, évidemment, pas un hasard s'ils sont convaincus qu'il y a quelque chose d'"ouvrier" dans les régimes de capitalisme d'Etat.
Leur raisonnement est simple :
Les Conseils, -qu'ils appellent toujours du nom russe, soviets- ne sont qu'une "forme" d'organisation. "Le contenu révolutionnaire de cette forme, ne peut être donné que par le parti. Cela est démontré par l'expérience positive de la Révolution d'Octobre et par l'expérience négative des autres pays (Allemagne, Autriche, Espagne)..."(Léon Trotsky. "Bolchevisme et Stalinisme". Août 1937).
Il s'en suit, continuent logiquement les trotskystes, que c'est le parti qui doit prendre le pouvoir, les Conseils n'étant que la courroie de transmission nécessaire à l'exercice de ce pouvoir.
- "Le prolétariat ne peut arriver au pouvoir qu'à travers son avant- garde. La nécessité même d'un pouvoir étatique découle du niveau culturel insuffisant des masses et de leur hétérogénéité. Dans l'avant-garde révolutionnaire organisée en parti se cristallise la tendance des masses à parvenir à leur affranchissement. Sans la confiance de la classe dans l'avant-garde, sans soutien de l'avant-garde par la classe, il ne peut être question de la conquête du pouvoir. C'est dans ce sens que la. Révolution Prolétarienne et la dictature sont la cause de toute la classe, MAIS PAS AUTREMENT QUE SOUS LA DIRECTION DE L'AVANT-GARDE. LES SOVIETS NE SONT QUE LA LIAISON ORGANISEE DE L'AVANT-GARDE AVEC LA CLASSE... Si le parti soumet politiquement les soviets à sa direction, en lui-même, ce fait change aussi peu le système soviétique que la domination d'une majorité conservatrice change le système du parlementarisme britannique". (idem. Souligné par nous).
Et nous voilà, en présence d'un parti au pouvoir et de la masse des travailleurs, qui évidemment lui a fait confiance, en train d'obéir passivement à son "avant-garde révolutionnaire". Sauf le fait que ce parti se dise révolutionnaire, rien, STRICTEMENT RIEN, n'est changé au régime de pouvoir bourgeois où les masses de la population laborieuse n'ont aucun pouvoir de décision réel. L'organe même qu'elles se sont données pour en finir avec cette situation et renverser enfin tous les rapports d'oppression de cette société, les trotskystes, à l'égal des staliniens, veulent qu'il reste la courroie de transmission du pouvoir de la minorité dirigeante.
Mais prenons les différentes parties de leur raisonnement. Ils expliquent d'abord que les Conseils ne sont qu'une "forme" dont "le contenu révolutionnaire ne peut être donné que par le parti".
Il est en général peu intelligent et en tout cas, totalement contraire à la pensée dialectique marxiste que de séparer les formes de leur contenu. Il est évident que toute forme détermine son contenu, de même que ce contenu détermine la forme. Voir dans les Conseils une sorte de récipient dans lequel on peut mettre toutes sortes d’idées révolutionnaires ou réactionnaires, indifféremment, comme on mettrait de l’urine ou du vin dans mie bouteille, c’est faire preuve de la plus grande incompréhension de ce qu’est la révolution et des liens obligatoires entre ses buts et les moyens qu'elle se donne pour leur réalisation. A entendre ces gens, on croirait que c'est vraiment par un heureux hasard que les Conseils se sont toujours formés "juste au moment" où explosait une insurrection prolétarienne.
Ils sont incapables de comprendre, après une dizaine d’expériences de formation de Conseils dans l'histoire, que ceux-ci sont la forme même d'organisation que la classe ouvrière se donne à l'époque révolutionnaire; qu’ils sont le moyen par lequel le prolétariat réalise son expérience propre, agit et met en branle un monde pour en mettre sur pied un nouveau; que, comme telle, la forme des Conseils est inséparable de son contenu et celui-ci est obligatoirement révolutionnaire.
Le fait qu'à plusieurs reprises on ait connu des Conseils où prédominaient des partis se rattachant au capitalisme n'a rien d'extraordinaire si on sait que ceci s'est toujours produit au début des révolutions. N'est-il pas normal, qu'au début de son expérience, la classe ouvrière garde encore des illusions sur des partis de "gauche" bourgeois camouflés ?
La pleine conscience révolutionnaire des masses ne leur vient pas de l'inspiration "divine" ni parce que cinq intellectuels la leur ont "donnée"; elle est le produit de leur propre expérience dans le combat, et les Conseils, constituent justement le moyen indispensable qui permet à TOUTE la classe de réaliser cette expérience.
Le phénomène des Conseils Ouvriers, imprégnés encore d'idées de partis bourgeois n'est qu'une expression d'un phénomène plus général, typique des époques révolutionnaires : la conscience des actes réalisés retarde sur les actes eux-mêmes ou comme dit Rosa Luxembourg "le processus historique objectif précède la logique subjective de ses protagonistes".
En formant des Conseils, il est possible que la classe ouvrière ne soit pas encore consciente de toutes les implications de son action; il serait même exceptionnel qu'elle puisse dans son ensemble s'en rendre compte dès le début. Cela est normal, et d'ailleurs secondaire. Ce qui est important, c'est qu'en se constituant en Conseils, la classe ouvrière s'oblige à prendre la responsabilité de ses actes ; ce qui la précipite irrésistiblement dans une totale prise de conscience des actes qu'elle entreprend et de leurs conséquences ; car le Conseil Ouvrier est en lui-même la contestation radicale du pouvoir ' existant sous toutes ses formes. Le Conseil est la forme spécifique que se donne la classe pour exercer son pouvoir. Surgissant toujours parallèlement à un pouvoir capitaliste, son existence devient immédiatement incompatible avec l'ordre établi. Ainsi le prolétariat, en se constituant en Conseils s'engage qu'il le veuille ou non, dans la contestation révolutionnaire du pouvoir existant.
Du fait même de leur formation, les Conseils créent une dualité de pouvoir qui devra obligatoirement se résoudre au cours d'une lutte à mort ; la violence des situations ainsi créées, oblige le prolétariat à prendre conscience. Ou bien les Conseils détruisent l'Etat bourgeois et exercent SEULS et INTEGRALEMENT le pouvoir (Russie. Octobre 1917), ou bien ils sont vaincus et dissouts par la force (Russie 1905, Hongrie 1919? Chine 1927...). Mais leur nature même les empêche de coexister avec l'ordre bourgeois sans violence. Ils ne peuvent jamais devenir l'organe de la contre-révolution ou alors ils se "suicident" en délégant leur pouvoir à un parti (Allemagne 1919, Russie 1921...) qui les dissoudra immédiatement ou les réduira à l'état de simples mots inscrits sur un dossier dans les archives d'un bureaucrate. Le Conseil a été conçu par la classe ouvrière pour exercer son pouvoir; s'il ne le fait pas, il perd ses raisons d'existence.
De même que le parlement bourgeoisie peut jamais devenir un organe du pouvoir de la classe ouvrière de par son isolement total de la réalité, de par le système de représentativité, de par sa constitution même en organe destiné à duper les masses et servir la bourgeoisie; de même les Conseils ne peuvent servir d'organe de pouvoir à la bourgeoisie : ou bien les Conseils finissent par écraser toute ombre de bourgeoisie, ou bien ils se soumettent à celle-ci en devenant irrévocables, irresponsables et n'exerçant eux-mêmes aucun pouvoir, c'est-à-dire en se suicidant, en cessant d'être des Conseils.
Les Conseils sont révolutionnaires ou ils ne sont pas !
Mais, si affirmer -comme le font les trotskystes- que les Conseils ne sont qu'une "forme" sans voir le contenu révolutionnaire que cette forme implique, c'est faire preuve d'une totale incompréhension de la dialectique marxiste, dire que "le contenu révolutionnaire de cette forme ne peut être donné que par le parti", c'est réfléchir en ecclésiastique borné.
Trotsky semble oublier qu'en Mars 1917, l'organe de cette "avant- garde" bolchevique -que les trotskystes veulent nous faire apparaître comme l’incarnation de la vérité pure, qui a sauvé les soviets en leur apportant la bonne parole, qui leur a permis de se sortir du "marais réformiste" où ils se trouvaient -"La Pravda" publiait :
"La tâche essentielle est d’instituer un régime républicain démocratique. Nous ne faisons pas nôtre -l’inconsistant mot d’ordre, A Bas la Guerre !". Ce furent les ouvriers du quartier de Vyborg à Petrograd qui obligèrent la Pravda à publier le lendemain une note rédigée par eux et disant: "Si le journal ne veut pas perdre la confiance des quartiers ouvriers, il doit porter et portera la lumière de la conscience révolutionnaire, si blessante soit elle pour les hiboux de la bourgeoisie." (raconté par Trotsky dans le 1° Tome de son Histoire de la Révolution Russe. Chapitre, Les Bolcheviks et Lénine). Trotsky semble aussi oublier que même plus tard, lorsque Lénine arriva en Avril, et se prononça contre la guerre et pour la destruction du pouvoir républicain en demandant "Tout le pouvoir aux soviets", il se trouva absolument seul dans le parti. Il ne trouva d’appui que parmi les ouvriers de Petrograd et les marins de Kronstadt.
Si le parti bolchevik évolua plus tard vers les positions de Lénine et des ouvriers révolutionnaires, ce ne fut pas par la force de l’individu Lénine mais bien par la pression de la base, des ouvriers et soldats qui étaient déjà sur des positions révolutionnaires et dont Lénine n'était que le porte-parole.
Qu’on ne vienne donc pas nous dire que c'est le parti qui a sorti la masse de son "marais réformiste", c'est au contraire les travailleurs de la base qui en ont sorti le parti en Russie.
Il ne s'agit pas pour nous ici de nier le rôle fondamental qu’a joué le parti bolchevik dans la révolution d'Octobre, en tant qu'organisation regroupant les éléments les plus avancés de la classe ouvrière; mais, simplement de couper court à tout ce verbiage qui montre "Le Parti" comme l'église de la révolution, l'incarnation de la vérité salvatrice.
Le parti, les organisations révolutionnaires du prolétariat, ne sont que le regroupement des éléments les plus avancés de la classe à UN MOMENT DONNE. Sa taille comme ses positions sont déterminées par la conscience générale de la classe -et non l'inverse. Il est le produit de cette conscience en même temps qu'il est un facteur actif fondamental pour l'élévation et la formation du niveau de cette conscience. Mais en aucun cas il ne peut être envisagé comme quelque chose de séparé de la classe, de "supérieur" à elle. La croissance de 1'influence du parti n'est pas le produit simple du "bon militantisme" de ses membres "qui convainquent tout le monde", mais de l'élévation du niveau de conscience des masses, produit de leur propre expérience révolutionnaire. Lorsque les Conseils retrouvent dans leur immense majorité les positions de leurs éléments les plus avancés, ce n'est là que le résultat normal de l'évolution de la conscience des masses en action, de même qu'on ne peut concevoir les positions de ses éléments avancés comme indépendantes de cette action des masses. C'est une constante interrelation dialectique qui s'établit entre la conscience des éléments les plus avancés et celle de l'ensemble de la classe. Une interrelation qui n'a justement rien à voir avec la conception mystique d'un sacro-saint parti qui inculque la vérité à ses brebis égarées, tel que voudraient nous le présenter les trotskystes.
Aussi faible est l'argument employé à toutes les sauces par les trotskystes pour justifier leur idée sur le rôle du parti et des Conseils, et qui consiste à dire : "En Russie, la conception des relations parti-masses était celle de Lénine et de Trotsky, et la révolution a triomphé. En Allemagne, les conceptions sur ce sujet étaient les conceptions spontanéistes de Rosa Luxembourg, et ça a abouti à un échec. Donc, la conception juste est celle que nous, trotskystes-léninistes nous préconisons".
Premièrement, avec de tels arguments, qui se résument à la constatation de faits sans tenir compte des causes et des raisons précises, qui les ont produits, on arriverait -comme le fait la bourgeoisie (qui profite de l'état de choses existant et qui donc à intérêt à ne faire que "constater")- à dire simplement: le prolétariat a tenté plus de dix fois dans l'histoire, suivant des idées marxistes d'instaurer définitivement le socialisme; il n'a jamais réussi à le faire; donc, toutes les idées marxistes et de la révolution sont fausses.
D'autre part, la plus petite analyse sérieuse des conditions historiques dans lesquelles se sont déroulées les révolutions russes et allemandes, permet immédiatement de comprendre que si, dans la première, le prolétariat a réussi à détruire l'Etat bourgeois et à instaurer au moins pendant un court délai, le pouvoir des Conseils, et que si dans la seconde il a été écrasé dès le début, cela ne correspond pas au fait que Rosa Luxembourg et Lénine aient eu des conceptions différentes au sujet du parti mais à la différence des conditions dans lesquelles la lutte du prolétariat russe et allemand se sont réalisées.
Alors que le prolétariat russe s'opposait à une bourgeoisie faible, désemparée après la perte de son protecteur le tsarisme, le prolétariat allemand au contraire, devait faire face à une bourgeoisie expérimentée de longue date dans la lutte des classes. C'est une bourgeoisie qui connaît déjà (grâce à la révolution russe de 1917) ce qu'est une révolution prolétarienne.
D'autre part, le prolétariat allemand est parfaitement encadré par l'appareil social-démocrate (parti et syndicat) au service de la bourgeoisie. Mais c'est dans le fait que la guerre s'arrête au début de la révolution allemande -alors qu'en Russie, la paix est l'œuvre du prolétariat au pouvoir- que se trouve la différence fondamentale de conditions entre la révolution allemande de 1919 et la révolution russe de 1917.
En effet, la guerre et ses conséquences, dans l'une comme dans l'autre de ces révolutions, ont été "un moteur" de la classe ouvrière. C'est à travers la lutte contre le massacre et la famine de la guerre que le prolétariat en Russie et en Allemagne comprend la nécessité d'abattre définitivement le capitalisme.
Mais alors qu'en Russie, cette sorte d'"aiguillon" qu'était la guerre, poussait les soldats et les ouvriers à prendre définitivement le pouvoir; il disparaissait en Allemagne dès le début de la révolution par l'armistice de 1918.
Ainsi, le soldat allemand revenant du front n'avait plus qu'un souci: jouir de la paix enfin acquise. Il comprenait souvent mal l'agitation du prolétariat des villes. Et, lorsque 1'insurrection éclate en Janvier à Berlin, nombreuses sont les casernes qui se déclarent "neutres" laissant le prolétariat berlinois seul aux prises avec les corps de Noske. C'est dans l'analyse concrète de ces facteurs que l'on retrouve l'explication de l'échec de la révolution allemande de 1918-1919, et non pas dans la stupide affirmation : Liebknecht et Rosa Luxembourg n'étaient pas des léninistes-trotskystes et donc la révolution a été un échec.
De tels arguments ne peuvent démontrer que l'ignorance de ceux qui les maintiennent.
Si le problème en restait là, ce ne serait pas trop grave. Il suffirait de constater la totale incompréhension de tous ces problèmes par les trotskystes. Hélas, ces derniers tirent des affirmations précédentes la conclusion que "Le prolétariat ne peut arriver au pouvoir qu'à travers son avant-garde", que "la révolution prolétarienne et la dictature sont la cause de toute la classe, mais pas autrement que sous la direction de l'avant-garde", comme nous l'avons déjà vu plus haut. C'est-à-dire que la classe ouvrière doit prendre le pouvoir, mais qu'elle ne doit pas le prendre ELLE-MEME, ce rôle étant réservé à son élite, son avant-garde, c'est-à-dire LE parti.
Quant aux Conseils, ils ne sont donc pas l'organe permettant à TOUTE la classe d'exercer son pouvoir ELLE-MEME, mais simplement un "LIEN ORGANISE", PERMETTANT AU PARTI D'EXERCER "la dictature du prolétariat".
En fait, on se retrouve là, devant le même schéma du pouvoir bourgeois. Une minorité au pouvoir, dirige l'ensemble de la population qui lui devient soumise.
C'est un schéma qui correspond exactement aux révolutions bour- geoise, où il s'agit en effet d'une minorité éclairée -"qui sait ce qu'elle veut"- suivie par une masse qui justement ne sait pas ce que cette minorité veut, mais la suit aveuglement. C'est le schéma qui correspond à une révolution faite par une classe minoritaire qui a uniquement besoin de l'appui des masses pour mieux les tromper et s'imposer à elles.
Le chemin de la révolution prolétarienne est, évidemment, radicalement contraire. Ce n'est plus une classe minoritaire, dont les intérêts s'opposent à ceux du reste de la population; c'est une classe qui, dans son mouvement, englobe la majorité de la population.
Son but est de chasser à jamais du pouvoir les minorités exploitantes et pour cela elle doit instaurer le pouvoir de toute la population. La condition même de son triomphe est, en opposition totale avec la révolution bourgeoise, la pleine conscience de l'ensemble des travailleurs, la participation consciente et active de tous et de chacun. Seule cette participation totale peut permettre la destruction réelle de l'appareil bourgeois car seule elle peut permettre la mise en place d'une nouvelle organisation de TOUTE la société. Elle seule, peut renverser effectivement tous les rapports actuels conçus "de haut en bas" pour les remplacer par le pouvoir EFFECTIF de la base.
Ceci est d'autant plus important que le capitalisme a la caractéristique d'être un système dans lequel, pour qu'une minorité devienne exploitante des travailleurs, elle n'a pas besoin d'être issue d'une race ou de familles particulières, elle ne nécessite pas de connaissances particulières, il lui suffit de s'ériger en dirigeante et de prendre en mains le contrôle des moyens de production.
La bourgeoisie, disait Marx n'est, en fin de comptes, "que l'agent passif et inconscient" du Capital.
Lorsque le prolétariat inscrivait sur les bannières de sa 1° Internationale "L'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes", ce n'était pas une "jolie" phrase pour "plaire" ; elle synthétisait simplement cette vérité qu'aucune minorité fut-elle l'avant-garde ne peut se substituer à la classe ouvrière dans sa tâche révolutionnaire. Car si, "tous les mouvements historiques ont été, jusqu'ici, des mouvements de minorités au profit de minorités, le mouvement prolétarien est LE MOUVEMENT SPONTANE DE L’IMMENSE MAJORITE AU PROFIT DE L'IMMENSE MAJORITE". (Manifeste Communiste. Souligné par nous).
Dire que "le prolétariat ne peut arriver au pouvoir QU'A TRAVERS SON AVANT-GARDE" et "PAS AUTREMENT QUE SOUS LA DIRECTION DE L'AVANT-GARDE", c'est ne pas connaître la nature même de la révolution prolétarienne, la transfigurer dans un mouvement bureaucratique.
Les trotskystes essayent de "s'expliquer" en disant que le parti est l'expression directe des masses et que par conséquent, quand il prend le pouvoir, c'est la classe qui le prend. "Dans l'avant- garde révolutionnaire organisée en parti se cristallise la tendance des masses à leur affranchissement -dit Trotsky. Sans la confiance de la classe dans l'avant-garde, sans soutien de l'avant-garde par la classe, il ne peut être question de la conquête du pouvoir. C'est dans ce sens que la révolution prolétarienne et la dictature sont la cause de toute la classe...".
Mais, en quoi tout cela diffère de la prise de pouvoir "démocratique" par un parti bourgeois dans la société actuelle ?
Lorsque des millions de travailleurs votent pour un parti bourgeois, est-ce que le parti ne jouit pas du "soutien" et de la "confiance" des travailleurs ? Lorsqu'un' parti nationaliste arrive à entraîner derrière lui des millions de travailleurs dans une lutte contre la clique au pouvoir avec le seul but de s'y mettre à la place, est-ce qu'il n'a pas le soutien de la masse ? Hitler aussi avait le soutien du peuple et gouvernait en son nom, mais est-ce que les travailleurs avaient un pouvoir quelconque ?
Rien, absolument rien, ne garantit aux travailleurs, qu'un parti auquel ils font confiance à un moment donné, représente réellement, et surtout, continuera de représenter leurs intérêts ! La seule garantie pour le prolétariat, c'est de ne déléguer son pouvoir à personne et de le prendre lui-même dans ses mains; c'est pour cela qu'il a créé les Conseils.
On dira qu'un parti comme celui de Hitler ne peut prendre le pouvoir que lors d'une totale absence de conscience révolutionnaire dans la classe ouvrière, alors que les masses n'accordent leur conscience à un parti révolutionnaire que lorsqu'elles possèdent cette conscience et que, par conséquent, on ne peut pas comparer. C'est une tautologie. L'argument principal pour justifier la "prise en charge" du pouvoir par le parti -"avant-garde consciente"- repose sur le prétendu manque de conscience des masses. Mais si la classe est "assez" consciente pour distinguer entre le "vrai parti" et les "partis imposteurs", on ne comprend plus pourquoi elle devrait confier son pouvoir à cette "avant-garde consciente" et pourquoi elle ne prendrait pas elle-même ses destins en main.
Mais supposons quand même que les masses accordent leur confiance et leur soutien à un parti révolutionnaire, à leur avant-garde, et lui donnent en effet, le rôle de dirigeant de la société en tant que leur représentant. Elles auront accordé le pouvoir, dans le meilleur des cas, aux hommes qui étaient une avant-garde AVANT la révolution, c'est-à-dire lorsque les masses sortaient à peine de la domination idéologique et physique de la bourgeoisie. Mais RIEN ne dit, -l'expérience russe montre plutôt le contraire- que ces hommes continueront à être "les éléments les plus avancés" une fois que la classe dans son ensemble sera sortie de l'apathie et de la crainte de la société capitaliste i La classe se retrouvera donc sous la domination d'une minorité qui ne s'est regroupée et constituée en parti que par rapport aux problèmes de la société capitaliste, c'est-à-dire suivant des critères qui n'ont plus aucun sens, une fois la prise du pouvoir par le prolétariat réalisée.
De plus, le prolétariat ne possède aucun contrôle sur l'organisation intérieure de ce parti auquel il "accorderait sa confiance". Pour être membre d'un parti, il suffit de se déclarer d'accord avec la plateforme politique de celui-ci et d'en devenir un militant actif ? une fois entré dans un parti, on en sort que par décision INTERIEURE des membres de celui-ci. Pour être délégué d'un Conseil Ouvrier au contraire, il faut posséder la confiance réelle et immédiate de tous les travailleurs qu'il regroupe? de plus, le délégué est responsable et révocable à tout instant.
En ce sens, si les travailleurs délèguent leur pouvoir à un parti, ils perdent toute possibilité de contrôle réel sur ceux qui les commandent* Le pouvoir d'un parti -aussi révolutionnaire eut-il été pendant la lutte contre le capitalisme- est ainsi exactement la négation du pouvoir des Conseils.
Par la seule conception des Conseils ouvriers comme simple "liaison organisée de l'avant-garde avec la classe", c'est-à-dire comme étant pour le parti ce que les syndicats bureaucratiques sont pour les partis parlementaires bourgeois, on arrive à affirmer que "si le parti soumet politiquement les soviets à sa direction, en lui-même, ce fait change aussi peu le système soviétique que la domination d'une majorité conservatrice change le système du parlementarisme britannique".
La domination politique des Conseils par le parti change tellement la nature même du pouvoir des Conseils, que tôt ou tard, il s'établit une contradiction qui finit par se résoudre par les armes, aussi révolutionnaire qu'ait pu être le dit parti* L'exemple de l'écrasement des marins de Kronstadt par le parti bolchevik, 4 ans après la révolution d'Octobre, pour la simple raison que les marins de Kronstadt exigeaient comme première revendication de nouvelles élections au Conseil de Kronstadt, c'est-à-dire l'application de la révocabilité des charges dans le Conseil, en est une preuve évidente.
Pour la défense de l'idée de la révolution faite par l'avant-garde un autre argument est utilisé ; celui que les bourgeois utilisent pour prouver qu'une vraie révolution est impossible. C'est le fait de dire que les masses travailleuses sont trop incultes pour entreprendre par elles-mêmes une telle transformation du monde. Les bourgeois disent ; donc, pas de révolution. Les trotskystes disent : donc, il faut que ce soit le parti qui exerce le pouvoir. "La nécessité même d'un pouvoir étatique, -dit Trotsky, découle du niveau culturel insuffisant des masses et de leur hétérogénéité.
Engels et Lénine (dans "L'Etat et la Révolution"), expliquent avec une extraordinaire rigueur scientifique que le pouvoir étatique "est le produit et la manifestation de ce fait que les contradictions de classes sont inconciliables". Voilà que Trotsky qui ne jure que par Lénine, pour tenter de justifier sa conception du pouvoir du parti, fait "découler" le pouvoir étatique "du niveau culturel insuffisant des masses et de leur hétérogénéité". Mais n'est-ce pas là ce que disent tous les gouvernements bourgeois qui nient que l'Etat soit un organe d'oppression d'une classe par une autre, mais simplement un organe permettant aux "meilleurs" de la société de gouverner "pour le bien de tous" et pallier ainsi au faible niveau culturel des masses?
Mais voyons ce que vaut l'affirmation selon laquelle "le niveau culturel insuffisant des masses" implique la nécessité de la prise de pouvoir par le parti et la soumission des Conseils à son autorité.
Il est vrai que les masses n'ont encore aucune expérience de gestion du pouvoir. C'est le cas de toute classe révolutionnaire au moment de prendre le pouvoir. Mais comment pourront-elles l'acquérir si ce n'est pas en l'exerçant ? L'expérience ne s'obtient qu'en exerçant la fonction, surtout quand il s'agit de millions d'hommes. Aucun parti, ni aucune couche, ne peuvent remplacer les masses dans l'acquisition de cette expérience. Celle-ci ne peut être réalisée que dans la vie de tous les jours par tous les travailleurs. Elle ne peut être effective qu'au grand jour car ce grand jour est la condition même pour que l'expérience se transmette à tous les Conseils, pour que l'expérience d'un de ceux-ci soit celle de tous.
Seuls des bureaucrates peuvent concevoir l'expérience du socialisme comme pouvant se réaliser dans le bureau d'un comité central.
Les trotskystes parlent d'un parti qui remplace les Conseils dans leur pouvoir pendant que ceux-ci prennent de l'expérience. Mais, d'où le parti a-t-il sorti son expérience de gestion ? Aussi révolutionnaire soit-il, il ne peut connaître que les méthodes de gestion de la société capitaliste car il n'y a pas encore eu de réelle expérience de gestion par les travailleurs.
Or, le prolétariat n'a que faire de cette expérience. L'inexpérience de la classe ouvrière n'est en rien un argument justifiant la nécessité du pouvoir d'un parti détaché de la population. Tout au contraire. "Le système social socialiste ne doit et ne peut être qu'un produit historique, né de l'école de l'expérience, à l'heure des réalisations de la marche de l'histoire vivante, laquelle, tout comme la nature organique, dont, en dernière analyse, elle est une partie, a la bonne habitude de faire naître toujours avec un réel besoin social le moyen de le satisfaire, avec le problème sa solution... Seule l'expérience est capable de faire les corrections et d'ouvrir des chemins nouveaux. Seule une vie fermentant sans entraves, s'engage dans mille formes nouvelles, improvise, reçoit une force CREATRICE, corrige elle-même ses faux pas. Si la vie publique des Etats à liberté limitée est si piètre, si pauvre, si schématique, si inféconde, c'est justement parce qu'en excluant la démocratie, elle ferme aux intelligences les sources vives de tout enrichissement et de tout progrès... Toute la masse du peuple doit y prendre part. Autrement le socialisme est décrété, octroyé, du haut du tapis vert du bureau d'une douzaine d'intellectuels... La pratique du socialisme exige toute une transformation intellectuelle dans les masses dégradées par des siècles de domination bourgeoise. Instincts sociaux à la place des instincts égoïstes, initiatives des masses à la place de l'inertie, idéalisme passant au-dessus de toute souffrance etc... le seul chemin qui conduise à la renaissance, c'est l'école même de la vie publique, la démocratie la plus large et la plus illimitée, l'opinion publique", (Rosa Luxembourg, La Révolution Russe),
La révolution prolétarienne, la prise en mains de toute la société par les travailleurs eux-mêmes, n'est pas l'invention d'un vieux sage; elle est une nécessité que la décomposition de la société présente impose. Le prolétariat aura à gérer tout sans avoir d'expérience. La question de savoir s'il "est capable de le faire" est absurde, car il n'y a pas de marche en arrière possible: IL DEVRA ETRE CAPABLE.
Comme toutes les classes révolutionnaires dans l'histoire, il devra apprendre à exercer sa fonction historique en l'exerçant. La seule question qui rationnellement peut être posée est de savoir comment il deviendra pleinement capable le plus vite. Et la seule réponse est: en s'organisant dans ses Conseils et détenant TOUS les pouvoirs.
Les trotskystes vivent dans une éternelle prosternation devant le passé; car de la très riche expérience du prolétariat russe dont ils se revendiquent, ils ne tirent comme modèles que les erreurs, les aspects de la dégénérescence de la révolution aux mains de la bureaucratie. Le prolétariat ne connaît pas de telles prosternations passives. Son expérience comme classe historique, ses PROPRES expériences, il ne les utilise que pour mieux aller de l'avant, et pour cela il remplace la béate admiration de ses expériences par l'esprit critique que donne aux classes révolutionnaires la force de l'histoire.
* * *
AUJOURD'HUI PLUS QUE JAMAIS, A L'HEURE OU LE CAPITALISME ENTRE DE NOUVEAU DANS UNE CRISE MONDIALE, A L'HEURE OU LA REVOLUTION PROLETARIENNE REVIENT DE NOUVEAU HANTER LE MONDE DES BOURGEOIS ET DES BUREAUCRATES, LES PROLETAIRES SAVENT DEJA QUE:
"L'EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA L'ŒUVRE DES TRAVAILLEURS EUX-MEMES".
*
* *
* * *
Toulouse. Décembre 1968
[1] Selon Brecht
[2] Le rôle prédominant de l'influence des gens du Parti, le système du "parrainage" pour l'entrée au Parti, font que, dans les faits, le critère de recrutement de la classe reste souvent l'hérédité.
[3] "Ni la transformation en sociétés par actions, ni la transformation en propriété d'Etat ne supprime la qualité de capital des forces productives. Pour les sociétés par actions, cela est évident. Et l'Etat moderne n'est à son tour que l'organisation que la société bourgeoise se donne pour maintenir les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre des empiètements venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. L'Etat moderne, quelle qu'en soit sa forme, est une machine essentiellement capitaliste: l'Etat des capitalistes, le capitaliste collectif idéal.
Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble." (Engels. "Anti- Dühring").
[4] Avec l'idée de la participation, les gaullistes ont lancé celle des syndicats autonomes qui ne sont en fait que des syndicats contrôlés directement par Le patronat et le gouvernement. On retrouve ainsi la combinaison idéale; la formule, des syndicats franquistes espagnols.
[5] Contrairement aux autres classes dans l'histoire, le prolétariat n'a besoin de la violence que pour ELIMINER les anciennes structures de classe. Quand la bourgeoisie fait sa révolution, elle a besoin de la violence, non seulement pour détruire les anciennes structures féodales, mais aussi pour instaurer son pouvoir de classe exploitante.
Elle élimine un régime d'oppression pour en instaurer un autre : le sien. Une fois détruits les anciens appareils ¿elle est obligée d'exercer une violence sans bornes sur toutes les NOUVELLES forces sociales qui lui sont antagonistes, à qui elle impose son pouvoir. (Après Louis XVI, c'est le révolutionnaire Babeuf qui doit être guillotiné). Le prolétariat, au contraire, réalise une révolution qui correspond aux intérêts de l'immense majorité de la population. Sa violence n'est que la réponse à la résistance des tenants de l'ancien régime. Elle ne peut jamais s'exercer contre le reste des travailleurs (petits paysans, artisans, etc...) que la classe ouvrière ne peut que rallier à elle; et encore moins à l'intérieur de la classe ouvrière elle-même. Au contraire du capitalisme qui naît "dans la boue et le sang", la révolution prolétarienne NE CONNAIT LA VIOLENCE QUE POUR DETRUIRE LE PASSE, JAMAIS POUR CONSTRUIRE L'AVENIR. Il n'y a pas de Thermidor pour la révolution prolétarienne. La dictature de la classe ouvrière n'est dictature que par rapport à la bourgeoisie.
[6] Les centrales syndicales sont aujourd'hui un moyen indispensable pour la planification capitaliste. Ils permettent à l'Etat de connaître l'état de combativité des masses, l'opportunité de telle ou telle mesure contre elles, les salaires minimums qu'elles sont prêtes à accepter. Ils sont devenus la courroie de transmission à travers laquelle l'Etat applique ses directives sur la classe ouvrière. (Conclusion de Conventions Collectives, conclusion des accords d’intéressement, préavis de grève, etc...). Aujourd'hui, une planification sans ces organismes pour encadrer la masse des travailleurs serait impensable. En ce sens, ils sont devenus des rouages indispensables de l'Etat capitaliste moderne ; ils ont cessé d'être des organismes au service de la classe ouvrière, pour devenir des organisations au service du Capital.
[7] Marx explique que le prolétariat devra prévoir un fond social qui devra comprendre :
"Premièrement : un fond destiné au remplacement des moyens de production usagés,
Deuxièmement : une fraction supplémentaire pour accroître la production,
Troisièmement : un fond de réserve ou d'assurance contre les accidents, les perturbations dues à des phénomènes naturels, etc..." (id.). Une fois que ces défalcations seront faites, il reste à distribuer le reste du produit total qui, lui, est destiné à la consommation.
Cette partie devra comprendre, explique Marx, deux masses : une, destinée à assurer des besoins de consommation généraux de la société, communs à tous, et une autre, destinée à la distribution entre les individus, La première masse comprend selon Marx:
"Premièrement ; les frais généraux d'administration qui sont indépendants de la production,
Comparativement à ce qui se passe dans la société actuelle, cette fraction se trouve d'emblée réduite au maximum et elle décroît à mesure que se développe la société nouvelle.
Deuxièmement : ce qui est destiné à satisfaire les besoins de la communauté : écoles, installations sanitaires, etc...
Cette fraction gagne d'emblée en importance, comparativement à ce qui se passe dans la société actuelle, et cette importance s'accroît à mesure que se développe la société nouvelle»
Troisièmement : le fond nécessaire à l'entretien de ceux qui sont in- capables de travailler, etc..., bref ce qui relève de ce qu'on nomme aujourd'hui l'assistance publique officielle", (idem).
La seconde masse est constituée par la fraction des biens de consommation destinée à être répartie individuellement entre les producteurs de la collectivité.
[8] A ce sujet, voir l’étude : "Principes Fondamentaux de la Production et de la Distribution Communiste". Travail collectif du groupe Internationaler Kommunisten. Hollande. 1930).
Heritage de la Gauche Communiste:
Révolution Internationale - 1969 (ancienne série)
- 772 lectures
Révolution Internationale n°2 - février
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 853.7 Ko |
- 262 lectures
Déclaration de principes
- 217 lectures
Le capitalisme en se développant a créé les conditions de sa disparition. Le prolétariat, produit spécifique du capitalisme, est, de par sa situation socio-économique dans le système, la seule classe appelée à réaliser définitivement son dépassement.
Au long de sa lutte en ce sens, la classe ouvrière n'a pu que définir les buts et les moyens de son action révolutionnaire.
Toute action organisée doit donc, pour être révolutionnaire, se placer à l'intérieur du cadre défini par les résultats des expériences successives de la lutte prolétarienne.
Ces résultats se traduisent essentiellement par les principes suivants.
ILe prolétariat, comme classe révolutionnaire, tend à définir POUR LES BESOINS de sa lutte et A TRAVERS elle, une conception du monde dont il fait partie et qu'il doit transformer.
Cette conception se distingue fondamentalement de celle des autres classes sociales par le fait que, première classe révolutionnaire dans l'histoire dont le but ne soit pas l'exploitation d'autres classes mais au contraire l'élimination définitive de toute exploitation, le prolétariat n'a nul besoin de justifier idéologiquement, à l'égard du reste de la société, sa lutte et son action. Cette conception du monde (Weltanschauung) est donc "NON IDEOLOGIQUE" puisqu'elle ne fait appel à aucune interprétation surnaturelle, à aucun système de mystification (religion, idéalisme, etc...) et "MATERIALISTE" puisque son unique champ d'investigation est la réalité sociale étudiée sans "a priori" d'aucune sorte.
Les "socialistes scientifiques" du siècle dernier (Marx, Engels), dans leur critique de l'économie, de la politique et de l'idéologie, n'ont fait qu'expliquer et analyser de façon théorique cohérente une pratique qui était déjà celle des classes sociales et en particulier du prolétariat à cette é- poque. Leur pensée politique n'est que le produit d'un certain stade historique des contradictions de la société capitaliste, du développement de la lutte des classes[1]. (l). L'instrument d'étude et de combat dont ils jettent les premières bases de façon explicite est appelé habituellement "marxisme".
Chaque fois que le prolétariat a agi comme classe révolutionnaire, il a retrouvé ET enrichi les fondements qui constituent le marxisme. Le marxisme s'est ainsi vérifié comme la formulation la plus exacte et la plus précise de la conception prolétarienne du monde.
IILa nécessité d'accroître la production d'une part, et le caractère limité du marché mondial d'autre part, placent le capitalisme dans l'impossibilité d'assurer, à partir d'un certain degré d'expansion, le développement des forces productives.
Avec la Io Guerre Mondiale, le capitalisme affirme son incapacité DEFINITIVE à satisfaire les besoins économiques de la société; obligé de vivre par la production d'armements et dans la guerre permanente, il est devenu le système de la destruction globale alors qu'il rejette systématiquement dans la misère une partie sans cesse croissante de la population mondiale.
En empêchant le développement des forces productives, il a perdu ses raisons historiques d'existence. Il est entré dans sa phase de décadence. L'alternative "socialisme ou barbarie" est devenue réalité et, en l'absence de révolution prolétarienne triomphante, le monde ne vit que dans la guerre permanente, la misère croissante et l'abrutissement systématique de l'individu.
IIISeule la suppression du capitalisme -en remplaçant la production faite en fonction du profit et de la vente par la production orientée selon les besoins et les possibilités de chacun, gérée par les travailleurs eux- mêmes- pourra permettre à l'humanité de sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve.
IVEn aucun cas, la classe ouvrière ne pourrait sé servir de l'Etat capitaliste, organe d'oppression d'une classe exploiteuse sur l'ensemble de la société. La prise du pouvoir par la classe ouvrière implique LA DESTRUCTION INTEGRALE DE CET APPAREIL et son remplacement par l'organisation de tous les travailleurs réunis en CONSEILS (assemblées élues et révocables) détenant EXCLUSIVEMENT ET INTEGRALEMENT TOUT LE POUVOIR.
VLa prise en mains de toute la société par les travailleurs organisés en Conseils n'est possible que par la socialisation des moyens de production, c'est-à-dire L'ELIMINATION DE TOUTE PROPRIETE DES MOYENS DE PRODUCTION (privée ou étatique)[2]. (l). Les nationalisations et étatisations ne sont qu'un transfert de propriété des moyens de production: l'Etat et sa bureaucratie remplacent la bourgeoisie dans ses fonctions. Ce n’est pas l'élimination de l'exploitation capitaliste mais la forme qu'elle tend à prendre dans la phase de décadence du système.
VIAucune organisation politique révolutionnaire ne peut remplacer, dans l'exercice de ce pouvoir l'ensemble des Conseils. Une telle attitude entraînerait obligatoirement la formation d'un nouveau pouvoir séparé qui .s'exercerait contre la classe ouvrière elle-même.
VIIC'est à travers ses luttes que la classe ouvrière définit et appréhende les buts et les moyens de son action. Le processus de sa prise de conscience n'est ni uniforme, ni immédiat. Pour devenir des facteurs déterminants de ce processus, les éléments les plus conscients doivent s'organiser politiquement, constituer l'organisation politique du prolétariat.
Cette organisation, le Parti révolutionnaire, a des buts radicalement différents de ceux de tout parti bourgeois -la tâche des partis bourgeois est d'exercer le pouvoir sur l'ensemble de la société en conquérant les leviers de l'appareil d'oppression capitaliste et d'entretenir la mystification des classes exploitées, nécessaire au maintien de ce pouvoir- 1'organisation politique du prolétariat a pour but, au contraire, d'aider la totalité de la classe ouvrière à prendre et à exercer le pouvoir ELLE- MEME, en accélérant le processus de généralisation de la conscience révolutionnaire, indispensable à cette prise du pouvoir.
A l'opposition des buts et des tâches entre parti bourgeois et parti révolutionnaire, correspond une opposition radicale de moyens d'action, structures et relations avec la masse des travailleurs entre ces mêmes partis.
En ce sens, la conception léniniste du parti, profondément marquée par l'idée jacobiniste bourgeoise, est à rejeter.
Le parti révolutionnaire n'est ni le "représentant", ni "l'état-major", ni "la conscience" de la classe ouvrière. Comme organisation, il n'a ni à diriger la classe, ni à exercer le pouvoir à sa place.
Son rôle est de contribuer à l'auto-organisation de la classe par le développement et la diffusion de la théorie révolutionnaire et la participation quotidienne aux luttes de la classe.
VIIINié par les besoins objectifs de la société, le capitalisme ne peut se survivre que par le renforcement de son appareil policier et militaire: L'ETAT. Le capitalisme d'Etat, absorption de toute la vie sociale pat l'appareil étatique -"le capitaliste idéal" (Engels)- est la réalisation ultime de cette tendance.
IXTous les Etats dits "socialistes", "communistes" ou "en voie vers le socialisme" (URSS, Chine, Cuba, etc...) sont des Etats de NATURE CAPITALISTE, se différenciant des Etats de capitalisme privé par le seul fait que c'est l'Etat et sa bureaucratie qui exercent toutes les fonctions d'exploitation (CAPITALISME D'ETAT).
Ils ont constitué la plus grande mystification de l'histoire du mouvement ouvrier et, avec les "partis communistes" du monde, ils ont été dans les derniers quarante ans la plus pure incarnation de la contre- révolution mondiale.
XDe même que la naissance du capitalisme va de pair avec la formation des nations, 1'élimination des nations va de pair avec l'établissement du socialisme. La prise en mains de 1$ société par le prolétariat international correspond, entre autres, au besoin objectif, créé par le développement des forces productives, du dépassement des cadres nationaux. La révolution ne peut donc remplir ses objectifs qu'à l'échelle internationale.
La théorie du "socialisme en un seul pays" -totalement étrangère au prolétariat- n'a été et ne reste que la couverture démagogique de la contre-révolution du capitalisme d'Etat.
XIDans le cadre historique actuel, la formation de nouvelles nations est totalement réactionnaire. Le monde est partagé en zones d'influence qui correspondent à la domination impérialiste des grandes puissances de l'Est ou de l'Ouest. Les luttes de "libération nationale" sont devenues une des formes de lutte entre ces blocs; un Etat ne peut se libérer d'un bloc sans l'aide de l'autre, sous l'emprise duquel il tombe obligatoirement. Ces guerres nationales, devenues simplement inter-impérialistes, sont aussi anti- prolétariennes que les grandes guerres mondiales. Les travailleurs de ces pays n'y interviennent que comme "chair à canon" des grandes puissances et des partis bourgeois-bureaucratiques nationaux.
Dans les pays coloniaux ou semi-coloniaux, comme dans tous les pays, c'est LA REVOLUTION PROLETARIENNE qui est à l'ordre du jour: toutes les luttes de caractère national qui placent le prolétariat local aux côtés de sa bourgeoisie et d'un des blocs impérialistes, n'en sont que des DETOURNEMENTS.
C'est pourquoi la seule attitude valable pour les travailleurs amenés à participer à ces guerres, est le DEFAITISME REVOLUTIONNAIRE: retourner leurs armes contre leurs propres exploiteurs.
XIIDans le capitalisme décadent, toute organisation PERMANENTE DE MASSE du prolétariat est obligatoirement incorporée aux structures étatiques, sous peine d'élimination physique. Dans sa phase de décadence, le capitalisme devient incapable d'octroyer une augmentation durable, donc réelle, de salaires (toute augmentation de salaires est devenue aujourd'hui synonyme de hausse des prix).
C'est pourquoi, organisations PERMANENTES de revendications fondamentalement SALARIALES, les syndicats sont devenus aujourd'hui partie intégrante et indispensable des rouages de l'Etat capitaliste.
Les luttes ouvrières ne sauraient se développer qu'à l'extérieur de ces organismes et contre eux.
Pour les mêmes raisons, toute participation aux élections et au Parlement, loin de mobiliser les masses ouvrières, ne fait que détourner le prolétariat de son activité révolutionnaire et doit être rejetée comme contre-révolutionnaire.
XIIILes tactiques d'alliance avec les fractions de la bourgeoisie ("front populaire*, "front unique", etc...) sous le prétexte du "moindre mal", de "l'anti-fascisme", etc... se sont avérées être le meilleur moyen pour vider les luttes prolétariennes de leur contenu révolutionnaire.
Aujourd'hui plus que jamais, l'autonomie du mouvement ouvrier par rapport à la bourgeoisie et aux bureaucraties est une condition fondamentale du triomphe de la lutte.
* * *Le processus de regroupement du courant révolutionnaire -aujourd'hui engagé- sera produit et facteur actif de la lutte de la classe ouvrière.
* * *[1] Mais, du coup, "la dialectique des idées ne devint que le SIMPLE REFLET CONSCIENT DU MOUVEMENT DIALECTIQUE DU MONDE REEL, et, ce faisant, la dialectique de Hegel fut totalement renversée, ou, plus exactement: elle se tenait sur la tête, on la remit de nouveau sur ses pieds. Et cette dialectique matérialiste, qui était depuis des années notre meilleur instrument de travail et notre arme la plus acérée, fut, chose remarquable, découverte à nouveau non seulement par nous, mais en outre, indépendamment de nous et même de Hegel, par un ouvrier allemand, Joseph Dietzen" (Friedrich En- Gels. "Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande").
[2] La terre est un moyen de production. Comme telle, elle doit être aussi socialisée. Les grandes propriétés doivent être immédiatement collectivisées et gérées par les Conseils Ouvriers agricoles; en aucun cas, elles ne sauraient être partagées en petites propriétés. Les terres des petits paysans propriétaires ne pourront cependant être collectivisées par la force. Seule la persuasion par l'exemple peut être envisagée pour amener ceo derniers à collectiviser leurs terres.
La crise monétaire
- 298 lectures
Les périodes de prospérité capitaliste et de calme social ont toujours fait' naître dans le mouvement ouvrier une série de théories sur les possibilités de développement indéfini du capitalisme: d'après ces théories, Marx se serait totalement trompé sur le capitalisme qui devait, selon lui, inévitablement entrer en crise, créant les conditions de l'avènement de la révolution prolétarienne.
A partir de cette position, il est sorti en général trois attitudes selon les époques et les courants.
- 1/ Le réformisme: étant donné que le capitalisme se développait et assurait une amélioration du niveau de vie de la classe ouvrière, on en déduisait que le socialisme ne serait pas le produit d'une révolution violente du prolétariat, mais de l'évolution du capitalisme: on préconisait par conséquent le travail de collaboration des classes avec la bourgeoisie, la voie parlementaire vers le socialisme. Ce fut le cas d'abord de Bernstein à la fin du XIX0 Siècle puis de la majorité de la II° Internationale au début du XX°.
- 2/ Le pessimisme: devant la fermeture de perspectives de crises économiques et 1'"embourgeoisement" de la classe ouvrière, on en arrivait, déçu, à dire que finalement le socialisme n'était qu'un rêve irréalisable, un juste souhait des hommes mais faisant partie du domaine de l’irréel.
- 3/ Le volontarisme: il ne faut pas attendre une crise économique du système pour qu'ait lieu la révolution. Le capitalisme a appris à éviter ses crises, mais il ne peut pas supprimer l'aliénation qu'il engendre. La révolution sera le produit de la révolte des hommes contre cette vie et cette aliénation, indépendamment de toute crise économique. D'ailleurs, de même que Marx se trompait en parlant d'inévitabilité des crises, il se trompait aussi quand il croyait que le prolétariat serait la classe révolutionnaire par, excellence: le capitalisme se développant indéfiniment, le prolétariat devient de plus en plus intégré au système et c'est aux couches sociales marginales que reviendra le rôle révolutionnaire. C'est pourquoi, pour que la révolution se fasse, ce qu'il faut, c'est une bonne organisation bien structurée capable de provoquer l'éclat et de diriger le mouvement (cf. certains anarchistes CNT-FAl) ou bien des "actes exemplaires" (cf. anarchistes, Internationale Situationniste).
Formulées dans des "périodes de prospérité", toutes ces théories ont été démenties à la base par des crises économiques quelques années plus tard: 1914, 1929, 1937, etc...
La crise que subit le capitalisme actuellement vient-elle aussi les démentir, et réaffirmer les perspectives du marxisme scientifique ?
L'IMPORTANCE DU PROBLEME
Il ne s'agit nullement ici de traiter un problème "théorique" en soi, et de spéculer sur la justesse ou la fausseté de quelques raisonnements.
Le problème de l'inévitabilité de la crise du capitalisme est en fait le problème de la révolution elle-même.
1 - LE SOCIALISME SCIENTIFIQUE
La théorie de Marx, le socialisme scientifique, se distingue du socialisme utopique qui le précéda dans l'histoire, par le fait qu'il fonde la possibilité du socialisme sur la nécessité objective de la disparition du capitalisme. Les socialistes utopiques, Owen, Fourier, Saint-Simon, etc... voyaient le socialisme comme le résultat d'un souci général de JUSTICE.
Ils ne comprenaient pas -et ils ne pouvaient pas le comprendre à leur époque- comment cette nouvelle société socialiste se construirait, ni pourquoi, ni par qui. "Ils voudraient améliorer l'existence de tous les membres de la société même des plus privilégiés. C'est pourquoi ils lancent sans cesse leur appel à l'ensemble de la société sans distinction, et même de préférence à la classe dominante" (Manifeste Communiste. 1843).
L'apport fondamental de Marx a été de donner à ce SOUHAIT de nouvelle société un fondement scientifique, en démontrant la NECESSITE de la disparition du capitalisme et de son dépassement par un système qui ne peut être que le socialisme.
Il définit les grands traits caractéristiques de cette nouvelle société, non d'après quelque désir de bonne volonté, mais à partir des conditions précises qui lui donneront naissance: le socialisme sera le fait de la classe ouvrière, du prolétariat, "produit spécifique du capitalisme", classe antagoniste des capitalistes, qui se développe dans la société capitaliste parallèlement aux forces productives, qu'il collectivisera.
Ce passage au socialisme devient une possibilité et une NECESSITE à partir du moment où le capitalisme, paralysé par ses contradictions internes, devient incapable d'assurer le développement nécessaire des forces productives, plongeant alors l'humanité dans la "barbarie" de la misère et de la guerre. Ce qui n'était qu'un "rêve" prend un caractère de NECESSITE.
Le socialisme, comme réalisation, devient quelque chose de fondé qu'il est possible de cerner, d'expliquer et donc de "préparer". La théorie scientifique de Marx donne ainsi au prolétariat un instrument indispensable d'investigation et de recherche pour appréhender la réalité qu'il a pour but de transformer. Et la "PIERRE ANGULAIRE" de cette théorie est l'inévitabilité de cette "paralysie", de cette crise du capitalisme.
C'est dire l'importance du problème de la crise, dès qu'il s'agit de comprendre la réalité.
2 - LA PRISE DE CONSCIENCE DU PROLETARIAT
Le passage à la nouvelle société n'est possible que si les hommes sont conscients et déterminés à le réaliser. "Il n'y a pas de situation sans issue" disait Lénine. Si cette conscience révolutionnaire n'existe pas, la crise au lieu de donner naissance au socialisme jette l'humanité dans la destruction et la guerre (voir la crise de 1929 qui, en l'absence de révolution prolétarienne, aboutit finalement à la II° Guerre Mondiale).
Cependant, cette conscience ne peut ni venir d'une "inspiration providentielle", ni être l'œuvre de quelques "prophètes". Elle ne peut être que le produit d'une situation sociale commune à un ensemble d'hommes, déterminés par les mêmes circonstances à exprimer une même volonté. Et, dans toutes les sociétés jusqu'à présent où la vie de chaque homme tourne essentiellement autour de la lutte pour sa subsistance, ces circonstances ont leur racine dans des facteurs économiques.
C'est pourquoi les groupes d'hommes qui ont été appelés à agir dans l'histoire passée ont été des CLASSES, c'est-à-dire des hommes considérés selon leur fonction dans le système économique. "L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes" (Manifeste Communiste. 1848). De même dans la société actuelle, c'est une classe, la classe ouvrière, qui est porteuse du socialisme.
Mais, qu'est-ce qui détermine le prolétariat à se lancer dans la lutte révolutionnaire ? Pourquoi à un moment plus qu'à un autre la révolution devient-elle possible ?
"Quels sont, en termes généraux, les signes caractéristiques d'une situation révolutionnaire ? Nous ne pensons pas nous égarer en indiquant ces trois signes principaux:
- 1) L'impossibilité pour les classes dominantes de maintenir inchangée leur domination; telle ou telle crise dans les "hauteurs", une crise dans la politique de la classe dominante, qui ouvre une brèche à travers laquelle surgissent le mécontentement et la colère des classes opprimées. En général, pour qu'éclate la révolution, il ne suffit pas que "ceux d'en bas ne veuillent plus", mais il faut encore que "ceux d'en- haut ne puissent plus" continuer à vivre comme auparavant.
- 2) Une aggravation de la misère et de la souffrance des classes opprimées supérieure à l'habituel.
- 3) Pour ces raisons, une intensification considérable de l'activité des masses, qui en temps de "paix" se laissent spolier tranquillement, mais qui dans des périodes de troubles sont poussées, aussi bien par toute la situation de crise, QUE PAR CEUX D‘"EN-HAUT" dans une action historique indépendante.
Sans ces changements objectifs, indépendants non seulement de la volonté des différents partis et groupes, mais aussi de celle des différentes classes, la révolution est, en général, impossible. (Lénine. "La Faillite de la Deuxième Internationale").
Or, aussi bien cette "crise dans les hauteurs" que "l'aggravation de la misère et de la souffrance des classes opprimées", sont toujours la manifestation d'une crise dans les infrastructures sociales, c'est-à-dire au niveau de la production économique: une crise économique.
Ainsi donc, la prise de conscience du prolétariat, comme les conditions objectives pour la réalisation de la révolution, dépendent de cette crise de la société qui a obligatoirement ses fondements dans une crise économique. Et cela est fondamental lorsqu'on parle de révolution mondiale (et on ne peut pas parler de révolution socialiste, si on ne parle pas de révolution mondiale; l'exemple de la Russie est là pour le prouver). En effet, à moins de tomber dans une simple rêverie, pour parler de la possibilité d'un soulèvement de la classe ouvrière dans le monde entier, il faut prouver cette possibilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir compter sur l'éventualité de la création d'une même situation sociale économique dans tous les pays, situation capable de pousser une même classe économique dans une action commune. Or, cette situation ne peut être autre que celle d'une crise MONDIALE du capitalisme. La révolution aurait beau éclater dans un pays, les travailleurs du reste du monde ne suivraient l'exemple que dans la mesure où la révolution viendrait répondre à leurs inquiétudes et nécessités du moment. L'exemple révolutionnaire n'est contagieux qu'à condition qu'il corresponde à des situations communes.
----------------------------------------------------
Nous ne sommes pas des "mécanicistes" ou des "économicistes simplistes", encore moins des "fatalistes"; ni non plus des gens qui "négligent l'aspect subjectif de la révolution". Nous savons, comme nous l'avons déjà dit, que "CRISE ECONOMIQUE N'IMPLIQUE PAS MECANIQUEMENT REVOLUTION" et nous connaissons, comme tout le monde, l'exemple de la crise de 1929. Nous sommes simplement des gens qui, comme Marx, pensent que le projet révolutionnaire repose sur des bases autrement plus solides que celles d'un simple souhait de "justice" providentielle ou de la volonté d'en finir.
C'est pourquoi, il nous semble fondamental de comprendre la crise dans laquelle est entré le capitalisme et de déterminer son ampleur.
----------------------------------------------------
LA CRISE ECONOMIQUE
Notre but n'est pas de fournir une quantité de statistiques, les unes derrière les autres, mais de montrer quels sont les caractères fondamentaux de la crise pour déterminer s'il s'agit d'une récession passagère ou bien d'une crise profonde du système, annonçant des perspectives révolutionnaires.
Les symptômes...
C'est au début de 1967 qu'il devient clair que quelque chose ne tourne plus rond dans l'économie mondiale. Plus d'un demi-million de chômeurs en Allemagne Occidentale et en Grande-Bretagne. En France le même fléau commence à sévir, l'ascension du chômage est plus lente mais sûre. La hausse des prix devient constante. Aux USA, la production automobile diminue sensiblement, l'inflation commence à devenir l'inquiétude fondamentale du gouvernement, l'appareil de production ne fonctionne plus qu'à 90 % de sa capacité en 1966, ce taux d'utilisation tombe à 85 % aux premiers mois de 1968.
Malgré les tentatives de Marché Commun, Kennedy Round, etc..., les concurrences entre les puissances s'aggravent. En Juin 1967 éclate la guerre du Moyen-Orient, qui permet aux pays arabes de canaliser le mécontentement croissant de la population, à Israël de résorber ses 45000 chômeurs, aux puissances d'écouler des stocks d'armes, à l'URSS d'écouler son pétrole en Grande-Bretagne...
Mais en Octobre 1967, on compte (selon l'Expansion d'oct.67) 6 millions de chômeurs en Occident, et en Novembre la Livre Sterling s'effondre, emportant avec elle les monnaies des pays de la zone de libre-échange et faisant chanceler le Dollar. Fin 1967, les USA prennent des mesures pour freiner l'inflation et le déficit croissant de leur balance des paiements, qui mène à la dévaluation du Dollar. Mais trois mois plus tard, celui-ci se précipite dans une nouvelle crise monétaire.
En France où le chômage n'a cessé de croître et les salaires réels de diminuer, éclate en Mai la plus grande grève de l'histoire. Six mois plus tard, c'est la crise du Franc, et à l'égal de l'Angleterre en 1966, elle est forcée à l"'austérité".
L’année 1969 commence dans un climat d'instabilité où le spectre de la crise et de l'effondrement total plane sur toute la société.
Les crises inter-blocs impérialistes s'aggravent et succèdent aux multiples accords internationaux de toutes sortes. Le "voyage d'amitié" de Nixon en Europe s'accompagne d'une crise franco-britannique, d'un écartèlement du Marché Commun, d'une nouvelle flambée de la guerre du Viêt-Nam, de l'état d'urgence en Egypte, et d'une nouvelle relance du problème de Berlin. Le tout dans une ambiance de course internationale à la hausse du taux d'escompte[1] -ce qui en de telles conditions ne peut pas ne pas rappeler les hausses vertigineuses des taux d'escompte à la veille du krack de 1929.
"Nous avons enfin appris à gérer une économie moderne de façon à assurer son expansion continue" disait Nixon dans son discours d'entrée en fonction comme Président des USA. Son trésorier, David Kennedy, lui, rappelait que la "balance commerciale s'est effondrée jusqu'à être inexistante, sous la pression de l'inflation." La revue économique américaine Fortune, quant à elle, parlait des "difficultés économiques les plus lourdes de conséquence et les plus prolongées depuis la Seconde Guerre."
1 - EST-CE SIMPLEMENT UNE CRISE MONETAIRE ?
Trois grandes crises monétaires en un an.
S'agit-il seulement, comme le prétendent certains économistes bourgeois d'une inadaptation du système monétaire aux besoins de la production ? Et alors suffit-il de refaire une conférence monétaire internationale style Bretton-Woods, pour que tout redevienne normal ?
Leur thèse serait essentiellement celle-ci: le système monétaire international établi à Bretton-Woods à la fin de la Seconde Guerre et dont la base est le Dollar au lieu de l'or, serait devenu inadéquat et ne permettrait plus les échanges (le Dollar n'ayant plus la place internationale qu'il avait à la fin de la Seconde Guerre, et les monnaies d'autres pays s'étant renforcées depuis).
Tout cela est évidemment absurde à la base. La monnaie n'est qu'un moyen d'échange. Comme telle, elle n'est qu'un instrument à un moment donné du processus général de la production, celui de l'échange.
Quand la production marche bien, les échanges se font sans difficultés et cet instrument peut jouer son rôle sans problème. Même quand il n'est pas suffisamment solide (ce qui est le cas de la plupart des monnaies du monde), c'est-à-dire, quand il ne représente pas réellement la valeur qu'il est supposé représenter, le besoin qu'on en a est tel qu'il peut servir à cet échange.
Ce n'est donc pas parce que la monnaie est mauvaise que la production s'effondre, c'est parce que la production menace de s'effondrer que le système monétaire entre en crise. Il est vrai que le système monétaire international est absolument aberrant. La plupart des grandes monnaies ne sont que très partiellement couvertes par des valeurs réelles, en réalité, la plupart des monnaies dans le monde représentent surtout du papier et très peu d'or. Mais ceci n'est pas nouveau- Depuis la 1° Guerre Mondiale, et surtout depuis la crise de 1929, les différents pays ont été obligés, pour faire face aux dépenses grandissantes de leur Etat, de recourir de plus en plus à la planche à billets, c'est-à-dire d'émettre de la monnaie sans couverture réelle.
Il est alors normal qu'à la moindre récession économique, dès que les échanges internationaux connaissent la moindre difficulté, les monnaies, moins demandées, tendent à revenir à leur véritable valeur et donc à dévaluer- Leur faiblesse, qui à un certain moment, a pu être la condition de l'expansion, devient alors un facteur certain de récession.
Mais ce n'est pas dans la faiblesse de la monnaie qu'il faut chercher l'explication de la crise actuelle, cette faiblesse n'étant elle-même qu'un symptôme de la crise au niveau de la production.
Un "nouveau Bretton-Woods", au cas où finalement les puissances finiraient par se mettre d'accord pour le tenir, ne pourrait rien arranger à la crise économique, car il s'attaquerait seulement à une des conséquences de la crise en laissant intactes ses racines profondes.
2 - LES FONDEMENTS DE LA CRISE
- "Il ne faut jamais oublier que la production de cette plus-value (et la reconversion d'une partie de cette plus-value en capital, ou accumulation, fait partie intégrante de cette production de la plus-value) est le but immédiat et le mobile déterminant de la production capitaliste". (Marx. Œuvres. Tome II. Le Capital III Editions de la Pléiade. P. 1025)-
Mais pour pouvoir réaliser cette reconversion de la plus-value "il faut que toute la masse des marchandises, le produit total... se vende" (idem).
D'autre part, cette production doit croître incessamment. "C'est une loi de la production capitaliste qu'impose le bouleversement continuel des méthodes de production, par la dépréciation concomitante du capital existant, la concurrence générale et la nécessité d'améliorer la production et d'en étendre l'échelle, ne fut-ce que pour la maintenir, et sous peine de courir à la ruine" (idem)
Or, alors que la production de la plus-value n'a pour limites "que les forces productives de la société", sa réalisation, la vente de la production est soumise au contraire "à la proportionnalité des branches et au pouvoir de consommation de la société. Mais celui-ci n'est déterminé ni par la force productive absolue, ni par le pouvoir de consommation absolu; il l'est par le pouvoir de consommation qui a pour base des conditions de répartition antagonistes qui réduisent la consommation de la grande masse de la société à un minimum variable dans des limites plus ou moins étroites. Il est en outre restreint par le désir d'accumuler, la tendance à augmenter le capital et à produire de la plus-value sur une échelle plus étendue... Il faut par conséquent, constamment élargir le marché, si bien que ses inter-relations et les conditions qui les règlent prennent de plus en plus la forme d'une loi naturelle indépendante des producteurs et deviennent de plus en plus incontrôlables. Cette contradiction interne tend à être compensée par l'extension du champ extérieur de la production. Mais, plus les forces productives se développent, plus elles entrent en conflit avec les fondements étroits sur lesquels reposent les rapports de consommation" (idem).
C'est là le fondement des grandes crises du capitalisme, en se développant, le capitalisme sature ses marchés et donc la condition de son expansion.
Comment s'en sort-il ? Par une destruction systématique qui ouvre de nouveaux débouchés.
Ainsi, depuis 1914, le capitalisme vit selon le cycle, crise - destruction - reconstruction - crise. La guerre de 1914-1918 vint soulager le capitalisme de la crise qui la précéda (Bilan, 18 millions de morts, 20 millions d'invalides). 1918-1929, reconstruction. 1929-1939, années de crise. "Seule la guerre en débarrassera le monde en 1939-1945".
Dans la période 1929-1939, le capitalisme trouve un moyen pour tenter de pallier à la crise, LA PRODUCTION MASSIVE D'ARMEMENTS (très nette surtout aux USA, en Allemagne et dans les autres pays fascistes). Mais ce n'est qu'un PALLIATIF qui n'éliminera pas (au contraire) la nécessité de la II° Guerre Mondiale. En 1939-1945, la II0 Guerre Mondiale (Bilan, 45 millions de morts, économies européenne et japonaise réduites à néant).
Depuis lors, le capitalisme ne s'est "développé" que grâce à la RECONSTRUCTION des ruines de la guerre, la production effrénée d'armements, l'absorption de quelques secteurs extra-capitalistes (pays sous-développés et secteurs agricoles de l'Italie, de la France, de l'Allemagne et du Japon).
A ces "soupapes" d'urgence, le capitalisme a ajouté depuis 1945 le maintien de la destruction systématique en entretenant de façon permanente des guerres locales sur des territoires en dispute: Indochine, Corée, Algérie, Viêt-Nam, Biafra, Moyen-Orient.
La crise actuelle du capitalisme marque la fin de la reconstruction, l'essoufflement de la production d'armements, la saturation des marchés mondiaux.
- LA FIN DE LA RECONSTRUCTION
"Au lendemain de la dernière guerre, la reconstruction a contribué au développement de la production. En France, s'y est ajouté le retard pris entre les deux guerres et qu'il fallait combler. Nous avons, certes, retrouvé en 1948 notre niveau de production de 1938, mais celui-ci était inférieur à celui de 1929, à vingt ans de stagnation ont succédé vingt ans d'expansion, qui en sont d'une certaine manière la contrepartie, ce qui peut nous réjouir, mais ne devrait pas nous tourner la tête (...). La reconstruction est achevée et la période de "rattrapage" en un sens close." ("L'Expansion". Octobre 1967."Faut-il avoir peur de la crise ?").
Les pays don~ l'économie avait été détruite pendant la II° Guerre Mondiale ont, non seulement été reconstruits, mais encore leur production a atteint des niveaux qui les obligent aujourd'hui à chercher des débouchés à l'extérieur. Or, ils avaient constitué jusqu'à présent le marché principal de l'économie mondiale.
Ainsi, on voit parallèlement :
- d’un côté la balance commerciale américaine se détériorer progressivement jusqu'à devenir négative en 1968,
- d'un autre côté, les balances commerciales du Japon (1965-66) de la France (1960-61) ce l'Italie (1° Semestre 1968) de la CEE (1967) devenir positives ou presque équilibrées. Mais pas pour longtemps, l'amélioration de ces balances commerciales loin d'annoncer une nouvelle phase d'expansion, marque au contraire la saturation mondiale des marchés, l'accroissement des concurrences inter-impérialistes (c'est le début de la politique "an- ti américaine" de De Gaulle, de la politique d'expansion de M. Sato au Japon), le début de la nouvelle crise.
- L'ESSOUFFLEMENT DE LA PRODUCTION D'ARMEMENTS
La politique de production massive d'armes, ne venant pas encombrer le marché national, a été poussée par le capitalisme jusqu'aux limites extrêmes, Cette production absorbe parfois près de la moitié du budget d'Etat des USA et de l'URSS. Les USA à eux seuls ont dépensé ces sept dernières années 200C milliards de Dollars, soit près de cinq fois le revenu annuel de la France, Ils dépensent actuellement plus de deux milliards de Dollars par mois uniquement pour la guerre du Viêt-Nam. 25 % des exportations françaises sont du matériel de guerre, etc…, etc...
Mais cette production de la destruction, financée par l'Etat est une source incontrôlable de hausse des prix, d'inflation (5 % aux USA en 1968). A partir de certaines limites, elle devient néfaste pour l'économie. Une fois la monnaie en danger, il est nécessaire de réduire cette production d'armements (voir les pressions de certains milieux financiers aux USA en ce sens, la réduction du budget d'armements de la Grande-Bretagne en 1966, de la France en 1968). Cependant, la réduction de la production de guerre est synonyme de récession et de chômage, et ainsi les Etats pour éviter une crise immédiate doivent se priver d'un des principaux facteurs qui a assuré leur expansion jusqu'à présent. Et, cela sans avoir de quoi le remplacer.
- LES MARCHES DU TIERS-MONDE
Quant aux marchés que constituent les pays du tiers-monde, ils sont entièrement saturés. Endettés de façon exorbitante, ces pays connaissent les mêmes difficultés que les grandes puissances : chômage (plus de trois millions de jeunes chômeurs en Inde), récession généralisée dans presque tous les pays d'Amérique Latine.
- LES SECTEURS AGRICOLES
Quant aux secteurs agricoles, dont l'intégration à l'économie capitaliste a été un facteur d'expansion en France, en Italie, en Allemagne, au Japon depuis la 11° Guerre, ils ne peuvent constituer aujourd'hui un marché suffisant pour relancer l'économie. De plus, cette intégration se heurte à des résistances extrêmement violentes que les gouvernements craignent dans la conjoncture sociale actuelle (voir l'opposition au plein Mansholt qui préconise justement cette intégration).
LES FACTEURS QUI ONT ASSURE L'EXPANSION DU CAPITALISME DEPUIS LA II° GUERRE MONDIALE PARVIENNENT AUJOURD'HUI A LEUR EPUISEMENT, et les fameux "boums" (allemands, italiens, etc.) d'après-guerre laissent la place à la récession généralisée: la crise du système monétaire, prélude d'une nouvelle CRISE MONDIALE DU CAPITALISME.
Les solutions apportées par les différents gouvernements (qui se traduisent par 1'"austérité" en Grande-Bretagne et en France en particulier) loin de résoudre le problème ne font que l'aggraver :
- le contrôle des changes ;
- le relèvement du taux d'escompte (8 % en Grande-Bretagne, 6 % en France) ;
- la limitation des crédits bancaires, entraînent la limitation des investissements (récession) et celle des achats à crédit (ce qui réduit la consommation et donc le marché) ;
- la réduction des dépenses de l'Etat (sursis publics, secteur nationalisé, armement, etc...) est la source la plus certaine de la récession ou du moins de l'affaiblissement de l'embauche ;
- la hausse des prix des services publics et la hausse de certains impôts (TVA en France) sont en fait des réductions de salaires, freins à la consommation, freins à l'emploi).
Toutes ces mesures ne sont que des "pataugements" pour mieux s'enfoncer.
LES PERSPECTIVES QU'OUVRE LA CRISE
Au contraire de la crise de 1929, qui éclate juste après l'écrasement du mouvement ouvrier international, la crise actuelle surgit au moment où les travailleurs dans le monde entier, en particulier dans les jeunes générations, se débarrassent des mystifications de la II° Guerre et de celles des bureaucraties staliniennes.
Dans les pays "sous-développés", en particulier en Amérique Latine, les luttes minoritaires de "libération nationale" laissent la place aux luttes de classe. Pour la première fois, tous ces pays connaissent des grandes grèves et des émeutes de caractère ouvrier. Dans les grandes puissances, (en particulier France, Angleterre et Italie) la classe ouvrière se réveille plus forte que jamais.
La perspective qu'ouvre la crise actuelle du capitalisme est celle du pouvoir des Conseils Ouvriers, de la Révolution mondiale.
"N'entendons pas par-là que "l’abondance" fomente les révolutions. Entendons seulement que "l'appauvrissement absolu n’est nullement nécessaire à la naissance de sentiments d’opposition. Pour entrer en révolte, les hommes n'ont pas besoin d‘être réduits à la famine: ils peuvent s'y jeter dès les premiers empiètements sérieux qui menacent leur standard de vie habituel, ou quand leur est interdit l'accès à ce qu'ils considèrent comme leur standard de vie. Mieux les hommes vivent, plus ils trouvent dure la moindre privation, et plus ils se cramponnent au style de vie qui leur est cher. C’est en ce sens ou un tarissement partiel de "1’abondance" régnante peut suffire à pulvériser le consentement qui l'accompagne."
P. Mattick. "Les limites de l’intégration".- 1965.
-----------------------------------------------
2 graphiques qui tendent à prouver la relation qui existe réellement entre Mai 68 et la situation économique...
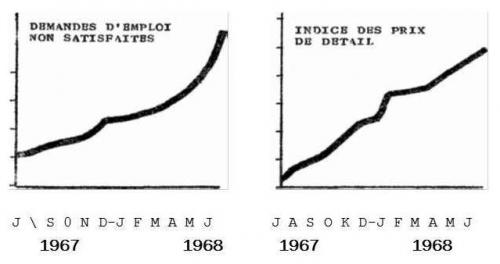
[1] La Grande-Bretagne fait passer son taux d'escompte de 7 % à 8 %, taux jamais atteint depuis la II° Guerre Mondiale (à la veille de 1929, il n'était monté pour les USA qu'à 7,6 %). La Suède le fait passer de 5 % à 6 %. La France en est déjà à 5 %.
Revolution Internationale N°3 - décembre
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 3.02 Mo |
- 609 lectures