Submitted by Revue Internationale on
- La situation politique internationale.
- L'accélération de la crise économique.
- Etat et dictature du prolétariat.
Un choix parmi les rapports présentés au Congrès de 76. Dans le contexte de la fin des espoirs sur la "reprise économique", ils développent une analyse du jeu des différents facteurs qui déterminent la situation actuelle : l'affrontement entre les blocs impérialistes, les conflits entre différents secteurs de la classe dominante et la lutte de classe.
Dans le cadre de nos discussions sur la période de transition, nous présentons aussi une résolution sur l'Etat après la révolution.
La première partie d'une étude sur le surgissement des fractions de Gauche dans la Russie d'après Octobre : Ossinsky, le Centralisme Démocratique, l'Opposition Ouvrière, le Groupe Ouvrier jusqu'à 1921. Cet article cherche à montrer les difficultés de la prise de conscience dans la période de dégénérescence de la révolution, et les jalons de l'avenir qu'ont posé les Communistes de Gauche avant même que l'Opposition Unifiée (Trotski-Zinoviev) ne se constitue.
Cet échange de lettres entre le CCI et Battag1ia Comunista (l'un des groupes issus du PC Internationaliste d'Italie fondé en 43) vise à mettre en évidence le danger de l'antifascisme dont les germes ont pu pénétrer jusque dans les rangs de la Gauche Italienne malgré sa position contre la guerre impérialiste. Ce rappel de l'histoire de la Gauche Communiste des années 40 peut être considéré comme la continuation de notre polémique contre le PCI (Programme Communiste) actuel en dégénérescence et constitue une suite aux textes de BILAN (organe de 1a fraction Italienne en exil des années 30) sur l'Espagne 36, que nous avons republiés dans les n°4, 6 et 7 de la Revue Internationale.
Une mise au point du CCI à propos du refus des librairies "Contra a Corrente" de diffuser les publications du CCI.
TEXTES DU SECOND CONGRES DE REVOLUTION INTERNATIONALE
Les textes sur la "situation internationale" et sur la "période de transition" que nous publions dans le présent numéro de la Revue Internationale sont des rapports du Second Congrès de RI, section du CCI en France. Ces deux thèmes constituaient la toile de fond sur laquelle se sont inscrits les travaux du Congrès, l'axe de ses débats. S'ils étaient inscrits à l'ordre du jour du Congrès, ce n'est pas selon un choix de sujets théoriques généraux mais bel et bien en réponse au développement de la situation générale. En effet, l'évolution actuelle de la crise du système - qui n'est qu'une continuation de sa décadence - pose par son acuité, de plus en plus ouvertement, la perspective révolutionnaire comme seule issue possible. Aujourd'hui, son développement inéluctable et dont plus personne ne cherche à prédire une fin prochaine, va contraindre le prolétariat à reprendre les armes de sa lutte historique. Et au même moment où le capital ne cherche même plus à faire miroiter les reflets illusoires de "beaux jours" encore possibles mais ne peut que demander aux prolétaires du monde entier de "se serrer la ceinture", la révolution n'apparaît plus comme une possibilité lointaine mais comme une nécessité vitale. Le contenu du socialisme, les premiers problèmes que posera la victoire deviennent une préoccupation de plus en plus ressentie par les révolutionnaires. Ce sont ces problèmes, l'analyse de la situation qui conduit à la révolution et les premières questions que sa victoire posera au prolétariat, auxquels le Congrès a tenté de répondre. Et de plus en plus, ces deux aspects de l'avenir, la situation avant et après la révolution, seront intimement liés car c'est le développement présent de la crise qui, faisant de la révolution une perspective de plus en plus concrète, amène à se poser comme un problème réel le contenu de celle-ci.
Ceci est tellement vrai qu'aujourd'hui plusieurs groupes sont amenés à se pencher sur les problèmes de la période de transition et à en concevoir l'importance. Des groupes comme le PIC, la CWO, la revue Spartacus ont consacré dans leurs publications des articles sur cette question qui, il y a quelques années encore, était pratiquement méconnue au sein du mouvement ouvrier renaissant. C'est fondamentalement l'évolution de la réalité elle-même qui fait naître un tel besoin. Il a fallu que la crise apparaisse dans toute sa réalité pour que les éléments de la classe qui, comme ICO, le GLAT, Alarma ou les situationnistes en 68-69, ironisaient sur les "prophéties" de RI, soient obligés de la reconnaître et d'en parler. De la même façon, c'est bel et bien l'évolution présente de la situation qui pousse aujourd'hui différents groupes à se pencher sur les problèmes de la révolution et à les reconnaître comme tels. "L'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre". C'est la réalité qui suscite le développement de la conscience du prolétariat de ses intérêts et de ses tâches ; c'est elle qui met les révolutionnaires face à leurs responsabilités dans le développement de cette conscience.
De plus en plus, donc, le développement de la situation va poser le problème du contenu de la révolution qui deviendra une préoccupation croissante dans le mouvement ouvrier. Qui prend le pouvoir, comment est ce pouvoir, comment il s'organise, quelles sont les premières mesures à prendre ? Toutes ces questions vont être soulevées et largement débattues. C'est seulement sur la base des expériences passées de la classe que les premiers éléments de réponse peuvent être apportés. Ils nécessitent une réflexion approfondie et la responsabilité des révolutionnaires à cet égard est d'autant plus grande que la rupture de la continuité organique avec le mouvement ouvrier du passé, la méconnaissance par le mouvement ouvrier actuel des acquis de son propre passé en augmentent la difficulté. Depuis plusieurs années déjà RI a engagé des discussions sur la période de transition ; celles-ci viennent d'aboutir dans un premier temps à la résolution publiée dans la revue et qui est versée comme contribution au débat qui se déroule au sein du CCI et à la classe ouvrière dans son ensemble.
Quant aux textes sur la "situation internationale", le premier, tout en faisant un tableau de la situation politique mondiale, cherche à faire la synthèse des discussions sur l'actualité qui ont eu lieu au sein du CCI cette année et à mettre en évidence les différents facteurs qui interviennent dans toute situation ; en ce sens, il se conçoit aussi comme un texte de méthode cherchant à développer les armes pour la compréhension de toute situation politique. Le second s'attache à donner un aperçu de la situation économique du système à l'heure actuelle.
Ainsi le Second Congrès de RI ne s'est pas penché seulement sur des problèmes spécifiques à la section en France ; c'est véritablement comme une partie intégrante du CCI qu'il a conçu son travail. Nous avons publié les textes relevant plus directement de la section française dans RI n°32 mais les textes qui suivent relevant d'un intérêt général et international, nous les versons comme contributions dans notre presse internationale, à tout le mouvement ouvrier.
CN.
LA SITUATION POLITIQUE INTERNATIONALE
Pendant des années, les porte-parole appointés de la bourgeoisie ont essayé d'exorciser par des incantations à prétention scientifique les démons de la crise. En couvrant de prix Nobel et d'honneurs ses économistes les plus stupidement béats, cette classe espérait que les faits se plieraient à ses aspirations. Aujourd'hui la crise du capitalisme est devenue d'une telle évidence que même les secteurs les plus "confiants" et "optimistes" de la classe dominante ont admis non seulement son existence mais aussi sa gravité. De ce fait, la tâche des révolutionnaires n'est plus d'en annoncer l'inévitabilité mais de souligner la faillite des théories qui avaient surgi comme champignons après la pluie lors de la période de fallacieuse "prospérité" accompagnant la reconstruction des ruines de la Seconde Guerre mondiale.
Parmi les théories les plus en vogue dans le monde bourgeois, celle de l'Ecole néo-keynésienne faisait figure de favorite. N'avait-elle pas annoncé une ère de prospérité illimitée grâce à une intervention judicieuse de l'Etat dans l'économie à travers les outils budgétaires ? Depuis 1945 une telle intervention a été la règle dans tous les pays : la catastrophe économique présente vient sonner le glas des illusions des disciples de celui que la bourgeoisie considère comme "le plus grand économiste du XXème siècle".
Plus généralement, la situation actuelle illustre la faillite de toutes les théories qui ont fait de l'Etat un possible sauveur du système capitaliste contre la menace de ses propres contradictions internes. Le capitalisme d'Etat qu'on a pu présenter comme la simple prolongation du processus de concentration engagé dans la période ascendante du capitalisme ou comme "dépassement de la loi de la valeur", se révèle de plus en plus pour ce qu'il a toujours été depuis son apparition au cours de la Première Guerre mondiale : la manifestation, essentiellement sur le plan politique, des efforts désespérés d'un système économique aux abois pour préserver un minimum de cohésion et pour assurer, non son expansion, mais sa survie.
La violence avec laquelle la crise mondiale frappe aujourd'hui les pays où le capitalisme d'Etat s'est développé le plus, anéantit de façon croissante les illusions sur leur nature "socialiste" et sur la prétendue capacité de la "planification" ou du "monopole du commerce extérieur" de venir à bout de l'anarchie capitaliste. Dans ces pays, le chômage est de plus en plus difficilement masqué par la sous-utilisassions de la main d'œuvre. C'est maintenant ouvertement et officiellement que les autorités reconnaissent l'existence de ce fléau typiquement capitaliste. De même, la hausse des prix, qui jusqu'à ces derniers temps ne touchait que le marché parallèle, s'étend de façon spectaculaire au marché officiel. L'économie de ces pays qui était censée tenir tête aux convulsions du capitalisme mondial se révèle fragile et mal armée pour affronter l'exacerbation actuelle de la concurrence commerciale. Loin d'être en mesure, comme l'annonçaient certains de leurs dirigeants, de "dépasser le capitalisme occidental", ces économies ont, au cours des dernières années, contracté d'énormes dettes à l'égard de celui-ci, ce qui aujourd'hui les place pratiquement dans une situation de banqueroute. Cet endettement considérable vient apporter un démenti cinglant à toutes les théories qui, oubliant, quelquefois même au nom du "marxisme", que la saturation générale des marchés n'est pas un phénomène spécifique à telle ou telle région du monde mais touche l'ensemble du capitalisme, ont cru trouver dans les pays soi-disant socialistes des débouchés miraculeux qui allaient résoudre les problèmes qui assaillent le capital.
Depuis la fin des années 60 où la bourgeoisie a commencé à prendre conscience des difficultés de son économie elle n'a eu de cesse de répéter que la situation actuelle est fondamentalement différente de celle de 1929. Terrifiée à l'idée qu'elle pourrait connaître une autre "dépression" de ce type, elle a essayé de se consoler en mettant en relief toutes les différences qui distinguent la crise actuelle de celle de l'entre-deux guerres. Elle a ainsi détaché de l'ensemble les différents aspects et les différentes étapes de la crise pour ne parler que de "la crise du système monétaire" à laquelle devait succéder la "crise du pétrole" rendue responsable à la fois de l'inflation galopante et de la récession.
Contrairement à ce que pensent la majorité des "spécialistes" de la classe dominante, la crise de 1929 et la crise actuelle ont la même nature fondamentale : les deux s'inscrivent dans le cycle infernal de la décadence du mode de production capitaliste : crise - guerre inter impérialiste –reconstruction - nouvelle crise, etc. Elles sont l'expression du fait qu'après une période de reconstitution de l'appareil productif détruit par la guerre impérialiste, le capitalisme se retrouve incapable d'écouler sa production sur un marché mondial saturé. Ce qui distingue les deux crises est du domaine du circonstanciel. En 1929, la saturation des marchés se traduit par un effondrement du crédit privé exprimé par l'effondrement de la Bourse. Après une première période de débandade on assiste, à travers les politiques d'armement et de grands travaux, comme dans l'Allemagne hitlérienne et le "New Deal" américain, à une intervention massive de l'Etat dans les mécanismes économiques qui permet une relance momentanée. Mais une telle politique trouve ses propres limites dans le fait que les réserves financières de l'Etat ne sont pas inépuisables : en 1938, les caisses sont vides et l'économie mondiale plonge dans une nouvelle dépression dont elle n'est sortie que par la guerre.
Dans la période qui suit la Seconde guerre l'intervention étatique ne se relâche pas comme dans celle qui suit la Première. En particulier les dépenses d'armement conservent une place majeure dans l'économie. Ceci explique le maintien depuis 1945 d'une inflation structurelle qui exprime la pression croissante des dépenses improductives nécessaires à la survie du système et qui conduit à un endettement de plus en plus généralisé particulièrement de la part des Etats. Avec la fin de la reconstruction et la saturation des marchés, le système ne trouve d'échappatoire que dans une fuite en avant de l'endettement qui transforme l'inflation structurelle en inflation galopante. Dès lors, le capitalisme n'a d'autre issue que d'osciller entre cette inflation et la récession dès que les gouvernements essayent de la combattre : c'est pour cela que plans de relance et plans d'austérité se succèdent dans un rythme dont l'accélération traduit en fait l'aggravation catastrophique des convulsions du système. Au stade actuel de la crise, c'est de façon de plus en plus simultanée et non alternée que l'inflation et la récession s'abattent sur les économies nationales.
L'intervention systématique de l'Etat a évité au système un effondrement du crédit privé comme celui de 1929. Obnubilée par les épiphénomènes et incapable de comprendre les lois fondamentales de sa propre économie, la bourgeoisie ne voit toujours pas venir devant elle son nouveau 29... pour la bonne raison qu'elle se trouve déjà dans la situation de 1938!
La situation présente de l'économie mondiale signe également la faillite de l'idée, défendue jusque dans les rangs des révolutionnaires, que la crise actuelle est une "crise de restructuration" comprise, non dans le sens qu'elle n'a d'issue que dans une transformation de la structure de la société, mais comme résultat d'un réaménagement des structures économiques existantes. En particulier, dans une telle conception les mesures de capitalisme d'Etat sont souvent présentées comme un moyen pour le système de surmonter ses contradictions.
Si, vers la fin des années 60, de telles théories pouvaient avoir un semblant de crédibilité, elles apparaissent aujourd'hui comme des élucubrations d'intellectuel original. Les dirigeants de l'économie bourgeoise seraient de bien piètres apprentis sorciers s'ils l'avaient plongée dans le chaos actuel uniquement dans le but de la "restructurer".
En fait, dans tous les domaines, la situation est aujourd'hui bien pire que celle qui existait il y a cinq ans, laquelle s'était déjà notablement dégradée par rapport à celle d'il y a dix ans. Si les conditions de départ d'il y a dix ans ont conduit au résultat d'il y a cinq ans et si celles de cette époque ont conduit au résultat actuel, on ne voit pas comment les conditions présentes - où la récession l'endettement et l'inflation n'ont jamais été pires - pourraient déboucher sur une quelconque amélioration de la situation de l'économie capitaliste.
Les prix Nobel d'économie comme les "révolutionnaires" qui ont jeté aux orties un marxisme prétendument "dépassé" devront se résigner : la crise actuelle est sans issue et ne peut aller qu'en s'aggravant.
Si la crise actuelle ne peut que s'approfondir de façon inéluctable, si aucune mesure prise par la classe dominante n'est capable d'en enrayer le cours, celle-ci est cependant conduite à adopter toute une série de dispositions afin de tenter, dans la débandade générale, d'assurer un minimum de défense de son capital national et d'en ralentir la dégradation.
Du fait que la crise est le résultat du caractère limité du marché mondial auquel se heurte l'expansion de la production capitaliste, une quelconque défense des intérêts d'un capital national passe nécessairement par un renforcement de ses capacités concurrentielles à l'égard des autres capitaux nationaux et corollairement le report sur eux d'une partie de ses difficultés. Outre les mesures à caractère extérieur aptes à améliorer ses positions sur la scène internationale, chaque capital national doit, sur le plan interne, mettre en place une politique tendant à diminuer le prix de revient de ses marchandises par rapport à celles des autres pays, ce qui suppose donc une baisse de des dépenses entrant dans la fabrication de chaque produit. Une telle baisse passe par une rentabilisation maximale du capital et une diminution de la consommation globale du pays, ce qui implique une attaque, d'une part contre les secteurs les plus arriérés de la production et contre l'ensemble des couches moyennes et, d'autre part contre le niveau de vie de la classe ouvrière.
C'est donc une politique à trois volets - report de ses difficultés sur les autres pays, sur les couches intermédiaires et sur les travailleurs - et qui ont pour dénominateur commun le renforcement de la tendance au capitalisme d'Etat, que tente partout la bourgeoisie de mettre en place. C'est dans les résistances auxquelles s'oppose cette mise en place, dans les contradictions qu'elle fait surgir, qu'il faut rechercher les mécanismes à travers lesquels la crise économique débouche sur la crise politique qui, aujourd'hui, tend à son tour à se généraliser.
Le premier volet de la politique de la bourgeoisie de chaque pays, face à la crise, la tentative de report des difficultés sur les autres pays, se heurte à la limite immédiate et évidente d'entrer en contradiction avec la même tentative de la part de chaque autre bourgeoisie nationale. Elle ne peut que conduire à une aggravation des rivalités économiques entre pays qui se reportent nécessairement sur le plan militaire. Mais que ce soit sur le terrain économique ou, encore plus, sur le terrain militaire, aucune nation ne peut seule s'opposer à toutes les autres nations du monde. C'est ce qui explique l'existence de blocs impérialistes qui tendent nécessairement à se renforcer au fur et à mesure que la crise s'approfondit.
La division en de tels blocs ne recouvre pas nécessairement les rivalités commerciales majeures (ainsi l'Europe occidentale, les USA, le Japon, principaux concurrents sur le plan économique, se retrouvent au sein du même bloc impérialiste), qui n'en continuent pas moins de s'aggraver. Mais, même si des affrontements militaires ne sont jamais exclus entre pays d'un même bloc (cf. l'Israël et la Jordanie en 67, la Grèce et la Turquie en 74), ces tensions économiques ne sauraient remettre en cause la "solidarité" militaire des principaux pays qui le constituent face à l'autre bloc. Ne pouvant s'exprimer sur le plan militaire, au sein d'un même bloc, sous peine de favoriser l'autre, l'intensification des rivalités économiques entre pays débouche sur l'intensification des rivalités militaires entre blocs. Dans une telle situation, la défense du capital national de chaque pays tend à entrer de plus en plus en conflit avec la défense des intérêts du bloc de tutelle, par laquelle elle passe de façon inévitable. Outre la première contradiction déjà relevée, c'est donc là une difficulté supplémentaire à laquelle se heurte la bourgeoisie de chaque pays dans la mise en œuvre du premier volet de sa politique contre la crise et qui ne peut déboucher que sur la soumission des intérêts nationaux à ceux du bloc de tutelle.
La capacité de mise en œuvre par chaque bourgeoisie de ce volet de sa politique est conditionnée essentiellement par la puissance de son économie. Ce fait s'est traduit en premier lieu par un report des premières atteintes de la crise sur les pays de la périphérie du système : ceux du Tiers-monde. Mais, au fur et à mesure que la crise s'aggrave, ses effets viennent frapper de plus en plus brutalement les métropoles industrielles parmi lesquelles celles qui disposent du potentiel économique le plus solide sont aussi celles qui y résistent le mieux. Ainsi la "reprise" de 1975-76 dont ont bénéficié surtout les USA et l'Allemagne a été payée par une détérioration catastrophique des économies européennes les plus faibles comme celles du Portugal de l'Espagne et de l'Italie, ce qui a accru d'autant leur dépendance à l'égard des pays les plus puissants, essentiellement des USA. Cette suprématie économique se répercute sur le plan militaire où, non seulement les pays les plus faibles doivent, au sein de chaque bloc, se soumettre de façon croissante au plus puissant, mais où, également, le bloc ayant l'assise économique la plus solide, celui dirigé par les USA, progresse et se renforce au détriment de l'autre. Il est aujourd'hui devenu clair, par exemple, que la fameuse "défaite" américaine au Vietnam constituait un repli tactique d’une zone sans grand intérêt militaire et économique afin de venir renforcer la puissance américaine dans les zones beaucoup plus importantes d'Afrique australe et surtout du Moyen Orient. L'aggravation de la crise vient donc annuler les velléités "d'indépendance nationale" qui s'étaient développées à la faveur de la reconstruction dans certains pays comme la France, de même qu'elle apporte un démenti cinglant à toutes les mystifications entretenues par l'extrême gauche du capital sur la "libération nationale" et la "victoire contre l'impérialisme américain".
Le deuxième volet de la politique bourgeoise face à la crise consiste dans une meilleure rentabilisation de l'appareil productif s'exerçant contre les couches sociales autres que prolétariennes. Il consiste d'une part, en une attaque contre le niveau de vie de l'ensemble des couches moyennes liées aux secteurs non productifs ou à la petite production, d'autre part, dans une élimination des secteurs économiques les plus anachroniques, les moins concentrés ou travaillant suivant des techniques les plus archaïques. Les couches sociales en général assez hétéroclites touchées par ces mesures, sont composées essentiellement de la petite paysannerie, de l'artisanat, de la petite industrie et du petit commerce dont le revenu est souvent réduit de façon drastique à travers une aggravation de la pression fiscale et de 1a concurrence de la part d'unités productives ou de distribution plus concentrées et qui sont conduits bien souvent à la ruine et à l'abandon de leur activité. Cette politique peut également frapper, à travers des mesures de capitalisme d'Etat, les professions libérales, les cadres, certains secteurs de l'administration ou du secteur tertiaire particulièrement parasitaires comme également des fractions de la classe dominante elle-même, sous sa forme la plus classique liée à la propriété individuelle.
Cette politique du capital national se heurte nécessairement à la résistance, quelquefois très vive, de l'ensemble de ces couches qui, bien qu'incapables de s'unifier et historiquement condamnées, peuvent peser de façon notable sur la vie politique. En particulier, ces couches peuvent avoir un poids électoral important et quelquefois décisif dans certains pays, dans la mesure où elles constituent l'appui essentiel des gouvernements de droite liés au capitalisme classique - qui ont dominé dans beaucoup de pays durant la période de reconstruction - ou même une force d'appoint des gouvernements de gauche, particulièrement en Europe du Nord. De ce fait, la résistance de ces couches sociales peut constituer une entrave très puissante contre les mesures de capitalisme d'Etat que ces gouvernements sont conduits à prendre de façon impérative. Cette entrave peut, dans certains cas, aboutir à une véritable paralysie des capacités de ces gouvernements à prendre ce type de mesures, ce qui est un facteur venant aggraver encore la crise politique de la classe dominante.
Le troisième volet de la politique capitaliste face à la crise, l'attaque du niveau de vie de la classe ouvrière, est celui qui est destiné à devenir le plus important dans la mesure où cette classe est la principale productrice de richesse sociale. Cette politique, qui a pour but essentiel de réduire les salaires réels et d'augmenter l'exploitation, se manifeste principalement à travers l'inflation qui touche plus particulièrement les prix des biens de consommation, importants dans les milieux ouvriers comme l'alimentation, l'augmentation massive du chômage, la suppression d'un certain nombre "d'avantages sociaux", qui, en fait, font partie des moyens de reproduction de la force de travail, donc du salaire, et enfin d'une intensification, quelquefois violente, des cadences de travail.
Cette agression contre le niveau de vie de la classe ouvrière est devenue une réalité évidente reconnue par la classe capitaliste elle-même qui en fait la pierre angulaire de ses "plans d'austérité". Elle est en fait bien plus violente que les chiffres officiels n'osent le dire, dans la mesure où ceux-ci ne prennent pas en compte cette atteinte aux "avantages sociaux" (médecine, sécurité sociale, cadre de vie, etc.), non plus que le chômage qui ne frappe pas seulement les travailleurs sans travail mais pèse sur l'ensemble de la classe ouvrière puisqu'il se traduit lui aussi par une baisse globale du capital variable destiné à l'entretien de la force de travail.
Cette situation vient détruire une autre théorie qui a eu son heure de gloire durant la période de reconstruction : celle de la faillite des prévisions marxistes sur la paupérisation absolue du prolétariat. Aujourd'hui ce n'est plus de façon relative mais bien de façon absolue que diminue la consommation des travailleurs et qu'augmente l'exploitation.
L'agression capitaliste contre la classe ouvrière s'est heurtée, depuis ses tous débuts en 1968-69, à une réponse très vive de celle-ci. Cet affrontement entre bourgeoisie et prolétariat est celui qui aujourd'hui détermine le cours général de l'évolution historique par rapport à la crise : non pas guerre impérialiste comme à la suite de la crise de 1929, mais guerre de classe. En ce sens, des trois volets de la politique bourgeoise, c'est celui qui s'adresse directement à la classe ouvrière qui va tendre à primer de plus en plus quant à l'évolution politique générale. En particulier dans les zones où le prolétariat est le plus important, le capital va mettre de plus en plus en avant ses fractions politiques "de gauche" qui sont les plus aptes à mystifier et encadrer la classe ouvrière et lui faire accepter les "sacrifices" exigés par la situation économique. Ce besoin de faire appel à la gauche se fait d'autant plus sentir, parmi les pays industrialisés, que la situation de l'économie elle-même est incapable de constituer un facteur de "consensus social" et de confiance dans la capacité du capitalisme à surmonter la crise. Contrairement aux plus prospères et résistant le mieux aux assauts de la crise, dans lesquels il n'est pas besoin de propagande "anticapitaliste" pour attacher les travailleurs au char de leur capital national, ces pays sont donc à la veille de remaniements importants de leur appareil politique. Cependant, et c'est là une contradiction supplémentaire qui assaille la classe dominante, ces remaniements se heurtent à une résistance souvent très décidée de la part des équipes encore au pouvoir et qui, même au détriment des intérêts globaux du capital national, font tout leur possible pour y rester ou y conserver une place importante.
Dans la mise en place de chacun de ces trois axes de sa politique, la bourgeoisie se heurte donc à toute une série de résistances et de contradictions mais, de plus en plus, ces axes de la politique capitaliste peuvent également entrer en contradiction entre eux. Dans certains cas il y a convergence entre certains de ces axes : par exemple les nécessaires mesures de capitalisme d'Etat qui doivent frapper les secteurs les plus anachroniques du capitalisme constituent en même temps un bon moyen pour les fractions de gauche du capital de mystifier les travailleurs en les faisant passer comme mesures "anticapitalistes" ou "socialistes". De même, il est possible que la lutte contre les secteurs les plus anachroniques de la société soit menée par des forces politiques qui ont la confiance et l'appui du bloc de tutelle, comme c'est le cas aujourd'hui en Espagne où le processus de "démocratisation" se fait en liaison et accord direct avec la bourgeoisie européenne et américaine. Cependant, on assiste très souvent à un conflit entre les mesures de capitalisme d'Etat, rendues indispensables par l'aggravation de la crise, et le resserrement des liens de soumission du capital national à l'égard de son bloc de tutelle, conflit qui peut résulter d'une atteinte aux intérêts économiques de la puissance dominante ou encore du fait que les forces politiques les plus appropriées pour les prendre ont, en politique internationale, des options non conformes à celles du bloc. Il peut, dans le même sens, surgir un conflit entre les nécessités du capital national en politique internationale et les mystifications nationalistes qu'il mettra partout en œuvre pour mieux encadrer le prolétariat.
A mesure que la crise s'approfondit, ces différentes contradictions tendent à s'aiguiser et à rendre encore plus inextricables les problèmes posés à la bourgeoisie, laquelle est de plus en plus conduite à faire face à ces problèmes, non pas avec un plan à long ou même à moyen terme, mais au coup par coup, au jour le jour, en fonction des urgences du moment. Cet aspect empirique de la politique de la bourgeoisie est encore accentué par le fait que cette classe est incapable de se donner une vision à long terme de ses propres perspectives historiques. Certes, elle a profité de ses expériences passées que ses hommes politiques et universitaires, économistes ou historiens, lui rappellent quand nécessaire pour lui éviter de commettre les mêmes erreurs : par exemple, sur le plan économique, elle a su éviter l'affolement de 1929, de même que sur le plan politique, elle a su prendre en 1945 les dispositions pour éviter une vague révolutionnaire d'après guerre comme celle de 1917-23. Cependant cette utilisation de ses propres expériences par la bourgeoisie ne va jamais bien plus loin que l'apprentissage d'un certain nombre de réponses précises face à des situations répertoriées. Ses propres préjugés de classe interdisent à la bourgeoisie de se donner une compréhension correcte des lois historiques, incapacité qui est encore aggravée par le fait qu'elle est aujourd'hui une classe réactionnaire dont la société qu'elle dirige est en pleine décomposition et décadence. Cette incapacité se manifeste avec d'autant plus d'ampleur que la situation économique lui échappe et avec elle l'intelligence des mécanismes de plus en plus complexes et contradictoires qui animent cette situation.
La compréhension des différentes politiques que la bourgeoisie de tel ou tel pays est amenée à adopter à tel ou tel moment, ainsi que de l'évolution des rapports de force et des affrontements entre les différentes fractions de cette classe, doit donc tenir compte de l'ensemble des données contradictoires des différents problèmes qu'elle doit résoudre et de l'importance relative que ces données acquièrent dans les différents pays, compte tenu de leur situation géographique, historique, économique et sociale respectives. Elle doit tenir compte, en particulier, du fait que la bourgeoisie n'agit pas nécessairement à chaque moment de la façon la plus appropriée à la défense de ses intérêts immédiats ou historiques et que c'est souvent à long terme et à travers des conflits quelquefois violents que ses fractions les plus aptes à faire face à une situation s'imposent à celles qui le sont le moins.
C'est dans les pays sous-développés que les contradictions rencontrées dans la mise en œuvre des tentatives de la bourgeoisie, sont les plus violentes. L'impasse totale sur le plan économique condamne à l'échec les différentes mesures que peut prendre la classe dominante : loin d'être en mesure de reporter sur les autres pays les difficultés du sien, celle-ci, au contraire, subit le poids de ce même type de politique de la part de la bourgeoisie des pays les plus développés. Cette impuissance sur le plan économique se répercute sur le plan politique par une instabilité chronique et des convulsions brutales. L'affrontement des différentes fractions du capital national, loin d'être en mesure de se résoudre sur le terrain institutionnel des rouages "démocratiques", débouche souvent sur des heurts armés. Ces heurts sont particulièrement violents entre d'une part, les fractions les plus liées au capitalisme d'Etat dont le besoin se fait sentir d'autant plus que l'économie est délabrée et d'autre part, les secteurs les plus anachroniques de la production particulièrement importants du fait du faible niveau de l'industrialisation.
Ces affrontements entre différents secteurs du capital national sont en général amplifiés par le poids des rivalités inter impérialistes quand ils ne sont pas purement et simplement mis au service de celles-ci comme c'est aujourd'hui le cas au Liban et en Afrique australe.
Pour toutes ces raisons, les pays sous-développés constituent le terrain de prédilection des luttes de "libération nationale"- surtout quand ils se trouvent dans les zones en dispute entre grands brigands impérialistes - ainsi que des coups d'Etat militaires dans la mesure où l'armée est en général la seule force de la société ayant un minimum de cohésion et où elle dispose de cet élément essentiel dans les conflits entre secteurs de la classe dominante de ce pays : la force physique. C'est elle en particulier qui, dans ces pays, se fait souvent l'agent le plus décidé du capitalisme d'Etat contre les secteurs "démocratiques" liés à des intérêts privés. Dans ces pays, cette prédominance des affrontements entre différentes fractions de la classe dominante est d'autant plus forte que la classe ouvrière, malgré les réactions quelquefois violentes qu'elle oppose à une exploitation féroce, est relativement faible de par le faible niveau d'industrialisation.
C'est dans les pays économiquement les plus puissants que la classe dominante contrôle encore le mieux l'ensemble des problèmes mis à nu par l'aggravation de la crise, qu'elle maintient la plus grande stabilité et maîtrise du jeu politique. Cela est lié au fait que c'est dans ces pays que les différents axes de la réponse bourgeoise à la crise provoquent le moins de contradictions, dans la mesure où la situation économique, moins délabrée qu'ailleurs, fait appel à des mesures moins extrêmes et où la classe dominante dispose encore d'énormes moyens politiques, résultat de son assise économique.
Concrètement, cela se manifeste par le fait que le capital national dispose d'une plus grande aptitude à concurrencer ses adversaires sur le plan économique et militaire, ce qui les place en moindre dépendance à l'égard des blocs impérialistes auxquels il impose un grand nombre de ses objectifs:
- par le poids très faible des points de vue numérique économique et, partant, politique des secteurs anachroniques de la production ;
- par la grande capacité de mystification de la classe ouvrière par le simple poids de la "prospérité" économique.
Ce dernier aspect de la puissance de la bourgeoisie est particulièrement sensible dans des pays comme les USA et l'Allemagne de l'Ouest où cette classe a pu se livrer à une attaque officiellement reconnue contre le niveau de vie du prolétariat (baisse sensible du salaire réel et augmentation massive du chômage) sans que celui-ci, pourtant le plus puissant du monde, n'ait réagi de façon majeure. Par ailleurs, dans ce type de pays, la tendance générale au capitalisme d'Etat que la crise vient accentuer de façon très puissante ne se traduit pas, comme dans les pays plus arriérés, par un choc violent entre secteur étatique et secteur privé de l'économie, mais par une fusion progressive de ces deux secteurs.
Dans ces conditions, la bourgeoisie dispose d'un marge de manœuvre relativement importante qui limite les affrontements entre ses différents secteurs (cf. la similitude des programmes entre les candidats Ford et Carter aux USA) ou les répercussions de ces affrontements (cf. la facilité avec laquelle la bourgeoisie américaine a surmonté et exploité l'affaire "Watergate"). Le faible niveau actuel des contradictions engendrées par la mise en place des premier et troisième volets de la politique capitaliste, pourtant les plus importants historiquement, peut, dans certains de ces pays, conduire à une prééminence circonstancielle de contradictions engendrées par la mise en place du deuxième. C'est ainsi qu'on peut s'expliquer la défaite social-démocrate en Suède et le recul du SPD en Allemagne dont le maintien au pouvoir, grâce au concours des libéraux, traduit cependant les besoins présents de la bourgeoisie allemande de moyens pour prendre des mesures de capitalisme d'Etat et mystifier la classe ouvrière.
Dans le cas des pays développés mais au capitalisme plus faible que les précédents, en particulier les pays d'Europe occidentale, les différentes contradictions auxquelles se heurtent les différents axes de la politique bourgeoise, tendent à l'heure actuelle à équilibrer leurs poids respectifs et à interagir jusqu'à aboutir à des situations à première vue paradoxales et précaires. Ce phénomène est particulièrement net en ce qui concerne la détermination de la place des PC dans la vie politique dans un certain nombre de pays européens. Ces partis constituent, dans ces pays, les fractions de l'appareil politique bourgeois les plus aptes à la fois de prendre les mesures résolues dans le sens du capitalisme d'Etat que la situation requiert et de faire accepter à la classe ouvrière le maximum de sacrifices. En ce sens, leur participation au pouvoir s'impose de plus en plus. Cependant, de par leurs options en politique internationale et la crainte qu'ils inspirent à des secteurs importants des classes possédantes, leur accession à des responsabilités gouvernementales se heurte à une résistance décidée du bloc américain qui trouve un appui important auprès des secteurs les plus anachroniques de la société. Ces dernières années, les PC ont tenté de donner au reste de la bourgeoisie un maximum de gages de leur attachement au capital national, de leur indépendance à l'égard de l'URSS et de leur volonté de respecter les règles démocratiques en vigueur dans leurs pays, volonté qui s'est exprimée en particulier par le rejet de la notion de "dictature du prolétariat". Cependant, toutes ces concessions n'ont pas suffi, pour le moment, à surmonter ces résistances alors que l'entrée des PC au gouvernement est devenue des plus urgentes dans certains de ces pays. Ceci constitue une illustration du fait, déjà signalé que, ballottée par ses contractions à l'échelle nationale et internationale, la bourgeoisie ne se donne pas nécessairement les instruments les plus appropriés aux moments les plus opportuns. Il est significatif du caractère éminemment temporaire et instable des situations et des rapports de force qui prévalent pour le moment dans un nombre important des pays d'Europe et plus particulièrement au Portugal, en Espagne, Italie et en France.
Le Portugal est des pays européens celui qui a, ces dernières années, illustré avec le plus d'évidence la crise politique de la bourgeoisie. Ses caractéristiques de pays sous-développé et qui expliquent le rôle fondamental joué par l'armée, jointe à ses caractéristiques de pays développé, en particulier une forte concentration prolétarienne animée d'une forte combativité à partir de la fin 73, sont à l'origine des soubresauts de ce pays en 1974 et 1975. La poussée initiale des forces de gauche : gauche militaire, gauche et gauchistes, qui s'expliquait à la fois par l'urgence des mesures de capitalisme d'Etat dans une économie particulièrement déliquescente et par le besoin de dévoyer et encadrer la classe ouvrière a laissé la place à un retour du balancier vers la droite à la faveur de la conjonction d'une retombée de la lutte de classe, d'une très forte résistance des secteurs liés à la petite propriété contre le capitalisme d'Etat et d'une énorme pression politique et économique du bloc américain. L'actuelle orientation de la politique portugaise vers la droite (remise en cause d'aspects de la réforme agraire, retour de Spinola, libération des agents de la PIDE), si elle exprime le reflux de la classe ouvrière et renforce sa démoralisation, est cependant peu armée pour faire face à la prochaine remontée et, de ce fait, est grosse d'instabilité future.
L'Espagne est un des pays européens appelés, dans les prochaines années, à connaître des convulsions majeures. La rigueur de la crise en même temps que la sénilité et l'impopularité de l'ancien régime franquiste y ont mis à l'ordre du jour des transformations politiques importantes dans le sens de la "démocratie" et que la disparition de Franco a permis de mettre en chantier. Ces transformations sont d'autant plus urgentes pour la bourgeoisie en Espagne qu'elle affronte un des prolétariats les plus combatifs du monde et que la simple répression est de moins en moins capable de contenir. Elles constituent "l'objectif" fondamental en direction duquel le capitalisme peut aujourd'hui, en Espagne, dévoyer la combativité ouvrière. Cependant, malgré l'urgence de la rupture ou de la "transition" démocratique, ce processus se heurte à une très forte résistance des secteurs les plus arriérés de la classe dominante ayant pour appuis essentiels la bureaucratie étatique, l'armée et surtout la police. De plus, la bourgeoisie espagnole, de même que l'ensemble de la bourgeoisie occidentale, reste extrêmement méfiante à l'égard d'un PCE, pourtant parmi les plus "eurocommunistes". Alarmée par l'expérience portugaise, elle tient en particulier à éviter qu'un passage trop rapide du pouvoir aux mains de l'opposition ne favorise trop le PCE qui en constitue la force majeure. En ce sens, elle met tout en œuvre pour qu'avant cette passation de responsabilités se constitue un grand parti du centre, défenseur de la bourgeoisie classique, capable de lui faire contrepoids.
C'est donc, par l'extrême fragilité de l'équilibre - traduction des faiblesses du capital national - entre la poussée de la lutte de classe, la résistance des vestiges du franquisme et les impératifs de la politique du bloc occidental que se traduit aujourd'hui en Espagne la crise politique de la bourgeoisie.
La situation du capital italien se caractérise elle aussi par l'extrême précarité des solutions politiques qu'il a pu jusqu'ici se donner. Face à une situation économique parmi les plus chaotiques d'Europe, sa fraction politique dominante, la Démocratie Chrétienne, se trouve dans l'incapacité de prendre des mesures d"'assainissement économique" et de renforcement effectif de l'Etat qui sont de plus en plus urgentes. Si, de l'avis même d'une partie croissante de la bourgeoisie, la venue au pouvoir du PCI est indispensable, cette solution se heurte pour l'heure à des résistances décisives. C'est la même alliance entre les intérêts de la bourgeoisie américaine et ceux des secteurs arriérés de l'économie nationale particulièrement visés par le capitalisme d'Etat qui avait, au Portugal, chassé le PC du pouvoir qui empêche son accession directe à ce même pouvoir en Italie. C'est pour le moment de façon indirecte que, face aux urgences de l'heure, le PCI assure ses responsabilités à la tête du capital italien. Cependant, son "soutien critique" à l'action du gouvernement minoritaire Andreotti ne peut constituer qu'un pis-aller qui ne saurait se prolonger très longtemps sans dangers majeurs pour ce capital.
En effet, cette solution bâtarde comporte le double inconvénient de ne pas permettre l'adoption de mesures énergiques de capitalisme d'Etat et de ne pas pouvoir être présentée comme une "victoire" pour les travailleurs comme le serait une participation directe du PCI au pouvoir alors qu'elle fait en même temps retomber sur lui une part de l'impopularité des mesures d"'austérité". Comme en Espagne, le capital est en Italie sur la corde raide.
En France, une longue période de stabilité politique touche à sa fin. Frappé, à la suite des autres pays latins, de plein fouet par la crise, ce pays est à la veille de bouleversements politiques importants. Les forces politiques au pouvoir depuis près de vingt ans sont de plus en plus usées et impuissantes pour prendre des mesures énergiques d"'assainissement" de l'économie. Très dépendantes des secteurs les plus retardataires de la société comme l'ont montré les affrontements parlementaires sur les "plus-values", ces forces ne sont capables que d'attaques relativement timides contre le niveau de vie de la classe ouvrière comme le fait apparaître la modération du plan Barre. Dans ces circonstances, "la gauche unie" pose avec assurance sa candidature à la succession de la droite qui interviendra probablement à la suite des élections législatives de 1978. De ce fait, celles-ci constituent de plus en plus le centre de polarisation de la vie politique en France, d'autant plus qu'elles doivent permettre, avec le relai opportun des municipales de 1977, de faire patienter jusqu'à cette "grande victoire" la classe ouvrière dont le mécontentement et l'inquiétude vont grandissants.
Dans l'attente de ce dénouement, la droite va se contenter d"'expédier les affaires courantes". Cependant, si la situation en France se rapproche de celles du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie par son caractère transitoire, le capital de ce pays dispose, comme traduction d'une plus grande force structurelle, d'une plus grande marge de manœuvre et de moyens plus importants pour parer dans l'immédiat à ses difficultés politiques.
Du point de vue de la précarité de son équilibre, la situation en Grande-Bretagne ne se distingue pas fondamentalement de celle des autres pays d'Europe considérés. Cependant, ce qu'il faut souligner concernant ce pays, c'est le paradoxe existant entre la profondeur avec laquelle il est frappé par la crise et la capacité de la bourgeoisie à continuer à maîtriser la situation sur le plan politique. En effet, si on prend en considération les différents axes de la politique bourgeoise, la classe dominante ne rencontre pas de problèmes majeurs avec les couches moyennes et en particulier avec la paysannerie proportionnellement la plus faible du monde. De même, sa fraction de gauche dominante, le parti travailliste, jouit de la parfaite confiance du bloc américain ; enfin, le capital a manifesté une grande capacité politique par la reprise en main d'un des prolétariats les plus combatifs du monde à travers un appareil syndical éprouvé dans lequel TUC et shop-stewards se partagent efficacement le travail.
Cependant, si la bourgeoisie la plus vieille du monde a momentanément surpris par l'ampleur de ses ressources, tout son "savoir faire" sera impuissant en fin de compte devant la gravité de la situation d'une économie qui depuis 1967 est une des moins épargnées par la crise mondiale.
Dans les pays dits "socialistes" la situation n'est pas fondamentalement différente de celle des pays du bloc occidental. C'est à travers les contradictions que soulèvent les divergences entre l'intérêt du bloc de tutelle et l'intérêt national, la nécessité de renforcer la cohésion d'un appareil productif peu efficace, les résistances sourdes mais quelquefois décisives de secteurs comme la paysannerie, les réactions limitées en nombre mais violentes de la classe ouvrière, que la crise se transmet de la sphère économique à la sphère politique. Cependant, la grande fragilité de ces régimes liée à leur faiblesse économique et à leur très grande impopularité leur laisse une marge de manœuvre très réduite, contrairement aux pays "démocratiques". En particulier, l'absence de forces politique de rechange du capital liée à son étatisation presque complète interdit une "relève démocratique" du type espagnol, capable de canaliser le mécontentement ouvrier. Les seuls changements que soit capable de se donner l'appareil politique de ces pays consiste dans la modification des cliques dirigeantes au sein du parti unique, ce qui limite de façon importante leur capacité de mystification. De ce fait, à part la récupération et l'institutionnalisation des organes que la classe peut se donner au cours de ses luttes et la mise en avant des thèmes "démocratiques" agités par des forces limitées destinées à rester dans l'opposition, le capital de ces pays dispose de peu de moyens d'encadrement de la classe ouvrière autre qu'une répression systématique et féroce. Sur chacun de ces points, la situation en Pologne est particulièrement significative : elle met en relief la grande faiblesse du capital de ces pays, la grande rigidité et les convulsions de son appareil politique qui sont liées à cette faiblesse ainsi que son impuissance à mener une attaque en règle contre le niveau de vie de la paysannerie et une classe ouvrière particulièrement combative.
Parmi les pays "socialistes", la Chine constitue un cas significatif. Son évolution - particulièrement mise en relief avec l'aggravation de la crise - tant en politique intérieure qu'en politique internationale, vient confirmer un certain nombre d'analyses déjà définies pour d'autres pays.
En premier lieu, son rapprochement à la fin des années 60 avec les USA apporte un démenti à la thèse qui veut qu'il y ait un "bloc du capitalisme d'Etat" aux intérêts fondamentalement "solidaires" face au "bloc du capitalisme privé". Ce rapprochement illustre également l'impossibilité d'une indépendance véritable de tout pays, aussi puissant soit-il, à l'égard des deux grands blocs impérialistes qui se partagent la planète, la seule "indépendance nationale" consistant en fin de compte dans une possibilité de passage de l'orbite de l'un à celle de l'autre.
En second lieu, les convulsions qui ont suivi la mort de Mao mettent en évidence la grande instabilité de ce type de régimes : l'affrontement entre les forces politiques plus ou moins favorables au bloc russe ou américain se combinent comme ailleurs avec les oppositions entre différentes orientations économiques et politiques et entre différents secteurs de la bureaucratie étatique pour aboutir à des règlements de compte violents et même sanglants entre les différentes cliques qui constituent l'Etat et le parti.
En troisième lieu, l'émergence à la tête de l'Etat de l'ancien chef de la police Hua Kuo-Feng s'appuyant en bonne partie sur 1'armée illustre à la fois que la répression la plus systématique et ouverte constitue le moyen privilégié pour contenir la lutte de classe et que, malgré ses caractéristiques particulières, la Chine n'échappe pas à la règle qui assigne à l'armée une place déterminante dans la politique intérieure des pays sous-développés.
Si c'est en prenant en considération, non pas un seul, mais les trois axes de la politique bourgeoise face à la crise et l'ensemble des contradictions qu'ils provoquent dans différents domaines qu'on a pu comprendre les conditions de l'actuelle crise politique de la classe dominante, cela ne signifie pas cependant que chacun de ces trois axes ait un impact égal dans l'évolution de celle-ci. On a déjà mis en relief le fait que certains d'entre eux peuvent à certains moments et de façon circonstancielle constituer l'élément déterminant d'une situation, mais il est également vrai que, sur le plan historique, certains de ces axes tendront de façon plus définitive à prendre le pas sur d'autres. On peut ainsi établir que l'importance des problèmes liés à l'attaque capitaliste contre les couches moyennes est appelée à diminuer en faveur des problèmes liés à ce qui touche les intérêts fondamentaux du capital et qui sont à la base de l'alternative ouverte par la crise : guerre de classe généralisée ou guerre impérialiste. Dans la période qui vient on verra donc s'accroître le poids des questions liées à la concurrence entre capitaux nationaux, ce qui se traduira par une aggravation des tensions inter impérialistes et un renforcement de la cohésion au sein des blocs, et d'autre part l'importance du facteur lutte de classe. Et dans la mesure où ce dernier est celui qui commande la survie du système, il devrait progressivement prendre le pas sur le précédent à mesure qu'augmentera la remise en cause de cette survie : l'histoire nous a montré, particulièrement en 1918, que le seul moment où la bourgeoisie peut oublier ses déchirements entre nations est celui où sa vie même est en jeu mais, qu'alors, elle est parfaitement capable de le faire.
Une fois posées ces perspectives globales, l'examen de la situation politique de la plupart des pays (à l'exception peut-être de l'Espagne et de la Pologne) conduit à la constatation que, cette dernière année, le facteur lutte de classe a été relativement effacé par rapport aux autres facteurs dans la détermination de la conduite des affaires bourgeoises. Et en fait, si contrairement aux années 30 la perspective générale n'est pas guerre impérialiste mais guerre de classe, il faut justement constater que la situation présente se distingue par l'existence d'un grand décalage entre le niveau de la crise économique et politique et le niveau de la lutte de classe. Ce décalage est particulièrement frappant quand on examine le pays qui, depuis 1969, a connu le plus grand nombre de mouvements sociaux : l'Italie. Si, dans ce pays, les premières atteintes de la crise avaient provoqué des réactions ouvrières aussi puissantes que celle du "mai rampant" de 1969, la véritable agression actuelle contre la classe ouvrière comme produit de la déliquescence de la situation économique ainsi que le chaos politique résultant également de cette situation, ne trouvent en face d'eux qu'une réponse prolétarienne très limitée, sans commune mesure avec celle du passé. Ce n'est donc pas seulement de stagnation de la lutte de classe dont il faut parler mais bien d'un repli de celle-ci et qui affecte aussi bien la combativité du prolétariat que son niveau de conscience puisque aujourd'hui, et particulièrement en Italie, l'appareil syndical -passablement bousculé et dénoncé par un nombre important de travailleurs dans le passé - a rétabli un contrôle assez efficace sur ceux-ci.
Indépendamment des explications qu'on peut donner au creux présent de la lutte de classe, ce phénomène vient donner un coup de grâce à toutes les théories qui voyaient dans la lutte de classe la cause du développement de la crise. Qu'elles soient le fait d'économistes bourgeois, en général les plus stupides et réactionnaires, ou qu'elles tentent de s'abriter derrière le "marxisme", ces conceptions sont aujourd'hui bien incapables d'expliquer par quel mécanisme un repli de la lutte de classe peut provoquer une telle aggravation de la crise économique. Le "marxisme" des situationnistes, qui voyaient dans mai 1968 la cause des difficultés économiques qu'ils n'ont découvert qu'avec plusieurs années de retard, comme celui du GLAT qui passe son temps à faire dire n'importe quoi à des cargaisons de chiffres a bien besoin d'aller se refaire une cure de santé.
Par contre, la situation actuelle semble apporter de l'eau au moulin des théories qui considèrent que la crise est l'ennemie des luttes ouvrières et que le prolétariat ne peut faire sa révolution que contre un système fonctionnant "normalement". Cette conception, qui trouve des arguments historique avec le cours suivi par la lutte de classe après 1929, est une des expressions, quand elle est développée par des révolutionnaires, de la démoralisation engendrée par la terrible contre-révolution qui a marqué la moitié du XXème siècle. Elle tourne le dos à l'ensemble de l'expérience historique et a été toujours combattue par le marxisme. De même, aujourd'hui, ce n'est pas en examinant d'une façon statique et immédiate la situation - ce qui peut effectivement conduire à la conclusion que le recul relatif des luttes est la conséquence de l'aggravation de la crise -, mais en prenant en compte l'ensemble des conditions et des caractéristiques du développement du mouvement prolétarien qu'on peut comprendre les causes de ce repli et, de ce fait, dégager les perspectives sur lesquelles débouche cette situation. Et de tous les facteurs qui déterminent la situation actuelle il faut en prendre en compte particulièrement trois :
- les caractéristiques du développement historique des mouvements révolutionnaires de la classe ;
- la nature et le rythme de la crise présente ;
- la situation créée par un demi-siècle de contre-révolution.
C'est depuis plus d'un siècle que les révolutionnaires ont mis en évidence que, contrairement aux révolutions bourgeoises qui "se précipitent de succès en succès", les révolutions prolétariennes "interrompent à chaque instant leur propre cours, (...) paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et se redresser à nouveau formidable en face d'elles" (K. Marx, Le 18 Brumaire). Ce cours en dents de scie de la lutte de classe qui se manifeste aussi bien par de grands cycles historiques de flux et de reflux que par des fluctuations à l'intérieur de ces grands cycles est lié au fait que, contrairement aux autres classes révolutionnaires du passé, la classe ouvrière ne dispose d'aucune assise économique dans la société. Ses seules forces étant sa conscience et son organisation constamment menacées par la pression de la société bourgeoise, chacun de ses faux pas ne se traduit pas par un simple coup d'arrêt de son mouvement mais par un reflux qui vient terrasser l'une et l'autre et la plonge dans la démoralisation et l'atomisation.
Ce phénomène est encore accentué par l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence dans laquelle la classe ouvrière ne peut plus se donner d'organisation permanente basée sur la défense de ses intérêts comme classe exploitée, comme pouvaient l'être les syndicats au siècle dernier. Aujourd'hui, au lendemain de la plus terrible contre-révolution de son histoire, ce caractère en dents de scie du développement des luttes de la classe est encore plus renforcé du fait de la rupture profonde entre les nouvelles générations ouvrières et les expériences passées du prolétariat. Celui-ci doit donc refaire toute une série d'expériences répétées avant d'être en mesure de pouvoir en tirer valablement les leçons, renouer avec son passé et tirer des expériences de ce1ui-ci les enseignements qu'il devra intégrer dans ses luttes futures.
Ce long chemin de la lutte de classe d'aujourd'hui est encore allongé par les conditions dans lesquelles s'opère la reprise : le développement lent d'une crise économique du système. Les mouvements révolutionnaires passés du prolétariat se sont tous développés à la suite de guerres, ce qui les plaçait d'emblée en face des convulsions les plus violentes que la société capitaliste puisse connaître et les confrontait rapidement aux problèmes politiques, en particulier à celui de la prise du pouvoir. Dans les conditions présentes, la prise de conscience de la faillite totale du système - particulièrement là où le prolétariat est le plus concentré, c'est-à-dire dans les pays les plus développés - est nécessairement un processus lent qui suit le rythme de la crise elle-même. Cela permet le maintien, pendant une longue période, de toute une série d'illusions sur la capacité de ce système à surmonter sa crise à travers différentes formules mises en avant par les équipes de rechange de la bourgeoisie.
C'est l'ensemble de cette situation qui a permis au capital de refaire une partie du terrain perdu au début de la crise face aux réactions brusques de la classe que celle-ci avait provoquées et qui avaient surpris la classe dominante dans un premier temps. En particulier, les fractions de gauche du capital et leur appareil syndical ont systématiquement saboté les luttes soit, quand elles étaient au pouvoir, en agitant la menace d'un "retour de la droite ou de la réaction", soit, plus souvent encore, en présentant la venue de la gauche - rendue de toutes façons de plus en plus nécessaire pour imposer des mesures de capitalisme d'Etat aux secteurs liés à la propriété individuelle comme un moyen de surmonter la crise et de préserver les intérêts prolétariens. Dans cette tâche, les gauchistes ont joué un rôle très important à travers leurs politiques de "soutien critique", racolant vers le terrain électoral et syndical les éléments de la classe qui commençaient à ruer dans les brancards de la gauche classique.
Cette perspective de victoire de la gauche a été facilitée par la déception qu'a pu faire peser sur la classe une série de défaites dans ses luttes économiques : ressentant le besoin d'une "politisation" de son action, mais ne disposant pas encore d'une expérience suffisante, elle a été conduite sur le terrain d'une "politisation" bourgeoise. Cette déception a également eu pour conséquence le développement d'un certain fatalisme parmi les travailleurs qui ne les incite à réagir de nouveau que face à une aggravation beaucoup plus violente de la crise.
L'ensemble de ces conditions permet d'expliquer les causes du désarroi actuel du prolétariat et du creux relatif de ses luttes. Mais avec l'aggravation irrémédiable de la crise économique et du fait que, contrairement à 1929, la classe d'aujourd'hui n'a pas été battue, ces conditions qui ont permis momentanément à la classe dominante de rétablir son emprise sur la classe ouvrière vont tendre à s'épuiser.
En effet, avec l'approfondissement de la crise et l'aggravation violente qu'elle suppose contre les conditions de vie du prolétariat, celui-ci sera contraint de nouveau à réagir quelles que soient les mystifications qui peuvent aujourd'hui encombrer sa conscience. Cette réaction va contraindre la gauche et ses rabatteurs gauchistes à se démasquer un peu plus là où ce n'est pas encore le cas.
Son accession à la tête de l'Etat rendue de plus en plus indispensable va probablement constituer, dans un premier temps, un facteur supplémentaire de temporisation. Mais en même temps, vont se mettre en place les conditions permettant au prolétariat de comprendre la seule issue de sa lutte : l'affrontement direct avec l'Etat capitaliste. Enfin, l'accumulation des expériences de la classe lui permettra de se doter des moyens de tirer les leçons de celles-ci, la démoralisation et les mystifications antérieurement subies se transformant dès lors en éléments supplémentaires de combativité et de prise de conscience.
Pour l'heure, les manœuvres mystificatrices déployées par la bourgeoisie portent encore leurs fruits et le rôle des révolutionnaires est de continuer à les dénoncer avec la plus grande énergie, plus particulièrement celles promues par les courants "gauchistes". Mais l'existence même du décalage présent entre le niveau de la crise et celui de la classe met à l'ordre du jour des resurgissements importants de cette dernière et qui tendront à combler ce décalage. Le calme relatif de la classe alors que la crise portait des coups de plus en plus violents, particulièrement en 1974-75, et qui l'ont comme étourdie dans un premier temps, ne saurait être interprété comme une inversion de la tendance générale de la reprise des luttes apparue à la fin des années 60. Le calme actuel est comme celui qui précède les tempêtes. Après un premier assaut à la fin des années 60 et au début des années 70, la classe ouvrière est en train, de façon souvent encore inconsciente, de préparer et concentrer ses forces pour un deuxième assaut. Les révolutionnaires doivent miser sur ce prochain assaut afin de ne pas être surpris par lui et être en mesure d'assumer pleinement leur fonction au sein des combats qui se préparent.
31/10/76
L'ACCELERATION DE LA CRISE ECONOMIQUE
"Il semble heureusement que, cette fois, le danger sera évité. La reprise a pris corps et s'est généralisée au premier semestre de 1976, et le chômage, qui avait atteint l'un de ses maxima d'après-guerre, a amorcé une baisse dans certains pays..." (Perspectives de l'OCDE, juin 76)
Quelques mois auront suffi pour balayer les prédictions optimistes de l'OCDE. Pour la première fois depuis la récession de 1974-75, les bourses de New York, Londres et Paris ont connu leurs cours les plus bas. Traduisant le profond scepticisme de la bourgeoisie quant à la profondeur de la "reprise", celle de Paris connaissait son "mardi noir" le 12 octobre avec une baisse moyenne de 3 % le même jour sur toutes les valeurs. Ce même mois, et le même jour, l'Espagne, le Portugal, l'Italie prenaient les mesures les plus draconiennes de leur histoire : hausse des produits courants, blocage des prix et des salaires, mesures protectionnistes de blocage des importations. Il est vrai que la France les avait déjà précédés dans cette voie, à un niveau plus faible, avec le "plan Barre". Simultanément, et le même mois, le franc, la livre, la lire continuaient leur lente descente aux enfers. "La reprise s'essouffle", pouvait conclure laconiquement le Monde du 5 octobre.
L'ESSOUFFLEMENT DE LA "REPRISE"
Avant d'examiner les phénomènes et la nature de la "reprise", il faut tout d'abord rappeler la situation de l'économie mondiale en 1975. Selon la Banque des Règlements Internationaux, l'expansion du commerce mondial a représenté cette année 35 milliards de dollars, c'est-à-dire le huitième du chiffre de 1974, la contraction du marché mondial la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale.
La paralysie des échanges qui traduit celle de l'appareil de production trop développé pour un marché mondial saturé de marchandises non réalisées se concrétise par un déclin de 10 % du volume du commerce international.
En août 75, et sur une année, la chute de la production industrielle était la suivante : USA : -12,5% ; Japon : - 14 % ; RFA : - 12 % ; France : - 9% ; Grande-Bretagne : - 6% ; Italie: - 12,2 %. Corrélativement, l'indice du cours mondial des métaux (base 100 en 1970) passait de 245,8 en mai 74 à 111,5 en juillet 75. Traduisant la contradiction irréductible entre les rapports de production et les forces productives, le chômage atteignait le chiffre record de 23 millions de chômeurs pour l'ensemble des pays de l'OCDE au milieu de l'année 75.
LES PHENOMENES DE LA "REPRISE"
Commencée au dernier trimestre 1975, la "reprise" trouve essentiellement sa cause dans le mouvement purement conjoncturel de restockage pendant 1975. Cet aspect artificiel de la "reprise" est souligné par le fait que "la constitution des stocks aura sans doute contribué cette année pour 1,75 % environ à l'expansion de la production en termes réels, alors que son rôle avait été négligeable à cet égard pendant les reprises de 1968 et 1972" ("Perspectives économiques" de l'OCDE).
Quels sont les résultats de cette opération "technique" ?
Toujours selon l'OCDE, dont les ministres se sont réunis en juin dernier à Paris : "l'expansion rapide que connaissent les Etats-Unis depuis le milieu de 1975 a donné une forte impulsion à la reprise dans d'autres pays, notamment au Japon. Le niveau de la production industrielle de la zone de l'OCDE est maintenant proche de son maximum des derniers mois de 1973. Le taux de chômage qui avait atteint quelque 5,50 % de la population active vers la fin de 1975 est maintenant descendu aux environs de 5 % de la population active, cette baisse reflétant essentiellement l'amélioration de la situation aux Etats-Unis. Au Japon et en Europe, le chômage partiel a nettement reculé mais le nombre de chômeurs est resté élevé".
Là aussi, ces optimistes prédictions devaient se trouver démenties par la réalité un mois plus tard
"L'infléchissement déjà observé en mai et juin se transforme maintenant en ralentissement et fait même craindre une chute précoce de l'activité économique. Les courbes de la croissance industrielle de la France et de l'Allemagne déclinent beaucoup plus qu'on aurait pu le prévoir il y a quelques mois. 5% par an de croissance, c'est peu pour un régime de croisière qui devrait normalement se situer à 7 ou 8%. L'Italie où la reprise est plus récente voit elle aussi sa courbe redescendre, bien que le rythme y reste encore élevé (18 %). Ne parlons pas de la Grande-Bretagne où l'essoufflement a suivi presque immédiatement le premier effort sérieux."
Quant aux deux géants économiques (USA et Japon), ils ont connu depuis le troisième trimestre 76 - moins marqué en raison de leur puissance économique - le même rythme de ... décroissance :
"Au Japon, le redémarrage a été tardif mais foudroyant : de 2 % à peine en novembre, le rythme est passé à près de 30 % en avril... En juin-juillet, le rythme n'y est plus que de 9 %. Seule, la courbe de croissance industrielle des Etats-Unis présente une forme différente, moins abrupte et plus rassurante : après un sommet de 18 % en septembre-octobre, le rythme a diminué pour atteindre 6 % au début de 76, puis il s'est stabilisé à 7 % en juin-juillet". (Le Monde, 5 octobre 1976)
Quant à la diminution du chômage présentée comme la grande victoire de la "reprise", elle est essentiellement le fait des USA où les effectifs de travail ont augmenté de 1.8 millions depuis le début de 1976 ([1]). Au contraire, en Europe, non seulement le chiffre de chômeurs est resté identique en France. Italie et même RFA, mais il a crû en Grande-Bretagne au point d'atteindre le chiffre record de 6,4% de la population active.
C'est cette extrême modération de la reprise qui explique le recul de l'inflation pour les prix de gros et des matières premières (à l'exception des prix de détail toujours en hausse) : comme en 75, a commencé un mouvement de baisse des cours des métaux depuis juillet-août, qui s'explique par l'arrêt des achats (particulièrement ceux du Japon). De fait, le recul de l'inflation présenté par les économistes du capital comme l'amorce de la "reprise" traduit en réalité la rechute dans la crise.
LES MECANISMES DE LA "REPRISE"
Contrairement aux "reprises" qui avaient suivi les récessions de 67-68 et 71, celle du premier semestre 76 se caractérise par sa nature sectorielle et non généralisée. La relance de la production, loin de se manifester par l'essor des investissements en capital fixe (comme cela avait été le cas dans les précédentes "reprises" par une politique d'hyper inflation) émane avant tout des achats en biens durables (automobiles, électroménager, etc.), à quoi il faut ajouter les dépenses en services (Sécurité Sociale, travaux publics, logements). Il s'agit, en fait, purement et simplement de dépenses de rattrapage (usure des biens durables et d'équipements publics). Comme le constate l'OCDE, à propos de la France :
"La demande émanant du secteur public et la consommation privée ont constitué les éléments moteurs de cette reprise. Elles ont été ensuite relayées par la demande extérieure et le retournement du cycle des stocks. La progression extrêmement vive de la demande des ménages a été stimulée par les mesures de relance de l'automne dernier, et a pris essentiellement la forme d'un rattrapage dans les achats de biens durables qui avaient été différés depuis le milieu de 1974."
Contrairement à ce que prétendent les descendants du professeur Dühring en la personne de la gauche et des gauchistes, la relance de la production par la consommation est plus que jamais un pur mensonge, non seulement parce que la survie même du capital implique une croissance plus rapide du secteur l (production) sur le secteur II des biens de consommation mais parce que la croissance du premier secteur implique la nécessaire décroissance relative ou absolue du second, contradiction qui est la base même du système capitaliste. De fait, il ne peut y avoir d'essor de la consommation qu'en fonction d'une croissance massive et durable de la production répondant à l'existence de marchés solvables ; cet essor étant purement relatif et conjoncturel. De fait, les crises du capital décadent s'accompagnent non seulement d'une diminution de la consommation relative mais d'une diminution absolue de celle-ci. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui que des millions d'ouvriers sont rejetés de la production tandis que la masse du prolétariat subit une diminution de plus en plus accélérée de son salaire et nominal, et réel.
C'est pourquoi la demande en biens de consommation qui s'est manifestée est essentiellement une demande de "rattrapage" correspondant à l'usure de biens durables nécessaires à l'entretien de la force de travail.
De fait, on voit toute la faillite du maintien du niveau de consommation pour une fraction de plus en plus restreinte de la population en ce que même cette politique dite de "relance", non seulement n'a pas empêché la décroissance de la production pour l'ensemble des pays capitalistes, mais s'est accompagnée d'une relance réelle et exacerbée de l'inflation, par une politique systématique d'endettements et de déficits budgétaires. Ainsi, l'augmentation du volume des échanges au cours du premier semestre 76 a entraîné une accélération du déficit courant de l'OCDE qui est passé d'environ 6 milliards de dollars en 75 à quelque 20 milliards de dollars (taux annuel) au cours de ce premier semestre.
Face au pessimisme grandissant de la bourgeoisie, les gouvernements ont pris toutes sortes de mesures en vue d'encourager les investissements à la production : depuis les crédits d'impôts, les subventions pour l'investissement, jusqu'aux amortissements accélérés. Ainsi, le gouvernement français a institué fin 75 des a11ègements fiscaux en faveur des entreprises représentant 10 % de la valeur des commandes de biens d'équipement passées entre le 1er mai 75 et le 7 janvier 76. Quand les gouvernements se trouvent dans une situation de semi-banqueroute sur le plan financier, ils font appel massivement à l'endettement extérieur : 1 milliard de dollars, prêt de l'OCDE à l'Italie ; il en a été de même en Grande-Bretagne et au Portugal où les banques centrales ont soutenu à bout de bras l'économie défaillante de ces pays. Mais, comme le notait The Economist, récemment : "Les banquiers sont maintenant inquiets sur "le sort de ces prêts, mais ils ont permis que "le commerce continue à fonctionner". On ne peut être plus clair : la survie à crédit, ou la mort subite du système !
Cette survie "à crédit" est encore plus nette dans les soi-disant pays "socialistes", où la dette de l'ensemble des pays du bloc russe à l'égard de l'occident se chiffre maintenant à 35 milliards de dollars. Pour certains, la situation est si grave qu'ils demandent déjà un moratoire ; la Corée du Nord a même cessé de payer le service de sa dette qui s'élève à quelque 1,5 milliard de dollars. La situation est identique dans les pays arriérés non pétroliers où le déficit de la balance courante atteint maintenant le chiffre tout aussi vertigineux de 37 milliards de dollars. Face à une telle situation, les banquiers et les Etats occidentaux ont alors décidé de restreindre leurs prêts aux pays de l'est ; dans les pays de leur bloc, ceux-ci, comme en Italie ou en Grande-Bretagne, sont assortis de toutes sortes de conditions qui brisent toute velléité "d'indépendance nationale" et ne seront plus accordés qu'en fonction de la nécessité de sauvegarder la cohésion de leur bloc. L'URSS n'a accordé de nouveaux crédits que sous la condition d'un contrôle plus strict de sa politique extérieure.
A travers la croissance des déficits budgétaires et de la dette extérieure, on assiste à une intervention de plus en plus accélérée de l'Etat. C'est lui qui est le véritable moteur de la "relance", faute d'une relance véritable par des marchés, lesquels ont continué à stagner et même à décroître (l'évo1ution des parts de marché des sept grands pays de l'OCDE a encore décru en 76, à la seule exception du Japon et de la RFA). Devant cette situation, les Etats ont mis au point un système d'encouragement à l'exportation par un jeu de primes ou de dégrèvement des impôts sur les bénéfices, ce qui a notablement encouragé les pays exportateurs comme le Japon ou la RFA à accroître notablement la part de leurs exportations dans leur commerce global.
BRIEVETE DES "REPRISES"
L'un des indices les plus probants du caractère permanent de la crise générale du système depuis 67 est le raccourcissement des phases de reprise. La crise de 67-68 est suivie de deux ans de reprise ; celle de 71 d'un an et demi de reprise. La reprise de 76 n'aura duré qu'un peu plus de six mois. On voit par contre se manifester un rallongement des phases de récession : un an en 67 et 71 ; presque deux ans en 74-75. On a donc des phases de reprise de plus en plus brèves jusqu'au point où elles deviennent inexistantes tandis que les phases de récession, en devenant de plus en plus longues, tendent à devenir permanentes.
On voit ici toute la vanité de prétendues explications marxistes (telle celle de "Programme Communiste" n° 67) qui croient déceler encore des cycles de croissance et de récession dans le capitalisme décadent. L'existence de cycles qui se vérifiait au XIXème siècle parce que les récessions ouvraient la voie à une expansion élargie sur un marché mondial encore en friche pour le capital ne peut plus être observée sous le capitalisme en déclin.
Dans cette période d'ascension continue du mode de production capitaliste, où il prend sa forme moderne de capital industriel, la constitution des cycles est la manifestation de la croissance organique du système. Les cycles d'expansion et de récession expriment alors de façon matérielle le développement contradictoire d'un système se heurtant aux limitations du marché national dans son cadre de vie déjà mondial. Non limité encore par l'achèvement de la conquête du marché mondial, le capital connaît des crises qui sont essentiellement d'adaptation, quand la croissance de la production tend à être plus rapide que celle du marché, ou quand la révolution technique incessante impose des déplacements de plus en plus rapides des capitaux dans les nouvelles branches de la production. Les crises étaient donc le moteur de nouveaux cycles de la production, toujours plus élargis à l'échelle du marché mondial. L'observation de phases périodiques de récession ou de stagnation aussi régulières que les marées, et généralement courtes, trouvait sa cause de moins en moins dans le poids des déterminismes agricoles et climatiques (crise de 1847, par exemple) que dans la faiblesse momentanée du secteur universel de la croissance de la production : le capital sous sa forme de monnaie (or et crédit). Les phases longues de dépression, toutes relatives, telle celle de 1873 à 1896, trouvaient leur origine dans le surgissement de capitaux plus modernes (Etats-Unis, Allemagne) venant concurrencer les vieux pays capitalistes (Grande-Bretagne, France) et étaient donc plus locales qu'internationales. Il s'agissait de paliers dans la phase générale d'expansion internationale du système. Quant aux crises qui éclataient à la charnière de ces cycles, elles devenaient de moins en moins fréquentes mais de plus en plus fortes (1873), à la mesure de l'extension colossale du système lui-même.
Ce qui était des cycles naturels de vie d'un système en pleine croissance n'est plus aujourd’hui que de simples convulsions, des spasmes de plus en plus rapides et rapprochés. Seuls, les mécanismes mis en place par la bourgeoisie depuis 29 sont en mesure - et de plus en plus faiblement, exactement comme un frein qui perd sa force d'avoir été trop utilisé - d'adoucir la violence croissante des convulsions. Estimer malgré cela que la bourgeoisie serait à même déclencher à volonté "reprises" et booms avant de retomber dans une nouvelle crise, c'est croire que la bourgeoisie est à même de surmonter ses contradictions aujourd'hui mortelles indéfiniment dans le temps :
"Le cycle mondial que nous avons observé de 1971 à 1975 a une période moyenne d'environ 4 à 5 ans... Dans cette hypothèse, la reprise lente au début devrait s'accélérer vers 1977 par le jeu de simultanéité du cycle économique et de l'entraînement mutuel des économies ; cette reprise devrait être d'autant plus forte que la baisse a été plus profonde et faire place vers 1978 à un nouveau boom productif". ("Programme Communiste", n° 67)
La reprise de la crise actuelle et la banqueroute dans laquelle glisse lentement l'ensemble de l'Europe après les pays du Tiers monde se sont chargées de balayer de telles jongleries pseudo-dia1ectiques sur les cyc1es "naturels" du capitalisme en décadence. On peut mettre en parallèle la vision trotskiste - et cette convergence n'est pas le fait du hasard - d'un E. Mandel : celui-ci croit déceler dans la crise de 1967-68 une "nouvelle onde longue à tonalité stagnante", voire le "résultat d'un mouvement cyclique traditionnel (septennal, décennal ou quinquennal)". Bref, les augures bordiguistes et trotskistes sont des oiseaux de bon augure pour le capitalisme agonisant, auquel ils donnent les vertus de l'immortalité.
LA "REPRISE" EST INEGALE
Les récessions dans la période de reconstruction des années 50 avaient une origine purement conjoncturelle (inégalité de la reconstruction selon les pays, poids des guerres coloniales, etc.) ; c'est pourquoi la reprise était générale et se poursuivait avec autant de régularité que de force.
Depuis l'ouverture de la phase de crise générale du capitalisme en 67, l'inverse s'est produit. La récession est devenue la règle, la reprise l'exception. De générale au niveau du monde, la reprise de 69-70 ne touche plus aujourd’hui que les pays les plus puissants économiquement, essentiellement les impérialismes dominants qui rejettent les effets de la crise sur leur zone d'influence, comme les USA ou l'URSS, qui ont bénéficié momentanément de la reprise par leur emprise renforcée sur leur propre bloc. En réalité, seuls trois pays ont connu une réelle reprise de leur production et de leur commerce extérieur : les Etats-Unis, l'Allemagne Fédérale et surtout le Japon. La fameuse "reprise" a vu en effet la chute de trois des plus grandes puissances capitalistes : l'Italie, la Grande-Bretagne, la France.
Au bout du compte, seuls les Etats-Unis sont plus à même par leur puissance à résister à la concurrence exacerbée de la RFA et du Japon, par tout un jeu de changes flottants du dollar et une série de mesures protectionnistes accompagnés de pressions politiques sur ses alliés. La faiblesse du Japon et de la RFA, dont la production dépend du maintien et même de l'accélération de leurs exportations, laisse voir, alors que les USA voient déjà leur production industrielle décliner au dernier trimestre 76 et leur chômage reprendre, qu'après avoir été internationaux en 69-70 et 72-73, les mouvements de "reprise" deviennent inégaux et purement locaux. On peut dire que, lorsqu'ils se manifestent localement, de plus en plus dans deux ou trois nations, ils prennent une forme négative, puisque la "reprise" de la production est une chute plus ralentie dans la récession, et relative, puisque la condition de cette reprise locale est l'accélération de la décomposition des économies concurrentes les plus faibles. Et, dans cette décomposition générale, ce que la bourgeoisie nomme "reprise" n'est plus qu'une capacité plus forte de freiner la chute libre de l'économie des pays les plus forts économiquement et ne correspond plus à un essor de la production industrielle et du commerce mondiaux. Dans cette nouvelle crise mortelle du capitalisme mondial, il ne peut plus y avoir d'alternance des cycles comme en phase ascendante : il n'existe qu'un seul cycle, celui de la crise permanente qui mène soit à la guerre, soit à la révolution.
Examinons plus en détail quelles mesures essayent de mettre en place le capital au niveau national et international pour freiner la décomposition rapide de l'économie.
LES "SOLUTIONS" DE LA BOURGEOISIE : EXPORTER PLUS
De l'est à l'ouest, c'est la solution miracle. En particulier, c'est la seule qui s'offre aux capitaux les plus faibles, en raison de la médiocrité de leur marché intérieur. Par exemple, en Pologne les exportations ont progressé de 30% en 1975, assurant l'essentiel du maintien du PNB. Pour l'ensemble des pays de l'est, les exportations vers la zone OCDE ont progressé de 22 % en 1970 à 30 % en 1975. Il en est de même pour l'Italie et la Grande-Bretagne où des dévaluations successives leur ont permis d'accroître le volume et la valeur de leurs exportations.
Malgré toute l'aide apportée par les différents Etats aux entreprises exportatrices, un nombre infiniment plus restreint de pays a profité de quelques mois de "reprise" par rapport à 72. Il s'agit essentiellement des pays où la productivité du travail s'est élevée notablement ou maintenu au niveau antérieur, tandis que diminuait le salaire réel des ouvriers. Cela est particulièrement vrai pour les trois grandes puissances commerciales mondiales : Japon. RFA et USA. On peut le constater au travers de l'évolution des coûts unitaires de main d'œuvre dans les industries manufacturières :
C'est grâce à sa plus grande compétitivité que le capital japonais a pu notablement améliorer ses positions au détriment des USA en devenant le premier exportateur d'acier, en s’implantant solidement en Amérique latine et en Europe dans le domaine de l'automobile et de l'électronique. Il en a été de même dans une moindre mesure pour la RFA et les USA. Néanmoins, le fait que ce maintien des exportations des capitaux les plus forts s'est opéré aux dépens des autres capitaux qui deviennent ainsi des marchés de moins en moins solvables pour les premiers entraîne en fait une diminution des marchés globaux.
La première contradiction de cette "solution" du capital se révèle aujourd'hui sous son jour le plus cru, dans l'exportation massive de capitaux. Celle-ci a pris des proportions inconnues : les investissements de la RFA et du Japon hors de leur cadre national se sont multipliés par sept depuis 1967. Ce qu'on a appelé les "multinationales" qui investissent de plus en plus hors de leurs pays d'origine, exprime en réalité le besoin du capital à réduire ses coûts de production : par une diminution de la part du capital variable incluse dans le prix de la marchandise. Cela ne peut se faire que là où le coût de la force de travail se situe en dessous de la moyenne des pays développés et où la production de marchandises ne nécessite qu'un travail simple. L'installation d'unités de production déversant les marchandises à coût inférieur sur le marché mondial ne fait que renforcer la concurrence qu'elle essayait de surmonter : selon la Far Eastern Review (15/10/76) l'implantation d'usines de montage électronique japonaises à Singapour, en Corée du Sud, a entraîné en retour une concurrence accrue sur le marché national japonais des appareils à transistors. Il en est de même jusque dans la plus grande puissance capitaliste où, en raison depuis trois ans du moindre coût salarial des ouvriers américains ([2]), les succursales des multinationales européennes et japonaises prennent déjà le 1/4 des exportations américaines avec un coût d'investissement moitié moindre qu'en 1970 (Neue Zürcher Zeitung, 29 juin 76).
Cette recherche de la diminution du coût des investissements sur le marché extérieur s'est accompagnée en retour de la chute des investissements dans les grands pays industriels.
C'est pourquoi la deuxième contradiction, symétrique de la première, qui se manifeste de plus en plus au sein des pays industrialisés est la nécessité de continuer à investir productivement afin de conserver un minimum de modernisation des installations, condition même du maintien de la compétitivité des marchandises exportées. De fait les mesures de restrictions budgétaires prises et la diminution massive des profits pour le capital entraînent une diminution croissante des investissements productifs et de la recherche technique au fur et à mesure même que les marchés se réduisent :
"La faible propension à investir que l'on observe depuis des années aux USA a eu pour résultat un phénomène de vieillissement de l'appareil de production beaucoup plus rapide qu'au Japon et en RFA. Alors qu'en RFA en 1975 moins de 50% du potentiel industriel avait onze ans d'âge et plus, aux USA cette proportion était de 85% ; dans des secteurs importants tels que l'acier, le papier, l'automobile, on ne trouve plus la moindre trace d'innovation". (Der Spiegel, 29 mars 1976)
Ce qui est déjà vrai aux USA (et encore plus en Grande-Bretagne) ne fait que se répéter à une plus grande échelle dans les pays les plus faibles. Les pays qui, comme l'URSS ou la Pologne, malgré la faiblesse de leur accumulation, ou plutôt en raison de celle-ci, tentent de moderniser leur appareil de production par des investissements opérés aux prix d'un endettement extérieur systématique ne font à long terme que grever leurs marchandises du poids de plus en plus lourd de la dette extérieure. Faute de positions sur le marché mondial, ils ne font qu'accélérer leur banqueroute (et aussi celle des Etats emprunteurs qui seront à la longue dans l'incapacité de recouvrir leurs prêts).
C'est pourquoi les seuls investissements possibles sont ceux que les capitalistes appellent cyniquement de "rationalité". Nous verrons plus loin comment ceux-ci se sont manifestés sous forme d'extension du chômage et d'une exploitation accrue de la classe ouvrière.
Ainsi donc, ce que la bourgeoisie se plaît à nommer "pénurie des capitaux" ne fait que traduire l'impuissance croissante du capital, à l'est comme à l'ouest, à trouver de nouveaux débouchés. Développer l'appareil productif pour une réalisation du capital de plus en plus restreinte devient de plus en plus absurde dans le cadre du système.
Aujourd'hui, seuls les capitalismes les plus développés sont à même de freiner la chute de leurs investissements pour maintenir leurs positions antérieures et cela au prix de la destruction des capitaux les plus faibles entraînant un nouveau rétrécissement des marchés solvables.
RETOUR AUX MESURES PROTECTIONNISTES
La fin de la "reprise" remet à l'ordre du jour les vieilles recettes de la bourgeoisie en crise. Compte tenu de la situation de banqueroute qui se manifeste par une balance négative de l'ensemble des pays de l'est, des pays du Tiers-monde comme de l'OCDE (à l'exception pour le moment de la RFA et du Japon), chaque Etat essaie de protéger son marché intérieur de la concurrence par des restrictions des importations de marchandises.
Ces derniers mois, la libre circulation des produits au sein de la CEE a vécu. Récemment, la France a décidé le blocage des prix de revente des importateurs jusqu'au 31 décembre, pour lutter contre la concurrence allemande. Depuis le printemps dernier, l'Italie a institué un dépôt obligatoire de 50 % sur les importations. Pour lutter contre la concurrence japonaise, la Grande-Bretagne parle d'instituer des contingentements supplémentaires. De façon générale, tous les plans anti-inflation adopté ces dernières semaines en Europe auront pour effet de restreindre les échanges extérieurs. La CEE envisage que les échanges au sein de la Communauté passeront en valeur de 13 à 10% d'ici un an.
Dans les pays de l'est, on commence à observer la même tendance puisque par exemple, le plan quinquennal hongrois 76-80 prévoit une diminution des importations, tant du Comecon que de l'OCDE : respectivement de 9,9% par an à 6,5% et de 8,3% à 6,5% (Courrier des Pays de l'est, mai 76).
Aux USA, le paradis du "libre échange", le gouvernement a décidé en juin d'imposer un contingentement sur les importations d'acier (aciers spéciaux et aciers inoxydables). La récente imposition de quotas à l'importation d'acier, ainsi que les nombreuses enquêtes antidumping touchant les télévisions japonaises, les chaussures et l'automobile, s'inscrivent dans cette même tendance au retour à une certaine autarcie.
Néanmoins de telles mesures extrêmes ne peuvent être prises que dans des limites bien définies, compte tenu :
- d'une division internationale du travail et d'une interpénétration ou plutôt interdépendance des capitaux plus grandes que par le passé ;
- du renforcement des blocs qui exige un minimum de stabilité économique, la banqueroute d'un pays donné sous les coups de mesures protectionnistes trop brutales pouvant entraîner la banqueroute des autres économies par un effet de réaction en chaîne ;
- des leçons qu'a tirées la bourgeoisie à la suite de la crise de 29 de l'effet catastrophique d'un retour brutal des économies nationales à l'autarcie ;
- du développement de la lutte de classe depuis 68 qui impose à la bourgeoisie une certaine prudence dans la limitation des importations de biens de consommation courante (cf., par exemple, les leçons qu'a tirées la bourgeoisie polonaise à la suite des émeutes des ouvriers polonais en 70).
Il est donc à prévoir que pendant une période encore on va voir ces mesures protectionnistes s'accompagner de marchandages sur les quotas d'exportation et de "compensations mutuelles" ([3]). Cependant, la limitation graduelle des échanges ne peut que reporter le krach inévitable de l'économie mondiale à une échelle beaucoup plus élargie. D'autre part les "aides" massives accordées par les banques centrales aux économies défaillantes, en déclenchant de nouvelles vagues d'hyperinflation risquent à plus ou moins long terme de déclencher une banqueroute financière généralisée à mesure que la permanence de la crise entraîne des mouvements de panique au sein de la bourgeoisie de plus en plus incontrôlables.
CAPITALISME D'ETAT ET AUSTERITE
Toutes les mesures de "re1ance" prises par les différents Etats nationaux, ainsi que la part de plus en plus importante prise par l'Etat pour favoriser les exportations et freiner les importations sur le marché déclinant national, s'inscrivent tout naturellement dans la prise en charge de l'ensemble de l'économie par l'appareil étatique, ultime béquille du système.
La tendance au capitalisme d'Etat qui a abouti dans les pays de l'est et dans la plupart des pays du tiers monde à un contrôle total de l'économie (Pérou, Algérie, Chine, etc.), dans tous les pays où le capitalisme se trouve dans un état de débilité et de stagnation endémiques, s'est considérablement accrue ces dernières années dans les pays où l'économie se trouvait en situation de force sur le marché mondial. La venue de la gauche au pouvoir en Europe, afin de prendre des mesures de nationalisations permettant de contrôler l'ensemble de l'économie par un appareil centralisé se montre de plus en plus inévitable dans les mois à venir. L'apparition répétée de "scandales" dans l'ensemble des pays d'Occident peut être interprétée comme des pressions de plus en plus intenses d'une fraction croissante de la bourgeoisie sur les secteurs les plus rétrogrades ou les plus développés du capital afin de se plier à la nécessité d'un contrôle de plus en plus énergique des grandes sociétés capitalistes par l'Etat. Là où le capital est traditionnellement le plus puissant (Japon, USA), cette tendance s'exerce essentiellement par des mouvements de plus en plus rapides de concentration, largement favorisés par l'Etat au moyen "d'aides" diverses. Ainsi, aux USA même, rien qu'entre janvier et avril 76, le nombre des fusions est monté à 264, soit 40% de plus que durant la même période en 1975. Aux USA encore, une fraction croissante de la classe capitaliste n'hésite plus à envisager comme une très forte probabilité la planification de l'économie. En avril 76, le président de la Commission des voies et des moyens de la Chambre des représentants devait déclarer :
"L'expression "planification économique" est considérée dans certains milieux comme un drapeau rouge que l'on déploie face à l'entreprise privée et évoque l'image de commissaires soviétiques ; il serait absurde qu'un gouvernement puisse planifier dans tous ses détails le système complexe de l'offre et de la demande, mais il le serait encore plus de prétendre que le gouvernement n'a aucune responsabilité dans la prévision et qu'il n'a pas à prendre de mesures intelligentes pour éviter les dangers et même le désastre." (Cité par Hiscox : "Analyse de la crise aux Etats-Unis", Critique de l'économie politique, n°24-25)
Même dans les pays de capitalisme d'Etat, cette tendance se poursuit par la mise en route de plans tendant, comme en Russie, à liquider la petite propriété paysanne et à regrouper les terres dans des complexes agro-industriels, après les catastrophes agricoles successives. C'est ainsi que le CC du PCUS a fait paraître un arrêté en date du 2 juin 76 sur le "développement de la spécialisation et de la concentration agricoles sur la base de la coopération interentreprises et de l'intégration agro-industrielle" qui va dans ce sens (cf. Courrier des pays de l'est, juillet-août 76). De même, ces dernières années la fusion du capital par des concentrations horizontales et verticales s'est particulièrement accélérée : cette fusion du capital avec l'Etat rendue plus étroite par ces mesures a permis en 1976 le développement des unions industrielles regroupant des entreprises jadis autonomes (leur nombre monte maintenant à 2300, d'après le discours de Kossyguine au XXVème congrès du PCUS).
Ces mesures de "rationalisation" de l'économie face à la crise s'accompagnent de mesures d'austérité sans précédent tendant à rendre "bon marché" pour l'accumulation un Etat lourdement paralysé par des déficits budgétaires de plus en plus vertigineux. En 1975, conséquences des mesures de relance après la récession, ils atteignaient des sommets jusqu'ici inconnus : 70 milliards de dollars aux USA ; 35 milliards de dollars en RFA ; 10 milliards au Japon, etc.
Avec la fin de la reprise, l'OCDE prévoit et conseille (!) à ses membres de réduire les déficits budgétaires, qui selon elle devait régulièrement se réduire dès 1977. Cela vise plus particulièrement "les services" (sécurité sociale dont les cotisations sont partout relevées) faisant partie des salaires des ouvriers. A New York, les mesures de "rationalisation" des services municipaux se sont soldées le 1er juillet 76 par la suppression de 36.000 emplois, tandis que dans d'autres grandes villes étaient décidés des licenciements massifs, un accroissement des impôts et une réduction draconienne de l'aide sociale. De même, de la France à l'Italie en passant par la Pologne, sont prises des mesures de blocages de salaires accompagnées d'augmentations d'impôts ; en Pologne, le gouvernement a décidé d'office de prélever une part des dépôts des caisses d'épargne pour subventionner la construction de logements.
PAUPERISATION CROISSANTE DU PROLETARIAT
Ces dernières années ont vu croître notablement le taux d'exploitation du prolétariat par un développement convulsif de la productivité, pour les ouvriers conservant leur poste de travail. A cette augmentation du taux d'exploitation par l'extraction de la plus-value relative s'est ajoutée l'exploitation absolue par l'augmentation des heures travaillées supplémentaires.
A cette paupérisation relative du prolétariat, permanente à chaque instant de l'existence du système capitaliste, s'est cumulée l'extension croissante de la paupérisation absolue. Niée hier par les réformistes quand les crises cycliques s'abattaient sur la grande masse du prolétariat et aujourd'hui par la gauche du capital alors que la crise est devenue permanente, elle a fini par toucher l'ensemble de la classe. Limitée pendant la période de reconstruction aux pays du Tiers-monde et de l'est européen, elle englobe aujourd'hui l'immense masse du prolétariat mondial :
- sous la forme d'un chômage constant depuis plusieurs années qui touche maintenant pour l'OCDE 20 millions d'ouvriers, pour les pays du Tiers-monde au moins 20 % de la population active et pour les pays de l'est, où il est souvent dissimulé par les camps de travail, quand il n'est pas officiellement reconnu (il y avait 600.000 chômeurs en Pologne avant les évènements de 1970, selon Contemporary Po1and, septembre 71). De plus en plus, cette masse immense de chômeurs tend à atteindre le seuil de misère physiologique à mesure que les gouvernements diminuent leurs aides (déjà misérables) aux sans-travail. Si ce seuil de misère physiologique varie en fonction des pays (salaire historique des différentes classes ouvrières) quantitativement, qualitativement il tend à être atteint ou même franchi (comme le montre d'ailleurs les enquêtes de l'OCDE sur la "pauvreté") dans l'ensemble du monde capitaliste touché par la crise. 80 % des chômeurs frappés par la crise n'ont pu retrouver un travail fixe pendant la "reprise", essayant plus ou moins de vivre par le travail "au noir". Ceci devient déjà de moins en moins possible. La classe capitaliste parle non seulement de diminuer son "aide sociale" mais de créer des chantiers de travail. En Belgique, par exemple, le ministre du travail a projeté de contraindre les chômeurs à trois journées de travail gratuit par semaine sous peine de suppression immédiate de ces "aides".
- sous la forme de la diminution du salaire réel qui se manifeste tant dans la diminution des prestations de services (allocations familiales, sécurité sociale, etc.) que dans la décroissance du pouvoir d'achat atteint de plus en plus lourdement par l'inflation galopante. Les statistiques officielles du Département of Commerce révèle que le salaire réel moyen des salariés ayant du travail a baissé de plus de 10 % entre 1972 et 1975 aux USA mêmes. Toujours selon les statistiques officielles des ministères du travail ou patronales, on peut calculer qu'en France, au Japon, en Grande-Bretagne, en moins d'un an, de 1974 à 1975, le salaire réel a chuté en moyenne de plus de 6%. Cette chute s'est montrée plus ou moins forte dans les différents pays touchés par la crise en fonction de la résistance plus ou moins forte de la classe ouvrière aux attaques massives du capital ; par exemple, en Pologne, c'est tout récemment que les ouvriers viennent de subir des réductions massives de leur salaire réel, alors que l'insurrection de 1970 avait contraint le gouvernement polonais à s'endetter massivement auprès des USA et de l'URSS afin de mouiller la poudre par une hausse nominale de 40% des salaires en cinq ans ( Le Monde Diplomatique, octobre 1976), ce qui explique en grande partie la situation de banqueroute du capital polonais aujourd'hui qui comprend que "produire plus" signifie "consommer moins".
Cette situation d'aggravation des conditions de vie de la classe ouvrière n'a fait d'ailleurs que s'aggraver avec la "reprise" qui s'est accompagnée de blocages de salaires, alors que l'inflation se faisait toujours plus convulsive avec les techniques de "relance" mises en œuvre. Tout le mensonge de la "reprise" tient là.
Le retour de la paupérisation absolue qu'on croyait définitivement bannie "des sociétés industrielles" donne aujourd'hui tout son sens à l'analyse de Rosa Luxembourg faite il y a presque 70 ans :
"Les couches les plus basses de miséreux et de réprouvés qui ne sont que faiblement ou pas du tout employées ne sont pas un rebut qui ne compterait pas dans la société "officielle", comme bien entendu la bourgeoisie les présente ; elles sont liées par des liens intimes à la couche supérieure des ouvriers d'industrie les mieux situés, au travers de tous les membres intermédiaires de l'armée de réserve. L'existence des couches les plus basses du prolétariat est régie par les mêmes lois de la production capitaliste qui la gonflent ou la réduisent et le prolétariat ne forme un tout organique, une classe sociale dont les degrés de misère et d'oppression permettent de saisir la loi capitaliste des salaires dans son ensemble que si on englobe les ouvriers ruraux et l'armée de réserve de chômeurs avec toutes ses couches, depuis la plus haute jusqu'aux plus basses."
(Rosa Luxembourg, "Introduction à l'économie politique")
La paupérisation de la classe n'implique donc nullement son écrasement ou son atomisation ; la paupérisation absolue, loin de se traduire par la décomposition organique de la classe exploitée, comme ce fut le cas dans les périodes de déclin des systèmes esclavagistes et féodal, est l'affirmation organique de toute une classe, la classe historique contrainte de s'affirmer révolutionnairement ou de disparaître par la guerre dans la destruction de l'ensemble de l'humanité.
PERSPECTIVES
Dans un récent rapport établi à l'issue d'un conseil des principaux ministres de l'O.C.D.E. en juin 1976, la bourgeoisie mondiale a imaginé des "scénarii" (la bourgeoisie ne parle plus de prévisions étant donné la faillite de plus en plus grandissante du capitalisme d'Etat)... de croissance. Elle estime :
- que la croissance jusqu'à 1980 devra être modérée (pas plus de 5 % annuel) afin d'éviter une nouvelle vague d'inflation qui pourrait faire sombrer le système monétaire et financier international dans la banqueroute après une "reprise" trop forte. Ainsi la bourgeoisie qui avait développé historiquement les forces productives et en avait tiré tout son orgueil de classe conquérante avoue aujourd'hui que sa condition de survie consiste maintenant à "contenir le risque d'une croissance excessive des profits" et à éviter "le risque que la vigueur des forces expansionnistes à l’œuvre soit sous estimée" (OCDE, juin 1976) ;
- que "la croissance entre 1975 et 1980 ne pourra se produire que si la progression des salaires n'atteint pas un rythme tel qu'elle compromette la progression de la productivité et décourage l'investissement". Autrement dit le ralentissement de la décroissance dépend maintenant de la limitation de la lutte de classe. La bourgeoisie commence à comprendre que la survie de son système tient maintenant dans les mains de la classe prolétarienne.
Néanmoins la crise actuelle se développe encore lentement. A la différence de 1929, le krach de l'économie ne s'étend pas des nations les plus puissantes aux plus fragiles (des USA à l'Allemagne de 1929 à 1932) mais inversement des centres les moins développés aujourd'hui (Italie, Grande-Bretagne, France) vers le cœur du capitalisme (USA, Japon, Allemagne, URSS), selon un processus lent dû au fait que la chute des économies faibles s'accompagne momentanément du relatif renforcement de leurs rivaux les plus forts. Compte tenu de la disparition graduelle de phases de reprise et du soutien par le capital mondial de ses fractions en état de banqueroute, par une croissance de plus en plus rapide du capital fictif, la moindre résistance de la bourgeoisie aux mouvements de panique qui se font de plus en plus jour en son sein (et ce malgré tous les organismes internationaux dont elle s'est dotée depuis 1945 pour assurer une cohésion dans les rangs des différents capitaux nationaux) laissent planer la menace d'une banqueroute générale du système sur la tête d'une classe bourgeoise de plus en plus apeurée.
Ce sont ces deux facteurs (lutte de classe, panique croissante de la bourgeoisie) qui parallèlement déterminent la survie du système.
ETAT ET DICTATURE DU PROLETARIAT
Présentation sur la période de transition
Dans la plate-forme du CCI, adoptée au premier congrès du CCI de janvier 1976, le point concernant les rapports entre prolétariat et Etat dans la période de transition est resté "ouvert" :
"L'expérience de la révolution russe a fait apparaître la complexité et la gravité du problème posé par les rapports entre la classe et l'Etat de la période de transition. Dans la période qui vient, les révolutionnaires ne pourront pas esquiver ce problème mais devront y consacrer tous les efforts nécessaires pour le résoudre". (Plate-forme du CCI, point XV sur la dictature du prolétariat)
C'est dans le cadre de cet effort que s'inscrit la décision du deuxième congrès de RI d'aborder cette question et de tenter de parvenir à une résolution faisant le point de l'état de ces discussions sur ce problème.
Mais la question abordée est d'ordre programmatique. La plate-forme du CCI étant depuis le premier congrès la seule base programmatique pour toutes les sections du Courant, il va de soi que seul le congrès général du CCI a compétence pour décider de l'opportunité et du contenu d'un éventuel changement de la plate-forme.
En se prononçant sur une résolution sur la période de transition, le deuxième congrès de RI ne modifie donc pas les bases programmatiques de RI (pas plus que n'importe quelle section du CCI, RI n'a pas da bases programmatiques distinctes de celles du CCI).
Le congrès ne fait que faire le point sur l'effort réalisé au sein de RI dans la tâche de l'approfondissement de cette question afin de mieux l'inscrire dans l'effort global de l'ensemble du Courant.
LES LIMITES DE L'APPORT POSSIBLE
Afin de mieux pouvoir se repérer dans la complexité des problèmes de la période de transition, on peut regrouper ces derniers autour de trois sujets de préoccupation, distingués ici uniquement pour tenter de rendre plus commode la présentation de l'analyse :
- les spécificités générales qui distinguent globalement les fondements de la période de transition du capitalisme au communisme de ces deux genèses des autres systèmes qui l'ont précédée dans l'histoire;
- les rapports entre la classe révolutionnaire et le reste de la société au cours de la période de transition, c'est-à-dire les problèmes posés par la compréhension de ce qu'est la "dictature du prolétariat" et, par conséquent, ce que doit être le rapport entre la classe révolutionnaire et l'Etat dans la période de transition ;
- enfin, les questions concernant l'ensemble des mesures "économiques" concrètes de transformation de la production sociale.
Le travail d'analyse des révolutionnaires ne saurait manquer à la tâche d'apporter des réponses à l'ensemble de ces problèmes. Cependant, depuis que Marx et Engels jetèrent les bases du "matérialisme scientifique", les révolutionnaires savent que, sous peine de se perdre dans des spéculations à la recherche de ce que Marx appelait avec mépris "des recettes pour les marmites de l'avenir", ils doivent être conscients des limites immenses que leur imposent les limites mêmes de l'expérience prolétarienne dans ce domaine.
C'est l'ampleur de ces limites que Marx soulignait en 1875 dans sa critique du programme de Gotha en écrivant:
"Quelle transformation subira l'Etat dans une société communiste ? Quelles fonctions sociales s'y maintiendront qui soient analogues aux fonctions actuelles de l'Etat ? Cette question ne peut être résolue que par la science et ce n'est pas en accouplant de mille façons le mot peuple avec le mot Etat qu'on fera avancer le problème d'un seul saut de puce".
C'est la même conscience que R. Luxembourg exprimait en 1918 dans sa brochure sur la révolution russe :
"Bien loin d'être une somme de prescriptions toutes faites, qu'on n'aurait qu'à mettre en application, la réalisation pratique du socialisme comme système économique, social et juridique est une chose qui réside dans le brouillard de l'avenir. Ce que nous possédons dans notre programme, ce ne sont que quelques grands poteaux indicateurs montrant la direction dans laquelle les mesures à prendre doivent être recherchées, indications d'ailleurs surtout de caractère négatif. (…) (Le socialisme) a pour condition préalable une série de mesures violentes contre la propriété, etc. Ce qui est négatif, la destruction, on peut le décréter ; ce qui est positif, la construction, non. Terre vierge. Problèmes par milliers. Seule l'expérience est capable de faire les corrections et d'ouvrir des chemins nouveaux".
Outre cette limite d'ordre général, la résolution est consciemment limitée par l'objet qu'elle se donne. Elle ne prétend pas faire une synthèse de tout ce qui a pu être dégagé par les révolutionnaires sur la période de transition. En particulier, la résolution n'aborde pas la question des mesures économiques de transformation de la production sociale. Elle regroupe d'une part des positions acquises de longue date par le mouvement ouvrier (avant l'expérience de la révolution russe) et qui se sont confirmées comme de véritables frontières de classe ; d'autre part, des positions concernant les rapports entre la dictature du prolétariat et l'Etat de la période transition, dégagées principalement de la révolution russe et qui, si elles ne constituent pas par elles-mêmes des frontières de classe, n'en reposent pas moins sur une base historique suffisamment développée pour être partie intégrante des bases programmatiques d'une organisation révolutionnaire.
Les positions de classe fondamentales : inéluctabilité de la période de transition ; primauté du caractère politique de l'action du prolétariat comme condition et garantie de la transition vers la société sans classes ; caractère mondial de cette transformation ; spécificité du pouvoir de la classe ouvrière, en particulier le fait que le prolétariat, contrairement aux autres classes révolutionnaires de l'histoire, au lieu d'affirmer son pouvoir politique afin de consolider une position de classe dominante économiquement, position qu'il ne possèdera jamais, agit pour l'élimination de toute domination économique de classe par l'abolition des classes elles-mêmes ; impossibilité pour le prolétariat de se servir de l'appareil d'Etat bourgeois et nécessité de la destruction de ce dernier comme condition première du pouvoir politique prolétarien ; inéluctabilité de l'existence d'un Etat pendant la période transition, bien que profondément différent des Etats qui ont précédemment existé dans l'histoire.
Toutes ces positions constituent déjà par elles-mêmes un rejet catégorique de toutes les conceptions social-démocrates, anarchistes, autogestionnaires et modernistes qui, si elles ont sévi dans le mouvement ouvrier depuis ses premiers temps, ne servent pas moins aujourd'hui de piliers idéologiques de la contre révolution.
c'est sur la base de ces positions de classe fondamentales que la résolution dégage, principalement à partir de l'expérience de la révolution russe, des indications sur le problème du rapport entre prolétariat et Etat dans la période de transition au cours de la dictature du prolétariat : il en est ainsi de la compréhension du caractère inévitablement conservateur de l'Etat de transition ; de l'impossibilité d'identification du prolétariat ou de son parti avec cet Etat ; de la nécessité pour la classe ouvrière de concevoir ses rapports avec cet Etat auquel elle participe en tant que classe politiquement dominante, comme des rapports de force : "la domination de la société, c'est aussi sa domination sur l'Etat" ; nécessité de l'existence et du renforcement (armé) des organisations propres et spécifiques à la classe ouvrière (seule classe organisée comme telle dans la société), organisations sur lesquelles l'Etat ne peut avoir aucun pouvoir de coercition.
Ces indications affirment un rejet des conceptions qui ont pu servir de base mystificatrice à la "contre révolution qui se développe en Russie sous la direction du parti bolchevik dégénérant" et sont reprises aujourd'hui par l'ensemble des courants staliniens et trotskistes comme fondement théorique de la présentation du capitalisme d'Etat comme synonyme de socialisme.
Elles constituent donc un véritable garde-fou contre un ensemble de conceptions erronées que devra rencontrer demain le prolétariat dans son assaut mondial contre le capitalisme.
Cependant, aussi importantes que puissent être demain les conséquences de ces positions dans la lutte prolétarienne, il est nécessaire de comprendre aujourd'hui les limites réelles de cet apport :
Les expériences historiques sur lesquelles sont fondées ces positions, concernant les rapports classe-Etat de transition, demeurent encore trop peu nombreuses, trop spécifiques, pour que les conclusions qui en sont tirées puissent être considérées aujourd'hui par les révolutionnaires comme des frontières de classe, c'est-à-dire des positions qui constituent des parties clairement définies de la ligne de démarcation qui sépare le camp bourgeois du camp prolétarien. Les frontières de classe ne peuvent être appréhendées et définies par les révolutionnaires en fonction d'une expérience historique insuffisante ou de leur appréciation de l'avenir, mais sur une base expérimentale, fournie par l'histoire même des luttes prolétariennes, qui soit suffisamment nette et claire pour permettre d'en dégager des enseignements indiscutables.([4])
Il faut donc souligner ici le caractère expressément limité des points que nous pouvons considérer acquis sur cette question : le rejet de l'identification du prolétariat ou de son parti avec l'Etat de transition ; la définition de la dictature du prolétariat par rapport à l'Etat comme une dictature de classe sur l'Etat et en aucun cas de l'Etat sur la classe ; la mise en avant de l'autonomie des organisations propres du prolétariat par rapport à l'Etat comme condition première d'une véritable autonomie et d'un véritable épanouissement de la dictature du prolétariat.
Ces points restent abstraits et généraux. Ils ne constituent que "quelques grands poteaux indicateurs montrant la direction dans laquelle les mesures à prendre doivent être recherchées, indicateurs d'un caractère souvent négatif". Les formes précises dans lesquelles ils pourront se concrétiser restent encore "terre vierge" que seule l'expérience permettra de défricher.
C'est une condition d'efficacité de l'organisation révolutionnaire que de savoir appréhender non seulement ce qu'elle sait et peut savoir, mais aussi ce qu'elle sait ni ne peut encore savoir. Il y va de sa capacité à savoir élaborer une véritable rigueur programmatique ainsi qu'à savoir faire siens à temps, dans l'action de la classe, les apports fondamentaux que seule la pratique vivante de la classe ouvrière peut fournir.
LE PROBLEME DU RAPPORT CLASSE-ETAT DE LA PERIODE DE TRANSITION DANS L'HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER
La méconnaissance généralisée de l'histoire du mouvement ouvrier, aggravée par la rupture organique qui sépare les révolutionnaires aujourd'hui des anciennes organisations politiques de la classe, ont pu faire paraître, dans certains cas, l'analyse sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui comme une "trouvaille", une "originalité" du CCI. Un rappel, même extrêmement bref et sommaire de la façon dont le problème a été abordé (il faudrait presque dire "découvert") par les révolutionnaires depuis Marx et Engels suffira à démontrer la fausseté d'une telle vision.
Dans le "Manifeste communiste" de Marx et Engels, qui n'emploie pas encore la formule de "dictature du prolétariat", "le premier pas dans la révolution ouvrière" est défini comme "la montée du prolétariat au rang de classe dominante, la conquête de la démocratie". Cette conquête n'est autre, en fait, que celle de l'appareil d'Etat bourgeois que le prolétariat devrait utiliser pour "arracher peu à peu toute espèce de capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de la production dans les mains de l'Etat - du prolétariat organisé en classe dominante - et pour accroître le plus rapidement possible la masse des forces productives". Même si l'idée de l'inévitable disparition de tout Etat est déjà établie depuis "Misère de la Philosophie", même si l'inévitabilité de l'existence d'un Etat pendant les "premiers pas de la révolution ouvrière" est présente, le problème même du rapport entre classe ouvrière et Etat de la période de transition n'est qu'à peine entrevu.
C'est avec la Commune de Paris et son expérience que le problème commence réellement à être perçu au travers des leçons que Marx et Engels en dégagent : nécessité de la destruction de l'appareil d'Etat bourgeois par le prolétariat, mise en place d'un appareil tout différent qui "n'est plus un Etat au sens propre du mot" (Engels), dans la mesure où il n'est plus un organe d'oppression de la majorité par la minorité. Un appareil dont le caractère de poids hérité du passé est clairement souligné par Engels qui en parle comme d'un fléau, un fléau dont le prolétariat hérite dans sa lutte pour arriver à sa domination de classe mais dont il devra, comme l'a fait la Commune et dans la mesure du possible, atténuer les effets, jusqu'au jour où une génération élevée dans une société d'hommes libres et égaux pourra se débarrasser de tout ce fatras gouvernemental. (Préface de "la Guerre civile en France")
Cependant, malgré l'intuition de la nécessité pour le prolétariat de développer toute sa méfiance envers cet appareil hérité du passé (le prolétariat, écrivait Engels, "avait à prendre des précautions contre ses propres subordonnés et ses propres fonctionnaires en les déclarant sans exception et en tout temps amovibles") et du fait que la très courte et circonscrite expérience de la Commune de Paris ne pouvait pas poser le problème des rapports entre le prolétariat, l'Etat et les autres classes non exploiteuses de la société, une des idées majeures qui fut dégagée de la Commune, fut celle de l'identification de la dictature du prolétariat avec l'Etat de la période de transition. Ainsi, trois ans après la Commune de Paris, Marx écrivait dans sa "Critique du _programme de Gotha" :
"Entre la société capitaliste et la société communiste, se situe la période de transformation révolutionnaire de l'une en l'autre. A cette période correspond également une phase de transition politique, où l'Etat ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat."
C'est cette base théorique que Lénine reformula dans le concept de "l'Etat prolétarien" dans "l'Etat et la Révolution", c'est sur elle que les bolcheviks et le prolétariat russe instaurèrent la dictature du prolétariat en 1917.
Les conditions dans lesquelles dut se dérouler cette tentative prolétarienne, par le fait même qu'elles cumulaient les plus grandes difficultés pour le maintien d'un pouvoir prolétarien (écrasante majorité de paysans dans la société, nécessité de soutenir immédiatement une guerre civile impitoyable, isolement international de la Russie, faiblesse extrême de l'appareil productif détruit par la Première Guerre mondiale puis par la guerre civile), toutes ces conditions eurent pour résultat de faire éclater dans toute son ampleur le problème du rapport entre dictature du prolétariat et Etat.
La dure réalité des faits devait démontrer qu'il ne suffisait pas de baptiser l'Etat "prolétarien" pour que celui-ci agisse en fonction des intérêts révolutionnaires du prolétariat ; qu'il ne suffisait pas de placer le parti prolétarien à la tête de l'Etat (au point de s'identifier complètement avec lui) pour que la machine étatique suivit le cours que les révolutionnaires les plus dévoués voulaient lui imprimer.
L'appareil d'Etat, la bureaucratie d'Etat ne pouvait pas être l'expression des seuls intérêts de la classe prolétarienne. Appareil chargé de la survie de la société, il ne pouvait exprimer que les intérêts de la survie de l'économie moribonde russe. Ce que les marxistes répètent depuis les premiers temps se vérifiait dans toute sa puissance : les impératifs de la survie économique s'imposaient impitoyablement à la politique de l'Etat. Et l'économie était loin de pouvoir être influencée en quoi que ce soit en un sens prolétarien.
Lénine devait constater cette impuissance clairement lors du XXIème congrès du Parti, un an après le début de la NEP :
"Apprenez donc, communistes, ouvriers, partie consciente du prolétariat qui s'est chargée de diriger l'Etat, apprenez à faire en sorte que l'Etat que vous avez entre vos mains agisse selon votre gré... l'Etat reste entre vos mains mais est-ce qu'en fait de politique économique il a marché selon vos désirs ? NON ! ... Comment a-t-il donc marché ? La machine vous glisse sous la main : on dirait qu'un autre homme la dirige, la machine court dans une autre direction que celle qu'on lui a tracée".
L'identification du parti prolétarien avec l'Etat n'aboutit pas à la soumission de l'Etat aux intérêts révolutionnaires du prolétariat, mais au contraire à la soumission du parti aux intérêts de l'Etat russe. C'est ainsi que sous la pression des impératifs de la survie de l'Etat russe (dans lequel les bolcheviks voyaient l'incarnation même de la dictature du prolétariat - il s'agissait de la sauvegarde du "bastion prolétarien"), le parti bolchevik finit par soumettre la tactique de l'IC aux intérêts de la Russie (alliances avec les grands partis social-chauvins européens en vue de tenter de faire relâcher le "cordon sanitaire" qui étouffait la Russie) ; c'est sous cette pression que fut signé le traité de Rapallo avec l'impérialisme allemand ; c'est aussi pour éviter l'affaiblissement du pouvoir de l'appareil d'Etat "prolétarien" (et en son nom) que furent écrasés les insurgés de Kronstadt par l'Armée rouge.
Quant aux masses ouvrières, si l'identification de leur parti avec l'Etat avait abouti à les amputer de leur avant-garde, au moment même où elles en avaient le plus besoin, l'idée de l'identification de leur pouvoir avec l'Etat ne servit qu'à les rendre impuissantes et confuses devant l'oppression croissante de la bureaucratie étatique. ([5])
La contre-révolution qui réduisait en cendres la dictature du prolétariat avait surgi de l'organe même que les révolutionnaires avaient pendant des décennies cru pouvoir identifier avec la dictature du prolétariat.
Le long processus de dégagement des leçons de l'expérience russe commença dès les débuts de la révolution elle-même.
Dans une confusion inévitable, en s'attaquant à des aspects parcellaires, sans pouvoir toujours saisir le fond même des problèmes au milieu des tourbillons d'une révolution dont les traits de dégénérescence se développaient à ses tous débuts, surgirent les premières réactions théoriques. Les critiques de Rosa Luxembourg dès 1918 dans sa brochure sur la révolution russe contre l'identification de la dictature du prolétariat avec celle du parti, tout comme sa critique de toute limitation par l'Etat de la vie politique de la classe ouvrière, portaient en elles déjà des bases de la critique de l'identification du prolétariat avec l'Etat de la période de transition. Rosa Luxembourg, malgré le fait de considérer toujours l'Etat de transition comme un "Etat prolétarien", malgré la subsistance de l'idée de "la conquête du pouvoir par le parti socialiste", dégage ce qui constitue le seul moyen réel d'atténuer les fâcheux effets du "fléau Etat" dont parlait Engels :
"L'unique moyen efficace que puisse avoir en main la révolution prolétarienne, ce sont, ici comme toujours, des mesures radicales de nature sociale et politique, une transformation aussi rapide que possible, les garanties sociales d'existence chez la masse et le déploiement de l'idéalisme révolutionnaire, qui ne saurait se maintenir durablement que par une vie immensément active des masses dans une liberté politique illimitée".
En Russie et au sein même du parti bolchevik, le développement de la bureaucratisation de l'Etat et donc de l'antagonisme entre prolétariat et pouvoir étatique provoqua dès les premières années la naissance de réactions telles celle du groupe d'Ossinsky ou plus tard du "groupe ouvrier" de Miasnikov qui, en mettant en question la bureaucratie soulevait déjà, même de façon confuse, le problème de la nature de l'Etat et des rapports entre classe et Etat de la période de transition.
Mais c'est probablement dans la polémique qui opposa Lénine et Trotski au Xème congrès du Parti, sur la question des syndicats, que la question de la nature de l'Etat fut posée de la façon la plus aiguë. En effet, contre Trotski qui défendait l'idée d'une plus grande intégration des syndicats ouvriers dans l'appareil d'Etat afin de mieux affronter les difficultés économiques, Lénine opposa la nécessité de sauvegarder l'autonomie de ces organisations de classe afin que les ouvriers puissent se défendre "des abus néfastes de la bureaucratie étatique". Lénine en arriva jusqu'à affirmer que l'Etat n'était pas "ouvrier, mais ouvrier et paysan avec de nombreuses déformations bureaucratiques". Même s'il est certain que ces débats étaient menés au milieu d'une confusion généralisée (pour Lénine, les divergences avec Trotski ne portaient pas sur des questions de principe mais résultaient de considérations contingentes), ils n'en étaient pas moins d'authentiques expressions de la recherche dans le prolétariat de réponses au problème des rapports entre sa dictature et l'Etat.
Les Gauches hollandaise et allemande, après avoir réagi dans le prolongement de Rosa Luxembourg au développement de la bureaucratie d'Etat contre le prolétariat en Russie et ayant eu à affronter les problèmes de la dégénérescence de la politique internationale de l'IC, furent aussi amenées à développer la critique de ce qu'elles appelèrent : le socialisme d'Etat. Cependant, le travail d'Appel fait en collaboration avec la gauche hollandaise sur les "Principes de base de la distribution communiste" aborda surtout la question de la période de transition du point de vue économique, les développements sur l'aspect politique demeurant essentiellement une réaffirmation des idées fondamentales de R. Luxembourg.
C'est surtout avec les travaux de la gauche italienne en Belgique et en particulier les articles de Mitchell publiés à partir du n°28 de mars-avril 1936 de la revue Bilan que les bases théoriques pour une compréhension plus profonde du problème ont été posées : tout en restant sur la base théorique "léniniste" de la quasi identité entre parti et classe, Bilan fut le premier à affirmer nettement le caractère néfaste de toute identification de la dictature du prolétariat avec l'Etat de la période de transition et à souligner parallèlement l'importance de l'autonomie de la classe et de son parti par rapport à cet Etat :
"Mais l'Etat soviétique ne fut pas considéré par les bolcheviks, au travers des terribles difficultés contingentes, essentiellement comme un "fléau dont le prolétariat hérite et dont il devra atténuer les plus fâcheux effets", mais comme un organisme pouvant s'identifier complètement avec la dictature prolétarienne, c'est-à-dire le Parti.
D'où résulta cette altération principale que le fondement de la dictature du prolétariat, ce n'était pas le parti, mais l'Etat qui, par le renversement des rapports qui s'ensuivit, se trouva placé dans des conditions d'évolution aboutissant non à son dépérissement mais au renforcement de son pouvoir coercitif et répressif. D'instrument de la révolution mondiale, l'Etat prolétarien était inévitablement appelé à devenir une arme de la contre-révolution mondiale.
Bien que Marx, Engels et surtout Lénine eussent maintes fois souligné la nécessité d'opposer à l'Etat son antidote prolétarien, capable d'empêcher sa dégénérescence, la Révolution Russe, loin de d'assurer le maintien et la vitalité des organisations de classe du prolétariat, les stérilisa en les incorporant à l'appareil d'Etat et ainsi dévora sa propre substance ".
L'analyse de Bilan porte encore des hésitations et des faiblesses, en particulier en ce qui concerne l'analyse de la nature de classe de l'Etat de la période de transition, considéré comme "Etat prolétarien".
Ces hésitations et ces insuffisances, normales, seront dépassées par les analyses d'Internationalisme en 1945 (voir article "la nature de l'Etat et la révolution prolétarienne" republié dans le n°1 du "Bulletin d'étude et de discussion" de RI, janvier 1973). Internationalisme affirme déjà de façon nette et se fondant sur des critères d'analyse objective de la nature économique et politique de la période de transition, la nature non prolétarienne et antisocialiste de l'Etat de la période de transition:
"L'Etat, dans la mesure où il est reconstitué après la révolution, exprime l'immaturité des conditions de la société communiste. Il est la superstructure politique d'une structure économique non encore socialiste. Sa nature reste étrangère et opposée au socialisme. De même que la phase transitoire est une inévitabilité historique objective par laquelle passe le prolétariat, de même l'Etat est un instrument de violence inévitable pour le prolétariat dont il se sert contre les classes dépossédées mais avec lequel il ne peut s'identifier. (...)
L'expérience russe a mis particulièrement en évidence l'erreur théorique de la notion d'Etat ouvrier, de la nature de classe prolétarienne de l'Etat et de l'identification de la dictature du prolétariat avec l'utilisation, par le prolétariat, de l'instrument de coercition qu'est l'Etat."
Internationalisme dégage de l'expérience de la révolution russe la nécessité vitale pour le prolétariat de savoir exercer un contrôle strict et permanent sur cet appareil d'Etat toujours prêt à devenir au moindre recul la force principale de la contre-révolution :
"L'histoire et l'expérience russe ont démontré qu'il n'existe pas d'Etat prolétarien proprement dit, mais un Etat entre les mains du prolétariat, dont la nature reste antisocialiste et qui, dès que la vigilance politique du prolétariat s'affaiblit, devient la place forte, le centre de ralliement et l'expression des classes dépossédées du capitalisme renaissant."
Encore imprégné de certaines des conceptions de la gauche italienne, dont il est issu, notamment en ce qui concerne la question du parti et des syndicats, mais se plaçant déjà dans la vision claire de la classe ouvrière comme véritable sujet de la révolution, Internationalisme affirme enfin la nécessité de la plus totale liberté politique de la classe et de ses organes unitaires (qu'il considère encore comme pouvant être les syndicats) par rapport à l'Etat, soulignant la condamnation de toute violence de ce dernier sur les premiers. Il est le premier aussi à établir une véritable cohérence entre les problèmes politiques et les problèmes économiques qui se posent pendant cette période :
"Cette phase transitoire du capitalisme au socialisme, sous la dictature politique du prolétariat, se traduit sur le terrain des rapports économiques par une politique énergique tendant à diminuer l'exploitation de la classe, d'augmenter constamment la part du prolétariat dans le revenu national, du capital variable par rapport au capital constant.
Cette politique ne peut être donnée par une affirmation programmatique du parti et encore moins être dévolue à l'Etat, organe de gestion et de coercition. Cette politique trouve sa condition, sa garantie et son expression dans la. classe elle-même et exclusivement en elle, dans la pression qu'exerce la classe dans la vie sociale, dans son opposition et sa lutte contre les autres classes.(...)
Toute tendance à diminuer le rôle des syndicats après la révolution, qui sous prétexte de l'existence de "l'Etat ouvrier", interdirait la liberté d'action syndicale et la grève, qui favoriserait l'immixtion de l'Etat dans les syndicats, qui, au travers de la théorie en apparence révolutionnaire de remettre la gestion aux syndicats, incorporerait en fait ces derniers dans la machine étatique, qui préconiserait la violence au sein du prolétariat et de son organisation, sous le couvert de et avec la meilleure intention révolutionnaire du but final, qui empêcherait l'existence de la plus large démocratie par le simple jeu de la lutte politique et des fractions au sein du syndicat, exprimerait une politique anti ouvrière faussant les l'apports du parti et de la classe, affaiblissant la position du prolétariat dans la phase transitoire. Le devoir communiste serait de dénoncer et de combattre avec la plus grande énergie toutes ces tendances et d'œuvrer au plein développement et à l'indépendance du mouvement syndical, indispensable pour la victoire de l'économie socialiste. "
Il revient à Internationalisme d'avoir su définir le cadre théorique général dans lequel la question des rapports entre la dictature du prolétariat et l'Etat dans la période de transition pouvait enfin être posée sur des bases solides et cohérentes.
C'est en s'inscrivant entièrement dans ce processus que la résolution présentée au congrès se conçoit comme une tentative de réappropriation des principaux acquis du mouvement ouvrier sur cette question et un effort pour continuer l'œuvre permanente d'approfondissement des bases programmatiques de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
C'est dire à quel point cette résolution n'a rien à voir avec une quelconque "trouvaille du CCI". Mais c'est dire aussi le poids de la responsabilité historique que fait peser sur les épaules de l'organisation révolutionnaire le fait d'assumer cet héritage.
CONTRIBUTION DU CONGRES DE R.I.
1) Entre le capitalisme et le socialisme existe inévitablement une période plus ou moins longue de transition de l'un à l'autre. Elle est transitoire dans le fait qu'elle ne connaît pas un mode de production propre ni stable. Sa caractéristique spécifique consiste dans le bouleversement ininterrompu et systématique qu'elle porte dans le mode de production. Par des mesures politiques et économiques, elle sape jusqu'aux fondements de l'ancien système et dégage les bases de nouveaux rapports sociaux : le communisme.
2) Le communisme est une société sans classes. La période de transition, qui ne se développe réellement qu'après le triomphe de la révolution l'échelle mondiale, est une période dynamique qui tend vers la disparition des classes, mais qui connaît encore la division en classes et la persistance d'intérêts divergents et antagoniques dans la société.
4) A la différence des révolutions bourgeoises qui eurent la région ou la nation pour cadre, le socialisme ne peut se réaliser qu'à l'échelle mondiale. L'extension de la révolution et de la guerre civile est donc l'acte primordial qui conditionne les possibilités et le rythme de la transformation économique et sociale dans le ou les pays où le prolétariat s’est déjà emparé du pouvoir politique.
3) A l'encontre des autres périodes de transition dans l'histoire, qui toutes se déroulaient au sein de l'ancienne société et culminaient dans la révolution, la période de transition du capitalisme au communisme ne peut débuter qu'après la destruction de la domination politique du capitalisme et en premier lieu de son Etat. La prise du pouvoir politique générale dans la société par la classe ouvrière, la dictature du prolétariat, précède.
5) Produit de la division de la société en classes, la dictature du prolétariat se distingue cependant du pouvoir des classes dominantes par le passé, essentiellement par les caractéristiques suivantes :
a) n’étant pas classe économiquement dominante, la classe ouvrière n'exerce pas son pouvoir pour défendre des privilèges économiques (qu'elle ne possède pas et ne possèdera jamais), mais pour détruire tous les privilèges ;
b) en conséquence, le prolétariat n'a nullement besoin, comme les autres classes, de cacher ses buts, de mystifier les autres classes en présentant sa dictature comme le règne de ²la liberté, l'égalité et la fraternité" ;
c) cette dictature n'a pas pour fonction de perpétuer l'état de choses existant, mais au contraire de le révolutionner, afin d'assurer l'avènement de la société véritablement humaine, sans exploitation ni oppression.
6) Dans toute société divisée en classes, afin d'empêcher que les antagonismes qui la travaillent n'explosent en luttes permanentes qui en menacent l'équilibre et mettent en péril jusqu'à son existence même, surgissent des superstructures, des institutions dont le couronnement est l'Etat, dont la fonction consiste essentiellement à maintenir ces luttes dans un cadre approprié, s'adaptant et conservant l'infrastructure existante.
7) La période de transition au socialisme est, comme nous l'avons vu, encore une société où subsiste la division en classes. C'est la raison pour laquelle surgit nécessairement cet organisme superstructurel, ce mal inévitable qu'est l'Etat. Mais des différences substantielles distinguent ce dernier de l'Etat des anciennes sociétés divisées en classes. L'expérience de la Commune de Paris a mis en évidence :
a) en premier lieu, le fait que pour la première fois dans l'histoire il est l'Etat de la majorité des classes exploitées et non exploiteuses contre la minorité (les anciennes classes dominantes déchues) et non d'une minorité exploiteuse pour l'oppression de la majorité ;
b) le fait qu'il ne se constitue pas sur une couche spécialisée, les partis politiques, mais sur la base de délégués élus par les organisations territoriales, les Conseils locaux, et révocables par elles ;
c) que toute cette organisation étatique exclut catégoriquement toute participation des couches et classes exploiteuses qui sont privées de tout droit politique ou civique ;
d) que la rémunération de ses membres ne peut jamais être supérieure à celle des ouvriers.
C'est dans ce sens que les marxistes pouvaient, avec raison, parler d'un semi-Etat, d'un Etat altéré, d'un Etat en voie d'extinction.
8) L'expérience de la révolution russe victorieuse devait apporter des enseignements précis, encore que négatifs, sur le rapport entre la dictature du prolétariat et l'institution étatique dans la période de transition :
a)la fonction des partis politiques du prolétariat se distingue fondamentalement de celle des partis bourgeois, tout particulièrement par le fait qu'ils ne sont pas et ne peuvent pas être des organismes d'Etat. Autant les partis de la bourgeoisie ne peuvent exister qu'en tendant à s'intégrer à l'appareil d'Etat, autant l'intégration des partis ouvriers à l'Etat après la révolution, les dénature et leur fait perdre complètement leur fonction spécifique dans la classe;
b) s'il est vrai que parce que la fonction de l'Etat se confond avec la conservation de l'état social existant, l'Etat dans les sociétés d'exploitation ne peut que s'identifier avec la classe économiquement dominante dans ce système et devenir l'expression principale de ses intérêts généraux et de son unité, à l'intérieur même de cette classe et face aux autres classes de la société, il n'est rien de tel pour le prolétariat qui, n'étant pas dominant économiquement, ne tend pas à conserver l'état de choses existant mais à le bouleverser et le transformer. Sa dictature ne peut trouver, dans une constitution conservatrice par excellence, comme est l'Etat, son expression authentique et totale. Il n'y a pas et il ne peut y avoir d'Etat socialiste. Etat et socialisme s'excluent par définition. Le socialisme étant l'intérêt historique du prolétariat, sa substance en développement, il y a identité et identification entre l'un et l'autre. En conséquence, dans la mesure même où on doit parler de prolétariat socialiste, on ne peut pas parler "d'Etat ouvrier", d'Etat du prolétariat. Aussi pensons nous que, sur la base de l'expérience de la révolution russe, une distinction très nette doit être faite entre l'Etat de la période de transition, que le prolétariat ne peut pas ne pas utiliser et soumettre à tout instant à sa dictature et cette dictature elle-même. Politiquement, l'identification entre les institutions étatiques de la période de transition et la dictature du prolétariat a apporté le plus grand mal à la dictature révolutionnaire du prolétariat et a parfaitement servi comme moyen de mystification à la contre révolution en Russie, sous la direction du parti bolchevik dégénérant ;
c) l'Etat de la période de transition, avec toutes ses altérations et limites, porte encore tous les stigmates d'une société divisée en classes. Il ne saurait jamais être l'organe concentrant et symbolisant le socialisme. Seule la classe prolétarienne est la classe porteuse du socialisme. Sa domination sur la société, c'est aussi sa domination sur l'Etat et elle ne peut l'assurer que par sa dictature de classe.
9) La dictature du prolétariat doit se définir par:
a) la nécessité de maintenir l'unité et l'autonomie de la classe dans ses organisations propres : les conseils ouvriers, en même temps qu'elle se prononce pour la dissolution de toute organisation propre aux autres classes en tant que classes ;
b) elle dicte comme règle générale son hégémonie au sein de la société, ce qui se traduit par sa participation hégémonique au sein de l'organisation d'où émane l'Etat mais interdit aux autres classes tout droit d'intervention au sein de sa propre organisation de classe ;
c) elle s'impose comme seule classe armée indépendamment de toute immixtion du reste de la société et tout particulièrement de l'Etat.
[1] Cette "augmentation" des effectifs de travail, saluée par la bourgeoisie américaine comme la grande réussite de la "reprise" n'exprime en fait qu'une certaine diminution du nombre des chômeurs, ridicule à l'échelle des 9 millions de chômeurs en 1975.
[2] Le salaire horaire est passé de 70 à 75 de 4,20 à 6,22 dollars aux USA alors qu'il grimpait de 2,08 à 6,46 dollars pour la Belgique ; et même 2,93 à 7,12 dollars en Suède (City Money International, mai 1976).
[3] C'est ce qui s'est effectivement fait au cours de ce dernier trimestre : le Japon, dont la compétitivité menaçait d'inonder de ses marchandises les pays de la CEE, a dû s'incliner. Il devra se plier aux décisions de la CEE contingentant ses exportations d'acier, limiter sa politique de dumping et ouvrir plus largement son marché aux produits européens.
[4] Les "bases programmatiques" d'une organisation révolutionnaire sont constituées par l'ensemble des positions principales et des analyses qui définissent le cadre général de son action. Les positions "frontières de classe" en font partie et en représentent inévitablement le squelette de base. Mais l'action d'une organisation révolutionnaire ne peut être définie par les seules frontières de classe. La nécessité de la plus grande cohérence de son intervention la contraint à chercher la plus grande cohérence dans ses conceptions et donc à définir le plus profondément possible le cadre général qui relie entre elles les différentes positions de classe en les plaçant dans une vision cohérente et globale des buts et des moyens de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
[5] Ces deux éléments expliquent en partie la confusion, parfois extrême, qui caractérise les soubresauts prolétariens contre la contre révolution étatique (Kronstadt).






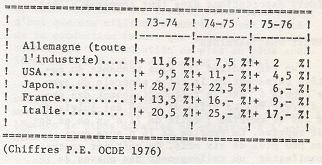
 del.icio.us
del.icio.us Digg
Digg Newskicks
Newskicks Ping This!
Ping This! Favorite on Technorati
Favorite on Technorati Blinklist
Blinklist Furl
Furl Mister Wong
Mister Wong Mixx
Mixx Newsvine
Newsvine StumbleUpon
StumbleUpon Viadeo
Viadeo Icerocket
Icerocket Yahoo
Yahoo identi.ca
identi.ca Google+
Google+ Reddit
Reddit SlashDot
SlashDot Twitter
Twitter Box
Box Diigo
Diigo Facebook
Facebook Google
Google LinkedIn
LinkedIn MySpace
MySpace