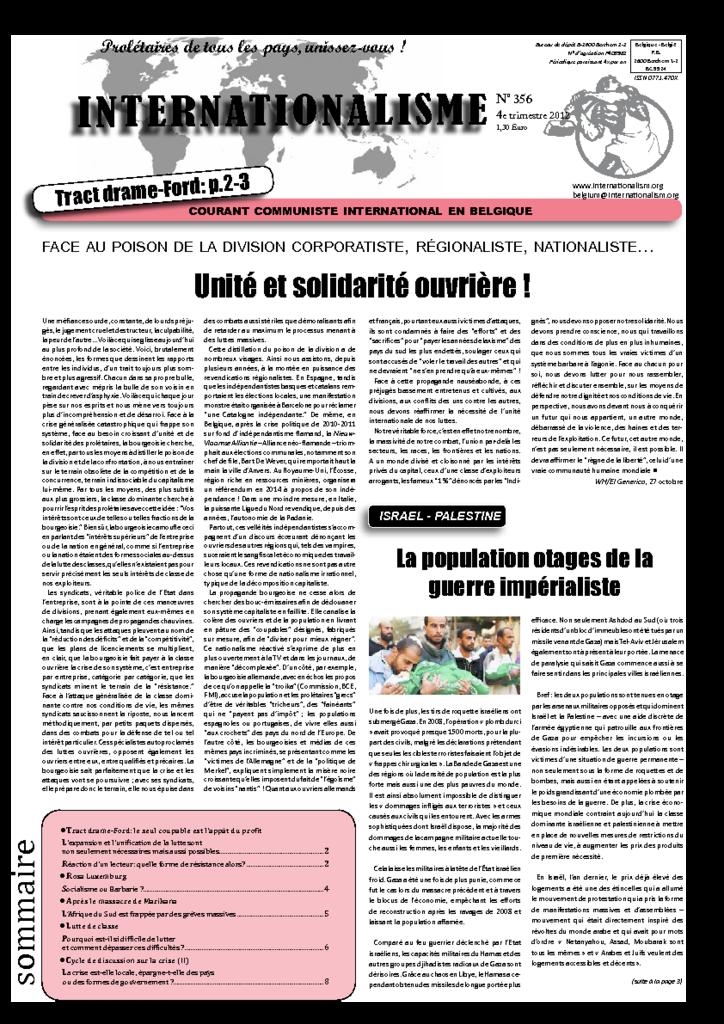Internationalisme no 356 - 4e trimestre 2012
- 1142 reads
Face au poison de la division corporatiste, régionaliste, nationaliste: unité et solidarité ouvrière!
- 1082 reads
Une méfiance sourde, constante, de lourds préjugés, le jugement cruel et destructeur, la culpabilité, la peur de l’autre... Voilà ce qui se glisse aujourd’hui au plus profond de la société. Voici, brutalement énoncées, les formes que dessinent les rapports entre les individus, d’un trait toujours plus sombre et plus agressif. Chacun dans sa propre bulle, regardant avec mépris la bulle de son voisin en train de crever d’asphyxie. Voilà ce qui chaque jour pèse sur nos esprits et nous mène vers toujours plus d’incompréhension et de désarroi. Face à la crise généralisée catastrophique qui frappe son système, face au besoin croissant d’unité et de solidarité des prolétaires, la bourgeoisie cherche, en effet, par tous les moyens à distiller le poison de la division et de la confrontation, à nous entraîner sur le terrain obsolète de la compétition et de la concurrence, terrain indissociable du capitalisme lui-même. Par tous les moyens, des plus subtils aux plus grossiers, la classe dominante cherche à pourrir l’esprit des prolétaires avec cette idée : “Vos intérêts sont ceux de telles ou telles fractions de la bourgeoisie.” Bien sûr, la bourgeoisie camoufle ceci en parlant des “intérêts supérieurs” de l’entreprise ou de la nation en général, comme si l’entreprise ou la nation étaient des formes sociales au-dessus de la lutte des classes, qu’elles n’existaient pas pour servir précisément les seuls intérêts de classe de nos exploiteurs.
Les syndicats, véritable police de l’Etat dans l’entreprise, sont à la pointe de ces manœuvres de divisions, prenant également eux-mêmes en charge les campagnes de propagandes chauvines. Ainsi, tandis que les attaques pleuvent au nom de la “réduction des déficits” et de la “compétitivité”, que les plans de licenciements se multiplient, en clair, que la bourgeoisie fait payer à la classe ouvrière la crise de son système, c’est entreprise par entreprise, catégorie par catégorie, que les syndicats minent le terrain de la “résistance.” Face à l’attaque généralisée de la classe dominante contre nos conditions de vie, les mêmes syndicats saucissonnent la riposte, nous lancent méthodiquement, par petits paquets dispersés, dans des combats pour la défense de tel ou tel intérêt particulier. Ces spécialistes autoproclamés des luttes ouvrières, opposent également les ouvriers entre eux, entre qualifiés et précaires. La bourgeoisie sait parfaitement que la crise et les attaques vont se poursuivre ; avec ses syndicats, elle prépare donc le terrain, elle nous épuise dans des combats aussi stériles que démoralisants afin de retarder au maximum le processus menant à des luttes massives.
Cette distillation du poison de la division a de nombreux visages. Ainsi nous assistons, depuis plusieurs années, à la montée en puissance des revendications régionalistes. En Espagne, tandis que les indépendantistes basques et catalans remportaient les élections locales, une manifestation monstre était organisée à Barcelone pour réclamer “une Catalogne indépendante.” De même, en Belgique, après la crise politique de 2010-2011 sur fond d’indépendantisme flamand, la Nieuw-Vlaamse Alliantie – Alliance néo-flamande – triomphait aux élections communales, notamment son chef de file, Bart De Wever, qui remportait haut la main la ville d’Anvers. Au Royaume-Uni, l’Écosse, région riche en ressources minières, organisera un référendum en 2014 à propos de son indépendance ! Dans une moindre mesure, en Italie, la puissante Ligue du Nord revendique, depuis des années, l’autonomie de la Padanie.
Partout, ces velléités indépendantistes s’accompagnent d’un discours écœurant dénonçant les ouvriers des autres régions qui, tels des vampires, suceraient le sang fiscal et économique des travailleurs locaux. Ces revendications ne sont pas autre chose qu’une forme de nationalisme irrationnel, typique de la décomposition capitaliste.
La propagande bourgeoise ne cesse alors de chercher des bouc-émissaires afin de dédouaner son système capitaliste en faillite. Elle canalise la colère des ouvriers et de la population en livrant en pâture des “coupables” désignés, fabriqués sur mesure, afin de “diviser pour mieux régner”. Ce nationalisme réactivé s’exprime de plus en plus ouvertement à la TV et dans les journaux, de manière “décomplexée”. D’un côté, par exemple, la bourgeoisie allemande, avec en échos les propos de ce qu’on appelle la “troika” (Commission, BCE, FMI), accuse la population et les prolétaires “grecs” d’être de véritables “tricheurs”, des “fainéants” qui ne “payent pas d’impôt” ; les populations espagnoles ou portugaises, de vivre elles aussi “aux crochets” des pays du nord de l’Europe. De l’autre côté, les bourgeoisies et médias de ces mêmes pays incriminés, se présentant comme les “victimes de l’Allemagne” et de la “politique de Merkel”, expliquent simplement la misère noire croissante qu’elles imposent du fait de “l’égoïsme” de voisins “nantis” ! Quant aux ouvriers allemands et français, pourtant eux aussi victimes d’attaques, ils sont condamnés à faire des “efforts” et des “sacrifices” pour “payer les années de laxisme” des pays du sud les plus endettés, soulager ceux qui sont accusés de “voler le travail des autres” et qui ne devraient “ne s’en prendre qu’à eux-mêmes” !
Face à cette propagande nauséabonde, à ces préjugés bassement entretenus et cultivés, aux divisions, aux conflits des uns contre les autres, nous devons réaffirmer la nécessité de l’unité internationale de nos luttes.
Notre véritable force, c’est en effet notre nombre, la massivité de notre combat, l’union par-delà les secteurs, les races, les frontières et les nations. A un monde divisé et cloisonné par les intérêts privés du capital, ceux d’une classe d’exploiteurs arrogants, les fameux “1 %” dénoncés par les “Indignés”, nous devons opposer notre solidarité. Nous devons prendre conscience, nous qui travaillons dans des conditions de plus en plus inhumaines, que nous sommes tous les vraies victimes d’un système barbare à l’agonie. Face au chacun pour soi, nous devons lutter pour nous rassembler, réfléchir et discuter ensemble, sur les moyens de défendre notre dignité et nos conditions de vie. En perspective, nous avons devant nous à conquérir un futur qui nous appartient, un autre monde, débarrassé de la violence, des haines et des terreurs de l’exploitation. Ce futur, cet autre monde, n’est pas seulement nécessaire, il est possible. Il devra affirmer le “règne de la liberté”, celui d’une vraie communauté humaine mondiale.
WH/El Generico, 27 octobre
Géographique:
- Belgique [2]
Rubrique:
Tract drame-Ford: le seul coupable est l'appât du profit
- 1402 reads

Ford Genk, récemment encore une usine de plus de 10.000 employés, ferme définitivement. Depuis les années 90, l'emploi y a été systématiquement réduit, la productivité augmentée, les salaires réduits de 12%. Malgré cela, le rideau tombe sur les 4.300 emplois directs et des milliers d’autres travailleurs sont touchés chez les différents fournisseurs. Après Renault-Vilvoorde (1997), VW Forest (2006) et Opel Anvers (2010), c’est la quatrième usine d’assemblage automobile qui ferme en Belgique. Cela touche durement la région limbourgeoise qui a vu disparaître, il y a 20 ans, plus de 17.000 jobs lors de la fermeture des mines de charbon.
Une crise du secteur automobile ? Et le Limbourg est-il particulièrement visé ?
Licenciements chez Belfius Banque, Arcelor Mittal acier, Beckaert Zwevegem, Volvo, Duferco, Alcatel, etc. A l’évidence, le nouveau drame social n'est pas spécifique à un secteur ou une province. La crise touche tous les secteurs et régions. C’est précisément ce qui rend la situation si dramatique et désespérée.
Au nom de la «compétitivité» et «de la réduction des pertes», les licenciements se succèdent. Encore avant l'annonce de la fermeture de Ford, plus de 3.000 emplois ont disparu de septembre à mi-octobre dans tous les secteurs, toutes les régions, des petites entreprises familiales jusqu’aux grandes multinationales, dans des entreprises nationales comme étrangères. D’autres assainissent drastiquement « sans licenciements secs», comme KBC, Brussels Airlines et Delhaize. Les contrats fixes sont remplacés par des contrats temporaires, des emplois à temps plein par des emplois à temps partiel, des contrats d’employés par des contrats d’indépendants. Le chômage temporaire est généralisé. Le travail saisonnier est de plus en plus la norme tout au long de l'année. Les fameuses « créations d’emplois » dont les médias ont la bouche pleine, se limitent en grande partie à des emplois de qualité inférieure, des emplois par « chèques services ». Afin d'échapper à la pauvreté, de nombreux travailleurs doivent chercher un 2ème ou un 3ème emploi. L’obtention d’un emploi n’équivaut plus nécessairement à un revenu décent!
L'État lui aussi est mal en point. Comme le montre la discussion sur la suspension temporaire (le saut d’index) ou la réforme de l'index, le pouvoir d'achat n'est pas une préoccupation centrale. Toujours au nom de la défense de la «compétitivité de l'économie nationale", tous les partis bourgeois, de la NVA au PS, sont d’accord pour dire qu’il faut constamment faire des économies pour réduire les coûts de main d’œuvre et améliorer le climat économique. On passe d’un «pacte social», à un autre « pacte des générations ». Car l'État est là pour appliquer les lois du capitalisme: favoriser la recherche du profit, la force concurrentielle et l’exploitation au moyen de mesures coercitives. Les milliards que les gouvernements cherchent pour permettre leurs plans de relance, leur équilibre budgétaire et la réduction de la dette d’État, seront en fin de compte soutirés aux mêmes familles ouvrières. Les allocataires sociaux, les retraités, les fonctionnaires, les enseignants, tous paieront les pots cassés. Selon le nouvel indicateur européen de la pauvreté, 21% de la population en Belgique est déjà menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale. L'inquiétude et l'indignation d'un nombre croissant de familles ouvrières ne se comprend donc que trop bien.
Ford Genk est aujourd'hui une illustration douloureuse de la nature impitoyable de cette attaque générale contre la classe ouvrière: licenciements nombreux, blocage et/ou réduction des salaires (chez Ford, on a accepté précédemment une réduction de 12%, chez VW-Audi 20%), prolongement du temps de travail. Sans riposte ouvrière, Ford Genk annonce des attaques encore plus douloureuses dans le futur pour l’ensemble de la classe ouvrière. La situation actuelle nécessite donc une résistance contre la dégradation des conditions de travail et de vie de la plupart d'entre nous. Elle contient aussi les germes d'une riposte commune de toute la classe ouvrière. Ce n’est pas que le personnel de Ford, mais tout le monde qui est visé, c’est pourquoi aussi tout le monde doit s’indigner, être solidaire, se mobiliser classe contre classe!
A qui la faute? Y a-t-il un bouc émissaire?
Depuis des décennies, on nous promet une sortie de la crise et de la misère. Le bout du tunnel était en vue, nous disait-on, encore quelques ultimes mesures exceptionnelles et des solutions durables s’imposeraient, les rationalisations ne surviendraient plus que dans «les vieilles industries», dans «des sociétés mère ou des filiales malades » ; plus tard, tout était cette fois-ci la faute « du vieillissement de la population» ou «des réfugiés», de «l’émigration incontrôlée » (la conséquence d’une misère et d’un désespoir pires encore ailleurs dans le monde!) ; plus tard encore les coupables du moment étaient les « bad banks », les fraudeurs, etc. Aujourd'hui, c’est de la faute du PDG de Ford que ce bain de sang social a lieu. Auparavant, lors de la fermeture des mines, les boucs émissaires étaient le ministre flamand socialiste De Batselier et le PDG de la société minière Gijselinck. Derrière toutes ces pseudo vérités et ces discours populistes creux se cache la propagande bourgeoise qui cherche constamment à trouver des boucs émissaires de telle sorte que la question de la faillite du système capitaliste ne soit pas posée. Ainsi, la colère est canalisée et est orientée vers la désignation de « coupables», faits sur mesure, pour mieux «diviser et régner».
Ce même scénario décrit ci-dessus est appliqué dans presque tous les pays du monde, les médias en témoignent quotidiennement. Évidemment, il y a des variantes, tout comme il y en a selon le secteur ou la région en Belgique même. Cependant, partout dans le monde, la question est posée : qui est le responsable de la crise ? Cette question a également été au cœur des débats dans les mouvements du «printemps arabe» en Tunisie et en Égypte, dans ceux des «Indignés» ou de «Occupy Wall Street».
Depuis plusieurs années se sont succédé, au niveau mondial, les crises de l'immobilier, de la bourse, du commerce et de l'industrie, des banques et de toutes les dettes souveraines des Etats. Ainsi, le total des dettes souveraines dans la zone euro s’élève à 8.517 milliards d'euros. Soit une moyenne de 90 % du produit intérieur brut de la zone euro. Une grande partie de celle-ci ne sera jamais remboursée. Quelqu'un doit financer ces dettes, mais financer des dettes impayables signifie finalement qu’on devient insolvable soi-même (un risque qui menace par exemple l'Allemagne). Comment le système peut-il alors financer la relance indispensable pour arrêter le bain de sang au sein de son économie ? En continuant à le faire essentiellement au moyen de mesures d’austérité et de rationalisation, il réduit encore le pouvoir d’achat dont il a besoin pour écouler ses produits, ce qui produira encore plus de rationalisations, de fermetures, de réductions des salaires. S’il écume le marché de l’épargne en imposant des taux d’intérêt dérisoires sous les 1%, tandis que l’inflation atteint les 2,76%, les réserves que de nombreuses familles ouvrières avaient mises de côté pour affronter des contretemps, l’accumulation de dettes ou le chômage, fonderont comme neige au soleil. Quelle que soit la méthode, elle ne peut donc mener à terme qu’à une nouvelle forte baisse du pouvoir d’achat. Devra-t-il se résoudre à faire marcher la planche à papier pour imprimer des billets supplémentaires, comme l’ont fait les USA, le Japon ou la Grande-Bretagne, afin de les mettre sur le marché à des taux de prêt extrêmement bas ? De cette manière, le système capitaliste accentue l’abîme des dettes et en revient au point de départ : en fin de compte, il faut toujours que de la valeur nouvelle soit produite en contrepartie de cet argent imprimé pour repayer les dettes. De l’argent fictif ne peut faire l’affaire, tel notre épargne que les banques remettent en circulation sous la forme d’un emprunt, tandis qu’elles nous font croire qu’il se trouve toujours sur notre compte. De la valeur nouvelle n’est obtenue qu’à partir du travail effectué en lui ajoutant une plus-value : les frais de production d’un produit ne peuvent constituer qu’une fraction de leur valeur de vente totale. Mais pour ce faire, il faut un marché solvable. S’il n’existe pas ou à peine (comme c’est le cas depuis des années), nous entrons dans une crise de surproduction permanente. C’est pourquoi des usines ferment, baissent leurs coûts de production (les salaires), augmentent la productivité, c’est pourquoi aussi les frais improductifs (sécurité sociale, allocations de chômage, retraites) sont constamment comprimés.
Tout ceci constitue la loi générale de la manière capitaliste de produire, qui ne peut être contournée par aucun patron individuel ou par aucun gouvernement particulier ! Si aujourd’hui les usines s’arrêtent, ce n’est pas parce que les travailleurs ne veulent plus travailler ou parce qu’il n’y a plus de besoins à assouvir, mais simplement parce que les capitalistes n’y voient plus de profit à réaliser. Le système capitaliste mondial est gravement malade : les marchés solvables se réduisent comme peau de chagrin et le profit ne peut être maintenu qu’à travers une spoliation sociale et une exploitation toujours plus intenses.
Se mobiliser massivement, forger l’unité, rechercher la solidarité, avoir confiance en sa propre force
Durant ces six derniers mois, protestations, grèves, manifestations massives ont éclaté sur tous les continents : de l’Argentine au Portugal, de l’Inde à la Turquie, de l’Egypte à la Chine. Ainsi, en septembre, des centaines de milliers ont occupé la rue au Portugal, des dizaines de milliers ont manifesté en Espagne en Grèce et en Italie. Au Japon, des manifestations contre la baisse des conditions de vie d’une telle ampleur n’avaient plus eu lieu depuis 1970 (170.000 manifestants à Tokyo). Partout, les mêmes questions sont posées : comment faire face à de telles attaques, comment organiser la lutte, quelles perspectives avancer ? Ce sont les mêmes questions que se posaient déjà les jeunes et les chômeurs du mouvement massif des Indignés ou de Occupy en 2011, e.a. en Espagne, en Grèce, aux USA ou au Canada.
A ce propos, trois besoins centraux pour la lutte ont été mis en avant : la nécessité de l’extension et de l’unification de la lutte, l’importance du développement d’une solidarité active parmi les salariés, les chômeurs et les jeunes et enfin le besoin d’une large discussion à propos de l’alternative pour le système actuel en faillite.
Notre vraie force est notre nombre, l’ampleur de notre lutte, notre destin commun, notre unité au delà des frontières des secteurs, des races, des régions, des pays. Face à un monde divisé et cloisonné par les intérêts personnels étroits d’exploiteurs arrogants, face au « chacun pour soi », à leur « compétitivité », nous devons opposer notre unité et notre solidarité. Nous devons refuser de nous laisser diviser, de réduire nos problèmes à des questions spécifiques et séparées, propres à l’entreprise, au secteur ou à la région. Non à la rivalité entre « jeunes » et « vieux », entre « fixes » et « temporaires », entre employés et ouvriers, entre travailleurs de la maison-mère et des filiales, entre travailleurs d’ici et d’autre part, ...
Cette unité est non seulement indispensable, elle est aussi possible aujourd’hui !
- L’extension de la lutte et de la solidarité avec d’autres secteurs et entreprises, qui sont fondamentalement touchés par les mêmes attaques et qui luttent souvent de manière isolée dans leur coin, pourra le mieux être engagée en envoyant des délégations massives vers les autres usines, c’est ce que nous apprennent les expériences de luttes précédentes ici comme ailleurs. Nos actions doivent renforcer notre lutte, l’étendre et lui donner des perspectives. Aller dans la rue pour « se défouler », mener un long combat isolé, chacun dans son usine ou sa région, ne permettront jamais de développer une lutte générale et massive.
- L’expérience nous apprend aussi que des actions comme la prise en otage de patrons, le sabotage de la production, le blocage de lignes de chemin de fer ou des actions désespérées, comme la menace de faire sauter l’usine, ne favorisent nullement l’union et l’extension de la lutte. Elles mènent au contraire à la démoralisation et à la défaite.
- Les leçons des luttes passées mettent en évidence que travailleurs et chômeurs doivent prendre en mains leurs propres luttes. Pour développer une véritable discussion collective, pour réfléchir et décider collectivement, il faut appeler à des assemblées générales massives, au sein desquelles chacun peut intervenir librement et avancer des propositions d’action, soumises au vote de l’assemblée. Pour forger l’unité du mouvement, ces assemblées doivent être ouvertes à tous les travailleurs et les chômeurs.
Et attention à la supercherie ! L’autre classe – la bourgeoisie – parle aussi de « solidarité » et « d’unité ». Elle appelle aux sacrifices des « secteurs forts » en « solidarité » avec les « secteurs faibles », pour répartir équitablement la misère. Quand son « gâteau devient plus petit », la discussion ne peut porter selon elle que sur une répartition « équivalente» de l’austérité qu’elle nous impose, sur ce qui est profitable à la compétitivité et à l’intérêt national . Elle appelle donc à « l’unité » avec les intérêts du capital. Comme si la répartition équivalente de la misère la rendait supportable ! Comme si la gestion commune de l’exploitation supprimait cette dernière. Ce discours ne sert qu’à entraver la mise en question du système et la recherche de perspectives dans le cadre d’une autre société basée sur l’assouvissement des besoins de tous et non pas des intérêts particuliers de certains !
unité et solidarité – extension et généralisation – confiance en ses propres forces – classe contre classe
Notre force, c’est notre solidarité, pas leur compétitivité.
Internationalisme / 02.11.12
Lettre d’un lecteur
Bonjour
Je vous écris à propos du tract publié récemment sur la crise «du secteur automobile».
Tout d'abord, sur l’analyse qui y est faite de la situation dans la branche de l’automobile, il n’y a rien à redire. Encore une fois, bon travail !
Cependant, la fin du tract reste (volontairement?) vague sur le plan de la prise en main.
Si les prises d’otage, le sabotage, les blocages, etc, ne constituent pas des formes de résistance anticapitaliste, quoi alors?
La mobilisation, la solidarité et l'unité de la classe ouvrière sont sûrement la première étape vers une base révolutionnaire - l'association de jeunes, de vieux, de chômeurs, de prolétaires, de précaires, etc. Cela devra se passer en premier lieu sur le plan économique (à l'intérieur des usines et sur les lieux de travail). L'ensemble de ce processus (comme décrit correctement dans le tract) prendra la forme d’assemblées générales (probablement clandestines), à la rigueur appelées conseils ou comités. Ces assemblées devront s’unir massivement (mutuellement par le biais de conseils / comités à l’échelle d’une «zone», «région» et «ville»).
C’est-à-dire, la démocratie prolétarienne à la base, à partir de l'économique (lieu de travail), vers le haut. Alors finalement, en théorie, l'organisation de masse surgit.
Mais quelle est alors l'arme de la classe ouvrière?
Jusqu’à présent, à côté des options plus radicales comme le sabotage, les occupations des lieux de travail et les blocages envers l’économie capitaliste et les traitres de la classe ouvrière (options qui certainement doivent être appliquées( !)), seule la grève semble être une arme légitime de la classe ouvrière.
Une grève entraîne la mobilisation de la classe ouvrière avec elle, et élimine pendant la période de la grève la division au sein de la classe.
En bref, la grève générale de masse est l'action directe contre l'économie capitaliste. Sur cette base, les exigences politiques envers l’État, le système, la social-démocratie et les syndicats peuvent être exprimées.*
Voilà ainsi une courte et simplifiée vision d'un lecteur. Mais quelle est alors l'alternative pour une révolution socialiste / communiste pour le CCI ?**
Sincèrement
KW/11.2012
.
* afin de ne pas compliquer ma lettre, j’ai ôté toute référence à la résistance ou à la participation des autorités et le militarisme.
** en tenant compte des conséquences juridiques. Ce qui peut expliquer l’imprécision de la conclusion du tract.
Réponse du CCI
Cher lecteur,
Merci pour ta contribution….Nous saluons chaque tentative d’approfondissement et de clarification de la discussion, même si cela implique une critique (fondamentale) des textes que nous avons publiés.
Nous souscrivons en grande partie avec ta contribution. Mais si tu n’y vois pas d’inconvénient, nous voulons aussi faire ici et là des remarques sur tes commentaires.
A la fin de ta lettre, tu écris «Cependant, la fin du tract reste (volontairement? vague sur le plan de la prise en main» et « cela (la mobilisation, la solidarité et l'unité de la classe ouvrière) devra se passer en premier lieu sur le plan économique. »
La question porte sur le fait que tu peux distinguer la lutte économique de la lutte politique mais elles ne sont pas totalement séparables l’une de l’autre.
« il n'existe pas deux espèces de luttes distinctes de la classe ouvrière, l'une de caractère politique, et l'autre de caractère économique(…) dans une action révolutionnaire de masse, la lutte politique et la lutte économique ne font plus qu'un ». Toute tentative de « distinction entre la lutte politique et la lutte économique, l'autonomie de ces deux formes de combat ne sont qu'un produit artificiel, quoique historiquement explicable, de la période parlementaire. (…)» (Rosa Luxembourg : grève de masse, parti et syndicat)
Dans la période de décadence du capitalisme, il n’est plus possible d’obtenir des réformes permanentes et durables. Cela signifie que toutes les luttes des travailleurs constituent indirectement une attaque à la nature du système. Toute opposition de la part de la classe peut ébranler les bases du capitalisme car le système a peu ou pas de marge de manœuvres pour neutraliser l’attaque des ouvriers.
La lutte de classe dans la période de décadence « vise à la fois à limiter les effets de l'exploitation capitaliste et à supprimer cette exploitation en même temps que la société bourgeoise.». En d’autres termes : « (toute) période de luttes de classe (a) un caractère à la fois politique et économique. ». (Idem)
Il est vrai que le point de départ de la lutte des ouvriers –en tout cas jusqu’à la période de l’insurrection révolutionnaire- sera toujours une résistance aux attaques sur les conditions de vie. Par conséquent, dans un sens, il est vrai que dans la lutte il ne s’agit pas de ce que les ouvriers attendent de leurs propres actions, mais de ce que la classe ouvrière est et de ce qu’elle est forcée de faire sur ce plan. Mais si la classe ouvrière est obligée de faire certaines choses, elle ne le fait pas sans une certaine conscience (surtout pas d’une manière mécanique, comme par exemple le chien de Pavlov). C’est pourquoi, le développement de la conscience dans la classe ouvrière est aussi, selon nous, une condition essentielle pour le développement d’un contre-pouvoir : une prise de conscience sur l’existence du salariat, la façon associée et collective dans laquelle les ouvriers sont dans la production et le fait que les travailleurs de cette façon, comme classe, sont les producteurs de toutes les richesses dans le monde.
Pour une minorité grande ou petite de la classe, il existe toujours l’idée et la perspective d’une autre société communiste. C’est parce qu’elle a une mémoire historique, un souvenir des périodes passées (que ce soit transmis ou non par une autre génération) et une capacité à apprendre de ses expériences de lutte. Ce qui fait qu’elle peut pousser l’enjeu de la lutte, à chaque fois qu’elle l’engage, à une échelle toujours plus générale. «Reculer pour mieux sauter» c’est-à-dire faire quelques pas en arrière pour mieux sauter en avant, c’est à peu près de cela qu’il s’agit pour la lutte ouvrière. Les travailleurs ont la capacité, chaque fois qu’ils engagent la lutte, de mettre de plus en plus de côté leurs propres intérêts immédiats et de la poser sur une échelle de plus en plus générale (et donc plus large et finalement aussi politique). Cette dynamique conduit à ce que le combat ne portera plus de façon prédominante sur un niveau direct économique mais sur un niveau politique : la lutte pour le pouvoir dans la société.
Salutations fraternelles
Au nom du CCI
A/11.2012
Géographique:
- Belgique [2]
Situations territoriales:
Rubrique:
Rosa Luxemburg: socialisme ou barbarie?
- 1352 reads
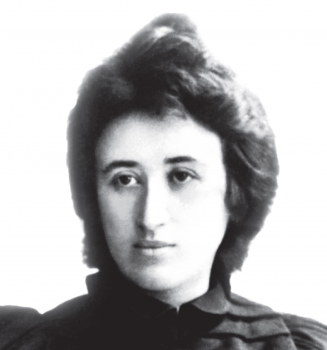 Nous publions ci-dessous de larges extraits du premier chapitre (1) de la brochure de Rosa Luxemburg "la Crise de la social-démocratie" (2).
Nous publions ci-dessous de larges extraits du premier chapitre (1) de la brochure de Rosa Luxemburg "la Crise de la social-démocratie" (2).
Ce texte magistral de 1915 doit être une source d’inspiration face aux difficultés actuelles du prolétariat. Alors confrontée à la pire boucherie de l’histoire de l’humanité, la Première Guerre mondiale (3) , et à la trahison de la social-démocratie qui a contribué à embrigader dans ce carnage impérialiste les ouvriers de tous les pays, Rosa Luxemburg ne cède pas au découragement. Au contraire ! Elle plaide pour un marxisme vivant, non dogmatique, empreint de la méthode scientifique, qui regarde les erreurs et les défaites en face pour en tirer les leçons et mieux préparer l’avenir. Car cette révolutionnaire a une confiance inébranlable en l’avenir et dans la capacité du prolétariat mondial à accomplir sa mission historique : lutter consciemment pour l’émancipation de toute l’humanité.
CCI
[…] Finie l’ivresse. […] L’allégresse bruyante des jeunes filles courant le long des convois ne fait plus d’escorte aux trains de réservistes et ces derniers ne saluent plus la foule en se penchant depuis les fenêtres de leur wagon, un sourire joyeux aux lèvres […]. Dans l’atmosphère dégrisée de ces journées blêmes, c’est un tout autre chœur que l’on entend : le cri rauque des vautours et des hyènes sur le champ de bataille. […] La chair à canon, embarquée en août et septembre toute gorgée de patriotisme, pourrit maintenant en Belgique, dans les Vosges, en Masurie, dans des cimetières où l’on voit les bénéfices de guerre pousser dru. […] Les affaires fructifient sur des ruines. Des villes se métamorphosent en monceaux de décombres, des villages en cimetières, des régions entières en déserts, des populations entières en troupes de mendiants, des églises en écuries. […]123
Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment.
Et au cœur de ce sabbat de sorcière s’est produit une catastrophe de portée mondiale : la capitulation de la social-démocratie internationale. Ce serait pour le prolétariat le comble de la folie que de se bercer d’illusions à ce sujet ou de voiler cette catastrophe : c’est le pire qui pourrait lui arriver. “Le démocrate” (c’est-à-dire le petit-bourgeois révolutionnaire) dit Marx, “sort de la défaite la plus honteuse aussi pur et innocent que lorsqu’il a commencé la lutte : avec la conviction toute récente qu’il doit vaincre, non pas qu’il s’apprête, lui et son parti, à réviser ses positions anciennes, mais au contraire parce qu’il attend des circonstances qu’elles évoluent en sa faveur.” Le prolétariat moderne, lui, se comporte tout autrement au sortir des grandes épreuves de l’histoire. Ses erreurs sont aussi gigantesques que ses tâches. Il n’y a pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer le chemin à parcourir. Il n’a d’autre maître que l’expérience historique. Le chemin pénible de sa libération n’est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d’erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l’atteindra s’il sait s’instruire de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l’autocritique, une autocritique sans merci, cruelle, allant jusqu’au fond des choses, c’est l’air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre. Dans la guerre mondiale actuelle, le prolétariat est tombé plus bas que jamais. C’est là un malheur pour toute l’humanité. Mais c’en serait seulement fini du socialisme au cas où le prolétariat international se refuserait à mesurer la profondeur de sa chute et à en tirer les enseignements qu’elle comporte.
Ce qui est en cause actuellement, c’est tout le dernier chapitre de l’évolution du mouvement ouvrier moderne au cours de ces vingt-cinq dernières années. Ce à quoi nous assistons, c’est à la critique et au bilan de l’œuvre accomplie depuis près d’un demi-siècle. La chute de la Commune de Paris avait scellé la première phase du mouvement ouvrier européen et la fin de la I Internationale. A partir de là commença une phase nouvelle. Aux révolutions spontanées, aux soulèvements, aux combats sur les barricades, après lesquels le prolétariat retombait chaque fois dans son Etat passif, se substitua alors la lutte quotidienne systématique, l’utilisation du parlementarisme bourgeois, l’organisation des masses, le mariage de la lutte économique et de la lutte politique, le mariage de l’idéal socialiste avec la défense opiniâtre des intérêts quotidiens immédiats. Pour la première fois, la cause du prolétariat et de son émancipation voyait briller devant elle une étoile pour la guider : une doctrine scientifique rigoureuse. A la place des sectes, des écoles, des utopies, des expériences que chacun faisait pour soi dans son propre pays, on avait un fondement théorique international, base commune qui faisait converger les différents pays en un faisceau unique. La théorie marxiste mit entre les mains de la classe ouvrière du monde entier une boussole qui lui permettait de trouver sa route dans le tourbillon des événements de chaque jour et d’orienter sa tactique de combat à chaque heure en direction du but final, immuable.
C’est le parti social-démocrate allemand qui se fit le représentant, le champion et le gardien de cette nouvelle méthode. […] Au prix de sacrifices innombrables, par un travail minutieux et infatigable, elle a édifié une organisation exemplaire, la plus forte de toutes ; elle a créé la presse la plus nombreuse, donné naissance aux moyens de formation et d’éducation les plus efficaces, rassemblé autour d’elle les masses d’électeurs les plus considérables et obtenu le plus grand nombre de sièges de députés. La social-démocratie allemande passait pour l’incarnation la plus pure du socialisme marxiste. Le parti social-démocrate occupait et revendiquait une place d’exception en tant que maître et guide de la IIree Internationale. […] La social-démocratie française, italienne et belge, les mouvements ouvriers de Hollande, de Scandinavie, de Suisse et des Etats-Unis marchaient sur ses traces avec un zèle toujours croissant. Quant aux Slaves, les Russes et les sociaux-démocrates des Balkans, ils la regardaient avec une admiration sans bornes, pour ainsi dire inconditionnelle. […] Pendant les congrès, au cours des sessions du bureau de l’Internationale socialiste, tout était suspendu à l’opinion des Allemands. […] “Pour nous autres Allemands, ceci est inacceptable” suffisait régulièrement à décider de l’orientation de l’Internationale. Avec une confiance aveugle, celle-ci s’en remettait à la direction de la puissante social-démocratie allemande tant admirée : elle était l’orgueil de chaque socialiste et la terreur des classes dirigeantes dans tous les pays.
Et à quoi avons-nous assisté en Allemagne au moment de la grande épreuve historique ? A la chute la plus catastrophique, à l’effondrement le plus formidable. […] Aussi faut-il commencer par elle, par l’analyse de sa chute […]. La classe ouvrière, elle, ose hardiment regarder la vérité en face, même si cette vérité constitue pour elle l’accusation la plus dure, car sa faiblesse n’est qu’un errement et la loi impérieuse de l’histoire lui redonne la force, lui garantit sa victoire finale.
L’autocritique impitoyable n’est pas seulement pour la classe ouvrière un droit vital, c’est aussi pour elle le devoir suprême. Sur notre navire, nous transportions les trésors les plus précieux de l’humanité confiés à la garde du prolétariat, et tandis que la société bourgeoise, flétrie et déshonorée par l’orgie sanglante de la guerre, continue de se précipiter vers sa perte, il faut que le prolétariat international se reprenne, et il le fera, pour ramasser les trésors que, dans un moment de confusion et de faiblesse au milieu du tourbillon déchaîné de la guerre mondiale, il a laissé couler dans l’abîme.
Une chose est certaine, la guerre mondiale représente un tournant pour le monde. […] La guerre mondiale a changé les conditions de notre lutte et nous a changés nous-mêmes radicalement. Non que les lois fondamentales de l’évolution capitaliste, le combat de vie et de mort entre le capital et le travail, doivent connaître une déviation ou un adoucissement. […] Mais à la suite de l’éruption du volcan impérialiste, le rythme de l’évolution a reçu une impulsion si violente qu’à côté des conflits qui vont surgir au sein de la société et à côté de l’immensité des tâches qui attendent le prolétariat socialiste dans l’immédiat toute l’histoire du mouvement ouvrier semble n’avoir été jusqu’ici qu’une époque paradisiaque. […] Rappelons-nous comment naguère encore nous décrivions l’avenir :
[…] Le tract officiel du parti, Impérialisme ou socialisme, qui a été diffusé il y a quelques années à des centaines de milliers d’exemplaires, s’achevait sur ces mots “Ainsi la lutte contre le capitalisme se transforme de plus en plus en un combat décisif entre le Capital et le Travail. Danger de guerre, disette et capitalisme - ou paix, prospérité pour tous, socialisme ; voilà les termes de l’alternative. L’histoire va au-devant de grandes décisions. Le prolétariat doit inlassablement œuvrer à sa tâche historique, renforcer la puissance de son organisation, la clarté de sa connaissance. Dès lors, quoi qu’il puisse arriver, soit que, par la force qu’il représente, il réussisse à épargner à l’humanité le cauchemar abominable d’une guerre mondiale, soit que le monde capitaliste ne puisse périr et s’abîmer dans le gouffre de l’histoire que comme il en est né, c’est-à-dire dans le sang et la violence, à l’heure historique la classe ouvrière sera prête et le tout est d’être prêt.” […] Une semaine encore avant que la guerre n’éclate, le 26 juillet 1914, les journaux du parti allemand écrivaient “Nous ne sommes pas des marionnettes, nous combattons avec toute notre énergie un système qui fait des hommes des instruments passifs de circonstances qui agissent aveuglément, de ce capitalisme qui se prépare à transformer une Europe qui aspire à la paix en une boucherie fumante. Si ce processus de dégradation suit son cours, si la volonté de paix résolue du prolétariat allemand et international qui apparaîtra au cours des prochains jours dans de puissantes manifestations ne devait pas être en mesure de détourner la guerre mondiale, alors, qu’elle soit au moins la dernière guerre, qu’elle devienne le crépuscule des dieux du capitalisme” (Frankfurter Volksstimme) […] Et c’est alors que survint cet événement inouï, sans précédent : le 4 août 1914.
Cela devait-il arriver ainsi ? […] Le socialisme scientifique nous a appris à comprendre les lois objectives du développement historique. Les hommes ne font pas leur histoire de toutes pièces. Mais ils la font eux-mêmes. Le prolétariat dépend dans son action du degré de développement social de l’époque, mais l’évolution sociale ne se fait pas non plus en dehors du prolétariat, celui-ci est son impulsion et sa cause, tout autant que son produit et sa conséquence. Son action fait partie de l’histoire tout en contribuant à la déterminer. Et si nous pouvons aussi peu nous détacher de l’évolution historique que l’homme de son ombre, nous pouvons cependant bien l’accélérer ou la retarder. Dans l’histoire, le socialisme est le premier mouvement populaire qui se fixe comme but, et qui soit chargé par l’histoire, de donner à l’action sociale des hommes un sens conscient, d’introduire dans l’histoire une pensée méthodique et, par là, une volonté libre. Voilà pourquoi Friedrich Engels dit que la victoire définitive du prolétariat socialiste constitue un bond qui fait passer l’humanité du règne animal au règne de la liberté. Mais ce “bond” lui-même n’est pas étranger aux lois d’airain de l’histoire, il est lié aux milliers d’échelons précédents de l’évolution, une évolution douloureuse et bien trop lente. Et ce bond ne saurait être accompli si, de l’ensemble des prémisses matérielles accumulées par l’évolution, ne jaillit pas l’étincelle de la volonté consciente de la grande masse populaire. La victoire du socialisme ne tombera pas du ciel comme fatum, cette victoire ne peut être remportée que grâce à une longue série d’affrontements entre les forces anciennes et les forces nouvelles […]. Friedrich Engels a dit un jour : “La société bourgeoise est placée devant un dilemme : ou bien passage au socialisme ou rechute dans la barbarie.” Mais que signifie donc une “rechute dans la barbarie” au degré de civilisation que nous connaissons en Europe aujourd’hui ? Jusqu’ici nous avons lu ces paroles sans y réfléchir et nous les avons répétées sans en pressentir la terrible gravité. Jetons un coup d’œil autour de nous en ce moment même, et nous comprendrons ce que signifie une rechute de la société bourgeoise dans la barbarie. Le triomphe de l’impérialisme aboutit à l’anéantissement de la civilisation – sporadiquement pendant la durée d’une guerre moderne et définitivement si la période des guerres mondiales qui débute maintenant devait se poursuivre sans entraves jusque dans ses dernières conséquences. C’est exactement ce que Friedrich Engels avait prédit, une génération avant nous, voici quarante ans. Nous sommes placés aujourd’hui devant ce choix : ou bien triomphe de l’impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquences, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien victoire du socialisme, c’est-à-dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l’impérialisme et contre sa méthode d’action : la guerre. C’est là un dilemme de l’histoire du monde, un ou bien – ou bien encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire : l’avenir de la civilisation et de l’humanité en dépendent. Au cours de cette guerre, l’impérialisme a remporté la victoire. En faisant peser de tout son poids le glaive sanglant de l’assassinat des peuples, il a fait pencher la balance du côté de l’abîme, de la désolation et de la honte. Tout ce fardeau de honte et de désolation ne sera contrebalancé que si, au milieu de la guerre, nous savons retirer de la guerre la leçon qu’elle contient, si le prolétariat parvient à se ressaisir et s’il cesse de jouer le rôle d’un esclave manipulé par les classes dirigeantes pour devenir le maître de son propre destin.
La classe ouvrière paie cher toute nouvelle prise de conscience de sa vocation historique. Le Golgotha de sa libération est pavé de terribles sacrifices. Les combattants des journées de Juin, les victimes de la Commune, les martyrs de la Révolution russe – quelle ronde sans fin de spectres sanglants ! Mais ces hommes-là sont tombés au champ d’honneur, ils sont, comme Marx l’écrivit à propos des héros de la Commune, “ensevelis à jamais dans le grand cœur de la classe ouvrière”. Maintenant, au contraire, des millions de prolétaires de tous les pays tombent au champ de la honte, du fratricide, de l’automutilation, avec aux lèvres leurs chants d’esclaves. Il a fallu que cela aussi ne nous soit pas épargné. Vraiment nous sommes pareils à ces Juifs que Moïse a conduits à travers le désert. Mais nous ne sommes pas perdus et nous vaincrons pourvu que nous n’ayons pas désappris d’apprendre. Et si jamais le guide actuel du prolétariat, la social-démocratie, ne savait plus apprendre, alors elle périrait “pour faire place aux hommes qui soient à la hauteur d’un monde nouveau”.
Junius (1915)
1 ) Dont le titre est Socialisme ou barbarie.
2 ) Aussi connue sous le nom de La brochure de Junius, pseudonyme utilisé par Rosa pour le signer, ce texte est intégralement disponible sur le site marxists.org.
3 ) De pires atrocités viendront ensuite, comme la Seconde Guerre mondiale.
Rubrique:
Après le massacre de Marikana, l'Afrique du Sud est frappée par des grèves massives
- 1219 reads
 En septembre (voir site web: RI no 435), nous analysions le contexte dans lequel s’est déroulé le massacre des mineurs en grève à Marikana par la police sud-africaine, le 16 août dernier. Nous montrions de quelle manière les syndicats et le gouvernement avaient en fait tendu un piège meurtrier aux ouvriers afin d’étrangler la dynamique de lutte qui touche depuis plusieurs mois “la plus grande démocratie africaine”. Tandis que ses flics brutalisaient et assassinaient les travailleurs en toute impunité, la bourgeoisie brandissait le thème de l’apartheid pour les entraîner sur le terrain stérile de la prétendue lutte des races dont les travailleurs noirs seraient les victimes. Si les grèves semblaient s’étendre à d’autres mines, il nous était toutefois impossible de déterminer avec certitude si elles glisseraient effectivement sur le terrain du conflit inter-racial ou continueraient à s’étendre.
En septembre (voir site web: RI no 435), nous analysions le contexte dans lequel s’est déroulé le massacre des mineurs en grève à Marikana par la police sud-africaine, le 16 août dernier. Nous montrions de quelle manière les syndicats et le gouvernement avaient en fait tendu un piège meurtrier aux ouvriers afin d’étrangler la dynamique de lutte qui touche depuis plusieurs mois “la plus grande démocratie africaine”. Tandis que ses flics brutalisaient et assassinaient les travailleurs en toute impunité, la bourgeoisie brandissait le thème de l’apartheid pour les entraîner sur le terrain stérile de la prétendue lutte des races dont les travailleurs noirs seraient les victimes. Si les grèves semblaient s’étendre à d’autres mines, il nous était toutefois impossible de déterminer avec certitude si elles glisseraient effectivement sur le terrain du conflit inter-racial ou continueraient à s’étendre.
Depuis la publication de notre article, nous avons assisté au plus important mouvement de grève en Afrique du Sud depuis la fin de l’apartheid en 1994. Ces grèves sont doublement significatives car, non seulement elles démontrent – si cela était encore nécessaire – que derrière le prétendu miracle économique des “pays émergents” se cache, comme partout, une misère croissante, mais elles mettent également en évidence que les travailleurs du monde entier, loin d’avoir des intérêts divergents, se battent partout contre les conditions de vie indignes qu’impose le capitalisme. A ce titre, malgré les faiblesses sur lesquelles nous reviendrons, les grèves qui secouent l’Afrique du Sud s’inscrivent dans le sillage des luttes ouvrières de par le monde.
Face aux mineurs, l’Etat divise, épuise et terrorise
Suite au massacre du 16 août, la lutte semblait devoir s’essouffler, écrasée par le poids des manœuvres de la bourgeoisie. En effet, tandis que la grève s’étendait à plusieurs autres mines avec des revendications identiques, une concertation de requins était organisée entre les seuls syndicats de Marikana, la direction et l’Etat, le tout sous la très sainte médiation de dignitaires religieux. La manœuvre visait à étouffer l’extension des grèves en divisant les ouvriers entre ceux, d’une part, qui bénéficiaient de négociations et de toute l’attention médiatique et ceux, d’autre part, qui se lançaient dans la grève dans l’indifférence générale, à l’exception de l’attention des flics (blancs et noirs) qui poursuivaient leur campagne de terreur, leurs provocations et leurs descentes nocturnes.
Sur le terrain, l’AMCU, syndicat qui avait profité du déclenchement de la grève sauvage à Marikana le 10 août pour lancer ses gros bras dans une guerre de territoire meurtrière contre son concurrent du MUN, incitait les ouvriers à s’en prendre physiquement aux mineurs qui avaient repris le travail : “La police ne pourra pas les protéger tout le temps, la police ne dort pas avec eux dans leurs baraquements. Si tu vas travailler, tu dois savoir que tu vas en subir les conséquences.” A cause du blackout médiatique qui s’est brutalement abattu sur cette lutte, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si les ouvriers ont effectivement cédé à la violence ou si les syndicats ont poursuivi leur règlement de comptes sous couvert des grèves ; toujours est-il que plusieurs assassinats et agressions ont été perpétuées tout au long du mouvement.
Bien que la propagande autour du “retour de l’apartheid” n’ait jamais réellement été prise au sérieux par les ouvriers, dans un tel contexte, la lutte refluait bel et bien. Pourtant, à ce stade, le mouvement connaissait un nouveau souffle.
La grève s’étend
Le 30 août, la population apprenait, par l’intermédiaire du journal de Johannesburg, The Star, qu’en affirmant avoir tiré sur les mineurs de Marikana “en Etat de légitime défense”, la police avait menti éhontément puisque les rapports d’autopsie montraient que les mineurs avaient en fait été abattus dans le dos, en essayant de fuir leurs bourreaux. Selon plusieurs témoignages de journalistes présents sur place, les flics pourchassaient même les grévistes pour les assassiner de sang froid. Or, presque au même moment, le tribunal de Pretoria annonçait son intention d’inculper les deux cent soixante-dix mineurs arrêtés le 16 août lors de la fusillade policière... pour le meurtre de leurs camarades ( !), en vertu d’une loi anti-émeute prévoyant l’inculpation pour meurtre de toutes les personnes arrêtées sur le site d’une fusillade impliquant la police. C’est que, dans “la plus grande démocratie africaine”, on ne fait pas dans la dentelle ; tandis qu’aucun des policiers qui ont abattu les mineurs de Marikana n’a été inquiété, l’Etat inculpe les survivants de la fusillade. Avec un peu d’imagination, le tribunal de Pretoria aurait presque pu exécuter une seconde fois les morts pour leur propre assassinat !
La consternation fût telle que, le 2 septembre, le tribunal était contraint de reculer en annonçant l’annulation des inculpations et la libération de l’ensemble des prisonniers. Surtout, l’Etat se rendait rapidement compte de son erreur puisque, sur la base des mêmes revendications, les grèves se sont aussitôt multipliées dans la plupart des mines du pays. En effet, le 31 août, quinze mille employés d’une mine d’or exploitée par le groupe Gold Fields, près de Johannesburg, lançaient une grève sauvage. Le 3 septembre, les mineurs de Modder East, employés par Gold One, entraient à leur tour dans la lutte. Le 5 septembre, presque tous les mineurs de Marikana manifestaient sous les acclamations de la population et refusaient, le lendemain, de s’associer à l’accord minable signé entre les syndicats et la direction de Lomin. Dès le 14 septembre, les compagnies Amplats, Aquarius et Xstrata, qui exploitent chacune plusieurs sites, annonçaient la suspension de leur activité, tandis que la production de presque l’ensemble des mines du pays semblait à l’arrêt. La vague de grève devait même s’étendre à d’autres secteurs, en particulier celui des transporteurs routiers.
Cette dynamique était, en partie, alimentée par l’indignation suscitée par les témoignages des grévistes emprisonnés : “Ils [les policiers] nous ont frappés et nous ont giflés, nous ont marchés sur les doigts avec leurs bottes”, “Je n’arrive toujours pas à comprendre ce qui m’est arrivé, c’est ma première fois en prison ! Nous réclamions une hausse de salaire et ils se sont mis à nous tirer dessus, et en prison les policiers nous ont battus, ils ont même volé les 200 rands [20 euros] que j’avais sur moi !”
Lent reflux de la lutte
La terreur policière s’abattait également sur les grévistes en liberté par le biais d’interventions très violentes, occasionnant des arrestations pour des motifs incongrus, de nombreux blessés et plusieurs morts (1). Ainsi, le 14 septembre, le porte-parole du gouvernement déclarait : “Il est nécessaire d’intervenir car nous sommes arrivés à un point où il faut faire des choix importants.” Après ce bel exemple de phrase creuse dont seuls les politiciens ont le secret, le porte-parole ajoutait, beaucoup moins laconiquement : “Si nous laissons cette situation se développer, l’économie va en souffrir gravement.” Le lendemain, une descente extrêmement brutale était organisée, vers deux heures du matin, dans les dortoirs abritant les ouvriers de Marikana et leur famille. La police, appuyée par l’armée, blessait de nombreuses personnes, dont plusieurs femmes. Au matin, des émeutes éclataient, des barricades étaient dressées sur les routes. Il n’en fallait pas moins à la police pour déchaîner sa violence sur les ouvriers de tout le pays au nom de la “sécurité des personnes”.
Tandis que ses flics terrorisaient la population, l’Etat, avec la complicité des syndicats, portait un coup important à la lutte, le 18 septembre, en accordant aux seuls mineurs de Marikana des augmentations de 11 à 22 %. Cette victoire en trompe-l’œil visait clairement à diviser les ouvriers et à priver le mouvement des travailleurs qui étaient jusque-là au cœur de la lutte. En clair, la bourgeoisie sacrifiait 22 % aux mineurs de Marikana pour étouffer la combativité des autres grévistes, stopper l’extension de la lutte et priver la plupart des ouvriers des augmentations de salaire revendiquées.
Pourtant, le 25 septembre, les neuf mille employés de la mine Beatrix entraient à leur tour en grève, ceux de Atlatsa se lançaient dans la lutte le 1er octobre. La violence de la police s’éleva à nouveau d’un cran avec son lot d’interpellations brutales, de matraquages et d’assassinats. Le 5 octobre, la compagnie Amplats sortait la grosse artillerie en annonçant le licenciement de douze mille mineurs. Dans la foulée, plusieurs compagnies, appuyées par les tribunaux, menacèrent de licencier massivement à travers un chantage écœurant : soit les ouvriers acceptaient les misérables augmentations de salaire proposées par les directions, soit ils étaient mis à la porte. Gold One devait finalement licencier mille quatre cents personnes, Gold Field mille cinq cents autres, etc.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les dernières poches de grévistes retournent peu à peu au travail. Mais cette lutte, et malgré les faiblesses qui l’ont caractérisée, exprime une certaine élévation de la conscience de classe. Les ouvriers sud-africains ont ressenti la nécessité de lutter collectivement, ont formulé des revendications précises et unitaires, ont constamment cherché à étendre leur combat. Dans un contexte où la crise et la misère vont inexorablement s’approfondir, ce mouvement est une expérience inaltérable dans le développement de la conscience de tous les prolétaires de la région et une leçon pour les prolétaires du monde entier.
El Generico, 22 octobre
1 ) Il est encore impossible de déterminer le nombre de grévistes abattus par la police sud-africaine, mais la presse a rapporté sept morts à Rustenburg et au moins un mort dans les rangs des chauffeurs de camion.
Géographique:
- Afrique [4]
Rubrique:
Pourquoi est-il si difficile de lutter et comment dépasser ces difficultés?
- 1249 reads
Tout semble a priori favorable à une explosion sans précédent de la colère ouvrière. La crise est manifeste, elle n’échappe à personne, et personne n’y échappe. Peu croient encore à la “sortie de crise” dont on nous rebat les oreilles quotidiennement. La planète nous déroule tout aussi quotidiennement son spectacle de désolation : guerres et barbarie, famines insupportables, épidémies, sans parler des manipulations irresponsables d’apprentis-sorciers délirants auxquels les capitalistes se livrent avec la nature, la vie et notre santé, au seul nom du profit.
Face à tout cela, il est difficile d’imaginer qu’un autre sentiment que la révolte et l’indignation puisse occuper les esprits. Il est difficile de penser qu’une majorité de prolétaires croient encore à un avenir sous le capitalisme. Et pourtant, les masses n’ont pas encore pleinement pris le chemin de la lutte. Faut-il alors penser que les jeux sont faits, que le rouleau compresseur de la crise est trop puissant, que la démoralisation qu’il engendre est indépassable ?
De grandes difficultés…
On ne peut nier que la classe ouvrière connaît actuellement des difficultés importantes. Il y a au moins quatre raisons essentielles à cela :
• La première, de loin la plus centrale, c’est tout simplement le fait que le prolétariat n’a pas conscience de lui-même, qu’il a perdu sa propre identité de classe. Suite à la chute du mur de Berlin, toute une propagande s’était en effet déchainée dans les années 1990 pour tenter de nous convaincre de la faillite historique du communisme. Les plus audacieux – et les plus stupides – annonçaient même “la fin de l’histoire”, le triomphe de la paix et de la “démocratie”… En amalgamant le communisme à la carcasse du monstre stalinien putréfié, la classe dominante a cherché à discréditer par avance toute perspective de classe visant à renverser le système capitaliste. Non contente de chercher à détruire toute idée de perspective révolutionnaire, elle s’est aussi efforcée de faire du combat prolétarien une sorte d’archaïsme bon à préserver comme “mémoire culturelle” au musée de l’Histoire, à l’instar des fossiles de dinosaures ou de la grotte de Lascaux.
Surtout, la bourgeoisie n’a cessé d’insister sur le fait que la classe ouvrière sous sa forme classique avait disparu de la scène politique. Tous les sociologues, journalistes, politiciens et philosophes du dimanche rabâchent l’idée que les classes sociales ont disparu, fondues dans le magma informe des “classes moyennes”. C’est le rêve permanent de la bourgeoisie d’une société où les prolétaires ne se verraient qu’en simples “citoyens”, divisés en catégories socioprofessionnelles plus ou moins bien discernées et surtout bien divisées – en cols blancs, cols bleus, employés, précaires, chômeurs, etc. – avec des intérêts divergents et qui ne “s’unissent” que momentanément, isolés et passifs, dans les urnes. Et il est vrai que le battage sur la disparition de la classe ouvrière, répété et asséné à grands renforts de reportages, de livres, d’émissions télévisés… a eu pour résultat que nombre d’ouvriers ne parviennent pour l’instant plus à se concevoir comme partie intégrante de la classe ouvrière et encore moins comme classe sociale indépendante.
• De cette perte de l’identité de classe découle, en second lieu, les difficultés du prolétariat à affirmer son combat et sa perspective historique. Dans un contexte où la bourgeoisie elle-même n’a aucune perspective à offrir autre que l’austérité, le chacun pour soi, l’isolement et le sauve-qui-peut dominent. La classe dominante exploite ses sentiments pour monter les exploités les uns contre les autres, les diviser pour empêcher toute riposte unie, pour les pousser au désespoir.
• Le troisième facteur, comme conséquence des deux premiers, c’est que la brutalité de la crise tend à paralyser de nombreux prolétaires, à cause de la peur de tomber dans la misère absolue, de ne pouvoir nourrir sa famille et de se retrouver à la rue, isolé et exposé à la répression. Même si certains, mis au pied du mur, sont poussés à manifester leur colère, à l’image des “Indignés”, ils ne se conçoivent pas comme une réelle classe en lutte. Ceci, malgré les efforts et le caractère parfois relativement massif des mouvements, limite la capacité à résister aux mystifications et aux pièges tendus par la classe dominante, à se réapproprier les expériences de l’histoire, à tirer des leçons avec le recul et la profondeur nécessaires.
• Il y a enfin un quatrième élément important pour expliquer les difficultés actuelles de la classe ouvrière à développer sa lutte contre le système : c’est l’arsenal d’encadrement de la bourgeoisie, ouvertement répressif, comme les forces de police, ou surtout plus insidieux et bien plus efficaces, comme les forces syndicales. Sur ce dernier aspect, notamment, la classe ouvrière n’est pas encore parvenue à dépasser ses craintes de lutter en dehors de leur encadrement, même si ceux qui ont encore des illusions sur la capacité des syndicats à défendre nos intérêts sont de moins en moins nombreux. Et cet encadrement physique se double d’un encadrement idéologique plus ou moins maîtrisé par les syndicats, les médias, les intellectuels, les partis de gauche, etc. Ce que la bourgeoisie réussit aujourd’hui le plus à développer est sans conteste l’idéologie démocratique. Tout événement est exploité pour vanter les bienfaits de la démocratie. La démocratie est présentée comme le cadre où toutes les libertés se développent, où toutes les opinions s’expriment, où le pouvoir est légitimé par le peuple, où les initiatives sont favorisées, où tout le monde peut accéder à la connaissance, à la culture, aux soins et, pourquoi pas, au pouvoir. En réalité, la démocratie n’offre qu’un cadre national au développement du pouvoir des élites, du pouvoir de la bourgeoisie, et le reste n’est qu’illusion, l’illusion qu’en passant par l’isoloir on exerce un quelconque pouvoir, que dans l’hémicycle s’expriment les opinions de la population au travers du vote de “représentants”. Il ne faut pas sous-estimer le poids de cette idéologie sur les consciences ouvrières, tout comme il ne faut pas oublier le choc extrême qu’aura provoqué l’effondrement du stalinisme à la charnière des années 1980 et 1990. A tout cet arsenal idéologique vient s’ajouter l’idéologie religieuse. Elle n’est pas nouvelle si l’on considère qu’elle a accompagné l’humanité depuis ses premiers pas dans le besoin de comprendre son environnement. Elle n’est pas nouvelle non plus si on se rappelle à quel point elle est venue légitimer toutes sortes de pouvoirs à travers l’histoire. Mais aujourd’hui, ce qu’elle présente d’original est qu’elle vient se greffer aux réflexions d’une partie de la classe ouvrière face au capitalisme destructeur et en faillite. Elle vient dévoyer cette réflexion en expliquant la “décadence” du monde occidental dans son éloignement des valeurs portées depuis des millénaires par la religion, en particulier les religions monothéistes. L’idéologie religieuse a cette force qu’elle réduit à néant la complexité extrême de la situation. Elle n’apporte que des réponses simples, faciles à mettre en œuvre. Dans ses formes intégristes, elle ne convainc qu’une petite minorité d’ouvriers, mais de façon plus générale, elle contribue à parasiter la réflexion de la classe ouvrière.
… et un formidable potentiel
Ce tableau est un peu désespérant : face à une bourgeoisie qui maîtrise ses armes idéologiques, à un système qui menace de misère la plus grande partie de la population, quand elle ne l’y plonge pas directement, y a-t-il encore une place pour développer une pensée positive, pour dégager un espoir ? Y a-t-il vraiment encore une force sociale capable de mener à bien une œuvre aussi immense que la transformation radicale de la société, rien de moins ? A cette question, il faut répondre sans hésitation : oui ! Cent fois oui ! Il ne s’agit pas d’avoir une confiance aveugle dans la classe ouvrière, une foi quasi-religieuse dans les écrits de Marx ou un élan désespéré dans une révolution perdue d’avance. Il s’agit de prendre du recul, d’avoir une analyse sereine de la situation, au delà des enjeux immédiats, tenter de comprendre ce que signifient réellement les luttes de la classe ouvrière sur la scène sociale et étudier en profondeur le rôle historique du prolétariat.
Dans notre presse, nous avons déjà analysé que, depuis 2003, la classe ouvrière est dans une dynamique positive par rapport au recul qu’elle a subi avec l’effondrement des pays de l’Est. De nombreuses manifestations de cette analyse se retrouvent dans des luttes plus ou moins importantes mais qui ont toutes pour caractéristique de montrer la réappropriation progressive par la classe de ses réflexes historiques comme la solidarité, la réflexion collective, et plus simplement, l’enthousiasme face à l’adversité.
Nous avons pu voir ces éléments à l’œuvre dans les luttes contre les réformes des retraites en France en 2003 et en 2010-2011, dans la lutte contre le CPE, toujours en France, en 2006, mais aussi de façon moins étendue en Grande-Bretagne (aéroport d’Heathrow, raffineries de Lindsay), aux Etats-Unis (Métro de New York), en Espagne (Vigo), en Egypte, à Dubaï, en Chine, etc. Les mouvements des Indignés et Occupy, surtout, reflètent une expression beaucoup plus générale et ambitieuse que des luttes se développant au sein d’une entreprise, par exemple. Qu’avons-nous vu, notamment, dans les mouvements des Indignés ? Des ouvriers de tous horizons, du précaire au cadre, simplement venus pour vivre une expérience collective et attendre d’elle une meilleure compréhension des enjeux de la période. Nous avons vu des personnes s’enthousiasmer à la seule idée de pouvoir à nouveau discuter librement avec d’autres. Nous avons vu des personnes discuter d’expériences alternatives et d’en poser les atouts et les limites. Nous avons vu des personnes refuser d’être les victimes impassibles d’une crise qu’ils n’ont pas provoquée et qu’ils refusent de payer. Nous avons vu des personnes mettre en place des assemblées spontanées, y adopter des formes d’expression favorisant la réflexion et la confrontation, limitant la perturbation et le sabotage des discussions. Enfin et surtout, le mouvement des Indignés a permis l’éclosion d’un sentiment internationaliste, la compréhension que, partout dans le monde, nous subissons la même crise et que nous devons lutter contre elle par-delà les frontières.
Certes, nous n’avons pas, ou peu, entendu parler explicitement de communisme, de révolution prolétarienne, de classe ouvrière et de bourgeoisie, de guerre civile, etc. Mais ce que ces mouvements ont montré, c’est avant tout l’exceptionnelle créativité de la classe ouvrière, sa capacité à s’organiser, issues de son caractère inaliénable de force sociale indépendante. La réappropriation consciente de ces caractéristiques est encore au bout d’un chemin long et tortueux, mais elle est indéniablement à l’œuvre. Elle s’accompagne forcément d’un processus de décantation, de reflux, de découragement partiel. Elle alimente cependant la réflexion des minorités qui se situent à l’avant-garde du combat de la classe ouvrière au niveau mondial, et dont le développement est visible, quantifiable, depuis plusieurs années.
C’est un processus sain qui contribue à la clarification des enjeux auxquels la classe ouvrière est confrontée aujourd’hui.
Finalement, même si les difficultés posées à la classe ouvrière sont énormes, rien ne permet dans la situation d’affirmer que les jeux sont faits, que la classe ouvrière n’aura pas la force de développer des luttes massives puis révolutionnaires. Bien au contraire, les expressions vivantes de la classe se multiplient et en étudiant ce qu’elles ont vraiment, non en apparence, où seule leur fragilité est évidente, mais en profondeur, alors apparaît le potentiel, la promesse d’avenir qu’elles contiennent. Leur caractère minoritaire, épars et sporadique n’est là que pour nous rappeler que les principales qualités des révolutionnaires sont la patience et la confiance en la classe ouvrière1 ! Cette patience et cette confiance s’appuie sur la compréhension de ce qu’est historiquement, la classe ouvrière : la première classe à la fois exploitée et révolutionnaire qui a pour mission d’émanciper toute l’humanité du joug de l’exploitation. Il s’agit là d’une vision matérialiste, historique, à long terme ; c’est cette vision qui nous a permis d’écrire en 2003, lorsque nous dressions le bilan de notre XVe congrès international : “Comme le disent Marx et Engels, il ne s’agit pas de considérer “ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier imagine momentanément comme but. Seul importe ce qu’il est et ce qu’il sera historiquement contraint de faire conformément à cet être” (la Sainte famille). Une telle vision nous montre notamment que, face aux coups très forts de la crise du capitalisme, qui se traduisent par des attaques de plus en plus féroces, la classe réagit et réagira nécessairement en développant son combat. Ce combat, à ses débuts, sera fait d’une série d’escarmouches, lesquelles annonceront un effort pour aller vers des luttes de plus en plus massives. C’est dans ce processus que la classe se comprendra à nouveau comme une classe distincte, ayant ses propres intérêts et tendra à retrouver son identité, aspect essentiel qui en retour stimulera sa lutte.”
GD / 25.10.2012
1) Lénine aurait ajouté l‘humour !
Rubrique:
La crise est-elle locale, épargne-t-elle des pays ou des formes de gouvernement? (cycle de discussion sur la crise II)
- 1193 reads
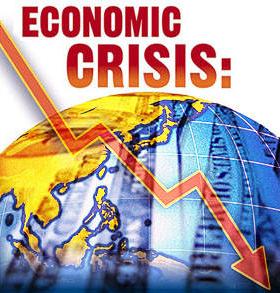 En avril et mai 2012, le CCI, avec une partie de ses sympathisants et autres intéressés venant d’horizons divers, a organisé un cycle de trois discussions sur la crise.
En avril et mai 2012, le CCI, avec une partie de ses sympathisants et autres intéressés venant d’horizons divers, a organisé un cycle de trois discussions sur la crise.
Dans la discussion l’accent a été mis sur la culture du débat et tous étaient invités à prendre part au débat. Nous soulignions que ce n’était pas une affaire d'experts car mêmes les plus grands experts économiques bourgeois n’avaient pas vu venir la crise. Et pourtant, ils dominent maintenant le débat dans les médias. A été posé le fait que pour nous il était grand temps que nous allions vers des arguments solides sur les causes des symptômes récurrents toujours plus graves de la crise et pourquoi cela ressemble de plus en plus à une crise du capitalisme en tant que système, aussi bien économiquement, socialement que politiquement.
La question se pose : réforme ou renversement révolutionnaire? Dans la contribution suivante, nous proposons la deuxième introduction de ce cycle. La discussion qui a suivi a été très animée et traversée d’une participation enthousiaste de tous les participants.
Un recueil de textes a été créé au service des participants. Il peut aussi être envoyé sur simple demande.
Qu’en est-il des pays “socialistes”, tels la Chine, la Corée du Nord ou Cuba ou les fameux pays BRICS
Tandis que les économies de l’ouest sont entraînés depuis la fin des années 1960 dan une spirale sans fin de secousses économiques, la bourgeoisie de droite comme de gauche nous assène régulièrement que ce n’est pas son système qui est en crise, puisqu’il y a des endroits dans le monde qui y échappent.
Ses représentants de gauche renvoient régulièrement dans la direction des pays “socialistes”, comme la Chine, Cuba, voire la Russie ... Ses représentants plus libéraux pointent plutôt du doigt vers les “miracles économiques” comme l’Argentine, les “Tigres asiatiques” dans les années 1980/ 90, mais plus récemment aussi vers l’Irlande, l’Islande, l’Espagne, et surtout aujourd’hui vers les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine) pour mettre en valeur le dynamisme du système.
Les pays “socialistes” vers lesquels on renvoyait il y a 25 ans étaient l’Union Soviétique et son bloc qui ont depuis lors disparu en 1989, après qu’ils se sont effondrés sous la pression de la crise économique et de la pression de la concurrence impérialiste du bloc américain (vu le poids des gigantesques « frais improductifs » dans le secteur militaire). La Corée du Nord ne tient que grâce au soutien chinois et sa population est régulièrement confrontée à la famine. Cuba enfin a déclaré récemment qu’elle voulait aussi ouvrir son économie aux capitaux étrangers sous un contrôle strict de l’Etat, comme d’autres pays (La Chine, le Vietnam) l’ont fait.
Les « données objectives »
Certaines « données objectives » sont indispensables pour donner une certaine crédibilité aux mensonges. Quelles sont celles que la propagande bourgeoise avance pour donner foi à son histoire ? Relevons les données concernant la Chine, dans la mesure où elles illustrent de la manière la plus marquée les faits également relevés dans le cas d’autres pays.
1. Durant les trente années de crise et de mondialisation (1980-2008), tandis que l’Europe voyait son Produit Intérieur Brut(1) augmenter de 1,7 fois, celui des USA de 2,2 fois, celui de l’ensemble de l’économie mondiale de 2,5 fois, l’Inde a vu le sien augmenter de 4 fois, les pays en développement d’Asie de 6 fois et la Chine de 10 fois.
2. La Chine est aujourd’hui l’atelier du monde et le secteur des services y a connu une croissance énorme. Le nombre d’emplois dans le secteur industriel, qui est de 170 millions, est de 40% supérieur à celui de l’ensemble des pays de l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques) qui en comptent 123 millions, alors qu’en 1952, la Chine était encore pour l’essentiel (84% de la population) un pays agraire.
3. La croissance économique annuelle est de 8 à 10% et la Chine ne produit plus seulement des produits de base pour l ‘exportation ou des produits d’assemblage dans ses ateliers à salaires base ; elle produit et exporte de plus en plus de produits à haute valeur ajoutée, comme de l’électronique et des matériaux de transport.
Par ailleurs, les salaires bas et les conditions de travail extrêmes sont utilisés par la bourgeoisie comme moyen de chantage à l’Ouest par rapport à l’emploi (menaces de délocalisation) ou aux salaires et aux conditions de travail.
Les données aujourd’hui
L’enthousiasme s’est quelque peu refroidi et les chiffres spectaculaires de croissance du PIB appartiennent tout doucement au passé. La deuxième économie mondiale connaît aujourd’hui deux contretemps inquiétants :
- La récession qui sévit dans les économies occidentales, le principal marché pour ses exploitations, a eu un impact direct sur ses chiffres de croissance, qui sont en baisse.
- Elle connait une forte inflation de plus de 10%, malgré l’intervention monétaire de l’Etat chinois depuis 2008, qui va de pair avec une énorme bulle financière spéculative (plus de 1700 milliards de dollars), qu’elle n’arrive pas à contrôler.
En réalité, la croissance de la Chine et d’autres pays constituant un « miracle économique » n’a été possible qu’à cause de la crise mondiale de l’économie capitaliste. En cas de stagnation ou de recul du taux de profit réel sur le plan mondial, le capital va à la recherche d’un environnement adéquat pour contrer cette tendance. Ces conditions, c’est des salaires bas et un contexte politique favorable. Cela explique aussi pourquoi la Chine s’est développée grâce aux exportations, mais dépend aussi de manière cruciale de celles-ci, malgré un développement relatif de son marché intérieur.
Mais c’est la même crise qui coince aujourd’hui la Chine entre le marteau et l’enclume, entre le marteau du marché extérieur qui se réduit et l’enclume du marché intérieur qu’elle doit soutenir, entre une inflation menaçante et des bulles spéculatives qui risquent d’exploser.
La situation n’est pas différente pour les autres « pays émergents », comme l’Inde et le Brésil par exemple. Pour eux aussi, la baisse des activités économiques à cause d’un marché mondial qui se réduit est une réalité actuelle (baisse de la croissance pour l’Inde de 9,3% à 7,2%, pour le Brésil de 7,5% à 3,7% de 2010 à 2011). DE même, ils sont confrontés à l’inflation et à des problèmes monétaires. Ainsi, une des premières décisions de la nouvelle présidente brésilienne D. Rousseff après sa victoire électorale a été d’imposer un ensemble de mesures d’austérité pour 30 milliards de dollars et d’augmenter le taux d’intérêt pour l’emprunt d’argent auprès de la banque centrale du Brésil à 12%.
Bref,
Aucun pays ne peut échapper aux lois du capitalisme mondial et à leurs conséquences. La crise économique qui continue à affaiblir le système capitaliste n’est pas une histoire sans fin, elle annonce la fin d’un système , mais aussi la nécessité de la lutte contre sa barbarie et pour un monde nouveau : le communisme.
(1) Le Prodit Intérieur Brut (PIB) peut être défini (cf. Wikipedia) comme l’ensemble de la valeur monétaire de tous les biens et services produits dans un pays donné (par l’Etat et le privé) pendant une période donnée (généralement un an). Généralement le PIB est fourni sur la base des prix du marché.
Rubrique:
En Israël et en Palestine, la population est otage de la guerre impérialiste
- 1686 reads
 Une fois de plus, les tirs de roquette israéliens ont submergé Gaza. En 2008, l’opération « plomb durci » avait provoqué presque 1500 morts, pour la plupart des civils, malgré les déclarations prétendant que seules les cibles terroristes faisaient l’objet de « frappes chirurgicales » . La Bande de Gaza est une des régions où la densité de population est la plus forte mais aussi une des plus pauvres du monde. Il est ainsi absolument impossible de distinguer les « dommages infligés aux terroristes » et ceux causés aux civils qui les entourent. Avec les armes sophistiquées dont Israël dispose, la majorité des dommages de la campagne militaire actuelle touche aussi les femmes, les enfants et les vieillards.
Une fois de plus, les tirs de roquette israéliens ont submergé Gaza. En 2008, l’opération « plomb durci » avait provoqué presque 1500 morts, pour la plupart des civils, malgré les déclarations prétendant que seules les cibles terroristes faisaient l’objet de « frappes chirurgicales » . La Bande de Gaza est une des régions où la densité de population est la plus forte mais aussi une des plus pauvres du monde. Il est ainsi absolument impossible de distinguer les « dommages infligés aux terroristes » et ceux causés aux civils qui les entourent. Avec les armes sophistiquées dont Israël dispose, la majorité des dommages de la campagne militaire actuelle touche aussi les femmes, les enfants et les vieillards.
Cela laisse les militaires à la tête de l’État israélien froid. Gaza a été une fois de plus punie, comme ce fut le cas lors du massacre précédent et à travers le blocus de l'économie, empêchant les efforts de reconstruction après les ravages de 2008 et laissant la population affamée.
Comparé au feu guerrier déclenché par l’Etat israéliens, les capacités militaires du Hamas et des autres groupes djihadistes radicaux de Gaza sont dérisoires. Grâce au chaos en Libye, le Hamas a cependant obtenu des missiles de longue portée plus efficace. Non seulement Ashdod au Sud (où trois résidents d’un bloc d’immeubles ont été tués par un missile venant de Gaza) mais Tel-Aviv et Jérusalem également sont à présent à leur portée. La menace de paralysie qui saisit Gaza commence aussi à se faire sentir dans les principales villes israéliennes.
Bref : les deux populations sont tenues en otage par les arsenaux militaires opposés et qui dominent Israël et la Palestine – avec une aide discrète de l’armée égyptienne qui patrouille aux frontières de Gaza pour empêcher les incursions ou les évasions indésirables. Les deux populations sont victimes d’une situation de guerre permanente – non seulement sous la forme de roquettes et de bombes, mais aussi en étant appelées à soutenir le poids grandissant d’une économie plombée par les besoins de la guerre. De plus, la crise économique mondiale contraint aujourd’hui la classe dominante israélienne et palestinienne à mettre en place de nouvelles mesures de restrictions du niveau de vie, à augmenter les prix des produits de première nécessité.
En Israël, l’an dernier, le prix déjà élevé des logements a été une des étincelles qui a allumé le mouvement de protestation qui a pris la forme de manifestations massives et d’assemblées – mouvement qui était directement inspiré des révoltes du monde arabe et qui avait pour mots d’ordre « Netanyahou, Assad, Moubarak sont tous les mêmes » et « Arabes et Juifs veulent des logements accessibles et décents».
Au cours de cette période courte mais stimulante, tout dans la société israélienne était ouvert à la critique et au débat – y compris le « problème palestinien », l’avenir des colonies et des territoires occupés. Une des plus grandes peurs des protestataires était que le gouvernement réponde à ce défi naissant à « l’unité » nationale en se lançant dans une nouvelle aventure militaire.
De même, l'été dernier, dans la région des territoires occupés de la Bande de Gaza, les augmentations du carburant et des prix de la nourriture ont provoqué une série de manifestations de colère, avec des blocages de route et des grèves. Les ouvriers du transport, de la santé et de l’éducation, des étudiants des universités et des écoles ainsi que des chômeurs, se sont retrouvés dans la rue face à la police de l’Autorité palestinienne en exigeant des hausses de salaires, du travail, des baisses de prix et la fin de la corruption. Il y a également eu des manifestations contre le coût de la vie dans le royaume de Jordanie.
Malgré les différences de niveau de vie entre les populations israélienne et palestinienne, en dépit du fait que cette dernière subit en plus l’oppression et l’humiliation militaire, les racines de ces deux révoltes sociales sont exactement les mêmes : l’impossibilité grandissante de vivre dans un système capitaliste profondément en crise .
Il y a eu beaucoup de spéculations sur les motifs de la dernière escalade militaire. Netanyahou essaie-t-il de faire monter le nationalisme pour améliorer ses chances de réélection ? Le Hamas a-t-il provoqué ses attaques à la roquette pour prouver son crédit militaire devant le défi que posent les bandes islamistes plus radicales ? Quel rôle sera appelé à jouer dans le conflit le nouveau régime en Égypte ? Comment ces événements vont-ils affecter la guerre civile en Syrie ?
Toutes ces questions, pertinentes en elles-mêmes, ne permettent pas de répondre au problème de fond qui les relie. La réalité, c'est qu'il s'agit d'une escalade guerrière de nature impérialiste, aux antipodes des intérêts et des besoins des populations israéliennes, palestiniennes et plus largement du Moyen-Orient.
Alors que les révoltes sociales des deux côtés permettent aux exploités de se battre pour leurs intérêts matériels contre les capitalistes et l’État qui les exploite, la guerre impérialiste crée une fausse unité entre les exploités et leurs exploiteurs, renforce les divisions des exploités des deux côtés. Lorsque les avions d’Israël bombardent Gaza, cela fait des nouvelles recrues pour le Hamas et les djihadistes pour lesquels tous les Israéliens sont l’ennemi. Lorsque les djihadistes tirent à coups de roquettes sur Ashdod ou Tel-Aviv, encore plus d’Israéliens se tournent vers la protection et les appels à la vengeance de « leur » État contre les « Arabes ». Les problèmes sociaux pressants qui existent derrière les révoltes sont écrasés sous une avalanche de haine et d’hystérie nationalistes.
Petites ou grandes, toutes les nations sont impérialistes ; petites ou grandes, toutes les fractions bourgeoises n’ont jamais aucun scrupule à utiliser la population comme chair à canon au nom des intérêts de la patrie. D’ailleurs, devant l’escalade actuelle de la violence à Gaza, quand les gouvernements « responsables » et démocratiques comme ceux des États-Unis et de la Grande-Bretagne appellent à « l’apaisement », au retour vers « le processus de paix », l’hypocrisie atteint des sommets. Car ce sont ces mêmes gouvernements qui font la guerre en Afghanistan, au Pakistan, en Irak. Les États-Unis sont aussi le principal soutien financier et militaire d’Israël. Les grandes puissances impérialistes n’ont aucune solution « pacifiques » pas plus que les États comme l’Iran qui arme le Hamas et le Hezbollah. Le réel espoir d’une paix mondiale ne se trouve pas chez « nos » dirigeants, mais dans la résistance des exploités, dans leur compréhension grandissante qu’ils ont les mêmes intérêts dans tous les pays, le même besoin de lutter et de s’unir contre un système qui ne peut rien offrir d’autre que la crise, la guerre et la destruction.
Amos (20 novembre 2012)