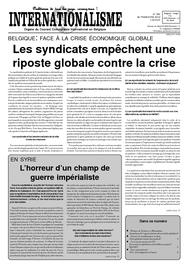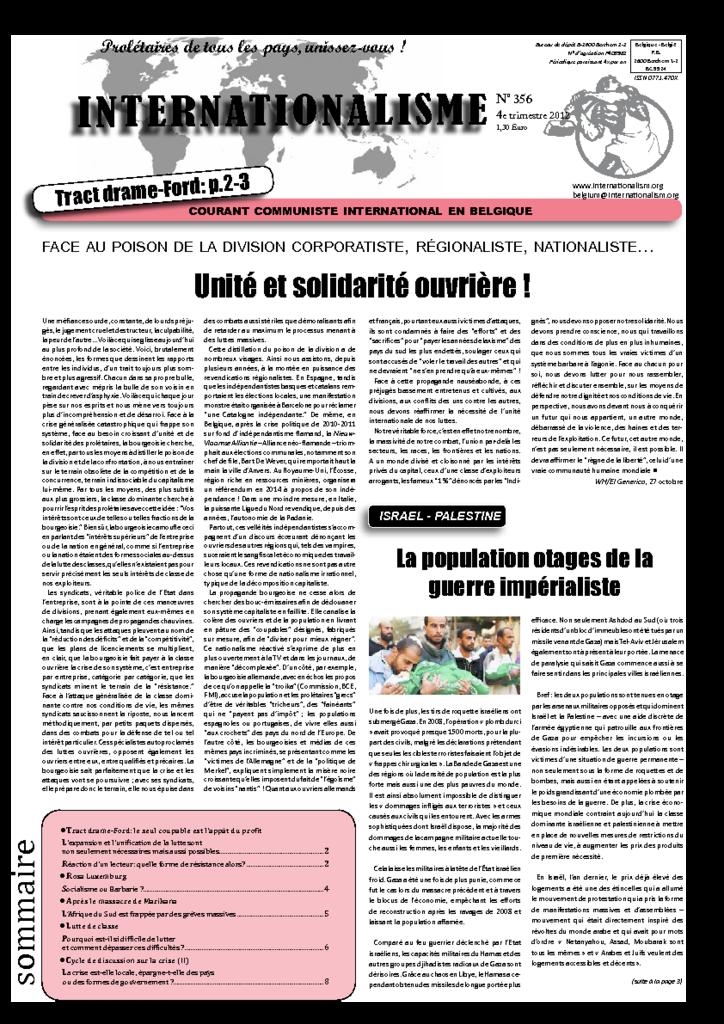Internationalisme - 2012
- 1394 reads
Internationalisme no 353 - 1er trimestre 2012
- 1137 reads
La crise, l'austérité et des actions syndicales stériles
- 1302 reads
Si récemment encore, la bourgeoisie présentait la situation économique belge comme une exception en Europe, plus personne aujourd'hui ne nie l'impact de la crise mondiale sur le pays. Rapports chiffrés et déclarations des "responsables" s'accumulent pour appeler la population à prendre conscience de la situation catastrophique et à se serrer la ceinture au nom d'une solidarité avec le système en place.
En Belgique aussi, l'avenir que nous promettent nos dirigeants s'annonce de plus en plus sombre.
Un système économique sans perspective
A la mi-février, 114 banques étaient menacées d'une dégradation de leur note par les agences de notation et la plupart des grandes banques belges ne répondent pas aux nouvelles normes de solvabilité, imposées par l'Europe d'ici à 2019. D'autre part, partout en Europe et dans le monde, des pays voient leur note de solvabilité dégradée par ces mêmes agences. La bourgeoisie dans tous les pays se rend compte de l'impasse, mais les recettes qu'elle avance ne présentent point de soulagement, comme en témoigne le récent sommet à Davos.
Faire marcher la planche à billets crée encore plus d'argent et provoque une flambée d'inflation. Stimuler de nouveaux emprunts et des déficits pour créer ainsi des débouchés artificiels n'offre pas plus d'issue dans un monde surendetté. Depuis des décennies le capitalisme vit, ou plutôt survit, à crédit. Augmenter les revenus de l'Etat par une augmentation des impôts, ce qui implique une restriction du pouvoir d'achat et une augmentation des coûts de production, ne fait qu'accentuer encore l'enfoncement dans la récession. Reste à réduire les dépenses des Etats et des entreprises. Pour l'Etat, cela passe par des coupes budgétaires afin de réduire le poids de l'endettement et élargir la marge de manSuvre pour les opérations de sauvetage des banques et des industries en difficulté. Pour les entreprises, le mot d'ordre est de baisser le coût de production des marchandises en espérant être moins chères que les concurrents et de garder suffisamment de profit sur leurs ventes. Dans la pratique, cela veut dire délocaliser davantage la production vers des régions aux coûts moindres, augmenter la productivité, supprimer la partie excédentaire de l'appareil productif, diminuer la charge salariale (directe et indirecte). Dans tous les cas, les salariés, ceux qui produisent les biens dans le monde entier, paient la note. Même si les économistes, tels P. De Grauwe, avertissent que cette politique entraîne à son tour un rétrécissement consécutif du pouvoir d'achat et donc du marché réel.
La bourgeoisie belge et son gouvernement, enfin sorti de couveuse, sont confrontés exactement aux mêmes dilemmes :
- elle doit gérer une dette de l'Etat dépassant en 2012 les 100% du PIB, plaçant la Belgique dans le même panier que la Grèce, le Portugal ou l'Italie ;
- elle fait face à une inflation croissante de 2,7% par rapport à 2011 ;
- il lui faut diminuer la vulnérabilité du financement public, fort exposé au secteur financier en difficulté, une situation comparable à l'Irlande. Après l'effondrement de la banque Fortis, c'est Dexia qui annonçait récemment une perte de 12 milliards d'euro en 2011. En outre, son incapacité à rembourser les garanties d'Etat cause un trou de centaines de millions d'euro dans le budget fédéral;
- elle veut mener une politique de relance, mais est dans le peloton de tête des 9 pays à croissance négative au sein de l'Union européenne, tandis que la récession entraine de plus en plus de restructurations d'entreprises ;
- elle est obligée de réduire un trou budgétaire qui s'accroît constamment, ce qui nécessite toujours plus de mesures d'austérité supplémentaires.
Et ses réponses ne sont pas différentes de ce qui se passe partout en Europe : réduction du nombre de fonctionnaires, allongement des carrières et réduction des allocations de retraite, augmentation de la flexibilité (emplois précaires, contrats limités) et de la productivité (moins d'absentéisme, d'interruptions de carrière payées, plus de maladies, de dépression, de stress&), pression accrue sur les chômeurs et réduction des allocations, recul des salaires, augmentation des taxes indirectes. En même temps, restructurations, délocalisations et licenciements se multiplient dans tous les secteurs : dans le port d'Anvers, la sidérurgie wallonne, Beckaert, Van Hool, Procter&Gamble, Crown-Cork, Nokia-Siemens, Alcatel-Lucent, ...
Voilà l'image d'un système sans autre perspective que l'imposition d'une misère et d'une violence toujours plus brutale et inhumaine.
Eviter la remise en cause du système
Dès l'annonce des mesures du gouvernement Di Rupo sur les pensions, le front uni des organisations syndicales a décrété "un programme ambitieux de manifestations et de grèves", culminant dans une journée de grève générale en janvier. Le président du parti socialiste flamand Tobback taxait immédiatement cette journée de grève générale de "bombe atomique" face à des mesures finalement fort modérées par rapport à ce qui était imposé dans d'autres pays européens. Dès ce moment, toute la campagne autour de cette grève générale a été orientée sur la division des travailleurs: débats autour du pour ou contre cette grève, sur la manière de mener la grève (qui mènerait à prendre en otage ceux qui ne veulent pas faire la grève et notre économie en difficulté). La classe est divisée par secteur et par usine face aux effets de la crise: secteurs publics opposés aux privés, secteur des transports en grève bloquant les secteurs non en grève, grandes entreprises opposées aux petites entreprises. Division entre générations : la grève générale est la grève des vieux qui veulent garder leurs avantages sur le plan du chômage et des retraites aux dépens des jeunes.
Derrière une unité de façade et des actions apparemment radicales, les syndicats organisent ainsi la division tous azimuts et évitent soigneusement toutes possibilités de mobilisation réelle et de discussions de fond sur la situation, brisant ainsi toute perspective de développement des luttes. Les mesures et les attaques sont vues comme des faits ponctuels, séparés. Aucun lien ou signe de solidarité n'apparaît entre conflits sociaux (entre Van Hool, Beckaert, Crown Cork ou les fonctionnaires par exemple). De fait, cette campagne enfermait la classe ouvrière dans une alternative pourrie: ou bien adhérer aux actions impuissantes syndicales, c.-à-d. la manifestation nationale en décembre et puis la grève générale d'un jour fin janvier, ou bien subir les mesures dans l'inertie : il y a le problème des sans-abris, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Les licenciements c'est grave, mais que faire? La vision par secteur et par usine amène à penser que certains secteurs ne sont plus assez performants, que leurs produits ne sont plus vendables et qu'il faut effectivement les rationaliser.
Mais l'effet le plus pervers de "l'échec" de la "bombe atomique" de la grève générale d'un jour, c'est l'avantage que la bourgeoisie belge en tire pour éviter toute réflexion sur une alternative au système en crise. Si la "bombe atomique" n'a pu arrêter les mesures, "arrêtons de rêver et essayons ensemble de gérer au mieux la crise du système": voilà en résumé le message que la bourgeoisie, avec l'aide de ses syndicats, veut faire passer. Son plus grand souci est d'écarter à tout prix une remise en cause du système en tant que tel et l'envisagement de son remplacement par un autre. L'indignation et la colère des exploités ne cesseront de croître face aux plans d'austérité successifs, en Belgique comme ailleurs et il faut éviter que cela aboutisse à la remise en cause du système. Les discours mystificateurs des gérants du système font dès lors appel au sens de responsabilité collectif et à la solidarité nationale pour "gérer ensemble" les problèmes. La lutte contre la fraude fiscale est mise en avant, comme si c'était une solution miracle, une punition pour les capitalistes (qui récupéreront évidemment les sommes transférées à l'Etat sur le dos des ouvriers et des consommateurs), cela permettra aussi de réprimer encore plus fort les "fraudeurs" sociaux, exclus de toute allocation et jetés dans la misère. On souligne le besoin écologique et démographique de consommer moins, pour mieux masquer derrière un voile idéologique l'austérité « librement » consentie. On tape sur les méchants banquiers qu'il faut soumettre à une régulation étatique. On répand des illusions sur une «Europe sociale» contre une "Europe des banquiers". On appelle aux bienfaits de la démocratie - "réelle", avec une participation plus grande de la population aux décisions de l'Etat capitaliste, pour imposer des mesures répartissant l'effort de façon "équitable". Faisons confiance à la démocratie bourgeoise, luttons pour une démocratisation du capitalisme, dans le cadre de la logique et des marges que nous offre le système actuel, donnons un visage humain aux mesures inhumaines innées à ce système économique. Comme si gérer "démocratiquement" une société d'exploitation signifie supprimer cette exploitation, comme si gérer "équitablement" la misère signifie la rendre supportable !
Que faire ?
Des changements de gouvernants ne changent rien aux attaques. Malgré ses divisions la bourgeoisie est unanime quant aux besoins des plans d'austérité drastiques. Seule la voie de la lutte, essentiellement dans la rue, classe contre classe, peut s'opposer effectivement aux attaques sur nos conditions de vie. Nous, prolétaires en activité ou au chômage, à la retraite ou en formation/études devons défendre partout les mêmes intérêts. Pour y parvenir nous devons prendre en main nous-mêmes nos luttes sous le contrôle des assemblés et surtout ne pas laisser la libre voie aux syndicats pour diviser la lutte et la dévoyer vers des voies sans issues, ne pas nous laisser démoraliser et réduire à l'impuissance. La bourgeoisie s'entredéchire face à sa crise, poussée par la concurrence et la recherche de profits. Cette situation par contre nous pousse, nous les exploités, à riposter de manière de plus en plus massive, unie et réellement solidaire !
Lac / 27.02.2012
Géographique:
- Belgique [2]
Rubrique:
De l'Iran à la Syrie, les manoeuvres impérialistes passent la vitesse supérieure
- 1226 reads
L’article suivant, a été écrit par un sympathisant de notre organisation, avant la récente attaque contre l’ambassade britannique en Iran.
Le 29 novembre, des étudiants ont fait irruption dans le bâtiment, causant des dommages aux bureaux de l’ambassade et à des véhicules. Dominick Chilcott, l’ambassadeur britannique, dans une interview à la BBC, a accusé le régime iranien d’être derrière ces attaques “spontanées”. En représailles, le Royaume-Uni a expulsé l’ambassade iranienne de Londres. Ces événements sont un nouvel épisode de la montée des tensions au Moyen-Orient entre l’Occident et l’Iran, autour de la question des armes nucléaires et de la Syrie. Le récent rapport de l’AIEA sur le nucléaire iranien a déclaré que l’Iran avait développé un programme nucléaire militaire. En réponse, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis ont introduit de nouvelles sanctions. Ces derniers jours, l’Iran a affirmé qu’il a abattu un drone américain qui tentait de recueillir des renseignements militaires. Par rapport à la Syrie, l’article mentionne la collaboration entre le régime d’Assad et la Garde Révolutionnaire Iranienne dans le massacre de la population syrienne. Dans le sac de l’ambassade britannique, on a également vu un coup de main de la part de la section jeunesse du Basij, téléguidé par El-Assad. De même que les rivalités inter-impérialistes, nous ne devons pas oublier les rivalités internes au sein des bourgeoisies nationales elles-mêmes. L’été dernier, il est devenu clair qu’un fossé croissant se creusait entre le président iranien Mahmoud Ahmadinejad et l’ayatollah Ali Khamenei. Malgré ses diatribes antisémites et sa rhétorique pleine de rodomontades, Ahmadinejad représente une fraction de la bourgeoisie iranienne qui veut maintenir quelques liens avec l’Occident. Khamenei avait arrêté quelques-uns des proches alliés d’Ahmadinejad au sein du gouvernement limogé. En réponse, Ahmadinejad a “fait grève” pendant 11 jours, refusant de s’acquitter de ses fonctions à la tête du gouverne-ment. Les récents événements autour de la mise à sac de l’ambassade britannique sont considérés par certains analystes des médias dans le cadre de cette querelle. Khamenei et ses partisans conservateurs sont considérés comme étant derrière les attaques pour saper la politique plus conciliante de M. Ahmadinejad et lui nuire en vue des prochaines élections de 2012.
Avec l’aggravation des tensions entre l’Iran et l’Occident, certains pronostiquent le déclenchement d’une troisième guerre mondiale. La question qui se pose dans la réalité est tout autre: est-ce que les ouvriers du Moyen-Orient et de l’Occident sont prêts à être mobilisés pour soutenir une autre guerre majeure ? Les travailleurs du monde entier supportent le fardeau de la crise sur leurs épaules et commencent à riposter. La guerre signifiera encore plus d’austérité, plus de violence contre les travailleurs, plus de désespoir. Les travailleurs n’ont aucun intérêt dans ces massacres impérialistes sanglants et ne sont pas prêts à y être embrigadés de façon massive.
CCI/28.01.2012
Courrier de lecteur
Après huit mois de manifestations, à l’origine parties d’un mouvement régional et international contre l’oppression, le chômage et la misère, impliquant Druzes, Sunnites, Chrétiens, Kurdes, hommes, femmes et enfants, les événements en Syrie continuent à prendre une sinistre allure. Si, par rapport à la défense de leurs propres intérêts et de leur stratégie, les États-Unis , la Grande-Bretagne et la France se méfient d’une attaque directe contre l’Iran, en revanche, ils peuvent contribuer à une agression sur son plus proche allié, le régime d’Assad en Syrie, dans la logique des rivalités inter impérialistes.
Les brutales forces de sécurité d’Assad, avec le soutien logistique de “300 à 400 Gardiens de la Révolution” d’Iran (The Guardian du 17 novembre 2011), ont massacré des milliers de personnes et donné naissance à la mensongère et hypocrite “préoccupation pour les civils” de la part des trois principales puissances du front anti-iranien nommées ci-dessus. Comme pour la Libye, les États-Unis sont le “leader par l’arrière”, cette fois en poussant la Ligue arabe (tout en l’amenant à se détacher des alliés algériens, irakiens et libanais d’Assad), dont la Syrie était une puissance majeure, à suspendre son adhésion et en la soumettant à des échéances ultérieures humiliantes. Au premier plan de cette préoccupation-bidon pour la vie et l’intégrité physique de la population se trouve le régime meurtrier d’Arabie Saoudite qui, il y a quelque temps, avait envoyé environ deux mille soldats de ses troupes d’élite, formées par la Grande-Bretagne, pour écraser les manifestations à Bahreïn ainsi que pour protéger les intérêts et les bases américaines et britanniques. Comble de l’hypocrisie, la confirmation de la suspension de la Syrie pour son “bain de sang” a été faite par la réunion de la Ligue Arabe dans la capitale marocaine, Rabat, le 16 novembre, alors même que les forces de sécurité de ce pays étaient en train d’attaquer et de réprimer des milliers de ses propres manifestants. Il y a des ramifications impérialistes plus larges par rapport à l’action de la Ligue Arabe, en ce sens que ses décisions ont été condamnées par la Russie, mais soutenues par la Chine.
Ce n’est pas seulement la Ligue Arabe que la Grande-Bretagne et les États-Unis poussent en avant dans cette voie, mais aussi la puissance régionale qu’est la Turquie, qui a également participé aux réunions à Rabat. Après avoir apparemment dissuadé l’État turc de mettre en place une sorte de zone tampon ou une “zone de non-survol” sur la frontière entre la Turquie et la Syrie, l’administration américaine a désormais changé d’avis. Ainsi, Ben Rhodes, conseiller d’Obama à la sécurité nationale, a dit la semaine dernière: “Nous saluons fortement l’attitude ferme que la Turquie a prise...” Le chef en exil des Frères Musulmans en Syrie a également déclaré aux journalistes la semaine dernière que l’action militaire turque (“pour protéger les civils”, bien sûr !) serait acceptable (The Guardian du 18 novembre 2011). La possibilité d’une zone tampon le long de la désormais fortement militarisée frontière turco-syrienne verrait la mystérieuse “Armée Syrienne Libre”, largement basée en Turquie (ainsi qu’au Liban) et, pour le moment, largement inférieure en nombre à l’armée syrienne, capable de se déplacer avec un armement beaucoup plus lourd. Au sein de cette convergence d’intérêts impérialistes se trouvent les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la majorité de la Ligue arabe, des gauchistes divers, les Frères musulmans et les djihadistes salafistes de Syrie qui ont également pris un plus grand rôle dans l’opposition à Assad. En outre, la déstabilisation de la région et la perspective d’une aggravation des problèmes sont bien visibles tant dans l’avertissement du président turc Gül adressé à la Syrie et précisant qu’elle aurait à payer pour semer le trouble dans le Sud-Est kurde de la Turquie que dans “la volonté renouvelée de Washington de fermer les yeux sur des incursions militaires turques contre les bases de guérilla kurdes dans le nord l’Irak.” (The Guardian du 18 novembre 2011). Toute cette instabilité, alimentée par ces puissances et ces intérêts, rend une intervention militaire de la Turquie dans le territoire syrien d’autant plus probable.
“L’Armée syrienne libre” a elle-même été impliquée dans des meurtres sectaires et des assassinats de civils en Syrie (Newsnight du 17 novembre 2011) et, comme elle opère à partir de ses refuges en dehors du pays, pour combattre et tuer les forces gouvernementales et la police, les représailles s’abattent sur la population civile. Le Conseil National Syrien, qui a fait son apparition le mois dernier, a également appelé à une intervention militaire contre les forces d'Assad, tandis qu’une autre force d’opposition, le Comité National de Coordination, a dénoncé cette position. Le ministre français des Affaires Étrangères, Alain Juppé, a déjà rencontré les forces d’opposition à Paris et, le secrétaire au Foreign Office, Hague, les a rencontrées à Londres le 21 novembre. Il n’a pas été précisé qui étaient ces “forces d’opposition”, ni si elles incluent l’Armée Syrienne Libre, le Conseil National Syrien, le Comité de Coordination Nationale, l’opposition kurde, les Frères Musulmans et les djihadistes salafistes. En outre, les coalitions de l’opposition incluent des staliniens, onze organisations kurdes, des structures tribales et claniques, plus un nombre ahurissant d’amorces d’intérêts contradictoires. En tout cas, Hague a appelé à un “front uni” et a nommé un “ambassadeur désigné” pour eux (BBC News du 21 novembre) !
Téhéran, l’objectif ultime
Depuis maintenant plusieurs années, les États-Unis , la Grande-Bretagne, Israël et l’Arabie Saoudite ont fait monter l’hystérie anti-iranienne et c’est ce qui se cache derrière leur soutien à l’opposition syrienne et leur “préoccupation pour les civils”. Cette campagne a été considérablement renforcée par un récent rapport de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) qui laissait entrevoir une “possible” dimension militaire aux ambitions nucléaires de l’Iran. Mais les États-Unis encerclent l’Iran depuis un certain temps. Sur la frontière orientale de l’Iran, il y a plus d’une centaine de milliers de soldats américains en Afghanistan, au Nord-Est, il y a le Turkménistan avec ses bases militaires américaines. Dans le sud de Bahreïn, ce sont des bases navales américaines et britanniques. De même au Qatar, il y a le siège du comman-dement avancé des forces américaines et la marionnette anti-iranienne, l’Arabie Saoudite. Le seul espace où l’Iran peut respirer se situe maintenant autour de sa frontière occidentale avec l’Irak et même ici, les forces spéciales américaines et britanniques ont fait un certain nombre d’incursions directes ou indirectes: en 2007, Bush a obtenu l’approbation du Congrès pour un programme de 400 millions de dollars afin de soutenir les groupes “ethniques”, tandis que, plus récemment, Seymour Hersch dans le Daily Telegraph et Brian Ross de la chaîne ABC ont eu des renseignements sur le groupe de gangsters terroristes iranien Joundallah. Le chef de ce groupe, Abdolmalek Rigi, capturé par les services secrets iraniens alors qu’il allait à Doha, affirme qu’il a rencontré la CIA à la base aérienne américaine de Manas au Kirghizistan pour apporter son aide dans des attaques terroristes en Iran. Au large des côtes de l’Iran, il y a une accumulation massive de navires de guerre américains dans le Golfe Persique et dans l’ensemble de la région du Golfe, les États-Unis vont renforcer leurs atouts au Koweït, au Bahreïn et dans les Émirats Arabes Unis. Des révélations récentes (The Guardian du 11 mars 2011) ont montré que le Royaume-Uni préparait des plans d’urgence pour la liaison avec les forces américaines en vue d’une possible attaque navale et aérienne contre des cibles en Iran. A seulement environ 1500 km de là se trouve Israël, qui possède l’arme nucléaire, qui a été impliqué dans l’attaque au virus Stuxnet qui a réussi à arrêter définitivement environ un cinquième des centres nucléaires d’Iran, et dans la mort de scientifiques iraniens, dont un expert nucléaire de premier plan, le major général Moghaddam, tué avec 16 autres dans une énorme explosion dans une base des Gardiens de la Révolution, près de Téhéran, il y a dix jours. Encore une fois, l’hypocrisie de la démocratie est presque incroyable: au mépris de leur rhétorique sur le désarmement, le British American Security Information Conseil affirme que les États-Unis dépenseront 700 milliards de dollars pour la modernisation de leur installations d’armes nucléaires au cours de la prochaine décennie et “d’autres pays, y compris la Chine, l’Inde, Israël, la France et le Pakistan devraient consacrer des sommes énormes pour les systèmes de missiles tactiques et stratégiques” (The Guardian du 31 octobre 2011). Le rapport poursuit en disant que “les armes nucléaires se voient assigner des rôles qui vont bien au-delà de la dissuasion... de rôles d’armes de guerre dans la planification militaire”. En ce qui concerne Israël, le rapport déclare: “... la dimension des têtes nucléaires des missiles de croisière de sa flotte sous-marine est augmentée et le pays semble être sur la bonne voie, grâce à son programme de lancement de fusée satellite, pour le développement futur d’un missile balistique intercontinental (ICBM)”.
La Grande-Bretagne, qui a contribué à fournir à Israël des armes nucléaires, n’est pas mentionnée dans ce rapport commandé par ce pays. Tout le monde sait qu’une attaque sur l’Iran serait de la folie, même le Mossad et le Shin Bet, les forces secrètes de sécurité externes et internes d’Israël. Utilisant leur canal habituel de fuite contre leurs politiciens, le journal koweïtien Al-Jarida, les deux agences ont exprimé leurs sérieux doutes et le patron du Mossad, qui a récemment pris sa retraite, Meir Dagan, a appelé la perspective d’une attaque sur l’Iran “la plus stupide des idées” dont il n’avait jamais entendu parler. Mais le fait qu’elles soient stupides ou irrationnelles ne les rend pas improbables: il suffit de regarder les guerres en Irak et l’interminable cauchemar, complètement irrationnel, en Afghanistan/Pakistan. La Syrie devient une autre étape manifeste dans la transformation de la guerre secrète contre l’Iran. Cela n’a rien à voir avec “la protection des civils”, mais s’identifie entièrement à l’avancée des objectifs de plus en plus irrationnels imposés par un système capitaliste en pleine décomposition.
Baboon /21.11.2012
Rubrique:
En Egypte et dans le Maghreb, quel avenir pour les luttes ?
- 1329 reads
La misère croissante, les morsures brutales de la crise économique, le besoin de liberté face au règne de la terreur, l’indignation face à la corruption, continuent d’agiter un peu partout les populations révoltées, notamment en Égypte (1).
Après les grandes mobilisations des mois de janvier et février dernier, les occupations devenues permanentes et quotidiennes sur la place Trahir du Caire se sont transformées en nouvelles démonstrations massives depuis le 18 novembre. Cette fois, c’est en grande partie l’armée et ses chefs qui sont dans le collimateur. Ces événements démontrent que si la colère demeure, c’est parce que, contrairement à ce que prétendaient la bourgeoisie et ses médias, il n’y a pas eu de “révolution” début 2011 mais un mouvement massif de contestation. Face à ce mouvement, la bourgeoisie est parvenue à imposer un simple changement de maître du pays : l’armée agit exactement comme Moubarak et rien n’a changé quant aux conditions d’exploitation et de répression pour la majorité de la population.
La bourgeoisie réprime dans le sang et calomnie les manifestants
Toutes les grandes villes égyptiennes ont de nouveau été touchées par la contagion du ras-le-bol vis-à-vis de la dégradation des conditions de vie et face à l’omniprésence de l’armée pour assurer le maintien de l’ordre. Le climat de confrontation est aussi présent à Alexandrie et Port-Saïd dans le Nord qu’au Caire ; des affrontements importants se sont produits au centre, à Suez et Qena, mais aussi dans le Sud à Assiout, Assouan, de même que vers l’Ouest à Marsa Matrouh. La répression a été brutale : 42 morts et environ 2.000 blessés ont été officiellement recensés ! L’armée n’hésite pas à violenter les foules avec ses forces antiémeutes. Elle multiplie ses tirs et lance des gaz lacrymogènes particulièrement nocifs. Certaines victimes décèdent après inhalation et suffocation. Une partie du sale travail de répression est “sous-traitée” : des tireurs spécialisés embauchés et embusqués utilisent ainsi en toute impunité des balles réelles. De jeunes manifestants s’effondrent dans la rue suite aux tirs meurtriers de ce genre de mercenaires. La police, pour compenser les limites imposées par l’usage de balles en caoutchouc, n’hésite pas à tirer systématiquement en plein visage. Une vidéo accablante circule et provoque la colère des manifestants qui peuvent entendre les propos d’un flic “arracheur d’yeux” félicitant son collègue : “Dans son œil ! C’est dans son œil ! Bravo, mon ami !” (L’express.fr) Les manifestants qui se retrouvent avec un œil en moins sont devenus légion! A cela, il faut ajouter les arrestations sauvages et les tortures. Bien souvent, les militaires sont accompagnés de miliciens, “les baltaguis”, utilisés en sous-main par le régime pour semer le désordre. Armés de barres de fer ou de gourdins, ils se chargent de mater plus ou moins discrètement les manifestants en essayant de les isoler. Ce sont eux par exemple qui, l’hiver dernier, avaient arraché et brûlé les tentes des opposants et qui avaient prêté main-forte pour de nombreuses arrestations (LeMonde.fr).
Contrairement à ce que les médias laissent entendre, les femmes, plus nombreuses aujourd’hui dans la foule des mécontents, sont souvent agressées sexuellement par les “forces de sécurité” et par exemple sont fréquemment contraintes à se soumettre à d’horribles humiliations comme les “examens de virginité”. Elles sont généralement considérées et davantage respectées par les manifestants, bien que l’agression de quelques journalistes occidentales ait été instrumentalisée (comme celle de Caroline Sinz, journaliste de France 3, où de jeunes “civils” seraient impliqués). Ainsi, “les débordements de Tahrir ne doivent pas faire oublier que, sur la place, un nouveau rapport s’établit entre hommes et femmes. Le simple fait que les deux sexes puissent dormir à proximité en plein air constitue une véritable nouveauté. Et les femmes se sont aussi saisies de cette liberté née sur la place. Elles sont parties prenantes de la lutte...” (Lepoint.fr).
On laisse aussi entendre insidieusement que les occupants de Tahrir sont des “voyous” parce qu’ils se “moquent des élections” et risquent de “mettre en péril la transition démocratique”. Ce sont ces mêmes médias qui, après avoir longtemps soutenu Moubarak et sa clique, ont soutenu et salué il y a quelques mois à peine le régime militaire qualifié de “libérateur”, aujourd’hui décrié, en profitant des illusions sur l’armée dans la population !
Le rôle clé de l’armée pour la bourgeoisie égyptienne
Même si, à l’heure actuelle, l’armée s’est fortement discréditée, c’est surtout le CSFA (Conseil suprême des forces armées) et son chef Hussein Tantaoui qui sont visés. Ce dernier, ministre de la Défense pendant dix ans sous Moubarak, perçu comme un clone du dictateur, génère un vœu unanime des foules qui se résume ainsi : “Dégage !”. Mais l’armée, soutien historique de Moubarak, est un solide rempart et continue de tenir l’ensemble des leviers de l’Etat. Elle n’a cessé de manœuvrer pour assurer sa position avec le soutien de toutes les grandes puissances, et en particulier des Etats-Unis, car l’Egypte est une pièce maîtresse de contrôle de la situation au Moyen-Orient et un facteur de stabilité essentiel dans la stratégie impérialiste dans la région, notamment dans le conflit israélo-palestinien. En vantant un “retour de l’armée dans les casernes”, la bourgeoisie parvient pour l’instant à mystifier sur l’essentiel. Non sans raisons, le quotidien Al Akhbar mettait en garde : “La plus dangereuse chose qui puisse arriver est la détérioration de la relation entre le peuple et l’armée.” En effet, l’armée n’a pas seulement un rôle politique majeur depuis l’arrivée au pouvoir de Nasser en 1954, constituant depuis un pilier essentiel et constant du pouvoir, elle détient aussi un rôle économique de premier plan, gérant directement nombre d’entreprises. En effet, depuis la défaite de la “guerre des 6 jours” contre Israël et surtout depuis les accords de Camp David en 1979, lorsque des dizaines de milliers de militaires ont été démobilisés, la bourgeoisie a encouragé et largement favorisé une partie de l’armée à se reconvertir en entrepreneurs, de crainte qu’elle ne représente une lourde charge supplémentaire sur le marché du travail où régnait déjà un chômage massif endémique. “Elle a commencé par la production de matériel pour ses propres besoins : armement, accessoires et habillement puis, avec le temps, s’est lancée dans différentes industries civiles et a investi dans des exploitations agricoles, exemptées de taxes et d’impôts” (Libération du 28.11.2011), investissant 30 % de la production et irriguant tous les rouages de la bourgeoisie égyptienne. Ainsi, “le CSFA peut être considéré comme le conseil d’administration d’un groupe industriel composé des sociétés possédées par l’institution [militaire] et gérées par des généraux à la retraite. Ces derniers sont aussi ultra-présents dans la haute administration : 21 des 29 gouvernorats du pays sont dirigés par d’anciens officiers de l’armée et de la sécurité”, selon Ibrahim al-Sahari, représentant du Centre des études socialistes du Caire, qui ajoute : “… on peut comprendre l’angoisse de l’armée face à l’insécurité et aux troubles sociaux qui se sont développés ces derniers mois. Il y a la crainte de la contagion des grèves à ses entreprises, où ses employés sont privés de tous droits sociaux et syndicaux tandis que toute protestation est considérée comme un crime de trahison” (cité par Libération du 28.11). La poigne de fer avec laquelle elle dirige le pays révèle donc son vrai visage répressif.
Une détermination courageuse dont les limites interpellent le prolétariat des pays centraux
Si la poursuite de la répression et la protestation des “comités de familles de blessés” ont précipité la cristallisation et la colère contre l’armée, ce n’est pas seulement pour réclamer l’abandon du pouvoir par les militaires, plus de démocratie et des élections, mais face à l’aggravation de la situation économique et la misère noire qui poussent les manifestants dans la rue aujourd’hui. Avec le chômage massif, nourrir sa famille devient simplement de plus en plus difficile. Et c’est cette dimension sociale qu’occul-tent précisément les médias. On ne peut que saluer le courage et la détermination des manifestants qui font face avec leurs mains nues aux violences de l’Etat. Seuls les trottoirs éventrés servent de munitions, les pavés et débris étant utilisés comme projectiles pour se défendre contre des flics armés jusqu’aux dents. Les manifestants témoignent d’une grande volonté de s’organiser dans un élan collectif et spontané pour les besoins de la lutte. Ils sont obligés de s’organiser et de développer avec ingéniosité une véritable logistique face à la répression. Ainsi, des hôpitaux de fortune s’improvisent un peu partout sur la grande place, des chaînes humaines laissent passer les ambulances. Des scooters servent à transporter les blessés vers les premiers soins ou les centres de secours. Mais la situation n’est plus la même qu’au moment de la chute de Moubarak où le prolétariat avait joué un rôle déterminant, où l’extension rapide de grèves massives et le rejet de l’encadrement syndical avaient largement contribué à pousser les chefs militaires, sous la pression des États-Unis, à chasser l’ancien président égyptien du pouvoir. La situation est bien différente pour la classe ouvrière aujourd’hui. Ainsi, dès le mois d’avril, une des premières mesures prises par l’armée a été de durcir la législation “contre les mouvements de grève susceptibles de perturber la production pour tout groupe ou secteur nuisant à l’économie nationale” et poussé les syndicats à les encadrer plus étroitement. Cette loi prévoit un an de prison ferme et une amende de 80.000 dollars (dans un pays où le salaire minimum est de 50 euros !) pour les grévistes ou pour ceux qui inciteraient à la grève.
Ainsi, le recours à la grève est resté ces derniers jours très localisé, se limitant à des mouvements purement économiques face à des fermetures d’usines ou face à des salaires impayés. La mobilisation ouvrière n’a plus été en mesure de rejouer un rôle important comme force autonome dans le mouvement.
Si la poursuite du mouvement rejette le pouvoir de l’armée, il n’en demeure pas moins affaibli et perméable à beaucoup d’illusions. D’abord, parce qu’il en appelle à un gouvernement “civil démocratique”, même si les Frères musulmans, voire les salafistes (les deux partis donnés en tête des législatives à travers le processus électoral), qui se savent aux portes d’un “gouvernement civil” de façade et sans réel pouvoir (dans la mesure où l’armée continuera d’assurer le réel pouvoir politique), se sont démarqués du mouvement de contestation et n’ont pas appelé aux rassemblements et aux manifestations pour négocier déjà leur avenir politique avec les militaires. Le mirage “d’élections libres”, les premières depuis plus de 60 ans, semble en mesure de saper momentanément la colère. Cependant, même si elles sont réelles, ces illusions démocra-tiques ne sont pas aussi fortes que ce que la bourgeoisie voudrait nous le faire croire : en Tunisie, où on nous a vanté 86 % de votants, il n’y a eu que 50 % des électeurs potentiels inscrits sur les listes électorale. Il en est de même au Maroc où le taux de participation aux élections était de 45 % et, en Egypte, où les chiffres sont restés plus flous (62 % des inscrits mais 17 millions de votants sur 40).
Aujourd’hui les fractions gauchistes de tous les pays crient : “Tahrir nous montre le chemin !” comme s’il s’agissait de recopier ce modèle de lutte en tout point, partout, de l’Europe aux Amériques. Il s’agit là d’un piège tendu aux travailleurs. Car tout n’est pas à reprendre de ces luttes. Le courage, la détermination, le slogan désormais célèbre “Nous n’avons plus peur !”, la volonté de se regrouper massivement sur les places pour vivre et lutter ensemble… constituent effectivement une source d’inspiration et d’espoirs inestimable. Mais il faut aussi, et peut être surtout, avoir conscience des limites de ce mouvement : les illusions démocratiques, nationalistes et religieuses, la faiblesse relative des travailleurs… Ces entraves sont liées au manque d’expérience révolutionnaire et historique de la classe ouvrière de cette région du monde. Les mouvements sociaux d’Egypte et de Tunisie ont apporté à la lutte interna-tionale des exploités le maximum de ce qui leur était possible pour l’heure. Ils atteignent aujourd’hui leurs limites objectives. C’est aujourd’hui au prolétariat le plus expérimenté, vivant sur les terres du cœur historique du capitalisme, en particulier d’Europe, de porter plus loin le glaive du combat contre ce système inhumain. La mobilisation des Indignés en Espagne appartient à cette dynamique internationale indispensable. Elle a commencé à ouvrir de nouvelles perspectives avec ces assemblées générales ouvertes et autonomes, avec ces débats dont ont parfois émergé des interventions clairement internationalistes et dénonçant la mascarade de la démocratie bourgeoise. Seul un tel développement de la lutte contre la misère et les plans d’austérités draconiens dans les pays du cœur du capitalisme peut ouvrir de nouvelles perspectives aux exploités, non seulement d’Egypte mais aussi dans le reste du monde. C’est la condition indispensable pour offrir un avenir à l’humanité !
WH / 01.12.2011
1) C’est évidemment le cas aussi en Syrie où le régime a tué plus de 4.000 personnes (dont plus de 300 enfants) en réprimant dans le sang les manifestations depuis le mois de mars. Mais nous reviendrons sur la situation dans ce pays dans un autre article à paraître ultérieurement.
Géographique:
- Afrique [3]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [4]
Rubrique:
Rapport sur la situation en Belgique
- 1292 reads
Depuis les élections fédérales de juin 2010, soit pendant près de 540 jours, les projecteurs des médias bourgeois ont été centrés sur les rebondissements de l’interminable feuilleton communautaire: négociations, compromis, ruptures, trahisons; le «citoyen» a été amené à osciller constamment entre l’espoir d’un compromis national et le désespoir de l’éclatement du pays. Aujourd’hui, après un accord péniblement conclu sur une réforme communautaire et un plan budgétaire pluriannuel, un nouveau gouvernement se met en place. Dans ce contexte, pour comprendre la situation à laquelle la classe ouvrière devra faire face dans les mois à venir, le rapport veut répondre aux questions suivantes:
-Où en est la Belgique sur le plan économique face à la dépression mondiale?
-Comment comprendre ces 18 mois de crise politique communautaire?
-quelles en sont les conséquences pour la population et plus spécifiquement pour la classe ouvrière?
-quelles sont les perspectives pour la lutte de classe?
1.La Belgique dans l’œil du cyclone de la crise
Depuis 2008, la bourgeoisie n’arrive pas à endiguer la tendance à la récession mondiale. Plus précisément depuis l’été 2011, on a vu s’accélérer la spirale infernale de la crise de la dette souveraine des États et la pression sur les obligations d’État en Europe, la crise de l’Euro, la pression sur les banques et la bourse, une économie mondiale glissant de plus en plus clairement vers une profonde récession mondiale, de nouvelles faillites d’établissements financiers, etc.
La Belgique est une des économies les plus ouvertes au monde mesurée en termes de la part du commerce extérieur au PIB. La Belgique est très dépendante de la situation qui prévaut chez ses principaux partenaires économiques, en particulier l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Le secteur manufacturier (21% du PIB), spécialisé dans les biens intermédiaires et semi-finis (produits métalliques et chimiques) et fortement exportateur, expose fortement le pays aux fluctuations de l’économie internationale.
1.1.Dans la première phase de la crise ouverte (en particulier de 2008 à 2010), la bourgeoisie a présenté la situation économique en Belgique comme une exception en Europe:
-Un État relativement épargné par la crise et l’austérité;
-Un État où le problème essentiel n’était pas la question économique ou sociale, mais les tensions communautaires entre Wallons «profiteurs» et flamands «arrogants».
Cette mystification sur la bonne santé de l’économie belge a été entretenue par l’ensemble des partis politiques et par le gouvernement «démissionnaire» Leterme qui affirme que «le gouvernement avait tout sous contrôle». Qu’est-ce qui a donné un semblant de crédibilité à cette illusion d’une «Belgique qui échappe à la crise» ? En réalité, trois facteurs l’ont favorisé:
-entre 2008 et 2011, l’économie belge a pu «parasiter» pendant quelques années sur la croissance allemande et sur les plans de relance de la France, dont elle est dépendante pour 65%;
-le gouvernement fédéral a continué à gérer les «affaires courantes», évitant la pression sur le budget des dépenses «partisanes» classiques imposées par les partis gouvernementaux pour satisfaire leur électorat traditionnel. D’autre part, les gouvernements régionaux, non démissionnaires, responsables de larges domaines de la gestion étatique, comme l’enseignement, la santé publique, l’écologie et la culture, ont donc pu pleinement prendre les mesures d’austérité qui s’imposent dans ces domaines;
-toute une série de mesures cadres pluriannuelles pour imposer l’austérité avaient déjà été prises dès 2009 par le gouvernement Van Rompuy dans le but de passer d’un déficit budgétaire de 6% en 2009 à 0% en 2015, soit 22 milliards d’Euros d’économies en 2011. Celles-ci ont continué à être appliquées.
1.2.Depuis l’automne 2011, le réveil est particulièrement dur et met en évidence une situation économique précaire, bien plus difficile que celle de ses voisins immédiats:
-les banques belges (Fortis, KBC, Dexia) ont fortement subi la crise bancaire et sont encore déstabilisées par des créances douteuses, en particulier envers certains pays de l’Europe de l’Est et du Sud, ce qui a mené récemment à la faillite de la banque franco-belge Dexia;
-si le PIB belge recule pour le moment moins que celui de ses principaux voisins, le déficit budgétaire 2010 est de 5,2%, au lieu des 4,8% prévu il y a un an (+1,3 milliards d’euros) et le soutien massif aux banques a fait regrimper la dette qui atteint actuellement les 96% du PIB;
-la Belgique subit de plus en plus la pression des marchés et les taux d’intérêts payés par l’État belge sur les marchés internationaux tendent à se rapprocher des niveaux des pays du groupe des PIIGS;
-l’agence de notation Standard en Poor’s (S&P) a dégradé le 25 novembre soir la note de la Belgique de AA+ à AA, avec une perspective négative.
Malgré la formation d’un nouveau gouvernement qui devrait faire disparaître «l’incertitude politique» tant décriée par les institutions bourgeoises internationales, la bourgeoisie belge sous-évalue encore la situation catastrophique dans laquelle ses contradictions internes l’ont placée. Ainsi, dans l’appréciation relative du poids de l’austérité imposée, les mesures prises depuis 2008 et celles inscrites dans le nouvel accord gouvernemental restent globalement au niveau de l’effort d’austérité imposé au début des années 1980 (dévaluation du franc) ou de celui pour intégrer l’euro à la fin des années 1990. Or, le tourbillon de la dette souveraine et de la dépression mondiale accentueront la pression pour imposer des attaques encore plus larges et globales sur les systèmes de calcul des salaires, des allocations de chômage et des retraites: «La Belgique est décrite comme le premier exemple de l’État-providence bismarckien congelé. La plupart des sources considère que la réforme en Belgique (s’il y en a) reste progressive et insuffisante pour faire face efficacement aux défis de la restructuration et au vieillissement de la population » (8ième Conférence ESPAnet 2010, « Politique sociale et la crise mondiale: conséquences et réponses»).
2.La pression de la décomposition met en évidence les faiblesses de la bourgeoisie belge
Pourquoi alors cette focalisation pendant près de 18 mois sur les tensions communautaires et linguistiques? La division au sein des diverses fractions nationales exprime avant tout la pression croissante de la crise historique du capitalisme sur la cohésion de l’ensemble des bourgeoisies de la planète. De l’opposition entre Républicains et démocrates aux USA sur la politique à mener pour faire face à la dépression jusqu’aux oppositions entre les régions riches d’Italie du Nord ou d’Espagne (la Catalogne) et les régions pauvres de ces pays, ou encore le surgissement dans des pays comme les Pays-Bas de fractions ouvertement anti-européennes, on peut constater que ces tensions s’exacerbent un peu partout. Dans ce cadre il est erroné de voir les tensions (sous-)nationalistes comme une «exception Belge»,
Ceci étant dit, il est également incontestable que la bourgeoisie belge est caractérisée par un manque évident d’homogénéité: depuis la création artificielle de l’État belge en 1830, des tensions existaient en son sein. Ces tensions entre fractions régionales se sont particulièrement développées depuis la première guerre mondiale et se sont exacerbées depuis l’ouverture de la crise historique à la fin des années 1960. Le dernier avatar de ces tensions a été la montée en puissance lors des dernières élections du parti autonomiste flamand NVA (Nieuwe Vlaamse Alliantie) qui a mené au blocage de la vie politique de la bourgeoisie pendant 18 mois. Pendant des mois, les diverses fractions se sont déchirées comme des loups enragés afin de se positionner le mieux possible pour assurer leur survie dans la lutte sans merci qui est engagée sur le marché mondial, perdant même de vue à certains moments que cette lutte fratricide risquait de les mener tous à leur perte.
Si la bourgeoisie belge est effectivement divisée en diverses fractions nationales et régionales qui s’entre-déchirent, lorsque leurs intérêts vitaux sont menacés, celles-ci, repoussent ces conflits au second plan et s’unissent afin de défendre leurs intérêts communs. Il serait naïf de croire que, pour la défense de leurs intérêts communs fondamentaux - le maintien de leurs profits, de leurs parts de marché menacées par la concurrence exacerbée - ces fractions bourgeoises ne se coalisent pas pour imposer leur loi aux exploités.
3.La bourgeoisie exploite ses faiblesses dans un battage nationaliste intense contre la classe ouvrière
L’histoire de ces 50 dernières années nous apprend que la bourgeoisie belge utilise habilement ses divisions internes contre la classe ouvrière dans un double objectif:
3.1.Freiner la prise de conscience des attaques et du rôle central de l’état dans celles-ci.
Face au risque de défaut de paiement, tous les états européens lancé de gigantesques plans d’austérité pour tenter d’assainir leurs finances publiques et leur système bancaire. Ces plans dévoilent toutefois de plus en plus le rôle de l’État, ce pseudo ‘État social’, dans l’imposition de l’austérité capitaliste, ce qui risque d’orienter la colère ouvrière contre celui-ci. Loin d’être un arbitre au-dessus de la mêlée, garant de la justice sociale, «l’État démocratique» se manifeste ici pour ce qu’il est en réalité: l’instrument de la classe exploiteuse pour imposer des conditions de plus en plus impitoyables à la classe ouvrière.
Cependant, les diverses bourgeoisies nationales utilisent tous les moyens de mystification à leur disposition pour occulter le plus longtemps possible cette réalité aux yeux de la classe ouvrière et pour aux contraire embobiner cette dernière dans les illusions démocratiques. Dans ce contexte, la bourgeoisie belge et ses diverses fractions, attisent précisément les oppositions entre régions et communautés afin de noyer les attaques et le rôle central qu’y occupe «l’État démocratique» dans un imbroglio institutionnel.
De manière révélatrice, les années 1970, les années de la première manifestation de la crise historique du capitalisme, ont aussi été en Belgique le début d’une vaste série de mesures de restructuration institutionnelle, visant à régionaliser l’État et à diluer les responsabilités à divers niveaux de pouvoir communautaire, régional ou communal. Une flopée de gouvernements fédéral, communautaires et régionaux (sept au total) ont vu le jour, des regroupements de communes et de régions urbaines ont été mis en place, en plus de la privatisation partielle ou totale de certaines entreprises publiques (Poste, chemin de fer, téléphones, gaz et électricité, secteur des soins de santé, ...). Ceci a entraîné un partage ubuesque des compétences, une redistribution des fonctionnaires du secteur public sur les différents niveaux de pouvoir et la création de toutes sortes de statuts mixtes. Dans le concret, ces «réformes de l’État» ont abouti aux résultats suivants:
-accroître l’efficacité de l’exploitation: la «responsabilisation» des entités autonomes organise de fait la concurrence interne entre régions. Les travailleurs flamands sont appelés à être plus «performants» que leurs collègues wallons et vice versa, les régions, les communes, sont en concurrence pour gérer plus rationnellement les budgets sociaux ou mieux implémenter la flexibilité de leurs fonctionnaires, etc.
-accélérer les restructurations et les attaques contre les statuts du personnel, les salaires et les conditions de travail des fonctionnaires sous le couvert de réorganisation des structures de l’État;
-diluer l’ampleur des attaques, en les fragmentant sur divers niveaux de pouvoir ou en responsabilisant divers niveaux de pouvoir pour divers types de mesures.
3.2.Paralyser la capacité de réaction et d’extension des luttes de la classe ouvrière.
Lorsque les travailleurs s’insurgent contre les attaques dont ils sont victimes, la bourgeoisie -à travers en particulier de ses syndicats- se sert de l’intensification du battage (sous-)nationaliste et régionaliste pour entraver toute réaction unitaire des travailleurs et toute extension de leurs luttes face à l’agression subie. Cela aussi c’est une constante du rapport de force entre les classes en Belgique.
Depuis les années 1960 en particulier, la bourgeoisie utilise la mystification régionaliste pour freiner la prise de conscience au sein de la classe ouvrière de la nécessité d’une réaction unitaire et de l’extension de ses luttes face aux attaques. Lors de la grève générale de 1960, le syndicalisme radical, avec à sa tête André Renard, détourne la combativité des ouvriers des grands bassins industriels de Liège et du Hainaut vers le sous-nationalisme wallon, faisant croire qu’un sous-état wallon sous la direction du PS pourrait s’opposer au capital national et sauver du déclin les industries de la région. Les travailleurs paieront cher cette mystification, car ce sont ces autorités régionales qui liquideront progressivement l’industrie minière et sidérurgique wallonne dans les années 1970 et 1980. Depuis la fin des années ’80, la Flandre est confrontée aux mêmes problèmes avec le bassin minier limbourgeois, les chantiers navals (Boel Tamise) et l’automobile (Renault et dernièrement Opel). Une fois de plus, c’est la même mystification qui est utilisée: «Ce que nous faisons-nous mêmes, nous le faisons mieux» est le slogan des sous-nationalistes flamands. De fait, la liquidation des mines et des chantiers navals a été rondement menée et récemment, ce sont les travailleurs d’Opel qui se sont fait rouler dans la farine par les promesses du gouvernement flamand et les campagnes sur le «combat de la Flandre pour sauver Opel».
Une fois de plus aujourd’hui, alors que les travailleurs commencent à engager la riposte face aux attaques, la régionalisation des différents niveaux de pouvoir et le battage (sous-)nationaliste sont exploités par la bourgeoisie et ses organisations syndicales, d’abord pour diviser, isoler et enfermer les mouvements de lutte dans des carcans qui n’offrent aucune perspective d’avancée pour la classe ouvrière. Ainsi, lorsque les fonctionnaires subiront des attaques contre leurs salaires et les conditions de travail, ils seront amenés à manifester, chaque groupe devant son pouvoir de tutelle (fédéral, communautaire, régional, provincial, communal, ...). D’autre part, les syndicats n’hésitent pas à entraîner la lutte ouvrière vers le terrain pourri de la division régionale, voire des intérêts nationalistes. Ainsi, les enseignants flamands et francophones sont appelés à lutter pour des revendications différentes dans chacune des régions. Et récemment encore, les organisations syndicales appelaient les travailleurs à manifester pour une sécurité sociale belge unitaire, contre les velléités des nationalistes flamands de la régionaliser.
4.Au-delà du programme d’austérité du nouveau gouvernement, des attaques d’ampleur se préparent
4.1.Le programme du nouveau gouvernement Di Ruppo contient des attaques contre la classe ouvrière sur deux plans.
Les mesures budgétaires pluriannuelles impliquent des mesures d’attaques globales contre l’ensemble de la classe ouvrière, en sus des mesures déjà prises dans le cadre du plan pluriannuel 2010-2015 de Van Rompuy, justifiées à partir de la défense de la crédibilité de l’État belge face aux marchés:
-réduction des allocations pour les chômeurs de longue durée, y compris chefs de famille, à partir de la 2ième année de chômage;
-la limitation de l’accès à la retraite anticipée, qui passe progressivement de 60 à 62 ans;
-suppression de la prise en compte des périodes de chômage, de retraite anticipée et de crédit d’heures pour la retraite;
-limitation du droit au crédit d’heures et à la pause carrière;
-réduction budgétaires dans les soins de santé, menaçant la qualité des soins aux patients. “
Les mesures de réforme de l’État impliquent une exacerbation de la concurrence entre les régions. Elles mèneront à l’exploitation des tensions communautaires sur le plan économique à travers de l’organisation d’une concurrence interne entre régions: fiscalité différenciée entre régions pour «attirer les entreprises», financement des régions partiellement lié à l’atteinte de critères de rentabilité et d’efficacité (exemple le budget pour les allocations chômage sera lié à l’efficacité de la politique de «mise au travail» des chômeurs). La concurrence et la course à la performance entre les régions impliqueront une pression accrue sur les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière.
4.2.Quelles sont les mesures prises dans les autres pays d’Europe? Allemagne, 82 milliards d’euros; Grande-Bretagne, 7,2 milliards d’euro en 2010; Italie, 13 milliards d’euro en 2011 et depuis lors, deux autres plans d’austérité; Espagne, 15 milliards d’euro extra. Ces attaques impressionnantes impliquent des suppressions massives d’emplois dans le secteur public, la réduction des salaires (par exemple -5% pour les fonctionnaires en Espagne), le recul de l’âge de la retraite et la baisse des pensions (baisse des allocations de certains fonds de pension en Hollande par exemple) ou des allocations de soins de santé. Bref, elles signifient une baisse conséquente du niveau de vie de la classe ouvrière, comparable à celle qu’elle a connue dans les années 1930.
Dans ce contexte Européen et dans le contexte de l’accroissement de la pression sur les banques et sur la dette de l’État, des mesures supplémentaires s’imposeront pour «restaurer la crédibilité de la Belgique». Dans les coulisses, les «think tanks économiques» de la bourgeoisie esquissent déjà les grandes lignes d’un redoutable plan d’austérité, basé sur une double orientation: une éduction drastique des dépenses budgétaires de l’État pour infléchir l’évolution de la detteet une éduction importante des salaires (évaluée globalement à 10% pour restaurer la position concurrentielle de la Belgique vis-à-vis de l’Allemagne (salaires +23,4% en 10 ans en Belgique, contre +8,8% en Allemagne) et pour reconquérir des parts de marché ou contrer la chute des investissements étrangers (-70%, faisant passer la Belgique de la 2e à la 10e place des pays attirant des investissements étrangers (De Morgen, 23.07.10).
5.Contexte et perspectives pour les luttes ouvrières
Le battage communautaire intense de la bourgeoisie, qui se développe en réalité de manière quasi ininterrompue depuis l’été 2008, a caché aux travailleurs la réalité de la crise et des enjeux et a créé des conditions difficiles pour leur mobilisation, pour leur lutte et surtout pour l’extension de celles-ci. Ceci explique pourquoi les réactions ouvrières sont jusqu’à présent moins marquées que dans les pays voisins comme la France ou l’Allemagne. Il serait par ailleurs illusoire de penser que la bourgeoisie s’attachera à dissiper le brouillard dans la période actuelle. Bien au contraire, elle tend à exploiter un certain soulagement au sein de la classe ouvrière du fait que les tensions au niveau de la gestion de l’État belge semblent réglées pour jouer à présent la carte de la nécessaire «unité nationale» face aux marchés en appelant à une «solidarité nationale» pour «défendre notre pays» contre les attaques d’un «monde extérieur agressif» et pour «corriger les erreurs du passé». Pour la classe ouvrière en Belgique, la situation a été difficile ces dernières années et cela va encore rester difficile pendant une certaine période.
En même temps, l’intensité du battage et la prudence de Sioux avec laquelle la bourgeoisie avance ses mesures est aussi révélateur de la peur de la bourgeoisie face à une classe ouvrière qui a montré dans les années ’70 et ’80 sa combativité. Mais la pression de la crise la contraint de plus en plus à rendre ses attaques plus directes. Par ailleurs, dès l’annonce des mesures du nouveau gouvernement, le front uni des organisations syndicales annoncent un programme impressionnant de mobilisations, de manifestations et de grèves afin d’occuper solidement le terrain social. Tous les éléments avancés dans ce rapport démontrent bien que le décalage avec la situation sociale dans les autres pays d’Europe est plus une question de perception et de prise de conscience qu’une réalité objective: la réalité économique et sociale en Belgique est tout à fait parallèle à celles de pays comme la France ou les Pays-Bas.
Aussi, la situation sociale peut évoluer très vite, comme l’ont illustré le «printemps arabe» et les événements en Espagne ou en Angleterre. Même si une période d’hésitations et de désamorçage de la combativité dans une multitude d’actions syndicales semble probable dans un premier temps, une dynamique de mûrissement de la combativité et de la réflexion dans des minorités est dès à présent perceptible:
-multiplications de débrayages: sidérurgistes à Liège; infirmières à Anvers et Bruxelles; grève dans les ateliers SNCB à Bruxelles; arrêts de travail dans les transports publics;
-apparition de minorités discutant de la situation et des perspectives à mettre en avant, dans différentes manifs ou assemblées dans le cadre des mouvements des «Indignés» ou «Occupy» à plusieurs endroits.
Ces derniers mouvements qui se développent depuis des mois révèlent une sincère volonté de vivre et de lutter ensemble, collectivement, de tourner le dos à l’individualisme du capitalisme pour occuper ensemble un lieu et y discuter; ces mouvements, aussi limités qu’ils soient encore, révèlent la volonté de débattre collectivement et de réfléchir collectivement. Le fait que ces mouvements se développent au niveau international leur donne leur importance décisive. Ils indiquent que la classe ouvrière en Belgique peut très vite retrouver le chemin de la lutte. Et une fois en mouvement, elle peut très bien réagir avec encore beaucoup plus de combativité et de détermination qu’ailleurs. Sur ce plan là aussi, contrairement aux campagnes de la bourgeoisie, la Belgique n’est pas une exception.
Internationalisme/11.2011
Vie du CCI:
Géographique:
- Belgique [2]
Rubrique:
Cycle de discussions : le capitalisme a fait faillite, pourquoi? Et alors, quoi d'autre?
- 1299 reads
À l’heure actuelle, dans toute la société, la crise économique est au cœur des préoccupations. Tout le monde se fait des soucis sur son avenir, celui de ses enfants, ses parents âgés, ses voisins, amis, collègues, ... existe t’il encore un avenir décent pour nous tous ou allons-nous tout droit dans la plus grande pauvreté et la précarité? Pour ne pas parler de la répression croissante par l’État et de la tendance toujours montante dans la société du chacun pour soi, du sentiment d’insécurité.
Comme le formulait jadis Marx : “il ne faut pas voir dans la misère que la misère”. La crise économique n’est pas une fatalité. Elle n’est pas une loi naturelle. Ce n’est pas une destinée qui nous est réservée. Elle est le résultat d’un système qui est empêtré dans ses propres contradictions, comme celles entre les forces productives et les rapports de production, en d’autres termes entre le caractère social du processus de production et la réappropriation privée de la production et de ses produits par les propriétaires capitalistes.
La crise économique reste encore toujours l’"alliée" de la classe ouvrière. Partout, elle pousse à s’engager dans la lutte contre les mesures d’austérité et ouvre de nouvelles perspectives pour le renforcement de la lutte pour une autre société. Elle pousse la lutte de classe à un tel point que la question d’une autre forme de société est posée. Elle pousse les contradictions à une telle extrême que la société actuelle devient porteuse d’une nouvelle société qui correspond et est en concordance avec le caractère essentiellement social du processus de production: un système qui existe pour le respect des besoins humains et pas pour l’appât du gain.
Nous organisons dans les prochains mois un CYCLE DE DISCUSSION
où nous voulons approfondir ce thème sous différents angles.
Qui désire y participer ou y prendre part, peut nous CONTACTER
via notre adresse e-mail ou l’adresse de la boîte postale.
Vie du CCI:
Rubrique:
Internationalisme no 354 - 2e trimestre 2012
- 1155 reads
Face à la crise économique globale, les syndicats empêchent une riposte globale contre la crise
- 1638 reads
La manifestation syndicale du 31 janvier dernier a déclenché une discussion intense dans les médias, les entreprises et un large milieu politique sur l'utilité de la grève générale syndicale d'un jour et de manière plus globale sur l'efficacité des actions syndicales, voire le rôle des syndicats dans la période actuelle.
Cette discussion est une question importante et pose des enjeux cruciaux. Depuis maintenant près de 5 ans, crises immobilières, crises boursières, crises monétaires, crises bancaires et crises de la dette souveraine des États se succèdent et se conjuguent, attestant de l'impasse dans laquelle se trouve le système capitaliste mondial. Pour les conditions de vie des travailleurs, les conséquences ne se sont pas fait attendre: attaques générales sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail, les retraites, ... En Belgique plus particulièrement, licenciements (Beckaert, Arcelor-Mittal), blocage des salaires, allongement des carrières, suppression des pauses carrières constituent l'avant-goût d'attaques plus pénibles encore qui s'annoncent. D'Espagne aux États-Unis, de l'Égypte à la Grèce, se pose la question comment faire face à de telles agressions, comment organiser la lutte, quelle perspective avancer. C'était déjà une des questions centrales débattue dans les mouvements des «Indignés» ou de «Occupy Wall Street». Il est donc pleinement légitime que cette question soit posée en Belgique également.
Les syndicats et les besoins actuels de la lutte contre les mesures
Face aux mesures générales et internationales, ces mouvements qui se sont développés pendant toute l'année 2011 ont mis en avant trois besoins impérieux pour la lutte: le besoin d'extension et d'unification des mouvements, l'importance du développement de la solidarité entre salariés, chômeurs, jeunes et la nécessité d'engager au sein du mouvement une ample discussion sur une alternative au système actuel en faillite. Les syndicats répondent-ils à ces besoins pour la lutte?
a) Les syndicats favorisent-ils l'extension et l'unifica-tion des luttes?
La spécialité des syndicats, ce sont les actions par usine, par secteur; lorsque la tension sociale monte, ils prônent des actions «symboliques» visant surtout à «lâcher de la vapeur» et à désamorcer la colère et la combativité. Lorsqu'ils organisent une grève générale, ils prennent bien soin de la limiter à un jour, ou à organiser des actions « tournantes» par région ou secteur. Ainsi, lors de la dernière grève générale du 31.1, toute la campagne autour de cette grève générale a été orientée sur la division des travailleurs: débats autour du pour ou contre cette grève, sur la manière de mener la grève (qui mènerait à prendre en otage ceux qui ne veulent pas faire la grève et notre économie en difficulté). La classe est divisée par secteur et par usine face aux effets de la crise: secteurs publics opposés aux privés, secteur des transports en grève bloquant les secteurs non en grève, grandes entreprises opposées aux petites entreprises. Division entre générations: la grève générale est la grève des vieux qui veulent garder leurs avantages sur le plan du chômage et des retraites aux dépens des jeunes.
Et ne parlons pas de perspectives sérieuses au niveau européen ou mondial, alors que la crise et les attaques le sont de manière évidente. Tout dans leurs actions est fait pour isoler et diviser tous azimuts les travailleurs, pour instiller un sentiment d'impuissance face au tsunami d'attaques qui leur tombe dessus.
b) Les syndicats favorisent-ils l'expression de la soli-darité entre retraités, salariés, chômeurs et jeunes?
Bien au contraire, les actions autour de la grève générale sur le recul de l'âge de la retraite a montré combien leurs actions stimulaient les rivalités entre «jeunes» et «vieux», qui se reprochaient mutuellement un «manque de solidarité». D'ailleurs, dans la logique syndicale, la solidarité se réduit aux sacrifices que les «secteurs mieux nantis «doivent faire pour les «secteurs plus faible», en d'autre mots une répartition plus équitable de la misère parmi les travailleurs.
c) Les syndicats favorisent-ils la discussion sur une alternative au système en faillite?
Les syndicats raisonnent uniquement dans le cadre de la «concertation» au sein du système capitaliste. Et lorsque le «gâteau se réduit», la discussion ne peut porter que sur une manière «équitable» de répartir l'austérité, ce qui signifie aussi «favorable» aux intérêts nationaux. Ils font tout pour éviter la remise en cause du système: en février, les syndicats exultaient: le gouvernement accepte de négocier et finit par assouplir certaines mesures secondaires: victoire sur toute la ligne pour la bourgeoisie grâce à ses syndicats: l'essentiel des mesures passe et l'impression est donnée que la lutte syndicale paie, ce qui permet d'éviter de contrer la réflexion sur la remise en cause du système. Si la «bombe atomique» n'a pu arrêter les mesures, «arrêtons de rêver et essayons ensemble de gérer au mieux la crise du système»: voilà en résumé le message que la bourgeoisie, avec l'aide de ses syndicats, veut faire passer. Comme si gérer «démocratiquement» une société d'exploitation signifie supprimer cette exploitation, comme si gérer «équitablement» la misère signifie la rendre supportable!
Les syndicats ne répondent donc aucunement aux besoins de la lutte, en Belgique comme ailleurs d'ailleurs. Bien au contraire. Leur action vise à neutraliser la colère et à désamorcer la combativité. La division et la démoralisation sont un objectif des syndicats pour dissuader à tout prix les ouvriers d'entrer massivement en lutte. Dans la réalité, la méfiance des travailleurs envers eux, leurs promesses creuses et leurs magouilles continuelles, s'accroît d'ailleurs fortement, comme l'a encore montré dernièrement la grève spontanée du personnel des transports publics bruxellois suite à une agression mortelle contre un de leurs collègues de celui-ci. Au delà de cette simple indignation face au sabotage des luttes par les syndicats, beaucoup de prolétaires se posent les mêmes questions plus fondamentales: est-ce que tout cela n'est qu'un malheureux hasard?
Existe-t-il de «bons«et de «mauvais« syndicats?
NON! Tous les syndicats, y compris les plus «radicaux» et «combatifs», ne défendent pas les intérêts des travailleurs mais ceux de la bourgeoisie. Leur fonction consiste à saboter les luttes en faisant semblant d'être du côté des exploités. Toutes les mobilisations derrière les syndicats ne mènent qu'à la défaite et à la démoralisation. L'apparente division entre les syndicats «mous» et les syndicats plus à gauche, «plus radicaux», ne sert qu'à diviser la classe ouvrière, à mieux couvrir tout le terrain de la lutte.
S'il n'y a pas de «bons» et de «mauvais» syndicats, c'est parce que le syndicalisme n'est plus adapté aux besoins de la lutte de classe aujourd'hui. Le syndicalisme est devenu une arme de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. Les syndicats sont devenus (depuis que le capitalisme a sonné la fin de sa période d'ascendance internationale avec l’éclat de la Première Guerre mondiale) des organes de l'État capitaliste dans les rangs ouvriers. Depuis près d'un siècle, leur fonction consiste à diriger les luttes pour empêcher la classe ouvrière de prendre elle-même la direction de ses combats, pour l'empêcher de développer sa solidarité et son unité lui permettant de se battre efficacement contre le capitalisme. Croire qu'il existe de «bons» syndicats est une pure illusion. La preuve: l'agitation des syndicats les plus «radicaux» n'a pas empêché la bourgeoisie de renforcer ses attaques et de faire passer tous ses plans d'austérité. Au contraire! La division entre les syndicats ne leur sert qu'à oeuvrer pour diviser la classe ouvrière et la conduire à la défaite.
Tous les syndicats sont complices du gouvernement et du patronat. Lorsqu'ils «négocient» (toujours dans le dos des travailleurs), c'est pour discuter avec les représentants du gouvernement et du patronat de la façon de faire passer les attaques. Tous les syndicats ont pour fonction d'encadrer les luttes pour maintenir l'ordre social du capital! Pour cela, ils se partagent le travail entre eux et en étroite collaboration avec les représentants de la classe dominante.
Peut-on «réformer» les syndicats?
NON! Dans la mesure où les syndicats sont devenus des organes d'encadrement de la classe ouvrière et ont été définitivement intégrés à l'appareil de l'État bourgeois, on ne peut pas les «réformer».
Beaucoup de prolétaires pensent que ce sont les bureaucraties syndicales qui sont pourries et qu'il suffirait de changer la direction des syndicats pour que ces derniers deviennent de vrais organes de défense des travailleurs. C'est une illusion! Si les syndicats ne sont pas «efficaces», ce n'est pas à cause de leurs «mauvais» leaders qui trahissent la «base». C'est la forme syndicale elle-même qui est devenue inefficace et totalement inadaptée aux besoins de la lutte.
Le syndicalisme est une idéologie réformiste basée sur la division de la classe ouvrière en corporations, en corps de métiers.
Le syndicalisme est une idéologie qui sème l'illusion que l'on peut se battre aujourd'hui pour obtenir des réformes durables afin d'améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière au sein-même du capitalisme (comme c'était le cas au 19e siècle). Aujourd'hui, avec l'enfoncement du capitalisme dans une crise économique sans issue et qui ne peut que continuer à s'aggraver, les seules «réformes» durables sont celles qui nous sont imposées par la bourgeoisie, telle la «réforme» du système de retraite. Ces «réformes», au lieu d'améliorer les conditions d'existence des salariés, ne peuvent que les plonger dans une pauvreté et une misère croissantes.
Le syndicalisme sème l'illusion qu'en se battant chacun dans son coin, derrière des revendications spécifiques à sa boîte, son secteur, sa corporation, on peut obtenir gain de cause. C'est FAUX! Seule une lutte massive englobant tous les secteurs de la classe ouvrière, derrière des mots d'ordre unitaires peut faire reculer le gouvernement et le patronat. Pour cela, il faut briser toutes les divisions corporatistes, sectorielles que les syndicats nous imposent.
Il ne sert à rien de chercher à «réformer» les syndicats ou créer de nouveaux syndicats. La preuve: lors des luttes des ouvriers de Pologne en 1980, par exemple, ces derniers avaient l'illusion qu'en créant un nouveau syndicat «libre» et «démocratique» (le syndicat Solidarnosc dirigé par Lech Walesa), ils allaient pouvoir renforcer leurs luttes et obtenir des réformes durables. On a vu ce que cela a donné: c'est grâce à la création du syndicat «indépendant» Solidarnosc (mis en place avec le soutien des syndicats occidentaux et de toute la bourgeoisie des États «démocratiques») que le général Jaruzelski a pu décréter l'état de guerre et réprimer férocement la classe ouvrière en Pologne (voir notre brochure sur les luttes en Pologne de 1980). Par la suite, on a vu le parcours du leader du syndicat Solidarnosc: Lech Walesa est devenu chef de l'État polonais et c'est lui qui a eu la responsabilité de gérer le capital national polonais et de porter des attaques directes contre la classe ouvrière!
Peut-on lutter efficacement sans les syndicats dans les pays «démocratiques»?
OUI! Pour cela, il faut que la classe ouvrière prenne confiance en elle-même et en ses propres forces. Il faut qu'elle puisse surmonter les hésitations et surtout la peur de la répression des grèves «sauvages» et «illégales». Cette peur de la répression (sous forme de sanctions disciplinaires) ne pourra être dépassée que si les travailleurs sont capables de développer la solidarité entre eux, s'ils refusent de se laisser diviser et intimider. Cette peur ne pourra être dépassée que lorsque les exploités prendront conscience qu'ils n'ont plus rien à perdre que leurs chaînes.
Les travailleurs, salariés ou au chômage, en retraite ou étudiants ne pourront prendre en mains leur propre destinée que lorsqu'ils auront compris que toutes les actions «radicales», les actions commandos préconisées par les syndicats (séquestration des patrons, sabotage de la production, blocage des voies ferrées, etc.) ou les actes de désespoir (telles les menaces de faire sauter l'usine) sont totalement stériles et ne peuvent conduire qu'à la démoralisation et à la défaite. Toutes ces actions pseudo-radicales derrière lesquelles les syndicats cherchent à entraîner les travailleurs les plus combatifs ne servent qu'à défouler leur colère et ne sont que des feux de paille.
Dans les pays «démocratiques», les syndicats sont les représentants de la «démocratie» bourgeoise au sein de la classe ouvrière, c'est-à-dire de la forme la plus sournoise et hypocrite de la dictature du capital.
Comment lutter efficacement ?
Pour pouvoir se battre efficacement en se dégageant de l'emprise totalitaire des syndicats, il faut faire vivre la vraie «démocratie» de la classe ouvrière. Cela veut dire développer la discussion collective au sein des assemblées générales massives et souveraines. Ces AG doivent être des lieux de débats où chacun peut intervenir librement, faire des propositions d'actions soumises au vote. Ces AG doivent élire des délégués révocables à tout moment, qu'ils soient syndiqués ou non. Si les délégués élus ne remplissent pas correctement le mandat confié par l'AG, l'AG suivante doit les remplacer. Contrairement aux méthodes de sabotage syndicales, il faut que ces AG soient ouvertes à TOUS les travailleurs (et pas seulement à ceux de la boîte, de l'entreprise ou de la corporation, ou les membres du syndicat). Les chômeurs doivent également être invités à y participer activement car ce sont des prolétaires exclus du monde du travail. Ceci est un des points forts que les mouvements en Espagne des Indignés et aux EU de Occupy nous ont montré. Avec un % toujours croissant d’exclus du marché régulier du travail (précaires, chômeurs) l’AG est devenu par excellence le lieu où toutes les parties de la classe exploitée peuvent s’unir et développer leur solidarité. Les AG souveraines doivent être des lieux de discussions public, (comme l'ont montré les travailleurs de Vigo en Espagne en 2006). Ce n'est qu'à travers la discussion et la réflexion collective dans ces AG ouvertes à tous que peut se construire l'unité et la solidarité de la classe exploitée. Ce n'est que dans ces Assemblées que peuvent se décider des actions unitaires, être mises en avant des revendications communes à tous et que pourront être démasquées les magouilles des syndicats.
Pour se battre efficacement en se débarrassant des entraves et du carcan des syndicats, les travailleurs doivent immédiatement poser la question de l'extension de leur lutte et de la solidarité avec tous leurs camarades des autres secteurs et entreprises frappés par les mêmes attaques de la bourgeoisie. Lorsque les travailleurs d'une entreprise engagent la lutte, ils doivent envoyer des délégations massives vers les autres entreprises voisines pour entraîner dans la lutte tous les travailleurs de la même zone géographique et élargir leur mouvement de proche en proche.
Aujourd'hui, si la classe ouvrière a beaucoup de difficulté à engager la lutte sans attendre les directives des syndicats, c'est parce qu'elle manque encore de confiance en elle-même et dans ses propres forces. C'est aussi parce que l'idéologie «démocratique» inoculée dans ses rangs par les syndicats (et le syndicalisme) pèse encore sur sa conscience.
L'idée qu'on a besoin des syndicats pour se battre est véhiculée par la bourgeoisie. La classe dominante veut nous faire croire que seuls les syndicats peuvent nous «représenter» parce que ce sont des professionnels de la «négociation», alors que ce sont des professionnels du sabotage, de la magouille et de la collaboration avec l'ennemi de classe.
Face aux plans d’austérité dont nous sommes tous victimes, il est possible de lutter efficacement. Mais pour construire un véritable rapport de force capable de faire reculer la bourgeoisie, les travailleurs doivent déjouer les manœuvres de sabotage des syndicats et comprendre qu’ils ne peuvent plus compter sur ces faux amis. Cette discussion est d’une grande importance si nous «voulons faire comprendre à toute la classe, à tous les collègues-ouvriers qu’à l 'intérieur du capitalisme pour eux il n'y a pas d’avenir et que seulement par la lutte, non comme syndicat mais comme classe-unie, nous pouvons remporter la victoire» (Sur les syndicats, A. Pannekoek, 1936). Nous appelons toutes les forces combattives d’engager la discussion là-dessus.
Les organisations syndicales n'ont pas d'autre fonction que de préserver l'ordre social capitaliste et faire passer les attaques du gouvernement et du patronat. Malgré leurs discours «radicaux», elles ne peuvent que continuer à nous diviser, à nous affaiblir pour empêcher tout «débordement» et nous faire voter la reprise du travail sans n'avoir rien obtenu. C'est bien grâce aux syndicats que la classe dominante peut continuer à cogner toujours plus fort et à faire payer aux travailleurs les frais de la crise insurmontable du capitalisme.
Jos & Sofiane /15.04.2012
Géographique:
- Belgique [2]
Situations territoriales:
Rubrique:
En Syrie, l'horreur d'un champ de guerre impérialiste
- 1474 reads
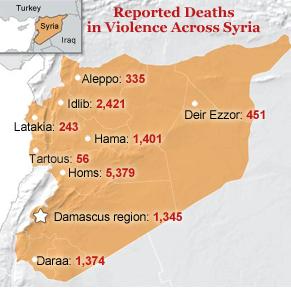 Samedi 4 février, un après-midi comme un autre à Homs. Une foule immense enterre ses morts et manifeste contre le régime de Bachar Al-Assad. Depuis le début des événements en avril 2011, il ne se passe pas un jour en Syrie sans qu’une manifestation ne soit réprimée. En moins d’un an, il y aurait eu largement plus de 2.500 morts et des milliers de blessés.
Samedi 4 février, un après-midi comme un autre à Homs. Une foule immense enterre ses morts et manifeste contre le régime de Bachar Al-Assad. Depuis le début des événements en avril 2011, il ne se passe pas un jour en Syrie sans qu’une manifestation ne soit réprimée. En moins d’un an, il y aurait eu largement plus de 2.500 morts et des milliers de blessés.
Mais dans la nuit du 4 au 5 février, la pratique de l’assassinat en masse s’est encore élevée d’un cran. Pendant des heures, dans l’obscurité, seuls s’entendent les canons de l’armée d’Assad qui tonnent et les cris des hommes qui meurent. Au petit-matin apparaît toute l’horreur de ce qui est aujourd’hui nommée «la nuit rouge d’Homs»: à la lumière du jour, les rues se révèlent jonchées de cadavres. Le bilan de la tuerie serait de 250 morts, sans compter tous ceux qui ont succombé à leurs blessures depuis lors ou qui ont été achevés froidement, après coup, par les militaires à la solde du pouvoir. Car ce massacre n’a pas pris fin à la levée du jour; les blessés ont été pourchassés jusque dans leur lit d’hôpital pour y être exécutés, des médecins surpris en train de soigner des «rebelles» ont été abattus, certains habitants d’Homs sont morts d’une balle dans la tête simplement pour avoir commis le crime de transporter des médicaments dans leurs poches. Ni les femmes ni les enfants n’échappent à ce carnage. La même nuit, la chaîne de télévision Al Jazeera a annoncé que de fortes explosions avaient été entendues dans la région de Harasta, dans la province de Rif Damas. Dans cette ville, située à une quinzaine de kilomètres au Nord de Damas, de violents combats opposent l’armée syrienne libre (ASL) et les forces du régime. Là-aussi, les massacres sont abominables.
Comment tout cela est-il possible? Comment un mouvement de protestation qui a débuté contre la misère, la faim et le chômage a pu en quelques mois se transformer en un tel bain de sang?
Qui est responsable de cette horreur? Qui commande la main meurtrière des militaires et des mercenaires?
La barbarie du régime syrien n’est plus à démontrer. La clique au pouvoir ne reculera devant aucune exaction, aucun massacre pour se maintenir à la tête de l’État et ainsi conserver ses privilèges. Mais qui est cette «armée syrienne libre» qui s’est mise au commandement de la «protestation du peuple»? Une autre clique d’assassins! L’ASL prétend se battre pour libérer le peuple, elle n’est que le bras armé d’une fraction bourgeoise concurrente à celle de Bachar Al-Assad. Et c’est bien là tout le drame des manifestants. Ceux qui veulent lutter contre leurs conditions de vie insoutenables, contre la misère, contre l’exploitation, ceux-là sont pris entre le marteau et l’enclume et ils s’y font écraser, torturer, massacrer...
En Syrie, les exploités sont trop faibles pour développer une lutte autonome; leur colère a ainsi été immédiatement détournée et instrumentalisée par les différentes cliques bourgeoises du pays, les manifestants sont devenus de la chair à canon, enrôlés dans une guerre qui n’est pas la leur pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, comme cela avait été le cas en Libye quelques mois plus tôt.
Ainsi, l’ASL n’a rien à envier à la nature sanguinaire du régime syrien au pouvoir. Début février, elle a, entre autres exemples, menacé de bombarder Damas et tous les postes de commandement du régime et ses fiefs. L’ASL demandant à la population de Damas de s’éloigner de ces cibles, ce qu’elle sait impossible. Les habitants de Damas n’ont en fait pas d’autres choix que de se terrer, terrorisés, dans les caves ou les souterrains tels des taupes ou des rats, à l’image de leurs frères exploités d’Homs.
Mais la bourgeoisie syrienne n’est pas seule responsable de ces massacres. Les complicités internationales sont aussi nombreuses qu’il y a de sièges à l’ONU. Ammar AL-Wawi, l’un des commandants de l’ASL, accuse ainsi directement la Russie et certains pays voisins, tels que le Liban et l’Iran par leur implication, et indirectement la Ligue arabe et la communauté internationale par leur inaction, d’avoir donné le feu vert à Assad pour massacrer le peuple. Quelle découverte!
- La Chine et la Russie défendent publiquement et politiquement le régime syrien. Avec l’Iran, la Russie approvisionne en armes ce régime. Et il est probable que des forces armées de ces pays interviennent directement sur le terrain sous une appellation ou une autre. Pour les puissances capitalistes, les morts ne comptent pas ni la souffrance humaine qu’inflige la défense de leurs sordides intérêts impérialistes.
- L’Iran joue en Syrie une grande partie de sa domination sur le Proche et le Moyen-Orient. C’est pourquoi cet État soutient de toutes ses forces, en s’impliquant même directement militairement, le régime syrien en place. Et les «grandes nations démocratiques» qui aujourd’hui proclament la main sur le cœur et des larmes de crocodile à l’œil que la répression des manifestants par l’armée de Bachar Al-Assad est insoutenable, n’ont aucune réelle compassion pour les familles en deuil, seul l’affaiblissement de l’Iran en mettant sous leur coupe la Syrie les intéresse. Mais il s’agit là d’un bras de fer dangereux car l’Iran n’est pas l’Irak. L’Iran est un pays de plus de 70 millions d’habitants, avec une armée nombreuse et bien équipée. Et surtout avec un pouvoir de nuisance autrement plus important que celui de la Syrie. Si on obligeait l’Iran à empêcher le passage du pétrole par le détroit d’Ormuz, quelle catastrophe économique ce serait! Toute attaque directe de l’Iran provoquerait un chaos incontrôlable. Des nuits rouges comme à Homs se généraliseraient à toute la région.
La Syrie au bord de la guerre impérialiste généralisée
 Chaque jour, les tensions montent entre l’Iran et bon nombre de puissances impérialistes dans le monde : États-Unis, Angleterre, France (1), Arabie Saoudite, Israël, etc. La guerre menace mais pour le moment n’éclate pas (2). En attendant et presque mécaniquement, les bruits de bottes se font de plus en plus entendre en direction de la Syrie, amplifiés encore par le veto de la Chine et de la Russie au sein de l’ONU concernant une proposition de résolution condamnant la répression par le régime de Bachar Al-Assad. Tous ces charognards impérialistes prennent le prétexte de l’infamie et de l’inhumanité du régime syrien pour préparer l’entrée en guerre totale dans ce pays. C’est en premier lieu par l’entremise du média russe La Voix de Russie, relayant la chaîne de télévision publique iranienne Pess TV, que des informations ont été avancées selon lesquelles la Turquie s’apprêterait avec le soutien américain à attaquer la Syrie. A cet effet, l’État turc masserait troupes et matériels à sa frontière syrienne. Depuis lors, cette information a été reprise par l’ensemble des médias occidentaux. En face, en Syrie, des missiles balistiques sol-sol de fabrication soviétique ont été déployés dans les régions de Kamechi et de Deir Ezzor, à la frontière avec l’Irak et la Turquie. Tout cela fait suite à une réunion tenue en novembre à Ankara qui a donné lieu à une série de rendez-vous. L’émissaire du Qatar a offert à Erdogan, premier ministre turc, de financer toute opération militaire depuis le territoire turc contre le président Al Assad (3). Réunions auxquelles ont participé aussi les oppositions libanaises et syriennes. Ces préparatifs ont amené les alliés de la Syrie, en premier lieu l’Iran et la Russie, à hausser le ton et à proférer des menaces à peines voilées contre la Turquie. Pour le moment, le Conseil National Syrien (CNS), qui regrouperait selon la presse bourgeoise la majorité de l’opposition dans ce pays, a fait savoir qu’il ne demandait aucune intervention militaire extérieure sur le sol syrien. C’est sans aucun doute ce refus qui paralyse encore les bras armés de la Turquie et éventuellement de l’État israélien. Le CNS se moque, comme toutes les autres fractions bourgeoises impliquées, des souffrances humaines qu’entraînerait une guerre totale sur le sol syrien Ce qu’il craint, c’est tout simplement de perdre totalement le peu de pouvoir qu’il possède actuellement en cas de conflit majeur.
Chaque jour, les tensions montent entre l’Iran et bon nombre de puissances impérialistes dans le monde : États-Unis, Angleterre, France (1), Arabie Saoudite, Israël, etc. La guerre menace mais pour le moment n’éclate pas (2). En attendant et presque mécaniquement, les bruits de bottes se font de plus en plus entendre en direction de la Syrie, amplifiés encore par le veto de la Chine et de la Russie au sein de l’ONU concernant une proposition de résolution condamnant la répression par le régime de Bachar Al-Assad. Tous ces charognards impérialistes prennent le prétexte de l’infamie et de l’inhumanité du régime syrien pour préparer l’entrée en guerre totale dans ce pays. C’est en premier lieu par l’entremise du média russe La Voix de Russie, relayant la chaîne de télévision publique iranienne Pess TV, que des informations ont été avancées selon lesquelles la Turquie s’apprêterait avec le soutien américain à attaquer la Syrie. A cet effet, l’État turc masserait troupes et matériels à sa frontière syrienne. Depuis lors, cette information a été reprise par l’ensemble des médias occidentaux. En face, en Syrie, des missiles balistiques sol-sol de fabrication soviétique ont été déployés dans les régions de Kamechi et de Deir Ezzor, à la frontière avec l’Irak et la Turquie. Tout cela fait suite à une réunion tenue en novembre à Ankara qui a donné lieu à une série de rendez-vous. L’émissaire du Qatar a offert à Erdogan, premier ministre turc, de financer toute opération militaire depuis le territoire turc contre le président Al Assad (3). Réunions auxquelles ont participé aussi les oppositions libanaises et syriennes. Ces préparatifs ont amené les alliés de la Syrie, en premier lieu l’Iran et la Russie, à hausser le ton et à proférer des menaces à peines voilées contre la Turquie. Pour le moment, le Conseil National Syrien (CNS), qui regrouperait selon la presse bourgeoise la majorité de l’opposition dans ce pays, a fait savoir qu’il ne demandait aucune intervention militaire extérieure sur le sol syrien. C’est sans aucun doute ce refus qui paralyse encore les bras armés de la Turquie et éventuellement de l’État israélien. Le CNS se moque, comme toutes les autres fractions bourgeoises impliquées, des souffrances humaines qu’entraînerait une guerre totale sur le sol syrien Ce qu’il craint, c’est tout simplement de perdre totalement le peu de pouvoir qu’il possède actuellement en cas de conflit majeur.
Les horreurs que nous voyons chaque jour à la télévision ou à la Une de la presse bourgeoise sont dramatiquement vraies. Si la classe dominante nous montre tout cela à longueur de temps, ce n’est ni par compassion, ni par humanité. C’est pour nous préparer idéologiquement à des interventions militaires toujours plus sanglantes et massives. Dans ce génocide en cours, Bachar Al-Assad et sa clique ne sont pas les seuls bourreaux. Le bourreau de l’humanité, c’est ce système capitaliste agonisant qui sécrète la barbarie de ces massacres inter-impérialistes comme la nuée porte l’orage.
Tino/16.02,2012
Notes du 16,04
(1) Début mars, la télévision officielle syrienne confirmait que l’armée avait emprisonné 18 agents français à Homs et un 19ième à Azouz. Ce message signifiait que les –prudentes- négociations entre Paris et Damas avaient échoué et que la Syrie décidait d’augmenter la pression sur la France en rendant l’affaire publique.
(2) Les États-Unis, au cours du mois de mars, ont mené des «entretiens intensifs» avec l’Inde, la Chine et la Turquie pour « inciter» ces pays d’arrêter l’exportation de pétrole d’Iran. Mais cela ne va pas de soi car ces pays sont réticents à abandonner leurs propres aspirations régionales impérialistes. Prenons par exemple la Turquie.
Un spécialiste dans le domaine des relations internationales, Sol Ozel, de l’Université Kadir Has, déclarait le 9 février que «la Turquie a clairement fait savoir qu’elle n’est pas d’accord avec les sanctions contre l’Iran.»
Une raison importante est que non seulement les entreprises turques profitent du commerce du pétrole provenant de l’Iran, mais aussi les banques turques. Elle transfère près d’un milliard de dollars par mois à Téhéran. La Banque Hall, qui est contrôlée par l’État turc, rend possible le paiement de l’exportation du pétrole iranien, en particulier vers l’Inde.
(3) la Russie et la Chine n’ont toujours pas accepté la résolution du Conseil de sécurité condamnant le comportement du régime syrien de Bachar al-Assad. Entre temps, bien qu’à contrecœur, ils sont d’accord avec «une déclaration de l’ONU » soutenant l’initiative de paix de Kofi Annan.
Géographique:
- Moyen Orient [9]
Rubrique:
Les drames de Toulouse et Montauban sont des symptômes de l'agonie barbare de la société capitaliste
- 1402 reads
 Les assassinats commis les 11, 15 et 19 mars à Toulouse et Montauban ainsi que leurs répercussions constituent une illustration saisissante de la barbarie dans laquelle s’enfonce le monde actuel.
Les assassinats commis les 11, 15 et 19 mars à Toulouse et Montauban ainsi que leurs répercussions constituent une illustration saisissante de la barbarie dans laquelle s’enfonce le monde actuel.
D’après le Président Sarkozy, Mohamed Merah, le jeune toulousain qui a commis ces crimes et qui a été exécuté par le RAID, était un «monstre». Cette affirmation soulève au moins deux questions:
C’est quoi un «monstre» ?
Comment la société a-t-elle pu fabriquer un tel «monstre»?
Les «bons monstres» et les «mauvais monstres»
Si le fait de tuer de sang-froid des personnes parfaitement innocentes, et par surcroît inconnues, fait d’un être humain un «monstre», alors la planète est gouvernée par des «monstres» puisqu’un grand nombre des chefs d’État de ce monde ont commis de tels crimes. Et ce ne sont pas seulement quelques «dictateurs sanguinaires» qui sont concernés comme Staline ou Hitler dans le passé, Kadhafi ou Assad dans la période actuelle. Que penser de Winston Churchill, le «Grand homme» de la Seconde Guerre mondiale qui a ordonné les bombardements des villes allemandes de Hambourg durant l’été 1943 et Dresde du 13 au 15 février 1945, bombardements qui firent des dizaines, voire des centaines de milliers de morts civils dont 50 % de femmes et 12 % d’enfants? Que penser de Harry Truman, président de la «grande démocratie» américaine, qui ordonna les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki au Japon en août 1945, lesquels firent plusieurs centaines de milliers de victimes civiles, en majorité des femmes et des enfants? Ces tués n’étaient pas des victimes «collatérales» d’opérations visant des objectifs militaires. Les bombardements visaient expressément les civils et notamment, dans le cas de l’Allemagne, ceux habitant les quartiers populaires. Aujourd’hui, les dirigeants des pays «démocratiques» «couvrent» en permanence tous les bombardements des populations civiles, qu’ils aient lieu en Irak, en Afghanistan, à Gaza ou en bien d’autres lieux.
Pour exonérer les dirigeants politiques et militaires, on entend que tous ces crimes sont le prix à payer pour gagner la guerre contre les «forces du mal». Même les opérations de représailles contre des populations civiles sont ainsi justifiées: ces actes de vengeance ont pour but de «démoraliser» et de «dissuader» l’ennemi. C’est exactement ce qu’a affirmé Mohamed Merah, si on en croit les policiers qui ont discuté avec lui avant son exécution: en s’attaquant aux militaires, il voulait «venger ses frères d’Afghanistan», en s’attaquant aux enfants d’une école juive, il voulait «venger les enfants de Gaza» victimes des bombardements israéliens.
Mais peut être que ce qui fait de Mohamed Merah un «monstre», c’est qu’il ait lui-même appuyé sur la gâchette de l’arme qui allait donner la mort. C’est vrai que les dirigeants qui ordonnent des massacres ne sont pas en contact direct avec leurs victimes: Churchill n’a pas actionné les lancers de bombes sur les villes allemandes et il n’a pas eu l’occasion de voir mourir ou agoniser les femmes et les enfants qu’elles ont tués. Mais n’est-ce pas aussi le cas de Hitler et de Staline qui eux sont considérés, à juste titre, comme de sinistres criminels? De plus, les soldats qui, sur le terrain, assassinent des civils désarmés, que ce soit sur ordre ou mus par la haine qu’on a mis dans leur tête, sont rarement traités de «monstres». Bien souvent, ils reçoivent même des médailles et ils sont parfois considérés comme des «héros».
Qu’il s’agisse des dirigeants des États ou de simples citoyens ordinaires enrôlés dans une guerre, les «monstres» sont pléthore dans le monde actuel et ils sont avant tout le produit d’une société qui elle, effectivement, est «monstrueuse».
L’itinéraire tragique de Mohamed Merah l’illustre de façon saisissante.
Comment on devient un «monstre»
Mohamed Merah était un très jeune homme issu de l’immigration maghrébine, élevé par une mère seule, qui s’est retrouvé en échec scolaire et a commis un certain nombre de délits de droit commun avec violence lorsqu’il était mineur, ce qui l’a conduit en prison. Il a connu le chômage à plusieurs reprises et a tenté de s’engager dans l’armée, ce qui lui a été refusé du fait de ses antécédents judiciaires. C’est à cette même période qu’il a commencé à s’approcher de l’islamisme radical, apparemment sous l’influence de son frère aîné.
Nous avons là un parcours extrêmement classique emprunté par beaucoup de jeunes d’aujourd’hui. C’est vrai que tous ces jeunes ne finissent pas dans la peau d’un assassin. Mohamed Merah avait une fragilité particulière comme l’attestent sa tentative de suicide lorsqu’il était en prison et le séjour qu’il a fait en établissement psychiatrique. Mais il est significatif – comme le montrent les tentatives de créer sur Internet des forums à sa gloire – que Mohamed Merah soit dès à présent considéré comme un «héros» parmi de nombreux jeunes des banlieues, tout comme le sont ces terroristes qui se font sauter avec leur bombe dans les lieux publics en Israël, en Irak ou à Londres. La dérive vers un Islam extrémiste et violent affecte principalement certains pays à population musulmane où elle peut même constituer un caractère de masse comme en témoigne, par exemple, le succès du Hamas à Gaza. Quand elle concerne des jeunes nés en France (ou dans d’autres pays d’Europe) elle résulte, en partie, des mêmes causes: la révolte contre l’injustice, le désespoir et le sentiment d’exclusion. Les «terroristes» de Gaza sont recrutés parmi les jeunes d’une population qui, depuis des décennies, vit dans la misère et le chômage, qui a subi la colonisation de l’État d’Israël et continue de recevoir régulièrement des bombes de cet État, et cela sans que se présente la moindre perspective d’amélioration. «La religion, comme l’écrivait Marx au 19e siècle, est le soupir de la créature accablée par le malheur. Elle est le cœur d’un monde sans cœur comme elle est l’esprit d’une époque sans esprit. Elle est l’opium du peuple.» Confrontées à un présent intolérable et à une absence de futur, les populations ne trouvent d’autre consolation et espoir que dans une fuite dans la religion qui leur promet le Paradis pour après la mort. Jouant sur l’irrationnel (puisqu’elles sont basées sur la foi et non sur la pensée rationnelle), les religions constituent un terrain propice au fanatisme, c’est-à-dire au rejet radical de la raison. Quand elles comportent l’ingrédient de la «guerre sainte» contre les «infidèles» comme moyen de gagner le Paradis (comme c’est le cas de l’islam mais aussi du christia-nisme) et qu’outre la misère et le désespoir, l’humiliation est quotidienne, elles sont prêtes à se convertir en justification céleste de la violence, du terrorisme et des massacres.
A l’automne 2005, la flambée de violence qui a embrasé les banlieues françaises était un symptôme du mal-être et du désespoir qui touche une jeunesse de plus en plus massivement victime du chômage et de l’absence de futur, et particulièrement la jeunesse issue de l’immigration maghrébine ou subsaharienne. Celle-ci subit la «double peine»: en plus de l’exclusion que constitue le chômage lui-même s’ajoute l’exclusion liée à la couleur de peau ou au nom; à compétences égales, Joseph ou Marie auront plus de chances de trouver un emploi que Youssef ou Mariam, surtout si cette dernière porte le voile comme l’exige sa famille.
Dans ce contexte, le "repli identitaire" ou le "communau-tarisme", comme le qualifient les sociologues, ne peut que s’aggraver, un repli qui trouve dans la religion son principal ciment. Et un tel communautarisme, notamment ses formes les plus xénophobes et violentes, est encore alimenté par la situation internationale où l’État d’Israël (et donc le juif), constitue "l’Ennemi" par excellence.
Les racines de l’antijudaïsme
Suivant les informations fournies par la police, c’est parce qu’il n’a pas trouvé de militaire à abattre le 19 mars que Mohamed Merah s’est «replié» sur une école juive, tuant trois enfants et un enseignant. Cet acte barbare n’est que la pointe extrême d’un très fort sentiment anti-juif qui habite aujourd’hui un grand nombre de musulmans.
Pourtant, l’antijudaïsme n’est pas une «spécialité» historique de l’Islam, bien au contraire. Au Moyen-Âge, la situation des juifs était bien plus enviable dans les pays dominés par l’Islam que dans les pays dominés par le Christianisme. Dans l’Occident chrétien, les persécutions prenant les juifs (accusés d’être les «assassins de Jésus») comme boucs émissaires dans les périodes de famine, d’épidémie ou de difficultés politiques étaient contemporaines des bonnes relations et de la coopération entre juifs et musulmans dans les pays de l’Empire arabo-musulman. A Cordoue, capitale de l’Al-Andalus (l’Andalousie musulmane), des juifs occupent des postes de diplomate ou de professeur d’université. En Espagne, les premières persécutions massives de juifs seront le fait des «rois catholiques» qui les chassent en même temps que les musulmans au moment de la «reconquête» en 1492. Par la suite, la situation des juifs sera bien meilleure au sud de la Méditerranée que dans les pays chrétiens, qu’ils soient catholiques ou orthodoxes. Le mot «ghetto» est d’origine italienne (16e siècle), le mot «pogrom» d’origine russe (19e siècle). C’est en Europe, face aux pogroms à l’Est et à la vague d’antisémitisme liée à «l’affaire Dreyfus» en France, et non au Maghreb ou au Proche-Orient, que se développe le sionisme, cette idéologie nationaliste née à la fin du 19e siècle qui prône le retour des juifs et la création d’un État confessionnel sur les terres de la Palestine biblique désormais peuplée essentiellement de musulmans. C’est la création après la Première Guerre mondiale d’un «Foyer national juif» en Palestine sous mandat britannique où émigrent dans les années 1930 de nombreuses victimes des persécutions nazies qui marque le début de l’antagonisme entre juifs et musulmans. Mais c’est surtout la création en 1948 de l’État d’Israël, destiné à accueillir des centaines de milliers de survivants de la «Shoah» qui ont tout perdu, qui va alimenter et aggraver l’hostilité de nombreux musulmans envers les juifs, notamment avec le départ vers des camps de réfugiés de 750.000 arabes. Les différentes guerres entre Israël et les pays arabes, de même que l’implantation de colonies dans les territoires occupés par Israël, ne vont évidem-ment pas arranger les choses ni non plus la propagande des gouvernements de la région qui ont trouvé dans la politique coloniale d’Israël un excellent exutoire pour défouler la colère des populations qu’ils maintiennent dans la misère et l’oppression. Et il en est de même des «croisades» rhétoriques ou armées des dirigeants américains et de leurs alliés occidentaux et israélien contre (ou dans) des pays musulmans (Irak, Iran, Afghanistan) au nom de la lutte contre le «terrorisme islamique».
Né de l’histoire barbare du 20e siècle, de plus au cœur d’une région cruciale du point de vue stratégique et économique, l’État d’Israël et sa politique sont condamnés à alimenter indéfiniment les tensions au Moyen-Orient et la haine du juif parmi les musulmans.
Quelles perspectives?
Mohamed Merah est mort, le corps criblé de balles, mais les causes qui sont à l’origine de son itinéraire tragique ne sont pas prêtes de disparaître. Avec l’aggravation de la crise d’un système capitaliste à l’agonie, avec la croissance inéluctable du chômage, de la précarité et de l’exclusion, particulièrement parmi les jeunes, le désespoir et la haine de même que le fanatisme religieux ont de beaux jours devant eux, ouvrant aux petits caïds de la drogue ou du «djihad» de belles perspectives de recrutement. Le seul contrepoison à cette dérive barbare réside dans le développement massif et conscient des luttes prolétariennes qui offrira aux jeunes une véritable identité, l’identité de classe, une véritable communauté, celle des exploités et non celle des «croyants», une véritable solidarité, celle qui se développe dans la lutte contre l’exploitation entre travailleurs et chômeurs de toutes races, nationalités et religions, un véritable ennemi à combattre et terrasser, non pas le juif, mais le capitalisme. Et ce sont ces mêmes luttes ouvrières qui seules permettront de sortir le Moyen-Orient de l’état de guerre permanent, ouvert ou larvé, dans lequel il se trouve, lorsque les prolétaires juifs et musulmans, de chaque côté du «Mur de la Honte» ou à l’intérieur de ce mur, comprendront qu’ils ont les mêmes intérêts et qu’ils doivent être solidaires contre l’exploitation. Des luttes ouvrières qui, en se développant dans tous les pays, devront de plus en plus comprendre et prendre en charge la seule perspective qui puisse sauver l’humanité de la barbarie: le renversement du capitalisme et l’instauration de la société communiste.
Fabienne/29.03.2012
Géographique:
- France [10]
Rubrique:
Journée de manifestation en Inde : grève générale ou pare-feu syndical ?
- 1307 reads
 En Inde, une journée de grève, lancée à l’appel des onze centrales syndicales nationales (c’était la première fois qu’elles agissaient ensemble depuis l’indépendance du pays en 1947) et de 50.000 syndicats plus petits, représentant 100 millions de travailleurs à travers tout le pays, a eu lieu le 28 février 2012. Elle a touché de nombreux secteurs, notamment les employés de banque, les travailleurs de la poste et des transports publics, les enseignants, les dockers… Cette mobilisation a été saluée comme étant une des grèves les plus massives du monde à ce jour.
En Inde, une journée de grève, lancée à l’appel des onze centrales syndicales nationales (c’était la première fois qu’elles agissaient ensemble depuis l’indépendance du pays en 1947) et de 50.000 syndicats plus petits, représentant 100 millions de travailleurs à travers tout le pays, a eu lieu le 28 février 2012. Elle a touché de nombreux secteurs, notamment les employés de banque, les travailleurs de la poste et des transports publics, les enseignants, les dockers… Cette mobilisation a été saluée comme étant une des grèves les plus massives du monde à ce jour.
Le fait que des millions de travailleurs se soient mobilisés montre que, malgré tous les discours sur le «boom» économique indien, il n’est pas ressenti comme tel par la classe ouvrière. Par exemple, les centres d’appels téléphoniques et l’industrie liée à la l’informatique en Inde, dépendant à 70 % de compagnies américaines, subissent lourdement le poids de la crise économique. C’est également le cas dans tout un tas de secteurs. L’économie indienne n’est pas à l’écart du reste de l’économie mondiale et de sa crise.
En Inde aussi donc la colère ouvrière gronde. C’est pourquoi les syndicats se sont tous mis d’accord sur l’appel commun à la grève… pour faire face, unis, à… la classe ouvrière! Quel autre sens donner à cette subite entente des organisations syndicales, elles qui dans le passé ont au contraire savamment entretenu la division, systématiquement, à chacune des précédentes mobilisations contre les mesures gouvernementales.
Loin de montrer que la bourgeoisie attaque aujourd’hui sans répit les travailleurs à cause de la crise d’un système malade et pourrissant, au contraire, les efforts des syndicats visent à faire croire qu’il faudrait faire confiance à ce système et que la bourgeoisie pourrait accorder n’importe quoi si elle souhaitait le faire. La preuve en est le cocktail de revendications avancées portant notamment sur l’obtention d’un salaire minimum national, réclamant aussi des emplois permanents pour 50 millions de travailleurs précaires, des mesures gouvernementales pour juguler l’inflation (qui a dépassé les 9 % pendant la majeure partie de ces deux dernières années), des améliorations sur la protection sociale comme sur les retraites pour tous les travailleurs, un renforcement du droit du travail comme des droits syndicaux et la fin de la privatisation des entreprises d’État. Ces revendications mises en avant par les syndicats reposent toutes sur l’hypothèse que le gouvernement est capable de répondre aux besoins des classes exploitées. Il répand aussi l’idée mensongère qu’il pourrait réduire l’inflation ou que, derrière l’appel à la défense des services publics, l’arrêt de la revente au privé de pans entiers de l’activité du secteur public bénéficierait d’une manière quelconque à la classe ouvrière.
Une «grève unitaire» très sélective
Les syndicats n’ont pas toujours demandé à leurs membres de se joindre à la grève. Ainsi, plus d’un million et demi de cheminots, et beaucoup d’autres ouvriers, la plupart d’entre eux membres de ces syndicats, n’étaient même pas appelés à faire grève. Dans la plupart des zones industrielles, dans des centaines de villes petites ou grandes, dans toute l’Inde, alors que les travailleurs du secteur public se mettaient en grève, des millions d’ouvriers du secteur privé continuaient à travailler et leurs syndicats n’ont pas appelé à la grève. Tout en appelant à une «grève générale», les syndicats ne se sont pas gênés pour que des millions de leurs membres aillent au travail comme d’habitude ce jour-là.
Même dans les secteurs où les syndicats ont appelé à la grève, leur attitude était plus celle d’appeler à une «grève absentéiste». Beaucoup de travailleurs ont fait grève tout en restant à la maison. Les syndicats n’ont pas fait de grands efforts pour les amener dans la rue tous ensemble et pour organiser des manifestations. Ni pour impliquer dans la grève les millions de travailleurs du secteur privé membres de syndicats nationaux en grève. Il faut rapprocher cette manœuvre au fait que récemment et pendant pas mal de temps, les ouvriers du secteur privé ont été beaucoup plus combatifs et moins respectueux des lois de la bourgeoisie. Même des zones industrielles comme Gurgaon et les industries automobiles près de Chennai, les usines comme Maruti à Gurgaon et Hyundai près de Chennai qui avaient récemment connu de grandes luttes, n’ont pas rejoint cette grève.
Pourquoi les syndicats ont-ils appelé à la grève?
Il est clair que les syndicats n’ont pas utilisé la grève pour mobiliser les ouvriers, pour les faire descendre dans la rue et s’unir. Ils l’ont utilisée comme un rituel, comme un moyen de lâcher un peu de vapeur, pour séparer les ouvriers, les inciter à la passivité et les démobiliser. Être assis à la maison, à regarder la télé, ne renforce pas l’unité et la conscience des travailleurs. Cela ne fait qu’accroître le sentiment d’isolement, la passivité et la sensation d’avoir perdu une occasion. Étant donnée cette attitude, pourquoi les syndicats ont-ils alors appelé à la grève? Et qu’est ce qui a pu tous les amener à s’unir, y compris le BMS (1) et ses plus de 6 millions d’adhérents? Pour comprendre cela, nous devons regarder quelle est la situation réelle au niveau économique et sociale comme ce qui se passe au sein de la classe ouvrière en Inde.
La dégradation des conditions de vie des travailleurs
Malgré les grands discours sur le boom économique, la situation économique a empiré ces dernières années. Comme partout, l’économie est en crise. Selon les statistiques gouvernementales, le taux de croissance annuelle est tombé de 9 % à 6 % environ. Beaucoup d’industries ont été sévèrement touchées dans les secteurs de l’informatique, du textile, de l’usinage des diamants, des biens de consommation, d’infrastructure, des compagnies privées d’électricité, des transports aériens. Cela a conduit à intensifier les attaques contre la classe ouvrière. L’inflation générale plane autour de 10 % depuis plus de deux ans. L’inflation au niveau des produits alimentaires et des objets de première nécessité est beaucoup plus élevée, allant quelques fois jusqu’à 16 %. La classe ouvrière s’enfonce dans la misère.
Le développement de la lutte de classe
Dans cette ambiance de conditions de vie et de travail dégradées, la classe ouvrière a repris le chemin de la lutte de classe. Depuis 2005, on a vu une accélération progressive de la lutte de classe dans l’Inde toute entière, démontrant qu’elle s’inscrit clairement dans le développement actuel de la lutte de classe internationale. Les années 2010 et 2011 en particulier ont connu de nombreuses grèves dans beaucoup de secteurs et des milliers de travailleurs ont pris part à des occupations d’usine, à des grèves sauvages et à des rassemblements de protestation. Quelques-unes de ces grèves ont été très importantes, notamment dans le secteur de l’automobile comme par exemple celles des ouvriers de Honda Motor Cycle en 2010 ou de Gurgaon et de Hyundai Motors à Chennai en 2011, dans lesquelles les travailleurs ont arrêté le travail à plusieurs reprises contre la précarisation et les autres attaques des patrons et ont exprimé une grande combativité et une forte détermination dans l’affrontement avec l’appareil de sécurité des patrons. Récemment, entre juin et octobre 2011, toujours dans les usines de production d’automobiles, les travailleurs ont agi de leur propre initiative et n’ont pas attendu les consignes syndicales pour se mobiliser avec de fortes tendances à la solidarité et une volonté d’extension de la lutte à d’autres usines. Ils ont aussi exprimé des tendances à l’auto-organisation et à la mise en place d’assemblées générales, comme lors des grèves à Maruti-Suzuki à Manesar, une ville nouvelle liée au boom industriel dans la région de Delhi, durant laquelle les ouvriers ont occupé l’usine contre l’avis de «leur» syndicat. Après une négociation signée par les syndicats début octobre, 1.200 travailleurs sous contrat n’ont pas été réembauchés et 3.500 ouvriers sont donc repartis en grève et ont occupé, pour montrer leur solidarité, l’usine d’assemblage des voitures. Cela a entraîné 8.000 ouvriers dans d’autres actions de solidarité dans une douzaine d’autres usines de la région. Cela a aussi conduit à des rassemblements et à la formation d’assemblées générales pour éviter le sabotage par les syndicats.
La redécouverte de l’assemblée générale en tant que forme la plus appropriée pour étendre la lutte et assurer l’échange d’idées le plus large possible représente une formidable avancée pour la lutte de classe. Les assemblées générales de Maruti-Suzuki à Manesar étaient ouvertes à tous et encourageaient chacun à participer à la réflexion sur la direction et les buts de la lutte.,
En plus de cette vague de lutte de classe qui monte lentement, les luttes qui se sont déroulées au Moyen Orient, en Grèce, en Grande-Bretagne, et l’ensemble du «mouvement Occupy» a eu un écho dans la classe ouvrière indienne.
La peur de la contagion de la lutte de classe au sein de la bourgeoisie
Au moment de la confrontation violente à l’usine de motos Honda et face aux grèves répétées à Maruti-Suzuki, on a pu voir clairement s’exprimer une certaine crainte de la part de la bourgeoisie. Chaque fois, les médias ont mis en avant le fait que les grèves pourraient s’étendre et impliquer d’autres compagnies automobiles à Gurgaon et paralyser toute la région. Ce n’était pas de la spéculation. Alors que les principales grèves ne touchaient que peu d’usines, d’autres ouvriers sont venus aux portes des usines en grève. Il y a eu des manifestations communes d’ouvriers et même une grève dans toute la cité industrielle de Gurgaon. Le gouvernement provincial était lui-même sérieusement inquiet de la propagation de la grève. Le Premier ministre et le ministre du travail du Haryana, à l’instigation du Premier ministre et du ministre du Travail de l’Union, ont réuni les patrons des entreprises et des syndicats pour étouffer la grève.
Comme le reste de la bourgeoisie, les syndicats ont été encore plus inquiets de perdre le contrôle sur les ouvriers si la combativité continuait à croître. Là aussi, ce fut évident dans les grèves à Maruti en 2011, quand les ouvriers ont accompli beaucoup d’actions contraires à ce que voulaient les directions syndicales. Cette peur a poussé les syndicats à vouloir apparaître comme faisant quelque chose. Ils ont appelé à un certain nombre de grèves rituelles, y compris une grève des employés de banque en novembre 2011. La grève actuelle, tout en étant, sans aucun doute, une expression de la montée de la colère et de la combativité au sein de la classe ouvrière, est aussi un des derniers efforts en date des syndicats pour la contenir et la canaliser.
Prendre nos luttes en main
Les travailleurs doivent comprendre que faire une journée de grève rituelle et rester à la maison ne nous mène nulle part. Pas plus que de se rassembler dans un parc pour écouter les discours des patrons syndicaux et des membres des partis parlementaires. Les patrons et leur gouvernement nous attaquent parce que le capitalisme est en crise et qu’ils n’ont pas d’autre choix. Nous devons comprendre que tous les travailleurs sont attaqués. Rester passifs et isolés les uns des autres ne décourage pas les patrons d’intensifier leurs attaques contre les travailleurs. Les ouvriers doivent utiliser ces occasions de se mobiliser pour prendre la rue, se rassembler et discuter avec d’autres travailleurs. Ils doivent prendre leurs luttes en main. Cela ne résoudra pas immédiatement les problèmes des travailleurs mais cela rendra possible le développement authentique de la lutte. Cela nous aidera à développer notre combat contre le système capitaliste et d’œuvrer à sa destruction. Comme le disaient ceux qui ont occupé la faculté de droit en Grèce en février 2012, «Pour nous libérer de la crise actuelle, nous devons détruire l’économie capitaliste!».
D’après deux articles de Communist Internationalist, organe du CCI en Inde/mars 2012
1) Le Bharatiya Mazdoor Sangh qui est le plus grand syndicat du pays, est lié au BJP, le parti religieux hindouiste fondamentaliste.
Géographique:
- Inde [11]
Rubrique:
le capitalisme a fait faillite, pourquoi? que faire ?
- 1220 reads
À l’heure actuelle, dans toute la société, la crise économique est au cœur des préoccupations. Tout le monde se fait des soucis sur son avenir, celui de ses enfants, ses parents retraités, ses voisins, amis, collègues, ... existe t’il encore un avenir décent pour nous tous ou allons-nous tout droit dans la plus grande pauvreté et la précarité? Cette situation est-elle dûe à des banquiers cupides et corrompus, des agences de notation? Est-ce le résultat de gouvernements irresponsables et de leurs banques centrales? Si oui! le système d'exploitation pourrait être réformé. Sinon, il est clair que le capitalisme n'a pas d'avenir et qu'il doit être totalement détruit pour être remplacé par une autre société. C'est pourquoi, cette discussion est importante pour déterminer les perspectives et les buts des effets de la crise.
1ère soirée : vendredi 27 avril – 19h30 à 22h30
La crise est-elle temporaire, donc le produit d’un dérapage, d’un déséquilibre dans le fonctionnement économique?
A quelle sorte de crise sommes-nous confrontés? Une crise de la dette, des banques, une crise immobilière, une crise de l’euro ou encore une crise historique du mode de production capitaliste?
La crise immobilière a débouché sur une crise ouverte de dimension mondiale, sur une chute de l’activité économique que la société n’a plus connue depuis 1929. En Grèce, en Espagne, en Italie ou au Portugal une austérité inouïe est mise en place. Dans de nombreux autres pays européens, de nouvelles attaques sont planifiées. Est-ce que cette situation est la faute de banquiers cupides et corrompus, des agences de notation? Est-ce le résultat de gouvernements irresponsables et de leurs banques centrales? Ou d’une Europe trop faible?
Marx soulignait: "ne voyons pas dans la misère que la misère". La crise économique n’est pas une fatalité. Ce n’est pas une loi naturelle. Il ne s’agit pas d’un destin qui s’impose à nous. C’est la conséquence d’un système qui s’est empêtré dans ses propres contradictions: comme celles entre les forces productives et les rapports de production, ou, en d’autres mots, entre le caractère social du processus de production et l’appropriation privée des produits de celui-ci par les propriétaires capitalistes.
2 ième soirée: Vendredi 11 mai – 19h30 à 22h30
La crise est-elle locale et y-a-t ‘il des pays ou des politiques qui y échappent?
(la Chine, la Corée, le Cuba "socialiste", ou les fameux pays BRICS?)
Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (les BRICS) ont montré ces dernières années une remarquable réussite économique.
La Chine, en particulier, est désormais considérée comme la deuxième puissance économique dans le monde et beaucoup pense qu’elle va bientôt détrôner les États-Unis. Cette performance flamboyante a amené des économistes à placer leurs espoirs dans ce groupe de pays comme la nouvelle locomotive pour l’économie mondiale. L’émergence des BRICS conduirait à un monde plus juste et plus équitable.
Il y a un soupçon de déjà vu au sujet de ce «miracle économique». L’Argentine et les tigres asiatiques dans les années 1980 et 1990 ou plus récemment l’Irlande, l’Espagne, l’Islande ont tous été, à différents moments, présentés comme des «miracles économiques».
Tous ces pays devaient cette croissance rapide à une augmentation effrénée de la dette. Ils ont tous connu une même fin fâcheuse: la récession et la faillite.
3 ième soirée: Vendredi 25 mai – 19h30 à 22h30
La crise est-elle structurelle et peut-elle être contenue par une série de réformes et d’ajustements?
Bon nombre reconnaissent que l'économie connaît de grandes difficultés. Mais, prétendent ils «avec plus de contrôle de l’État sur les finances, nous pouvons construire une nouvelle économie, plus sociale et plus prospère». Est-ce qu’une plus grande ingérence de l’État peut résoudre les problèmes économiques? Les ménages, les entreprises, les banques et Etats, tous sont endettés. Qu’est-ce qu’on fait les États? Ils ont injecté des milliards de dollars dans l’économie afin d’éviter de nouvelles faillites en faisant des nouvelles dettes! Comment une réforme du système financier peut-elle ici apporter une réponse? Et les nationalisations alors? Depuis l’expérience de la Commune de Paris le rôle de l’État contre les ouvriers nous est connue. «L’Etat moderne, quel qu’en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l’Etat des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n’est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble». Depuis lors, chaque bourgeoisie nationale se range derrière son État pour mener la guerre commerciale internationale impitoyable.
Vie du CCI:
Rubrique:
Internationalisme no 355 - 3e trimestre 2012
- 1526 reads
Elections communales : rien que du bluff et des illusions
- 1241 reads
L'avenir ne se décide plus dans le bulletin de vote, mais dans la lutte sociale : classe contre classe
Avec l’automne, voici le retour du carnaval électoral, cette fois-ci sur le plan communal ; et avec lui, le cortège inépuisable de bluff, de magouilles politiciennes, de mensonges, d’illusions. Une fois de plus on nous appellera à remplir notre "devoir de citoyen", à participer par notre vote au choix d’une bonne gestion du système, d’un meilleur fonctionnement des services publics, cette fois-ci sur le plan communal, à nous mobiliser pour la "défense de la démocratie". En réalité, les dés sont pipés d’avance : c’est toujours la bourgeoisie qui gagne les élections. Que la gauche ou la droite l’emporte, Janssens ou De Wever, Reynders ou Di Rupo, tel candidat ou tel autre, pour les travailleurs, les chômeurs, les jeunes, cela signifie de toute façon la même politique d’attaques incessantes sur leurs conditions de vie.
C’est pourquoi, aujourd’hui le CCI souligne plus que jamais que la classe ouvrière n’a rien à attendre du terrain électoral. Cette attitude des révolutionnaires n’est pas liée aux spécificités des élections communales qui se dérouleront en octobre en Belgique, mais découle, comme le texte ci-dessous le rappelle, des caractéristiques générales du développement du capitalisme depuis le début du siècle précédent.
Face à l’angoisse de l’avenir, à la peur du chômage, au ras-le-bol de l’austérité et de la précarité, la bourgeoisie utilise les élections afin de pourrir la réflexion des ouvriers, en exploitant les illusions encore très fortes au sein du prolétariat.
Le refus de participer au cirque électoral ne s’impose pas de manière évidente au prolétariat du fait que cette mystification est étroitement liée à ce qui constitue le cœur de l’idéologie de la classe dominante, la démocratie. Toute la vie sociale dans le capitalisme est organisée par la bourgeoisie autour du mythe de l’Etat “démocratique”. Ce mythe est fondé sur l’idée mensongère suivant laquelle tous les citoyens sont “égaux” et “libres” de “choisir”, par le vote, leurs représentants politiques et le parlement est présenté comme le reflet de la “volonté populaire”. Cette escroquerie idéologique est difficile à déjouer pour la classe ouvrière du fait que la mystification électorale s’appuie en partie sur certaines vérités. La bourgeoisie utilise, en la falsifiant, l’histoire du mouvement ouvrier en rappelant les luttes héroïques du prolétariat pour conquérir le droit de vote. Face aux grossiers mensonges propagandistes, il est nécessaire de revenir aux véritables positions défendues par le mouvement ouvrier et ses organisations révolutionnaires. Et cela, non pas en soi, mais en fonction des différentes périodes de l’évolution du capitalisme et des besoins de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
La question des élections au 19e siècle dans la phase ascendante du capitalisme
Le 19e siècle est la période du plein développement du capitalisme pendant laquelle la bourgeoisie utilise le suffrage universel et le Parlement pour lutter contre la noblesse et ses fractions rétrogrades. Comme le souligne Rosa Luxemburg, en 1904, dans son texte Social-démocratie et parlementarisme : “Le parlementarisme, loin d’être un produit absolu du développement démocratique, du progrès de l’humanité et d’autres belles choses de ce genre, est au contraire une forme historique déterminée de la domination de classe de la bourgeoisie et ceci n’est que le revers de cette domination, de sa lutte contre le féodalisme. Le parlementarisme bourgeois n’est une forme vivante qu’aussi longtemps que dure le conflit entre la bourgeoisie et le féodalisme”. Avec le développement du mode de production capitaliste, la bourgeoisie abolit le servage et étend le salariat pour les besoins de son économie. Le Parlement est l’arène où les différents partis bourgeois s’affrontent pour décider de la composition et des orientations du gouvernement en charge de l’exécutif. Le Parlement est le centre de la vie politique bourgeoise mais, dans ce système démocratique parlementaire, seuls les notables sont électeurs. Les prolétaires n’ont pas le droit à la parole, ni le droit de s’organiser.
Sous l’impulsion de la 1ère puis de la 2e Internationale, les ouvriers vont engager des luttes sociales d’envergure, souvent au prix de leur vie, pour obtenir des améliorations de leurs conditions de vie (réduction du temps de travail de 14 à 10 heures, interdiction du travail des enfants et des travaux pénibles pour les femmes…). Dans la mesure où le capitalisme était alors un système en pleine expansion, son renversement par la révolution prolétarienne n’était pas encore à l’ordre du jour. C’est la raison pour laquelle la lutte revendicative sur le terrain économique au moyen des syndicats et la lutte de ses partis politiques sur le terrain parlementaire permettaient au prolétariat d’arracher des réformes à son avantage. “Une telle participation lui permettait à la fois de faire pression en faveur de ces réformes, d’utiliser les campagnes électorales comme moyen de propagande et d’agitation autour du programme prolétarien et d’employer le Parlement comme tribune de dénonciation de l’ignominie de la politique bourgeoise. C’est pour cela que la lutte pour le suffrage universel a constitué, tout au long du 19e siècle, dans un grand nombre de pays, une des occasions majeures de mobilisation du prolétariat”. (1) Ce sont ces positions que Marx et Engels vont défendre tout au long de cette période d’ascendance du capitalisme pour expliquer leur soutien à la participation du prolétariat aux élections.
La question des élections au 20e siècle, dans la phase de décadence du capitalisme
A l’aube du 20e siècle, le capitalisme a conquis le monde. En se heurtant aux limites de son expansion géographique, il rencontre la limitation objective des marchés : les débouchés à sa production deviennent de plus en plus insuffisants. Les rapports de production capitalistes se transforment dès lors en entraves au développement des forces productives. Le capitalisme, comme un tout, entre dans une période de crises et de guerres de dimension mondiale.
Un tel bouleversement va entraîner une modification profonde du mode d’existence politique de la bourgeoisie, du fonctionnement de son appareil d’Etat et, a fortiori, des conditions et des moyens de la lutte du prolétariat. Le rôle de l’Etat devient prépondérant car il est le seul à même d’assurer “l’ordre”, le maintien de la cohésion d’une société capitaliste déchirée par ses contradictions. Les partis bourgeois deviennent, de façon de plus en plus évidente, des instruments de l’Etat chargés de faire accepter la politique de celui-ci.
Le pouvoir politique tend alors à se déplacer du législatif vers l’exécutif et le Parlement bourgeois devient une coquille vide qui ne possède plus aucun rôle décisionnel. C’est cette réalité qu’en 1920, lors de son 2e congrès, l’Internationale communiste va clairement caractériser : “L’attitude de la 3ème Internationale envers le parlementarisme n’est pas déterminée par une nouvelle doctrine, mais par la modification du rôle du Parlement même. A l’époque précédente, le Parlement en tant qu’instrument du capitalisme en voie de développement a, dans un certain sens, travaillé au progrès historique. Mais dans les conditions actuelles, à l’époque du déchaînement impérialiste, le Parlement est devenu tout à la fois un instrument de mensonge, de tromperie, de violence, et un exaspérant moulin à paroles... A l’heure actuelle, le Parlement ne peut être en aucun cas, pour les communistes, le théâtre d’une lutte pour des réformes et pour l’amélioration du sort de la classe ouvrière, comme ce fut le cas dans le passé. Le centre de gravité de la vie politique s’est déplacé en dehors du Parlement, et d’une manière définitive”.
Désormais, il est hors de question pour la bourgeoisie d’accorder des réformes réelles et durables des conditions de vie de la classe ouvrière. C’est l’inverse qu’elle impose au prolétariat : toujours plus de sacrifices, de misère et d’exploitation. Les révolutionnaires sont alors unanimes pour reconnaître que le capitalisme a atteint des limites historiques et qu’il est entré dans sa période de déclin, comme en a témoigné le déchaînement de la Première Guerre mondiale. L’alternative était désormais : socialisme ou barbarie. L’ère des réformes était définitivement close et les ouvriers n’avaient plus rien à conquérir sur le terrain des élections.
Néanmoins un débat central va se développer au cours des années 1920 au sein de l’Internationale communiste sur la possibilité, défendue par Lénine et le parti bolchevique, d’utiliser la “tactique” du “parlementarisme révolutionnaire”. Face à d’innombrables questions suscitées par l’entrée du capitalisme dans sa période de décadence, le poids du passé continuait à peser sur la classe ouvrière et ses organisations. La guerre impérialiste, la révolution prolétarienne en Russie, puis le reflux de la vague de luttes prolétariennes au niveau mondial dès 1920 ont conduit Lénine et ses camarades à penser que l’on peut détruire de l’intérieur le Parlement ou utiliser la tribune parlementaire de façon révolutionnaire. En fait cette “tactique” erronée va conduire la 3e Internationale vers toujours plus de compromis avec l’idéologie de la classe dominante. Par ailleurs, l’isolement de la révolution russe, l’impossibilité de son extension vers le reste de l’Europe avec l’écrasement de la révolution en Allemagne, vont entraîner les bolcheviks et l’Internationale, puis les partis communistes, vers un opportunisme débridé. C’est cet opportunisme qui allait les conduire à remettre en question les positions révolutionnaires des 1er et 2e Congrès de l’Internationale communiste pour s’enfoncer vers la dégénérescence lors des congrès suivants, jusqu’à la trahison et l’avènement du stalinisme qui fut le fer de lance de la contre-révolution triomphante.
C’est contre cet abandon des principes prolétariens que réagirent les fractions les plus à gauche dans les partis communistes (2). A commencer par la Gauche italienne avec Bordiga à sa tête qui, déjà avant 1918, préconisait le rejet de l’action électorale. Connue d’abord comme “Fraction communiste abstentionniste”, celle-ci s’est constituée formellement après le Congrès de Bologne en octobre 1919 et, dans une lettre envoyée de Naples à Moscou, elle affirmait qu’un véritable parti, qui devait adhérer à l’Internationale communiste, ne pouvait se créer que sur des bases antiparlementaristes. Les gauches allemande et hollandaise vont à leur tour développer la critique du parlementarisme. Anton Pannekoek dénonce clairement la possibilité d’utiliser le Parlement pour les révolutionnaires, car une telle tactique ne pouvait que les conduire à faire des compromis, des concessions à l’idéologie dominante. Elle ne visait qu’à insuffler un semblant de vie à ces institutions moribondes, à encourager la passivité des travailleurs alors que la révolution nécessite la participation active et consciente de l’ensemble du prolétariat.
Dans les années 1930, la Gauche italienne, à travers sa revue Bilan, montrera de façon concrète comment les luttes des prolétaires français et espagnols avaient été détournées vers le terrain électoral. Bilan affirmait à juste raison que c’est la “tactique” des fronts populaires en 1936 qui avait permis d’embrigader le prolétariat comme chair à canon dans la 2ème boucherie impérialiste mondiale. A la fin de cet effroyable holocauste, c’est la Gauche communiste de France qui publiait la revue Internationalisme (dont est issu le CCI) qui fera la dénonciation la plus claire de la “tactique” du parlementarisme révolutionnaire : “La politique du parlementarisme révolutionnaire a largement contribué à corrompre les partis de la 3ème Internationale et les fractions parlementaires ont servi de forteresses de l’opportunisme (…). La vérité est que le prolétariat ne peut utiliser pour sa lutte émancipatrice “le moyen de lutte politique” propre à la bourgeoisie et destiné à son asservissement. Le parlementarisme révolutionnaire en tant qu’activité réelle n’a, en fait, jamais existé pour la simple raison que l’action révolutionnaire du prolétariat quand elle se présente à lui, suppose sa mobilisation de classe sur un plan extra-capitaliste, et non la prise des positions à l’intérieur de la société capitaliste.” (3) Désormais, la non participation aux élections, est une frontière de classe entre organisations prolétariennes et organisations bourgeoises. Dans ces conditions, depuis plus de 80 ans, les élections sont utilisées, à l’échelle mondiale, par tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, pour dévoyer le mécontentement ouvrier sur un terrain stérile et crédibiliser le mythe de la “démocratie”. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si aujourd’hui, contrairement au 19e siècle, les Etats “démocratiques” mènent une lutte acharnée contre l’abstentionnisme et la désaffection des partis, car la participation des ouvriers aux élections est essentielle à la perpétuation de l’illusion démocratique.
Les élections ne sont qu’une mystification
Contrairement à la propagande indigeste voulant nous persuader que ce sont les urnes qui gouvernent, il faut réaffirmer que les élections sont une pure mascarade.
Certes, il peut y avoir des divergences au sein des différentes fractions qui composent l’Etat bourgeois sur la façon de défendre au mieux les intérêts du capital national mais, fondamentalement, la bourgeoisie organise et contrôle le carnaval électoral pour que le résultat soit conforme à ses besoins en tant que classe dominante. C’est pour cela que l’Etat capitaliste organise, manipule, utilise ses médias aux ordres. Ainsi, depuis la fin des années 1920 et jusqu’à aujourd’hui, quel que soit le résultat des élections, que ce soit la droite ou la gauche qui sorte victorieuse des urnes, c’est finalement toujours la même politique anti-ouvrière qui est menée.
Ces derniers mois, la focalisation orchestrée par la bourgeoisie autour des élections présidentielles de mai 2007 a réussi momentanément à capter l’attention des ouvriers et à les persuader qu’elles étaient un enjeu pour leur avenir et celui de leurs enfants. Non seulement la bourgeoisie plonge le prolétariat dans la paupérisation absolue, mais en plus elle l’humilie en lui donnant “des jeux et du cirque électoral”. Aujourd’hui, le prolétariat n’a pas le choix. Ou bien il se laisse entraîner sur le terrain électoral, sur le terrain des Etats bourgeois qui organisent son exploitation et son oppression, terrain où il ne peut être qu’atomisé et sans force pour résister aux attaques du capitalisme en crise. Ou bien, il développe ses luttes collectives, de façon solidaire et unie, pour défendre ses conditions de vie. Ce n’est que de cette façon qu’il pourra retrouver ce qui fait sa force en tant que classe révolutionnaire : son unité et sa capacité à lutter en dehors et contre les institutions bourgeoises (parlement et élections) en vue du renversement du capitalisme. D’ailleurs, face à l’aggravation des attaques et malgré ce bourrage de crane électoraliste, le prolétariat est en train de développer une réflexion en profondeur sur la signification du chômage massif, sur les attaques à répétition, sur le démantèlement des systèmes de retraite et de protection sociale. A terme, la politique anti-ouvrière de la bourgeoisie et la riposte prolétarienne ne peuvent que déboucher sur une prise de conscience croissante, au sein de la classe ouvrière, de la faillite historique du capitalisme. Le prolétariat n’a pas à participer à la fabrication de ses propres chaînes, mais à les briser ! Au renforcement de l’Etat capitaliste, les ouvriers doivent répondre par la volonté de sa destruction !
L’alternative qui se pose aujourd’hui est donc la même que celle dégagée par les gauches marxistes dans les années 1920 : électoralisme et mystification de la classe ouvrière ou développement de la conscience de classe et extension des luttes vers la révolution ! n
D. (d'après Internationalisme n° 331, avril 2007)
(1) Plate-forme du CCI.
(2) Le CCI est l’héritier de cette Gauche communiste et nos positions en sont le prolongement.
(3) Lire cet article d’Internationalisme n°36 de juillet 1948, reproduit dans la Revue Internationale n°36.
Rubrique:
La pire des attaques à nos conditions de vie (pour le moment), jusqu'où ? comment riposter ? (tract)
- 1079 reads
Voici un tract avec lequel notre section en Espagne dénonce la pire attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière, une attaque qui paraîtra pourtant “légère” en comparaison à celles qui vont venir. C’est aussi une analyse de la situation, qui essaie d’apporter des solutions aux dernières luttes.

En 1984, le gouvernement du PSOE (Parti socialiste, de gauche) imposa la première Réforme du travail ; il y a tout juste trois mois, le gouvernement actuel du PP (Parti populaire, de droite) a mis en place la plus grave des Réformes du travail connue jusqu’ici. En 1985, le gouvernement du PSOE fit la première Réforme des retraites ; en 2011, un autre gouvernement de ce même PSOE en imposa une autre. Pour quand la prochaine ? Depuis plus de 30 ans, les conditions de vie des travailleurs ont empiré graduellement, mais depuis 2010 cette dégradation a pris un rythme frénétique et, avec les nouvelles mesures gouvernementales du PP, elle a atteint des niveaux qui, malheureusement, sembleront bien bas lors des futures attaques. Il y a, par-dessus le marché, un acharnement répressif de la part de la police : violence contre les étudiants à Valence en février dernier, matraquage en règle des mineurs, usage de balles en caoutchouc utilisées, entre autres, contre des enfants. Par ailleurs, le Congrès est carrément protégé par la police face aux manifestations spontanées qui s’y déroulent depuis mercredi dernier et qui s’y sont renouvelées dimanche 15 juillet...
Nous, l’immense majorité, exploitée et opprimée, mais aussi indignée ; nous, travailleurs du public et du privé, chômeurs, étudiants, retraités, émigrés..., nous posons beaucoup de questions sur tout ce qui se passe. Nous devons tous, collectivement, partager ces questionnements dans les rues, sur les places, sur les lieux de travail, pour que nous commencions tous ensemble à trouver des réponses, à donner une riposte massive, forte et soutenue.
L’effondrement du capitalisme
Les gouvernements changent, mais la crise ne fait qu’empirer et les coupes sont de plus en plus féroces. On nous présente chaque sommet de l’UE, du G20, etc.., comme la “solution définitive”... qui, le jour suivant, apparaît comme un échec retentissant ! On nous dit que les coupes vont faire baisser la prime de risque, et ce qui arrive est tout le contraire. Après tant et tant de saignées contre nos conditions de vie, le FMI reconnaît qu’il faudra attendre… 2025 (!) pour retrouver les niveaux économiques de 2007. La crise suit un cours implacable et inexorable, faisant échouer sur son passage des millions de vies brisées.
Certes, il y a des pays qui vont mieux que d’autres, mais il faut regarder le monde dans son ensemble. Le problème ne se limite pas à l’Espagne, la Grèce ou l’Italie, et ne peut même pas se réduire à la “crise de l’euro”. L’Allemagne est au bord de la récession et déjà, il s’y trouve 7 millions de mini-jobs (avec des salaires de 400 €) ; aux Etats-Unis, le chômage part en flèche à la même vitesse que les expulsions de domicile. En Chine, l’économie souffre d’une décélération depuis 7 mois, malgré une bulle immobilière insensée qui fait que, dans la seule ville de Pékin, il y a 2 millions d’appartements vides. Nous sommes en train de souffrir dans notre chair la crise mondiale et historique du système capitaliste dont font partie tous les Etats, quelle que soit l’idéologie officielle qu’ils professent –“communiste” en Chine ou à Cuba, “socialiste du 21ème siècle” en Équateur ou au Venezuela, “socialiste” en France, “démocrate” aux Etats-Unis, “libérale” en Espagne ou en Allemagne. Le capitalisme, après avoir créé le marché mondial, est devenu depuis presque un siècle un système réactionnaire, qui a plongé l’humanité dans la pire des barbaries (deux guerres mondiales, des guerres régionales innombrables, la destruction de l’environnement...) ; aujourd’hui, depuis 2007, après avoir bénéficié de moments de croissance économique artificielle à base de spéculation et de bulles financières en tout genre, il est en train de se crasher contre la pire des crises de son histoire, plongeant les États, les entreprises et les banques dans une insolvabilité sans issue. Le résultat d’une telle débâcle, c’est une catastrophe humanitaire gigantesque. Tandis que la famine et la misère ne font qu’augmenter en Afrique, en Asie et en Amérique latine, dans les pays “riches”, des millions de personnes perdent leur emploi, des centaines de milliers sont expulsées de leur domicile, la grande majorité n’arrive plus à boucler les fins de mois ; le renchérissement de services sociaux ultra-réduits rend l’existence très précaire, ainsi que la charge écrasante des impôts, directs et indirects.
L’Etat démocratique c’est la dictature de la classe capitaliste
Le capitalisme divise la société en deux pôles : le pôle minoritaire de la classe capitaliste qui possède tout et ne produit rien ; et le pôle majoritaire des classes exploitées, qui produit tout et reçoit de moins en moins. La classe capitaliste, ce 1 % de la population comme le disait le mouvement Occupy aux États-Unis, apparaît de plus en plus corrompue, arrogante et insultante. Elle cumule les richesses avec un culot indécent, se montre insensible face aux souffrances de la majorité et son personnel politique impose partout des coupes et de l’austérité... Pourquoi, malgré les grands mouvements d’indignation sociale qui se sont déroulés en 2011 (Espagne, Grèce, Etats-Unis, Egypte, Chili etc..), continue-t-elle avec acharnement à appliquer des politiques contre les intérêts de la majorité ? Pourquoi notre lutte, malgré les précieuses expériences vécues, est si en dessous de ce qui serait nécessaire ?
Une première réponse se trouve dans la tromperie que représente l’Etat démocratique. Celui-ci se présente comme étant “l’émanation de tous les citoyens” mais, en vérité, il est l’organe exclusif et excluant de la classe capitaliste, il est à son service, et pour cela il possède deux mains : la main droite composée de la police, des prisons, des tribunaux, des lois, de la bureaucratie avec laquelle elle nous réprime et écrase toutes nos tentatives de révolte ; et la main gauche, avec son éventail de partis de toutes idéologies, avec ses syndicats apparemment indépendants, avec ses services de cohésion sociale qui prétendent nous protéger..., qui ne sont que des illusions pour nous tromper, nous diviser et nous démoraliser.
A quoi ont-ils servi, tous ces bulletins de vote émis tous les quatre ans ? Les gouvernements issus des urnes ont-ils réalisé une seule de leurs promesses ? Quelle que soit leur idéologie, qui ont-ils protégé ? Les électeurs ou le capital ?
À quoi ont servi les réformes et les changements innombrables qu’ils ont faits dans l’éducation, la sécurité sociale, l’économie, la politique, etc.. ? N’ont-t-ils pas été en vérité l’expression du “tout doit changer pour que tout continue pareil” ? Comme on le disait lors du mouvement du 15-Mai : “On l’appelle démocratie et ça ne l’est pas, c’est une dictature mais on ne le voit pas.”
Face à la misère mondiale, révolution mondiale contre la misère !
Le capitalisme mène à la misère généralisée. Mais ne voyons pas dans la misère que la misère ! Dans ses entrailles se trouve la principale classe exploitée, le prolétariat qui, par son travail associé – travail qui ne se limite pas à l’industrie et à l’agriculture mais qui comprend aussi l’éducation, la santé, les services, etc.. –, assure le fonctionnement de toute la société et qui, par là même, a la capacité tant de paralyser la machine capitaliste que d’ouvrir la voie à une société où la vie ne sera pas sacrifiée sur l’autel des profits capitalistes, où l’économie de la concurrence sera remplacée par la production solidaire pour la pleine satisfaction des besoins humains. En somme, une société qui dépasse le nœud de contradictions dans lesquelles le capitalisme tient l’humanité prisonnière.
Cette perspective, qui n’est pas un idéal mais le fruit de l’expérience historique et mondiale de plus de deux siècles de luttes du mouvement ouvrier, paraît cependant aujourd’hui difficile et lointaine. Nous en avons déjà mentionné une des causes : on nous berce avec l’illusion de l’Etat démocratique. Mais il y a d’autres causes plus profondes : la plupart des prolétaires ne se reconnaissent pas comme tels. Nous n’avons pas confiance en nous-mêmes en tant que force sociale autonome. Par ailleurs, et surtout, le mode de vie de cette société, basé sur la concurrence, sur la lutte de tous contre tous, nous plonge dans l’atomisation, dans le chacun pour soi, dans la division et l’affrontement entre nous.
La conscience de ces problèmes, le débat ouvert et fraternel sur ceux-ci, la récupération critique des expériences de plus de deux siècles de lutte, tout cela nous donne les moyens pour dépasser cette situation et nous rend capables de riposter. C’est le jour même (11 juillet) où Rajoy a annoncé les nouvelles mesures que quelques ripostes ont immédiatement commencé à poindre. Beaucoup de monde est allé à Madrid manifester sa solidarité avec les mineurs. Cette expérience d’unité et de solidarité s’est concrétisée les jours suivants dans des manifestations spontanées, appelées à travers les réseaux sociaux. C’était une initiative, hors syndicats, propre aux travailleurs du public ; comment la poursuivre en sachant qu’il s’agit d’une lutte longue et difficile ? Voici quelques propositions :
La lutte unitaire
Chômeurs, travailleurs du secteur public et du privé, intérimaires et fonctionnaires, retraités, étudiants, immigrés, ensemble, nous pouvons. Aucun secteur ne peut rester isolé et enfermé dans son coin. Face à une société de division et d’atomisation nous devons faire valoir la force de la solidarité.
Les assemblées générales et ouvertes
Le capital est fort si on laisse tout entre les mains des professionnels de la politique et de la représentation syndicale qui nous trahissent toujours. Il nous faut des assemblées pour réfléchir, discuter et décider ensemble. Pour que nous soyons tous responsables de ce que nous décidons ensemble, pour vivre et ressentir la satisfaction d’être unis, pour briser les barreaux de la solitude et de l’isolement et cultiver la confiance et l’empathie.
Chercher la solidarité internationale :
Défendre la nation fait de nous la chair à canon des guerres, de la xénophobie, du racisme ; défendre la nation nous divise, nous oppose aux ouvriers du monde entier, les seuls pourtant sur lesquels nous pouvons compter pour créer la force capable de faire reculer les attaques du capital.
Nous regrouper
Nous regrouper dans les lieux de travail, dans les quartiers, par Internet, dans des collectifs pour réfléchir à tout ce qui se passe, pour organiser des réunions et des débats qui impulsent et préparent les luttes. Il ne suffit pas de lutter ! Il faut lutter avec la conscience la plus claire de ce qui arrive, de quelles sont nos armes, de qui sont nos amis et nos ennemis !
Tout changement social est indissociable d’un changement individuel
Notre lutte ne peut pas se limiter à un simple changement de structures politiques et économiques, c’est un changement de système social et, par conséquent, de notre propre vie, de notre manière de voir les choses, de nos aspirations. Ce n’est qu’ainsi que nous développerons la force de déjouer les pièges innombrables que nous tend la classe dominante, de résister aux coups physiques et moraux qu’elle nous donne sans trêve. Nous devons développer un changement de mentalité qui nous ouvre à la solidarité, à la conscience collective, lesquelles sont plus que le ciment de notre union, mais aussi le pilier d’une société future libérée de ce monde de concurrence féroce et de mercantilisme extrême qui caractérise le capitalisme. n
CCI / 16.07.2012
Rubrique:
La situation en Syrie et au Mali révèle l'avenir dans le capitalisme
- 1314 reads
 Depuis plus d’un an et demi en Syrie, le pouvoir d’Assad bombarde, massacre, viole et torture, sous les yeux d’une “communauté internationale” qui se répand en lamentations hypocrites sur le sort d’une population syrienne soumise quotidiennement à toutes ces horreurs. De part et d’autre, les réunions internationales se multiplient, dénonçant les 16.000 morts de la répression syrienne, tout comme les appels à la paix assortis de menaces plus stériles les unes que les autres. Bernard Henry Lévi, ce “philosophe” représentant sans faille des intérêts impérialistes de la bourgeoisie française et insatiable samouraï des plateaux télés et des salons parisiens depuis la guerre en ex-Yougoslavie, n’en peut plus d’appeler à l’intervention militaire en Syrie, à l’instar des États-Unis dont le doigt est sur la gâchette pour régler son compte au potentat syrien.
Depuis plus d’un an et demi en Syrie, le pouvoir d’Assad bombarde, massacre, viole et torture, sous les yeux d’une “communauté internationale” qui se répand en lamentations hypocrites sur le sort d’une population syrienne soumise quotidiennement à toutes ces horreurs. De part et d’autre, les réunions internationales se multiplient, dénonçant les 16.000 morts de la répression syrienne, tout comme les appels à la paix assortis de menaces plus stériles les unes que les autres. Bernard Henry Lévi, ce “philosophe” représentant sans faille des intérêts impérialistes de la bourgeoisie française et insatiable samouraï des plateaux télés et des salons parisiens depuis la guerre en ex-Yougoslavie, n’en peut plus d’appeler à l’intervention militaire en Syrie, à l’instar des États-Unis dont le doigt est sur la gâchette pour régler son compte au potentat syrien.
Et, depuis six mois, le Mali est entré dans une situation de guerre qui n’offre elle aussi aucune perspective d’apaisement avant longtemps. Là encore, les dignes représentants de la bourgeoisie démocratique occidentale n’ont de cesse de s’offusquer et de s’inquiéter de l’enfer qui attend les habitants de cette région où les bandes armées peu ou prou islamistes sévissent sans vergogne. Mais qu’en est-il de ces velléités et de tout ce battage médiatique censé nous interpeller sur le sort de ces deux pays en particulier ? Rien ! Du vent et encore du vent !
Non seulement les grandes puissances ne se préoccupent au fond aucunement de la barbarie que vivent les populations vivant en Syrie ou au Mali, comme partout ailleurs, mais elles n’ont pour réelle problématique que de calculer les bénéfices possibles à tirer d’une intervention militaire et les risques qui en découleraient.
Ces deux situations sont une expression critique de l’impasse dans laquelle se trouve le monde capitaliste et de l’impuissance dans laquelle sont plongées les puissances occidentales.
Au Mali, une population prise au piège…
Au Mali, il s’agit d’un imbroglio qui est directement issu à la fois de la pourriture sociale qu’a laissé derrière lui le colonialisme français et de son incapacité à faire vivre un État malien suffisamment stable. L’explosion des différentes fractions qui sont apparues ces derniers mois en dit assez long sur l’état de déliquescence de toute cette région, bien au-delà du Mali proprement dit. De l’Aqmi au Mnla en passant par les divers groupes dissidents et opposants au régime de Bamako, tous plus “vrais croyants” les uns que les autres, il s’agit de cliques de bandits armés qui ne sont pas apparues hier par enchantement. On nous dit que le facteur déclenchant de cette nouvelle zone de chaos sahélienne a été le retour des touaregs anciennement enrôlés par Khadafi, c’est-à-dire de centaines d’hommes entraînés, aguerris, et traînant avec eux des armes lourdes.
Comme s’il ne fallait pas s’y attendre ! Comble de “surprise”, la Libye n’ayant pas de frontières communes avec le Mali, les touaregs ont dû franchir deux frontières : Libye-Algérie et Algérie-Mali. Et ils n’ont même pas été désarmés (!), venant grossir de façon significative les rangs et les forces d’une rébellion touarègue chronique, excitant de ce fait les appétits des petits truands locaux et régionaux.
Car le ver était depuis longtemps dans le fruit. Le Mali, avec l’ensemble du Sahel, fait en effet partie de ces endroits historiquement difficilement contrôlables du fait de l’existence d’une myriade de populations aux cultures différentes et parmi lesquelles les ex-puissances coloniales, en l’occurrence la France, ont pendant plus de 150 ans excité et entretenu les dissensions, selon l’adage : “diviser pour mieux régner”. Et si la situation actuelle est le produit de ce qu’on appelait la “Françafrique”, elle ne peut qu’être aggravée par la guerre larvée qui se mène entre les États-Unis et la France depuis vingt ans pour le contrôle du marché des matières premières africaines.
Après le Soudan, il n’est donc pas impossible que le Mali connaisse une partition en deux États. En attendant, une épidémie de choléra se développe à Goa, que les islamistes forcenés ont de surcroît miné aux alentours, prenant toute la population en otage. Mais, soyons rassurés, le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à des sanctions contre les rebelles du nord du Mali dans une résolution adoptée à l’unanimité jeudi, tandis que la Cedeao refuse toute ingérence militaire occidentale dans le pays !
… comme en Syrie
Ville après ville, le pays est soumis à un bombardement d’artillerie intense et la population est piégée dans les maisons ou les caves, privée de nourriture et d’électricité durant des jours, voire des semaines. Les snipers de l’armée s’installent sur les toits, cueillant ceux qui sont assez fous pour tenter de trouver à manger pour leurs familles. Et lorsque la ville tombe au bout du compte, toutes les familles sont frappées de façon directe et personnelle, soit par les soldats de l’armée régulière, ou plus fréquemment – du fait des désertions massives des soldats dégoûtés de ce qu’ils ont été contraints de faire – par des bandes de vagues criminels nommés “Shabiha”, c’est-à-dire des “fantômes”. Les deux massacres les plus connus ont eu lieu à Houla et Mazraat al-Qubair, mais ils sont loin d’être les seuls exemples.
Avec l’arrogance la plus éhontée, les porte-parole du régime justifient ces bains de sang par l’existence de “groupes terroristes armés” qui auraient pris place dans les villes en question. Très souvent, ils accusent même les massacres les plus médiatisés de femmes et d’hommes comme étant du fait de ces groupes, agissant prétendument pour jeter le discrédit sur le gouvernement.
Devant les larges protestations qui ont surgi contre sa domination lors d’autres mouvements massifs à travers l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Bashar el-Assad a essayé de suivre les traces de son père : en 1982, Hafez el-Assad avait dû faire face à un autre soulèvement, conduit par les Frères musulmans et concentré sur Hama. Le régime avait envoyé l’armée et provoqué une atroce boucherie : le nombre de morts a été estimé entre 17.000 et 40.000. La révolte fut écrasée et la dynastie Assad a pu maintenir un contrôle plus ou moins contesté sur le pays pendant presque 30 ans.
Ce qui a débuté l’an dernier comme une révolte populaire non-armée contre le régime d’Assad s’est transformé en guerre locale entre les puissances impérialistes régionales et mondiales. L’Iran, allié principal de la Syrie dans la région, se tient fermement aux côtés d’Assad, et on sait que des Gardiens de la Révolution ou autres agents de la République islamique travaillent sur le terrain et sont complices de la campagne de terreur d’Assad. Ce dernier continue également de profiter de la protection de la Russie et de la Chine, qui s’activent au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour bloquer les résolutions condamnant son gouvernement et appelant à des sanctions. Même si la Russie a été contrainte, devant les atrocités commises, de modérer sa position, faisant ses premières critiques timides des massacres d’Assad, son soutien à une politique de “non-intervention” revient à renforcer son aide massive en armes envers la Syrie. Hillary Clinton a récemment accusé la Russie d’alimenter la Syrie en hélicoptères d’attaques – ce à quoi le ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a répondu que les hélicoptères n’avaient qu’une destination “défensive” et que, de toute façon, l’Ouest armait les rebelles. Ce qui est également vrai.
Car dès que l’opposition s’est coalisée en force bourgeoise politique sérieuse autour de l’Armée libre de Syrie et du Conseil national syrien, il y a eu des acheminements d’armes depuis l’Arabie Saoudite et le Qatar.
Quant à la Turquie, alors qu'elle a longtemps manifest de bonnes relations avec le régime d'Assad, ces derniers mois ont vu son discours radicalement changer avec une condamnation de son inhumanité, offrant sa protection aux militaires dissidents et aux réfugiés fuyant le massacre.
Au niveau militaire, elle a amassé des forces considérables sur sa frontière syrienne et, dans le même discours accusant Moscou de soutenir la Syrie, Hillary Clinton a suggéré que l'arrivée massive de troupes syriennes autour d'Aleppo, proche de la frontière turque, "pourrait bien être une ligne rouge pour les Turcs en termes de défense de leurs intérêts nationaux stratégiques." De la part de l'Etat turc, il s'agit d'une politique de provocation évidente (1) destinée à lui assurer aux yeux des puissances occidentales un statut renforcé de puissance majeure au niveau régional.
La politique de terreur, loin de renforcer la main de fer d’Assad sur le pays, a fait bouillir le tout dans une perspective de conflit impérialiste imprévisible. Les divisions ethniques et religieuses à l’intérieur du pays ne cessent de s’accroître. Les Iraniens soutiennent la minorité Alawite, c’est-à-dire les Saoudiens, et sans aucun doute tout un tas de djihadistes hors de contrôle attirés par le conflit, afin d’imposer une sorte de régime sunnite. Les tensions montent aussi entre chrétiens et musulmans, et entre Kurdes et Arabes. Le tout dans un contexte où Israël fait pression sur les États-Unis pour attaquer l’Iran et menace de faire le boulot lui-même. Aussi, une escalade de la guerre en Syrie aurait pour effet de mettre encore plus en lumière la question de l’Iran, avec les conséquences encore plus dévastatrices qui s’ensuivraient.
Les répercussions sociales et politiques d’un nouveau théâtre de guerre s’ouvrant aux grandes puissances dans cette région syrienne ravagée seraient incalculables. Il en est de même au Mali où le risque d’embrasement de tout le Sahel est réel avec la création d’un immense foyer de conflits traversant l’Afrique d’Ouest en Est.
Nous ne pouvons donc pas prédire si les puissances occidentales interviendront dans la période à venir, que ce soit en Syrie ou au Mali, car la situation ne serait alors probablement pas contrôlable. Mais qu’elles le fassent ou non, les morts s’entassent et leurs grands discours “humanitaires” montrent ce qu’ils valent : mensonges, mépris des populations et calculs d’intérêts.
Wilma/7.07.2012
(1) La destruction d'un avion turc dans l'espace aérien libyen en est une preuve.
Géographique:
- Afrique [3]
- Moyen Orient [9]
Rubrique:
C'est quoi en fait l'impérialisme ? Dans quel contexte surgit-il ? quelle est son origine ?
- 20969 reads
Le texte que nous publions ci-dessous faisait figure d’introduction à une discussion du cercle de discussion Spartacus le 11 mars à Anvers.
Le cercle Spartacus se définit comme suit : " Spartacus est l’initiative de quelques jeunes qui veulent consciemment créer des moments de clarification politique en confrontant différents points de vue et visions. Nous voulons créer un endroit où l’on peut mener un débat libre sur des sujets engagés. Spartacus doit devenir selon nous un groupe engagé et militant et pas un ‘club de baratineurs’ académiste ou lieu de ‘formation’ scolaire. Car pour un meilleur monde, il faut lutter. Cependant, la question qui se pose est " Comment ? ". Le sens d’un groupe de discussion se reflète dans cette question, où la théorie et la pratique se joignent. En discutant, nous espérons développer notre propre conscience et celles des autres sur nos actes.(…) "
Le texte introductif développe très bien la question de l’impérialisme au cours de l’histoire, dès les sociétés antiques jusqu’à la société capitaliste, ce que nous avons souligné lors de cette soirée.
(https://discussiegroepspartacus.wordpress.com/2012/03/10/inleiding-imperialisme/#more-1234 [14])
Ce qui selon notre point de vue manquait était l’insistance qui doit être mis sur le rôle que l’impérialisme va jouer dès que le capitalisme dépasse son sommet de développement. C’est surtout Rosa Luxemburg qui au début du 20ième siècle va lier la question de la crise de surproduction avec la tendance générale de la politique impérialiste appliquée par tous les États et pose ainsi les bases pour la combattre efficacement.
Comme l’écrivait Rosa Luxembourg, “L'impérialisme actuel est (…) la dernière étape de son processus historique d'expansion : la période de la concurrence mondiale accentuée et généralisée des états capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe. Dans cette phase finale, la catastrophe économique et politique constitue l'élément vital, le mode normal d'existence du capital, autant qu'elle l'avait été dans sa phase initiale, celle de l' " accumulation primitive ". (…) De même, dans la phase finale de l'impérialisme, l'expansion économique du capital est indissolublement liée à la série de conquêtes coloniales et de guerres mondiales que nous connaissons. (…) Ainsi l'impérialisme ramène la catastrophe, comme mode d'existence, de la périphérie de son champ d'action à son point de départ. (…)l'expansion capitaliste précipite aujourd'hui les peuples civilisés de l'Europe elle-même dans une suite de catastrophes dont le résultat final ne peut être que la ruine de la civilisation ou l'avènement de la production socialiste. A la lumière de cette conception, l'attitude du prolétariat à l'égard de l'impérialisme est celle d'une lutte générale contre la domination du capital..”( R. Luxemburg,Critique des critiques).
(Voir aussi : https://fr.internationalism.org/ri372/imperialisme.html#sdfootnote1sym [15])
Une grande partie de ce travail n'est pas sur l'impérialisme même parce que le terme impérialisme est souvent utilisé en vase clos et souvent à propos d’appareils d’États ou de politique étrangère de certains États. Toutefois, il est important de voir l'impérialisme comme un développement historique associé à d'autres développements qui font partie d’une certaine logique. Ce texte ne vise donc pas tellement à chercher à définir bêtement l'impérialisme mais surtout à mettre à nu cette "logique". De cette expérience, il m'est apparu clairement que chercher à définir l'impérialisme est un exercice qui porte peu de fruits pour une meilleure compréhension politique. Or, c'est bien cela que nous recherchons ?
Une quête de l'impérialisme.
Nous recherchons une définition de l'impérialisme qui nous donne une compréhension de quelque chose dont nous pouvons pointer ce qui en fait partie (par ex. Les guerres), mais pas quels sont les critères qui font en sorte que certains phénomènes historiques en font partie. Nous voulons avant tout que ces critères nous offrent une compréhension de ce qui est typique des conflits entre les États, à notre époque.
Une première tentative.
A première vue, définir ce qu'est l'impérialisme ne semble pas être si difficile. Nous pouvons faire référence à l'élément central dans impérialisme: "Imperium". Imperium renvoie à la possibilité de commander (en latin : imperare). Mais toutefois, le mot "Imperium" nous fait plutôt penser à un type spécifique d'État et l'exemple typique en Europe Occidentale est l'Empire romain (Latin : Imperium Romanum).
Mais un (ou plusieurs) Empire(s) ne semble pas suffire pour parler d'impérialisme. En effet, un "isme" se réfère à une propagation plus large, une tendance générale, une idéologie, une ère ou quelque chose de similaire (1).
Une seconde tentative : États et lutte.
Nous devons donc chercher une tendance générale qui est censée se trouver dans une période historique. Supposons un instant que l'impérialisme est une période où les États essayent de construire un empire mondial. Les États entrent alors en conflit. Dans une telle définition, l'impérialisme est de tous les temps. Des périodes historiques dans lesquelles de tels conflits permanents pour des territoires existaient sont nombreux. Nous pensons par exemple aux guerres entre l'Empire romain et les Sassanides (250-550 après JC), les Mayas et leurs peuples voisins (250-900 après JC), les Grecs et les Perses (400 av. J.-C. – 60 après JC), les Turcs et les arabes (av. 1000-1200 après JC) etc.
L’avidité de conquête semble fondamentale pour l'impérialisme. Pourtant, je dirais que ce ne sont pas des exemples d’impérialisme. Nous devons affiner pour en avoir une meilleure compréhension. Un exemple pour démontrer que de tels conflits ne relèvent pas de l’impérialisme: la guerre de Cent Ans (1337-1453) entre la maison de Valois (France) et la maison de Plantagenet (Angleterre) pour le trône du royaume Occidental des Francs tel qu'il a surgi après la division de l'empire carolingien (888 après JC). Ce combat impliquait deux appareils d’État développés qui convoitaient les mêmes zones. Les deux maisons possédaient déjà des territoires et si l’une obtenait la victoire sur l’autre, cela lui garantissait la domination sur l’Europe occidentale.
Mais je pense qu'une telle définition de l'impérialisme rend trop peu en évidence les développements des 300 dernières années qui ont donné naissance au terme impérialisme même. La base : l'impérialisme est une période historique dans laquelle les États entrent en conflit entre eux parce qu'ils tentent de conquérir des territoires les uns des autres. Mais nous devons ajouter deux autres hypothèses: 1) les États concernés ne sont pas en premier lieu intéressés dans un territoire aussi vaste que possible et 2) les zones pour lesquelles les États se battent ne font pas parties des territoires des États impérialistes, mais de territoires d’autres États, moins puissants (à condition que des États existent sur ce territoire). La Guerre de Cent ans dans ce sens n'est pas une guerre impérialiste : il s'agissait de territoires appartenant aux deux États qui étaient intéressés par un territoire aussi grand que possible. La raison pour cela réside dans l'utilité spécifique de ces territoires au cours de la guerre de Cent ans : plus de territoire signifiait plus de seigneurs tributaires qui à leur tour saignaient la pyramide de soumis. Il importait peu quel territoire l'on capturait: toutes les régions d'Europe connaissaient la même structure et leur conquête donnait tout simplement au roi plus de revenus. Peu importait si l'on pouvait acquérir le comté de Hollande, le Royaume de Bohême ou le comté de Navarre. Au Moyen Age, tous les territoires étaient similaires. L'impérialisme implique donc une troisième chose: 3) que les États aient un intérêt réel dans des caractéristiques économiques très spécifiques de la zone concernée. Il est de plus en plus évident que l'impérialisme est enraciné dans le capitalisme.
L'impérialisme et ses prédécesseurs.
Nous commençons avec l’État-Cité, comme il existait par exemple dans la Grèce classique, à la fin du Moyen-Âge Européen et le Moyen-Âge islamique. L’État-Cité s'est formé comme un lieu de rassemblement de commerçants dans un endroit sûr souvent créé par la présence militaire. Le commerce se faisait avec d'autres (proto-)villes et la campagne environnante. Les commerçants de la ville avaient souvent une relation symbiotique avec les militaires : ils leur offraient les biens et services dont ils avaient besoin et les militaires donnaient les biens et l'argent dont les commerçants à leur tour avaient besoin. Souvent on était militaire et marchand en même temps, ou encore les habitants de la ville étaient censés contribuer à la puissance militaire comme réservistes. L’État-Cité, puissance économique et militaire, était en mesure de soumettre tant militairement qu'économiquement la campagne environnante. L'utilité de cette domination réside dans les relations économiques inégales qui en résultent. Une campagne indépendante permettait à l'agriculteur de décider ce qu'il produisait et éventuellement avec qui il échangeait contre son prix. La soumission à une ville signifiait, dans le cas le moins grave, que l'agriculteur ne pouvait écouler son produit qu’uniquement dans la ville dominante. Cependant, existait également la situation où l'agriculteur était obligé de céder une partie de sa production (p. ex. en Mésopotamie antique) ou encore où il récupérait une partie de ses biens en devises de la ville (p. ex. Le Levant médiéval), ou encore où il devait céder la totalité de son produit et où sa famille devenait esclave de la ville (p. ex. en Grèce Antique).
Un exemple : la ville de Rome, dans les premiers siècles avant J.C. Elle était impliquée dans une guerre éternelle avec Carthage. Après une longue guerre, les Romains ont détruit Carthage mais ont conquis la campagne environnante (!) pour s’approprier l’abondante production de grain. Carthage ne pouvait plus appliquer des prix élevés sur le troc, la campagne répondait maintenant directement à Rome. Il en va de même pour beaucoup d'États-Cités, sous une forme ou une autre: l'assujettissement d'autres territoires plus faibles afin d’acquérir de ces territoires un plus grand bénéfice.
Comme dans l'impérialisme moderne il y avait souvent des alliances entre les États-Cités afin de défendre conjointement les intérêts individuels.
Dans le haut moyen-âge européen, la campagne était dominante et les villes soumises aux seigneurs ruraux qui les dominaient par leur importance économique et supériorité numérique. Les rois et les empereurs, qui étaient supérieurs aux seigneurs ruraux mais fortement dépendant d'eux, ont vu des opportunités dans les villes émergentes. Parce que les seigneurs organisaient eux-mêmes ce qui allait dans les caisses du roi, celui-ci commence bientôt à comprendre que les nouvelles villes offraient une occasion de consolider son propre pouvoir. Les villes émergentes et en expansion étaient exemptées des revendications des seigneurs locaux, étaient des refuges où les serfs en fuite pouvaient s'établir et étaient directement soumises et tributaires du roi ou de l'empereur. Un exemple d'un roi qui maîtrisait bien ce processus était, par exemple. Frédéric I, ou Barberousse. Ces villes devenaient ce que l'on appelait " villes Royales " ou " Villes de la Couronne ". Au travers des siècles, les villes et ses citoyens dépassaient par une croissance proto-capitaliste les seigneurs "appauvris". Nous utilisons ici des parenthèses parce que les seigneurs locaux ne produisent pas substantiellement plus ou moins (ils ont toujours été "pauvres"). La ville, mais surtout la campagne qui tombait sous l'influence de la ville, connaissaient une croissance beaucoup plus rapide. En Europe occidentale, par exemple en Hollande, la campagne fut capitalisée au XVe siècle (au lieu d’être féodalisée). La terre pouvait être vendue (chose inconcevable auparavant), et les agriculteurs incorporés comme travailleurs libres sur ces mêmes terres. Les propriétaires de la terre, vous l'aurez bien sûr deviné étaient: les citoyens des villes. Les États modernes, comme nous venons de le décrire avec des villes dominantes et un roi central ou une structure républicaine, ont connu la prospérité. La force et la portée des pays riches se sont accrues parce qu'il y avait croissance économique. C'est l'endroit où s'est créé ce que nous appelons "l'impérialisme".
Impérialisme
L'impérialisme est le processus par lequel des États nationaux ou pré-nationaux, par des moyens de soumission économique et militaire, rendent des régions économiquement plus faibles dépendantes d’un État dominant. Cela crée nécessairement un conflit entre ces États nationaux, car les régions économiquement plus faibles sont rares. Ce processus a commencé à se produire à partir du début du 16ème siècle dans les États européens, par exemple avec la Compagnie des Indes orientales dans la République des Sept Provinces des Pays-Bas-Unis. Toutefois, cela ne signifie pas que seuls les États européens sont impérialistes : c'est un processus, une logique de conflit entre États dans le cadre du capitalisme. Le but de conquérir ces régions économiquement plus faibles est double et les accents varient selon les circonstances: 1) réduire les coûts de production par des moyens de production moins chers ou 2) dominer le marché local pour écouler ses propres produits. On voit déjà surgir ces deux processus dans les relations entre la ville et la campagne, mais dans l'impérialisme, ils ont une nouvelle dimension. L'origine des deux se situe donc dans un (proto)-capitalisme. Qu’est-ce que j’entends par économiquement plus faible ? Je veux dire par là, essentiellement un manque de capital propre dans les limites d'une certaine région déterminée, où il devient impossible de développer soi-même une certaine puissance économique.
D'une part, cette zone reste militairement arriérée. La région se rend surtout intéressante par sa main d’œuvre moins coûteuse pour la production de produits à forte intensité de main-d'œuvre, surtout les matières premières rares. D’autre part, il y a aussi le potentiel d’écoulement des marchés que le capitalisme recherche dans les limites d'un territoire soumis. Par exemple, au XVII siècle, le Pendjab avait développé une proto-industrie où le lin était transformé en toutes sortes de produits. Par la conquête des anglais, avec un développement supérieur de leurs moyens de production, se développèrent rapidement des produits à base de lin meilleur marché à l’intérieur et pour le marché anglais. Quand celui-ci s’est avéré saturé et que le coût minimum du lin atteignait le fond, le lin a également été écoulé sur le marché du Pendjab (où là encore, un prix fort était demandé). Le résultat fut une famine dans le Pendjab, puisque pour le Pendjab, en raison de leurs produits coûteux, le marché en Grande-Bretagne était déjà devenu caduc. La destruction du marché local a été le coup de massue pour l'industrie des tisserands de lin. L'exemple provient d’Eric Hobsbawm.
Les marxistes à leur tour ont mis l’accent sur diverses composantes du processus, mais il existe une logique symbiotique entre les deux parties du processus. Une école récente de
Marxistes en sociologie/histoire, a essayé de réunir les deux en une seule description. Le sociologue Immanuel Wallerstein affirme qu’historiquement, les territoires étaient divisés en trois parties: le centre, les États semi-périphériques et les États périphériques. Les États centraux produisaient des biens et des services à forte valeur ajoutée, dont la production nécessitait un degré élevé de capital. Les États centraux essayaient activement de garder la compétitivité de leur capital sur leurs concurrents et la périphérie. Les États centraux ont une relation générale dominante sur les États périphériques. Les États périphériques vendent bon marché les matières premières nécessaires aux États centraux et importent de ces derniers les produits plus chers de haute qualité. Il en résulte un système de commerce mondial où l'impérialisme, la conquête d'autres États en vue d’importer et d’exporter forment une substance nécessaire dans la lutte concurrentielle de la bourgeoisie des centres.
Je pense avoir défini dans une certaine mesure l’impérialisme. Il y a encore suffisamment de place ici pour en discuter.
Pratique politique
Nous voulons nous positionner face à l'impérialisme. Mais à partir de quelles positions pouvons-nous choisir? Le court texte qui suit présente des idéologies qui ne sont pas élaborées mais plus une collection d'idées qui sont souvent combinées.
L'approche des conservateurs et libéraux. ans celle-ci, on suppose que la conquête des États n'a rien à voir avec une base matérielle de l'augmentation des profits, mais est considérée comme une partie nécessaire de la condition humaine. La guerre a été de tous les temps, les batailles entre les empires aussi. Un affaiblissement, une perte de volonté de se battre, une décadence, comme le conservateur historien Edward Gibbon l’appelle dans le cas de l'Empire romain, feront en sorte que les empires périssent. Il vaut mieux donc s’armer contre les autres groupes et territoires. Cela fait complètement abstraction de la nature historique de l'impérialisme !
Une forme particulière de cette approche conservatrice, est l'idée du "choc des civilisations" (Huntington). C'est l'idée que les empires se composent réellement de groupes culturellement homogènes qui devront combattre ensemble pour la vie et la mort. Mais ici aussi une base matérielle est niée. Le monde serait composé d’idéologies, de religions et de cultures qui pour des raisons encore obscures mais évidentes ne s’accordent pas les unes les autres une place au soleil.
L'approche sociale-démocrate . Ici, on préfère ne pas parler d’'impérialisme et on ne voit que les cas concrets d’exploitation dans les pays qui se trouvent à la périphérie. On essaie de remédier à ces cas d'exploitation par des accords internationaux ou par des interdits moraux. On part du fait qu’une entreprise (Nike) ou "un pays" (les mines de l'État chinois) exploite ses ouvriers, mais on ne tient pas compte du contexte plus large qui se trouve derrière. Au mieux, cela a à voir ou bien avec l'avarice des entreprises (sociaux-démocrates), la consommation excessive des Occidentaux (verts/consommation éthique), ou le fait que nos gouvernements nationaux interviennent peu dans la condamnation des violations du droit international (Chrétiens-démocrates). En aucun cas n’est vu le lien matériel.
L’approche socialiste nationale (trotskistes/staliniens) . Il est reconnu qu'il existe une base matérielle sous-jacente à l'impérialisme et la solution qui est proposée est un appel à soutenir activement les pays supposés " plus faibles " ou ayant une auréole " prolétarienne ". Par exemple : l’Anti-OTAN, Pour Chavez contre les États-Unis, etc.… Le problème ici est qu'à la base il est supposé que dans les conflits entre États, il y a quelque chose de "prolétarien". Cela n’est tout simplement pas le cas, et même si la classe ouvrière est activement impliquée dans un conflit (par exemple dans le cas où un fort sentiment anti-américanisme, qui est un nationalisme déguisé, est présent), il est naïf de croire que sa participation sert les intérêts de la classe ouvrière. Selon moi, un tas d’arguments contredisent l’idée que la classe ouvrière aurait un intérêt commun avec l’État qui la domine. Car, tous les États sont pris dans les mêmes restrictions bourgeoises. D’ailleurs, en se focalisant activement sur par exemple l’Anti-OTAN, on peut aussi devenir l’instrument de la bourgeoisie du Vénézuéla, Chine, Iran, etc.. En outre, dans certains conflits, il est difficile de savoir quel est le pays "le plus faible" parce que les nations sous-développées entre elles essaient aussi de grimper sur l’échelle du capitalisme. L'idée du " moindre impérialisme " que nous, socialistes, devrions prendre comme position lors d’un conflit me semble donc extrêmement dangereuse et insensée.
Une approche socialiste internationaliste. Dans cette approche, il est clair que tous les États fonctionnent à partir d'une logique qui leur est indiquée par les règles du capitalisme, et qui est inhérente à leur positionnement sur le terrain. Le remplacement d’un impérialisme par un autre, est dénué de sens parce que cela ne change en rien les règles du capitalisme international. La seule chose qu'on puisse faire, est de radicaliser la classe ouvrière et de lui expliquer la futilité du nationalisme dans ce jeu.
SP.L./11.03.2012
(1)Une comparaison pour clarifier cela. Ce n'est pas parce que nous pouvons découvrir quelqu'un au Moyen-Âge qui passe toute sa journée à accumuler l'argent acquis précédemment qu’on peut déjà parler de capitalisme. Pour parler de capitalisme, ce phénomène doit être généralisé et occuper une position dominante dans la société.
Vie du CCI:
Rubrique:
De quelle crise parlons-nous ? (cycle de discussion sur la crise, 1)
- 1429 reads
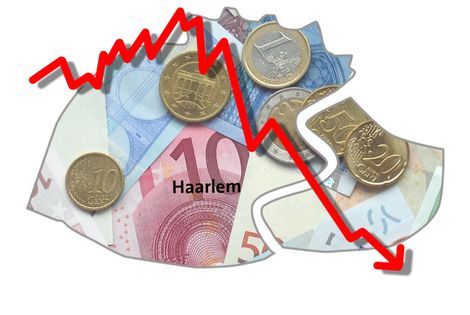
En avril et mai 2012, le CCI, ensemble avec ses sympathisants et autres intéressés venant d’horizons divers, a organisé un cycle de trois discussions sur la crise.
Dans la discussion l’accent a été mis sur la culture du débat et tous étaient invités à prendre part au débat. Nous soulignions que ce n’était pas une affaire d'experts car mêmes les plus grands experts économiques bourgeois n’avaient pas vu venir la crise. Et pourtant, ils dominent maintenant le débat dans les médias. A été posé le fait que pour nous il était grand temps que nous allions vers des arguments solides sur les causes des symptômes récurrents toujours plus graves de la crise et pourquoi cela ressemble de plus en plus à une crise du capitalisme en tant que système, aussi bien économiquement, socialement que politiquement. La question se pose : réforme ou renversement révolutionnaire?
Dans la contribution suivante, nous proposons la première introduction de ce cycle. La discussion qui a suivi a été très animée et traversée d’une participation enthousiaste de tous les participants.
Cette première discussion s’est centrée autour de quatre axes : la recherche d’une meilleure compréhension des définitions et concepts utilisés (argent et crédit, dette, marché, échange et valeurs d’usage, etc..); la crise historique du capitalisme (sa décadence) et la question de la surproduction ; le lien entre crise-guerre-reconstruction et le rôle de l'impérialisme, thèmes qui lançaient déjà les deux prochains tours de discussion.
Un recueil de textes a été créé au service des participants. Il peut aussi être envoyé sur simple demande.
Indéniablement, la crise se manifeste, et de manière particulièrement spectaculaire même, sur le plan financier : depuis la fin des années 1980, les banques ont reçu toute la latitude pour étendre leur politique de financement et de commercialisation de toutes sortes de produits financiers, de sorte qu’elles constituent aujourd’hui – même si c’est de manière virtuelle à travers les systèmes informatiques – un marché plus important que tous les secteurs non financiers réunis. En 2008, la totalité des transactions financières mondiales avait atteint la somme de 2.200.000 milliards de dollars, face à un Produit National Brut sur le plan mondial de 55.000 milliards. L’économie spéculative est en conséquence 40 fois plus importante que l’économie ‘réelle’. Or, durant ces dernières années, ces milliards ont été investis de manière croissante dans des placements totalement aberrants et autodestructeurs.
Durant ces 25 dernières années en effet, les transactions financières ne sont plus basées sur des valeurs réelles et intrinsèques, mais sont devenues un processus fonctionnant pleinement selon une logique propre. Le secteur financier a perdu tout contact avec la réalité économique, il n’est plus depuis longtemps au service de l’économie réelle, mais est basé sur de la plus-value irréelle, sur du vent. C’est bien là que se situe l’origine de l’accumulation hallucinante des dettes des gouvernements, des institutions financières, des entreprises et des particuliers.
Cette crise, est-elle à la base une crise hypothécaire ?
A la fin du 20e siècle, la bourgeoisie a donné le feu vert aux banques pour conclure des prêts hypothécaires plus importants que d’habitude à des taux de départ très bas. L’explosion du crédit hypothécaire a mené dans un grand nombre de pays à une hausse des prix immobiliers et des habitations. En offrant des prêts de plus en plus importants pour des prix fortement surévalués sur le marché immobilier, les banques sont arrivées à engranger sous la forme d’intérêts une partie de plus en plus importante du salaires des travailleurs.
A un moment donné, les taux ont toutefois été relevés pour contrer une inflation menaçante (la hausse du prix des habitations menait à une surchauffe sur le marché immobilier). Et soudain, une masse de familles ouvrières n’arrivaient plus à repayer leur crédit hypothécaire. Le phénomène des familles ouvrières liées pieds et poings à une hypothèque n’est cependant pas nouveau dans le capitalisme. Il l’a toujours accompagné et ne peut expliquer l’ampleur de la crise actuelle. Aujourd’hui, ces familles sont liées pieds et poings aux banques, avant, elles l’étaient au patron, comme on le sait à travers les rapports de Friedrich Engels : " ‘L’enchaînement du travailleur à sa propre maison’ existait déjà dans les années ’80 du 19e siècle. (Le fabriquant) Dolfuss et ses collègues essayaient de vendre aux travailleurs de petites maisons qu’ils devaient repayer en traites annuelles (...). De cette manière, les travailleurs avaient de lourdes charges hypothécaires sur le dos (...) et devenaient ensuite vraiment les esclaves de leurs patrons : ils étaient liés à leurs maisons, ils ne pouvaient pas s’en aller et ils devaient accepter sans rechigner n’importe quelles conditions de travail. " (Friederich Engels, 1887).
Mais aujourd’hui, le blocage ne touche pas le marché immobilier en soi, mais l’ensemble du mécanisme de marché, avec son caractère spéculatif exacerbé.
La crise s’explique-t-elle alors par une crise du crédit, une crise bancaire ?
Les prêts bancaires extravagants aux ménages et aux entreprises, qui ont déclenché la crise, n’avaient aucun caractère productif. Aucune valeur réelle n’était créée. Seuls les frais des marchandises et de services déjà existants ont augmenté à cause de cette politique des banques. D’une manière encore plus vulgaire, les assureurs ont vendu des polices avec de gigantesques frais cachés, ce qu’on appelle adéquatement des polices usuraires. D’une manière imagée, on pourrait dire que les banques et les assureurs ont gagné de l’argent en disposant des points de péage intermédiaires, pas en construisant de nouvelles routes.
Si ces banques ont réalisé des bénéfices, elles ont comme toutes les institutions partout dans le monde (fonds de pension, banques, sociétés immobilières) profité des bénéfices réalisés au moyen de prêts hypothécaires pourris, en particulier au niveau du marcher immobilier américain. Ces prêts hypothécaires pourris, ces investissements à hauts risques, ont été mélangé avec des investissements moins dangereux et proposés comme des produits boursiers par ces banques.
Et de par le fait que ces actions et obligations de ces banques et des compagnies d’assurance continuaient à monter, d’autres, qui voulaient également leur part du butin, commencèrent également à prendre plus de risques. Afin de participer à ce jeu de hasard, les banques (en tant que véritables entreprises d’utilité publique) reçurent l’autorisation de leurs Etats respectifs de réduire leurs réserves liquides au minimum. Les rentrées augmentaient en effet fortement. Ainsi, les fonds de pension aux Pays-Bas y gagnaient tellement que l’Etat a puisé deux fois dans leurs caisses dans les années ’90, parce qu’ils disposaient de tellement de réserves. La croissance exponentielle des bénéfices ne démontrait-elle pas que tout cela ne pouvait causer aucun souci.
Mais lorsqu’aux USA, la survaleur (virtuelle) disparut brusquement en fumée, les différentes institutions dans le reste du monde se réveillèrent avec la gueule de bois : Leurs placements dans des hypothèques pourries ne valaient du jour au lendemain pratiquement plus rien. Une fois de plus toutefois, ce phénomène n ‘est pas nouveau, nous l’avons déjà vu dans l’histoire, et il ne nous apprend rien sur les causes de l’actuelle crise. Un des phénomènes principaux de la Grande Dépression des années 1930 était la faillite d’un grand nombre de banques. A ce moment-là aussi, la confiance entre les banques descendit sous zéro (on se demandait avec angoisse : quelle banque a des crédits pourris et combien ?), ce qui fit que l’instillation de liquidités dans l’économie, la graisse indispensable au fonctionnement des mécanismes, s’arrêta presque complètement.
La cause de la crise doit-elle alors être trouvée auprès des spéculateurs, des fraudeurs ?
Ces dernières années, chaque effondrement boursier est effectivement allé de pair avec des cas de fraude. Et cela ne posait pas seulement la question des fraudeurs ! Ainsi, les magouilles de Madoff ont bien été contrôlées huit fois ces dernières seize années par toutes sortes d’organismes de contrôle, comme la Securities and Exchange Commission. Et malgré le fait que les contrôleurs avaient été informés sur des pratiques frauduleuses, ils n’ont jamais rien trouvé. Mais en décembre 2008, Bernard Madoff était brusquement un fraudeur. L’entreprise bancaire géante Lehman Brothers voyait s’évaporer 65 milliards de dollars. La même chose se passa en septembre 2011 avec Kweku Adoboli avec une " fraude " de 2,3 milliards de dollars auprès de la banque suisse UBS. En janvier 2008, Jérôme Kerviel provoqua une " fraude " de 4,82 milliards d’euros auprès de la banque française Société Générale.
Mais ici encore, la spéculation n’est pas un phénomène nouveau : " Un certain Sullivan se voit attribué au moment de son départ – pour une mission gouvernementale – vers une région d’Inde qui est éloignée des régions où l’on cultive l’opium, un contrat concernant l’opium. Sullivan vend son contrat pour £40.000 à un certain Binn. Binn vend ce contrat le même jour encore pour £60.000 et l’acheteur ultime et exécuteur du contrat déclara qu’il en tira encore malgré tout de substantiels bénéfices ". Et ce phénomène n’est par ailleurs pas non plus caractéristique pour la crise actuelle. Il existe depuis très longtemps dans le cadre du capitalisme. Marx a décrit à son époque l’activité destructrice du secteur financier et des spéculateurs comme " des chevaliers pillards du crédit ", une " classe parasitaire " : " le capital usuraire utilise le mode d’exploitation capitaliste, sans mettre en oeuvre le mode de production capitaliste ".
Bref, la spéculation accompagne toute l’histoire du capitalisme et ne peut donc fournir les fondements pour expliquer la crise actuelle.
S’agit-il enfin d’une crise de la dette souveraine des Etats ?
Lorsque les Etats ont décidé de sauver les banques du naufrage, on a vu la dette des Etats exploser. Suivant l’exemple " brillant " d’autres Etats de l’UE, le gouvernement grec a également injecté des capitaux importants dans les banques afin de les sauver de la faillite. Jusqu’à présent, les banques grecques ont reçu plus de 110 milliards de soutien financier sous diverses formes. Elles n’ont bien sûr jamais utilisé cet argent pour stimuler l’économie réelle. La dette de l’Etat grec avait bien augmenté jusqu’à des proportions inconsidérées. Sa dette correspondait déjà en 2008 à 125% du PIB et, à cause d’un déficit annuel de 12%, elle continuait à augmenter par bonds.
Mais à nouveau, la dette étatique n’est pas plus un phénomène nouveau au sein du capitalisme. Marx (Le Capital) en son temps expliquait déjà parfaitement en quoi consistait la dette d’Etat : " La dette de l’Etat implique que l’aliénation de l’Etat imprime sa marque sur l’ère capitaliste. La seule partie de la soi-disant richesse nationale qui est véritablement la propriété collective des peuples modernes, est leur dette d’Etat (...). Les emprunts (par l’Etat) permettent aux gouvernements d’effectuer des dépenses extraordinaires sans que ceux qui paient des impôts le sentent immédiatement, mais ils rendent une augmentation des impôts dans le futur indispensable. D’autre part, ces augmentations d’impôts, causées par une accumulation de dettes successives, poussent les gouvernements dans le cas de nouvelles dépenses extraordinaires à souscrire continuellement de nouveaux emprunts ". Il s’agit là d’un cycle infernal de dettes, dont l’Etat ne peut d’aucune manière se dégager, une fois qu’il a été engagé. C’est comme toute dépendance, on s’enfonce de plus en plus. Plus la période de dépendance de l’Etat est longue, plus ce dernier a besoin de sa drogue pour se maintenir dans la concurrence économique internationale. Le phénomène n’est donc pas nouveau, mais existe déjà depuis les premiers agissements financiers au sein du mode de production capitaliste.
S’agit-il plus précisément d’une crise de la monnaie unique européenne, d’une crise de l’euro ?
Il existe sans doute un gouffre entre les économies de pays du Sud et des pays du Nord comme les Pays-Bas et l’Allemagne, mais ceci était évident en 2000 déjà. Un pays comme la Grèce n’est pas en état de supporter la concurrence avec des pays plus au Nord. Depuis le début, il était évident que la situation était intenable et que cela devait miner les fondements même de la monnaie unique européenne.
C’est en parfaite harmonie avec leurs intérêts économiques que les différentes bourgeoisies du Nord ont agi dans le passé en intégrant dans la zone euro des pays de la périphérie européenne, qui trichaient de manière évidente avec leurs statistiques budgétaires. Des règles fiscales contraignantes ont été mises de côté face à la promesse de nouveaux marchés protégés pour les entreprises de ces pays du Nord.
Et aujourd’hui encore, les politiciens noient le poisson en attaquant celui par qui le scandale arrive. Mais cela correspond bien sûr au rôle pour lequel ils sont élus et payés : mettre en place un rideau de fumée sur le fondement des événements qui provoquent la pression sur certains pays européens et exacerbent les tensions au sein de la zone euro, cacher qu’ils révèlent fondamentalement les contradictions fondamentales qui caractérisent le capitalisme et qui sont insolubles au sein du système.
Quels sont donc les fondements de la crise actuelle ?
Le capitalisme est la première forme de société dans l’histoire dont la crise n’est pas la conséquence d’une sous-production, d’une production de la pénurie, mais d’une surproduction, d’une abondance de marchandises. Avec les crises éclate une épidémie sociale qui aurait semblé absurde dans toutes les périodes précédentes, une épidémie de surproduction. C’est une crise du mode de production capitaliste basé sur le salariat.
Le capitalisme est marqué depuis sa naissance par une tare congénitale : il produit en abondance un poison que son organisme ne peut contrôler, la surproduction. Il produit plus de marchandises que son marché peut absorber. Pourquoi ? Prenons un exemple pour l’expliquer. Un travailleur travaille à la chaine ou derrière son ordinateur et reçoit à la fin du mois un salaire de 800 euro. En réalité, il ne produit pas l’équivalent de ces 800 euro, mais une valeur de, disons, 1600 euro. Il a donc produit une valeur qui ne lui est pas ristournée sous forme de salaire, en d’autres mots, il a produit de la plus-value. Que fait le capitaliste avec cette plus-value qu’il a volé des travailleurs (à condition bien sûr qu’il la réalise en vendant les marchandises sur le marché !) ? Il utilise une partie (peut-être 150 euro) pour sa consommation personnelle. Mais l’essentiel, les 650 euro restants, il les réinvestit dans le capital de son entreprise, généralement pour l’achat d’un équipement plus moderne. Pourquoi le capitaliste agit-il de la sorte ? Parce qu’il y est contraint du point de vue économique. Le capitalisme est un système de concurrence, les produits doivent être vendus meilleur marché que ceux du voisin, du concurrent qui produit les mêmes produits. En conséquence, chaque patron doit non seulement réduire ses frais de production (les salaires) mais surtout et d’abord réinvestir la majeure partie du travail non payé des travailleurs dans des machines plus modernes pour accroître la productivité. S’il ne le fait pas, il ne peut pas moderniser sa production et il perdra des parts de marché à un concurrent qui, lui, a réussi à proposer des produits meilleur marché.
Le système capitaliste est caractérisé par un phénomène contradictoire : en ne rétribuant pas complètement les travailleurs pour le travail effectivement réalisé et en imposant aux patrons de ne pas consommer eux-mêmes une grande partie des bénéfices qu’ils ont arrachés aux travailleurs, le système produit plus de valeur qu’il ne peut traiter en son sein. Les travailleurs et les capitalistes ne peuvent jamais ensemble consommer l’intégralité des marchandises produites. Le capitalisme doit donc vendre le surplus de marchandises en dehors de sa propre sphère de production, sur des marchés qui n’ont pas encore été conquis par les rapports de production capitalistes, et que nous appelons des marchés extra-capitalistes. S’il n’arrive plus à le faire, nous sommes alors confrontés à une crise de surproduction.
Voilà donc dans de grandes lignes les conclusions de Karl Marx dans ‘Le Capital’ et de Rosa Luxembourg dans ‘L’Accumulation du Capital’. Pour le formuler de manière encore plus concise, nous résumerons la théorie de la surproduction en quelques points :
- Le capital exploite ses ouvriers (ou autrement dit : leurs salaires ne recouvrent pas la valeur réelle qu’ils réalisent par leur travail).
- De cette manière, le capital peut vendre ses marchandises avec un profit, pour un prix qui comprend, outre le salaire des ouvriers et la plus-value, également le remboursement des moyens de productions. Mais à qui vend-il ?
- Bien sûr, les ouvriers achètent des marchandises... Pour un montant permis par leur salaire. Une bonne partie des marchandises restera donc à vendre autre part. La valeur de celles-ci est égale à la partie non payée du travail des ouvriers. Ce n’est que cette partie qui possède la caractéristique magique de réaliser du profit pour le capital.
- Les capitalistes ne consomment eux-mêmes qu’une partie des marchandises qui sont porteuses de la plus-value. S’il veut réaliser du profit, le capital ne peut acheter la totalité des marchandises pour lui-même. ce serait absurde, comme s’il sortait l’argent de sa poche de droite pour le fourrer dans sa poche de gauche. Ce n’est pas une manière de générer du profit.
- Pour accumuler, pour se développer, le capital doit donc trouver impérativement des acheteurs en dehors de la sphère des ouvriers et des capitalistes. Autrement dit, il doit trouver des marchés en dehors de son système, c’est une question cruciale s’il ne veut pas rester avec des marchandises invendues sur les bras qui étouffent le marché, s’il ne veut pas tomber dans une ‘crise de surproduction’ !
DS
Récent et en cours:
- Crise économique [17]
Rubrique:
Internationalisme no 356 - 4e trimestre 2012
- 1142 reads
Face au poison de la division corporatiste, régionaliste, nationaliste: unité et solidarité ouvrière!
- 1082 reads
Une méfiance sourde, constante, de lourds préjugés, le jugement cruel et destructeur, la culpabilité, la peur de l’autre... Voilà ce qui se glisse aujourd’hui au plus profond de la société. Voici, brutalement énoncées, les formes que dessinent les rapports entre les individus, d’un trait toujours plus sombre et plus agressif. Chacun dans sa propre bulle, regardant avec mépris la bulle de son voisin en train de crever d’asphyxie. Voilà ce qui chaque jour pèse sur nos esprits et nous mène vers toujours plus d’incompréhension et de désarroi. Face à la crise généralisée catastrophique qui frappe son système, face au besoin croissant d’unité et de solidarité des prolétaires, la bourgeoisie cherche, en effet, par tous les moyens à distiller le poison de la division et de la confrontation, à nous entraîner sur le terrain obsolète de la compétition et de la concurrence, terrain indissociable du capitalisme lui-même. Par tous les moyens, des plus subtils aux plus grossiers, la classe dominante cherche à pourrir l’esprit des prolétaires avec cette idée : “Vos intérêts sont ceux de telles ou telles fractions de la bourgeoisie.” Bien sûr, la bourgeoisie camoufle ceci en parlant des “intérêts supérieurs” de l’entreprise ou de la nation en général, comme si l’entreprise ou la nation étaient des formes sociales au-dessus de la lutte des classes, qu’elles n’existaient pas pour servir précisément les seuls intérêts de classe de nos exploiteurs.
Les syndicats, véritable police de l’Etat dans l’entreprise, sont à la pointe de ces manœuvres de divisions, prenant également eux-mêmes en charge les campagnes de propagandes chauvines. Ainsi, tandis que les attaques pleuvent au nom de la “réduction des déficits” et de la “compétitivité”, que les plans de licenciements se multiplient, en clair, que la bourgeoisie fait payer à la classe ouvrière la crise de son système, c’est entreprise par entreprise, catégorie par catégorie, que les syndicats minent le terrain de la “résistance.” Face à l’attaque généralisée de la classe dominante contre nos conditions de vie, les mêmes syndicats saucissonnent la riposte, nous lancent méthodiquement, par petits paquets dispersés, dans des combats pour la défense de tel ou tel intérêt particulier. Ces spécialistes autoproclamés des luttes ouvrières, opposent également les ouvriers entre eux, entre qualifiés et précaires. La bourgeoisie sait parfaitement que la crise et les attaques vont se poursuivre ; avec ses syndicats, elle prépare donc le terrain, elle nous épuise dans des combats aussi stériles que démoralisants afin de retarder au maximum le processus menant à des luttes massives.
Cette distillation du poison de la division a de nombreux visages. Ainsi nous assistons, depuis plusieurs années, à la montée en puissance des revendications régionalistes. En Espagne, tandis que les indépendantistes basques et catalans remportaient les élections locales, une manifestation monstre était organisée à Barcelone pour réclamer “une Catalogne indépendante.” De même, en Belgique, après la crise politique de 2010-2011 sur fond d’indépendantisme flamand, la Nieuw-Vlaamse Alliantie – Alliance néo-flamande – triomphait aux élections communales, notamment son chef de file, Bart De Wever, qui remportait haut la main la ville d’Anvers. Au Royaume-Uni, l’Écosse, région riche en ressources minières, organisera un référendum en 2014 à propos de son indépendance ! Dans une moindre mesure, en Italie, la puissante Ligue du Nord revendique, depuis des années, l’autonomie de la Padanie.
Partout, ces velléités indépendantistes s’accompagnent d’un discours écœurant dénonçant les ouvriers des autres régions qui, tels des vampires, suceraient le sang fiscal et économique des travailleurs locaux. Ces revendications ne sont pas autre chose qu’une forme de nationalisme irrationnel, typique de la décomposition capitaliste.
La propagande bourgeoise ne cesse alors de chercher des bouc-émissaires afin de dédouaner son système capitaliste en faillite. Elle canalise la colère des ouvriers et de la population en livrant en pâture des “coupables” désignés, fabriqués sur mesure, afin de “diviser pour mieux régner”. Ce nationalisme réactivé s’exprime de plus en plus ouvertement à la TV et dans les journaux, de manière “décomplexée”. D’un côté, par exemple, la bourgeoisie allemande, avec en échos les propos de ce qu’on appelle la “troika” (Commission, BCE, FMI), accuse la population et les prolétaires “grecs” d’être de véritables “tricheurs”, des “fainéants” qui ne “payent pas d’impôt” ; les populations espagnoles ou portugaises, de vivre elles aussi “aux crochets” des pays du nord de l’Europe. De l’autre côté, les bourgeoisies et médias de ces mêmes pays incriminés, se présentant comme les “victimes de l’Allemagne” et de la “politique de Merkel”, expliquent simplement la misère noire croissante qu’elles imposent du fait de “l’égoïsme” de voisins “nantis” ! Quant aux ouvriers allemands et français, pourtant eux aussi victimes d’attaques, ils sont condamnés à faire des “efforts” et des “sacrifices” pour “payer les années de laxisme” des pays du sud les plus endettés, soulager ceux qui sont accusés de “voler le travail des autres” et qui ne devraient “ne s’en prendre qu’à eux-mêmes” !
Face à cette propagande nauséabonde, à ces préjugés bassement entretenus et cultivés, aux divisions, aux conflits des uns contre les autres, nous devons réaffirmer la nécessité de l’unité internationale de nos luttes.
Notre véritable force, c’est en effet notre nombre, la massivité de notre combat, l’union par-delà les secteurs, les races, les frontières et les nations. A un monde divisé et cloisonné par les intérêts privés du capital, ceux d’une classe d’exploiteurs arrogants, les fameux “1 %” dénoncés par les “Indignés”, nous devons opposer notre solidarité. Nous devons prendre conscience, nous qui travaillons dans des conditions de plus en plus inhumaines, que nous sommes tous les vraies victimes d’un système barbare à l’agonie. Face au chacun pour soi, nous devons lutter pour nous rassembler, réfléchir et discuter ensemble, sur les moyens de défendre notre dignité et nos conditions de vie. En perspective, nous avons devant nous à conquérir un futur qui nous appartient, un autre monde, débarrassé de la violence, des haines et des terreurs de l’exploitation. Ce futur, cet autre monde, n’est pas seulement nécessaire, il est possible. Il devra affirmer le “règne de la liberté”, celui d’une vraie communauté humaine mondiale.
WH/El Generico, 27 octobre
Géographique:
- Belgique [2]
Rubrique:
Tract drame-Ford: le seul coupable est l'appât du profit
- 1402 reads

Ford Genk, récemment encore une usine de plus de 10.000 employés, ferme définitivement. Depuis les années 90, l'emploi y a été systématiquement réduit, la productivité augmentée, les salaires réduits de 12%. Malgré cela, le rideau tombe sur les 4.300 emplois directs et des milliers d’autres travailleurs sont touchés chez les différents fournisseurs. Après Renault-Vilvoorde (1997), VW Forest (2006) et Opel Anvers (2010), c’est la quatrième usine d’assemblage automobile qui ferme en Belgique. Cela touche durement la région limbourgeoise qui a vu disparaître, il y a 20 ans, plus de 17.000 jobs lors de la fermeture des mines de charbon.
Une crise du secteur automobile ? Et le Limbourg est-il particulièrement visé ?
Licenciements chez Belfius Banque, Arcelor Mittal acier, Beckaert Zwevegem, Volvo, Duferco, Alcatel, etc. A l’évidence, le nouveau drame social n'est pas spécifique à un secteur ou une province. La crise touche tous les secteurs et régions. C’est précisément ce qui rend la situation si dramatique et désespérée.
Au nom de la «compétitivité» et «de la réduction des pertes», les licenciements se succèdent. Encore avant l'annonce de la fermeture de Ford, plus de 3.000 emplois ont disparu de septembre à mi-octobre dans tous les secteurs, toutes les régions, des petites entreprises familiales jusqu’aux grandes multinationales, dans des entreprises nationales comme étrangères. D’autres assainissent drastiquement « sans licenciements secs», comme KBC, Brussels Airlines et Delhaize. Les contrats fixes sont remplacés par des contrats temporaires, des emplois à temps plein par des emplois à temps partiel, des contrats d’employés par des contrats d’indépendants. Le chômage temporaire est généralisé. Le travail saisonnier est de plus en plus la norme tout au long de l'année. Les fameuses « créations d’emplois » dont les médias ont la bouche pleine, se limitent en grande partie à des emplois de qualité inférieure, des emplois par « chèques services ». Afin d'échapper à la pauvreté, de nombreux travailleurs doivent chercher un 2ème ou un 3ème emploi. L’obtention d’un emploi n’équivaut plus nécessairement à un revenu décent!
L'État lui aussi est mal en point. Comme le montre la discussion sur la suspension temporaire (le saut d’index) ou la réforme de l'index, le pouvoir d'achat n'est pas une préoccupation centrale. Toujours au nom de la défense de la «compétitivité de l'économie nationale", tous les partis bourgeois, de la NVA au PS, sont d’accord pour dire qu’il faut constamment faire des économies pour réduire les coûts de main d’œuvre et améliorer le climat économique. On passe d’un «pacte social», à un autre « pacte des générations ». Car l'État est là pour appliquer les lois du capitalisme: favoriser la recherche du profit, la force concurrentielle et l’exploitation au moyen de mesures coercitives. Les milliards que les gouvernements cherchent pour permettre leurs plans de relance, leur équilibre budgétaire et la réduction de la dette d’État, seront en fin de compte soutirés aux mêmes familles ouvrières. Les allocataires sociaux, les retraités, les fonctionnaires, les enseignants, tous paieront les pots cassés. Selon le nouvel indicateur européen de la pauvreté, 21% de la population en Belgique est déjà menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale. L'inquiétude et l'indignation d'un nombre croissant de familles ouvrières ne se comprend donc que trop bien.
Ford Genk est aujourd'hui une illustration douloureuse de la nature impitoyable de cette attaque générale contre la classe ouvrière: licenciements nombreux, blocage et/ou réduction des salaires (chez Ford, on a accepté précédemment une réduction de 12%, chez VW-Audi 20%), prolongement du temps de travail. Sans riposte ouvrière, Ford Genk annonce des attaques encore plus douloureuses dans le futur pour l’ensemble de la classe ouvrière. La situation actuelle nécessite donc une résistance contre la dégradation des conditions de travail et de vie de la plupart d'entre nous. Elle contient aussi les germes d'une riposte commune de toute la classe ouvrière. Ce n’est pas que le personnel de Ford, mais tout le monde qui est visé, c’est pourquoi aussi tout le monde doit s’indigner, être solidaire, se mobiliser classe contre classe!
A qui la faute? Y a-t-il un bouc émissaire?
Depuis des décennies, on nous promet une sortie de la crise et de la misère. Le bout du tunnel était en vue, nous disait-on, encore quelques ultimes mesures exceptionnelles et des solutions durables s’imposeraient, les rationalisations ne surviendraient plus que dans «les vieilles industries», dans «des sociétés mère ou des filiales malades » ; plus tard, tout était cette fois-ci la faute « du vieillissement de la population» ou «des réfugiés», de «l’émigration incontrôlée » (la conséquence d’une misère et d’un désespoir pires encore ailleurs dans le monde!) ; plus tard encore les coupables du moment étaient les « bad banks », les fraudeurs, etc. Aujourd'hui, c’est de la faute du PDG de Ford que ce bain de sang social a lieu. Auparavant, lors de la fermeture des mines, les boucs émissaires étaient le ministre flamand socialiste De Batselier et le PDG de la société minière Gijselinck. Derrière toutes ces pseudo vérités et ces discours populistes creux se cache la propagande bourgeoise qui cherche constamment à trouver des boucs émissaires de telle sorte que la question de la faillite du système capitaliste ne soit pas posée. Ainsi, la colère est canalisée et est orientée vers la désignation de « coupables», faits sur mesure, pour mieux «diviser et régner».
Ce même scénario décrit ci-dessus est appliqué dans presque tous les pays du monde, les médias en témoignent quotidiennement. Évidemment, il y a des variantes, tout comme il y en a selon le secteur ou la région en Belgique même. Cependant, partout dans le monde, la question est posée : qui est le responsable de la crise ? Cette question a également été au cœur des débats dans les mouvements du «printemps arabe» en Tunisie et en Égypte, dans ceux des «Indignés» ou de «Occupy Wall Street».
Depuis plusieurs années se sont succédé, au niveau mondial, les crises de l'immobilier, de la bourse, du commerce et de l'industrie, des banques et de toutes les dettes souveraines des Etats. Ainsi, le total des dettes souveraines dans la zone euro s’élève à 8.517 milliards d'euros. Soit une moyenne de 90 % du produit intérieur brut de la zone euro. Une grande partie de celle-ci ne sera jamais remboursée. Quelqu'un doit financer ces dettes, mais financer des dettes impayables signifie finalement qu’on devient insolvable soi-même (un risque qui menace par exemple l'Allemagne). Comment le système peut-il alors financer la relance indispensable pour arrêter le bain de sang au sein de son économie ? En continuant à le faire essentiellement au moyen de mesures d’austérité et de rationalisation, il réduit encore le pouvoir d’achat dont il a besoin pour écouler ses produits, ce qui produira encore plus de rationalisations, de fermetures, de réductions des salaires. S’il écume le marché de l’épargne en imposant des taux d’intérêt dérisoires sous les 1%, tandis que l’inflation atteint les 2,76%, les réserves que de nombreuses familles ouvrières avaient mises de côté pour affronter des contretemps, l’accumulation de dettes ou le chômage, fonderont comme neige au soleil. Quelle que soit la méthode, elle ne peut donc mener à terme qu’à une nouvelle forte baisse du pouvoir d’achat. Devra-t-il se résoudre à faire marcher la planche à papier pour imprimer des billets supplémentaires, comme l’ont fait les USA, le Japon ou la Grande-Bretagne, afin de les mettre sur le marché à des taux de prêt extrêmement bas ? De cette manière, le système capitaliste accentue l’abîme des dettes et en revient au point de départ : en fin de compte, il faut toujours que de la valeur nouvelle soit produite en contrepartie de cet argent imprimé pour repayer les dettes. De l’argent fictif ne peut faire l’affaire, tel notre épargne que les banques remettent en circulation sous la forme d’un emprunt, tandis qu’elles nous font croire qu’il se trouve toujours sur notre compte. De la valeur nouvelle n’est obtenue qu’à partir du travail effectué en lui ajoutant une plus-value : les frais de production d’un produit ne peuvent constituer qu’une fraction de leur valeur de vente totale. Mais pour ce faire, il faut un marché solvable. S’il n’existe pas ou à peine (comme c’est le cas depuis des années), nous entrons dans une crise de surproduction permanente. C’est pourquoi des usines ferment, baissent leurs coûts de production (les salaires), augmentent la productivité, c’est pourquoi aussi les frais improductifs (sécurité sociale, allocations de chômage, retraites) sont constamment comprimés.
Tout ceci constitue la loi générale de la manière capitaliste de produire, qui ne peut être contournée par aucun patron individuel ou par aucun gouvernement particulier ! Si aujourd’hui les usines s’arrêtent, ce n’est pas parce que les travailleurs ne veulent plus travailler ou parce qu’il n’y a plus de besoins à assouvir, mais simplement parce que les capitalistes n’y voient plus de profit à réaliser. Le système capitaliste mondial est gravement malade : les marchés solvables se réduisent comme peau de chagrin et le profit ne peut être maintenu qu’à travers une spoliation sociale et une exploitation toujours plus intenses.
Se mobiliser massivement, forger l’unité, rechercher la solidarité, avoir confiance en sa propre force
Durant ces six derniers mois, protestations, grèves, manifestations massives ont éclaté sur tous les continents : de l’Argentine au Portugal, de l’Inde à la Turquie, de l’Egypte à la Chine. Ainsi, en septembre, des centaines de milliers ont occupé la rue au Portugal, des dizaines de milliers ont manifesté en Espagne en Grèce et en Italie. Au Japon, des manifestations contre la baisse des conditions de vie d’une telle ampleur n’avaient plus eu lieu depuis 1970 (170.000 manifestants à Tokyo). Partout, les mêmes questions sont posées : comment faire face à de telles attaques, comment organiser la lutte, quelles perspectives avancer ? Ce sont les mêmes questions que se posaient déjà les jeunes et les chômeurs du mouvement massif des Indignés ou de Occupy en 2011, e.a. en Espagne, en Grèce, aux USA ou au Canada.
A ce propos, trois besoins centraux pour la lutte ont été mis en avant : la nécessité de l’extension et de l’unification de la lutte, l’importance du développement d’une solidarité active parmi les salariés, les chômeurs et les jeunes et enfin le besoin d’une large discussion à propos de l’alternative pour le système actuel en faillite.
Notre vraie force est notre nombre, l’ampleur de notre lutte, notre destin commun, notre unité au delà des frontières des secteurs, des races, des régions, des pays. Face à un monde divisé et cloisonné par les intérêts personnels étroits d’exploiteurs arrogants, face au « chacun pour soi », à leur « compétitivité », nous devons opposer notre unité et notre solidarité. Nous devons refuser de nous laisser diviser, de réduire nos problèmes à des questions spécifiques et séparées, propres à l’entreprise, au secteur ou à la région. Non à la rivalité entre « jeunes » et « vieux », entre « fixes » et « temporaires », entre employés et ouvriers, entre travailleurs de la maison-mère et des filiales, entre travailleurs d’ici et d’autre part, ...
Cette unité est non seulement indispensable, elle est aussi possible aujourd’hui !
- L’extension de la lutte et de la solidarité avec d’autres secteurs et entreprises, qui sont fondamentalement touchés par les mêmes attaques et qui luttent souvent de manière isolée dans leur coin, pourra le mieux être engagée en envoyant des délégations massives vers les autres usines, c’est ce que nous apprennent les expériences de luttes précédentes ici comme ailleurs. Nos actions doivent renforcer notre lutte, l’étendre et lui donner des perspectives. Aller dans la rue pour « se défouler », mener un long combat isolé, chacun dans son usine ou sa région, ne permettront jamais de développer une lutte générale et massive.
- L’expérience nous apprend aussi que des actions comme la prise en otage de patrons, le sabotage de la production, le blocage de lignes de chemin de fer ou des actions désespérées, comme la menace de faire sauter l’usine, ne favorisent nullement l’union et l’extension de la lutte. Elles mènent au contraire à la démoralisation et à la défaite.
- Les leçons des luttes passées mettent en évidence que travailleurs et chômeurs doivent prendre en mains leurs propres luttes. Pour développer une véritable discussion collective, pour réfléchir et décider collectivement, il faut appeler à des assemblées générales massives, au sein desquelles chacun peut intervenir librement et avancer des propositions d’action, soumises au vote de l’assemblée. Pour forger l’unité du mouvement, ces assemblées doivent être ouvertes à tous les travailleurs et les chômeurs.
Et attention à la supercherie ! L’autre classe – la bourgeoisie – parle aussi de « solidarité » et « d’unité ». Elle appelle aux sacrifices des « secteurs forts » en « solidarité » avec les « secteurs faibles », pour répartir équitablement la misère. Quand son « gâteau devient plus petit », la discussion ne peut porter selon elle que sur une répartition « équivalente» de l’austérité qu’elle nous impose, sur ce qui est profitable à la compétitivité et à l’intérêt national . Elle appelle donc à « l’unité » avec les intérêts du capital. Comme si la répartition équivalente de la misère la rendait supportable ! Comme si la gestion commune de l’exploitation supprimait cette dernière. Ce discours ne sert qu’à entraver la mise en question du système et la recherche de perspectives dans le cadre d’une autre société basée sur l’assouvissement des besoins de tous et non pas des intérêts particuliers de certains !
unité et solidarité – extension et généralisation – confiance en ses propres forces – classe contre classe
Notre force, c’est notre solidarité, pas leur compétitivité.
Internationalisme / 02.11.12
Lettre d’un lecteur
Bonjour
Je vous écris à propos du tract publié récemment sur la crise «du secteur automobile».
Tout d'abord, sur l’analyse qui y est faite de la situation dans la branche de l’automobile, il n’y a rien à redire. Encore une fois, bon travail !
Cependant, la fin du tract reste (volontairement?) vague sur le plan de la prise en main.
Si les prises d’otage, le sabotage, les blocages, etc, ne constituent pas des formes de résistance anticapitaliste, quoi alors?
La mobilisation, la solidarité et l'unité de la classe ouvrière sont sûrement la première étape vers une base révolutionnaire - l'association de jeunes, de vieux, de chômeurs, de prolétaires, de précaires, etc. Cela devra se passer en premier lieu sur le plan économique (à l'intérieur des usines et sur les lieux de travail). L'ensemble de ce processus (comme décrit correctement dans le tract) prendra la forme d’assemblées générales (probablement clandestines), à la rigueur appelées conseils ou comités. Ces assemblées devront s’unir massivement (mutuellement par le biais de conseils / comités à l’échelle d’une «zone», «région» et «ville»).
C’est-à-dire, la démocratie prolétarienne à la base, à partir de l'économique (lieu de travail), vers le haut. Alors finalement, en théorie, l'organisation de masse surgit.
Mais quelle est alors l'arme de la classe ouvrière?
Jusqu’à présent, à côté des options plus radicales comme le sabotage, les occupations des lieux de travail et les blocages envers l’économie capitaliste et les traitres de la classe ouvrière (options qui certainement doivent être appliquées( !)), seule la grève semble être une arme légitime de la classe ouvrière.
Une grève entraîne la mobilisation de la classe ouvrière avec elle, et élimine pendant la période de la grève la division au sein de la classe.
En bref, la grève générale de masse est l'action directe contre l'économie capitaliste. Sur cette base, les exigences politiques envers l’État, le système, la social-démocratie et les syndicats peuvent être exprimées.*
Voilà ainsi une courte et simplifiée vision d'un lecteur. Mais quelle est alors l'alternative pour une révolution socialiste / communiste pour le CCI ?**
Sincèrement
KW/11.2012
.
* afin de ne pas compliquer ma lettre, j’ai ôté toute référence à la résistance ou à la participation des autorités et le militarisme.
** en tenant compte des conséquences juridiques. Ce qui peut expliquer l’imprécision de la conclusion du tract.
Réponse du CCI
Cher lecteur,
Merci pour ta contribution….Nous saluons chaque tentative d’approfondissement et de clarification de la discussion, même si cela implique une critique (fondamentale) des textes que nous avons publiés.
Nous souscrivons en grande partie avec ta contribution. Mais si tu n’y vois pas d’inconvénient, nous voulons aussi faire ici et là des remarques sur tes commentaires.
A la fin de ta lettre, tu écris «Cependant, la fin du tract reste (volontairement? vague sur le plan de la prise en main» et « cela (la mobilisation, la solidarité et l'unité de la classe ouvrière) devra se passer en premier lieu sur le plan économique. »
La question porte sur le fait que tu peux distinguer la lutte économique de la lutte politique mais elles ne sont pas totalement séparables l’une de l’autre.
« il n'existe pas deux espèces de luttes distinctes de la classe ouvrière, l'une de caractère politique, et l'autre de caractère économique(…) dans une action révolutionnaire de masse, la lutte politique et la lutte économique ne font plus qu'un ». Toute tentative de « distinction entre la lutte politique et la lutte économique, l'autonomie de ces deux formes de combat ne sont qu'un produit artificiel, quoique historiquement explicable, de la période parlementaire. (…)» (Rosa Luxembourg : grève de masse, parti et syndicat)
Dans la période de décadence du capitalisme, il n’est plus possible d’obtenir des réformes permanentes et durables. Cela signifie que toutes les luttes des travailleurs constituent indirectement une attaque à la nature du système. Toute opposition de la part de la classe peut ébranler les bases du capitalisme car le système a peu ou pas de marge de manœuvres pour neutraliser l’attaque des ouvriers.
La lutte de classe dans la période de décadence « vise à la fois à limiter les effets de l'exploitation capitaliste et à supprimer cette exploitation en même temps que la société bourgeoise.». En d’autres termes : « (toute) période de luttes de classe (a) un caractère à la fois politique et économique. ». (Idem)
Il est vrai que le point de départ de la lutte des ouvriers –en tout cas jusqu’à la période de l’insurrection révolutionnaire- sera toujours une résistance aux attaques sur les conditions de vie. Par conséquent, dans un sens, il est vrai que dans la lutte il ne s’agit pas de ce que les ouvriers attendent de leurs propres actions, mais de ce que la classe ouvrière est et de ce qu’elle est forcée de faire sur ce plan. Mais si la classe ouvrière est obligée de faire certaines choses, elle ne le fait pas sans une certaine conscience (surtout pas d’une manière mécanique, comme par exemple le chien de Pavlov). C’est pourquoi, le développement de la conscience dans la classe ouvrière est aussi, selon nous, une condition essentielle pour le développement d’un contre-pouvoir : une prise de conscience sur l’existence du salariat, la façon associée et collective dans laquelle les ouvriers sont dans la production et le fait que les travailleurs de cette façon, comme classe, sont les producteurs de toutes les richesses dans le monde.
Pour une minorité grande ou petite de la classe, il existe toujours l’idée et la perspective d’une autre société communiste. C’est parce qu’elle a une mémoire historique, un souvenir des périodes passées (que ce soit transmis ou non par une autre génération) et une capacité à apprendre de ses expériences de lutte. Ce qui fait qu’elle peut pousser l’enjeu de la lutte, à chaque fois qu’elle l’engage, à une échelle toujours plus générale. «Reculer pour mieux sauter» c’est-à-dire faire quelques pas en arrière pour mieux sauter en avant, c’est à peu près de cela qu’il s’agit pour la lutte ouvrière. Les travailleurs ont la capacité, chaque fois qu’ils engagent la lutte, de mettre de plus en plus de côté leurs propres intérêts immédiats et de la poser sur une échelle de plus en plus générale (et donc plus large et finalement aussi politique). Cette dynamique conduit à ce que le combat ne portera plus de façon prédominante sur un niveau direct économique mais sur un niveau politique : la lutte pour le pouvoir dans la société.
Salutations fraternelles
Au nom du CCI
A/11.2012
Géographique:
- Belgique [2]
Situations territoriales:
Rubrique:
Rosa Luxemburg: socialisme ou barbarie?
- 1352 reads
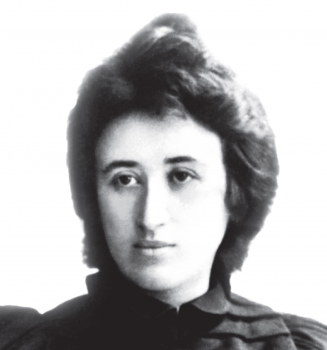 Nous publions ci-dessous de larges extraits du premier chapitre (1) de la brochure de Rosa Luxemburg "la Crise de la social-démocratie" (2).
Nous publions ci-dessous de larges extraits du premier chapitre (1) de la brochure de Rosa Luxemburg "la Crise de la social-démocratie" (2).
Ce texte magistral de 1915 doit être une source d’inspiration face aux difficultés actuelles du prolétariat. Alors confrontée à la pire boucherie de l’histoire de l’humanité, la Première Guerre mondiale (3) , et à la trahison de la social-démocratie qui a contribué à embrigader dans ce carnage impérialiste les ouvriers de tous les pays, Rosa Luxemburg ne cède pas au découragement. Au contraire ! Elle plaide pour un marxisme vivant, non dogmatique, empreint de la méthode scientifique, qui regarde les erreurs et les défaites en face pour en tirer les leçons et mieux préparer l’avenir. Car cette révolutionnaire a une confiance inébranlable en l’avenir et dans la capacité du prolétariat mondial à accomplir sa mission historique : lutter consciemment pour l’émancipation de toute l’humanité.
CCI
[…] Finie l’ivresse. […] L’allégresse bruyante des jeunes filles courant le long des convois ne fait plus d’escorte aux trains de réservistes et ces derniers ne saluent plus la foule en se penchant depuis les fenêtres de leur wagon, un sourire joyeux aux lèvres […]. Dans l’atmosphère dégrisée de ces journées blêmes, c’est un tout autre chœur que l’on entend : le cri rauque des vautours et des hyènes sur le champ de bataille. […] La chair à canon, embarquée en août et septembre toute gorgée de patriotisme, pourrit maintenant en Belgique, dans les Vosges, en Masurie, dans des cimetières où l’on voit les bénéfices de guerre pousser dru. […] Les affaires fructifient sur des ruines. Des villes se métamorphosent en monceaux de décombres, des villages en cimetières, des régions entières en déserts, des populations entières en troupes de mendiants, des églises en écuries. […]123
Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment.
Et au cœur de ce sabbat de sorcière s’est produit une catastrophe de portée mondiale : la capitulation de la social-démocratie internationale. Ce serait pour le prolétariat le comble de la folie que de se bercer d’illusions à ce sujet ou de voiler cette catastrophe : c’est le pire qui pourrait lui arriver. “Le démocrate” (c’est-à-dire le petit-bourgeois révolutionnaire) dit Marx, “sort de la défaite la plus honteuse aussi pur et innocent que lorsqu’il a commencé la lutte : avec la conviction toute récente qu’il doit vaincre, non pas qu’il s’apprête, lui et son parti, à réviser ses positions anciennes, mais au contraire parce qu’il attend des circonstances qu’elles évoluent en sa faveur.” Le prolétariat moderne, lui, se comporte tout autrement au sortir des grandes épreuves de l’histoire. Ses erreurs sont aussi gigantesques que ses tâches. Il n’y a pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer le chemin à parcourir. Il n’a d’autre maître que l’expérience historique. Le chemin pénible de sa libération n’est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d’erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l’atteindra s’il sait s’instruire de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l’autocritique, une autocritique sans merci, cruelle, allant jusqu’au fond des choses, c’est l’air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre. Dans la guerre mondiale actuelle, le prolétariat est tombé plus bas que jamais. C’est là un malheur pour toute l’humanité. Mais c’en serait seulement fini du socialisme au cas où le prolétariat international se refuserait à mesurer la profondeur de sa chute et à en tirer les enseignements qu’elle comporte.
Ce qui est en cause actuellement, c’est tout le dernier chapitre de l’évolution du mouvement ouvrier moderne au cours de ces vingt-cinq dernières années. Ce à quoi nous assistons, c’est à la critique et au bilan de l’œuvre accomplie depuis près d’un demi-siècle. La chute de la Commune de Paris avait scellé la première phase du mouvement ouvrier européen et la fin de la I Internationale. A partir de là commença une phase nouvelle. Aux révolutions spontanées, aux soulèvements, aux combats sur les barricades, après lesquels le prolétariat retombait chaque fois dans son Etat passif, se substitua alors la lutte quotidienne systématique, l’utilisation du parlementarisme bourgeois, l’organisation des masses, le mariage de la lutte économique et de la lutte politique, le mariage de l’idéal socialiste avec la défense opiniâtre des intérêts quotidiens immédiats. Pour la première fois, la cause du prolétariat et de son émancipation voyait briller devant elle une étoile pour la guider : une doctrine scientifique rigoureuse. A la place des sectes, des écoles, des utopies, des expériences que chacun faisait pour soi dans son propre pays, on avait un fondement théorique international, base commune qui faisait converger les différents pays en un faisceau unique. La théorie marxiste mit entre les mains de la classe ouvrière du monde entier une boussole qui lui permettait de trouver sa route dans le tourbillon des événements de chaque jour et d’orienter sa tactique de combat à chaque heure en direction du but final, immuable.
C’est le parti social-démocrate allemand qui se fit le représentant, le champion et le gardien de cette nouvelle méthode. […] Au prix de sacrifices innombrables, par un travail minutieux et infatigable, elle a édifié une organisation exemplaire, la plus forte de toutes ; elle a créé la presse la plus nombreuse, donné naissance aux moyens de formation et d’éducation les plus efficaces, rassemblé autour d’elle les masses d’électeurs les plus considérables et obtenu le plus grand nombre de sièges de députés. La social-démocratie allemande passait pour l’incarnation la plus pure du socialisme marxiste. Le parti social-démocrate occupait et revendiquait une place d’exception en tant que maître et guide de la IIree Internationale. […] La social-démocratie française, italienne et belge, les mouvements ouvriers de Hollande, de Scandinavie, de Suisse et des Etats-Unis marchaient sur ses traces avec un zèle toujours croissant. Quant aux Slaves, les Russes et les sociaux-démocrates des Balkans, ils la regardaient avec une admiration sans bornes, pour ainsi dire inconditionnelle. […] Pendant les congrès, au cours des sessions du bureau de l’Internationale socialiste, tout était suspendu à l’opinion des Allemands. […] “Pour nous autres Allemands, ceci est inacceptable” suffisait régulièrement à décider de l’orientation de l’Internationale. Avec une confiance aveugle, celle-ci s’en remettait à la direction de la puissante social-démocratie allemande tant admirée : elle était l’orgueil de chaque socialiste et la terreur des classes dirigeantes dans tous les pays.
Et à quoi avons-nous assisté en Allemagne au moment de la grande épreuve historique ? A la chute la plus catastrophique, à l’effondrement le plus formidable. […] Aussi faut-il commencer par elle, par l’analyse de sa chute […]. La classe ouvrière, elle, ose hardiment regarder la vérité en face, même si cette vérité constitue pour elle l’accusation la plus dure, car sa faiblesse n’est qu’un errement et la loi impérieuse de l’histoire lui redonne la force, lui garantit sa victoire finale.
L’autocritique impitoyable n’est pas seulement pour la classe ouvrière un droit vital, c’est aussi pour elle le devoir suprême. Sur notre navire, nous transportions les trésors les plus précieux de l’humanité confiés à la garde du prolétariat, et tandis que la société bourgeoise, flétrie et déshonorée par l’orgie sanglante de la guerre, continue de se précipiter vers sa perte, il faut que le prolétariat international se reprenne, et il le fera, pour ramasser les trésors que, dans un moment de confusion et de faiblesse au milieu du tourbillon déchaîné de la guerre mondiale, il a laissé couler dans l’abîme.
Une chose est certaine, la guerre mondiale représente un tournant pour le monde. […] La guerre mondiale a changé les conditions de notre lutte et nous a changés nous-mêmes radicalement. Non que les lois fondamentales de l’évolution capitaliste, le combat de vie et de mort entre le capital et le travail, doivent connaître une déviation ou un adoucissement. […] Mais à la suite de l’éruption du volcan impérialiste, le rythme de l’évolution a reçu une impulsion si violente qu’à côté des conflits qui vont surgir au sein de la société et à côté de l’immensité des tâches qui attendent le prolétariat socialiste dans l’immédiat toute l’histoire du mouvement ouvrier semble n’avoir été jusqu’ici qu’une époque paradisiaque. […] Rappelons-nous comment naguère encore nous décrivions l’avenir :
[…] Le tract officiel du parti, Impérialisme ou socialisme, qui a été diffusé il y a quelques années à des centaines de milliers d’exemplaires, s’achevait sur ces mots “Ainsi la lutte contre le capitalisme se transforme de plus en plus en un combat décisif entre le Capital et le Travail. Danger de guerre, disette et capitalisme - ou paix, prospérité pour tous, socialisme ; voilà les termes de l’alternative. L’histoire va au-devant de grandes décisions. Le prolétariat doit inlassablement œuvrer à sa tâche historique, renforcer la puissance de son organisation, la clarté de sa connaissance. Dès lors, quoi qu’il puisse arriver, soit que, par la force qu’il représente, il réussisse à épargner à l’humanité le cauchemar abominable d’une guerre mondiale, soit que le monde capitaliste ne puisse périr et s’abîmer dans le gouffre de l’histoire que comme il en est né, c’est-à-dire dans le sang et la violence, à l’heure historique la classe ouvrière sera prête et le tout est d’être prêt.” […] Une semaine encore avant que la guerre n’éclate, le 26 juillet 1914, les journaux du parti allemand écrivaient “Nous ne sommes pas des marionnettes, nous combattons avec toute notre énergie un système qui fait des hommes des instruments passifs de circonstances qui agissent aveuglément, de ce capitalisme qui se prépare à transformer une Europe qui aspire à la paix en une boucherie fumante. Si ce processus de dégradation suit son cours, si la volonté de paix résolue du prolétariat allemand et international qui apparaîtra au cours des prochains jours dans de puissantes manifestations ne devait pas être en mesure de détourner la guerre mondiale, alors, qu’elle soit au moins la dernière guerre, qu’elle devienne le crépuscule des dieux du capitalisme” (Frankfurter Volksstimme) […] Et c’est alors que survint cet événement inouï, sans précédent : le 4 août 1914.
Cela devait-il arriver ainsi ? […] Le socialisme scientifique nous a appris à comprendre les lois objectives du développement historique. Les hommes ne font pas leur histoire de toutes pièces. Mais ils la font eux-mêmes. Le prolétariat dépend dans son action du degré de développement social de l’époque, mais l’évolution sociale ne se fait pas non plus en dehors du prolétariat, celui-ci est son impulsion et sa cause, tout autant que son produit et sa conséquence. Son action fait partie de l’histoire tout en contribuant à la déterminer. Et si nous pouvons aussi peu nous détacher de l’évolution historique que l’homme de son ombre, nous pouvons cependant bien l’accélérer ou la retarder. Dans l’histoire, le socialisme est le premier mouvement populaire qui se fixe comme but, et qui soit chargé par l’histoire, de donner à l’action sociale des hommes un sens conscient, d’introduire dans l’histoire une pensée méthodique et, par là, une volonté libre. Voilà pourquoi Friedrich Engels dit que la victoire définitive du prolétariat socialiste constitue un bond qui fait passer l’humanité du règne animal au règne de la liberté. Mais ce “bond” lui-même n’est pas étranger aux lois d’airain de l’histoire, il est lié aux milliers d’échelons précédents de l’évolution, une évolution douloureuse et bien trop lente. Et ce bond ne saurait être accompli si, de l’ensemble des prémisses matérielles accumulées par l’évolution, ne jaillit pas l’étincelle de la volonté consciente de la grande masse populaire. La victoire du socialisme ne tombera pas du ciel comme fatum, cette victoire ne peut être remportée que grâce à une longue série d’affrontements entre les forces anciennes et les forces nouvelles […]. Friedrich Engels a dit un jour : “La société bourgeoise est placée devant un dilemme : ou bien passage au socialisme ou rechute dans la barbarie.” Mais que signifie donc une “rechute dans la barbarie” au degré de civilisation que nous connaissons en Europe aujourd’hui ? Jusqu’ici nous avons lu ces paroles sans y réfléchir et nous les avons répétées sans en pressentir la terrible gravité. Jetons un coup d’œil autour de nous en ce moment même, et nous comprendrons ce que signifie une rechute de la société bourgeoise dans la barbarie. Le triomphe de l’impérialisme aboutit à l’anéantissement de la civilisation – sporadiquement pendant la durée d’une guerre moderne et définitivement si la période des guerres mondiales qui débute maintenant devait se poursuivre sans entraves jusque dans ses dernières conséquences. C’est exactement ce que Friedrich Engels avait prédit, une génération avant nous, voici quarante ans. Nous sommes placés aujourd’hui devant ce choix : ou bien triomphe de l’impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquences, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien victoire du socialisme, c’est-à-dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l’impérialisme et contre sa méthode d’action : la guerre. C’est là un dilemme de l’histoire du monde, un ou bien – ou bien encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire : l’avenir de la civilisation et de l’humanité en dépendent. Au cours de cette guerre, l’impérialisme a remporté la victoire. En faisant peser de tout son poids le glaive sanglant de l’assassinat des peuples, il a fait pencher la balance du côté de l’abîme, de la désolation et de la honte. Tout ce fardeau de honte et de désolation ne sera contrebalancé que si, au milieu de la guerre, nous savons retirer de la guerre la leçon qu’elle contient, si le prolétariat parvient à se ressaisir et s’il cesse de jouer le rôle d’un esclave manipulé par les classes dirigeantes pour devenir le maître de son propre destin.
La classe ouvrière paie cher toute nouvelle prise de conscience de sa vocation historique. Le Golgotha de sa libération est pavé de terribles sacrifices. Les combattants des journées de Juin, les victimes de la Commune, les martyrs de la Révolution russe – quelle ronde sans fin de spectres sanglants ! Mais ces hommes-là sont tombés au champ d’honneur, ils sont, comme Marx l’écrivit à propos des héros de la Commune, “ensevelis à jamais dans le grand cœur de la classe ouvrière”. Maintenant, au contraire, des millions de prolétaires de tous les pays tombent au champ de la honte, du fratricide, de l’automutilation, avec aux lèvres leurs chants d’esclaves. Il a fallu que cela aussi ne nous soit pas épargné. Vraiment nous sommes pareils à ces Juifs que Moïse a conduits à travers le désert. Mais nous ne sommes pas perdus et nous vaincrons pourvu que nous n’ayons pas désappris d’apprendre. Et si jamais le guide actuel du prolétariat, la social-démocratie, ne savait plus apprendre, alors elle périrait “pour faire place aux hommes qui soient à la hauteur d’un monde nouveau”.
Junius (1915)
1 ) Dont le titre est Socialisme ou barbarie.
2 ) Aussi connue sous le nom de La brochure de Junius, pseudonyme utilisé par Rosa pour le signer, ce texte est intégralement disponible sur le site marxists.org.
3 ) De pires atrocités viendront ensuite, comme la Seconde Guerre mondiale.
Rubrique:
Après le massacre de Marikana, l'Afrique du Sud est frappée par des grèves massives
- 1219 reads
 En septembre (voir site web: RI no 435), nous analysions le contexte dans lequel s’est déroulé le massacre des mineurs en grève à Marikana par la police sud-africaine, le 16 août dernier. Nous montrions de quelle manière les syndicats et le gouvernement avaient en fait tendu un piège meurtrier aux ouvriers afin d’étrangler la dynamique de lutte qui touche depuis plusieurs mois “la plus grande démocratie africaine”. Tandis que ses flics brutalisaient et assassinaient les travailleurs en toute impunité, la bourgeoisie brandissait le thème de l’apartheid pour les entraîner sur le terrain stérile de la prétendue lutte des races dont les travailleurs noirs seraient les victimes. Si les grèves semblaient s’étendre à d’autres mines, il nous était toutefois impossible de déterminer avec certitude si elles glisseraient effectivement sur le terrain du conflit inter-racial ou continueraient à s’étendre.
En septembre (voir site web: RI no 435), nous analysions le contexte dans lequel s’est déroulé le massacre des mineurs en grève à Marikana par la police sud-africaine, le 16 août dernier. Nous montrions de quelle manière les syndicats et le gouvernement avaient en fait tendu un piège meurtrier aux ouvriers afin d’étrangler la dynamique de lutte qui touche depuis plusieurs mois “la plus grande démocratie africaine”. Tandis que ses flics brutalisaient et assassinaient les travailleurs en toute impunité, la bourgeoisie brandissait le thème de l’apartheid pour les entraîner sur le terrain stérile de la prétendue lutte des races dont les travailleurs noirs seraient les victimes. Si les grèves semblaient s’étendre à d’autres mines, il nous était toutefois impossible de déterminer avec certitude si elles glisseraient effectivement sur le terrain du conflit inter-racial ou continueraient à s’étendre.
Depuis la publication de notre article, nous avons assisté au plus important mouvement de grève en Afrique du Sud depuis la fin de l’apartheid en 1994. Ces grèves sont doublement significatives car, non seulement elles démontrent – si cela était encore nécessaire – que derrière le prétendu miracle économique des “pays émergents” se cache, comme partout, une misère croissante, mais elles mettent également en évidence que les travailleurs du monde entier, loin d’avoir des intérêts divergents, se battent partout contre les conditions de vie indignes qu’impose le capitalisme. A ce titre, malgré les faiblesses sur lesquelles nous reviendrons, les grèves qui secouent l’Afrique du Sud s’inscrivent dans le sillage des luttes ouvrières de par le monde.
Face aux mineurs, l’Etat divise, épuise et terrorise
Suite au massacre du 16 août, la lutte semblait devoir s’essouffler, écrasée par le poids des manœuvres de la bourgeoisie. En effet, tandis que la grève s’étendait à plusieurs autres mines avec des revendications identiques, une concertation de requins était organisée entre les seuls syndicats de Marikana, la direction et l’Etat, le tout sous la très sainte médiation de dignitaires religieux. La manœuvre visait à étouffer l’extension des grèves en divisant les ouvriers entre ceux, d’une part, qui bénéficiaient de négociations et de toute l’attention médiatique et ceux, d’autre part, qui se lançaient dans la grève dans l’indifférence générale, à l’exception de l’attention des flics (blancs et noirs) qui poursuivaient leur campagne de terreur, leurs provocations et leurs descentes nocturnes.
Sur le terrain, l’AMCU, syndicat qui avait profité du déclenchement de la grève sauvage à Marikana le 10 août pour lancer ses gros bras dans une guerre de territoire meurtrière contre son concurrent du MUN, incitait les ouvriers à s’en prendre physiquement aux mineurs qui avaient repris le travail : “La police ne pourra pas les protéger tout le temps, la police ne dort pas avec eux dans leurs baraquements. Si tu vas travailler, tu dois savoir que tu vas en subir les conséquences.” A cause du blackout médiatique qui s’est brutalement abattu sur cette lutte, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si les ouvriers ont effectivement cédé à la violence ou si les syndicats ont poursuivi leur règlement de comptes sous couvert des grèves ; toujours est-il que plusieurs assassinats et agressions ont été perpétuées tout au long du mouvement.
Bien que la propagande autour du “retour de l’apartheid” n’ait jamais réellement été prise au sérieux par les ouvriers, dans un tel contexte, la lutte refluait bel et bien. Pourtant, à ce stade, le mouvement connaissait un nouveau souffle.
La grève s’étend
Le 30 août, la population apprenait, par l’intermédiaire du journal de Johannesburg, The Star, qu’en affirmant avoir tiré sur les mineurs de Marikana “en Etat de légitime défense”, la police avait menti éhontément puisque les rapports d’autopsie montraient que les mineurs avaient en fait été abattus dans le dos, en essayant de fuir leurs bourreaux. Selon plusieurs témoignages de journalistes présents sur place, les flics pourchassaient même les grévistes pour les assassiner de sang froid. Or, presque au même moment, le tribunal de Pretoria annonçait son intention d’inculper les deux cent soixante-dix mineurs arrêtés le 16 août lors de la fusillade policière... pour le meurtre de leurs camarades ( !), en vertu d’une loi anti-émeute prévoyant l’inculpation pour meurtre de toutes les personnes arrêtées sur le site d’une fusillade impliquant la police. C’est que, dans “la plus grande démocratie africaine”, on ne fait pas dans la dentelle ; tandis qu’aucun des policiers qui ont abattu les mineurs de Marikana n’a été inquiété, l’Etat inculpe les survivants de la fusillade. Avec un peu d’imagination, le tribunal de Pretoria aurait presque pu exécuter une seconde fois les morts pour leur propre assassinat !
La consternation fût telle que, le 2 septembre, le tribunal était contraint de reculer en annonçant l’annulation des inculpations et la libération de l’ensemble des prisonniers. Surtout, l’Etat se rendait rapidement compte de son erreur puisque, sur la base des mêmes revendications, les grèves se sont aussitôt multipliées dans la plupart des mines du pays. En effet, le 31 août, quinze mille employés d’une mine d’or exploitée par le groupe Gold Fields, près de Johannesburg, lançaient une grève sauvage. Le 3 septembre, les mineurs de Modder East, employés par Gold One, entraient à leur tour dans la lutte. Le 5 septembre, presque tous les mineurs de Marikana manifestaient sous les acclamations de la population et refusaient, le lendemain, de s’associer à l’accord minable signé entre les syndicats et la direction de Lomin. Dès le 14 septembre, les compagnies Amplats, Aquarius et Xstrata, qui exploitent chacune plusieurs sites, annonçaient la suspension de leur activité, tandis que la production de presque l’ensemble des mines du pays semblait à l’arrêt. La vague de grève devait même s’étendre à d’autres secteurs, en particulier celui des transporteurs routiers.
Cette dynamique était, en partie, alimentée par l’indignation suscitée par les témoignages des grévistes emprisonnés : “Ils [les policiers] nous ont frappés et nous ont giflés, nous ont marchés sur les doigts avec leurs bottes”, “Je n’arrive toujours pas à comprendre ce qui m’est arrivé, c’est ma première fois en prison ! Nous réclamions une hausse de salaire et ils se sont mis à nous tirer dessus, et en prison les policiers nous ont battus, ils ont même volé les 200 rands [20 euros] que j’avais sur moi !”
Lent reflux de la lutte
La terreur policière s’abattait également sur les grévistes en liberté par le biais d’interventions très violentes, occasionnant des arrestations pour des motifs incongrus, de nombreux blessés et plusieurs morts (1). Ainsi, le 14 septembre, le porte-parole du gouvernement déclarait : “Il est nécessaire d’intervenir car nous sommes arrivés à un point où il faut faire des choix importants.” Après ce bel exemple de phrase creuse dont seuls les politiciens ont le secret, le porte-parole ajoutait, beaucoup moins laconiquement : “Si nous laissons cette situation se développer, l’économie va en souffrir gravement.” Le lendemain, une descente extrêmement brutale était organisée, vers deux heures du matin, dans les dortoirs abritant les ouvriers de Marikana et leur famille. La police, appuyée par l’armée, blessait de nombreuses personnes, dont plusieurs femmes. Au matin, des émeutes éclataient, des barricades étaient dressées sur les routes. Il n’en fallait pas moins à la police pour déchaîner sa violence sur les ouvriers de tout le pays au nom de la “sécurité des personnes”.
Tandis que ses flics terrorisaient la population, l’Etat, avec la complicité des syndicats, portait un coup important à la lutte, le 18 septembre, en accordant aux seuls mineurs de Marikana des augmentations de 11 à 22 %. Cette victoire en trompe-l’œil visait clairement à diviser les ouvriers et à priver le mouvement des travailleurs qui étaient jusque-là au cœur de la lutte. En clair, la bourgeoisie sacrifiait 22 % aux mineurs de Marikana pour étouffer la combativité des autres grévistes, stopper l’extension de la lutte et priver la plupart des ouvriers des augmentations de salaire revendiquées.
Pourtant, le 25 septembre, les neuf mille employés de la mine Beatrix entraient à leur tour en grève, ceux de Atlatsa se lançaient dans la lutte le 1er octobre. La violence de la police s’éleva à nouveau d’un cran avec son lot d’interpellations brutales, de matraquages et d’assassinats. Le 5 octobre, la compagnie Amplats sortait la grosse artillerie en annonçant le licenciement de douze mille mineurs. Dans la foulée, plusieurs compagnies, appuyées par les tribunaux, menacèrent de licencier massivement à travers un chantage écœurant : soit les ouvriers acceptaient les misérables augmentations de salaire proposées par les directions, soit ils étaient mis à la porte. Gold One devait finalement licencier mille quatre cents personnes, Gold Field mille cinq cents autres, etc.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les dernières poches de grévistes retournent peu à peu au travail. Mais cette lutte, et malgré les faiblesses qui l’ont caractérisée, exprime une certaine élévation de la conscience de classe. Les ouvriers sud-africains ont ressenti la nécessité de lutter collectivement, ont formulé des revendications précises et unitaires, ont constamment cherché à étendre leur combat. Dans un contexte où la crise et la misère vont inexorablement s’approfondir, ce mouvement est une expérience inaltérable dans le développement de la conscience de tous les prolétaires de la région et une leçon pour les prolétaires du monde entier.
El Generico, 22 octobre
1 ) Il est encore impossible de déterminer le nombre de grévistes abattus par la police sud-africaine, mais la presse a rapporté sept morts à Rustenburg et au moins un mort dans les rangs des chauffeurs de camion.
Géographique:
- Afrique [3]
Rubrique:
Pourquoi est-il si difficile de lutter et comment dépasser ces difficultés?
- 1249 reads
Tout semble a priori favorable à une explosion sans précédent de la colère ouvrière. La crise est manifeste, elle n’échappe à personne, et personne n’y échappe. Peu croient encore à la “sortie de crise” dont on nous rebat les oreilles quotidiennement. La planète nous déroule tout aussi quotidiennement son spectacle de désolation : guerres et barbarie, famines insupportables, épidémies, sans parler des manipulations irresponsables d’apprentis-sorciers délirants auxquels les capitalistes se livrent avec la nature, la vie et notre santé, au seul nom du profit.
Face à tout cela, il est difficile d’imaginer qu’un autre sentiment que la révolte et l’indignation puisse occuper les esprits. Il est difficile de penser qu’une majorité de prolétaires croient encore à un avenir sous le capitalisme. Et pourtant, les masses n’ont pas encore pleinement pris le chemin de la lutte. Faut-il alors penser que les jeux sont faits, que le rouleau compresseur de la crise est trop puissant, que la démoralisation qu’il engendre est indépassable ?
De grandes difficultés…
On ne peut nier que la classe ouvrière connaît actuellement des difficultés importantes. Il y a au moins quatre raisons essentielles à cela :
• La première, de loin la plus centrale, c’est tout simplement le fait que le prolétariat n’a pas conscience de lui-même, qu’il a perdu sa propre identité de classe. Suite à la chute du mur de Berlin, toute une propagande s’était en effet déchainée dans les années 1990 pour tenter de nous convaincre de la faillite historique du communisme. Les plus audacieux – et les plus stupides – annonçaient même “la fin de l’histoire”, le triomphe de la paix et de la “démocratie”… En amalgamant le communisme à la carcasse du monstre stalinien putréfié, la classe dominante a cherché à discréditer par avance toute perspective de classe visant à renverser le système capitaliste. Non contente de chercher à détruire toute idée de perspective révolutionnaire, elle s’est aussi efforcée de faire du combat prolétarien une sorte d’archaïsme bon à préserver comme “mémoire culturelle” au musée de l’Histoire, à l’instar des fossiles de dinosaures ou de la grotte de Lascaux.
Surtout, la bourgeoisie n’a cessé d’insister sur le fait que la classe ouvrière sous sa forme classique avait disparu de la scène politique. Tous les sociologues, journalistes, politiciens et philosophes du dimanche rabâchent l’idée que les classes sociales ont disparu, fondues dans le magma informe des “classes moyennes”. C’est le rêve permanent de la bourgeoisie d’une société où les prolétaires ne se verraient qu’en simples “citoyens”, divisés en catégories socioprofessionnelles plus ou moins bien discernées et surtout bien divisées – en cols blancs, cols bleus, employés, précaires, chômeurs, etc. – avec des intérêts divergents et qui ne “s’unissent” que momentanément, isolés et passifs, dans les urnes. Et il est vrai que le battage sur la disparition de la classe ouvrière, répété et asséné à grands renforts de reportages, de livres, d’émissions télévisés… a eu pour résultat que nombre d’ouvriers ne parviennent pour l’instant plus à se concevoir comme partie intégrante de la classe ouvrière et encore moins comme classe sociale indépendante.
• De cette perte de l’identité de classe découle, en second lieu, les difficultés du prolétariat à affirmer son combat et sa perspective historique. Dans un contexte où la bourgeoisie elle-même n’a aucune perspective à offrir autre que l’austérité, le chacun pour soi, l’isolement et le sauve-qui-peut dominent. La classe dominante exploite ses sentiments pour monter les exploités les uns contre les autres, les diviser pour empêcher toute riposte unie, pour les pousser au désespoir.
• Le troisième facteur, comme conséquence des deux premiers, c’est que la brutalité de la crise tend à paralyser de nombreux prolétaires, à cause de la peur de tomber dans la misère absolue, de ne pouvoir nourrir sa famille et de se retrouver à la rue, isolé et exposé à la répression. Même si certains, mis au pied du mur, sont poussés à manifester leur colère, à l’image des “Indignés”, ils ne se conçoivent pas comme une réelle classe en lutte. Ceci, malgré les efforts et le caractère parfois relativement massif des mouvements, limite la capacité à résister aux mystifications et aux pièges tendus par la classe dominante, à se réapproprier les expériences de l’histoire, à tirer des leçons avec le recul et la profondeur nécessaires.
• Il y a enfin un quatrième élément important pour expliquer les difficultés actuelles de la classe ouvrière à développer sa lutte contre le système : c’est l’arsenal d’encadrement de la bourgeoisie, ouvertement répressif, comme les forces de police, ou surtout plus insidieux et bien plus efficaces, comme les forces syndicales. Sur ce dernier aspect, notamment, la classe ouvrière n’est pas encore parvenue à dépasser ses craintes de lutter en dehors de leur encadrement, même si ceux qui ont encore des illusions sur la capacité des syndicats à défendre nos intérêts sont de moins en moins nombreux. Et cet encadrement physique se double d’un encadrement idéologique plus ou moins maîtrisé par les syndicats, les médias, les intellectuels, les partis de gauche, etc. Ce que la bourgeoisie réussit aujourd’hui le plus à développer est sans conteste l’idéologie démocratique. Tout événement est exploité pour vanter les bienfaits de la démocratie. La démocratie est présentée comme le cadre où toutes les libertés se développent, où toutes les opinions s’expriment, où le pouvoir est légitimé par le peuple, où les initiatives sont favorisées, où tout le monde peut accéder à la connaissance, à la culture, aux soins et, pourquoi pas, au pouvoir. En réalité, la démocratie n’offre qu’un cadre national au développement du pouvoir des élites, du pouvoir de la bourgeoisie, et le reste n’est qu’illusion, l’illusion qu’en passant par l’isoloir on exerce un quelconque pouvoir, que dans l’hémicycle s’expriment les opinions de la population au travers du vote de “représentants”. Il ne faut pas sous-estimer le poids de cette idéologie sur les consciences ouvrières, tout comme il ne faut pas oublier le choc extrême qu’aura provoqué l’effondrement du stalinisme à la charnière des années 1980 et 1990. A tout cet arsenal idéologique vient s’ajouter l’idéologie religieuse. Elle n’est pas nouvelle si l’on considère qu’elle a accompagné l’humanité depuis ses premiers pas dans le besoin de comprendre son environnement. Elle n’est pas nouvelle non plus si on se rappelle à quel point elle est venue légitimer toutes sortes de pouvoirs à travers l’histoire. Mais aujourd’hui, ce qu’elle présente d’original est qu’elle vient se greffer aux réflexions d’une partie de la classe ouvrière face au capitalisme destructeur et en faillite. Elle vient dévoyer cette réflexion en expliquant la “décadence” du monde occidental dans son éloignement des valeurs portées depuis des millénaires par la religion, en particulier les religions monothéistes. L’idéologie religieuse a cette force qu’elle réduit à néant la complexité extrême de la situation. Elle n’apporte que des réponses simples, faciles à mettre en œuvre. Dans ses formes intégristes, elle ne convainc qu’une petite minorité d’ouvriers, mais de façon plus générale, elle contribue à parasiter la réflexion de la classe ouvrière.
… et un formidable potentiel
Ce tableau est un peu désespérant : face à une bourgeoisie qui maîtrise ses armes idéologiques, à un système qui menace de misère la plus grande partie de la population, quand elle ne l’y plonge pas directement, y a-t-il encore une place pour développer une pensée positive, pour dégager un espoir ? Y a-t-il vraiment encore une force sociale capable de mener à bien une œuvre aussi immense que la transformation radicale de la société, rien de moins ? A cette question, il faut répondre sans hésitation : oui ! Cent fois oui ! Il ne s’agit pas d’avoir une confiance aveugle dans la classe ouvrière, une foi quasi-religieuse dans les écrits de Marx ou un élan désespéré dans une révolution perdue d’avance. Il s’agit de prendre du recul, d’avoir une analyse sereine de la situation, au delà des enjeux immédiats, tenter de comprendre ce que signifient réellement les luttes de la classe ouvrière sur la scène sociale et étudier en profondeur le rôle historique du prolétariat.
Dans notre presse, nous avons déjà analysé que, depuis 2003, la classe ouvrière est dans une dynamique positive par rapport au recul qu’elle a subi avec l’effondrement des pays de l’Est. De nombreuses manifestations de cette analyse se retrouvent dans des luttes plus ou moins importantes mais qui ont toutes pour caractéristique de montrer la réappropriation progressive par la classe de ses réflexes historiques comme la solidarité, la réflexion collective, et plus simplement, l’enthousiasme face à l’adversité.
Nous avons pu voir ces éléments à l’œuvre dans les luttes contre les réformes des retraites en France en 2003 et en 2010-2011, dans la lutte contre le CPE, toujours en France, en 2006, mais aussi de façon moins étendue en Grande-Bretagne (aéroport d’Heathrow, raffineries de Lindsay), aux Etats-Unis (Métro de New York), en Espagne (Vigo), en Egypte, à Dubaï, en Chine, etc. Les mouvements des Indignés et Occupy, surtout, reflètent une expression beaucoup plus générale et ambitieuse que des luttes se développant au sein d’une entreprise, par exemple. Qu’avons-nous vu, notamment, dans les mouvements des Indignés ? Des ouvriers de tous horizons, du précaire au cadre, simplement venus pour vivre une expérience collective et attendre d’elle une meilleure compréhension des enjeux de la période. Nous avons vu des personnes s’enthousiasmer à la seule idée de pouvoir à nouveau discuter librement avec d’autres. Nous avons vu des personnes discuter d’expériences alternatives et d’en poser les atouts et les limites. Nous avons vu des personnes refuser d’être les victimes impassibles d’une crise qu’ils n’ont pas provoquée et qu’ils refusent de payer. Nous avons vu des personnes mettre en place des assemblées spontanées, y adopter des formes d’expression favorisant la réflexion et la confrontation, limitant la perturbation et le sabotage des discussions. Enfin et surtout, le mouvement des Indignés a permis l’éclosion d’un sentiment internationaliste, la compréhension que, partout dans le monde, nous subissons la même crise et que nous devons lutter contre elle par-delà les frontières.
Certes, nous n’avons pas, ou peu, entendu parler explicitement de communisme, de révolution prolétarienne, de classe ouvrière et de bourgeoisie, de guerre civile, etc. Mais ce que ces mouvements ont montré, c’est avant tout l’exceptionnelle créativité de la classe ouvrière, sa capacité à s’organiser, issues de son caractère inaliénable de force sociale indépendante. La réappropriation consciente de ces caractéristiques est encore au bout d’un chemin long et tortueux, mais elle est indéniablement à l’œuvre. Elle s’accompagne forcément d’un processus de décantation, de reflux, de découragement partiel. Elle alimente cependant la réflexion des minorités qui se situent à l’avant-garde du combat de la classe ouvrière au niveau mondial, et dont le développement est visible, quantifiable, depuis plusieurs années.
C’est un processus sain qui contribue à la clarification des enjeux auxquels la classe ouvrière est confrontée aujourd’hui.
Finalement, même si les difficultés posées à la classe ouvrière sont énormes, rien ne permet dans la situation d’affirmer que les jeux sont faits, que la classe ouvrière n’aura pas la force de développer des luttes massives puis révolutionnaires. Bien au contraire, les expressions vivantes de la classe se multiplient et en étudiant ce qu’elles ont vraiment, non en apparence, où seule leur fragilité est évidente, mais en profondeur, alors apparaît le potentiel, la promesse d’avenir qu’elles contiennent. Leur caractère minoritaire, épars et sporadique n’est là que pour nous rappeler que les principales qualités des révolutionnaires sont la patience et la confiance en la classe ouvrière1 ! Cette patience et cette confiance s’appuie sur la compréhension de ce qu’est historiquement, la classe ouvrière : la première classe à la fois exploitée et révolutionnaire qui a pour mission d’émanciper toute l’humanité du joug de l’exploitation. Il s’agit là d’une vision matérialiste, historique, à long terme ; c’est cette vision qui nous a permis d’écrire en 2003, lorsque nous dressions le bilan de notre XVe congrès international : “Comme le disent Marx et Engels, il ne s’agit pas de considérer “ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier imagine momentanément comme but. Seul importe ce qu’il est et ce qu’il sera historiquement contraint de faire conformément à cet être” (la Sainte famille). Une telle vision nous montre notamment que, face aux coups très forts de la crise du capitalisme, qui se traduisent par des attaques de plus en plus féroces, la classe réagit et réagira nécessairement en développant son combat. Ce combat, à ses débuts, sera fait d’une série d’escarmouches, lesquelles annonceront un effort pour aller vers des luttes de plus en plus massives. C’est dans ce processus que la classe se comprendra à nouveau comme une classe distincte, ayant ses propres intérêts et tendra à retrouver son identité, aspect essentiel qui en retour stimulera sa lutte.”
GD / 25.10.2012
1) Lénine aurait ajouté l‘humour !
Rubrique:
La crise est-elle locale, épargne-t-elle des pays ou des formes de gouvernement? (cycle de discussion sur la crise II)
- 1193 reads
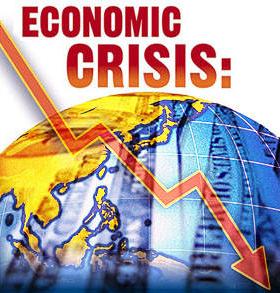 En avril et mai 2012, le CCI, avec une partie de ses sympathisants et autres intéressés venant d’horizons divers, a organisé un cycle de trois discussions sur la crise.
En avril et mai 2012, le CCI, avec une partie de ses sympathisants et autres intéressés venant d’horizons divers, a organisé un cycle de trois discussions sur la crise.
Dans la discussion l’accent a été mis sur la culture du débat et tous étaient invités à prendre part au débat. Nous soulignions que ce n’était pas une affaire d'experts car mêmes les plus grands experts économiques bourgeois n’avaient pas vu venir la crise. Et pourtant, ils dominent maintenant le débat dans les médias. A été posé le fait que pour nous il était grand temps que nous allions vers des arguments solides sur les causes des symptômes récurrents toujours plus graves de la crise et pourquoi cela ressemble de plus en plus à une crise du capitalisme en tant que système, aussi bien économiquement, socialement que politiquement.
La question se pose : réforme ou renversement révolutionnaire? Dans la contribution suivante, nous proposons la deuxième introduction de ce cycle. La discussion qui a suivi a été très animée et traversée d’une participation enthousiaste de tous les participants.
Un recueil de textes a été créé au service des participants. Il peut aussi être envoyé sur simple demande.
Qu’en est-il des pays “socialistes”, tels la Chine, la Corée du Nord ou Cuba ou les fameux pays BRICS
Tandis que les économies de l’ouest sont entraînés depuis la fin des années 1960 dan une spirale sans fin de secousses économiques, la bourgeoisie de droite comme de gauche nous assène régulièrement que ce n’est pas son système qui est en crise, puisqu’il y a des endroits dans le monde qui y échappent.
Ses représentants de gauche renvoient régulièrement dans la direction des pays “socialistes”, comme la Chine, Cuba, voire la Russie ... Ses représentants plus libéraux pointent plutôt du doigt vers les “miracles économiques” comme l’Argentine, les “Tigres asiatiques” dans les années 1980/ 90, mais plus récemment aussi vers l’Irlande, l’Islande, l’Espagne, et surtout aujourd’hui vers les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine) pour mettre en valeur le dynamisme du système.
Les pays “socialistes” vers lesquels on renvoyait il y a 25 ans étaient l’Union Soviétique et son bloc qui ont depuis lors disparu en 1989, après qu’ils se sont effondrés sous la pression de la crise économique et de la pression de la concurrence impérialiste du bloc américain (vu le poids des gigantesques « frais improductifs » dans le secteur militaire). La Corée du Nord ne tient que grâce au soutien chinois et sa population est régulièrement confrontée à la famine. Cuba enfin a déclaré récemment qu’elle voulait aussi ouvrir son économie aux capitaux étrangers sous un contrôle strict de l’Etat, comme d’autres pays (La Chine, le Vietnam) l’ont fait.
Les « données objectives »
Certaines « données objectives » sont indispensables pour donner une certaine crédibilité aux mensonges. Quelles sont celles que la propagande bourgeoise avance pour donner foi à son histoire ? Relevons les données concernant la Chine, dans la mesure où elles illustrent de la manière la plus marquée les faits également relevés dans le cas d’autres pays.
1. Durant les trente années de crise et de mondialisation (1980-2008), tandis que l’Europe voyait son Produit Intérieur Brut(1) augmenter de 1,7 fois, celui des USA de 2,2 fois, celui de l’ensemble de l’économie mondiale de 2,5 fois, l’Inde a vu le sien augmenter de 4 fois, les pays en développement d’Asie de 6 fois et la Chine de 10 fois.
2. La Chine est aujourd’hui l’atelier du monde et le secteur des services y a connu une croissance énorme. Le nombre d’emplois dans le secteur industriel, qui est de 170 millions, est de 40% supérieur à celui de l’ensemble des pays de l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques) qui en comptent 123 millions, alors qu’en 1952, la Chine était encore pour l’essentiel (84% de la population) un pays agraire.
3. La croissance économique annuelle est de 8 à 10% et la Chine ne produit plus seulement des produits de base pour l ‘exportation ou des produits d’assemblage dans ses ateliers à salaires base ; elle produit et exporte de plus en plus de produits à haute valeur ajoutée, comme de l’électronique et des matériaux de transport.
Par ailleurs, les salaires bas et les conditions de travail extrêmes sont utilisés par la bourgeoisie comme moyen de chantage à l’Ouest par rapport à l’emploi (menaces de délocalisation) ou aux salaires et aux conditions de travail.
Les données aujourd’hui
L’enthousiasme s’est quelque peu refroidi et les chiffres spectaculaires de croissance du PIB appartiennent tout doucement au passé. La deuxième économie mondiale connaît aujourd’hui deux contretemps inquiétants :
- La récession qui sévit dans les économies occidentales, le principal marché pour ses exploitations, a eu un impact direct sur ses chiffres de croissance, qui sont en baisse.
- Elle connait une forte inflation de plus de 10%, malgré l’intervention monétaire de l’Etat chinois depuis 2008, qui va de pair avec une énorme bulle financière spéculative (plus de 1700 milliards de dollars), qu’elle n’arrive pas à contrôler.
En réalité, la croissance de la Chine et d’autres pays constituant un « miracle économique » n’a été possible qu’à cause de la crise mondiale de l’économie capitaliste. En cas de stagnation ou de recul du taux de profit réel sur le plan mondial, le capital va à la recherche d’un environnement adéquat pour contrer cette tendance. Ces conditions, c’est des salaires bas et un contexte politique favorable. Cela explique aussi pourquoi la Chine s’est développée grâce aux exportations, mais dépend aussi de manière cruciale de celles-ci, malgré un développement relatif de son marché intérieur.
Mais c’est la même crise qui coince aujourd’hui la Chine entre le marteau et l’enclume, entre le marteau du marché extérieur qui se réduit et l’enclume du marché intérieur qu’elle doit soutenir, entre une inflation menaçante et des bulles spéculatives qui risquent d’exploser.
La situation n’est pas différente pour les autres « pays émergents », comme l’Inde et le Brésil par exemple. Pour eux aussi, la baisse des activités économiques à cause d’un marché mondial qui se réduit est une réalité actuelle (baisse de la croissance pour l’Inde de 9,3% à 7,2%, pour le Brésil de 7,5% à 3,7% de 2010 à 2011). DE même, ils sont confrontés à l’inflation et à des problèmes monétaires. Ainsi, une des premières décisions de la nouvelle présidente brésilienne D. Rousseff après sa victoire électorale a été d’imposer un ensemble de mesures d’austérité pour 30 milliards de dollars et d’augmenter le taux d’intérêt pour l’emprunt d’argent auprès de la banque centrale du Brésil à 12%.
Bref,
Aucun pays ne peut échapper aux lois du capitalisme mondial et à leurs conséquences. La crise économique qui continue à affaiblir le système capitaliste n’est pas une histoire sans fin, elle annonce la fin d’un système , mais aussi la nécessité de la lutte contre sa barbarie et pour un monde nouveau : le communisme.
(1) Le Prodit Intérieur Brut (PIB) peut être défini (cf. Wikipedia) comme l’ensemble de la valeur monétaire de tous les biens et services produits dans un pays donné (par l’Etat et le privé) pendant une période donnée (généralement un an). Généralement le PIB est fourni sur la base des prix du marché.
Rubrique:
En Israël et en Palestine, la population est otage de la guerre impérialiste
- 1686 reads
 Une fois de plus, les tirs de roquette israéliens ont submergé Gaza. En 2008, l’opération « plomb durci » avait provoqué presque 1500 morts, pour la plupart des civils, malgré les déclarations prétendant que seules les cibles terroristes faisaient l’objet de « frappes chirurgicales » . La Bande de Gaza est une des régions où la densité de population est la plus forte mais aussi une des plus pauvres du monde. Il est ainsi absolument impossible de distinguer les « dommages infligés aux terroristes » et ceux causés aux civils qui les entourent. Avec les armes sophistiquées dont Israël dispose, la majorité des dommages de la campagne militaire actuelle touche aussi les femmes, les enfants et les vieillards.
Une fois de plus, les tirs de roquette israéliens ont submergé Gaza. En 2008, l’opération « plomb durci » avait provoqué presque 1500 morts, pour la plupart des civils, malgré les déclarations prétendant que seules les cibles terroristes faisaient l’objet de « frappes chirurgicales » . La Bande de Gaza est une des régions où la densité de population est la plus forte mais aussi une des plus pauvres du monde. Il est ainsi absolument impossible de distinguer les « dommages infligés aux terroristes » et ceux causés aux civils qui les entourent. Avec les armes sophistiquées dont Israël dispose, la majorité des dommages de la campagne militaire actuelle touche aussi les femmes, les enfants et les vieillards.
Cela laisse les militaires à la tête de l’État israélien froid. Gaza a été une fois de plus punie, comme ce fut le cas lors du massacre précédent et à travers le blocus de l'économie, empêchant les efforts de reconstruction après les ravages de 2008 et laissant la population affamée.
Comparé au feu guerrier déclenché par l’Etat israéliens, les capacités militaires du Hamas et des autres groupes djihadistes radicaux de Gaza sont dérisoires. Grâce au chaos en Libye, le Hamas a cependant obtenu des missiles de longue portée plus efficace. Non seulement Ashdod au Sud (où trois résidents d’un bloc d’immeubles ont été tués par un missile venant de Gaza) mais Tel-Aviv et Jérusalem également sont à présent à leur portée. La menace de paralysie qui saisit Gaza commence aussi à se faire sentir dans les principales villes israéliennes.
Bref : les deux populations sont tenues en otage par les arsenaux militaires opposés et qui dominent Israël et la Palestine – avec une aide discrète de l’armée égyptienne qui patrouille aux frontières de Gaza pour empêcher les incursions ou les évasions indésirables. Les deux populations sont victimes d’une situation de guerre permanente – non seulement sous la forme de roquettes et de bombes, mais aussi en étant appelées à soutenir le poids grandissant d’une économie plombée par les besoins de la guerre. De plus, la crise économique mondiale contraint aujourd’hui la classe dominante israélienne et palestinienne à mettre en place de nouvelles mesures de restrictions du niveau de vie, à augmenter les prix des produits de première nécessité.
En Israël, l’an dernier, le prix déjà élevé des logements a été une des étincelles qui a allumé le mouvement de protestation qui a pris la forme de manifestations massives et d’assemblées – mouvement qui était directement inspiré des révoltes du monde arabe et qui avait pour mots d’ordre « Netanyahou, Assad, Moubarak sont tous les mêmes » et « Arabes et Juifs veulent des logements accessibles et décents».
Au cours de cette période courte mais stimulante, tout dans la société israélienne était ouvert à la critique et au débat – y compris le « problème palestinien », l’avenir des colonies et des territoires occupés. Une des plus grandes peurs des protestataires était que le gouvernement réponde à ce défi naissant à « l’unité » nationale en se lançant dans une nouvelle aventure militaire.
De même, l'été dernier, dans la région des territoires occupés de la Bande de Gaza, les augmentations du carburant et des prix de la nourriture ont provoqué une série de manifestations de colère, avec des blocages de route et des grèves. Les ouvriers du transport, de la santé et de l’éducation, des étudiants des universités et des écoles ainsi que des chômeurs, se sont retrouvés dans la rue face à la police de l’Autorité palestinienne en exigeant des hausses de salaires, du travail, des baisses de prix et la fin de la corruption. Il y a également eu des manifestations contre le coût de la vie dans le royaume de Jordanie.
Malgré les différences de niveau de vie entre les populations israélienne et palestinienne, en dépit du fait que cette dernière subit en plus l’oppression et l’humiliation militaire, les racines de ces deux révoltes sociales sont exactement les mêmes : l’impossibilité grandissante de vivre dans un système capitaliste profondément en crise .
Il y a eu beaucoup de spéculations sur les motifs de la dernière escalade militaire. Netanyahou essaie-t-il de faire monter le nationalisme pour améliorer ses chances de réélection ? Le Hamas a-t-il provoqué ses attaques à la roquette pour prouver son crédit militaire devant le défi que posent les bandes islamistes plus radicales ? Quel rôle sera appelé à jouer dans le conflit le nouveau régime en Égypte ? Comment ces événements vont-ils affecter la guerre civile en Syrie ?
Toutes ces questions, pertinentes en elles-mêmes, ne permettent pas de répondre au problème de fond qui les relie. La réalité, c'est qu'il s'agit d'une escalade guerrière de nature impérialiste, aux antipodes des intérêts et des besoins des populations israéliennes, palestiniennes et plus largement du Moyen-Orient.
Alors que les révoltes sociales des deux côtés permettent aux exploités de se battre pour leurs intérêts matériels contre les capitalistes et l’État qui les exploite, la guerre impérialiste crée une fausse unité entre les exploités et leurs exploiteurs, renforce les divisions des exploités des deux côtés. Lorsque les avions d’Israël bombardent Gaza, cela fait des nouvelles recrues pour le Hamas et les djihadistes pour lesquels tous les Israéliens sont l’ennemi. Lorsque les djihadistes tirent à coups de roquettes sur Ashdod ou Tel-Aviv, encore plus d’Israéliens se tournent vers la protection et les appels à la vengeance de « leur » État contre les « Arabes ». Les problèmes sociaux pressants qui existent derrière les révoltes sont écrasés sous une avalanche de haine et d’hystérie nationalistes.
Petites ou grandes, toutes les nations sont impérialistes ; petites ou grandes, toutes les fractions bourgeoises n’ont jamais aucun scrupule à utiliser la population comme chair à canon au nom des intérêts de la patrie. D’ailleurs, devant l’escalade actuelle de la violence à Gaza, quand les gouvernements « responsables » et démocratiques comme ceux des États-Unis et de la Grande-Bretagne appellent à « l’apaisement », au retour vers « le processus de paix », l’hypocrisie atteint des sommets. Car ce sont ces mêmes gouvernements qui font la guerre en Afghanistan, au Pakistan, en Irak. Les États-Unis sont aussi le principal soutien financier et militaire d’Israël. Les grandes puissances impérialistes n’ont aucune solution « pacifiques » pas plus que les États comme l’Iran qui arme le Hamas et le Hezbollah. Le réel espoir d’une paix mondiale ne se trouve pas chez « nos » dirigeants, mais dans la résistance des exploités, dans leur compréhension grandissante qu’ils ont les mêmes intérêts dans tous les pays, le même besoin de lutter et de s’unir contre un système qui ne peut rien offrir d’autre que la crise, la guerre et la destruction.
Amos (20 novembre 2012)