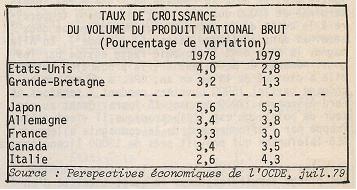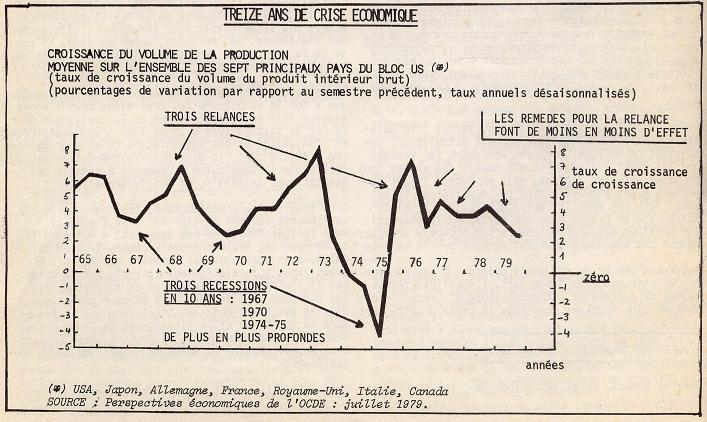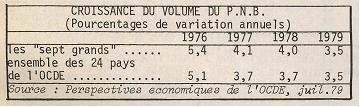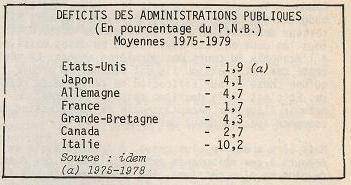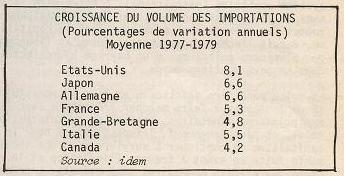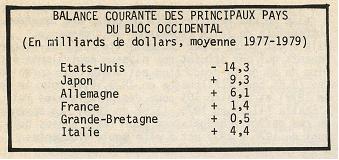Revue Internationale no 20 - 1e trimestre 1980
- 2991 reads
Années 80 : les années de vérité
- 2853 reads
L'histoire ne se plie pas aux chiffres des calendriers. Cependant les décennies sont souvent associées dans la tête des hommes à des périodes spécifiques de l'histoire. Ainsi, si on parle des années 30 on pense immédiatement à la grande crise qui a frappé le capitalisme il y a 50 ans; si on évoque les années 40, c'est à la guerre que l'on pense, à cette guerre qui a anéanti l'équivalent d'un pays comme l'Italie ou la France. A l'aube des années 80, quelle image peut-on associer à la décennie qui se termine, quel sera le phénomène saillant de celle qui commence ?
La crise ? On peut dire qu'elle a marqué de son empreinte les années 70, mais elle marquera encore plus les années 80. Entre les années 60 et les années 70, il y eut effectivement une différence dans la situation économique du monde. Les premières furent les années de la fin de la reconstruction, celles où brillèrent les derniers feux d'une "prospérité" factice, basée sur des mécanismes on ne peut plus éphémères puisqu'associés à la reconstitution du potentiel industriel et commercial de l'Europe et du Japon détruit par la guerre. Ce potentiel reconstitué, le capitalisme s'est de nouveau trouvé confronté à son impasse mortelle : la saturation des marchés. C'est pour cela que, sur le plan économique, la décennie qui se termine n'a pas ressemblé à la précédente : "prospérité" pour l'une, marasme pour l'autre. Par contre, il n'y aura pas de différence de cette nature entre les années 70 et les années 80, sinon que, durant les secondes, la crise sera pire encore.
La misère humaine et les massacres ? Les années qui viennent s'annoncent particulièrement "riches" dans ce domaine : jamais il n'y a eu autant de famines et autant d'exterminations de populations de par le monde : à force de "libérer" des peuples, à force de leur apporter leur aide (qui en général, se réduit à l'envoi d'engins de mort), les grandes puissances les auront bientôt rayés de la carte du monde. Cette apocalypse n'est pas nouvelle. Dans la prochaine décennie, avec l'aggravation de la crise, on verra, malgré toutes les pétitions et toutes les campagnes humanitaires, se multiplier les Cambodge. Mais ce ne sera là, certes à un degré de plus en plus terrifiant, que la poursuite de calamités qui n'ont pratiquement pas cessé depuis la seconde guerre mondiale, qui ont fait de la société humaine un véritable enfer pour la majorité de ses membres. En ce sens, même s'ils sont appelés à se multiplier, on ne pourra qualifier la décennie qui vient comme celle des génocides, car en cela on ne saurait la distinguer de celles qui l'ont précédée.
Cependant,, les événements qui se sont produits ces derniers temps attestent que des changements très importants dans la vie de la société mûrissent en ses entrailles et qui concernent bien moins son infrastructure économique ou le degré de misère de ses membres que la façon d'être et d'agir des principales classes qui la composent : bourgeoisie et prolétariat.
D'une certaine façon, les années 70 furent les années d'illusion. Même dans les grandes métropoles du capitalisme, bourgeoisie et prolétariat ont été confrontés à la réalité de la crise, et même souvent de façon très crue. Mais en même temps, et notamment dans les pays les plus développés, ceux où se décide l'enjeu de la vie du monde, ces deux classes ont eu longtemps tendance à se voiler les yeux devant cette réalité : la première parce qu'il lui est insupportable de regarder en face le tableau de sa faillite historique, la seconde parce qu'elle a subi en partie les illusions véhiculées par la classe dominante mais aussi parce qu'il ne lui est jamais facile d'assumer d'emblée la formidable responsabilité historique qui pèse sur ses seules épaules et qu'une conscience claire de la signification de la crise lui aurait rappelée. Face à la crise qui se développait, la bourgeoisie s'est cramponnée pendant des années à l'espoir qu'il y avait des solutions. Certes, depuis 67, les récessions se sont succédé de façon régulière (67, 70-71, 74-75) en même temps que l'inflation devenait un mal chronique. Mais, à l'issue de chacune de ces récessions, il y avait une "reprise"; celle de 1972-73 faisant d'ailleurs connaître aux pays occidentaux (notamment les USA) des taux d'expansion parmi les plus élevés depuis la guerre. De même, il y avait de fortes poussées d'inflation galopante, mais certains plans de stabilisation n'échouaient pas complètement et on pouvait même voir certains pays "faire" moins de 5% par an: il suffisait de suivre leur trace. Evidemment, la bourgeoisie s'était rendu compte que les plans de "relance" relançaient...1'inflation et que les plans de "stabilisation" provoquaient...une nouvelle récession, mais elle s'était faite à l'idée que, même si les choses n'étaient plus comme "avant", on pourrait quand même continuer à marcher à ce rythme à condition "d'assainir" et de "couper les branches mortes", en d'autres termes d'imposer l'austérité et de licencier.
Aujourd'hui la bourgeoisie déchante. De façon sourde mais lancinante elle découvre qu'il n'y a pas de solution à la crise, à la suite, comme nous le voyons dans l'article "L'accélération de la crise", de l'échec de tous les remèdes qu'elle a administrés à son économie et qui ont fini par l'empoisonner encore plus. Réalisant qu'elle est dans une impasse, il ne lui reste plus que la fuite en avant. Et pour elle, la fuite en avant, c'est la marche vers la guerre.
Cette marche vers la guerre n'est pas nouvelle ; en fait, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le capitalisme n'a jamais désarmé comme il l'avait fait partiellement à l'issue de la première. Et depuis qu'il a connu une nouvelle aggravation de sa situation économique à la fin des années 60, les tensions impérialistes n'ont cessé de s'accentuer, les armements de croître de manière phénoménale : aujourd'hui, c'est un million de dollars qui sont engouffrés chaque minute en moyens destinés à semer la mort et la destruction. Mais jusqu'à présent, c'était de façon encore semi-inconsciente que la bourgeoisie s'acheminait vers une nouvelle guerre mondiale: elle y était poussée par les nécessités objectives de son économie mais en même temps elle ne se rendait pas vraiment compte que c'était la seule perspective que son système offrait à l'humanité. De même, la bourgeoisie n'avait pas vraiment conscience que son incapacité présente de mobiliser le prolétariat pour la guerre constituait l'obstacle le plus sérieux sur le chemin d'une telle issue.
Aujourd'hui, avec le constat de la faillite totale de son économie, la bourgeoisie est en train de prendre une conscience plus claire de la situation et elle agit en conséquence. D'une part, elle renforce encore ses armements. Partout les budgets militaires connaissent des hausses vertigineuses. Partout, on remplace des armes déjà terrifiantes par des armes encore plus "efficaces" ("Backfire", Pershing 2, bombe à neutrons, etc..). Mais elle n'agit pas seulement sur le terrain des armements. Comme nous le signalons dans notre prise de position sur la crise Iran/USA, elle a également entrepris de créer une psychose de guerre afin de préparer l'opinion à ses projets de plus en plus bellicistes. "Puisqu'à la guerre il faut aller et puisque les masses ne sont pas préparées à cette perspective, il faut utiliser tous les prétextes pour créer ce "sursaut national", cette "union sacrée", et les guider sur le bon chemin, celui qui s'écarte des sordides conflits d'intérêts (lire les conflits de classe) et mène à la "défense de la patrie et de la civilisation" contre ces forces de la barbarie qui les menacent, qu'elles aient nom fanatisme islamique, cupidité arabe, totalitarisme ou impérialisme". Tel est le discours que se tient de plus en plus la classe dominante partout dans le monde.
Face à la classe ouvrière, le langage de la bourgeoisie est donc en train de changer: tant que pouvait subsister l'apparence qu'il y avait des solutions à la crise, elle a bercé les exploités de promesses illusoires : acceptez l'austérité aujourd'hui et ça ira mieux demain. La gauche avait fait merveille dans ce style de mensonges : le crise n'était pas le résultat des contradictions insurmontables du mode de production capitaliste, mais celui d'une "mauvaise gestion" ou de la "cupidité des monopoles" et autres "multinationales" : qu'on vote pour elle et tout allait changer! Aujourd'hui ce langage ne prend plus, la gauche au gouvernement, là où elle y était parvenue, n'a pas fait mieux que la droite et, du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, elle a même souvent fait pire. Puisque promettre des "lendemains qui chantent" ne trompe plus personne, la classe dominante a changé de registre. C'est le contraire que l'on commence à promettre maintenant en disant bien fort que le pire est devant nous mais qu'on n'y est pour rien, que "c'est la faute des autres", qu'il n'y a pas d'autre issue, et en espérant réaliser cette unité nationale que Churchill, en d'autres temps, avait obtenu de la population anglaise en lui promettant "du sang et des larmes".
Ainsi , de plus en plus, la bourgeoisie, en même temps qu'elle perd ses propres illusions, est obligée de parler clair à la classe ouvrière quant à l'avenir qu'elle lui réserve. Si celle-ci était résignée, démoralisée comme au cours des années 30, ce langage pourrait être efficace : "Puisque, de toutes façons, il n'y a pas d'autre issue, puis qu’il faut sauver quand même ce qui peut être sauvé : "la démocratie", la "terre de mes ancêtres", mon "espace vital", va pour la guerre et ses sacrifices !" Tel est l'écho que la classe dominante aimerait rencontrer à ses discours. Malheureusement pour elle, les nouvelles générations ouvrières n'ont pas la résignation de leurs aînées. Dès les premières atteinte de la crise, avant même que celle-ci ne soit reconnue comme telle par quiconque, à l'exception de quelques toutes petites minorités révolutionnaires qui n'avaient pas oublié les enseignements du marxisme, la classe ouvrière a engagé la lutte. Ses combats, au tournant des années 60 et 70, par leur extension et par leur détermination, signifiaient que c'en était fini de la terrible contre-révolution qui avait pesé sur la société à la suite de l'écrasement de la vague révolutionnaire du premier après-guerre. Il n'était plus "minuit dans le siècle", le capitalisme devait de nouveau compter avec ce géant qu'il croyait définitivement endormi : le prolétariat. Mais même si celui-ci débordait de nouveau de vitalité, il manquait d'expérience, et il s'est laissé en bonne partie piéger par les chausse-trappes que le capitalisme, une fois revenu de sa surprise, a disposé sur son chemin. S'appuyant sur le fait que la crise de son économie avançait à un rythme beaucoup plus lent que dans les années 30, la bourgeoisie a réussi à communiquer au prolétariat ses propres illusions sur la possibilité d'une "solution" à la crise. Pendant un certain nombre d'années, celui-ci a cru dans les bobards de "l'alternative de gauche", qu'elle ait nom "gouvernement travailliste", "pouvoir populaire", "programme commun", "pacte de la Moncloa", "compromis historique", etc.. Abandonnant pour un temps la lutte ouverte, il s'est laissé promener dans les impasses électorales et démocratiques, il a encaissé sans presque réagir une austérité et un chômage à doses de plus en plus massives. Mais ce que sa première vague de luttes débutée en 68 révélait déjà, est en train maintenant de se confirmer: les mystifications bourgeoises d'aujourd'hui n'ont pas la force de celles du passé. A force de servir, les discours sur la "défense de la patrie", de la "civilisation", de la "démocratie", de la "patrie socialiste", s'usent. Et ceux sur "l'intérêt national", la "menace terroriste" et autres "gadgets" n'arrivent pas à les remplacer. Comme le fait ressortir notre article : "Notre intervention et ses censeurs", le prolétariat a repris maintenant le chemin de la lutte au point de contraindre la gauche, là où elle était au gouvernement, à poursuivre dans l'opposition sa tâche capitaliste et, partout, à radicaliser son verbe.
Avec une crise qui fait peser chaque jour plus sur elle ses terribles effets, avec une expérience d'une première vague de luttes et de l'arsenal de pièges que peut lui tendre la bourgeoisie pour les asphyxier, avec enfin la réapparition encore timide mais qui ne cesse de se confirmer de ses minorités révolutionnaires, la classe ouvrière revient donc affirmer sa puissance et son énorme potentiel de combativité. Si la bourgeoisie n'a d'autre avenir à proposer à l'humanité que la guerre généralisée, les combats qui se développent aujourd'hui démontrent que le prolétariat n'est pas prêt à lui laisser les mains libres et que lui a un autre avenir à proposer, un avenir où il n'y aura plus de guerre ni d'exploitation : le communisme.
Dans la décennie qui commence, c'est donc cette alternative historique qui va se décider : ou bien le prolétariat poursuit son offensive, continue de paralyser le bras meurtrier du capitalisme aux abois et ramasse ses forces pour son renversement, ou bien il se laisse piéger, fatiguer et démoraliser par ses discours et sa répression et, alors, la voie est ouverte à un nouveau holocauste qui risque d'anéantir la société humaine.
Si les années 70 furent tant pour la bourgeoisie que pour le prolétariat les années d'illusion, parce que la réalité du monde actuel s'y révélera dans toute sa nudité, et parce que s'y décidera pour bonne part l'avenir de l'humanité, les années 80 seront les années de la vérité.
Questions théoriques:
- Décadence [1]
- Le cours historique [2]
L'accélération de la crise
- 2883 reads
Les soi-disant "explications économiques" dont les classes dominantes abreuvent la population à travers la presse, la radio, la télévision ont presque toujours un objectif clair et déclaré : justifier au nom d'une prétendue "science économique" les nouveaux "sacrifices" que le capital exige de ses exploités.
Les "experts" ne prennent la parole et ne citent leurs statistiques que pour "expliquer" pourquoi il faut accepter l'augmentation du chômage, la baisse des salaires réels, pourquoi il faut cependant travailler plus, pourquoi les impôts augmentent, pourquoi il faut expulser les travailleurs immigrés, bref pourquoi il faut rester soumis aux lois du capitalisme alors que celles-ci conduisent l'humanité à la ruine et au désespoir.
Refuser et combattre la domination de ces lois, c'est aussi rejeter les justifications "économiques" avec lesquelles les gouvernements imposent leur système d'exploitation. Mais il ne suffit pas de se dire : "De toutes façons tout ce qu'ils racontent est faux". Il faut encore comprendre en quoi et pourquoi c'est faux, si on veut être capable de construire quelque chose de réellement différent demain.
La révolution prolétarienne est une révolution CONSCIENTE. Le prolétariat ne pourra pas débarrasser l'humanité des entraves qui la paralysent sous le capitalisme sans savoir quelles sont ces entraves.
La compréhension de la situation économique du capitalisme est indispensable pour agir consciemment au niveau global de la société, car jusqu'à présent les hommes restent soumis à leurs besoins économiques.
Dans le capitalisme, comme dans toutes les sociétés passées, comprendre le monde c'est d'abord comprendre sa vie économique. Comprendre comment le détruire, c'est aussi comprendre comment il s'affaiblit : c'est comprendre ses crises.
L'article qui suit s'inscrit dans cet effort. Son objet est de faire le point sur le développement actuel de la crise et d'en dégager les perspectives. Il s'attache à démontrer que l'actuelle aggravation de la crise annonce pour le début des années 80 une récession de l'économie mondiale sans précédent depuis la guerre.
L'article comporte beaucoup de chiffres, mais il faut passer par ce terrain aride pour tenter de mesurer où en est la crise du capitalisme et où elle va. Nous nous sommes servis de chiffres "officiels" en sachant ce qu'ils valent. Les statistiques économiques subissent des distorsions d'ordre aussi bien idéologique que technique. Du fait même que la soi-disant "science économique" fait partie intégrante de l'idéologie et de la propagande de la classe dominante, ses statistiques subissent toujours toutes les déformations utiles pour justifier, la survie et la défense du système. Les "experts" de la bourgeoisie ne le font pas toujours avec des visions machiavéliques : ils sont eux-mêmes victimes du poison idéologique qu'ils sécrètent. Mais leurs statistiques ne subissent pas uniquement des déformations idéologiques. Elles sont aussi victimes d'incapacités techniques qui tiennent au délabrement même du système économique. En effet, l'instrument de mesure de la plupart des statistiques économiques c'est la monnaie, que ce soit le dollar ou autre.
Or l'inflation et les soubresauts de plus en plus fréquents et violents des taux de change des monnaies internationales, rendent les monnaies de moins en moins capables de mesurer l'activité économique réelle. Cela est particulièrement vrai pour la mesure des agrégats économiques en termes de "volume", (le volume du produit national brut, par exemple) c'est à dire en termes de "monnaie constante", une monnaie théorique qui n'aurait pas été dévaluée par l'inflation.
Mais, quels que soient les défauts, connus, des statistiques économiques existantes, elles sont les seules disponibles. Et si elles manquent de précision, elles n'en rendent pas moins compte d'une façon ou d'une autre, du SENS des principaux mouvements économiques.
De toute façon, tenter de démontrer la faillite du capitalisme et la possibilité de le détruire en se servant des statistiques des capitalistes eux-mêmes, n'affaiblit pas la force de la démonstration ; cela tendrait plutôt à la renforcer.
L'économie mondiale entre dans les affinées 80 en s'enfonçant dans une nouvelle récession. La quatrième depuis 1967.
Dans les pays de l'Est, la croissance de la production est tombée au niveau le plus bas depuis la 2ème guerre mondiale (4% de croissance en 1978). Le secrétariat de l'OCDE, l'organisation qui regroupe les 24 pays les plus industrialisés du bloc occidental, annonce pour l'ensemble de sa zone 3% de croissance en 1979 et prévoit une chute de cette croissance à 1,5% en 1980. 1,5%, c'est la quasi-stagnation de l'activité économique. Ce sont les Etats-Unis et le Royaume Uni qui s'enfoncent les premiers dans la nouvelle récession. La première et la cinquième puissance du bloc -qui réalisent à elles seules plus de 40% de la production des pays de l'OCDE- connaîtront en 1980 des taux de croissance de leur production négatifs, c'est à dire que la masse de production réalisée chaque jour va non seulement cesser de croître, mais va diminuer de façon absolue.
Quelle sera l'ampleur de cette récession ? Combien de pays va t'elle toucher ? Combien de temps peut-elle durer ? Quelle sera sa profondeur ? Elle s'annonce la plus étendue géographiquement depuis la 2ème guerre : pour la première fois, toutes les zones de la planète vont être simultanément touchées.
Elle risque d'être la plus longue par la durée. Elle devrait être aussi la plus profonde en termes de recul de la croissance de la production et donc d'aggravation du chômage.
En d'autres termes, les travailleurs du monde entier vont connaître la plus violente dégradation de leurs conditions d'existence depuis la seconde guerre mondiale. Des nouveaux millions de travailleurs vont être licenciés dans tous les pays, même dans ceux qui semblaient garder la tête hors de l'eau. Quant aux salaires réels, ils vont connaître de violentes réductions par l'action combinée des politiques de blocage de salaires et de l'aggravation de l'inflation. Des nouveaux millions de travailleurs vont être licenciés dans tous les pays, même dans ceux qui semblaient garder la tête hors de l'eau. Quant aux salaires réels, ils vont connaître de violentes réductions par l'action combinée des politiques de blocage des salaires et de l'aggravation de l'inflation.
Les dernières miettes accordées par le capitalisme pendant les années de relative prospérité de la reconstruction sont reprises par le capital...et il ne parle pas de les rendre de si tôt. Les différents Etats du monde se préparent à connaître un nouveau regain de convulsions économiques et sociales.
Mais qu'est-ce qui permet d'affirmer que la récession dans laquelle s'enfonce actuellement le capitalisme sera la plus large, la plus longue et la plus profonde depuis la guerre ?
Trois types de facteurs :
- Premièrement, l'ampleur de la dégradation que connaît dans 1'immédiat 1’économie mondiale
- Deuxièmement l'inefficacité croissante des moyens dont se sert le capital pour relancer la croissance économique.
- Troisièmement 1'impossibilité grandissante pour les Etats de continuer à recourir aux moyens de relance.
Ce qu'on peut exprimer en d'autres termes : la maladie mortelle du capitalisme connaît actuellement une aggravation majeure ; or, non seulement les remèdes que les Etats lui administrent depuis des années font de moins en moins d'effet, mais en outre, l'abus du recours à ces remèdes a fini par empoisonner le malade. Tels ces médecins qui s'acharnaient à maintenir en vie un Franco plus que moribond, la bourgeoisie pratique aujourd'hui envers son économie un acharnement thérapeutique pourtant dénoncé par la science.
Reprenons chacun de ces trois points : l'aggravation de la crise actuelle d'une part, l'inefficacité des moyens de relance et l'impossibilité d'y recourir davantage sans aggraver davantage la crise d'autre part.
L’AGGRAVATION ACTUELLE DE LA CRISE
Pour le moment, parmi les grands pays industrialisés du bloc occidental, les pays les plus frappés sont les Etats-Unis et la Grande Bretagne. C'est dans ces deux pays que la croissance de la production s'est le plus ralentie au cours de l'année 1979 comme le montre le tableau suivant :
Cependant, personne ne se fait d'illusions sur la possibilité pour les autres pays du bloc de maintenir longtemps les rythmes de croissance actuels avec l'entrée des Etats-Unis en récession dans la mesure où les économies du Japon et de l'Europe sont totalement liées à celle de leur chef de file économique et militaire.
Cette dépendance qui repose tout d'abord sur la suprématie absolue du leader du bloc au sein de sa zone (elle est la même dans le bloc russe), n'a fait que se renforcer depuis le début des années 70. En ralentissant la croissance de leur production, les Etats-Unis cherchent à réduire la masse de leurs importations. Mais, en réduisant leurs achats sur le marché mondial, ils rétrécissent directement ou indirectement les débouchés pour la production européenne et japonaise.
Contrairement à ce qu'ont affirmé certains économistes, l'actuelle croissance en Europe et au Japon ne pourra pas se maintenir pour compenser l'effondrement des Etats-Unis. Au contraire, comme en 1969, la chute de la croissance aux Etats-Unis annonce celle des autres pays industriels.
Le rapport annuel de la Commission du Marché Commun, qui a publié en octobre ses prévisions pour l'année 80, annonce déjà un ralentissement de la croissance pour la CEE de 3,1% en 1979 à 2% en 1980 ; une accélération de l'inflation et une augmentation du taux de chômage (de 5,6% à 6,2%), "la plus forte augmentation prévue depuis que la Commission a commencé à établir des statistiques en 1973" ("Le Soir", Bruxelles).
Dans tous les pays occidentaux, les annonces de licenciements se sont multipliées à la fin de 1979. Mais la spécificité de ces annonces, c'est qu'elles concernent non seulement des secteurs déjà en difficulté, mais également des secteurs qui avaient été jugés jusqu'ici relativement épargnés par la crise. Les licenciements continuent de se multiplier dans les secteurs déjà frappés : le premier producteur d'acier des Etats-Unis -US Steel- annonce la fermeture de 10 usines et le licenciement 13000 travailleurs en Grande-Bretagne ; la British Steel Corporation entend réduire sa force de travail de 50000 travailleurs.
Mais désormais, c'est aussi l'automobile et l'électronique, ces secteurs que Ton disait être des "locomotives de l'économie", qui sont fortement touchés. Aux Etats-Unis, la production automobile a diminué de 25% entre décembre 78 et décembre 79. "Cent mille salariés de l'automobile (soit 1 sur 7) sont d'ores et déjà au chômage pour une durée indéterminée et 40000 ouvriers sont en chômage temporaire à la suite de fermetures d'usines d'une ou deux semaines dans plusieurs Etats" ("Le Monde"). En Allemagne, le pays dont l'économie reste enviée par les gouvernements du monde entier, la production automobile a diminué de 4% en un an. OPEL a du mettre au chômage partiel 16000 ouvriers pendant 2 semaines et Ford-Allemagne 12000 pendant 25 jours. Quant au secteur de pointe qu'est 1'électronique, il vient d'être frappé par l'effondrement de la compagnie allemande AEG-Telefunken qui prévoit près de 13000 licenciements,
Dans les pays sous-développés, la crise économique qui plonge depuis longtemps la quasi-totalité d'entres eux dans un marasme total, est venue frapper violemment les quelques pays que l'on disait "miraculés". Que ce soit les pays qui avaient connu un relatif développement industriel au cours des dernières années (la Corée du sud ou le Brésil par exemple) ou que ce soit les pays producteurs de pétrole (l'Iran ou le Venezuela par exemple), ils connaissent tous une violente dégradation de leur situation économique et avec elle l'écroulement de tous les mythes sur leur éventuel "décollage industriel".
Quant aux pays de l'Est, ils connaissent actuellement une puissante aggravation de leurs difficultés économiques. Malgré leur politique destinée à réduire leur endettement à l'égard de l'occident, celui-ci s'est encore accru. Selon la Commission Economique pour l'Europe ces Nations Unies, cet endettement a augmenté de plus de 17% en 1978 par rapport à l'année précédente. Quant à la situation interne, l'examen de la situation économique auquel ont procédé les dirigeants de l'URSS à l'occasion délia session d'automne 79 du Soviet Suprême, fait état d'un bilan particulièrement défavorable dans des domaines aussi fondamentaux que les transports^, la production agricole et pétrolière. Dans les pays satellites, tels que la Pologne, les gouvernements commencent à parler officiellement de chômage et partout d'inflation ; cette maladie que le dogme stalinien prétend réservée aux pays occidentaux, connaît une accélération sans précédent.
Voilà pour la situation immédiate. A elle seule, par 'étendue et la rapidité de la dégradation économique, elle permettrait de prévoir qu'elle ne constitue que le début d'une nouvelle récession dont le plus fort est encore à venir.
LES MOYENS DE "RELANCE"
I. L'INEFFICACITE CROISSANTE DES MOYENS DE "RELANCE"
Une des caractéristiques majeures de l'évolution économique mondiale, et plus particulièrement en occident depuis la récession de 1974-75, c'est que, contrairement à ce qui s'était produit au lendemain des récessions de 1967 ou de 1970, les politiques de "relance", malgré les efforts considérables de la part des gouvernements, se sont soldés par des résultats de plus en plus médiocres, sinon nuls.
Avec l'arrêt définitif de tous les mécanismes de la reconstruction au milieu des années 60, le capitalisme en occident a commencé à vivre suivant des oscillations de plus en plus amples et violentes. Comme une bête enragée qui se cogne la tête contre les murs de sa cage, le capitalisme occidental s'est heurté de plus en plus violemment à deux écueils : d'une part des récessions de plus en plus profondes, d'autre part des relances de moins en moins efficaces et de plus en plus inflationnistes.
Le graphique ci-dessous qui trace l'évolution de la croissance de la production pour l'ensemble constitué par les "sept grands" du bloc occidental (Etats-Unis, Japon, Allemagne de l'ouest, France, Grande-Bretagne, Italie et Canada), montre comment ces oscillations se sont faites de plus en plus brutales pour aboutir de 1976 à 1979 à un retentissant fiasco des politiques de "relance".
On peut brièvement résumer les principales phases de la crise dans l'économie occidentale depuis 1967 de la façon suivante :
- en 1967, ralentissement de la croissance ;
- en 1968, relance ;
- de 1969 à 1971, nouvelle récession plus profonde que celle de 1967 ;
- de 1972 au milieu de l'année 1973, deuxième relance faisant craquer le système monétaire international avec la dévaluation du dollar en 1971 et la mise en flottement des principales parités monétaires ; les gouvernements financent une relance générale avec des tonnes de "monnaie de singe" ;
- au début de 1973, les "sept grands" connaissent le taux de croissance le plus élevé depuis 18 ans (8 1/3 en base annuelle au 1er semestre 1973) ;
- fin 1973 à fin 1975, nouvelle récession ; la troisième mais aussi la plus longue et la plus profonde ; au second semestre 1973, la production n'augmente plus qu'au rythme de 2% annuel ; plus d'un an plus tard, au début de 1975, elle recule de façon absolue au rythme de 4,3% par an ;
- 1976-1979, troisième relance ; mais cette fois-ci malgré le recours à la politique keynésienne de relance par la création de déficits des budgets des Etats, malgré le nouveau marché constitué par les pays de l'OPEP qui grâce à la hausse du prix du pétrole ont représenté une forte demande pour les produits manufacturés des pays industrialisés([1] [3]) malgré enfin l'énorme déficit de la balance commerciale des Etats-Unis qui, grâce au rôle international du dollar, ont créé et entretenu un marché artificiel en important beaucoup plus qu'ils n'exportaient, malgré tous ces moyens mis en œuvre par les gouvernements, la croissance économique, après une brève reprise en 1976, ne cesse de s'effriter, lentement mais systématiquement.
Pourtant les doses de remèdes employées par les gouvernements ont été particulièrement importantes.
Déficits budgétaires : les principaux pays industrialisés ont eu recours depuis 1975 et sans interruption à une augmentation des dépenses de l'Etat supérieure à celle de ses recettes afin de créer une demande susceptible de faire redémarrer la croissance. Cela s'est traduit par des déficits budgétaires permanents qui ont atteint des niveaux équivalents à plus de 5% de la production nationale dans certains cas (5,8% pour l'Allemagne en 1975, 5,4% pour le Japon en 1979) et dépassé 10% pour des pays faibles tels l'Italie (11,7% en 1975, 11,5% en 1979). La moyenne de ces déficits budgétaires pour les 5 années qui vont de 1975 à 1979 est à elle seule éloquente.
Le financement de la croissance du bloc par le déficit extérieur des Etats-Unis : en achetant à l'étranger beaucoup plus qu'ils ne parvenaient à vendre, les Etats-Unis ont, de 1976 à 1979, constitué un facteur de croissance pour l'économie de leur bloc. En réalité, c'est depuis la fin de la reconstruction de l'Europe et du Japon à la fin des années 60, et avec la guerre du Vietnam que la croissance du bloc occidental est en partie financée artificiellement par le déficit extérieur des Etats-Unis. Le dollar américain étant la monnaie d'échange et de réserve, dans le marché mondial, les autres pays sont contraints d'accepter la monnaie de singe des Etats-Unis comme moyen de paiement.
C'est ainsi que déjà la relance au lendemain de la récession de 1970 fut "stimulée" par deux années de déficit particulièrement important des Etats-Unis. Mais depuis la récession de 1974-75, les Etats-Unis ont eu recours à la même politique avec une ampleur et une persistance sans précédent. Au cours des trois dernières années, les Etats-Unis ont augmenté leurs importations plus rapidement que les autres puissances de leur bloc, comme le montrent les chiffres ci-dessous.
Cette politique s'est traduite par un développement vertigineux du déficit de la balance commerciale des Etats-Unis. Un déficit qui a momentanément permis aux autres puissances de connaître pendant ces mêmes années des balances commerciales positives.
Comme on le voit, que ce soit le remède "déficits budgétaires" ou que ce soit le remède "déficit extérieur des Etats-Unis" ("injection de dollars"), tous les deux ont été administrés en doses massives à l'économie au cours des dernières années. La médiocrité des résultats«qu'ils ont obtenus ne prouve qu'une chose : leur efficacité ne cesse de se réduire. Et c'est là la deuxième raison qui permet de prévoir l'ampleur exceptionnelle de la récession qui commence avec le début des années 80.
Mais il y a encore plus grave. A force d'avoir eu recours à ces stimulants artificiels avec des doses de plus en plus massives, les gouvernements ont fini par empoisonner totalement le corps de leur économie.
II. L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER A RECOURIR AUX MEMES REMEDES
L'année 1979 a été marquée, entre autres soubresauts sur le plan économique, par la plus spectaculaire alerte monétaire que le système ait connu depuis la guerre. Au moment même où le capitalisme fêtait les 50 ans du krach de 1929, le prix de l'or s'enflammait et atteignait des sommets sans précédent. En quelques semaines de hausse, le cours de l'or a dépassé 400 dollars l'once ! Cette alerte ne traduisait pas un simple accident spéculatif. Au début des années 70, le cours officiel de l'or était de 38 dollars l'once après la première dévaluation du dollar en 1971). 9 ans plus tard, il faut dix fois plus de billets verts pour acquérir la même quantité d'or ! Mais le cours de l'or n'a pas augmenté seulement en dollars. C'est dans toutes les monnaies qu'il a flambé. C'est à-dire que c'est le pouvoir d'achat réel de toutes les monnaies qui a brusquement baissé.
Ce qu'a exprimé la récente crise de l'or n'est rien d'autre que la menace d'un écroulement définitif du système monétaire international, c'est-à-dire la menace de la disparition de l'outil qui conditionne toutes les opérations économiques dans le capitalisme, depuis l'achat de savonnettes jusqu'au financement par plusieurs puissances d'un barrage hydroélectrique dans un pays du tiers-monde.
La crise monétaire sanctionne en fait l'impossibilité de continuer à faire marcher l'économie avec des manipulations monétaires, nationales ou internationales, et plus largement, l'impossibilité pour le capitalisme de continuer à survivre dans une incessante fuite en avant à travers l'inflation et le recours aux crédits monétaires tous azimuts. L'endettement de l'ensemble de l'économie mondiale a atteint des niveaux critiques dans tous les domaines : l'endettement des pays du tiers-monde qui, pendant des années, ont acheté des usines à crédit mais qui ne disposent pas de débouchés pour les faire fonctionner, l'endettement des pays de l'Est qui n'a cessé de se développer sans que l'on entrevoie avec quoi ces pays pourraient payer, l'endettement enfin des Etats-Unis qui ont inondé le monde de dollars (Eurodollars ou Pétrodollars) et qui ont connu dans les dernières années une accélération sauvage de leur endettement interne.
D'après l'hebdomadaire "Business Week", un des porte paroles les plus conséquents du grand patronat américain : "Depuis la fin de 1975, les Etats-Unis ont relancé l'économie d'endettement et provoqué une explosion du crédit si effrénée qu'elle laisse loin derrière elle la fièvre qui avait marqué le début des années 1970" (16 octobre 1978). D'après le même article, de 1975 à 1978, l'endettement de l'Etat (emprunts) a augmenté de 47% atteignant 825 milliard:' de dollars en 1978, soit plus du tiers du Produit National Brut du pays ; quant à l'endettement de l'ensemble des agents économiques (entreprises, particuliers, Etat, etc.), il a atteint cette même année 3900 milliards de dollars, soit à peu près le double de ce même P.N.B. !
Confronté à l'impossibilité croissante de vendre ce qu'il est capable de produire, le capitalisme a vécu de plus en plus en s'endettant pour l'avenir. Le crédit sous toutes ses formes a permis de repousser en partie les problèmes de fond. Mais ce faisant, il ne l'a pas résolu, au contraire, il n'a fait que l'aggraver. A force de reculer les échéances à coup de stimulants artificiels, l'économie capitaliste mondiale est parvenue à un degré de fragilité et d'instabilité extrêmes comme vient de le démontrer la chai de "alerte de l'or" de l'automne 1979.
Au début des années 80, le capitalisme se trouve placé devant l'alternative suivante : ou bien continuer des politiques de "relance" et c'est la culbute monétaire définitive ; ou bien cesser de recourir aux remèdes artificiels et c'est la récession.
Le gouvernement américain a déjà été contraint de choisir la seconde "issue"... et ce faisant, il a choisi pour le monde.
UNE FAUSSE ALTERNATIVE POUR LES TRAVAILLEURS
Devant cette situation, les gouvernements dans chaque pays prétendent convaincre les travailleurs qu'i doivent accepter les baisses de salaires et les licenciements pour que "ça aille mieux demain". Ce serait la condition de "la reprise" : "restructurons notre économie nationale et on s'en sortira".
Il est certain que l'insuffisance des marchés contraint les capitaux nationaux à être le plus compétitifs possible (et cela implique licenciements et baisses des salaires). Les quelques marchés existants iront à ceux des capitalistes qui parviennent à vendre au meilleur prix. Mais mourir les derniers ne veut pas dire échapper à la mort. C'est tous les pays qui doivent faire face à la pénurie des débouchés. Le rétrécissement du marché est mondial. Et quel que soit l'ordre dans lequel les entreprises et les pays s'effondrent, ils s'effondrent tous.
La restructuration de l'appareil productif aujourd'hui n'est pas une préparation à une nouvelle renaissance, mais une préparation à la mort ; ce n'est pas une crise de jeunesse que subit le capitalisme mais une convulsion d'agonie.
Pour les travailleurs, accepter les sacrifices aujourd’hui ne résoudra en rien leurs problèmes de demain. La seule chose qu'ils auraient à y gagner serait de subir sans réaction la plus violente attaque du capital. Et se soumettre au capitalisme lorsque celui-ci est aux abois, c'est se préparer à se faire conduire à la seule solution que le capitalisme a pu trouver à ses crises depuis 60 ans : la guerre.
Par contre, résister à cette attaque c'est forger la volonté et la force pour détruire le vieux monde en déclin et bâtir un nouveau.
R.V.
[1] [4] D’après le rapport annuel du GATT sur le commerce international en 1978-79, en 1978, les pays sous-développés ont absorbé, grâce surtout aux revenus des pays de l’OPEP, 20% des produits manufacturés exportés par l’Europe occidentale et 46% de ceux exportés par le Japon.
Récent et en cours:
- Crise économique [5]
Questions théoriques:
- Décadence [1]
Derrière la crise Iran-USA, les campagnes idéologiques
- 2844 reads
Dix mois après une "révolution" qui avait accompli l'exploit de mettre en place un régime encore plus anachronique que le précédent, la situation en Iran est revenue avec force au centre de l'actualité mondiale, provoquant un raz-de-marée d'imprécations contre la "barbarie" des Iraniens et des musulmans, ainsi que des prévisions alarmistes sur les risques de guerre ou de catastrophe économique. Au milieu de ce bruit et de cette fureur complaisamment amplifiés par les mass-médias, il est nécessaire aux révolutionnaires d'y voir clair et notamment de répondre aux questions suivantes :
1°) Que traduit la prise des otages de l'ambassade américaine concernant la situation interne de l'Iran ?
2°) Quel impact cette opération et cette situation ont-elles sur la situation mondiale et notamment :
- quel est le jeu des grandes puissances ?
- y a-t'il réellement une menace d'un conflit armé ?
3°) Quels enseignements faut-il en tirer quant aux perspectives générales qui se présentent à la société dans la prochaine décennie ?
1) La prise en otage du personnel diplomatique par un gouvernement légal constitue une sorte de "première" dans le monde pourtant agité du capitalisme contemporain. Les prises d'otages en elles-mêmes sont chose courante dans les convulsions qui assaillent le capitalisme en décadence : dans tous les affrontements inter-impérialistes, ce sont des populations entières qui en sont les victimes sans que cela émeuve particulièrement la communauté internationale des brigands impérialistes. La particularité et le caractère "scandaleux" de celle de Téhéran réside dans le fait qu'elle bafoue les règles élémentaires de convivialité établies entre ces brigands : de même que le silence par rapport à la police est la règle d'or entre gangsters du milieu, le respect des diplomates est celle des gangsters de l'impérialisme. Le fait que les dirigeants de l'Iran se soient laissé aller à adopter ou à cautionner un comportement qui, en général, est réservé aux "terroristes" en dit long sur le degré de décomposition de la vie politique de ce pays.
En effet, depuis le départ du Shah, la classe dominante de l'Iran s'est révélée incapable d'assurer la plus élémentaire stabilité politique. La presqu'unanimité qui s'était faite contre la dictature sanglante et corrompue du Shah s'est rapidement désagrégée, de par :
- le caractère hétéroclite des forces sociales qui avaient combattu l'ancien régime, le caractère complètement anachronique du nouveau régime, s'appuyant sur des thèmes idéologiques de type médiéval,
-l'incapacité de ce régime d'apporter une quelconque satisfaction aux revendications économiques des couches les plus pauvres, et notamment la classe ouvrière,
-l'affaiblissement important subi par les forces armées en partie décapitées après la chute du Shah, où la démoralisation et la désertion gagnaient de plus en plus.
En quelques mois, les oppositions contre le gouvernement se sont développées au point de compromettre totalement la cohésion et les bases économiques de l'édifice social :
- opposition des secteurs "libéraux" et modernes de la bourgeoisie,
- menace de sécession des provinces kurdes,
- reprise des luttes prolétariennes qui menacent de plus en plus la source quasi unique de riches ses du pays : la production et le raffinage de pétrole.
Face à cette décomposition générale de la société, les dirigeants de la "République Islamique" se sont rabattus sur le thème qui avait réussi, 10 mois avant, à réaliser une unité éphémère : la haine du Shah et de la puissance qui l'avait soutenu jusqu’a son renversement et qui l'héberge en ce moment. Que l'occupation de l'ambassade américaine ait été "spontanée" ou voulue par les dirigeants iraniens "durs" (Khomeiny, Ghotbzadeh) ne change rien au fait que la mise en avant de 1'épouvantail du Shah, utilisé, comme en d'autres circonstances, d1épouvantail fasciste, a permis de façon momentanée de reconstituer une certaine "unité nationale":
-cesser le feu des nationalistes kurdes,
-interdiction des grèves par le "Conseil de la Révolution"
Mais, à terme, le remède choisi par Khomeiny et compagnie est pire que le mal et exprime bien toute l'impasse dans laquelle se trouve cette équipe dirigeante : en choisissant de s'affronter politiquement et économiquement à la première puissance mondiale, elle n'a fait que plonger dans une fuite en avant qui ne pourra qu'aggraver la situation intérieure et en premier lieu sur le plan économique.
2) Les convulsions qui agitent aujourd'hui l'Iran constituent une nouvelle illustration :
a) de la gravité de la crise actuelle du capitalisme mondial, qui s'exprime dans les pays avancés par des crises politiques de plus en plus fréquentes et profondes et qui, dans les pays arriérés, se répercute sous la forme extrême d'une décomposition presque totale du corps social.
b) de l'incapacité d'une réelle indépendance nationale de la part des pays sous-développés : soit ceux-ci se rangent docilement derrière un bloc ou Vautre, soit ils sont plongés dans une instabilité et une déroute économique telles qu'ils sont, en fin de compte, obligés d'en venir à un tel ralliement : là où la France de De Gaulle et la Chine de Mao ont échoué, on ne voit pas comment l'Iran de l'imam Khomeiny pourrait réussir.
3) Face aux convulsions que connaît en ce moment l'Iran, il n'existe pas, contrairement à toute une série de rumeurs alarmistes, de danger immédiat d'affrontement militaire majeur dans la région. La raison essentielle en est que, malgré toute la campagne anti-américaine menée par Khomeiny, il n'y a pas actuellement de possibilité de basculement de l'Iran dans le camp russe. Comme l'ont déjà montré plusieurs exemples du passé, notamment l'affaire de Chypre en 74, si les difficultés et l'instabilité qui peuvent surgir dans un pays du bloc américain, dans le sens où elles peuvent affaiblir ce bloc, sont en général un élément favorable pour l'autre, elles ne signifient pas nécessairement que ce dernier soit en mesure de les orienter directement à son profit. A l'heure actuelle, l'URSS, qui éprouve déjà les plus grandes difficultés avec les guérillas musulmanes en Afghanistan et qui doit compter avec une menace possible d'agitation nationaliste parmi ses populations musulmanes, n'est pas en mesure de mettre la main sur un pays en ce moment submergé par une vague islamique et d'en conserver le contrôle, et cela d'autant plus qu'il n'existe pas en Iran de force politique apte à prendre en charge un tel basculement (PC faible et officiers de l'armée bien contrôlés parle bloc US)
4) Pendant un certain nombre de mois, la situation en Iran a échappé au contrôle des USA. En partie à cause de l'absence d'une équipe de rechange crédible, cette puissance avait commis l'erreur de soutenir trop longtemps un régime complètement déconsidéré, y compris dans les rangs de la classe dominante. C'est ce retard dans la politique américaine qui a été le principal responsable de l'échec des tentatives de dernière heure visant, en la personne de Bakhtiar, à une transition sans heurts vers un régime plus "démocratique", apte à calmer le mécontentements populaire. Face au processus de désagrégation de l’armée qui s'était instauré début février 79, c'est donc "à chaud" que s'était opérée cette transition et en faveur de la force politique momentanément la plus "populaire" mais à terme la moins appropriée à une direction un tant soit peu lucide et efficace du capital iranien. A l'heure actuelle, nous assistons à une étape de la reprise en main de la situation iranienne par le bloc US, qui, après l'échec d'une solution progressive tentée avec Bazargan, vise à laisser pourrir la situation locale. Semblable à la déclaration de guerre du dictateur vénézuélien Gomez aux USA et aux puissances européennes dans les années 30, la décision iranienne de déclarer, outre la "guerre sainte", la guerre économique aux USA, équivaut à un véritable suicide : l’interruption des échanges commerciaux entre l'Iran et les Etats-Unis, si elle ne peut provoquer que des perturbations mineures pour ces derniers, condamne l'Iran à l'asphyxie économique. La politique américaine consiste donc à laisser le régime actuel s'enferrer dans l'impasse où il s'est mis, le laisser s'isoler face aux différents secteurs de la société, afin de cueillir le fruit quand il sera mûr, en remplaçant l'équipe Khomeiny par une autre formule gouvernementale ([1] [6]) qui devra avoir les caractéristiques suivantes:
- être plus conciliante à l'égard du bloc US,
- être plus apte à contrôler la situation,
- avoir l'appui de Tannée (si ce n'est pas l'armée elle-même), dans la mesure où cette institution, comme dans tout pays du Tiers-Monde, est primordiale dans la vie politique.
Il est probable que nous aurons en Iran, toutes proportions gardées, un processus similaire à celui du Portugal où l'instabilité politique et la prépondérance d'un parti hostile aux USA (le PCP), résultant du caractère tardif et brutal de la transition hors d’une dictature complètement déconsidérée, avaient été éliminées à la suite d'une pression massive du bloc US sur le plan diplomatique et économique.
5) L'épreuve de force entre l'Iran et les USA, loin de marquer un affaiblissement du bloc dominé par cette puissance, a toutes les raisons au contraire de le renforcer. Outre qu'elle va aboutir tôt ou tard à une reprise en main de la situation au Moyen-Orient, elle permet un raffermissement de l'allégeance; des puissances occidentales (Europe, Japon) à l'égard du pays leader. Cette allégeance avait été perturbée ces derniers temps par le" fait que ces puissances étaient (outre les pays arriérés non producteurs) les principales victimes des hausses pétrolières encouragées en sous-main par les USA (cf. Revue Internationale n°19). La crise actuelle met en évidence la dépendance bien plus grande de ces puissances à l'égard du pétrole iranien que celle des USA et leur commande de resserrer les liens autour de leur chef de file pour collaborer à la stabilisation de la situation dans cette région du monde. La relative modération de certaines de ces puissances (notamment la France) dans leur condamnation des agissements de Khomeiny ne doit pas faire illusion : si elles ne se lient pas d'emblée complètement les mains, c'est afin de mieux pouvoir apporter leur concours, notamment sur le plan diplomatique, au processus de reprise en main de la situation au profit du bloc US : comme on a déjà pu le constater au Zaïre, par exemple, une des forces de ce bloc réside dans sa capacité à faire intervenir ses éléments les moins "compromis" là où la puissance de tutelle ne peut pas agir par elle-même.
6) Si un des objectifs des USA dans la crise actuelle est le renforcement de son bloc sur le plan de la cohésion internationale, un autre objectif bien plus important encore réside dans la mise en place d'une psychose de guerre. Jamais les malheurs de 50 citoyens américains n'avaient provoqué une telle sollicitude de la part des mass-médias, de la totalité des hommes politiques ainsi que des églises. Depuis longtemps on n'avait vu se déverser un tel torrent d'hystérie guerrière au point que le gouvernement, qui pourtant orchestre la campagne, fait figure de modéré. Auprès d'une population traditionnellement peu favorable à l'idée d'une intervention extérieure, à qui il avait fallu l'attaque de Pearl Harbour en 1941 pour la mobiliser dans la 2ème guerre mondiale, qui depuis la guerre du Vietnam était échaudée de ce genre d'aventure, les agissements "barbares" de la "République Islamique" sont un thème excellent pour les campagnes bellicistes de la bourgeoisie américaine. Si Khomeiny a trouvé dans le Shah un épouvantai1 efficace pour ressouder l'unité nationale menacée, Carter„qu'il ait voulu délibérément la crise actuelle en laissant entrer le Shah comme il semblerait, ou qu'il l'ait seulement utilisée, a trouvé dans Khomeiny un épouvantail similaire pour renforcer sa propre unité nationale et préparer la population américaine à l'idée d'une intervention extérieure même si elle ne se réalise pas en Iran. La seule différence existant cependant entre les deux manœuvres réside dans le fait que la première est désespérée et va se retourner rapidement contre ses promoteurs alors que la deuxième s'inscrit dans un plan plus lucide du capital américain.
Les USA ne sont pas le seul pays à utiliser la crise présente pour mobiliser l'opinion en vue des préparatifs pour la guerre impérialiste, En Europe occidentale également, avec des thèmes adaptés à la situation locale, tout le battage présent sur le "péril arabe" ou "islamique" (semblable au "péril jaune" d'autrefois)censé être responsable de la crise, s'inscrit dans le même type de préparatifs, dans la création de la même psychose de guerre.
Quant à l'URSS, même si elle ne tente pas d'exploiter la situation à l'extérieur pour les raisons qu'on a vues, elle essaye de faire chez elle corps à la campagne occidentale sur les "droits de l'homme" en dénonçant les menées impérialistes des USA et en se solidarisant des "sentiments anti-américains des masses iraniennes".
7) Même si elle prend dans ce pays, comme dans l'ensemble des pays sous-développés une forme caricaturale, la décomposition interne de l'Iran n'exprime nullement un phénomène strictement local. Au contraire, la virulence des campagnes idéologiques actuelles des grandes puissances indique que partout la bourgeoisie a le dos au mur, que de plus en plus elle se réfugie dans la fuite en avant vers un nouvel affrontement inter-impérialiste et qu'elle ressent le manque de mobilisation des masses autour de ses objectifs bellicistes comme l'entrave majeure vers une telle issue.
Il revient donc une nouvelle fois aux révolutionnaires :
- de dénoncer toutes ces campagnes idéologiques d'où qu'elles viennent, quelles que soient leurs feuilles de vigne (droits de l'homme, anti-impérialisme, menace arabe, etc.) et quelles que soient leurs promoteurs^ de droite ou de gauche, de l'Est ou de l’Ouest ;
- d'insister sur la seule sortie qui puisse se présenter à l'humanité pour lui éviter un nouvel holocauste ou même la destruction : la poursuite de l'offensive prolétarienne et le renversement du capitalisme
CCI 28 novembre 1979
[1] [7] La façon précise dont va s'opérer ce remplacement est encore difficile à prévoir : capitulation de l'actuelle équipe, scission en son sein, coup d'Etat militaire, intervention armée d'un pays arabe ; l'hypothèse la moins probable étant celle d'une intervention militaire directe.
Géographique:
- Etats-Unis [8]
- Moyen Orient [9]
Questions théoriques:
- Impérialisme [10]
Combat ouvrier et manœuvres syndicales au Venezuela
- 2814 reads
CORRESPONDANCE
L'agitation et la combativité qui se sont manifestées durant la négociation de la dernière convention dans l'industrie textile n'ont pas disparu. A la suite d'une convocation du syndicat des textiles (SUTISS), une assemblée nomme un "comité de conflit" au niveau régional en vue d'organiser une riposte ouvrière. Que ce comité soit dominé par des syndicalistes du parti AD ([1] [11]), n'enlève rien au fait important que même confusément, s'exprime la nécessité d'une organisation de lutte distincte de l'appareil syndical.
C'est quelque chose d'analogue qui s'est produit avec les ingénieurs qui ont exigé l'incorporation à la table des négociations d'un délégué élu en Assemblée Générale. Ce "comité de conflit" lance l'idée d'une grève régionale pour le 17 octobre 1979. Au début, la Fédération syndicale se montre réticente mais finalement cède devant le comité (elle lui prête même ses locaux) et après bien des pourparlers tendant à obtenir l'agrément de la centrale syndicale CTV ([2] [12]), on rend public l'appel à la grève pour le mercredi 17 octobre. La CTV commence alors à parler de l'organisation d'une grève nationale pour le 25. Ce qui allait se produire en Aragua était vu comme un test qui déterminerait le cours ultérieur des événements.
"SUIVEZ L'EXEMPLE QU'ARAGUA A DONNE !" ([3] [13])
Le 17, Maracay ([4] [14]) se réveille paralysée; dans quelques zones périphériques le trafic est interrompu par une multitude d'objets divers déversés sur la chaussée. Les ouvriers arrivent à leurs usines et de là se dirigent vers la place Girardot dans le centre de la ville. Les syndicats avaient diffusé Tordre de grève mais étaient volontairement restés silencieux sur l'heure et le lieu de rassemblement. La direction syndicale était intéressée au succès numérique de la grève mais elle tenait tout autant à conserver le contrôle des masses. Cela explique la diffusion de l'appel à la grève et le maintien du monopole de l'information concernant les actions prévues. Néanmoins, les ouvriers ne voulaient pas perdre l'occasion de manifester leur mécontentement et ont accepté ces conditions dans leur désir de pouvoir s'unir dans la rue avec leurs frères de classe.
A 10 heures du matin, la place est pleine de monde. Dans leur immense majorité, il s'agit d'ouvriers : on note une multitude de pancartes faites précipitamment indiquant la présence de leur usine respective, exigeant des augmentations de salaires ou simplement affirmant une vision de classe (exemple : "Eux ils ont le pouvoir parce qu'ils en ont la volonté"). Commencent alors les éternels discours dont les axes sont : l'augmentation des prix, le besoin d'un ajustement salarial, la mauvaise administration gouvernementale, la lutte contre les Chambres de Commerce et d'Industrie et la préparation de la grève nationale.
Dans la foule, on sent que les ouvriers interprètent aussi bien le rassemblement que la grève comme le début d'un affrontement avec la bourgeoisie et son Etat. Visiblement, la masse ouvrière ne se contente pas d'écouter passivement mais désire s'exprimer comme un corps collectif et cela ne peut se réaliser qu'en défilant dans les rues. La pression dans ce sens est tellement forte que, malgré ce qui a été prévu (uniquement un rassemblement), les dirigeants syndicaux finissent par appeler à défiler dans l'avenue Bolivar jusqu'au Parlement provincial. Auparavant des groupes de jeunes ouvriers s'étaient chargés de parcourir les rues du centre faisant fermer les magasins (excepté les pharmacies) avec une attitude décidée de faire respecter la grève, mais sans aucune tentative de violence individuelle ou d'agression envers des personnes. De même, ils interceptent les autobus et les taxis, font descendre les passagers et laissent ensuite les véhicules s'éloigner sans le moindre inconvénient.
LA MANIFESTATION DEVIENT INCONTROLABLE
La classe ouvrière prend pratiquement possession des rues du centre de la ville, empêche le trafic, ferme les magasins, fait éclater sa colère, impose son pouvoir. A partir de là les événements vont prendre leur propre dynamique. Les 10 à 15000 manifestants (la presse parle de 30000, probablement en raison de la grande peur que la journée lui a causée - infarctus de E.Mendoza ([5] [15]), commencent à lancer des consi gnes improvisées, insistant particulièrement sur celles qui expriment leur sentiment de classe ("l'ouvrier mécontent exige son droit" et "en chaussures ou en espadrilles, la classe ouvrière ça se respecte" entre autres). Impossible de reprendre le ton quémandeur de l'appui explicite à la loi salariale introduite par la CTV. Le seul chiffre avancé est 50% d'augmentation, mais en général les manifestants ne formulent pas de "demandes" précises ; ils expriment leur rage et leur volonté de lutte. Souvent on entend des commentaires qui parlent de la totale inutilité de la fameuse loi, du début de la guerre des "pauvres contre les riches". Aux alentours du Palais du Parlement apparaît brusquement un petit détachement des "forces de Tordre". La tête de la manifestation se jette sur lui et les policiers doivent courir se réfugier dans le dit palace où ils se sentent plus à l'abri. Immédiatement, la foule se concentre en face de l'entrée évidemment fermée. La manifestation n'a pas été préparée et ne se décide pas à tenter d'y pénétrer mais elle sent toute la différence entre le "peuple" dans la rue et ses "représentants" retranchés dans le palais. Comme il était à prévoir, la bureaucratie syndicale consacre tout son effort pour pacifier les manifestants et pour détourner l'attention en appelant à retourner place Girardot pour clore la journée. Après quelques hésitations, le cortège se met à nouveau en marche mais au lieu de se diriger vers la place Girardot, il préfère auparavant faire le tour des quatre côtés du "Palais législatif" Ainsi, la classe ouvrière désigne les lieux que demain elle devra occuper. Montés sur des voitures, des orateurs spontanés se succèdent et les manifestants savourent le fait d'être les maîtres de la rue, en contraste avec les vexations et les impuissances auxquelles ils sont soumis quotidiennement.
Place Girardot les attendent autant de nouveaux discours syndicaux avec pour but de mettre un point final "à cela". Mais une partie de la manifestation, une fois arrivée à la place, poursuit son chemin jusqu'à l'immeuble de l'Inspection du Travail. Il est, bien sûr,fermé. Ils retournent donc à la place. Là, des milliers d'ouvriers déjà fatigués sont assis sur la chaussée et les trottoirs. Ils ne savent pas très bien que faire, mais personne ne semble avoir envie de retourner chez soi et retrouver la monotone et insupportable vie quotidienne. Déjà, les chefs sont partis et les militants syndicalistes plient leurs banderolles. Apparemment, c'est la fin.
MAIS, ÇA CONTINUE ...
A midi, apparaît soudain une petite manifestation d'ouvriers du textile. L'animation reprend de nouveau et cette fois sans direction syndicale on entreprend un parcours démentiel à travers toute la ville. En un premier temps, on décide ensemble de marcher vers la Municipalité où, après avoir monté et rempli les marches des quatre étages, on exige une confrontation avec les Conseillers Municipaux. Ceux-ci n'ont pas l'air d'apprécier l'insistance avec laquelle un ouvrier déjà d'un certain âge frappe à la porte armé de sa canne. Puis l'idée est lancée de se diriger vers les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie où, curieusement, il n'y a personne sauf quelques caisses de bouteilles d'eau qui sont prestement utilisées pour calmer la soif collective. De là les travailleurs prennent la décision d'aller jusqu'à la station terminus des transports. En chemin, ils interrompent un chantier de construction et cherchent le contremaître pour lui donner quelques "conseils". Ils se partagent, avec un sens social et démocratique élevé, les poulets et les accompagnements d'un magasin de volailles qui a eu la malencontreuse idée de rester ouvert.
Il était plus de 2 heures de l'après-midi et la ma nifestation avait parcouru quelque 10 kilomètres. La faim, la chaleur et la fatigue avaient considéra blement réduit le nombre de manifestants. Il était temps de mettre fin à l'ivresse collective et de les faire revenir à la triste réalité. Etant donné que la direction syndicale avait échoué, cette tâche revenait à d'autres organismes. A coups de matraques et autres moyens "persuasifs" ([6] [16]), les forces de l'ordre démontrent pour la nième fois que les rues n'ap partiennent pas encore au peuple mais à la police. A 3 heures de l'après-midi l'ordre régnait à Maracay.
La journée avait été extrêmement riche en expériences. Instinctivement, la classe ouvrière avait identifié quelques points névralgiques du pouvoir : le Parlement, le Conseil Municipal, le Ministère du Travail, les syndicats et le terminus des passagers, ce" dernier comme pivot pour étendre la lutte en dehors de Maracay. Ce fut comme une sorte de mission de reconnaissance du terrain qui servira pour des luttes ultérieures. Durant la nuit, il semble qu'il y ait eu des manifestations dans certains quartiers. Ce fut un jour de fête prolétarienne.
LA C.T.V. : TROUBLE-FETE
Si certains ouvriers avaient pu entretenir l'illusion qu'il s'agissait d'un premier pas dans un cours de luttes apparemment triomphantes grâce à l'appui des appareils syndicaux, la presse du lendemain s'est chargée de leur rappeler leur condition de classe exploitée et manipulée. En effet, d'un côté la CTV, comme par magie, transformait la grève nationale en une mobilisation générale... pour 4 heures de l'après-midi le 25 octobre. Visiblement, la CTV ne voulait pas que se reproduise à l'échelle nationale le débordement par l'initiative des masses. Que les ouvriers travaillent d'abord toute la journée et s'il leur reste encore quelques envies, qu'ils aillent manifester ! La nuit se chargera de calmer les exaltations. Pour les syndicats, il s'agissait maintenant de tenter la formidable manifestation mais sans grève, formule qui leur permettrait de maintenir simultanément l'apparence de luttes et le contrôle social. Par ailleurs, quelques industries d'Aragua profitant du caractère juridiquement illégal de la grève du 17, procédèrent au licenciement massif d'ouvriers (spécialement à La Victoria ([7] [17]) où on a compté quelques 500 cas de licenciements). Avec cela, elles mettent en pratique des projets prévus de "réduction de personnel", de "déplacement des industries", d'"aménagements administratifs". Il s'agit d'affronter au moindre coût la situation financière particulièrement critique des petites et moyennes entreprises. Cette manoeuvre crée une situation particulièrement tendue à La Victoria avec des marches et des protestations ouvrant la perspective de nouvelles luttes dans les semaines à venir, mais maintenant sans le simulacre de l'appui de la CTV. Les ouvriers de La Victoria devront apprendre à se battre par eux-mêmes ou seront obligés d'accepter les conditions de la dictature du capital.
LA COLERE ECLATE MALGRE TOUT
La journée de "mobilisation nationale" du 25 octobre a donné lieu à de nouvelles manifestations de combativité ouvrière malgré son caractère signalé plus haut. Dans l'Etat du Carabobo et en Guyana ([8] [18]) eurent lieu des grèves régionales avec des marches regroupant beaucoup de monde très enthousiaste. A Caracas, la capitale, où il était nécessaire pour le prestige syndical que la manifestation soit nombreuse, la CTV s'est même chargée d'amener par cars des contingents ouvriers qui, pour leur part,ont profité de l'occasion qu'on leur offrait pour la première fois depuis des années pour exprimer leur haine de classe. Le gouvernement conscient, après les événements du 17, du danger de débordement ouvrier, ne pouvait pas permettre que la manifestation envahisse toutes les rues du centre de la capitale comme c'était arrivé à Maracay. Aussi, les "forces de l'ordre" avaient-elles décidé d'affronter la gigantesque masse ouvrière pratiquement dès le début. Il ne s'agit donc pas d'un excès ou d'une erreur, il s'agit simplement d'une fonction de classe accomplie vaillamment par les forces de police. L'affrontement a eu lieu. Les gens ne couraient pas paniques comme d'habitude mais ont opposés une dure résistance durant plusieurs heures ; ils ont détruit des symboles de l'opulence bourgeoise des alentours et il s'en est suivi un climat de violence qui s'est prolongé pendant plusieurs jours dans les quartiers ouvriers et en particulier au "23 de enero" ([9] [19]), avec pour solde plusieurs morts.
Pendant ce temps à Maracay, la masse ouvrière qui avait déjà savouré les événements du 17 n'était pas gagnée à participer à ce qui paraissait être pour tout le monde une pâle répétition. Très peu d'ouvriers se sont dérangés pour aller à ce rassemblement. En contre-partie, la fausse rumeur qu'un étudiant avait été assassiné à Valencia ([10] [20]) (en réalité, il y eut effectivement un mort à Valencia : un ouvrier) avait lancé quelques 2000 étudiants dans la rue. C'est typique des étudiants de se scandaliser pour la mort d'un étudiant tué par la police et rester aveugles aux peu spectaculaires destructions journalières de la classe ouvrière dans les usines : 250 accidents mortels par an et plus d'un million de blessés et malades pour raison professionnelle révèlent à satiété la violence capitaliste. La manifestation était de type estudiantin ; le caractère ouvrier du 17 avait disparu, le tout était noyé dans une mer de consignes universitaires, juvéniles et autres. Malgré cela, on pouvait noter l'absence des organismes estudiantins traditionnels ainsi que la participation de beaucoup d'étudiants"indépendants" qui pourront dans le futur converger avec la révolte ouvrière naissante. Seul un groupe de professeurs -ils étaient en grève- a maintenu un certain caractère de classe.
Il était démontré que la classe ouvrière est disposée à manifester son profond mécontentement dès que l'occasion se présente mais qu'elle n'était pas et n'est pas actuellement en condition de chercher à créer par initiative propre, de façon autonome, cette possibilité.
DE LA RUE AU PARLEMENT
Sans perdre de temps, la CTV en conclut qu'il s'agit d'empêcher à tout prix qu'une telle occasion ne se présente. Dans les faits, nous sommes en train d'assister à une relative pacification momentanée, situation qui pourrait bien être bouleversée à l'occasion des primes de fin d'année, étant donné les difficultés financières de certaines entreprises. On parle de moins en moins de mobilisations et de plus en plus des négociations parlementaires qui devraient faire promulguer la fameuse loi proposée par la CTV; mais cette fois-ci il n'est plus question de créer une capacité de pression au niveau de la rue. Le 29 octobre, le conseil consultatif de la CTV concrétise les résultats des négociations entre sociaux-démocrates et démocrates-chrétiens et décide que la centrale devra désormais être préalablement consultée à l'occasion de tout mouvement de grève décidé par les fédérations locales ou professionnelles. Il s'agit de maintenir le contrôle de toute situation potentiellement dangereuse. Et une fois ce point acquis, les grèves ministérielles sont déclarées illégales. C'est ainsi que la centrale agit avec ses propres fédérations; on peut imaginer ce que sera son attitude face à un mouvement ouvrier agissant de façon autonome par rapport aux syndicats.
Tout cela jette une claire lumière sur la prétendue alternative qui caractériserait les syndicats : être des agences de réclamations ou bien être des instruments de lutte. Dans la réalité, les syndicats sont des agences de réclamations pendant les périodes de calme social et des organes de sabotage des luttes dès que le prolétariat surgit.
LA VIEILLE TAUPE MONTRE SON NEZ ET LES LEADERS CONTEMPLENT LE FIRMAMENT.
La situation actuelle est celle du resurgissement de la classe ouvrière sur la scène nationale. C'est un phénomène analogue à celui qui s'est produit au début des années 60 et pendant les années 69-72. Ce resurgissement a été le produit de la fin de la période de la manne pétrolière et des rêves de grandeur de la bourgeoisie nationale. Aujourd'hui il faut régler l'addition, ce qui en deux mots veut dire rationalisation de la production entraînant la faillite des petites et moyennes entreprises (dont le maintien des profits constitue un des motifs de préoccupation de nos "socialistes".. .Ah que le capitalisme était beau lorsqu'il n'y avait pas de monopoles!), et l'intensification de l'exploitation de la classe ouvrière.
La libération des prix n'est en fait qu'un des instruments de la politique de restructuration de l'appareil productif du pays, restructuration qui ne peut être faite qu'à travers le seul chemin qui reste aux capitalistes : la crise, la récession. Contrairement à ce qu'affirment d'éminents professeurs d'université, il ne s'agit pas d'une politique erronée, mais d'une politique inévitable dans le cadre du système capitaliste. Lutter contre cette politique sans s'attaquer aux fondements mêmes du système capitaliste (comme le prétendent ceux qui demandent la révocation du cabinet économique, soi-disant "mal informé" ou trop "ignorant"), c'est faire preuve d'une myopie sociopolitique qui confine au rejet de la lutte révolutionnaire.
Face aux problèmes qu'impose aux masses le développement capitaliste, ce qu'il faut mettre en avant c'est l'impérative nécessité de dépasser les rapports de production marchands et monétaires par la prise en main de la production et de la distribution par les producteurs librement associés. On cherche à détourner l'attention en l'orientant vers une loi des salaires qui, par la crainte même des syndicats à mobiliser les masses, se trouve réduite à sa plus simple expression. En fait cette loi vise à peine à compenser l'inflation telle qu'elle est mesurée et reconnue par la Banque Centrale du Venezuela depuis la libération des prix. Les plus "radicaux" prétendent l'être en demandant des pourcentages plus élevés, voire même le nec-plus-ultra d'une échelle mobile des salaires (ce qui équivaut, dans le meilleur des cas, à lier définitivement le revenu des ouvriers aux oscillations de l'économie bourgeoise). A ce propos, il est intéressant de signaler que les ouvriers brésiliens viennent de s'opposer à une loi analogue parce que, d'après eux, elle diminue leur capacité de lutte au niveau des usines en vue d'obtenir des augmentations nettement supérieures à celles de l'inflation, comme cela s'est effectivement produit au début de 1'année.
Il ne s'agit pas d'un problème de pourcentages, d’augmentation. Ce dont il s'agit c'est d'impulser toutes les luttes qui tendent à mettre en évidence 1'autonomie des intérêts ouvriers face à la société bourgeoise, toutes les luttes qui tendent à se généraliser, s'unifiant et s'étendant par-dessus les étroitesses professionnelles à tous les secteurs en lutte, toutes celles qui tendent à s'attaquer à l'existence même du travail salarié. Ce ne sont pas tant les motifs particuliers de chaque lutte qui importent, mais les expériences organisationnelles acquises pendant leur déroulement. On peut remarquer par ailleurs qu'il s'est produit une rupture dans le comportement du prolétariat lorsqu'on constate que depuis 1976 le nombre de grèves n'a cessé d'augmenter alors qu'il n'en a pas été de même pour les dépôts légaux de cahiers de revendications. Ce fait semble indiquer que la classe ouvrière se sent de moins en moins concernée par la légalité bourgeoise et tend de plus en plus à agir en fonction directe de ses intérêts.
Face à la libération des prix, les travailleurs devront imposer une libération de fait des salaires; tout comme ils devront mettre en pièces les délais stipulés dans les conventions collectives. Il leur faudra se préparer à une lutte quotidienne et permanente sur lieurs lieux de travail et dans la rue.
LES TRAVAILLEURS DU VENEZUELA NE SONT PAS SEULS
Ce qui se passe actuellement au Venezuela n'est pas unique dans le monde; au contraire, nous ne faisons que nous incorporer dans un phénomène qui a des dimensions universelles. Nulle part le capitalisme n'a réussi, et nulle part il ne réussira à satisfaire de façon stable les besoins de l'humanité. Le chômage en Europe et en Chine, l'inflation aux USA et en Pologne, l'insécurité d'ordre alimentaire ou d'ordre atomique qui sévissent dans le monde, tout comme les luttes sociales qu'elles engendrent, en sont le témoignage.
Le cri de guerre de la 1ère Internationale reste à 1'ordre du jour:
"L’émancipation de la classe ouvrière sera l'œuvre de la classe ouvrière elle même*"
Venezuela, Novembre 1979
[1] [21] Parti Accion Democratica (Social-démocrate) passé à l'opposition aux dernières élections présidentielles portant au pouvoir les Démocrates-chrétiens.
[2] [22] CTV : Confédération des Travailleurs Vénézuéliens, inféodée au Parti AD.
[3] [23] Un des Etats du Venezuela (industrie textile). L'hymne national vénézuélien dit : "Suivez l'exemple que Caracas a donné !".
[4] [24] Capitale de l'Etat d'Aragua.
[5] [25] Grand représentant du patronat vénézuélien.
[6] [26] Au Venezuela, la police a l'habitude de frapper les manifestants avec le plat de longues machettes.
[7] [27] Ville industrielle d'Aragua
[8] [28] Deux zones où existent des concentrations industrielles (métallurgie et sidérurgie)
[9] [29] Quartier à grande concentration ouvrière très combattive.
[10] [30] Capitale de l'Etat de Carabobo.
Géographique:
- Vénézuela [31]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [32]
Sur l'intervention des révolutionnaires : réponse à nos censeurs
- 2997 reads
INTRODUCTION
Le renouveau de la combativité ouvrière depuis plus d'un an oblige les organisations révolutionnaires à développer leur intervention. Plus que jamais, il faut savoir comprendre rapidement l'enjeu d'une situation et intervenir en mettant en avant "les buts généraux du mouvement" de façon concrète et compréhensible.
L'intervention concrète dans les luttes est un test, la mesure de la solidité théorico-politique et organisationnelle d'un groupe révolutionnaire. Dans ce sens, des ambigüités, voire des tergiversations sur le plan programmatique se traduisent inévitablement par des interventions fausses, floues, éparpillées, ou même par une paralysie face à la réalité d'un mouvement de montée des luttes. Par exemple, dans les luttes actuelles et à venir, la compréhension du rôle des syndicats est une question-clé pour le développement de l'autonomie du prolétariat sur son terrain de classe. Si un groupe révolutionnaire n'a pas compris que les syndicats ne sont plus des organes de la classe ouvrière et sont devenus à tout jamais et sans aucun chemin de retour des armes de l'État capitaliste en milieu ouvrier, ce groupe ne peut pas contribuer à l'évolution de la conscience de classe.
L'action même de la classe exige des réponses nettes sur l'ensemble des fondements théoriques d'un programme de classe : que ce soit à propos de la crise économique, ou que ce soit à propos des luttes de libération nationale ou des diverses expressions de la décomposition du monde bourgeois en général. C'est pour cette raison que la discussion et la réflexion dans les groupes révolutionnaires aujourd'hui et entre les groupes sur le terrain international se donne comme but de clarifier, de critiquer, de compléter et d'actualiser l'héritage des positions politiques du marxisme et surtout de la dernière grande organisation ouvrière internationale, l'Internationale Communiste.
Mais l'intervention concrète au cours des affrontements de classe ne mesure pas seulement les capacités "théoriques", "programmatiques", d'une organisation, elle est aussi une mesure des capacités organisationnelles d'un groupe politique prolétarien. Pendant les dix années qui nous séparent de la vague de luttes de 1968, le milieu révolutionnaire a travaillé longuement et péniblement pour prendre conscience de la nécessité d'un travail organisé internationalement ; pour entretenir et développer une presse révolutionnaire, pour créer des organisations dignes de ce nom. Dans la période actuelle de resurgissement des luttes, un groupe qui n'est pas capable de se mobiliser, de marquer sa présence politique, d'intervenir énergiquement quand les événements se précipitent est voué à l'échec, à l'impuissance. Aussi justes puissent être ses positions politiques elles se trouvent réduites à un pur verbalisme, à des phrases creuses. Pour une organisation prolétarienne, l'efficacité de son intervention dépend des principes programmatiques ainsi que de la capacité de se donner un cadre organisationnel conforme à ces principes. Mais si ce sont là des conditions nécessaires, ce ne sont pas pour autant des conditions suffisantes. De même que la capacité de créer une organisation politique appropriée ne découle pas automatiquement d'une compréhension théorique des principes communistes, mais nécessite en plus une prise de conscience spécifique de la question d'organisation des révolutionnaires (appréhender et savoir adapter les enseignements du passé aux spécificités de la période actuelle), de la même façon, l'intervention efficace dans les luttes actuelles n'est pas le résultat automatique d'une compréhension théorique ou organisationnelle. La réflexion et l'action forment un tout cohérent, la praxis, mais chaque aspect de la totalité apporte sa contribution à l'ensemble et exige des capacités spécifiques.
Sur le plan théorique, il faut savoir analyser les rapports de forces entre les classes mais sur un laps de temps assez long, à l'échelle des phases historiques. Les positions de classe, le programme communiste, évoluent et s'enrichissent lentement au fur et à mesure de l'expérience historique, fournissant à ceux qui se penchent sur ces problèmes le temps de les assimiler. De plus, l'étude théorique permet, sinon de façon intégrale du moins de façon adéquate, de comprendre le matérialisme historique, le fonctionnement du système capitaliste et ses lois fondamentales.
De même, en ce qui concerne la question de la pratique organisationnelle, si une connaissance théorique ne remplace pas une continuité organique brisée par les convulsions du 20ème siècle, un effort de volonté et l'expérience limitée mais réelle de notre génération peuvent apporter des éclaircissements. Il en est tout autrement en ce qui concerne l'intervention ponctuelle dans le feu des événements. Ici, il s'agit d'analyser une conjoncture non pas sur une échelle de 20 ans, ni même 5, mais de pouvoir saisir l'enjeu à court terme, quelques mois, des semaines, même parfois des jours. Lors d'une épreuve de force entre les classes, on assiste à des fluctuations importantes et rapides face auxquelles il faut savoir s'orienter, guidé par les principes et les analyses sans se noyer. Il faut être dans le flot du mouvement, sachant comment concrétiser des "buts généraux" pour répondre aux préoccupations réelles d'une lutte, pour pouvoir appuyer et stimuler les tendances positives qui se font jour. Ici une connaissance théorique ne peut plus remplacer l'expérience. Même des expériences limitées auxquelles la classe ouvrière et les révolutionnaires ont pu participer depuis 1968 ne sont pas suffisantes pour acquérir un jugement sur.
Le CCI, pas plus que la classe ouvrière ne "découvre" l'intervention tout à coup aujourd'hui. Mais nous voulons contribuer à une prise de conscience de l'envergure que peuvent prendre les luttes dans les années à venir qui n'auront pas de commune mesure avec le passé immédiat. Les explosions actuelles et encore plus à venir mettront les révolutionnaires devant de grandes responsabilités et l'ensemble du milieu ouvrier devrait profiter des expériences des uns et des autres pour mieux corriger nos faiblesses, pour mieux se préparer. C'est pour cela que nous revenons ici sur les luttes en France de l'hiver dernier et l'intervention dg CCI depuis l'attaque du commissariat de police de Longwy en février 1979 par les ouvriers de la sidérurgie jusqu'à la Marche sur Paris du 23 mars 1979. Depuis lors, il y a eu d'autres expériences importantes d'intervention notamment dans la grève des dockers de Rotterdam en automne 1979 (voir Internationalisme, journal de la section du CCI en Belgique). Mais nous consacrons cet article aux événements autour du 23 mars parce que nous avons reçu un certain nombre de critiques de la part de groupes politiques; des critiques parfois "d'en haut" (généralement par ceux qui ne sont pas intervenus du tout) par des groupes qui apparemment veulent nous faire la leçon.
Le CCI n'a jamais prétendu avoir la science infuse ni le programme achevé. Nous commettons des erreurs inévitablement et nous nous efforçons de les reconnaître pour mieux les corriger. En même temps, nous voulons répondre à "nos censeurs", espérant ainsi clarifier une expérience pour tous et non pas encourager un tournoi stérile entre les groupes politiques
SIGNIFICATION DE LA "MARCHE SUR PARIS"
Si on prend la manifestation du 23 mars 1979 à part, comme un événement isolé, on ne comprend pas pourquoi cela devait susciter tant de discussions et de polémiques. Une manifestation à Paris, conduite par la CGT n'est pas chose nouvelle. L'énorme foule défilant durant des heures n'a rien en soi de quoi exciter l'imagination. Même la mobilisation exceptionnelle des forces de police et l'affrontement violent de milliers de manifestants aux forces de l'ordre n'est absolument pas chose nouvelle. On a vu cela autrefois. Mais la vision change radicalement et prend une tout autre signification dès qu'on se dégage d'une optique événementielle et qu'on situe le 23 mars dans un contexte plus général. Ce contexte indique un changement profond intervenu dans l'évolution de la lutte du prolétariat. Ce n'est pas le 23 mars qui ouvre le changement, mais c'est le changement intervenu qui explique le 23 mars qui n'est somme toute qu'une de ses manifestations.
En quoi consiste cette nouvelle situation ? La réponse est : l'annonce d'une nouvelle vague de luttes dures et violentes de la classe ouvrière contre l'aggravation de la crise et les mesures draconiennes d'austérité que le capital impose au prolétariat: licenciements, chômage, inflation, baisse du niveau de vie, etc.
Durant quatre ou cinq années, de 1973 à 1978, le capitalisme est parvenu en Europe à enrayer le mécontentement des ouvriers en faisant miroiter la perspective du "changement". "La gauche au pouvoir" était la principale arme pour mystifier la classe ouvrière et permit de canaliser le mécontentement dans l'impasse électoraliste. La gauche s'employait de toutes ses forces et durant des années, à minimiser la portée historique et mondiale de la crise, ramenant et réduisant celle-ci à une simple "mauvaise gestion" des partis de droite. La crise cessant d'être une crise générale du capitalisme devenait une crise propre à chaque pays et donc trouvait sa source dans les gouvernements de droite. Il en découlait que la solution devait également se trouver dans le cadre national, dans le remplacement de la droite par la gauche au gouvernement. Ce thème mystificateur a été grandement efficace dans la démobilisation de la classe ouvrière dans tous les pays d'Europe occidentale. Durant des années, l'espoir illusoire d'une amélioration possible de leurs conditions de vie par la venue de la gauche au pouvoir, a endormi la combativité de la première vague des luttes ouvrières. C'est ainsi que la gauche a pu mettre en pratique le "Contrat Social" en Grande-Bretagne, le "Compromis Historique" en Italie, le "Pacte de la Moncloa" en Espagne et le "Programme Commun" en France, etc.
Mais comme l'écrivait Marx, "il ne s'agit pas de savoir ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier se représente momentanément comme but. Il s'agit de ce que le prolétariat est et de ce qu'il sera historiquement contraint de faire conformément à son être". Le poids de l'idéologie et des mystifications bourgeoises peuvent momentanément avoir raison du mécontentement ouvrier mais elles ne peuvent pas arrêter indéfiniment le cours de la lutte de classe. Dans les conditions historiques actuelles, les illusions de la "gauche au pouvoir" ne pouvaient tenir trop longtemps devant l'aggravation de la crise, et cela aussi tien dans les pays où la gauche était déjà arrivée au gouvernement que dans ceux où elle était encore sur ses marches. Le barrage de la "gauche au pouvoir" s'usait et cédait lentement devant, l'accumulation d'un mécontentement chaque jour plus perceptible et moins convenable.
Ce sont les syndicats, les plus directement présents au sein de la classe, sur les lieux de travail, dans les usines qui enregistrent le mieux et les premiers ce changement qui est en train de se produire dans la classe et les dangers d'une explosion de la lutte. Ils sont conscients que, de la place qu'ils occupent, c'est-à-dire le soutien de la "gauche au pouvoir", ils ne sauraient contrôler de telles luttes. Ce sont eux qui font pression sur les partis politiques de gauche, dont ils sont le prolongement, et font valoir la nécessité du passage urgent dans l'opposition -la place la plus adéquate- pour faire plus sûrement dérailler le train de la nouvelle reprise des luttes ouvrières.
Ne pouvant plus comme auparavant, s'opposer et empêcher l'éclatement des luttes et des grèves, les partis de gauche et avant tout, les syndicats, doivent faire semblant de les soutenir et radicaliser leur langage afin de mieux les torpiller au cours de leur déroulement.
Les groupes révolutionnaires ont tardé et tardent encore à saisir pleinement cette nouvelle situation, caractérisée par la gauche dans l'opposition et tout ce qu'elle implique. En se contenant dans des généralités, sans tenir compte des changements intervenus dans la réalité concrète, leurs interventions restent forcément abstraites et leurs tirs marquent inévitablement les buts.
Le 23 mars n'est pas un événement isolé mais fait partie du cours général de reprise des luttes. Il est précédé par une série de grèves, un peu partout en France, et plus particulièrement à Paris : des grèves dures avec une haute combativité. Il est surtout le produit direct des luttes des ouvriers de la sidérurgie de Longwy et de Denain accompagnées d'affrontements violents contre les forces armées de l'État. Ce sont les ouvriers de Longwy et de Denain, en lutte contre la menace des licenciements massifs qui ont émis l'idée de la marche sur Paris. Les révolutionnaires devaient-ils soutenir cette initiative et participer à cette action ? Toute hésitation à ce sujet est absolument inadmissible. Le fait que la CGT, après avoir, en accord avec les autres centrales syndicales, tout fait pour faire échouer ce projet et le retarder, se soit décidé à y participer en prenant sur elle la tâche "d'organiser" cette marche ne pouvait nullement justifier l'abstention de la part des révolutionnaires. Il serait de la plus grande stupidité de leur part d'attendre des luttes "pures" et que la classe ouvrière soit déjà parvenue à se débarrasser complètement de la présence des syndicats pour daigner y participer. Si telle devait être la condition, les révolutionnaires ne participeraient jamais aux luttes menées par la classe ouvrière, jusqu'à et y compris la révolution. En même temps, on aura prouvé la parfaite inutilité de l'existence même des groupes révolutionnaires.
En prenant l'initiative FORMELLE de la marche du 23 mars, la CGT a démontré, non pas l'inanité de la manifestation mais sa capacité extrême de s'adapter à la situation, une capacité énorme de manœuvre et de récupération afin de mieux pouvoir saboter et dévoyer les actions du prolétariat. Cette capacité des syndicats de saboter les luttes ouvrières de l'intérieur même des luttes est le plus grand danger qu'aura à affronter dans les prochains mois et pour longtemps la classe ouvrière, et c'est aussi le combat le plus difficile que les révolutionnaires auront à livrer contre ces pires agents de la bourgeoisie. C'est de l'intérieur des luttes, et non en restant sur les bords que les révolutionnaires devront apprendre à combattre ces organes. Et c'est non pas par des généralités -abstraites, mais dans la pratique, par des exemples concrets au cours de la conduite de la lutte, compréhensibles et convaincants pour chaque ouvrier, que les révolutionnaires parviendront à démasquer les syndicats et dénoncer leur rôle anti-ouvrier.
NOS CENSEURS
Toute autre est la démarche de nos éminents censeurs. Ne parlons pas des modernistes, qui sont encore et toujours à se demander : qui est le prolétariat ? Ceux-là sont toujours à chercher et à découvrir les forces subversives capables de transformer la société. Perte de temps que d'essayer de les convaincre. Nous les retrouverons, peut-être, après la révolution, si toutefois ils survivent jusqu'alors ! Il en est d'autres, les intellectuels, trop occupés à écrire leurs grandes œuvres. Ils n'ont pas de temps à perdre dans des bagatelles comme le 23 mars. Il y aussi les "vieux combattants" par nature sceptiques et qui regardent les luttes actuelles avec des haussements d'épaules. Lassés et désabusés, par les luttes passées auxquelles ils avaient participé autrefois s’ils n'accordent plus grande foi aux luttes présentes» Ils préfèrent écrire leurs mémoires et il serait inhumain de les déranger de leur triste retraite. Il y a aussi les spectateurs de bonne volonté, qui, s'ils souffrent parfois du mal d'écriture, sont toutefois des "anti-militants" forcenés. Ils ne demandent pas mieux que de se laisser convaincre mais pour cela ils ... attendent les évènements. Ils attendent... et ne comprennent pas que d'autres s'y engagent.
Mais il y a aussi des groupes politiques pour qui l'intervention militante est la raison de leur existence et qui trouvent cependant à critiquer notre intervention du 23 mars.
Le FOR, par exemple. Activiste et volontariste au-delà du commun, ce groupe se refuse à participer à la manifestation, probablement pour la raison que celle-ci avait pour axe la lutte contre les licenciements. Le FOR qui ne reconnaît qu'une "crise de civilisation" nie qu'il y ait crise économique du système capitaliste. Licenciements, chômage, austérité, ne sont pour lui que des apparences ou des phénomènes secondaires qui ne peuvent servir de terrain de mobilisation pour des luttes ouvrières. Pourtant le FOR s'est bien souvent livré à l'élaboration des revendications économiques comme la hausse massive des salaires, le refus des heures supplémentaires, et notamment en 68, émettait la revendication de la semaine de 35 h. A croire que c'était uniquement par un goût prononcé de la surenchère et du radicalisme verbal. La présence de la CGT et sa direction de la manifestation complétaient la raison de la dénonciation de celle-ci.
Un autre exemple, le PIC. Ce groupe qui avait fait de l'intervention à toute vapeur son cheval de bataille s'est distingué par son absence précisément dans ces mois tourmentés de luttes du début de 1979. Ayant pris en 74 -dans le moment de stagnation et de recul des luttes- un départ à plein gaz (prétendant "intervenir" dans chaque petite grève localisée, se proposant de multiplier des feuilles de boites, etc....) le PIC à la façon d'un mauvais sportif, arrive épuisé et essoufflé au moment où il faut sauter. Évidemment, il ne vient pas à l'idée du PIC de se demander si la raison des échecs répétés de ses "campagnes" artificielles (rassemblement pour le soutien des ouvriers portugais, conférence des groupes pour l'autonomie ouvrière, bloc anti-électoral, rencontres internationales, etc.) ne résiderait pas dans son incompréhension de ce que peut et doit être une intervention, dans son ignorance voulue du rapport existant nécessairement entre l'intervention communiste et l'état de la lutte de classe. L'intervention pour le PIC est un pur acte de volonté, et de même qu'il ne comprend pas la nécessité de nager sur les côtés quand on veut remonter la rivière, il ne comprend pas davantage pourquoi on doit nager au milieu quand on veut aller dans le sens de la rivière. Tout ce raisonnement reste de l'hébreu pour le PIC qui préfère inventer d'autres explications pour justifier son absence et pour -comme il se doit- la théoriser. Ainsi, les interventions bidon, l'illusion de l'intervention se transforment aujourd'hui en non intervention effective.
C'est juste au moment où se manifeste une nouvelle irruption de la classe et sa volonté combative de faire face aux attaques du capitalisme et de sa politique d'austérité et de licenciements que le PIC "découvre" que ces luttes, comme les luttes pour les revendications économiques en général relèvent du réformisme. A ces luttes de résistance, il oppose "l'abolition du salariat" pour laquelle il se propose de lancer une nouvelle campagne.
Nous savons par expérience ce qu'il y a derrière ces "campagnes" épisodiques du PIC : des bulles de savon qui apparaissent et disparaissent aussitôt dans le vide. Ce qui est plus intéressant, c'est la redécouverte que le PIC fait du langage des modernistes et la récupération pour lui de cette "phraséologie révolutionnaire" typique de feu Union Ouvrière dont il entend peut-être occuper la place vide. Mais revenons à la définition du réformisme que le PIC identifie à tort avec la résistance ouvrière aux attaques immédiates de la bourgeoisie[1]. Le réformisme dans le mouvement ouvrier d'avant 1914 ne consistait nullement dans le fait de la défense des intérêts immédiats de la classe ouvrière mais dans la séparation opérée par lui entre cette défense des intérêts immédiats et le but final historique du prolétariat : le communisme, ne peut être atteint que par la révolution[2].
Les idéologues de la petite bourgeoisie radicale, les restes du mouvement étudiant, les continuateurs anarchisants de l'école proudhonienne opposent au réformisme l'haleine brûlante de leur phraséologie pseudo-révolutionnaire, mais partagent avec lui la séparation artificielle entre luttes immédiates et but final, entre revendications économiques et luttes politiques. Le "mouvement est tout, le but n'est rien" (Bernstein) du réformisme et le "but est tout le mouvement n'est rien" des phraséologues modernistes ne s'opposent qu'en apparence mais sont en réalité l'endroit et l'envers d'une même démarche.
Les marxistes révolutionnaires ont de tout temps combattu les uns et les autres. Ils se sont toujours élevés énergiquement contre toute tentative d'opérer ce genre de séparation. Ils ont de tout temps montré l'unité indivisible du prolétariat, à la fois classe exploitée et classe révolutionnaire, et l'unité indivisible de sa lutte, à la fois pour la défense de ses intérêts immédiats et pour son but historique. De même que dans la période ascendante du capitalisme -avec la possibilité d'obtenir des améliorations durables l'abandon du but historique révolutionnaire équivalait à une trahison du prolétariat, de même dans la période de décadence l'impossibilité des améliorations ne saurait servir de justification pour la renonciation à la lutte de la résistance ouvrière et l'abandon de ses luttes pour la défense de ses intérêts immédiats. Une telle démarche quel que soit le radicalisme de la phraséologie qui la recouvre, signifie purement et simplement la désertion et l'abandon de la classe ouvrière.
C'est un abus éhonté que d'utiliser "l'abolition du salariat" à l'encontre de la lutte violente que livre la classe ouvrière contre les licenciements dont elle est victime aujourd'hui. Citer à tort et à travers en la séparant de son contexte cette formule célèbre extraite du fameux exposé fait par Marx dans le "Conseil général" de TAIT en 1865 contre l'oweniste J.Weston, et connue sous le nom de "Salaire, prix et profit", revient à commettre une grossière déformation de la lettre et de l'esprit de son auteur. Cette déformation qui a pour racine un "radicalisme faux et superficiel" (Marx. "Salaire, prix et profit". Ed. Sociales, p. 117) repose entièrement sur la séparation et l'opposition faites entre la défense des conditions de vie de la classe ouvrière et l'abolition du salariat. Dans cet exposé remarquable, Marx s'acharne à démontrer la possibilité et la nécessité pour la classe ouvrière de mener une lutte quotidienne pour la défense de ses intérêts économiques, non seulement parce que tel est son intérêt immédiat mais surtout parce que cette lutte est une des conditions majeures de sa lutte historique contre le capital. Il énonce cet avertissement : «S'il (le prolétariat) se contentait d'admettre la volonté, l'ukase du capitaliste comme une loi économique constante, il partagerait toute la misère de l'esclave sans jouir de sa situation assurée" (idem. p. 135). Et plus loin, après avoir démontré que la "tendance générale de la production capitaliste n'est pas d'élever les salaires moyens, mais de les abaisser", Marx tire cette première conclusion :
- " Mais telle étant la tendance des choses dans ce régime, est-ce à dire que la classe ouvrière doive renoncer à sa résistance contre les empiétements du capital et abandonner ses efforts pour arracher dans les occasions qui se présentent tout ce qui peut apporter quelques améliorations à sa situation ? Si elle le faisait, elle se ravalerait à n'être plus qu'une masse informe écrasée, d'êtres faméliques auxquels on ne pourrait plus du tout venir en aide"»
Et revenant sur le même point, il poursuit plus loin :
- " Si la classe ouvrière lâchait pied dans son conflit quotidien avec le capital, elle se priverait elle-même de la possibilité d'entreprendre tel ou tel mouvement de plus grande ouverture"'. (idem. p.141)
Il n'est jamais venu à Marx l'idée saugrenue d'opposer le mot d'ordre de l'abolition du salariat à la lutte immédiate, considérée et rejetée comme réformiste, comme veulent le faire croire tous les fanfarons qui se gargarisent avec la phraséologie 'révolutionnaire". Non, c'est textuellement contre 'illusion et le mensonge d'une harmonie possible entre le prolétariat et le capital, basée sur une fausse notion abstraite de justice et d'équité qu'il oppose son mot d'ordre :
- " Au lieu du mot d'ordre conservateur "un salaire équitable pour une journée de travail équitable ils (les ouvriers) devraient inscrire sur leur drapeau le mot d''ordre révolutionnaire "abolition du salariat".
Devons-nous rappeler encore la lutte de Rosa Luxemburg contre la séparation entre programme minimum et programme maximum, revendiquant dans son discours au "congrès de la Fondation du Parti Communiste" fin 1918, l'unité du programme, de la lutte économique et immédiate et de la lutte politique du but final, comme deux aspects d'une seule lutte historique du prolétariat. C'est aussi dans le même sens que Lénine, tant abhorré par le PIC, pouvait affirmer que "derrière chaque grève se profile le spectre de la révolution".
Pour le PIC, au contraire, la lutte contre les licenciements équivaut à revendiquer... le salariat, tout comme pour Proudhon l'association des ouvriers et les grèves signifiaient la reconnaissance du capital. Voilà comment nos sévères censeurs ont compris et interprètent et déforment la pensée marxiste !
Le PCI bordiguiste, quant à lui, n'est pas en reste quand il s'agit de minimiser l'importance de la manifestation du 23 mars ou même d'en faire tout autre chose que ce qu'elle représentait réellement. Alors que dans "Le Prolétaire" nr288, on couvre la plus grande partie de la première page par un article sur le 1er mai bien que cette journée ne soit plus depuis longtemps qu'une célébration de la "fête du travail", qu'une sinistre mascarade orchestrée par ces pires ennemis de la classe ouvrière que sont les partis de gauche et les syndicats , on ne consacre, avant et après le 23 mars, que quelques commentaires furtifs, tendant à faire de cette manifestation exactement la même chose que n'importe quelle "journée d'action". Ainsi, avant le 23 mars, on peut lire dans "Le Prolétaire " nc285 (p.2) : "Dès lors que les forces ont été contenues, il n'y a plus qu’à donner le change par une "vaste action" de type journée nationale qui en donnant l'illusion de la solidarité, détruit son tranchant de classe et ne lui laisse d'autre issue qu'une intervention sur le terrain parlementaire ..."
Après le 23 mars, le PCI revient sur cette journée pour n'y voir autre chose que : "Un gaspillage prévisible d’énergies ouvrières, une entreprise de division et de démoralisation, une journée de bourrage de crâne à coups de beuglements chauvins, de pacifisme social et de crétinisme électoral." (Le Prolétaire n°287 : "Quelques enseignements de la marche sur Paris").
Ainsi, enfermé dans ses schémas du passé, le PCI est passé en bonne partie à côté de la réalité des affrontements de classe de l'hiver dernier. Ceci ne l'a pas empêché de dénoncer (Le Prolétaire n°285) "les nouvelles formes plus "romantiques" d'opportunisme qui ne manqueront pas de fleurir en réaction au sabotage réformiste et centriste, à savoir les formes de syndicalisme, de conseillisme, d'autonomisme, de terrorisme, etc." Sans faire de persécution, nous pouvons nous sentir visés par cette référence aux "conseillistes" quand on sait que le PCI qualifie toujours ainsi notre organisation et que ses militants ne se sont pas privés lors de diverses réunions publiques d'attaquer notre "opportunisme" et notre "suivisme" par rapport aux luttes du début 79 en France. À croire qu'il ne se regarde jamais dans un miroir! Ne sait-il donc pas qu'on ne doit jamais parier de corde dans la maison d'un pendu !
Nous le reprocher, c'est le comble de la part d'un "Parti" (sic) qui défend toujours la "nature prolétarienne des syndicats, parce qu'ils rassemblent des ouvriers", argument aussi spécieux que la défense trotskyste de la nature "toujours prolétarienne" de l'État russe. Il n'y a pas si longtemps que le PCI faisait encore valoir les titres de noblesse de la CGT, dues à ses origines prolétariennes et qui la distingueraient des autres confédérations syndicales, aux origines plus douteuses. Et que penser du cahier de revendications immédiates élaboré par le PCI où, entre autres, on réclame pour les chômeurs le droit... de rester membres des syndicats ? On se souviendra aussi de la réclamation équitable, du droit de vote... pour les ouvriers immigrés. On n'a pas oublié le zèle particulier avec lequel les membres du PCI, dans le service d’ordre de la manifestation des Foyers Sonacotra interdisaient, sous prétexte d'apolitisme, la vente des journaux révolutionnaires. Et comment doit-on apprécier ce soutien apporté par le PCI au Comité de Coordination des Foyers Sonacotra, en se chargeant de la diffusion (lors de la réunion publique de la "Gauche Internationaliste") d'un tract appelant à un meeting à Saint-Denis, contresigné par des sections syndicales et l'union locale CFDT, et en plus portant cette précision : "Meeting soutenu par "Parti Socialiste Saint-Denis"? Le PCI se reconnaîtrait-il donc en lisant dans ce tract : "Aujourd'hui, tous les démocrates de ce pays doivent prendre position."
Ces terribles pourfendeurs de l'opportunisme qui sont encore à préconiser la tactique, oh combien "révolutionnaire" (!) du Front Unique syndical, tactique quotidiennement appliquée par la CGT et la CFDT pour mieux encadrer et immobiliser les ouvriers en lutte, sont vraiment mal placés pour donner des leçons à qui que ce soit. En identifiant syndicats EN GENERAL et réformisme, ils entretiennent la plus grande confusion parmi les ouvriers. En effet, les révolutionnaires pouvaient et devaient participer au mouvement syndical dans la période ascendante du capitalisme, malgré le fait que l'orientation et la majorité était réformiste. Il n'en n'est pas de même aujourd'hui, dans la période de décadence quand les syndicats devaient nécessairement devenir et sont effectivement devenus des organes de l'État capitaliste dans tous les pays. Il n'y a aucune place pour la défense de classe et donc pour les révolutionnaires dans de telles organisations.
En ne tenant pas compte de cette différence fondamentale entre les syndicats d'aujourd'hui et le réformisme, en les identifiant, et en qualifiant ces syndicats de réformistes le PCI rend le plus grand service à la bourgeoisie, en l'aidant à faire croire aux ouvriers que c'est leur organisation. D'autre part, il lui fait gratuitement un cadeau -sa caution révolutionnaire- très appréciable, un cache sexe, avec lequel les syndicats cachent leur nudité, leur nature et leur fonction anti-ouvrière. Quand le PCI aura compris cette différence, il saura alors peut-être, mieux juger ce qu'est une intervention révolutionnaire et ce qu'est opportunisme et suivisme.
LA CWO ET NOTRE INTERVENTION
Pour terminer d'une façon plus détaillée, examinons le n°15 de "Revolutionary Perspectives" dans lequel la Communist Workers Organisation de Grande-Bretagne se livre à une dissection professorale de ce qu’il fallait faire, de ce qui aurait dû être fait, de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on aurait pu faire le 23 mars dernier, le tout avec un minimum d'informations et un maximum de remarques outrancières à l'égard du CCI... pour les besoins de la cause polémique:
- " Étant donné la vision de ce groupe (le CCI), dominé par le spontanéisme et l'économisme, son intervention n'était qu'une série d'efforts incohérents et confusionnistes. Bien que le CCI soit intervenu très tôt dans les villes de la sidérurgie en dénonçant les syndicats et en appelant les ouvriers à s'organiser et à étendre la lutte3 il a rejeté pour lui tout rôle d'avant-garde fidèle à ses tendances conseillistes. Le CCI s'est refusé de canaliser l'aspiration des ouvriers en faveur d'une marche sur Paris vers un aboutissement pratique, préférant dire aux ouvriers de s'organiser "eux-mêmes". À certaines occasions, le CCI a pu surmonter cette hésitation comme par exemple à Dunkerque où les militants du CCI ont aidé les ouvriers à transformer une réunion syndicale en assemblée de masse. Mais ceci a été fait empiriquement sans dépasser réellement ses conceptions spontanéistes et conseillistes. Le CCI dans son "tournant pratique" va finir dans l'opportunisme et non pas dans une pratique cohérente d'intervention puisqu'il lui manque toute compréhension de la conscience et du rôle de l'avant-garde communiste... ".
Le CWO, par contre, qui comprend parfaitement les chemins de la conscience et du parti dirigeant a tout compris du 23 mars : "Par rapport au 23 mars il est clair que seule une action d'arrière-garde était alors possible"'. Voilà une clarté magnifique qui vient, 6 mois après les événements nous dire que ce n'était pas la peine de se casser la tête !
Quelle analyse approfondie de la CWO lui a-t-elle permis d'avoir cette clarté lumineuse ? Que dit la CWO sur la situation politique et sociale en France ? Dans le n°10 de Revolutionary Perspectives, au moment des élections en France, nous avions lu que la CWO constatait (avec le monde entier) que "l'initiative reste du côté de la classe dominante" et qu'il y a eu une relative paix sociale en France depuis 5 ans. Dans le n°15, en octobre 79, la CWO récite ce passage en ajoutant : "Depuis lors, nous sommes heureux de vous informer que la situation a changé". Merci pour la nouvelle! Constater une réalité quand elle crève les yeux n'est guère une base pour l'intervention. L'intervention ne se prépare pas en s'agitant après coup pour se donner de l'importance mais en affinant à temps ses analyses politiques. Ce n'est pas chose facile, surtout en comité restreint comme pour la CWO mais également pour toute organisation révolutionnaire. Cependant, malgré la difficulté de saisir toutes les nuances d'une réalité mouvante, dès avant les élections de mars 1978, le CCI (dans la RINT n°13) a attiré l'attention sur le fait que les conditions du reflux commençaient à s'épuiser et que des soubresauts de la combativité ouvrière longtemps contenue se préparaient (ce qui allait se révéler juste à travers les grèves du printemps 1978 en Allemagne, aux USA, en Italie et en France). De cette perspective tracée par le CCI qui nous a permis de rester vigilants et de reconnaître l'importance des premiers signes de lutte et d'y être présents, de cette analyse qui ensuite nous a permis de mettre en garde la classe ouvrière contre le danger de la gauche dans l'opposition, la CWO ne parle pas et pour cause : petite polémique oblige. Se contenter de constater une situation, c'est quand même mieux que l'attitude d'autres groupes révolutionnaires qui refusent de reconnaître la montée des luttes mais ce n'est pas suffisant pour s'orienter rapidement face à des surgissements brusques.
Si la CWO ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas su armer l'organisation pour affronter la lutte de classe, il nous reproche par contre de ne pas avoir su "être l'avant-garde" d'un mouvement "voué à être une action d'arrière-garde". On dirait, avec cette notion "d'avant-garde de l'arrière-garde" que la CWO donne l'impression d'avoir le cul par-dessus tête, ou, tout au moins d'être amateur de contorsions.
Mais sur quelle analyse géniale se base la CWO pour pouvoir dire du haut de sa chaire que le 23 mars était d'avance voué à l'échec ? Quelle était réellement la situation ?
La combativité ouvrière a explosé à Longwy avec la mobilisation générale des ouvriers sidérurgistes contre les licenciements, l'attaque du commissariat de police, la destruction des dossiers au siège patronal, une situation de lutte ouverte échappant au contrôle des syndicats et dénoncée par ces derniers. L'agitation s'étend à Denain et à toute la sidérurgie. De plus, à Paris, plusieurs grèves éclatent contre les licenciements, contre l'austérité et les conditions de travail : à la Télévision française (SFP), dans les banques, les assurances, aux PTT. Dans cette situation pleine de potentialités dans le contexte de la crise, que faire ? Se contenter de parler dans le vague de la nécessité de généraliser la grève, de sortir de la région et de la catégorie ? Les ouvriers, eux, ont pensé à concrétiser cette idée de l'extension de la lutte et Ils ont commencé à parler d'une marche sur Paris, Paris où à travers toute l'histoire du mouvement ouvrier en France, le détonateur social a toujours été le plus efficace. Comment ne pas soutenir ce besoin exprimé et revendiqué par les ouvriers des zones en lutte de se centrer à Paris ? Pourquoi pendant plus d'un mois, les syndicats ont-ils fait face à ce projet ouvrier en repoussant de jour en jour sa réalisation ? N'est-ce pas qu'ils espéraient l'annuler complètement ou du moins de le désamorcer ?
Mais avant même d'avoir fixé la date de fin mars (suffisamment tard pour permettre un matraquage des ouvriers) les syndicats faisaient déjà inlassablement leur travail de sape. Ils utilisaient la tactique de la division syndicale pour rompre toute tendance à l'unité parmi les ouvriers : la CGT (syndicat PC) prenait sur elle "l'organisation" de la marche pour mieux la saboter de l'intérieur alors que la CFDT criait bien haut qu'elle refusait les "journées nationales étouffoirs". Au début, personne ne pouvait se prononcer avec certitude sur l'ampleur que pourrait prendre la manifestation du 23 mars. Toute la question repose dans les potentialités des luttes qui se déroulaient à ce moment-là. Dix jours avant la manifestation, il était encore possible que cette marche devienne le catalyseur concret de la volonté d'élargir les luttes et faire l'unité entre les sidérurgistes et les ouvriers en grève à Paris, de faire de cette marche un débordement syndical. Mais si les révolutionnaires ont senti cette potentialité, (c'est à dire ceux qui ne croient pas que tout est voué à l'échec d'avance), la bourgeoisie et son armée syndicale l'ont senti aussi. Les syndicats se sont mis à la besogne et quelques jours avant le 23 mars, ils ont précipité la rentrée de tous les grévistes de la région de Paris. Une à une les luttes se sont éteintes sur une pression syndicale hors du commun. De toute façon, il est clair que la date tardive de la manifestation avait été choisie par les syndicats en vue de l'application de cette tactique.
Nous avions distribué des tracts aux grévistes en les appelants à la marche, à l'unité dans la lutte, au débordement syndical. Mais la pression de la bourgeoisie a eu raison de cette première tentative d'expression de la combativité ouvrière. Déjà, dans les villes du nord, les ouvriers se méfiaient et avec raison de la CGT qui avait tout encadré. Tout en disant qu'il ne fallait pas laisser venir des délégations syndicales, que les ouvriers devaient venir en masse, ce qui constituait la seule possibilité de sauver la marche, nous nous sommes rendus compte que la délégation de Denain, par exemple, serait beaucoup plus restreinte qu'on ne pouvait le penser.
Que faire ? Continuer sur la lancée comme si rien n'était ? Bien sûr que non ! Les jours précédant le 23 mars, le CCI a préparé un tract pour la manifestation qui disait que seul le débordement syndical pouvait donner à la marche le véritable contenu qu'avaient espéré les ouvriers. Au passage, la CWO accuse le CCI d'avoir diffusé un tract désignant la manifestation comme un "pas en avant". Il est facile d'extraire un mot d'une phrase pour lui faire dire son contraire, or il est dit dans ce tract : "Pour que la journée du 23 mars soit un pas en avant pour notre lutte à tous." et le contenu du tract ne laisse pas planer le doute sur la nécessité de rompre le cordon syndical. Les syndicats l'ont d'ailleurs si bien compris que leurs S.0.déchiraient le tract et agressaient nos militants qui vendaient le journal RI n°59, lequel titrait: "Pas d'extension des luttes sans débordement syndical" et "Salut aux ouvriers de Longwy".
Mais attention ! La CWO, elle, aurait fait autrement. Elle nous donne la leçon : d'abord on aurait dû "canaliser la marche vers un aboutissement pratique" au lieu de "dire aux ouvriers de s'organiser eux-mêmes". Que signifie exactement "canaliser la marche nous-mêmes" ? "... Avant la manifestation, le CCI aurait dû intervenir pour dénoncer la manifestation comme une manœuvre pour tuer la lutte..." Ceci, dès le début en février, ou seulement après que la CGT ait pris le train en marche et fait rentrer les ouvriers de Paris ? La CWO ne daigne pas éclaircir ces petits détails. Il ne semble pas comprendre qu'un mouvement de classe va vite et des rapports de force entre les classes sont à saisir sur le terrain au fur et à mesure. Mais "le CCI aurait dû appeler à une autre alternative pour la marche : aller aux usines de Paris et appeler aux grèves de solidarité". Nous avons appelé à la solidarité dans les entreprises à Paris, Mais pour la CWO, si nous avons bien compris, la manifestation était vouée à l'échec d'avance. Fallait-il la dénoncer et en proposer une autre? (Où ? à la télé ? en tirant un lapin du chapeau ?) et au cours de celle-ci marcher sur les usines (lesquelles ? aucune n'était alors en grève). La CWO devrait se mettre d'accord : soit une manifestation est vouée à l'échec d'avance et alors on la dénonce à la rigueur mais on ne se fait pas d'idées sur le "détournement", soit une manifestation a une potentialité importante et alors on ne la dénonce pas. Quant à une manifestation "alternative", cette idée est aussi absurde que celle d'une poignée d'ouvriers de Longwy qui nous a demandé de les loger à Paris s' ils descendent à 3000. Supposer que nous aurions pu offrir cette alternative aujourd'hui, c'est planer dans les nuages de la rhétorique, c'est se croire en période quasi-insurrectionnelle. La question n'était pas d'imaginer l'impossible sur le papier, mais de réaliser tout ce qui était possible dans la pratique.
La CWO pense qu'il était possible à une minorité révolutionnaire de détourner cette manifestation. Il néglige encore une fois de préciser comment et dans quelle circonstance. Curieuse conception de la CWO, qui, en gros, verrait la révolution à chaque coin de rue, du moment que le parti infaillible donne les bonnes directives, et cela quel que soit le degré de maturité de la classe.
Cependant, malgré le sabotage le plus raffiné, le plus systématique, malgré un service d'ordre de 3000 "gros bras" du PC pour encadrer les ouvriers, malgré l'éparpillement des ouvriers les plus combatifs dès leur arrivée dans la banlieue parisienne, malgré la dispersion manu-militari dans les rues avoisinantes de l'Opéra, le 23 mars n'était pas une manifestation promenade à l'image des sinistres 1er mai. Le 23 Mars, la combativité ouvrière ne pouvant pas trouver une brèche par où s'exprimer, a explosé dans une bagarre où des centaines d'ouvriers ont affronté le service d'ordre syndical. Mais là aussi, la CWO a une version à elle de la vérité : "aller suivre ces ouvriers sans réfléchir en un combat futile avec les CRS/CGT était un acte désespéré".
La CWO invente à présent que notre intervention "irréfléchie" s'est réduite à aller combattre les flics aux côtés des ouvriers dans un combat "futile" Venant d'une autre publication, cette "accusation" nous laisserait songeurs! Avons-nous vraiment besoin de préciser que nos camarades n'ont pas cherché la bagarre mais se défendaient contre les charges de CRS comme les autres ouvriers et avec eux. Ils ont reculé avec les manifestants jusqu'à la dispersion complète du rassemblement tout en continuant à diffuser et à discuter. Le CCI n'a jamais exalté la violence en soi, ni aujourd'hui, ni demain, au contraire, comme en témoignent les textes publiés sur la période de transition. La CWO nous reproche maintenant d'avoir été obligés de nous défendre contre la police tandis que dans le n°13 de RP, on peut lire : "Le CCI est sous l'influence grandissante des illusions libérales et pacifistes"(p.6). La CWO devrait se décider : les membres du CCI sont des "rêveurs", des "utopistes", parce qu'ils sont contre la violence au sein de la classe pendant la révolution (tandis que la CWO, telle l'instituteur de la révolution, se frotte déjà les mains en préparant la bonne leçon de plomb destinée aux ouvriers qui ne marcheront pas droit) ; par contre, quand le CCI s'affronte avec la police dans une manifestation, alors la CWO trouve cela "irréfléchi". S'affronter avec la police est "futile" mais s'entretuer, voilà une "tactique" vraiment révolutionnaire !
Nous avons dit que la marche sur Paris offrait une occasion de concrétiser la nécessité et la possibilité de la généralisation des luttes, une occasion pour montrer la force réelle de la classe ouvrière. Que cette potentialité n'ait pas pu se réaliser n'est pas de notre fait. Bien que nous ayons tenté de lancer l'idée d'un meeting par une prise de parole, la rapidité de la charge de la police en conjonction avec la dispersion organisée tambour battant par les syndicats n'a pas permis aux milliers de prolétaires qui "ne se dispersaient pas" de tenir un meeting.
Le fait que la manifestation du 23 mars n'ait rien donné d'autre que ce que voulaient en faire les syndicats ne signifie cependant nullement qu'elle n'ait eu aucune potentialité. Malgré tout le sabotage préalable, malgré le report de sa date après la fin des grèves de la région parisienne, elle aurait pu également tourner autrement comme l'a démontré quelques jours plus tard le débordement de la manifestation de Dunkerque où le meeting syndical qui devait la clore s'était transformé en assemblée ouvrière où un nombre important de travailleurs avait dénoncé les syndicats. Avec la logique de la CWO, les révolutionnaires n'auraient pas dû participer à cette manifestation puisque encore plus encadrée et d'une certaine façon bien plus "artificielle" que celle du 23 mars; ils se seraient alors privés d'une intervention importante et relativement efficace comme s'en est privé le PCI qui avait une analyse similaire à celle de la CWO.
Après la marche, le CCI a diffusé à toutes les usines où se font les interventions régulières un tract-bilan analysant la réussite du sabotage syndical. Il y était dit que l'enseignement essentiel de cette lutte où les syndicats se sont dévoilés comme défenseurs de la police contre la colère des ouvriers réside dans le fait qu'il n'y a pas d'autre issue pour la classe ouvrière que le débordement syndical.
Dans l'intervention de l'organisation lors de toute la période mouvementée des luttes des ouvriers de la sidérurgie en France, la CWO ne voit que la "culmination d'une longue série de capitulations politiques du CCI". Ce groupe ne sait pas mesurer ses mots. Outre le fait que ses remarques sur comment une "véritable (!) intervention révolutionnaire" aurait pu se faire ne tiennent pas debout, il n'y a rien dans ce qui a été fait par le CCI qui justifierait l'accusation de "capitulation politique". Le CCI a été fidèle à ses principes et une orientation cohérente. L'agitation est une arme difficile à manier et elle s'apprend sur le terrain. Nous ne prétendons pas que chacun des 7 tracts diffusés en 6 semaines soit un chef d'œuvre, mais il n'y a rigoureusement rien dans toutes les critiques de la CWO qui pourrait prouver un quelconque écart à nos principes. Que Messieurs les futurs aspirants à la "direction" de la classe ouvrière de demain reconnaissent que l'intervention du CCI n'est pas du style substitutioniste, nous nous en félicitons, mais dans la pratique, ils n'ont rien de précis à apporter comme contribution et leurs paroles ne sont en fin de compte autre chose que du vent.
La CWO conclut son assaut de mauvaise foi contre le CCI en disant que sur les questions vitales du mouvement ouvrier d'aujourd'hui, telles que "doit-on aider à la constitution de groupes d'ouvriers chômeurs? Doit-on aider des noyaux ouvriers ? Doit-on assister à des réunions internationales d'ouvriers même s'il y a encore une influence syndicale ?", le CCI ne fait que laisser ses membres dans le noir et les destine à tomber dans l'opportunisme. Là, il dépasse la mesure. La CWO a pourtant assisté au 3ème Congrès du CCI où ces questions ont été soulevées : mais il est devenu amnésique à moins qu'il n'ait fait la sourde oreille. Il faut dire que lorsqu'on n'est pas habitué comme c'est le cas de la CWO à l'élaboration des positions politiques dans une organisation internationale et quand on croit au monolithisme à l'intérieur de son armoire, on a du mal à s'orienter dans un Congrès où il y a forcément différentes propositions, une confrontation d'idées. Mais si la CWO se noie déjà aujourd'hui dans un verre d'eau, que fera-t-il dans la tourmente de la lutte de classe le jour où tous les ouvriers se mettront à réfléchir.
Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses, pas plus que la CWO d'ailleurs qui, dans un sursaut de réalisme, avoue qu'il n'a "pas encore une totale clarté sur ces question". Mais sur les questions posées plus haut, le CCI a déjà répondu oui dans la pratique (cf. le comité de chômeurs d'Angers, la grève de Rotterdam, la réunion internationale des dockers à Barcelone). Tout en appuyant toute tendance vers l'auto organisation de la classe ouvrière, nous devons savoir comment l'orienter, quels dangers éviter, comment contribuer à cet effort ? Et pour cela, on ne peut compter que sur les principes et l'apport de l'expérience.
C'est dans ce sens que nous affirmons la nécessité de donner notre soutien à toutes les luttes du prolétariat sur un terrain de classe. Nous appuyons les revendications décidées par les ouvriers eux-mêmes à condition que celles-ci soient conformes aux intérêts de la classe ouvrière. Nous refusons le jeu de la surenchère gauchiste (les syndicats et la gauche demandent 20 centimes, alors les gauchistes proposent 25 centimes !) ainsi que l'idée absurde du PCI de faire des "cahiers de revendications" à la place des ouvriers.
Le plus grand obstacle devant les luttes ouvrières aujourd'hui est constitué par les syndicats. Nous nous efforçons dans une période de montée des luttes de dénoncer les syndicats non seulement de façon générale abstraite mais surtout concrètement, dans la lutte, de démontrer dans le quotidien leur sabotage de la combativité ouvrière.
L'essentiel de toute lutte ouvrière aujourd'hui c'est la poussée vers l'extension : au-delà des catégories, des régions et même des nations, l'unité de la lutte ouvrière contre la décomposition du système capitaliste en crise. Une lutte qui se laisse isoler va vers la défaite. Il n'y a qu'une seule chose qui fait reculer le capital, l'unité et la généralisation des luttes. En cela, la situation présente se distingue de celle du siècle dernier où la durée d'une lutte était un facteur essentiel de sa réussite : en face d'un patronat beaucoup plus dispersé qu'aujourd'hui, le fait d'arrêter la production pendant une longue période pouvait créer des pertes économiques catastrophiques pour l'entreprise et constituait donc un moyen efficace de pression. A l'heure actuelle, par contre, il existe une solidarité d'ensemble du capital national, prise en charge notamment par l’État, qui permet à une entreprise de tenir bien plus longtemps (surtout dans un moment de surproduction et d'excédent des stocks). De ce fait, une lutte qui s'éternise a toutes les chances d'être perdue de par les difficultés économiques qu'elle provoque pour les grévistes et la lassitude qui s'installe à la longue. C'est pour cela que les syndicats ne sont pas trop gênés pour jouer à peu de frais les "va-t-en-guerre" en déclarant "nous tiendrons le temps qu'il faudra": ils savent, qu'à la longue, la lutte sera brisée. Par contre, ce n'est pas par hasard qu'ils sabotent tout effort de généralisation : ce que craint par dessous tout la bourgeoisie, c'est d'avoir à affronter un mouvement touchant non telle ou telle catégorie de la classe ouvrière, mais tendant à se généraliser à son ensemble mettant en présence deux classes antagoniques et non pas un groupe d'ouvriers à un patron. Alors elle risque d'être paralysée tant économiquement que politiquement et c'est pour cela qu'une des armes de la lutte c'est la tendance à son élargissement même s'il ne se réalise pas d'emblée. La bourgeoisie a bien plus peur des grévistes qui vont d'usine en usine pour tenter de convaincre leurs camarades d'entrer en lutte, que de grévistes qui s'enferment dans leur usine même avec la volonté de tenir deux mois.
C'est pour cela et parce qu'elle préfigure les combats révolutionnaires de demain qui embraseront toute la classe que la généralisation des luttes est le leitmotiv de l'intervention des révolutionnaires aujourd'hui.
Pour pouvoir mener la lutte en dehors et contre les syndicats, la classe ouvrière s'organise de façon hésitante au début mais en laissant entrevoir déjà les premiers signes de la tendance vers l'auto-organisation du prolétariat (voir la grève de Rotterdam en septembre 1979). Nous appuyons de toutes nos forces les expériences qui enrichissent la conscience de classe sur ce point capital.
Quant aux ouvriers les plus combatifs, nous poussons à ce qu'ils se groupent non pas pour constituer de nouveaux syndicats, ni même pour qu'ils se perdent dans un apolitisme stérile issu d'un manque de confiance en soi, mais en groupes ouvriers, comités d'actions, collectifs, coordinations, etc., lieux de rencontres entre ouvriers, ouverts à tous les ouvriers pour discuter les questions fondamentales devant la classe. Sans s'enthousiasmer plus qu'il ne faut et sans bluffer, nous affirmons que le bouillonnement dans la classe ouvrière s'annonce déjà par des minorités combatives contribuant au développement de la conscience de classe non pas tant par les individus directement concernés à un moment donné mais par le fil historique que la classe reprend en ouvrant la discussion et la confrontation en son sein.
Sur ces questions comme sur la manifestation du 23 mars, on doit affirmer qu'il n'y a pas de recettes toutes faites valables de tout temps. Demain de multiples autres manifestations de la combativité ouvrière concentreront notre attention parce que révélatrices de la force du prolétariat. Comme l'ensemble de la classe, les révolutionnaires ont devant eux des tâches de la plus grande importance : définir des perspectives en tenant compte d'une situation précise, savoir quand il faut passer de la dénonciation générale à la dénonciation concrète fournie par les faits, quand il faut aller à un rythme supérieur, apprécier le niveau réel de la lutte, définir à chaque étape les buts immédiats par rapport à la perspective révolutionnaire.
Nous ne sommes dans le monde qu'une poignée de militants révolutionnaires ; il ne faut pas se faire d'illusions sur l'influence directe des révolutionnaires aujourd'hui, ni sur la difficulté qu'aura la classe ouvrière à se réapproprier le marxisme. Dans le tourbillon des explosions de lutte, dans cette œuvre "de la conscience, de la volonté, de la passion, de l'imagination qu'est la lutte prolétarienne'', les révolutionnaires ne pourront jouer un rôle que "s'ils n'ont pas désappris d'apprendre".
JA/MC/JL/CG
[1] En effet, dans "Jeune Taupe" n°27, le PIC ait suivre un tract d'un groupe d'ouvriers d'Ericsson qu'il reproduit, d'une critique dans laquelle il lui reproche de s'opposer aux licenciements en arguant que : "Il ne semble pas que l'on puisse à la fois "maintenir l'emploi" et "en finir avec le capitalisme et le salariat".
[2] Il faut se garder de confondre le réformisme avec les syndicats d'aujourd'hui. Le réformisme fondait sa politique de négation de la nécessité de la révolution, en lui opposant la défense des intérêts immédiats des ouvriers, sur des illusions émanant d'un capitalisme en pleine expansion. Tandis que les syndicats dans la période de décadence ne nourrissent aucunes illusions, et s'ils sont toujours contre la révolution, ils ont en plus abandonné également la défense des intérêts immédiats des ouvriers, se convertissant en organes directs de l' État capitaliste.
Heritage de la Gauche Communiste:
Gauche mexicaine 1938
- 2464 reads
INTRODUCTION
Dans le n°10 de la Revue Internationale (juin-août 1977) nous avons commencé la publication de textes de la gauche communiste mexicaine. Comme nous l'avons proposé, nous avons continué ce travail, il est vrai avec retard, mais indépendamment de notre seule volonté, en publiant dans le dernier numéro (19) le texte sur "Les nationalisations". Texte dans lequel la gauche mexicaine dénonçait vigoureusement cette mystification, largement utilisée par les partis soi-disant ouvriers pour tromper sans vergogne la classe ouvrière et mieux la rattacher à la défense du capital national. Aujourd'hui comme hier, les nationalisations continuent à être la plate-forme de ces partis, et l'accélération de cette évolution vers le capitalisme d'Etat est toujours présentée par eux comme l'alternative ouvrière à la crise du capitalisme. Et tout comme hier, les trotskystes et autres gauchistes continuent sur cette question comme sur tant d'autres à leur emboîter le pas et leur servir d'auxiliaires très dévoués.
Les deux textes que nous publions aujourd'hui sont à notre connaissance les derniers que ce groupe a publiés dans leur revue "Comunismo" n°2 (octobre-décembre 1938). La violente hostilité de toutes les forces de la bourgeoisie, de droite et de gauche, la campagne de dénonciation publique dans le style stalinien par la section mexicaine de la 4ème Internationale contre les militants et le groupe comme étant des "provocateurs, agents de Hitler et de Staline", la répression (voir leur "Appel" publié dans le n° 10 de la Revue Internationale) du gouvernement de gauche, et surtout la bourrasque de la guerre s'approchant à pas accélérés ont eu raison des faibles forces de la gauche mexicaine, qui vu son extrême jeunesse n'a pas su résister longtemps à une telle coalition des forces ennemies. Le "Groupe des travailleurs marxistes" de Mexico disparaît dans la tourmente de l'année 1939. Mais dans ce court laps de temps (2 ans) de son existence, le groupe communiste de gauche du Mexique a su apporter une contribution effective dans la défense des positions communistes fondamentales. Sa place et sa contribution dans les heures .les plus sombres du mouvement révolutionnaire international ne devraient pas rester méconnues des nouvelles générations.
Le premier texte que nous publions dans cette revue est un exemple vivant de comment les révolutionnaires défendent dans un pays sous-développé les positions de classe et dénoncent tous les mensonges d'une bourgeoisie "progressive". Bon exemple, non seulement contre les trotskystes et leur soutien à Cardenas, mais également contre les bordiguistes d'aujourd'hui qui ne trouvaient rien de mieux que de critiquer ( !) "les faiblesses" du gouvernement de gauche d'Allende au Chili face à Pinochet, de lui reprocher ses hésitations (!) et de lui donner post festum des conseils édifiants sur la "violence révolutionnaire".
On se souvient de l'apologie faite par les bordiguistes de la "terreur révolutionnaire" exemplaire les khmers rouges au Cambodge. C'est aussi à eux lue s'adresse la conclusion de l'article de la gauche mexicaine, quand dénonçant les mensonges de "révolution sociale" dont s'affublait le parti national révolutionnaire (parti gouvernemental) elle s'écrie :
"Quelle vision sociale si magnifique : établir dans le pays la paix de cimetière et décréter qu’elle est "la société sans classe".... comme l’entendent les généraux."
Le deuxième texte est une étude analytique des thèses du 2ème congrès de l'Internationale Communiste sur la question nationale et coloniale. Il est absolument inévitable pour tout groupe communiste, se dégageant du long cours de la dégénérescence et de la trahison finale de la 3ème Internationale de dénoncer non seulement la contre-révolution stalinienne mais encore de soumettre à une critique minutieuse les travaux de l'Internationale Communiste depuis ses premières années au temps glorieux de Lénine. Tout comme les fractions italiennes et belge de la gauche communiste internationale, la gauche mexicaine ne pouvait se contenter d'emboucher simplement les clairons de la plus plate apologie de tout ce qui venait de Lénine, comme le faisaient les trotskystes ou comme le font aujourd'hui les bordiguistes. La gauche mexicaine aurait le plus grand mal à reconnaître dans ces derniers les continuateurs de "Bilan" tant ils ont régressé sur bien des questions pour apparaître comme une variante du trotskysme. Comme les révolutionnaires, lors de l'éclatement de la première guerre mondiale, ne pouvaient se contenter d'un simple constat de la trahison de la 2ème Internationale mais devaient soumettre à un examen critique toute l'involution au cours de son histoire, la gauche communiste ne pouvait et ne devait pas se contenter de stigmatiser le triomphe de la contre-révolution stalinienne mais devait chercher à mettre à nu ses racines dont, non la moindre, se trouve dans l'immaturité de la pensée et l'organisation du mouvement communiste lui-même. Le stalinisme ne tombe pas du ciel et ne surgit pas du néant. Et s'il est absurde de jeter l'enfant avec l'eau sale de la baignoire, de condamner l'Internationale Communiste parce qu'en son sein a pu se développer et triompher le stalinisme (voir par exemple "les modernes" tard venus, et sévères "juges de paix provinciaux" comme le PIC et la Gauche Internationaliste"), il n'est pas moins absurde de prétendre que l'eau de la baignoire a toujours été absolument pure et parfaitement limpide, de présenter l'histoire de "L'Internationale Communiste" divisée en deux périodes bien tranchées, dont l'une, la première serait du cristal pur, révolutionnaire, sans la moindre tâche, sans défaillance aucune et brusquement interrompue par l'explosion de la contre-révolution. Ces imageries d'un paradis bienheureux et d'un horrible enfer sans aucun lien entre eux, n'a rien à voir avec un mouvement réel, telle l'histoire du mouvement communiste où la continuité se fait au travers de profondes ruptures, et où les futures ruptures ont leurs germes dans le processus de la continuité.
Seul l'examen critique inexorable, l'autocritique constante permet au mouvement révolutionnaire de la classe de surmonter ses faiblesses, son immaturité d'hier et de corriger ses erreurs du passé et lui donner la possibilité de se hisser à la hauteur de ses tâches historiques, de mieux ajuster ses positions au travers de l'expérience. Il n'est pas surprenant que la gauche mexicaine ait porté l'examen de la question nationale au centre de ses préoccupations. A côté des questions de la période historique de la décadence et ses implications -la question syndicale, électorale, fascisme et antifascisme, fronts uniques- la question nationale est une de celles qui a laissé le plus d'ambiguïtés permettant des interprétations opportunistes et entrouvrant la porte à ces courants.
Dans la première partie de ce texte, la gauche mexicaine, en rappelant le premier et le deuxième paragraphe de la deuxième thèse du second congres de l'IC, s'efforce de démontrer comment les trotskys-tes et autres "anti-impérialistes" dénaturent sans vergogne la position de principe énoncée dans les thèses du second congrès. Elle revendique ses principes internationalistes comme un acquis du mouvement communiste et dénonce toute altération comme une régression vers des positions nationalistes bourgeoises. C'est par la suite, que la gauche mexicaine se proposait de faire la critique des insuffisances, des ambiguïtés que contenaient encore ces thèses, notamment le troisième paragraphe. Autant les deux premiers paragraphes mettent clairement l'accent sur la séparation nécessaire entre les intérêts de classe des exploités et le concept trompeur bourgeois d'un soi-disant intérêt national commun à toutes les classes, le troisième paragraphe, lui, reste dans le vague, dans la simple description de l'exploitation à outrance de la majorité des pays sous-développés par une minorité de pays où le capital est hautement développé sans tirer d'autre conclusion que le constat que telle est "la situation propre à l'époque du capital financier impérialiste".
Que découlait-il de ce constat ? Pour la majorité centriste de l'Internationale autour de Lénine et le parti bolchevique, il s'en suivait que dans certaines circonstances et plus particulièrement dans une période révolutionnaire, le prolétariat concentré dans les pays de haut développement capitaliste pouvait trouver dans son assaut contre le monde capitaliste un appui dans les pays sous-développés en butte à 1'oppression des grandes puissances. L'erreur d'une telle conclusion réside dans le fait de faire découler mécaniquement d'un constat d'antagonismes existants entre pays dominants et pays dominés une affirmation qui fait de cet antagonisme une opposition historique irréconciliable contre l'ordre existant. La société bour-geoise n'est pas une société harmonieuse mais fondée sur beaucoup d'antagonismes entre pays à capital hautement développé et pays sous-développés, entre des pays développés eux-mêmes, entre un bloc de pays contre un autre bloc, pour la domination du monde. Ce qui aboutit dans la période impérialiste à des guerres généralisées. La question est de savoir si ces antagonismes mettent en question 1'ordre bourgeois, tendent à donner une solution aux contradictions qui déchirent la société, la mènent à des catastrophes, ou bien ces antagonismes ne sont que les manifestations de l'ordre existant, son mode d'existence ?
Pour les marxistes, seul l'antagonisme de classe du prolétariat contre la bourgeoisie présente une dynamique révolutionnaire, non pas seulement parce que c'est la lutte des opprimés contre l'oppression, mais uniquement parce que le prolétariat porte en lui la solution à tous les antagonismes et contradictions dans lesquels la société s'est embourbée et cette solution est l'instauration d'un nouvel ordre social : une société sans classes et sans divisions nationales : le communisme. L'ambiguïté de la position plaçait l'Internationale Communiste sur une pente dangereuse. Les démentis fracassants et les échecs successifs auxquels cette politique a conduit (voir le soutien à Kemal Pacha en Turquie, ou à Tchang Kaï chek en Chine) n'a fait que savonner plus la pente et accélérer la dégénérescence de l'Internationale. D'une "possibilité occasionnelle", la position devenait une règle constante et la possibilité pour le prolétariat de trouver un appui problématique dans les luttes nationales des pays coloniaux s'est transformée en un soutien inconditionnel du prolétariat aux luttes nationales et nationalistes. C'est ainsi que les trotskystes ont fini par participer à la guerre impérialiste et à la défense nationale au nom de 1'antifascisme allemand et que les bordiguistes, tournant le dos à la conception d'une révolution internationale ont construit une théorie d'aires géographiques où dans les unes, (une minorité) serait à Tordre du jour la révolution prolétarienne et dans les autres (groupant l'immense majorité des pays et de la population mondiale) serait à l'ordre du jour "la révolution démocratique bourgeoise anti-impérialiste".
La disparition de sa revue en 1939 a empêché la gauche mexicaine de poursuivre sa critique implacable des positions ambiguës de la 3ème Internationale. Mais déjà cette première partie de leur étude constitue une contribution très importante à ce travail.
Il appartient aux révolutionnaires aujourd'hui de le reprendre et de le continuer.
LE PARTI DE LA REVOLUTION MEXICAINE «RECONNAIT LA LUTTE DE CLASSE» POUR COMBATTRE LA REVOLUTION PROLETARIENNE
Un des traits les plus caractéristiques de la vie politique de nos jours est le fait que la bourgeoisie, pour dévoyer l'attaque des masses affamées et désespérées ,se présente, hypocritement et démagogiquement, comme l'opposé de ce qu'elle est en réalité, c'est à dire, elle se fait passer pour le défenseur des masses contre la bourgeoisie elle-même. Bien entendu, pour réussir un mensonge aussi éhonté et absurde, la bourgeoisie doit se diviser en deux secteurs : l'un "oppresseur" et l'autre "protecteur" et ces deux secteurs, les "mauvais" capitalistes et les "bons" doivent être "en lutte". Dans le cas des pays à dictature masquée qui se dénomment "démocratiques", ce sont les "bons" capitalistes qui détiennent le pouvoir ; dans le cas des pays à dictature ouverte, ce sont les "mauvais". Dans le second cas, les "bons" capitalistes, les "protecteurs des masses" se trouvent en situation "d'opposition irréconciliable" selon leurs propres ternies. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est un secteur capitaliste qui "défend" les masses contre un autre secteur capitaliste. Les ouvriers et les paysans pauvres, pour se libérer du joug capitaliste n'ont plus qu'à offrir leur destinée aux capitalistes eux-mêmes -bien entendu aux "bons", ceux qui se déguisent ennemis". Cet abandon total à l'ennemi de classe qui, naturellement, exige d'énormes sacrifices économiques et politiques et jusqu'à la vie même (comme c'est le cas aujourd'hui en Espagne et en Chine), pour "protéger" les prolétaires et les paysans contre les autres capitalistes, les "réactionnaires", "fascistes", ou "impérialistes", cet abandon de la lutte, donc, se nomme, ironiquement "lutte". Au Mexique, devenu aujourd'hui le jardin tropical de l'exubérance démagogique, cela s'appelle même "lutte de classe"!
Lorsqu'on lit les phrases ci-après de la déclaration du "nouveau" P.R.M., "Parti de la Révolution Mexicaine et authentique représentant des travailleurs", et l'éditorial intitulé "Sur le patriotisme" dans "El Nacional" du 21 avril 1938, on se croirait facilement dans un asile de fous.
"La lutte de classe est reconnue -par le Parti de la Révolution mexicaine et par le consensus de l'opinion ouvrière du pays, comme une réalité insurmontable étant donné que c'est un phénomène inhérent au système de production capitaliste. On ne pourra espérer la paix sociale que lorsque ce régime sera substitué. Nous; les révolutionnaires, concevons la société structurée en deux couches superposées par la force d'une loi économique que le capitalisme impose comme valable, ne fut-ce que de façon transitoire. Le paysan maya est plus frère du pêcheur finlandais, brumeux dans ses eaux polaires, que du propriétaire blanc, maître de la même langue, fils du même sol et protégé par des institutions identiques, qui n'emploie ce qu'il a en commun avec son serf que pour mieux le spolier."
Et qui est-ce qui parle ainsi ? L'authentique représentant de la bourgeoisie, l'authentique représentant du système capitaliste, l'authentique représentant des propriétaires blancs, l'ennemi irréconciliable des [paysans mayas et des pécheurs finlandais, le parti de la soi-disant "révolution mexicaine"!
LES OPPRESSEURS VEULENT DIRIGER LA LUTTE DES OPPRIMES.
Les capitalistes et propriétaires fonciers mexicains "reconnaissent" ainsi la lutte de classe, mais, naturellement, ils ne se réfèrent.pas à la lutte de classe entre eux et les masses opprimées, mais à la lutte entre les opprimés et les exploités et les autres propriétaires fonciers et capitalistes, les "mauvais", les "fascistes". Contre ces derniers, la "bonne" bourgeoisie mexicaine, dirigée par les généraux "démocratiques" lutte à côté des ouvriers et de paysans, et-non seulement elle participe à cette lutte, mais encore elle la dirige! Il est clair qu'une telle "lutte de classe", dirigée par un secteur de la bourgeoisie elle-même, ne signifie pas lutte des opprimés contre les oppresseurs, mais, au contraire, une lutte de ceux-ci contre les opprimés. C'est la lutte de classe de la bourgeoisie et des propriétaires fonciers, "bons" et "mauvais" ensemble, contre les prolétaires et les paysans.
La bourgeoisie mexicaine "reconnaît" la lutte de classe dans le but de dénaturer la lutte des exploités contre les exploiteurs et d'utiliser la combativité aux fins de la lutte des exploiteurs contre les exploités. Voilà la clé de la confusion qui règne aujourd'hui parmi le prolétariat et la paysannerie du pays et l'explication de leurs innombrables défaites.
IL MANQUE UN PARTI DE LA REVOLUTION PROLETARIENNE !
Le triomphe de la démagogie "classiste" de la bourgeoisie mexicaine s'explique par l'absence d'un parti classiste du prolétariat du Mexique. Il n'existe, en dehors de notre organisation, aucun autre groupe, aussi petit soit-i1, qui essaie de combattre à partir des positions du marxisme, le mensonge de la bourgeoisie "révolutionnaire" du pays. Ainsi, la démagogie du P.R.M. et de tous les grands "ouvriéristes" au gouvernement trouve la voie libre et atteint des limites inconnues dans d'autres pays.
"Celui qui accepte seulement la lutte de classe n'est pas encore marxiste et peut rester dans le cadre de la pensée et de la politique bourgeoises.. . Est marxiste seulement celui qui "étend la reconnaissance de la lutte de classes " jusqu'à la DICTATURE DU PROLETARIAT". (Lénine dans l’Etat et la révolution)
Combattre la bourgeoisie et la détruire complètement au moyen de la dictature du prolétariat, c'est cela pour les marxistes, pour les communistes, le seul chemin pour "substituer" au régime actuel un autre qui instaurera enfin la "paix sociale" (pour reprendre les termes de la déclaration du P.R.M.).
Les généraux du P.R.M. et leurs rusés conseillers "ouvriéristes" ont, bien entendu, une conception entièrement différente. D'après eux, SUBSTITUER un régime à un autre, cela signifie simplement CHANGER SON ETIQUETTE, et cela naturellement, ils peuvent et doivent le faire EUX-MEMES. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'une soi-disant "lutte de classes", mais d'une "révolution sociale"... sous la direction des généraux !
Quelle magnifique vision "sociale" : établir dans le pays la paix des cimetières et décréter que c'est là la "société sans classes"... telle que l'entendent les généraux !
UNE ANALYSE DES THESES DU 2eme CONGRES DE L INTERNATIONALE COMMUNISTE 1920 (1ière partie).
Sur les questions nationale et coloniale
"Abolissez l’exploitation de l'homme par l'homme et vous aurez aboli l'exploitation d'une nation par une autre".
Le paragraphe 2 des Thèses du Second Congrès de l'Internationale Communiste, sur les questions nationale et coloniale, dit textuellement :
"Conformément à son but essentiel - la lutte contre la démocratie bourgeoise, dont il s'agit de démasquer l'hypocrisie - le Parti Communiste- interprète conscient du prolétariat en lutte contre le joug de la bourgeoisie, doit considérer comme formant la clef de voûte de la question nationale, non des principes abstraits et formels, mais : 1° une notion claire des circonstances historiques et économiques ; 2° la. dissociation précise des intérêts des classes opprimées, des travailleurs, des exploités, par rapport à la conception générale des soi-disant intérêts nationaux, qui signifient en réalité ceux des classes dominantes ; 3° la division tout aussi nette et précise des nations opprimées, dépendantes, protégées, et oppressives et exploiteuses, jouissant de tous les droits, contrairement à l'hypocrisie bourgeoise et démocratique qui dissimule, avec soin, l'asservissement (propre à l'époque du capital financier de l'impérialisme) par la puissance financière et colonisatrice, de l'immense majorité des populations du globe à une minorité de riches pays capitalistes."
Nous allons analyser ce paragraphe avec soin, point par point.
LA LUTTE CONTRE LA DEMOCRATIE.
Le plus significatif dans ce paragraphe est sans aucun doute son début : l’affirmation claire, sans équivoque que la tâche essentielle du Parti Communiste Mondial n'est pas la fameuse "défense de la démocratie" dont nous parlent tant aujourd'hui les prétendus "communistes", mais au contraire la lutte contre elle !
Cette affirmation répétée tant de fois dans d'autres thèses de l'Internationale de l'époque de Lénine, quoiqu'aujourd'hui niée catégoriquement par l'institution qui porte encore ce nom, servait à Lénine et à ses camarades de point de départ précisément pour l'étude des questions nationale et coloniale. Et il n'y a pas d'autre point de départ ! Ceux qui n'acceptent pas la lutte contre la démocratie bourgeoise comme la tâche principale des communistes, ne peuvent jamais donner une solution marxiste à ces questions.
LE MENSONGE DE L'EGALITE DANS LE SYSTEME DANS LE SYSTEME CAPITALISTE.
Le premier paragraphe des thèses explique plus en détail quels sont ces "principes abstraits et formalistes" que le Parti de la Révolution Prolétarienne doit rejeter comme base de sa tactique dans les questions nationale et coloniale.
"La position abstraite et formelle de la question de l'égalité, y compris de l'égalité des nations, est propre à la démocratie bourgeoise sous la forme de l'égalité des personnes en général. La démocratie bourgeoise proclame l'égalité formelle ou juridique du prolétaire, de l'exploiteur et de l'exploité, induisant ainsi les classes opprimées dans la plus profonde erreur. L'idée d'égalité% qui n'était que le reflet des rapports créés par la production pour le négoce, devient, entre les mains de la bourgeoisie, une arme contre l'abolition des classes combattue désormais au nom de l'égalité absolue des personnalités humaines."
La lutte pour l'abolition des classes serait évidemment superflue si, comme l'affirme la bourgeoisie, l'égalité était réellement possible au sein de la société actuelle malgré sa division en classes. La vérité est que non seulement il n'y a pas d'égalité au sein de la société actuelle, mais qu'il ne peut pas y en avoir. Les thèses ajoutent, à la fin du paragraphe cité :
"Quant à la signification véritable de la revendication égalitaire, elle ne réside que dans la volonté d'abolir les classes".
Et encore une fois, au paragraphe 4, on parle de :
"Car ce rapprochement est la seule garantie de notre victoire sur le capitalisme, sans laquelle ne peuvent être abolies ni les oppressions nationales, ni l'inégalité"'.
En d'autres termes : l'affirmation de l'existence de l'égalité ou, au moins dans la société actuelle, de la possibilité de son existence, a comme but de préserver l'exploitation et l'oppression de classes et de nations. La revendication de l'égalité, sur la base de l'abolition des classes poursuit le but opposé : la destruction de la société actuelle et la construction d'une nouvelle société sans classe . La première est l'arme préférée de tous les réformistes au service de la contre-révolution. La deuxième est une revendication du prolétariat conscient de ses intérêts de classe, l'exigence du Parti de la Révolution Prolétarienne Mondiale.
LES PROLETAIRES N'ONT PAS D’INTERETS NATIONAUX".
D'après le second point des thèses citées, le Parti Communiste Mondial doit rejeter le "concept général des soi-disant intérêts nationaux" parce que ces intérêts n'existent pas et ne peuvent pas exister puisque toutes les nations sont divisées en classes aux intérêts opposés et irréconciliables, de sorte que ceux qui parlent d'"intérêts nationaux", consciemment ou inconsciemment, défendent les intérêts des classes dominantes. L'affirmation selon laquelle il pourrait exister des "intérêts nationaux", c'est-à-dire des intérêts communs à tous les membres d'une nation, se fonde justement sur la soi-disant "égalité formelle et juridique de l'exploiteur et de l'exploité" proclamée hypocritement par les classes possédantes et exploiteuses elles-mêmes. Sur les traces de Marx et Engels, nous devons combattre le mensonge qui dit par exemple que "tous les mexicains" seraient égaux et que nous aurions des intérêts communs et donc une "patrie" commune à défendre. La patrie est à eux. Les travailleurs, comme l'a déjà affirmé avec une absolue clarté le Manifeste Communiste il y a presque cent ans, n'ont pas de patrie. Notre futur ne connaîtra pas des patries différentes au nom desquelles les classes possédantes pourront envoyer les dépossédés sur les champs de bataille, mais une seule patrie : l'humanité laborieuse.
LE BON VOISIN DE LA BOURGEOISIE MEXICAINE
Pour combattre efficacement la bourgeoisie et détruire sa société, nous devons rejeter non seulement le mensonge de l'égalité des hommes au sein des nations, mais aussi celui de l'égalité des nations. Nous devons démontrer, comme nous le montre le deuxième point des thèses citées, que "1'asservissement par la puissance financière et colonisatrice de l'immense majorité des populations du globe à une minorité de riches pays capitalistes" (Etats Unis, Angleterre, France, Allemagne, Italie, Japon) est une situation propre à l’époque du capital financier et Impérialiste" et que cet asservissement, par conséquent, ne peut disparaître avec quelques déclarations mensongères contre l'impérialisme pour une soi-disant politique du "bon voisin", mais seulement avec la disparition du capitalisme lui-même, avec sa destruction violente par le prolétariat mondial.
Nous ne devons pas nous lasser de répéter cette vérité fondamentale, non pas sous une forme abstraite, générale mais sous une forme qui démasque concrètement chaque jour l'hypocrisie démocratique dont parlent les thèses. Dans le cas du Mexique, il est nécessaire de démasquer le mensonge selon lequel un pays capitaliste avancé et, par conséquent, impérialiste comme les Etats-Unis, pourrait être le "bon voisin" d'un pays capitaliste arriéré comme le Mexique. Il faut détruire le mensonge selon lequel l'amitié qui se noue en ce moment entre les exploiteurs d'Amérique du Nord et les serviles exploiteurs mexicains équivaudrait à une "amitié entre les peuples d'Amérique du Nord et du Mexique", comme les exploiteurs des deux pays veulent nous faire croire. Il faut au contraire insister sur le fait que nos seuls bons voisins sont les prolétaires et tous les opprimés des Etats Unis et du monde entier, avec lesquels de vrais intérêts communs nous unissent contre les exploiteurs et leurs "patries" respectives.
LE PATRIOTISME CONTRE-REVOLUTIONNAIRE DES STALINIENS ET DES TROTSKYSTES.
Tout cela est admis "théoriquement" par les soi-disant "communistes" de souche stalinienne et trotskyste, mais, dans la pratique, ils font le contraire. Les staliniens du Mexique et des Etats-Unis sont aujourd'hui au premier rang de ceux qui font l'éloge de la "nouvelle politique" de l'impérialisme nord-américain. Les trotskystes ne le font pas aussi ouvertement ; ils utilisent la méthode indirecte qui consiste à n'attaquer que les "mauvais voisins" de la bourgeoisie mexicaine : l'impérialisme anglais, allemand, japonais.
Mais leur lutte contre les positions fondamentales de l'Internationale Communiste du temps de Lénine va plus loin. Utilisant un tour de passe-passe propre aux renégats, les staliniens et les trotskystes "oublient" le point des thèses citées qui parle de "la dissociation précise des intérêts des classes opprimées, des travailleurs, des exploités, par rapport à la conception générale des soi-disant intérêts nationaux, qui signifient en réalité ceux des classes dominantes" et s'accrochent exclusivement à l'autre point qui parle de "la division tout aussi nette et précise des nations opprimées, dépendantes, protégées et des nations oppressives et exploiteuses".
C'est ce que fait par exemple Léon Trotski dans ses attaques contre notre position sur la guerre chinoise (voir le bulletin interne de la Ligue Communiste Internationaliste du Mexique n°1). Avec cette méthode, il arrive exactement à la même position que les staliniens : au lieu de démontrer aux prolétaires chinois que leurs intérêts de classe sont irréconciliables avec les soi-disant "intérêts nationaux" (en réalité les intérêts des exploiteurs chinois) et que, par conséquent, ils doivent lutter autant contre leurs ennemis "compatriotes" que contre l'ennemi envahisseur, au moyen de la fraternisation avec les soldats japonais et du défaitisme révolutionnaire. Au lieu de cela, Trotski s'efforce de convaincre les exploités de Chine que leurs intérêts de classes: coïncident dans une certain mesure, c'est-à-dire sur le point de la défense de la soi-disant "patrie", avec "les intérêts nationaux" de leurs exploiteurs !
Pour Trotski, les prolétaires "en général" n'ont pas de patrie. Il reste par là "théoriquement" fidèle au marxisme. Mais dans le cas concret des prolétaires de Chine, du Mexique, de tous les pays opprimés et dépendants, c'est-à-dire dans le cas de la majorité écrasante des pays du monde, cette règle fondamentale du marxisme n'a pour lui aucune application. "Le patriotisme chinois est légitime et progressif" affirme ce renégat ! Bien entendu, pour lui et ses semblables, il en va de même pour le patriotisme mexicain, guatémaltèque, argentin, cubain, etc.
LES TRAVAILLEURS N'ONT PAS DE PATRIE MEME DANS LES PAYS OPPRIMES !
Pour un marxiste, cela ne fait pas de doute que le plus important des points cités dans les thèses du Second Congrès de TIC est justement le deuxième point, celui qui insiste sur la non-existence d' "intérêts nationaux" et que la distinction qui est faite au troisième point, entre "nations opprimées" et "nations oppressives", doit se comprendre dans ce sens. En d'autres termes, même dans les nations opprimées, il n'existe pas d'autre "intérêt national" que celui des classes dominantes. La conclusion pratique de cette position théorique est que les règles fondamentales de la politique communiste doivent être appliquées à tous les pays, impérialistes, semi-coloniaux et coloniaux. La lutté contre le patriotisme et la fraternisation avec lés opprimés de tous les pays, y compris les prolétaires et paysans en uniforme des armées dés pays impérialistes, est une des règles dé la politique communiste qui n'admet pas d'exception"!
"Il résulte de ce qui précède que la pierre angulaire de la politique de l'Internationale Communiste, dans les questions coloniale et nationale, doit être le rapprochement des prolétaires et des travailleurs de toutes les nations et de tous les pays pour la lutte commune contre les possédants et la bourgeoisie. Car ce rapprochement est la seule garantie de notre victoire sur le capitalisme, sans laquelle ne peuvent être abolies ni les oppressions nationales, ni l'inégalité."
L'application de cette "pierre angulaire" aux situations concrètes exclut clairement tout cas de "patriotisme légitime" et de "'défense nationale". Dans le cas de la guerre en Chine par exemple, quelle autre application peut avoir la règle générale de la "lutte commune des prolétaires et travailleurs de toutes les nations et de tous les pays contre les possesseurs et la bourgeoisie" que celle de la fraternisation entre les soldats chinois et japonais pour la lutte commune contre les possesseurs et les capitalistes chinois et japonais, c'est-à-dire le défaitisme révolutionnaire des deux côtés ? Comment peut-on faire entrer dans cette règle générale, la politique de Trotski de participation dans la lutte militaire sous les ordres de Tchang-Kai-Chek ?
CHANGEMENT DE TACTIQUE, PAS DE PRINCIPE !
Pour nous répondre, Trotski cite le cas de Marx et Engels qui ont soutenu la guerre des Irlandais contre la Grande Bretagne et celle des Polonais contre le Tsar, même si, dans ces deux guerres nationales, les chefs étaient dans la majorité bourgeois et parfois même féodaux. Le problème est que Trotski, malgré ses grandes connaissances, n'a pas compris l'importance primordiale du premier point que les thèses du Second Congrès de TIC qualifient de "clé de voûte de la question nationale" : "une notion claire des circonstances historiques et économiques".
Notre grand historien ex-marxiste ne se souvient-il pas que la tactique communiste ne peut pas être la même dans la phase ascendante du capitalisme (dont il nous cite deux exemples de guerres progressives) et dans sa phase de décomposition, la phase impérialiste, celle que nous vivons actuellement ? Les circonstances historiques et économiques ont changé à un tel point depuis l'époque où Marx et Engels ont soutenu la guerre des Irlandais et des Polonais, que ce serait un suicide pour le prolétariat de suivre aujourd'hui la même tactique qu'à cette époque.
Il est clair que les changements tactiques ne doivent jamais sortir du cadre des principes communistes déjà établis et dont la validité a été vérifiée mille fois par les événements. Loin de sortir de ce cadre, chaque réajustement tactique doit être une application plus correcte, plus rigide de ces principes, parce que ce ne sont pas seulement de nouvelles situations qui nous obligent à effectuer de tels changements mais aussi l'expérience historique c'est-à-dire l'étude de nos erreurs du passé. Ce n'est que comme ça que l'on peut maintenir la continuité de la lutte communiste à travers la décomposition des anciens organismes ouvriers et la création de nouveaux.
LE RENEGAT TROTSKY REVISE LE MANIFESTE COMMUNISTE ET LES THESES DU SECOND CONGRES DE L’IC.
Un des principes fondamentaux qui doit guider toute notre tactique sur la question nationale est l’antipatriotisme. "Les travailleurs n'ont pas" de patrie". Quiconque propose une nouvelle tactique qui aille à rencontre de ce principe abandonne les rangs du marxisme et passe au service de 1'ennemi.
Or, ce qui est intéressant est que le même Trotski qui insiste sur le fait que le prolétariat doit aujourd'hui suivre la même tactique qu'à l'époque de Marx et Engels, abandonne ouvertement le principe déjà affirmé par ces deux hommes dans le Manifeste Communiste ! Dans sa préface à la nouvelle édition du Manifeste Communiste publiée récemment sn Afrique du Sud, ce renégat déclare sans honte : "...Il est bien évident que la "patrie nationale" qui, dans les pays avancés, est devenue le pire "frein historique, reste encore un facteur relativement progressif dans les pays arriérés, ceux qui sont obligés de lutter pour leur existence indépendante".
Ainsi le renégat veut régler sa montré 100 ans en retard ! (Texte inachevé)
Géographique:
- Mexique [35]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [36]