La Décadence du Capitalisme
- 11240 reads
Les textes recueillis dans cette brochure ont été publiés pour la première fois entre 1973 et 1978.
Pourquoi et comment les révolutionnaires doivent analyser la crise est une contribution du C.C.I. à la 2ème Conférence Internationale des groupes de la gauche communiste
L'Introduction est la présentation faite par Internationalism et World Revolution à la première édition en anglais (1975) des articles sur la décadence du capitalisme parus dans Révolution Internationale n° 2, 4 et 5 de 1973.
Certaines statistiques se référant à l'évolution immédiate de la crise économique du capitalisme sont aujourd'hui dépassées. Mais ce "dépassement" s'est fait, comme prévu, dans le sens d'une confirmation de plus en plus évidente de la décadence accélérée du capitalisme.Structure du Site:
- Brochures [1]
Heritage de la Gauche Communiste:
PRESENTATION - Pourquoi et comment les révolutionnaires doivent analyser la crise
- 7799 reads
Toutes les crises du capitalisme n'ont pas déclenché des mouvements révolutionnaires du prolétariat, mais tous les grands moments de la lutte prolétarienne ont été provoqués par des crises du capitalisme. Ces crises ont eu parfois la forme de crises économiques ouvertes (1848, 1921-23 en Allemagne), mais la plupart du temps, c'est sous la forme de guerres qu'elles ont poussé la classe ouvrière à l'action révolutionnaire (1871, 1905, 1917-18).
Le prochain assaut révolutionnaire du prolétariat sera certainement la réponse à la crise économique ouverte dans laquelle le capitalisme s'enfonce depuis maintenant près de dix ans. La combativité retrouvée par le prolétariat depuis la fin des années 60, et demeurée intacte depuis lors aux quatre coins de la planète, l'échec des campagnes d'embrigadement idéologique tentées par la bourgeoisie dans les pays industrialisés, permettent d'affirmer que la bourgeoisie mondiale ne pourra recourir à une nouvelle guerre mondiale sans avoir au préalable affronté et écrasé la classe révolutionnaire.
Comprendre la crise actuelle du capitalisme, ses causes et ses perspectives, est donc indispensable pour comprendre les conditions objectives qui créent le terrain sur lequel le prolétariat livrera encore une fois bataille pour tenter d'arracher l'humanité à la barbarie et ouvrir la voie à la société communiste.
Mais au travers de l'analyse de la crise du capitalisme se dessine aussi l'analyse de ce que devra être la société future et les moyens de la bâtir. La base objective sur laquelle la société communiste commencera à se bâtir sera sa capacité à faire disparaître les entraves qui bloquent aujourd'hui l'évolution de l'humanité. Suivant l'idée que l'on se fait de ce que sont ces entraves, on aura tendance à mettre en avant, dans le projet de la nouvelle société, telle ou telle mesure qui les élimine. Ainsi, par exemple, la défense de l'idéologie du capitalisme d'État comme synonyme du socialisme, ou étape nécessaire vers le socialisme, s'accompagne généralement d'analyses qui voient la cause de la crise du capitalisme dans l'existence de "200 familles de milliardaires" ou bien dans les "multinationales".
Par la compréhension de la marche et des causes de la crise du capitalisme, le prolétariat renforce sa prise sur les moyens et le contenu de sa lutte historique.
C'est seulement dans le cadre d'une intervention révolutionnaire militante que peut et doit être menée l'activité d'analyse de la crise. Cependant, l'extraordinaire affaiblissement du mouvement révolutionnaire sous les coups de la contre-révolution triomphante pendant près d'un demi-siècle a fait que, depuis, les travaux d'analyse de la vie économique du capitalisme ont été particulièrement peu importants dans le courant révolutionnaire. Qui plus est, l'introduction dans les universités d'un marxisme émasculé pour être transformé en partie intégrante de la "science économique", a fait surgir des "économistes marxistes" qui ont embourbé les analyses révolutionnaires dans le plus stérile académisme universitaire.
Avec l'approfondissement de la crise actuelle et l'inévitable développement de la réflexion politique au sein de la classe ouvrière en lutte, la question de la compréhension des causes, de la marche et de l'issue de la crise devient pourtant de plus en plus une question concrète qui sera débattue, non pas dans des cercles de révolutionnaires initiés, ou dans les salles de cours des universités, mais dans les groupes de chômeurs, les assemblées d'usines, et tous les lieux où se forge au feu de la lutte la conscience révolutionnaire du prolétariat. C'est dans cette perspective, en vue d'être capables d'y être des facteurs actifs de clarté, que les révolutionnaires doivent s'attacher à analyser l'évolution économique du capitalisme.
L'AMPLEUR DE LA CRISE ACTUELLE
Trois récessions de plus en plus profondes de la croissance de la production mondiale en 10 ans ; 18 millions de chômeurs dans les seuls pays industrialisés du bloc occidental ; la quasi-totalité des pays sous-développés en banqueroute totale ; l'effondrement du système monétaire international ; quasi-stagnation de la croissance du commerce international ; développement ininterrompu du protectionnisme de la part de tous les pays ; la réalité de l'enfoncement du capitalisme mondial dans une nouvelle crise ouverte de surproduction est devenue aujourd'hui la préoccupation majeure de tous les gouvernements du monde, sans qu'ils parviennent pour autant à offrir d'autre issue qu'une nouvelle guerre mondiale.
C'est en 1967 que les premiers symptômes se font sentir de façon certaine : la croissance annuelle de la production mondiale tombe à son niveau le plus bas depuis 10 ans. Dans les pays de l'OCDE, le chômage et l'inflation connaissent des accélérations faibles, mais certaines. La croissance des investissements se ralentit sans discontinuité de 65 à 67. En 1967, il y a officiellement 7 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE, et le PNB croit de 3,5%. Ce sont des chiffres qui aujourd'hui semblent négligeables comparés au niveau atteint par la crise actuellement, mais ils n'en marquaient pas moins la fin de la prospérité d'après-guerre, comme on peut le voir dans les graphiques ci-après :
CROISSANCE DU VOLUME DE LA
PRODUCTION MONDIALE
(% par an)
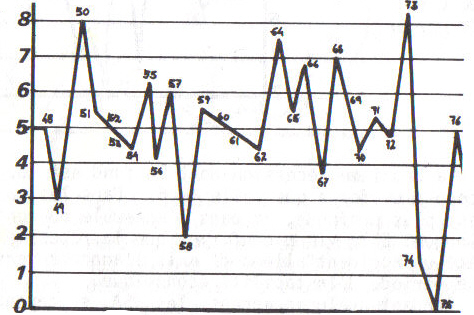
La courbe de la croissance de la production mondiale est une moyenne qui peut indiquer la tendance générale mais manque de précision. En réalité, elle suit avec quelques déformations celle des pays industrialisés du bloc occidental (OCDE). L'importance de la récession de 65-67 apparaît encore plus nettement dans l'évolution de la croissance des pays de l'OCDE :
CROISSANCE DU VOLUME DE LA
PRODUCTION DES PAYS DE L'OCDE
(% par an)
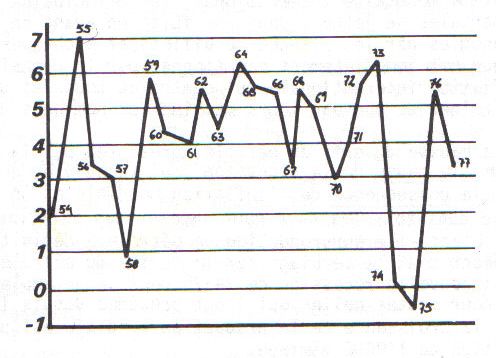
Dans les pays de l'Est, et d'après leurs chiffres mêmes, la fin des années 60 marque aussi un ralentissement définitif de la croissance de la production. La comparaison des graphiques permet par ailleurs de constater comment l'évolution de la production des pays dits "communistes" suit de façon de plus en plus proche celle des pays occidentaux.
CROISSANCE DU VOLUME DE LA
PRODUCTION DES PAYS DE L'EST
(% par an)
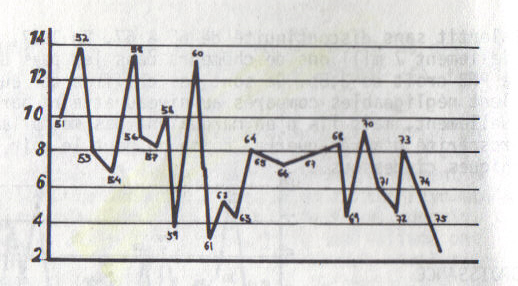
La deuxième récession, dont le fond est touché en 70, est beaucoup plus forte que celle de 67. Dans les pays de l'OCDE, elle est plus profonde, et dans l'ensemble du monde, elle est plus longue. Elle vient confirmer que la récession de 67 n'avait pas été un accident "allemand" mais l'annonce certaine d'une nouvelle période d'instabilité économique.
Pendant quelques années, les USA, soutenant l'effort militaire de la guerre au Viêt-nam, ont entretenu l'illusion d'une croissance mondiale. Avec leur désengagement progressif, la croissance retombe, en même temps que l'endettement américain apparaît dans toute son ampleur. Pour réduire leur endettement, et accroître artificiellement la compétitivité de leurs marchandises, les USA laissent "s'effondrer" le Dollar et avec lui le système monétaire international, les principales puissances occidentales se jettent dans une fuite en avant en relançant leurs économies par les planches à billets (et à chèques). Cette politique est immédiatement sanctionnée par le déchaînement d'une inflation internationale qui contraint tous les gouvernements à"freiner"de nouveau leurs machines économiques dès 73.
La hausse du prix du pétrole, présentée par la bourgeoisie comme la cause de la récession qui va suivre, ne fut en fait que la conséquence de l'inflation mondiale et un prétexte utilisé dans tous les pays pour imposer des politiques d'austérité. L'actuelle surproduction de pétrole a définitivement réduit à néant tout le verbiage sur la "crise du pétrole".
La nouvelle récession de 74-75 dépasse en ampleur et en profondeur toutes celles qui l'ont précédée depuis la guerre. En 75, la croissance de la production mondiale est nulle. La production de l'OCDE diminue.
La crise, qui jusqu'alors était surtout apparue sous sa forme superficielle de crise monétaire, apparaît dans toute sa réalité. En moins de deux ans, le nombre de chômeurs dans l'OCDE passe de moins de 10 millions à plus de 16 millions.
NOMBRE DE CHÔMEURS
(OCDE - en millions)
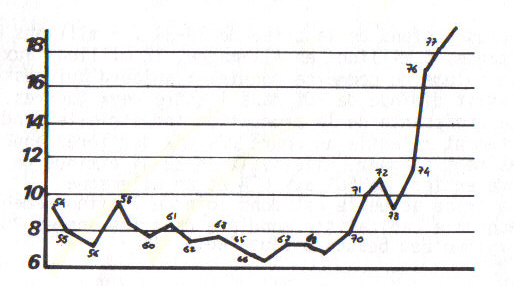
L'année 1976 a été chantée par la plupart des économistes et des gouvernements comme la fin du cauchemar. La croissance de la production semblait reprendre. Mais les résultats de l'année 77 puis ceux de 78 sont venus réduire en fumée tous ces espoirs. Le chômage n'a pour ainsi dire pas cessé de croître depuis 67 dans le monde entier, sans que plus aucun gouvernement ne se risque à parler de possible amélioration dans les années qui suivent, au contraire. Dans les grands pays industrialisés, le chômage atteint jusqu'à présent surtout les secteurs économiques les moins rentables et au sein de la classe ouvrière, les secteurs que le capital pouvait le plus facilement frapper: les femmes, les jeunes, les travailleurs noirs aux USA, les immigrés en Europe. Il attaque maintenant la totalité de la classe ouvrière.
Pendant dix années, les gouvernements du monde ont alterné régulièrement les "politiques de relance" et les "politiques de refroidissement" pour tenter de parer aux difficultés de leurs économies nationales. Le bilan peut être résumé par les résultats de ces fluctuations : alors que les politiques de relance sont de moins en moins capables de provoquer la reprise de la croissance de la production sans déclencher une inflation incontrôlable, les "refroidissements" se traduisent par des effondrements de la croissance chaque fois plus profonds
Depuis dix ans, la tendance générale de l'économie mondiale dessine sans ambiguïté :
- le ralentissement croissant de la production,
- l'augmentation continue du chômage,
- le ralentissement du commerce mondial et le développement du protectionnisme.
On peut mieux cerner l'ampleur et le rythme de la crise actuelle en la comparant aux données de la crise de 1929. Les chiffres "officiels" du chômage actuel (18 millions de chômeurs pour les pays de l'OCDE) sont encore loin des chiffres atteints au plus profond de la crise de 29 34 : 3 millions en Grande-Bretagne, 6 millions en Allemagne, 12 millions aux USA.
Le volume du commerce mondial a aujourd'hui cessé de croître, il avait diminué de 80% dans l'entre-deux guerres.
La croissance de la production industrielle mondiale s'est fortement ralentie au cours des dix dernières années jusqu'à quasiment stagner. Elle avait en 29-34 diminué de 38% pour le monde entier, de 50% aux USA et en Allemagne.
La crise actuelle est donc loin de l'effondrement connu par l'économie capitaliste mondiale dans les années 30, et son rythme est beaucoup plus lent.
Depuis 1929, les économies de tous les pays sont progressivement passées sous un contrôle direct plus important et plus omniprésent de leurs États. Depuis la 2ème Guerre Mondiale, ce contrôle étatique au niveau national s'est doublé au niveau international du contrôle des deux principales puissances impérialistes qui ont organisé le monde en deux blocs soumis à leur autorité. Cette "organisation" de la production capitaliste a permis pendant des décennies de maîtriser beaucoup mieux qu'en 29 les contradictions du système, et elle explique aujourd'hui la lenteur de la crise. Mais pallier aux effets des contradictions ne veut pas dire les résoudre. Le capitalisme n'a pu contrôler les effets de ses contradictions qu'en repoussant le jour de leur dénouement. Il ne les a pas résolues, il les a rendues plus explosives.
La crise actuelle, en mettant en évidence l'impuissance de l'organisation et des politiques économiques mises en place depuis les années 30 et la 2ème Guerre Mondiale, s'annonce plus grave et plus définitive que toutes les crises précédentes du capitalisme.
LES CAUSES DE LA CRISE
Il faut distinguer, premièrement, la cause fondamentale, la contradiction principale du capitalisme telle qu'elle existe depuis les premiers temps du capitalisme et ne devient une entrave définitive qu'à partir d'un certain degré de développement du système ; deuxièmement, la cause "immédiate" de la crise actuelle, c'est-à-dire la raison pour laquelle le capitalisme n'est plus parvenu depuis 10 ans à pallier à sa contradiction fondamentale.
La contradiction fondamentale du capitalisme
La théorie des crises du capitalisme a été un objet permanent du débat parmi les révolutionnaires depuis les analyses sur l'impérialisme dans la période de la 1ère Guerre Mondiale. On ne trouve pas chez Marx de théorie achevée de la crise, d'une part parce qu'il est mort avant d'avoir écrit les travaux sur le marché mondial dans lesquels il se proposait de traiter de façon systématique la question. D'autre part parce que les conditions historiques de l'époque où il a vécu rendaient plus difficile de percevoir tous les aspects de contradictions pas encore parvenues à un degré de développement définitivement critique. Cependant, ce problème traverse toute son oeuvre. Il revient à Rosa Luxemburg d'avoir systématisé la théorie ébauchée chez Marx, se servant des données fournies par le développement même du capitalisme, et en particulier de l'impérialisme. Rejetées par Lénine et Boukharine, les analyses théoriques de Rosa Luxemburg n'ont depuis cessé de nourrir le débat parmi les révolutionnaires. Ainsi, dans des groupes comme la Fraction de la Gauche Italienne pendant l'entre-deux guerres (Bilan), ou dans Internationalisme pendant la seconde guerre, la théorie de Rosa Luxemburg coexistait en débat au sein de la même organisation avec d'autres analyses (Lénine, Boukharine, Grossmann).
Ce débat, surtout au cours des dernières années, a eu tendance à se cristalliser autour de deux analyses principales : celle de Rosa Luxemburg et celle qui présente la baisse tendancielle du taux de profit exposée de façon complète, systématique, alors que la contradiction entre les lois qui régissent la sphère de la production et celles qui régissent celle de la consommation, empêchant les capitalistes de créer les débouchés nécessaires à l'expansion de leur production se trouve souvent éparse, du Manifeste Communiste au Livre III du Capital. Marx prévoyait un exposé systématique dans des travaux qu'il n'a jamais pu réaliser. Mais rien ne serait plus absurde que d'en déduire l'exclusivité de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit comme analyse marxiste des crises.
L'analyse de la contradiction fondamentale du capitalisme par Rosa Luxemburg -que nous partageons- n'est pas une "nouvelle" théorie par rapport à Marx, mais l'exposé systématique de l'analyse des crises dont Marx n'a pu tracer que les axes fondamentaux. C'est ainsi que l'on peut exposer "la théorie de Rosa Luxemburg'' des crises avec les formulations mêmes de Marx :
"Il suffit de rappeler les crises commerciales qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise. Dans ces crises, une grande partie, non seulement des produits déjà créés, mais encore des forces productives existantes est livrée à la destruction. Une épidémie sociale éclate qui, à toute autre époque, eut semblé absurde : l'épidémie de la surproduction. Brusquement, la société se voit rejetée dans un état de barbarie momentané ; on dirait qu'une famine, une guerre de destruction universelle, lui ont coupé les vivres ; l'industrie, le commerce, semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de vivres, trop d'industries, trop de commerce". (Marx, Manifeste Communiste).
Cette crise de surproduction "qui, à toute autre époque eut semblé absurde", trouve son origine fondamentale, d'après Marx (comme d'après Rosa Luxemburg) dans une trop grande production par rapport non pas aux besoins réels des hommes (ceux-ci sont en faits jetés dans une plus grande misère par la crise), mais par rapport au pouvoir d'achat des masses :
"Il n'est pas produit trop de richesses. Mais périodiquement, il est produit trop de richesses dans les formes antagoniques du capital". (Marx, Le Capital, Livre III, Sème Section, p.104, Ed. La Pléiade).
Ces "formes antagoniques du capital" sont celles qui opposent d'une part la production capitaliste poussée par la concurrence à s'élargir toujours plus sous peine de mort, comme si elle n'avait d'autre limite que les besoins de consommation absolus des hommes, et d'autre part le fait que le capital ne peut distribuer dans la société le revenu, le pouvoir d'achat nécessaire pour l'acheter dans sa totalité.
Les capitalistes et les ouvriers ont un pouvoir de consommation solvable qui constitue un marché pour une partie de la production : il équivaut à la masse des salaires versés aux ouvriers plus la part du profit destinée à la consommation personnelle des capitalistes. Mais reste la partie du profit destinée à être réinvestie dans la production : cette partie ne peut trouver d'acheteurs au sein des rapports capitalistes. Elle doit être vendue "à l'extérieur", aux secteurs non capitalistes (artisans, paysans, pays où dominent des formes de production archaïques). Lorsque ces marchés "extérieurs" font défaut, la crise apparaît, mettant en évidence le décalage entre le besoin d'expansion de la production et l'incapacité de la masse des travailleurs de s'en rendre acquéreurs :
"Le pouvoir de consommation des travailleurs est limité en partie par les lois du salaire, en partie par le fait qu'ils ne sont employés qu'aussi longtemps que leur travail est profitable pour la classe capitaliste. La raison ultime de toutes les crises réelles c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n'avaient pour limite que le pouvoir de consommation absolue de la société." (p. 1206, idem, souligne par nous)
Le capitaliste ne peut pas résoudre cette contradiction en augmentant les salaires, car il ne ferait qu'augmenter les coûts de production et donc baisser la compétitivité de ses marchandises sur le marché. Il ne peut pas plus augmenter la consommation personnelle des capitalistes, car il ne ferait alors que réduire la part du profit destinée à l'investissement et à élargir l'accumulation de son capital.
C'est pourquoi, à la recherche de débouchés nouveaux et toujours plus larges, il est contraint de vendre aux secteurs non capitalistes. Historiquement, le capitalisme a trouvé les débouchés nécessaires à son expansion d'abord chez les paysans et artisans des pays capitalistes, enfin dans les pays où dominaient des formes de production pré-capitalistes, pays qu'il a colonisés et dans lesquels il a instauré des rapports de production capitalistes.
"Poussée par les besoins de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe ; partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir, partout elle établit des relations (...). Le plus bas prix de ses marchandises est ta grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares les plus xénophobes. Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, d'adopter le mode de production bourgeois ; elle les contraint d'importer chez elle ce qu' elle appelle la civilisation, autrement dit : elle en fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image:' (souligné par nous) (Marx, Le Manifeste Communiste)
Le capitalisme compense donc son incapacité à créer ses propres débouchés et la misère qu'il crée pour ses exploités directs, en étendant son marché au monde entier, en créant le marché mondial. Mais, au fur et à mesure qu'il étend son mode de production, il réduit d'autant les débouchés dont il a besoin pour vivre.
"(Les crises) gagnent en fréquence et en violence. C'est que la masse des produits et donc le besoin de débouchés s'accroît, alors que le marché mondial se rétrécit ; c est que chaque crise soumet au monde commercial un marché non encore conquis ou peu exploité et restreint ainsi les débouchés". (Marx, Travail salarié et capital, -Ed. la Pléiade, p. 228).
Telle est la "raison ultime de toutes les crises réelles" d'après Marx. Poursuivant cette analyse, Rosa Luxemburg montra comment l'impérialisme se développe à la fin du 19ème siècle et aboutit à la première guerre mondiale:
"La deuxième étape du processus historique d'expansion du capitalisme : la période de la concurrence mondiale accentuée et généralisée des États capitalistes autour des derniers restes de territoire non capitalistes du globe". (Rosa Luxemburg, Critique des Critiques, Ed. Maspero, p.229)
La loi de la baisse tendancielle du taux de profit, découverte par Marx, traduit la contradiction entre le fait que le capitalisme ne peut extraire son profit que du travail de l'ouvrier, du travail "vivant", alors qu'avec le développement du capitalisme, la part de ce travail dans la production diminue systématiquement au profit de celle du "travail mort", les machines et matières premières. Cette contradiction est une réalité fondamentale du capitalisme et, contrairement à ce qu'ont pu prétendre certains défenseurs de l'idée qu'elle était la seule théorie marxiste des crises, elle n'est ni contradictoire avec la théorie de la saturation des marchés, ni la "raison ultime de toutes les crises".
Elle n'est pas contradictoire avec la théorie de l'incapacité du capitalisme de créer ses propres marchés parce que :
- d'une part, c'est la concurrence entre capitalistes pour des marchés qui contraint en permanence le capital à accroître sa productivité, donc la composition organique du capital, c'est à dire la part de travail mort (capital constant) par rapport à celle du travail vivant (capital variable).
- d'autre part, c'est par l'extension de l'échelle de la production et donc par la conquête de nouveaux débouchés que les capitalistes 1) compensent la baisse du taux de profit par la masse du profit 2) contrecarrent cette baisse par l'accroissement de l'exploitation que permet une extraction plus puissante de plus-value relative (l'extension de l'échelle de la production permet une diminution des coûts de production des biens nécessaires à la subsistance de l'ouvrier et donc de la valeur réelle de son salaire).
La loi de la baisse tendancielle du taux de profit n'est pas non plus la "raison ultime de toutes les crises" par le fait même qu'elle peut être contrecarrée et compensée du moment que le capital peut trouver des débouchés nouveaux pour son expansion. En dernière instance, c'est parce que le capital ne trouve plus de débouchés suffisants que la baisse tendancielle du taux de profit devient baisse effective. La saturation des marchés est la raison ultime des baisses réelles du taux de profit et non l'inverse. Dans la réalité concrète de l'histoire du capitalisme, la lutte pour le maintien du taux de profit se traduit par la lutte pour des marchés nouveaux.
Les causes immédiates de la crise actuelle
Pour comprendre pourquoi depuis 10 ans, le capitalisme mondial se trouve de nouveau confronté avec sa contradiction fondamentale au point de plonger dans une nouvelle crise ouverte de surproduction, alors qu'il était parvenu depuis la guerre à s'assurer une prospérité relativement stable, il est nécessaire de replacer cette crise dans son cadre historique, celui de la décadence du capitalisme. La première guerre mondiale mit en évidence que le développement atteint par le capitalisme au début du siècle était devenu définitivement trop important par rapport aux capacités d'absorption du marché mondial. La planète entière achevait d'être partagée entre les principales puissances capitalistes. Les nouveaux venus sur le marché mondial, l'Allemagne ou le Japon, par exemple, ne pouvaient plus se développer sans mettre en question le partage existant et cette remise en question ne pouvait être faite que par le moyen de la guerre.
"Pour la première fois, le monde se trouve partagé entièrement, si bien qu'à l'avenir il pourra UNIQUEMENT être question de nouveaux partages, c'est à dire du passage d'un "possesseur" à un autre, et non de la "prise de possession" de territoires sans maître" (Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, Ed. de Moscou 1971, p. 716)
Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait plus, à cette époque, un seul secteur non capitaliste dans le monde. En 1914, comme encore aujourd'hui, il restait dans le monde non seulement des pays où les secteurs archaïques pré-capitalistes existant étaient devenus trop restreints par rapport à l'ampleur atteinte par les besoins d'expansion du capitalisme mondial. Il n'y avait pas assez de marchés par rapport au nombre de puissances capitalistes et à leur développement, ou, dit d'une autre façon, il y avait trop de puissances trop développées par rapport aux marchés existants.
La guerre de type impérialiste et mondiale, qui, contrairement à la plupart des guerres du passé ne se déroule plus uniquement dans des zones peu explorées, mais étend son champ de bataille aux centres industriels et à la population civile, a deux vertus pour résoudre momentanément la crise du capitalisme : d'une part, elle élimine les pays capitalistes détruits de la compétition mondiale pour les marchés ; d'autre part, elle transforme momentanément les pays détruits en marchés pour les marchandises des vainqueurs qui contribuent à leur reconstruction.
C'est ainsi que depuis 1914, le capitalisme en déclin vit suivant un cycle de crises, guerre, reconstruction. C'est dans ce cycle de barbarie permanente et généralisée que nous devons replacer la crise actuelle.
- 1914 1918 : première guerre mondiale. Durée, 4 ans, 24 millions de morts.
- 1919-1929 : reconstruction. Les USA deviennent la première puissance mondiale aux dépens des pays européens qu'ils aident à reconstruire, tout en s'emparant progressivement de leurs empires coloniaux sous le drapeau du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes".
- 1929-1938 : fin de la reconstruction. Crise économique sans précédent dans l'histoire du capitalisme. A partir de 34-35, le renforcement de 'État sous la pression de la décadence du capitalisme, la tendance au capitalisme d'État (stalinisme en Russie, fascisme en Italie et en Allemagne, New Deal aux USA, Front Populaire en France) permet des politiques de création de marchés artificiels par l'augmentation des commandes de l'État ("grands travaux", mais surtout armement intensif). Le chômage est quelque peu résorbé, mais dès 38, une nouvelle crise économique mondiale commence à éclater. En 1939, Hitler déclare la seconde guerre mondiale au cri de "L'Allemagne doit exporter ou périr !".
- 1939-45 : seconde Guerre Mondiale. Durée : 6 ans. 50 millions de morts. A l'exception de ceux des USA, presque tous les grands centres industriels du monde sont touchés.
- 1945-67 : reconstruction. Le monde est organisé en deux blocs hégémoniques. La guerre entre les deux puissances dominantes devient permanente au travers des conflits locaux dans les pays sous-développés sous les couleurs des "luttes de libération nationale".
Les années 65-67 marquent globalement pour le bloc occidental la fin de la reconstruction qui a suivi la seconde guerre mondiale. L'achèvement des périodes de reconstruction n'est pas caractérisé par le fait que les pays détruits atteignent des volumes de production analogues à ceux qu'ils réalisaient avant la guerre. Cet achèvement est plutôt marqué par le fait que l'ensemble des pays détruits sont devenus de nouveau des puissances concurrentes sur le marché mondial c'est à dire qu'ils ont atteint un degré de développement tel qu'ils peuvent et doivent exporter plus de marchandises qu'ils n'en importent.
A ce stade, non seulement ils cessent de constituer eux-mêmes un marché pour les pays "reconstructeurs", mais en outre, ils entrent inévitablement en concurrence avec eux pour les marchés existants. Ce stade fut globalement atteint autour de 1965-67 pour le bloc occidental. C'est ce que montre l'évolution des taux de couverture des balances commerciales (pourcentage des exportations sur les importations) du Japon et de la CEE (Communauté économique européenne, "les six"). Dans le graphique ci-dessous, sont représentées les évolutions de ces taux de couverture depuis 1948 :
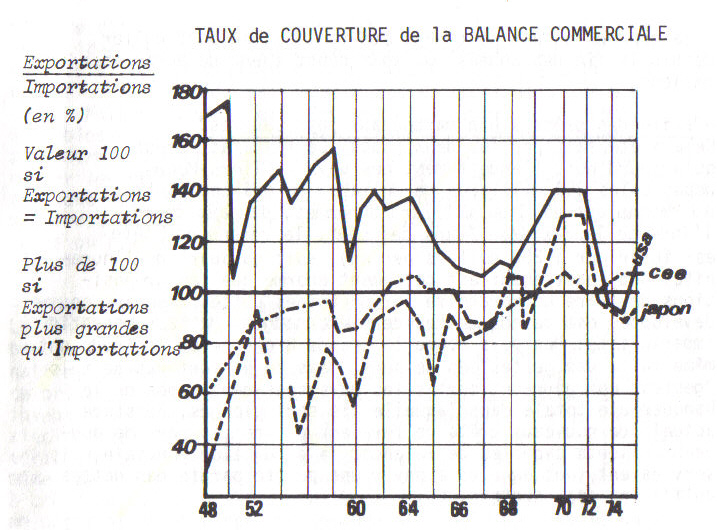
On a représenté sur le même graphique le taux de couverture de la balance commerciale des USA afin de mieux illustrer le processus antagonique de la reconstruction.
Comme on le voit, en 1948 lorsque la reconstruction de l'Europe et du Japon bat son plein, les exportations des USA sont presque deux fois plus grandes que leurs importations, alors que les exportations japonaises ne couvrent que 40% de ses importations, et celles de l'ensemble des 6 pays de la CEE les couvrent de 60%. Vingt ans plus tard, la balance commerciale américaine se dégrade jusqu'à devenir négative, alors que l'Europe et le Japon deviennent exportateurs. Telle est la cause immédiate principale de la crise actuelle du capitalisme. La reconstruction, après l'holocauste de la 2ème guerre mondiale, ce palliatif auquel le capitalisme décadent a recours pour compenser l'insuffisance définitive des marchés extra-capitalistes, est achevée.
LES PERSPECTIVES DE LA CRISE
Il est difficile de prévoir exactement le rythme auquel continuera de se développer la crise. On peut cependant constater que la plupart des mesures proposées aujourd'hui, ici et là, par les économistes et les politiciens pour trouver ou créer artificiellement de nouveaux débouchés à la production ont soit déjà été tentées, en particulier depuis la fin des années 60, soit constituent de pures aberrations.
- "Faire des prêts à bon marché aux pays pauvres" :
Cela a été ait par les deux blocs. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'endettement des pays du Tiers-Monde dépasse les 250 milliards de dollars, ce qui équivaut au revenu annuel d'un milliard d'hommes, de pays comme l'Inde ou le Pakistan (dans ces pays, le revenu par tête est inférieur à 250 dollars par an), soit du quart de l'humanité. Cet endettement est tellement énorme que les propositions de faire un moratoire sur certaines dettes des pays sous-développés est devenu un des derniers gadgets de la démocratie impérialiste. Des pays comme la Grande-Bretagne ou la Suède ont même fait "des gestes" en ce sens, mais ce ne sont pas de tels "gestes" qui pourront sortir les pays sous-développés de la banqueroute totale dans laquelle ils sont plongés. Au stade actuel, de nouveaux prêts ne feraient pas de ces pays de nouveaux clients capables de relancer la production mondiale. Ils serviraient tout au plus à payer une petite partie des dettes qu'ils ont déjà contractées.
- "Augmenter les crédits entre pays développés afin de faciliter de nouveaux échanges"˚:
C'est en grande partie ce qui a été fait depuis le milieu des années 60, organisé à l'échelle des blocs. Les fameux "droits de tirage spéciaux" du FMI (Fonds Monétaire International) constituent des crédits gigantesques que les pays occidentaux se font entre eux sous la direction du chef du gang occidental, les USA. Les dettes d'un pays sont épongées par des promesses de paiement des autres pays, elles-mêmes couvertes par d'autres dettes contractées internationalement. On paie des dettes avec des dettes sur d'autres dettes. Depuis 1965, l'endettement international a progressé en spirale au point que la vie capitaliste actuelle repose sur un immense tas de papier, de reconnaissance de dettes, l'essentiel étant sous la forme de dollars. De nouveaux crédits, c'est-à-dire de nouveaux endettements, peuvent difficilement relancer une économie qui croule déjà sous les dettes.
-"Développer les relations commerciales entre les deux blocs"
Cela aussi a Été tenté. Depuis le développement de la coexistence pacifique par les pays de l'Est et les politiques d'ouverture à l'Est des pays occidentaux, les échanges entre les deux blocs ont progressivement augmenté. Mais non seulement ces échanges sont restés somme toute très restreints, ils ont en outre déjà abouti à un développement trop élevé des dettes des pays de l'Est. La dette de ceux-ci à l'égard de l'occident s'élève déjà à 40 milliards de dollars. En 1977, ces pays ont dû décider de réduire leurs achats pour réduire leur déficit commercial de 7,5 milliards de dollars en 1976 à 5 milliards en 1977. La crise n'a pas relancé ces échanges mais les a réduits. Mais si toutes les solutions pour créer des marchés solvables au niveau international échouent lamentablement, peut-être y a-t-il des solutions "nationales" telles qu'augmenter les dépenses publiques de l'État ou bien, comme le préconisent les nouveaux "sous-consorrnnationnistes", augmenter les salaires. Ces solutions n'ont pas plus de chance d'être efficaces ou réalisables que celles envisagées au niveau international.
- "Augmenter les dépenses publiques"˚:
Le fondement de l'apport de Keynes à l'économie politique bourgeoise peut se résumer au fait d'avoir accepté de reconnaître, en plein marasme de la crise de 1929, l'ineptie de ce principe religieux de la science économique bourgeoise, inventé par l'économiste français Jean-Baptiste Say au 19ème siècle, suivant lequel le capitalisme ne peut pas connaître de véritable crise de marchés puisque "toute production est en même temps une demande". La solution keynésienne consisterait à créer une demande artificielle par l'États. Si le capital ne parvient pas à créer une demande nationale suffisante pour absorber la production, et si en outre, les marchés internationaux sont saturés, Keynes préconise que l'État se fasse acheteur des masses de produits qu'il paiera avec de la monnaie de singe émise par lui. Comme tout le monde a besoin de cet argent, personne ne protestera sur le fait qu'il ne représente que du papier. Les politiques des grands travaux d'abord, celles de production massive d'armements ensuite, permirent après 1929 de sortir de la crise pour aller ...à la deuxième guerre mondiale. Au lendemain de la guerre, c'est au niveau du bloc occidental que les principes keynésiens sont appliqués. Au début des années 70, leur utilisation est encore renforcée. En ce sens, l'actuelle crise n'est pas la manifestation d'un besoin de politique keynésienne, mais au contraire de leur épuisement.
- "Augmenter les salaires"˚:
C'est la "solution" que se plaisent à préconiser certains partis qui se trouvent actuellement dans l'opposition. Mais cela est impossible dans un monde capitaliste, et ces partis le savent bien qui, une fois au gouvernement, s'empressent d'appliquer la politique contraire. Toutes conditions égales par ailleurs, un pays qui paye ses ouvriers plus cher est automatiquement moins compétitif au niveau du marché mondial. Rêver d'un capitalisme qui se porte d'autant mieux qu'il augmente d'autant plus les salaires de ses exploités est aussi absurde que de rêver d'un capitalisme sans exploitation. La réalité est éloquente à ce sujet : face à la crise, aucun pays n'a même envisagé d'augmenter les salaires. Au contraire, c'est l'austérité qui est la règle générale.
Le capitalisme n'a plus de politique économique à offrir autre que la guerre. Toute la récente évolution de la situation internationale vérifie qu'il en est ainsi. Du point de vue de l'évolution de la crise, nous sommes plus proches de la situation de 1938 que de celle de 1929. La différence avec les années 30 réside actuellement essentiellement en deux points majeurs :
1) l'organisation au niveau national et international du capitalisme lui permet d'atténuer relativement la chute dans la crise par la capacité que le totalitarisme de sa domination lui donne de "détourner" partiellement et momentanément les propres lois capitalistes ;
2) la classe ouvrière n'est ni défaite ni encadrée pour marcher vers une nouvelle guerre mondiale. De ce fait, non seulement elle retarde la marche vers l'holocauste mais elle impose "tacitement" des limites à une dégradation de la situation économique qui risquerait de la jeter dans le combat révolutionnaire. Cependant, ce rôle de frein, la classe ouvrière ne peut le jouer de façon "tacite" longtemps. Le capitalisme ne peut retarder ses échéances qu'en les rendant plus explosives. En s'effondrant, le capitalisme fait du prolétariat, chaque jour plus, le détenteur de l'initiative historique, mais si le prolétariat ne parvient pas à dépasser le stade d'une résistance passive, "menaçante", le capitalisme imposera dans le sang sa propre solution.
Depuis la première guerre mondiale, le capitalisme décadent a survécu par une série de politiques dont le caractère commun est de constituer toujours des moyens pour biaiser avec ses propres lois économiques qui se sont transformées en entraves à son propre développement. La loi de l'échange marchand, cette loi que le capitalisme a héritée du passé et qu'il a eu pour mission historique de généraliser aussi bien à tous les domaines de la vie sociale (en particulier, à celui de la force de travail qu'il a transformée en marchandise) qu'à la planète entière unifiée en un seul marché mondial, cette loi s'est transformée avec l'énorme développement de la productivité du travail, en un anachronisme pour l'humanité et une condamnation à mort de son dernier et plus puissant défenseur. L'actuel effondrement du capitalisme en marquant l'échec des dernières tentatives du capitalisme pour maintenir en vie cette loi tout en la détournant en permanence, constitue un appel de l'histoire à la seule force capable d'exécuter la sentence: le prolétariat mondial.
L'INTERVENTION DES RÉVOLUTIONNAIRES
Quelle que soit la vitesse avec laquelle la crise se développera, elle est dès à présent la préoccupation principale de toute la société et en premier lieu de la classe ouvrière. L'intervention des révolutionnaires dans leur classe doit avoir pour objectif principal de mettre en évidence comment ce nouvel effondrement de l'économie capitaliste, en même temps qu'il met plus en évidence que jamais la NÉCESSITÉ HISTORIQUE de la révolution communiste mondiale, crée la POSSIBILITÉ de sa réalisation.
Pour cela, ils doivent démontrer en termes clairs
- que la crise actuelle n'est pas un "accident" dans la vie du capitalisme, mais la manifestation de contradictions objectives, insurmontables du système de production marchand généralisé à la planète entière;
- que la seule issue que le capitalisme peut offrir à sa crise actuelle est, comme en 1914, comme en 1939, une nouvelle guerre mondiale, qui cette fois-ci menace la survie même de l'humanité;
- que les solutions proposées par les "partis ouvriers" de la bourgeoisie tels : "gagner moins pour résorber le chômage" ne sont qu'un leurre : même si les travailleurs acceptaient aujourd'hui de travailler gratuitement, le capitalisme ne parviendrait pas à surmonter sa crise;
- que la démagogie "sous-consommationniste" de certains partis d'opposition parlant d'augmentation de salaires pour relancer la demande ne sont que la préparation à de nouvelles politiques d'austérité qu'ils se chargent eux-mêmes d'imposer une fois au gouvernement;
- que la crise économique est une réalité INTERNATIONALE qui ne peut donc trouver sa solution ailleurs que sur le terrain international;
- que le seul moyen d'empêcher la marche capitaliste à une troisième boucherie impérialiste mondiale, c'est la destruction du capitalisme mondial et l'instauration d'une nouvelle société, sans production marchande ni salariat, sans frontières ni États, où le seul objectif de l'activité productive soit la satisfaction des besoins humains: la SOCIÉTÉ COMMUNISTE;
- que la seule force capable de mener à bien cette tâche, c'est la CLASSE OUVRIÈRE MONDIALE;
- enfin, que la classe ouvrière doit voir dans la misère que l'actuelle crise généralise aux travailleurs de toute la planète sans exception, non pas un simple sujet de lamentations impuissantes, mais comme le seul et puissant facteur d'unification de l'armée révolutionnaire mondiale.
C.C.I. Texte préparatoire à la III Conférence Internationale
des groupes de 1a gauche communiste (Novembre 78)
Questions théoriques:
- Décadence [3]
Heritage de la Gauche Communiste:
La Décadence du Capitalisme - Introduction
- 3726 reads
Pour savoir si la révolution socialiste est possible et nécessaire aujourd'hui, pour définir les bases historiques du programme et de la stratégie du prolétariat dans l'époque actuelle, nous devons poser la question de la décadence du capitalisme.
Les problèmes du contenu du socialisme, de la nature des syndicats, des politiques de frontisme, de la nature des luttes de libération nationales, sont étroitement liés à l'analyse de la décadence du capitalisme.
LA THÉORIE DE LA DÉCADENCE DANS L'HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER
Ce n'est pas parce que l'immense majorité des hommes sont exploités et donc aliénés que le socialisme est une nécessité historique aujourd'hui. L'exploitation et l'aliénation existaient déjà dans l'esclavagisme, le féodalisme et le capitalisme du XIXème siècle, mais le socialisme ne pouvait être réalisé à aucune de ces époques.
Pour que le socialisme devienne une réalité, il faut non seulement que les moyens de son instauration (la classe ouvrière et les moyens de production) soient suffisamment développés, mais il faut aussi que le système qu'il est appelé à remplacer - le capitalisme - ait cessé d'être un système indispensable au développement des forces productives, qu'il soit devenu une entrave grandissante à ce développement, c'est-à-dire, qu'il soit entré dans sa période de déclin ou de décadence.
Les socialistes du début du XIXème siècle voyaient le socialisme comme un idéal à atteindre, et sa réalisation devait être le résultat de la simple bonne volonté des hommes pour ce qui est des socialistes utopiques, de la bonne volonté de la classe dominante elle-même. Le grand apport de Marx et Engels fut leur compréhension et leur élaboration scientifique de la nécessité matérielle de la disparition du capitalisme et de la réalisation du communisme. Ce n'est pas par hasard que Marx, voulant résumer l'essence de son travail dans un court passage, a donné un condensé de la croissance et de la décadence historiques des divers modes de production sociale à travers lesquels l'humanité s'est développée :
"Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale. Le changement dans les fondations économiques s'accompagne d'un bouleversement plus ou moins rapide dans tout cet énorme édifice. Quand on considère ces bouleversements, il faut toujours distinguer deux ordres de choses. Il y a le bouleversement matériel des conditions de production économique. On doit le constater dans l'esprit de rigueur des sciences naturelles. Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout. On ne juge pas un individu sur l'idée qu'il a de lui-même. On ne juge pas une époque de révolution d'après la conscience qu'elle a d'elle-même. Cette conscience s'expliquera plutôt par les contrariétés de la vie matérielle, par le conflit qui oppose les forces productives sociales et les rapports de production. Jamais une société n'expire, avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir; jamais des rapports supérieurs de production ne se mettent en place, avant que les conditions matérielles de leur existence ne soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se propose jamais que les tâches qu'elle peut remplir: à mieux considérer les choses, on verra toujours que la tâche surgit là où les conditions matérielles de sa réalisation sont déjà formées, ou sont en voie de se créer. Réduits à leurs grandes lignes, les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne apparaissent comme des époques progressives de la formation économique de la société".
(K. Marx : "Avant-propos à la critique de l'économie politique", Coll. La Pléiade, Oeuvres, t. 1, p.272-274)
La méthode d'investigation adoptée dans ce passage reste indispensable pour comprendre comment les différentes sociétés surgissent et dépérissent. La conception selon laquelle un mode de production ne peut expirer avant que les rapports de production sur lesquels est basé ce système social soient devenus des entraves au développement des forces productives, est la base de l'élaboration du programme politique prolétarien. Marx, et Engels exprimaient très clairement que la perspective de la révolution communiste dépendait de l'évolution matérielle, historique, globale du capitalisme lui-même.
La délimitation actuelle de l"'époque de révolution sociale" dans le développement du capitalisme était moins claire pour Marx, surtout dans ses premiers écrits ; et ce manque de clarté est lui-même un produit objectif du fait que la méthode du matérialisme historique a surgi bien avant l'éclosion de cette époque.
Marx a lancé son premier appel à la révolution prolétarienne non pas dans la période de déclin du capitalisme, mais dans sa période d'ascension la plus spectaculaire. L'imminence de la révolution prolétarienne que proclamait le Manifeste Communiste était contredite par la croissance continuelle des rapports sociaux capitalistes et leur extension à la planète toute entière. Il est certain que Marx avait tort d'affirmer à cette époque que les rapports sociaux capitalistes étaient entrés en conflit mortel avec les forces productives. Bien que le conflit entre eux ait toujours été une caractéristique du capitalisme, le conflit n'était jamais irrémédiable au XIXème siècle parce qu'il restait au capitalisme de vastes zones du globe pour étendre sa reproduction sans cesse élargie, pour compenser la tendance à la saturation des marchés et à la baisse du taux de profit.
Toutefois, malgré ces erreurs, Marx et Engels étaient encore en mesure de reconnaître, comme base à leur programme, que le capitalisme était encore un système progressif. Leur vision, déjà ébauchée dans Le Manifeste Communiste et approfondie partout ailleurs, selon laquelle le prolétariat venant au pouvoir dans cette période aurait comme principale tâche de développer le capitalisme de la façon la plus progressive possible, et non simplement de le détruire, était une expression de cette analyse (malheureusement, ce qu'exprimait alors la justesse de la vision de Marx a été utilisé comme une confusion réactionnaire dans la période de décadence par ceux qui invoquent les mesures prônées dans le Manifeste comme si elles étaient adaptées à l'époque actuelle). Et surtout, la pratique des marxistes de la 1ère internationale était avec raison basée sur l'analyse selon laquelle, tant que le capitalisme avait encore un rôle progressif à jouer, il était nécessaire au mouvement ouvrier de soutenir les mouvements bourgeois qui préparaient le terrain historique du socialisme (luttes de libération nationale, etc.).
De même, il était nécessaire que les ouvriers continuent à se battre pour des réformes tant que le développement du capitalisme les rendait possibles. Ces positions matérialistes étaient défendues contre les appels a-historiques des anarchistes à une abolition immédiate du capitalisme et leur opposition complète à des réformes; (ces dernières positions, apparemment ultra-révolutionnaires, sont en fait l'expression du désir petit-bourgeois d"'abolir" le capitalisme et le travail salarié, non pas en avançant vers leur dépassement historique, mais en régressant au monde des petits producteurs indépendants).
La IIème Internationale a rendu encore plus explicite cette adaptation stratégique à la période, en adoptant un "programme minimum" de réformes immédiates (reconnaissance des syndicats, diminution de la journée de travail, etc.), en même temps qu'un "programme maximum", le socialisme, à mettre en pratique le jour où l'inévitable crise historique du capitalisme surviendrait.
Mais pour la majorité des principaux tacticiens et des leaders officiels de la seconde Internationale, le programme minimum devait devenir de plus en plus le seul programme réel de la Social-Démocratie. Selon les mots de Bernstein : "Le but final, quel qu'il soit, n'est rien. Le mouvement est tout".
Le Socialisme, la révolution prolétarienne se réduisirent à des platitudes rabâchées comme des sermons lors des parades des jours de premier mai, tandis que l'énergie du mouvement officiel était de plus en plus concentrée sur l'obtention pour la Social-Démocratie d'une place à l'intérieur du système capitaliste, quel qu'en fût le prix. Inévitablement, l'aile "opportuniste" de la Social-Démocratie commença à rejeter l'idée même de la nécessité de destruction du capitalisme et de révolution sociale, pour défendre l'idée de la possibilité d'une transformation lente, graduelle, du capitalisme au socialisme.
Ces idéologies sont apparues au moment où le système capitaliste vivait la dernière phase de son ascension, où l'expansion impérialiste commençait à révéler son aspect de dernière carte dans le jeu du capitalisme mondial, et où la lutte de classe se faisait de plus en plus dure (grèves de masse en Amérique, en Allemagne, et surtout, en Russie). Contre l'opportunisme de Bernstein et Cie, la Gauche de la Social-Démocratie, les Bolcheviks, le groupe des tribunistes hollandais, Rosa Luxemburg et d'autres révolutionnaires défendaient la position marxiste fondamentale de la nécessité d'une destruction violente et définitive du capitalisme. La plus claire expression de cette défense du marxisme fut "Réforme ou Révolution" de Rosa Luxemburg (1899) qui, tout en reconnaissant que le capitalisme était encre en expansion grâce à de "brusques sursauts expansionnistes" (c'est-à-dire à l'impérialisme) insistait sur le fait que le capitalisme allait de façon inévitable à la saturation du marché mondial qui entraînerait sa "crise de sénilité" et amènerait la nécessité immédiate de la prise de pouvoir révolutionnaire du prolétariat. En 1913, Rosa Luxemburg publia son grand ouvrage théorique "L'accumulation du capital" qui tentait d'analyser les véritables fondements économiques de cette crise historique dont la conséquence allait bientôt apparaître clairement à l'humanité sous la forme de la première guerre mondiale.
La conclusion de cette analyse est que le déclin historique du capitalisme commence lorsqu'il y a une relative saturation des marchés pré-capitalistes, puisque le capitalisme est " le premier mode de production qui est incapable d'exister par lui-même, qui a besoin d'autres systèmes économiques pour lui servir de médiation et de sol nourricier. Bien qu'il tende à devenir universel, et donc à cause de cette tendance, il doit être brisé, parce qu'il est par essence incapable de devenir une forme de production universelle." (Rosa Luxemburg, L'Accumulation du capital)
Cette conclusion reste la plus claire analyse des origines fondamentales de la décadence du capitalisme qui ait été faite jusqu'à nos jours, et sur laquelle se sont appuyées les différentes élaborations théoriques que le mouvement ouvrier a pu faire surgir avec l'expérience de soixante années de décadence.
L'explosion de la guerre impérialiste en 1914 marque un tournant décisif aussi bien dans l'histoire du capitalisme que dans celle du mouvement ouvrier. Le problème de la "crise de sénilité" n'était plus un débat théorique entre différentes fractions du mouvement ouvrier. La compréhension du fait que la guerre ouvrait une nouvelle période pour le capitalisme, en tant que système historique, exigeait un changement dans la pratique politique dont les fondements devinrent une frontière de classe : d'un côté les opportunistes et les centristes, qui montrèrent clairement leur visage d'agents du capitalisme en "ajournant" la révolution par l'appel à la "défense nationale" dans une guerre impérialiste. De l'autre, la gauche révolutionnaire - les bolcheviks autour de Lénine, le groupe "Internationale", les radicaux de gauche de Brême, les tribunistes hollandais, etc. - qui se réunirent à Zimmerwald et Kienthal et affirmèrent que la guerre marquait l'ouverture de l'ère de "guerres et de révolutions" annoncée par Marx, et que la seule alternative à la barbarie capitaliste était le soulèvement révolutionnaire du prolétariat contre la guerre impérialiste.
De tous les révolutionnaires qui assistèrent à ces Conférences, les plus clairs sur la question de la guerre furent les Bolcheviks qui, avec la gauche radicale allemande, mirent en avant le mot d'ordre "transformer la guerre impérialiste en guerre civile", définissant clairement la position révolutionnaire sur la guerre face à celles des différentes sectes pacifistes. Lorsque la situation révolutionnaire mûrit en Russie, la compréhension qu'avaient les bolcheviks des tâches qu'imposait la nouvelle période leur permit de lutter contre les conceptions mécanistes et nationalistes des Mencheviks. Lorsque ces derniers tentèrent de minimiser l'importance de la vague révolutionnaire sous prétexte du trop grand "sous-développement de la Russie pour le socialisme", les Bolcheviks affirmèrent que le caractère mondial de la guerre impérialiste révélait que le capitalisme mondial était arrivé au stade de maturation nécessaire à la révolution socialiste. En conséquence, ils luttaient pour la prise du pouvoir de la classe ouvrière, considérant cette tâche comme un prélude à la révolution prolétarienne mondiale.
Pour défendre les intérêts de la révolution mondiale, les Bolcheviks contribuèrent activement à la fondation de l'Internationale communiste en 1919. Les partis révolutionnaires qui se rallièrent autour de la IIIè Internationale étaient tout à fait conscients de l'importance cruciale d'une définition de la période historique pour l'élaboration du Programme Communiste :
"Buts et tactiques"
"1- L'époque actuelle est l'époque de la désintégration et de l'effondrement du système capitaliste mondial tout entier, qui entraînera dans sa chute toute la civilisation européenne si le capitalisme n'est pas détruit, et avec lui, toues ses contradictions insolubles."
"2.- La tâche qui s'impose au prolétariat aujourd'hui est la prise du pouvoir d'État immédiate. La prise du pouvoir d'État signifie la destruction de l'appareil d'État de la bourgeoisie et l'organisation d'un nouvel appareil de domination prolétarien." (Extrait de l'Invitation au premier Congrès de l'Internationale Communiste, 24/1/19)
Les résolutions du Premier Congrès de l'Internationale communiste témoignent d'une clarté et d'une confiance absolues au sujet des tâches révolutionnaires du prolétariat. Tout l'accent était mis sur la nécessité de la prise du pouvoir immédiat par la classe ouvrière, basé sur la dictature des soviets. Cela impliquait donc une claire compréhension de la nécessité de rompre avec les buts et les organisations de l'ancien mouvement ouvrier :les sociaux-démocrates furent dénoncés comme agents du capitalisme et toute collaboration avec ceux qui avaient trahi le prolétariat fut rejetée. La voie parlementaire fut jugée incapable de servir les intérêts de la classe ouvrière. Il fut établi que le problème de l'oppression coloniale ne pouvait être résolu que dans le contexte d'une société socialiste mondiale. Ces positions et d'autres étaient l'expression de la vague révolutionnaire qui balayait alors le monde entier.
Mais dans les Congrès suivants de l'Internationale, et surtout dans le troisième, apparut une importante détérioration de la cohérence et des principes révolutionnaires, détérioration qui, à son tour, reflétait le reflux de la révolution mondiale et la dégénérescence du parti bolchevik dans le contexte d'isolement de la révolution russe. L'État bolchevik était contraint de s'avancer sur un chemin qui le menait à assumer le rôle de gérant du capital russe. Parallèlement, la IIIème Internationale devint de plus en plus un instrument de la politique étrangère de la Russie. Les tentatives désespérées des Bolcheviks qui essayaient de sauver quelque chose contre cette vague de contre-révolution les amenèrent à abandonner les positions révolutionnaires du premier Congrès et à revenir aux tactiques de l'ancienne période: parlementarisme, syndicalisme, fronts uniques avec des fractions bourgeoises, soutien aux luttes de libération nationale, etc.. Le fait que toutes ces tactiques fussent justifiées par tout un verbiage révolutionnaire n'enlevait rien au fait que le changement de période les avait rendues directement contre-révolutionnaires, et cela quelles que fussent les intentions de ceux qui les employaient.
Ceux qui agissent aujourd'hui au sein de la classe ouvrière en tant que fractions de gauche de l'appareil politique du capital - staliniens, trotskystes et autres - sont en fait les vrais héritiers de ces politiques contre-révolutionnaires. La nature de classe de ces organisations les empêche de comprendre la nature de la période et d'en tirer les conséquences programmatiques. Les staliniens et les trotskystes peuvent employer le concept de décadence du capitalisme mais ce n'est pour eux qu'une phrase creuse et hypocrite, privée de toute base matérielle si l'on considère que dans le même temps ils estiment que la moitié du monde ou presque est socialiste ou "non capitaliste" et donc dans une phase historiquement ascendante et méritant le soutien des révolutionnaires. Dans tous les cas, leur application de la théorie de la décadence du capitalisme aux pays dont ils acceptent la nature capitaliste est entièrement subordonnée à leurs besoins immédiats, pragmatiques, empiriques et organisationnels, quand ils en font une application...
Lors de la première grande vague révolutionnaire, les conséquences révolutionnaires de l'analyse matérialiste de la période étaient surtout défendues par la gauche communiste qui scissionna du Kominterm en dégénérescence, principalement par le KAPD allemand. Les interventions du KAPD au troisième Congrès (cf. "La Gauche Allemande" Paris, 1973) concernent toutes les tâches que la nouvelle période imposait aux révolutionnaires et symbolisaient presque la rupture fondamentale qui naissait à cette époque dans le mouvement ouvrier.
Pour ce qui est de l'interprétation de la crise économique mondiale, Schwab, militant du KAPD, insistait sur les différences fondamentales qui existaient entre la période ascendante du capitalisme et sa période de déclin, et on trouvait une compréhension du fait que ce déclin historique ne signifiait pas une complète stagnation des forces productives, mais évolution du capitalisme sur une base de plus en plus destructive. "Le capital reconstruit, préserve ses profits, mais aux dépens de la productivité. Le capital restaure son pouvoir en détruisant l'économie". On trouve déjà là, la vision des dépenses improductives, de la sous-utilisation du capital, et surtout du cycle de crise - guerre - reconstruction qui sont les caractéristiques fondamentales de la phase décadente du capitalisme.
C'est un malheur que la contre-révolution ait fait disparaître de nombreux textes du KAPD, qui auraient pu approfondir cette analyse. La majorité du KAPD tenta de continuer l'analyse de Rosa Luxemburg qu'elle considérait à juste titre comme son "ancêtre" direct. Néanmoins, la compréhension de la décadence que pouvait avoir le mouvement ouvrier de l'époque était inévitablement limitée par la rapidité avec laquelle avait surgi la crise et par la promptitude de la réaction contre-révolutionnaire. L'analyse économique que faisait la gauche allemande n'était pas le plus important de son apport: le plus important était son intransigeance sur la nécessité qui s'imposait au prolétariat de rompre avec les pratiques de l'ancienne période et donc avec les pratiques réformistes et de s'adapter aux nouvelles tâches qu'appelait la mise à l'ordre du jour de la révolution prolétarienne.
C'est sur cette base matérialiste, et non sur la base d'un esprit "anarchiste" ou "infantile" que la Gauche communiste rejeta les tactiques opportunistes adoptées par la IIIème Internationale. Au cours du troisième congrès de l'Internationale communiste, le KAPD, tout en reconnaissant que l'organisation de fractions parlementaires avait été une nécessité pour la classe ouvrière dans la phase ascendante du capitalisme, était en mesure d'affirmer:
"Pousser le prolétariat à prendre part aux élections dans la période de décadence du capitalisme revient à nourrir en son sein l'illusion que la crise peut être surmontée par des moyens parlementaires."
De même pour la question syndicale, le KAPD affirma que des organisations qui avaient été construites dans l'unique but de défendre la classe ouvrière à l'intérieur du capitalisme dans la période réformiste étaient non seulement inadéquates comme instruments révolutionnaires dans la nouvelle période, mais étaient devenus aujourd'hui des piliers de l'ordre capitaliste et devaient être renversés par la classe. Il en était de même pour tous les partis réformistes de l'ancienne époque, la Social-Démocratie et autres. La gauche communiste refusa systématiquement de s'associer à tout front unique avec ce qui était devenu une partie de la classe ennemie. Les principes de la gauche communiste et sa courageuse défense des principales frontières de classe face à la contre-révolution étaient basés sur une profonde compréhension des implications de la nouvelle période; ils sont un point de départ indispensable pour toute cohérence révolutionnaire aujourd'hui.
La gauche communiste était essentiellement une réaction prolétarienne à la contre-révolution qui devait bientôt dominer entièrement. L'inévitable désintégration du mouvement ouvrier sous le long règne de la contre-révolution n'a laissé que quelques petites fractions qui défendent le programme de la classe ouvrière. Fait aussi sinistre qu'inévitable, une plus grande compréhension de la décadence n'a pu se dessiner qu'à travers les terribles expériences de la contre-révolution et les formes putréfiées d'organisation capitaliste qu'elle a fait surgir: le Stalinisme, le Nazisme, les Fronts Populaires, l'économie de guerre, etc..
Dans les années 30, la fraction qui analysait la période de la façon la plus cohérente regroupait ceux qui restaient de la gauche italienne en exil, autour d'une revue: "Bilan". Dans un article intitulé "Les crises et les cycles de l'agonie de l'économie capitaliste" (Bilan, n° 11, Sept. 1934), l'auteur, Mitchell, a fait ressortir de nombreuses tendances caractéristiques du capital en décadence. Envisageant le problème d'un point de vue qui considérait la saturation des marchés et la baisse tendancielle du taux de profit comme des éléments interdépendants de la crise historique, l'auteur définissait la décadence du mode de production capitaliste comme un processus, dans lequel:
"La société capitaliste, vu le caractère aigu des contradictions inhérentes à son mode de production, ne peut plus remplir sa mission historique˚: développer les forces productives et la productivité du travail humain de façon continue et progressive. Le choc entre les forces productives et leur appropriation privée, autrefois sporadique, est devenu permanent. Le capitalisme est entré dans sa crise générale de décomposition".
Mitchell a exprimé la différence essentielle entre les crises cycliques du capitalisme ascendant et les périodes de boom et de marasme de la décadence. Alors que, dans la période précédente, les crises étaient des moments nécessaires dans l'expansion continue du marché capitaliste mondial, la saturation des marchés qui a donné naissance à la nouvelle période signifie qu'à partir de ce moment, les crises du capitalisme ne peuvent plus être "résolues" que par les guerres impérialistes:
"Dans la phase décadente impérialiste, le capitalisme ne peut orienter les contradictions de son système que dans une seule direction: la guerre. L'humanité ne peut échapper à cette issue que par la révolution prolétarienne."
Avec une acuité de vue presque prophétique, l'auteur entame une discussion sur les perspectives probables de la période à venir
"Quelle que soit la façon dont il évolue, quels que soient les moyens qu'il emploie pour surmonter sa crise, le capitalisme est irrésistiblement attiré vers son destin: la guerre. Où et comment elle arrivera, c'est impossible à définir aujourd'hui. Ce qu'il est important de savoir et d'affirmer c'est qu'elle explosera avec entre autres le problème du découpage de l'Asie, et qu'elle aura une ampleur mondiale."
Mitchell continue par une dénonciation de l'alternative capitaliste "fascisme contre démocratie", qui détourne le prolétariat de sa lutte de classe et sert à le mobiliser pour l'intérêt de la guerre capitaliste. Mais la classe ouvrière avait à cette époque essuyé trop de défaites pour entendre les avertissements des fractions communistes et leur appel à la révolution ; les fractions elles-mêmes n'avaient aucune illusion sur l'ampleur de la défaite qu'avait subie le prolétariat.
Avec la gauche italienne, les communistes de conseil (le groupe communiste internationaliste hollandais et d'autres) restèrent les seuls à défendre des positions de classe face à la boucherie impérialiste en Espagne et à celle de la deuxième guerre mondiale. Mais les conseillistes avaient tendance à être moins clairs sur la nature de la période, et commencèrent à qualifier l'expérience de la révolution russe de révolution purement bourgeoise, ce qui est une impossibilité dans la période de décadence capitaliste. En Amérique, Paul Mattick commença à élaborer une théorie de crise permanente basée sur les analyses de Grossman de la baisse tendancielle du taux de profit, mais sa façon de procéder le conduisait à un certain nombre d'aberrations, comme de considérer le capitalisme d'État comme un nouveau mode de production qui n'aurait aucune dynamique impérialiste, et donc aurait une certaine nature progressiste: d'où les ambiguïtés de Mattick sur la Chine, le Vietnam, etc. Les groupes qui aujourd'hui se réclament des seuls communistes de conseil ont une forte tendance à rejeter le problème de la décadence comme étant trop "théorique" et donc ne comportant aucun intérêt réel pour les luttes de la classe ouvrière.
L'élaboration de la théorie communiste après la deuxième guerre mondiale trouva donc sa meilleure expression chez ceux qui tentèrent d'établir une synthèse des contributions de la gauche italienne, allemande et hollandaise. Le groupe Internationalisme qui rompit avec les sections de la gauche italienne qui tentaient de construire de façon volontariste un parti en pleine période de réaction, a été capable d'assimiler beaucoup de la vision qu'avait la gauche allemande des relations entre le parti et les conseils ouvriers, point sur lequel Bilan avait été moins clair. Ce qui est plus important, il formula une analyse profonde de la tendance du capitalisme décadent à l'étatisation et put définir la nature capitaliste de la Russie sans tomber dans l'erreur d'appeler révolution bourgeoise Octobre 17. Le travail de ce groupe en France et celui du groupe vénézuélien Internacionalismo dans les années 60, sont à l'origine directe de notre Courant Communiste International, qui tente d'approfondir et de poursuivre l'analyse entamée par ses prédécesseurs. Alors que le système capitaliste mondial entre une fois encore dans une période de crise ouverte, notre compréhension de la nature historique de cette crise nous permet de réaffirmer que l'alternative qui se pose à l'humanité est une fois encore la guerre impérialiste mondiale ou la révolution prolétarienne, le socialisme ou la barbarie.
Comme cela a pu se dégager de ce bref aperçu historique, la compréhension de la période dans laquelle nous vivons est indispensable pour défendre les positions de classe et maintenir une pratique révolutionnaire. Tenter de défendre des positions de classe sans comprendre la décadence ne peut mener qu'à la confusion et à la démobilisation. Donc, nous pouvons affirmer que sans cette appréciation de la période de décadence, toutes nos positions sur les syndicats, le réformisme, les guerres de libération nationale , etc. n'auraient aucune base matérielle et ne seraient que de pures affirmations moralisatrices.
Bien que comprendre la décadence du capitalisme soit absolument nécessaire à toute pratique communiste aujourd'hui, cette compréhension n'est pas suffisante. Fritz Sternberg, dont l'ouvrage est largement cité dans cette brochure, pouvait présenter l'analyse luxemburgiste de la crise de façon très convaincante, tout en soutenant le Labour Party. Et l'approfondissement de la crise commence à faire surgir nombre de groupes qui reprennent l'analyse de la décadence faite par les fractions communistes, à des fins essentiellement non prolétariennes. C'est ainsi que des groupes comme Communist Practice en Angleterre, ou Une Tendance Communiste en France utilisaient la théorie de la décadence pour spéculer sur les possibilités qu'aurait le prolétariat de dépasser la prise de pouvoir politique pour se "nier" immédiatement dans un "mouvement communiste" sans forme qui abolirait les classes avant même d'abolir le pouvoir politique de la bourgeoisie. La théorie de la décadence n'est pas en elle-même une garantie d'une pratique communiste authentique: il faut que toutes ses conséquences concrètes soient comprises et mises en pratique ; et cela signifie une intervention militante à l'intérieur de la lutte de classe et une organisation qui facilite cette intervention à l'échelle internationale. La nature de la crise aujourd'hui impose de lourdes tâches au prolétariat mondial et une responsabilité qui pèse non moins lourdement sur les minorités communistes du prolétariat. Nous dédions donc cette brochure à la nouvelle génération de militants prolétariens dont une des tâches spécifiques est de défendre et de clarifier sans trêve les tâches communistes de la classe ouvrière internationale.
WR/Internationalism. Printemps 1975
Questions théoriques:
- Décadence [3]
Heritage de la Gauche Communiste:
Crise et décadence
- 3543 reads
Un homme de cent ans est sans aucun doute un homme en déclin. Il est potentiellement en crise permanente. Cependant il ne connaît de crise pouvant entraîner sa mort qu'à des moments précis. Il existe une différence entre cet état de sénilité irréversible et les convulsions violentes qui marquent régulièrement le déroulement de cette décadence.
Décadence et crise ouvertes du capitalisme sont au XXème siècle des phénomènes LIES mais DISTINCTS, NON IDENTIQUES mais DÉPENDANTS.
Notre objet ici n'est pas l'étude de ces moments de crise (1929, 1938 par exemple) ; il n'est pas de savoir si actuellement le capitalisme commence ou non à connaître une situation de ce genre. Nous nous attacherons à montrer que le capitalisme connaît un état de sénilité, de décadence depuis 1914 et que les magnifiques "taux de croissance" dont il se flatte, surtout depuis la Seconde Guerre Mondiale, cachent en fait l'agonie d'un système qui parvient de moins en moins à créer les conditions de sa reproduction.
LE CONCEPT DE DÉCADENCE
L'introduction nous a montré comment la réalité de l'histoire du capitalisme a vérifié l'explication générale que Marx a donné de l'ascendance et du déclin des différents modes de production. Une analyse détaillée nous montrerait comment se sont succédés les caractères d'expansion et de faillite des modes de production pré-capitalistes (esclavagiste, féodal).
On peut synthétiser cette loi historique de la façon suivante :
Contrairement à ce que pouvait laisser croire une conception évolutionniste de l'histoire, présentant le progrès de la société humaine comme un processus continu, ininterrompu, toujours ascendant aucune société n'a disparu au moment de son apogée. C'est seulement à la suite d'une plus ou moins longue période de déclin que les sociétés pré-capitalistes ont cédé la scène de l'histoire à de nouvelles formes d'organisation sociale.
L'apogée d'une société constitue bien une limite pour celle-ci. Il correspond en effet à cette période au cours de laquelle dans un cadre social donné, les hommes parviennent à obtenir un maximum de développement de leurs richesses matérielles avec le niveau de techniques existant. Il est ce degré de développement qui marque un certain point d'arrêt parce qu'il ne peut être dépassé sans l'utilisation de nouvelles techniques de travail, c'est à dire sans l'abandon des rapports de production prévalant jusqu'alors, et par conséquent, sans le bouleversement de l'ordre social fondé sur ces rapports. Il est ce zénith qui fait de l'avènement de la nouvelle société une nécessité objective à l'ordre du jour.
Si le cours de l'histoire était un processus harmonieux de constante évolution, c'est donc à la suite de ces apogées que les bouleversements sociaux auraient dû avoir lieu. Mais l'histoire est celle de la lutte de classes. La nécessité matérielle d'un bouleversement social se développe avec les forces productives, comme un processus objectif indépendant de la volonté des hommes. Mais le bouleversement lui-même est l'œuvre des hommes et plus exactement d'une classe sociale. Sa réalisation effective dépend par conséquent aussi des conditions objectives et subjectives qui déterminent la volonté et la possibilité d'action de cette classe.
Or, ces conditions n'existent pas au moment de l'apogée d'une forme sociale. A la suite de leur apogée, avant de disparaître, toutes les sociétés passées ont connu une longue période de crises et de convulsions. Les vieilles structures se décomposent. Les nouvelles forces tentent de s'imposer. Cette période de désagrégation et de gestation, cette ère de barbarie et cette "ère de révolution sociale" est ce qui constitue la phase de décadence d'une société.
LES RAISONS DU PHÉNOMÈNE
Mais quels sont ces facteurs nécessaires à la révolution sociale dont l'inexistence à l'apogée du mode de production rend inéluctable la période de sa décadence ?
- Un ensemble de rapports sociaux ayant lié entre eux les hommes pendant des siècles n'est pas dépassé du jour au lendemain. L'homme n'abandonne pas l'outil dont il se sert avant d'avoir fait la preuve de son inutilité. Une forme sociale ne peut prouver son "inutilité", son obsolescence historique que par la misère et la barbarie que son maintien peut provoquer. Il a fallu des années de famine, d'épidémies, de guerre et d'anarchie pour que les hommes aient été forcés de commencer à abandonner l'esclavagisme et le féodalisme. Seuls de tels évènements, engendrés par la décadence de la société, parviennent à bout de siècles de coutumes, d'idées, de traditions. La conscience collective retarde toujours sur la réalité objective qu'elle vit.
- Parallèlement à cet élément, deux facteurs objectifs, nécessaires à la réalisation du passage à la nouvelle société, font aussi défaut au moment de l'apogée de l'ancienne : l'affaiblissement du pouvoir de la classe dominante d'une part, l'apparition du projet nouveau et des forces sociales pour le réaliser d'autre part.
- Le pouvoir de la classe dominante et l'attachement de celle-ci à ses privilèges sont de puissants facteurs de conservation d'une forme sociale. Mais le pouvoir de cette classe prend ses racines dans l'efficacité du système qu'elle domine. L'existence des classes est le résultat d'une certaine division du travail nécessaire à un moment donné du développement des techniques de production. La force de leur pouvoir, les classes dominantes la puisent donc en premier lieu dans le caractère unique et indispensable des rapports de production existants sous leur domination. L'apogée d'un système économique est aussi celui de la stabilité du pouvoir de la classe dominante. Réciproquement, l'effondrement de ce pouvoir ne peut se réaliser définitivement qu'avec celui des rapports de production, c'est à dire au cours de la phase de décadence du système. Toutes les tentatives pour maintenir ce pouvoir artificiellement par l'étatisme et le totalitarisme politique (tentatives qui, comme nous le verrons, n'ont jamais manqué de se réaliser et constituent de ce fait un symptôme significatif) ne traduisent en fait que la décomposition de ce pouvoir.
- Enfin troisièmement, un homme n'abandonne pas définitivement un outil qui lui est indispensable avant d'en avoir trouvé un autre pour le lui substituer. Pour qu'un type de rapports de production soit abandonné (alors qu'il est celui qui a permis jusqu'alors la subsistance de la société) il faut qu'il se dégage au sein de l'ancienne société le projet et les forces indispensables à l'établissement de nouveaux rapports. Or dans les sociétés passées, la classe porteuse du nouvel ordre n'existe pas (ou seulement de façon embryonnaire) tant que la société n'est pas encore entrée dans sa phase de décadence. (Les grandes propriétés féodales ne se développent vraiment dans la Rome Antique que sous le Bas Empire ; de même sous le féodalisme, la bourgeoisie ne prend un réel essor qu'à partir du 14ème siècle).
Ces trois éléments principaux apportés par le déclin d'un système, ne sont certainement pas les seuls à rendre compte des raisons qui ont provoqué une période de décadence pour les sociétés féodale et esclavagiste : Ils permettent cependant de comprendre le pourquoi de l'inévitabilité d'une période de décadence pour les sociétés passées. Il nous restera à voir si ces mêmes raisons subsistent sous le capitalisme.
Mais il faut d'abord rappeler ce qu'ont été les manifestations des périodes de décadence.
LES MANIFESTATIONS DE LA DÉCADENCE
Toutes ces manifestations peuvent se résumer en un état de crise généralisée atteignant tous les domaines et toutes les structures de la vie sociale.
1.- au niveau économique (infrastructure de la société) la production se heurte de façon croissante à des entraves qui ne sont autres que les rapports sociaux de production eux-mêmes. Le rythme de développement des forces productives se trouve ralenti, voire arrêté. La société connaît des crises économiques dont la gravité et l'étendue s'amplifient à chaque occasion.
2.- au niveau des superstructures : la subsistance matérielle ayant été dans toutes les sociétés jusqu'à présent le premier problème social, il en découle que,"en dernière instance", ce sont toujours les rapports de production qui ont déterminé la forme et le contenu des différentes structures sociales. Lorsque ces rapports se sont effondrés, ils ont entraîné dans leur mouvement tout l'édifice qui reposait sur eux. Lorsqu'un tel état de crise se développe au niveau économique, tous les autres domaines de la vie sociale sont obligatoirement atteints.
C'est ici qu'il faut chercher la véritable racine des fameuses "crises de civilisation". Les visions idéalistes se perdent en études sur les "relâchements moraux", sur les "méfaits de l'abondance", sur l'influence néfaste ou bénéfique de telle philosophie ou religion, bref, elles cherchent dans le domaine des idées, de la pensée existante, les raisons de ces crises. Sans nier l'influence certaine des idées sur le cours des événements, il est cependant certain que, comme le dit Marx
"On ne juge pas un individu sur l'idée qu'il a de lui-même. On ne juge pas une époque de révolution d'après la conscience qu'elle a d'elle-même. Cette conscience s'expliquera plutôt par les contrariétés de la vie matérielle, par le conflit qui oppose les forces productives sociales et les rapports de production".
Dans le domaine idéologique : la conservation du système devient une absurdité trop criante et permet de moins en moins la survie de l'idéologie qui le justifie. L'idéologie se décompose, les anciennes valeurs morales s'écroulent, la création artistique stagne ou prend des formes contestataires, l'obscurantisme et le pessimisme philosophique se développent.
Dans le domaine des rapports sociaux, la décadence se manifeste par :
1) Le développement des luttes entre différentes fractions de la classe dominante. Les conditions d'extraction et la quantité même du profit deviennent de plus en plus difficiles à maintenir ; les nantis qui veulent assurer leur subsistance doivent (abandonnant toute possibilité de coopération) le faire aux dépens des autres membres ou fractions de leur classe.
2) Le développement des luttes entre classes antagonistes˚:
- Lutte de la classe exploitée, qui ressent d'autant plus sa misère que l'exploitation est portée à son comble par la classe exploiteuse aux abois.
- Lutte de la classe porteuse de la nouvelle société
(dans les sociétés passées, il s'est toujours
agi d'une classe distincte de la classe exploitée) qui se
heurte aux forces de l'ancien ordre social.
Dans le domaine politique : face à cet état de crise,
la classe dominante ne parvient plus à assurer son pouvoir
politique comme auparavant, l'appareil de l'ordre, l'État,
cristallisation ultime des intérêts de l'ancienne
société, tend à se renforcer et à étendre
son emprise à tous les domaines de la vie sociale.
o - O - o
Cet ensemble de phénomènes a existé à la fin de l'esclavagisme romain et de l'époque féodale. Ces manifestations étaient les caractéristiques inéquivoques de la décadence de ces sociétés. Mais est-ce que la stagnation du capitalisme depuis 1914 s'accompagne de ce mûrissement des conditions de la révolution sociale typique d'une période de décadence
LA DÉCADENCE DU CAPITALISME
Mais peut-on pour autant définir une décadence du capitalisme ?
Des symptômes analogues ne permettent de diagnostiquer une même maladie chez des individus différents, qu'à condition que ces derniers soient de même espèce ou de mime nature. Vis-à-vis des caractéristiques qui apparaissent au cours des décadences passées, peut-on mettre le capitalisme sur le même plan que ces sociétés? Les anciens symptômes et causes restent-ils valables?
Sur le plan de la production matérielle, l'asservissement du système social au développement des forces productives est une loi qui reste valable pour le capitalisme.
Tant que l'humanité vivra dans "le règne de la nécessité", tant qu'elle ne sera pas parvenue au stade de l'abondance permettant l'élimination des problèmes de subsistance matérielle, ou du moins leur relégation à un second plan, ce dont l'humanité est encore loin, la première fonction d'un système économique demeure le développement des forces productives. Qui plus est, en généralisant l'économie concurrentielle de marché, le capitalisme, ce système où tout capital qui ne se développe pas est condamné à disparaître ou à passer en d'autres mains, a rendu plus contraignante encore cette obligation de développement.
Il est donc certain que pour le capitalisme, tout comme pour le féodalisme ou l'esclavagisme, le développement insuffisant des forces productives représente historiquement un arrêt de mort.
Mais peut-il ou doit-il pour autant -si cette condition se réalisait- connaître comme eux une phase de décadence ?
La société capitaliste demeure, premièrement, une société divisée en classes, deuxièmement une société où les hommes continuent de vivre dominés par leurs besoins économiques, et subissent par conséquent inconsciemment leurs structures sociales. Aussi retrouve-t-on sous le capitalisme certains des traits essentiels des sociétés passées, et en particulier ceux qui rendent inévitable l'apparition d'une période de décadence :
Retard de la conscience collective sur la réalité qu'elle vit, dépendance du pouvoir politique de la classe dominante par rapport à l'efficacité des rapports de production, poids et inertie des coutumes et habitudes correspondant à l'ancienne société, impossibilité de passer à une nouvelle forme sociale tant que l'ancienne n'a pas fait les preuves de son obsolescence, et qu'un nouveau projet n'a pu commencer à germer au sein de la société. On est donc en droit d'affirmer que tout comme les sociétés qui l'ont précédé, le capitalisme peut et doit connaître une phase de décadence.
Cependant, à côté de ces traits, communs à toutes les sociétés d'exploitation, le capitalisme possède des caractéristiques qui le distinguent aussi radicalement de l'esclavagisme que du féodalisme.
D'autre part, le système qui constitue la négation et le dépassement du capitalisme, n'est plus lui-même un système d'exploitation.
Aussi, la décadence du capitalisme connaît-elle des spécificités nouvelles par rapport à celles des autres systèmes.
Le socialisme est le premier système dans l'histoire qui ne surgit pas au sein de la société qu'il est appelé à dépasser. Les rapports économiques féodaux sont nés au sein du Bas-Empire dans de grandes propriétés qui parvenaient plus ou moins à se rendre indépendants du pouvoir central; le capitalisme naît dans les bourgs puis les villes dans la société féodale. Dans les deux cas, la future classe dominante se substitue à l'ancienne progressivement.
Le prolétariat par contre n'a aucune possibilité de construire une nouvelle société au sein du capitalisme. Classe exploitée, source directe du profit de la classe dominante, il ne peut avancer dans son projet sans se débarrasser totalement du pouvoir de cette dernière. Contrairement au passé, la coexistence des deux systèmes est ici exclue. Le capitalisme étant le premier système à avoir intégré toute la production mondiale dans un même circuit, ceci est vrai à l'échelle de la planète : le socialisme dans un seul pays est impossible.
Il en découle que la décadence du capitalisme doit être une décadence plus "nette", plus violente.
Le féodalisme a pu vivre en France, même si ce n'est que sous sa forme monarchique, jusqu'au I8ème siècle, grâce à la prospérité de la bourgeoisie qui permettait de satisfaire partiellement aux besoins économiques que le féodalisme ne parvenait plus à assumer. Rien de tel pour le capitalisme, celui-ci s'achemine seul vers sa mort. Son fossoyeur n'est pas un concurrent éventuellement utile et dont on peut s'accommoder ne fut-ce que provisoirement, mais un ennemi mortel engendré par des siècles d'oppression et avec qui tout partage est impossible. Toutes les conséquences de la décadence capitaliste s'abattent sur la société, sans qu'elles puissent être amorties. Aussi peut-on conclure dans un premier temps d'une part au caractère plus intense de cette décadence, d'autre part à la plus grande brièveté de celle-ci, la violence des effets étant plus grande, le temps de réaction se trouve abrégé.
Le prolétariat : à l'inverse des autres classes révolutionnaires de l'histoire, le prolétariat n'apparaît pas au cours de la phase de décadence mais dès le début du système. Lorsque la société capitaliste a atteint son apogée, le prolétariat est déjà pleinement développé comme classe économique ; lorsque le système commence à entrer en décadence, son fossoyeur est déjà dans toute sa force numérique. La fin du capitalisme ne devra pas attendre comme par le passé que son artisan naisse et se développe dans le fumier du vieux monde en déclin.
Deux autres facteurs contribuent à l'écourtement de la décadence :
I°: La faible importance des rapports idéologiques. Il n'existe sous le système du salariat et du capital aucun rapport religieux, politique ou personnel pour médiatiser le rapport d'exploitation (contrairement à ce qui se produit dans l'esclavage et le servage). Il en découle un lien plus direct entre la vie sociale et la vie proprement économique de la société, et donc une réaction plus rapide sur le plan social, aux difficultés économiques qui caractérisent la période de décadence.
2°: Enfin et surtout, ne vivant que dans et pour la concurrence (à l'échelle nationale et internationale) le capitalisme ne peut vivre sans développement.
Aucune société dans le passé, il est vrai n'a pu exister sans assurer d'une façon ou d'une autre un certain développement des forces productives. Mais dans le passé, ce développement n'a jamais été véritablement intrinsèque aux rapports de production existants. Les profits et privilèges des membres de la classe dominante ne dépendaient pas directement de leur capacité à assurer leur propre expansion économique. Le profit qu'ils extirpaient du travail des serfs ou des esclaves était consacré à leur consommation personnelle et au luxe. Ce n'est qu'accessoirement qu'il servait à développer la production. Aussi lorsque ces systèmes commençaient à se heurter à leurs contradictions économiques, on pouvait assister à un ralentissement de la croissance, voire à la stagnation sans que, dans l'immédiat, les classes dominantes en fussent précipitées dans la faillite et la misère, sans que la vie économique de la société ne fût paralysée.
Sous le capitalisme, si l'accumulation croissante du capital ne peut être assurée, c'est le profit en entier puis le processus de production en lui-même qui s'en trouvent bloqués. C'est là un des traits essentiels de la nature du système capitaliste.
Or, la principale caractéristique de la décadence d'un système est l'impossibilité croissante dans laquelle se trouve la société d'assurer un développement économique sans abandonner les rapports de production existants. Encore une fois donc on peut difficilement croire à un capitalisme connaissant une longue période de décadence.
o-O-o
On peut donc affirmer sans grande crainte d'erreur que :
- "La décadence" d'une société est un phénomène historique réel dont les causes et les manifestations principales peuvent être suffisamment précisées.
- Que tout comme les sociétés qui l'ont précédé, le capitalisme peut connaître un phase de décadence.
- Que les manifestations de celle-ci demeurent pour le capitalisme d'une nature analogue à celle des sociétés précédentes.
- Que de divers point de vue, cette décadence semble devoir être plus brève et plus intense qu'elle ne le fut pour les autres systèmes.
o-O-o
Ceci dit, il faut maintenant confronter l'analyse à la réalité du capitalisme.
LA THÉORIE DE LA DÉCADENCE ET LA RÉALITÉ DU CAPITALISME MONDIAL
On pourra peut-être dire qu'il aurait fallu commencer dès le débat par là. Rien de moins certain. Le concept de décadence d'une société n'a véritablement pu intéresser les révolutionnaires qu'à partir de la période de la première guerre mondiale, c'est à dire tout naturellement à partir de l'entrée du capitalisme dans sa phase de déclin. La rupture entre la deuxième et la troisième internationale au cours de la première guerre mondiale s'est faite sous le signe de la discussion sur la fin de la période ascendante du capitalisme et son entrée dans la période de "guerre ou révolution". Cependant depuis lors, pendant les 50 années environ de contre révolution triomphante, et à cause d'elle, la théorie révolutionnaire n'a connu ni l'essor ni l'approfondissement qui auraient été nécessaires pour rendre compte des transformations que subissait la réalité mondiale. Aujourd'hui à la sortie de ce tunnel idéologique, c'est malheureusement trop souvent que les différents courants se revendiquant du mouvement révolutionnaire prolétarien, se partagent encore d'un côté entre un goût excessif pour les "nouvelles applications" de la "réalité nouvelle" ("le marxisme est dépassé" ... ) et de l'autre côté l'attachement religieux aux vieux textes et aux vieilles idées par dépit contre la première tendance (cf. les "bordiguistes" P.C.I., et leur "rien de nouveau sous le soleil" ou leur "invariabilité du programme révolutionnaire" depuis 1848 ). Entre les deux pôles et tombant simultanément dans les deux travers, on trouve les trotskystes attachés à la moindre lettre du "programme de transition" de Trotsky mais prêts à suivre toute théorie à la mode : (autogestion, néocapitalisme, tiers-mondisme) du moment que cela peut permettre de "gagner quelques recrues".
Il en résulte que le concept de "décadence", à peine ébauché par Marx, reste encore une idée trop floue, et prêtant à trop de confusions dans le contexte révolutionnaire pour que nous ayons pu éviter de reprendre au début de cette étude sa définition.
LES SUPERSTRUCTURES
Il peut sembler peu logique de commencer cette "confrontation avec la réalité" par l'analyse des superstructures (idéologie, politique, luttes sociales...) et non par celle de l'économie, les premières n'étant, "en dernière instance" qu'un produit de cette dernière. C'est cependant cet ordre que nous utiliserons pour la facilité de l'exposé. En effet, alors qu'il est en général facile de reconnaître dans le capitalisme actuel les manifestations superstructurelles d'une phase de décadence (tout moraliste moderne se sent obligé de parler sporadiquement de "crise de civilisation", etc.), il est cependant beaucoup moins fréquent de rencontrer une lucidité vis à vis du processus économique.
Par là même la plupart des explications de ces "crises de civilisation" ne dépassent pas le niveau de l'empirisme idéaliste.
En nous attaquant en premier lieu aux "superstructures", non seulement nous facilitons l'exposé en "commençant par le plus simple", mais en outre nous développons le premier argument important pour la solution du problème économique, à savoir l'impératif scientifique d'une cohérence.
1 - Dans le domaine idéologique
On ne peut développer ici l'étude que méritent les liens existants entre l'idéologie dominante et la vie du capitalisme des dernières décades. Nous constaterons simplement la décomposition de l'idéologie dominante.
L'idéologie proprement capitaliste est assez difficile à cerner dans toute sa spécificité : D'une part parce qu'elle reprend à son compte le long héritage idéologique commun à toutes les sociétés d'exploitation depuis des millénaires, D'autre part parce que sous le système du machinisme aveugle, la dépendance des rapports sociaux vis à vis des moyens de production est telle que l'idéologie en tant que moyen de conservation de ces rapports a pu jouer un rôle moindre que par le passé, même s'il demeure encore important.
On peut toutefois affirmer que "le culte du travail", "la glorification de l'ascension sociale", "la confiance et le respect des institutions", ou "la foi dans l'avenir capitaliste" constituent des éléments clés de l'idéologie dominante. Or tous ces éléments ont été violemment érodés depuis 50 ans par la simple action des atrocités de la vie du capitalisme.
Il est de plus en plus difficile de continuer à chanter les louanges, les gloires et les valeurs d'un société, lorsqu'elle connaît en 50 ans près de cent millions de morts, pour cause de guerres dont l'inutilité apparaît de plus en plus clairement; lorsqu'elle s'avère incapable de permettre à deux hommes sur trois de se procurer leur subsistance élémentaire, alors que les deux plus grandes puissances économiques dépensent uniquement en armes l'équivalent du revenu d' un tiers de l'humanité; lorsque dans la partie privilégiée de la planète il faut payer le droit à ne pas mourir de faim de la plus cruelle déshumanisation de la vie quotidienne.
Le recours aux gigantesques opérations idéologiques, style Hitler, Mussolini, Staline, Mao, (phénomènes qu'il faut rapprocher du développement du culte et de la divination aussi bien de l'empereur sous le Bas-Empire romain que de la monarchie absolue à la fin du féodalisme) les crises de l'église, les difficultés du capitalisme à abandonner son ancienne méthode d'enseignement devenue depuis longtemps inadaptée à ses besoins techniques, ainsi que les crises de l'université (1 [4]), principal centre de l'idéologie dominante, expriment dans toute son acuité ce premier symptôme de décadence qu'est la décomposition de l'idéologie.
Cette décomposition est apparue de façon spectaculaire depuis une dizaine d'années en particulier au sein de la jeunesse. Le dégoût des dernières générations pour le monde actuel, ses différentes tentatives de fuite par un certain "marginalisme", son aspect "contestataire" ont fait mille fois la une des journaux. Ce "sursaut" est d'abord l'expression d'un certain retard (plus de 50 ans après 1914 et la révolution de 17-23). Et ce retard peut trouver une explication, entre autres, dans le décalage constant avec lequel les formes idéologiques suivent l'évolution de la réalité socio-économique. Il aura fallu attendre une génération qui n'ait ni fait la seconde guerre mondiale, ni subit les contrecoups violents de la contre révolution qui a suivi la vague révolutionnaire de 17-23. D'autre part, ce retard s'explique par la stabilité économique de près de 25 années qu'a connu le système grâce à la période de reconstruction après la deuxième guerre. Les premiers signes de faiblesse de cette expansion ne toucheront la société et en particulier la jeunesse qu'à la fin des années 60.
Philosophiquement, il y a de moins en moins de place pour les idées d'épanouissement dans "l'harmonie existante". Les penseurs du temps se veulent ou bien révolutionnaires, ou bien désabusés, pessimistes et indifférents à l'extrême. L'obscurantisme et le mysticisme connaissent de nouvelles vogues.
Sur le plan artistique, la décadence se manifeste particulièrement violemment, et il y aurait long à écrire sur l'évolution de l'art s'il ne stagne pas dans une éternelle répétition des anciennes formes, se veut contestataire, souvent l'expression d'un cri d'horreur.
Lorsque le monde des idées connaît de tels bouleversements c'est que quelque chose s'effondre dans celui de la production matérielle
2 - Dans le domaine social
- Développement des luttes entre fractions de la classe dominante.
Si l'exacerbation de la concurrence entre capitaux d'une même nation s'est parfois résolue par des concentrations allant jusqu'à la prise en main de toute la production par l'État, cette concurrence a atteint un degré de démence entre les différentes fractions du capital mondial.
1914-18 : 20 millions de morts.
1939-45 : 50 millions de morts.
Depuis lors, par mouvements de libération nationale interposés, la guerre entre différents blocs capitalistes n'a jamais cessé et a apporté des millions de morts sur l'autel du partage du monde. Un monde dont les capitalistes ne parviennent plus à tirer suffisamment de profit pour pouvoir se le partager en parfaite collaboration. La décadence des sociétés passées a provoqué la désolation de pays entiers ; aujourd'hui, c'est la planète dans sa totalité qui se trouve menacée.
- Développement des luttes de la classe exploitée
Au XIXème siècle les luttes de la classe ouvrière se cantonnent la plupart du temps au terrain des réformes, c'est-à-dire à la recherche d'un aménagement du système. (La Commune de Paris, en ce qu'elle eut d'authentiquement révolutionnaire, fut plus un "accident de l'histoire" qu'un véritable signe des temps).
Avec la première guerre mondiale ces combats connaissent une transformation radicale aussi bien dans leur ampleur que dans leur contenu. Le mouvement qui se développe n'est plus celui de quelques usines, ni même d'une ville. C'est l'Europe entière qui est ébranlée par le plus puissant mouvement prolétarien de tous les temps. Son contenu n'est plus la réforme du système mais son bouleversement radical. "La fraction russe du prolétariat mondial" parvient à détruire l'appareil d'État bourgeois et à se hisser momentanément au pouvoir.
Dès lors tout devait et allait changer sur le terrain "social" du capitalisme.
La vague révolutionnaire de 17-23 fut écrasée, et la révolution russe, isolée, mourut étouffée.
Mais, malgré le poids de la défaite et la confusion que sema pendant des décades l'expérience soviétique, la "menace prolétarienne" loin d'avoir disparue est devenue une constance de la vie sociale capitaliste. Rappelée sporadiquement par des soulèvements prolétariens isolés et par des luttes quotidiennes de la classe, elle marque de tout son poids les 50 dernières années d'histoire : tous les États du monde se sont dotés d'organismes spécifiques pour la "défense des travailleurs" c'est à dire pour assurer l'encadrement strict de la classe révolutionnaire. Les vieilles formes d'organisation ouvrière, les syndicats, sont devenues des rouages essentiels de cette intégration.
Et si la "prospérité" qui suivit la Seconde Guerre Mondiale a fait croire momentanément, à certains, que "la lutte des classes est terminée", le nouvel élan que connaissent les luttes ouvrières depuis 1968 aux cinq coins de la planète, est venu rappeler violemment son existence et annoncer ce qui sera probablement la plus importante vague révolutionnaire de l'histoire.
3 - Dans le domaine politique : le renforcement de l'Etat
Il est une des manifestations les plus frappantes de la décadence des sociétés passées. Il est aussi une des principales caractéristiques du capitalisme depuis 1914.
Le capitalisme d'État, la forme la plus sénile du système mais que les capitalistes et bureaucrates du monde entier se plaisent à définir comme "Socialisme", n'est que l'aboutissement ultime de cette tendance.
L'État a joué un rôle important dans les premiers temps du capitalisme industriel, lors de l'accumulation primitive du capital. Ceci a fait dire à certains que l'étatisme actuel, en particulier dans les pays sous-développés, était le signe d'un nouveau développement du capitalisme mondial. La moindre lucidité historique permet cependant de constater que l'étatisme de notre temps n'a rien à voir avec les interventions ponctuelles de l'État bourgeois du XVIIIème ou XIXème siècle.
L'étatisme de ce siècle n'est plus un à-côté provisoire, mais un processus continu et irréversibles Ses fondements n'ont plus leurs racines dans la lutte contre les restes de systèmes pré-capitalistes féodaux, mais dans la lutte contre les propres contradictions internes du système.
Les causes directes du renforcement de l'État capitaliste à notre époque traduisent toutes les difficultés dues à l'inadaptation définitive du cadre des rapports capitalistes au développement atteint par les forces productives. En effet, l'État a accru l'étendue et l'emprise de son pouvoir parce qu'il s'est avéré la seule entité capitaliste capable de :
- réaliser la centralisation et la "rationalisation" économique qu'impose à chaque nation l'exacerbation de la concurrence internationale dont le champ est devenu trop étroit ;
- assurer toutes les tâches de guerre et de"préparation de guerre" devenues une nécessité de premier ordre pour la subsistance de chaque nation ;
- assurer la cohésion des mécanismes sociaux dont les structures tendent constamment à se désagréger.
Quant au capitalisme d'État dans les pays sous-développés il n'y traduit pas moins la sénilité du système mondial que dans les pays industrialisés. Ces pays ne sont pas de "jeunes capitalismes" mais les secteurs faibles du capitalisme mondial. Aussi ressentent-ils plus violemment que les autres les contradictions internes du capitalisme mondial ; aussi doivent-ils recourir plus rapidement et plus énergiquement aux formes étatiques du système.
Le cas de l'Union Soviétique ne dément pas non plus le caractère décadent du capitalisme étatisé. Ici comme ailleurs c'est l'étroitesse du cadre capitaliste et les conditions draconiennes qu'il impose à chaque nation pour survivre dans le concert international, qui ont été à la base du renforcement de l'État. Ici comme ailleurs c'est la faiblesse de l'économie nationale, et donc l'incapacité du capital privé à soutenir la concurrence qui ont été les principaux accélérateurs du processus. Le fait que ces deux facteurs principaux aient résulté, dans le cas précis de la Russie, de la situation exceptionnelle engendrée par l'échec d'une révolution prolétarienne ne modifie en rien les fondements réels du problème. Ces particularités n'expliquent qu'une chose : les raisons qui ont fait de l'URSS le PREMIER PAYS à concrétiser ce qui était devenu une tendance générale à l'échelle de la planète.
- o-O-o -
Décomposition de l'idéologie, des valeurs dominantes; déshumanisation des rapports sociaux à tous les niveaux : les antagonismes atteignant leur paroxysme périodiquement aussi bien au sein de la classe dominante que dans les rapports de celle-ci avec la classe exploitée; renforcement de l'appareil de coercition, l'État, et intégration de toute vie sociale à son contrôle direct... On retrouve dans le capitalisme actuel tous les traits de la décomposition d'une civilisation, toutes les caractéristiques de la période de décadence d'un système au niveau de ses superstructures sociales.
Mais qu'en est-il au niveau de l'infrastructure ? Au niveau de la production matérielle ?
Comme nous l'avons montré, jamais de tels phénomènes de crise ne se sont produits auparavant sans avoir été accompagnés d'une décadence économique. Du point de vue marxiste ils ne traduisent "en dernière instance" qu'une crise au niveau de la production matérielle.
De 1914 à 1939, les statistiques, nous le verrons, sont claires et peu nombreux sont ceux qui prétendent nier qu'il s'agit là d'une période de stagnation. Cependant, depuis la fin de la Seconde guerre le cours de l'histoire semblerait avoir changé profondément : les symptômes d'une décadence "superstructurelle" continuent à se développer mais - toujours selon les statistiques existantes - le capitalisme connaîtrait une phase de croissance, jamais égalée auparavant.
Le Marxisme a-t-il péri dans la barbarie de la Seconde Guerre ? Sommes-nous en présence d'un "NEO-CAPITALISME" ? Ou bien ces manifestations de crise ne sont-elles que les signes prémonitoires d'une décadence encore lointaine ?
De 1953 à 1969, le produit national brut des Etats-Unis (calculé en volume et par habitant) est multiplié par 1,4, celui de l'Italie et de l'Allemagne le sont par 2,1, celui de la France a doublé, celui du Japon est multiplié par 3,8 ... Où est donc la "décadence" ?
Même si une grande partie de cette production est utilisée uniquement à des fins militaires, même si l'écart entre pays développés et pays sous-développés ne fait que se creuser, force est de constater que "les forces productives n'ont pas cessé de croître". Même si l'évolution des structures politiques, la décomposition des valeurs dominantes témoignent tous d'une "crise de civilisation", d'un déclin du capitalisme au niveau des superstructures, il apparaît difficile et hasardeux à certains marxistes de parler, en de telles conditions "d'expansion économique", de "décadence du système capitaliste".
(RI N°2. Février 197).
1 [5] cf : "Le mouvement étudiant" et "critique" dans RI n°3 (ancienne série)
Questions théoriques:
- Décadence [3]
Heritage de la Gauche Communiste:
Quel développement des forces productives ?
- 15165 reads
Marx a écrit :
"Jamais une société n'expire avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir".
C'est une certaine interprétation de cette fameuse phrase qui a par exemple amené un Trotsky à écrire en tête de son "Programme de Transition" (1938) :
"La prémisse économique de la révolution prolétarienne est arrivée depuis longtemps au point le plus élevé qui puisse être atteint sous le capitalisme. Les forces productives de l'humanité ont cessé de croître".
Trotsky décrivait une réalité que les statistiques vérifiaient alors approximativement. Mais, indépendamment des réalités de 1938, fallait-il, pour montrer que l'humanité était entrée dans une ère de révolution sociale, et donc dans la phase de décadence du capitalisme, s'assurer que les forces productives avaient définitivement cessé de croître ? Et lorsque 20 ans plus tard les mêmes statistiques constataient une croissance relativement puissante de la production mondiale fallait-il alors conclure à l'idée contraire ? Bref, faut-il pour qu'une société entre irréversiblement dans une crise de déclin que les forces productives cessent totalement de croître ? Le problème posé par Marx dans l'avant propos à la "Critique de l'économie politique", -d'où est tirée la fameuse phrase citée- est bien celui de définir les conditions économiques dans lesquelles le passage à une forme de société nouvelle, est rendu possible.
La réponse de Marx peut être résumée comme suit : Les rapports de production que les hommes nouent entre eux dans la production sociale de leur existence et qui constituent les fondations réelles de leur société, correspondent à un degré donné de développement des forces productives matérielles. Le libre développement de ces forces exige au cours de l'histoire des changements importants et répétés de ces rapports de production.
Pour qu'une forme sociale fondée sur des rapports nouveaux puisse être viable, il faut que l'évolution correspondante se soit produite au niveau des forces productives. Si ces forces ne sont pas "suffisamment" développées, il n'existe aucune possibilité objective pour que le nouveau système de production naisse et demeure.
Le problème est de déterminer quel est le contenu de ce "suffisamment développé", quel est ce maximum de forces productives "que l'ancienne société ... est assez large pour contenir" et qui une fois atteint rend possible et nécessaire l'avènement d'une nouvelle société.
La réponse marxiste ne se réfère pas à un niveau quantitatif quelconque, déterminé en dehors des mécanismes économiques ( le niveau nul y compris). Elle se réfère au contraire au niveau qualitatif de la relation qui lie les rapports de production eux-mêmes et le développement des forces productives.
"A un certain degré de leur développement les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors ... Alors commence une ère de révolution sociale" (souligné par nous).
C'est l'apparition de cette "collision" de façon définitive, irrémédiable, et non un blocage du développement des forces productives qui ouvre "l'ère" de décadence de l'ancienne société.
Marx précise bien le critère : "Hier encore formes de développement des forces productives ces conditions se changent en de lourdes entraves".
La "sentence" de Marx doit donc si on veut la préciser être comprise dans le sens : jamais une société n'expire avant que le développement des forces productives n'ait commencé à être définitivement freiné par les rapports de production existants. Dans la vision marxienne, la période de décadence d'une société ne peut donc être caractérisée par l'arrêt total et permanent de la croissance des forces productives, mais par le RALENTISSEMENT DÉFINITIF DE CETTE CROISSANCE.
Les blocages absolus de la croissance des forces productives apparaissent bien au cours des phases de décadence. Mais, (dans le système capitaliste, la vie économique ne pouvant pas exister sans accumulation croissante et permanente du capital) ils ne surgissent que momentanément. Ils sont les convulsions violentes qui régulièrement marquent le déroulement de la décadence.
Tout changement social est le résultat d'un approfondissement réel et prolongé de la collision entre rapports de production et développement des forces productives. Si nous nous situons dans l'hypothèse d'un blocage définitif et permanent de ce développement, seul un rétrécissement "absolu" de l'enveloppe que constituent les rapports de production existants pourrait expliquer un mouvement net d'approfondissement de cette contradiction. Or on peut constater que le mouvement qui se produit généralement au cours des différentes décadences de l'histoire (capitalisme y compris) tend plutôt vers un élargissement de l'enveloppe jusqu'à ses dernières limites que vers un rétrécissement. Sous l'égide de l'État et sous la pression des nécessités économiques, sociales, la carapace se tend en se dépouillant de tout ce qui peut s'avérer superflu aux rapports de production en n'étant pas strictement nécessaire à la survie du système. Le système se renforce mais dans ses dernières limites.
L'affranchissement des esclaves sous le Bas-Empire Romain, celui des serfs à la fin du Moyen Âge, les libertés, même parcellaires que la royauté en déclin doit accorder aux nouvelles villes bourgeoises, le renforcement du pouvoir central de la couronne, l'élimination de la noblesse d'épée au profit d'une "noblesse de robe", centralisée, réduite et soumise directement au roi, de même que des phénomènes capitalistes tels que les tentatives de planification, les efforts pour tenter d'alléger le poids des frontières économiques nationales, la tendance au remplacement des bourgeois parasitaires par des "managers" efficaces, salariés du capital, les politiques de type "New Deal" et les manipulations permanentes de certains des mécanismes de la loi de la valeur sont tous autant de témoignages de cette tendance à l'élargissement de l'enveloppe juridique par le dépouillement des rapports de production. Il n'y a pas d'arrêt du mouvement dialectique au lendemain de l'apogée d'une société. Ce mouvement se transforme alors qualitativement mais il ne cesse pas. L'intensification des contradictions inhérentes à l'ancienne société se poursuit nécessairement et pour cela, il faut bien que le développement des forces emprisonnées existe même si ce n'est que sous sa forme la plus ralentie.
Ce qui caractérise la décadence d'une forme sociale donnée du point de vue économique est donc :
1˚: un ralentissement effectif de la croissance des forces productives compte tenu du rythme qui aurait été techniquement et objectivement possible en l'absence du freinage exercé par la permanence des anciens rapports de production. Ce freinage doit avoir un caractère inévitable, irréversible. Il doit être provoqué spécifiquement par la perpétuation des rapports de production qui soutiennent la société. L'écart de vitesse qui en découle au niveau du développement des forces productives ne peut aller qu'en s'accroissant et donc en apparaissant de plus en plus aux classes sociales.
2° : l'apparition de crises de plus en plus importantes en profondeur et en étendue. Ces crises, ces blocages momentanés fournissent par ailleurs les conditions subjectives nécessaires à l'accomplissement d'une tentative de bouleversement social. C'est au cours de ces crises, que le pouvoir de la classe dominante subit de profonds affaiblissements et qu'à travers l'intensification objective de la nécessité de son intervention, la classe révolutionnaire trouve les premiers fondements de son unité et de sa force,
Y A T-IL EU RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DES FORCES PRODUCTIVES DEPUIS 1914 ?
Alors que de 1850 à 1913 le commerce extérieur mondial avait plus que décuplé ( 1 [6] ), "de 1919 à 1936-38, le commerce extérieur mondial ne s'accroîtra que de 7,4% (1913 = 100 ; 1936-38 = 107,4) et le niveau du commerce de produits industriels se trouvera inférieur en 1936-38 (92,2%) au résultat atteint à la veille de la première guerre mondiale. Ajoutons qu'en 1950, nous avons à grand peine retrouvé le niveau de 1938 en d'autres termes, le commerce mondial est resté stagnant de 1913 à 1950 ! "( 2 [7] )
- DE 1914 A 1929.
Au cours de la première guerre mondiale, la production des pays européens diminue de 1/3 et celle du monde de 10% ( 3 [8] ). Jamais et de loin, le capitalisme n'avait connu auparavant une telle baisse de sa production.
A la suite de la guerre et jusqu'à la crise de 1929, le capitalisme connaît une certaine "prospérité" grâce à la reconstruction des économies détruites par la guerre et l'achèvement de l'expansion de deux jeunes capitalismes : les USA et le Japon. Cependant l'Europe a perdu sa place prépondérante dans le monde capitaliste. Elle ne se relèvera jamais véritablement de son effondrement de la grande guerre. Malgré la reconstruction, l'Angleterre n'aura pas encore retrouvé en 1929 son niveau d'exportation d'avant-guerre. Sa position de centre financier mondial s'érode lentement. L'Allemagne, pays le plus frappé s'effondre ou stagne :
indice de la production
industrielle allemande (1913-1929)
1913 1925 1926 1927 1928 1929
100 83 79 100 102 102
Face à l'enlisement relatif de l'Europe, les États-Unis et le Japon connaissent une prospérité certaine. Débiteurs de l'Europe au début de la guerre, ils en sortent créanciers avec en outre une augmentation de près de 15% de leur production.
Cependant, cette expansion subit déjà les effets d'un manque de débouchés. Pour les USA :
- toute la masse du solde positif de la balance commerciale au cours des dix années (1919-1929) reste inférieure aux investissements mobilisés naguère pour l'extension du réseau ferré (achevé quasiment en 1919) ( 4 [9] )
- de 1919 à 1929, alors que l'indice de la production industrielle (1935-1939 = 100) augmente de près de 60% le nombre de salariés diminue de 8,4 à 8,3 millions.
- de 1910 à 1924, 13 millions d'acres de terre cultivée retournent à l'état de prairie, de steppes ou de pâturages.
En outre, la vive expansion des marchés extérieurs américains ne peut plus se faire vers de nouveaux territoires mais vers des zones déjà conquises par les puissances en guerre avec lesquelles il faudra "partager". L'évolution de la répartition des importations argentines entre les grandes puissances de 1919 à 1929 est à ce titre particulièrement significative :
% DES IMPORTATIONS ARGENTINES
SELON LEUR ORIGINE
1913 1923 1925 1927 1929
Grande-Bretagne 31.00 23.80 21.90 19.40 17.60
Allemagne 16.90 13.60 11.50 11.30 11.50
France 9.00 6.70 6.80 6.90 6.10
USA 14.70 20.40 23.50 25.40 26.40
La part américaine a doublé alors que celle de l'Angleterre a presque diminué de moitié. Le phénomène est sensiblement le même pour ce qui est de l'expansion américaine au Canada. L'expansion extérieure du Japon doit se dérouler avec les mêmes contraintes : ainsi dans les Indes Britanniques, entre 1913 et 1929, la part anglaise dans les importations tombe de 64,2% à 42,8%, celle du Japon augmente de 2,6% à 9,8%. ( 5 [10] )
- DE 1929 A 1938
La grande dépression de 1929 fut pour le monde entier ce que la première guerre fut pour l'Europe. Cette fois, c'est le monde entier qui perd 1/3 de sa production. La chute est 3 fois supérieure à celle qui s'était produite au cours de la guerre. Le relèvement ne sera pas aussi rapide. Jusqu'à la deuxième guerre, la production civile mondiale ne parviendra pas à retrouver son niveau de 1929; nous avons dit ce qu'il en était du commerce ; la production de la première puissance mondiale s'effondre.
|
Indice de production industrielle U. S. A. moyenne annuelle 1935 -39 = 100 |
1929 = 110 1934 = 75 1935 = 87 1936 = 103 1937 = 113 1938 =89 |
Seuls les États ayant commencé à développer une production massive d'armements (japon, Allemagne, URSS) connaissent une certaine croissance de leur production.
Deux chutes extraordinaires de la production, liées entre elles par une période de reconstruction et suivies par une phase de stagnation jusqu'à la seconde guerre mondiale, c'est avec une indiscutable netteté qu'apparaît de 1914 à 1940 le violent freinage subi par la croissance mondiale.
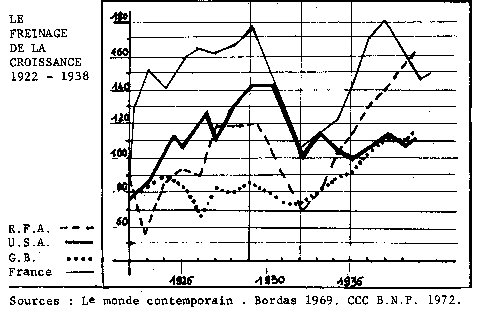
Mais ce ralentissement marque-t-il l'entrée définitive du capitalisme dans sa phase de déclin ou s'agit-il d'un ralentissement important, mais passager, dans un cours général de croissance qui ne s'est interrompu à Sarajevo que pour reprendre mieux à Yalta ?
LA CÉSURE DE LA GUERRE DE 1914-18
La première guerre marque une césure définitive dans deux domaines particulièrement significatifs de l'expansion capitaliste :
- l'expansion impérialiste
- l'expansion de la classe ouvrière au sein de la composition de la structure sociale.
1 - La fin de l'expansion impérialiste du capitalisme
Après sa course triomphale du XIXè siècle conquérant régulièrement et irréversiblement un pays après l'autre, l'expansion impérialiste des métropoles capitalistes connaît un arrêt quasi total au début de ce siècle. Tous les pays sont pénétrés par l'influence capitaliste des différentes puissances qui se les partagent intégralement.
La première guerre mondiale marque l'impossibilité pour toute puissance de trouver une zone du globe véritablement vierge pour assurer son expansion. L'Allemagne arrivée relativement en retard pour la "conquête", est forcée, pour se tailler une place en accord avec sa puissance économique, de provoquer la première guerre mondiale de l'histoire. Après la guerre, le Japon et les USA comme on l'a vu ne pourront assurer leur expansion qu'aux dépens de celle de l'Europe.
Après 1914, le monde sera partagé et repartagé de diverses façons suivant les rapports de force entre puissances. Mais aucune expansion géographique véritablement nouvelle n'aura pu être réalisée. La croissance économique au cours de la phase ascendante du capitalisme s'était caractérisée par l'importance croissante des marchés coloniaux dans le commerce mondial. Cette importance ne cesse pas statistiquement de croître dès 1914-18 : de 1914 à 1929 elle ne fait que ralentir. De 1929 à1938, elle connaît même une certaine relance (voir graphique). Ce n'est qu'au cours de la 2° guerre que statistiquement, la tendance se renverse totalement. Mais ce n'est en fait là, que le résultat d'un processus commencé en 1914. L'importance relative du commerce des pays du Tiers-monde au cours de l'entre-deux guerres est surtout le fait de la chute vertigineuse des échanges entre les pays au sein du monde industrialisé. C'est la guerre de 1914 qui en certifiant la fin de l'ère d'expansion impérialiste du capitalisme mondial a marqué l'ouverture d'un processus de rétrécissement accéléré des débouchés extérieurs au système (voir graphe ci-dessous).
COMMERCE EXTÉRIEUR DES -PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
(en % du commerce mondial)
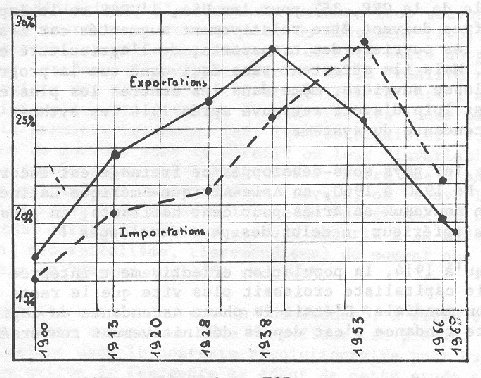
- Importations CAF. exportations FOB.
- Sources : P. Bairoch., OCDE. Novembre 1970
Guide statistique B. N. P. 1972.
2 - La fin de la croissance de l'importance de la classe ouvrière dans la structure sociale.
On estimait à 10% la population mondiale travaillant selon des méthodes capitalistes en 1850. Ce taux atteint prés de 30% en 1914. Mais dès le début du siècle, dans les pays industrialisés, cette expansion s'est fortement ralentie. Le nombre des ouvriers allemands augmente bien de 8 millions en 1882 à 14 millions en 1925, mais leur proportion au sein de la population active, après avoir atteint un taux de 50% en 1895 descendra à 45% en 1925. ( 6 [11] )
"La même évolution apparaît dans d'autres pays. Le nombre des ouvriers se stabilise généralement autour de 50% du total de la population ; ce niveau est légèrement dépassé en Angleterre alors qu'il n'est pas tout à fait atteint en France et en Allemagne."( 7 [12] )
Ce freinage marqué de l'expansion de la part de la "principale force productive" n'a cessé de s'exercer jusqu'à nos jours.
Dans les pays les plus industrialisés du monde, la proportion de "travailleurs industriels, y compris la construction et le logement", selon l'INSEE ( 8 [13] ) n'atteignait en 1968 que le taux de 47-48% pour Allemagne ou l'Angleterre, 45% pour l'ensemble de la CEE, 35% pour les USA, l'URSS ou le Japon. Ces chiffres doivent être relativement augmentés car ils excluent les ouvriers des transports, de l'agriculture et de la pêche. Mais ils attestent sans équivoque que la progression de la classe ouvrière, même dans les centres les plus capitalisés, est loin d'avoir retrouvé après 1914 les rythmes de la phase ascendante du système.
Dans les pays sous-développés ce freinage est encore plus violent. De 1950 à 1960, en Asie, Afrique, Amérique Latine, le nombre de nouveaux salariés pour cent habitants, en plus, est neuf fois inférieur à celui des pays développés !
Jusqu'à 1914, la population effectivement intégrée à l'économie capitaliste croissait plus vite que le reste de la population mondiale. C'était la phase ascendante du capitalisme. Cette tendance s'est depuis définitivement renversée.
LA "CROISSANCE" DEPUIS LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Il y a donc quelque chose de profondément changé dans le capitalisme à partir et depuis 1914, et à fortiori à partir de 1929. Le trait fondamental de ce changement est sans aucun doute la fin de l'expansion impérialiste. Elle constituait en effet le principal débouché extérieur du capitalisme "ascendant". C'était ce débouché qui absorbait cette partie -relativement faible- de la production capitaliste (la plus value destinée à être réinvestie) ... mais dont la réalisation est si indispensable pour l'accumulation du capital.
On ne peut que constater le bouleversement radical qui accompagne cet évènement dans la vie du capitalisme : deux guerres mondiales et une crise de l'ampleur de celle de 1929-38 en moins de trente ans.
La période qui s'annonce avec la IIème guerre mondiale ne se situe pas en dehors du cadre des conditions apparues en 1914. L'importance des marchés coloniaux (ou semi-coloniaux) est comme on l'a vu marquée au cours de cette période par un déclin vertigineux.
Cependant, du fait que cette phase d'expansion a suivi la quasi stagnation des années trente, elle est communément considérée comme étant de nature différente. Les trotskystes de la IVè Internationale ont même utilisé le terme pompeux de "Néo-capitalisme" pour la caractériser et marquer ainsi l'importance qu'ils ont attachée au changement.
Certains taux de croissance atteints depuis la deuxième guerre mondiale approchent - voire dépassent - ceux atteints au cours de la phase ascendante du capitalisme avant 1913. C'est le cas pour les pays comme la France et le Japon. C'est cependant loin d'être le cas pour la première puissance industrielle, les USA (50% de la production mondiale au début des années 50 ( 9 [14] ), 4,6% de taux de croissance annuel moyen entre 1957 et 1965 contre 6,9% entre 1850 et 1880 ( 10 [15] ). Mais la nature, le contenu réel de cette croissance sont radicalement différents de ceux de l'expansion qui s'achève en 1913.
La croissance économique depuis la fin de la IIè guerre a eu comme principaux champs d'expansion :
1° : La reconstruction consécutive à la guerre.
2° : La production permanente et massive d'armements et fourniture militaires.
3° : La meilleure exploitation des marchés anciens.
Seule "la meilleure exploitation des anciens marchés" est commune aux deux périodes ; mais c'est là un trait commun à toute l'histoire du capitalisme. Tout au plus pourrions-nous faire remarquer l'importance majeure que cette politique a prise à l'époque de l'impossibilité de dégager de véritables nouveaux débouchés. L'exploitation du Tiers-monde, même si son importance a immensément diminué du fait de l'insuffisance des marchés solvables qu'il représente, n'en a pas moins continué le plus efficacement possible. De même, les puissances possédant encore un marché intérieur "extra-capitaliste" (en particulier une agriculture encore arriérée - Japon, France, Italie) ont procédé à son intégration de façon systématique depuis la guerre. Mais l'analogie ne peut aller au-delà. Contrairement à ce qui était au XIXè siècle, ce type de débouchés est devenu beaucoup trop restreint par rapport aux nouveaux besoins de l'expansion "naturelle" du capitalisme. Tout s'est passé comme pour ce nénuphar dont la surface double chaque jour : alors qu'il peut lui falloir un temps relativement lent pour démarrer sa croissance et parvenir à couvrir la moitié de l'étang dans lequel il se développe, il ne lui faudra plus qu'un seul jour pour atteindre d'un seul coup les dernières limites de son champ d'expansion. Chaque jour il nécessite pour sa croissance une surface d'étang égale au double de celle de la veille. Mais la surface totale de son champ étant limitée d'avance, la partie qui lui reste à couvrir diminue à un rythme aussi accéléré que celui de ses besoins d'expansion.
Au début du siècle, la masse de débouchés dont avait besoin le capitalisme pour assurer une année de sa croissance était plus de 6 fois inférieure à celle que nécessite une année de production aujourd'hui. Ce rapport serait encore bien plus fort si le capitalisme avait connu depuis 1913 les mêmes conditions d'aisance pour sa croissance. Mais simultanément les débouchés se sont rétrécis de façon vertigineuse.
De ce fait, le capitalisme a dû recourir à la destruction et à la production de moyens de destruction comme palliatifs pour tenter de compenser ses pertes accélérées en "espace vital".
De ce fait aussi, il n'y a aucune continuité réelle entre le capitalisme d'après la deuxième guerre et celui qui précède 1913.
Le capitalisme "ascendant" ne connaît pas "l'économie de reconstruction". Les conflits inter-impérialistes de cette phase n'ont rien de commun avec les guerres du XXè siècle. Leurs effets destructeurs ne touchent jamais aux centres de production. Il n'y a pas de "reconstruction" parce qu'il n'y a pas de véritable destruction.
Quant à la production d'armements et les frais militaires, en général leur volume ainsi que leur part dans le produit national des puissances ne peut même pas se comparer à ce qu'ils deviendront dans le capitalisme moderne :
"L'Allemagne wilhemenienne passait pour la terre d'élection du militarisme. Au cours des dernières années précédant la guerre, ses dépenses militaires connurent une augmentation considérable qui atteignit son apogée en 1913 avec un budget de deux milliards pour l'armée et la marine réunies. Ce chiffre représentait alors 4% du revenu national et s'élevait à 50 milliards de marks". (souligné par nous) ( 11 [16] )
Aucune comparaison possible avec les 10% du PNB couramment atteints, et souvent dépassés par les USA depuis la "paix" de la deuxième guerre, ni avec les 20% de l'URSS. ( 12 [17] )
Le capitalisme des dernières décades -loin de constituer une reprise de la phase ascendante qui s'achève en 1913- apparaît plutôt comme une suite logique, "synthétique", des 30 années de déclin qui l'ont précédé.
C'est en effet au cours de ces années de stagnation que le capitalisme a "découvert" les "bienfaits" économiques de la reconstruction et de la production pour la destruction.
LE CYCLE GUERRE-RECONSTRUCTION
L'autodestruction de l'Europe au cours de la première guerre mondiale s'est accompagnée d'une croissance de 13% de la production américaine. Les USA découvraient dans le chaos du vieux continent un débouché considérable. l'Europe doit importer des USA des masses de bien de consommation, des moyens de production et d'armes. Une fois la guerre terminée, c'est la reconstruction de l'Europe qui s'avère être un débouché nouveau et important. Dans la destruction massive en vue de la reconstruction, le capitalisme découvre une issue dangereuse et provisoire, mais efficace, pour ses nouveaux problèmes de débouchés.
Au cours de la première guerre, les destructions n'ont pas été "suffisantes" : les opérations militaires n'affectèrent directement qu'un secteur industriel représentant moins d'un dixième de la production mondiale, environ 5 à 7 % ( 13 [18] ). Dès 1929, le capitalisme mondial se heurte de nouveau à une crise.
Tout comme si la leçon avait été retenue, les destructions de la seconde guerre mondiale sont beaucoup plus importantes en intensité et en étendue :
"Dans l'ensemble, près d'1/3 des régions industrielles du monde entra durant la deuxième guerre dans le champ des opérations militaires et se trouve ainsi directement exposé à des activités destructives".( 14 [19] )
La Russie, l'Allemagne, le Japon, la Grande-Bretagne, la France et la Belgique en partie subissent violemment les effets d'une guerre qui, pour la première fois, se donne le but conscient de détruire systématiquement le potentiel industriel existant. La "prospérité" de l'Europe et du Japon après la guerre semble déjà systématiquement prévue au lendemain de la guerre. (Plan Marshall, etc.)
Contrairement au lieu commun généralisé, "la reconstruction" ne s'arrête pas lorsque la nation détruite atteint le niveau de production égal à celui d'avant-guerre :
- La reconstruction ne concerne pas uniquement les biens directement productifs, mais aussi toutes les infrastructures et moyens de vie détruits au cours de la guerre et dont la reconstruction n'est pas immédiatement nécessaire pour l'atteinte du niveau de production antérieur à la guerre.
- La reconstruction n'est jamais entreprise avec les techniques d'avant-guerre. La productivité et la concentration du capital connaissent au cours des guerres des progrès importants. Aussi le fait de retrouver l'ancien niveau de production ne s'accompagne pas obligatoirement d'une reconstitution de la même masse de valeur en capital productif.
- Enfin, pendant leur destruction, les pays concernés acquièrent un retard industriel important par rapport aux autres puissances. Leur reconstruction ne peut être considérée comme achevée qu'à partir du moment où ils retrouvent, non pas l'ancien niveau, mais celui qui leur rend leur compétitivité internationale.
En ce sens, la croissance de la période post deuxième guerre jouit des effets de la reconstruction jusqu'aux années 60 et non jusqu'aux années 50 comme cela est souvent dit.
LA PRODUCTION PERMANENTE D'ARMEMENTS
C'est seulement en 1934-35 que l'on peut constater une certaine "reprise" de l'économie mondiale après l'effondrement de 1929. Cette reprise a cependant une particularité sans précédent dans l'histoire du capitalisme : elle ne s'accompagne pas d'une augmentation proportionnelle du commerce mondial. Entre 1932 et 1936, l'indice de l'activité mondiale (URSS comprise) monte de 69 à 111 (1929 = 100), l'indice des exportations en valeur baisse au contraire de 39 à 37,8%. Cette reprise est le fait d'une production qui ne se commercialise pas : les armes. Elle résulte du réarmement intensif de certaines puissances : l'Allemagne, le Japon, la Russie, et, dans une certaine mesure, l'Angleterre.
"En 1937, la Fédération des Industries Britanniques déclarait que les dépenses d'armement avaient donné à l'activité économique en 1936 une impulsion de 4 à 6 fois plus grande que celle due aux placements de capitaux britanniques à l'étranger." ( 15 [20] )
En Allemagne, les dépenses d'armement ont atteint entre 1933 et 1938, 90 milliards de marks. Lorsque Hitler le révéla en 1940, ce chiffre dépassait toutes les estimations qui avaient pu être faites jusqu'alors. L'indice de la production des biens de production quadrupla de 1932 à 1934, celui de la production automobile -grâce à la motorisation de l'armée- sextupla. Le nombre de chômeurs passa de 5 331 000 en 1933 à 172 000 en novembre 1938 ( 16 [21] ).Au Japon., l'indice des bénéfices nets des sociétés essentiellement industrielles fit plus que doubler de 1933 à 1937 ( 17 [22] ). Les matières premières nécessaires à l'armement connaissent une demande exceptionnelle : un pays comme la Suède, dont les puissances européennes se disputent le minerai de fer, a vu l'indice de ses profits passer de 28 à 91,4 entre 1932 et 1936.
Aussi, cette reprise se manifeste-t-elle de façon inégale. En 1937, l'Europe réalise 65% des dépenses mondiales d'armement. Son indice de production industrielle est de 11 points supérieur à celui de 1929. Par contre, en Amérique du Nord, où la production à des fins militaires demeure encore faible ce même indice est encore à un niveau inférieur de 7 points à celui atteint en 1929.
En 1937-38, lorsqu'une nouvelle crise menace le monde capitaliste, c'est encore une relance de la production d'armement -dans les puissances non encore armées- qui "sauvera" le système. La production des USA était tombée à un niveau inférieur de 37% à celui de 1929. D'autres pays où l'économie de paix restait prédominante subissent violemment les contrecoups de la crise américaine, ainsi le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Bulgarie, l'Estonie, la Finlande, la Roumanie.
"Les achats pour les besoins d'armement -écrit sans méandres un rapport de la SDN en 1938- se sont accélérés précisément entre le milieu de 1937 et celui de 1938, c'est à dire pendant une période où la régression aux États-Unis et la demande des marchandises risquaient une dépression mondiale analogue à celle qui avait commencé en 1929" ( 18 [23] ).
Il n'y a aucun doute possible sur la nature de la reprise économique après la crise de 1929. Elle est due exclusivement à l'économie d'armement, c'est à dire à la production de moyens de destruction.
Ce type de production ne trouve un écoulement que dans la guerre. La guerre est la seule forme de rentabilisation des investissements militaires. La guerre éclata. Elle ouvrit des possibilités nouvelles aux puissances qui assuraient l'approvisionnement de la destruction, Ainsi le Canada connut dans le laps de temps que dura la guerre une croissance égale à celle de l'ensemble de ses 25 dernières années ! ( 19 [24] ) Les USA réalisèrent une croissance de 50% de leur production industrielle !( 20 [25] )
A la fin de la guerre, malgré les plus grandes destructions de l'histoire de l'humanité, la production mondiale n'avait pas diminué. Elle avait dépassé son niveau d'avant-guerre. Les USA avaient atteint un des plus forts taux de croissance de leur histoire. Mais ils avaient dû pour cela consacrer aux dépenses militaires non plus une partie secondaire de leur économie (en 1929, la part des dépenses militaires ne dépasse pas 1% du PNB) mais l'essentiel de leur capacité de production.
"Le secteur militaire de la production (américaine) ne représente pas comme durant la première guerre, une partie négligeable de l'effort économique, mais au moment de sa plus grande extension il atteignit presque l'importance que la production américaine toute entière avait eu à la "veille du conflit." ( 21 [26] )
-o-O-o-
Mais avant de voir de quelle façon cette nouvelle forme de "vie" du système va marquer la période qui suit la deuxième guerre mondiale, on peut se poser la question : Pourquoi l'économie d'armement a-t-elle permis au capitalisme de résoudre -au moins momentanément- les contradictions qui le paralysaient ? Est-ce parce qu'elle agit comme frein à la baisse tendancielle du taux de profit ? Est-ce parce qu'elle pallie à la tendance au rétrécissement des marchés ?
Sans aborder la discussion de fond entre la théorie de Rosa Luxembourg et celle de Grossman-Mattick au sujet des contradictions primordiales du système capitaliste, quelques remarques peuvent être dégagées de la réalité de cette période.
De façon générale, il est impossible de considérer séparément la baisse tendancielle du taux de profit et la tendance au rétrécissement des marchés :
- C'est la menace de la baisse du taux de profit qui force le capitalisme à développer en permanence l'accumulation du capital et donc à se procurer de nouveaux débouchés. L'accroissement du volume de la production- que seule l'acquisition de nouveaux débouchés peut permettre- constitue le principal facteur permettant de contrecarrer la baisse tendancielle de taux de profit.
- Simultanément, la tendance à la baisse du taux de profit a comme moteur fondamental l'élévation permanente de la technicité du capital (c'est à dire de sa composition organique). Or ce qui rend inéluctable cette élévation, est, en premier lieu, la concurrence mortelle entre les différentes fractions du capital pour le contrôle des marchés existants (la puissance d'un capital face à un autre devant un marché se mesure à sa capacité de vendre bon marché, c'est à dire de produire avec un degré de technicité plus élevé).
L'économie d'armement agit simultanément à ces deux niveaux de contradictions du capitalisme.
1° : elle agit sur le rétrécissement des débouchés en fournissant un nouveau marché -même provisoire- à la production. Ce débouché est d'autant plus intéressant que contrairement aux marchés fournis par les politiques de grands travaux : "Front Populaire", "autoroutes hitlériennes", "New Deal" etc..
- Il s'adresse à un secteur beaucoup plus large de l'économie (les besoins militaires concernent presque tous les domaines de la production).
- L'exigence d'un armement toujours plus puissant et sophistiqué stimule particulièrement les secteurs de pointe de l'industrie et en général ceux où la concentration du capital est la plus intense. (22 [27] )
- Enfin la production à des fins militaires a l'immense avantage de ne pas venir encombrer le marché de la production "civile".
2° : L'économie d'armement agit aussi directement sur la baisse tendancielle du taux de profit :
- Par le biais de l'accroissement des débouchés.
- Par l'augmentation du taux d'exploitation ( 23 [28] ), les salaires réels étant réduits par l'inflation (ou en temps de guerre par le rationnement et l'inflation) ; ( 24 [29] ) le temps de travail est prolongé (en temps de guerre les heures supplémentaires deviennent obligatoires et sous le mot de service civil on institue même des camps de travail ; ce que firent les USA dès 1933, ainsi que l'Autriche, l'Australie, le Canada, le Danemark, la Pologne, la Suisse, la Tchécoslovaquie et surtout l'URSS et l'Allemagne) ( 25 [30] ).
- Par l'accélération puissante qu'elle fournit au processus de concentration -et donc de rentabilisation- du capital. ( 26 [31] ).
Cependant, l'histoire de cette période montre à l'évidence que le capital le plus concentré du monde, avec les ouvriers les moins payés qui soient, ne peut en aucun cas développer sa production s'il ne trouve pas de débouchés pour l'écouler. Au cours de la grande dépression de 29-34 les salaires avaient connu aussi des baisses extraordinaires, et la concentration de capitaux (par le mouvement de sélection qu'imposent les crises) avait reçu un puissant coup de fouet. Il n'en demeurait pas moins que la production et les taux de profit continuaient de stagner ou de baisser.
C'est-à-dire que c'est au niveau de la vente de sa production (c'est-à-dire de la réalisation de la plus-value) que se concentre et s'exprime l'ensemble des contradictions inhérentes au capital.
C'est-à-dire aussi que c'est bien en son essence même, la marchandise (l'obligation de vendre), que le système a été mortellement blessé en 1914 par la réduction accélérée de ses possibilités d'expansion impérialiste.
Les chefs d'État qui ont eu à faire face à ce marasme ne se trompaient pas sur son origine, lorsqu'ils déclaraient tel Roosevelt peu avant l'entrée en guerre des USA : "Nous ne consommons pas tous les aliments que nous pouvons produire. Nous n'utilisons pas tout le pétrole que nous pouvons extraire, nous n'employons pas toutes les marchandises que nous pouvons fabriquer." ( 27 [32] )
Il est clair pour le premier responsable du capital mondial que le problème n'apparaît pas au niveau des conditions de la production (de la création de la plus-value) : "Nous pouvons produire...", "nous pouvons extraire…", "nous pouvons fabriquer..." mais au niveau des débouchés (de la réalisation de la plus-value) : "nous n'utilisons pas...", "nous n'employons pas…", "nous ne consommons pas...".
Hitler n'était pas moins lucide quand il lançait en février 1939, son fameux cri de guerre : "L'Allemagne doit exporter ou périr ! "
-o-O-o-
Nous avons vu comment -du fait qu'elle se fondait sur la reconstruction- la croissance du capitalisme d'après la deuxième guerre était une continuité du déclin qui avait précédé la guerre. Le maintien par le capitalisme au cours de cette période d'une production d'armement suffisamment importante pour constituer de fait un aiguillon fondamental de la croissance, représente une deuxième manifestation importante de cette continuité.
En effet, après la deuxième guerre les puissances capitalistes ne procédèrent pas à un désarmement complet. L'exacerbation toujours ininterrompue des antagonismes inter-impérialistes ne lui permet plus de le faire. Par des conflits localisés, avec la chair à canon des pays sous-développés -généralement par l'utilisation d'un quelconque mouvement de libération nationale- les grandes puissances n'ont jamais cessé de déchirer la planète en vue de se la partager et se la repartager. Le monde n'a pour ainsi dire jamais connu une période de paix totale depuis Hiroshima. Et la guerre, même localisée consomme une masse toujours croissante d'armes.
La deuxième guerre avait permis de réintégrer à l'exploitation capitaliste les 9 millions de chômeurs américains de 1939 ( 28 [33] ). La fin des hostilités provoqua en moins de trois ans aux USA, la réapparition de trois millions de chômeurs.
Cette croissance ininterrompue des besoins militaires permettra au capitalisme de résorber un chômage potentiel croissant.
"On peut dire que pendant l'exercice 1965, prés de six millions de personnes étaient employées d'une manière ou "d'une autre à la défense et que pendant l'exercice 1968 "ce chiffre atteignait presque huit millions" ! ( 29 [34] )
L'ampleur prise par cette gigantesque production d'armement peut être illustrée par le fait que "le monde a plus dépensé en armement depuis 10 ans que pendant toute la première moitié du siècle, deux guerres mondiales comprises" ! ( 30 [35] )
Si l'on se rappelle que la part du revenu national américain destinée à des fins militaires était inférieure à 1% en 1929 et que, avant 1913, le taux atteint par l'Allemagne à la veille de la guerre (4%) représentait un maximum sans précédent, on comprendra l'importance des taux conservés après la fin de la deuxième guerre.
Pourcentage des dépenses de défense dans le Produit ( 31 [36] ) National Brut
(Etats-Unis et Grande-Bretagne)
1950-51 1951-52 1952-53
1953-54 1954-55 1955-56
1956-57 1957-58
USA 7.6
13.4
14.5 13.0
11.2
10.3 9.8
10.2
GB 5.7 7.5 9.1 9.3 8.4 7.4 7.8 7.3
Pour la France, en ne comptant que les dépenses comptabilisées dans le budget annuel et les collectifs on a :
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
Fr. 5.9 8.5 10.3 10 8.9 7.9 8.2 8.1
En continuant à développer une production d'armement qui lui sert de béquille et trouvant dans le débouché militaire un aiguillon déterminant de sa croissance, le capitalisme continue à survivre des mêmes remèdes qu'avant la guerre.
Avec la reconstruction, on se trouve ici en présence des mêmes médicaments qui ont entretenu le système depuis 1914.
La façon dont l'État utilise ces moyens, l'intensité de cette utilisation, l'adresse avec laquelle elle est menée à bout, a évolué. Ils ont permis une plus grande efficacité des interventions de l'État sur la conjoncture immédiate.
Mais le contenu des "remèdes" est resté le même. La raison en est que la nature de la maladie n'a pas changé non plus : rétrécissement irréversible des champs d'extension du système, menace permanente de baisse du taux de profit, concurrence accrue entre les différentes fractions du capital mondial, exacerbation sourde des antagonismes de classe, utilisation incomplète du capital, instabilité des moyens d'échange ...
Tous ces symptômes économiques nés avec la première guerre mondiale et développés au cours de la crise 29-38, sont demeurés dans la période suivante en constante aggravation. La période du capitalisme après le deuxième guerre n'est qu'un moment dans le déroulement du nouveau cycle qui caractérise la vie générale du système depuis 1914, à savoir : crise-guerre-reconstruction.
La reconstruction est le moment le moins catastrophique de ce cycle ; il est celui où le capital peut le mieux dissimuler sa sénilité. La seconde période de reconstruction a été plus longue, plus spectaculaire et suivant une destruction plus intense que la première. Elle a joui de moyens de survie plus aiguisés. Le capitalisme en a tiré une prospérité suffisante, du moins dans les pays développés, pour faire oublier momentanément ce qu'il était devenu depuis la première guerre. Mais dès que cette prospérité relative menace de se ralentir, les vieilles plaies de la décadence momentanément dissimulées ressortent plus béantes que jamais.
La période contemporaine est la continuation logique du déclin qui l'a précédé. Elle n'a rien à voir avec une quelconque reprise de la phase ascendante du capitalisme. La manifestation économique principale de cet état de fait apparaît naturellement au niveau de développement des forces productives.
LE RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DES FORCES PRODUCTIVES DEPUIS LA SECONDE GUERRE MONDIALE
L'appréciation du rythme de développement des forces productives après la IIè guerre a été un des problèmes qui a provoqué la scission de la IVè Internationale en 1952. Pour la fraction "lambertiste" (AJS-OCI) la prémisse économique qui rend possible et nécessaire la révolution socialiste (c'est-à-dire celle qui définit la décadence du capitalisme) est l'arrêt total de la croissance des forces productives. Ils sont en cela fidèles à la lettre au programme de transition de Trotsky. Nous avons vu au début de cet article l'inconsistance de cette théorie du point de vue marxiste. Sa confrontation avec les chiffres de la période contemporaine ridiculise ses auteurs. Les lambertistes insistent sur la nature improductive de la production d'armements pour tenter de faire correspondre les statistiques à leurs vues. Mais même si le rôle de frein de la production d'armes est certain, il est statistiquement impossible de prétendre qu'elle ait paralysé ou "annulé" la croissance des forces productives depuis 1945.
Le dogmatisme borné de cette position est d'autant plus ridicule qu'il se heurte violemment à un autre dogme (programme de transition) cher à l'AJS-OCI : "L'URSS n'est pas capitaliste - elle est un État ouvrier dégénéré". Les forces productives s'y développeraient donc beaucoup plus rapidement que dans les États capitalistes. Or la Russie dédie à l'armement une part de sa production très supérieure à celle des plus grandes puissances occidentales.
Pour les trotskystes de la IVè Internationale officielle (Ligue Communiste) la décadence ne se définit pas par "le verrouillage" de la croissance des forces productives, mais par le ralentissement de cette croissance sous le poids des rapports de production. Ils sont en cela fidèles à "la lettre" de Marx. Mais si on gratte un tant soit peu leurs conceptions, on retrouve un rafistolage théorique bâti en fonction de dogmes aussi contradictoires que ceux de l'OCI
Dans une brochure intitulée "Qu'est-ce que l'AJS", Weber, théoricien de la IVè Internationale, s'attache à tenter de critiquer les "théories absurdes et les contorsions grotesques des lambertistes" sur cette question ( 32 [37] ).
Pour résoudre la contradiction avec le dogme des "États ouvriers dégénérés" -car la Ligue pense aussi qu'il y a toute une quantité de pays dans le monde qui ne sont pas capitalistes- Weber attribue un caractère productif à la production d'armement. Pour répondre au problème de la formulation de Trotsky sur les prémisses du socialisme et l'arrêt de la croissance des forces productives, Weber explique que Trotsky ne faisait que "décrire la réalité qu'il avait sous les yeux en 1938".
Quant à la question de définir les caractéristiques, le contenu du ralentissement qui caractérise les périodes de décadence, on ne trouve pas non plus quelque chose de très précis. On nous parle de "néocapitalisme" qui commence au lendemain de la IIè Guerre Mondiale et qui se caractérise par "une expansion économique sans précédent".
On nous dit que "la crise générale du capitalisme est ouverte par la première guerre". On nous dit aussi que "c'est en 1848, il y a 120 ans, que Marx dénonce les rapports de production capitaliste comme entraves au développement des forces productives. C'est en 1848 qu'il déclare 'régressif et réactionnaire' le mode capitaliste de production" ( 33 [38]). Et on nous rappelle les phrases du Manifeste Communiste :
"Depuis des dizaines d'années, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est autre chose que l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production..."
"...Il est donc manifeste que la bourgeoisie est incapable de renforcer plus longtemps son rôle de classe dirigeante et d'imposer à la société, comme loi suprême, les conditions d'existence de sa classe".
Ce morceau est cité par Weber pour se poser la question "est-ce à dire que Marx et Engels se sont trompés ?". Réponse : C'est ce que devrait conclure sans hésiter tout lambertiste qui prend un peu ses propres thèses au sérieux. Si la contradiction entre le développement des forces productives et le maintien des rapports capitalistes de production se traduit par le blocage pur et simple des forces productives, alors Marx et Engels se sont trompés, non seulement en 1848, mais toute leur vie puisque, selon les lambertistes, la stagnation des forces productives commence en 1914 ! On ébauche alors une réponse confuse : "Mais la théorie lambertiste du verrouillage des forces productives est étrangère au marxisme...".
Par contre, si vous avez la conception de Weber, Marx et Engels ne se sont pas trompés. Ainsi, après celle de Trotsky, voilà l'infaillibilité de Marx et Engels sauvée, dans la tête de Weber. Le dogme des différentes infaillibilités est respecté. Mais du coup, on se retrouve simultanément en pleine décadence du capitalisme en 1848 ; au début seulement de "la crise générale du capitalisme" en 1914, et en pleine expansion victorieuse du "Néo-capitalisme" en 1960 ! La rupture se situe-t-elle "des dizaines d'années avant 1848 ?", "il y a 120 ans" en 1848 ? en 1914 ? Ou en 1945, au début du soi-disant "néo-capitalisme" ? Quand est-ce que s'ouvre cette fameuse "époque de révolution sociale" dont parle Marx ?
On aura du mal à trouver une réponse cohérente dans ce lamentable rafistolage "théorique" élaboré en fin de compte uniquement pour sauver quelques dogmes organisationnels et justifier le caractère "progressiste" de tous les mouvements bureaucratiques du Tiers-monde, la nature "anti-impérialiste" des puissances de Pékin et Moscou, et toutes sortes de syndicalismes "critiques", d'électoralismes pédagogiques et de réformismes "transitoires".
De toutes façons, dans la vision des léninistes de "Que faire ?", tous ces problèmes économiques de caractérisation des périodes historiques etc., ont peu d'importance, puisque ces "scientifiques" peuvent être réellement convaincus que le seul vrai problème est celui de la direction révolutionnaire : "La crise historique de l'humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire" (Trotsky, 1938).
De tous ces rapiéçages théoriques qui servent de couverture aux différentes variétés trotskystes, il y a peu de choses à tirer, si ce n'est la nécessité de se tenir à une définition sérieuse de ce qu'on entend par ralentissement de la croissance des forces productives.
Nous avons dit précédemment que ce ralentissement devait, pour être significatif d'une période de décadence :
- résulter spécifiquement de l'étroitesse des rapports de production ;
- avoir un caractère irréversible et inévitable ;
- provoquer un écart toujours croissant entre le développement effectivement réalisé des forces productives et celui qui serait possible en l'absence des entraves constituées par les rapports de production dominants.
Au moment où Marx et Engels écrivaient le Manifeste Communiste, il y avait bien des ralentissements périodiques de la croissance par des crises cycliques. Au cours de ces crises, on voyait bien jaillir déjà des contradictions fondamentales du capitalisme. Mais ces "révoltes des forces productives modernes contre les rapports modernes de production n'étaient que des révoltes de jeunesse. L'aboutissement de ces explosions régulières n'était autre que le renforcement du système qui, dans une ascension fulgurante, se débarrassait de ses habits d'enfance et des dernières contraintes féodales qu'il trouvait sur son chemin. En 1850, seulement 10% de la population mondiale est intégrée aux rapports de production capitalistes. Le système du salariat a tout un avenir devant lui. Marx et Engels ont eu la géniale perspicacité de dégager dans les crises de croissance du capitalisme l'essence de toutes ses crises et d'annoncer ainsi à l'histoire future les fondements de ses convulsions les plus profondes. S'ils ont pu le faire, c'est parce que, dès sa naissance, une forme sociale porte en elle, en germe, toutes les contradictions qui l'amèneront à sa mort. Mais tant que ces contradictions ne sont pas développées au point d'entraver de façon permanente sa croissance, elles constituent le moteur même de cette croissance. Les ralentissements que connaît par à-coups l'économie capitaliste au XIXè siècle n'ont rien à voir avec ces entraves permanentes et croissantes. Tout au contraire, l'intensité de ces crises est allée en s'adoucissant au fur et à mesure de leur répétition. Marx et Engels se sont radicalement trompés dans leur analyse de 1848 (Marx dans "Les luttes de classe en France" ainsi qu'Engels dans l'introduction qu'il fit à ce texte plus tard, n'ont d'ailleurs par craint de le reconnaître).
Beaucoup plus lucide fut l'analyse faite par Rosa Luxembourg en 1898 ("Réforme ou Révolution") :
"... Les crises telles que nous les avons connues jusqu'à présent (revêtent) elles aussi en quelque sorte le caractère de crises juvéniles. Nous n'en sommes pas parvenus pour autant au degré d'élaboration et d'épuisement du marché mondial qui pourrait provoquer l'assaut fatal et périodique des forces productives contre les barrières des marchés, assaut qui constituerait le type même de la crise de sénilité du capitalisme... Une fois le marché mondial élaboré et constitué dans ses grandes lignes et tel qu'il ne peut plus s'agrandir au moyen de brusques poussées expansionnistes la productivité du travail continuera à s'accroître d'une manière irrésistible ; c'est alors que débutera, à plus ou moins brève échéance, l'assaut périodique des forces de production contre les barrières qui endiguent les échanges, assaut que sa répétition même rendra de plus en plus rude et impérieux".
Lorsque s'ouvre la période de reconstruction de la IIè guerre mondiale, il y a déjà longtemps que le capitalisme "ne peut plus s'agrandir au moyen de brusques poussées expansionnistes". Depuis des décades, la productivité du travail s'accroît trop vite pour être contenue dans les rapports de production capitaliste. Il y a déjà trente ans que les assauts répétés et de plus en plus violents des forces productives contre "les barrières qui endiguent leur développement" ravagent sauvagement la société entière.
Il n'y a que la misère et la barbarie de ces années de dépression croissante qui peuvent expliquer l'éblouissement général provoqué par le développement économique qui s'annonce avec la reconstruction. Car, de quelque façon qu'on l'envisage, ce "développement" constitue en fait le plus grand ralentissement que la croissance des forces productives de l'humanité ait connu jusqu'à présent. Jamais auparavant le contraste entre ce qui est possible et ce qui est effectivement réalisé n'atteint de telles proportions. Jamais "la suite du développement n'apparut à ce point comme un déclin". (Marx)
Pour rendre compte de l'ampleur de ce ralentissement, plusieurs problèmes peuvent se poser : faut-il ou non inclure dans le volume de la production effectivement réalisée, la part destinée aux armes alors qu'il s'agit d'exprimer le développement des forces productives ? De quelle façon peut-on déterminer le niveau de production "qui aurait été possible" ? Faut-il comparer les niveaux effectivement réalisés à ceux qui auraient été atteints si la croissance s'était poursuivie selon les taux de la phase ascendante du système ? Et ceci en faisant partir la croissance de 1913 ou de 1945 ? Faut-il au contraire déterminer les taux qui seraient possibles en fonction des techniques existantes sur le moment ? Faut-il considérer que les forces productives "livrées à elles-mêmes" se développeraient suivant des taux croissants ou constants ?
Nous allons comparer :
1° : la production industrielle mondiale effectivement réalisée de 1913 à 1959 (production d'armes comprise) avec celle qui se serait produite si à partir de 1913 la croissance industrielle s'était poursuivie au même rythme qu'elle atteignait au cours de la décade 1880-1890 ( 34 [39] ) (Ceci en supposant que ce développement se serait fait à un taux constant. Dans la réalité, ce taux ayant eu plutôt tendance à augmenter sous l'influence de l'accroissement de la productivité.)
2° : la période qui nous intéresse est celle qui commence au lendemain de la guerre. La comparaison avec la croissance hypothétique définie dans le premier cas pourrait être complétée par une comparaison avec une croissance des nouveaux taux rendus possibles par le développement des techniques à l'époque du IIè conflit. Pour avoir une idée plus précise de la puissance du ralentissement, nous ferons partir cette croissance hypothétique du lendemain, même de la guerre en 1946.
Pour cette comparaison nous avons pris comme taux de croissance, comme repère estimé possible à la suite de la IIè guerre (si les rapports de production capitaliste n'avaient pas entravé le développement), celui qui fut atteint par la production industrielle des USA entre 1939 et 1944 : la guerre avait ouvert à l'économie américaine des débouchés suffisamment importants pour lui permettre de libérer son appareil productif au maximum de sa puissance. C'est toutefois un taux limité par le fait que l'immense accroissement de la production eut pour objet un type de production qui ne pouvait pas être réintégré à la production pour accélérer à son tour la croissance : les armes. En outre, ce taux se réalise aux USA au même moment où les autres puissances sont ravagées : la croissance de l'économie américaine ne peut donc jouir de l'accélération technique que fournit la collaboration internationale. Nous le retenons parce qu'il a cependant -tout comme le taux-repère précédent- la vertu d'avoir été effectivement réalisé à un moment donné, et qu'il fournit donc une appréciation des capacités techniques réellement acquises par la société.
L'indice de la production industrielle des USA passe de 109 à 235 entre 1939 et 1944 (100=1938), soit 110% d'accroissement en 5 ans. (voir Graphique ci-dessous ).
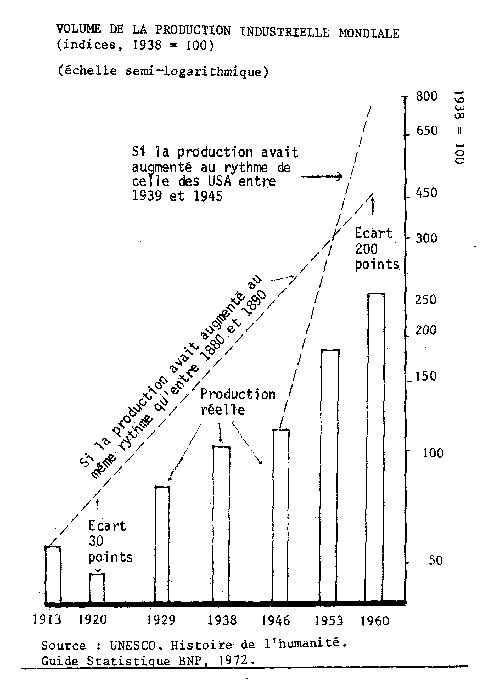
On voit apparaître sur le graphique des écarts qui, aussi bien dans un cas que dans l'autre, se creusent à une vitesse croissante.
Ce graphique n'est que très approximatif et donne une image probablement inférieure à celle des freinages effectivement exercés. Il donne cependant une idée claire de l'ampleur sans précédent de ces freinages, de leur caractère irréversible et inéluctable, ainsi que de leur accroissement ininterrompu. Les périodes au cours desquelles les écarts ralentissent leur croissance correspondent à celles de réarmement ou de reconstruction. Leur caractère de palliatif provisoire ressort nettement.
RI N°4, juin 1973
_________________
"AU DELA D'UN CERTAIN POINT, LE DÉVELOPPEMENT DES FORCES PRODUCTIVES DEVIENT UNE BARRIÈRE POUR LE CAPITAL ; EN D'AUTRES TERMES, LE SYSTÈME CAPITALISTE DEVIENT UN OBSTACLE POUR L'EXPANSION
DES FORCES PRODUCTIVES DU TRAVAIL. ARRIVÉ A CE POINT, LE CAPITAL, OU PLUS EXACTEMENT LE TRAVAIL SALARIÉ, ENTRE DANS LE MÊME RAPPORT AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE LA RICHESSE SOCIALE ET DES FORCES PRODUCTIVES QUE LE SYSTÈME DES CORPORATIONS, LE SERVAGE, L'ESCLAVAGE, ET IL EST NÉCESSAIREMENT REJETÉ COMME UNE "ENTRAVE. LA DERNIÈRE FORME DE LA SERVITUDE QUE PREND L'ACTIVITÉ HUMAINE TRAVAIL SALARIE D'UN CÔTE, ET CAPITAL DE L'AUTRE EST ALORS DÉPOUILLÉE, ET CE DÉPOUILLEMENT LUI-MÊME EST LE RÉSULTAT DU MODE DE PRODUCTION QUI CORRESPOND AU CAPITAL. EUX-MËNES, NÉGATION DES FORMES ANTÉRIEURES DE LA PRODUCTION SOCIALE ASSERVIE, LE TRAVAIL SALARIE ET LE CAPITAL SONT A LEUR TOUR NIÉS PAR LES CONDITIONS MATÉRIELLES ET SPIRITUELLES ISSUES DE LEUR PROPRE PROCESSUS DE PRODUCTION".
Karl Marx, Principes d'une critique de l'économie politique
_____________________________________
1 [40] FRITZ STERNBERG "Le conflit du siècle", page 24 (éditions le Seuil, collection "Esprit")
2 [41] "Le conflit du siècle", page 75.
3 [42] "Le conflit du siècle", p. 308.
4 [43] "Le conflit du siècle", p. 292.
5 [44] "Le conflit du siècle", p. 273 à 275.
6 [45] "Le conflit du siècle", p. 117 et 118.
7 [46] "Le conflit du siècle", p. 117 et 118.
8 [47] INSEE, Tableaux de l'économie française, 1970.
9 [48] "Le conflit du siècle", p. 560
10 [49] P,Bairoch, Diagnostic de l'évolution du Tiers-Monde, cité par "Guide statistique 1972" B.N.P.
11 [50] "Le conflit du siècle", p. 166
12 [51] Estimation pour 1956, "Le conflit du siècle", p.547.
13 [52] "Le conflit du siècle", p. 548.
14 [53] "Le conflit du siècle", p. 550.
15 [54] Henri Claude, "De la crise économique à la guerre mondiale" page 65, Editions Sociales 1947.
16 [55] Henri Claude, "De la crise économique à la guerre mondiale" page 70, Editions Sociales 1947.
17 [56] Henri Claude, "De la crise économique à la guerre mondiale" page 71, Editions Sociales 1947.
18 [57] SDN "Aperçu général du commerce mondial", 1938, page 30, cité par Henri Claude
19 [58] Henri Claude, "De la crise économique à la guerre mondiale" page 214, Editions Sociales 1947.
20 [59] "Le conflit du siècle", page 562.
21 [60] "Le conflit du siècle", page 569.
22 [61] Par exemple, en 1962 les dépenses militaires américaines en avions, missiles, matériel électronique et équipement de télécommunications absorbent 75% des dépenses militaires totales de l'Etat. Les navires, l'artillerie, les véhicules et les équipements connexes (plus "divers"), ce qui fut un temps l'essentiel des forces armées, se partagent les 25% restants.
23 [62] Ce facteur apparaît dans toute son importance si on exprime le taux de profit général sous la forme::
P1/(C+V) = (P1/V)/(1+C/V)
P1/V étant la définition du taux d'exploitation (ou de plus value).
24 [63] II semble incontestable qu'aux USA les salaires réels aient augmenté au cours de la deuxième guerre, fait probablement lié à la non-intégration du territoire américain à la guerre. Mais le gouvernement américain ne manque pas moins d'offrir aux travailleurs la fameuse "alternative" de Goering -résolue toujours d'avance- : "Du beurre ou des canons": au cours de la guerre la production de biens de consommation "durables" fut interdite.
25 [64] Henri Claude, "De la crise économique à la guerre mondiale" page 61, Editions Sociales 1947.
26 [65] En 1945, cette concentration avait fait de tels progrès aux USA que l'on pouvait estimer (Sternberg) que les 250 plus grandes entreprises produisaient l'équivalent des 75000 entreprises industrielles d'avant le conflit!!
27 [66] Discours du 28 mai 1941.
28 [67] 9,48 millions de chômeurs en 1939, 670000 en 1944 et 3,395 millions en 1949 (Rapport économique du président, 1950).
29 [68] ONU, 26ème session de l'assemblée générale -réponse des USA au questionnaire de l'ONU sur "les conséquences économiques et sociales de la course aux armements..." 1972, page 48.
30 [69] "L'express" du 22-5-1972
31 [70] F.Perroux "Guerre ou partage du pain", tome III, page 495.
32 [71] "Qu'est ce que l'AJS", cahiers rouges, rérie "Marx ou crève" (sic), pages 12 à 35.
33 [72] "Qu'est ce que l'AJS", idem, page 30.
34 [73] De 1880 à 1890, l'indice de la production industrielle est multiplié par 1,6 ("Le conflit du siècle", page 14)
Questions théoriques:
- Décadence [3]
Heritage de la Gauche Communiste:
Les crises de la période de décadence
- 4979 reads
Après le ralentissement de la croissance des forces productives, il nous faut voir si l'on retrouve dans le capitalisme depuis 1914 et surtout depuis 1945, cette condamnation aux crises de plus en plus intenses et étendues (la seconde caractéristique de la décadence économique d'une société). Ceci nous amènera à analyser la question de la production militaire et, à travers elle, le problème plus général du travail improductif.
De 1914 à 1946, le tableau des crises offert par le capitalisme se passe de commentaires : deux guerres mondiales et une dépression comme celle de 1929, en moins de trente ans, c'est une série éloquente en elle-même.
Deux remarques peuvent cependant paraître utiles :
- Du fait qu'elle fut une crise économique au sens le plus traditionnel du terme, la dépression de 1929-34 est souvent citée comme "LA" crise du capitalisme moderne. Mais les deux guerres mondiales ont constitué des crises non moins profondes du système. Tout comme la dépression économique de l'entre-deux-guerres, les conflits mondiaux ont exprimé de la façon la plus brutale L'IMPUISSANCE DES RAPPORTS CAPITALISTES A CONTINUER DE SE REPRODUIRE NORMALEMENT. Les crises économiques "pures" éliminent les capitaux excédentaires par la faillite, les guerres par la destruction physique et la violence armée. Mais dans les deux cas, le contenu est le même : LE CAPITAL EST CONTRAINT DE S'AUTODÉTRUIRE SOUS LA PRESSION DES CONTRADICTIONS DE SON PROPRE MODE DE FONCTIONNEMENT. Dans les deux cas, le système connaît des convulsions où éclate violemment l'inadaptation définitive des rapports de production dominants aux besoins et aux possibilités de la société. Dans le monde dominé par le capital, il n'est rien qui ne soit économique : ces "crises politiques internationales" que sont les guerres mondiales, loin de constituer des phénomènes extra-économiques n'ont été que la manifestation barbare des crises économiques les plus profondes.
- Contrairement aux crises de la phase ascendante du capitalisme, les convulsions du capitalisme décadent connaissent un mouvement général et accentué d'aggravation systématique. Il y a dans ce fait la preuve même de leur différence de nature. La crise de 1929 a entraîné une chute de la production supérieure à celle causée par la première guerre mondiale ; la deuxième guerre a été beaucoup plus destructrice que la première et a provoqué un désastre sans comparaison possible avec 1929.
Cette progression en intensité traduit le caractère irréversible d'un mouvement général de déclin.
-o-O-o-
De 1914 à la fin de la IIème guerre, l'importance et la signification de ces convulsions paraissaient de plus en plus évidentes. Mais l'absence de crise sérieuse au cours des 20 années qui ont suivi a suffi à beaucoup pour croire à la disparition définitive des crises du capitalisme et, par voie de conséquence, pour reléguer les crises de la période précédente dans le paradis des "crises de croissance".
Et pourtant, au lendemain de la IIème guerre, le capitalisme repart sur des bases aussi viciées que celles qui l'y avaient amené : l'expansion économique dépend plus que jamais de deux béquilles (entre autres) qui viennent de démontrer leur incapacité à plus ou moins long terme :
1- les mécanismes de "reconstruction" ;
2- la production à des fins militaires.
Certes, les destructions ont été beaucoup plus étendues cette fois ci et la reconstruction pourra se prolonger plus longtemps ; la guerre est devenue permanente au travers des conflits locaux constamment entretenus et la production de matériel de guerre a pris en temps de "paix" des proportions supérieures à celles des temps de conflagration mondiale. L'État a appris à mieux affronter les effets des contradictions internes qui minent toujours plus le système dont il tend progressivement à devenir le véritable gérant. Bref, le capital se lance dans une nouvelle étape de son déclin avec une panoplie de palliatifs particulièrement efficaces ... mais la nature de palliatif de ces moyens n'est démentie à aucun moment.
LES LIMITES DE LA RECONSTRUCTION
Ce point a été longuement aborde dans l'article "la crise" paru dans les N° 6 et 7 de R.I. (ancienne série). Il serait inutile de répéter ici ce qui se trouve clairement étayé dans cet article. En y renvoyant le lecteur, nous nous contenterons ici de rappeler quelques uns des principaux phénomènes économiques qui, depuis la deuxième moitié des années 60, expriment de manière inéquivoque les limites de ce palliatif. L'achèvement de la reconstruction des pays européens et du Japon autour de l'année 65 provoque des bouleversements profonds dans les circuits économiques internationaux qui président à "l'expansion" capitaliste depuis la guerre. Tous les systèmes de change internationaux entrent en crise. L'agressivité commerciale des anciens débouchés de l'industrie américaine devient le sujet de préoccupation primordiale la conjoncture économique. Les États Unis connaissent en 1967 un déficit de leur balance commerciale pour la première fois depuis 1893. Bref, ce qui avait permis la vie du système depuis des décades arrive à épuisement, sans que nulle part n'apparaisse une éventuelle solution de rechange. Le cycle sur lequel se "développe" le capitalisme depuis son entrée en déclin (crise guerre reconstruction) arrive à nouveau a une échéance fatale: la fin de la reconstruction.
LES LIMITES DU STIMULANT ÉCONOMIQUE MILITAIRE
Nous avons vu précédemment les "vertus" du débouché constitué par les besoins militaires ainsi que l'importance de ce facteur dans l'économie capitaliste depuis la seconde guerre. Les limites de ce type de débouché reconnu communément comme un des principaux "aiguillons de l'expansion capitaliste" à notre époque, doivent être analysées si l'on veut comprendre le fondement de l'inévitabilité de l'actuelle crise aiguë du système. Nous nous attarderons particulièrement sur ce sujet non seulement parce qu'il constitue une partie de la réponse au problème des crises de la décadence du capitalisme, mais aussi parce qu'il est une des illustrations les plus spectaculaires d'un phénomène particulièrement significatif de cette décadence : le développement vertigineux des secteurs improductifs aux dépens du secteur productif.
La confusion générale qui règne à propos de la nature de la production militaire n'est pas étrangère à notre souci de tenter de clarifier le problème : il n'est en effet pas rare d'entendre des "marxistes" prétendre que toute distinction entre des productions telles que celle d'armement et des productions aboutissant à des moyens de production ou de subsistance, correspond à des "critères éthiques" totalement étrangers aux critères économiques marxistes ( 1 [74] ).
L'ARMEMENT : UNE PERTE SÈCHE POUR LE CAPITAL GLOBAL
Le capital ne vit que pour et par son auto-valorisation, c'est a dire ce processus qui part de l'exploitation du travail vivant -extraction de la plus value- et aboutit à l'accroissement du capital grâce à la transformation d'une part de cette plus value en nouveau capital.
Le capital n'est pas synonyme de richesse accumulée même s'il est aussi cela. Sa caractéristique spécifique réside l° : dans sa capacité à extirper du surtravail et 2° : dans le but de cette exploitation : l'accroissement du capital.
Or, les armes ont cette particularité majeure de posséder une valeur d'usage qui ne leur permet en aucun cas d'entrer sous quelque forme que ce soit dans le processus de production. Une machine à laver peut servir à reconstituer la force de travail, tout comme du pain ou des chemises. Par le contenu de leur valeur d'usage, ces biens peuvent servir comme capital sous la forme de capital variable. Un ordinateur, une tonne de fer ou une machine à vapeur, en tant qu'ils sont des moyens ou des objets de travail peuvent fonctionner comme capital sous forme de capital constant. Mais des armes ne peuvent que détruire ou rouiller.
Prenons l'exemple de Marcel Dassault, un des premiers producteurs d'armes du monde, qui vend des armes à des pays étrangers et à l'État français. Considérons d'abord le premier cas : par exemple la vente de Mirage au Pérou. Dassault reçoit en contrepartie une somme d'argent dont il pourra se servir pour remplacer le capital dépensé et accroître le capital de son entreprise, en achetant de nouvelles machines, et de nouvelles quantités de forces de travail. Pour le capital Dassault, c'est une affaire normale, productive. Pour le capital français il en est de même.
Qu'en est-il pour le capital péruvien ? Pour se procurer l'argent nécessaire à l'achat de ces Mirage, le Pérou a du -par exemple- vendre pour une valeur équivalente de farine de poisson. Cette valeur, il aurait pu l'employer à accroître son propre pouvoir d'exploitation, son capital (des usines de farine ou des bateaux de pêche ...). Au lieu de cela, il la transforme en bombardiers supersoniques. Ceux-ci rempliront éventuellement de fierté la clique militaire "progressiste" au pouvoir, mais le capital national ne pourra en tirer les moyens d'extraire un sous de plus-value (à moins de monter une compagnie de transport civil ce qui est peu rentable). Pour le capital péruvien, cette opération se solde donc par une DESTRUCTION DE CAPITAL.
Pour le capital MONDIAL, la nature improductive des armes n'a pas disparue : elle s'est tout simplement déplacée d'un point de la sphère à un autre. Quels que soient les échanges réalisés, il n'en demeure pas moins que, quelque part dans le monde, du travail productif a été stérilisé pour le développement du capital. L'endroit où se fait sentir le poids de cette improductivité ne change rien au problème : ce n'est pas parce que les armes passent une frontière qu'elles transforment leur nature vis-à-vis du capital global.
Considérons maintenant le deuxième cas : Dassault vend ses Mirage à l'État français. Pour le marchand de canons, l'opération est toujours aussi rentable et productive pour son capital. Mais pour le capital français global, elle ne l'est plus. Que ce soit par des impôts sur le capital, le revenu, ou des taxes indirectes, c'est toujours de la plus-value extraite au travail vivant que l'État, client de Dassault, prend pour acheter ses Mirage. Pour le capital national, c'est là de la plus-value gaspillée. Aussi, à chaque fois qu'il consacre, en gaspillant cette plus-value, une partie du travail à la production d'armes pour sa propre consommation, c'est autant de plus-value qui ne valorisera pas le capital, qui sera consommée improductivement.
LE CONCEPT DE CAPITAL GLOBAL
Il est commun d'opposer à cette analyse l'idée selon laquelle le concept de capital global est une pure abstraction, sans existence réelle qui ne peut être utilisé dans une argumentation concernant le problème de la rentabilité d'un type de production. Selon cet argument, chaque capitaliste ou nation se soucie bien peu du "capital global". Il serait par conséquent absurde de vouloir définir une totalité économique à partir d'une somme d'entités antagonistes.
Le fait que le capital, comme globalité, ne vive que sous la forme divisée n'implique pas qu'il n'existe pas. L'ensemble des voleurs d'une ville vit en constante concurrence les uns par rapport aux autres et la loi de leur milieu n'est que celle du plus fort. Il n'en demeure pas moins que cet ensemble existe en lui-même, qu'il a des intérêts propres (par exemple face à la police). Le fait qu'il ne puisse exister pour lui-même, c'est à dire avec une conscience collective et unifiée de ses intérêts et agissant en fonction d'eux, ne change rien au problème. Le capital global est toujours une somme de capitaux antagonistes. Il n'en existe pas moins avec des lois générales qui agissent à son niveau uniquement, avec des phénomènes propres (guerres mondiales, crises mondiales) qui s'imposent à chacune de ses fractions et sur lesquels aucune fraction n'a de prise réelle.
Dans le capitalisme, la domination du capital s'est depuis longtemps étendue à l'ensemble de la planète. N'importe quelle marchandise peut contenir aujourd'hui du travail et des matières premières des quatre coins du monde. Dans un tel état de choses, c'est d'abord la réalité du capital global qui détermine la réalité de chacune de ses parties et non l'inverse.
La production militaire massive est un phénomène qui, par son origine, son déroulement et ses effets, concerne l'économie capitaliste mondiale. Vouloir juger sa nature en dehors du concept de capital global, c'est tout simplement renoncer à l'analyse.
Pour analyser le problème de la reproduction du capital, Marx n'hésite pas à se situer sur ce terrain :
"Pour débarrasser l'analyse générale d'incidents inutiles, il faut considérer le monde commerçant comme une seule nation." (Livre 1 du Capital)
Cela n'a rien à voir avec une soi-disant théorie de l'ultra-impérialisme. C'est la prise en considération du seul terrain OBJECTIF où peuvent prendre tout leur sens les phénomènes fondamentaux du capitalisme développé.
Certains cependant, acceptent le concept de capital global (qui peut s'appliquer au niveau mondial comme au niveau national -capital national), sans pour cela croire à la possibilité d'une production qui soit simultanément rentable pour un capitaliste -ou une fraction du capital global- et ne le soit pas pour le capital global. C'est l'objection qui pourrait être formulée par la boutade américaine : "Ce qui est bon pour la General Motors est bon pour les États-Unis". On s'imagine que si la production militaire est productive pour un capitaliste, elle l'est aussi pour le capital global.
Tout comme dans le cas de l'objection précédente, ici encore la RÉALITÉ CONTRADICTOIRE du capital est ignorée. La contradiction fondamentale du système capitaliste, celle qui sous-tend toutes ses contradictions, c'est celle qui oppose le caractère de plus en plus universel, socialisé du processus de production aux rapports de propriété privée, parcellaire selon lesquels il est réalisé. Dans la première vision, seul l'aspect parcellaire, divisé du capital est pris en considération, la globalité du capital étant ignorée. Ici, ce sont les antagonismes inévitables entre capitaux qui sont laissés de côté, pour faire place à une vision harmonieuse d'un capital global sans contradictions entre ses parties et le tout. Les conditions dans lesquelles un capitaliste particulier réalise son profit sont évidemment liées à long terme à celle de l'ensemble du capital. Mais il peut arriver que ce lien se distende temporairement au point de faire apparaître "ce qui est mauvais" pour les USA comme ce" qui est bon pour la General Motors" ! (L'exemple classique est celui du capitaliste producteur de biens de consommation nécessaires à la classe ouvrière : toute augmentation générale des salaires est, pour lui, condition supplémentaire de réalisation (marché), alors qu'elle constitue une menace pour le taux de profit pour l'ensemble du capital).
L'inévitable disharmonie qui règne dans le système de propriété privée ne peut que s'accroître avec le déclin du système. Aussi cette phase connaît-elle le développement de l'intervention de l'État en vue de pallier par une centralisation forcée aux tendances de plus en plus puissantes à la désagrégation.
Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'un même critère de rentabilité, dans le système capitaliste, donne des résultats différents selon qu'il est appliqué à un capitaliste particulier ou au capital global.
Il nous faudra expliquer pourquoi et comment c'est l'État, représentant du capital national, qui entretient le capitaliste marchand de canons, alors que la production de ce dernier est "improductive" pour le capital national (nous laissons de côté la possibilité de reporter les frais sur un autre État). Et en premier lieu, il est nécessaire de définir de façon précise le critère marxiste de "productivité" et d'"improductivité'' d'une industrie.
TRAVAIL PRODUCTIF ET TRAVAIL IMPRODUCTIF
La réponse de Marx peut être résumée par la fameuse formule : "EST PRODUCTIF LE TRAVAIL QUI CRÉE DIRECTEMENT DE LA PLUS-VALUE, CEST A DIRE QUI VALORISE LE CAPITAL" ( 2 [75] ) Cette formulation est spécifique au mode de production capitaliste. Elle est distincte de celle qui s'applique "à la question du travail productif en général", lorsqu'on étudie "le procès de travail, sous son aspect le plus simple, commun à toutes ses formes historiques, comme acte qui se passe entre l'homme et la nature" ( 3 [76] )
De ce point de vue général, historiquement, est productif tout travail du moment qu'il aboutit à un produit et que ce produit correspond à un besoin humain quelconque.
"Dans le processus de travail, l'activité de l'homme effectue, à l'aide des moyens de travail, une modification voulue de son objet. Le processus s'éteint dans le produit, c'est à dire dans une valeur d'usage, une matière assimilée aux besoins humains par un changement de forme. Le travail, en se combinant avec son objet, s'est matérialisé et la matière est travaillée. Ce qui était mouvement chez le travailleur apparaît maintenant dans le produit comme une propriété en repos. L'ouvrier a tissé et le produit est un tissu.
Si l'on considère l'ensemble de ce mouvement du point de vue de son résultat, du produit, alors tous les deux, moyen et objet de travail se présentent comme moyens de production, et le travail lui même comme travail productif." ( 4 [77] )
Ceci dit, Marx explique :
"Cette détermination du travail productif devient tout à fait insuffisante dès qu'il s'agit de la production capitaliste". (nous soulignons)
Le processus productif prend sous le capitalisme des formes spécifiques qui ne permettent plus de se contenter de cette formulation, quasiment tautologique. Il y a deux raisons :
l- : La première apparaît du point de vue du travail face au capital. Dans le capitalisme, la force de travail est achetée par le capital dont elle semble devenir une partie intégrante. Cette force ne peut affirmer sa capacité productive qu'en restituant au capital une somme de valeur supérieure à celle qu'elle en reçoit (salaire). Pour être productif comme travail vivant et non comme simple partie du capital, il ne suffit plus que le travail produise n'importe quelle valeur dans n'importe quelle quantité : il faut qu'il crée une "survaleur", une PLUS-VALUE.
2- : La deuxième raison apparaît du point de vue du capital face au travail vivant. Le but du capital n'est pas de satisfaire des besoins, mais de produire du profit, de la plus-value. Cela n'élimine pas la détermination primitive du travail productif, dans la mesure où le capitalisme produit des marchandises, donc des valeurs d'usage. Mais cette détermination devient "insuffisante". La valeur d'usage n'est plus comme dans les systèmes passés le fondement de la production... elle ne demeure que comme un pis-aller, un soutien nécessaire de la valeur d'échange, mais dont le contenu spécifique est indifférent au capitaliste.
Aussi ne suffit-il pas, pour le capitaliste, que le travail qu'il achète se concrétise dans une valeur d'usage quelconque : il faut qu'il VALORISE SON CAPITAL.
"La plus-value, produit spécifique du processus de la production capitaliste, est crée uniquement grâce à l'échange avec le travail productif. Ce qui en constitue la valeur d'usage spécifique pour le capital, ce n'est pas son caractère utile bien déterminé, pas plus que les quantités utiles particulières du produit dans lequel il se matérialise, mais son caractère d'élément créateur de la valeur d'échange (plus-value)." ( 5 [78] )
"Seul est productif le travail dont le processus s'identifie avec le processus productif de consommation de la force de travail par le capital ou le capitaliste." ( 6 [79] )
Bref, la spécificité de la détermination du travail productif en capitalisme diffère de la détermination générale valable pour les systèmes passés du fait de la différence qu'introduit ce système au niveau du "processus productif de la consommation de la force de travail".
Cette différence ne réside pas dans l'extraction même de la plus-value : le seigneur féodal ou l'esclavagiste de l'antiquité tiraient aussi le profit du surtravail de leurs serfs et esclaves. Ce qui distingue la plus-value des autres formes de surtravail, c'est le fait qu'elle est TRANSFORMÉE EN NOUVEAU CAPITAL et non consommée improductivement selon le mode antique ou féodal. C'est seulement lorsque cette transformation de la plus-value est achevée que LA VALORISATION du capital s'est réalisée (accumulation du capital).
Le problème de la possibilité de cette transformation est donc fondamental dans la définition du travail productif dans le système capitaliste.
"La distinction entre travail productif et travail improductif est importante eu égard a l'accumulation, car seul l'échange contre le travail productif est une des conditions de la reconversion de la plus-value en capital." ( 7 [80] )
Or, c'est à ce niveau que naissent la plupart des confusions concernant le problème du travail productif. En effet, les conditions de transformation de la plus-value diffèrent selon qu'elles concernent le capitaliste individuel ou le capital global.
Un capitaliste ne consomme qu'exceptionnellement ce que son entreprise produit. Chaque fraction du capital n'est qu'un atome au sein d'un réseau dont la complexité s'accroît au même rythme que la socialisation de la production. Chaque capitaliste n'a de ce réseau qu'une conscience très parcellaire et pratiquement aucune prise sur lui. Une fois la marchandise créée, elle disparaît de la sphère du capitaliste qui l'a produite. Ce qui importe à ce dernier, c'est d'en recevoir la contrepartie monétaire qui lui permettra de puiser à son tour dans le circuit productif, les biens nécessaires à la reconstitution et à la valorisation de son capital.
Il en découle que pour le capitaliste individuel, ou de façon générale, pour une fraction du capital global, "... le fait pour le travail d'être productif n'a absolument rien à voir avec le contenu déterminé du travail, son utilité particulière ou la valeur d'usage particulière dans laquelle il se matérialise." ( 8 [81] ) Quelle que soit la valeur d'usage de ses produits, du moment qu'il parvient à en réaliser la valeur d'échange, sa plus-value peut être transformée en capital. Celui-ci est valorisé et le travail qu'il a employé est productif.
Aussi du point de vue d'une fraction du capital global, ainsi que du point de vue de chaque travailleur face au capital, la détermination du travail productif est INDÉPENDANTE DU CONTENU UTILE DE CE TRAVAIL.
Le capital global, par contre, consomme lui-même l'essentiel de sa production puisqu'il est l'ensemble des capitalistes. Le contenu de la valeur d'usage de ce qu'il produit conditionne directement ses possibilités d'expansion, de valorisation.
"Pour accumuler, il faut transformer une partie du produit net en capital. Mais à moins de miracles, on ne saurait convertir en capital que des choses propres à fonctionner dans le procès de travail, c'est à dire des moyens de production et d'autres choses propres à soutenir le travailleur, c'est à dire des subsistances. Il faut donc qu'une partie du surtravail annuel ait été employée à produire des moyens de production et de subsistances additionnels, en sus de ceux nécessaires au remplacement du capital avancé. En définitive, la plus-value n'est donc convertible en capital que parce que le produit net dont elle est la valeur, contient déjà les éléments matériels d'un nouveau "capital"". (Marx) ( 9 [82] )
Du point de vue du capital global, du processus de l'accumulation générale du capital -et c'est le SEUL POINT DE VUE QUI PEUT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION LORSQUE L'
ON JUGE DU DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME CAPITALISTE- est productif le travail qui crée de la plus-value ET QUI SE CRISTALLISE DANS LES VALEURS D'USAGES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONSOMMÉES PRODUCTIVEMENT DANS LE PROCESSUS D'ACCUMULATION DU CAPITAL.
C'est pourquoi nous affirmons que le travail (vivant et mort) consacré à la production de biens tels que les armes (ainsi que les produits de luxe, etc.) CONSTITUENT DU TRAVAIL IMPRODUCTIF.
"Pas plus que les marchandises achetées par le capitaliste pour sa consommation privée, les services qu'il achète volontairement ou involontairement (à l'État, etc.) pour sa consommation à cause de leur valeur d'usage ne deviennent des facteurs du capital. Par conséquent, ce ne sont pas des travaux productifs et leurs agents ne sont pas des travailleurs productifs". (10 [83] )
La plupart des confusions parmi les marxistes au sujet du travail productif ont deux sources :
1- Le fait que Marx ait la plupart du temps abordé le problème du point de vue du CAPITALISTE ISOLÉ, ou du travailleur en tant qu'exploité par le capital. Deux raisons peuvent contribuer à expliquer cette insistance de Marx sur un seul aspect du problème :
a) La polémique qu'il livrait à ce sujet avec J-B. Say et Bastiat qui situent le problème sur ce terrain ;
b) L'importance relativement secondaire du problème dans le cours du développement général du capitalisme, au temps où Marx écrit (Les dépenses improductives du capital -faux frais- ne prendront des proportions véritablement significatives qu'à partir de la lère guerre mondiale.) ( 11 [84] )
2- La deuxième source de confusion réside peut-être dans le contenu du terme "plus-value".
Supposons une nation capitaliste qui au cours d'une année ne produit que des biens et des services dont la consommation est directement productive, c'est-à-dire des marchandises entrant directement dans le processus de production (Nous supposons donc exclue toute production de biens de luxe ou d'armes par exemple).
Au bout de l'année, et après avoir remboursé tous les frais de production engagés pendant l'année, les capitalistes se trouvent en possession d'une masse de produits dont ils disposent à l'exclusion du reste de la société : c'est la masse de plus-value, la plus-value réelle du capital global de la nation
Supposons encore qu'au bout de cette première année, ils décident de ne pas consacrer -comme ils l'ont fait jusqu'à présent- toute la plus-value extraite à la production de nouveaux biens productifs : afin de récompenser leur situation de privilégiés, ils s'accordent à créer une industrie de luxe ; afin de se défendre d'éventuelles agressions d'autres nations, ils décident de créer une industrie militaire. Ces deux nouvelles industries vont évidemment fonctionner selon des rapports de production capitalistes : salariat, etc. ( 12 [85] )
Le problème est le suivant : quelle est la nature et l'origine du profit que vont encaisser les capitalistes de ces nouveaux secteurs ? Les travailleurs de ces industries créent-ils de la plus value ? Quel est le rapport entre le profit des capitalistes de ce secteur et la plus-value réelle du secteur productif ?
La réponse apparaît clairement du moment qu'on réalise que toute la production de ces secteurs est achetée par les capitalistes, par l'ensemble des capitalistes (à travers leur appareil d'État lorsqu'il s'agit de biens militaires). Les salaires des travailleurs de ces industries, ainsi que les profits des capitalistes correspondants, sont payés avec de la plus value déjà créée. Le capital global ne va pas se valoriser d'une seule heure de travail fourni par ces industries improductives. Il va par contre consacrer une part de la plus-value qui aurait pu être dédiée à son auto-valorisation, à l'entretien aussi bien des travailleurs que des capitalistes de ces branches.
Du point de vue du CAPITAL GLOBAL -national dans ce cas- ces travailleurs ne créent donc pas de la plus-value. Au contraire, ils en consomment. Mais du point de vue des capitalistes des secteurs concernés, ces travailleurs leur fournissent -par leur surtravail- LE DROIT DE PUISER (au prorata de leur capital engagé, suivant la loi du "milieu capitaliste") DANS LA MASSE DE LA PLUS-VALUE RÉELLE.
Dassault ou Chanel fournissent aux autres capitalistes des marchandises produites selon le mode d'exploitation capitaliste dans la valeur de ces marchandises, il y a inclus le travail non payé fourni par les travailleurs et dont l'équivalent en valeur appartient bien -toujours selon la loi capitaliste- à Dassault et à Chanel. Les autres capitalistes achètent ces marchandises à leur valeur et donc réalisent la plus value de leurs confrères.
La force de travail des secteurs improductifs a donc affirmé sa capacité productive face au capital immédiat qui l'a achetée en lui fournissant une valeur supérieure à celle qu'elle en a reçu. Elle a créé de la plus-value pour lui. Mais pour le capital global, elle en a détruit.
Le travailleur exploité d'une industrie capitaliste improductive est tout autant un prolétaire que celui du secteur productif. Mais alors que la plus-value que crée le second fait partie de la plus-value RÉELLE qui valorise le capital global, la plus-value du premier n'est source de profit que pour le capitaliste immédiat ; elle est une charge improductive pour le capital global.
Notre point de départ a été de répondre à la question : l'armement est-il une solution aux crises capitalistes ? Peut-il empêcher une prochaine crise ? Ces questions nous ont amené à poser le problème des caractéristiques du travail productif.
La réponse à ce dernier problème nous permet maintenant de conclure de façon claire à la première question :
L'ARMEMENT N'EST PAS UNE SOLUTION AUX CRISES
Le débouché constitué par les besoins militaires représente simultanément une lourde charge pour l'économie de chaque puissance. Elle est pour le capital un gaspillage inouï, pour le développement des forces productives une production à inscrire au passif du bilan définitif. ( 13 [86] )
On peut estimer que dans les dernières décades les USA ont transformé, en moyenne, le tiers de leur surplus annuel (produit net) en biens militaires. C'est à dire que -au bas mot- si ces dépenses pouvaient être transformées en biens productifs, la croissance américaine (si elle trouvait les débouché nécessaires évidemment) serait ipso facto de 33% plus rapide.
La production d'un canon n'implique pas seulement pour le capital la perte du travail qu'il contient. Il y a surtout une stérilisation de ce travail, un BLOCAGE du processus d'auto-valorisation permanente du capital. Le travail qui, après un long processus, se cristallise dans un tel bien, bloque le processus définitivement. En plus de la simple perte du travail passé, le capital supporte la charge de la paralysie de son processus productif.
Il apparaît donc clairement qu'en aucun cas, le "stimulant militaire" ne peut assurer l'éternité de l'expansion capitaliste. Comme débouché, il ne peut être qu'un stimulant accessoire (en période de reconstruction, par exemple) et en tout état de cause, ses effets sont -tout comme ceux de la reconstruction- de durée limitée : une nation qui transformerait tout son surplus annuel en armes verrait sa croissance économique totalement bloquée au bout d'un an. Elle ne pourrait reprendre son expansion économique qu'en rentabilisant ces armes, c'est à dire la guerre (et encore faudrait-il que la nation soit victorieuse). ( 14 [74] ) Plus la part de surplus transformée en armes est importante, plus courte est la durée des effets stimulants de ce débouché, plus vite la question de leur rentabilisation se pose avec acuité. Plus cette solution tarde, plus le poids immense de la charge improductive s'exerce sur l'économie nationale : INFLATION, BAISSE DE COMPÉTITIVITÉ des produits nationaux dans le marché international (car les coûts des produits incluent de plus en plus les frais militaires), ce qui à son tour, par la perte de marché qui en découle, vient aggraver le problème initial de manques de débouchés.
L'insistance de plus en plus pressante du gouvernement américain auprès des nations européennes afin qu'elles prennent en charge leur propre défense militaire, n'a pas d'autre explication.
Ceci dit, il faut répondre à la question posée de savoir pourquoi, si la production militaire est si néfaste pour le développement du capital, toutes les nations du monde, et en premier lieu les grandes puissances, consacrent une part aussi gigantesque de leurs capacités à ce type de produits ?
Nous avons vu que la demande créée par les besoins militaires possède une série d'avantages particuliers comme débouchés : par exemple, elle touche à presque tous les domaines de l'industrie, tout en privilégiant les secteurs où le capital est le plus concentré (secteurs de pointe).
Le rôle de stimulant économique a fait dire à certains que le développement de cette industrie était le fruit de la volonté consciente des capitalistes de créer un DÉBOUCHÉ ARTIFICIEL inventé pour les besoins d'une économie menacée en permanence d'étouffement par le manque de marchés. Rien n'est plus faux.
Le capitalisme produit des marchandises. Certes ce qui l'intéresse en premier lieu dans la marchandise, c'est sa VALEUR D'ÉCHANGE, sa contrepartie monétaire. Mais cela ne lui permet pas pour autant de ne pas tenir compte de son soutien par la VALEUR D'USAGE. Un bien qui ne possède pas de valeur d'usage, c'est à dire qui ne correspond pas à un besoin social quel qu'il soit, est tout, sauf une marchandise. IL n'a pas sa place dans le monde du capital. L'acheteur d'armements, l'État capitaliste, autant que n'importe quel autre capitaliste, demeure prisonnier de la loi de la valeur : il ne peut acheter que ce qui correspond effectivement à un besoin réel.
Les débouchés qui S'INVENTENT À VOLONTÉ n'existent que dans les rêves des capitalistes en faillite. Le développement de l'industrie militaire est lié à l'exacerbation des antagonismes inter-impérialistes. Dans un monde entièrement partagé entre puissances, et dans un partage où les participants connaissent des excédents en permanence, la force militaire de chaque nation se transforme en un outil INDISPENSABLE, INÉVITABLE de sa survie économique. Les guerres mondiales ont montré le prix dont une puissance peut avoir à payer son insuffisance dans ce domaine.
1 [87] voir par exemple Henri Weber dans sa brochure de polémique avec l'AJS.
2 [88] "Matériaux pour l'économie", La Pléiade, Tome 2, p.387.
3 [89] "Le Capital", Livre I, Tome I, p.1001 (éditions La Pléîade)
4 [90] "Le Capital", idem, p.731.
5 [91] "Matériaux. . .',' p. 392
6 [92] "Matériaux...", p.387.
7 [93] "Matériaux...", p.398
8 [94] "Matériaux...", p. 393
9 [95] "Le Capital", op.cité, p.1083.
10 [96] "Matériaux...", p.390. On ne peut que constater l'ignorance aussi bien du marxisme que de la réalité capitaliste que montrent les "marxistes" à la Weber qui- se réclamant de "l'aride et sèche théorie" ne voient dans cette détermination du travail productif que des "critères éthiques".
11 [97] La détermination du travail productif sous le capitalisme ne devient liée au contenu utile de ce travail qu'à partir d'un certain degré de développement du système. Les premières manufactures capitalistes produisaient principalement des biens
"improductifs": armes, poudre à canon, draperies de luxe, etc... Cela ne posait, cependant pas de problèmes majeurs pour leur développement. La raison en est que le secteur capitaliste demeurait un simple atelier au milieu d'un processus social de production où prédominent encore largement les formes de production pré-capitalistes (essentiellement féodales). La production agricole et artisanale pouvait encore fournir aux manufactures capitalistes l'essentiel de la matière des moyens de production et des biens de subsistance nécessaires à une production qui fonctionnait avec une composition technique du capital extrêmement faible, c'est à dire où le travail vivant prédominait largement sur le travail mort. (Les premières manufactures étaient souvent de simples associations d'artisans, travaillant avec leurs anciennes techniques, mais soumis au régime du salariat par un entrepreneur).
Dans ces conditions, le contenu de la valeur d'usage des marchandises capitalistes avait peu d'importance pour le développement du capital. C'est seulement lorsque le mode de production capitaliste s'empare de l'ensemble de la production sociale ("domination réelle du capital")que la détermination du travail productif doit tenir compte de son utilité spécifique. C'est pourquoi Engels pouvait écrire : "Au début du XlVe siècle, la poudre à canon est passée des arabes aux européens occidentaux et a bouleversé, comme nul ne l'ignore, toute la conduite de la guerre. Mais l'introduction de la poudre à canon et des armes à feu n'était nullement un acte de violence, c'était un progrès industriel, donc économique. L'industrie reste l'industrie, qu'elle s'oriente vers la production ou la destruction d'objets" (Anti-DÎlhring p. 200, Ed. Soc.).
H. Weber qui a eu le malheur un jour de vouloir écrire sur ce sujet dans la brochure déjà citée, n'a pas manqué d'en déduire qu'aujourd'hui l'industrie destinée à créer des armes, "ces biens de consommation courante", constitue une industrie aussi productive que toute autre. M. Weber ne voit vraiment pas pourquoi il faut penser que quelque chose change dans la nature productive ou improductive du travail des usines Dassault, selon qu'elles produisent des bombardiers ou des avions de transport civil. Au XVe siècle, toutes les entreprises capitalistes pouvaient se consacrer à ne produire que des armes et connaître une expansion certaine. Que M. Weber se représente la même chose aujourd'hui -et en voyant ce que deviendrait dans ce cas l'expansion capitaliste- peut-être commencera-t-il à comprendre.
12 [98] Nous supposons que cette nation ne fait pas de commerce extérieur lui permettant de réléguer la charge improductive de ces industries à d'autres nations comme dans l'exemple que nous avions pris(exemple Dassault-Pérou).
13 [99] Le travail vivant et les moyens de production dépensés à ce type de production ne sont pas PRODUCTIFS, ils ne sont pas des FORCES PRODUCTIVES -ou, si l'on veut se situer du point de vue du critère général, abstrait, tel qu'il se définir du point de vue du processus de travail, ce sont des forces productives stérilisées, annihilées. Seule la science et les techniques de production développées dans ces secteurs, dans la mesure où elles demeurent après la production et uniquement dans la mesure où elles peuvent être appliquées à la création de biens productifs, sont des forces productives.
14 [87] L'image de l'URSS en train de démanteler des usines entières en Tchécoslovaquie ou en Mongolie pour les rebâtir sur son territoire, à la fin de la 2ème guerre mondiale, illustre de la façon la plus spectaculaire les besoins de cette "rentabilisation" de la production militaire.
Questions théoriques:
- Décadence [3]
Heritage de la Gauche Communiste:
Les frais improductifs
- 3444 reads
Il n'y a pas que l'armement qui soit une industrie improductive pour le capital. La décadence du capitalisme depuis 1914 est caractérisée par le développement vertigineux de toute une série d'activités économiques improductives. Toutes ces dépenses ont ceci de commun qu'elles ont une même raison d'être : PALLIER AUX DIFFICULTÉS CROISSANTES QUE RENCONTRE DANS TOUS LES DOMAINES LE SYSTÈME ÉCONOMIQUE POUR CONTINUER A SE REPRODUIRE.
L'armement est seulement l'une d'entre elles (si nous avons été amené à le traiter à part, c'est du fait de l'importance de son rôle comme stimulant économique.)
Parmi les dépenses de ce type, qui ont connu des développements particulièrement importants, on peut citer :
l- les dépenses destinées à maintenir "la paix sociale" : il s'agit d'une part des frais occasionnés par l'entretien de tout corps d'employés qui va des CRS aux appareils syndicaux, et des assistantes sociales jusqu'au personnel des facultés de sociologie. D'autre part, de toutes les dépenses telles que les allocations de chômage etc. (La Grande Bretagne par exemple entretient plus d'un million de chômeur depuis plus de sept ans !)
2- les dépenses destinées à pallier aux difficultés économiques intérieures à chaque nation -ou à chaque entreprise-. Gonflement démesuré de l'administration économique générale de l'État : organisme de planification, d'intervention etc. ... Il faut ajouter à ceci tous les frais de prise en charge d'entreprises déficitaires, ainsi que les aberrations toujours croissantes de l'agriculture dans le système capitaliste : arrachage d'arbres, stérilisation de terres, destruction de récoltes et de surplus, frais "d'assainissement" des marchés agricoles.
D'autre part, les dépenses des entreprises privées confrontées en permanence à des problèmes de vente et de commercialisation toujours plus insolubles, et aigus du fait de la concurrence : marketing, gestion de l'entreprise et surtout publicité (ces frais sont généralement plus faibles dans les pays à capitalisme d'État ; ils y sont cependant largement compensés par les gaspillages gigantesques que la lourdeur et l'irresponsabilité bureaucratique font subir aux circuits de commercialisation). Le développement du secteur tertiaire est en grande partie le résultat de ce type de dépenses improductives.
3- Les dépenses occasionnées par des aberrations résultant de l'action désespérée des entreprises dans certains pays (USA et en partie Europe et Japon) pour tenter de pallier au manque de débouchés. Le plus frappant de ces phénomènes est la réduction de la valeur d'usage des biens de consommation (voitures, bas, biens électroménagers, etc.) construits consciemment en vue d'abréger la durée de leur utilisation. Cette technique est renforcée par la publicité destinée à créer les MODES et donc à DÉMODER (Sur l'ampleur souvent insoupçonnée de ces phénomènes depuis la IIème guerre et du gaspillage qu'ils représentent, voir le livre de Vance Packard : "L'art du gaspillage"). Parmi ces aberrations, l'exemple de la voiture (moyen de transport de la force de travail) devient de plus en plus un gaspillage nuisible.
4- Les dépenses occasionnées par les rapports internationaux en particulier l'ampleur des dépenses militaires dépassent toute imagination. Les dépenses militaires des USA et de l'URSS ensemble sont à elles seules supérieures à la somme des revenus nationaux de toute l'Amérique Latine plus l'Inde, plus le Pakistan ! Quant aux États du Moyen-Orient, ils consacrent en moyenne 25% de leur PNB à l'armement. Dans les 10 dernières années, le capital mondial a plus dépensé en armes qu'au cours des 50 premières années de ce siècle, les deux guerres mondiales comprises.
L'HYPERTROPHIE DU SECTEUR IMPRODUCTIF, CARACTÉRISTIQUE DE LA DÉCADENCE
Les dépenses improductives existaient déjà dans le capitalisme ascendant. La consommation de luxe de la classe dominante par exemple -dont nous n'avons pas estimé nécessaire de parler plus haut, mais dont le caractère improductif est tout aussi évident- existe depuis le début du capital. Il en est de même de la police, de l'armée, de l'administration.
Mais,
1) L'ampleur de ces dépenses au cours des siècles précédents n'a rien de comparable avec celle qu'elles ont si rapidement acquise depuis 60 ans.
2) Le contenu improductif de ces "FAUX FRAIS" de production se trouvait, dans le capitalisme ascendant, atténué par le caractère de FORCE PRODUCTIVE que les rapports de production eux-mêmes pouvaient posséder. Lorsque le capitalisme envahit la planète en détruisant les rapports de production précapitalistes, lorsqu'il impose ses techniques au monde entier, ses rapports de productions constituent, par la même, des forces productives. Les frais généraux nécessaires à leur maintien bénéficient à cette époque de la nature productive de ces rapports ports. Ainsi par exemple, lorsqu'une armée impérialiste imposait les rapports capitalistes dans une partie du monde, le capital mondial s'enrichissait d'autant. Ces armées constituaient en certaines occasions de véritables forces productives pour le capital.
Ceci disparaît entièrement du moment que le monde est partagé entre puissances. Les guerres ne peuvent plus aboutir qu'à des repartages, toutes conquête nouvelle étant devenue impossible.
Dès lors, toute puissance capitaliste ne peut gagner militairement une zone qu'aux dépens d'une autre. Pour le capital mondial, la guerre ne peut représenter qu'un déchirement interne, un gaspillage néfaste.
Lorsque les rapports de production capitalistes cessent d'être porteurs du développement des forces productives pour en devenir des entraves, tous les "faux-frais" qu'ils peuvent occasionner, deviennent de simples gaspillages. Ce qu'il est important de noter, c'est que cette inflation de "faux-frais" a été un phénomène inévitable qui s'est imposé au capitalisme avec autant de violence que ses contradictions.
L'histoire des nations capitalistes depuis un demi-siècle est rempli de "politiques d'austérité", d'essais de retour en arrière, de luttes contre l'expansion incontrôlée des frais de l'État, des dépenses improductives en général. A chaque fois que la concurrence internationale s'exacerbe de façon critique, la question de ces dépenses se trouve posée de façon plus aiguë. ( 1 [100] )
Toutes ces tentatives aboutissent cependant systématiquement à des échecs. On se rappelle le plan d'austérité de Nixon (15 août 1972), et le budget anti-inflationniste qui l'accompagna : malgré tous les discours, les dépenses militaires -principale source d'inflation aux USA- étaient une fois encore augmentées. Les dépenses improductives jouent pour le capitalisme décadent le même rôle que certains médicaments poisons pour certains malades. Plus la maladie s'aggrave, plus il faut augmenter la dose ; plus cette dose augmente, plus la maladie s'aggrave. L'inflation est le cancer du capitalisme moderne. Les dépenses improductives sont son principal aliment. Or, plus le capitalisme connaît de difficultés, plus il doit développer ses "faux-frais". Ce cercle vicieux, cette gangrène qui ronge le système du salariat n'est qu'un des symptômes d'une même maladie : la décadence capitaliste.
Les issues sont connues depuis plus d'un demi-siècle : guerre mondiale ou révolution prolétarienne ; socialisme ou barbarie.
___________________________________________________________________
1 [101] Le succès aux USA d'un Ralph Nader, ennemi des voitures qui tuent et des produits qui se cassent tout seuls, ne vient pas uniquement de la colère des "consommateurs".
Questions théoriques:
- Décadence [3]
Heritage de la Gauche Communiste:
Conclusion
- 3024 reads
Arrivé au terme de cette étude, le problème est loin d'être épuisé, et nombreuses demeurent les questions qui n'ont pu être approfondies ici. Le dernier demi-siècle a soulevé une série de nouveaux problèmes à la théorie révolutionnaire et fourni des données permettant de mieux comprendre les problèmes posés depuis longtemps. Nous ne prétendions pas tous les aborder, encore moins tous les résoudre.
Nos soucis principaux ont été les suivants : premièrement, expliquer les fondements de notre conviction que la révolution prolétarienne est à l'ordre du jour depuis la première guerre mondiale. Deuxièmement, rendre compte du changement profond subi par la réalité capitaliste, qui a rendu une grande partie des positions des révolutionnaires qui, tactiques légitimes au XIXè siècle, sont devenues aujourd'hui (parlement, syndicats, question nationale ...) contre-révolutionnaires.
Cela nous a amené à montrer que seule l'analyse qui aboutit à la notion de décadence du capitalisme depuis 1914, permet d'intégrer dans une vision cohérente, tous les phénomènes marquants qui sont apparus à partir de cette date :
- freinage et ralentissement de la croissance des forces productives par les rapports de productions dominants.
- exacerbation permanente des antagonismes entre fractions de la classe dominante.
- apparition de crises et guerres mondiales d'ampleur sans précédent, qui sont allées en s'approfondissant à chaque occasion.
- développement démesuré des secteurs improductifs aux dépens des secteurs productifs.
- décomposition accélérée de toutes les valeurs idéologiques du système.
- développement des antagonismes de classe et surgissement de mouvements révolutionnaires prolétariens, mettant en question le système à l'échelle mondiale.
- développement et renforcement de l'appareil étatique capitaliste et de son contrôle sur toute la société (tendance générale au capitalisme d'État).
Tous ces phénomènes ne peuvent se comprendre que comme des expressions de l'inadaptation définitive des rapports de production capitalistes aux besoins historiques de l'humanité.
Ceux qui tout en parlant aujourd'hui de révolution, nient la réalité de la décadence se devraient d'expliquer non pas tel ou tel de ces phénomènes pris isolément, mais la cohérence qui, obligatoirement, les lie.
Mais à ceux qui reconnaissent cette vision de la période historique actuelle, il reste la tâche d'approfondir l'analyse de la décadence et de tirer jusqu'au bout toutes les conséquences qui en découlent pour la pratique révolutionnaire.
RI N05. octobre-Nov. 1973,
R. Victor
Questions théoriques:
- Décadence [3]