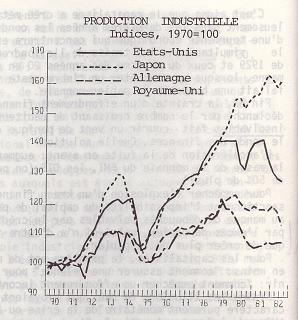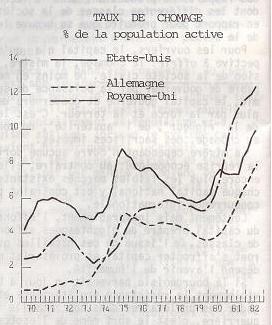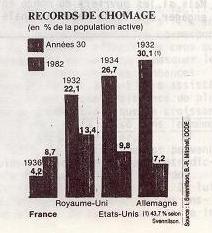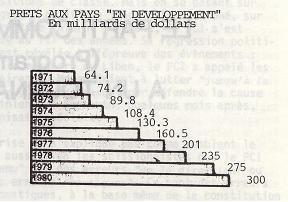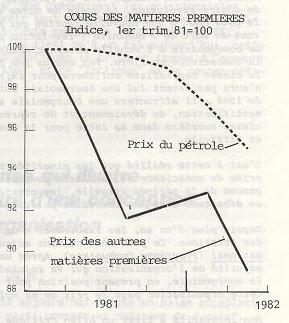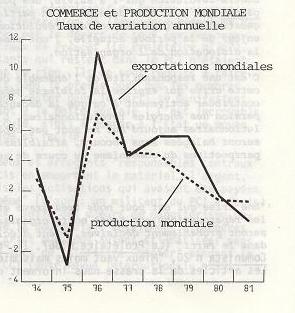Revue Internationale no 32 - 1er trimestre 1983
- 2896 reads
La crise de surproduction capitaliste mondiale : une tourmente qui pose la question de la révolution
- 8126 reads
Alors que l'humanité a développé ses forces productives qui, bien employées", permettraient d'éliminer en quelques années toute pénurie de moyens de subsistance (alimentation, santé, logement, communication, éducation, etc..) et ce sur toute la surface de la terre, ces forces, cette potentialité productive se voient aujourd'hui de plus en plus paralysées, détruites par les mécanismes et les contradictions internes aux rapports de production capitalistes.
De plus en plus, le monde manque de tout, plongé dans une crise de surproduction capitaliste.
A la fin de 1982, le nombre de chômeurs dans les principaux pays industrialisés bat tous les records depuis la seconde guerre. Qui plus est, la croissance du chômage s'accélère: près d'un demi million de chômeurs de plus en un seul mois aux USA.
Même record et même accélération pour le nombre d'entreprises en faillite et de pays en banqueroute financière. Les famines se multiplient et s'étendent dans les zones sous-développées du monde.
Dans les pays de l'Est le rationnement alimentaire prend les allures des pires années de la dernière guerre alors qu'au coeur de la première puissance mondiale, à Détroit, les queues de chômeurs sans ressources s'allongent devant les soupes populaires.
Pendant ce temps, les usines ferment, ou tournent en employant une part toujours moindre de leur capacité productive (moins de 70% aux USA, l'industrie de l'acier en Europe est immobilisée à 50%!); des excédents agricoles sont détruits et le cours des matières premières, alimentaires ou industrielles, s'effondre par manque d'acheteurs.
Quant aux perspectives, les gouvernements ont abandonné la rhétorique des "nous voyons déjà le bout du tunnel" pour celle des "nous devons nous préparer à des années de rigueur, d'austérité et de sacrifices".
La réalité devient de plus en plus évidente: ce ne sont pas des raisons "NATURELLES" (manque d'énergie ou de matières premières) qui bloquent les forces productives: les marchands internationaux ne savent plus quoi faire des stocks de pétrole ou de lait invendus. Ce n'est pas non plus le manque de force de travail (éduquée ou non): le chômage touche aussi bien les ouvriers analphabètes que les porteurs de diplômes universitaires.
Ce n'est pas un manque d’innovation technique: les secteurs les plus avancés de 1’industrie moderne (électronique, informatique), longtemps épargnés par la crise, sont frappés à leur tour de plein fouet (la "Silicon Valley" californienne, haut lieu mondial de l'électronique de pointe, connaît pour la première fois l'épidémie du chômage). Ce n'est pas enfin, un manque de "bonnes politiques de gestion capitaliste". Toutes les politiques économiques font faillite: les politiques à la Reagan qui annonçaient la relance par la rigueur et l'équilibre budgétaire, n'ont obtenu ni relance ni équilibre: aux USA la production recule et le déficit de l'Etat est un des plus élevés de l'histoire du pays. Les politiques à la Mitterrand qui au contraire annonçaient la reprise par l'augmentation de la consommation populaire et du déficit de l'Etat, ont bien réussi à creuser le déficit public, mais la croissance industrielle en France continue de s'effriter tout comme le niveau de vie des travailleurs. Quant au capitalisme d'Etat des pays de l'Est, il étouffe dans l'hypertrophie de la production d'armements.
A chaque convulsion de la crise une réalité apparaît de plus en plus crûment : c'est dans le système social mondial de production lui-même que se trouve la source de l'étranglement des forces productives.
Une fois de plus, depuis plus d'un demi siècle, l'humanité est en train de vivre l'impitoyable démonstration pratique de la caducité historique des lois de production capitalistes.
Qu'elles le veuillent ou non, les classes exploitées, sont confrontées aux questions que leur pose un horizon de plus en plus chargé de nuages sombres.
Y aura-t-il de nouveau une période de relative "reprise économique" comme ce fut le cas après les convulsions de 1967, de 1970, ou de 1974-75? Une solution de type véritablement communiste est-elle autre chose qu'un joli rêve?
Y-AURA-T-IL UNE REPRISE ECONOMIQUE A COURT OU MOYEN TERME?
Voyons d'abord ce qu'en disent les experts des organismes économiques internationaux occidentaux. Le Financial Times du I7/11/82 rendait compte des conclusions de la réunion du comité d'Economie Politique de l'OCDE au sujet des prévisions pour l'année 83, dans les termes suivants: "Le secrétariat de l'organisation doute désormais que les prévisions qu'il avait faites auparavant d'une augmentation de la production de 2,5% en 83 puissent être atteintes, étant donnée la stagnation en 82. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas de croissance en Europe 1'année prochaine, et que 1 'économie Japonaise continue à ralentir, en partie à cause des accords sur la limitation des exportations. L'OCDE est moins optimiste que Washington quant à une reprise économique solide aux Etats-Unis."
Pour le proche avenir, ceux qui théoriquement ont pour tâche d'assurer le bon fonctionnement de l'économie capitaliste, ne voient aucune relance possible. Tout au plus, certains d'entre eux envisagent aux USA, et seulement là, un ralentissement momentané de la dégradation de la situation économique, le temps des élections présidentielles... mais, à juger par l'évolution actuelle, même cette mièvre perspective semble irréaliste.
A moyen et à long terme, certains de ces "savants" de la bourgeoisie décadente, parlent bien d'une éventuelle reprise économique. Mais ils ne savent ni quand, ni comment, ni par quoi ou par qui une telle relance pourrait être amorcée.
Ce manque de perspective traduite le désarroi de la bourgeoisie devant l’inefficacité croissante de toutes ses politiques économiques, mais aussi devant l’accumulation de difficultés que ces mêmes politiques ont à leur tour engendré.
Comme nous l'écrivions au début de 1980: "... non seulement les remèdes que les états administrent a la crise depuis des années font de moins en moins d'effet, mais en outre, l'abus du recours à ces remèdes a fini par empoisonner le malade. "(Revue Internationale N°20, "Années 80 : l'accélération de la crise").
L'insolvabilité financière des gouvernements du Mexique, de l'Argentine, de la Pologne et du Zaïre, ne constitue pas un problème "localisé" dans les zones moins industrialisées. Elle sanctionne la faillite de la politique du capital international fondée sur l'endettement généralisé.
Les médias parlent beaucoup de l'endettement des pays moins développés. Mais les 500 milliards de dollars auxquels est évalué aujourd'hui l'ensemble de l'endettement de ces pays paraît dérisoire lorsqu'on le compare à l'endettement des économies des pays les plus puissants... et en premier lieu à celui des USA. Dans la première métropole industrielle du monde l'endettement global de l'économie a été entre i960 et 1980, multiplié par 5,4! Entre 1970 et 1980 la dette des pouvoirs publics américains est passée de 450 milliards de dollars à 1069 milliards et celle du secteur privé de 975 à 2840 milliards!
Aujourd'hui, de plus en plus de dettes viennent à échéance, mais les débiteurs n'ont pas plus les moyens réels de payer qu'au moment où ils ont commencé à s'endetter massivement. Dans ces conditions aucun gouvernement n'ose plus parler de relance véritable. L'insuffisance, le handicap congénital du capitalisme c'est son incapacité à créer par lui même ; des débouchés en mesure d'absorber, d'acheter toute la production qu'il est potentiellement capable de réaliser. Contrairement au féodalisme et à l'esclavagisme antique, lorsque le système capitaliste devient historiquement incapable d'assurer à la société ses moyens matériels de subsistance, ce n'est pas par manque de moyens de production (il en a "trop" à ce moment-là) mais par manque de marchés solvables.
Le capitalisme décadent, dont la pénurie de marchés l'a entraîné à deux reprises à des guerres mondiales, qui soumet l'ensemble de la vie sociale, et entre autres la recherche scientifique la plus avancée, aux impératifs militaires que lui impose "la protection des marchés" des uns contre les autres5 ce système sénile et barbare donc, a cru pouvoir trouver dans le crédit un palliatif à ce manque de débouchés devenu chronique. Et cela surtout depuis la fin des années 60, fin de la reconstruction d'après-guerre.
Mais le développement du crédit ne peut faciliter le fonctionnement de l'économie que s'il s'accompagne entre temps d'une augmentation correspondante des moyens de paiement effectif de ceux qui s'endettent. Autrement il ne sert qu'à masquer les problèmes de fond, qu'à retarder les échéances tout en les aggravant. Or, ce à quoi on a assisté pendant ces années, c'est à une croissance de plus en plus accélérée du crédit alors que la croissance de la production réelle n'a cessé dans le même temps "5e" se ralentir jusqu'à" reculer.
A travers le crédit, le capitalisme est parvenu à retarder l'explosion violente de ses contradictions, mais il n'a fait que cela : a retarder.
Pour y parvenir il a dû payer très cher. Il lui a fallu détruire les fondements d'un de ses instruments les plus vitaux: le système monétaire international.
C'est ainsi que le capitalisme a créé méticuleusement dans les dernières années les conditions d'une tourmente économique qui concentrera en elle simultanément les traits de l'effondrement de 1929 et ceux du marasme des années 20 en Allemagne, lorsque pour acheter un timbre-poste il fallait une brouette de papier-monnaie.
Fin 82, la crainte d'un effondrement financier déclenché par le nombre croissant de débiteurs insolvables fait courir un vent de panique dans le monde des finances. Quelle solution?
L'accélération de la fuite en avant : augmenter la masse de la monnaie du FMI, les DTS (on parle de b0% de plus!).
Pour empêcher l'explosion d'un krach financier sanctionnant l'impossibilité du capital de pallier au manque de débouchés solvables par le crédit, par l'excès de papier, celui-ci n'a d'autre issue que de créer plus de papier.
Pour les capitalistes, le problème est de moins en moins: "comment assurer une relance" pour devenir "comment empêcher un effondrement incontrôlé".
Finies les illusions de ceux qui croyaient au caractère purement "monétaire"de la crise ou à la thèse de la"restructuration". C'est au coeur même des rapports de production, dans la façon même dont les différentes classes de la société sont en rapport pour produire que se trouve le noyau de la crise.
Pour les ouvriers, le capital n'a qu'une perspective à offrir: le chômage, la misère, 1'exclusion de la société civile. De moins en moins capable de gouverner par la puissance de son économie, le capital gouverne et gouvernera de plus en plus par la force et la terreur. C'est le langage de la "rigueur", de 1'"austérité", du chantage au chômage, des sacrifices imposés.
La misère cependant n'ouvre aucune porte vers la reprise économique: au contraire, elle rétrécit encore plus les faibles marchés existants. Mais chaque capital national y est contraint par la concurrence internationale.
Lentement mais inexorablement, l'effondrement du capital prépare de gigantesques affrontements de classes. De 1'issue de ces batailles qui verront s'affronter capital et prolétariat mondial, dépend l'avenir de l'humanité.
Si la bourgeoisie parvenait un jour à briser violemment la résistance prolétarienne et à embrigader les prolétaires dans une nouvelle folie guerrière, c'est le sort même de l'espèce humaine qui se trouverait mis en question.
Mais si les ouvriers du monde entier parviennent à engager une lutte internationale pour la défense intransigeante de leurs intérêts de classe ils ouvriront la porte à la seule issue possible pour l'humanité: le communisme.
LE COMMUNISME N'EST PAS UNE UTOPIE MAIS LA SEULE ISSUE REALISTE.
Parce que le mal se trouve à la racine du système, c'est à la racine qu'il faut l'extirper.
Les institutions capitalistes, le capital, le salariat, l'échange, la marchandise, les nations sont devenus des absurdités vivantes eu égard aux capacités et aux nécessités de l'humanité.
Les fondements de ces lois datent de la fin du Moyen-âge. A cette époque, un serf pouvait à peine nourrir par son travail et celui de toute sa famille un individu membre de la noblesse. Aujourd'hui un agriculteur salarié américain peut nourrir 80 personnes. Cependant, tout comme pour les ouvriers de la Renaissance, son revenu n'est déterminé ni en fonction de ses besoins ni en fonctions des possibilités productives de la société, mais par la valeur sur le marché de sa force de travail comme marchandise. En outre, tout comme à l'époque des marchands de Venise, le capital n'a jamais produit et ne produira jamais qu'en fonction des besoins de sa propre accumulation.
Lorsque cette accumulation, pour des raisons marchandes devient impossible, la production capitaliste s'effondre, quelles que soient les forces productives dont la société dispose, quels que soient les besoins des hommes.
L'humanité ne pourra faire l'économie d'une révolution sociale mondiale, violente, bouleversant de fond en comble l'organisation de la société.
Il lui faudra faire tourner les usines en fonction exclusivement des besoins humains, il faut pouvoir distribuer la production en fonction des nécessités et des possibilités des hommes, et donc éliminer l'échange et le salariat. Il lui faut unifier consciemment la production mondiale. Bref, il lui faut construire le communisme.
La crise, qui n'en est qu'à ses débuts, se chargera de démontrer par les dévastations de ses effets que ce qui peut sembler encore aujourd'hui un rêve utopique, constitue en réalité la seule issue possible pour échapper à l'apocalypse nucléaire.
La crise économique .mondiale met chaque jour plus le prolétariat international devant ses responsabilités historiques: ou briser les chaînes du vieux monde ou périr avec lui.
OU EN EST LA CRISE ?
La production industrielle au niveau de 1973
Pour la quatrième fois depuis le début de la crise à la fin des années 60, la capital connaît une nouvelle chute de la croissance industrielle qui comme par le passé devrait être plus profonde que les précédentes.
Depuis 1979 la production industrielle a globalement reculé dans les principaux pays occidentaux. Fin 1982 elle est tombée au niveau de 1973 dans la plupart d'entre eux, soit le niveau d'il y a dix ans. Le Japon est à son tour frappé : la croissance s'y ralenti de plus en plus et sa chute ne sera que plus violente, comme en 1974-75.
Le chômage s'accélère
Le nombre de chômeurs et 1a proportion de ceux-ci dans la population active sont les plus élevés depuis la guerre. Mais la croissance du chômage, loin de se ralentir, s'accélère depuis 1980 à des rythmes sans précédents
"La bourgeoisie ... ne peut régner, car elle ne peut plus assurer 1'existence de 1'esclave à 1'intérieur de son esclavage : elle est forcée de le laisser déchoir si bas qu'elle doit le nourrir au lieu d'être nourrie par lui. La société ne peut plus vivre sous la bourgeoisie; c'est à dire que 1'existence de la bourgeoisie et 1'existence de la société sont devenues incompatibles ".
MARX et ENGELS, Le manifeste du parti communiste.
La crise est devant nous
Les taux de chômage sont généralement encore loin de ceux atteints pendant la dépression économique des années 30. Il ne faut pas y voir une "consolation" mais une illustration de jusqu'où peut aller le capitalisme en crise, si le prolétariat international n'a pas la force d'imposer sa propre issue révolutionnaire.
L'explosion de l'endettement
La fuite en avant par le crédit apparaît clairement dans l'évolution de l'endettement des pays moins développés (celui-ci a presque quintuplé en dix ans).
Il ne constitue cependant qu'une petite partie de l'endettement global du capital mondial.
La baisse des matières premières
La crise de SURPRODUCTION se traduit par une chute de la demande et des prix des matières premières, surtout depuis 1981. Pour les pays moins développés, producteurs essentiellement de matières premières, c'est la certitude de nouvelles banqueroutes. Pour le système financier international c'est le danger d'effondrements en chaîne.
La baisse du prix du pétrole au moment où la crise s'aggrave, ruine le mythe de "la crise du pétrole".
Le ralentissement du commerce mondial
La croissance du commerce mondial, tout comme celle de la production, n'ont cessé de se ralentir depuis 1977.
En 1982, lai croissance des échanges internationaux recule de façon absolue et plus rapidement que celle du volume de la production, ce qui traduit et annonce une tendance au développement du protectionnisme.
Sources : Rapport annuel du GATT,1981/82 ; Newsweek,; OCDE, Principaux Indicateurs Economiques
Questions théoriques:
- L'économie [1]
- Décadence [2]
Convulsions dans le milieu révolutionnaire : le P C I (Programme Communiste) à un tournant de son histoire
- 4265 reads
Depuis la fin des années 60, la classe ouvrière, en engageant la lutte internationalement (1968 en France, 1969 en Italie, 1970 en Pologne, 1975-76 en Espagne, etc.) a mis un terme à cinquante ans de contre-révolution. La grève de masse en Pologne en 1980-81 a marqué jusqu'à présent le point le plus haut d'une nouvelle reprise qui mène à des affrontements de classe décisifs qui décideront du sort de 1'humanité : révolution ou guerre.
La bourgeoisie à 1'échelle internationale reconnaît le danger mortel pour son système contenu dans la combativité ouvrière. Par dessus les frontières nationales et même celle des blocs impérialistes, la classe capitaliste collabore pour faire face au danger de la grève de masse. Le prolétariat n'aura pas devant lui une bourgeoisie surprise et déconcertée comme dans la première vague de lutte de 1968, il affrontera une bourgeoisie avertie, préparée à utiliser au maximum ses capacités de mystification, de dévoiement et de répression. Le processus d'unification internationale de la classe ouvrière dans sa lutte pour la destruction du capitalisme s'annonce comme un processus long et difficile.
C'est à cette réalité que les minorités révolutionnaires qui participent du processus d'unité et de prise de conscience de la classe ouvrière se trouvent confrontées. Loin d'être à la hauteur des exigences de la période actuelle, les organisations révolutionnaires sont extrêmement minoritaires et se débattent dans une confusion politique et une dispersion organisationnelle profondes.
Depuis plus d'un an, les faiblesses n'ont fait que s'accentuer dans des disparitions de groupe et des scissions. Ce phénomène culmine aujourd'hui avec la crise qui secoue le Parti Communiste International (Programme Communiste). Après une vague d'exclusions et de nombreux départs, c'est une majorité de 1'organisation qui va rejoindre les positions les plus chauvines et nationalistes de la bourgeoisie, en prenant position pour un camp dans la guerre impérialiste au Moyen-Orient. Cette organisation paye le prix de sa sclérose politique et organisationnelle.
Son incapacité à tirer un bilan critique de la vague révolutionnaire des années 1917-23 et de la contre-révolution qui 1'a suivie, des positions de 1'Internationale Communiste et des fractions de gauche qui s'en sont dégagées, - en particulier sur la question nationale et syndicale et sur la question de 1'organisation des révolutionnaires et du parti -, son incapacité à comprendre les enjeux de la période actuelle, l'ont mené tout droit à 1'opportunisme et à 1'activisme, jusqu'à la dislocation de 1'organisation.
C'est une responsabilité de 1'ensemble des organisations révolutionnaires de tirer les leçons de cette crise qui exprime la faiblesse générale du mouvement révolutionnaire aujourd'hui, et de contribuer activement à ce que la décantation nécessaire et inévitable ne se transforme en dispersion des énergies révolutionnaires. L'histoire ne pardonne pas, et si les organisations révolutionnaires aujourd'hui ne sont pas capables de répondre aux exigences de la situation, elles seront balayées sans recours, affaiblissant la classe ouvrière dans sa tâche de défense des perspectives du communisme au cours de ses combats.
"Une crise qui est pour nous très grave et dont les répercussions sur toute notre organisation seront probablement décisives, vient d'éclater dans le Parti" (Le Prolétaire n°367, Il Programma Comunista n°20, "Mieux vaut moins mais mieux"). Les articles de la presse nous informent de départs en cascade :
En France ;
- la scission de ceux qui Se regroupent autour d'El Oumami, autrefois organe du PCI pour l'Algérie, aujourd'hui devenu l’"organe des communistes léninistes algériens", pour défendre des positions nationalistes bourgeoises dans le plus pur style tiers-mondiste ;
- le départ de la majorité des membres à Paris et d'autres un peu partout en France "parmi les quels ceux qui avaient des responsabilités de di rection", apparemment sur des positions proches d'El Oumami, avec pour certains le projet de sortir une revue, Octobre.
"En Italie, la crise a secoué toutes les sections du fait même de sa précipitation, mais à la liquidation n 'ont adhéré que quelques camarades de Turin et - nous ne savons pas encore combien - quelques camarades de Florence" (Il Programma Communista 29-10-82).
En Allemagne, la disparition de la section et de la publication Proletarier.
La presse du PCI, en donnant ces nouvelles, ne parle pas :
- de l'expulsion l'an dernier des sections du sud de la France dont Marseille, par la même direction qui est partie actuellement en France, et des sections en Italie, dont Ivrea. Il semblerait que les expulsés mettaient en question toute la politique consistant à mettre en place une panoplie de "comités" ("comité contre les licenciements", "comité anti-répression", comités dans l'armée, féministes, de squatters, etc.), ayant tous pour objectif de mieux "implanter" le Parti au sein des "luttes sociales".
- des départs d'autres éléments ensuite, pour protester contre ces expulsions, et des démissions individuelles pour des raisons non encore claires.
- de la disparition du "secteur Amérique Latine".
Ce sont des pans entiers du PCI qui se sont volatilisés en quelques mois sans aucune clarté réelle. Pourquoi cette crise ? Pourquoi maintenant ?
Les événements de la période de montée des luttes de classe aujourd'hui commencent à dissiper le brouillard de l'idéologie bourgeoise dans la tête des ouvriers. De même, ils mettent à l'épreuve les positions politiques des minorités révolutionnaires en balayant les débris des groupes gangrenés par l'idéologie bourgeoise, en secouant, plus, disloquant des groupes ambigus et inutiles.
Dans ce sens, la crise du PCI est la manifestation la plus spectaculaire des convulsions du milieu révolutionnaire aujourd'hui. Il y a un an, quand nous avons parlé des convulsions, des scissions, des régressions politiques dans le milieu révolutionnaire (Revue Internationale n°28) face aux "années de vérité", tout le milieu politique a fait la sourde oreille. Aujourd'hui, peut-être ces messieurs vont-ils se réveiller ! Le milieu révolutionnaire (y inclus le PCI) n'a pas voulu créer un cadre de Conférences internationales, permettant la décantation des positions politiques dans la clarté ; aujourd'hui, il subit la décantation par la "force des choses", avec tous les risques de perte des énergies militantes que cela comporte. Même si aujourd'hui, il est clair que la réalité sanctionne les insuffisances programmatiques du PCI, il est de la responsabilité des révolutionnaires de tirer le bilan qui s'impose impérieusement pour éviter de répéter les mêmes erreurs à 1'infini.
On ne peut ignorer que pendant longtemps le PCI a été un pôle de référence dans plusieurs pays pour des éléments qui cherchaient la voie des positions de classe. Mais en se basant sur un programme politique inadéquat et erroné, sur une structure interne de secte, le PCI s'est sclérosé au fil des années. Sa régression politique s'est révélée à l'épreuve des événements : devant le massacre au Liban, le PCI a appelé les prolétaires au Moyen-Orient à lutter "jusqu'à la dernière goutte de sang" pour défendre la cause palestinienne à Beyrouth. Quelques mois après, 1'organisation éclate.
La crise ne s'explique pas comme semblent le croire aussi bien les scissionnistes que le PCI "maintenu" par des erreurs "de la direction" ou par des erreurs "tactiques". Ce sont des erreurs programmatiques, à la base même de la constitution du PCI qui se payent aujourd'hui. Le "retour à Lénine" pour appuyer la "glorieuse lutte de libération nationale" que préconisent les scissionnistes, pour couvrir tout simplement leur démarche maoïsante est toute proche de la position du PCI. Si le PCI ne tient qu'à un fil aujourd'hui, cette manière d'expliquer la crise en termes d'"erreurs de direction" et de "tactique" va le couper définitivement.
UNE CRISE QUI ILLUSTRE LA FAILLITE D'UNE CONCEPTION DE L'ORGANISATION
LE BLUFF DU PCI
La crise aujourd'hui laisse un bilan accablant pour "le parti compact et puissant de demain".
Elle se traduit, selon la presse du PCI, "par 1'effondrement organisatif du centre international et la disparition de 1'ancienne Rédaction du Prolétaire, par le départ de tous les responsables centraux de France" (Le Prolétaire n°367). Les militants qui restent dans le PCI n'étaient au courant de rien. Ils en sont réduits à faire des appels dans la presse pour que les membres qui veulent rester dans le parti se manifestent en écrivant à la Boite Postale ! C'est incroyable d'être acculé ainsi à donner à l'Etat un moyen de repérage si facile.
Les fameux et arrogants "responsables centraux" sont partis en emportant le matériel, l'argent, "y compris les cotisations qui avaient été payées le jour même" (d'après un militant du PCI à Paris), des locaux. Voila des moeurs de gangstérisme politique de la bourgeoisie totalement étrangères au prolétariat que nous avions stigmatisées sans ambiguïté lors de l"Affaire Chénier" pendant la crise du CCI (voir Revue Internationale n°28).
Les grands mots ronflants sur le parti pur et dur, "centralisé", n'étaient qu'un bluff. Le PCI s'effondre comme un château de cartes : "La crise s'est traduite par une activité décentralisée et localiste, couverte seulement en apparence par une centralisation de façade" (Il PC 29-10-82). Les grands discours sur le "centralisme organique" cachaient un fédéralisme de la pire espèce où chaque partie de l'organisation finit par n'en faire qu'à sa tête, une structure molle ouverte à tous les vents de l'idéologie bourgeoise, véritable pépinière d'irresponsables, d'apprentis-bureaucrates, de futurs sergents-recruteurs pour les massacres impérialistes, comme déjà aujourd'hui pour le Moyen-Orient.
Après s'être gargarisé de mots pendant 40 ans sur le parti qui "organise" la classe ouvrière, on ne peut tomber de plus haut.
Peut-être que cette crise servira de leçon à tous les groupes dans le mouvement actuel qui réduisent tout débat à la question du parti, qui se décernent des titres de gloire qu'ils n'ont rien fait pour mériter, qui entravent tout progrès réel vers un véritable Parti de la classe ouvrière par leurs prétentions absurdes d'aujourd'hui. Expliquer les difficultés de la lutte de classe dans la situation internationale par l'absence du parti, tracer comme seule perspective celle de sa présence eucharistique qui résoudra tout, comme l'a ressassé le PCI depuis des années, est non seulement faux et ridicule, ça se paye. Comme nous le disions : "Le drame du bordiguisme est de vouloir être ce qu'il n'est pas : le Parti, et de ne pas vouloir être ce qu'il est : un groupe politique. Ainsi, il n'accomplit pas - sauf en paroles - les fonctions du parti qu 'il ne peut accomplir, et n'assume pas les tâches, mesquines à ses yeux, d'un vrai groupe politique" ("Une caricature de parti : le parti bordiguiste", Revue Internationale n°14).
Où est donc le fameux parti "bloc monolithique" ? Sans failles ? Ce "monolithisme", revendiqué par le PCI, n'a jamais été qu'une invention stalinienne. Il n'y a jamais eu d'organisations "monolithiques" dans l'histoire du mouvement ouvrier. La discussion constante et la confrontation politique organisées dans un cadre unitaire et collectif, est la condition d'une véritable solidité, homogénéité et centralisation d'une organisation politique prolétarienne. En étouffant tout débat, en cachant les divergences derrière le mot de "discipline", le PCI n'a fait que comprimer les contradictions jusqu'à l'éclatement. Pire, en empêchant la clarification à l'extérieur comme à l'intérieur de l'organisation, il a endormi la vigilance de ses militants. La sécurisation bordiguiste de la vérité pyramidale, la direction des chefs, a laissé les militants dépourvus d'armes théoriques et organisationnelles devant les scissions et les démissions. C'est ce que le PCI semble reconnaître lorsqu'il écrit : "Nous entendons traiter (ces questions) de façon plus ample dans notre presse, en mettant nos lecteurs devant les problèmes qui se posent à l'activité du parti" (Il PC, id.). Ces mots semblent être pour le moment plus un clin d'oeil aux militants qui sont partis dans une confusion politique complète, et dont certains ne se doutent certainement pas du bourbier dans lequel ils se sont enfoncés, qu'une véritable reconnaissance de la faillite de l'étouffoir du PCI "seul au monde". La reconnaissance de la nécessité d'ouvrir le débat sur "les problèmes qui se posent à l'activité", et l'ouverture effective de discussions à l'intérieur et à l'extérieur est une des conditions pour garder le PCI au prolétariat, pour lutter contre la pourriture politique qui ronge l'organisation. Le PCI a connu d'autres scissions dans ses quarante ans d'existence, mais celle d'aujourd'hui ébranle non seulement son cadre organisationnel, mais les fondements de sa trajectoire politique, et le met devant l'alternative : tiers-mondisme ou marxisme.
L’INTERNATIONALISME CONTRE TOUTE FORME DE NATIONALISME
LE NATIONALISME AVOUE D1EL OUMAMI
El Oumami a scissionné avec le PCI parce que le jusqu'auboutisme dans la défense de l'OLP a Beyrouth devait y rencontrer des résistances. Ces résistances doivent être bien faibles si on en juge par la position du PCI sur la question. On peut cependant supposer qu'elles portent sur le degré d'engagement, El Oumami intitulant le document dans lequel il Se présente : "Du parti-programme au parti d'action révolutionnaire". Tout un programme !
El Oumami défend le caractère progressiste du mouvement national palestinien contre "le cancer greffé sur le corps arabe qu'est 1'entité sioniste", "1'Etat-colon, mercenaire, raciste et expansionniste d'Israël". Pour El Oumami, il est hors de question de mettre sur un pied d'égalité "l'Etat-pied-noir" et les "Etats légitimes" du "monde arabe".
Ce type de distinction a toujours été l'argument de la bourgeoisie pour embrigader la classe ouvrière dans la guerre. Oui, tous les Etats capitalistes sont ennemis de la révolution, nous dit-on, mais il y a l'ennemi n°1 et l'ennemi n°2. Pour la première guerre mondiale, "battons-nous contre "le despotisme russe" disait en substance la Social-Démocratie allemande ; pour l'autre camp, c'était se battre contre "le militarisme prussien". Dans la 2ème guerre mondiale, c'est avec le même langage que les "antifascistes" de tous bords, staliniens en tête, ont embrigadé les prolétaires en appelant et en participant à "abattre l'ennemi n°1", "l'Etat fasciste", pour défendre "l'Etat démocratique".
Pour El Oumami, 1'"union sacrée juive" fait disparaître les antagonismes de classe à l'intérieur d'Israël. Inutile donc de faire des appels au prolétariat d'Israël. C'est exactement le "peuple allemand, peuple maudit" des staliniens pendant la 2ème guerre mondiale. Et quand, au cours d'une manifestation "OLP-Solidarité", aux cris de "Sabra et Chatila, vengeance !", El Qumami se vante d'avoir "capturé un sioniste qui a reçu une terrible raclée", on est au niveau de "à chacun son boche" du PCF à la fin de la 2ème guerre.
El Oumami se joint aux rangs de la bourgeoisie au niveau du chauvinisme le plus abject. A ce niveau, c'est un groupe maoïsant, tiers-mondiste virulent, qui ne mérite pas qu'on s'attarde particulièrement. Mais ce qui frappe, en lisant les textes, c'est que ces chauvins nationalistes ont plein la bouche de la Gauche Italienne, cette fraction de la Gauche Communiste Internationale qui fut une des rares et la plus conséquente pour résister à la contre-révolution et maintenir l'internationalisme prolétarien dans la tourmente de la 2ème guerre impérialiste.
Comment le PCI, "continuateur" de la Gauche Italienne, a-t-il pu laisser se développer un tel poison nationaliste en son sein ? Et c'était la direction de Paris, la rédaction du Prolétaire, la rédaction d'EI Oumami, la section en Allemagne ?
Nous rappellerons dans la troisième partie de cet article comment le PCI a conçu cet enfant dans l'oubli de toute une période de l'histoire de la Gauche Italienne entre 1926 et 1943, comment il s'est formé avec des groupes de "Partisans" de la "Résistance" en Italie, le "comité anti-fasciste de Bruxelles" en 1945, comment les confusions politiques sur le rôle de 1'"antifascisme" et la nature des camps en présence à la fin de la 2ème guerre mondiale que le(s) PCI n'ont jamais clarifiées, sont à la racine de ce qui éclate au grand jour aujourd'hui.
Parce que le PCI a nourri cet enfant et le reconnaît même aujourd'hui, ce dernier est le produit légitime de sa propre incohérence et dégénérescence.
LE NATIONALISME HONTEUX DU P.CI.
"Pour le vrai révolutionnaire naturellement, il n'y a pas de 'question palestinienne', mais uniquement la lutte des exploités du Moyen-Orient, arabes et juifs y compris, qui fait partie de la lutte générale des exploités du monde entier" (Bilan n°2).
El Oumami s'en fout d'une telle position : à l'école de la "tactique" du PCI, il pose la question non pas en terme de classes, mais en terme de nations. Le futur "parti d'action révolutionnaire" met donc son géniteur, le PCI, au pied du mur, connaissant fort bien son incohérence congénitale, et lui lance un défi : "Imaginons un instant 1'invasion de la Syrie par 1'Armée Sioniste. Devons-nous rester indifférents ou pire (sic) appeler au défaitisme révolutionnaire sous prétexte que 1'Etat syrien est un Etat bourgeois à abattre ? Si les camarades du Prolétaire sont conséquents, ils doivent le déclarer publiquement. Quant à nous, nous prenons position ouvertement contre Israël". Et encore : "Le Prolétaire se prononce pour la destruction de 1'Etat pied-noir d'Israël. Soit. Mais en même temps, il soutient que les Palestiniens subissent une oppression nationale dans les pays arabes, qu'Israël est entré au Liban continuer 1'oeuvre de la Syrie. Alors, où réside la spécificité d'Israël? Devons-nous comprendre que la destruction de1'Etat pied-noir a la même signification que la destruction des Etats arabes, aussi réactionnaires soient-ils ?".
Pour El Oumami, c'est net : le critère réactionnaire ne doit pas jouer pour un prolétaire arabe. Son Etat, c'est un Etat arabe, un point c'est tout. D'abord la guerre, après les lendemains qui chantent.
Mais que répond le PCI ? Que répondent les défenseurs intransigeants, les héritiers de la Gauche Italienne, le Parti Historique ? Tout juste un petit "oui, mais"...
L'article "La lutte nationale des masses palestiniennes dans le cadre du mouvement social au Moyen-Orient" publié dans Le Prolétaire et II Programma commence en nous sermonnant sur le sentiment panarabe, le capital arabe, la tendance unitaire arabe et la nation arabe : le rêve d'un étudiant universitaire qui a du rater la fin du cours sur le panslavisme, la négritude, et autres guevarismes des années 60.
Le "capital arabe" n'est pas inféodé au capital américain... Ce serait une vision "superficielle". Par contre, "l'Etat colon juif" l'est "constitutionnellement". Le PCI ne dit pas qu'Israël est totalement un bloc sans classes, niais que les prolétaires là-bas lui semblent "plus anti-arabes que les bourgeois". Et les sentiments xénophobes ne touchent jamais les prolétaires palestiniens ou français ou italiens comme de bien entendu. Et pour finir, on nous sort la vieille cuisine du niveau le plus bas du"maoïsme"le plus répugnant qu'on pouvait trouver chez les "Students for Démocratie Socialism" américains, sur la classe ouvrière ayant "le privilège de peau blanche" qui exploiterait les ouvriers noirs d'Amérique.
Quant à l'OLP, il reste un défenseur de la veuve et de l'orphelin à "la pointe la plus avancée des luttes sociales gigantesques du Moyen-Orient".
Le PCI affirme : "C'est précisément sur le terrain de la lutte commune (entre bourgeoisie et prolétariat) que les prolétaires palestiniens et arabes peuvent acquérir la force pour se dresser contre leurs alliés apparents, mais en réalité déjà leurs ennemis d'aujourd'hui". De qui ? De quoi ? Ah, mais ce n'est que "1'apparence qui est inter-classiste" nous dit la science bordiguiste... En réalité la guerre des Classes "vit à l'intérieur des sujets physiques eux-mêmes", (...) "au-delà et en dehors et même contre la conscience des individus eux-mêmes". Le PCI remplace la politique par la psychologie individuelle.
"Il faut renforcer la lutte nationale en la remplissant de contenus que la bourgeoisie se garde bien de lui donner". Ceci s'appelle défendre la "révolution double", sans y être et tout en y étant.
Cet article de clarification (?) finit tout simplement dans le délire. Il faut "construire une armée à direction prolétarienne grâce au travail organisatif des communistes" pour créer un "cobelligérant" avec l'armée de l'OLP !!
Le PCI déverse exactement les mêmes lamentations que la scission : "Le prolétariat dans les métropoles ne se mettaient pas vraiment en mouvement"; alors "à sa place, on a cherché les mouvements de jeunes, de femmes, anti-nucléaire, pacifiste" (Le Prolétaire n°367). C'est le triste refrain de tous les tiers-mondistes, les étudiants, les blasés et les modernistes : le prolétariat les "déçoit".
Comme le PCI prétendait être déjà le parti, ses enfants n'ont fait que vouloir le mouvement "tout de suite" ; de là ses qualificatifs de "mouvementistes" pour les démissionnaires et les scissionnistes. Une scission "propre", El Oumami ? Cette scission est proprement tombée dans le gauchisme du PCI.
Sortir de ce marasme gauchiste ne sera pas facile pour le PCI. Il n'en prend pas le chemin. Pour le moment, il gémit des "mea culpa" exactement sur le même terrain qu'El Oumami. Le Parti n'aurait pas su faire "le lien tactique" avec les masses ; il serait resté trop "abstrait", trop "théorique". Tout cela est faux. Le PCI a utilisé le mot "programme communiste" pour couvrir un vide théorique et justifier une pratique de soutien au nationalisme et d'activisme sans principes. Ce vide théorique et sa pratique actuelle, c'est ce que nous allons voir maintenant.
LA SOURCE DES ERREURS : LE VIDE THEORIQUE
"Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants" (Marx. "Le 18 Brumaire").
L'IC ET LES GAUCHES
Pour expliquer la crise du PCI, il faut remonter aux sources de sa régression politique, au manque de compréhension des erreurs de 1'Internationale Communiste (IC), au nécessaire réexamen critique du passé que le milieu actuel n'a jamais su ni voulu faire jusqu'au bout.
La Gauche Communiste des années 20 n'a pas cherché à expliquer la dégénérescence de l'IC par une "crise de direction", comme le fait le PCI aujourd'hui, pour lui-même, ni seulement par des"erreurs tactiques". Ce serait la réduire au tronc commun du trotskisme : "la crise du mouvement révolutionnaire se résume à la crise de sa direction" (Programme de transition de Trotsky). La Gauche Communiste se rendait compte que l'IC fondée sur une vague révolutionnaire internationale surgissant brusquement de la guerre, n'arrivait pas à saisir toutes les exigences de la nouvelle"période de guerre et de révolution". Chacun des Congrès de l'IC témoigne à un degré grandissant des difficultés à saisir les implications de la crise historique du capitalisme, à se débarrasser des anciennes tactiques social-démocrates, à comprendre le rôle du parti et des conseils ouvriers. Dans la situation tourmentée de l'époque, tirer toutes les implications programmatiques d'une telle situation était impossible. Vouloir aujourd'hui ériger tout ce qu'a produit l'IC en dogmes serait justement tourner le dos à la Gauche Communiste.
Au sein de l'IC, les Gauches allemande, italienne, hollandaise, anglaise, russe, et américaine étaient l'expression de 1'avant-garde du prolétariat des grands centres industriels. Avec ses formulations hésitantes et souvent confuses, la Gauche a essayé de poser les vrais problèmes de la nouvelle époque : est-ce que les syndicats restent des organes de la classe ouvrière ou ont-ils été happés dans l'engrenage de l'Etat bourgeois ? Faut-il en finir avec la tactique "parlementaire"? Comment comprendre la lutte nationale dans l'ère globale de l'impérialisme ? Quelle est la perspective pour ce nouvel Etat russe ?
La Gauche Communiste n'a jamais réussi à s'assumer en tant que fraction au sein de la 3ème Internationale, à confronter les positions en son sein. Dès 1921 (moment de l'interdiction "provisoire" des fractions dans le Parti bolchevik en Russie), la Gauche allemande (KAPD) est exclue de l'IC. L'élimination successive de toutes les Gauches va suivre jusqu'à la mort de l'IC avec l'acceptation du "socialisme en un seul pays".
Si les Gauches étaient déjà disloquées au sein de l'IC, elles allaient l'être encore plus en dehors. Quand l'IC est morte, la Gauche allemande est déjà dispersée en plusieurs morceaux, tombant dans l'activisme, l'aventurisme, et est éliminée sous les coups d'une répression sanglante; la Gauche russe est dans les prisons de Staline ; les faibles Gauches anglaise et américaine ont disparu depuis longtemps. En dehors du trotskysme, c'est essentiellement la Gauche italienne, et ce qui restait de la Gauche hollandaise qui vont, à partir de 1928, maintenir une activité politique prolétarienne, sans Bordiga et sans Pannekoek, en partant chacune de bilans différents de l'expérience vécue.
Le mouvement révolutionnaire d'aujourd'hui a encore tendance à voir la Gauche Communiste uniquement sous sa forme disloquée et partielle léguée par la contre-révolution. Il parle des apports positifs ou négatifs de telle ou telle Gauche en dehors du contexte global de l'époque. Le PCI a accentué et aggravé cette tendance en réduisant toute la Gauche Communiste à la Gauche italienne, et uniquement celle de la période de 1920 à 1926. Pour le PCI, la Gauche allemande devient une bande d'"anarcho-syndicalistes", identique à la tendance de Gramsci. Ce n'est pas qu'il ne faut pas critiquer sévèrement les erreurs de la Gauche allemande, mais chez le PCI cela devient une caricature totale. L'idée de restaurer l'héritage de la Gauche Communiste enseveli par la contre-révolution, se réduit dans le PCI à la republication à l'infini des textes de Bordiga. L'héritage de la Gauche est surtout une oeuvre critique ; le PCI l'a réduit à une liturgie de secte jalouse. Ainsi, toute une génération de militants du PCI ne connaît qu'une vision déformée de la réalité de la Gauche Communiste Internationale, et les questions politiques qu'elle a posées.
LA PERIODE DE LA "FRACTION" ET BILAN (1926-1945)
Jamais les bordiguistes ne parlent de cette époque de la Gauche italienne : ni vu, ni connu pour le PCI. Que devient la "continuité organique" dont se réclame le PCI pour se proclamer le seul et l'unique héritier de la Gauche Communiste ? Un trou de 20 années de travail militant. Mais pendant toutes ces années, Bordiga n’était pas là. La seule explication qu'on peut trouver, c’est que la "continuité organique" est en fait la présence d'un "chef génial".
La Gauche italienne dans l'émigration autour de la revue Bilan a continué le travail de la Gauche Communiste, avec la consigne de l'heure : "Ne pas trahir". Le lecteur trouvera le détail de cette période dans la brochure La Gauche Communiste d'Italie, publiée par le CCI.
Pour continuer son activité, et dans une période autrement plus difficile que la notre, elle a rejeté la méthode qui consiste à se raccrocher à Lénine comme à une bible. Elle s'est donnée la tâche de tirer les enseignements de la défaite en passant l'expérience au crible de la critique "sans aucun interdit ni ostracisme" (Bilan n°1). A l'étranger, la Fraction a pu s'enrichir des apports de l'héritage luxembourgiste à travers, entre autre, l'apport des militants de Belgique qui se sont ralliés à la Gauche italienne. En tant que "Fraction italienne de la Gauche Communiste", elle a repris le travail de la Gauche toute entière : en rejetant la défense des libérations nationales, en mettant en question la nature "prolétarienne" des syndicats (sans aboutir à une position définitive); en analysant la dégénérescence de la révolution russe, le rôle de l'Etat et du parti. Elle a tracé la perspective historique de son époque de cours vers la guerre impérialiste mondiale avec une lucidité telle, qu'elle lui a permis d'être une des seules organisations à rester fidèle aux principes prolétariens, en dénonçant 1'anti-fascisme, les fronts populaires et la participation à la défense de l'Espagne "républicaine".
La guerre a numériquement affaibli la Fraction mais le PCI occulte complètement le fait qu'elle a maintenu son activité politique pendant la guerre comme en témoignent les 9 bulletins et les tracts les Conférences et la constitution (en 1942) du noyau français de la Gauche Communiste qui publiera Internationalisme.
Vers la fin de la guerre, la Fraction exclut un de ses dirigeants, Vercesi, condamnant sa participation au "Comité anti-fasciste de Bruxelles" (comme elle avait exclue la minorité qui s'était laissée entraîner dans l'embrigadement anti-fasciste de la guerre d'Espagne). Par contre, le PCI naissant en Italie en 1943 a flirté avec des "Partisans" et a adressé des Appels pour un front unique de classe au P.C stalinien et au Parti Socialiste d'Italie (Voir l'article "Le PCI tel qu'il prétend être et tel qu'il est" dans ce numéro de la Revue Internationale).
LA FORMATION DU PCI
Le Partito Communista Internazionalista d'Italie se forme sur la base d'un regroupement politique hétérogène : il exige la dissolution pure et simple de la Fraction tandis que des groupes du "Mezziogiorno" qui avaient des rapports ambigus avec 1'anti-fascisme, les trotskystes et même le PC stalinien sont intégrés en tant que groupes constitutifs et avec la caution de Bordiga. Vercesi et l'ancienne minorité exclue sur la question de l'Espagne sont également intégrés sans discussions. " Le nouveau parti n'est pas une unité politique mais un conglomérat, une addition de courants et de tendances qui ne manqueront pas de se heurter. L'élimination de l'un ou l'autre courant est Inévitable. Tôt ou tard, la délimitation politique et organisationnelle s 'imposera" (Internationalisme n° 7, Février 1946).
En effet, en 1952, la tendance Damen a scissionné du parti avec la majorité de ses membres, le journal Battaglia Comunista, ainsi que la revue Prometeo. ([1] [3])
Tout le travail politique et théorique de la Fraction disparaît pour le PCI formé dans un regroupement immédiatiste et sans principes. Le PCI tourne le dos à tout l'héritage de Bilan sur 1'anti-fascisme, la décadence du capitalisme, les syndicats, la libération nationale, la signification de la dégénérescence de la révolution russe, l'Etat dans la période de transition. Tout cet héritage, le PCI le considère comme des "lâchages" du programme "invariant". Pour le nouveau PCI, les partis staliniens sont réformistes", la Russie, un impérialisme moins dangereux que l'ennemi numéro1, l'impérialisme américain, la décadence historique du capitalisme devient des "crises cycliques et structurelles", les approfondissements théoriques de Bilan sur le programme cèdent complètement la place au retour de la "tactique léniniste". C'est ainsi que le PCI a contribué à ramener le débat dans le mouvement révolutionnaire 20 ans en arrière, au moment de l'IC, comme si rien n'avait existé entre 1926 et 1945.
Alors que Bilan insiste sur le fait qu'un parti ne se forme que dans une période de montée des luttes de classe, le PCI s'autoproclame le "Parti" en pleine période de réaction. Ainsi, il a créé une "tradition" selon laquelle n'importe qui peut se proclamer qui n'était que trop contente de constater leur refus. Mais, même un début de clarification politique était trop dur pour le PCInt et la Communist Workers'Organisation. Ils ont "exclu" le CCI à la 3ème Conférence pour des désaccords sur la question du parti, non pas après un débat profond, mais a priori par une manoeuvre digne des plus sinistres intrigues à la Zinoviev de l'IC dégénérescente. Quelle école que celle du bordiguisme ! Et surtout si on touche à son fétiche, "le parti", que seuls les bordiguistes savent construire comme on peut en voir aujourd'hui le résultat. A une réunion récente, appelée "la 4ème Conférence Internationale de la Gauche Communiste", considérée par le PCInt comme un"indiscutable pas en avant par rapport aux Conférences précédentes" (Battaglia Comunista, du 10-11-82), le PCInt et la CWO ont "commencé à aborder les vrais problèmes du futur parti" ... avec un groupe d'étudiants iraniens mal dégagé du tiers-mondisme. Après tout, chacun a son peuple à libérer : Programma ses Palestiniens, Battaglia ses Iraniens.
Mais à cette époque, de 1976 à 1980, le PCI a tout de même fini par sentir qu'il fallait bouger". Ayant tourné le dos à la clarification politique internationale et sans analyse cohérente de la période nouvelle, le PCI a simplement troqué son immobilité pour un activisme frénétique : les deux faces de la même médaille. Aujourd'hui, en constatant que l'organisation part en lambeaux, sur quoi insiste le PCI ? De nouveau sur la "tactique", et pas seulement sur la question nationale, mais sur toutes les questions.
Le PCI a transformé 1'anti-parlementarisme de la Fraction abstentionniste en "tactique" pour ensuite appeler à participer à des élections et des référendums. Il appelle à la défense des "droits démocratiques" dont le droit de vote, pour les ouvriers immigrés. Pour quoi faire ? Pour après leur dire de ne pas aller voter ? On voit aujourd'hui 1'"après". 1'"antiparlementarisme" est devenu purement verbal, séparé de toute cohérence sur la période historique du capitalisme.
N'importe quelle "tactique" syndicale, de comités frontistes, d'appui critique aux groupes terroristes comme Action Directe en France, est bonne pour "organiser" les masses.
Et en Pologne, le PCI a vu dans les saboteurs de l'autonomie de la classe ouvrière, Solidarnosc et ses conseillers du KOR, les "organisateurs" du mouvement de la classe, eux qui ont tout fait pour le ramener sur le terrain de la défense de l'économie nationale. Et le PCI réclame la "légalisation" de Solidarnosc aux côtés de la bourgeoisie démocratique !
Ne voulant pas discuter avec les "déchets du réveil de la classe", le PCI a préféré "recruter" dans les résidus de la décomposition du maoïsme. Lorsque le PCI se fit le flic du"service d'ordre" contre le "danger fasciste" des manifestations de la lutte des foyers de travailleurs immigrés en France, interdisant en fait la distribution de la presse révolutionnaire, ce fut un symbole de sa descente à grande vitesse sur la pente glissante du gauchisme.
PERSPECTIVES
Le PCI aurait du rejeter les positions de El Oumami depuis longtemps, avant que cette gangrené n'ait pénétré toute l'organisation. El Oumami entonne le chant des sirènes pour attirer le PCI vers la cohérence de la bourgeoisie. Le PCI ne peut plus se réfugier dans l'incohérence et le charabia pour y résister. Des replâtrages ne tiendront plus le coup dans la période actuelle. En premier lieu, le PCI et tout le milieu révolutionnaire doivent reconnaître clairement que l'internationalisme è notre époque ne peut se développer qu'en rupture totale avec toute forme de nationalisme, ne peut signifier qu'une lutte intransigeante contre tout mouvement national qui ne peut être aujourd'hui qu'un moment des luttes entre puissances impérialistes, petites ou grandes. Toute défaillance sur cette question ouvre une brèche immédiate à la pression de l'idéologie bourgeoise qui entraînera une organisation inéluctablement et rapidement dans la contre-révolution.
Il ne serait pas trop tard pour le PCI de se ressaisir, à condition qu'il ait la force et la volonté de regarder la réalité en face, de réexaminer les leçons du passé, de revoir de façon critique ses propres origines.
Il y a eu d'autres départs du PCI au cours de l'année passée, mais nous ne savons pas exactement ce que deviennent ces militants. A Marseille subsisterait un cercle pour qui "le parti formel est mort, seul vit le parti historique". Ce vocabulaire bordiguiste n'est pas très clair pour le commun des mortels ; est-ce que "le parti historique" dans ce sens veut dire le programme bordiguiste ? Le marxisme ? Quel bilan faut-il tirer et pourquoi le silence de ces éléments aujourd'hui ?
D'autres ont quitté le PCI à cause de l'étouffement organisationnel et par réaction instinctive à la dégénérescence. Mais il faut aller plus loin qu'un constat, jusqu'à la racine du mal. Il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin, en croyant "restaurer" un "vrai" bordiguisme qui n'existe pas, le pur bordiguisme "de Bordiga" qui n'a jamais existé. Ce chemin mène tout droit aux cénacles, à la création de "Partiti" de plus en plus réduits, chacun se disputant le titre légitime en ignorant les autres comme ont fait bon nombre de scissionnistes-bordiguistes depuis des années, chacun se disputant la "direction" de la classe ouvrière pour l'emmener au "paradis".
La clarification politique ne peut pas venir de rafistolages ni de 1'isolement. Elle ne peut se faire qu'avec et dans le milieu révolutionnaire. Il faut rompre le silence en ouvrant un débat public, dans la presse, dans des réunions, pour en finir avec les erreurs du passé, pour assurer que cette décantation se fasse de façon consciente, pour éviter la dispersion et la perte d'énergies révolutionnaires. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra déblayer le terrain pour le regroupement des révolutionnaires qui contribuera au processus de l'unification de la classe ouvrière internationale. Voilà la tâche de l'heure, voilà la vraie leçon de la crise du PCI.
J.A.
[1] [4] Le parti de Bordiga devient après la scission II Partito Comunista Internazionale. Beaucoup d'ex-membres de la Fraction sont partis avec Damen et le programme de Battaglia Comunista (PCInt.) en 1952 contient certaines positions importantes de Bilan : sur la question nationale, la question syndicale, sur la Russie. Malheureusement, les quarante années qui nous séparent des débuts de Battaglia Comunista ont vu ce groupe s'engager dans un processus de sclérose qu'une lecture de sa presse aujourd'hui, comparée à sa plateforme de 1952, ne manquera pas de révéler.
Courants politiques:
- Bordiguisme [5]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le parti communiste international (Programme Communiste) à ses origines, tel qu’il prétend être, tel qu’il est.
- 5384 reads
Introduction
Dans le milieu politique prolétarien, on connaît, plus ou moins bien, le courant bordiguiste tel qu'il prétend être, à savoir un "Parti dur et pur" avec un "Programme achevé et invariant".
Cela tient, de toute évidence, davantage de la légende que de la réalité. Dans la réalité, en fait du "Parti", par exemple, nous connaissons au moins 4 ou 5 groupes provenant du même tronc, dont le PC International (Programme), qui prétendent être chacun l'unique héritier, le seul légitime, de ce que fut la Gauche Italienne, et incarner le "Parti historique" de leur rêve. C'est probablement là la "seule invariance" qui leur soit commune. On connaît par contre, très mal, ou pas du tout –et cela est vrai avant tout pour la majorité des militants de ces partis– les véritables positions de ce "Parti" à son origine, c'est-à-dire à sa fondation, en 1943-1944, après et suite à l'effondrement du régime de Mussolini en Italie au milieu de la 2ème guerre mondiale.
Pour pallier à cette ignorance, nous estimons très important de publier ci-dessous un des premiers documents de ce nouveau parti (PC.Int) paru dans le premier numéro de son journal Prometeo. Ce document qui porte sur une question cruciale : la position des révolutionnaires face à la guerre impérialiste et les forces politiques qui y participent, permettra à tout militant de se faire une idée exacte sur l'état de clarté et de maturité des positions politiques qui ont présidé à la fondation de ce Parti, et l'action pratique que cela impliquait nécessairement.
Ce que le parti communiste internationaliste prétend être
Pour mieux faire ressortir la différence (entre ce qu'il prétend être et ce qu'il a été et continue d'être), il serait bon de commencer par rappeler ce qu'il prétendait être. Pour ce faire, nous nous limiterons à quelques citations extraites d'un article qui se voulait fondamental et qui sert toujours de point central de référence : Sur le Parti "compact et puissant de demain" paru dans le numéro 76 de Programme Communiste en Mars 78.
- "Son existence (du Parti) n'est pas attestée par le fait qu'il est "fini" plutôt qu'en construction, mais par le fait qu'il grandit comme un organisme qui se développe avec les cellules et la structure qu'il avait en naissant ; qu'il grandit et se renforce sans s'altérer, avec les matériaux qui ont servi à le constituer, avec ses membres théoriques et son squelette organisationnel". (p15).
En laissant de côté le style toujours pompeux propre aux bordiguistes, et en faisant de grandes réserves sur l'affirmation que les "matériaux... théoriques" sont l'unique et exclusive condition de la proclamation du Parti, indépendamment du facteur de flux ou reflux de la lutte de classe, nous pouvons retenir l'idée que l'évolution ultérieure d'une organisation dépend largement de ses positions politiques et de sa cohérence à ses débuts. Le PC.Int (Programme) en est une excellent illustration !
Polémiquant contre nous, l'auteur de l'article se trouve contraint de s'expliquer (une fois n'est pas péché mortel !) sur les positions défendues par la Fraction Italienne de la Gauche Communiste et de l'énorme contribution théorique et politique de cette dernière dans sa revue Bilan et ensuite dans la revue Octobre dans les années 30 à 451.
- "Revendiquer aujourd'hui la continuité que la Fraction a réussi, grâce à une splendide bataille, à maintenir fermement... signifie également comprendre les raisons matérielles pour lesquelles la Fraction nous a légué, à côté de tant de valeurs positives, des éléments caducs." (p7)
Ces éléments caducs sont entre autres : qu'il "ne s'agit pas de chercher dans ses propres armes théoriques et programmatiques, mais au contraire de redécouvrir sur tous les points leur force et leur puissance, et de se référer à elles comme à un bloc monolithique pour repartir de l'avant... arriver, en reprenant les armes d'origine à l'exclusion de toute autre, à la compréhension complète des causes de la défaite en même temps que des conditions d'une future offensive".
D'avoir commis l'imprudence de soumettre à la critique les positions et orientations de l’I.C. "a conduit la Fraction à certains lâchages, comme par exemple sur la question nationale et coloniale, ou encore à propos de la Russie.... que dans la recherche d'une voie différente de celle des bolcheviks dans l'exercice de la dictature, ... et aussi, en un certain sens, dans la question du Parti ou de l'Internationale."
Et, plus loin, Programme cite comme illustration des hérésies de la Fraction, Bilan qui écrit "les fractions de gauche ne pourront se transformer en parti, que lorsque les antagonismes entre la position du parti dégénéré et la position du prolétariat menacent tout le système des rapports de classe..."
"Des passages de ce genre nourrissent évidemment la spéculation de ceux qui, tel le groupe Révolution Internationale, théorise aujourd'hui comme inévitable la dégénérescence opportuniste de tout parti de classe qui prétend se constituer avant la vague révolutionnaire future, et .qui, en attendant cette vague et sous prétexte de "Bilan" préliminaire à la renaissance du parti formel, se livrent à une révision complète des thèses constitutives de l'Internationale." (p9)
Le parti bordiguiste ne conçoit absolument pas que l’on puisse mettre en critique, à la lumière de l'expérience vivante, des positions qui se sont avérées fausses ou inadéquates. Invariance oblige. Retenons toutefois, qu'après avoir tiré un coup de chapeau à la "fermeté", à la "splendide bataille" aux "valeurs positives", le porte-parole du PCI rejette aussi "fermement" ce qui constitue justement l'essentiel de l'apport véritable dans l'oeuvre de la Fraction. Quant à nous, le CCI, nous reconnaissons volontiers que cet apport de la Fraction nous a grandement nourris dans notre propre développement, et cela non seulement dans la question du moment de la constitution du Parti, mais dans tant d'autres questions que l'article désigne comme du "lâchage". Le "bloc monolithique" dont parle l'article, en plus de nous paraître comme une phrase ronflante, n'indique rien d'autre qu'un retour en deçà des positions de la Fraction, et même une régression par rapport à l’I.C.
- "Ce qui définit comme Parti un tout petit noyau de militants, c'est la conscience claire de devoir conquérir sur la classe une influence qu'il ne possède que virtuellement, et l'effort consacré à atteindre ce but non seulement par la propagande pour son programme, mais par la participation active aux luttes et aux formes de la vie collective de la classe ; et c'est ce qui, dès ce moment, nous définissait bien comme Parti." (p14)
Voilà une nouvelle définition de la constitution du Parti. Cette fois l'accent est mis sur "l'activisme". On connaît cet activisme qui démange tous les gauchistes, des différents partis des trotskistes aux maoïstes. Le PCI n'a pas manqué de tomber dans cette ornière hier comme aujourd'hui, depuis sa fondation durant la guerre en 43 jusqu'à son soutien actif de la guerre au Liban dans le camp palestinien, en passant par la participation, aux côtés des trotskistes et maoïstes, à toutes sortes de Comités fantômes, celui des soldats, de soutien de la lutte de Sonacotra, des immigrés, etc. Dans ses actions fébriles, il était en effet moins question de "défense de programme" que de se faire les porteurs d'eau afin de "conquérir sur la classe une influence". Mais cela ne l'empêche pas de retomber, comme un chat, sur ses pattes pour écrire :
- "Remarquons en passant que la Fraction à l'étranger ne s'est nullement limitée à la "recherche théorique", mais a mené une rude bataille pratique ! Si elle n'a pas encore été Parti mais seulement son prélude ce n'est pas faute d'activité pratique, mais plutôt à cause de l'insuffisance du travail théorique." (Note p13)
Passons sur "l'insuffisance du travail théorique" de la Fraction. Cette dernière n'a jamais eu la prétention d'avoir dans sa poche un "programme achevé" à l'instar de Programme Communiste, et se contentait humblement de vouloir être une contribution au développement du programme à la lumière d'un examen critique de l'expérience de la première grande vague révolutionnaire et de ta contre-révolution qui l’a suivie. La Fraction manquait, certes, de cette mégalomanie propre au bordiguisme du lendemain de la 2ème guerre mondiale qui, sans la moindre gêne et sans rire, peut écrire :
- "L'histoire de notre petit mouvement a d'ailleurs prouvé.... que le Parti ne naît pas parce que et lorsque la classe a retrouvé, sous la poussée de déterminations matérielles, la voie unique et nécessaire de la reprise. Il naît parce que et lorsque un cercle forcément "microscopique" de militants a atteint la compréhension des causes de la situation objective immédiate et la conscience des conditions de son retournement futur ; parce qu'il a tiré la force, non pas de "compléter" le marxisme par des nouvelles théories.... mais de réaffirmer le marxisme dans son intégralité, inchangée et intacte ; parce qu'il était capable, sur cette base,.... de tirer le bilan de la contre-révolution en tant que confirmation totale de notre doctrine dans tous les domaines." (p10)
- "C'est parce qu'il (le courant bordiguiste) l'avait atteint (le "Bilan global du passé") qu'il a pu 25 ans plus tard se constituer en conscience critique organisée, en corps militant agissant, en Parti ;" et de continuer ainsi : "nous verrons (plus loin) dans quelles conditions et sur quelles bases, mais nous pouvons dire d'emblée que ce n'est pas porté par un mouvement ascendant, mais au contraire en le précédant de loin." (p5)
Cette base est définie en ces termes :
- "... la base du bloc unitaire des positions théoriques, programmatiques et tactiques reconstitué par le petit, le "microscopique" parti de 1951-52 (?) ou d'aujourd'hui, et elle ne peut se faire que dans ses rangs."(p5-6)
Retenons bien cette conclusion "elle ne peut se faire que dans ses rangs". Il est arrivé pourtant à ce Parti un regrettable accident en cours de route, un accident dont on parle avec quelque gêne :
- "En 1949.... fut rédigé l'Appel pour la réorganisation internationale du mouvement révolutionnaire marxiste. Ce qu'on proposait là aux petits noyaux éparpillés d'ouvriers révolutionnaires qui voulaient réagir.... contre le cours désastreux de l'opportunisme, ce n'était certes pas un bazar.... de ceux qui voulaient construire... l'édifice bancal de "l'unité des forces révolutionnaires" dont tout le monde radote. On leur proposait au contraire une méthode de lutte homogène, fondée sur le rejet des solutions présentées par les "groupes influencés ne serait-ce que partiellement (sic !) et indirectement (reste !) par les suggestions et le conformisme... .qui infestent le monde, solution dont "la critique doctrinale" confirmait l'inanité". (p15)
Passons sur toutes ces contorsions, en guise d'explication d'une démarche qui est suffisamment claire par son titre même. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que le Parti bordiguiste lançait de tels Appels –et pas seulement "aux petits noyaux éparpillés d'ouvriers révolutionnaires". Comme nous verrons de suite, un tel Appel s'adressait en pleine guerre impérialiste, à des forces autrement plus "sérieuses" pour la constitution d'un "Front Ouvrier" pour "l'Unité de classe du prolétariat".
Voyons donc ce Parti à l’œuvre tel qu'il est, tel qu'il a été "en naissant".
Appel du "Comité d'Agitation" du PCI (Prometeo n°1, avril 1945)
Le présent appel est adressé par le Comité d'agitation du Parti Communiste Internationaliste aux comités d'agitation des partis à direction prolétarienne et des mouvements syndicaux d'entreprise pour donner à la lutte révolutionnaire du prolétariat une unité de directives et d'organisation à la veille d'événements sociaux et politiques qui devront révolutionner la situation italienne et européenne ; dans ce but, il est proposé un rassemblement de ces divers comités pour mettre au point un plan d'ensemble.
Pour faciliter une telle tâche, le Comité d'Agitation du PC.Int. expose brièvement son point de vue programmatique que l’on pourrait considérer comme base initiale de discussion.
Pourquoi avons nous pensé qu'il était opportun de s'adresser aux comités d'agitation d'usines plutôt qu'aux comités centraux des différents partis ?
Un regard panoramique sur le milieu politique qui s'est précisé non seulement dans la lutte antifasciste mais aussi dans celle plus spécifique du prolétariat, nous a convaincus (et cela pas seulement aujourd'hui) de l'impossibilité de trouver un minimum de dénominateur commun idéologique et politique pour jeter les fondements d'un accord sur l'action révolutionnaire. Les différentes appréciations portées sur la guerre (sa nature et ses buts), les différentes appréciations sur la définition de l'impérialisme et dont les divergences existant dans les méthodes de lutte ou syndicale, ou politique, ou militaire démontrent suffisamment une telle impossibilité.
D'un autre côté, nous sommes tous d'accord pour considérer la crise ouverte par la guerre comme la plus profonde et la plus incurable qui se soit abattue sur le régime bourgeois ; (d'accord aussi) pour considérer que le régime fasciste est fini socialement et politiquement, même si les armes allemandes lui apportent encore de l'oxygène, même si on doit le combattre durement et de façon sanglante pour l'extirper du sol italien, pour considérer enfin que le prolétariat est le seul protagoniste de cette nouvelle histoire du monde qui doit surgir de ce conflit inhumain.
Mais le triomphe du prolétariat est possible à la seule condition qu'il ait résolu préventivement le problème de son unité dans l'organisation et dans la lutte.
Et une telle unité ne s'est pas réalisée, et elle ne pourra jamais se réaliser sur la base du Comité de Libération Nationale, surgi de raisons contingentes dues à la guerre, qui a voulu assumer un aspect de la guerre idéologique contre le fascisme et l'hitlérisme mais qui a été impuissant constitutionnellement à poser les problèmes pour surpasser de telles contingences. Il n'a pas repris a son compte les revendications et les objectifs historiques de la classe ouvrière, qui se seraient du reste heurtés aux raisons et aux buts de la guerre démocratique dont le Comité de Libération nationale (C. de LN) fut l'instigateur et l'animateur, il s'est montré aussi incapable de rassembler dans l'unité les profondes forces de travail.
Face à la guerre, mis à part les pressions idéologiques, on peut voir les uns à côte des autres les représentants de la haute finance, du capitalisme industriel et agraire et ceux des organisations ouvrières; mais qui oserait penser a un C. de LN, centre moteur de la lutte de classe et de l'assaut du pouvoir bourgeois, dans lequel siégeraient des De Gasperi, des Gronchi, des Solen, des Gasparotto, des Croce, des Sforza, etc. ?
Si le C. de LN peut être historiquement capable de résoudre les problèmes dus à l’état d'urgence et à la continuation de celle-ci dans le cadre de l’Etat bourgeois, il ne sera en aucun cas l’organe de la révolution prolétarienne, dont la tâche revient au parti de la classe qui aura compris les exigences fondamentales du prolétariat et aura profondément adhéré à la nécessité de sa lutte.
Mais ce même parti sera impuissant à accomplir sa mission historique s'il trouve devant lui un prolétariat moralement et physiquement divisé, désabusé par l’inanité des luttes intestines, sceptique sur la validité de son propre avenir.
C'est cette situation bloquée que nous avons connue dans tous les moments de crise de ces dernières années, et contre lesquels viennent se briser les grosses lames de la révolution prolétarienne. Un prolétariat désuni ne peut aller à l'attaque du pouvoir bourgeois, et nous devons avoir le courage de reconnaître qu'actuellement le prolétariat italien est désuni et sceptique comme l'ensemble du prolétariat européen.
La tâche impérieuse de l'heure est donc l’unité de classe du prolétariat qui trouvera, dans les usines et tous les postes de travail, le milieu naturel et historique idéal pour l'affirmation d'une telle unité. C'est à cette seule condition que le prolétariat sera capable de tourner à son avantage la crise du capitalisme que la guerre a ouverte mais qu'elle est impuissante à résoudre.
Nous concluons notre appel en rassemblant en quelques points notre pensée :
-
puisque les raisons, la finalité, la pratique de la guerre divisent le prolétariat et ses forces de combat, à la politique qui veut subordonner la lutte de classe à la guerre, on doit opposer la subordination de la guerre et de toutes ses manifestations à la lutte de classe ;
-
nous souhaitons la création d'organismes unitaires du prolétariat qui soient l'émanation des usines et des entreprises industrielles et agricoles ;
-
de tels organismes seront de fait le front unique de tous les travailleurs, et auxquels les comités d'Agitation participeront démocratiquement ;
-
tous les partis liés aux luttes du prolétariat auront le droit de cité pour faire la propagande de leurs idées et de leurs programmes : bien plus, nous pensons que ce sera en ces lieux de débats d'idées et de programmes, que le prolétariat parviendra a sa maturité politique et au libre choix de quelle direction politique le conduira à la victoire ;
-
la lutte du prolétariat, des agitations partielles à l'insurrection armée, devra se développer, pour triompher sur une base de classe, pour culminer dans la conquête violente de tout le pouvoir qui constitue l’unique et sérieuse garantie de victoire.
10 février 1945
Commentaires de Prometeo aux réponses à l'appel
A cet appel, nous retenons la réponse du Comité d'Agitation du PDA et celle du Parti du Travail (de Milan) qui déclarait ne pouvoir prendre en compte notre proposition, bien qu'ils l'eussent fait dans des conditions plus favorables, parce que la ligne politique spécifique suivie par le PIL, bien que vouée à la révolution prolétarienne ne lui permet pas d'exercer une quelconque influence sur les masses de l'Italie septentrionale.
Notre appel recevait l'entière adhésion des syndicats révolutionnaires, qui acceptaient explicitement de collaborer à la création d'organismes de base et qui se déclaraient pleinement d'accord avec notre point de vue sur la lutte contre la guerre.
Réponse aussi des Communistes Libertaires, qui reconnaissaient dans les termes de la proposition le terrain sur lequel eux-mêmes se trouvaient "tant du point de vue de la situation politique générale, que du point de vue de l'attitude par rapport à la guerre et de la nécessité d'une organisation de classe des travailleurs qui ait pour objectif la révolution expropriatrice à travers la constitution de conseils ouvriers de gestion", et ils se satisfaisaient qu'un tel point de vue soit partagé par des camarades communistes internationalistes.
Il est par contre stupéfiant que le PCI ait refusé de nous répondre par des communications verbales, ayant déjà exprimé son point de vue sur nous dans sa presse. Peu de temps après, à la fin d'une campagne sporadique de dénigrement contre nous (nous accusant d'être des fascistes masqués) il sortait un entrefilet dans la revue "Usine" qui nous traitait de provocateurs et dans lequel on se référait directement à notre proposition de constitution d'organismes de front unique ouvrier et en mars, suivait une circulaire de la Fédération Milanaise invitant tes organismes de base "à intervenir énergiquement pour épurer..."
Traditionnellement incapable de répondre oui ou non, le PS a au contraire répondu :
- "Chers camarades, en réponse à votre appel, nous vous confirmons que notre Parti n'a rien contre le fait que vos camarades participent aux Comités d'Agitation périphériques dans les usines où votre Parti a réellement une assise et que leur collaboration se fasse dans le cadre de la lutte générale de masse, pour laquelle les comités d'agitation ont surgi."
A cette lettre qui éludait élégamment la question, nous avons répondu :
- "Chers camarades, nous aurions préféré que votre réponse fut plus conforme aux questions posées dans notre document, et en ce sens plus concluantes, évitant la perte de temps, d'autant plus que la situation politique, suite aux événements militaires, s'aggrave de plus en plus et pose des tâches toujours plus graves et urgentes aux masses et aux partis prolétariens en particulier."
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur 2 points :
-
Notre proposition ne posait pas la question d'une adhésion à des comités déjà existants, de tel ou tel parti, mais un accord entre tes organismes dirigeants de tels comités pour concrétiser un plan d'action commun, pour résoudre unitairement tous les problèmes surgis de la crise du capitalisme.
-
Il était implicite que notre initiative ne pouvait avoir pour objectif une "lutte générale de masses" mais la création d'organismes à représentation proportionnelle sur le terrain de classe et avançant vers des objectifs de classe.
Il va de soi que de tels comités ne peuvent avoir rien en commun avec tes comités surgis sur la base de la politique du CLN, qui comme vous le dites, ne peuvent être considérés comme des organismes de classe.
Nous vous sollicitons pour une réponse plus précise sur ces points dont dépend la possibilité d'un travail commun.
A cette heure il n'y a eu aucune réponse.
(Prometeo n°1 avril 1945)
Conclusion
Nous pouvons nous épargner la peine de faire des commentaires. Un tel Appel adressé aux (forces vives du prolétariat !) PC et PS pour la construction de l'unité prolétarienne parle de lui-même, et cela en dépit de l'astuce tactique qui consiste à ce que ce ne soit pas le Parti lui-même qui l'adresse directement aux autres partis mais par le biais d'un "Comité d'Agitation" fantôme du Parti qui l'adresse aux "Comités d'agitation" des autres partis.
Il faut ajouter, que rien n'est sorti (et pour cause !) de cet Appel –sauf de nous laisser un témoignage, une indication d'un parti qui a "grandi.... avec les matériaux qui ont servi a le constituer, avec ses membres théoriques et son squelette organisationnel".
Mais il serait inexact de dire que cet Appel n'ait rien produit. Voilà quel était son résultat :
- "En suivant les directives données par nos organes dirigeants, sous la pression des événements, nos camarades –après avoir préventivement mis en garde les masses contre les coups de tête prématurés et après avoir de façon répétée indiqué quels objectifs (objectifs de classe) ils devaient atteindre– se sont unis sans distinction aux formations en mouvement dans l’œuvre de destruction de l'odieux appareil fasciste en participant à la lutte armée et à l'arrestation des fascistes..." (Coup d’œil panoramique sur le mouvement des masses dans les usines, in Prometeo n°2, 1er mai 1945 ; Cité par A.Peregalli, l'Altra Resistanza, la dissidema di sinistra in Italia 1943-45)
Voilà pour ce qui concerne le Parti dans le nord du pays. Quant au sud du pays nous pouvons citer en exemple la Calabre (Catanzaro) où les militants bordiguistes regroupes autour de Maruca futur dirigeant du groupe de Damen, restent au sein du PCI stalinien jusqu'en 1944, date à laquelle ils passent à la "Frazione" :
- "Maruca affirme (en 1943) que la victoire du front antifasciste est la condition historique indispensable pour que le prolétariat et son parti soient mis en condition d'accomplir leur mission de classe". (cité par Peregalli, op. cité, p57)
En conclusion, en ce qui concerne le parti bordiguiste, nous pouvons dire :
- dis moi d'où tu viens et je saurais où tu vas.
M.C.
1 L'auteur parle de l'activité de la Fraction de "30 à 40" passant complètement sous silence son existence et activité entre 40 et 45, date de sa dissolution. Est-ce par simple ignorance ou pour s'éviter d'être obligé de faire une comparaison entre les positions défendues par la Fraction durant la guerre et celles du PC.Int. constitué en 43-44 ?
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Bordiguisme [5]
Questions théoriques:
Heritage de la Gauche Communiste:
La tache de l'heure formation du parti ou formation des cadres. Internationalisme (août-1946)
- 3258 reads
Après la présentation, le texte que nous publions ci-dessous est un article paru dans "Internationalisme" n°12 en Août 46.
Présentation
Aujourd'hui, 36 ans après, il présente un intérêt, non seulement comme témoignage d'une période historique, celle qui s'est ouverte au lendemain de la guerre, mais aussi un intérêt d'actualité, quant au fond du débat soulevé dans ce texte sur le moment où s'ouvre la nécessité et la possibilité d'un processus de la constitution du parti.
Pour ceux qui nient purement et simplement la nécessité du parti politique de classe, les questions de son rôle, de sa fonction et du moment de sa constitution, ne présentent évidemment aucun intérêt.
Il en va tout autrement pour ceux qui ont compris et acceptent l'idée du Parti comme une nécessité qui se manifeste pour la classe ouvrière dans sa lutte historique contre l'ordre capitaliste. Pour ces militants et dans le cadre de la compréhension de cette nécessité, situer le problème de la constitution du Parti dans le cours historique est une question de la plus grande importance, car elle se rattache à la conception-même qu'on a du Parti: le Parti est-il le produit de la stricte volonté d'un groupe de militants ou le produit de la classe en lutte?
Dans le premier cas, le Parti peut se construire et exister dans n'importe quel moment, dans le deuxième cas son existence et sa construction sont nécessairement liées aux périodes de flux et de reflux de la lutte de classe du prolétariat.
Dans le premier cas, nous avons à faire à une vision volontariste, idéaliste de l'Histoire, dans le second, à une vision matérialiste, déterministe de l'Histoire et de sa réalité concrète.
Que l'on ne s'y trompe pas. Il ne s'agit là nullement de spéculations abstraites. Loin d'être un débat oiseux sur les mots et les noms à donner à l'organisation, Parti ou Fraction (groupe), ce débat implique des démarches diamétralement opposées. La démarche erronée, la non compréhension du moment historique de la proclamation du Parti, implique nécessairement la conséquence pour l'organisation révolutionnaire, de vouloir être ce qu'elle ne peut pas encore être, et de ne pas être ce qu'elle devrait être. En prenant des vessies pour des lanternes, en s'agitant en guise d'agir, en se drapant de"principes" devenus des dogmes à la place d'une ferme défense des positions politiques claires, acquises à la lumière de l'examen critique des expériences, une telle organisation, à la recherche à tout prix d'une audience immédiate, se trouve non seulement en porte-à-faux de la réalité présente mais compromet encore plus son devenir en négligeant ses vraies tâches à plus long terme, et ouvre toutes grandes ses portes à l'opportunisme et à toutes sortes de compromissions politiques.
C'est là-dessus que portait la critique d'Internationalisme en 46, et 36 années d'activité du Parti bordiguiste sont là pour confirmer pleinement la validité de celle-ci.
Certaines formulations d'Internationalisme peuvent prêter le flanc à des malentendus. Il en est ainsi de la formulation: "Le Parti, c'est l'organisme politique que se donne le prolétariat au travers de l'activité duquel le prolétariat unifie ses luttes..." (page 2). Ainsi formulé, cela laisserait entendre que le Parti est l'unique moteur de cette unification des luttes, ce qui ne correspond pas à la position exacte défendue par Internationalisme comme le montre une lecture attentive de la Revue. Ce qu'on doit comprendre dans cette formulation c'est qu'une des tâches majeures du Parti est d'être un facteur, le facteur conscient oeuvrant comme tel dans le processus de l'unification des luttes de la classe en les orientant "vers une lutte frontale en vue de la destruction de l'Etat et de la société capitaliste et à l'édification de la société communiste" (ibid).
En ce qui concerne une troisième guerre, elle ne s'est pas réalisée selon la perspective d'Internationalisme, en une guerre généralisée mais en une succession de guerres localisées et périphériques dites de "libération" et d'"indépendance" nationale ou de décolonisation, mais toujours sous l'égide et les exigences des intérêts des grandes puissances en lutte pour l'hégémonie mondiale.
Il reste néanmoins fondamentalement vrai que la seconde guerre mondiale a débouché, comme l'avait annoncé Internationalisme, sur une longue période de réaction et de profond reflux de la lutte de classe qui a duré jusqu'à la fin de la période de reconstruction.
Certains lecteurs pourront peut-être être choqués par les termes de "formation de cadres" qu'Internationalisme annonçait comme "la tâche de l'heure" à l'époque. Sous ce terme on entend aujourd'hui la formation de forces d'encadrement du prolétariat. A l'époque et sous la plume d'Internationalisme, la "formation des cadres" signifiait que la situation ne présentait pas les conditions nécessaires pour permettre aux révolutionnaires d'exercer une large influence dans les masses ouvrières, et de ce fait, le travail de recherche et d'élaboration théorique prenait inévitablement le pas sur le travail d'agitation.
Nous vivons aujourd'hui une toute autre période, une période de crise ouverte du capitalisme et de reprise de la lutte de classe. Une telle période pose à l'ordre du jour la nécessité et la possibilité de regroupement des forces révolutionnaires. Cette perspective ne saurait être assurée positivement par les groupes révolutionnaires existants et dispersés qu'en se dégageant résolument de toute théorisation de leur isolement passé; en ouvrant largement les portes à la confrontation des positions héritées du passé, et pas pour autant forcément valables aujourd'hui; en s'engageant consciemment dans un processus de décantation, ouvrant ainsi la voie à un regroupement des forces.
C'est cela la voie ouverte aujourd'hui à la reconstruction du Parti.
MOMENT DE LA CONSTITUTION DU PARTI
Il existe deux conceptions sur la formation du Parti ; deux conceptions qui se sont heurtées depuis l'apparition historique du prolétariat c'est-à-dire non son existence en tant que catégorie économique, mais dans sa tendance à se poser en tant que classe indépendante, ayant une fonction et une mission propres à assumer dans l'histoire.
Ces deux conceptions peuvent être résumées brièvement de la manière suivante :
La première conception stipule que la formation du Parti relève essentiellement, sinon exclusivement, du désir des individus, des militants, de leur degré de conscience, en un mot cette conception voit dans la formation du Parti un acte subjectif et volontariste.
La deuxième conception considère la formation du Parti comme un moment de la prise de conscience, en rapport direct et étroit avec la lutte de la classe ; du rapport de forces existant entre les classes, tel qu'il résulte, dans une situation donnée, des luttes passées, de la situation économique, sociale et politique présente, et de l'orientation générale de la lutte de classe, en connexion avec les perspectives immédiates et lointaines.
La première conception, essentiellement subjective et volontariste se rattache d'une façon plus ou moins consciente à une conception idéaliste de l'histoire ; le Parti cesse d'être déterminé, il devient un phénomène indépendant, libre, se déterminant lui-même, et de ce fait, le moteur déterminant de la lutte de classe, de l'évolution de la lutte de classe.
Nous trouvons des défenseurs acharnés de cette conception dans le mouvement ouvrier, depuis sa naissance tout au long de son long développement, jusqu'à nos jours.
Weitling et Blanqui furent les figures les plus représentatives de cette tendance, à l'aube du mouvement ouvrier.
Quelle que puisse être la grandeur de leur erreur, et la critique sévère et méritée qu'en fit Marx, nous devons les considérer, eux et leurs erreurs, comme des produits historiques ; ce qui ne nous empêche pas de reconnaître, comme le fit Marx lui-même, leur immense apport dans le mouvement, par leur valeur révolutionnaire incontestable, leur dévouement à la cause de l'émancipation, et leur mérite de pionniers, insufflant partout et toujours dans les masses, l'ardente volonté de destruction de la société capitaliste.
Mais ce qui fut un défaut chez Weitling et chez Blanqui, leur méconnaissance des lois objectives du développement de la lutte de classe, devait devenir chez les continuateurs de cette conception, la base de leur activité. Le volontarisme se transformait chez ces derniers en un aventurisme caractérisé.
Les représentants typiques sont incontestablement, aujourd'hui, le trotskisme et tout ce qui s'y rattache. Leur action et agitation ne connaissent pas d'autres limites que celles de leur imagination et caprice.
On construit et on dissout des "partis" et des "internationales" à volonté ; on lance des mots d'ordre, on agite et on s'agite tout comme un malade pris de convulsions.
Plus près de nous, nous trouvons les R.K.D ([1] [9]) et ( [2] [10]) les C.R. , qui ayant séjourné trop longtemps dans le trotskisme, d'où ils ne se sont dégagés que très tard, reproduisant encore, cette agitation pour l'agitation, c'est-à-dire l'agitation dans le vide, faisant de cela le fondement de leur existence en tant que groupe.
La deuxième conception peut être définie comme objectiviste et déterministe. Non seulement elle considère le Parti déterminé historiquement, mais encore elle considère son existence et sa constitution déterminées aussi immédiatement, contingentement, présentement. Pour que le Parti puisse exister effectivement, il ne suffit pas de démontrer sa nécessité en général, mais il faut qu'il repose sur des conditions présentes, immédiates, telles, qui rendent son existence possible et nécessaire.
Le Parti, c'est l'organisme politique que se donne le prolétariat, au travers de l'activité duquel le prolétariat unifie ses luttes, et les oriente vers une lutte frontale, en vue de la destruction de l'Etat et de la société capitaliste, et en vue de l'édification de la société communiste.
En l'absence d'un cours de développement réel de la lutte de classe qui a ses racines, non dans la volonté des militants révolutionnaires mais dans la situation objective, en l'absence des luttes de classe ayant atteint un degré avancé de crise sociale, le Parti ne peut exister, son existence est inconcevable. ([3] [11])
Le Parti ne peut se construire dans une période de stagnation de la lutte de classe. Il n'existe aucun exemple de constitution de parti révolutionnaire dans ces conditions dans toute l'histoire du mouvement ouvrier. Par contre, l'histoire nous apporte une série d'exemples où les partis construits dans des périodes de stagnation, ne parviennent jamais à influencer et à diriger effectivement les mouvements de masse de la classe. Restent des formations qui n'ont de parti que le nom, et leur nature artificielle fait qu'au lieu d'être un élément de futur parti ils deviennent un handicap à sa construction. De telles formations sont condamnées à n'être que de petites sectes dans tout le sens du terme, et qui ne sortent de leur état de secte que pour tomber, ou dans l'aventurisme et le donquichottisme, ou à évoluer dans le plus crasseux opportunisme. La plupart du temps elles tombent dans les deux à la fois, (voir le trotskisme).
LA POSSIBILITÉ DU MAINTIEN DU PARTI DANS UNE PÉRIODE DE REFLUX
Ce que nous venons de dire plus haut pour la constitution du Parti est également vrai pour le maintien d'un parti, après des défaites décisives, dans une période de reflux révolutionnaire prolongée.
C'est à tort qu'on citerait l'exemple du parti bolchevik comme démenti à notre affirmation. C'est là une vue formelle.
Le parti bolchevik qui se maintient après 1905 ne peut être considéré comme un PARTI mais comme une FRACTION du PARTI social-démocrate russe, lui-même disloqué en plusieurs fractions et tendances.
C'est à cette condition que la fraction bolchévik pouvait subsister et servir de noyau central à la constitution du parti communiste en 1917. Tel est le sens réel de l'histoire du parti bolchévik.
La dissolution de la 1ère Internationale nous montre que Marx et Engels ont eu une conscience aiguë de l'impossibilité du maintien de l'organisation internationale révolutionnaire de la classe dans une période prolongée de reflux. Il est vrai que les esprits bornés et formalistes voient dans la dissolution de la 1ère Internationale l'effet d'une manœuvre de Marx contre Bakounine.
Nous n'entendons pas entrer ici dans la question de procédure ni de justifier en tous points la manière dont Marx s'y est pris.
Que Marx ait vu dans les bakouninistes un danger menaçant l'Internationale et ait entrepris une lutte pour l'écarter est absolument exact (et nous sommes de ceux qui estimons que Marx avait absolument raison sur le fond. L'anarchisme depuis, a eu l'occasion de révéler plus d'une fois sa nature idéologique foncièrement petite-bourqeoise).
Mais ce ne fut pas ce danger qui le convainquit de la nécessité de la dissolution de l'organisation.
A maintes reprises, au moment de la dissolution et par la suite, Marx s'est expliqué à ce sujet. C'est à la fois lui faire une injure gratuite et lui attribuer une force démoniaque que de voir dans la dissolution de la 1ère Internationale le simple effet d'une manoeuvre, d'une intrigue personnelle. Il faut vraiment être aussi borné que James Guillaume, pour voir dans les événements d'une importance historique, le simple produit de la volonté des individus. Au delà de la légende anarchiste il faut voir et saisir la signification de la dissolution de la 1ère Internationale.
Et on saisit cette signification en rapprochant ce fait d'autres disparitions et dissolutions des organisations politiques dans l'histoire du mouvement ouvrier.
Ainsi, le profond changement de la situation sociale et politique survenu, qui se produit en Angleterre au milieu du XIXème siècle entraîne la dislocation et la disparition du mouvement chartiste.
Un autre exemple est celui de la dissolution de la Ligue Communiste après les années orageuses de la révolution de 1848-50. Tant que Marx croit que la période révolutionnaire n'est pas encore passée, en dépit de lourdes défaites et des échecs subis, il tend à maintenir la Ligue, à regrouper les cadres dispersés, à renforcer l'organisation. Mais dès qu'il s'est convaincu de la fin de la période révolutionnaire, de l'ouverture d'un long cours historique réactionnaire, il proclame l'impossibilité du maintien du parti, il se prononce pour un repli de l'organisation vers des tâches plus modestes, moins spectaculaires et plus réellement fécondes : l'élaboration théorique et la formation des cadres.
Il n’y a vraiment pas eu nécessité de l'existence de Bakounine, ni besoin de "manoeuvres urgentes" pour que Marx, 20 ans avant, comprenne l'impossibilité de l'existence d'un parti et d'une internationale dans une période révolutionnaire.
25 ans après, Marx, rappelant la situation de 1850-51 et les luttes de tendances qui se produisirent au sein de la Ligue Communiste, écrit :
- "La répression violente d'une révolution laisse dans les esprits des acteurs de cette révolution, de ceux en particulier qui ont été chassés de leur patrie et jetés dans l'exil, une commotion telle que même les personnalités de valeur deviennent pour un temps plus ou moins long, en quelque sorte irresponsables. Ils ne peuvent s'accommoder de la marche qu'a prise l'histoire et ils ne veulent pas comprendre que la forme du mouvement s'est modifiée..." (Epilogue aux révélations sur le procès des communistes de Cologne, 8 janvier 1875)
Dans ce passage nous trouvons la pensée fondamentale de Marx s'élevant contre ceux qui ne veulent pas comprendre que la forme du mouvement, de l'organisation politique de la classe, les tâches de l'organisation, ne restent pas toujours identiques, elles suivent la situation et se transforment, se modifient avec les changements survenus dans la situation objective. Pour réfuter ceux qui voudraient voir dans ces lignes une justification a posteriori, il n'est pas sans intérêt de citer les arguments de Marx, tels qu'il les a formulés au moment même de la lutte contre la Fraction Willich-Schapper. Dans l'exposé des motifs de sa proposition de scission qu'il a présenté au Conseil Central de la Ligue le 15 septembre 1850 Marx disait entre autres :
- "A la place de la conception critique, la minorité met une conception dogmatique et à la place de la conception matérialiste une conception idéaliste. Au lieu de la situation réelle, c'est la simple volonté qui devient la force motrice de la révolution. ..
- .. . Vous leur dites (aux ouvriers), "il nous faut immédiatement arriver au pouvoir ou bien nous n'avons qu'à dormir sur nos deux oreilles."
- . . .De même que les démocrates ont fait du mot peuple une entité sacrée, vous faites, vous, une entité sacrée du mot prolétariat. Tout comme les démocrates, vous substituez à l'évolution révolutionnaire, la phraséologie révolutionnaire. "
Nous dédions ces lignes tout particulièrement aux camarades tels que R.K.D, et C.R. qui pendant longtemps nous ont reproché de ne pas vouloir "construire" le parti nouveau.
Dans la lutte contre l'aventurisme du trotskisme que nous avons soutenue depuis 1932, dans la question de formation du nouveau parti et de la IVème Internationale, le R.K.D. voyait surtout on ne sait quelle "hésitation" subjective. Le R.K.D. n'a jamais compris la notion de "Fraction" c'est-à-dire une organisation particulière, avec des tâches particulières correspondant à une situation particulière dans laquelle ne peut exister ni être constitué le parti. Cette notion de "Fraction" le RKD n'a jamais fait d'effort pour le comprendre. Il préférait se livrer à la traduction simpliste étymologique du mot "Fraction" pour voir dans le "bordiguisme" des "redresseurs" de l'ancien parti. Ils appliquaient à la Gauche Communiste, la mesure de leur nature propre, la mesure trotskiste par excellence : "On est pour le redressement de l'ancien parti, ou on est pour la proclamation du nouveau parti".
La situation objective et les tâches des révolutionnaires, en correspondance avec la situation, cela est bien trop prosaïque, trop compliqué pour ceux qui se plaisent dans la facilité de la phraséologie révolutionnaire, La lamentable expérience de l'organisation C.R. ne semble avoir guère profité à ces camarades. Dans l'échec de l'O.C.R. ils ne voient pas la rançon de la formation précipitée d'une organisation qu'ils voulaient achevée, et qui fut en réalité artificielle, hétérogène, groupant des militants sur un vague programme d'action, imprécis et inconsistant. Ils attribuent leur échec à une mauvaise qualité de l'élément humain, ne voyant surtout pas l'échec en corrélation avec l'évolution de la situation objective.
LA SITUATION PRÉSENTE
Il peut paraître étrange à première vue que des groupes se réclamant de la Gauche Communiste Internationale, et qui pendant des années ont combattu avec nous l'aventurisme trotskiste de la création artificielle de nouveaux partis aient enfourché aujourd'hui ces mêmes dadas et soient devenus les champions de cette construction à un rythme accéléré.
On sait qu'en Italie existe déjà le Parti Communiste Internationaliste, qui quoique très faible numériquement, tend néanmoins à jouer le rôle du parti. Les récentes élections à la Constituante auxquelles participait le PCI d'Italie, ont révélé l'extrême faiblesse de son influence réelle sur les masses, ce qui nous montre que ce parti n'a guère dépassé les cadres restreints d'une fraction. La Fraction belge de son coté, lance des appels pour la construction du nouveau parti. La FFGC, récente formation sans base de principe bien définie emboîte le pas et se donne pour tâche pratique la construction du nouveau parti en France.
Comment expliquer ce fait? Cette nouvelle orientation? Qu'un certain nombre d'individualités ([4] [12]) qui ont rejoint ce groupe récemment ne fassent qu'exprimer leur incompréhension, leur non assimilation de la notion de la "fraction", qu'il continuent à exprimer dans les divers groupes de la GCI les conceptions trotskistes qu'ils ont eues hier et qu'ils continuent à professer sur le Parti, aucun doute à cela.
D'autre part, il est également exact de voir dans la contradiction existant entre l'énonciation théorique abstraite et la politique pratique, concrète, dans la question de la construction du parti, une contradiction supplémentaire dans le lot des contradictions dont se sont rendus coutumiers ces groupes. Cependant tout cela n'explique pas encore la conversion de l'ensemble de ces groupes. Cette explication doit être recherchée dans l'analyse qu'ils font de la situation présente et les perspectives qu'ils entrevoient.
On connait la théorie sur "l'économie de guerre" professée avant et pendant la guerre par la tendance Vercesi dans la GCI. D'après cette théorie, l'économie de guerre et la guerre sont des périodes de plus grand développement de la production, de l'essor économique. Il en résultait qu'aucune crise sociale ne peut surgir pendant cette période de "prospérité". Il fallait attendre "la crise économique de l'économie de guerre", c'est-à-dire le moment où la production de guerre ne parviendrait plus à répondre au besoin de la consommation de la guerre, la pénurie des moyens matériels à la poursuite de la guerre, pour que cette crise nouvelle manière ouvre la crise sociale et la perspective révolutionnaire.
Il était logique, d'après cette théorie, de mer toute possibilité d'éclosion de convulsions sociales pendant la guerre. De là aussi la négation absolue et obstinée de toute signification sociale dans les événements de juillet 43 en Italie ([5] [13]) De là également l'incompréhension totale de la signification de l'occupation de l'Europe par les forces armées des alliés et Russes, et plus particulièrement l'importance qu'acquérait la destruction systématique de l'Allemagne, la dispersion du prolétariat allemand transformé en prisonnier de guerre, exilé, disloqué rendu momentanément inoffensif et incapable de tout mouvement indépendant.
Pour ces camarades, la reprise de la lutte de classe, et encore plus précisément, l'ouverture d'un cours ascendant de la révolution ne pouvait se faire qu'après la fin de la guerre, non parce que le prolétariat était imprégné d'une idéologie nationaliste patriotique mais parce que les conditions objectives d'une telle lutte ne pouvaient exister dans la période de guerre. Cette erreur démentie par l'histoire (la Commune de Paris et la révolution d'Octobre) et partiellement dans cette guerre-ci (se rappeler les convulsions sociales des événements de 43 en Italie et certaines manifestations de l'esprit défaitiste dans l'armée allemande au début de 45 devait être fatalement doublée par une erreur non moins grande que la période de l'après-guerre ouvre automatiquement un cours de reprise de luttes de classe et de convulsions sociales.
La formulation théorique la plus achevée de cette erreur a été donnée par la Fraction belge dans l'article de Lucain publié dans l'Internationaliste. D'après son schéma, dont il veut de force faire endosser à Lénine la paternité, la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, reste vraie, à condition que l'on élargisse cette position à la période de l'après-guerre. En d'autres termes, c'est dans la période d'après-guerre que se réalise la transformation de la guerre en guerre civile.
Une fois cette théorie systématisée et postulée, tout deviendra simple et il ne restera plus qu'à examiner l'évolution de la situation et des événements au travers et partant d'elle.
Ainsi l'analyse de la situation présente serait celle d'une situation de transformation en guerre civile. Partant de cette analyse centrale, on proclamera la situation en Italie particulièrement avancée, justifiant la constitution immédiate du Parti, on verra dans les troubles aux Indes et en Indonésie ou dans d'autres colonies, dont les ficelles sont étroitement tenues par les divers impérialismes en compétition et par la bourgeoisie indigène, la manifestation du commencement de la guerre civile anti-capitaliste. Le massacre impérialiste en Grèce fera aussi partie de la révolution en marche. Inutile de dire que l'idée ne leur viendra pas de mettre un seul instant en doute le caractère révolutionnaire des grèves en Amérique et en Angleterre, et même celles de France. Récemment l'Internationaliste a salué la formation de cette petite chapelle qu'est la CNT en France, comme un indice "entre autres" de l'évolution révolutionnaire de la situation en France. La FFGC ira jusqu'à prétendre que la reconduction du tripartisme gouvernemental s'est faite en fonction de la menace de classe du prolétariat, et insistera sur la haute signification objective qu'acquiert l'adhésion de quelques cinq camarades du groupe "Contre le Courant" ([6] [14]) à leur groupe.
Une telle analyse de la situation, avec la perspective de batailles de classe décisives dans le proche avenir, conduit tout naturellement ces groupes à l'idée de la nécessité urgente de construire le plus rapidement possible le Parti. Cela devient la tâche présente, la tâche du jour, sinon de 1'heure.
Le fait que le capitalisme international ne semble nullement inquiet de cette menace de lutte du prolétariat qui pèserait sur lui, et se livre tranquillement à ses affaires, à ses intrigues diplomatiques, à ses rivalités internes, à ses conférences de paix dans lesquelles il étale publiquement ses préparatifs de guerre prochaine, tout cela ne pèse pas lourd dans l'analyse de ces groupes.
On n'exclue pas complètement l'éventualité d'une prochaine guerre, d'abord parce que cela peut servir de thème de propagande et ensuite parce que se souvenant de l'aventure de 37-39, où également on niait la perspective de la guerre mondiale, on préfère être plus prudent cette fois-ci et se laisser une porte de sortie pour le cas échéant. De temps à autre on dira,à la suite du PCI d'Italie, que la situation en Italie est réactionnaire, mais cela ne portera pas à conséquence et restera une phrase épisodique, sans rapport avec l'analyse fondamentale de la situation qui mûrit "lentement mais sûrement" vers des explosions révolutionnaires décisives.
Cette analyse est également partagée par d'autres groupes comme le CR qui oppose à la perspective objective de la 3ème guerre impérialiste celle de la révolution inévitable, ou encore celle du RKD qui, plus prudent, se réfugie dans la théorie du double cours, de la croissance parallèle et simultanée du cours de la révolution et du cours de la guerre. Le RKD n'a évidemment pas encore compris que la croissance du cours vers la guerre est en premier lieu conditionnée par l'affaiblissement du prolétariat et 1'éloignement de la menace de la révolution, à moins d'épouser la théorie de la tendance Vercesi avant 39 pour qui la guerre impérialiste n'est pas une lutte d'intérêt entre les différents impérialistes, mais un acte de plus haute solidarité impérialiste en vue du massacre du prolétariat, une guerre de classe directe du capitalisme contre la menace révolutionnaire du prolétariat. Les trotskistes qui donnent également la même analyse, paraissent infiniment plus logiques avec eux-mêmes, car pour eux il n'y a pas nécessité de nier la tendance vers la 3ème guerre, la prochaine n'étant pour eux que la lutte armée généralisée entre le capitalisme d'une part et le prolétariat groupé autour de"l'Etat Ouvrier" russe de 1 ' autre.
En fin de compte, ou on confond d'une façon ou d'une autre la prochaine guerre impérialiste avec la guerre de classe, ou on minimise la menace de la guerre en la faisant précéder d'une indispensable période de grandes luttes sociales et révolutionnaires. Dans le deuxième cas, l'aggravation des antagonismes inter impérialistes, l'accélération des préparatifs de guerre auxquels nous assistons est expliquée par une myopie, une inconscience dans laquelle se trouve, le capitalisme mondial et ses chefs d'Etat.
On peut rester bien sceptique sur une analyse basée sur nulle autre démonstration que son désir propre, s'accordant le bénéfice d'une clairvoyance tandis qu'on attribu-2 généreusement à l'ennemi de classe un aveuglement total. Le capitalisme mondial a plutôt donné des preuves d'une conscience autrement plus aiguë des réalités que le prolétariat. Sa conduite en 43 en Italie et en 45 en Allemagne, prouve qu'il a diablement bien assimilé les enseignements de la période révolutionnaire de 1917, bien mieux que ne le fit le prolétariat et son avant-garde. Le capitalisme a appris à mater le prolétariat non seulement par la force mais à écarter le danger en utilisant le mécontentement même des ouvriers et en dirigeant ce mécontentement vers un sens capitaliste. Il a su faire, avec les armes d'hier du prolétariat, des chaînes contre lui. Il suffit de constater que le capitalisme se sert volontiers aujourd'hui des syndicats, du marxisme, de la Révolution d'Octobre, du socialisme, communisme, anarchisme, du drapeau rouge, du 1er mai, comme moyens les plus efficaces pour duper le prolétariat. La guerre de 39-45 fut menée au nom de "l'antifascisme" qui a été déjà expérimenté dans la guerre espagnole. Demain c'est sous le drapeau de la lutte contre le fascisme russe ou au nom de la Révolution d'Octobre que les ouvriers seront, une fois de plus, jetés sur le champ de bataille.
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, 1ibération nationale, reconstruction, revendications "économiques", participation ouvrière à la gestion, contrôle ouvrier, et autres slogans du même acabit, sont devenus les moyens les plus efficaces du capitalisme pour la destruction de la conscience de classe du prolétariat. C'est avec ces slogans qu'on mobilise les ouvriers dans tous les pays. Les troubles qui éclatent de ci de là, et les grèves restent dans ce cadre et ont pour résultat un plus grand enchaînement des ouvriers à 1'Etat capitaliste.
Dans les colonies, les masses se font massacrer dans une lutte, non pour la destruction de l'Etat mais pour sa consolidation, son indépendance à l'égard de la domination d'un impérialisme au bénéfice d'un autre impérialisme. Aucun doute possible sur la signification du massacre en Grèce, quand nous voyons l'attitude protectrice que prend la Russie, quand nous voyons Jouhaux devenir l'avocat de la CGT grecque en conflit avec le gouvernement. En Italie les ouvriers "luttent" contre la monarchie au nom de la république, ou se font massacrer mutuellement pour la question de Trieste. En France, les ouvriers donnent le spectacle écœurant de défiler en bleu de travail au pas cadencé, dans le défilé militaire du 14 juillet. Telle est la réalité prosaïque de la situation présente.
Il n'est pas vrai que les conditions pour la reprise de la lutte de classe, se présentent dans l’après guerre. Quand le capitalisme a "terminé" une guerre impérialiste mondiale qui a duré 6 ans sans voir l'embrasement d'une révolution, cela signifie la défaite du prolétariat et que nous ne sommes pas à la veille de grandes luttes révolutionnaires mais à la veille d'une d'une défaite. Cette défaite a eu lieu en 45, dans la destruction physique du centre de la révolution que représentait le prolétariat allemand, et elle fut d'autant plus décisive que le prolétariat mondial n'avait même pas pris conscience de la défaite qu'il venait de subir.
Le cours vers la 3ème guerre impérialiste mondiale est ouvert. Il faut cesser de jouer à l'autruche et chercher à se consoler en ne voulant pas voir la gravité du danger. Dans les conditions présentes, nous ne voyons pas la force susceptible d'arrêter ou de modifier ce cours,La pire chose que peuvent faire les faibles forces des groupes révolutionnaires c'est de lever le pied dans un cours de marche descendant. Fatalement ils aboutiront à se briser le cou.
La Fraction belge croit être quitte en disant que, si la guerre éclate, cela prouverait que la formation du parti aurait été prématurée. Quelle naïveté ! Cela ne se fera pas impunément, il faudra payer chèrement l'erreur.
En se jetant dans l'aventurisme de la construction prématurée et artificielle de partis, on commet, non seulement une erreur d'analyse de la situation, mais on tourne le dos à la tâche présente des révolutionnaires, on néglige l'élaboration critique du programme de la révolution, on abandonne l'oeuvre positive de formation de cadres.
Mais il y a encore pire, et les premières expériences du parti en Italie sont là pour nous le confirmer. Voulant à tout prix jouer au parti dans une période réactionnaire, voulant à tout prix faire du travail de masse, on descend au niveau de la masse, on lui emboîte le pas, on participe au travail syndical, on participe aux élections parlementaires, on fait de l'opportunisme.
A l'heure présente, l'orientation de l'activité vers la construction du Parti ne peut être qu'une orientation opportuniste.
Que l'on ne vienne pas nous reprocher d'abandonner la lutte quotidienne des ouvriers, de nous extraire de la classe. On ne reste pas avec la classe parce qu'on s'y trouve physiquement et encore moins en voulant garder à tout prix la liaison avec les masses, 1iaison qui, en période réactionnaire, ne peut être maintenue qu'au prix d'une politique opportuniste. Que l'on ne vienne pas nous reprocher de vouloir nous isoler dans notre tour d'ivoire, nous accuser de tendre vers des sectes de doctrinaires qui renoncent à toute activité, après nous avoir accusés d'activisme dans les années 43-45.
Le sectarisme n'est pas l'intransigeance de principes, ni la volonté d'études critiques, ni même le renoncement momentané à un large travail extérieur. Le vrai caractère du sectarisme est sa transformation du programme vivant en un système mort, les principes guidant l'action en dogmes, que cela soit braillé ou chuchoté.
Ce que nous proclamons nécessaire dans la période réactionnaire présente, c'est le besoin de faire des études objectives, de comprendre la marche des événements, leurs causes, et oeuvrer pour les faire comprendre à un cercle d'ouvriers forcément restreint dans une période de réaction.
La prise de contact entre les groupes révolutionnaires de divers pays,la confrontation de leurs idées, la discussion internationale organisée en vue de la recherche d'une réponse aux problèmes brûlants, soulevés par l'évolution, un tel travail est autrement plus fécond, et se rattache autrement à la classe, que la vaine agitation creuse, dans le vide.
La tâche de l'heure des groupes révolutionnaires est la formation des cadres, tâche moins tapageuse, moins portée à des succès faciles, immédiats et éphémères, et infiniment plus sérieuse, car la formation des cadres aujourd'hui est la condition et la garantie du FUTUR PARTI DE LA REVOLUTION.
Marco.[1] [15] R.K. D. -Communistes Révolutionnaires d’Allemagne- , Groupe trotskiste autrichien qui s'est oppose à la fondation d'une 4ème Internationale lors de la Conférence Internationale qui l'avait proclamée en 1938, l'estimant largement prématurée. Ce groupe en exil prendra de plus en plus de distance par rapport à cette Internationale (et notamment en ce qui concerne la participation à la 2ème guerre sous prétexte de défense de l'URSS) et finalement contre la théorie de l'Etat ouvrier dégénéré, chère au trotskisme. Ce groupe en exil avait le mérite politique incontestable de mener une campagne intransigeante contre la guerre impérialiste et contre toute participation, sous quelque prétexte que ce soit. A ce titre il a pris contact avec la Fraction de la Gauche Communiste Italienne et Française durant la guerre et a participé à la publication, en mai 45, d'un tract en commun avec la Fraction française, adressé aux ouvriers et aux soldats de tous les pays, et en plusieurs langues, dénonçant la campagne chauvine lors de la "libération" de la France et appelant au défaitisme révolutionnaire et à la fraternisation. Après la guerre ce groupe s'est rapidement orienté vers l'anarchisme dans lequel il finit par se dissoudre.
[2] [16] Le C.R. (Communistes Révolutionnaires) est un groupe de trotskistes français que le R.K.D. a réussi à détacher du trotskisme vers la fin de la guerre et qui a suivi une évolution identique au R.K.D. Ces deux groupes ont participé à la Conférence Internationale en 47-48 réunie en Belgique à l'initiative du groupe de la Gauche Hollandaise, qui réunissait tous les groupes restés internationalistes et qui rejétaient toute participation à la guerre.
[3] [17] Il faut absolument se garder contre une erreur couramment commise et qui consiste à identifier le Parti avec 1'activité toujours possible et nécessaire des groupes révolutionnaires et le déterminisme avec un fatalisme impuissant et désespéré. La tendance Vercesi de la G.C.I., est tombée dans cette erreur pendant la guerre.
Considérant que les conditions du moment ne permettaient, ni l'existence d'un parti, ni l'entreprise d'une large agitation dans les masses, elle a conclu à la condamnation de tout travail révolutionnaire et a nié la possibilité de l'existence même des groupes révolutionnaires. Elle a oublié que les hommes ne sont pas simplement des produits de l'histoire mais que... "Les hommes font leur propre histoire."(Marx)
L'action des révolutionnaires est forcément limitée par les conditions objectives. Mais cela n'a rien à voir avec les cris désespérés du fatalisme : quoi que tu fasses tu n'arriveras à rien.
Le marxisme révolutionnaire au contraire dit : "En prenant conscience des conditions existantes et agissant dans leurs limites dans un sens révolutionnaire, on fait de sa participation une force complémentaire réagissante qui à son tour influence et est susceptible de modifier le cours de événements." (Trotsky - "Cours nouveau"-)
[4] [18] Il s'agit des anciens membres de l'Union Communiste, groupe qui publiait "L'Internationale" dans les années 30 et qui a disparu à la déclaration de la Guerre en 1939.
[5] [19] Chute du régime de Mussolini et refus des masses ouvrières à continuer la guerre.
[6] [20] Un petit groupe qui s'est constitué après la guerre qui a connu une existence éphémère, et dont les membres, après un bref passage au P. CI s’est perdu dans la nature.
Questions théoriques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Critique du Groupe Communiste Internationaliste
- 3467 reads
LUTTE REVENDICATIVE, LUTTE REVOLUTIONNAIRE : LA DYNAMIQUE DE LA CLASSE OUVRIERE
Le "Groupe Communiste Internationaliste", formé en 1979 par des militants ayant quitté le CCI, est une illustration typique des difficultés et de la faiblesse dans lesquelles se trouve aujourd'hui le milieu révolutionnaire. La constitution hâtive par ces camarades d'une"tendance" dans notre organisation sur des bases hétéroclites et incohérentes, leur départ précipité sans qu'ils aient essayé de mener un débat de fond permettant de clarifier pleinement leurs divergences, exprimaient certains des travers les plus répandus aujourd'hui dans le milieu révolutionnaire : 1'immédiatisme, le volontarisme, et le sectarisme. En effet, le point de départ de leur démarche était une impatience devant la stagnation des luttes de classe au milieu des années 70. Déçus par le prolétariat, ils se sont réfugiés dans la vision propre aux bordiguistes qui fait du Parti le "deus ex machina" du mouvement de la classe. De même, frustrés de n'avoir pas convaincu immédiatement 1 'ensemble de 1 'organisation, ils ont préféré la quitter avant même d'avoir rédigé un document synthétisant l'ensemble de leurs divergences. A un travail révolutionnaire sérieux qui implique aussi de se trouver en minorité dans une organisation vivante du prolétariat, ils ont préféré se livrer aux penchants typiquement gauchistes et estudiantins de multiplication de petits cercles où chacun peut s'adonner à coeur joie à 1'ambition petite-bourgeoisie d'être "maître chez soi". En un mot, le sectarisme.
Sur la lancée de ses origines, le GCI n'a eu de cesse, depuis son apparition, de dénigrer systématiquement le CCI, en s'acharnant à trouver des contre-exemples destinés à démentir nos analyses, en utilisant massivement la déformation de nos positions en lieu et place d'une polémique véritable et fructueuse.
Quand à 1'argumentation de leurs positions de départ, elle a conduit ces camarades a développer des théories fumeuses et des schémas abstraits auxquels ils "adaptent" la réalité. Ainsi, ils ont abandonné rapidement une compréhension réelle de ce qu'est la classe ouvrière et de son mouvement; ils ont rejeté aux poubelles de l'histoire une partie du mouvement ouvrier, et notamment toute la seconde Internationale.
Cet abandon est à la base, comme pour beaucoup de groupes révolutionnaires aujourd'hui, des graves confusions du GCI sur de multiples problèmes, notamment le processus de prise de conscience du prolétariat et le rôle des minorités révolutionnaires, la nature et le rôle de la violence de classe, les perspectives actuelles de la lutte de classe et le cours historique de notre période, confusions qui interdisent d'apporter une contribution fructueuse aux combats qui se préparent.
C'est ce que nous proposons de montrer dans cet article.
CONSCIENCE DE CLASSE ET ROLE DU PARTI
Le GCI ([1] [22]) reconnaît très clairement que la révolution prolétarienne, à la différence des révolutions bourgeoises, sera une révolution CONSCIENTE :
" Les conditions et les déterminations de la lutte prolétarienne sont donc radicalement différentes de ce qui conditionnait les luttes de classe du passé, pour le prolétariat qui n'a aucun nouveau système d'exploitation à imposer, la connaissance de son être en mouvement (et donc de son but) est une nécessité pour sa victoire" (Le Communiste n°6, page 3).
Malheureusement, s'il accepte cette prémisse générale, c’est pour aussitôt la déformer, en 1'"adaptant" à sa propre vision de la classe et du parti. Le préjugé bien ancré du GCI est que seule une minorité du prolétariat peut arriver à une conscience claire des buts et moyens de la révolution : " exiger que la conscience soit générale au sens où l'ensemble des ouvriers soient conscients des objectifs, des moyens pour y arriver et de l'expérience accumulée, c'est demander l'impossible : les conditions même de l'exploitation l'empêchent" (Rupture avec le CCI, page 10). La conscience de classe est vue comme l'apanage de ceux qui ("noyaux, groupes, fractions, voire individus, communistes") doivent se constituer en parti communiste mondial. Quant aux larges masses d'ouvriers, ce n'est que plus tard, après la prise du pouvoir, pendant la dictature du prolétariat, qu'elles acquerront cette donnée précieuse. Le GCI se trouve ainsi prisonnier de ses deux affirmations, qui s'excluent réciproquement; d'une part l'affirmation que"pour le prolétariat, la connaissance de son être en mouvement (et donc de son but) est une nécessité pour sa victoire" et d'autre part l'affirmation que "exiger que la conscience soit générale, au sens où l'ensemble des ouvriers soient conscients... c'est demander l'impossible". C'est dans l'emploi du mot "ensemble" et le sens abusif qu'il lui donne que le GCI s'enfonce dans la confusion tout en croyant s'en tirer. Faut-il rappeler que pour le marxisme, "l'ensemble" n'a nullement un sens arithmétique d'une somme d'ouvriers additionnés un à un? L'"ensemble" se rapporte à la classe comme une entité sociale, avec sa dynamique propre, historique. Il se rapporte à la conscience de la classe comme un tout, et non à la conscience de chaque ouvrier comme individu. C'est cette difficulté à saisir le concept de classe comme un tout, un ensemble, cette difficulté commune à toute démarche petite-bourgeoise, qui plonge le GCI dans cet embarras insurmontable, et ne lui permet de s'en dégager qu'en recourrant à une autre et vieille aberration .
Comment selon le GCI, le prolétariat pourra-t-il donc faire la révolution? C'est au parti que revient l'essentiel de cette tâche.
Cette position n'est pas sans poser quelques difficultés, lorsqu'on aborde des problèmes plus concrets. Si les ouvriers ne sont que des moutons inconscients, pourquoi suivront-ils le parti, les mots d'ordre révolutionnaires, plutôt que la bourgeoisie? Pourquoi les ouvriers, en Allemagne, n'ont-ils pas suivi leurs partis (KPD, KAPD) qui décrétèrent l'Action de Mars en 1921? "Il y a eu putsch car impréparation (cf. Les changements de positions du VKPD, du jour au lendemain) et erreurs d'appréciation de l'état d'esprit des masses, du rapport de force entre les deux classes antagoniques" (Le Communiste, n°7, pagel6).
En quoi consistait cette préparation, réussie en Russie et ratée en Allemagne? "Dans l'action de Mars, il n'y a aucune "conspiration sérieuse", aucun "complot insurrectionnel, aucune insurrection massive, et encore moins un déforcement de la bourgeoisie" (Idem). Voilà comment le GCI se "sort" de la position difficile dans laquelle il s'est placé : en éliminant totalement le facteur "conscience de classe".
Les facteurs déterminant une insurrection victorieuse sont réduits du coté du parti...à une "conspiration", un "complot", et du coté de la classe à... une"insurrection massive". Un point c'est tout.
Si le GCI peut éliminer aussi facilement la conscience de classe de l'analyse des mouvements révolutionnaires, alors qu'il en parle tellement dans d'autres textes, c'est parce que fondamentalement, il ne sait pas de quoi il parle, parce qu'il ne comprend pas ce qu'est la conscience de classe.
La conscience de classe est la conscience qu'a la classe ouvrière de son être propre, de ses perspectives et des moyens qu'elle se donne pour les réaliser. Elle n'est pas une conscience sur un objet, extérieur au prolétariat, mais une" conscience de soi, et dans cette mesure, elle s'accompagne d'une modification du prolétariat. La conscience de classe n'existe que par l'existence d'une classe consciente. Que la classe soit consciente ne signifie pas que tous les prolétaires, pris individuellement, aient cette conscience, mais c'est un fait matériel : la classe consciente est une classe qui s'affirme par la destruction matérielle du système capitaliste. Toute tentative de dissocier conscience de classe - classe consciente-destruction matérielle du capitalisme - ne consiste qu'à réintroduire l'idéologie bourgeoise, ses séparations et ses spécialisations, dans la théorie révolutionnaire.
La conscience de classe, collective, ne peut donc, par sa nature même,être détenue par une minorité. Le parti, les noyaux révolutionnaires ont bien une compréhension théorique des problèmes de la révolution, mais ne peuvent prétendre être les détenteurs exclusifs de la conscience de classe.
En fait le GCI ne voit pas d'où vient la conscience de classe, comment elle s'élabore. Sous prétexte que "l'action précède la conscience", il refuse de comprendre que la conscience de classe s'élabore au travers des luttes quotidiennes de la classe ouvrière et de la réflexion forcée et inévitable de ses expériences. Et que c'est parce que le prolétariat devient plus conscient qu'il est capable de modifier sa façon de lutter. Le prolétariat ne fera pas une "insurrection massive" poussé uniquement par la misère, comme semble le penser le GCI. Le prolétariat ne fera la révolution que s'il sait ce qu'il fait et vers où il va.
Sur ce point, le GCI se pi ait à répandre l'idée que le CCI est, entre autre, profondément "démocrate". "Avec son culte de la conscience généralisée (dont il fait un fétiche devant lequel il se met à genoux), le CCI est retombé tout droit dans l'idéologie"démocratique bourgeoise" (Rupture avec le CCI, page 11). Le GCI affirme par ailleurs que "l'aspect minoritaire de la conscience de classe restera une donnée certaine jusqu'à un stade avancé du processus révolutionnaire, pour s'élargir à des couches de plus en plus larges d'ouvriers pendant la période de dictature. La révolution communiste est donc principalement anti-démocratique".
Contrairement à ce que pense le GCI, la question réelle n'est pas "minorité" ou "majorité" en soi. Nous ne sommes pas attachés à des images de mécanismes de vote, à des forêts de bras levés, à de belles majorités qui 1'emportent...mais à comprendre les conditions qui rendent la révolution possible. Ni la révolution, ni la transformation ultérieure ne seront possibles avec pour seul atout une "minorité consciente". La transformation de la société capitaliste, dont les forces aveugles dominent le prolétariat comme toute la société, ne se fera pas par décrets, mais elle n'est possible que par l'action consciente et collective du prolétariat. C'est la mobilisation du prolétariat, sa capacité à assumer l'entièreté du pouvoir, qui seront les garanties de la transformation de la société. C'est pour cette raison que la dictature du prolétariat signifiera la démocratie ouvrière, c'est à dire une égalité réelle, une liberté sans précédent pour toute la classe ouvrière.
Cela signifiera aussi le refus de toute contrainte, de toute violence au sein du prolétariat. A ce sujet, on peut se demander ce que signifie concrètement le fait que pour le GCI, la révolution communiste sera anti-démocratique au sein même du prolétariat?
Avec la même virulence, le GCI reproche au CCI son"assembléisme", ou "formalisme" ou "fétichisme des Assemblées générales" - le terme varie selon les jours- bref, le fait que le CCI fait, dans son intervention en général, de la propagande pour certaines formes d'organisation de la lutte ouvrière : les Conseils Ouvriers en période révolutionnaire, et, dans les luttes actuelles, les organes qui les préfigurent, Assemblées Générales, comités de grève, délégués élus et révocables... L'argument du GCI en la matière étant que toutes les formes d'organisations (Conseils, comités de grève, unions etc..) pouvant être récupérées par la bourgeoisie (ce qui est tout à fait exact), peu importe la forme que prend l'organisation des ouvriers, ce qui importe, c'est le contenu . Le GCI a ainsi développé un schéma, où le lien entre la forme et contenu de la lutte est banni.
Nous ne sommes pas attachés à une forme d'organisation en tant que telle, mais à un contenu: le développement de la conscience de classe par la participation active des ouvriers â la lutte, le fonctionnement collectif, le dépassement des séparations entre "économique" et "politique", la rupture des divisions sectorielles, usinistes, entre les ouvriers. A ce contenu ne correspondent pas 36 organisations, et en tout cas, pas les syndicats (même si le GCI en juge certains de "classes" ni les unions. Le manque de clarté d'un groupe politique sur les organisations où s'exprimera la dynamique révolutionnaire est dangereux. La position du GCI sur les formes d'organisation de la lutte aujourd'hui l'a conduit à avoir, par rapport à la Pologne, une intervention totalement inadéquate. D'une part, en cherchant à prouver l'idée selon laquelle on ne peut prétendre à l'avance et en dehors de la vie réelle que les formes "syndicats de classe", "unions", "conseils", "communes", "soviets" ont toutes épuisé complètement leur cycle historique et ne ressurgiront plus comme expression du mouvement prolétarien (Le Communiste n° 4, page 29), au lieu de dénoncer les syndicats libres, le GCI écrit : " Ceux-ci peuvent en effet être de réels organismes ouvriers, larges, ouverts à tous les prolétaires en lutte, la coordination, centralisation des comités de grève, mais également sous pressions conjointes des autorités et des "dissidents", se transformer en organismes de l'Etat bourgeois" (Le Communiste n°7, page 4).
D'autre part, le GCI s'est contenté de mettre l'accent sur le caractère massif et centralisé du mouvement, sans se résoudre à parler des fermes d'organisations que cela supposait : Assemblées Générales, délégués élus et révocables, sans doute parce que cette réalité était trop "démocratique" à son goût?
Le silence dont fait preuve le GCI par rapport aux formes d'organisation de la lutte est d'autant plus profond que finalement, il n'est pas intéressé à comprendre le mouvement de la lutte de la classe ouvrière. En effet, à ses yeux, c'est le parti qui organise la classe.
LE ROLE CONCRET DU PARTI
" (les communistes) ne s'opposent pas aux nombreuses associations qui surgissent parmi les prolétaires et qui luttent pour des objectifs particuliers (...) . Ils agissent pour élever leur niveau, généraliser leurs tâches et leurs objectifs les fondre ensemble organiquement : c'est-à-dire les réunir en une seule organisation, ou du moins, si ce n'est pas possible directement, les centraliser autour du pôle le plus avancé" (Rupture avec le CCI, page 8). Le parti centralisant tendanciellement toute la classe, la fonction que joua la Première Internationale au 19ème siècle : "organiser et coordonner les forces ouvrières pour le combat qui les attend" (Marx, 1871), constitue l'idéal absolu du GCI. Ce que le GCI méconnaît totalement, c'est que l'évolution de la classe ouvrière d'une part, le changement de période historique de l'autre, ont modifié le rôle des révolutionnaires dans l'histoire : "Il était normal que dans un premier temps, la nécessité, d'organisations communistes distinctes remplissant une fonction propre ne se soit pas faite sentir de manière plus impérieuse : la première tâche d'organisation que des révolutionnaires comme Marx se sont donnée fut de tenter de faire exister le prolétariat comme force autonome, et organisée, en unifiant les expressions de classe existantes qui restaient éparpillées. Ce fut le sens de la Première Internationale, qui tenait autant du parti politique au sens strict du terme, que de l'organisation générale de la classe (associations et sociétés ouvrières, organes syndicaux). Avec la Deuxième Internationale, une plus grande distinction s'était opérée entre d'une part le parti politique et d'autre part les organismes plus généraux tels les syndicats. Cependant, l'immaturité du prolétariat en pleine croissance, la possibilité de mener des luttes permanentes pour des réformes et donc de créer et maintenir en vie des organisations de lutte permanentes (syndicats) donnaient toujours un poids à l'influence"organisatrice" des révolutionnaires; les partis eux-mêmes étaient des organisations de masse liées aux syndicats. Cette pratique s'est reflétée dans l'idée que les marxistes se faisaient de leur tâche. Pendant toute cette période en fait, l'absence d'expérience révolutionnaire décisive (l'exemple de la Commune de Paris demeurait tout à fait isolé), les marxistes ne parvenaient pas à concevoir le parti politique autrement que comme un organisme qui organiserait plus ou moins progressivement la majorité de la classe, et qui par ce caractère de masse, serait amené à exercer la dictature du prolétariat. Cette conception s'était particulièrement renforcée sous la social-démocratie.
Mais dés 1905 en Russie, cette conception s'est effondrée. L'entrée du capitalisme dans sa phase de déclin et la période de la révolution mondiale surgie de la première guerre mondiale changent définitivement et profondément les conditions de la lutte ouvrière, et donc également les caractéristiques de ses organisations. La crise du capitalisme empêche la survivance des luttes permanentes, les organisations de masses (syndicats et partis) sont englouties par l'appareil d'Etat; parallèlement, la plus grande maturité du prolétariat lui permet de se lancer dans des affrontements révolutionnaires et de créer spontanément des organisations de classe unitaires abolissant la frontière entre politique et économique, les Conseils Ouvriers. Les Conseils Ouvriers sont "la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat" (Lénine). Dans cette situation, la fonction propre des organisations révolutionnaires prend tout son sens: les révolutionnaires, même lorsqu'ils forment des partis, constituent une minorité dont l'impact organisateur se réduit vis-à-vis de la masse de prolétaires en mouvement, alors que leur tâche politique, en tant qu'organe spécifique, de développement de la conscience de classe devient cruciale pour la marche de la Révolution"(Internationalisme n563 : Nécessité et Fonction du Parti).
A l'époque actuelle, où le prolétariat tend à se lancer dans des luttes massives, les ouvriers à s'organiser par millions, la vision d'un parti réunissant les associations ouvrières en "une seule organisation" révèle une mégalomanie et un anachronisme profonds chez ceux qui la véhiculent. Le GCI pense avoir trouvé un support historique à sa conception : le KAPD en 20-21 en Allemagne, qui travaillait essentiellement dans les "Unions". Cette forme d'organisation bénéficie de ses faveurs pour deux raisons : parce que les "Unions" dépendaient étroitement d'un parti politique, et parce qu'il y avait un critère politique d'adhésion : l'accord sur la dictature du prolétariat.
Le GCI glorifie donc le KAPD : "Force nous est de trouver, dans la pratique du KAPD, les indications sur le contenu du futur mouvement révolutionnaire" (Le Communiste, n° 7, pagel8-19). Aveuglé par le fait d'avoir trouvé enfin la forme d'organisation qu'il cherchait et un parti qui l'a créée, le GCI se défend d'envisager en quoi, et la création des Unions et l'intervention du KAPD étaient à maints égards le produit de la faiblesse du mouvement révolutionnaire en Allemagne. Les Unions sont créées après l'échec des Conseils Ouvriers, que la bourgeoisie avait réussi à neutraliser. La désorientation politique du prolétariat qui s'en suivit se refléta dans ces organes, qui étaient clairement un repli sur l'usine, et que les ouvriers considéraient comme des syndicats plus radicaux. Cette désorientation va aussi influencer l'intervention des révolutionnaires : le KAPD va adopter une attitude volontariste dans son intervention, tenter de reconstruire le mouvement de masse grâce aux Unions. La centralisation dans le KAPD sera le reflet du manque de centralisation réelle dans la classe, d'une dispersion des forces. Finalement les attitudes putschistes du KAPD (Action de Mars) n'aboutiront qu'à 1'échec.
Armé de tout ce bagage "historico-théorique", le GCI conçoit son rôle comme étant prioritairement "d'organiser la classe", du moins les éléments qui veulent bien se laisser organiser par lui. Ses entreprises se sont soldées par un échec, soit parce que ses"appels" ne rencontrent aucun écho auprès des groupes concernés (cf. son appel â "une coordination des ouvriers en lutte", dans Le Communiste n°2, critiqué dans Internationalisme n° 35), soit parce que ayant bâti artificiellement des comités de tout genre, ceux-ci dé pourvus d'une vie réelle interne, succombaient rapidement à leurs contradictions. Ces expériences désastreuses devraient suffire pour démontrer au GCI que ce n'est pas là le sens du travail révolutionnaire aujourd'hui. Dans la période actuelle, les révolutionnaires doivent intervenir au sein des luttes générales de la classe pour y défendre des perspectives claires : ce que le GCI ne faisait quasiment plus jusqu’aux récents mouvements début 82 en Belgique, étant trop préoccupé par l'organisation et l'activation de ses "comités" fantômes.
LA CLASSE OUVRIERE
Emporté dans sa recherche de "minorités agissantes", "historiques",1e GCI a été amené à définir d'une façon très particulière ce que constitue pour lui la classe ouvrière : "Le CCI méconnaît que l'existence de la classe ouvrière ne se manifeste pas dans 1'énumération statique des prolétaires, ni même forcement dans une majorité d'entre eux, mais souvent dans des minorités d'entre eux parmi lesquelles s'exprime la tendance à la constitution en classe"(Rupture avec le CCI, page 3). Le GCI a ainsi développé une vision totalement abstraite de la classe ouvrière. Une vision qui se situe en dehors du marxisme parce qu'elle efface tout simplement et complètement les déterminations économiques de la classe. D'où yient en effet le "mouvement" qu'il retient comme critère pour définir la classe, quel est le moteur matériel de la lutte, sinon l'exploitation des prolétaires?
C'est cette définition de la classe ouvrière qui a été le support de l'intervention du GCI. Il a ainsi progressivement centré cette intervention vers des secteurs de la classe ouvrière, essentiellement les chômeurs, sans doute parce qu'il les jugeait susceptibles de se mettre plus rapidement en mouvement que les ouvriers au travail des concentrations industrielles. On peut voir à quel point le GCI est arrivé dans son culte du "mouvement", indépendamment des forces sociales qui animent celui-ci, dans sa position sur la lutte des squatters à Berlin : "La lutte à Berlin, surtout menée par des jeunes,se rattache de fait au prolétariat, parce que l'occupation correspond à la satisfaction autoritaire d'un besoin ouvrier général, parce que pour mener ces occupations, le mouvement doit s'affronter à l'Etat bourgeois, et il remet en cause le sacré principe de la propriété privée" ( Action Communiste n° 4, page 6).
Si le GCI a refusé les "déterminations économiques statiques", c'est pour être prêt à glorifier un mouvement avec pour critère qu'il s'affronte avec l'Etat et au nom de critères moraux : "satisfaction autoritaire", "propriété privée" etc..
Le mouvement squatter est une expression de l'impasse du capitalisme qui provoque des convulsions dans toute la société.
Mais celles-ci ne sont pas pour autant porteuses du dépassement de ce système. Seule la classe ouvrière est porteuse de ce dépassement et peut et doit développer sa lutte pour rassembler toutes ces révoltes sociales. Le GCI préfère assigner des perspectives particulières au mouvement des squatters : centraliser les luttes pour le logement au-delà des frontières. L'attirance aveugle pour "tout ce qui bouge" du GCI lui fait remettre en question une base essentielle de la lutte révolutionnaire et du marxisme: la classe ouvrière est la seule classe révolutionnaire aujourd'hui.
LA VIOLENCE DE CLASSE
Le GCI, ne comprenant pas la capacité de la classe ouvrière à s'organiser de façon unitaire et à développer sa conscience de classe, ne saisit pas non plus comment, par sa violence de classe organisée, le prolétariat pourra avoir raison de la bourgeoisie. Cela le conduit à bon nombre de confusions, dont le point commun est l'idée que les affrontements physiques joueront un rôle central dans le développement de la perspective révolutionnaire. Le GCI défend aussi le terrorisme "ouvrier", insiste sur la "préparation militaire" de l'insurrection', sur la nécessité pour le prolétariat de développer une terreur rouge. Parce que nous ne partageons pas ces conceptions, le GCI nous accuse de "pacifisme" et de "légalisme" : "Le CCI ne s'est jamais dégagé du "social-pacifisme"" (Rupture avec le CCI, page 14).
Il ne fait aucun doute pour le CCI que la lutte de classe est une violence permanente entre deux classes irréductiblement antagonistes et que la révolution sera violente. Mais la question réelle est : quel rôle joue la violence dans la révolution prolétarienne?
A cette question, Rosa Luxembourg répondait : " Dans les révolutions bourgeoises antérieures ce sont les partis bourgeois qui avaient pris en main l'éducation politique et la direction de la masse révolutionnaire, et d'autre part, il s'agissait de renverser purement et simplement l'ancien gouvernement; alors le combat de barricades, de courte durée, était la forme la plus appropriée de la lutte révolutionnaire. Aujourd'hui, la classe ouvrière est obligée de s'éduquer, de se rassembler, et de se diriger elle-même au cours de la lutte et ainsi, la révolution est dirigée autant contre l'exploitation capitaliste que contre le régime d'Etat ancien; si bien que la grève de masse apparaît comme un moyen naturel de recruter, d'organiser et de préparer à la révolution les couches prolétaires les plus larges, de même qu'elle est en même temps un moyen de miner et d'abattre l'Etat ancien ainsi que d'endiguer l'exploitation capitaliste (...) Ce qui autrefois était la manifestation extérieure principale de la révolution : le combat de barricades, l'affrontement direct avec les forces de l'Etat, ne constitue dans la Révolution actuelle que le point culminant, qu'une phase du processus de la lutte de masse prolétarienne" (Grève de Masse).
Les combats pour la révolution prolétarienne seront peut-être plus violents, plus meurtriers que ceux qu'a menés la bourgeoisie pour faire sa révolution. Mais ce sera la conscience et la capacité du prolétariat à s'organiser qui déterminera l'efficacité de sa violence et non une "préparation militaire en soi" comme le pense le GCI. Pour cette raison, le rôle du parti prolétarien dans la préparation de l'insurrection comme à un niveau plus général consiste avant tout à développer la conscience de classe.
Les incompréhensions du GCI sur la question de la violence de classe déterminent par conséquent des erreurs dans son intervention. Pour le GCI, la classe ouvrière aurait à faire un apprentissage spécifique de la violence. Cela le conduit à applaudir à chaque acte violent posé par des groupes isolés de la classe ouvrière. " La violence est aujourd'hui un besoin immédiat de toute lutte qui veut marquer des points" (Voir leur article sur Longwy-Denain dans Le Communiste n° 1). Et parce qu'il craint que cela affaiblisse sa propagande pour la violence, la GCI s'interdit formellement de penser que ces manifestations de violence recouvrent bien souvent une combativité exemplaire associée à un manque de perspectives, comme dans la sidérurgie en France ou en Belgique. L'intervention du GCI ne correspond pas aux réels besoins de la classe.
La classe ouvrière n'a pas à apprendre à être violente, comme elle n'a pas à apprendre à faire grève. La classe ouvrière fait surgir des organisations révolutionnaires en son sein, pour ses besoins de comprendre et d'analyser la situation et de tracer des perspectives claires au cours de la lutte, non pour applaudir à ce qu'elle fait de plus immédiatement spectaculaire.
Dans ses tracts, le GCI ne manque pas de mettre en avant des mots d'ordre tels que "séquestration des patron", "destruction des stocks de marchandises". Pourtant les"exploits" du syndicalisme de base (destruction de sièges de banque, chambres syndicales, hôtels des impôts, séquestration de patrons) devraient lui faire comprendre que ces mots d'ordre ne sont pas plus que d'autres, en eux-mêmes, une manifestation de la radicalité de la lutte autonome du prolétariat.
Activisme organisateur, culte des mouvements partiels, apologie des "minorités" et de la violence dans un contexte d'immaturité de la classe ouvrière qui, jusqu'à présent, a encore laissé place aux illusions sur le parti "dirigeant la classe", 1'"organisant", "centralisant sa violence", voilà les facteurs qui ont permis que l'intervention du GCI ait produit un relatif développement numérique et éphémère en Belgique. Les bases du GCI sont peu solides. Nous venons de voir qu'elles reposent sur une incompréhension fondamentale de la nature de la classe ouvrière, de la façon dont celle-ci forge sa prise de conscience et du rôle des organisations révolutionnaires et du parti. Il s'agit de fait d'une incompréhension de la dynamique de la lutte de classe.
Lorsque l'on quitte le domaine des définitions et de la théorie, devenue pure abstraction pour le GCI, on peut voir dans toute son ampleur les conséquences des erreurs théoriques. Celui-ci s'avère en effet incapable de fournir une analyse sérieuse du mouvement de la lutte de classe. La cause essentielle de ce déficit est son refus de prendre en compte les conditions objectives, c'est-à-dire les conditions matérielles, qui, au sein du système capitaliste, sont un facteur déterminant dans les potentialités - ou les limites - de toute la lutte. Sa démarche idéaliste se dénote aussi bien dans son incompréhension historique (lutte en période ascendante et décadente du capitalisme) que dans son incompréhension du développement de la lutte à un niveau international aujourd'hui.
LE REJET DE LA 2ème INTERNATIONALE ET DES SYNDICATS
Le GCI a très vite rejeté le concept de périodisation du système capitaliste en une phase ascendante et une phase décadente, concept qui cimente la plateforme du CCI. Entendons-nous : il n'a jamais procédé à une critique réelle, mais en a touché un mot de-ci de-la ([2] [23]). Il rejette également les implications qu'a cette périodisation sur les potentialités de la lutte ouvrière. A savoir : au 19ème siècle, époque ou le capitalisme était en pleine expansion, la révolution n'était pas directement 4 l'ordre du jour. Dans ce contexte d'expansion, la lutte du prolétariat pouvait aboutir à des réformes, à des améliorations de sa condition, tant sur le plan économique (diminution du temps de travail, augmentation des salaires) que sur le plan politique (acquisition du droit d'association, de réunion, de presse, extension du droit de yote..). Au-delà de ces objectifs immédiats, c'est au travers de ces luttes que les prolétaires développaient leur organisation, leur unité, leur conscience de classe; au travers de cette expérience se préparait la lutte révolutionnaire. Social-démocratie et syndicats étaient les organisations qui, à l'époque, regroupaient les prolétaires autour de ces objectifs immédiats et à long terme. Un siècle plus tard, le GCI juge, quant à lui, que toute réforme intégrable par le capitalisme était par essence anti-prolétarienne: "Par suite de l'amélioration des conditions de travail et de la hausse des salaires, rendue possible par le haut niveau d'accumulation du capital, les luttes ouvrières furent chaque fois transformées en lutte pour des réformes (et par conséquent détruites en tant que combat prolétarien.), facteurs de l'expansion capitaliste et du progrès (Le Communiste n° 6, page 32). Pour quel objectif le prolétariat devait-il lutter alors? Selon le GCI, "il n'y a qu'un seul cas de conquête partielle envisageable, réalisé par notre classe : lorsque les ouvriers arrachent au capital une diminution du taux d'exploitation" (Le Communiste n°4, page 14). Nous avons déjà répondu à cette absurdité sans nom : "Jamais les luttes ouvrières ne se sont fixées comme objectif, en dehors des moments révolutionnaires, de mettre fin à l'accroissement du taux d'exploitation pour la bonne et simple raison qu'une telle chose aurait signifié l'arrêt de l'accumulation du capital, et donc du capital lui-même (Lutte revendicative et révolution, Internationalisme n° 40). Cette "analyse" illustre bien la démarche du GCI, oui se pi ait à élaborer des schémas stériles. La réalité de la lutte à la fin du 19ème siècle n'y entre-t-elle pas? Elle est simplement rejetée comme déchet à la poubelle de l'histoire. Les organisations du prolétariat à l'époque? Social-démocratie et syndicats sont décrétés "contre-révolutionnaires" les uns dès leur naissance, les autres dés leur légalisation par l'Etat bourgeois.
Au-delà du grotesque politique de ce genre d'affirmation, cet exemple est significatif. Ce que le GCI refuse en fait, c'est que la classe ouvrière est non seulement une classe révolutionnaire, mais aussi une classe exploitée. Ceci implique qu'elle lutte d'abord pour des objectifs immédiats (pour l'amélioration ou contre la détérioration de ses conditions d'existence), et que cette lutte ne peut réaliser sa potentialité révolutionnaire que dans des circonstances historiques déterminées : la période de décadence du capitalisme.
Pour le GCI, la classe ouvrière devrait être révolutionnaire dans toutes les conditions historiques et dans chaque lutte ponctuelle. Il tente de faire coller la réalité à son schéma, en affirmant jusque dans ses moindres tracts, que les ouvriers luttent aujourd'hui "pour une augmentation des salaires et des allocations de chômage", "pour une diminution de temps de travail", prêtant à toute lutte un caractère d'offensive directe vis-à-vis de la bourgeoisie, et ce, sur le terrain économique. Cette vision est, à maints égards, une absurdité profonde. Même dans la période actuelle, où la question de la Révolution est directement contenue dans les luttes décidées de la classe, l'aspect défensif est un caractère présent dans toute lutte. C'est la résistance à la dégradation de ses conditions d'existence qui pousse la classe ouvrière à développer son combat jusqu'à en faire une lutte révolutionnaire, moment où l'aspect défensif passe au second plan, mais est toujours présent. La transformation de sa lutte de résistance en lutte révolutionnaire nécessite toute une maturation de la classe ouvrière, de sa lutte et de sa conscience, C'est une vision totalement idéaliste de la classe ouvrière que celle du GCI qui ne reconnaît comme "lutte" que les mouvements qui posent la question de la révolution, et selon laquelle celle-ci serait directement contenue dans chaque lutte, dans chaque usine.
INTERNATIONALISATION DE LA LUTTE ET COURS HISTORIQUE
L'INTERNATIONALISATION DE LA LUTTE
Le GCI ignore généralement le problème de l'internationalisation de la lutte et quand il le pose, c'est toujours d'une façon erronée parce qu'il ne comprend pas les conditions matérielles qui déterminent les potentialités des combats ouvriers actuels.
Pour le GCI, la Révolution prolétarienne est à l'ordre du jour partout dans le monde; le prolétariat affronte sa tâche historique de façon unitaire tout en présentant des différences secondaires entre les divers pays. Le sort de la Révolution prolétarienne se jouera dans les pays centraux du capitalisme, là où le prolétariat est le plus concentré, où il y a la plus grande expérience de lutte, là où justement la bourgeoisie est le mieux développée, avec tout ce que cela comporte. C'est pourquoi nous avons toujours situé la reprise internationale des luttes en 68, au moment où toute l'Europe est secouée par des convulsions sociales. Nous rejetons explicitement la théorie "des maillons faibles" selon laquelle la Révolution se déclenchera dans les pays où la bourgeoisie est faible et mal armée contre le prolétariat. Nous avons réaffirmé cette position en essayant de comprendre la perspective qui s'ouvrait à la grève de masse en Pologne en 80-81, Nous avons mis l'accent sur le fait que le développement de la lutte en Pologne comme, à terme, la question de la Révolution, dépendait essentiellement de l'entrée en lutte du prolétariat des pays centraux du capitalisme.
A propos de cette question, le GCI jusqu'à présent fait preuve d'une incapacité notoire à comprendre la dynamique de la lutte de classe dans la période actuelle : quels en sont les grands moments? Où se situera au sein du mouvement international de la classe ouvrière, le noeud des confrontations entre bourgeoisie et prolétariat? Etc.,,
Ainsi, sous prétexte qu'il y a eu des luttes antérieures à 1968, le GCI se croit original à ignorer et minimiser ce que constitue comme ouverture la période de 1968. De même, lorsque nous analysons la Pologne comme "le mouvement ouvrier le plus important depuis 1917", le GCI (plus pour faire valoir une"originalité" que pour affirmer une autre analyse) pérore-t-il, que cette "affirmation grandiloquente et apologétique est un réel oubli actif (rien que ça!) des importants mouvements de classe, qui, ces dernière années, de l'Amérique Latine à l'Iran, de la Turquie à la Corée, de l'Italie à la Chine, ont ébranlé le monde capitaliste" (Le Communiste n913, page 13). Que le GCI soit rassuré, nous n'oublions aucune de ces luttes. Mais tous ces mouvements n'ont pas la même importance ([3] [24]). Il ne s'agit pas de juger des caractéristiques d'un mouvement dans l'absolu (de ce point de vue, la lutte en Amérique Latine a souvent été plus violente, plus généralisée que les combats en Europe) mais de voir comment il a pu s'intégrer -ou non- dans la dynamique générale qui anime la classe ouvrière mondiale, de par la maturité - historique- d'une situation. De ce point de vue, la Pologne marquait bien une avancée qualitative du mouvement, tout comme les mouvements de 68 en Europe, et ce dans la conscience ouvrière mondiale.
Le GCI, lui, met tout sur le même plan. Pire, il inverse parfois l'ordre d'importance des événement Ainsi, alors que "en Pologne, c'est le schéma de la contre-révolution qui se déroule" (après le 13 décembre), la "lutte du prolétariat au Salvador a marqué un grand pas dans la lutte communiste et à la formation du parti mondial". Si la première chose qu'il affirme à propos de la défaite en Pologne, c'est que celle-ci montre pleinement "la carence se matérialisant par l'inexistence d'une direction communiste", la leçon qu'il tire du Salvador est que : "Nous savons par notre propre expérience de classe que dans es conditions présentes au Salvador (...) il y a malgré tout des minorités révolutionnaires" (Le Communiste n°12). L'importance totalement démesurée que le GCI accorde ici au Salvador, et en général aux luttes en Amérique Latine et Centrale ([4] [25]) provient de son culte de la violence dans les luttes, des affrontements "militaires" entre bourgeoisie et prolétariat.
L'incapacité qu'il a de comprendre que seule la lutte dans les pays centraux du capitalisme offrira une perspective à la combativité des ouvriers des pays périphériques et de défendre cette perspective face à la classe ouvrière, le condamne à n'être qu'un spectateur admiratif des massacres qui se perpétuent là-bas, à faire l'apologie de l'isolement de cette fraction du prolétariat mondial.
Dans de telles conditions, il ne faut pas s'étonner du fait que le GCI ne comprenne rien au problème de l’internationalisation de la lutte de classe. "Depuis toujours le marxisme révolutionnaire analyse que la meilleure façon de généraliser un mouvement n’est ni d'"envahir" les autres pays, (...) ni d’"attendre" que simultanément le mouvement se déclenche partout (...). Au contraire, la meilleure manière de généraliser, de mondialiser un mouvement, c'est de répondre coup pour coup contre "sa propre" bourgeoisie ou les représentants directs de la bourgeoisie mondiale; c'est d'intensifier, le plus possible la guerre de classe là où elle s'est déclenchée" (Le Communiste n°13, page 9-10), avançait-il comme réponse aux questions posées par la Pologne: quand, comment, une telle lutte pourra-t-elle s'internationaliser? A nouveau l'affirmation du GCI est, par son aspect partiel, à moitié juste et donc aussi à moitié fausse. Il est certain que pour les ouvriers d'un pays donné, la meilleure façon de favoriser l'internationalisation d'un mouvement n'est pas d'attendre, mais de prendre des initiatives dans ce sens. Mais il était nécessaire d'aller plus loin que ces banalités, et de répondre aussi aux questions suivantes : est-ce que la situation était mûre pour qu'un tel dépassement des frontières nationales voit le jour à partir du mouvement en Pologne? Quelles sont les conditions objectives de maturité d'une telle situation? Il s'agit essentiellement de la mise en branle du prolétariat des pays centraux du capitalisme. De ce point de vue on ne pouvait que constater une immaturité de la lutte de classe internationale (Voir Revue Internationale n°24, 25, 26..., et Internationalisme n°59 et 60). Le GCI semble incapable de se situer à ce niveau d'analyse, de comprendre que les conditions de l'internationalisation sont avant tout des conditions mondiales.
LE COURS HISTORIQUE
Le doute profond qu'a le GCI par rapport aux potentialités de la classe ouvrière, 1'empêche d'avoir une réponse claire à la question : vers où va la société? Vers la guerre généralisée? Ou vers des affrontements de classe?
Le CCI a mis en évidence que depuis le début de la crise, le prolétariat a recommencé à lutter au niveau mondial, contrairement à la situation que la classe a connue dans" les années 30. Alors que la guerre est la seule "solution" que la bourgeoisie puisse apporter à la crise, celle-ci ne peut la déclencher tant qu'elle n'a pas réussi à briser la résistance du prolétariat, et ce au niveau mondial. L'avenir est donc à ces combats de classe, d'où dépendra la victoire du prolétariat (et donc la Révolution) ou sa défaite (et la possibilité pour la bourgeoisie de déclencher la guerre).
Le GCI reconnaît bien la différence entre la situation d'aujourd'hui et celle des années 30 : il affirme très justement que dans cette période de noire contre-révolution, le cours était inévitablement à la guerre. Mais pour lui, aujourd'hui, la tendance vers la guerre et celle vers la Révolution se développeraient simultanément, et en prenant appui l’une sur l'autre.
A propos de la lutte en Pologne, le GCI écrivait par exemple : "et il est clair que les événements d'aujourd'hui qui matérialisent la force historique de notre classe,renforcent dialectiquement l'intensification de la marche forcée de la bourgeoisie mondiale vers "sa solution" à la crise, la guerre généralisée. Le développement de la lutte prolétarienne est aussi un développement des mesures et des mystifications anti-ouvrières, renforçant ainsi la lutte entre les classes" (Le Communiste n° 7, page 7).
L'"apport" du GCI à la théorie marxiste est d'avoir complété "dialectiquement" le mot d'ordre que Lénine adressait aux ouvriers pendant la première guerre mondiale: "Transformation de la guerre impérialiste en guerre civile" en son complément pour la bourgeoisie. Celle-ci aurait la capacité de "transformer (...) le danger de la guerre civile en la réalité de la préparation matérielle et idéologique à la guerre impérialiste" (Le Communiste n° 13, page 3). Cette nouvelle théorie fumeuse dissimule mal la méfiance profonde, l'incompréhension du GCI de ce que signifie pratiquement la lutte du prolétariat. Le GCI ne comprend pas réellement que lorsque le prolétariat lutte, il a tendance à prendre conscience de ses intérêts propres, à lutter sur son terrain de classe, à s'organiser en dehors du contrôle de la bourgeoisie et tant qu'il aura cette capacité, la bourgeoisie ne pourra l'emmener à la guerre. Le GCI, au contraire, voit le prolétariat comme une masse manipulée, soit par un parti, soit par la bourgeoisie. Celle-ci en effet, pourrait faire face aux luttes, sécréter des mystifications qui entraîneraient directement le prolétariat de son terrain de classe (où il est solidaire, internationaliste, où il lutte en même temps contre la crise et contre la guerre) vers la guerre impérialiste (où le prolétariat est divisé, soumis à l'idéologie nationaliste et belliciste)! Cette position conduit le GCI à de nombreuses erreurs: sur le plan théorique, il véhicule sans complexe l'idée bourgeoise que la lutte de classe accentue les dangers de guerre. Son analyse de situations plus ponctuelles est tout aussi erronée: n'a t-il pas qualifié de guerre inter impérialiste (entre les USA et l'URSS) le conflit des Malouines, destiné en réalité à donner plus de consistance aux campagnes idéologiques actuelles de la bourgeoisie sur la guerre (Voir la Revue Internationale n°30) Ces positions erronées ne peuvent que rendre plus stérile son intervention au sein de la classe ouvrière.
CONCLUSION
Ce texte ne constitue pas une critique exhaustive des positions du GCI. Nous nous sommes surtout efforcés, au travers de cette polémique d'opérer une clarification sur une série d'idées confuses qui règnent encore dans le milieu révolutionnaire. En effet, pour le GCI comme pour d'autres groupes, la source essentielle des confusions est l'incompréhension de la nature de la classe ouvrière, de sa dynamique réelle, des différents aspects de sa lutte. L'étendue des confusions sur ce problème montre bien les difficultés qu'a le milieu révolutionnaire à se réapproprier la théorie marxiste. Elle fait également ressortir la nécessité, pour les organisations prêtes à faire un travail de clarification, de répondre à ces confusions, que ce soit dans des réunions publiques, ou dans des articles dans la presse.
A notre avis, le GCI ne fait pas partie des groupes qui sont une expression de l'effort de clarification des perspectives révolutionnaires. Jusqu'à présent, la fonction essentielle du GCI dans le milieu révolutionnaire (y compris parmi les éléments qu'il "organisait" au sein de ses comités) a été de répandre la confusion.
Outre la régression théorique qu'il a opérée depuis son départ du CCI et la somme d'innovations "historico-théoriques" qu'il déverse régulièrement dans ses publications, son attitude par rapport au milieu révolutionnaire actuel en constitue une autre preuve. En effet, par son refus de tenir des réunions de discussions publiques, ou de participer à celles que nous organisons, par son attitude de sabordage de la 3ème Conférence Internationale des Groupes de la Gauche Communiste, le GCI n'a jusqu'à présent réussi à démontrer qu'une seule chose : le sectarisme profond qu'il n'a cessé de développer. Le GCI a en effet pour souci principal de s'auto satisfaire, de justifier son existence par une vision "originale" tant de l'histoire du mouvement ouvrier que des problèmes posés aujourd'hui.
Malheureusement, ces "découvertes" du GCI ne mènent pas à grand chose, sinon à une remise en question de plus en plus profonde du marxisme. Le fait que ce groupe, après nous avoir promis depuis plus de 3 ans des "Thèses d'orientation politique définissant les bases théoriques de notre groupe" (Le Communiste n°1, mai 79), ne soit toujours pas parvenu à publier l'ensemble de ces "bases théoriques", en dit long sur les difficultés qu'il éprouve à se définir une nouvelle cohérence.
A ceux qui, comme le GCI, se réclament tant de Lénine, il convient de rappeler que rien ne l'irritait plus que la "phraséologie radicale, grandiloquente et creuse ".
A ceux qui ont du "bolchevisme" plein la bouche, rappelons la réponse donnée par Lénine à l'occasion d'un appel au "bolchevisme à l'échelle de 1'Europe occidentale":
"Je n'attache pas d'importance au désir de s'accrocher au mot "bolchevisme", car je connais certains "vieux bolcheviks" dont je souhaite que le ciel nous préserve...
A mon avis, c'est faire preuve de légèreté et d'un manque d'esprit de parti absolument inadmissible que d'annoncer à son de trompe pendant toute une année un nouveau bolchevisme et d'en rester là . N'est-il pas temps de réfléchir et de donner aux camarades quelque chose qui expose en un tout cohérent ce "bolchevisme à l'échelle de l'Europe occidentale"? (Lénine, Oeuvres Complètes, Tome 23, page 18).
J
[1] [26] Groupe Communiste Internationaliste: BP 54 Bruxelles 31 1060 BRUXELLES
[2] [27] Avec le GCI, on apprend que la notion de "décadence du capitalisme", défendue par la Gauche Communiste sur la base de l'analyse économique de Luxemburg, n'était en fait "qu'une des deux thèses bourgeoises dominantes de l'époque - en 1936- (soutenues par les sociaux-démocrates, les trotskistes, les staliniens.)" (Le Communiste n° 6, page 46), affirmation qu'ils ne songent pas un instant a démontrer!
Le GCI pense réfuter cette notion en déclarant simplement que "le capitalisme n'avait pas cessé de croître, comme cela s'est vérifié par la suite : la guerre impérialiste de 39 à 45, la croissance infernale du capitalisme après la guerre. "(Idem). Mais par cet argument, il n'a rien montré, sinon qu'il s'est englué dans le marais de la propagande bourgeoise qui, à coups de taux de croissance , veut démontrer la vie éternelle du capitalisme!
[3] [28] Par contre, ce que le GCI, lui, Ignore, ou n'a jamais appris, c'est de savoir distinguer la portée de telle ou telle lutte, la signification et l'impact qu'elle a dans le développement mondial de la lutte de classe. Pour lui,"tous les chats sont gris".
[4] [29] Ainsi, c'est en Argentine et au Pérou qu'ont existé, selon le GCI,des"syndicats de classe", organisations "ouvrières" dont il serait par ailleurs incapable de donner un exemple dans une autre partie du monde. Le GCI ne manque pas non plus d'illustrer la vague révolutionnaire de 17-23 par l'exemple de la lutte de classe .en Patagonie (Le Communiste n° 5). Enfin plus récemment, le GCI a"découvert" qu'au Salvador, une des organisations populaires dirigées par des gauchistes, le BPR, constitué en 1975, était à 1'origine un organe prolétarien! (Le Communiste n°12).