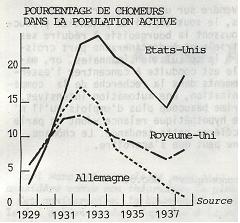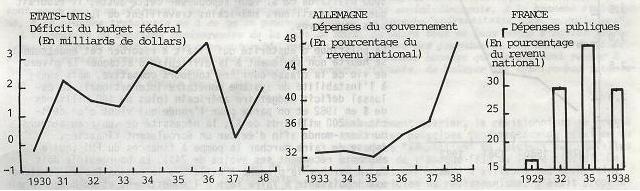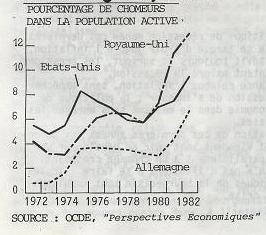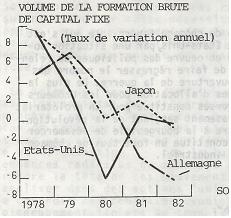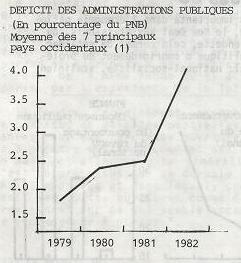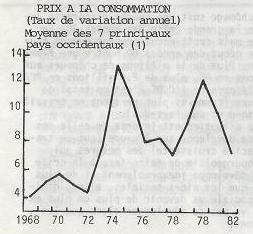Revue Internationale no 33 - 2e trimestre 1983
- 3423 reads
Où va la lutte de classe ? : vers la fin du repli de l'apres-Pologne
- 2651 reads
" Les révolutions prolétariennes, par contre,comme celles du XIX° siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà accompli pour le recommencer à nouveau, raillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces dans la terre et se redresser à nouveau formidable en face d'elles, reculer constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soit créée la situation qui rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles-mêmes crient:" Hic Rhodus, hic salta" ([1] [1])
MARX, Le 18 Brumaire.
Années de vérité, les années 80 ont commencé marquées par la lutte prolétarienne. La grève de masse d'Août 80 en Pologne montra d'emblée, par la puissance de son choc contre l'Etat/que la lutte ouverte entre prolétariat et classe dominante était devenue et, devrait de plus en plus devenir la caractéristique première de la période à venir. Cependant, les ouvriers polonais se sont retrouvés isolés. De 1980 à 1982 le nombre des luttes ouvrières, en particulier dans les pays les plus industrialisés, n'a cessé de diminuer de façon générale.
Comment comprendre ce recul au moment même où s'accélère l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme ? Quelles sont les perspectives de la lutte de classe ?
1968-1982, 15 ans de crise économique et de luttes ouvrières
C'est seulement envisagée dans ses dimensions MONDIALE ET HISTORIQUE que la lutte prolétarienne peut être comprise, car elle n'est pas une mosaïque de mouvements nationaux sans passé ni avenir. Pour comprendre le mouvement actuel de la lutte de classe mondiale il. faut d'abord le resituer dans son cadre historique et plus particulièrement dans le mouvement général commencé par la rupture de 1968.
De la compréhension de la dynamique des rapports entre classes dans ces années de crise économique ouverte du capitalisme décadent, on pourra dégager des perspectives pour la lutte de classe.
On peut, dans les grandes lignes, distinguer quatre périodes entre 1968 et 1982 suivant les caractéristiques majeures du rapport de force entre prolétariat et bourgeoisie : ([2] [2])
1968-1974 : développement de la lutte de classe ;
1975-1977 : reflux, contre-offensive de la bourgeoisie ;
1978-1980 : reprise de la lutte ;
1980-1982 : reflux, contre-offensive.
1968-1974 : RUPTURE AVEC UN DEMI-SIECLE DE CONTRE-REVOLUTION TRIOMPHANTE
Le coup de tonnerre des 10 millions de grévistes en France en Mai-Juin 68 ouvrit une période de luttes prolétariennes qui rompait ouvertement avec 50 ans de contre-révolution. Depuis le milieu des années 20, les ouvriers du monde entier avaient vécu, marqués par l'écrasement de la vague révolutionnaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le stalinisme, le fascisme, 1'anti-stalinisme, l'anti-fascisme, l'idéologie des mouvements de libération nationale, la démocratie bourgeoise avaient maintenu les prolétaires dans un état d ' atomisation , de soumission matérielle et idéologique, voire d'embrigadement derrière les drapeaux des différents capitaux nationaux.
Des "penseurs" à la mode, à la veille de 1968, ne théorisaient-ils pas la "disparition de la classe ouvrière" dans "l'embourgeoisement" et la soi-disant "société de consommation"?
La vague de luttes de 1968 à 1974 qui a touché, à des degrés divers, presque tous les pays (développés ou non) a constitué, par elle-même, un éclatant démenti à toutes les théorisations de la "paix sociale éternelle" et, ce ne fut pas là son moindre apport.
De Paris à Cordoba, en Argentine, de Détroit à Gdansk, de Shanghai à Lisbonne, 1968-1974 fut la réponse de la classe ouvrière aux premières secousses de la crise économique mondiale dans laquelle le capitalisme commençait à s'enfoncer depuis l'achèvement, au milieu des années 60, de vingt ans de reconstruction d'après-guerre.
Cette première grande période de lutte posa, dès ses débuts, tous les problèmes auxquels le prolétariat devait se confronter dans les années suivantes : 1'encadrement syndical et des partis bourgeois dits "ouvriers", les illusions dans les possibilités d'une nouvelle prospérité capitaliste, dans le mécanisme de la démocratie bourgeoise, la vision nationaliste de la réalité de la lutte de classe. Bref, les difficultés à développer son autonomie et son auto organisation face aux forces politiques de l'Etat bourgeois.
Presque partout les luttes ouvrières durent s'affronter, souvent violemment, non seulement aux gouvernements locaux, mais aussi et surtout aux forces d'encadrement de la bourgeoisie : syndicats, partis de gauche.
Mais, ces affrontements sont restés généralement dans le cadre des illusions d'une époque où les réalités de la crise économique étaient encore à leurs premiers développements.
Le capitalisme venait de connaître, pendant vingt ans, une période de relative stabilité économique. L'idée qu'un retour à la situation précédente était possible dominait encore la société. Et cela, d'autant plus qu'en 1972-73; le capital occidental, pour sortir de la récession de 70-71, se débarrassa des contraintes des taux de change fixes et de la convertibilité du dollar en or et connut une croissance sans précédent.
Entre 1968 et 1974, le chômage augmente sensiblement dans beaucoup de pays occidentaux, mais le niveau de celui-ci reste encore relativement bas ([3] [3]).L'attaque subie par la classe ouvrière dans cette période se situe surtout au niveau des prix à la consommation ([4] [4])
Devant la montée de la lutte de classe, les forces de gauche de la bourgeoisie ont su, en un premier temps, radicaliser leur langage et réadapter 1eurs structures, afin de pouvoir garder, d'une façon ou d'une autre, le contrôle des 1uttes. L'exemple des syndicats italiens pendant 1'"automne chaud" de 1969 est peut-être un des plus significatifs et spectaculaires: après avoir été violemment contestés par les assemblées d'ouvriers en lutte, ils savent instaurer des "conseils d'usine" formés de délégués de base pour mieux asseoir leur pouvoir dans les usines.
Cela s'avère insuffisant. Devant la nouvelle accentuation de la crise économique en 74-75, la bourgeoisie devra imposer encore de nouveaux sacrifices aux exploités. Se reposant sur les illusions encore for tes quant à la possibilité d'un "retour à la prospérité d'antan" (illusions dont elle est elle-même prisonnière) elle va développer la perspective de "la gauche au pouvoir".
A travers cette première vague de luttes, le prolétariat mondial a affirmé son retour au centre de l'histoire. Mais l'évolution de la situation objective ne permet pas encore à la classe révolutionnaire de posséder la force et l'expérience pour comprendre les perspectives et résoudre les problèmes que pose la lutte.
1975-1978 : CONTRE-OFFENSIVE DE LA BOURGEOISIE, LA GAUCHE AU POUVOIR
La récession de 74-75, que la presse appelait "le choc pétrolier", marque le véritable début des effets réels de la crise. Il se produit un changement profond dans la vie sociale. Les restrictions sur le niveau de vie des travailleurs deviennent de plus en plus sensibles. Le chômage augmente irréversiblement en Europe et, s'il diminue momentanément aux Etats-Unis, il reste toujours à un niveau élevé. En 76, les partis de gauche ont déjà formé des gouvernements aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne. En France, la gauche accroît ses triomphes électoraux et lance la campagne "ne pas faire de grèves pour ne pas effrayer la population et permettre le triomphe de la gauche.
En Italie, après ses victoires électorales retentissantes, le PCI pratique le partage du pouvoir par le "compromis historique" avec le gouvernement démocrate-chrétien.
Le nombre de grèves diminue de façon générale dans la majorité des pays.
La réalité des faits se charge, cependant, de détruire peu à peu les illusions. La crise économique ne cesse de s'approfondir. Les triomphes électoraux des partis de gauche n'y changent rien. Les appels aux sacrifices se multiplient alors que leur efficacité apparaît de moins en moins évidente.
Dès 1978, les signes qui annoncent la fin de cette période de repli se font jour.
1978-1980 : LA DEUXIEME VAGUE DE LUTTES, LA POLOGNE
Au début 1981, nous parlions de cette "deuxième vague de luttes (...) où l'on voit tour à tour les mineurs américains en 78, les ouvriers de la sidérurgie en France début 79, les travailleurs du port de Rotterdam à l'automne 79, les ouvriers de la sidérurgie en Grande-Bretagne début 80, ainsi que les métallurgistes brésiliens durant toute cette période... reprendre le chemin du combat!
C'est à cette deuxième vague de luttes qu'appartient le mouvement présent du prolétariat polonais" ("La dimension internationale des luttes ouvrières en Pologne" (Revue Internationale N°24 ).
Les luttes ouvrières qui précédent celles de Pologne sont moins nombreuses que celles de 68-74. Mais 1orsqu'on les envisage dans leur ensemble, on s'aperçoit qu'elles résument, en un peu plus d'un an, l'essentiel de l'expérience de la première vague de luttes.
En se heurtant aux syndicats pour les déborder, comme les mineurs des USA, en se donnant dans la grève une forme d'auto organisation indépendante .des syndicats, comme les travailleurs du port de Rotterdam, en tentant de porter la lutte vers les centres du pouvoir et de force de la classe, comme les sidérurgistes français et leur "marche sur Paris", en faisant de la solidarité l'axe de leur combat, comme les sidérurgistes britanniques et leurs piquets de grève volants, les ouvriers,1ors de ces batailles,ont repris certains problèmes de la lutte au niveau où les avaient laissés les affrontements de la première vague.
La grève de masse en Pologne apporta dans la pratique d'importants éléments de réponse à ces problèmes. La grève de masse a démontré la capacité du prolétariat à s'unifier, à se battre sans distinction de catégories ou de secteurs de production. Elle a mis en évidence la capacité d'auto organisation par les assemblées et les comités de délégués à une échelle inconnue pendant la première vague. Et surtout, elle a illustré concrètement comment; en s'unifiant par la généralisation et en s'auto organisant, le prolétariat peut parvenir à développer une force et une maîtrise de soi capable d'affronter et de faire reculer les gouvernements les plus totalitaires.
Mais, en développant cette force, en désarçonnant et faisant reculer le gouvernement national, et avec lui le bloc militaire soviétique, le prolétariat s'est trouvé porté à un niveau supérieur d'affrontement avec l'Etat. Jamais, depuis les années 20, la classe ouvrière n'avait imposé un tel rapport de force politique à la bourgeoisie. Les luttes en Pologne ont démontré concrètement qu'à ce degré de confrontation entre les classes, les choses ne se jouent plus au niveau national. La bourgeoisie a affronté les prolétariats polonais avec la contribution de toutes ses forces économiques, mi1itaires et idéologiques dont elle dispose au niveau international. Même s'ils n'en ont pas toujours eu conscience, les ouvriers ont été mis devant la réalité des conséquences de leur propre force : s'ils voulaient pouvoir répondre à la riposte de la bourgeoisie, s'ils voulaient aller plus loin dans leur combat, seul moyen de ne pas reculer, il leur fallait LA GENERALISATION INTERNATIONALE de la lutte prolétarienne.
Cette généralisation était indispensable non seulement pour d'évidentes raisons militaires et économiques, mais d'abord et surtout parce qu'elle conditionnait l'évolution de la conscience même des ouvriers en Pologne. Les ouvriers en Pologne sont restés prisonniers de deux mystifications importantes : le nationalisme et les illusions sur la démocratie bourgeoise (lutté" pour un syndicat légal, etc.). Or, seule la lutte massive des ouvriers des autres pays de l'Est et surtout celle des principaux pays industrialisés d'Occident, pouvait apporter au prolétariat de Pologne, dans les faits, la démonstration pratique:
1°) de la possibilité d'unification internationale du prolétariat et donc de se débarrasser des perspectives nationales et de percevoir le caractère diviseur et anti-prolétarien de l'idéologie nationale,
2°) du caractère illusoire et dictatorial de la "démocratie" bourgeoise, avec ses syndicats et ses Parlements à l'occidentale.
Comme son être matériel, la conscience du prolétariat a une réalité mondiale. Elle ne pouvait se développer indéfiniment en un seul pays. Les ouvriers polonais ne pouvaient que poser objectivement le problème de la généralisation internationale. Seul, le prolétariat des autres pays industrialisés, en particulier en Europe occidentale, pourra y apporter une réponse pratique. Ce fut là le principal enseignement du mouvement prolétarien en Pologne.
1980-1982 : LA NOUVELLE CONTRE-OFFENSIVE DE LA BOURGEOISIE, LA GAUCHE DANS L'OPPOSITION :
RECUL DES LUTTES OUVRIERES
Lorsque explose la grève de masse en Août 80 en Pologne, la bourgeoisie occidentale a déjà entamé une contre-offensive face à la nouvelle montée de la lutte de classe. Elle a commencé à réorganiser la disposition de ses forces politiques. La priorité est donnée à un renforcement de l'appareil d'encadrement du prolétariat sur le terrain même de l'usine et de la rue. Face à l'effritement des illusions, les gouvernements de gauche cèdent la place à des gouvernements de droite au langage "franc", ferme et menaçant...Thatcher et Reagan en deviennent les symboles. Les partis de gauche reprennent leur place dans l'opposition pour assurer leur fonction de contrôle des mouvements prolétariens en se mettant à leur tête et les étouffant dans la logique de la défense de l'intérêt national.
La façon dont la bourgeoisie mondiale a fait face à la lutte des ouvriers en Pologne même, les campagnes qu'elle a développées internationalement pour mieux en cacher le véritable contenu et la profonde portée, illustrent les caractéristiques les plus essentielles de cette contre-offensive.
En Pologne même, ce fut la construction de l'appareil de "Solidarnosc" avec la collaboration, le soutien financier et les conseils expérimentés de tous les syndicats du bloc US, soutenus par leurs gouvernements. Cette gauche dans l'opposition "à la polonaise" sut exploiter le sentiment "anti-russe" de la population pour enfermer les prolétaires dans une vision nationaliste de leur lutte. Elle sut détourner systématiquement les luttes ouvrières contre l'intensification de l'exploitation et de la misère, en combats pour une "Pologne démocratique". Elle sut maintenir l'ordre et saboter ouvertement les grèves au nom des intérêts de l'économie nationale et de la paix sociale'(Bydgoszcz) sans trop perdre de sa crédibilité:
-grâce au développement d'un appareil de base du syndicat, capable de prendre la tête des mouvements qui s'opposaient à la direction syndicale, tout en les maintenant dans le cadre syndicaliste,
-grâce au langage "anti-Solidarnosc" que développa le gouvernement qui fit de ses dirigeants des victimes et des martyrs et redora son blason.
Complémentarité et partage du travail entre gouvernement et opposition pour faire face au prolétariat, complémentarité et partage du travail au sein des forces de gauche entre les directions "modérées" et une base politique et syndicale "radicale" La Pologne fut un laboratoire vivant pour la construction de la contre-offensive de la bourgeoisie.
La façon dont la bourgeoisie affronte les luttes des sidérurgistes belges au début 1982, celles des ouvriers italiens en janvier 1983, constitue presque une caricature schématique de ce qu'elle fit en Pologne: durcissement du gouvernement devenu plus "de droite", radicalisation du langage de la gauche dans l'opposition, utilisation du syndicalisme de "base" ou de "combat" pour mieux contrôler les mouvements qui tendent à mettre en question le carcan syndical.
Sur le plan international, Va campagne organisée par la bourgeoisie occidentale à propos de la Pologne est un exemple typique de la série de campagnes idéologiques orchestrées internationalement et ayant comme objectif conscient le déboussolement, la désorientation des prolétaires. ([5] [5])
Pour dénaturer l'exemple de la réponse des ouvriers polonais à la crise économique mondiale, pour détruire la tendance des ouvriers du monde entier à se reconnaître dans la combativité des prolétaires polonais, la bourgeoisie occidentale, avec la collaboration explicite de celle de l'Est, à coup de "Reagan show" le Pape en tête/développe le thème "La lutte des ouvriers polonais n'a rien à voir avec votre situation ; son objectif c'est vivre comme en Occident . Nous ne nous battons pas pour abolir l'exploitation mais pour avoir un régime comme le votre".
Le coup de force du 13 décembre fut le premier résultat de cette contre-offensive. Les campagnes de déboussolement et l’instauration d'un climat de terreur: El Salvador, la guerre des Malouines, le terrorisme, les massacres du Liban, ont contribué à en étendre les bâti vite prolétarienne.
Cette contre-offensive de la bourgeoisie au début des années 80 n'a pas été seulement idéologique. La répression policière et bureaucratique a connu des développements spectaculaires. Tous les gouvernements ont multiplié les brigades "antiémeutes" et la collaboration internationale des polices face à ceux qui mettent en question "la sécurité de l'Etat".
Mais la pire forme de répression que subissent les ouvriers n'est autre que les effets de la crise économique: les heures de queue devant les magasins et la jungle du marché noir dans les pays de l'Est, la misère du chômage et la baisse des salaires dans les pays occidentaux.
La violente accélération de la crise entre 1980 et 1982 se traduit concrètement par un rapide resserrement de l'étau qui soumet les prolétaires à 1'atomisation et à la concurrence entre eux. La bourgeoisie mondiale a su en tirer momentanément le maximum de profit.
Dans les principaux pays occidentaux, le nombre des grèves diminue fortement à partir de 19807 En 1981, dans des pays aussi importants pour la lutte de classe que les Etats-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France ou l'Italie le nombre des grèves enregistré est le plus bas ou un des plus bas depuis plus de 10 ans.
Comme au milieu des années 70, la bourgeoisie a réussi à dresser un barrage contre la montée de la combativité ouvrière.
Mais les barrages du capital sont faits de matériaux périssables et les flots qu' ils ont pour tâche de contenir puisent leur source dans les plus profondes nécessités historiques de l'humanité.
Les facteurs objectifs et subjectifs sur lesquels a reposé la dernière contre-offensive de la bourgeoisie s'usent d'autant plus vite que la décomposition du système économique s'accélère.
PERSPECTIVES : VERS LA FIN DU REPLI
De façon générale la bourgeoisie -comme toutes les classes exploiteuses dans l'histoire - a assuré son pouvoir:
1°) par la capacité du système économique qu'elle gère à assurer un minimum de moyens de subsistance à 1 a principale ; classe productrice et exploitée
2°) par sa domination idéologique ;
3°) par la répression.
Mais lorsque les rouages économiques se grippent et que 1'obsolescence des rapports de production est démontrée chaque jour par la réalité, ce sont les bases matérielles qui sous-tendent le pouvoir idéologique de la classe dominante qui s'effondrent. Dans ces conditions, 1a répression pour le maintien de 1'"ordre", pour le maintien de la "rentabi1ite", apparaît de plus en plus comme la défense barbare des privilèges d'une minorité.
Telle est la tendance depuis le début de la crise ouverte à la fin des années 60. Elle s'est accélérée avec le début des années 80.
Les conditions du repli de la lutte de classe ne peuvent que s'effriter car la tendance générale n'est pas vers une plus grande union entre bourgeoisie et prolétariat mais au contraire vers l'exacerbation de l'antagonisme entre les deux classes principales de la société.
En 15 ans, les contradictions, les tensions générales que provoque la crise du capitalisme en déclin n'ont cessé de s'exacerber: contradiction entre, d'une part la nécessité et la possibilité du développement des forces productives et, d'autre part, les lois et les institutions sociales dans lesquelles ces forces sont utilisées ; contradiction entre la réalité concrète de décomposition et l'impasse d' une société en ruines d'un côté, et l'idéologie dominante qui chante les louanges des fondements de ce type de société de l'autre; contradiction entre les intérêts de l'immense majorité de la population soumise à une misère croissante et ceux de la minorité qui gère et profite du capital ; contradiction entre la nécessité objective de la révolution communiste mondiale et le renforcement de la répression- capitaliste.
Si, avant 1968;la bourgeoisie pouvait faire croire que le capitalisme était devenu un système éternel, sans crises économiques, si en 1975-78 elle a encore pu accréditer l'idée que la crise était momentanée et qu' elle serait surmontée par des économies de pétrole et les restructurations industrielles nécessaires, si elle a pu développer à la fin des années 70 l'idée qu'en "travaillant plus et gagnant moins" les prolétaires permettraient le recul du chômage, aujourd'hui la réalité rend quotidiennement évident qu'il ne s'agit, dans tout cela, que de mystifications destinées à la sauvegarde du système.
Il en est de même pour des mystifications qui pendant des décennies (et en particulier pendant la crise des années 30) ont pesé sur le prolétariat mondial: la nature "ouvrière" des régimes des pays de l'Est, (la Pologne a joué un rôle décisif dans la destruction de ce mensonge), le caractère "progressiste" des luttes de libération nationale, l'efficacité des mécanismes électoraux et des partis "ouvriers" pour empêcher l'intensification de l'exploitation et de la misère de la vie, le mythe de l'Etat-providence et protecteur.
Cela se traduit dans la réalité par le caractère de plus en plus précaire de l'efficacité des grandes campagnes idéologiques de la bourgeoisie mondiale. Les prolétaires croient de moins en moins dans les valeurs idéologiques qui justifient le système capitaliste.
QU'EN EST-T-IL AU NIVEAU DE LA LUTTE OUVRIERE ELLE-MEME?
Que ce soit l'affaiblissement de la force du prolétariat en Pologne enfermé dans les impasses du nationalisme et des illusions sur la "démocratie occidentale", que ce soit l'isolement de la lutte des sidérurgistes belges au début de 1982 ou l'incapacité à s'unifier des mouvements des prolétaires en Italie au début 1983, la réalité de la lutte de classe montre clairement que la lutte ouvrière dans les années à venir connaîtra deux problèmes essentiels et interdépendants :
1°) la nécessité de généraliser la lutte,
2°) la nécessité de ne pas laisser la conduite du combat aux mains des forces de gauche du capital travaillant dans les rangs ouvriers.
LA GENERALISATION
En Août 80, les ouvriers polonais ont démontré, dans la pratique, deux vérités essentielles pour la lutte ouvrière:
- la classe ouvrière peut étendre sa lutte, par elle-même sans recours à aucun appareil syndical ;
- seule, la force que donne cette extension peut faire reculer la puissance de 1'Etat.
Un an d'isolement international du mouvement en Pologne à3 en outre, démontré que la lutte ouvrière ne peut développer sa pleine puissance qu'en se généralisant par-delà les frontières nationales.
En ce sens, la perspective tracée au début des années 80 par la lutte en Pologne c'est celle de la généralisation au niveau international. Cette perspective dépend fondamentalement de l'action du prolétariat d'Europe occidentale, du fait de son nombre, de sa puissance, de son expérience, et…. de sa vie divisée en une multitude de petites nations. Elle ne s'y concrétise pas du jour au lendemain. Une telle généralisation sera inévitablement précédée de toute une série de luttes à l'échelle locale, voire "nationale", expériences qui seules pourront en démontrer dans la pratique, le caractère vital, indispensable.
Les récentes luttes des ouvriers en Belgique et en Italie ont toutes deux vu se manifester nettement des tendances spontanées à l'extension. Le prolétariat européen se prépare effectivement à suivre le chemin ouvert en Pologne en août 1980. Mais il lui faut certainement encore développer sa propre expérience de lutte pour y parvenir. D'autant plus que sur ce chemin, il trouve et trouvera devant lui le barrage systématique des organisations syndicales et des forces politiques de la gauche de la bourgeoisie.
LA GAUCHE DANS LES RANGS OUVRIERS
Le mouvement en Pologne en 1981, en Belgique en 1982 illustre concrètement comment les forces radicales de la gauche bourgeoise peuvent parvenir à détourner et conduire dans des impasses les poussées ouvrières vers la généralisation.
Au moment de l'établissement de l'état de guerre en Pologne, les conséquences de l'isolement international du mouvement apparurent dans toute leur violence. La nécessité de faire appel aux ouvriers des autres pays apparaissait comme une question cruciale. "Solidarnosc" et ses tendances radicales surent détourner cette nécessité vers des appels...aux gouvernements de la bourgeoisie occidentale (voir les banderoles de décembre 1981 aux portes des chantiers de Szczecin).
En Belgique, lorsque dans les assemblées des sidérurgistes des différentes villes en grève se sont manifestées de plus en plus de critiques aux directions syndicales et des poussées vers une unification directe et l'extension de la lutte, les tendances radicales du syndicat ont su prendre la tête de ces mouvements et les canaliser dans des actions "unifiées" sous le contrôle des centrales syndicales soigneusement isolées de tous les autres secteurs de la classe ouvrière.
Le prolétariat, jusqu'à son émancipation définitive, trouvera devant lui, dans ses rangs, ces habiles forces de la classe dominante. Mais poussé par la nécessité de réagir à l’attaque du système en crise, il apprend et apprendra à les contrer et à les détruire de la même façon qu'il a tout appris : par l’expérience de la lutte.
Il faudra, certainement, encore beaucoup de combats, de défaites partielles, momentanées, pour que la classe ouvrière parvienne à prendre systématiquement ses affaires en main et aller vers la généralisation. C'est un processus qui se déroule à l’échelle mondiale et dans lequel, constamment, les luttes ouvrières, comme dit Marx, "reviennent sur ce qui semble accompli pour le recommencer à nouveau".
VERS LA REPRISE DES LUTTES
Les hésitations, les reculs momentanés sont inévitables dans le développement de la lutte d'une classe exploitée. Ce Qu'il faut comprendre c'est qu'au travers de ses hauts et ses bas, la tendance générale de la lutte ouvrière depuis 15 ans, renforcée avec l'entrée dans les années 80, va dans le sens d'un dégagement de l'idéologie dominante, vers des heurts de plus en plus violents avec les forces de gauche du capital et vers la généralisation des combats.
Le développement de la crise économique est devant nous. Ses effets, l'attaque qu'ils constituent contre la classe ouvrière mondiale, iront s'accentuant, contraignant les prolétaires à hisser leur combat à des niveaux de plus en plus élevés, globaux, généraux.
Le chômage, effet principal de la crise, qui frappe les ouvriers comme une des pires formes de répression (qu'il soit effectif le ou sous forme de menace) peut, momentanément constituer un facteur de frein à la lutte. En mettant les ouvriers en concurrence entre eux pour les postes de travail, il peut rendre plus difficile l'unification du prolétariat. Mais il ne peut l'empêcher. Au contraire la lutte contre les licenciements, contre les conditions de vie des chômeurs constituera une des bases luttes ouvrières à venir. Ce qui en un premier temps peut constituer un frein 'se' transformera en accélérateur contraignant les ouvriers, chômeurs et non chômeurs, à envisager leur lutte de façon toujours plus générale, à assumer toujours plus le contenu politique, social et révolutionnaire de leur combat.
La gravité même de la crise du système, son ampleur poussent les luttes ouvrières à, comme le disait Marx, " reculer constamment à nouveau devant 1 ' immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soi t créée enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles mêmes crient "Hic Rhodus, tic saita."
R. V.
"F.ENGELS DIT QUE LA VICTOIRE DEFINTIVE DU PROLETARIAT SOCIALISTE CONSTITUE UN BOND QUI FAIT PASSER L'HUMANITE DU REGNE DE L'ANIMALITE A CELUI DE LA LIBERTE. MAIS CE "BOND" N'EST PAS ETRANGER AUX LOIS D'AIRAIN DE L'HISTOIRE, IL EST LIE AUX MILLIERS DE MAILLONS DE L'EVOLUTION QUI LE PRECEDENT, EVOLUTION DOULOUREUSE ET ËIEN TROP LENTE. ET CE BOND NE SAURAIT ETRE ACCOMPLI SI, DE L'ENSEMBLE DES PREMISSES MATERIELLES ACCUMULEES PAR L'EVOLUTION, NE JAILLIT PAS L'ETINCELLE DE LA VOLONTE CONSCIENTE DE LA GRANDE MASSE POPULAIRE JAMAIS LA VICTOIRE DU SOCIALISME NE TOMBERA DU CIEL COMME LE FATUM ANTIQUE, CETTE VICTOIRE NE PEUT ETRE REMPORTEE QUE GRACE A UNE LONGUE SERIE D'AFFRONTEMENTS OPPOSANT LES FORCES ANCIENNES AUX NOUVELLES, AFFRONTEMENTS AU COURS DESQUELS LE PROLETARIAT INTERNATIONAL FAIT SON APPRENTISSAGE (...) ET TENTE DE PRENDRE EN MAIN SES PROPRES DESTINEES, DE S'EMPARER DU GOUVERNAIL DE LA VIE SOCIALE. (...)
LA CLASSE OUVRIERE NE DOIT JAMAIS AVOIR PEUR DE REGARDER LA VERITE EN FACE, MEME SI CETTE VERITE CONSTITUE POUR ELLE L'ACCUSATION LA PLUS DURE, CAR SA FAIBLESSE N'EST QU'UN ERRE- MENT ET LA LOI IMPERIEUSE DE L'HISTOIRE LUI REDONNE LA FORCE, LUI GARANTIT SON SUCCES FINAL."(Rosa Luxembourg, "La crise de la social-démocratie")
[1] [6] "Voici Rhodes, c'est ici qu'il faut sauter". Proverbe latin inspiré d'une fable d'Esope qui signifie : c'est le moment de montrer ce dont on est capable.
[2] [7] Il n'est pas toujours aisé dé déterminer de façon précise des périodes dans l'histoire. Il n'y a pas une simultanéité stricte de la crise sociale dans tous les pays. Suivant le développement économique, suivant la situation géographique, suivant les conditions politiques caractérisant telle ou telle zone de la planète, les tendances générales internationales de la lutte de classe s'y manifesteront plus ou moins rapidement avec plus ou moins d'ampleur et d'intensité. En ce sens, dire "Telle année marque la fin de la période de repli de la classe et commence une période de reprise" ne veut pas dire que l'année en question tous les ouvriers du monde ont brisé leur atomisation pour engager le combat. Ce dont il s'agit, c'est de déterminer des points de repère indispensables pour dessiner les tendances générales du mouvement mondial. Par ailleurs, la vie de la lutte de classe dans les pays les plus industrialisés qui concentrent les forces les plus nombreuses et les plus expérimentées du prolétariat et de la bourgeoisie a inévitablement une place prépondérante dans la détermination de telles périodes.
[3] [8] Le taux de chômage moyen des pays industrialisés du bloc occidental tourne autour de 3% à la fin des années 60; (il dépasse aujourd'hui les 10%). En 1974 il n'a augmenté que de 1 ou 2 points. En 1975, année la plus noire de la récession de 74-75 il est autour de 5% en moyenne.
[4] [9] Entre 1968 et 1975 l'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation, passe de 4,2 à 9,1 aux USA, de 5,3 à 11,8 au Japon, de 2,9 à 6% en Allemagne, de 4,1 à 11,3% dans l'ensemble de l'OCDE.
[5] [10] Il nous a souvent été reproche par certains de nos critiques d'avoir une vision machiavéliste de l'histoire lorsque nous parlons de telles campagnes. Nous avons longuement répondu à cette question dans les articles "Machiavélisme, conscience et unité de la bourgeoisie" dans le n°31 (4e trimestre 82) de cette revue. Pour ceux qui ont la mémoire courte rappelons que de telles campagnes n'ont rien de nouveau. Dès la fin de la Seconde guerre mondiale, dans la période de la "guerre froide", les deux nouvelles puissances militaires qui se partageaient le monde devaient se livrer à de gigantesques campagnes idéologiques internationales au sein de leur bloc pour incruster dans le cerveau des populations les nouvelles alliances impérialistes: les ennemis d'hier étaient devenus alliés, et les alliés ennemis. 40 ans après il serait candide de croire que la bourgeoisie serait devenue, aujourd'hui, moins manipulatrice.
Géographique:
- Pologne [11]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [12]
Où en est la crise?
- 2429 reads
LE CHOMAGE DANS LES ANNEES 30
Après une progression du chômage foudroyante qui s'est traduite, notamment aux Etats-Unis, par une situation sociale explosive, la mise en oeuvre des politiques de relance par l'Etat a permis de faire régresser le nombre des sans-emploi jusqu'à l'ouverture de la guerre. De plus la mise en place de systèmes d'allocation pour les chômeurs et d'aides sociales diverses constitue pour un prolétariat encore marqué par l'écrasement sanglant de la révolution, le piège qui va permettre à la bourgeoisie de désamorcer la bombe politique que constitue un fort taux de chômage au coeur du capitalisme industriel.
Source: A.Madisson, « Economic Grouth ».
LE POIDS DE L'ETAT DANS L'ECONOMIE DES ANNEES 30
L'Etat prend une part de plus en plus importante dans l'économie nationale que ce soit par l'économie de guerre comme en Allemagne, le New Deal aux Etats-Unis, ou les nationalisations du Front Populaire en France. L'Etat s'endette, cela permet de retarder les effets de la crise qui rejaillit. Ce répit permet une politique d'embrigadement du prolétariat dans la guerre derrière les illusions de l'Etat social: national-socialiste, stalinien et derrière le Welfare-State démocratique.
LE CHOMAGE AUJOURD'HUI
La progression du chômage suit une courbe différente aujourd'hui de celle de la grande crise des années 30. La progression est lente mais croît régulièrement durant toutes les années 70. Le début des années 80 montre une flambée de la progression. Plus de 11 millions de chômeurs aux USA, plus de 3 millions en GB, plus de 2,5 millions en RFA. Pour l'ensemble des 24 pays de l'OCDE c'est un total de 32 millions de chômeurs (comme si plus personne ne travaillait en RFA, en Belgique et aux Pays-Bas). De ce point de vue la situation est inverse de celle des années 30. La crise se développe sur l'usure (qui se traduit par une inefficacité croissante) des mesures qui avaient permis à la bourgeoisie de faire face à la crise de 29. Le chômage se développe inexorablement et de plus en plus vite, tandis que les aides sociales, elles, diminuent. La situation sociale va devenir de plus en plus explosive. L'emploi ne va pas se développer alors que les investissements chutent.
LA CHUTE DES INVESTISSEMENTS
L'impossibilité de vendre sur un marché sursaturé les marchandises produites, le sous-emploi du potentiel productif qui en résulte, poussent la bourgeoisie à réduire ses investissements industriels et à destiner une part croissante de ses capitaux à la spéculation (monnaies, or, matières premières). Elle est conduite à concentrer l'essentiel de ses investissements dans la recherche de la compétitivité par une mécanisation, une automation intensives. Ce qui, de fait, supprime beaucoup plus d'emplois qu'il n'en est créé . Même une hypothétique relance -dont on parle tant- ne ferait qu'accélérer cette tendance. Le chômage, dans ces conditions, ne peut que s'accroître.
Source : OCDE, "Perspectives Economiques", déc.82
L’ENDETTEMENT MONDIAL
La politique de relance se fonde sur l'endettement de l'Etat. Au début des années 30, cette politique était nouvelle : l'Etat n'était pas encore surendetté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les USA, qui ont été le moteur des relances successives dans les années 70 se sont surendettés à l'extrême : la dette publique et privée avoisine un total de 5000 milliards de $. Pour rembourser cette dette, il faudrait que les travailleurs américains travaillent de 1,5 à 2 ans sans être payés.
La politique d'austérité qui visait à résorber cet endettement se heurte non seulement à la difficulté d'attaquer le niveau de vie de la classe ouvrière toujours combative, mais aussi à l'instabilité du système monétaire international. Le colossal déficit budgétaire américain (plus de 100 milliards de $ en 1982 et on parle pour l'année qui vient d'un déficit de 200 milliards de $), la nécessité de venir au secours du tiers-monde afin d'éviter un écroulement financier, impose de faire marcher la pompe à finances du FMI (qui a augmenté récemment ses avoirs de 74%). La bourgeoisie doit faire marcher la planche à billets : la potion Reagan-Tchatcher est impuissante à faire face à l'endettement et au danger d'une relance de l'inflation qui menace. La relance ne peut être qu'une relance de l'inflation.
Source : OCDE, id.
UNE INFLATION TOUJOURS PRESENTE
Pour justifier la politique de récession menée ces dernières années, la bourgeoisie se targue d'avoir jugulé l'inflation. En fait, l'inflation sévit toujours et surtout, les pressions inflationnistes augmentent malgré la récession.
La politique de relance relance l'inflation, sans empêcher la tendance à la récession de s'imposer ; la politique de récession plonge l'économie dans le marasme sans enrayer les tendances inflationnistes.
La baisse de l'inflation de ces dernières années est momentanée ; les années qui viennent vont voir se développer une inflation croissante parallèlement à un chômage croissant.
La classe ouvrière n'a pas d'illusions à se faire : toutes les politiques économiques de la bourgeoisie sont impuissantes à faire face à la crise.
Source : OCDE, id.
Récent et en cours:
- Crise économique [13]
Cent ans après la mort de Marx : l'avenir appartient au marxisme
- 3099 reads
Karl Marx est mort le 14 mars 1883. Il y a donc un siècle que s'est tu celui que le mouvement ouvrier considère comme son théoricien le plus important.
Cet anniversaires la bourgeoisie -cette classe que Marx a combattue sans relâche toute sa vie et qui le lui a bien rendu- s'apprête à le célébrer à sa façon en déversant de nouveaux tombereaux de mensonges sur Marx et son oeuvre.
Suivant sa coloration, les intérêts plus particuliers qu'il a charge de défendre ou sa place spécifique dans l'appareil de mystification, chaque secteur bourgeois y va de sa petite spécialité.
Ceux pour qui Marx était "un être malfaisant", une sorte "d'incarnation du mal, une créature du démon", ont pratiquement disparu. De toute façon ils sont les moins dangereux aujourd'hui.
Par contre, il en reste bon nombre pour qui Marx, "au demeurant un homme très intelligent et cultivé, s'est complètement trompé" ; une variante de ce mensonge consistant à affirmer que : "Si l'analyse de Marx était valable au I9ème siècle, elle est aujourd'hui complètement dépassée".
Cependant, les plus dangereux ne sont pas ceux qui rejettent explicitement les apports de Marx. Ce sont ceux qui s'en réclament, qu'ils appartiennent à la branche social-démocrate, à la branche stalinienne, à la branche trotskyste ou à ce qu'on pourrait appeler la branche "universitaire" les "marxologues".
A l'occasion du centième anniversaire de la mort de Marx, on verra tout ce beau monde s'agiter fébrilement, faire du bruit, parler avec autorité, envahir les colonnes des journaux et les écrans de télévision. Il revient donc aux révolutionnaires, et c'est là le véritable hommage qu'ils puissent rendre à Marx et à son oeuvre, de réfuter ces mensonges abondamment diffusés, de balayer les dithyrambes intéressés pour rétablir la simple vérité des faits.
MARX DEPASSE ?
Marx découvrit le profond secret du mode de production capitaliste : le secret de la plus-value appropriée par les capitalistes grâce au travail non payé des prolétaires. Il montra qu'au lieu de s'enrichir par son travail, le prolétaire s'y appauvrissait, que les crises devenaient de plus en plus violentes parce que le besoin de débouchés s'accroissait tandis que le marché mondial se rétrécissait davantage. Il s'attacha à montrer que le capitalisme, en vertu de ses propres lois, court à sa perte et crée avec une nécessité d'airain les conditions de l'instauration du communisme. Etant venu au monde couvert de sang et de boue, s'étant nourri en cannibale de la force de travail des prolétaires, le capitalisme quitterait la scène dans un cataclysme.
C'est pour cette raison que, depuis un siècle, la bourgeoisie s'est employée à combattre les idées de Marx. Des légions d'idéologues ont fait tentative sur tentative pour anéantir sa pensée. Des professeurs, des savants, des prédicateurs ont fait de la "réfutation" de Marx leur métier. Par ses écoles, ses universités, la bourgeoisie a dirigé un feu nourri contre Marx. A l'intérieur même du mouvement ouvrier, le révisionnisme se dressa contre les principes fondamentaux du marxisme au nom d'une "adaptation" de celui-ci aux nouvelles réalités de l'époque (fin du 19ème siècle). Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que Bernstein, le théoricien du révisionnisme, s'était proposé d'attaquer le marxisme sur deux points fondamentaux :
- le capitalisme aurait découvert le moyen de surmonter ses crises économiques catastrophiques;
- l'exploitation de la classe ouvrière pourrait s'atténuer progressivement jusqu'à disparaître.
Ce sont ces deux idées essentielles que la bourgeoisie a agité frénétiquement chaque fois que la situation économique du capitalisme a semblé s'améliorer permettant la distribution de quelques miettes à la classe ouvrière. Ce fut notamment le cas dans la période de reconstruction qui a suivi la seconde guerre mondiale où l'on a pu voir les économistes et les politiciens prédire la fin des crises. Ainsi, le prix Nobel d'économie Samuelson s'exclamait dans son livre "Economies" (p.266) : "tout se passe aujourd'hui comme si la probabilité d'une grande crise- d'une dépression profonde, aiguë et durable comme il a pu s'en produire en 1930, 1870 et 1890 se trouvait réduite à zéro".
De son côté, le président Nixon n'avait pas peur de déclarer, le jour de son "inauguration" (janvier 1969) : " Nous avons enfin appris à gérer une économie moderne de façon à assurer son expansion continue".
Ainsi, jusqu'au début des années 70, c'est avec beaucoup d'autorité que se sont exprimés ceux pour qui "Marx est dépassé" ([1] [14]).
Depuis, les clameurs se sont tues. Inexorablement la crise se déploie. Toutes les potions magiques préparées par les prix Nobel des différentes écoles ont échoué et ont même aggravé le mal. Pour le capitalisme l'heure est aux records : record d'endettement, du nombre de faillites, de la sous-utilisation des capacités productives, du chômage. Le spectre de la grande crise de 29 revient hanter la bourgeoisie et ses professeurs appointés. Leur optimisme béat a fait place à un noir pessimisme et au désarroi. Il y a déjà quelques années, le prix Nobel Samuel son constatait avec détresse "la crise de la science économique" qui se révélait incapable d'apporter des solutions à la crise. Il y a un an et demi, le prix Nobel Friedmann avouait "qu'il n'y comprenait plus rien". Plus récemment, le prix Nobel Von Hayek constatait que le "krach est inévitable" et qu'il n'y a rien à faire".
Dans la postface de la 2ème édition allemande du Capital, Marx constatait que la "crise générale, par l'universalité de son champ d'action et l'intensité de ses effets, allait faire entrer la dialectique dans la tête même aux tripoteurs qui avaient poussé comme champignons" à l'occasion d'une phase de prospérité du capitalisme. Ces spécialistes du tripotage que sont les économistes en font une nouvelle fois l'expérience : la crise qui se déchaîne aujourd'hui commence à les rendre intelligents. Ils commencent à comprendre, à leur grand effroi, que leur "science " est impuissante, qu'il n'y a "rien à faire" pour sortir leur cher capitalisme du gouffre.
Non seulement Marx n'est pas "dépassé" aujourd'hui, mais il est nécessaire d'affirmer bien net que jamais ses analyses n'ont été autant à l'ordre du jour.
Toute l'histoire du 20ème siècle est une illustration de la validité du marxisme. Les deux guerres mondiales, la crise des années 30 étaient la preuve du caractère insurmontable des contradictions qui assaillent le mode de production capitaliste. Le surgissement révolutionnaire des années 1917-23, malgré sa défaite, confirmait que le prolétariat est bien la seule classe révolutionnaire d'aujourd'hui, la seule force de la société capable de renverser le capitalisme, d'être le "fossoyeur" (suivant l'expression du Manifeste Communiste) de ce système moribond.
La crise aiguë du capitalisme qui se développe aujourd'hui balaye les illusions semées par la reconstruction du 2ème après-guerre. Illusions sur un capitalisme définitivement prospère, illusions sur la "coexistence pacifique" entre grands blocs impérialistes, illusions sur "l'embourgeoisement" du prolétariat et la "fin de la lutte de classes" comme Ta montré, dès mai 68, le ressurgissement historique de la classe ouvrière qui n'a fait que se confirmer depuis, notamment par les combats en Pologne en 1980. Une nouvelle fois se découvre dans toute sa clarté l'alternative indiquée par Marx et Engels : "Socialisme ou chute dans la barbarie".
Ainsi, le premier hommage qui soit rendu à la pensée de Marx au moment du centième anniversaire de sa mort nous vient des faits eux-mêmes : de la crise, de l'aggravation inéluctable des convulsions du capitalisme, du resurgissement historique de la lutte de classe. Quel meilleur hommage à celui qui écrivait en 1844 :
"La question de savoir si la pensée humaine peut prétendre à la vérité objective n'est pas une question de théorie mais une question pratique. C'est dans la pratique que l'homme doit prouver la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance, la matérialité de sa pensée".
(Thèses sur Feuerbach)
L'UTILISATION DE MARX CONTRE LA CLASSE OUVRIERE
Les grands révolutionnaires ont toujours été persécutés durant leur vie: leur doctrine a toujours été en butte à la haine ''la plus féroce, aux campagnes de mensonge et de diffamation les plus ineptes de la part des classes oppresseuses. Après leur mort on tente de les convertir en icônes inoffensives, de les canoniser pour ainsi dire, d'entourer leur nom d'une auréole de gloire pour la consolation des classes opprimées et pour leur duperie, en même temps qu'on émascule la substance de-leur ''enseignement révolutionnaire, qu'on en émousse le tranchant, qu'on l'avilit".
Lénine "L'Etat et la Révolution"
Ces mots de Lénine écrits en 1917 contre la Social-Démocratie et notamment son "Pape", Karl Kautsky, se sont illustrés par la suite à une échelle que leur auteur était loin de soupçonner. Lui-même fut transformé après sa mort "en icône inoffensive" et cela au sens propre puisque sa momie est encore aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage.
La Social-Démocratie dégénérescente, celle qui en 1914 allait passer ouvertement aux côtés de la bourgeoisie, avait déjà beaucoup fait pour "émasculer" la pensée de Marx, pour la vider de tout contenu révolutionnaire. Si la première offensive contre le marxisme, celle de Bernstein à la fin du 19ème siècle, se proposait de "réviser" cette théorie, celle de Kautsky autour de 1910 se fit au nom de "l'orthodoxie marxiste". Par un choix judicieux de citations de Marx et Engels, on leur faisait dire l'exact contraire de leur pensée véritable. Il en fut ainsi notamment de la question de l'Etat bourgeois. Alors que depuis la Commune de Paris la nécessité de détruire celui-ci avait été affirmée clairement par Marx, Kautsky fit silence sur cette affirmation pour partir à la recherche de formulations qui pourraient accréditer l'idée opposée. Et comme les révolutionnaires, y compris les plus grands, ne sont pas à l'abri des ambiguïtés ou même des erreurs, Kautsky parvint à ses fins au grand bénéfice des pratiques réformistes de la Social-Démocratie, c'est-à-dire au grand détriment du prolétariat et de sa lutte.
Mais l'ignominie Social-Démocrate ne s'est pas arrêtée à une falsification du marxisme. Cette falsification, après avoir préparé la démobilisation totale du prolétariat face à la menace de guerre annonçait une trahison complète, un passage avec armes et bagages dans le camp bourgeois. C'est au nom du "marxisme" qu'elle sauta les pieds joints dans le sang et la boue de la première guerre impérialiste, qu'elle aida la bourgeoisie mondiale à colmater la brèche ouverte dans l'édifice croulant du capitalisme par la révolution de 1917, qu'elle a froidement fait assassiner Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ainsi que des milliers de spartakistes en 1919. En usurpant le nom de Marx, la Social-Démocratie a obtenu des fauteuils ministériels dans les gouvernements bourgeois, des postes de préfet de police, de gouverneur aux colonies. Au nom de Marx elle s'est faite le bourreau du prolétariat européen et des populations coloniales.
Cependant, aussi loin qu'ait pu aller la Social-Démocratie dans l'abjection elle fut dépassée sur tous les plans par le stalinisme.
Les falsifications sociales-démocrates du marxisme n'étaient encore rien à côté de celles que les staliniens devaient lui faire subir. Jamais idéologues de la bourgeoisie n'avaient fait preuve d'un tel cynisme pour déformer la moindre phrase et lui faire dire l'exact contraire de son sens véritable.
Alors que l'internationalisme, le rejet de tout chauvinisme, avait été la pierre angulaire tant de la révolution d'octobre 17 que de la fondation de l'Internationale Communiste, il revint à Staline et à ses complices d'inventer la théorie monstrueuse de la "construction du socialisme dans un seul pays". C'est au nom d'Engels et de Marx qui écrivait dès 1847 :
"La révolution communiste... ne sera pas une révolution purement nationales elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés….Elle est une révolution universelle"
(Principes du communisme) "Les prolétaires n'ont pas de patrie (Manifeste Communiste) ; c'est en leur nom que le parti, bolchevik dégénéré et les autres partis dits "communistes" appelèrent à la "construction du socialisme en URSS", à la défense de la "patrie socialiste" et plus tard à la défense de l'intérêt national, de la patrie, du drapeau dans leur pays respectif, A côté de l'hystérie chauvine des partis staliniens avant, pendant et au lendemain de la 2ème boucherie impérialiste, à côté des "A chacun son boche" et "Vive la France éternelle" (l'Humanité en 1944), le "jusqu'au-boutisme" des socialistes de 1914 en vint à faire pâle figure.([2] [15])
Ennemi de l'Etat (et de façon bien plus conséquente que l'anarchisme), ennemi de la religion, le marxisme est devenu entre les mains des staliniens une religion d'Etat, une religion de l'Etat. Alors qu'il jugeait incompatibles l'existence de l'Etat et celle de la liberté, qu'il considérait comme indissolublement liés l'Etat et l'esclavage, Marx est utilisé comme knout idéologique des pouvoirs en place en URSS et ses satellites, il est devenu le pilier porteur de l'appareil de répression policier. Alors qu'il entra dans la vie politique en luttant centre la religion considérée par lui comme "l'opium du peuple", Marx est récité tel un catéchisme par des centaines de millions d'éco1iers.
Alors que Marx voyait dans la dictature du prolétariat la condition de l'émancipation des exploités et de toute la société, c'est au nom de cette "dictature du prolétariat" que la bourgeoisie règne par la terreur la plus brutale sur des centaines de millions de prolétaires.
Après la vague révolutionnaire du 1er après-guerre, la classe ouvrière a subi la plus terrible contre-révolution de son histoire. Le principal fer de lance de cette contre-révolution, ce fut la "patrie socialiste" et les partis qui s'en réclamaient. Et c'est au nom de Marx et de la révolution communiste pour laquelle il avait lutté toute sa vie qu'a été menée cette contre-révolution avec ses dizaines de millions de cadavres des camps staliniens et du second holocauste impérialiste. Toutes les ignominies dans lesquelles s'était vautrée la Social-Démocratie, le stalinisme les a renouvelées, au décuple. ([3] [16])
MARX SAVANT OU MILITANT ?
La bourgeoisie n'en a pas eu assez de transformer Marx et le marxisme en symboles de la contre-révolution. Pour parachever son oeuvre, il lui fallait en faire également des disciplines universitaires, des sujets de thèse en philosophie, en sociologie, en économie. A l'occasion du centième anniversaire de la mort de Marx, à côté des socialistes et des staliniens, on verra donc s'agiter les "marxologues" (qui sont aussi souvent socialistes ou staliniens d'ailleurs). Quelle sinistre ironie : Marx qui avait refusé de faire carrière à l'université pour pouvoir se consacrer à la lutte révolutionnaire est mis au rang des philosophes, économistes et autres idéologues de la bourgeoisie.
C'est juste que dans beaucoup de domaines de la pensée, il y a un "avant" et un "après" Marx. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'économie : après l'énorme contribution de Marx à l'intelligence des lois économiques de la société, cette discipline fut complètement transformée. Mais on ne peut y voir un phénomène identique à celui de la découverte d'une grande théorie en physique par exemple. Dans ce dernier cas, la découverte est le point de départ de tout un progrès dans la connaissance (ainsi "l’après" Einstein constitue un approfondissement considérable dans la lecture des lois de l'univers). Par contre, les découvertes de Marx en économie n'inaugurent pas, pour les pontifes économistes de la bourgeoisie, des progrès dans cette discipline mais au contraire une énorme régression. A cela, il existe une raison très simple. Les économistes qui ont précédé Marx étaient les représentants intellectuels d'une classe qui portait avec elle le progrès historique, d'une classe révolutionnaire dans la société féodale : la bourgeoisie. Les Smith et les Ricardo, malgré leurs insuffisances, étaient capables de faire avancer la connaissance de la société parce qu'ils étaient les défenseurs d'un mode de production -le capitalisme- qui, à leur époque, constituait une étape progressive dans l'évolution de cette société. Face à l'obscurantisme propre à la société féodale, ils avaient besoin de déployer le maximum de rigueur scientifique que leur permettait leur époque.
Marx salue et utilise les travaux des économistes classiques. Cependant son objectif est complètement différent du leur. S'il étudie l'économie capitaliste ce n'est nullement pour tenter d'améliorer son fonctionnement mais pour la combattre et préparer son renversement. C'est pour cela qu'il n'écrit pas une "Economie politique" mais une "Critique de l'Economie Politique". Et c'est justement parce qu'il se situe de ce point de vue dans l'étude de la société bourgeoise, du point de vue de son renversement révolutionnaire, qu'il est capable d'en comprendre aussi bien les lois. Seule une classe qui n'a aucun intérêt à la préservation du capitalisme, le prolétariat, pouvait mettre à nu ses contradictions mortelles. Si Marx a fait faire un tel progrès à la connaissance de l'économie capitaliste, c'est avant tout parce qu'il était un combattant de la révolution prolétarienne.
Après Marx, tout nouveau progrès dans la connaissance de l'économie capitaliste ne pouvait se faire qu'à partir de ses découvertes et donc en partant du même point de vue de classe. Par contre, l'économie politique bourgeoise qui, par essence, se refusait un tel peint de vue, ne pouvait plus être que de l'apologétique, une discipline destinée à justifier par n'importe quel argument la conservation du capitalisme et incapable de ce fait de comprendre ses lois véritables. C'est pour cette raison que les économistes, même les plus huppés, font figure aujourd'hui de crétins.
Le marxisme est la théorie du prolétariat, il ne peut être une discipline universitaire. Seul un militant révolutionnaire peut être marxiste. Cette unité entre la pensée et l'action est justement un des fondements du marxisme. Elle s'exprime avec clarté dès 1844 dans les thèses sur Feuerbach et notamment dans la dernière :
"Jusqu'ici les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières; il s'agit maintenant de le transformer". Certains ont voulu faire de Marx un pur savant enfermé avec ses livres et coupé du monde. Rien n'est plus étranger â la vérité. Lorsqu'un jour ses filles lui font subir un questionnaire (publié par Riazanov sous le nom de "Confession") et lui demandent quelle est son idée du bonheur, il répond : "la lutte". Et c'est bien la lutte qui est au centre de sa vie comme elle est au centre de la vie de tout militant révolutionnaire.
Dès 1842, alors qu'il n'a pas encore adhéré au communisme, il commence le combat politique contre l'absolutisme prussien à la rédaction puis à la tête de la "Gazette Rhénane". Par la suite, c'est un lutteur infatigable que les différentes autorités européennes expulsent d'un pays à l'autre des années durant jusqu'au moment (août 49) où il viendra se fixer définitivement à Londres. Entre temps, Marx a pris part directement aux combats de la vague révolutionnaire qui a secoué toute l'Europe en 1848-49. A ces combats il a participé avec sa plume à la tête de la "Nouvelle Gazette Rhénane", quotidien publié à Cologne entre juin 48 et mai 49 et dans lequel il avait investi toutes ses économies personnelles. Mais sa contribution la plus importante à la lutte du prolétariat, c'est au sein de la Ligue des Communistes qu’il l’a donnée. Car c'est une constante dans la démarche de Marx : contrairement à certains pseudo-marxistes d'aujourd'hui, il considère l'organisation des révolutionnaires comme un instrument essentiel de la lutte du prolétariat. Ainsi, le texte le plus célèbre et le plus important du mouvement ouvrier, le "Manifeste Communiste" rédigé par Marx et Engels en 1847, s'intitulait en fait "Manifeste du Parti Communiste" et constituait le programme de la Ligue des Communistes à laquelle avaient adhéré les deux amis quelques mois auparavant après "que fut éliminé des Statuts tout ce qui favorisait la superstition autoritaire" (Marx),
De même qu'il avait joué un rôle majeur dans le développement de la Ligue des Communistes, Marx prit une part prépondérante dans la fondation et la vie de l’A.I.T, c'est-à-dire la première grande organisation mondiale du prolétariat. C'est à lui que nous devons l'Adresse inaugurale et les statuts de TAIT ainsi que la plupart des textes fondamentaux de celle-ci, notamment l'Adresse sur la guerre civile en France écrite pendant la Commune de Paris. Mais sa contribution à la vie de l’AIT ne s'est pas limitée à cela. En fait, entre 1864 et 1872, il exerça une activité quotidienne et infatigable au sein du Conseil Général de l'Internationale dont il était le véritable animateur sans pour cela d'ailleurs en tirer une gloire quelconque. Sa participation à la vie de l’AIT lui prit des quantités énormes de temps et d'énergie qu'il ne put consacrer à l'achèvement de son travail théorique, Le Capital, dont le Livre I fut publié en 1867 et dont les autres livres ne furent publiés qu'après sa mort par Engels. Mais c'était un choix délibéré de sa part. Il considérait son activité militante au sein de l’AIT comme fondamentale parce que c'était T organisation vivante de la classe ouvrière mondiale, de cette classe qui en s'émancipant elle-même devait émanciper l'humanité. Comme Ta écrit Engels : "La vie de Marx sans l'Internationale aurait été comme une chevalière à laquelle il manquerait le diamant".
Par la profondeur de sa pensée et la rigueur de son raisonnement, par l'étendue de sa culture et sa quête infatigable de nouvelles connaissances, Marx ressemble incontestablement à ceux qu'on nomme les "savants". Mais ses découvertes ne furent jamais pour lui l'occasion de bénéficier ni d'honneurs et titres officiels, ni d'avantages matériels. Son engagement au côté de la classe ouvrière, et qui motivait l'énergie avec laquelle il mena son travail théorique, lui valut au contraire la haine et les attaques permanentes de la "bonne société" de son temps. Il lui valut également de se débattre la plus grande partie de sa vie contre une extrême misère matérielle. Comme l'écrivait son biographe Franz Mehring :
"Non seulement dans la pauvreté de son train de vie mais dans l'insécurité totale de toute son existence, Marx a partagé le sort du prolétariat moderne". Mais, à aucun moment, l'adversité de même que les plus cruelles défaites enregistrées par le prolétariat ne put le détourner de son combat.
Bien au contraire. Comme il l'écrivait-lui même à Johann Phi 1ipp Becker :
"...toutes les natures vraiment bien trempées une fois qu'elles se sont engagées sur la voie révolutionnaire, puisent continuellement de nouvelles forces dans la défaite, et deviennent de plus en plus résolues à mesure que le fleuve de l'histoire les emporte plus loin".
ETRE MARXISTE AUJOURD'HUI
Dans l'histoire de la pensée humaine, il n'y a pas de maître qui n'ait été involontairement trahi par l'un ou l'autre de ses disciples. Marx n'a pas échappé au sort commun qui,, de son vivant même, vit sa méthode d'analyse du réel se transformer en facile passe-partout. Par avance, il avait décliné toute responsabilité pour l'usage édulcoré qu'en faisaient certains sociaux-démocrates. A la place d'une scolastique morte, il entendait que ceux-ci étudient une société en constante évolution à l’aide d'une méthode et non qu'ils utilisent à tort et à travers chacune de ses paroles comme une loi invariante.
Chercher chez Marx des solutions toutes faites à transplanter artificiellement d'une époque révolue à une époque nouvelle, c'est figer une pensée toujours en éveil et aiguillonnée par le souci de rester une arme critique en une rêche cristallisation. Ainsi, plutôt que d'accepter sans examen tout ce qui vient de Marx, le marxiste d'aujourd'hui doit déterminer exactement ce qui continue à servir la lutte de classe et ce qui a cessé d'avoir cette fonction. Une série de lettres t d'Engels à Sorge (1886-1894) invite à se préserver de la bigoterie car, d'après les propres termes du co-auteur du "Manifeste Communiste" et de "L'Idéologie Allemande", Marx ne prétendit jamais construire une théorie rigide, une orthodoxie. Dans le rejet d'un doctrinarisme dit "invariant", il y a, de notre part, le rejet d'un contresens absolu : une théorie vraie de toute éternité, Verbe qui engendre l'action et qui n'attend plus que des catéchumènes pour devenir Action.
Cette "invariance" ne se trouve nulle part dans l'oeuvre de Marx car elle est incapable de distinguer le transitoire du permanent*. Ne correspondant plus aux situations nouvelles et multiformes elle est disqualifiée comme méthode d'interprétation des faits. Sa vérité est trompeuse, malgré les rodomontades qui l'accompagnent.
"De telles idées n'ont d'intérêt que pour "une classe rassasiée qui se sent à son aise "et se voit confirmée dans la situation pré-"sente. Elles ne valent rien pour une classe "qui lutte et s'efforce de progresser et que "la situation atteinte laisse nécessairement "insatisfaite". Korsch "Au coeur de la conception matérialiste".
Etre marxiste aujourd'hui ce n'est donc pas se réclamer à la lettre de chacun des écrits de Marx. Cela poserait d'ailleurs de sérieux problèmes dans la mesure où Ton trouve dans l'oeuvre de
Marx nombre de passages qui se contredisent. Ce n'est nullement d'ailleurs la preuve d'un manque de cohérence dans sa pensée : même ses adversaires ont reconnu au contraire l'extraordinaire cohérence de sa démarche et de son oeuvre. C'est en réalité la marque du fait que sa pensée était vivante, qu'elle était constamment en éveil et à l'écouta du réel et de l'expérience historique. A l'image des "révolutions prolétariennes (qui).. "se critiquent elles-mêmes constamment, reviennent sur ce qui semble déjà être accompli pour le recommencer à nouveau, raillent "impitoyablement les hésitations et les faiblesses. .. de leurs premières tentatives". (K. Marx le 18 Brumaire), Marx n'a jamais hésité à remettre en question ses analyses antérieures. Ainsi, dans la préface à l'édition allemande du Manifeste Communiste de 1872, il reconnaît qu' "il ne faut pas attribuer trop d'importance "aux mesures révolutionnaires énumérées à la "fin du chapitre II. Ce passage serait, à "bien des égards, rédigé tout autrement aujourd'hui.. .La Commune, notamment, a démontré que la classe ouvrière ne peut pas se "contenter de prendre possession telle quelle "de la machine d'Etat et de la faire fonctionner pour ses propres fins. " Cette démarche est celle des véritables marxistes...C'est celle de Lénine qui en 1917 combat les mencheviks qui s'appuyaient sur la lettre de Marx pour soutenir la bourgeoisie et s'opposer à la révolution prolétarienne en Russie. C'est celle de Rosa Luxemburg qui, en 1906, se heurte aux bonzes syndicaux qui condamnaient la grève de masse en se basant sur un texte de Engels de 1873 écrit contre les anarchistes et leur mythe de "la grève générale". Sa défense de la grève de masse comme arme essentielle de la lutte prolétarienne dans la nouvelle période c'est justement au nom du marxisme qu'elle la conduit :
"Si donc la Révolution russe rend indispensable une révision fondamentale de l'ancien point de vue marxiste à l'égard de la grève de masse, ce n'en sont pas moins les méthodes et les points de vue généraux du marxisme qui, sous une nouvelle forme, en sortent vainqueurs. .." ( Grève de masse, Parti,Syndicats). Etre marxiste aujourd'hui c'est utiliser "les méthodes et les points de vue généraux du marxisme" dans la définition des tâches fixées au prolétariat par la nouvelle période ouverte dans la v vie du capitalisme avec la première guerre mondiale : la période de décadence de ce mode de production.
C'est en particulier dénoncer tout syndicalisme avec la même démarche qui conduisait Marx et l'A.I.T. à encourager la syndicalisation des ouvriers. C'est combattre toute participation au Parlement et aux élections avec le même point de vue qui animait le combat de Marx et Engels contre les anarchistes et leur abstentionnisme. C'est refuser tout soutien aux prétendues luttes de "libération nationale" d'aujourd'hui en employant la même méthode que la Ligue des Communistes et l'A.I.T. faisaient leur pour comprendre la nécessité d'appuyer certaines luttes nationales de leur temps.
C'est rejeter la conception du Parti de masses pour la révolution future pour les mêmes raisons fondamentales qui faisaient de la première et la deuxième Internationales des organisations de masse.
Etre marxiste aujourd'hui, c'est tirer les enseignements de toute l'expérience du mouvement ouvrier, des apports successifs de la Ligue des Communistes, de la 1ère, de la 2ème et de la 3ème Internationales et des fractions de gauche qui se sont dégagées de cette dernière lors de sa dégénérescence, afin d'en féconder les combats prolétariens que la crise du capitalisme a fait surgir à partir de 1968, et les armer pour le renversement du capitalisme.
RC/FM
"LE MARXISME N'EST PAS UNE CHAPELLE OU L'ON SE DELIVRE DES BREVETS D1 "EXPERTISE" ET DEVANT LAQUELLE LA MASSE DES CROYANTS DOIT MANIFESTER SA CONFIANCE AVEUGLE. LE MARXISME EST UNE CONCEPTION REVOLUTIONNAIRE DU MONDE, APPELEE A LUTTER SANS CESSE POUR ACQUERIR DES RESULTATS NOUVEAUX, UNE CONCEPTION QUI N'ABHORRE RIEN TANT QUE LES FORMULES FIGEES ET DEFINITIVES ET QUI N'EPROUVE SA FORCE VIVANTE QUE DANS LE CLIQUETIS D'ARMES DE L'AUTOCRITIQUE ET SOUS LES COUPS DE TONNERRE DE L'HISTOIRE."
(Rosa Luxembourg. "L'accumulation du capital")
[1] [17]
Il
est important de signaler que les défenseurs avoués du système capitaliste ne
furent pas les seuls avocats de cette idée. Au cours des années 1950. et 60, on
a vu se développer, parmi des groupes et éléments se réclamant pourtant de la
révolution communiste, une tendance à la remise en cause des acquis essentiels
du marxisme. C’est ainsi que le groupe « Socialisme ou Barbarie » a
échafaudé, sous la conduite de son grand théoricien (allias Chailieu-Cardan),
une thèse sur la « dynamique du capitalisme »affirmant que Marx avait
fait simplement fausse route en tentant de démontrer le caractère insoluble des
contradictions économiques de ce système. Depuis, les choses sont revenues à
leur place : le professeur Castoriadis s'est distingué comme caution
"de gauche" de l’effort de guerre du Pentagone en publiant un livre
qui "démontre" que les USA ont un énorme retard sur l'URSS en matière
d'armements (!). D une façon toute naturelle, le rejet par Castoriadis du
marxisme lui a ouvert toutes grandes les porter de la bourgeoisie.
[2] [18] Il est clair que cela n'excuse en rien les crimes Sociaux-démocrates ou n'atténue leur gravité. Le prolétariat n'a pas à faire un choix entre la peste social-démocrate et le choléra stalinien. L'une et l'autre poursuivent le même but : la conservation du régime capitaliste avec des méthodes parfois différentes dues aux conditions particulières des pays où ils agissent. Ce qui fait du stalinisme un dépassement de la social-démocratie dans l'ignominie c'est la place extrême qu'il occupe dans le capitalisme décadent, dans son évolution vers sa forme historique de capitalisme d'Etat et le développement du totalitarisme étatique. Ce processus inexorable du capital nécessite dans les pays arriérés, où la bourgeoisie privée est moins développée et déjà sénile, une force politique particulièrement brutale capable d'instaurer de la façon la plus sanglante le régime du capitalisme d'Etat. Selon les pays, cette force politique se présente sous la forme du stalinisme qui, en plus d'exercer une oppression sanglante, prétend instaurer le capitalisme d'Etat au nom du "Socialisme", du "Communisme" ou du "marxisme" battant ainsi tous les records d'ignominie et de cynisme.
[3] [19] Avec leurs modestes moyens, les trotskystes ont emboîté le pas à leurs grands frères sociaux- démocrates et staliniens. C'est avec une véhémence exacerbée qu'ils se réclament de Marx et du marxisme (Ainsi, le Parti Communiste Internationaliste, tendance "lambertiste", a lancé une souscription pour republier la biographie de Marx écrite par Franz Mehring), alors que depuis plus de 40 ans, ils n'ont pas manqué une occasion d'apporter un soutien "critique" aux ignominies staliniennes (résistance, défense de l'URSS, exaltation des prétendues "luttes de libération nationale", soutien des gouvernements de gauche).
Heritage de la Gauche Communiste:
Problèmes actuels du mouvement ouvrier - Extraits d'Internationalisme n°25 (août-1947) - présentation
- 4136 reads
Ce texte d'Internationalisme est extrait d'une série d'articles publiés tout au long de l'année 1947, intitulée "Problèmes actuels du mouvement ouvrier". Dans ces articles, Internationalisme entend par "mouvement ouvrier" ou "mouvement révolutionnaire", les groupes et les organisations politiques. Il polémique contre l'activisme ambiant qui existe parmi les groupes qui voient, avec la fin de la 2ème guerre mondiale, la possibilité d'une répétition du processus révolutionnaire tel qu'il s'était déroulé à la fin de la 1ère guerre mondiale de 1917 à 1923.
Internationalisme analyse au contraire la fin de la 2ème guerre comme une défaite profonde pour la classe ouvrière internationale. Les conditions ne sont pas les mêmes qu'à la fin de la 1ère guerre mondiale ; la classe ouvrière a été physiquement et idéologiquement vaincue ; la survie du capitalisme a accentué la tendance au capitalisme d'Etat qui modifie les données pour la lutte de classe ; les conditions ne sont pas réunies pour une reprise générale de la lutte révolutionnaire.
Internationalisme combat le volontarisme des groupes qui mettent en avant la formation immédiate du parti, sans prendre en compte ces nouvelles données de la période, avec pour seul cadre politique une répétition à leur échelle microscopique des positions et des orientations du Parti bolchevik de la période révolutionnaire, sans un bilan de la défaite et des erreurs de ce parti. Ces groupes sont des scissions du trotskysme, mais surtout les fractions de la Gauche Communiste Internationale qui appuient la constitution d'un Parti Communiste Internationaliste (PCI) en Italie en 1943.
Poursuivant la critique qu'il faisait dès le moment de la constitution du PCI1, Internationalisme rappelle quelles sont les conditions de la constitution d'un parti. L'histoire du mouvement ouvrier montre que la naissance et le développement, tout comme la fin, la dégénérescence ou la trahison des organisations politiques du prolétariat (Ligue des communistes, AIT, 2ème Internationale, Internationale Communiste, Parti bolchévik), sont étroitement liés à l'activité de la classe ouvrière elle-même. Au sein de la classe ouvrière, un parti, c'est-à-dire une organisation capable d'influer sur le cours des événements de la lutte de classe de manière décisive, ne peut surgir que s'il s'exprime dans la classe une tendance à s'organiser et à s'unir contre le capitalisme, dans une montée de lutte de classe.
Cette tendance n'existe pas à la fin de la 2ème guerre mondiale. Les mouvements de grève de 1943 en Italie, les manifestations contre la faim en 1945 en Allemagne où l’on voit même parfois la police se retourner contre le pouvoir, sont circonscrites et isolées. S'ils attestent d'une combativité de classe que tous les groupes politiques reconnaissent, ils restent limités et prisonniers de l'idéologie et des forces d'encadrement de la bourgeoisie, partis de gauche et syndicats.
Pour Internationalisme, l'heure n'est certainement pas à la formation du parti. Contre ceux qui voient dans sa position un "défaitisme", un rejet de l'activité révolutionnaire. Internationalisme réaffirme que le débat n'est pas "construction du parti" ou "rien", mais quelles tâches pour les groupes révolutionnaires, et sur quel programme. Ce qui tient lieu de théorie est pour beaucoup un bavardage incohérent répétant les positions de l'Internationale Communiste comme si rien ne s'était passé depuis la période révolutionnaire et faisant le silence sur tous les débats d'avant la guerre.
On trouve à la constitution du PCI des éléments qui, comme Vercesi, récusaient pendant la guerre toute possibilité d'activité révolutionnaire, refusant de prendre position contre la guerre, théorisant la "disparition du prolétariat" pour aboutir à participer à des "comités antifascistes"2. On y trouve aussi beaucoup d'éléments qui n'avaient pas participé ni suivi le travail politique et théorique de la Gauche Communiste de 1'entre-deux-guerres et qui, à l'appel des anciens des années 20 restés à l'écart de ce travail comme Damen et surtout Bordiga, rejoignent les rangs du PCI, sans que jamais ne soient discutées les positions politiques de la Gauche.
Pour Internationalisme, qui se situe résolument dans la continuité de ce travail, il n'a jamais été question de rejeter la nécessité de l'activité révolutionnaire. Comme il le dit : "le cours de la lutte de classe ne se modifie pas par la volonté des militants, pas plus qu'il ne se modifie indépendamment de leur volonté".
Quelle activité, avec quelles méthodes ? Telle est la question qu'Internationalisme pose aux organisations révolutionnaires.
La "construction du parti" du PCI veut dire en fait se jeter dans un activisme sans principes, et le parti est un regroupement fait de bric et de broc, de tendances diverses, y inclus des groupes qui ont participé aux côtés de la bourgeoisie à la "résistance antifasciste".
Pour Internationalisme au contraire, il faut poursuivre un travail de fraction communiste, continuer le bilan de la vague révolutionnaire précédente en tirant les leçons de la défaite et de la période de guerre, assurer dans la mesure de ses moyens une propagande constante à contre-courant, entretenir le plus possible la confrontation et la discussion dans le milieu révolutionnaire nécessairement réduit dans les conditions de la période.
En 1947, Internationalisme peut déjà faire le constat de l'échec des divers groupes qui prennent leur propre agitation pour 1'activité de la classe depuis quelques années, ce qui entraîne la démoralisation et la dispersion de forces militantes immatures et hâtivement regroupées à qui on a fait miroiter, sans discussion aucune, des perspectives qui ne correspondent en rien à la réalité.
Des groupes qui ont scissionné avec le trotskysme abandonnent le marxisme, se disloquent. De 3000 membres environ que compte le PCI à ses débuts, celui-ci se trouve engagé dans un processus de défections massives et de dispersion. Des dirigeants de ce parti, des éléments des fractions française et belge qui l'appuie, loin de se rendre compte des causes réelles de ce phénomène, l'expliquent par une pirouette philosophique, la "transformation de la quantité en qualité" !
Contre cette aberration, Internationalisme explique ce qui se passe d'une part par l'incapacité à comprendre la période, mais aussi d'autre part par les méthodes défendues et en vigueur dans le PCI : le rejet du travail d'approfondissement politique et théorique par l'ensemble des militants.
Ces méthodes reposent sur la reprise d'une conception erronée de la lutte et de la prise de conscience de la classe, selon laquelle la conscience ne peut être apportée à la classe que "de l'extérieur". Cette conception, que Lénine dans "Que faire ?" reprit de Kautsky, ne voit pas la prise de conscience comme le fait de l'ensemble de la classe ouvrière, dont le parti en son sein est l'expression la plus claire et la plus décidée sur les moyens et les buts généraux du mouvement. Elle la voit comme le fait d'une minorité éclairée détentrice des connaissances théoriques qu'elle doit "importer" dans la classe.
Rapportée sur le plan du parti, cette conception amène à théoriser que seules des individualités particulières ont la capacité d'approfondir la théorie révolutionnaire, pour la distiller et la transmettre en quelque sorte "toute mâchée" aux membres de l'organisation.
C'est cette conception d'un chef génial, seul capable de mener le travail théorique de l'organisation, que critique l'extrait de "Problèmes actuels du mouvement ouvrier" que nous publions ci-dessous. L'attitude que le PCI défendait par rapport à Bordiga, et défend toujours en général en ce qui concerne les questions théoriques dans le mouvement ouvrier, relève de cette conception. Elle sert de base au rejet de la discussion ouverte de toutes les questions et orientations de l'organisation. Elle implique pour les militants une obéissance servile et une confiance aveugle dans les orientations politiques élaborées par le seul centre de l'organisation et une absence de véritable formation. Nous publierons la suite de cet article dans un prochain numéro de la Revue Internationale, article intitulé "La discipline, force principale..." qui combat cette vision militaire du travail militant dans une organisation révolutionnaire.
La vision sclérosée du PCI des méthodes d'une organisation révolutionnaire qu'Internationalisme combattait en 1947, sévit encore aujourd'hui, en particulier dans les groupes qui se réclament du "léninisme". Face aux difficultés que fait surgir l'accélération de l'histoire actuelle, cette vision ne fait qu'accentuer l'opportunisme et le sectarisme dans un milieu révolutionnaire en difficulté.3
A l'inverse de cette vision, le parti, comme toute organisation révolutionnaire, ne peut remplir sa fonction que s'il est un lieu d'élaboration constante collective par tous ses membres des orientations politiques. Ceci implique nécessairement la discussion la plus ouverte et la plus large possible, à l'image de la classe ouvrière dont la condition de son émancipation est l'action consciente collective à laquelle participent toutes les parties et tous les membres de la classe.
1 Lire "La tâche de l'heure : formation du parti ou formation des cadres [22]" – REVUE INTERNATIONALE n°32
2 Lire la brochure publiée par le CCI "Contribution à une histoire de la Gauche Communiste d’Italie".
3 Lire "Convulsions actuelles du milieu révolutionnaire [23]" – REVUE INTERNATIONALE n°28.
Lire "Problèmes actuels du milieu révolutionnaire" – REVUE INTERNATIONALE n°32, en particulier "Le Parti Communiste International (Programme Communiste) à un tournant de son histoire [24]".
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [26]
- Bordiguisme [27]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [28]
Heritage de la Gauche Communiste:
Problèmes actuels du mouvement ouvrier - Extraits d'Internationalisme n°25 (août-1947) - La conception du chef génial
- 3410 reads
Ce n'est pas nouveau en politique qu'un groupe change radicalement ses façons de voir et d'agir en devenant une grande organisation, un parti de masses. On peut citer maints exemples de telles métamorphoses. On pourrait, avec raison, l'appliquer également, en partie tout au moins, au Parti bolchevik après la révolution. Mais ce qui frappe, pour le Parti Communiste Internationaliste d'Italie, c'est la rapidité surprenante avec laquelle l'esprit de ses principaux dirigeants a subi ce changement. Et cela est d'autant plus surprenant que, somme toute, le Parti italien représente, aussi bien numériquement que fonctionnellement, tout au plus une fraction élargie.
Comment expliquer alors ce changement ?
Par exemple : le Parti Communiste italien à sa fondation, animé par la direction de la Gauche et de Bordiga, a toujours été l'enfant terrible dans l'I.C. Ne reconnaissant pas la soumission "a priori" à l'autorité absolue des chefs, même de ceux envers qui il portait la plus grande estime, le PC d'Italie entendait discuter librement, et combattre, s'il le fallait, toute position politique qu'il ne partageait pas. Dès la fondation de l’IC, la fraction de Bordiga se trouvera sur bien des points en opposition et exprimera ouvertement ses désaccords avec Lénine et autres dirigeants du Parti bolchevik, de la révolution russe et de l’IC. On connaît les débats qui ont eu lieu entre Lénine et Bordiga au 2ème Congrès. Personne ne songeait alors à contester ce droit de libre discussion et il ne serait venu à personne de voir en cela une atteinte à l'autorité des "chefs". Peut-être que des hommes, aussi veules et serviles que Cachin[1] [30], pouvaient dans leur for intérieur en être scandalisés, mais ils n'osaient même pas le montrer. Mieux que cela : la discussion n'était même pas considérée comme un droit mais comme un DEVOIR, l'unique moyen permettant, par la confrontation des idées et l'étude, l'élaboration des positions programmatiques et politiques courantes nécessaire pour l'action révolutionnaire.
Lénine écrivait : "il est du devoir des militants communistes de vérifier par eux-mêmes les résolutions des instances supérieures du Parti. Celui qui, en politique, croit sur parole est un indécrottable idiot". Et on sait quel mépris Lénine mettait dans ces termes d'"indécrottable idiot". Sans cesse Lénine insistait sur la nécessité de l'éducation politique des militants. Apprendre, comprendre, ne peut se faire que par la libre discussion, par la confrontation générale des idées par l'ensemble des militants .sans exception. Ce n'est pas là simplement une question de pédagogie mais une condition première de l'élaboration politique, de la marche en avant du mouvement de l'émancipation du prolétariat.
Après la victoire du stalinisme et l'exclusion de la gauche de l’IC, la fraction italienne n'a cessé de combattre le mythe du chef infaillible, et face a Trotsky réclamait dans l'opposition de gauche le plus grand effort dans le réexamen critique des positions passées et la recherche théorique par la plus large discussion des problèmes nouveaux. La Fraction italienne a fourni cet effort avant la guerre. Elle n'a cependant pas prétendu avoir résolu tous les problèmes et se trouvait elle-même, comme on le sait, très divisée sur des questions de première importance.
Or on doit constater que toutes ces bonnes dispositions et traditions se sont évanouies avec la constitution du Parti. Le PCI est actuellement le groupement où la discussion théorique et politique est la moins existante. La guerre, l'après-guerre ont soulevé un grand nombre de problèmes nouveaux. Aucun de ces problèmes n'a été et n'est abordé dans les rangs du Parti italien. Il suffit de lire les écrits et journaux du Parti pour se rendre compte de leur extrême pauvreté théorique. Quand on lit le procès-verbal de la Conférence constitutive du Parti, on se demande si cette conférence a eu lieu en 1946 ou en 1926. Et un des dirigeants du Parti –si nous ne nous trompons pas c’était le camarade Damen–, avait raison de dire que le Parti reprenait et repartait des positions de...1925. Mais ce qui pour lui représente une force (les positions de 1925) exprime, on ne peut mieux, le terrible retard théorique et politique et souligne précisément l'extrême faiblesse du Parti.
Aucune période, dans l'histoire du mouvement ouvrier, n'a tant bouleversé les données acquises et posé tant de nouveaux problèmes que cette période, relativement courte, de 20 ans, entre 1927 et 1947, pas même la période pourtant si mouvementée de 1905 à 1925. La plus grande partie des Thèses fondamentales qui étaient à la base de l’IC ont vieilli et sont périmées. Les positions sur 1a question nationale et coloniale, sur la tactique, sur les mots d'ordre démocratiques, sur le parlementarisme, sur les syndicats, sur le Parti et ses rapports avec la classe sont à réviser radicalement. D'autre part, la réponse est à donner aux questions de l’Etat après la révolution, la dictature du prolétariat, sur les caractères du capitalisme décadent, sur le fascisme, sur le capitalisme d'Etat, sur la guerre impérialiste permanente, sur les nouvelles formes de lutte et d'organisation unitaire de la classe. Autant de problèmes que l’IC a à peine entrevus et abordés, et qui sont apparus après la dégénérescence de l’IC.
Quand, devant l'immensité de ces problèmes, on lit les interventions à la Conférence de Turin où on a répété comme des litanies les vieilles positions de Lénine de la "Maladie infantile du Communisme", déjà périmées à l'époque même où il l’a écrit, quand on voit le Parti reprendre, comme si rien ne s'était passé, les vieilles positions de 1924 de participation aux élections bourgeoises et de lutte à l'intérieur des syndicats, on mesure tout le retard politique de ce Parti et tout ce qu'il a à rattraper.
Et cependant c'est ce Parti qui est de loin le plus en retard, répétons-le, par rapport aux travaux de la Fraction d'avant-guerre, qui s'oppose le plus à toute discussion politique intérieure et publique. C'est dans ce Parti ou la vie idéologique est la plus terne.
Comment cela s'explique-t-il ? L'explication nous a été donnée par un des dirigeants de ce Parti, dans une conversation qu'il a eue avec nous[2] [31]. Il nous a dit :
- "Le Parti italien est composé, dans sa grande majorité, d'éléments nouveaux sans formation théorique et politiquement vierges. Les anciens militants, eux-mêmes, sont restés pendant 20 ans isolés, coupés de tout mouvement de la pensée. Dans l’état présent les militants sont incapables d'aborder les problèmes de la théorie et de l’idéologie. La discussion ne ferait que troubler leur vue et ferait plus de mal que de bien. Ils ont pour le moment besoin de marcher sur la terre ferme, serait-ce même les vieilles positions actuellement périmées, mais déjà formulées et compréhensibles pour eux. Pour le moment il suffit de grouper les volontés pour l'action. La solution des grands problèmes soulevés par l'expérience d'entre les deux guerres exige le calme de la réflexion. Seul un "grand cerveau" peut les aborder avec profit et donner la réponse qu'ils nécessitent. La discussion générale ne ferait qu'apporter de la confusion. Le travail idéologique n'est pas le fait de la masse des militants mais des individualités. Tant que ces individualités géniales n'auront pas surgi, on ne peut espérer d'avancer en idéologie. Marx, Lénine étaient ces individualités, ces génialités dans une période passée. Il faut attendre la venue d'un nouveau Marx. Nous, en Italie, sommes convaincus que Bordiga sera cette génialité. Ce dernier travaille actuellement sur une oeuvre d'ensemble qui contiendra la réponse aux problèmes qui tourmentent les militants de la classe ouvrière. Quand cette oeuvre paraîtra, les militants n'auront qu'à l'assimiler, et le Parti à aligner sa politique et son action sur ces nouvelles données".
Ce discours que nous reproduisons presque textuellement contient trois éléments. Premièrement une constatation de fait : le bas niveau idéologique dès membres du Parti. Deuxièmement, le danger qui consiste à ouvrir d'amples discussions dans le Parti, parce que ne pouvant que troubler les membres et disloquer ainsi leur cohésion. Et troisièmement que la solution aux problèmes politiques nouveaux ne peut être QUE l’œuvre d'un cerveau génial.
Sur le premier point le camarade dirigeant a absolument raison, c'est là un fait incontestable. Mais cette constatation devrait inciter, croyons-nous, à poser la question de la valeur de ce Parti. Que représente un tel Parti pour la classe ? Que peut-il apporter à la classe ?
Nous avons vu la définition que donne Marx sur ce qui distingue les communistes de l'ensemble du prolétariat : leur conscience des fins générales du mouvement et les moyens pour y parvenir. Si les membres du Parti italien ne représentent pas cette distinction, si leur niveau idéologique ne dépasse pas celui de l'ensemble du prolétariat, peut-on alors parler d'un Parti communiste ?
Bordiga formulait justement l'essence du Parti, par un "corps de doctrine et une volonté d'action". Si ce corps de doctrine manque, mille regroupements ne forment pas encore le Parti. Pour le devenir réellement, le PCI a pour première tâche : la formation idéologique des cadres, c'est-à-dire le travail idéologique préalable pour pouvoir devenir un parti réel.
Ce n'est pas la pensée de notre dirigeant du PCI, qui estime au contraire qu'un tel travail n'est susceptible que de troubler la volonté d'action des membres. Que dire d'une telle pensée sinon qu'elle nous paraît MONSTRUEUSE. Faut-il rappeler les remarquables passages du "Que faire" où Lénine cite Engels sur la nécessité de la lutte sur trois fronts : l'économique, le politique et le front idéologique ?
De tous les temps existaient ces socialistes qui craignaient que la discussion et la manifestation des divergences puissent troubler la bonne action des militants. Ce socialisme peut être appelé le socialisme borné ou le socialisme de l'ignorance.
Contre Weitling, le chef reconnu, le jeune Marx fulminait en s'écriant : "Le prolétariat n'a pas besoin de l'ignorance" ! Si la lutte des idées peut troubler l'action des militants, combien cela serait encore plus vrai pour l'ensemble du prolétariat ? Et alors c'en est fini du Socialisme à moins de professer que le socialisme c'est de l'ignorance. C'est là une conception d'Eglise, qui elle aussi craint de troubler les cerveaux de ses fidèles, par trop de questions doctrinales.
Contrairement à l'affirmation que les militants ne peuvent agir que dans la certitude, "fusse-t-elle même fondée sur des positions fausses", nous opposons qu'il n'y a pas de certitude, mais un continuel dépassement des vérités. Seule l'action basée sur les données les plus récentes, en continuel enrichissement, est révolutionnaire. Par contre, l'action faite sur la base d'une vérité d'hier, mais déjà, périmée aujourd'hui, est stérile, nuisible et réactionnaire. On veut nourrir les membres de bonnes vérités certaines et absolues, alors que seules les vérités relatives contenant leur antithèse du doute donnent une synthèse révolutionnaire.
Si le doute et la controverse idéologique doivent troubler l'action des militants, on ne voit pas pourquoi cela serait un phénomène uniquement valable pour aujourd'hui. A chaque étape de la lutte, la nécessité surgit de dépasser les positions antérieures. A chaque moment la vérification des idées acquises et des positions prises sont mises en doute. Nous serons donc placés dans un cercle vicieux : ou de réfléchir, de raisonner et en conséquence ne pas pouvoir agir, ou d'agir sans savoir si notre action repose sur un raisonnement réfléchi.
Belle conclusion à laquelle doit aboutir notre dirigeant du PCI s'il était logique avec ses prémisses. C'est en tout cas l'idéalisation du type de "l'indécrottable idiot" contre lequel Lénine n'avait pas assez de sarcasmes. C'est le "parfait crétin" hissé à la hauteur de membre idéal du PCI d'Italie !
Tout le raisonnement de notre dirigeant sur l'impossibilité "momentanée" de la recherche et de la controverse théorico-politique, au sein du PCI, ne contient pas l'ombre d'une justification.
Le trouble provoqué par de telles controverses est justement la condition de la formation du militant, la condition que son action puisse reposer sur une conviction sans cesse vérifiée, comprise et enrichie. C'est la condition fondamentale de l'action révolutionnaire, en dehors de laquelle il n'y a qu’obéissance, crétinisme et servitude.
Mais la pensée intime de notre dirigeant se trouve exprimée dans le troisième point. C'est là sa pensée profonde. Les problèmes théoriques de l'action révolutionnaire ne sont pas résolus par des controverses et des discussions mais par le cerveau génial d'un individu, du chef. La solution n'est pas une oeuvre collective mais individuelle du penseur isolé dans son cabinet de travail, tirant de sa génialité les éléments fondamentaux de la solution. Ce travail achevé, la solution donnée, il ne reste à la masse des militants, à l'ensemble du Parti que d'assimiler cette solution et d'aligner sur elle leur action politique. Cela rendrait les discussions sinon nuisibles du moins un luxe inutile, une perte de temps stérile. Et pour appuyer cette thèse, de citer entre autres l'exemple de l’œuvre de Marx.
Notre dirigeant se fait une drôle d'idée de Karl Marx. Jamais penseur n'a été moins "l'homme-de-cabinet-de-travail" que Marx. Moins que chez tout autre, on ne peut séparer chez Marx l'homme de l'action, le militant du mouvement et le penseur. La pensée de Marx mûrit en correspondance directe non de l’action des autres mais de son action avec les autres dans le mouvement général. Pas une idée contenue dans son oeuvre que Marx n'ait déjà exposée, opposée, sous forme de conférences et de controverses, à d'autres idées au cours de son action. C'est pourquoi son oeuvre garde cette fraîcheur d'expression et de vitalité. Toute son œuvre, et même le Capital, n'est qu'une incessante controverse où les recherches théoriques les plus ardues et les plus abstraites voisinent, et sont étroitement mêlées à la discussion et à la polémique directe. Curieuse façon de concevoir l’œuvre de Marx que de la considérer comme le produit de la composition biologique miraculeuse du cerveau de Marx !
D'une façon générale c'en est fini du génie dans l'histoire humaine. Que représentait le génie dans le passé ? Rien d'autre que le niveau extrêmement bas de la connaissance de la moyenne des hommes en rapport de qui la connaissance de quelques éléments d'élite faisait une différence incommensurable. A un stade inférieur du développement de la connaissance humaine, la connaissance toute relative pouvait être un acquis individuel, tout comme le moyen de production pouvait avoir un caractère individuel. Ce qui distingue l'outil de la machine c'est son changement de caractère qui de produit rudimentaire d'un travail privé, devient un produit compliqué d'un travail social collectif. Il en est autant pour la connaissance en général. Tant qu'elle restait élémentaire, un individu isolé pouvait l'embrasser dans sa totalité. Avec le développement de la société et de la science, la connaissance cesse de pouvoir être embrassée par l'individu pour être mieux saisie par l'humanité tout entière. L’écart entre le génie et la moyenne des hommes diminue dans la proportion même où la somme des connaissances humaines s’élève. La science, comme la production économique, tend à se socialiser. Du génie l'humanité est passée au savant isolé et du savant à l'équipe de savants. La division du travail tend à grandir. Pour produire aujourd'hui il est nécessaire de compter sur la coopération des grandes masses d'ouvriers. Cette même tendance à la division est dans la production "spirituelle" et assure précisément par là son développement. Le cabinet du savant cède la place au laboratoire où coopèrent dans leurs recherches des équipes de savants, comme l'atelier de l'artisan a cédé sa place aux grandes usines.
Le rôle de l'individu tend à diminuer dans la société humaine, non en tant qu'individu sensible mais en tant qu'individu émergeant de la masse confuse, surnageant le chaos humain. L'homme-individu cède la place à l'homme social. L'opposition de l'unité individuelle à la société est résolue par la synthèse d'une société où tous les individus retrouvent leur personnalité véritable. Le mythe du génie n’est pas l’avenir de l’humanité. Il doit aller rejoindre le mythe du héros et du demi-dieu dans le musée de la préhistoire.
On peut penser ce que l'on veut de la diminution du rôle de l'individu dans l'histoire humaine. On peut applaudir ou le regretter. On ne peut contester ce processus. Pour pouvoir continuer la production techniquement évoluée le capitalisme était forcé d'instaurer l'instruction générale. La bourgeoisie a été obligée d'ouvrir un nombre de plus en plus grand d'écoles, dans une certaine mesure compatible avec ses intérêts. Elle s'est vue obligée de laisser accéder les fils des prolétaires à une instruction supérieure.
Dans cette même mesure elle a élevé la culture générale de la moyenne de la société. Mais elle ne peut dépasser un certain degré sans atteindre à sa propre domination et devient ainsi une entrave au développement culturel de la société.
C’est là une des manifestations de la contradiction historique de la société bourgeoise que seul le socialisme peut résoudre. Le développement de la culture et de la conscience sans cesse dépassée est la résultante mais aussi la CONDITION du socialisme et voilà un homme qui se dit marxiste, qui prétend être un dirigeant d'un Parti communiste qui nous parle et nous demande d'attendre le Génie sauveur.
Pour nous convaincre, il nous a conté cette anecdote : se présentant après la guerre chez Bordiga, qu'il n'a pas vu depuis 20 ans, il a soumis à sa critique des écrits théoriques et politiques. Après lecture, Bordiga trouvant leur contenu erroné, lui aurait demandé ce qu'il comptait en faire. Les publier dans les revues du Parti, a répondu notre dirigeant. Sur quoi Bordiga aurait répliqué que ne pouvant les combattre, n'ayant pas le temps de faire les recherches théoriques nécessaires pour réfuter le contenu de ces articles, il s'opposait à leur publication. Et si le Parti passait outre, il retirerait sa collaboration littéraire. La menace de Bordiga a suffi pour faire renoncer notre dirigeant à la publication de ses articles.
Cette anecdote qu'on nous donnait en exemple devait nous convaincre de la grandeur du maître et du sens de mesure de l'élève. Elle nous laisse plutôt un sentiment pénible. Si cette anecdote est vraie, elle nous donne une idée de l'esprit qui règne dans le PCI d'Italie, un esprit absolument lamentable. Ainsi ce n'est pas le Parti, la masse des militants, la classe ouvrière dans son ensemble qui est appelée à juger de la justesse ou de l'erreur de telle ou telle position politique. Cette masse ne doit pas même être informée. Le "maître", seul juge de ce qu'elle peut comprendre et de ce dont elle doit être renseignée. Quel sublime souci de ne pas "troubler" la quiétude de la masse. Et si le "maître" se trompe ? s'il est dans l'erreur ? Cela ne peut être, car si le "maître" se trompe, comment voulez-vous qu'un simple mortel puisse, lui, avoir même la possibilité de juger ! Pourtant cela est bien arrivé à d'autres "maîtres" de se tromper : à Marx, à Lénine. Eh bien, cela n'arrivera pas à "notre maître", au VRAI. Et si cela arrivait, il ne peut appartenir qu'à un "maître" futur de le corriger. C'est là une conception typiquement aristocratique de la pensée. Nous ne nions pas la grande valeur que peut avoir la pensée du spécialiste, du savant, du penseur, mais nous rejetons la conception authentiquement monarchiste de la pensée, le Droit Divin sur la pensée. Quant au "maître" lui-même, il cesse d être un être humain dont la pensée se développe au contact des autres humains, pour devenir en quelque sorte un phénix, un phénomène se mouvant par lui-même, l'Idée pure se cherchant, se contredisant et se saisissant soi-même comme chez Hegel.
L'attente du génie c'est la proclamation de sa propre impuissance, c'est la masse attendant au pied du mont Sinaï la venue d'un je ne sais quel Moïse, apportant on ne sait quelle Bible d'inspiration divine. C'est la vieille et éternelle attente du Messie juif venant libérer son peuple. Le vieux chant révolutionnaire du prolétariat, l'Internationale dit : "il n'y a pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun", Il faudrait veiller à l'avenir d'ajouter "ni génie" à l'intention particulière des membres du PCI d'Italie.
Il existe bien des présentations modernes de cette conception messianique : le culte du "chef infaillible" des staliniens, le “Führer prinzip” des hitlériens, l'appartenance au Duce des chemises noires. Elles sont l'expression de l’angoisse de la bourgeoisie décadente prenant vaguement conscience de sa fin prochaine et cherchant à se sauver en se jetant au pied du premier aventurier venu. Le concept du génie fait partie de la même famille des divinités.
Le prolétariat n'en a que faire et n'a pas à craindre d'être troublé en regardant la réalité en face car l'avenir du monde lui appartient.
(A suivre [32])
[1] [33] Vieux parlementaire du Parti socialiste, chef de cabinet du ministre socialiste Sembat durant la 1ère guerre mondiale. Chauvin invétéré chargé de porter des fonds de l'Etat français à Mussolini pour faire campagne pour l'entrée en guerre de l'Italie au côté de l'Entente... Converti en 1920 en partisan de l’IC où il continue sa carrière de parlementaire et est le plus veule partisan, jusqu'à sa mort, de Staline.
[2] [34] Conversation avec Vercesi
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [28]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rapport sur la structure et le fonctionnement des organisations revolutionnaires - conference internationale (janvier 82)
- 4772 reads
1) La structure dont se dote l'organisation des révolutionnaires correspond à la fonction qu'elle assume dans la classe ouvrière. Comme cette fonction comporte des tâches valables à toutes les étapes du mouvement ouvrier, mais aussi des tâches plus particulières à telle ou telle époque de ce mouvement, il existe des caractéristiques constantes de l'organisation des révolutionnaires et des caractéristiques plus circonstancielles, plus déterminées par les conditions historiques dans lesquelles elle surgit et se développe.
Parmi les caractéristiques constantes, on peut relever :
-
l'existence d'un programme valable pour toute l'organisation. Le programme en tant que synthèse de l'expérience du prolétariat dont l'organisation est une partie et parce qu'il relève d'une classe n'ayant pas seulement une existence présente mais aussi un devenir historique :
-
exprime ce devenir par la formulation des buts de la classe et du chemin à suivre pour les atteindre ;
-
rassemble les positions essentielles que l'organisation doit défendre dans la classe ;
-
sert de base d'adhésion ;
-
son caractère unitaire, expression de l'unité de son programme et de celle de la classe ouvrière dont elle est l'émanation, unité qui se traduit pratiquement par une centralisation de sa structure.
Parmi les caractéristiques plus circonstancielles, on peut mettre en évidence :
-
le caractère plus ou moins large de son étendue, suivant qu'on se situe aux balbutiements du mouvement ouvrier (sociétés secrètes, sectes), à son étape de plein développement au sein de la société capitaliste (partis de masse de la 2ème Internationale), à son étape d'affrontement direct avec le capitalisme en vue de sa destruction (période ouverte avec la Révolution de 1917 et la fondation de l'Internationale Communiste) qui impose à l'organisation des critères de sélection plus stricts et plus étroits ;
-
le niveau auquel se manifeste le plus directement son unité programmatique et organique : niveau national lorsque la classe ouvrière était confrontée à des tâches plus spécifiques, au sein d'un capitalisme en plein développement, dans les différents pays où elle menait la lutte (partis de la 2ème Internationale), niveau international lorsque le prolétariat n'a plus qu'une tâche à l'ordre du jour : la Révolution Mondiale.
2- Le mode d'organisation du CCI participe directement de ces différentes données :
-
unité programmatique et organique à l'échelle mondiale,
-
organisation "étroite", aux critères d'adhésion stricts.
Mais le caractère unitaire au niveau international est d'autant plus marqué pour le CCI que, contrairement aux organisations ayant surgi auparavant dans la période de décadence (Internationale Communiste, fractions de gauche), il n'y a pas de lien organique avec les organisations venant de la 2ème Internationale où la structure par pays était plus marquée. C'est pour cela que le CCI a surgi d'emblée comme organisation internationale suscitant progressivement l'apparition de sections territoriales, et non comme résultat d'un processus de rapprochement d'organisations déjà formées au niveau national.
Cet élément plus "positif" résultant de la rupture organique est cependant contre-balancé par tout une série de faiblesses liées à cette rupture, et concernant la compréhension des questions d'organisation. Faiblesses qui ne sont pas propres au CCI mais concernent l'ensemble du milieu politique révolutionnaire. Ce sont ces faiblesses qui se sont manifestées une nouvelle fois dans le CCI et qui ont motivé la tenue d'une Conférence Internationale et le présent texte.
3) Au centre des incompréhensions qui pèsent sur le CCI figure la question du centralisme. Le centralisme n'est pas un principe abstrait ou facultatif de la structure de l'organisation. C'est la concrétisation de son caractère unitaire : il exprime le fait que c'est une seule et même organisation qui prend position et agit dans la classe. Dans les rapports entre les différentes parties de l'organisation et le tout, c'est toujours le tout qui prime. Il ne peut exister face à la classe de position politique ou de conception de l'intervention particulière à telle ou telle section territoriale ou locale. Celles-ci doivent toujours se concevoir comme partie d'un tout. Les analyses et positions qui s'expriment dans la presse, les tracts, les réunions publiques, les discussions avec les sympathisants ; les méthodes employées dans notre propagande comme dans notre vie interne, sont celles de l'organisation dans son ensemble, même s'il existe des désaccords sur tel ou tel point, en tel ou tel lieu, ou chez tel ou tel militant et même si l'organisation porte à l'extérieur les débats politiques qui se déroulent en son sein. La conception selon laquelle telle ou telle partie de l'organisation peut adopter face à la classe ou à l'organisation des positions ou des attitudes qui lui semblent correctes au lieu de celles de l'organisation qu'elle estime erronées est à proscrire absolument car :
-
si l'organisation fait fausse route, la responsabilité des membres qui estiment défendre une position correcte n'est pas de se sauver eux-mêmes dans leur coin, mais de mener une lutte au sein de l'organisation afin de contribuer à la remettre dans "le droit chemin"[1];
-
une telle conception conduit une partie de l'organisation à imposer arbitrairement sa propre position à toute l'organisation par rapport à tel ou tel aspect de son travail (local ou spécifique).
Dans l'organisation, le tout n'est pas la somme des parties. Celles-ci reçoivent délégation pour l'accomplissement de telle activité particulière (publications territoriales, interventions locales, etc.) et sont donc responsables devant l'ensemble de ce mandat qu'elles ont reçu.
4) Le moment privilégié où s’exprime avec toute son ampleur l’unité de l’organisation est son Congrès International. C’est au congrès international qu’est défini, enrichi, rectifié le programme du CCI, que sont établies, modifiées ou précisées ses modalités d’organisation et de fonctionnement, que sont adoptées ses analyses et orientations d’ensemble, qu’il est fait un bilan de ses activités passées et élaboré ses perspectives de travail pour le futur. C’est pour cela que la préparation du Congrès doit être prise en charge avec le plus grand soin et la plus grande énergie par l’ensemble de l’organisation. C’est pour cela que les orientations et décisions du Congrès doivent servir de références constantes à l'ensemble de la vie de l'organisation après celui-ci.
5) Entre deux Congrès, l'unité de même que la continuité de l'organisation s'exprime par l'existence d'organes centraux nommés par le Congrès et responsables devant lui. C'est aux organes centraux que revient la responsabilité (suivant le niveau de compétence : international ou territorial) :
-
de représenter l'organisation face à l'extérieur,
-
de prendre position chaque fois que nécessaire sur la base des orientations définies au Congrès,
-
de coordonner et d'orienter l'ensemble des activités de l'organisation,
-
de veiller à la qualité ce l'intervention face à l'extérieur et notamment celle de la presse,
-
d'animer et de stimuler la vie interne de l'organisation notamment par la mise en circulation de bulletins internes et par des prises de positions sur les débats quand c'est nécessaire,
-
de gérer les ressources financières et matérielles de l'organisation,
-
de mettre en oeuvre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité de l'organisation et son aptitude à remplir ses tâches,
-
de convoquer les Congrès.
L'organe central est une partie de l'organisation et comme tel, il est responsable devant elle, lorsqu'elle est réunie en Congrès. Cependant, c'est une partie qui a comme spécificité d'exprimer et de représenter le tout, et de ce fait, les positions et décisions de l'organe central priment toujours sur celles des autres parties de l'organisation prises séparément.
Contrairement à certaines conceptions, notamment celles dites "léninistes", l'organe central est un instrument de l'organisation et non le contraire. Il n'est pas le sommet d'une pyramide suivant une vision hiérarchique et militaire de l'organisation des révolutionnaires. L'organisation n'est pas formée d'un organe central plus les militants, mais constitue un tissu serré et uni au sein duquel s'imbriquent et vivent toutes ses composantes. Il faut donc plutôt voir l'organe central comme le noyau de la cellule qui coordonne le métabolisme d'une entité vivante.
En ce sens, c'est de façon constante que l'ensemble de l'organisation est concerné par les activités de ses organes centraux, lesquels sont tenus de faire des rapports réguliers sur leurs activités. Même si c'est uniquement au Congrès qu'ils rendent leur mandat, les organes centraux sont tenus d'avoir des oreilles toujours ouvertes à la vie de l'organisation et de tenir constamment compte de cette vie.
Suivant les nécessités et circonstances, les organes centraux peuvent être conduits à désigner en leur sein des sous-commissions à qui il revient la responsabilité d'exécuter et de faire exécuter les décisions adoptées lors des réunions plénières des organes centraux ainsi que d'accomplir toute autre tâche (notamment les prises de positions) qui s'avère nécessaire entre deux réunions plénières.
Ces sous-commissions sont responsables devant ces réunions plénières. D'une façon plus générale, les rapports établis entre l'ensemble de l'organisation et les organes centraux valent également entre ceux-ci et leurs sous-commissions permanentes.
6) Le souci de la plus grande unité du sein de l'organisation préside également à la définition des mécanismes qui permettent les prises de position et la nomination des organes centraux. Il n'existe aucun mécanisme idéal garantissant le meilleur choix quant aux décisions à prendre, aux orientations à adopter et aux militants à nommer dans les organes centraux. Cependant, le vote et l'élection sont ceux qui permettent le mieux de garantir tant l'unité de l'organisation que la plus grande participation de l'ensemble de celle-ci à sa propre vie.
En général, les décisions à tous les niveaux (Congrès, organes centraux, sections locales) sont prises (quand il n'y a pas d'unanimité) à la majorité simple. Cependant, certaines décisions qui peuvent avoir une répercussion directe sur l'unité de l'organisation (modification de la plate-forme ou des statuts, intégration ou exclusion de militants) sont prises à une majorité plus forte que la majorité simple (3/5, 3/4, etc..).
Par contre, dans le même souci d'unité, une minorité de l'organisation peut provoquer la convocation d'un Congrès extraordinaire à partir du moment où elle est significative (par exemple les 2/5) : en règle générale, il revient au Congrès de trancher sur les questions essentielles, et l'existence d'une forte minorité demandant sa tenue est l'indice de l'existence de problèmes importants au sein de l'organisation.
Enfin, il est clair que le vote n'a de sens que si les membres qui sont en minorité appliquent les décisions qui ont été prises et qui deviennent celles de l'organisation.
Dans la nomination des organes centraux, il est nécessaire de prendre en considération les trois éléments suivants :
-
la nature des tâches à accomplir par ces organes,
-
l'aptitude des candidats par rapport à ces tâches,
-
leur capacité à travailler de façon collective.
C'est en ce sens que l'on peut dire que l'assemblée (Congrès ou autre) qui doit désigner un organe central nomme une équipe : c'est pour cela qu'en général, l'organe central sortant fait une proposition de candidats. Cependant, il revient à cette assemblée (et c'est le droit de tout militant) de proposer d'autres candidats si elle l'estime nécessaire et, en tout état de cause, d'élire individuellement les membres des organes centraux. Seul ce type d'élections permet à l'organisation de se doter d'organes en qui elle a un maximum de confiance.
L'organe central a pour responsabilité de mettre en application et de défendre les décisions adoptées par le Congrès qui l'a élu. En ce sens, il est opportun que figure en son sein une forte proportion de militants, qui, lors du Congrès, se sont prononcés en faveur de ces décisions et orientations. Cela ne veut pas dire cependant que seuls ceux qui ont défendu dans le Congrès les positions majoritaires, positions qui sont devenues à la suite de celui-ci celles de l'organisation, puissent faire partie de l'organe central. Les trois critères définis plus haut restent valables quelles que soient les positions défendues lors des débats par tel ou tel candidat éventuel. Cela ne veut pas dire non plus qu'il doit exister un principe de représentation -par exemple proportionnelle- des positions minoritaires au sein de l'organe central. C'est là une pratique courante dans les partis bourgeois, notamment les partis sociaux-démocrates, où la direction est constituée par les représentants des différents courants ou tendances en proportion des voix recueillies dans les Congrès. Un tel mode de désignation de l'organe central correspond au fait que, dans une organisation bourgeoise, l'existence de divergences est basée sur la défense de telle ou telle orientation de gestion du capitalisme, ou plus simplement sur la défense de tel ou tel secteur de la classe dominante ou de telle ou telle clique, orientation ou intérêts qui se maintiennent de façon durable et qu'il s'agit de concilier par une "répartition équitable" des postes entre représentants. Rien de tel dans une organisation communiste où les divergences n'expriment nullement la défense d'intérêts matériels, personnels ou de groupes de pression particuliers, mais sont la traduction d'un processus vivant et dynamique de clarification des problèmes qui se posent à la classe et sont destinés comme tels à être résorbés avec l'approfondissement de la discussion et à la lumière de l'expérience. Une représentation stable, permanente et proportionnelle des différentes positions qui sont apparues sur les divers points de l'ordre du jour d'un Congrès tournerait donc le dos au fait que les membres de organes centraux :
-
ont comme première responsabilité de mettre en application les décisions et orientations du Congrès,
-
peuvent parfaitement changer de position personnelle (dans un sens ou dans un autre) avec l'évolution du débat.
7) L'utilisation des termes "démocratique" ou "organique" pour qualifier le centralisme de l'organisation des révolutionnaires est à proscrire :
-
parce qu'elle ne fait pas avancer d'un pas la compréhension correcte du centralisme ;
-
parce que ces termes sont eux-mêmes entachés par les pratiques qu'ils ont couverts dans l'histoire.
En effet, le "centralisme démocratique" (terme que l'on doit à Lénine) est marqué aujourd'hui du sceau du stalinisme qui l'a employé pour masquer et recouvrir le processus d'étouffement et de liquidation de toute vie révolutionnaire au sein des partis de l'Internationale, processus dans lequel d'ailleurs Lénine porte une responsabilité pour avoir demandé et obtenu au l0ème Congrès du PCUS (1921) l'interdiction des fractions, qu'il estimait à tort nécessaire (même à titre provisoire) face aux terribles difficultés traversées par la Révolution. D'autre part, la revendication_ d'un "véritable centralisme démocratique" qui était pratiqué dans le parti bolchevique n'a pas de sens non plus dans la mesure où :
-
certaines conceptions défendues par Lénine (notamment dans "Un pas en avant, deux pas en arrière") sur le caractère hiérarchisé et "militaire" de l'organisation, et qui ont été exploitées par le stalinisme pour justifier ses méthodes, sont à rejeter ;
-
le terme "démocratique" lui-même n'est pas le plus approprié tant étymologiquement ("pouvoir du peuple") que par le sens qu'il a acquis dans le capitalisme qui en a fait un fétiche formaliste destiné à masquer et faire accepter la domination de la bourgeoisie sur la société.
D’une certaine façon, le terme « organique » (que l’on doit à Bordiga), serait plus correct pour qualifier la nature du centralisme qui existe dans l’organisation des révolutionnaires. Cependant, l’usage qu’en fait le courant bordiguiste pour justifier un mode de fonctionnement qui exclut tout contrôle des organes centraux et de sa propre vie par l’ensemble de l’organisation, le déqualifie et il est nécessaire de le rejeter également. En effet, pour le bordiguisme, le fait –juste en soi- que l’existence d’une majorité en faveur d’une position ne garantisse pas que celle-ci soit correcte, ou que l’élection des organes centraux ne soit pas un mécanisme parfait prévenant ceux-ci de toute dégénérescence, est utilisé pour défendre une conception de l’organisation où le vote et l’élection sont bannis. Dans cette conception, les positions correctes et les "chefs" s’imposent "d’eux-mêmes" à travers un processus soi-disant "organique", mais qui en pratique, revient à confier au "centre" le soin de décider seul et en tout, de trancher tout débat, et conduit ce "centre" à s’aligner sur les positions d’un "chef historique" qui serait investi d’une sorte d’infaillibilité divine. Combattant toute forme d’esprit religieux et mystique, les révolutionnaires ne sauraient remplacer le pontife de Rome par celui de Naples ou Milan.
Encore une fois, le vote et l’élection, aussi imparfaits qu’ils soient, sont encore le meilleur moyen, dans les conditions actuelles, pour garantir un maximum d’unité et de vie dans l’organisation.
8) Contrairement à la vision bordiguiste, l'organisation des révolutionnaires ne peut être "monolithique". L'existence de divergences en son sein est la manifestation que c'est un organe vivant qui n'a pas de réponses toutes faites à apporter immédiatement aux problèmes qui surgissent devant la classe. Le marxisme n'est ni un dogme, ni un catéchisme. C'est l'instrument théorique d'une classe qui, à travers son expérience et en vue de son devenir historique, avance progressivement, avec des hauts et des bas, vers une prise de conscience qui est la condition indispensable de son émancipation. Comme toute réflexion humaine, celle qui préside au développement de la conscience prolétarienne n'est pas un processus linéaire et mécanique, mais bien contradictoire et critique. Il suppose nécessaire la confrontation des arguments. En fait, le fameux "monolithisme" ou la fameuse "invariance" des bordiguistes est un leurre (ce qu'on peut vérifier fréquemment dans les prises de positions de cette organisation et de ses diverses sections), ou bien l'organisation est complètement sclérosée et n'est plus en prise avec la vie de la classe, ou bien elle n'est pas monolithique et ses positions ne sont pas invariantes.
9) Si l'existence de divergences au sein de l'organisation est un signe qu'elle est vivante, seul le respect d'un certain nombre de règles dans la discussion de ces divergences permet que celles-ci soient une contribution au renforcement de l'organisation et à l'amélioration des tâches pour lesquelles la classe l'a fait surgir.
On peut ainsi énumérer un certain nombre de ces règles :
-
réunions régulières des sections locales et mises à l'ordre du jour de celles-ci des principales questions débattues dans l'ensemble de l'organisation : d'aucune façon le débat ne saurait être étouffé,
-
circulation la plus ample possible des différentes contributions au sein de l'organisation au moyen des instruments prévus à cet effet (les bulletins internes),
-
rejet par conséquent des correspondances secrètes et bilatérales, qui loin de favoriser la clarté du débat, ne peuvent que l'obscurcir en favorisant les malentendus, la méfiance, et la tendance à la constitution d'une organisation dans l'organisation,
-
respect par la minorité de l'indispensable discipline organisationnelle (comme on l'a vu au point 3),
-
rejet de toute mesure disciplinaire ou administrative de la part de l'organisation à l'égard de ses membres qui soulèvent des désaccords : de même que la minorité doit savoir être une minorité au sein de l'organisation, la majorité doit savoir être une majorité et, en particulier, ne pas abuser du fait que sa position est devenue celle de l'organisation pour annihiler le débat par quelque moyen que se soit, par exemple en obligeant les membres de la minorité à être les porte-parole de positions auxquelles il n'adhèrent pas,
-
l'ensemble de l'organisation est intéressé à ce que la discussion (même si elle porte sur des divergences de principes qui ne peuvent qu'aboutir à une séparation organisationnelle) soit menée le plus clairement possible (sans pour cela évidemment paralyser ou affaiblir les tâches de l'organisation) pour se convaincre mutuellement de la validité de leurs analyses respectives ou, tout au moins, permettre que la plus grande clarté soit faite sur la nature et la portée des désaccords.
Dans la mesure où les débats qui traversent l'organisation concernent en général l'ensemble du prolétariat, il convient que celle-ci les porte à l'extérieur, en respectant les conditions suivantes :
-
ces débats concernent les questions politiques générales et ils ont atteint une maturité suffisante pour que leur publication constitue une réelle contribution à la prise de conscience de la classe ouvrière ;
-
la place donnée à ces débats ne doit pas remettre en cause l'équilibre général des publications ;
-
c'est l'organisation comme un tout qui décide et prend en charge cette publication en fonction des critères valables pour la publication de n'importe quel article dans la presse : qualités de clarté et de forme rédactionnelle, intérêt qu'ils présentent pour la classe ouvrière. Sont donc à proscrire les publications de textes en dehors des organes prévus à cet effet sur l'initiative "privée" d'un certain nombre de membres de l'organisation. De même, il n'existe aucun "droit" formel pour quiconque dans l'organisation (individu ou tendance) de faire publier un texte si les organes responsables des publications n'en voient pas l'utilité ou l'opportunité.
10) Les divergences existant dans l'organisation des révolutionnaires peuvent conduire à l'apparition de formes organisées des positions minoritaires. Si, face à un tel processus, aucune mesure de type administratif (comme l'interdiction de telles formes organisées) ne saurait se substituer à la discussion la plus approfondie possible, il convient également que ce processus soit pris en charge de façon responsable, ce qui suppose :
-
que cette forme organisée des désaccords ne peut se baser que sur une position positive et cohérente et non sur une collection hétéroclite de points d'oppositions et de récriminations,
-
que l'organisation soit en mesure de comprendre la nature d'un tel processus ; qu'elle connaisse notamment la différence entre une tendance et une fraction.
La tendance est avant tout l'expression de la vie de l’organisation du fait que la pensée ne se développe jamais de façon rectiligne, mais à travers un processus contradictoire et de confrontation des idées. Comme telle, une tendance est en général destinée à se résorber dès lors qu'une question est devenue suffisamment claire pour que l'ensemble de l'organisation puisse se donner une analyse unique soit comme résultat de la discussion, soit par l'apparition de données nouvelles venant confirmer telle vision et réfuter l'autre.
Par ailleurs, une tendance se développe essentiellement sur des points conditionnant l'orientation et l'intervention de l'organisation. Sa constitution n'a donc pas comme point de départ des questions d'analyse théorique. Une telle conception de la tendance aboutirait à un affaiblissement de l'organisation et à une parcellisation à outrance de l'énergie militante.
La fraction est l'expression du fait que l'organisation est en crise de par l'apparition d'un processus de dégénérescence en son sein, de capitulation face au poids de l'idéologie bourgeoise. Contrairement à la tendance qui ne s'applique qu'à des divergences sur l'orientation face à des questions circonstancielles, la fraction s'applique à des divergences programmatiques qui ne peuvent trouver d'aboutissement que dans l'exclusion de la position bourgeoise ou par le départ de l'organisation de la fraction communiste et c'est dans la mesure où la fraction porte en elle la séparation de deux positions devenues incompatibles au sein du même organisme qu'elle tend à prendre une forme organisée avec ses propres organes de propagande.
C'est parce que l'organisation de la classe n'est jamais garantie contre une dégénérescence que le rôle des révolutionnaires est de lutter à chaque moment pour l'élimination des positions bourgeoises pouvant se développer en son sein. Et c'est quand ils se trouvent en minorité dans cette lutte que leur tâche est de s'organiser en fraction soit pour gagner l'ensemble de l'organisation aux positions communistes et exclure la position bourgeoise soit, quand cette lutte est devenue stérile de par l'abandon du terrain prolétarien par l'organisation - généralement lors d'un reflux de la classe - de constituer le pont vers une reconstitution du parti de classe qui ne peut alors surgir que dans une phase de remontée des luttes.
Dans tous les cas, le souci qui doit guider les révolutionnaires est celui qui existe au sein de la classe en général. Celui de ne pas gaspiller les faibles énergies révolutionnaires dont dispose la classe. Celui de veiller sans cesse au maintien et au développement d'un instrument aussi indispensable mais aussi fragile que l'organisation des révolutionnaires.
11) Si l'organisation doit s'interdire l'usage de tout moyen administratif ou disciplinaire face à des désaccords, cela ne veut pas dire qu'elle doit se priver de ces moyens en toutes circonstances. Il est au contraire nécessaire qu'elle recourre à de tels moyens, comme la suspension temporaire ou l'exclusion définitive, lorsqu'elle est confrontée à des attitudes, comportements ou agissements qui sont de nature à constituer un danger pour son existence, sa sécurité ou son aptitude à accomplir ses tâches. Cela s'applique à des comportements au sein et en dehors de l'organisation qui seraient incompatibles avec l'appartenance à une organisation communiste.
Par ailleurs, il convient que l'organisation prenne toute disposition nécessaire à sa protection face à des tentatives d'infiltration ou de destruction de la part des organes d'Etat capitalistes ou de la part d'éléments qui, sans être directement manipulés par ces organes, ont des comportements de nature à favoriser leur travail.
Lorsque de tels comportements sont mis en évidence, il est du devoir de l'organisation de prendre des mesures non seulement en faveur de sa propre sécurité, mais également en faveur de la sécurité des autres organisations communistes.
12) Une condition fondamentale de l'aptitude d'une organisation à remplir ses tâches dans la classe est une compréhension correcte en son sein des rapports qui s'établissent entre les militants et l'organisation. C'est là une question particulièrement difficile à comprendre à notre époque, compte tenu du poids de la rupture organique avec les fractions du passé et de l'influence de l'élément estudiantin dans les organisations révolutionnaires après 68 qui ont favorisé la résurgence d'un des boulets du mouvement ouvrier du l9ème siècle : l'individualisme.
D'une façon générale, les rapports qui s'établissent entre les militants et l'organisation relèvent des mêmes principes que ceux évoqués plus haut concernant les rapports entre les parties et le tout.
Plus précisément, il convient d'affirmer sur cette question les points suivants :
-
la classe ouvrière ne fait pas surgir des militants révolutionnaires mais des organisations révolutionnaires : il n’existe pas de rapport direct entre les militants et la classe. Les militants participent au combat de la classe en tant qu'ils deviennent membres et prennent en charge les tâches de l'organisation. Ils n'ont pas de "salut" particulier à conquérir face à la classe ouvrière ou à l'histoire. Le seul "salut" qui leur importe est celui de la classe et de l'organisation dont elle s'est dotée ;
-
le même rapport qui existe entre un organisme particulier (groupe ou parti) et la classe existe entre l'organisation et le militant. Et de même que la classe n'existe pas pour répondre aux besoins des organisations communistes, de même celles-ci n'existent pas pour résoudre les problèmes de l’individu militant. L'organisation n'est pas le produit des besoins des militants. On est militant dans la mesure où on a compris et adhéré aux tâches et à la fonction de l'organisation ;
-
dans cet ordre d'idées, la répartition des tâches et des responsabilités dans l’organisation ne vise pas une "réalisation" des individus-militants. Les tâches doivent être reparties de sorte que l'organisation comme un tout puisse fonctionner de façon optimale. Si l'organisation veille autant que possible au bon état de chacun de ses membres, c'est avant tout dans l’intérêt de l’organisation. Cela ne veut pas dire que soient ignorés l'individualité du militant et ses problèmes, mais signifie que le point de départ et le point d'arrivée sont l'aptitude de l'organisation à accomplir sa tâche dans la lutte de classe ;
-
il n'existe pas dans l'organisation de tâches "nobles" et des tâches "secondaires" ou moins"nobles". Le travail d'élaboration théorique comme la réalisation des tâches pratiques, le travail au sein des organes centraux comme le travail spécifique des sections locales, sont tous aussi importants pour l'organisation et ne sauraient de ce fait être hiérarchisés (c'est le capitalisme qui établit de telles hiérarchies). C'est pour cela qu'est parfaitement à rejeter, comme bourgeoise, l'idée suivant laquelle la nomination d'un militant dans un organe central constituerait pour lui une "ascension", l'accession à un "honneur" ou à un privilège. L'esprit de carriérisme doit être résolument banni de l'organisation comme totalement opposé au dévouement désintéressé qui est l'une des caractéristiques dominantes du militantisme communiste ;
-
s'il existe effectivement, surtout entretenues et renforcées par la société de classes, des inégalités d'aptitude entre individus et entre militants, le rôle de l'organisation n'est pas, à l'image des communautés utopistes, de prétendre les abolir. L'organisation se doit de renforcer au maximum la formation et les aptitudes politiques de ses militants comme condition de son propre renforcement mais elle ne pose jamais le problème en terme d'une formation scolaire individuelle de ses membres, ni d'une égalisation de ces formations. La véritable égalité qui peut exister entre militants est celle qui consiste pour chacun d’eux à donner le maximum de ce qu'ils peuvent donner pour la vie de l'organisation ("de chacun selon ses moyens", formule de Saint -Simon reprise par Marx). La véritable "réalisation" des militants, en tant que militants, consiste à tout faire de ce qui est de leur ressort pour que l'organisation puisse réaliser les tâches pour lesquelles la classe l'a fait surgir ;
-
l'ensemble de ces données signifie que le militant ne fait pas un "investissement" personnel dans l'organisation dont il attendrait des dividendes ou qu'il pourrait retirer s'il est amené à la quitter. Sont donc à proscrire absolument comme totalement étrangères au prolétariat toutes les pratiques de "récupération" de matériel ou de fonds de l'organisation même en vue de constituer un autre groupe politique ;
-
de même, "les rapports qui se nouent entre les militants de l'organisation, s’ils portent nécessairement les stigmates de la société capitaliste ne peuvent être en contradiction flagrante avec le but poursuivi par les révolutionnaires... Ils s'appuient sur une solidarité et une confiance mutuelles qui sont une des marques de l'appartenance de l’organisation a la classe porteuse du communisme. (Plate-forme du CCI, le 23-10-81)
1. Cette affirmation n'est pas seulement à usage interne ; elle ne vise pas uniquement les scissions qui se sont produites (ou pourront encore se produire) dans le CCI. Dans le milieu politique prolétarien, nous avons toujours défendu cette position. Ce fut le cas notamment lors de la scission de la section d'Aberdeen de la "Communist Workers' Organisation" et de la scission du Nucleo Comunista Internazionalista d'avec "Programme Communiste". Nous avions alors critiqué le caractère hâtif des scissions basées sur des divergences apparemment non fondamentales et qui n'avaient pas eu l'occasion d'être clarifiées par un débat interne approfondi. En règle générale, le CCI est opposé aux "scissions" sans principes basées sur des divergences secondaires (même lorsque les militants concernés posent ensuite leur candidature au CCI, comme ce fut le cas d'Aberdeen). Toute scission sur des questions secondaires relève en réalité d'une conception monolithique de l'organisation qui ne tolère aucune discussion ni divergence au sein de celle-ci. C'est le cas typique des sectes.
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [28]