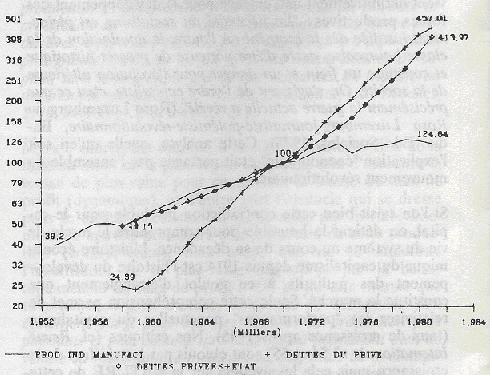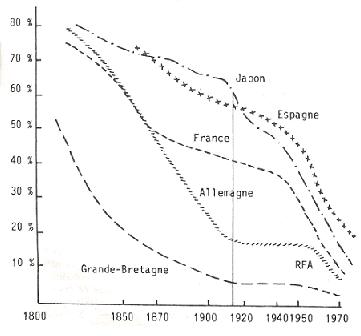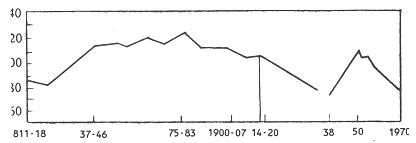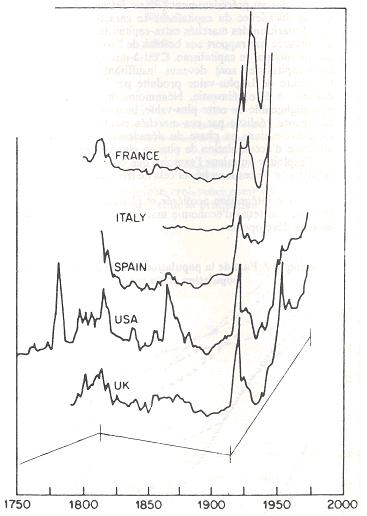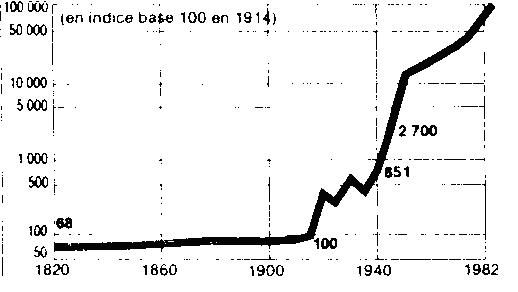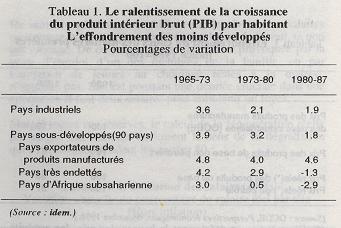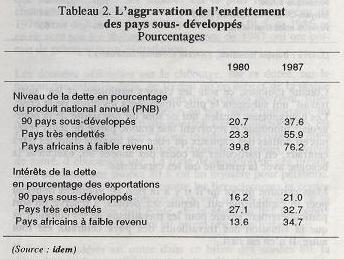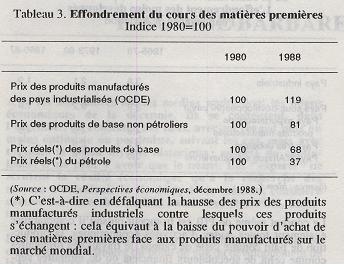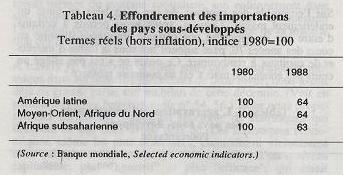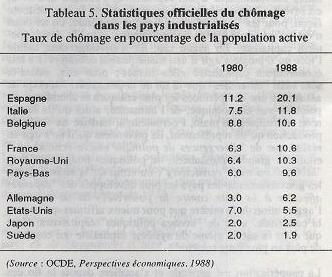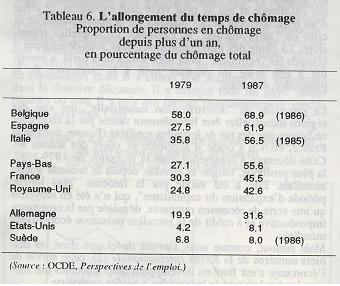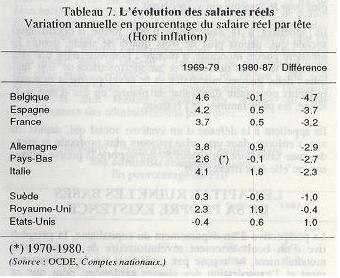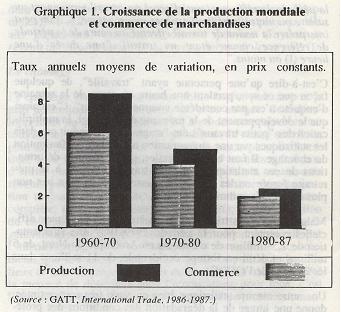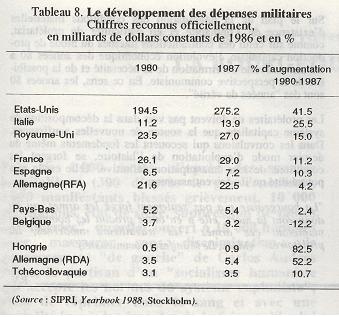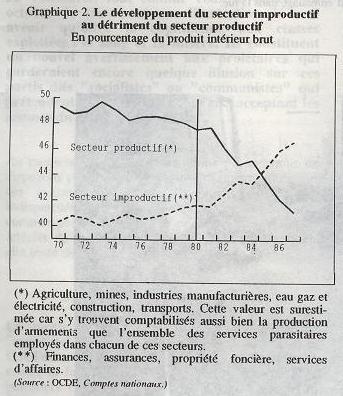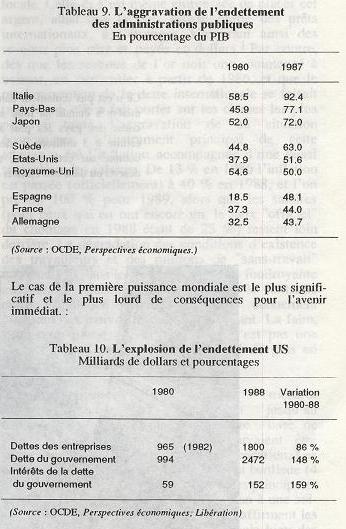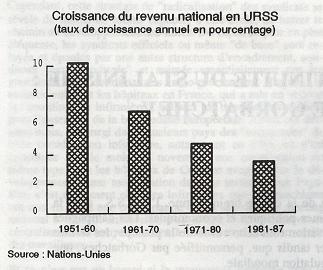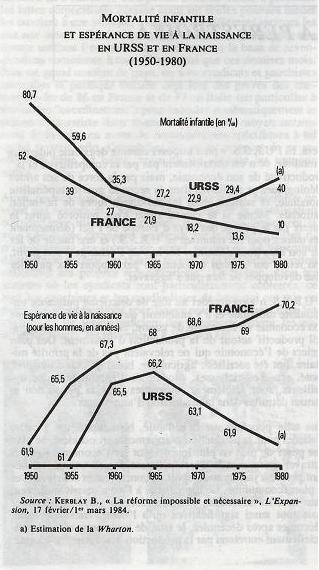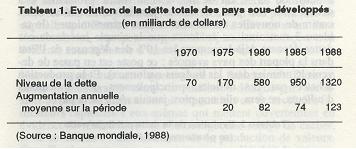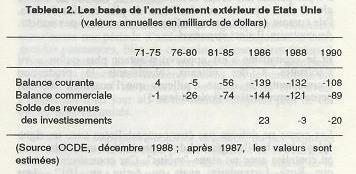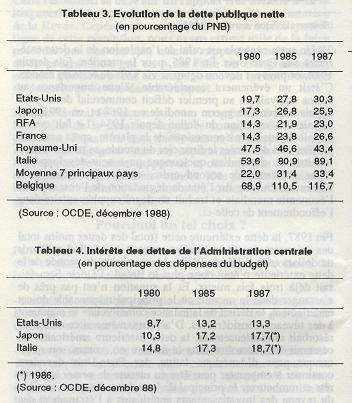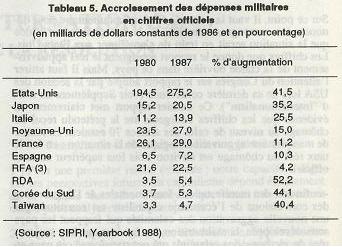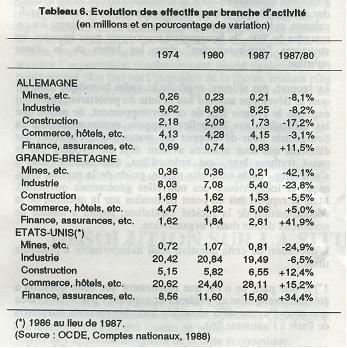Revue Int. 1989 - 56 à 59
- 3867 reads
Revue Internationale no 56 - 1e trimestre 1989
- 2794 reads
Editorial : FRANCE : les "coordinations" à l'avant-garde du sabotage des luttes
- 2671 reads
Les mouvements sociaux qui agitent la France depuis plusieurs mois dans presque toutes les branches du secteur public constituent une illustration éclatante de la perspective mise en avant par le CCI depuis de nombreuses années : face aux attaques de plus en plus brutales et massives d'un capital plongé dans une crise insurmontable (voir dans ce n° l'article sur la situation économique), la classe ouvrière mondiale n'est pas résignée, bien au contraire. Le profond mécontentement qu'elle a accumulé se transforme maintenant en une énorme combativité qui contraint la bourgeoisie à déployer des manoeuvres de plus en plus vastes et subtiles pour ne pas être débordée. Ainsi en France, elle a mis en oeuvre un plan très élaboré qui faisait appel non seulement aux différentes formes de syndicalisme (syndicalisme "traditionnel" et syndicalisme "de base") mais encore et surtout à des organes qui se prétendent encore plus "à la base" (puisqu'ils sont sensés s'appuyer sur les assemblées générales de travailleurs en lutte), les "coordinations", dont l'utilisation dans le sabotage des luttes ne va pas s'arrêter de sitôt.
Jamais, depuis de nombreuses années, "rentrée sociale" en France n'avait été aussi explosive que celle de l'automne 88. Depuis le printemps, il était clair que d'importants affrontements de classe se préparaient. Les luttes qui s'étaient déroulées entre mars et mai 88 dans les entreprises "Chausson" (construction de camions) et SNECMA (moteurs d'avions) avaient fait la preuve que la période de relative passivité ouvrière qui avait suivi la défaite de la grève dans les chemins de fer en décembre 86 et janvier 87 était bien terminée. Le fait que ces mouvements aient éclaté et se soient développés alors que se déroulaient les élections présidentielles et législatives (pas moins de 4 élections en deux mois) était particulièrement significatif dans un pays où traditionnellement ce type de période est synonyme de calme social. Et cette fois-ci, le Parti socialiste revenu au pouvoir ne pouvait espérer aucun "état de grâce" comme en 81. D'une part les ouvriers avaient déjà appris entre 81 et 86 que l'austérité "de gauche" ne vaut pas mieux que celle "de droite". D'autre part, dès son installation, le nouveau gouvernement avait clairement mis les points sur les i : il était hors de question de remettre en cause la politique économique appliquée par la droite durant les deux années précédentes. Et elle avait mis à profit les mois d'été pour aggraver cette politique.
C'est pour cela que la combativité ouvrière que le cirque électoral du printemps avait partiellement paralysée ne pouvait manquer d'exploser dès l'automne en des luttes massives, en particulier dans le secteur public où les salaires avaient baissé de près de 10% en quelques années. La situation était d'autant plus menaçante pour la bourgeoisie que depuis les années du gouvernement PS-PC (81-84), les syndicats avaient subi un discrédit considérable et n'étaient plus en mesure dans beaucoup de secteurs de contrôler à eux seuls les explosions de colère ouvrière. C'est pour cette raison qu'elle a mis en place un dispositif visant à émietter, à disperser les combats de classe, où évidemment les syndicats avaient leur place, mais dont le premier rôle serait tenu pendant toute la phase initiale par des organes "nouveaux", "non syndicaux", "vraiment démocratiques" : les "coordinations".
UNE NOUVELLE ARME DE LA BOURGEOISIE CONTRE LA CLASSE OUVRIERE : LES "COORDINATIONS"
Le terme de "coordination" a été employé déjà en de multiples reprises ces dernières années dans différents pays d'Europe. Ainsi nous avons connu, au milieu des années 80 en Espagne, une "Coordinadora de Estibadores" (Coordination de dockers) ([1] [1]) dont le langage radical et la très grande ouverture (notamment en permettant aux révolutionnaires d'intervenir dans ses assemblées) pouvait faire illusion, mais qui n'était pas autre chose qu'une structure permanente du syndicalisme de base. De même, nous avons vu se constituer en Italie, au cours de l'été 87, un "Coordinamento di Macchinisti" (Coordination des conducteurs de train), qui s'est révélé rapidement comme étant de même nature. Mais la terre d'élection des "coordinations" est incontestablement, à l'heure actuelle, la France où, depuis l'hiver 86-87, toutes les luttes ouvrières importantes ont vu se manifester des organes portant ce nom :
- "coordinations" des "agents de conduite" (dite de Paris-Nord) et "intercatégorielle" (dite de Paris Sud-Est) lors de la grève dans les chemins de fer en décembre 86 ([2] [2]);
- "coordination des instituteurs" lors de la grève de cette catégorie en février 87 ;
- "coordination Inter-SNECMA" lors de la grève dans cette entreprise au printemps 88 ([3] [3]).
Parmi ces différentes "coordinations", certaines sont de simples syndicats, c'est-à-dire des structures permanentes prétendant représenter les travailleurs dans la défense de leurs intérêts économiques. Par contre, d'autres de ces organes n’on pas à priori la vocation de se maintenir de façon permanente? Ils surgissent, ou apparaissent au grand jour, au moment des mobilisations de la classe ouvrière dans un secteur et disparaissent avec elles. Il en a été ainsi, par exemple des coordinations qui avaient surgi lors de la grève dans les chemins de fer en France fin 86. Et c'est justement ce caractère "éphémère" qui, en donnant l'impression qu'ils sont des organes constitués par la classe spécifiquement pour et dans la lutte, qui les rend d'autant plus pernicieux.
En réalité, l'expérience nous a montré que de tels organes, quand ils n'étaient pas préparés de longs mois à l'avance par des forces politiques précises de la bourgeoisie, étaient "parachutés" par celles-ci sur un mouvement de luttes en vue de son sabotage. Déjà dans la grève des chemins de fer en France, nous avions pu constater comment la "coordination des agents de conduite", en fermant complètement ses assemblées à tous ceux qui n'étaient pas conducteurs, avait contribué de façon très importante à l'isolement du mouvement et à sa défaite. Or cette "coordination" s'était constituée sur la base de délégués élus par les assemblées générales des dépôts. Pourtant, elle avait été immédiatement contrôlée par des militants de la "Ligue Communiste" (section de la 4ème Internationale trotskiste) qui, évidemment, ont pris en charge le sabotage de la lutte comme c'est leur rôle. Mais avec les autres "coordinations" qui ont surgi par la suite, déjà avec la "coordination inter catégorielle des cheminots" (qui prétendait combattre l'isolement corporatiste), et plus encore avec la "coordination des instituteurs" qui est apparue quelques semaines après, on a constaté que ces organes étaient constitués de façon préventive avant que les assemblées générales n'aient commencé à envoyer des délégués. Et à l'origine de cette constitution on retrouvait toujours une force bourgeoise de gauche ou gauchiste preuve que la bourgeoisie avait compris le parti qu'elle pouvait tirer de ces organismes.
Mais l'illustration la plus claire de cette politique bourgeoise nous a été donnée par la constitution et les agissements de la "Coordination Infirmière" à qui la bourgeoisie a confié le rôle principal dans la première phase de sa manoeuvre : le déclenchement de la grève dans les hôpitaux en octobre 88. En fait cette "coordination" avait été constituée dès mars 88, dans les locaux du syndicat socialisant CFDT, par des militants de celui-ci. Ainsi, c'est directement le Parti socialiste, qui s'apprêtait à revenir au pouvoir, qui a porté sur les fonts baptismaux cette soi-disant organisation de lutte des travailleurs. Le déclenchement de la grève elle-même porte la marque de l'action du parti socialiste et donc du gouvernement. Il s'agissait pour la bourgeoisie (non pas ses forces d'appoint comme les gauchistes, mais directement ses forces dominantes, celles qui se trouvent au sommet de l'Etat) de lancer un mouvement de lutte dans un secteur particulièrement arriéré sur le plan politique afin de pouvoir "mouiller la poudre" du mécontentement qui s'accumulait depuis des années dans l'ensemble de la classe ouvrière. Il est clair que les infirmières qui allaient involontairement constituer l'infanterie de cette manoeuvre bourgeoise avaient elles aussi de réelles raisons d'exprimer leur mécontentement (des conditions de travail invraisemblables qui ne cessaient de s'aggraver et des salaires de misère). Mais l'ensemble des événements qui se sont déroulés sur plus d'un mois permet de mettre en évidence la réalité du plan bourgeois destiné à établir un contre-feu face à la montée du mécontentement ouvrier.
LES AGISSEMENTS DES "COORDINATIONS" DANS LA GREVE DES HOPITAUX EN FRANCE
En choisissant les infirmières pour développer sa manoeuvre, la bourgeoisie savait ce qu'elle faisait. C'est un secteur parmi les plus corporatistes qui soient, où le niveau de diplômes et de qualification requis a permis l'introduction de préjugés très forts et un certain mépris vis-à-vis d'autres personnels hospitaliers (aides soignantes, ouvriers de l'entretien, etc.) considérés comme "subalternes". De plus, en France, l'expérience de lutte est très faible dans ce secteur. L'ensemble de ces éléments donnait à la bourgeoisie la garantie qu'elle pourrait contrôler globalement le mouvement sans crainte de débordements significatifs, et en particulier que les infirmières ne pourraient en aucune façon constituer le fer de lance de l'extension des luttes.
Cette garantie était renforcée par la nature et la forme des revendications mises en avant par la "Coordination infirmière". Parmi celles-ci, la revendication d'un "statut" et de la "revalorisation de la profession" recouvrait en réalité la volonté de mettre en avant la "spécificité" et la "qualification particulière" des infirmières vis-à-vis des autres travailleurs de l'hôpital. De plus cette revendication contenait l'exigence répugnante de n'accepter dans les écoles d'infirmières que des élèves ayant leur baccalauréat. Enfin, dans la même démarche élitiste, la revendication d'une augmentation de 2 000 francs par mois (qui représentait de 20 à 30 %) était rattachée au niveau d'études des infirmières (baccalauréat < plus 3 ans), ce qui voulait dire que les autres travailleurs hospitaliers moins qualifiés, et encore moins payés, n'avaient aucune raison d'avoir les mêmes exigences et cela d'autant plus que, sans le prendre officiellement à son compte évidemment, la "Coordination" faisait et laissait dire qu'il ne fallait pas que les autres catégories revendiquent des augmentations de salaire car cela serait déduit des augmentations des infirmières.
Un autre indice de la manoeuvre est le fait que c'est dès le mois de juin que le noyau initial de la "Coordination infirmière" a planifié le début du mouvement pour le 29 septembre avec une journée de grève et une grande manifestation dans la capitale. Cela donnait le temps à la "Coordination" de bien se structurer et d'élargir son assise avant l'épreuve du feu. Ce renforcement de la capacité de contrôle des travailleurs par la "Coordination" s'est poursuivi dès la fin de la manifestation par une assemblée de plusieurs milliers de personnes où les membres de sa direction se sont présentés pour la première fois en public. Cette assemblée a constitué une première légitimation a posteriori de la "Coordination" où elle a "magouillé" du mieux possible pour empêcher que la grève ne démarre immédiatement, tant qu'elle n'aurait pas bien "les choses en main". Elle lui a permis également de bien affirmer sa "spécificité infirmière", notamment en "encourageant" les autres catégories qui avaient participé à la manifestation (preuve de l'énorme "ras-le-bol" existant), et qui se trouvaient dans la salle, à créer leurs "propres coordinations". Ainsi était mis en place le dispositif qui allait permettre un émiettement systématique de la lutte au sein des hôpitaux, de même que son isolement à l'intérieur de ce secteur. Les "coordinations" qui allaient se créer à partir du 29 septembre dans la foulée de la "Coordination infirmière" (pas moins de 9 dans le seul secteur de la santé) se sont chargées de compléter le travail de division de celle-ci parmi les hospitaliers, alors qu'il revenait à une "coordination des personnels de santé" (créée et contrôlée par le groupe trotskiste "Lutte ouvrière"), qui se voulait "ouverte" à toutes les catégories, d'encadrer les travailleurs qui rejetaient le corporatisme des autres "coordinations" et de paralyser toute tentative de leur part d'élargir le mouvement en dehors de l'hôpital.
Le fait que ce soit une "coordination" et non un syndicat qui ait lancé le mouvement (alors qu'elle avait été constituée par des syndicalistes), n'est évidemment pas le fait du hasard. En réalité, c'était le seul moyen permettant une mobilisation importante compte tenu du discrédit considérable que subissent en France les syndicats, notamment depuis le gouvernement de la "gauche unie" entre 1981 et 1984. Ainsi, les "coordinations" ont comme fonction d'assurer cette "mobilisation massive" qui est ressentie par tous les ouvriers comme une nécessité pour faire reculer la bourgeoisie et son gouvernement. Cette mobilisation massive, il y a un bon moment déjà que les syndicats ne l'obtiennent plus derrière leurs "appels à la lutte". En fait, dans de nombreux secteurs, il suffit souvent qu'une "action" soit appelée par tel ou tel syndicat, pour qu'un nombre important d'ouvriers considère que c'est une manoeuvre destinée à servir les intérêts de chapelle de ce syndicat et décide de s'en détourner. Cette méfiance, et le faible écho que rencontrent les appels syndicaux, ont d'ailleurs été souvent employés par la propagande bourgeoise pour faire entrer dans la tête des ouvriers l'idée d'une "passivité" de la classe ouvrière en vue de développer en son sein un sentiment d'impuissance et de démoralisation. Ainsi, seul un organisme ne portant pas l'étiquette syndicale était en mesure d'obtenir au sein de la corporation choisie par la bourgeoisie comme principal terrain de sa manoeuvre, une "unité", condition d'une participation massive derrière ses appels. Mais cette "unité" que la "Coordination infirmière" prétendait être seule à garantir contre les habituelles "chamailleries" entre les différents syndicats n'était que le revers de l'écoeurante division qu'elle a promue et renforcée parmi les travailleurs de l'hôpital. L'"anti-syndicalisme" qu'elle a affiché s'accompagnait de l'argument crapuleux suivant lequel les syndicats ne défendent pas les intérêts des travailleurs justement parce qu'ils sont organisés non par profession mais par secteur d'activité. Un des thèmes majeurs mis en avant par la "Coordination" pour justifier l'isolement corporatiste était que les revendications unitaires avaient pour résultat de "diluer" et "d'affaiblir" les revendications "propres" aux infirmières. Cet argument n'est pas nouveau. Il nous a notamment été servi lors de la grève des chemins de fer de décembre 86 par la "coordination des agents de conduite". On le retrouve également dans le discours corporatiste tenu par le "Coordinamento di Macchinisti" dans les chemins de fer italiens en 87. En fait, au nom de la "remise en cause" ou du "dépassement" des syndicats on en revient ici à une base d'organisation qui appartenait à la classe ouvrière au siècle dernier, lorsqu'elle a commencé par constituer des syndicats de métier, mais qui dans la période actuelle ne peut être moins bourgeoise que les syndicats eux-mêmes. Alors que la seule base sur laquelle peut aujourd'hui s'organiser la classe ouvrière est la base géographique, par-delà les distinctions entre entreprises et branches d'activité (distinctions que les syndicats ne cessent évidemment de cultiver dans leur travail de division et de sabotage des luttes), un organisme qui se constitue spécifiquement sur la base de la profession ne peut se situer que dans le camp bourgeois.
On voit ainsi le piège dans lequel les "coordinations" se proposent d'enfermer les ouvriers : ou bien ils "marchent" derrière les syndicats (et dans les pays où il existe le "pluralisme syndical" ils deviennent les otages des différents gangs qui entretiennent leurs divisions) ou bien ils se détournent des syndicats mais c'est pour se diviser d'une autre façon. En fin de compte les "coordinations" ne sont pas autre chose que le complément des syndicats, l'autre mâchoire de l'étau qui vise à emprisonner la classe ouvrière.
LE PARTAGE DU TRAVAIL ENTRE LES "COORDINATIONS" ET LES SYNDICATS
Cette complémentarité entre le travail des syndicats et celui des "coordinations" s'est révélée de façon claire dans les deux mouvements les plus importants qui se sont déroulés en France ces deux dernières années : dans les chemins de fer et dans les hôpitaux. Dans le premier cas, le rôle des "coordinations" s'est réduit essentiellement à "contrôler le terrain" en laissant le soin aux syndicats de mener les négociations avec le gouvernement. En cette circonstance elles ont d'ailleurs joué un rôle utile de rabatteurs pour le compte des syndicats en affirmant bien fort qu'elles ne leur contestaient nullement la responsabilité de "représenter" les travailleurs auprès des autorités (elles ont tout juste réclamé sans succès d'avoir un petit strapontin à la table de négociation). Dans le second cas, alors que les syndicats étaient bien plus contestés, la "Coordination infirmière" a été finalement gratifiée d'une place à part entière à cette même table. Après que le ministre de la santé ait au début refusé de la recevoir (à l'issue de la première manifestation du 29 septembre), c'est par la suite le premier ministre lui-même qui, le 14 octobre, après une manifestation rassemblant près de 100 000 personnes à Paris, lui a accordé cette faveur. C'était la moindre des récompenses que le gouvernement pouvait donner à ces gens qui lui rendaient de si fiers services. Mais le partage des tâches s'est également réalisé en cette circonstance : finalement, ce 14 octobre les syndicats (à l'exception du plus "radical", la CGT contrôlée par le PC) ont signé un accord avec le gouvernement alors que la "coordination" continuait à appeler à la lutte. Soucieuse d'apparaître jusqu'au bout comme un "véritable défenseur" des travailleurs, elle n'a jamais officiellement accepté les propositions du gouvernement. Le 23 octobre, elle a enterré le mouvement à sa façon en appelant à la "poursuite de la lutte sous d'autres formes" et en organisant de temps en temps des manifestations où l'assistance de moins en moins nombreuse ne pouvait que démobiliser les travailleurs. Cette démobilisation résultait également du fait que le gouvernement, s'il n'avait rien donné aux autres catégories d'hospitaliers et s'il avait refusé toute augmentation d'effectif du personnel infirmier (une des revendications importantes), avait accordé à celui-ci des augmentations de salaire non négligeables (de l'ordre de 10 %) sur des fonds (1,4 milliard de francs) qui d'ailleurs étaient déjà prévus à l'avance dans le Budget. Cette "demi-victoire" des seules infirmières (prévue et planifiée depuis longtemps par la bourgeoisie : on avait pu voir l'ancien ministre de la santé participer aux manifestations de la "Coordination" et même Mitterrand avait déclaré que les revendications des infirmières étaient "légitimes") présentait le double avantage d'aggraver encore la division entre les différentes catégories de travailleurs de l'hôpital et d'accréditer l'idée qu'en se battant sur un terrain corporatiste, notamment derrière une "coordination", on pouvait obtenir quelque chose.
Mais la manoeuvre bourgeoise visant à désorienter l'ensemble de la classe ouvrière ne s'arrêtait pas avec la reprise du travail dans les hôpitaux. La dernière phase de l'opération débordait largement le secteur de la santé et appartenait pleinement aux syndicats que le travail des coordinations avait remis en selle. Alors que pendant toute la montée du mouvement dans la santé, les syndicats et les groupes "gauchistes" avaient fait tout leur possible pour empêcher le démarrage de grèves dans d'autres secteurs (notamment dans les postes où la volonté de lutte était très forte), à partir du 14 octobre, ils ont commencé à appeler à la mobilisation et à la grève un peu partout. C'est ainsi que le 18 octobre la CGT a convoqué une "journée d'action inter catégorielle" et que le 20 octobre les autres syndicats, rejoints au dernier moment par la CGT, ont appelé à une journée d'action dans la fonction publique. Par la suite, les syndicats, et en première ligne la CGT, ont commencé à appeler systématiquement à la grève dans les différentes branches du secteur public, les unes après les autres : postes, électricité, chemins de fer, transports urbains des villes de province puis de la capitale, transports aériens, sécurité sociale... Il s'agit pour la bourgeoisie d'exploiter à fond la désorientation créée dans la classe ouvrière par le mouvement dans les hôpitaux au moment de son reflux, pour déployer sa manoeuvre dans tous les autres secteurs. On assiste à une "radicalisation" des syndicats - CGT en tête - qui font de la "surenchère" par rapport aux "coordinations" en appelant à "l'extension", qui organisent, là où ils conservent une influence suffisante, des grèves "jusqu'auboutistes" et minoritaires, faisant appel à des "actions de commando" (comme parmi les conducteurs des camions des postes qui ont bloqué les centres de tri) ce qui a pour effet de les isoler encore plus. A l'occasion, d'ailleurs, les syndicats n'hésitent pas à se coiffer ouvertement de la casquette des "coordinations" lorsque cela peut "aider" comme ce fut le cas aux postes où la CGT a créé la sienne.
Ainsi, le partage des tâches entre "coordinations" et syndicats couvre tout le champ social : aux premières il revenait de lancer et de contrôler à la base le mouvement "phare", le plus massif, celui de la santé ; aux seconds, après qu'ils aient négocié de façon "positive" avec le gouvernement dans cette branche, il revient maintenant la responsabilité de compléter le travail dans les autres catégories du secteur public. Et en fin de compte, l'ensemble de la manoeuvre a réussi puisque, aujourd'hui, la combativité ouvrière se retrouve dispersée en de multiples foyers de lutte isolés qui ne pourront que l'épuiser, ou paralysée chez les ouvriers qui refusent de se laisser entraîner dans les aventures de la CGT.
QUELLES LEÇONS POUR LA CLASSE OUVRIERE ?
Alors que, deux mois après le début du mouvement dans les hôpitaux, les grèves se poursuivent encore en France dans différents secteurs, ce qui met bien en évidence les énormes réserves de combativité qui s'étaient accumulées dans les rangs ouvriers, les révolutionnaires peuvent déjà en tirer un certain nombre d'enseignements pour l'ensemble de la classe.
En premier lieu, il importe de souligner la capacité de la bourgeoisie d'agir de façon préventive et en particulier de "susciter le déclenchement de mouvements sociaux de façon prématurée lorsqu'il n'existe pas encore dans l'ensemble du prolétariat une maturité suffisante permettant d'aboutir à une réelle mobilisation. Cette tactique a déjà été souvent employée dans le passé par la classe dominante, notamment dans des situations où les enjeux étaient encore bien plus cruciaux que ceux de la période actuelle. L'exemple le plus marquant nous est donné par ce qui s'est passé à Berlin en janvier 1919 où, à la suite d'une provocation délibérée du gouvernement social-démocrate, les ouvriers de cette ville s'étaient soulevés alors que ceux de la province n'étaient pas encore prêts à se lancer dans l'insurrection. Le massacre de prolétaires (ainsi que la mort des deux principaux dirigeants du Parti communiste d'Allemagne : Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht) qui en a résulté a porté un coup fatal à la Révolution dans ce pays où, par la suite, la classe ouvrière a été défaite paquet par paquet.
Aujourd'hui et dans les années à venir, cette tactique visant à prendre les devants pour battre les ouvriers paquet par paquet sera systématiquement employée par la bourgeoisie alors que la généralisation des attaques économiques du capital commande une riposte de plus en plus globale et unie de la part de la classe ouvrière. L'exigence de l'unification des luttes qui est ressentie de façon croissante par les ouvriers est appelée à se heurter à une multitude de manoeuvres, impliquant un partage des tâches entre toutes les forces politiques de la bourgeoisie, et particulièrement la Gauche, les syndicats et les organisations gauchistes, visant à diviser la classe ouvrière et à émietter son combat. Ce que nous confirment les événements récents en France, c'est que parmi les armes les plus dangereuses mises en oeuvre par la bourgeoisie dans la conduite de cette politique, il faut ranger les "coordinations" dont l'utilisation se fera de plus en plus fréquente à mesure que se développera le discrédit des syndicats et la volonté des ouvriers de prendre en main leurs luttes.
Face aux manoeuvres de la bourgeoisie visant à chapeauter les luttes par ces fameuses "coordinations", il appartient à la classe ouvrière de comprendre que sa force véritable ne provient pas de ces prétendus organes de "centralisation" mais, en premier lieu, de ses assemblées générales à la base. La centralisation du combat de classe constitue un élément important de sa force, mais une centralisation précipitée, lorsqu'à la base n'existe pas un niveau suffisant de prise en main de la lutte par l'ensemble des travailleurs, lorsque ne«se manifestent pas des tendances significatives à l'extension, ne peut aboutir qu'au contrôle de l'ensemble du mouvement par des forces bourgeoises (en particulier les organisations gauchistes) et à son isolement, c'est-à-dire, deux éléments de sa défaite. L'expérience historique a démontré que plus on s'élève dans la pyramide des organes créés par la classe pour centraliser son combat, que plus on s'éloigne du niveau où l'ensemble des ouvriers peut s'impliquer directement dans celui-ci, et plus les forces de gauche de la bourgeoisie ont le jeu facile pour établir leur contrôle et développer leurs manoeuvres. Cette réalité on a pu la constater même dans des périodes révolutionnaires. C'est ainsi qu'en Russie, durant la plus grande partie de l'année 1917, le Comité exécutif des soviets a été contrôlé par les mencheviks et les socialistes révolutionnaires ce qui a conduit les bolcheviks pendant toute une période à insister pour que les soviets locaux ne se sentent pas liés par la politique menée par cet organe de centralisation. De même, en Allemagne, en novembre 1918, le Congrès des Conseils ouvriers ne trouve rien de mieux à faire qu'à remettre tout le pouvoir aux sociaux-démocrates passés à la bourgeoisie, prononçant ainsi l'arrêt de mort de ces mêmes conseils.
Cette réalité, la bourgeoisie l’a parfaitement comprise. C'est pour cela qu'elle va systématiquement susciter l'apparition d'organes de "centralisation" qu'elle pourra facilement contrôler en l'absence d'une expérience et d'une maturité suffisantes de la classe. Et pour mieux se garantir, elle va le plus souvent possible, notamment par l'entremise de ses forces gauchistes, fabriquer à l’avance de tels organes qui vont par la suite se faire "légitimer" par des simulacres d'assemblées générales empêchant de cette façon que celles-ci ne créent elles-mêmes de véritables organes de centralisation : comités de grève élus et révocables au niveau des entreprises, comités centraux de grève au niveau des villes, des régions, etc.
Les luttes récentes en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe, ont fait la preuve que, quoi qu'en puissent dire les éléments conseillistes-ouvriéristes qui aujourd'hui se pâment devant les "coordinations", la classe ouvrière n'a pas encore atteint à l'heure actuelle la maturité suffisante lui permettant de constituer des organes de centralisation de ses luttes à l'échelle de tout un pays comme se proposent de le faire les "coordinations". Elle ne pourra pas prendre de raccourci et sera contrainte de déjouer pendant une longue période tous les pièges et obstacles que la bourgeoisie dispose devant elle. Elle devra en particulier poursuivre l'apprentissage de l'extension de ses luttes et d'une réelle prise en main de celles-ci à travers les assemblées générales souveraines sur les lieux de travail. Le chemin est encore long pour le prolétariat, mais il n'en existe pas d'autre.
FM. 22-11-88
Géographique:
- France [7]
Heritage de la Gauche Communiste:
Où en est la crise économique ? De la crise du crédit a la crise monétaire et a la récession ou le crédit n'est pas une solution
- 2644 reads
Un an après l'effondrement boursier d'octobre 1987 qui vit partir en fumée près de 2 000 milliards de dollars de capitaux spéculatifs (soit l'équivalent de près de 400 dollars par être humain), le capitalisme mondial semblerait en bonne santé : l'année 1988 s'annoncerait même, d'après les estimations actuelles, la meilleure depuis le début des années 80. Mais les années 1973 et 1978-79 qui ont précédé les grandes récessions de 1974-75 et 1980-82 furent aussi les plus brillantes en leur temps. La fuite dans le crédit n'est pas une solution éternelle. Ce qui s'annonce dans "l’euphorie" actuelle c'est une convulsion monétaire avec au bout une nouvelle récession mondiale.
D'ailleurs au lendemain même des élections américaines, le langage des propagandes officielles commence déjà à changer et le triomphalisme cède le pas aux appels à la prudence.
- "La fin du mandat Reagan est caractérisée par une expansion persistante depuis maintenant six ans, la plus longue de l’histoire américaine en temps de paix... En valeur absolue le déficit américain peut paraître important. Mais, comme le pays produit le quart du PNB mondial, le déficit américain est, en pourcentage, inférieur à la moyenne OCDE... La 'crise des déficits' américains est une astuce des relations publiques employée par l’establishment républicain traditionnel pour purger le parti d'hommes politiques populaires... Ce qu'il faut, c'est un système monétaire qui empêche les banques centrales de mettre en danger la prospérité économique." (P.C. Roberts, professeur au Centre d'études stratégiques, USA, un des théoriciens de la dite "économie de l'offre" ou "reaganomics")([1] [9]).
En d'autres termes, ce que disent certains économistes, c'est que les gigantesques déficits et l'endettement massif du capital américain ne constituent pas des problèmes majeurs. Les inquiétudes que le développement vertigineux de ces phénomènes soulève, seraient sans fondement réel et traduiraient tout au plus des "astuces" liées à des guerres de clans parmi les politiciens américains. Derrière cette affirmation d'autruche se trouve en fait posée la question de savoir si la fuite en avant dans le crédit ne serait pas, finalement, un remède éternel, un moyen de permettre à l'économie capitaliste de poursuivre, à condition que les autorités monétaires aient une politique adaptée, un développement ininterrompu : "L'expansion persistante... la plus longue de l'histoire américaine en temps de paix" confirmerait une telle possibilité.
En réalité, les fameuses six années d"'expansion" de l'économie américaine qui ont provisoirement empêché l'effondrement total de l'économie mondiale ([2] [10]) n'ont pas été le fruit d'une nouvelle découverte économique. Elles étaient une continuation de la vieille politique keynésienne de déficits étatiques et de la fuite en avant dans l'endettement. Et, contrairement à ce qu'affirme notre éminent professeur, l'ampleur de cet endettement - produit d'une véritable explosion du recours au crédit au cours des dernières années - loin d'être une question sans importance, pose DES A PRESENT des problèmes énormes aussi bien au capital américain qu'à l'économie mondiale et ouvre à brève échéance la perspective d'une nouvelle récession mondiale.
LES EFFETS DEVASTATEURS DE L'EXCES DE CREDIT
- "En 1987, l'Amérique importait près de deux fois plus qu'elle n'exportait. Elle dépensait 150 milliards de dollars de plus, dans les autres pays, qu'elle ne gagnait, et le gouvernement fédéral dépensait 150 milliards de dollars de plus sur le marché intérieur qu'il n'engrangeait de recettes fiscales. Les Etats-Unis comptant environ 75 millions de ménages, chacun d'entre eux a ainsi dépensé l'an dernier 2 000 dollars (12 500 F) de plus qu'il n'a gagné en moyenne et a emprunté le solde à l'étranger. " ([3] [11])
Les statistiques sont cette science qui permet d'affirmer que lorsqu'un bourgeois possède cinq automobiles et que sou voisin chômeur n'en possède aucune, ce dernier en possède tout de même deux et demie. La moyenne de dépenses à crédit pour chaque ménage américain n'est qu'une moyenne, mais elle donne une image de l'ampleur du phénomène de recours au crédit qui a caractérisé le capitalisme américain au cours des dernières années.
Cette situation a, dès à présent, des conséquences particulièrement significatives de l'état d'empoisonnement de la machine capitaliste aussi bien aux Etats-Unis que dans le reste du monde.
Aux Etats-Unis
L'année 1988, outre le record d'endettement global du capital américain, a vu trois autres records historiques particuliers être battus :
- le record de faillites bancaires : en octobre 1988 le nombre de ces faillites avait déjà pulvérisé le record de 1987;
- le record de paiement des autorités fédérales pour indemniser les clients de caisses d'épargnes en faillite;
- le record de la masse d'intérêts payés par le trésor américain sur sa dette : "D'un moment à l'autre, les comptables du gouvernement US enregistreront un moment remarquable dans les comptes fédéraux : les intérêts que le Trésor paie sur les 2 000 milliards de dollars de la dette nationale sont sur le point de dépasser le montant de l'énorme déficit du budget. Le gouvernement US paie quelques 150 milliards de dollars par an en intérêts, soit 14% du total de la dépense gouvernementale. De ces 150 milliards, de 10 à 15% vont aux investisseurs étrangers." (New York Times, 11 octobre 1988).
Cependant, l'effet immédiat le plus grave de cette course dans l'endettement est la hausse des taux d'intérêt qu'elle entraîne. Le Trésor américain a de plus en plus de mal a trouver de nouveaux prêteurs pour financer sa dette. Pour y parvenir il est contraint d'offrir des taux d'intérêts de plus en plus élevés. Le gouvernement avait été contraint de rabaisser ces taux en octobre 1987 pour freiner l'effondrement boursier, mais depuis lors, il a de nouveau été conduit à les remonter. Le taux des Bons du Trésor à trois mois est ainsi passé de 5,12 % fin octobre 87 à 7,20 en août 88.
Les conséquences immédiates sont déjà dévastatrices à deux niveaux. Premièrement, au niveau de la dette elle-même : étant donné l'ampleur de l'endettement, on estime qu'un point de plus des taux d'intérêt se traduit par 4 milliards de dollars de plus à payer par an par le capital américain. Deuxièmement, et surtout, la hausse des taux d'intérêt entraîne un freinage inévitable de la machine économique, c'est-à-dire annonce une récession à plus ou moins brève échéance.
Dans le monde
Mais le capital des Etats-Unis n'est pas le seul endetté dans le monde, loin s'en faut, même s'il est devenu le premier débiteur de la planète. La hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis entraîne celle des taux d'intérêt dans le monde entier. Pour les pays de la périphérie, depuis longtemps confrontés à l'incapacité de faire face à leurs dettes, en particulier ceux d'Afrique et d'Amérique latine, cela veut dire une augmentation immédiate des intérêts à débourser et donc de leur dette déjà faramineuse. Leur faillite chronique pousse déjà leurs taux d'inflation vers de nouveaux records. Pour le Brésil, par exemple, il est prévu une inflation de 820% pour l'année 1988. Sur le plan des investissements, ceux-ci connaissent déjà une chute vertigineuse et généralisée.
Pour les capitaux créanciers des Etats-Unis, ceux qui bénéficient théoriquement en premier des déficits US car ils y trouvent dans l'immédiat un débouché pour leurs exportations (Japon et Allemagne en particulier), ils se trouvent de plus en plus en possession de montagnes de "promesses de paiement" américaines, libellées en dollars, sous toutes sortes de formes : bons du Trésor, actions, obligations, etc. Cela fait beaucoup de richesse sur le papier, mais que devient cette masse de papier du moment que le capital américain ne parvient pas à payer ou si - on y reviendra plus loin - les USA dévaluent le dollar ?
La thèse des économistes qui prétendent que la fuite en avant dans le crédit, en particulier aux Etats-Unis, n'est pas une véritable menace pour le capital mondial, est un leurre que la réalité dément dès à présent par les effets dévastateurs qu'elle exerce, même sans tenir compte des perspectives qu'elle ouvre pour l'avenir.
LE CREDIT N'EST PAS UNE SOLUTION ETERNELLE
Le capitalisme a toujours eu recours au crédit pour assurer sa reproduction. Il constitue un élément fondamental de son fonctionnement en particulier au niveau de la circulation. Sa généralisation par le capital constitue un accélérateur de son processus d'accumulation et en tant que tel il est un instrument indispensable à son bon fonctionnement. Mais il ne joue ce rôle que dans la mesure où le capital fonctionne dans des conditions d'expansion réelles, c'est-à-dire, si au bout du retardement qu'il crée entre le moment de la vente et le moment du paiement, il existe un remboursement réel.
- "Le maximum que puisse faire le crédit dans ce domaine -qui concerne la seule circulation - c'est de sauvegarder la continuité du processus productif, A CONDITION qu'existent toutes les autres conditions de cette continuité, c'est-à-dire, qu'existe réellement le capital contre lequel il doit être échangé. " (Marx, Grundrisse).
Or, le problème pour le capitalisme actuellement, aussi bien aux USA qu'ailleurs, c'est que "le capital contre lequel (le crédit) doit être échangé", "les autres conditions de cette continuité du processus productif n'existent pas.
Contrairement à ce qui se produit dans des conditions de véritable expansion, le capital ne recourt pas aujourd'hui au crédit pour accélérer un processus productif sain, mais pour retarder les échéances d'un processus productif embourbé dans la surproduction et le manque de débouchés solvables. Depuis la fin des années 1950-60, depuis la fin du processus de reconstruction qui suivit la deuxième guerre mondiale, le capitalisme n'a survécu qu'en poussant les manipulations économiques de toutes sortes à des extrêmes insoupçonnables, mais il n'a pas pour autant résolu son impasse de fond. Au contraire il n'a fait, et ne fait, que l'aggraver.
LA POURSUITE DE LA FUITE EN AVANT
Aux Etats Unis. Au lendemain du "krach" d'octobre 1987 les USA n'ont eu d'autre solution que de poursuivre leur endettement. Certains économistes estiment que les Banques centrales des autres pays ont dû ainsi racheter pour près de 120 milliards de dollars.
Dans les pays moins développés. Certains économistes avaient parlé de faire des moratoires et d'annuler tout simplement la dette des pays les plus pauvres. Comme nous l'avions prévu dans le n° 54 de cette revue, cela s'est réduit essentiellement à des promesses verbales et à quelques miettes.
Il est vrai que l'annulation de l'obligation de rembourser les crédits éliminerait le problème. Mais cela reviendrait à faire du capitalisme un mode de production qui ne produit plus pour le profit... ce qui n'est plus du capitalisme. Non, la "solution" trouvée a été d'ouvrir de nouveaux crédits. On assiste ainsi à la fin de 1988 à une spectaculaire ouverture de nouveaux crédits à ces pays : de nouveaux rééchelonnements des dettes sont accordés et le Mexique s'est même vu accorder un prêt d'urgence, par les Etats-Unis : 3,5 milliards de dollars, le prêt le plus important accordé à un pays débiteur depuis 1982.
Dans les pays de l'Est L'URSS, après toute une période où elle s'est attachée à réduire son endettement, revient quémander des crédits aux puissances occidentales, Perestroïka aidant. Des consortiums bancaires en Italie, RFA, France et Grande Bretagne devraient permettre à Moscou d'obtenir environ 7 milliards de dollars de crédits. Il en est de même pour la Chine qui connaît une situation de plus en plus analogue à celle des pays d'Amérique latine (inflation galopante, demande de nouveaux crédits pour pallier l'incapacité de rembourser ceux contractés auparavant).
LES PERSPECTIVES
L'économie capitaliste ne va pas vers une crise du crédit. Elle est déjà entièrement plongée dans une telle crise. C'est sur le plan monétaire que celle-ci devrait désormais se manifester.
- "Le système monétaire est essentiellement catholique, le système de crédit essentiellement protestant... The Scotch hâte gold (l’Ecossais hait Vor). Sous la forme de papier, l’existence monétaire des marchandises est de nature purement sociale. C'est la FOI qui sauve : la foi en la valeur monétaire considérée comme l’esprit immanent des marchandises, la foi dans le mode de production et son ordre prédestiné, la foi dans les agents individuels de la production tenus pour de simples personnifications du capital qui croît de lui-même.. Pas plus que le protestantisme ne peut s'émanciper des fondements du catholicisme, le système du crédit ne peut s'émanciper des fondements du système monétaire." (Marx, Le Capital, III, "Circulation, crédit, change", XVIII, Ed. La Pléiade, t. II, 1265).
En ce sens, Roberts ressent quelque chose de juste quand il nie le problème d'un excès de crédit pour les Etats-Unis et ne voit que celui des limites monétaires imposées par les banques centrales.
Mais ce qu'il ne voit pas c'est que ce qui en découle n'est pas que les banques centrales devront créer plus de monnaie, mais qu'elles en ont déjà créé trop et que c'est dans le domaine de la monnaie, dans la perte de "la FOI" dans la monnaie (et en premier lieu celle dans laquelle se fait la quasi-totalité du commerce mondial, LE DOLLAR) que s'exprimera dans le prochain temps la crise de surproduction capitaliste (dont la crise du crédit n'est qu'une manifestation superficielle).
Le capital américain, pas plus que les autres capitaux, ne peut pas et ne pourra rembourser ses dettes. Mais il est le plus puissant des gangsters. Et il dispose des moyens de faire violemment "réduire" par la force sa dette - une fois de plus - par ses propres créanciers. Contrairement aux autres Etats du monde, les Etats-Unis sont les seuls à pouvoir payer leur dette avec leur propre monnaie (les autres doivent la payer en devises et en particulier en dollars). C'est pourquoi, tout comme en 1973 et en 1979, ils n'ont d'autre issue que la dévaluation du dollar.
Mais une telle perspective aujourd'hui est l'annonce directe d'un nouveau marasme monétaire mondial ouvrant la porte à une nouvelle récession qui sera autrement plus profonde que celles de 1974-75 et 1980-82.
La dévaluation du dollar constitue d'une part une "ruine" sur le plan financier pour les principaux capitaux créanciers des Etats-Unis, et en premier lieu du Japon et de l'Allemagne... qui n'y pourront rien et qui par là même ne pourront en aucun cas jouer le fameux rôle de "locomotive" pour remplacer celle, défaillante, des USA. Mais d'autre part, cela constitue une barrière douanière qui ferme l'accès du marché américain - celui qui a servi depuis six ans de "locomotive" - pour l'ensemble de l'économie mondiale.
Comme nous l'écrivions dans le n° 54 de cette revue, seule l'attente des élections américaines retardait le déclenchement d'un tel processus. Quelle que soit sa vitesse, il apparaît désormais en marche.
Les six dernières années ont traduit une ambiance particulièrement troublante. La crise de l'économie mondiale, loin de se résorber ou de disparaître n'a cessé de se développer en profondeur : poursuite de la croissance du chômage dans presque tous les pays, développement de la misère dans des proportions inconnues jusqu'à présent dans les zones les plus pauvres de la planète, désertification industrielle au coeur même des centres vitaux du capitalisme, paupérisation des classes exploitées dans les pays les plus industrialisés; au niveau financier ça a été l'explosion de l'endettement et les plus grandes secousses boursières depuis un demi-siècle, le tout pataugeant dans une frénésie spéculative sans précédent dans l'histoire. Cependant, la machine capitaliste ne s'est pas réellement effondrée. Malgré des records historiques de faillites, malgré des craquements de plus en plus puissants et fréquents, la machine à profits a continué de tourner, concentrant de nouvelles fortunes gigantesques - produit du carnage auquel se livrent les capitaux entre eux - et affirmant une arrogance cynique sur les bienfaits des lois "du libéralisme mercantile". "Les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres", constatent souvent les journalistes économiques, mais la machine "tourne" et les résultats de 1988, du moins dans les statistiques, s'annoncent les meilleurs de la décennie.
Plus grand monde ne croit réellement à la possibilité d'une nouvelle période de "prospérité" économique, comme celle des années 1950-60. Mais la perspective d'un nouvel effondrement capitaliste comme celui de 1974-75 ou de 1980-82 semblerait s'éloigner grâce aux multiples manipulations des gouvernements sur la machine économique. Ni réelle reprise, ni véritable effondrement : l'incertitude pour l'éternité.
Il n'en est rien. Jamais le système capitaliste ne fut aussi malade. Jamais son corps ne fut aussi empoisonné par les doses massives de drogues et de médicaments auxquelles il a dû avoir recours pour assurer sa médiocre et effroyable survie des six dernières années. Sa prochaine convulsion, qui une fois encore, combinera récession et inflation, n'en sera que plus violente, plus profonde et plus étendue mondialement.
Les forces destructrices et autodestructrices du capital se déchaîneront, une fois de plus, avec une violence sans précédent; mais cela provoquera l'indispensable ébranlement qui contraindra le prolétariat mondial à porter ses luttes à des niveaux supérieurs et à tirer profit de toute l'expérience accumulée en particulier au cours des dernières années.
20-11-88, RV.
[1] [12] Le Monde, 25 octobre 1988.
[2] [13] Pour une analyse de la réalité de cette "expansion" et de ses effets sur l'économie mondiale, voir "La perspective d'une récession n'est pas écartée, au contraire" dans la Revue Internationale n° 54, 3e trimestre 1988.
[3] [14] Stephen Marris, Le Monde, 25 octobre 1988
Récent et en cours:
- Crise économique [15]
Rubrique:
Algérie : la bourgeoisie massacre
- 2857 reads
Fin septembre et début octobre, l'Algérie a connu une vague sociale sans précédent dans son histoire depuis "l'Indépendance" de 1962. Dans les grandes villes et les centres industriels, grèves ouvrières massives et émeutes de la faim d'une jeunesse sans travail se sont succédé. Avec une barbarie inouïe, l'Etat "socialiste" algérien et le parti unique FLN ont massacré des centaines de jeunes manifestants. Cet Etat et ce parti, salués il y a 20 ans par les trotskystes et les staliniens comme "socialistes", ont opposé aux revendications "du pain et de la semoule" le plomb et la mitraille de l'armée. Assassinats, tortures, arrestations massives, état de siège et militarisation du travail, voilà la réponse de la bourgeoisie algérienne aux revendications des exploités.
1. Les grèves et les émeutes s'expliquent par la rapide détérioration de l'économie algérienne. Celle-ci, déjà en proie à la crise permanente des pays sous-développés s'effondre littéralement. La chute des cours du pétrole et du gaz algériens, dont le pays vit quasi exclusivement, l'épuisement de ces ressources vers l'an 2000, tout cela explique l'austérité draconienne des années 80. Comme la Roumanie de Ceausescu, l'Algérie de Chadli s'est engagée à rembourser sa dette auprès des banques mondiales, tâche à laquelle elle a travaillé activement. L'abandon du soutien de l'Etat à tous les secteurs (santé, alimentation, logement) s'est traduit par une situation effroyable pour les couches laborieuses. Des queues dès 6h du matin pour obtenir pain et semoule ; la viande introuvable, l'eau coupée pendant plusieurs mois ; l'impossibilité de trouver un logement, des salaires de misère bloqués, le chômage généralisé pour la jeunesse (65% des 23 millions d'habitants ont moins de 25 ans), tel est le résultat de 25 années de "socialisme" algérien, engendré par la lutte de "libération nationale". Face aux exploités, la bourgeoisie algérienne - parasitaire - se maintient totalement au travers d'une féroce dictature militaire. Les bureaucrates du FLN et les officiers de l'armée, qui ont la haute main sur l'appareil économique, vivent de spéculations, stockant les denrées alimentaires importées pour les revendre au prix fort sur le marché noir. Cela illustre toute la faiblesse de cette bourgeoisie. Si elle s'appuie de plus en plus sur le mouvement intégriste musulman qu'elle a encouragé ces dernières années, ce mouvement, - en dehors de fractions de la petite bourgeoisie et du lumpenprolétariat - est sans influence réelle sur la population ouvrière.
2. Le véritable sens des événements sociaux d'octobre, en réaction à la misère dramatique, c'est le surgissement net du prolétariat d'Algérie sur la scène sociale. Plus que lors des émeutes de 1980, 1985 et 1986, l'importance du mouvement ouvrier est incontestable. Dès fin septembre 88, des grèves éclataient dans toute la zone industrielle de Rouiba-Reghaia, à 30 km d'Alger, dont l'avant-garde est constituée des 13 000 ouvriers de la société nationale des véhicules industriels (ex-Berliet). De là, la grève s'étendait à toute la région d'Alger : Air Algérie, et surtout les postiers des FIT (Postes et télécommunications). Malgré la répression des ouvriers de Rouiba - arrosés par la police à coups de canon à eau - le mouvement s'étendait jusque dans les grandes villes de l'Est et de l'Ouest. En Kabylie, les tentatives de militaires et de policiers de dresser "Kabyles" contre "Arabes" - "ne soutenez pas les Arabes qui ne vous ont pas soutenu en 1985", claironnaient les voitures de police - n'ont rencontré que mépris et haine. Enfin, de façon significative, face aux grèves sauvages, le syndicat étatique UGTA a dû prendre ses distances avec le gouvernement, pour mieux prendre le "train en marche", et tenter de contrôler un tant soit peu le mouvement.
C'est dans ce contexte et cette ambiance qu'ont éclaté à partir du 5 octobre émeutes, pillages, destructions de magasins et édifices publics accomplis par des milliers de jeunes chômeurs, dont des enfants, auxquels se sont mêlés parfois provocateurs de la police secrète et intégristes. Ces émeutes ont été montées en épingle par les médias algériens et occidentaux pour mieux dissimuler l'étendue et le sens de classe des grèves. D'autre part, la bourgeoisie algérienne en a profité pour faire un bain de sang préventif, qu'elle a par la suite utilisé pour souligner la nécessité de "réformes" "démocratiques" et éliminer des fractions de son appareil d'Etat trop liées à l'armée et au FLN et inadéquates devant la menace prolétarienne.
Les émeutes de cette population très jeune, sans espoir et sans travail, ne sont pas la continuité des grèves ouvrières. Elles s'en distinguent nettement par leur absence de perspectives et leur trop facile utilisation et manipulation par l'appareil d'Etat. Il est vrai que cette jeunesse semble avoir manifesté un timide début de politisation en refusant de suivre et les mots d'ordre de l'Opposition à l'étranger (Ben Bella et Ait Ahmed, ex-chefs de FLN, éliminés par Boumediene) et les intégristes islamiques, qui ne sont qu'une création du régime et des militaires. Ici et là ces jeunes ont arraché le drapeau national algérien, ont saccagé mairies et sièges du FLN, détruit à Alger le siège du Polisario sahraoui, mouvement nationaliste soutenu par l'impérialisme algérien, et symbole de la guerre larvée avec le Maroc. Mais un tel mouvement doit être soigneusement distingué de celui des ouvriers en grève. La jeunesse en tant que telle n'est pas une classe. Composée aussi bien de jeunes chômeurs, de jeunes sans-travail tombés dans le lumpenprolétariat (appelés là bas les "gardiens du mur" en raison de leur oisiveté quotidienne), son action - séparée de l'action prolétarienne - est sans issue.
En s'attaquant seulement aux symboles de l'Etat, en pillant et détruisant aveuglément, ces révoltes sont impuissantes ; elles ne sont que des feux de paille ne pouvant guère contribuer au développement de la conscience et de la lutte ouvrières. Elles ne se différencient guère des émeutes périodiques des bidonvilles en Amérique latine. Elles traduisent la décomposition accélérée d'un système qui engendre dans les couches de sans-travail des explosions sans perspective historique.
L'absence - semble-t-il - d'organisation de la grève a sans doute permis à ces révoltes de passer au premier plan. Ce fait explique l'étendue de la répression policière et militaire (environ 500 morts, souvent très jeunes). L'armée n'a pas été contaminée ; elle n'a même pas connu un début de décomposition. Les 70 000 jeunes de l'armée de terre, ceux du contingent, sur une armée qui en compte 120 000, n'ont pas bougé.
C'est pourquoi, une fois l'eau rétablie dans les grandes villes, et les magasins "miraculeusement" réapprovisionnés, le gouvernement Chadli pouvait mettre fin à l'état de siège le 12 octobre. La grève générale de 48 heures en Kabylie et les quelques affrontements avec les policiers ont été un combat d'arrière-garde. L'ordre bourgeois a été rétabli avec quelques promesses "démocratiques" de Chadli (référendum sur la Constitution) et les appels au calme des imams (14 octobre) qui en appellent à une "république islamique" avec les militaires. Il s'agit en fait d'une pause dans une situation qui reste toujours explosive et se traduira par des mouvements sociaux ayant plus d'ampleur, où la présence du prolétariat sera plus visible et plus déterminante. Cette défaite est une première manche dans les affrontements futurs, de plus en plus décisifs, entre prolétariat et bourgeoisie. Des grèves sauvages ont d'ailleurs éclaté début novembre à Alger (7 novembre).
3. Malgré l'apparent "retour au calme", ces événements sociaux ont une importance historique considérable. En tant que tels ils ne peuvent être assimilés ni à l'Iran en 1979, ni aux événements actuels en Yougoslavie et au Chili. En aucun cas, les ouvriers et les jeunes sans-travail n'ont suivi les intégristes musulmans. Contrairement à ce qu'affirment la presse, les intellectuels bourgeois, le PC français, qui soutiennent peu ou prou Chadli, les intégristes sont l'arme idéologique des militaires, avec lesquels ils travaillent main dans la main. La religion, à la différence de l'Iran, n'a presque aucun impact sur les jeunes chômeurs et encore moins sur les ouvriers.
Mais le PLUS GRAND DANGER ACTUEL consisterait pour le prolétariat à croire dans les promesses de "démocratisation" et de rétablissement des "libertés", surtout depuis le référendum fin octobre (90% de votants pour Chadli). Le prolétariat n'a rien à espérer mais tout à craindre de telles promesses. Le bavardage démocratique ne fait que préparer d'autres ignobles massacres par la classe bourgeoise qui n'a rien à offrir d'autre que misère, plomb et mitraille aux exploités. C'est une leçon générale pour tous les prolétaires du monde : ON VOUS PROMET LA "DEMOCRATIE"; VOUS AUREZ D'AUTRES MASSACRES SI VOUS NE METTEZ PAS FIN A L'ATROCE BARBARIE CAPITALISTE!
Les événements d'octobre en Algérie ont une importance historique pour 4 raisons :
- ils sont dans le prolongement des grèves et émeutes de la faim qui ont secoué le Maroc et la Tunisie limitrophes depuis le début des années 80. Ils traduisent une réelle menace d'extension à tout le Maghreb, où ils ont déjà rencontré un large écho. La solidarité immédiate des gouvernements marocain et tunisien avec Chadli - en dépit d'appétits impérialistes contradictoires - est à la mesure de la peur qui a envahi la classe bourgeoise de ces pays ;
- ils montrent surtout -face aux GREVES OUVRIERES - la solidarité des grandes puissances impérialistes (France, USA) contre le prolétariat et leur soutien aux bains de sang pour rétablir "l'ordre". Déjà équipée en armes par la France, la RFA, les USA - qui ont pris la place des russes -, l'Algérie va être encore plus l'objet de soins attentifs du bloc américain sous forme d'armements et d'équipements de guerre civile.
Une fois de plus, se vérifie la Sainte Alliance de l'ensemble du monde capitaliste contre le prolétariat d'un pays, lequel n'affronte pas seulement "sa" bourgeoisie, mais toutes les bourgeoisies.
- en raison de l'importance de la classe ouvrière d'origine maghrébine, et surtout algérienne (presque 1 million d'ouvriers) en France, de tels événements ont déjà un impact énorme dans ce pays. L'unité du prolétariat contre la bourgeoisie en Europe occidentale et dans la périphérie immédiate se trouve posée, les conditions sont aujourd'hui propices pour la formation de minorités révolutionnaires dans le prolétariat algérien : dans un premier temps, dans l'immigration en France et en Europe, dans un second temps en Algérie, où le prolétariat est le plus développé, et même en Tunisie et au Maroc.
- Enfin, pour le prolétariat en Algérie, la grève généralisée est une première expérience d'envergure de confrontation avec l'Etat. Les prochains mouvements auront moins l'aspect d'un feu de paille. Ils se démarqueront plus nettement des révoltes des jeunes sans-travail.
A la différence des couches peu conscientes, perméables à la décomposition, le prolétariat ne s'attaque pas à des symboles, mais à un système, le capitalisme. Le prolétariat ne détruit pas pour aussitôt sombrer dans la résignation ; lentement, mais sûrement, il est appelé à développer sa conscience de classe, sa tendance à l'organisation. C'est dans ces conditions que le prolétariat, en Algérie comme d'ailleurs dans les pays du tiers monde, pourra orienter la révolte des jeunes sans-travail pour la canaliser vers la destruction de l'anarchie et de la barbarie capitalistes.
Chardin, 15-11-88
«Il n'existe pas de preuve plus flagrante de 1'impossibilité d'une révolution bourgeoise de nos jours que le caractère politique des régimes de "libération nationale". Ceux-ci sont inévitablement organisés dans le but avoué d'empêcher et, si nécessaire, de briser par la force tout embryon de lutte autonome de la classe ouvrière. La plupart d'entre eux sont des Etats policiers à parti unique, qui proscrivent le droit de grève. Leurs prisons sont remplies de dissidents. Nombreux sont ceux qui se sont illustrés dans l'écrasement sanglant de la classe ouvrière ; nous avons déjà mentionné la précieuse contribution de Ho-Chi-Minh à l'écrasement de la Commune ouvrière de Saigon ; nous pourrions aussi rappeler comment Mao a envoyé l'armée de "libération du peuple" "restaurer l'ordre" après les grèves, les débuts d'insurrection et les aventures ultra-gauchistes qu'avait provoqués la soi-disant "révolution culturelle". Nous devrions aussi nous souvenir de la répression des grèves des mineurs par Allende ou de celle exercée par la très "progressiste" junte militaire de Peron. La liste est pratiquement inépuisable. »
Nation ou Classe, brochure du CCI.
Géographique:
- Afrique [16]
Comprendre la décadence du capitalisme (6) : Le mode de vie du capitalisme en décadence
- 3932 reads
- Dans les deux articles précédents nous avons montré que tout mode de production est rythmé par un cycle ascendant et décadent (Revue Internationale n° 55) et qu'aujourd'hui nous vivons au coeur de la décadence du capitalisme (Revue Internationale n° 54). L'objet de cette contribution-ci est de mieux cerner les éléments qui ont permis au capitalisme de survivre tout au long de sa décadence et plus particulièrement de dégager les bases explicatives des taux de croissance d'après 1945 (les plus élevés de l'histoire du capitalisme). Mais surtout, nous montrerons en quoi ce soubresaut momentané du capitalisme est un soubresaut de croissance droguée qui constitue une fuite en avant d'un système aux abois. Les moyens mis en oeuvre (crédits massifs, interventions étatiques, production militaire croissante, frais improductifs, etc.) pour la réaliser viennent à épuisement, ouvrant la porte à une crise sans précédent.
La contradiction fondamentale du capitalisme
"Ce qui est décisif dans le processus de production c'est la question suivante : quels sont les rapports entre ceux qui travaillent et leurs moyens de production." (Rosa Luxemburg, Introduction à l'économie politique, Ed. 10/18). Dans le capitalisme le rapport qui lie les moyens de production et les travailleurs est constitué par le salariat. C'est le rapport social de production de base qui à la fois imprime la dynamique du capitalisme, et contient ses contradictions insurmontables ([1] [17]). Rapport DYNAMIQUE en ce sens que, pour vivre, le système doit constamment s'élargir, accumuler, étendre et pousser à bout l'exploitation salariale, aiguillonné par la baisse tendancielle du taux de profit (la péréquation de ce dernier découlant de la loi de la valeur et de la concurrence). Rapport CONTRADICTOIRE en ce sens que le mécanisme même de production de plus-value crée plus de valeur qu'il n'en distribue ; la plus-value étant la différence entre la valeur du produit du travail et le coût de la marchandise force de travail : le salaire. En généralisant le salariat, le capitalisme restreint ses propres débouchés, contraignant le système à constamment devoir trouver des acheteurs en dehors de sa sphère capital-travail :
"(...)Plus la production capitaliste se développe, et plus elle est obligée de produire à une échelle qui n'a rien à voir avec la demande immédiate, mais dépend d'une extension constante du marché mondial (...). Ricardo ne voit pas que la marchandise doit être nécessairement transfonnée en argent. La demande des ouvriers ne saurait suffire, puisque le profit provient justement du fait que la demande des ouvriers est inférieure à la valeur de leur produit et qu'il est d'autant plus grand que cette demande est relativement moindre. La demande des capitalistes entre eux ne saurait pas suffire davantage (..). Dire enfin que les capitalistes n'ont en somme qu'à échanger et consommer les marchandises entre eux, c'est oublier tout le caractère de la production capitaliste et oublier qu'il s'agit de mettre le capital en valeur (...). La surproduction provient justement du fait que la masse du peuple ne peut jamais consommer davantage que la quantité moyenne des biens de première nécessité, que sa consommation n'augmente pas au rythme de l'augmentation de la productivité du travail (...). Le simple rapport entre travailleur salarié et capitaliste implique :
1) Que la majeure partie des producteurs (les ouvriers) ne sont pas consommateurs, acheteurs d'une très grande portion de leur produit;
2) Que la majeure partie des producteurs, des ouvriers, ne peuvent consommer un équivalent de leur produit, qu'aussi longtemps qu'ils produisent plus que cet équivalent, qu'ils produisent la plus-value, le surproduit. Il leur faut constamment être surproducteurs, produire au-delà de leurs besoins pour pouvoir être consommateurs ou acheteurs (...). La surproduction a spécialement pour condition la loi générale de production du capital: produire à la mesure des forces productives, c'est-à-dire selon la possibilité qu'on a d'exploiter la plus grande masse de travail avec une masse donnée de capital, sans tenir compte des limites existantes du marché ou des besoins solvables (...)." (Marx, Le Capital, Ed.. Sociales, 1975, livre IV, t.II et livre III, t.I).
Marx a clairement montré, d'une part, l'inéluctabilité de la fuite en avant de la production capitaliste afin d'accroître la masse de plus-value pour compenser la baisse du taux de profit (dynamique), et d'autre part l'obstacle qui se dresse pour le capital : l'éclatement de la crise par le rétrécissement du marché nécessaire à l'écoulement de cette production (contradiction), bien avant que ne se manifeste l'insuffisance de la plus-value engendrée par la baisse tendancielle du taux de profit : "Or, au fur et à mesure que sa production s'est étendue, le besoin de débouchés s'est également élargi pour lui. Les moyens de production plus puissants et plus coûteux qu'il a créés lui permettent bien de vendre sa marchandise meilleur marché, mais ils le contraignent en même temps à vendre plus de marchandises, à conquérir un marché infiniment plus grand pour ses marchandises (...). Les crises deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes déjà du fait que, au fur et a mesure que la masse de produits et, par conséquent, 1e besoin de marchés élargis s'accroissent, le marché mondial se rétrécit de plus en plus et qu'il reste de moins en moins de marchés à exploiter, car chaque crise antérieure a soumis au commerce mondial un marché non conquis jusque là ou exploité de façon encore superficielle par le commerce" (Marx, Travail salarié et capital, Ed.. de Pékin, 1970).
Cette analyse fut systématisée et amplement développée par Rosa Luxemburg qui dégagea l'idée que, puisque la totalité de la plus-value du capital social global ne pouvait être réalisée, de par sa nature même, au sein de la sphère purement capitaliste, la croissance du capitalisme était dépendante de ses continuelles conquêtes de marchés pré-capitalistes ; l'épuisement relatif, c'est-à-dire eu égard aux besoins de l'accumulation, de ces marchés devra précipiter le système dans sa phase de décadence :
"Par ce processus, le capital prépare doublement son propre effondrement: d'une part, en s'étendant aux dépens des formes de production non capitalistes, il fait avancer le moment où l'humanité toute entière ne se composera plus effectivement que de capitalistes et de prolétaires et où l'expansion ultérieure, donc l'accumulation, deviendront impossibles. D'autre part, à mesure qu'il avance, il exaspère les antagonismes de classe et l'anarchie économique et politique internationale à tel point qu'il provoquera contre sa domination la rebellion du prolétariat intemational bien avant que l'évolution économique ait abouti à sa dernière conséquence : la domination absolue et exclusive de la production capitaliste dans le monde. (...) L'impérialisme actuel (...) est la dernière étape du processus historique (du capitalisme) : la période de concurrence mondiale accentuée et généralisée des Etats capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe." (L'accumulation du capital, Ed.. Maspéro, 1967).
Outre son analyse du lien indissoluble entre les rapports de production capitalistes et l'impérialisme, qui montre que le système ne peut vivre sans s'étendre, sans être impérialiste par essence, ce que Rosa Luxemburg apporte de fondamental ce sont les outils d'analyse pour comprendre pourquoi, comment et quand le système entre dans sa phase de décadence. A cette question Rosa y répondra dès les prodromes de la guerre 1914-18, estimant que le conflit inter impérialiste mondial ouvre l'époque où le capitalisme devient définitivement une entrave pour le développement des forces productives : "La nécessité du socialisme est pleinement justifiée dès le moment où l'autre, la domination de la classe bourgeoise, cesse d'être porteuse de progrès historique et constitue un frein et un danger pour l'évolution ultérieure de la société. Or, s'agissant de l'ordre capitaliste, c'est ce que précisément la guerre actuelle a révélé" (Rosa Luxemburg, in Rosa Luxemburg jountaliste-polémiste-révolutionnaire, Badia. Ed.. Sociales, 1975). Cette analyse, quelle qu'en soit l'explication "économique" était partagée par l'ensemble du mouvement révolutionnaire.
Si l'on saisit bien cette contradiction insoluble pour le capital, on détient la boussole pour comprendre le mode de vie du système au cours de sa décadence. L'histoire économique du capitalisme depuis 1914 est l'histoire du développement des palliatifs à ce goulot d'étranglement que constitue le marché. Seule cette compréhension permet de relativiser les "performances" ponctuelles du capitalisme (taux de croissance après 1945). Nos critiques (cf. Revue Intemationale n° 54 et 55) sont éblouis par les chiffres de la croissance mais cela les aveugle sur la NATURE de cette croissance. Ils s'écartent ainsi de la méthode marxiste qui s'efforce de dégager l'essence véritable cachée derrière l'existence des choses. C'est ce que nous allons tenter de montrer ([2] [18]).
Quand la réalisation de la plus-value prend le pas sur sa production
Globalement, en phase ascendante, la demande dépasse l'offre, le prix des marchandises est déterminé par les coûts de production les plus élevés qui sont ceux des secteurs et pays les moins développés. Ceci permet à ces derniers de réaliser des profits permettant une réelle accumulation et aux pays les plus développés d'encaisser des sur-profits. En décadence, c'est l'inverse, globalement l'offre dépasse la demande et les prix sont déterminés par les coûts de production les plus bas. De ce fait, les secteurs et les pays ayant les coûts les plus élevés sont contraints de vendre leurs marchandises avec des profits réduits quand ce n'est à perte ou de tricher avec la loi de la valeur pour survivre (cf. infra). Cela ramène leur taux d'accumulation à un niveau extrêmement bas. Même les économistes bourgeois avec leur terminologie propre (prix de vente et de revient) constatent cette inversion : "Nous avons été frappés par l'inversion contemporaine de la relation entre prix de revient et prix de vente (...) à long terme le prix de revient conserve son rôle (...) Mais alors qu'hier, le principe était que le prix de vente pouvait TOUJOURS être fixé au-dessus du prix de revient, aujourd'hui il apparaît le plus souvent comme devant être soitmis au prix de marché. Dans ces conditions, lorsque l'essentiel n'est plus la production mais la vente, lorsque la concurrence se fait de plus en plus rude, les chefs d'entreprise partent du prix de vente pour remonter progressivement jusqu'au prix de revient (...) pour vendre, le chef d'entreprise a plutôt tendance aujourd'hui à considérer en premier le marché, donc à examiner d'abord le prix de vente. (...) Si bien que désormais, on assiste souvent au paradoxe que ce sont de moins en moins les prix de revient qui déterminent les prix de vente et de plus en plus l'inverse. Le problème est : ou bien renoncer à produire, ou bien produire au-dessous du prix de marché." (Fourastier J. et Bazil B., Pourquoi les prix baissent, Ed. Hachette - Pluriel).
Ce phénomène se marque spectaculairement dans la part démesurée que prennent les frais de distribution et de marketing dans le produit final. Ces fonctions sont assurées par le capital commercial qui participe au partage général de la plus-value. Ces frais sont donc inclus dans les coûts de production. En phase ascendante, tant que le capital commercial assurait l'augmentation de la masse de plus-value et du taux annuel de profit, par la réduction de la période de circulation des marchandises et le raccourcissement du cycle de rotation du capital circulant, il contribuait à la baisse généralisée des prix, caractéristique de cette période (cf. graphique 4). Ce rôle se modifie en phase de décadence. A mesure que les forces productives se heurtent aux limites trop étroites du marché, le rôle du capital commercial devient moins celui d'accroître la masse de plus-value que d'en assurer la réalisation. Ceci s'exprime dans la réalité concrète du capitalisme, d'une part par un accroissement du nombre de personnes employées dans la sphère de la distribution et de façon générale par une diminution relative du travail réellement productif et, d'autre part par l'accroissement des marges commerciales dans la plus-value finale. On estime que les frais de distribution atteignent aujourd'hui en moyenne entre 50 à 70 % du prix des marchandises dans les grands pays capitalistes. L'investissement dans les secteurs parasitaires du capitalisme commercial (campagne marketing, sponsoring, lobbing, etc.), secteurs qui vont au-delà de la fonction normale de distribution de la marchandise, prend de plus en plus le pas sur l'investissement réellement productif. Cela correspond purement et simplement à de la destruction de capital. productif. Ceci montre le caractère de plus en plus parasitaire du système.
Le crédit
"Le système de crédit accélère par conséquent le développement matériel des forces productives et la constitution d'un marché mondial; la tâche historique de la production capitaliste est justement de pousser jusqu'à un certain degré le développement de ces deux facteurs, base matérielle de la nouvelle forme de production. Le crédit accélère en même temps les explosions violentes de cette contradiction, les crises et, partant, les éléments qui dissolvent l'ancien mode de production." (Marx, Le Capital, Livre III).
En phase ascendante, le crédit a constitué un puissant moyen pour accélérer le développement du capitalisme par le raccourcissement du cycle de rotation du capital. L'avance sur la réalisation de la marchandise que constitue le crédit trouvait son dénouement grâce à la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés extra-capitalistes. En décadence ce dénouement est de moins en moins possible, le crédit se mue alors en un palliatif à l'incapacité de plus en plus grande du capital à réaliser la totalité de la plus-value produite. L'accumulation rendue momentanément possible par le crédit ne fait que développer un abcès insoluble qui débouche inévitablement dans la guerre inter-impérialiste généralisée.
Le crédit n'a jamais constitué une demande solvable en soi et encore moins en décadence comme voudrait nous le faire dire Communisme ou Civilisation (CoC) : "Parmi les raisons qui permettent au capital d'accumuler figure maintenant le crédit ; autant dire que la classe capitaliste est capable de réaliser la plus-value grâce à une demande solvable provenant de la classe capitaliste. Si, dans la brochure du CCI sur la Décadence du capitalisme, cet argument n'apparaît pas, il fait désormais partie de la panoplie de tout initié de la secte. On admet ici ce qui, jusque là, a été farouchement nié à savoir la possibilité de la réalisation de la plus-value destinée à l'accumulation." (CoC n°22) ([3] [19]). Le crédit constitue une avance sur la réalisation de la plus-value et permet ainsi d'accélérer la clôture du cycle complet de la reproduction du capital. Ce cycle comprend, selon Marx - on l'oublie trop souvent -, la production ET la réalisation de la marchandise produite. Ce qui se modifie entre la phase ascendante et la phase décadente du capitalisme, ce sont les conditions dans lesquelles opère le crédit. La saturation mondiale des marchés permet de moins en moins, et de moins en moins vite, de récupérer le capital investi. C'est pourquoi le capital vit de plus en plus sur une montagne de dettes qui prend des proportions astronomiques. Le crédit permet ainsi de maintenir la fiction d'une accumulation élargie et de repousser l'échéance où le capital devra passer à la caisse. Chose qu'il est d'ailleurs incapable d'assurer, ce qui le pousse inexorablement à la guerre commerciale et à la guerre inter-impérialiste tout court. Les crises de surproduction en décadence n'ont de "solution" que dans la guerre (cf. Revue Internationale n° 54). Les chiffres du tableau n° 1 et le graphique n°1 illustrent ce phénomène.
Concrètement les chiffres du tableau n° 1 nous montrent que les Etats-Unis vivent sur 2,5 ans de crédits, l'Allemagne sur 1 an. Pour rembourser ces crédits, si tant est qu'ils le seront un jour, les travailleurs de ces pays devraient respectivement travailler 2,5 et 1 ans gratuitement. Ces chiffres illustrent également une croissance plus rapide des crédits que du P.N.B. indiquant que le développement économique se fait de plus en plus à crédit au cours du temps.
Ces deux exemples ne constituent nullement une exception mais sont illustratifs de l'endettement mondial du capitalisme. L'estimer constitue un exercice périlleux, surtout à cause du manque de statistiques fiables mais l'on peut supputer que ce dernier se monte à 1,5 à 2 fois le PNB mondial. Entre 1974 et 1984 le taux d'accroissement de cet endettement est d'environ 11 % tandis que celui du P.N.B. mondial oscille autour de 3,5 % !
Tableau 1. Évolution de l'endettement du capitalisme
|
|
Dette publique et privée |
(en % du PNB) |
Dette des ménages (en % du revenu disponible) |
|---|---|---|---|
|
|
RFA |
USA |
USA |
|
1946 |
|
|
19,6% |
|
1950 |
22% |
|
|
|
1955 |
39% |
166 % |
46,1 % |
|
1960 |
47% |
172% |
|
|
1965 |
67% |
181 % |
|
|
1969 |
|
200% |
61,8 |
|
1970 |
75 % |
|
|
|
1973 |
|
197% |
71,8% |
|
1974 |
|
199% |
93% |
|
1975 |
84% |
|
|
|
1979 |
100% |
|
|
|
1980 |
250% |
|
|
Sources : Economic Report of the President (0l/1970) / Survey of Current Business (07/1975) / Monthly review (vol. 22, n°4, 09/1970, p.6) / Statistical Abstract of United States (1973).
Graphique 1. Belgique, croissance comparée de l'endettement et de la production.
Source : Bulletin de l'IRES, 1982, n°80 (l'échelle de gauche est un indice d'évolution des deux indicateurs, qui, pour être comparés, ont été ramenés à l'indice 100 en 1970).
Le graphique n° 1 est illustratif de l'évolution de la croissance et de l'endettement dans la majorité des pays. L'accroissement des crédits est nettement supérieur à celui de la production industrielle manufacturière. Si précédemment la croissance s'effectuait de plus en plus à crédit (1958-74: production= 6,01 %, crédit=13,26 %), aujourd'hui, le simple maintien de la stagnation se réalise à crédit (1974-81 : production = 0,15 %, crédit = 14,08 %).
Depuis le début de la crise chaque reprise économique est supportée par une masse de crédits de plus en plus importante. La reprise de 75-79 a été stimulée par des crédits accordés aux pays du "tiers-monde" et aux pays dits "socialistes", celle de 83 a été entièrement supportée par un accroissement des crédits aux pouvoirs publics américains - essentiellement consacré aux dépenses militaires - et aux grands trusts d'Amérique du Nord, crédits servant aux fusions d'entreprises, donc non productifs. CoC ne comprend rien à ce processus et sous-estime complètement le crédit et son ampleur comme mode de survie du capitalisme dans sa phase de décadence.
Les marches extra-capitalistes
Nous avons vu précédemment (Revue Intentationale n° 54) que la décadence du capitalisme se caractérisait non par une disparition des marchés extra-capitalistes mais par leur insuffisance par rapport aux besoins de l'accumulation élargie atteints par le capitalisme. C'est-à-dire que les marchés extra-capitalistes sont devenus insuffisants pour réaliser l'entièreté de la plus-value produite par le capitalisme et destinée à être réinvestie. Néanmoins une partie encore non négligeable de cette plus-value, bien que décroissante, est encore réalisée par ces marchés extra-capitalistes. Le capitalisme dans sa phase de décadence, aiguillonné par une base d'accumulation de plus en plus restreinte, va tenter d'exploiter au mieux l'exutoire que constitue pour lui la subsistance de ces marchés et cela de trois façons :
Par une intégration accélérée et planifiée, surtout après 1945, des secteurs d'économie marchande subsistants dans les pays développés.
Graphique 2. Part de la population active agricole dans la population active totale.
Le graphique n° 2 montre que si, pour certains pays, l'intégration de l'économie marchande agricole au sein des rapports sociaux capitalistes de production est déjà réalisée dès 1914, pour d'autres (France, Japon, Espagne, etc.), elle s'effectue encore au cours de la décadence et de façon accélérée après 1945.
Jusqu'à la seconde guerre mondiale l'augmentation de la productivité du travail dans l'agriculture était plus faible que dans celle de l'industrie, résultat d'un plus lent processus de développement de la division du travail dû, entre autres, à un poids encore important de la rente foncière qui détourne une part des capitaux nécessaires à la mécanisation. Après la seconde guerre mondiale la croissance de la productivité du travail est plus rapide dans l'agriculture que dans l'industrie. Ceci se matérialise par une politique conjugant tous les moyens pour ruiner les entreprises agricoles familiales de subsistance relevant de la petite production marchande, et les transformer en entreprises purement capitalistes. C'est le processus d'industrialisation de l'agriculture.
Aiguillonnée par la recherche impérative de nouveaux marchés, la période de décadence se caractérise par une meilleure exploitation des marchés extra-capitalistes subsistants.
D'une part, le développement des moyens techniques, des communications, et la baisse des coûts de transport facilitent la pénétration - tant intensive qu'extensive - et la destruction de l'économie marchande de la sphère extra-capitaliste.
D'autre part, le développement de la politique de "décolonisation" soulage les métropoles d'un fardeau coûteux, leur permet de rentabiliser au mieux leurs capitaux et d'accroître les ventes aux anciennes colonies (payées par la sur-exploitation des populations autochtones). Ventes dont une part non négligeable est constituée par l'armement, nécessité première et absolue de l'édification d'un pouvoir étatique local.
En phase ascendante le contexte dans lequel se développe le capitalisme permet une homogénéisation des conditions de la production (conditions techniques et sociales, degré de productivité moyenne du travail, etc.). La décadence, par contre, accroît les iriégalités de développement entre pays avancés et sous-développés (cf. Revue Intemationale n° 54 et 23).
Alors qu'en ascendance la part des profits retirés des colonies (ventes, prêts, investissements) est supérieure à la part des profits résultant de l'échange inégal ([4] [20]), en décadence c'est l'inverse qui se produit. L'évolution sur longue période des termes de l'échange est un indicateur de cette tendance. La détérioration de ces derniers pour les pays dits du "tiers monde" est devenue extrêmement importante depuis la seconde décennie de ce siècle.
Le graphique n° 3 ci-dessous illustre l'évolution des termes de l'échange de 1810 à 1970 pour les pays du "tiers-monde", c'est-à-dire du rapport entre prix des produits bruts exportés et prix des produits industriels importés. L'échelle exprime un rapport de prix (x 100), ce qui signifie que lorsque cet indice est supérieur à 100, il est favorable aux pays du "tiersmonde", et inversement lorsqu'il est inférieur à 100. C'est au cours de la deuxième décennie de ce siècle que la courbe passe l'indice pivot de 100 et entame sa chute, seulement interrompue par la guerre de 1939-45 et la guerre de Corée (forte demande de produits de base dans un contexte de pénurie).
Graphique 3. Evolution des termes de l'échange 1810 à 1970
Sources : Emilio de Figueros, Economie appliquée, t. XXII, n°1 et 2, publié également dans Le Monde du 29/07/69.
Le capitalisme d'État
Nous avons vu précédemment (Revue Internationale n° 54) que le développement du capitalisme d'Etat est étroitement lié à la décadence du capitalisme ([5] [21]). Le capitalisme d'Etat est une politique globale qui s'impose au système dans tous les domaines de la vie sociale, politique et économique. Il concourt à atténuer les contradictions insurmontables du capitalisme : au niveau social par un meilleur contrôle d'une classe ouvrière suffisamment développée pour constituer un réel danger pour la bourgeoisie ; au niveau politique pour maîtriser les tensions croissantes entre fractions de la bourgeoisie ; et au niveau économique pour modérer les contradictions explosives qui s'accumulent. A ce dernier niveau, qui nous occupe ici, l'Etat intervient par le biais d'une série de mécanismes :
Les tricheries avec la loi de la valeur.
Nous avons vu qu'en décadence une partie de plus en plus importante de la production échappe à la détermination stricte de la loi de la valeur (Revue Internationale n° 54). La finalité de ce processus est le maintien en vie d'activités qui autrement n'auraient pas survécu à l'impitoyable verdict de la loi de la valeur. Le capitalisme parvient ainsi pour un temps, mais pour un temps seulement, à éviter les conséquences des fourches caudines du marché.
L'inflation permanente est un des moyens qui répond à cette finalité. L'inflation permanente est d'ailleurs un phénomène typique, propre à la décadence d'un mode de production ([6] [22]).
Graphique 4. Evolution des prix de gros dans cinq pays développés de 1750 à 1950-70.
Alors qu'en ascendance la tendance globale des prix est stable ou le plus souvent décroissante, la période de décadence marque l'inversion de la tendance. 1914 inaugure la phase d'inflation permanente.
Graphique 5. Evolution des prix de détail en France de 1820 à 1982
Stables pendant un siècle, les prix en France explosent après la première guerre mondiale et surtout la seconde : ils sont multipliés par 1000 entre 1914 et 1982. Sources: INSEE pour la France.
Si une chute et une adaptation périodique des prix aux valeurs d'échange (prix de production) sont artificiellement interdites par un gonflement du crédit et de l'inflation, toute une série d'entreprises qui sont déjà tombées au-dessous de la moyenne de la productivité du travail de leur secteur peuvent alors échapper à une dévalorisation de leur capital et à la banqueroute. Mais ce phénomène ne peut qu'accroître à la longue le déséquilibre entre la capacité de production et la demande solvable. La crise est reportée mais en devient du coup plus ample. Historiquement, dans les pays développés, l'inflation est tout d'abord apparue avec les dépenses étatiques dues à l'armement et à la guerre. Ensuite, le développement du crédit et des dépenses improductives de tous ordres s'y ajoute et en devient la cause majeure.
Les politiques anti-cycliques : armée de l'expérience de la crise de 1929 - où le repli sur soi a considérablement aggravé la crise - la bourgeoisie s'est débarrassée des restes d'illusions libre-échangistes d'avant 1914. Les années 30, et plus encore après 1945 avec le keynésianisme, sont marquées par la mise en place de politiques capitalistes d'Etat concertées. Il serait illusoire de vouloir toutes les énumérer mais elles ont une seule et même finalité : maîtriser tant bien que mal les fluctuations économiques et artificiellement soutenir la demande.
L'intervention croissante de l'Etat dans l'économie. Ce point à déjà été largement traité dans des Revue Internationale antérieures, nous n'aborderons ici qu'un aspect encore relativement peu abordé à savoir, l'intervention de l'Etat dans le domaine social et ses implications économiques.
En phase ascendante, les hausses salariales, la baisse du temps de travail, les conquêtes au niveau des conditions de travail sont des "concessions arrachées de haute lutte au capital (...) la loi anglaise sur les dix heures de travail par jour, est en fait le résultat d'une guerre civile longue et opiniâtre entre la classe capitaliste et la classe ouvrière." (Marx, Le Capital). En décadence, les concessions faites par la bourgeoisie à la classe ouvrière, suite aux mouvements sociaux révolutionnaires des années 1917-23, sont, pour la première fois, des mesures prises pour calmer (journée des huit heures, suffrage universel, assurances sociales, etc.) et encadrer (conventions collectives, droits syndicaux, commissions ouvrières, etc.) un mouvement social qui ne s'assigne plus comme but l'obtention de réformes durables dans le cadre du système mais la conquête du pouvoir. Dernières mesures à être un sous-produit des luttes, elles marquent le fait qu'en décadence c'est l'Etat avec l'aide des syndicats qui organisent, encadrent et planifient les mesures sociales afin de prévenir et contenir le danger prolétarien. Ceci se marque par le gonflement des dépenses étatiques consacrées au domaine social (salaire indirect prélevé sur la masse salariale globale) :
Tableau 2. Dépenses de l'État dans le domaine social
En pourcentage du PNB
|
|
|
All |
Fr |
GB |
US |
|
ASCENDANCE |
1910 |
3.0% |
- |
3.7% |
- |
|
|
1912 |
- |
1.3% |
- |
- |
|
DÉCADENCE |
1920 |
20.4% |
2.2% |
6.3% |
- |
|
|
1922 |
- |
- |
- |
3.1% |
|
|
1950 |
27.4% |
8.3% |
16.0% |
7.4% |
|
|
1970 |
- |
- |
- |
13.7% |
|
|
1978 |
32.0% |
- |
26.5% |
- |
|
|
1980 |
- |
10.3% |
- |
- |
Sources : Ch. André & R. Delorme, op. cit. dans la Revue internationale n° 54.
En France, en plein calme social, l'Etat prend une série de mesures sociales : 1928-30 assurance maladie, 1930 enseignement gratuit, 1932 allocations familiales ; en Allemagne, assurance sociale élargie aux employés et ouvriers agricoles, aide aux chômeurs (1927). C'est au cours de la seconde guerre mondiale, c'est à dire au sommet de la défaite de la classe ouvrière qu'est conçu, discuté et planifié au sein des pays développés la mise en place du système actuel de sécurité sociale ([7] [23]), en France en 1946, en Allemagne en 1954-57 (loi sur la cogestion en 1951), etc.
Le but premier de toutes ces mesures vise à un meilleur contrôle social et politique de la classe ouvrière, à accroître sa dépendance vis-à-vis de l'Etat et des syndicats (salaire indirect). Mais la conséquence secondaire de ces mesures sur le plan économique est l'atténuation des fluctuations de la demande dans le secteur II de la production (biens de consommations), là où apparaît en premier la surproduction.
L'instauration de revenus de remplacement, de programmation des hausses salariales ([8] [24]) et le développement du crédit à la consommation participent du même mécanisme.
Armements, guerres, reconstruction
En période de décadence du capitalisme, les guerres et la production militaire n'ont plus aucune fonction de développement global du capital. Ils ne constituent ni des champs d'accumulation du capital ni des moments de centralisation politique de la bourgeoisie - cf. guerre Franco-Prussienne de 1871 pour l'Allemagne (voir Revue Internationale n° 51, 52, 53).
Les guerres sont la plus haute expression de la crise et de la décadence du capitalisme. "A Contre-courant" (ACC) se refuse à un tel constat. Pour ce "groupe" les guerres ont une fonctionnalité économique au travers du processus de dévalorisation du capital suite aux destructions, de même, elles accompagnent un capitalisme en développement toujours croissant dont elles expriment le degré grandissant des crises. Ainsi les guerres ne recèlent aucune différence qualitative entre l'ascendance et la décadence du capitalisme : "A ce niveau nous tenons à relativiser même l'affirmation de guerre mondiale (...). Toutes les guerres capitalistes ont donc essentiellement un contenu international (...). Ce qui change réellement n'est pas le contenu mondial invariant (n'en déplaise aux déeadentistes) mais bien l'étendue et la profondeur chaque fois plus réellement mondiale et catastrophique." (n° 1). ACC mobilise deux exemples à l'appui de sa thèse, la période des guerres Napoléoniennes (1795-1815) et le caractère encore local (sic!) de la première guerre MONDIALE par rapport à la seconde. Ces exemples sont totalement inopérants. Les guerres Napoléoniennes se situent à la charnière entre deux modes de production, ce sont les dernières guerres d'Ancien Régime (décadence féodale), elles ne peuvent être prises comme caractéristiques des guerres de type capitaliste. Si Napoléon, par ses mesures économiques, va favoriser le développement du capitalisme, il va, sur le plan politique, entamer une campagne guerrière dans le droit fil de la tradition d'Ancien Régime. La bourgeoisie ne s'y trompera d'ailleurs pas, après l'avoir soutenu dans un premier temps, elle le lâchera par la suite, trouvant ses campagnes trop coûteuses et supportant de plus en plus mal un blocus continental qui étouffe son développement. Quant au second exemple il faut un sacré culot ou une bonne dose d'ignorance historique pour le soutenir. La question n'est pas tant de comparer la première à la seconde guerre mondiale mais de les comparer aux guerres du siècle dernier, chose que ACC se garde bien de réaliser. Là, l'évidence ne peut échapper à personne.
Après la démence des guerres d'Ancien Régime, celles-ci se sont adaptées et circonscrites aux nécessités du capital conquérant le monde, telles que nous les avons longuement décrites dans la Revue Internationale n° 54, pour se muer à nouveau dans l'irrationalité la plus complète en décadence du système capitaliste. Avec l'approfondissement des contradictions du capital il est normal que la seconde guerre mondiale soit plus ample et destructrice que la première, mais dans leurs grandes caractéristiques elles sont identiques et s'opposent aux guerres du siècle dernier.
Quant à l'explication de la fonction économique de la guerre par la dévalorisation du capital (hausse du taux de profit - PV/CC+CV - par destruction de capital constant) elle ne tient pas debout. D’une part parce que l'on constate que les travailleurs (CV) sont également fauchés au cours de la guerre et d'autre part parce que la croissance de la composition organique du capital se poursuit pendant la guerre. S'il y a accroissement momentané du taux de profit dans l'immédiat après-guerre, c'est d'une part parce qu'il y a augmentation du taux de plus-value due à 1a défaite et la sur-exploitation de la classe ouvrière et d'autre part, grâce à l'accroissement de la plus-value relative engendrée par le développement de la productivité du travail.
A l'issue de la guerre le capitalisme se trouve toujours face au même problème de la nécessité d'écouler la totalité de sa production. Ce qui a changé c'est d'une part, la diminution momentanée de la masse de la plus-value destinée à être réinvestie qui doit être réalisée (les destructions de la guerre ont fait disparaître la surproduction d'avant guerre) et d'autre part, le désengorgement du marché par l'élimination de concurrents (les USA s'accaparent l'essentiel des marchés coloniaux des anciennes métropoles européennes).
Quant à la production d'armement, sa motivation première est également imprimée par la nécessité de survivre dans un environnement inter-impérialiste quel qu'en soit le coût. Ce n'est que subséquemment qu'elle joue un rôle économique. Bien que constituant une stérilisation de capital et se soldant par un bilan nul, au niveau du capital global, après un cycle de production, elle permet au capital de décaler ses contradictions dans le temps ET dans l'espace. Dans le temps parce que la production d'armements entretient momentanément la fiction de la poursuite de l'accumulation et dans l'espace parce qu'en instiguant en permanence des foyers de guerres localisées et en vendant une grande part de cette production dans le "tiersmonde", le capital opère un transfert de valeur de ces derniers pays vers les plus développés ([9] [25]).
L'épuisement des palliatifs
Employés partiellement APRES la crise de 1929 sans pouvoir la résoudre (New Deal, Front Populaire, plan De Man, etc.) les moyens mis en oeuvre par le capitalisme pour reporter l'échéance de sa contradiction fondamentale, et décrit ci-dessus, ont déjà été amplement utilisés dès le début et tout au long de la période qui va de la guerre à la fin des années 60. Ils viennent tous aujourd'hui à épuisement. Ce à quoi nous assistons ces vingt dernières années c'est à la fin de l'efficacité de ces palliatifs.
La poursuite de la croissance militaire est une nécessité (car poussée par les besoins impérialistes toujours plus importants), mais elle ne constitue plus un palliatif temporaire. De par leur ampleur les coûts de cette production grèvent directement le capital productif. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à un ralentissement de sa croissance (sauf au USA, 2,3 % de croissance pour 1976-80 et 4,6 % pour 1980-86) et à une diminution de la part du "tiers-monde" dans les achats, encore que de plus en plus de dépenses militaires soient masquées, dans la "recherche" notamment. Quoi qu'il en soit, les dépenses militaires mondiales continuent d'augmenter chaque années (3,2 %, 1980-85) à un rythme supérieur à celui du PNB mondial (2,4 %).
L'emploi massif de crédits est arrivé à un point tel qu'il provoque de graves secousses monétaires (cf. octobre noir de 1987). Le capitalisme n'a plus d'autre choix que de naviguer entre le danger de la reprise de l'hyper-inflation (crédits inconsidérés) et de la récession (taux d'intérêts élevés pour contenir le crédit). Avec la généralisation du mode production capitaliste, la production se détache de plus en plus du marché, la réalisation de la valeur des marchandises et de la plusvalue se complique davantage. Le producteur ignore de plus en plus si ses marchandises trouveront un débouché réel, si elles rencontreront un "dernier consommateur". En permettant une expansion de la production sans rapport avec les capacités d'absorption du marché, le crédit retarde l'échéance des crises mais aggrave le déséquilibre et rend par conséquent la crise plus violente quand elle éclate.
Le capitalisme peut de moins en moins supporter des politiques inflationnistes pour artificiellement soutenir l'activité économique. Une telle politique suppose des taux d'intérêts élevés (car inflation déduite il ne reste plus grand chose de l'intérêt sur les sommes déposées). Mais des taux d'intérêts bancaire élevés impliquent un taux de profit élevé dans l'économie réelle (en règle général le taux d’intérêt doit être inférieur au taux de profit moyen). Or, c'est de moins en moins possible, les méventes, la crise de surproduction font chuter 1a rentabilité du capital investi et ne permettent plus de dégager un taux de profit suffisant pour payer les intérêts bancaires. Ce différentiel en tenaille s'est concrétisé en octobre 1987 par la panique boursière que l'on connaît.
Les marchés extra-capitalistes sont tous sur-exploités, pressurés à fond, et ils sont loin de constituer un exutoire possible.
Aujourd'hui c'est la rationalisation des faux frais qui est de mise, le développement des secteurs improductifs aggrave plus qu'il ne soulage du fait de leur sur-développement.
Ces palliatifs employés abondamment depuis 1948 n'étaient déjà pas fondés sur une base saine mais leur épuisement actuel engendre une impasse économique d'une gravité sans précédent. La seule politique possible aujourd'hui est l'attaque frontale de la classe ouvrière, attaque que tous les gouvernements de droite comme de gauche, à l'Est comme à l'Ouest appliquent avec zèle. Cependant cette austérité qui fait payer cher la crise à la classe ouvrière, au nom de la compétitivité de chaque capital national, ne porte pas en elle même une une "solution" à la crise globale au contraire, elle ne fait que réduire encore plus la demande solvable.
Conclusions
Si nous nous sommes penchés sur les éléments explicatifs de la survie du capitalisme en décadence ce n'est pas par souci académique comme nos censeurs mais dans un but militant. Ce qui nous importe c'est de mieux comprendre les conditions du développement de la lutte de classe en la renlaçant dans le seul cadre valable et cohérent : la décadence, en saisissant toutes les modalités introduites par le capitalisme d'Etat et en comprenant toute l'urgence et l'enjeu de la situation actuelle par la reconnaissance de l'épuisement de tous les palliatifs à la crise catastrophique du capitalisme (cf. Revue Internationale n° 23, 26, 27, 31).
Marx n'a pas attendu d'avoir achevé Le Capital pour s'engager et prendre position dans la lutte de classe. Rosa Luxemburg et Lénine n'ont pas attendu d'accorder leurs violons sur l'analyse économique de l'impérialisme avant de prendre position sur la nécessité de fonder une nouvelle internationale, de lutter contre la guerre par la révolution, etc. D'ailleurs derrière leurs différences (Lénine = baisse tendancielle du taux de profit et monopole, Rosa Luxemburg = la saturation des marchés) il y a un profond accord sur toutes les questions cruciales pour la lutte de classe et notamment la reconnaissance de la faillite historique du mode de production capitaliste qui met à l'ordre du jour la révolution socialiste :
"De tout ce qui a été dit plus haut de l'impérialisme, il ressort qu'on doit le caractériser comme un capitalisme de transition ou, plus exactement, comme un capitalisme AGONISANT. (...) le parasitisme et la putréfaction caractérisent le stade historique suprême du capitalisme c'est-à-dire l'impérialisme. (...) L'impérialisme est le prélude de la révolution sociale du prolétariat. Cela s'est confirmé, depuis 1917, à l'échelle mondiale."( Lénine, L'impérialisme stade suprême du capitalisme, Oeuvres complètes, Ed.. de Moscou, t. 22). Si ces deux grands marxistes se sont tellement fait attaquer à propos de leur analyse économique c'est moins pour celle-ci que pour leur prise de positions politiques. De même, derrière l'attaque dont le CCI est l'objet sur les questions économiques se cache en réalité un refus de l'engagement militant, une conception conseilliste du rôle des révolutionnaires, une non reconnaissance du cours historique actuel aux affrontements de classes et une non conviction de la faillite historique du mode de production capitaliste.
C.Mcl
- "Les rapports juridiques, pas plus que les formes de l'Etat, ne peuvent s"expliquer ni par eux-même, ni par la prétendue évolution de l'esprit humain ; bien plutôt, ils prennent leurs racines dans les conditions matérielles de la que Hegel, à l'exemple des anglais et des français du XVIIIe siècle, comprend dans leur ensemble sous le nom de "société civile" ; et c'est dans l'économie politique qu'il convient de chercher l'anatomie de la société civile...
- "ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de productions existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de dévekloppement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociales." Marx, Avant-propos à la crtique de l'économie politique.
[1] [26] C'est pourquoi Marx a toujours été très clair sur le fait que le dépassement du capitalisme et l'avènement du socialisme supposent l'abolition du salariat : "Sur leur bannière, il leur faut effacer cette devise conservatrice : 'Un salaire équitable pour une journée de travail équitable', et inscrire le mot d'ordre révolutionnaire: Abolition du salariat!' (... ) pour l'émancipation finale de la classe ouvrière, c'est-à-dire pour abolir enfin le salariat". (Marx, Salaire, prix et plus-value, Ed.. La Pléiade).
[2] [27] Nous ne prétendons pas ici avancer une explication détaillée des mécanismes économiques et de l'histoire du capitalisme depuis 1914 mais simplement poser les éléments majeurs qui ont permis sa survie et nous centrer sur les moyens qu'il a déployés pour repousser l'échéance de sa contradiction fondamentale.
[3] [28] Nous devons signaler ici qu'à part quelques questions "légitimes", bien qu'académiques, cette brochure-critique n'est qu'un ramassis de déformations motivé par la politique de "qui veut tuer son chien prétend qu'il a la rage".
[4] [29] La loi de la valeur règle l'échange sur la base de l'équivalence des quantités de travail. Mais, compte tenu du cadre national des rapports sociaux capitalistes de production et des différences nationales croissantes des conditions de la production (productivité et intensité du travail, composition organique du capital, salaires, taux de plus-value, etc.) au cours de la décadence, la péréquation du taux de profit parvenant à la formation d'un prix de production opère essentiellement dans le cadre national. II existe donc des prix de production différents d'une même marchandise dans différents pays. Ceci implique qu'au travers du commerce mondial le produit d'une journée de travail d'une nation plus développée sera échangée contre le produit de plus d'une journée de travail d'une nation moins productive ou à salaires nettement inférieurs... Les pays exportateurs de produits finis peuvent vendre leurs marchandises au-dessus de leur prix de production mais tout en restant en dessous du prix de production du pays importateur. Ils réalisent ainsi un sur-profit par transfert de valeurs. Ex. : un quintal de blé US revient en 1974 à 4 h de salaire d'un manceuvre aux Etats-Unis mais à 16 h en France du fait de la plus grande productivité de l'agriculture outre Atlantique. Les entreprises agro-industrielles US peuvent vendre leur blé en France au-dessus de leur prix de production (4 h) tout en restant plus compétitives que le blé français (16 h) - ceci explique le redoutable protectionnisme du marché agricole de la CEE face aux produits US et les incessantes querelles sur cette question.
[5] [30] Pour la FECCI cela n'est plus vrai. C'est le passage de la domination formelle à la domination réelle qui explique le développement du capitalisme d'Etat. Or, si cela était, nous devrions statistiquement constater une progression continue de la part de l'Etat dans l'économie puisque ce passage de domination se déroule sur toute une période et, de plus, cette progression devrait débuter au cours de la phase ascendante. Manifestement ce n'est pas du tout le cas. Les statistiques que nous avons publiées nous montrent une rupture nette en 1914. En phase ascendante la part de l'Etat dans l'économie est FAIBLE et CONSTANTE (elle oscille autour de 12 %) alors qu'elle croît au cours de la décadence pour atteindre aujourd'hui une moyenne avoisinant les 50 % du P.N.B. Ceci confirme notre thèse de l'indissoluble lien entre le développement du capitalisme d'Etat et la décadence et infirme catégoriquement celle de la FECCI.
[6] [31] Au terme de cette suite d'articles, il faut être aveugle comme nos censeurs pour ne pas voir la rupture constituée par la première guerre mondiale dans le mode de vie du capitalisme. Toutes les séries statistiques sur le long terme publiées dans l'article montrent cette rupture : production industrielle mondiale, commerce mondial, prix, intervention de l'Etat, termes de l'échange et armements. Seule l'analyse de la décadence et son explication par la saturation mondiale des marchés permet de comprendre cette rupture.
[7] [32] A la demande du gouvernement anglais, le député libéral Sir William Beveridge rédige un rapport, publié en 1942, qui servira de base pour édifier le système de sécurité sociale en GB mais inspirera également tous les systèmes de sécurité sociale des pays développés. Le principe est d'assurer à TOUS, en contre partie d'une cotisation prélevée sur le salaire, un revenu de remplacement en cas de "risque social" (maladie, accident, décès, vieillesse, chômage, maternité, etc.).
[8] [33] C'est également au cours de la seconde guerre mondiale que la bourgeoisie au Pays-Bas planifie avec les syndicats la hausse progressive des salaires selon un coefficient qui est fonction de la hausse de la productivité tout en lui étant inférieur.
[9] [34] CoC aime quand 2 et 2 font a, dès qu'on leur explique que quatre peut être obtenu en faisant 6 moins 2 c'est, pour eux, contradictoire. C'est pourquoi CoC revient "au CCI et d ses considérations contradictoires sur l'armement. Si d'un côté tes armements fournissent des débouchés d la production au point que par exempte la reprise économique après ta crise de 1929 serait due exclusivement d l'économie d'armement, d'un autre côté nous apprenons que l'armement n'est pas une solution aux crises et donc que tes dépenses d'armements sont pour le capital un gaspillage inouï pour !e développement des forces productives, une production d inscrire au passif du bilan définitif." (n' 22 p. 23)
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [36]
Vingt ans depuis 1968 : l'évolution du milieu politique depuis 1968 (3ème partie)
- 2627 reads
LES DEUX PREMIERES PARTIES DE CET ARTICLE SONT PARUES DANS LES NUMEROS 53 ET 54 DE LA REVUE INTERNATIONALE
Le milieu de l’année 1983 est marqué par la reprise de la lutte de classe. Sabotées par les manoeuvres du syndicalisme de base impulsé par la gauche et les gauchistes, déboussolées par le passage de la gauche dans l'opposition, les luttes de 78-80 en occident ont été dévoyées, et leur reflux ponctué par la répression brutale de décembre 1981 en Pologne, préparée par le travail de sape de Solidarnosc. Après trois ans de recul, la combativité retrouvée du prolétariat ne va cesser de s'affirmer sur l'ensemble de la planète : après les grèves massives des ouvriers de Belgique à l'automne 1983, ce sont successivement la Hollande, la R.FA., la Grande-Bretagne, les U.S A., la Suède, la France, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la Corée, la Pologne, et la liste n'est pas exhaustive, qui sont marqués par des luttes significatives de la classe ouvrière.
Comment le milieu politique prolétarien et les organisations qui le constituent, vont-ils réagir ? Comment va être assumée la responsabilité essentielle des révolutionnaires, une nouvelle fois posée avec acuité par la lutte de classe en développement : celle de la nécessité de l'intervention des révolutionnaires au sein des luttes de leur classe
Quelles vont être les conséquences de l'accélération de l'histoire sur tous les plans : économique, militaire et social, sur la vie du milieu politique prolétarien ? Le redéploiement de la lutte de classe porte en lui le développement potentiel du milieu révolutionnaire. Cette revitalisation de la lutte ouvrière va-t-elle permettre au milieu politique prolétarien de surmonter la crise qu'il a traversée dans la période précédente ? Va-t-elle lui permettre de dépasser les difficultés et les faiblesses qui le marquent depuis la reprise historique de la lutte de classe en 1968 ?
UN MILIEU POLITIQUE AVEUGLE FACE A LA LUTTE DE CLASSE
"Les formidables affrontements de classe qui se préparent seront également une épreuve de vérité pour les groupes communistes : ou bien, ils seront capables de prendre en charge ces responsabilités et ils pourront apporter une contribution réelle au développement des luttes, ou bien ils se maintiendront dans leur isolement actuel et ils seront balayés par le flot de l’histoire sans avoir pu mener à bien la fonction pour laquelle la classe les a fait surgir. "
Adresse du CCI aux groupes politiques prolétariens (2° trimestre 1983).
Le CCI sera la seule organisation à reconnaître pleinement dans les mouvements de classe de l'année 1983 les signes d'une reprise internationale de la lutte de classe. Pour l'ensemble des autres groupes du milieu prolétarien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour ceux-ci, les luttes ouvrières qui se développent sous leurs yeux, à partir de 1983, n'ont rien de significatif ; elles restent encore sous l'emprise des appareils syndicaux, donc elles ne peuvent être l'expression d'une reprise prolétarienne !
En dehors du CCI., la plupart des organisations du milieu politique prolétarien qui ont survécu à la décantation et à la crise de la fin des années 70 et du début des années 80, théorise, comme un seul homme, que nous sommes toujours en période de contre-révolution. Les plus anciennes organisations du milieu révolutionnaire, chacune à sa manière, affirment donc que depuis la débâcle prolétarienne des années 30, il n'y a pas grand-chose de changé, notamment celles issues du P.C.I. de 1945, c'est-à-dire les différents groupes de la diaspora bordiguiste d'une part (P.C.I.-Programme communiste ou II Partito Comunista par exemple) et Battaglia Comunista (regroupée avec la C.W.O. de G.B. au sein du B.I.P.R.) d'autre part. Quant au F.O.R., lui qui au plus profond de la défaite ouvrière dans les années 30 voit la révolution triomphante en Espagne, aujourd’hui, il ne voit dans les luttes ouvrières que leur faiblesse !
Les micro-sectes parasitaires, incapables d'exprimer une cohérence propre, soit développent un académisme bordiguisant tout à fait stérile comme par exemple Communisme ou Civilisation en France, soit sombrent dans une dérive anarcho-conseilliste; les deux tendances n'étant d'ailleurs absolument pas contradictoires comme le montre un groupe tel que le G.C.I. Mais le point commun reste toujours une négation bornée de la réalité de la lutte de classe présente. Même les vestiges du milieu "moderniste" issues de 1968, participent à leur manière à cette négation généralisée de la combativité en développement du prolétariat dans les années 80. Ainsi on a pu voir surgir de manière éphémère mais significative en France une revue au titre évocateur : La Banquise.
La vision, généralisée en dehors du CCI., selon laquelle le cours historique est toujours à la contre-révolution, traduit à l'évidence une sous-estimation dramatique de la lutte de classe depuis 1968 et ne peut donc que se manifester négativement sur le plan essentiel pour les révolutionnaires qu'est celui de leur intervention au sein des luttes. Cette situation déjà évidente à la fin des années 60, lorsque les organisations alors constituées, telles le P.CI.(Programme communiste) et le P.CI.(Battaglia comunista) sont étrangement absentes, car elles ne voient pas la lutte de classe qui se déroule sous leurs yeux et nient l'importance significative des luttes ouvrières de mai 68 en France - grève la plus massive que le prolétariat ait jamais menée en France pourtant-, se confirme à la fin des années 70. L'intervention du CCI dans la vague de lutte qui se redéploie, va être la cible des critiques de l'ensemble du milieu prolétarien. Cette vision du cours historique prend un tour encore plus aigu avec la reprise des luttes depuis 1983.
LA QUESTION DE L'INTERVENTION AU COEUR DES DEBATS
Depuis le début du renouveau de la lutte de classe qui marque les années 80, l'intervention des organisations politiques révolutionnaires dans les luttes ouvrières, en dehors de, celle du CCI., va être quasiment inexistante. Les groupes politiquement les plus faibles vont aussi être, bien sûr, les plus absents de l'intervention directe dans les luttes. Après un activisme tous azimuts au début des années 80, le G.C.I., alors que la lutte de classe se développe, va s'enfoncer dans un académisme douillet, tandis que le F.O.R., pour justifier son inexistence sur le terrain de la lutte de classe, va se réfugier derrière la théorisation de son manque de moyens matériels ([1] [37]) ! Tout à fait significatif est le fait que, malgré leurs rodomontades, ces groupes n'ont, durant cette période qui s'est ouverte depuis 1983, pas dû faire plus de tracts qu'une seule main ne compte de doigts, sans parler même de leur contenu.
Le B.I.P.R. quant à lui, exprime certainement une autre solidité politique que celle des groupes que nous venons de citer; pourtant, son intervention au sein des luttes n'est guère plus reluisante. Cela est d'autant plus grave que cette organisation constitue en dehors du CCI. le principal pôle de regroupement au sein du milieu politique prolétarien international. La volonté effective d'intervention de ce groupe lors de la longue grève des mineurs en Grande-Bretagne en 1984 ne va malheureusement pas se répéter dans les luttes qui vont suivre. Malgré une présence effective de membres du B.I.P.R. en France, celui-ci ne développera aucune intervention lors de la grève des cheminots en 1986 et, si Battaglia Comunista intervient dans la lutte des travailleurs de l'école en 1987 en Italie, ce sera avec de longues semaines de retard sous la sollicitation insistante de la section du CCI dans ce pays.
Cette faiblesse de l'intervention du B.I.P.R. trouve son origine dans ses conceptions politiques erronées qui ont déjà été au coeur des débats des conférences internationales des groupes de la Gauche communiste qui se sont déroulées en 1977, 1978 et 1980. Cela s'exprime essentiellement sur deux plans :
- une incompréhension de la période historique présente qui entraîne l'incompréhension des caractéristiques de la lutte de classe dans cette période et se traduit par une sous-estimation profonde de celle-ci. Ainsi, la C.W.O. peut écrire au groupe Alptraum du Mexique à propos des luttes en Europe : "Nous ne pensons pas que la fréquence et l'extension de ces formes de luttes indiquent -tout au moins jusqu'à aujourd’hui- une tendance vers leur développement progressif Par exemple, après les luttes des mineurs britanniques, des cheminots en France, nous avons l'étrange situation dans laquelle les couches agitées sont celles de la petite-bourgeoisie /", et de citer ensuite, entre autres, comme exemple de la petite-bourgeoisie, les enseignants !
- de graves confusions sur la question du parti qui se traduisent par une incompréhension du rôle des révolutionnaires. Toujours à Alptraum qui a publié cette lettre dans Comunismo n° 4, le B.I.P.R. peut ainsi écrire : "Il n'existe pas un développement significatif des luttes parce qu'il n'existe pas le parti; et le parti ne pourra exister sans que la classe ne se trouve dans un processus de développement des luttes". Comprenne qui pourra dans cette étrange dialectique, mais dans ces conditions, c'est toute la question du rôle décisif de l'intervention des révolutionnaires qui est escamotée en attendant le surgissement du 'deus ex-machina', du parti avec un grand P.
Durant toute cette période, le CCI. qui ne se proclame pas Parti comme le P.C.I.(Battaglia comunista), a, quant à lui, essayé de développer son intervention dans la mesure de ses forces, essayant de s'élever à la hauteur des responsabilités historiques qui sont celles des révolutionnaires vis-à-vis de leur classe. Pas une lutte significative, là où existent des sections du CCI. , dans laquelle les positions révolutionnaires n'aient été défendues, et où l'intervention du CCI n'ait tenté de pousser la dynamique ouvrière, de briser l'étau syndical, d'impulser l'extension, que ce soit par tracts, par des prises de paroles dans les assemblées ouvrières, par la diffusion de notre presse, etc. Il ne s'agit pas ici de tirer gloriole de ce fait ni de s'étaler démesurément, mais de poser simplement ce que doit être l'intervention des révolutionnaires lorsque le prolétariat développe ses luttes et que l'impact de leurs idées s'en trouve donc facilité.
Dans ces conditions, il n'est par conséquent pas surprenant que les débats et polémiques entre les différents groupes communistes sur la question de l'intervention proprement dite soient finalement restés plutôt maigres. Face à la vacuité de l'intervention des autres groupes, il n'a pu y avoir de réels débats sur le contenu d'une intervention qui n'existait pas. Il a fallu revenir aux principes de base sur le rôle des révolutionnaires que le CCI. a défendus avec vigueur. Quant à la critique des autres groupes vis-à-vis du CCI., elle s'est en général bornée à dire que le CCI surestimait la lutte de classe et sombrait dans l'activisme !
De fait, les questions de la reconnaissance du développement réel de la lutte de classe et du rôle des révolutionnaires dans la question de l'intervention vont constituer la ligne de démarcation au sein du milieu communiste qui polarisera, durant les années 80, tous les débats en son sein.
LES DEBATS AU SEIN DU CCI ET LA FORMATION DE LA F.E.CCI.
Les tendances délétères de la propagande bourgeoise qui a durant ces années imposé un black-out sur la réalité des grèves pour mieux en nier l'existence, n'ont pas seulement poussé l'ensemble des autres organisations prolétariennes à rester aveugles face aux luttes ouvrières, à les sous-estimer profondément, mais ont aussi pesé sur le CCI. De la lutte au sein du CCI contre ces tendances à la sous-estimation de la lutte de classe va naître un débat qui a pour fondement les questions de la conscience de classe et du rôle des révolutionnaires. Ce débat va ensuite se développer pour poser :
- la question du danger que constitue dans la période actuelle le conseillisme qui cristallise une tendance à nier la nécessité de l'organisation politique et donc à nier la nécessité d'une intervention organisée au sein de la classe;
- la question de l'opportunisme comme expression de l'infiltration de l'idéologie dominante au sein des organisations du prolétariat.
Ces débats vont être la source d'un renforcement politique et de clarifications essentielles au sein du CCI. Ils vont permettre un renforcement de la capacité d'intervention au sein des luttes par une meilleure compréhension du rôle actif des révolutionnaires dans le processus de développement de la conscience dans la classe, et une meilleure réappropriation de l'héritage des fractions révolutionnaires du passé qui va s'exprimer dans une vision plus adéquate du processus de dégénérescence et de trahison des organisations de la classe au début du siècle et dans les années 30.
Se trouvant réduits à une petite poignée, plus dilettante que militante, des camarades en désaccord vont saisir le premier prétexte venu pour se retirer, dès le début de ses travaux, du 6e Congrès du CCI., fin 1985, contents de se "libérer" du "carcan" de l'organisation, et vont se constituer en "Fraction Externe" du CCI., prétendant être les défenseurs "orthodoxes" de la plate-forme du CCI. Cette scission irresponsable traduit une incompréhension profonde de la question de l'organisation et donc une sous-estimation grave de sa nécessité. Plus que toutes les arguties théoriques et le tombereau de calomnies que la F.E.CCI a pu déverser sur le CCI pour justifier son existence de secte, ce qui détermine son surgissement, c'est une sous-estimation de la lutte de classe et du rôle essentiel des révolutionnaires dans leur intervention au sein de celle-ci. La F.E.CCI., si parfois elle reconnaît formellement la reprise des luttes prolétariennes depuis 1983, s'est engagée ainsi dans les mêmes ornières de passivité académique où patauge malheureusement déjà la majorité des organisations plus anciennes du milieu prolétarien, comme nous venons de le voir. Elle qui se proclame le défenseur orthodoxe de la plate-forme du CCI., va peu à peu, depuis 1985, se trouver une multitude de nouvelles divergences qui constituent autant d'abandons de la cohérence dont elle entendait pourtant se faire le "dernier" défenseur ! La F.E.CCI a ouvert la boîte de Pandore, et comme l'ont fait avant elle d'autres scissions du CCI. tels le P.I.C et le G.C.I., c'est à d'autres abandons bien plus graves, mettant en cause la plate-forme dont elle se réclame, qu'elle se prépare dans la dynamique où elle se trouve entraînée pour valider son existence séparée.
LE POIDS DE LA DECOMPOSITION SOCIALE ET LA DECANTATION AU SEIN DU MILIEU REVOLUTIONNAIRE
Cette nouvelle scission est-elle le signe d'une crise du CCI., l'indice d'un affaiblissement politique et organisationnel de l'organisation qui constitue aujourd’hui le principal pôle de regroupement et de clarté au sein du milieu prolétarien? Bien au contraire, ce que la F.E.CCI. exprime, c'est la résistance à la mise en adéquation des activités des révolutionnaires aux besoins de la lutte de classe à un moment où le prolétariat reprend de manière déterminée la voie de la lutte et où se pose de façon aiguë la nécessité de l'intervention, c'est-à-dire de ne pas rester au balcon à regarder la lutte ouvrière qui passe de manière "critique", mais d'être partie prenante de ces luttes, de défendre en leur sein les positions révolutionnaires à un moment où il peut se développer un réel écho à celles-ci. C'est parce que le CCI a su poursuivre la clarification théorique et politique, et le renforcement organisationnel indispensable pour jouer son rôle d'organisation de combat de la classe que les éléments les moins convaincus qui préfèrent les discussions académiques au feu de la lutte de classe l'ont quitté. Paradoxalement, même si tout départ de militants ne peut en aucun cas être quelque chose de souhaitable et si on ne peut que regretter la scission irresponsable qui a donné lieu à la formation de la F.E.CCI et n'a fait qu'apporter un peu plus de confusion dans le milieu qui n'en a nullement besoin, c'est à un renforcement politique et organisationnel du CCI qu'on assiste durant cette période et qui va se concrétiser par sa plus grande capacité à assurer une présence des idées révolutionnaires au sein de la lutte de classe en plein développement.
Cependant, si le surgissement de la F.E.CCI ne traduit pas une crise du CCI qui signifierait, dans la mesure où c'est la principale organisation du milieu, une crise de l'ensemble du milieu prolétarien, elle n'en traduit pas moins les difficultés qui pèsent de manière persistante sur les groupes révolutionnaires depuis le ressurgissement du prolétariat sur la scène de l'histoire en 1968.
Ces difficultés trouvent leur origine, comme nous l'avons vu, dans l'inadéquation théorique et politique fondamentale de la majorité des groupes qui ne voient pas la lutte de classe qui se déroule sous leurs yeux et sont par conséquent bien incapables de se revitaliser à son contact. Mais là n'est pas la seule explication. L'immaturité organisationnelle, produit de décennies de rupture organique d'avec les fractions révolutionnaires issues de l'Internationale communiste, qui marque le milieu prolétarien ressurgi au lendemain de 1968, se concrétise dans un sectarisme pesant, entrave le nécessaire processus de clarification et de regroupement au sein du milieu communiste, va être le biais par lequel s'infiltre l'idéologie dominante dans son aspect le plus pernicieux, celui de la décomposition.
Une des caractéristiques spécifiques de la période historique présente est que, alors que la fuite en avant de la bourgeoisie dans la guerre est freinée par la combativité prolétarienne et que par conséquent la voie à une nouvelle guerre impérialiste généralisée, n'est pas ouverte, le développement lent de la crise et de la lutte de classe n'a pas permis que surgisse encore clairement au sein de la société la perspective prolétarienne de la révolution communiste. Cette difficulté est inhérente au fait que c'est justement face à la crise que la classe ouvrière doit développer ses luttes et sa prise de conscience révolutionnaire. Cette situation de "blocage" se traduit dans le pourrissement sur pied, la décomposition générale de l'ensemble de la vie sociale et de l'idéologie dominante. Avec l'accélération de la crise au dé but des années 80, cette décomposition n'a cessé de s'accentuer. Elle touche particulièrement les couches petites-bourgeoises qui n'ont aucun avenir historique, mais elle tend aussi malheureusement à manifester ses effets pervers sur la vie du milieu prolétarien. C'est la forme que tend à prendre le processus de sélection de l'histoire, de décantation politique au sein du milieu dans la période présente.
Le poids de la décomposition environnante tend à se traduire de différentes manières au sein du milieu prolétarien, on peut notamment citer :
- La multiplication des micro-sectes. Le milieu communiste a connu ces dernières années de multiples petites scissions qui toutes traduisent la même faiblesse, aucune d'elles n'a représenté un quelconque apport à la dynamique de regroupement en se situant clairement par rapport aux pôles de débat déjà existants, mais au contraire, elles se sont enfermées dans leur spécificité pour constituer de nouveaux aspects de confusion dans un milieu prolétarien déjà trop dispersé et émietté. On peut ainsi citer, en dehors de la F.E.CC. dont nous avons déjà trop parlé, A Contre Courant qui quitte le CCI en 1988. S'il exprime une réaction positive face à la dégénérescence du G.C.I., il n' est pas pour autant dans sa critique capable d'aller au-delà d'un retour aux sources de ce groupe, origines qui portent déjà les germes de tous les déboires qu'il a connus ultérieurement. Il en est ainsi aussi de la scission récente du F.O.R. qui s'est réfugié derrière de fausses arguties organisationnelles sans être capable de publier une quelconque argumentation politique. De plus, on a vu ressurgir ou naître, en France par exemple, une multitude de petites sectes parasitaires comme Communisme ou Civilisation, Union prolétarienne, Jalons, Cahiers Communistes, etc., qui représentent quasiment autant de points de vue que les quelques individus qui les composent et qui, de flirts en divorces, n'en finissent pas d'alimenter la confusion au sein du milieu politique et face à la classe en fournissant de lamentables caricatures d'organisations prolétariennes. Tous ces groupuscules irresponsables constituent autant de repoussoirs pour des éléments sérieux qui tentent de se rapprocher d'une cohérence révolutionnaire.
- Une perte du cadre normal de débat au sein du milieu révolutionnaire. Ces dernières années ont été marquées par de graves dérapages polémiques au sein du milieu prolétarien dont le CCI. a été la cible essentielle. Que le CCI. soit au centre des débats cela est parfaitement normal dans la mesure où il constitue le principal pôle au sein du milieu révolutionnaire actuel, cependant, cela ne peut en aucun cas justifier les imbécillités dangereuses qui ont pu être écrites sur son compte. Ainsi la mauvaise foi et le dénigrement systématique de la F.E.CCI. qui trouve sa cohésion dans "l’anti-CCI", le F.O.R. qui traite le CCI. de "capitaliste" parce que celui-ci serait riche, et pire encore, le G.C.I. qui édite un article intitulé "Une fois de plus le CCI. du côté des flics contre les révolutionnaires" ! Ces dérapages, plus que l'imbécillité de ceux qui en sont les auteurs traduisent une grave perte de vue de ce qui constitue l'unité du milieu politique prolétarien face à toutes les forces de la contre-révolution et les principes qui doivent présider aux rapports existants en son sein afin de le protéger.
- L'érosion des forces militantes, face au poids dominant de l'idéologie capitaliste, notamment dans ses variantes petites-bourgeoises, la perte de vue de ce qu'est le militantisme révolutionnaire, la perte de conviction et le repli dans le confort "familial" sont un phénomène qui, de tout temps, a pesé sur les organisations révolutionnaires. Cependant dans la période actuelle, cette usure de la conviction militante par l'idéologie dominante s'en trouve accentuée de par la décomposition environnante. De plus, la confrontation aux difficultés de l'intervention dans la lutte de classe est un puissant facteur d'hésitation pour les convictions les moins ancrées, et souvent, tout autant que le retrait pur et simple du militantisme sans divergences réelles, la fuite en avant dans l'académisme stérile, loin du combat que mène la classe est l'expression d'une même peur des implications pratiques du combat révolutionnaire : confrontation avec les forces de la bourgeoisie, répression, etc.
Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que l'usure de l'idéologie dominante dans sa forme décomposée affecte en priorité les organisations politiquement et organisationnellement les plus faibles. Ces dernières années, leur dégénérescence s'est accélérée. L'exemple le plus clair en est le G.C.I. Sa fascination morbide pour la violence l'a mené dans une dérive de plus en plus forte vers le gauchisme et l'anarchisme qui s'est traduite par exemple dans un soutien aux actions du Sentier Lumineux du Pérou, organisation maoïste s'il en est ou encore, récemment, dans le soutien totalement irresponsable aux luttes en Birmanie embrigadées derrière la bannière démocratique et où les ouvriers sont allés au casse-pipe face à l'armée ! Le F.O.R. qui aujourd'hui encore, nie de manière psychotique la crise, s'enfonce dans les marécages modernistes et son outrance verbale cache de plus en plus mal sa vacuité théorique et pratique. Quant à la F.E.CCI., sa critique-critique systématique de la cohérence du CCI la pousse dans une incohérence toujours plus grande et dans sa presse semble s'exprimer autant de points de vue qu'il y a de militants !
De son côté, la diaspora bordiguiste ne s'est pas remise de l'effondrement du P.C.I. (Programme communiste) ([2] [38]) et végète tristement en fournissant son obole au syndicalisme de base. Tous ces groupes, incapables de se situer dans la lutte de classe aujourd'hui parce que fondamentalement ils la nient ou la sous-estiment trop profondément, sont donc incapables de se régénérer à son contact et leur avenir risque d'avoir rapidement l'odeur nauséabonde des poubelles de l'histoire.
Les organisations qui sont l'expression de réels courants historiques au sein du milieu communiste parce qu'elles expriment une plus grande cohérence théorique et une plus grande expérience organisationnelle, sont mieux à même de résister au poids délétère de l'idéologie dominante. Ce n'est certainement pas par hasard si aujourdhui le CCI. et le B.I.P.R. sont les principaux pôles de regroupement au sein du milieu prolétarien. Cependant, cela n'est certainement pas une garantie d'immunisation contre les virus de l'idéologie dominante. Même les organisations les plus solides n'ont pas échappé aux effets pernicieux de la décomposition environnante. L'exemple du P.C.I. bordiguiste qui, à la fin des années 70, était la principale (au moins au niveau numérique) organisation du milieu et qui s'est définitivement effondré (2) au début des années 80, en est le plus parfait exemple. Ces dernières années, le départ du CCI. des éléments qui allaient former la F.E.CCI., ou plus récemment, le départ acerbe des éléments du Noyau nord d'Accion Proletaria, la section en Espagne du CCI., tout comme la participation d'un élément du B.I.P.R. en France à une pseudo-conférence réunissant à Paris la F.E.CCI., Communisme ou Civilisation, Union prolétarienne, Jalons et des individus isolés, validant ainsi ce bluff pour ensuite quitter le B.I.P.R. devant le désaveu rencontré, sont autant d'éléments qui montre que la vigilance et le combat contre les effets de la décomposition de l'idéologie sont une priorité.
Le CCI., pour sa part a su prendre clairement position sur ces questions : en diagnostiquant la crise du milieu prolétarien en 1982, en soulignant en 1984 le danger de l'infiltration de l'idéologie dominante qui trouve son expression politique au niveau historique dans l'opportunisme et le centrisme, en posant aujourd'hui dans l'analyse des spécificités de la période actuelle, notamment le poids de la décomposition de l'idéologie capitaliste environnante. Ce faisant, il s'est armé politiquement et renforcé organisa-tionnellement. Le B.I.P.R. quant à lui, préfère faire la politique de l'autruche, la crise du milieu au début des années 80, il l'a splendidement niée, déclarant péremptoirement que ce n'était que la crise des autres groupes. Il est vrai que Battaglia comunista et par la suite le B.I.P.R. n'ont pas connu de scission, mais cela en soi est-il significatif de la vitalité d'une organisation ? Durant les longues années qui ont précédé l'éclatement final du P.CI. (Programme communiste) en 1983, il n'avait pas connu de scissions significatives.... Le manque de débats internes, la sclérose politique ne se traduisent pas le plus souvent par des scissions politiques, mais par un déboussolement politique croissant qui se traduit par une hémorragie militante dans le désenchantement sans qu'il y ait clarification, ni pour ceux qui partent, ni pour ceux qui restent.
Pour le B.I.P.R., son repli de l'intervention dans la lutte de classe, sa théorisation de la contre-révolution persistante sont autant de facteurs inquiétants pour son avenir.
Devant ce bilan des difficultés que traverse le milieu politique, doit-on tirer la conclusion que le milieu communiste n'est pas sorti de sa crise du début de la décennie qui s'était pleinement exprimée dans la disparition du bordiguisme comme principal pôle de référence au sein du milieu prolétarien?
Avec la reprise de la lutte de classe, le développement du milieu prolétarien
La situation du milieu prolétarien est aujourd’hui bien différente de celle qui détermine la crise de 1982-83 ([3] [39]) :
- L’échec des Conférences des groupes de la Gauche communiste, sept ans plus tard, même s'il pèse encore, est digéré;
- nous ne sommes plus dans une période de recul de la lutte de classe, au contraire, celle-ci a repris depuis cinq ans maintenant ;
- l'organisation la plus importante du milieu prolétarien n'est plus une organisation sclérosée et dégénérée comme l'était le P.C.I. bordiguiste.
En ce sens, le milieu politique n'est pas, malgré les faiblesses très graves qui continuent de le marquer et dont nous venons de tracer un rapide bilan, dans la même situation de crise que celle qui l'a marqué au début de la décennie. Au contraire, depuis 1983, le développement de la lutte de classe en même temps qu'il crée le terrain pour un écho renforcé des positions révolutionnaires tend à faire surgir de nouveaux éléments au sein du milieu prolétarien. Même si, à l'image de la lutte de classe dont il est le produit, ce surgissement d'un nouveau milieu révolutionnaire est un processus lent, il n'en est pas moins significatif de la période présente.
L'apparition d'un milieu politique prolétarien à la périphérie des principaux centres du capitalisme mondial comme au Mexique avec Alptraum qui publie Comunismo et le Grupo Proletario Internacionalista qui publie Revolucion Mundial, en Inde avec les groupes Communist Internationalist et Lai Pataka et le cercle Kamunist Kranti, en Argentine avec le groupe Emancipacion Obrera, est extrêmement important pour l'ensemble du milieu prolétarien, alors que durant des années, nul écho des positions révolutionnaires ne semblait surgir de ces pays marqués par le sous-développement capitaliste. Bien sûr, tous ces groupes n'expriment pas le même degré de clarté, et leur survie reste fragile étant donnés leur manque d'expérience politique, leur éloignement du centre politique du prolétariat que constitue l'Europe, les conditions matérielles extrêmement précaires dans lesquelles ils doivent se développer. Cependant, le simple constat de leur existence est la preuve de la maturation générale de la conscience de classe qui est en train de se développer au sein du prolétariat mondial.
Le surgissement de ces groupes révolutionnaires à la périphérie du capitalisme pose de manière cruciale la responsabilité des organisations révolutionnaires déjà existantes qui ont tenté de se réapproprrier l'expérience historique du prolétariat qui fait cruellement défaut aux nouveaux groupes surgissant sans connaissance réelle des fractions révolutionnaires du passé, sans même une connaissance des débats qui ont animé le milieu communiste depuis deux décennies, sans expérience organisationnelle. La situation de dispersion du milieu politique ancien marqué par le sectarisme est une entrave dramatique au nécessaire processus de clarification dans lequel ces nouveaux éléments qui surgissent au sein du milieu révolutionnaire doivent s'engager. Vu de loin, il est extrêmement difficile de s'y retrouver dans le dédale des multiples groupes existant en Europe et d'apprécier à leur juste mesure l'importance politique des différents groupes et des débats existants.
Les mêmes difficultés qui affectent le milieu politique ancien centré sur l'Europe pèsent d'un poids encore plus fort sur les nouveaux groupes qui surgissent à la périphérie, par exemple le sectarisme d'un groupe comme Alptraum au Mexique ou du cercle Kamunist Kranti en Inde sont malheureusement à signaler, mais il est extrêmement important de comprendre que la confusion politique que ces groupes et éléments peuvent manifester, est d'une nature différente de celle des groupes existants en Europe : si dans le premier cas elle exprime une immaturité de jeunesse renforcée par le poids de l'isolement, dans le second elle est l'expression d'une sclérose précoce ou d'une dégénérescence sénile.
L'influence des groupes anciens va être déterminante pour l'évolution des nouveaux groupes qui surgissent. Ceux-ci ne peuvent développer leur cohérence, se renforcer politiquement, survivre comme expression révolutionnaire qu'en brisant leur isolement, en s'intégrant aux débats existants au sein du milieu politique international, en se rattachant aux pôles historiques déjà existants. Les influences négatives d'un groupe tel que le G.C.I. qui nie l'existence d'un milieu politique prolétarien et véhicule des confusions extrêmement graves vont peser de tout leur poids sur l'évolution d'un groupe tel que Emancipacion Obrera en Argentine, renforçant de plus ses faiblesses intrinsèques. De même, l'académisme de petite secte de Communisme ou Civilisation avec qui Alptraum développe son activité, ne peut mener ce dernier qu'à la stérilité. Le B.I.P.R., dans l'ensemble, a développé une attitude plus correcte vis-à-vis des nouveaux groupes qui surgissaient ; cependant, celle-ci reste entachée par l'opportunisme des conceptions organisa-tionnlles qui ont présidé à la naissance du B.I.P.R. ([4] [40]) : par exemple, l'intégration hâtive de Lai Pataka comme expression du B.I.P.R. en Inde. De plus, la sous-estimation grave de la lutte de classe que tous ces groupes anciens expriment, tend à entraver fortement l'évolution des nouveaux groupes qui surgissent, en les privant de la compréhension fondamentale de ce qui a déterminé leur naissance : le développement international actuel de la lutte ouvrière.
Le CCI. quant à lui, parce qu'il a fait dès son origine, au lendemain de 1968, le constat de la passivité et de la confusion politique des organisations qui existaient alors, notamment chez le P.CI.(Programme communiste) et le P.CI.(Battaglia comunista), prend particulièrement à coeur ses responsabilités vis-à-vis des nouveaux groupes qui surgissent au sein du milieu prolétarien De la même manière que l'intervention au sein de la lutte de classe, l'intervention vis-à-vis des groupes que la lutte de classe fait naître pour notre organisation est une priorité.
Dans la presse du CCI. ont été publiés, loin de tout esprit sectaire, des textes de Emancipacion Obrera, Alptraum, du G.P.I., de Communist Internationalist, et de tous les groupes dont il a été fait mention dans notre presse, les faisant souvent ainsi connaître à l'ensemble du milieu révolutionnaire, contribuant ainsi grandement à briser leur isolement. Pas un de ces groupes avec lequel une importante correspondance n'ait été échangée, pas un qui n'ait reçu notre visite, afin de permettre des discussions approfondies et contribuer ainsi à une meilleure connaissance réciproque et à la clarification nécessaire, non pas pour faire du recrutement et pousser à une intégration prématurée au sein du CCI., mais pour permettre leur réelle solidification politique, leur survie, étape indispensable pour qu'un regroupement que nous estimons toujours nécessaire puisse se faire dans la plus grande clarté.
Si l'apparition de nouveaux groupes dans des pays éloignés des centres traditionnels du prolétariat est un phénomène particulièrement important, tout à fait significatif du développement actuel de la lutte de classe et de ses effets sur la vie du milieu politique, notre insistance ne signifie en aucun cas qu'il n'y a point un développement corollaire là où le milieu politique est déjà présent, bien au contraire. Mais ce développement ne prend pas la même forme, parce que le milieu politique est déjà présent avec ses organisations. Le surgissement de nouveaux éléments tend à se traduire non pas par l'apparition de nouveaux groupes mais par l'apparition d'éléments qui se rapprochent des groupes déjà existants. Les nouveaux éléments qui surgissent, contrairement à la situation de 1968 et de ses lendemains, marquée par le poids du milieu étudiant qui déterminait des préoccupations théoriques générales, le font au contact direct de la lutte ouvrière, produits en son sein. De nouveau, sur ce plan, la question de l'intervention apparaît comme cruciale pour permettre à ces éléments de rejoindre le milieu prolétarien, d'en renforcer les capacités militantes. Le développement actuel des comités de lutte et des cercles de discussion est l'expression du développement de la conscience qui est en train de s'opérer dans la classe. Pour les groupes prolétariens aujourd'hui, sous-estimer la question de l'intervention revient à se couper de ce qui détermine leur vie, cela est particulièrement évident en ce qui concerne le développement des ressources militantes, l'arrivée d'un sang neuf. Les organisations qui ne voient pas cela aujourd'hui, se condamnent à la stagnation d'abord, à la sclérose et à la régression ensuite, à la démoralisation et à la crise plus tard.
Avec le renouveau de la lutte de classe, une nouvelle génération de révolutionnaires est en train de naître. Non seulement l'avenir, mais déjà le présent sont porteurs d'une nouvelle dynamique de développement du milieu prolétarien. Mais cette dynamique ne signifie pas simplement que le relatif isolement des révolutionnaires de leur classe est en train de se briser de façon immédiate, ni que tout va s'en trouver facilité, elle signifie d'abord une décantation accélérée au sein du milieu prolétarien. Rien n'est gagné d'avance, l'avenir des organisations prolétariennes, leur capacité à forger demain le parti communiste mondial indispensable à la révolution communiste dépend de leur capacité présente à assumer les responsabilités pour lesquelles la classe les a produites. Tels sont les enjeux des débats et de l'activité présents du milieu communiste. Les organisations incapables d'assumer dès aujourd'hui leurs responsabilités, d'être partie prenante du combat de classe, ne sont d'aucune utilité pour le prolétariat et pour cette raison, le processus historique apportera sa sanction.
J.J.
[1] [41] Voir l'édifiant article intitulé "Hé ! Ceux du CCI." dans Alarme n° 37-38.
[2] [42] Voir deuxième partie de cet article dans la Revue Internationale n° 54.
[3] [43] Voir deuxième partie de cet article dans la Revue Internationale n° 54.
[4] [44] Voir deuxième partie de cet article dans la Revue Internationale n° 54.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [45]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [46]
1918 - 1919: il y a 70 ans ; a propos de la révolution allemande, II
- 3236 reads
Dans le n° 55 de la Revue Internationale, nous avons abordé quelques-uns des traits généraux les plus marquants de l’échec du mouvement révolutionnaire en Allemagne de novembre 1918 à janvier 1919, et les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce mouvement. Nous revenons dans cet article sur la politique contre-révolutionnaire systématique que mena dans cette période le SPD passé dans le camp de la bourgeoisie.
Au début de novembre 1918, la classe ouvrière en Allemagne avait été capable de mettre fin à la première guerre mondiale par sa lutte de masse, par le soulèvement des soldats. Pour couper l'herbe sous les pieds du mouvement, pour éviter un aiguisement plus fort des contradictions de classe, la classe dominante avait été obligée de mettre fin à la guerre sous la pression de la classe ouvrière, et de faire abdiquer le Kaiser ; il lui fallait ensuite éviter que la flamme de la révolution prolétarienne, qui s'était allumée un an plus tôt par la révolution d'octobre 1917 en Russie, n'embrasât aussi l'Allemagne. Tous les révolutionnaires étaient conscients que la classe ouvrière en Allemagne était au centre de l'extension internationale des luttes révolutionnaires : "Pour la classe ouvrière allemande nous sommes en train de préparer... une alliance fraternelle, du pain et une aide militaire. Nous allons tous exposer nos vies, pour aider les ouvriers allemands à pousser en avant la révolution qui a commencé en Allemagne." (Lénine, 1er octobre 1918, "Lettre à Sverdlov").
Tous les révolutionnaires étaient d'accord sur le fait que la révolution devait aller plus loin : "La révolution a commencé. Nous ne nous devons pas nous réjouir de ce qui a été réalisé, nous ne devons pas avoir le sentiment d'un triomphe sur l’ennemi écrasé, mais nous devrions faire la plus forte autocritique, pousser courageusement notre énergie ensemble, pour continuer ce que nous avons commencé. Parce que ce que nous avons réalisé est peu, et l’ennemi n’a pas été défait. " (Rosa Luxemburg, "Le début", 18 novembre 1918).
S'il avait été plus facile pour la classe ouvrière en Russie de renverser la bourgeoisie, la classe ouvrière en Allemagne avait affaire à une classe dominante autrement plus forte et plus intelligente, qui n'était pas seulement mieux armée du fait de sa force économique et politique, mais qui avait tiré des leçons des événements de Russie, et qui jouissait du soutien des classes dominantes des autres pays. Mieux encore, ce qui fut son atout décisif c'est que la bourgeoisie disposait du soutien du parti social-démocrate passé de son côté : "Dans toutes les révolutions antérieures, les combattants s'affrontaient de façon ouverte, classe contre classe, programme contre programme, épée contre bouclier. (...) Dans la révolution d'aujourd'hui les troupes qui défendent l'ordre ancien se rangent non sous leur propre drapeau et dans l'uniforme de la classe dominante, mais sous le drapeau du 'parti social-démocrate'. Si la question cardinale de la révolution était ouvertement et honnêtement posée dans les termes de capitalisme ou socialisme, les grandes masses du prolétariat n'auraient eu aucun doute ou hésitation. (...) Mais l'histoire ne nous rend pas les choses aussi faciles et confortables. La domination de classe bourgeoise mène aujourd'hui sa dernière lutte historique mondiale sous un drapeau étranger, sous le drapeau de la révolution elle-même. C'est un parti socialiste, c'est-à-dire la création la plus originale du mouvement ouvrier et de la lutte de classe, qui est lui-même devenu l'instrument le plus important de la contre-révolution bourgeoise. Le fond, la tendance, la politique, la psychologie, la méthode, tout cela est capitaliste de bout en bout. Seuls restent le drapeau, l'appareil et la phraséologie du socialisme." ("Une victoire à la Pyrrhus", Rosa Luxemburg, 21 décembre 1918, Oeuvres choisies, vol.4, p. 472). Comme déjà pendant la première guerre mondiale, le SPD devait être le plus loyal défenseur du capital pour écraser les luttes ouvrières.
ARRET DE LA GUERRE, GOUVERNEMENT SPD-USPD ET REPRESSION
Le 4 novembre 1918, l'appel du commandement militaire à la flotte, enjoignant d'appareiller pour une nouvelle bataille navale contre l'Angleterre - ordre que même certains généraux considéraient comme suicidaire - déclencha la mutinerie des marins de Kiel, sur la mer Baltique. Devant à la répression de la mutinerie, une vague de solidarité avec les marins se développa comme une traînée de poudre dans les premiers jours de novembre, à Kiel, puis dans les principales villes d'Allemagne. Tirant les leçons de l'expérience russe, le commandement militaire du général Groener, véritable détenteur du pouvoir en Allemagne, décida de mettre fin immédiatement à la guerre. L'armistice, réclamé aux Alliés dès le 7 novembre, fut signé le 11 novembre 1918. Avec ce cessez-le-feu la bourgeoisie éliminait un des facteurs les plus importants de radicalisation des conseils d'ouvriers et de soldats. La guerre avait arraché aux ouvriers leurs acquis, mais la plupart d'entre eux croyaient que, une fois la guerre terminée, il serait possible de revenir à la vieille méthode gradualiste et pacifique pour "faire avancer les choses". Beaucoup d'ouvriers se sont engagés dans le combat, avec la "paix" et la "république démocratique" comme principaux objectifs de la lutte. Une fois la "paix" et la "république" obtenues, au mois de novembre 1918, le combat de classe avait perdu l'aiguillon qui l'avait fait se généraliser, et cela se ressentira tout au long des luttes qui se poursuivront.
Le commandement militaire, levier central du pouvoir de la bourgeoisie, avait eu assez de perspicacité pour comprendre qu'il avait besoin d'un cheval de Troie pour arrêter le mouvement. Wilhelm Groener, chef suprême du commandement militaire, déclarera plus tard à propos de l'accord du 10 novembre 1918 avec Friedrich Ebert, dirigeant du SPD et chef du gouvernement :
"Nous avons formé une alliance pour combattre la révolution dans la lutte contre le bolchevisme. Le but de l'alliance que nous avons constituée le soir du 10 novembre était le combat sans merci contre la révolution, le rétablissement d'un pouvoir gouvernemental de l'ordre, le soutien de ce gouvernement par la force des armes et l'appel d'une assemblée nationale dès que possible. (...) A mon avis, il n'y avait aucun parti en Allemagne à ce moment avec assez d'influence dans le peuple, particulièrement parmi les masses, pour reconstruire une force gouvernementale avec le commandement militaire. Les partis de droite avaient complètement disparu et il était bien sûr hors de question de travailler avec les radicaux extrémistes. Il ne restait rien d'autre à faire pour le commandement militaire que de former une alliance avec les sociaux-démocrates majoritaires. "
Les cris de guerre les plus sournois du SPD contre les luttes révolutionnaires furent "unité des ouvriers", "pas de lutte fratricide", "unité du SPD et de l'USPD". Face à la dynamique vers une polarisation croissante entre les deux forces opposées, poussant à une situation révolutionnaire, le SPD s'efforça de masquer les contradictions entre les classes. D'un côté il ne cessa de cacher et déformer son propre rôle au service du capital pendant la guerre, de l'autre il s'appuya sur la confiance dont il jouissait encore parmi les ouvriers, résultant du rôle prolétarien qu'il avait joué avant la guerre pendant plus de trente ans. Il contracta une alliance avec l'USPD - composé d'une droite qui se distinguait à peine des sociaux-démocrates majoritaires, d'un centre hésitant, et d'une aile gauche, les Spartakistes -, dont le centrisme favorisa la manoeuvre du SPD. L'aile droite de l'USPD rejoignit en novembre le conseil des commissaires du peuple, qui était dirigé par le SPD, en d'autres termes le gouvernement bourgeois du moment.
Quelques jours après la création des conseils, ce gouvernement commença les premiers préparatifs d'une répression militaire systématique : organisations de Corps francs (troupes de mercenaires), rassemblant des unités de soldats républicains et des officiers fidèles au gouvernement, pour enrayer l'effondrement de l'armée et avoir de nouveaux chiens sanglants à sa solde.
Il était difficile pour les ouvriers de percer le rôle du SPD. Ancien parti ouvrier, puis protagoniste de la guerre et défenseur de l'Etat démocratique capitaliste, le SPD développait d'un côté un langage ouvrier "en défense de la révolution", et de l'autre il faisait, soutenu par l'aile droite de l'USPD, la chasse aux sorcières contre la "révolution bolchevik" et ceux qui la soutenaient, les Spartakistes.
Liebknecht, au nom des Spartakistes, écrivait dans le Rote Fahne du 19 novembre 1918 : "Ceux qui appellent le plus fort à l'unité (...) trouvent maintenant un écho surtout parmi les soldats. Ce n'est pas étonnant. Les soldats sont loin d'être tous prolétaires. Et la loi martiale, la censure, le bombardement de la propagande officielle n'ont pas manqué d'avoir un effet. La masse des soldats est révolutionnaire contre le militarisme, contre la guerre, et contre les représentants ouverts de l'impérialisme. Par rapport au socialisme, elle est encore indécise, hésitante, immature. Une grande partie des soldats prolétariens, comme les ouvriers, considèrent que la révolution a été accomplie, que nous devons seulement maintenant établir la paix et démobiliser. Ils veulent qu'on les laisse en paix après autant de souffrances. Mais ce n'est pas n'importe quelle unité qui nous rend forts. L'unité entre un loup et un agneau condamne l'agneau à être dévoré par le loup. L'unité entre le prolétariat et les classes dominantes sacrifie le prolétariat. L'unité avec les traîtres signifie la défaite. (...) La dénonciation de tous les faux amis de la classe ouvrière, est dans ce cas notre premier devoir (...) ".
Pour affaiblir les SPARTAKISTES, fer de lance du mouvement révolutionnaire, une campagne fut lancée contre eux: outre les calomnies systématiques qui présentaient Spartakus comme composé d'éléments corrompus, pillards, terroristes, les Spartakistes étaient interdits de parole. Le 6 décembre, les troupes gouvernementales occupèrent le journal de la Ligue Spartakus, le Rote Fahne (Drapeau rouge), le 9 puis le 13 décembre, le quartier général de la Ligue fut occupé par les soldats. Liebknecht fut dénoncé comme terroriste, responsable de l'anarchie et du chaos. Le SPD appela au meurtre de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht dès le début de décembre. Ayant tiré les leçons des luttes en Russie, la bourgeoisie allemande était déterminée à utiliser tous les moyens possibles contre les organisations révolutionnaires en Allemagne. Sans hésitation elle utilisa la répression contre elles dès le premier jour et ne cacha jamais ses intentions de tuer les dirigeants les plus importants.
CONCESSIONS REVENDICATIVES ET CHANTAGE AU RAVITAILLEMENT
Dès le 15 novembre, les syndicats et les capitalistes avaient conclu un accord pour limiter la radicalisation des ouvriers en faisant quelques concessions économiques. Ainsi fut accordée la journée de 8 heures sans réduction de salaire (en 1923 elle repassa à 10-12 heures). Surtout, des " conseils d'usine" (Betriebsrâte) furent instaurés systématiquement, dont l'objectif était de canaliser l'initiative des ouvriers dans les usines, et de les soumettre au contrôle de l’Etat. Ces conseils d'usine furent formés pour contrecarrer les conseils ouvriers. Les syndicats jouèrent un rôle primordial dans la mise en place de cet obstacle.
Enfin, le SPD lança la menace d'une intervention des Etats-Unis, qui bloquerait la fourniture de l'approvisionnement alimentaire au cas où les conseils ouvriers continueraient à "déstabiliser" la situation.
LA STRATEGIE DU SPD : DESARMER LES CONSEILS OUVRIERS
C'est surtout contre les conseils ouvriers que la bourgeoisie concentra son offensive. Elle essaya d'empêcher que le pouvoir des conseils ouvriers n'arrivât à saper, à paralyser l'appareil d'Etat.
- Dans certaines villes, le SPD prit l'initiative de transformer les conseils d'ouvriers et de soldats en "parlements populaires", moyen par lequel les ouvriers se trouvaient "dilués" dans "le peuple", ce qui leur ôtait toute possibilité de reprendre un rôle dirigeant vis-à-vis de l'ensemble de la classe travailleuse (c'est ce qui arriva à Cologne par exemple, sous la direction de K. Adenauer, qui sera plus tard chancelier).
- Les conseils ouvriers furent privés de toute possibilité concrète de mettre réellement en pratique les décisions qu'ils prenaient. Ainsi, le 23 novembre, le Conseil exécutif de Berlin (les conseils de Berlin avaient élu un Conseil exécutif, Vollzugsrai) n'opposa aucune résistance lorsque ses prérogatives lui furent retirées des mains, quand il renonça à exercer le pouvoir pour le laisser au .gouvernement bourgeois. Dès le 13 novembre, sous la pression du gouvernement bourgeois et des soldats qui le soutenaient, le Conseil exécutif avait renoncé à créer une garde rouge. Le Conseil exécutif se trouva ainsi confronté au gouvernement bourgeois sans avoir aucune arme à sa disposition, alors que dans le même temps, le gouvernement bourgeois s'occupait à rassembler des troupes en masse.
- Après que le SPD eût réussi à entraîner l'USPD au gouvernement, promulguant une frénésie d'"unité" entre les "différentes parties de la social-démocratie", il poursuivit son intoxication des conseils ouvriers. Dans le Conseil exécutif de Berlin comme dans les conseils des autres villes, le SPD insista sur l’égalité du nombre de délégués dans les conseils entre SPD et USPD. Avec cette tactique, il eut plus de mandats que le rapport de forces dans les usines ne lui en aurait alloués. Le pouvoir des conseils ouvriers comme organes essentiels de direction politique et organes de l'exercice du pouvoir fut ainsi encore plus déformé et vidé de tout contenu.
Cette offensive de la classe dominante se mena parallèlement à la tactique des provocations militaires. Ainsi, le 6 décembre les troupes fidèles au gouvernement occupèrent le Rote Fahne, arrêtèrent le Conseil exécutif de Berlin et provoquèrent un massacre parmi les ouvriers qui manifestaient (plus de 14 tués). Même si pendant cette phase, la vigilance et la combativité de la classe n'étaient pas encore brisées - le jour suivant les provocations, d'énormes masses d'ouvriers (150 000) prirent la rue -, et même si la bourgeoisie devait encore compter avec une résistance courageuse des ouvriers, le mouvement était très dispersé. L'étincelle de la révolte avait embrasé une ville après l'autre mais la dynamique de la classe ouvrière à la base, dans les usines, n'était pas très forte.
Dans une telle situation, l'impulsion au mouvement doit venir de plus en plus fortement de la base : des comités d'usine doivent se former, dans lesquels les ouvriers les plus combatifs se regroupent, des assemblées générales doivent se tenir, des décisions être prises, leur réalisation étant contrôlée, et les délégués doivent rendre compte aux assemblées générales qui les ont mandatés et si nécessaire être révoqués. Des initiatives doivent être prises. Bref, la classe doit mobiliser et rassembler toutes ses forces à la base par-delà les usines, les ouvriers doivent exercer un contrôle réel sur le mouvement. Mais en Allemagne le niveau de coordination englobant des villes et des régions n'avait pas été atteint ; au contraire l'aspect dominant était encore l'isolement entre les différentes villes, alors qu'une unification des ouvriers et de leurs conseils par delà les limites des villes est un pas essentiel dans le processus pour faire face aux capitalistes. Lorsque les conseils ouvriers surgissent et se confrontent au pouvoir de la bourgeoisie, une période de double pouvoir s'ouvre et ceci requiert que les ouvriers aussi centralisent leurs forces à une échelle nationale et même internationale. Cette centralisation ne peut ne peut qu'être le résultat d'un processus que les ouvriers contrôlent eux-mêmes. En arrière-plan de la dispersion du mouvement qui prévalait encore, l'isolement des différentes villes, le conseil des ouvriers et des soldats de Berlin, poussé par le SPD, convoqua un congrès national des conseils d'ouvriers et de soldats du 16 au 22 décembre. Ce congrès devait constituer une force centralisatrice avec une autorité centrale. En réalité, les conditions pour une telle centralisation n'étaient pas encore mûres, parce que la pression et la capacité de la classe à donner une impulsion dans ses propres rangs et à contrôler le mouvement n'étaient pas assez fortes. La dispersion était encore le trait dominant. Cette centralisation artificielle, PREMATUREE, à l'initiative du SPD, qui était plus ou moins "imposée" aux ouvriers au lieu d'être un produit de leur lutte, constitua un très grand obstacle pour la classe ouvrière.
Ce n'est pas surprenant si la composition des conseils ne correspondait pas à la situation politique dans les usines, si elle ne suivait pas les principes de responsabilité devant les assemblées générales et de révocabilité des délégués : la répartition des délégués correspondait plutôt aux pourcentages de votes pour les partis, sur la base du scrutin de 1910. Le SPD sut aussi comment utiliser l'idée courante à l'époque qu'un tel conseil devait travailler suivant les principes des parlements bourgeois. Ainsi, par une série de trucs parlementaires, de manoeuvres de fonctionnement, le SPD parvint à garder le congrès sous son contrôle. Après l'ouverture du congrès les délégués mirent en place immédiatement des fractions : sur 490 délégués, 298 étaient des membres du SPD, 101 de l'USPD, parmi lesquels 10 Spartakistes, 100 "divers".
Ce congrès était en fait une assemblée autoproclamée, qui parlait au nom des ouvriers, mais qui dès le début devait trahir les intérêts des ouvriers.
- Une délégation d'ouvriers russes, qui devait assister au congrès sur invitation du Conseil exécutif de Berlin, fut refoulée à la frontière sur ordre du gouvernement SPD '."L'Assemblée générale réunie le 16 décembre ne traite pas de délibérations internationales mais seulement d'affaires allemandes, dans lesquelles les étrangers ne peuvent bien sûr pas participer. (...) La délégation russe n'est rien d'autre que des représentants de la dictature bolchevik", telle fut la justification du Vorwarts, organe central du SPD (n° 340, 11 décembre 1918). C'est ainsi que la perspective d'unification des luttes à travers l'Allemagne et la Russie, ainsi que leur extension internationale, furent combattues par le SPD. Avec l'aide des manoeuvres tactiques du praesidium, le congrès rejeta la participation de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht : ils ne furent même pas admis comme observateurs sans droit de vote, sous prétexte qu'ils n'étaient pas des ouvriers des usines de Berlin.
Pour faire pression sur le congrès, la Ligue Spartakus organisa une manifestation de masse le 16 décembre 1918 à laquelle participèrent 250 000 ouvriers, parce que de très nombreuses délégations d'ouvriers et de soldats qui voulaient présenter leurs motions au congrès avaient été pour la plupart rejetées ou écartées.
Le congrès signa son arrêt de mort quand il décida d'appeler à la formation d'une assemblée constituante le plus tôt possible, assemblée qui devait détenir tout le pouvoir de la société. L'appât de la démocratie parlementaire bourgeoise tendu par la bourgeoisie entraîna la majorité des ouvriers dans le piège. L'arme du parlement bourgeois fut le poison utilisé contre l'initiative des ouvriers. Enfin le congrès mit en avant l'écran de fumée des "premières mesures de socialisation" qui devaient être prises, alors que la classe ouvrière n'avait même pas pris le pouvoir.
La question centrale, celle du désarmement de la contre-révolution, du renversement du gouvernement bourgeois fut ainsi repoussée à l’arrière-plan. "Prendre des mesures politico-sociales dans des usines particulières est une illusion tant que la bourgeoisie détient encore le pouvoir politique." (IKD, Der Kommunist).
Le congrès fut un succès total pour la bourgeoisie. Pour les Spartakistes il signifiait l'échec : "Le point de départ et la seule acquisition tangible de la révolution du 9 novembre, a été la formation des conseils d'ouvriers et de soldats. Le premier congrès de ces conseils a décidé de détruire cette seule acquisition, de voler au prolétariat ses positions de pouvoir, de démolir le travail du 9 novembre, d'emporter la révolution. (...) Puisque le congrès des conseils a condamné le véritable organe des conseils d'ouvriers et de soldats qui lui a donné son mandat, à n'être que l'ombre de lui-même, il a donc violé ses compétences, trahi le mandat que les conseils d'ouvriers et de soldats lui ont remis, il a détruit le sol sous les pieds de sa propre existence et autorité. (...) Les conseils d'ouvriers et de soldats déclareront nul et vide le travail contre-révolutionnaire de leurs délégués infâmes." ("Les esclaves d'Ebert", Rosa Luxemburg, 2 décembre 1918, ibid., vol. 4, p. 469). Dans quelques villes, Leipzig par exemple, les conseils locaux d'ouvriers et de soldats protestèrent contre les décisions du congrès. Mais la centralisation préventive des conseils les fit tomber rapidement dans les mains de la bourgeoisie. La seule voie pour combattre cette manoeuvre était d'accroître la pression de la "base", des usines, de la rue.
Encouragée et renforcée par les résultats de ce congrès, la bourgeoisie en vint alors à provoquer des confrontations militaires. Le 24 décembre, la Division de la marine du peuple, une troupe d'avant-garde, fut attaquée par les troupes gouvernementales. Plusieurs marins furent tués. Une fois encore un orage d'indignation éclata parmi les ouvriers. Le 25 décembre, un nombre important d'ouvriers prit la rue. En arrière-plan de ces actions contre-révolutionnaires ouvertes du SPD, l'USPD se retira du gouvernement le 29 décembre. Le 30 décembre et le 1er janvier la Ligue Spartakus et les IKD formèrent le parti communiste (KPD) dans le feu des luttes. A son congrès de fondation un premier bilan du mouvement fut tiré. Nous reprendrons le contenu des débats à ce congrès à une autre occasion. Le KPD, par la voix de Rosa Luxemburg, souligna : "Le passage de la révolution de soldats prédominante le 9 novembre 1918 à une révolution ouvrière spécifique, la transformation du superficiel, purement politique, dans le lent processus de règlement de comptes général économique entre le travail et le capital, réclame de la classe ouvrière révolutionnaire un niveau complètement différent de maturité politique, d'éducation, de ténacité de celui qui a suffi pour la première phase de début." ("Le 1er congrès", 3 janvier 1919, Die Rote Fahne).
LA BOURGEOISIE PROVOQUE UNE INSURRECTION PREMATUREE
Après avoir rassemblé un nombre suffisant de troupes loyalistes surtout à Berlin, après avoir mis en place un nouvel obstacle contre les conseils ouvriers avec le résultat du "congrès" de Berlin et avant que la phase de luttes économiques puisse prendre un plein essor, la bourgeoisie voulait marquer des points décisifs contre les ouvriers sur le plan militaire.
Le 4 janvier 1919, le superintendant de la police de Berlin, qui était membre de l'aile gauche de l'USPD, fut écarté par les troupes gouvernementales. Au début de novembre le quartier général de la police avait été occupé par les ouvriers et les soldats révolutionnaires, et jusqu'en janvier il n'était pas encore tombé aux mains du gouvernement bourgeois. Une fois de plus une vague de protestation éclata contre le gouvernement. A Berlin des centaines de milliers de gens prirent la rue le 5 janvier. Le Vorwarts, journal du SPD, fut occupé aussi bien que d'autres organes de presse de la bourgeoisie. Le 6 janvier, il y eut encore plus de manifestations de masse avec des centaines de milliers de participants.
Bien que la direction du KPD fît constamment de la propagande sur la nécessité de renverser le gouvernement bourgeois avec le SPD à sa tête, elle ne pensait pas que le moment était venu pour le faire ; en fait, elle mettait en garde contre une insurrection prématurée. Cependant, avec la présence écrasante des masses dans les rues, qui fit que beaucoup de révolutionnaires pensaient que les masses ouvrières étaient prêtes pour l'insurrection, un "comité révolutionnaire" fut fondé le soir du 5 janvier 1919, dont la tâche était de mener la lutte pour le renversement du gouvernement et de prendre temporairement en main les affaires gouvernementales, une fois le gouvernement bourgeois expulsé des bureaux. Liebknecht rejoignit ce "comité". En fait, la majorité du KPD considérait que le moment de l'insurrection n'était pas encore venu, et insistait sur l'immaturité des masses pour un tel pas en avant. Il est vrai que les gigantesques manifestations de masse à Berlin avaient exprimé un rejet énorme du gouvernement SPD, mais bien que le mécontentement s'accrut dans de nombreuses villes, la combativité et la détermination dans les autres villes étaient en retard. Berlin se trouva totalement isolé. Pire même : après que le congrès national des conseils en décembre et le conseil exécutif de Berlin eussent été désarmés, les conseils ouvriers à Berlin ne furent plus un lieu de centralisation, de prise de décisions et d'initiative des ouvriers. Ce "comité révolutionnaire" n'émanait pas de la force des conseils ouvriers, il n'avait même pas un mandat. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas eu une vue d'ensemble de l'état d'esprit des ouvriers et des soldats. Il ne prit à aucun moment la direction du mouvement à Berlin ou dans d'autres villes. En fait, il finit par n'avoir aucun pouvoir et manqua lui-même d'orientation. Ce fut une insurrection sans conseils.
Les appels du comité furent sans effet, ils n'étaient même pas pris au sérieux par les ouvriers. Les ouvriers étaient tombés dans le piège des provocations militaires. Le SPD n'hésita pas dans sa contre-offensive. Ses troupes envahirent les rues et entamèrent des combats de rue avec les ouvriers armés. Les jours qui suivirent, les ouvriers de Berlin durent subir un terrible bain de sang. Le 15 janvier 1919, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht furent assassinés par les troupes fidèles au SPD. Avec le bain de sang des ouvriers de Berlin, l'assassinat des principaux dirigeants du KPD, la tête du mouvement avait été brisée, l'arme féroce de la répression s'était abattue sur les ouvriers. Le 17 janvier, la Rote Fahne fut interdite. Le SPD intensifia sa campagne démagogique contre les Spartakistes et justifia l'ordre d'assassiner Rosa et Karl : "Luxemburg et Liebknecht eux-mêmes (...) sont maintenant victimes de leur propre tactique de terreur sanguinaire (...). Liebknecht et Luxemburg n'étaient plus des sociaux-démocrates depuis longtemps, parce que pour les sociaux-démocrates les lois de la démocratie sont sacrées, et qu'ils ont rompu avec ce principe. Parce qu'ils enfreignirent ces lois, nous devions les combattre et nous devons encore le faire (...) ainsi l'écrasement du courant Spartakiste signifie pour l’ensemble du peuple, en particulier pour la classe ouvrière, un acte de sauvegarde, quelque chose que nous étions obligés de faire pour le bien-être de notre peuple et pour l'histoire".
Alors que pendant les journées de juillet 1917 en Russie, les bolcheviks avaient réussi à empêcher une insurrection prématurée malgré la résistance des anarchistes, pour pouvoir jeter tout leur poids dans un soulèvement victorieux en octobre, le KPD ne parvint pas à le faire en janvier 1919. Et un des plus importants dirigeants, Karl Liebknecht, surestima la situation et se laissa emporter par la vague de mécontentement et de colère. La majorité du KPD vit la faiblesse et l'immaturité du mouvement ; elle ne put cependant éviter le massacre.
Comme un membre du gouvernement le déclara le 3 février 1919 : "Dès le début un succès des gens de Spartakus était impossible, parce que, grâce à notre préparation, nous les avons forcés à une insurrection immédiate.".
Avec le massacre du prolétariat à Berlin, le coeur du prolétariat avait été touché, et après le bain de sang des Corps francs à Berlin, ces derniers purent être déplacés vers d'autres centres de résistance prolétarienne dans d'autres régions d'Allemagne ; car au même moment dans quelques villes, qui étaient isolées les unes des autres, des républiques avaient été proclamées depuis le début de novembre 1918 (le 8 en Bavière, le 10 à Brunswig et à Dresde, le 10 à Brème), comme si la domination du capital pouvait être renversée à travers une série d'insurrections isolées et dispersées. Aussi les mêmes troupes contre-révolutionnaires marchèrent sur Brème en février. Après avoir fait subir un nouveau bain de sang, elles procédèrent de même dans la Ruhr en Allemagne centrale en mars, et en avril 100 000 contre-révolutionnaires marchèrent sur la Bavière pour écraser la "République de Bavière". Mais même avec ces massacres la combativité de la classe ne fut pas immédiatement brisée. Beaucoup de chômeurs manifestèrent dans les rues tout au long de l'année 1919, il y eut encore un grand nombre de grèves dans différents secteurs, luttes contre lesquelles la bourgeoisie n'hésita jamais à employer la troupe. Pendant le putsch du général Kapp en avril 1920 et pendant les soulèvements en Allemagne centrale (1921) et à Hambourg (1932), les ouvriers témoignèrent encore de leur combativité, jusqu'en 1923. Mais avec la défaite du soulèvement de janvier 1919 à Berlin, avec les massacres dans beaucoup d'endroits d'Allemagne au cours de l'hiver 1919, la phase ascendante avait été brisée, le mouvement privé de son coeur et sa direction avait été décapitée.
La bourgeoisie était parvenue à enrayer l'extension de la révolution prolétarienne en Allemagne, en empêchant la partie centrale du prolétariat de rejoindre la révolution. Après une autre série de massacres des mouvements en Autriche, en Hongrie, en Italie, les ouvriers en Russie restèrent isolés et furent alors exposés aux attaques de la contre-révolution. La défaite des ouvriers en Allemagne, ouvrit la voie à une défaite internationale de toute la classe ouvrière, et pava le chemin d'une longue période de contre-révolution.
QUELQUES LEÇONS DE LA REVOLUTION ALLEMANDE
C'est la guerre qui avait catapulté la classe ouvrière dans ce soulèvement international, mais en même temps il en résultait que :
- la fin de la guerre écartait la cause première de la mobilisation aux yeux de la plupart des ouvriers ;
- la guerre avait divisé profondément le prolétariat, en particulier à la fin de celle-ci entre pays "vaincus", où les ouvriers se sont lancés à l'assaut de la bourgeoisie nationale, et pays "vainqueurs" où le prolétariat subissait le poison nationaliste de la "victoire".
Pour toutes ces raisons, il doit être clair pour nous aujourd'hui combien les conditions de la guerre étaient vraiment défavorables à l'époque pour le premier assaut à la domination capitaliste. Seuls des simples d'esprit pourraient croire que l'éclatement d'une troisième guerre mondiale aujourd'hui fournirait un terrain plus fertile pour un nouvel assaut révolutionnaire.
Malgré les spécificités de la situation, les luttes en Allemagne nous ont laissé tout un héritage de leçons. La classe ouvrière aujourd'hui n'est plus divisée par la guerre, le développement lent de la crise a empêché un embrasement spectaculaire des luttes. Dans les innombrables confrontations d'aujourd'hui, la classe acquiert plus d'expérience et développe sa conscience (même si ce processus n'est pas toujours direct et souvent sinueux).
Cependant, ce processus de prise de conscience sur la nature de la crise, les perspectives du capitalisme, la nécessité de sa destruction, s'oppose exactement aux mêmes forces qui déjà en 1914, 17, 18, 19, étaient à l'oeuvre : la gauche du capital, les syndicats, les partis de gauche et leurs chiens de garde, les représentants de l'extrême gauche du capital. Ce sont eux qui, aux côtés d'un capitalisme d'Etat beaucoup plus développé et de son appareil de répression, empêchent la classe ouvrière de parvenir à poser la question de la prise du pouvoir plus rapidement.
Les partis de gauche et les gauchistes, comme les sociaux-démocrates qui à l'époque assumèrent le rôle de bourreau de la classe ouvrière, se posent encore aujourd'hui comme amis et défenseurs des ouvriers, et, les gauchistes comme les syndicalistes d'"opposition" auront aussi dans le futur la responsabilité d'écraser la classe ouvrière dans une situation révolutionnaire.
Ceux qui comme les trotskystes parlent aujourd'hui de la nécessité d'amener ces partis de gauche au pouvoir, pour mieux les dévoiler, ceux qui aujourd'hui clament que ces organisations, bien qu'elles aient trahi dans le passé, ne sont pas intégrées à l'Etat, et qu'on peut soit les reconquérir, soit faire pression sur elles pour "changer leur orientation", maintiennent les pires illusions sur ces gangsters. Les "gauchistes" ne jouent pas seulement un rôle de sabotage des luttes ouvrières. La bourgeoisie ne pourra pas se limiter à laisser la gauche dans l'opposition ; le moment venu, elle aura à amener ces gauchistes au gouvernement pour écraser les ouvriers.
Alors que, à l'époque, beaucoup de faiblesses de la classe ouvrière pouvaient s'expliquer du fait de l'entrée récente du capitalisme dans sa période de décadence, ce qui n'avait pas laissé le temps de clarifier beaucoup de choses, aujourd'hui aucun doute n'est permis après soixante-dix ans d'expérience concernant :
- la nature des syndicats,
- le poison du parlementarisme,
- la démocratie bourgeoise et le simulacre de libération nationale.
Les révolutionnaires les plus clairs montrèrent déjà à l'époque le rôle dangereux de ces formes de lutte propres aux années de prospérité historique du capitalisme. Toute confusion et illusion sur la possibilité de travailler dans les syndicats, dans l'utilisation des élections parlementaires, toute tergiversation sur le pouvoir des conseils ouvriers et le caractère mondial de la révolution prolétarienne, auront des conséquences fatales.
Bien que les Spartakistes, aux côtés des Radicaux de gauche de Brème, Hambourg et de Saxe aient fait un héroïque travail d'opposition pendant la guerre, il n'en demeure pas moins que la fondation tardive du Parti communiste a été une faiblesse décisive de la classe. Nous avons essayé de montrer le contexte historique plus large des causes de celle-ci. Néanmoins, l'histoire n'est pas condamnée au fatalisme. Les révolutionnaires ont un rôle conscient à jouer. Nous devons tirer toutes les leçons des événements en Allemagne et de la vague révolutionnaire en général. Aujourd'hui il revient aux révolutionnaires non de se lamenter sans cesse sur la nécessité du parti, mais de constituer les fondations réelles de la construction du parti. Il ne s'agit pas de s'autoproclamer "dirigeants", comme le font aujourd'hui une douzaine d'organisations, mais de continuer le combat pour la clarification des positions programmatiques, prendre le rôle d'avant-garde dans les luttes quotidiennes de la classe - ce qui requiert aujourd'hui pas moins qu'à l'époque une dénonciation vigoureuse du travail de la gauche du capital, et de montrer les perspectives larges et concrètes de la lutte de classe. La pré condition réelle pour remplir cette tâche est d'assimiler toutes les leçons de la vague révolutionnaire, en particulier les événements en Allemagne et en Russie. Nous reviendrons sur les leçons des événements d'Allemagne sur la question du parti dans un prochain article de cette revue.
Dino
"La classe des capitalistes impérialistes, dernier rejeton des classes exploiteuses, surenchérit en bestialité, en cynisme effronté, en ignominie sur tous ses prédécesseurs. Pour défendre son Saint des Saints: le profit et le monopole de l’exploitation, elle emploiera les dents et les ongles, elle utilisera au maximum chacune des méthodes froidement implacables qui ont fait leur apparition quotidienne dans l'histoire de la politique coloniale et dans la dernière guerre mondiale. Elle déchaînera le ciel et l'enfer contre la révolution prolétarienne. Elle mobilisera la paysannerie contre les villes, elle excitera les couches arriérées du prolétariat à frapper leur propre avant-garde ; elle fera de ses officiers des organisateurs de massacres, elle paralysera chaque mesure socialiste par les mille et un moyens de la résistance passive, (...) Elle transformera plutôt le pays en un tas de ruines fumantes qu'elle ne renoncera de bon gré à l'esclavagisme du salariat. "
"Toutes ces résistances devront être brisées pas à pas, avec un poing de fer, avec une énergie inébranlable. Il faut opposer à la violence de la contre-révolution la violence révolutionnaire du prolétariat tout entier. Aux guets-apens, aux pièges et aux traquenards de la bourgeoisie, l'implacable clarté du but, la vigilance et l'initiative permanentes des masses ouvrières."
(...)
"La lutte pour le socialisme est la plus violente des guerres civiles que l'histoire ait jamais vue, et la révolution prolétarienne doit prendre, en vue de cette guerre civile, toutes les dispositions nécessaires, elle doit acquérir, pour le mettre à profit, l'art de combattre et de vaincre. "
"Que veut Spartakus ?", Programme de la Ligue Spartakus, 14 décembre 1918, rédigé par Rosa Luxemburg,
Géographique:
- Allemagne [47]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [48]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 57 - 2e trimestre 1989
- 2823 reads
La décomposition du capitalisme
- 3113 reads
L'impasse dans laquelle se trouve acculé le système capitaliste nous donne chaque jour plus l'image d'une société en train de courir à sa propre perte. Aux guerres et aux massacres qui, depuis la fin de l'holocauste de la seconde guerre mondiale, se perpétuent à la périphérie du capitalisme viennent aujourd'hui s'ajouter d'autres manifestations de la barbarie de ce système décadent dont l'agonie prolongée ne peut engendrer que destructions sur destructions. Les catastrophes "naturelles" ou accidentelles qui se sont multipliées ces derniers temps dans toutes les parties du monde, le développement du banditisme, du terrorisme, de l'usage et du trafic des drogues sont aujourd'hui autant de manifestations du phénomène de décomposition générale qui gangrène l'ensemble du corps de la société capitaliste.
Si l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence était la condition rendant possible le renversement de ce système par la révolution prolétarienne, la perpétuation de cette décadence n'est pas sans danger pour la classe ouvrière. Cette putréfaction du capitalisme, en se propageant à toutes les couches de la société, comporte un risque de contamination de la seule classe porteuse d'un avenir pour l'humanité. Face à la gravité des enjeux contenus dans cette situation de pourrissement sur pied du capitalisme, il revient aux révolutionnaires, non pas de consoler les ouvriers de leur misère et de leurs souffrances en leur masquant toute l'horreur de ce monde pourrissant, mais d'en souligner, au contraire, toute l'ampleur afin de les mettre en garde contre le danger de cette contamination qui les menace quotidiennement.
L'annonce de catastrophes provoquées par des phénomènes "naturels" ou par des accidents, tuant ou mutilant chaque jour une multitude de vies humaines, est aujourd'hui entrée dans le quotidien de l'actualité. Ces derniers mois, il ne s'est pas passé une semaine sans que les médias ne nous renvoient les images apocalyptiques de ces catastrophes frappant tantôt les pays sous-développés, tantôt les grandes métropoles industrielles du monde occidental. La banalisation de ces événements chaque jour plus meurtriers, leur accumulation partout dans le monde, n'engendrent pas seulement une insécurité croissante pour la classe ouvrière comme pour l'ensemble de la population. Elles sont de plus en plus ressenties comme une menace qui risque d'engloutir toute l'espèce humaine au même titre que la guerre nucléaire.
EN S'ENFONÇANT DANS LA DÉCADENCE LE CAPITALISME NE PEUT ENGENDRER QUE TOUJOURS PLUS DE DESTRUCTIONS
Pluies torrentielles au Bangladesh faisant plus de 30 millions de victimes en septembre 1988, sécheresse au Sahel qui, ces dernières années, a provoqué des famines comme jamais l'humanité n'en a connues ; cyclones au large des Caraïbes ou à l'ile de la Réunion, détruisant sur leur passage les habitations de la population locale ; tremblement de terre en Arménie où, en quelques minutes, ce sont des villes entières qui ont été rasées, ensevelissant sous leurs décombres des dizaines de milliers d'êtres humains... Toutes ces catastrophes à grande échelle qui ont ravagé ces derniers mois les pays sous-développés ne constituent pas un phénomène localisé aux États du "tiers-monde" ou du bloc de l'Est.
Elles tendent à se généraliser aux régions du monde les plus industrialisées comme en témoigne la succession effarante d'accidents d'avions ou de trains qui se sont soldés, ces derniers mois, par plusieurs centaines de victimes au cœur des grandes métropoles d'Europe occidentale.
Et ce n'est certainement pas, comme voudrait nous le faire croire la bourgeoisie, à la fatalité, à une quelconque "loi des séries" ou aux "forces incontrôlables de la nature" qu'il faut distribuer toutes ces destructions, toutes ces pertes en vies humaines. Ces "explications" dont s'accommode fort bien la classe dominante n'ont d'autre objectif que celui de dégager la responsabilité de son système, d'en cacher toute la barbarie et la pourriture. Car le véritable responsable de toutes ces tragédies, de ces souffrances humaines indicibles, c'est bien le capitalisme lui-même et cette succession effarante de catastrophes "naturelles" ou "accidentelles" n'est que l'expression la plus spectaculaire d'une société moribonde, d'une société qui part en lambeaux.
Ces tragédies font éclater au grand jour la faillite totale d'un mode de production -le capitalisme- qui est entré depuis la première guerre mondiale dans sa période de décadence. Cette décadence signifie qu'après toute une période de prospérité où il a été capable de faire accomplir un bond gigantesque aux forces productives et aux richesses de la société en créant et unifiant le marché mondial, en étendant son mode de production à toute la planète, ce système a atteint depuis le début du siècle ses propres limites historiques. Ce déclin du capitalisme se traduit aujourd'hui par le fait qu'il ne peut désormais engendrer à l'échelle planétaire que toujours plus de destruction et de barbarie, de famines et de massacres.
C'est en particulier cette décadence qui explique que les pays du "tiers-monde" n'aient pu se développer : ils sont arrivés trop tard sur un marché mondial déjà constitué, déjà partagé, déjà saturé (cf. notre brochure La décadence du capitalisme). C'est elle qui condamne ces pays, malgré tous les discours hypocrites sur leur prétendu "développement", à être aujourd'hui les premières victimes de toute la barbarie du capitalisme moribond, les lieux privilégiés, si l'on peut dire, de l'horreur absolue.
En se prolongeant, l'agonie du capitalisme, fait apparaître aujourd'hui dans toute leur horreur les traits les plus saillants de cette décadence en même temps qu'éclatent au grand jour les contradictions internes, insolubles de ce système.
Certes, on ne peut reprocher au capitalisme d'être à l'origine d'un tremblement de terre, d'un cyclone ou de la sècheresse. En revanche, on peut mettre à son passif le fait que tous ces cataclysmes liés aux phénomènes naturels se transforment en immense catastrophe sociale, en gigantesque tragédie humaine.
Ainsi, le capitalisme dispose de forces technologiques telles qu'il est capable d'envoyer des hommes sur la Lune, de produire des armes monstrueuses susceptibles de détruire des dizaines de fois la planète, mais en même temps il ne se donne pas les moyens -pour protéger les populations des pays exposés aux cataclysmes naturels- de construire des digues, de détourner des cours d'eau, d'édifier des maisons qui puissent résister aux tremblements de terre ou aux ouragans.
Pire encore, ce n'est pas seulement dans l'incapacité du capitalisme à prévenir ces catastrophes qu'éclatent dans toute leur nudité les contradictions du système, mais aussi dans son inaptitude à remédier aux effets dévastateurs de ces catastrophes. Ce que la bourgeoisie appelle aujourd'hui l'"aide internationale" aux populations sinistrées est un ignoble mensonge. Ce sont tous les États, tous les gouvernements de la classe dominante, qui sont directement responsables des souffrances et de la détresse de ces centaines de millions d'êtres humains qui tombent chaque jour comme des mouches, victimes de la dysenterie, du choléra ou de la faim.
Alors que des dizaines de millions d'enfants sont aujourd'hui menacés par la famine, dans les grands centres industriels du capitalisme, ce sont des milliers de tonnes de lait qu'on détruit chaque année pour éviter une chute brutale des cours sur le marché. Alors que dans les pays ravagés par la mousson ou les cyclones, la population en est réduite à se battre pour une ration de céréales, les gouvernements des pays de la CEE prévoient de geler 20 % des terres cultivables pour cause de... surproduction !
Mais cette barbarie effroyable qu'engendre le capitalisme décadent ne se traduit pas seulement par son impuissance à soulager les souffrances des populations victimes de ces cataclysmes. C'est la crise permanente, insoluble, de ce système qui est elle-même une immense catastrophe pour toute l'humanité, comme le révèle en particulier le phénomène de paupérisation croissante de millions d'êtres humains réduits à l'indigence, à la misère la plus totale. L'incapacité du capitalisme décadent à intégrer dans le processus de production d'immenses masses de sans-travail ne touche pas seulement les pays arriérés. C'est au cœur même des États les plus industrialisés que la misère atroce dans laquelle sont plongés des dizaines de millions de prolétaires révèle chaque jour plus toute la pourriture de ce système. Non seulement à travers le développement massif du chômage auquel aucune "politique économique" n'est en mesure de remédier, mais encore à travers la généralisation de la pauvreté qui touche de plus en plus les ouvriers au travail. Et c'est dans l'État le plus riche du monde que cette paupérisation croissante de la classe ouvrière des pays les plus développés est aujourd'hui particulièrement édifiante avec le phénomène de clochardisation de masses immenses d'ouvriers. Ainsi, aux USA, ce sont maintenant des millions de travailleurs, pour la plupart salariés à plein temps (représentant 15% de la population et vivant au-dessous du seuil de pauvreté), qui sont transformés en sans-abri et contraints de dormir sur les trottoirs, dans les cinémas pornographiques (les seuls qui restent ouverts la nuit) ou dans des voitures, faute de pouvoir se payer un logement.
Plus le capitalisme est asphyxié par sa crise de surproduction généralisée, moins il est capable d'assurer le minimum vital à ceux qu'il exploite, de venir à bout des famines qui, dans des pays comme l'Éthiopie ou le Soudan, prennent aujourd'hui la forme de véritables génocides. Plus il avance dans la maîtrise de la technique, moins il l'utilise au service de la sécurité des populations.
Face à cette effarante réalité, que peuvent valoir toutes les campagnes "humanitaires" d'"aide aux sinistrés et aux affamés" orchestrées par les grandes "démocraties" occidentales, tous les appels aux "élans de solidarité" lancés par des célébrités de tous bords ? Quelle est l'"efficacité" réelle de toutes les entreprises caritatives qui, dans les pays avancés, distribuent des repas aux plus pauvres et les hébergent pour quelques nuits ? Quelle signification accorder aux subsides misérables distribués par certains États à ceux qui n'ont plus rien ? Au mieux, toutes ces aides réunies ensemble ne représentent qu'une goutte d'eau dans un océan de misère et de famine. Lorsqu'elles sont adressées aux pays du "tiers-monde", elles ne font que repousser de quelques semaines les échéances tragiques pour les populations concernées. Quand elles sont mises en place dans les pays avancés, elles permettent tout juste d'éviter que ceux-ci ne ressemblent pas trop aux précédents. En réalité, ces "aides" et ces "campagnes de solidarité" ne sont pas autre chose que de sinistres mascarades, un racket sordide et cynique dont la seule "efficacité" véritable réside dans leur capacité à acheter des "bonnes consciences", à faire oublier l'absurdité et la barbarie du monde actuel.
Car, aux meilleurs sentiments et à l'humanisme bourgeois, il y a des limites. Malgré les larmes de crocodile des curés et autres âmes charitables de tout poil, malgré la "bonne volonté" affichée par les gouvernements, ces limites sont dictées par le fait que la bourgeoisie ne peut détourner les lois de son système, et cela d'autant moins qu'après trois quarts de siècle de décadence, ces lois lui échappent totalement comme en témoignent aujourd'hui les catastrophes accidentelles en série qui frappent la population des pays les plus industrialisés.
Ces derniers mois, la multiplication des accidents ferroviaires, notamment dans le réseau urbain des grandes villes des pays les plus avancés, comme la France et la Grande-Bretagne, ont démontré que l'insécurité ne menaçait pas seulement les populations des pays sous-développés, mais le monde entier et dans tous les moments de la vie. Et, contrairement aux mensonges crapuleux de la bourgeoisie, ce ne sont pas les défaillances de tel ou tel conducteur de train qui sont responsables des accidents ferroviaires comme celui de la gare de Lyon à Paris en juin 1988 ou celui de Clapham Junction au sud de Londres en décembre 1988 ; ce n'est pas à une mauvaise gestion de l'économie que l'on doit l'état de délabrement actuel des moyens de production, la vétusté des moyens de transports, qui, chaque jour, tuent ou mutilent des centaines de vies humaines dans les pays les plus industrialisés.
Ces accidents en cascade ne sont que les conséquences désastreuses des politiques de "rationalisation" de la production où tous les États, dans leur quête insatiable de profit, de compétitivité face à l'aggravation de la crise économique mondiale, cherchent à faire des petites économies, au mépris des vies humaines, en grignotant sur tout ce qui concerne la sécurité des ouvriers et de l'ensemble de la population. "Rationalisation" totalement irrationnelle où, en fait de rentabilité, le capitalisme se livre aujourd'hui à une destruction de plus en plus massive de forces productives. Destruction de force de travail non seulement avec le développement du chômage mais aussi avec les pertes en vie humaines et les mutilations que provoquent ces catastrophes de même que tous les accidents de travail résultant de cette "rationalisation". Destruction de moyens technologiques avec les fermetures d'usines, mais aussi avec les dégâts matériels causés par tous ces "accidents".
De même, des phénomènes tels que la pollution croissante qui empoisonne les cours d'eau, l'atmosphère et la population des villes, les "accidents" d'usines chimiques comme ceux de Seveso en Italie et de Bhopal en Inde, qui fit plus de 2000 morts, les catastrophes nucléaires comme celles de Three Miles Island et de Tchernobyl, les "marées noires" qui, régulièrement, viennent détruire la flore et la faune des littoraux, compromettant pour des décennies ou plus les réserves alimentaires des océans (comme on vient encore de le voir dans l'Antarctique), la destruction par les aérosols de la couche d'ozone qui protège les êtres vivants des rayons ultra-violets, la disparition rapide des forêts amazoniennes, principal poumon de la planète..., tous ces méfaits attribués par les écologistes au "progrès technologique" ne sont pas autre chose que des manifestations de la logique irrationnelle, suicidaire, du capitalisme décadent, de son incapacité totale à maîtriser les forces productives qu'il a mises en œuvre et qui risquent de compromettre pour des siècles, ou même définitivement, l'équilibre de la planète nécessaire à la vie de l'espèce humaine.
Et cette logique suicidaire, cet engrenage du capitalisme décadent dans la destruction, prend des dimensions bien plus terrifiantes encore avec la production massive d'engins de mort toujours plus sophistiqués. Toute la technologie la plus avancée est aujourd'hui orientée vers la production d'armements dans la perspective de massacres infiniment plus meurtriers encore que ceux qui se déchaînent à l'heure actuelle - même en temps de "paix" - dans les pays périphériques. Pour ce monstre sanguinaire qu'est le capitalisme décadent, l 'horreur ne connaît pas de limite.
Mais toutes ces destructions qu'engendre ce système moribond ne sont que la partie visible de l'iceberg. Elles ne sont que les manifestations caricaturales d'un phénomène plus général qui affecte tous les rouages de la société capitaliste. Elles ne traduisent rien d'autre que la réalité d'un monde en pleine décomposition.
LA DÉCOMPOSITION IDÉOLOGIQUE DE LA SOCIETE CAPITALISTE
Cette décomposition ne se limite pas au seul fait que le capitalisme, malgré tout le développement de sa technologie, se retrouve de plus en plus soumis aux lois de la nature, qu'il est incapable de maîtriser les moyens qu'il a mis en œuvre pour son propre développement. Elle n'atteint pas seulement les fondements économiques du système. Elle se répercute aussi dans tous les aspects de la vie sociale à travers une décomposition idéologique des valeurs de la classe dominante qui, en continuant de s'effondrer, entraînent à présent avec elles un écroulement de toute valeur rendant possible la vie en société, notamment par une tendance à l'atomisation croissante des individus.
Cette décomposition des valeurs bourgeoises n'est pas un phénomène nouveau. Elle était déjà marquée dès la fin des années 1960 par l'apparition de phénomènes marginaux qui pouvaient encore colporter l'illusion d'une possibilité de constituer les îlots d'une autre société, fondés sur d'autres rapports sociaux, au sein même du capitalisme.
C'est cette décomposition des valeurs de la classe dominante qu'exprimait déjà l'apparition des idéologies de type "communautaire" -fruit de la révolte des couches petites bourgeoises frappées par l'aggravation de la crise capitaliste et particulièrement affectées par la décomposition sociale- telles qu'elles furent véhiculées par le mouvement hippie ou encore par toutes sortes de courants préconisant le "retour à la terre", à la "vie naturelle", etc. En fondant leur existence sur une prétendue "critique radicale", contestataire du travail salarié, de la marchandise, de l'argent, de la propriété privée, de la famille, de la "société de consommation", etc., toutes ces communautés se présentaient comme autant de "solutions alternatives", "révolutionnaires", à l'effondrement des valeurs bourgeoises et à l'atomisation des individus. Toutes trouvaient leur justification dans l'illusion qu'il suffisait de "changer les mentalités" en multipliant ces expériences communautaires pour construire un monde meilleur. Cependant, ces idéologies minoritaires édifiées sur du sable - puisqu'elles émanaient de couches sociales qui, contrairement au prolétariat, n'ont aucun avenir historique - ne se contentaient pas de véhiculer des illusions, comme le confirme aujourd'hui leur faillite totale. Leur projet mégalomaniaque n'était, en réalité, qu'une parodie grotesque du communisme primitif. Cette nostalgie du retour à un type de société archaïque et dépassé depuis des millénaires ne traduisait rien d'autre qu'une idéologie parfaitement réactionnaire dont l'essence religieuse s'est d'ailleurs révélée par le fait que tous ces thèmes "purificateurs" furent amplement repris presque à la lettre par les sectes mystiques telles que Moon, Krishna et autres "Enfants de Dieu" qui se sont développées par la suite sur les décombres de ces communautés.
Aujourd'hui, les communautés des années 1970 ont cédé la place soit à ces sectes religieuses - pour la plupart largement exploitées, voire manipulées par l'État capitaliste et les services secrets des grandes puissances -, soit à des phénomènes plus éphémères encore tels que les grands rassemblements au sein des concerts rock organisés par des institutions bourgeoises comme SOS Racisme en France ou Amnesty International et qui, au nom de grandes causes humanitaires -la faim dans le monde ou la lutte contre l'Apartheid-, ne peuvent offrir aux nouvelles générations qu'un ersatz de communauté et de solidarité humaines.
Mais cette décomposition idéologique de la société capitaliste se traduit surtout depuis quelques années par le développement, au cœur des grandes métropoles industrielles, d'idéologies de type nihiliste -telle l'idéologie "punk", par exemple -, expressions d'une société qui est de plus en plus aspirée vers le néant.
Aujourd'hui, l'impasse économique dans laquelle est acculé le système capitaliste engendre une misère et une barbarie telles que c'est l'image d'un monde sans avenir, un monde au bord du gouffre, qui tend à s'imposer à toute la société. C'est l'évidence de cette impasse depuis le début des années 80 qui est venue balayer toutes les "solutions alternatives" de la décennie précédente. À l'utopie du "peace and love" des communautés hippies s'est substitué le "no future" des bandes de "punks", "hooligans" ou "skin heads" semant la terreur au cœur des grandes villes. Ce n'est plus l'amour, le pacifisme, la non-violence béate des idéologies marginales de la période précédente, mais la haine, la violence, le désir de tout casser, qui animent maintenant cette frange de la jeunesse livrée à elle-même dans un monde sans espoir, un monde qui n'a rien d'autre à lui offrir que la perspective du chômage, de la misère et d'une barbarie croissante.
Toute la vie sociale est aujourd'hui asphyxiée par les relents nauséabonds de cette décomposition des valeurs dominantes. C'est le règne de la violence, de la "débrouille individuelle", du "chacun pour soi", qui gangrène toute la société, et particulièrement ses couches les plus défavorisées, avec son lot quotidien de désespoir et de destruction : chômeurs qui se suicident pour fuir la misère, enfants qu'on viole et qu'on tue, vieillards qu'on torture et assassine pour quelques centaines de francs... Partout, l'insécurité, la terreur permanente, la loi de la jungle, le terrorisme, qui se développent de plus en plus dans les grandes concentrations industrielles, sont aujourd’hui une manifestation criante de l'état avancé de décomposition de cette société.
Quant aux médias, ils sont le reflet et le propagateur de cette décomposition. A la télévision, au cinéma, la violence est omniprésente, le sang et l'horreur éclaboussent quotidiennement les écrans, y compris dans les films destinés aux enfants. De façon systématique, obsédante, l'ensemble des moyens de communication participe à une gigantesque entreprise d'abrutissement des populations, et particulièrement des ouvriers. Tous les moyens sont bons : depuis l'occupation généralisée des écrans par les spectacles sportifs, où s'affrontent des "héros" gonflés aux anabolisants, jusqu'aux appels à participer à toutes sortes de loteries et autres jeux de hasard grâce auxquels, en échange des dernières pièces de monnaie qu'on peut grappiller dans leurs poches, on vend, semaine après semaine, ou même jour après jour, l'espoir illusoire d'une vie meilleure à ceux que la misère prend à la gorge. En fait, c'est l'ensemble de la production culturelle qui, aujourd'hui, exprime la pourriture de la société. Non seulement le cinéma et la télévision, mais également la littérature, la musique, la peinture ou l'architecture, ne savent de plus en plus qu'exprimer et générer l'angoisse, le désespoir, l'éclatement de la pensée, le néant.
Une des manifestations les plus flagrantes de toute cette décomposition est à l'heure présente le développement de plus en plus massif de la drogue. Sa consommation prend aujourd'hui une signification nouvelle, exprimant non plus la fuite dans les chimères, comme c'était le cas dans les années 70, mais une fuite en avant effrénée dans la folie et le suicide. Ce n'est plus pour "planer" collectivement autour d'un "joint" de marijuana que toute cette partie de la jeunesse s'accroche aux drogues les plus dures, mais pour "s'éclater", "se défoncer".
Et c'est toute la société qui est maintenant affectée par ce cancer et non pas les seuls consommateurs. En particulier, ce sont les États eux-mêmes qui sont aujourd'hui gangrénés de l'intérieur par un tel phénomène. Non seulement ceux du "tiers-monde", comme la Bolivie, la Colombie, le Pérou, où l'exportation de la drogue est la principale activité leur permettant de maintenir leur économie à flot, mais également les USA, qui sont aujourd'hui un des premiers producteurs du monde de cannabis avec une exploitation représentant la troisième récolte nationale en valeur après le mais et le soja.
Là encore, le capitalisme se trouve confronté à une contradiction insurmontable. D'un côté, ce système ne peut tolérer l'usage massif de la drogue (dont la consommation annuelle aux USA représente environ 250 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du budget de la défense US), qui, en favorisant le développement de la criminalité, des maladies mentales ou des épidémies comme le SIDA, constitue une véritable calamité du point de vue strictement économique ; de l'autre, c'est le trafic de cette marchandise qui constitue aujourd'hui un des piliers de l'État, comme on le voit, non seulement dans les pays sous-développés tels le Paraguay ou le Surinam, mais également au sein de l'État "démocratique" le plus puissant du monde, les USA.
Ainsi, c'est en grande partie grâce aux exportations de cannabis que sont financés les services secrets américains, à tel point que Bush, qui se fait aujourd'hui le champion de la campagne anti-drogue aux USA, a lui-même directement trempé dans le trafic en tant que chef de la CIA. Et toute cette corruption liée au commerce de la drogue, ce pourrissement dont se nourrit aujourd'hui l'État capitaliste à travers les mœurs de gangsters de ses dirigeants, ne sont pas une spécificité des pays producteurs de drogue. Tous les États sont directement contaminés comme en témoigne encore tout récemment le scandale du blanchiment des "narco-dollars" dans lequel était impliqué le mari de l'ex-ministre de la Justice d'un pays aussi "propre" que la Suisse.
Ce n'est d'ailleurs pas uniquement autour de la drogue que se développe toujours plus la corruption de l'appareil politique de la bourgeoisie : la pourriture ne cesse de progresser dans tous les domaines. A l'heure actuelle, à tous les horizons de la planète, il ne se passe pas un mois sans qu'éclate un nouveau scandale éclaboussant les plus hauts dignitaires de l'État (et comme toujours, ces scandales ne révèlent qu'une infime partie de la réalité). Par exemple, en ce moment même, au Japon, nous en arrivons à une situation où ce sont pratiquement tous les membres du gouvernement, y compris le Premier ministre, qui sont mouillés dans une énorme affaire de corruption. La pourriture est telle que la bourgeoisie a les plus grandes peines du monde à trouver des hommes politiques "présentables" pour remplacer les ministres démissionnaires, et lorsqu'elle pense avoir enfin découvert un tel "oiseau rare", un "véritable incorruptible", c'est pour qu'on découvre au bout de quelques jours qu'il n'avait pas été parmi les derniers à se faire généreusement "arroser".
Et le Japon n'est pas, évidemment, le seul pays avancé où se produisent de tels événements. Dans un pays comme la France, c'est le Parti socialiste, dont les thèmes électoraux, pourtant, dénoncent traditionnellement "les puissances d'argent", qui se trouve en première ligne d'une affaire de "délit d'initié" (utilisation des informations secrètes obtenues dans l'entourage du pouvoir pour s'enrichir en quelques heures), et c'est un ami intime d'un président réputé pour ses dénonciations de l'"argent corrupteur" qui figure parmi ceux qui s'en sont mis plein les poches. D'ailleurs, la spéculation boursière, qui constitue le moyen de cet enrichissement, est elle-même significative, par l'ampleur phénoménale qu'elle est en train de prendre, de la pourriture de la société capitaliste où la bourgeoisie, tels les "flambeurs" de la roulette, draine la plus grande partie de ses capitaux, non pas vers les investissements productifs, mais vers les "coups de dés" destinés à rapporter gros, tout de suite. De plus en plus, les Bourses ressemblent aux salles de jeu de Las Vegas.
Si, jusqu'à présent, le capitalisme avait pu repousser à la périphérie (les pays sous-développés) les manifestations les plus extrêmes de sa propre décadence, cette pourriture lui revient aujourd'hui comme un boomerang, le touchant en son cœur même. Et cette décomposition qui gagne les grands centres industriels n'épargne désormais aucune classe sociale, aucune classe d'âge, même pas les enfants.
Jusque maintenant on connaissait la criminalité et la délinquance des enfants dans les pays du "tiers-monde" où le marasme économique chronique plonge depuis des décennies les populations dans une misère atroce et le chaos généralisé. Aujourd'hui, la prostitution des enfants sur les trottoirs de Manille ou les mœurs de gangsters des gamins de Bogota ne sont plus des fléaux lointains et exotiques. C'est au cœur même de la première puissance mondiale, dans l'État le plus développé des USA - la Californie - qu'apparaît maintenant ce phénomène, aux portes de la Silicon Valley, région où se trouve concentrée la technologie la plus avancée du monde. Aucune image ne peut résumer de façon plus édifiante les contradictions insolubles que porte en lui le capitalisme décadent. D'un côté, une accumulation gigantesque de richesses, de l'autre, une misère effroyable qui entraîne aujourd'hui des bandes d'enfants dans des mœurs suicidaires : fuite en avant de fillettes à peine pubère dans la prostitution quand ce n'est pas, en quête d'une raison de vivre, dans la maternité ; fuite en avant dans la consommation et le trafic de drogue, où ce sont des gosses de huit à dix ans qui sont happés dans la spirale infernale du banditisme, du meurtre organisé (dans la seule ville de Los Angeles, ce ne sont pas moins de 100 000 enfants - membres de gangs responsables de 387 meurtres en 1987 - qui se partagent le marché de détail de la drogue).
Mais ce n'est pas seulement aux USA que le capitalisme pourrissant sème chaque jour le désespoir et la mort au sein des jeunes générations. Dans les grandes concentrations industrielles d'Europe occidentale, outre le développement pharamineux, ces dix dernières années, de la délinquance et de la toxicomanie chez les adolescents, le taux de suicides parmi les jeunes prend aujourd'hui des proportions désastreuses. Ainsi, la France, par exemple, est actuellement, avec la Belgique et la RFA, un des pays d'Europe occidentale qui connaît le taux de suicides le plus élevé chez les jeunes de quinze à vingt-quatre ans. Avec une moyenne officielle de 1000 suicides par an, représentant plus de 13 % du taux de mortalité dans cette tranche d'âge (alors qu'il est de 2,5 % pour l'ensemble de la population), les chiffres ont triplé entre 1960 et 1985. Sans compter les tentatives de suicide manquées qui, elles, sont dix fois plus nombreuses dans cette même tranche d'âge !
Toutes les manifestations de décomposition de cette société qui regarde aujourd'hui mourir ses enfants nous renvoient ainsi l'image hallucinante d'un monde qui court à sa propre perte. Le capitalisme est semblable à un organisme qui est arrivé au bout du rouleau et dont le maintien artificiel en vie ne peut se traduire que par un pourrissement de tous ses organes.
SEUL LE PROLÉTARIAT PEUT SORTIR LA SOCIETE DE CETTE IMPASSE
La décomposition générale de la société n'est pas un phénomène nouveau. Toutes les sociétés décadentes du passé ont connu un tel phénomène. Mais, comparées à celles des modes de production antérieurs, les manifestations de pourrissement de la société actuelle prennent les formes d'une barbarie jamais vue dans toute l'histoire de l'humanité. De plus, contrairement aux sociétés du passé, où plusieurs modes de production pouvaient exister simultanément dans différentes régions du monde, le capitalisme est devenu un système universel, un système qui a soumis le monde entier à ses propres lois. De ce fait, les différentes calamités pouvant toucher telle ou telle partie de la planète se répercutent inévitablement partout ailleurs, comme en témoigne, par exemple, l'extension à tous les continents de maladies telles que le SIDA. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire, c'est toute la société humaine qui est menacée d'être engloutie par les manifestations de ce phénomène de décomposition. Par ailleurs, une telle barbarie est liée au fait qu'il n’existe aucune possibilité pour que surgissent, au sein du capitalisme, les fondements d'une nouvelle société. Alors que dans le passé, les rapports sociaux de même que les rapports de production d'une nouvelle société en gestation pouvaient éclore au sein même de l'ancienne société en train de s'effondrer (comme c'était le cas pour le capitalisme qui a pu se développer au sein de la société féodale en déclin), il n'en est plus de même aujourd'hui. La seule alternative possible ne peut être que l'édification, SUR LES RUINES DU SYSTÈME CAPITALISTE, d'une autre société - la société communiste - qui pourra apporter une pleine satisfaction des besoins humains grâce à un développement considérable, un épanouissement et une maîtrise des forces productives que les lois mêmes du capitalisme rendent impossibles. Et la première étape de cette régénération de la vie sociale ne peut être que le renversement du pouvoir de la bourgeoisie par la seule classe qui soit aujourd'hui en mesure d'offrir un avenir à l'humanité, le prolétariat mondial :
"C'est parce que dans le prolétariat développé l’abstraction de toute humanité, et même de toute APPARENCE d'humanité, est achevée en pratique ; c'est parce que les conditions d'existence du prolétariat résument toutes les conditions d'existence de la société actuelle parvenues au paroxysme de leur inhumanité ; c'est parce que, dans le prolétariat l'homme s'est perdu lui-même, mais a acquis en même temps la conscience théorique de cette perte et, qui plus est, se voit contraint directement, par la MISERE désormais inéluctable, impossible à farder, absolument impérieuse-expression pratique de la NECESSITE - à se révolter contre cette inhumanité : c'est pour toutes ces raisons que le prolétariat peut et doit se libérer lui-même. Toutefois, il ne peut se libérer lui-même sans abolir ses propres conditions d'existence. Il ne peut abolir ses propres conditions d'existence sans abolir TOUTES les conditions d'existence inhumaines de la société actuelle que sa propre situation résume." (K. Marx, La Sainte Famille.)
Ce que Marx écrivait déjà au siècle dernier, à l'époque où le capitalisme était un système florissant, est encore plus vrai aujourd'hui. Face à cette décomposition qui menace la survie même de l'homme, seul le prolétariat, de par la place qu'il occupe dans les rapports de production capitaliste, est en mesure de sortir l'humanité de sa préhistoire, de construire une véritable communauté humaine.
Jusqu'à présent, les combats de classe qui, depuis vingt ans, se sont développés sur tous les continents, ont été capables d'empêcher le capitalisme décadent d'apporter sa propre réponse à l'impasse de son économie : le déchaînement de la forme ultime de sa barbarie, une nouvelle guerre mondiale. Pour autant, la classe ouvrière n'est pas encore en mesure d'affirmer, par des luttes révolutionnaires, sa propre perspective ni même de présenter au reste de la société ce futur qu'elle porte en elle.
C'est justement cette situation d'impasse momentanée, où, à l'heure actuelle, ni l'alternative bourgeoise, ni l'alternative prolétarienne ne peuvent s'affirmer ouvertement, qui est à l'origine de ce phénomène de pourrissement sur pied de la société capitaliste, qui explique le degré particulier et extrême atteint aujourd'hui par la barbarie propre à la décadence de ce système. Et ce pourrissement est amené à s'amplifier encore avec l'aggravation inexorable de la crise économique.
Plus le capitalisme va s'enfoncer dans sa propre décadence, plus il va prolonger son agonie, moins la classe ouvrière des pays centraux du capitalisme sera épargnée par tous les effets dévastateurs de la putréfaction de ce système.
Ce sont en particulier les nouvelles générations de prolétaires qui sont aujourd'hui directement menacées par ce danger de contamination qui gangrène toutes les couches de la société. Le désespoir menant au suicide, l'atomisation et la débrouille individuelle, la drogue, la délinquance et tout autre phénomène de marginalisation -tel que la clochardisation des jeunes chômeurs qui n'ont jamais été intégrés au processus de production- sont autant de fléaux qui risquent d'exercer une pression vers la dissolution et la décomposition du prolétariat et, partant, d'affaiblir ou même de remettre en cause sa capacité à réaliser sa tâche historique de renversement du capitalisme.
Toute cette décomposition, qui infeste de plus en plus les jeunes générations, peut ainsi porter un coup mortel à la seule force porteuse d'avenir pour l'humanité. De la même façon que le déchaînement de la guerre impérialiste au cœur du monde "civilisé" avait, comme le disait Rosa Luxemburg en 1915 dans La Brochure de Junius, anéanti, décimé, en quelques semaines "les troupes d'élite du prolétariat international, fruit de dizaines d'années de sacrifices et d'efforts de plusieurs générations", de même le capitalisme pourrissant peut faucher, dans les années à venir, la "fine fleur" du prolétariat, qui constitue notre seule force, notre seul espoir.
Face à la gravité des enjeux que pose cette situation de pourrissement sur pied du capitalisme, les révolutionnaires doivent alerter le prolétariat contre le risque d'anéantissement qui le menace aujourd'hui. Ils doivent, dans leur intervention, appeler la classe ouvrière à trouver dans toute cette pourriture qu'elle subit quotidiennement en plus des attaques économiques contre l'ensemble de ses conditions de vie une raison supplémentaire, une plus grande détermination pour développer ses combats et forger son unité de classe. De la même façon qu'elle doit comprendre que ses luttes contre la misère et l'exploitation portent en elles l'abolition de la barbarie guerrière, de même elle doit prendre conscience que le développement, l'unification de ses combats, sont seuls en mesure de sortir l'humanité de l'enfer capitaliste, de ce suicide collectif vers lequel la décomposition de ce vieux monde entraîne toute la société.
Les luttes actuelles du prolétariat mondial pour son unité et sa solidarité de classe, notamment dans les grandes concentrations industrielles d'Europe occidentale, constituent l'unique lueur d'espoir au milieu de ce monde en pleine putréfaction. Elles seules sont en mesure de préfigurer un certain embryon de communauté humaine. C'est de la généralisation internationale de ces combats que pourront enfin éclore les germes d'un monde nouveau, que pourront surgir de nouvelles valeurs sociales. Et ces valeurs ne s'étendront à l'ensemble de l'humanité qu'avec l'édification par le prolétariat d'un monde débarrassé des crises, des guerres, de l'exploitation et des miasmes de toute cette décomposition. Le désespoir dans lequel se trouvent plongées de plus en plus toutes les couches non exploiteuses de la société ne pourra ainsi être surmonté que lorsque la classe ouvrière s'acheminera DE FAÇON CONSCIENTE dans cette perspective.
Et c'est au prolétariat le plus concentré, le plus expérimenté du monde -celui des pays d'Europe occidentale - que revient la responsabilité historique de se porter à l'avant-garde de la classe ouvrière mondiale dans sa marche vers ce but. L'étincelle qui surgira de ses combats sera seule en mesure de déclencher l'incendie de la révolution prolétarienne.
Avril (22/2/1989)
Questions théoriques:
- Décomposition [50]
Bilan économique des années 80 : l'agonie barbare du capitalisme
- 10340 reads
A la fin des années 80, les médias multiplient les bilans économiques de la décennie. Ils se contentent, dans l'ensemble, de constater des faits, avec un regard plus ou moins optimiste ou pessimiste, suivant les cas, mais avec toujours la même myopie historique : au-delà du capitalisme, il ne peut y avoir que le néant. Les "experts" ne scrutent la réalité économique qu'à la recherche des moyens d'entretenir la vie du système existant, considéré comme un ensemble de lois naturelles, éternelles, indestructibles.
Pourtant, depuis la seconde guerre mondiale, les années 80 ont été les plus barbares du point de vue du développement de la misère dans le monde, les plus violentes contre la classe ouvrière, mais aussi été les plus autodestructrices pour le capital, dont les contradictions internes se sont exacerbées à l'extrême.
Si nous examinons cette réalité, ce n'est pas pour larmoyer sur la misère croissante ni pour chercher des remèdes pour la machine capitaliste en proie aux pires difficultés. Ce dont il s'agit, c'est de dénoncer, une fois encore le renforcement de l'exploitation et de la barbarie dans laquelle la survie des lois capitalistes plonge de plus en plus l'humanité; mais aussi, de mettre en évidence l'affaiblissement économique des fondements mêmes du système capitaliste, son enfermement dans ses propres contradictions. Bref, il s'agit de mesurer l'évolution économique des années 80 à l'aune de la maturation des conditions de la révolution communiste.
A travers les différents articles analysant la situation économique dans les numéros précédents de cette revue, nous avons déjà en grande partie tirée un bilan de cette décennie. (Voir en particulier Revue Internationale n° 54, 56.) Nous nous proposons ici surtout de fournir un ensemble de statistiques qui illustrent ce que nous avons déjà dit. Les statistiques économiques, même les plus déformées, contredisent violemment ceux qui saluent les années 80 comme celles d'un nouveau capitalisme, plus "agressif et plus "efficace", qui aurait retrouvé sa force et une capacité à améliorer les conditions matérielles d'existence de la société.
Nous utiliserons évidemment les statistiques officielles, seules disponibles, en sachant ce qu'elles valent. Contrairement à la période où Marx devait passer des journées dans les bibliothèques de Londres à la recherche de quelques maigres statistiques pour analyser l'évolution du système économique qu'il combattait, aujourd'hui, le capitalisme offre, du moins dans les pays les plus développés, un énorme ensemble de statistiques. Celles-ci sont le produit du développement de la tendance au capitalisme d'Etat, qui exige une gestion plus "globale" de l'économie et du fait qu'il s'agit de gérer une machine de plus en plus complexe et contradictoire. Mais il faut considérer en outre la volonté des gouvernements de fournir de prétendus justificatifs économiques aux politiques dites d'"austérité" qu'ils imposent aux classes exploitées. Quelles que soient les déformations, parfois énormes, de la réalité que ces statistiques contiennent (nous y reviendrons), elles tendent à mentir toujours dans le sens de la défense de l'ordre établi. Le fait qu'elles permettent de mettre en évidence les faillites et les faiblesses de ce système ne peut que renforcer, dans la plupart des cas leur pouvoir démonstratif.
Pour tirer un bilan économique de ces années, nous distinguerons deux aspects de la réalité qui, bien qu'étant étroitement liés et dépendants entre eux, n'en sont pas moins distincts : d'une part, l'évolution des conditions d'existence de l'ensemble de l'humanité et en particulier de celles de la classe ouvrière; d'autre part, la "santé" des mécanismes internes de la machine capitaliste, le développement de ses contradictions.
LE CAPITAL CONDUIT L'HUMANITE A L'AGONIE
Pour le capitalisme, assurer la subsistance des exploités ne constitue pas un objectif mais un "pis aller", un "frais de production". Comme les systèmes d'exploitation du passé (esclavagisme, féodalisme), le capitalisme est contraint de nourrir la classe exploitée pour pouvoir en extirper du surtravail. Mais, à la différence de l'esclave et du serf féodal, qui telles les bêtes de somme, étaient toujours nourris, quel que fut le travail à faire, le prolétaire du capitalisme n'a accès aux biens nécessaires à sa subsistance qu'à condition d'être embauché :
"...le prolétariat, la classe des travailleurs modernes, qui ne vivent qu'autant qu'ils trouvent du travail, et qui ne trouvent de l'ouvrage qu'autant que leur travail accroît le capital. Ces travailleurs sont obligés de se vendre morceau par morceau, telle une marchandise; et, comme tout autre article de commerce, ils sont livrés à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché." (Marx, Le Manifeste communiste, "Bourgeois et prolétaires".)
C'est pourquoi tout ralentissement de la croissance capitaliste se traduit inévitablement par un développement de la misère et de la pauvreté. Dans le capitalisme, décadent, où l'essor des forces productives rencontre une entrave chronique, la misère matérielle connaît une extension et une ampleur sans précédent dans l'histoire. La réalité des pays sous-développés ([1] [51]) en est une des manifestations les plus criantes. Dans ces pays vit, à côté d'une bourgeoisie locale étalant ses richesses et régnant souvent avec les formes les plus barbares d'oppression, une partie croissante de l'humanité dans des conditions de pauvreté absolue. Quel est le bilan des années 80 à l'égard de cette réalité ?
La Banque mondiale, cet organisme financier international chargé plus spécifiquement des pays qu'il appelle hypocritement "en voie de développement", tire un bilan catastrophique dans son dernier rapport de 1988 :
"La pauvreté s'aggrave : entre 1970 et 1980, le nombre de mal nourris est passé de 650 millions â 730 millions dans les pays en développement (Chine exclue). Et, depuis 1980, la situation a encore empiré : les taux de croissance économique se sont tassés, les salaires réels ont diminué et la croissance de remploi s'est ralentie dans la plupart de ces pays. Les fortes baisses des prix des produits de base ont réduit les revenus ruraux et les dépenses publiques affectées aux services sociaux ont diminué en valeur réelle.
On manque de données complètes sur la pauvreté, en particulier pour les années les plus récentes, mais des données fragmentaires provenant de divers pays confirment l'impression générale d'une dégradation des conditions sociales dans bien des pays. Les auteurs d'une étude récente ont constaté que le nombre de personnes ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté a augmenté au moins jusqu en 1983-1984 au Brésil, au Chili, au Ghana, à la Jamaïque, au Pérou et aux Philippines, et que la tendance à l'amélioration des normes de santé, de nutrition et d'éducation des enfants s'était, dans bien des cas, nettement inversée. Selon d'autres sources, la ration calorique quotidienne par habitant aurait diminué entre 1965 et 1985 dans 21 des 35 pays en développement à faible revenu. Entre 1979 et 1983, l'espérance de vie a baissé dans neuf pays d'Afrique subsaharienne. En Zambie, le nombre des nourrissons et des enfants morts de malnutrition a doublé entre 1980 et 1984 et, au Sri Lanka, la consommation calorique des 10 % de la population les plus pauvres a diminué de 9 % entre 1979 et 1982. Au Costa Rica, la baisse des salaires réels en 1979-1982 a accru le nombre de pauvres de plus de deux tiers. Dans les pays en développement à faible revenu, le montant réel par habitant des dépenses publiques d'éducation et de santé a stagné entre 1975 et 1984. Dans six d'entre eux, le nombre de médecins, rapporté à la population, a diminué entre 1965 et 1981 et, dans douze pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne, les taux de scolarisation dans le primaire ont baissé. "
(Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, 1988.)
On ne pourrait accuser une des principales institutions bancaires internationales d'anti-capitalisme. Pourtant, son bilan est sévère. C'est que la réalité est trop criante. Et que, de toute façon, pour les "experts" de la Banque mondiale, un tel bilan n'est qu'un appel à plus de capitalisme, plus de développement capitaliste. En aucun cas, ils n'envisageraient même l'idée qu'il puisse s'agir d'une inadéquation définitive des lois économiques capitalistes elles-mêmes ; pour eux, celles-ci sont aussi "naturelles" que la loi de la pesanteur. Alors qu'ils assistent à une des périodes les plus critiques et aberrantes, du point de vue économique, de l'humanité, alors qu'ils mesurent, statistiques en main, l'écroulement barbare du mode de production qu'ils représentent, ils prétendent qu'il ne s'agit en réalité que de "divergences de politique macro-économique" entre les grandes puissances, de politiques budgétaires trop "laxistes" ou trop restrictives", ou enfin de la réduction par les gouvernements des pays les plus développés des "dépenses affectées à la lutte contre la pauvreté". Ils ne montrent l'aggravation de la misère que pour mieux affirmer qu'on peut la combattre, avec de "bonnes politiques" capitalistes, alors que c'est la survie même du système capitaliste qui engendre de plus en plus cette misère.
La paupérisation est générale et s'accélère depuis la fin des années 70. Les années 80 l'ont vu s'approfondir et s'étendre, plongeant les pays les moins développés dans la banqueroute pure et simple. La Banque mondiale fournit des chiffres parlants à cet égard :
Le concept même de PIB est trompeur puisqu'il comptabilise également toutes sortes d'activités économiques, la production de pain comme celle de canons, le travail des prolétaires comme celui de spéculateurs financiers ou de militaires supposés produire l'équivalent de leur revenu. Il ne s'en dégage pas moins clairement l'appauvrissement qui caractérise les années 80.
Le cas des "pays exportateurs de produits manufacturés" regroupe une minorité de pays dont le caractère exceptionnel ne fait que mettre plus en relief l'effondrement de l'ensemble. Il suffit de rappeler que cinq pays (Brésil, Mexique, Taiwan, Corée du Sud, Singapour) réalisent 75 % des exportations manufacturières de l'ensemble des pays sous-développés.
Sur l'ensemble des capitaux de ces pays pèse en outre un endettement massif. Celui-ci, après avoir permis à certains d'entre eux de connaître une certaine croissance illusoire au cours des années 70, pèse aujourd'hui sous la forme d'intérêts et de capitaux à rembourser. Ce poids ne s'est pas allégé au cours des années 80 mais s'est au contraire renforcé :
Un des facteurs principaux qui entretient le sous-développement de ces pays est le fait que la quasi-totalité d'entre eux tirent leur revenu extérieur essentiellement de l’exportation de produits de base, agricole ou minéral. Or le cours de ces produits s'effondre dès que la machine industrielle des pays les plus développés se ralentit. Cet effondrement des cours se trouve en outre renforcé par la hausse des prix des produits manufacturés par les pays les plus industriels. Le ralentissement général de la croissance mondiale au cours des années 80 n'a pas manqué d'agir fortement en ce sens :
Le poids de l'endettement, intérêts et capitaux à rembourser, l'effondrement des cours de leurs produits d'exportation, font retomber sur ces pays les effets de la crise des années 80 de façon particulièrement dévastatrice. La bourgeoisie s'y est vue contrainte de réduire de façon draconienne les importations traduisant cela par une chute des investissements et par une réduction massive de la consommation des classes exploitées et de l'ensemble de la population marginalisée :
Comme toujours, ce sont les classes exploitées et les "sans-travail" qui subissent le plus violemment les effets de la crise. Les bourgeoisies locales, qui ne sont qu'une partie de la bourgeoisie mondiale et reçoivent une grande partie de leurs revenus en dollars des capitaux qu'elles ont investis dans les pays centraux, en particulier au cours des années 80, exécutent la besogne avec la brutalité qui les caractérise.
Mais certains diront qu'il n'y a là rien de vraiment nouveau pour le capitalisme qui, depuis ses débuts, a réservé un sort particulièrement sévère pour les travailleurs de ses colonies, et que la situation des travailleurs des pays centraux est tout autre. Il n'en est rien.
LE CAPITAL SAIGNE A BLANC LE PROLETARIAT DANS LES PAYS LES PLUS INDUSTRIALISES
L'aggravation des conditions d'existence des travailleurs dans les pays moins industrialisés au cours des années 80 s'est accompagnée d'une attaque non moins violente dans les zones les plus développées, même si le niveau de départ y est beaucoup plus élevé et que la classe ouvrière y dispose d'une force qui lui permet de mieux résister. Dans un récent rapport la Commission européennes de Bruxelles estimait qu'il y avait dans la CEE, en 1985 (date des dernières estimations disponibles), 40 millions de personnes, 6 millions de plus que dix ans auparavant, considérées comme pauvres ("ayant un revenu inférieur à la moitié du revenu moyen de leurs pays").
Le chômage
Le chômage constitue sans aucun doute la plus puissante et la plus déterminante manifestation de cette attaque. Son développement au cours des années 80 a eu des conséquences sur tous les aspects de la vie de l'ensemble de la classe ouvrière : pour les chômeurs ayant la "chance" de percevoir une allocation, avec ou sans "stages de formation" et autres "travaux d'utilité publique", cela a été une chute rapide et continue du revenu; pour ceux qui n'ont pas eu cette chance (une proportion toujours plus grande), ça a été l'indigence, la misère complète; pour les travailleurs restés actifs, la généralisation du chômage s'est traduite par une baisse des salaires, par la généralisation de la précarité de toute situation de travail, par l'intensification de l'exploitation sous menace de licenciements, par le renforcement de la répression politique dans les lieux de travail; pour les jeunes de la classe ouvrière, ça a été la menace de désespoir dans l'atomisation; pour tous, c'est l'étau d'acier du capitalisme qui s'est serré de plusieurs crans.
Depuis le milieu des années 80, après l'explosion mondiale du chômage qui a accompagné la récession de 1979-82, les gouvernements de certains pays, tels les Etats-Unis ou l'Angleterre affirment, chiffres à l'appui, être parvenus à faire baisser le chômage. En réalité, ils sont surtout parvenus à modifier les statistiques et les définitions du "chômage".
Mais, même en prenant en compte les statistiques les plus officielles et les plus déformées, le bilan des années 80, mises à part quelques rares exceptions, fait ressortir une augmentation générale et nette du chômage dans les pays les plus industrialisés :
On imagine mal à quel point ces chiffres sous-estiment consciemment, déguisent délibérément la réalité. Au cours des années 80, il y a eu une série de révisions de la façon de comptabiliser le chômage : la raison invoquée a été celle de standardiser internationalement les mesures, la définition modèle étant celle du Bureau international du travail (BIT).
Les estimations, car il s'agit toujours d'"estimations", sont basées sur des sondages, et partiellement, et dans certains pays, sur les listes de chômeurs inscrits dans les bureaux de chômage. Dans les enquêtes, les chômeurs sont définis comme ceux qui ne sont pas des "personnes au travail". Et ce dernier ensemble est défini comme les "personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail moyennant un salaire ou un traitement en espèces ou en nature; (...) on peut interpréter la notion de travail effectué au cours de la période de référence comme étant un travail d'une durée d'une heure (!) au moins."
C'est-à-dire qu'une personne ayant "travaillé", de quelque façon que ce soit, pendant une heure au cours de la semaine d'enquête n'est pas considérée comme "chômeur". C'est ainsi que le développement de la précarité de l'emploi, la multiplication des "petits travaux", des "stages", ne se traduit pas dans les statistiques par une augmentation mais par une diminution du chômage. Il faut encore signaler, parmi d'autres déformations de ces statistiques, que les travailleurs mis à la préretraite forcée ou les jeunes "en formation" ne sont pas non plus considérés comme chômeurs.
Malgré toutes ces tricheries grossières, les statistiques officielles comptent, pour la période 1979-1987 une augmentation de 1,5 million de chômeurs en Amérique du Nord, de 6 millions et demi en Europe occidentale, de 11 millions dans les 24 pays de l'OCDE.
Une autre mesure statistique, bien qu'aussi très sous-estimée, donne une image de la dégradation des conditions des prolétaires des pays industrialisés : la proposition de chômeurs de "longue durée". Celle-ci n'a fait qu'augmenter au cours des années 80 :
Les salaires réels
S'il est des chiffres que les gouvernements déforment, ce sont ceux qui mesurent les salaires en termes "réels", c'est-à-dire compte tenu de la perte de pouvoir d'achat de la monnaie par l'inflation. Et pour cause, c'est sur leur base que le gouvernement fixe le niveau des salaires. Il est connu que, dans tous les pays, les indices des prix à la consommation sont toujours sous-estimés ne fût-ce que parce que les biens de première nécessité, qui ont une part si importante pour les bas revenus, sont sous-représentés dans le calcul de ces indices. Quel ouvrier ne s'est pas indigné en regardant les chiffres de l'inflation annoncés à la télévision et leur décalage avec ce qu'il constate tous les jours dans les magasins ?
Une autre façon de déformer la réalité est le calcul des rémunérations par salarié. Pour ce faire, les statistiques disponibles sont celles de "la masse salariale", c'est-à-dire la somme de TOUS les salaires, y compris ceux des hauts fonctionnaires, cadres, dirigeants d'entreprise, etc., qui sont aussi considérés "salariés" même si l'essentiel de leur revenu est fait de plus-value extirpée aux prolétaires tout comme les revenus des capitalistes actionnaires.
De manière générale, les chiffres sur le niveau des salaires concernent le revenu par salarié ou par heure de travail, et non par ménage. De ce fait, la baisse de revenu provoquée par la perte d'emploi d'un des membres de la famille, ou par l'entretien de jeunes au chômage restés à la maison, n'apparaît pas. Elle est pourtant une donnée cruciale dans une époque où il faut deux salaires pour entretenir un foyer.
Malgré toutes ces réserves, le calcul de la rémunération réelle par salarié fait ressortir nettement le sens de la dégradation qui s'est réalisée pendant les années 80 :
Ces chiffres sont des moyennes annuelles et font apparaître des taux parfois encore positifs pour 1980-87. En réalité, au début des années 80, la variation des salaires réels par tête est dans beaucoup de cas négative. C'est en Suède, la "socialiste", que l'attaque contre les salaires est la plus importante : la chute du salaire réel par tête, par rapport à son niveau de 1976, était déjà de -6 % en 1980; elle atteint -14 % en 1986, et ce ne sont pas les légères augmentations de 1987 qui ont permis de rattraper cette dégradation.
Les données officielles sur le chômage, sur sa durée, sur le niveau des salaires réels, ne livrent qu'un aspect de la réalité de la dégradation de la condition de la classe ouvrière. Elles ne prennent pas en considération qu'une partie importante du revenu des ouvriers, en particulier en Europe occidentale, est fournie par le capital sous forme indirecte à travers les dites "dépenses sociales" : allocations chômage, retraites, services de santé, d'éducation, etc. La forte dégradation de ces prestations au cours des années 80 n'est un mystère pour personne. La multiplication des luttes contre les licenciements et contre la détérioration des conditions de travail qui en découle, de la part des travailleurs de l'école, de la santé ou des transports publics, au cours des années 80, en est une manifestation.
Il faut considérer en outre dans ce bilan des années 80, la dégradation des conditions générales d'existence provoquée par le développement de phénomènes telle la pollution (rendre nocifs à l'existence humaine l'air, les eaux, la terre, les villes, etc.) la désorganisation croissante de la production et donc de la vie sociale - sauf la répression - la décomposition qui se généralise. (Voir dans cette revue l'article "La décomposition de la société capitaliste".)
Dans les pays les plus industrialisés comme dans les pays sous-développés et dans les pays de l'Est, qui pour beaucoup entrent dans cette dernière catégorie (nous traiterons spécifiquement du bilan des années 80, dans les pays de l'Est, dans le prochain numéro de la Revue Internationale) pour la classe ouvrière, pour l'ensemble de la population qui ne fait pas partie des classes dominantes, le bilan des années 80 est totalement négatif.
Certains "experts" se chargent de consoler la population en expliquant, à longueur de temps sur les antennes, que cela aurait pu être bien pire si de tels sacrifices n'avaient pas été consentis; qu'il s'agit de secousses de "la restructuration après les deux chocs pétroliers des années 70". Mais que, demain, cela ira mieux à condition que chacun sache travailler encore plus dur et accepter plus de privations. "Rendre compétitif le capital national face à la concurrence étrangère", telle est la rengaine éternelle à laquelle aboutissent tous les "raisonnements" des "experts économistes" : "Sacrifiez-vous encore plus pour le système qui vous détruit !"
Ils appellent à la sauvegarde d'une forme d'organisation sociale qui, depuis plus de trois quarts de siècle, depuis la première guerre mondiale, a plongé l'humanité dans une des périodes les plus difficiles et autodestructrices de son histoire : deux guerres mondiales et le développement des instruments pour faire disparaître la planète en cas d'une troisième, les pires famines de l'histoire.
Ils appellent à la défense d'un système social qui, depuis 20 ans, s enfonce dans une crise toujours plus profonde et étendue, une crise dont les années 80 ont apporté la preuve définitive qu'elle était irréversible.
LE CAPITAL RUINE LES BASES DE SA PROPRE EXISTENCE
La perspective d'un dépassement du capitalisme, la perspective d'un bouleversement révolutionnaire de l'ordre établi mondialement, ne repose pas seulement sur le mécontentement et l'exaspération des classes exploitées; pour que ce mécontentement puisse s'unifier, se renforcer et aboutir à un processus révolutionnaire international - et c'est seulement à cette échelle qu'il peut véritablement exister-, il faut qu'éclate ouvertement l'incapacité définitive du système dominant de remplir sa fonction économique élémentaire. Il faut que la machine d'exploitation s'affaiblisse dans ses fondements, qu'elle se trouve de plus en plus bloquée par ses propres contradictions. Pour reprendre la fameuse formule de Lénine : "Il ne suffît pas que ceux d'en bas ne veuillent plus, encore faut-il que ceux d'en haut ne puissent plus." De ce point de vue, le bilan des années 80 est une confirmation du développement des conditions de la perspective révolutionnaire.
Les années 80 sont, en effet, clairement marquées par un nouveau ralentissement simultané de la croissance de la production et du commerce mondial :
Un des traits les plus significatifs de ce ralentissement est le fait qu'il a été plus marqué dans le commerce que dans la production. Pour le capitalisme, qui est le système marchand par excellence et qui ne peut vivre sans expansion, ce signe d'un rétrécissement de ses marchés est la manifestation de sa crise de "surproduction" et l'annonce de nouvelles régressions. La chute des importations des pays sous-développés y compris les "pétroliers", dont nous avons déjà parlé, a constitué à elle seule un puissant frein à la croissance de la production mondiale.
Le processus de "désertification industrielle", qui voit des régions industrielles être littéralement rasées par la crise pour ne laisser que des tas de ferrailles rouillées (Ecosse, nord de la France, etc.) n'a cessé d'accélérer au cours des années 80. Cette décennie a commencé dans la récession de 1979-1982, la plus profonde, longue et étendue depuis la seconde guerre mondiale. Elle a été suivie par la fameuse "plus longue période d'expansion du capitalisme", qui n'a été en moyenne qu'une sorte de récession rampante, déguisée par la croissance improductive et à crédit de la première puissance économique mondiale.
Mais surtout, comme nous l'avons développé dans les derniers numéros de la Revue Internationale ([2] [52]), cette survie de l'économie s'est faite en développant deux maladies qui rongent les fondements de la machine à profits capitaliste:
1. la croissance du secteur improductif de l'économie (militarisme mais aussi tous les autres secteurs parasitaires) ([3] [53]), au détriment du secteur productif.
2. l'explosion du crédit et de l'endettement mondial.
Le développement du secteur improductif
Les chiffres officiels concernant les dépenses militaires des gouvernements sont encore parmi le moins fiables et les plus sous-estimés. Aux raisons politiques évidentes s'ajoutent le prétexte du "secret militaire". Mais, encore une fois, malgré les déformations grossières, l'observation des données les plus officielles donne une idée de l'ampleur du développement des frais militaires, en particulier aux Etats-Unis :
En grande partie, la "reprise" d'après 1982 a servi à produire le réarmement des Etats-Unis.
Mais, parallèlement à la gangrène militariste, le capitalisme des années 80 a vu se développer celle d'un ensemble d'activités tout aussi parasitaires, tel le secteur financier : banques et assurances, une grande partie du secteur commercial : marketing, publicité, la bureaucratie étatique : police, etc. C'est là un phénomène typique de l'époque de décadence du capitalisme, mais il a connu une accélération importante dans la dernière décennie. Il a marqué tous les pays, industrialisés ou non. Il a pris des formes particulièrement spectaculaires aux Etats-Unis :
Pour certains "experts", il n'y a là rien de très grave. Peu importe au capitaliste que ses profits viennent de la spéculation boursière ou de la production de gaz chimiques, du moment qu'il obtient un profit. Mais, de même que la production d'engins de destruction doit être inscrite avec le signe négatif et que la valeur créée par les services financiers repose sur du vent, de même les profits qui en découlent s'avèrent être, tôt ou tard, au niveau du capital global, des profits fictifs. L'effondrement boursier d'octobre 1987, détruisant 2000 milliards de dollars en quelques jours, est là pour le montrer et annoncer l'avenir.
L'endettement
Le recours massif au crédit par une fuite en avant dans l'endettement est aussi une des caractéristiques majeures des années 80. Nous en avons longuement traité dans la Revue Internationale n° 56, mettant en avant son caractère de palliatif provisoire et de source de difficultés dont les effets auto-destructeurs sur le capital se font sentir dès à présent, tout en préparant de futures catastrophes pour le capital. Nous avons déjà illustré dans le tableau 2 l'ampleur du phénomène pour les pays sous-développés. Rappelons ici ce qu'a été son développement dans les pays industrialisés. Le tableau 9 montre le saut réalisé, pendant les années 80, par l'endettement des administrations publiques :
L'accroissement vertigineux des intérêts de cet endettement, dont personne ne sait comment il pourrait être effectivement remboursé; la multiplication des faillites du système bancaire aux Etats-Unis et la crise des caisses d'épargne, qui contraint le gouvernement Bush à emprunter de nouvelles sommes faramineuses pour rembourser les épargnants et tenter d'empêcher un vent de panique; la hausse irrésistible des taux d'intérêt aux Etats-Unis, et par suite dans le monde, annonciatrice d'une nouvelle récession; la confirmation de l'accélération de l'inflation dans tous les pays, tels sont les aboutissements des politiques "miraculeuses" ("libéralisme reaganien" et autres "perestroïka") au bout des années 80.
Le capital mondial n'est pas parvenu à surmonter les difficultés qu'il avait déjà subies si violemment dans les années 70. Il n'a pu survivre qu'en les aggravant.
Les années 80 ont, plus que toutes autres, mis en lumière la faillite des lois économiques capitalistes, le caractère décadent et barbare de ce mode de production. Le capitalisme est né "dans le sang et dans la boue" (Marx). Après une période de croissance et d'extension, il agonise comme une aberration anachronique, une puissance de mort et de destruction.
Sur le plan de la dégradation des conditions matérielles d'existence de l'humanité et en particulier du prolétariat, comme sur celui des contradictions internes du mode de production capitaliste, l'évolution économique des années 80 a été une nouvelle confirmation de la nécessité et de la possibilité de la perspective communiste. En ce sens, les années 80 sont des "années de vérité".
Les prolétaires ne doivent pas voir dans la décomposition du système capitaliste que la source de nouvelles souffrances. Dans les convulsions qui secouent les fondements même du dernier mode d'exploitation de l'histoire, se forgent les conditions de leur émancipation définitive. Telle est la responsabilité qu'ils doivent assumer.
"La bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui lui donneront la mort; elle a en outre produit les hommes qui manieront ces armes - les travailleurs modernes, les prolétaires. " (Marx, Le Manifeste communiste.)
RV.
[1] [54] Nous employons ce terme pour désigner la réalité de tous ces pays, généralement anciennes colonies, qui, arrivés trop tard sur le marché mondial, n'y ont été intégrés qu'en fonction des impératifs des principales puissances dominantes (monoculture, marginalisation des populations par la destruction sans avenir des modes de production pré-capitaliste, etc.). Le terme "pays en développement", tel qu'il est pudiquement employé par les organismes économiques internationaux, n'est qu'un hypocrite mensonge : leurs propres statistiques montrent comment l'écart entre pays développés et sous-développés s'est creusé dans les dernières décennies. Cet écart était évalué à 7 300 dollars de revenu par habitant en 1967, à 10 000 en 1980 et à 12 000 en 1987. Les camarades du groupe Emancipacion Obrera, en Argentine insistent souvent sur le fait que des pays comme l'Argentine ont un degré de développement économique bien plus avancé que des pays comme la Bolivie ou le Tchad. Ce qui est vrai, mais ne change rien à l'existence de traits communs et importants.
[2] [55] Voir en particulier Revue Internationale n° 56.
[3] [56] Pour une définition du concept d'"improductivité" d'un secteur économique, voir notre brochure La décadence du capitalisme.
Questions théoriques:
- Décadence [36]
- L'économie [57]
Emeutes de la faim et répression sanglante au Venezuela : la bourgeoisie massacre
- 3749 reads
Près de 1000 morts, d'après des sources hospitalières (300 d'après le gouvernement), 3 000 manifestants blessés grièvement, 10 000 arrestations, état de siège, suppression de toutes les "libertés", quartier ouvert à 10 000 hommes pour massacrer sans discrimination : le gouvernement "de gauche" de Carlos Andrés Pérez, le partisan d'un "socialisme humaniste qui accepte les normes du système capitaliste", vient de réprimer dans le sang et avec une brutalité inouïe,les émeutes de la faim qu'il a lui même provoquées par un train de mesures qui, du jour au lendemain, ont fait doubler le prix des transports collectif et tripler celui de certains biens de première nécessité. Telles sont les "normes du système capitaliste" en crise. Telle est la réalité qui se cache derrière les discours "humanistes" des fractions "de gauche" du capital qui n'ont rien à envier dans ce domaine à celles "de droite".
Les événements de la première semaine de mars au Venezuela, tout comme ceux d'Algérie en octobre dernier, sont une illustration du seul avenir qu'offre le capitalisme aux classes exploitées : le sang et la misère. Ils constituent un nouvel avertissement aux prolétaires qui garderaient encore quelque illusion sur ces partis dits "socialistes" ou "communistes" qui prétendent les représenter tout en "acceptant les normes du système capitaliste".
Au moment où nous mettons sons presse, nous ne disposons pas encore de toutes les informations sur ces événements. Mais dés à présent il est indispensable de dénoncer ce nouveau massacre commis par la bourgeoisie pour la défense de ses intérêts de classe et les mensonges avec lesquels elle tente de les recouvrir.
DES EMEUTES DE LA FAIM
La presse, en particulier celle de la gauche "socialiste", celle des amis européens du président C.A.Pérez, tente de nier qu'il s'est agi de révoltes contre la faim. Le Venezuela, un des grands pays pétroliers du monde, serait un "pays riche". Les récentes mesures du gouvernement n'auraient eu comme objectif que de faire comprendre à la population que la période de la "manne pétrolière" est terminée et qu'il s'agit -pour "le bien des familles" - de s'adapter aux nouvelles conditions de l'économie mondiale. En somme, les "pauvres" du Venezuela auraient pris de mauvaises habitudes de riches. D s'agissait de les faire revenir à la réalité. Le cynisme de la bourgeoisie est sans limites.
Même aux moments des plus fortes hausses des prix du pétrole, au milieu et à la fin des années 70, la richesse des "pétrodollars" est évidemment restée pour l'essentiel aux mains de la classe dominante locale. Celle-ci s'est même empressée de placer cet argent, ainsi que la plus grosse partie des prêts internationaux, à l'étranger, s'assurant ainsi des revenus plus sûrs et payés en dollars ([1] [58]). Par contre, dés que les revenus de l'or noir ont commencé à baisser, en particulier à partir de 1986, et que le remboursement de la dette internationale se faisait trop lourd, elle a fait porter sur les classes les plus pauvres toute l'aggravation de sa situation économique. L'instrument principal de cette attaque a été l'inflation accompagnée d'une quasi stagnation des salaires. De 13 % en 1986 l'inflation est passée (officiellement) à 40 % en 1988, et l'on prévoit 100 % pour 1989, alors que les salaires (pour ceux qui en ont encore un, le taux "officiel" du chômage en 1988 étant de 25 %) restent loin derrière. La dégradation des conditions d'existence des travailleurs et des millions de "sans-travail" marginalisés dans les bidonvilles, a été foudroyante au cours des dernières années. Jamais le contraste entre l'opulence des riches et le dénuement croissant des pauvres n'a été aussi criant. La faim, pour cette partie de la population, n'est pas une menace pour l'avenir mais une réalité de plus en plus oppressante depuis des années.
C'est pourquoi les récentes mesures gouvernementales, qui impliquent jusqu'au triplement du prix du lait en poudre - base de l'alimentation des enfants - ne pouvaient être vécues que comme la plus brutale provocation. Les émeutes qui ont explosé à Caracas et sa banlieue (4 millions d'habitants) mais aussi dans les principales villes du pays, n'étaient pas une réaction à une soi-disant "baisse de standing", comme l'affirment les dandys de la gauche bien pensante, mais bien des émeutes de la faim : des réactions spontanées à l'aggravation d'une misère devenue insupportable. "Nous préférons nous faire tuer plutôt que continuer à mourir de faim" ont crié des manifestants à la soldatesque déchaînée.
La classe ouvrière peut imposer un rapport de force à la bourgeoisie par la grève et le combat politique de classe. Mais les masses des "sans-travail", les populations marginalisées des pays sous-développés ne peuvent, par elles-mêmes, répondre aux attaques du capital que par l'action désespérée des pillages et des émeutes sans issue. Le fait que leurs premières actions aient consisté à piller des épiceries (dont beaucoup pratiquent la pénurie pour faire monter les prix) et des supermarchés d'alimentation, dit clairement que c'est de la faim qu'il s'agit.
Les émeutes de début mars au Venezuela sont tout d'abord cela : la réponse des masses marginalisées aux attaques de plus en plus barbares du capitalisme mondial en crise. Elles font partie des secousses qui ébranlent de plus en plus fortement les fondements mêmes de la société capitaliste en décomposition.
LE VERITABLE VISAGE DE LA DEMOCRATIE BOURGEOISE
Mais la barbarie du capitalisme décadent ne s'arrête pas au niveau économique. La répression à laquelle s'est livrée la bourgeoisie au Venezuela est éloquente. A l'ampleur de la boucherie il faut ajouter sa sauvagerie : blessés achevés sur le trottoir, enfants assassinés devant les parents, chambre de torture installée dans une pension de famille désaffectée, etc.
Jamais la bourgeoisie vénézuélienne, qui a pourtant gouverné avec des régimes militaires pendant des décennies, ne s'était livrée à un tel carnage. En une semaine la réalité a fait voler en éclats le mythe tant vanté de "la démocratie, rempart contre la dictature militaire". La "démocratie" n'est que le masque anesthésiant de la pire brutalité bourgeoise. C'est ce qu'a clairement montré le travail, main dans la main, du gouvernement d'Accion Democratica, parti membre de l'Internationale socialiste, et des gorilles de l'année pour protéger leurs biens, leur argent, leurs lois, leur système.
Ceux qui aujourd'hui se lamentent sur les "dangers que ces événements font courir à la fragile démocratie vénézuélienne" sont les mêmes qui ont préparé la répression en faisant croire qu'en votant aux récentes élections, pour C.A.Pérez ou tout autre, "on serait protégés des militaires".
C'EST LA BOURGEOISIE MONDIALE QUI S'EST LIVREE A UN BAIN DE SANG AU VENEZUELA
Mais le président C.A.Pérez n'est pas seulement le représentant de la bourgeoisie locale. Sa réaction en défense des intérêts de sa classe est la même que celle de tout gouvernement bourgeois qui se sent menacé. Un aréopage de chefs d'Etats s'est chargé de le lui manifester cérémonieusement, quelques semaines avant le massacre, au cours de son intronisation comme nouveau président. Fidel Castro lui à même déclaré : "Il faut un leader à l'Amérique Latine, et ce sera toi.". Quelques mois auparavant il se réunissait à Paris, dans une conférence de l'Internationale socialiste. Les socialistes suédois, anglais, les Willy Brandt d'Allemagne, Mitterrand de France, Craxi d'Italie, Kreysky d'Autriche, Gonzales d'Espagne, Soares du Portugal, Papandreou de Grèce, etc. tous ces vibrants "démocrates socialistes", "humanistes" reconnaissent chaleureusement ouvertement comme l'un des leurs celui qui restera comme le boucher de Caracas.
Les "démocrates" du monde entier cherchent à présenter le gouvernement vénézuélien comme une "victime du FMI". Celui-ci serait une sorte de "monstre impitoyable", venu d'on ne sait où, pour contraindre les bourgeois des pays les plus endettés à exploiter et à engendrer toujours plus de misère et d'oppression, à être des bourgeois. Mais, en réclamant le remboursement de la dette, en réprimant ceux qui s'attaquent à l'ordre établi, le FMI et C.A.Pérez ne font qu'appliquer les "nonnes du système capitaliste", les normes de tous les bourgeois du monde. C'est leur "ordre" qui a été rétabli au Venezuela, celui qu'ils font régner dans tous les pays et pour le maintient duquel ils n'ont jamais hésité à employer les méthodes les plus barbares.».
Un "ordre" qui pourrit sur pied dans la barbarie et que seul le prolétariat mondial pourra détruire.
Pour la classe ouvrière, au Venezuela comme dans tous les pays et en particulier dans les plus industrialisés ces événements constituent, en ce sens, un nouveau rappel des responsabilités historiques qui sont les siennes.
[1] [59] Le montant des investissements de la bourgeoisie à vénézuélienne à l'étranger (aux Etats-Unis en particulier) est supérieur au montant de la dette extérieure du pays : 30 milliards de dollars. C'est dire toute l'hypocrisie de la bourgeoisie locale qui prétend justifier par les "diktats du FMI", la misère qu'elle impose.
Géographique:
- Vénézuela [60]
1919 : fondation de l'Internationale Communiste
- 5326 reads
Parmi les nombreux anniversaires historiques à célébrer en cette année 1989, il en est un que les médias et les historiens passent sous silence, ou bien, quand ils l'évoquent -en général très rapidement-, c'est pour en dénaturer consciemment la signification. En mars 1919 s'est tenu le premier congrès de l'Internationale Communiste, le congrès de constitution de la 3e Internationale.
En fêtant l'anniversaire de la révolution française de 1789 -tout comme pour le bicentenaire des Etats-Unis-, les historiens grassement payés au service de la bourgeoisie insistent sur les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de démocratie, de nation, présentées comme les principes absolus et définitifs enfin trouvés pour l'accession au "bonheur" de l'humanité. Deux siècles d'exploitation, d'affrontement des classes, de misère et de guerres impérialistes ont dévoilé la réalité du capital masquée derrière ces belles paroles. Pour la bourgeoisie, l'objectif de ces célébrations est de faire oublier que "le capitalisme est né dans le sang et la boue" (K. Marx), qu'il est né de la lutte ^des classes, et surtout qu'il est une société transitoire appelée à disparaître comme tous les autres modes de production avant lui.
Pour la bourgeoisie de 1989, l'anniversaire de la constitution de l'Internationale communiste lui rappelle la réalité et l'actualité de la lutte des classes dans le capitalisme en crise d'aujourd'hui, de l'existence du prolétariat comme classe exploitée et révolutionnaire, et l'annonce de sa propre fin.
LA VAGUE REVOLUTIONNAIRE INTERNATIONALE EN 1919
La constitution de l'IC éveille aussi de très mauvais souvenirs pour l'ensemble de la classe capitaliste et ses serviteurs zélés. En particulier, l'angoisse qu'elle eut au sortir de la première guerre mondiale devant le flot montant, et qui paraissait alors à tous inéluctable, de la vague révolutionnaire internationale. 1917: révolution prolétarienne victorieuse en Russie en octobre, mutineries dans les tranchées ; 1918 : abdication de Guillaume II et signature précipitée de l'armistice devant les mutineries et la révolte des masses ouvrières en Allemagne ; mouvements ouvriers à partir de 1919 : insurrections ouvrières en Allemagne, instauration sur le modèle russe de républiques des conseils ouvriers en Bavière et en Hongrie, début de grèves de masse ouvrières en Italie et en Grande-Bretagne ; mutineries dans la flotte et les troupes françaises, ainsi que dans des unités militaires britanniques, re rusant d'intervenir contre la Russie soviétique...
C'est Lloyd George, le Premier ministre du gouvernement britannique de l'époque, qui exprime le mieux la frayeur de la bourgeoisie internationale devant le pouvoir des soviets ouvriers en Russie, devant la force du mouvement révolutionnaire, lorsqu'il déclarait, en janvier 1919, que Vil tentait actuellement d'envoyer un millier de soldats britanniques en occupation en Russie, les troupes se mutineraient", et que "si l'on entreprenait une opération militaire contre les bolcheviks, l'Angleterre deviendrait bolchevique et il se créerait un soviet à Londres.(...) L'Europe tout entière est gagnée par l'esprit révolutionnaire. Il y a chez les ouvriers un sentiment profond, non seulement de mécontentement, mais de colère et de révolte contre les conditions d'avant-guerre.L'ordre établi, sous ses aspects politique, social, économique, est remis en question par les masses de la population d'un bout à l'autre de l'Europe." (Cité par E.H. Carr, La révolution bolchevique, Editions de Minuit, 1974.)
La constitution de l'IC marque -nous le savons aujourd'hui- le point culminant de la vague révolutionnaire qui va pour le moins de 1917 à 1923 et qui parcourut le monde entier, traversant l'Europe de part en part, atteignant l'Asie (Chine) et le "nouveau" continent, Canada (Winnipeg) et USA (Seattle) jusqu'à l'Amérique latine. Cette vague révolutionnaire est la réponse du prolétariat international à la première guerre mondiale, à quatre années de guerre impérialiste entre les Etats capitalistes pour le partage du monde. L'attitude des partis et des militants de la social-démocratie, de la 2e Internationale engloutie en 1914 face à la guerre impérialiste mondiale, allait déterminer celle qu'ils allaient prendre face à la révolution et à l'Internationale communiste.
-
"La 3e Internationale Communiste s'est constituée à la fin du carnage impérialiste de 1914-1918, au cours duquel la bourgeoisie des différents pays a sacrifié 20 millions de vies.
Souviens-toi de la guerre impérialiste ! Voilà la première parole que l’Internationale communiste adresse à chaque travailleur, quelles que soient son origine et sa langue. Souviens-toi que, du fait de l'existence du régime capitaliste, une poignée d'impérialistes a eu, pendant quatre longues années, la possibilité de contraindre les travailleurs de partout à s'entre—égorger ! Souviens-toi que la guerre bourgeoise a plongé l'Europe et le monde entier dans la famine et le dénuement! Souviens-toi que sans le renversement du capitalisme, la répétition de ces guerres criminelles est non seulement possible, mais inévitable !" (Statuts de l'Internationale communiste, 2e Congrès, juillet 1920.)
LA CONTINUITE DE L'I.C. AVEC LA 2e INTERNATIONALE
La 2e Internationale et la question de la guerre impérialiste
Dans le Manifeste Communiste (1848), K. Marx énonce un Mes principes essentiels de la lutte du prolétariat contre le capitalisme : "Les ouvriers n'ont pas de patrie." Ce principe ne signifiait pas que les ouvriers devaient se désintéresser de la question nationale, mais au contraire qu'ils devaient définir leur prise de position et leur attitude sur cette question et celle des guerres nationales en fonction du développement même de leur propre lutte historique. La question des guerres et l'attitude du prolétariat a toujours été au centre des débats dans la le Internationale (1864-1873) tout comme dans la 2e Internationale (1889-1914). Dans la majeure partie du XIXe siècle, le prolétariat ne pouvait rester indifférent aux guerres d'émancipation nationale contre la réaction féodale et monarchique, en particulier contre le tsarisme.
C'est au sein de la 2e Internationale que les marxistes, particulièrement derrière Rosa Luxemburg et Lénine, surent reconnaître le changement de période dans la vie du capitalisme survenu à l'aube du XXe siècle. Le mode de production capitaliste se trouve alors à son apogée et règne maintenant sur l'ensemble de la planète. S'ouvre ensuite la période de "l'impérialisme, stade suprême du capitalisme", comme le dit Lénine. Dans cette période, la guerre européenne à venir sera une guerre impérialiste et mondiale, opposant les différentes nations capitalistes pour la dispute et le partage des colonies et du monde. C'est principalement rafle gauche de la 2e Internationale qui mena le combat pour armer l'Internationale et le prolétariat, dans la situation nouvelle, contre l'aile opportuniste qui abandonnait chaque jour un peu plus les principes de la lutte prolétarienne. Un des moments essentiels de cette bataille politique est le congrès international de Stuttgart en 1907, où Rosa Luxemburg, tirant les leçons de l'expérience de la grève de masse en Russie de 1905, lie la question de la guerre impérialiste à la question de la grève de masse et de la révolution prolétarienne :
-
"J'ai demandé la parole, dit Rosa Luxemburg, au nom des délégations russe et polonaise pour vous rappeler que nous devons tirer sur ce point (la grève de masse en Russie et la guerre, NDLR.) la leçon de la grande Révolution russe... La Révolution russe n’a pas surgi seulement comme un résultat de la guerre ; elle a aussi servi à mettre fin à la guerre. Sans elle, le tsarisme aurait sûrement continué la guerre..." (Cité par B.D. Wolfe, Lénine, Trotski, Staline, Calmann-Lévy, 1951.)
La Gauche fait adopter un amendement de la plus haute importance à la résolution du congrès, présenté par Rosa Luxemburg et Lénine :
-
"Si néanmoins une guerre éclate, les socialistes ont le devoir d oeuvrer pour qu'elle se termine le plus rapidement possible et d'utiliser par tous les moyens la crise économique et politique provoquée par la guerre pour réveiller le peuple et de hâter ainsi la chute de la domination capitaliste." (Cité dans "La résolution sur la position envers les courants socialistes et la conférence de Berne", Premier congrès de l'Internationale communiste, Pierre Broué, EDI, 1974.)
En 1912, le congrès de Bâle de la 2e Internationale réaffirme cette position face aux menaces de plus en plus fortes de guerre impérialiste en Europe :
-
"Que les gouvernements bourgeois n'oublient pas que la guerre franco-allemande donna naissance à l'insurrection révolutionnaire de la Commune et que la guerre russo-japonaise mit en mouvement les forces révolutionnaires de Russie. Aux yeux des prolétaires, il est criminel de s'entretuer au profit du gain capitaliste, de la rivalité dynastique et de la floraison des traités diplomatiques." (Ibid.)
La trahison et la mort de la 2e Internationale
Le 4 août 1914 éclate la première guerre mondiale. Gangrenée par l'opportunisme, emportée par la tempête chauvine et guerrière, la 2e Internationale éclate et se meurt dans la honte : les principaux partis qui la composent -et surtout les partis social-démocrates allemand, français et anglais aux mains de directions opportunistes- votent les crédits de guerre, appellent h la "défense de la patrie", à l'"union sacrée" avec la bourgeoisie contre "l'étranger", et sont même récompensés en France par des postes de ministre pour leur renoncement à la lutte de classe. Ils reçoivent l'appui "théorique" du "centre" (entre les ailes droite et gauche de l'Internationale) quand Kautsky, "le pape du marxisme", séparant la guerre et la lutte de classe, déclare cette dernière possible seulement en "temps de paix". Et bien sûr impossible en "temps de guerre".
-
"Pour les ouvriers conscients (...), le krach de la 2e Internationale, c'est l'abominable trahison, par la majorité des partis social-démocrates, de leurs convictions, des solennelles déclarations des congrès internationaux de Stuttgart et de Bâle, des résolutions de ces congrès, etc." (Lénine, "Le krach de la 2e Internationale", 1915, dans le recueil Contre le Courant, Maspéro, 1970.)
Seuls quelques partis résistent à la tempête : principalement le» partis italien, serbe, bulgare et russe. Ailleurs, des militants bien souvent isolés, essentiellement de la Gauche, tels RosaLuxemburg et les "Tribunistes" hollandais autour de Pannekoek et Gorter, vont rester fidèles à l'internationalisme prolétarien et à la lutte de classe, et essayer de se regrouper.
La mort de la 2e Internationale signifie une lourde défaite pour le prolétariat, qu'il paiera de son sang dans les tranchées. Nombre d'ouvriers révolutionnaires vont disparaître dans la boucherie. Pour les "social-démocrates révolutionnaires", c'est la perte de leur organisation internationale, qui est à reconstruire :
-
"La 2e Internationale est morte vaincue par l'opportunisme. A bas l'opportunisme, et vive la 3e Internationale débarrassée non seulement des transfuges (...) mais aussi de l'opportunisme !" (Lénine, "Situation et tâches de l'Internationale socialiste", 1er octobre 1914, Ibid.)
Les conférences de Zimmerwald et de Kienthal : un pas vers la construction de l'Internationale communiste
En septembre 1915 se tient "la conférence socialiste internationale de Zimmerwald". Elle devait être suivie d'une seconde conférence en avril 1916 à Kienthal, toujours en Suisse. Malgré les conditions de guerre et de répression, des délégués de 11 pays y participent, d'Allemagne, d'Italie, de Russie, de France, etc.
Le Manifeste de Zimmerwald reconnaît la guerre comme une guerre impérialiste. La majorité de la conférence se refuse à dénoncer la droite opportuniste des partis social-démocrates passés dans le camp de l'"union sacrée" et à envisager la scission d'avec elle. Cette majorité centriste est pacifiste, et défend le mot d'ordre de la "paix".
Unie derrière les représentants de la fraction bolchevik, Lénine et Zinoviev, la "gauche zimmerwaldienne" défend la nécessité de la rupture et de la construction de la 3e Internationale. Contre le pacifisme, elle affirme que "la lutte pour la paix sans action révolutionnaire est une phrase creuse et mensongère" (Lénine) et elle oppose au centrisme le mot d'ordre de "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. Ce mot d'ordre, précisément, est indiqué par les résolutions de Stuttgart et de Bâle." (Lénine.) Bien que la Gauche se renforce d'une conférence à l'autre, elle ne réussit pas à convaincre les délégués et reste minoritaire. Pourtant, elle tire un bilan positif :
-
"La deuxième conférence de Zimmerwald (Kienthal) constitue indiscutablement un progrès, c'est un pas en avant. (...) Que faire donc demain? Demain, continuer à lutter pour notre solution, pour la social-démocratie révolutionnaire, pour la 3e Internationale ! Zimmerwald et Kienthal ont montré que notre voie était la bonne." (Zinoviev, 10 juin 1916, Ibid.)
La rencontre et le combat communs des gauches de différents pays durant les conférences a permis la constitution du "premier noyau de la 3e Internationale en formation", devait reconnaître Zinoviev en mars 1918.
La réalisation par le prolétariat des résolutions des congrès de Stuttgart et de Bâle
Nous l'avons vu précédemment, la révolution prolétarienne, en Russie de 1917, ouvre une période de vague révolutionnaire dans toute l'Europe. La menace prolétarienne décide la bourgeoisie internationale à mettre fin au carnage impérialiste. Le mot d'ordre de Lénine se réalise : le prolétariat russe puis international transforme la guerre impérialiste en guerre civile. Le prolétariat rend ainsi honneur à la Gauche de la 2e Internationale en appliquant la fameuse résolution de Stuttgart.
La guerre a rejeté définitivement la droite opportuniste des partis sociaux-démocrates dans le camp de la bourgeoisie. La vague révolutionnaire met au pied du mur les pacifistes du centre, et va mener à son tour une grande partie d'entre eux -surtout les dirigeants, comme Kautsky - à rejoindre l'ennemi de classe. Il n'existe plus d'Internationale. Les nouveaux partis qui se constituent en rupture avec la social-démocratie commencent à adopter l'appellation de "parti communiste", en même temps que la vague révolutionnaire nécessite et pousse à la constitution du parti mondial du prolétariat, la 3e Internationale.
La constitution de pic et la continuité politique et principielle avec la 2e Internationale
L'Internationale, qui prend le nom d'Internationale communiste, se forme donc en mars 1919 sur la base de la rupture organique avec la droite des partis de la défunte 2e Internationale. Pour autant, elle ne rejette pas les principes et les apports de celle-ci :
-
"Rejetant loin de nous toutes les demi-mesures, les mensonges et la paresse des partis socialistes officiels surannés, nous nous considérons, nous communistes, rassemblés dans la 3e Internationale, comme les continuateurs directs des efforts héroïques et du martyre de toute une longue série de générations révolutionnaires, depuis Babeuf jusqu'à Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Si la 1e Internationale a prévu le développement de l'histoire et préparé ses voies, si la 2e a rassemblé et organisé des millions de prolétaires, la 3e Internationale, elle, est l'Internationale de l'action de masse ouverte, de la réalisation révolutionnaire, l'Internationale de l’action." ("Manifeste de l'IC", P. Broué, Ibid.)
Les courants, les fractions, les traditions et les positions défendues et approfondies par la Gauche, qui vont être à la base de l'IC, sont apparus et se sont développés au sein de la 2e Internationale :
-
"l'expérience est là pour nous prouver que c'est seulement un groupement sélectionné dans le milieu historique où s'est développé le prolétariat d'avant-guerre : la 2e Internationale, que la lutte prolétarienne contre la guerre impérialiste a pu être poussée à ses conséquences extrêmes car il est le seul ayant pu formuler un programme avancé de la révolution prolétarienne et, par là, le seul qui ait pu jeter les bases pour le nouveau mouvement prolétarien." ("Bilan" n° 34, Bulletin théorique de la fraction italienne de la Gauche communiste, août 1936.)
Au-delà d'individus tels Lénine, Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek, au-delà même des groupes et fractions des partis social-démocrates tels les bolcheviks, les gauches allemande, hollandaise, italienne, etc., il existe une continuité politique et organique entre la Gauche de la 2e Internationale, la Gauche de Zimmerwald et la 3e Internationale. C'est sur l'initiative du Parti communiste (bolchevik) de Russie -ex-Parti ouvrier social-démocrate (bolchevik) de Russie adhérant à la 2e Internationale- et du Parti communiste d'Allemagne -ex-Ligue Spartacus- qu'est convoqué le premier congrès de la nouvelle Internationale. Les bolcheviks ont animé et entraîné la Gauche à Zimmerwald. Celle-ci, véritable lien organique et politique entre la 2e et la 3e Internationale comme "fraction de gauche" de la 2e, tire le bilan de son combat passé et indique la nécessité de l'heure :
-
"Les conférences de Zimmerwald et de Kienthal eurent leur importance à une époque où il était nécessaire d'unir tous les éléments prolétariens décidés sous une forme ou une autre à protester contre la boucherie impérialiste. (...) Le groupement de Zimmerwald a fait son temps. Tout ce qui était véritablement révolutionnaire dans le groupement de Zimmerwald passe et adhère à l’Internationale communiste." ("Déclaration des participants à Zimmerwald", P. Broué, Ibid.)
Nous insistons particulièrement sur la continuité qui existe, entre les deux Internationales. En effet, nous l'avons vu, l'IC ne surgit pas du néant au niveau organique. Il en est de même au niveau de son programme et de ses principes politiques. Ne pas reconnaître le fil historique qui les relie serait tombé dans l'anarchisme, incapable de comprendre le déroulement de l'histoire, ou céder au spontanéisme le plus mécanique en voyant l'IC comme le produit du seul mouvement révolutionnaire des masses ouvrières.
Ne pas reconnaître la continuité, c'est l'impossibilité de comprendre en quoi l'IC rompt avec la 2e Internationale. Car, s'il y a continuité entre les deux -continuité de principe s'exprimant entre autre dans la résolution de Stuttgart-, il y a aussi une rupture. Rupture matérialisée dans le programme politique de l'IC, dans ses positions politiques et dans sa pratique organisationnelle et militante comme "parti communiste mondial". Rupture au travers des faits eux-mêmes, dans l'emploi des armes et la répression sanguinaire, par le gouvernement de Kerenski, auquel participent mencheviks et socialistes-révolutionnaires, membres de la 2e Internationale, contre le prolétariat et les bolcheviks en Russie, par le gouvernement social-démocrate de Noske-Scheidemann contre le prolétariat et le KPD en Allemagne.
Ne pas reconnaître cette "rupture dans la continuité", c'est rendre impossible aussi la compréhension de la dégénérescence de l'IC dans les années 20 et le combat qu'ont mené en son sein, et par la suite dans les années 30 en dehors, car exclues, les fractions de la Gauche Communiste "italienne", "allemande" et "hollandaise" pour ne citer que les plus importantes. C'est de ces fractions de gauche, de leur défense des principes communistes et de leur travail de bilan critique de l'IC et de la vague révolutionnaire de 1917-23, que les groupes communistes d'aujourd'hui et les positions qu'ils défendent sont le produit.
Ne pas reconnaître l'héritage de la 2e, l'héritage politique du prolétariat, rend incapable de comprendre les fondements des positions de l'IC, ni la validité actuelle de certaines d'entre elles parmi les plus importantes, ni les apports des fractions des années 30. C'est-à-dire être incapable de défendre de manière conséquente, assurée et déterminée les positions révolutionnaires aujourd'hui.
LA RUPTURE DE L'I.C. AVEC LA 2e INTERNATIONALE
Le programme politique de l’I.C.
Trotski rédige fin janvier 1919 la Lettre d'invitation au congrès de constitution de l'IC, qui détermine les principes politiques que veut se donner la nouvelle organisation. Elle est en fait le projet de "Plate-forme de l'Internationale communiste" et en fournit un bon résumé. Elle se base sur les programmes des deux principaux partis communistes :
-
"La reconnaissance des principes suivants établis sous forme de programme et élaborés à partir des programmes de la Ligue Spartacus en Allemagne et du Parti communiste (bolchevik) de Russie, doit, selon nous, servir de base à la nouvelle Internationale." ("Lettre d'invitation au 1er congrès", P. Broué, Ibid.)
La Ligue Spartacus n'existe plus alors, depuis la constitution du Parti communiste allemand le 29 décembre 1918. Ce dernier, le KPD, vient de perdre ses principaux dirigeants, Rosa | Luxemburg et Karl Liebknecht, assassinés par la social-démocratie lors de la répression terrible qu'a subie le prolétariat berlinois en janvier. C'est donc au moment où elle se constitue que l'IC connaît sa première défaite en même temps que le prolétariat international. A deux mois de sa constitution, elle vient de perdre deux de ses dirigeants au prestige, à ( la force et aux capacités théoriques et politiques comparables à ceux de Lénine et de Trotsky. C'est Rosa Luxemburg qui a le plus développé dans ses écrits et prises de position, à la fin du siècle dernier, le point qui va devenir la clé de voûte du programme politique de la 3e Internationale.
Le déclin historique irréversible du capitalisme
Pour Rosa Luxemburg, il est clair qu'avec la guerre de 1914, s'est ouverte la période de décadence du mode de production capitaliste. Cette position ne souffre plus de contestation après le carnage impérialiste :
-
"Historiquement, le dilemme devant lequel se trouve l'humanité d'aujourd'hui se pose de la façon suivante : chute dans la barbarie, ou salut par le socialisme." ("Discours sur le Programme" au congrès de fondation du KPD, dans Spartacus et la commune de Berlin, Editions Spartacus.)
Cette position est réaffirmée avec force par l'Internationale dans le premier point de la Lettre d'invitation au congrès :
-
"1° La période actuelle est celle de la décomposition et de l'effondrement de tout le système capitaliste mondial, et sera celle de l’effondrement de la civilisation européenne en général, si le capitalisme, avec ses contradictions insurmontables, n’est pas abattu." Et
"Une nouvelle époque est née : l’époque de la désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. L'époque de la révolution communiste du prolétariat." ("Plate-forme de l'Internationale communiste", P.Broué, Ibid.)
Les implications politiques de l’époque de décadence du capitalisme
Pour tous ceux qui se situent sur le terrain de l'Internationale communiste, le déclin du capitalisme a des conséquences sur les conditions de vie et de lutte du prolétariat. Contrairement à la position du centre pacifiste, à Kautsky par exemple, la fin de la guerre ne signifie pas le retour à la vie et au programme d'avant-guerre. Là se situe un des points de rupture entre la 2e Internationale morte et la 3e :
- "Une chose est certaine, la guerre mondiale représente un tournant pour le monde. (...)"La guerre mondiale a changé les conditions de notre lutte et nous a changés nous-mêmes radicalement." (La crise de la social-démocratie, dite Brochure de Junius, Rosa Luxemburg, 1915, Editions La Taupe.)
L'ouverture de la période de déclin de la société capitaliste, marquée par la guerre impérialiste, signifie de nouvelles conditions de vie et de lutte pour le prolétariat international. La grève de masse en Russie en 1905, le surgissement pour la première fois d'une nouvelle forme d'organisation unitaire des masses ouvrières, les soviets, la formation de conseils ouvriers, l'avaient annoncée. Rosa Luxemburg (Grève de masse, parti et syndicats, 1906) et Trotsky (1905) tirèrent les leçons essentielles de ces mouvements de masse. Avec R.Luxemburg, l'ensemble de la Gauche mena le débat sur la grève de masse et la bataille politique au sein de la 2e Internationale contre l'opportunisme des directions syndicales et des partis social-démocrates, contre leur vision d'une évolution pacifique et graduelle vers le socialisme. En rupture avec la pratique social-démocrate, l'IC affirme que :
- "La méthode fondamentale de la lutte est l’action de masse du prolétariat, y compris la lutte ouverte à main armée contre le pouvoir d'Etat du capital." ("Lettre d'invitation au congrès").
La révolution et la dictature du prolétariat
L'action des masses ouvrières mène à l'affrontement avec l'Etat bourgeois. L'apport le plus précieux de l'IC est sur l'attitude du prolétariat révolutionnaire face à l'Etat. Rompant avec le réformisme de la social-démocratie, reprenant la méthode marxiste et les leçons des expériences historiques : la Commune de Paris, 1905, et surtout l'insurrection d'Octobre 1917 puis la destruction de l'Etat capitaliste en Russie et l'exercice du pouvoir des conseils ouvriers, l’IC se prononce clairement et sans ambiguïté pour la destruction de l'Etat bourgeois et la dictature du prolétariat, la dictature des masses ouvrières organisées dans les conseils ouvriers.
Dans la Lettre d'invitation déjà citée, on lit :
- "2° La tâche du prolétariat consiste maintenant à s'emparer du pouvoir d'Etat. La prise du pouvoir signifie la destruction de l'appareil d'Etat de la bourgeoisie et l'organisation d'un nouvel appareil du pouvoir prolétarien.
- "3° Le nouvel appareil du pouvoir doit représenter la dictature de la classe ouvrière, et, dans certains endroits aussi celle des petits paysans et des ouvriers agricoles (...). Le pouvoir des conseils ouvriers ou des organisations ouvrières est sa forme concrète.
- "4° La dictature du prolétariat doit être le levier de l’expropriation immédiate du Capital, de l'abolition de la propriété privée des moyens de production et de sa transformation en propriété sociale."
Cette question est un point essentiel du congrès qui voit la présentation et l'adoption des "Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature prolétarienne" présentées par Lénine.
Les thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat
Les thèses commencent par dénoncer la fausse opposition entre la démocratie et la dictature "car, dans aucun pays capitaliste civilisé, il n'existe de 'démocratie en général', mais seulement une démocratie bourgeoise." La Commune de Paris a montré le caractère dictatorial de la démocratie bourgeoise. Défendre la démocratie "pure" dans le capitalisme, c'est défendre dans les faits la démocratie bourgeoise, la forme par excellence de la dictature du capital. Quelle liberté de réunion pour les ouvriers ? Quelle liberté de presse ? Lénine répond :
- "La 'liberté de presse' est également un des principaux mots d'ordre de la 'démocratie pure'. Néanmoins, les ouvriers savent (...) que cette liberté est un leurre, tant que les meilleures imprimeries et les plus gros stocks de papier sont accaparés par les capitalistes, et tant que le pouvoir du capital demeure sur la presse, ce pouvoir qui s'exprime dans le monde entier d'autant plus cyniquement que la démocratie et le régime républicain sont plus développés, par exemple comme en Amérique. Pour conquérir une véritable égalité et une véritable démocratie pour les travailleurs, pour les ouvriers et les paysans, on doit retirer aux capitalistes la possibilité d'embaucher des écrivains, d'acheter des maisons d'éditions et de corrompre la presse. A cet effet, il est nécessaire de secouer le joug du capital, de renverser les exploiteurs et de briser leur résistance." ("Thèses sur la démocratie et la dictature du prolétariat", P.Broué, Ibid.)
Revendiquer et défendre la démocratie pure, comme les kautskystes, est un crime contre le prolétariat après l'expérience de la guerre et de la révolution, continuent les thèses. C'est pour les intérêts des différents impérialismes, d'une minorité de capitalistes, que des millions d'hommes ont été massacrés dans les tranchées et que dans tous les pays, démocratiques ou non, s'est édifiée la "dictature militaire de la bourgeoisie". C'est la démocratie bourgeoise qui a assassiné Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg alors qu'ils étaient arrêtés et emprisonnés par le gouvernement social-démocrate.
- "Dans un tel état de fait, la dictature du prolétariat ne se légitime pas seulement en tant que moyen de renverser les exploiteurs et de briser leur résistance, mais aussi par le fait qu'elle est nécessaire à la masse des travailleurs comme unique moyen de défense contre la dictature de la bourgeoisie, qui a mené à la guerre et qui prépare de nouvelles guerres.(...)"La différence fondamentale entre la dictature du prolétariat et la dictature des autres classes (...) consiste en ce que (...) la dictature du prolétariat est la répression par la violence de la résistance des exploiteurs, c'est-à-dire de la minorité infime de la population des grands propriétaires fonciers et des capitalistes. (...)"
La forme de la dictature du prolétariat déjà élaborée en fait, c'est-à-dire le pouvoir des soviets en Russie, le système des conseils ouvriers en Allemagne, les Shop-stewards Committees et autres institutions soviétiques dans d'autres pays signifient et réalisent précisément pour les classes laborieuses, c'est-à-dire pour l'énorme majorité de la population, une possibilité effective de jouir des droits et libertés démocratiques, comme il n'en a jamais existé, même approximativement, dans les meilleures républiques démocratiques bourgeoises." (Ibid.)
Seule la dictature du prolétariat à l'échelle mondiale peut détruire le capitalisme, abolir les classes, et assurer le passage au communisme.
- "L'abolition du pouvoir d'Etat est l’objectif que se sont assigné tous les socialistes, Marx en tête. Tant que cet objectif n'est pas réalisé, la démocratie véritable, c'est-à-dire l’égalité et la liberté, est irréalisable. Seule la démocratie soviétique ou prolétarienne conduit pratiquement à ce résultat, car elle commence aussitôt à préparer le dépérissement complet de tout Etat, en associant les organisations des masses laborieuses à la gestion de l'Etat." (Ibid.)
La question de l'Etat est cruciale au moment où la vague révolutionnaire déferle en Europe et à l'heure où la bourgeoisie de tous les pays mène la guerre civile contre le prolétariat en Russie, quand l'antagonisme entre le travail et le capital, entre le prolétariat et la bourgeoisie atteint son degré le plus extrême et le plus dramatique. C'est concrètement que se pose aux révolutionnaires la nécessité de la défense de la dictature du prolétariat en Russie et de l'extension internationale de la révolution, du pouvoir des soviets à l'Europe. Pour ou contre l'Etat de la dictature du prolétariat en Russie et la vague révolutionnaire. "Pour" signifie l'adhésion à l'Internationale communiste, et la rupture politique et organique avec la social-démocratie. "Contre" veut dire la défense de l'Etat bourgeois et le choix définitif du camp de la contre-révolution. Et pour les courants centristes hésitants devant l'alternative, ce sera l'éclatement et la disparition. Les périodes révolutionnaires ne laissent pas de place à la politique timorée du "juste milieu".
AUJOURD'HUI ET DEMAIN : CONTINUER LE TRAVAIL DE L'I.C.
Le changement de période historique définitivement révélé avec la guerre de 1914-1918 détermine la rupture entre les positions politiques de la 2e et de la 3e Internationales. Nous venons de le voir sur la question de l'Etat. Le déclin du capitalisme et ses conséquences sur les conditions de vie et de lutte pour le prolétariat posaient toute une série de nouveaux problèmes : fallait-il toujours participer aux élections et se servir du parlementarisme ? Face aux conseils ouvriers, les syndicats qui ont participé à l’"union sacrée", étaient-ils encore des organisations ouvrières ? Quelle attitude adopter vis-à-vis des luttes de libération nationale dans l'époque des guerres impérialistes ?
L'IC ne sait pas répondre à ces nouvelles questions. Elle se constitue plus d'un an après octobre 1917 en Russie, deux mois après la première défaite du prolétariat à Berlin. Les années qui suivent, sont marquées par la défaite et le recul de la vague révolutionnaire internationale et, par conséquent, par l'isolement croissant du prolétariat en Russie. Cet isolement est la raison déterminante de la dégénérescence de l'Etat de la dictature du prolétariat. Ces événements vont rendre incapable l'IC de résister au développement de l'opportunisme. A son tour, elle en mourra.
Pour tirer un bilan de l'IC, il faut évidemment la reconnaître comme le Parti communiste international qu'elle fut. Pour ceux qui n'y voient qu'une organisation bourgeoise -du fait de sa dégénérescence ultérieure- il est impossible d'en tirer un bilan et des leçons. Le trotskisme lui, se revendique des "Quatre premiers congrès" sans critique. Il n'a jamais vu que, là où le premier rompait avec la 2e Internationale, les congrès suivants marquaient un recul : en opposition à la scission accomplie au 1er Congrès avec la social-démocratie, le 3e propose à cette dernière l'alliance dans le "Front unique". Après avoir reconnu son passage définitif dans le camp de la bourgeoisie, elle réhabilite la social-démocratie au 3e Congrès. Cette politique d'alliance avec les partis social-démocrates allait mener le trotskisme à l’'entrisme", c'est-à-dire à entrer dans ces partis dans les années 30 au mépris des principes mêmes du 1er Congrès. Cette politique d'alliance, de capitulation, aurait dit Lénine, devait précipiter encore plus le courant trotskyste dans la contre-révolution avec le soutien au gouvernement républicain bourgeois dans la guerre d'Espagne et ensuite la participation dans la 2e guerre impérialiste mondiale, trahissant ainsi Zimmerwald et l'Internationale.
C'est au sein de l’IC que, dès le début des années 20, s'est créée une nouvelle Gauche pour essayer de lutter contre la dégénérescence : en particulier les Gauches italienne, allemande et hollandaise. Ces fractions de Gauche, qui ont été exclues tout au long des années 1920, continuèrent leur combat politique pour assurer la continuité entre l'IC qui se mourait et le "parti de demain" en tirant un bilan de la vague révolutionnaire et de l'Internationale communiste. "Bilan" était précisément le nom de la revue de la Fraction italienne de la Gauche communiste dans les années 1930.
En continuité avec les principes de l'Internationale, ces groupes ont critiqué les faiblesses de sa rupture avec la 2e Internationale. Leur travail obscur au plus profond de la contre-révolution, leur défense des principes communistes dans les années 30 et au cours de la 2e guerre impérialiste mondiale, ont permis le surgissement et l'existence des groupes communistes d'aujourd'hui, qui, à défaut d'une continuité organique, assurent la continuité politique. Les positions défendues et élaborées par ces groupes répondent aux problèmes soulevés dans l'IC par la nouvelle période de décadence du capitalisme.
C'est donc sur la base du bilan critique accompli par les Fractions de la Gauche communiste que l'IC vit actuellement et vivra dans le Parti communiste mondial de demain.
Aujourd'hui, face à l'exploitation et à la misère croissantes, le prolétariat doit adopter la même position que la Gauche de Zimmerwald :
- Non à l'union sacrée avec sa bourgeoisie dans la guerre économique !
Non aux sacrifices pour sauver l'économie nationale !
Vive la lutte de classe !
Transformation de la guerre économique en guerre civile !
Face à la catastrophe économique, face à la décomposition de la société, face à la perspective d'une troisième guerre impérialiste mondiale, auxquelles nous mène le capitalisme, l'alternative historique reste la même qu'en 1919 : destruction du capitalisme et instauration de la dictature du prolétariat au niveau mondial, socialisme ou barbarie.
L'avenir appartient au communisme.
R.L.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Conscience de classe et parti - GPI, Mexique : débat avec le BIPR
- 3796 reads
Avertissement préliminaire :
Parmi les divers groupes politiques prolétariens avec lesquels le GPI a pu prendre contact et établir un échange de publications, le BIPR (et, au sein de celui-ci, plus particulièrement le Parti Communiste Internationaliste -PCInt) a été un des rares groupes à s'être donné la peine de faire une critique directe et élaborée de nos positions, telles qu'elles sont exprimées dans Revolucion Mondial. C’est une attitude du BIPR que nous saluons. Les questionnements dont nous ont fait part ces camarades sont d'ordres divers, mais ils tournent tous autour d'une préoccupation centrale : selon eux, le GPI « a adopté de manière immédiate et manquant de sens critique toutes les positions qui caractérisent particulièrement le CCI au sein du camp prolétarien ». Bien entendu, ils expliquent ceci par le contact "direct et exclusif avec le CCI" qui a été « à l'origine dit GPI, bien que -poursuivent les camarades - vu que nous sommes convaincus que le CCI (sans nier sont mérite d'être une organisation de militants sincères et fidèles à la classe prolétarienne) ne représente pas un pôle de regroupement valable pour la constitution du parti révolutionnaire international, nous croyons que les camarades du GPI doivent faire des pas ultérieurs vers un réel processus de clarification, de décantation et de sélection des positions utiles à la constitution d’un pôle révolutionnaire au Mexique (...) la discussion politique sérieuse et les faits qui en découleront pourront démontrer que nous avons raison" ([1] [64])
Que le GPI s'est constitué sous l'influence du CCI, reprenant de manière immédiate ses positions (ou, si on veut le poser dans une autre perspective : que nous sommes un résultat du travail militant du CCI), c'est quelque chose que nous n'avons jamais omis de signaler. Nous avons déjà dit qu'actuellement, face aux faiblesses du milieu révolutionnaire international, face à l'absence d'un pôle unique de référence et de regroupement des forces révolutionnaires, les nouveaux militants surgissent sous l'influence déterminante de tel ou tel groupe, héritant autant ses mérites que ses déficiences, se trouvant d'emblée devant la nécessité de "prendre parti" face aux divergences existantes dans le milieu.
Mais il n'est pas juste de dire que le GPI a adopté ses positions avec peu de sens critique. Car nous avons reconnu dès le début l'existence d'un camp de groupes politiques prolétariens, ce qui veut dire que nous ne considérons pas le CCI comme le détenteur de "toute la vérité" et nous aurons l'occasion d'exposer nos divergences avec lui. Bien que, a dire vrai, la connaissance des positions des autres regroupements nous a laissé la certitude que le CCI, au moins, est parmi ceux qui maintiennent la plus grande cohérence théorique politique.
Nous insistons une fois encore sur le fait que le GPI considère que sa consolidation ne pourra se faire qu'en approfondissant les positions politiques auxquelles, il est parvenu, notamment en les confrontant sérieusement à celles que soutiennent les différents groupes du milieu communiste international. Que nous sommes ouverts à la discussion et à la collaboration avec d'autres groupes, jusqu'au point où le permet le maintien des principes prolétariens, car nous nous considérons comme une minuscule partie du processus vers la constitution du Parti Communiste Mondial.
C'est dans ce sens que nous publions ici notre prise de position sur la conception du BIPR de la conscience de classe et de la fonction du parti.
Nous pensons que les conditions pour le regroupement des révolutionnaires en un nouveau parti international sont encore loin d'être données ; probablement seul un événement très important de la lutte de classe permettra une polarisation claire et effective des forces révolutionnaires existantes. Nous n'avons pas encore idée de la forme concrète que prendra cette polarisation. Ce qui est certain c’est que la nécessité d'un parti communiste à échelle mondiale se pose au prolétariat de manière chaque fois plus urgente, et ses minorités révolutionnaires doivent aujourd'hui s'efforcer de déblayer le chemin qui conduit à sa constitution, en posant les bases pour que les différents groupes existants en viennent au regroupement avec la plus grande définition politique possible en commençant par la mise au clair des points d'accord et de désaccord qui existent sur la fonction du parti communiste dans la classe ouvrière.
De toute évidence le GPI ne fait ici que s' « immiscer » dans le débat fondamental qui a occupé les révolutionnaires depuis de nombreuses années et qui a connu récemment deux moments importants lors des conférences convoquées par le PCInt et ensuite avec les réponses à la "Proposition Internationale" fait en 1986 par Emancipacion Obrera). Et si nous entrons dans ce débat avec les camarades du PCInt c'est parce que tous les points qu'ils ont mis en discussion nous renvoient à la question de la conscience de classe et du parti. Nous sommes loin de prétendre apporter maintenant une solution de dernière instance à la question. Mais si nous arrivons au moins à poser clairement ce qui constitue à nos yeux les faiblesses du BIPR (et de ceux qui partagent ses positions), nous considérerons que nous avons atteint le but de cet article.
Nos critiques se réfèrent fondamentalement à l'article la conscience de classe dans la perspective marxiste (Revue Communiste n° 2), à la plate-forme du BIPR et à la correspondance que nous a envoyée le PCint directement.
1. DONNEES DU PROBLEME
Dans l'article "La conscience de classe dans la perspective marxiste", le BIPR expose sa conception sur le sujet, essayant a la fois de démontrer que dans la polémique qui tournait autour de Lénine et de Rosa Luxembourg au sujet de la formation de la conscience de classe et la fonction du parti, le premier avait raison et la deuxième se trompai( et avec elle, ses "héritiers" actuels).
II y a en effet, dans le milieu communiste international, une tendance à présenter les divergences actuelles sur le parti (et sur tous les sujets) comme une reproduction ou une continuation des anciens débats qui ont animé de tout temps les révolutionnaires. C'est là le résultat non d'un exercice académique, mais de l'effort réel des regroupements politiques prolétariens de ne pas perdre le fil historique des positions révolutionnaires.
II est évident cependant que le débat actuel ne peut pas être exactement le même qu'il y a presque un siècle. "Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts" depuis lors : le prolétariat a vécu non seulement la vague révolutionnaire la plus grandiose qu'on ait connue jusqu'à nos jours, mais aussi la plus longue période de contre-révolution. Pour les minorités révolutionnaires actuelles il y a une immense accumulation d'expériences qui pose les bases de la clarification d'une série de problèmes qui vont se poser au prolétariat dans sa lutte, mais en même temps elles éprouvent une plus grande difficulté à faire cette clarification, étant donné leur existence précaire. C'est ainsi que le débat actuel entre les révolutionnaires sur le rapport conscience de classe - parti reproduit apparemment les mêmes divergences qu'entre la tendance exprimée par Lénine et celle exprimée par Rosa Luxembourg, mais il cache une divergence beaucoup plus profonde, plus grave que celle qui séparait ces deux dirigeants du prolétariat.
En effet, au début du siècle la préoccupation des révolutionnaires portait sur le processus par lequel les masses prolétariennes arrivent à la conscience de classe, c'est-à-dire, à la compréhension de l'antagonisme irréconciliable entre bourgeoisie et prolétariat et la nécessité ainsi que la possibilité d'une révolution communiste ; si cette préoccupation subsiste encore, elle est doublée par une autre, plus générale et élémentaire, plus « primitive » pourrait-on dire : celle de savoir si, de manière générale, les masses prolétariennes arrivent ou non -d'une manière ou d'une autre- à la conscience de classe. Une partie du milieu révolutionnaire actuel, y compris le BIPR, considère que "le parti communiste est le seul ou le principal dépositaire de la conscience de classe", jusqu'à la destruction de l'Etat bourgeois et l'instauration de la dictature du prolétariat, et que ce n'est qu'à ce moment que les masses acquerront une conscience de classe. L'autre partie, dans laquelle s'inscrit le GPI, considère que la condition fondamentale préalable pour la destruction de l'Etat bourgeois et l'instauration de la dictature du prolétariat, c'est la prise de conscience de classe du prolétariat, de masses déterminantes de la classe (au moins la majorité des prolétaires des grandes villes). De là qu'il existe un véritable abîme dans la conception défendue sur la fonction du parti (et plus spécifiquement sur le rôle que doivent jouer actuellement les minorités révolutionnaires organisées). Au fond, le débat ne concerne pas le rôle plus ou moins décisif que joue le parti dans le processus de constitution du prolétariat en classe pour soi ; le problème majeur n'est pas de définir si le parti Il oriente" ou "dirige", mais une question plus générale : qu'entend-on par "classe pour soi" `?
Ainsi par exemple, nous pourrions peut-être nous mettre d'accord sur le fait que la fonction du parti est de "diriger" le prolétariat. Mais cet accord ne serait qu'apparent : car à partir du moment ou l'on considère "idéaliste" que les masses prolétariennes puissent développer une conscience révolutionnaire comme condition préalable à 1a prise du pouvoir, il est évident que par "direction" il faut entendre alors un rapport essentiellement identique à celui qui existe, par exemple, entre l'officier et les soldats dans l'armée moderne, ou entre le patron et les ouvriers clans l'usine, c'est-à-dire, un rapport dans lequel seul le dirigeant connaît les buts réels poursuivis, tandis que, pour la partie dirigée, ces buts demeurent dans l'obscurité, confus, voilés par des nuages idéologiques -et c'est pour cela même qu'elle se laisse diriger ; il s'agit alors d'une direction imposée (que ce soit de manière patriarcale ou de manière autoritaire), d'un rapport de dominant à dominés. Pour nous, au contraire, la direction du parti communiste n'est pas autre chose que la compréhension, la conviction profonde que développe l'ensemble de la classe ouvrière de la justesse des positions programmatiques et des mots d'ordre du parti, lesquels sont l'expression du mouvement même de la classe. Une conviction à laquelle parviennent les masses à travers les enseignements historiques qu'elles tirent de leurs luttes, auxquelles le parti participe en tant qu'avant-garde. Entre le parti et la masse prolétarienne il existe un rapport d'un type nouveau, propre 3 la classe ouvrière.
Ainsi, pour les uns, la constitution du prolétariat en classe signifie que le parti, seul dépositaire de la conscience prolétarienne-révolutionnaire, se met à la tête des masses, lesquelles, malgré toutes leurs expériences de lutte, demeurent sous la domination de l'idéologie bourgeoise. Pour d'autres, au contraire, la constitution du prolétariat en classe signifie que les masses, grâce à leur expérience et à l'intervention du parti, développent une conscience prolétarienne révolutionnaire. Le BIPR soutient la première position. Nous la deuxième. Le GPI serait-il submergé dans l'idéalisme ?
II. COMMENT LE BIPR ESSAIE D'APPROFONDIR LENINE
Une des premières questions qui ressortent de l'article cité du BIPR, c'est la nouvelle formulation qu'il fait des thèses que Lénine a exprimées dans son ouvrage Que Faire ?. Mais les changements introduits par les camarades dans la terminologie employée par Lénine n'entraînent pas tant une "précision" de sa pensée qu'une distorsion de celle-ci, derrière laquelle se trouve un déplacement du débat de la question de "comment est-ce que les masses arrivent à la conscience de classe ?" A celle de savoir si, en général, il est possible qu'elles y arrivent. C'est pour cela que, bien que nous ne partagions pas la démarche de Lénine selon laquelle la conscience est apportée à la classe ouvrière de l'extérieur, avant d'essayer de "critiquer" Lénine, nous devrons le "défendre", essayer de restituer sa pensée, exprimer clairement quelles étaient sa préoccupation et ses intentions dans le combat contre le courant "économiste" (pour qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations, disons clairement que quand nous nous référons à "Lénine" ou a n'importe quel autre révolutionnaire, nous ne recherchons pas si celui-ci "se trompait" ou s'il était "infaillible" en tant que personne. Nous le prenons comme représentant d'un courant politique à un moment donné ; et ce n'est que parce que tel ou tel courant s'exprime plus clairement dans tel ou tel ouvrage que nous pouvons le prendre comme "spécimen").
Bien. Lénine appelle conscience trade-unioniste (syndicaliste) la "conviction qu'il faut s'unir en syndicats, se battre contre !es patrons, réclamer du gouvernement telles ou telles lois nécessaires aux ouvriers..." ([2] [65]), et conscience social démocrate (nous dirions aujourd'hui communiste) la "conscience de l'opposition irréductible de leurs intérêts (celui des ouvriers) avec tout ordre politique et social existant" ([3] [66]). D'après Lénine, la classe ouvrière, à partir de ses luttes spontanées, de résistance, n'est capable d'atteindre qu'une conscience tride-unioniste -de là que la conscience communiste doive lui être "apportée de l'extérieur" par le parti.
Le BIPR modifie la formulation de Lénine en posant que "l'expérience immédiate de la classe ouvrière la mène à prendre conscience de son identité de classe et de la nécessité de lutter collectivement (...)", que "les conditions d'existence du prolétariat, ses luttes et ses réflexions sur celles-ci , élèvent sa conscience au point qu'il peut se reconnaître comme une classe à part et se définir par la nécessité de lutter contre la bourgeoisie. Mais identité de classe ne veut pas dire conscience communiste." ([4] [67]) Et un peu plus haut il signalait que 'pour que l'identité de classe se transforme en conscience communiste, l'organisation des prolétaires 'en classe, et donc en parti politique si nécessaire". Nous verrons tout de suite plus précisément ce que le BIPR entend quand il parle de "transformation". D'abord il faut signaler que les camarades appellent ici « conscience de identité de classe » ce que Lénine appelait « conscience trade-unioniste ».
Ceci dit, Lénine posait que si l'élément spontané est la forme embryonnaire du conscient. "puisque les masses ouvrières sont incapables d’élaborer elles-mêmes une idéologie indépendante dans le cours de leur mouvement, le problème se pose en ces seuls termes : il faut choisir entre idéologie bourgeoise ou idéologie socialiste. Il n'y a pas de milieu (…) le développement spontané du mouvement ouvrier aboutit justement à le subordonner à l'idéologie bourgeoise (...) c’est pourquoi notre tâche, celle de la social-démocratie, est de combattre la spontanéité de détourner le mouvement ouvrier de cette tendance spontanée du trade-unioniste à se réfugier sous l'aile de la bourgeoisie, pour l'attirer sous l'aile de la social-démocratie révolutionnaire (le parti prolétarien de l'époque).([5] [68])
I1 y a lieu de demander alors : de quel côté le BIPR situe-t-il cette "conscience de l'identité de classe" qu'élaboreraient les ouvriers '? Et il répond : "les expériences acquises par la classe ouvrières dans son combat contre la bourgeoisie son politiquement revêtues par les analyses et les interprétations de la bourgeoisie elle-même . elles donnent seulement naissance un sentiment (?) d'identité de classe qui reste une forme de conscience bourgeoise" ([6] [69]). Ainsi donc, en faisant tout un détour (en remplaçant "conscience" par "sentiment") le BIPR nous dit que la conscience d'identité de 1a classe ouvrière est... une forme de la conscience bourgeoise. Retenons ceci qui, d'emblée. n'est que l'introduction d'une énorme confusion de termes dans le marxisme. Mais nous ne faisons que commencer ; le BIPR (fort maintenant expliquer comment l'identité de classe, c'est-à-dire, cette forme de conscience bourgeoise "se transforme en conscience communiste" :
« une partie de la bourgeoisie passe au prolétariat, et, notamment, cette partie des idéologues bourgeois qui se sont élevés jusqu'à l'intelligence théorique de l'ensemble du mouvement historique" (Manifeste du Parti Communiste). Sous une forme lapidaire, on trouve là la conception matérialiste de la conscience de classe. La lutte spontanée de la classe ouvrière peut élever sa conscience jusqu'au niveau de l'identité de classe, lui permettant de se rendre compte qu'elle n'est pas une fraction du 'peuple", mais une classe en soi (sic). C’est un préalable indispensable pour que puisse s'opérer le saut qualitatif vers la conscience de classe (l'apparition d’une classe pour soi,. mais celui-ci ne peut intervenir que si la "philosophie", que si la compréhension théorique du mouvement historique dans son ensemble se développe et s’empare de la classe. C'est-à-dire si la classe parvient à se convaincre de la nécessite d'un parti Porteur d'une interprétation scientifique globale. Une telle analyse globale est nécessairement élaborée au-dehors de la lutte de classe (bien qu'elle y puise en partie ses matériaux) et au dehors de l'existence quotidienne de l'ensemble du prolétariatt, même si des prolétaires isoles participent à son élaboration ([7] [70]).
Un trouve dans ce paragraphe du BIPR une telle quantité de confusions qu'il nous est très difficile de choisir par où commencer. Essayons de reprendre le raisonnement. Le BIPR nous offre ici trois "niveaux" de conscience -appelons-les ainsi- :
- Premier niveau : conscience de l'identité de classe, laquelle n'est plus considérée maintenant comme identité de classe en opposition aux patrons, mais seulement comme "différenciation d'avec le 'peuple"'. Le BIPR rabaisse par là cet "embryon de conscience" produit des luttes dont parlait Lénine, au niveau de la "connaissance" vulgaire de n'importe quel ouvrier, ou encore de n'importe quel enfant, qui sait faire la distinction entre "ouvriers", "paysans", etc. Mais en même temps, le BIPR signale cette identité comme un préalable indispensable pour que puisse s'opérer le saut vers la conscience de classe. Cependant le BIPR nous disait il y a un instant que cette "identité de classe" n'était pas autre chose qu'une forme de la conscience bourgeoise. D'où il résulte que la conscience bourgeoise est un préalable indispensable pour... la conscience prolétarienne : en d'autres termes! la seule chose que nous disent les camarades c'est que, pour que le prolétariat parvienne à être une "classe pour soi" il a besoin, avant, d'être une "classe en soi", ou, pour que le prolétariat parvienne à la conscience de classe, c'est un préalable indispensable qu'il ne l'ait pas.
Deuxième niveau : la conscience de classe. Par un saut qualitatif le prolétariat devient classe pour soi. En quoi consiste ce saut ? En la conviction des masses de la nécessité d'un parti porteur, lui, de la conscience communiste. Mais cette conviction implique-t-elle que les masses prolétariennes rompent, en fin de comptes, avec l'idéologie bourgeoise? D'après le raisonnement du BIPR non. Les masses ne peuvent pas développer la conscience communiste avant la prise du pouvoir et, comme il n'y a pas de "milieu", alors le saut qualitatif en question, en réalité, n'en est pas un.
Le prolétariat, d'après le BIPR, se constitue en classe pour soi, mais les masses prolétariennes demeurent sous la domination de l'idéologie bourgeoise. II y aurait lieu de demander alors : sur quelle base les masses sont-elles "convaincues" de la nécessité d'un parti communiste ? II n'en existe aucune, mis à part cette même idéologie bourgeoise. Autrement dit : comment est ce que les masses reconnaissent le parti "juste" ? Etann donné qu'elles demeurent sous la domination de l'idéologie bourgeoise et que, donc, elles ne peuvent pas comprendre les positions révolutionnaires du parti, une telle "conviction" devient un pur hasard, quelque chose qui dépend non pas de la justesse des positions du parti, mais de l'habileté plus ou moins grande à manoeuvrer de celui-ci par rapport aux autres partis (bourgeois et petits-bourgeois) qui essaieront aussi de "convaincre" les masses. C'est à cela que le BIPR réduit la constitution du prolétariat en classe pour soi.
Troisième niveau : la conscience communiste, compréhension théorique du mouvement, interprétation scientifique globale dont le parti est porteur. D'où provient elle ? Avant nous comprenions, avec Marx, que "Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découvert par tel ou tel réformateur du monde. Elles ne sont que l'expression générale des conditions réelles d'une lutte de classes existante. d'un mouvement historique qui s’opère sous nos yeux ." (Manifeste communiste). Mais maintenant le BIPR, "approfondissant" Lénine, a découvert que les thèses, théoriques des communistes se fondent sur les analyses élaborées au-dehors de la lutte de classe (bien qu'elles y puisent leurs matériaux) par tel ou tel idéologue bourgeois ou par tel ou tel prolétaire isolé qui s'élève au niveau d'idéologue. Très bien. Mais la lutte de classe est la forme d'existence réelle des classes, son processus, sa forme de mouvement ; les classes n'existent que dans la lutte. Affirmer, donc, comme le fait le BIPR, que la conscience communiste s'élabore en dehors de la lutte des classes revient à dire qu'elle s'élabore en dehors des classes, de manière indépendante, à la marge de celles-ci, et notamment à la marge du prolétariat. Et en effet, le raisonnement du BIPR tend à faire une différence entre ce qui serait la conscience de classe du prolétariat da conviction de la nécessité du parti), et ce qui serait la conscience communiste, faisant de cette dernière une sorte de... "philosophie" inaccessible aux profanes.
Certes, on peut trouver dans l'article du BIPR de magnifiques paragraphes qui contredisent ce qui précède, comme là où il est dit que "le parti doit étudier en profondeur la réalité sociale, les contradictions qui travaillent la société bourgeoise, sa courbe historique ; en même temps qu'il doit intervenir concrètement dans la lutte de classe. Il cherche ainsi à souder toutes les parcelles de conscience communiste provenant de la lutte de classe, à les fondre dans une vision globale et homogène et à rassembler tous ceux qui souscrivent à cette analyse en une seule et même force capable d'intervenir, capable d'intégrer l'expérience de la classe ouvrière dans un cadre communiste cohérent" ([8] [71]). Ainsi formulée, la question de l'élaboration de la théorie communiste n'a rien à voir avec la conception selon laquelle elle serait l'oeuvre d'idéologues qui se situent en dehors de la lutte de classes. Mais ce n'est pas nous mais le BIPR qui doit choisir une de ces deux positions qui sont en contradiction.
En quoi consiste donc l'approfondissement de Lénine fait par le BIPR ?
D'après Lénine, les masses prolétariennes ne peuvent pas, par elles-mêmes, à partir de leurs luttes spontanées, s'élever à la conscience communiste. A cause de cela le parti doit leur insuffler cette conscience, la leur apporter, car il soutient que "la conscience socialiste des masses ouvrières est la seule base qui peut nous garantir le triomphe ". « Le parti doit avoir toujours la possibilité de révéler à la classe ouvrière l'antagonisme hostile entre ses intérêts et ceux de la bourgeoisie ». La conscience de classe atteinte par le parti « doit être diffusée parmi les masses ouvrières avec un zèle croissant ». Si on trouve des ouvriers dans l'élaboration de la théorie socialiste, "ils n'y participent que dans la mesure ou ils parviennent à acquérir les connaissances plus ou moins parfaites de leur époque et à les faire progresser. Or, pour que les ouvriers y parviennent plus souvent, il faut s'efforcer le plus possible d'élever le niveau de conscience des ouvriers en général." (Le BIPR a cité la première partie de cet extrait de Lénine, mais il a "oublié" de citer la seconde).
Que la tache du parti est de "tirer profit des étincelles de conscience politique que la lutte économique a fait pénétrer dans l'esprit des ouvriers pour élever ceux-ci au niveau de la conscience politique social-démocrate" (c'est-à-dire communiste). Que la "conscience politique de classe ne peut être apportée à l'ouvrier que de l'extérieur de la sphère des rapports entre ouvriers et patrons. La seule sphère dans laquelle on peut trouver ces connaissances et celle des rapports de toutes les classes entre elles". Que le militant communiste est partisan du "développement intégral de la conscience politique du prolétariat". Que "la sociale-démocrate (le parti) est toujours en première ligne ... proposant un matériel abondant pour le développement de la conscience politique et de l’activité politique du prolétariat". Enfin, que le parti doit s'occuper « d’une agitation politique multiforme, c'est-à-dire, d'un travail qui justement tend à rapprocher et à fusionner en un tout la force destructive spontanée de la foule et la force destructive consciente de l'organisation des révolutionnaires ».
A l'opposé de cela, le BIPR considère qu’ « admettre que l'ensemble ou même la majorité de la classe ouvrière, compte tenu de la domination du capital, peut acquérir une conscience communiste avant la prise du pouvoir et l'instauration de la dictature du prolétariat, c'est purement et simplement de l'idéalisme » ([9] [72])
Les camarades devraient étendre leur critique au-delà de Rosa Luxembourg et de ses "héritiers". Au-delà de leur critique à Engels, dont ils qualifient de "crétinisme social-démocrate" son affirmation selon laquelle "Le temps des coups de main, des révolutions exécutées par de petites minorités conscientes à la tête des masses inconscientes et passé. Là où il s'agit d'une transformation complète de l'organisation de la société, il faut que les masses elles-mêmes y coopèrent, qu'elles aient déjà compris elles-mêmes de quoi il s'agit, pour quoi elles interviennent (avec leur corps et avec leur vie).(...). Mais pour que les masses comprennent ce qu'il y a à faire, un travail long, persévérant est nécessaire" ([10] [73]) Des formules de ce type « impliquent -d'après le BIPR- une surestimation du degré de conscience communiste auquel pourrait s'élever le prolétariat grâce au parti » ([11] [74])
Mais alors le BIPR devrait étendre sa critique, disions-nous, à Lénine lui-même,car apparemment lui aussi "surestimait" le degré de conscience communiste auquel pouvait s'élever le prolétariat, au point de considérer le travail du parti d'élever cette conscience comme sa tache de base et fondamentale, au point de considérer que la conscience communiste des masses est la seule garantie pour le triomphe de la révolution.
Tout le combat de Lénine exprimé dans le Que faire ? était dirigé contre "les économistes", contre ceux qui - objectivement- maintenaient les ouvriers au niveau du trade-unionisme, dans le spontanéisme qui conduit les ouvriers à rester sous la domination de l'idéologie bourgeoise. Et voici que le BIPR, pour soi-disant combattre le "spontanéisme", au lieu de chercher comment élever la conscience des masses, érige au contraire en théorie le maintien de ces masses sous la domination de l'idéologie bourgeoise.
Les camarades ne se sont pas aperçus qu'en essayant d'approfondir Lénine, ce qu'ils ont fait -sans le vouloir, bien entendu-, c'est se rapprocher de ces mêmes "économistes" que Lénine combattait. La thèse du BIPR selon laquelle les masses ne peuvent pas se débarrasser de la domination idéologique de la bourgeoisie avant la prise du pouvoir, ce qui ne leur laisse d'autre choix que de se convaincre de la nécessité d'un parti porteur, lui, de la conscience communiste, ressemble trop à la thèse fondamentale de l"'économisme" : "que les ouvriers s'occupent de la lutte trade-unioniste et qu'ils laissent aux intellectuels marxistes la lutte politique".
Et ainsi, alors que pour Lénine la constitution du prolétariat en classe pour soi signifiait élever les masses à la conscience communiste, fonder ainsi en un tout le mouvement spontané et le socialisme scientifique, pour le BIPR par contre, la constitution du prolétariat en classe pour soi signifie le maintien des masses sous la domination de l'idéologie bourgeoise, la fusion en un tout de l'idéologie bourgeoise avec la conscience communiste. C'est à cela que se réduit sa "dialectique".
Dans le prochain numéro de Revolucion Mundial nous poursuivrons ce travail. Nous aborderons les fondements du marxisme sur la conscience du prolétariat et la fonction du parti.
Ldo. (Octobre 1988)
[1] [75] Lettre du BIPR au GPI, 19 mars 1988.
[2] [76] Que Faire ? , Lénine, Ed. Seuil.
[3] [77] Ibid.
[4] [78] "La conscience de classe dans la perspective marxiste",. Revue Communiste n° 2.
[5] [79] Que Faire ?
[6] [80] "La conscience de classe dans la perspective marxiste",. Revue Communiste
[7] [81] idem
[8] [82] idem
[9] [83] idem
[10] [84] Introduction d'Engcls aux luttes de Classe en France. cité dans le Même article de la Revue Communiste.
[11] [85] idem
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [46]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 58 - 3e trimestre 1989
- 2855 reads
Communiqué : sur les événements en chine
- 2716 reads
Le 3 juin 1989 la bourgeoisie chinoise a lâché ses chiens enragés sur la population de Pékin. Plusieurs milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés, les habitants de Pékin ont payé très cher leur résistance aux chars de l'Armée "Populaire". En province aussi la répression a fait rage, peu à peu l'écho parvient de massacres à Shanghai, Nankin, etc. Bien au-delà des étudiants, constamment mis sur le devant de la scène médiatique, c'est toute la population prolétaire des villes qui subit la répression: après les mitraillages, les rafles, les appels à la délation, les arrestations massives et arbitraires, la terreur qui règne partout.
La bourgeoisie du monde entier met à profit l'indignation justement soulevée par cette répression barbare pour verser ses larmes de crocodile et renforcer ses campagnes de diversion démocratiques. Le vacarme médiatique sur la démocratie est intense, mais il ne doit pas nous aveugler, car il est un piège pour la classe ouvrière : aussi bien sur le plan international qu'en Chine même.
STALINISME, DEMOCRATIE ET REPRESSION
Toute la propagande occidentale utilise les événements pour accréditer l'idée que seules les dictatures staliniennes ou militaires ont le monopole de la répression, que la démocratie est pacifique, n'utilise pas de telles armes. Rien de plus faux. L'histoire a suffisamment montré que les démocraties occidentales ont peu à envier des pires dictatures de ce point de vue, le sanglant massacre des luttes ouvrières de Berlin 1919 reste un exemple historique. Depuis elles ont montré leur savoir faire meurtrier dans les répressions coloniales et dans l'envoi de conseillers-tortionnaires pour maintenir l'ordre de leurs intérêts impérialistes sur toute la planète.
Deng Xiaoping, aujourd'hui mis au banc de la bonne conscience démocratique internationale était, il y a encore quelques jours, pour l'ensemble de la bourgeoisie occidentale, le symbole de l'après maoïsme éclairé et des "réformateurs", l'homme de l'ouverture vers l'Occident, l'interlocuteur privilégié. Cela va-t-il changer ? Rien n'est moins sûr ! Une fois la chape de plomb remise en place, qui que ce soit qui sorte vainqueur, nos belles démocraties, aujourd'hui soulevées d'indignation, essuieront leurs larmes hypocrites pour tenter de se concilier les grâces des nouveaux dirigeants.
Il n'y a aucun antagonisme entre démocratie et répression, au contraire, elles sont les deux faces indissociables de la domination capitaliste. La terreur policière-militaire et le mensonge démocratique se complètent et se renforcent l'un, l'autre. Les "démocrates" d'aujourd'hui sont les bourreaux de demain, et les tortionnaires d'hier, comme par exemple Jaruzelski, jouent aujourd'hui aux "démocrates".
Alors que le battage démocratique résonne assourdissant sur toute la planète, de l'Est à l'Ouest, les massacres succèdent aux massacres, en Birmanie, en Algérie où, après avoir ordonné la fusillade contre les émeutiers, le président Chadli "démocratise". Au Venezuela, c'est l'ami de Mitterrand, le social-démocrate Carlos Andrès Perez qui lance la soldatesque contre les révoltés de la misère et de la faim. En Argentine, au Nigeria, en U.R.S.S. (Arménie, Géorgie, Ouzbékistan), etc., ce sont des milliers de morts que la survie du capital impose en quelques mois. La Chine vient ponctuer provisoirement une longue liste sinistre.
CHINE: LA GUERRE DES CLIQUES
La crise économique mondiale impose à toutes les fractions de la bourgeoisie une rationalisation-"modernisation" de leurs économies qui se concrétise :
- par l'élimination de secteurs anachroniques et déficitaires, les canards boiteux du capital, provoquant des tensions croissantes au sein de la classe dominante ;
- dans des programmes d'austérité de plus en plus draconiens qui polarisent un mécontentement grandissant au sein du prolétariat
En Chine, la mise en place depuis une dizaine d'année de réformes "libérales" de l'économie s'est traduite par une misère croissante de la classe ouvrière et des tensions de plus en plus fortes au sein du Parti qui regroupe la classe dominante. La mise en place des réformes économiques se trouve doublement entravée par le poids du sous-développement et par les spécificités de l'organisation du capitalisme d'Etat à la sauce stalinienne. Alors que plus de 800 millions de chinois sont des paysans qui vivent dans des conditions qui n'ont pas fondamentalement changé depuis des siècles, de larges fractions de l'appareil d'Etat, quasiment féodales, contrôlent des régions entières, des fractions de l'armée, de la police et voient d'un mauvais oeil des réformes qui risquent de remettre en cause les bases de leur domination. Les secteurs les plus dynamiques du capital chinois : l'industrie du sud (Shanghai, Canton, Wuhan), de plus en plus liée au commerce mondial, les banques qui traitent avec l'Occident, le complexe militaro-industriel qui cristallise les technologies de pointes, etc., ont toujours dû composer avec l'énorme force d'inertie des secteurs anachroniques du capital chinois. Durant des années Deng Xiaoping a personnifié l'équilibre fragile qui régnait à la tête du P.C. chinois et de l'armée. Alors que son grand âge lui rend de plus en plus difficile d'assumer ses fonctions et que les rivalités entre les cliques se sont aggravées, la fraction regroupée autour de Zhao Ziyang a lancée la guerre de succession. Gorbatchev a fait des émules, mais la Chine n'est pas l'U.R.S.S.
Dans la plus pure tradition maoïste, Zhao Ziyang a lancé une gigantesque campagne démocratique par étudiants interposés pour tenter de mobiliser le mécontentement de la population à son profit et s'imposer à l'ensemble du capital chinois. Représentant de la faction réformatrice, qui, pour mieux encadrer et : exploiter le prolétariat, rêve d'une Perestroïka à la chinoise, il n'a pas pu imposer son point de vue, et la réaction des fractions rivales de l'appareil d'Etat a été brutale. Deng Xiaoping, qui a été le père des réformes économiques, a réduit à néant : les illusions de son ex-protégé. Un secteur dominant de lai bourgeoisie chinoise pense qu'il y a plus à perdre de la tentative de mise en place de formes démocratiques d'encadrement : qu'à y gagner. Peut-être même considère-t-il, non sans raisons, que c'est là une tâche impossible et que le seul résultat ; serait une déstabilisation de la situation sociale en Chine. Cependant, même si elles représentent partiellement des intérêts divergents au sein du capital chinois, les cliques qui s'affrontent aujourd'hui n'utilisent les arguments idéologiques que comme paravent mystificateur : les organisateurs de la répression peuvent aussi bien essayer de se transformer demain en "démocrates" pour mieux abuser les ouvriers : Jaruzelski et Chadli ont montré l'exemple.
Ces événements dramatiques s'inscrivent dans le processus de déstabilisation de la situation mondiale sous les coups de boutoirs de la crise. Ils traduisent la barbarie croissante qu'impose la décomposition accélérée dans laquelle s'enfonce le capitalisme mondial. La Chine est entrée dans une période d'instabilité qui risque de perturber grandement les intérêts impérialistes des deux grands et d'ouvrir la porte à des tensions dangereuses pour la stabilité mondiale.
UN TERRAIN PIEGE POUR LE PROLETARIAT
Sur le terrain de la guerre de succession, engagée entre les différentes cliques de la bourgeoisie chinoise, le prolétariat n'est pas sur son terrain de classe. Il n'a rien à gagner dans cette bataille. Les prolétaires de Pékin qui ont essayé de résister héroïquement à la répression -plus par haine du régime en place que par la profondeur de leurs illusions sur des fractions démocratiques au sein du parti - ont payé chèrement leur combativité. Plus que par enthousiasme pour les manifestations pour la démocratie des apprentis-bureaucrates étudiants, les ouvriers ont manifesté leur prudence dans les grandes villes industrielles du sud de la Chine. L'appel à la grève générale des étudiants, (qui appellent aussi à l'appui de Zhao Ziyang face à la répression) n’a pas été suivi
Le prolétariat n'a pas à choisir entre la dictature militaire et la dictature démocratique. Ce faux choix est celui qui a servi à mobiliser le prolétariat pour ses pires défaites, lors de la guerre d'Espagne en 1936 et ensuite dans la IIième boucherie impérialiste mondiale. En Chine aujourd'hui, appeler le prolétariat à lutter, à faire grève alors que la répression se déchaîne, c'est le mener à l'abattoir pour un combat qui n'est pas le sien, ou il a tout à perdre.
Même si le prolétariat chinois a montré par des grèves ces dernières années, et dans sa résistance désespérée de ces derniers jours, sa combativité grandissante, il ne faut pourtant pas surestimer ses capacités immédiates. Il a peu d'expérience et n'a eu, à aucun moment ces dernières semaines, l'occasion de s'affirmer sur son véritable terrain de classe. Dans ces conditions, et alors que la répression bat son plein la perspective ne saurait être la possibilité d'une entrée immédiate des prolétaires sur leur propre terrain de classe.
Mais, les effets de la crise qui ébranle de plus en plus profondément l'économie capitaliste, particulièrement dans les pays les moins développés comme la Chine, ainsi que l'exacerbation de la haine des prolétaires à l'égard de la classe dominante, violemment renforcée par les derniers crimes de celle-ci, annoncent qu'il n'en sera pas ainsi longtemps.
Les événements qui viennent d'ébranler le pays le plus peuplé du monde, mettent, une fois encore, en évidence l'importance du combat mondial du prolétariat pour arrêter la barbarie sanguinaire du capital. Ils soulignent la responsabilité particulière des prolétaires des pays centraux, à vieille tradition de démocratie bourgeoise, qui seuls peuvent, par leurs combats, détruire les bases des illusions sur celle-ci.
9-6-1989
Géographique:
- Chine [87]
Récent et en cours:
- Mouvement étudiant [88]
Questions théoriques:
- Décadence [36]
Rubrique:
Editorial : les manoeuvres bourgeoises contre l'unification de la lutte de classe
- 2365 reads
"L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes." Il est des périodes où cette vérité générale, qui est un des fondements du marxisme, ne s'applique pas immédiatement. Ainsi les guerres mondiales ne peuvent s'expliquer par la confrontation entre prolétariat et bourgeoisie : au contraire leur déclenchement n'est rendu possible que par l'affaiblissement de cette confrontation. Mais s'il est une époque où ce jugement s'applique à la réalité immédiate c'est bien celle que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai au niveau du cours historique actuel : comme le CCI l'a démontré depuis longtemps, seules les luttes et la mobilisation de la classe ouvrière depuis que le capitalisme est entré en crise ouverte, à la fin des années 60, ont empêché ce système d'apporter sa propre réponse à son effondrement économique : la guerre impérialiste généralisée. C'est vrai pour ce qui concerne plus spécifiquement la décennie qui s'achève où le développement et l'âpreté des combats de classe depuis l'automne 1983 ont contraint la bourgeoisie à développer à grande échelle des campagnes idéologiques de tous ordres - notamment des campagnes pacifistes - destinées à masquer aux ouvriers les véritables enjeux de la situation présente. C'est encore plus vrai, enfin, à l'heure actuelle où l'intensification de ces campagnes, de même que le déploiement de multiples manoeuvres sur le terrain des luttes, sont un des plus sûrs indices du potentiel de développement de celles-ci.
Jamais, depuis la 2ème Guerre mondiale, la classe ouvrière de tous les pays n'avait subi des attaques d'une brutalité comparable à celles que le capitalisme déchaîne à l'heure actuelle. Dans les pays de la périphérie, comme au Mexique, en Algérie, au Venezuela, c'est souvent de moitié qu'a chuté le niveau de vie des ouvriers au cours des dernières années. Dans les pays centraux, la situation n'est pas fondamentalement différente. Derrière des chiffres frelatés "expliquant" que les "choses vont mieux", que "le chômage régresse" et autres mensonges grossiers, la bourgeoisie ne peut masquer aux ouvriers la dégradation constante de leurs conditions de vie, les baisses des salaires réels, le démantèlement des "prestations sociales", la multiplication des emplois précaires et des "petits boulots" payés une misère, la montée irrésistible de la paupérisation absolue.
Face à cette dégradation inexorable de ses conditions de vie, la classe ouvrière mondiale a mené depuis plus de 20 ans nombre de combats de grande envergure. Ceux de la fin des années 60 - début des années 70 (mai 68 en France, "automne chaud" italien de 69, soulèvement des ouvriers de Pologne en décembre 70, etc.), alors même que la crise ouverte du capitalisme commençait tout juste à affecter les conditions de vie de la classe ouvrière, ont fait la preuve irréfutable que le prolétariat s'était dégagé de la chape de plomb de la contre-révolution qui avait pesé sur lui depuis la fin des années 20. La perspective ouverte par l'intensification des contradictions du mode de production capitaliste n'était pas celle d'une nouvelle boucherie impérialiste, comme au cours des années 30, mais celle d'affrontements de classe généralisés. Pour sa part, la vague de combats ouvriers de la fin des années 70 - début des années 80 (Longwy-Denain en France, sidérurgie et bien d'autres secteurs en Grande-Bretagne, Pologne, etc.) confirmait que la vague précédente n'était pas un feu de paille mais avait ouvert toute une période historique où l'affrontement entre bourgeoisie et prolétariat ne ferait que s'aiguiser. La courte durée du recul des luttes succédant à la défaite subie par la classe ouvrière lors de ces combats (défaite ponctuée par le coup de force de décembre 81 en Pologne), témoignait à son tour de cette même réalité. Dès l'automne 83, avec les luttes massives du secteur public en Belgique, s'ouvrait en effet toute une série de combats dont l'ampleur et la simultanéité dans la plupart des pays avancés, et notamment européens, traduisait de façon significative l'approfondissement d’antagonisme de classe dans les pays centraux, décisifs pour sa perspective générale à l'échelle mondiale. Cette série de combats, notamment le conflit généralisé du secteur public du printemps 86 en Belgique, montrait clairement que le caractère de plus en plus frontal et massif des attaques capitalistes posait désormais comme nécessité aux luttes prolétariennes celle de leur unification, c'est-à-dire non seulement leur extension géographique par dessus les secteurs et les branches [professionnelles, mais aussi la prise en charge consciente par a classe ouvrière de cette extension. En même temps, les différentes luttes de cette période, et particulièrement celles qui se sont déroulées ces dernières années en France (chemins de fer en décembre 86, hôpitaux à l'automne 88) et en Italie (enseignement au printemps 87, chemins de fer durant l'été et l'automne 87) ont mis en relief le phénomène d'usure des syndicats, l'affaiblissement de leur capacité à se présenter comme les "organisateurs" des luttes ouvrières. Même si ce phénomène ne s'est manifesté de façon évidente que dans les pays où les syndicats se sont le plus déconsidérés par le passé, il correspond à une tendance historique générale et irréversible. Surtout qu'il se double d'un discrédit croissant dans les rangs ouvriers à l'égard des partis politiques de gauche, et plus généralement à l'égard de la Démocratie bourgeoise, discrédit que l'on peut constater notamment par une abstention croissante lors des farces électorales.
Dans ce contexte historique d'une combativité prolétarienne qui ne s'est pas démentie depuis 20 ans et d'affaiblissement des structures fondamentales d'encadrement de la classe ouvrière, l'aggravation continue des attaques capitalistes crée les conditions de nouveaux surgissements encore plus considérables de celle-ci, d'affrontements bien plus massifs et déterminés que ceux que nous avons connus par le passé. Voilà ce qui constitue le cadre véritable des enjeux de la situation mondiale. Voilà ce que la bourgeoisie essaie par tous les moyens de cacher aux ouvriers.
LE RENFORCEMENT DES CAMPAGNES IDEOLOGIQUES DE LA BOURGEOISIE
En regardant la télévision, écoutant la radio, lisant les journaux, nous "apprenons" que les faits majeurs et significatifs de la situation mondiale présente sont :
- le "réchauffement" des relations entre les principales "puissances", les Etats-Unis et l'URSS en premier lieu, mais aussi entre cette dernière et la Chine ;
- la "réelle volonté" de tous les gouvernements de construire un monde "pacifique", de régler par la négociation les conflits pouvant subsister dans différentes parties du monde et de limiter la course aux armements (notamment les plus "barbares" comme les armes atomiques et chimiques) ;
- le fait que le principal danger qui menace aujourd'hui l'humanité soit constitué par la destruction de la nature, notamment de la forêt amazonienne, par "l'effet de serre" qui va désertifier d'immenses étendues de la planète, par les "risques technologiques" à la Tchernobyl, etc. ; qu'il faut par conséquent se mobiliser derrière l'action des écologistes et des gouvernements qui maintenant reprennent à leur compte les préoccupations des premiers ;
- l'aspiration croissante des peuples vers la "Liberté" et la "Démocratie", aspiration dont Gorbatchev et ses "extrémistes", tel Boris Eltsine, figurent parmi les principaux interprètes en compagnie d'un Walesa portant en bandoulière son Prix Nobel, d'un Bush converti en grand pourfendeur de ses anciens amis "gorilles" et trafiquants de drogue à la Noriega, d'un Mitterrand exhibant aux quatre coins du monde son bicentenaire de la "Déclaration des Droits de l'Homme", des étudiants chinois, enfin, qui apportent une touche exotique et "populaire" à ce grand remue-ménage ;
- la préparation de l'Europe de 93, la mobilisation pour cet "événement historique incomparable" que constituera l'ouverture des frontières entre ses pays membres et dont les élections du 18 juin seront un jalon de premier ordre ;
- le danger que représente "l'intégrisme islamique", son grand maître Khomeiny avec ses appels Rushdicides et ses bataillons de terroristes.
Au milieu de ce tintamarre, la crise et la classe ouvrière sont étrangement discrètes. Quand on évoque la première, c'est pour proclamer qu'elle s'éloigne (les taux de croissance ne retrouvent-ils pas leur niveau des années 60?), pour nous faire vibrer pour le cours du dollar, nous "informer" que les grands de ce monde se préoccupent de la dette des pays sous-développés et "font quelque chose". Quant à la seconde, lorsque les médias s'y intéressent (en général ses luttes font l'objet du plus systématique des black-out), c'est surtout pour prononcer son oraison funèbre où afficher des bulletins de santé alarmistes à son sujet : elle est morte ou bien presque morte, en tout cas "elle est en crise puisque le syndicalisme est en crise".
L'intoxication n'est pas un phénomène nouveau dans la vie du capitalisme, ou même des sociétés de classe. Depuis ses origines la bourgeoisie a raconté des balivernes aux exploités afin de leur faire accepter leur sort, de les détourner du chemin de la lutte de classe. Mais ce qui distingue notre époque, c'est le niveau extrême du totalitarisme que l'Etat capitaliste a su mettre en place en vue de contrôler les esprits. Il n'assène pas une vérité unique et officielle, mais, pluralisme oblige, cinquante "vérités" concurrentes parmi lesquelles chacun est "libre de faire son choix", comme dans un hypermarché, et qui ne sont en réalité que cinquante variantes d'un même mensonge. Avant même les réponses, ce sont les questions elles-mêmes qui sont mensongères : pour ou contre le désarmement ? Pour ou contre l'élimination des missiles à courte portée ? Pour ou contre un Etat palestinien ? Pour ou contre le "libéralisme" ? Gorbatchev est-il sincère ? Reagan était-il sénile ? Voilà les questions "fondamentales" des "débats" télévisés ou des sondages, quand ce n'est pas "pour ou contre la chasse au renard" ou "pour ou contre le massacre des éléphants".
Si les mensonges et les campagnes médiatiques ont pour objet principal de recouvrir d'un rideau de fumée les vrais problèmes qui se posent à la classe ouvrière, leur intensification présente ne fait que traduire la conscience qu'a la bourgeoisie du danger croissant d'explosions de combativité prolétarienne, du processus de développement de la conscience qui traverse la classe. Ainsi, comme nous l'avons déjà mis en évidence dans cette Revue (par exemple dans "Guerre, militarisme et blocs impérialistes", Revue n°53, page 27), une des causes du remplacement des campagnes militaristes du début de la décennie (la croisade reaganienne contre 1'"Empire du Mal") par la campagne pacifiste actuelle à partir de 83-84, réside dans le fait que le thème sur le danger de guerre, s'il pouvait accentuer la démoralisation de la classe ouvrière dans un moment de défaite, risquait au contraire d'ouvrir les yeux des ouvriers sur les véritables enjeux de la période actuelle dès lors qu'ils avaient repris le chemin des combats ouverts. Sur le fond, il n'y a pas eu de réelle atténuation des conflits entre les grandes puissances impérialistes, au contraire : comme preuve suffisante on peut retenir le fait que les dépenses militaires ne cessent de s'accroître alors qu'elles représentent un fardeau de plus en plus lourd pour l'économie de tous les pays. Mais ce qui a changé, c'est le fait que la classe ouvrière est aujourd'hui en meilleure position pour comprendre que la seule force qui puisse empêcher une troisième guerre mondiale, c'est sa propre lutte. Dans ces conditions, il importait pour la bourgeoisie de "démontrer" que c'est la "sagesse" des gouvernements qui permet de parvenir à un monde plus pacifique, moins menacé par la guerre.
Dans ce même sens, les campagnes actuelles sur les dangers écologiques, la volonté affichée par les gouvernements de "lutter" contre ces dangers, ont pour but principal d'obscurcir la conscience du prolétariat. Ces dangers constituent une menace réelle pour l'humanité. Ils sont une manifestation de la décomposition générale, du pourrissement sur pied, qui affecte aujourd'hui la société capitaliste (voir l'article "La décomposition du capitalisme", Revue Internationale n°57). Mais les campagnes à leur sujet ne visent évidemment pas à promouvoir une telle analyse. Ce qu'il s'agit de "démontrer", et la bourgeoisie y est pour le moment parvenue dans une certaine mesure dans nombre de pays, c'est que la principale menace pesant sur l'humanité n'est pas la guerre mondiale. En proposant une "peur de substitution" aux inquiétudes qu'un monde à l'agonie engendre nécessairement dans la population, on renforce l'impact des campagnes pacifistes. En outre, bien plus que la guerre dont la classe ouvrière sait bien qu'elle est la principale victime, la menace écologique se présente comme beaucoup plus "démocratique" : l'air pollué de Los Angeles ne sélectionne pas les poumons des prolétaires, les nuages radioactifs de Tchernobyl ont frappé indistinctement les ouvriers, les paysans et les bourgeois de la région (en réalité, dans ce domaine également, les ouvriers sont beaucoup plus exposés que les bourgeois). De ce fait "l'écologie est l'affaire de tous" : là encore, il importe de masquer à la classe ouvrière l'existence de ses intérêts spécifiques. Il s'agit aussi de l'empêcher de comprendre que ce type de problèmes (comme ceux de l'insécurité croissante ou de la drogue) n'a pas de solution au sein de la société capitaliste dont la crise irrémédiable ne peut engendrer que toujours plus de barbarie. C'est ce but que visent principalement les gouvernements lorsqu'ils annoncent qu'ils vont "s'attaquer sérieusement" aux dangers qui menacent l'environnement. De plus, les dépenses supplémentaires que vont occasionner les mesures "écologiques" (hausse des impôts et des prix des biens de consommation telle la "voiture propre") auront bon dos pour justifier la baisse du niveau de vie des ouvriers. Il est évidemment plus facile de faire accepter des sacrifices au nom des "frais pour l'amélioration du cadre de vie" qu'au nom des dépenses d'armement (quitte à détourner discrètement les premiers au bénéfice des secondes).
Cette tentative de faire accepter aux ouvriers des sacrifices supplémentaires au nom des "grandes causes", nous la retrouvons d'ailleurs dans les campagnes sur la "construction de l'Europe". Déjà, lorsque les ouvriers de la sidérurgie se révoltaient contre les licenciements massifs, à la fin des années 70, chaque Etat national avait utilisé cet argument : "ce n'est pas le gouvernement qui est responsable de ces réductions d'effectifs, la décision vient de Bruxelles". Aujourd'hui, on reprend la même rengaine : il faut que les ouvriers améliorent leur productivité, soient "raisonnables" dans leurs revendications pour permettre à l'économie nationale d'être compétitive dans "le Grand Marché européen de 93". En particulier, "l'harmonisation des fiscalités et des prestations sociales" sera l'occasion de "niveler par le bas" ces dernières, c'est-à-dire de porter une nouvelle attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière.
Les campagnes démocratiques, enfin, ont pour objet de "faire comprendre" aux ouvriers des grandes métropoles occidentales la "chance" qu'ils ont de disposer des biens aussi précieux que sont "la Liberté" et "la Démocratie" même si, par ailleurs, leurs conditions de vie sont de plus en plus dures. Aux ouvriers des pays qui sont encore privés de "Démocratie", il importe de faire passer le même message : leur mécontentement tout à fait légitime face à la dégradation continuelle et catastrophique de leurs conditions de vie, face à la misère croissante qui les accable, doit se tourner vers le soutien d'une politique - la "démocratisation" - visant à surmonter les causes de ces calamités (voir dans ce numéro de la Revue l'article sur la "glasnost").
Une mention spéciale doit être accordée au battage médiatique considérable qui, en ce moment même, entoure les événements de Chine : "la force véritable capable de défier un gouvernement, ce n'est pas la classe ouvrière, mais les étudiants" (c'est une chanson que nous avions déjà entendue par le passé, notamment en mai 68 en France et, dans ce même pays, en décembre 86) : voilà le message qu'il faut faire passer car tout est bon pour tenter de convaincre la classe ouvrière qu'"elle n'est rien", ou au moins d'entraver en son sein la prise de conscience qu'elle est la seule classe porteuse d'un avenir, que ses luttes actuelles sont des préparatifs en vue de la seule perspective qui puisse sauver l'humanité, une condition du renversement de ce système qui engendre tous les jours une barbarie croissante.
Mais pour parvenir à cette fin, la bourgeoisie ne se contente pas de ses grandes campagnes médiatiques. Elle doit en même temps, et plus encore, s'attaquer à la combativité, à la confiance en soi et au développement de la conscience du prolétariat sur le terrain où ils se manifestent le plus directement, celui des luttes contre les attaques de plus en plus brutales que la bourgeoisie lui assène.
LES MANOEUVRES DE LA BOURGEOISIE CONTRE LES LUTTES OUVRIERES
Si l'unification de ses combats constitue à l'heure actuelle pour la classe ouvrière une nécessité vitale, il est clair que c'est sur ce terrain que la bourgeoisie doit déployer ses efforts majeurs. Et il en est bien ainsi dans le moment présent.
En effet, on a pu assister ces derniers mois au déploiement de toute une offensive bourgeoise consistant à prendre les devants de la combativité ouvrière, en provoquant des luttes de façon préventive, afin de briser dans l'oeuf l'élan vers une mobilisation massive et solidaire de l'ensemble de la classe. Et c'est en Grande-Bretagne, pays où domine la bourgeoisie la plus expérimentée et habile du monde, qu'une telle tactique a été mise en oeuvre dès l'été dernier avec la grève des postes du mois d'août. En déclenchant prématurément un mouvement dans un secteur aussi central que les postes, dans la période de l'année la moins propice à un élargissement du combat, la bourgeoisie s'est donnée ainsi toutes les garanties au maintien de l'isolement et à l'enfermement catégoriel. Le succès d'une telle manoeuvre a donné le feu vert à la bourgeoisie des autres pays d'Europe occidentale pour exploiter à fond cette stratégie comme on a pu le voir en France, dès le mois de septembre, avec le déclenchement artificiel et planifié plusieurs mois auparavant de la grève des infirmières. En cette circonstance également, il s'agissait pour la bourgeoisie de faire partir prématurément un secteur, de provoquer un affrontement sur un terrain miné avant que n'aient mûri suffisamment dans l'ensemble de la classe ouvrière les conditions d'un réel combat frontal (voir l'article "France : les "coordinations" à l'avant-garde du sabotage des luttes", Revue Internationale n°56). Dès le mois de décembre, c'est en Espagne que la bourgeoisie, forte des succès remportés en Grande-Bretagne et en France, va reprendre à son compte une telle stratégie comme on a pu le voir avec l'appel de tous les syndicats à la fameuse "grève générale" du 14 décembre où, cette fois, ce n'est pas un secteur particulier mais des millions d'ouvriers de tous les secteurs qui ont été embarqués dans une bataille prématurée, dans une fausse démonstration de "force". Voilà comment la bourgeoisie, dans tous les pays où elle a été confrontée ces deux dernières années à des luttes importantes, est parvenue à mouiller la poudre en prenant les devants pour étouffer tout nouveau surgissement de combats massifs.
Pour être en mesure de mener à bien une telle politique de sabotage des luttes ouvrières, l'Etat capitaliste est aujourd'hui contraint de renforcer l'ensemble de ses forces d'encadrement sur le terrain. Face au discrédit croissant des syndicats dans les rangs ouvriers, face aux tendances de la classe ouvrière à prendre elle-même en main la conduite de ses luttes, partout la bourgeoisie a tenté non seulement de remettre en selle ses syndicats officiels mais encore de mettre en place des structures "extra syndicales" pour occuper tout le terrain de la lutte, reprendre à son propre compte les besoins de la classe pour mieux les vider de leur contenu et les retourner contre elle.
C'est ainsi qu'en France, on assiste à une extrême "radicalisation" de la CGT (contrôlée par le PC), en même temps que des remaniements sont opérés au sein des autres syndicats afin de "gauchiser" leur image. En Espagne, c'est à cette même radicalisation que se sont trouvés confrontés les ouvriers, radicalisation qui a permis à tous les syndicats unis d'orchestrer la manoeuvre du 14 décembre. En particulier, on a vu l'UGT (syndicat lié au PSOE au gouvernement) se démarquer subitement du PSOE, en engageant la "bataille" aux côtés des Commissions ouvrières et du PC contre la politique d'austérité du gouvernement. C'est cette même radicalisation des syndicats officiels qui a entravé également le développement des luttes aux Pays-Bas ces derniers mois, où comme en Espagne, les syndicats non seulement ont tenté de redorer leur blason à travers leurs discours d'opposition au gouvernement, mais ont surtout tenté de reprendre à leur propre compte le besoin d'unité des ouvriers pour le dénaturer et le dévoyer. Si, en Espagne, c'est l'unité syndicale UGT-CCOO-CNT qui a été mise en avant dans la manoeuvre du 14 décembre, alors que tout était organisé pour éviter que les différents secteurs ouvriers ne se retrouvent dans les manifestations, aux Pays-Bas, c'est à travers un appel à une fausse "solidarité active" que les syndicats ont pu prendre les devants et dévoyer ce besoin essentiel de la classe. Et, à cet effet, ils avaient mis en place dès l'automne dernier un "comité de coordination" destiné soi-disant à "organiser la solidarité" avec les différents secteurs en lutte.
En Grande-Bretagne, enfin, la bourgeoisie n'est pas restée à la traîne dans la politique de "radicalisation" des syndicats. Dans la récente grève générale des transports de la région de Londres, la plus importante dans ce secteur depuis 1926, ce sont les syndicats "officiels" eux-mêmes qui ont pris la responsabilité d'appeler à une grève illégale.
Cependant, cette stratégie de "radicalisation" des syndicats se révèle de moins en moins capable, à elle seule, de barrer le chemin au développement des luttes. De façon de plus en plus fréquente, les syndicats officiels ou même "de base" sont relayés et épaulés par une autre structure d'encadrement, soi-disant "extra-syndicale" et animée essentiellement par les gauchistes : les coordinations auto-proclamées. Depuis le mouvement dans les hôpitaux en France, qui a mis en vedette la "coordination infirmière", celle-ci est devenue un modèle pour l'ensemble de la bourgeoisie européenne. Ainsi, ces derniers mois, ont surgi dans plusieurs pays des "succursales" de cette coordination infirmière, notamment en RFA où s'est constituée dès le mois de novembre une coordination du même type dans les hôpitaux de Cologne avant même le développement d'une mobilisation dans ce secteur. Aux Pays-Bas, c'est également chez les infirmières que les gauchistes ont mis en place une coordination et ont appelé à un meeting national à Utrecht en février, c'est-à-dire à une tentative de centralisation ne correspondant à aucune mobilisation réelle des travailleurs.
Et ce n'est pas un hasard si la manoeuvre déployée avec la grève des infirmières en France sert aujourd'hui de modèle, de référence pour la bourgeoisie des autres pays européens. C'est elle qui, grâce à la pseudo victoire qu'elle a obtenu (alors que les fonds destinés aux augmentations avaient été débloqués depuis longtemps par le gouvernement), a été le fer de lance de l'offensive bourgeoise actuelle visant à présenter les luttes corporatistes comme étant les seules pouvant mener les ouvriers à une victoire, à opposer les différents secteurs les uns aux autres, afin de saper toute velléité de développer une riposte unifiant l'ensemble des secteurs sur la base de revendications communes à tous. C'est ainsi que ces derniers mois, dans un grand nombre de pays, on a vu syndicats et gauchistes intensifier la politique utilisée déjà lors des grèves des chemins de fer de 86 en France et de 87 en Italie (en particulier à travers les "coordinations") pour inoculer systématiquement le poison corporatiste dans toutes les luttes, au moyen notamment de la mise en avant de revendications spécifiques à tel ou tel secteur, afin d'empêcher les autres secteurs de se reconnaître dans les luttes, voire de les opposer les uns aux autres.
Ainsi, en Espagne, la grande manoeuvre du 14 décembre ne visait pas seulement à prendre les devants de la mobilisation ouvrière pour mouiller la poudre. Elle ouvrait également la voie à toute une campagne syndicale sur le thème : "il faut tirer maintenant les leçons du grand succès du 14 décembre dans chaque secteur car chaque secteur a sa propre convention collective, ses propres revendications". De même, dans les secteurs où les syndicats sont particulièrement contestés, ce sont les gauchistes et les syndicalistes de base qui ont mis en avant des revendications spécifiques pour les roulants dans les chemins de fer, les mécaniciens des transports aériens, les mineurs de Tewel, les infirmières à Valence etc.
En RFA, c'est au moyen d'une vaste campagne médiatique autour de la revalorisation du métier d'infirmière que la bourgeoisie, en utilisant un secteur particulier s'est efforcée d'inoculer le poison du corporatisme au sein de la classe ouvrière. Et sur le terrain, ce sont les gauchistes de la coordination constituée à Cologne qui ont mis en avant la revendication d'une augmentation de salaire de 500 Marks pour les seules infirmières, comme ce fut le cas en France.
Aux Pays-Bas, alors que depuis le début de l'année la combativité ouvrière menaçait d'éclater ouvertement dans tous les secteurs contre les nouvelles mesures d'austérité annoncées par le gouvernement, les syndicats et les gauchistes ont su exploiter leur image radicale pour enfermer, isoler les unes des autres toutes les luttes qui se sont développées depuis le début de l'année 89 dans de nombreux secteurs : aux usines Philips, dans le port de Rotterdam, chez les enseignants, les employés communaux d'Amsterdam, les sidérurgistes des aciéries de Hoogovens, les conducteurs de camions, les ouvriers du bâtiment, etc. La stratégie de dispersion des luttes déployée par les forces d'encadrement (grèves tournantes secteur après secteur, meetings régionaux, débrayages de 2 ou 3 heures, "journées d'action" appelées dans un seul secteur, etc.) s'est appuyée essentiellement sur la mise en avant de revendications catégorielles, de telle sorte que les autres secteurs de la classe ne puissent se reconnaître dans telle ou telle lutte (semaine de 36 heures pour les sidérurgistes, paiement des heures supplémentaires pour les camionneurs, défense de la qualité de l'enseignement pour les instituteurs etc.).
Voilà comment la bourgeoisie déploie à l'heure actuelle ses manoeuvres en Europe occidentale, c'est-à-dire là où est concentré le fer de lance du prolétariat mondial. Cette stratégie a réussi pour le moment à désorienter la classe ouvrière et à entraver sa marche vers l'unification de ses combats. Mais le fait que la classe dominante soit de plus en plus obligée de s'appuyer sur ses forces "gauchistes" constitue un indicateur, au même titre que l'intensification de ses campagnes médiatiques, du processus profond de maturation des conditions pour de nouveaux surgissements massifs, de plus en plus déterminés et conscients de la lutte prolétarienne. En ce sens, les luttes extrêmement massives et combatives qu'ont menées ces derniers mois les ouvriers dans différents pays de la périphérie, tels la Corée du Sud, le Mexique, le Pérou et surtout le Brésil (où, pendant plusieurs semaines, une mobilisation de plus de 2 millions d'ouvriers a passablement débordé les syndicats), ne sont que les signes avant-coureurs d'une nouvelle série d'affrontements majeurs dans les pays centraux du capitalisme affirmant toujours plus que c'est bien la classe ouvrière qui détient entre ses mains la clé de toute la situation historique présente.
FM, 28-5-89
Récent et en cours:
- Luttes de classe [89]
Un mensonge dans la continuité du stalinisme : la perestroïka de Gorbatchev
- 5660 reads
Après les années d'immobilisme incarnées par le règne de la clique brejnévienne, l'U.R.S.S., sous la houlette de Gorbatchev est prise d'une frénésie de réformes politiques et économiques. Les campagnes médiatiques sur la réforme économique, sur la démocratisation font écho sur toute la planète ; les termes de Perestroïka et de Glasnost ont franchi le rideau de fer tandis que, personnifiée par Gorbatchev, une nouvelle image pacifiste de l'U.R.S.S. est offerte à la population mondiale.
Que se passe-t-il en U.R.S.S. ? Quelle est la signification de ces bouleversements qui remuent la deuxième puissance impérialiste mondiale ? Que peut en attendre le prolétariat ?
L'U.R.S.S. D'AVANT LA PERESTROÏKA
Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de resituer le contexte économique et historique du capital russe qui détermine directement les aspects spécifiques permettant de mieux comprendre la situation présente.
LA FAIBLESSE ECONOMIQUE DE L'U.R.S.S.
La situation présente en U.R.S.S. est le résultat de décennies de crise permanente du capital russe. L'économie russe est fondamentalement sous-développée. La puissance économique de l'U.R.S.S. se caractérise plus par sa taille que par sa qualité. Le P.N.B./habitant estimé à 5700 $ en 1988 ([1] [90]) place l'U.R.S.S. au 53e rang mondial juste avant la Libye. Les exportations de l'U.R.S.S. sont caractéristiques des pays sous-développés : essentiellement des matières premières, gaz et pétrole dont elle est le premier producteur mondial.
La situation de sous-développement du capital russe est ancienne, il est arrivé trop tard sur le marché mondial. Entravé dans son développement par la féodalité tsariste au XIXème siècle, à peine s'impose-t-il politiquement, portant encore les marques profondes du féodalisme, que son Etat est anéanti et son économie bouleversée par la révolution prolétarienne de 1917. Ce n'est qu'avec la contre-révolution stalinienne qu'il s'imposera sur la scène internationale. Le capitalisme stalinien, surgi en pleine période de décadence capitaliste, en porte irrémédiablement les stigmates. Produit de la pire des contre-révolutions, il est une caricature du capitalisme d'Etat décadent. Si l'U.R.S.S. a pu s'imposer comme deuxième puissance mondiale, ce n'est certainement pas par la compétitivité et la productivité de son économie, mais par la force de ses armes idéologiques et militaires dans la seconde guerre impérialiste mondiale, et ensuite, dans les soi-disant luttes de libération nationale. Même si le capital russe s'est renforcé après la guerre par le pillage des pays d'Europe de l'Est (démantelant des usines pour les remonter en U.R.S.S.) et une tutelle de fer sur son bloc pour détourner les lois de l'échange à son profit, son retard sur le plan économique par rapport aux pays les plus développés ne fera que s'aggraver.
L'U.R.S.S. n'a pu accéder au rôle de deuxième puissance impérialiste mondiale et s'y maintenir qu'en transformant toute son économie en économie de guerre, en polarisant son appareil productif autour de la production d'armement. Des pans entiers de l'économie qui ne relevaient pas de la priorité militaire, ont été sacrifiés : agriculture, biens de consommation, santé, etc. Les richesses, produit de l'exploitation des travailleurs, sont faiblement réinvesties dans la production et surtout détruites dans la production d'armements.
Une telle ponction sur l'économie, bien supérieure à celles réalisées pour la production d'armements en occident, ne peut que peser de plus en plus lourdement sur l'économie russe et entraver gravement le développement de son capital, lui faisant perdre à jamais tout espoir de concurrencer ses rivaux sur le plan économique. Le capitalisme à l'est s'inscrit totalement dans la crise mondiale, sous des formes parfois différentes mais tout aussi significatives qu'à l'ouest. Irrésistiblement, décennies après décennies, le taux de croissance officiel, artificiellement entretenu par la production d'armements, baisse.
Une telle politique économique où tout est sacrifié sur l'autel de l'économie de guerre et de la stratégie impérialiste, ne peut que se traduire par des attaques permanentes contre le niveau de vie de la classe ouvrière.
Cependant, à terme, une telle faiblesse économique ne peut que constituer une entrave à la capacité de développement de la puissance impérialiste de l’U.R.S.S.. C'est ce qu'illustre l'histoire du capital russe après la guerre. ([2] [91])
LE RECUL DU BLOC RUSSE ET L'IMMOBILISME BREJNEVIEN
Avec les accords de Yalta qui entérinent le partage du monde et notamment de l'Europe, entre l'U.R.S.S. et les U.S.A., s'ouvre une nouvelle période marquée par l'antagonisme de ces deux puissances impérialistes mondiales dominantes, avides de s'approprier des lambeaux de l'empire colonial de l'Europe défaillante. Les soi-disant "luttes de libération nationales" vont être un des vecteurs de l'impérialisme des deux "grands". Tout comme les U.S.A., l'U.R.S.S. va mettre à profit la période de décolonisation pour sortir de son isolement continental. Usant et abusant de son discours idéologique mystificateur, par son soutien armé aux mouvements "anticoloniaux" et "nationalistes" elle va étendre sa zone d'influence : en Asie (Chine, Vietnam), au Moyen-Orient (Egypte, Syrie, Irak), et même en Amérique (Cuba). Partout dans le monde, les partis staliniens et les "guérillas" soutenus par l'U.R.S.S. témoignent de sa puissance mondiale. Mais, ce que l'U.R.S.S. est capable de gagner sur le plan militaire et idéologique, elle se révèle incapable de le consolider sur le plan économique. Avec les années 60, s'engage un irréversible processus de déclin, qui va s'accélérer avec le développement de la crise économique dans les années 70 : le gain de Indochine ne compense pas la perte catastrophique de la Chine ; la réaction occidentale impose un recul dans l'affaire des missiles à Cuba ; la défaite militaire de ses alliés au Proche-Orient, face à Israël, accélère sa perte d'influence dans la région ; en Amérique et en Afrique, les mouvements de "lutte de libération nationale" qu'elle soutient, sont défaits et la "victoire" en Angola qui met à profit la décolonisation tardive des possessions portugaises, n'est qu'une maigre consolation.
Ce recul traduit la situation de faiblesse relative dans laquelle se trouve le bloc russe vis-à-vis de son concurrent occidental.
L'U.R.S.S. pour consolider son bloc à la périphérie ne peut quasiment rien offrir sur le plan économique : ses aides financières sont pauvres et incapables de concurrencer les subsides de l'occident ; elle n'a pas de réels débouchés à offrir aux exportations de ses alliés, sa technologie est déficiente et ne permet pas à ses vassaux de concurrencer efficacement leurs rivaux sur le plan économique. Les pays sous sa domination vont s'appauvrir et s'affaiblir vis-à-vis de leurs concurrents du bloc occidental. Pour n'importe quel capital national, il est plus intéressant économiquement de se trouver inséré au sein du bloc le plus puissant dominé par les U.S.A.
Face à cette situation de faiblesse, les seuls atouts de l'U.R.S.S. sont la force des armes et le mensonge idéologique. Mais, la faiblesse économique du bloc russe ne peut, à la longue, que saper ces deux piliers de la puissance du capital russe. A cet égard, le règne de Brejnev va être exemplaire. Après les ambitions de Kroutchev (qui prévoyait le communisme et l'abondance pour 1980 !!!), la bourgeoisie russe doit revoir ses ambitions à la baisse. Après l'euphorie des années 50 : expansion impérialiste, succès technologiques (premier Spoutnik), les échecs répétés au début des années 60 : recul dans l'épisode des missiles de Cuba, brouille avec la Chine, le mécontentement de la classe ouvrière qui va culminer avec les émeutes sanglantes de Novotcheikass, l'hostilité de la Nomenklatura aux réformes économiques, vont précipiter la chute de Kroutchev qui sera "démissionné pour raison de santé" en 1964. Brejnev prend la succession.
Finie la politique de réforme ambitieuse. Les réformes économiques proposées par Lieberman pour dynamiser l'économie russe sont enterrées. Les campagnes idéologiques de "déstalinisation" inaugurées par le XXe Congrès et menées pour tenter de recrédibiliser l'Etat, sont stoppées net. L'incapacité de la bourgeoisie russe de mener ce programme de modernisation va se traduire par l'immobilisme. Le capitalisme russe s'enfonce encore plus dans le marasme économique. Plus que jamais le seul moyen pour l'U.R.S.S. de s'ouvrir de nouveaux marchés, non pour les faire fructifier mais pour les piller, c'est la force des armes. Des armes, c'est la seule chose que l'U.R.S.S. a à offrir à ses alliés. Des armes, la Russie de Brejnev va en produire à profusion. L'industrie de l'armement va continuer de s'hypertrophier aux dépens des autres secteurs de la production.
Sur le plan international, l'arrivée de Brejnev sanctionne le recul de l'impérialisme russe. Alors que la guerre au Vietnam s'intensifie et que les deux puissances s'y embourbent, les relations entre les deux grands sont paradoxalement marquées par les campagnes sur la "coexistence pacifique" et des accords de limitation des armements sont signés : en 1968, un traité de non-prolifération des armes nucléaires et en 1973, les célèbres accords S.A.L.T. Loin des discours "pacifistes" de l'après-Vietnam, la course aux armements se poursuit et impose des sacrifices toujours plus forts à l'économie. Mais l'économie est un tout. Les impasses faites dans certains secteurs se traduisent par un retard technologique croissant qui se répercute inévitablement sur l'efficacité des armes. La quantité d'armements va tendre à remplacer la qualité. Durant les années 70, l'influence du bloc de l'est va se réduire comme peau de chagrin. Même la victoire sur le terrain au Vietnam va se traduire par une déroute stratégique avec l'alliance de la Chine et des U.S.A. Les pays où l'Est maintient sa présence à la périphérie du capitalisme, sont soumis à une pression militaire, économique de la part du bloc occidental et sont un gouffre pour le capital russe sans que celui-ci puisse en tirer grand profit ni sur le plan économique, ni sur le plan stratégique.
L'effondrement du régime du Shah en Iran en créant un vide béant dans le dispositif militaire du bloc occidental qui enserre le bloc de l'Est, donne à l’U.R.S.S. l'opportunité de s'ouvrir une route vers son rêve stratégique d'un accès aux mers chaudes et aux richesses du Moyen-Orient. Après des années de litanies pacifistes, l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge, fin 1979, est une remise en cause dans les faits des accords de Yalta. Les années 80 s'ouvrent sous les auspices inquiétants d'un très brutal réchauffement des tensions inter impérialistes entre les deux grands. Le bloc occidental réagit par une offensive impérialiste de grande envergure. Le bloc de l'Est est soumis à un blocus technologique et économique. Les budgets d'armements occidentaux font un bond, de nouvelles armes toujours plus perfectionnées et efficaces sont fabriquées, de nouveaux programmes intégrant les dernières découvertes technologiques sont lancés, une politique militairement plus agressive est imposée partout où l'U.R.S.S. a encore une influence, l'arme de la "guérilla" est retournée contre le bloc russe en Angola, en Ethiopie, au Cambodge, en Afghanistan.
Le brutal accroissement des tensions impérialistes va mettre en relief les carences du dispositif militaire russe. Déjà, la guerre du Kippour en 1973 où, en quelques heures, l'aviation israélienne avait cloué au tapis, sans aucune perte, une centaine d'avions russes de l'armée syrienne, avait montré le retard technologique des armements russes, leur inefficacité. La fourniture par les U.S.A. de missiles Stinger aux "moudjahiddines" afghans va bouleverser le champ de bataille. L'armée rouge ne peut plus utiliser ses hélicoptères blindés comme auparavant et son aviation ne peut plus se permettre sans risque de bombarder les "résistants" à basse altitude ; quant à ses chars, ils sont des cibles fragiles face aux nouveaux missiles et roquettes anti-chars qui sont livrés par l'occident. Malgré un contingent de plus de 100 000 hommes, des milliers de chars, des centaines d'hélicoptères et d'avions, l'armée rouge est incapable de s'imposer sur le terrain. L'état-major "soviétique" doit constater l'inefficacité de ses armes, leur retard technologique. L'annonce par Reagan du programme dit de la "guerre des étoiles" qui rendrait caduques les missiles stratégiques nucléaires et donc, du même coup, l'essentiel de l'arsenal nucléaire russe, le constat du retard dramatique dans des domaines essentiels tels que l'électronique provoque parmi les stratèges du bloc russe la crainte d'une percée technologique occidentale qui surclasserait totalement leurs systèmes d'armes.
Au sein de la bourgeoisie russe, la fraction militaire responsable du complexe militaro-industriel et de l'armée devient la plus chaude partisane d'une réforme économique destinée à redresser la situation. Des armes en quantité, ce n'est pas suffisant si celles-ci ne sont pas de qualité. Pour moderniser les armes, il faut "moderniser" l'économie, c'est-à-dire exploiter plus et mieux les travailleurs pour renforcer la capacité technologique du secteur militaro-industriel.
La nécessaire réforme économique se heurte à la pesanteur bureaucratique de la classe dominante regroupée dans le Parti qui paralyse le fonctionnement de la production et justifie tous les gaspillages. Le capitalisme russe a la particularité de s'être imposé directement au travers de l'Etat, le secteur privé ayant été réduit à sa plus simple expression par la Révolution russe. Le marché intérieur ne joue pas le rôle de régulateur par la concurrence. Les gestionnaires et responsables de la production sont plus soucieux de leur place dans la Nomenklatura et des privilèges qui en découlent, que de la production. Le népotisme, la corruption et les combines règnent. Les membres du Parti, pour qui le poste de directeur d'usine ne correspond à aucune compétence particulière, mais à une situation où au travers de privilèges multiples, on peut s'en mettre plein les poches, sont peu soucieux de la production. Liés à un clan ou à un autre, parrainés en haut lieu, leur carrière ne dépend pas de leurs résultats économiques. L'anarchie bureaucratique qui règne dans la production est tout à fait profitable aux "apparatchiks". Une large fraction de la Nomenklatura y trouve tout à fait son compte et en fait sa base d'existence. Les fractions de la bourgeoisie qui ont soutenu l'immobilisme brejnévien, sont hostiles à tout changement qui remettrait en cause leurs privilèges, même si c'est pour le bien du capital national. Avec la mort de Léonid Brejnev, les rivalités de cliques vont s'exacerber et la guerre de succession va faire rage.
Mais le principal obstacle à la mise en place d'une réforme économique reste le prolétariat. En effet, la réforme économique implique une attaque renforcée contre les conditions de vie des travailleurs. Comme dans le reste du monde, dans le bloc de l'Est, les luttes ouvrières ont réapparu sur la scène de l'histoire. Les années de plomb de la contre- révolution stalinienne se sont éloignées, une nouvelle génération de prolétaires est née que la terreur et la répression ne parviennent plus à soumettre.
LA QUESTION SOCIALE DANS LE BLOC DE L'EST
Dans la tradition stalinienne, les conditions de vie de la population ont été sacrifiées aux besoins de l'économie de guerre. La pénurie règne, les magasins sont vides, le rationnement est imposé, les salaires sont maigres et le quadrillage policier impose le silence. Cette situation ne s'est pas beaucoup améliorée sous le régime de Kroutchev et Brejnev. Elle s'est même aggravée avec l'approfondissement de la crise économique mondiale à partir de la fin des années 60 qui fait aussi sentir ses effets à l'Est. Le mécontentement s'est développé au sein de la classe ouvrière, l'étau de la résignation face à la terreur policière a commencé à se desserrer pour une nouvelle génération de prolétaires qui n'a pas connu les pires années de la contre-révolution stalinienne. Le développement de la lutte de classe en Pologne est particulièrement significatif h cet égard ([3] [92]). Les grèves et les émeutes des villes de la Baltique (Gdansk, Slettin, Sopot, Gdynia) durant l'hiver 1969-70 en Pologne, sauvagement réprimées dans un bain de sang, la vague de grèves de 1976 et finalement la grève de masse de 1980 qui se répand comme une traînée de poudre et embrase toute la Pologne, montrent la combativité retrouvée du prolétariat. Elles montrent aussi à la bourgeoisie que la répression ne suffît plus à maintenir le prolétariat sous le joug : malgré les répressions successives, après de bref reculs, la lutte de classe s'est redéployée à un niveau supérieur. La répression, si elle peut parvenir à intimider le prolétariat, constitue aussi un important facteur de prise de conscience pour une classe dont la combativité renaissante est aiguillonné par les attaques incessantes contre ses conditions de vie : le divorce entre l'Etat et la société civile est total, l'ennemi est clairement identifié. La fracture entre les exploités et la classe dominante étant tranchée, le prolétariat parvient plus facilement à reconnaître son unité de classe et imposer ses méthodes de luttes.
Pour la bourgeoisie, la répression est une arme à double tranchant. Mal employée, loin de démoraliser les ouvriers, elle risque de renforcer la mobilisation et la détermination du prolétariat. Au plus fort de la grève en Pologne, réprimer le mouvement portait le risque de cristalliser le mécontentement grandissant de la classe ouvrière dans tous les pays d'Europe de l'Est et d'ouvrir les portes à la généralisation de la grève au-delà des frontières de la Pologne. Face à la grève de masse en Pologne, la bourgeoisie a dû reculer pour se donner une marge de manoeuvre. Les accords de Gdansk d'août 1980, en même temps qu'ils marquent l'apogée de la lutte de classe, marquent aussi le début de la contre-offensive de la bourgeoisie. Celle-ci va se mener sous le masque de l'illusion démocratique et du nationalisme. Le prolétariat de Pologne qui avait montré sa combativité, son courage, sa détermination, son unité, ses réflexes de classe pour contrôler, organiser et orienter sa lutte, montre son immaturité, son inexpérience face aux mystifications plus sophistiquées de la bourgeoisie : la création de Solidarnosc, la montée en première ligne de l'Eglise donne une nouvelle crédibilité démocratique à l'Etat stalinien. Walesa va faire le pompier de la lutte de classe, demandant aux ouvriers en grève de reprendre le travail pour ne pas entraver le processus de "démocratisation" et la modernisation du capital polonais. La nouvelle "opposition" fait de la surenchère nationaliste avec le Parti communiste dirigeant. Le prolétariat polonais est déboussolé, démobilisé, divisé, isolé de ses frères de classe des autres pays. La bourgeoisie va en profiter pour réprimer une nouvelle fois à la fin de 1981. Solidarnosc est interdit, ce qui va renforcer sa crédibilité, mais son travail de sabotage de la lutte de classe va se poursuivre. La classe va continuer, malgré la répression, de manifester sa combativité tout au long des années 80, mais ses luttes sont détournées par Solidarnosc qui jouit d'une très grande popularité, et transformées en "lutte pour la démocratie", pour la reconnaissance "officielle" du nouveau syndicat.
Le prolétariat de Pologne est la fraction la plus avancée du prolétariat des pays de l'Est. Il montre dans ses forces et ses faiblesses des caractéristiques qui ne lui sont pas propres, mais que partagent d'autres fractions du prolétariat :
- une caractéristique générale au prolétariat mondial, celle d'un développement de la combativité, de la volonté de lutter. Dans les pays de l'Est comme ailleurs une nouvelle génération de prolétaires est arrivée sur la scène de l'histoire qui n'a pas subi le joug de la contre-révolution triomphante qui a marqué ce siècle, qui n'est pas vaincue, résignée, qui possède un potentiel de combativité intacte qui ne demande qu'à se déployer ;
- des caractéristiques plus particulières, qui se rencontrent à la fois dans les pays de 1’Est et dans les pays sous- développés :
- le manque d'expérience par rapport aux mystifications les plus sophistiquées de la bourgeoisie : l'illusion démocratique, le pluralisme électoral, le syndicalisme "libre" sont autant de pièges dont le prolétariat d'Europe de l'Est a très peu l'expérience; de plus sa propre expérience de la terreur stalinienne tend à renforcer ses illusions démocratiques, à idéaliser le modèle occidental ;
- le poids ancien des illusions nationalistes a été constamment renforcé par le centralisme néo colonial et brutal de Moscou qui, sur ce plan, a repris l'héritage du tsarisme. Attiser le nationalisme par la répression a été une constante du stalinisme qui, en divisant le prolétariat en multiples nationalités, renforçait son pouvoir central.
La faiblesse du prolétariat d'Europe de l'Est par rapport aux illusions démocratiques et nationalistes, est connue depuis longtemps par la bourgeoisie stalinienne. Elle a toujours su utiliser adroitement un savant dosage de répression et de libéralisation pour maintenir le prolétariat dans les chaînes de l'exploitation : Gomulka et Gierek qui dirigent le capital polonais respectivement de 1956 à 1970 et de 1970 à 1980, avant d'être ceux qui ordonnent la répression, auront été les artisans d'une "libéralisation" du régime. Le "printemps de Prague" montre comment certaines fractions du régime stalinien peuvent être d'ardents défenseurs de la "démocratie" pour mieux contrôler le mécontentement de la population. Depuis 1956, le K.G.B. a fait de la Hongrie son domaine réservé pour y expérimenter ses réformes politiques de "libéralisation". L'épisode Kroutchev et la "déstabilisation" montrent que le désir d'un encadrement "démocratique" du prolétariat, plus efficace que la seule terreur policière préoccupe la bourgeoisie du bloc russe.
La question sociale est déterminante dans la capacité du bloc de 1’Est à manoeuvrer sur le terrain impérialiste :
- sur le plan économique, la résistance grandissante des ouvriers entrave la course du capital à la productivité et sur tout rend dangereuse une réforme économique, indispensable au renforcement du potentiel militaire mais qui implique une exploitation renforcée du prolétariat. La modernisation de l'appareil productif porte avec elle le danger de luttes ouvrières, d'une crise sociale et d'une déstabilisation du bloc ;
- sur le plan politique, le mécontentement croissant du prolétariat entrave la capacité de manoeuvre de la bourgeoisie. La colère vis-à-vis de l'aventure afghane a crû avec le retour des morts et des blessés du champ de bataille, tandis que les aides aux alliés du tiers-monde devenaient de plus en plus impopulaires face à un niveau de vie qui allait en se dégradant. L'hostilité du prolétariat vis-à-vis des sacrifices imposés par les ambitions de l'impérialisme russe va grandissante ;
- sur le plan stratégique, les grèves de Pologne, en paralysant les chemins de fer, ont complètement perturbé l'approvisionnement du plus important dispositif militaire russe le long du rideau de fer, montrant concrètement pourquoi la paix sociale est absolument nécessaire à la guerre impérialiste.
LA CREDIBILITE DE L'ETAT
Au début des années 80, l'état de décrépitude sénile de Brejnev est à l'image du capital russe. Des mesures de réformes sont urgentes, et en premier lieu des réformes politiques afin de redonner une crédibilité à l'Etat russe aussi bien sur le plan intérieur qu'international.
Cependant, cette politique de démocratisation, la bourgeoisie stalinienne ne s'en est jamais vraiment donnée les moyens, si elle les a jamais eus. Pour la mettre en place, elle se heurte à des obstacles de taille :
.- jusqu'aux événements de Pologne 1980, la combativité du prolétariat avait pu être facilement contenue, surtout grâce à une répression brutale, ce qui ne poussait pas la Nomenklatura à envisager des réformes politiques en profondeur ;
- les intérêts de larges fractions de la bourgeoisie sont liés à la forme même de l'Etat et à son fonctionnement stalinien. La peur de perdre ses privilèges est un puissant facteur de résistance d'une fraction de l'appareil d'Etat hostile à toute idée de réforme ;
- le sous-développement du capital russe est une entrave très lourde à la crédibilisation des illusions démocratiques alors qu'en dehors de belles paroles, il n'a à offrir aucune amélioration des conditions de vie du prolétariat ;
- même si le prolétariat est fragile face aux mystifications démocratiques, pour autant sa méfiance absolue vis-à-vis de l'Etat rend difficile sa crédibilisation. Il est ainsi plus facile d'enraciner l'illusion démocratique en réprimant qu'en intégrant une opposition permanente dans le fonctionnement de l'Etat, ce qui risque de nuire à la crédibilité de celle- ci, qui est la clé de voûte de la légitimation de la "démocratie".
La crédibilité de son Etat est une question essentielle pour la bourgeoisie, aussi bien sur le plan intérieur, qu'international. A priori, c'est d'autant plus vrai pour une puissance impérialiste majeure telle que l'U.R.S.S. Pourtant, la bourgeoisie russe exprime dans son fonctionnement la faiblesse de son capital sous-développé et le poids de ses origines historiques par un immobilisme, une paralysie politique qui se traduisent dans une résistance profonde aux réformes politiques nécessaires à son capital. La bourgeoisie d'Etat russe a vécu sur les acquis de sa contre-révolution victorieuse :
- sur le plan interne, l'écrasement du prolétariat, l'anéantissement de la révolution par Staline a assuré à la bourgeoisie une longue paix sociale que la seule répression a permis globalement de maintenir. La crédibilité de l'Etat correspondait à la terreur qu'il était capable d'entretenir.
- sur le plan international, la puissance de ses armes et notamment le développement de son arsenal nucléaire sont en soi suffisants pour crédibiliser l'impérialisme russe. Cependant, l'U.R.S.S. durant des décennies a pu jouir de l'insigne privilège de se réclamer impunément de la révolution prolétarienne, dont il a été le pire bourreau, pour mener une politique internationale offensive en s'attirant la sympathie de prolétaires et d'exploités abusés par le mensonge stalinien. Le plus grand mensonge du siècle, celui de la nature prolétarienne de l'Etat russe a été le principal vecteur de la crédibilité de sa propagande internationale.
Ces acquis de la bourgeoisie russe se sont usés, avec l'accélération de l'histoire. Au début des années 80, la réalité des contradictions du capitalisme russe va devenir criante. La question de la crédibilité de l'Etat russe est cruciale ; d'elle dépend sa capacité à moderniser son économie, à maintenir sa puissance impérialiste. Sur le plan intérieur, la terreur policière ne suffit plus à faire taire le prolétariat. La dynamique de développement de la lutte de classe en Pologne montre en fait une tendance générale qui s'exprime dans l'ensemble des pays de l'Est, même si c'est à un niveau moindre. Sur le plan international, l'U.R.S.S. a peu à peu perdu sa crédibilité idéologique. La situation économique désastreuse de ses alliés à la périphérie du capital et, notamment, la catastrophe sociale du Vietnam après le départ des américains, se sont chargés de balayer grandement les illusions sur le "progressisme", le "socialisme" du bloc de l'Est. Les événements de Tchécoslovaquie en 1968 ont montré aux ouvriers du monde entier la brutalité répressive de l'U.R.S.S., semant le doute parmi des millions de prolétaires de par le monde jusque-là crédules. L'influence des partis communistes pro-russes, solidement implantés au sein du bloc adverse, va aller en se réduisant. Les luttes ouvrières en Pologne vont se charger de porter le coup de grâce sur le mensonge de la nature prolétarienne de l'Etat russe et de ses affidés.
La capacité de l'U.R.S.S. a maintenir la puissance de son impérialisme est liée à sa capacité à maintenir la crédibilité de son Etat. Avec l'accélération des années 80, avec l'enlisement de l'expédition afghane et l'explosion sociale en Pologne, des réformes radicales, une remise en cause déchirante pour la bourgeoisie se révèlent indispensables pour assurer la survie du capital russe comme puissance dominante.
LA PERESTROÏKA ET LA GLASNOST DES MENSONGES CONTRE LA CLASSE OUVRIERE
LA VICTOIRE DES PARTISANS DES REFORMES
La mort de Léonid Brejnev en 1982 va mettre fin à deux décennies d'immobilisme. L'heure des choix difficiles arrive pour la Nomenklatura russe ; la lutte pour la succession va faire rage et mettre aux prises les partisans des réformes à ceux qui s'y opposent. Dans un premier temps le nouveau secrétaire général Andropov, l'ancien chef du K.G.B., va annoncer de timides réformes et surtout commencer à purger l'appareil d'Etat de ses hiérarques brejnéviens, mais sa mort prématurée en 1984 permet le retour des brejnéviens. Tchernenko, le nouveau secrétaire général marque la victoire des tenants de l'attentisme, mais celle-ci sera de courte durée. Un an plus tard, il décédera à son tour. Les décès se multiplient parmi les gérontes qui diligent l'U.R.S.S., témoignant de l'âpreté de la lutte pour le pouvoir. Le nouveau secrétaire général, Mikaël Gorbatchev, qui arrive en 1985 à la tête de l'U.R.S.S., est alors peu connu, mais très rapidement, il va se signaler par son dynamisme politique. Le vent a tourné, la fraction "réformatrice" de la bourgeoisie russe a pris les rênes du pouvoir. L'heure est à la réforme économique et politique et une intense campagne idéologique est menée : Perestroïka (refonte), Glasnost (transparence) font écho dans le monde entier.
Paradoxalement, les secteurs de l'appareil politique les plus favorables à cette politique de réforme économique et démocratique ne sont pas les secteurs traditionnellement "libéraux", mais les secteurs centraux de l'Etat russe : l'état-major du complexe militaro-industriel, soucieux de la préservation de la compétitivité impérialiste de l'U.R.S.S , et la direction du K.G.B. qui est bien placée pour mesurer les risques de la croissance du mécontentement du prolétariat et qui a particulièrement suivi le déroulement de la situation en Pologne. L'intelligentsia russe est à l'image de ses consoeurs occidentales, toujours prompte à soutenir des causes perdues, à servir de faire-valoir aux fractions les plus mystificatrices de la bourgeoisie. Elle va servir de porte-flambeau à Gorbatchev. De la même manière, Kroutchev avait bénéficié de son soutien 30 ans auparavant. Sakharov, longtemps persécuté sous Brejnev, va se faire le défenseur déterminé de la Perestroïka.
Les secteurs les plus résistants à cette "nouvelle politique" sont ceux à tous les échelons du parti qui profitent du modèle stalinien de contrôle de l'Etat : les potentats locaux du Parti qui ont bâti leur pouvoir sur des années de magouilles politicardes et policières, et leur fortune sur les pots-de-vin, trafics et rackets de toute sorte ; les responsables économiques, directeurs d'usines plus soucieux de leur situation privilégiée pour spéculer sur le marché noir que de la qualité de la production, et toute une série de bureaucrates à tous les échelons de la machine politico-policière du parti plus soucieux de leurs privilèges particuliers que de l'intérêt de leur capital national. La bourgeoisie russe porte les stigmates du sous-développement de son capital. Le poids de ses anachronismes pèse très lourdement sur sa capacité d'adaptation.
De plus, une fraction centrale de la Nomenklatura russe qui a pu constater l'échec de l'expérience Kroutchevienne et qui s'est incarnée dans l'immobilisme brejnévien, est toujours en place. Pas seulement en U.R.S.S., mais dans tout le glacis Est-européen. Cette fraction doute de la capacité de l'Etat-capital russe à mener la politique ambitieuse que veulent les "réformateurs". C'est cette peur, non sans raisons, d'un échec des réformes, porteur du risque d'un chaos économique et social amplifié qui l'a poussée durant 20 ans dans une paralysie conservatrice. La mise en place des réformes prend donc d'abord la forme d'une guerre de cliques qui luttent pour le contrôle de la direction. L'empoignade au sein de la bourgeoisie russe, discrète mais violente, après la mort de Brejnev, va devenir spectaculaire avec l'arrivée de Gorbatchev qui va se servir des différentes purges pour alimenter la campagne de crédibilisation démocratique. C'est au pas de charge des purges staliniennes qu'est menée la Perestroïka. Mais au fait, quelle Perestroïka ?
L'ECHEC DE LA PERESTROÏKA ECONOMIQUE
A l'origine, Perestroïka signifiait : refonte de l'économie, tandis que la Glasnost, la transparence, était le volet politique, celui des réformes "démocratiques". Mais les mots magiques que les experts en publicité savent trouver pour alimenter les campagnes médiatiques de la bourgeoisie peuvent voir leur contenu évoluer suivant les besoins. Le mot Perestroïka a pris le sens de l'idée même de changement, s'est étendu à tous les domaines, a englobé la Glasnost heureusement pour lui, parce que plus de quatre ans après l'arrivée du nouveau Secrétaire général, la réforme économique, elle, est toujours au point mort.
Les réformes promulguées à coups de décrets et claironnées à coups de fanfares médiatiques sont sans grands effets sur l'économie réelle ; elles sont absorbées, digérées et détournées par l'appareil du parti et rendues inapplicables par le poids des carences et des dysfonctionnements de l'économie. Le grand barouf sur l'autonomie financière des entreprises, sur les nouvelles entreprises familiales privées ou les entreprises mixtes à participation de capitaux étrangers correspond plus à un battage médiatique qu'à une transformation économique réelle. Pour ne citer qu'un exemple, parce qu'il a été largement médiatisé, l'entrepreneur américain qui s'était lancé avec l'Etat russe dans la distribution de pizzas et dont on a pu voir les camions assiégés par les moscovites curieux sur les chaînes de T.V. du monde entier, a préféré renoncer à son entreprise : lorsque les camions tombaient en panne, il fallait des semaines pour les réparer ; les frigos pour entreposer la marchandise manquaient et étaient souvent défectueux ; la qualification de la main-d'oeuvre laissait à désirer; le vol, les bakchich bureaucratiques rendaient toute gestion impossible.
Cet exemple est à l'image de l'économie russe. La pénurie de capital est telle qu'elle rend toute réforme particulièrement aléatoire. Les ambitions affichées au départ par l'équipe Gorbatchev ont été rapidement revues à la baisse et, aujourd'hui, un des principaux conseillers économiques du Secrétaire général déclare qu'il faudra "une ou deux générations pour réaliser la Perestroïka". Au rythme actuel même compter en siècles ne serait pas suffisant. Depuis l'arrivée de la nouvelle clique dirigeante la situation des prolétaires, malgré toutes les affirmations de la propagande, loin de s'améliorer, s'est encore dégradée. La pénurie de biens de consommation s'est aggravée. Même à Moscou, la capitale jusque-là privilégiée dans son approvisionnement, des denrées aussi banales que le sucre et le sel sont rationnées. Les magasins de la Perestroïka sont vides ([4] [93]).
LA PRIORITE DE LA GLASNOST
Pourtant, même si une véritable réforme de l'économie relève plus de la propagande que de possibilités réelles, il n'en demeure pas moins que la bourgeoisie russe doit mener à bien un certain nombre de mesures destinées à renforcer le potentiel militaire de son économie. Mais toutes les mesures envisagées sur ce plan :
- libération des prix par la suppression des subventions ;
- imposition de contrôles de qualité à toute l'économie suivant des critères issus de la production militaire ;
- autonomie financière des entreprises d'Etat et fermetures des usines non rentables ;
- développement d'un nouveau système de primes pour développer la productivité des travailleurs ;
- déplacement massif de main-d'oeuvre des secteurs où il y a sureffectifs vers ceux où on manque de bras ; etc., se heurtent à la résistance d'une fraction importante de l'appareil du Parti, et surtout, mises en place telles quelles, elles risquent de mettre le feu aux poudres du mécontentement social.
En effet, n'importe laquelle de ces mesures signifie une attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière. La Perestroïka est en fait un programme d'austérité. L'exemple polonais, en 1980, où une augmentation massive des prix avait déclenché la dynamique de la grève de masse qui s'est étendue à tout le pays, est toujours suffisamment présent pour inciter la bourgeoisie russe à la prudence et pour lui permettre d'en tirer les leçons. Avant d'entreprendre de telles attaques d'envergure, la bourgeoisie russe doit d'abord se donner les moyens de les faire le plus possible accepter et surtout doit doter son appareil d'Etat des armes d'encadrement et de mystification idéologique qui lui permettront de se confronter au mécontentement inéluctable du prolétariat. Ainsi, lorsque les planificateurs froids annoncent que d'ici à la fin du siècle, ce sont 16 millions de travailleurs qui devront être déplacés, cela signifie aussi des millions de travailleurs dans la rue, avec le danger que cela comporte au niveau social. La bourgeoisie stalinienne doit donc adapter son appareil d'encadrement du prolétariat, d’assouplir, le rendre plus crédible ; elle doit mettre en place des mystifications idéologiques de plus en plus intensives et sophistiquées pour masquer la réalité concrète de plus en plus désastreuse.
La Glasnost est le volet politique de la Perestroïka, le mensonge destiné à masquer la mise en place d'une austérité renforcée. Les réformes de l'appareil politique destinées à le crédibiliser et le renforcer sont une priorité, leur mise en place est la condition de la réussite de la Perestroïka. Cela est tellement vrai que le gouvernement russe a préféré reporter à plus tard les mesures de libération des prix et en 1988, a laissé filer les salaires - les augmentations ont été de 9,5 % - de manière à ne pas attiser le mécontentement et ne pas affaiblir l'impact immédiat des campagnes idéologiques sur la "démocratisation".
Le retour au premier plan de la question sociale en Europe de l'Est oblige la bourgeoisie russe a utiliser les mêmes armes que partout la bourgeoisie mondiale fourbit contre le prolétariat parce que partout celui-ci a redressé la tête, développé ses luttes. Les campagnes pour la démocratie se sont développées à l'échelle planétaire, et la Perestroïka démocratique en U.R.S.S. fait écho aux campagnes actives menées par les U.S.A., au sein de leur bloc, pour remplacer rapidement les "dictatures" usées par des "démocraties" flambant neuf. Ce n'est pas que dans tous ces pays la bourgeoisie craigne une révolution prolétarienne, loin de là, mais c'est le risque d'une explosion sociale déstabilisatrice des intérêts de l'impérialisme qui inquiète la classe dominante et la pousse à renforcer son front social par la panacée démocratique : pluralisme des partis, élections à répétition, opposition légale, syndicats crédibles et radicalisés, etc. A l'est comme à l'ouest, ce sont les mêmes politiques qui sont menées et pour les mêmes raisons.
LES CAMPAGNES DE "DEMOCRATISATION" EN U.R.S.S.
Les campagnes démocratiques ne sont pas une chose nouvelle en U.R.S.S. Kroutchev, en son temps, avait tenté une Perestroïka avant l'heure. Ce qui est nouveau, ce sont les moyens employés : la bourgeoisie russe s'est mise à copier ses consoeurs occidentales. La campagne médiatique est intense, les manipulations politiques se font plus fréquentes pour tenter de redonner une nouvelle crédibilité démocratique à l'Etat. Ces campagnes vont de pair avec un renouvellement en profondeur des organes dirigeants du Parti. Le limogeage de la vieille garde stalinienne, en même temps qu'elle permet d'éliminer des fractions résistantes à la Perestroïka, sert à renforcer la crédibilité démocratique des changements actuellement en cours en mettant en avant des éléments plus jeunes favorables aux réformes. Les vieux bureaucrates, caciques du parti stalinien depuis des décennies, complètement pourris par des années de pouvoir et de concussion sont un épouvantail tout trouvé, par la haine qu'ils inspirent à la population, pour défouler la vindicte populaire et justifier les difficultés de la Perestroïka sur le plan économique. Avec les "conservateurs" constamment désignés dans la presse et comme dans un théâtre de guignol personnifiés par Ligatchev, membre du bureau politique, Gortatchev a trouvé le faire-valoir idéal qui lui assure le soutien d'une partie de la population, notamment les intellectuels qui craignent le retour des méthodes policières passées et de l'étouffement de l'illusion de liberté actuelle.
Le débat entre "réformateurs" et "conservateurs" va quotidiennement se développer dans tous les médias russes. Un savant partage du travail est organisé : la Pravda va défendre une orientation conservatrice tandis que les Izvestia prendront le parti des réformateurs ; des polémiques multiples sont publiées pour essayer de polariser 1’attention des travailleurs et les inviter à participer aux débats. Une nuée de publication semi-légale, défendant tout et n'importe quoi, va ajouter à la confusion générale. Des procès pour corruption contre les personnalités de la période Brejnev, notamment son propre gendre, servent à dédouaner et légitimer le nouveau régime.
Mais tout cela est encore peu, comparé à la gigantesque manipulation qui va être mise en place pour organiser la kermesse électorale du printemps 1989. Gorbatchev, qui tient les rênes du pouvoir, a trouvé en la personne de Ligatchev le repoussoir qui lui sert à rehausser sa propre image, mais il a aussi besoin 'une gauche crédible pour canaliser le mécontentement et chapeauter les multiples petites chapelles oppositionnelles, pour offrir l'image d'une vraie démocratie. En Pologne, où la démocratisation s'est faite à chaud, dans la confrontation directe à la lutte de classe, Solidamosc a d'emblée bénéficié d'une grande crédibilité auprès du prolétariat. Par ailleurs, l'Eglise, pourtant depuis longtemps intégrée à l'appareil d'Etat polonais, s'était toujours cantonnée dans une opposition discrète et avait conservé une popularité certaine dans la population. En U.R.S.S., la situation est bien différente. La "démocratisation" se fait à froid, à titre préventif ; et après des décennies de répression, la bourgeoisie russe n'a pas grand chose sur quoi s'appuyer pour conforter ses nouveaux habits démocratiques. Il va lui falloir créer une opposition de toutes pièces pour animer le spectacle électoral.
Un ponte du parti de Moscou, Boris Eltsine, membre du Bureau politique, va se faire le chantre de la Perestroïka à tout va, le critique intransigeant des insuffisances dans la course à la démocratie ; il va stigmatiser les résistances des conservateurs, se faire le défenseur des intérêts de la population. Après une algarade avec le chef de file des conservateurs, Ligatchev, durant une réunion en plénum du Comité central, il va être exclu de son poste de suppléant du Bureau politique, perdre son poste dans la hiérarchie du Parti. Une campagne de rumeurs sur le contenu radical de son intervention devant le Comité central se développe, tandis que durant des mois, il va jouer l'arlésienne. Au sein du Parti à Moscou, une campagne est menée en sa faveur par la "base". Finalement, Eltsine va réapparaître pour animer et crédibiliser la campagne électorale pour le renouvellement d'une partie du Soviet suprême. Toutes les mesures prises à son encontre, les médisances distillées sur son compte par la bureaucratie vont lui donner une crédibilité toute neuve. Dans un pays où durant des décennies tout le monde a appris une chose essentielle, c'est que l'Etat ment, ce qui donne une crédibilité à un individu, à son discours, c'est la répression, les tracasseries bureaucratiques auxquelles il est soumis. Dans les bagarres qui secouent la Nomenklatura, une foule d'apparatchiks ambitieux, qui sauront coller à l'air du temps, va se forger une image d'"opposition", de radicalisme, d'anti-corruption, de populisme à bon compte face à la hargne bureaucratique des gérontes qui ne veulent pas céder leur place. Les intellectuels, longtemps humiliés par Brejnev, vont constituer les troupes électorales de la nouvelle "opposition" apportant leur caution "libérale" et "démocratique" en la personne de Sakharov. La nouvelle "opposition" est créée. Les élections du printemps 1989 vont la légitimer.
Pour ces élections une innovation de taille va être apportée : des candidatures multiples issues du Parti et des structures de l'Etat sont encouragées, donnant une illusion de pluralisme. Rien ne va être négligé pour crédibiliser ces élections et, par conséquent, les nouveaux oppositionnels. Une campagne "à l'américaine" va pour la première fois être menée en U.R.S.S. L'"opposition" va se mobiliser devant les médias. Eltsine est passé sur toutes les chaînes de télévision : interviewé dans son modeste logement, avec sa femme et sa fille qui paraissaient tout effrayées de tant de nouveauté ; en train de jouer poussivement au tennis, short blanc et bandeau sur le front, pour le mettre en valeur ; on lui avait même trouvé un sparring-partner bureaucratique encore plus boursouflé, plus grotesque.
Eltsine fait un come-back retentissant, il est omniprésent, avec Gorbatchev évidemment, dans les médias. Un miracle bureaucratique et médiatique de plus. Dans le même temps des manifestations de soutien sont organisées dans les rues de Moscou avec son portrait en emblème. L'ambiance est chauffée par les démêlés de nos "réformateurs radicaux" pour faire accepter leurs candidatures aux oligarchies locales du Parti. Sakharov s'empoigne avec les bureaucrates de l'Académie des sciences. La popularité des nouvelles candidatures ne fait que croître.
Pourtant, tout cela n'est pas encore suffisant. La bourgeoisie russe va en rajouter en manipulations pour rameuter les prolétaires vers les urnes et crédibiliser les élections et l'idée de changement. Quelque temps avant le jour électoral fatidique, une manifestation nationaliste en Géorgie sera sévèrement réprimée. Plusieurs manifestants tués restent sur le carreau. Les conservateurs, la droite, sont accusés de vouloir saboter la Perestroïka. Des rumeurs inquiétantes d'attentat dans le métro à Moscou circulent. Gorbatchev serait en difficulté, les éléments conservateurs prépareraient un retour en force. Il faut voter pour préserver la direction actuelle ; la gauche, derrière Eltsine, se pose comme le meilleur obstacle à un retour du conservatisme, comme le meilleur garant de l'application des réformes. La population est appelée à donner son point de vue, à se prononcer, son destin en dépend. La victoire des "radicaux" de la Perestroïka va être totale. A Moscou, Eltsine va être triomphalement élu avec 89 % des voix, dans toute l'U.R.S.S., la nouvelle "gauche" fait des scores impressionnants. Des hiérarques du P.C. sont battus. De ces élections, l'Etat russe sort renforcé : l'illusion démocratique d'un changement électoral prend une apparence de vérité, une gauche à la crédibilité naissante se met à exister à la fois au sein et en dehors du Parti.
Fort de ce succès, contrairement aux fausses rumeurs qui avaient circulé avant les élections, Gorbatchev sort renforcé et mène une nouvelle purge. Une centaine de délégués au Soviet suprême démissionnent aimablement, tandis que la gauche va organiser des manifestations où cote à cote Eltsine et Sakharov mènent le bal pour soutenir les nouveaux députés réformateurs du Soviet. En mai 1989, 100 000 personnes manifestent derrière eux à Moscou et on remarquera dans l'assistance une délégation de la 4ème Internationale trotskiste. Quelle caution !
Par son habileté politique à mettre en place les éléments d'une nouvelle crédibilité de l'Etat russe, ce que montre Gorbatchev, ce n'est pas tant sa sincérité démocratique, mais sa capacité manoeuvrière typiquement stalinienne. Purges bureaucratiques, manipulations politiques et policières multiples, campagnes idéologiques mystificatrices, rumeurs organisées, répression savamment dosée, etc., cette panoplie du mensonge et de la terreur montre que, par-delà les apparences, Gorbatchev est le digne héritier du stalinisme qui adapte son savoir-faire aux besoins de la situation présente. Cette réalité va particulièrement s'exprimer sur le terrain des "nationalités".
LE NATIONALISME EN SOUTIEN DE LA PERESTROÏKA
Depuis 1988, les manifestations nationalistes en Arménie, en Azerbaïdjan, dans les pays baltes, en Géorgie, polarisent l'attention sur la situation en U.R.S.S.. La question des nationalités est un vieux problème en U.R.S.S. Héritée du passé colonial de la Russie des tzars, renforcée par la répression brutale des staliniens, elle traduit le poids du sous-développement du capital soviétique. Ces manifestations traduisent un mécontentement réel existant au sein de la population. Cependant, parce qu'elles se déroulent sur un terrain purement nationaliste, ces expressions de mécontentement ne peuvent dans cette logique que renforcer l'emprise de la classe dominante, même si elles ont été provoquées par les rivalités de cliques. Elles sont le terrain parfait pour les manipulations de l'Etat central russe, manipulations dont l'équipe gorbatchévienne dans la lignée d'une vieille tradition, montre qu'elle est maîtresse.
La bourgeoisie russe a toujours su exploiter au mieux le poids des illusions nationalistes, la grogne anti-russe, pour diviser ses prolétaires et dévoyer le mécontentement social dans le nationalisme qui est le terrain privilégié de la domination bourgeoise. Cela est vrai, non seulement en U.R.S.S. même, mais aussi dans tout le glacis européen sous sa coupe impérialiste. Les événements en Pologne sont là depuis 1980 pour montrer à l'évidence cette réalité : les illusions démocratiques et le nationalisme anti-russe ont été les principales armes de la bourgeoisie polonaise pour faire rentrer les ouvriers dans le rang. Le développement présent de la propagande nationaliste dans les pays de l'Est n est certainement pas un pur produit des illusions d'une population mécontente, même si celles-ci existent réellement, mais correspond à une politique voulue mise en place par l'administration Gorbatchev. La propagande nationaliste qui se déchaîne aujourd'hui, sous le masque de l'opposition, correspond à la nouvelle politique anti-ouvrière menée pour entraver le développement à venir des luttes prolétariennes face à la politique draconienne d'austérité qui est en train d'être mise en place.
Dans ces conditions, ce n'est donc certainement pas l'expression d'une perte de contrôle de l'Etat russe si en Arménie, la branche locale du P.C. soutient la revendication nationaliste du rattachement du Haut-Karabak, alors qu'en Azerbaïdjan, elle soutient exactement l'inverse, soufflant sur les braises nationalistes (à cet égard on peut se poser de réelles questions sur l'origine des pogroms anti-arméniens qui ont mis le feu aux poudres), tandis que dans les pays baltes, c'est le P.C. qui a directement organisé les manifestations nationalistes autour d'un débat constitutionnel n'ayant pour but que de valider les illusions démocratiques et nationalistes.
Tout ce remue-ménage, loin d'affaiblir Gorbatchev, lui a permis de développer son offensive politique. En laissant se développer des manifestations massives, il a renforcé son image libérale à peu de frais, et même le cataclysme qui a frappé l'Arménie lui a permis de faire un one-man-show médiatique sur sa politique d'ouverture. De même, cette situation qui met en lumière les carences de l'administration est un prétexte tout trouvé pour intensifier les purges en cours au sein du parti stalinien. Même la répression dans ce contexte hyper-médiatisé est présentée comme une preuve de fermeté rassurante vis-à-vis d'excès qui risquent de freiner les réformes.
La répression cynique et meurtrière d'une manifestation en Géorgie a été le prétexte d'une nouvelle campagne contre les "conservateurs" pour mobiliser les ouvriers sur le terrain électoral en dramatisant la situation. La clique dirigeante locale en a fait incidemment les frais en passant à la trappe d'un remaniement. Mais à qui le crime a-t-il réellement profité, sinon à Gorbatchev ?
Ce n'est pas seulement en U.R.S.S. que cette politique de propagande nationaliste anti-ouvrière est mise en place : nous avons déjà cité la Pologne, mais c'est aussi en Hongrie où se déchaîne la propagande anti-roumaine ; en Roumanie, c'est, évidemment, la propagande anti-hongroise ; en Bulgarie, c'est la propagande anti-turque. Chaque fois, le nationalisme des minorités nationales est attisé, au besoin par la simple répression, pour justifier des campagnes plus générales.
Les divers nationalismes qui se développent aujourd'hui dans les pays de l'Est, ne sont pas l'expression d'un affaiblissement de l'Etat central, mais au contraire le moyen de son renforcement. Les illusions nationalistes sont le digne complément des mystifications démocratiques.
LE SUCCES INTERNATIONAL DE LA PERESTROÏKA
Jamais une campagne idéologique de la bourgeoisie russe n'aura reçu un tel soutien de la part de l'Occident. Gorbatchev est devenu une nouvelle star médiatique mondiale ; il est venu concurrencer celui qu'on surnommait le "grand communicateur" : Reagan. La bourgeoisie russe a visiblement bien appris de ses consoeurs occidentales l'art de la manipulation médiatique.
La mise en avant dès son arrivée au pouvoir d'une volonté de concessions sur le plan impérialiste, la tenue d'un langage de "paix", les propositions de désarmement, largement médiatisées, sont autant de facteurs qui suggèrent une sympathie instinctive aux habitants de la planète traumatisés par les campagnes militaristes incessantes qui se sont succédé depuis 1980. Dans l'incapacité de se lancer dans une surenchère militaire à cause du manque d'adhésion de la population, face à l'offensive impérialiste occidentale des années 80, l'U.R.S.S. est obligée une nouvelle fois de reculer. L'intelligence de la bourgeoisie russe, et notamment de sa fraction animée par Gorbatchev, va être de savoir mettre à profit ce recul imposé pour rénover sa stratégie de politique intérieure et internationale.
Les nouveaux axes de la propagande soviétique - la paix et le désarmement au niveau international, la Perestroïka-Glasnost sur le plan intérieur - vont prendre à contre-pied les thèmes de la propagande occidentale basés sur la dénonciation de 1'"Empire du mal", du militarisme russe et de l'absence de démocratie dans les pays de l'Est. Cette situation va provoquer un chamboulement médiatique mondial. Le Bloc de 1 Ouest va être obligé de changer le fusil de ses campagnes médiatiques d'épaule. Face aux thèmes "pacifistes" de la diplomatie russe, les U.S.A. ne peuvent se permettre d'apparaître comme les seuls va-t-en-guerre, surtout face à un prolétariat qui après le recul qui marque le début des années 80, a repris de manière significative le chemin de la lutte au milieu des années 80. Les deux blocs impérialistes qui se partagent la terre vont alors se lancer à l'unisson dans une surenchère pacifiste et démocratique. Les campagnes mensongères sur la paix sont un moment de la lutte que se mènent les deux blocs sur le plan idéologique.
Cependant, si le bloc occidental a suivi Gorbatchev dans le changement de tonalité des campagnes idéologiques, s'il parait le soutenir dans sa volonté de réformes politiques, ce n'est certainement pas qu'il en croit un traître mot. Même si les concessions militaires de l'U.R.S.S. sont réelles et toujours bonnes à prendre, ce n'est pas bien nouveau. Brejnev avait fait de même et "la paix et le désarmement" sont des thèmes éculés de la propagande stalinienne depuis toujours. Et ce n'est certainement pas non plus, même si c'est un aspect réel, parce que le bloc occidental s'est trouvé piégé par la nouvelle propagande russe. Cela ne l'obligeait certainement pas à chanter les louanges de Gorbatchev comme il l'a fait, soutenant de toute la force de ses médias les initiatives "démocratiques" de la Perestroïka, les crédibilisant ainsi aux yeux du monde entier, les intégrant dans une gigantesque et assommante campagne médiatique sur la "Démocratie" menée à l'échelle planétaire.
Ce soutien de l'Occident au nouveau groupe dirigeant russe dont la politique étrangère offensive vise à donner une nouvelle crédibilité à l'impérialisme russe, et la politique intérieure à renforcer la force de l'Etat et de son économie de guerre, peut sembler paradoxal. Cependant, cette situation s'explique par les leçons qu'a tirées la bourgeoisie du bloc de F Ouest des événements d Iran et de Pologne. Elle ne tient pas à voir se développer des luttes sociales en Europe de l'Est qui pourraient avoir des effets internationaux contagieux et, en provoquant une déstabilisation de la classe dominante du bloc adverse, pourraient permettre l'accession au pouvoir de fractions de la bourgeoisie particulièrement stupides, autrement dangereuses pour la stabilité mondiale qu'un Khomeiny en Iran, étant donné le potentiel militaire russe.
Malgré sa plus grande puissance, le bloc occidental est fondamentalement confronté aux mêmes difficultés que le bloc russe. Le développement des mêmes thèmes de propagande traduit des besoins identiques : encadrer le prolétariat, entraver et dévoyer l'expression de son mécontentement, lui faire accepter des mesures d'austérité de plus en plus draconiennes, le ressouder à "son" Etat au nom de la Démocratie et ouvrir la voie vers la guerre ([5] [94]).
LE PROLETARIAT AU COEUR DE LA SITUATION
A écouter les commentateurs avisés de l'a bourgeoisie internationale, la Perestroïka irait de succès en succès et Gorbatchev volerait de victoire en victoire. On a vu rapidement ce qu'il en était sur le plan économique : un fiasco jusqu'à présent. Où se situe donc la réussite de Gorbatchev? D'abord sur le plan politique dans sa capacité à s'imposer face aux secteurs réticents de la bourgeoisie russe ; les purges successives en témoignent. Le bilan de la mise en place des nouveaux habits démocratiques du stalinisme est plus mitigé. L'essentiel reste encore à faire pour développer une réelle crédibilité de l'Etat russe vis-à-vis de sa propre population. Bien sûr 1'"intelligentsia" applaudit les timides réformes démocratiques à tout rompre, et par son agitation incessante leur donne l'apparence de la vie, mais quelle est la réaction du prolétariat, de l'immense majorité de la population, face à ce tourbillon médiatique autour des "réformes" ?
La méfiance vis-à-vis d'un Etat qui incarne 60 ans de domination du stalinisme, de répression cynique, de mensonge permanent, de pourriture bureaucratique, est très forte au sein de la classe ouvrière. Même si les thèmes démocratiques mis en avant par la Perestroïka peuvent susciter un certain intérêt parmi les travailleurs, le fait que les réformes soient imposées par en haut, qu'elles viennent de la hiérarchie du P.C., ne peut que susciter la défiance. L'expérience de Kroutchev n'est pas si loin pour être oubliée; les belles paroles démocratiques d'alors s'étaient terminées par la répression des luttes ouvrières en 1962 et 1963. Face à la Perestroïka, le prolétariat continue à utiliser les mêmes armes que face à la tutelle policière de Brejnev: la résistance passive.
La politique de rigueur et de "transparence" de la nouvelle direction soviétique se heurte aux vieux réflexes de méfiance et de "démerde" profondément enracinés dans le prolétariat russe et donne souvent des résultats paradoxaux typiques de l'économie russe. Le rationnement tout à fait impopulaire de l'alcool a provoqué une razzia des stocks de sucre dans les magasins, pour alimenter les alambics clandestins, entraînant le rationnement du sucre. L'annonce par un bureaucrate, face aux rumeurs de pénurie sur le thé à Moscou, qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement, provoque immédiatement une panique des consommateurs qui se ruent vers le magasin le plus proche, et le thé aussi devra être rationné. Ces faits qui font les délices des journalistes étrangers et la misère des travailleurs de l'U.R.S.S. traduisent la résistance et la méfiance par rapport à toutes les initiatives de l'Etat. Cette hypothèque, a Perestroïka ne l'a pas levée, elle n'en a pas les moyens ; les rayons des magasins sont toujours plus vides et c'est là qu'est la vérité pour le prolétariat. Dans la mesure où il n'a rien matériellement à offrir, le gouvernement ne peut réellement mystifier directement ; tout au plus peut-il essayer d'enraciner l'idée qu'il est moins répressif, plus ouvert au dialogue que ceux qui l'ont précédé, mais cela ne remplit pas les estomacs.
Le véritable danger mystificateur pour le prolétariat vient de ceux qui se posent comme étant les "opposants", qui critiquent ouvertement le gouvernement et dénoncent la pénurie, qui prétendent défendre les intérêt de la classe laborieuse. Cependant, la nouvelle "opposition" regroupée autour de Eltsine et Sakharov a encore des progrès à faire si elle veut gagner une réelle crédibilité mystificatrice au sein du prolétariat. L'ébullition actuelle autour de l’"opposition" est essentiellement animée par l'intelligentsia et des jeunes sans grande expérience. Fondamentalement les ouvriers sont restés plutôt indifférents face à ce remue-ménage. La personnalité des Eltsine et Sakharov, eux-mêmes dignes membres de la Nomenklatura, n'est pas faite pour les enthousiasmer. Cette relative indifférence de la classe ouvrière ne doit pourtant pas faire sous-estimer la fragilité de la classe ouvrière en Russie face aux mystifications plus sophistiquées que la bourgeoisie est en train de mettre en place. L'exemple polonais est là pour le démontrer.
L'offensive idéologique de l'Etat russe en est encore à ses débuts. Avec la mise en place d'une opposition c'est seulement une première pierre de son édifice "démocratique" que Gorbatchev a posée. L'utilisation d'un syndicalisme radical avec Solidarnosc en Pologne, l'instauration d'un pluralisme politique et syndical en Hongrie montrent que la bourgeoisie russe est prête à aller beaucoup plus loin pour renforcer la crédibilité de son Etat et dissoudre la méfiance ouvrière. La création d'un syndicat crédible est la condition indispensable d'un encadrement "démocratique" de la classe ouvrière. Nul doute que Gorbatchev va devoir s'atteler à cette rude tache s'il veut mener à bien son programme de renforcement du capitalisme russe. Comme les syndicats dans le monde de l'Ouest, Solidarnosc en Pologne a suffisamment montré sa capacité à étouffer les luttes ouvrières pour que la bourgeoisie russe veuille se doter d'un tel outil. Mais si un parti politique, une opposition peut tenter de se crédibiliser à froid, dans et par le sacro-saint "débat démocratique", il n'en est pas de même d'un syndicat qui, lui, doit tirer sa crédibilité de la lutte de classe, des grèves.
Le prolétariat russe, ces dernières années, n'a pas particulièrement manifesté sa combativité par des grèves, à ce qu'on en sait tout du moins. Cependant, la diminution croissante de son niveau de vie va s'accélérer avec la Perestroïka; conjuguée aux effets "désinhibiteurs" de la "libéralisation" qui a besoin d'un minimum de permissivité pour être un tant soi peu crédible, elle ne peut qu'encourager les ouvriers à lutter. Dans les pays du bloc de l'Est, comme dans ceux de l'Ouest la perspective est au développement de la lutte de classe. C'est dans ce contexte que la Perestroïka/Glasnost se montrera comme une amie redoutable contre le prolétariat: les ouvriers de l'Est devront se confronter à des mystifications particulièrement dangereuses: "oppositions radicales" se réclamant faussement de ses intérêts, syndicats "libres" qui saboteront ses luttes, tapage médiatique permanent, etc., dont il n'ont quasiment aucune expérience.
Cette expérience, c'est celle que le prolétariat polonais est en train de faire. Elle signifie un dur apprentissage et des défaites pour la classe ouvrière en Europe de l'Est ([6] [95]). Cette situation, c|est celle que le prolétariat des pays développés d'Occident vit depuis (tes décennies, celle du mensonge du totalitarisme "démocratique" sur laquelle il a accumulé une expérience irremplaçable. Parce que partout la perspective est à un développement de la lutte de classe, partout la bourgeoisie essaie de mettre en place les mêmes armes, les plus efficaces, les plus mensongères, les plus dangereuses: celles de la "Démocratie", pure illusion qui cache le totalitarisme du capitalisme décadent. La campagne est mondiale. De fait, la situation du prolétariat mondial s'homogénéise: la répression policière se fait plus fréquente et plus forte dans les vieilles démocraties occidentales, tandis que dans tous les pays sous-développés du monde - U.R.S.S. comprise - l'heure est à la rénovation de la façade étatique d'un bon coup de peinture démocratique.
La question n'est pas de savoir si Gorbatchev, ou même la bourgeoisie mondiale, a les moyens de sa politique. La question est: comment le prolétariat va se confronter a l'arsenal de mystifications que la bourgeoisie est en train de mettre en place pour lui imposer l'austérité renforcée des réformes économiques ? La capacité du prolétariat d'Europe de l'Est à déjouer les pièges est indissolublement liée à la capacité du prolétariat d'Europe occidentale à développer ses luttes, à montrer sous l'éclairage cru de la confrontation de classe la réalité du mensonge démocratique, tout comme les prolétaires d'Europe de l'Est, par leurs luttes, ont montré à leurs frères de classe du monde entier la réalité du mensonge stalinien ([7] [96]). Les illusions sur l'Occident, sur son modèle démocratique, pèsent lourdement sur la conscience des ouvriers d'Europe de l'Est. Seule la lutte de classe qui se développe au coeur de l'Europe occidentale industrialisée, au coeur du mensonge démocratique, peut déchirer le mirage, clarifier les consciences, renforcer ainsi, partout dans le monde, la capacité du prolétariat à déjouer les pièges, à briser les rideaux de fer du capital, et à poser les jalons de sa dynamique d'unification mondiale.
JJ. 29 mai 1989
[1] [97] Source : Nations Unies
[2] [98] Sur la crise dans les pays de l'Est lire les articles dans la Revue Internationale n° 12-14-23-43.
[3] [99] Sur les luttes en Pologne voir Revue Internationale n° 24-25-26-27, et de manière plus générale sur la lutte de classe en Europe de l'Est voir Revue Internationale n° 27-28-29.
[4] [100] Sur la situation économique en U.R.S.S. à l'heure de la Perestroïka un article sera publié dans un prochain numéro de la Revue Internationale qui développera plus largement sur cette question. Voir aussi Revue Internationale n' 49-50.
[5] [101] Voir article "Les paix de l'été", Revue Internationale n° 55.
[6] [102] Voir article "Pologne: l'obstacle syndical", Revue Internationale n° 54.
[7] [103] Voir article "Le prolétariat d'Europe de l'Ouest au coeur de la lutte de classe", Revue Internationale n° 31.
Après les années d'immobilisme incarnées par le règne
Géographique:
Heritage de la Gauche Communiste:
- Capitalisme d'Etat [105]
Comprendre la décadence du capitalisme (7) : Le bouleversement des formes idéologiques
- 5715 reads
Le bouleversement des formes idéologiques
La "crise idéologique", "crise des valeurs" dont parlent les journalistes et sociologues depuis des décennies n'est pas, comme ils disent, "une douloureuse adaptation aux progrès technologiques capitalistes". Elle est au contraire la manifestation de l'arrêt de tout progrès historique réel du capitalisme. C'est la décomposition de l'idéologie dominante qui accompagne la décadence du système économique.L'ensemble des bouleversements subis par les formes idéologiques capitalistes depuis trois quarts de siècle constitue en réalité non pas un rajeunissement permanent du capitalisme mais une manifestation de sa sénilité, une manifestation de la nécessité et de la possibilité de la révolution communiste.
Dans les articles précédents de cette série[1] [106] destinée à répondre à ces "marxistes" qui rejettent l'analyse de la décadence du capitalisme, nous nous sommes penchés surtout sur les aspects économiques de la question : "C'est dans l'économie politique qu'il convient de chercher l'anatomie de la société civile", disait Marx[2] [107]. Nous avons rappelé la vision marxiste d'après laquelle ce sont des causes économiques qui font qu'à un moment donné de leur développement les systèmes sociaux (esclavagisme antique, féodalisme, capitalisme) entrent en décadence :
- "A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété nu sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale." Marx[3] [108]
Nous avons montré comment depuis la période de la première guerre mondiale et de la vague révolutionnaire prolétarienne internationale qui y a mis fin, le mode de production capitaliste connaît un tel phénomène. Comment celui-ci s'est transformé en une entrave permanente au développement des forces productives des moyens de subsistance de l'humanité : les pires destructions guerrières de l'histoire, économie permanente d'armement, les plus grandes famines, épidémies, des zones de plus en plus étendues condamnées au sous-développement chronique. Nous avons mis en évidence l'enfermement du capitalisme dans ses propres contradictions et sa fuite en avant, explosive, dans le crédit et les dépenses improductives.
Au niveau de la vie sociale nous avons analysé certains des bouleversements fondamentaux que ces changements économiques ont entraîné dans : la différence qualitative entre les guerres du XXe siècle et celles du capitalisme ascendant; l'hypertrophie croissante de la machine étatique dans le capitalisme décadent par opposition au "libéralisme économique" du 20ème siècle ; la différence des formes de vie et de lutte du prolétariat au 20ème siècle et dans le capitalisme décadent.
Ce tableau reste cependant incomplet. Au niveau des "superstructures", des "formes idéologiques" qui reposent sur ces rapports de production en crise, il se produit des bouleversements qui sont tout aussi significatifs de cette décadence.
- "Le changement dans les fondements économiques s'accompagne d'un bouleversement plus ou moins rapide dans tout cet énorme édifice. Quand on considère ces bouleversements, il faut toujours distinguer deux ordres de choses. Il y a le bouleversement matériel des conditions de production économique. On doit le constater dans l'esprit de rigueur des sciences naturelles. Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout." Marx[4] [109]
Dans nos textes sur la décadence du capitalisme (en particulier dans la brochure qui y est consacrée) nous avons relevé certaines caractéristiques de ces bouleversements idéologiques. Nous y reviendrons ici en répondant à certaines aberrations formulées sur cette question par nos critiques.
L'aveuglement de l'invariance
Ceux qui rejettent l'analyse de la décadence, qui ne parviennent déjà pas à percevoir un quelconque changement dans le capitalisme depuis le 16ème siècle sur le plan concret de la production, ne sont pas moins myopes lorsqu'il s'agit de voir l'évolution du capitalisme au niveau des formes idéologiques. Qui plus est, pour certains d'entre eux, les anarcho-bordiguistes-punk du GCI en particulier[5] [110], prétendre reconnaître des bouleversements a ce niveau là, ne peut relever que d'une vision "moralisatrice" de "curés". Voici ce qu'ils écrivent à ce propos :
- “(...) il ne reste plus aux décadentistes que la justification idéologique, que l'argumentation moralisatrice (...) d'une décadence super-structurelle reflétant (en parfaits matérialistes vulgaires qu'ils sont) la décadence des rapports de production. ‘L'idéologie se décompose, les anciennes valeurs morales s'écroulent, la création artistique stagne ou prend des formes contestataires, l'obscurantisme et le pessimisme philosophiques se développent’. La question à cinq francs est bien : qui est l'auteur de ce passage : Raymond Aron ? Le Pen ? ou Monseigneur Lefèbvre ? [6] [111] (...) Eh bien non, il s'agit de la brochure du CCI : La décadence du capitalisme, page 34 ! Le même discours moralisateur correspond donc à la même vision évolutionniste et ce dans la bouche de tous les curés de gauche, de droite ou d’‘ultragauche’”.
- “Comme si l'idéologie dominante se décomposait, comme si les valeurs morales essentielles de la bourgeoisie s'écroulaient ! Dans la réalité l'on assiste plutôt à un mouvement de décomposition/recomposition chaque fois plus important : à la fois de vieilles formes de l'idéologie dominante se trouvent disqualifiées et donnent naissance à chaque fois à de nouvelles recompositions idéologiques dont le contenu, l'essence bourgeoise reste invariablement identique.”[7]
L'avantage avec le GCI c'est sa capacité de concentrer en peu de lignes un nombre particulièrement élevé d'absurdités, ce qui, dans une polémique, permet d'économiser du papier. Mais commençons par le début.
Bouleversements économiques et formes idéologiques
D'après le GCI ce serait du "matérialisme vulgaire" que d'établir un lien entre décadence des rapports de production et déclin des superstructures idéologiques. Le GCI a lu chez Marx la critique de la conception qui ne voit dans les idées qu'un reflet passif de la réalité matérielle. Marx lui oppose la vision dialectique qui perçoit l'interrelation permanente qui lie ces deux entités. Mais il faut être un "invariantiste" pour en déduire que les formes idéologiques ne subissent pas l'évolution des conditions matérielles.
Marx est très clair :
- "A toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes ; autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est en même temps la puissance spirituelle dominante. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose en même temps de ce fait, des moyens de la production intellectuelle, si bien qu'en général, elle exerce son pouvoir sur les idées de ceux à qui ces moyens font défaut. Les pensées dominantes ne sont rien d'autre que l'expression en idées des conditions matérielles dominantes, ce sont ces conditions conçues comme idées, donc l'expression des rapports sociaux qui font justement d'une seule classe la classe dominante, donc les idées de sa suprématie." Marx[8] [113]
Comment les "conditions matérielles dominantes" pourraient elles connaître les bouleversements d'une décadence sans qu'il en soit de même pour leurs "expressions en idée" ? Comment une société vivant une époque de véritable développement économique, où les rapports sociaux de production apparaissent comme une source d'amélioration des conditions générales d'existence, pourrait-elle s'accompagner de formes idéologiques identiques à celles d'une société où, ces mêmes rapports conduisent la société à la misère à l'autodestruction massive, à l'angoisse permanente et généralisée ?
En niant le lien qui existe entre les formes idéologiques d'une époque et la réalité économique qui la sous-tend, le GCI prétend combattre le "matérialisme vulgaire", mais ce n'est que pour défendre le point de vue de l'idéalisme qui croit à l'existence première des idées et à leur indépendance à l'égard du monde matériel de la production sociale.
L'idéologie dominante est-elle putrescible ?
Ce qui heurte le GCI c'est qu'on puisse parler de décomposition de l'idéologie dominante. Voir dans celle-ci une manifestation de la décadence historique du capitalisme serait développer une "argumentation moralisatrice". Pour s'y opposer il nous assène cette grande vérité : l'idéologie bourgeoise au 20ème siècle est tout comme au 18ème..., "invariablement" bourgeoise.
Conclusion ? Donc, elle ne se décompose pas. (?)
Cela fait partie de la "dialectique" de "l'invariance" qui nous enseigne que tant que le capitalisme existe il demeure "invariablement" capitaliste et que tant que le prolétariat subsiste il reste, tout aussi "invariablement" prolétarien.
Mais après avoir déduit de ces tautologies la non-putréfaction de l'idéologie dominante, le GCI s'efforce d'approfondir la question : "l'on assiste plutôt à un mouvement de décomposition/recomposition chaque fois plus important. De vieilles formes de l'idéologie dominante se trouvent disqualifiées et donnent naissance à chaque fois à de nouvelles recompositions idéologiques".
Voilà qui n'est plus si "invariant". Le GCI ne fournit évidemment aucune explication sur l'origine, les causes, le début de ce "mouvement chaque fois plus important". La seule chose dont il est certain c'est que -contrairement aux conceptions "décadentistes"- cela n'a rien à voir avec l'économie.
Mais revenons à la découverte d'un "mouvement" par le GCI : la décomposition/recomposition. D'après ce qui nous est expliqué, l’idéologie dominante connaît en permanence de "nouvelles recompositions idéologiques". Oui, "nouvelles". C'est la jeunesse éternelle ! Quelles sont-elles ? Le GCI nous répond sans attendre :
- "C'est ce que nous constatons dans la ré-émergence en force et au niveau mondial des idéologies (...) religieuses".
Ce qui, tout le monde le sait, est le dernier cri en matière de mystification idéologique. Autres nouveautés : "l'antifascisme... les mythes démocratiques... l'anti-terrorisme".
Qu'y a-t-il de nouveau dans ces vieilles rengaines usées par les classes dominantes depuis au moins un demi-siècle, si ce n'est des millénaires ? Si le GCI n'a pas d'autres exemples à donner c'est parce que fondamentalement il n'y a pas "nouvelles recompositions idéologiques" dans le capitalisme décadent. L'idéologie capitaliste ne peut pas plus se rajeunir que le système économique qui l'engendre. Ce à quoi nous assistons dans le capitalisme décadent, c'est au contraire à l'usure, plus ou moins lente ou rapide suivant les zones de la planète, des "éternelles" valeurs bourgeoises.
Sur quoi repose l'emprise de l'idéologie dominante ?
L'idéologie de la classe dominante se résume aux "idées de sa suprématie" comme classe. En d'autres termes, elle est la justification permanente du système social que gère cette classe. Le pouvoir de cette idéologie se mesure d'abord et avant tout non pas dans le monde abstrait des idées confrontées à des idées, mais dans l'acceptation de cette idéologie par les hommes eux-mêmes et en premier lieu par la classe exploitée.
Cette "acceptation" repose sur un rapport de force global. Elle s'exerce comme une pression constante sur chaque membre de la société, de la naissance aux cérémonies d'enterrement. La classe dominante dispose d'hommes spécifiquement chargés de ce travail : les services religieux ont par le passé assumé la plus lourde part de cette fonction ; dans le capitalisme décadent cela revient à des "scientifiques de la propagande" (nous y reviendrons). Marc parlait des "idéologues actifs et conceptistes dont le principal gagne-pain consiste à entretenir l'illusion que cette classe nourrit à son propre sujet"[9] [114].
Mais cela ne suffit pas pour asseoir à long terme une domination idéologique. Encore faut-il que les idées de la classe dominante aient un minimum de correspondance avec la réalité existante. La plus importante de ces idées est toujours la même : les règles sociales existantes sont les meilleures possibles pour assurer le bien être matériel et spirituel des membres de la société. Toute autre forme d'organisation sociale ne peut conduire qu'à l'anarchie, la misère et la désolation.
C'est sur cette base que les classes exploiteuses justifient les sacrifices permanents qu'elles demandent et imposent aux classes exploitées. Mais qu'advient-il de cette idéologie lorsque le mode de production dominant ne parvient plus à assurer le minimum de bien-être et que la société s'enfonce dans l'anarchie, la misère et la désolation ? Lorsque les sacrifices les plus difficiles n'apportent plus aucune compensation aux exploités ?
Les idées dominantes se trouvent alors quotidiennement contredites par la réalité elle-même. Leur pouvoir de conviction s'amenuise dans le même mouvement. Suivant un processus toujours complexe, plus ou moins rapide, jamais linéaire, fait d'avancées et de reculs qui traduisent les vicissitudes de la crise économique et du rapport de forces entre les classes, les "valeurs morales" de la classe dominante s'écroulent sous les coups mille fois répétés de la réalité qui les dément.
Ce ne sont pas de nouvelles idées qui détruisent les anciennes, c'est la réalité qui les vide de leur pouvoir mystificateur.
- "La morale, la religion, la métaphysique et toute autre idéologie, ainsi que les formes de conscience qui leur correspondent, ne conservent plus l'apparence d'autonomie. Elles n'ont pas d'histoire ; elles n'ont pas d'évolution ; ce sont les hommes qui, en développant la production matérielle et les relations matérielles, transforment en même temps leur propre réalité, leur manière de penser et leurs idées." Marx[10] [115]
C'est l'expérience de deux guerres mondiales et des dizaines de guerres locales, la réalité de près de 100 millions de morts, pour rien, en trois quarts de siècle, qui ont porté les coups les plus dévastateurs, surtout dans le prolétariat des pays européens, contre l'idéologie patriotique. C'est le développement de la misère la plus effroyable, dans les pays de la périphérie capitaliste, et de plus en plus dans les principaux centres industriels, qui détruit les illusions sur les bienfaits des lois économiques capitalistes. C'est l'expérience de centaines de luttes "trahies", systématiquement sabotées par les syndicats qui ruine le pouvoir idéologique de ceux-ci et explique, dans les pays les plus avancés, la désaffection de plus en plus massive des syndicats par les ouvriers. C'est la réalité de l'identité de pratique des partis politiques "démocratiques", de droite ou de gauche, qui n'a cessé d'éroder le mythe de la démocratie bourgeoise et conduit dans les plus vieux pays "démocratiques" à des records historiques d'abstention aux élections. C’est l'incapacité croissante du capitalisme d'offrir une autre perspective que celle du chômage et de la guerre qui fait s'effondrer les anciennes valeurs morales qui chantent les louanges de la fraternité capital-travail.
Les "nouvelles recompositions idéologiques" dont parle le GCI, ne désignent que les efforts de la bourgeoisie pour tenter de redonner vigueur à ses vieilles valeurs morales, en les recouvrant d'une couche de maquillage plus ou moins sophistiqué. Cela peut tout au plus freiner le mouvement de décomposition idéologique -en particulier dans les pays les moins développés où l'expérience historique de la lute de classe est moindre[11] [116]- en aucun cas l'inverser, ni même l'arrêter.
Les idées de la bourgeoisie, et leur emprise, ne sont pas plus indécomposables que ne le furent celles des seigneurs féodaux ou des maîtres d'esclaves en leur temps, n'en déplaise aux gardiens de l'orthodoxie "invariantiste".
Enfin, pour conclure sur la défense intransigeante par le GCI de la qualité indestructible des idées des bourgeois, quelques mots sur la référence aux hommes de droite. Le GCI, avec sa puissante capacité d'analyse, a remarqué que certains bourgeois "de droite", en France, constatent l'effritement des valeurs morales de leur classe. Le GCI en déduit de quoi faire un amalgame, un de plus, avec "les décadentistes". Pourquoi ne pas amalgamer ces derniers avec les pygmées, puisque, tout comme les "décadentistes", ils constatent que le soleil se lève tous les matins ? Il est normal que les fractions de droite affirment plus aisément la décomposition du système idéologique de leur classe : ce n'est là que le pendant complémentaire des politiciens de gauche, dont la tâche essentielle est de tenter d'entretenir en vie cette idéologie moribonde, en la présentant déguisée de verbiage "ouvrier" et "anticapitaliste". Ce n'est pas par hasard si la "popularité" de Le Pen et de son "Front National" est le résultat d'une opération politique et médiatique, soigneusement organisée par le Parti socialiste de Mitterrand.
Nous ne sommes plus à la fin du 19ème siècle, lorsque les crises économiques s'atténuaient de plus en plus, que les arts et les sciences se développaient de façon exceptionnelle, les prolétaires voyant leur conditions d'existence s'améliorer régulièrement sous la pression de leurs organisations économiques et politiques de masses. Nous sommes à l'époque d'Auschwitz, d'Hiroshima, du Biafra, et du chômage massif et croissant pendant 30 ans sur 75.
L'idéologie dominante n'a plus l'emprise qu'elle avait au début de ce siècle, lorsqu'elle pouvait se permettre de faire croire à des millions d'ouvriers que le socialisme pourrait être le produit d'une évolution pacifique et quasi naturelle du capitalisme. Dans la décadence du capitalisme, l'idéologie dominante doit de plus en plus être imposée par la violence des manipulations médiatiques, précisément parce qu'elle peut de moins en moins s'imposer autrement.
Le développement des moyens de manipulation idéologique
Le GCI fait une constatation banale mais vraie :
- "La bourgeoisie, même avec sa vision limitée (limitée du point de vue de son être de classe) a tiré énormément de leçons du passé et à renforcé, affiné en conséquence l’utilisation de ses armes idéologiques".
C’est un fait indéniable. Mais le GCI n'en comprend ni l’origine, ni la signification.
Le GCI confond renforcement de l'idéologie dominante et renforcement des instruments de sa diffusion. Il ne voit pas que le développement de ces derniers est le produit de la faiblesse de cette idéologie, de la difficulté pour la classe dominante à maintenir "spontanément" son pouvoir. Si la bourgeoisie a dû multiplier au centuple ses dépenses en propagande depuis la 1ère guerre mondiale, ce n'est pas par un subit désir pédagogique, mais parce que, pour maintenir son pouvoir, la classe dominante a dû imposer aux classes exploitées des sacrifices sans précédent, et faire face à la première vague révolutionnaire internationale.
Le début du développement vertigineux des instruments idéologiques de la bourgeoisie date précisément de la période d'ouverture de la décadence capitaliste. La première guerre mondiale est la première guerre "totale", la première qui se fait par une mobilisation de la totalité des forces productives de la société en vue du but guerrier. Il ne suffit plus d'embrigader idéologiquement les troupes au front, il faut en outre encadrer, et de la façon la plus stricte, l'ensemble des classes productives. C'est à ce travail que les "syndicats ouvriers' se transformeront définitivement en rouages de l'Etat capitaliste. Un travail d'autant plus rude que jamais guerre n'avait été aussi absurde et destructrice et que le prolétariat se lançait dans sa première tentative révolutionnaire internationale.
Au cours de la période de l'entre-deux guerres, la bourgeoisie, confrontée à la plus violente crise économique de son histoire et à la nécessité de préparer une nouvelle guerre, va systématiser et développer encore les instruments de la propagande politique, en particulier "l'art" de la manipulation des masses : Goebbels et Staline ont laissé à la bourgeoisie mondiale des traités pratiques qui demeurent aujourd'hui les références de base de tout "publiciste" ou "manipulateur" des médias. "Un mensonge répété mille fois devient une vérité" enseignait le principal responsable de la propagande hitlérienne.
Après la seconde guerre mondiale, la bourgeoisie va disposer d'un nouvel instrument redoutable : la télévision. L'idéologie dominante à domicile distillée quotidiennement pour chaque cerveau par les services des gouvernements et des marchands les plus puissants. Présenté comme un luxe, les Etats sauront en faire le plus puissant instrument de manipulation idéologique.
La bourgeoisie a bien "renforcé et affiné l'utilisation de ses armes idéologiques", mais, contrairement aux affirmations du GCI, premièrement, cela n'a pas empêché l'usure et la décomposition de l'idéologie dominante, deuxièmement ce phénomène est le produit direct de la décadence du capitalisme.
Ce développement du totalitarisme idéologique se retrouve aussi dans la décadence des sociétés passées, tel que l'esclavagisme antique et le féodalisme. Dans l'empire romain décadent, la divinisation de la charge d'empereur ainsi que l'imposition du christianisme comme religion d'Etat, dans le féodalisme du Moyen-Âge, la monarchie de droit divin et l'emploi systématique de l'inquisition en sont des manifestations parmi d'autres, Mais elles n'y traduisaient pas plus que dans le capitalisme un quelconque renforcement de l'idéologie, une plus grande adhésion de la population aux idées de la classe dominante. Au contraire.
La spécificité de la décadence capitaliste
Il faut noter ici, encore une fois, l'importance des différences entre la décadence du capitalisme et celles des sociétés qui l'ont précédée en Europe. Tout d'abord, la décadence capitaliste est un phénomène aux dimensions mondiales, qui touche simultanément, même si dans des conditions différentes, tous les pays. Celle des sociétés passées reste toujours un phénomène local.
Ensuite, le déclin de l'esclavagisme antique, tout comme celui de la féodalité, se fait en même temps que le surgissement, au sein de l'ancienne société et coexistant avec elle, du nouveau mode de production. C'est ainsi que les effets de la décadence romaine sont atténués par le développement simultané de formes économiques de type féodal. C'est ainsi que ceux de la féodalité décadente le sont par le développement du commerce et des rapports de production capitalistes à partir des grandes villes.
Par contre, le communisme ne peut pas coexister avec le capitalisme décadent, ni même commencer à s'instaurer, sans avoir auparavant réalisé une révolution politique - le prolétariat commence sa révolution sociale 1à où les précédentes révolutions la terminaient : la destruction du pouvoir politique de l'ancienne classe dominante.
Le communisme n'est pas l'oeuvre d'une classe exploiteuse qui pourrait, comme par le passé, partager le pouvoir avec l'ancienne classe dominante. Classe exploitée, le prolétariat ne peut s'émanciper qu'en détruisant de fond en comble le pouvoir de cette dernière. Il n'y a aucune possibilité que les prémices de nouveaux rapports, communistes, puissent venir alléger, limiter les effets de la décadence capitaliste.
C'est pourquoi la décadence capitaliste est beaucoup plus violente, destructrice, barbare que celle des sociétés passées.
A côté des moyens développés par la bourgeoisie pour assurer son oppression idéologique, ceux des plus délirants empereurs romains décadents, ou des plus cruels des inquisiteurs féodaux, apparaissent comme des jeux d'enfants. Mais ces moyens sont à la mesure du degré de pourriture interne atteint par l'idéologie du capitalisme décadent.
"Les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout."
Mais il n'y a pas que l'idée d'une décomposition de l'idéologie dominante ou de l'écroulement des valeurs morales qui choque le GCI. Pour les prêtres de l'invariance, parler de manifestations de la décadence au niveau des formes philosophiques, artistiques, etc. c'est encore du "moralisme".
Encore une fois on ne peut que se demander pourquoi le GCI tient-il tellement à continuer à se réclamer du marxisme. Comme on l'a vu, non seulement Marx en parle, mais il y voit un domaine particulièrement crucial: "les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout."
Pour le marxisme "les hommes" sont déterminés par les rapports entre les classes. Aussi la façon dont se manifeste la prise de conscience du conflit entre les rapports de production existants et la nécessité du développement des forces productives, est différente suivant qu'il s'agisse de telle ou telle classe.
Pour la classe dominante, la prise de conscience de ce conflit se traduit sur le plan politique et juridique par un blindage de son Etat, par un durcissement et une généralisation totalitaire du contrôle de l'Etat, des lois, sur toute la vie sociale. C'est le capitalisme d'Etat, le féodalisme de la monarchie absolue, c'est l'Empire de droit divin. Mais, simultanément, la vie sociale plonge de plus en plus dans l'illégalité, dans la corruption généralisée, dans le brigandage. Depuis les trafics de la première guerre mondiale qui ont fait et défait des fortunes colossales, le capitalisme mondial n'a cessé de développer toutes les formes de trafics : drogue, prostitution, armes jusqu'à en faire devenir une source de financement permanent (par exemple pour les services secrets des grandes puissances) et, dans le cas de certains pays, la première source de revenu. La corruption sans limites, le cynisme, le machiavélisme le plus sordide et sans scrupules sont devenus des qualités indispensables pour survivre au sein d'une classe dominante qui s'entre-déchire d'autant plus violemment que les sources de richesse se tarissent.
Pour les artistes, philosophes et certains religieux, qui font en général partie des classes moyennes, la perte d'avenir de leur maîtres, qu'ils ressentent probablement avec une plus grande sensibilité que leurs employeurs eux mêmes, ils ont tendance à l'assimiler à leur propre fin et à la fin du monde. Le blocage du développement matériel par les contradictions des lois sociales dominantes, ils l'expriment par le pire pessimisme.
Voici comment formulait ce sentiment, Albert Camus, prix Nobel de littérature 1957, au lendemain de la 2ème guerre mondiale, dans la décennie des guerres de Corée, d'Indochine, de Suez, d'Algérie, etc.: "L'unique donnée est pour moi l'absurde. Le problème est de savoir comment en sortir et si le suicide doit se déduire de cet absurde."
Une sorte de "nihilisme" se développe, refusant à la raison toute possibilité de comprendre et de maîtriser le cours des choses. Le mysticisme, en tant que négation de la raison se développe. Et ici encore c'est un phénomène qui marque les décadences passées. Ainsi dans la décadence féodale du 14ème siècle :
- "Le temps du marasme voit éclore le mysticisme sous toutes ses formes. Il est intellectuel avec les Traités de l'art de mourir et, surtout, l'Imitation de Jésus Christ. Il est émotionnel avec les grandes manifestations de la piété populaire exacerbée par la prédication d'éléments incontrôlés du clergé mendiant: les 'flagellants' parcourent les campagnes, se déchirant la poitrine à coups de lanière sur la place des villages, afin de frapper la sensibilité humaine et d'appeler les chrétiens à la pénitence. Ces manifestations donnent le jour à une imagerie d'un goût souvent douteux, comme ces fontaines de sang qui symbolisent le Rédempteur. Très rapidement le mouvement tourne à l'hystérie et la hiérarchie ecclésiastique doit intervenir contre les fauteurs de trouble, pour éviter que leur prédication n'accroisse encore le nombre de vagabonds. (...) L'art macabre se développe (...) un texte sacré l'emporte alors dans la faveur des esprits les plus lucides : l'Apocalypse "[12] [117].
Alors que dans les sociétés passées le pessimisme dominant se trouvait contrebalancé, après un certain temps, par l'optimisme engendré du fait de l'émergence d'une nouvelle société, dans le capitalisme décadent, la chute semble sans fond.
La décadence capitaliste détruit les anciennes valeurs, mais la bourgeoisie sénile n'a rien d'autre à offrir sinon le vide, le nihilisme. "Dont think !", "Ne pensez pas !" Telle est la seule réponse que peut désormais offrir le capitalisme en décomposition à la question des plus désespérés : "No future !".
Une société qui bat des records historiques de suicide, parmi les jeunes en particulier, une société où l'Etat est contraint, dans une capitale comme Washington, d'instaurer le couvre-feu contre les jeunes, les enfants, afin de limiter l'explosion du banditisme, est une société bloquée, en décomposition. Elle n'avance plus. Elle recule. C'est cela "la barbarie". Et c'est cette barbarie qui s'exprime dans le désespoir, ou dans la révolte, qui traverse les formes artistiques, philosophiques, religieuses depuis des décennies.
Dans l'enfer que devient pour les hommes une société en proie à la décadence de son mode de production, seule l'action de la classe révolutionnaire est porteuse d'espoir. Dans le cas du capitalisme cela se vérifie plus qu'en toute autre occasion.
Toute société soumise à la pénurie matérielle, donc toutes les formes de sociétés ayant existé jusqu'à présent, est organisée de sorte que la première des priorités sont d'assurer la subsistance matérielle de la communauté. La division de la société en classes n'est pas une malédiction tombée du ciel, mais le fruit du développement de la division du travail en vue de subvenir à cette première nécessité. Les rapports entre les hommes depuis la façon de se répartir les richesses créées, jusqu'à la façon de vivre l'amour, toutes les relations humaines sont médiatisées par leur mode d'organisation économique.
Que la machine économique vienne à se bloquer et c'est le lien, la médiation, le ciment des relations entre les hommes qui s'effrite, se décompose. Que l'activité productive cesse d'être créatrice d'avenir et ce sont les activités humaines dans leur quasi-totalité qui semblent perdre leur sens historique.
Dans le capitalisme l'importance de l'économie dans la vie sociale atteint des degrés inégalés auparavant. Le salariat, le rapport entre le prolétaire et le capital est de tous les rapports d'exploitation de l'histoire, le plus dépouillé de toute relation non-marchande, le plus impitoyable. Même dans les pires conditions économiques, les maîtres d'esclaves ou les seigneurs féodaux nourrissaient leurs esclaves et serfs, comme leur bétail. Dans le capitalisme, le maître ne nourrit l'esclave que pour autant qu'il en a besoin pour ses affaires. Pas de profit, pas de travail, pas de rapport social. L'atomisation, la solitude, l'impuissance. Les effets du blocage de la machine économique sur la vie sociale sont, dans le cas de la décadence capitaliste beaucoup plus profonds que dans celle des sociétés passées. La désagrégation de la société que provoque la crise économique engendre des retours à des formes de rapports sociaux primitifs, barbares : la guerre, la délinquance comme moyen de subsistance, la violence omniprésente, la répression brutale[13] [118].
Dans ce marasme, seul est porteur d'avenir le combat contre le capitalisme qui détruit toute perspective autre que celle de l'autodestruction généralisée. Seul est unificateur et créateur de véritables rapports humains, le combat contre le capitalisme qui les aliène et les atomise. Ce combat, c'est le prolétariat qui en est le principal protagoniste.
C'est pourquoi la conscience de classe prolétarienne, telle qu'elle s'affirme lorsque le prolétariat agit comme classe, telle qu'elle est développée par les minorités politiques révolutionnaires, est la seule qui peut "regarder le monde en face", la seule qui soit une véritable "prise de conscience" du conflit dans lequel se trouve bloquée la société.
Le prolétariat l'a montré pratiquement en portant ses luttes revendicatives à leurs dernières conséquences, dans la vague révolutionnaire internationale ouverte par la prise de pouvoir du prolétariat en Russie 1917. Il réaffirma alors clairement le projet dont sont porteurs les prolétaires du monde entier : le communisme.
L'activité organisée des minorités révolutionnaires, en mettant systématiquement en évidence les causes de cette décomposition, en dégageant la dynamique générale qui conduit à la révolution communiste, constitue un facteur décisif de cette prise de conscience.
C'est essentiellement dans et par le prolétariat que "les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout".
Décomposition de l'idéologie dominante : développement des conditions de la révolution
Pour la classe révolutionnaire, il ne sert à rien de se lamenter sur les misères de la décadence capitaliste. Elle doit au contraire voir dans la décomposition des formes idéologiques de la domination capitaliste, un facteur qui dégage les prolétaires de l'emprise idéologique du capital. Elle constitue un danger lorsque le prolétariat se laisse aller à la résignation et à la passivité. La lumpénisation des jeunes prolétaires chômeurs, l'autodestruction par la drogue ou la soumission au "chacun pour soi" préconisé par la bourgeoisie, sont des dangers d'affaiblissement réels pour la classe ouvrière. (Voir "La décomposition du capitalisme", Revue Internationale n° 57). Mais la classe révolutionnaire ne peut porter son combat jusqu'au bout sans perdre ses dernières illusions sur le système dominant. La décomposition de l'idéologie dominante fait partie du processus qui y conduit.
Par ailleurs cette décomposition a des effets sur les autres parties de la société. La domination idéologique de la bourgeoisie sur l'ensemble de la population non-exploiteuse, en dehors du prolétariat, s'en trouve aussi affaiblie. Cet affaiblissement n'est pas en lui même porteur d'avenir : la révolte de ces couches, sans l'action du prolétariat, ne conduit qu'à la multiplication des massacres. Mais, lorsque la classe révolutionnaire prend l'initiative du combat, cela lui permet de compter sur la neutralité, voire l'appui de ces couches.
Il ne peut y avoir de révolution prolétarienne triomphante si les corps armés de la classe dominante ne sont pas eux-mêmes décomposés. Si le prolétariat doit affronter une armée qui continue d'obéir inconditionnellement à la classe dominante, son combat est condamné d'avance. Trotsky en faisait une loi déjà au lendemain des luttes révolutionnaires en Russie en 1905. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui, après des décennies de développement de l'armement par la bourgeoisie décadente. Le moment où les premiers soldats refusent de tirer sur des prolétaires en lutte, constitue toujours un moment décisif dans un processus révolutionnaire. Or seule la décomposition des valeurs idéologiques de l'ordre établi, jointe à l'action révolutionnaire du prolétariat, peut provoquer la désagrégation de ces corps armés. Pour cela encore, le prolétariat ne saurait "voir dans la misère que la misère".
***
Le CCI, pour qui la révolution est et a toujours été à l'ordre du jour, ne comprend pas plus les changements dans les formes idéologiques dominantes, qu'il ne voit se mouvoir quoi que ce soit dans son univers "invariant". Mais ce faisant, il s'interdit de comprendre le véritable mouvement qui conduit à la révolution.
La décomposition des formes idéologiques du capitalisme est une manifestation criante de la mise à l'ordre du jour de l'histoire de la révolution communiste mondiale. Elle fait partie du processus où mûrissent la conscience de la nécessité de la révolution et où se créent les conditions de sa possibilité.
RV
[1] [119] Revue Internationale n° 48,49, 50, 54, 55, 56.
[2] [120] Avant-propos de la critique de l'économie politique ; Ed. La Pléiade, T.1.
[3] [121] Ibid
[4] [122] Ibid
[5] [123] Voir les articles Précédents de cette série.
[6] [124] Célèbres personnages de la droite en France
[7] [125] Le communiste n° 23.
[8] [126] L'Idéologie allemande, "Feuerbach, conception matérialiste contre conception idéaliste" ; Ed. La Pléiade, T. 3.
[9] [127] Ibid.
[10] [128] Ibid.
[11] [129] Les exemples concrets de "nouvelle recomposition idéologique" données par le GCI se réfèrent pour la plupart à des pays moins développés : "renaissance de l'Islam", "le retour de nombreux pays anciennes 'dictatures fascoïdes' au 'libre jeu des droits et libertés démocratiques', Grèce, Espagne, Portugal, Argentine. Brésil, Pérou, Bolivie ...". Ce faisant, "l'invariance" ignore la décomposition croissante de ces mêmes valeurs dans les pays de plus longue tradition et concentration prolétarienne, tout comme la rapidité avec laquelle elles s’usent dans leurs nouveaux lieux d’application. Mais il est difficile de voir l’accélération de l’histoire, lorsqu’on la croit « invariante ».
[12] [130] J. Favier, De Marco Polo à Christophe Colomb.
[13] [131] Le développement massif et dans tous les pays de corps armés spécialisés dans la répression des foules et des mouvements sociaux, est une caractéristique spécifique du capitalisme décadent
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [36]
A la mémoire de Munis, un militant de la classe ouvrière
- 2971 reads
Le 4 février 1989, mourait Manuel Fernandez Grandizo, dit G. Munis. Le prolétariat vient de perdre un militant qui a consacré toute sa vie au combat de classe. Né au début du siècle, c'est très jeune que Munis a commencé sa vie de révolutionnaire comme militant du trotskisme, à une époque où ce courant se trouvait encore dans le camp du prolétariat et menait une lutte acharnée contre la dégénérescence stalinienne des partis de l'Internationale Communiste. Il est membre de l'Opposition, de gauche espagnole (OGE) qui se orée en février 1930 à Liège, en Belgique, autour de F. Garcia Lavid, dit "H. Lacroix". Il milite dans sa section de Madrid où il prend position pour la tendance "Lacroix" en mars 1932 contre le Centre dirigé par Andrés Nin. La discussion au sein de l'Opposition de gauche (OG) portait alors sur la nécessité ou non de créer "un deuxième parti communiste" ou bien de poursuivre l'Opposition aux PC avec pour but de les redresser. Cette dernière position qui était, dans les années 30, la position de Trotsky sera mise en minorité à la troisième Conférence de l'OGE, qui changera alors de nom pour devenir Izquierda Comunista espanola (ICE - Gauche communiste espagnole). Malgré son désaccord, Munis continuera à militer en son sein. La concrétisation de cette orientation de création d'un nouveau parti aboutit à la fondation, en septembre 1934, du POUM, parti centriste, catalaniste et sans principes regroupant l'ICE et le Bloc ouvrier et paysan (BOC) de J. Maurin. Munis s'oppose alors avec une poignée de camarades à la dissolution des révolutionnaires dans le POUM et fonde le Groupe B-L d'Espagne (Bolchevique-léniniste).En 1936 au milieu de la dispersion des révolutionnaires espagnols, il reforme le groupe B-L qui avait disparu, et surtout, il participe avec beaucoup de courage et de décision, aux côtés des "Amis de Durruti", à l'insurrection des ouvriers de Barcelone en Mai 1937 contre le gouvernement de Front populaire. Arrêté en 1938, il réussit à s'évader des prisons staliniennes en 1939.Le déclenchement de la 2ème guerre impérialiste mondiale conduit Munis à rompre avec le trotskisme sur la question de la défense d'un camp impérialiste contre un autre et à adopter une position internationaliste claire de défaitisme révolutionnaire contre la guerre impérialiste. Il dénonce la Russie comme pays capitaliste ce qui aboutit à la rupture de la section espagnole d'avec la IV° internationale à son 1er congrès d'après guerre en 1948 (c.f. "Explication y Uamaminento a los militantes, grupos y secciones de la IV° international", septembre 1949). Après cette rupture, son évolution politique en direction d'une plus grande clarté révolutionnaire se poursuivra, en particulier sur la question syndicale et la question parlementaire, à la suite notamment des discussions avec les militants de la Gauche Communiste de France. Cependant, le "Second Manifeste Communiste" qu'il publie en 1965 (après qu'il ait été emprisonné en 1952 pendant quelques années dans les geôles franquistes) témoigne de sa difficulté à rompre complètement avec la démarche trotskiste, bien que ce document se situe clairement sur un terrain de classe prolétarien. En 1967, il participe, en compagnie de camarades d'"Internacionalismo", à une prise de contact avec le milieu révolutionnaire en Italie. Aussi, à la fin des années 60, avec le resurgissement de la classe ouvrière sur la scène de l'histoire, il sera sur la brèche aux côtés des faibles forces révolutionnaires existantes, dont celles qui vont fonder "Révolution Internationale". Au début des années 70, il reste malheureusement à l'écart de l'effort de discussion et de regroupement qui allait notamment aboutir, en 1975, à la constitution du Courant Communiste International. En revanche, le Ferment Ouvrier Révolutionnaire (FOR), l'organisation qu'il avait fondée autour des positions du "Second Manifeste", sera partie prenante de la première Conférence des Groupes de la Gauche Communiste qui s'est tenue en 1977 à Milan. Mais cette attitude sera remise en cause à la deuxième Conférence, où le FOR se retire dès l'ouverture, ce qui exprime une démarche d'isolement sectaire qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui dans cette organisation. Il est donc clair que nous avions des divergences très importantes avec le FOR, ce qui nous a conduit à polémiquer en de nombreuses reprises avec cette organisation dans notre presse (voir notamment l'article de la Revue Internationale n° 52). Cependant, malgré les erreurs sérieuses qu'il a pu commettre, Munis est resté jusqu'au bout un militant profondément fidèle au combat de la classe ouvrière. Il était un de ces très rares militants qui ont résisté à la pression de la plus terrible contre-révolution qu'ait subit le prolétariat dans son histoire, alors que beaucoup désertaient le combat militant ou même trahissaient, pour être présent aux côtés de la classe ouvrière lors de la reprise historique de ses combats à la fin des années 60.C'est à ce militant du combat révolutionnaire, à sa fidélité au camp prolétarien et à son engagement indéfectible que nous voulons rendre hommage. A ses camarades du FOR, nous adressons notre salut fraternel.
RI
Courants politiques:
- Gauche Communiste [46]
Contribution pour une histoire du mouvement révolutionnaire : histoire de la gauche germano-hollandaise
- 2826 reads
L'histoire de la gauche communiste internationale depuis le début du siècle, telle que nous avons commencé à la relater dans les brochures sur La Gauche communiste d'Italie, n'est pas seulement un travail d'historien. Ce n'est que d'un point de vue militant, du point de vue de l'engagement dans le combat de la classe ouvrière pour son émancipation que peut être abordée l'histoire du mouvement ouvrier, histoire dont la connaissance, pour la classe ouvrière, n'est pas affaire de savoir, mais d'abord et avant tout une arme de son combat pour les luttes du moment et à venir, par les leçons du passé qu’elle enseigne.
C'est de ce point de vue militant que nous publierons, comme contribution pour une histoire du mouvement révolutionnaire, une brochure sur La gauche communiste germano-hollandaise, qui paraîtra dans le courant de cette année. C'est ce point de vue de comment nous avons abordé cette histoire qui est présenté ci-dessous dans l'introduction à cette brochure.
INTRODUCTION A L'HISTOIRE DE LA GAUCHE GERMANO-HOLLANDAISE
Franz Mehring, auteur réputé d'une biographie de Marx et d'une histoire de la social-démocratie allemande, compagnon d'armes de Rosa Luxemburg, soulignait en 1896 -dans la Neue Zeit - toute l'importance que revêt pour le mouvement ouvrier la réappropriation de son propre passé :
"C'est un avantage qu'a le prolétariat, par rapport à tous les autres partis, de pouvoir puiser sans cesse de nouvelles forces dans l'histoire de son propre passé pour mener la lutte du présent et atteindre le nouveau monde du futur. "
L'existence d'une véritable "mémoire ouvrière" traduit un effort constant du mouvement ouvrier, dans sa dimension révolutionnaire, pour se réapproprier son propre passé. Cette réappropriation est indissociablement liée à l'auto développement de la conscience de classe, qui se manifeste pleinement dans les luttes massives du prolétariat. Et Mehring notait dans le même article que "comprendre c'est dépasser" (auflieben), dans le sens de conserver et d'assimiler les éléments d'un passé qui portent en germe le futur d'une classe historique, d une classe qui est la seule classe historique en étant porteuse du "nouveau monde du futur". Ainsi, on ne peut guère comprendre l'émergence de la Révolution russe d'octobre 1917 sans les expériences de la Commune de Paris et de 1905 en Russie.
Considérant que l'histoire du mouvement ouvrier ne peut se réduire à une suite d'images d'Epinal, faisant revivre de façon colorée un passé révolu, et encore moins à des études académiques où "le passé du mouvement ainsi miniaturisé en des études minutieuses, pédantes, privées de toute perspective générale, isolées de leur contexte, n'est susceptible de susciter qu'un intérêt fort limité" (G. Haupt, L'Historien et le mouvement social), nous avons fait le choix dans notre travail d'aborder l'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire germano-hollandais en tant que praxis. Nous faisons nôtre cette définition donnée par G. Haupt. Considérée comme l'expression d'un "matérialisme militant" (Plékhanov), cette praxis se définit comme un "laboratoire d'expériences, d'échecs et de succès, champ d'élaboration théorique et stratégique, où rigueur et examen critique s’imposent pour fixer la réalité historique et par là même découvrir ses ressorts cachés, pour inventer donc innover à partir d'un moment historique perçu comme expérience." (Haupt, Ibid.)
Pour le mouvement ouvrier révolutionnaire, l'histoire de son propre passé n'est pas "neutre". Elle implique une constante remise en question et donc assimilation critique de son expérience passée. Le bouleversement révolutionnaire dans la praxis du prolétariat est sous-tendu finalement par un bouleversement en profondeur de la conscience de classe. Seul l'examen critique du passé, sans dogmes ni tabous, peut redonner au mouvement ouvrier révolutionnaire cette dimension historique caractéristique d'une classe ayant une finalité, sa libération et celle de l'humanité. Rosa Luxemburg définissait ainsi la méthode d'investigation par le mouvement ouvrier de son propre passé :
"Il n'existe pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer (au prolétariat) les voies sur lesquelles il doit s'engager. Il n'a pas d'autre maître que l’expérience historique. Le chemin de croix de sa libération n'est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d'erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l'atteindra s'il sait tirer l'enseignement de ses propres erreurs" (R. Luxemburg, La crise de la social-démocratie ; cité par G. Haupt, L'historien et le mouvement social, Maspéro, 1980.)
Alors que l'histoire du mouvement ouvrier, comme praxis, se traduit par une discontinuité théorique et pratique, au contact de l'expérience historique nouvelle, elle se présente aussi comme une tradition jouant un rôle mobilisateur de la conscience ouvrière et alimentant la mémoire collective. Si souvent elle joue un rôle conservateur dans l'histoire du prolétariat, elle exprime encore plus ce qui demeure de stable dans les acquis théoriques et organisationnels du mouvement ouvrier. Ainsi, la discontinuité et la continuité sont les deux dimensions indissociables de cette histoire politique et sociale de ce mouvement.
Les courants communistes de gauche, issus de la 3e Internationale, comme la Gauche italienne "bordiguiste", d'un côté, et la Gauche communiste hollandaise de Gorter et Pannekoek, de l'autre, n'ont pas échappé à la tentation de se situer unilatéralement dans la continuité ou la discontinuité du mouvement ouvrier. Le courant "bordiguiste" a choisi résolument d'affirmer une "invariance" du marxisme et du mouvement ouvrier depuis 1848, une "invariance" de la théorie communiste depuis Lénine. Le courant "conseilliste" des années 1930, aux Pays-Bas, par contre, a fait le choix de nier toute continuité dans le mouvement ouvrier et révolutionnaire. Sa théorie du Nouveau Mouvement ouvrier rejetait dans le néant "l'ancien" mouvement ouvrier, dont l'expérience était jugée négative pour l'avenir. Entre ces deux attitudes extrêmes, se situaient le KAPD de Berlin et surtout "Bilan", la revue de la Fraction italienne en exil en France et en Belgique dans les années 1930. Les deux courants, allemand et italien, tout en innovant théoriquement et en marquant la discontinuité entre le nouveau mouvement révolutionnaire des années 1920 et 1930 et celui qui précéda, dans la social-démocratie, la guerre de 1914-1918, s'orientaient dans la continuité avec le mouvement marxiste originel. Toutes ces hésitations montrent la difficulté à saisir le courant de la gauche communiste dans sa continuité et sa discontinuité, c'est-à-dire la conservation et le dépassement de leur héritage actuel.
Les difficultés d'une histoire du mouvement révolutionnaire communiste de gauche et communiste de conseils ne tiennent pas seulement au dépassement critique de leur propre histoire. Elles sont surtout le produit d'une histoire, tragique, qui depuis presque soixante années s'est traduite par une disparition des traditions révolutionnaires du mouvement ouvrier, qui avaient culminé avec la Révolution russe et la Révolution en Allemagne. Une sorte d'amnésie collective a semblé s'installer dans la classe ouvrière, sous l'effet de défaites successives et répétées trouvant leur culmination dans la deuxième guerre mondiale, qui a détruit des générations qui maintenaient vivantes les expériences vécues d'une lutte révolutionnaire et le fruit de décennies d'éducation socialiste. Mais c'est surtout le stalinisme, la contre-révolution la plus profonde qu'ait connue le mouvement ouvrier, avec la dégénérescence de la Révolution russe, qui a réussi le mieux à gommer cette mémoire collective, indissociable d'une conscience de classe. L'histoire du mouvement ouvrier, et surtout celle du courant révolutionnaire de gauche dans la 3e Internationale, est devenue une gigantesque entreprise de falsifications idéologiques au service du capitalisme d'Etat russe, puis des Etats qui se bâtirent sur le même modèle après 1945. Cette histoire devenait la glorification cynique du Parti unique au pouvoir et de son appareil étatique et policier. Sous couvert d' 'internationalisme", l'histoire officielle, "révisée", au fur et à mesure des règlements de comptes et des "tournants" successifs, devenait un discours étatique et nationaliste, de justification de toute guerre impérialiste et de la terreur, de justification des instincts les plus bas et les plus morbides cultivés sur le sol putréfié de la contre-révolution et de la guerre.
Il vaut la peine, à ce propos, de citer l'historien Georges Haupt, disparu en 1980, qui s'est fait connaître par la probité de ses travaux sur la 2e et la 3e Internationales :
"A l'aide de falsifications inouïes, foulant aux pieds et méprisant les réalités historiques les plus élémentaires, le stalinisme a méthodiquement gommé, mutilé, remodelé le champ du passé pour le remplacer par sa propre représentation, ses mythes, son autoglorification. L'histoire du mouvement ouvrier international se fige elle aussi en une collection d'images mortes, truquées, vidées de toute substance, remplacées par des copies maquillées où le passé se reconnaît à peine. La fonction que le stalinisme assigne à ce qu'il considère et déclare être l'histoire, et dont la validité sera imposée au mépris de toute vraisemblance, exprime une peur profonde de la réalité historique qu'il s'efforce de masquer, tronquer, déformer systématiquement pour en faire le terrain du conformisme et de la docilité. A l'aide d'un passé imaginaire, fétichisé, privé des éléments rappelant la réalité, le pouvoir cherche non seulement à obstruer la vision du réel mais à tétaniser la faculté de perception elle-même. D'où la nécessité permanente d'anesthésier, de pervertir la mémoire collective, dont le contrôle devient total du moment que le passé se voit traiter en secret d'Etat et l'accès aux documents est interdit."
Enfin, vint la période de mai 1968, le surgissement d'un mouvement social d'une telle ampleur, qui parcourut le monde de la France à la Grande-Bretagne, de la Belgique à la Suède, de l'Italie à l'Argentine, de la Pologne à l'Allemagne. Nul doute que la période d'éclosions ouvrières dans la période 1968-1974 a favorisé la recherche historique sur le mouvement révolutionnaire. Nombre de livres parurent sur l'histoire des mouvements révolutionnaires du XXe siècle, en Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne. Le fil rouge d'une continuité historique, entre le passé lointain des années 1920 et la période de mai 1968, apparut évidente à ceux qui ne se laissaient pas abuser par le côté spectaculaire de la révolte étudiante. Bien rares furent cependant ceux qui virent l'existence d'un mouvement ouvrier renaissant de ses cendres, dont l'effet fut le réveil d'une mémoire historique collective, anesthésiée, endormie pendant près de quarante années. Pourtant, dans un enthousiasme confus, les références historiques révolutionnaires sortaient spontanément et dans une joyeuse profusion de la bouche des ouvriers qui parcouraient les rues de Paris et fréquentaient les Comités d'action, antisyndicaux. Et ces références, ce n'étaient pas les étudiants "gauchistes", historiens et sociologues qui les leur soufflaient dans l'oreille. La mémoire collective ouvrière évoquait - souvent de façon confuse, et dans la confusion des événements - toute l'histoire du mouvement ouvrier, ses principales étapes : 1848, la Commune de Paris, 1905, 1917, mais aussi 1936, qui en était l'antithèse avec la constitution du Front populaire. C'est à peine si était évoquée l'expérience décisive de la Révolution allemande (1918-1923). L'idée des conseils ouvriers, préférée à celle de soviets moins purement prolétariens avec leur masse de soldats et paysans, apparaissait de plus en plus dans les discussions de la rue et dans les comités d'action nés de la vague de grève généralisée.
Le resurgissement du prolétariat sur la scène historique, d'une classe qui était déclarée par certains sociologues "intégrée" et "embourgeoisée", a largement créé les conditions favorables à une recherche sur l'histoire des mouvements révolutionnaires des années 1920 et 1930. Des études, trop rares, ont été consacrées aux gauches de la 2e et 3e Internationales. Les noms de Gorter et Pannekoek, les sigles KAPD et GIC, à côté de ceux de Bordiga et Damen, sont devenus plus familiers aux éléments se déclarant "ultra-gauche" ou "communistes internationalistes". La chape de plomb du stalinisme était soulevée, mais d'autres formes, plus insidieuses, de troncature et de déformation de l'histoire du mouvement révolutionnaire sont apparues, avec le déclin du stalinisme. Une historiographie de type social-démocrate, trotskyste, ou purement universitaire - suivant l'air du temps - est apparue, dont les effets sont tout aussi pervers que ceux du stalinisme. L'historiographie social-démocrate, comme la stalinienne, a essayé d'anesthésier et de gommer tout le côté révolutionnaire du mouvement communiste de gauche, pour le réduire à une "chose morte" du passé. Souvent, les critiques de la Gauche communiste à la social-démocratie ont soigneusement été gommées, de façon à en rendre l'histoire tout à fait inoffensive. L'historiographie gauchiste, et trotskyste en particulier, a pratiqué de son côté le mensonge par omission, en évitant soigneusement de trop parler des courants révolutionnaires à gauche du trotskisme. Beaucoup d'entre eux, quand il fallait inévitablement en parler, la mentionnaient au passage en lui collant l'étiquette - se voulant infamante - d'ultra-gauche, de "sectaire", et renvoyaient à la critique de "l'infantilisme de gauche" par Lénine. Une méthode longtemps pratiquée d'ailleurs par l'historiographie stalinienne. L'histoire devenait celle de leur propre auto-justification, un instrument de légitimation. Citons de nouveau ce que dit l'historien George Haupt, qui était loin d'être révolutionnaire, à propos de l'historiographie de cette "nouvelle gauche" :
"Il v a une décennie à peine, la ‘nouvelle gauche’ anti réformiste et antistalinienne, censeur sévère de l'histoire universitaire quelle rejette comme bourgeoise, affichait une attitude 'traditionnelle' envers l'histoire, retombant dans les mêmes ornières que les staliniens et les social-démocrates en coulant le passé dans le même type de moules. Ainsi les idéologues de l'opposition extraparlementaire (qui ne l'est plus depuis bien longtemps, NDR) dans les années soixante en Allemagne, eux aussi se sont employés à rechercher leur légitimité dans le passé. Ils ont traité l'histoire comme un gros gâteau dont chacun pouvait retrancher un morceau selon son goût ou son appétit'. Erigée en source de légitimité et utilisée comme instrument de légitimation, l'histoire ouvrière reste une sorte de dépôt d’accessoires, de déguisements, où chaque fraction, chaque groupuscule trouve sa référence justificatrice, utilisable pour les besoins du moment. " (Ibid.)
Des courants révolutionnaires, comme le "bordiguisme" ou le "conseillisme", parce qu'ils n'ont pu échapper au danger du sectarisme, ont fait eux aussi de l'histoire du mouvement révolutionnaire une source de légitimation de leurs conceptions. Au prix d'une déformation de l'histoire réelle, ils ont opéré un soigneux découpage, écartant toutes les composantes du mouvement révolutionnaire qui n'allaient pas dans leur sens. L'histoire de la Gauche communiste n'était plus celle de l'unité et de l'hétérogénéité de ses composantes, une histoire complexe à écrire dans toute sa globalité et sa dimension internationale, pour mieux en montrer l'unité, mais devenait celle de courants antagonistes et rivaux. Les "bordiguistes" ignoraient superbement l'histoire des Gauches communistes hollandaise et allemande. Quand ils en pariaient, c'était toujours avec un superbe mépris, et comme les trotskystes, ils renvoyaient à la critique "définitive" de Lénine de l'infantilisme de gauche. Ils gommaient soigneusement qu'en 1920 Bordiga, tout comme Gorter et Pannekoek, avait été condamné par Lénine comme "infantile", pour le même rejet du parlementarisme et de l'entrée du PC britannique dans le Labour Party. L'historiographie "conseilliste" a une attitude similaire. Glorifiant l'histoire du KAPD et des Unions -qu'elle réduisait le plus souvent à ses courants "antiautoritaires" et anarchisants, comme celui de Ruhle -, et surtout celle du GIC, elle ignorait non moins superbement l'existence du courant de Bordiga, celle de la Fraction italienne autour de "Bilan" dans les années 1930. Ce courant était rejeté dans le même sac que le "léninisme". Elle gommait aussi, avec un zèle non moins grand que celui des bordiguistes, les différences énormes entre la Gauche hollandaise de 1907 à 1927, revendiquant une organisation politique, et le conseillisme des années 1930. L'itinéraire de Pannekoek d'avant 1921 comme après 1927 devenait pour le "conseillisme" parfaitement droit. Le communiste de gauche Pannekoek d'avant 1921 était "révisé" à la lumière de son évolution conseilliste.
Outre le sectarisme de ces historiographies bordiguiste et conseilliste, qui se veulent "révolutionnaires" - alors que seule la vérité est révolutionnaire-, on doit souligner l'optique étroitement nationale de ces courants. En réduisant l'histoire du courant révolutionnaire à une composante nationale, choisie en fonction de leur "terroir" d'origine, ces courants ont manifesté une étroitesse nationale bornée et un fort "esprit de clocher". Le résultat a été que la dimension internationale de la Gauche communiste a été gommée. Le sectarisme de ces courants est inséparable de leur propre localisme, qui laisse transparaître la soumission inconsciente à des caractéristiques nationales, aujourd'hui révolues pour un véritable mouvement révolutionnaire international.
Vingt ans après mai 1968, le plus grand danger qui menace les tentatives d'écrire une histoire du mouvement révolutionnaire est moins la déformation ou la "désinformation" que la pression idéologique énorme, qui s'est fait ressentir ces dernières années. Cette pression va dans le sens d'une diminution notable des études et des recherches, dans le cadre universitaire, sur l'histoire du mouvement ouvrier. Pour s'en rendre compte, il suffit de citer les conclusions de la revue Le Mouvement social (n° 142, janvier-mars 1988), revue française connue pour ses recherches sur l'histoire du mouvement ouvrier. Un historien note une baisse sensible, dans cette revue, des articles consacrés au mouvement ouvrier et aux partis et organisations politiques s'en réclamant. Il constate une "baisse tendancielle de l'histoire politique 'pure' 60 % des articles au début, 10-15 % aujourd'hui. Depuis 1981, avec sans doute l'érosion de l'"illusion lyrique" sur la gauche au pouvoir, on assiste à une baisse sensible des études dur le communisme en général. Ce "décrochage" a été brutal depuis 1985-1986. Signe plus inquiétant d^me pression idéologique -celle de la bourgeoisie, devant l'incertitude croissante qui ébranle ses soubassements économiques, avec la crise mondiale- l'auteur note qu'une "prépondérance ouvrière (dans cette revue) est lentement grignotée par la montée de la bourgeoisie". Et il conclut par une hausse des études consacrées à l'histoire de la bourgeoisie et des couches non ouvrières. L'histoire du mouvement ouvrier cède de plus en plus la place à celle de la bourgeoisie et de l'histoire économique tout court.
Ainsi, après toute une période où furent écrites des études sur le mouvement ouvrier et révolutionnaire, dont les limites dans le monde universitaire étaient les semi vérités et les demi mensonges répétés, le gommage de l'histoire du mouvement dans sa dimension révolutionnaire, on assiste à une période de réaction. Même 'neutre', accommodée au goût du jour, même anesthésiante, l'histoire du mouvement ouvrier, surtout quand elle est révolutionnaire, apparaît "dangereuse" pour l'idéologie dominante. C'est que l'histoire politique et idéologique du mouvement révolutionnaire est explosive. Etant une praxis, elle est lourde de leçons révolutionnaires pour le futur. Elle remet en cause toutes les idéologies de la gauche officielle. Leçon critique du passé, elle est lourde d'une critique du présent. Elle est "une arme de la critique", laquelle -comme l'affirmait Marx- peut se changer en "critique des armes". On peut citer à ce propos le même G. Haupt : "...l'histoire est un terrain explosif, dans la mesure où la réalité des faits ou les expériences d'un passé souvent escamoté sont susceptibles de remettre en question toute prétention à la représentation unique de la classe ouvrière. Car l'histoire du monde ouvrier touche le fondement idéologique sur lequel s'appuient tous les partis à vocation d'avant-garde pour maintenir leurs visées hégémoniques." (p. 38, idem).
Cette histoire de la Gauche Communiste germano-hollandaise va à contre-courant de l'historiographie actuelle. Elle ne vise pas une pure histoire sociale de ce courant. Elle veut être une histoire politique, redonnant vie et actualité à tous les débats politiques théoriques qui s'y développèrent. Elle veut replacer dans son cadre international cette Gauche, sans lequel son existence devient incompréhensible. Elle se veut surtout une histoire critique, pour en montrer, sans a priori ni anathème, les lignes de force et de faiblesse. Elle n'est ni une apologie ni un rejet du courant communiste germano-hollandais. Elle veut montrer les racines du courant conseilliste, pour mieux en souligner les faiblesses intrinsèques et expliquer les raisons de sa disparition. Elle veut montrer aussi que l'idéologie du conseillisme traduit un éloignement des conceptions du marxisme révolutionnaire, exprimées dans les années 20 et 30 par le courant bordiguiste et le KAPD. Et en tant que telle cette idéologie, proche de l'anarchisme, peut être particulièrement pernicieuse pour le mouvement révolutionnaire futur, par son rejet de l'organisation révolutionnaire et de la Révolution russe, finalement par son rejet de toute l'expérience acquise par le mouvement ouvrier et révolutionnaire du passé. C'est une idéologie qui désarme la classe révolutionnaire et ses organisations.
Bien qu'écrite dans un cadre universitaire, cette histoire est donc une arme de combat. Pour reprendre l'expression de Mehring, elle est une histoire-praxis, une histoire "pour mener la lutte du présent et atteindre le nouveau monde du futur".
Cette histoire n'est donc pas "impartiale". Elle est un travail engagé. Car la vérité historique, quand il s'agit de l'histoire du mouvement révolutionnaire, exige un engagement révolutionnaire. La vérité des faits, leur interprétation dans un sens prolétarien, ne peut être que révolutionnaire.
Dans cet ouvrage, nous avons fait nôtres les réflexions de Trotski -dans sa Préface à son "Histoire de la Révolution russe"- sur l'objectivité du travail d'une histoire révolutionnaire :
"Le lecteur n'est pas, bien entendu, obligé de partager les vues politiques de l’auteur, que ce dernier n'a aucun motif de dissimuler. Mais le lecteur est en droit d'exiger qu'un ouvrage d'histoire constitue non pas l'apologie d'une position politique, mais une représentation intimement fondée du processus réel de la révolution. Un ouvrage d'histoire ne répond pleinement à sa destination que si les événements se développent, de page en page, dans tout le naturel de leur nécessité...
"Le lecteur sérieux et doué de sens critique n'a pas besoin d'une impartialité fallacieuse qui lui tendrait la coupe de l'esprit conciliateur, saturée d'une bonne dose de poison, d'un dépôt de haine réactionnaire, mais il lui faut la bonne foi scientifique qui, pour exprimer ses sympathies, ses antipathies, franches et non masquées, cherche à s'appuyer sur une honnête étude des faits, sur la démonstration des rapports réels entre les faits, sur la manifestation de ce qu'il y a de rationnel dans le déroulement des faits. Là seulement est possible l'objectivité historique, et elle est alors tout à fait suffisante, car elle est vérifiée et certifiée autrement que par les bonnes intentions de l'historien -dont celui-ci donne d'ailleurs la garantie- mais par la révélation de la loi intime du processus historique."
Le lecteur pourra juger, par l'abondance des matériaux utilisés, que nous avons visé cette bonne foi scientifique, sans cacher nullement nos sympathies et antipathies.
Ch.
Géographique:
- Hollande [132]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [48]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [46]
Revue Internationale no 59 - 4e trimestre 1989
- 2712 reads
Editorial : Chine, Pologne, Moyen-Orient, grèves en URSS et aux Etats-Unis
- 2705 reads
CONVULSIONS CAPITALISTES ET LUTTES OUVRIERES
En quelques mois, le monde a été le théâtre de toute une série d'événements particulièrement significatifs des enjeux réels de la période historique actuelle : les événements de Chine au printemps, les grèves ouvrières en URSS durant l'été, la situation au Moyen Orient, marquée par des faits d'apparence "pacifique" comme la nouvelle orientation de la politique de l'Iran, mais aussi par des événements sanglants et menaçants comme la destruction systématique de Beyrouth et les gesticulations belliqueuses de la flotte française au large du Liban. Enfin, le dernier événement qui ait fait la "une" des journaux, la constitution en Pologne, pour la première fois dans un pays à régime stalinien, d'un gouvernement dirigé par une formation politique qui n'est ni le parti "communiste", ni même une de ses marionnettes (comme le "parti paysan" où autres), rend compte de la situation inédite dans laquelle se trouvent ces pays.
Pour les commentateurs bourgeois, ces différents événements trouvent en général une explication spécifique, sans lien aucun avec celle des autres. Et quand ils s'emploient à dégager ce qui les relie entre eux, à établir un cadre général dans lequel ils s'insèrent, c'est pour les mettre au service des campagnes démocratiques qui se déchaînent à l'heure actuelle. C'est ainsi qu'on peut lire et entendre que :
- "les convulsions qui ont secoué la Chine sont liées au problème de la succession du vieillard autocrate Deng Xiaoping" ;
- "les grèves des ouvriers en URSS s'expliquent par les difficultés économiques spécifiques auxquelles ils se confrontent" ;
- "le nouveau cours de la politique iranienne est la conséquence de la disparition du fou paranoïaque Khomeiny" ;
- "les affrontements sanglants du Liban et l'expédition militaire française ont pour cause les appétits excessifs de Assad, le "Bismarck" du Moyen Orient" ;
- "on ne peut comprendre la situation actuelle en Pologne qu'en partant des spécificités de ce pays"...
"Mais tous ces événements ont un point commun : ils participent de la lutte universelle entre la "Démocratie" et le totalitarisme", entre les défenseurs des "Droits de l'Homme" et ceux qui les bafouent."
Face à la vision du monde des bourgeois qui ne dépasse pas le bout de leur nez et surtout face aux mensonges qu'ils répètent à satiété en espérant que les prolétaires en feront leur vérité, c'est le rôle des révolutionnaires de mettre en avant les véritables enjeux que les événements récents traduisent, de dégager le cadre réel dans lequel ils se situent.
A la racine de la situation internationale actuelle se trouve l'effondrement irréversible des bases matérielles de l'ensemble de la société, la crise mondiale insurmontable de l'économie capitaliste. La bourgeoisie a eu beau saluer ces deux dernières années comme celles de la "reprise" et même de la "sortie de la crise", elle a bien pu s'extasier sur les taux de croissance "d'un niveau inconnu depuis les années 60", elle ne peut rien contre des faits qui restent toujours aussi têtus : les "performances" récentes de l'économie mondiale (en fait de l'économie des pays les plus avancés) ont été payées par une nouvelle fuite en avant dans l'endettement généralisé qui augure de futures convulsions encore plus dramatiques et brutales que les précédentes ([1] [133]). Et, déjà, le retour d'une inflation galopante dans la plupart des pays et notamment dans la Grande Bretagne de Madame Thatcher, modèle de "vertu économique" commence à semer l'inquiétude... Toutes les déclarations euphoriques de la bourgeoisie n'auront pas plus d'effet que les incantations des hommes préhistoriques pour faire pleuvoir : le capitalisme est dans une impasse. Depuis qu'il est entré dans sa période de décadence au début du siècle, la seule perspective qu'il sache offrir à l'humanité, dans une telle situation de crise ouverte, est celle d'une fuite en avant dans la guerre dont l'aboutissement est la guerre impérialiste généralisée.
LIBAN ET IRAN : LA GUERRE HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN...
C'est bien ce que viennent confirmer les derniers événements du Liban. Ce pays, qui autrefois était appelé la "Suisse du Moyen Orient", n'a pas connu de répit depuis plus de 15 ans. Sa capitale, qui a bénéficié de la sollicitude de nombreux "libérateurs" et "protecteurs" (Syriens, Israéliens, Américains, Français, Anglais, Italiens...) est en passe d'être rayée de la carte. Véritable Carthage des temps modernes, elle fait l'objet aujourd'hui d'une destruction systématique, méticuleuse, qui, au moyen de centaines de milliers d'obus par semaine, la transforme en un champ de ruines et condamne ses habitants rescapés à vivre comme des rats. Contrairement au passé, ce ne sont plus à l'heure actuelle les deux grandes puissances qui 's'y affrontent : l'URSS qui, pendant un temps, s'était trouvée derrière la Syrie, a dû ravaler ses ambitions face au déploiement de force du bloc occidental de 1982. Cependant, dans le monde actuel, les antagonismes entre les deux blocs impérialistes, s'ils déterminent, en dernière instance, la physionomie générale des affrontements guerriers, ne sont pas les seuls à occuper le terrain militaire. Avec l'aggravation catastrophique de la crise capitaliste, les revendications particulières des petites puissances tendent à s'exacerber, surtout lorsqu'elles constatent qu'elles sont les victimes d'un marché de dupes, comme c'est le cas de la Syrie aujourd'hui. Après 83, ce pays avait échangé, avec le bloc américain, son retrait de l'alliance avec l'URSS contre une partie du Liban. Il s'était même converti en "gendarme" de sa zone d'occupation contre l'OLP et les groupuscules pro-iraniens. Mais en 88, estimant qu'il n'avait plus à craindre le retour dans la région d'un bloc russe de plus en plus pris à la gorge, le bloc américain a décidé qu'il n'avait plus besoin de respecter les clauses du marché. En téléguidant l'offensive du général chrétien Aoun, il a entrepris de faire revenir la Syrie à l'intérieur de ses frontières, ou au moins de réduire ses prétentions, afin de confier le contrôle du Liban à des alliés plus fiables, les milices chrétiennes et Israël, tout en mettant au pas les milices musulmanes. Le résultat en est ce massacre dont les populations civiles des deux côtés sont les premières victimes. Et dans cette affaire, on assiste une nouvelle fois à un judicieux partage des tâches entre les différents pays du bloc occidental : les Etats-Unis feignant de ne pas prendre parti entre les deux camps belligérants afin de ramasser la mise quand la situation sera mûre, alors que la France s'implique directement sur le terrain en envoyant un porte-avions et 6 autres navires de guerre dont personne n'arrive à croire, même en faisant beaucoup d'efforts, qu'ils sont investis d'une "mission humanitaire , comme le raconte Mitterrand. Au Liban, comme partout ailleurs, les croisades sur les "droits de l'homme" et la "liberté" ne sont que le cache-sexe des calculs impérialistes les plus sordides.
Le Liban constitue à l'heure actuelle un concentré de la barbarie dont est capable le capitalisme moribond. Il fait la preuve que toutes les paroles de paix qui ont été prononcées depuis un an ne sont que... des paroles. Même si un certain nombre de conflits ont été mis en sourdine ces derniers temps, il n'existe pour le monde aucune perspective de paix réelle. Bien au contraire.
C'est de cette façon que nous devons comprendre l'évolution récente de la situation en Iran. La nouvelle orientation du gouvernement de ce pays, qui désormais est prêt à coopérer avec le "Grand Satan" américain, n'a pas pour cause fondamentale la disparition de Khomeiny. Elle résulte essentiellement de la formidable pression que ce même "Grand Satan" a exercée pendant des années, en compagnie de la totalité de ses alliés les plus proches, pour remettre au pas ce pays après qu'il ait tenté de se soustraire au contrôle du bloc américain. Il y a deux ans à peine, celui-ci, en envoyant dans le Golfe persique la plus formidable armada qu'on ai vue depuis la seconde guerre mondiale, tout en intensifiant son soutien à l'Irak en guerre avec l'Iran depuis 8 ans, avait clairement signifié à ce dernier que "les choses avaient assez duré". Le résultat ne s'était pas fait attendre bien longtemps : l'an dernier, l'Iran acceptait de signer un armistice avec l'Irak et d'entamer des négociations de paix avec ce pays. C'était un premier succès de l'offensive du bloc occidental, mais jugé encore insuffisant par ce dernier. Il fallait en plus que la direction du pays passe aux mains de forces politiques capables de comprendre où se trouvait son "véritable intérêt" et de museler les cliques religieuses fanatiques et complètement archaïques qui l'avaient conduit dans cette situation. Les déclarations "Rushdicides" de l'hiver dernier traduisaient une dernière tentative de ces cliques, regroupées autour de Khomeiny, pour reprendre le contrôle d'une situation qui tendait à leur échapper, mais la mort du descendant du Prophète a sonné le glas de leurs ambitions. En fait, celui-ci constituait, par l'autorité qu'il conservait encore, le dernier verrou bloquant l'évolution de la situation, comme le cas s'était déjà présenté en Espagne, au début des années 70, où la survie de Franco était le dernier obstacle à un processus de "démocratisation" ardemment souhaité par la bourgeoisie nationale et par celle du bloc américain. La rapidité avec laquelle évolue aujourd'hui la situation politique en Iran, où le nouveau président Rafsandjani s'est entouré d'un gouvernement de "techniciens" excluant tous les anciens "politiques" (à part lui), fait la preuve que la situation était "mûre" depuis longtemps, que les forces sérieuses de la bourgeoisie nationale étaient pressées d'en finir avec un régime dont le bilan se solde par la ruine totale de l'économie. Cette bourgeoisie risque vite de déchanter : au milieu de la catastrophe actuelle de l'économie mondiale, il n'y a aucune place pour le "rétablissement" d'un pays sous-développé, et de plus détruit et saigné par huit ans de guerre. En revanche, pour les grandes puissances du bloc occidental, le bilan est nettement plus positif : ce bloc a réussi à faire un nouveau pas dans le développement de sa stratégie d'encerclement de l'URSS, un pas qui vient s'ajouter à celui qu'il avait accompli en obtenant le retrait d'Afghanistan des troupes de ce pays. Cependant, la "Pax Americana" qui est en passe de se rétablir, au prix d'incroyables massacres, dans cette partie du monde n'augure nullement une "pacification" définitive. En refermant de plus en plus son étau sur l'URSS, le bloc occidental ne fait que reporter à un niveau supérieur les antagonismes insurmontables entre les deux blocs impérialistes.
Par ailleurs, les différents conflits du Moyen-Orient ont mis en relief une des caractéristiques générales de la période actuelle : la décomposition avancée, le véritable pourrissement sur pieds qui affecte aujourd'hui la société bourgeoise du fait de la perpétuation et de l'aggravation continuelle de la crise depuis plus de vingt ans. Plus encore que l'Iran, le Liban témoigne de ce phénomène, avec la loi de ses bandes armées rivales, avec l'éternisation d'une guerre qui n'a jamais été déclarée, avec les attentats terroristes quotidiens et avec ses "preneurs d'otages". Les guerres entre factions de la bourgeoisie n'ont jamais été des jeux de fillettes, mais cette classe s'était par le passé donné des règles pour "organiser" ses déchirements et ses massacres. Aujourd'hui, preuve de cette décomposition de l'ensemble de la société, même ces règles sont quotidiennement bafouées.
Mais la barbarie et la décomposition sociales actuelles ne se limitent pas aux guerres et aux moyens qu'elles emploient aujourd'hui. C'est dans ce cadre qu'il faut également comprendre les événements du printemps en Chine et ceux de l'été en Pologne.
CHINE ET POLOGNE : LES CONVULSIONS DES REGIMES STALINIENS
Ces deux séries d'événements, en apparence diamétralement opposés, révèlent une même situation de crise profonde, un même phénomène de décomposition qui affecte les régimes dits "communistes".
En Chine, la terreur qui s'est abattue sur le pays parle d'elle-même. Les massacres de juin, les arrestations en masse, les exécutions en série, la délation et l'intimidation quotidiennes rendent compte, non pas d'une quelconque force du régime, mais de son extrême fragilité, des convulsions qui menacent de le disloquer. De cette faiblesse nous avions eu une illustration flagrante lors de la venue de Gorbatchev à Pékin, le 15 mai, lorsque les manifestations étudiantes avaient, fait incroyable, contraint les autorités à chambouler complètement le programme de la visite de l'inventeur de la "Perestroïka". En fait, les déchirements au sein de l'appareil du parti, entre la clique des "conservateurs" et celle des "réformateurs" qui a utilisé les étudiants comme masse de manoeuvre, ne relevaient pas uniquement de la lutte pour la succession de Deng Xiaoping. Ils révélaient aussi, et fondamentalement, le niveau de la crise politique qui secoue cet appareil.
Les convulsions de ce type ne sont pas nouvelles dans ce pays. Par exemple, la prétendue "Révolution culturelle" avait correspondu à une période de troubles et d'affrontements sanglants. Cependant, durant une dizaine d'années, après l'élimination de la "bande des quatre" et sous la direction de Deng Xiaoping, la situation a donné l'impression de s'être quelque peu stabilisée. En particulier, l'ouverture vers l'Occident et la "libéralisation" de l'économie chinoise avaient permis une petite modernisation de certains secteurs créant l’illusion d'un développement enfin "pacifique" de la Chine. Les convulsions qui ont secoué ce pays au printemps dernier sont venues mettre un terme à ces illusions. Derrière la façade de la "stabilité", les conflits s'étaient en réalité aiguisés au sein du parti entre les "conservateurs" qui estimaient qu'il y avait déjà trop de "libéralisation" et les réformateurs" qui considéraient qu'il fallait poursuivre le mouvement sur le plan économique et même l'élargir, éventuellement, au plan politique. Les deux derniers secrétaires généraux du parti, Hu Yaobang et Zhao Zyiang, étaient partisans de cette deuxième ligne. Le premier a été chassé de son poste en 86 après le lâchage de Deng Xiaoping, qui pourtant l'avait sacré. Le second, qui était le principal instigateur des manifestations étudiantes du printemps, sur lesquelles il comptait pour imposer sa ligne et sa clique, a connu le même sort après la terrible répression de juin. C'en était fini du mythe de la "démocratisation de la Chine" sous l'égide du nouveau "timonier" Deng. Ce fut d'ailleurs l'occasion, pour certains "spécialistes", de rappeler qu'en réalité, toute la carrière de cet individu s'était faite comme organisateur de la répression et en utilisant la plus grande brutalité contre ses adversaires. Ce qu'il est nécessaire de préciser, c'est que tous les dirigeants chinois ont fait ce type de carrière. La force brute, la terreur, la répression, les massacres, constituent la méthode de gouvernement presque exclusive d'un régime qui, sans de tels moyens, s'effondrerait au milieu de ses contradictions. Et lorsque, de temps en temps, un ancien boucher, un tortionnaire recyclé, embouche les trompettes de la "Démocratie", en faisant baver la petite bourgeoisie intellectuelle du pays et les bonnes âmes médiatiques du monde entier, ses fanfaronnades sont vite ravalées : soit il est assez intelligent (comme Deng Xiaoping) pour changer à temps de registre, soit il passe à la trappe.
En Chine, avec les événements du printemps et leur sinistre épilogue, c'est de façon évidente que s'est exprimée une nouvelle fois la situation de crise aiguë qui affecte le régime de ce pays. Mais ce type de situation n'est pas réservé à la Chine. Il ne résulte pas seulement de son arriération économique considérable. Ce qui se passe à l'heure actuelle en Pologne démontre de façon claire que c'est l'ensemble des régimes de type stalinien qui subit aujourd'hui les rigueurs d'une telle crise.
Dans ce pays, la constitution d'un gouvernement dirigé par Solidarnosc, c'est-à-dire par une formation qui n'est ni le parti stalinien, ni même directement contrôlée par celui-ci (et qui se trouvait, il y a peu de temps encore, dans la clandestinité), ne constitue pas seulement une première historique pour les pays du glacis soviétique. Cet événement est également significatif du niveau de la crise économique et politique qui frappe ces pays. En effet, il ne s'agit pas là d'une décision prévue et pré-paiée délibérément par la bourgeoisie afin de renforcer son appareil politique, mais le résultat de l'affaiblissement de celui-ci qui ne peut que contribuer à l'affaiblir encore. En fait, ces événements traduisent de la part de la bourgeoisie une perte de contrôle de la situation politique. Ils appartiennent à un processus de dérapage dont les étapes et les résultats n'ont été voulus par aucun des partenaires de la "table ronde" du début 89. En particulier, ni l'ensemble de la bourgeoisie, ni aucune de ses forces en particulier, n'a pu maîtriser le jeu électoral et "semi-démocratique" élaboré au cours de ces négociations. Déjà, au lendemain des élections de juin, il est apparu clairement que leur résultat, la défaite cuisante du parti stalinien et le "triomphe" de Solidarnosc, embarrassait autant le second que le premier. Aujourd'hui, la situation qui s'est instaurée rend bien compte de la gravité réelle de la crise et présage clairement des futures convulsions.
En effet, nous avons à l'heure actuelle en Pologne un gouvernement dirigé par un membre de Solidarnosc, dont les postes clés (surtout pour un régime dont le contrôle sur la société repose essentiellement sur la force) de l'Intérieur et de la Défense sont entre les mains de deux membres du POUP (en fait les précédents titulaires), c'est-à-dire le parti qui, il y a encore quelques mois, maintenait Solidarnosc dans l'illégalité et qui avait fait emprisonner ses dirigeants il y a quelques années. Même si tout ce beau monde témoigne d'une même et indéfectible solidarité anti-ouvrière (sur ce point on peut lui faire confiance), la "cohabitation" entre les représentants de ces deux formations dont les programmes politiques et économiques sont antinomiques, risque d'être tout sauf harmonieuse. Concrètement, les mesures économiques décidées par une équipe qui ne jure que par le "libéralisme" et "l'économie de marché" ont toutes les chances de rencontrer une résistance décidée de la part d'un parti dont le programme et la raison d'être même ne peuvent s'accommoder d'une telle perspective. Et cette résistance, ce n'est pas seulement au sein du gouvernement qu'elle va se manifester. Elle proviendra principalement de tout l'appareil du parti, de ces centaines de milliers de fonctionnaires de la "Nomenklatura" dont le pouvoir, les privilèges et les prébendes sont liés à la "gestion" (si toutefois ce terme a encore un sens quand on voit la désorganisation actuelle) administrative de 1’économie. En Pologne, comme dans la plupart des autres pays de l'Est, on a pu déjà constater, en de multiples circonstances, la difficulté d application de ce type de réformes, alors qu'elles étaient plus timides que celles prévues par les "experts" de Solidarnosc et qu'elles étaient décidées par la direction du parti. Aujourd'hui si on voit très bien que la gestion d'un gouvernement inspiré par ces experts signifie pour les ouvriers une nouvelle aggravation de leurs conditions d'existence, on ne voit vraiment pas, en revanche, comment elle pourrait parvenir à un autre résultat qu'une désorganisation encore plus grande de l'économie.
Mais les difficultés de ce nouveau gouvernement ne s'arrêtent pas là. Celui-ci sera confronté en permanence au gouvernement "bis", constitué autour de Jaruzelski et composé pour l'essentiel de membres du POUP. En réalité, c'est à ce dernier qu'obéira l'ensemble de l'appareil administratif et économique existant qui, lui aussi, se confond avec le POUP. Ainsi, dès sa constitution, le gouvernement Mazowiecki, salué comme une "victoire de la Démocratie" par les campagnes médiatiques occidentales, n'a d'autre perspective que le développement d'un chaos économique et politique encore plus grand que celui qui règne à l'heure actuelle.
La création en 1980 du syndicat indépendant Solidarnosc, destinée à canaliser, dévoyer et défaire la formidable combativité ouvrière qui s'était exprimée durant l'été avait, en même temps, engendré déjà une situation de crise politique qui ne s'était résolue qu'avec le coup de force et la répression de décembre 81. La mise hors-la-loi du syndicat, une fois qu'il eût achevé son travail de sabotage, montrait que les régimes de type stalinien ne peuvent supporter sans dommages l'existence en leur sein d'un "corps étranger", d'une formation qui ne soit pas directement sous leur contrôle. La constitution aujourd'hui d'un gouvernement dirigé par ce même syndicat (le fait, unique dans l'histoire, que ce soit un syndicat qui se trouve à la tête d'un gouvernement en dit long, par lui-même, sur le degré d'aberration de la situation qui s'est créée en Pologne) ne peut donc qu'entraîner, à une échelle encore plus vaste, ce type de contradictions et de convulsions. En ce sens, la "solution" de décembre 81, l'emploi de la force, une répression féroce, n'est nullement à exclure. Le ministre de l'intérieur de l'état de guerre, Kiszczak, est d'ailleurs toujours à son poste...
Les convulsions qui secouent à l'heure actuelle la Pologne, même si elles prennent dans ce pays une forme caricaturale, ne doivent pas être considérées comme spécifiques à ce pays. En fait, c'est l'ensemble des pays à régime stalinien qui se trouve dans une impasse. La crise mondiale du capitalisme se répercute avec une brutalité toute particulière sur leur économie qui est, non seulement arriérée, mais aussi incapable de s'adapter d'une quelconque façon à l'exacerbation de la concurrence entre les capitaux. La tentative d'introduire dans cette économie des normes "classiques" de gestion capitaliste, afin d'améliorer sa compétitivité, ne réussit qu'à provoquer une pagaille plus grande encore, comme le démontre en URSS, l'échec, complet et cuisant de la "Perestroïka". Cette pagaille se développe également sur le plan politique, lorsque sont introduits des essais de "démocratisation" destinés à défouler et canaliser quelque peu l'énorme mécontentement qui existe depuis des décennies dans la population et qui va croissant. La situation en Pologne l'illustre bien, mais celle qui se développe en URSS en constitue une autre manifestation : par exemple, l'explosion actuelle des nationalismes, que le relâchement de l'emprise du pouvoir central a favorisé, constitue une menace grandissante pour ce pays. De même, c'est la cohésion de l'ensemble du bloc de l'Est qui est aujourd'hui affectée : les déclarations hystériques des partis "frères" d'Allemagne de l'Est et de Tchécoslovaquie contre les "assassins du marxisme" et les "révisionnistes' qui sévissent en Pologne et en Hongrie ne sont pas du cinéma ; elles rendent compte des clivages qui sont en train de se développer entre ces différents pays.
La perspective pour l'ensemble des régimes staliniens n'est donc nullement celle d'une "démocratisation pacifique" ni d'un "redressement" de l'économie. Avec l'aggravation de la crise mondiale du capitalisme, ces pays sont entrés dans une période de convulsions d'une ampleur inconnue dans leur passé pourtant déjà "riche" de soubresauts violents.
Ainsi la plupart des événements qui se sont déroulés cet été nous renvoient l'image d'un monde qui, de toutes parts, s'enfonce dans la barbarie : affrontements militaires, massacres, répressions, convulsions économiques et politiques. Cependant, dans le même moment, s'est exprimé de façon extrêmement significative la seule force qui puisse offrir un autre avenir à la société : le prolétariat. Et c'est justement en URSS qu'il s'est manifesté de façon massive.
URSS : LA CLASSE OUVRIERE AFFIRME SA LUTTE
Les luttes prolétariennes qui, à partir de la mi-juillet et durant plusieurs semaines, ont paralysé la plupart des mines du Kouzbass, du Donbass et du grand nord sibérien, mobilisant plus de 500 000 ouvriers, revêtent une importance historique considérable. De très loin, elles constituent le mouvement le plus massif du prolétariat en URSS depuis la période révolutionnaire de 1917. Mais surtout, dans la mesure même où elles ont été menées par le prolétariat qui avait subit le plus durement et profondément la terrible contre-révolution, longue de quatre décennies, qui s'était déchaînée à l'échelle mondiale à la fin des années 20, elles sont une confirmation lumineuse du cours historique actuel : la perspective ouverte par la crise aiguë du capitalisme n'est pas celle d'une nouvelle guerre mondiale mais celle des affrontements de classe.
Ces luttes n'ont pas eu l'ampleur de celles de Pologne en 1980, m même de beaucoup de celles qui se sont développées dans les pays centraux du capitalisme depuis 1968. Cependant, pour- un pays comme 1’URSS, où pendant plus d'un demi-siècle, face à des conditions de vie intenables, les ouvriers ne pouvaient, à de rares exceptions près, que se taire, la rage au ventre, elles ouvrent une nouvelle perspective pour le prolétariat de ce pays. Elles font la preuve que même dans la métropole du "socialisme réel", face à la répression mais aussi face à tous les poisons du nationalisme et des campagnes démocratiques, les ouvriers peuvent s'exprimer sur leur terrain de classe.
Elles ont aussi fait la preuve, comme ce fut déjà le cas en Pologne en 80, de ce dont est capable le prolétariat lorsque, ne sont pas présentes les forces classiques d'encadrement de ses luttes, les syndicats. L'extension rapide du mouvement d'un centre minier à l'autre avec l'envoi de délégations massives, la prise en charge collective du combat par les assemblées générales, l'organisation de meetings et de manifestations de masse dans la rue, dépassant la séparation en entreprises, l'élection de comités de grève par les assemblées et responsables devant elles, voilà les formes élémentaires de lutte que se donne spontanément la classe dès lors que le terrain n'est pas occupé, ou qu'il l'est faiblement, par les professionnels du sabotage.
Face à l'ampleur et à la dynamique du mouvement, et pour éviter son extension à d'autres secteurs, les autorités n'ont eu d'autre remède que d'accepter, sur le moment, les revendications mises en avant par les ouvriers. Il est clair cependant que la plupart de ces revendications ne seront jamais réellement satisfaites : la catastrophe économique dans laquelle s'enfonce l'URSS ne le permet absolument pas. Les seules revendications qui risquent de ne pas être remises en cause sont justement celles qui révèlent les limites du mouvement : "l'autonomie" des entreprises permettant à celles-ci de fixer le prix du charbon et de vendre sur le marché intérieur et mondial ce qui n'aura pas été prélevé par l'Etat. De la même façon que, en 1980, la constitution d'un syndicat "libre" en Pologne était un piège qui s'est rapidement refermé sur la classe ouvrière, cet "acquis", la fixation des prix du charbon par les entreprises, va très vite se transformer en un moyen de renforcer l'exploitation des mineurs et de provoquer des divisions entre eux et les autres secteurs du prolétariat qui devront payer plus cher le charbon cour se chauffer. Ainsi, les combats considérables des ouvriers des mines en URSS constituent aussi, au même titre que ceux de Pologne en 80, une illustration de la faiblesse politique du prolétariat des pays de l'Est Dans cette partie du monde, malgré tout le courage et toute la combativité qu'elle est amenée à manifester face à des attaques d'une ampleur sans précédent, la classe ouvrière est encore extrêmement vulnérable face aux mystifications bourgeoises syndicalistes, démocratiques, nationalistes et même religieuses (si on prend le cas de la Pologne). Enfermés pendant des décennies dans le silence par la terreur policière, les ouvriers de ces pays manquent cruellement d'expérience face à ces mystifications et ces pièges. De ce fait, les convulsions politiques qui régulièrement secouent ces pays, et qui les secoueront de plus en plus, sont la plupart du temps retournées contre leurs luttes, comme on a pu le voir en Pologne où l'interdiction de Solidarnosc entre 81 et 89 a servi à lui redorer un blason terni par ses nombreuses interventions comme "pompier social". C'est ainsi également que les revendications "politiques" des mineurs en URSS (démission des cadres locaux du parti, nouvelle constitution, etc.), ont pu être utilisées par la politique actuelle de Gorbatchev.
C'est pour ces raisons que les luttes qui se sont déroulées cet été en URSS constituent un appel à l'ensemble du prolétariat mondial, et particulièrement à celui des métropoles du capitalisme, là où sont concentrés ses bataillons les plus puissants et expérimentés. Ces luttes témoignent de la profondeur, de la force et de l'importance des combats actuels de la classe. En même temps, elles mettent en évidence toute la responsabilité du prolétariat de ces métropoles : seul son affrontement contre les pièges les plus sophistiqués que peut semer sur son chemin la bourgeoisie la plus forte et expérimentée du monde, seule la dénonciation par et dans la lutte de ces pièges permettra aux ouvriers des pays de l'Est de combattre victorieusement ces mêmes pièges. Les combats ouvriers qui se sont déroulés cet été aux Etats-Unis, dans la première puissance mondiale, au même moment que ceux qui secouaient la deuxième puissance, combats qui ont mobilisé plus de cent mille ouvriers dans les hôpitaux, les télécommunications et l'électricité, font la preuve que ce prolétariat des pays centraux poursuit son chemin sur cette voie. De même, la très forte combativité ouvrière qui s'est exprimée pendant plusieurs mois en Grande-Bretagne, notamment dans les transports et dans les docks, en se heurtant au sabotage syndical mis en place par la bourgeoisie la plus forte du monde sur le plan politique, constitue une autre étape de ce chemin.
FM, 7/9/89.
[1] [134] Sur la question de la crise économique voir la résolution sur la situation internationale du 8ème congrès du CCI ainsi que sa présentation.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [89]
Questions théoriques:
- Guerre [135]
Le 8eme congres international du CCI : les enjeux du congres
- 2415 reads
Le Courant Communiste International vient de tenir son 8ème congrès. Outre la présence de délégations des dix sections du CCI, des délégués du Grupo Proletario Internacionalista (GPI) du Mexique et de Communist Intemationalist (CI) d'Inde ont participé aux travaux du congrès. A travers leur participation active et enthousiaste, c'est de la périphérie du capitalisme, là où la lutte du prolétariat est la plus difficile, là où les conditions d'une activité militante communiste sont les plus défavorables, qu'est venu un souffle nouveau d'énergie et de confiance qui a animé toutes nos discussions et donné le ton au congrès. La délégation du GPI était mandatée pour poser l'adhésion des militants du groupe à notre organisation, adhésion que le congrès a discuté et accepté dès son ouverture. Nous y reviendrons plus loin. Ce congrès s'est tenu au moment où l'histoire s'accélère considérablement.
Le capitalisme conduit l'humanité à la catastrophe. Les conditions d'existence de l'immense majorité des êtres humains sont chaque jour plus dramatiques, les émeutes et les révoltes de la faim se multiplient, l'espérance de vie diminue pour des milliards d'hommes, les catastrophes de tout ordre causent des milliers de victimes, et les guerres des millions.
La situation de la classe ouvrière dans le monde, y compris dans les pays riches et développés de l'hémisphère nord, se dégrade constamment elle aussi, le chômage croît, les salaires baissent, les conditions de travail et de vie empirent. La classe ouvrière ne reste pas passive face à cela et, en essayant de résister pas à pas aux attaques économiques qui lui sont portées, elle développe ses luttes, son expérience et sa conscience. La dynamique de développement des luttes ouvrières s'est trouvée confirmée encore dernièrement par les grèves massives qui ont eu lieu cet été en Grande-Bretagne et en URSS. A 1’Ouest comme à l'Est, le prolétariat international lutte contre le capital.
Les enjeux sont clairs : le capitalisme nous mène à la chute encore plus brutale dans la catastrophe économique et dans la 3ème guerre mondiale. Seule la résistance du prolétariat, le développement de ses luttes, empêchent aujourd'hui, et peuvent empêcher demain, le déchaînement de l'holocauste généralisé et dégager pour l'humanité la perspective révolutionnaire du communisme.
Nous n'allons pas entrer ici dans les débats que nous avons menés au congrès sur la situation internationale. Nous renvoyons le lecteur à la résolution adoptée par le congrès et à sa présentation publiées dans ce numéro de la Revue Internationale. Disons simplement que le congrès devait confirmer la validité de nos orientations précédentes et leur accélération sur les trois volets de la situation internationale : crise économique, conflits inter-impérialistes, et lutte des classes. Il a permis de réaffirmer la validité et l'actualité de l'existence d'un cours historique vers des affrontements de classes : les dernières années n'ont pas vu la remise en cause de cette perspective ; le prolétariat, malgré ses faiblesses et ses difficultés, n'a pas subi de défaite majeure provoquant le renversement de ce cours historique et le cours à la guerre mondiale reste barrée pour le capitalisme. Plus précisément, le congrès devait confirmer la réalité et la continuation de la vague de luttes ouvrières qui se développe depuis 1983 au niveau international face aux mensonges et à la propagande de la bourgeoisie, face aux doutes, aux hésitations, au manque de confiance, et au scepticisme régnant actuellement parmi les groupes du milieu politique prolétarien.
Le GPI et CI se sont constitués autour, et sur nos analyses générales de la période actuelle, et en particulier, sur la reconnaissance du cours historique vers des affrontements de classes. Les interventions du délégué d'Inde et des nouveaux militants du CCI au Mexique se sont donc intégrées tout à fait dans la réaffirmation et la manifestation par l'ensemble du congrès de notre confiance dans la lutte du prolétariat, dans ses luttes actuelles. Là résidait un des enjeux du congrès. La résolution adoptée répond clairement à cet enjeu. Comme on peut le voir à sa lecture, le congrès a su aller plus loin encore dans la clarification des différentes caractéristiques de la période présente, et il a décidé d'ouvrir une discussion sur le phénomène de la décomposition sociale.
LA DEFENSE ET LE RENFORCEMENT DE L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE.
C'est dans le cadre de cette compréhension générale des enjeux historiques actuels que les organisations révolutionnaires qui sont à la fois le produit et aussi partie prenante des combats menés par le prolétariat mondial, doivent se mobiliser, se préparer et participer à la lutte historique de leur classe. Le rôle qui leur échoit est essentiel : sur la base de la compréhension la plus claire possible de la situation actuelle et de ses perspectives, il leur revient d'assumer dès aujourd'hui le combat politique d'avant-garde dans les luttes ouvrières.
Pour cela, les perspectives d'activités pour notre organisation que le congrès a dégagées, forment un tout avec l'analyse et la compréhension de la période historique actuelle. Après avoir tiré un bilan positif du travail militant accompli depuis le 7ème congrès, la résolution adoptée sur les activités réaffirme notre orientation précédente :
"Les activités du CCI pour les deux ans qui viennent doivent se mener en continuité avec les tâches entreprises depuis la reprise des combats de classe en 1983, tracées lors des deux précédents congrès de 1985 et 1987, suivant les priorités de l'intervention dans les luttes ouvrières, de la participation à leur orientation, et un engagement militant plus important, à long terme, face aux perspectives :
- de nouvelles intégrations issues de la vague actuelle de la lutte de classe, en premier lieu la constitution d'une nouvelle section territoriale, un des principaux enjeux à court terme pour le CCI ;
- d'un rôle déplus en plus important de l'organisation dans le processus des luttes ouvrières vers leur unification (...).
Les expériences les plus récentes de l'organisation ont permis en particulier de mettre en évidence plusieurs leçons qui doivent être pleinement intégrées dans les perspectives d'activités:
- la nécessité de mener le combat pour la tenue des assemblées générales ouvertes, qui se donnent dès le début l'objectif de l'élargissement de la lutte, de son extension géographique ;
- la nécessité de revendications unitaires, contre les surenchères démagogiques et les particularismes corporatistes ;
- la nécessité de ne pas être naïfs face à l'action de la bourgeoisie sur le terrain, pour pouvoir faire échec aux manoeuvres de confiscation de la lutte par les syndicats et les coordinations telles qu'elles se développent aujourd'hui ;
- la nécessité d'être au premier rang de l'intervention dans la constitution et l'action des comités de lutte (...)".
Dans la période actuelle, l'intervention dans les luttes ouvrières détermine tous les plans de l'activité d'une organisation révolutionnaire. Pour pouvoir mener à bien les tâches d'intervention, les révolutionnaires doivent pouvoir se doter d'organisations politiques centralisées solides. De tout temps, la question de 1’organisation politique et sa défense a été une question politique centrale. Les organisations communistes subissent la pression de l'idéologie bourgeoise, et aussi celle de la petite-bourgeoisie qui se manifeste par l'individualisme, le localisme, l'immédiatisme, etc., contre l'activité des organisations communistes. Cette pression devient encore plus forte sur les groupes communistes d'aujourd'hui par les effets de la décomposition sociale qui touche la société capitaliste. Comme le souligne la résolution sur les activités adoptée :
"La décomposition de la société bourgeoise, son pourrissement sur pied en l'absence d'une perspective d'issue immédiate exerce sa pression sur le prolétariat et ses organisations politiques (...)."
Cette pression accrue sur les groupes communistes rend la question de la défense de l'organisation révolutionnaire encore plus cruciale. C'est là le second volet de notre discussion au congrès sur les activités. La résolution réaffirme que, face à ce danger, "la force principale du CCI réside dans son caractère international, uni et centralisé". Dans ce sens, le congrès a engagé l'ensemble de l'organisation, des sections et des camarades à renforcer le tissu organisationnel, le travail collectif, à développer la centralisation internationale, à développer la rigueur dans le fonctionnement et l'implication militante. Il s'agit là de contrecarrer les effets particuliers d'aujourd'hui de la décomposition sur les groupes politiques révolutionnaires tels que le localisme, l'individualisme, voir les pratiques manoeuvrières et destructrices.
LA CONSTITUTION DE "REVOLUCION MUNDIAL" COMME NOUVELLE SECTION DU CCI.
Confiance dans la lutte du prolétariat, confiance dans le rôle et l'intervention des révolutionnaires, confiance dans le CCI : tels étaient les enjeux du congrès, avons-nous dit. La présence d'une délégation de CI, la demande d'intégration des camarades du Mexique, leurs interventions durant les débats, étaient l'illustration de leur propre confiance sur ces trois plans, situant les camarades dans la dynamique même du congrès. Au delà des textes, documents et résolutions adoptés, la manifestation la plus concrète de cette confiance par le congrès, fut l'adoption de la résolution d'intégration des camarades du GPI dans le CCI et la constitution d'une nouvelle section au Mexique. En voici les principaux extraits :
1- Produit du développement de la lutte de classe, le Grupo Proletario Internacionalista est un groupe communiste qui s'est constitué -avec la participation active du CCI- sur la base des positions politiques principielles du CCI et de ses orientations générales, en particulier celle de l'intervention dans la lutte des classes. (...)
2- Le 1er congrès du GPI a vu la ratification par tous ses militants (...) des positions politiques de classe développées par le groupe. En étroite relation avec le CCI, il a ouvert un processus de réappropriation et de clarification politiques, et dégagé les lignes principales pour l'établissement d'une présence politique conséquente du groupe au Mexique.
3- Un an plus tard, le 2ème congrès du GPI - ainsi que le CCI
- a tiré un bilan positif de ce processus de clarification politique. Le groupe a su en effet :
- prendre connaissance, se confronter et prendre position sur les différents courants et groupes du milieu politique prolétarien ;
- défendre les positions programmatiques, théoriques et politiques du CCI ;
- développer les mêmes orientations d intervention dans les luttes ouvrières et le milieu politique prolétarien que le CCI ;
- assumer une présence politique tant au niveau local qu'international ;
- avoir une vie politique interne vivante, intense et fructueuse.
4- C'est avec succès que le 2ème congrès du GPI a affronté et dépassé les faiblesses conseillistes du groupe qui s'étaient exprimées dans le processus de clarification politique :
- au plan théorique, par l'adoption unanime d'une position correcte sur la question de la conscience de classe et du parti ;
- au plan politique, par la demande unanime d'ouverture d'un processus d'intégration dans le CCI de ses militants que le (CCI) a accueillie favorablement.
5- Sept mois plus tard, le Sème congrès du CCI tire un bilan positif de ce processus d'intégration. C'est à l'unanimité que les camarades du GPI se sont prononcés en accord avec la Plate-forme du CCI et ses statuts après des débats approfondis. Par ailleurs, le GPI a maintenu les tâches d'une véritable section du CCI depuis l'ouverture de ce processus par une correspondance régulière et fréquente, des prises de position dans les débats du CCI, l'intervention dans la lutte de classes, la publication régulière de Revolucion Mundial
6- Le 8ème congrès du CCI (...), conscient des difficultés d'intégration pour l'organisation d'un ensemble de militants dans un pays relativement isolé, estime donc que le processus de rapprochement et d'intégration des camarades du GPI avec le CCI touche à son terme. En conséquence, le congrès se prononce pour l'intégration des militants du GPI dans l'organisation et leur constitution en section du CCI au Mexique."
Après la décision du congrès, la délégation, comme le précisait son mandat fixé par le GPI, a déclaré dissout ce dernier. A partir de ce moment, bien évidemment, les délégués sont intervenus dans le congrès comme délégués de la nouvelle section au Mexique, Revolucion Mundial, comme membres à part entière du CCI. Par le haut niveau de clarté politique qui s'est exprimé dans la préparation au congrès et dans la participation énergique et importante de sa délégation, la constitution de la section manifeste un renforcement considérable du CCI au niveau politique et au niveau de sa présence consolidée sur le continent américain.
UN RENFORCEMENT DU MILIEU POLITIQUE PROLETARIEN.
Cette dynamique de clarification politique, vers l'engagement militant, de regroupement, en particulier avec le CCI, n'est pas le seul fait des camarades de RM. A l'issue du congrès, le délégué de CI, groupe avec lequel nous sommes en étroit contact depuis plusieurs années, a posé sa candidature à notre organisation, candidature que nous avons acceptée. Cette intégration et la publication de Communist Internationalist comme organe du CQ en Inde signifie la perspective d'une présence politique, d'une douzième section de notre organisation, dans un pays et sur un continent, l'Asie, où les forces révolutionnaires sont pratiquement inexistantes, et où le prolétariat, malgré une grande combativité comme en Inde justement, est peu concentré et a peu d'expérience historique et politique. A vrai dire, ce processus de rapprochement et d'intégration au CCI n'est pas propre aux pays de la périphérie. Nous constatons, et nous y participons aussi, un renouveau des contacts et une dynamique vers l'engagement militant en Europe même, là où le CCI, et les principaux groupes et courants communistes, sont déjà présents.
Soyons clairs : même si ces intégrations et cette dynamique au renforcement militant nous enthousiasment, il ne s'agit pas pour nous de faire ici du triomphalisme. Nous sommes bien trop conscients des enjeux historiques, des difficultés du prolétariat et des faiblesses des forces révolutionnaires.
Pour le CCI qui, depuis sa fondation, a toujours revendiqué et travaillé afin d'assumer les tâches d'un véritable pôle international de référence et de regroupement politiques, ces nouvelles adhésions sont un succès. Elles sont la confirmation de la justesse de ses positions politiques, valables aussi bien dans les pays développés que de la périphérie, sur tous les continents, et de l'orientation de son intervention en direction du milieu politique prolétarien. Mais aussi, et nous en sommes extrêmement conscients, elles nous posent des responsabilités accrues : d'une part, réussir complètement ces intégrations et, d'autre part, une plus grande responsabilité militante encore face au prolétariat mondial.
Le surgissement d'éléments et de groupes politiques dans les pays de la périphérie (Inde, Amérique Latine), l'apparition d'une nouvelle génération de militants, sont le produit de la période historique, le produit des luttes ouvrières d'aujourd'hui. C est d'ailleurs, nous l'avons vu, essentiellement sur la reconnaissance plus ou moins claire du cours historique vers des affrontements de classes, de la réalité de la vague de luttes actuelles que ces éléments et groupes se constituent.
La question du cours historique est la question centrale qui "sépare" les groupes du milieu politique prolétarien. Au delà des différences programmatiques existantes, c'est elle qui détermine aujourd'hui la dynamique dans laquelle se situent les différents courants et groupes : soit vers l'intervention dans les luttes, dans le milieu révolutionnaire, vers la discussion et la confrontation politiques, et, à son terme, le regroupement ; soit le scepticisme devant les luttes, le refus et la peur de l'intervention, le repli sectaire, la dispersion, le découragement et la sclérose.
La reconnaissance du développement des luttes ouvrières, et la volonté d'intervention des révolutionnaires en leur sein, est à la base de la capacité des groupes révolutionnaires à faire face aux responsabilités qui sont les leurs : dans les luttes ouvrières elles-mêmes bien sûr ; mais aussi face aux éléments et groupes qui surgissent de par le monde; face à la nécessité de développer des organisations centralisées et militantes pouvant jouer un rôle de référence et de regroupement.
Le renforcement du CCI représente, à notre avis, un renforcement de tout le milieu politique prolétarien. Ce sont les premiers regroupements, réels et significatifs, depuis une décennie, en fait depuis la constitution de la section du CCI en Suède. Ils marquent un coup d'arrêt à la multiplication des scissions, à la dispersion et à la perte de forces militantes. Pour tous les groupes politiques prolétariens, pour tous les éléments révolutionnaires qui surgissent, ce doit être un élément de confiance dans la situation actuelle et d'appel au sérieux et à la responsabilité militante.
L'HISTOIRE ACCELERE SUR TOUS LES PLANS.
Par la réaffirmation de sa confiance dans les luttes ouvrières actuelles, sa conviction dans leur développement au cours de la période qui vient, par la réaffirmation de l'orientation vers l'intervention dans ces luttes, par le renforcement encore du cadre centralisé et international du CCI en vue de sa défense, par l'intégration de nouveaux camarades et la constitution d'une nouvelle section "Revolucion Mundial" et la publication de Communist Intemationalist, nous pouvons d'ores et déjà tirer un bilan positif du 8ème congrès du CCI, véritable congrès "mondial avec la participation de camarades d'Europe, d'Amérique et d'Asie.
L'histoire s'accélère.
C'est dans ce cadre historique que le congrès a réussi à se situer. Le 8ème congrès du CCI aura été à la fois un produit de cette accélération de l'histoire, et n'en doutons pas, un moment et un facteur de celle-ci.
"Dans les épreuves de l'histoire, les tâches du prolétariat moderne sont aussi gigantesques que ses erreurs. Il n'existe pas de schéma préalable, valable une fois pour toutes, pas de guide infaillible pour lui montrer les voies sur lesquelles il doit s'engager. Il n'a d'autre maître que l'expérience historique. Le chemin de croix de sa libération n'est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d'erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l'atteindra s'il sait tirer enseignement de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l'autocritique, une autocritique impitoyable, cruelle, allant jusqu'au bout des choses, c'est l'air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre."
Rosa Luxemburg. La crise de la social-démocratie.
"Ce n'est qu'en période révolutionnaire, où les fondements sociaux et quand les murailles de la société de classes se lézardent et se disjoignent continuellement, que toute action politique de classe entamée par le prolétariat peut, en quelques heures, arracher à leur immobilité des couches de la classe ouvrière, jusque là inertes."
Rosa Luxemburg, Grève de masses, parti et syndicats, 1906.
Conscience et organisation:
8ème Congrès du CCI : la situation internationale
- 2950 reads
PRESENTATION DE LA RESOLUTION
Nous publions dans ce numéro la résolution sur la situation internationale adoptée par le 8ème Congrès du CCI. Cette résolution se base sur un rapport très détaillé dont la longueur ne nous permet pas de le publier dans ce numéro de la Revue. Cependant, compte tenu du caractère synthétique de cette résolution, nous avons estimé utile de la faire précéder par des extraits, non du rapport lui-même, mais de la présentation qui en a été faite au Congrès-même, extraits que nous avons accompagnés d'un certain nombre de données prélevées dans le rapport.
Habituellement, le rapport pour un congrès tend compte de l'évolution de la situation depuis le congrès précédent. En particulier, il examine dans quelle mesure les perspectives qui avaient été dégagées deux ans auparavant se sont vérifiées. Pour sa part, le présent rapport ne se contente pas de prendre en compte les deux dernières années. Il se propose de faire un bilan pour l'ensemble des années 80, celles que nous avons appelées "les années de vérité".
Pourquoi un tel choix ?
Parce qu'au début de la décennie, nous avions annoncé que celle-ci allait représenter tout un tournant dans l'évolution de la situation internationale. Un tournant entre :
- une période où la bourgeoisie avait encore tenté de masquer à la classe ouvrière -et à elle-même- la gravité des convulsions de son système ;
- et une période où ces convulsions allaient atteindre un tel niveau, qu'elle ne pourrait plus cacher comme auparavant l'impasse où se trouve le capitalisme, une période où cette impasse s'afficherait toujours plus aux yeux de l'ensemble de la société.
Cette différence entre ces deux périodes devait évidemment se répercuter sur tous les aspects de la situation mondiale. Elle devait en particulier souligner le niveau des enjeux présents des combats de la classe ouvrière.
Pour le présent Congrès, qui est le dernier congrès des années 80, il était donc important de vérifier la validité de cette orientation générale que nous avions adoptée il y a dix ans. Il importait notamment de mettre en évidence qu'à aucun moment cette orientation n'avait été démentie, en particulier face aux doutes et fluctuations qui peuvent exister dans l'ensemble du milieu politique prolétarien et qui tendent à sous-estimer les enjeux de la période présente, et particulièrement l'importance des combats de la classe ouvrière.
Quels sont les points qu'il convient de souligner particulièrement pour ce Congrès ?
SUR LA CRISE ECONOMIQUE
Il est indispensable que le congrès parvienne à une pleine clarté sur ce sujet. En particulier, avant même de dégager les perspectives catastrophiques de l'évolution du capitalisme dans les années qui viennent, il importe de mettre en évidence toute la gravité de la crise telle qu'elle s'est déjà manifestée jusqu'à présent.
Pourquoi est-il nécessaire de faire un tel bilan ?
1°) Pour une première raison évidente : notre capacité à dégager les perspectives futures du capitalisme dépend étroitement de la validité du cadre d'analyse que nous nous sommes donné pour analyser la situation passée.
2e) Parce que, et c'est également une évidence, de l'évaluation correcte de la gravité actuelle de la crise dépend, pour une large part, notre capacité à nous prononcer sur les réels enjeux et potentialités des luttes présentes de la classe ouvrière, notamment face aux sous-estimations qui existent dans le milieu politique.
3°) Parce qu'il a pu exister, dans l'organisation, des tendances à sous-estimer la gravité réelle de l'effondrement de l'économie capitaliste en se basant de façon unilatérale sur l'évolution des indicateurs fournis habituellement par la bourgeoisie tels que le "Produit National Brut" ou le volume du marché mondial.
Une telle erreur peut être très dangereuse. Elle pourrait nous conduire à nous enfermer dans une vision similaire à celle de Vercesi ([1] [136]), à la fin des années 30, qui prétendait que le capitalisme avait désormais surmonté sa crise. Cette vision se basait sur l'accroissement des chiffres bruts de la production sans se préoccuper DE QUOI était faite cette production (en réalité, principalement des armements) ni se demander QUI allait la payer.
C'est justement pour cette raison que le rapport, de même que la résolution, base son appréciation de l'aggravation considérable de la crise capitaliste tout au long des années 80, non pas tant sur ces chiffres (qui eux semblent indiquer une "croissance", en particulier ces dernières années) mais sur toute une série d'autres éléments qui, pris ensemble, sont beaucoup plus significatifs. Il s'agit des éléments suivants :
- l'accroissement vertigineux de l'endettement des pays sous-développés, mais aussi de la première puissance mondiale de même que des administrations publiques de tous les pays ;
- la progression continue des dépenses d'armement, mais également de l'ensemble des secteurs improductifs tels que, par exemple, le secteur bancaire, et cela au détriment des secteurs productifs (production de biens de consommation et de moyens de production) ;
- l'accélération du processus de désertification industrielle qui fait disparaître des pans entiers de l'appareil productif et jette dans le chômage des millions d'ouvriers ;
- l'énorme aggravation du chômage tout au long des années 80 et, plus généralement, le développement considérable de la lunpénisation absolue au sein de la classe ouvrière des pays es plus avancés ;
Sur ce point, il vaut la peine de faire un commentaire pour dénoncer les campagnes actuelles de la bourgeoisie sur l'idée que la situation serait en train de s'améliorer aux Etats-Unis. Les chiffres que donne le rapport soulignent le réel appauvrissement de la classe ouvrière dans ce pays. Mais il faut attirer l'attention du Congrès sur le rapport adopté par la section des USA lors de sa dernière conférence (voir Supplément au n°64 d’Internationalism). Ce dernier rapport met clairement en évidence que les chiffres bourgeois sur le prétendu recul du chômage au niveau de celui des années 70 essaient en réalité de masquer une aggravation tragique de la situation : en fait le taux réel du chômage est environ trois fois supérieur au taux officiel.
- enfin une des manifestations fondamentales de l'aggravation des convulsions de l'économie capitaliste est constituée par une nouvelle aggravation des calamités qui frappent les pays sous-développés, la malnutrition, les famines qui font toujours plus de victimes, des calamités qui ont transformé ces pays en un véritable enfer pour des milliards d'êtres humains.
En quoi faut-il considérer ces différents phénomènes comme des manifestations très significatives de l'effondrement de l'économie capitaliste ?
Pour ce qui concerne l'endettement généralisé, nous avons là une expression claire des causes profondes de la crise capitaliste : la saturation générale des marchés. Faute de réels débouchés solvables, à travers lesquels pourrait se réaliser la plus-value produite, la production est écoulée en grande partie sur des marchés fictifs.
On peut prendre trois exemples :
1°) Pendant les années 70, on a assisté à une augmentation sensible des importations des pays sous-développés. Les marchandises achetées provenaient principalement des pays avancés, ce quia permis de relancer momentanément la production dans ces pays. Mais comment étaient payés ces achats ? Par des emprunts contractés par les pays sous-développés acheteurs auprès de leurs fournisseurs (voir tableau 1). Si les pays acheteurs payaient réellement leurs dettes, alors on pourrait considérer que ces marchandises ont été réellement vendues, que la valeur qu'elles contenaient a été effectivement réalisée. Mais nous savons tous que ces dettes ne seront jamais remboursées ([2] [137]). Cela signifie que, globalement, ces produits ont été vendus non pas contre un paiement réel, mais contre des promesses de paiement, des promesses qui ne seront jamais tenues. Nous disons globalement, parce que, pour leur part, les capitalistes qui ont effectué ces ventes peuvent avoir été payés. Mais cela ne change pas le fond du problème. Ce que ces capitalistes ont encaissé avait été avancé par des banques ou des Etats qui, eux, ne seront jamais remboursés. C'est bien là que réside la signification profonde de toutes les négociations actuelles (désignées par le terme de "plan Brady") visant à réduire de façon significative l'endettement d'un certain nombre de pays sous-développés, à commencer par le Mexique (pour éviter que ces pays ne se déclarent ouvertement en faillite et cessent tout remboursement). Ce "moratoire" sur une partie des dettes veut dire qu'il est officiellement prévu, dès à présent, que les banques ou les pays prêteurs ne récupéreront pas la totalité de leur mise.
2°) Un autre exemple est celui de l'explosion de la dette extérieure des Etats-Unis. En 1985, pour la première fois depuis 1914, ce pays est devenu débiteur vis à vis du reste du monde. C'était un événement considérable, d'une importance au moins équivalente au premier déficit commercial de ce pays depuis la première guerre mondiale en 1968 et, en 1971, à la première dévaluation du dollar depuis 1934. Le fait que la première puissance économique de la planète, après avoir été pendant des décennies le financier du monde, se retrouve dans un situation digne d'un quelconque pays sous-développé ou d'une puissance de second ordre, comme par exemple la France, en dit long sur l'état de dégradation de l'ensemble de l'économie mondiale et traduit un degré supplémentaire dans l'effondrement de celle-ci.
Fin 1987, la dette extérieure nette (total des dettes moins total des créances) des Etats-Unis se montait déjà à 368 milliards de dollars (soit 8,1% du PNB). Le champion du monde de la dette extérieure n'était donc plus le Brésil : l'Oncle Sam faisait déjà trois fois mieux. Et la situation n'est pas près de s'arranger dans la mesure où le principal responsable de cet endettement, le déficit de la balance commerciale se maintient à des niveaux considérables. D'ailleurs, même si ce déficit se résorbait miraculeusement, la dette extérieure américaine ne cesserait de s'accroître dans la mesure où, comme un quelconque pays d'Amérique latine, les Etats-Unis devraient continuer à emprunter pour être en mesure de verser les intérêts et rembourser le principal de leur dette. De plus, le solde du revenu des investissements américains à l'étranger et des investissements étrangers aux Etats Unis, qui était encore positif de 20,4 milliards de dollars en 1987, ce qui limitait les conséquences financières du déficit de la balance commerciale, est devenu négatif en 1988 et poursuivra son effondrement dans les années suivantes (voir le tableau 2).
Sur la base de ces projections, la dette extérieure des Etats-Unis est donc destinée à s'accroître de façon très importante dans l'avenir : elle devrait atteindre 1000 milliards de dollars en 1992 et 1400 milliards de dollars en 1997. Ainsi, au même titre que la dette des pays sous-développés, la dette américaine n'a pas la moindre perspective de remboursement.
3°) Le dernier exemple est celui des déficits budgétaires, de l'accumulation des dettes de tous les Etats à un niveau astronomique (voir les tableaux 3 et 4). Nous avons déjà mis en évidence, lors des précédents congrès, que ce sont en grande partie ces déficits, et particulièrement le déficit fédéral des Etals-Unis, qui ont permis une relance timide de la production à partir de 83. C'est de nouveau le même problème. Ces dettes, elles non plus, ne seront jamais remboursées, sinon contre de nouvelles dettes encore plus astronomiques (le tableau 3 met ainsi en évidence que le simple intérêt de ces dettes dépasse déjà largement les 10% des dépenses de l'Etat dans la plupart des pays avancés : ce poste est en passe de devenir le premier dans les budgets nationaux). Et la production achetée par ces déficits, principalement des armements d'ailleurs, ne sera, elle non plus, jamais réellement payée.
En fin de compte, pendant des années, une bonne partie de la production mondiale n'a pas été vendue mais tout simplement donnée. Cette production, qui peut correspondre à des biens réellement fabriqués, n'est donc pas une production de valeur, c'est-à-dire la seule chose qui intéresse le capitalisme. Elle n'a pas permis une réelle accumulation de capital. Le capital global s'est reproduit sur des bases de plus en plus étroites. Pris comme un tout, le capitalisme ne s est donc pas enrichi. Au contraire, il s'est appauvri.
Et le capitalisme s'est appauvri d'autant plus qu'on a vu s'accroître à des niveaux ahurissants la production d'armements, de même d'ailleurs que l'ensemble des dépenses improductives (voir tableau 5).
Les armes ne doivent pas être comptabilisées avec un signe "plus" dans le bilan général de la production mondiale, mais au contraire avec un signe "moins". Car contrairement à ce que Rosa Luxemburg avait pu écrire en 1912, dans "L'accumulation du capital", et à ce qu'affirmait Vercesi à la fin des années 30, le militarisme n'est nullement un champ d'accumulation pour le capital. Les armes peuvent enrichir les marchands de canons mais nullement le capitalisme comme un tout puisqu’elles ne peuvent pas s'incorporer dans un nouveau cycle de production. Au mieux, quand elles ne servent pas, elles constituent une stérilisation de capital. Et quand elles servent, elles aboutissent à une destruction de capital.
Ainsi, pour se faire une idée véritable de l'évolution de l'économie mondiale, pour rendre compte de la valeur réellement produite, il faudrait retrancher des chiffres officiels sensés représenter la production (indicateurs du PNB par exemple) les chiffres de l'endettement de la période considérée, de même que les chiffres correspondant aux dépenses d'armement et à l'ensemble des dépenses improductives. Pour ce qui concerne les Etats-Unis, par exemple, sur la période 1980-87, le seul accroissement de l'endettement de l'Etat est plus élevé que la croissance du PNB : 2,7% du PNB pour l'accroissement de l'endettement contre 2,4% de croissance du PNB en moyenne annuelle. Ainsi, pour la décennie qui s'achève, la seule prise en compte des déficits budgétaires nous indique déjà une régression de la première économie mondiale. Régression qui est bien plus importante dans la réalité, du fait :
l°) des autres endettements (extérieur, entreprises, particuliers, administrations locales, etc.) ;
2°) des énormes dépenses improductives.
En fin de compte, même si nous ne disposons pas des chiffres exacts permettant de calculer au niveau mondial le réel déclin de la production capitaliste, on peut conclure du simple exemple précédent, la réalité de cet appauvrissement global de la société que nous évoquions.
Un appauvrissement considérable au cours des années 80.
C'est uniquement dans ce cadre - et non pas en faisant de la stagnation ou du recul du PNB la manifestation par excellence de la crise capitaliste - que Ton peut comprendre la signification réelle des "taux de croissance exceptionnels" dont s'est félicitée la bourgeoisie ces deux dernières années. En réalité, si l'on retranchait de ces formidables "taux de croissance" affichés par la bourgeoisie tout ce qui est stérilisation de capital et endettement nous aurions une croissance nettement négative. Face à un marché mondial de plus en plus saturé, une progression des chiffres de la production ne peut correspondre qu'à une nouvelle progression des dettes. Une progression encore plus considérable que les précédentes. ,
C'est donc en constatant la réalité d'un réel appauvrissement de l'ensemble de la société capitaliste, une destruction réelle de capital tout au long des années 80, que l'on peut comprendre les autres phénomènes qui sont analysés dans le rapport.
Ainsi la désertification industrielle constitue une illustration flagrante de cette destruction de capital. Le tableau 6 nous donne une idée chiffrée de ce phénomène qui, de façon concrète, se traduit par le dynamitage ou la mise à la casse d'usines à peine construites, par les paysages de désolation, de terrains vagues sordides et de ruines, dans lesquels se sont transformées certaines zones industrielles, et surtout par les licenciements massifs d'ouvriers. Par exemple, ce tableau nous indique qu'aux Etats-Unis, entre 1980 et 1986, les effectifs ont diminué de 1,35 millions dans l'industrie alors qu'ils augmentaient de 3,71 millions dans le secteur du commerce-hôtels-restaurants et de 3,99 millions dans le secteur finances-assurances-affaires. La prétendue "diminution du chômage", dont la bourgeoisie de ce pays fait aujourd'hui ses choux gras, n'a nullement permis une amélioration des capacités productives réelles de l'économie américaine : en quoi la "reconversion" d'un ouvrier qualifié de la métallurgie en vendeur de "hot dogs" est-elle positive pour l'économie capitaliste, sans parler du travailleur lui-même ?
De même, la progression du chômage réel, la paupérisation absolue de la classe ouvrière et la plongée des pays sous-développés dans le dénuement le plus total (dont l'article de la Revue Internationale n°57, "Bilan économique des années 80 : l'agonie barbare du capitalisme", nous donne un tableau impressionnant) sont les manifestations de cet appauvrissement global du capitalisme, de l'impasse historique de ce système ([3] [138]), un appauvrissement que la classe dominante fait payer aux exploités et aux masses misérables.
C'est pour cela que la prétendue "croissance" dont se vante la bourgeoisie depuis 83 a été accompagnée d'attaques sans précédent contre la classe ouvrière. Ces attaques ne sont évidemment pas l'expression d'une "méchanceté" délibérée de la bourgeoisie, mais bien la manifestation de l'effondrement considérable qu'a connu l'économie capitaliste au cours de ces années. Un effondrement dont les tricheries bourgeoises avec les lois du capitalisme, le renforcement des politiques de capitalisme d'Etat à l'échelle des blocs, la fuite en avant dans l'endettement, ont permis qu'il n'apparaisse de façon trop évidente sous la forme d'une récession ouverte.
Une remarque sur cette question de la "récession". Dans un souci de plus grande clarté, la résolution désigne par "récession ouverte" le phénomène de stagnation ou de recul des indicateurs capitalistes eux-mêmes qui mettent ouvertement en évidence la réalité de ce que la bourgeoisie essaye de cacher, et de se cacher : l'effondrement de la production de valeurs. Cet effondrement, pour sa part, et comme l'établit le rapport, se poursuit même dans les moments qualifiés de "reprise" par la bourgeoisie. C'est ce dernier phénomène que la résolution désigne par le terme de "récession".
En conclusion de cette partie sur la crise économique, il faut souligner une nouvelle fois très clairement l'aggravation considérable de la crise du capitalisme, et des attaques contre la classe ouvrière, tout au long des années 80, confirmant sans aucune ambiguïté la validité de la perspective que nous avions tracée il y a dix ans. De même, il faut souligner que cette situation ne pourra que s'aggraver à une échelle encore bien plus considérable dans la période qui vient, du fait de l'impasse totale dans laquelle se trouve le capitalisme aujourd'hui.
SUR LES CONFLITS IMPERIALISTES
Sur cette question, qui n'a pas soulevé de débats importants, la présentation sera très brève et va se résumer à la réaffirmation lapidaire de quelques idées de base :
1°) C'est uniquement en s'appuyant fermement sur le cadre du marxisme que l'on peut comprendre l'évolution réelle des conflits impérialistes : au delà de toutes les campagnes idéologiques, l'aggravation de la crise du capitalisme ne peut conduire qu'à une intensification des antagonismes réels entre les blocs impérialistes.
2°) Manifestation de cette intensification, l'offensive du bloc US, par les succès qu'elle a remportés, permet d'expliquer l'évolution récente de la diplomatie de l'URSS et le désengagement de cette puissance d'un certain nombre de positions qu'elle ne pouvait plus tenir.
3°) Cette évolution diplomatique ne signifie donc nullement que s'ouvre une période d'atténuation des antagonismes entre grandes puissances, bien au contraire, ni que soient éteints, à l'heure actuelle, les conflits qui ont ravagé de nombreux points de la planète ces dernières années. En de nombreux endroits la guerre et les massacres se poursuivent et peuvent s'intensifier d'un jour à l'autre, semant toujours plus de cadavres et de calamités.
4°) Dans les campagnes pacifistes actuelles, un des éléments déterminants est la nécessité pour l'ensemble de la bourgeoisie de masquer à la classe ouvrière les véritables enjeux de la période présente à un moment où se développent ses luttes.
L'EVOLUTION DE LA LUTTE DE CLASSE
Ce que se propose de faire essentiellement la présentation, c'est d'expliciter le bilan global de la lutte de classe au cours des années 80.
Pour donner les grandes lignes d'un tel bilan, pour rendre compte du chemin parcouru, il est nécessaire de voir brièvement où en était le prolétariat au début de la décennie.
Le début des années 80 est marqué par le contraste entre, d'une part, l'affaiblissement de la lutte du prolétariat des grandes concentrations ouvrières des pays avancés du bloc de l'Ouest, en particulier d'Europe occidentale, faisant suite aux grands combats de la seconde vague de luttes en 1978-79 et, d'autre part, les formidables affrontements de Pologne de l'été 80, qui constituent le point culminant de cette vague. Cet affaiblissement de la lutte des bataillons décisifs du prolétariat mondial est dû en grande partie à la politique de la gauche dans l'opposition mise en place par la bourgeoisie dès le début de cette deuxième vague de luttes. Cette nouvelle carte bourgeoise a surpris la classe ouvrière et a, en quelque sorte, brisé son élan. C est pour cela que les combats de Pologne se déroulent dans un contexte général défavorable, dans une situation d'isolement international. C'est une situation qui évidemment facilite d'autant leur dévoiement sur les terrains du syndicalisme, des mystifications démocratiques et nationalistes ; qui facilite par conséquent la brutale répression de décembre 81. En retour, la défaite cruelle subie par le prolétariat en Pologne ne peut qu'aggraver pour un temps la démoralisation, la démobilisation et le désarroi du prolétariat des autres pays. Elle permet en particulier de redorer de façon très sensible le blason du syndicalisme à l'Est et à l'Ouest. C'est pour cela que nous avons parlé de défaite et de recul de la classe ouvrière," non seulement sur le plan de sa combativité, mais aussi sur le plan idéologique.
Cependant, ce recul est de courte durée. Dès l'automne 83, se développe une 3ème vague de luttes, une vague particulièrement puissante qui met en évidence la combativité intacte du prolétariat, et qui se distingue par le caractère massif et simultané des luttes.
Face à cette vague de luttes ouvrières, la bourgeoisie déploie en beaucoup d'endroits une stratégie de dispersion des attaques destinée à émietter les luttes, stratégie accompagnée d'une politique d'immobilisation menée par les syndicats là où ils sont les plus déconsidérés. Mais dès le printemps 86, les combats généralisés du secteur public, en Belgique, de même que la grève des chemins de fer de décembre en France, mettent en évidence les limites d'une telle stratégie du fait même de l'aggravation considérable de la situation économique qui contraint la bourgeoisie à mener des attaques de plus en plus frontales. La question essentielle que posent désormais, et pour toute une période historique, ces expériences de la classe et le caractère même des attaques capitalistes, est celle de l'unification des luttes. C'est-à-dire une forme de mobilisation qui ne se contente pas de la simple extension mais où la classe prendra en main directement celle-ci à travers ses assemblées générales en vue de constituer un front uni face à la bourgeoisie. ([4] [139])
Face à ces nécessités et potentialités de la lutte, il est évident que la bourgeoisie ne reste pas inactive. Elle déploie d'une manière encore plus systématique qu'auparavant les armes classiques de la gauche dans l'opposition :
- la radicalisation des syndicats classiques,
- la mise en avant du syndicalisme de base,
- la politique consistant pour ces organes à prendre les devants afin de mouiller la poudre.
Mais de plus, elle utilise, notamment là où le syndicalisme est le plus déconsidéré, des armes nouvelles telles les coordinations, qui complètent où précèdent le travail du syndicalisme. Enfin, elle utilise en de nombreux pays le poison du corporatisme visant notamment à enfermer les ouvriers dans un faux choix entre "l'élargissement avec les syndicats" et le repliement "auto-organisé" sur le métier.
Cet ensemble de manoeuvres a réussi pour le moment à désorienter la classe ouvrière et à entraver sa marche vers l'unification de ses combats. Cela ne veut pas dire que soit remise en cause la dynamique des luttes ouvrières dans la mesure même où la radicalisation des manoeuvres bourgeoises est, au même titre que toutes les campagnes médiatiques actuelles, pacifistes et autres, un signe du développement des potentialités vers de nouveaux combats de bien plus grande envergure et beaucoup plus conscients.
En ce sens, le bilan global qu'il faut tirer des années 80 est celui, non pas d'une quelconque stagnation de la lutte de classe, mais bien d'une avancée décisive. Cette avancée, elle s'exprime notamment dans le contraste existant entre le début des années 80, qui voit un renforcement momentané du syndicalisme, et la fin de cette période où, comme le disent les camarades de WR, "la bourgeoisie manoeuvre pour imposer des structures "anti-syndicales" dans les luttes de la classe ouvrière".
Le rapport, par ailleurs, explicite le cadre historique dans lequel se développe aujourd'hui la lutte du prolétariat, cadre qui explique le rythme lent de ce développement, de même que les difficultés sur lesquelles s'appuie systématiquement la bourgeoisie pour développer ses manoeuvres. Plusieurs des éléments qui sont avancés avaient déjà été évoqués par le passé (rythme lent -qui aujourd'hui, évidemment, tend à s'accélérer- de la crise elle-même, poids de la rupture organique et inexpérience des nouvelles générations ouvrières). Mais le rapport fait un point particulier sur la question de la décomposition de la société capitaliste, lequel a suscité de nombreux débats dans l'organisation.
L'évocation de cette question était indispensable à plusieurs titres :
1°) D'une part, ce n'est que récemment que cette question a été clairement mise en évidence et explicitée par le CCI (bien que nous l'ayons déjà identifiée lors des attentats terroristes de Paris à l'automne 86).
2°) Il importait d'examiner dans quelle mesure un phénomène qui affecte les organisations révolutionnaires (et qui est particulièrement souligné dans le rapport d'activités) pèse également sur la classe dont ces organisations constituent l'avant garde.
La présentation ne reviendra pas sur ce qui est dit dans le rapport. Nous nous bornerons à mettre en avant les points suivants :
1°) Depuis déjà longtemps, le CCI a mis en évidence le fait que les conditions objectives dans lesquelles se développent aujourd'hui les luttes ouvrières (l'enfoncement du capitalisme dans sa crise économique qui touche simultanément tous les pays) sont bien plus favorables au succès de la révolution que celles qui se trouvaient à l'origine de la première vague révolutionnaire (la 1ère guerre impérialiste).
2°) De même, nous avons montré en quoi les conditions subjectives étaient également plus favorables dans la mesure où il n'existe pas aujourd'hui de grands partis ouvriers, comme les partis socialiste, dont la trahison au cours même de la période décisive pourrait, à l'image du passé, désarçonner le prolétariat.
3°) En même temps, nous avons également mis en évidence les difficultés spécifiques et les entraves que rencontre la vague historique actuelle des combats de classe : le poids de la rupture organique, la méfiance vis à vis du politique, le poids du conseillisme (voir en particulier la résolution sur la situation internationale adoptée par le 6ème congrès du CCI).
Il importait donc de mettre en évidence, en simple cohérence avec ce que nous disons sur les difficultés que rencontre l'organisation, que le phénomène de décomposition pèse à l'heure actuelle et pour toute une période d'un poids considérable, qu'il constitue un danger très important auquel la classe doit s'affronter pour s'en protéger et se donner les moyens de le retourner contre le capitalisme.
En prenant conscience de la gravité de cette réalité, il ne s'agit évidemment pas de dire que tous les aspects de la décomposition constituent un obstacle à la prise de conscience du prolétariat. Les éléments objectifs qui mettent clairement en évidence la barbarie totale dans laquelle s'enfonce la société constituent un facteur de dégoût pour ce système et contribuent donc à la prise de conscience du prolétariat. De même, dans la décomposition idéologique, des éléments comme la corruption de la classe bourgeoise ou l'effondrement des piliers classiques de sa domination son également des facteurs de prise de conscience de la faillite du capitalisme. En revanche, tous les éléments de la pourriture idéologique qui pèsent sur l'organisation révolutionnaire pèsent également d'un poids encore plus fort sur l'ensemble de la classe, rendant plus difficile le développement de la conscience et des combats du prolétariat.
De même ce constat ne doit être nullement une source de démoralisation ou de scepticisme.
l°) Tout au long des années 80, c'est malgré ce poids négatif de la décomposition, systématiquement exploité par la bourgeoisie, que le prolétariat a été en mesure de développer ses luttes face aux conséquences de l'aggravation de la crise, laquelle s'est confirmée une nouvelle fois comme la "meilleure alliée de la classe ouvrière" (comme nous l'avons souvent dit).
2°) Le poids de la décomposition constitue un défi qui doit être relevé par la classe ouvrière. C'est aussi dans sa lutte contre cette influence, notamment en renforçant, dans l'action collective, son unité et sa solidarité de classe, que le prolétariat forgera ses armes en vue du renversement du capitalisme.
3°) Dans ce combat contre le poids de la décomposition, les révolutionnaires ont un rôle fondamental à jouer. De la même façon que le constat de ce poids dans nos propres rangs n'est pas fait pour nous démoraliser, mais au contraire pour nous mobiliser, pour renforcer notre vigilance et notre détermination, le constat de cette difficulté que rencontre la classe ouvrière est un facteur de plus grande détermination, conviction et vigilance dans notre intervention au sein de la classe.
Pour conclure cette présentation, nous dirons donc que la discussion sur la situation internationale doit faire ressortir dans nos rangs, non seulement la plus grande clarté, mais aussi :
- la plus grande confiance dans la validité des analyses sur lesquelles s'est formé et développé le CCI, et tout particulièrement la confiance dans le développement du combat de classe vers des affrontements de plus en plus profonds et généralisés, vers une période révolutionnaire ;
- la plus grande détermination à nous montrer à la hauteur des responsabilités que le prolétariat nous a confiées.
RESOLUTION SUR LA SITUATION INTERNATIONALE
1) L'accélération de l'histoire tout au long des années 1980 a mis en relief les contradictions insurmontables du capitalisme. Les années 1980 sont des années de vérité. Vérité de l'approfondissement de la crise économique. Vérité de l'aggravation des tensions impérialistes. Vérité du développement de la lutte de classe.
Face à cette clarification de l'histoire la classe dominante n'a plus que des mensonges à offrir : "croissance", "paix" et "calme social".
LA CRISE ECONOMIQUE
2) Le niveau de vie de la classe ouvrière a subi, durant cette décennie, sa plus forte attaque depuis la guerre :
- développement massif du chômage et de l'emploi précaire ;
- attaques contre les salaires et diminution du pouvoir d'achat;
- amputation du salaire social ;
Tandis que le prolétariat des pays industriels subissait une paupérisation croissante, la majorité de la population mondiale s'est retrouvée à la merci de la famine et du rationnement.
3) La bourgeoisie, contre l'évidence subie dans leur chair par les exploités du monde entier, chante la "croissance" retrouvée de son économie. Cette "croissance" est un mythe.
Cette soi-disant "croissance" de la production a été financée par un recours effréné au crédit et à coups de déficits commerciaux et budgétaires gigantesques des USA, de manière purement artificielle. Ces crédits ne seront jamais remboursés.
Cet endettement a, pour l'essentiel, financé la production d'armement, c'est-à-dire que c'est du capital détruit. Alors que des pans entiers de 1 industrie ont été démantelés, les secteurs à forte croissance sont ceux, donc, de l'armement et de manière générale les secteurs improductif (services : publicité, banques, etc.), ou de pur gaspillage (marché de la drogue).
La classe dominante n'a pu maintenir son illusion d'activité économique que par une destruction de capital. La fausse "croissance" des capitalistes est une vraie récession.
4) Pour parvenir à ce "résultat", les gouvernements ont dû avoir recours aux mesures capitalistes d'Etat à un niveau jamais atteint jusqu'à présent : endettement record, économie de guerre, falsification des données économiques, manipulations monétaires.
Le rôle de l'Etat, contrairement à l'illusion selon laquelle les privatisations représentent un démantèlement du capitalisme d'Etat, s'est renforcé.
Imposée par les USA, la "coopération" internationale s'est développée entre les puissances occidentales participant du renforcement du bloc impérialiste.
5) De son coté, la "perestroïka" constitue la reconnaissance au sein du bloc de l'Est de la faillite de l'économie. Les méthodes capitalistes d'Etat à la russe : l'emprise totale de l'Etat sur l'économie et l'omniprésence de l'économie de guerre, ont eu pour seul résultat une anarchie bureaucratique croissante de la production et un gaspillage gigantesque de richesses. L'URSS et son bloc se sont enfoncés dans le sous-développement économique. La nouvelle politique économique de Gorbatchev n'y changera rien.
A l'Est comme à l'Ouest, la crise capitaliste s'accélère tandis que les attaques contre la classe ouvrière vont en s'intensifiant.
6) Aucune mesure de capitalisme d'Etat ne peut permettre une réelle relance de l'économie, ni même toutes utilisées en semble. Elles sont une gigantesque tricherie par rapport aux lois économiques. Elles ne sont pas un remède, mais un facteur aggravant de la maladie. Leur utilisation massive est le symptôme le plus évident de celle-ci.
En conséquence, le marché mondial a été fragilisé : fluctuation croissante des monnaies, spéculation effrénée, crise boursière, etc., sans que l'économie capitaliste sorte de la récession dans laquelle elle a plongé au début des années 1980.
Le poids de la dette s'est terriblement accru. A la fin des années 1980, les USA, la première puissance mondiale, sont devenus le pays le plus endetté du monde. L'inflation n'a jamais disparu : elle a continué de galoper aux portes des pays industrialisés, et sous la pression inflationniste de l'endettement, elle connaît aujourd'hui une accélération irréversible au coeur du capitalisme développé.
7) Avec la fin des années 1980, les politiques capitalistes d'Etat montrent leur impuissance. Malgré toutes les mesures prises, la courbe de croissance officielle descend irrésistible ment et annonce la récession ouverte à venir et l'indice des prix remonte lentement. L'inflation artificiellement masquée est prête à faire un retour en force au coeur du monde industriel.
Durant cette décennie, la classe dominante a fait une politique de fuite en avant. Cette politique, même employée de plus en plus massivement, montre ses limites. Elle sera de moins en moins efficace immédiatement et les traites sur l'avenir qui ont été tirées, devront être payées. Les années à venir seront des années de plongée encore accélérée dans la crise économique, où l'inflation va se conjuguer toujours plus avec la récession. Malgré le renforcement international du contrôle des Etats, la fragilité du marché mondial va s'accroître et les convulsions vont s'accentuer sur les marchés (financiers, monétaires, boursiers, matières premières) tandis que les faillites vont se développer dans les banques, l'industrie et le commerce.
Les attaques contre le niveau et les conditions de vie du prolétariat et de l'humanité ne pourront donc que s'accentuer à un degré dramatique.
LES TENSIONS INTER-IMPERIALISTES
8) Les années 1980 se sont ouvertes sous les auspices de la chute du régime du Shah en Iran, ayant eu pour conséquence le démantèlement du dispositif militaire occidental au sud de l'URSS, et l'invasion de l'Afghanistan par les troupes de l'Armée rouge.
Cette situation a déterminé le bloc américain, aiguillonné par la crise économique, a lancer une offensive impérialiste de grande envergure visant à consolider son bloc, mettre au pas les petits impérialismes récalcitrants (Iran, Libye, Syrie), à expulser l'influence russe de la périphérie du capitalisme et à l'étouffer dans les limites étroites de son glacis en imposant un quasi-blocus.
Cette offensive vise en dernière instance à retirer à l'URSS son statut de puissance mondiale.
9) Face à cette pression, incapable de soutenir les enchères de la course aux armements et de moderniser ses armes périmées au niveau requis par ces enchères de la course aux armements, incapable d'obtenir une quelconque adhésion de son prolétariat à son effort de guerre comme l'ont montré les événements de Pologne et l'impopularité croissante de l'aventure afghane, l'URSS a dû reculer.
La bourgeoisie russe a su mettre à profit ce recul pour lancer, sous la houlette de Gorbatchev, une offensive diplomatique et idéologique de grande envergure sur le thème de la paix et du désarmement.
Les USA, face au mécontentement croissant du prolétariat au sein de leur bloc ne pouvaient apparaître comme la seule puissance belliciste et ont entonné à leur tour la rengaine de la paix.
10) Commencées sous les diatribes guerrières de la bourgeoisie, les années 1980 se terminent sous le martèlement des campagnes idéologiques sur la paix.
La paix dans le capitalisme en crise est un mensonge. Les paroles de paix de la bourgeoisie servent à camoufler les antagonismes inter-impérialistes et les préparatifs guerriers qui vont en s'intensifiant, à cacher à la classe ouvrière les véritables enjeux historiques, guerre ou révolution, pour empêcher les ouvriers de prendre conscience du lien entre l'austérité et les préparatifs guerriers et endormir la classe dans un faux sentiment de sécurité.
Les traités sur le désarmement n'ont aucune valeur. Les armes mises au rencard ne constituent qu'une infime partie de l'arsenal de mort de chaque bloc et sont, pour l'essentiel, périmées. Et, la tricherie et le secret étant la règle, rien n est réellement vérifiable.
L'offensive occidentale se poursuit tandis que l'URSS essaie de mettre à profit la situation pour rattraper son retard technologique et moderniser son armement et pour se recréer une virginité politique mystificatrice.
La guerre continue en Afghanistan, la flotte occidentale est toujours massée dans le golfe, les armes parlent toujours au Liban, etc. Les budgets de l'armée continuent de grossir, alimentés si besoin est de manière discrète. De nouvelles armes toujours plus destructrices sont mises en chantier pour les 20 ans à venir. Non seulement rien n'a fondamentalement changé malgré tous les discours somnifères, mais encore la spirale guerrière est allée en s'accélérant.
A l'Ouest, les propositions américaines de réductions des troupes en Europe ne sont que l'expression de la pression du chef de bloc sur les puissances européennes pour qu'elles contribuent plus à l'effort de guerre global. Ce processus est déjà en cours avec la formation d'armées "communes", la proposition d'un avion de chasse européen, le renouveau des missiles Lance, le projet Euclide, etc. Derrière la fameuse Europe 1992, il y a une Europe armée jusqu'aux dents pour faire face à l'autre bloc.
Le recul présent du bloc russe est porteur des surenchères militaires de demain. La perspective est au développement des tensions impérialistes, au renforcement de la militarisation de la société et à une décomposition à la "libanaise" particulièrement dans les pays les plus touchés par les conflits inter impérialistes et les pays les moins industrialisés, comme aujourd'hui l'Afghanistan. Ce processus peut connaître, à long terme, de tels développements en Europe si le développement international de la lutte de classe n'est pas suffisant pour y faire obstacle.
11) Alors que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour imposer sa "solution" : la guerre impérialiste généralisée, et que a lutte de classe n'est pas encore suffisamment développée pour permettre la mise en avant de sa perspective révolutionnaire, le capitalisme est entraîné dans une dynamique de décomposition, de pourrissement sur pied qui se manifeste sur tous les plans de son existence :
- dégradation des relations internationales entre Etats manifestée par le développement du terrorisme ;
- catastrophes technologiques et soi-disant naturelles à répétition ;
- destruction de la sphère écologique ;
- famines, épidémies, expressions de la paupérisation absolue qui se généralise ;
- explosion des "nationalités" ;
- vie de la société marquée par le développement de la criminalité, de la délinquance, des suicides, de la folie, de l'atomisation individuelle ;
- décomposition idéologique marquée entre autre par le développement du mysticisme, du nihilisme, de l'idéologie du "chacun-pour-soi", etc..
LA LUTTE DE CLASSE
12) La grève de masse en Pologne a éclairé les années 1980 et posé les enjeux de la lutte de classe pour la période. Le dévoiement de la stratégie bourgeoise de la gauche dans l'opposition en Europe occidentale, le sabotage syndical et la répression par l'armée des ouvriers en Pologne ont déterminé un recul bref mais difficile pour la classe ouvrière au début de la décennie.
La bourgeoisie occidentale a profité de cette situation pour lancer des attaques économiques redoublées (développement brutal du chômage), tout en accentuant sa répression et en menant des campagnes médiatiques sur la guerre destinées à accentuer le recul en démoralisant et terrorisant, et à habituer les ouvriers à l'idée de la guerre.
Cependant, les années 1980 ont, avant tout, été des années de développement de la lutte de classe. A partir de 1983, le prolétariat, sous la pression des mesures d austérité qui tombent en cascade, retrouve internationalement le chemin de la lutte. Face aux attaques massives la combativité du prolétariat se manifeste avec ampleur dans des grèves massives sur tous les continents, et surtout en Europe occidentale, au coeur du capitalisme, là où se trouvent concentrés les bataillons les plus expérimentés de la classe ouvrière mondiale. Ainsi des luttes ouvrières ont éclaté d'un continent à l'autre : Afrique du sud, Corée, Brésil, Mexique, etc...et, en Europe : Belgique 1983, mineurs de Grande-Bretagne 1984, Danemark 1985, Belgique 1986, cheminots en France 1986, Espagne 1987, RFA 1987, enseignants en Italie 1987, hospitaliers en France en 1988, etc.
Cette vérité de la lutte de classe n'est pas celle de la bourgeoisie. De toutes ses forces elle tente de la cacher. La chute statistique des journées de grève par rapport aux années 1970 qui a alimenté les campagnes idéologiques de démoralisation de la classe ouvrière ne rend pas compte du développement qualitatif de la lutte. Depuis 1983, les grèves courtes et massives sont de plus en plus nombreuses, et malgré le black-out sur l'information auquel elles sont soumises la réalité du développement de la combativité ouvrière s'impose peu à peu à tous.
13) La vague de lutte de classe qui se développe depuis 1983 pose la perspective de l'unification des luttes. Dans ce processus, elle se caractérise par :
- des luttes massives et souvent spontanées, liées à un mécontentement général qui touche tous les secteurs,
- une tendance à la simultanéité croissante des luttes,
- une tendance à l'extension comme seule manière d'imposer un rapport de force à la classe dominante soudée derrière son Etat,
- la croissante prise en main des luttes par les ouvriers pour réaliser cette extension contre le sabotage syndical,
- le surgissement des comités de lutte.
Cette vague de lutte traduit non seulement le mécontentement grandissant de la classe ouvrière, sa combativité intacte, sa volonté de lutter mais aussi le développement et l'approfondissement de sa conscience. Ce processus de maturation se concrétise sur tous les aspects de la situation à laquelle se confronte le prolétariat : guerre, décomposition sociale, impasse du capitalisme, etc., mais il se concrétise plus particulièrement sur deux points essentiels, puisqu'ils déterminent le rapport du prolétariat à l'Etat :
- la méfiance par rapport aux syndicats va en se développant, ce qui se traduit internationalement par des confrontations répétées avec les forces d'encadrement et par la tendance à la désyndicalisation ;
- le rejet des partis politiques de la bourgeoisie s'intensifie, comme le concrétisent par exemple les luttes continues pendant les campagnes électorales et l'abstention grandissante aux élections.
14) Loin de la minimisation des médias étatiques, les convulsions sociales sont une préoccupation centrale et permanente de la classe dominante, à l'ouest comme à l'est. Première ment, parce qu'elles interfèrent avec toutes les autres questions à un niveau immédiat, deuxièmement la lutte ouvrière porte en germe la remise en cause radicale de l'état de choses existant.
De même que la préoccupation de la classe dominante s'exprime dans les pays centraux par un développement sans précédent de la stratégie de la gauche dans l'opposition, elle se manifeste aussi :
- dans la volonté des dirigeants américains du bloc occidental de remplacer les "dictatures" caricaturales dans les pays sous leur contrôle par des "démocraties" plus adaptées à faire face à l'instabilité sociale en incluant une "gauche" capable de saboter les luttes ouvrières de l'intérieur (les leçons de l'Iran ont été tirées) ;
- dans celle de l'équipe Gorbatchev qui fait de même dans son bloc au nom de la " glastnost" (là ce sont les leçons de la Pologne).
15) Face au mécontentement de la classe ouvrière, la bourgeoisie n'a rien à offrir sinon toujours plus d'austérité et de répression. Face à la vérité des luttes ouvrières, la bourgeoisie n'a que le mensonge pour pouvoir manoeuvrer.
La crise rend la bourgeoisie intelligente. Face à la perte de crédibilité de son appareil politico-syndical d'encadrement de la classe ouvrière, elle a du utiliser celui-ci de manière plus subtile :
* d'abord, en faisant manoeuvrer sa "gauche" en étroite connivence avec l'ensemble des moyens de l'appareil d'Etat : "droite" repoussoir pour renforcer la crédibilité de la "gauche", médias aux ordres, forces de répression, etc. La politique de gauche dans l'opposition s'est renforcée dans tous les pays, malgré les vicissitudes électorales ;
* ensuite, en adaptant ses organes d'encadrement pour entraver et saboter les luttes ouvrières de l'intérieur :
- radicalisation des syndicats classiques,
- utilisation accrue des groupes gauchistes,
- développement du syndicalisme de base,
- développement de structures en dehors du syndicat, qui prétendent représenter la lutte : coordinations.
16) Cette capacité de manoeuvre de la bourgeoisie est parvenue jusqu'à présent à entraver le processus d'extension et d'unification dont est porteuse la vague présente de lutte de classe. Face à la dynamique vers des luttes massives et d'extension des mouvements, la classe dominante encourage tous les facteurs de division et d'isolement : corporatisme, régionalisme, nationalisme. Face à cette même dynamique la bourgeoisie est prête à lancer des actions préventives afin de pousser la classe ouvrière à lutter dans des conditions défavorables. Dans chaque lutte les ouvriers sont obligés de se confronter à la coalition de l'ensemble des forces de la bourgeoisie.
Cependant, malgré les difficultés qu'elle rencontre, la dynamique de lutte de la classe ouvrière n'est pas brisée. Au contraire, elle se développe. La classe ouvrière a un potentiel de combativité, non seulement intact, mais qui va en se renforçant. Sous l'aiguillon douloureux des mesures d'austérité qui ne peuvent aller qu'en s'intensifiant la classe ouvrière est poussée à la lutte et à la confrontation avec les forces de la bourgeoisie. La perspective est à un développement de la lutte de classe. C'est pourquoi les armes de la bourgeoisie, parce que celles-ci vont être utilisées de plus en plus fréquemment sont destinées à se dévoiler.
17) L'apprentissage que fait le prolétariat de la capacité manoeuvrière de la bourgeoisie est un facteur nécessaire de sa prise de conscience, de son renforcement face à l'ennemi qu'il confronte.
La dynamique de la situation le pousse à imposer sa force par l'extension réelle de ses luttes, c'est-à-dire l'extension géographique contre la division organisée par la bourgeoisie, contre l'enfermement sectoriel, corporatiste ou régionaliste, contre les propositions de fausse extension des syndicalistes et des gauchistes.
Pour mener à bien cet élargissement nécessaire de son combat, la classe ouvrière ne peut compter que sur elle-même et, avant tout, sur ses assemblées générales. Celles-ci doivent être ouvertes à tous les ouvriers et assumer souverainement, par elles-mêmes, la conduite de la lutte, c'est-à-dire en priorité son extension géographique. De ce fait, les assemblées générales souveraines doivent rejeter tout ce qui tend à les étouffer (leur fermeture aux autres ouvriers) et à les déposséder de la lutte (les organes de centralisation prématurée que la bourgeoisie, aujourd'hui, ne se prive pas de susciter et de manipuler, ou pire ceux qu'elle parachute de l'extérieur : coordinations, comités de grève syndicaux, etc.). De cette dynamique dépend l'unification future des luttes.
Le manque d'expérience politique de la génération prolétarienne actuelle, dû à près d'un demi-siècle de contre-révolution, pèse lourdement. Elle est encore renforcée par :
- la méfiance et le rejet de tout ce qui est politique, expression de décennies d'écœurement des manoeuvres politicardes bourgeoises des partis prétendument ouvriers ;
- le poids de la décomposition idéologique environnante sur laquelle s'appuient et s'appuieront de plus en plus les manoeuvres bourgeoises visant à renforcer l'atomisation, le "chacun pour soi", et à saper la confiance croissante de la classe ouvrière en sa propre force et en l'avenir que porte son combat.
De la capacité de la classe ouvrière dans la période présente de renforcer, dans l'action collective, son unité et sa solidarité de classe, de tirer les leçons de ses luttes, de développer son expérience politique dépend sa capacité à surmonter ses faiblesses et à confronter demain l'Etat du capital pour le mettre à bas et ouvrir les portes de l'avenir.
Dans le processus vers l'unification, dans le combat politique pour l'extension contre les manoeuvres syndicales, les révolutionnaires ont un rôle d'avant-garde, déterminant et indispensable à remplir. Ils sont partie intégrante de sa lutte. De leur intervention dépend la capacité de la classe à traduire sa combativité sur le plan du mûrissement de sa conscience. De leur intervention dépend l'issue future.
18) Le prolétariat est au coeur de la situation internationale. Si les années 1980 sont des années de vérité, cette vérité c'est d'abord celle de la classe ouvrière. Vérité d'un système capitaliste qui entraîne l'humanité à sa perte, par la décomposition barbare déjà à l'oeuvre maintenant, et dont la guerre apocalyptique que la bourgeoisie prépare avec toujours plus de folie est l'aboutissement extrême.
Les années 1980 ont posé les enjeux et ses responsabilités au prolétariat : socialisme ou barbarie, guerre ou révolution ! De sa capacité à y répondre dans les années à venir, par la mise en avant de sa perspective révolutionnaire, par et dans sa lutte, dépend l'avenir de l'humanité.
[1] [140] Vercesi était le principal animateur de la Fraction de gauche du Parti communiste d'Italie. Sa contribution politique et théorique dans celle-ci, et dans l'ensemble du mouvement ouvrier, est considérable. Mais à la fin des années 30, il a développé une théorie aberrante sur l'économie de guerre comme solution à la crise qui a désarmé et désarticulé la Fraction face à la seconde guerre mondiale.
[2] [141] D'ailleurs, les "experts" bourgeois eux-mêmes le disent clairement : "Pratiquement plus personne ne pense aujourd'hui que la dette puisse être remboursée, mais les pays occidentaux insistent pour élaborer un mécanisme qui permettrait de dissimuler ce fait et d'éviter des termes aussi durs que cessation de paiement et banqueroute." (W.Pfaff, "International Herald Tribune" du 30-1-89). Ce que l'auteur oublie de préciser, ce sont les causes profondes d'une telle "pudeur". En réalité, pour la bourgeoisie des grandes puissances occidentales, proclamer officiellement la faillite complète de ses débiteurs, c'est reconnaître la faillite de son système financier et, au delà, de l'ensemble de l'économie capitaliste. En fin de compte, la classe dominante ressemble un peu à ces personnages de dessins animés qui continuent de courir alors qu'ils se trouvent déjà au dessus d'un précipice et qui n'y tombent qu'au moment où ils en prennent conscience.
[3] [142] Les famines et la paupérisation absolue de la classe ouvrière, telles que nous les avons vécues ces dernières années, ne sont pas des phénomènes nouveaux dans l'histoire du capitalisme. Mais au delà de l'ampleur qu'elles prennent aujourd'hui (et qui n'est comparable qu'aux situations vécues lors des guerres mondiales), il importe de distinguer ce qui relevait de l'introduction du mode de production capitaliste dans la société (qui s'est faite effectivement "dans la boue et le sang", suivant les termes de Marx, en s'appuyant sur la création d'une armée de miséreux et de mendiants, sur les "workhouses", le travail de nuit des enfants, l'extraction de la plus value absolue...) de ce qui relève de l'agonie de ce mode de production. De même que le chômage ne représente plus aujourd'hui une "armée industrielle de réserve", mais traduit l'incapacité du système capitaliste de poursuivre ce qui constituait une de ses tâches historiques - développer le salariat, le retour des famines et de la paupérisation absolue (après une période où elle avait été remplacée par la paupérisation relative) signe la faillite historique totale de ce système.
[4] [143] Cette analyse est développée dans les rapports et résolutions des précédents congrès publiés dans la Revue Internationale n°35, 44 et 51.
PRE
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [144]
Questions théoriques:
- Guerre [135]
- Le cours historique [145]
- L'économie [57]
Il y a 50 ans : les véritables causes de la 2eme guerre mondiale
- 24500 reads
Le texte que nous publions ci-dessous est une partie du Rapport sur la situation internationale présenté et débattu à la Conférence de la Gauche communiste de France (GCF) qui s'est tenue en juillet 1945 à Paris. Aujourd'hui, quand la bourgeoisie mondiale commémore avec enthousiasme les hauts faits de la victoire de la "démocratie" contre le fascisme hitlérien qui, selon elle, était la seule raison de la 2ème guerre mondiale de 1939-45, il est nécessaire de rappeler à la classe ouvrière, non seulement la vraie nature impérialiste de cette boucherie sanglante qui a fait 50 millions de victimes et a laissé en ruines fumantes tant de pays d'Europe et d'Asie, mais aussi ce qui s'annonçait être la "paix" capitaliste qui allait suivre.
Tel était l'objectif que cette petite minorité de révolutionnaires qu'était la GCF s'était donnée dans cette conférence, en démontrant, contre tous les laquais de la bourgeoisie allant des PS-PC jusqu'aux groupes trotskystes, que, dans le capitalisme dans sa période impérialiste, la "paix" n'est qu'un intervalle entre les guerres, quelle que soit l'étiquette sous laquelle ces guerres se camouflent.
De 1945 à aujourd'hui, les innombrables conflits armés localisés, qui ont déjà fait au moins autant de victimes que la guerre mondiale de 1939-45, la crise économique mondiale qui dure depuis vingt ans, la course effarante aux armements, ont amplement confirmé ces analyses, et plus que jamais reste valable la perspective : lutte de classe du prolétariat débouchant sur la révolution communiste comme seule alternative à la course vers une 3ème guerre mondiale qui mettrait en question la survie même de l'humanité.
RAPPORT SUR LA SITUATION INTERNATIONALE
GAUCHE COMMUNISTE DE FRANCE (juillet 1945, extraits)
I. GUERRE ET PAIX
Guerre et paix sont deux moments d'une même société : la société capitaliste. Elles ne se présentent pas comme des oppositions historiques s'excluant Tune l'autre. Au contraire, guerre et paix en régime capitaliste représentent des moments complémentaires indispensables l'un à l'autre, des phases successives d'un même régime économique, des aspects particuliers et complémentaires d'un phénomène unique.
A l'époque du capitalisme ascendant les guerres (nationales, coloniales et de conquêtes impérialistes) exprimèrent la marche ascendante de fermentation, d'élargissement et de l'expansion du système économique capitaliste. La production capitaliste trouvait dans la guerre la continuation de sa politique économique par d'autres moyens. Chaque guerre se justifiait et payait ses frais en ouvrant un nouveau champ d'une plus grande expansion, assurant le développement d'une plus grande production capitaliste.
A l'époque du capitalisme décadent, la guerre au même titre que la paix exprime cette décadence et concourt puissamment à l'accélérer.
Il serait erroné de voir dans la guerre un phénomène propre négatif par définition, destructeur et entrave du développement de la société, en opposition à la paix, qui, elle, sera présentée comme le cours normal positif du développement continu de la production et de la société. Ce serait introduire un concept moral dans uni cours objectif, économiquement déterminé.
La guerre fut le moyen indispensable au capitalisme lui ouvrant des possibilités de développement ultérieur, à l'époque où ces possibilités existaient et ne pouvaient être ouvertes que par le moyen de la violence. De même le croulement du monde capitaliste ayant épuisé historiquement toutes les possibilités de développement, trouve dans la guerre moderne, la guerre impérialiste, l'expression de ce croulement, qui, sans ouvrir aucune possibilité de développement ultérieur pour la production, ne fait qu'engouffrer dans l'abîme les forces productives et accumuler à un rythme accéléré ruines sur ruines.
Il n'existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix, mais il existe une différence entre les deux phases ascendante et décadente de la société capitaliste et partant une différence de fonction de la guerre (dans le rapport de la guerre et de la paix), dans les deux phases respectives. Si dans la première phase, la guerre a pour fonction d'assurer un élargissement du marché, en vue d'une plus grande production de consommation, dans la seconde phase la production est essentiellement axée sur la production de moyens de destruction, c'est-à-dire en vue de la guerre. La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique - période ascendante -, l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre -période de décadence.
Cela ne signifie pas que la guerre soit devenue le but de la production capitaliste, le but restant toujours pour le capitalisme la production de plus-value, mais cela signifie que la guerre prenant un caractère de permanence est devenue le mode de vie du capitalisme décadent.
Dans la mesure où l'alternative guerre paix n'est pas simplement destinée à tromper le prolétariat, à endormir sa vigilance et à lui faire quitter son terrain de classe, cette alternative n'exprime que le fond apparent, contingent, momentané, servant au regroupement des différentes constellations en vue de la guerre. Dans un monde où les zones d'influences, les marchés d'écoulement des produits, les sources de matières premières et les pays de l'exploitation forcenée de la main d'oeuvre sont définitivement partagés entre les grandes puissances impérialistes, les besoins vitaux des jeunes impéria-lismes les moins favorisés se heurtent violemment aux intérêts des vieux impérialismes les plus favorisés et s'expriment dans une politique belliqueuse et agressive pour obtenir par la force un nouveau partage du monde. Le bloc impérialiste de la "Paix" ne signifie nullement une politique basée sur un concept moral plus humain, mais simplement la volonté des impérialismes repus et favorisés, de défendre par la force leurs privilèges acquis dans les brigandages antérieurs. La "paix" pour eux ne signifie nullement une économie se développant pacifiquement, qui ne peut exister en régime capitaliste, mais la préparation méthodique à l'inévitable compétition armée et l'écrasement impitoyable au moment propice des impérialismes concurrents et antagoniques.
La profonde aversion des masses travailleuses pour la guerre est d'autant plus exploitée qu'elle offre un magnifique terrain de mobilisation pour la guerre contre l'impérialisme adverse... fauteur de guerres.
Entre les deux guerres, la démagogie de la "paix" a servi aux impérialismes anglo-américano-russe de camouflage à leur préparation à la guerre, qu'ils savaient inévitable et à leur préparation idéologique des masses.
La mobilisation pour la paix est du charlatanisme conscient de tous les laquais du capitalisme et dans le meilleur des cas un songe creux, une phrase vide et impuissante, des petits bourgeois se lamentant. Elle désarme le prolétariat en faisant miroiter devant lui l'illusion dangereuse entre toutes d'un capitalisme pacifique.
La lutte contre la guerre ne peut être efficace et avoir un sens qu'en liaison indissoluble avec la lutte de classe du prolétariat, avec la lutte révolutionnaire pour la destruction du régime capitaliste.
A l'alternative mensongère de guerre-paix le prolétariat oppose la seule alternative que pose l'histoire : GUERRE
IMPERIALISTE ou REVOLUTION PROLETARIENNE.
II. LA GUERRE IMPERIALISTE
Le bureau international de la Gauche communiste a commis, l'erreur à la veille de la guerre, de ne voir en celle-ci avant tout qu'une expression directe de la lutte de classe, une guerre de la bourgeoisie contre le prolétariat. Il prétendait nier complètement ou partiellement l'existence des antagonismes inter impérialistes s'exacerbant et déterminant la conflagration mondiale. Partant d'une vérité indéniable de l'inexistence de nouveaux débouchés à conquérir, qui de ce fait rend la guerre inopérante en tant que moyen de résoudre la crise de surproduction, le bureau international aboutissait à la conclusion simpliste et erronée d'après laquelle la guerre impérialiste ne serait plus le produit du capitalisme divisé en Etats antagoniques luttant chacun pour l'hégémonie mondiale. Le capitalisme sera présenté comme un tout unifié et solidaire et ne recourant à la guerre impérialiste que dans le but de massacrer le prolétariat et d'entraver la montée de la révolution.
L'erreur fondamentale dans l'analyse de la nature de la guerre impérialiste se doublait d'une deuxième erreur dans l'appréciation des rapports de forces des classes en présence au moment du déclenchement de la guerre impérialiste.
L'ère des guerres et des révolutions ne signifie pas qu'au développement du cours de la révolution réponde un développement du cours de la guerre. Ces deux cours ayant leur source dans une même situation historique de crise permanente du régime capitaliste, sont toutefois d'essences différentes n'ayant pas des rapports de réciprocité directe. Si le dé roulement de la guerre devient un facteur direct précipitant les convulsions révolutionnaires, il n'en est pas de même en ce qui concerne le cours de la révolution qui n'est jamais un facteur de la guerre impérialiste.
La guerre impérialiste ne se développe pas en réponse au flux de la révolution, mais c'est exactement le contraire qui est vrai, c'est le reflux de la révolution qui suit la défaite de la lutte révolutionnaire, c'est l'évincement momentané de la menace de la révolution qui permet à la société capitaliste d'évoluer vers le déclenchement de la guerre engendrée par les contradictions et les déchirements internes du système capitaliste.
La fausse analyse de la guerre impérialiste devait amener fatalement à présenter le moment du déclenchement de la guerre comme la réponse au flux de la révolution, à confondre et à intervertir les deux moments, à donner une appréciation erronée des rapports de forces existants entre les classes.
L'absence de nouveaux débouchés et de nouveaux marchés où puisse se réaliser la plus-value incluse dans les produits au cours du procès de la production, ouvre la crise permanente du système capitaliste. La réduction du marché extérieur a pour conséquence une restriction du marché intérieur. La crise | économique va en s’amplifiant.
A l'époque impérialiste l'élimination achevée des producteurs isolés et groupes de petits et moyens producteurs par la victoire et le monopole des grandes concentrations du capital, les syndicats et les trusts, trouve son corollaire sur le plan international par l'élimination et la complète subordination des petits Etats à quelques grandes puissances impérialistes dominant le monde. Mais de même que l'élimination des petits producteurs capitalistes ne fait pas disparaître la concurrence qui, de petites luttes éparpillées en surface qu'elle était» se creuse en profondeur et se manifeste en des luttes géantes dans la mesure même de la concentration du capital, de même l'élimination des petits Etats et leur vassalisation par les 4 ou 5 Etats impérialistes monstres, ne signifie pas atténuation des antagonismes inter impérialistes.
Au contraire ces antagonismes ne font que se concentrer et ce qu'ils perdent en surface, en nombre, ils le gagnent en intensité et dont les chocs et les explosions ébranlent jusqu'aux fondements de la société capitaliste.
Plus se rétrécit le marché, plus devient âpre la lutte pour la possession des sources de matières premières et la maîtrise du i marché mondial. La lutte économique entre divers groupes capitalistes se concentre de plus en plus, prenant la forme la plus achevée des luttes entre Etats. La lutte économique exaspérée entre Etats ne peut finalement se résoudre que par la j force militaire. La guerre devient le seul moyen non pas de solution à la crise internationale, mais le seul moyen par le quel chaque impérialisme national tend à se dégager des difficultés avec lesquelles il est aux prises, aux dépens des Etats impérialistes rivaux.
Les solutions momentanées des impérialismes isolés, par des |victoires militaires et économiques, ont pour conséquence non seulement l'aggravation des situations des pays impérialistes adverses, mais encore une aggravation de la crise mondiale et la destruction des masses de valeurs accumulées par des dizaines et des centaines d'années de travail social. La société capitaliste à l'époque impérialiste ressemble à un bâtiment dont les matériaux nécessaires pour la construction des étages supérieurs sont extraits de la bâtisse des étages inférieurs et des fondations. Plus frénétique est la construction en hauteur, plus fragile est rendue la base soutenant tout l'édifice. Plus est imposante en apparence, la puissance au sommet, plus l'édifice est, en réalité, branlant et chancelant. Le capitalisme, forcé qu'il est de creuser sous ses propres fondations, travaille avec rage à l'effondrement de l'économie mondiale, précipitant la société humaine vers la catastrophe et l'abîme.
"Une formation sociale ne périt pas avant que soient développées toutes les forces productives auxquelles elle ouvre un champ libre" disait Marx, mais cela ne signifie pas qu'ayant épuisé cette mission, la formation sociale disparaît, s'évanouit d'elle-même. Pour cela, il faut qu'une nouvelle formation sociale correspondant à l'état des forces productives et à même de leur ouvrir des champs nouveaux pour leur développement, renne la direction de la société. En cela elle se heurte à 'ancienne formation sociale, qu'elle ne peut remplacer qu'en la vainquant par la lutte et la violence révolutionnaires. Et si, se survivant, l'ancienne formation, restée maîtresse des destinées de la société, continue à agir et à guider la société non plus vers l'ouverture des champs libres au développement des forces productives, mais d'après sa nouvelle nature désormais réactionnaire, elle oeuvre vers leur destruction.
Chaque jour de survivance du capitalisme se solde pour la société par une nouvelle destruction. Chaque acte du capitalisme décadent est un moment de cette destruction.
Prise dans ce sens historique, la guerre à l'époque impérialiste, présente l'expression la plus haute en même temps que la plus adéquate du capitalisme décadent, de sa crise permanente et de son mode de vie économique : la destruction.
Aucun mystère n'enveloppe la nature de la guerre impérialiste. Historiquement, elle est la matérialisation de la phase décadente et de destruction de la société capitaliste se manifestant par la croissance des contradictions et l'exaspération des antagonismes inter-impérialistes qui servent de base concrète et de cause immédiate au déchaînement de la guerre.
La production de guerre n'a pas pour objectif la solution d'un problème économique. A l'origine, elle est le fruit d'une nécessité de l'Etat capitaliste de se défendre contre les classes dépossédées et de maintenir par la force leur exploitation, d'une part, et d'assurer par la force ses positions économiques et de les élargir, aux dépens des autres Etats impérialistes.
Plus les marchés de réalisation de la plus-value se rétrécissent, plus la lutte entre impérialistes devient acerbe, plus l'antagonisme inter-impérialiste s'exacerbe, et plus l'Etat est amené à renforcer son appareil offensif et défensif. La crise permanente pose l'inéluctabilité, l'inévitabilité du règlement des différends impérialistes par la lutte armée. La guerre et la menace de guerre sont les aspects latents ou manifestes d'une situation de guerre permanente dans la société. La guerre moderne est essentiellement une guerre de matériel. En vue de la guerre une mobilisation monstrueuse de toutes les ressources techniques et économiques des pays est nécessaire. La production de guerre devient aussi l'axe de la production industrielle et le principal champ économique de la société.
Mais la masse des produits représente-t-elle un accroissement de la richesse sociale ? A cette question, il faut répondre catégoriquement par la négative, la production de guerre, toutes les valeurs qu'elle matérialise, est destinée à sortir de la production, à ne pas se retrouver dans la reprise du procès de la production et à être détruite. Après chaque cycle de production, la société n'enregistre pas un accroissement de son patrimoine social, mais un rétrécissement, un appauvrissement dans la totalité.
Qui paie la production de guerre ? Autrement dit, qui réalise la production de guerre ?
En premier lieu, la production de guerre est réalisée aux dépens des masses travailleuses dont l'Etat par diverses opérations financières : impôts, emprunts, conversions, inflation et autres mesures, draine des valeurs avec lesquelles il constitue un pouvoir d'achat supplémentaire et nouveau. Mais toute cette masse ne peut réaliser qu'une partie de la production de guerre. La plus grande partie reste non réalisée et attendant sa réalisation au travers de la guerre, c'est-à-dire au travers du brigandage exercé sur l'impérialisme vaincu. Ainsi s'opère en quelque sorte une réalisation forcée.
L'impérialisme vainqueur présente la note de sa production de guerre, sous l'appellation de "réparations" et se taille la livre de chair sur l'impérialisme vaincu à qui il impose sa loi. Mais la valeur contenue dans la production de guerre de l'impérialisme vaincu, comme d autres petits Etats capitalistes, est complètement et irrémédiablement perdue. Au total, si on fait le bilan de l'ensemble de l'opération pour l'économie mondiale prise comme un tout, le bilan sera catastrophique, quoique certains secteurs et certains impérialismes isolément se trouvent enrichis.
L'échange des marchandises au travers duquel la plus-value parvenait à se réaliser, ne fonctionne que partiellement avec la disparition du marché extra-capitaliste et tend à être supplanté par "l'échange" forcé, de brigandage sur les pays vaincus et plus faibles, par les capitalistes les plus forts, au travers des guerres impérialistes. En cela réside un aspect nouveau de la guerre impérialiste.
III. LA TRANSFORMATION DE LA GUERRE IMPERIALISTE EN GUERRE CIVILE
Comme nous l'avons dit plus haut, c'est l'arrêt de la lutte de classes, ou plus exactement la destruction de la puissance de classe du prolétariat, la destruction de sa conscience, la déviation de ses luttes, que la bourgeoisie parvient à opérer par l'entremise de ses agents dans le prolétariat, en vidant ces luttes de leur contenu révolutionnaire et les engageant sur les rails du réformisme et du nationalisme, qui est la condition ultime et décisive de l'éclatement de la guerre impérialiste.
Ceci doit être compris non d'un point de vue étroit et limité d'un secteur national isolé, mais internationalement.
Ainsi la reprise partielle, la recrudescence de luttes et de mouvements de grèves constatés en 1913 eh Russie ne diminue en rien notre affirmation. A regarder les choses de près, nous verrons que la puissance du prolétariat international à la veille de 1914, les victoires électorales, les grands partis sociaux-démocrates et les organisations syndicales de masses, gloire et fierté de la 2ème Internationale, n'étaient qu'une apparence, une façade cachant sous son vernis le profond délabrement idéologique. Le mouvement ouvrier miné et pourri par l'opportunisme régnant en maître, devait s'écrouler comme un château de cartes devant le premier souffle de guerre.
La réalité ne se traduit pas dans la photographie chronologique des événements. Pour la comprendre, il faut saisir le mouvement sous-jacent, interne, les modifications profondes qui se sont produites avant qu'elles n'apparaissent à la surface et soient enregistrées par des dates. On commettrait une grave erreur en voulant rester fidèle à l'ordre chronologique de l'histoire, et présenter la guerre de 1914 comme la cause de l'effondrement de la 2ème Internationale, quand en réalité l'éclatement de la guerre fut directement conditionné par la dégénérescence opportuniste préalable du mouvement ouvrier international. Les fanfaronnades de la phrase internationaliste
se faisaient d'autant plus extérieurement, qu'intérieurement triomphait et dominait la tendance nationaliste. La guerre de 1914 n'a fait que mettre en évidence, au grand jour, l'embourgeoisement des partis de la 2ème Internationale, la substitution à leur programme révolutionnaire initial, par l'idéologie de l'ennemi de classe, leur rattachement aux intérêts de leur bourgeoisie nationale.
Ce processus interne de la destruction de la conscience de classe a manifesté son achèvement ouvertement dans l'éclatement de la guerre de 1914 qu'il a conditionnée.
L'éclatement de la 2ème guerre mondiale était soumis aux mêmes conditions.
On peut distinguer trois étapes nécessaires et se succédant entre les deux guerres impérialistes.
La première s'achève avec l'épuisement de la grande vague révolutionnaire de l'après 1917 et consignée dans une suite de défaites de la révolution dans plusieurs pays, dans la défaite de la Gauche exclue de l'IC où triomphe le centrisme et l'engagement de l'URSS dans une évolution vers le capitalisme au travers de la théorie et la pratique du "socialisme en un seul pays".
La deuxième étape est celle de l'offensive générale du capitalisme international parvenant à liquider les convulsions sociales dans le centre décisif où se joue l'alternative historique du capitalisme-socialisme : l'Allemagne, par l'écrasement physique du prolétariat et l'instauration du régime hitlérien jouant le rôle de gendarme en Europe. A cette étape correspond la mort définitive de l'IC et la faillite de l'opposition de gauche de Trotski qui, incapable de regrouper les énergies révolutionnaires, s'engage par la coalition et la fusion avec des groupements et des courants opportunistes de la gauche socialiste, s'oriente vers des pratiques de bluff et d'aventurisme en proclamant la formation de la 4ème Internationale.
La troisième étape fut celle du dévoiement total du mouvement ouvrier des pays démocratiques. Sous le masque de défense des "libertés" et des "conquêtes" ouvrières menacées par le fascisme, on a en réalité cherché à faire adhérer le prolétariat à la défense de la démocratie, c'est-à-dire de leur bourgeoisie nationale, de leur patrie capitaliste. L'anti-fascisme était la plate-forme, l'idéologie moderne du capitalisme que les partis traîtres du prolétariat employaient pour envelopper la marchandise putréfiée de la défense nationale.
Dans cette troisième étape s'opère le passage définitif des partis dits communistes au service de leur capitalisme respectif, la destruction de la conscience de classe par l'empoisonnement des masses par l'idéologie "anti-fasciste", l'adhésion des masses à la future guerre impérialiste au travers de leur mobilisation dans les "fronts populaires", les grèves dénaturées et déviées de 1936, de la guerre "antifasciste" espagnole, la victoire définitive du capitalisme d'Etat en Russie se manifestant entre autre par la répression féroce et le massacre physique de toute velléité de réaction révolutionnaire, son adhésion à la SDN ; son intégration dans un bloc impérialiste et l'instauration de l'économie de guerre en vue de la guerre impérialiste se précipitant. Cette période enregistre également la liquidation de nombreux groupes révolutionnaires et des communistes de gauche surgis par la crise de TIC et qui, au travers de l'idéologie "anti-fasciste" à la "défense de l'Etat ouvrier" en Russie, sont happés dans l'engrenage du capitalisme et définitivement perdus en tant qu'expression de la vie de la classe. Jamais l'histoire n'a encore enregistré un pareil divorce entre la classe et les groupes qui expriment ses intérêts et sa mission. L'avant-garde se trouve dans un état d'absolu isolement et réduit quantitativement à de petits îlots négligeables.
L'immense vague de la révolution jaillie à la fin de la première guerre impérialiste a jeté le capitalisme international dans une telle crainte, qu'il a fallu cette longue période de désarticulation des bases du prolétariat, pour que la condition soit requise pour le déchaînement de la nouvelle guerre impérialiste mondiale.
La guerre impérialiste ne résout aucune des contradictions du régime qui la engendrée. Mais cette manifestation pouvant s'épanouir grâce à l'effacement "momentané" du prolétariat luttant pour le socialisme, provoque le plus grand déséquilibre de la société, et accule l'humanité à l'abîme. Conditionnée par l'effacement de la lutte de classe, la guerre devient au cours de son déroulement un facteur puissant de réveil de la conscience de classe et de la combativité révolutionnaire des masses. Ainsi se manifeste le cours dialectique et contradictoire de l'histoire.
Les ruines accumulées, les destructions multipliées, les cadavres s'entassant par millions, la misère et la famine se développant et s'amplifiant chaque jour, tout pose devant le prolétariat et les couches travailleuses le dilemme aigu et direct de mourir ou de se révolter. Les mensonges patriotiques et la fumée chauvine se dissipent et font apparaître devant les masses l'atrocité et l'inutilité de la boucherie impérialiste. La guerre devient un puissant moteur accélérant la reprise de la lutte de classe et transformant rapidement celle-ci en guerre civile de classe.
Au cours de la troisième année de la guerre, commencent à se manifester les premiers symptômes d'un processus de désintégration du prolétariat de la guerre. Processus encore profondément souterrain, difficilement décelable et encore moins mesurable. Contrairement aux russophiles et anglophiles, les amis platoniques de la révolution, et en premier lieu les trotskystes, qui cachaient leur chauvinisme sous l'argument que la démocratie offrait plus de possibilité à l'éclosion d'un mouvement révolutionnaire du prolétariat et voyaient dans la victoire des impérialismes démocratiques, la condition de la révolution, nous placions, nous, le centre de la fermentation révolutionnaire dans les pays de l'Europe et plus précisément en Italie et en Allemagne, où le prolétariat a subi moins la destruction de sa conscience que la destruction physique, et n'a adhéré à la guerre que sous la pression de la violence.
A la faveur de la guerre, la puissance du gendarme allemand s'épuisait. Les auspices économiques extrêmement fragiles de ces impérialistes qui n'ont pas pu supporter dans le passé les convulsions sociales, devaient être ébranlées aux premières difficultés, aux premiers revers militaires. Ces "révolutionnaires de demain" mais aujourd'hui chauvins nous citaient triomphalement les grèves de masse en Amérique et en Angleterre (tout en les condamnant et les déplorant parce qu'elles affaiblissaient la puissance des démocraties) comme preuve des avantages qu'offre la démocratie pour la lutte du prolétariat. En dehors du fait que le prolétariat ne peut déterminer la forme du régime qui convient le mieux, à un moment donné du capitalisme, et du fait que placer le prolétariat sur le terrain du choix : démocratie-fascisme, c'est lui faire abandonner son terrain propre de lutte contre le capitalisme, les exemples des grèves citées, des masses en Amérique ou en Angleterre, ne prouvaient nullement une plus grande maturation de la combativité des masses ouvrières dans ces pays, mais plutôt la plus grande solidité du capitalisme dans ces pays pouvant supporter des luttes partielles du prolétariat.
Loin de nier l'importance de ces grèves, et les soutenant intégralement comme manifestations de classe pour des objectifs immédiats, nous ne nous leurrons pas sur leur portée encore limitée et contingente.
Notre attention fut avant tout concentrée sur l'endroit où s'accomplissait un processus de décomposition des forces vitales du capitalisme et de fermentation révolutionnaire de la plus haute portée où la moindre manifestation extérieure prenait une acuité et posait l'imminence de l'explosion révolutionnaire. Déceler ces symptômes, suivre attentivement cette évolution, s'y préparer et participer à leur explosion, telle devait être et a été notre tâche dans cette période.
Une partie de la fraction italienne de la Gauche communiste nous taxant d'impatience, se refusait à voir dans les mesures draconiennes prises par le gouvernement allemand dans l'hiver 1942-43, tant à l'intérieur que sur les fronts, autre chose que la suite ordinaire de la politique fasciste et niait que ces mesures reflétaient un processus moléculaire interne. Et c'est parce qu'ils les niaient qu'ils se sont trouvés surpris et dépassés par les événements de juillet 1943, au cours desquels le prolétariat italien rompait le cours de la guerre et ouvrait celui de la guerre civile.
Enrichi par l'expérience de la première guerre, incomparablement mieux préparé à l'éventualité de la menace révolutionnaire, le capitalisme international a réagi solidairement avec une extrême habileté et prudence contre un prolétariat décapité de son avant-garde. A partir de 1943, la guerre se transforme en guerre civile. En l'affirmant nous n'entendons pas dire que les antagonismes inter-impérialistes ont disparu, ou qu'ils ont cessé d'agir dans la poursuite de la guerre. Ces antagonismes subsistaient et ne faisaient que s'amplifier, mais dans une mesure moindre et acquérant un caractère secondaire, en comparaison de la gravité présentant pour le monde capitaliste la menace d'une explosion révolutionnaire.
La menace révolutionnaire sera le centre des soucis et des préoccupations du capitalisme dans les deux blocs : c'est elle qui déterminera en premier lieu le cours des opérations militaires, leur stratégie et le sens de leur déroulement. Ainsi d'un accord tacite entre les deux blocs impérialistes antagonistes et afin de circonvenir et d'étouffer les premiers brasiers de la révolution, l'Italie, chaînon le plus faible et le plus vulnérable sera coupée en deux tronçons. Chaque bloc impérialiste sera chargé par des moyens propres, la violence et la démagogie, d'assurer l'ordre dans un des deux tronçons.
Cet état de cernement et de division de l'Italie dont la partie industrielle et le centre vital le plus important, le Nord, confié à l'Allemagne, et voué à la répression féroce du fascisme, sera maintenu en dépit de toute considération militaire, jusqu'après l'effondrement du gouvernement en Allemagne.
Le débarquement allié, le mouvement contournant des armées russes permettant la destruction systématique des centres industriels et de concentration prolétarienne, obéiront au même objectif central de cernement et de destruction préventives, face à une menace éventuelle d'explosion révolutionnaire. L'Allemagne même sera le théâtre d'une destruction et d'un massacre encore inégalés dans l'histoire.
A l'effondrement total de l'armée allemande, à la désertion massive, aux soulèvements des soldats, des marins et des ouvriers, répondront des mesures de représailles d'une sauvagerie féroce, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, la mobilisation des dernières réserves d'hommes jetés sur les champs de bataille et voués consciemment et inexorablement à l'extermination.
A rencontre de la première guerre impérialiste, où le prolétariat une fois engagé dans le cours de la révolution garde l'initiative et impose au capitalisme mondial l'arrêt de la guerre, dans cette guerre-ci dès le premier signal de la révolution en Italie, en juillet 1943, c'est le capitalisme qui se saisira de l'initiative et poursuivra implacablement une guerre civile contre le prolétariat, empêchera par la force toute concentration des forces prolétariennes, n'arrêtera pas la guerre même 3uand après l'effondrement et la disparition du gouvernement 'Hitler, l'Allemagne demandera avec insistance l'armistice, afin de s'assurer par un carnage monstre et un massacre préventif impitoyable, contre toute velléité de menace de révolution du prolétariat allemand.
Quand on sait que les terribles bombardements auxquels les alliés ont soumis l'Allemagne et qui ont eu pour effet la destruction de centaines de milliers de maisons d'habitation et le massacre de millions d'hommes, ont cependant laissé intacts comme nous annonce la presse alliée, 80% des usines, on saisit toute la signification de classe de ces bombardements "démocratiques".
Le chiffre total des morts de la guerre en Europe s'élève à 40 millions d'hommes dont les deux tiers à partir de 1943, à lui seul ce chiffre donne le bilan de la guerre impérialiste en général et de la guerre civile du capitalisme contre le prolétariat en particulier.
Aux sceptiques qui n'ont pas vu la guerre civile ni du côté du prolétariat, ni du côté du capitalisme, parce qu'elle ne s'est pas reproduite d'après les schémas connus et classiques nous laissons entre autre ces chiffres à leur méditation de sages.
Le trait original et caractéristique de cette guerre qui la distingue de 1914-1918, c'est la transformation brusque en guerre contre le prolétariat tout en poursuivant ses buts impérialistes. C'est la poursuite du massacre méthodique du prolétariat et ne s'arrêtant qu'après s'être assuré momentanément et partiellement il est vrai, contre le foyer de la révolution socialiste.
Comment cela fut-il possible, comment expliquer cette victoire momentanée mais incontestable du capitalisme contre le prolétariat ? (...) Comment se présentait la situation en Allemagne ?
L'acharnement avec lequel les alliés poursuivaient une guerre d'extermination, le plan de déportation massive du prolétariat allemand, plus particulièrement émis par le gouvernement russe, la méthodique et systématique destruction des villes, laissait peser la menace d'une extermination et d'une dispersion telle du prolétariat allemand, qu'avant qu'il ait pu esquisser le moindre geste de classe, il soit mis hors de combat pour des années.
Ce danger a existé effectivement, mais le capitalisme n'a pu réussir à appliquer que partiellement son plan. La révolte des ouvriers et des soldats, qui, dans certaines villes, se sont rendus maîtres des fascistes, a forcé les alliés à précipiter leur marche et à finir cette guerre d'extermination avant le plan prévu. Par ces révoltes de classe, le prolétariat allemand a réussi un double avantage : brouiller le plan du capitalisme, en le forçant à précipiter la fin de la guerre, et esquisser ses premières actions révolutionnaires de classe. Le capitalisme international a su mater momentanément le prolétariat allemand, et empêcher qu'il prenne la tête de la révolution mondiale, mais il n'a pas réussi à l'éliminer définitivement.
GCF, juillet 1945.
L'ETINCELLE N° l. Janvier 1945 Organe de la Fraction Française de la Gauche Communiste
MANIFESTE
La guerre continue.
La "libération" avait pu faire espérer aux ouvriers la fin du massacre et la reconstruction de l'économie, au moins en France.
Le capitalisme a répondu à cet espoir par le chômage, la famine, la mobilisation. La situation qui accablait le prolétariat sous l'occupation allemande s'est aggravée ; pourtant il n'y a plus d'occupation allemande.
La Résistance et le Parti communiste avaient promis la démocratie et de profondes réformes sociales ! Le gouvernement maintient la censure et renforce sa gendarmerie. Il s'est livré à une caricature de socialisation en nationalisant quelques usines, avec indemnités aux capitalistes ! L'exploitation du prolétariat reste et aucune réforme ne peut le faire disparaître. Pourtant la Résistance et le parti communiste sont aujourd'hui tout à fait d'accord avec le gouvernement : c'est qu'Us se sont toujours moqués de la démocratie et du prolétariat.
Ils n'avaient qu'un seul but : la guerre.
Ils l'ont, et c'est maintenant l'Union sacrée.
Guerre pour la revanche, pour le relèvement de la France, guerre contre l'hitlérisme, clame la bourgeoisie.
Mais la bourgeoisie a peur ! Elle a peur des mouvements prolétariens en Allemagne et en France, elle a peur de l'après-guerre
Il lui faut museler le prolétariat français ; elle accroît sa police, qu'elle enverra demain contre lui.
Il lui faut se servir de lui pour écraser la révolution allemande ; elle mobilise son armée.
La bourgeoisie internationale l'aide. Elle l'aide à reconstruire son économie de guerre pour maintenir sa propre domination de classe.
L'URSS l'aide, la première, et fait avec elle un pacte de lutte contre les prolétaires français et allemands.
Tous les partis, les socialistes, les "communistes" l'aident :
"Sus à la cinquième colonne, aux collaborateurs ! sus à l'hitlérisme î sus au maquis brun !"
Mais tout ce bruit ne sert qu'à cacher l'origine réelle de la misère actuelle : le capitalisme, dont le fascisme n'est que le fils.
A cacher la trahison aux enseignements de la révolution russe, qui s'est faite en pleine guerre et contre la guerre.
A justifier la collaboration avec la bourgeoisie au gouvernement.
A jeter à nouveau le prolétariat dans la guerre impérialiste.
A lui faire prendre demain les mouvements prolétariens en Allemagne pour une résistance fanatisée de l'hitlérisme !
Camarades ouvriers !
Plus que jamais la lutte tenace des révolutionnaires pendant la première guerre impérialiste, de Lénine, Rosa Luxemburg et Liebknecht doit être la notre !
Plus que jamais le premier ennemi à abattre est notre propre bourgeoisie !
Plus que jamais, face à la guerre impérialiste, se fait sentir la nécessité de la guerre civile 1
La classe ouvrière n'a plus de parti de classe -le parti "communiste" a trahi, trahit aujourd’hui, trahira demain.
L'URSS est devenue un impérialisme. Elle s'appuie sur les forces les plus réactionnaires pour empêcher la révolution prolétarienne. Elle sera le pire gendarme des mouvements ouvriers de demain : elle commence dès aujourd'hui à déporter en masses les prolétaires allemands pour briser toute leur force de classe.
Seule la fraction de gauche, sortie de ce "cadavre pourrissant" qu'est devenue la 2ème, la 3ème Internationale, représente aujourd'hui le prolétariat révolutionnaire.
Seule la gauche communiste s'est refusée à participer au dévoiement de la classe ouvrière par l'antifascisme et l'a, dès le début, mise en garde contre ce nouveau guet-apens.
Seule elle a dénoncé l'URSS comme le pilier de la contre-révolution depuis la défaite du prolétariat mondial en 1933 !
Seule elle restait, au déclenchement de la guerre, contre toute Union sacrée et proclamait la lutte de classe comme la seule lutte du prolétariat, dans tous les pays, y compris l'URSS.
Enfin, seule elle entend préparer les voies du futur parti de classe, rejetant toutes compromissions et front unique, et suivant dans une situation mûrie par l'histoire le dur chemin suivi par Lénine et la fraction bolchevique avant la première guerre impérialiste.
Ouvriers ! La guerre ce n'est pas seulement le fascisme ! C'est la démocratie et le "socialisme dans un seul pays" : l'URSS, c'est tout le régime capitaliste qui, en périssant, veut faire périr la société !
Le capitalisme ne peut pas vous donner la paix ; même sorti de la guerre, il ne peut plus rien vous donner.
Contre la guerre capitaliste, il faut répondre par la solution de classe : la guerre civile !
C'est de la guerre civile, jusqu'à la prise du pouvoir par le prolétariat, et seulement d'elle que peut surgir une société nouvelle, une économie de consommation et non plus de destruction !
Contre le patriotisme et l'effort de guerre ! Pour la solidarité prolétarienne internationale. Pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile.
La Gauche communiste (Fraction française)
M.Thorez, secrétaire général du Parti Communiste Français, déclarait en 1945 : "Les communistes ne formulent pas présentement des exigences socialiste ou communiste. Ils disent franchement qu'une seule chose préoccupe le peuple : gagner la guerre au plus vite pour hâter l'écrasement de l'Allemagne hitlérienne, pour assurer le plus vite possible le triomphe de la démocratie, pour préparer la renaissance de la France démocratique et indépendante. Ce relèvement de la France est la tâche de la nation toute entière, la France de demain sera ce que ses enfants l'auront faite.
Pour contribuer à ce relèvement, le Parti communiste est un parti de gouvernement ! Mais il faut encore une armée puissante avec des officiers de valeur, y compris ceux qui ont pu se laisser abuser un certain temps par Pétain. Il faut remettre en marche les usines, en premier lieu les usines de guerre, faire plus que le nécessaire pour fournir les soldats en .armes."
Les Statuts de l'Internationale Communiste déclaraient en 1919 : "Souviens-toi de la guerre impérialiste ! Voila la première parole que l'Internationale Communiste adresse à chaque travailleur, quelles que soient son origine et la langue qu'il parle. Souviens-toi que du fait de l’existence du régime capitaliste, une poignée d'impérialistes a eu pendant 4 années, la possibilité de contraindre les travailleurs de partout à s entr'égorger l Souviens-toi que la guerre bourgeoise a plongé l'Europe et le monde entier dans la famine et le dénuement. Souviens-toi que sans le renversement du capitalisme, la répétition de ces guerres criminelles est non seulement possible mais inévitable !"
Evènements historiques:
- Deuxième guerre mondiale [146]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [46]
Questions théoriques:
- Décadence [36]
Polémique avec Battaglia Comunista : le rapport fraction-parti dans la tradition marxiste (1° partie)
- 4718 reads
Première partie : la Gauche italienne, 1922-1937
Nous publions ici la première partie d'un article consacré à la clarification de la définition du rapport Fraction-Parti telle qu'elle s'est progressivement affirmée dans l'histoire du mouvement révolutionnaire. Cette première partie traitera du travail de la Fraction de Gauche du Parti Communiste italien dans les années 1930, en insistant particulièrement sur les années décisives, de 1935 à 1937, années dominées par la guerre d'Espagne, pour répondre aux critiques exprimées à plusieurs reprises par les camarades de Battaglia Comunista à l'égard de "la Fraction", c'est-à-dire du groupe qui se constitue à la fin des années 1920 comme "fraction" du Parti Communiste d'Italie en lutte contre la dégénérescence stalinienne de celui-ci.
Comme nous avons déjà répondu plusieurs fois à ces critiques sur divers points particuliers ([1] [147]), ce qui nous intéresse aujourd'hui est de développer les éléments généraux du rapport historique entre "fraction" et parti. L'importance de ce travail pourrait paraître secondaire, à un moment où les communistes ne se considèrent plus depuis un demi-siècle comme des fractions des vieux partis passés à la contre-révolution. Mais, comme nous le verrons au cours de cet article, la Fraction est une donnée politique qui va au delà de la pure donnée statistique (partie du Parti), elle exprime substantiellement la continuité dans l'élaboration politique qui va du programme du vieux parti au programme du nouveau parti, conservé et enrichi parce qu'il condense les nouvelles expériences historiques du prolétariat. C'est la signification profonde de cette méthode de travail, de ce fil rouge que nous voulons faire ressortir pour les nouvelles générations, pour les groupes de camarades qui, dans le monde entier, sont à la recherche d'une cohérence de classe. Face à tous les imbéciles qui s'amusent à faire "table rase" de l'histoire du mouvement ouvrier antérieur à eux, le CCI réaffirme que ce n'est que sur la base de cette continuité du travail politique que pourra surgir le Parti communiste mondial, arme indispensable dans les batailles qui nous attendent.
LES CRITIQUES DE "BATTAGLIA COMUNISTA" ENVERS LA FRACTION ITALIENNE A L'EXTERIEUR
Tout d'abord, tentons d'exposer systématiquement, et sans les déformer, les positions de Battaglia sur lesquelles nous entendons polémiquer. Dans l'article "Fraction-Parti dans l'expérience de la Gauche italienne", est développée la thèse selon laquelle la Fraction, fondée à Pantin, dans la banlieue parisienne, en 1928 par les militants en exil, aurait rejeté hypothèse trotskyste de fondation immédiate de nouveaux partis, parce que les vieux partis de l'Internationale communiste n'étaient pas encore officiellement passés de l'opportunisme à la contre-révolution. "Ce qui revenait à dire que (...) si les partis communistes, malgré l'infection de l’opportunisme, n'étaient pas encore passés, avec armes et bagages, au service de l'ennemi de classe, on ne pouvait pas mettre à l'ordre du jour la construction de nouveaux partis. " Ceci est absolument vrai, même si, comme on le verra, ce n'était qu'une des conditions nécessaires à la transformation de la Fraction en Parti. A part cela, il peut être utile de rappeler que les camarades qui ont fondé la fraction en 1928, avaient déjà dû, en 1927, se séparer d'une minorité activiste qui considérait déjà les PC comme contre-révolutionnaires ("Hors de l'Internationale de Moscou !", disait-elle) et qui, rapidement, en ayant l'illusion que la crise de 1929 était un prélude immédiat à la révolution, adoptait la position de la Gauche allemande, qui elle même avait, en 1924 donné naissance à une éphémère "nouvelle" "Internationale communiste ouvrière".
Poursuivant sa reconstitution, Battaglia rappelle que la Fraction "...a surtout un rôle d'analyse, d'éducation, de préparation des cadres, qu'elle développe la plus grande clarté sur la phase dans laquelle elle agit pour se constituer en parti, au moment même où la confrontation entre les classes balaie l'opportunisme." (Rapport pour le Congrès de 1935). "Jusque là - poursuit BC -, les termes de la question semblaient être suffisamment clairs. Le problème Fraction-Parti a été 'programmatiquement' résolu du fait que la première dépendait du processus de dégénérescence qui était en cours dans ce dernier, (...) et non grâce à une élaboration théorique abstraite qui aurait élevé ce type particulier d'organisation des révolutionnaires à une forme politique invariante, valable pour toutes les périodes historiques de stagnation de la lutte de classe (...). L'idée que l'on ne peut envisager la possibilité de transformation de la fraction en parti que dans des situations 'objectivement favorables', c'est-à-dire en présence d'une reprise de la lutte de classe, reposait sur l'éventualité calculée que ce n'est que dans une telle situation ou dans les orages qui V accompagnent que se serait vérifiée dans les faits la trahison définitive des partis communistes. "
La trahison des PC a été publiquement déclarée en 1935, avec l'appui de Staline et du PCF (imité par tous les autres) aux mesures de réarmement militaire décidées par le gouvernement bourgeois de France "pour défendre la démocratie. Face à ce passage officiel du côté de l'ennemi de classe, la Fraction lançait le manifeste "En dehors des Partis communistes, devenus instruments de la contre-révolution" et se réunissait en congrès pour donner une réponse en tant qu'organisation à ces événements. L'article de Battaglia affirme que :
"Suivant le schéma développé au cours des années précédentes, la Fraction aurait dû accomplir sa tâche en fonction de cet événement et passer à la construction du nouveau parti.
Mais pour la mise en pratique, même si la perspective restait celle-là, il s'exprima au sein de la Fraction quelques tendances qui s'efforçaient de renvoyer le problème plutôt que de le résoudre dans ses aspects pratiques.
Dans le rapport de Jacobs sur lequel aurait dû se développer le débat, la trahison du centrisme et le mot d'ordre lancé par la Fraction de sortir des partis communistes (n'impliquait pas) 'sa transformation en parti, ni ne représentait la solution prolétarienne à la trahison du centrisme, solution qui ne sera ^ donnée que par les événements de demain et auxquels la fraction se prépare aujourd'hui.'(...)
Pour le rapporteur la réponse au problème de la crise du mouvement ouvrier ne pouvait pas consister en l'effort de souder les rangs dispersés des révolutionnaires pour redonner au prolétariat son organe politique indispensable, le parti (...), mais bien de lancer le mot d'ordre 'sortir des PC sans aucune autre indication, puisque 'il n'existe pas de solution immédiate au problème que pose cette trahison.' (...)
S'il était vrai que les dommages provoqués par le centrisme avaient fini par immobiliser la classe, politiquement désarmée, dans les mains du capitalisme (...), il était tout aussi vrai que la seule possibilité d'organiser une quelconque opposition à la tentative de l'impérialisme de résoudre ses propres contradictions par la guerre, passait par la reconstruction de nouveaux partis (...) de façon à ce que l'alternative guerre ou révolution ne soit pas seulement un slogan dont on se gargarise.
Les thèses de Jacobs créèrent au sein du congrès de la Fraction une forte opposition qui (...) divergeait sur l'analyse attentiste du rapporteur. Pour Gatto (...), il était urgent de clarifier le rapport Fraction-Parti, pas sur la base de petites formes mécaniques, mais bien sur la base des tâches précises qu'imposait la nouvelle situation :
'nous sommes d'accord sur le fait qu'on ne puisse pas passer immédiatement à la fondation du parti, mais par ailleurs, il peut se présenter des situations qui nous imposent la nécessité de passer à sa constitution. La dramatisation du rapporteur peut conduire à une espèce de fatalisme.' Ce souci n'était pas vain puisque la Fraction devait rester dans l’attente jusqu'à son acte de dissolution en 1945."
Battaglia affirme ensuite que la Fraction est restée paralysée par celte divergence, en notant que "le courant partidiste , demeuré toutefois dans l'immobilisme le plus absurde, restait cohérent avec les positions exprimées au congrès, alors que dans le courant ' attentiste', et tout particulièrement chez son élément le plus prestigieux, Vercesi, les hésitations et les changements de route ne manquèrent pas. "
Les conclusions politique de Battaglia sur ce point sont inévitables : "soutenir que le parti ne peut surgir qu'en relation avec une situation révolutionnaire où la question du pouvoir est à l'ordre du jour, alors que dans les phases contre-révolutionnaires le parti 'doit' disparaître ou laisser la place aux fractions" signifie "priver la classe dans les périodes les plus dures et délicates d'un minimum de référence politique" avec "pour seul résultat de se faire dépasser par les événements. "
Comme on le voit, nous n'avons pas lésiné sur la place pour retracer de la façon la plus fidèle possible la position de Battaglia, de manière à la faire connaître aux camarades qui ne lisent pas l'italien. Pour résumer, Battaglia affirme que :
a) depuis sa fondation jusqu'au congrès de 1935, la Fraction ne faisait que défendre en réalité sa transformation en Parti de la reprise de la lutte de classe,
b) la minorité même qui défendait en 35 la formation du Parti, est restée politiquement cohérente, mais dans l'immobilisme pratique le plus complet les années suivantes (c'est-à-dire dans les années des occupations d'usines en France et de la Guerre d'Espagne) ;
c) les fractions (considérées comme des "organismes pas très bien définis", "des succédanés") ne sont pas en mesure d'offrir un minimum de référence politique au prolétariat dans les périodes contre-révolutionnaires. Ce sont là trois déformations de l'histoire du mouvement ouvrier. Voyons pourquoi.
LES CONDITIONS POUR LA TRANSFORMATION DE LA FRACTION EN PARTI
Battaglia soutient que le lien entre la transformation en parti et la reprise de la lutte de classe est une nouveauté introduite en 1935 dont on ne trouve pas trace si on remonte à la naissance de la Fraction en 1928. Mais si on veut remonter dans le temps, pourquoi s'arrêter en 1928 ? Il vaut mieux aller jusqu'en 1922, aux Thèses de Rome légendaires (approuvées par le 2ème congrès du PC d'Italie), qui constituent par définition le texte de base de la Gauche italienne :
"Le retour, sous l'influence de nouvelles situations et d'incitations à l'action exercées par les événements sur la masse ouvrière, à l’organisation d'un véritable Parti de classe, s'effectue sous la forme d'une séparation d'une partie du Parti qui, à travers les débats sur le programme, la critique des expériences défavorables à la lutte, et la formation au sein du Parti d'une école et d'une organisation avec sa hiérarchie (fraction), rétablit cette continuité dans la vie d'une organisation unitaire fondée sur la possession d'une conscience et d'une discipline d'où surgit le nouveau Parti."
Comme on le voit, les textes de base mêmes de la Gauche sont très clairs sur le fait que la transformation de la fraction en parti n'est possible que "sous l'influence de nouvelles situations et d'incitations à l'action exercées par les événements sur la masse ouvrière."
Mais venons-en à la Fraction et à son texte de base sur la question, "Vers l'Internationale 2 et 3/4 ?", publié en 1933 et que Battaglia considère comme "bien plus dialectique" que la position de 1935 :
"La transformation de la fraction en Parti est conditionnée par deux éléments intimement liés :
1. L'élaboration, par la fraction, de nouvelles positions politiques capables de donner un cadre solide aux luttes du Prolétariat pour la Révolution dans sa nouvelle phase plus avancée. (...)
2. Le renversement des rapports de classe du système actuel (...) avec l'éclatement de mouvements révolutionnaires qui pourront permettre à la Fraction de reprendre la direction des luttes en vue de l’insurrection." (Bilan n°l)
Comme on le voit, la position est restée identique à celle de 1922 et ne varie pas si on prend en considération les textes de base qui ont suivi. Nous lisons dans le "Rapport sur la situation en Italie" d'août 1935 :
"Notre fraction pourra se transformer en parti dans la mesure où elle exprimera correctement l'évolution du prolétariat qui sera à nouveau jeté sur la scène révolutionnaire et démolira le rapport de force actuel entre les classes. Tout en ayant toujours, sur la base des organisations syndicales, la seule position pouvant permettre la lutte des masses, notre fraction doit s'acquitter du rôle qui lui revient : formation des cadres en Italie aussi bien que dans l’émigration. Les moments de sa transformation en parti seront les moments mêmes de l’ébranlement du capitalisme."
Sur ce point, prenons directement en considération la phrase que Battaglia elle-même rapporte sur le Rapport pour le Congrès de 1935, en jugeant que "les termes de la question semblaient assez clairs." Dans cette phrase, on affirme textuellement que la transformation de la fraction en Parti est possible "dans les moments où la confrontation entre les classes balaie l'opportunisme"? C’est-à-dire, dans un moment de reprise du mouvement de classe." Effectivement, les termes de la question semblaient déjà clairs dans cette phrase. Par ailleurs, pour lever tous les doutes, il faut lire quelques lignes plus loin :
"La classe se retrouve donc dans le parti au moment où les conditions historiques déséquilibrent les rapports des classes et ï affirmation de V existence du parti est alors l’affirmation de la capacité d'action de la classe."
Plus clair que cela, on meurt ! Comme le disait souvent Bordiga, il suffit de savoir lire. Le problème, c'est que quand on veut réécrire l'histoire avec les lunettes déformantes d'une thèse préétablie, on est obligé de lire le contraire de ce qui est écrit.
Mais le plus stupéfiant, c'est que pour retomber sur leurs pieds, les camarades de Battaglia sont obligés de devenir incapables de lire ce qu'eux-mêmes ont écrit à propos du congrès de la Fraction en 1935 :
"Il convient ici de rappeler que la Gauche italienne abandonne le titre de ‘Fraction de gauche du PCI' pour celui de 'Fraction italienne de la Gauche Communiste Internationale' à un Congrès de 1935. Cela lui fut imposé du fait que contrairement à ses prévisions, la trahison ouverte des PC opportunistes au prolétariat n'attendit pas l'éclatement de la seconde guerre. (...) Le changement de titre marquait à la fois une prise de position par rapport à ce 'tournant' des PC officiels, et le fait que les conditions objectives ne permettaient toujours pas de passer à la formation de nouveaux partis. "
Comme à notre habitude, nous ne nous sommes pas appuyés sur telle ou telle phrase dite incidemment par tel ou tel membre de Battaglia, mais nous avons cité la Préface politique par laquelle le PCInt (Battaglia), en mai 1946, présentait aux militants des autres pays sa Plate-forme Programmatique, tout récemment adoptée à la Conférence de Turin. Ce même document de base, destiné à expliquer la filiation historique existante entre le PC d'Italie de Livourne 1921, la fraction à l'étranger et le PCInt de 1943, exprimait clairement qu'un des points clés de démarcation avec le trotskysme concernait : "...les conditions objectives requises pour que le mouvement communiste se reconstitue en partis influençant effectivement les masses, conditions dont Trotski ou bien ne tenait pas compte, ou dont une analyse erronée des perspectives lui faisait admettre l'existence dans la situation en cours. D'une part elle établissait (s’appuyant sur l'expérience de la fraction bolchevique) que le cours déformation du parti était essentiellement un cours où, la lutte de classe se livrant dans des conditions révolutionnaires, les prolétaires étaient amenés à se regrouper autour d'un programme marxiste restauré contre l'opportunisme et défendu jusque là par une minorité."
Comme on le voit, le PCInt lui-même dans ses textes officiels de 1946, ne s'écartait pas d'une virgule de la position sur cette question de la Fraction, dont, par ailleurs, il revendiquait officiellement les positions politiques. Celle qui, au contraire, s'en écarte si rapidement qu'elle en devient insaisissable, c'est bien Battaglia qui, dans la même discussion, réussit à aligner au moins quatre positions différentes. La concomitance entre reprise de la lutte de classe et reconstruction du Parti est en fait qualifiée par BC de :
a) somme toute "hypothétisable", de 1927 à 1935 ;
b) "fataliste" et "dans ses grandes lignes, mécaniciste", s'il s'agit de la Fraction entre 1935 et 1945 ;
c) tout à fait correcte, c'est ce qui ressort des textes, s'il s'agit du PCInt en 1946 ;
d) redevient "une conception anti-dialectique et liquidatrice" dans la nouvelle Plate-forme approuvée par Battaglia en 1952, dont on parlera plus en détail dans un second article. Mais laissons de côté les zigzags intéressés de Battaglia, et retournons au congrès de 1935.
LE DEBAT DE 1935 : FATALISME OU VOLONTARISME
De ce qui est écrit plus haut, on peut voir que ce n'est pas la majorité du congrès qui a introduit de nouvelles positions, mais la minorité qui a remis en question celles de toujours, en reprenant les formulations des adversaires politiques de la Fraction. Ainsi, Gatto accuse de "fatalisme' un rapport qui cependant répondait aux accusations de fatalisme qui étaient lancées à la Fraction par ceux-là qui, trotskystes en tête, refusaient le travail de fraction pour l'illusion de "mobiliser les masses". Piero affirme que "notre orientation doit changer, nous devons rendre notre presse plus accessible aux ouvriers", en faisant concurrence aux pseudo "ouvriers de l'opposition", spécialistes pour "accrocher les masses" moyennant l'adulation systématique de leurs illusions. Tullio tire des conclusions logiques en apparence : "si nous disons que quand il n'y a pas de parti de classe, il manque la direction, nous voulons dire que celle-ci est indispensable même dans les périodes de dépression", publiant cependant que Bilan avait déjà répondu à Trotsky :
"De la formule, la Révolution est impossible sans Parti communiste, on tire la conclusion simpliste qu'il faut déjà dès maintenant construire le nouveau Parti. C'est comme si des prémisses : sans insurrection, on ne peut plus défendre les revendications élémentaires des travailleurs, on déduisait lé nécessité de déchaîner immédiatement l'insurrection." (Bilan n°l.)
En réalité, ce qui ne tient pas, c'est la tentative de Battaglia de présenter le débat comme une confrontation entre ceux qui veulent le Parti déjà bien trempé au moment des affrontements révolutionnaires et ceux qui veulent l'improviser au dernier moment. La majorité du Congrès, à qui était posée l'alternative ridicule : "mais est-il nécessaire d'attendre que lies événements révolutionnaires se présentent pour passer à la fondation du nouveau parti, ou, inversement, ne serait-il pas mieux que les événements se manifestent avec la présence du parti " avait déjà répondu une fois pour toutes : "Si, pour nous, ce problème se limitait à un simple problème de volonté, nous serions tous d'accord et il n'y aurait personne qui s'efforcerait de discuter."
Le problème qui était posé au Congrès n'était pas un problème de volonté, mais de volontarisme, comme les années suivantes 1'ont démontré.
LE DEBAT DE 1935-37 : VERS LA GUERRE IMPERIALISTE OU VERS LA REPRISE DE CLASSE
En présentant le débat de 1935 comme une confrontation entre ceux qui voulaient le parti indépendamment des conditions objectives et ceux qui se "réfugiaient" dans l'attente de telles conditions, Battaglia oublie ce que la Préface de 1946 avait mis au clair, c'est que : "les constructeurs de Parti" ne se limitent pas à sous-estimer ou à ignorer les conditions objectives, mais ils sont aussi, nécessairement poussés "à admettre l'existence de telles conditions, sur la base d'une fausse analyse des perspectives." Et c'est justement cela le centre de la discussion en 1935, qui semble échapper complètement à Battaglia. La minorité activiste ne se borne pas à affirmer son "désaccord sur la constitution du parti seulement en période de reprise prolétarienne", mais est nécessairement contrainte de développer une fausse analyse des perspectives qui lui permette d'affirmer que s'il n'y a pas encore de véritable reprise prolétarienne, il y a cependant les premiers mouvements annonciateurs dont il faut prendre la direction, et ainsi de suite. Au congrès, cette remise en discussion des analyses de la Fraction sur le cours à la guerre impérialiste n'a pas été développée ouvertement par la minorité qui, probablement, ne se rendait pas encore bien compte de là où sa manie de fonder des partis devait nécessairement la conduire. Cette ambiguïté explique qu'à côté des activistes déclarés, provenant en grande partie du défunt "Réveil communiste", se trouvaient des camarades comme Tullio et Gatto Mammone, qui se sépareront de la minorité dès que le véritable objet de la discussion deviendra clair. Mais si la minorité ne révèle pas encore l'étendue de ses divergences (approuvant le rapport de Jacobs à l'unanimité), les éléments les plus lucides de la majorité en voient déjà toute l'ampleur :
"Il est facile d'apercevoir cette tendance, quand on examine la position soutenue par des camarades envers de récents conflits de classe, où ceux-ci défendirent que la fraction pouvait assurer également, dans la phase actuelle de décomposition du prolétariat, une fonction de direction dans ce mouvements, faisant par là abstraction du véritable rapport entre les forces" (Eieri)
"Ainsi, comme la discussion Va prouvé, on pourrait croire que nous puissions intervenir dans les événements actuels de désespoir (Brest-Toulon) pour en diriger le cours (...) Croire que la fraction puisse diriger des mouvements de désespoir prolétarien, c'est compromettre son intervention dans les événements de demain." (Jacobs)
Les mois suivant le Congrès voient une polarisation grandissante des deux tendances. Ainsi, Bianco, dans son article "Un peu de clarté, s'il vous plaît" (Bilan n° 28, janvier 1936), dénonce-t-il le fait que des membres de la minorité déclarent désormais ouvertement qu'ils rejettent le rapport de Jacobs qu'ils venaient à peine d'approuver, et attaque en particulier : "le camarade Tito qui est prolixe en gros mots comme 'changer de ligne' ; ne pas se borner à être présents 'mais prendre la tête, la direction du mouvement de renaissance communiste' : d'abandonner, en vue de former un organisme international, tout 'apriorisme obstructionniste' et 'nos scrupules de principe'. "
Les regroupements définitifs se font désormais jour (même si Vercesi dans le même numéro de Bilan tente de minimiser la portée des divergences). Déjà dans le numéro précédent du journal en langue italienne, Prometeo,Gatto avait pris ses distances avec la minorité, réaffirmant que "la Fraction s'exprimera comme parti dans le feu des événements" et pas avant que le prolétariat ne déchaîne "sa bataille émancipatrice."
Mais pour comprendre l'ampleur des errements que la minorité se préparait à faire, il faut prendre un peu de recul et considérer le rapport de force entre les classes dans ces années décisives et l'analyse qu'en faisaient les différentes forces de gauche. La Gauche italienne caractérisait la période comme contre-révolutionnaire se basant sur la dure réalité des faits : 1932, éradication politique des réactions au stalinisme, avec l'exclusion hors de l'Opposition de Gauche, de la Gauche italienne et des autres forces qui ne s'accommodaient pas des zigzags de Trotski ; 1933, écrasement du prolétariat allemand ; 1934, écrasement du prolétariat espagnol des Asturies ; 1935, écrasement du prolétariat autrichien, embrigadement du prolétariat français derrière le drapeau tricolore de la bourgeoisie. Face à cette course folle vers un massacre mondial, Trotski fermait les yeux pour maintenir le moral des troupes. Pour lui, jusqu'en 1933, le PC allemand pourri était toujours "la clé de la Révolution mondiale" ; et, si en 1933, le PC allemand s'écroulait face au nazisme, alors, ça voulait dire que la voie était dégagée pour fonder un nouveau parti, aussi bien qu'une nouvelle internationale, et si les militants contrôlés par le stalinisme n'y étaient pas, alors c'était l'aile gauche de la social-démocratie qui "évoluait vers le communisme", et ainsi de suite... Le manoeuvriérisme opportuniste de Trotski suscita donc des scissions à gauche de groupes de militants qui se refusaient à le suivre sur cette voie (Ligue des Communistes Internationalistes en Belgique, Union Communiste en France, Revolutionary Workers League en Amérique, etc.). Jusqu'en 1936 de tels groupes paraissaient se situer à mi-chemin entre la rigueur de la Gauche italienne et les acrobaties de Trotski. L'épreuve de 1936 prouvera que leur solidarité avec le trotskysme était beaucoup plus solide que leurs divergences. 1936 représente, dans les faits, le dernier sursaut désespéré de classe du prolétariat européen : entre mai et juillet, se succédèrent les occupations d'usines en France, la vague de lutte en Belgique, la réponse de classe du prolétariat de Barcelone au coup de Franco, à la suite de laquelle les ouvriers resteront pendant une semaine entière maîtres de la Catalogne. Mais c'est le dernier soubresaut. En l'espace de quelques semaines, le capitalisme réussit non seulement à circonscrire ces réactions, mais même à les dénaturer complète ment, en les transformant en des moments d'Union Sacrée pour la défense de la démocratie. Trotski ignore cette récupération, lui qui proclame que "la Révolution est commencée en France" et qui pousse le prolétariat espagnol à s'enrôler comme chair à canon dans les milices antifascistes pour défendre la république. Toutes les dissidences de gauche, de la LCI à l'UC, de RWL à une bonne partie des communistes de conseils s'y laissent prendre, au nom de "la lutte armée contre le fascisme", La minorité même de la Fraction italienne adhère dans les faits aux analyses de Trotski, proclamant qu'en Espagne, la situation reste "objectivement révolutionnaire" et que dans les zones contrôlées par les milices on pratique la collectivisation "sous le nez des gouvernements de Madrid et de Barcelone" (Bilan n°36, Documents de la minorité). L'Etat bourgeois survit et renforce son contrôle sur les ouvriers ? Il ne s'agit que d'une "façade", d'une "enveloppe vide, un simulacre, un prisonnier de la situation " parce que le prolétariat espagnol, en soutenant la République bourgeoise, ne soutient pas l'Etat, mais la destruction prolétarienne de l'Etat. En cohérence avec cette analyse, beaucoup de ses membres se rendirent en Espagne pour s'enrôler dans les milices antifasciste gouvernementales. Pour Battaglia, ces sauts périlleux à 360° veulent dire rester "cohérents avec eux-mêmes dans le plus complet immobilisme." Etrange conception de la cohérence de l'immobilisme
En réalité, la minorité a abandonné le cadre d'analyse de la Fraction, pour reprendre intégralement les acrobaties dialectiques de Trotski, contre lesquelles la Fraction avait déjà écrit, à l'occasion du massacre des mineurs dans les Asturies par la République démocratique en 1934 :
"Le terrible massacre de ces derniers jours en Espagne devrait mettre fin aux jeux d' équilibristes selon lesquels la République est certainement 'une conquête ouvrière' à défendre,mais à 'certaines conditions' et surtout dans 'la mesure où' elle n'est pas ce qu'elle est, ou à la condition qu'elle 'de vienne' ce qu'elle ne peut devenir, ou enfin, si, loin d'avoir la signification et les objectifs qu'elle a effectivement, elle s'apprête à devenir l'organe de la domination de la classe travailleuse. " (Bilan n° 12, octobre 1934.)
LA LIGNE DE PARTAGE HISTORIQUE DES ANNEES 1935-37
Seule la majorité de la Fraction italienne (et une minorité des communistes de conseils) restait sur la position défaitiste de Lénine face à la guerre impérialiste d'Espagne. Mais ce n'est que la Fraction qui tire toutes les leçons de ce tournant historique, en niant qu'il existerait encore des situations d'arriération où on pourrait lutter transitoirement pour la démocratie, ou pour la libération nationale, et en caractérisant comme bourgeoise et comme instrument de la guerre impérialiste toute forme de milice partisane antifasciste. Il s'agit de la position politique indispensable pour rester internationaliste dans le massacre impérialiste qui se prépare et, par conséquent, avoir les cartes en main pour contribuer à la renaissance du futur Parti communiste mondial. Les positions de la Fraction depuis 1935 (guerre sino-japonaise, guerre italo-abyssinienne) jusqu'en 1937 (guerre d'Espagne) constituent donc la ligne de partage historique qui signe la transformation de la Gauche italienne en Gauche communiste internationaliste et sélectionne les forces révolutionnaires à partir de ce moment-là.
Et quand nous parlons de sélection, nous parlons de sélection sur le terrain et pas dans les petits schémas théoriques dans la tête de quelques-uns. A la faillite en Belgique de la Ligue des Communistes répond l'apparition d'une minorité qui se constitue en Fraction belge de la Gauche communiste. A la faillite d'Union communiste en France répond la sortie de quelques militants qui adhèrent à la Fraction italienne et qui seront à l'origine, en pleine guerre impérialiste, de la Fraction française de la Gauche communiste. A la faillite en Amérique de la Revolutionary Workers League et de la Liga Comunista mexicaine correspond la rupture d'un groupe de militants mexicains et immigrés oui se constituent en Groupe des travailleurs marxistes sur les positions de la Gauche Communiste Internationale. Aujourd'hui encore, seuls ceux qui se situent en continuité absolue avec ces positions de principe, sans distinguo ou recherche d'une "troisième voie", ont aujourd'hui les bonnes cartes pour contribuer à la renaissance du Parti de classe.
Le CCI, comme on le sait, revendique intégralement cette délimitation programmatique. Mais quelle est la position de Battaglia ?
"Les événements de la Révolution espagnole ont mis en évidence les points forts comme les points faibles de notre propre tendance : la majorité de Bilan apparaît comme attachée à une formule, théoriquement impeccable qui a cependant le défaut de rester une abstraction simpliste ; la minorité apparaît, de son côté, dominée par le souci d'emprunter, de toute façon, le chemin d'un participationnisme qui n'a pas toujours été assez prudent pour éviter les pièges du jacobinisme bourgeois, même quand on est sur les barricades.
Puisqu'il existait la possibilité objective, nos camarades de Bilan auraient dû poser le problème, le même que devait poser plus tard notre parti face au mouvement de partisans, en appelant les ouvriers qui s'y battaient à ne pas tomber dans le piège de la stratégie de la guerre impérialiste"
Cette position que nous citons d'un numéro spécial de Prometeo consacré à la Fraction en 1958, n'est pas accidentelle, mais a été réaffirmée plusieurs fois, même récemment ([2] [148]) Comme on le voit, Battaglia se détermine pour une troisième voie, éloignée autant des abstractions de la majorité que de la participation de la minorité. Mais s'agit-il vraiment d'une troisième voie ou d'une reprise pure et simple des positions de la minorité ?
LA GUERRE D'ESPAGNE :
"PARUCIPATIONNISME"
OU "DEFAITISME REVOLUTIONNAIRE" ?
Quelle est l'accusation portée à la majorité ? D'être restée inerte face aux événements, de s'être contentée d'avoir raison en théorie, sans cependant se donner la peine d'intervenir pour défendre une orientation correcte parmi les ouvriers espagnols. Cette accusation reprend mot à mot celle exprimée à ce moment-là par la minorité, les trotskystes, les anarchistes, les Poumistes, etc. : "dire aux ouvriers espagnols ce danger vous menace et ne pas intervenir nous mêmes pour combattre ce danger, c'est une manifestation d'insensibilité et de dilettantisme." (Bilan n°35, Textes de la minorité). Une fois établi que les accusations sont identiques, il faut encore dire qu'il s'agit de mensonges éhontés. La majorité s'est immédiatement mise à combattre aux côtés du prolétariat espagnol sur le front de classe, et pas dans les tranchées. Si on veut faire la différence avec la minorité, c'est que cette dernière a abandonné l'Espagne à la fin de 1936, tandis que la majorité y continuait son activité politique, jusqu'en mai 1937, quand son dernier représentant, Tulho, retourne en France, pour annoncer à la Fraction et aux ouvriers du monde entier que la République antifasciste en était venue à massacrer directement les prolétaires en grève à Barcelone.
Certes la présence de la majorité était plus discrète que celle des minoritaires qui avaient à leur disposition pour leurs communiqués la presse du Parti ouvrier d'unification marxiste (POUM) de gouvernement, et qui devenaient généraux de brigade sur le front d'Aragon, comme leur porte-parole Condiari. Mitchell, Tullio, Candali, qui représentaient la majorité, agissaient au contraire dans la plus stricte clandestinité, avec le risque constant d'une arrestation par les escouades staliniennes -qui les recherchaient, d'être dénoncés par le POUM ou des anarchistes qui les considéraient plus ou moins comme des espions fascistes. Dans ces terribles conditions, ces camarades continuèrent à combattre pour soustraire au moins Quelques militants à la spirale de la guerre impérialiste, affrontant non seulement les risques mais aussi l'hostilité et le mépris des militants avec qui ils discutaient. Même les éléments les plus lucides, comme l'anarchiste Bemeri (ensuite assassiné par les staliniens) étaient déboussolés par l'idéologie au point de se faire les promoteurs de l'extension du régime d'économie de guerre - et de la militarisation de la classe qui en découlait - à toutes les usines plus ou moins grandes, et étaient totalement incapables de comprendre où se trouvait la frontière de classe, jusqu'à écrire que "les trotskystes, les bordiguistes, les staliniens, ne sont divisés que sur quelques conceptions tactiques". (Guerre de classe, octobre 1936). Malgré le fait que toutes les portes se soient claquées devant eux, les camarades de la majorité continuaient à frapper à r toutes les portes : c'est ainsi qu'en sortant d'une énième discussion infructueuse au local du POUM, ils trouvèrent les "killers" staliniens qui les attendaient et qui par pur hasard ne réussirent pas à les éliminer.
Notons au passage que la minorité qui en 1935 criait que le Parti devait être prêt à l'avance par rapport aux affrontements de classe théorise alors qu'en Espagne, c'est la révolution et qu'elle va vaincre, sans même une once de parti de classe. Au contraire, la majorité considère le parti comme le centre de son analyse et déclare qu'il ne peut y avoir de révolution en cours, étant donné qu'il ne s'est formé aucun parti et qu'il n'y a même pas la moindre tendance à l'apparition de petits noyaux qui iraient dans ce sens, malgré l'intense propagande faite par la fraction dans ce but. Ce n'était pas dans la majorité que se trouvaient ceux qui sous-estimaient l'importance du Parti... et de la Fraction. Face au naufrage de la minorité, qui à la fin eut l'illusion de trouver le parti de classe au sein du POUM, parti de gouvernement, on peut mesurer toute la justesse des mises en garde de la majorité au congrès de 1935, sur le danger d'en arriver "à dénaturer les principes mêmes de la Fraction."
Pour Battaglia, la minorité s'est rendue coupable d'un "participationnisme pas toujours (!) Assez prudent pour éviter les pièges bourgeois." Que veut dire une formulation aussi vague ? La différence entre la majorité et la minorité réside justement en ceci, que la première est intervenue pour convaincre au moins une avant-garde réduite de déserter la guerre impérialiste, alors que la seconde est intervenue pour y participer, à travers l'enrôlement volontaire dans les milices gouvernementales. Certes, Battaglia posséderait un atout extraordinaire dans sa manche si elle connaissait un moyen de participer à la guerre impérialiste qui soit tellement "prudent" que cela ne fasse pas le jeu de la bourgeoisie... Qu'est-ce que ça veut dire que la majorité aurait dû se comporter comme l’a fait ensuite le PCInt "face au mouvement des partisans" ? Cela signifie peut-être qu'elle aurait dû lancer l'appel au "front unique" aux partis staliniens, socialistes, anarchistes et poumistes, comme le PCInt l'a fait en 1944, en proposant le front unique aux Comités d'Agitation des PCI, PSI, PRI et anarcho-syndicalistes ? Battaglia pense probablement que "puisque les conditions objectives existaient", de telles propositions "concrètes" auraient permis à la Fraction de faire sortir de son chapeau de magicien le parti qui manquait tant. Espérons que Battaglia n'ait pas d'autres atouts dans sa manche, d'autres expédients miraculeux capables de transformer une situation objective contre-révolutionnaire en son exact contraire, chose certainement possible, "mais à certaines conditions" et surtout "dans la mesure où elle n’est pas ce qu'elle est", ou à la condition qu'elle "devienne ce qu'elle ne peut devenir" (Bilan n°12.)
Le problème est autre, c'est que Battaglia s'éloigne de la Fraction, dont elle se réclame pourtant, au moins sur deux points essentiels, les conditions pour la fondation de nouveaux partis et l'attitude à avoir, en période globalement contre-révolutionnaire, dans la confrontation avec des formations à façade prolétarienne, comme les milices antifascistes. Dans le prochain article, qui traitera de la période de 1937 à 1952, nous venons comment ces incompréhensions se manifestent ponctuellement dans la fondation du PCInt en 943 et dans 'ambiguïté de son attitude envers les partisans.
En nous penchant sur cette période tragique pour le mouvement ouvrier, nous démontrerons en outre combien est fausse l'affirmation de Battaglia qui dénie à un organe comme la Fraction toute capacité d'offrir à la "classe un minimum d'orientation politique dans les périodes les plus dures et délicates."([3] [149])
Beyle
[1] [150] Sur la Guerre d'Espagne, voir les articles dans la Revue Internationale n*50 et 54. Sur la Fraction italienne et ses positions politiques, voir les divers articles et documents publiés dans la Revue Internationale, et notre livre "La gauche communiste d'Italie. Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire" paru en français et italien (et prochainement en espagnol) ainsi que son "Complément" traitant des "Rapports entre la fraction de gauche du P.C. d'Italie et l'opposition de gauche internationale, 1929-1933".
[2] [151] Dans l'article "Le CCI et le cours historique", BC n*3, 1987, Battaglia force la dose : "la Fraction (...) évaluait dans les années 30 la perspective de la guerre comme un absolu", ce qui l'aurait conduite "à commettre des erreurs politiques", comme "la liquidation de toute possibilité d'intervention révolutionnaire en Espagne avant même que le prolétariat n'ait été défait."
[3] [152] Ces attaques à la Fraction, du nom de laquelle Battaglia se revendique, sont d'autant plus significatives qu'elles se produisent à un moment où différents groupes bordiguistes commencent à redécouvrir la Fraction après le silence entretenu par Bordiga (voir les articles parus dans "Il Comunista" de Milan, et la republication par "Il Partito Comunista" de Florence, du manifeste de la Fraction sur la Guerre d'Espagne). Battaglia et les bordiguistes en seraient-ils à s'échanger leurs rôles ?
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [153]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [154]