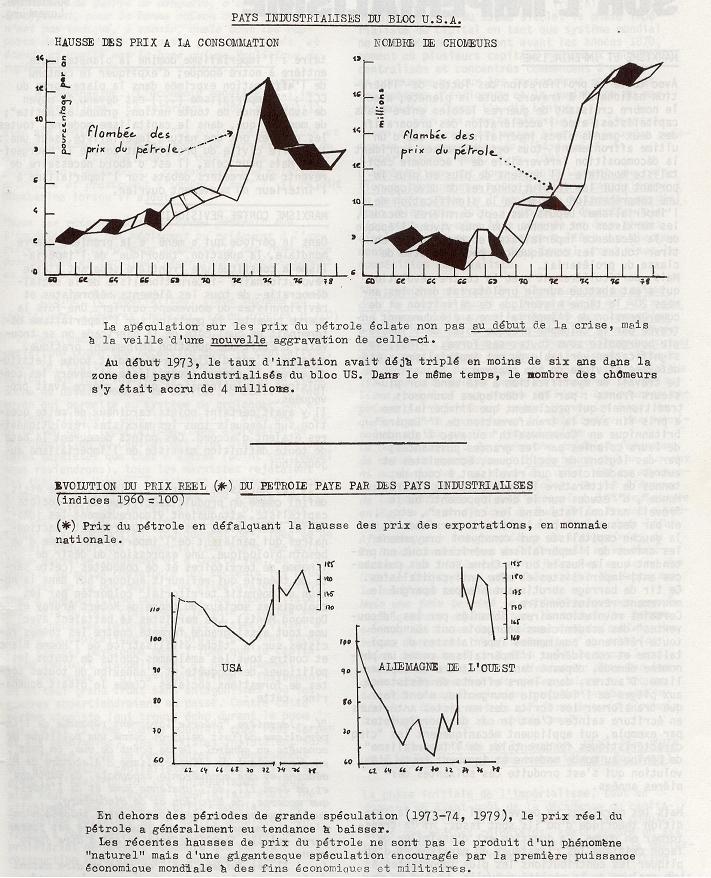Revue Internationale no 19 - 4e trimestre 1979
- 2714 lectures
La hausse du prix du pétrole : une conséquence et non la cause de la crise
- 25386 lectures
La hausse du prix du pétrole constitue depuis la fin de 1973 le principal argument avec lequel les gouvernements et les économistes expliquent dans le monde occidental la crise économique et ses conséquences : le chômage et l'inflation. Quand une entreprise ferme ses portes, les travailleurs jetés dans la rue s'entendent dire : "c'est la faute au pétrole11. Lorsque les travailleurs voient leur salaire réel diminuer sous le poids de la hausse des prix, les mass-médias leur expliquent : "c'est à cause de la crise du pétrole". La "crise du pétrole" est devenue l'alibi, le prétexte avec lequel la bourgeoisie en crise entend tout faire gober aux exploités. Elle est devenue dans la propagande des classes dominantes une sorte de cataclysme naturel contre lequel les hommes ne pourraient rien, sinon subir impuissants toutes ces calamités qui ont nom : chômage et inflation.
Et pourtant qu'y-a-t-il de "naturel" dans le fait que des marchands de pétrole vendent plus cher leur produit à d'autres marchands. La hausse du pétrole est une péripétie, non pas de la nature, mais du commerce capitaliste. La classe capitaliste, comme toutes les classes exploiteuses dans l'histoire attribuent ses privilèges aux volontés de la nature. Les lois économiques qui font d'eux les maîtres de la société sont dans leurs imaginations aussi naturelles et immuables que la loi de la pesanteur, lorsque la subsistance de ces lois -devenues avec le temps inadaptées- provoque des crises qui plongent la société dans la misère et la désolation, les nantis attribuant toujours la raison aux imperfections de la "nature" : la nature est trop pauvre ou les hommes sont trop nombreux. Jamais leur esprit ne parvient à concevoir que ce puisse être le système économique existant qui soit devenu anachronique, obsolète.
A la fin du moyen-âge, dans la décadence du XIV° siècle, des moines annonçaient la fin du monde à cause de l'épuisement de terres fertiles. Aujourd'hui on nous assène 10 fois par jour que si tout va mal, c'est à cause de l'épuisement du pétrole.
Y A-T-IL VRAIMENT EPUISEMENT DU PETROLE DANS LA NATURE ?
En mars 1979, les pays producteurs de pétrole de l'OPEP se réunissaient pour proclamer solennellement qu'ils allaient réduire leur production, une fois de plus. Ils réduisent leur production pour maintenir le prix réel, tout comme des paysans détruisent des excédents de fruits pour empêcher que leur prix ne s’effondre.
L'Europe risque de manquer de pétrole en 1980 nous annonce-t-on. Peut-être, mais qui croira encore qu'il s'agit d'une pénurie naturelle, physique ?
Les pays de l'OPEP ne produisent pas à pleine capacité, loin de là. Depuis quelques années, des gisements nouveaux et importants ont été mis en service en Alaska, en Mer du Nord, au Mexique. Chaque semaine, on découvre quelque part dans le monde de nouveaux gisements. Par ailleurs, on nous dit que des réserves de pétrole sous la forme de schistes bitumeux, relativement plus chers à exploiter, sont énormes par rapport aux réserves de pétrole connues actuellement. Comment dans ces conditions peut-on parler de pénurie physique de pétrole ? On peut concevoir qu'un jour un minerai servant de matière première arrive à être épuisé dans la planète à cause d'une exploitation sans limites de l'homme. Mais cela n'a rien à voir avec le fait que des marchands décident de réduire leurs ventes afin de préserver leur profit. Dans le premier cas, il s'agirait effectivement d'un épuisement dans la nature, dans le second, il s'agit d'une vulgaire opération de spéculation marchande.
Si la situation économique mondiale était par ailleurs "saine" dans tous ses aspects, si le seul problème existant actuellement était celui d'un épuisement physique et imprévu du pétrole dans la nature, nous assisterions non pas à un ralentissement de la croissance- du commerce et des investissements comme c'est le cas actuellement, mais au contraire à un boom économique mondial extraordinaire : la réadaptation du monde à de nouvelles formes d'énergie se traduirait par une véritable nouvelle révolution industrielle. Il y aurait certes des crises de restructuration ici et là dans certains secteurs avec des fermetures d'entreprises et des licenciements, mais ces fermetures et ces licenciements seraient immédiatement compensés par l'ouverture de nouvelles entreprises et la multiplication de nouveaux postes de travail.
Or, nous assistons à quelque chose de complètement différent : les pays qui produisent le pétrole le plus rentable réduisent leur production; les entreprises qui ferment ne sont pas remplacées par d'autres; les travailleurs licenciés ne trouvent pas de travail ailleurs; les investissements dans la recherche de nouvelles formes d'énergie restent insignifiants dans la plupart des puissances.
La thèse de l'épuisement physique du pétrole dans la nature est utilisée par les médias et les économistes pour expliquer la hausse vertigineuse du prix du pétrole en 1974 et en 1979. Mais comment explique-t-on alors les hausses spectaculaires de l'ensemble des produits de base, autres que le pétrole, sur le marché mondial en 1974 ou en 1977 ? Comment explique-t-on les accès de fièvre qu'ont connu les prix des métaux de base tel le cuivre, le plomb, l'étain au début de 1979 ? A suivre les "experts" de la bourgeoisie, il faudrait croire qu'il n'y a pas que le pétrole qui est en train de s'épuiser dans la nature, mais aussi la plupart des métaux, et même les denrées alimentaires. En effet, entre 1972 et 1974, l'indice des prix des minéraux et des métaux exportés dans le monde, autres que le pétrole a plus que doublé, celui des denrées alimentaires a lui, presque triplé. Au deuxième trimestre de 1977, ces mêmes denrées coûtaient encore sur le marché mondial trois fois plus qu'en 1972. Nous serions donc en train d'assister au tarissement de la nature non seulement en pétrole mais dans tous les domaines. Ce qui est une pure absurdité.
La théorie de l'épuisement physique de la nature parvient difficilement à expliquer la hausse des prix du pétrole; mais elle est en plus grande difficulté encore lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi le prix réel du pétrole, payé par les pays importateurs industrialisés, c'est à dire le prix payé compte tenu de l'évolution de l'ensemble de l'inflation mondiale et de l'évolution de la valeur du dollar US ([1] [1]), a régulièrement diminué avant 1973-1974 et après jusqu'en 1978. Entre 1960 et 1972, le prix réel du pétrole brut importé a diminué de 11% pour le Japon, de 14% pour la France, de 30% pour l'Allemagne! En 1978, ce même prix avait diminué par rapport aux niveaux de 1974 ou 1975 de 14% au Japon, de 6% en France, de 11% en Allemagne.
Comment le prix de matières en cours d'épuisement définitif dans la nature pourrait-il diminuer au point de contraindre les producteurs à réduire leur production artificiellement afin d'éviter l'effondrement des cours ?
Si l'on veut comprendre les actuelles hausses et baisses des cours des matières premières, ce n'est pas vers la plus ou moins grande générosité de la mère nature qu'il faut tourner ses regards, mais vers le monde en décomposition du commerce capitaliste.
Nous sommes en présence non pas de la découverte soudaine de certaines pauvretés grotesques de la nature, mais de gigantesques opérations de spéculations marchandes sur les matières premières. Ce n'est pas là un phénomène nouveau; toutes les crises économiques importantes du capitalisme sont accompagnées de fièvres spéculatives sur des matières premières.
LA SPECULATION : UNE CARACTERISTIQUE TYPIGUF DES CRISES ECONOMIQUES DU CAPITALISME
La source réelle de tous les profits capitalistes réside dans l'exploitation des prolétaires au cours du processus de production. Le profit, la plus-value, c'est du surtravail extirpé aux salariés. Lorsque les affaires des capitalistes vont bien, c'est à dire lorsque tout ce qui est produit parvient à être vendu avec des taux de profit suffisants, les capitalistes réinvestissent les profits ainsi obtenus dans le processus de production. L'accumulation du capital, c'est ce processus qui consiste à transformer le surtravail des ouvriers en capital, c'est à dire en nouvelles machines, nouvelles matières premières, nouveaux salaires pour exploiter de nouvelles quantités de travail vivant.
C'est ainsi que les capitalistes font ce qu'ils appellent "travailler l'argent". Mais lorsque les affaires vont mal, l’orque la production ne rapporte plus par manque de débouchés, ces masses de capitaux sous forme monétaire qui cherchent à s'investir tendent à se réfugier dans des opérations spéculatives.
Ce n'est pas qu'ils raffolent de ce genre d'opérations avec des risques aussi élevés où l'on peut se retrouver ruiné du jour au lendemain. Ils lui préfèrent mille fois mieux la paisible exploitation par la production. Mais, lorsqu'il n'y a plus de placement rentable dans la production, que faire ? Garder l'argent dans un coffre, c'est le voir perdre tous les jours de la valeur sous l'effet de l'érosion monétaire. La spéculation constitue alors un placement risqué certes, mais qui peut rapporter très gros en très peu de temps.
C'est ainsi que lors de chaque crise économique capitaliste, on a assisté à des phénomènes de spéculation d'une ampleur extraordinaire. La loi interdit la spéculation mais ceux qui spéculent ne sont autres que ceux qui ont fait les lois. Très souvent cette spéculation s'est polarisée sur une matière première. Ainsi, par exemple, lors de la crise économique de 1836, le directeur de la Banque des Etats-Unis, un certain BEAGLE, avait profité du fait que la demande de la Grande-Bretagne était encore forte pour s'emparer de toute la récolte de coton et la vendre à prix d'or aux anglais plus tard. Malheureusement pour lui, sous le coup de la crise, la demande de coton s'effondra en 1839 et les stocks soigneusement cumulés dans la folie spéculative devinrent invendables. Les cours de coton s'effondrèrent sur le marché mondial. Ce qui vint faire croître le nombre déjà élevé de faillites (1000 banques en banqueroute aux USA).
La crise économique, après avoir provoqué la hausse des prix des matières premières de manière spectaculaires, fait s'effondrer celles-ci par manque de demande.
Ces montées subites du prix d'une matière première suivie d'un effondrement vertigineux sont typiques de la spéculation en temps de crise. Ces phénomènes se produisent de façon particulièrement nettes lors des crises de 1825, 1836 et 1867 sur le coton ou sur la laine; lors des crises de 1847 et de 1857 sur le blé; en 1873, 1900 et 1912 c'est sur l'acier et sur la fonte; en 1907, c'est sur le cuivre; en 1929, c'est sur presque tous les métaux.
La spéculation est l'œuvre non pas de quelques individus épars, assez troubles, travaillant dans l'illégalité ou de petits "détenteurs" comme le laisse entendre la presse. Les spéculateurs, ce sont les gouvernements, les Etats, les banques grandes et petites, les grands industriels, bref, les détenteurs de l'essentiel de la masse monétaire qui cherche à se rentabiliser, à faire des profits.
La spéculation n'est pas non plus "une tentation" à laquelle les capitalistes peuvent échapper en temps de crise économique. Le banquier qui a la responsabilité de faire rapporter des milliers de comptes d'épargne n'a pas le choix. Lorsque le profit se fait de plus en plus rare, il faut le prendre quel qu'il soit et où qu'il soit. Les scrupules hypocrites des temps de prospérité où l'on promulgue des lois "interdisant la spéculation" disparaissent, et les plus respectables institutions financières se jettent tête baissée dans la tourmente spéculative. Dans la jungle capitaliste, seul celui qui fait du profit survit. Les autres sont dévorés. Lorsque la spéculation devient le seul moyen de faire des profits, la loi devient : celui qui ne spécule pas ou qui spécule mal est dévoré.
Ce qu'on a coutume d'appeler "la crise du pétrole" constitue en fait une gigantesque opération spéculative au niveau de la planète.
POURQUOI LE PETROLE ?
Le pétrole n'a pas été au cours des dernières années le seul objet de spéculation. Depuis la dévaluation de la Livre Sterling en 1967, la spéculation n'a cessé de se développer dans le monde entier s'attaquant à une liste toujours plus longue de produits : les monnaies, l'immobilier, les matières premières, végétales ou minérales, l'or, etc. Mais la spéculation sur le pétrole marque pour son importance financière. Elle a provoqué des mouvements de capitaux d'une ampleur et d'une rapidité probablement sans précédent dans l'histoire. En quelques mois, un flot gigantesque de dollars s'est mis à couler vers les grands pays exportateurs de pétrole, à partir de l'Europe et du Japon. Pourquoi en se portant sur le pétrole, la spéculation a-t-elle réussi de tels profits ? Premièrement^ parce que toute l'industrie moderne repose sur l'électricité et l'électricité, elle repose pour l'essentiel sur le pétrole. Aucun pays ne peut produire aujourd'hui sans pétrole. Le chantage spéculatif à la pénurie de pétrole est un chantage qui a l'atout de la force économique. Mais le pétrole n'est pas seulement un moyen indispensable pour produire et construire. Il est tout aussi indispensable pour détruire et faire la guerre.
L'essentiel de l'armement moderne, des chars aux bombardiers, des porte-avions aux camions et aux jeeps, tout cela fonctionne avec du pétrole. S'armer, c'est non seulement produire des armes mais aussi se procurer les moyens pour les faire fonctionner aussi longtemps que nécessaire. La course aux armements est aussi une course au pétrole. La spéculation sur le pétrole touche donc à un produit dont l'importance économique et militaire est de premier ordre. Et c'est cela une des raisons de son succès au moins momentané. Mais elle n'est pas la seule.
LA BENEDICTION DU CAPITAL AMERICAIN
Un des thèmes favoris du bla-bla-bla des commentateurs des médias sur le pétrole est celui de la "revanche des pays sous-développés sur les pays riches". Par leur simple décision de réduire la production et d'augmenter le prix du pétrole,, des pays qui font partie du peloton des nations du tiers-monde, condamnées depuis des décennies à produire et vendre à bon marché des matières premières pour les pays industrialisés, ont réussi à prendre à la gorge les principales puissances industrielles. C'est le David et Goliath des temps modernes.
La réalité est tout autre. Derrière la "crise du pétrole" il y a le capital américain. Il suffirait pour s'en convaincre de prendre en considération deux facteurs simples et évidents :
1) les pays les plus puissants de l'OPEP se comptent en même temps parmi les plus inconditionnellement soumis à l'impérialisme US. Les gouvernements de l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole mondial, de l'Iran du Shah ou du Venezuela, pour ne prendre que quelques exemples, ne prennent aucune décision importante sans l'accord explicite de leur puissant "protecteur";
2) la quasi totalité du commerce mondial du pétrole se trouve sous le contrôle des grandes compagnies pétrolières américaines: les profits réalisés par ceux-ci grâce aux variations des prix du pétrole sont si gigantesques que le gouvernement US a dû organiser une parodie de procès à la télévision pour tenter de canaliser sur les "7 big sisters" -les "7 grandes sœurs"- la colère de la population américaine qui se voit imposer des plans d'austérité au nom de la "crise pétrolière".
Mais au cas où cela ne suffirait pas pour se convaincre du rôle déterminant joué par les USA dans la "hausse du prix du pétrole", rappelons quelques uns des avantages qu'a tiré la première puissance économique mondiale de la "crise pétrolière":
1) Sur le marché international, le pétrole est payé en dollars US. Concrètement, cela veut dire que les USA peuvent se procurer du pétrole en faisant simplement fonctionner leur planche à billets alors que tous les autres pays doivent se procurer des dollars ([2] [2]);
2) les Etats-Unis ne dépendent du pétrole importé que pour 50% de leurs besoins nationaux. Leurs concurrents directs sur le marché mondial -l'Europe et le Japon- par contre, doivent importer la quasi totalité de leur pétrole. Toute augmentation du prix du pétrole se répercute donc de façon beaucoup plus puissante sur les coûts de production des marchandises européennes et japonaises. La compétitivité des marchandises US s'en trouve augmentée automatiquement d'autant. Ce n'est pas par hasard si les exportations US connaissent
des progressions spectaculaires au détriment de celles de leurs concurrentes au lendemain de chaque hausse du pétrole.
3) Mais c'est certainement sur le plan militaire que les USA ont tiré les plus grands avantages de la "crise pétrolière".
Comme on l'a vu, le pétrole demeure un instrument majeur de la guerre. La hausse du prix du pétrole a permis la rentabilisation de nouveaux gisements à proximité du territoire US (Alaska, Mexique, ainsi qu'au sein même des USA). De ce fait, le potentiel militaire américain se trouve moins dépendant des sources de pétrole du Moyen-Orient, trop distantes de Washington et trop proches de l'URSS. D'autre part, les énormes revenus pétroliers ont permis le financement de la "Pax Americana" au Moyen-Orient par l'Arabie Saoudite interposée. En effet, le passage de l'Egypte dans le bloc US a été payé à prix d'or, en partie par les aides financières de l'Arabie Saoudite au nom de la fraternité arabe. L'Arabie Saoudite a influencé directement la politique de pays tels que l'Egypte, l'Irak, le Syrie (pendant le conflit du Liban) moyennant de substantielles "aides" payées avec les revenus pétroliers. L'actuel rapprochement de l'O.L.P. du bloc américain n'est pas complètement étranger à l'aide financière que l'Arabie Saoudite fournit à 1'O.L.P.
L'impérialisme américain s'est ainsi payé le luxe de faire financer sa politique internationale par ses concurrents et alliés européens et japonais.
Ainsi, pour des raisons aussi bien économiques que militaires, les USA ont eu tout intérêt à laisser se développer, voire à encourager, la hausse du prix du pétrole.
L'attitude du gouvernement Carter lors de la fièvre spéculative déclenchée par l'interruption des livraisons de pétrole de l'Iran est éloquente à cet égard. Au moment même où l'Allemagne et la France cherchaient à juguler les hausses spéculatives qui se développaient au premier semestre de 1979 sur le "marché libre" de Rotterdam, le gouvernement US a cyniquement annoncé qu'il était prêt à acheter toute quantité de pétrole à un cours supérieur aux plus élevés atteints dans le port hollandais. Malgré l'envoi de délégués spéciaux de Bonn et de Paris à Washington pour "protester énergiquement" contre ce "coup de poignard dans le dos", la Maison Blanche n'est pas revenue sur son offre.
Quelle que soit la raison de cette hausse, une question demeure : quels ont été ses effets sur l'économie mondiale. La propagande officielle a-t-elle raison lorsqu'elle affirme que c'est la hausse des prix du pétrole qui a engendré la crise économique ?
LES EFFETS DE LA HAUSSE DU PRIX DU PETROLE
Il ne fait aucun doute que la hausse du prix d'une matière première constitue une entrave à la rentabilité d'une entreprise capitaliste. Pour le capital industriel, les matières premières constituent en frais de production, une dépense. Si ses frais augmentent, sa marge de profit tend à se réduire d'autant. Pour lutter contre les effets de cette réduction de sa rentabilité, il ne dispose que de deux moyens :
- réduire les autres frais de production, en particulier les frais en main-d’œuvre;
- répercuter l'augmentation de ses frais dans le prix de vente.
Les capitalistes se servent généralement des deux moyens en même temps. Ils s'appliquent à réduire leurs frais de production en imposant des politiques d'austérité sur les salariés ; ils cherchent à maintenir leurs profits en alimentant l'inflation. Il est donc certain que la hausse des prix du pétrole est un facteur qui impose à chaque capital national de nouveaux efforts de rentabilisation : élimination des secteurs les moins productifs, réduction des salaires, concentration du capital. Tout comme il est vrai que la hausse du pétrole est en partie responsable de l'inflation.
La hausse du prix du pétrole a effectivement constitué un facteur aggravant de la crise. Mais, contrairement à ce que prétend la propagande des médias, elle n'a été que cela : un facteur aggravant et non la cause, ni même une cause importante de la crise économique.
Il suffit pour s'en convaincre de constater que la crise économique n'a pas commencé avec la hausse du pétrole. La spéculation pétrolière n'a été qu'une des conséquences de la série de bouleversements économiques qui ont secoué le capitalisme mondial dès la fin des années 60.
A entendre "les experts" de la bourgeoisie, on croirait qu'avant la date fatidique du second semestre 1973, tout allait pour le mieux dans l'économie mondiale.
Pour mieux justifier leur politique d'austérité, ces messieurs oublient, ou feignent d'oublier, qu'au début de 1973, avant les premières grandes hausses du prix du pétrole, le taux d'inflation avait, en moins d'un an, doublé aux USA, triplé au Japon; ils prétendent oublier que de 1967 à 1973, le capitalisme avait déjà connu deux récessions importantes : une en 1967 (le taux de croissance annuel de la production diminua de moitié aux USA -1,8 % au premier semestre 1967- et tomba au dessous de zéro en Allemagne) ; l'autre en 1970-71 : aux USA, la production recule de façon absolue. Ils oublient ou cachent que le nombre officiel de chômeurs dans la zone de l'O.C.D.E. (les 24 pays industrialisés du bloc US) avait presque doublé en six ans, passant de 6 millions et demi en 1966 à plus de 10 millions en 1972. Ils font semblant d'ignorer qu'au début de 1973, après six ans d'instabilité monétaire commencée avec la dévaluation de la livre sterling de 1967, le système monétaire international s'était définitivement effondré avec la seconde dévaluation du dollar en moins de deux ans.
La spéculation pétrolière n'éclate pas dans un climat de sereine prospérité économique. Elle apparaît au contraire comme une nouvelle convulsion du capitalisme, secoué depuis six ans par la crise la plus profonde qu'il ait connue depuis la 2ème guerre mondiale.
A moins de vouloir expliquer les bouleversements de la période 1967-1973 par les hausses pétrolières de 1974, il est absurde d'affirmer que l'augmentation du prix du pétrole est la cause de la crise économique du capitalisme.
La spéculation sur le pétrole a porté un coup à l'économie mondiale, mais il n'était ni le premier ni le plus grave. La relativité du coup porté par la hausse du pétrole peut être mesurée "en négatif" en observant la situation d'un pays industrialisé qui a réussi à éliminer le problème du pétrole grâce à l'exploitation de gisements propres. Tel est le cas de la Grande-Bretagne qui n'a plus besoin d'importer du pétrole grâce à ses gisements de la Mer du Nord. En 1979, le taux de chômage en Grande-Bretagne est deux fois supérieur à celui de l'Allemagne, trois fois supérieur à celui du Japon, deux pays qui pourtant continuent d'importer la quasi totalité de leur pétrole. Quant à l'inflation des prix à la consommation, elle y est le double qu'en Allemagne et neuf fois plus importante qu'au Japon. Enfin, quant au taux de croissance de la production, il est le plus faible des sept grandes puissances économiques occidentales (au premier semestre de 1979, la production brute n'a pas augmenté : elle a même diminué de 1 % en taux annuel).
Les causes de l'actuelle crise du capitalisme sont autrement plus profondes que les péripéties de la spéculation sur le pétrole.
Depuis le milieu des années 60, le capitalisme vit dans une permanente fuite en avant pour tenter de retarder les conséquences de la fin de la période de reconstruction. Depuis plus de dix ans, les régions industrielles détruites pendant la seconde guerre mondiale ont non seulement été reconstruites -faisant disparaître ce qui avait constitué le débouché principal des exportations américaines-mais sont devenues de puissants concurrents des USA sur le marché mondial. Les Etats-Unis sont devenus un pays qui exporte moins qu'il n'importe et qui doit, pour financer son déficit, inonder la planète de papier monnaie sans couverture. Depuis dix ans, avec la fin de la reconstruction, la croissance mondiale repose essentiellement sur les ventes à crédit aux pays sous-développés et sur la capacité des USA à maintenir son déficit. Or, aussi bien les uns que les autres sont au bord de la banqueroute financière. L'endettement des pays du tiers-monde a atteint des proportions insoutenables (l'équivalent du revenu annuel d'un milliard d'hommes dans ces régions). Quant aux USA, ils sont actuellement contraints de se jeter dans une nouvelle récession pour parvenir à réduire leurs importations et la croissance de leur endettement. La récession qui commence aux USA annonce inévitablement une nouvelle récession majeure au niveau mondial. Une récession qui, suivant le déclin engagé en 1967, sera plus profonde que les trois précédentes.
Les spéculations sur le prix du pétrole ne sont qu'un aspect secondaire d'une réalité autrement plus importante : l'inadaptation définitive des rapports de production capitalistes aux possibilités et aux nécessités de l'humanité.
Après près de quatre siècles de domination sur le monde, les lois capitalistes ont fait leur temps. Après avoir été des forces de progrès, elles sont devenues des entraves à la survie même de l'humanité.
Ce ne sont pas quelques pétroliers venus du désert qui ont mis à genoux la production capitaliste. Le capitalisme s'effondre économiquement de lui-même parce qu'il est de plus en plus rongé par ses contradictions internes, et, en premier lieu, par son incapacité à créer des débouchés suffisants pour écouler sa production avec profit. Nous vivons la fin d'un nouveau tour du cycle crise-guerre-reconstruction, que le capitalisme impose à l'humanité depuis plus de soixante ans.
Pour l'humanité, l'issue n'est ni dans des baisses des prix de vente du pétrole, ni dans des baisses de salaires, mais dans l'élimination de la vente et du salariat, dans l'élimination du capitalisme comme système à l'Est comme à l'Ouest.
Seule une nouvelle organisation de la société mondiale, suivant des principes réellement communistes, peut lui permettre d'échapper à l'holocauste sans fin que lui promet le capitalisme en crise.
R. VICTOR
[1] [3] Constater que le prix courant du pétrole augmente ne veut en soi rien dire puisque l'inflation mondiale touche tous les produits et revenus. Pour un pays importateur de pétrole, la vraie question c'est de savoir si les prix du pétrole augmentent plus vite ou plus lentement que celui de ses exportations. Pour un pays importateur de pétrole, la hausse des prix du pétrole n'a de conséquence négative qu'à partir du moment où elle est plus rapide que celle des prix des marchandises qu'il exporte lui-même, c'est-à-dire, la source de ses revenus sur le marché mondial. Que lui importe de payer le pétrole 20 % plus cher s'il peut simultanément augmenter le prix de ses propres exportations d'autant.
[2] [4] De ce fait, le danger de nouvelles pressions vers la dévaluation du dollar, du fait des nouvelles masses de dollars-papier introduites par les USA sur le marché mondialise trouve relativement limité par l'accroissement de la demande de dollars provoqué par la hausse du prix du pétrole.
Récent et en cours:
- Crise économique [5]
Questions théoriques:
- Décadence [6]
Sur l'impérialisme
- 6754 lectures
MARXISME ET IMPERIALISME
Avec toute la prolifération des luttes de "libération nationale" à travers toute la planète; avec le nombre croissant de guerres locales entre Etats capitalistes; avec l'accélération des préparatifs des deux grands blocs impérialistes en vue d'un ultime affrontement -tous ces phénomènes exprimant la décomposition irréversible de l'économie capitaliste mondiale- il devient de plus en plus important pour les révolutionnaires de développer une compréhension claire de la signification de l'impérialisme. Depuis les sept dernières décades, les marxistes ont reconnu que nous vivons 1'époque de la décadence impérialiste, et ont tenté d'en tirer toutes les conséquences pour la lutte de classe du prolétariat.
Mais -particulièrement avec la contre-révolution qui s'est abattue sur le prolétariat dans les années 20- la tâche historique de définition et de compréhension de l'impérialisme a été durement entravée par le triomphe presque total de l'idéologie bourgeoise sous toutes ses formes. Ainsi, la signification véritable du mot impérialisme a été déformée et vidée de son contenu. Le travail de mystification a été mené sur plusieurs fronts : par les idéologues bourgeois traditionnels qui proclament que l'impérialisme a pris fin avec la transformation de 1'"Empire" britannique en "Commonwealth" ou avec l'abandon de leurs colonies par les grandes puissances; par des légions de sociologues, économistes et autres académiciens qui rivalisent à coup de tonnes de littérature illisible sur le "Tiers-Monde", d'"études sur le développement" ou le "réveil nationaliste dans les colonies", etc. ; et par dessus tout par les pseudo-marxistes de la gauche capitaliste qui conspuent bruyamment les crimes de l'impérialisme américain tout en prétendant que la Russie ou la Chine sont des puissances anti-impérialistes et même anticapitalistes. Ce tir de barrage abrutissant n'a pas épargné le mouvement révolutionnaire.
Certains révolutionnaires, ébranlés par les "découvertes" des académiciens bourgeois ont abandonné toute référence aux menées impérialistes du capitalisme et considèrent l'impérialisme comme un phénomène démodé, dépassé dans l'histoire du capitalisme. D'autres, dans leurs efforts de résistance aux pièges de l'idéologie bourgeoise, n'ont fait que transformer les écrits des marxistes antérieurs en écriture sainte. C'est le cas des bordiguistes par exemple, qui appliquent mécaniquement les "cinq caractéristiques fondamentales de l'impérialisme" de Lénine au monde moderne et ignorent toute l'évolution qui s'est produite ces soixante dernières années.
Mais les marxistes ne peuvent, ni ignorer la tradition théorique d'où ils sont issus, ni la transformer en dogme. La question est d'assimiler de façon critique les classiques du marxisme et d'appliquer les contributions les plus importantes à une analyse de la réalité actuelle. Le but de ce texte est de mettre en lumière la signification réelle et contemporaine de la formulation élémentaire : l'impérialisme domine la planète toute entière à notre époque; d'expliquer le contenu de 1'affirmation exprimée dans la plate-forme du CCI : "l'impérialisme (...) est devenu le moyen de subsistance de toute nation, grande ou petite"; de montrer que, dans le capitalisme moderne, toutes les guerres ont une nature impérialiste, sauf une : la guerre civile du prolétariat contre la bourgeoisie. Mais pour cela, il est d'abord nécessaire de revenir aux premiers débats sur l'impérialisme à l'intérieur du mouvement ouvrier.
MARXISME CONTRE REVISIONISME
Dans la période qui a mené à la première guerre mondiale, la question "théorique" de l'impérialisme a constitué une frontière séparant l'aile révolutionnaire -internationaliste de la social-démocratie- de tous les éléments réformistes et révisionnistes du mouvement ouvrier. Une fois la guerre ouverte, la position sur l'impérialisme déterminait de quel côté de la barricade on se trouvait. C'était une question éminemment pratique, puisque, c'est d'elle que dépendait toute l'attitude envers la guerre impérialiste et envers les convulsions révolutionnaires que la guerre avait provoquées.
Il y avait certains points cardinaux de cette question sur lesquels tous les marxistes révolutionnaires étaient d'accord. Ces points demeurent la base de toute définition marxiste de l'impérialisme aujourd’hui.
1) Les marxistes, pour qui l’impérialisme était défini comme un produit spécifique de la société capitaliste, attaquaient vigoureusement les idéologies bourgeoises les plus ouvertement réactionnaires qui parlaient de l'impérialisme comme d'un besoin biologique, une expression du désir de l'homme de territoires et de conquêtes (cette sorte de théorie qui refleurit aujourd'hui dans la notion d’"impératif territorial" colportée par les zoologistes sociaux du genre de Robert Ardrey et Desmond Monis). Les marxistes se battaient avec une tout aussi grande fermeté contre les thèmes racistes sur la "tâche civilisatrice de l'Homme Blanc et contre tous les amalgames confus de toutes les politiques de conquête et d'annexion de toutes sortes de formations sociales. Comme le disait Boukharine, cette :
"(..)dernière "théorie" largement répandue de l'impérialisme définit celui-ci comme une politique de conquête en général. De ce point de vue3 on peut en dire autant de l'impérialisme d'Alexandre de Macédoine et des conquérants espagnols> de Carthage et de Jean III, de l'ancienne Rome et de l'Amérique moderne, de Napoléon et de Hindenburg.
Quelle que soit sa simplicité3 cette théorie n'en n'est pas moins absolument fausse. Elle est fausse parce qu'elle "explique" tout c'est à dire juste rien.
(….) Il est évident que l'on peut en dire autant de la guerre. La guerre est un moyen de reproduction de certains rapports de production. La guerre de conquête est un moyen de reproduction élargie de ces rapports. Or, donner à la guerre la simple définition de guerre de conquête, c'est tout à fait insuffisant3 pour la bonne raison que l1essentiel n'est pas indiqué, à savoir, quels sont les rapports de production que cette guerre affermit et étend, et quelle est la base qu'une "politique de rapine" donnée est appelée à élargir". N. BOUKHARINE. L'économie mondiale et l'impérialisme". Ed.anthropos, 1969, p.110-111)
Bien que Lénine dise que "la politique coloniale et l'impérialisme existaient avant ce dernier stade du capitalisme, et même avant le capitalisme ; Rome, fondée sur l'esclavage, poursuivait une politique coloniale et pratiquait l'impérialisme" ; il rejoint Boukharine lorsqu'il ajoute :
"Mais les raisonnements "d'ordre général" sur l'impérialisme, qui négligent ou relèguent à l'arrière plan la différence essentielle des formations économiques et sociales, dégénèrent infailliblement en banalités creuses ou en rodomontades". LENINE. L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme". Œuvres choisies, Ed. du Progrès, p.720)
2) Deuxièmement les marxistes définissaient l'impérialisme comme une nécessité pour le capitalisme, comme le résultat direct du processus de l'accumulation, des lois inhérentes du capital. A un stade donné du développement du capital, c'était le seul moyen qui permette au système de prolonger son existence. Il était donc irréversible. Bien que l'explication de l'impérialisme comme expression de l'accumulation du capital est plus claire chez certains marxistes que chez d'autres (point sur lequel nous reviendrons), tous les marxistes rejetaient les thèses de Hobson, Kautsky et d'autres qui considéraient l'impérialisme comme une simple "politique" choisie par le capitalisme ou plutôt par des fractions particulières du capitalisme. Ces thèses s'accompagnaient logiquement de l'idée qu'on pouvait prouver que l'impérialisme était une politique mauvaise, coûteuse et à courte-vue, et qu'on pouvait au moins convaincre les secteurs les plus éclairés de la bourgeoisie qu'elles avaient avantage à une politique généreuse, non impérialiste. Tout cela ouvrait clairement la voie à toutes sortes de recettes réformistes, pacifistes, visant à rendre le capitalisme moins brutal et moins agressif. Kautsky développa même l'idée que le capitalisme évoluait graduellement et pacifiquement vers une phase d’"ultra-impérialisme", fusionnant en un seul grand trust sans antagonismes, où les guerres appartiendraient au passé. Contre cette vision utopiste (qui trouva écho durant le boom qui suivit la 2ème guerre mondiale chez Paul Cardan et ses semblables), les marxistes insistaient sur le fait que, loin de représenter un dépassement des antagonismes capitalistes, l'impérialisme exprimait l’exacerbation des antagonismes à leur plus haut degré. L'époque impérialiste était inévitablement une époque de crise mondiale, de despotisme politique et de guerre mondiale; confronté à cette perspective catastrophique, le prolétariat ne pouvait répondre que par la destruction révolutionnaire du capitalisme.
3) L'impérialisme était ainsi, considéré comme une phase spécifique de l'existence du capital.
Sa phase ultime et finale. Bien qu'on puisse parler d'impérialisme britannique et français dans la première partie du 19ème siècle, la phase impérialiste du capital en tant que système mondial ne commence pas vraiment avant les années 1870, moment où plusieurs capitaux nationaux hautement centralisés et concentrés commencent à entrer en concurrence pour les possessions coloniales, les sphères d'influence et la domination du marché mondial. Comme l'a dit Lénine :
"un des traits essentiels de l'impérialisme est la rivalité entre plusieurs grandes puissances à la poursuite de l'hégémonie". (Impérialisme, chap. 7, p. 109) L'impérialisme est donc essentiellement une relation de concurrence entre les Etats capitalistes à un certain stade de l'évolution du capital mondial. Pour aller plus loin; l'évolution de cette relation peut elle-même être séparée en deux phases distinctes qui sont directement liées aux changements du milieu global dans lequel prend place la compétition impérialiste.
"La première période de l'impérialisme se situa dans le dernier quart du 19ème siècle et fit suite à l'époque des guerres nationales par lesquelles s 'était cimentée la constitution des grands Etats nationaux et dont la guerre franco j-allemande marqua à peu près le terme extrême. Si la longue période de dépression économique qui succéda à la crise de 1873 portait déjà en germe La décadence du capitalisme, celui-ci put encore utiliser les courtes reprises qui jalonnèrent cette dépression pour, en quelque sorte, parachever l'exploitation des territoires et des peuples retardataires. Le capitalisme, à la recherche aride et fiévreuse de matières premières et d'acheteurs qui ne fussent ni capitalistes, ni salariés, vola, décima et assassina les populations coloniales, Ce fut l'époque de la pénétration et de l'extension de l'Angleterre en Egypte et en Afrique du Sud, de la France au Maroc, à Tunis et au Tonkin, de l'Italie dans l'Est Africain, sur les frontières de l'Abyssinie, de la Russie tsariste en Asie Centrale et en Mandchourie, de l'Allemagne en Afrique et en Asie, des USA aux Philippines et à Cuba, enfin du Japon sur le continent asiatique.
Mais une fois terminé le partage entre ces grands regroupements capitalistes, de toutes les bonnes terres, de toutes les richesses exploitables, de toutes les zones d'influence, bref de tous les coins du monde où peut être volé du travail qui, transformé en or, allait s 'entasser dans les banques nationales des métropoles, alors se trouva terminée aussi la mission progressive du capitalisme... il est certain qu'alors devrait s'ouvrir la crise générale du capitalisme". (Le problème de la guerre. 1935. Par JEHAN, un militant de la gauche communiste en Belgique)
La phase initiale de l'impérialisme, tout en donnant un avant-goût de la décadence du capitalisme, apportant misère et massacres aux populations des régions coloniales, avait encore un aspect progressif, en ce qu'il établissait la domination du capital à l'échelle mondiale, condition préalable à la révolution communiste. Mais une fois cette domination du monde accomplie, le capitalisme cesse d'être un système progressif, et les fléaux qu'il avait fait subir aux peuples coloniaux rebondissent alors au cœur du système, ce que confirme l'éclatement de la première guerre mondiale.
" Lrimpérialisme actuel n’est pas le prélude à l'expansion capitaliste. Il est la dernière étape de son processus historique d'expansion : la période de la concurrence mondiale accentuée et généralisée des Etats capitalistes autour des derniers restes de territoires non capitalistes du globe. Dans cette phase finale, la catastrophe économique et politique constitue l'élément vital, le mode normal d'existence du capital, autant qu'elle l'avait été dans sa phase initiale, celle de l''accumulation primitive. La découverte de l'Amérique et de la voie maritime pour l'Inde n'était pas seulement un exploit théorique de l'esprit et de la civilisation humaine, comme le veut la légende libérale, mais avait entraîné une suite de massacres collectifs de populations primitives du Nouveau Monde et introduit un trafic d'esclaves sur une grande échelle avec les peuples d'Asie et d'Afrique. De même, dans la phase finale de l'impérialisme, l'expansion économique du capital est indissolublement liée à la série de conquêtes coloniales et de guerres mondiales que nous connaissons. Le trait caractéristique de l'impérialisme en tant que lutte concurrentielle suprême pour l'hégémonie mondiale capitaliste n'est pas seulement l'énergie et l'universalité de l'exportation -signe significatif que la boucle de l'évolution commence à se refermer- mais le fait que la lutte décisive pour l'expansion rebondit des régions qui étaient sa convoitise, aux métropoles. Ainsi l'impérialisme ramène sa catastrophe de la périphérie de son champ d'action à son point de départ. Après avoir livré pendant quatre siècles l'existence et la civilisation de tous les peuples non-capitalistes d'Afrique, d'Asie, d’Amérique et d'Australie à des convulsions incessantes et au dépérissement en masse, l'expansion capitaliste précipite aujourd’hui les peuples civilisés de l'Europe elle-même dans une suite de catastrophes dont le résultat final ne peut être que la ruine de la civilisation ou l'avènement de la production socialiste". Rosa Luxemburg, ("Critique des critiques ou : ce que les épigones ont fait de la théorie marxiste", V., Petite Collection Maspéro 48, 1969, p.222, in "L'accumulation du capital")
Le capitalisme dans sa phase impérialiste finale entre dans "l'ère des guerres et des révolutions" comme l'affirma l'Internationale Communiste, une ère ou l'humanité est confrontée au strict choix : socialisme ou barbarie. Pour la classe ouvrière, cette époque signifie l'érosion de toutes les réformes gagnées au 19ème siècle et une attaque grandissante de son niveau de vie par l'austérité et la guerre. Politiquement, elle signifie la destruction ou la récupération de ses organisations antérieures et l'oppression impitoyable de l'Etat-Léviathan impérialiste, Etat astreint par la logique de la concurrence impérialiste et par la décomposition de l'édifice social à prendre en charge tous les aspects de la vie sociale, économique et politique. C'est pourquoi, confrontée au désastre de la 1ère guerre mondiale, la gauche révolutionnaire tira la conclusion que le capitalisme avait définitivement achevé son rôle historique, et que la tâche immédiate de la classe ouvrière internationale était de transformer la guerre impérialiste en guerre civile, de renverser le capitalisme en attaquant la racine du mal :
- le système capitaliste mondial. Naturellement, cela signifiait une rupture totale avec les traîtres de la Social-Démocratie qui, comme Scheideman, Millerand et d'autres, étaient devenus ouvertement les avocats chauvins de la guerre impérialiste, ou avec les "Social-pacifistes", comme Kautsky, qui continuaient à répandre l'illusion que le capitalisme pouvait exister sans impérialisme, sans dictature, terreur ou guerre.
- Jusque là, il ne pouvait y avoir de désaccord entre les marxistes, et en fait, ces points de base étaient suffisants pour le regroupement de l'avant- garde révolutionnaire dans l'Internationale Communiste. Mais les désaccords qui existaient alors et qui existent encore aujourd'hui dans le mouvement révolutionnaire surgirent lorsque les marxistes tentèrent de faire une analyse plus précise des forces motrices de l'impérialisme et de ses manifestations concrètes, et quand ils tirèrent les conséquences politiques de cette analyse. Ces désaccords tendaient à correspondre aux différentes théories de la crise du capitalisme et du déclin historique du système, puisque l'impérialisme était une tentative du capital pour surmonter ses contradictions mortelles, ce sur quoi tous s'accordaient. Ainsi, Boukharine et Luxemburg par exemple, insistèrent sur des contradictions différentes dans leurs théories des crises, et donc rendaient compte différemment de la force motrice de l'expansion impérialiste. Ce débat fut encore compliqué du fait que le gros du travail de Marx sur les questions économiques avait été écrit avant que l'impérialisme ne soit vraiment établi, et ce trou dans son travail donna lieu à différentes interprétations sur la façon dont les écrits de Marx pouvaient être appliqués à l'analyse de l'impérialisme. Il n'est pas possible dans ce texte de revenir sur tous ces débats sur la crise et l'impérialisme dont la plupart ne sont pas encore résolus aujourd'hui; ce que nous voulons faire, c'est examiner brièvement les deux grandes définitions de l'impérialisme développées à l'époque - thèse de LENINE/BOUKHARINE et thèse de LUXEMBURG - et voir comment s'adaptent les deux définitions à la fois à l'époque d'alors et à l'époque actuelle. Ce faisant, nous tenterons de préciser notre propre conception de l'impérialisme aujourd'hui.
LA CONCEPTION DE L' IMPERIALISME DE LENINE
Pour Lénine, les traits caractéristiques de l'impérialisme étaient :
1. Concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu'elle a créé des monopoles dont le rôle est décisif dans la vie économique.
2. Fusion du capital bancaire et du capital industriel, et création, sur la base de ce 'capital financier1, d'une oligarchie financière.
3. L'exportation des capitaux, à la différence de l'exportation des marchandises, prend une importance toute particulière.
4. Formation d'unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde.
5. Fin du partage territorial du globe entre les grandes puissances capitalistes.
("L'impérialisme, stade suprême du capitalisme", VII Ed. du Progrès, Moscou 1971, p.726)
Bien que la définition de l'impérialisme de Lénine contienne un nombre d'indications importantes, sa principale faiblesse est d'être plus une description de certains effets de l'impérialisme qu'une analyse des racines de l'impérialisme dans le processus d'accumulation. L'évolution organique ou intensive du capital vers des unités de plus en plus concentrées, et le développement géographique ou extensif du champ d'activité du capital (la recherche de colonies, la division territoriale du globe) sont fondamentalement des expressions de son processus interne d'accumulation. C'est la composition organique croissante du capital, avec la baisse tendancielle du taux de profit et le rétrécissement du marché intérieur qui contraignent le capital à chercher des débouchés nouveaux, rentables pour l'investissement de capital et à étendre continuellement le marché pour ses marchandises.
Mais bien que la dynamique profonde de l'impérialisme ne change pas, les manifestations extérieures de cette dynamique sont soumises à des modifications, de telle sorte que de nombreux aspects de la définition de Lénine de l'impérialisme sont inadéquats aujourd'hui, et même au temps où il les avait élaborés. C'est ainsi que la période où le capital semblait être dominé par une oligarchie du "capital financier" et par des "groupements de monopoles internationaux" ouvrait déjà la voie à une nouvelle phase pendant la 1ère guerre mondiale; l'ère du capitalisme d'Etat, de l'économie de guerre permanente. A l'époque des rivalités inter-impérialistes chroniques sur le marché mondial, le capital tout entier tend à se concentrer autour de l'appareil d'Etat qui subordonne et discipline toutes les fractions particulières du capital aux besoins de survie militaire/économique. La reconnaissance du fait que le capitalisme était entré dans une phase de luttes violentes entre les "trusts capitalistes d'Etat" nationaux était beaucoup plus claire chez Boukharine que chez Lénine (voir "L'économie mondiale et l'impérialisme" Ed.Anthropos, 1969), bien que Boukharine soit encore prisonnier du rapport impérialisme-capital financier, ce qui fait que son "trust capitaliste d'Etat" est en grande partie présenté comme un instrument de l'oligarchie financière, alors que l'Etat est en réalité l'organe dirigeant suprême à notre époque. Plus encore, comme le soulignait Bilan :
"Définir l'impérialisme comme 'produit du capital financier' comme le fait Boukharine, c'est établir une fausse filiation et surtout c'est perdre de vue l'origine commune de ces deux aspects du processus capitaliste : la production de plus-value." (Bilan n°ll, p.387)
L'échec de Lénine à comprendre la signification du capitalisme d'Etat devait avoir de graves conséquences politiques dans un certain nombre de domaines : les illusions sur la nature progressive de certains aspects du capitalisme d'Etat qui ont été appliqués, avec des conséquences désastreuses, par les bolcheviks dans la révolution russe ; l'incapacité à voir l'intégration des anciennes organisations ouvrières à l'Etat, et la théorie confuse de 1'"aristocratie ouvrière", des "partis ouvriers-bourgeois" et des "syndicats réactionnaires" mais toutefois distincts de la machine étatique (le problème avec ces organisations n'était alors plus qu'un des dirigeants traîtres avait été corrompu par les "superprofits impérialistes", mais que l'appareil tout entier était incorporé au colosse qu'est l'appareil d'Etat). Les conclusions tactiques tirées de ces théories erronées sont bien connues : front unique, travail syndical, etc. De même, l'insistance de Lénine sur le fait que les possessions coloniales étaient un trait distinctif et même indispensable de l'impérialisme n'a pas tenu l'épreuve du temps. Malgré la prévision que la perte des colonies, précipitée par les révoltes nationales dans ces régions, ébranlerait le système impérialiste jusque dans ses fondements, l'impérialisme s'est adapté tout à fait facilement à la "décolonisation". La décolonisation n'a fait qu'exprimer le déclin des anciennes puissances impérialistes et le triomphe des géants impérialistes qui n'étaient pas entravés par un grand nombre de colonies au moment de la 1ère guerre mondiale. C'est ainsi que les Etats-Unis et l'URSS purent développer une politique cynique "anticoloniale" pour mener à bien leurs propres objectifs impérialistes, pour s'appuyer sur les mouvements nationaux et les transformer immédiatement en guerres inter-impérialistes par "peuples" interposés.
La théorie de l'impérialisme de Lénine devint la position officielle des bolcheviks et de l'Internationale Communiste, en particulier en liaison avec la question nationale et coloniale, et c'est là que les manques de la théorie devaient avoir les conséquences les plus sérieuses. Si l'impérialisme est essentiellement défini par des caractéristiques superstructurelles, il devient facile de diviser le monde en nations impérialistes, oppresseuses, et en nations non-impérialistes, opprimées, et même pour certaines puissances impérialistes de "cesser" tout d'un coup d'être impérialistes, lorsqu'elles perdent une ou plusieurs de ces caractéristiques. En même temps s'est développée une tendance à noyer les différences de classe dans les "nations opprimées" et à défendre que le prolétariat -comme champion national de tous les opprimés- devait rallier les nations opprimées sous sa bannière révolutionnaire. Cette position s'appliquait principalement aux colonies, mais Lénine, dans sa critique à la "brochure de Junius", défend l'idée que même les pays capitalistes développés de l'Europe moderne, pourraient, dans certaines circonstances, combattre dans une guerre légitime pour l'indépendance nationale. Pendant la première guerre mondiale, cette idée ambiguë n'eut pas de conséquence, grâce à l'évaluation correcte de Lénine, selon laquelle le contexte impérialiste global de la guerre ne permettait pas au prolétariat de soutenir une politique d'indépendance nationale de quelque belligérant que ce soit. Mais les faiblesses de cette théorie furent démontrées de façon éclatante après la guerre : avant tout, avec le déclin de la vague révolutionnaire et l'isolement de l'Etat russe. L'idée d'un caractère "anti-impérialiste" des "nations opprimées" fut démentie par les faits en Finlande, en Europe de l'Est, en Perse, en Turquie et en Chine, où les tentatives de mener des politiques d'"autodétermination nationale" et de "fronts uniques anti-impérialistes" furent impuissantes à empêcher les bourgeoisies locales de s'allier aux puissances impérialistes et d'écraser toute initiative en faveur de la révolution communiste ([1] [7]). La plus grotesque application des idées avancées par Lénine dans son "à propos de la brochure de Junius" fut peut-être l'expérience "nationale bolchevik" en Allemagne en 1923 : selon ce concept sans fondement, l'Allemagne aurait soudain cessé d'être une puissance impérialiste avec la perte de ses colonies, et le pillage que l'Entente lui avait fait subir. Une alliance anti-impérialiste avec certains secteurs de la bourgeoisie allemande était donc à Tordre du jour. Bien sur, il n'y a pas une ligne directe qui relie les faiblesses théoriques de Lénine à ces trahisons totales. Entre les deux, il y a tout un processus de dégénérescence. Néanmoins il est important que les communistes démontrent que c'est précisément les erreurs des révolutionnaires du passé qui peuvent servir aux partis en dégénérescence ou contre-révolutionnaires pour justifier leur trahison. Ce n'est pas un hasard si la contre-révolution, sous ses formes stalinienne , maoïste ou trotskyste, fait abondamment référence aux théories de Lénine sur l'impérialisme et la libération nationale, pour "prouver" que la Russie ou la Chine ne sont pas impérialistes (voir le truc typique des gauchistes : "où sont les monopoles et les oligarchies financières en URSS ?"); ou aussi pour "prouver" que de nombreuses cliques bourgeoises des pays sous-développés doivent être soutenues dans leur lutte "anti-impérialiste". Il est vrai qu'ils déforment et corrompent nombre d'aspects de la théorie de Lénine, mais les communistes ne devraient pas avoir peur d'admettre qu'il y a de nombreux éléments dans la conception de Lénine qui peuvent être repris plus ou moins "tels quels" par ces forces bourgeoises. Ce sont précisément ces éléments que nous devons être capables de critiquer et de dépasser.
L'IMPERIALISME ET LA BAISSE TENDANCIELLE DU TAUX DE PROFIT
Dans Lénine, il est pratiquement implicite que l'expansion impérialiste puise ses racines dans le processus d'accumulation dans la nécessité de surmonter la baisse tendancielle du taux de profit en cherchant de la main d'œuvre bon marché et des matières premières dans les régions coloniales. Cet élément est plus explicitement mis en évidence par Boukharine, et ce n'est peut-être pas par hasard si l'analyse plus rigoureuse de l'impérialisme par Boukharine était, du moins au début, accompagnée d'une position plus claire sur la question nationale -(pendant la première guerre mondiale et les premières années de la révolution russe, Boukharine a combattu la position de Lénine sur l'auto-détermination nationale. Plus tard, il changea de position : ce fut la position de Luxemburg sur la question nationale -intimement liée à sa théorie de l'impérialisme ([2] [8])- qui s'est avérée la plus consistante.)- Sans aucun doute, la nécessité de contrecarrer la baisse tendancielle du taux de profit fut un élément primordial de l'impérialisme, puisque l'impérialisme commence précisément au stade où un grand nombre de capitaux nationaux à haute composition organique arrivent sur le terrain du marché mondial. Mais, bien que nous ne puissions pas traiter davantage la question ici ([3] [9]), nous considérons que les explications de l'impérialisme qui se réfèrent plus ou moins exclusivement à la baisse tendancielle du taux de profit souffrent de deux faiblesses majeures.
1) De telles explications tentent de dépeindre l'impérialisme comme le fait des seuls pays hautement développés -pays a forte composition organique du capital, obligés d'exporter le capital pour surmonter la baisse tendancielle du taux de profit.
Cette idée a atteint un niveau caricatural avec la CWO ([4] [10]) qui assimile l'impérialisme à l'indépendance économique et politique et conclue qu'il n'y a aujourd'hui que deux puissances impérialistes dans le monde - les USA et l'URSS, parce qu'ils sont les seuls à être vraiment "indépendants" (les autres pays n'ont que des tendances impérialistes qui ne peuvent jamais être réalisées). C'est la conséquence logique du fait de voir le problème du point de vue des capitaux individuels plutôt que du capital global. Comme le soulignait Rosa Luxemburg :
"La politique impérialiste n'est pas l'œuvre d'un pays ou d'un groupe de pays. Elle est le produit de l'évolution mondiale du capitalisme à un moment donné de sa maturation. C'est un phénomène international par nature, un tout inséparable qu'on ne peut comprendre que dans ses rapports réciproques et auquel aucun Etat ne saurait se soustraire." ("La crise de la Social-Démocratie" (Brochure de Junius) - Edition la Taupe, 1970 p.177)
Ceci ne veut pas dire que la conclusion de la CWO es la conséquence inévitable du fait d'expliquer l'impérialisme uniquement en se référant à la baisse tendancielle du taux de profit. Si on prend le point de vue du capital global, il devient clair que si c'est le taux de profit des pays les plus développés qui détermine le taux de profit global, les menées impérialistes des pays avancés qui en découlent ont aussi un écho dans les capitaux les plus faibles. Mais dès l'instant où on considère réellement le problème du point de vue du capital global, une autre contradiction du cycle de l'accumulation apparaît -l'incapacité du capital global à réaliser toute la plus-value à l'intérieur de ses propres rapports de production. Ce problème, posé par Luxemburg dans L'Accumulation du Capital fut nié par Lénine, Boukharine et leurs successeurs, qui l'ont considérée comme un abandon du marxisme. Il n'est pourtant pas difficile de montrer que Marx était préoccupé par le même problème ([5] [11]):
"Plus la production capitaliste se développe, plus elle est forcée de produire à une échelle qui n'a rien à voir avec la demande immédiate mais qui dépend d'une expansion constante du marché mondial. Ricardo recourt à l'affirmation rebattue de Say selon laquelle les capitalistes ne produisent pas dans le but du profit, de la plus-value, mais qu'ils produisent des valeurs d'usage directement pour la consommation -pour leur propre consommation. Il ne tient pas compte du fait que la marchandise doit être convertie en argent. La consommation des ouvriers ne suffit pas, puisque le profit provient précisément du fait que la consommation des ouvriers est inférieure à la valeur de leur produit et qu'il (le profit) est d'autant plus grand que la consommation est, relativement, petite. La consommation des capitalistes eux-mêmes est également insuffisante." (Théories sur la plus-value, 2ème partie, chap. XVI "La théorie de Ricardo sur le profit" - traduit de 1'anglais par nous)
Ainsi, toute analyse sérieuse de l'impérialisme doit prendre en compte cette nécessité d'une "expansion constante du marché mondial". Une théorie qui ignore ce problème est incapable d'expliquer pourquoi ce fut précisément au moment où le marché mondial devint incapable de poursuivre son expansion -avec l'intégration des secteurs les plus importants de l'économie précapitaliste dans l'économie capitaliste mondiale aux débuts du 20ème siècle- que le capitalisme est jeté dans la crise permanente de sa période impérialiste finale. La simultanéité historique de ces deux phénomènes peut-elle être rejetée comme une simple coïncidence ? Alors que toutes les analyses marxistes de l'impérialisme ont vu que la chasse aux matières premières et à la force de travail, toutes deux à bon marché, a été un aspect central de la conquête coloniale, seule celle de Rosa Luxemburg comprend 1'importance décisive des marchés précapitalistes des colonies et des semi-colonies, puisqu’ils fournissent le terrain pour une "expansion constante du marché mondial" jusqu'aux premières années du 20ème siècle. Et c'est précisément cet élément qui est la "variable" dans l'analyse. Le capital peut toujours trouver la force de travail pas chère et les matières premières bon marché dans les régions sous-développées : ceci est vrai à la fois avant et après l'incorporation des colonies et semi-colonies dans l'économie capitaliste mondiale, à la fois dans les phases ascendante et décadente du capital.
Mais d'une part la demande globale de ces régions cesse d'être "extra-capitaliste" et d'autre part le gros de cette demande est intégré dans les rapports de production capitalistes; le capital global n'a pas de nouveaux débouchés pour la réalisation de cette fraction de la plus-value destinée à l'accumulation, il a perdu sa capacité d'étendre continuellement le marché mondial. Maintenant les "régions coloniales" sont-elles mêmes productrices de plus-value, concurrentes des métropoles. La force de travail et les matières premières dans ces régions peuvent rester encore bon marché, elles peuvent rester des aires d'investissement profitables, mais elles ne peuvent plus aider le capital mondial à résoudre les problèmes de réalisation : elles sont devenues parties prenantes du problème. De plus, cette incapacité à étendre le marché mondial des quelques degrés requis par la productivité du capital prive aussi la bourgeoisie d'une des principales contre-tendances à la baisse du taux de profit : l'accroissement de la masse de profit par la production et la vente d'une somme croissante de marchandises. Ainsi se trouvent confirmées les prévisions du Manifeste Communiste :
"Les institutions bourgeoises sont devenues trop étroites pour contenir la richesse qu'elles ont créé. Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'une part, en imposant la destruction d'une masse de forces productives ; d'autre part, en s'emparant de marchés nouveaux et en exploitant mieux les anciens. Qu'est-ce à dire ? Elle prépare des crises plus générales et plus profondes, tout en réduisant les moyens de les prévenir". MARX. ("Manifeste du Parti Communiste.")
C'est la théorie de l'impérialisme de Rosa Luxemburg qui est la meilleure continuation de la pensée de Marx sur cette question.
LA CONCEPTION DE LUXEMBURG SUR L'IMPERIALISME ET SES CRITIQUES
"L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. Géographiquement, ce milieu représente aujourd'hui encore la plus grande partie du globe. Cependant le champ d'expansion offert à l'impérialisme apparaît comme minime, comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces de production capitalistes. Il faut tenir compte en effet de la masse énorme de capital déjà accumulé dans les vieux pays capitalistes et qui lutte pour écouler un surproduit et pour capitaliser sa plus-value et, en outre, de la rapidité avec laquelle les pays précapitalistes se transforment en pays capitalistes.
Sur la scène internationale, le capital doit donc procéder par des méthodes appropriées. Avec le degré d'évolution élevé atteint par les pays capitalistes et l'exaspération de la concurrence des pays capitalistes pour la conquête des territoires non-capitalistes, la poussée impérialiste, aussi bien dans son agression contre le monde non-capitaliste que dans les conflits plus aigus entre les pays capitalistes concurrents, augmente d'énergie et de violence. Mais plus s'accroissent la violence et l'énergie avec lesquelles le capital procède à la destruction des civilisations non-capitalistes, plus il rétrécit sa base d'accumulation. L'impérialisme est à la fois une méthode historique pour prolonger les jours du capital et le moyen le plus sûr et le plus rapide d'y mettre objectivement un terme. Cela ne signifie pas que le point final ait besoin d'être atteint à la lettre. La seule tendance vers ce but de l'évolution capitaliste se manifeste déjà par des phénomènes qui font de la phase finale du capitalisme une période de catastrophes." R.LUXEMBURG.("L'accumulation du capital." Ed. Maspéro. Page 111. Ch.31)
Comme on peut le voir dans ce passage, la définition luxemburgiste de l'impérialisme se concentre sur les bases du problème, c'est à dire le processus d'accumulation, et en particulier la phase du processus qui concerne la réalisation, plus que les ramifications superstructurelles de l'impérialisme. Par ailleurs, cependant, elle montre que le corollaire politique de l'expansion impérialiste est la militarisation de la société et le renforcement de l'Etat : l'essoufflement de la démocratie bourgeoise et le développement de formes ouvertement despotiques de la domination capitaliste, la brutale dégradation du niveau de vie des ouvriers pour maintenir le secteur militaire hypertrophié de l'économie. Bien que "1'Accumulation du Capital" contienne des idées contradictoires sur le militarisme vu comme un "département de l'accumulation", Luxemburg avait fondamentalement raison de voir l'économie de guerre comme une caractéristique indispensable du capitalisme impérialiste décadent. Mais l'analyse fondamentale de la force motrice de l'impérialisme de Luxemburg a été l'objet de nombreuses critiques. La plus importante fut écrite par Boukharine dans son ".L’impérialisme et Accumulation du Capital" (1924). Le gros de ses arguments contre la théorie de Luxemburg a trouvé récemment un écho dans la Communist Workers'Organisation (voir leur revue Revolutionary Perspectives n°6 :"1'Accumulation des contradictions"). Nous répondrons ici aux deux plus importantes critiques émises par Boukharine :
1) Selon Boukharine, la théorie de Luxemburg, selon laquelle le moteur de l'impérialisme réside dans la recherche de nouveaux marchés, rend l'époque impérialiste indifférenciée des autres périodes du capital :
" Le capitalisme commercial et le mercantilisme, le capitalisme industriel et le libéralisme, le capitalisme financier et l'impérialisme -toutes ces phases du développement capitaliste disparaissent et se fondent dans le capitalisme en tant que tel". (Boukharine, "Impérialisme et Accumulation", Ed.EDI, Ch.IV, p.l2l) "
Et pour la CWO :
" (...) et son analyse de l'impérialisme basée sur la "saturation des marchés" est extrêmement faible et inadéquate. Si comme l'admettait Luxemburg... les métropoles capitalistes contenaient encore des enclaves précapitalistes (serfs, paysans), pourquoi le capitalisme a-t-il besoin de s'étendre à l'extérieur, loin des métropoles capitalistes depuis le tout début de son existence ? Pourquoi n'a-t-il pas d'abord intégré ces couches dans le rapport capital-travail salarié s'il cherchait uniquement de nouveaux marchés? L'explication réside non dans le besoin de Mouvaux marchés, mais dans la recherche des matières premières et du profit maximum. Deuxièmement, la théorie de Luxemburg implique que l'impérialisme est une caractéristique permanente du capitalisme. Comme le capitalisme, pour Luxemburg, a toujours cherché à étendre le marché pour accumuler , sa théorie ne peut faire la distinction entre l'expansion originelle des économies de commerce et d'argent à l'aube du capitalisme en Europe et son expansion impérialiste ultérieure...le capital mercantile était nécessaire à l'accumulation originelle, mais c'est un phénomène qualitativement différent de la façon dont le capitalisme accumule une fois qu'il s'est établi comme mode de production dominant."
("Revolutionary Perspectives" n°6, P.18-19)
Dans ce passage; la virulence de la CWO contre le "luxemburgisme" surpasse même la polémique acérée de Boukharine. Un certain nombre de points doivent être établis avant de poursuivre. D'abord, Luxemburg n'a jamais dit que l'expansion impérialiste était due uniquement à la recherche de nouveaux marchés : elle a clairement décrit sa quête planétaire à la recherche de main d'œuvre bon marché et de matières premières, comme la CWO le note à la même page de Revolutionary Perspectives n°6. Deuxièmement, il est étonnant de présenter le besoin du capitalisme "d'étendre ses marchés pour accumuler" comme une découverte de Luxemburg, alors que c'est une position fondamentale défendue par Marx contre Say et Ricardo, comme nous l'avons déjà vue. Boukharine lui-même, n'a en aucune manière nié que l'impérialisme recherchait de nouveaux marchés, en fait, il considère ce fait comme une des trois forces motrices de l'expansion impérialiste :
" Nous avons mis à nu trois mobiles fondamentaux de la politique de conquête des Etats capitalistes modernes. Une compétition accrue sur le marché de la vente, sur le marché des matières premières et pour la sphère d'investissement du capital...Ces trois racines de la politique du capital financier, toutefois, représentent en substance seulement trois facettes d'un même phénomène, qui n'est autre que le conflit entre l'accroissement des forces productives et les limites "nationales" de l'organisation de la production".
BOUKHARINE. ("L'économie mondiale et l'impérialisme." Ch. 4. P. 101-102)
Néanmoins, l'opposition demeure : pour Lénine, Boukharine et autres, c'est "1'exportation des capitaux" et non celles des "marchandises" qui distinguent la phase impérialiste du capital de sa phase précédente. Est-ce que la théorie de Luxemburg ignore cette distinction et donc implique que l'impérialisme était une caractéristique du capital dès le début ?
Si nous nous référons aux passages de Luxemburg cités dans le texte, particulièrement à la longue citation de la "Critique des critiques", nous pouvons voir que Luxemburg faisait elle-même clairement une distinction entre la phase d'accumulation primitive et la phase impérialiste, qui est indubitablement présentée comme une phase déterminée dans le développement du capital. Est-ce que ce sont des mots creux ou est-ce qu'ils correspondent à la substance de la théorie de Luxemburg ?
En fait, il n'y a pas là de contradiction dans l'analyse de Luxemburg. L'impérialisme à proprement parler débute après les années 1870, lorsque le capitalisme mondial arrive à une nouvelle configuration significative : la période où la constitution des Etats nationaux d'Europe et d'Amérique du Nord est achevée, et où, au lieu d'une Grande-Bretagne "usine du monde", nous avons plusieurs "usines" capitalistes nationales développées en concurrence pour la domination du marché mondial -en concurrence non seulement pour l'obtention des marchés intérieurs des autres mais aussi pour le marché colonial . C'est cette situation qui provoque la dépression des années 1870 -"germes de la décadence capitaliste" justement parce que le déclin du système est synonyme de la division du marché mondial entre capitaux concurrents- avec la transformation du capitalisme en un "système fermé" dans lequel le problème de la réalisation devient insoluble. Mais, bien sûr, dans les années 70, la possibilité de briser le cercle fermé existait encore, et cela explique en grande partie la course désespérée de l'expansion impérialiste à cette époque.
Il est vrai, comme le souligne la CWO, que le capital a toujours recherché des marchés coloniaux, mais il n'y a pas de mystère à cela -les capitalistes chercheront toujours des zones d'exploitation rentables et des bonnes ventes, même si les marchés disponibles "chez soi" ne sont pas totalement saturés. Il serait absurde de s'attendre à ce que le capitalisme suive un cours de développement régulier -comme si les capitalistes s'étaient rencontrés pour dire ensemble : "d'abord nous allons épuiser tous les secteurs précapitalistes en Europe, ensuite nous nous étendrons à l'Asie, ensuite à 1'Afrique, etc ..."
Néanmoins, derrière le développement chaotique du capitalisme, on peut voir une caractéristique bien déterminée : le pillage des colonies par le capitalisme naissant; l'utilisation de ce pillage pour accélérer la révolution industrielle dans la métropole; ensuite, sur la base du capitalisme industriel, une nouvelle poussée dans les régions coloniales. Bien sûr, la première période de l'expansion coloniale n'était pas une réponse à une surproduction intérieure, mais correspondait aux nécessités de l'accumulation primitive. Nous ne pouvons commencer à parler d'impérialisme que 1orque l'expansion coloniale devient une réponse aux contradictions d'une production capitaliste pleinement développée. Dans cette mesure, nous pouvons situer les débuts de l'impérialisme à l'époque où les crises commerciales du milieu du 19ème siècle agissent comme aiguillon de l'expansion du capital britannique vers les colonies et semi-colonies. Mais, comme nous l'avons dit, l'impérialisme dans le plein sens du terme implique une relation de concurrents entre Etats capitalistes; et c'est lorsque le marché des métropoles a été partagé de façon décisive entre plusieurs géants capitalistes que l'expansion impérialiste devient une nécessité inévitable pour le capital. C'est ce qui explique la transformation rapide de la politique coloniale britannique dans la dernière partie du 19ème siècle. Avant la dépression des années 1870, avant l'accroissement de la concurrence des USA et de l'Allemagne, les capitalistes britanniques se demandaient si les colonies existantes valaient les dépenses qu'elles entraînaient et étaient hésitants à s'emparer de nouvelles colonies; ils furent à cette époque convaincus de la nécessité pour la Grande-Bretagne de maintenir et d'étendre sa politique coloniale. La course aux colonies de la fin du 19èmé siècle ne fut pas le résultat d'une soudaine vague de folie de la part de la bourgeoisie ou d'une recherche orgueilleuse de prestige national, mais était une réponse à une contradiction fondamentale du cycle d'accumulation : la concentration grandissante du capital et le partage du marché dans les métropoles, aggravant simultanément la baisse tendancielle du taux de profit, et le fossé entre la productivité et les marchés solvables, c'est à dire le problème de la réalisation.
L'idée que l'orientation vers l'ouverture de nouveaux marchés fut un élément de l'expansion impérialiste n'est pas, contrairement à ce que proclame la CWO dans RP n°6 (P.19) contredit par le fait que le gros du commerce mondial à cette époque était constitué par le commerce des métropoles capitalistes entre elles. Le phénomène avait été souligné par Luxemburg elle-même :
" (...) Avec le développement international du capitalisme, la capitalisation de la plus-value devient de plus en plus urgente et précaire. Il élargit d1rautre part la base dû capital constant et du capital variable en tant que masse, aussi bien dans l'absolu que par rapport à la plus value. De là le phénomène contradictoire que les anciens pays capitalistes, tout en constituant les uns pour les autres un marché toujours plus large et en pouvant de moins en moins se passer les uns des autres, entrent en même temps dans une concurrence toujours plus acharnée pour les relations avec les pays non capitalistes". R.LUXEMBURG ("L'Accumulation du Capital" Ch.26, p.39)
Les marchés "extérieurs" étaient pour le capital global un espace d'air frais dans une prison plus forte et plus peuplée. Plus l'espace d'air frais se rétrécit par rapport à la surpopulation de la prison, et plus les prisonniers se jetaient désespérément dessus.
Le fait que durant cette période, il y eut un net accroissement des exportations de capital ne signifie pas non plus que l'expansion impérialiste n'ait rien à voir avec un problème de marchés. L'exportation de capital vers les régions coloniales était nécessaire non seulement parce qu'elle permettait au capitalisme de produire dans des zones où la force de travail était bon marché et donc d'augmenter le taux de profit, mais encore parce qu'elle étendait le marché mondial :
a) parce que l'exportation de capitaux inclut l'exportation de biens de production qui sont eux-mêmes des marchandises qui doivent être vendues;
b) parce que l'exportation de capital -que ce soit sous la forme de capital monétaire pour l'investissement ou de biens de production- servait à étendre 1'ensemble du marché pour la production capitaliste en l'implantant dans de nouvelles régions et en amenant de plus en plus d'acheteurs solvables dans son orbite. L'exemple le plus évident est la construction de chemins de fer, qui ont servi à étendre la vente des marchandises capitalistes à des millions et des millions de nouveaux acheteurs.
Le problème du "marché" peut aider à expliquer une des caractéristiques les plus nettes de la façon dont l'impérialisme a étendu la production capitaliste à travers le monde : la "création" du sous-développement. Parce que les impérialistes voulaient un marché soumis -un marché d'acheteurs qui ne deviendraient pas des concurrents des métropoles en devenant producteurs capitalistes eux-mêmes. Il en découle le phénomène contradictoire par lequel l'impérialisme a exporté le mode de production capitaliste et a détruit systématiquement les formations économiques précapitalistes, tout en freinant simultanément le développement de capital indigène en pillant impitoyablement les économies coloniales, en subordonnant leur développement industriel aux besoins spécifiques de l'économie des métropoles et en appuyant les éléments les plus réactionnaires et les plus soumis des classes dominantes indigènes. C'est pourquoi, contrairement aux prévisions de Marx, le capitalisme n'a pas crée une image réfléchie de lui-même dans les régions coloniales. Dans les colonies et les semi-colonies, il ne devait pas naître de capitaux nationaux indépendants -pleinement formés avec leur propre révolution bourgeoise et leur base industrielle saine- mais plutôt des caricatures grossières des capitaux des métropoles, affaiblies par le poids des vestiges en décomposition des modes de production antérieurs, industrialisées au rabais pour servir les intérêts étrangers, avec des bourgeoisies faibles, nées séniles, à la fois au niveau économique et politique. L'impérialisme avait ainsi crée le sous-développement et ne serait plus jamais capable de l'abolir; en même temps, il s'assurait qu'il ne pourrait pas y avoir de révolutions bourgeoises dans les zones arriérées.
En grande partie, les répercussions profondes du développement impérialiste, répercussions qui ne sont que trop évidentes aujourd'hui où le "Tiers-Monde" sombre dans la barbarie, ont leurs origines dans la tentative impérialiste d'utiliser les colonies et les semi-colonies pour résoudre les problèmes des marchés.
Selon Boukharine, la définition de l'impérialisme par Luxemburg signifie que l'impérialisme cesse d'exister lorsqu'il n'y a plus de vestige du milieu non-capitaliste à se disputer :
" (...) Il suit de cette définition que la lutte pour des territoires DEJA capitalistes n'est pas de l’'impérialisme, ce qui est absurde ... il suit de la même définition que la lutte pour des territoires qui sont déjà "occupés" n1est pas non plus de l'impérialisme. La fausseté de ce moment de la définition saute aux yeux lui aussi... Citons un exemple typique qui permettra d'illustrer le caractère insoutenable de la conception luxemburgienne de l'impérialisme. Nous songeons à l'occupation de la Ruhr par les français (1923).
Du point de vue de la définition de Rosa Luxemburg, il n'y a ici aucun impérialisme, car :
1) il manque ici les "derniers territoires"
2) il n'existe ici aucun "territoire non-capitaliste"
3) le territoire de la Ruhr possédait déjà avant l'occupation un propriétaire impérialiste.".
("Impérialisme et Accumulation", p.121-122)
Cet argument a été repris dans la question naïve posée par la CWO à la 2ème Conférence Internationale à Paris : "Où sont les marchés précapitalistes ou autres dans la guerre entre Ethiopie et Somalie pour le désert de l'Ogaden ?" Une telle question trahit une compréhension bien faible de ce que dit Luxemburg, ainsi qu'une tendance regrettable à voir l'impérialisme, non comme "un phénomène international par nature, un tout inséparable" mais comme "l'œuvre d'un pays ou d'un groupe de pays"; en d'autres termes, une tendance à voir le problème du point de vue partiel et individuel des capitaux nationaux.
Si Boukharine s'est soucié de citer plus que la première phrase du passage de "L'Accumulation du capital" dé Luxemburg que nous avons cité entièrement TpTl3), il aurait montré que pour Luxemburg, l'épuisement grandissant du milieu non-capitaliste ne signifiait pas la fin de l'impérialisme, mais l'intensification des antagonismes impérialistes entre les Etats capitalistes eux-mêmes. C'est ce que voulait dire Luxemburg quand elle écrivait que : "l'impérialisme ramène sa catastrophe de la périphérie de son champ d'action à son point de départ" ("Critique des critiques"). Dans la phase finale de l'impérialisme, le capital est plongé dans une horrible série de guerres où chaque capital ou bloc de capitaux, incapable de s'étendre "pacifiquement" à de nouvelles zones, est contraint de s'emparer des marchés et des territoires de ses rivaux. La guerre devient le mode de survie de tout le système.
Bien sûr Luxemburg pensait que la révolution mettrait fin au capitalisme bien avant que le milieu non capitaliste n'en soit réduit à l'insignifiant facteur qu'il est aujourd'hui. L'explication de la façon dont le capitalisme décadent a prolongé son existence en l'absence de fait de ce milieu n'est pas l'objet de ce texte ([6] [12]). Mais tant qu'on considère l'impérialisme comme un "produit de l'évolution mondiale du capitalisme à un moment donné de sa maturation", "un phénomène international par nature, un tout inséparable", nous pouvons voir la validité de la définition de Luxemburg. Elle nécessite seulement d'être modifiée dans la mesure où aujourd'hui, les politiques impérialistes de conquête et de domination sont déterminées par la quasi complète disparition d'un marché extérieur, au lieu d'être une lutte directe pour des vestiges précapitalistes. Il est importait de souligner un changement global dans l'évolution du capitalisme mondial -l'épuisement des marchés extérieurs- qui pousse chaque fraction particulière du capital à se comporter de façon impérialiste.
Revenons aux objections de Boukharine : il n'est pas nécessaire de chercher des "milieux non-capitalistes" dans chaque conflit impérialiste, parce que c'est le capital comme un tout, le capital global, qui nécessite un marché extérieur pour son expansion. Pour le capitaliste individuel, les capitalistes et les ouvriers offrent un marché parfaitement valable pour ses marchandises : de même, pour un capital national, une nation capitaliste rivale peut être utilisée pour absorber sa plus-value. Tout marché que se disputent les Etats impérialistes n'a pas toujours été précapitaliste, et c'est de moins en moins le cas au fur et à mesure que ces marchés s'intègrent au capital mondial. Chaque lutte inter-impérialiste n'est pas non plus une lutte directe pour des marchés, loin de là. Dans la situation actuelle, la rivalité globale entre les USA et l'URSS est conditionnée par l'impossibilité d'étendre progressivement le marché mondial. Mais beaucoup, et peut-être la plupart des aspects spécifiques des politiques étrangères des USA et de l'URSS sont dirigés vers la consolidation d'avantages stratégico-militaires sur l'autre bloc. Par exemple, Israël n'est pas plus un marché pour les USA que Cuba pour l'URSS. Ces positions sont entretenues principalement pour leur valeur stratégico-politique, au prix de considérables dépenses de la part de leurs souteneurs. A une plus petite échelle, le pillage par le Vietnam des champs de riz cambodgiens n'est que cela, un pillage. Le Cambodge n'en constitue pas pour autant un "marché" pour l'industrie vietnamienne. Mais le Vietnam est contraint de piller les champs de riz cambodgiens parce que la stagnation industrielle de son secteur agricole ne lui permet pas de produire suffisamment pour nourrir la population vietnamienne. Et sa stagnation industrielle est déterminée par le fait que le marché mondial ne peut pas s'étendre, est déjà partagé, et n'admettrait pas de nouveaux arrivants. Une fois encore, ces
questions ne trouvent leur sens qu'en partant du point de vue global .
CONCLUSIONS POLITIQUES : L’IMPERIALISME ET L'IMPOSSIBILITE DES GUERRES NATIONALES
Les implications politiques du débat théorique sur l'impérialisme ont toujours été centrées sur une question : l'époque de l'impérialisme a-t-elle rendu plus probables les guerres nationales révolutionnaires comme l'affirmait Lénine, ou les a-t-elle rendues impossibles, comme l'affirmait Luxemburg ? Pour nous 1'histoire a de façon irréfutable confirmé l'affirmation de Luxemburg selon laquelle :
"La tendance générale de la politique capitaliste actuelle domine la politique des Etats particuliers comme une loi aveugle et toute puissante, tout comme les lois de la concurrence économique déterminent rigoureusement les conditions de production pour chaque entrepreneur particulier". ("Brochure de Junius", p.178)
Et en conséquence :
"A l'époque de cet impérialisme déchaîné, il ne peut plus y avoir de guerres nationales. Les intérêts nationaux ne sont qu'une mystification qui a pour but de mettre les masses populaires laborieuses au service de leur ennemi mortel : l'impérialisme."
(Idem, p.220)
La première citation a les applications concrètes suivantes à cette époque -qui vérifient toutes deux de façon éclatante la seconde citation :
a) Toute nation, toute bourgeoisie en puissance, est contrainte de s'aligner derrière un des blocs impérialistes dominants, et donc de se conformer et de se plier aux impératifs du capitalisme mondial. Encore une fois, selon les mots de Luxemburg :
"Les petites nations, dont les classes dirigeantes sont les jouets et les complices de leurs camarades de classe des grands Etats, ne sont que des pions dans le jeu impérialiste des grandes puissances et tout comme les masses, ouvrières des grandes puissances, elles sont utilisées comme instruments pendant la guerre pour être sacrifiées après la guerre aux intérêts capitalistes". ("La crise de la Social-Démocratie" (Brochure de Junius) p.221)
Contrairement à l'espoir de Lénine que les révoltes des "nations opprimées" affaibliraient l'impérialisme, toutes les luttes nationales à notre époque ont été transformées en guerres impérialistes par l’irréversible domination des grandes puissances; comme le reconnaissait Lénine lui-même, l'impérialisme signifie que le monde entier est divisé entre les grands Etats capitalistes : "de telle sorte que dans l'avenir seul un repartage est possible, c'est à aire que les territoires ne peuvent que passer d'un "propriétaire" à un autre, au lieu de passer du stade de territoire libre à celui de "propriétaire". ("L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme")
L'expérience des 60 dernières années a montré que ce que Lénine appliquait aux "territoires" peut être appliqué aussi à toutes les nations. Aucune ne peut échapper à l'étau impérialiste. C'est particulièrement évident aujourd'hui où le monde a été partagé, depuis 1945, en 2 blocs impérialistes constitués de façon permanente. Alors que la crise s'approfondit et que les blocs se renforcent, il devient clair que même les géants capitalistes comme le Japon et la Chine doivent se soumettre humblement aux diktats de leur maître, les USA. Dans une telle situation, comment peut-on encore avoir des illusions sur la possibilité d'indépendance nationale" des pays chroniquement faibles que sont les anciennes colonies ?
b) Toute nation ([7] [13]) est contrainte d'agir de façon impérialiste par rapport à ses concurrents. Même en étant subordonnée à un bloc dominant, toute nation est obligée de tenter d'en soumettre d'autres, plus petites, à son hégémonie. Luxemburg a noté ce phénomène pendant la première guerre mondiale, par rapport à la Serbie :
" Formellement, la Serbie mène sans aucun doute une guerre de défense nationale. Mais sa monarchie et ses classes dominantes sont bourrées de velléités expansionnistes comme le sont les classes dominantes de tous les Etats modernes... Ainsi, la Serbie avance aujourd'hui vers les côtes adriatiques où elle mène un véritable conflit impérialiste avec l'Italie sur le dos des Albanais." ("Brochure de Junius". p.181.182)
L'état d'asphyxie du marché mondial fait de la décadence l'époque de la guerre de chacun contre tous. Loin de pouvoir échapper à cette réalité, les petites nations sont contraintes de s'adapter totalement. La militarisation extrême des capitaux les plus arriérés, les fréquentes guerres locales entre les Etats des régions sous-développées, sont les manifestations chroniques du fait qu'"aucune nation ne peut rester à l'écart" de la politique impérialiste aujourd'hui.
Selon la CWO, "l'idée que tous les pays sont impérialistes contredit l'idée des blocs impérialistes". (Revolutionary Perspectives.n°12. p.25). Mais cela n'est vrai que si on limite la discussion à l'avance en affirmant que seules les puissances "indépendantes" sont impérialistes. Il est vrai que toute nation doit s'inscrire dans l'un ou l'autre bloc impérialiste, mais elle le fait seulement parce que c'est la seule façon de défendre ses propres intérêts impérialistes. Les conflits et les conflagrations à l'intérieur de chaque bloc n'en sont pas éliminés pour autant (et ils peuvent même prendre la forme de guerres ouvertes comme entre la Grèce et la Turquie en 1974) : ils sont seulement subordonnés à un conflit qui prévaut sur tous les autres. Les blocs impérialistes, comme toutes les alliances bourgeoises, ne peuvent être réellement unifiés ou harmonieux. Les voir ainsi, ou du moins considérer les nations faibles d'un bloc seulement comme des pantins dans les mains des puissances dominantes, rend impossible à comprendre les contradictions réelles et les conflits qui surgissent au sein du bloc, non seulement entre les nations faibles elles-mêmes, mais entre les besoins des nations les plus faibles et ceux de la puissance dominante. Le fait que ces conflits se règlent presque toujours en faveur de l'Etat dominant, ne les rend pas moins réels. De même, ignorer les menées impérialistes des petites nations rend pratiquement impossible à expliquer les guerres entre ces Etats. Le fait que ces menées soient invariablement utilisées pour les intérêts des blocs ne signifie pas qu'elles soient purement produites par les décisions secrètes de Moscou ou de Washington. Elles proviennent des tensions et des difficultés réelles au niveau local, difficultés qui donnent inévitablement lieu à une réponse impérialiste de la part des Etats locaux. Il ne tient pas debout de dire que les plus petites nations ont seulement des tendances impérialistes lorsqu'on voit par exemple le Vietnam envahir le Cambodge, renverser son gouvernement, installer un régime qui lui est soumis, piller son économie, et faire des appels pour la formation d'une "Fédération Indochinoise" sous l'hégémonie Vietnamienne. Le Vietnam n'a pas seulement des appétits impérialistes; il les satisfait concrètement en gobant ses voisins.
Si nous rejetons l'idée que cette politique est l'expression d'un Etat ouvrier livrant une guerre révolutionnaire, si nous ne considérons pas le clan dominant au Vietnam comme le protagoniste d'une lutte bourgeoise historiquement progressive pour l'indépendance nationale, il n'y a qu'un seul mot pour une politique et des actes de cet acabit : impérialisme.
GUERRE IMPERIALISTE OU REVOLUTION PROLETARIENNE
Si toutes les "luttes nationales" servent les intérêts d'Etats impérialistes grands ou petits, alors il est impossible de parler de guerre de défense nationale, de libération nationale, ou de mouvements révolutionnaires nationaux à cette époque. Il est nécessaire de rejeter toute tentative de réintroduire la position de l'Internationale Communiste sur la question nationale et coloniale. Ainsi par exemple, le Nucleo Comunista Internazionalista ([8] [14]) suggère qu'il serait possible d'appliquer les thèses de l'IC aux régions sous-développées si un vrai parti communiste existait :
"(...) dans les zones extra-métropolitaines, la mission d'un parti communiste passe, obligatoirement par l'accomplissement de tâches qui ne sont pas ''siennes" (en termes immédiats), même 'démocraties-bourgeoises' (constitution d'un Etat national indépendant, unification territoriale et économique, réforme agraire, nationalisation, "
(Notes pour une orientation sur la question nationale et coloniale. Textes préparatoires, vol.I, 2ème Conférence Internationale. Paris. Nov.78). La préoccupation du NCI est que le prolétariat et son avant-garde ne peuvent être indifférents aux mouvements sociaux des masses opprimées dans ces régions, doivent prendre la tête de leurs révoltes, les rattacher à la révolution communiste mondiale : ceci est parfaitement correct. Mais pour cela, le prolétariat doit aussi reconnaître que l'élément "national" ne vient pas des masses opprimées et exploitées, mais de leurs oppresseurs et exploiteurs. Dès 1'instant où ces révoltes sont entraînées dans une lutte pour des tâches "nationales", elles sont déviées sur le terrain de la bourgeoisie. Dans le contexte actuel national implique impérialisme :
"Depuis lors, l'impérialisme a complètement enterré le vieux programme bourgeois démocratique : l'expansion au-delà des frontières nationales (quelles que soient les conditions nationales des pays annexés) est devenue la plate-forme de la bourgeoisie de tous les pays. Certes la phrase nationale est demeurée, mais son contenu réel et sa fonction se sont mués en leur contraire. Elle ne sert plus qu'à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elle ne soit utilisée comme cri de guerre, dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de leur faire jouer le rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes." ("Brochure de Junius", p.178)
Cette vérité a été confirmée par tous les soi- disant mouvements de "libération nationale" du Vietnam à l'Angola, du Liban au Nicaragua. Avant et après leur accession au pouvoir, les forces bourgeoises de libération nationale agissent invariable ment comme agents de Tune ou l'autre des grandes puissances impérialistes. Dès le moment où elles s'emparent de l'Etat, elles commencent à poursuivre leurs propres buts impérialistes. Donc, la question n'est pas de diriger la révolte des masses "opprimées dans un "moment" de la lutte nationale démocratique bourgeoise, mais de les conduire hors du terrain national bourgeois, sur le terrain prolétarien de la guerre de classe. "Transformer la guerre impérialiste en guerre civile" est le cri de |ralliement du prolétariat dans toutes les parties du monde aujourd'hui.
Le caractère impérialiste actuel de toutes les fractions de la bourgeoisie et de tous leurs projets politiques ne peut pas être inversé, pas même momentanément, pas même par le meilleur parti communiste du monde. C'est une réalité historique profonde, basée sur une évolution sociale objectivement déterminée.
"L'ère des guerres impérialistes et des révolutions prolétariennes n'oppose plus des Etats réactionnaires et des Etats progressistes dans des guerres où se forge, avec le concours des masses populaires, l'unité nationale de la Bourgeoisie, où s'édifie la base géographique et politique servant de tremplin aux forces productives.
Elle n'oppose plus davantage la Bourgeoisie aux classes dominantes des colonies dans des guerres coloniales fournissant air et espace aux forces capitalistes de production déjà puissamment développées.
Mais cette époque oppose des Etats impérialistes, entités économiques se partageant et se repartageant le monde, incapables cependant de comprimer les contrastes de classe et les contradictions économiques autrement qu'en opérant, par la guerre, une gigantesque destruction de forces productives inactives et d'innombrables prolétaires répétés de la production.
DU POINT DE VUE DE L'EXPERIENCE HISTORIQUE, ON PEUT AFFIRMER QUE LE CARACTERE DES GUERRES QUI EBRANLENT PERIODIQUEMENT LA SOCIETE CAPITALISTE, AINSI QUE LA POLITIQUE PROLETARIENNE CORRESPONDANTE, DOIVENT ETRE DETERMINES NON PAR L'ASPECT PARTICULIER ET SOUVENT EQUIVOQUE - SOUS LEQUEL CES GUERRES PEUVENT APPARAITRE, MAIS PAR LEUR AMBIANCE HISTORIQUE ISSUE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DU DEGRE DE MATURITE DES ANTAGONISMES DE CLASSE."(Souligné par nous) (Le problème de la guerre. 1935. Jehan.)
Quand nous concluons que dans le contexte historique actuel, toutes les guerres, toutes les politiques de conquête, toutes les relations concurrentes entre Etats capitalistes, ont une nature impérialiste, nous ne sommes pas en contradiction avec ce qu'affirmait avec raison Boukharine, qu'il fallait juger du caractère d'une politique des guerres et des conquêtes à partir de la question : "Quels rapports de production sont renforcés ou étendus par la guerre." Nous n'affaiblissons pas la précision du terme "impérialisme" en élargissant son emploi. Car, si les marxistes identifiaient les guerres nationales à des guerres au service d'une fonction progressive par l'extension des rapports de production à l'époque où ceux-ci servaient encore de base pour le développement des forces productives, ils opposaient les guerres de ce type aux guerres impérialistes - guerres historiquement réactionnaires en ce qu'elles servent à maintenir les rapports capitalistes alors qu'ils sont devenus une entrave à tout développement ultérieur. Aujourd'hui, toutes les guerres de la bourgeoisie et toutes les politiques extérieures visent à préserver un mode de production décadent, pourri : on peut donc toutes les qualifier à juste raison d'impérialistes. En effet, un des traits les plus caractéristiques de la décadence du capitalisme est que, alors que dans sa phase ascendante, "la guerre a pour fonction d’assurer un élargissement du marché, en vue d'une plus grande production de moyens de consommation, dans la phase (décadente) la production est essentiellement axée sur la production de moyens de destruction, c'est-à-dire en vue de la guerre. La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique (période ascendante), l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre." (Gauche Communiste de France, "Rapport sur la situation internationale", 1945)
Bien que le but de la production capitaliste reste la production de plus-value, la subordination croissante de toute l'activité économique aux nécessités de la guerre représente une tendance du capital à se nier lui-même. La guerre impérialiste née de la course aux profits de la bourgeoisie assume une dynamique au cours de laquelle les lois de la rentabilité et de l'échange sont de plus en plus balayées. Les calculs des profits et des pertes, les rapports normaux de vente et d'achat sont laissés en marge de la course folle du capital vers son autodestruction. Aujourd'hui, la "solution" qu'offre le capital à l'humanité logique de son auto cannibalisme, est un holocauste nucléaire qui pourrait détruire la race humaine toute entière. Cette tendance à 1'auto-négation du capital dans la guerre s'accompagne d'une militarisation universelle de la société : un processus qui apparaît dans toute son ampleur dans le tiers-monde et dans les régimes staliniens mais qui, si la bourgeoisie a la voie libre, deviendra bientôt une réalité pour les ouvriers des "démocraties" occidentales également. La subordination totale de la vie économique, politique et sociale aux besoins de la guerre : telle est la terrible réalité de l'impérialisme dans tous les pays aujourd'hui. Plus que jamais, la classe ouvrière mondiale se trouve devant 1'alternative mise en avant par Rosa Luxemburg en 1915 :
"Soit le triomphe de l'impérialisme et la destruction de toute culture comme dans la Rome ancienne, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un immense cimetière soit la victoire du socialisme, c'est-à-dire la lutte consciente du prolétariat international contre l'impérialisme."
("Brochure de Junius", traduit de l'anglais par nous)
C.D.Ward
[1] [15] Voir la brochure du CCI "Nation ou Classe" pour une argumentation plus détaillée.
[2] [16] Ici nous devons corriger une mauvaise compréhension de la CWO lorsqu'elle rejette l’idée que "la vision de Luxemburg sur la question nationale a pour base sa vision économique : la première précède la seconde de plus de 10 ans." (Revolutionary Perspectives n°12, p.25). De toute évidence, la CWO n'est pas au courant de ce passage écrit par Luxemburg en 1898 et publié dans la première édition de "Réforme ou Révolution" :
"Quand nous examinons la situation économique actuelle, nous devons certainement admettre que nous ne sommes pas encore entrés dans la phase de pleine maturité capitaliste qui est prévue par la théorie de Marx des crises périodiques. Le marché mondial est encore dans une phase d'expansion. Donc, bien que nous n'en soyons plus au stade de ces soudains surgissements de nouvelles zones d'ouverture à l'économie qui avaient lieu de temps en temps jusque dans les années 1870, et avec eux, des premières crises pour ainsi dire de 'jeunesse' du capitalisme, nous n'en sommes pas encore à ce degré de développement, de pleine expansion du marché mondial, qui produira des collisions périodiques entre les forces productives et les limites du marché, ou, en d'autres termes, les crises réelles d'un capitalisme pleinement développé...Une fois que le marché mondial est plus ou moins pleinement étendu, de telle sorte qu'il ne peut plus y avoir d'ouverture brutale de marchés, la croissance incessante de la productivité du travail produit tôt ou tard ces collisions périodiques entre les forces productives et les limites du marché qui deviennent de plus en plus violentes et aiguës avec leur répétition."
(cité par Sternberg, "Capitalisme et Socialisme", traduit de l'anglais par nous).
[3] [17] Voir "Théories économiques et lutte pour le socialisme", Revue Internationale n°16.
[4] [18] Communist Workers' Organisation qui publie Revolutionary Perspectives : c/o 21 Durham St. Pelaw,Gateshead, Tyne and Wear, NE10 OXS, GB.
[5] [19] Voir "Marxisme et théories des crises", Revue Internationale n°13.
[6] [20] Voir la brochure à paraître sur "La décadence du capitalisme".
[7] [21] Quand nous disons "toute nation est impérialiste", il est clair que nous faisons une généralisation et que, comme dans toute généralisation, des exceptions peuvent être trouvées, des exemples de tel ou tel Etat qui n'est jamais apparu commettre des crimes impérialistes ; mais, de telles exceptions ne démentent pas l’ensemble. Pas plus que le problème ne peut être évité par des questions stupides du genre "Où est l1impérialisme des Seychelles, de Monaco, de San Remo ?" Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les paradis de la finance ou des tours joués par l'histoire, mais des capitaux nationaux qui, bien qu'ils ne soient pas indépendants, ont une existence palpable et une activité sur le marché mondial !
[8] [22] Partito e Clase : c/o P.Turco Stretta Matteoti 6, 33043 Cividale, Italie.
Questions théoriques:
- Impérialisme [23]
Heritage de la Gauche Communiste:
La Grande Bretagne depuis la 2eme guerre (II)
- 3525 lectures
LE PARTI TRAVAILLISTE : EQUIPE GOUVERNEMENTALE ET OPPOSITION LOYALE
9. Le parti de la bourgeoisie qui correspond le mieux aux besoins globaux du capital national britannique - pas seulement dans la crise conjoncturelle actuelle mais dans toute la période de décadence — est le Parti Travailliste. Sa structure spécifique et son orientation sont celles qui correspondent le mieux pour répondre aux exigences du capital britannique, en particulier depuis la 2ème guerre mondiale, par rapport aux nécessités de :
- l'étatisation de l'économie,
- le soutien au bloc occidental,
- contenir la classe ouvrière.
Bien qu'il serait erroné de ne pas reconnaître la souplesse du Parti Conservateur, produit de sa maturité en tant que parti le plus expérimenté de la plus vieille nation capitaliste, l'expérience de ces derniers temps n'a fait que souligner le rôle du Parti Travailliste. En effet, ces derniers dix ans ont vu une crise économique profonde, une intensification des rivalités inter-impérialistes et une combativité ouvrière comme on n'en n'avait pas vue depuis la dernière vague révolutionnaire. A première vue, cet argument peut ne pas paraître si évident : depuis la fin de la guerre, les deux partis ont été au pouvoir environ 17 ans chacun. Cette statistique cache en fait deux facteurs importants:
- La plus longue période de gouvernement conservateur, de 1951 à 1964, avait comme objectif principal d'essayer de maintenir l'unité de l'Empire Commonwealth comme marché de réserve au capital britannique. Son effort n'a pas réussi et une telle situation exigeant un gouvernement semblable ne se reproduira plus.
- Depuis le début de la crise ouverte, les deux occasions où le Parti Travailliste a été chassé du pouvoir ont été produites par des poussées de luttes de classe qui ont considérablement usé la capacité du Parti Travailliste et des syndicats à contenir le prolétariat, usure accentuée par les périodes où le parti de gauche au gouvernement avait attaqué le niveau de vie des ouvriers. Pendant ces périodes, le Parti Travailliste et les syndicats ont traversé des phases d'"opposition" pendant lesquelles ils ont essayé de regrouper leurs forces le plus efficacement possible pour pouvoir répondre aux exigences de la combativité ouvrière. Mais, même dans l'opposition, le rôle de dévoiement de la lutte de la classe ouvrière demeure de manière prédominante et propre à cette fraction de la bourgeoisie.
Ainsi, on peut voir, lorsqu'on étudie l'évolution de la situation depuis 1945, que le défenseur le plus efficace du capital national est le Parti Travailliste. Il est par conséquent l'ennemi le plus dangereux de la lutte du prolétariat.
10. Lorsque nous examinons les manœuvres des partis dans cette période et que nous les relions aux questions qu'affronte la bourgeoisie, on doit se rappeler que :
- Si les différences entre Parti Travailliste et Parti Conservateur ne sont pas aussi grandes que leur propagande essaye de le faire croire, elles correspondent néanmoins à des visions différentes du programme nécessaire au capital britannique. Par exemple, le Parti Travailliste est de loin le plus engagé dans le contrôle de l'Etat sur l'économie que les Conservateurs qui gardent une loyauté plus grande envers les intérêts particuliers de la société ; les Travaillistes sont plus fortement liés à l'appareil syndical, ce que les Conservateurs ne peuvent faire.
- Les programmes défendus par chacun de ces partis ne sont pas figés, mais changent en fonction de la pression imposée au capital national et en fonction des options présentées dans une période donnée. Cette pression provient des circonstances immédiates aussi bien que des effets à long terme de la crise permanente du capitalisme. Par exemple, par rapport à l'accroissement de l'étatisation (qui est maintenant une nécessité historique pour tout capital national), les Conservateurs ont glissé vers une position beaucoup plus à gauche que celle prise, disons il y a environ 10 ans.
- Chaque parti possède plusieurs courants ou fractions en son sein qui reflètent différents programmes pour traiter les problèmes du capital national. Qu'un parti bourgeois puisse tenter de paraître monolithique, il n'empêche que des fractions internes se combattent continuellement. Les changements dans les politiques du parti peuvent ainsi s'effectuer par l'affirmation d'une fraction aux dépends d'une autre.
- Les Travaillistes et les Conservateurs sont tous deux contraints par la structure parlementaire et par le système électoral qui l'exige, d'avoir "recours" à différents secteurs de l'électorat ; ceci est un fardeau sur la capacité de la bourgeoisie à mettre en place la fraction gouvernante qu'elle souhaite, bien que dans le cas de la Grande-Bretagne, le parlementarisme ait constitué une source importante de mystification contre la classe ouvrière. Cependant, la bourgeoisie a la volonté et  la capacité d'interrompre la mascarade électorale lorsque le besoin s'en fait sentir, comme elle l'a fait par exemple entre 1939 et 1945 avec la formation de la coalition nationale.
11. Au début de la 2ème guerre mondiale, la bourgeoisie britannique était gouvernée par la fraction du Parti Conservateur qui avait essayé d'éviter la guerre. Cette fraction tomba à la fin de la "drôle de guerre" et fut remplacée par une alliance de ces secteurs de la bourgeoisie qui considéraient que leur tâche première était d'arrêter l'expansionnisme allemand. Le gouvernement de coalition a conduit par Churchill incluait une représentation substantielle du Parti Travailliste pour deux raisons principales :
- Le Parti Travailliste possédait la capacité nécessaire pour organiser et imposer la domination de l'Etat sur tous les aspects de l'économie et I pour subordonner l'économie aux besoins de la production de guerre.
- Seul le Parti Travailliste était capable de mobiliser la classe ouvrière par d'une part l'austérité et des taux élevés d'exploitation exigés pour lai production de guerre, et d'autre part pour la conscription dans l'armée. Malgré la majorité des Conservateurs dans le gouvernement, le poids réel de l'organisation de la société pour la guerre était assumé par le Parti Travailliste et les syndicats. Et en fait, même la chute de Chamberlain et le choix des Conservateurs de le remplacer par Churchill étaient dus en grande partie aux efforts du Parti Travailliste.
La guerre s'est poursuivie sur plusieurs objectifs dont la plupart étaient partagés par les USA : la défaite de l'Allemagne et du Japon et la résistance à la menace russe en Europe. Cependant, le gouvernement de coalition résista à la menace que représentaient les USA sur l'économie britannique et sur ses colonies. La bourgeoisie britannique ne voulait pas devenir une dépendance des USA. Pour donner une idée de cette résistance, on peut mentionner le fait que, malgré tous les efforts de la bourgeoisie US, ce n'est qu'avec la crise du Canal de Suez en 1955 que la Grande-Bretagne a finalement et ouvertement perdu sa place de puissance mondiale.
Le rôle important qu'a joué le Parti Travailliste dans la coalition a permis à la bourgeoisie de voir plus facilement la nécessité de mettre en place un programme adapté à la période de l'après-guerre qui permettrait de désamorcer toute lutte ouvrière potentielle ; la bourgeoisie avait tiré les leçons des conséquences de la fin non planifiée de la 1ère guerre mondiale. Le rapport Beveridge fut ainsi décrété pour poursuivre et pousser plus loin l'étatisation tout en ayant l'apparence d'offrir des palliatifs consacrés spécifiquement à la classe ouvrière.
12. Le gouvernement Travailliste sous Attlee, élu en 1945, correspondait à la situation de l'immédiat après-guerre. Confronté à une dislocation profonde de l'économie, il maintint beaucoup de mesures prises en temps de guerre pour continuer à répartir ouvriers et matières premières entre les industries. Il mit en œuvre un programme de nationalisation massive qui incluait la Banque d'Angleterre, le charbon, le gaz, l'électricité, le fer et l'acier ainsi que des secteurs de beaucoup d'autres industries. En politique extérieure, le gouvernement reconnût qu'il ne pouvait pas y avoir de renversement du nouvel ordre mondial -les USA étaient les maîtres de ce bloc- et que les jours de l'Empire britannique étaient comptés, puisque le coût économique et militaire pour le préserver ne pouvait plus être soutenu. La concession de l'indépendance à l'Inde ne fut pas par conséquent un coup aussi rude qu'il l'aurait été pour des secteurs du Parti Conservateur. Bien qu'il ait essayé de minimiser les pires des mesures économiques américaines contre la Grande-Bretagne, le Parti Travailliste était mieux adapté à réaliser les mesures d'austérité réclamées par les USA. En travaillant avec l'appareil syndical, il était capable d'enfoncer le niveau des ouvriers pendant des années. Devant les ouvriers, il se présentait avant tout comme le parti du "plein emploi".
- Le Parti Travailliste n'est revenu au pouvoir qu'en 1950 et tomba lors des élections de l'année suivante. Ce tournant électoral vers la droite était le résultat de plusieurs facteurs :
- La reconstruction avait aidé à stimuler l'économie et tendait à renforcer la résistance des secteurs de la bourgeoisie aux projets de nationalisation accrue et de pertes possibles d'autres colonies.
- L'encadrement des travailleurs réussi par le gouvernement Travailliste avait dissipé la crainte de la part de la bourgeoisie dans son ensemble d'un soulèvement social important.
- La résistance aux politiques économiques des USA envers la Grande-Bretagne s'accroissait. Ceci joua contre l'administration Attlee qui était associée à leur mise en œuvre.
13. Les 13 années pendant lesquelles le Parti Conservateur resta au pouvoir ont correspondu aux années de profit économique important dû à la reconstruction d'après-guerre, bien qu'une succession de mesures d'inflation et de déflation ont été nécessaires pour maintenir l'équilibre économique. De plus, il y avait une inertie générale du prolétariat : la lutte de classe était étouffée par la capacité retrouvée de la bourgeoisie à trouver des palliatifs issus de la santé relative de l'économie. Les politiques des Conservateurs du point de vue économique étaient devenues plus appropriées à la période du fait du changement dans le parti vers une acceptation plus réaliste d'un plus haut niveau de capitalisme d'Etat, qui fut entériné par l'adoption de la "Charte Industrielle" de 1947. Les secteurs du parti qui ont ratifié ce document étaient à ce moment-là majoritaires, d'abord sous Churchill, puis sous Eden, et finalement sous Macmillan qui représentait le plus clairement la tendance capitaliste d'Etat dans le parti depuis les années 30.
Macmillan représentait aussi dans le parti la tendance qui voyait que l'Empire britannique ne pourrait pas se maintenir comme avant et il avait soutenu une reconsidération des mesures nécessaires du maintien des anciennes colonies sous la domination économique britannique. Cette tendance fut par conséquent portée au pouvoir après que l'intervention sur Suez d'Eden ait démontré l'impossibilité de maintenir les colonies. L'une de ses principales tâches fut d'établir un programme pour l'indépendance coloniale et ce but fut souligné par Macmillan en 1961 dans le discours de CapTown sur le "vent de changement" soufflant sur l'Afrique.
Sur la question "Europe ou Commonwealth", la bourgeoisie essaya encore de miser sur les deux voies, tenter d'avoir accès aux marchés constitués en Europe tout en maintenant le système des privilèges du Commonwealth. Bien que le gouvernement Conservateur ait favorisé la tenue à l'écart de la Grande-Bretagne lors de la formation de la CEE en 1957, dans les années 60, il y eut des négociations ouvertes pour rejoindre la CEE, puisque les bénéfices du vieux commerce du Commonwealth s'évaporaient devant ses yeux. Mais ce ne fut pas avant les années 70 que les principales fractions de la bourgeoisie sentirent l'affaiblissement de la position économique de la Grande-Bretagne et la nécessité de rejoindre la CEE, outil essentiel pour l'organisation d'une partie importante de l'activité économique du bloc occidental.
Dès les années 60, il était clair que les Conservateurs n'avaient pas d'autre solution politique pour stimuler l'économie et la rendre plus productive, ce qui devenait de plus en plus urgent face à l'accroissement de la compétition allemande et japonaise Il y a eu aussi, lors de la seconde moitié des années 50, une résistance croissante de la part des ouvriers, aux tentatives du gouvernement d'imposer des "restrictions de salaire" et d'accroître l'exploitation. Bien que le niveau de lutte de classe ait été en général bien plus bas qu'à la fin des années 60 ou qu'au début des années 70, la bourgeoisie s'alarma de l'accroissement des grèves illégales.
14. Pour s'occuper de ces problèmes, le gouvernement Travailliste de Wilson fut porté au pouvoir. Il visait à entreprendre une intervention étatique dans l'économie encore plus poussée que celle du gouvernement Conservateur. Il avait des buts limités en matière de nationalisation officielle (principalement une renationalisation de la sidérurgie) ; il s'engageait davantage dans la voie de la planification étatique globale des ressources économiques afin de développer la productivité du capital britannique. Il visait aussi à renforcer le contrôle sur la masse salariale en attirant les organisations patronales et syndicales sous le parapluie de la planification étatique, et à contrôler la vague montante de grèves sauvages en votant des lois sur les syndicats. Afin d'alléger l'économie du fardeau des charges militaires, Wilson retira de l'Est du canal de Suez la plus grande partie du potentiel militaire anglais. De même que le gouvernement précédent d'Attlee, Wilson avait une politique favorable aux USA comme le montre son soutien à l'intervention américaine dans le Sud-est asiatique.
le Parti Travailliste parlementaire, et depuis le début des années 70, entre le gouvernement et le TUC par l'intermédiaire d'un comité de liaison (une partie importante des membres du Parti Travailliste est en fait parrainée par les syndicats). Au niveau idéologique, on peut en gros distinguer deux groupes principaux dans le Parti Travailliste -la gauche et la droite- bien qu'en réalité aucune d'elles ne soit homogène. Quoi que sujettes à des variations, les principales différences d'orientation entre ; ces deux tendances sont :
- En ce qui concerne l'économie, la gauche tend à passer dans le sens d'une plus grande étatisation directe par le biais des nationalisations totales et des contrôles physiques directs. La droite, elle, insiste plus sur le mélange des composantes étatiques et privées de l'économie avec un contrôle étatique moins direct.
Cependant, les plans grandioses de cette administration pour régénérer l'économie britannique s'écroulèrent face à deux problèmes primordiaux :
- La ruée sur la Livre Sterling qui était un trait habituel de l'économie anglaise depuis la guerre, culmina en une attaque massive que la bourgeoisie ne put soutenir. Il s'ensuivit la dévaluation de la Livre Sterling en 1967 qui non seulement marquait la fin du rôle de la Livre en tant que monnaie de réserve internationale, mais en fait annonçait la nouvelle période de crise ouverte du capital mondial.
- L'éruption d'une vague de lutte prolétarienne jamais vue depuis 40 ans et qui signifiait un changement qualitatif dans la nature de la période. Dans les années qui suivirent, une profonde rupture apparut dans le gouvernement Travailliste, au sein du Parti Travailliste, entre le gouvernement et les syndicats, etc. La bourgeoisie était donc en plein désarroi au moment même où elle avait le plus besoin d'un appareil politique uni pour faire face à l'accroissement des luttes ouvrières. Le gouvernement Travailliste tomba en 1970 mais pour être remplacé par l'administration Heath encore plus inadaptée. Pour expliquer le pourquoi de ce désarroi et comment le Parti Travailliste et les syndicats regroupèrent leurs forces entre 1970 et 1974 afin d'affronter la classe, il est nécessaire d'examiner les principales tendances dans le parti et l'appareil syndical.
- Bien que le parti travailliste dans son ensemble accepte la domination américaine sur le bloc occidental, l'aile droite a toujours été plus complaisante que la gauche qui s'est prononcée pour une ligne plus "indépendante" -immédiatement après guerre, une fraction de la gauche s'opposa résolument à la politique américaine et plaida pour la création d'une "3ème force" afin de contrer à la fois la Russie et la domination US sur la Grande-Bretagne.
- Par rapport aux ouvriers la gauche a beaucoup plus insisté sur la nature de classe de la société que la droite. Par exemple, elle a beaucoup plus défendu la "démocratie industrielle" et le "contrôle ouvrier", idée que la droite tendait à laisser tomber.
Ces courants idéologiques se répartissent dans tout le Parti Travailliste et dans l'appareil syndical en des forces et concentrations qui dépendent de plusieurs facteurs, entre autres :
- en général, la situation objective de l'économie et les problèmes militaires qu'affronte le capital britannique; la pression de la classe ouvrière;
- la proximité relative de ces différents secteurs du centre de l'appareil d'Etat ;
- les fonctions spécifiques remplies par ces différentes fractions de l'appareil ; par exemple, les sections de base des circonscriptions électorales et les syndicats, quoiqu'étant tous deux au service du capital britannique, remplissent des tâches différentes;
- la fragilité de ces différentes fractions de l'appareil face aux pressions électorales.
15. A cause de ses origines historiques, le "système" du Parti Travailliste est un amalgame complexe d'institutions reliées à différents niveaux et avec des liens plus ou moins forts. A la Conférence annuelle, les principales organisations représentées sont les sections de base des circonscriptions électorales et les syndicats qui siègent, avec le Parti Travailliste parlementaire, au Comité National Exécutif. En dehors de cette structure, dans le Parlement, les membres du Parti Travailliste élisent le chef de file et quelques autres, la composition du cabinet ou "Shadow Cabinet" (cabinet fantôme) est déterminée par ce chef de file. Il existe aussi des liens directs entre le Comité National Exécutif et
Avec ces différences entre les principaux courants idéologiques qui existent dans tout l'appareil, on peut comprendre pourquoi différentes " fractions ont dominé le parti et les syndicats en diverses occasions, et ce que leurs rivalités ont signifié.
16. La composition du gouvernement Travailliste d'après-guerre fut déterminée par la nécessité de se conformer aux diktats économique et militaire des USA, par le maintien d'un contrôle étatique solide sur l'économie et par l'imposition d'un programme d'austérité à la classe ouvrière. Le parti et les syndicats étaient dominés par l'aile droite pour la bonne raison que la bourgeoisie anglaise dominait une classe ouvrière qui a été écrasée pendant les années 30 et la guerre.
L'administration Attlee correspondait donc bien à la situation :
- Elle consolida le contrôle étatique commencé dans les années de guerre en évitant une trop grande résistance des fractions de la bourgeoisie privée encore puissantes. A cet égard le gouvernement dut aussi restreindre le programme de nationalisations à une limite tolérable pour les USA. La bourgeoisie US a imposé des restrictions au processus de nationalisations à travers les conditions qu'elle dicta à la Grande-Bretagne moyennant l'aide du plan Marshall ; les USA voyaient en effet dans ce processus de nationalisation de l'Etat britannique, une menace possible contre son propre programme d'exportation.
- Dans cette période de rivalité aiguë avec l'URSS, le gouvernement Attlee était d'accord pour maintenir un potentiel militaire puissant en Europe, et particulièrement en Allemagne.
- Même si le rapport de forces était bien en faveur de la bourgeoisie, le gouvernement voyait encore la nécessité de mystifier les ouvriers, de faire accepter l'austérité avec l'idée que le pays devait être reconstruit dans le but évident d'élever le niveau de vie des ouvriers. Pour gérer le "Welfare State", un représentant de la gauche, Bevan, fut désigné comme Ministre de la Santé; cette utilisation de la gauche fut encore renforcée quelques années plus tard lorsque ce même Bevan, un de ses principaux porte-parole, devint Ministre du Travail.
17. Durant la période où le Parti Travailliste passe dans l'opposition, des années 50 au début des années 60, une redistribution des forces intervient dans le Parti Travailliste et l'appareil syndical. Au début des années 50, il y a un renforcement de la gauche dans les sections des circonscriptions électorales à propos des questions de politique étrangère et de réarmement. Comme la menace d'une troisième guerre mondiale recule, la gauche se bat contre des dépenses militaires élevées (et accrues par la réduction du soutien de l'Allemagne aux forces britanniques basées dans le pays) et contre les conséquences de la politique militaire américaine en Extrême-Orient. Les dépenses étant trop importantes, la résistance de la gauche aux exigences américaines grandit. Néanmoins, la droite reste forte à la tête de l'appareil syndical car le faible niveau de la lutte de classe ne favorise pas le développement de la gauche.
A partir du milieu des années 50 le tableau commence à changer. L'amélioration progressive de la situation économique provoque une poussée électorale vers la droite, ce qui fit pression sur le Parti Travailliste parlementaire pour suivre le mouvement pour conserver son corps électoral. La fraction Gaitskill fut celle qui exprima le mieux la réponse du Parti à ces pressions lorsqu’elle demanda de revoir le programme du Parti à la Conférence Travailliste de 1960. Elle proposait l'abandon de l'engagement théorique sur la voie des nationalisations de l'ensemble des moyens de production. Ceci se heurta à une forte opposition de la gauche non seulement dans la base électorale mais aussi dans les syndicats au sein desquels se dessinait une évolution vers la gauche dès la seconde moitié des années 50. La lutte de classe se développait. Elle s'exprimait par une augmentation considérable des grèves non officielles contre lesquelles l'aile droite des syndicats n'a pas tenu longtemps. Le premier pas significatif d'une avancée de la gauche fut l'élection de Cousins à la tête du TGWU en 1956 après la mort de Deakin. Cette évolution se poursuivit dans les années 60 avec Lowther et Williamson remplacés par Scanlon, Jones et d'autres.
La fin des années 50 et le début des années 60 fut une période d'agitation intense dans le Parti Travailliste; la gauche avait suffisamment de force dans le Parti et les syndicats pour vaincre les tentatives de Gaitskill d'abandonner la voie des nationalisations. A cette même Conférence, la gauche parvint à faire passer une résolution appelant au désarmement nucléaire unilatéral britannique (bien que cette décision fut renversée dans les années qui suivirent). Alors que la droite dominait encore le Parti, la gauche avait nettement renforcé sa position; ce fut avec ce mélange de forces agissantes au sein du Parti Travailliste que Wilson (qui prit la succession de Gaitskill à sa mort) vint au pouvoir en 1964.
18. Nous avons déjà présenté dans ce texte les buts généraux de l'administration de Wilson, y compris ceux qui visaient la classe ouvrière. Ce gouvernement s'est trouvé presque immédiatement confronté à des difficultés économiques, surtout en ce qui concerne la faiblesse de la Livre Sterling et a donc été obligé de mettre en place un programme contre la classe ouvrière. Ce qui devait être réalisé par l'imposition d'une politique concertée pour contrôler les salaires et par des lois tendant à contrôler les grèves sauvages. L'espoir était de mieux contrôler les grèves par un rapprochement légal entre syndicats et le gouvernement. A cette fin, la commission Donovan fut créée en 1965 pour préparer le terrain aux mesures qui allaient apparaître plus clairement dans le document "à la place des luttes" ("in place of strife") en 1969. Cette approche reflétait directement la forte présence de la fraction de Gaitskill dans le gouvernement et mettait en évidence le décalage grandissant entre cette administration et les syndicats qui devaient faire face directement aux luttes ouvrières. Par conséquent, plutôt que la grève des marins de 1966 soit comprise comme une mise en garde, pour une attitude plus souple envers les syndicats, elle a tout bonnement durci la détermination du gouvernement à agir d'une manière plus rigide et inflexible envers eux. Sous la pression combative des ouvriers, une rupture s'est opérée au niveau idéologique entre les syndicats et le gouvernement. A cette occasion, le gouvernement a été obligé de reculer et d'accepter une politique de salaires décidée "volontairement" par les syndicats. Incapable de venir à bout des luttes ouvrières et divisé par le conflit avec les syndicats, le gouvernement devait tomber avec les élections de 1970.
19. Le principal souci de toute la bourgeoisie pendant la période suivante du gouvernement de Heath (Parti Conservateur) fut la lutte ouvrière. La capacité de ce gouvernement à maîtriser la situation n'était pas meilleure que celle de la précédente équipe travailliste. Le Parti Conservateur appliquait la politique de son aile gauche et c'était ce qu'il pouvait faire de mieux. Il fit les mêmes erreurs que le gouvernement Travailliste qui le précédait et fit passer une loi sur les rapports sociaux dans l'industrie (The Industrial Relations Act) que les syndicats ont combattue.
Dans l'opposition le Parti Travailliste et l'appareil syndical ont regroupé leurs forces avec deux aboutissements essentiels :
- un renforcement significatif de l'aile gauche;
- la création de liens organisationnels entre le TUC et le Parti Travailliste à travers un comité de liaison afin d'éviter les erreurs des années précédentes où ils n'opéraient pas de façon concertée.
La chute de Heath devant la ferme combativité des mineurs en 1974 a ramené les Travaillistes, par une petite majorité, au pouvoir. Pendant les élections, les syndicats et le Parti Travailliste ont pu fonctionner ensemble et entraîner les ouvriers aux urnes.
20. Sous le nouveau gouvernement Travailliste, la consolidation du travail des années précédentes s'est poursuivie et a produit :
- un gouvernement avec une plus forte représentation de la gauche ;
- un "Contrat Social" qui a permis au gouvernement et aux syndicats d'affronter ensemble les ouvriers pour imposer l'austérité et la discipline dont l'économie en crise avait besoin.
A cause de l'inexpérience de la classe ouvrière et malgré une forte combativité, les perspectives de luttes ouvrières restaient très limitées. De plus les ouvriers avaient devant eux le Parti Travailliste au gouvernement et les syndicats, tous deux de nouveau réunis contre les luttes ouvrières. Il s'en est suivi que les luttes ouvrières ont reflué comme elles avaient commencé à refluer dans les autres pays avancés. Dans la phase qui suit le reflux des luttes ouvrières, l'austérité a été de plus en plus durement imposée.
Malgré le mouvement vers la gauche sous le nouveau gouvernement de Wilson et, encore plus sous Callaghan, cette tendance a été freinée par le besoin de faire attention aux intérêts de l'ensemble de la bourgeoisie qui redoutait une évolution trop poussée vers la gauche et par le besoin de calmer la bourgeoisie américaine. En définitive, l'accélération du mouvement vers la gauche devenait de moins en moins nécessaire au fur et à mesure que refluait la lutte de classe. Cependant, dans le contexte de resurgissement des luttes de classe depuis la fin de 1978, de nouvelles pressions se sont fait sentir imposant un nouveau virage à gauche de la politique et des membres du Parti Travailliste. Chassé du pouvoir en mai 1979 à cause de son incapacité à imposer son programme d'austérité à une classe de plus en plus combative, le Parti Travailliste se retrouve une fois de plus dans le rôle de parti d'opposition et, une fois de plus secoué par des luttes de fractions, tentatives pour le rendre apte à affronter la future tourmente.
21. Les conclusions principales qu'on peut tirer du rôle des Partis Travailliste et Conservateur :
- Le Parti Travailliste est le plus approprié à la défense globale des intérêts du capital national britannique, non seulement pour la situation présente, mais aussi dans cette période historique. Ceci est souligné par le fait que, chaque fois que les Conservateurs viennent au pouvoir, ils ne peuvent changer de façon significative la politique des Travaillistes.
- Les manœuvres du Parti Travailliste face au problème du capital britannique doivent être considérées en rapport avec celles des syndicats. Nous pouvons constater que pendant les deux dernières décennies, les liens idéologiques et organisationnels indispensables entre les différentes fractions du mouvement Travailliste se sont considérablement renforcés.
Le cadre parlementaire dans lequel la bourgeoisie britannique a évolué ces dernières années a eu une grande influence sur la manière dont le Parti Travailliste et les syndicats accomplissent leur tâche. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas une position permanente dans le gouvernement et leur attaque du prolétariat est différente selon qu'ils se trouvent au pouvoir ou dans l'opposition. Ce passé de l'appareil d'Etat est très dangereux pour les ouvriers parce qu'il a évolué avec la reconnaissance que le prolétariat est le fossoyeur du capital.
LE RAPPORT DE FORCES ENTRE LES CLASSES
22. L'évolution dans le rapport de forces des deux principales classes de la société depuis la 2ème guerre mondiale a pris une dimension historique. La période de la guerre était marquée par l'apogée du pouvoir de la bourgeoisie et le plus bas niveau de la force du prolétariat. Mais aujourd'hui, le prolétariat n'est pas seulement un frein à la guerre mais il montre à travers son défi et sa résistance à l'austérité que le cours historique est de nou veau vers la révolution. Le fait que la 2ème guerre mondiale n'ait pas été immédiatement suivie par une 3ème guerre entre l'URSS et les USA est dû à la re construction contrôlée de l'économie mondiale qui a suffisamment atténué les rivalités inter-impérialistes pour créer une pause dans la tendance vers la guerre de l'époque de décadence du capitalisme. Parce que la reconstruction de l'économie s'est faite à un niveau global et mondial, il y a eu une période de stimulation économique plus longue que celle qui a suivi la 1ère guerre. Cette période prolongée qui a duré plus d'une génération, a permis à la classe ouvrière de se débarrasser des effets accablants de la longue période de contre-révolution qui a débuté à la fin des années 20. Bien que ces évaluations du cours historique viennent d'une perspective globale des rapports de forces entre les classes, il est néanmoins possible et nécessaire d'analyser les expressions de ce changement de cours dans des pays spécifiques.
23. Pendant toute la période de la contre-révolution, les ouvriers n'ont jamais cessé de lutter. Avec toute sa faiblesse, la classe n'a jamais complètement perdu sa combativité même pendant la guerre. En Grande- Bretagne, malgré le fait que toutes les grèves étaient déclarées illégales selon le "Décret 1305", il y a eu plusieurs grèves sauvages surtout parmi les mineurs et les métallurgistes, catégories qui étaient parmi les plus brutalement exploitées pendant la guerre. Une propagande féroce a été dirigée contre eux à la veille de la grève des apprentis- métallos et ils ont été menacés d'un envoi immédiat; au front s'ils ne reprenaient pas le travail. Les mineurs de Betteshanger ont été emprisonnés, mais la grève a été si combative que les bureaucrates de l'Etat ont dû poursuivre les négociations avec les grévistes emprisonnés. Cependant, le rapport de forces était, bien sûr, largement en faveur de la bourgeoisie qui a réussi une mobilisation totale de la population pour l'effort de guerre, surtout au niveau de la production où l'appareil syndical et les shop-stewards ont réussi à imposer des niveaux d'exploitation que le reste de la bourgeoisie enviait.
Dans la période d'après-guerre -sous le gouvernement travailliste- les conditions d'austérité brutale ont été maintenues (le rationnement par exemple n'a pris fin que vers le milieu des années 50). La résistance des ouvriers n'était encore que fragmentaire, mais il y avait des poches de forte résistance chez les mineurs et les dockers. Pendant leur grève, des ouvriers ont été jetés en prison et persécutés par le gouvernement en utilisant des lois du temps de guerre. Le poids de la bourgeoisie était encore d'une force énorme. Au début des années 50, le niveau de la lutte de classe tendait à baisser ; les mesures d'austérité se sont relâchées peu à peu et les ouvriers ont gagné pas mal d'avantages, dont le plein emploi. Les syndicats continuaient néanmoins à appuyer la politique de "restriction des salaires" des gouvernements travailliste et conservateur. C'est seulement en 1956 que le TUC a retiré son appui formel à cette politique, reconnaissant ainsi la résistance grandissante qui se développait parmi les ouvriers.
24. La fin des années 50 a été caractérisée par une reprise importante des luttes, ce qui a particulièrement préoccupé la bourgeoisie, dans la mesure où les luttes ont surgi dans des secteurs-clé, dockers, électriciens et ouvriers de l'industrie automobile en tête. La bourgeoisie a utilisé plusieurs tactiques pour faire face aux revendications salariales et aux grèves :
- prolonger les "négociations" entre le syndicat et le patronnât afin de retarder les grèves pour des revendications salariales ;
- dévoyer les luttes sur le terrain des rivalités entre les différents syndicats : des luttes pour déterminer "la compétence" d'un syndicat par rapport à un autre, étaient courantes à la fin des années 50 (et ceci relié au processus de concentration au sein de l'appareil syndical à ce moment-là) ;
- la concession d'augmentations salariales : dans la mesure où l'expansion de l'économie pouvait le permettre, la bourgeoisie accordait des augmentations de salaire (qui, avec le taux d'inflation relativement faible de l'époque, ne subissaient qu'une érosion lente).
Pendant les années 60, la pression des ouvriers n'a cessé d'augmenter et les palliatifs ne pouvaient être trouvés que dans un accroissement de productivité, ce qui accélérait le taux d'exploitation vers des niveaux explosifs pour plus tard. En même temps, plusieurs industries ont procédé à des licenciements massifs à cause de l'introduction de nouvelles technologies telles que l'automation. Dans ces industries a surgi le plus haut niveau de combativité : mines, industrie automobile, docks, chemins de fer, sidérurgie, etc. Au milieu des années 60, juste avant de la crise ouverte, certaines conditions allaient influer sur le déroulement des luttes à venir entre les deux principales classes de la société.
La classe ouvrière a eu le temps, pendant toute la période de reconstruction, de se remettre des défaites passées, mais elle n'a connu que des expériences de lutte à un faible niveau qui pouvaient être contenues dans le cadre de l'expansion économique.
La bourgeoisie avait également peu d'expérience récente de luttes très combatives et, en plus, son principal appareil politique pour contrôler et mystifier les ouvriers -Parti Travailliste plus appareil syndical- n'était pas complètement "synchronisé" et connaissait en son sein des différends idéologiques prononcés.
25. Avec l'ouverture de la crise et l'intensification de la lutte de classe, l'équilibre économique, politique et social a été détruit. La première vague de combativité prolétarienne en Grande-Bretagne se caractérise par plusieurs aspects importants:
- elle a duré longtemps -68-74- avec des phases de montée et de reflux avec une évolution relativement lente;
- elle a entrainé, à un niveau ou un autre, toute la classe ouvrière et dans ce sens elle se distingue nettement des luttes des années 40, 50 et début 60;
- Malgré les convulsions dans lesquelles la société se trouvait à cause de ces grèves, la lutte n'a jamais pris une dimension explicitement politique.
La réaction de la bourgeoisie a été d'abord de reculer, de regrouper ses forces les plus puissantes et puis quand la lutte a commencé à refluer, elle est passée à la contre-offensive.
Le "recul" a été un pas en arrière devant le danger de confrontations directes avec les ouvriers tant que la montée continuait. En reconnaissant ces dangers, la bourgeoisie a limité l'emploi des armes répressives de l'Etat contre les ouvriers. Les dirigeants syndicaux, eux aussi, ont dû reculer dans la mesure où, dans un premier temps, ils étaient incapables de contenir les ouvriers. L'exemple le plus dramatique de cela a eu lieu en 1970, lorsque les mineurs ont manifesté devant le siège du syndicat national des mineurs (NUM), furieux contre les dirigeants syndicaux qui avaient essayé de briser la grève sauvage et en affrontant la police qui protégeait le bâtiment syndical. De telles menaces étaient claires et les syndicats furent forcés de laisser faire la classe pendant un temps. C'est à cette période que le gouvernement de Wilson a été renversé.
Le gouvernement de Heath a reconnu ces dangers, mais pas aussi clairement que la gauche de la bourgeoisie; il s'est laissé entraîner dans la voie de l'affrontement; on l'a considéré ainsi comme "l'incarnation de la force anti-ouvrière dans la société" pour le plus grand profit du Parti Travailliste et des syndicats qui du coup arrivaient à "organiser" la plus grande mobilisation des ouvriers depuis les années 20 dans la lutte contre 1'"Industrial Relations Act". C'est au cours de cette période que s'est fait le rapprochement et le regroupement des forces entre le Parti Travailliste et les syndicats que nous avons analysés plus haut. Entretemps, les shop-stewards ont pris la relève avec la tactique de "coller" à la classe pour pouvoir plus tard reprendre les rênes et freiner les luttes. Ils ont concentré leurs forces pour isoler les grèves les unes des autres, entre elles, et avec les autres fractions de la classe qui n'étaient pas en grève : cette stratégie a été éprouvée pendant les grèves avec occupation d'usines en 71 et 72. L'utilisation de la semaine de trois jours, ainsi que les élections de février 74 pour briser la grève des mineurs, ont permis à un nouveau gouvernement travailliste, renforcé par cette épreuve, de faire face à la classe. La contre-offensive a commencé juste après les élections contre une vague de combativité déjà en déclin. Travaillant ensemble d'une façon plus concertée qu'ils n'avaient pu le faire dans les années 60, le gouvernement travailliste et les syndicats ont construit progressivement toute une campagne pour le "Contrat Social", jusqu'à le sceller en 1975. Après avoir cédé pendant un moment des augmentations de salaire relativement fortes, le gouvernement travailliste reprenait une fois de plus son rôle naturel : en se cachant derrière le sacro-saint principe de l'intérêt national, il redevenait encore le parti de 1'austérité. 26. Les mesures d'austérité durent depuis longtemps en Grande-Bretagne et ont été un modèle pour toute la bourgeoisie occidentale. A mesure que le reflux s'est précisé, l'austérité s'est renforcée. En 1977, après deux ans de Contrat Social, les syndicats ont fait semblant de ne pas vouloir le poursuivre. Le Contrat Social a encore duré; l'austérité a continué, mais les syndicats ont essayé de diminuer en apparence leur part de responsabilité directe dans les mesures d'austérité. Malgré cette mise en scène, le plan d'austérité a érodé la crédibilité des syndicats et de la gauche. Par conséquent, la bourgeoisie s'est trouvée devant un problème majeur, à savoir, que l'utilisation de son visage de gauche aujourd'hui diminue sa crédibilité. C'est ce qu'on a vu tout au long de l'année 1979, avec les défis lancés à l'autorité des syndicats et des shop-stewards et dans l'indifférence totale des ouvriers par rapport aux manœuvres du Parti Travailliste.
27. La récente vague de grèves montre que la classe ouvrière a commencé à sortir de la période de reflux et à s'affirmer sur son propre terrain de classe.
Et si la principale fraction de gauche de la bourgeoisie, le Parti Travailliste, est passé à une position d'"opposition loyale" pour se remettre à neuf, ce n'est pas à cause d'un renforcement, mais d'un affaiblissement de la classe dominante, pour affronter un prolétariat de plus en plus combatif. La lutte ouvrière devient un facteur de la crise politique de la classe dominante et redevient l'axe essentiel de toute la situation sociale.
Ce texte n'a fait que tracer les lignes générales de l'évolution de la situation en Grande-Bretagne depuis la deuxième guerre mondiale. Il a couvert une période dans laquelle le rapport de forces a été de manière prédominante en faveur de la bourgeoisie, et il a souligné le contexte général à partir duquel surgiront las mouvements titanesques futurs du prolétariat. La façon spécifique dont se développe cette deuxième vague de luttes actuelle depuis la crise ouverte de 1968 est décrite dans le Rapport sur la situation en Grande-Bretagne paru dans World Révolution n° 26.
Marlowe
Géographique:
- Grande-Bretagne [25]
Questions théoriques:
- Décadence [6]
Le caractère réactionnaire des nationalisations dans la phase impérialiste du capitalisme (gauche mexicaine 1938).
- 3266 lectures
Dans le n° 10 de la REVUE INTERNATIONALE (juin-août 1977), nous avons présenté le "Groupe des Travailleurs Marxistes" du Mexique, groupe surgi dans les années les plus sombres du mouvement ouvrier international. Son surgi s sèment dans les années 1937-39 ne pouvait signifier l’annonce d'une reprise du mouvement mais l'expression d'un dernier sursaut de conscience communiste de la classe face au cynisme sanglant du capitalisme triomphant qui se préparait à fêter ce triomphe dans l'ivresse de la deuxième guerre mondiale.
L'évolution vers le capitalisme d'Etat accéléré par la crise et les préparatifs de la guerre, trouvait son expression majeure dans la campagne pour les nationalisations. De DE MAN à BLUM, de la CGT aux Partis Staliniens, des Travaillistes anglais aux Fronts Populaires, les nationalisations étaient devenues la plateforme par excellence de la gauche du capital et présentées par elle aux ouvriers comme la marche vers le socialisme. Les Trotskistes, et Trotski en personne, comme d'autres extrême-gauche, n'ont pas su échapper à cette idéologie. Ils sont tombés dans le panneau et ont embouché le même clairon. A les entendre, les nationalisations, si elles n'étaient pas encore du socialisme, étaient cependant un pas très progressif que la classe ouvrière devait soutenir de toutes ses forces.
Aujourd'hui, comme dans les années 30, les nationalisations continuent à servir de programme économique de la gauche, comme le montre encore récemment feu le "Programme Commun" en France ; et l'ampleur des nationalisations préconisées sert de signe de "radicalité" et de certificat d'authenticité prolétarienne avec lesquels ces partis cachent leur nature capitaliste. Aujourd'hui, comme hier, trotskystes, maoïstes, anarchistes et autres gauchistes cachent la vérité que les nationalisations ne font que renforcer l'Etat capitaliste et s'efforcent de convaincre les ouvriers que ces mesures affaiblissent le capital. Aujourd'hui comme hier, les révolutionnaires doivent dénoncer cette démagogie, démontrer théoriquement et dans le concret le véritable contenu capitaliste et anti-ouvrier des nationalisations. C'est pour contribuer à cela que nous publions cette étude de la gauche mexicaine, parue dans le premier numéro de La revue "COMMUNISME" en 1938.
AVEC LA NATIONALISATION DES INDUSTRIES, LA BOURGEOISIE SE PROTEGE CONTRE LA REVOLUTION PROLETARIENNE
F.Engels disait en 1878 :
"Mais ni la transformation en sociétés par actions, ni la transformation en propriété d'Etat ne supprime la qualité de capital des forces productives. Pour les sociétés par actions, cela est évident. Et l'Etat moderne n'est à son tour que l'organisation que la société bourgeoise se donne pour maintenir les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre des empiétements venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. L'Etat moderne, quelle qu'en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'Etat des capitalistes, le capitaliste collectif idéal. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble. Mais, arrivé à ce comble, il se renverse. La propriété d'Etat sur les forces productives n'est pas la solution du conflit, mais elle renferme en elle le moyen formel, la façon d'accrocher la solution : (...) la prise du pouvoir d'Etat par le prolétariat."
(F.Engels, "L'Anti-Duhring", Ed.Sociales 1963, p.318)
Ces simples et claires paroles du compagnon de K.Marx, prononcées il y a 60 ans, s'appliquent expressément à la récente transformation de l'industrie pétrolière et de chemin de fer en propriété de l'Etat des capitalistes mexicains. Il est d'une importance primordiale, pour le prolétariat du Mexique, de comprendre la vérité fondamentale contenue dans ces phrases : "l'Etat moderne n'est qu'une organisation que se donne la société bourgeoise pour défendre les conditions matérielles du système capitaliste de production contre les attaques des ouvriers comme des capitalistes individuels. L'Etat moderne, quel que soit sa forme, est une machine essentiellement capitaliste; c'est l'Etat des capitalistes; c'est le capitaliste collectif idéal." Combien sont-ils aujourd'hui, parmi ceux qui se disent "marxistes", qui connaissent la vérité de ces affirmations d'un des fondateurs du marxisme ? Combien sont-ils qui admettent que ces affirmations s'appliquent à tous les Etats capitalistes, quelle que soit leur forme, c'est à dire également aux Etats capitalistes qui se disent "ouvriéristes"? Combien se risquent à dire que ces Etats "ouvriéristes" exploitent les ouvriers, et que cette exploitation s'étend chaque fois que de nouvelles forces productives deviennent sa propriété ? Combien se risquent à dire que dans chaque nouvelle "nationalisation", les relations capitalistes entre possesseurs et producteurs (c'est à dire entre capitalistes et prolétariat), loin d'être abolies par de telles mesures, sont aiguisées et accrues ? Qui se risque, aujourd'hui, au Mexique, à dire que toutes ces affirmations s'appliquent aussi aux récentes "nationalisations" de l'industrie pétrolière et des chemins de fer ? Pourquoi les "marxistes" du Mexique n'appliquent-ils pas les enseignements du marxisme aux problèmes actuels ?
Pourquoi, en premier lieu, ne pas expliquer que "nationalisation" ne signifie en aucune manière "propriété de la'nation'", mais uniquement, exclusivement propriété de 1'Etat, c'est à dire propriété d'une partie de la "nation" : la bourgeoisie, dont l'Etat est l'instrument ? En d'autres termes, pourquoi ne pas expliquer qu'avec la "nationalisation", la propriété passe simplement des capitalistes individuels ou des compagnies capitalistes au, "capitalisme collectif" (pour employer la formule d'Engels) c'est à dire l'Etat des capitalistes ?
Pourquoi ne pas dire tout cela ? Nous le savons très bien : en le disant, comme devrait le faire celui qui s'appelle "marxiste", on ne peut rester le serviteur loyal de la bourgeoisie "progressiste" du Mexique, on perd sa popularité, peut-être sa liberté, et sa vie ... Mieux vaut ne pas appliquer les enseignements du marxisme aux problèmes du jour! Il est utile de s'appeler "marxiste", mais être marxiste est trop dangereux pour ces messieurs qui s'intitulent "leaders ouvriers".
LA VERITABLE SIGNIFICATION DE LA NATIONALISATION DU PETROLE ET DES CHEMINS DE FER
Quelles sont alors, d'après le marxisme, la portée et la signification de "l'expropriation" de la propriété des compagnies pétrolières? Cela signifie tout simplement que cette propriété est passée des mains d'un groupe d'exploiteurs (les compagnies pétrolières) aux mains d'un autre groupe : l'Etat mexicain. Ni plus, ni moins. La nature de cette propriété n'a, en rien, était modifiée, elle reste capitaliste comme auparavant. Les travailleurs restent dans la même situation de prolétaires obligés de vendre leur force de travail aux propriétaires des instruments de production, à savoir au maître des champs pétrolifères, des installations de l'appareillage de distribution, et le propriétaire (aujourd'hui l'Etat mexicain) conserve la plus-value produite par les travailleurs, c'est à dire les exploite,.
En d'autres termes, l'industrie pétrolière mexicaine s'est convertie en une seule et gigantesque "Pétrolex" avec des directeurs et techniciens "nationaux" au lieu d'étrangers, et la tâche principale de cette grande "pétromex" est exactement la même qu'auparavant celle de la petite "pétromex" (le gouvernement mexicain était, avant les "nationalisations" récentes, propriétaire d'une compagnie pétrolière) : empêcher ou briser les grèves, comme ce fut le cas pour la grève des protestations de 1'année dernière.
Dans l'industrie pétrolière du Mexique, depuis la dite expropriation, précisément comme avant, s'opposent les deux classes fondamentales de la société capitaliste : capitalistes et prolétaires, exploiteurs et exploités. L'industrie pétrolière reste ce qu'elle était auparavant : le bastion du système capitaliste au Mexique, d'autant plus que ce bastion est actuellement plus fort qu'auparavant, parce qu'au lieu d'avoir à faire à plusieurs compagnie étrangères seulement protégées par l'Etat mexicain, les travailleurs ont, aujourd'hui, en face d'eux, directement cet Etat, avec sa démagogie "ouvriériste", ses comités de conciliation, sa police, ses prisons, son armée. La lutte des travailleurs de l'industrie du pétrole est aujourd'hui mille fois plus difficile qu'avant. L'Etat protégeait la propriété capitaliste parce que telle est sa fonction fondamentale, aujourd'hui cette protection a changé de forme : pour être plus efficace et pour mettre l'industrie pétrolière à l'abri des attaques des travailleurs, l'Etat a déclaré comme sa propriété celle qui a besoin de protection : la propriété des capitalistes américains et anglais.
L'ETAT "OUVRIERISTE" DEFEND LE SYSTEME CAPITALISTE CONTRE LA REVOLUTION PROLETARIENNE
Selon les enseignements du marxisme, l'Etat est une institution née de la division de la société en classes ayant des intérêts irréconciliables, et sa fonction est de perpétuer cette division et avec elle "le droit de la classe possédante d'exploiter celle qui ne possède rien, et la domination de la première sur la seconde" (Engels). L'Etat moderne est l'organisation que se donne la bourgeoisie pour défendre ses intérêts collectifs, ses intérêts de classe, contre les attaques des ouvriers d'une part et des capitalistes individuels d'autre part (en premier lieu contre ceux des capitalistes et compagnies qui ne veulent pas abandonner une partie de leurs intérêts individuels en faveur de la défense des intérêts collectifs de la classe bourgeoise contre les travailleurs). Toute l'activité de la classe capitaliste, bien qu'il se dise "ouvriériste", ne sert qu'à une seule fin : le renforcement du régime capitaliste. Dans la phase de l'expansion du capitalisme, le renforcement de celui-ci avait un caractère progressif, en dépit de l'oppression constante qui en résultait, parce qu'en ce temps-la l'histoire n'avait pas encore posé la révolution prolétarienne à l'ordre du jour. L'unique progrès possible était le capitalisme. Aujourd'hui, dans sa phase de décomposition, c'est à dire dans la phase impérialiste que nous vivons, le renforcement ou la "réforme" du capitalisme prend un caractère extrêmement réactionnaire et contre-révolutionnaire, parce qu'aujourd'hui la destruction du capitalisme seulement peut sauver l'humanité de la barbarie. Le rôle actuel de l'Etat est de défendre le capitalisme contre la révolution prolétarienne. Dans la phase impérialiste, l'Etat capitaliste, quelle que soit sa forme, est la véritable incarnation de la réaction et de la contre-révolution. Aujourd'hui, il n'y a, et ne peut y avoir, un Etat capitaliste progressif. Tous sont réactionnaires et contre-révolutionnaires. Renforcer l'Etat équivaut donc à prolonger la vie du barbare système capitaliste. Seuls ceux qui luttent pour la destruction de l'Etat capitaliste sont au côté du prolétariat et de tous les exploités et opprimés luttant avec eux pour leur émancipation par la révolution prolétarienne.
QUAND LA NATIONALISATION EST PROGRESSIVE ?
Les paroles déjà citées, d'Engels au sujet de la signification de la conversion de la propriété des capitalistes individuels en propriété des compagnies anonymes, et concernant la transformation de celles-ci en propriété de l'Etat capitaliste, s'appliquent à la phase ascendante du capitalisme, à la phase de son expansion, lorsque le système capitaliste constituait un progrès. Dans cette phase, la concentration des forces de production dans les mains de groupes de capitalistes signifiait un important pas en avant, dans le sens de la socialisation croissante de la production, laquelle, pour sa part, posait devant 1'humanité la tâche de la socialisation de la propriété de ces forces de production. Citons une autre fois Engels :
La période de haute pression industrielle avec son crédit enflé sans limites, aussi bien que le krach lui-même par la ruine de grands établissements capitalistes, poussent à la socialisation de masses considérables de moyens de production; et cette socialisation s'opère sous la forme des diverses espèces de sociétés par action. Beaucoup de ces moyens de production et de communication sont dès l'abord si colossal qu'ils excluent toute autre forme d'exploitation capitaliste : c'est le cas par exemple des chemins de fer. Mais à un certain degré de développement, cette forme même n'est plus suffisante; le représentant officiel de la société capitaliste, l'Etat, est contraint de prendre la direction de ces moyens de production et de communication. La nécessité de les transformer en propriété de l'Etat apparaît d'abord pour les grands établissements servant aux communications (postes, télégraphes, chemins de fer)."
Mais ajoutait Engels, "c'est seulement au cas où les moyens de production et de consommation échappent réellement à la direction des sociétés par action, c'est seulement lorsque l'étatisation est devenue économiquement inévitable, c'est seulement alors que, même réalisée par l'Etat actuel, elle marque un progrès économique, un stade préliminaire à la prise de possession de toutes les forces productives par la société même. Mais il est né récemment, depuis que Bismarck s'est mis à étatiser, un faux socialisme qui, dégénérant même ça et là en complaisance servile, déclare socialisme dés l'abord toute étatisation, même celle de Bismarck. Mais si l'étatisation du tabac était socialiste, Napoléon et Metternich compteraient parmi les fondateurs du socialisme. Quand l'Etat belge, pour des raisons politiques et financières tout à fait banales, construit lui-même ses principales lignes de chemin de fer, quand Bismarck, en dehors de toute nécessité économique, étatise les principales lignes de Prusse, tout simplement pour pouvoir mieux les organiser et les utiliser en vue de la guerre, pour faire des employés de chemins due fer un troupeau d'électeurs dociles, et surtout pour se procurer une nouvelle source de revenus indépendante des décisions du Parlement, ce ne sont là à aucun degré, ni directement ni indirectement, ni consciemment ni inconsciemment, des mesures socialistes. Sans cela, le commerce maritime royal, la manufacture de porcelaine royale, et même le tailleur de la compagnie dans l'armée seraient des institutions socialistes. "
F.Engels. ("L'Anti-Dühring", Ed. Sociales, 1963, p.316-317)
Personne ne dira que la nationalisation de l'industrie pétrolière du Mexique fut économiquement inévitable, parce que son administration, depuis le moment de la production, avait débordé le cadre des compagnies. Et personne ne verra un progrès économique dans la transformation de la propriété des grandes compagnies internationales, mille fois mieux organisées et plus puissantes que l'Etat mexicain, en propriété de ce dernier. En réalité, des paroles d'Engels que nous venons de citer, les seules qui conviennent, dans le cas des récentes nationalisations au Mexique, ce sont celles qui parlent des "raisons politiques et financières" et de l'intérêt de l'Etat à créer une "nouvelle source de profit" et à transformer le personnel des chemins de fer en "troupeaux d'électeurs dociles".
Une telle nationalisation, dit Engels, ne représente aucun progrès.
LE CARACTERE REACTIONNAIRE DES NATIONALISATIONS DANS LA PHASE IMPERIALISTE DU CAPITALISME
C'est seulement en analysant les récentes nationalisations au Mexique comme faisant partie du processus de décomposition du capitalisme que nous pouvons comprendre leur véritable signification historique.
Dans la phase ascendante du capitalisme, existait la possibilité de nationalisations progressives bien que beaucoup d'entre elles, comme nous venons de le voir par les exemples cités par Engels, n'avaient pas un tel caractère. Aujourd'hui dans la phase de décomposition du système capitaliste, il n'y a pas la possibilité de nationalisation de caractère progressif, de même qu'il n'y a pas une seule mesure progressive de la part de la société capitaliste en décomposition et de son représentant officiel, l'Etat capitaliste. Dans la phase ascendante du capitalisme, les signes de l'expansion de la production et de la concentration de la propriété étaient, en principe, l'Etat national unifié, dont la formation constituait un progrès en comparaison avec les entités féodales dispersées. Mais, rapidement, l'expansion de la production et la concentration de la propriété débordèrent les limites des Etats nationaux. Les grandes compagnies anonymes prirent de plus en plus un caractère international, créant à leur manière une division internationale du travail, et cela, en dépit de son caractère contradictoire, constituant une des contributions les plus importantes du capitalisme au progrès de l'humanité.
Le caractère, de plus en plus international de la production, commence alors a se heurter avec la division du monde en Etats nationaux. "L'Etat national", affirme le 1er Congrès de l'Internationale Communiste en 1919, "après avoir donné un élan vigoureux au développement capitaliste est amené à être trop étroit pour l'expansion des forces productives".
Durant la phase pendant laquelle l'Etat national constituait un facteur progressif, c'est à dire dans la phase ascendante du capitalisme (et seulement à elles s’appliquent les citations d'Engels concernant le caractère progressif de certaines nationalisations), la conversion de la propriété des compagnies anonymes - lesquelles, dans le même temps ne débordaient pas encore des limites de l'Etat national- en propriété de celui-ci, était progressive.
Mais, au moment de convertir les sociétés anonymes en organismes qui embrassaient déjà plusieurs Etats, les nationalisations commencèrent a changer de signification : dirigées chaque fois davantage contre la croissante division internationale du travail, elles constituèrent par conséquent, au lieu d'un progrès, une régression. L'unique progrès possible est aujourd'hui la transformation de la propriété des grandes compagnies anonymes et de l'Etat capitaliste en propriété de l'Etat prolétarien qui surgira de la révolution communiste^ Surtout les nationalisations faites pendant et depuis la guerre mondiale montrèrent, dans tout le monde capitaliste, cet aspect réactionnaire en une forme chaque fois plus accentuée. Leur objet n'étant déjà plus 1'expansion de la production mais sa restriction... avec une exception significative: les industries de guerre. Restreindre la production des objets de consommation et organiser la production des instruments pour la destruction des produits et des propres producteurs, cela est une des fins primordiales des nationalisations pendant la guerre mondiale de 1914-1918 et pendant les récentes guerres en Ethiopie, en Espagne et en Chine. Et ceci s'applique, non seulement aux pays qui entrèrent directement en guerre, mais à tous, que les gouvernements soient fascistes ou démocratiques. Voir les nationalisations des deux côtés en Espagne, et la récente nationalisation des chemins de fer et industries de guerre en France. Destruction et non construction, voilà le grand actif de la société capitaliste dans ses heures d'agonie.
Tandis que les nationalisations dans le passé étaient l'expression de la croissance et de l'expansion du capitalisme, actuellement, elles sont, au contraire, l'expression de la régression et de la décomposition chaque fois plus violente du système capitaliste. Avant de disparaître de la scène historique, le capitalisme détruit une grande part de ce qu'il a crée lui-même : son magnifique appareil de production, le prolétariat moderne et la division internationale du travail, enchaînant chaque fois davantage les forces de production dans les limites des Etats nationaux.
Le prolétariat, au contraire, quand sonnera son heure historique, "libérera les forces productives de tous les pays des chaînes des Etats nationaux, unifiant les peuples en étroite collaboration économique" (Manifeste du premier congrès de TIC).
Ce sont des paroles claires, en opposition irréductible avec les idées de ceux qui veulent combiner les mots d'ordre de la révolution prolétarienne, laquelle a un caractère international, et ceux aits de "l'émancipation nationale".
L'unique possibilité de libérer les peuples opprimés réside dans la destruction des Etats nationaux par la révolution prolétarienne triomphante et dans 1'unification du monde entier en une étroite coopération fraternelle.
LE TRIOMPHE DU "BON VOISIN"
Ce qui vient d'être dit d'une façon générale, concernant la signification des nationalisations dans la phase de décomposition du capitalisme nécessitent certains compléments et modifications dans le cas des pays semi-coloniaux, comme le Mexique. Tout d'abord, s'il fût possible de placer une partie de la propriété des grandes compagnies internationales sous le contrôle effectif d'un petit Etat national, il est clair qu'une telle nationalisation n'accroîtra pas la division internationale du travail, crée par le capitalisme, mais au contraire, la minera et la détruira, révélant ainsi son caractère réactionnaire, plus encore que dans le cas des grands Etats impérialistes.
Mais en réalité, une nationalisation effective de la part des petits Etats est impossible, surtout quand elle s'applique à la propriété des grandes compagnies internationales, parce que ce sont les Etats impérialistes et leurs gouvernements qui contrôlent complètement la gestion économique et politique des petits Etats. Seuls, les Etats impérialistes peuvent aujourd'hui nationaliser, soit au dedans de leur domaine politique direct, soit dans les petits Etats contrôlés par eux. Les "nationalisations" effectuées par eux ne sont, par conséquent, rien de plus qu'une farce, un changement d'étiquette. Celui qui "nationalise " est en réalité, non le petit Etat "libre" et "anti-impérialiste", mais son propre maître impérialiste. L'unique changement possible, c'est que le petit Etat, comme dans notre cas, le Mexique, passe du contrôle de quelques compagnies impérialistes et de leur Etat, au contrôle d'autres compagnies et de leur Etat.
Et c'est précisément ce qui s'est passe dans le cas de la récente "nationalisation" du pétrole au Mexique : les grandes sociétés nord-américaines (la Huestee Standart Oil et la Gulf) et leur Etat ne pouvaient, jusqu'à maintenant, que partager le contrôle de la richesse pétrolière, et de tous les destins du Mexique, avec la société anglaise El Aguila (Royal Dutch Shell) et avec l'Etat anglais; avec la dite "nationalisation", ce contrôle est passé aux mains des maîtres exclusifs de ce que la bourgeoisie mexicaine appelle "notre patrie". Ce qui s'est passé dans ce cas est uniquement ce qui peut se passer dans la phase impérialiste du capitalisme. Toutes les fondamentales "rédemptions nationales" signifient inévitablement le triomphe de l'un ou l'autre impérialisme. Dans le cas du Mexique, celui qui a triomphé est " le fameux" " voisin".
La bourgeoisie internationale admet cela en toute franchise, comme le montre l'opinion ou Bulletin du service des Archives de Genève (nous citons seulement les dernières notes du 7 juin : "Dorénavant, les Etats-Unis sont les maîtres indiscutables dans tous les domaines au Mexique. La dernière forteresse anglaise (en Amérique Latine) a été démolie jusque dans ses fondations ... Les Etats-Unis ont adopté l'unique moyen de chasser l'Angleterre du Mexique sans tirer un coup de fusil..."
Ce fut Cardenas, insinue le bulletin, "qui finalement a aidé les Etats-Unis à expulser les Britanniques. Apparemment, tout fut très simple. Quand précisément les Anglais étaient heureux de posséder 60% du pétrole mexicain contre les 40% qu'avaient les Etats-Unis, Cardenas s'est approprié le tout. Mais, alors que Londres déchaînait une tempête contre les expropriations, Washington accueillait la chose avec un calme extraordinaire...
Que vient-il alors à l'esprit ?" Le Bulletin penche pour une entente entre Washington et Mexico, par laquelle tout le pétrole devient américain, "démolissant ainsi définitivement la dernière forteresse britannique dans cet hémisphère". Ceci nous est dit par un périodique bourgeois de Suisse... (texte traduit de l'espagnol, faute de posséder l'original).
"El Nacional", organe du gouvernement du Mexique, donna la même interprétation quand il annonça la rupture des relations diplomatiques avec le gouvernement anglais par les deux titres suivants : "Le Mexique rompt avec l'Angleterre" et "Les conversations avec les Compagnies américaines sont en bonne voie".
Il n'est pas meilleure illustration de la transformation du Mexique en une colonie exclusivement nord-américaine que l'adulation pour l'impérialisme yankee qui apparaît dans chaque numéro de "El Nacional" et dans tous les discours des autres mandataires mexicains. Selon eux, l'impérialisme nord-américain est aujourd'hui, en réalité, "anti-impérialiste", seul l'impérialisme anglais est impérialiste.
... Et le grand maître, Léon Trotski, les appuie dans cette propagande, avec ses lettres ouvertes dans lesquelles également "impérialisme" équivaut à "impérialisme anglais", cependant que l'auteur de ces lettres ne dit pas une seule parole sur l'impérialisme américain...
"L'ADMINISTRATION OUVRIERE" DOIT SAUVER LA PROPRIETE DES CAPITALISTES
Le système capitaliste se trouve dans une situation sans issue. Sa destruction par le prolétariat révolutionnaire est historiquement inévitable.
Mais, actuellement, le prolétariat affaibli et désorienté par tant de défaites et trahisons, au lieu de lutter contre le capitalisme, avec le but de l'abattre et de construire sur les ruines une nouvelle société, est, au contraire, en train de le défendre. Appuyée par tous les prétendus "leaders ouvriers", la bourgeoisie est parvenue à dévier les travailleurs de la lutte de classes et à les lier aux intérêts du capitalisme par le canal de l'Etat.
Aveuglés par les idées de démocratie et de patrie, les prolétaires défendent ce qu'ils devraient détruire; ce que nous voyons en Espagne, en Chine, au Mexique, dans le monde entier.
Au lieu de profiter de la crise mortelle du système capitaliste pour le détruire, les travailleurs, ne croyant pas au triomphe de leur propre cause, se sont temporairement transformés en ses meilleurs défenseurs. Exactement, comme au temps de la guerre mondiale, quand ils sacrifièrent leurs conquêtes économiques et leurs vies en luttes fratricides, sous le commandement de leurs ennemis de classe. Bien entendu, aujourd'hui, comme alors, la responsabilité n'en revient pas aux travailleurs, mais à ces "marxistes" qui, par leurs capitulations devant les fétiches de la démocratie et de la patrie ont trahi le marxisme et la cause de la révolution prolétarienne. Et il est également inutile d'insister sur le fait que la situation actuelle ne peut durer toujours et que, tôt ou tard, le prolétariat prendra le chemin de la révolution. Historiquement, la révolution prolétarienne reste inévitable et invincible.
En Espagne, et surtout en Catalogne, nous avons vu, dans ces dernières années, comment la bourgeoisie parvient à conjurer le danger de la révolution prolétarienne au moyen de l'armement des travailleurs et de la "socialisation" des industries, avec leur "livraison" aux travailleurs. Ceux-ci, sous l'illusion d'être alors les maîtres du pays, renoncèrent à l'attaque contre les institutions capitalistes et commencèrent à défendre, au prix de sacrifices inouïs, ce qui, maigre certains changements d'étiquette, continuait d'être la propriété capitaliste et l'Etat capitaliste. A la faveur du massacre quotidien sur les champs de bataille en Espagne, le capitalisme s'est renforce politiquement, remplissant ses objectifs avec le sang des exploités qui luttaient des deux côtés.
Suivant l'exemple de la bourgeoisie espagnole, la bourgeoisie mexicaine et son bon "voisin" nord-américain tentent de conjurer le danger de révolution prolétarienne au Mexique par la "livraison" des industries aux ouvriers. Une fois que celles-ci seront "aux mains" des travailleurs, l'ennemi mortel du système capitaliste se transformera en son meilleur défenseur ... ainsi calcule la bourgeoisie au Mexique et à Washington.
La bourgeoisie mexicaine et américaine connaissait la haine des masses travailleuses du Mexique et de toute l'Amérique Latine contre les grandes compagnies étrangères. Une attaque du prolétariat contre celles-ci équivaudrait à une attaque contre le cœur du système capitaliste. Ce serait le commencement de la fin de la domination impérialiste au Mexique et dans tous les pays coloniaux et semi-coloniaux... et la bourgeoisie de ces pays, en premier lieu celle du Mexique, sait fort bien que, ce qui, uniquement, la maintient et la protège contre "ses" ouvriers et paysans, c'est précisément la domination impérialiste. On comprend pourquoi elle considère la bourgeoisie nord-américaine comme sa "bonne voisine".
Face à l'accroissement quotidien de la colère des masses contre les compagnies impérialistes, il fallait éviter à tout prix une attaque frontale des travailleurs contre elles. Cette tâche revenait bien entendu au gouvernement du Mexique. Ce qui se passe avec les gouvernements semi-coloniaux, quand ils ne peuvent accomplir de telles tâches, est bien connu de tous : ils disparaissent, comme ont disparu tant de gouvernements au Mexique, à Cuba et autres pays latino-américains, au moment où ils se montrent incapables de dévier l'attaque des ouvriers contre la sacro-sainte propriété impérialiste. Le "bon voisin" a besoin de serviteurs efficaces, et il est démontré que le serviteur le plus efficace est un gouvernement "ouvriériste" .
Pour un gouvernement capitaliste "ouvriériste", il ne fut pas difficile de trouver la solution du problème. Les faux "marxistes" du type staliniens et trotskystes l'avaient proposée depuis longtemps : le front unique contre le prolétariat et la bourgeoisie. Contre qui ? Et bien, contre 1'impérialisme, quoique vous ne le croyiez pas!
En Espagne et en Chine, ce front unique entre exploiteurs et exploités a déjà été réalisé, avec des résultats magnifiques pour les exploiteurs, qu'ils soient fascistes ou antifascistes, impérialistes ou anti-impérialistes, et avec des résultats funestes pour les exploités des deux côtés. Au Mexique, quelque chose de très ressemblant se développait depuis quelques années. A la fin, cela prit une forme définitive, quand commença la farce de la prétendue "rédemption nationale". Simulant une lutte implacable contre l'impérialisme (en paroles), la bourgeoisie américaine et son gouvernement purent livrer (en fait) le contrôle chaque fois plus absolu des désunis de la prétendue "patrie mexicaine".
En même temps, simulant la remise de l'industrie pétrolière et des chemins de fer aux travailleurs, elle pourra tirer d'eux les sacrifices les plus inouïs.
Plein triomphe sur toute la ligne! Sous la forme de la "nationalisation", la bourgeoisie et son gouvernement purent remettre l'industrie la plus importante du pays au contrôle exclusif de l'impérialisme yankee; dans cette transaction, le gouvernement de la bourgeoisie mexicaine contracte une dette d'"honneur" avec la bourgeoisie nord-américaine et anglaise, dette que paieront bien entendu les travailleurs; et c'est non seulement eux qui seront tenus de supporter ce sacrifice ("volontairement", comme l'affirment leurs leaders traîtres), mais qui devront offrir sur l'autel de la patrie, bien entendu toujours "volontairement", les 50 millions demandés par les Compagnies il y a deux ans! Suivant un communiqué du Comité Exécutif du Syndicat des Travailleurs du Pétrole, publié dans la presse du 28 avril 1938, ce syndicat :
" était parfaitement d'accord avec son gouvernement, au moment où cela était nécessaire pour la Nation, et acceptait, par considération patriotique, que les bénéfices qui découlent de la décision des juntes de conciliation et d'arbitrage, groupe 7, malgré le sacrifice que représentent pour les travailleurs du pétrole (évidemment pas pour leurs leaders !) les longues années de lutte pour obtenir une vie plus humaine dans les champs pétrolifères ne s 'appliquent pas pendant que prévaudra la situation actuelle; en outre les travailleurs de cette industrie remettront à divers organismes pour un total approximatif de 140 millions de pesos; indépendamment de cela, nos diverses sections, conscientes de leur devoir comme mexicains, remettront une journée de salaire mensuel, pour un temps indéfini, afin de contribuer à résoudre la dépression économique de la nation, ce qui équivaut à une somme mensuelle de plus de 150.000 pesos" .
En additionnant ces quantités, la fameuse "rédemption nationale" coûte aux travailleurs du pétrole la respectable somme de plus de 190 millions de pesos, (pour ne parler que de ces travailleurs ), sans considérer les autres millions perdus pendant ces deux dernières années, pour s'être confiés aux juntes de conciliation au lieu d'obliger les compagnies, au moyen de la grève, à payer de plus hauts salaires. Au lieu d'obtenir que, sur les 50.millions qui étaient demandés aux Compagnies, il leur soit payé au moins les 20 millions que la décision "favorable" des juntes leur promettait, ils sont obligés de payer aux compagnies impérialistes, par le canal du gouvernement "anti-impérialiste" du Mexique, une somme cinq fois plus grande. Au lieu de recevoir 20 millions, ils sont obligés de payer plus de 190 millions, comme contribution à la prétendue "dette d'honneur".
Il serait difficile de trouver, dans toute l'histoire de la bourgeoisie mondiale, un autre exemple d'une tromperie si parfaitement exécutée. Dans le chœur des palabres patriotiques au sujet de la "libération économique du Mexique", se cache le vol le plus gigantesque que connaisse l'histoire. Les ouvriers sentent instinctivement qu'en réalité il ne s'agit de rien d'autre que d'un vol, mais, aveuglés par l'idée de la "patrie en danger", ils ne parvenaient pas à percer la vérité. Puisse notre faible voix permettre à certains de comprendre la véritable situation et les aider à se débarrasser de leurs songes et illusions!
LA TACHE DU PROLETARIAT FACE AUX RECENTES NATIONALISATIONS
Si aux faux "leaders marxistes" du Mexique, il manquait la valeur pour caractériser la véritable signification de la "nationalisation" du pétrole et des chemins de fer, il était tout de même moins risqué de parler de la tâche du prolétariat face à ces nationalisations faites par la bourgeoisie et au bénéfice de la bourgeoisie.
Engels parlait en toute clarté et franchise de cette tâche. Lui, bien entendu, ne voulait rien savoir de "l'appui au gouvernement" que préconisaient les traîtres à leur classe. Au contraire, l'unique chemin qu'il signalait, face aux nationalisations de la bourgeoisie, c'est la prise du pouvoir d'Etat par le prolétariat, et la transformation de la propriété des capitalistes, y compris la propriété" de l’Etat capitaliste, en propriété de l'Etat prolétarien
Il indiquait clairement quelle était l'unique leçon que les travailleurs devaient tirer de la transformation de la propriété des capitalistes individuels et des compagnies capitalistes en propriété de l'Eta-c capitaliste :
" Le régime capitaliste de production ... en poussant progressivement à transformer les grands moyens de production en propriété de l'Etat, indique lui-même les moyens d'accomplir cette révolution : le prolétariat s'empare du pouvoir d'Etat et transforme les moyens de production en propriété de l'Etat ...
F. ENGELS. (L'Anti-Dühring p.319)
La tâche du prolétariat mexicain est, alors, non de se sacrifier pour que l'industrie pétrolière et les chemins de fer soient profitables pour les capitalistes impérialistes et nationaux, ni d'accepter la farce de la "remise" des industries à une prétendue "administration ouvrière" mais de les conquérir, c'est à dire, de les arracher à la bourgeoisie au moyen de la révolution prolétarienne.
Telle est l'unique leçon que nous devons tirer des récentes nationalisations.
Géographique:
- Mexique [26]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [27]
Questions théoriques:
- Impérialisme [23]