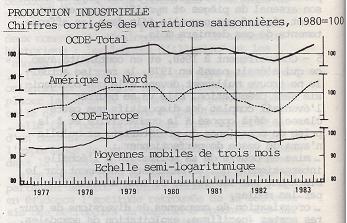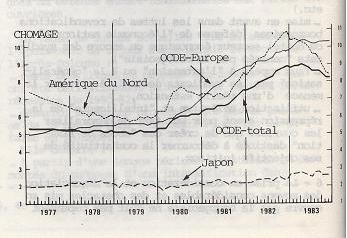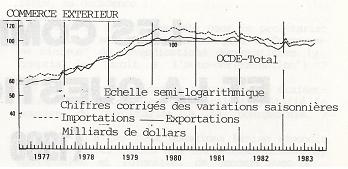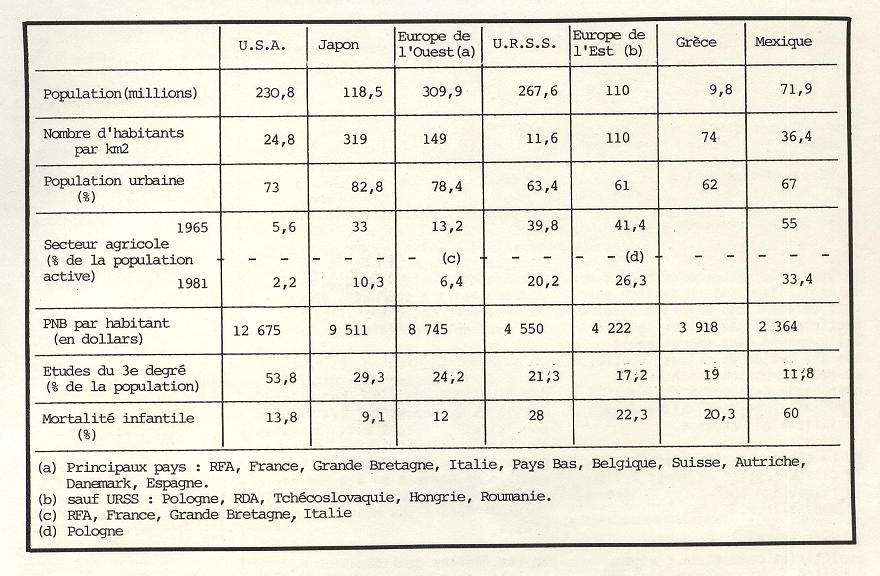Revue Internationale no 37 - 2e trimestre 1984
- 2528 lectures
La reprise de la lutte de classe
- 2646 lectures
Avec les années 80, l’économie capitaliste s’enfonce dans une impasse de plus en plus complète, l’histoire s'accélère. Les caractéristiques profondes et fondamentales de la décadence capitaliste sont mises à nu. En ce sens, les années 80 sont bien des "années de vérité" où les véritables enjeux de la vie de la société apparaissent de plus en plus au grand jour : guerre généralisée et destruction de l'humanité, ou révolution communiste internationale.
Les deux termes de cette alternative existent de façon constante dans la vie de la société depuis l'aube de la décadence : "l'ère des guerres et des révolutions prolétariennes" qu'avait défini l'Internationale Communiste. Mais ils ne se posent pas de façon symétrique et ne pèsent pas du même poids à tout moment sur l'avenir qui se profile. Depuis 68, le prolétariat, seule classe porteuse d'une solution historique à la décadence du capitalisme, a ressurgi sur la scène de l'histoire, ouvrant un cours à des affrontements de classe. Cela ne signifie pas que les conflits inter impérialistes se sont tus. Au contraire, ils n'ont jamais cessé,et, avec les années 80, c'est à 1'exacerbation de ces antagonismes qu'on assiste, à une inféodation croissante de toute la vie économique aux nécessités militaires, à la poursuite et à l'accentuation de la barbarie capitaliste avec ses monceaux de cadavres et de destruction que viennent encore une fois d'illustrer dernièrement la poursuite de la guerre au Liban et les hideux massacres perpétrés dans le renouveau de la guerre Irak Iran. Mais cela signifie que le prolétariat, par sa combativité, par sa non adhésion à l'idéologie dominante, par sa non soumission à la classe capitaliste, barre la route à la généralisation de ces conflits en une troisième conflagration mondiale. ([1] [1])
Cette affirmation du caractère déterminant de la lutte du prolétariat dans la situation actuelle peut paraître gratuite quand on regarde le tableau désolé et sans perspectives que nous offrent les médias bourgeois. Mais la compréhension des grandes tendances qui caractérisent une situation et sa dynamique, ne peut se suffire de l'apparence superficielle et mystifiée des choses présentée par la classe dominante. C'est que la lutte du prolétariat, en tant que lutte d'une classe exploitée,ne peut suivre un cours linéaire, ne peut développer graduellement sa force. Expression du rapport de forces entre deux classes antagoniques, la lutte de classe suit un cours sinueux, en dents de scie, fait d'avancées, de reculs durant lesquels la classe dominante s'efforce d'effacer et de détruire toute trace des avancées précédentes. Cette tendance est exacerbée dans la période de décadence où la forme de domination politico-économique de la bourgeoisie qu'est le capitalisme d'Etat tend en permanence à absorber toute manifestation de la vie sociale. Pour autant, la lutte de classe subsiste comme moteur de 1'histoire et 1'on ne peut comprendre pourquoi la situation de décomposition accélérée dans laquelle la crise historique du système a jeté la société, perdure sans déboucher dans une boucherie généralisée, si l'on ne saisit pas que le prolétariat a constitué et continue d'être l'entrave déterminante à l'aboutissement des tendances guerrières du capitalisme.
LA LUTTE REPREND DANS TOUS LES PAYS
Depuis 1968, nous avons assisté à deux avancées du prolétariat international : de 68 à 74 où la bourgeoisie a été surprise par la réémergence de cette force sociale qu'elle croyait définitivement enterrée, et de 78 à 80 où le mouvement a culminé en Pologne avec une grève de masse développant toutes les caractéristiques de la lutte de classe en période de décadence ([2] [2]). Depuis la mi-83, la tendance à la reprise des luttes du prolétariat dont nous avions annoncé la perspective après deux années de déboussolement et de paralysie à la suite de la défaite partielle du prolétariat mondial en Pologne ([3] [3]), s'est réaffirmée : en BELGIQUE, en HOLLANDE, en ALLEMAGNE, en GRANDE BRETAGNE, en FRANCE, aux ETATS-UNIS, en SUEDE, en ESPAGNE, en ITALIE etc., des grèves ont éclaté contre les mesures d ' austérité draconiennes imposées par la bourgeoisie, touchant tous les pays du coeur du monde industriel où se joue la perspective historique pour l'humanité ([4] [4]). Dans les pays secondaires carme la Tunisie, le Maroc, la Roumanie, des émeutes et des grèves ont explosé. C'est une tendance internationale de résistance à la logique infernale de la crise du capital qui se dessine à nouveau.
Les "Thèses sur la reprise de la lutte de classe" que nous publions plus loin, mettent en évidence les grandes lignes qui ont présidé à l'avancée du prolétariat durant les deux vagues de lut te précédentes et tracent les caractéristiques de celle qui ne fait que commencer.
Si prises séparément, une à une, aucune des luttes qui ont eu lieu dans les pays mentionnés plus haut n'est en soi profondément significative d'un grand pas en avant du prolétariat international, le contexte de crise exacerbée, de décomposition sociale, d'usure des mystifications, de fossé grandissant entre l'Etat et la société civile, le phénomène d'accélération de l'histoire constituent le terrain propice au développement de la conscience du prolétariat révolutionnaire. Ce sont le caractère international et historique de ces réactions, la compréhension du processus de prise de conscience au travers de l'accumulation de ses expériences, de l'évolution de ses luttes et de leur dynamique qui nous donnent la clé des perspectives qui s'ouvrent au prolétariat et existent en germe dans ce renouveau de la combativité.
EN GERME, LES TRAITS DE L'AVENIR
Aucune des luttes que nous avons vu se développer depuis l'importante grève du secteur public en Belgique en septembre 83 n'a permis réellement de faire reculer la bourgeoisie sur les mesures qu'elle voulait imposer à la classe ouvrière. Que ce soit les luttes du secteur public en Hollande ou celle des employés de la compagnie de bus Greyhound aux Etats-Unis contre la baisse des salaires, que ce soit celle des sidérurgistes de Sagunto en Espagne ou des ouvriers de l'usine automobile Talbot-Poissy en France contre les licenciements, ou encore celle des postes en France contre l'augmentation des heures de travail, etc., aucune n'a obtenu de résultat, même momentanément. Cependant, le fa^t que le prolétariat résiste, qu'il ne se laisse pas imposer quasiment passivement ces mesures, comme ça a pu être le cas par exemple aux USA où, pendant 4 ans, de nombreux secteurs ont accepté sans réaction des baisses de salaire, est un signe très positif de sa non soumission aux intérêts de l'économie nationale, de sa combativité. Et la première victoire de la lutte, c'est la lutte elle-même.
Alors que les nécessites d'un développement de la perspective historique de lutte de classe vont imposer à la classe ouvrière, conformément aux caractéristiques des luttes dans la période de décadence, une extension et une auto organisation de ses combats, une confrontation radicale à l'appareil syndical et à toutes les mystifications démocratiques et syndicalistes de la bourgeoisie, une politisation de son mouvement, aucune des luttes qui ont eu lieu n'a réellement réussi à développer pleinement ne serait-ce qu'une seule de ces caractéristiques. Cependant, examinons de plus près, à la lumière de ces nécessités, quelques aspects de ces divers mouvements :
- par rapport à la nécessité de l'extension de la lutte, c'est-à-dire la prise de conscience que le prolétariat ne peut pas se battre de façon isolée, minoritaire, qu'il ne peut pas imposer un rapport de forces en sa faveur sans s'impliquer massivement dans le combat, nous ..avons assisté en Belgique à une tentative spontanée d'extension du mouvement par les cheminots de Charleroi, dépassant dès le départ l'éternelle division communautaire et linguistique Flandres/Wallonie largement usée dans le passé par la bourgeoisie pour dévoyer le prolétariat. Les syndicats se sont trouvés dans l'obligation d'"étendre" la grève à tout le secteur public, visant par là à noyer le mouvement dans des parties moins combatives des travailleurs et à imposer la division catégorielle "secteur public"-"secteur privé". Ce n'est pourtant qu'au bout de trois semaines, après avoir impliqué plusieurs centaines de milliers de travailleurs dans un pays de 9 millions d'habitants, que la grève s'est terminée. A peine celle-ci finie que démarrait dans le paradis du Welfare State" qu'est la Hollande, une grève du secteur public également, la première depuis 1903, qui allait durer 6 semaines. Celle-ci a commencé sous la poussée de la combativité des cheminots et des chauffeurs de bus, et si, grâce à la collaboration étroite entre syndicats belges et syndicats hollandais, et entre toutes les fractions de droite, de gauche et syndicales de la bourgeoisie nationale, plus l'organisation d'une campagne "pacifiste" en plein milieu du mouvement, celui-ci a abouti dans une impasse, ce n'est pas sans mal que la situation est rentrée "dans l'ordre".
Aux USA, des ouvriers d'autres secteurs ont soutenu la grève des employés du Greyhound en participant aux piquets ; les syndicats ont du organiser leur éternelle "aide financière" sous forme de "cadeaux de Noël" aux employés du Greyhound pour répondre au sentiment de solidarité qui se manifestait dans la population et empêcher la réelle et seule solidarité de classe possible, celle de la lutte, de s’exprimer
- par rapport à la nécessité de l'auto organisation de la lutte, des assemblées générales ont eu lieu dans la plupart des mouvements. Mais la question de l'auto organisation pose et contient le problème de la confrontation aux syndicats, c'est-à-dire un pas que le prolétariat n'a pas encore franchi et qui implique un niveau de confiance en lui-même et de conscience qui n'est encore qu'en germe aujourd'hui. Cependant, la question syndicale a été posée dans de multiples cas, dans ces tous premiers mouvements de la reprise. La plupart de ces grèves ont été déclenchées spontanément, sans attendre les consignes syndicales, ou si les syndicats ont su prendre dès le départ le mouvement sous leur responsabilité, comme en Hollande ou dans les grèves en Italie, c'est bien parce qu'ils comprenaient que les mouvements auraient lieu de toutes façons. En Belgique, c'est en dehors des syndicats qu'a démarré le mouvement qu'ils n'ont pu reprendre en main qu'au bout de trois jours ; en Hollande à de nombreuses reprises dans des assemblées générales çà et là, les consignes syndicales n'ont pas été suivies. En Grande Bretagne, 1200 ouvriers ont manifesté contre des manoeuvres syndicales. Même en Suède où la grève des mineurs de Kiruna qui n'a duré qu'une journée, avait été appelée par le syndicat, la consigne de celui-ci qu'une partie seulement des mineurs fasse grève, a été débordée, et tous les mineurs s'y sont mis. Partout, en Italie, en France, en Espagne, en Hollande, en Belgique, c'est au syndicalisme de base, avec son langage radical qu'ont été laissées les choses en main, les appareils étant de moins en moins suivis, sinon pas du tout. L'usure de la mystification syndicale commence d'ores et déjà à se faire sentir, posant les jalons de la future capacité de la classe à prendre en main son propre destin, de son auto organisation.
- par rapport à la question de la politisation du mouvement, c'est-à-dire l'établissement d'un rapport de forces du prolétariat face à l'Etat comme on a pu le voir pleinement développé en août 80 en Pologne, cette question contient la capacité du prolétariat à s'organiser et à étendre lui-même sa lutte. On n'en est pas encore là. Mais d'ores et déjà la question de l'Etat est posée dans les grèves des fonctionnaires qui sont de moins en moins mystifiés par le caractère soi -disant "social" de l'Etat, dans la résistance aux mesures d'austérité que la crise impose à chaque Etat de prendre contre les ouvriers. Elle est par exemple clairement posée dans la confrontation à Sagunto en Espagne entre sidérurgistes et forces de l'ordre, des forces de l'ordre "socialistes". La démystification du caractère réactionnaire des syndicats en tant que rouages de l'Etat fait aussi partie des jalons de cette prise de conscience politique.
Ce qu'on peut conclure de ces quelques éléments, c'est qu'au tout début de cette reprise, la classe ouvrière se heurte aux obstacles sur lesquels elle avait échoué lors de la vague de 78-80 : face à la nécessité de l'extension, les syndicats proposent une fausse extension catégorielle ; face à la nécessité de l'auto organisation, les syndicalistes de base proposent des comités de grève syndicaux "à la base" ; face à la nécessite de la solidarité active, les syndicats proposent le soutien "matériel" inefficace aujourd'hui ; face au problème de la politisation, les syndicats proposent la fausse radicalisation verbale du syndicalisme "de combat" dont les gauchistes se font les fervents porteurs. Ainsi, tous les ingrédients de la précédente vague sont déjà présents.
En réalité, la mise en place de la gauche dans l'opposition face à la précédente vague de luttes en 78-80, la "radicalisation" soudaine des partis de gauche et des syndicats après des années de langage "responsable" en vue d'accéder au pouvoir, la réapparition du syndicalisme de base et des gauchistes en son sein ont été les anti-corps sécrétés par la bourgeoisie contre le prolétariat et qui l'ont momentanément déboussolé. Aujourd'hui, ces anti-corps existent dès le début des luttes, tentant d'en saboter la dynamique dès l'origine, mais, en même temps, dédorant leur blason.
En ce sens, ce troisième mouvement de reprise ne peut être que plus difficile au départ, le prolétariat occidental se heurtant à la bourgeoisie la plus forte et la plus expérimentée du monde, contrairement à ce qui se présentait en Pologne en 80. Il se fera de façon relativement lente, mais cette difficulté même est porteuse de leçons plus profondes.
Lorsqu'une vague de luttes reprend à l'échelle internationale, on ne peut s'attendre automatiquement à ce qu'un pas qualitatif s'opère à son début. Avant que la progression ne se marque, le prolétariat doit souvent revivre dans la pratique les difficultés auxquelles il a été confronté, et c'est la dynamique même de la lutte combinée à l'accumulation des expériences favorisée justement par l’accélération de la crise qui permettra à la conscience de s'épanouir plus largement.
Les conditions de la révolution communiste ont été définies par Marx et Engels, dès l'origine .du mouvement ouvrier : crise économique internationale, internationalisation des luttes. Aujourd'hui, les conditions de la généralisation des combats de la classe ouvrière qui contient la perspective révolutionnaire, se réunissent. Il y aura encore des avancées et des reculs. Les enjeux de l'histoire ne sont pas joués d'avance, mais ils sont en train de se jouer. Les organisations révolutionnaires doivent être à même de reconnaître la dynamique de la perspective historique, afin d'assumer dans leur classe la fonction déterminante pour laquelle elle les a sécrétées.
CN.
[1] [5] Voir l’article"conflits inter-impérialistes et lutte~de classe":"l’histoire s'accélère", in Revue Internationale n° 36, 1er trimestre 84.
[2] [6] Voir tous les articles sur la lutte de classe en Pologne, ses enseignements et ses implications, in Revue Internationale n° 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
[3] [7] Voir l'article "Où va la lutte de classe ? Vers la fin du repli de 1'après-Pologne", in Revue Internationale n° 33, 2e trimestre 83.
[4] [8] Voir l'article "Le prolétariat d'Europe de l'ouest au coeur de la généralisation de la lutte de classe" in Revue Internationale n° 31,.4e trimestre 82.
Géographique:
- Europe [9]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [10]
Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe
- 2453 lectures
1 - Le 5e Congrès du CCI constatait, dans sa ré solution sur la situation internationale ([1] [11]) que "la crise qui maintenant atteint de -plein fouet les métropoles du capitalisme, obligera le prolétariat de ces métropoles à exprimer ses réserves de combativité qui n’ont pas été jusqu'à présent entamées de façon décisive". "La crise se révèle la meilleure alliée du prolétariat mondial". Ce qui n'était qu'annoncé au moment du Congrès, sans qu'il n'en soit prévu l'imminence, est devenu aujourd'hui une réalité. Depuis le milieu de 1983,- la classe ouvrière est sortie du recul marqué du sceau de la défaite en Pologne en 81 et s'est engagée dans une nouvelle vague de combats contre le capitalisme. En moins de 6 mois, ce sont des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, la France, les Etats-Unis, l'Espagne et dans une moindre mesure, l'Allemagne, la Grande Bretagne et l'Italie qui ont connu des mouvements importants et significatifs de la classe.
2 - La reprise actuelle des luttes exprime le fait que, dans la période présente d'aggravation inexorable et catastrophique de la crise du capitalisme située dans un contexte général de cours historique aux affrontements de classe, les moments de recul du prolétariat sont et seront de plus en plus de courte durée. Ce qui se révèle dans cette reprise, c'est qu'aujourd'hui, les défaites partielles et la désorientation momentanée qui les permet ou qu'elles provoquent, ne sauraient entraver de façon décisive la capacité du prolétariat à riposter de façon croissante aux attaques économiques de plus en plus violences que lui assène le capital. Elle illustre une nouvelle fois le fait que, depuis 1968, c'est la classe ouvrière mondiale qui détient l'initiative historique, qui est passée globalement à l'offensive face à une bourgeoisie qui, malgré une défense pas à pas et un déploiement massif et impressionnant de son arsenal anti-ouvrier, n'a pas les mains libres pour apporter sa réponse propre à sa crise : la guerre impérialiste généralisée.
3 - La vague présente de lutte s'annonce d'ores et déjà comme devant dépasser en ampleur et en importance les deux vagues qui l'ont précédée depuis la reprise historique de la fin des années 60 : celle de 1968-74, et celle de 1978-80.
La première vague a eu comme caractéristiques majeures :
- d'annoncer avec fracas et de façon spectaculaire (notamment avec Mai 68 en France, le Mai rampant italien, les affrontements de Pologne) la fin de la période de contre-révolution, l'entrée du capitalisme dans une période nouvelle dominée par la confrontation entre les deux classes décisives de la société,
- de surprendre la classe bourgeoise qui avait perdu l'habitude de voir le prolétariat comme acteur de premier plan dans la vie de la société,
- de se développer à partir d'une situation économique encore relativement peu dégradée, ce qui laissait la place pour de nombreuses illusions au sein du prolétariat et notamment celle de l'existence d'une "alternative de gauche".
La deuxième vague se distingue par les éléments suivants :
- elle se base sur une dégradation beaucoup plus avancée de l'économie capitaliste, des attaques beaucoup plus sévères contre les conditions de vie de la classe,
- elle se situe à une période charnière entre deux moments du développement de la situation historique : les "années d'illusion" et les "années de vérité",
- elle voit la bourgeoisie des pays avancés réorienter sa stratégie face au prolétariat, remplacer la carte de "la gauche au pouvoir" par celle de "la gauche dans l'opposition",
- elle fait pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, avec les combats de Pologne 80, l'expérience de cette arme décisive de la classe dans la période de décadence:1a grève de masse,
- elle culmine dans un pays de la périphérie appartenant au bloc le plus "arriéré", ce qui met en évidence l'aptitude retrouvée de la bourgeoisie des métropoles du capital à opposer des lignes de défense encore considérables aux luttes ouvrières.
La vague de luttes actuelles tire sa source de l'épuisement' de ce\qui avait permis le recul de 1'après-Pologne :
- reste des illusions propres aux années 70 qui ont été définitivement balayées par la très forte récession de 1980-82,
- désarroi momentané provoqué tant par le passage de la gauche dans l'opposition que par la défaite en Pologne.
Elle démarre :
- à partir d'une longue période d'austérité et de montée du chômage, d'une intensification des attaques économiques contre la classe ouvrière dans les pays centraux,
- à la suite de plusieurs années d'utilisation de la carte de la gauche dans l'opposition et de l'ensemble des mystifications qui y sont associées.
Pour ces raisons, elle va se poursuivre par des engagements de plus en plus puissants et déterminés du prolétariat des métropoles contre le capitalisme dont le point culminant se situera de ce fait à un niveau supérieur à celui de chacune des vagues précédentes.
4 - Les caractéristiques de la vague présente, tel les qu'elles se sont déjà manifestées et qui vont se préciser de plus en plus, sont les suivantes :
- tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de l'extension géographique des luttes, tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant, en particulier à leur début, un certain débordement des syndicats,
- simultanéité croissante des luttes au niveau international, jetant les jalons pour la future généralisation mondiale des luttes,
- développement progressif, au sein de l'ensemble du prolétariat,de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité de s'opposer comme classe aux attaques capitalistes,
- rythme lent du développement des luttes dans les pays centraux et notamment de l'aptitude à leur auto organisation, phénomène qui résulte du déploiement par la bourgeoisie de ces pays de tout son arsenal de pièges et mystifications et qui s'est réalisé une nouvelle fois dans les affrontements de ces derniers mois.
5 - Contrairement à 1968, et en continuité avec ce qui s'était passé en 1978, la reprise actuel le ne trouve nullement devant elle une bourgeoisie sans préparation. Elle va se heurter à l'éventail complet des dispositifs que cette classe a déjà opposé à la combativité et à la prise de conscience du prolétariat, et qu'elle n'aura de cesse de perfectionner :
- mise en oeuvre de sa solidarité à l'échelle internationale qui se manifeste notamment par le black-out sur les luttes ou leur dénaturation par les médias,
- organisation de campagnes de diversions de toutes sortes (pacifisme, exploitation de scandales, etc.)
- mise en avant dans les luttes de revendications bourgeoises (défense de "l'économie nationale" ou de tel secteur économique ou encore des syndicats "menacés par la bourgeoisie"),
- faux appels à "l'extension" ou à la "généralisation" par les syndicats destinés à prévenir la menace d'une réelle extension,
- utilisation sélective et "intelligente" de la répression ayant pour but tant de démoraliser les ouvriers que de créer des "abcès de fixation" destinés à détourner la combativité de ses objectifs initiaux.
6 - La prise en considération et la dénonciation des moyens considérables et des obstacles mis en oeuvre par la bourgeoisie ne doit pas cependant conduire à un manque de confiance envers la capacité du prolétariat à les affronter et les surmonter. Cet arsenal sera responsable du développement lent, progressif des luttes dans les métropoles du capital (ce qui n'exclut pas la possibilité de brusques accélérations à certains moments, notamment là où la bourgeoisie n'a pas pu placer ses forces de gauche dans l'opposition comme en Espagne et surtout en France). En cela, les pays centraux continueront à se distinguer des pays de la périphérie (Europe de l'Est et surtout Tiers Monde) qui pourront connaître des explosions de colère et de désespoir, des "révoltes de la faim" violentes et massives mais sans perspectives propres et condamnées à une répression féroce. Cependant, l'utilisation permanente et de plus en plus intensive et simultanée par la bourgeoisie des pays avancés de tous ses moyens de sabotage des luttes, va nécessairement provoquer leur usure :
- les black-out et falsifications conduiront à une perte de confiance absolue envers les médias bourgeois,
- les campagnes de diversion montreront de plus en plus leur vrai visage face à la réalité des luttes sociales,
- les contorsions, même radicales, de la gauche, des gauchistes, des syndicats et du syndicalisme de base à force de conduire dans des impasses et à la défaite, provoqueront une méfiance croissante envers ces forces du capital comme cela se révèle déjà dans la période actuelle, notamment par une tendance nette à la désyndicalisation (en termes d'effectifs ou d'implication des ouvriers dans la vie syndicale),
- l'emploi de la répression, même s'il sera "modéré" dans les pays avancés dans la période qui vient, conduira en fin de compte à une prise de conscience de la nécessité de s'affronter directement et massivement à l'Etat.
En fin de compte, l'impasse économique totale du capitalisme, la misère croissante dans laquelle ce système va plonger la classe ouvrière, vont épuiser progressivement l'ensemble des mystifications qui ont permis jusqu'à présent à la bourgeoisie de maintenir son contrôle sur la société et, notamment, celles du "Welfare State". S'il est donc vain de s'attendre dans les pays centraux du capitalisme pour la période qui vient à des "sauts qualitatifs" brusques, à de soudains surgissements de la grève de masse, il est par contre nécessaire de souligner la tendance des affrontements qui ont d'ores et déjà commencé, à prendre un caractère de plus en plus massif, puissant, et simultané.
En ce sens, comme il l'a déjà été dit, "la crise reste la meilleure alliée du prolétariat mondial".
Récent et en cours:
- Luttes de classe [10]
Où en est la crise ? : Le mythe de la reprise économique
- 2601 lectures
La bourgeoisie fait grand cas d'une soi-disant "reprise" économique qui marquerait la victoire des politiques d'austérité à la Reagan. L'OCDE, dans ses PERSPECTIVES ECONOMIQUES de décembre 83, commence son rapport par une affirmation presque triomphante : "La reprise de l'activité concerne désormais presque tous les pays de l'OCDE". Et de relever une série de points positifs : croissance du PNB et de la production industrielle, ralentissement de l'inflation, réduction des déficits budgétaires, augmentation des profits. Deux pages plus loin, l'OCDE écrit : "Si cette appréciation se révélait fausse, il faudrait revoir les prévisions quant à la vigueur et à la persistance de la reprise. " ... Ce genre de phrase montre à quel point la bourgeoisie elle-même a confiance en ce qu'elle annonce à grand fracas.
Il est un fait indéniable que plusieurs indicateurs économiques sont devenus positifs en 83 alors qu'ils étaient négatifs en 82, ce qui signifie que l'année 83 est moins pire que la précédente, du moins pour la bourgeoisie. De là à parler de reprise économique réelle il y a plus qu'un pas, il y a un fossé. Avant d'en analyser les causes et les perspectives, examinons brièvement la réalité de cette "reprise".
LA CROISSANCE DU PNB ET DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Cette croissance est pratiquement limitée aux Etats-Unis, et atteint des chiffres plutôt miserables. Le PNB a progressé de 3.5% en 83 aux Etats-Unis, mais n'atteint péniblement que 1% en Europe. La croissance de la production industrielle atteint 6% aux Etats-Unis, mais ne parvient même pas à compenser la chute de 82 (-8.1%) : au total des deux années le bilan reste à une baisse de -2.6% ! Quant aux pays européens, ils connaissent une croissance de leur production industrielle magnifique, puisqu'elle varie de ... -4.3% en Italie à 1% en Grande-Bretagne !
L'UTILISATION DES FORCES PRODUCTIVES
La sous-utilisation des forces productives est une des manifestations les plus claires de la surproduction. Malgré une augmentation de 10% par rapport à 82, le taux d'utilisation des capacités industrielles n'a pas dépassé 80% aux Etats-Unis. Quant au chômage, contrairement aux miracles annoncés, il n'a baissé, à l'échelle annuelle, que de 0.2% aux Etats-Unis, tandis qu'il a poursuivi sa progression hallucinante dans TOUS les pays Européens.
En pourcentage de la population active chiffres corrigés des variations saisonnières
LES INVESTISSEMENTS
Les investissements des entreprises ont continué à décliner, malgré la "reprise". Comme ces investissements sont la base d'une reprise à long terme, la bourgeoisie montre par là qu'elle ne croit pas elle-même en une telle reprise.
LE COMMERCE MONDIAL
Celui-ci a stagné en 83, après une baisse globale de 2% en 1982.
L'ensemble de ces chiffres (tirés pourtant des statistiques officielles de la bourgeoisie : OCDE) prouve sans conteste que, si le capitalisme connaît un pallier momentané dans l’approfondissement. de la crise, il ne s'agit nullement d'une reprise économique réelle. La seule évolution positive dont peut se targuer la bourgeoisie est la réduction effective de l'inflation, mais nous verrons plus loin ce que signifie cette réduction. L'existence d'un léger mieux temporaire dans un cours général vers l'effondrement ne fait que traduire le profil en dents de scie qui a toujours caractérisé l'évolution de l'économie capitaliste. L'important est de voir dans quel sens est orientée la scie : les dents sont aujourd'hui inclinées vers le bas, sans aucune perspective d'inversion de la tendance.
Après la récession profonde de 1975, la bourgeoisie occidentale a réagi en recourant massivement à l'usage de sa drogue classique : le crédit, l'impression de papier monnaie sans contrepartie économique. Les Etats-Unis ont joué à ce niveau un rôle de premier plan, la multiplication des dollars et le déficit de leur balance de paiements ayant un effet de locomotive sur l'ensemble de l'économie mondiale. C'est la faillite de cette politique au travers d'une inflation mondiale démesurée qui a poussé la bourgeoisie à renverser la tendance et à développer les conceptions monétaristes. L'histoire ne se répète pas, et aujourd'hui la bourgeoisie n'a plus les moyens de reproduire le même scénario, car le spectre d'un effondrement du système financier international, reste présent de façon constante, même sans inflation, ne fut-ce qu'à cause de l'endettement colossal de la plupart des Etats qui n'a fait que s'aggraver avec la hausse du dollar. C'est ainsi que, malgré la fameuse "reprise", les Etats-Unis ont enregistré un record de faillites bancaires en 83.
Le "truc" inventé par la bourgeoisie américaine pour stimuler l'économie sans engendrer d'inflation consiste essentiellement à provoquer un transfert de capitaux entre ses mains. D'une part, grâce à des taux d'intérêts exceptionnellement élevés, les Etats-Unis attirent les capitaux du monde entier et rapatrient la masse des dollars dispersés à l'étranger. D'autre part, la réduction générale des salaires dans le monde et la forte augmentation de la productivité du travail permettent d'accroître sensiblement le capital revenant à la bourgeoisie sous forme de plus-value. Ce double mouvement d'appauvrissement du prolétariat et des autres pays relativement aux Etats-Unis, fournit à ceux-ci les ressources nécessaires pour financer leurs déficits budgétaire, commercial et des opérations courantes. Ces derniers se sont considérablement accrus au cours de la dernière année, montrant que les discours monétaristes de Reagan ne sont en définitive que du bluff. Le déficit du budget fédéral a triplé en deux ans passant de 70 milliards de dollars en 1981 à 179 milliards en 1983 ; celui de la balance commerciale a doublé en un an passant de 36 milliards de dollars en 82 à 63 milliards de dollars en 83 ; celui des opérations courantes a quadruplé en un an, passant de 11 à 42 milliards de dollars.
Ces chiffres astronomiques, qui cependant se sont accompagnés d'une diminution de l'inflation et d'une appréciation du dollar contrairement à la logique économique apparente, traduisent bien l'énorme drainage de capitaux vers les Etats-Unis qui s'opère aujourd'hui. Il dévoile par la même occasion toutes les limites de la "reprise" actuelle. Contrairement à ce qui s'était passé à la fin des années 70, les Etats-Unis ne sont plus aujourd'hui à même de jouer un rôle de "locomotive" pour l'économie mondiale. Bien qu'ils recommencent à importer une grande quantité de marchandises, l'effet d'entraînement que pourrait constituer la poursuite de cette politique est partiellement annulé par le transfert de capitaux dans le même sens et par le renchérissement des matières premières libellées en dollars (exemple : pétrole). L'amélioration de la situation économique aux Etats-Unis, qui - comme nous l'avons vu - n'a pourtant rien de spectaculaire, s'accompagne aussi d'une stagnation des économies européennes, qui n'est pas destinée à se modifier qualitativement.
A plus long terme, le mécanisme actuel de la "reprise" aux Etats-Unis annonce un avenir catastrophique pour l'économie mondiale. La surévaluation actuelle du dollar, conséquence des hauts taux d'intérêt américains, permet aux Etats-Unis d'importer à bon marché, mais détériore la compétitivité de leurs secteurs exportateurs, ce qui aggrave encore le déficit commercial. Sous la pression de la loi de la valeur, le dollar est condamné à dévaluer et toute la belle mécanique à l'oeuvre aujourd'hui éclatera comme une baudruche. A ce moment, les déficits budgétaire et commercial américains, que l'on laisse gonfler de façon spectaculaire, ne seront plus compensés, et l'inflation masquée par les hauts taux d'intérêt et les mouvements de capitaux apparaîtra au grand jour.
Le capitalisme se trouvera alors dans une situation dix fois empirée et sera précipité dans des gouffres de plus en plus profonds.
M.L.
Récent et en cours:
- Crise économique [13]
Les communistes et la question nationale (1900-1920) 2ème partie
- 3113 lectures
Le débat pendant la guerre impérialiste
Dans le premier article de cette série, paru dans le numéro 34 de la Revue Internationale , nous avons examiné l'attitude des communistes sur la question nationale à l'aube de la décadence du capitalisme et notamment le débat entre Lénine et Rosa Luxemburg sur la question du soutien de la classe ouvrière au "droit des nations à 1'auto-détermination". Nous avons conclu que, même lorsque certaines luttes de libération nationale pouvaient encore être considérées comme progressistes du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, un tel mot d'ordre devait être rejeté.
Avec l'éclatement de la guerre en 1914, toute une série de questions nouvelles se sont posées au mouvement ouvrier. Dans cet article, nous nous proposons d'examiner les premières tentatives des communistes pour en débattre et leurs implications quant à la question du soutien à toutes les luttes nationalistes.
Une des fonctions propres aux révolutionnaires consiste à faire de leur mieux pour analyser la réalité à laquelle la classe se trouve confrontée. Au cours de la première guerre mondiale, le débat au sein des fractions de la "Gauche de Zimmerwald" sur les luttes de libérations nationales, tentait de répondre, pour une bonne part, à ce souci, afin de mettre en évidence les conditions auxquelles la lutte de classe se trouvait confrontée, conditions nouvelles, sans précédent de la guerre capitaliste mondiale, de l'impérialisme déchaîné et du contrôle massif de l'Etat-
Soixante ans plus tard, le débat n'est plus le même; les révolutionnaires se doivent de ne pas répéter ses inadéquations et erreurs. L'expérience de la classe a apporté des réponses, de même qu'elle a soulevé de nouveaux problèmes. Et si les minorités politiques n'adoptent plus le même esprit de critique impitoyable et d'investigation pratique, en restant attachées aux mots d'ordre propres à la période ascendante du capitalisme, elles faillissent à leurs devoirs fondamentaux et rejettent toute la méthodologie de Lénine, Luxemburg et des fractions de gauche. C'est cette méthodologie qui a amené le CCI à rejeter les positions de Lénine sur la question nationale et à développer la contribution faite par Rosa Luxemburg
La question nationale dans la gauche de Zimmerwald
Les révolutionnaires qui sont restés fidèles à l'esprit du Manifeste Communiste et à son cri de ralliement - "Les prolétaires n'ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!" - se sont regroupés dans le mouvement de Zimmerwald composé des opposants à la guerre mais ils ont été rapidement contraints de s'organiser en aile gauche au sein de ce mouvement afin de défendre une position de classe claire contre les tendances réformistes et pacifistes de la majorité. La gauche de Zimmerwald fut fondée en 1915 sur la base de rassemblement suivante :
- reconnaissance de la nature impérialiste de la guerre, contre le mensonge de « la défense de la patrie »;
- reconnaissance de la nécessité de la lutte pour le pouvoir politique et de la révolution prolétarienne comme unique réponse à l'impérialisme;
- reconnaissance du fait que le début de cette lutte serait une lutte active contre la guerre.
Tout en ne rejetant ni le vieux programme minimum de la social-démocratie ni la lutte pour des réformes au sein du capitalisme, cette lutte devait désormais être menée "en vue d'aiguiser toute crise sociale et politique du capitalisme en général, de même que la crise causée par la guerre et de transformer cette lutte en une attaque contre la forteresse fondamentale du capitalisme .. Sous le mot d'ordre de socialisme, cette lutte rendra les, masses laborieuses imperméables au mot d'ordre de l'asservissement d'un peuple par un autre..."
(Projet de Résolution de la Gauche de Zimmerwald, 1915).
Malgré un attachement persistant au programme minimum, qui était approprié à la période ascendante du capitalisme, les positions de la Gauche de Zimmerwald reflétaient le constat d'une rupture dans la période historique et dans le mouvement ouvrier lui-même. Désormais, il ne pouvait plus être question pour le prolétariat de soutenir les mouvements nationalistes bourgeois en vue de faire avancer la lutte pour la démocratie dans le cadre d'un capitalisme encore en pleine expansion. L'attitude du prolétariat envers la question nationale était maintenant inséparable de la nécessité de lutter contre la guerre impérialiste et, plus généralement, contre le capitalisme impérialiste lui-même, avec comme objectif de créer les conditions pour la prise de pouvoir révolutionnaire du prolétariat.
Dans la Gauche de Zimmerwald, le Parti Bolchevik exprimait déjà clairement l'attitude générale, historique des révolutionnaires face aux luttes de libération nationale :
"Les guerres réellement nationales qui ont eu lieu, notamment dans la période de 1789-1871, étaient 1'expression de mouvements nationaux de masse, d'une lutte contre l'absolutisme et le système féodal, pour 1'abolition de l'oppression nationale et la création d'Etats sur une base nationale, condition préalable du développement capitaliste.
L'idéologie nationale engendrée par cette époque a laissé des traces profondes dans la masse de la petite bourgeoisie et dans une partie du prolétariat. C'est ce dont profitent actuellement, à une époque toute différente, celle de l'impérialisme, les sophistes de la bourgeoisie et les traîtres au socialisme qui rampent à leur suite, afin de diviser les ouvriers et de les détourner de leurs tâches de classe et de la lutte révolutionnaire contre la bourgeoisie.
Les paroles du Manifeste Communiste : "Les ouvriers n'ont pas de patrie", sont aujourd'hui plus justes que jamais. Seule la lutte internationale du prolétariat contre la bourgeoisie peut sauvegarder ses conquêtes et ouvrir aux masses opprimées la voie d'un avenir meilleur. "
(Résolution de la Conférence de Berne des sections à l'étranger du POSDR, mars 1915 - Lénine, Oeuvres T.21, p. 158-159)
C'est dans ce cadre que prit place le débat entre les différentes fractions de la Gauche de Zimmerwald sur la question nationale. Ce débat, mené essentiellement entre les communistes d'Europe occidentale et Lénine s'était focalisé à l'origine sur la question : est-il encore possible pour le prolétariat d'apporter son soutien au "droit des nations à 1'auto-détermination" ? Il reprenait en grande partie les grandes lignes de la polémique d'avant-guerre entre Lénine et Rosa Luxemburg; mais il devait s'élargir et s'ouvrir sur deux questions fondamentales posées par l'entrée du capitalisme dans sa phase impérialiste, sa décadence :
1 - Etait-il encore possible pour le prolétariat de lutter au sein du capitalisme pour un "programme minimum" de revendications démocratiques (y compris le "droit à l'autodétermination") ?
2 - Des guerres nationales progressistes étaient-elles encore possibles qui auraient justifié le soutien du prolétariat à la bourgeoisie ?
Alors qu'à ces deux questions Lénine répondit "oui", d'autres telles que les gauches Allemande, Hollandaise et Polonaise, de concert avec le groupe Kommunist autour de Boukharine et Piatakov au sein du Parti Bolchevik, commencèrent timidement à répondre "non", rejetant définitivement le mot d'ordre de l'autodétermination et tentant de définir les taches du prolétariat face aux conditions nouvelles du capitalisme décadent. Ce furent ces fractions, tendant vers des positions cohérentes autour de la théorie de l'impérialisme défendue par Rosa Luxemburg, qui ont le mieux réussi à s'affronter à la question nationale dans la décadence, et non pas les combats d'arrière-garde de Lénine qui répugnait à apporter des éléments quant à 1' obsolescence du programme minimum soi-disant encore apte à jouer un rôle vital dans la révolution prolétarienne en Russie et dans les pays arriérés d'Europe de l'Est et d'Asie.
Est-il encore possible de lutter pour la "démocratie" ?
Quand, à la Conférence de Berne du Parti Bolchevik en 1915, Boukharine s'opposa au droit des nations à l'autodétermination en tant que tactique prolétarienne, Lénine fut le premier à insister sur le fait qu'on ne peut rejeter un seul aspect de la lutte du prolétariat pour la démocratie sans remettre en question cette lutte elle-même dans son ensemble : si la revendication de l'autodétermination était impossible à l'époque de l'impérialisme, pourquoi ne pas rejeter toutes les autres revendications démocratiques ?
Lénine posait le problème de la façon suivante : comment relier l'avènement de l'impérialisme à la lutte pour des reformes et pour la démocratie ? Pourtant, il dénonça la position de Boukharine qu’il qualifia d'"économisme impérialiste", c'est-à-dire un rejet de la nécessité de la lutte politique et, par conséquent, une capitulation devant l'impérialisme.
Mais Boukharine ne rejetait nullement la nécessité de la lutte politique, mais son identification à la lutte pour le programme minimum.
Boukharine et le groupe "Komminist" posaient le problème en termes de nécessité pour le prolétariat de rompre de façon décisive avec les méthodes du passe et d'adopter une nouvelle tactique et des mots d'ordre répondant à la nécessité de détruire le capitalisme par la révolution prolétarienne. Alors que les communistes avaient défendu fermement la lutte pour la démocratie, ils y étaient désormais opposés.
Comme l'exprima de façon plus complète Boukharine dans un développement ultérieur de cette position :
"... il est parfaitement clair, a priori, que les mots d'ordre et buts spécifiques du mouvement dépendent entièrement du caractère de l'époque dans laquelle le prolétariat en lutte doit agir. La période passée était celle d'un rassemblement des forces et d'une préparation pour la révolution. La période présente est celle de la révolution elle-même, et cette distinction fondamentale implique également des différences profondes dans les mots d'ordre et buts concrets du mouvement. Dans le passé, le prolétariat avait besoin de la démocratie parce qu'il n'était pas encore en mesure d'envisager l'établissement de sa propre dictature. La démocratie était précieuse pour autant qu'elle aidait le prolétariat à élever d'un pas sa conscience, mais le prolétariat était obligé de présenter ses revendications de classe dans une forme "démocratique"... Cependant, il n'est pas besoin de faire nécessité vertu... L'heure est venue d'un assaut direct de la forteresse capitaliste et de l'élimination des exploiteurs..."
(La théorie de la Dictature du Prolétariat, 1919)
Puisque l'époque de la démocratie bourgeoise progressiste était désormais révolue et que l'impérialisme était inhérent à la survie du capitalisme, les revendications anti-impérialistes maintenant intacts les rapports de production capitalistes étaient devenus utopiques et réactionnaires.
L'unique réponse à l'impérialisme ne pouvait être que la révolution prolétarienne :
"La social-démocratie ne doit pas avancer de revendications 'minimum' dans les conditions présentes de la politique internationale... Toute mise en avant de tâches 'partielles', de 'libération des nations' dans le cadre du système capitaliste, signifie un détournement des forces prolétariennes de la véritable solution du problème, et leur fusion avec les forces des groupes bourgeois nationaux correspondants.. . Le mot d'ordre d''autodétermination' des nations est avant tout utopique (il ne peut être réalisé dans les limites du capitalisme) et nuisible comme mot d'ordre qui sème des illusions. En ce sens, il ne diffère nullement des mots d'ordre sur les "cours d'arbitrage", sur le "désarmement", etc., qui présupposent la possibilité d'un soi-disant capitalisme pacifique",
(Thèses sur le droit à l'autodétermination, 1915)
Mais Boukharine allait plus loin dans son rejet du programme minimum à l'ère de l'impérialisme, en montrant la nécessité d'utiliser une tactique et des mots d'ordre exprimant la nécessité pour le prolétariat de détruire l'Etat capitaliste.
Alors que dans la période ascendante du capitalisme l'Etat avait assuré les conditions générales de l'exploitation par des capitalistes individuels, l'époque de l'impérialisme a donné naissance à un appareil d'Etat militariste exploitant directement le prolétariat avec le passage de la propriété individuelle du capital à la propriété collective à travers une unification des structures capitalistes (en trusts, syndicats, etc.), et la fusion de ces structures avec l'Etat. Cette tendance au capitalisme d'Etat s'étend de la sphère économique à toutes les sphères de la vie sociale :
"Toutes ces organisations ont tendance à fusionner entre elles, et à se transformer en une seule organisation des exploiteurs. Telle est l'étape la plus récente du développement, étape qui est devenue particulièrement évidente pendant la guerre... Ainsi surgit une organisation unique, absorbant toutes les autres : 1'Etat impérialiste pirate moderne, organisation omnipotente de la domination bourgeoise.. . et si seuls les Etats les plus avancés ont jusque là atteint cette étape, chaque jour, et en particulier chaque jour de guerre, tend à généraliser cet état de fait."
(L'Etat Pirate Impérialiste, 1915).
La seule force capable d'affronter cette unité des forces de toute la bourgeoisie ne pouvait être que 1 'action de masse du prolétariat. Dans ces conditions nouvelles, le mouvement révolutionnaire avait besoin, par dessus tout, de manifester son opposition à l'Etat, ce qui impliquait le rejet de tout soutien à quelque pays capitaliste que ce soit ([1] [14]).
Ce fut contre cette attaque impitoyable du programme minimum et contre le rejet de l'autodétermination exprimés par la majorité des Gauches d'Europe occidentale que Lénine écrivit ses Thèses sur la révolution socialiste et le droit des nations à l'autodétermination au début de 1916.
Dès le début, la nécessité d'éviter tout soutien objectif à la démocratie bourgeoise réactionnaire et à l'Etat démocratique le contraignit à adopter une position défensive. Il devait ainsi tomber d'accord avec Boukharine sur le fait que :
- "La domination du capital financier, comme celle du capital en général, ne saurait être éliminée par quelque transformation que ce soit dans le domaine de la démocratie politique; or, l'autodétermination se rapporte entièrement et exclusivement à ce domaine." (Thèse n°2, Oeuvres, T.22)
- "... toutes les revendications fondamentales de la démocratie politique, qui à l'époque de l'impérialisme, ne sont 'réalisables' qu'incomplètement, sous un aspect tronqué et à titre tout à fait exceptionnel (par exemple, la séparation de la Norvège d'avec la Suède, en 1905). " (Ibid. ) ([2] [15]) .
- La formation de nouvelles nations (Pologne, Inde, etc..) dans le futur, serait le produit de "quelque changement insignifiant" dans la politique et les rapports stratégiques entre les principales puissances impérialistes.
La position de Lénine était également basée sur la reconnaissance du fait que la nature de la nouvelle période exigeait une rupture avec les anciennes méthodes réformistes de lutte :
"... il est nécessaire de formuler toutes ces revendications et de les faire aboutir non pas en réformistes, mais en révolutionnaires ; non pas en restant dans le cadre de la légalité bourgeoise, mais en le brisant, en entraînant les masses à l'action, en élargissant et en attisant la lutte autour de chaque revendication démocratique fondamentale jusqu'à l'assaut direct du prolétariat contre la bourgeoisie, c'est-à-dire jusqu'à la révolution socialiste, qui exproprie la bourgeoisie." (Ibid.)
Le capitalisme et l'impérialisme ne pourraient être renversés qu'à travers une révolution économique. Néanmoins :
"Ce serait une erreur capitale de croire que la lutte pour la démocratie est susceptible de détourner le prolétariat de la révolution socialiste ou d'éclipser celle-ci, de 1'estomper, etc. Au contraire, de même qu'il est impossible de concevoir un socialisme victorieux qui ne réaliserait pas la démocratie intégrale, de même le prolétariat ne peut se préparer à la victoire sur la bourgeoisie s'il ne mène pas une lutte générale, systématique et révolutionnaire pour la démocratie." (Ibid.)
Telle était, dans les grandes lignes, toute l'argumentation de Lénine, mais, si l'on tient compte des arguments avancés contre lui à la même époque, deux questions étaient restées sans réponse :
- à l'époque de l'impérialisme, alors que la démocratie bourgeoise était devenue réactionnaire, quel était le contenu de cette lutte pour la démocratie ?
- comment le prolétariat pourrait-il, dans la pratique, éviter tout soutien à l'appareil militariste et impérialiste de l'Etat ?
Lénine était indéniablement au fait de ces problèmes, mais il ne pouvait pas les résoudre.
Il était d'accord avec le fait que l'impérialisme avait fait de la démocratie une illusion, mais, par ailleurs, il continuait d'encourager les « aspirations démocratiques » des masses; de ce fait, il existait un antagonisme entre l'impérialisme en tant que négation de la démocratie et la "lutte" des masses pour la démocratie. Ce qui était condensé dans la position de Lénine c'était la poursuite de la nécessité, pour la classe ouvrière, de lutter non pas pour détruire l'Etat capitaliste
- du moins, pas dans l'immédiat - mais au sein de celui-ci, d'utiliser ses institutions afin d'obtenir des réformes démocratiques :
"La solution marxiste au problème de la démocratie consiste en l'utilisation par le prolétariat de toutes les institutions démocratiques dans sa lutte de classe contre la bourgeoisie afin de se préparer à leur renversement et d'assurer sa propre victoire."
(Lénine, Réponse à Kiewsky (Y. Piatakov), 1916)
Avant la révolution de Février, Lénine défendait, en compagnie de Kautsky, l'idée suivant laquelle l'attitude marxiste envers l'Etat consistait à pousser le prolétariat à s'emparer du pouvoir d'Etat et à l'utiliser pour construire le socialisme.
Il critiquait la position de Boukharine comme non marxiste et semi- anarchiste, affirmant de nouveau que les socialistes étaient pour l'utilisation des institutions étatiques existantes.
Mais dans l'élaboration de sa propre réponse à Boukharine en 1916, il revint sur sa position et retourna aux écrits originaux de Marx sur la nécessité de détruire l'appareil d'Etat bourgeois, insistant sur la signification réelle de l'apparition des soviets en 1905 : en tant que forme spécifique de la dictature du prolétariat, alternative au pouvoir de l'Etat bourgeois. Sa réfutation de Boukharine fut remplacée par la brochure mieux connue sous le titre de L'Etat et la Révolution, qui appelle clairement à la destruction de l'Etat bourgeois.
Cependant, malgré cette clarification essentielle dans son attitude envers l'Etat, malgré sa lutte acharnée pour la réalisation du mot d'ordre "Tout le pouvoir aux soviets" en octobre 17, Lénine n'a jamais renoncé à sa conception théorique de la "révolution démocratique". Ainsi, par exemple, alors que dans ses Thèses d'Avril il concluait que, dans la mesure ou le pouvoir d'Etat était maintenant passé aux mains de la bourgeoisie, "la révolution démocratique bourgeoise en Russie est complète" , il incluait encore dans son programme la nécessité pour le prolétariat d'accomplir des tâches bourgeoises, démocratiques, y compris la défense de l'autodétermination, dans la lutte pour le pouvoir des soviets.
Suivant l'expression de Boukharine, sa position sur la question nationale restait "pro-étatique", encore largement influencée par les conditions auxquelles se trouvait confronté le prolétariat des pays capitalistes sous-développés, et fondée sur des conceptions obsolètes plus appropriées à la période ascendante du capitalisme qu'à la période de décadence impérialiste.
Les guerres nationales sont-elles encore progressistes ?
Puisque la période des guerres nationales correspondait à une période historique déterminée - en gros comprise entre 1789 et 1871 - la question qui était posée était de savoir, premièrement, si cette période était définitivement révolue avec l'éclatement de la guerre en 1914, et deuxièmement, étant donnée la nature incontestablement impérialiste et réactionnaire de cette guerre, si cette nature était devenue une caractéristique générale et irréversible des guerres dans la nouvelle période. De nouveau, alors que les Gauches européennes commençaient timidement à répondre par l'affirmative à ces deux questions, Lénine hésitait à admettre ces réponses, malgré un degré d'accord assez important.
Cette question dans son ensemble était évidemment essentielle pour la Gauche à Zimmerwald, qui dénonça, au milieu de la guerre impérialiste, les mensonges de la bourgeoisie sur la défense de la patrie et la nécessité de mourir pour son pays; si certaines guerres pouvaient encore être qualifiées de progressistes et révolutionnaires, alors les internationalistes pouvaient, dans ce cas particulier, appeler les ouvriers à défendre leur patrie.
Comme Boukharine l'avait mis en avant avec la guerre, cette question était devenue une frontière de classe :
" Le problème de tactique le plus important à notre époque est celui de la prétendue défense nationale. Cette question montre exactement où se trouve tracée la ligne de démarcation entre l'ensemble du monde bourgeois et l'ensemble du monde prolétarien. Ce mot lui-même contient une supercherie car il ne concerne pas réellement le pays en tant que tel, c'est-à-dire sa population, mais son organisation étatique."
(L'Etat Pirate Impérialiste).
Par conséquent : "La tâche de la social-démocratie à l'heure actuelle consiste à mener une propagande pour l'indifférence en ce qui concerne la 'patrie', la 'nation' etc., ce qui présuppose de poser la question non pas d'un point de vue 'pro-étatique'... (protestation contre une 'desintégration' de l'Etat) mais au contraire, d'un point de vue clairement révolutionnaire à l'égard du pouvoir d'Etat et du système capitaliste dans son ensemble,"
(Thèse 7, Thèses sur le droit à l'autodétermination, 1915T
Boukharine démontrait que si le mot d'ordre de l'autodétermination était concrètement appliqué (c'est-à-dire en garantissant l'indépendance et le droit à la sécession) dans les conditions de la guerre impérialiste, il ne deviendrait rien d'autre qu une variante du mot d'ordre de la "défense de la patrie", puisqu'il faudrait défendre concrètement les frontières du nouvel Etat indépendant dans l'arène impérialiste; sinon, que pouvait recouvrir en réalité une telle revendication ? Dans une telle situation, les forces internationalistes du prolétariat seraient éclatées et sa lutte de classe canalisée sur un terrain nationaliste :
" Il découle de là qu'en aucun cas et sous aucun prétexte nous ne soutiendrons le gouvernement d'une grande puissance qui réprime le soulèvement d'une nation opprimée; pas plus que nous ne mobiliserons les forces prolétariennes derrière le mot d'ordre du « droit des nations à l'autodétermination ». Dans une telle situation, notre tâche consiste à mobiliser les forces du prolétariat des deux nations (unies aux autres) derrière le mot d'ordre de la guerre civile, de la guerre de classe pour le socialisme, et à mener campagne contre la mobilisation derrière le mot d'ordre du 'droit des nations'...» (Thèse 8, Ibid. )
La Gauche Allemande, dont les fondements résident dans la théorie de Rosa Luxemburg, qui, dans la Brochure de Junius avait affirmé qu'aujourd'hui "la phrase nationale... ne sert plus qu'à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elle ne soit utilisée comme cri de guerre dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de leur faire jouer leur rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes", s'éleva elle aussi clairement contre l'idée des guerres nationales progressistes à l'époque de l'impérialisme :
"A l'époque de cet impérialisme déchaîné, il ne peut plus y avoir de guerres nationales. Les intérêts nationaux ne sont qu'une mystification qui a pour but de mettre les masses populaires laborieuses au service de leur ennemi mortel : 1'impérialisme. "
(Thèse 5, Thèses sur les taches de la social-démocratie internationale, complément à la Brochure de Junius, 1916).
Dans sa riposte vigoureuse, Lénine revint en arrière en faisant cette conclusion générale sur la nature de la nouvelle période :
- le caractère incontestablement impérialiste de la guerre mondiale n'impliquait pas que les guerres nationales n'étaient plus possibles. Au contraire, elles étaient à la fois inévitables et progressistes;
- alors que la défense de la patrie était réactionnaire pour ce qui concerne une guerre entre des puissances impérialistes rivales, dans une guerre nationale "authentique" les socialistes n'étaient pas opposés au fait d'appeler à la défense nationale.
Lénine ne pouvait pas concevoir que l'entrée du capitalisme dans sa phase impérialiste dictait la nature réactionnaire de toute guerre, insistant sur la nécessité d'une évaluation concrète de chaque guerre prise séparément; il refusa également de voir que la nature impérialiste évidente des pays avancés d'Europe et d'Amérique signifiait qu'un changement s'était opéré dans l'ensemble du système capitaliste, changement auquel même les1 pays arriérés d'Asie et d'Afrique ne pouvaient échapper. Dans les pays capitalistes avancés, la période des guerres nationales était révolue depuis longtemps, mais en Europe de l'Est et dans les pays semi-coloniaux et coloniaux les révolutions bourgeoises étaient encore à l'ordre du jour; dans ces pays, les luttes de libération nationales contre les plus grandes puissances impérialistes n'étaient pas encore lettre morte, et par conséquent, la défense de l'Etat national était encore progressiste. En outre, même en Europe, on ne pouvait considérer les guerres nationales des petites nations annexées ou opprimées par les grandes puissances comme impossibles (bien qu'il sous-entendait qu'elles étaient improbables).
Il citait l'exemple hypothétique de la Belgique annexée par l'Allemagne au cours de la guerre pour illustrer la nécessité pour les socialistes de soutenir même le "droit" de la bourgeoisie belge "opprimée" à l'autodétermination.
L'hésitation de Lénine à adhérer aux arguments, de loin les plus cohérents, de la Gauche Allemande, sur l'impossibilité des guerres nationales résultait principalement de son souci pratique de ne pas rejeter tout mouvement ou événement qui pourrait accélérer une crise dans le système capitaliste, crise que le prolétariat pourrait mettre à profit :
"La dialectique de l'histoire fait que les petites nations, impuissantes en tant que facteur indépendant dans la lutte contre l'impérialisme, jouent le rôle d'un des ferments,d'un des bacilles qui favorisent 1'entrée en scène de la force véritablement capable de lutter contre 1'impérialisme, à savoir : le prolétariat socialiste.
Nous serions de piètres révolutionnaires si, dans la grande guerre libératrice du prolétariat pour le socialisme, nous ne savions pas tirer profit de tout mouvement populaire dirigé contre tel ou tel fléau de l'impérialisme, afin d'aggraver et d'approfondir la crise."
(Bilan d'une discussion sur le droit des nations à |disposer d' elles-mêmes, chap.10. Oeuvres, T. 22 ).
Ce n'était pas le sort des mouvements nationalistes en eux-mêmes qui l'intéressait mais uniquement leur capacité à affaiblir l'emprise des grandes puissances impérialistes au milieu de la guerre mondiale; et par conséquent, il mettait le soulèvement irlandais de 1916 sur le même plan que les révoltes coloniales en Afrique et les mutineries dans les troupes coloniales en Inde, à Singapour etc. , comme autant de signes annonciateurs de l'approfondissement de la crise de l'impérialisme.
Prenons comme exemple concret celui du soulèvement nationaliste irlandais de 1916 pour illustrer certains dangers d'une telle approche. Pour Lénine, cette rébellion était la preuve de la validité de sa position suivant laquelle l'encouragement aux aspirations nationalistes des nations opprimées ne pouvait être qu'un facteur actif et positif dans la lutte contre l'impérialisme; et ceci contre la position de certains autres tels que Radek et Trotsky qui affirmaient qu'il s'agissait d'un putsch désespéré sans appui sérieux montrant, au contraire, que la période des luttes de libération nationale était terminée. Lénine ne soutenait pas qu'il existait un mouvement de masse prolétarien derrière cette rébellion, qui se présentait elle-même comme un "combat de rue menée par un secteur de la petite bourgeoisie urbaine et un secteur de la classe ouvrière" : le problème réel résidait dans la nature de classe de ces révoltes nationalistes ou, en d'autres termes : de tels mouvements participent-ils au renforcement de la "seule force anti-impérialiste, le prolétariat socialiste" (Lénine) ou de la bourgeoisie impérialiste ?
Lénine attribuait de façon dangereuse un potentiel anti-capitaliste à ces actions nationalistes, il disait que, malgré leurs lubies réactionnaires, "elles attaqueront objectivement le capital" (ibid.), et que le prolétariat devait seulement s'y associer et les diriger pour faire avancer le processus de la révolution sociale. Cependant, sans entrer dans toute l'histoire de la "question irlandaise", nous pouvons dire brièvement qu'elle contient des faits contredisant cette idée.
La révolte irlandaise de 1916 marqua du sceau du nationalisme la lutte de classe du prolétariat en Irlande - déjà affaibli par la défaite partielle de ses luttes d'avant-guerre - en mobilisant activement les ouvriers dans la lutte armée du nationalisme catholique de l'Irlande du sud. Malgré le manque de sympathie existant au sein des masses ouvrières pour ce putsch militaire désespéré, les campagnes massives de terreur de l'Etat britannique qui s'ensuivirent n'ont fait qu'achever la désorientation des ouvriers et que les conduire dans le giron des nationalistes réactionnaires; cela s'est traduit par un massacre et le sabotage systématique des dernières manifestations de la lutte autonome de la classe contre le capital, sabotage mené tant par les Anglais "noirs et jaunes" que par l'IRA républicaine. La défaite de cette fraction relativement faible et isolée du prolétariat mondial, défaite imposée par l'unification des forces de la bourgeoisie irlandaise et britannique, ne faisait que traduire un renforcement de l'impérialisme mondial dont l'intérêt majeur est toujours la défaite de son ennemi mortel. La rébellion irlandaise prouvait uniquement que toutes les fractions bourgeoises, y compris les nations soi-disant opprimées, se rangent du côté de l'impérialisme lorsqu'elles se trouvent confrontées à la menace de destruction du système d'exploitation, condition du maintien de leurs privilèges.
A condition d'être clairvoyants, les révolutionnaires, aujourd'hui, ne peuvent que conclure que l'histoire a donné tort à Lénine, et que les Gauches, malgré leurs confusions, avaient vu juste pour l'essentiel. La leçon qu'il s'agit de tirer de la révolte irlandaise réside dans la compréhension que tout soutien au nationalisme conduit directement à subordonner la lutte de classe aux guerres impérialistes de la période de décadence du capitalisme.
LENINE CONTRE LES "LENINISTES"
L'exhortation de Lénine au soutien à toute révolte nationaliste a été inévitablement utilisée par la bourgeoisie comme prétexte pour plonger les ouvriers et les paysans dans d'innombrables bains de sang derrière le drapeau du nationalisme et de 1'"anti-impérialisme". Cependant, une rivière de sang sépare encore les pires erreurs de Lénine des "meilleures" positions défendues par ceux qui prétendent être ses véritables héritiers : les bourreaux du prolétariat, qu'ils soient staliniens, trotskystes ou maoïstes.
Il est également nécessaire de sauver le véritable contenu critique des écrits de Lénine de certaines déformations comme celles du PCI (Programme Communiste) entre autres, qui, bien que celui-ci appartienne au milieu révolutionnaire, préfèrent également rester attachées à toutes les erreurs du passé, même lorsqu'elles mènent dangereusement à la défense des fractions capitalistes les plus réactionnaires sous couvert de "libération nationale" (cf. Revue Internationale n°32, pour une analyse plus développée des erreurs du PCI et de sa récente décomposition).
Lénine a toujours été conscient des dangers pour les révolutionnaires de soutenir le nationalisme; il insistait constamment sur la nécessité pour le prolétariat de préserver son unité et son autonomie face à toutes les forces bourgeoises même si cela devait rendre sa position encore plus inapplicable et contradictoire dans la pratique.
Et même lorsqu'il appelait les révolutionnaires à soutenir chaque révolte contre l'impérialisme, il ajoutait « à condition qu'il ne s'agisse pas de la révolte d'une classe réactionnaire. »
Ce que les Gauches, comme celle â laquelle appartenait R. Luxemburg, ont défendu de façon beaucoup plus cohérente, c'était le fait que les éléments nationalistes dans toutes les révoltes contre la répression sanglante des grandes puissances impérialistes étaient toujours introduits par la classe la plus réactionnaire - la bourgeoisie - pour endiguer la menace d'un réel soulèvement de la classe ouvrière; les révolutionnaires devaient établir une ligne de démarcation très claire entre le nationalisme et la lutte de classe, puisque seule celle-ci représente, dans la période de l'impérialisme, la voie progressiste pour l'humanité.
Au fil de ses écrits, Lénine modéra sa position afin d'éviter le danger toujours présent de subordonner la lutte de classe à la lutte nationale, que ce soit par la capitulation devant l'appareil d'Etat démocratique ou devant la bourgeoisie des nations "opprimées". L'attitude marxiste face à la question nationale devait toujours reconnaître la primauté de la lutte de classe :
"A l'opposé des démocrates petit -bourgeois, Marx voyait dans toutes les revendications démocratiques sans exception non pas un absolu, mais l'expression historique de la lutte des masses populaires, dirigées par la bourgeoisie, contre le régime féodal. Il n'est pas une seule de ces revendications qui, dans certaines circonstances, ne puisse servir et n'ait servi à la bourgeoisie à tromper les ouvriers. Il est radicalement faux, du point de vue théorique, de monter en épingle, à cet égard, l'une des revendications de la démocratie politique, à savoir le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, et de l'opposer à toutes les autres. Dans la pratique, le prolétariat ne peut conserver son indépendance qu'en subordonnant sa lutte pour toutes les revendications démocratiques, sans en excepter la république, à sa lutte révolutionnaire pour le renversement de la bourgeoisie."
(La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, Thèse 5, Oeuvres, T.22, avril 1916).
Par conséquent, Lénine devait rectifier concrètement sa position sur l'autodétermination afin de défendre la nécessité de l'unité internationale de la classe ouvrière et de résoudre cette préoccupation cruciale pour les révolutionnaires de sa division théorique du prolétariat en deux camps : celui des nations "opprimées" et celui des nations "qui oppriment". Ceci constituait pour Lénine, "la tâche la plus difficile et la plus importante".
Ainsi, alors que le prolétariat des pays "oppresseurs" devait revendiquer l'indépendance des colonies et des petites nations opprimées par leur "propre" impérialisme,
". . . les socialistes des nations opprimées doivent s'attacher à promouvoir et réaliser l'unité complète et absolue, y compris sur le plan de 1'organisation, des ouvriers de la nation opprimée avec ceux de la nation oppressive. Sans cela, il est impossible de sauvegarder une politique indépendante du prolétariat et sa solidarité dé classe avec le prolétariat des autres pays, devant les manoeuvres de toutes sortes, les trahisons et les tripotages de la bourgeoisie."
(Ibid., Thèse 4, souligné par nous).
Que de fois entendons-nous les "léninistes" d'aujourd'hui s'enthousiasmer pour les luttes de libération nationale en citant Lénine ! Lénine était bien explicite : en l'absence de l'unité de classe du prolétariat, y compris de ses expressions organisationnelles concrètes, la classe ouvrière était incapable de défendre son autonomie face à son ennemi de classe. La lutte de classe ne pouvait ainsi qu'être subordonnée à la lutte nationale, c'est-à-dire, en réalité, à la lutte de l'impérialisme pour une partie du marché mondial; dans cette lutte, les ouvriers ne pouvaient que servir de chair à canon à leur propre bourgeoisie, les mots d'ordre du Manifeste Communiste -"les prolétaires n'ont pas de patrie" prolétaires de tous les pays, unissez-vous!" - se retournant en leur contraire : "prolétaires des nations opprimées, défendez votre patrie !".
Dans la position de Lénine, c'est cet élément de réponse, au soutien à l'autodétermination que les gauchistes d'aujourd'hui ignorent ou dissimulent; c'est pourtant un élément central pour la défense de l'internationalisme prolétarien puisqu'il contient encore, malgré une certaine déformation, une vision des intérêts généraux de la classe ouvrière.
Ailleurs, dans ses écrits, Lénine rejette fermement toute approche abstraite et non critique " du soutien aux mouvements nationalistes :
"aucune revendication démocratique ne doit conduire à favoriser des abus; nous ne sommes pas tenus d'appuyer ni 'n'importe quelle' lutte pour l'indépendance ni 'n'importe quel mouvement républicain ou anti-clérical'".
(Bilan d'une discussion...)
Les intérêts généraux de la lutte de classe pouvaient être en contradiction avec le soutien à tel ou tel mouvement nationaliste :
"Il peut arriver que le mouvement républicain d'un pays ne soit que l'instrument d'intrigues cléricales, financières ou monarchiques d'autres pays : nous avons alors le devoir de ne pas soutenir ce mouvement concret donné."
(Ibid., chap.7, Oeuvres, T.22)
Et, suivant l'exemple de Marx qui refusait de soutenir le nationalisme tchèque au 19ème siècle, Lénine tirait cette conclusion : si la révolution prolétarienne éclatait dans un certain nombre de pays européens les plus importants, les révolutionnaires seraient favorables à une "guerre révolutionnaire" contre les autres nations capitalistes qui agiraient comme remparts de la réaction : c'est-à-dire favorables à l'écrasement de celles-ci, quelles que soient les luttes de libération nationale qui surgissent en leur sein.
Donc, pour Lénine, il était possible que des mouvements nationalistes agissent comme autant d'armes des puissances impérialistes contre la lutte de classe; pour Luxemburg et Boukharine, c'était un phénomène général et inévitable de la phase impérialiste du capitalisme. Bien qu'il n'ait pas l'avantage de la cohérence du point de départ théorique de ces derniers, Lénine était contraint par le poids des arguments du moins de s'orienter vers leur position. De façon significative, il était désormais contraint d'admettre que le mot d'ordre de l'indépendance de la Pologne était utopique et réactionnaire dans les conditions contemporaines, allant jusqu'à dire que "... même une révolution en Pologne même ne changerait rien et ne ferait que détourner l'attention des masses en Pologne de la tâche principale le lien entre leur lutte et celle du prolétariat de Russie et d'Allemagne." (Bilan de discussion) . Mais il se refusait encore à tirer une conclusion générale de cet exemple spécifique.
Quelques conclusions sur le débat dans la gauche de Zimmerwald
En plus de leur méthode fondamentale, il est une chose avec laquelle tous les membres de la Gauche de Zimmerwald étaient d'accord, une chose bien souvent ignorée dans les débats où l'on se paie de paroles quant à la possibilité de soutenir les mouvements nationaux : seule la lutte de la classe ouvrière est porteuse d'avenir pour les masses opprimées et pour l'humanité. Nulle part dans les affirmations les plus confuses de Lénine, il n'est sous-entendu que le capitalisme décadent m pourrait être détruit par un autre moyen que la violence de la révolution prolétarienne. Le souci qui animait Lénine, Boukharine, Luxemburg et les autres était de savoir si, et jusqu'où, les luttes nationales pouvaient contribuer à accélérer la crise finale du capitalisme et oeuvrer, ainsi, en faveur de la lutte révolutionnaire en participant à l'affaiblissement de tout l'édifice pourrissant de l'impérialisme.
Malgré son incontestable accord avec le cadre de base du débat, une importante partie du mouvement ouvrier pensait encore qu'une rupture complète avec la théorie et la pratique du passé sur cette question n'était pas déjà justifiée; Lénine pensait que les ouvriers n'avaient rien à perdre à soutenir les mouvements nationalistes parce que ceux-ci allaient tous dans le sens de la destruction du capitalisme.
Aujourd'hui, les innombrables massacres d'ouvriers par les fractions nationalistes nous fournissent suffisamment de preuves pour nous permettre d'apporter notre propre contribution à ce débat en concluant que la lutte de classe et le nationalisme sous toutes ses formes n'ont aucun point de convergence : celui-ci reste toujours une arme entre les mains de l'ennemi contre celle-là.
Les révolutionnaires qui, de façon hésitante, ont eu le courage d’affirmer que le moment était en effet venu de rompre clairement avec le passé, étaient à l'avant-garde des tentatives du prolétariat, pour comprendre le monde dans lequel il vivait et luttait. Leur contribution, et notamment la théorie de R. Luxemburg sur la question de l'impérialisme dans son ensemble et de la crise mortelle du capitalisme, est encore une pierre angulaire essentielle du travail des révolutionnaires dans la période de décadence.
Quant à la position de Lénine sur la question nationale, comme nous le savons tous, elle a été saccagée par la bourgeoisie pour justifier toutes sortes de guerres réactionnaires de "libération nationale". Ce n'est pas non plus par accident que la gauche du capital, en quête de références marxistes pour sa participation aux guerres impérialistes, choisit de régurgiter les écrits de Lénine, qui contiennent suffisamment de dangereuses faiblesses pour laisser la porte ouverte à ce qui est devenu aujourd'hui une des pierres angulaires de l'idéologie bourgeoise.
En vérité, on ne peut faire porter à Lénine la responsabilité de la façon dont la bourgeoisie a déformé sa pensée, dans le sillage de la défaite de la révolution prolétarienne pour laquelle il avait combattu avec acharnement. Contre les anarchistes et les libertaires, pour lesquels Lénine a toujours été un politicien bourgeois n'utilisant le marxisme que pour justifier sa propre lutte pour le pouvoir, nous pouvons insister sur la manière dont la contre-révolution bourgeoise a été contrainte de pervertir tout le cadre du débat auquel Lénine a participé, et de masquer ou de supprimer certains principes fondamentaux qu'il défendait, ceci afin de vider sa contribution de son contenu marxiste révolutionnaire.
Mais ceci dit, à la différence des bordiguistes, il n'est pas nécessaire que nous restions aveugles face aux erreurs du passé. Compte tenu des points que nous venons de mentionner, nous pouvons voir que de dangereuses faiblesses et ambiguïtés étaient présentes dans les écrits de Lénine dès le début, faiblesses qu'il nous faut rejeter définitivement aujourd'hui pour rester sur la défense des positions de classe.
Nous traiterons dans un article à venir des tragiques conséquences pratiques des incompréhensions des bolcheviks sur la question nationale après octobre 1917 à travers la politique de l'Etat soviétique.
S. FAY.
[1] [16] La position de Boukharine sur la nécessité de détruire le pouvoir d'Etat bourgeois et son insistance sur l'action de masse des ouvriers était, en partie assimilée par celui-ci, à partir des travaux de Pannekoek et de la Gauche Allemande avec lesquels le groupe Kommunist en exil avait collaboré pendant la guerre. Dans sa polémique avec Kautsky, dans la période d'avant-guerre, Pannekoek avait insisté sur le fait que :
"La bataille prolétarienne n'est pas seulement une bataille contrée la bourgeoisie pour le pouvoir d'Etat; elle est également une lutte CONTRE LE pouvoir DE L'ETAT" (L'action de masse et la révolution, 1911).
La réponse prolétarienne à la répression sanglante de l'Etat bourgeois était LA GREVE DE MASSE.
[2] [17] On pourrait insister sur le fait que la séparation de la Norvège de la Suède en 1905 était le SEUL exemple concret que Lénine pouvait mettre en avant comme support à sa politique sur l'autodétermination, raison pour laquelle il s'est gardé d'y faire allusion dans tous ses écrits sur ce sujet. Sans chercher trop loin, nous pouvons dire que cet exemple possède suffisamment de spécificités pour rendre fragiles les bases d'une théorie générale : cela s'est passé à l'aube de la décadence capitaliste, dans une région du monde excentrée par rapport aux plus grands pays situés au coeur du capitalisme, dans un pays ayant un prolétariat relativement faible. De plus, la bourgeoisie norvégienne a toujours bénéficié d'une certaine autonomie politique et son indépendance formelle a pu, par la suite, être achevée parce que la bourgeoisie suédoise était entièrement prête à L'accepter. C'est la raison pour laquelle elles ont organisé, d'abord, un référendum...
Courants politiques:
- Gauche Communiste [18]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Impérialisme [20]
Heritage de la Gauche Communiste:
La conception de l'organisation dans les gauches allemande et hollandaise
- 3531 lectures
Pour les groupes de discussion et les individus qui surgissent aujourd'hui sur des bases révolutionnaires, il est nécessaire que leur travail de clarification se fasse par une réappropriation des positions de la Gauche communiste,y compris celles de la Gauche allemande et de la Gauche hollandaise. Ces dernières, en particulier, ont défendu politiquement et théoriquement les premières, toute une série de positions de classe essentielles : rejet du syndicalisme et du parlementarisme, rejet de la conception substitutionniste du parti, dénonciation du frontisme, définition de tous les prétendus Etats socialistes comme capitalistes d'Etat.
Néanmoins, la réappropriation seulement sous un angle théorique des positions de classe ne suffit pas. Sans une conception claire de l'organisation révolutionnaire, tous ces groupes et individus sont condamnés au néant ... Il ne suffit pas de se proclamer révolutionnaire en paroles et de façon individuelle, il faut encore défendre -collectivement- les positions de classe dans un cadre organisé. La reconnaissance de la nécessité d'une organisation ayant une fonction indispensable dans la classe et fonctionnant comme un corps collectif, centralisé est la condition première de tout travail militant. Toute hésitation ou incompréhension sur la nécessité d'une organisation est sanctionnée terriblement par la désagrégation. Cela vaut en particulier pour les groupes "conseillistes" aujourd'hui.
Tirer les leçons de l'histoire de la Gauche allemande et de la Gauche hollandaise, c'est montrer la nécessité vitale d'une organisation pour que la théorie ne soit pas une pure spéculation mais une arme qui s'empare des masses prolétariennes dans la révolution future.
L'apport de la Gauche allemande - et principalement du KAPD - n'est pas d'avoir reconnu la nécessité du parti dans la révolution. Pour le KAPD, qui se formait en parti en 1920, cela allait de soi. Son apport fondamental est d'avoir compris que la fonction du parti n'était plus la même dans la période de décadence. Non plus parti de masse - organisant et rassemblant la classe -mais parti noyau rassemblant les combattants les plus actifs et les plus conscients du prolétariat. Partie sélectionnée de la classe, le parti intervient dans la lutte de classe et dans les organismes que la classe fait surgir : les conseils ouvriers et les comités de grève. Le parti est un parti combattant pour la révolution et non plus pour des réformes graduelles dans des organismes
où le prolétariat n'a plus rien à faire (syndicats) ou à dire (parlement) sinon d'oeuvrer à leur destruction. Enfin parce que le parti est une partie de la classe et non son représentant, ou son chef, il ne peut se substituer à elle dans sa lutte ou l'exercice du pouvoir. La dictature de la classe est celle des conseils et non celle du parti. Contrairement à la vision bordiguiste ce n'est pas le parti qui crée la classe mais la classe qui crée le parti. (1[1] [22]) Ce qui ne signifie pas - comme dans la vision populiste ou menchevik - que le parti est au service de la classe. Il n'est pas un serviteur qui passivement s'adapte à chaque hésitation ou errements de la classe. Au contraire, il doit "développer la conscience de classe du prolétariat même au prix d'une contradiction extérieure apparente avec les larges masses"([2] [23]).
Le KAPD en Allemagne et le KAPN de Gorter en Hollande n'avaient rien à voir avec la vision de Ruhle, dont se réclament aujourd'hui les "conseillistes". Ruhle et sa tendance à Dresde furent expulsés du KAPD à la fin de l'année 1920. Le KAPD n'avait rien à voir avec les tendances anarchisantes qui proclamaient que tout parti est par essence contre-révolutionnaire ; que la révolution n'est pas une question de parti mais d'éducation. Les conceptions du pédagogue Ruhle n'avaient rien à voir avec celles du KAPD. Pour ce dernier le parti n'est pas la volonté individuelle de chacun ; il est "une totalité élaborée programmatiquement, fondue en une volonté unitaire, organisée et disciplinée de la base au sommet. Il doit être la tête et l'arme de la révolution". (Thèses sur le rôle du parti). Le parti joue en effet un rôle décisif dans la révolution prolétarienne. Parce qu'il cristallise et concentre dans son programme et son action la volonté consciente de la classe, il est une arme indispensable de la classe. Parce que la révolution est fondamentalement politique, qu'elle implique un combat sans merci contre les tendances bourgeoises et les partis qui travaillent contre le prolétariat au sein de ses organismes, le parti est un instrument politique de lutte et de clarification. Cette conception n'a rien à voir avec toutes les visions substitutionnistes du parti. Le parti est sécrété par la classe et par conséquent est un facteur actif dans le développement de la conscience générale de la classe.
Néanmoins, avec la défaite de la révolution en Allemagne, la dégénérescence de la révolution en Russie, certaines faiblesses du KAPD vont paraître au grand jour.
LE VOLONTARISME ET LA DOUBLE ORGANISATION
Constitué au moment où la révolution reflue en Allemagne après la défaite de 1919, le KAPD se mit à défendre l'idée que l'on pouvait se substituer au déclin de l'esprit révolutionnaire dans le prolétariat par une tactique putschiste. Lors de l'action de Mars 1921 en Allemagne centrale, il poussa les ouvriers des usines Leuna (près de Halle) à l'insurrection contre leur volonté. Il manifestait là une profonde incompréhension de la fonction du parti qui contribua à sa désagrégation. Le KAPD gardait encore l'idée d'un parti "état-major" militaire" du prolétariat, alors que le parti est avant tout une avant-garde politique de l'ensemble de la classe ouvrière.
De même, confronté à la désagrégation des conseils ouvriers, prisonnier de son volontarisme, le KAPD s'entêta à défendre l'idée d'une double organisation permanente du prolétariat, ajoutant ainsi à la confusion entre organisme unitaire de classe surgissant dans la lutte et pour la lutte (assemblées, comités de grève, conseils ouvriers) et organisation de la minorité révolutionnaire intervenant dans ces organisations unitaires pour féconder leur action et leur réflexion. Ainsi, en laissant subsister et en poussant au maintien des unions - organisations d'usines nées dans la révolution allemande et se rattachant au parti - tout en étant à côté du parti, il se trouva lui-même incapable de déterminer ses tâches : soit devenir une ligue de propagande ([3] [24]) , un simple appendice politique, d'organisation d'usines aux fortes tendances économistes; soit devenir un parti de type léniniste ayant des courroies de transmission sur le terrain économique au sein de la classe. C'est-à-dire dans les deux cas ne plus savoir qui est qui et qui fait quoi ([4] [25]).
Que les conceptions erronées du KAPD aient largement contribué à sa disparition à la fin des années 20 est indubitable. C'est une leçon pour les révolutionnaires d'aujourd'hui qui, par démangeaison activiste et immédiatiste croient suppléer leur faible existence numérique par la création de"groupes ouvriers" artificiels liés au parti. Telle est par exemple la conception de Battaglia Comunista et de la C.W.O. La différence historique est cependant de taille : autant le KAPD se trouvait confronté à des organismes (unions) qui étaient des tentatives artificielles de maintenir en vie des conseils ouvriers qui venaient de disparaître, autant, la conception actuelle des organisations révolutionnaires aux penchants opportunistes reposent sur du bluff.
LA GENESE DU PARTI
Derrière les erreurs du KAPD sur le plan organisationnel, il y avait une difficulté à reconnaître, après l'échec de l'Action de Mars en 1921,1'arrêt momentané de la vague révolutionnaire et donc de tirer les conclusions pour son action dans une telle situation.
Le parti révolutionnaire en effet, comme organisation ayant une influence directe sur l'action et la réflexion des masses ouvrières, ne peut se constituer que dans un cours montant à la lutte de classe. Et en particulier, la défaite et le reflux de la révolution ne permet pas de maintenir en vie une organisation révolutionnaire assumant pleinement la fonction de parti. Si se prolonge un tel recul de la lutte ouvrière, si la voie se dégage pour une reprise en main de la situation par la bourgeoisie, alors soit le parti dégénère sous la pression de la contre-révolution montante et en son sein surgissent des fractions qui poursuivent l'activité théorique et politique du parti (cas de la Fraction Italienne) , soit le parti voit son influence et son assise militante se réduire et devient une organisation plus restreinte qui ne peut que se fixer pour tâche essentielle de préparer le cadre théorique et politique en vue de la prochaine vague révolutionnaire. Le KAPD ne comprenait pas qu'un arrêt de la montée révolutionnaire s'était produit. D'où la difficulté à faire le bilan de la période précédente et à s'adapter à la nouvelle période.
Ces difficultés ont donné jour à deux réponses fausses et incohérentes au sein de la gauche germano-hollandaise :
- proclamer de façon volontariste la naissance d'une nouvelle Internationale, tel est le cas de la KAI([5] [26]) de Gorter en 1922;
- de ne pas se constituer en fraction mais de s'autoproclamer le parti, au fil des scissions ; le terme "parti" devenant une simple étiquette pour chaque organisation scissionniste, réduite à quelques centaines de membres, quand ce n'est pas moins ([6] [27]).
Qui sait qu'il existe 4 "partis" en Italie se réclamant de la Gauche italienne. Cette mégalomanie de petits groupes se prenant pour le "Parti" ne contribue pas peu aujourd'hui à ridiculiser la notion de parti et à entraver le difficile regroupement des révolutionnaires, qui est la première condition subjective pour que surgisse demain un véritable parti mondial du prolétariat.
Toutes ces incompréhensions allaient être dramatiques. Dans la Gauche allemande allaient coexister trois courants, au fur et à mesure que le KAPD de Berlin s'affaiblissait :
- les uns se ralliaient aux thèses de Ruhle que toute organisation politique est mauvaise en soi ; tombant dans l'individualisme, ils disparurent de la scène politique ;
- d'autres - en particulier dans le KAPD de Berlin en lutte contre les tendances anarchisantes développées dans les Unions - avaient tendance à nier les conseils ouvriers pour ne plus voir que le parti. Ils développaient une vision "bordiguiste" avant la lettre ([7] [28]) ;
- les derniers, enfin, considéraient que l'organisation en parti était impossible. La KAU ([8] [29]), née de la fusion d'une scission du KAPD et des Unions (AAU et AAU-E), ne se considérait pas vraiment comme une organisation, mais comme une union lâche de tendances éparses, décentralisée. Le centralisme organisationnel du KAPD était abandonné.
C'est ce dernier courant, appuyé par le GIC hollandais ([9] [30]) né en 1927, qui allait triompher dans la Gauche hollandaise.
LA GAUCHE HOLLANDAISE : LE GIC, PANNEKOEK ET LE SPARTACUSBOND
Le traumatisme de la dégénérescence de la révolution russe et du parti bolchevik a laissé de lourdes séquelles. La Gauche hollandaise qui reprenait l'héritage théorique de la Gauche allemande,^ en a pas repris les apports positifs dans la question du parti et de l'organisation des révolutionnaires .
Elle rejetait la vision substitutionniste du parti Etat-major de la classe, pour ne plus voir que l'organisation générale de la classe : les conseils ouvriers. L'organisation révolutionnaire n'était plus considérée que comme une "ligue de propagande" des conseils ouvriers.
Le concept de parti était ou bien rejeté, ou bien vidé de son contenu. C'est ainsi que Pannekoek considérait tantôt que "un parti ne peut être qu'une organisation visant à diriger et à dominer le prolétariat" ([10] [31]), tantôt que "les partis - ou groupes de discussion, ou ligues de propagande, peu importe le nom par lequel on les désigne -ont un caractère tout à fait différent de cette organisation en partis politiques que nous avons connue dans le passé"([11] [32]).
D'une idée juste - que l'organisation et le parti changeaient de fonction dans la décadence - on aboutissait à des conclusions fausser. Non seulement on ne voyait plus ce qui différencie l'organisation d'un parti dans la période du capitalisme ascendant de celle d'un parti dans une période révolutionnaire, dans une période de pleine maturation de la conscience de classe, mais on abandonnait la vision marxiste de l'organisation politique comme facteur actif de la lutte de classe.
1. Les fonctions indissociables de l'organisation : théorie et praxis étaient séparées. Le GIC se concevait non corme un corps politique avec un programme, mais comme une somme de consciences individuelles et une somme d'activités séparées. Ainsi le GIC préconisait la formation de "groupes de travail" fédérés, par peur de voir naître une organisation unie par son programme et imposant des règles d'organisation : "Il est préférable que des ouvriers révolutionnaires travaillent à la prise de conscience en milliers de petits groupes plutôt que leur activité soit soumise dans une grande organisation aux tentatives de la dominer et diriger" (Canne-Mejer, Le devenir d'un nouveau mouvement ouvrier, 1935).
Plus grave était la définition de l'organisation comme "groupe d'opinion"qui laissait la porte ouverte à l'éclectisme théorique. Selon Pannekoek, le travail théorique visait à l'auto éducation personnelle, à "1'activité intensive de chaque cerveau". De chaque cerveau surgissait une pensée, un jugement personnel "et dans chacune de ces pensées diverses se trouvait en fait une parcelle de la vérité plus ou moins grande" (Pannekoek, Les Conseils Ouvriers). A la vision marxiste d'un travail collectif d'organisation, réel point de départ "d'une activité intensive de chaque cerveau" était substituée une vision idéaliste. Le point de départ était la conscience individuelle, comme dans la philosophie cartésienne, au point que Pannekoek affirmait que le but était non la clarification dans la classe mais "la connaissance par soi-même de la méthode pour distinguer ce qui est vrai et bon", (ibid.)
Si l'organisation n'était qu'un groupe de travail où se forgeait l'opinion de chacun, elle ne pouvait être qu'un "groupe de discussion" ou "un groupe d' études" se "donnant pour tâche 1'analyse des événements sociaux" (Canne-Mejer : Le devenir d'un nouveau mouvement ouvrier, 1935). La nécessité des "groupes de discussion" dont la fonction était la clarification politique et théorique a certes existé. Mais elle correspondait au stade primaire du développement du mouvement révolutionnaire au siècle dernier. Cette phase où pullulaient-les sectes et les groupes séparés était une phase transitoire. Le sectarisme et le fédéralisme qui existaient dans de tels groupes surgis de la classe, étaient des maladies infantiles. Ces maladies disparaissaient avec l'apparition d'organisations prolétariennes centralisées. Comme le notait Mattick en 1935, cette vision du GIC et de Pannekoek était une régression : "Une organisation fédéraliste ne peut pas se maintenir parce que dans la phase du capital monopoliste où se trouve le prolétariat, elle ne correspond finalement à rien...Elle constituerait un pas en arrière par rapport au vieux mouvement au lieu d'être un pas en avant". (Rate-Korrespondenz n° 10-11, Septembre 1935).
2. Dans les faits, le fonctionnement du GIC a été celui d'une fédération d'"unités indépendantes", incapables de jouer un rôle politique actif. Il vaut la peine de citer un article de Canne-Mejer de 1938 (Radencommunisme n° 3) :
"Le groupe des communistes internationaux n'avait pas de statuts, pas de cotisations obligatoires et ses réunions "internes" étaient ouvertes à tous les autres camarades des autres groupes. Il s'ensuit qu'on ne connut jamais le nombre exact de membres que comptait le groupe. Il n'y avait jamais de vote, cette opération n'étant pas nécessaire, car il ne s'agissait jamais de faire une politique de parti. On discutait un problème et quand il y avait une différence d'opinion importante, les divers points de vue étaient imprimés, sans plus. Une décision à la majorité était sans signification. C'était à la classe ouvrière de décider".
En quelque sorte, le GIC s'auto castrait de peur de violer la classe. Par peur de violer la conscience de chacun par des règles d'organisation ou de violer la classe en lui "imposant" une prise de position, le GIC se niait comme partie militante de la classe. En effet, sans moyens financiers réguliers, pas de possibilité de sortir une revue et des tracts en temps de guerre. Sans statuts, pas de règles permettant à l'organisation de fonctionner en toutes circonstances. Sans centralisation avec des organes exécutifs élus, pas de possibilité de maintenir une vie et une activité en toute période et particulièrement en période d'illégalité où le cloisonnement face au déchaînement de la répression impose la centralisation la plus stricte. Et en période de montée de la lutte de classe, comme aujourd'hui, pas de possibilité d'intervenir de façon centralisée et mondiale dans le prolétariat.
Ces errements du courant conseilliste, hier avec le GIC, aujourd'hui dans des groupes informels se réclamant du communisme des conseils reposent sur l'idée que l'organisation n'est pas un facteur actif, mais un facteur négatif dans la classe. En "laissant la classe ouvrière décider", on laisse entendre que l'organisation révolutionnaire est "au service de la classe" ; en quelque sorte une ronéo et non un groupe politique amené - parfois même dans la révolution- à travailler à contre-courant des idées et actions de la classe. L'organisation n'est pas un reflet de ce que "pensent les ouvriers"([12] [33]), elle est un corps collectif portant la vision historique du prolétariat mondial, qui n'est pas ce qu'il pense à tel ou tel moment mais ce qu'il est contraint de faire : la réalisation des buts communistes.
Il n'est donc point étonnant si le GIC disparut en 1940. Tout le travail théorique du GIC fut transmis par le Spartacusbond né d'une scission du parti de Sneevliet en 1942 (cf. article de la Revue Internationale n° 9, "Rupture avec le Spartacusbondy 1977). Malgré une vision plus saine de la fonction le Bond reconnaissait le rôle indispensable d'un parti dans la révolution comme facteur actif de la conscience - et du fonctionnement -le Bond avait des statuts et des organes centraux -, le Spartacusbond finit par être dominé par les anciennes idées du GIC sur l'organisation.
Aujourd'hui, le Spartacusbond est agonisant, et Daad en Gedachte -qui est sorti du Bond en 1965 -est un bulletin météorologique des grèves ouvrières. Aujourd'hui, la Gauche hollandaise agonise comme courant révolutionnaire. Ce n'est donc pas par elle que peut être transmis tout son héritage théorique aux éléments révolutionnaires qui surgissent dans la classe. La compréhension et le dépassement de cet héritage est l'oeuvre d'organisations révolutionnaires et non d'individus ou de groupes de discussion.
Les idées"conseillistes" sur l'organisation n'ont cependant pas disparu, comme on peut le constater dans différents pays. Faire un bilan critique de la conception de l'organisation dans la Gauche allemande et hollandaise, c'est prouver non la faillite des organisations révolutionnaires, mais au contraire leur rôle indispensable pour tirer les leçons du passé et se préparer aux combats de demain.
Sans théorie révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire, mais sans organisation révolutionnaire, il n'y a pas non plus de théorie révolutionnaire. Ne pas le comprendre, c'est emprunter la voie qui mène au néant pour toute organisation informelle, et pour les individus. C'est la voie qui mène à être désabusé sur la possibilité d'une révolution. (Cf. dans cette revue, le texte de Canne-Mejer).
CH.
[1] [34] "...il n'est même pas possible de parler de classe tant qu 'il n 'existe pas dans celle-ci une minorité tendant à s 'organiser en un parti politique ." (Bordiga : "Parti et classe").
[2] [35] "Thèses sur le rôle du parti dans la révolution prolétarienne", KAPD, 1920.
[3] [36] Comme l'affirmait Franz Pfemfert, l'ami de Ruhle, directeur de la revue "Die aktion", membre du KAPD.
[4] [37] Michaelis, ex-dirigeant du KAPD et membre de la KAU en 1931, déclarait : "Dans la pratique, l'union devint elle-même un second parti...le KAP regroupait même, plus tard, les mêmes éléments que l'union".
[5] [38] KAI : Internationale Communiste Ouvrière.
[6] [39] En 1925, en Allemagne il y avait 3 KAPD : un pour la tendance de Berlin et 2 pour la tendance d'Essen. Cette erreur, qui était une tragédie dans le camp prolétarien à l'époque, s'est répétée sous forme de farce en 1943 en Italie, avec la proclamation - en pleine contre-révolution - du Parti Communiste Internationaliste de Damen et Maffi.
[7] [40] Le même Michaelis avoue en 1931 : "Les choses allèrent même si loin que pour maints camarades, les conseils n'étaient considérés comme possibles que dans la mesure où ils acceptaient la ligne du KAP."
[8] [41] KAU : Union Communiste Ouvrière
[9] [42] GIC : Groupe des Communistes Internationaux.
[10] [43] Parti et classe ouvrière, 1936.
[11] [44] Les Conseils Ouvriers, 1946.
[12] [45] On peut lire dans le même n° cité de Radencommunisme : "Quand il y avait une grève sauvage, les grévistes faisaient souvent faire des tracts par les groupes ; ceux-ci les réalisaient même s'ils n'étaient pas absolument d'accord avec leur contenu" (souligné par nous).
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [18]
Heritage de la Gauche Communiste:
La faillite du conseillisme
- 2693 lectures
En complément de l'article "La conception de l'organisation dans Les Gauches allemande et hollandaise", dans ce numéro, nous publions ci-dessous des extraits d'un texte de CANNE-MEJER qui fut un des militants les plus actifs et un des théoriciens de ce courant politique, notamment dans le GIC dans les années 30. Ce texte écrit à la fin des années 50, intitulé LE SOCIALISME PERDU, illustre un des aboutissements des erreurs contenues dans la conception théorique et politique du "communisme de conseils" : la mise en question du marxisme et de la signification historique de la lutte prolétarienne; la croyance en la pérennité du capitalisme avec la capitulation à la pression de l'idéologie bourgeoise, dans ce cas celle de la période de reconstruction d'après-guerre sur la "société de consommation et de loisirs" qui fit fureur dans les années 60.
Nous faisons précéder ce texte de quelques commentaires introductifs de notre part
UN SOCIALISTE PERDU
A l'époque où le texte est écrit, les quelques rescapés de la Gauche communiste sont pour la plupart isolés et dispersés. La longue période de contre-révolution a épuisé les énergies. La deuxième guerre mondiale n’a pas fait surgir de mouvement révolutionnaire du prolétariat carme en 1917. Ce qui reste des Gauches communistes italienne et germano-hollandaise qui avaient résisté pendant près de 20 ans dans de petites minorités organisées est disloqué et extrêmement réduit ou se trouve dans une terrible confusion politique. Dans cette situation, les erreurs politiques qui n'ont pas été dépassées vont donner le jour à des aberrations grandissantes sur les bases mêmes de la théorie révolutionnaire, sur la compréhension de ce qu'est le marxisme.
Dans la Gauche italienne, le Parti communiste internationaliste se forme dans la confusion en Italie en pleine deuxième guerre mondiale avec le resurgissement des luttes ouvrières en 43.(1) Il rejette l'héritage de la Gauche communiste internationale qui est le seul groupe vraiment conséquent des années 30 (BILAN). Les critiques et les appels répétés de la Gauche communiste de France (INTERNATIONALISME) à reprendre à fond les questions politiques restent sans réponse. Un peu plus tard Bordiga, dans le Parti communiste international, scission du Parti communiste internationaliste va théoriser de plus en plus, par une fidélité dogmatique et bornée à la révolution russe et à Lénine, un monolithisme du marxisme.
Dans la Gauche germano-hollandaise, dont la dislocation et l'incapacité à tirer les leçons de la révolution russe dés les années 30 ont déjà accéléré la dégénérescence, Canne-Mejer va aboutir dans les années 50, à force de rejeter la révolution russe, à une remise en question complète du marxisme et de la lutte de classe.
Le processus qui mène à ces incompréhensions du marxisme n'est donc pas identique et n'a pas la même origine pour ces deux courants politiques. L'origine de l'échec des groupes qui se réclament de la Gauche italienne se trouve dans l'incapacité à assurer la continuité du travail d'élaboration théorique et politique effectué par la GCI avant la guerre D'une part la pression de la guerre et de l'après-guerre va faire céder le travail politique organisé sur les bases de cette continuité par la GCF qui se ra dissoute en 1953. D'autre part, les autres tendances de ce même courant vont, de concession politique en considération tactique, se maintenir en régressai sur les positions politiques et se fossiliser avec des conséquences dont on peut encore voir les résultats aujourd'hui avec la désagrégation du PCI (Programme Communiste) et les dérapages politiques du PCI (Battaglia Comunista) ([1] [48]). Par contre, l'échec de la Gauche germano-hollandaise trouve ses racines antérieurement. Dans les années 20 c'est dans les Gauches allemande et hollandaise qu'on trouve les tentatives de compréhension les plus avancées sur les apports fondamentaux de la nouvelle période ouverte avec la Guerre mondiale et la vague révolutionnaire : l'impossibilité du parlementarisme révolutionnaire ; la nature contre-révolutionnaire des syndicats ; le rejet des luttes de libération nationale; le rejet du parti de masses" et toute tentative de rapprochement et d'unification avec la social-démocratie et ses courants de "gauche" et la tactique dite de "front unique". -Mais dans les années 30, parce qu'il rejette le parti bolchevik et de plus en plus la nature de classe de la révolution d'octobre, l'héritier de cette Gauche, le courant des "communistes de conseil", va saper toute possibilité d'intégrer les nouvelles positions politiques dans une cohérence théorique et organisationnelle. Il se maintiendra sur un terrain de classe, mais sans pouvoir avancer réellement au-delà d'une répétition des positions sans élaboration.
En fait, seul BILAN est capable à cette époque, bien qu'il n'aille pas jusqu'au bout de cette élaboration, de reprendre les leçons de la révolution et de fournir des bases pour une compréhension actuelle de ces questions. BILAN peut apparaître peu clair sur la formulation théorique, de certaines positions et notamment sur le rapport parti/classe, mais, en s'attachant à l'histoire, il comprend la dynamique de la révolution et du reflux beaucoup plus clairement et ce que sont les taches des révolutionnaires qui en découlent. BILAN fournit ainsi un cadre plus global, plus cohérent, en continuité avec le mouvement ouvrier. Au contraire, on trouve dans les bases du "conseillisme" un rejet de ce cadre historique global. La non reconnaissance du parti bolchevik comme un parti du prolétariat empêche ce courant d'aborder une critique méthodique des positions politiques qui se sont exprimées dans la révolution russe. Au plan théorique, ce courant, d'une sous-estimation d'abord, aboutira ensuite à une négation de la fonction active et indispensable de l'organisation politique révolutionnaire dans la révolution prolétarienne. Ce qu'exprime en fait cette conception c'est une incompréhension du processus de prise de conscience de la classe elle même, contrairement à l'insistance constante mais finalement purement formelle de ce courant sur cette question.
C'est cette conception que développe le "communisme de conseils", et sur cette base, dans la période de reconstruction, au cours de laquelle il semble que le capitalisme a retrouvé un second souffle et que le prolétariat n'a plus les moyens et n'exprime plus les buts de sa lutte, Canne-Mejer, qui fut pourtant toute sa vie un militant dévoué à la cause du prolétariat, finira par divaguer sur les "loisirs" et "l'amélioration possible des conditions de vie sur la base de la collaboration de classe" !
Nous reviendrons de façon plus élaborée dans d'autres articles sur cette question de conception qui se pose toujours aujourd'hui.
Le danger n'est certes plus de prendre les feux de la reconstruction pour un nouveau regain du capitalisme, mais l'abandon du combat de classe, face aux difficultés de la période, existe. La sous-estimation des taches des révolutionnaires dans la lutte de la classe - comme partie prenante active et organisée, capable de fournir des orientations claires - l'irresponsabilité et le sectarisme qui règnent parmi les groupes qui se réclament de la révolution dans la mouvance "anti-léniniste" est tout aussi néfaste que la mégalomanie ridicule des groupes qui se réclament du "léninisme". Elle peut parfois l'être plus. La faillite de la conception du marxisme monolithique et du parti injectant la conscience à la classe apparaît évidente dans les échecs spectaculaires des avatars des diverses "tactiques" des groupes qui s'en réclament. La conception "conseilliste" est plus diffuse, mais dans une période où la bourgeoisie tente de profiter des hésitations de la classe ouvrière, et vise à son déboussolement et à son immobilisation, c'est une idéologie qui, dans sa logique, va dans le même sens, tout comme Canne-Mejer finit par entonner les chants de la bourgeoisie dans une autre période. Le texte que nous publions n'a que peu d'intérêt en lui-même, mais il révèle l'aboutissement d'une méthode et d'une conception profondément erronée de la lutte de classe qui mène, en rejetant le marxisme, à rejeter toute perspective de lutte de la classe ouvrière.
Il ne s'agit pas de reprendre du marxisme "tout" à la manière des bordiguistes, c'est-à-dire mot pour mot, à la lettre, mais de comprendre que le marxisme est un matérialisme historique, et si on relègue au rang de "vieillerie à la rigueur valable pour le siècle dernier" la dimension historique et politique du marxisme pour n'en garder que l'analyse des phénomènes, on quitte le terrain de la lutte de classe et de la révolution communiste pour se jeter dans les bras de la bourgeoisie.
Dans ce texte, Canne-Mejer ne voit dans la classe ouvrière qu'une catégorie économique de la société. Il n'aborde les taches du prolétariat que sur la question de la prise en mains des moyens de production et de consommation ; la lutte de classe est évoquée comme une simple "rébellion", rébellion liée non à une nécessité objective historique de l'impasse où les contradictions internes du mode de production capitaliste l'ont amenée : son entrée dans la décadence, ni aux conditions générales et au devenir de la classe, mais au seul "travail lui-même". Canne-Mejer a encore quelques souvenirs : il fait référence à la critique qu'ont toujours faite les marxistes selon laquelle il n'y a pas un "automatisme" de la lutte de classe seulement lié aux mécanismes du capitalisme ; mais il est nécessaire encore que se développe un des facteurs déterminants de cette lutte, la conscience de la classe de son action. Mais ce rappel devient chez Canne-Mejer une question de "psychologie sociale" ou d'"éthique", tout aussi mécanique, parallèle ou alternant avec la "rébellion". Rien n'est plus étranger au marxisme. Il n'est question nulle part chez Canne-Mejer de poser les vraies questions : quelles sont les taches politiques de la classe ouvrière ? Quels sont la nature et le rôle des communistes au sein de la classe ouvrière ? etc. La conception marxiste de la lutte de classe est réduite à la lutte pour des réformes dans les syndicats et les parlements du 19e siècle, sans référence à l'étude des conditions historiques dans lesquelles le marxisme a toujours situé ses luttes en indiquant toujours leurs limites par rapport au but général du combat de la classe, le communisme par la destruction de l'Etat capitaliste. Tout cet aspect est réduit à une vague notion de "lutte acharnée" hors de tout contexte historique des conditions matérielles de la révolution. Et puisque selon la vision "conseilliste", la révolution russe n’est pas ouvrière pour Canne-Mejer, cette "lutte acharnée" n'a donc pas eu lieu au 20ème siècle. Même les conseils ouvriers sont oubliés. Puisqu'il n'y a pas eu "lutte acharnée", Marx s'est trompé. Le massacre de générations de prolétaires dans la contre-révolution et dans les guerres est ignoré, et bien qu'on prétende "attirer l'attention sur deux phénomènes primordiaux de la vie économique durant ce siècle", l'économie de guerre est également ignorée.
LE SOCIALISME PERDU ESPERANCES DU MOUVEMENT MARXISTE D'AUTREFOIS
EXTRAITS D'UN TEXTE DE H.CANNE-MEYER
On rejoint la bourgeoisie dans l'étude de "l'augmentation des capitaux investis" et de "l'immense croissance de la productivité du travail". La classe ouvrière est assimilée aux syndicats et ses conditions de vie actuelle, ce sont principalement les "loisirs". Et c'est ce qui montre les "mécomptes de Marx" selon Canne-Mejer... Tel est le triste aboutissement du conseillisme.
MS.
CERTITUDE DE L'AVENEMENT DU COMMUNISME
Marx n'a jamais donné de description de la société communiste. Il ne faisait que montrer que la production, organisée sur la base de la propriété privée des moyens de produire, finirait par devenir un fardeau insupportable à la grande masse de la population, de sorte que celle-ci mettrait en commun ces moyens, et supprimerait l'exploitation due aux classes sociales. Dans l'esprit de Marx, décrire la société future c'était retomber dans l'Utopisme. Selon lui, une société nouvelle émerge du giron de la vieille sous l'action des forces réelles qui gouvernent le processus du travail social. Marx remarquait que la possession privée des moyens de production développait un processus de travail collectif en rassemblant des milliers et des milliers d'ouvriers. Ces ouvriers deviendraient les fossoyeurs de la possession privée des moyens de production. Car, pendant que croissent misère, oppression, esclavage, dégénérescence et exploitation, augmente également la rébellion de la classe ouvrière, unifiée et organisée par le processus de travail lui-même ([2] [49]).
"La centralisation des moyens de production et le caractère social atteignent un point où ils sont incompatibles avec 1'enveloppe capitaliste. Cette enveloppe éclate. La dernière heure de la propriété privée a sonné." ([3] [50]).Selon Marx, le mode de production capitaliste produit sa propre négation "avec l'inéluctabilité d'une loi de la nature". ([4] [51]).
Cette formulation de Marx, avec l'allusion à "1'inéluctabilité des lois de la nature" a causé beaucoup de malentendus. Souvent elle menait beaucoup de marxistes à une interprétation mécaniste du développement social. On croyait souvent à un écroulement automatique du système capitaliste, soit à cause des crises, soit à cause de l'abaissement du taux de profit, soit par manque de débouchés pour réaliser la plus-value. Lors d'un tel écroulement, la classe ouvrière pourrait, pour ainsi dire, prendre les moyens de production à son compte. Il suffirait plus ou moins à la classe ouvrière d'observer ce que Marx appelait "la décomposition - inévitable et de plus en plus visible -..."([5] [52]) du système. Les modifications, que subissent les capacités intellectuelles de la classe ouvrière pendant une lutte continue et qui la conduisent à pouvoir maîtriser politiquement et économiquement la vie sociale, apparaissent superflues.
Pourtant cette conception d'un écroulement définitif est en contradiction avec la méthode de penser de Marx... Pour lui, cette "inéluctabilité" n'est pas une nécessité extérieure à l'homme, une nécessité immanente qui s'exécute en dépit des hommes, au sens où, par exemple, certains penseurs bourgeois parlent souvent de développement immanent de l'esprit comme de la force motrice du monde. Pour Marx, il s'agit d'une inévitabilité imposée par les hommes eux-mêmes en conséquence de leur expérience de la vie sociale. Marx était persuadé crue les ouvriers devraient constamment s'opposer violemment aux tendances opprimantes du capitalisme, et que cette lutte se poursuivrait jusqu'à ce qu'ils aient vaincu le capitalisme. Ainsi, 1'"inéluctabilité" dont parlait Marx se trouvait découler de la nécessité naturelle de lutter contre le capitalisme.
LE MARXISME EN TANT QUE PSYCHOLOGIE SOCIALE
Donc Marx n'énonçait pas seulement une théorie qui mettait à jour les forces matérielles motrices du système capitaliste, mais, en plus, fournissait une théorie de la psychologie sociale qui prédisait le changement dans les pensées, la volonté, les sentiments et les actions des ouvriers. La pression de l'exploitation du capital concentré serait contrecarrée par la lutte organisée où se serait forgées la solidarité, la promptitude de chacun et de tous au sacrifice, formant ainsi une unité solide de pensée, de volonté, d'action. Le développement de l'individualité d'un ouvrier ne serait possible que comme partie d'un tout actif plus vaste, comme partie de son organisation de lutte. Les idées sur le bien et le mal dans la vie sociale seraient de nouveau remodelées par cette lutte et en accord avec les nécessités de cette lutte. Ces idées nouvelles que l'on peut appeler "valeurs éthiques", serviraient à leur tour de forces motrices pour commencer de nouvelles luttes. Chaque lutte se convertirait en valeurs éthiques et ces nouvelles valeurs éthiques pousseraient à de nouvelles luttes. La nouvelle éthique serait à la fois fille et mère de la lutte.
LA NAISSANCE DE LA NOUVELLE SOCIETE
Marx puisait sa certitude de l'avènement d'une société sans exploitation et sans classes dans sa certitude d'une lutte acharnée contre le capitalisme. Par cette lutte, la nouvelle société naîtrait du giron de la vieille. Cette lutte se ferait au moyen des syndicats qui amélioreraient les conditions de travail et au moyen des partis socialistes qui développeraient la conscience de classe. Pratiquement pour s'attaquer à ce développement il fallait s'attacher à lutter pour le perfectionnement du système parlementaire bourgeois (du suffrage universel) et pour des réformes sociales.
Ce n'est pas que Marx attendait de grands succès pratiques de la lutte parlementaire et syndicale. Pour lui, le mouvement des salaires n'était à prime abord fonction que de l'accumulation du capital. Dans une période de prospérité où la vie économique se développait, le besoin de main-d'oeuvre croissait et les syndicats pouvaient obtenir un salaire plus haut. Mais si les salaires montaient au point où la production cesserait d'être profitable l'accumulation devrait décroître, avec comme résultat chômage, "surpopulation", et baisse des salaires. Ainsi la base de profit s'élargirait à nouveau ([6] [53]).
"Donc l'augmentation du prix du travail ne reste pas seulement restreinte entre des limites qui ne touchent pas aux fondations du capitalisme, mais ces limites donnent également une certitude d'un élargissement à une plus grande échelle"([7] [54]).
Le sens de la lutte de classe se trouvait, pour Marx surtout dans le développement des caractéristiques intellectuelles qui mèneraient à la chute du capitalisme.
Marx pensait que les syndicats, par eux-mêmes, ne pourraient jamais vaincre le capitalisme aussi longtemps que la classe capitaliste disposerait de l'Etat. Le point cardinal de la lutte politique devait être recherché dans la conquête du pouvoir de l'Etat, soit par les voies parlementaires, (Marx les considérait comme possibles pour l'Angleterre et la Hollande), soit par des méthodes révolutionnaires. Après la Commune de Paris il fut convaincu que l'Etat ne devait pas être conquis mais brisé. En tout cas la tache du gouvernement révolutionnaire ne serait pas d' "établir" le communisme, par exemple en étatisant les moyens de production (quoique la nationalisation de quelques branches ne doive pas être exclue). Marx ne prescrivit pas ce que les révolutionnaires devaient faire en cas de révolution, mais il pensait que le développement devait être confié aux forces révolutionnaires à l'oeuvre dans la société, " quand une véritable révolution éclatera" - dit-il - "on verra également apparaître les conditions ( sans doute pas idylliques ) dans lesquelles elle réalisera ses mesures immédiates les plus urgentes".([8] [55])
Beaucoup de marxistes de cette époque soutenaient l'opinion que la tâche d'un gouvernement révolutionnaire consistait surtout à ne pas entraver les luttes des ouvriers contre les entrepreneurs, il était même de son devoir de les étayer. Les syndicats auraient ainsi les mains libres pour aménager la vie sociale selon leurs besoins, les capitalistes seraient dépossédés, non par le truchement des nationalisations, mais parce que les profits cesseraient d'être payés. Ainsi le capital perdrait toute valeur et pendant ce temps la gestion de la vie sociale tomberait entre les mains de l'association des producteurs libres et égaux. D'un côté la naissance de la nouvelle société au sein de l'ancienne se trouvait liée à l'épanouissement de la conscience politique qui devait mener au pouvoir politique, sous quelque forme que ce soit, de l'autre elle était reliée au processus de déploiement des forces s'opposant aux entrepreneurs, préparant ou bâtissant tout en même temps, les nouveaux organes de gestion sociale.
En illustration de ce qui précède nous pouvons citer un fait historique rapporté par le marxiste bien connu A. Pannekoek. En 1911, il y avait, en Allemagne, une grève et les grévistes tentaient d'empêcher les jaunes de travailler. La presse bourgeoise qualifiait cette action de "terrorisme". Les tribunaux intervinrent et tentèrent d'accuser quelques grévistes de séquestration. Selon les tribunaux, les grévistes avaient contraint les jaunes de les suivre devant le comité de grève, où ils étaient interrogés comme par un tribunal, puis, après quelques mises en garde, relâchés. Lors de leur interrogatoire par la "justice officielle", les jaunes déclarèrent, cependant, qu'il n'était pas question de séquestration; ils avaient suivi les grévistes de leur plein gré. Et le juge, très surpris, de dire : "Ainsi, vous admettez que cette organisation, qui vous est hostile, est une instance si compétente que vous n'osez pas vous soustraire à 1'ordre de les suivre que vous adressèrent les grévistes ?"
Pour Pannekoek, à cette époque, cette anecdote était un exemple de la manière dont les organisations ouvrières travailleraient ensuite comme organes indépendants opposés aux vieux organes de l'Etat. Il suffisait de briser le pouvoir de l'Etat pour permettre l'essor des organisations ouvrières autonomes.
LE MECOMPTE
Ce que Marx attendait du développement du capital, s'est, en général, réalisé. Mais ses prédictions, au sujet de la lutte de classes, sont, jusqu'à présent, apparues fausses. La concentration des capitaux et la centralisation de la vie économique (et politique) se sont effectuées. La classe des salariés devint prépondérante; des milliers d'ouvriers furent rassemblés dans des usines, des millions d'entre eux s'organisèrent en syndicats. Les crises économiques se succédèrent toujours, de plus en plus vite jusqu'en 1939, se montrant de plus en plus destructrices, la première, puis la seconde guerre mondiale, venues de la concurrence des capitaux, causaient le massacre de milliers d'ouvriers et épuisaient l'appareil de production européen. Mais si ces prédictions des vieux marxistes se réalisèrent, il n'en est pas de même de celle concernant l'appauvrissement de la classe laborieuse, au moins si on la considère sous l'angle de la consommation et de la garantie de subsistance. Quantité et diversité des biens de consommation se sont accrues au cours des années; les assurances sociales qui portent sur le chômage, les invalidités, les maladies, la vieillesse etc... sont devenues un appui non négligeable dans l'existence , la réduction du temps de travail, les vacances, la radio, le cinéma, la télévision et les possibilités de voyager assurent des loisirs certains auxquels les vieux marxistes n'avaient sûrement pas rêvé.
Pourtant cette augmentation du niveau de la vie matérielle et cette sécurité plus grande de subsister ne sont pas en soi responsables de l'anéantissement des perspectives ouvrières de société sans classes et sans exploitation. Cette responsabilité incombe plutôt à la façon dont cette amélioration a été obtenue. Si cette amélioration a-vait été conquise au cours des années par des luttes de masse des ouvriers face à une résistance acharnée des entrepreneurs, le processus de développement de nouveaux caractères psychiques, mentionné ci-dessus, serait entré en ligne de compte. La certitude du communisme, son inéluctabilité, se trouvait dans la nécessité d'une lutte permanente et acharnée pour réaliser le prix du travail au niveau de la valeur du travail, avec comme conséquence psychologique la volonté de réaliser le communisme. Les conceptions des ouvriers de la solidarité et d'une solide discipline de classe, l'expression de nouvelles valeurs sociales, d'une nouvelle conscience morale, tout cela est lié à une lutte active des ouvriers eux-mêmes, comme c'était réellement le cas au temps de Marx.
Ici se trouve l'erreur de Marx. Il a sous-estimé les conséquences de l'augmentation prodigieuse de la productivité, qui ouvrait un chemin plus facile à l'augmentation du niveau de vie. Surtout à partir de la première guerre mondiale, le caractère de la lutte de classe devait changer, la collaboration entre le capital et le travail par le truchement des parlements et des syndicats devenait possible sur la base de la productivité accrue du travail, et fournissait une issue à la situation sans que les masses mêmes soient obligées d'intervenir. La lutte acharnée des masses elles-mêmes n'a, jusqu'à présent, pas été absolument nécessaire et il s'ensuit que les prédictions de caractère psychologico-social n'ont pas été réalisées.
TRAVAIL MANUEL ET TRAVAIL INTELLECTUEL
Avant de terminer ce chapitre, nous voulons signaler que l'augmentation du niveau de vie n'est pas en contradiction avec la loi de la valeur de la force de travail formulée par Marx. A première vue cette augmentation, incarnée en radios, cinémas, télévisions, possibilités de voyages etc., semble en contradiction avec cette loi. Mais ce n'est qu'en apparence. Cette loi dit que la valeur du travail est déterminée par les frais de reproduction de la force de travail y compris la reproduction dans la nouvelle génération. Autrefois, ces frais se limitaient en frais d'une méchante habitation, de l'habillement et de la nourriture, le bistrot et l'Eglise assurant une détente suffisante. De nos jours, cette reproduction, exige beaucoup plus, et cela vient du changement de caractère du travail.
C'est la machine qui a modifié ce caractère. Tout le temps où l'on a travaillé avec des machines peu compliquées ou sans machines du tout, le travail avait surtout un caractère manuel, physique. C'étaient surtout les muscles qui comptaient, l'effort intellectuel ou nerveux jouant un rôle secondaire. Ainsi les frais de reproduction de la force de travail se limitaient au rétablissement des facultés physiques et à l'éducation corporelle des enfants. Avec l'extension généralisée du travail mécanisé, aux machines toujours plus compliquées, l'effort intellectuel, une attention constamment soutenue, amenaient une modification du caractère du travail (chauffeurs, chemins de fer, ateliers de confection, travail à la chaîne, emplois de bureaux,). Au lieu du travail musculaire apparaissait l'épuisement corporel et intellectuel. La régénération des facultés physiques cessait d'être suffisante. L'ensemble aboutissait à un raccourcissement du temps de travail et concurremment à une extension des moyens de distraction : cinéma, radio, vacances etc.. Autrement dit : l'épuisement corporel et mental avait pour résultat une augmentation du coût de la valeur du travail qui s'exprimait par une augmentation des frais de reproduction de celle-ci. L’élévation du niveau de vie, loin d'être en désaccord avec la loi de la valeur de la force de travail, en est au contraire une confirmation.
Mais il est sûr que, de nos jours, la classe ouvrière n'a pas réussi à réaliser la nouvelle valeur de sa force de travail malgré le soi-disant pouvoir des syndicats et des partis socialistes parlementaires. Du point de vue du rythme de la vie économique, on doit constater une régression qui ne s'exprime pas en biens de consommation mais en nervosité générale et en maladies nerveuses. Ce n'est pas là ce que Marx attendait.
[1] [56] Voir en particulier les articles consacrés aux premières années des PCI (Internationaliste et International) dans les numéros 32 et 36 de la REVUE INTERNATIONALE.
[2] [57] Voir le Capital 1 chap.24
[3] [58] Voir note 1.
[4] [59] Idem.
[5] [60] Marx, lettre à Domela Neuwenhuis 22-2-1880. p. 317. éd. Institut Marx-Engels-Lénine.
[6] [61] "Le Capital" 1 chap.23 n°1.
[7] [62] "Le Capital" 1 chap.23 n°2.
[8] [63] Voir note 4.
Conscience et organisation:
Débat : à propos de la critique de la théorie du "maillon le plus faible"
- 3121 lectures
A la suite de la défaite et de la répression subies par la classe ouvrière en Pologne, en décembre 81, une discussion s'est engagée dans le CCI en vue de tirer un maximum d'enseignements de cette expérience. Les principales questions étaient :
- Pourquoi et comment la bourgeoisie mondiale a-t-elle réussi à isoler les ouvriers en Pologne de leurs frères de classe des autres pays ?
- Pourquoi leur lutte n'a-t-elle pas donné le signal d'un développement des combats dans le reste du monde ?
- Pourquoi, en Pologne même, les travailleurs qui avaient, en août 80, fait preuve d'une telle combativité, d'une telle capacité d'auto organisation, qui avaient utilisé avec autant d'intelligence l'arme de la grève de masse contre la bourgeoisie, ont-ils par la suite été piégés aussi facilement par le syndicat "Solidarnosc" qui les a livrés pieds et poings liés à la répression ?
- Quelle est, pour le prolétariat mondial, l'ampleur réelle de la défaite subie en Pologne? S'agit-il d'une défaite partielle, de portée relativement limitée, ou d'une défaite décisive qui signifie que la bourgeoisie a d'ores et déjà les mains libres pour donner sa propre réponse à 1'aggravation inexorable de la crise économique : la guerre impérialiste généralisée ?
A ces questions, la Revue Internationale du CCI (n°29, 2ème trimestre 82) apportait une réponse dans l'article "Après la répression en Pologne : perspectives des luttes de classe mondiales". Cependant, la réflexion du CCI ne s'était pas arrêtée aux éléments contenus dans ce texte. Elle l'a conduit à préciser sa critique de la thèse, ébauchée par Lénine et développée par ses épigones, suivant laquelle la révolution communiste débuterait, non dans les grands bastions du monde bourgeois, mais dans des pays moins développés : la "chaîne capitaliste" devait se briser à son "maillon le plus faible". Cette démarche a abouti à la publication dans la Revue Internationale n°31 (4ème trimestre 82) d'un texte dont le titre résume bien la thèse qui y est défendue : "Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe, critique de la théorie du maillon le plus faible'".
Elle a conduit également en juillet 83 à l'adoption par le 5ème congrès du CCI d'une résolution sur la situation internationale qui précise que :
"L'autre enseignement majeur de ces combats (en Pologne 80-81) et de leur défaite est que cette généralisation mondiale des luttes ne pourra partir que des pays qui constituent le coeur économique du capitalisme : les pays avancés d'Occident et parmi eux, ceux où la classe ouvrière a acquis 1'expérience la plus ancienne et la plus complète :1'Europe occidentale..,
Si 1'acte décisif de la révolution se jouera lorsque la classe ouvrière aura terrassé les deux monstres militaires de l'Est et de l'Ouest, son premier acte se jouera nécessairement au coeur historique du capitalisme et du prolétariat L'Europe occidentale." (Revue Internationale n°35, page. 21).
L'ensemble du CCI s'est trouvé d'accord sur la nécessité de critiquer la thèse du "maillon le plus faible" dont l'Internationale Communiste dégénérescente a fait un dogme et qui a servi à justifier les pires aberrations bourgeoises, notamment celle du "socialisme dans un seul pays".
Cependant, une minorité de camarades a rejeté l'idée que "le prolétariat d'Europe occidentale serait au centre de la généralisation mondiale de la lutte de classe", que "l'épicentre du séisme révolutionnaire à venir se trouve placé" dans cette région du monde.
"Dans la mesure où les débats qui traversent 1'organisation concernent en général 1'ensemble du prolétariat, il convient que celle-ci les porte à l'extérieur". (Revue Internationale n°33, "Rapport sur la structure et le fonctionnement de l'organisation des révolutionnaires").
Nous publions donc ci-dessous- un texte de discussion émanant d'un camarade de la minorité et qui synthétise d'une certaine façon les désaccords apparus au cours des débats sur cette question précise.
Dans la mesure où ce texte se réfère à une "Résolution sur la critique de la théorie du maillon faible", adoptée en janvier 83 par l'organe central du CCI, nous avons estimé utile de faire précéder ce texte par celle-ci bien qu'elle n'ait pas été écrite aux fins de publication à l'extérieur mais de prise de position dans le débat interne. C'est pour cela que la langue en est difficile à comprendre pour le lecteur non familiarisé avec nos analyses et que nous incitons à lire au préalable les textes de la Revue Internationale n°29 et 31 déjà cités.
Enfin, outre la résolution et le texte de discussion, nous publions la réponse du CCI aux arguments donnés dans celui-ci.
RESOLUTION DU CCI
1) Le CCI réaffirme l'unité des conditions de la révolution prolétarienne au niveau mondial. L'unification du monde capitaliste dans la période de décadence implique que c'est le monde entier, quel que soit le degré de développement des pays qui le compose, qui est mûr pour la révolution communiste, dont les conditions sont données depuis 1914 mondialement. Il rejette la théorie bordiguiste des révolutions bourgeoises dans certaines aires géographiques du tiers-monde, comme étape première de la révolution prolétarienne. Celle-ci n'est pas seulement nécessaire mais possible pour chaque secteur du prolétariat mondial pour lequel elle constitue la seule perspective à la crise générale du système.
2) De même que l'unité des conditions de la révolution n'est pas la somme de conditions nationales particulières, de même le prolétariat mondial n'est pas la somme de ses parties.
La conception marxiste de la révolution n'est pas une conception matérialiste vulgaire. La révolution est un processus dynamique, et non statique, dont la marche est le dépassement des conditions géo historiques particulières. C'est pourquoi le CCI rejette aussi bien la théorie du "maillon le plus faible du capitalisme" que celle de la "Révolution ouest-européenne".
La première, élaborée par l'Internationale Communiste lors de son déclin, affirmait implicitement que le prolétariat des pays arriérés pourrait jouer un rôle plus révolutionnaire que celui des pays développés (absence d'"aristocratie ouvrière" ; inexistence du poison de la "démocratie"; faiblesse de la bourgeoisie nationale).
La seconde, développée dans la "Réponse à Lénine" de Gorter, soutenait que seuls les prolétaires d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord seraient en mesure de réaliser la révolution mondiale, réduite dans les faits à l'ouest européen, étant données des conditions objectives plus favorables (fortes concentrations ouvrières, tradition de lutte). L'erreur symétrique de ces deux conceptions trouve son origine aussi bien dans les conditions de l'époque (la révolution naît en 17 de la guerre, à la périphérie de l'Europe industrielle, dans un monde capitaliste encore divisé en une constellation d'impérialismes et de capitaux privés) que dans la confusion entre champ d'extension et dynamique de la révolution. En cherchant à déterminer les conditions objectives les plus favorables à l'éclatement de la révolution, les révolutionnaires de l'époque eurent tendance à confondre point de départ et point d'arrivée de tout le processus dynamique d'extension de la révolution. Bien que ces deux théories ne fussent pas des conceptions bourgeoises et expriment la vie du mouvement révolutionnaire de l'époque à la recherche d'une cohérence, elles ont mené aux pires aberrations : la théorie des "maillons faibles" aboutissant au tiers-mondisme ; celle de la "révolution ouest-européenne"à un néo-menchevisme.
3) La grève de masse d'août 80 limitée à la Pologne ne remet pas en cause le schéma classique de la généralisation internationale de la lutte de classe, comme bond qualitatif nécessaire à l'ouverture d'un cours révolutionnaire.
La Pologne a reposé avec acuité la question des conditions objectives les plus favorables au développement de la dynamique internationale de la grève de masse :
- à la différence de 1917-18, la bourgeoisie est beaucoup mieux préparée et plus unie internationalement pour étouffer toute menace de généralisation par-delà les frontières d'un pays ;
- un processus révolutionnaire ne peut naître dans un seul pays en l'absence d'une dynamique brisant le cadre national dans lequel la grève de masse ne peut être qu'étouffée.
4) Déterminer le point de départ de cette dynamique, et donc les conditions optimales de la naissance du séisme révolutionnaire, n'est pas nier l'unité du prolétariat mondial. Elle est le processus même par lequel l'unité potentielle devient unité réelle.
Cependant, unité n'est pas identité des parties qui restent soumises à des conditions matérielles différentes. Il n'y a pas d'égalité naturelle entre les divers organes et le coeur ou le cerveau d'un corps vivant, qui remplissent les fonctions vitales complémentaires.
Comme lors de la première vague révolutionnaire, le prolétariat des pays développés se trouve au coeur même du processus d'internationalisation de la grève de masse. Il est le noyau même de la prise de conscience mondiale par le prolétariat de ses taches révolutionnaires.
5) Le CCI rejette la conception naïvement égalitariste suivant laquelle n'importe quel pays pourrait être le point de départ de la dynamique révolutionnaire. Cette conception repose sur la croyance anarchiste que tous les pays - à l'exemple de la grève générale révolutionnaire - pourraient simultanément initier un processus révolutionnaire.
En réalité, le développement inégal du capitalisme, en creusant un fossé toujours plus grand entre grands pays industrialisés concentrant la majorité du prolétariat d'industrie moderne et pays du tiers- monde, a pour conséquence que les conditions les plus favorables à la naissance du bouleversement, révolutionnaire sont étroitement déterminées par le cadre historique et social.
6) Le point de départ de la révolution mondiale se trouve nécessairement en Europe occidentale, où à la force du nombre, s'ajoute celle de la tradition et de l'expérience révolutionnaire du prolétariat de 1848 à la première vague révolutionnaire, où la classe ouvrière a affronté le plus directement la contre-révolution, où se trouve le champ de batail le ultime de la guerre impérialiste généralisée entre Etats capitalistes. Parce que l'Europe occidentale est :
- la première puissance économique et concentration ouvrière, où l'existence de plusieurs nations contiguës pose plus immédiatement la question du dépassement des frontières nationales ;
- au coeur même des contradictions du capitalisme en crise qui le pousse vers la guerre mondiale ;
- le noeud gordien des mystifications bourgeoises les plus puissantes (démocratiques, parlementaires et syndicales) que le prolétariat devra trancher pour faire le saut libérateur de l'ensemble du prolétariat mondial ;
- elle est au coeur même du cours vers la révolution.
La fin de la période de contre-révolution marquée par la grève de mai 68, la maturation de la conscience prolétarienne en Europe dans les années 70, l’existence d'un milieu politique prolétarien plus développé dans cette partie du monde que partout ailleurs, tous ces facteurs n'ont fait que le confirmer.
7) Ni les pays du tiers-monde, ni les pays de l'Est, ni l'Amérique du Nord, ni le Japon, ne peu vent être le point de départ du processus menant à la révolution :
- les pays du tiers-monde en raison de la faiblesse numérique du prolétariat et du poids des illusions nationalistes ;
- le Japon, et les USA surtout, pour n'avoir pas affronté aussi directement la contre-révolution et avoir subi moins directement la guerre mondiale, et en l'absence d'une profonde tradition révolutionnaire ;
- les pays de l'Est, en raison de leur arriération économique relative, de la forme spécifique (pénurie) qu'y prend la crise mondiale entravant une prise de conscience globale et directe des causes de celle-ci (surproduction), de la contre-révolution stalinienne qui a transformé dans la tête des ouvriers l'idéal du socialisme en son contraire et a permis un nouvel impact des mystifications démocratiques, syndicalistes et nationalistes.
8) Cependant, si le point de départ de la révolution mondiale se trouve nécessairement en Europe de l'Ouest, le triomphe de la révolution mondiale dépend en dernière instance de son extension victorieuse rapide aux USA et en URSS, têtes des deux blocs impérialistes où se jouera le dernier grand acte de la révolution.
Pendant la première vague révolutionnaire, les pays où se trouvait le prolétariat le plus avancé et le plus concentré, étaient en même temps les pays capitalistes militairement les plus puissants et les plus décisifs, c'est-à-dire les pays d'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, bien que ce soit encore en Europe de l'Ouest que se trouvent les bataillons les plus avancés et concentrés du prolétariat, les centres de la puissance militaire du capital mondial se sont déplacés vers les USA et l'URSS, ce qui a des conséquences pour le développement d'un mouvement prolétarien révolutionnaire.
Aujourd'hui, une nouvelle Sainte Alliance anti ouvrière du capital russe et américain par dessus leurs rivalités impérialistes, imposera une intervention militaire directe contre l'Europe révolutionnaire, c'est-à-dire une mondialisation de la guerre civile dont l'issue dépendra de l'aptitude du prolétariat des deux têtes de bloc, et notamment des USA, à paralyser et renverser l'Etat bourgeois.
9) Le CCI met en garde contre un certain nombre de confusions dangereuses :
- l'idée que "tout est possible à tout moment, en tout lieu", dès que surgissent à la périphérie du capitalisme des affrontements de classe aigus, laquelle idée repose sur l'identification entre combativité et maturation de la conscience de classe.
- l'assimilation inconsciente entre grève de masse internationale et révolution, alors que la généralisation internationale de la grève de masse est un pas qualitatif qui annonce la révolution -naissance d'une situation pré-révolutionnaire -mais ne peut être confondue avec elle. Celle-ci se traduit nécessairement par la dualité des pouvoirs qui pose l'alternative : dictature des conseils ouvriers ou contre-révolution sanglante, ouvrant un cours vers la guerre.
- la conception d'un développement linéaire de l'internationalisation de la grève de masse, alors que celle-ci suit nécessairement un cours sinueux, avec des avancées et des reculs, à l'exemple de la Pologne.
Il appartient aux révolutionnaires de garder la tête froide et de ne pas céder à l'exaltation immédiatiste qui mène à l'aventurisme, ou aux "coups de cafard", à chaque recul, qui se traduisent par la démoralisation.
Si l'histoire s'accélère depuis août 80 et donne une perspective exaltante pour les révolutionnaires, il appartient de comprendre que notre travail est et reste à long terme.
CRITIQUE DE QUELQUES POSITIONS DU CCI. SUR LA THEORIE DES MAILLONS FAIBLES"
Ces deux dernières années ont mis à l'épreuve les capacités des minorités révolutionnaires. L'approfondissement soudain de la crise dans le monde entier, la brutalité des mesures d'austérité que la bourgeoisie a prises, les préparatifs de guerre massifs et évidents, tout cela semblait exiger une réponse foudroyante du prolétariat mondial. Et pourtant, la classe ouvrière a subi une importante défaite en Pologne cependant que partout ailleurs la lutte stagnait. Les organisations révolutionnaires sont restées minuscules et sans écho significatif. Cette situation a mis â nu les nombreuses faiblesses qui existaient dans le milieu révolutionnaire. La confusion est considérable et compréhensible. Les révolutionnaires ne peuvent plus se limiter à la réaffirmation des leçons du passé. Ils doivent évaluer et expliquer la défaite en Pologne et les difficultés présentes. Ils doivent clarifier les perspectives de la lutte ouvrière, expliquer comment parvenir à une étape supérieure.
Dans ce contexte, le CCI a formulé sa critique de la "théorie du maillon le plus faible" (Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe, Revue Internationale n° 31 ; Résolution sur la critique de la "théorie du maillon faible"). Ces textes rejettent à juste titre la position de Lénine qui considère que le renversement du capitalisme démarrera dans les pays les plus faibles et, à partir de là, s'étendra vers le reste du système. Cette théorie a été un instrument pour ceux qui cherchent le fossoyeur du capitalisme en dehors du prolétariat. Le problème, avec les"léninistes" qui défendent cette position aujourd'hui, n'est pas qu'ils ont des illusions sur la force des ouvriers dans les pays faibles , mais qu'ils ont des illusions sur ces pays faibles eux-mêmes. Pour eux, le prolétariat n'est que de la chair à canon du "mouvement anti-impérialiste".
Mais les textes du CCI vent plus loin que le rejet de cette théorie désastreuse. Ils expliquent la défaite en Pologne par ce fait même que la Pologne est un pays et un Etat faibles. Ils affirment également que "ce n'est donc qu'en Europe occidentale ... qu'il (le prolétariat) pourra développer pleinement sa conscience politique indispensable à sa lutte pour la révolution" (Revue Internationale n° 31, p.9). Ici, la bourgeoisie ne pourrait pas isoler une grève de masse parce que "la mise en place d'un cordon sanitaire économique deviendra impossible" et "qu'un cordon sanitaire politique n'aura plus d'effets" (ibid.).
Cette vision offre certainement les moyens de digérer la défaite en Pologne et de voir plus clairement cannent avancer. Mais en mené temps :
- elle obscurcit certaines leçons de la Pologne et d'autres luttes qui ont pris place et qui vont se produire en dehors de l'Europe occidentale. Elle voit leurs implications comme nécessairement limitées du fait qu'elles se passent - aux yeux du CCI - en dehors de la zone géographique où les mystifications capitalistes les plus importantes peuvent être dépassées ;
- elle créé la fausse impression que la capacité de la bourgeoisie d'isoler une grève de masse dépendrait du lieu où elle se déroule, de sorte qu'elle ne s'y heurterait pas aux mêmes problèmes qu'en Pologne ou qu'elle pourrait les vaincre plus facilement ;
- elle donne le faux espoir que la conscience révolutionnaire peut se développer pleinement dans la seule Europe occidentale et faire tomber ensuite, par la force de l'exemple, les mystifications capitalistes dans les autres zones industrialisées.
"Ce n'est qu'au moment où le prolétariat de ces pays aura déjoué les pièges les plus sophistiqués tendus par la bourgeoisie (...) qu'aura sonné l'heure de la généralisation mondiale des luttes prolétariennes,1'heure des affrontements révolutionnaires", (ibid., p. 10) .
FORCES DE CLASSE ET CONSCIENCE DE CLASSE.
La lutte prolétarienne se développe à partir de la nécessité et non à partir de la conscience. Les mystifications ne peuvent être dépassées que par la lutte et dans la lutte. C'est la potentialité de croissance de la lutte qui permet à la classe de briser les mystifications capitalistes, plutôt que l'inverse. Les luttes se développent en dépit du poids de nombreuses illusions, qui ont toutes corme dénominateur commun la croyance en la possibilité d'obtenir une amélioration des conditions de vie, une victoire, dans le cadre du capitalisme. Ce cadre a beaucoup de nems et il est coloré par des "spécificités" locales, mais c'est toujours le cadre de l’Etat-Nation.
Cette illusion entrave encore la lutte ouvrière dans tous les pays. Mais elle a un effet très différent dans les pays où le prolétariat n'est qu'une petite minorité, éclipsée par les autres classes, à l'opposé des pays où le prolétariat a la force potentielle de paralyser l'économie entière et de détruire l'Etat bourgeois (à condition qu'il n'ait à affronter que sa "propre " bourgeoisie! . Dans le premier cas, cette illusion tend à dévoyer les travailleurs de leur terrain de classe pour les rallier à une fraction de la bourgeoisie (l'Eglise, la gauche, la guérilla, les militaires "progressistes" etc..) tant leurs propres forces potentielles sont réduites dans le cadre de la nation. C'est pourquoi les ouvriers dans ces pays ont besoin des démonstrations de force de la classe dans les pays industrialisées, pour trouver la voie de la lutte autonome, pour que cette voie ne se présente pas comme désespérée.
Ce n'est que dans le deuxième cas que cette illusion d'une possibilité de changement dans le cadre de la nation, fondement de toutes les mystifications capitalistes, est incapable d'empêcher le développement de la lutte de la classe ouvrière sur son propre terrain. Ici, les ouvriers sont assez forts pour ne compter que sur eux-mêmes, même si, pour le moment, ils ne se voient que comme une catégorie sociale qui exerce sa pression dans le cadre de la nation, et pas encore canne une classe mondiale qui détient entre ses mains le sort de l'humanité. C'est donc le développement de la lutte ouvrière dans ces pays qui est la clé de la prise de conscience croissante par l'ensemble du prolétariat de sa propre force. Et c'est cette prise de conscience croissante qui permet au prolétariat de déchirer le filet des mystifications capitalistes. Par conséquent, les concentrations majeures du prolétariat dans les pays industrialisés situés au coeur des deux blocs jouent le rôle décisif dans le développement de la conscience de classe révolutionnaire. Ce n'est que là qu'en dépit du poids de l'idéologie bourgeoise, la lutte peut se développer et devenir le levier avec lequel la conscience prolétarienne sera libérée du poids de l'idéologie de la classe dominante.
Mais l'existence de la lutte ne suffit pas en elle-même. Comme le disait Marx, de mène qu'un homme ne se débarrasse de son outil de travail qu ' une fois qu'il lui est devenu inutile et qu'il en ait trouvé un autre pour le remplacer, le prolétariat ne détruira pas le système social existant avant que la nécessité et la possibilité de cette tâche historique ne soient gravées dans sa conscience. Et ce processus n'est pas possible dans les limites de la seule Europe occidentale.
PRENDRE CONSCIENCE DE LA NECESSITE DE LA GENERALISATION.
Pour comprendre la nécessité de la révolution, la classe ouvrière doit être à même de percevoir la destruction des bases objectives des mystifications capitalistes. Toutes ces mystifications sont fondées sur la croyance en la possibilité d'une économie prospère dans le cadre de la nation. Pour que cet espoir s'effondre aux yeux de tous les ouvriers sa fausseté doit être démontrée clairement partout dans le monde, non pas dans les économies les plus faibles, mais dans les nations capitalistes les plus fortes.
Tant que subsiste l'illusion d'une possibilité de reprise significative pour les économies les plus fortes, la croyance que la nation capitaliste peut offrir un cadre pour leur survie subsistera parmi les ouvriers de tous les pays, faibles et forts. Cela implique que la révolution n'est pas pour l'an prochain. Concevoir un assaut révolutionnaire à court terme, tel que certains l'ont fait pendant la grève de masse en Pologne, ne peut mener qu'à la démoralisation. Mais cela signifie également que, pour la première fois dans l'histoire, cette condition essentielle pour la révolution mondiale va être pleinement remplie. Toutes les tentatives révolutionnaires du passé se sont heurtées à ce problème. La mobilisation des ouvriers pour la première guerre mondiale, et plus tard la défaite de la première vague révolutionnaire, ont été rendues possibles, pour une bonne part, par la promesse d'une reprise dans les pays les plus développés. La mobilisation des ouvriers pour la deuxième guerre mondiale, leur défaite dans les pays comme l'Espagne, ont été possibles en raison du poids de la défaite de la première vague révolutionnaire, mais également de la capacité du capitalisme à offrir un nouvel espoir de redressement en développant le capitalisme d'Etat à un niveau sans précédent (en Allemagne, par exemple, entre 1933 et 38, la production industrielle avait augmenté de 90% et le chômage avait diminué de 3,7 millions à 200 000). Aujourd'hui, pour la première fois, le capitalisme s'approche du moment où il n'aura plus aucun moyen économique objectif de maintenir en vie quelque espoir de redressement, pour pouvoir encore apporter une amélioration temporaire à la situation de "ses" ouvriers, même pas de façon limitée ou sur une partie de la planète. Le capitalisme d'Etat a déjà été développé non pas jusqu'à son maximum théorique, mais jusqu'à son maximum d'efficacité. Le développement du capitalisme d'Etat à l'échelle internationale, et la redistribution de la plus-value grâce aux aides gouvernementales , du FMI, de la Banque Mondiale, etc. ne pourraient pas être poussés suffisamment loin pour que les fondements mêmes du capitalisme - la concurrence- puissent imposer une limite de fer à ce développement. Ce développement du capitalisme d'Etat a déjà été utilisé pleinement pendant l'après-guerre, pour créer les marchés requis par le haut degré de développement des forces productives dans les pays les plus industrialisés, ce qui a conduit à une interdépendance sans précédent entre tous les éléments de la machine capitaliste. Il en résulte qu'aucun pays n'a aujourd'hui les moyens de se protéger de la crise. En tentant d'y échapper, ils ne feraient qu'aggraver leur situation.
Pour la première fois, un déclin brusque, sans espoir crédible de redressement devient inévitable pour tous les pays. Cela ne veut pas dire que la situation soit devenue la même dans tous les pays, que partout les ouvriers vont être jetés dans la famine. Cela signifie que certains vont être jetés dans la famine et les autres dans une exploitation barbare, dans la militarisation, la terreur, la concurrence entre eux et, finalement, dans la guerre et la destruction globale s'ils ne savent pas s'y opposer. La situation spécifiques de tous les ouvriers ne deviendra pas la même. Une multitude de différences continuera à exister. Ce qui sera pareil partout, c'est l'attaque totale de la bourgeoisie, les intérêts des ouvriers et les perspectives qu'ils auront.
PRENDRE CONSCIENCE DE LA POSSIBILITE DE LA GENERALISATION.
Mais, pour que la révolution devienne le but conscient de la lutte, il faut non seulement que les ouvriers en voient la nécessité, mais également la possibilité comme étant à la portée de leurs forces. Le niveau de conscience politique est nécessairement limité par les forces dont ils disposent. Une lutte qui se déclenche à partir d'une plateforme de revendications économiques limitées ne peut élargir ses objectifs, ne peut devenir politique que par la croissance des forces dont la classe dispose, par l'extension et l'auto-organisation. Mais les possibilités dépendent aussi de l'opposition que les ouvriers ont à vaincre. Et à ce niveau également, nous voyons d'importantes différences entre la situation de 17 et celle d'aujourd'hui. En 17, la bourgeoisie était divisée et désorganisée par la guerre, désorientée par son manque d'expérience. Dans ces circonstances, il y avait effectivement des "maillons faibles" dans sa ligne de défense, que le prolétariat pouvait mettre à profit. Suivant la logique de la résolution du CCI, les ouvriers en Russie auraient dû rêver de la démocratie bourgeoise puisqu'ils n'avaient pas été directement confrontés aux mystifications les plus sophistiquées de la bourgeoisie occidentale. Mais, malgré les plaidoyers des menchéviks, ils n'ont pas perdu leur temps avec celle-ci parce que le degré atteint dans l'auto-organisation, l'extension de la lutte à travers la Russie, l'agitation ouvrière dans les pays voisins et la faiblesse de la bourgeoisie qu'ils devaient affronter leur permettaient de dépasser largement cette perspective et rendaient possible l'objectif d'une victoire révolutionnaire en Russie, avec l'espoir raisonnable que les autres pays suivraient rapidement.
Aujourd'hui, par contre, chaque fraction prolétarienne en lutte affronte une bourgeoisie mondiale unifiée. Il n'y a plus de "maillon faible" dans la ligne de défense du capitalisme. Ce qui était alors possible ne l'est plus, et puisque la conscience de classe est liée aux possibilités objectives, ceci implique que la maturation de la conscience révolutionnaire prendra plus de temps, pour que les forces de la classe soient supérieures à celles requises en 17. Si ces forces ne sont pas développées à une échelle internationale, au-delà d'une zone limitée telle que l'Europe occidentale, si les mystifications capitalistes parviennent à isoler les luttes entre elles, à empêcher le prolétariat de prendre conscience de ses intérêts et perspectives communs, alors aucune grève de masse, où qu'elle se produise, ne lui permettra de "développer pleinement sa conscience politique indispensable à sa lutte pour la révolution" (Revue Internationale n°31), parce qu'il sera impossible aux ouvriers de voir quelles sont les forces nécessaires à la tâche du renversement d'une bourgeoisie mondiale unifiée.
En de telles circonstances, une grève de masse ne peut que stagner, ce qui signifie qu'elle dépérira rapidement. Faute d'une perception claire de la possibilité d'un objectif prolétarien plus large qui puisse se graver dans la conscience des prolétaires, le niveau d'auto organisation ne pourra être maintenu et il régressera. Alors, une perspective basée sur des mystifications bourgeoises s'imposera inévitablement. Le CCI ne se rendait pas compte de cela quand il écrivait, plus de trois mois après le démantèlement de l'organisation autonome de la classe en Pologne : "Loin de s'essouffler, le mouvement s'est durci" (Revue Internationale n°24, p.4) , ni quand , par la suite, il attribuait le succès des mystifications capitalistes en Pologne au poids des "spécificités" du bloc de l'Est et, en particulier, de la Pologne.
LE POIDS DES SPECIFICITES.
Comme l'écrivait le CCI, "L'idée qu'il existe des 'spécificités nationales ou de bloc' (...) sera de plus en plus battue en brèche par le nivellement par le bas de la situation économique de tous les pays, ainsi que des conditions de vie de tous les travailleurs" (Revue Internationale n°29, p.51. Ceci ne signifie pas que les révolutionnaires doivent nier l'existence de toutes sortes de différences, entre ouvriers de différents pays, secteurs et régions, utilisés par le capital pour les diviser. Mais sa capacité de division ne résulte pas des "spécificités" elles-mêmes, mais de la capacité globale du capitalisme à maintenir des illusions sur son propre système. Sans la démystification progressive de ces illusions par la crise et la lutte de classe, les ouvriers resteront isolés dans leurs situations "spécifiques", dans les pays "forts" aussi bien que dans les pays "faibles". S'il est possible que la puissance de l'Eglise en Pologne soit spécifique à ce pays, il n'y a rien de spécifique dans les mystifications que cette institution emploie contre la classe ouvrière : nationalisme, pacifisme, légalisme, etc... En d'autres termes, ces mystifications ne sont pas puissantes parce que l'Eglise est puissante, c'est le contraire qui est vrai. L'Eglise joue le rôle d'une gauche dans l'opposition parce que le manque de profondeur de la crise - non pas en Pologne mais à l'échelle internationale - et l'immaturité du développement de la lutte des ouvriers, également au niveau international, permet au capital d'employer ces mystifications avec succès. Cela signifie que les révolutionnaires doivent insister sans cesse sur l'unité mondiale de la lutte du prolétariat et démasquer les mystifications que recouvrent ces spécificités. Cela signifie qu'il faut combattre la peur que l'extension et la généralisation de la lutte ne soient impossibles à cause des différences spécifiques et son corollaire, l'illusion de la possibilité d'une victoire, d'un plein développement de la conscience révolutionnaire dans un seul pays, ou dans une seule partie du continent.
Voyons donc de plus près les spécificités principales que le CCI croient être responsables du fait que les ouvriers en Occident soient seuls sur le chemin vers la conscience révolutionnaire.
La"pénurie" dans le bloc de l'Est.
"La forme spécifique (pénurie) qu'y prend la crise mondiale entravant une prise de conscience globale et directe des causes de celle-ci (surproduction) " .. (Résolution sur la critique de la théorie du maillon faible)...
Pour les ouvriers à l'Est, de même que pour ceux de l'Ouest, la surproduction et la pénurie ne peuvent être comprises que s'ils quittent le point de vue "spécifique" pour voir le système capitaliste comme un tout. Sans cette vision globale, les manifestations de la surproduction à l'Ouest se présentent comme le fait d'une distribution injuste, un manque de protection contre la concurrence étrangère, etc... La surproduction ne peut être localisée uniquement en Occident. En vérité, les pays faibles sont les premiers à la ressentir: à cause de la composition organique plus faible de leurs capitaux, ils se heurtent plus tôt aux limites du marché mondial. Même R. Luxemburg, sur les théories économiques de laquelle se base le CCI, était claire sur le fait que la surproduction n'est pas un phénomène auquel seulement quelques pays sont confrontés, tandis que les autres n'en subiraient que les conséquences : elle la voit comme le résultat d'une disproportion inhérente au processus de production qui est donc présente dans chaque pays. Même dans les pays les plus faibles, les ouvriers peuvent voir comment la surproduction sur le marché mondial abaisse les prix des marchandises qu'ils produisent, provoquant et leur infligeant famine et chômage, tandis qu'en même temps elle pousse "leur" bourgeoisie à détourner une masse croissante de plus-value vers le secteur des moyens de destruction. Même dans un pays sous-développé typique comme le Ghana, l'industrie ne fonctionne qu'à moins de 15% de sa capacité (New York Times, 4/2/83). De la même manière, la pénurie ne peut être comprise que d'un point de vue global.
Si on se place au-delà du point de vue d'un pays particulier, il faut conclure que la pénurie existe dans chaque pays (à divers degré, mais à un taux croissant partout) :
- pénurie de biens de consommation pour les ouvriers et les chômeurs pour qui les produits dont ils ont besoin sont de plus en plus inaccessibles, tandis que la classe dominante en dispose en abondance ;
- pénurie de capital pour la classe dominante qui fait des tentatives désespérées pour augmenter la plu6-value extorquée aux ouvriers afin de protéger sa place sur un marché mondial rétréci.
Ce point de vue global, nécessaire pour percevoir les racines du système et la possibilité de la révolution socialiste, le prolétariat en Occident ne le possède pas de naissance. Il ne peut résulter que de la tendance de la lutte de classe elle-même à se globaliser et à avoir une portée internationale.
L'insuffisance de tradition révolutionnaire, de culture, d'âge.
La vision selon laquelle il n'y a jamais eu de mouvement ouvrier fort en dehors de l'Europe est un préjugé coloré par l'influence d'historiens bourgeois qui ont de bonnes raisons de minimiser le mouvement révolutionnaire. Mais, ce qui est plus important, c'est que ces leçons du passé sont encore latentes dans la mémoire du prolétariat et, qu'elles ne peuvent être réappropriées que par la lutte, avec l'aide de la minorité communiste qui, elle-même est sécrétée par la lutte. La longue contre-révolution a coupé, en Europe, autant qu'ailleurs, les ouvriers des traditions du passé. C'est une aberration de dire, comme la résolution du CCI, que les ouvriers aux USA et au Japon ne se sont pas trouvés confrontés assez directement à la contre-révolution, alors que ceux du bloc de l'Est y ont été trop confrontés, et que, par conséquent, I'"idéal" du socialisme s'est transformé, dans leurs têtes, en son contraire. Partout dans le monde, la vaste majorité des ouvriers identifie le "communisme" au stalinisme ou à ses variantes "eurocommunisme " ou "trotskyste". Ce n'est pas par l'éducation et la culture bourgeoises mais par le développement de la lutte que les ouvriers s'ouvrent aux leçons des expériences de leurs frères de classe dans les autres parties du monde, de même qu'aux leçons du passé. Tous les arguments sur la "tradition", la "culture" et l'"âge" volent en éclat si l'on considère le fait historique que les pays où le prolétariat a réussi le mieux à homogénéiser sa conscience révolutionnaire étaient la Russie et la Hongrie où la classe ouvrière était relativement jeune, privée d'une tradition de longue date, et avec un niveau relativement bas d'éducation bourgeoise. Ceci ne signifie pas que l'expérience ne serait pas importante, que toutes les leçons seraient oubliées au moment où il n'y a pas de luttes ouvertes. Pour les ouvriers en Russie, 1'expérience était très importante, mais elle était directement liée à leur lutte. Ce n'était pas leur situation géographique, ni une confrontation directe avec la démocratie, mais uniquement leur lutte autonome, qui les rendaient capables d'assimiler les expériences de leurs luttes et de celles du reste de la classe, et de les incorporer dans la phase suivante de leur combat.
L'absence d'une confrontation directe avec les mystifications les plus puissantes.
Quand les ouvriers d'Europe occidentale rompront avec les mystifications démocratiques et syndicales ce ne sera pas le résultat de leur confrontation quotidienne à ces pièges. Cela ne se fera que dans et par la lutte, parce que la généralisation de la crise et la lutte simultanée des ouvriers dans les autres pays créent les conditions pour le dépassement de l'isolement que ces mystifications tentent d'imposer. Il en est de même pour les ouvriers de l'Est. En dehors de la lutte, les "syndicats libres" et l'Etat démocratique peuvent être vus comme des produits d'importation de l'Ouest exotiques et attrayants. Mais, dans la lutte, ils deviennent "l'institutionnalisation du mouvement", suivant les termes d'A. Kolodziej, le délégué du MKS de Gdynia qui a refusé de poser_sa candidature aux élections des comités de "Solidarnosc".
Des luttes à l'étranger auraient offert d'autres perspectives aux ouvriers. Elles auraient pu rendre majoritaire la position de Kolodziej, ou du moins, elles auraient ouvert plus de possibilités de succès aux ouvriers dans leurs affrontements avec les syndicats après la mort du MKS. Le fait que cela ne se soit pas passé ne résultait pas de l'absence de confrontation directe à ces mystifications. Sinon, la lutte du prolétariat eût été désespérée. Le capital peut toujours donner une nouvelle enveloppe à ses vieux mensonges, à moins que la base matérielle de toutes les mystifications ne soit dé-. truite par la crise internationale et par la lutte de classe. Si les syndicats en Europe occidentale perdent toute crédibilité par leur pratique quotidienne, il reste toujours les syndicalistes de base pour avancer la mystification d'un nouveau syndicat unitaire, il reste toujours la possibilité d'institutionnaliser des "Conseils Ouvriers" et l'autogestion dans le cadre de l'Etat, il reste la possibilité de gouvernements de gauche radicaux pour préparer la répression, etc.
La conscience de classe révolutionnaire ne peut se développer que par l'assimilation des expériences de la classe dans le monde entier. C'est vrai pour les ouvriers de l'Est aussi bien que pour ceux de l'Ouest."Dans le domaine de la dénonciation du rôle des syndicats, les ouvriers en Pologne ont accompli en quelques mois le chemin que le prolétariat des autres pays a mis plusieurs générations à parcourir" (Revue Internationale n°24, p.3). Ceci s'est fait malgré le manque d'une longue expérience des "syndicats libres". Mais la conscience qu'ils ont acquise ainsi n'est pas un acquis permanent qui subsiste en dehors de la lutte. Elle devra être réappropriée dans les luttes à venir, aussi bien en Pologne qu'ailleurs.
Nous considérons comme limitée la défaite en Pologne. Ceci est correct, non parce que la Pologne n'est qu'un pays secondaire, mais parce que les acquis pour l'ensemble du prolétariat, les leçons de la Pologne, ont plus de poids à long terme que la défaite elle-même. Bien sûr, ce n'était pas une belle retraite. Mais le prolétariat n'est pas une armée, avec un Etat-major et des bataillons, faibles et forts, engagés dans une guerre tactique. Sa lutte n'est pas de nature militaire, mais elle est une lutte pour sa propre conscience révolutionnaire et sa propre organisation. Jamais aucune armée ne connut de telles avancées et de tels reculs suivant le degré d'extension de la conscience de classe. Dans cette bataille, il n'y a pas de belles retraites. Tout arrêt, tout pas en arrière résulte de l'encadrement bourgeois. L'expérience du MKS devra être répétée et améliorée dans plusieurs pays avant que le renversement du rapport de forces entre les classes à l'échelle internationale (le processus d'internationalisation) ne paralyse la classe dominante. Mais les luttes futures pourront tirer profit des leçons de la Pologne. Il est crucial que ces leçons - non seulement celles de la phase ascendante de la lutte, mais, plus encore, celles de sa retombée - ne soient pas obscurcies en attribuant à sa force (tel que le fait la bourgeoisie) ou à ses faiblesses (tel que le fait le CCI) des "spécificités" polonaises. Dans ses luttes prochaines, le prolétariat devra se souvenir de la puissance de l'auto organisation qui a fait ses preuves en Pologne. Il devra se rappeler comment la bourgeoisie lorsqu'elle ne peut empêcher l'auto organisation, tente de contrôler ses organes unitaires pour en faire des instruments destinés à empêcher l'action spontanée de la classe, propager le nationalisme, le légalisme, et d'autres poisons et se transformer finalement en institutions bourgeoises- Il devra se souvenir des affrontements entre "Solidarnosc" et les ouvriers, qui montrent comment chaque syndicat, même nouvellement formé, devient immédiatement l'ennemi mortel de la lutte. Il devra se souvenir comment l'isolement de la lutte la plus radicale depuis des décennies a montré la nécessité de rompre avec toutes les divisions sectorielles ou nationales.
La destruction des principales mystifications capitalistes nécessite une attaque clés deux côtés. D'une part, de l'intérieur, par une lutte qui, grâce à son auto organisation et à sa radicalisation, se tourne activement vers la solidarité des ouvriers des autres pays ; d'autre part, et en lien dialectique avec cela, elle nécessite une attaque de l'extérieur , par l'agitation explosive du reste de la classe qui, en assimilant les expériences des luttes partout dans le monde, prend conscience de l'unité de ses intérêts, permettant ainsi la solidarité.
Pour faire la révolution le prolétariat n'a d'autre arme que celle de sa conscience révolutionnaire et donc internationale. Par conséquent, cette conscience doit se développer dans les luttes qui précèdent la révolution. La généralisation ne débutera pas au moment de l'assaut révolutionnaire en Europe occidentale pour s'étendre par un effet "de domino" touchant pays après pays, parce que le "maillon le plus fort" du capitalisme serait brisé ou, suivant l'expression du CCI, parce que son "coeur et son cerveau" seraient détruits.
La généralisation est un processus qui fait partie de la maturation de la conscience du prolétariat, qui se développe de façon internationale dans ses luttes précédant l'assaut révolutionnaire, assaut rendu possible par l'existence même de ce processus. Le seul "maillon faible" (futur) du capitalisme, c'est l'unité mondiale du prolétariat.
Sander. (5/4/83)
REPONSE AUX CRITIQUES
Une des particularités du texte du camarade Sander, c'est qu'il comporte côte à côte d'excellents passages où il développe très clairement les analyses du CCI et des affirmations également très claires, mais qui malheureusement sont en contradiction avec la vision qui sous-tend les passages précédents.
Ainsi, le camarade Sander reconnaît à la fois qu'il est nécessaire de rejeter fermement la théorie du "maillon le plus faible" et qu'il faut établir une différence nette entre le prolétariat des pays développés et celui du Tiers Monde quant à leur capacité respective de constituer des bataillons décisifs de l'affrontement révolutionnaire futur. Il considère que dans les pays arriérés, "les ouvriers ont besoin de la démonstration de force de la classe dans les pays industrialisés, pour trouver la voie de la lutte autonome, pour que cette voie ne se présente pas comme désespérée". Nous le suivons parfaitement dans ces affirmations. Cependant, là où surgit le désaccord, c'est lorsque :
- il considère que les ouvriers des pays autres que ceux du Tiers Monde (c'est à dire d'Amérique du Nord, du Japon, d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est) se trouvent sur un pied d'égalité quant à leur aptitude à déjouer les mystifications bourgeoises, à constituer en quelque sorte une avant-garde du prolétariat mondial lors des combats révolutionnaires ;
- il estime que "la capacité de la bourgeoisie d'isoler une grève de masse" ne dépend pas "du lieu où elle se déroule" ;
- il rejette l'idée que la généralisation mondiale des luttes se produira par un "effet de dominos" (suivant ses propres termes), qu'il s'agit d'un processus prenant son essor en un point donné de la planète pour se propager ensuite dans le reste du monde,
- il combat l'idée qu'il existe une sorte de "coeur et de cerveau" du prolétariat mondial là où il est à la fois, le plus concentré, le plus développé et le plus riche en expérience.
En fin de compte, le défaut principal du texte de Sander, et qui est à la base de tous les autres, c'est qu'il adopte, pour démontrer sa thèse, toute une démarche qui se veut marxiste mais qui, à certains moments s'écarte en fait complètement d'une réelle vision marxiste.
UNE DEMARCHE QUI S'ECARTE DU MARXISME
Le raisonnement de base du camarade Sander est le suivant :
1°- "La lutte prolétarienne se développe à partir de la nécessité et non à partir de la conscience";
2°- "C'est le développement de la lutte ouvrière qui est la clé de la prise de conscience croissante par l'ensemble du prolétariat de sa propre force" ;
3 - "C'est cette prise de conscience croissante (de sa force) qui permet au prolétariat de déchirer le filet des mystifications capitalistes" ;
4°- "les mystifications ne peuvent (donc) être dépassées que par la lutte et dans la lutte. C'est la potentialité de croissance de la lutte qui permet à la classe ouvrière de briser les mystifications capitalistes, plutôt que l'inverse" ;
5°- Le capitalisme est dans une impasse économique complète. Partout dans le monde, il dévoile sa faillite et passe à une attaque totale contre les intérêts des travailleurs ;
6°- Partout dans le monde se développe donc la "nécessité" qui est à la base de la lutte ouvrière.
Conclusion : Partout où le prolétariat n'est pas une "petite minorité éclipsée par les autres classes" (pays du Tiers Monde) sont en cours d'apparition, et de façon égale, les conditions d'une prise de conscience révolutionnaire.
Le raisonnement a l'apparente rigueur d'un syllogisme. Malheureusement il est faux. Il s'appuie certes sur des vérités générales admises par le marxisme mais qui, dans ce cas particulier, sont affirmées en dehors de leur champs d'application réel. Elles deviennent des demi vérités et aboutissent à des contrevérités.
Si on peut souscrire à l'étape 5 du raisonnement et (avec des réserves) à l'étape 6, prises en elles-mêmes, on se doit par contre de critiquer et de remettre en cause les autres étapes et donc de remettre en cause l'ensemble du raisonnement.
1 - "La lutte prolétarienne se développe à partir de la nécessité et non à partir de la conscience" Oui si c'est pour dire que "1'existant précède le conscient" (Marx), que ce sont des intérêts maté riels qui mettent,en dernière instance, les classes en mouvement. Mais le marxisme n'est pas un matérialisme vulgaire. Il est dialectique. C'est pour cela que Marx a pu écrire "quand la théorie s'empare des masses, elle devient force matérielle".
C'est parce que le CCI est fidèle à cette vision dialectique qu'il a pu comprendre que nous étions aujourd'hui dans un cours à l'affrontement de classes et non dans un cours à la guerre. Dès 1968, nous écrivions (Révolution Internationale n°2, ancienne série) :
"Le capitalisme dispose de moins en moins de thèmes de mystifications capables de mobiliser les masses et les jeter dans le massacre. Le mythe russe s'écroule, le faux dilemme démocratie bourgeoise contre totalitarisme est bien usé. Dans ces conditions, la crise apparaît dès ses premières manifestations pour ce qu'elle est. Dès ses premiers symptômes, elle verra surgir, dans tous les pays, des réactions de plus en plus violentes des masses."
Donc, si le CCI affirme que, dans la période actuelle, l'aggravation de la crise provoquera un développement des luttes de classe, et non une démoralisation croissante ouvrant la voie à l'holocauste impérialiste comme dans les années 30, c'est parce qu'il prend en compte les facteurs subjectifs qui agissent sur la situation : le fait que le prolétariat ne sorte pas d'un écrasement récent (comme dans les années 20), l'usure des mystifications utilisées dans le passé. C'est parce qu'elle avait cette approche, dont nous nous revendiquons, que la Gauche Communiste Italienne a su analyser correctement la nature de la guerre d'Espagne et qu'elle n'est pas tombée dans les absurdités d'un Trotski fondant -parce que les conditions objectives étaient mûres- une nouvelle Internationale un an avant... la guerre.
Tout cela, le camarade Sander le sait et il l'affirme dans un autre passage de son texte. Le problème, c'est qu'il l'oublie dans son raisonnement.
2 - "C'est le développement de la lutte ouvrière . . . qui est la clé de la prise de conscience croissante par 1'ensemble du prolétariat de sa propre force" : nous renvoyons à ce qui vient d'être dit.
3 - "C'est cette prise de conscience croissante (de sa force) qui permet au prolétariat de déchirer le filet des mystifications capitalistes". Là encore, Sander énonce une idée juste mais partielle et unilatérale. La conscience du prolétariat est avant tout conscience "de soi" (comme le mot l'indique). Partant, elle comporte la conscience de sa propre force. Mais elle ne se résume pas à cela. Si le sentiment d'être fort "permet au prolétariat de déchirer le filet des mystifications capitalistes", alors on ne comprend absolu ment pas ce qui s'est passé en 1914, lorsqu'un prolétariat qui se sentait plus fort que jamais a été précipité du jour au lendemain dans le massacre impérialiste. Avant 14, la classe ouvrière semblait voler de succès en succès. En réalité, elle reculait pied à pied devant l'idéologie bourgeoise C'est d'ailleurs là une méthode employée abondamment par la bourgeoisie contre le prolétariat tout au long du 20° siècle : lui présenter ses pires défaites (socialisme dans un seul pays? front populaire, "Libération" de 45) comme des victoires, des éléments de sa force. La phrase de Sander doit donc être complétée par "c'est dans son aptitude à déchirer le filet des mystifications capitalistes que le prolétariat témoigne de sa force, qu'il l'accroît et qu'il accroît la conscience de celle-ci". Cet oubli permet au camarade Sander de poursuivre tranquillement son raisonnement. Mais c'est malheureuse ment sur une faussé piste, dans une voie de garage.
4 - "Les mystifications ne peuvent (donc) être dépassées que par la lutte et dans la lutte. C'est la potentialité de croissance de la lutte qui permet à la classe ouvrière de briser les mystifications capitalistes, plutôt que l'inverse."Pour la première fois, Sander fait une petite concession à la méthode dialectique ("plutôt que l'inverse"). Cependant, il ne se défait pas de sa méthode unilatérale et partielle, ce qui le conduit à énoncer une idée en total désaccord avec toute l'expérience du mouvement ouvrier. Par exemple, au cours de la première guerre mondiale, ce n'est pas la lutte en soi qui a été le seul, ni même le premier facteur de démystification des ouvriers en Russie ou en Allemagne. En 1914, embrigadés derrière les drapeaux bourgeois par les partis socialistes, les ouvriers des principaux pays d'Europe sont partis "la fleur au fusil" se massacrer mutuellement au nom de la "défense de la civilisation" et de la "lutte contre le militarisme" ou le "tsarisme". Comme l'écrivait Rosa Luxemburg, "la guerre est un meurtre méthodique, organisé, gigantesque". En vue d'un meurtre systématique, chez des hommes normalement constitués, il faut cependant d'abord produire une ivresse appropriée" (Brochure de Junius). Tant que dura cette ivresse, les ouvriers adhérèrent au mot d'ordre stupide de la social démocratie (notamment celle d'Allemagne) expliquant que"la lutte de classe n'est valable qu'en temps de paix". Ce ne sont pas les luttes qui ont dessoûlé le prolétariat; ce sont plusieurs années de barbarie de la guerre impérialiste qui lui ont fait comprendre que, dans les tranchées, il ne se battait pas pour "la civilisation". Ce n'est qu'en prenant conscience qu'il se faisait massacrer et massacrait ses frères de classe pour des intérêts qui n'étaient pas les siens, qu'il a développé ses luttes qui allaient aboutir aux révolutions de 1917 en Russie et 1918 en Allemagne.
La méthode de Sander, faite de juxtapositions de demi vérités partielles le conduit à énoncer une autre contre-vérité totale : "la conscience qu'ils (les ouvriers polonais) ont acquise ainsi n est pas un acquis permanent qui subsiste en dehors de la lutte".
D'abord, nous constatons que cette affirmation contredit ce que dit, par ailleurs, Sander lui-même: "... les luttes futures (de l'ensemble du prolétariat) pourront tirer profit des leçons de Pologne... Il (le prolétariat) devra se souvenir des affrontements entre "Solidarnosc" et les ouvriers, qui montrent comment chaque syndicat,même nouvellement créé, devient immédiatement l'ennemi mortel de la lutte". Ainsi Sander refuse-t-il aux protagonistes directs dés combats de Pologne une "mémoire" de leur expérience que pourraient conserver les ouvriers d'autres pays malgré toutes les déformations des médias bourgeoises. Peut-être considère-t-il que cela résulte du fait qu'en Pologne (et pourquoi pas dans tous les pays de l'Est) les conditions spécifiques dans lesquelles lutte le prolétariat sont moins favorables à une prise de conscience que dans d'autres pays (pourquoi pas ceux d'Europe occidentale). C'est justement la thèse que combat Sander.
Nous découvrons ainsi un élément supplémentaire de la méthode du camarade Sander : le rejet de la cohérence.
Mais revenons sur cette idée que "la conscience n'est pas un acquis permanent". Nous épargnerons à Sander et au lecteur des développements sur le processus de la prise de conscience du prolétariat; c'est une question qui a déjà été traitée dans cette revue et qui le sera à nouveau. Nous nous contenterons ici de poser les questions suivantes :
- pourquoi en Pologne même, les combats de 1980 sont-ils allés bien plus loin que ceux de 70 et de 76 ?
- n'est-ce pas la preuve "qu'il subsiste un acquis des luttes" ?
- ce niveau supérieur des luttes en 80, est-il le seul résultat de l'aggravation de la crise économique ?
- ne faut-il pas y voir aussi le produit de tout un processus de maturation de la conscience du prolétariat qui s'est poursuivi après les luttes de 70 et 76 ?
- plus généralement, quel sens revêt l'idée marxiste de base suivant laquelle le prolétariat tire les leçons de ses expériences passées, qu'il met à profit l'accumulation de ses expériences ? '
- enfin, quelle est la fonction des organisations révolutionnaires elles-mêmes, si ce n'est justement de systématiser ces enseignements, les employer à développer la théorie révolutionnaire afin qu'elle puisse féconder, les combats futurs de la classe qui secrète justement ces organisations à cet effet ?
A toutes ces questions, le camarade Sander sait donner des réponses correctes. Il connaît le marxisme ainsi que les positions du CCI, mais brusquement, il les "oublie". Faut-il croire qu'il a tendance à attribuer au développement de la conscience du prolétariat sa propre démarche de pensée aux accès fréquents d'amnésie ?
Se voulant "matérialiste", la vision de Sander sombre en fin de compte dans le positivisme, elle tend à rejeter le marxisme pour se noyer dans les sophismes du conseillisme le plus plat, celui qui refuse à l'organisation des révolutionnaires toute fonction dans la lutte de classe.
UN CONSEILLISME «HORIZONTAL»
Le propre de la conception conseilliste (nous parlons de la conception conseilliste dégénérée, développée notamment par Otto Rhule, et non de la conception de Pannekoek qui ne tombait pas dans les mêmes aberrations) est de nier le fait qu'il y ait une hétérogénéité dans la classe dans son processus de prise de conscience. Elle se refuse à admettre que certains éléments de la classe parviennent avant les autres à "comprendre les conditions, la marche et les buts généraux du mouvement ouvrier" (Manifeste Communiste). C'est pour cela que, selon elle, il ne peut exister pour le prolétariat d'autre organisation que son organisation unitaire, les conseils ouvriers, au sein de laquelle tous les ouvriers avancent d'un même pas sur le chemin de la conscience. Nous ne ferons évidemment pas à Sander l'injure de lui attribuer une telle conception. Son texte prouve par ailleurs qu'elle n'est pas sienne et si c'était le cas on ne voit pas ce qu'il ferait à militer dans le CCI.
Cependant, la même démarche unilatérale et non dialectique qui conduit Sander à ouvrir involontairement la porte au conseillisme classique, l'amène à entrer de plein pied, et volontairement cette fois, dans une autre variété de conseillisme. Si on peut qualifier de "vertical" le conseillisme de Otto Rhule qui nie que, dans le chemin vers la révolution, certains éléments de la classe puissent se hisser à un niveau plus élevé de conscience que les autres, on peut considérer que le conseillisme de Sander est "horizontal" puisqu'il met un signe d'égalité entre les niveaux de conscience des prolétariats des différents pays ou zones du globe (le Tiers Monde excepté). Sander admet, avec tout le CCI, que même au moment de la révolution, il subsistera une grande hétérogénéité dans la conscience du prolétariat, ce qui se traduira notamment par le fait que,lors de la prise de pouvoir par la classe, les communistes seront encore une minorité. Mais pourquoi cette hétérogénéité ne pourrait-elle pas exister entre des secteurs du prolétariat diversement constitués, ayant des histoires et des expériences différentes, subissant, certes, une même crise, mais sous des formes et avec des degrés divers.
Sander tente de repousser les éléments donnés par le CCI pour expliquer le rôle central du prolétariat Ouest européen dans le futur mouvement de généralisation des luttes, dans la révolution de demain. En fait, ce n'était pas la peine qu'il se donne le mal d'examiner un par un les différents éléments puisque l'unité et l'homogénéité du prolétariat mondial sont posées à priori. Significative de cela est la façon dont il réfute l'idée que les ouvriers d'Occident peuvent plus facilement comprendre que ceux de l'Est la crise du capitalisme comme crise de surproduction :
"Pour les ouvriers à 1'Est, de même que pour ceux de 1'Ouest, la surproduction et la pénurie ne peuvent être comprises que s'ils quittent le point de vue "spécifique" pour voir le système capitaliste comme un tout... Ce point de vie global, nécessaire pour percevoir les racines du système et la possibilité de la révolution socialiste, le prolétariat en Occident ne le possède pas de naissance. Il ne peut résulter que de la tendance de la lutte de classe elle-même à se globaliser et à avoir une portée internationale".
Le "point de vue global" du camarade Sander est sans aucun doute l'analyse que font les révolutionnaires de la nature du capitalisme et de ses contradictions. Ce point de vue global", les révolutionnaires peuvent l'appréhender qu'ils se trouvent dans des pays avancés comme l'Angleterre où vivaient Marx et Engels où qu'ils viennent de pays arriérés comme Posa Luxemburg ou Lénine. Cela provient du fait que les positions politiques et analyses des organisations révolutionnaires ne sont pas une expression des conditions immédiates dans lesquelles se trouvent leurs militants où des circonstances particulières de la lutte de classe dans tel ou tel pays mais une sécrétion, une manifestation de la prise de conscience du prolétariat comme être historique, comme classe mondiale au devenir révolutionnaire.
Disposant d'un cadre théorique qui leur permet, beaucoup mieux que le reste de leur classe/d'aller plus rapidement au-delà des apparences pour appréhender l'essence des phénomènes, ils sont beaucoup plus en mesure de reconnaître dans n'importe quelle manifestation de la vie du capitalisme les résultats des lois profondes qui gouvernent ce système.
Par contre, ce qui est vrai de la minorité révolutionnaire de la classe ne l'est pas en général de ses grandes masses. Dans la société, "les idées dominantes sont les idées de la classe dominante" (Marx). La grande majorité des travailleurs est soumise à l'influence de l'idéologie bourgeoise. Et si elle s'amoindrira progressivement, cette influence se maintiendra néanmoins jusqu'à la révolution. Cependant, la bourgeoisie aura d'autant plus de mal à maintenir cette influence que l'image que donnera d'elle-même sa société trahira plus ouvertement la nature profonde de celle-ci. C'est pour cela que la crise ouverte du capitalisme est la condition de la révolution. Non seulement parce qu’elle obligera le prolétariat à développer ses luttes, mais parce qu'elle permettra que se révèle à ses yeux l'impasse totale dans laquelle se trouve ce système. Il en sera de même pour l'idée que le communisme est possible, que le capitalisme peut céder la place à une société basée sur l'abondance, permettant une pleine satisfaction des besoins humains, "dans laquelle le libre développement de ' chacun est la condition du libre développement de tous". Une telle idée pourra s'imposer d'autant plus facilement parmi les ouvriers que se révélera clairement la cause de la crise : la surproduction généralisée. A l'Est comme à l'Ouest les ouvriers seront plongés dans une misère croissante et contraint à des luttes de plus en plus puissantes. Mais la prise de conscience que cette misère résulte - de façon absurde - d'une surproduction de marchandises se fraiera un chemin bien plus facilement là où des millions de chômeurs côtoieront des magasins pleins à craquer que là où les queues devant des magasins vides pourront être présentées comme résultant d'une production insuffisante ou de la mauvaise gestion de bureaucrates irresponsables.
De même qu'il se refuse à reconnaître le poids des spécificités économiques sur le processus de prise de conscience de la classe, le camarade Sander est très choqué par ce que nous écrivons sur l'importance de toute une série de facteurs historiques ou sociaux sur ce processus :
"Tous les arguments sur la tradition, la culture et l'âge volent en éclat si l'on considère le fait historique que les pays où le prolétariat a réussi le mieux à homogénéiser sa conscience révolutionnaire étaient la Russie et la Hongrie où la classe ouvrière était relativement jeune, privée d'une tradition de longue date et avec un niveau relativement bas d'éducation bourgeoise. "
Cependant, Sander, fâché qu'il semble être avec la cohérence, nous avait déjà donné la réponse avant : "Mais les possibilités (de la lutte et de la prise de conscience politique) dépendent aussi de 1'opposition que les ouvriers ont à vaincre. Et à ce niveau également, nous voyons d'importantes différences entre la situation de 17 et celle d'aujourd'hui. En 17, la bourgeoisie était divisée et désorganisée par la guerre, désorientée par son manque d'expérience. Dans ces circonstances, il y avait effectivement des "maillons faibles" dans sa ligne de défense, que le prolétariat pouvait mettre à profit."
C'est justement une des grandes différences entre la situation actuelle et celle qui prévalait lorsqu’a surgi la révolution en 1917. Aujourd'hui, instruite par son expérience, la bourgeoisie est capable, malgré ses rivalités impérialistes, d'opposer un front uni contre la lutte de classe. C'est ce qu'elle a montré en de multiples reprises et notamment lors des grands combats de Pologne en 80-81 où l'Est et l'Ouest se sont remarquablement partagés le travail pour défaire le prolétariat comme nous l'avons souvent souligné dans notre presse.
Face aux luttes de Pologne, la tâche spécifique de l'occident a été de cultiver , via sa propagande dans les radios en langue polonaise et ses envois de syndicalistes, les illusions sur les syndicats libres et la démocratie. Cette propagande pourra avoir un impact tant que les ouvriers de l'Ouest, et notamment ceux d'Europe occidentale, n'auront pas dénoncé, dans leur propre lutte, le syndicalisme comme agent de l'ennemi de classe et la démocratie comme dictature du capital. Par contre, le seul fait que, dans les pays de l'Est et comme expression de la terrible contre-révolution qui s'est abattue sur cette zone (cf. Revue Internationale n°34, l'article : "Europe de l'Est : les armes de la bourgeoisie contre le prolétariat"), le système ne soit pas en mesure de tolérer l1existence durable de "syndicats libres", permet régulièrement à ceux-ci, en se couvrant de l'auréole du martyr, de redorer leur blason aux yeux des ouvriers. Si les luttes des ouvriers de Pologne ont porté un coup décisif aux illusions qui subsistaient en occident sur le "socialisme" à l'Est, par contre, elles ont maintenu presque intactes les illusions syndicalistes et démocratiques tant à l’Est qu'à l'Ouest.
Dans l'aide réciproque que s'apportent, face à la classe ouvrière, les bourgeoisies des deux blocs, c'est la bourgeoisie la plus forte qui peut donner le plus. C'est pour cela que la capacité du prolétariat mondial à généraliser ses luttes et à engager le combat révolutionnaire est bien plus déterminé par les coups directs qu'il pourra porter à cette dernière qu'à la première.
C'est également pour cela que, plus que jamais seront déterminants dans la période qui vient les éléments qui sont, dans la vision marxiste, à la base de la force du prolétariat, de sa capacité à développer sa conscience :
- son nombre, sa concentration, le caractère associé du travail des prolétaires;
- la culture qu'est obligée de lui dispenser la bourgeoisie pour augmenter la productivité de leur travail;([1] [64])
- sa confrontation quotidienne avec les formes les plus élaborées des pièges bourgeois.
- son expérience historique;
toutes choses qui existent à plus ou moins grande échelle partout où travaillent des prolétaires mais qui sont le plus pleinement développées là où le capitalisme a surgi historiquement : l'Europe occidentale.
L’UNITE DU PROLETARIAT
Pour le camarade Sander, le maître mot est "l'unité du prolétariat" : "le seul 'maillon faible' (futur) du capitalisme, c'est l'unité mondiale du prolétariat". Nous sommes parfaitement d'accord avec lui. Le problème c'est qu'il n'en est pas entièrement convaincu. Parce que nous constatons une évidence : les différences qui existent entre les différents secteurs de la classe ouvrière et que nous en déduisons certaines des caractéristiques du processus de généralisation mondiale des luttes ouvrières, il s'imagine que nous ignorons l'unité du prolétariat mondial. Comme le dit la résolution de janvier 83:
"Unité n'est pas identité des parties qui restent soumises à des conditions matérielles différentes. Il n'y a pas d'égalité naturelle entre les divers organes et le coeur ou le cerveau d'un corps vivant, qui remplissent des fonctions vitales complémentaires. . .
Déterminer le point de départ de cette dynamique (de 1'internationalisation de la grève de masse), et donc les conditions optimales de la naissance du séisme révolutionnaire, n'est pas nier l'unité du prolétariat mondial. Elle est le processus même par lequel l'unité potentielle devient unité réelle."
Cette vision s'appuie sur une démarche dialectique, dynamique qui, comme le disait Marx, "pose l'abstrait (l'unité potentielle du prolétariat mondial) pour s'élever ensuite au concret (le processus réel de développement de cette unité) ". Sander passe bien par cette étape mais, fidèle à sa démarche unilatérale et partielle, il oublie par contre la seconde. Ce faisant, il reste à terre, au ras de ses abstractions ce qui l'empêche de découvrir l'horizon et d'apercevoir ce que sera le processus véritable du développement mondial de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
F.M.
[1] [65] Pour le camarade Sander le blanc et le noir existent et ce sont deux couleurs bien distinctes. Cependant pour lui, apparemment, le gris et les différentes variantes de cette couleur, comprises entre le noir et le blanc, n'existent pas. Il admet facilement qu'il existe une différence considérable entre la force du prolétariat des pays avancés et celle du prolétariat du Tiers Monde, différence liée à des facteurs objectifs matériels. Par contre, qu'il puisse exister des situations intermédiaires, cela lui échappe complètement. Ainsi, lorsqu'on prend en considération un certain nombre d'éléments qui peuvent caractériser le degré de développement économique d'un pays et la force du prolétariat qui s'y trouve (voir tableau), on est frappé de constater que l'URSS et l'ensemble des pays de l'Est accusent une arriération très notable par rapport aux Etats Unis, au Japon et à l'Europe Occidentale.
Que l'on prenne des facteurs comme :
- le Produit National Brut par habitant, qui rend compte de la productivité moyenne du travail, et par suite notamment de son degré d'association ;
- la proportion de la population vivant dans les villes qui est une des composantes du degré de concentration de la classe ouvrière ;
- la proportion de la population active occupée dans le secteur agricole, qui illustre le poids de l'arriération campagnarde et est en rapport inverse du niveau de dépendance du travail agricole à l'égard du secteur industriel ;
- la proportion de la population ayant suivi des études du 3° degré qui est un indice du degré de technicité introduite dans la production ;
- la mortalité infantile qui est une des manifestations nettes de l'arriération économique et sociale ; l'URSS et les pays d'Europe de l'Est se trouvent à peu près sur le même plan qu'un pays comme la Grèce, bien loin de la situation qui est le lot commun des pays les plus avancés.